ICConline - 2011
- 2340 lectures
Dossier spécial "crise économique"
- 2731 lectures
Quelles sont les raisons de l'effroyable crise économique mondiale qui fait actuellement rage ? Allons-nous revivre une grande dépression comme en 1929 ? Le capitalisme pourra-t-il s'en relever ?
C'est à toutes ces questions que nous essayons de répondre dans ce dossier spécial qui analyse les violentes convulsions économiques de ces dernières années :
Eté 2007 : Explosion de la bulle immobilière américaine (crise des subprimes).
Automne 2008 : Faillite de la banque Lehmann Brothers, séisme financier international, plongeon de l'économie mondiale.
2009 et 2010 : Envolée de l'endettement des Etats.
Eté 2011 : Croissance américaine en berne, crise de la dette des Etats, risque de faillite de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande, de l'Italie et de l'Espagne, menace d'éclatement de la zone euro…
La catastrophe économique mondiale est inévitable [1]
"La crise de la dette" : pourquoi ? [2]
Crise économique : ils accusent la finance pour épargner le capitalisme ! [3]
Crise économique mondiale : un été meurtrier [4]
Mort à crédit [5]
Face à la crise capitaliste, il n'existe aucune voie de sortie [6]
Après la Grèce, l'Irlande... à qui le tour ? [7]
Grèce, Espagne, Portugal : des États en faillite [8]
Sommet du G20 de Pittsburgh : la fin de la crise ? [9]
Sommet du G20 à Londres : un nouveau monde capitaliste n'est pas possible [10]
Les Etats sont toujours les ennemis des ouvriers [11]
La plus grave crise économique de l'histoire du capitalisme [12]
Au sommet du G20, l'impuissance de la bourgeoisie face à la crise économique [13]
Crise du "néolibéralisme" ou crise du capitalisme ? [14]
1929-2008 : le capitalisme est un système en faillite, mais un autre monde est possible : le communisme ! [15]
Va-t-on revivre un krach comme en 1929 ? [16]
Existe-t-il une issue à la crise ? (2ème partie) [17]
Les Etats-Unis, locomotive de l'économie mondiale ... vers l'abîme [18]
Existe-t-il une issue à la crise économique ? (1ère partie) [19]
Chute des Bourses, secousses bancaires... Vers une violente accélération de la crise économique [20]
Crise financière : de la crise des liquidités à la liquidation du capitalisme ! [21]
La crise immobilière, un symptôme de la crise du capitalisme [22]
Rubrique:
Dossier spécial sur le mouvement des Indignés et des Occupy
- 3939 lectures
Place Puerta del Sol, Madrid
Le mouvement des Indignés, parti d’Espagne à la mi-mai 2011, et qui a pris aux Etats-Unis et en Angleterre le nom Occupy, a une importance historique. Les populations déshéritées et la classe ouvrière, en particulier la jeunesse, sont en train de réagir massivement aux coups de boutoirs de la crise économique. Mais plus encore que l'immense colère qui s'y manifeste, l'organisation de la lutte en assemblées générales et la réflexion qui anime ces débats font la preuve d'une véritable avancée pour le combat de notre classe.
Tous les articles, témoignages et vidéos sur ce thème sont publiés ici au fur et à mesure.
Rubrique:
Une contribution du TPTG sur le mouvement des « Indignés » en Grèce
- 2130 lectures
Nous avons reçu récemment ce texte des camarades du TPTG (Les Enfants de la Galère) en Grèce et nous sommes très heureux de le publier parce qu’il représente une des premières prises de position claire sur le « mouvement des assemblées » en Grèce, écrite par des camarades qui ont pris part au mouvement. Leur analyse des événements récents en Grèce correspond de très près à ce que nous avons dit du mouvement des « Indignés » en Espagne qui a fourni un catalyseur immédiat pour la mobilisation à Athènes et dans d’autres villes grecques. Exactement comme nous avions identifié une lutte à l'intérieur du mouvement en Espagne entre une « aile démocratique » qui vise à récupérer les assemblées au profit d’un projet de réforme capitaliste, et une aile prolétarienne qui est pour le développement de l’auto-organisation et un questionnement de fond sur les rapports sociaux capitaliste, le texte du TPTG conclut en disant :
« Une chose est sûre : ce mouvement insaisissable, contradictoire, attire l’attention de tout le monde politique et constitue une expression de la crise des rapports de classe et de la politique en général. Aucune autre lutte ne s’est exprimée de façon aussi ambivalente et explosive au cours des dernières décennies. Ce qui inquiète les politiciens de tous bords dans ce mouvement des assemblées, c' est que la colère et l’indignation prolétariennes (et de couches petites-bourgeoises) ne s’expriment plus par le circuit médiatique des partis politiques et des syndicats. Il n’est donc pas aussi contrôlable et il est potentiellement dangereux pour le système représentatif du monde politique et syndical en général (…) le caractère multiforme et ouvert de ce mouvement met à l’ordre du jour la question de l’auto-organisation de la lutte, même si le contenu de cette lutte reste vague. »
En résumé : malgré ses nombreuses faiblesses (et le mouvement en Grèce semble souffrir plus que son modèle en Espagne du poids mort du nationalisme), toute cette expérience représente un moment très important de l’émergence d’une forme plus profonde de conscience de classe et d’organisation prolétariennes, un moment dans lequel les révolutionnaires ont besoin d’être activement impliqués.
Quels que soient les désaccords qui puissent exister entre nos organisations, il est clair, d’après ce texte, que les principes que nous avons en commun sont encore plus significatifs : opposition aux manœuvres des gauchistes et des syndicats, rejet total du nationalisme et effort déterminé pour contribuer à l’émergence de ce que les camarades de TPTG appellent « une sphère prolétarienne publique » qui rendra possible à un nombre grandissant d’éléments de notre classe non seulement d’œuvrer pour la résistance aux attaques capitalistes contre nos conditions de vie mais aussi de développer les théories et les actions qui conduisent ensemble à une nouvelle façon de vivre.
CCI, juillet 2011.
Notes préliminaires à un compte-rendu du « Mouvement des Assemblées populaires » en Grèce par le TPTG
Le mouvement des assemblées populaires a débuté d’une façon complètement inattendue le 25 mai à Athènes. On ne sait pas exactement quel était le groupe de personnes qui a pris l’initiative de mettre un post sur Facebook appelant à un rassemblement sur la place Syntagma pour exprimer leur « indignation » et leur colère face aux mesures d’austérité du gouvernement. Il semble malgré tout que quelques personnes autour d’un groupe politique influencé par l’idéologie démocratique développée les derniers temps par Castoriadis aient été impliquées entre autres dans cette initiative. L’appel a reçu une publicité favorable dans les médias et, pendant les premiers jours, il était fait référence dans ces mêmes médias à une banderole supposée être apparue lors de la mobilisation en Espagne : « Chut, ne criez pas, sinon, nous réveillerions les Grecs ! » ou quelque chose de ce genre. Naturellement, personne ne pouvait s’attendre à ce qui a suivi.
L’appel initial était une déclaration d’indépendance et de sécession vis-à-vis des partis politiques, de leurs représentants et de leur idéologie. Il déclarait aussi la volonté de protester pacifiquement contre la gestion étatique de la crise de la dette et « tous ceux qui nous ont amenés là où nous en sommes ». De plus, un des principaux mots d’ordre était l’appel à une « démocratie réelle ». Ce mot d’ordre, « démocratie réelle ! » fut rapidement remplacé après quelques jours par celui de « démocratie directe ! ». Les efforts faits au début par les organisateurs pour mettre en place un ensemble de règles démocratiques pour les assemblées furent rejetés par les participants. Cependant, certaines règles furent établies au bout de quelques jours en ce qui concernait la durée des prises de parole (90 secondes), la façon dont quelqu’un pouvait proposer un sujet de discussion (en étant choisi par tirage au sort)… Nous devons aussi mentionner qu’autour de la colonne vertébrale de l’assemblée générale, il y avait toujours plein de discussions, d’événements et même des confrontations entre les participants.
Au début, il y avait un esprit communautaire dans l’effort d’auto-organiser l’occupation de la place et officiellement les partis politiques n’étaient pas tolérés. Cependant, les gauchistes et, en particulier, ceux qui venaient de SYRIZA (coalition de la Gauche Radicale) furent rapidement impliqués dans l’assemblée de Syntagma et conquirent des postes importants dans le groupe qui avait été formé pour gérer l’occupation de la place Syntagma et, plus spécifiquement, dans le groupe pour le « secrétariat de soutien » et celui responsable de la « communication ». Ces deux groupes sont les plus importants parce qu’ils organisent les ordres du jour des assemblées aussi bien que la tenue des discussions. On doit remarquer que ces gens ne faisaient pas état de leur affiliation politique et qu’ils apparaissaient comme des « individus ». Cependant, ces politiciens sont incapables de manipuler complètement une assemblée aussi insaisissable et hétérogène quand le déni de légitimité aux partis politiques est prédominant. Il est très difficile de participer en tant qu’individu dans ces groupes spécifiques d’ailleurs, puisqu’il vous faut vous confronter avec les mécanismes de fonctionnement occulte des partis gauchistes.
Les regroupements organisés sur une base quotidienne devenaient graduellement de plus en plus massifs et exprimaient le refus complet de toute légitimité au gouvernement et au système politique en général. Dans le rassemblement le plus massif participaient environ 500 000 personnes (le dimanche 5 juin).
La composition sociale mélangée de la foule qui venait chaque jour, allait d’ouvriers sans emploi, de retraités et d’étudiants jusqu’aux petits entrepreneurs ou ex-petits patrons durement touchés par la crise. Dans ces rassemblements sur la place Syntagma, une division s’était faite dès les premiers jours entre ceux qui étaient « en haut » (proches du parlement) et ceux qui étaient « en bas » (carrément sur la place). Dans la première catégorie, quelques groupes nationalistes et d’extrême-droite ont été très actifs depuis le début pour influencer les gens les plus conservateurs et/ou moins politisés qui participaient aux manifestations (soit des prolétaires, soit des ex-petits entrepreneurs prolétarisés). Il est relativement courant pour la plupart d’entre eux réunis autour du parlement de brandir des drapeaux grecs, de faire le bras d’honneur contre les députés, de crier des slogans populistes et nationalistes comme « traîtres» ou « voleurs », ou même de chanter l’hymne national. Cependant, le fait que ces gens soient politiquement plus conservateurs ne signifie pas nécessairement qu’ils soient plus contrôlables quand les conflits s’enveniment avec la police ou qu’ils puissent compter dans leurs rangs des groupes d’extrême droite organisés. De l’autre coté, le deuxième groupe qui formait l’essentiel de l’assemblée etait beaucoup plus orienté vers la gauche démocratique (patriotique, antifasciste, anti-impérialiste) comme on peut le voir dans les communiqués votés[1] et est aussi prolétarien dans sa composition (ouvriers au chômage, fonctionnaires, étudiants, travailleurs du secteur privé, etc.).
Les gauchistes se sont débrouillés pour organiser une série de discussions sur la « crise de la dette » et la sur la « démocratie directe » avec des conférenciers invités venant de la gauche universitaire (par exemple, des économistes politiques de gauche comme Lapavitsas) qui sont en lien avec différents partis politiques de gauche (principalement SYRIZA et ANTARSYA). L’organisation de ces moments de discussions reproduit et renforce la division entre « experts » et « non-experts » et le contenu des présentations des conférenciers invités a été centré sur une alternative politique et une gestion économique des rapports capitalistes et de la crise. Par exemple, les principales visions concernant la question de la dette allaient de propositions de « restructuration de la dette » et d’annulation de la « partie inacceptable de la dette » à des appels à suspendre immédiatement les paiements de la part de l’Etat grec ou préconisant la sortie de la zone Euro et de l’Union Européenne. Dans tous les cas, le contenu politique développé pendant ces débats est celui d’une voie alternative et plus patriotique pour le « développement du pays » et de la création d’un Etat social-démocrate réel. En d’autres termes, ces débats essaient d’orienter les discussions vers une voie alternative pour la reproduction des rapports capitalistes en Grèce, qui serait mise en place par un gouvernement différent dans lequel les gauchistes assumeraient le rôle qu’ils méritent…il y a eu, à l’occasion, des critiques de la part de participants à l’assemblée sur le rôle prédominant des experts en statistiques tout autant que sur leur conception de la dette comme une question nationale, de logistique. Cependant elles étaient trop faibles pour changer l’orientation. La proposition la plus répandue d’une gestion de gauche de la « dette nationale » vient de la Commission d’Audit Grecque, composée de différents politiciens de gauche, de bureaucrates universitaires et syndicalistes, qui sont en faveur de l’idée de l’annulation de la « partie inacceptable de la dette » selon le modèle équatorien. Cette présence de la Commission s’est instituée sur la place dès les premiers jours, en dépit de résolutions votées pour l’exclusion des partis politiques et des organisations, sous prétexte qu’elle était une « association de citoyens » !
Quelques uns d’entre nous ont participé à une assemblée à thème qui avait été formée par l’assemblée générale sur les questions du travail et du chômage et appelée Groupe des ouvriers et des chômeurs. En lien avec d’autres camarades, cette assemblée a essayé de mettre en avant la pratique d’auto-organisation de la « suspension des paiements » à la base pour la satisfaction directe de nos besoins. Bien sur, cela était en complète contradiction avec les propositions politiques de gauche de « suspension des paiements de la dette souveraine ». Dans ce but, quelques interventions avaient été organisées sur les bureaux de chômage, appelant les chômeurs à rejoindre le groupe sur la place Syntagma et essayant d’entamer des discussions visant à organiser des assemblées locales de chômeurs (cet objectif n’a malheureusement pas connu de succès). Trois actions dans la station de métro de Syntagma ont aussi été organisées, en coopération avec un collectif qui agissait déjà dans ce domaine, la coalition de comités appelée « je ne paye pas », dans lesquelles les composteurs avaient été bloqués. Les gauchistes qui participaient à cette assemblée ont essayé de limiter ses activités à des revendications politiques de gauche sur le « droit au travail », pour réclamer « du travail à temps plein, décent et stable pour tous », etc. sans trouver un réel intérêt à communiquer leur expérience de lutte (s’ils en ont une) et à s’engager dans une action collective directe. Les résultats de cette confrontation sont détaillés dans le communiqué disponible sur le lien indiqué. [2] Toutefois, le problème principal est, qu’à part nous, quelques anarchistes anti-autoritaires et les gauchistes, la participation d’autres gens autant dans la discussion que dans les actions a été presque inexistante, bien que les actions qui ont été organisées aient eu l’accord de l’assemblée générale.
Cela nous amène à faire une autre observation importante sur l’assemblée de la place Syntagma. Bien que l’assemblée ait pris pendant tous ces jours des décisions qui impliquaient l’organisation d’actions, en définitive, très peu de gens y participaient. Il semble que le processus démocratique direct de seulement voter pour ou contre une proposition spécifique dans une assemblée de masse telle que celles-ci, tend à faire que se reproduisent la passivité et le rôle de spectateur/votant individuel.
Cette passivité et cet individualisme d’une partie significative des gens ont été dépassés le jour de la grève générale (le 15 juin) quand le besoin de lutter contre les tentatives de l’Etat de disperser la manifestation et de réoccuper la Place Syntagma a conduit non seulement concrètement à la participation de milliers de gens dans les conflits avec la police mais a aussi provoqué l’expression d’une réelle solidarité entre les manifestants : des gens étaient libérés des mains des flics par d’autres manifestants, l’équipe médicale aidait toute personne en danger, des milliers de gens dansaient joyeusement au milieu des gaz lacrymogènes, etc.
Il y avait toutefois certaines forces, à savoir les médias, les partis de gauche et les fascistes qui essayaient de favoriser la séparation entre les manifestants à propos de la question de la violence et au travers d’accusations contre quelques manifestants violents d’être poussés par des agents provocateurs de la police. Quand le bloc anarchiste/antiautoritaire et les blocs syndicalistes de base arrivèrent sur la place Syntagma et que quelques camarades rejoignirent la zone devant le parlement, un groupe de fascistes exploita le jet de deux ou trois cocktails Molotov par quelques individus et se mit à crier dans des porte-voix en direction des manifestants que les « kukuluforoi » ( personnes cagoulées) étaient des provocateurs de la police déguisés et qu’ils devaient être isolés. Ce groupe commença à attaquer les anarchistes/antiautoritaires et se débrouilla pour impliquer dans cette attaque d’autres manifestants. Les anarchistes/antiautoritaires réussirent à faire face à cette attaque avec succès. Cependant, les media ont exploité cet incident en le dépeignant comme une attaque des anarchistes contre les « indignés » ( comme s’appelle la foule qui manifeste sur la place) afin de favoriser la séparation entre manifestant « violents » et « pacifiques » au sein du mouvement. La vidéo de cet incident est passée en boucle le reste de la journée. Toutefois, au niveau de la politique de la rue, cette tentative ne connut pas un grand succès puisque quand la police attaqua plus tard la manifestation, elle se heurta à une foule complètement mélangée.
En dehors des médias, ce sont aussi les partis de gauche qui ont essayé de favoriser la séparation entre manifestants « violents » et « pacifiques » à travers leur « provocateurologie » et leurs accusations et leur propagande continuelles contre le milieu anarchiste/antiautoritariste. Leurs buts étaient évidemment différents : ils voulaient que le mouvement reste dans les limites de la légalité et du pacifisme pour pouvoir capitaliser celui-ci selon leur souhait de participer à un futur gouvernement qui suivrait une voie de gauche pour le développement du capitalisme grec. Nous devons ajouter ici que le Groupe de travailleurs et de chômeurs de la place Syntagma auquel participaient certains d’entre nous a proposé une résolution condamnant la « provocateurologie » et les fausses divisions au sein du mouvement mais le texte n’a jamais été voté en tant que sujet de discussion. Ce fut le résultat de l’intervention des organisateurs gauchistes et de manipulation combinée avec un faible soutien des participants.
Beaucoup de visions différentes se sont cependant exprimées en ce qui concerne la question de la « provocateurologie » et aussi du « caractère violent ou pacifique de notre mouvement ». Le caractère dynamique et contradictoire de l’assemblée peut être perçu au travers de quelques décisions de l’assemblée deux jours avant la grève générale des 28-29 juin. Les organisateurs de gauche se débrouillèrent pour remporter un vote appelant les forces de police à « montrer du respect pour la volonté du peuple et le droit constitutionnel de la souveraineté du peuple (…) et ne pas empêcher le peuple de protéger sa propre constitution » ! En même temps, il y avait une autre résolution qui condamnait « les professionnels de la violence qui servent le système et pas le mouvement », expression de la « provocateurologie » gauchiste contre ceux qui n’agissaient pas en accord avec l’idéologie d’obéissance à « la loi et l’ordre ». Au contraire, le lendemain, dans une autre décision, l’assemblée a voté en faveur de « ceux qui vont à l’affrontement avec les forces de répression » en décidant que « personne ne devait les prendre à partie dans les prises de parole par haut-parleur. » Le même jour, la proposition de « condamner toute forme de violence pendant les 48 heures de grève » fut rejetée.
On doit remarquer que jusqu’à maintenant, le « mouvement des places » a été réellement efficace dans le sens où il a réussi à élargir le champ de l’opposition à la politique du gouvernement, quelque chose que les grèves générales conventionnelles et les grèves de secteur isolées n’avaient pas réussi à faire. Cela a obligé le syndicat GSEE discrédité à appeler à une grève de 24 heures le 15 juin et à une grève de 48 heures quand le second plan d’austérité allait être voté et beaucoup de travailleurs ont saisi cette occasion pour participer aux manifestations du matin jusqu’au au soir. Bien que cela n’ait pas réussi à faire annuler le vote du plan d’austérité, cela n’en a pas moins réussi à créer une profonde crise ministérielle et une crise politique. Jamais avant, même pas pendant les émeutes de décembre 2008, le système politique de représentation n’avait aussi profondément perdu sa légitimité. Cependant, les organisateurs gauchistes réussirent à préserver le rôle de médiation des syndicats – au moins au niveau idéologique – en appelant avec eux à la grève générale de 48 heures.
Une première observation concernant cette grève est qu’il est impossible d’évaluer précisément le nombre de gens qui ont pris part à cet événement pendant les deux jours. Il y avait un afflux et un départ continu de gens sur la zone d’occupation des lieux au centre d’Athènes (c’est-à-dire sur la place Syntagma et dans les rues aux alentours) et le nombre de manifestants fluctuait entre quelques milliers et 100 000. La participation à la grève, au rassemblement et aux affrontements a néanmoins été beaucoup plus faible le premier jour que le second : le nombre de manifestants sur la place Syntagma le mardi 28 juin ne dépassait pas 20 000 personnes[3]. Au cours de ces deux jours, de rudes affrontements eurent lieu entre les manifestants et la police anti-émeute dans une grande partie de la ville autour de la place Syntagma. Des milliers de substances chimiques furent utilisées par la police anti-émeute, créant une atmosphère toxique et suffocante. Le deuxième jour, la mobilisation a été indiscutablement plus intense et plus massive.
Selon la police, 131 flics ont été blessés, 75 personnes ont été atteintes et 38 personnes ont été interpellées. Selon l’équipe médicale de la place Syntagma, plus de 700 personnes ont reçu les premiers soins dans les centres médicaux improvisés sur la place et dans la station de métro de Syntagma et une centaine de gens ont été transférés dans des hôpitaux. Il y a eu des dégâts dans des banques, des hôtels de luxe, à la poste de la place Syntagma ainsi que dans quelques établissements commerciaux et dans des restaurants.
Il ne fait aucun doute que, dès le début, le but de l’Etat était d’évacuer la place, de terroriser et de disperser les manifestants[4]. Cependant, l’état d’esprit persistant des manifestants se résumer parfaitement à travers ce mot d’ordre : « nous ne quitterons pas la place ». Résultat : la confrontation avec la police, physique comme verbale, était presque continuelle. Le premier jour, la plupart des gens étaient repoussés dans des rues autour de la place, menant des batailles plus ou moins longues, jusqu’ à ce que la police réussisse à créer « un cordon sanitaire » de flics autour de la place, empêchant toute personne de s’en approcher. Malgré cela, quelques centaines de personnes sont restées sur la place tard dans la nuit.
Le deuxième jour, à coté du rassemblement sur la place Syntagma, il y eut des tentatives de faire des blocages tôt le matin de façon à empêcher l’entrée des députés au parlement. Cette action avait été votée par l’assemblée de Syntagma comme par les assemblées qui s’étaient formées dans d’autres quartiers en dehors du centre d’Athènes. Malheureusement, une centaine seulement de manifestants participèrent à ces blocages qui furent immédiatement attaqués brutalement, repoussés et dispersés par la police. Ainsi, le plan d’empêcher les politiciens de rentrer dans le parlement ne fonctionna pas. Dans le cas du blocage de l’avenue Vasileos Konstantinou, les manifestants furent repoussés dans les rues avoisinantes où ils érigèrent des barricades et, après quelques heures et quelques confrontations sans gravité avec la police, ils commencèrent une longue manifestation qui passa dans les parties touristiques du centre pour rejoindre finalement le grand rassemblement sur la place Syntagma. Il faut remarquer que l’organisation des blocages a été totalement inefficace parce que les organisations gauchistes qui jouaient un rôle important du fait de leur contrôle sur les principaux groupes de l’assemblée de Syntagma n’avaient rien fait pour assurer une plus grande participation et une réelle confrontation avec la police. Bien sûr, l’attitude des gauchistes n’excuse pas l’incapacité de l’assemblée à simplement respecter ses décisions et la passivité d’un grand nombre de participants.
En ce qui concerne les conflits autour du parlement, des scènes semblables à celles du premier jour eurent aussi lieu le second jour, mais ce fut beaucoup plus difficile pour la police d’arriver à ses fins. Des milliers de manifestants participaient aux affrontements le deuxième jour. La plupart des manifestants s’étaient préparés aux assauts en portant des masques à gaz ou d’autres protections improvisées ; beaucoup transportaient des solutions anti-acide et quelques uns étaient complètement équipés pour se battre contre les flics. Dans nombre de cas, il y avait une « zone de front » où se passaient les batailles et une « zone de l’arrière » où les gens criaient des slogans, aidaient ceux qui en avaient besoin et même « alimentait » la « zone du front » en nouveaux renforts.
Les gens « pacifiques » épaulaient ceux qui se battaient avec la police : la présence physique d’une foule énorme était en elle-même un obstacle aux manœuvres de la police. Les protestataires bloquèrent un groupe de motos des forces de police des sinistres escadrons DIAS et DELTA en se mettant devant lui alors que les policiers étaient prêts à se lancer à l’attaque. Les manifestants « pacifiques » n’étaient pas effrayés par les affrontements et ce ne sont que les violentes attaques continuelles et massives de la police anti-émeute qui les obligèrent à abandonner les rues autour de Syntagma. Contrairement à ce que beaucoup prédisaient les jours précédents et en particulier pendant les affrontements du 28 juin, les affrontements n’ont pas « terrorisé » le « peuple » mais, dans un sens, ils exprimaient la colère accumulée contre un gouvernement largement décrédibilisé, contre la brutalité de la police et la dégradation des conditions de vie de la classe ouvrière.
Ce jour-là en particulier, reparurent les insurgés de décembre 2008 (anarchistes, anti-autoritaires, étudiants, ultras, jeunes prolétaires précaires) aux cotés d’une partie considérable de la classe ouvrière plus « respectable » et plus stable qui protestait contre les mesures d’austérité en s’affrontant à la police. C’était la première fois depuis le 5 mai 2010 qu’il arrivait quelque chose de semblable.
La grève générale de 48 heures avait une autre ressemblance avec la rébellion de décembre 2008 : la gaieté. Beaucoup de mots d’ordre ou de chansons des manifestants contre le gouvernement et le FMI étaient dérivés de slogans ou de chansons de la culture de rue tandis que pendant les affrontements avec la police, des batteurs encourageaient les manifestants et les incitaient à maintenir leurs positions.
Les deux jours, la police finit par « nettoyer » les environs et les rues du centre tard dans la nuit et il ne resta plus qu’une poignée de personnes déterminés à rester sur la place toute la nuit.
Les milliers de gens qui avaient participé aux affrontements comme leur diversité contredisaient dans la pratique les théories des organisations/partis de gauche et des médias sur une prétendue « conspiration de provocateurs » ou de « gangs para-étatiques » et démontraient combien était ridicule toute propagande similaire bien répandue sur ces groupes « particuliers » qui « créent le chaos ». Beaucoup de gens ont réalisé qu’il était nécessaire de jeter des pierres, des pétards et de dresser des barricades dans la rue contre des flics armés, enragés et sans pitié qui exécutaient les ordres du capital et de l’Etat.
Ce changement était aussi le résultat du dépassement des confrontations (habituellement verbales) entre les protestataires « non violents » et « violents » au cours des mobilisation du dernier mois. Beaucoup de « non violents », en particulier les plus vieux, réalisaient enfin que derrière les « masques » des « provocateurs », il y avait surtout des gens normaux, remplis de rage. Ici, c’était une dame sexagénaire parlant amicalement avec un jeune de 16 ans, « masqué », du « droit de riposter aux attaques des flics» et là, c’étaient des protestataires « indignés » bien habillés qui discutaient avec des « émeutiers » de thèmes semblables.
Une autre caractéristique dominante de ces jours de rage, c’était la l’atmosphère mêlée à la fois de bagarre et de fête. Pendant les affrontements, il y avait de la musique en live, les gens chantaient et, comme nous l’avons dit avant, en quelques occasions des joueurs de batterie accompagnaient les contre-attaques face aux escadrons anti-émeutes ! Dans l’après-midi du 28, un concert fut donné malgré les bagarres et les gaz et les manifestants dansaient pendant que la police arrosait la place de gaz lacrymogènes.
Les « expropriations » de pâtisseries, de gâteaux et de glaces d’un grand café sur la place donnait à la lutte un goût très doux le 29, bien que le groupe en charge de la nourriture ait condamné le pillage par haut-parleurs, ayant été probablement engueulé par quelques « organisateurs » de gauche. Plus tard, dans l’après-midi, un groupe important composé principalement de membres de SYRIZA essayèrent d’empêcher les gens d’empiler des pierres pour s’en servir contre une attaque éventuelle des escadrons anti-émeutes, mais n’ayant aucun plan alternatif pour contrer l’attaque, ils laissèrent rapidement tomber. Juste après, l’équipement en micros et mégaphones fut retiré de la place sous prétexte qu’il pouvait être endommagé. Le choix d’éloigner la « voix » de la mobilisation à ce moment précis, quand les affrontements avec la police aux alentours de la place étaient encore en cours, affaiblissait de façon évidente la défense de la place. Quelques minutes plus tard, de nombreuses forces de police anti-émeute envahissait la place et, dans une opération particulièrement violente d’encerclement, réussissait à disperser la foule, la refoulant jusque dans la station de métro. Il n’y eut qu’une centaine de personnes qui revinrent sur la place et encore moins qui y restèrent tard dans la nuit.
Nous devons mentionner aussi que le sentiment de rage contre les politiciens et la police est réellement en train de grandir. A part des affrontements généralisés, cette rage se reflétait aussi dans les condamnations verbales qu’on pouvait entendre ici et là : « nous devrions brûler le parlement », « nous devrions les pendre », « nous devrions prendre les armes », « nous devrions visiter les maisons des députés », etc. Il est à remarquer que la plupart de ces déclarations provenaient de gens plus âgés. Plusieurs cas « d’arrestation » de flics camouflés dans la foule sont aussi révélateurs du degré croissant de colère : dans la soirée du 29, des manifestants se saisirent d’un flic camouflé en civil dans la station de métro de Syntagma et essayèrent de le retenir quand les secouristes de Croix-Rouge sont intervenus et l’ont aidé à s’échapper (selon la rumeur, il n’avait pas plus son arme quand il est parti…)
En ce qui concerne le rôle des syndicats (GSEE-ADEDY), à part leur appel à la grève de 48 heures, qui était plus ou moins un résultat de la pression du « mouvement de la rue », ils n’ont réellement joué aucun rôle important. Il est significatif que les rassemblements sous leurs sigle n’aient attiré que quelques centaines de personnes et que, le second jour, quand le nouveau plan d’austérité allait être voté, le GSEE ait organisé son rassemblement tard dans l’après-midi, sur une autre place dans le centre-ville (à deux pas de la place Omonia et dans la direction opposée à Syntagma !) De plus, le 30 juin, le GSEE fidèle à sa théorie d’un complot fomenté, publiait un communiqué de presse qui condamnait « des destructions et des émeutes préparées à l’avance entre les encagoulés et la police qui coopérent contre les travailleurs et les manifestants (..) Le GSEE condamne toute violence d’où elle vienne et appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités… ». De l’autre coté, ADEDY a gardé une attitude plus prudente : dans ses communiqués de presse du 29 et du 30 juin, il condamnait « la barbarie du gouvernement » et « la brutalité de la police » contre les manifestants et appelait même à un rassemblement le 30 juin à la place Syntagma… qu’il n’a jamais organisé !
Quelques points généraux concernant le mouvement contre l’application des plus dures mesures d’austérité depuis la Seconde Guerre mondiale :
1 Le nationalisme (principalement sous sa forme populiste) est dominant, favorisé à la fois par les diverses cliques d’extrême droite et par les partis de gauche et les gauchistes. Même pour beaucoup de prolétaires et de petit-bourgeois frappés par la crise qui ne sont pas affiliés à des partis politiques, l’identité nationale apparaît comme un dernier refuge imaginaire quand tout le reste s’écroule rapidement. Derrière les mots d’ordre contre « le gouvernement vendu à l’étranger » ou pour « le salut du pays », « la souveraineté nationale » la revendication d’une « nouvelle constitution » apparaît comme une solution magique et unificatrice. Les intérêts de classe sont souvent exprimés en des termes nationalistes et racistes, ce qui donne un cocktail politique confus et explosif.
2 La manipulation de la principale assemblée sur la place Syntagma (il y en a plusieurs autres dans différents quartiers d’Athènes et dans d’autres villes) par des membres « non déclarés » des partis et des organisations de gauche est évidente et c’est un obstacle réel à une direction de classe du mouvement. Cependant, à cause de la profonde crise de légitimité du système politique de représentation en général, eux aussi devaient cacher leur identité politique et garder un équilibre –pas toujours réussi - entre d’un coté un discours général et abstrait sur « l’autodétermination », la « démocratie directe », « l’action collective », « l’anti-racisme », le « changement social », etc., et de l’autre coté contenir le nationalisme extrême, le comportement de voyou de quelques individus d’extrême-droite qui participaient aux regroupements sur la place.
3 Une partie significative du milieu anti-autoritaire aussi bien qu’une partie de la gauche (en particulier les marxistes-léninistes et beaucoup de syndiqués) gardent leurs distances envers les assemblées ou leur sont ouvertement hostile : les premiers les accusent surtout d’avoir montré de la tolérance vis-à-vis des fascistes devant le parlement ou d’avoir pris la défense des députés devant l’assemblée, d’être un ensemble politique petit-bourgeois, réformiste, manipulé par certains partis de gauche. Les seconds accusent les assemblées d’apolitisme, d’hostilité envers la gauche et le « mouvement syndiqué, organisé ».
Une chose est certaine : ce mouvement insaisissable, contradictoire attire l’attention de tout le monde politique et constitue une expression de la crise des rapports de classe et de la politique en général. Aucune autre lutte ne s’est exprimée de façon aussi ambivalente et explosive au cours des dernières décennies. Ce qui inquiète les politiciens de tous bords dans ce mouvement des assemblées, c’est que la colère et l’indignation prolétariennes (et de couches petite-bourgeoises) grandissantes ne s’exprime plus par le circuit médiatique des partis politiques et des syndicats. Il n’est donc pas aussi contrôlable et il est potentiellement dangereux pour le système représentatif du monde politique et syndical en général. Le rôle de la « provocateurologie » est donc crucial : celle-ci est utilisée comme un exorcisme, une calomnie à l'encontre d'une partie croissante de la population qui, exilée dans le no man’s land de « l’activité para-étatique » doit être réduite à l’inertie. A un autre niveau, le caractère multiforme et ouvert de ce mouvement met à l’ordre du jour la question de l’auto-organisation de la lutte, même si le contenu de cette lutte reste vague. Le débat public sur la nature de la dette est une question épineuse car il pourrait conduire à un mouvement de « refus de payer » pour l’Etat grec ( une question bien au-delà de l’horizon politique des partis, des syndicats et de la grande majorité de la gauche extra-parlementaire, restée profondément pro-étatiste). Après le vote sanglant du Programme à Moyen Terme ( NDT : autre nom donné au 2e plan d’austérité ), on ne sait pas quelle direction prendra le mouvement des assemblées à une époque où toutes les certitudes semblent s’évanouir dans les airs.
TPTG (11/7/2011)
Sources URL : https://en.internationalism.org/icconline/2011/07/notes-on-popular-assem... [25]
[1]Voir https://real-democracy.gr [26]
[2] https://real-democracy.gr/en/node/159 [27].
[3] Le fait que la plupart des gens aient choisi de faire grève le deuxième jour des 48 heures de grève générale, quand le « programme cadre de consolidation fiscale à moyen terme » était voté, révélait fortement le caractère idéologique et mensonger des appels des gauchistes à une grève générale illimitée. La grosse réduction des revenus et des ressources des ouvriers combinée à la crise complète des syndicats rendait un tel projet impossible, au moins à court terme, à la fois au niveau subjectif et objectif. Les appels des gauchistes à la grève générale illimitée sont dépourvus de tout contenu réel et sont utilisés comme propagande pseudo-combative de façon à cacher leur incapacité totale ou leur refus de s’engager dans des actions directes et concrètes appropriées mettant en avant la « suspension des paiements » pour les prolétaires de la base. Les cadres de tous les partis gauchistes et des groupuscules sont bien plus enclins à garder leurs positions institutionnelles dans les différentes associations syndicales et dans les organisations non gouvernementales qu’à favoriser tout activité réelle de classe antagonique
[4] Comme il a été révélé plus tard dans les media, cet objectif avait déjà été planifié et décidé au cours d’une conférence de l’état-major de la police grecque le mardi et cela montre à la fois l’importance accordée par le gouvernement au vote des nouvelles mesures d’austérité et l’absurdité de la théorie de la « provocation » des flics par la violence. Par ailleurs, d’après les conversations très vives entre les policiers anti-émeutes et les manifestants, nous pouvons conclure que ces escadrons doivent subir une sorte d’entraînement idéologique de la part des officiels gouvernementaux de façon à ce qu’ils ne ressentent aucun doute moral pour exécuter les ordres : l’argument dominant était que la majorité des manifestants sont « des fonctionnaires qui ont perdu leurs privilèges »…
Géographique:
- Grèce [28]
Qu’y a-t-il derrière la campagne contre les « violents » autour des incidents de Barcelone ?
- 1695 lectures
Le mouvement du 15-M (15 mai) tend à refluer, en partie à cause de la fatigue de tant de jours de mobilisation, et aussi à travers le travail de sape de l’intérieur réalisé par la DRY[1] [29] et « de l’extérieur » par l’action des médias et l’intervention des politiciens, du gouvernement central et des gouvernements régionaux.
C’est dans ce contexte que les incidents de Barcelone ont eu lieu. Une minorité agresse et humilie quelques parlementaires, ce qui a donné lieu à une campagne assourdissante et passablement hystérique « contre la violence », « pour la défense des institutions démocratiques », etc. On fait la « différence » entre une majorité pacifique et une minorité radicale anti-système, laquelle « abîmerait » le mouvement, en exigeant des « leaders » de celui-ci de combattre et d’en écarter les « violents »[2] [30]. Et pour compléter le délire total des uns et des autres, on parle même de « kale borroka » [nom basque donné aux émeutes de rue des nationalistes, N. du T.]...
Il est nécessaire de mettre les points sur les i : Qu’est-ce que la violence ?, Quelles en sont les causes ? Tous les genres de violence sont-ils identiques ?, Qui est à l’origine des incidents de Barcelone ? Contre qui est dirigé la campagne actuelle « antiviolence » ? Quelles sont les perspectives mises en avant ?
Qu’est-ce que la violence ?
Lorsque des malades meurent à cause des réductions de dépenses dans le secteur de la santé ; lorsque les personnes âgées connaissent une vieillesse amère à cause des misérables pensions ; lorsque des travailleurs meurent dans des accidents de travail parfaitement évitables ; lorsque des années de travail laissent leur trace sous la forme des maladies psychiques ou physiques ; lorsque des millions de personnes souffrent dans le désespoir d’un chômage sans fin ; lorsque des immigrés se retrouvent enfermés dans les Centres d’Internement des Étrangers (CIE) sans la moindre charge contre eux ; lorsque ta vie dépend chaque jour d’un contrat précaire de travail-poubelle ; lorsqu’on te jette hors de chez toi par ordonnance d’expulsion ; lorsqu’on te coupe l’électricité, etc., c’est quoi si ce n’est pas de la violence ?
Dans cette société basée sur l’exploitation et la concurrence à mort, la violence règne en maître, une violence organisée, institutionnalisée, considérée comme « normale », présentée comme « la vie elle-même », légitimée par les lois et avalisée par l’appareil répressif des polices, des tribunaux et des prisons.
Que peut-on faire face à cette violence ? Nous taire ? L'accepter avec résignation ? Non ! Nous devons suivre le chemin du mouvement du 15-M, suivre ce qui a été fait avant en France contre la réforme des retraites, ou en Egypte, en Grèce, ou par les étudiants en Grande-Bretagne : nous unir, nous organiser nous-mêmes en assemblées, organiser des manifestations, des rassemblements, des grèves.
Cette action collective signifie rompre avec la normalité quotidienne de cette société, basée sur une course à la survie où il y en très peu qui gagnent et beaucoup qui perdent, où le voisin n’est pas considéré comme un camarade avec lequel il faut coopérer, mais un rival qu’il faut utiliser et écarter sans scrupule dans une « lutte pour la vie ». Rompre avec cette situation de violence permanente et imposer notre action collective contre ceux qui en sont responsables et en bénéficient -le Capital et son Etat- porte un nom : la violence. Essayer d’éviter le mot en nommant la chose « désobéissance civile », « non-violence », « pacifisme » et d’autres euphémismes avec lesquels la DRY prétend camoufler et obscurcir les questions, c’est de la tromperie, c’est une manière de nous éloigner de ces moyens collectifs de combat pour nous enfermer dans les « moyens démocratiques » -les multiples modalités d’élections, les quêtes de signatures, la confiance aveugle dans des leaders charismatiques qui se bagarrent pour conquérir nos voix, etc. Ce sont là des moyens qui nous renvoient à notre atomisation, enfermés dans notre « chacun pour soi », passifs et concurrents ; autrement dit, on attaque la racine de notre force collective : la solidarité, l’unité, le débat, l’action commune.
La société capitaliste exsude la violence par tous ses pores, elle ne se maintient que par la violence, elle engendre de la violence entre les classes et aussi entre les individus. Ceci dit, la violence en général n’existe pas, il existe différents types de violence. Le type de violence de la bourgeoisie n’a rien à voir avec celle pratiquée par le prolétariat. La violence de celui-ci a des caractéristiques propres et spécifiques qui la différencient radicalement de celle qui est exercée quotidiennement par le système capitaliste et son Etat. Voilà, à notre avis, la question essentielle : comprendre en quoi consiste la violence prolétarienne et quels sont ses moyens.
Ce n’est pas ici le lieu de développer en détail cette question [3] [31], mais, en bref résumé, on peut dire que la violence du prolétariat ne se fonde pas seulement sur la révolte contre la violence systématique de l’ordre établi, mais aussi sur la perspective historique de la construction d’une nouvelle société sans classes, sans Etats, sans frontières, une communauté humaine mondiale qui vivra et agira par et pour elle-même. Les moyens de la violence du prolétariat doivent être cohérents avec cette fin, on ne peut pas en faire usage en suivant le précepte jésuitique de « la fin justifie les moyens » ; il existe une éthique prolétarienne [4] [32].
Si ce que l’on recherche, c’est la libération de l’humanité, la violence prolétarienne ne peut pas être irrationnelle, sadique, aveugle ; si nous aspirons à une société où la solidarité soit le principe même de l’existence, on doit rejeter l’insulte, la calomnie, le dénigrement, la violence entre les ouvriers eux-mêmes, la recherche de bouc émissaires sur lesquels se défouler, la vengeance et la revanche. La violence prolétarienne rejette la torture, l’humiliation et le sadisme, la guerre impérialiste et le terrorisme. Elle se fonde sur l’action directe de masse : les assemblées, les manifestations, les grèves, les rassemblements, la culture du débat.
Les événements de Barcelone semblent avoir été une provocation policière, mais ils sont en lien avec une orientation que le mouvement du 15-M s’est donnée ces derniers temps et qui consiste dans le fait d’organiser des rassemblements devant les parlements régionaux et les mairies et une fois là, insulter les politiciens, les traitant d’escrocs, les huer, en déchargeant sur eux toutes les rages et les frustrations accumulées.
Ce genre d’action est incompatible avec l’éthique et les moyens de violence du prolétariat et la seule chose qu’on réussit à faire avec ces actions, c’est de renforcer les mécanismes démocratiques de domination capitaliste.
La focalisation sur tel ou tel politicien corrompu signifie que l’on désigne les effets en évitant les causes, qu’on décharge les tensions sur un quidam livré à la vindicte publique tel un bouc émissaire, qu’on personnalise les choses, qu’on ne s’inscrit ni plus ni moins que dans les rapports générateurs de violence de cette société. Et en même temps, et contrairement au scandale hystérique monté par les médias et les politiciens, ce genre d’action ne va pas contre la démocratie mais il la renforce plutôt. Quand on s'en prend à tel ou tel politicien, on tombe dans l’illusion selon laquelle avec un autre « plus honnête » ou « plus représentatif », les choses iraient mieux. Ainsi, l’institution démocratique ne serait pas le problème mais la solution. Le problème resterait cantonné aux « corrompus », aux « truands », à « ceux qui n’écoutent pas le peuple » et si on les change par des gens honnêtes, représentatifs, les choses pourraient s’arranger.
Les incidents de Barcelone : une plus que probable provocation policière
Sur Internet circulent des textes et des vidéos qui montrent avec des preuves convaincantes que les incidents devant le Parlement catalan ont été largement provoqués par des policiers infiltrés [5] [33]. Qui plus est, dans la zone où ces événements se sont produits, il y avait très peu de policiers pour la surveiller, ce qui a donné lieu à une passe d’armes entre le Président de la Généralité catalane et son « ministre » de l’Intérieur.
Cette politique qui consiste à provoquer des incidents « impopulaires » pour, immédiatement, justifier la répression sur une classe sociale, un parti ou un secteur d’un mouvement, n’est pas nouvelle. À la fin du 19e siècle, le gouvernement espagnol organisa une bande qui perpétrait des attentats pour justifier ainsi une répression brutale contre le mouvement ouvrier et les anarchistes. En 1978, à Barcelone, des agissements violents perpétrés par des provocateurs de la police au théâtre L'Escala furent utilisés par la démocratie à peine naissante pour justifier des rafles massives envers des ouvriers radicaux. On pourrait écrire des tomes entiers pour raconter les centaines et les centaines de ces manipulations au niveau national et international. Nous nous trouvons face à une classe dominante -la bourgeoisie- qui est particulièrement cynique et tordue, dont l’un des premiers idéologues – Machiavel - a mis en avant une pratique – nommée par la suite « machiavélisme »- consistant à organiser les actions le plus troubles pour justifier les politiques les plus brutales.
Vociférant à l’unisson, les politiciens de tous bords et les médias de toute idéologie ont déchaîné une furieuse campagne contre « les violents anti-système ». On a encouragé les leaders du 15-M à écarter de leur sein cette « scorie », on a construit une sale association de mots qu’un éditorialiste d’El País, journal réputé « progressiste », a bien verbalisé : « Le mouvement doit approfondir son âme réformiste et pacifique en écartant son âme révolutionnaire et agressive ». Voilà qui est dit : révolutionnaire serait synonyme d’agressivité, de violence, de sauvagerie, tandis que réformisme serait équivalent de paix, harmonie, respect.
Quels sont les objectifs de cette campagne qui n’a rien de pacifique déjà par la violence des propos, mais surtout par les menaces lancées par des politiciens et les éditoriaux de la presse, etc. ?
Le premier objectif est de faire croire que la ligne de démarcation dans le mouvement partagerait la violence et la non-violence, le radicalisme « révolutionnaire » et le pacifisme démocratique. La véritable frontière n’est pas celle-là, mais celle qui sépare, d’un coté, la « réforme de la démocratie »[6] [34] et, de l’autre, la lutte de classe contre les coupes sociales en tous genres et contre le capitalisme.
Mais il y encore un deuxième objectif en lien avec le précédent. Dans notre article « De la place Tahrir du Caire à la Puerta del Sol de Madrid »[7] [35], nous disions que « Dans les assemblées, deux ‘âmes’ cohabitent : l’âme démocratique qui constitue un frein conservateur et l’âme prolétarienne qui cherche à se définir sur une vision de classe. ». Les forces du régime démocratique cherchent à tout prix à faire taire « l’âme prolétarienne » incarnée dans une large minorité de camarades de toutes sortes, de collectifs, etc., qui mettent en avant la défense des Assemblées –il y a même un secteur qui défend : « Tout le pouvoir aux Assemblées »-, qui est favorable à une lutte massive de la classe ouvrière contre les coupes sociales et à une orientation internationaliste de destruction du capitalisme. Ce secteur est l’expression de la plateforme que la classe ouvrière se donne pour essayer d’avancer dans le développement de sa conscience, de son auto-organisation et de sa force collective, pour franchir de nouvelles étapes qui reprennent le meilleur du mouvement du 15-M et, en même temps, dépassent ses faiblesses et ses limitations. C’est cette « large minorité » qu’on veut stigmatiser en l’associant à la violence irrationnelle, qu’on veut que la DRY marginalise –en utilisant d’ailleurs des méthodes violentes- pour imposer son message démocratique et citoyen.
Cette minorité -comme l’ensemble des travailleurs- doit comprendre qu’il est impossible que la classe dominante abandonne volontairement ses privilèges et le pouvoir qu’elle exerce sur la société. L’histoire nous démontre qu’elle recourt aux pires crimes quand il s’agit de les conserver. Il y a 140 ans, un gouvernement républicain, soutenu par un parlement élu au suffrage universel, assassina en une semaine 30 000 ouvriers qui avaient osé défier la bourgeoisie avec le grand mouvement de la Commune de Paris [8] [36]. Depuis lors, les choses n’ont pas du tout changé : les massacres orchestrés par les gouvernements les plus « démocratiques » en Irak et ailleurs, ne sont pas réservés qu’aux populations lointaines soumises à un état de guerre. C’est avec la même cruauté et le même cynisme que ces gouvernements massacreront leurs exploités s’ils se sentent menacés ! Et contre la violence organisée et systématique de la classe dominante, la classe ouvrière devra prendre les armes pour la renverser. Mais, comme nous l’avons affirmé plus haut et comme l’expérience de la Commune de Paris en 1871, celle de Révolution Russe de 1917 ou d’Allemagne en 1918-19, le démontrent, les moyens que cette violence utilise sont radicalement différents que ceux de la bourgeoisie.
Cette minorité qui est le canal par lequel s’exprime « l’âme » prolétarienne du mouvement [9] [37] doit impulser le débat le plus large pour ouvrir la voie aux éclaircissements sur la question de la violence et sur plein d’autres questions qui ont commencé à se poser autour du mouvement du 15-M (reforme ou révolution ?, démocratie ou assemblées ?, revendications démocratiques ou revendications sociales ?, mouvement citoyen ou mouvement de classe ?). Elle doit encourager les efforts d’auto-organisation dans les lieux de travail, chez les chômeurs et les précaires, dans les centres d’enseignements, dans les quartiers, pour ainsi développer une nouvelle phase de mobilisation dont la classe ouvrière soit le centre.
Tout cela, nous devons le faire en sachant que nous faisons partie d’un large mouvement historique et international au sein duquel l’immédiatisme, l’empressement désespéré pour obtenir des résultats rapides, n’est qu’un piège. À ce propos, nous voudrions finir cet article en citant un texte de quelques camarades de Madrid [10] [38] qui est très clair là-dessus :
« Les politiciens, les syndicats et les médias font pression sur nous pour qu’on donne des buts concrets au mouvement le plus tôt possible, pour qu’on mette au clair ce que nous voulons. Et, de fait, depuis quelques jours, dans toutes les Assemblées, on essaye de consolider un catalogue de revendications (...), on y parle de la reforme électorale, de la démocratie participative, de l’intolérance vis-à-vis de la corruption, on parle aussi de coopératives, de nationaliser la banque (...) Nous sommes convaincus que ce ne sera pas en faisant les choses à toute vitesse, tel que le veulent, d’une façon bien intéressée, tous les politiciens et tous ceux qui veulent que rien ne change, ou, plutôt, qui veulent changer quelques petits détails pour que tout continue comme avant (...) que nous arriverons à synthétiser ce que voulons tous ceux qui sommes en lutte (...) la meilleure manière de donner une forme aux protestations c’est de concrétiser non pas ce que nous voulons, mais ce que nous ne voulons pas. (...) Nous ne voulons pas être des marchandises, ni mal vivre dans un monde qui transforme tous les rapports humains en rapports marchands. Nous ne voulons plus être soumis à la tyrannie de l’économie qui détruit nos vies et toute la planète. Nous ne voulons pas d'une société divisée en classes où la majorité de l’humanité vit dans un esclavage caché pour que quelques uns puissent vivre comme des rois. Nous pensons fermement que ce sont là des axes sur lesquels nous pouvons articuler et étendre les protestations, que ce sont des axes sur lesquels nous pouvons nous développer et commencer à entrevoir dans l’avenir, peu à peu, sans se presser, ce que nous voulons ».
CCI (19 juin 2011)
[1] [39] « Le mouvement citoyen ‘Democracia Real Ya !’ : une dictature sur les assemblées massives [40] ».
[2] [41] Ces « leaders » ont demandé aux manifestants de photographier avec leurs caméras ceux qui provoquent des incidents pour porter plainte contre eux.
[3] [42] Nous renvoyons à deux documents publiés dans notre Revue internationale : « Terreur, terrorisme et violence de classe [43] », et « Résolution sur : TERRORISME, TERREUR et VIOLENCE de CLASSE [44] ». [4] [45] Voir Revue internationale nº 127 et 128 : « Marxisme et éthique (débat interne au CCI) [46] » et « Débat interne au sein du CCI - Texte d'orientation : sur le marxisme et l'éthique (juin 2004) [47] ».
[5] [48] Voir https://es.search.yahoo.com/?fr2=p:newsrd,mkt:es [49]. Sur Youtube est apparu un document où apparaissent d’étranges manifestants isolés, avec des oreillettes et du genre robuste qui par la suite se sont mélangés aux gens rassemblés. Au bout de quelque temps, l’accès à cette vidéo a été bloqué.
[6] [50] Une démocratie au nom de laquelle on justifie et on maintien des lois répressives très dures, ou l’on participe à des guerres comme celle en Libye ou en Afghanistan, ou l’on garde enfermés des milliers d’immigrés, des tas de choses qui n’ont rien de pacifique.
[7] [51] fr.internationalism.org/icconline/2011/dossier_special_indignes/de_la_place_tahrir_a_la_puerta_del_sol_de_madrid.html [52]
[8] [53] On peut lire La guerre civile en France [54], prise de position de la Première Internationale sur la Commune de Paris, rédigée par Marx.
[9] [55] Sur notre site en espagnol [56] (il y a aussi un « dossier spécial » en français et en anglais ainsi que beaucoup de textes traduits en italien, allemand, néerlandais et portugais), nous avons ouvert des dossiers et des débats sur le mouvement du 15-M dont on a publié des textes de groupes, de collectifs et de camarades, avec lesquels nous ne sommes pas forcement d’accord sur tout, qui expriment la richesse et l’effort politique de cette minorité prolétarienne.
[10] [57] « Carta abierta a las Asambleas [58] » (Lettre ouverte aux Assemblées).
Rubrique:
Un texte d'anarchistes madrilènes sur le mouvement des Indignés
- 3245 lectures
Le texte que nous publions ci-dessous a été rédigé par un groupe d'anarchistes madrilènes autour du 27 mai. Il nous a été envoyé sur notre site en espagnol1 par un de nos lecteurs. Nous l’avons publié et nous le traduisons ici parce qu'au-delà des divergences que nous pouvons avoir parfois, il donne une description vivante et juste de ce qui s'est passé dernièrement sur la Puerta del Sol de Madrid. Par ailleurs, il pose le problème de l’intervention des révolutionnaires dans ce genre de mouvement.
CCI (15 juin)
Les anarchistes et le mouvement du 15 mai : réflexions et propositions
Ce texte a été écrit à Madrid, il se peut donc que pas mal de descriptions et de réflexions ne soient pas celles d’autres endroits, à cause ne serait-ce que de l’hétérogénéité du mouvement du 15-M2. Cependant, nous pensons qu’il peut être utile en tant que point de départ pour la réflexion de tous les compagnons3 qui sont impliqués dans les assemblées, quel que soit le lieu. Ce texte a été rédigé et corrigé un peu dans la précipitation pour qu’il soit disponible avant l’appel aux assemblées de quartier ou de villes de banlieue du 28 mai. Tenez-en compte au moment de lire ce qui suit et excusez-nous pour toutes sortes d’erreurs que ce texte pourrait contenir.
Quelques anarchistes madrilènes.
0. Quelques mots pour commencer...
Mettons les choses au clair. Nous, qui signons ce texte, sommes des anarchistes, des communistes antiautoritaires, anticapitalistes ou bien une autre étiquette à votre goût. Autrement dit, nous sommes pour l’abolition du travail salarié et du capital, pour la destruction de l’Etat et son remplacement par de nouvelles formes horizontales et fraternelles de vie collective. Nous pensons que les moyens pour y arriver doivent être le plus en cohérence possible avec les objectifs recherchés et, par conséquent, nous sommes contre la participation aux institutions, contre les partis politiques (parlementaires ou pas) et les organisations hiérarchiques, nous misons sur une politique basée sur l’assembléisme4, la solidarité, l’entraide, l’action directe, etc., parce que nous sommes convaincus que ces moyens sont les plus efficaces pour atteindre la révolution. Si nous déclarons tout cela d'emblée, c’est pour éliminer toute défiance et bien marquer le cadre dans lequel cette contribution a été faite. Cependant, le fait que nous soyons favorables à une révolution sociale qui détruise le capitalisme, l’Etat et qui implique l’abolition des classes sociales (et de tant d’autres choses), ne signifie pas du tout que nous croyons que cela puisse se réaliser à court terme, du jour au lendemain. Ce que nous mettons ici en avant ce sont des objectifs, c'est-à-dire des situations que nous pourrons atteindre, avec de la chance, après un long parcours et un développement considérable du mouvement révolutionnaire. Croire le contraire ce n’est pas de l’utopie, c’est tout simplement un exercice de délire et de rêverie immédiatiste. Quand on met en avant un projet révolutionnaire, il faut qu’il se concrétise dans une stratégie à court terme, dans une série de propositions pour intervenir dans la réalité, des propositions qui nous rapprochent de situations dans lesquelles des questions comme l’abolition du travail salarié, l’instauration du communisme libertaire, la révolution sociale... peuvent être à l’ordre du jour, des questions qui aujourd’hui ne le sont pas du tout, évidemment. Cette intervention ne peut pas se limiter à répéter en rabâchant jusqu’à plus soif l’impérieuse nécessité d’une révolution, de l’abolition de l’État et du capital. Être anarchiste ne veut pas dire être un casse-pied qui poursuit les autres en répétant encore et encore que l’État est très méchant et que l’anarchie est très bonne. Et pourtant, à la suite du mouvement du 15-M, dans ces derniers jours, nous avons pu lire sur Internet des textes et des commentaires proches du délire et, pire encore, nous avons entendu des compagnons et des amis qui glissent vers « l’anarcho-casse-pieds », qui, avec les meilleures intentions du monde, s’accrochent au maximalisme des mots d’ordre grandioses, des propositions à long terme, etc. Nous savons tous très bien de quoi il s’agit, nous nous sommes tous trouvés dans des situations semblables et, ce qui est pire encore, nous avons contribué souvent à les répandre. Il faut dire clairement que ce texte est autant une critique qu’une autocritique et qu’il doit avant tout nous servir à ne pas tomber nous mêmes dans ces pièges-là. Enfin, il faut tenir compte du fait que ce texte a été écrit à la va-vite, au rythme que les événements nous imposent, avec le but qu’il sorte avant le 28 [mai], jour où des assemblées populaires ont été convoquées dans différents quartiers et dans la banlieue de Madrid : ne vous étonnez donc pas si sur certains points, on peut remarquer un peu de précipitation et d’urgence. Nous sommes limités : c’est ainsi.
Ce texte prétend être une réflexion et une proposition pour sortir de l’impasse dans lequel nous nous trouvons depuis longtemps, pour nous défaire des lourdeurs que beaucoup d’entre nous traînons et qui nous immobilisent. C’est, au fond, une réflexion pour essayer de nous clarifier, pour savoir qu’est-ce que nous pouvons apporter et comment nous pouvons participer dans tout ce qui arrive autour de nous.
1. Le Mouvement du 15 mai :les coordonnées de base
Et ce qui arrive autour de nous, c’est bien évidemment le mouvement appelé 15-M qui, la dernière semaine, a fait irruption dans la vie politique nationale comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Que cela nous plaise ou non, qu’on le veuille ou non, le mouvement du 15-M a brisé toutes les perspectives et a surpris tout le monde : la police, les politiciens, les journalistes, ceux qui ont fait l’appel [aux manifs], les gens en général, les citoyennistes5, les gauchistes et, bien entendu, les anarchistes. Dans un premier temps, tout le monde était hors jeu, et à partir de là, il y a eu toute une série de tentatives plus ou moins heureuses de prendre position face ou à l’intérieur du 15-M. On ne va pas se mettre à en analyser les causes ou passer en revue les différentes théories « conspiranoïaques » ou les intoxications idéologiques diverses surgies de cet événement ; ce n’est pas important pour ce que nous voulons dire. Nous voudrions mettre en avant comment nous comprenons les coordonnées de base de ce qu’on appelle le mouvement du 15-M ou, du moins les plus importantes, pour pouvoir ainsi voir si une participation anarchiste ou anticapitaliste est possible en son sein et, si oui, quel type de participation. Ce sera, logiquement, une description fragmentaire, partielle et incomplète. Ce n’est pas le plus important, les choses vont trop vite.
La première chose à affirmer c’est que le mouvement du 15-M est un mouvement social authentique et, comme tel, il est énormément hétérogène et contradictoire. Il y a de tout et ce tout est déversé à des doses très diverses. Il ne s’agit pas de donner des caractéristiques définitives et absolues, mais plutôt de distinguer des tendances, des nuances, etc. Des expressions d’un mouvement en construction au sein duquel il y a des luttes, des tensions, un changement continu.
Cela dit, par sa composition sociale et par les mots d’ordre qu’on entend le plus souvent dans les assemblées et les groupes de travail, ainsi que par les idées des gens qui en font continuellement la propagande sur Internet (Twitter) on pourrait dire qu’il s’agit, surtout, d’un mouvement d’idéologie « citoyenne» et ouvertement démocrate. Dit autrement, c’est bien ce genre d’idées de réformisme politique et social (reforme électorale, démocratie réelle, plus de participation, critique des partis politiques majoritaires, mais pas du système représentatif et des partis en général...) qui, en général, agglutinent autour d’elles le plus de monde et des mains levées.
Cependant, ce contenu s’exprime avec des formes assembléistes, qui rejettent toute représentation classique (comme, par exemple, le rejet de devenir un autre parti politique de plus) et qui rejettent toute idéologie, tout symbole ou forme politique déjà cuisinée (des partis aux drapeaux républicains, en passant par les A encerclés). Il y a un mot d’ordre qui circule sur Twitter : « Ce n’est pas une question de gauche ou de droite, mais de haut et de bas ». Et, pour le moment, ce mouvement mise majoritairement sur l’auto-organisation, sur l’action directe (non violente) et sur la désobéissance civile, même si on n’y utilise pas ces mots magiques. La non-violence est, de fait, une autre des coordonnées fondamentales du 15-M, quelque chose qui est, sans doute, assumé collectivement sans discussion. Nous y reviendrons plus loin.
Tout cela n’empêche pas qu’en son sein il y ait clairement une « lutte pour le pouvoir » entre différentes « fractions », organisées ou non. Il y a des membres et des militants des partis politiques de gauche, des membres des mouvements sociaux, des libertaires, des gens « normaux » et des « indignés » qui se pointent avec leur propre vision du monde, etc. Tous s’y battent à tous les niveaux, depuis l’orientation idéologique ou pratique du mouvement, jusqu’au contrôle (et, très souvent, la manipulation) des assemblées, des commissions, etc.
Au sein de beaucoup des commissions ou des regroupements, on voit de tout : des disparitions fortuites de comptes rendus, des personnalismes, des gens qui s’accrochent au rôle de porte-parole, des délégués qui taisent des choses lors des assemblées générales, des commissions qui ignorent les accords adoptés, des petits groupes qui font leurs petites affaires dans leur coin, etc. Beaucoup de ces choses sont sans doute le fruit de l’inexpérience et des égos, d’autres paraissent sorties directement des vieux manuels de manipulation des assemblées. Autour de cette lutte, il y a aussi tous les gens qui passent par là. Des personnes qui s’approchent pour y participer, écouter, être écoutées, apporter de la nourriture ou du matériel divers ou même, tout simplement, se faire quelques photos comme des touristes dans leur propre ville. Sous les tentes de la Puerta del Sol, on a la sensation d’être dans un grand bazar où rien ne se vend ni ne s’achète.
Par ailleurs, l’un des grands problèmes des campements, c’est la difficulté pour y participer pleinement : il n’y a pas beaucoup de monde qui puisse aller au centre ville tous les jours, qui puisse y rester pour dormir, qui puisse participer fréquemment aux commissions, etc. Ceci peut favoriser l’apparition de leaderships informels, des chapelles, des trucs bizarres, d’étranges tournures que les gens, qui ne sont pas bêtes, vont remarquer, vont commenter en agissant en conséquence. En fait, une conséquence possible due aux gens qui commencent à prendre un rôle prépondérant dans le campement (et aussi qui sont les plus habitués à y aller et à proposer des activités) est la ghettoïsation progressive que le campement a subi ce week-end-end. Ce week-end-end, comparé avec l’ambiance de retrouvailles et de contestation des jours les plus intenses (surtout vendredi dernier, à cause de la situation d’attente liée à l’interdiction des rassemblements de la part de la Commission électorale centrale), il y avait beaucoup moins d’élan et on a commencé à remarquer une ambiance plus ludique et moins protestataire, malgré les commissions, les sous-commissions et les groupes de travail qui continuaient à fonctionner. À certains moments, on dirait que « l’acampada de Sol » reproduit le pire et le plus banal des gens ghettoïsés : des ateliers, des concerts, des batucadas6, des repas, des spectacles de clowns, etc. au détriment des ce qui était marquant au début : la protestation, la politique, « l’indignation » (aussi pro-démocrate et limitée qu’elle fût). Sur Twitter, dont il ne faut pas oublier le rôle dans la montée du mouvement du 15-M et du campement de la Puerta del Sol, est en train de se faire jour ce mécontentement des gens qui critiquent cette dérive. Un exemple clair de ce mécontentement a eu lieu ce week-end : ça a été la discussion autour de « botellón sí-botellón no »7 : samedi une des assemblées a dû partir de Sol à cause de la quantité des gens à coté complètement pétés et, dimanche on a dû remettre quelque assemblée parce qu’on n'entendait rien à cause du bruit des batucadas. Il faut dire que, aussi bien les batucadas que le botellón ont eu pas mal de succès.
Il est évident que le mouvement du 15-M n’est pas une révolution, même le plus naïf des militants s’en rend compte, et ce n’est pas la peine de le critiquer en se basant sur le hashtag #spanishrevolution avec lequel il s’est étendu au début : c’était un mélange de marketing, de trucs marrants et de rêve. Pas plus.
La dernière chose que nous voudrions faire remarquer, c’est que, pour nous, le plus important peut-être de tout ce qu’on a vu, en plus du caractère assembléiste et horizontal (avec tous ses défauts, et ils sont nombreux), a été le changement brutal d’attitude qu’on a pu observer dans les parages de Sol pendant toute cette semaine. Récapitulons. À la suite de la manifestation massive initiale du 15 mai et, surtout, après l’expulsion des premiers campeurs, le gens ont pris possession soir après soir de la Puerta del Sol, d’une manière qu’aucun d’entre nous n’avait jamais vu. Les mobilisations contre la guerre, même si certaines furent plus massives, n’eurent ni de près ni de loin la continuité, la participation, l’attitude et l’ambiance que nous avons pu voir cette semaine à Sol. C’est comme si, soudainement, la passivité et le chacun pour soi s’étaient brisés autour de la Puerta del Sol de Madrid. Distribuer des tracts à Sol et dans les rues adjacentes est une joie, les gens s’approchent pour t’en demander, les prennent avec le sourire, te questionnent, te remercient... Les premiers jours, il suffisait d’un petit cercle pour parler de quelque chose et les gens tendaient l’oreille pour ensuite écouter et intervenir. C’était quelque chose qui est devenu normal de voir des gens les plus divers discutant en petits groupes. Les groupes de travail et les assemblées générales sont des événements massifs, rassemblant 500, 600 ou 2000 personnes (assises, debout, se resserrant pour mieux entendre), etc. Au-delà de ça, il y avait l’impression permanente de vivre une bonne chose, dans la meilleure ambiance, « quelque chose d'exceptionnel ». Tout cela a atteint son point culminant lors de la journée dite de réflexion. Entendre quelque 20 000 personnes crier ‘Nous sommes des hors-la-loi’8 en jouissant du fait de passer par-dessus la loi, franchement, ça impressionne. Il est bien vrai que cette ambiance intense, de participation et de politique véritable a commencé à décroître à partir de cette nuit-là. En partie à cause de la montée de tension elle-même de vendredi soir, en partie à travers la décision de « ne pas faire de politique » pendant tout le samedi et dimanche, ayant ainsi ce week-end un ton plus festif, plus « cirque » que les jours précédents. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas de souvenir de quelque chose de semblable auparavant, voilà la vérité.
2. Ce qui n’est pas en jeu. Une vision stratégique
Cela dit, qu’est-ce que nous, anarchistes, avions-nous à faire là-dedans ? Pour n’importe quel libertaire avec deux sous de jugeote, la grande majorité heureusement, il est évident qu’il fallait être là, il n’y a pas matière à discuter là-dessus. Ce qui n’est pas clair pour nous, c’est ce qu’on peut y faire, ce qu’on peut y apporter et espérer du mouvement du 15-M. Il est logique de se poser ces questions, étant donné l’hétérogénéité et les contradictions qui le traversent. Nous allons essayer dans cette partie d’exprimer comment et dans quel sens nous voyons l’intérêt d’y participer et ce qu’on peut apporter à ce mouvement. Nous parlons d’une vision stratégique parce qu’il s’agit d’une vision générale, que nous essayerons de définir plus loin avec des propositions concrètes et quelques considérations tactiques.
La plus grande partie du processus qui se développe ces jours-ci au sein du mouvement du 15-M consiste à essayer de trouver les mots d’ordre et les revendications politiques qui vont le définir. Ce processus se produit aussi bien au sein des groupes de travail qu’au sein des commissions elles-mêmes. Au sein de ces groupes, dominent le débat et le combat idéologiques, et dans quelques commissions, où se concrétisent ces débats, c’est là que l’on voit les ruses, les manigances, etc. Pas besoin d’être très futé pour savoir où se trouve le problème : c’est dans des commissions telles que celles nommées « communication », « interne », « assemblée et politique » où l’on peut trouver le plus grand nombre de politiciens au mètre carré, alors qu’au sein des commissions comme « infrastructure », « alimentation » ou « respect », les coups bas sont bien moins nombreux. Attention ! On n’est pas en train de dire qu’au sein des commissions on ne fait que ça, mais il y a certaines choses qu’on a vues ou qu’on nous a racontées qui ne sont pas piquées des vers...
Comme nous l’avons dit plus haut, les revendications qui ont le plus d’écho dans #acampadasol sont celles qui concernent la reforme politique et, dans une moindre mesure, la reforme sociale, toutes avec un contenu pleinement citoyenniste : reforme de la loi électorale, une loi de responsabilité politique, une plus grande participation, une loi de révision des hypothèques immobilières, etc. Les membres et les militants des partis de gauche (IU, IA, etc.) et d’autres mouvements sociaux sont en train d’essayer de faire tourner le bateau du mouvement vers la gauche, pour que celui-ci prenne en charge les revendications classiques de la gauche (depuis le revenu de base ou le moratoire sur la dette extérieure jusqu’à la nationalisation des banques) mais, en face, il y a ceux qui préfèrent que le mouvement soit le plus neutre possible (voir, par exemple, https://twitpic.com/51lyqa [59]) et qu’il soit centré sur un #consensodeminimos9 [consensus a minima, NdT]. À notre avis, le plus probable, c’est que l’objectif final des uns et des autres (par le biais d’une Initiative Législative Populaire10, ou conduit par quelque parti politique, sans doute Izquierda Unida (IU) soit de présenter une proposition au Congrès qui soit ratifié par référendum. En ce sens, les uns et les autres débattent sur les contenus de cette proposition et sans doute sur les moyens pour la réaliser, mais à un moment donné, ils finiront par se mettre d’accord sur quelques points fondamentaux.
Il est évident que nous, anarchistes, sommes convaincus que si on réussissait à mettre en place certaines de ces reformes, même en changeant quelques uns des « défauts » du système qui mettent le plus en colère les gens, cela ne va rien changer pour l’essentiel. Le problème n’est pas la corruption politique, mais la politique en tant que sphère séparée de la vie ; le problème n’est pas le manque de transparence des gouvernements mais les gouvernements eux-mêmes ; et le problème n’est pas la banque et les banquiers, mais l’exploitation capitaliste : la grande et la petite.
Ceci dit, nous pensons que nous, les anarchistes, ne sommes pas ni ne devons être dans cette bagarre, celle des revendications grandiloquentes et de la politique de haut vol. Nous ne devrions pas rentrer dans ce jeu, et étant donné que nous voulons être présents dans les assemblées, il faudra assumer le fait que nous devrons endurer ce genre de choses et les affronter. Nous n’avons rien à faire dans cette histoire. Le mouvement du 15-M n’est pas un mouvement anarchiste ou anticapitaliste, ce qui veut dire que les revendications anarchistes maximalistes sont hors de propos. Cela n’a pas de sens de se battre pour que les assemblées générales assument des choses comme l’autogestion généralisée, l’abolition des prisons et même, tout simplement, la grève générale indéfinie, parce qu’il est évident que les gens qui sont là, qui suivent les débats avec attention et sympathie, ne sont pas là pour ces revendications. En supposant (ce qui est trop beau pour être vrai) que pour une quelconque et étrange raison ou manigance, on arrive à ce que l’assemblée générale ou les assemblées de quartiers acceptent ou assument comme le leur l’un de ces mots d’ordre, on peut être sûr que le mouvement du 15-M se dégonflerait aussi sec, perdrait une grande partie de ses soutiens et ses sympathies et resterait dans un étrange cocktail front-populiste de militants gauchistes, citoyennistes, communistes et anarchistes. Autrement dit, juste tout ce que nous avons toujours critiqué et le lieu où nous n'avons jamais voulu être. En politique, il y a une expression « voter avec les pieds » qui veut dire que si la gestion d’un endroit quelconque te déplait, tu pars simplement ailleurs. Quelque chose de semblable arrive dans toutes les assemblées, il y a pas mal de personnes qui, quand quelque chose ne leur plaît pas ou qu'elles ne se sentent pas à l’aise, se taisent, baissent la tête et ne manifestent pas leur mécontentement. Pourquoi arrive-t-il tout cela ? Parce que les mouvements réels sont souvent assez complexes. Ils ont leur propre composition, leur nature et leur propre dynamique et, surtout parce qu’on ne peut pas prétendre que les gens deviennent des anarchistes du jour au lendemain. Aucun de nous n’est arrivé à le devenir par la voie rapide et sans casse, mais à coups d’erreurs, d’illusions, de désillusions, d’incohérences, de débats, de frustrations, de flips et de chutes par terre au sens figuré comme au sens propre, parfois avec un flic sur le dos. La question n’est pas de déplorer avec mille regrets que dans des occasions comme celle d’aujourd’hui, les personnes et les choses n'évoluent à toute vitesse, mais de reconnaître que cela ne marche pas ainsi.
Nous devons être conscients de la représentativité des commissions face aux personnes mobilisées. On l’a vu clairement dans la commission Politique, qui au moment le plus haut a pu rassembler quelque 350 personnes entre les deux sous-commissions (à court et à long terme). Il est clair que les assemblées sont ouvertes et que tout le monde peut y participer mais en vérité, à la fin, cette commission « Politique » s’est donc scindée en deux sous-commissions qui apparemment se sont créés sur des bases temporelles mais qui, en définitive, recouvrent des points de vue très différents, le « réformiste » et le « révolutionnaire », entre ceux qui exigent de petites ou de grandes reformes législatives, légitimant ainsi les structures de pouvoir et ceux qui veulent mettre en avant un programme de rupture avec le modèle imposé par le capitalisme.
Ceci est une erreur grave, parce qu’il peut exister des mesures « révolutionnaires » ou radicales à court et à long terme. C’est le contexte actuel qu’il faut avoir clairement en tête et les pas qu’on veut faire dans ce contexte. Pour ne citer qu’un exemple : dans la Commission Court Terme, on met en avant des changements dans la Constitution espagnole, et dans la Commission Long Terme, on discute sur le consensus pour la grève générale. Nous ne pensons pas qu’un changement dans la Constitution (qui requiert le vote favorable des 3/5 des députés et des sénateurs) soit plus faisable à court terme que l’appel à une grève générale (qui est d’ailleurs plus un outil de lutte qu’une fin en soi), même si, à l’heure actuelle, ce serait très compliqué à faire avancer.
Nous pensons qu’il faut faire une réflexion sur notre implication au sein des commissions, en essayant de les rendre plus efficaces, en évitant l’usure de tant d’énergie. Il ne sert à rien que 200 personnes avec des idées « similaires » se rassemblent et donnent une orientation qui ne peut pas être assumée par ce mouvement (au jour d’aujourd’hui), il ne sert à rien non plus de laisser le champ libre aux exigences à court terme qui ne sont rien d'autre qu'un plaidoyer pour renforcer l’Etat-providence... Lors de cette réflexion à faire, il nous faudra faire une autocritique et mettre en avant dans l’immédiat des propositions à court et long terme qui puissent être assumées et qui nous fassent avancer petit pas à petit pas vers une vraie révolution sociale, autrement nous déboucherons sur l'inaction typique d’un groupe de personnes qui planent au-dessus du mouvement actuel.
Nous devrions montrer une certaine intelligence et nous joindre réellement à cette envie de changement qu’on respire ces jours-ci du coté de la Puerta del Sol, pour voir si entre tous, nous réussissons à faire que ce changement aille un peu au-delà de quelques raccommodages sur la façade de la démocratie.
Quel choix nous reste-t-il à faire alors ?
Il est sûr que beaucoup se seront posés la question de ce qu’on pourrait appeler un affaiblissement de notre discours, et sans doute ils se seront trouvés en train de le faire sans même s’en rendre compte. C'est-à-dire d’édulcorer nos propositions pour voir si avec un peu de sucre ça passe mieux. Par exemple, en jouant sur une confusion sémantique intéressée qui parle de « démocratie directe » au lieu « d’anarchie », d’avaler tout ce qu’il faudra avaler pour être dans l'air du temps, etc.
Une autre alternative c’est d’abandonner la partie à cause du réformisme de ces assemblées. Tel que nous le voyons, ceci serait tout simplement absurde. Fondamentalement, parce que les mouvements révolutionnaires, aujourd’hui comme dans le passé, ne surgissent pas du néant ou tous seuls. Ce sont les révolutionnaires eux-mêmes, et les événements, qui avec leur effort et leur persévérance, réussissent parfois à ce que les mouvements sociaux cessent d’être la chasse gardée des partis, des profiteurs, etc.
Nous parlerons de tout cela plus loin, mais nous voulons déjà faire comprendre que notre idée n’est pas de transformer le mouvement du 15-M en « mouvement révolutionnaire » de masse, ce serait se raconter des histoires, quelque chose comme rêver que l’anarchie arrivera demain si nous le désirons avec force. Nous ne disons pas non plus qu’il faut y rester jusqu’à la fin parce qu’il faut y rester. Il est clair pour nous que si nous ne faisons pas bien les choses, il faudra bien partir un jour ou, ce qui plus probable, qu’on finisse par nous mettre dehors. Mais il nous semble évident qu’on n’en est pas encore là, qu’il reste encore des moments où l’on peut participer à cet événement en y apportant des choses, surtout en vue de la convocation d’assemblées populaires dans les quartiers.
Nous ne sommes donc pas des naïfs auxquels le 15-M aurait troublé la vue ou qui auraient fermé leurs petites boutiques « pour cause de révolution », mais nous sommes tout simplement des anarchistes qui se sont trouvés face à une occasion claire, la première depuis longtemps, d’être partie prenante d’un mouvement réel d’une ampleur considérable.
3. Pour une participation anarchiste pratique et concrète
À notre avis, ce qui est en jeu dans le mouvement du 15-M, c’est d’arriver à faire qu’il soit un point de départ capable d’activer la lutte quotidienne pour des choses concrètes et de base, une lutte menée de façon horizontale, basée sur l’assembléisme, l’action directe, la participation directe, la solidarité, etc., tout ce qui fait partie des axes de base du mouvement du 15-M. Pour que les assemblées ne soient que des lieux d’où l’on exige (de qui ?, comment ?) des lois, des reformes et des référendums (lesquels ?), mais des espaces ouverts où les gens débattent sur les propres problèmes, cherchent des solutions et décident sur comment les mener à bien par eux-mêmes. Pour qu’elles deviennent des points de rencontre, de communication et de participation véritables ; des petits (ou grands) noyaux solidaires de résistance.
Il est clair qu’une partie importante de ce processus consiste à savoir quels problèmes et quelles solutions on va y traiter, quel contenu, pour ainsi dire, va s’exprimer au sein des ces assemblées. Voilà une autre tache que nous pourrions nous donner : essayer de faire que les sujets à traiter dans les assemblées soient des questions de classe, de lutte contre le sexisme, etc. qu’on y approfondisse, à partir de la pratique, sur la critique de l’Etat, du capital et du travail salarié.
Autrement dit, nous proposons qu’on participe pratiquement et concrètement dans une perspective et un fonctionnement antiautoritaires, sur des questions fondamentales de classe et sur d’autres oppressions aussi importantes tel que le patriarcat, le racisme, etc.
Pour compléter cette contribution pratique, nous devons apporter notre point de vue et notre discours, et, encore une fois, sans tomber dans des maximalismes du genre « Révolution maintenant ! ».
Tel que nous le voyons, le fait d’essayer que les gens fassent que notre discours soit le leur n’est pas, ça ne doit pas être, d'aller rabâcher nos mots d’ordre et nos principes anarchistes de toujours. Ces mots d’ordre seraient, à notre avis, hors de propos. Et non pas parce qu’ils n’auraient aucun sens ou qu’ils ne seraient pas vrais, mais parce qu’ils ne sont pas dans le coup de ce qui se passe, ils sont hors contexte. C’est comme si on était en train de parler avec un copain de football et un autre se pointe et commence à te raconter un film iranien. Est-ce que cela signifie que nous devrions abandonner l’anarchisme et passer du coté de la démocratie ? Évidemment pas. Devrions-nous nous cacher ? Non. Devrions-nous exhiber face au monde notre condition d’anarchistes ? Pour nous, cela n’a aucun sens si ça ne va pas plus loin que se « déclarer anarchiste ». Se dire soi-même anarchiste ne veut rien dire en soi, ni bon ni mauvais. Â notre avis, il ne s’agit pas de nous cacher ni de nous exhiber, mais de pratiquer l’anarchisme dans un contexte donné. Un exemple : entre tous les slogans que quelques-uns d’entre-nous et d’autres copains avons chanté les premiers jours à la Puerta del Sol il n’y a eu que deux qui se sont un peu rependus au-delà de notre cercle : « le peuple uni fonctionne sans partis » et « A…anti…anticapitalistes ». Pourquoi ? Non pas parce que ces slogans seraient particulièrement extraordinaires, ils ne le sont pas, non pas parce qu’ils seraient ingénieux non plus, mais nous pensons que c’est parce que, à ce moment-là et en ce lieu, c’étaient des slogans qui pouvaient être pris en charge par une partie au moins des gens présents. Que cela nous plaise ou non, les gens n’étaient pas là contre la police nationale, ou parce qu’ils voulaient démolir l’État.... Le travail est bien plus de fond... Si nous nous limitons à chanter ou à proposer dans les assemblées des mots d’ordre hors du contexte, ce que nous faisons c’est de la propagande pure et dure, dans le plus mauvais sens du terme, et non pas de la participation.
Parce qu’il arrive souvent que l’inertie nous gagne, comme aux autres sans doute, au lieu de réfléchir à ce qu’on peut et ce qu’on veut dire, on finit par aller au plus facile, du genre « la lutte est le seul chemin », ou « du nord au sud, d’est en ouest », « mort à l’État » et ainsi de suite. Voilà un discours, à notre avis, hors sujet et par conséquent, inefficace. La même chose à peu près est arrivée au sein du Bloc Libertaire lors de la manif du 15 mai. Après une première phase avec des slogans (meilleurs ou moins bons, plus ou moins utiles, ce n’est pas important) mais sur le sujet en question (démocratie, capitalisme, crise) on est passé à une mixture typique du ghetto11 (des prisonniers jusqu’à Patricia Heras en passant par les « police assassin ! »), en glissant vers « l’autoréférentiel », vers l’attitude de faire bloc... Malheureusement, personne ne savait dans les parages qui était Patricia Heras, excepté quelques uns d’entre-nous, quel sens ça avait de crier son nom sans un tract qui l’explique ?, la seule chose que nous avons réussie à faire, c’est de dérouter les gens, qui nous regardaient comme si on venait d’une autre planète... Toute chose a son moment et son lieu, et si nous ne savons pas adapter notre discours à ce moment et ce lieu, ça ira mal pour nous. Adapter le discours, ce n’est pas le rabaisser, c’est ajuster le message au contexte, adapter le code au récepteur, c’est donner notre avis sur ce dont les gens parlent, et non pas sur ce que nous pensons qu’ils devraient parler.... Et donner cet avis dans leur « idiome » et non pas dans notre « dialecte », plein de langue de bois et de formules, qui sont pratiques pour parler entre nous, mais qui créent des barrières et des confusions chez qui ne les utilise pas.
4. Quelques objectifs et axes possibles d’action
Cette proposition de participer à partir de la pratique et à partir du concret a plusieurs objectifs. Celui, évidemment, d’améliorer nos conditions de survie dans le capitalisme. Sans doute certains taxeront cela de réformisme, mais pour nous, c’est simplement une nécessité. Un autre objectif pendant tout le processus est celui d’être capables de montrer et de démonter toutes les contradictions et les misères du capitalisme, de la démocratie, des syndicats, etc. Non pas par le biais des discours préfabriqués, mais par le débat et la réflexion sur tout ce qu’on trouvera sur notre chemin, quelque chose de bien plus complexe et difficile que de simplement éditer des bouquins écrits à d’autres moments et dans d’autres lieux. Chercher aussi à créer et à rependre au sein de la population une culture de la lutte, un sentiment collectif du fait que les objectifs s’atteignent en luttant avec d’autres comme nous, en réglant les problèmes par les personnes mêmes qui les subissent, sur la base de la solidarité et du soutien mutuel, sans les laisser entre les mains des professionnels de la médiation ou de la représentation. Un sentiment de « aujourd’hui c'est pour toi, demain c'est pour moi » doit rentrer profondément dans la population et remplacer ceux du « chacun pour soi » ou du « encore heureux que j’ai pu l’éviter ! » qui sont en train de démolir notre société.
Enfin, s’il y a quelque chose qui a été clair pour nous pendant cette semaine c’est que, s’il est vrai que les anarchistes ont beaucoup de choses à apporter, nous avons aussi beaucoup, énormément de choses à apprendre, autant des gens que nous trouverons sur notre chemin que des situations que nous devrons affronter. Participer aux assemblées est l’occasion parfaite pour mous clarifier nous-mêmes, nos positions et la manière avec laquelle nous les ferons passer à nos égaux. Ceci est on ne peut plus normal. La meilleur façon de nous rendre compte de nos failles et de nos incohérences (et on en a sûrement à la pelle), c’est d’essayer d’expliquer et de partager nos positions avec ceux qui ne les connaissent pas.
Nous pensons sincèrement que c’est là une bonne façon de nous tirer du piège d’une intervention à partir de l’idéologie, qui cherche à faire adopter des principes ou des objectifs à long terme spécifiquement anarchistes, une chose qui, comme on l’a déjà répété maintes fois, ne peut pas être à l’ordre du jour, du jour au lendemain. Nous pensons aussi que ce serait là une manière d’esquiver les luttes de pouvoir qu’il va y avoir dans les assemblées, quand il s’agira des questions de « haut vol » (les lois… etc.) sans pour autant cesser de participer à un mouvement qui a encore de l’avenir devant lui. S'installer dans une guerre d’usure pour que de telles propositions ne se fassent pas jour ou nous affronter ouvertement et sans répit à tous les gauchistes, les citoyennistes et des gens en général qui ne veulent qu’un ou deux changements, ne nous servira à rien du tout. Nous devons être conscients, à tout instant, du moment où on en est et jusqu’où peut-on aller. Si nous ne faisons pas cet exercice d’analyse et de réflexion, on va sentir passer les coups multiples et variés et on va ressentir une frustration considérable.
Bien évidemment, en participant au mouvement du 15-M, il y a toujours le risque pour nous de finir par faire le boulot et le sale travail de la gauche et de l’idéologie citoyenne. Nous pensons qu’à l’heure actuelle, étant donné notre faible capacité d’appel et de soutien, ce risque sera toujours là, dans n’importe laquelle des mobilisations réelle qu’on rejoindra (grèves et autres conflits). C’est un risque qu’on ne peut pas prévoir et c’est sans doute quelque chose d’inévitable jusqu’un certain point, mais ce qu’on doit faire, c’est être toujours attentifs, ne pas se laisser emporter par les émotions et essayer d’évaluer à quel moment notre participation commence à ne devenir qu’une main d’œuvre pour d’autres, et, à ce moment-là, il faut plier bagage.
Pour en finir avec cette partie, nous considérons qu’il est nécessaire de concrétiser quelques lignes sur les actions, quelques exemples de ce que nous avons dans nos têtes. Ce ne sont pas les seules, ni les meilleures, elles sont même un peu vagues ; ce ne sont que quelques exemples d’idées qui nous trottent dans la tête ou que nous avons entendues ces jours-ci dans les assemblées. Nous devrions entre tous les compléter, les éclaircir, les critiquer, etc...
- Logement : S’auto-organiser pour résister aux expulsions et au harcèlement immobilier. Proposer le squat comme alternative temporaire lors des expulsions qu’on ne puisse pas stopper. Faire pression sur les propriétaires qui se fichent ou profitent de leurs locataires. Faire pression par l’action directe sur les succursales bancaires qui gèrent les hypothèques des familles en difficulté pour les renégocier ou, simplement, pour rendre visible le conflit. Rendre visible le conflit avec des banderoles ou quelque chose de ce genre sur les fenêtres des logements sous pression.
- Travail/Chômage : Profiter de l’exemple de Sol pour le porter sur les lieux de travail, débattre et parler dans les assemblées sur les conflits du travail, sur nos problèmes en tant que chômeurs, proposer que les assemblées soient un point d’appui au cas où on aurait un problème au boulot. Visiter et dénoncer les lieux de travail où se produisent des accidents de travail...
- Migrations : Essayer d’incorporer les immigrés, qui sont sans doute sous-représentés, informer les gens sur ce qui se passe dans les CIE (Centres d’internement des étrangers), renseigner et proposer des mécanismes d’action face aux coups de filet contre les immigrants, s’auto-organiser pour leur offrir des renseignements légaux, avec des centres de conseils, des ateliers, etc.
- Santé : essayer d’impliquer les travailleurs et les usagers-bien-souffrants de la santé publique dans la lutte contre la dégradation et l’inaccessibilité, en évitant qu’on nous monte les uns contres les autres («c'est la faute aux travailleurs qui ne bossent pas assez » ou « c'est la faute aux petits vieux qui n’arrêtent pas d’aller se faire soigner dans les centres hospitaliers »).
- Sexisme : il faudrait se pencher sur comment freiner la vague actuelle d’antiféminisme qui déferle sur la société et qu’on a pu vérifier à plusieurs reprises dans les campements. Il serait intéressant de pouvoir débattre sur la violence machiste...
- Organisation : Essayer d’améliorer le fonctionnement des assemblées. Lutter pour une véritable horizontalité, pas seulement formelle, en évitant les camarillas de spécialistes ou de représentants perpétuels, en évitant de devenir nous-mêmes une camarilla de spécialistes ou de représentants perpétuels.
Ces sujets et ces propositions ne peuvent qu’être limitées, parce qu’il faut aller vite et à cause de notre manque d’expérience dans ce genre de mouvements. Il faut les améliorer, les clarifier et les partager. Et, surtout, il faut les construire en commun avec les gens qui viennent aux assemblées, dans un processus qui changera aussi bien ces propositions que ceux qui les assument et les mettent en pratique. Ceci dit, nous ne pensons pas que c'est parce qu’on se pointe avec quatre propositions concrètes au lieu du couplet anarchiste de toujours, que les gens vont les accepter comme par enchantement. Non, nous ne proposons pas des incantations. Il doit être clair pour nous que, tout en étant capables d’entamer ce processus, ce sera un chemin long et difficile. Nous pensons qu’avec le temps, on apprendra et on s’éclaircira de plus en plus. D’une certains manière, les anarchistes devront prendre ces assemblées du 15-M comme un laboratoire où l’on expérimente, où l’on propose, où l’on se trompe, où l’on réapprend et l’on recommence.
5. Assemblées de quartier : espoirs et localismes
Une grande partie de ce texte a été rédigé avec l’idée de le réaliser avant l’installation des assemblées populaires dans les quartiers appelées pour le 28 mai. C’est la raison de son urgence, de sa précipitation et d’une bonne partie des erreurs qu’il peut contenir.
L’extension vers les quartiers est une extension logique parce que l’acampada à Sol devient insoutenable à long terme et parce que, de par ses caractéristiques, elle ne permet pas une large participation, comme nous l’avons déjà dit.
En parlant avec pas mal de compagnons, nous avons pu vérifier que certains ont mis leurs espoirs sur les assemblées de quartier. L’idée est : « il n’y a plus rien à faire à Sol, allons dans les quartiers ». Ne nous trompons pas : si le mouvement du 15-M continue à avoir son pouvoir d’attraction, les quartiers vont devenir des petites « Puertas de Sol », avec leurs bons et leur mauvais cotés, y compris avec les militants des partis qui vont à la pêche, les citoyennistes, etc. En fait, dans certains quartiers et banlieues du sud de Madrid, la proportion des militants des partis politiques peut même augmenter par rapport à ce qu’on a vu à Sol. Il se peut que le terrain soit plus petit et moins pesant, mais l’hétérogénéité, les problèmes, les contradictions et les conflits seront les mêmes, si ce n’est pas plus grands.
Nous pensons que les militants gauchistes, mais aussi tous les gens « normaux » [en espagnol « courants », ce qui n’est pas un terme péjoratif : « de la rue », « sans militantisme particulier ». NdT], qui sont favorables aux quatre reformes de base, vont essayer de transformer les assemblées populaires en plateforme pour faire la promotion des mots d’ordre et des revendications pour lesquelles ils se sont bagarrés à Sol. Ils vont se mettre à ramasser des signatures, à faire de la propagande lors des mobilisations et comptabiliser les soutiens dans les quartiers (associations d’habitants, de commerçants…) dans une stratégie à moyen terme pour pousser aux changements légaux. Et pas beaucoup plus. Les citoyennistes essayeront sans doute d’entraîner les gens vers les problèmes spécifiques des quartiers, en établissant des liens avec les associations d’habitants, en mettant en avant leurs locaux, leurs centres sociaux et leurs bureaux des droits sociaux là où ils en possèdent, etc.
Nous avons déjà dit précédemment qu’il peut être intéressant de participer à ces assemblées. Mais nous voudrions ajouter que certains sujets ou propositions peuvent avoir plus de profondeur dans un quartier ou dans une banlieue que dans d’autres, (par exemple, dans certaines zones, les coups de filet contre les immigrants sont plus fréquents que dans d’autres, à certains endroits la santé est dans une plus mauvaise situation encore que dans d’autres, etc.) Il faudra voir ce qui est plus urgent et plus important dans chaque cas, les formules magiques n’existent pas.
6. Questions tactiques
Ce texte commence à être long et nous voudrions le conclure avec quelques réflexions –on va essayer d’être brefs- sur quelques aspects tactiques sur tout ce qu’on a pu voir et qu’on continuera à voir ces jours-ci.
- Violence/Non-violence :
Comme nous l’avons dit plus haut, le rejet de la violence est un point fondamental sur lequel repose le mouvement du 15M. Les initiateurs (Democracia Real Ya) se sont chargés de le mettre en avant de la manière la plus répugnante qui soit : en se démarquant des incidents d’après manif et en montrant du doigt ceux qui s'en prenaient aux flics. Ce n’est vraiment pas étonnant, étant donné le bombardement médiatique qu’on a subi sur ce sujet dans les dernières années. La police, les journaux comme La Razón [droite] ou Público [gauche] n’ont pas hésité à donner l’alerte sur le « danger des 400 antisystème » qui essayaient de contrôler et/ou de faire exploser le mouvement. Une semaine après, rien de tout cela. Il semble que la grande majorité des anarchistes a assumé (avec plus ou moins de difficultés) qu’il ne se passe rien de particulier quand quelqu’un se déclare non violent. La violence ou l’autodéfense sont des questions qui seront toujours là mais qui sont totalement secondaires. Si nous cessons de considérer ces questions comme des choses qui peuvent être utiles ou inutiles, qui peuvent être bénéfiques ou nuisibles selon les circonstances et si, au contraire, nous les déclarons comme quelque chose à laquelle on ne peut pas renoncer, ou si on se met à trépigner parce que le 15-M chante des louanges à la non-violence, nous serions dans le déboussolement le plus total. Aujourd’hui, c’est le tour de la non-violence, demain ce sera autre chose.
Assembléisme :
On entend souvent une critique selon laquelle les assemblées ne sont pas de véritables assemblées, qu’il n’y a pas de véritable horizontalité, que certains essayent de les manipuler, etc. Voilà qui est des plus normal, parce que justement ce sont des vraies assemblées, avec des gens de la rue, au milieu d’une bagarre entre différents secteurs pour le « contrôle » (consciemment ou pas) de la situation. L’horizontalité, l’égalité, l’efficacité des assemblées, la communication des assemblées… ce n’est pas quelque chose qui tombe du ciel tout rôti dans le bec parce que des gens se réunissent sur une place et parlent entre eux. Absolument pas. Pour construire une assemblée, il faut se bagarrer contre les manipulateurs, les politiciens et ceux qui l’intoxiquent ; et face à des années de démobilisation, de grégarisme et de mentalité quotidienne de délégation de pouvoir. Si ceci n’est pas clair pour nous, nous nous trouverons entre les mains de ceux qui viennent aux assemblées pour qu’elles deviennent des courroies de transmission qui se limitent à approuver leurs propositions cuisinées chez eux.
- Lutter contre des monstres :
Participer dans des assemblées où des gens sont disposés à tout faire (manipuler, mentir et, la plupart du temps, ne pas se faire remarquer) pour que leurs idées s’imposent, c’est quelque chose de très compliqué et frustrant. N’importe qui, ayant été contraint d’avaler ces couleuvres, sait que c’est une sacrée merde. D’abord à cause de tout ce qu’il doit ravaler, ensuite parce que beaucoup de gens n’arrivent pas à le voir, de sorte que si on accuse quelqu’un, c’est soi-même qui finit par être suspecté, on finit par confondre les simples erreurs ou étourderies avec les tentatives de manipulation (autrement dit, on frise la paranoïa) et, enfin, parce que, sans s’en rendre compte, on finit par être obligé de faire de trucs qui ressemblent à ceux des autres. Ces jours-ci, nous avons entendu des trucs comme « prendre la tête des commissions », « prendre les postes de pouvoir dans les assemblées », « se disperser dans les assemblées », « faire semblant de ne pas se connaître » et quelques autres gracieusetés de ce genre, de la part des compagnons sur qui on n’a pas le moindre doute ou suspicion, et qu’on ne va pas juger ici, évidemment. Ces situations sont ainsi, la frustration, la rogne contre les manipulateurs, le fait de se retrouver le dos au mur, nous font dire et faire des choses de ce genre. Contre cela, il n’y a pas d’autre solution que d’être constamment sur ses gardes, de faire l’autocritique, savoir critiquer et encaisser les critiques, en évitant les accusations hystériques ou le victimisations stupides. Il faut assumer le fait qu’à un moment ou à un autre, on devra se salir les mains, qu’on le veuille ou non. Cela arrive dans les meilleures familles (comme on dit en espagnol).
- « N’aie pas peur : va de l’avant et joue » (Charlie Parker) :
En lien avec ce qui précède, il faut être conscients du fait que participer au mouvement du 15-M veut dire entrer en territoire inconnu pour la plupart d’entre nous. Il faut assumer les multiples gaffes qu’on va faire. Les anarchistes ne sont pas et ne veulent pas être des gens parfaits, on a tous le droit de se tromper. Se refuser à agir par la peur de devenir un réformiste ou, pire encore, par peur qu’un imbécile quelconque nous taxe de réformiste ou encore d’avant-gardiste, est aussi absurde que de renoncer à penser par peur de se tromper.
- Avant-gardisme anarchiste :
Ces deux mots ensembles pourraient paraître une contradiction, mais ce n’est pas du tout le cas. Certains courants marxistes ont la prétention de se considérer l’avant-garde, même si personne ne les suit. Nous, les anarchistes, refusons de devenir une avant-garde, ce qui n’empêche que si on n'y prend pas garde, on finira par tomber dans l’avant-gardisme. S’il s’agit d’aller plus vite que les événements, on court le risque de s’en détacher de plus en plus jusqu’à ce qu’on reste seuls, loin du réel et de tout ce qui se passe. Ça ne nous assure même pas d’être « devant » les autres, parce qu’on aurait pu emprunter un chemin erroné. Nous, les anarchistes, ne voulons pas dire à quiconque ce qu’il doit ou ne doit pas faire sur la base d’on ne sait quel livre sacré ou tiré d’un bréviaire des saints révolutionnaires, mais cela ne nous empêche pas de finir par nous croire parfois meilleurs que les autres, en pensant qu’ils « devraient suivre notre exemple », surtout quand on participe dans des conflits comme celui qui est pleinement actuel.
- Symboles et dialectes :
Pour que notre participation soit efficace, pour qu’on puisse construire collectivement quelque chose qui vaille la peine, il faut qu’on laisse de coté tous ces symboles, ces codes à nous, ces mots fétiches et d’autres trucs du merchandising typique de notre mouvement-ghetto. Pareil avec la question du discours dont nous parlions plus haut. Cela ne veut pas du tout dire édulcorer son discours ou tromper les gens, cela signifie abandonner les mots et les concepts parfois incantatoires qu’on utilise. Des concepts comme « abstention active », « action directe », « soutien mutuel », « révolution », etc. qui ne peuvent pas être compris d’emblée par des gens qui ne sont pas familiers de ces idées. Il ne sert à rien de rester bloqués là-dessus. Il est plus utile d’essayer de s'expliquer dans un langage simple, sans jouer à l’intellectuel en utilisant des termes abstraits anarchistes. Et c’est la même chose en ce qui concerne l’esthétique de la propagande, qui est souvent aussi uniforme que lointaine pour la majorité des gens. Un exemple clair nous a été donné avec le problème qu’on a eu avec les A encerclés au campement de Sol. Étant donné qu’aucun symbole ou drapeau politique n’est permis, beaucoup de gens étaient d’avis, avec raison ou pas, que les A encerclés ne devraient pas être là. Étant bien entendu que ces A encerclés ne sont pas des symboles politiques mais tout le contraire, certains l’ont très mal pris. D’autres, montrant qu’il arrive très souvent que l’horizontalité et le consensus ne sont respectés que quand ça les intéresse, ont continué à les utiliser sur des pancartes et des affiches. Quoi qu’il en soit, il faudra réfléchir si ce n’est pas de notre faute de ne pas avoir su pendant toutes ces années faire comprendre que nous n'avons pas la même camelote que les autres à refiler, même s'il faut dire à notre décharge que la décision d’interdire aussi les A encerclés parait avoir été discutée 12. Mais ce qui est important ce n’est pas l’histoire des A encerclés, mais les messages que nous voulons faire passer ; donc, s’il faut enlever ces A, on les enlève, ce n’est vraiment pas si grave. En fin de compte, comme le disait un compagnon l’autre jour, nous n’avons rien à vendre (ce qui est vrai quand, dans la pratique, nous avons ce comportement, ce qui n’est pas le cas parfois). Bien pire que l’affaire des A encerclés qui, même si elle nous a fait du tort, est jusqu’à un certain point compréhensible, est celle du féminisme, qui se heurte à une certaine opposition aussi bien dans les campements que sur Twitter, avec des gestes moches et des commentaires hors de propos.
7. La fin, enfin
On va enfin terminer en livrant une dernière réflexion. Le mouvement du 15-M a eu un début et il aura une fin. Pour être réalistes et en sachant qu’on n’est vraiment pas nombreux, nous les anarchistes, et qu’on n’a pas une grande expérience, il est peu probable que notre participation dans ce mouvement soit une composante qui puisse être déterminante dans son développement ou sa fin. Malgré tout, nous pensons qu’on a de la marge et la capacité pour y participer en faisant des apports pour qui ne se limite pas à un mouvement de reforme citoyenne ou au bricolage d'un minable cabanon d’un parti dérisoire. Cette proposition va dans ce sens, celle d’essayer d’aller plus loin. Nous n’avons pas de grands espoirs sur la possibilité que le mouvement du 15-M change radicalement la nature de la société actuelle ; il ne le pourrait pas même s’il le voulait et tout nous fait penser qu’il ne le veut pas. Même s’il arrivait à atteindre ses objectifs, tout se concrétiserait dans une reforme du système démocratique ou, peut-être même, d’un renforcement temporaire de l’Etat-providence. Mais tout cela ne peut constituer des excuses pour rester à la maison. Nous pensons qu’il faut être là et y participer, parce que si nous faisons les choses ne serait-ce qu’un peu plus correctement, cela peut être bénéfique pour l’anticapitalisme et l’anarchisme à moyen et à long terme.
En premier lieu, nous pensons que le système démocratique et le capital sont ce qu’ils sont et que tous les partis sont, dans le fond, à mettre dans le même sac. Si le mouvement du 15-M prospère et réussit à faire réformer le système démocratique, en en finissant avec le « bipartisme » et la « partitocratie », le temps passant, les partis minoritaires finiront aussi par apparaître pour ce qu’ils sont, parce que le système démocratique et le capital sont ainsi faits.
En deuxième lieu, il y a une chose positive dans tout cela, quoi qu’il arrive. Il y a un mois, le sentiment général était « ce monde, c’est de la merde, mais qu’est-ce qu’on peut y faire ? ». Aujourd’hui, il y a une foule de gens qui pense qu’on peut changer la loi électorale, qu’il est légitime de sauter par-dessus de ce que dit la Commission Electorale, quand ce qu’elle dit est injuste, etc. Il faut bien commencer par quelque chose. Si le mouvement du 15-M continue et si on arrivait à obtenir des choses par le biais des mobilisations et des assemblées (et celles-ci fonctionnent plus ou moins bien, mais elles fonctionnent, indépendamment du résultat) voilà qui est un filon à exploiter. Dans ce pays, on n’a rien gagné du tout depuis des lustres : rien contre l’entrée dans l’OTAN, rien concernant la catastrophe du Prestige, rien sur la guerre en Irak, rien à partir des luttes à l’Université, ... En fait, le seul changement que beaucoup de gens avaient assumé comme le leur, fut au moment où le PSOE (gauche) gagna sur le PP (droite) à la suite des attentats du 11 mars [2004], et cela s’est fait en votant !, ce qui n’a fait, en plus, que renforcer les illusions démocratiques.
En troisième lieu, le mouvement du 15-M a réussi à faire sortir les gens dans la rue pour y parler collectivement et publiquement de politique, de quelques uns des problèmes sociaux et politiques qui les entourent. Il y a longtemps qu’on ne n'avait pas vu quelque chose de semblable. La plupart des conversations se sont faites autour des questions des réformes, de changements minimaux mais, comme on le disait tout à l’heure, il faut bien commencer par quelque chose. D’une certaine manière, on a ouvert une brèche au milieu du « ne te mêle pas de politique ! », du « désenchantement » ou du « on ne peut rien faire », autrement dit au milieu des trois petits « cadeaux » que le franquisme, la transition et la démocratie nous avaient légués. Ce qui n’est pas acceptable, c’est que lorsque les gens restent chez eux, on les critique parce qu’ils ne sortent pas dans la rue et, lorsqu’ils sortent dans la rue, on les critique parce que ce qu’ils demandent n’est pas la révolution sociale. Cela n’a aucun sens.
Si on arrive à obtenir certaines choses par la lutte dans la rue, à avoir gain de cause sur certaines revendications, nous pensons que, une fois tout cela terminé, ce sera sans doute plus facile de convaincre les gens du fait qu’une assemblée sur le lieu de travail peut fonctionner, que sortir dans la rue pour manifester peut servir à quelque chose, qu’on peut sortir gagnant d’une grève ou défaire un plan d’urbanisme : grâce à la solidarité, l’action directe, etc. Bien évidemment, si ce qu’on arrive à obtenir n’est le résultat que des manœuvrés politiques, des votes, des référendums, etc. (quelque chose de peu probable s’il n’y a pas une pression considérable dans la rue), la seule chose qui va sortir renforcée c’est le système démocratique. Voilà la question, voilà où les anarchistes devront être présents.
Nous verrons comment tout cela va se terminer, mais le mouvement anarchiste en sortira renforcé si ses pratiques, sa manière d’affronter la réalité et quelques uns de leurs points de vue s’étendent et s’enracinent dans les idées collectives. Le mouvement anarchiste sera aussi d’autant plus fort si notre participation dans le mouvement du 15-M se concrétise, après la critique, l’autocritique et l’analyse publique, à travers de nouvelles expériences collectives. Il est peu probable que, grâce au 15-M, on atteigne nos objectifs au niveau social à long terme et significativement, au-delà du fait que nous puissions convaincre certaines personnes. Cette lutte pour nos objectifs emprunte d’autres chemins, ceux du travail constant pour ouvrir des locaux, pour éditer du matériel, faire des analyses, organiser des journées, des réunions de discussions, etc. toutes choses qu’en aucun cas nous ne devrions abandonner pour être présents uniquement dans le mouvement du 15-M.
Quelques anarchistes madrilènes
1 En espagnol : https://es.internationalism.org/book/export/html/3110 [60] ou sur https://www.alasbarricadas.org/noticias/?q=node/17755 [61] (NdT) et d’autres sites.
2 Le mouvement des Indignés a pris toute son ampleur en Espagne après la brutale répression du 15 mai ce qui lui a donné son nom le 15-M (NdT).
3 Le mot « compañero » en espagnol est utilisé indistinctement par les anarchistes ou par nous, militants de la Gauche communiste, qui utilisons aussi le terme « camarada ». En espagnol, « compañero » a un sens plus large, étendu aux gens qui luttent à nos cotés, etc… C’est à la fois « camarade », « collègue » et « compagnon ». L’usage d’un terme ou l’autre pourrait paraître quelque chose de secondaire. Mais, malheureusement, pour la traduction en français, il faut choisir, parce qu’on dirait que, derrière les mots, il y a toute un contentieux historique. Ce texte a été rédigé par des anarchistes madrilènes ce qui nous incite à le traduire par « compagnon » qui est le mot utilisé en France par les anarchistes pour parler de leurs « camarades » de combat. Curieusement, ce mot français, camarade, a été emprunté à la langue espagnole. Que ce soit « celui qui partage la chambrée » ou « celui qui partage le pain », nous partageons tous le même combat : celui de combattre le capitalisme et de construire une autre société. [NdT]
4 Nous adoptons ce néologisme en français pour traduire l’idée des « partisans des assemblées souveraines »
5 En espagnol « ciudadanistas » est, nous le pensons, un néologisme pour nommer cette nébuleuse altermondialiste, pro-État dit protecteur et national contre un capitalisme apatride, un État au sein duquel on est citoyen et non pas exploité ou exploiteur, la « démocratie réelle » et autres idéologies citoyennes, ATTAC et autres « résistances » diverses et plutôt avariées. [NdT]
6 Groupes de percussionnistes brésiliens jouant dans la rue. [NdT]
7 Le « botellón » est l’habitude prise par des groupes de jeunes, parfois des centaines, de se saouler à mort avec des mélanges d’alcool, sur les places publiques, surtout le week-end-end. Lors de ce mouvement, une des préoccupations était d’éviter toute confusion à ce sujet. [NdT]
8 Dimanche 22 mai il y a eu des élections locales en Espagne. La loi stipule que le samedi précédant (le 21) c’est le jour de « réflexion » où tout rassemblement est interdit…[NdT]
9 Au moment où l’on corrigeait ce texte, l’acampada de Sol a approuvé les quatre points qui définissent le dénommé #consensodeminimos. Nous n’allons pas analyser ce vote, car nous pensons que cela ne change en rien ce qui est dit dans ce texte-ci : nous nous attendions à ce que quelque chose de ce genre arrive tôt ou tard.
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_popular [62]
11 Les auteurs de ce texte font sans doute référence, dans une autocritique implicite, à leur « monde », un peu refermé sur lui-même.[NdT]
12 Il nous est difficile de comprendre ce paragraphe. La traduction peut s’en ressentir. (NdT)
Rubrique:
L’évolution de la situation en Espagne à la suite des manifestations du 19 juin
- 2540 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d'un article réalisé par Accion Proletaria, organe de presse du CCI en Espagne, sur la situation sociale qui prévaut dans ce pays depuis les grandes manifestations du 19 juin.
Ce jour-là, ces manifestations ont été massives et leur contenu a été bien plus social et de classe que précédemment. Il est possible que le mouvement devienne moins visible, mais les leçons tirées et, autour de celles-ci, l’action des minorités plus conscientes et actives doivent servir à préparer des nouvelles luttes, tout simplement parce que le capitalisme en crise ne nous octroiera pas la moindre trêve, mais nous livrera toujours plus d’attaques et de plus en plus dures !
Le dimanche 19 juin a connu des manifestations massives dans plus de 60 villes d'Espagne. Quelques chiffres : 140 000 personnes à Madrid, 100 000 à Barcelone, 60 000 à Valence, 25 000 à Séville, 8 000 à Vigo, 20 000 à Bilbao, 20 000 à Saragosse, 10 000 à Alicante, 15 000 à Malaga...
Si la massivité impressionne, le contenu est encore plus significatif. Durant les deux dernières semaines, il y avait eu une pression des politiques et des médias pour demander au mouvement de faire « des propositions concrètes », et DRY[1], dans ce concert de pressions, de l'intérieur du mouvement, essayait d'entraîner le mouvement vers le piège des réformes démocratiques[2]. Mais ce dimanche, le poids qu'avaient pu avoir ces mystifications était moindre. Si les organisateurs eux-mêmes avaient ressenti le besoin de donner un caractère social à la manifestation, les manifestants, d'eux-mêmes, se sont chargés de montrer la tendance profonde : à Bilbao, le slogan le plus scandé était: « Voilà ce qu’est la violence : ne pas pouvoir arriver à la fin du mois ! ». À Valence, la banderole de début de manifestation disait : « Le futur nous appartient ! », à Valladolid « La violence c’est aussi le chômage et les expulsions » ... A Madrid, la manifestation a été impressionnante : elle était convoquée par une Assemblée de quartiers et de banlieues du sud de Madrid, c'est-à-dire par les concentrations ouvrières les plus touchées par le chômage. Le thème de ce rassemblement était : « Marchons ensemble contre la crise et contre le capital ». Les revendications étaient : « Non aux réductions de salaires et des pensions ; pour lutter contre le chômage : la lutte ouvrière, contre l’augmentation des prix, pour l’augmentation des salaires, pour l’augmentation des impôts de ceux qui gagnent le plus, en défense des services publics, contre les privatisations de la santé, de l’éducation ... VIVE L'UNITE DE LA CLASSE OUVRIERE ! »[3]
Un collectif d'Alicante a adopté le même manifeste. A Valence, un « Bloc Autonome et Anticapitaliste » formé de plusieurs collectifs très actifs dans les assemblées a diffusé un manifeste qui dit : « Nous voulons une réponse au chômage. Que les chômeurs, les précaires, ceux qui connaissent le travail au noir, se réunissent en Assemblées, qu'ils décident collectivement de leurs revendications et que celles-ci soient satisfaites. Nous demandons le retrait de la loi de réforme du Code du travail et de celle qui autorise des Plans sociaux sans contrôle et avec une indemnisation de 20 jours. Nous demandons le retrait de la loi sur la réforme des pensions de retraites car, après une vie de privation et de misère, nous ne voulons pas sombrer dans encore plus de misère et d'incertitude. Nous demandons que cessent les expulsions. Le besoin humain d'avoir un logement est supérieur aux lois aveugles du commerce et de la recherche du profit. Nous disons NON aux réductions qui touchent la santé et l'éducation, NON aux licenciements à venir que préparent les gouvernements régionaux et les mairies suite aux dernières élections ».[4]
La marche de Madrid s'était organisée en plusieurs colonnes qui étaient parties de 6 banlieues ou quartiers de la périphérie différents ; au fur et à mesure que ces colonnes avançaient, une foule toujours plus dense les rejoignait. Ces "couleuvres" reprenaient la tradition ouvrière des grèves de 1972-76 (mais aussi la tradition de 68 en France) où on avait vu qu'à partir d'une concentration ouvrière ou d'une usine "phare", comme à l'époque la Standard de Madrid, les manifestants voyaient des masses croissantes d'ouvriers, d’habitants, de chômeurs, de jeunes les rejoindre, et toute cette masse convergeant vers le centre de la ville. Cette tradition était réapparue dans les luttes de Vigo de 2006 et 2009[5].
A Madrid, le manifeste lu pendant le rassemblement, appelait à tenir des « Assemblées afin de préparer une grève générale », ce qui fut accueilli par des cris massifs de « Vive la classe ouvrière ! ».
Nous sommes à un moment charnière
Dans notre prise de position « De la place Tahrir du Caire à la Puerta del Sol de Madrid »[6], nous disions : « Même si, pour se donner un symbole, ce mouvement s’appelle « du 15-M » (pour « du 15 mai »), cet appel ne l’a pas créé, mais lui a prêté tout simplement une couverture. Mais cette couverture est devenue carrément une cuirasse qui l’emprisonne en lui donnant un objectif aussi utopique que mystificateur : la "régénération démocratique" de l’Etat espagnol ». Il y a des secteurs significatifs qui essayent de briser cette cuirasse, et ces manifestations du 19 juin vont dans cette direction. Nous entrons dans une étape nouvelle ; nous ne savons pas concrètement comment cela va se réaliser ni quand ; mais cette nouvelle étape, très probablement, s'orientera dans le sens de développer des Assemblées et des luttes ouvrières sur un terrain de classe, contre les diminutions de toutes les prestations sociales, l'unité de tous les exploités rompant avec les barrières corporatistes, d'usine, de race, d'origine, de situation sociale etc. Une telle orientation ne peut vraiment atteindre sa pleine signification que dans une perspective internationale de lutte contre le capitalisme.
Il est vrai que concrétiser cette orientation ne va pas être facile. D'abord à cause des illusions et des confusions sur la démocratie, les illusions sur les possibilités de réformes qui pèsent sur beaucoup de secteurs ; illusions sur lesquelles jouent la DRY, les politiciens, les médias, qui tous profitent des hésitations présentes, de cet immédiatisme qui pousse à vouloir obtenir des « résultats rapides et palpables », de la peur face à l’énormité de la tâche qu’on a devant nous, pour nous enfermer dans le terrain des « réformes », du « citoyennisme », de la « démocratie », en encourageant l’illusion que ce terrain nous permettrait d’obtenir quelques améliorations, une « trêve » face aux attaques sans répit et sans merci qui s'abattent sur la classe ouvrière.
Ensuite, se mobiliser sur les lieux de travail relève de l'acte héroïque aujourd'hui, à cause du risque élevé de perdre son poste de travail, de se retrouver sans ressources ce qui, dans beaucoup de familles, représente la frontière pas seulement entre une vie acceptable et la misère mais entre la misère et la faim. Dans de telles conditions, la lutte ne peut qu'être le fruit, non pas d'une décision individuelle, comme le présentent les syndicats et l'idéologie démocratique, mais le résultat du développement d'une force et d'une conscience collective, aspects qui sont fortement entravés par les syndicats (qui actuellement semblent avoir disparu de la scène des combats, mais qui sont très présents sur les lieux de travail, semant le virus du corporatisme, de la lutte enfermée dans le secteur ou l’entreprise et s’opposant à toute tentative de lutte ouverte).
Malgré ces difficultés, il apparaît probable que l'effort qui mènera à l'éclatement de grèves d’une ampleur plus ou moins grande est d'ores et déjà en cours. Pour aider ce processus à affronter tous les obstacles qui vont jalonner sa route, il nous faut tirer les leçons de ce qui vient de se passer, entre le 15 mai et le 19 juin et dégager quelques perspectives.
« Voilà notre force »
Souvenons-nous combien de fois, ces dernières années, nous avons entendu : « Mais comment est-ce possible qu’on ne bouge pas avec tout ce qui nous tombe dessus ? »
Au moment où la crise actuelle a éclaté, nous avons mis en avant le fait que : « dans un premier temps », les combats étaient « désespérés et relativement isolés, même s’ils bénéficient d’une sympathie réelle des autres secteurs de la classe ouvrière. C’est pour cela que si, dans la période qui vient, on n’assiste pas à une réponse d’envergure de la classe ouvrière face aux attaques, il ne faudra pas considérer que celle-ci a renoncé à lutter pour la défense de ses intérêts. C’est dans un second temps, lorsqu’elle sera en mesure de résister aux chantages de la bourgeoisie, lorsque s’imposera l’idée que seule la lutte unie et solidaire peut freiner la brutalité des attaques de la classe régnante, notamment lorsque celle-ci va tenter de faire payer à tous les travailleurs les énormes déficits budgétaires qui s’accumulent à l’heure actuelle avec les plans de sauvetage des banques et de « relance » de l’économie, que des combats ouvriers de grande ampleur pourront se développer beaucoup plus » [7]
Ce « second temps » est en train de mûrir –avec des difficultés bien évidemment- avec des mouvements comme celui qui a eu lieu en France contre la reforme des retraites (octobre 2010), celui des jeunes en Grande-Bretagne contre les brutales augmentations des coûts scolaires et universitaires (décembre 2010), les mobilisations en Tunisie et en Egypte, la mobilisation en Grèce…
Pendant plus d’un mois, des Assemblées et des manifestations massives nous montrent que OUI, « nous pouvons nous unir ! », qu’il ne s’agit pas là d’une utopie, mais, au contraire, à travers les témoignages de participants actifs à ces mouvements, il apparaît qu'il s'agit là d'une source de joie et d'un fort sentiment de dignité. Parlant de la manifestation du 19 juin, un manifestant dit : « L'ambiance était celle d'une fête authentique. On marchait ensemble, des gens très variés et de tous les âges : des jeunes autour de 20 ans, des retraités, des familles avec leurs enfants, d'autres personnes encore différentes... et cela, alors que des gens se mettaient à leur balcon pour nous applaudir. Je suis rentré épuisé à la maison, mais avec un sourire rayonnant. Non seulement j'avais la sensation d'avoir contribué à une cause juste, mais en plus, j’ai passé un moment vraiment extra ».
Avant ce séisme social que nous venons de vivre, on entendait tout le temps le commentaire « les ouvriers ne bougent pas », un sentiment d'impuissance prédominait. Aujourd’hui commence à émerger l'idée que la solidarité, l’union, la construction d’une force collective, peuvent se faire jour. Ce qui ne veut pas dire qu’on sous-estime les graves obstacles que la nature même du capitalisme, basé sur la concurrence à mort et la méfiance des uns vis-à-vis des autres, met en travers de la route dans ce processus d’unification. Ce processus ne pourra se développer que sur la base d’une lutte unitaire et massive de la classe ouvrière, une classe qui, parce qu’elle est la productrice collective et associée des principales richesses, porte en elle la reconstruction de l’être social de l’humanité.
En contraste avec le sentiment amer d’impuissance qui dominait, les expériences vécues ce dernier temps, commencent à faire germer l’idée que « Nous pouvons être forts face au Capital et à son État ». « Après l’effondrement du bloc de l’Est et des régimes soi-disant « socialistes », les campagnes assourdissantes sur la « fin du communisme », voire sur la « fin de la lutte de classe », ont porté un coup sévère à la conscience au sein de la classe ouvrière de même qu’à sa combativité. Le prolétariat a subi alors un profond recul sur ces deux plans, un recul qui s’est prolongé pendant plus de dix ans (...) [la bourgeoisie] a réussi à créer au sein de la classe ouvrière un fort sentiment d’impuissance du fait de l’incapacité de celle-ci à mener des luttes »[8].
Comme le disait un manifestant à Madrid « C’est vraiment important de voir tous ces gens rassemblés sur une place, parlant politique ou luttant pour leurs droits. N’avez-vous pas la sensation que nous sommes en train de récupérer la rue ? ». Cette récupération de la rue montre comment commence à mûrir un sentiment de force collective. Le chemin est long et difficile, mais on est en train de construire les bases pour que des luttes massives de la classe ouvrière éclatent, des luttes qui lui permettront de développer la confiance en elle-même et de se comprendre comme force sociale capable de faire face à ce système et de construire une nouvelle société.
Le mouvement du 15 mai ne se réduit pas à une explosion d'indignation. Il a surtout essayé de se donner les moyens pour comprendre les causes de la misère et de se donner les moyens de s'organiser pour la lutte. Et ces moyens ce sont les assemblées massives. Une manifestante du 19 juin disait: « le mieux, ce sont les Assemblées, la parole se libère, les gens se comprennent, on pense à haute voix, on peut parvenir à des accords en commun alors que nous sommes des milliers de personnes qui ne se connaissent pas. Ce n'est pas merveilleux çà ? »
La classe ouvrière n’est pas une armée disciplinée avec des membres, peut-être très convaincus mais dont le rôle se réduirait à suivre les ordres d’un état-major, voilà une idée du monde qui doit être jetée dans les poubelles de l’histoire comme une vieillerie ! La classe ouvrière se conçoit comme une masse qui pense, discute, décide, agit et s’organise de manière collective et solidaire, en additionnant le meilleur de chacun dans une formidable synthèse d’action commune. Le moyen et le facteur concrets de cette vision sont les Assemblées, « Tout le pouvoir aux Assemblées ! » voilà ce qui a été repris à Madrid et à Valence. Ce slogan surgi, certes encore minoritairement, lors de ce mouvement, est l’écho lointain du vieux cri de ralliement de la Révolution russe : « Tout le pouvoir aux Conseils ouvriers (Soviets) ! »[9].
D’une façon certes embryonnaire, le mouvement a mis en avant la nécessité d’une lutte internationale. Lors d’une manifestation à Valence on entendait le cri : « Ce mouvement n’a pas de frontières ». Il y a eu des volontés encore timides et confuses qui vont dans ce sens. Dans plusieurs campements, on a organisé des manifestations « pour la Révolution européenne » ; le 15 juin, il y a eu des manifestations de soutien aux luttes en Grèce. Le 19 juin sont apparus, minoritaires, des slogans internationalistes : sur une pancarte on lisait « Joyeuse union mondiale », sur une autre en anglais « World Revolution » (révolution mondiale).
Pendant des années, ce qu’on a appelé la « mondialisation de l’économie » servait à la bourgeoisie de gauche à susciter des réflexes nationalistes, leur discours consistant à revendiquer face aux « marchés apatrides » la « souveraineté nationale », autrement dit, on proposait aux ouvriers d’être encore plus nationalistes que la bourgeoisie elle-même ! Avec le développement de la crise, mais aussi grâce à la popularisation d’Internet, les réseaux sociaux, etc., la jeunesse ouvrière commence à renverser les choses. Il émerge un sentiment selon lequel « face à la globalisation de l’économie, il faut répondre avec la globalisation internationale des luttes », face à une misère mondiale, la seule riposte possible est une lutte mondiale.
Le mouvement a eu une répercussion très étendue. Les mobilisations qui se déroulent depuis 2 semaines en Grèce suivant le même « modèle » de concentrations et d’assemblées massives sur les places principales, se sont inspirées directement et consciemment des événements en Espagne. Selon le site Kaosenlared le 19 juin « des milliers de personnes de tout âge ont manifesté ce dimanche place Syntagma, devant le Parlement grec, quatrième dimanche de suite, en riposte à un appel du mouvement paneuropéen des 'indignés' pour protester contre les mesures d’austérité ».
En France, en Belgique, au Mexique, au Portugal, il y a des assemblées régulières, plus minoritaires, où s’affirment la solidarité avec les indignados et la volonté d’encourager le débat et de construire des ripostes. Au Portugal « Quelques 300 personnes, des jeunes pour la plupart, ont marché dimanche après-midi dans le centre de Lisbonne, appelés par le mouvement ‘Democracia Real Ya’, en se référant aux ‘indignados’ espagnols. Les manifestants portugais ont marché dans le calme derrière une banderole où l’on pouvait lire : « Europe, réveille-toi ! », « Espagne, Grèce, Irlande, Portugal : notre lutte est internationale » ; en France « La police française a arrêté une centaine d’'indignés' au moment où ils voulaient manifester devant la cathédrale Notre-Dame, à Paris. L’après-midi, les manifestants se sont assis devant ce monument pour ainsi continuer une protestation qui avait commencé à midi sur le même chemin que celles d’Espagne » [10]
Face à une situation insupportable : préparons de nouvelles luttes !
La crise de la dette souveraine s’accentue jour après jour. Les experts eux-mêmes reconnaissent le fait qu’au lieu de la « reprise économique » qu’on n’arrête pas d’annoncer, l’économie mondiale peut subir une rechute encore plus violente que celle d’octobre 2008. La Grèce montre un abîme insondable : les plans de sauvetage requièrent d’autres plans de sauvetage et, à la fois, l’État se trouve au bord de la cessation de paiements, un phénomène qui n’est en rien « grec », mais qui touche de plein fouet les Etats-Unis, première puissance mondiale.
La crise de la dette montre la crise sans issue du capitalisme : il faut instaurer des plans d’austérité d’une brutalité inouïe, des plans qui signifient des licenciements, des coupes sociales, des réduction des salaires, des augmentations de l’exploitation, des impôts..., des mesures qui ne font qu’entraîner une contraction du marché solvable ; ce qui oblige à établir …de nouveaux plans d’austérité !
Face à une telle spirale, il n’y a pas d’autre chemin possible que la lutte massive. Cette lutte peut et doit mûrir grâce à l’intervention de la large minorité qui, au sein des Assemblées, penchait vers des positions de classe, favorables aux assemblées et contre le capitalisme. Les acampadas sont en train de disparaître, les assemblées centrales n’ont plus lieu, il y a un tissu assez contradictoire d’assemblées de quartier. Mais ces minorités ne doivent pas se disperser, elles doivent se maintenir unies, en se coordonnant au niveau national et, si cela est possible, en développant des contacts internationaux. Les formes sont très variées : des collectifs, des assemblées pour la lutte, des comités d’action, des groupes de débat... Ce qui est important, c’est qu’au sein de ce milieu, le débat et le combat se développent. Un débat sur les nombreuses questions qui se sont posées au cours de ce dernier mois : reforme ou révolution ?, démocratie ou assemblées ?, mouvement citoyen ou mouvement de classe ?, revendications démocratiques ou revendications contre les coupes sociales ?, pacifisme citoyen ou violence de classe ?, apolitisme ou politique de classe ?, etc. Un combat pour impulser les Assemblées, l’auto-organisation, la lutte intransigeante et indépendante. Il faut concrétiser le sentiment de force et la capacité d’union qui ont germé pour riposter aux coupes brutales que les gouvernements régionaux sont en train de concocter dans l'éducation et la santé et les « surprises » que sans aucun doute nous prépare le gouvernement.
« La situation d’aujourd’hui est très différente de celle qui prévalait lors du surgissement historique de la classe à la fin des années 1960. A cette époque, le caractère massif des combats ouvriers, notamment avec l’immense grève de mai 1968 en France et l’automne chaud italien de 1969, avait mis en évidence que la classe ouvrière peut constituer une force de premier plan dans la vie de la société et que l’idée qu’elle pourrait un jour renverser le capitalisme n’appartenait pas au domaine des rêves irréalisables. Cependant, dans la mesure où la crise du capitalisme n’en était qu’à ses tous débuts, la conscience de la nécessité impérieuse de renverser ce système ne disposait pas encore des bases matérielles pour pouvoir s’étendre parmi les ouvriers. On peut résumer cette situation de la façon suivante : à la fin des années 1960, l’idée que la révolution était possible pouvait être relativement répandue mais celle qu’elle était indispensable ne pouvait pas s’imposer. Aujourd’hui, au contraire, l’idée que la révolution soit nécessaire peut trouver un écho non négligeable mais celle qu’elle soit possible est extrêmement peu répandue. »[11]
Dans les assemblées, on a beaucoup parlé de révolution, de comment détruire ce système inhumain. Le mot « révolution » ne fait pas peur. Le chemin est bien long, mais le mouvement qui va du 15 mai au 19 juin a permis de comprendre que lutter c’est possible, que s’organiser pour lutter c’est possible et que tout cela non seulement nous renforce contre le Capital et son État, mais nous donne aussi de la joie, de la vitalité, nous permet de sortir de la sinistre prison qu’est devenue la vie quotidienne sous le capitalisme.
« Une transformation massive des hommes s’avère nécessaire pour la création en masse de cette conscience communiste, comme aussi pour mener à bien la chose elle-même ; or, une telle transformation ne peut s’opérer que par un mouvement pratique, par une révolution ; cette révolution n’est donc pas seulement rendue nécessaire parce qu’elle est le seul moyen de renverser porque la classe dominante, elle l’est également parce que seule une révolution permettra à la classe qui renverse l’autre de balayer toute la pourriture du vieux système qui lui colle après et de devenir apte à fonder la société sur des bases nouvelles »[12]
Dans ce sens, le mouvement qu’on vient de vivre a déjà apporté un petit quelque chose à ce changement d’état d’esprit et d’attitude. Ce grand changement de la société et de nous-mêmes, ne pourra se réaliser qu’à l’échelle mondiale. En cherchant la solidarité et l’unité avec l’ensemble du prolétariat international, le prolétariat en Espagne pourra développer de nouvelles luttes et avancer dans cette perspective. Le futur est entre nos mains !
CCI (24 juin)
1. DRY sigles de Democracia Real Ya (Démocratie Réelle Maintenant), association de plus d’une centaine d’organisations où ATTAC a le plus grand poids. Voir https://fr.internationalism.org/icconline/2011/dossier_special_indignes/... [63]
2. En analysant attentivement les récents événements, nous pouvons nous rendre compte comment une telle réforme est illusoire et mystificatrice. Les listes ouvertes ont été acceptées par l’ultra-droitière Madame Aguirre, baronne de la communauté autonome de Madrid ; le corrompu Camps –roitelet de la communauté de valencienne- a promis de les « étudier ». Une autre revendication, les ILP (Initiatives Législatives Populaires), a été reprise par les syndicats -durement critiqués dans les Assemblées- qui ont présenté un million de signatures pour que le Parlement retire la Loi de Reforme du Code du Travail, avec des possibilités nulles d’obtenir quoi que ce soit, comme les leaders syndicaux le reconnaissaient eux-mêmes. Enfin, la « reforme » de la Loi Electorale prétend favoriser les « petits partis » qui soi-disant représenteraient mieux les électeurs et seraient plus critiques vis-à-vis des pouvoirs économiques et politiques. Ceci a été totalement démenti par le comportement d’Izquierda Unida (IU - coalition de gauche, minoritaire, centrée autour du PC) qui se présentait comme une alternative radicale « plus à gauche » et qui, lors de dernières élections, a fini par aplanir le chemin de la Droite vers le pouvoir dans plus de 30 municipalités et dans la région d’Estrémadure. Et ce n’est pas la première fois : en 1995, Anguita, grand chef d’IU à l'époque, s’est allié avec le PP (droite) pour déloger le PSOE du pouvoir.
3. Voir https://asambleaautonomazonasur.blogspot.com/ [64]
4. Voir https://infopunt-vlc.blogspot.com/2011/06/19-j-bloc-autonom-i-anticapitalista.html [65]
5. Voir « Grève de la métallurgie à Vigo en Espagne : Une avancée dans la lutte prolétarienne », https://fr.internationalism.org/isme/326/vigo [66] et aussi « A Vigo, en Espagne : les méthodes syndicales mènent tout droit à la défaite », https://fr.internationalism.org/icconline/2009/a_vigo_en_espagne_les_methodes_syndicales_menent_tout_droit_a_la_defaite.html [67]
6. https://fr.internationalism.org/icconline/2011/dossier_special_indignes/de_la_place_tahrir_a_la_puerta_del_sol_de_madrid.html [52]
7. Résolution sur la Situation Internationale, adoptée par le 18ème Congres du CCI, Revue Internationale nº 138, https://fr.internationalism.org/rint138/resolution_sur_la_situation_internationale_18e_congres_du_cci_mai_2009.html [68]
8. Idem.
9. Lire « Solidarité avec les "indignés" en Espagne : l'avenir appartient à la classe ouvrière ! [69]».
10. Eléments repris du site espagnol https://kaosenlared.net/ [70]
11. Idem.
12. Marx et Engels, L’idéologie allemande (1845-46), p. 101, éditions sociales, 1982
Rubrique:
"L'apolitisme" est une mystification dangereuse pour la classe ouvrière
- 2219 lectures
Dans le mouvement des "indignés" en Espagne comme en France et dans tous les pays, le collectif Democracia Real Ya (DRY) ! ("Démocratie Réelle Maintenant !"), a exploité le dégoût légitime des jeunes envers les partis politiques bourgeois (et la corruption des politiciens), pour promouvoir une idéologie extrêmement pernicieuse : celle de "l'a-politisme". Ainsi, partout, on a pu entendre les mentors de DRY faire croire aux "indignés" que leur mouvement de protestation contre les effets de la crise du capitalisme (notamment le chômage des jeunes) devait rester un mouvement "apolitique", en dehors et contre tous les partis, associations et syndicats. Partout, les éléments politisés devaient donc respecter la consigne : ne pas prendre la parole au nom de leur groupe politique mais uniquement en tant que simples "citoyens"1. Tous ceux qui font de la politique étaient ainsi suspectés de vouloir diviser ou récupérer le mouvement pour le compte de leur propre "chapelle".
L'hypocrisie sans borne de DRY atteint son comble lorsqu'on sait que derrière cette vitrine prétendue "apolitique" se cachent en réalité non seulement toute la brochette des partis de la gauche du capital (PS, PC, NPA, Front de Gauche, etc…), mais également des partis de droite et d'extrême-droite (puisque leurs militants ont droit de cité dans les assemblées en tant que "citoyens au-dessus de tout soupçon").
C'est en réalité à une union sacrée de toutes les bonnes âmes respectueuses de la "citoyenneté" capitaliste que nous convie la politique démagogique et populiste de DRY. En réalité, ce que visent les leaders de DRY, c'est à attacher les jeunes prolétaires au char de l'ordre capitaliste.
Lorsque DRY appelle à revendiquer une réforme de la loi électorale en Espagne, lorsqu'elle nous demande d'aller voter et de rester ainsi de bons "citoyens", lorsque ses slogans mensongers nous appellent à lutter contre la "dictature des banques" et nous fait croire qu'un capitalisme "propre", "éthique", à "visage humain" est possible, DRY ne fait rien d'autre que de la… "politique" ! Et cette politique réformiste, de gestion de la crise économique, c'est celle des partis de la gauche du capital, avec ses politiciens plus ou moins "propres" et corrompus (comme Strauss-Kahn, Zapatero, Papandréou et consorts).
L'"apolitisme" est une pure mystification et un piège dangereux pour les exploités ! Cette idéologie hypocrite ne vise qu'à les déposséder de leurs propres moyens de lutte afin de les rabattre sur le terrain pourri de la "légalité" de la "démocratie" bourgeoise. Les partis de gauche et les syndicats, après avoir porté tant de coups à notre classe, ont de plus en plus de mal à déverser leurs poisons : les divisions corporatistes ou sectorielles, le noyautage des luttes et des assemblées générales et, surtout, les illusions réformistes et électorales… Les exploités sont animés d'une méfiance grandissante à leurs égards, voire d'un réflexe de rejet ; ils ont appris à détecter la puanteur de leurs poisons. "L'apolitisme" de l'alter-mondialisme a donc pour mission de nous refourguer ce même poison mais en le rendant préalablement inodore ! Il s'agit d'un tour de passe-passe, ni plus ni moins, qui vise au bout du compte à ramener les prolétaires dans le giron des ennemis officiellement rejetés : les partis de gauche et les syndicats !
La classe exploitée ne doit pas oublier que c'est au nom de "l'apolitisme" que le fascisme est arrivé au pouvoir dans les années 1930. C'est sous couvert "d'apolitisme" que les mouvements sociaux ont toujours été récupérés par ceux qui se font les promoteurs patentés de cette idéologie, tels les "altermondialistes" de DRY ou d'ATTAC.
C'est ce que nous avions vu, par exemple en France, dans le mouvement des étudiants contre le CPE au printemps 2006 où de nombreux enfants de la classe ouvrière ont été récupérés, entre autres par le NPA, dans la perspective des élections présidentielles de 2007. Ils ont été dévoyés sur le terrain des isoloirs électoraux derrière un front uni "anti-Sarko".
Pour ne pas se faire "récupérer" et dévorer par des loups déguisés en agneaux, les jeunes générations d'aujourd'hui doivent se souvenir du slogan des étudiants de Mai 68 : "Si tu ne t'intéresses pas à la politique, la politique s'intéressera à toi".
Oui, il faut s'intéresser à la "politique" ! Confronter les idées politiques dans les assemblées générales est le seul moyen de démasquer nos faux amis, de déjouer leurs pièges et de ne pas se laisser confisquer nos luttes par des politicards "spécialistes" de la négociation et de la magouille. C'est dans la confrontation et le débat politique, notamment au sein des assemblées souveraines, que les exploités en lutte peuvent faire la distinction entre les groupes politiques qui défendent vraiment leurs intérêts et ceux qui jouent le rôle de chiens de garde du Capital.
La lutte de la classe exploitée contre la classe exploiteuse est toujours un combat politique. C'est uniquement dans ce combat, à travers le débat le plus large possible que les exploités peuvent construire un rapport de force en leur faveur face à l'ignominie du Capital et de ses politiciens de tous bords. C'est dans ce combat politique, dans la rue et au sein des assemblées massives, qu'ils peuvent retrouver leur identité de classe, développer leur solidarité, leur unité, et retrouver confiance en leur propre force.
La classe exploitée, qu'elle soit salariée ou au chômage, est la seule force politique qui puisse changer le monde, renverser le capitalisme et construire une société véritablement humaine, sans crise, sans guerre, sans exploitation.
Sofiane (29 juin)
1 Voir notre article "Altercation entre Democracia Real et le CCI : Notre indignation face aux méthodes 'démocratiques' de DRY" sur notre site web.
Rubrique:
Altercations entre « Démocratie Réelle Maintenant » et le CCI à Paris : NOTRE INDIGNATION FACE AUX METHODES "DEMOCRATIQUES" de « DRY » !
- 3417 lectures
Le mouvement du 15 Mai (15M) initié par Democracia Real Ya (DRY), chapeauté par l'association altermondialiste ATTAC, a fait des petits également en France, et notamment à Paris, avec pour objectif la "prise de la Place de la Bastille". Dans les assemblées à Paris, des militants du CCI sont intervenus pour défendre une position de classe et non pas en tant que simples "citoyens" revendiquant une "démocratie réelle maintenant" dans le cadre de la préservation du système capitaliste.
Nos camarades ont également apporté une table de presse pour diffuser nos publications sur la place publique où se tenaient les assemblées.
Le 29 mai, les organisateurs de DRY sont venus nous trouver pour protester avec les arguments suivants :
ce mouvement est "a-politique" et n'accepte aucun parti, aucun groupe politique et aucun syndicat;
la diffusion de notre presse ne peut que "diviser" le mouvement.
Une petite altercation a alors eu lieu entre les militants du CCI et certains militants de DRY qui nous ont demandé, de façon très virulente, de plier bagage. Voici les arguments que nous avons opposés à cette tentative de nous bâillonner :
Aucun mouvement de protestation sociale n'est "apolitique". L'a-apolitisme de DRY n'est que pure hypocrisie. Nous savons pertinemment que derrière la bannière de DRY, c'est ATTAC et ses épigones qui se cache avec son idéologie altermondialiste.
Nous ne sommes pas un parti politique, et encore moins un parti électoral.
DRY fait exactement la même chose que les staliniens qui nous ont toujours "virés" des lieux publics considérés comme leur chasse gardée, leur "territoire";
A la différence de DRY et de tous les autres groupes, des syndicats et partis politiques bourgeois, présents dans ce mouvement, le CCI ne cache pas son drapeau (même si, dans nos interventions au sein des Assemblées nous ne parlons pas au nom de notre organisation politique).
Même les flics, qui assistaient à cette scène derrière leurs boucliers, semblaient plus "démocratiques" que DRY, puisqu'ils ne nous ont pas demandé, eux, de plier bagage. Quand nous avons souligné l'ironie de cette situation d'une Democracia Real Ya plus coercitive que les forces de répression de l'Etat français, les membres de la DRY ont été particulièrement mal à l'aise.
Nous avons donc refusé de nous laisser prendre en otage par la loi imposée par DRY et sommes restés sur la Place de la Bastille en nous écartant un peu pour laisser la place à l'assemblée.
Le dimanche 12 juin, l'assemblée organisée par DRY s'est tenue boulevard Richard-Lenoir à Paris. Nos militants étaient également présents et ont apporté de nouveau leur table de presse.
Même scénario : des militants de DRY sont venus faire un esclandre pour nous faire dégager avec les mêmes arguments.
Nous leur avons dit que nous revenions de Barcelone et que sur la place de Catalogne, les "indignés" étaient ravis que nous exposions notre presse. La "commission logistique" nous avait prêté deux tréteaux et une planche pour présenter nos publications. Un "indigné" de la "commission art" nous a même prêté un mégaphone pour que nous organisions un débat autour de notre table de presse.
Une militante de DRY, complètement déchaînée, ne nous a pas crus et nous a demandé des "preuves". Nous avons alors sorti notre caméra vidéo pour lui montrer que nous ne bluffions pas. Nous avions filmé la Place de Catalogne à Barcelone (où on y voit très clairement la table de presse du CCI). Mais cette militante de DRY a fait la politique de l'autruche et a refusé de voir notre vidéo. Elle nous a alors demandé si les "indignés" de Barcelone nous ont remis un … "papier" autorisant notre table de presse ! Peut-être que DRY voulait un papier tamponné par la préfecture nous autorisant à diffuser notre presse ?
En réalité, ce que les militants de DRY à Paris ne voulaient surtout pas voir, c'est l'indignation des "indignés" de Barcelone contre les manœuvres de DRY qui, sous couvert d'apolitisme ou d'apartidisme, sabote les débats en cherchant à museler toutes les voix qui n'entonnent pas son credo à la gloire de la citoyenneté de la république bourgeoise. Voilà le vrai visage de la "démocratie réelle" de DRY !
En réalité, " l'extension internationale" du 15M n'est qu'une mascarade derrière laquelle DRY cherche à embrigader les exploités, et les jeunes générations de la classe ouvrière, dans un "front populiste", au coude à coude avec des "citoyens" appartenant aux partis de la gauche et de la droite du Capital (et même de l'extrême-droite, comme nous l'a d'ailleurs dit cette militante très "citoyenne" de DRY).
Contre la dictature de DRY, contre son "front populiste" réactionnaire, les exploités doivent opposer un front de classe !
CCI (14 juin)
Rubrique:
Sur l'hétérogénéité du mouvement des "indignés" et les manœuvres de Démocracia Real Ya (contribution au débat)
- 4537 lectures
Nous publions ci-dessous, comme contribution au débat, un texte rédigé par un jeune étudiant de Barcelone qui nous l'a adressé. Ce texte souligne à juste titre l'hétérogénéité du mouvement des "indignés". Il a surtout le mérite d'être très clair sur les manœuvres de Démocracia Real Ya, une véritable "auberge espagnole" soi disant "apolitique" (dans laquelle se retrouvent rassemblés dans un "front populiste", aussi bien des "citoyens" de droite, d'extrême-droite que de gauche et d'extrême gauche) .
15 M et Spanishrevolution
Contrôle, confusion et manipulation
Le Mouvement du 15M, dit Mouvement des Indignés, est né à Madrid le 15 mai 2011et trouve son origine dans la répression et les passages à tabac de la Puerta del Sol, après les affrontements entre la police et le Bloc autonome et libertaire qui suivirent la manifestation de Democracia Real Ya (DRY), dont ce Bloc se distinguait clairement en critiquant son discours insuffisant, réformiste et vide de conscience de classe (1). Le détonateur de ce mouvement qui s’enflamma comme une traînée de poudre dans tout l’Etat a cependant été en réalité son explosion médiatique. DRY ne put que constater la spontanéité des rassemblements et se refusa à en prendre la tête, non sans parvenir à faire reprendre son discours ambigu et citoyen par les porte-paroles présumés du mouvement.
Le manifeste de DRY ne demande pas la disparition du capitalisme, mais seulement l’amélioration des conditions de vie des exploités et plus de « transparence démocratique » (2). Parmi ses idéologues se distingue Enrique Dans, de NoLesVotes (2 3). Enrique Dans a suivi une formation d’entreprise à l’UCLA et à Harvard, il travaille pour de grands groupes financiers qui font partie du réseau oligarque responsable et défenseur de la situation actuelle d’injustice sociale (4).
Parmi les manifestations de soutien reçues parle 15M se distinguent pêle-mêle celles de Ynestrillas, de la Phalange espagnole des JONS, des Communautés chrétiennes populaires ou d’Eduard Punset, solide défenseur du Nouvel ordre mondial qui prit la parole avec les Indignés d’Oviedo et coïncida avec eux sur plusieurs points : listes électorales ouvertes, limitation du mandat présidentiel, réforme de la Loi électorale… (5) (6) (7), qui semblent être le fruit d’une indignation ultralibérale proche des idées anti-étatistes de Ron Paul (qui incarne le néofascisme déguisé en mouvement social). Ces faits permettent deux interprétations.
1) La première est que les rassemblements de Madrid, Barcelone et autres villes se font en marge de DRY et fonctionnent de façon assembléiste et autonome. L’infiltration de groupes d’extrême-droite serait donc une lamentable conséquence de l’hétérogénéité du mouvement qui a écarté tout sectarisme pour avancer dans la voie de la révolution « des gens ordinaires » (8).
2) La future convocation à une manifestation mondiale pour le 15 octobre (9), les rapports entre DRY et l’oligarchie financière, la symbolique anarcho-capitaliste présente dans plusieurs plateformes citoyennes étroitement liées (10), en accord avec le discours globaliste et interclassiste du « Nouvel ordre mondial » expliqueraient l’impact médiatique du mouvement. La dictature médiatique de l’État espagnol est bien connue ; seul un groupe puissant, avec une forte influence, riche, et ayant un intérêt à la chose est capable de faire changer le regard des medias sur la lutte sociale, tout comme d’empêcher la répression et la violence policière qui se sont déchainées en d’autres occasions lors d’actions populaires contre le système (lutte contre le TAV à Euskal Herria, manifestations étudiantes contre le Plan Bologne, grève générale du 29 Septembre, etc.).
La complicité de la dictature médiatique, tout comme les mots d’ordre « nous sommes apolitiques », « nous ne sommes ni de droite ni de gauche » et autres « nous n’avons pas d’idéologie » nous font suspecter que le 15M n’est qu’un projet de dissidence contrôlée fabriqué par le système capitaliste lui-même, afin de servir de soupape au mal-être social et le canaliser vers des positions acceptables pour le Pouvoir. L’élément le plus important dans ce sens est le pacifisme irrépressible qui s’impose, ajouté au rejet de toute collaboration avec les partis et syndicats minoritaires de la gauche radicale qui ont toujours eu un poids plus ou moins important dans la lutte de classe.
Il n’est cependant pas évident de contrôler un mouvement de masses. Dans certaines assemblées, l’existence d’un groupe de personnes qui monopolise les tours de parole est évidente, elle influe sur les commissions populaires et manipule les votes en cachant les résolutions derrière des termes abstraits et interprétables ou en limitant les options. A la Plaça de Catalunya (Barcelone), par exemple, nombreux sont les accords obtenus à partir de discussions privées et la centralisation de l’assemblée, ce qui la rend plus facilement manipulable (11). A Valence, par contre, les assistants ont détecté une sorte de secte qui limite la liberté d’expression (12), comme ce fut le cas lors de la macabre manœuvre pour faire approuver la « restructuration » du campement de Sol : le peuple vota pour choisir s’il devait partir le lendemain ou discuter, en commissions, sur comment et quand s’en aller sur la base d’un plan de réduction du campement, sans que soit évoquée l’option de résister indéfiniment comme c’était la volonté populaire. Les votes, cependant, durent être remis face aux protestations de personnes et de commissions rebelles (13) (Lire attentivement cette note).
Un effort démesuré semble être fait pour contenir la masse populaire dans le pacifisme, l’inaction, et la forcer à revenir à la routine de la production et de la consommation. La conclusion que peut tirer un authentique révolutionnaire de tout ce mouvement, après une analyse attentive, est claire. Ce mouvement nouveau est en gestation, il n’est pas orienté idéologiquement et contient une multitude de contradictions internes, mais à la longue ils ne pourront plus le contrôler ; c’est alors que commenceront réellement les évacuations en même temps que les informations sur de prétendues infiltrations « anti-système » qui justifieront la répression policière. Le peuple doit prendre en main ce mouvement pour le conduire jusqu’à la révolution sociale, chose impossible sans certains fondements historiques inexistants encore lors du 15-M. La lutte révolutionnaire se centre donc à présent vers la réalisation de deux objectifs :
1) l’évolution vers un discours de classe dans le mouvement (« nous ne sommes pas des citoyens indignés, mais des exploités qui se révoltent pour l’abolition des classes sociales ») ;
2) la création d’un contre-pouvoir populaire qui fasse perdre toute légitimité aux institutions dictatoriales de l’État espagnol : un réseau d’assemblées locales, librement organisées, dont l’objectif soit la destruction du système capitaliste et de son régime de contrôle social et de propriété privée pour construire une société horizontale, sans leaders ni hiérarchies, dans laquelle se respecte l’autonomie et l’autogestion des peuples et des territoires. Ce qui est impossible sans une grève générale illimitée.
Augusto Pelusita
1 https://www.alasbarricadas.org/noticias/?q=node/17536 [71]
2 NoLesVotes est un “mouvement citoyen” qui propose de ne pas voter pour les partis politiques majoritaires PSOE, PP et CiU lors des élections municipales et autonomiques en Espagne le 22 mai 2011 (ndt).
3 democraciarealya.es [72]
4 boltxe.info.
5 www.kaosenlared.net/noticia/indignado-punset-discursos-coincidentes-glob... [73]
6 www.eduardpunset.es/11280/general/no-tiene-sentido-que-cada-pais-vaya-a-... [74]
7 cadenaser.com/ser/2011/05/25/espana/1306281031_850215.html [75]
8 www.kaosenlared.net/noticia/las-revoluciones-gente-comun [76]
9 https://www.lavanguardia.com/noticias/20110530/54162716915/democracia-real-ya-prepara-una-manifestacion-mundial-para-el-15-de-octubre.html [77]
10 antimperialista.blogia.com/2011/052901-la-refundacion-del-capitalismo.-similitudes-entre-el-movimiento-15-m-el-anarcoca.php
11 barcelona.indymedia.org/newswire/display/421156/index.php [78]
12 barcelona.indymedia.org/newswire/display/422833/index.php [79]
13 www.kaosenlared.net/noticia/sol-nos-quedamos-victoria-popular-ante-amena... [80]
Rubrique:
Répression à Valence : solidarité avec les "indignés", indignation contre l'État démocratique !
- 1902 lectures
Une protestation pacifique avait été organisée devant le nouveau parlement régional de Valence. Elle demandait que les politiciens ne soient plus corrompus et qu'ils écoutent les citoyens, c'est-à-dire que cela apportait de l'eau au moulin aux illusions sur un État "expression de la volonté populaire".
Ce dernier a répondu de façon extrêmement pédagogique : plusieurs manifestants ont été frappés avec violence, traînés à terre, soumis à un traitement arrogant et brutal. 18 manifestants ont été blessés et cinq arrêtés. Ils n'ont pas été traités comme des "citoyens" mais comme des délinquants.
La nouvelle a provoqué une forte indignation.
Une manifestation a été appelée à 20h.15 à la station de métro Colon, devant la sous-délégation du gouvernement. Peu à peu se sont rassemblés des manifestants, un cortège venu de la place de la Vierge – où il y avait eu un rassemblement sur la langue valencienne – s'est joint au cortège, ce qui a provoqué de grands applaudissements. De façon improvisée, il a été décidé d'aller au commissariat de Zapodores où l'on supposait que se trouvaient les détenus. Le nombre de manifestants augmentait de minute en minute, les habitants du quartier de Ruzafa s'unissaient au cortège ou applaudissaient de leur balcon. On criait aux policiers : "Libérez les prisonniers, "Ne nous observe pas ! Toi aussi, on te vole !".
A l'arrivée au centre de Zapadores, la foule s'est regroupée dans un grand sit-in. On criait : "Nous ne partirons pas sans eux !", "S'ils ne sortent pas, nous, nous entrons !". Des nouvelles sont arrivées annonçant la solidarité de l'Assemblée de Barcelone1 ou la décision du campement madrilène d'apporter son soutien avec une nouvelle manifestation devant Les Cortes (Chambre des Députés)2. Au même moment à Barcelone, on criait les slogans : "Non à la violence à Saint- Jacques de Compostelle et à Valence !" (à Saint-Jacques de Compostelle, également, il y avait eu une charge policière).
Une heure plus tard, devant la nouvelle que les détenus – qui avaient été transférés à la cité de la Justice – allaient être libérés, la manifestation s'est dispersée, mais quelques centaines de manifestants se sont rendus à la cité pour attendre leur libération, laquelle a eu lieu peu après minuit.
De ce récit des événements, nous pouvons tirer quelques conclusions.
La première conclusion est la force de la solidarité. Ne pas laisser tomber les emprisonnés. Ne pas faire confiance au "bon sens de la Justice", les prendre en charge, les considérer comme les nôtres, concevoir leur vie comme notre propre vie. Tout au long de l'histoire, la solidarité a été une force vitale des classes exploitées et avec la lutte historique du prolétariat, elle a été placée au cœur de son combat et comme pilier d'une future société, la communauté humaine mondiale, le communisme.3 La solidarité est détruite par la société capitaliste qui est fondée sur tout le contraire : la compétition, le tous contre tous, le chacun pour soi.
Mais en même temps que la solidarité, se développe une indignation croissante contre l'État "démocratique". Les charges policières de Madrid et Grenade ainsi que le traitement inhumain infligé aux détenus de Madrid ont impulsé le mouvement du 15-M (15 mai). La cynique et brutale charge policière de Barcelone a montré le véritable visage de l'État démocratique, occulté quotidiennement au moyen des "élections libres" et de la "participation citoyenne". La répression de vendredi à Valence et Saint-Jacques de Compostelle et celle d'aujourd'hui samedi à Salamanque viennent de le mettre en évidence.
Il est nécessaire d'ouvrir la réflexion et le débat : les événements de Madrid, Grenade, Barcelone, Valence, Salamanque et Saint-Jacques seraient-ils des "exceptions" résultant d'excès ou d'erreurs ?
La réforme de la loi de la loi électorale, les "ILP" (Initiatives législatives populaires) et autres propositions du "consensus démocratique" pourraient-elles en finir avec ces exactions ou mettre l'État au service du peuple ?
Pour répondre à ces questions, nous devons comprendre ce qu'est l'État et qui il sert.
L'État est dans tous les pays l'organe de la minorité privilégiée et exploiteuse, l'organe du Capital. Cette règle générale s'applique aussi bien aux États qui utilisent les effluves déodorantes de la démocratie comme à ceux qui exhalent l'odeur fétide de la dictature.
L'État n'a pas comme ciment la "participation citoyenne", mais l'armée, la police, les tribunaux, les prisons, l'Eglise, les partis, les syndicats, les organisations patronales, etc., c'est-à-dire une immense toile d'araignée bureaucratique au service du capital qui opprime et suce le sang de la majorité et se légitime périodiquement avec le maquillage des élections, des consultations populaires, des référendums, etc.
Cette face obscure de l'État, occultée au quotidien par les lumières multicolores de la démocratie, apparaît clairement avec des lois comme la réforme des pensions de retraite, la réforme du travail, les nouvelles mesures adoptées récemment par le gouvernement qui permetent aux entreprises de recourir à l'ERE (Expediente Regulacion de Empleo)4 sans la moindre limitation ou encore les coupes dans les indemnisations des salariés licenciés, ramenées à 20 jours par année travaillée (au lieu de 45 auparavant). Ou quand la police distribue les coups de matraques "pour éviter des problèmes", selon l'euphémisme utilisé par Rubalcaba5. La répression n'est pas l'apanage de tel ou tel parti ou de telle ou telle idéologie, c'est la réponse nécessaire et consciente de l'État chaque fois que les intérêts de la classe capitaliste sont menacés ou simplement chaque fois qu'il s'agit de les renforcer et de les appuyer.
L'immédiatisme, l'empressement à "faire des propositions concrètes", a conduit à ce qu'un secteur important des assemblées – influencé par des groupes comme Democracia Real Ya ! – fasse confiance au miroir aux alouettes de la "réforme démocratique" : loi électorale, listes ouvertes, initiative législative populaire… Cela apparaît comme un chemin facile, concret, mais en réalité, cela ne conduit qu'a à renforcer l'illusion que l'État pourrait être amélioré, qu'on pourrait "le mettre au service de tous", ce qui conduit à se fracasser la tête contre les murs blindées de l'État capitaliste et… tendre la tête pour lui faciliter son travail !
Dans les assemblées, on a beaucoup parlé de "changer cette société", d'en finir avec ce système social et économique injuste, il s'est exprimée l'aspiration à un monde où n'existerait pas l'exploitation, où nous ne "serions pas des marchandises", où la production serait au service de la vie et non la vie au service de la production, où il existerait une communauté humaine mondiale sans États ni frontières.
Mais comment atteindre cet objectif ? Est-ce que la formule des jésuites suivant laquelle "la fin justifie les moyens" serait valable ? Est-ce qu'on pourrait changer ce système en utilisant les moyens de participation que, de façon trompeuse, il nous offre ?
Les moyens à employer doivent être cohérents avec la fin poursuivie. Tous les moyens ne sont pas valables. N'est pas valable l'atomisation et l'individualisme des isoloirs électoraux, n'est pas valable la délégation de la prise en charge des affaires entre les mains des politiciens, ne sont pas valables les manœuvres troubles de la politicaillerie habituelle, c'est-à-dire ne sont pas valables les moyens habituels du jeu démocratique.
Ces "moyens" éloignent radicalement du but poursuivi. Les moyens qui permettent de s'approcher de cet objectif – bien que celui-ci soit encore lointain -, ce sont les assemblées, l'action collective directe dans la rue, la solidarité, la lutte internationale de la classe ouvrière.
CCI (11/6/11)
1A Barcelone, plusieurs centaines de manifestants ont occupé la "Diagonale" (grande avenue qui traverse toute la ville) et les automobilistes les ont soutenus en klaxonnant.
2 Le jeudi, une manifestation avait déjà eu lieu contre la réforme du travail.
3 Voir notre texte d'orientation sur "La confiance et la solidarité dans la lutte prolétarienne [81]"
4 La nouvelle loi ERE autorise désormais les entreprises à faire passer des plans sociaux sans aucune justification préalable, alors que, auparavant, celles-ci devaient afficher des pertes dans leur bilan pour pouvoir licencier leurs salariés.
5 Ministre de l'Intérieur et successeur désigné de Zapatero.
Rubrique:
Le mouvement citoyen « Democracia Real Ya ! » : une dictature sur les assemblées massives
- 3685 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article réalisé par Acción Proletaria, organe de presse du CCI en Espagne.
Il y a juste quelques semaines, dans les principales villes d’Espagne se rassemblaient des milliers de personnes dans des assemblées où chacun pouvait prendre la parole et pouvait parler en toute confiance sur le manque d’avenir qu’on nous offre et sur comment faire pour y faire face. Et on écoutait avec respect. On discutait partout, en petits groupes, dans les bars, dans les « acampadas » (campements)..., des générations différentes (jeunes, retraités). Un sentiment grandissait : celui de l’émotion partagée, de l’unité, de la créativité, de la réflexion et du débat, dans un effort de prendre en charge la tâche gigantesque de mettre en avant une perspective face à ce « no future» que le capitalisme nous offre.
Aujourd’hui, il y a de moins en moins de gens à des réunions qu’on ne peut plus appeler assemblées, où la discussion n’est plus permise. Plusieurs commissions « filtrent » la prise de parole et on ne permet pratiquement pas de parler en quoi que ce soit d’une perspective de lutte sociale. On présente au vote ou au « consensus » des mots d’ordre démocratiques comme s’ils étaient l’expression du mouvement, alors que la majorité ne les connaît pas et ne les a pas discutés, même si beaucoup de gens sont ouvertement contre. Avec l’excuse de « l’apolitisme » on fini par faire la « même merde » politique que le PSOE et le PP1.
Qu’est-ce qui est arrivé ? Ont-ils raison ceux qui disent que depuis le début, ce mouvement était un mouvement citoyen de reforme démocratique, un montage ? Ou n’est-ce pas plutôt qu’il est en train de se réaliser une attaque contre les assemblées, un sabotage pour en finir avec les rassemblements massifs, la discussion et la réflexion, parce que cela fait peur à l’État et le met sous tension ?
Assemblées massives non pas « pour la démocratie », mais « malgré la démocratie »
Deux jours après la répression brutale des manifestations du 15 mai (le mouvement des « indignés » porte d’ailleurs pour nom en Espagne « le mouvement du 15-M »), des campements sont dressés à la Puerta del Sol, qui ont servi d’exemple à d’autres villes. De plus en plus de monde s’est rassemblé sur les places de ces villes en organisant des discussions et des assemblées. Toute cette mobilisation a été totalement spontanée. Ceux qui, comme ¡ Democracia Real Ya ! (DRY), veulent maintenant s’attribuer l’initiative du mouvement, mentent. Et pourtant, ces mêmes « ci-devant citoyens » ont voulu, à ce moment-là, laisser bien clair que le mouvement des « acampadas » n’était pas de leur fait. Comme c’est raconté dans un texte signé par « quelques anarchistes madrilènes » : « ils ont tout fait pour l’exprimer de la façon la plus dégueulasse qui soit : en se démarquant des incidents après la manif et en montrant du doigt ceux qu’il fallait montrer ».
L’aggravation des attaques à nos conditions de vie, le chômage, les expulsions, les coupes sociales, d’un coté, et, de l’autre, l’exemple de la place Tahrir, celui des luttes contre la « reforme » des retraites en France, des étudiants en Grande-Bretagne, des luttes en Grèce, des discussions sur les lieux de travail ou au sein des minorités révolutionnaires, les commentaires sur Facebook et Twitter et, bien sûr, le ras-le-bol du cirque parlementaire et de la corruption... tout cela et le reste a fait que, soudainement, le mécontentement et l’indignation ont éclaté, en déchaînant un torrent de vitalité, de combativité, en brisant la normalité démocratique de la passivité et du vote.
Des milliers, parfois des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées sur les places centrales des villes les plus importantes de l’Espagne, devenues des véritables « agoras ». Elles y venaient après le travail, ou restaient pour y camper, ou y allaient en famille… les gens se cherchaient… pour parler et parler encore. La parole « s’est libérée » dans les assemblées2. Même les plus anti-Etat se rendaient compte du fait que ce n’était point du tout un mouvement qui empruntait les voies démocratiques de l’État, comme le dit le même texte anarchiste cité précédemment : « C’est comme si, soudainement, la passivité et le chacun pour soi s’étaient brisés autour de la Puerta del Sol de Madrid... Les premiers jours, il suffisait d’un petit cercle pour parler de quelque chose et les gens tendaient l’oreille pour ensuite écouter et intervenir. C’était quelque chose qui est devenu normal de voir des gens les plus divers discutant en petits groupes. Les groupes de travail et les assemblées générales sont des événements massifs, rassemblant 500, 600 ou 2000 personnes (assises, debout, se resserrant pour mieux entendre), etc. Au-delà de ça, il y avait l’impression permanente de vivre une bonne chose, dans la meilleure ambiance, « quelque chose d’exceptionnel ». Tout cela a atteint son point culminant lors de la journée dite de réflexion. Entendre les quelques 20 000 personnes crier ‘Nous sommes des hors-la-loi’3 en jouissant du fait de passer par-dessus la loi, franchement, ça impressionne ».
Il est vrai que le mouvement n’a jamais mis en avant un affrontement ouvert contre l’État démocratique. En réalité, à chaque tentative d’arriver à des revendications concrètes, on les détournait vers la « reforme démocratique », en y incrustant les mots d’ordre de Democracia Real Ya !. Et ceci est normal, parce qu’il manque la confiance pour se lancer dans la lutte, il manque la clarté sur la perspective, et surtout, parce que la classe ouvrière n’a pas encore pu récupérer son identité en tant que sujet révolutionnaire qu’elle est pour qu’elle puisse prendre la tête d’un assaut révolutionnaire. Mais la discussion, la réflexion et la tentative de prendre en charge sa propre lutte, voilà justement le chemin pour raffermir cette confiance, cette clarté dans le processus de récupération de l’identité de la classe ouvrière, comme l’ont montré, surtout à Barcelone, les tentatives de certains secteurs en grève de rejoindre les assemblées, et la convocation à des manifestations unitaires pour des revendications du travail à Tarrasa4. La véritable confrontation avec l’État démocratique s’est faite dans les assemblées auto-organisées et massives qui se sont étendues à tout le pays et au delà.
Et c’est justement cela que l’Etat ne pouvait pas tolérer.
La réponse de l’Etat : reconstruire les voies démocratiques
Après une première tentative pour freiner les événements à la fin de la semaine électorale, en interdisant les rassemblements, une interdiction légale qui fut transgressée allègrement par la présence massive sur toutes les places à l’heure où ladite loi devait être respectée, c'est-à-dire au petit matin du samedi 21 mai, la stratégie a été de combiner l’attente d’un affaiblissement naturel du mouvement à cause de la fatigue et de la difficulté à mettre en avant une perspective de lutte, avec le sabotage du mouvement de l’intérieur.
Au moment où, une semaine après les élections municipales, le mouvement commençait à s’affaiblir, l’Etat a déclenché à Madrid et à Barcelone, une stratégie avec une grande répercussion médiatique.
À Madrid, on a encouragé les plaintes des commerçants et des « petits entrepreneurs » de la Puerta del Sol, de manière à culpabiliser les « campeurs » comme s’ils en rajoutaient à la crise, et on a mis en avant une stratégie visant à démanteler les concentrations massives pour n’y laisser « qu’un point d’information ».
À Barcelone, l’intervention calculée de la police catalane5, même si momentanément elle a eu comme effet d’augmenter la présence aux rassemblements6, elle a réussi néanmoins à dévoyer complètement les discussions vers la revendication démocratique d’exiger la démission du « ministre » de l’Intérieur de la Catalogne, Felip Puig, en y introduisant le discours de l’opposition contre le nouveau gouvernement catalan de la droite nationaliste.
Mais tout cela n’aurait pas eu le même impact s’il n’y avait pas eu le travail de sabotage de l’intérieur de la part de ¡ Democracia Real Ya !.
Le sabotage de l’intérieur : la dictature de ¡ Democracia Real Ya !
Si les premiers jours, face à l’avalanche d’assemblées, ¡ Democracia Real ya ! (DRY) n’a pas eu d’autre solution que de ne pas se faire voir sur le devant de la scène, ceci ne veut pas dire qu’elle n’a pas essayé de prendre des positions dans les commissions clé des campements et de diffuser des positions « citoyennes » pour reformer le système, tellles que le fameux « décalogue » ou d’autres trucs du même acabit. Par contre, tout cela, la DRY le faisait sans se montrer ouvertement, sous couvert du refus des partis et en défendant l’apolitisme, ce qui empêchait les autres alternatives politiques de diffuser leurs positions, alors que la DRY les diffusait sans retenue et sans signature.
Des anarchistes de Madrid avaient déjà détecté cette ambiance au début du mouvement : « Au sein de beaucoup de commissions ou des groupements on voit de tout : des disparitions fortuites de comptes rendus, des personnalismes, des gens qui s’accrochent au rôle de porte-paroles, des délégués qui taisent des choses lors des assemblées générales, des commissions qui ignorent les accords adoptés, des petits groupes qui font leurs petites affaires dans leur coin, etc. Beaucoup de ces choses sont sans doute le fruit de l’inexpérience et des égos, d’autres paraissent sorties directement des vieux manuels de manipulation des assemblées ».
Mais il a fallu attendre les premiers symptômes de reflux du mouvement pour voir une véritable offensive des gens du « mouvement citoyen », la DRY en tête, contre les assemblées.
À la Puerta del Sol, c’est eux qui ont pris en charge les plaintes des commerçants et ont poussé au démantèlement du campement et de n’y laisser qu’un « point d’information ». C’est eux qui filtrent les interventions dans les assemblées, où d’ailleurs on ne discute plus que les propositions des commissions, qu’ils contrôlent. Ils présentent ouvertement leurs positions comme si elles étaient l’expression du mouvement, sans qu’elles aient été discutées dans les assemblées. Ils convoquent des réunions de coordination des assemblées de quartier sans que celles-ci aient élu leurs délégués pour les représenter, et ils ont même convoqué une assemblée de coordination nationale pour le 4 juin dont on n’a pratiquement pas entendu parler dans les assemblées générales... Et on voit la même dynamique dans toutes les grandes villes.
À Barcelone, la liberté de parole a été prise en otage. Il ne reste aux assemblées qu’à se prononcer sur les propositions élaborées à leur insu. La discussion a été remplacée par des conférences de « professeurs intellectuels ». Ici, l’un des symptômes les plus sensibles de l’offensive contre les assemblées est le poids pris par le nationalisme. La première semaine après le 15 mai, des milliers de personnes remplissaient la place de Catalogne où l’on discutait en plusieurs langues, où l’on traduisait également en des langues différentes les communiqués qu’on recevait et qu’on émettait. Pas un seul drapeau catalan. Récemment, par contre, il a été voté de parler exclusivement en catalan.
À Valence, c’est la même chose si ce n’est pire. Nous laissons la parole à un texte intitulé Contrôle des assemblées à Valence, qui circule sans signature : « Depuis le 27 mai, la dynamique interne du campement et des assemblées quotidiennes a changé radicalement... on ne peut presque pas parler en son sein de politique ni de problèmes sociaux... On peut résumer la situation ainsi : une commission appelée « de participation citoyenne » et une autre appelée « juridique », au total quelque 15/20 personnes, ont pris le contrôle total de la modération des assemblées, ce sont des « modérateurs professionnels » qui s’imposent aussi dans les petits groupes et les commissions... On a retiré de la place toutes les affiches qui avaient un contenu politique, économique ou tout simplement social. C’est devenu maintenant une espèce de foire alternative... Il n’y a pas de liberté d’expression ni sur la place ni dans l’assemblée. Ils ont instauré, dans les commissions où ils ont pu le faire, le système du « consensus a minima » de telle sorte qu’on ne puisse jamais arriver à des accords avec un contenu... Ils ont présenté un document qu’ils prétendent approuvé aujourd’hui, appelé « Citoyen, participe ! » où, tout en l’ornant de bien jolies choses, on établit que seules les commissions ont le droit de présenter des propositions aux assemblées... Il est établi dans ce document que les commissions fonctionneront dorénavant et obligatoirement, par consensus a minima... c’est un bouclage total du contrôle pour commencer à vider le mouvement de son contenu ». Et, si ce n’était pas suffisant, aujourd’hui même, ces « citoyens » ont transformé une manifestation de retraités contre les mesures prises sur les retraites, en protestation contre l’article 87-3 de la Constitution ; tandis que les retraités revendiquaient « une pension minimale de 800 € » et « pour la retraite à 60 ans », le mouvement citoyen proclamait « nous sommes prisonniers depuis 1978 »7 pour réclamer une constitution plus représentative.
Mais c’est à Séville où la DRY s’est montrée le plus à visage découvert en demandant sans scrupules un chèque en blanc à l’assemblée, pour faire et défaire à sa guise. Elle a même osé demander aux participants aux assemblées de s’inscrire massivement derrière ses sigles.
Ce qui est en jeu
Il est évident que la stratégie de la DRY, au service de l’Etat démocratique de la bourgeoisie, consiste dans le fait de mettre en avant un mouvement citoyen de reformes démocratiques, pour essayer d’éviter que ne surgisse un mouvement social de lutte contre l’État démocratique, contre le capitalisme. Les faits ont montré, cependant, que lorsque l’énorme malaise social accumulé trouve un terrain aussi étroit soit-il pour s’exprimer, les pleurnichards de la démocratie « plus-que-parfaite » sont écartés sans le moindre égard. Ni la DRY ni l’Etat démocratique ne peuvent stopper le développement du mécontentement social et de la combativité ; ils vont essayer, par contre, de mettre devant lui toutes sortes d’entraves.
Et la charge contre les assemblées en est une. Pour une « large minorité » (qu’on nous permette d’utiliser cette expression paradoxale), ces assemblées sont une référence pour la recherche de la solidarité, pour raffermir la confiance, pour l’apprentissage et la pratique de la discussion en assemblées, pour prendre en charge les luttes contre les attaques sans merci contre nos conditions de vie. Continuer à discuter comme dans les assemblées, même dans des rassemblements plus petits, c’est le chemin pour préparer les luttes futures. Organiser des assemblées massives et ouvertes chaque fois qu’une lutte surgit, voilà l’exemple à suivre. Le sabotage de la DRY en imposant ce mouvement « citoyen » peut faire qu’une partie de cette « minorité croissante » perde espoir et pense que « tout cela n’a été qu’un rêve ». Ces « citoyens » ne pourront pas effacer l’histoire comme on efface un concurrent d’un programme de télé-réalité, mais ils peuvent créer la confusion dans les mémoires.
C’est pour tout cela que l’alternative est celle de défendre les assemblées là où il reste un tant soit peu de vitalité, de combattre et de dénoncer le sabotage de la DRY, et d’appeler à continuer la lutte quand l’occasion se présente, avec le regroupement de minorités ou dans des assemblées lors des luttes, avec cette dynamique de prendre en charge le débat et le combat.
Lutter contre le capitalisme est possible ! L’avenir appartient à la classe ouvrière !
CCI (3 juin)
1 « PSOE y PP la misma mierda es » est un slogan contre le « bipartisme » qui est devenu emblématique de ce mouvement. [NdT]
2 « Libérer la parole » a été l’un des mots d’ordre des récentes assemblées lors du mouvement contre la « reforme » des retraites en France.
3 Dimanche 22 mai, il y a eu des élections locales en Espagne. La loi stipule que le samedi précédant (le 21), c’est le jour de « réflexion » où tout rassemblement est interdit…[NdT]
4 Ville industrielle de la banlieue barcelonaise [NdT]
5 La bourgeoisie en Espagne n’est pas aussi stupide en ce qui concerne l’affrontement avec la classe ouvrière, et encore moins en Catalogne, et il est difficile de croire que, peu de jours après la répression des manifestations du 15 mai, qui a entraîné les mobilisations, elle refasse la même gaffe. De plus, ce qui démontre qu’il y a toujours une exception à la règle, les déclarations pathétiques à la télévision du porte-parole du Parti socialiste, dans l’opposition en Catalogne, qui a parlé avec mépris des gens du campement, en disant que le PS était d’accord avec leur expulsion « mais avec d’autres manières », démontre que ce plan d’évacuation avait été discuté entre le gouvernement et l’opposition.
6 La répression a été brutale (il y a encore eu quelques blessés graves), ce qui a poussé à la solidarité entre les différentes assemblées.
7 Date de la mise en vigueur de la dernière Constitution espagnole rédigée après la mort du dictateur Franco. [NdT]
Rubrique:
A Oakland (Etats-Unis), le mouvement d'occupation cherche des liens avec la classe ouvrière
- 1511 lectures
Vous trouverez ci-dessous la traduction d'un article d'Internationalism, organe de presse du CCI aux Etats-Unis, qui s'appuie très largement sur différents textes produits par l'assemblée générale des Occupy Oakland.
Nous publions ici les appels de "l'Assemblée Générale pour Occuper Oakland" pour lancer une grève générale le 2 novembre. C'est un développement significatif que ce mouvement d'occupation aux Etats-Unis, qui tout en étant généralement critique par rapport au 'capitalisme' a également été entravé par une vision très confuse de ce qu'est réellement ce système d'exploitation, et en particulier de la seule façon de s'y opposer : à travers la lutte des classes. Mais cet appel, venant après un certain nombre d'expériences particulièrement amères de la répression policière, marque une véritable avancée en ce sens ; il est un appel direct à la classe ouvrière locale pour soutenir le mouvement à travers la grève. La réponse à l'appel de l'AG a été très impressionnante, non pas tant par le nombre de lieux de travail fermés, qui semble avoir été inégal, mais par la volonté de milliers de travailleurs de rejoindre les manifestations, même souvent après le travail. La manif du soir sur le port a été planifiée afin de permettre à ceux qui travaillent d'y participer et a attiré plusieurs milliers de personnes (selon certaines estimations, jusqu'à 20 000). Bien que le port soit plus ou moins resté ouvert pendant la journée, les manifestants ont réussi à persuader les dockers et les camionneurs de se joindre à eux et le port a été fermé pour la nuit. C'est ainsi que le Los Angeles Times a décrit les événements ainsi : « Comme des milliers de manifestants convergeaient vers le port, les camionneurs se sont battus pour venir avec leur véhicule. D'autres, comme Mann Singh, se sont plantés autour, un large sourire sur leur visage. Un résident de 42 ans, de Pittsburgh, a dit qu'il était arrivé à 16h30 avec son camion vide, dans l'espoir de le garer et de rentrer à la maison, mais comme les manifestants se rassemblaient, il s'est arrêté pour les soutenir. »
Quelles que soient les critiques d'ordre secondaires que nous puissions faire des textes qui suivent, nous ne pouvons qu'appuyer leur esprit et leur approche globale :
Textes des Occupy Oakland
1. Proposition
Nous, en tant qu'occupants de 'Oscar Grant Plaza', proposons que le mercredi 2 novembre 2011, nous libérions la population d'Oakland et arrêtions le 1%1.
Nous proposons une grève générale de la ville et nous proposons d'inviter tous les étudiants à sortir des universités. Les travailleurs, au lieu d'aller au travail et les étudiants, au lieu d'aller à l'université, convergeront vers le centre-ville d'Oakland pour fermer la ville.
Toutes les banques et les entreprises devront fermer pour la journée, sinon nous marcherons sur elles.
Nous appelons à une grève générale, mais nous demandons aussi beaucoup plus. Les gens qui s'occupent de leur quartier, les écoles, les organismes communautaires, les groupes associatifs, les lieux de travail et les familles sont encouragées à s'organiser eux-mêmes d'une manière qui leur permette de participer au bouclage de la ville de telle sorte qu'ils puissent le faire facilement.
Le monde entier a les yeux tournés vers Oakland. Montrons-leur ce qui est possible.
Le Conseil de Coordination de la Grève commencera à se réunir tous les jours à 17 heures sur Oscar Grant Plaza avant l'Assemblée Générale de 19 heures. Tous les participants à la grève sont invités. Restez à l'écoute pour plus d'informations et rendez-vous pour mercredi prochain.
2. Comment vous pouvez participer à la grève générale !
1er novembre 2011
LES MOYENS DE PARTICIPER A LA GREVE GENERALE DU 2 NOVEMBRE ET A LA JOURNEE D'ACTION appelée par 'Occuper Oakland'
'Occuper Oakland' appelle à ce qu'il n'y ait ni travail, ni école le 2 novembre, dans le cadre de la grève générale. Nous demandons que tous les travailleurs en grève prennent un congé de maladie, un jour de congé ou qu'ils aillent tout simplement se promener en dehors de leur travail avec leurs collègues. Nous demandons également que tous les étudiants sortent des écoles et rejoignent les travailleurs et les membres de la communauté du centre-ville d'Oakland. Toutes les banques et les grandes entreprises doivent fermer pour la journée ou les manifestants marcheront sur elles.
L'Assemblée de Grève de 'Occuper Oakland' a fait vœu de rester sur les lignes de piquet et d'occuper toutes les entreprises ou écoles où les employés ou étudiants seraient sanctionnés pour avoir participé à la grève générale du 2 novembre. Si vous êtes l'objet d'une quelconque mesure disciplinaire, s'il vous plaît, faites-le savoir sur le mail [email protected] [82].
'Occuper Oakland' reconnaît que tous les travailleurs, étudiants et membres de la communauté ne peuvent pas faire grève toute la journée du 2 novembre, et nous saluons toute forme de participation qui leur semblera appropriée. Nous les encourageons à nous rejoindre avant ou après le travail ou pendant leurs heures de repas.
Voici quelques idées d'actions pour participer à la grève :
Se rassembler dans le centre-ville d'Oakland pour aider au bouclage de la ville :
Rejoindre les rassemblements massifs sur la 14ème rue et à Broadway à 09h, 12h, 17h. Des rallyes rassemblements de grève auront lieu à ces heures avec des orateurs politiques et les micros seront ouverts afin que chacun puisse faire entendre sa voix. Il y aura également des annonces d'actions faites sur des estrades pour ceux qui sont intéressés à participer à des piquets de grève et à la fermeture des banques et des grandes entreprises.
Conduire une marche à partir de votre quartier, lieu de travail, école, centre communautaire, lieu de culte, etc., vers le centre-ville d’Oakland pour rejoindre l'un des trois rassemblements massifs. Amusez-vous et donnez de la voix le long de la route pour faire savoir aux gens pourquoi vous marchez sur le centre-ville !
Former un blocus mobile ou piquet volant qui peut prendre le contrôle des carrefours importants du centre-ville avec des fêtes de rues et autres moyens créatifs pour faire entendre nos voix et boucler la ville.
Il y aura de nombreux piquets et de nombreuses actions devant les banques et les sociétés à travers le centre-ville, mais nous avons besoin d'être plus nombreux ! Faites venir un groupe d'amis, des membres de la famille, des collègues ou camarades de classe pour former un groupe d'affinité et faire entendre nos voix et ressentir notre présence à l'un de ces endroits au centre-ville. Faites connaître votre action aux estrades de la 14e rue et de Broadway, afin qu'ils puissent l'annoncer à la foule.
Il y a beaucoup d'autres actions autonomes prévues pour la journée qui auront lieu au centre-ville. L'une d'elles est la marche anti-capitaliste à 14h, dont le rassemblement se fera à l'intersection de Broadway et de Telegraph et une autre est celle du bloc féministe et homosexuel contre le capitalisme qui se réunira à 14h30 entre la 14ème rue et Broadway.
Rejoindre les marches du centre-ville pour boucler le port d'Oakland. Ces marches se finiront à 16h et une autre de 2 miles partira à 17h vers le port pour manifester sa solidarité avec les débardeurs et arrêter les activités du soir sur le port.
Rejoindre le trajet à vélo de 'Critical Mass' à partir de 16h qui va de la 14e rue et de Broadway pour aller vers le port pour participer à son bouclage.
Mieux vaut ne pas conduire dans le centre-ville : il est probable que de nombreuses rues seront bloquées à la circulation de sorte qu'il est préférable de prendre le vélo ou les transports en commun. Il sera également utile d'avoir un vélo pour vous déplacer entre les actions ou marcher sur le port.
Passez à l'action dans vos quartiers et leurs collectivités :
Rassembler les voisins, collègues, camarades de classe et organiser des groupes de marche dans son quartier pour un moment festif, sensibiliser et encourager les autres à vous rejoindre dans les rues ! Apporter de quoi faire du bruit, des écriteaux, des banderoles et faire savoir à votre communauté pourquoi vous participez à la grève.
S'arrêter devant les banques, les chaînes de magasins, les stations-service, les grands médias commerciaux, etc. pour protester et installer des piquets de grève.
Se rassembler dans les centres de quartiers et aux angles des principaux carrefours pour organiser des débats, des barbecues et des fêtes de rue. Y faire entendre votre voix et sensibiliser les gens en réclamant des espaces où les membres de la communauté peuvent vous rejoindre et parler des questions qui les affectent le plus et sur comment on peut s'organiser ensemble pour construire un puissant mouvement.
Si vous devez faire des courses, ne dépenser de l'argent que dans les commerces de quartiers et autant que possible, n'y acheter que des produits locaux.
Les organisations sans but lucratif et communautaires :
Utilisez vos données personnelles et organisez vous à travers les réseaux sociaux des médias (sites Internet, Facebook, Linked-in, des bulletins électroniques, etc) pour soutenir les actions et permettre à vos circonscriptions d'être tenu au courant de ce qui se passe dans les rues d'Oakland.
En cas de violences policières, contacter votre réseau organisé pour dénoncer la répression policière et appeler à la libération de tous les grévistes arrêtés.
Fournir des ressources pour permettre aussi la participation de ceux qui vous entourent : donnez vous du temps pour pouvoir participer à des actions directes; encourager le travail qui concourt au succès de la grève générale et donnez vous un objectif d'occupation.
Soyez prêts :
A apporter des matériaux pour faire des écriteaux : du papier carton, des marqueurs, de la peinture, des bombes à peinture, des chevilles, etc.
A apporter de la nourriture et de l'eau à partager !
A apporter de quoi faire du bruit, systèmes de sonorisation et autres moyens que nous pouvons transformer au centre-ville en une célébration de notre pouvoir collectif.
Notez ce numéro vers le bas de votre corps en cas d'arrestation: 415.285.1011 Ce numéro pourra être composé toute la journée et permettra de coordonner le soutien juridique pour les personnes arrêtées pendant la grève.
Se souvenir de ces quatre points communs agréés par l'Assemblée Générale de la Grève :
Solidarité avec les mouvements d'occupation du monde entier !
En finir avec les attaques de la police sur nos communautés !
Défendre les écoles et les bibliothèques d'Oakland !
Contre un système économique basé sur le colonialisme, l'inégalité et le pouvoir des entreprises qui perpétue toutes les formes d'oppression et de destruction de l'environnement !
Quelques chants pour la grève
«Grève, Occupation, Verrouillage ! Oakland est une ville populaire »
«Chaque heure, chaque jour ! L'occupation est là pour rester ! »
«Tout occuper! Libérez Oakland. »
«Politiciens et banquiers, menteurs et voleurs, nous vous reprenons tout! Nous ne disons pas s'il vous plaît ! »
"Plus de flics, nous n'en avons pas besoin! Tout ce que nous voulons, c'est la liberté totale. »
« Fermez OPD! Non à la Bibliothèque publique ! »
«Allons à Oakland ! Allons-y ! [Clap] [clap] »
1 NDLR : Ceux qui manifestent et occupent les places aux Etats-Unis se font nommer les 99% (autrement dit, le "peuple"), et affirment se battre contre ceux qui représentent le 1% restant, qui dirigent le pays et s'enrichissent.
Géographique:
- Etats-Unis [83]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]
Communiqué sur les méthodes policières rédigé par des personnes arrêtées à la suite de la manifestation du 15 mai 2011 à Madrid
- 1729 lectures
Ce qui se passe en Espagne[1] est parti d’une manifestation « contre les politiciens », organisée par Democracia Real Ya ! (« Démocratie réelle tout de suite ! »). Ces manifestations du 15 mai ont eu un succès spectaculaire : le mécontentement général, le malaise face à l’avenir ont trouvé dans ces manifestations une issue inattendue. Tout aurait dû apparemment s’arrêter là mais, à Madrid et à Grenade, à la fin de la manifestation, il y a eu de violentes charges de police avec plus de 20 détenus durement maltraités dans les commissariats. Ces détenus se sont regroupés dans un collectif qui a adopté un communiqué, dont la diffusion a causé une forte impression et une réaction foudroyante d’indignation et de solidarité. Un groupe de jeunes a décidé d’établir un campement sur la « Puerta del Sol » de Madrid (Place du centre historique). Ce même lundi, l’exemple madrilène s’étend à Barcelone, Grenade et Valence. Une nouvelle flambée de répression n'a fait que réchauffer les esprits et, depuis lors, les rassemblements n’ont fait que s’étendre à plus de 70 villes et leur affluence n’a fait que croître à un rythme vertigineux. Nous publions ci-dessous ce Communiqué.
Nous voulons écrire ces quelques lignes pour exprimer nos sentiments face à ce qui vient de se passer. Nous sommes toutes des personnes très différentes les unes des autres, les unes se définissant comme anarchistes, d’autres comme altermondialistes, ou encore comme féministes ou écologistes, des personnes favorables à une démocratie réelle, etc., mais nous tous avons subis dans nos chairs les mêmes abus policiers injustes et disproportionnés. Pour commencer, il y en a qui n’ont même pas participé à la manifestation, et ceux qui ont participé affirment avoir le droit de participer à des actions politiques ; mais on a tous le même sentiment : le mécontentement par rapport à nos conditions de vie (la difficulté pour trouver du travail, la précarité, le fait de ne même pas pouvoir rêver à réaliser nos moindres projets à cause des inégalités économiques et toute cette éducation basée sur la consommation à outrance, le fait d’être réprimés à cause des nos idées politiques ou tout simplement de vouloir être différents de ce qui nous entoure). Nous sommes face à une perspective sans le moindre espoir, sans un futur qui nous encourage à vivre tranquillement et à pouvoir nous consacrer à ce qui nous tient à cœur à chacun.
C’est pour tout cela que la plupart d’entre nous sont allés à la manifestation du 15 mai : pour essayer de remplacer ce système par quelque chose de plus juste et équitable, et quelle a été la riposte ? : la répression de la part des forces de l’ordre de l’État. Ce fut quelque chose de honteux que de voir des hommes surexcités, habillés et armés pour faire peur et frapper sur tout ce qui bougeait, sur toute personne un tant soit peu différente des modes imposées par les marchés, de voir une police, supposée être là pour maintenir l’ordre et la paix sociale, qui frappait impunément tous ceux qui se trouvaient à leur portée, des policiers avec des visages pleins de haine, avec des pupilles dilatées, peut-être à cause des stimulants qu’ils avaient consommés, toute une terreur qu’ils utilisent pour défendre leurs banquiers, leurs politiciens, leurs grands entrepreneurs.
Nous, les personnes arrêtées, affirmons à l’unanimité que la police a agi d’une façon disproportionnée et aléatoire :
1. Un copain est arrêté ; dans le fourgon, les mains liées, des policiers prennent sa tête et la cognent sur les sièges du fourgon, tout en l’insultant et lui disant que les « locks » qu’il porte, c’est « antihygiénique », et que c’était pareil s’il n’avait rien fait parce qu’il était un porc et que cela suffisait pour lui cogner dessus. Et au moment où les coups cessent de pleuvoir, il y a un autre policier anti-émeutes qui rapplique pour lui dire d’arrêter de se plaindre, « parce qu’il n’y en a qu’un seul qui t’a tapé dessus ».
2. Ils disent à un autre qui portait des pantalons bouffants : « Normal que tu ne trouves pas du travail avec ces pantalons de pédé que tu portes ! », avec d’autres commentaires du même tonneau, homophobe et machiste.
3. Un autre copain qui rentrait chez lui après la manif accompagné de sa fiancée, voit comment des policiers s’acharnent à matraquer un adolescent, il leur demande d’arrêter et c’est lui alors qui est frappé et arrêté pour « s’être mêlé de ce qui ne le regarde pas »
4. Deux autres, en voyant les policiers anti-émeutes frapper les gens assis au milieu de l’avenue Gran Vía, interviennent pour aider les jeunes assis par terre à s’en tirer. Ils sont arrêtés par des policiers en civil, habillés style skinhead, qui ne se sont identifiés comme des policiers qu’après les arrestations.
5. Un autre d’entre nous, rentrant de jouer au foot, a eu la malchance de vouloir prendre un train de banlieue à la station de Sol. On l’a arrêté « parce qu’il se trouvait là au mauvais moment et au mauvais endroit », comme on lui a dit plus tard, devant nous tous, en se foutant de lui, en l’humiliant au moment où ils ont vu le contenu de son sac à dos avec tout son équipement de foot, chaussures, protège-tibias, habits et ballon, pour finir en lui lançant la bonne blague : « Ne te plains pas, comme ça, tu auras une histoire à raconter à tes petits-enfants ! »
6. La plupart des détenus n’avait jamais été arrêtés ; ils demandaient quand est-ce qu’ils pourraient téléphoner à un proche. On leur répondait : « Vous regardez trop de films américains, ici, en Espagne, vous n’avez pas le droit de passer des appels extérieurs. »
7. Dans la Brigade de Renseignements de la Région de Madrid, située dans le quartier de Moratalaz, nous ne pouvions pas lever le regard du sol au risque de recevoir des coups. C’était comme dans les films de terrorisme, les flics étaient tous cagoulés, et même comme ça, ils nous interdisaient de les regarder en face quand ils nous demandaient de leur répondre. Malheureusement, la réalité a dépassé la fiction.
8. Jetés par terre, avec les menottes aux poignets, face contre terre, un autre copain a prévenu qu’il avait des problèmes cardiaques, qu’il avait été opéré et qu’il prenait des médicaments. Il a demandé à être transporté à l’hôpital ; les agents lui ont répondu en se moquant de lui et en lui refusant toute assistance médicale. Deux heures après, un chef s'est décidé à appeler le SAMU, qui est arrivé une heure plus tard. Les flics trouvaient la situation marrante et ont décidé d’appeler notre copain « Monsieur Syncope » avec des blagues et des commentaires. Finalement, il fut transporté à l’hôpital, où on l’a mis quelque temps sous perfusion et on lui a donné des médicaments. De retour en prison, on a lui a confisqué ses médicaments en lui disant que, quand il en aurait besoin, il n’avait qu’à les demander. Au bout de quelques heures, il y a eu un changement d’équipe. Personne n’avait informé la nouvelle équipe de ce cas, de sorte qu’au moment de la prise de la nouvelle dose par notre camarade, on la lui refusa. Il a eu une crise de panique et ils ont fini par accepter sa demande au bout de plus de deux heures pendant lesquelles nous, les autres détenus, n’avons pas arrêté de crier pour qu’on vienne à son aide.
9. Au début, beaucoup d’entre nous étions très paniqués et, dans un premier temps, on n’a pas voulu qu’on avertisse nos parents ou un médecin. Après le choc initial, nous avons sollicité ces droits, mais un des responsables du commissariat de Moratalaz a crié ces mots doux : « Bande de pédés, petits merdeux de mes deux, je vais vous mettre un coup de pied au cul qui finira par vous sortir par la bouche. D’abord nous ne voulez pas qu’on avertisse maman et, maintenant, au bout de 5 minutes, vous le voulez, mais où est-ce que vous croyez que vous êtes, bande de cons ? Allez vous faire foutre ! »
10. Pendant tous les déplacements en voiture, ils conduisaient exprès de façon dangereuse, à grande vitesse, à grands coups de volant et en faisant crisser les freins, de sorte que nous, qui étions à l’arrière du fourgon, nous nous cognions contre les portes et les cloisons.
11. Enfin, voici quelques autres échantillons des vexations et des intimidations psychologiques qu'ils nous ont fait subir :
- Ils disaient à l’un d’entre nous : « Tu as eu de la chance, j’aurais pu te mettre deux balles dans le buffet. » ;
- Pendant qu’ils nous traînaient vers le haut de l’escalier, ils disaient : « On pourrait les jeter par la fenêtre, ce n’est que des « rouges » de merde » ;
- Nous avons pu voir les mauvais traitements et le racisme vis-à-vis d’autres personnes arrêtée ;.
- Ils ont refusé de donner des protections hygiéniques à une camarade qui en avait besoin ;
- Ils ont altéré notre notion du temps en perturbant nos cycles de sommeil ;
- Ils n’ont pas arrêté de se moquer du choix végétarien de certaines d’entre nous, en proférant des railleries comme : “Regarde, c’est celle-là la végétarienne.” “Normal, avec cette gueule d’enterrement qu’elle traîne ». Il va sans dire qu’au moment de manger, ils n’ont pas tenu compte de ce choix. En plus, ils ont dit qu’on n’aurait pas beaucoup à manger, en ajoutant en s'adressant aux filles « avec ce régime, vous serez bonnes à sauter cet été ».
1. Voir: /icconline/2011/dossier_special_indignes/mouvement_des_indignes_en_espagne_l_avenir_appartient_a_la_classe_ouvriere.html [69]
Rubrique:
De la place Tahrir du Caire à la Puerta del Sol de Madrid
- 2733 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un l'article sur le mouvement des indignés, réalisé dès le 25 mai par Acción Proletaria, organe de presse du CCI en Espagne.
Les événements qui se déroulent actuellement en Espagne, quel que soit leur dénouement final, quelle que soient les confusions ou les illusions de leur protagonistes, sont en train de construire l’histoire, sont un fait historique de premier ordre dans l’évolution de la lutte de classe.
Un maillon dans la chaîne internationale des luttes de classe
Les événements sont expliqués par des facteurs prétendument nationaux, ce qui se concrétise dans l’expression maintenant si connue de la « Spanish Revolution ».
Rien de plus faux et trompeur ! Le désenchantement vis-à-vis de ce qu’on nomme « classe politique » est un phénomène mondial ; il est très difficile de trouver un pays où les habitants fassent confiance à leur « représentants », qu’ils soient élus à travers la mascarade électorale ou qu’ils soient imposés par voie dictatoriale. La corruption, qui a été proposée comme un autre motif de révolte, est également un phénomène mondial auquel presque aucun pays n’échappe1. Il est vrai qu’autant dans la « qualité » des politiciens que dans la corruption, il y a des degrés différents selon les pays, mais ces différences sont l’arbre qui cache le phénomène historique et mondial de la dégénérescence et du pourrissement du capitalisme.
D’autres raisons ont été mises sur la table, tels que le chômage massif, surtout chez les jeunes. On parle aussi de précarité, des coupes sociales généralisées qui ont été réalisées et d’autres prévues pour après les élections. Tout cela n’est pas une particularité espagnole. Nous le voyons en Grèce, en Irlande ou au Portugal, mais aussi aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne. S’il est vrai que ces attaques contre la classe ouvrière et contre la grande majorité de la population ont des degrés différents selon les pays -le capitalisme est une source permanente d’inégalités- c’est une erreur de dire qu’un tel est moins pauvre que tel autre, alors que la tendance est à être tous de plus en plus pauvres !
Le visage sinistre du chômage, on le voit autant à Madrid qu’au Caire, autant à Londres qu’à Paris, autant à Athènes qu’à Buenos-Aires. Il est absurde et stérile de rechercher avec insistance tout ce qui différencie la colère, alors que nous devons rechercher ce qui nous unit. Dans la situation actuelle, on voit avec de plus en plus d’évidence que ce qui domine, c’est la dégradation générale des conditions de vie des exploités du monde entier. Nous nous trouvons tous réunis dans la même chute vers l’abîme, ce qui ne se concrétise pas seulement à travers le chômage, l’inflation, la précarité, la suppression d’allocations sociales, mais aussi dans la multiplication de désastres nucléaires, des guerres et à travers une forte dislocation des rapports sociaux accompagnée d’une désintégration de toute valeur morale.
Il est évident que la pression de l’idéologie dominante, étroitement nationaliste, essaie d’enfermer le mouvement que nous sommes en train de vivre dans les murs étroits d'une « Spanish Revolution ». Il est vrai que les difficultés de la prise de conscience font que beaucoup d’acteurs de ce mouvement le voient à travers ce prisme déformant, et c’est ainsi que dans les assemblées, les réflexions sur la situation mondiale, ou sur la situation même de l’immense majorité de travailleurs, sont encore rares2.
Mais, comment se fait-il que nous parlons d’un maillon dans le mouvement international de la classe ouvrière, alors que la plupart des présents, même si ce sont des ouvriers (chômeurs, jeunes travailleurs précaires, fonctionnaires, retraités, étudiants, immigrés...), se reconnaissent comme appartenant à la classe ouvrière, et lors des assemblées ces mots ne sont pratiquement jamais prononcés ?3
Il y a des facteurs différents qui expliquent cette difficulté : la classe ouvrière souffre d’un problème aigu d’identité et de confiance en elle-même. Par ailleurs, le mécontentement ne touche pas seulement la classe ouvrière, mais aussi de larges couches de la population opprimée et non exploiteuse, ce qui se concrétise par une prolétarisation de couches sociales petites-bourgeoises et des professions libérales4. Tout cela fait que le mouvement peut paraître, avec un regard plus que superficiel, comme interclassiste, partant d’une manière chaotique vers une foule de préoccupations, très sensible aux idéologies démocratiques mais, en le regardant avec plus de profondeur, ce mouvement appartient entièrement au combat international de la classe ouvrière. Nous sommes dans un processus vers des luttes massives, lesquelles vont aider à ce que le prolétariat commence à prendre confiance en ses propres forces, commence à se concevoir comme une classe autonome capable de mettre en avant une alternative à cette société qui, autrement, va tout droit vers sa ruine. La faille tectonique qui traverse la France en 20065, la Grèce en 20086, pour revenir encore en France en 2010, continuer en Grande-Bretagne toujours en 2010 et suivre encore avec l’Egypte et Tunisie en 20117, est en train de s’exprimer dans cet énorme et fantastique séisme espagnol. On est en train de construire les galeries pour d’autres tremblements de terre sociaux qui finiront par ouvrir le dur chemin vers l’émancipation de l’humanité.
Les détonateurs immédiats de ce mouvement
Une analyse internationale et historique est plus claire si elle arrive à intégrer les facteurs particuliers, nationaux ou conjoncturels. Par contre, on ne pourra jamais comprendre les faits si on part de ces facteurs spécifiques. Le mouvement que nous sommes en train de vivre est parti d’une manifestation « contre les politiciens » organisée par Democracia Real Ya ! (« Démocratie réelle maintenant ! »). Les manifestations du 15 mai ont eu un succès spectaculaire : le mécontentement général, le malaise face à l’avenir ont trouvé dans ces manifestations une issue inattendue.
Tout aurait dû apparemment s’arrêter là mais, à Madrid et à Grenade, à la fin de la manifestation, il y a eu de violentes charges de police avec plus de 20 détenus durement maltraités dans les commissariats. Les détenus se sont groupés dans un collectif qui a adopté un communiqué8, dont la diffusion a causé une forte impression et une réaction foudroyante d’indignation et de solidarité. Un groupe de jeunes a décidé d’établir un campement à la « Puerta del Sol » de Madrid (Place du centre historique). Ce même lundi, l’exemple madrilène s’est étendu à Barcelone, Grenade et Valence. Une nouvelle flambée de répression n’a fait que réchauffer les esprits et, depuis lors, les rassemblements n’ont fait que s’étendre à plus de 70 villes et leur affluence n’a fait que croître à un rythme vertigineux.
Le moment décisif a été mardi après-midi. Les organisateurs avaient prévu des actions silencieuses de protestation ou, encore, des mises en scènes ludiques défouloir (qu’on appelle des « spectacles »), mais la foule des présents n’arrêtait pas d’augmenter en demandant à grands cris la tenue d’assemblées. Mardi à 20 heures se tiennent des assemblées à Madrid, à Barcelone, à Valence et dans d’autres villes, mais à partir de mercredi, c’est devenu une véritable et formidable avalanche et les rassemblements sont devenus des assemblées ouvertes.
Même si, pour se donner un symbole, ce mouvement s’appelle « du 15-M » (pour « 15 mai »), cet appel ne l’a pas créé, mais lui a prêté tout simplement une couverture. Mais cette couverture est devenue carrément une cuirasse qui l’emprisonne en lui donnant un objectif aussi utopique que mystificateur : la « régénération démocratique » de l’Etat espagnol9. On essaye de canaliser l’énorme mécontentement social vers ce que l’on appelle la « deuxième transition ». Après 34 ans de démocratie, la grande majorité de la population en est très déçue, mais ceci s’expliquerait parce « qu’on subirait une démocratie imparfaite et limitée » à cause du pacte qui a dû être établi avec les « secteurs intelligents » du franquisme, de sorte qu’une « deuxième transition » serait nécessaire pour nous conduir à une « démocratie pleine ».
Le prolétariat en Espagne est vulnérable à cette mystification étant donné que la droite espagnole est très autoritaire, arrogante et irresponsable, faisant ainsi que la « démocratie réellement existante » soit peu crédible. Mais en encourageant le « peuple » à se « révolter contre les politiciens » et à exiger une « démocratie réelle de suite », la bourgeoisie essaye de cacher que cette démocratie est la seule possible et qu’il n’en existe pas d’autre.
On ne peut pas dire que le gouvernement socialiste de Zapatero ait été très bien inspiré face à une situation explosive avec plus de 40% de jeunes au chômage. Zapatero a taxé de « scélérats » ceux qui osaient mettre en cause les… « grandes conquêtes sociales » (sic !) de son gouvernement, ce qui n’a fait que réchauffer les esprits de beaucoup de jeunes. Mais il y a encore quelque chose de plus profond : le jeu démocratique10 proposait comme alternative au PSOE [Parti Socialiste], un PP [Parti populaire, droite] craint par tout le monde parce tout le monde connaît bien son arrogance, sa brutalité et ses réflexes autoritaires. L’Espagne n’est pas la Grande-Bretagne, où Cameron –avec l'aval des « modernes » libéraux- avait une meilleure image préalable ; en Espagne, même si dans la pratique le PSOE est toujours le parti qui entreprend les pires attaques, la droite a une réputation bien méritée d’ennemie des classes travailleuses, pour ne pas parler du fait qu’elle est représentée par une cohorte de personnages passablement arriérés et corrompus11.
Une grande majorité de la population regarde avec appréhension une situation qui la ferait passer de la brutalité de ses « amis » socialistes à une brutalité, on ne sait pas si elle serait plus forte, de ses ennemis déclarés du PP. Voilà ce que veut dire avoir confiance dans le jeu démocratique et dans ses résultats électoraux ! Face à une situation insupportable et à un avenir plus que terrifiant, les gens se sont jetés dans la rue. Leurs confusions et leurs propres illusions, ainsi que la propagande démocratique, ont fait que la proposition d’en finir avec le bi-partisme a eu une forte audience au sein des assemblées. Mais il s’agit là de quelque chose d’irréaliste et purement mystificateur, car la carte politique espagnole est rigidement bi-partite –étant en cela la suite de la longue étape de bipartisme des temps de Cánovas12- et qui, comme d’ailleurs les résultats des municipales et régionales viennent de le démontrer, tend à se renforcer13.
Les Assemblées, « une arme chargée de futur »14
Cependant, face à cette démocratie qui réduit la « participation » au fait de « choisir » tous les 4 ans le politicien de service qui ne tiendra jamais les promesses qu'il a faites et qui, par contre, réalisera le « programme occulte » dont il n’avait jamais parlé, le mouvement en Espagne a retrouvé une arme extraordinaire où la grande majorité peut, vraiment, s’unir, penser et décider : les assemblées massives de ville.
Dans la démocratie bourgeoise, le pouvoir de décision est laissé entre les mains d’un corps bureaucratique de politiciens professionnels qui, à leur tour, obéissent sans broncher aux ordres du Parti, lequel n’est autre chose qu’un défenseur et un interprète des ordres du Capital.
Par contre, dans les assemblées, le pouvoir de décision est exercé directement par ceux qui y participent et qui discutent et décident ensemble et qui eux-mêmes s’organisent pour mettre en pratique leurs décisions.
Dans la démocratie bourgeoise, c’est l’atomisation individuelle qui est consacrée et renforcée, c’est la concurrence et l’enfermement du « chacun pour soi », qui est caractéristique de cette société. Par contre, dans les assemblées se développe une pensée collective, chacun peut apporter le meilleur de soi-même, tous peuvent ressentir la force et la solidarité commune, un espace se crée qui est un antidote contre la division et le déchirement de la société capitaliste, contre l’opposition entre besoins individuels et collectifs, tout en forgeant les bases d’une nouvelle société basée sur l’abolition de l’exploitation et des classes, sur la construction d’une communauté humaine mondiale.
S’il est vrai que la démocratie bourgeoise fut un progrès indéniable face au pouvoir absolu des monarques, l’évolution de l’Etat dès le début du 20e siècle a consacré la toute-puissance d’une combinaison entre ce qu’on appelle la classe politique et les grands pouvoirs économiques et financiers, autrement dit, le Capital dans son ensemble. On a beau faire toutes les listes électorales ouvertes qu’on voudra, on pourra mettre toutes les entraves qu’on voudra au bipartisme, rien n’empêchera que le pouvoir soit entre les mains de cette minorité privilégiée, un pouvoir actuellement bien plus absolu et dictatorial que la plus absolue des monarchies. Mais à la différence de celles-ci, cette dictature du capital reçoit sa légitimité périodique avec la farce électorale.
Les Assemblées se greffent dans la tradition prolétarienne des Conseils ouvriers de 1905 et 1917 en Russie15 qui se sont étendus à l’Allemagne et à d’autres pays lors de la grande vague révolutionnaire mondiale de 1917-23.
Qu’est-ce que l’ambiance peut être lourde dans un bureau de vote où les « citoyens » arrivent en silence, comme s’ils remplissaient un devoir d’une utilité douteuse, en ressentant une forte culpabilité à cause d’un vote émis qui est toujours ressenti comme « erroné » !
Par contraste, comment est fortement émouvant tout ce que nous pouvons vivre ces jours-ci dans les assemblées ! On y perçoit un grand enthousiasme et d’énormes envies d’y participer. De nombreux orateurs prennent la parole pour poser des questions en tous genres. Une fois l’Assemblée finie, il y a des réunions de commissions qui se tiennent tout au long des 24 heures. On prend contact, on apprend à se connaître les uns les autres, on réfléchit en dialoguant, on passe en revue tous les aspects de la vie sociale, politique, culturelle, économique. On découvre qu’on peut vraiment parler, qu’on peut traiter collectivement de toutes les affaires. On monte des bibliothèques sur les places occupées, on organise une « banque du temps » pour délivrer des enseignements aussi bien scientifiques que culturels, artistiques, politiques ou économiques. On y exprime des sentiments de solidarité, on écoute attentivement sans que personne n'ait à redire ni à imposer quoi que ce soit, c’est une voie qui s’ouvre à l’empathie. D’une manière encore timide, on est en train de créer une culture du débat massive16, avec de multiples réflexions, des propositions souvent intéressantes, des idées variées, on dirait que ceux qui sont là voudraient rendre publiques leurs pensées, leurs sentiments, ruminés pendant longtemps dans la solitude de l’atomisation. Les places sont inondées par une gigantesque vague collective d’idées, les masses arrivent à exprimer le meilleur et le plus profond d’elles-mêmes et de tout un chacun. Tous ces gens anonymes présentés comme des perdants dans la vie, enferment en eux-mêmes des capacités intellectuelles, des sentiments actifs, des émotions sociales, insoupçonnées, immenses, profondes.
Les gens se sentent libérés et jouissent avec passion du grand plaisir de pouvoir discuter collectivement. En apparence, ce torrent de pensées ne débouche sur rien. Il n’y a pas de propositions concrètes. Mais ceci n’est pas forcement une faiblesse, après de longues années de normalité capitaliste oppressive où l’immense majorité subit la dictature du mépris, les routines les plus aliénantes, les sentiments négatifs de culpabilité, de frustration, d’atomisation, il est inévitablement une première étape d’explosion désordonnée. Il n’y a pas d’autre moyen, il n’existe pas des plans prétentieux pour que la pensée de l’immense majorité puisse s’exprimer. Elle sait parcourir ce chemin –qui en apparence ne mène nulle part- pour se transformer elle-même et transformer de haut en bas le panorama social.
Il est vrai que les organisateurs présentent de façon répétitive des manifestes démocratiques et nationalistes. Ils reflètent en partie les illusions et les confusions de la majorité, mais, en même temps, le cours que suit la pensée de beaucoup des participants va dans d’autres directions, qui essaient de se frayer un chemin. Ainsi, par exemple, à Madrid, un mot d’ordre qui a commencé à devenir populaire sans qu’il ait été repris par les porte-paroles est : « Tout le pouvoir aux Assemblées », ou encore « sans travail, sans maison, sans peur », « le problème n’est pas la démocratie, le problème c’est le capitalisme », « Ouvriers, réveillez-vous ! ». À Valence, il y avait des femmes qui disaient : « Ils ont trompé les grands-parents, ils ont encore trompé les fils, il faut que les petits-enfants ne se laissent pas avoir ! », ou « 600 euros par mois, voilà où est de la violence ! ».
Les Assemblées ont été témoins d’un débat qui a surgi dans une espèce de tension entre des insistances différentes centrées sur trois axes :
1º Faut-il se limiter à la régénération démocratique ?17 Ou bien, les problèmes n’ont-ils pas leur origine dans le capitalisme, lequel ne peut pas être réformé et doit être détruit de fond en comble ?
2º Doit-on considérer comme terminé ce mouvement le 22 mai, jour des élections, ou, au contraire, faut-il le poursuivre pour lutter massivement contre les réductions sociales, le chômage, la précarité, les expulsions ?
3º Ne devrait-on pas étendre les assemblées aux lieux de travail, aux quartiers, aux agences pour l’emploi, aux lycées et aux universités pour que le mouvement s’enracine chez les travailleurs, qui sont les seuls qui ont la force et les bases pour mener une lutte généralisée ?
Dans les assemblées, deux « âmes » cohabitent : l’âme démocratique qui constitue un frein conservateur et l’âme prolétarienne qui cherche à se définir sur une vision de classe.
Regard serein sur l’avenir
Les assemblées de dimanche 22 ont résolu le deuxième point du débat en poursuivant le mouvement. Beaucoup d’interventions affirment : « nous ne sommes pas ici à cause des élections, même si elles ont été le détonateur ». Par rapport au troisième point, il y a une multiplication des interventions pour « aller vers la classe ouvrière » en proposant d’adopter des revendications contre le chômage, la précarité, les coupes sociales. De la même manière, il a été décidé d’étendre les assemblées aux quartiers, et on commence à entendre des demandes d’extension vers les lieux de travail, les hôpitaux, les universités, les agences pour l’emploi. À Malaga, Barcelone et Valence s’est posée la question d’organiser une manifestation contre les réductions du salaire social, en proposant une nouvelle grève générale qui « soit vraie », comme l’a dit l’un des orateurs.
La phase initiale de cette « agora » est déjà en elle-même une grande conquête du mouvement. Elle devrait se continuer, parce qu’elle signifie que des masses importantes d’exploités commencent à refuser de « continuer à vivre comme jusqu’à maintenant », l’indignation amenant à la nécessité d’une régénération morale, d’un changement culturel, les propositions faites –même si elles peuvent parfois paraître naïves ou farfelues- expriment un désir, même timide ou confus, de vouloir « vivre autrement ».
Mais en même temps, est-ce qu’un mouvement qui a atteint un tel degré peut y rester sans formuler des objectifs concrets ?
Il n’est pas aisé d’y répondre : il y a deux réponses qui sont l'enjeu en profondeur de la bataille engagée, deux expressions des deux « âmes » comme on disait tout à l’heure, la démocratique et la prolétarienne. La démocratique enfonce ses racines dans le terreau du manque de confiance de la classe ouvrière en ses propres forces, le poids des couches sociales non prolétariennes mais non exploiteuses, l’impact de la décomposition sociale18, qui fait que l’on s’accroche au clou brûlant de l’État « justicier » et « équitable ».
L’autre voie, celle d’étendre les assemblées aux lieux de travail, aux établissement d’enseignement, aux agences pour l’emploi, aux quartiers, en se focalisant sur la lutte contre les effets du chômage et la précarité, en riposte aux attaques sans fin que nous avons subi et celles à venir, s’incarne dans un secteur très combatif. À Barcelone, des ouvriers de Telefónica, des travailleurs des hôpitaux, des pompiers, des étudiants de l’université, mobilisés contre les coupes sociales, ont rejoint les assemblées et commencent à leur insuffler une tonalité différente, l’Assemblée centrale de Barcelone apparaissant comme la plus distante vis-à-vis des questions sur la régénération démocratique.
L’Assemblée centrale de Madrid a convoqué des assemblées dans les quartiers qui apportent un réel souffle ouvrier. À Valence, il y a eu une jonction entre les manifestations des chauffeurs de bus et une manifestation d’habitants contre les coupes budgétaires dans l’enseignement. À Saragosse, les travailleurs des bus se sont joints aux rassemblements avec enthousiasme.
Cette seconde voie a une difficulté supplémentaire. Il est clair qu’il existe le réel danger que « l’extension » du mouvement finisse par l’emporter en le dispersant et en l’enfermant dans des questionnements sectoriels et corporatistes. C’est une vraie contradiction. D’un coté, le mouvement ne peut se poursuivre que s’il réussit à susciter, ou du moins qu’il commence à réveiller la participation de la classe ouvrière en tant que telle. Cependant, une telle extension peut favoriser le fait que les syndicats prennent le train en marche et enferment le mouvement dans des compartiments sectoriels et, dans les quartiers, que tout finisse par se consumer dans des revendications localistes, etc. Sans nier ce danger, il faut se poser la question : est-ce que le fait d’essayer, même avec un éventuel échec, ne fournit pas les prémices pour une lutte collective qui pourrait avoir une grande force dans le futur ?
Quelle que soit la direction prise par ce mouvement, sa contribution à la lutte internationale de la classe ouvrière est indiscutable :
-
C’est un mouvement massif et général, avec l’implication de tous les secteurs sociaux.
-
Ce n’est pas une réaction à une attaque concrète comme en France ou Grande-Bretagne, mais c’est l’indignation face à la situation qu’on nous fait vivre. Ceci rend difficile le fait de se focaliser sur des revendications concrètes, ce qui rend aussi difficile l’expression de sa nature prolétarienne19. Mais, en même temps, ce mouvement signifie clairement que des masses importantes se réveillent face aux problèmes de notre société, ouvrant ainsi la voie à la politisation de ces mouvements.
-
Le fait que le cœur de ce mouvement s’est trouvé dans les assemblées.
La compréhension de ce qui est en train de se passer doit nous pousser à laisser de coté les vieux schémas. La Révolution en Russie de 1905 fit clairement surgir une nouvelle manière d’agir des masses. Ceci fit sombrer dans la perplexité, dans le rejet par la suite et, enfin, dans la trahison, à beaucoup de dirigeants syndicaux et sociaux-démocrates, à des théoriciens importants tels que Kautsky et Plekhanov, qui s’accrochaient désespérément aux vieux schémas de « l’accumulation méthodique des forces » par le biais d’un travail graduel syndical et parlementaire20.
Nous devons aujourd’hui éviter un piège similaire. Les faits n’arrivent pas tels qu’on pouvait s’y attendre selon un schéma adapté aux luttes des années 1970 et 1980. D’abord, un prolétariat avec des problèmes d’identité et de confiance en soi ne peut pas apparaître en s’affirmant à grands cris ; il est vrai aussi qu’à ses cotés se mobilisent aussi les couches sociales non exploiteuses. Avancer vers des luttes massives, vers un combat révolutionnaire, ne se passe pas sur des rails bien délimités qui laisseraient clairement apparaître le terrain de classe. Ceci entraîne des risques : un prolétariat encore faible peut se retrouver désorienté et confus au milieu d’un vaste mouvement social, il pourrait même apparaître comme totalement perdu, si l’on peut dire, comme c’est arrivé en Argentine en 2001.
Tout cela, néanmoins, n’enlève rien des possibilités de ce qui est en train de se passer :
-
Aujourd’hui, les grandes concentrations industrielles ont un moindre poids et elles apparaissent dispersées dans un immense réseau national et international, ce qui fait que la lutte traditionnelle à partir de grandes usines est aujourd’hui difficile. Pour dépasser cette difficulté, le prolétariat a trouvé un moyen : prendre massivement la rue en étant accompagné par d’autres couches sociales. Tout cela fait que la nature de classe n’apparaît pas aussi facilement et directement que par le passé, cela signifie un effort plus grand pour parvenir à un niveau supérieur de clarification et de prise de conscience.
-
Face à la décomposition sociale ambiante, qui détruit les liens sociaux et accentue la barbarie morale, l’orientation des assemblées vers une « agora » (place publique) où toute la vie humaine est matière à réflexion, même dans une certain confusion, va dans le sens d’une réponse pour que puissent se tisser les liens sociaux, que puisse s’affirmer la morale prolétarienne, la solidarité, l’alternative face à une société de concurrence mortelle.
-
Il est vrai qu’en tant qu’expression d’une situation matérielle dramatique et qui est en train de pourrir pour longtemps, le prolétariat se lance dans un combat massif accompagné des couches sociales non exploiteuses qui ne partagent pas nécessairement ses objectifs révolutionnaires et qui tendent à le diluer dans une masse confuse. Ceci comporte de sérieux dangers, mais, en même temps, représente l’avantage de commencer à créer une fraternité dans la lutte, de pouvoir aborder méthodiquement les problèmes, d’établir une compréhension mutuelle plus grande, tout ce qui sera vital face aux affrontements à venir contre l’Etat bourgeois.
CCI (25 mai 2011)
1 La corruption fait partie des gènes du capitalisme puisque sa « morale » consiste en ce que « tout sert » pourvu qu’on arrive à en obtenir le plus de profit. Sur la base de cette tare congénitale et dans le cadre de l’approfondissement de la crise (qui ne fait qu’entraîner les comportements irresponsables à se développer aussi bien au sein du patronat que chez les politiciens), la corruption devient inévitable dans n’importe quel État, quelles que soient ses lois particulières.
2 Ceci dit, lors des assemblées commencent à apparaître des expressions internationalistes. Un orateur, à Valence, dimanche, s’est proclamé « citoyen du monde », en disant qu’on ne pouvait pas se limiter à changer l’Espagne. On est en train de faire un effort de traduction des communiqués des assemblées dans toutes les langues « étrangères » possibles, ce qui tranche avec le coté « hispano-espagnol » du début. S’il est vrai que les mobilisations hors d’Espagne se comprenaient, dans de nombreux pays, comme une « affaire des Espagnols dans le monde », il semblerait que certains rassemblements commencent à prendre un autre sens.
3 Encore que cela commence à se dire à partir des assemblées de dimanche 22.
4 Pas seulement dans les pays du « Tiers monde » (terminologie bien anachronique !), mais aussi dans les pays centraux. Des informaticiens hautement qualifiés, des avocats, des journalistes etc., se voient relégués à la condition de précaires ou de free lance, dans des situations très instables. Et des petits entrepreneurs qui deviennent des auto-patrons qui travaillent plus d’heures qu’une montre ! ...
5 Voir « Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France » contre le CPE, https://fr.internationalism.org/rint125/france-etudiants [85] et bien d’autres articles sur ce sujet
6 « Les révoltes de la jeunesse en Grèce confirment le développement de la lutte de classe », https://fr.internationalism.org/rint136/les_revoltes_de_la_jeunesse_en_g... [86].
7 On peut sur notre site les différentes prises de positions en 2010 et 2011 sur les mouvements en France, Grande-Bretagne, Tunisie, Egypte (Revue international nº 144 et 145 et aussi Révolution internationale et Internationalisme)
8 Cf. madrid.indymedia.org/node/17370 : le communiqué des détenus a exprimé avec éloquence les traitements qu’ils ont subis.
9 L’État est l’organe de la classe dominante. Il peut apparaître sous sa forme démocratique, mais sa structure même sur la quelle il est construit est celle de la délégation de pouvoir, ce qui ne pose le moindre problème à la minorité exploiteuse, laquelle, en possédant les moyens de production, tient « la poêle par le manche », comme on dit en espagnol, autrement dit toutes les manettes, de sorte qu’elle peut soumettre les politiciens professionnels à ses intérêts. Par contre, pour la classe ouvrière et l’immense majorité de la population, c’est une autre affaire : leur « participation » est réduite à donner un chèque en blanc à ces messieurs, lesquels, même s’ils agissent avec honnêteté et renoncent à tout intérêt personnel, sont totalement emprisonnés dans la toile d’araignée bureaucratique de l’État. Par ailleurs, les reformes proposées, au cas où elles étaient prises vraiment au sérieux, prendraient un temps extrêmement long en formalités et chicanes parlementaires, de plus elles seraient facilement dénaturées, et leur application serait incertaine.
10 Le dernier dimanche 22 mai, il y a eu des élections locales en Espagne.
11 Il est significatif que la stratégie adoptée par le candidat du PP, Rajoy, consiste dans le fait de ne dire absolument rien, en tenant un discours vide mais rempli des plus pathétiques lieux communs ; garder un silence assourdissant est la seule manière qu’il a à sa disposition pour empêcher que les votants de gauche ne se mobilisent contre lui.
12 Après la Révolution de 1868 –nommée « La Glorieuse »- et les années tourmentées qui la suivirent, en 1876 s’est instauré un tour de rôle entre le parti conservateur de Cánovas et le parti libéral de Sagasta, ce qui a duré jusqu’à 1900.
13 Les petits partis dans lesquels beaucoup d’interventions au sein des assemblées placent tant d’espoir, au-delà du fait que leur programme est celui d’une défense du capitalisme aussi affirmée que celle des grands partis et d’avoir une structure interne aussi dictatoriale et bureaucratique que ceux-ci, n’ont aucun rôle propre à jouer : ils sont comme une espèce de baudruche qui se gonfle de façon conjoncturelle quand l’un des grands partis baisse et se dégonfle quand les deux grands ont besoin d’occuper tout l’espace, dans le gouvernement comme dans l’opposition.
14 Ce titre en espagnol « Las asambleas son un arma cargada de futuro » fait référence au titre d’un poème très émouvant et combatif de Gabriel Celaya qui dit « LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO » (années 50)
15 Dans notre Revue internationale, nous venons de publier une série sur ce sujet : « Qu'est ce que les conseils ouvriers ? » (nº 140, 141, 142, 143, 145). Voir : https://fr.internationalism.org [87], taper les mots clés « conseils ouvriers »
16 Voir « La culture du débat : une arme de la lutte de classe », /rint131/la_culture_du_debat_une_arme_de_la_lutte_de_classe.html [88].
17 Qui s’est concrétisé dans le « Décalogue démocratique » approuvé par l’Assemblée de Madrid : listes ouvertes, reforme électorale...
18 Lire « La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste [89] », thèses que nous avons publiées en 1990.
19 En France et en Grande-Bretagne, les mobilisations avaient l’axe bien clair de construire une riposte face à des attaques très dures de la part des gouvernements.
20 Face à eux, Rosa Luxemburg avec Grève de masse, parti et syndicats, ou Trotsky avec Bilan et perspectives, surent appréhender les caractéristiques et la dynamique de la nouvelle époque de lutte de classe.
Rubrique:
Les manifestations massives se poursuivent en Israël malgré les tensions guerrières
- 1642 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d'un article de World Revolution (WR), organe de presse du CCI en Grande-Bretagne et mis en ligne sur notre site en anglais le 4 septembre.
Dans l'article sur le mouvement 'pour plus de justice sociale' en Israël que nous avons publié en août1, nous avions écrit : « De nombreux manifestants ont exprimé leur frustration face à l'incessant couplet sur la ' sécurité' et sur la 'menace du terrorisme', utilisé pour que les gens oublient la réalité de la misère sociale et économique croissante. Certains ont ouvertement mis en garde contre le danger que le gouvernement pourrait provoquer des affrontements militaires ou même une nouvelle guerre pour restaurer 'l'unité nationale' et diviser le mouvement de protestation. »
Ces craintes se sont avérées bien fondées. Le 18 août, il y a eu un déluge d'attaques armées contre des civils israéliens et des patrouilles militaires. Deux autobus de transports publics dans le Sud d'Israël ont subi des tirs, faisant plusieurs morts et blessés. Il y a eu une certaine confusion quant à la responsabilité du Comités de Résistance Populaire (CRP) ou du Hamas par rapport à ces attaques, aucun des deux ne les ayant revendiquées. De toute façon, le gouvernement israélien a réagi, comme à l'accoutumée, de manière brutale, par des frappes aériennes sur Gaza, tuant des membres du CRP, mais aussi un groupe d'enfants et de gardes-frontières égyptiens. Cela a à son tour provoqué d'autres attaques de roquettes lancées depuis Gaza sur des villes du Sud d'Israël.
Peu importe qui a initié cette dernière spirale de la violence, provoquant un accroissement des tensions guerrières, cela ne peut que profiter aux nationalistes des deux camps. L'intention était de créer des difficultés majeures pour le développement du mouvement de contestation, de faire hésiter ceux incités à poursuivre l'expérience des villages de tentes et à continuer à manifester, à un moment où il y a une énorme pression pour maintenir 'l'unité nationale'. Itzik Shmul, le leader de l'Union Nationale des Etudiants a certes lancé un appel pour annuler les manifestations, mais un noyau important de manifestants a rejeté cet appel. Cette tentative d'intimidation a échoué. Dans la nuit du samedi 20, des manifestations se sont déroulées, bien qu'elles devaient être 'muettes', et qu'elles étaient à une plus petite échelle que dans les précédentes semaines. Il en a été de même pour les manifestations du samedi 28 août.
Ce qui est significatif est que ces manifestations ont vraiment eu lieu, attirant jusqu'à 10 000 personnes à Tel-Aviv et plusieurs milliers dans d'autres villes2. Et il n'y a pas eu de dérobade par rapport à la question de la guerre, au contraire, les slogans soulevés au dessus des manifs reflétaient une compréhension croissante de la nécessité de résister à la marche à la guerre et, pour les opprimés des deux camps, de lutter pour leurs intérêts communs: « Juifs et Arabes refusent d'être ennemis », « La justice sociale est exigée en Israël et dans les territoires », « Vivre dans la dignité à Gaza et à Ashdod dans la dignité », « Non à une autre guerre, qui va enterrer les revendications ! » La 'Tente 1948' judéo-palestinienne, sur le boulevard de Rothschild a publié une déclaration qui a été lue publiquement : «C'est le moment de montrer une véritable force... Restez dans la rue pour condamner la violence et refusez de retourner chez vous ou d'aller dans l'armée pour prendre part à l'attaque vengeresse sur Gaza. »
Un discours prononcé à Haïfa par le Raja Za'atari a également exprimé l'émergence de sentiments internationalistes, même si il a été libellée dans la langue de la démocratie et du pacifisme : «A la fin de la journée, une famille sans abri est une famille sans abri, et un enfant affamé est un enfant affamé, peu importe qu'il parle en arabe, en hébreu, en russe ou en amharique. A la fin de la journée, la faim et l'humiliation, tout comme la richesse, n'ont pas de patrie et aucune langue ... Nous disons: il est temps de parler de paix et de justice dans un seul souffle! Aujourd'hui plus que jamais, il est évident pour tous que, dans le but d'empêcher que l'on parle de justice, ce gouvernement pourrait entamer une autre guerre. » onedemocracy.co.uk/news/we-will-be-a-jewish-arab-people [90]
Le fait que ces slogans et sentiments puissent devenir tellement plus populaires qu'ils ne l'étaient, il y a seulement un an ou deux, indique que quelque chose de profond se passe en Israël, et surtout parmi la jeune génération. Nous avons vu poindre une protestation comparable de le jeunesse contre le statu quo dans le Gaza islamique3.
Comme en Israël, ceux qui se réclament des « jeunes de Gaza » ' constitue une petite minorité, sur laquelle pèsent tous sortes d'illusions, en particulier, sur le nationalisme palestinien. Mais dans un contexte global de révolte croissante contre l'ordre existant, les bases sont posées pour le développement d'un véritable internationalisme, fondé sur la lutte de classe et la perspective d'une authentique révolution des exploités.
D'après WR, organe du CCI en Grande-Bretagne (28 août)
1 en.internationalism.org/icconline/2011/08/social-protests-israel [91]
2 La meilleure preuve en est que le samedi 3 septembre, au moment où nous traduisions ce texte, de gigantesques manifestations, plus massives encore que le 6 août, rassemblant cette fois plus de 400 000 personnes (le plus grand rassemblement de l'histoire du pays) se sont à nouveau déroulées à Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem, non seulement sur la question du logement mais dirigée aussi contre la hausse exorbitante des denrées alimentaires, de l'essence, le coût de l'éducation et toujours contre l'escalade militariste du gouvernement (NDT).
The Guardian du 28 août a également signalé qu'un certain nombre de bâtiments inoccupés à Jérusalem ont été pris par des manifestants qui exigent qu'ils soient utilisés pour loger des gens avec un loyer abordable. https://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/28/israel-squatting-campaign-h... [92]
3 ‘A radical manifesto from Gaza’: https://en.internationalism.org/icconline/2011/gaza [93]
Géographique:
- Israel [94]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]
Mouvement 'Occupy' : les illusions sur la 'Démocratie' entravent la réponse aux attaques du capitalisme
- 1408 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article d’Internationalism USA, organe de presse du CCI aux Etats-Unis et également disponible dans sa version originale sur notre site en anglais à cette adresse https://en.internationalism.org/internationalismusa/201112/4629/occupy-movement-response-capitalism-s-attacks-hampered-illusions-dem [95] depuis le 19 décembre.
Le Mouvement 'Occupy', qui a frappé l'imagination des gens qui en ont assez de leurs conditions de vie sous le capitalisme en décomposition, est arrivé à un tournant. Les campements dans les parcs et autres 'espaces publics' dans des douzaines de villes à travers l'Amérique du Nord ont été attaqués par les forces de répression bourgeoises. Les services de police municipale, sous le prétexte que les villes de tentes étaient devenues des menaces pour la santé publique, ont expulsé des campements à Atlanta, Baltimore, Los Angeles, Toronto, Vancouver, Philadelphie et beaucoup d'autres villes. Cela s'est produit même dans les villes régies par des maires soi-disant amis, qui, nous racontent-ils, ont été contraints d'agir dans un souci de sécurité des manifestants eux-mêmes, leurs campements étant devenus des aimants pour la « criminalité ».
Sans aucun doute, l'expulsion la plus importante a eu lieu dans le Zuccotti Park de New York, là où tout a commencé, lorsque la police du maire Bloomberg a expulsé les manifestants de 'Occupy Wall Street' (OWS), dans les premières heures du matin du 15 novembre. Cela a déclenché un combat juridique curieux, dans le système judiciaire bourgeois, avec des avocats qui défendaient les occupants en faisant valoir que l'expulsion violait le droit de libre expression que leur donne le premier amendement. La décision du juge a été une victoire à la Pyrrhus pour les manifestants : celle-ci leur permettait de retourner dans le parc pour s'engager dans une protestation conforme à la loi, mais leur refusait les tentes et le matériel de camping. Ainsi, OWS se trouve privé de son modus vivendi. Avec un Etat bourgeois qui ne veut plus jouer les gentils, le mouvement Occupy n'a maintenant plus la possibilité d'occuper quoi que ce soit sans conséquence.
Est-ce que ceci pourrait contribuer à étendre le mouvement ? Privés du droit de camper légalement dans le parc, est-ce que les manifestants pourraient être amenés à créer un mode différent de lutte, en se concentrant moins sur l'occupation d'un espace géographique particulier et en développant plus les organes pour la clarification et l'approfondissement théorique, tels que des groupes de discussion ? En ce moment, il n'est pas possible de l'affirmer, mais c'est souvent dans la nature des mouvements sociaux que les actions de l'Etat ont ce genre de conséquences imprévues.
Bien que beaucoup dans le mouvement aient juré de poursuivre leur lutte contre l'avidité des entreprises, l'inégalité des revenus et la corruption supposée du 'processus démocratique' des Etats-Unis, il est clair, en ce moment, que la phase initiale du mouvement d'occupation tire à sa fin. Tout au long des premières semaines d'occupation, les manifestants ont pu généralement bénéficier de l'appui de l'opinion publique, ce qui obligeait les autorités à agir avec un certaine retenue à leur égard. Ce n'est plus le cas. Alors que les sondages continuent de montrer que la population voue une énorme sympathie pour les objectifs et les griefs des manifestants, le soutien aux occupations elles-mêmes a diminué. Le sentiment que les occupants ont surestimé leur force est répandu. La pression est désormais mise sur les occupants pour qu'ils fassent entendre leurs doléances en restant dans la légalité.
Alors que nous ne pouvons pas prédire quelle direction ce mouvement va prendre, ni même si il peut survivre en tant mouvement social indépendant, en dehors des institutions de la politique bourgeoise, il est approprié, à ce stade, pour les révolutionnaires, de tenter de faire un bilan de ce mouvement afin de tirer les leçons pour l'avenir de la lutte de classes. Qu'est-ce qui a été positif dans ce mouvement? Quelles ont été ses faiblesses? Que pouvons-nous en attendre ?
Malgré ces questions sans réponse et l'ambiguïté générale exprimée par ce mouvement, nous pensons qu'il est une manifestation de la volonté de certains secteurs de la classe ouvrière, parmi les autres groupes sociaux, de se battre contre les attaques massives que le système capitaliste est en train de mener contre les conditions de vie. Même si ce mouvement rappelle beaucoup ce même activisme politique que nous voyons depuis la fin des années 1990, avec le mouvement alter-mondialiste, il semble néanmoins s'être effectué dans une dynamique fondamentalement différente de ces mouvements précédents, qui pourrait contenir les semences pour une nouvelle radicalisation.
Ainsi, alors que nous ne pouvons pas encore nous prononcer de façon définitive sur la nature de ce mouvement, nous pouvons néanmoins essayer de le situer dans une perspective de classe et d'en tirer certains enseignements majeurs pour la période à venir.
Le contexte international
Le Mouvement 'Occupy' en Amérique du Nord a clairement constitué un maillon dans la chaîne de protestations et de mouvements sociaux qui ont balayé les quatre coins du monde au cours de l'année 2011. Ces mouvements ont massivement cherché à répondre aux effets de la crise du capitalisme sur les conditions de vie de la classe ouvrière et de la société en général. De la révolte dans le monde arabe, au printemps, à l'éclatement de luttes massives en Chine, au Bangladesh, en Espagne, en Israël et au Chili, le mouvement Occupy a été clairement inspiré par des événements qui ont eu lieu loin des côtes américaines. Jamais, depuis la période de la fin des années 1960 jusqu'au début des années 1970, nous n'avons assisté à un tel éventail de mouvements à travers le monde, cherchant tous à répondre aux mêmes provocations fondamentales : l'attaque sur les conditions de travail et de vie de la population résultant de la récession mondiale et les attaques massives d'austérité déferlant sur le salaire social dans le sillage de la crise de la dette souveraine et de la crise financière de 2008.
Tous ces mouvements ont été caractérisés par le désir d'un nombre toujours croissant de gens de faire quelque chose en réponse à la montée de ces attaques, même s'il y a eu peu de clarté quant à ce qui doit être fait. Le mouvement Occupy est une manifestation importante de cette tendance internationale dans le 'ventre de la bête' lui-même. Comme le mouvement massif dans le Wisconsin, plus tôt dans l'année, le mouvement Occupy a réfuté l'idée persistante que la classe ouvrière d'Amérique du Nord est totalement intégrée dans le capitalisme ou sans volonté et incapable de résister à ses attaques. Toutefois, alors que les événements dans le Wisconsin ont eu lieu dans un seul Etat, le mouvement Occupy s'est propagé à des centaines de villes à travers le continent et même dans le monde entier. Par ailleurs, alors que les manifestations du Wisconsin ont été très rapidement récupérées par les syndicats et le Parti Démocrate, les manifestants d'Occupy ont tenu à affirmer leur autonomie, estimant qu'un changement significatif ne peut découler que d'une 'nouvelle forme' de mouvement. Ils ont montré une méfiance très saine à l'égard des partis et des programmes officiels, ce qui démontre leur méfiance croissante envers les partis officiels pour les représenter dans leurs luttes.
Comme les mouvements dans d'autres parties du globe, ceux des Occupy ont été caractérisés par l'afflux de nouvelles générations de travailleurs, dont beaucoup ont peu d'expérience politique et ont quelques idées préconçues sur la façon d'organiser une lutte. Ce qui unit ces participants est un désir presque prémonitoire de se réunir avec les autres et de sentir l'expérience d'une solidarité active et communautaire pour poser une alternative à la société existante à travers l'expérience vécue de la lutte. Il n'y a pas de doute que ces désirs sont surtout alimentés par le sentiment croissant d'aliénation sociale face à la décomposition capitaliste, ainsi que par les énormes difficultés des jeunes générations ont à s'insérer sur le marché de l'emploi lui-même. Le manque d''expérience du travail collectif et le sentiment d'isolement qui l'accompagne, l'atomisation et le désespoir poussent aujourd'hui de plus en plus les travailleurs, en particulier les jeunes et ceux qui ont été chassés du processus de production, à rechercher la solidarité à travers la lutte. Sont également présents dans ces luttes des gens d'autres couches sociales : toutes sortes de gens profondément frustrés et inquiets devant la direction que prend la société. Cependant, en Amérique du Nord, ces manifestations ont été dominées par les jeunes générations de travailleurs et les personnes les plus profondément touchées par la crise et le chômage de longue durée.
Bien sûr, cela ne veut pas dire que le mouvement Occupy lui même, notamment à travers la tactique de l'occupation d'espaces géographiques spécifiques, représente la forme que la lutte de classes va prendre à l'avenir. Au contraire, ce mouvement, comme tous les mouvements frères à travers le globe, ont été marqués par des faiblesses fondamentales, qu'il sera nécessaire pour la classe ouvrière de dépasser si elle veut aller de l'avant. Nous pouvons conclure que le mouvement Occupy représente une tentative importante par des parties du prolétariat pour répondre aux attaques agressives du capitalisme, même si il ne représente pas un modèle parfait pour les luttes futures.
L'importance des Assemblées Générales
Une des caractéristiques les plus importantes du Mouvement Occupy a été l'émergence d'assemblées générales (AG) en tant qu'organe souverain de la lutte. La redécouverte de l'AG comme la forme la mieux capable d'assurer la plus large participation et le plus large échange d'idées a marqué une avancée considérable pour la lutte de classes dans la période actuelle. Par rapport au mouvement Occupy, les AG semblent avoir été adoptées par les luttes antérieures, en particulier celle des 'Indignés' en Espagne, ce qui démontre que, dans cette période, il y a une tendance à assimiler rapidement les méthodes de luttes dans d'autres régions du monde et à adopter les tactiques et les formes les plus efficaces. La rapidité avec laquelle les AG se sont propagées à travers le monde cette année écoulée a en effet été assez impressionnante.
Comme ailleurs, les AG du mouvement Occupy ont été ouvertes à tous, encourageant tous ceux qui se sentent concernés à participer à l'orientation du mouvements. Les AG ont pratiqué une politique ostensible d'ouverture. Des compte-rendus étaient distribués. Une volonté claire s'est exprimée pour que les AG restent distinctes de tout parti, groupe ou organisation qui peut chercher à confisquer leur autonomie. Les AG représentaient donc une prise de conscience naissante qu'on ne pouvait pas se fier aux partis et aux institutions existants, même les partis de gauche et les syndicats, pour diriger la lutte au nom des masses. Au contraire, les manifestants eux-mêmes devaient rester souverains, eux seuls pouvaient déterminer la façon d'aller de l'avant.
Néanmoins, malgré ces caractéristiques très positives, l'expérience des AG, dans le mouvement Occupy, a été marquée par une profonde faiblesse. Dès le début, le mouvement s'est constitué comme une occupation d'une parcelle de l'espace géographique. OWS avait initialement prévu d'occuper le quartier financier de New York lui-même, ou de mettre en place un lieu symbolique de manifestation à Wall Street, mais, une fois qu'il est devenu clair que l'Etat ne tolérerait pas cela, les manifestants ont occupé un parc voisin, presque par défaut1. Cela représente le pied de la montagne, mais n'est pas tout à fait sur la montagne elle-même : le modèle était ainsi fixé pour le mouvement dans d'autres villes, dont une écrasante majorité a pris la forme d'un campement dans un parc de ville. Bien qu'il y ait un précédent de ce genre d'occupation dans l'histoire des Etats-Unis (l'occupation de terre en friche par la Bonus Army, dans la ville de Wahington, pour protester contre les conditions de vie des vétérans de la Première Guerre mondiale, à l'époque de la Grande Dépression), la décision de se définir comme le mouvement d'occupation d'un emplacement géographique spécifique a constitué une faiblesse profonde qui a contribué à l'isolement du mouvement Occupy.
Assez rapidement, en particulier à New York, Occupy a été dominé par le sentiment qu'il avait à défendre le parc qui était devenu le lieu de regroupement du mouvement et en fait était devenu une sorte de communauté pour la plupart des manifestants individuels. Sans aucun doute, le sens positif de solidarité que beaucoup de manifestants ressentaient en tant que participants à un mouvement pour le changement a contribué à définir les limites du mouvement comme les limites du parc et à chercher à défendre ces frontières contre les attaques de l'Etat ou sa récupération par les grands courants politiques.
Cependant, cela a tendu aussi à produire une tension dans le mouvement Occupy entre, d'une part, un mouvement pour le changement social en général et, de l'autre, une nouvelle expérience de vie communautaire. De fait, alors qu'il était un campement provisoire, à la suite de nécessités tactiques, Zuccotti Parc, a eu tendance à être perçu par les occupants comme une nouvelle sorte 'd'abri ' au sein de la société capitaliste. Des rumeurs d'une répression policière imminente n'ont fait que renforcer le désir de 'défendre le parc.' Alors que les occupants ont fait des incursions occasionnelles en dehors du parc pour protester contre les banques, dans les quartiers bourgeois, plus le mouvement persistait, plus prédominait la tendance à essayer de constituer un noyau d'une façon alternative de vie dans le parc. Aucun effort réel n'a jamais été fait pour étendre la lutte à l'ensemble de la classe ouvrière, au-delà des limites du parc.
A contrario, ce fétichisme qui consistait à occuper un espace géographique spécifique n'a pas caractérisé les mouvements en Espagne, en Israël et au Moyen-Orient. Là-bas, les places publiques étaient considérées davantage comme un point de rencontre où des manifestants pouvaient se réunir pour un but spécifique, discuter, organiser des rassemblements et décider des tactiques. Le désir de s'accrocher à des espaces publics avec des campements permanents a été une caractéristique particulière pour l'Amérique du Nord, des récents mouvements, qui exige un examen plus approfondi.
Cependant, peut-être encore plus dommageable que le fétichisme de l'occupation, les AG dans le mouvement Occupy ont finalement été incapables de remplir leur fonction d'unifier les manifestants, étant donné qu'au cours de la lutte, d'organes de décision, elles ont été transformées en organes de plus en plus passifs aux mains d'activistes et de gauchistes professionnels, principalement à travers les activités des groupes et comités de travail. Au lieu de constituer l'organe de la discussion la plus large, en leur sein régnait la peur omniprésente de travailler en dehors des exigences concrètes, parce qu'elles étaient considérées comme semant les divisions et la polarisation plutôt qu'unificatrices, ce qui les rendait impuissantes face à la nécessité de prendre des décisions concrètes dans le feu de l'action.
Les illusions démocratiques et les traumatismes du passé
Une caractéristique du mouvement Occupy qui a été commune à la plupart des mouvements de revendication que nous avons vus au cours de la dernière année a été la prépondérance d'énormes illusions par rapport à la 'démocratie' en tant qu'alternative au système actuel. Cela a pris la forme d'une hypothèse sous-jacente selon laquelle les problèmes auxquels le monde se trouve confronté pourraient remonter à la domination de la vie économique et politique par une clique de financiers parasitaires, de banquiers et de grands entrepreneurs qui placent leurs propres intérêts immédiats au-dessus de celui de l'ensemble de la société dans son ensemble. Pour les Etats-Unis, il est dit que ce phénomène a corrompu le processus démocratique américain, au point que les grandes entreprises sont effectivement en mesure de dicter leur politique au Congrès et au Président par le biais de leur contrôle des fonds de campagne.
Ainsi, le mouvement Occupy a eu tendance à penser que la solution à l'oppression et à la souffrance passait par la revitalisation de la démocratie contre la cupidité des entreprises et la spéculation financière. Alors que la définition précise du terme 'démocratie' peut différer d'un manifestant à l'autre (certains peuvent se contenter d'un amendement interdisant les contributions des entreprises aux campagnes électorales, tandis que d'autres ont une définition plus radicale de l'autonomie gouvernementale à l'esprit), le sens sous-jacent est néanmoins que la 'démocratie' est en quelque sorte opposée à l'oppression et à l'exploitation économique.
Par ailleurs, tandis que de nombreux manifestants sont maintenant prêts à dire que le 'capitalisme' est, soit une partie, soit à la racine des problèmes économiques mondiaux, il n'y a pas de consensus sur ce qu'est en réalité le 'capitalisme'. Pour beaucoup, le capitalisme équivaut tout simplement aux banques et aux grandes entreprises. La compréhension marxiste que le capitalisme est un mode de production associé à toute une époque de l'histoire humaine, qui se caractérise par l'exploitation du travail salarié est seulement abordée à la marge de ce mouvement. Ainsi, tandis que de nombreux manifestants reconnaissent que Marx avait quelque chose d'important à dire sur les problèmes du capitalisme, il y a peu de clarté quant à la pertinence du marxisme et du mouvement ouvrier par rapport à leur projet de construire, aujourd'hui, un nouveau monde. Ces hésitations, également observées dans d'autres mouvements dans le monde, constituent une limitation essentielle pour l'expression de la dynamique des futurs mouvements.
Si ces illusions sur la démocratie étaient restées au niveau idéologique, on pourrait à juste titre les attribuer à l'immaturité du mouvement, comme l'expression d'une phase d'ouverture dans la lutte de classe, que la classe ouvrière dépasserait à la lumière de l'expérience. Cela peut se révéler être le cas, mais pour l'instant, pour le mouvement Occupy, la démocratie est fétichisée au point qu'elle constitue un obstacle fondamental à sa capacité à aller de l'avant. En outre, cette vision a fourni la base pour précisément ce que le mouvement ne connaissait pas au début : sa récupération par l'idéologie pro-démocratique et réformiste, dans le contexte de l'approche de la campagne électorale présidentielle de 2012.
Dès le début, en prenant au sérieux le mandat de créer une nouvelle forme de démocratie dans le cadre de la lutte, l'AG a essayé de fonctionner sur la base du modèle démocratique du 'consensus'. A bien des égards, c'était une réaction saine, visant à assurer la participation la plus large possible et à s'assurer que personne ne se sentait exclu des décisions prises par l'AG. Ce modèle a, sans doute, été adopté comme une réponse à l'expérience négative des mouvements précédents dominés par des militants professionnels et des organisations politiques, dans lesquels le participant moyen ne pouvait que se sentir à peu près au niveau d'un soldat de troupe, dans un mouvement dirigé par des professionnels.
En ce sens, le désir de s'assurer que chacun se sente inclus est parfaitement compréhensible. En réalité, l'insistance sur le fonctionnement sur un modèle de consensus a empêché le mouvement d'aller au-delà de ses limites, en bloquant la nécessaire confrontation des idées et des perspectives qui aurait permis au mouvement de sortir de son isolement dans le parc. Faute de pouvoir prendre de véritables décisions, afin de répondre aux besoins immédiats du mouvement, en négligeant de développer un organe exécutif, l'AG est très rapidement tombée sous la coupe de divers groupes de travail et comités, beaucoup d'entre eux dominés par des militants très professionnels, ce qu'elle craignait à l'origine. D'une certaine façon, l'insistance sur le fait que chaque décision devait être prise sur la base d'un vote à l'unanimité assurait qu'aucune véritable décision ne pouvait être prise et que les différents 'groupes' (groupes de travail, comités, etc) commenceraient à se substituer à 'l''ensemble' (l'AG ). Ainsi, la crainte de l'exclusion de la part de l'AG autorisait le 'substitutionnisme' à se glisser par la porte de derrière, une situation qui a finalement conduit à de nombreuses distorsions de la souveraineté de l'AG.
L'a priori de l'insistance sur le fonctionnement basé sur l'adoption à l'unanimité était également évident dans la très difficile question de l'augmentation des revendications concrètes. Depuis le début, le mouvement Occupy semblait fier de son refus de définir des revendications précises ou de formuler un programme. C'est un souci compréhensible de la part de ceux qui souhaitent éviter d'être récupérés dans la même vieille politique réformiste, offerte par l'Etat, mais, comme le montre le sort du mouvement Occupy, le réformisme ne peut pas être bloqué par le refus de présenter des revendications. Le mouvement a été caractérisé par une extrême hétérogénéité des revendications. La vision la plus radicale pour un changement total de la société sur des bases égalitaires coexistait avec des exigences totalement réformistes qui restent de la compétence du légalisme bourgeois, comme le demande de faire passer un amendement constitutionnel pour mettre fin à 'la personnalité d'entreprise'.
Une des leçons les plus importantes du mouvement Occupy est donc que les mouvements à venir devront aborder la question de savoir comment développer un organe exécutif compétent qui reste responsable devant l'AG : un véritable organe de décision qui fonctionne avec un mandat de l'AG révocable à tout moment. Un tel organe est nécessaire si le mouvement veut prendre des décisions dans le feu de la lutte et tisser la solidarité, la confiance et l'unité entre tous les participants. Comme ce mouvement le montre, le développement d'un véritable organe exécutif ne peut pas être évité, si le mouvement veut aller au-delà d'un stade très élémentaire. Comment des décisions tactiques peuvent-elles être prises dans le feu de la lutte ? Comment les AG maintiendront-elles leur souveraineté sur tout ces comités et organes qui seront nécessaires ? Telles sont les questions essentielles qui doivent être abordées.
Bien sûr, il est également vrai qu'un organe exécutif ne peut pas être proclamé ex nihilo. Un organe exécutif qui ne repose que sur la base du plus large débat et du plus large échange d'idées entre tous les participants serait, au mieux une farce totale et au pire une autre voie pour que le 'substitutionnisme' se glisse par la porte de derrière. Un organe exécutif ne peut fonctionner que comme une concrétisation de la vitalité de l'AG et il ne peut pas se substituer à elle. Par conséquent, alors que l'échec à prendre en charge la question d'une fonction exécutive peut avoir été un facteur clé dans la disparition du mouvement Occupy, cela ne signifie pas qu'un organe exécutif déclaré de façon volontariste par les éléments les plus actifs dans la lutte l'aurait sauvegardé.
Plus que tout, ce qui a été absent dans ce mouvement a été un véritable désir de discuter des racines de la crise elle-même. Plutôt que d'essayer de s'engager dans ce qui est devenu une discussion inévitable sur la nature des troubles de la société, le mouvement Occupy est resté enfermé dans sa vision fétichiste du mode de décision. Enlisé dans une problématique démocratique bourgeoise, le mouvement n'a jamais abordé les questions fondamentales de fond : ce mouvement doit-il rester emprisonné dans une problématique d'unanimité interclassiste ou doit-il exprimer les réactions et le point de vue des exploités ? Est-ce que les banques sont à blâmer pour l'impasse dans laquelle se trouve la société ou est-ce que leurs manigances sont un simple symptôme d'un plus large échec du système économique lui-même ? Peut-on produire un changement significatif en aiguillonnant l'Etat pour qu'il agisse dans l'intérêt de la société ou devons-nous réfléchir aux moyens de dépasser l'Etat ? Alors qu'il était possible de trouver des participants des deux côtés de ces questions (et un peu plus pour démarrer !), le mouvement n'a jamais compris qu'il fallait décider quelles positions étaient 'justes'. Sous le prétexte de 'toutes les positions sont les bienvenues ici', le mouvement n'a jamais dépassé une foi simpliste dans sa propre capacité à montrer la voie par l'exemple d'une nouvelle forme de vie du consensus.
La nécessité d'étendre la lutte
Un aspect du mouvement Occupy qui a figuré en bonne place dans son échec final a été son incapacité à étendre efficacement la lutte au-delà des différents sites de campement. De nombreux facteurs figurent dans l'isolement final du mouvement : la tendance pour les occupants de voir les sites de campement comme une communauté interclassiste, la tendance pour les divers parcs d'être vus comme des forteresses d'espace libéré qui doit être défendu, etc. Toutefois, le facteur le plus important a été l'incapacité du mouvement à se relier efficacement avec l'ensemble de la lutte de la classe ouvrière pour défendre ses conditions de vie et de travail, face aux attaques agressives du capitalisme.
En dehors de la grève générale controversée à Oakland qui a arrêté les opérations portuaires de la ville pour une journée, le mouvement a été incapable d'inspirer une réponse plus large de la part de la classe ouvrière aux attaques du capitalisme contre elle.
Dans l'ensemble, la classe ouvrière sur son lieu de travail reste désorientée face à la vaste offensive du capitalisme contre ses conditions de vie et est incapable de s'engager dans une lutte massive pour se défendre. En dehors de quelques grèves éparpillées, contrôlées par les syndicats, la classe ouvrière demeure en tant que telle pour le moment largement absente des luttes.
Dans un certain sens, cela ne devrait pas être surprenant. La crise actuelle et l'intensification actuelle de l'assaut sur la classe ouvrière sont arrivées après plus de 30 ans d'attaques ouvertes sur la vie de la classe ouvrière, sur ses conditions de travail et sur le fondement même de la solidarité de classe. Par ailleurs, les attaques actuelles sont remarquablement brutales par leur férocité, à la fois au niveau du point de production et du salaire social. En plus de cela, la crise politique actuelle de la bourgeoisie américaine doit être prise en compte dans toute analyse de l'apparente passivité de la classe ouvrière. Les attaques agressives des insurgés de l'aile droite du parti Républicain sur l'appareil syndical, ainsi que la rhétorique de plus en plus loufoque émergeant du Tea Party ont sans doute eu un effet désorientant sur la conscience de la classe ouvrière. Dans ces conditions, beaucoup de travailleurs restent au niveau de chercher à protéger ce qu'ils ont encore à travers les institutions existantes des syndicats et du Parti Démocrate. D'autres sont devenus tellement désorientés qu'ils sympathisent avec tel ou tel politicien qui semble le plus en colère, même s'il se trouve appartenir au Tea Party.
Néanmoins, malgré les difficultés et les obstacles auxquels elle est confrontée pour retrouver son identité de classe et son terrain de lutte, l'ensemble de la classe ouvrière n'a pas été totalement silencieuse. Les exemples de mobilisations dans le Wisconsin, plus tôt cette année, sont la preuve que nous sommes entrés dans une phase ouverte depuis la grève à New York City Transit en 2005/2006, avec une tendance vers l'accroissement de la confrontation de classe, vers la reprise de la solidarité et vers une volonté de résister à la paralysie instillée par les attaques du capitalisme. Si le traumatisme de l'escalade des attaques dans le sillage de la débâcle financière de 2008 et le chaos politique actuel de la classe dirigeante américaine, actuellement, pèsent lourdement sur la classe ouvrière et sa combativité, la mémoire de ces luttes agit encore au niveau souterrain.
Cependant, alors que les sondages d'opinion ont toujours montré un haut niveau de sympathie de la part de la population pour les manifestants d'Occupy, cela ne s'est pas traduit dans une action massive efficace. Il y a eu des cas, bien sûr, où cette perspective a été évoquée. Cela s'est surtout produit autour de la question de la répression policière. A New York, Oakland et ailleurs, chaque fois que l'Etat semblait aller trop loin dans sa répression des manifestants, une indignation massive de l'opinion publique a contraint l'Etat à plus de retenue. Cependant, alors que les syndicats de New York ont été obligés à plusieurs reprises d'appeler les travailleurs à montrer de la sympathie avec les manifestants devant l'imminence d'une répression, c'est seulement à Oakland que la répression policière a provoqué une réponse plus large de la part de la classe ouvrière.
Il n'est donc pas surprenant que les manifestants d'Occupy aient peu fait pour ralentir les attaques actuelles contre la classe ouvrière. La mise en faillite d'American Airlines, le lock-out permanent à l'American Crystal Sugar et Cooper Tire et l'austérité massive prévue dans l'administration des Postes sont quelques exemples qui montrent que la bourgeoisie n'a pas été intimidée par le mouvement Occupy au point d'infléchir ses attaques contre la classe ouvrière. De toute évidence, la tactique de l’occupation des parcs aux environs du quartier de la finance ne s'est pas avérée efficace dans la lutte contre les attaques du capitalisme. Plutôt que de camper aux abords de Wall Street, de Bay Street et d'autres centres financiers, les manifestants n'auraient-ils pas été plus efficaces s' ils avaient concentré leurs efforts dans les quartiers ouvriers, en montrant aux autres prolétaires, encore trop désorientés pour lutter, qu'ils ne sont pas seuls ?
Il est clair qu'un débat sérieux sur la tactique est devenu nécessaire pour tous ceux qui cherchent à lutter contre la dégradation actuelle de la vie humaine causée par les assauts continus du capitalisme sur la société. Malheureusement pour le mouvement Occupy, son parti-pris fétichiste pour le consensus démocratique, son désir presque de principe de s'abstenir de discussions tactiques et son pluralisme au détriment d'actions concrètes, l'ont empêché jusqu'à présent d'aborder ces questions de manière efficace. Surtout, face à la répression de l'Etat, il n'a pas été en mesure de réfléchir aux questions de manière efficace, « Vers qui devons-nous nous tourner pour trouver le soutien ? » Et « Où allons-nous si nous ne pouvons plus vivre dans le parc ? » Incapable d'examiner ces questions de façon plus profonde, le mouvement Occupy, pour l'instant, tourne en rond et fait face à un avenir incertain.
De notre point de vue, même si le mouvement Occupy représente un premier pas très important d'une partie de la classe ouvrière la plus touchée par la crise du capitalisme, il est clair que l'avenir exigera un réexamen fondamental des objectifs de la lutte et de la méthode pour les réaliser. Comment un mouvement social peut-il aller de l'avant, de manière à éviter les écueils du passé, mais qui lui permette de fonctionner d'une manière vraiment efficace dans le feu de la lutte ? Comment un mouvement social attaché à l'idée qu'un autre monde est possible, reste-t-il fidèle à cet objectif, mais a encore le courage d'affronter tactiquement l'Etat bourgeois ? C’est à toutes ces questions importantes que les révolutionnaires et tous ceux engagés dans une lutte pour un monde différent devront nécessairement prendre en compte dans la période à venir.
Internationalism (5 décembre 2011)
1 Une série d'événements similaires sont survenus à Toronto, où il avait été prévu que les manifestants se réunissent en plein cœur du quartier Bay Street de la ville, pour ensuite se déplacer dans un petit parc à la périphérie du centre ville. La police de Toronto, encore sous le choc de la condamnation par l'opinion publique de leur répression violente contre les manifestants du G20 l'année précédente, était plus que disposée à permettre aux occupants de rester dans le parc.
Géographique:
- Etats-Unis [83]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]
Occuper Londres : le poids des illusions
- 1486 lectures
Occuper Londres : le poids des illusions
Nous publions ci-dessous un article de World Revolution (WR), organe du CCI en Grande-Bretagne.
«'Occuper Londres' est en accord avec les occupations du monde entier, nous sommes les 99%. Nous sommes un forum pacifique et non-hiérarchique. Nous sommes d'accord sur le fait que le système actuel est antidémocratique et injuste. Nous avons besoin d'alternatives; vous êtes invités à nous rejoindre dans le débat et à les développer; afin de créer un avenir meilleur pour tous. »
Ceci est la déclaration qui vous accueille sur le site Web de 'Occuper Londres' (occupylsx.org). Il est certainement vrai qu'il y a des mouvements d'occupation partout dans le monde, avec des actions qui surgissent dans plus d'une centaine de villes aux Etats-Unis, à commencer par le mouvement 'Occuper Wall Street', et dans divers lieux à travers l'Europe (Francfort et Glasgow, pour n'en citer que deux). La forme générale est l'occupation d'un espace public suivi par des discussions, des manifestations et des actions communes.
Que les personnes qui prennent part à des occupations aient des préoccupations par rapport au véritable état du monde, à l'économique, à l'action politique est incontestable. Un camarade de WR a récemment visité deux sites occupés : « J'ai visité Finsbury Square où j'ai parlé à deux jeunes femmes, à un chômeur et à quelqu'un qui avait un emploi. L'un d'eux explique leurs raisons d'être là comme étant dans une certaine mesure mécontents de l'état actuel des choses: 'Les occupations fournissent quelque chose qui n'est pas abondant en Grande-Bretagne: un espace public où les gens sont libres de venir et de discuter dans des assemblées générales, dans un effort pour essayer de comprendre la situation actuelle du monde. Les gens viennent de différentes régions du pays, ainsi que d'autres pays. Certains, bien qu'ils aient un emploi, participent à la protestation. Il y a des tentatives pour envoyer des délégués à, entre autres choses, l'actuelle protestation des électriciens'. Ceci se déroule à un moment où, à travers tout le pays, malgré la peur et la colère engendrées par la pluie de mesures d'austérité, commence à apparaître quelque chose qui va un peu dans le sens d'une authentique réponse des travailleurs. Comme les événements récents en Espagne et en Grèce l'ont démontré, les assemblées sont l'élément vital de l'auto-organisation des travailleurs. Elles sont le lieu où la confrontation politique, la clarification et la réflexion peuvent avoir lieu. Le meilleur exemple en est les discussions intenses, en Espagne, entre ceux qui plaident pour la 'démocratie réelle', qui est une démocratie gouvernementale améliorée et ceux qui mettent en avant une perspective prolétarienne: 'Il y a eu quelques moments très émouvants lorsque les intervenants étaient très excités et parlaient presque tous de révolution, de dénoncer le système, d'être radical (dans le sens de aller à la racine du problème') comme l'a dit l'un d'eux. »[1]
Les discussions autour des revendications d’Occuper Londres s'articulent autour de deux thèmes principaux: comment 'améliorer' la démocratie parlementaire, pour regagner du terrain 'en faveur du peuple', contre les riches, les banquiers, les élites et, deuxièmement comment amener la justice sociale, c'est–à-dire une répartition plus équitable dans le capitalisme. Comme notre camarade l'a dit : « J'ai finalement trouvé la réunion, assez tard, dans la Tente de l'Université où il y avait une discussion sur la démocratie, où j'ai entendu qu'ils n'ont pas vraiment la démocratie en Espagne, étant donné qu'il y a toute une liste de partis, proportionnellement représentés, sans droit de vote pour un député en tant qu'individu, et que les partis font partie de l'Etat, que certains d'entre eux étaient des héritiers directs de la dictature sous Franco ... Dans cette réunion, les politiciens blâmaient à peu près tout. Il y a eu quelques voix discordantes qui ont tenté de soulever la question de l'économie, de souligner que la démocratie au Royaume-Uni n'est pas meilleure. Et il y a eu quelques contributions bizarres à la discussion, incluant l'idée que nous devrions faire participer le public dans la Fonction publique, dans le même genre que ceux qui sont appelés à faire partie d'un jury : peut-être cela pourrait-il remplacer le favoritisme politique à la Chambre des Lords ... ou nous devrions obtenir de meilleurs dirigeants dans le gouvernement, comme en Chine ... L'un pensait que le fait de bricoler le système de vote pour les parlements était le moyen d'essayer d'élargir l'expérience parlementaire. J'ai pu faire trois brèves contributions à la discussion : sur le fait que la façon dont les politiciens se comportent n'est pas causée par le système de vote espagnol, britannique ou tout autre système représentatif, mais par le fait qu'ils défendent le capitalisme, que la crise n'est pas une simple question de banquiers, pour dire que j'avais espéré en apprendre davantage sur les assemblées, et j'ai mentionné une liste d'expériences historiques, y compris les conseils ouvriers. Même s'il y a eu quelques mains qui se sont agitées en signe d'approbation d'une partie de ce que je venais de dire, la discussion générale est retournée à la recherche de moyens pour rendre plus parfaite la démocratie bourgeoise. »
'Occuper Londres' n'est pas seulement plus réduit que les mouvements en Espagne et aux Etats-Unis qui l'ont inspiré, mais les voix qui s'élèvent en faveur d'une perspective de classe ouvrière sont relativement faibles, et celles qui défendent la démocratie parlementaire relativement fortes. Par exemple, les efforts de solidarité avec les revendications des électriciens pour envoyer des 'délégations' vers eux, seulement à une courte distance de marche, ont été considérés comme une décision totalement individuelle et l'initiative de ceux qui y avaient participé, alors que le mouvement 'Occuper Oakland' avait appelé à une grève générale ainsi qu'à des réunions en soirée afin que ceux qui devaient travailler puissent aussi y participer (voir https://occupyoakland.org/ [96]). Cela a laissé le mouvement 'Occuper Londres' très vulnérable par rapport aux manœuvres autour de la menace d'éviction ou de la proposition d'une réduction du nombre de tentes pour une période de deux mois et du cirque médiatique autour de ce qui se passe dans la hiérarchie religieuse de la cathédrale Saint-Paul avec la démission du Chanoine, puis du Doyen.
La réaction des médias a été assez prévisible, avec les « Choc ! Horreur! » des manchettes des articles à la Une dans la presse de l'aile gauche comme libérale, arguant que ces professions représentent un ‘stimulant ' ou une 'secousse' pour un système démocratique guindé. Dans l'ensemble, la plupart des journalistes, et l’institution religieuse, ont essayé de trouver un moyen de faire valoir que les politiciens devraient être 'réactifs' aux 'préoccupations' de protestations légitimes. Mais en l'absence de mise en avant d’une perspective pour prendre contact avec l'ensemble de la classe ouvrière, ces médias s’en sont emparés, comme on pouvait le prévoir de la façon dont ils présentent l'occupation, pour en faire un point de fixation.
La menace d'expulsion et comment se défendre contre la violence et la répression sont évidemment une préoccupation importante. Dans de nombreux endroits d'Amérique, cette 'réponse' des politiciens élus a pris la forme d'une lourde répression (peuvent en témoigner les 700 manifestants dupés et ensuite arrêtés en essayant de traverser le pont de Brooklyn, ou ceux arrêtés et passés à tabac dans d'autres occupations[2]). Toutefois, lorsque l'un de nos camarades est allé à une assemblée générale à Finsbury Square qui discutait sur la façon de réagir à la menace d'expulsion de Saint-Paul (avant la proposition d’y séjourner 2 mois pour en repartir à une date convenue) la façon dont les médias traiteraient leur réponse était la préoccupation majeure. Une proposition d'aller directement vers les travailleurs, faite par notre camarade, en écho à un autre intervenant qui mettait en avant que leurs objectifs vont au-delà du maintien indéfini de l'occupation n'a pas été reprise. En fait les deux interventions ont été ressenties comme sans importance.
Le plus grand danger est maintenant que 'Occuper Londres' se trouve piégé dans une dynamique désespérée, tournée vers l'intérieur en laissant l'Eglise et les médias faire ce qu’ils veulent du mouvement.
Graham (4 novembre)
1. https://en.internationalism.org/icconline/2011/september/indignados [97]
2. The Guardian a rapporté que même le fils du légendaire bluesman Bo Diddley a été arrêté alors qu'il tentait de manifester son soutien à l'Occupation dans une place en Floride... qui porte le nom de son père ! (14 octobre 2011)
Géographique:
- Grande-Bretagne [98]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]
Révoltes sociales en Israël : “Moubarak, Assad, Netanyahou : tous pareils !”
- 1893 lectures
En Israël, depuis la mi-juillet, des centaines de milliers de gens gagnent régulièrement les rues pour manifester contre la hausse vertigineuse du coût de la vie, contre l'impossibilité croissante pour la population de se loger et contre le démantèlement de l'Etat-providence. Les manifestants réclament la “justice” sociale, mais beaucoup parlent aussi de “révolution”. Ils ne font pas mystère du fait qu'ils ont été inspirés par la vague de révolte qui a secoué le monde arabe et qui s'étend maintenant à l'Espagne et à la Grèce. La Premier ministre d'Israël, Netanyahou, dont la politique effrontément droitière semblait avoir rallié un soutien populaire, est soudain comparé à des dictateurs comme en Egypte ( Moubarak, aujourd'hui en procès pour avoir fait tirer sur les manifestants) et en Syrie (Assad ordonnant actuellement encore d'atroces massacres contre une partie croissante de la population exaspérée par son régime).
Comme dans les mouvements dans le monde arabe et en Europe, des manifestations et des campements poussent aujourd'hui dans de nombreuses villes en Israël, mais à Tel Aviv en particulier semblent avoir surgi de nulle part : des messages sur Facebook, quelques personnes installent des tentes dans des parcs... et à partir de là il y a eu entre 50 000 et 150 000 personnes rassemblées (avec plus de 200 000 le samedi 6 août et plus de 300 000 le 13 août ! ) et peut être 3 ou 4 fois plus se sont mobilisés dans l'ensemble du pays, des jeunes pour la majorité d'entre eux.
Comme dans les autres pays, les manifestants se sont fréquemment affrontés à la police. Comme dans les autres pays, les partis politiques officiels et les syndicats n'ont pas joué un rôle de premier plan dans le mouvement, même s'ils étaient certainement présents. Les gens impliqués dans le mouvement sont souvent associés au courant de la démocratie réelle et même à l'anarchisme. Un animateur interrogé sur le réseau RT News a demandé si les manifestations avaient été inspirées par les événements dans les pays arabes. Il a répondu : “Ce qui s'est passé sur la place Tahrir a eu beaucoup d'influence. Cela garde beaucoup d'influence, bien sûr. C'est quand les gens comprennent qu'ils ont le pouvoir, qu'ils peuvent s'organiser eux-mêmes, ils n'ont plus besoin d'un gouvernement pour leur dire ce qu'ils doivent faire, ils peuvent commence à dire aux gouvernements ce qu'ils veulent.” Ces points de vue, même s'ils n'expriment que l'opinion d'une minorité consciente, reflètent certainement un sentiment beaucoup plus général à l'égard de l'ensemble du système politique bourgeois, que ce soit sous sa forme dictatoriale ou démocratique.
Comme ses homologues d'ailleurs, ce mouvement est historique dans sa signification, comme l'a mentionné un journaliste israélien, Noam Sheizaf : “Contrairement à la Syrie ou à la Libye, où les dictateurs massacrent leur propre peuples par centaines, ce n'a jamais été le talon de fer qui a maintenu l'ordre social en Israël, pour autant qu'il s'agissse de la communauté juive. C'est l'endoctrinement qui l'a fait- l'idéologie dominante, pour utiliser le terme préféré par les théoriciens critiques. Et c'est cet ordre culturel (ou idéologique) qui s'est retrouvé balayé dans ce tourbillon de protestations. Pour la première fois, une grande partie de la classe moyenne juive-il est trop tôt pour évaluer l'ampleur que cette masse représente- ont reconnu que le problème n'était pas vis-à-vis d'autres Israéliens, ni avec les Arabes, ou avec tel ou tel politicien qu'il était mais avec l'ordre social tout entier, avec le système dans son ensemble. En ce sens, c'est un événement inédit dans l'histoire d'Israël.
C'est pourquoi cette contestation a un potentiel tellement énorme. C'est aussi la raison pour laquelle nous ne devrions pas en attendre de retombées politiques immédiates, je ne pense pas que nous allons voir tomber le gouvernement prochainement mais dans ses conséquences à long terme, de façon sous-jacente, c'est ce qui est sûr de se produire.” (cf. l'article “La réelle importance du mouvement des tentes”[1])
Ceux qui minimisent l'importance de ces événements
Et pourtant, il y a ceux qui ne sont que trop heureux de minimiser le sens de ces événements. La presse officielle dans sa très grande majorité les a complètement ignorés. Il y a un fort contingent de correspondants de la presse étrangère à Jérusalem - entre 800 et 1000 personnes (la deuxième en taille après ceux basés à Washington qui n'a commencé à manifester un certain intérêt envers lui que plusieurs semaines après que le mouvement ait démarré. Vous deviez chercher longtemps et avec persévérance pour le voir mentionné dans des journaux dits “progressistes” comme The Guardian ou Socialist Worker au Royaume-Uni.
Une autre tactique pour les minimiser est de les cataloguer comme représentatifs du mouvement des classes moyennes. Il est vrai que, comme pour tous les autres mouvements, nous considérons une révolte sociale très large qui peut exprimer le mécontentement de beaucoup de couches différentes de la société, allant des petits entrepreneurs jusqu'aux ouvriers à la chaîne, qui sont toutes touchées par la crise économique mondiale, par l'écart grandissant entre les riches et les pauvres, et, dans un pays comme Israël par l'aggravation des conditions de vie à cause des exigences insatiables de l'économie de guerre. Mais le terme de “classe moyenne” est devenu un synonyme de paresseux, un terme “fourre-tout” pour parler de quelqu'un qui a reçu une certaine éducation ou bénéficie d'un travail et, en Israël comme en Afrique du Nord, en Espagne ou en Grèce, un nombre croissant de jeunes gens instruits sont poussé dans les rangs du prolétariat, travaillant dans des emplois précaires mal rémunérés et peu qualifiés où l'on peut embaucher n'importe qui ; en tous cas, des secteurs plus “classiques” de la classe ouvrière ont été également impliqués dans les manifestations : le secteur public, les ouvriers dans l'industrie, les fractions les plus pauvres des chômeurs, certains d'entre eux étant des immigrés non-Juifs venus d'Afrique et d'autres pays du tiers-monde.
Il y a eu aussi une grève générale de 24 heures que la fédération syndicale Histradut a lancée pour tenter de faire face au mécontentement de ses propres adhérents.
Mais les plus grands détracteurs du mouvement sont ceux d'extrême-gauche. Comme l'a rapporté l'un des posts sur libcom [2] :“J'ai eu une grosse dispute avec une animatrice du SWP dans ma section syndicale dont l'argument était qu'il n'y avait pas de classe ouvrière en Israël. Je lui ai alors demandé qui conduisait les bus, qui construisait des routes, qui s'occupait des enfants dans les crèches et les écoles, etc. et elle juste esquivé la question et embrayé sur le sionisme et l'occupation des territoires palestiniens.”
Le même fil sur le web contenait également un lien vers un blog de gauche[3] qui a présenté une version plus sophistiquée de cet argument : “Certes, toutes les couches de la société israélienne, des syndicats aux systèmes d'éducation, les forces armées et les partis politiques dominants, sont impliqués dans un système d'apartheid. Cela était vrai dès la création, dans les formes très embryonnaires de l'Etat israélien construit dans la période du protectorat britannique. Israël est une société de colons et cela a des conséquences énormes pour le développement de la conscience de classe. Tant qu'il se développe sous le renforcement des avant-postes coloniaux, aussi longtemps que les gens sont amenés à identifier leurs intérêts avec l'expansion d'un peuplement par la colonisation, il y peu de chances de pouvoir développer une classe ouvrière révolutionnaire, une force sociale indépendante. Non seulement, il s'agit d'une société de colons et de colonisés mais ce régime est aussi soutenu par les ressources matérielles de l'impérialisme américain.”
L'idée que la classe ouvrière israélienne serait un cas particulier conduit de nombreux gauchistes à soutenir que le mouvement de protestation ne devrait pas être pris en charge ou ne devrait être soutenu que s'il prenait d'abord position sur la question palestinienne : “ Les manifestations sociales sont deux fois plus importantes depuis les années 1970 et devraient se traduire dans des politiques de réformes ou même de remaniement gouvernemental. Mais jusqu'à ce que les réformes portent sur toutes les questions au coeur de la situation d'oppression et de discrimination envers les logements, jusqu'à ce que les changements politiques mettent les Palestiniens sur un pied d'égalité avec les Israéliens, jusqu'a ce que les avis d'expulsion des terres ne soient plus traitées arbitrairement, les programmes de réforme sont vains et les manifestations sont inutiles”, le mouvement de protestation unilatérale “libérale” d'Israël n'est pas un mouvement digne de le rejoindre, ni même de le soutenir”, Sami Kishawi[4] sur le blog “Seize minutes pour la Palestine”.
En Espagne, parmi les participants au mouvement du 15-mai, des débats similaires se sont déroulés, par exemple autour d'une proposition selon laquelle “les manifestants israéliens ne devraient être soutenus que “s'ils prennent position, en tant que mouvement, sur la question palestinienne, en dénonçant clairement et l'ouvertement l'occupation des territoires, le blocus autour de Gaza et [en appelant à] la fin des colonisations” (sur le même fil, dans libcom.)
Une réponse est en train d'être donnée dans la pratique par le mouvement en Israël à ces arguments gauchistes. D’abord, le problème se déroule dans les rues israéliennes et il est dèjà difficile de faire une division entre les Juifs, les Arabes et les autres. Quelques exemples : à Jaffa, des dizaines de manifestants arabes comme juifs portaient des pancartes écrites à la fois en Hébreu et en Arabe où on pouvait lire “Les Arabes et les Juifs veulent un logement au prix abordable” et “Jaffa ne veut pas d'offres de logements réservées aux riches.”
Des militants arabes unt installé un campement dans le centre de Taibeh et des centaines de personnes le visitent chaque nuit. “ Ceci est une protestation sociale consécutive à la détresse profonde dans la communauté arabe. Tous les Arabes souffrent du coût de la vie et de la pénurie de logements” comme l'a dit l'un des organisateurs, le docteur Zoheir. Un certain nombre de jeunes Druzes ont dressé des tentes à l'extérieur des villages de Yarka et de Julis, en Galilée Occidentale. “Nous essayons d'attirer tout le monde dans les tentes pour nous joindre la manifestation” a déclaré Wadji Khatar, l'un des initiateurs de la protestation. Un campement rassemblant Juifs et Palestiniens a été mis en place dans la ville d'Akko, ainsi que dans Jérusalem-Est où il y a eu des manifestations de Juifs et d'Arabes pour protester contre l'expulsion de ces derniers, partant du quartier de Cheikh Jarrah. A Tel-Aviv, des contacts ont été établis avec les résidents de camps de réfugiés dans les territoires occupés, qui ont visité à leur tour les villages de tentes et ont engagé des discussions avec les manifestants.[5]
Dans le Parc Levinsky, au Sud de Tel-Aviv le lundi 1er août, où le deuxième plus grand village de tentes a résisté pendant près d'une semaine, plus d'une centaine d'immigrés et de réfugiés africains se sont réunis[6] pour débattre des protestations contre les conditions de vie actuelles à travers le pays.
Il n'y a aucune raison d'accepter l'austérité
De nombreux manifestants ont exprimé leur frustration face à la manière dont la rengaine incessante sur la “sécurité” et sur la menace du terrorisme est utilisée pour faire accepter la misère économique et sociale croissante. Certains ont ouvertement mis en garde contre le danger que le gouvernement pourrait provoquer des affrontements militaires ou même une nouvelle guerre pour restaurer “l'union nationale” et diviser le mouvement de protestation.[7] Comme cela se produit, le gouvernement Netanyahou semble se tenir en retrait pour le moment, pris de cours et essayant de recourir à toutes sortes d'expédients pour prendre la température du mouvement. Il n'en demeure pas moins qu'il y a effectivement une prise de conscience croissante que la situation militaire et la situation sociale sont très étroitement liées.
Comme toujours, la situation matérielle de la classe ouvrière est la clé du développement de la conscience et le mouvement social actuel accélère grandement la possibilité d'appréhender le situation militaire d'un point de vue de classe. Le prolétariat israélien, souvent décrit par l'aile gauche du capital comme “une caste de privilégiés vivant en dehors de la misère des Palestiniens”, paie effectivement très cher la note de “l'effort du guerre” dans sa chair, en termes de dommages psychiques comme à travers une paupérisation matérielle. Un exemple très précis lié à l'un des principaux enjeux du mouvement social en cours, c'est la question du logement : le gouvernement verse des sommes exorbitantes pour aider à établir des colonies dans les territoires occupés plutôt que d'augmenter le parc des logements dans le reste d'Israël.
L'importance du mouvement actuel en Israël, avec toutes ses confusions et hésitations, c'est qu'il a très clairement confirmé l'existence de l'exploitation de classe et de la lutte de classe au sein de l'apparent monolithisme national de l'Etat d'Israël. La défense des conditions de vie de la classe ouvrière se heurtera inévitablement aux sacrifices exigés par la guerre et par conséquent toutes les questions politiques concrètes posées par la guerre devront être soulevées, débattues et clarifiées : les lois discriminatoires en Israël et dans les territoires occupés, la brutalité de l'occupation, la conscription et jusqu'à l'idéologie du sionisme et du faux idéal de l'Etat juif. Certes, ces questions sont difficiles et les réponses peuvent diviser comme il y a eu une forte tentation d'éviter de les poser directement. Mais la politique a un chemin pour s'immiscer dans tous les conflits sociaux. Un exemple en a été donné par le conflit croissant entre les manifestants et des représentants de l'extrême droite “kahaniste” qui veulent expulser les Arabes d'Israël comme avec des colons “fondamentalistes” qui voient les manifestants comme des traîtres à la nation.
Mais ce ne serait pas une avancée si le mouvement qui a rejeté ces idéologies de droite adoptait les positions de l'aile gauche du capital : le soutien au nationalisme palestinien, une solution pour créer deux Etats ou un “Etat laïque et démocratique”. L'actuelle vague de révoltes contre l'austérité capitaliste ouvre la porte à une toute autre solution : la solidarité de tous les exploités face à toutes les divisions religieuses ou nationales ; la lutte de classes dans tous les pays dans le but de faire la révolution dans le monde entier qui sera la négation des frontières nationales et l'abolition des Etats. Il y a un an ou deux, une telle perspective aurait semblé totalement utopique à la plupart des gens . Aujourd'hui, un nombre croissant de personnes voit la révolution mondiale comme une alternative réaliste à l'ordre du monde capitaliste en train de s'effondrer.
Amos-WR (8 juillet 2011)
[1] https://972mag.com/the-essence-of-the-tent-protest-2128-7201/ [100]
[2] https://libcom.org/forums/news/israelis-take-streets-protesting-rising-p... [101]
[3] https://leninology.blogspot.com/2011/08/few-observations-on-israel-prote... [102]
[4] https://smpalestine.com/author/samikishawi/ [103]
[5] Une des Israéliennes qui a pris part à ces discussions décrit ainsi les effets positifs (voir par exemple l'interview de Stav Shafir sur RT News) que celles-ci ont eu sur le développement de la conscience et de la solidarité : “Nos hôtesses, certaines religieusement voilées, écoutent attentivement l'histoire des jeunes juifs de la classe moyenne qui n'ont pas d'endroit pour vivre, pour étudier et pour travailler. Les tentes sont si nombreuses et si petites. Elles hochaient la tête de surprise, exprimant leur sympathie et peut être même un certain plaisir à mesure que s'exprimaient de nouvelles possibilités de solidarité. Une femme à la langue bien pendue a lancé un slogan auquel aucun d'entre nous n'avait jamais pensé : “Hada Muchayem Lajiyin Israelliyn !”- “Un camp de réfugiés pour les Israéliens !”, s'est-elle exclamée.
Nous avons ri de cette petite blague. C'est sûr, nous n'avons pas du tout les mêmes conditions de vie- ou peut-être juste un petit quelque chose, après tout. Les jeunes de Rotschild (puisse Allah les aider et qu'ils récoltent les fruits de leur contestation !) sont censés pouvoir se lever à l'heure qu'ils veulent et peuvent réintégrer à tout moment la grisaille de la vie à laquelle ils étaient habitués avant de s'installer dans la chaleur caniculaire du boulevard central. Cependant, ils sont condamnés à se trouver tout au bout de la chaîne israélienne d'obtention de logements- sans propriété, sans terre et sans toit qui soit à eux. Certaines des femmes qui étaient avec nous ce soir-là, pleines de curiosité et de passion pour se divertir-ont vécu dans la “réalité” des camps de réfugiés la plus grande partie de leur existence. Certaines sont nées dedans, d'autres se sont mariées et ont déménagé de leurs maisons en ruines en partageant pendant de nombreuses années le sort des nombreuses familles entassées dans des tentes de fortune à la périphérie des villes et des villages de Cisjordanie.
Les “camps de réfugiés” des habitants en colère d'Israël s'éveillent ces jours-ci dans tout le pays et sortent d'une fausse conscience qui les a amenés jusqu’à cette rencontre délicate de l'été 2011. Il ne s'agit pas d'une étape facile, mais cela vaut la peine de faire l'effort d'aller jusqu'au bout du chemin, jusqu'à la racine de nos problèmes. Ceux d'entre nous qui ont eu le privilège le week-end dernier de danser, de chanter, de se tenir bras dessus bras dessous sur un toit de Tel-Aviv avec nos amies des villages et des camps de réfugiés des territoires occupés, ne consentiront jamais à abandonner avec des gens que nous considérions autrefois comme des ennemis. Il suffit de penser combien de bons appartements pourraient être construits avec les sommes gaspillées au cours de décennies entières pour renforcer l'idée stupide selon laquelle tous les non-Juifs constitueraient “un danger pour notre démographie.”
[6] https://mondoweiss.net/2011/08/will-israels-tent-protesters-awaken-to-th... [104]
[7] https://www.youtube.com/watch?v=6i6JKSGEs8Y&feature=player_embedded#... [105]
Solidarité avec les "indignés" en Espagne : l'avenir appartient à la classe ouvrière !
- 3568 lectures
 Manifestation à Berlin en solidarité avec les Indignés d'EspagneAu moment où, dans beaucoup de pays, les médias font, jour après jour, leurs gros titres sur le "séisme" du "scandale DSK", un autre "séisme", réel, frappe l'Europe : celui d'un vaste mouvement social en Espagne qui se cristallise, depuis le 15 mai, par l'occupation jour et nuit de la Place Puerta Del Sol à Madrid par une marée humaine composée essentiellement de jeunes, révoltés par le chômage, les mesures d'austérité du gouvernement Zapatero, la corruption des politiciens. Ce mouvement social s'est répandu comme une trainée de poudre à toutes les villes du pays grâce aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) : Barcelone, Valence, Grenade, Séville, Malaga, León… Mais les informations n'ont pas franchi la barrière des Pyrénées. En France, seuls les réseaux sociaux Internet et certains médias alternatifs ont largement diffusé les images et les vidéos de ce qui se passait en Espagne depuis la mi-mai. Si les médias bourgeois ont fait un tel black-out sur ces événements, en préférant nous intoxiquer avec la "série américaine" de l'affaire DSK, c'est justement parce que ce mouvement constitue une étape très importante dans le développement des luttes sociales et des combats de la classe ouvrière mondiale face à l'impasse du capitalisme.
Manifestation à Berlin en solidarité avec les Indignés d'EspagneAu moment où, dans beaucoup de pays, les médias font, jour après jour, leurs gros titres sur le "séisme" du "scandale DSK", un autre "séisme", réel, frappe l'Europe : celui d'un vaste mouvement social en Espagne qui se cristallise, depuis le 15 mai, par l'occupation jour et nuit de la Place Puerta Del Sol à Madrid par une marée humaine composée essentiellement de jeunes, révoltés par le chômage, les mesures d'austérité du gouvernement Zapatero, la corruption des politiciens. Ce mouvement social s'est répandu comme une trainée de poudre à toutes les villes du pays grâce aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) : Barcelone, Valence, Grenade, Séville, Malaga, León… Mais les informations n'ont pas franchi la barrière des Pyrénées. En France, seuls les réseaux sociaux Internet et certains médias alternatifs ont largement diffusé les images et les vidéos de ce qui se passait en Espagne depuis la mi-mai. Si les médias bourgeois ont fait un tel black-out sur ces événements, en préférant nous intoxiquer avec la "série américaine" de l'affaire DSK, c'est justement parce que ce mouvement constitue une étape très importante dans le développement des luttes sociales et des combats de la classe ouvrière mondiale face à l'impasse du capitalisme.
Les prémices du mouvement
Le mouvement des "indignés" en Espagne a mûri depuis la grève générale du 29 septembre 2010 contre le projet de réforme des retraites. Cette grève générale s'est soldée par une défaite tout simplement parce que les syndicats ont négocié avec le gouvernement et accepté le projet de réforme (les travailleurs actifs de 40-45 ans toucheront, à leur départ à la retraite, une pension inférieure de 20% à leur pension actuelle). Cette défaite a provoqué un profond sentiment d'amertume au sein de la classe ouvrière. Mais elle a suscité un profond sentiment de colère parmi les jeunes qui s'étaient mobilisés et avaient participé activement au mouvement, notamment en apportant leur solidarité dans les piquets de grève.
Début 2011, la colère commence à gronder dans les universités. En mars, au Portugal, un appel à une manifestation du groupe Jeunes Précaires est lancé sur Internet et débouche sur une manifestation regroupant 250 000 personnes à Lisbonne. Cet exemple a eu un effet immédiat dans les universités espagnoles, notamment à Madrid. La grande majorité des étudiants et des jeunes de moins de 30 ans survit avec 600 euros par mois grâce à des petits boulots. C'est dans ce contexte qu'une centaine d'étudiants ont constitué le groupe "Jeunes sans futur" ("Jovenes sin futuro"). Ces étudiants pauvres, issus de la classe ouvrière, se sont regroupés autour du slogan "sans soins, sans toit, sans revenus, sans peur". Ils ont appelé à une manifestation le 7 avril. Le succès de cette première mobilisation qui a rassemblé environ 5000 personnes, a incité le groupe "Jeunes sans futur" à programmer une nouvelle manifestation pour le 15 mai. Entre temps est apparu à Madrid, le collectif "Democracia Real Ya" (Démocratie Réelle Maintenant !) dont la plateforme se prononçait aussi contre le chômage et la "dictature des marchés", mais qui affirmait être "apolitique", ni de droite ni de gauche. Democracia Real Ya a lancé également des appels à manifester le 15 mai dans d'autres villes. Mais c'est à Madrid que le cortège a connu le plus grand succès avec environ 25 000 manifestants. Un cortège bon enfant qui devait se terminer tranquillement sur la Puerta del Sol (la "Porte du Soleil").
La colère de la jeunesse "sans futur" gagne l'ensemble de la population
Les manifestations du 15 mai appelées par Democracia Real Ya ont connu un succès spectaculaire : elles exprimaient un mécontentement général, notamment parmi les jeunes confrontés au problème du chômage à la fin de leurs études. Tout aurait dû apparemment s'arrêter là, mais à la fin des manifestations à Madrid et à Grenade des incidents provoqués par un petit groupe de "black blocks" sont réprimés par les charges de la police et se sont soldées par plus d'une vingtaine d'arrestations. Les détenus, brutalisés dans les commissariats, se sont regroupés dans un collectif et ont adopté un communiqué dénonçant les violences policières. La diffusion de ce communiqué a suscité immédiatement une réaction d'indignation et de solidarité générale face à la brutalité des forces de l'ordre. Une trentaine de personnes totalement inconnues et inorganisées décident d'occuper la Puerta del Sol à Madrid et d'y établir un campement. Cette initiative a fait immédiatement tâche d'huile et a gagné la sympathie de la population. Le même jour, l'exemple madrilène s'étend à Barcelone, Grenade et Valence. Une nouvelle flambée de répression policière met le feu aux poudres et depuis lors, les rassemblements de plus en plus massifs sur les places centrales se sont étendus à plus de 70 villes du pays et n'ont fait que croître à toute allure.
Dans l'après-midi du mardi 17 mai, les organisateurs du "mouvement du 15 Mai" avaient prévu des actions silencieuses de protestation ou des mises en scène ludique "défouloir", mais la foule rassemblée sur les places publiques ne cessait de croître en réclamant à grands cris la tenue d'assemblées. A 20 heures, commencent à se tenir des assemblées à Madrid, Barcelone, Valence et dans d'autres villes. A partir du mercredi 18, ces assemblées prennent la forme d'une véritable avalanche. Les rassemblements se transforment en Assemblées générales ouvertes sur les places publiques.
Face à la répression et dans la perspective des élections municipales et régionales, le collectif Democracia Real Ya lance le débat autour d'un objectif : la "régénération démocratique" de l'État espagnol. Il revendique une réforme de la loi électorale afin d'en finir avec le bipartisme PSOE/Parti Populaire en réclamant une "vraie démocratie" après 34 ans de "démocratie imparfaite" suite au régime franquiste.
Mais le mouvement des "indignés" a largement débordé la seule plateforme revendicative, démocratique et réformiste, du collectif Democracia Real Ya. Il ne s'est pas cantonné à la seule révolte de la jeune "génération perdue des 600 euros". Dans les manifestations et sur les places occupées à Madrid, comme à Barcelone, Valence, Malaga, Séville etc., sur les pancartes et banderoles, on pouvait y lire des slogans tels que : "Démocratie sans capital!", "PSOE et PP, la même merde", "Construisons un futur sans capitalisme !", "Si vous ne nous laissez pas rêver, nous ne vous laisserons pas dormir", "Tout le pouvoir aux Assemblées !", "Le problème n'est pas la démocratie, le problème, c'est le capitalisme !", "Sans travail, sans maison, sans peur", "ouvriers, réveillez-vous !" "600 euros par mois, voilà où est la violence !".
A Valence, des femmes criaient : "ils ont trompés les grands-parents, ils sont encore trompés les fils, il faut que les petits enfants ne se laissent pas avoir !".
Les Assemblées massives, une "arme chargée de futur"
Face à la démocratie bourgeoise qui réduit la "participation" au fait de "choisir" tous les quatre ans le politicien qui ne tiendra jamais ses promesses électorales et mettra en œuvre les plans d'austérité exigés par la l'aggravation inexorable de la crise économique, le mouvement des "indignés" en Espagne s'est réapproprié spontanément une arme du combat de la classe ouvrière : les Assemblées générales ouvertes. Partout ont surgi des assemblées massives de villes, regroupant des dizaines de milliers de personnes de toutes les générations et de toutes les couches non exploiteuses de la société. Dans ces assemblées, chacun peut prendre la parole, exprimer sa colère, lancer des débats sur différentes questions, faire des propositions. Dans cette atmosphère d'ébullition générale, la parole se libère, tous les aspects de la vie sociale sont passés en revue (politique, culturel, économique…). Les places sont inondées par une gigantesque vague collective d'idées discutées dans un climat de solidarité et de respect mutuel. Dans certaines villes, on installe des "boîtes à idées", des urnes où chacun peut déposer des idées rédigées sur un bout de papier. Le mouvement s'organise avec une très grande intelligence. Des commissions se mettent en place, notamment pour éviter les débordements et les affrontements avec les forces de l'ordre : la violence y est interdite, l'alcoolisation proscrite avec le mot d'ordre "La revolución no es botellón" (La révolution n'est pas une beuverie). Chaque jour, des équipes de nettoyage sont organisées. Des cantines publiques servent des repas, des garderies pour enfants et des infirmeries sont montées avec des volontaires. Des bibliothèques sont mises en place ainsi qu'une "banque du temps" (où son organisés des enseignements aussi bien scientifiques que culturels, artistiques, politiques, économiques). Des "journées de réflexion" sont planifiées. Chacun apporte ses connaissances et ses compétences.
En apparence, ce torrent de pensées ne semble déboucher sur rien. Il n'y a pas de propositions concrètes, pas de revendications réalistes ou immédiatement réalisables. Mais ce qui apparaît clairement, c'est d'abord et avant tout un énorme ras-le-bol de la misère, des plans d'austérité, de l'ordre social actuel, une volonté collective de briser l'atomisation sociale, de se regrouper pour discuter, réfléchir tous ensemble. Malgré les nombreuses confusions et illusions, dans les bouches comme sur les banderoles et pancartes, le mot "révolution" est réapparu et ne fait plus peur.
Dans les Assemblées, les débats ont fait apparaître des questions fondamentales :
- faut-il se limiter à la "régénération démocratique" ? Les problèmes n'ont-ils pas leur origine dans le capitalisme, un système qui ne peut être réformé et doit être détruit de fond en comble ?
- Le mouvement doit-il s'arrêter le 22 mai, après les élections, ou faut-il le poursuivre pour lutter massivement contre les attaques des conditions de vie, le chômage, la précarité, les expulsions ?
- Ne devrait-on pas étendre les assemblées aux lieux de travail, aux quartiers, aux agences pour l'emploi, aux lycées, aux universités ? Doit-on enraciner le mouvement chez les travailleurs qui sont les seuls à avoir la force de mener une lutte généralisée ?
Dans ces débats au sein des Assemblées, deux tendances sont apparues très clairement :
- l'une, conservatrice, animée par les couches sociales non prolétariennes semant l'illusion qu'il est possible de réformer le système capitaliste à travers une "révolution démocratique et citoyenne";
- l'autre, prolétarienne, mettant en évidence la nécessité d'en finir avec le capitalisme.
Les assemblées qui se sont tenues le dimanche 22 mai, jour des élections, ont décidé de poursuivre le mouvement. De nombreuses interventions ont déclaré : "nous ne sommes pas ici à cause des élections, même si elles ont été le détonateur". La tendance prolétarienne s'est plus clairement affirmée à travers les propositions d'"aller vers la classe ouvrière" en mettant en avant des revendications contre le chômage, la précarité, les attaques sociales. A la Puerta del Sol, la décision est prise d'organiser des "assemblées populaires" dans les quartiers. On commence à entendre des propositions d'extension vers les lieux de travail, les universités, les agences pour l'emploi. A Malaga, Barcelone et Valence, les assemblées ont posé la question d'organiser une manifestation contre les réductions du salaire social, en proposant une nouvelle grève générale, qui soit "véritable" comme l'a affirmé l'un des orateurs.
C'est surtout à Barcelone, capitale industrielle du pays, que l'Assemblée centrale de la place de Catalogne, apparaît comme la plus radicale, la plus animée par la tendance prolétarienne et la plus distante par rapport à l'illusion de la "régénération démocratique". Ainsi, des ouvriers de la Telefónica, des travailleurs des hôpitaux, des pompiers, des étudiants mobilisés contre les coupes sociales, ont rejoint les assemblées de Barcelone et ont commencé à leur insuffler une tonalité différente. Le 25 mai, l'Assemblée de la place de Catalogne décide de soutenir activement la grève des travailleurs des hôpitaux, tandis que l'Assemblée de la Puerta del Sol à Madrid décide de décentraliser le mouvement en convoquant des "assemblées populaires" dans les quartiers afin de mettre en pratique une "démocratie participative horizontale". A Valence, les manifestations des chauffeurs de bus ont rejoint une manifestation d'habitants contre les coupes budgétaires dans l'enseignement. A Saragosse, les conducteurs de bus se sont joints aux rassemblements avec le même enthousiasme.
A Barcelone, les "indignés" décident de maintenir leur campement et de continuer à occuper la place de Catalogne jusqu'au 15 juin.
L'avenir est entre les mains des jeunes générations de la classe ouvrière
Quelle que soit la direction dans lequel va se poursuivre le mouvement, quelle que soit son issue, il est clair que cette révolte initiée par les jeunes générations confrontée au chômage (en Espagne, 45 % de la population des 20-25 ans n'a pas de travail), se rattache pleinement au combat de la classe ouvrière. Sa contribution à la lutte internationale de la classe ouvrière est indiscutable.
C'est un mouvement généralisé qui a impliqué toutes les couches sociales non exploiteuses, notamment toutes les générations de la classe ouvrière. Même si celle-ci a été noyée dans la vague de colère "populaire" et ne s'est pas affirmée de façon autonome à travers des grèves et manifestations massives, en mettant en avant ses propres revendications économiques immédiates. Ce mouvement exprime en réalité une maturation en profondeur de la conscience au sein de la seule classe qui puisse changer le monde en renversant le capitalisme : la classe ouvrière.
Ce mouvement révèle clairement que, face à la faillite de plus en plus évidente du capitalisme, des masses importantes commencent à se lever dans les pays "démocratiques" d'Europe occidentale, ouvrant la voie à la politisation des luttes du prolétariat.
Mais surtout, ce mouvement a révélé que les jeunes, en grande majorité des travailleurs précaires et chômeurs, ont été capables de s'approprier les armes de combat de la classe ouvrière : les assemblées générales massives et ouvertes, qui leur ont permis de développer la solidarité et de prendre eux-mêmes en main leur propre mouvement en dehors des partis politiques et des syndicats.
Le mot d'ordre "Tout le pouvoir aux assemblées !" qui a surgi dans le mouvement, même si de façon encore minoritaire, n'est qu'un remake du vieux mot d'ordre de la Révolution russe "Tout le pouvoirs aux conseils ouvriers !" (soviets).
Même si, aujourd'hui, le mot "communisme" fait encore peur (du fait du poids des campagnes déchainées par la bourgeoisie au lendemain de l'effondrement du bloc de l'Est et des régimes staliniens), le mot "révolution" n'a effrayé personne, bien au contraire.
Ce mouvement n'est nullement une "Spanish Revolution" comme le présente le collectif Democracia Real Ya. Le chômage, la précarité, la vie chère et la dégradation constante des conditions d'existence des masses exploitées ne sont pas une spécificité espagnole ! Le visage sinistre du chômage, notamment le chômage des jeunes, on le voit autant à Madrid qu'au Caire, autant à Londres qu'à Paris, autant à Athènes qu'à Buenos Aires. Nous sommes tous unis dans la même chute dans l'abîme de la décomposition de la société capitaliste. Cet abîme, ce n'est pas seulement celui de la misère et du chômage, mais aussi celui de la multiplication des catastrophes nucléaires, des guerres et d'une dislocation des rapports sociaux accompagnée d'une barbarie morale (comme en témoigne, entre autres, l'augmentation des agressions sexuelles et des violences faites aux femmes dans les pays "civilisés").
Le mouvement des "indignés" n'est pas une "révolution". Il n'est qu'une nouvelle étape dans le développement des luttes sociales et des combats de la classe ouvrière à l'échelle mondiale, qui seuls, peuvent ouvrir une perspective d'avenir pour cette jeunesse "sans futur" comme pour l'ensemble de l'humanité.
Ce mouvement (malgré toutes ses confusions et ses illusions sur la "république indépendante de la Puerta del Sol"), révèle que, dans les entrailles de la société bourgeoise, la perspective d'une autre société est en gestation. Le "séisme espagnol" révèle que les nouvelles générations de la classe ouvrière, qui n'ont rien à perdre, sont d'ores et déjà les acteurs de l'histoire. Elles sont en train de creuser les galeries pour d'autres tremblements de terre sociaux qui finiront par ouvrir la voie vers l'émancipation de l'humanité. Grâce à l'utilisation de réseaux sociaux Internet, de la téléphonie mobile et des moyens modernes de communication, ces jeunes générations ont montré leur capacité à briser le black-out de la bourgeoise et de ses médias pour commencer à développer la solidarité au-delà des frontières.
Cette nouvelle génération de la classe ouvrière a émergé sur la scène sociale internationale à partir de 2003, d'abord face à l'intervention militaire en Irak de l'administration Bush (dans de nombreux pays, les jeunes manifestants protestaient contre la "busherie"), puis avec les premières manifestations en France contre la réforme des retraites en 2003. Elle s'est affirmée au printemps 2006 dans ce même pays avec le mouvement massif des étudiants et lycéens contre le CPE. En Grèce, en Italie, au Portugal, en Grande-Bretagne, la jeunesse scolarisée a fait également entendre sa voix face à la seule perspective que le capitalisme est capable de lui offrir : la misère absolue et le chômage.
Le raz de marée de cette nouvelle génération "sans futur" a frappé récemment la Tunisie et l'Égypte, conduisant à une gigantesque révolte sociale qui a provoqué la chute de Ben Ali et de Moubarak. Mais il ne faut pas oublier que l'élément déterminant qui a obligé la bourgeoisie des principaux pays "démocratiques" (et notamment Barak Obama) à lâcher Ben Ali et Moubarak, ce sont les grèves ouvrières et la menace d'une grève générale face à la répression sanglante des manifestants.
Depuis, la place Tarhir est devenue un emblème, un encouragement à la lutte pour les jeunes générations de la classe ouvrière dans de nombreux pays. C'est sur ce modèle que les "indignés" en Espagne ont établi leur campement à la Puerta del Sol, ont occupé les places de plus de 70 villes et ont agrégé dans les assemblées toutes les générations et toutes les couches sociales non exploiteuses (à Barcelone, les "indignés" ont même renommé la place de Catalogne, "Plaza Tahrir").
Le mouvement des "indignés" est, en réalité, beaucoup plus profond que la révolte spectaculaire qui s'est cristallisée au Caire sur la place Tahrir.
Ce mouvement a explosé dans le principal pays de la péninsule ibérique, et qui constitue le pont entre deux continents. Le fait qu'il se déroule dans un Etat "démocratique" d'Europe occidentale (et, de surcroit, dirigé par un gouvernement "socialiste" !), ne peut que contribuer, à terme, à balayer les mystifications démocratiques déployées par les médias depuis la "révolution de jasmin " en Tunisie.
De plus, bien que Democracia Real Ya qualifie ce mouvement de "spanish revolution", aucun drapeau espagnol n'a été exhibé, alors que la place Tahrir était inondée de drapeaux nationaux1.
Malgré les illusions et confusions qui jalonnent inévitablement ce mouvement initié par les jeunes "indignés", ce dernier constitue un maillon très important dans la chaîne des luttes sociales qui explosent aujourd'hui. Avec l'aggravation de la crise mondiale du capitalisme, ces luttes sociales ne peuvent que continuer à converger avec la lutte de classe du prolétariat et contribuer à son développement.
Le courage, la détermination et le sens profond de la solidarité de la jeune génération "sans futur" révèle qu'un autre monde est possible : le communisme, c'est-à-dire l'unification de la communauté humaine mondiale. Mais pour que ce "vieux rêve" de l'humanité puisse devenir réalité, il faut d'abord que la classe ouvrière, celle qui produit l'essentiel des richesses de la société, retrouve son identité de classe en développant massivement ses combats dans tous les pays contre l'exploitation et contre toutes les attaques du capitalisme.
Le mouvement des "indignés" a commencé à poser de nouveau la question de la "révolution". Il appartient au prolétariat mondial de la résoudre et de lui donner une direction de classe dans ses combats futurs vers le renversement du capitalisme. C'est uniquement sur les ruines de ce système d'exploitation basé sur la production de marchandises et le profit que les nouvelles générations pourront édifier une autre société, rendre à l'espèce humaine sa dignité et réaliser une véritable "démocratie" universelle.
Sofiane (27 mai 2011)
1 On a même vu, au contraire, apparaître des slogans appelant à une "révolution globale" et à l'"extension" du mouvement au-delà des frontières nationales. Dans toutes les Assemblées une "commission internationale" a été créée. Le mouvement des "indignés" a essaimé dans toutes les grandes villes d'Europe et du continent américain (même à Tokyo, Pnom-Penh et Hanoï, des regroupements de jeunes espagnols expatriés déploient la bannière de Democracia Real Ya !).
Géographique:
- Espagne [106]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]
Solidarité avec les indignés de Barcelone matraqués par la démocratie bourgeoise : A BAS L' ETAT POLICIER !
- 1536 lectures
Le vendredi 27 mai, entre 6 et 7 heures du matin, 300 agents de la police catalane et de la police municipale ont fait évacuer brutalement la Place de Catalogne à Barcelone, occupée par 3000 "Indignés". Ceux-ci y campaient jour et nuit depuis le 16 mai pour protester, comme à Madrid et dans environ 70 autres villes en Espagne, contre le chômage, la misère, la précarité et l'absence de futur.
Cette intervention musclée se justifiait, selon les dires du porte-parole de la Generalitat catalane (le gouvernement provincial), par la nécessité de faire place nette pour la retransmission le lendemain soir sur écran géant de… la finale de la Champions League de football "Barça,-Manchester United" ! La manifestation de la colère face à la pauvreté grandissante devait donc laisser sa place à quelque chose de bien plus important pour l'humanité (sic !) : la fête prévue au centre ville en cas de victoire du club de Barcelone ! Ce prétexte, évidemment crapuleux, permettait surtout d'évacuer de force un des lieux où la contestation avait pris une des tournures les plus “radicales” en mettant en cause l'exploitation du monde capitaliste.
Les occupants de la place ont essayé, avec détermination mais de manière totalement non violente, de résister à cette expulsion honteuse. Un groupe important de jeunes ont ainsi voulu bloquer l'accès à la place tandis que d'autres ont distribué des fleurs aux flics. Environ 200 "indignés" sont aussi restés assis au centre de la place. Les forces de police ont alors effectué plusieurs charges contre eux, à grands coups de matraque, tabassant une foule pacifique, les deux mains levées. Certains brandissaient des pancartes « Resistencia pacifica » (résistance pacifique). Un hélicoptère menaçant était en vol stationnaire au-dessus de la place tandis qu'une vingtaine de véhicules municipaux démontaient systématiquement les tentes de campement. Quelques bouteilles d'eau en plastique ont été lancées mais les manifestants sont restés calmes en majorité et ont répondu en scandant : « Me da verguenza » (ça me fait honte [le comportement des policiers]) ou « Donde esta la placa ? » (Où est la plaque [d'identification des policiers] ?). Un manifestant resté au centre de la place montrait une pancarte à l'intention de ceux qui étaient à l'extérieur : « Assemblea dice policia fuera, nosotras limpiamos la plaça. » (L'assemblée a dit : les policiers dehors, nous nettoyons la place). Un manifestant portait une pancarte avec les mots "ils ne pourront déloger nos rêves".
121 personnes ont été blessées lors de cette opération, dont une douzaine ont dû être hospitalisées. Un jeune a été gravement blessé avec un poumon perforé !
Un autre campement à Lérida (Lleida en Catalan), a également été évacué par la police le vendredi matin. Après le repli des forces de répression, en fin de matinée, les manifestants, de plus en plus nombreux ont réinvesti la place. En une seule après-midi, la cuisine assurant des repas gratuits, l'antenne médicale, la bibliothèque, le potager, etc., détruits le matin, ont été remis en service. Le point info a répondu aux questions tandis que le réseau social Twitter relayait une foule de commentaires indignés sur l'intervention de la police. Un tract a raconté l'évacuation et donné rendez-vous à 17h pour une manifestation partant de la statue de Christophe Colomb vers la place de Catalogne. Elle a rassemblé quelques milliers de personnes pour dénoncer les coupes budgétaires dans la santé et l'éducation. À 19h, la place était de nouveau noire de monde (entre 4 et 5000 personnes) pour une « cassolada » (concert de casseroles). A 21h, une pétition demandant la démission du ministre régional de l'intérieur était lancée. Les commissions (action, extension et diffusion, théâtre, art, etc.) se sont réunies à nouveau tandis qu'à la Puerta del Sol de Madrid, les manifestants, agitant des fleurs, criaient "Barcelone n'est pas seule". Des appels à des manifestations de soutien aux "indignés" de Barcelone ont été lancés, via Twitter, pour vendredi soir dans toutes les villes espagnoles.
Samedi soir, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour continuer à montrer leur indignation et dénoncer les violences policières.
Alors oui, solidarité totale avec les matraqués de Barcelone et hommage à leur courage ! Non, nos camarades de Barcelone ne sont pas seuls, ce n'est pas une “révolution espagnole” : en Grèce, au Portugal, comme en Tunisie, en Egypte, au Maroc, le combat à mener est le même, comme partout dans le monde. Cette expérience de répression doit contribuer à dissiper certaines illusions démocratiques encore largement présentes chez les “indignés” et sur lesquelles s'appuie la classe dominante : elle doit faire prendre conscience que les violences policières ne sont que le bras armé de l'Etat capitaliste et qu'elles sont la seule réponse que peut nous offrir cet Etat qui nous fait subir quotidiennement la violence de son exploitation. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir à l'échelle mondiale pour le renverser.
CCI (04 juin)
Rubrique:
Vidéo : protestations contre les attaques du système de santé à Tarrasa (Espagne)
- 2010 lectures
qE4_jhZ6RW4 [107]
Nous publions ici une vidéo présentant une assemblée qui se tient dans la ville ouvrière de Tarrasa de la banlieue de Barcelone. On y voit notamment le personnel de l'hôpital de Tarrasa participer au mouvement et protester contre les attaques du gouvernement socialiste contre le système de santé publique.
Géographique:
- Espagne [106]
Rubrique:
Vidéo: Sur le mouvement des Indignés à Barcelone
- 1626 lectures
EV5phB8gTag [108]
Rubrique:
ICConline - janvier 2011
- 1852 lectures
Campagne sur la chute de Ben Ali : les médias aux ordres de la bourgeoisie démocratique
- 2157 lectures
Pendant plusieurs semaines, tous les États démocratiques, la France en tête, ont apporté leur caution au régime sanguinaire de Ben Ali. Un black-out presque total de l'information a été organisé alors que tous les gouvernements savaient pertinemment ce qui se passait en Tunisie. Tous les medias bourgeois ont justifié la désinformation en faisant croire que le pays était en proie à des émeutes, à une situation "confuse", "chaotique", "difficile à comprendre". Ils nous ont fait croire que personne ne savait ce qui se passait réellement. Mensonges ! La sauvagerie de la répression était connue dans le monde entier. Grâce aux vidéos, aux réseaux Internet utilisés par les jeunes manifestants, aux touristes et aux journalistes qui étaient sur place, l'information n'était pas "totalement verrouillée" comme l'ont affirmé tous les gouvernements et leurs médias aux ordres. C'est de façon délibérée que la loi et l'ordre du silence se sont imposés face aux exactions des assassins à la solde de Ben Ali. C'est de façon délibérée que les grèves, les manifestations de rue, la révolte dans les lycées et les universités ont fait l'objet d'un black out total afin que les prolétaires des pays démocratiques ne puissent pas se sentir concernés par la répression du mouvement et manifester leur solidarité.
Aujourd'hui, après la chute de Ben Ali, les langues se délient enfin et toutes les caméras sont braquées sur la "révolution" en Tunisie. Immédiatement après l'annonce officielle du départ de Ben Ali, pendant que l'état d'urgence est décrété et que l'armée est déployée dans tout le pays, les chaînes de télévision françaises nous ont abreuvés de scènes de la communauté tunisienne en liesse, notamment dans les quartiers de Paris. Alors que pendant plusieurs semaines, rien ne filtrait des manifestations quotidiennes réprimées dans le sang par la police, les images de la foule immense qui a envahi l'avenue Bourguiba à Tunis le 14 janvier sont maintenant largement diffusées et tournent en boucle sur toutes les chaînes de télévision. Sur les plateaux télé, des personnalités de la classe politique (tel Bertrand Delanoë qui prétend, la main sur le coeur, n'avoir pas été en mesure de dénoncer l'atteinte aux "droits de l'homme"), des journalistes, des spécialistes et autres "envoyés spéciaux" sont invités dans un grand débat "démocratique" sur la situation en Tunisie qui est suivie heure après heure. Et bien sûr, tout ce joli monde prend maintenant hypocritement ses distances avec le régime de Ben Ali et glorifie "le courage et la dignité du peuple tunisien" (selon les propres termes de Barak Obama) qui a pu, "tout seul", se débarrasser du dictateur !
La chute de Ben Ali fait aujourd'hui la Une de tous les quotidiens alors que, pendant près d'un mois, le calvaire de la population tunisienne en proie à une répression féroce n'a pas fait couler beaucoup d'encre. Une telle hypocrisie n'est pas gratuite. Si les médias nous inondent maintenant d'informations en temps réel après plusieurs semaines de black out, ce n'est certainement pas parce que la classe dominante des États démocratiques serait aujourd'hui "aux côtés du peule tunisien", comme l'a affirmé avec un cynisme sans borne le gouvernement français (qui, 3 jours auparavant, se proposait de prêter main forte aux forces de répression de Ben Ali après que l'armée ait décidé de ne pas tirer sur la population !). Si la bourgeoisie des pays démocratiques, avec tout son appareil de manipulation médiatique, retourne aujourd'hui sa veste en encensant la "révolution du peuple tunisien", c'est parce qu'elle y trouve un intérêt évident. La débandade de Ben Ali lui donne une nouvelle opportunité de déchaîner une gigantesque campagne visant à vanter les bienfaits de la "démocratie" et de la mascarade électorale.
Les médias bourgeois continuent à mentir lorsqu'ils montent en épingle aujourd'hui la grève des avocats du 6 janvier que certains présentent comme l'élément moteur de la révolte qui aurait fait tomber la dictature de Ben Ali. Ils mentent lorsqu'ils prétendent que c'est une jeunesse cultivée appartenant à la "classe moyenne" qui a fait tomber le dictateur. Ils mentent lorsqu'ils mettent en avant que la seule aspiration de la classe exploitée et des jeunes générations qui ont été au cœur du mouvement est celle de la liberté d'expression. Ils mentent lorsqu'ils occultent aujourd'hui les raisons profondes de la colère : la misère et le chômage qui touche 55% des jeunes diplômés et ont provoqué plusieurs suicides au début du mouvement. C'est cette réalité, résultant de l'aggravation de la crise économique mondiale, que la campagne médiatique, orchestrée autour de la chute de Ben Ali, s'efforce aujourd'hui de masquer. Le seul objectif de cet engouement des médias pour la "révolution tunisienne" vise à intoxiquer la conscience des exploités, à dévoyer leurs luttes contre la misère et le chômage sur le terrain de la défense de l'État démocratique bourgeois qui n'est rien d'autre que la forme la plus sournoise, la plus hypocrite, de la dictature du capital.
Sofiane (14 janvier)
Géographique:
- Afrique [109]
Dans la région de Murcie (Espagne) les fonctionnaires protestent contre des problèmes qui touchent tout le monde : salariés, chômeurs, précaires, étudiants, émigrés
- 3432 lectures
En juin 2010, le gouvernement Zapatero a réduit les salaires des fonctionnaires de 5%, et c’est maintenant le gouvernement régional de Murcie [Sud-est de l’Espagne] du Parti Populaire [droite] qui les réduit de 7%. Mais les fonctionnaires se sont refusés à avaler la pilule aussi facilement...
Nos camarades du CCI en Espagne ont fait cette prise de position.
Il ne se passe pas un jour sans qu’une nouvelle tuile ne tombe sur l’ensemble des travailleurs de toutes conditions :
Plus de 17 millions de foyers vont être frappés par l’augmentation du prix de l’électricité de 9,8% , ce qui représente une hausse de ces tarifs de 43% en 3 ans.
À Alboraia et Xátiva (Valence), les mairies ont ouvert un ERE1 de 44 et 60 licenciements, ce qui peut paraître un chiffre symbolique et « local », mais qui ouvre en fait la voie aux extensions des ERE à bien d’autres communes.2
Dans la région de Murcie, le gouvernement régional PP (droite) de Valcarcel annonce une loi, pompeusement dénommée « Mesures extraordinaires pour la 'soutenabilité'3 des Finances Publiques », ce qui veut dire concrètement une réduction mensuelle du salaire des fonctionnaires de 75 € (7% de réduction salariale qui vient s’ajouter à celle de 5% de juin) et une augmentation de l’horaire hebdomadaire de travail entre 3 et 5 heures.
Le contexte actuel dans lequel ces mesures sont prises est celui d’une aggravation de la crise mondiale et sa concrétisation en Espagne dans le contexte d'un déficit public effréné qui s’il est déjà très grave au niveau central, est encore plus dangereux au niveau des régions et des communes. C’est pour cela qu’un nouveau train de mesures de « réajustement » a été entamé dans les administrations régionales et locales. Ainsi, le gouvernement central avait interdit aux gouvernements régionaux de Murcie et de Castille-La Mancha de s’endetter davantage, ce qui a sans doute poussé la région de Murcie à prendre ces mesures.
Les protestations des travailleurs ne se sont pas faites attendre. « Mercredi soir, 10 000 personnes ont encerclé le domicile du président Valcárcel sur la Gran Vía [de la ville de Murcie], qui n’a pas pu assister à une commémoration. Ce même soir, trois dirigeants conservateurs du Parti Populaire furent bousculés et insultés et ont fini par se réfugier dans l’église de Santo Domingo, au centre ville. Les protestations ont continué devant le siège de l’Assemblée Régionale à Carthagène, où 5000 travailleurs ont lancé des œufs contre les députés qui entraient dans le bâtiment, en essayant par la suite d’y entrer aux cris de « Nous sommes la majorité, nous voulons y entrer ». Ils ont été repoussés par la Police nationale, qui a utilisé des matraques et des flash-ball pour empêcher l’assaut de la part des fonctionnaires. Les affrontements se sont soldés avec un travailleur blessé à la tête. La foule portait des pancartes où il était écrit des slogans comme : « Députés, baissez votre propre salaire ! » ou « Valcarcel, minable, baisse ton salaire à toi » (résumé d’agences).
Le 29 décembre, une nouvelle manifestation est partie de la place de la Fuensanta avec 15 000 travailleurs, selon les agences de presse. Les syndicats ont annoncé de nouvelles mobilisations.
Dans la manifestation, un travailleur de la Santé dénonçait le licenciement de 600 intérimaires. Sur une pancarte qu’il tournait vers le public qui regardait sur le trottoir, il avait ajouté : CECI VOUS CONCERNE !. Peut-être parce que c’est bien là un sentiment très répandu, un syndicat, le STERM [Syndicat de l’enseignement], faisait un appel aux « citoyens » pour qu’ils « se mobilisent aussi, parce ce que ce dont on parle c’est de la quantité et de la qualité de l’enseignement, de la santé, de la politique sociale et de l’ensemble du service public de la région de Murcie ».
Le piège de la lutte enfermée dans un secteur
Est-ce qu’il s’agit d’un problème limité à la région de Murcie ? Est-une affaire qui ne concerne que les fonctionnaires ?
Les syndicats limitent le problème aux gaspillages du dépensier gouvernement murcien qui a rempli la région de lotissements et de terrains de golf. Et c’est ainsi qu’ils ont limité les appels à la mobilisation aux seuls fonctionnaires, comme si les chômeurs, les retraités ou les étudiants n’étaient pas concernés. Cette façon de présenter les chosesr est typique de l’idéologie et de la pratique syndicale avec lesquelles nous devrons rompre.
Face à chaque attaque, les syndicats ne font que répéter que la faute en incombe à tel ou tel gouvernant, tel ou tel parti, telle ou telle région, tel ou tel patron. Ce serait toujours quelque chose de spécifique, de particulier et corporatif, qui n’aurait rien à voir avec l’ensemble des travailleurs et de la population exploitée. Il ne s’agirait pas d’une situation causée par le système capitaliste, mais d’une situation qui pourrait se résoudre à l’intérieur de ce système en changeant de politique ou de politiciens ou en mettant en avant la défense du service public face aux intérêts privés.
Les explications sont aussi fausses que les solutions ! On peut vérifier jour après jour que les problèmes concernent le monde entier et qu’ils ne sont pas la conséquence d’une politique économique donnée, mais qu’ils sont le résultat de toutes les politiques et de tous les gouvernements, ce qui ne peut que nous amener à en déduire qu’ils viennent du système capitaliste mondial lui-même.
De plus, ce raisonnement syndicaliste qui consiste à dire que le problème est celui d’un secteur ou d’une région ou qu’il est dû à tel ou tel personnage particulièrement « mauvais », « incompétent » ou « corrompu », a une conséquence pratique : celle de pousser à lutter dans l’isolement, enfermé dans les murs étanches du secteur ou de la corporation.
On se berce de l’illusion selon laquelle si les fonctionnaires font beaucoup de bruit, sont très radicaux dans leurs actions, s’ils paralysent les administrations, les hôpitaux et les écoles, ils vont obliger le gouvernement ou le patron en place à reculer.
Est-ce que nous avons face à nous seulement le patron X ou le gouvernement régional Y ? Non, absolument pas ! Le gouvernement « bleu » (conservateur) du PP dans la région de Murcie est soutenu par le gouvernement central « rose » (social-démocrate) du PSOE. La représentante du gouvernement central de Murcie, du PSOE, dans un bel étalage d’hypocrisie, s’est permis d’aller à la manifestation du 23 et de mettre la loi sur le dos du « gouvernement dépensier » de Valcarcel. Mais, en même temps, la police, qui dépend de cette déléguée du gouvernement, allait à la manifestation pour défendre le gouvernement régional en tapant brutalement sur les travailleurs. Au-delà des bonnes paroles ou des « critiques » plus ou moins bien ficelées, le gouvernement régional et le gouvernement central sont un seul et même ennemi contre les travailleurs, le PP et le PSOE savent très bien travailler ensemble sur des « affaires d’Etat ». Imposer l’austérité aux travailleurs et réprimer leur lutte est une « affaire d’État » par excellence.
Nous sommes tous touchés, nous avons tous besoin de la solidarité en tant que travailleurs
Mais, est-ce que les autres travailleurs vont rester les bras croisés, en regardant comment on impose les baisses de salarie à leurs camarades de Murcie ?
Ce que le gouvernement central ou les gouvernements régionaux imposent à un secteur isolé lui sert de précédent pour finir par l’imposer aux autres. En février, les contrôleurs aériens ont subi une baisse salariales de… 33% ! Cette attaque d'un secteur pointé du doigt et rendu « impopulaire » a servi de levier pour imposer en juin une baisse de 5% aux fonctionnaires et c’est maintenant le 7% imposé au secteur public de la région de Murcie. À la suite de ces expériences, peut-on être sûr que d’autres baisses ne vont pas tomber venant d’autres régions ou d’autres communes ? Est-ce qu’on peut considérer séparément ces baisses salariales et la suppression de l’allocation de 426 € aux chômeurs en fin de droits ?
Si, face à une attaque contre une partie des travailleurs, on se croit à l’abri en pensant « ça ne me concerne pas ! », on ne fait que laisser les mains encore plus libres aux gouvernements et au patronat pour imposer leurs mesures à tout un chacun.
D’abord les contrôleurs aériens, maintenant les fonctionnaires de Murcie, qui va être le suivant ?
Nous sommes tous attaqués : la reforme du code du Travail, les baisses de salaires des fonctionnaires, la suppression des 426 € pour les chômeurs, la prochaine reforme de la retraite et des négociations collectives, les « politiques actives de l’emploi » qui menacent les chômeurs, l’augmentation de l’électricité…
Ce sont là les seules branches mortes qui peuvent sortir d’un tronc pourri : la crise du capitalisme. La seule « solution » pour celui-ci c’est d’essayer de soutirer le maximum en faisant peser sa crise le dos de tous les exploités.
Nous avons besoin de développer un fort et profond sentiment de solidarité : si un secteur ouvrier est attaqué, tous les autres doivent se sentir attaqués. Lorsqu’un secteur est attaqué, nous devons tous développer toutes les actions de lutte à notre portée pour exprimer cette solidarité.
Le gouvernement et ses médias de désinformation racontent toujours la même histoire : il s’agirait de réduire tel ou tel « privilège » de telle ou telle catégorie de travailleurs. Les médias, à plat ventre devant le pouvoir, ne peuvent que nous présenter le monde à l’envers. Rendre encore plus intenables les conditions de travail, rendre les conditions de vie encore plus précaires, moins sures, plus misérables pour tous les travailleurs, ces misérables paillassons appellent ça « réduire les privilèges ». Lorsque le ministre de l’industrie présente l’augmentation de l’électricité comme « renoncer au simple privilège de prendre un café », il ne fait pas seulement acte de démagogie insultante, mais il essaye de cacher la simple et dure réalité : l’augmentation de l’électricité va obliger beaucoup de foyers qui ont déjà des problèmes jusqu’au cou, à renoncer à un repas. Et ces carpettes de la « communication » de « le courage » dudit ministre, comme ils ont salué la virile détermination de Zapatero et de son vice-président pour mater ces « privilégiés » de contrôleurs du ciel.4
Face à de tels tirs de barrage de mesures accompagnées chaque fois d’une campagne médiatique écrasante, chaque lutte des travailleurs doit s’organiser en assemblées ouvertes où puissent participer des travailleurs d’autres secteurs, des chômeurs, des étudiants, des retraités. Des assemblées ouvertes et unitaires pour suivre l’exemple d’autres qui ont pu se dérouler en France ou en Grande-Bretagne.
Chaque manifestation doit s’ouvrir à l’ensemble de la population exploité, doit devenir une tribune où les chômeurs, les immigrés, les étudiants, les retraités et les ouvriers des autres secteurs puissent aussi exprimer leur mécontentement, puissent rechercher et construire leur unité, puissent s’affirmer comme une force sociale d'ensemble face à la déferlante de misère que les gouvernements de toute couleur et quelle que soit son étiquette ont lancé contre tous.
CCI, 31-12-10
1 ERE : « Expediente de Regulación de Empleo », Plan social de restructuration de l’emploi, ou autrement dit en termes moins bureaucratiques « charrette de licenciements »
2 Il y a 17 régions en Espagne (dont Murcie), qui ont plus « d’autonomie » qu’ailleurs et qui se sont surtout endettées sans compter, par le biais, entre autres, d’un réseau insensé de Caisses d’Épargne de toutes sortes, vérolées par les dettes immobilières. Quand aux communes, pour comprendre l’importance de ces « charrettes », il faut savoir qu’elles ont en Espagne plus de poids et sont bien plus étendues qu’en France.
3 Nous nous permettons ce néologisme pour essayer de traduire le jargon administratif.
4 À coté de ceux qui saluent « l’épique présidentialiste » du chef Zapatero, quelqu’un de « capable de prendre des mesures risquées et impopulaires », il arrive que des éditorialistes trouvent que « ça va trop loin », qui « s’indignent » des « exigences des marchés » et du fait que tout tombe sur les mêmes. Il y a même des responsables du PSOE qui « ont des états d’âme », qui se voient en « prostitués » face aux « marchés », parce que, autrement, « ils disparaitraient » (déclarations d’Ibarra, représentant de l’aile gauche du PSOE). On peut rassurer Ibarra : ils ne disparaitront pas tant que le capital aura besoin d’eux, en tant que prostitués ou en tant que chef maquerelle.
Géographique:
- Espagne [106]
Rubrique:
La classe dirigeante de la Corée du Sud déchire le voile de sa "démocratie"
- 2766 lectures
Nous venons de recevoir des nouvelles de Corée selon lesquelles huit militants de la "Socialist Workers' League of Korea" (Sanoryun) ont été arrêtés et accusés en vertu de l’infâme "Loi de sécurité nationale".1 Ils sont susceptibles d'être condamnés le 27 janvier.
Il ne fait aucun doute que c'est un procès politique, et une parodie de ce que la classe dirigeante aime à appeler sa "justice". Trois faits en témoignent:
-
Premièrement, le fait que les tribunaux sud-coréens eux-mêmes aient à deux reprises rejeté les charges de la police contre ceux qui étaient arrêtés.2
-
Deuxièmement, le fait que les militants soient accusés de "constitution d'un groupe au profit de l'ennemi" (c’est-à-dire de la Corée du Nord), malgré le fait que Oh Se-Cheol et Nam Goong Won, entre autres, étaient signataires de la "Déclaration internationaliste depuis la Corée contre la menace de guerre", d'octobre 2006, qui dénonçait les essais nucléaires en Corée du Nord et déclarait notamment que: "L'Etat capitaliste nord-coréen (...) n'a absolument rien à voir avec la classe ouvrière ou le communisme, et n'est rien d'autre qu'une version extrême et grotesque de la tendance générale du capitalisme décadent vers la barbarie militariste.3
-
Troisièmement, le discours d'Oh Se-Cheol ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'oppose à TOUTES les formes du capitalisme, y compris le capitalisme d'Etat nord-coréen.
Ces militants sont accusés de rien d'autre que du délit d'opinion d'être des socialistes. En d'autres termes, ils sont accusés d'inciter les travailleurs à défendre eux-mêmes, leurs familles et leurs conditions de vie, et de révéler ouvertement la vraie nature du capitalisme. Les peines requises par le ministère public ne sont qu'un exemple de plus de la répression infligée par la classe dirigeante de la Corée du Sud contre ceux qui osent se mettre en travers de son chemin. Cette répression brutale avait déjà pris pour cible les jeunes mères de la "brigade des poussettes" qui avaient emmené leurs enfants aux manifestations à la chandelle de 2008 et qui, plus tard, avaient été en butte au harcèlement judiciaire et policier.4 Elle avait aussi pris pour cible les travailleurs de Ssangyong qui avaient été passé à tabac par la police anti-émeute qui avait envahi leur usine occupée.5
Face à la perspective de lourdes peines de prison, les militants arrêtés se sont conduits au tribunal avec une dignité exemplaire, et ils ont profité de l'occasion pour exposer clairement la nature politique de ce procès. Nous reproduisons ci-dessous une traduction du dernier discours de Oh Se-Cheol devant le tribunal.
Depuis la provocation du bombardement de Yeonpyeong Island en novembre de l'an dernier, et le meurtre de civils par les canons du régime nord-coréen, les tensions militaires dans la région se sont aggravées. Les Etats-Unis ont répondu par l'envoi d'un porte-avions nucléaire dans la région pour mener des exercices militaires conjoints avec les forces armées sud-coréennes. Dans cette situation, l'affirmation selon laquelle l'humanité est aujourd'hui face au choix entre le socialisme et la barbarie sonne plus vraie que jamais.
La propagande des Etats-Unis et de ses alliés se plaît à dépeindre la Corée du Nord comme un "Etat voyou", dont la clique dirigeante vit dans le luxe grâce à la répression impitoyable de sa population affamée. Cela est certainement vrai. Mais la répression infligée par le gouvernement sud-coréen aux mères, aux enfants, aux travailleurs qui luttent, et maintenant aux militants socialistes montre assez clairement, en dernière analyse, que toute bourgeoisie nationale règne par la peur et la force brutale.
Face à ce constat, nous déclarons notre entière solidarité avec les militants arrêtés, malgré les désaccords politiques que nous pouvons avoir avec eux. Leur lutte est notre lutte. Nous adressons notre plus sincère solidarité à leurs familles et à leurs camarades. Nous serons heureux de transmettre aux camarades les messages de soutien et de solidarité que nous pouvons recevoir à l'adresse suivante: international [@] internationalism.org.6
Dernier discours de Oh Se-Cheol devant le tribunal, en décembre 2010
(Ce qui suit est le texte du discours d'Oh Se-Cheol, traduit par nous du coréen)
Plusieurs théories ont tenté d'expliquer les crises qui ont eu lieu tout au long de l'histoire du capitalisme. Une d'entre elles est la théorie des catastrophes, qui soutient que le capitalisme va s'effondrer de lui-même au moment où les contradictions capitalistes arriveront à leur point le plus élevé, laissant la place à un nouveau millénaire paradisiaque. Cette position extrême, apocalyptique ou anarchique a créé de la confusion et des illusions par rapport à la compréhension des souffrances du prolétariat face à l'oppression et l'exploitation capitalistes. Beaucoup de gens ont été infectés par ce point de vue non-scientifique.
Une autre théorie est celle, optimiste, que la bourgeoisie ne cesse de répandre. Selon cette théorie, le capitalisme a lui-même les moyens de surmonter ses propres contradictions et l'économie réelle fonctionne bien en éliminant la spéculation.
Une position plus raffinée que les deux mentionnées ci-dessus, et qui a fini par l'emporter sur les autres, estime que les crises capitalistes sont périodiques, et que nous devons seulement attendre tranquillement jusqu'à ce que la tempête soit terminée pour aller de nouveau de l'avant.
Une telle position était appropriée pour le capitalisme au 19e siècle : elle ne l'est plus pour les crises capitalistes des 20e et 21e siècles. Les crises capitalistes au 19e siècle ont été des crises appartenant à la phase du capitalisme en expansion illimitée, que Marx dans le Manifeste du Parti Communiste a appelées l'épidémie de la surproduction. Cependant, la tendance à la surproduction débouchant sur la famine, la pauvreté et le chômage n'avait pas pour cause un manque de biens, mais parce qu'il y avait trop de biens, trop d'industrie et trop de ressources. Une autre cause des crises capitalistes est l'anarchie du système capitaliste basée sur la concurrence. Au 19e siècle, les rapports de production capitalistes pouvaient être élargis et approfondis grâce à la conquête de nouvelles zones pour gagner du travail salarié et de nouveaux débouchés pour les produits et ainsi les crises, durant cette période, étaient comprises comme les pulsations d'un coeur en bonne santé.
Au 20e siècle, ce fut la fin de la phase ascendante du capitalisme avec le tournant de la Première Guerre mondiale. A partir de ce moment, les rapports capitalistes de production des matières premières et du travail salarié avaient été élargis à travers toute la planète. En 1919, l'Internationale Communiste a appelé le capitalisme de cette époque comme la période "des guerres ou des révolutions". D'une part, la tendance capitaliste à la surproduction a poussé vers la guerre impérialiste dans le but de s'approprier et de contrôler le marché mondial. D'autre part, à la différence du 19e siècle, cette tendance rend l'économie mondiale dépendante d'une crise semi-permanente qui amène instabilité et destruction.
Une telle contradiction a donné lieu à deux événements historiques, la Première Guerre mondiale et la crise mondiale de 1929 qui ont coûté 20 millions de morts et un taux de chômage de 20 à 30%, ce qui a ouvert la voie, d'un côté, aux soi-disant "pays socialistes" avec le capitalisme d'Etat par la nationalisation de l'économie, et aux pays libéraux, avec une combinaison de bourgeoisie privée et de bureaucratie étatique, de l'autre.
Après la Seconde Guerre mondiale, le capitalisme, y compris les soi-disant "pays socialistes", a connu une prospérité extraordinaire résultant de 25 années de reconstruction et de dettes accumulées. Cela a conduit la bureaucratie gouvernementale, les dirigeants syndicaux, les économistes et les soi-disant "marxistes" à déclarer haut et fort que le capitalisme avait définitivement surmonté sa crise économique. Mais la crise a constamment empiré comme le montrent les exemples suivants: la dévaluation de la livre sterling en 1967, la crise du dollar en 1971, le premier choc pétrolier en 1973, la récession économique de 1974-75, la crise d'inflation en 1979, la crise du crédit en 1982 , la crise de Wall Street en 1987, la récession économique en 1989, la déstabilisation des monnaies européennes en 1992-93, la crise des "tigres" et des "dragons" d'Asie en 1997, la crise de la "nouvelle économie" américaine en 2001, la crise des subprimes en 2007, la crise financière de Lehman Brothers, etc., et la crise financière de 2009-2010.
Est-ce là une série de "crises cycliques", une "crise périodique"? Pas du tout! Cela est le résultat de la maladie incurable du capitalisme, de la rareté des marchés par rapport à la capacité de payer, de la baisse du taux de profit. Au moment de la grande dépression mondiale en 1929, le pire ne s'est pas produit à cause d'une gigantesque intervention des Etats. Mais les cas récents de crise financière et économique montrent que le système capitaliste ne peut plus survivre avec l'aide de ces mesures instantanées de renflouement de l'argent des Etats ou des dettes de l'Etat. Le capitalisme est maintenant face à une impasse en raison de l'impossibilité de l'expansion des forces productives. Cependant, le capitalisme est engagé dans une lutte à mort contre cette impasse. Autrement dit, il dépend sans cesse du crédit d'Etat et de l'écoulement de la surproduction par la création de marchés fictifs.
Pendant 40 ans, le capitalisme mondial a échappé à la catastrophe échappant au moyen de crédits immenses. Le crédit pour le capitalisme joue le même rôle que la drogue pour un toxicomane. Finalement ces crédits vont se retrouver comme un fardeau exigeant le sang et la sueur des travailleurs à travers le monde. Ils se traduiront également par la pauvreté des travailleurs à travers le monde, par des guerres impérialistes, et par des catastrophes écologiques.
Le capitalisme est-il en déclin? Oui. Il ne va pas s'écrouler soudainement, mais nous nous trouvons dans une nouvelle étape dans la chute d'un système, la dernière étape dans l'histoire du capitalisme, qui tire à sa fin. Nous devons sérieusement nous rappeler le vieux slogan d'il y a 100 ans: "guerre ou révolution?" Et encore une fois développer la compréhension historique de l'alternative "socialisme ou barbarie" et la pratique du socialisme scientifique. Cela signifie que les socialistes doivent travailler ensemble et s'unir, qu'ils doivent se tenir fermement sur la base du marxisme révolutionnaire. Notre objectif est de vaincre le capitalisme basé sur l'argent, les marchandises, le marché, le travail salarié, et la valeur d'échange, et de construire une société de travail libéré, dans une communauté d'individus libres.
Les analyses marxistes ont confirmé que la crise générale du mode de production capitaliste a déjà atteint son point critique en raison de la baisse du taux de profit et de la saturation des marchés dans le processus de production et de réalisation de la plus-value. Nous nous trouvons face à l'alternative entre le capitalisme, qui signifie la barbarie et le socialisme, le communisme, qui signifie la civilisation.
Premièrement, le système capitaliste arrive au point où il ne peut même plus nourrir les esclaves du travail salarié. Chaque jour, partout dans le monde, cent mille personnes meurent de faim et, toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 5 ans meurt de faim. 842 millions de personnes souffrent de sous-alimentation permanente et un tiers d'une population de 6 milliards se bat chaque jour pour sa survie à cause du renchérissement des denrées alimentaires.
Deuxièmement, le système capitaliste actuel ne peut pas maintenir l'illusion de la prospérité économique.
Les miracles économiques de l'Inde et de la Chine se sont révélés être des illusions. Au cours du premier semestre de 2008, en Chine, 20 millions de travailleurs ont perdu leur emploi et 67.000 entreprises ont fait faillite.
Troisièmement, une catastrophe écologique est attendue. Par rapport au réchauffement de la planète, la température moyenne de la terre a augmenté de 0,6% depuis 1896. Au 20e siècle, l'hémisphère nord a connu le réchauffement le plus grave des 1000 dernières années. Les zones couvertes de neige ont diminué de 10% depuis la fin des années 1960 et la couche de glace au pôle Nord a diminué de 40%. Le niveau moyen des mers a augmenté de 10 à 20% au cours du 20e siècle. Une telle augmentation signifie une augmentation 10 fois supérieure à celle des 3000 dernières années. L'exploitation de la terre au cours des 90 dernières années a pris la forme de la déforestation sauvage, de l'érosion des sols, de la pollution (air, eau), de l'utilisation de produits chimiques et matières radioactives, la destruction des animaux et des plantes, de l'apparition de terribles épidémies. La catastrophe écologique peut être vue sous une forme intégrée et globale. Il est donc impossible de prévoir exactement avec quelle gravité ce problème se développera dans l'avenir.
Comment s'est donc développée l'histoire de la lutte de classe contre la répression et l'exploitation capitalistes?
La lutte de classe existe en permanence, mais elle n'a pas été couronnée de succès. La Première Internationale a échoué en raison de la puissance du capitalisme dans sa période ascendante. La Deuxième Internationale a échoué en raison du nationalisme et de l'abandon de son caractère révolutionnaire. Et la Troisième Internationale a échoué en raison de la contre-révolution stalinienne. En particulier, les courants contre-révolutionnaires ont, depuis 1930, induit en erreur les travailleurs sur la nature du capitalisme d'Etat qu'ils ont appelé le "socialisme". En fin de compte, ils ont joué un rôle de soutien au système capitaliste mondial, dans sa répression et son exploitation du prolétariat mondial par le biais du déguisement de l'affrontement entre deux blocs.
En outre, selon la campagne bourgeoise, la chute du bloc de l'Est et du système stalinien a été une "victoire évidente du capitalisme libéraliste", 'la fin de la lutte de classes" et même la fin de la classe ouvrière elle-même. Une telle campagne a conduit la classe ouvrière à un grave recul au niveau de sa conscience et de sa combativité.
Au cours des années 1990, la classe ouvrière n'a pas complètement renoncé, mais elle n'avait pas le poids ni la capacité correspondant à celles des syndicats qui avaient été les organes de lutte dans une période précédente. Mais les luttes en France et en Autriche contre les attaques sur les retraites ont constitué un point tournant pour la classe ouvrière, depuis 1989, pour reprendre son combat. La lutte ouvrière s'est le plus développée dans les pays centraux: la lutte à Boeing et la grève des transports à New York aux Etats-Unis en 2005, les luttes de Daimler et d'Opel en 2004, celle des médecins, au printemps 2006, la lutte à Telekom en 2007, en Allemagne, la lutte à l'aéroport de Londres en août 2005 en Grande-Bretagne et la lutte anti-CPE en France en 2006. Dans les pays de la périphérie, il y a eu la lutte au printemps 2006 à Dubaï, celle des travailleurs du textile au Bangladesh au printemps 2006, la lutte des travailleurs du textile au printemps 2007 en Egypte.
Entre 2006 et 2008, la lutte de la classe ouvrière mondiale est en expansion dans le monde entier, en Egypte, à Dubaï, en Algérie, au Venezuela, au Pérou, en Turquie, en Grèce, en Finlande, en Bulgarie, en Hongrie, en Russie, en Italie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, aux Etats-Unis et en Chine. Comme l'a montré la lutte récente en France contre la réforme des retraites, la lutte de classe doit devenir de plus en plus largement offensive.
Comme montré ci-dessus, la tendance finale de la décadence du capitalisme mondial et la crise qui pèse sur la classe ouvrière ont inévitablement provoqué des luttes ouvrières partout dans le monde, contrairement aux crises que nous avons connues auparavant.
Nous nous trouvons maintenant devant l'alternative, à vivre dans la barbarie, non comme des êtres humains mais comme des animaux ou à vivre heureux dans la liberté, l'égalité et la dignité humaine.
La profondeur et l'importance des contradictions du capitalisme coréen sont plus graves que celles des pays dits avancés. La souffrance des travailleurs coréens semble être beaucoup plus grande que celle des travailleurs dans les pays européens. C'est une question de vie humaine de la classe, qui ne peut se mesurer avec les vaines prétentions du gouvernement coréen de jouer à être l'hôte de la réunion du sommet du G20, ou l'étalage de données quantitatives d'indices économiques.
Le capital est international, de par sa nature. Les différents capitaux nationaux ont toujours été en concurrence et en conflits, mais ils ont collaboré ensemble pour maintenir le système capitaliste, pour cacher ses crises et attaquer les travailleurs en tant qu'êtres humains. Les ouvriers ne se battent pas contre les capitalistes, mais contre le système capitaliste qui n'agit que pour l'augmentation de ses bénéfices et à cause d'une concurrence illimitée.
Historiquement, les marxistes ont toujours lutté aux côtés de la classe ouvrière, qui est maître de l'histoire, en révélant la nature des lois historiques de la société humaine et celle des lois des systèmes sociaux, en montrant l'orientation vers le monde de la véritable vie humaine et en dénonçant les obstacles représentés par des systèmes et des lois inhumaines.
Pour cette raison, ils ont construit des organisations comme les partis et ont participé de façon concrète aux luttes. Au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, de telles activités pratiques des marxistes n'ont encore jamais connu de contraintes judiciaires. Leur pensée et leur pratique ont plutôt été très appréciées en tant que contributions au progrès de la société humaine. De tels chefs-d'oeuvre de Marx, comme Le Capital ou Le Manifeste du Parti Communiste, ont été lus aussi largement que la Bible.
Le cas du SWLK est historique, il montre au monde entier la nature barbare de la société coréenne à travers sa répression de la pensée, et serait comme une tache dans l'histoire des procès du socialisme dans le monde. Dans l'avenir, il va y avoir des mouvements socialistes plus ouverts et plus massifs. Les mouvements marxistes seront largement et puissamment développés dans le monde et en Corée. L'appareil judiciaire traitera de cas de violence organisée, mais il ne pourra pas supprimer les mouvements socialistes, les mouvements marxistes, parce qu'ils vont se poursuivre indéfiniment, aussi longtemps que l'humanité et les travailleurs existeront.
Les mouvements socialistes et leur pratique ne peuvent pas être victimes de peines judiciaires. Au contraire, ils doivent être un exemple de respect et de confiance. Voici mes derniers mots:
-
Abolir la loi de sécurité nationale qui supprime la liberté de pensée, de la science et de l'expression!
-
Arrêtez la répression par la puissance du capital contre les luttes ouvrières qui sont le véritable acteur de l'histoire!
-
Travailleurs du monde entier, unissez-vous afin d'abolir le capitalisme et construire une communauté d'individus libres!
1 Oh Se-Cheol, Yang Hyo-sik, Yang Jun-seok, et Choi Young-ik risquent sept ans de prison, et Nam Goong Won, Park Jun-Seon, Jeong Won-Hyung, Oh et Min-Gyu risquent cinq ans. Au pire, la Loi de sécurité nationale prévoit la peine de mort contre les accusés.
2 Voir cet article sur le site anglais du Hankyoreh [110].
3 Voir le texte de la déclaration [111].
5 Voir l'assaut de la police filmé sur YouTube [113].
6 Nous attirons également l'attention de nos lecteurs sur l'initiative de protestation lancée par Loren Goldner [114]. Bien que nous partagions le scepticisme de Loren par rapport à l'efficacité de "l'écriture" dans les "campagnes par e-mail", nous sommes d'accord avec lui sur le fait "qu'une attention internationale portée sur cette affaire pourrait bien avoir un effet sur la condamnation définitive de ces militants exemplaires".
Géographique:
- Corée du Sud [115]
Personnages:
- Oh Se-Cheol [116]
- Nam Goong-Won [117]
Récent et en cours:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [119]
Réflexions sur les récentes luttes étudiantes en Grande-Bretagne
- 1717 lectures
En novembre et décembre 2010, des manifestations contre certains aspects des coupes dans l'éducation ont montré que l'application de mesures d'austérité se trouve confrontée à une certaine résistance en Grande-Bretagne. Nous publions ici des extraits d'un rapport interne de World Revolution, section du CCI en Grande-Bretagne, adaptés à notre presse publique. C'est une contribution à la large discussion que les événements récents ont provoqué. Nous avons l'intention de publier un texte distinct sur l'intervention du CCI dans le mouvement dans un proche avenir.
"Nous voulons un avenir"
Ce slogan a été scandé à l'une des nombreuses manifestations qui ont eu lieu spontanément à travers la Grande-Bretagne, le 24 novembre. Des dizaines de milliers de collégiens, de lycéens (16-18 ans) et d'étudiants en formation continue sont descendus dans la rue pour protester contre les projets du gouvernement de coalition de supprimer « l'Education Maintenance Allowance », un paiement hebdomadaires d'un maximum de 30 £ pour les étudiants les plus pauvres, d'augmenter les frais universitaires de 3000 £ par an à un maximum de 9000 £, de réduire le financement de l'enseignement universitaire de 100 % pour les sciences humaines et jusqu'à 95 % pour le reste. Une partie importante de la jeune génération pense qu'on lui a volé son avenir, et n'est pas disposée à accepter ces mesures passivement.
Cette génération, face à l'aggravation de la crise, est profondément consciente de la nécessité d'acquérir une qualification universitaire ou professionnelle. Ces jeunes sont aussi pleinement conscients de l'alternative, soit devenir l'un des 1 000 000 de moins de 18 ans sans formation, sans allocation ni emploi, que le système abandonne littéralement sans rien (« vous ne pouvez prétendre à aucune prestation tant que vous n'avez pas 18 ans »), soit avoir un travail faiblement rémunéré, sans qualification. On leur a profondément enfoncé cela dans le crâne dès leur plus jeune âge, et tout à coup on leur dit qu'ils n'obtiendront aucune aide au collège et que, s’ils arrivent à l'université, ils seront confrontés à jusqu'à 50.000 £ de dettes, qu'ils auront à rembourser pendant des décennies.
L'attaque sur l'EMA est particulièrement importante pour ce mouvement parce que c'est un élément essentiel du salaire social pour de nombreuses familles ouvrières. Elle sert à payer les déplacements au collège, les livres, le papier et la nourriture, tout au moins en partie. Compte tenu du coût élevé des transports dans les grandes villes et les zones rurales, sa perte aura pour conséquence de restreindre l'accès à l'enseignement supérieur aux étudiants les plus pauvres. Les plus jeunes ont vu cela comme une attaque non seulement contre eux, mais aussi contre leur famille et, dans de nombreux cas, contre toute la classe ouvrière. C'est cette attaque qui a fait que le mouvement s'est tellement étendu dans les villes et villages à travers toute l'Angleterre. Les lycéens les plus âgés et les étudiants en formation continue ont pris possession de la rue là où il n'y a pas d'université. Ces jeunes prolétaires ont été à l'avant-garde de ce mouvement.
L'onde de tempête du mécontentement croissant des travailleurs balaie la Grande-Bretagne
Il y a seulement quelques semaines, les médias britanniques se moquaient de la lutte sociale en France, comme étant typique de ces latins au 'sang chaud' qui descendent dans la rue à tout moment. Dans le même temps, ils louaient le 'sens commun', le pragmatisme et la passivité de la classe ouvrière en Grande-Bretagne.
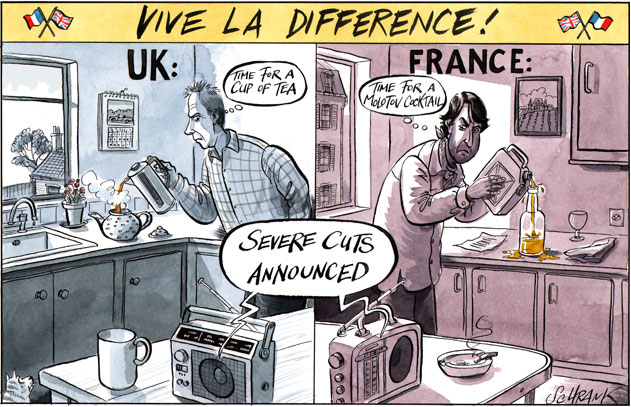 The Independant, 21 octobre 2010
The Independant, 21 octobre 2010
Le 10 Novembre, la vague de protestations des étudiants qui balaie le monde depuis 2006, à travers la France, la Grèce, l'Allemagne, les États-Unis, Puerto Rico et l'Italie, s'est abattue sur les rivages des îles britanniques dans une onde de tempête de combativité parmi les enfants de la classe ouvrière. Le siège spontané du quartier général du Parti Tory, lors de la première manifestation des étudiants contre les attaques sur l'enseignement supérieur, a mis le feu à la poudrière de mécontentement qui couve depuis des années. Encouragé par l'exemple pratique des étudiants refusant d'être parqués dans une vaine manifestation allant des points A à B et, au contraire, prenant les choses en main dans les environs du QG du Parti Tory et, complètement indifférent à la réaction furieuse de la classe dirigeante et de ses médias, le mouvement a connu quatre semaines de manifestations, d'occupations d'écoles, de collèges et d'universités et une défiance de plus en plus ouverte des forces répressives de l'État.
Une marée de combativité ouvrière a traversé le pays, au cours de laquelle les lycéens et les étudiants ont montré leur capacité d'auto-organisation. Dans certains établissements, les élèves ont organisé des réunions pour discuter des attaques : il y a eu des exemples de plusieurs établissements qui ont coordonné leurs actions et des discussions à travers les villes, des manifestations ont été appelées via Facebook, des occupations d'universités ont ouvert leurs discussions à quiconque voulait se joindre à elles, elles ont diffusé leurs discussions par Internet et créé des forums où les gens pouvaient envoyer des messages de solidarité ou entrer en discussion avec elles. A Londres, certains étudiants sont allés à la rencontre des piquets de grève du métro (lesquels, en retour, ont manifesté leur solidarité lors la dernière manifestation à Londres), cependant que les occupants du University College London ont réussi à effectuer le paiement d'un 'salaire minimum' au personnel de nettoyage de l'université , ce qui était une de leurs revendications.
Ces expressions d'auto-organisation n'ont pas été aussi étendues et aussi claires que lors du mouvement anti-CPE en France en 2006 mais elles ont certainement exprimé la même dynamique vers la mobilisation massive d'une génération de jeunes travailleurs pour se défendre.
La question sociale est bien vivante
En l'espace d'un mois, cette explosion de combativité s'est exprimée à travers le siège du QG du Parti Tory. Près de 30 000 lycéens, étudiants et autres manifestants ont ouvertement défié la répression de l'État, à Londres, le 9 décembre. A cette occasion, les manifestants ont réussi à déjouer la présence policière massive pour envahir Parliament Square, dont l'accès était bloqué par des barrières (il est illégal de manifester devant la maison de la démocratie, sans autorisation de la police) afin d'épargner aux députés d'entendre la colère de leurs victimes, alors qu'ils étaient en train de voter ces attaques. Les députés ont entendu plus que leur voix : ils ont aussi entendu les hélicoptères de la police, leurs fourgonnettes, les charges de la police montée, les charges au bâton d'assaut, et la résistance des manifestants que la police a contenue et battue pendant des heures pour avoir eu l'audace de se dresser pour défendre leurs propres intérêts.
La fureur de la classe dirigeante face à ce refus d'être maté par la répression s'est exprimée dans ses médias. Les reportages TV en direct et les bulletins de nouvelles n'avaient aucune prétention à l'objectivité par rapport au fait que ces porte-parole de la classe dirigeante attaquaient les étudiants, les lycéens, leurs parents et d'autres manifestants qui cherchaient à se défendre contre une force de police qui, d'après certains rapports, devait faire en sorte que les participants soient terrorisés au point de ne plus vouloir jamais manifester. Les principaux médias avaient essayé de cacher l'usage des charges à cheval de la police pendant la manifestation du 24 novembre ; et le 9 décembre, seulement deux semaines plus tard, ils montraient ouvertement les charges de la police montée, parfois jusqu'à 15 à la fois, dans la foule. Ils n'ont également pas été tellement discrets pour montrer des policiers en train de frapper des manifestants et n'ont pas été avares d'éloges en défense de la démocratie. Il a été fait le compte exact du nombre de policiers blessés alors que les manifestants blessés n'ont été mentionnés qu'incidemment, ou dans le cadre d'un plaidoyer en faveur d'une démocratie moins répressive.
Hors de Paliament Square, les étudiants, en s'appuyant sur leur expérience précédente où ils avaient été contenus par la police, ont fait éclater leur manifestation en de nombreux petits mouvements qui se sont dirigés dans plusieurs directions. D'après différents rapports, il semble que ces manifestations n'aient pas rencontré beaucoup d'hostilité et même aient souvent été accueillis par les applaudissements des gens sur le trottoir.
C'est l'une de ces manifestations qui a croisé le prince Charles et son épouse dans leur voiture. Leur regard étonné était le miroir de la classe dirigeante : la plèbe se révolte et nous n'avons pas été en mesure de la contrôler.
L'idée qu'il y ait une certaine forme de paix sociale en Grande-Bretagne a été matraquée avec ces étudiants qui ont été sans motif frappés à la tête par l'État. Plus important encore, beaucoup de ceux qui ont participé à ce mouvement ont vu leurs illusions dans la démocratie maltraitées. Ils ont appris que la seule façon d'être entendu est de se dresser, de défier l'État, de ne pas se soumettre.
Un coup dur pour les attaques idéologiques de la nouvelle équipe dirigeante

Dans la suite de l'élection générale de 2010, la bourgeoisie britannique espérait utiliser la coalition des conservateurs et des libéraux-démocrates pour maintenir et renforcer l'attaque idéologique contre la classe ouvrière :
La coalition avec les Libéraux Démocrates visait à contribuer à l'adoucissement de l'image des Tories, à l'enterrement du souvenir de Thatcher et des années 1980.
La formation de la coalition était censée montrer que les politiciens et donc la population peuvent mettre les divergences de côté et s'unir dans l'intérêt commun du pays.
Les mesures d'austérité devaient être acceptées parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, mais elles devaient être exécutées de façon équitable.
Il n'y a rien d'autre à faire en dehors de faire confiance aux politiciens pour qu'ils règlent les difficultés.
Les événements de ces dernières semaines ont constitué un sérieux défi pour la capacité de la bourgeoisie à maintenir cette offensive idéologique. Le fait que la première manifestation de lutte massive ouverte contre cette coalition s'est concentrée sur le QG des Tories et ait été accompagnée de chants furieux contre la 'racaille Tory' par des milliers de gens qui n'ont jamais connu de gouvernement conservateur a sapé tout espoir que la bourgeoisie a pu avoir de redorer l'image des conservateurs. La haine de la classe ouvrière pour les conservateurs est si profonde qu'elle se transmet de génération en génération. Quant aux libéraux-démocrates comme contrepoids, comme force de modération, cela a été infirmé par le fait que leurs dirigeants ont voté pour ces attaques, après la signature de promesses avant les élections qu'ils n'augmenteraient pas les frais. À certains égards, la direction Lib Dem est encore plus haïe que les conservateurs. Il sera intéressant de voir l'impact des récentes révélations de The Telegraph, dont les reporters infiltrés ont surpris plusieurs députés libéraux-démocrates entrain de faire des commentaires acrimonieux sur leurs partenaires de la coalition.
L'oraison du gouvernement, selon laquelle 'nous sommes tous dans le même bateau' n'est traitée avec rien d'autre que par un mépris général. Ce mouvement a été animé par une haine des riches, profonde, enflammée, qu'ils considèrent comme ayant reçu des milliards de livres en termes de gratifications et d'économies d'impôt, tandis que les étudiants et les lycéens, avec le reste de la classe ouvrière, se voient voler leur avenir. Il n'y a aucune hésitation chez la grande majorité des lycéens et des étudiants en formation continue et chez de nombreux étudiants d'université à se voir eux-mêmes comme partie de la classe ouvrière et à voir ces attaques comme étant contre la classe ouvrière.
L'idée 'd'équité' a été bafouée sans pitié. Les élèves remarquent le fait que les riches s'en tirent en payant le moins d'impôt possible, alors qu'on leur demande à eux de se sacrifier.
De toute évidence, cette rage contre les riches est très importante pour le développement futur d'une conscience de classe plus large et plus profonde. Cependant, elle est en ce moment aussi utilisée comme le portail principal pour la pénétration de l'idéologie bourgeoise dans ce mouvement. Cette colère primale, sans perspective plus large concernant la nature du système, se mélange à un sentiment d'injustice, que les riches devraient payer leur part. Ce qui est plus dangereux c'est que la gauche est entrain d'utiliser l'idée que ces attaques sont tout simplement idéologiques, parce que, prétend-elle, la classe dirigeante pourrait facilement payer pour la formation continue et pour l'EMA, si seulement elle imposait les riches de façon efficace, si seulement elle dépensait de l'argent pour l'éducation et non pour la guerre, et que ce qui arrive est ce à quoi nous devons nous attendre avec les conservateurs. On ne peut pas oublier la puissance de ces illusions idéologiques.
Si, pour le moment, ces illusions constituent un poids sur le mouvement, beaucoup de ceux qui y participent ne se font pas beaucoup d'illusions sur le Parti travailliste. Ils se souviennent que ce sont eux qui ont été les premiers à introduire les frais de scolarité. Et puis le Parti travailliste n'a pas apporté son soutien au mouvement, et il n'a pas dit qu'il supprimerait la hausse des frais s'il était élu.
Le point culminant du mouvement à ce jour, le 9 décembre, a également posé très nettement la question de la démocratie. Jusque-là, il y avait une forte croyance que si ils protestaient avec assez de vigueur, le gouvernement pouvait reculer, mais le résultat du vote a montré qu'il n'était pas en mesure de le faire. Et puis ces illusions dans le caractère raisonnable de la bourgeoisie en ont pris un coup violent, avec les forces de répression qui leur cognaient littéralement sur la tête. Tout cela a beaucoup donné à penser à ceux qui ont participé et au reste de la classe ouvrière.
Un problème majeur pour la classe dirigeante, un manque de contrôle politique sur le mouvement
Depuis son début, ce mouvement a confronté la classe dirigeante à un grand défi : celui des moyens de contenir et de contrôler politiquement le mouvement. Pendant un mois, la classe dirigeante a été confrontée à un mouvement qu'aucune de ses nombreuses forces politiques n'a été en mesure de contenir entièrement ni de contrôler :
Le National Union of Students (NUS), qui a organisé la protestation initiale le 10 novembre, et a mobilisé 50 000 étudiants, a perdu sa capacité d'agir en tant qu'organe principal des étudiants lorsque son chef, Aaron Porter, a dénoncé à maintes reprises l'attaque contre le QG du Parti Tory dans les journaux télévisés. On a eu cette situation ridicule où, lorsqu'il a dénoncé l'attaque de Millbank comme venant d'une minorité violente, la télévision montrait en direct des milliers d'étudiants qui entouraient le bâtiment et le commentateur lui disait « comment pouvez-vous dire cela, lorsque vous regardez ces images? » Après sa performance, le NUS a perdu toute capacité même d'essayer de contrôler la situation et ses militants de base ont dû aller dans le mouvement pour maintenir une certaine forme de crédibilité.
Le NUS n'a pas d'influence chez les lycéens et très peu chez les étudiants en formation continue.
Le Parti travailliste ne pouvait pas contrôler ce mouvement parce qu'il devait dénoncer l'attaque contre le QG des Tories et qu'il avait lui-même introduit les frais de scolarité.
Quant à l'extrême-gauche, aucune des organisations pseudo-révolutionnaires en Grande-Bretagne n'a assez d'influence pour contrôler le mouvement. Le Socialist Worker Party est probablement le plus important, mais son influence a diminué au cours de la dernière décennie. Le Socialist Party (ex-Militant Tendency) a joué un rôle à travers ses militants dans les universités et les lycées, mais il n'a pas d'influence nationale globale. Les gauchistes ont, dans une large mesure, dû se cacher derrière les principaux réseaux 'activistes', comme le Education Activists Network (EAN) et le National Campaign Against Fees and Cuts (NCAFC). Ils ont certainement eu une influence sur le mouvement, mais il est significatif que lors des réunions de ces réseaux, il y a eu un fort reflet de la force réelle du mouvement, par exemple, dans le fait que les organisateurs ont souvent été contraints d'accepter un débat libre et ouvert, contrairement à la lourde mise en scène en scène des réunion traditionnelles des gauchistes. Certaines réunions convoquées par les gauchistes sont encore dénommé 'assemblées' (comme à Brighton, par exemple), ce qui reflète autant un réel désir de nouvelles formes d'auto-organisation que la fonction de récupération des gauchistes.
Les mêmes jours que ces manifestations nationales, il y a eu de nombreuses manifestations locales appelées, via Facebook, par des réunions d'étudiants en formation continue, de lycéens, d'individus, des organes de coordination, comme le réseau qui a été mis en place à Oxford. De plus, ce même jour, des élèves ont spontanément déserté leurs cours : dans un cas, 3 adolescents ont appelé les élèves d'un lycée et 800 d'entre-eux sont sortis et les ont suivis. Dans de nombreux cas, les enseignants ont essayé de verrouiller les enfants ou la police a menacé de les arrêter pour absentéisme scolaire. Cela a conduit à une situation intéressante où dans des grandes villes comme Manchester, la principale manifestation n'a attiré que quelques centaines d'élèves, alors que dans de plus petites villes, le nombre de manifestants était plus important comme, par exemple, à Brighton où le 24 novembre, 2000 élèves ont déserté les cours pour aller manifester. Cette manifestation s'est terminée avec 400 élèves tentant de prendre d'assaut le commissariat central où leurs amis avaient été arrêtés.
Les citations suivantes dans The Guardian et Libcom.org donnent une idée de la nature spontanée de ce mouvement :
«Des centaines d'adolescents sont sortis du lycée Allerton Grange de Leeds pour se joindre à la manifestation. »
« L'action bien planifiée a vu presque toute l'école vide avec des banderoles soigneusement préparées ramassées dans des magasins ».
«Les élèves sont maintenant en route vers le lycée voisin Roundhay pour encourager ses élèves à les rejoindre. Il s'agit de deux lycées très performants dans un quartier particulièrement prospère de Leeds. Les deux établissements remportent régulièrement des places à Oxbridge. »
«Les élèves chantent 'ils disent réduisons, nous disons ripostons ' Deux élèves de 16 ans ont déclaré que l'accent était mis sur la perte de l'allocation d'études. L'un des deux a dit: «sans l'EMA Je ne pourrai jamais aller à l'université. Je veux réaliser mon rêve. » (The Guardian)
«I l y avait une grande énergie. La marche progressait rapidement en cercles toujours plus larges pendant plus de 3 heures d'affilée, en se tenant à l'écart de la police et parfois en en perçant les lignes. Cela a provoqué un vrai chaos dans la circulation et a contribué à empêché la police d'encercler la manifestation avec ses camionnettes pour la contenir. »
« Nous sommes passés par Cabot Circus & le centre commercial et nous nous sommes arrêtés pour une pause rapide au milieu de la zone de shopping, en pensant que c'était un endroit sûr parce qu'ils ne voudraient pas encercler une foule excitée au milieu d'un tas de boutiques de luxe. »
« Il y a eu une brève tentative pour entrer dans une boutique Vodafone. La police a été bombardée de moutarde devant le marché de Noël allemand. Il y a eu deux jolies tentatives pour occuper la maison du conseil municipal et le centre administratif de l'Université de Bristol. Des boules de neige ont été lancées sur les flics et les chevaux (qui ne les aiment vraiment pas). »
« La marche a été encerclée à la fin, à l'université de Bristol, quoiqu'une bonne partie des manifestants ait vu arriver la police et ait évité l'encerclement en sautant à travers des haies. »
« La police montée a fait une charge de cavalerie dans la foule qui avait échappé à l'encerclement. Quelqu'un aurait vraiment pu être blessé. Deux personnes ont été battues par la police en bordure de l'encerclement. Il y a eu 10 arrestations, principalement vers la fin, quand les gens essayaient de sortir de l'encerclement. Je pense que la plupart étaient des lycéens » (Libcom.org, 30/11/10).
Les informations que nous avons sur l'ampleur de ces manifestations locales sont limitées parce que la plupart des médias ont minimisé la participation des élèves. Toutefois, il est clair qu'une importante minorité d'entre-eux ont participé à ces manifestations et, dans de nombreux cas, les ont eux-mêmes organisées.
Ici, il est nécessaire de mentionner l'utilisation d'Internet et des téléphones mobiles dans ce mouvement. La jeune génération a fait un plein usage de ses compétences et de sa connaissance des médias. Facebook a joué un rôle important dans la coordination des luttes ; Twitter a également permis aux gens de rester en contact ; les occupants de l'University College of London ont également mis en place une carte Google, le 9 décembre, qui a montré où la police se trouvait afin que les manifestants puissent l'éviter. Internet a aussi été utilisé pour l'affichage de photos et de vidéos des manifestations, et de la répression policière. Par exemple, des séquences YouTube du 24 novembre ont démenti le fait que la police a nié avoir chargé la foule à cheval, alors qu'une vidéo montrant la police en train de malmener un manifestant dans un fauteuil roulant et de le traîner sur la route était accessible partout dans le monde.
Tout ceci montre que les principaux médias ont été écartés par beaucoup de ceux qui ont participé et qu'ils ont fait leurs propres rapports sur ce qui s'était passé. Les médias traditionnels déforment l'information, mais c'est ce qui a encouragé les jeunes à compter sur leurs propres sources d'information et sur leur propre organisation.
Les difficultés réelles que la bourgeoisie a eu en essayant de faire face à ce mouvement peuvent se résumer dans l'appel que le chef de la police de Bristol a lancé pour que quelqu'un devienne le leader du mouvement :
« M. Jackson a appelé à ce qu'une personne du corps étudiant se présente afin qu'ils puissent mieux coordonner ce qu'il a appelé une 'manifestation sans chef' »(presse locale citée sur Libcom.org).
La seule réponse de la classe dirigeante: accroitre la répression
Le dernier mois a vu une escalade de l'usage de la répression de la part de la classe dirigeante au fur et à mesure que le mouvement se développait. Avec ses organes politiques toujours incapables de contrôler le mouvement, l'État a eu une réponse principale: une répression de plus en plus violente. Certains ont comparé la confrontation entre la police et les étudiants qui a culminé le 9 décembre à l'émeute Poll Tax de 1990. Mais cette comparaison ne tient pas compte de la différence de contexte historique. L'émeute Poll Tax a marqué la fin d'un mouvement et a eu lieu dans une période de recul dans la conscience de classe. Ces récents affrontements entre le mouvement et la police, qui ont eu lieu non seulement à Londres mais aussi dans d'autres villes, se déroulent dans une période de recrudescence internationale des luttes, après cinq années d'attaques de plus en plus draconiennes sur la classe ouvrière. Et surtout c'est le premier mouvement étendu en Grande-Bretagne, mobilisant des dizaines de milliers de jeunes prolétaires et d'autres depuis la réapparition des luttes en 2003.
Il n'y a pas eu de confrontation entre les classes aussi radicale en Grande-Bretagne depuis le milieu des années 1980 avec les luttes des mineurs et des imprimeurs. La bourgeoisie a passé le dernier quart du siècle à se vanter de sa capacité d'amener la 'paix sociale’ et de connaître un très faible niveau de lutte de classe. Au cours de ces dernières semaines, la guerre de classe a été placée au premier plan de l'attention des travailleurs.
Le siège et l'attaque su QG du Parti Tory Partie n'a été la cause de presque aucune violence contre la police et de seulement quelques bris de fenêtres. Lorsque quelqu'un a lancé un extincteur d'incendie du toit de l'immeuble, celui-ci a été condamné par la foule aux cris de 'arrête de jeter, merde!'
Une faible présence policière a suffi pour arrêter une invasion massive de l'édifice. Deux semaines plus tard, ces mêmes élèves se sont trouvé confrontés à des charges répétées de la police montée et à de coups de matraque de la part d'une police en tenue anti-émeute .
La progression de l'usage de la violence pure de l'État contre ceux qui, dans de nombreux cas, étaient des jeunes ,montre sa préoccupation. La manifestation du 24 novembre a été témoin de l'utilisation par la police du 'kettling', qui consiste essentiellement dans le piégeage dans des zones confinées des manifestants en bloquant tous les moyens de sortie. Cette méthode avait été utilisée lors de la manifestation du G20 en 2009 et avait été critiquée, même par une partie de la bourgeoisie parce que contre-productive, dans la mesure où elle alimentait la colère. Elle a été plus largement utilisée, lors de la manifestation du 30 novembre et enfin le 9 décembre, où la politique du 'kettling' a été systématiquement pratiquée. Autour du Parlement, il semblerait que la police ait pratiqué cette technique en cercles concentriques, de telle sorte que si vous pouviez sortir d'un cercle, vous vous retrouviez dans un autre. Cela a été démontré à la fin de la manifestation quand la police a 'libéré' ceux qui avaient été pris au piège pendant des heures à l'extérieur du Parlement, qui se sont retrouvés à nouveau piégé sur le pont de Westminster pendant plusieurs heures dans le froid glacial et entassés comme du bétail.
Parallèlement au 'kettling', il y a eu une utilisation croissante de la violence. Avant la manifestation du 9 décembre, il y avait eu des affrontements entre la police et certains de ceux qui étaient pris au piège, alors qu'ils cherchaient désespérément à s'échapper. Par ailleurs, il y a eu des incidents où l'on a vu des manifestants battus par la police, mais cela a généralement été caché par les médias. Le 9 décembre cependant, les médias ont montré ouvertement la charge des chevaux dans la foule, la police anti-émeute matraquant les gens, etc. évidemment dans la vision d'une police qui devait se protéger. Mais le message était très clair : si vous protestez vous serez face à toute la force de l'État. Les journaux télévisés, sur un ton quasi hystérique, affirmaient clairement que c'était la police qui 'défendait' le droit démocratique de 'manifester pacifiquement', que la violence était dûe à une petite minorité, etc. Par rapport aux personnes sur le terrain, la police a dit que si elle était aussi violente, c'était dans le but de décourager les gens de fréquenter des futures manifestations.
ll est clair que, le 9 décembre, certains éléments devaient être prêts à affronter la police, mais la grande majorité était venue pour montrer sa détermination à exprimer sa colère face à ces attaques, malgré la répression croissante. Les jeunes manifestants ont très vite appris à ne pas se laisser encercler, comme cela s'était produit lors de la manifestation du 24 novembre, mais la police les a encerclés de façon systématique et a commencé à les attaquer. Dans de nombreux cas, ils se sont retrouvés en une foule compacte, ce qui rendait très difficile d'échapper aux accusations de la police alors qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de se battre ou bien d'être piétinés par les chevaux ou battus par la police. Même dans une telle situation, de nombreux manifestants ont été en mesure de voir au-delà de la violence immédiate:
« Nous nous couchons tous, les uns contre les autres, les chevaux au dessus de nous, des coups de matraque qui vont pleuvoir sur nos têtes et nos épaules. J'ai vraiment peur d'être sur le point de mourir, et je commence à pianoter le numéro de mes parents sur mon portable pour leur envoyer un message d'amour. »
«Au dessus de moi, une jolie blonde de dix-sept ans pleure, des larmes coulent sur son visage tuméfié et elle crie contre les abus de la police. Les manifestants commencent à crier 'honte à vous!', Mais même dans le feu de la bataille, ces jeunes gens ne tardent pas à se rappeler ce qui est réellement en jeu dans ce mouvement. «Nous nous battons pour vos enfants! » chantent-ils, devant les flics en ligne. «Nous nous battons pour vos jobs!" (New Statesman).
Les télévisions et les couvertures des magazines montrent des jeunes masqués affrontant la police , mais la majorité est démasquée et tente désespérément de se défendre.
Dans ce chaos, la jeunesse a toujours affiché son esprit vibrant. Certains, à l'instar des étudiants italiens, avaient un bouclier fait à la maison, en forme de livre, avec Marx sur le devant, ou avec des titres comme Le Meilleur Des Mondes, Dans la dèche à Paris et à Londres, et Dialectique Négative d'Adorno. Ce dernier a apparemment joué un rôle majeur lorsqu'un gendarme à cheval a été désarçonné !
 (The really open university)
(The really open university)
Il était évident que l'État allait gagner dans une telle confrontation, mais le résultat à long terme de cette répression va être extrêmement important. L'idée d'un État et d'une coalition étant en quelque sorte 'gentils et équitables' s'est envolée par la fenêtre. Des milliers de jeunes et de moins jeunes ont vécu la violence de l'État ou ont vu leurs amis et des membres de leur famille non seulement attaqués, mais traités comme des criminels. La police prenait en permanence des vidéos de la manifestation ; même dans les petites villes, elle a photographié les participants, souvent ouvertement en allant au milieu de ceux qui étaient encerclés pour les photographier. Une génération entière a vu que la seule réponse de l'État à leur demande d'être écouté était la violence. Les implications de cette situation sont encore visibles.
Les perspectives pour une plus large confrontations
Ce mouvement a montré les premiers pas dans le dépassement de la démoralisation infligée au prolétariat en Grande-Bretagne, avec l'écrasement des mineurs, des imprimeurs et autres travailleurs dans les années 1980. Une génération de jeunes prolétaires s'est levée et il faudra compter avec elle. De nombreux travailleurs plus âgés ont vu ce mouvement avec admiration et avec un sentiment de 'enfin, nous ripostons!'. La question de la violence a pris une nouvelle dimension. Pendant des années, les médias ont présenté la population, c'est à dire la classe ouvrière, comme étant passive. Au début du mouvement, les médias ont pu trouver des étudiants prêts à critiquer le recours à la violence, mais, après les affrontements du 9 décembre, Newsnight a été incapable de trouver un étudiant prêt à critiquer l'usage de la violence de leur côté : au lieu de cela, les étudiants demandaient aux divers journalistes pourquoi ils ne dénonçaient pas la violence de la police? Les tentatives de l'État pour présenter le programme d'austérité comme 'juste' et équitablement réparti dans la société ont été considérées comme frauduleuses, et la seule réponse à la protestation a été la montée de la violence et de la répression. Ce dernier mois a laissé la classe ouvrière avec matière à réfléchir.
Bien que l'adoption le 9 décembre de la loi augmentant les frais de scolarité et le début de la période des vacances de Noël, aient inévitablement produit une pause dans le mouvement, beaucoup d'étudiants se sont engagés à le poursuivre en janvier. Nous constatons déjà une radicalisation dans le ton des syndicats, par exemple dans un article écrit par Len McCluskey, secrétaire général du syndicat du secteur public Unite, à la rubrique 'votre tribune' de The Guardian du 20 Décembre écrit ceci :
«Les étudiants de Grande-Bretagne ont certainement mis le mouvement syndical sur la sellette. Leurs protestations massives contre l'augmentation des frais de scolarité ont rafraîchi les partis politiques dont une centaine de débats, de conférences et de résolutions n'avaient abouti à rien.... Les syndicats ont aussi besoin de leur tendre la main. Les étudiants doivent savoir que nous sommes de leur côté. Nous devons condamner sans équivoque le comportement de la police dans les récentes manifestations. Le 'kettling', le matraquage et les charges de la police montée contre les adolescents n'ont pas leur place dans notre société.
Il est ironique que les jeunes aient été rejetés comme étant apathique et indifférent à la politique, pour que, dès qu'ils se révèlent en nombre, ils sont traités comme 'l'ennemi intérieur', d'une manière familière pour ceux d'entre nous qui ont passé les années 1970 et 1980 sur les lignes du piquet de grève.
"Et nous devons travailler en étroite collaboration avec nos collectivités qui sont les premières victimes de l'attaque. C'est pourquoi Unite a accepté de soutenir la vaste Coalition de la Résistance créée le mois dernier, qui regroupe, partout dans le pays, les syndicats et les associations locales anti-réduction.
"La manifestation du TUC, le 26 mars, sera un jalon essentiel dans l'élaboration de notre résistance, pour donner aux membres des syndicats la confiance pour faire grève pour la défense des emplois et des services ».
Le même jour, le site Web de The Guardian annonce que Unite et un autre syndicat important du secteur public, le GMB, vont soutenir la prochaine journée d'action demandée par le NCAFC et l'EAN pour le 29 janvier.
Au même moment, le leader du syndicat RMT, Bob Crow, parle de la nécessité de « l'action industrielle, de la désobéissance civile et de millions de gens dans la rue » pour redorer le profil de la gauche et des syndicats, pour mieux les aider dans leur tentative de récupérer un mouvement contre les attaques d'austérité.
La perspective est à de plus vastes et de plus larges confrontations de classe. La bourgeoisie prépare maintenant son appareil syndical pour prendre en charge la situation, mais il n'est pas garanti à l'avance qu'ils vont réussir.
World Revolution, section du CCI en Grande-Bretagne (23 décembre 2010)
Géographique:
- Grande-Bretagne [98]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]
Répression sanglante en Tunisie et en Algérie : la bourgeoisie est une classe d'assassins ! SOLIDARITE INTERNATIONALE DE TOUTE LA CLASSE OUVRIERE !
- 2685 lectures
Depuis plusieurs semaines, on assiste en Tunisie à un soulèvement contre la misère et le chômage qui frappe particulièrement la jeunesse. Aux quatre coins du pays, des manifestations de rue, des rassemblements, des grèves ont surgi spontanément pour protester contre le régime de Ben Ali. Les manifestants réclament du pain, du travail pour les jeunes et le droit de vivre dignement. Face à cette révolte des exploités et de la jeunesse privée d'avenir, la classe dominante a répondu par le plomb et la mitraille. Ce sont nos frères de classe et ce sont leurs enfants qui se font massacrer dans les manifestations et dont le sang coule aujourd'hui en Tunisie comme en Algérie ! Les tueurs et leurs commanditaires à la tête de l'État tunisien ou algérien dévoilent dans toute son horreur le vrai visage de nos exploiteurs et de la domination de système capitaliste sur toute la surface de la terre. Ces assassins ne se contentent pas de nous faire mourir de misère et de faim, ils ne se contentent pas de pousser au suicide des dizaines de jeunes réduits au désespoir, non ils nous tuent aussi en tirant à balles réelles sur les manifestants ! Les unités de police déployées à Thala, Sidi Bouzid, Tunis et surtout Kasserine n'ont pas hésité à tirer dans la foule et à assassiner froidement hommes, femmes et enfants, faisant plusieurs dizaines de morts depuis le début des affrontements. Face à ce carnage, la bourgeoisie des pays "démocratiques", et notamment l'État français, fidèle allié de Ben Ali, n'a pas levé le petit doigt pour condamner la barbarie du régime et exiger l'arrêt de la répression. Rien d'étonnant à cela. Tous les gouvernements, tous les États sont complices ! Toute la bourgeoisie mondiale est une classe d'affameurs et d'assassins !
Que s'est-il réellement passé en Tunisie et en Algérie ?
Tout a commencé le vendredi 17 décembre, au centre du pays, suite à l'immolation par le feu d'un jeune chômeur diplômé de 26 ans, Mohamed Bouazizi, à qui la police municipale de Sidi Bouzid avait confisqué son seul gagne-pain, sa charrette de fruits et légumes. Immédiatement, un vaste mouvement de solidarité et d'indignation s'est développé dans la région. Dès le 19 décembre, des manifestations totalement pacifiques contre le chômage, contre la misère et la vie chère (les protestataires brandissent des baguettes de pain !), surgissent. Immédiatement, le gouvernement répond par la répression, ce qui ne fait qu'accentuer la colère de la population.
Une grève des soins non urgents de deux jours a été entamée le 22 décembre par les médecins universitaires pour protester contre leur manque de moyens et la dégradation de leurs conditions de travail. Elle a gagné tous les centres hospitalo-universitaires du pays. Le 22 décembre également, un autre jeune, Houcine Neji, se suicide sous les yeux de la foule, à Menzel Bouzaiane, en s'accrochant à une ligne de haute tension : "je ne veux plus de la misère et du chômage", crie-t-il. D'autres suicides vont renforcer encore l'indignation et la colère. Le 24 décembre, la police tue par balles un jeune manifestant de 18 ans, Mohamed Ammari. Un autre manifestant, Chawki Hidri, grièvement blessé décédera le 1er janvier. Aujourd'hui le bilan provisoire est d'au moins 65 tués par balles !
Face à la répression, très vite, le mouvement s'étend à tout le pays. Des chômeurs diplômés manifestent les 25 et 26 décembre au centre de Tunis. Des rassemblements et des manifestations de solidarité se développent dans tout le pays : Sfax, Kairouan, Thala, Bizerte, Sousse, Meknessi, Regueb, Souk Jedid, Ben Gardane, Medenine, Siliana… Malgré la répression, malgré l'absence de liberté d'expression, des manifestants brandissent des pancartes : "Aujourd'hui, nous n'avons plus peur !".
Les 27 et 28 décembre, ce sont les avocats qui se joignent au mouvement de solidarité avec la population de Sidi Bouzid. Face à la répression qui s'abat sur les avocats, avec des arrestations et des passages à tabac, une grève générale des avocats est appelée pour le 6 janvier. Des mouvements de grèves touchent également les journalistes de Tunis et les enseignants de Bizerte. Comme l'indique Jeune Afrique daté du 9 janvier, les mouvements sociaux de protestation et de rassemblement dans la rue sont totalement spontanés et échappent au téléguidage ou au contrôle des organisations politiques et syndicales : "La première certitude est que le mouvement de protestation est avant tout social et spontané. C'est ce que confirment des sources crédibles." 'Aucun parti, aucun mouvement ne peut prétendre qu'il fait bouger la rue ou qu'il est capable de l'arrêter', déclare-t-on à la section régionale de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT)".
Un black-out total de l'information est organisé. Dans la région de Sidi Bouzid, plusieurs localités sont placées sous couvre-feu et l'armée est mobilisée. A Menzel Bouzaiane, les blessés ne peuvent pas être transportés, la population a du mal à s'approvisionner et les écoles servent à loger les renforts de police.
Pour tenter de ramener le calme, Ben Ali sort de son silence et fait une déclaration publique de 13 minutes dans laquelle il promet de créer 300 000 emplois en 2011-12 et la libération de tous les manifestants, excepté ceux qui ont commis des actes de vandalisme. Il limoge le ministre de l'Intérieur, utilisé comme fusible et dénonce en même temps "l'instrumentalisation politique" du mouvement et l'action d'une minorité d'"extrêmistes" et de "terroristes" qui cherchent à nuire aux intérêts du pays.
Ce discours provocateur, criminalisant le mouvement, ne pouvait que galvaniser encore la colère de la population, et particulièrement des jeunes. Dès le 3 janvier, les lycéens se mobilisent et utilisent les téléphones portables et les réseaux Internet, notamment Facebook et Twitter, pour appeler à une grève générale des lycéens. Ces derniers manifestent les 3 et 4 janvier et sont rejoints par les diplômés chômeurs à Thala. Les jeunes manifestants font face aux matraques et aux gaz lacrymogènes des forces de répression. Au cours des affrontements, le siège du gouvernement est envahi et le local du parti au pouvoir incendié. L'appel à la grève nationale des lycéens, relayé par les réseaux Internet, est suivi dans plusieurs villes. A Tunis, Sidi Bouzid, Sfax, Bizerte, Grombalia, Jbeniana, Sousse, les lycéens ont rejoint les chômeurs. Des rassemblements de solidarité ont également eu lieu à Hammamet et Kasserine.
La révolte s'étend aux universités.
Au même moment, en Algérie, le mardi 4 janvier à Koléa, une petite ville à l’ouest de la capitale algérienne, toute une masse de chômeurs, d’ouvriers excédés et en colère descendent à leur tour dans la rue. Le même jour, les dockers du port d’Alger entrent en grève, pour protester contre un accord entre la société de gestion portuaire et le syndicat amputant le paiement des heures supplémentaires de nuit. Les grévistes refusent de donner suite à l’appel pour la suspension de la grève lancé par les représentants syndicaux. Là aussi la colère gronde ; pour ces ouvriers ayant un salaire de misère, se nourrir eux et leurs familles est une préoccupation quotidienne au même titre que les jeunes sans travail de Tunis ou d’Alger. Le 5, le mouvement de révolte se propage en Algérie notamment sur le littoral et en Kabylie (Oran, Tipaza, Bejaïa, ...) autour des mêmes revendications sociales face au chômage endémique des jeunes et à la pénurie de logements qui les poussent à rester chez leurs parents et à s'entasser dans des taudis (dans les faubourgs d'Alger pullulent des cités-dortoirs datant de années 1950 qui ressemblent à des bidonvilles contraignant les jeunes à squatter des terrains de jeu d'où ils se font régulièrement expulser par les charges musclées des forces de police). La réponse du gouvernement ne s’est pas fait attendre. Les forces de répression et l’armée ont immédiatement frappé et frappé fort. Rien que dans le quartier de Bab el Oued à Alger, les blessés se comptent par centaines. Mais là aussi la répression féroce de l’État algérien contribue à accroître la colère. En quelques jours, les manifestations gagnent vingt départements (wilayas). Le bilan officiel fait état de trois morts (à M'Silla, Tipaza et Boumerdès). Chez les manifestants la rage est là. "Nous n’en pouvons plus, nous n’en voulons plus." "Nous n’avons plus rien à perdre." Voilà les cris que l’on entend le plus souvent dans les rues d’Algérie. Ces émeutes ont pour détonateur immédiat la nouvelle augmentation brutale des prix d'aliments de première nécessité, annoncée le 1er janvier dernier : les prix des céréales ont augmenté de 30%, l’huile de 20% et le sucre lui a connu une envolée de 80% ! Après 5 jours de répression et de calomnies déversées sur le mouvement, Bouteflika amorce une marche arrière pour faire baisser la tension : il promet une détaxation sur les produits ayant subi une forte augmentation.
En Tunisie, le 5 janvier, à l'occasion des funérailles du jeune marchand de légumes qui s'est suicidé à Sidi Bouzid le 17 décembre, la colère est à son comble. Une foule de 5000 personnes a défilé derrière le cortège funèbre en criant son indignation : "Nous te pleurons aujourd'hui, nous ferons pleurer ceux qui ont causé ta mort !". Le défilé prend la tournure d'une manifestation. La foule scande des slogans contre la cherté de la vie "qui a conduit Mohamed au suicide" et crie "Honte au gouvernement !". Le soir même, la police procède à des arrestations musclées de manifestants à Jbedania et Thala. Des jeunes sont arrêtés et pourchassés par la police en armes.
Le 6 janvier, la grève générale des avocats est suivie à 95%. Partout, dans les localités du centre, du sud et de l'ouest du pays, des grèves, des manifestations de rue, des affrontements avec la police ont lieu et l'agitation gagne même les villes du littoral Est, plus riches.
La police se déploie devant tous les lycées et toutes les universités du pays. A Sfax, Jbeniana, Tajerouine, Siliana, Makhter, Tela, des manifestations de lycéens, étudiants, habitants sont brutalement dispersées par la police. A Sousse, la faculté de Sciences Humaines est prise d'assaut par les forces de l'ordre qui procèdent à des arrestations d'étudiants. Le gouvernement décide la fermeture de tous les lycées et de toutes les universités.
Face à la répression du mouvement, le 7 janvier, dans les villes de Regueb et Saida proches de Sidi Bouzid, des affrontements entre manifestants et police font 6 blessés. Des manifestants lancent des projectiles sur un poste de sécurité et la police tire sur la foule. Trois jeunes sont grièvement blessés.
Le 8 janvier, le syndicat officiel UGTT sort enfin de son silence, mais ne dénonce pas la répression. Son Secrétaire général, Abid Brigui, se contente de déclarer, sous la pression de la base, qu'il soutient les "revendications légitimes des populations de Sidi Bouzid et des régions de l'intérieur du pays". "Nous ne pouvons pas être en dehors de ce mouvement. Nous ne pouvons que nous ranger du côté des droits des nécessiteux et des demandeurs d'emploi". Face à la violence de la répression, il déclare timidement : "il est contre nature de condamner ce mouvement. Il n'est pas normal d'y répondre par des balles". Mais il ne lance aucun appel à la mobilisation générale de tous les travailleurs, aucun appel à l'arrêt immédiat de la répression qui s'est déchainée avec une violence accrue au cours du week-end des 8 et 9 janvier.
A Kasserine, Thala et Regueb, la répression des manifestations tourne au massacre. La police tire froidement sur la foule, faisant plus de 25 morts par balles. Dans la ville de Kasserine terrorisée par les exactions de la police qui a même tiré sur les cortèges funèbres, l'armée, divisée non seulement refuse de tirer sur la population mais s'interposée pour assurer sa protection contre la police anti-émeute. Pour sa part, le chef d'état-major de l'armée de terre est limogé pour avoir donné l'ordre de ne pas tirer sur les manifestants. D'ailleurs, si l'armée a été déployée dans les principales villes pour protéger les bâtiments publics, elle est mise à l'écart des opérations de répression directe, y compris dans la capitale d'où elle a fini par se retirer. Face au bain de sang, le personnel hospitalier de la région, bien que débordé par les urgences, débraye en signe de protestation.
Depuis le week-end sanglant des 8 et 9 janvier, la colère a gagné la capitale. Le 12 janvier, des émeutes explosent dans la banlieue de Tunis. La répression fera 8 morts dont un jeune tué d'une balle dans la tête. Le gouvernement impose le couvre feu. La capitale est aujourd'hui quadrillée par les forces de sécurité et le syndicat officiel UGTT a fini par appeler à une grève générale de 2 heures pour le vendredi 14. Malgré le couvre-feu et le déploiement des forces de répression dans la capitale, des affrontements se sont poursuivis en plein cœur de Tunis et partout des portraits de Ben Ali sont brûlés. Le 13 janvier, la révolte gagne les stations balnéaires du littoral et notamment la grande station touristique de Hammamet où les magasins sont pillés et les portraits de Ben Ali déchirés tandis que des affrontements entre manifestants et police se poursuivent au cœur de la capitale. Face au risque de basculement du pays dans le chaos, face à la menace d'une grève générale, et sous la pression de la "communauté internationale", notamment de l'État français qui, pour la première fois, commence à "condamner" Ben Ali, celui-ci finit par lâcher du lest. Il déclare à la population le soir du 12 janvier 13 janvier : "Je vous ai compris" et il affirme qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections... prévues en 2014 ! Il promet une baisse du prix du sucre, du lait, du pain et demande enfin aux forces de l'ordre de ne plus tirer à balles réelles en affirmant qu'"il y a eu des erreurs et des morts pour rien".
La complicité des États "démocratiques"
Face à la sauvagerie de la répression, tous les gouvernements "démocratiques" se sont contentés pendant plusieurs semaines d'affirmer leur "préoccupation" en appelant au "calme" et au "dialogue". Au nom du respect de l'indépendance de la Tunisie et de la non ingérence dans les affaires intérieures du pays, aucun n'a condamné les violences policières et le massacre perpétré par les sbires aux ordres de Ben Ali, même si en toute hypocrisie, la plupart déplorent "un usage excessif du recours à la force". Après le week-end sanglant des 8 et 9 janvier, l'État français a même ouvertement apporté son soutien à ce dictateur sanguinaire. Après avoir "déploré" hypocritement les violences, Michèle Alliot-Marie, ministre des affaires étrangères a proposé l'aide "sécuritaire" de la France aux forces de répression de l'État tunisien dans son discours à l'Assemble nationale le 12 janvier : "Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce pays".
Le "savoir-faire" des forces de sécurité françaises, on a vu ce que cela signifie lors des bavures policières qui ont provoqué la mort par électrocution de deux adolescents poursuivis par des flics en 2005 et qui ont constitué l'élément majeur du déclenchement des émeutes des banlieues. Ce "savoir-faire", on l'a encore vu à l'œuvre dans le mouvement de la jeunesse contre le CPE où la brigade anti-émeutes a envahi certaines universités avec des chiens pour terroriser les étudiants en lutte contre la perspective du chômage et de la précarité. Ce savoir-faire "sécuritaire" de nos bons flics français s'est dévoilé aussi dans les tirs de flash ball qui ont blessé plusieurs lycéens lors des manifestations contre la LRU en 2007. Et plus récemment, dans le mouvement contre la réforme des retraites, la répression qui s'est abattue notamment à Lyon contre des jeunes manifestants ont encore montré l'efficacité des forces de "sécurité" de l'État démocratique.français ! Des centaines de jeunes ont déjà été condamnés à de lourdes peines de prison ou sont menacés de l'être. Bien sûr, les États "démocratiques" ont plus de retenue et ne tirent pas aujourd'hui à balles réelles sur les manifestants, mais ce n'est certainement pas parce qu'ils seraient plus "civilisés", moins barbares ou plus "respectueux des droits de l'homme et de la liberté d'expression", mais parce que la classe ouvrière de ces pays est plus forte, a une longue expérience de luttes et n'est pas prête à accepter un tel degré de répression.
Quant à la criminalisation des mouvements sociaux permettant de justifier la répression, le gouvernement de Ben Ali n'a rien à envier à son complice français qui a été le premier à dénoncer les étudiants en 2006, de même que les travailleurs de la SNCF et de la RATP (en lutte pour la défenses des régimes spéciaux des retraites) en 2007, comme des "terroristes".
Il est clair que la seule chose qui "préoccupe" tant la classe dominante de tous les pays, c'est le renforcement "efficace" de l'État policier destiné au maintien de l'ordre capitaliste, un ordre social qui n'a aucun avenir à offrir aux jeunes générations. Partout dans le monde, face la crise insurmontable du capitalisme, cet "ordre" ne peut engendrer que toujours plus de misère, de chômage et, finalement, de répression.
La complicité évidente de toute la bourgeoisie mondiale révèle que c'est bien tout le système capitaliste qui est responsable du bain de sang en Tunisie, et pas seulement le régime corrompu de Ben Ali. L'État tunisien n'est qu'une caricature de l'État capitaliste !
Une révolte qui se rattache au combat de la classe ouvrière mondiale
Bien que la Tunisie soit dominée par un régime totalitaire gangréné par la corruption, la situation sociale dans ce pays n'est pas une exception. En Tunisie, comme partout, la jeunesse est confrontée au même problème : l'absence de perspective. Cette révolte "populaire" se rattache au combat général de la classe ouvrière et de ses jeunes générations contre le capitalisme. Elle s'inscrit dans la continuité des luttes qui se sont déroulées depuis 2006, en France, en Grèce, en Turquie, en Italie en Angleterre où toutes les générations se sont retrouvées dans une immense vague de protestation contre la dégradation des conditions de vie, la misère, le chômage des jeunes et la répression. Le fait que la révolte sociale ait été marquée par un vaste mouvement de solidarité dès les événement du 17 décembre, montre que, malgré toutes les difficultés de la lutte de classe en Tunisie ou en Algérie, malgré le poids des illusions démocratiques lié à l'inexpérience et la chape de plomb de ces régimes qui exposent les prolétaires à l'isolement et aux bains de sang, cette révolte contre le chômage et la vie chère appartient au combat de la classe ouvrière mondiale.
La conspiration du silence qui a entouré ces événements ne vient d'ailleurs pas que de la censure de ces régimes. Elle a été partiellement rompue par l'activité d'une jeunesse qui a su activer ses réseaux Internet, Twitter ou Facebook comme arme de combat, comme moyen de communication et d'échange pour montrer et dénoncer la répression assurant ainsi un lien entre eux mais aussi avec leur famille ou amis en dehors du pays, notamment en Europe. Mais les médias de la bourgeoisie ont partout contribué à instaurer un black-out, en particulier par rapport aux luttes ouvrières qui ont inévitablement accompagné ce mouvement et dont les échos ne sont parvenus que de manière très fragmentaires 1.
Ces médias ont également, comme lors de chaque lutte de la classe ouvrière, tout fait pour déformer et discréditer cette révolte contre la misère et la terreur capitaliste en la présentant à l'extérieur comme un remake des émeutes dans les banlieues en France, comme l'œuvre d'une bande de "casseurs" irresponsables et de pillards, là encore en toute complicité avec le gouvernement de Ben Ali, alors que de nombreux manifestants ont dénoncé les pillages comme étant l'œuvre des flics cagoulés destinée à discréditer le mouvement. Les vidéos amateurs des jeunes ont également montré des policiers en civil qui ont cassé des vitrines à Kasserine le 8 janvier pour servir de prétexte à la terrible répression qu'ils ont déchaînée dans cette ville.
Face à la barbarie capitaliste, face à la loi du silence et du mensonge, la classe ouvrière de tous les pays doit manifester sa solidarité envers ses frères de classe en Tunisie et en Algérie. Et cette solidarité ne peut s'affirmer que par le développement de ses luttes contre toutes les attaques du capital dans tous les pays, contre cette classe d'exploiteurs, d'affameurs et d'assassins qui ne peut maintenir ses privilèges qu'en continuant à plonger l'humanité dans le gouffre de la misère. Ce n'est qu'en développant massivement ses luttes, en développant sa solidarité et son unité internationale que la classe ouvrière, notamment dans les pays "démocratiques" les plus industrialisés, pourra offrir une perspective d'avenir à la société.
Ce n'est qu'en refusant de faire les frais de la faillite du capitalisme partout dans le monde, que la classe exploitée pourra mettre un terme à la misère et à la terreur de la classe exploiteuse en renversant le capitalisme et en construisant une autre société basée sur la satisfaction des besoins de toute l'humanité et non sur le profit et l'exploitation.
Solidarité avec nos frères de classe au Maghreb !
Solidarité avec les jeunes générations de prolétaires partout où elles luttent contre un avenir bouché !
Pour en finir avec le chômage, la misère et la mitraille, il faut en finir avec le capitalisme !
WM (13 janvier 2011)
1 Pour mémoire, rappelons qu'en Tunisie en 2008, la région des mines de phosphates de Gafsa avait été le coeur d'une épreuve de force avec le pouvoir durement réprimée et qu'en Algérie, en janvier 2010, 5000 grévistes de la SNVI et d'autres entreprises avaient tenté, malgré l'intervention brutale des forces de l'ordre, de se rassembler pour étendre et unifier leur lutte au centre d'une zone industrielle rassemblant 50 000 ouvriers dans la région de Rouiba aux portes d'Alger
Géographique:
- Afrique [109]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]
ICConline - février 2011
- 1728 lectures
En Libye, un soulèvement populaire enterré par des luttes entre factions bourgeoises
- 2373 lectures
Les événements qui se déroulent en Libye sont extrêmement difficiles à suivre. Une chose est claire cependant : la population souffre de la répression depuis des semaines. Elle connaît la peur et l'incertitude. Peut-être des milliers d'entre-eux sont-ils morts, d'abord des mains de l'appareil répressif du régime mais, de plus en plus, ils sont pris entre deux feux, puisque le gouvernement et l'opposition se battent pour le contrôle du pays. Pour quelle raison meurent-ils ? D’un côté, pour maintenir le contrôle de Kadhafi sur l'Etat et dans l’autre pour que le Conseil National Libyen (l'auto-proclamée 'la voix de la révolution') contrôle l'ensemble du pays. La classe ouvrière, en Libye et au-delà, se voit demander de choisir entre deux groupes de gangsters. En Libye, on leur dit qu'ils devraient prendre une part active dans cette grandissante guerre civile entre deux partis rivaux de la bourgeoisie libyenne pour le contrôle de l'Etat et de l'économie. Dans le reste du monde, nous sommes encouragés à soutenir la lutte courageuse de l'opposition. Les travailleurs n'ont aucun intérêt à soutenir l'une ou l'autre des factions.
Les événements en Libye ont commencé comme une manifestation massive contre Kadhafi, inspirée par les mouvements en Egypte et en Tunisie. Ce qui a provoqué l'explosion de colère dans de nombreuses villes semble avoir été la répression brutale des premières manifestations. Selon The Economist du 26 février, l'étincelle initiale a été la manifestation d'une soixantaine de jeunes à Benghazi, le 15 février. Des manifestations similaires ont eu lieu dans d'autres villes et toutes ont été accueillies par des balles. Face à l'assassinat de plusieurs dizaines de jeunes, des milliers de gens sont descendus dans les rues pour livrer des batailles désespérées avec les forces de l'Etat. Au cours de ces luttes, on eu lieu des actions d'un grand courage. La population de Benghazi, apprenant que des mercenaires avaient débarqué à l'aéroport, est descendue massivement jusqu'à l'aéroport et en a pris le contrôle, malgré de lourdes pertes. Dans une autre action, des civils ont réquisitionné des bulldozers et autres véhicules et ont pris d'assaut une caserne lourdement armée. La population dans d'autres villes a chassé les forces de répression de l'Etat. La seule réponse du régime a été encore plus de répression, mais cela a entraîné l'éclatement d'une grande partie des forces armées, et des soldats et des officiers ont refusé d'exécuter les ordres de tuer les manifestants. Un simple soldat a tué un commandant qui lui ordonnait de tirer pour tuer. Donc, initialement, ce mouvement semble avoir été une véritable explosion de colère populaire, particulièrement de la part de la jeunesse urbaine, face à la répression brutale et à l'aggravation de la misère économique.
Pourquoi les choses ont-elles pris une tournure si différente en Libye ?
L'aggravation de la crise économique et un refus croissant d'accepter la répression a été le contexte plus large pour les mouvements en Tunisie, en Egypte et ailleurs, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La classe ouvrière et la population en général ont subi des années de pauvreté et d'exploitation brutale, dans le même temps que la classe dirigeante accumulait des richesses immenses.
Mais pourquoi la situation en Libye est-elle si différente de celle de la Tunisie et de l'Egypte ? Dans ces deux derniers pays, alors qu'il y avait la répression, les principaux moyens pour contrôler le mécontentement social a été l'utilisation de la démocratie. En Tunisie, les manifestations grandissantes de la classe ouvrière et d'une population plus large contre le chômage ont été détournées en une nuit vers l'impasse de savoir qui remplacerait Ben Ali. Sous la direction de l'armée américaine, l'armée tunisienne a demandé au président de déguerpir. Il a fallu un peu plus longtemps en Egypte pour obtenir que Moubarak fasse de même, mais sa résistance même a permis de s'assurer que ce mécontentement se focalise sur la volonté de se débarrasser de lui. Fait important, l'une des choses qui l'a finalement poussé vers la sortie a été le déclenchement de la grève réclamant de meilleures conditions de vie et de meilleurs salaires. Cela a montré que les travailleurs, tout en ayant participé à des manifestations massives contre le gouvernement, n'ont pas oublié leurs propres intérêts et ne sont pas prêts à les mettre de côté pour soi-disant donner une chance à la démocratie.
En Egypte et en Tunisie, l'armée est l'épine dorsale de l'Etat et elle a été capable de placer les intérêts du capital national au-dessus des intérêts particuliers des cliques. En Libye, l'armée n'a pas le même rôle. Le régime de Kadhafi a délibérément maintenu, pendant des décennies, l'armée faible, ainsi que toutes les autres parties de l'Etat qui pouvaient constituer une base de pouvoir pour ses rivaux. « Kadhafi a tenté de maintenir les militaires en état de faiblesse, pour qu'ils ne puissent pas le renverser, comme elle a renversé le roi Idris » a déclaré Paul Sullivan, un expert en Afrique du Nord, de la National Defense University, à Washington. Le résultat est « une armée chichement entraînée par des officiers mal formés qui sont sur la corde raide, pas tout à fait stables sur le plan personnel, et avec de nombreuses armes qui flottent tout autour. » (Bloomberg, 2 mars) Cela signifie que la seule réponse du régime à tout mécontentement social est la répression à l'état pur.
La brutalité même de la réponse de l'Etat a entraîné la classe ouvrière dans une flambée de colère désespérée à la vue du massacre de ses enfants. Mais les travailleurs qui ont rejoint les manifestations l'ont fait en grande partie en tant qu'individus : malgré le grand courage qu'il a fallu pour résister aux armes lourdes de Kadhafi, les travailleurs n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs propres intérêts de classe.
En Tunisie, comme nous l'avons dit, le mouvement a commencé au sein de la classe ouvrière et des pauvres contre le chômage et la répression. Le prolétariat, en Egypte, est entré dans le mouvement après avoir participé, ces dernières années, à plusieurs vagues de luttes et cette expérience lui a donné confiance dans sa capacité de défendre ses propres intérêts. L'importance de cela a trouvé sa démonstration, lorsqu'à la fin des manifestations, une vague de grèves a éclaté.
Le prolétariat libyen est entré dans le conflit actuel dans une position de faiblesse. Il y a eu des communiqués sur une grève dans un champ pétrolifère. Mais il est impossible de dire s'il y a eu d'autres expressions de l'activité de la classe ouvrière. C’est peut-être le cas, mais il reste que le prolétariat, en tant que classe, est plus ou moins absent. Cela signifie que la classe ouvrière, a été, dès le début, vulnérable à tous les poisons idéologiques sécrétés par une situation de chaos et de confusion. L'apparition du vieux drapeau monarchiste et son acceptation, en seulement quelques jours, comme le symbole de la révolte, est le signe de la profondeur de cette faiblesse. Ce drapeau a flotté de concert avec le slogan nationaliste 'Une Libye libre'. Il y a eu aussi des expressions de tribalisme, avec l'appui ou l'opposition au régime de Kadhafi, déterminé, dans certains cas, par des intérêts régionaux ou tribaux. Des chefs tribaux ont usé et usent encore de leur autorité pour se mettre à la tête de la rébellion. Il semble y avoir aussi une forte présence de l'islamisme avec le chant 'Allahu Akbar' se faisant entendre dans de nombreuses manifestations.
Ce bourbier idéologique a exacerbé une situation où des dizaines, sinon des centaines de milliers de travailleurs étrangers ont ressenti le besoin de fuir le pays. Pourquoi des travailleurs étrangers défileraient-ils derrière un drapeau national, peu importe sa couleur ? Un véritable mouvement prolétarien aurait incorporé, dès le début, les travailleurs étrangers, parce que les réclamations auraient été communes : de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et la fin de la répression pour tous les travailleurs. Ils se seraient unis parce que leur force est leur unité, quelle que soit la nation, la tribu ou la religion.
Kadhafi a fait pleinement usage de tout ce poison pour essayer d'obtenir le soutien des travailleurs et de la population, contre la prétendue menace que pèserait sur sa 'révolution' : les étrangers, le tribalisme, l'islamisme, l'Occident…
Dans l'attente d'un nouveau régime
La majorité de la classe ouvrière déteste le régime. Mais le véritable danger pour la classe ouvrière, extrêmement grave, est qu'elle soit entraînée derrière 'l'opposition'. Cette opposition, avec le nouveau 'Conseil National', qui assume de plus en plus une position de leadership, est un conglomérat de différentes fractions de la bourgeoisie : les anciens membres du régime, les monarchistes, etc., ainsi que des chefs tribaux et religieux. Tous ont pleinement tiré parti du fait que ce mouvement n'a pas de direction prolétarienne indépendante pour imposer leur volonté de remplacer la direction par Kadhafi de l'Etat libyen.
Le Conseil National est clair sur son rôle : « L'objectif principal du Conseil National est d'avoir un visage politique ... pour la révolution »,« Nous allons aider à libérer d'autres villes libyennes, en particulier Tripoli, grâce à notre armée nationale, à nos forces armées, dont une partie a annoncé son soutien au peuple », (Reuters Africa du 27 février) « Une Libye divisée est impensable »(Reuters 27 février). En d'autres termes, leur but est de maintenir la dictature capitaliste actuelle, mais avec un visage différent.
Cependant, l'opposition n'est pas unie. L'ancien ministre de la justice de Kadhafi, Mohamed Mustafa Abud Ajleil, a annoncé la formation d'un gouvernement provisoire, siégeant à Al-Baida, à la fin de février, avec le soutien de certains anciens diplomates. Cette initiative a été rejetée par le Conseil National dont le siège est à Benghazi.
Cela montre qu'il y a des divisions profondes dans l'opposition qui exploseront inévitablement, soit qu'ils parviennent à se débarrasser de Kadhafi, soit que ces 'leaders' se querellent pour sauver leur peau si Kadhafi parvient à rester au pouvoir.
Le Conseil National montre un meilleur visage au public. Il est dirigé par Ghoga, un célèbre avocat des Droits de l'Homme et il n'est donc pas trop compromis par des liens avec l'ancien régime, contrairement à Ajleil. C'est beaucoup mieux pour vendre cette bande à la population.
Les médias ont fait beaucoup de bruit à propos des comités qui ont vu le jour dans les villes et les régions dont Kadhafi a perdu le contrôle. Bon nombre de ces comités semblent avoir été auto-désignés par les dignitaires locaux, et même si certains d'entre eux étaient des expressions directes de la révolte populaire, il semble qu'ils ont été entraînés dans le cadre étatique bourgeois du Conseil National. L'effort du Conseil national pour mettre en place une armée nationale signifie autant la mort et la destruction pour la classe ouvrière et l'ensemble de la population que si cette armée se battait aux côtés des forces de Kadhafi. La fraternisation sociale qui a initialement contribué à saper les efforts du régime de répression a été vite remplacée par des batailles rangées, sur un front purement militaire, alors que la population a été appelée à faire des sacrifices pour s'assurer que l'Armée Nationale puisse se battre.
La transformation de l'opposition bourgeoise en un nouveau régime est accélérée par le soutien de plus en plus ouvert des grandes puissances : les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, etc. Les gangsters impérialistes prennent maintenant leurs distances avec leur ancien copain Kadhafi en vue de veiller à ce que, si une nouvelle équipe arrive au pouvoir, ils détiennent une certaine influence sur elle. Le soutien ira à ceux qui s'inscrivent dans la défense des intérêts impérialistes des grandes puissances.
Ce qui semble avoir commencé comme une réponse désespérée à la répression de la part d'une partie de la population a très rapidement été utilisé par la classe dirigeante en Libye et à l'étranger à ses propres fins. Un mouvement qui a commencé comme un effort plein de fureur et de colère pour arrêter le massacre des jeunes a fini par un autre massacre et un bain de sang , mais maintenant, au nom d'une « Libye libre ».
Le prolétariat de Libye et d'ailleurs ne peut répondre qu'en accentuant sa détermination à ne pas se laisser entraîner dans des luttes sanglantes entre les factions de la classe dirigeante au nom de la démocratie ou d'une nation libre. Dans les jours et semaines à venir, si Kadhafi s'accroche au pouvoir, le soutien international à l'opposition sera de plus en plus fort. Et s’il s'en va, il y aura une campagne tout aussi assourdissante sur le triomphe de la démocratie, le pouvoir du peuple et la liberté. Dans les deux cas, les travailleurs seront invités à s'identifier avec le visage démocratique de la dictature du capitalisme.
Phil (5 mars)
Géographique:
- Libye [120]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]
Les difficultés de la bourgeoisie américaine après les élections de mi-mandat
- 2026 lectures
Nous publions ci-dessous un article d'Internationalism, organe de presse du CCI aux Etats-Unis montrant comment la bourgeoisie américaine, touchée par les effets de la décomposition, est de plus en plus divisée. Une partie d'entre-elle est même en train de se vautrer dans l'obscurantisme le plus crasse. Mais par ce texte, nos camarades révèlent aussi à quel point la crise économique frappe de plein fouet la première puissance mondiale sans qu'aucune issue ne soit envisageable pour le capital américain.
Les élections de la mi-mandat de la fin 2010 ont été désastreuses pour le Parti démocrate. Les Républicains ont gagné à une forte majorité la Chambre des Représentants, ce qui leur donne la capacité de faire obstruction à toute loi qui doit passer par les deux chambres du Congrès.
Pour les médias bourgeois, ces élections ont mis les Républicains dans une position favorable pour gagner les présidentielle de 2012 face à Barak Obama. Le président américain a d'ailleurs lui-même admis qu'il avait subi une lourde défaite électorale et a promis de faire de son mieux pour travailler avec les Républicains au Congrès. Pendant ce temps, la gauche du Parti démocrate, dit 'progressiste', chantait un air différent, faisant valoir que les résultats des élections s'expliquaient au contraire par l'effondrement de la coalition électorale du président à cause de son manque de prudence face à l'obstructionnisme républicain, de sa trahison par rapport au programme national de santé et de son programme pro Wall-Street.
Cependant, il n'y a pas eu que de bonnes nouvelles pour les Républicains. Les élections ont aussi mis en lumière des fractures importantes en leur sein. Le poids croissant du Tea Party dans les rangs du Parti lui a sans doute coûté son contrôle du Sénat. Bien que la démagogie du Tea Party ait été utile pour la mobilisation de la base du parti conservateur dans la Chambre des Représentants des districts, elle a aussi détourné de nombreux électeurs. Pourtant, un certain nombre de républicains provocateurs, tels que l'extrémiste libertaire Paul Rand, du Kentucky, auront des sièges au Sénat lorsque le nouveau Congrès se réunira en janvier 2011. Le Parti républicain entrera donc de plus en plus divisé dans le nouveau Congrès, son aile droite apparaissant autant en contradiction avec les 'républicains modéré' qu'avec les démocrates.
Il est clair que le système politique est soumis à un stress face une crise économique persistante qui ne va pas disparaître, quoique fasse la bourgeoisie. Le chômage reste extrêmement élevé, le crédit est encore en grande partie gelé, les entreprises ne trouvent tout simplement plus à investir de manière rentable, la capacité de consommation de la classe ouvrière est fortement réduite par l'effondrement des prêts à la consommation… Pendant ce temps, la bourgeoisie commence enfin à prendre conscience de l'ampleur de la menace que représente la dette nationale ; des gouvernements locaux et des Etats se trouvent face de graves déficits budgétaires.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la classe ouvrière ? Le prolétariat n'a jamais rien à gagner dans les élections bourgeoises. Les élections sont des moments de la vie de la bourgeoisie où elle tente toujours de lier la classe ouvrière à l'Etat, de régler les conflits internes dans ses rangs et de mettre au pouvoir l'équipe la mieux adaptée au moment. Cependant, la classe ouvrière a un besoin vital de comprendre la stratégie politique de la classe dominante.
Aujourd'hui, le poids néfaste de la décomposition sociale sur l'appareil politique de la bourgeoisie donne lieu à une difficulté croissante pour la classe dirigeante pour gérer son système politique et électoral pour obtenir les meilleurs résultats possibles du point de vue de l'ensemble du capital national. La tendance croissante au 'chacun pour soi' dans l'arène de la politique pèsent aujourd'hui lourdement sur la bourgeoisie américaine. Quelle profondeur la crise politique de la bourgeoisie a-t-elle atteint ? Telle est la question essentielle pour la classe ouvrière quand il s'agit de l'analyse des élections bourgeoises.
Les contradictions de la politique économique bourgeoise : austérité ou stimulation ?
Selon les médias bourgeois, les experts sont divisés sur ce que devrait être la politique économique la plus urgente dans la conjoncture actuelle. D'une part, les 'chasseurs de déficit' affirment que la dette nationale des Etats-Unis est entrée dans une spirale non contrôlable qui menace sur le long terme la position de la nation en tant que leader impérialiste mondial. Pour ces économistes, le besoin le plus pressant face l'Etat est d'adopter des mesures d'austérité douloureuses pour réduire les dépenses fédérales, de promulguer des coupes claires dans les programmes sociaux, de réduire les effectifs du gouvernement fédéral, de rationaliser le code des impôts et de rendre sa solvabilité à l'Etat. Selon cette ligne de pensée, si la dette n'est pas sous contrôle, les Etats-Unis finiront par se trouver face à une crise de la dette souveraine de l'ordre de ce que la Grèce et l'Irlande connaissent aujourd'hui. En voyant les Etats-Unis comme un mauvais investissement, comme un pays qui refuse de prendre les mesures nécessaires pour assainir ses finances, les investisseurs étrangers cesseront d'acheter des bons du trésor ce qui coupera l'herbe sous les pieds du modèle 'emprunter et dépenser' qui a maintenu les pays à flot pendant au moins la dernière décennie. Le récent rapport de la Commission Présidentielle de la Dette, allant dans le même sens, a appeler à relever l'âge de la retraite, à réaliser des coupes de la sécurité sociale, l'élimination du crédit d'impôt hypothécaire, la réduction du personnel fédéral et même certaines réductions du budget militaire, afin de réduire la dette nationale.
D'autre part, des économistes de gauche, comme Paul Krugman et Robert Reich, font valoir que les inquiétudes concernant la dette fédérale, même si elles portent sur un problème réel, sont exagérées. Pour eux, la priorité pour l'Etat est de faire redémarrer l'économie en adoptant des programmes de relance expansionnistes afin de stimuler les dépenses de consommation et créer des emplois. Selon cette perspective, l'économie américaine souffre d'un grave problème de 'sous-consommation', les salaires de la classe ouvrière ont été tellement réduits qu'ils ne peuvent tout simplement pas se permettre d'acheter ce qui est produit. Bien que ce problème ait été supprimé au cours des 20 dernières années grâce à un recours massif au crédit à la consommation, cette logique suit maintenant son cours. Selon la thèse du couple Reich-Krugman, une autre série de relances keynésiennes est nécessaire pour mettre plus d'argent dans les poches des consommateurs, permettant la croissance de l'économie et la retombée du chômage. Adopter une politique d'austérité forte et trop vite pourrait être un désastre.
Il n'est pas nécessaire de beaucoup réfléchir pour reconnaître que, dans le court terme, ces deux politiques sont en complète contradiction l'une par rapport l'autre. L'une appelle à contracter l'économie afin d'améliorer, sur le long terme, la position budgétaire de l'Etat, tandis que l'autre prend le risque d'empirer la dette nationale dans le but d'améliorer, dans l'immédiat, la consommation et donc l'économie. Cependant, il n'y a rien de surprenant à ce que deux factions différentes d'économistes expriment deux visions contrastées des priorités les plus importantes pour l'Etat. Cela reflète simplement la contradiction fondamentale dans laquelle se trouve aujourd'hui le capitalisme sur le plan international. Après prêt de cent années d'authentique capitalisme d'Etat, presque tous les Etats se trouvent confrontés à un choix fondamental face à la crise économique permanente : tenter de stimuler l'économie avec le risque de nouveaux dommages à long terme sur les finances publiques ou adopter tout de suite une politique d'austérité et prendre le risque de rendre comateuse une économie faible.
Néanmoins, il ne faut pas interpréter le débat entre ces deux positions de principe comme la preuve d'une véritable divergence, au sein de la bourgeoisie américaine, sur la nécessité d'adopter l'austérité contre la vie de la classe ouvrière et ses conditions de travail. Toutes les fractions de la bourgeoisie reconnaissent que la crise financière de l'Etat est réelle et devra finalement être traitée en faisant des 'sacrifices douloureux'. Les débats politiques du moment, au sein de la bourgeoisie, ne concernent que le calendrier de l'austérité et la question de savoir si, oui ou non, une autre série de stimuli, étant donné les risques sur le long terme, aidera vraiment l'économie à se redresser. Malgré une campagne médiatique concertée, dirigée vers la classe ouvrière, autour de la menace que pose à la nation la dette nationale, une forte faction au sein de la bourgeoisie américaine estime qu'une plus grande impulsion est nécessaire. Pour le moment, cette faction semble avoir l'oreille de l'administration Obama1. L'extension récente de la période des réductions fiscales de Bush, combinée avec une autre extension du programme d'indemnisation d'urgence du chômage au niveau fédéral et une réduction de la taxe sociale sur les salaires, ont été mises en place par l'administration comme un 'programme de relance' censé ajouter jusqu'à 1,3 million d'emplois au cours des deux prochaines années2. Bien entendu, toutes ces réductions d'impôts et ces extensions des prestations de chômage vont venir augmenter le poids de la dette nationale.
La classe ouvrière ne doit pas se laisser berner par le recours continu de l'administration Obama à des politiques keynésiennes. Derrière ces politiques à court terme, toutes les factions de la bourgeoisie savent que "le jour du jugement viendra", le Scylla de la dette et de la crise financière l'emportera sur le Charybde du chômage et de la stagnation économique3. La question que se pose la bourgeoisie, en ce moment, est : quelle faction politique devra détenir le pouvoir d'Etat lorsque l'assaut sur le salaire social commencera ?
Du point de vue de historique, il semble probable que la bourgeoisie américaine soit tentée de faire sortir le Parti démocrate du pouvoir afin qu'il puisse jouer le rôle traditionnel de la gauche dans l'opposition, pendant que les républicains gouverneront et adopteront les mesures d'austérité nécessaires. Toutefois, étant donné la hauteur de la tourmente qui s'est produite dans le système politique américain au cours de la dernière décennie, l'accomplissement d'une telle manoeuvre n'est plus du tout simple, aujourd'hui, pour la bourgeoisie. Bien que la décomposition sociale ait touché l'ensemble du spectre politique bourgeois au cours des dix dernières années, il n'a pas touché de façon égale les deux partis politiques américains. Au cours de la dernière décennie, le Parti républicain a été de plus en plus dirigé par des factions de la bourgeoisie qui n'ont pas nécessairement la capacité d'agir dans l'intérêt général du capital national. L'actuelle coalition républicaine comprend les obscurantistes de la droite chrétienne, les tenants de l'idéologie libertaire qui veulent abolir la Réserve Fédérale, les fondamentalistes du marché libre, les factions les plus belliqueusement anti-immigré que la bourgeoisie a à offrir et ceux qui se délectent de l'héritage de la diplomatie cowboy de l'ère Bush. En plus de cela, nous devons maintenant ajouter ceux du Tea Party, dont beaucoup sont des idéologues qui croient vraiment dans les philosophies extrémistes qu'ils prêchent. Alors que les 'républicains modérés', fidèles à la sagesse de Washington, contrôlent encore les leviers du pouvoir dans le Parti, ils sont soumis aux agressions de "l'insurrection de droite" dans leurs propres rangs, les obligeant à se plier aux exigences de ces factions, en même temps qu'ils essayent de les manipuler pour améliorer leur position électorale.
Il y a de nombreux risques pour la bourgeoisie dans la période venir. Faut-il ramener le Parti républicain au pouvoir en vue des difficiles, mais nécessaires, mesures d'austérité au risque d'une réédition des années Bush ? Faut-il se rallier à Barack Obama, de nouveau en 2012, dans l'espoir de maintenir une administration démocrate de centre-droit plus responsables et compétente, mais au risque de bouleverser la division idéologique droite-gauche contre la classe ouvrière ?
La campagne présidentielle pour 2012
Dans les jours suivant les élections de la mi-mandat, Obama ressemblait à un président en fin de mandat. Son parti avait subi une défaite historique aux élections : les candidats démocrates au Congrès, pour d'importants Etats industriels qu'Obama avait remporté en 2008, avaient subi défaites sur défaites. Les démocrates avaient même été incapables de conserver l'ancien siège d'Obama au Sénat de l'Illinois. Les médias ont appelé ces élections "la marée républicaine". Cela a été présenté comme un rejet total de l'ordre du jour d'Obama, notamment, de son projet de loi controversé de réforme de la santé. Il a été déclaré que la seule façon pour les républicains de perdre en 2012 serait de nommer un candidat extrémiste du Tea Party, comme Sarah Palin. Tout ce que les républicains auraient à faire pour revenir au pouvoir en 2012 serait de désigner un candidat crédible, qui discréditerait et abattrait rapidement Obama. Les républicains peuvent fairet obstruction au Congrès à toute nouvelle législation, pendant les deux prochaines années, ce qui laisserait Obama faible et inefficace. Le public le rejetterait à coup sûr.
Cependant, à peine deux mois depuis l'élection, le vent politique a semblé changer une fois de plus. Obama a repris de la vigueur après une série d'importantes victoires législatives dans ce canard boiteux de Congrès et il semble maintenant à nouveau présidentiable. Il a appuyé au Sénat le nouveau traité START avec la Russie, contre l'obstruction obstinée de certains républicains. Il a finalement fait passer la loi qui met fin à la politique militaire du 'Don't Ask Don't Tell' qui permettait que de nombreuses personnes qualifiées gay soient bannies du service. La fin de cette politique a été approuvée par le Secrétaire de la Défense d'Obama, républicain, contre les objections gratuites d'un certain nombre de républicains obstinés, y compris John Mc Cain, le concurrent d'Obama aux présidentielle de 2008.
Surtout, Obama a passé un compromis avec les républicains pour prolonger de deux ans la période des réductions d'impôts de Bush pour tous les Américains, mais qui s'étend finalement au programme d'urgence du gouvernement fédéral d'assurance-chômage pendant 13 mois et comprend une autre série de réductions d'impôts, qui sont attendues par de nombreux économistes comme devant fournir un stimulus correct à l'économie au cours des deux prochaines années. Selon certains analystes, Obama a complètement doublé les républicains sur ce projet de loi, en adoptant une forme de relance économique plus importante que tout ce qui l'a précédé.
Pourtant, cela n'a pas empêché une mini révolte d'avoir lieu au sein du Parti démocrate sur l'accord fiscal qu'Obama a trouvé avec les républicains. Les rémocrates soi-disant 'progressistes' ont accusé leur propre président de s'être vendu, d'avoir accepté un compromis sans combattre, d'avoir cédé aux exigences du Parti républicain pour poursuivre des réductions d'impôts irresponsables en faveur des Américains les plus riches et d'aggraver ainsi la dette nationale.
Pendant la plus grande partie de la semaine, les blogs de gauche et le réseau MSNBC ont multiplié les appels à une primaire 2012 défiant Obama ou lui lançant le défi d'un troisième candidat de la part de la gauche4. Les démocrates du Congrès ont promis de voter contre le compromis de taxe, tandis que Bernie Sanders, le sénateur socialiste autoproclamé du Vermont, se gaussait à la tribune du Sénat du compromis fiscal, pestait contre la baisse du niveau de vie de la classe ouvrière américaine, tandis que les Américains les plus riches continuent de se remplir les poches. Durant cette période, la base du Parti démocrate s'est trouvée dans un état de choc et d'incrédulité et a semblé former une opposition courroucée contre leur propre président.
Néanmoins, tout s'est rapidement calmé et le compromis fiscal en tant que programme de stimulation a remporté suffisamment de voix démocrates pour franchir les deux chambres du Congrès et prendre force de loi. Ce "dramelet" au cours de cette législation peut être un aperçu des choses à venir. Si la bourgeoisie décide qu'il est trop risqué de retirer le Parti républicain du pouvoir, est-il possible qu'ils puissent tenter de pratiquer l'austérité avec une administration de centre-droit démocrate, tacitement appuyée par les 'républicains modérés', tandis que la base démocrate du Congrès jouerait le rôle de la gauche dans l'opposition ? En ce moment, nous ne pouvons pas dire si cela se produira. Cependant, la controverse sur le compromis fiscal donne un indict pour savoir comment une telle disposition pourrait fonctionner.
Mais cet arrangement gouvernementale pourrait comporter un autre risque, celui de la radicalisation de la droite du Parti républicain, et éventuellement, amener une scission avec le Tea Party et ainsi l'apparition d'un troisième parti qui concurrencerait la droite. Beaucoup d'idéologues républicains du Congrès rejettent en effet catégoriquement les tentatives de leurs dirigeants de faire des compromis avec Obama.
Une campagne est en cours dans les médias, dirigée par des 'républicains responsable', pour tenter de convaincre Sarah Palin de ne pas être candidate à la présidence en 2012. Même si elle peut être utile pour collecter des fonds pour les républicains et pour le ralliement au vote de la base conservatrice, il y a un consensus général parmi les principales factions de la bourgeoisie dans les deux Partis sur le fait qu'elle serait une présidente désastreuse, exponentiellement pire que Bush. En outre, sa candidature pourrait poser des difficultés pour enlever le Parti républicain du pouvoir en 2012, dans la mesure où elle est susceptible de réveiller les électeurs d'Obama.
En dernière analyse, la situation politique des Etats-Unis se caractérise actuellement par une instabilité provoquée par la décomposition. Toutes les factions responsables de la bourgeoisie reconnaissent finalement la nécessité d'adopter l'austérité. Cependant, à l'heure actuelle, il y a peu de consensus sur la manière d'y parvenir au niveau politique. Alors que l'histoire nous dit que la bourgeoisie cherche à placer le Parti démocrate dans l'opposition, de telle sorte que les républicains puissent adopter les coupes nécessaires (pendant que les démocrates travaillent avec les syndicats pour canaliser et finalement saboter la réplique de la classe ouvrière), la situation actuelle de décomposition rend cette opération un peu moins simple pour la bourgeoisie. La classe dirigeante pourrait opter pour une tentative d'adopter ces coupes avec un président de centre-droit démocrate, de connivence avec les républicains. En ce cas, le groupe démocrate du Congrès, avec les syndicats5, jouerait l'illusion de l'opposition de gauche. Ce type d'action comporterait le risque grave d'une rupture dans la division idéologique traditionnelle du travail entre les démocrates et les républicains. Toutefois, étant donné la dégradation idéologique du Parti républicain et la possibilité d'un candidat présidentiel dangereux émergeant de ses rangs, la bourgeoisie n'a peut-être pas d'autre choix que d'opter pour une telle politique.
Bien sûr, il est également possible que les effets de la décomposition aient une telle emprise sur l'appareil politique bourgeois qu'à la fin, les principales factions de la bourgeoisie ne puissent pas empêcher une présidence Palin, ou certains de même veine. Si Palin décide de se lancer, il est possible que l'insurrection du Tea Party saura l'amener à la victoire dans les primaires républicaines. En tant que candidate du Parti républicain, elle peut dynamiser la base démocrate pour venir aux urnes, mais compte tenu des contraintes du système politique américain, en particulier des anachronismes du Collège Electoral, il est possible que, dans une répétition comique de l'élection de 2000, Sarah Palin puisse gagner la présidence, mais perdre le vote populaire. Bien que ce soit là une possibilité très lointaine pour le moment, nous pouvons être assurés que c'est une éventualité à laquelle les principales factions de la bourgeoisie se préparent et font de leur mieux pour éviter.
Pour la classe ouvrière, le message est clair. Le système politique bourgeois ne peut nous offrir rien d'autre que plus de souffrance, d'austérité et de misère. La décomposition du système politique capitaliste a atteint un tel point que la classe dirigeante elle-même ne peut plus être certaine d'obtenir les résultats souhaités par le cirque électoral. Peut-on encore douter que ce cirque politique et électoral soit absolument inutile à notre classe ?
Henk (25 décembre 2010)
1 En cela, la bourgeoisie américaine va à l'encontre de la tendance internationale qui a vu la plupart des Etats européens prendre des mesures d'austérités. Tout comme des éléments de la bourgeoisie américaine ont peur d'une relance nationale prématurée, ils craignent aussi que les mesures d'austérités européennes mettent en péril la reprise de l'économie mondiale.
2 Même si l'économie ajoute tous les emplois annoncés (ce qui est plus qu'improbable) ceci doit être replacé dans le contexte des 8 millions d'emplois qui ont été perdus depuis 2007, sans parler de la montée de la jeune génération de travailleurs couverts de dettes qui arrivent chaque année sur le marché du travail.
3 A bien des égards, cette attaque est déjà en cours au niveau national et local, les gouvernements locaux n'ayant pas la même capacité à recourir à l'endettement.
4 Le gauchiste notoire Michael Moore a fait allusion à un défi de gauche à Obama d'un troisième parti possible dans l'émission Countdown with Keith Olberman sur MSNBC.
5 Nous devons remarquer ici que le processus de décomposition a également affecté les syndicats. Témoin la participation d'Andy Stern, l'ancien président du syndicat des employés des services, à la Commission Présidentielle de la Dette d'Obama. Stern a fièrement proclamé qu'il allait mettre sa loyauté au travail au service de la nation.
Géographique:
- Etats-Unis [83]
Soulèvements en Tunisie et en Egypte : la meilleure solidarité, c’est la lutte de classe
- 1863 lectures

Nous publions ci-dessous un article réalisé par World Revolution, organe de presse du CCI en Grande-Bretagne et mis en ligne sur notre site en anglais dès le 5 février.
Le vent de colère soufflant en Tunisie et en Egypte depuis des semaines est en train de gagner l’Algérie, la Libye, le Maroc, la bande de Gaza, la Jordanie, la Syrie, l’Irak, le Bahreïn et le Yémen !
Quels que soient les drapeaux que les manifestants brandissent, toutes ces manifestations ont leurs racines dans la crise mondiale du capitalisme et dans ses conséquences directes : le chômage, la hausse des prix, l'austérité, la répression et la corruption des gouvernements qui dirigent ces attaques brutales contre les conditions de vie. Elles ont les mêmes origines que la révolte de la jeunesse grecque contre la répression policière en 2008, la lutte contre les 'réformes' des retraites en France, les rébellions des étudiants en Italie et en Grande-Bretagne, et les grèves des travailleurs du Bangladesh à la Chine, de l'Espagne au Etats-Unis.
La détermination, le courage et le sens de la solidarité affichés dans les rues de Tunis, du Caire, d'Alexandrie et de nombreuses autres villes sont une véritable source d'inspiration. Les masses qui occupent la place Tahrir au Caire ou d'autres lieux publics ont repoussé les attaques des voyous à la solde du régime et de la police, ont appelé les soldats à fraterniser avec elles, ont soigné leurs blessés, ont ouvertement rejeté les divisions sectaires entre musulmans et chrétiens, entre religieux et laïcs. Dans les quartiers, elles ont formé des comités pour protéger leurs maisons contre les pillards manipulés par la police. Des dizaines de milliers de personnes se sont effectivement mises en grève pendant des jours et même des semaines, afin de grossir les rangs des manifestants.
Face à ce spectre d'une révolte massive, avec la perspective cauchemardesque de sa propagation à travers tout le 'monde arabe', et même au-delà, la classe dirigeante a réagi dans le monde entier avec ses deux armes les plus fiables, la répression et la mystification :
-
En Tunisie, des quantités de gens ont été abattus dans les rues, et maintenant la classe dirigeante proclame 'le commencement d'une transition vers la démocratie' .
-
En Egypte, le régime de Moubarak alterne entre tabassages, insultes, gazage des manifestants et de vagues promesses.
-
A Gaza, le Hamas arrête des manifestants qui cherchent à faire preuve de solidarité avec les révoltes en Tunisie et en Egypte.
-
En Cisjordanie, l'OLP a interdit 'les réunions non autorisées' qui appellent à soutenir les soulèvements.
-
En Irak, les manifestations contre le chômage et la pénurie se font tirer dessus par le régime installé par les 'libérateurs' américains et britanniques.
-
En Algérie, après l'étouffement des premiers signes de la révolte, des concessions sont faites pour légaliser de timides revendications.
-
En Jordanie le roi limoge son gouvernement.
Au niveau international, la classe capitaliste alterne également ses discours : certains, en particulier ceux de droite, et bien sûr les dirigeants d'Israël, soutiennent ouvertement le régime de Moubarak comme le seul rempart contre une prise de pouvoir islamiste. Mais le ‘la’ est donné par Obama : après quelques hésitations, le message est que Moubarak doit s'en aller et s'en aller vite. La 'transition vers la démocratie' est présentée comme la seule voie possible pour les masses opprimées d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Les dangers qui menacent le mouvement
Ce mouvement massif, dont l'Egypte pour centre, est donc confronté à deux dangers.
Le premier est que l'esprit de révolte soit noyé dans le sang. Mais il semble que les tentatives initiales par le régime de Moubarak de se sauver par la poigne de fer ont été contrecarrées : d'abord la police a dû se retirer de la rue face aux manifestations massives, et l'envoi des voyous pro-Moubarak, la semaine dernière, n'a pas non plus réussi à entamer la volonté des manifestants à poursuivre leur mouvement. Dans ces deux rounds d'affrontement, l'armée s'est présentée comme une force 'neutre', et même comme étant du côté des manifestants anti-Moubarak et étant là pour les protéger des agressions des défenseurs du régime. Il ne fait aucun doute que beaucoup de soldats sympathisent avec les manifestants et ne seraient pas prêts à tirer sur les masses dans les rues. D'ailleurs, certains ont déjà déserté. Au sommet de la hiérarchie de l'armée, il y a certainement des factions qui veulent que Moubarak s'en aille maintenant. Mais l'armée de l'Etat capitaliste n'est pas une force neutre. Sa 'protection' de la place Tahrir est aussi une sorte de confinement, un énorme encerclement, et quand les choses se gâteront, l'armée sera effectivement utilisée contre la population exploitée, sauf si cette dernière réussit à neutraliser la troupe en la ralliant à sa cause.
Mais ici nous arrivons au deuxième grave danger qui guette : le danger qui réside dans les illusions largement répandues sur la démocratie, dans la croyance que, peut-être, l'Etat pourrait, après quelques réformes, être mis au service du peuple, dans la conviction que 'tous les Egyptiens', à l'exception de, peut-être, quelques individus corrompus, ont les mêmes intérêts fondamentaux, dans la croyance en la neutralité de l'armée, dans la croyance que la terrible pauvreté à laquelle est confrontée la majorité de la population peut être surmontée s'il y a un parlement qui fonctionne et la fin du règne arbitraire d'un Ben Ali ou d'un Moubarak.
Ces illusions, exprimées chaque jour dans les paroles des manifestants eux-mêmes et sur leurs bannières, désarment le véritable mouvement d'émancipation, qui ne peut avancer que comme un mouvement de la classe ouvrière, combattant pour ses propres intérêts, qui soit distinct de celui des autres couches sociales, et qui soit avant tout diamétralement opposé aux intérêts de la bourgeoisie, de tous ses partis et factions. Les innombrables expressions de solidarité et d'auto-organisation que nous avons vues jusqu'ici reflètent déjà l'élément véritablement prolétarien des révoltes sociales actuelles et, comme bon nombre des manifestants l'ont déjà dit, elles laissent présager une société nouvelle et plus humaine. Mais cette société nouvelle et meilleure ne peut pas être amenée par des élections parlementaires, qui placeront un El Baradei ou les Frères musulmans ou toute autre faction bourgeoise à la tête de l'Etat. Ces factions, qui peuvent être portées au pouvoir par la force des illusions des masses, n'hésiteront pas plus tard à utiliser la répression contre ces mêmes masses.
Il y a eu beaucoup de discours sur la 'révolution' en Tunisie et en Egypte, à la fois de la part des principaux médias et de l'extrême gauche. Mais la seule révolution qui a aujourd'hui un sens, c'est la révolution prolétarienne, parce que nous vivons à une époque où le capitalisme, qu'il soit démocratique ou dictatorial, ne peut tout bonnement rien offrir à l'humanité. Une telle révolution ne peut réussir qu'à l'échelle internationale, en brisant toutes les frontières nationales et en renversant tous les Etats-nations. Les combats de classe et les révoltes massives d’aujourd'hui sont certainement des étapes sur la voie d'une telle révolution, mais ils se heurtent à toutes sortes d'obstacles sur leur route. Pour atteindre l'objectif de la révolution, de profonds changements dans l'organisation politique et dans la conscience de millions de personnes n'ont pas encore eu lieu.
D'une certaine manière, la situation actuelle en Egypte est un résumé de la situation historique de l'ensemble de l'humanité. Le capitalisme est dans sa phase terminale. La classe dirigeante ne peut offrir aucune perspective pour l'avenir de la planète, mais la classe exploitée n'est pas encore conscience de son propre pouvoir, de sa propre perspective, de son propre programme pour la transformation de la société. Le danger ultime est que cette impasse temporaire prenne fin dans « la ruine commune des classes en lutte », comme le dit le Manifeste Communiste, dans un plongeon dans le chaos et la destruction. Mais la classe ouvrière, le prolétariat, ne découvrira sa véritable puissance qu'en s'engageant dans de véritables luttes, et c'est pourquoi ce qui se déroule actuellement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient est, malgré toutes ses faiblesses et illusions, un véritable phare pour les travailleurs du monde entier.
Et surtout c'est un appel aux prolétaires des pays les plus développés, qui commencent aussi à reprendre la route de la résistance aux attaques, pour qu'ils accomplissent la prochaine étape, en exprimant concrètement leur solidarité avec les masses du 'tiers-monde', en intensifiant leur propre combat contre l'austérité et l'appauvrissement, et, ce faisant, en mettant à nu tous les mensonges sur la liberté et la démocratie capitaliste, dont ils ont une longue et amère expérience.
World Revolution (5 février)
Rubrique:
ICConline - mars 2011
- 1559 lectures
Anton Pannekoek, sa signification indéniable pour la lutte historique du prolétariat
- 1940 lectures
I. L'intérêt dans le milieu politique pour les théories marxistes
Depuis un certain nombre d'années il existe un intérêt renouvelé pour les approches classiques, développées par l'humanité en général et par la classe ouvrière en particulier au cours de son histoire. Plus que jamais, plus profondément que jamais, on est à la recherche d'idées, de prises de position, d’approches et de méthodes qui peuvent constituer une réelle contribution dans le développement d'une alternative fondamentale au mode de production capitaliste, qui mène l’humanité dans une impasse, dans une spirale de crises et de guerres. Le capitalisme se trouve dans un état de crise permanente, le salariat mène l'humanité à l'abîme.
D'où le besoin de lire, de redécouvrir les théoriciens les plus importantes du mouvement ouvrier et des diverses organisations ouvrières, que ces dernières ont générés au cours de leur histoire. Les personnes et les organisations seraient trop nombreuses à mentionner, mais elles comprennent tout le panel de théoriciens du communisme de Marx à Bordiga et les organisations internationalistes de la IIIème Internationale au CCI.
A la fin des années 1960, il existait une atmosphère politique comparable à aujourd’hui, avec la différence qu'à l'époque, il existait encore beaucoup plus d'illusions sur les perspectives que le capitalisme pouvait encore offrir à l'humanité. Car au cours de sa reprise historique, «le caractère massif des combats ouvriers, notamment avec l’immense grève de mai 1968 en France et l’automne chaud italien de 1969, avait mis en évidence que la classe ouvrière peut constituer une force de premier plan dans la vie de la société et que l’idée qu’elle pourrait un jour renverser le capitalisme n’appartenait pas au domaine des rêves irréalisables. Cependant, dans la mesure où la crise du capitalisme n’en était qu’à ses tous débuts, la conscience de la nécessité impérieuse de renverser ce système ne disposait pas encore des bases matérielles pour pouvoir s’étendre parmi les ouvriers » (1) (Résolution sur la situation internationale du 18ème Congrès du CCI).
Bien qu'existaient de nombreux débats enthousiastes sur la destruction des rapports de production capitalistes, cela signifiait surtout qu'on voulait mettre fin à l'exploitation, à l'aliénation, à l'oppression, aux structures autoritaires et au racisme. Mais la question du travail salarié était à peine remise en cause. Ce qu'on recherchait n'était en fait pas beaucoup plus qu'un capitalisme à visage plus humain. On a beaucoup parlé de changements radicaux et structurels, mais quand on en arrivait là, cela se limitait souvent à une « marche vers les institutions ». Souvent, on cherchait la réponse aux questions qui se posaient auprès de théoriciens bourgeois comme Marcuse, Foucault, Habermas, Fanon, etc.
Cependant, une autre tendance se développait simultanément: en réponse à ce système parlementaire et syndicaliste pourri, et à la dictature stalinienne, un « communisme » sclérosé (2), qui s'était développée face à elle, est apparu une attirance pour des formes de démocratie où la classe ouvrière donnait le ton. De là, le regain d'intérêt à la fin des années 1960 pour les courants qui faisaient de la propagande pour l'autogestion, la démocratie des Conseils, ou pour l’une ou l’autre forme de syndicalisme de base. Ainsi, on redécouvre non seulement des anarchistes comme Kropotkine et Rocker, mais aussi des communistes de Conseils comme Pannekoek, Rühle, Mattick et Korsch.
Quand on évoque l'intérêt renouvelé pour les communistes classiques comme Marx, Engels, Lénine et Trotski, mais aussi pour les positions communistes de Conseils, il faut savoir exactement de quoi on parle. Car tous les communistes de Conseils n'ont pas les mêmes fondements, ni n'utilisent la même méthode. Ainsi, Anton Pannekoek, décédé il y a maintenant cinquante ans, surpasse de loin tous ses épigones qui ont parlé et parlent encore en son nom. Ce « classique » parmi les marxistes a sans nul doute acquis une importance comparable à celle de Rosa Luxembourg ou d’Amadeo Bordiga. Et le fait que, plus tard dans sa vie, dans la période la plus noire de la contre-révolution, il en soit arrivé à se contredire et à s’embrouiller dans ses contradictions n'y change rien. Anton Pannekoek était et est resté, même à un âge avancé après la seconde guerre mondiale, un vrai théoricien du socialisme d'abord, et du communisme ensuite, quelqu'un qui au cours de sa vie a fourni une contribution essentielle au développement de la méthode marxiste.
II. Le combat de Pannekoek contre l'opportunisme dans la deuxième et la troisième Internationale
Au début du 20ème siècle, il s’impose déjà comme défenseur des intérêts de la lutte ouvrière en menant le combat contre les tendances révisionnistes à l'intérieur du mouvement ouvrier néerlandais représentées par Troelstra. Avec Gorter, il dénonce radicalement toute collaboration avec des fractions libérales progressistes de la bourgeoisie au parlement. « Ni une attitude conciliante, ni la concertation, ni le rapprochement avec les partis bourgeois et l'abandon de nos revendications fondamentales ne sont les meilleurs moyens d'obtenir quelque chose, mais le renforcement de nos organisations, en nombre, en connaissance et en conscience de classe, de façon à ce qu'elles apparaissent à la bourgeoisie comme des forces toujours plus menaçantes et terrifiantes » (Anton Pannekoek et Herman Gorter, Marxisme et Révisionnisme, NieuwTijd, 1909).
Lorsqu'il se rendit en Allemagne en 1906, pour donner des cours à l'école du SPD, il entra rapidement en conflit avec la direction du SPD, en particulier avec Kautsky, sur l'importance d'une action de masse autonome des ouvriers. Avec Rosa Luxembourg, il défendit l’option de la grève de masse, contre la stratégie défendue par Kautsky, de ne pas tirer toutes ses cartouches en même temps et de mettre lentement la pression sur la bourgeoisie en menant des grèves locales démonstratives. « Quand nous parlons d'actions de masse, de leur nécessité, nous voulons désigner par là une activité politique extra-parlementaire de la classe ouvrière organisée, activité par laquelle elle agit directement sur la politique, au lieu de le faire par le truchement de ses représentants. Ces actions de masse ne sont pas synonymes d'action de « rue ». Même si les manifestations de rue en sont une expression, son expression la plus puissante, la grève de masse, peut aussi s’imposer quand les rues dont désertes. Les luttes syndicales qui mettent en branle d'emblée les masses mènent d'elles-mêmes à une action de masse politique. Envisagée sous un angle pratique, l’action de masse n’est rien d'autre qu'une extension du champ d'activité des organisations prolétariennes. » (Anton Pannekoek, Action de masse et révolution: Neue Zeit, XXX, 2e vol, 1912).
En 1911, il était le premier parmi les socialistes à réaffirmer, à la suite de Marx après la défaite de la Commune de Paris, que la lutte contre la domination capitaliste ne laissait aux ouvriers pas d'autre choix que la destruction de l'état bourgeois. “La lutte du prolétariat écrivait-il, n'est pas simplement une lutte contre la bourgeoisie pour le pouvoir d'Etat en tant que tel; c'est une lutte contre le pouvoir d'Etat... La révolution prolétarienne consiste à anéantir les instruments de la force de l'Etat et à les dissoudre (Auflösung) par les instruments de la force du prolétariat. (...) La lutte ne cesse qu'au moment où le résultat final est atteint, au moment où l'organisation de l'Etat est complètement détruite. L'organisation de la majorité a alors démontré sa prédominance en anéantissant l'organisation de la minorité dominante." ( Cité dans Lénine: l'Etat et la révolution, 1917).
A l'éclatement de la guerre mondiale en 1914, il prit fermement position contre la trahison des leaders sociaux-démocrates dans la seconde Internationale: “Avec la croissance énorme du parti et des organisations syndicales, s'est développée l'armée des employés, des politiciens, des dirigeants et des fonctionnaires, qui en tant que spécialistes des formes de lutte traditionnelles se sont tellement identifiés à elles (…) qu’ils constituent un obstacle sur le chemin d’un développement ultérieur de la tactique. (…) Au lieu de la conquête du pouvoir de l'Etat, qui semble si lointaine et difficile, s’impose la pensée petite-bourgeoise que le capitalisme peut être rendu supportable par de petites réformes. Ainsi est né le réformisme, qui a supplanté la lutte de classe et a dominé les partis socialistes dans presque tous les pays d'Europe occidentale. (…) Et l'Internationale aussi a participé de cette dégénérescence. (…) Et lorsque vint le moment où les gouvernements voulaient la guerre, ni la force ni le courage n’étaient présents pour la lutte contre la guerre; l'internationalisme s'est envolé en fumée, et l'Internationale s'est effondrée comme une épave vermoulue. (…) La deuxième Internationale est morte; sans gloire, elle a péri dans l'incendie mondial. Mais cette mort n'est pas le fruit du hasard. Elle a simplement montré que l'Internationale ne pouvait survivre à elle-même. L'effondrement de l'Internationale est en même temps l'effondrement de la tactique, de la méthode, de la théorie qui l'avaient guidée: le parlementarisme.” (Anton Pannekoek, De ineenstorting van de Internationale, De Nieuwe Tijd, 1914).
Pendant la guerre, il devient sympathisant du ISD de Brême et du SPD aux Pays-Bas, et écrit des articles contre la politique de guerre. Dans une lettre à Van Ravensteyn datée du 22 octobre 1915, il explique ce qui l'a poussé à se lier à l'initiative de la Gauche de Zimmerwald. Car, malgré le caractère hétérogène de l'initiative, il se déclarait prêt “sur la demande de Lénine et Radek, à occuper avec Madame Roland Holst la fonction de rédacteur” de la publication de la Gauche zimmerwaldienne. Je serais “plus volontiers resté entre nous, avec des tenants de la même opinion”. Mais c'est maintenant “en discutant et en traitant les problèmes nouveaux, le moyen unique de répandre nos positions sur la tactique, l'impérialisme, l'action de masse, etc. parmi ceux qui seront amenés à prendre la direction des mouvements à venir” (B.A. Sijes, Anton Pannekoek, 1873-1960. Dans Anton Pannekoek, Herineringen, 1976, p. 41).
Par la suite, il a exprimé sa solidarité inconditionnelle avec les ouvriers russes lorsque ceux-ci, organisés en Soviets, ont pris le pouvoir en octobre 1917, et il a propagé la nécessité d'une révolution mondiale. “Ce que nous espérions est entretemps arrivé. Les 7 et 8 novembre, les ouvriers et les soldats de Petrograd ont renversé le gouvernement Kerenski. Et il est probable (…) que cette révolution va s'étendre à toute la Russie. Une nouvelle période commence, non seulement pour la révolution russe, mais pour la révolution prolétarienne en Europe. Pour la première fois depuis la Commune de Paris, le prolétariat, allié aux classes petites-bourgeoises, est maître du pouvoir d'Etat, non seulement dans une ville, mais dans un grand Etat. Pour la première fois, de véritables socialistes, formés de manière moderne, sont appelés à jouer un rôle de dirigeants dans l'organisation et la construction de la société. (…) En effet, une nouvelle ère commence” (Anton Pannekoek, La Révolution russe III, de Nieuwe Tijd, 1917 p. 560; La Révolution russe VIII, De Nieuwe Tijd, 1918 p. 125).
Mais son enthousiasme n'a pas duré très longtemps. La troisième Internationale était à peine constituée que les ouvriers révolutionnaires d'Allemagne étaient confrontés à une politique initiée par le KPD, qui devenait de plus en plus opportuniste. Alors que la majorité lançait le mot d'ordre “Sortez les syndicats!”, la direction du KPD commençait à mettre sur pied des syndicats “alternatifs” sous la forme d'organisations d'entreprises. Un peu plus tard, des négociations étaient entamées avec l'USPD centriste et enfin, il était décidé de reprendre le travail parlementaire. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec cela furent exclus du parti à la fin de 1919, et c'était la majorité du parti. Tout cela se déroula durant l'année 1919 et, dans la lutte contre cet opportunisme aussi, Pannekoek se positionna à l'avant-plan et défendit avec verve le caractère prolétarien du mouvement global contre son sabotage par la direction du KPD.
Lorsque la majorité exclue du KPD fonda en avril 1920 un nouveau parti, le KAPD, Pannekoek fut le grand inspirateur du programme de cette organisation politique. Dans ce programme étaient rassemblées les positions les plus importantes de la nouvelle période. Même si cela ne représente pas un texte individuel, mais le produit collectif de toute la gauche germano-hollandaise, il est important, étant donné le haut niveau de conscience de classe qu’il exprime, d’en citer quelques extraits: “Le capitalisme a fait l'expérience de son fiasco définitif, il s'est lui même historiquement réduit à néant dans la guerre de brigandage impérialiste, il a créé un chaos, dont la prolongation insupportable place le prolétariat devant l'alternative historique: rechute dans la barbarie ou construction d'un monde socialiste. (…) Conformément à ses objectifs maximalistes le KAPD conclut également au rejet de toutes les méthodes de lutte réformistes et opportunistes. ( …) A côté du parlementarisme bourgeois les syndicats forment le principal rempart contre le développement ultérieur de la révolution prolétarienne en Allemagne. (…)Plus l'idée de la lutte de classe internationale sera clairement conçue par le prolétariat, plus on mettra de conséquence à en faire le leitmotiv de la politique prolétarienne mondiale, et plus impétueux et massifs seront les coups de la révolution mondiale qui briseront en morceaux le capital mondial en décomposition. » (Programme du KAPD, avril 1921, Revue Internationale 97, 1999).
Bref, ses plus grandes contributions sur le plan politique dans la période précitée, la plus importante de sa vie politique, peuvent être résumées dans les points suivants:
sa première contribution importante fut sa lutte contre l'opportunisme dans la deuxième Internationale. Il a plus ou moins prévu la trahison des organisations social-démocrates et anarchistes, qui dissociaient but et mouvement contre toute tradition marxiste;
sa deuxième contribution importante a été la défense de l'internationalisme prolétarien contre l'hystérie nationaliste de la première guerre mondiale; sa collaboration à Zimmerwald, le développement d'une Gauche (travail d'opposition) en réponse à la dégénérescence de la deuxième Internationale; la lutte pour le pouvoir des Conseils ouvriers et sa collaboration à la fondation de la troisième Internationale;
mais sa contribution sans doute la plus importante au marxisme, Pannekoek l'a laissée au travers de sa collaboration au développement des conséquences du cadre de la décadence du capitalisme pour les conditions de la lutte du prolétariat. Parce que les conditions historiques avaient changé suite à l'ouverture de la période de décadence, le parlement et les syndicats ne constituaient plus des moyens de lutte du prolétariat pour son émancipation. (Voir aussi: Buchbesprechung zu Cajo Brendels Anton Pannekoek – Denker der Revolution, Weltrevolution 12 & 130, année 2005).
III Comment a-t-il pu arriver à ces contributions et quelles faiblesses contiennent-elles malgré tout?
l a été capable de fournir ces contributions en premier lieu, parce qu'il faisait partie du mouvement ouvrier organisé et qu'au sein de celui-ci, il menait la lutte d'une façon collective; en second lieu, parce qu'il se rattachait fermement à la méthode marxiste, en appliquant celle-ci à chaque nouvelle situation, dans les polémiques et les discussions avec ses camarades de lutte.
C'est pour cela qu'il a été capable de prévoir et de critiquer sans concession la trahison de la social-démocratie à la veille de la première guerre mondiale. Qu’il a réussi aussi à apprécier à sa juste valeur la signification de la Révolution russe et de la vague révolutionnaire de 1917-23. Enfin, Pannekoek était (exactement comme Rosa Luxembourg jusqu'à son assassinat en 1919) au début des années 1920, un défenseur, critique il est vrai, mais acharné de la Révolution d'octobre.
Son grand engagement et le sérieux de sa méthode ne l'ont cependant pas empêché, contrairement à ce qui s’est passé avec la deuxième Internationale, de tirer finalement des leçons erronées de l’échec de la Révolution d'octobre 1917 en Russie. En ce qui concerne celle-ci, il arriva finalement à la conclusion que les Bolcheviks avaient en fait dirigé une révolution bourgeoise. Pourquoi? Non seulement parce que dans la Russie de 1917 subsistaient encore des restes de féodalisme, des formes dispersées de production petite-bourgeoise, mais aussi parce que selon lui, Lénine n'avait pas bien compris la distinction entre matérialisme prolétarien et matérialisme bourgeois. (cf. John Harper (Anton Pannekoek), Lénine philosophe, 1938).
Mais c'est Lénine, dans ses fameuses Thèses d'avril de 1917, qui a démontré que la révolution prolétarienne se trouve seulement à l'ordre du jour de l'histoire quand les contradictions mondiales ont atteint un certain degré de maturité. Le fait que Pannekoek ait oublié ces leçons plus tard ne doit pas seulement être compris comme l'expression de sa déception et de son désarroi après la défaite de la révolution mondiale. Mais cela doit aussi et surtout être vu comme la conséquence de son énorme déception suite au dépérissement du bastion russe isolé, dans lequel il avait placé tous ses espoirs après l'effondrement de la lutte ouvrière en Europe occidentale. Dans la suite des années 1920, il avait placé toutes ses attentes dans la mise en place d'une économie communiste à l'Est, parce qu'il partait de l'illusion que cela permettrait de saper la domination de la classe bourgeoise à l'Ouest.
Malgré sa mésestimation de la Révolution d'octobre en Russie et même s’il était de plus en plus isolé du fait de la période de contre-révolution, il est resté fidèle à la tâche historique de la classe ouvrière et a continué à défendre:
la nécessité d'une lutte autonome massive de la classe ouvrière, qui s'organise en comités de grève, conseils d'entreprises et d'autres formes qui puissent exprimer son unité dans la lutte contre la bourgeoisie;
la signification d'une organisation politique qui « diffuse, étudie, discute la connaissance et la compréhension, formule des idées et essaie de clarifier la conscience des masses au travers de sa propagande » (Anton Pannekoek, Cinq thèses sur la lutte de la classe ouvrière contre le capitalisme, Southern Advocate for Workers Councils, Melbourne, n° 33, mai 1947).
IV La méthode matérialiste dialectique de Pannekoek
Pannekoek a démontré et confirmé sa maîtrise et sa contribution à la méthode marxiste au travers des différents ouvrages qu'il a écrits au cours de sa vie. Sa première contribution était « Marxisme et Ethique » en 1906 et sa dernière « L'Anthropogenèse » en 1945. Pendant toute cette période, il a approfondi une série de sujets différents sur base d'une approche méthodologique solide. Une méthode qu'en tant que communistes, nous devons conserver et défendre bec et ongles contre ce qu'en ont fait et tentent encore d’en faire ses épigones. Pour donner une idée de la profondeur, aussi bien que de la simplicité de la méthode de Pannekoek, citons le passage ci-dessous. Il y explique, non seulement comment l'être détermine la conscience, mais aussi comment la conscience à son tour influence l'être:
« On a souvent affirmé que la réalité dans la société humaine est quand même principalement de nature spirituelle, car l’homme est tout d’abord un être pensant et capable de volonté; partout (…) les relations humaines existent seulement parce que les hommes en ont plus ou moins conscience, par leur conscience, leurs sentiments, leur savoir et leur volonté. (…) La conception bourgeoise part du contenu spirituel de la conscience comme quelque sorte de donné, dont on n’a pas besoin de retracer l’origine plus en détail, et qui a sa source dans la « nature » de l’esprit ou dans l’existence d’un être spirituel abstrait en dehors de l’homme. Cette conception ignore le matérialisme historique ». (Anton Panekoek, Le matérialisme historique, De Nieuwe Tijd 1919, pp. 15 et 52; Anton Pannekoek, Parti, Conseils et Révolution, 1970, rassemblé et annoté par Jaap Kloosterman).
Alors que beaucoup de ses contemporains communistes de conseils se sont débattus avec cette question sans être capables d'en sortir, Pannekoek savait que le marxisme avait résolu depuis longtemps cette contradiction entre être et conscience, entre monde extérieur et monde intérieur, entre penser et sentir ici ou agir là.
«Donc, si Marx nous dit que l’existence sociale détermine la conscience, cela ne signifie pas que les idées actuelles sont déterminées par la société actuelle. La réalité sociale actuelle est un élément, le monde des idées constitué de la réalité précédente est un autre élément ; à partir de ces deux éléments surgit la nouvelle conscience comme l'expression des forces spirituelles qui s'influencent mutuellement (…). La conception marxiste part de la conviction que le contenu de la conscience doit s’être formé à partir d’un impact du monde réel, et il en cherche l’origine dans les conditions de vie antérieures des hommes. Et il n’en est pas seulement ainsi pour la conscience ; pour les autres propriétés de l’esprit aussi, dans les inclinaisons et les pulsions, dans les instincts et les coutumes, qui se cachent dans les profondeurs de l’inconscient et qui apparaissent comme une mystérieuse nature humaine innée, se manifestent les impressions héritées depuis des milliers d’années, depuis les temps les plus reculés» (14) Anton Pannekoek, Le matérialisme historique, De NieuwTijd 1919 pp. 15 et 52; Anton Pannekoek, Parti, Conseils et Révolution, 1970, rassemblé et annoté par Jaap Kloosterman.
Pannekoek ne pouvait développer le point de vue cité ci-dessus qu’en complétant et approfondissant le matérialisme historique développé par Marx et Engels, par les prises de position de Dietzgen (un social-démocrate de la première génération). Ce dernier avait essentiellement démontré comment le comportement des hommes s'explique par l'intervention et le fonctionnement de l'esprit humain: « Le matérialisme historique avait établi que la conscience est déterminée par l'être; il est vrai que pour les idées, il n'existe pas d'autres source que le monde extérieur pour le contenu réel (matériel) de l'esprit. Mais à ce stade, on n'avait pas encore répondu à la question du comment » (…) « L'esprit (c'est-à-dire la conscience) n'a pas d'autre matériel que les empreintes du monde; il les enregistre et les transforme en quelque chose d'autre, en quelque chose de spirituel, même en pensées et en concepts. Comment procède-t-il et en quoi consiste son activité, son mode de fonctionnement? Marx ne s'est pas vraiment occupé de la question de l’essence de l'être humain. Pour la connaissance de la société, la démonstration d’où l'esprit tirait son contenu, qu'il ne pouvait le puiser que dans le monde réel, était suffisante. Dès lors, la question de savoir quel est le contenu de l'esprit et quel est son rapport avec le matériel restait ouverte. Dietzgen a résolu ce problème. » (Anton Pannekoek: L'Oeuvre de Dietzgen, Neue Zeit, avril 1913).
Pour tout révolutionnaire actuel, l'œuvre de Pannekoek reste une référence essentielle, ne serait-ce que parce qu'il a, avec d'autres communistes de gauche, jeté un pont entre la fin de la deuxième Internationale social-démocrate et les débuts de la troisième Internationale communiste, dans une période qui s'étend de 1914 à 1919. Pour accomplir cela, comme nous l'avons expliqué ci-dessus, il a activement pris part à la diffusion de différentes voix éparses contre la guerre, comme celle des ISD (Internationale Socialisten Duitsland à Brème), du SPD aux Pays-Bas et en particulier des idées de ce qu'on a appelé la Gauche zimmerwaldienne.
Mais lorsqu'il a vu que la vague révolutionnaire venue de Russie, à cause de son isolement, se dirigeait vers une voie de garage et commençait à dégénérer de l'intérieur et de l'extérieur, il a décroché. Même s'il a déploré la liquidation du Nieuwe Tijd par le CPH (Parti communiste de Hollande), celle-ci a constitué pour lui une occasion de lever le pied. A partir du début des années 1920, encore plus que dans la période précédente, il va mettre l’accent sur le travail théorique, et il n'a jamais plus été membre actif d'un groupe révolutionnaire. « J'aspirais à tranquillement me réorienter et à rendre des comptes. Il s'agissait de nouveau, comme avant dans le socialisme et maintenant dans le communisme, de faire d’un parti aux principes purs une force et une puissance dans le mouvement ouvrier. A nouveau, c'est le réformisme opportuniste qui a pris le dessus sous l'apparence d'un puissant parti de masse, mais aujourd'hui de façon bien plus nocive que par le passé, plus superficielle, plus en décalage par rapport aux principes, plus démagogique, se parant du nom du marxisme tout en foulant aux pieds ce même marxisme... » (Anton Pannekoek, Mémoires, 1976, p. 208).
Cela ne signifie pas qu'il se tenait complètement à l'écart des organisations politiques du prolétariat, car, jusqu'à la deuxième guerre mondiale, il a maintenu un contact étroit avec le groupe communiste de Conseils GIC (Groupe des Communistes Internationaux) aux Pays-Bas. En plus de sujets d’actualité qui concernaient la lutte de la classe ouvrière à ce moment-là, il a consacré toute la période jusqu'à la deuxième guerre mondiale à trouver une explication à la trahison de la social-démocratie et aux raisons de la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23.
Pendant la deuxième guerre mondiale, le contact avec d’autres communistes révolutionnaires étaient pratiquement impossibles. Dès lors, il s’est uniquement consacré pendant ces cinq années à la réflexion théorique et à la réalisation d’un de ses ouvrages les plus connus : ‘Les conseils ouvriers’. Dès que le contact pouvait être rétabli avec les groupes révolutionnaires existants, comme par exemple avec le Ligue Communiste Spartacus en Hollande, il a repris la discussion de ses positions et de celles des autres.
V Son attachement inconditionnel à la lutte du prolétariat
Dans les différents écrits - courts pour la plupart - qu'il a produits après la guerre, il démontre à nouveau clairement où il se situe dans la lutte pour la défense des intérêts de classe du prolétariat, et dans ce cadre, par rapport à la tâche des minorités politiques conscientes, qui sont secrétées par la lutte historique de la classe. Non pas que les positions qu'il y défend sont toujours les plus développées, les plus avancées du moment ou même toujours orientées dans la bonne direction. Non pas qu'il lui arrivait d’hésiter par rapport au bon déroulement de la lutte pour une société où « on donne selon les besoins et on reçoit selon les capacités ». Mais il y montre que le combat pour le communisme lui tenait toujours à cœur. Il y révèle qu'il avait toujours confiance dans la capacité de la classe ouvrière à donner au cours de l'histoire un sens positif et à donner par sa lutte une perspective à l'ensemble de l'humanité.
A propos de la signification des grèves « sauvages », de l'importance de la solidarité prolétarienne et de la conscience qui s'y développent, il a écrit avec beaucoup d'engagement et de clarté. En partie, c'est à cause d'une vision erronée de sa part à propos de la perspective historique, qui à ce moment-là n'était certainement pas mûre pour une reprise généralisée de la lutte ouvrière. En partie, c'était toutefois aussi le résultat de la maturité et de la solidité de la méthode avec laquelle il analysait les événements quotidiens. « En Europe, en Angleterre, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, et aux Etats-Unis aussi, des grèves sauvages éclatent, menées jusqu’ici par des petits groupes n’ayant ni clairement conscience de leur rôle social, ni des buts plus radicaux, mais faisant preuve d’une admirable solidarité. Elles affrontent le gouvernement de ‘Labour’ en Grande-Bretagne et sont hostiles envers le Parti Communiste au gouvernement en France et en Belgique. Les travailleurs commencent à sentir que le pouvoir d’Etat est maintenant leur plus important ennemi. Leurs grèves sont dirigées autant contre ce pouvoir que contre les patrons capitalistes. Les grèves deviennent un facteur politique ; et lorsque les grèves éclatent avec une intensité telle qu’elles paralysent des branches entières et ébranlent la production sociale en ses fondements, elles deviennent un facteur politique de première importance. Les grévistes n’ont peut-être pas l’intention d’être révolutionnaires, mais ils le sont – ni les grévistes ni même la plupart des socialistes ne s’en rendent compte. Et par nécessité, la conscience et la lucidité se formeront progressivement à partir de ce qui n’a été qu’intuitif, et rendront les actions plus directes et plus efficaces. » (Anton Pannekoek, Strikes, dans Western Socialist, janvier 1948).
A la fin de sa vie, Pannekoek résumait de plus en plus la tâche des minorités politiques conscientes de la classe comme une tâche d'éducation et d'information bien plus que comme une tâche propagandiste et de direction politique. Cependant c'est cette même conviction profonde de Pannekoek sur l'importance cruciale de la théorie, de la critique et de l'engagement révolutionnaires, qui l'amène encore une fois à expliquer ce qu'est la contribution des minorités à la lutte de la classe pour l'unité et pour le développement de sa compréhension dans les changements importants que sa lutte apportera à la société. « …notre tâche est principalement une tâche théorique : trouver et indiquer, par l’étude et la discussion, le meilleur chemin de l’action pour la classe ouvrière. L’éducation qui en découle ne doit pas avoir lieu à l’intention seulement des membres du groupe ou du parti, mais doit viser les masses de la classe ouvrière. Elles devront décider dans leurs meetings d’usine et leurs conseils quel est le meilleur chemin à suivre, Mais pour être capables de prendre la décision adéquate, elles doivent être éclairées par des avis bien considérés, venant du plus grand nombre de personnes possible. En conséquence, un groupe qui proclame que l’action autonome de la classe ouvrière est la forme la plus importante de la révolution socialiste se donnera pour tâche primordiale d’aller parler aux ouvriers ; par exemple par le moyen de tracts populaires qui éclairciront les idées des ouvriers en expliquant les changements importants dans la société, et la nécessité d’une direction des ouvriers par eux-mêmes dans toutes leurs actions comme aussi dans le travail productif futur. » (Lettre de Pannekoek à Castoriadis (Socialisme ou Barbarie), 8 novembre 1953).
Finalement, il entretient aussi une correspondance régulière et passionnée avec des gens comme Alfred Weiland, Paul Mattick et plusieurs autres. Surtout dans sa correspondance avec « Socialisme ou Barbarie », il exprime une nouvelle fois de manière très concise ce qu'il considère comme le caractère fondamental de la révolution prolétarienne. Dans ce sens, cette correspondance peut quasiment être considérée comme son testament: “….la libération des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. De plus, la révolution prolétarienne ne peut être comparée à une simple rébellion ou à une campagne militaire, dirigée par un commandement central, et même pas à une période de luttes comme par exemple la grande révolution française, qui ne fut elle-même qu’un épisode dans l’ascension au pouvoir de la bourgeoisie. La révolution prolétarienne est beaucoup plus vaste et profonde ; elle est l’accession de la masse des gens à la conscience de son existence et de sa nature. Ce ne sera pas une convulsion simple; Elle se manifestera à travers le contenu d’une période entière de l’histoire de l’humanité, dans laquelle la classe ouvrière devra découvrir et réaliser ses propres talents et son potentiel, tout comme d’ailleurs ses propres buts et méthodes de lutte. » (Idem)
Pannekoek, né le 2 janvier 1873, mourut... en communiste sincère le 28 avril 1960.
Dixoff
Résolution sur la situation internationale du 18eme Congrès international du CCI
L'anti-stalinisme a aussi joué un très grand rôle à la fin des années 1960, suite au rôle de saboteurs de la lutte ouvrière qu'ont joué les organisations politiques et les syndicats staliniens dans les mouvements de grève les plus importants de cette époque, mais aussi suite à l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes russes en 1968, pour écraser dans le sang la résistance à la dictature.
Anton Pannekoek et Herman Gorter, Marxisme et révisionnisme, NieuwTijd 1909
Anton Pannekoek, Action de masse et Révolution, NeuzZeit, XXX, deuxième volume, 1912.
Cité dans L'Etat et la révolution de Lénine, 1917
Anton Pannekoek, L'effondrement de l'Internationale, De Nieuwe Tijd, p. 677, 1914.
B.A. Sijes, Anton Pannekoek, 1873-1960. Dans Anton Pannekoek, Mémoires, p. 41, 1976
Anton Pannekoek, La Révolution russe III, De Nieuwe Tijd 1917, p. 560; La Révolution russe VIII, De Nieuwe Tijd p. 125, 1918.
Programme du KAPD, avril 1921 dans Revue Internationale 97, 1999.
Voir aussi: Buchbesprechung zu Cajo Brendels Anton Pannekoek – Denker der Revolution, Weltrevolution 12 et 130; 2005.
John Harper (Anton Pannekoek), Lénine philosophe, 1938
Anton Pannekoek, Cinq thèses sur la lutte de la classe ouvrière contre le capitalisme, Southern Advocate for Workers Councils, Melbourne, n° 33, mai 1947
Anton Pannekoek, Le matérialisme historique, De Nieuwe Tijd 1919, pp. 15 et 52; Anton Pannekoek, Parti, conseils et révolution, 1970, rassemblé et annoté par Jaap Kloosterman
Idem
Anton Pannekoek: L'oeuvre de Dietzgen, Neue Zeit, avril 1913; Brochure de Radenkommunisme, Beverwijk, 1980 p. 43
Anton Pannekoek, Mémoires, 1976, p. 208
Anton Pannekoek, Strikes, dans Western Socialist, janvier 1948
Lettre de Pannekoek à Castoriadis (Socialisme ou Barbarie), 8 novembre 1953
Idem
Personnages:
- Pannekoek [121]
Espagne : de la "grève générale" au "Pacte social" (tract)
- 1900 lectures
Nous publions ci-dessous un tract réalisé par Accion Proletaria, organe de presse du CCI en Espagne, et distribué dans ce pays tout au long du mois de février1.
Mais qu’arrive-t-il ? Tout d’un coup, les syndicats ont replié le drapeau de la « lutte », se sont mis en costard-cravate et sont allés signer le « Pacte social ». Leur drapeau de « lutte » était une pantomime comme l’a démontré la journée du 29 septembre 2010, alors que maintenant ils participent à quatre mains à l’imposition d’un nouveau coup : la reforme des retraites…et bien d’autres qui vont pleuvoir.
Les syndicats, autant lorsqu’ils appellent à une mobilisation que quand ils vont signer ce que le gouvernement et le patronat leur demandent, sont toujours contre la classe ouvrière. L’un ne va pas sans l’autre.
Nous allons voir les raisons de ce « changement » de politique et aussi ce que nous, les travailleurs, pouvons faire.
Pourquoi est-on passé de la « grève générale » au « Pacte social » ?
Nous sommes en train de vivre une situation où, avec l’aggravation considérable de la crise et des attaques contre les conditions de vie de la grande masse des travailleurs, surgissent ici et là des mouvements significatifs de la lutte de classe. En même temps qu’il y a eu des luttes d’une certaine envergure en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Grèce etc., on est en train de vivre l’entrée en lutte des jeunes générations en Tunisie, en Algérie et en Egypte...
Les confusions, l’inexpérience, le retard politique, font que ces luttes souffrent de faiblesses importantes, dont la bourgeoisie tire profit pour les présenter comme des « mouvements démocratiques » pour ainsi rejeter dans l’ombre le fait que ces mouvements font partie d’un courant international de lutte contre la crise capitaliste, d'un mûrissement des luttes massives dans les rangs prolétariens. On veut ainsi les isoler et faire croire que, dans ces pays prétendus « arriérés », on lutterait pour ce « bien-être démocratique » dont on peut « jouir » dans les pays « avancés ».
C’est dans ce contexte que l’on doit ajouter, pour bien comprendre toute la portée de ce qui se passe, la menace de banqueroute qui guette l’Etat espagnol et ce n’est pas parce que les médias en parlent un peu moins dernièrement que ladite menace se serait évanouie, loin de là2; c'est ce qui a amené le gouvernement, le patronat et les syndicats à signer un Pacte Social officialisant la violente attaque d’une dureté inouïe que représente la réforme des retraites, en y incluant aussi des mesures concernant les conventions collectives et les dénommées « politiques actives d’emploi », lesquelles contiennent essentiellement une attaque contre les chômeurs.
Pour accompagner ce qui précède, il y a eu le coup assené par la région de Murcie à ses fonctionnaires territoriaux, qui n’a été que le signal de démarrage d’un plan d’envergure dans les différentes régions contre les employés du secteur publis : réductions salariales, licenciements des contractuels en CDD, augmentations des horaires, intensification des contrôles, etc. La Catalogne et son plan de 10% de réduction budgétaire annoncé par A. Mas, le Président régional de la Catalogne, parait avoir pris la relève de la région de Murcie. Et la convention municipale du PSOE adopte aussi un plafond de dépenses dans les régions gouvernées par ce parti. Ces mesures sont élargies à toutes les administrations municipales.
Le pari politiquede la bourgeoisie espagnole
Comment analyser ce Pacte Social ? Nous pensons qu’il est la concrétisation d’un pari politique fait par la bourgeoisie espagnole sur la manière avec laquelle doit être menée l’attaque brutale contre les travailleurs. Les raisons de ce pari ? : Le malaise, l’indignation, la réflexion persistants qui animent une combativité qui mûrit lentement au sein de la classe ouvrière en Espagne, une combativité qui, malgré tout, n’est pas arrivée au point où notre classe peut apparaître comme une force sociale active. La politique suivie par les syndicats entre février et septembre 2010 était devenue contreproductive. Pendant cette période, ils ont appelé à des protestations mollassonnes, avec cette tactique de mobiliser tout en démobilisant comme on a pu le voir lors de la « grève générale » du 29 septembre3. Cette politique a semé la passivité et l’attentisme dans les rangs ouvriers, mais elle a aussi fini par discréditer les syndicats qui n’apparaissent que comme une instance se limitant à faire acte d’une présence un peu braillarde avec des simulacres de lutte.
C’est pourquoi les syndicats, et la bourgeoisie espagnole dans son ensemble, ont dû reprendre une attitude « responsable » en particulier le tandem Commissions Ouvrières (CO)-Union Générale des Travailleurs (UGT). D’un coté, ils avalisent l’illusion –qui est passablement entamée mais qui est toujours présente- selon laquelle « nous sortirons de cette crise en acceptant quelques sacrifices » et, d’un autre coté, ils cherchent à semer la passivité chez les ouvriers, parce ce sont les syndicalistes eux-mêmes, aidés par les médias, qui se chargent de rabâcher jusqu’à la nausée que si le 29 septembre a échoué, c’est à cause de la passivité et de l’égoïsme des ouvriers. Il faut que ceux-ci se sentent coupables, il faut les stigmatiser en les rendant responsables de l’attitude favorable au Pacte social de la part des syndicats.
Cette politique a aussi comme pilier la manœuvre gouvernementale de décembre où les contrôleurs aériens ont été désignés comme têtes de Turc4. Lors de cette campagne, on a présenté cette catégorie de personnel comme « l’ennemi du peuple », on les a punis avec la militarisation directe de leur travail, l’augmentation brutale de leurs horaires et une nouvelle réduction de leurs salaires.
Cette politique a continué : il suffit de voir la campagne qui a été montée suite à l’agression d'un conseiller régional de Murcie, avec laquelle on a pu dénigrer sans retenue les travailleurs du public de cette région qui avaient réagi spontanément contre la réduction de 7% de leurs salaires, l’augmentation de 5 heures de leurs horaires hebdomadaires et du licenciement de 600 personnes en CDD dans le secteur de la santé5. Et dans le même registre, un tribunal menace de sanctions très dures les grévistes du métro de Madrid6. Une grève de mécaniciens ferroviaires a donné lieu à une campagne hystérique avec le même schéma qui a été employé contre les contrôleurs aériens. À Valence, à propos des 1419 fonctionnaires du secteur de la Justice, la télévision n’a pas arrêté de diffuser en boucle les images de 55 d’entre eux les montrant en train de se livrer à quelques tricheries picaresques avec le pointage, ce qui a permis d'entamer une énième campagne médiatique contre les fonctionnaires de cette branche.
La bourgeoisie essaye par tous les moyens d’éviter la mobilisation massive et généralisée des ouvriers. Sa politique cherche à canaliser une combativité et une indignation qui mûrissent, vers le terrain piégé des mobilisations partielles et corporatistes. Les syndicats « renoncent » à la « grève générale », mais, par contre, ils ne renoncent pas du tout à promouvoir des mobilisations bien enfermées et encadrées dans les secteurs et les régions, c'est-à-dire, dans un cadre de division. La boucle se referme avec ces campagnes de dénigrement médiatique menées avec une jubilation mal dissimulée par le gouvernement et ses moyens de désinformation.
Les syndicats « alternatifs » ne sont pas l’alternative
Le 27 janvier, une poignée de syndicats « alternatifs » ont convoqué une « grève générale » qui s’est limitée au Pays Basque, à la Catalogne et à la Galice, limitant pour le reste de l’Espagne l’appel à quelques rassemblements très peu suivis.
Chacune de ces grèves « générales » est restée enfermée dans des motivations nationalistes et particulières : on voit bien là comment ces syndicats qui se prétendent « alternatifs » s’adaptent très bien à l’orientation générale de la bourgeoisie de parcellariser, diviser et fragmenter par tous les moyens la riposte prolétarienne7.
Ces « alternatifs » n'ont qu'une enveloppe un peu différente par rapport au tandem CO-UGT, le fond demeure identique. Comme ceux-ci, ceux-là appellent à une mobilisation sans la moindre assemblée ni débat, tout se règle avec quelques affiches, quelques réunions de syndicalistes et quelques courriers électroniques. Lors des rassemblements, c’est le même folklore. Le même bruit abrutissant que lors des manifs d’UGT-CO, ce qui ne fait qu’encourager l’atomisation, en empêchant le contact entre travailleurs, en obstruant tout débat et toute coordination. Ils ne sont pas une alternative, mais une mauvaise photocopie des appels de CO-UGT.
Ils ne parlent pas de la gravité mondiale de la crise, ni du fait que nous sommes tous attaqués, ni de la nécessité de lutter contre le capitalisme, mais ils propagent l’illusion selon laquelle une intervention publique de l’Etat qui « serre la vis » aux banquiers et aux spéculateurs nous permettrait de nous en sortir.
Ils demandent qu’on défende le « système public des retraites », mais c’est justement cet objectif qui est partagé et mis en avant par tous les partis et les forces du Capital depuis la droite la plus extrême jusqu'à la gauche ! La bourgeoisie ne prétend pas éliminer le « système public des retraites », mais le sauver en réduisant substantiellement les pensions (d’au moins 20 %) et être de plus en plus restrictive quant au droit d’accès à une pension. Cette attaque virulente est cachée par les syndicats avec l'épouvantail de la menace selon laquelle les pensions publiques seraient remplacées par des fonds privés.
Ils exigent « plus d’État » face au supposé « moins d’État » du « néolibéralisme », en essayant de nous cacher le fait qu’autant l’État « néolibéral » que l’État « socialiste » défendent à mort le système capitaliste, qu’ils sont les garants de l’exploitation dont nous souffrons. Ils exigent que l’État agisse au « profit du peuple », ce qu’il n’a jamais fait ni ne fera jamais ! Parce que l’État est un instrument de la classe capitaliste et les mesures qu’il prend, autant lorsqu’elles bénéficient au privé qu'au public, n’ont d’autre objectif que celui de défendre les intérêts du Capital et le maintien de l’exploitation.
L’alternative ne peut venir que des travailleurs eux-mêmes
Comment se fait-il qu’une minorité privilégiée parvienne à maintenir la grande majorité dans l’exploitation et l’oppression ? Il est évident qu’en dernier ressort, c’est parce que son État possède le monopole de la force : police, armée, législation, tribunaux, prisons. Mais ce monopole serait inefficace s’il n’était pas entouré, protégé et quelque part fardé par l’appareil des partis, des syndicats et tout le système des soi-disant « droits » et « libertés » dont on jouirait, autrement dit par la voie de la démocratie.
La démocratie bourgeoise est basée sur la délégation. Délégation de la gestion de nos vies à une caste de politiciens qui tous les 4 ans nous appellent à voter en nous bourrant la tête de promesses qu’ils ne tiennent jamais. Délégation aux professionnels syndicaux de la mobilisation dans la lutte et de la négociation. Cette délégation aux représentants politiques et syndicaux nous amène à l’atomisation, à la passivité, à l’individualisme. Cette délégation fait que, même quand nous luttons (par exemple, les mobilisations syndicales du genre 29 septembre ou le récent 27 janvier des « alternatifs »), nous rentrons à la maison avec un sentiment d’impuissance, avec l’arrière-goût amer dans la bouche d’avoir perdu notre temps.
La lutte de la classe ouvrière n’est pas basée sur la délégation mais sur la participation active et consciente de la grande majorité. L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ou elle ne sera pas, voilà ce qu'affirmait déjà la Première Internationale il y a 150 ans. Ceci se concrétise, entre autres, dans les expériences de se réunir en assemblées générales : débat pour décider des mesures à prendre pour le combat, développement de la solidarité et de la mobilisation, du sentiment que nous faisons partie d’un tout dans lequel nous sommes individuellement et collectivement plus forts, sentiment de courage qui nous fait oser des choses que, seuls et atomisés, nous serions incapables de réaliser.
En France, lors des mobilisations contre la réforme des retraites ont surgi des assemblées générales interprofessionnelles regroupant des travailleurs de différents secteurs qui, de façon unitaire, essayaient d’impulser l’ensemble de la classe ouvrière pour que celle-ci prenne en main la lutte, en dépassant le travail de sabotage des syndicats. En Italie du Nord, une assemblée autonome de travailleurs a regroupé un millier de camarades qui ont essayé d’impulser la lutte. Ici aussi, en Espagne, des groupes de travailleurs sont en train d’émerger qui essayent d’impulser un mouvement à la base, pour qu’on puisse décider collectivement de comment lutter, quand, avec quels moyens, comment gagner la solidarité, comment étendre la lutte et ne pas rester enfermés, isolés.
Tout cela est riche de potentialités pour le futur. Il s’agit pour le moment d’un mouvement très limité, avec de grandes difficultés, avec des doutes et des pas en arrière. Mais face à la passivité, à la duperie et à la démobilisation imposée par les politiciens et les syndicats, il existe une alternative : développer notre force collective. Il va de soi que de nombreuses erreurs seront faites, qu’il y aura des problèmes et des contretemps. Mais nous n’avons pas d’autre chemin possible pour pouvoir nous défendre.
CCI (8 février)
1 Pour ceux qui veulent participer à la diffusion la plus large possible de ce tract, il est possible de l'éditer en espagnol à l'dresse suivante : https://es.internationalism.org/files/es/pacto.pdf [122].
2 La preuve : les nouvelles lois, décrétées à toute vitesse, sur les Caisses d’épargne qui vont être soldées à vil prix.
3 Lire le tract fait en commun (CCI, CREE et la Red de Solidaridad y Encuentro d’Alicante) : https://es.internationalism.org/node/2960 [123]
4 Voir notre prise de position sur https://fr.internationalism.org/ri419/etat_d_urgence_en_espagne.html [124]
5 Lire https://fr.internationalism.org/icconline/2011/dans_la_ré [125]gion_de_M [125]urcie_les_fonctionnaires_protestent_contre_des_problè [125]mes_q [125]ui_touchent_tout_le_monde.html [125]
6 Les travailleurs du Métro de Madrid ont été les acteurs d’une grève impulsée par des assemblées générales en juin 2010. Lire « Leçons de la grève du Métro de Madrid » dans https://fr.internationalism.org/icconline/2010/lecons_de_la_greve_du_met... [126]
7 Nous ne mettons pas du tout en doute l’envie de lutter ni la volonté de défendre les intérêts ouvriers des militants de base de ces syndicats. Justement, pour qu’ils ne soient pas les victimes d’une escroquerie et ne se retrouvent pas démoralisés et trompés, il leur faut instaurer un débat sur la nature de ces syndicats et sur le syndicalisme en général.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]
L'autorité palestinienne, feuille de vigne de l'impérialisme
- 1591 lectures
Nous publions ci-dessous un article réalisé par World Revolution, organe de presse du CCI en Grande-Bretagne.
Le mois dernier, lorsque le prolétariat et les masses d’une grande partie du Maghreb et du Proche-Orient ont commencé à se soulever contre leurs dirigeants capitalistes, une manifestation a été appelée à marcher à Gaza derrière les drapeaux du Fatah pour protester contre le fait que l’Autorité palestinienne a été quelque peu insultée par des révélations la qualifiant de « troisième arme de la sécurité israélienne » (dixit le coordinateur américain pour la sécurité pour Israël et la Palestine, le général Keith Dayton). Or, comme le disait World Revolution il y a quelque temps, en décembre 2004 pour être précis, « alors que l’OLP était à l’origine un agent du bloc russe, l’Autorité palestinienne a été essentiellement créée pour agir en tant que force auxiliaire de répression pour le compte de l’armée israélienne. »
Le rôle de l’Autorité palestinienne, défenseur des intérêts impérialistes des Etats-Unis, de l’Angleterre et de l’Union européenne et par conséquent soutenue par eux, a été mis à nu par les 1600 documents qui ont fui vers Al-Jazeera et ont été publiés par le Guardian depuis la fin janvier. Ces documents, dont certains ont été rédigés afin de protéger leurs sources, ont été authentifiés par le journal et confirmés par les récents mails révélés par Wikileaks en provenance du consulat américain à Jerusalem et l’ambassade des Etats-Unis à Tel Aviv. Ils racontent l’histoire des gangsters totalement corrompus de l’Autorité, mis en place par les parrains américains, anglais et égyptiens, mendiant à leurs maîtres israéliens une « feuille de vigne » leur permettant de leur offrir une certaine crédibilité.
Les documents détaillent par le menu le complet mensonge et la comédie de tout le « processus de paix », une pantalonnade jouée maintenant depuis deux décennies alors même que les masses palestiniennes sont passées par tous les stades d’une misère humiliante, de la répression et de la guerre. Voilà la nature de la « paix capitaliste ». Le processus de paix au Proche-Orient n’a jamais été autre chose qu’une expression de l’impérialisme impliquant toutes les principales puissances et tous les gangsters locaux de la région. Entre autres choses, la nature anti-ouvrière de la libération nationale, ici la chimère d’un État palestinien, apparaît non seulement sous la forme d’un rêve pour les Palestiniens, mais aussi comme une attaque idéologique contre la classe ouvrière partout dans le monde.
Quoi qu’il advienne, les documents montrent que seul un très petit nombre de réfugiés pourront retourner dans les maisons dont ils ont été chassés, et dont ils continuent à être chassés au nom des intérêts du Grand Israël et des intérêts plus larges des impérialismes américain et anglais. Ils présentent une suggestion pas si étrange que ça de la secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice, il y a quelques années, faisant écho à des visions de l’après-Seconde guerre mondiale, lorsqu’il avait été demandé aux Juifs de s’installer dans des marais infestés de maladies en Amérique latine, et qui demandait si les Palestiniens ne pouvaient pas être déplacés vers des pays comme « le Chili, l’Argentine, etc. ». La juriste, ex-agent du Mossad et actuelle ministre des affaires étrangères israélienne, Tzipi Livni, qui « négocie » avec l’Autorité palestinienne, a dit : « Je suis contre la loi, la loi internationale en particulier ». Le fait qu’il n’y ait pas de processus de paix, que l’impérialisme ne reconnaisse aucune loi, qu’elle soit internationale ou autre, est particulièrement mis en lumière par le fait que le juriste Tony Blair soit rémunéré en tant qu’« envoyé du quartet pour la paix au Proche-Orient » ! Il y a bien une loi à l’œuvre ici, mais c’est la loi de la jungle, et le chef négociateur de l’Autorité palestinienne, Saeb Erekat, l’a parfaitement résumé : « nous avons dû tuer des Palestiniens… Nous avons même tué notre propre peuple pour maintenir l’ordre et la loi ». En plus de cela, et pour confirmer la nature de gangsters des acteurs de l’actuel « processus de paix », il y a la stupéfiante révélation qu’au cours d’une rencontre en 2005 entre le ministre de l’Intérieur de l’Autorité palestinienne, Nasser Youssef, et le ministre de la Défense israélien, Shaul Mofaz, ce dernier a posé à Youssef cette question concernant un commandant des Brigade des Martyrs d’Al-Aqsa soupçonné de préparer un attentat en Israël : « Vous connaissez son adresse… Pourquoi ne le tuez-vous pas ?» Les documents montrent le rôle de la Grande-Bretagne dans la constitution d’une force de sécurité de contacts « sûrs » de l’Autorité palestinienne dans les opérations clandestines en lien direct avec les services secrets israéliens. L’actuel directeur du MI6, mis en place par le gouvernement travailliste, a été lui-même ambassadeur britannique en Egypte au début des années 2000.
L’ordre capitaliste, sa loi, c’est la torture et le meurtre. D’autres documents montrent qu’en réponse à la proposition de l’Autorité palestinienne de reconnaître toutes les implantations israéliennes en terre palestinienne, une offre immédiatement rejetée par les Israéliens, ces derniers ont proposé que les Palestiniens vivant en Israël soient en quelque sorte « échangés », autrement dit déplacés vers l’emprise de l’Autorité palestinienne. Livni est très claire sur la politique à long terme d’Israël qui est de s’emparer de « …toujours plus de territoires, jour après jour… » afin de créer « un fait accompli par le sol ».
L’Autorité palestinienne, elle-même gangrenée par la corruption et les rivalités manipulées par la CIA, le MI6 et les services secrets israéliens et égyptiens, a été ainsi avertie à l’avance de l’invasion israélienne de Gaza en 2008/2009.
Mieux, comme le notait le Guardian : « Les dépêches mettent en lumière l’implication profonde et officielle des Britanniques dans la mise sur pied de l’appareil de sécurité de l’Autorité palestinienne dans les Territoires ». Ils montrent ainsi que le MI6 a concocté son propre plan de sécurité pour la Palestine, de concert avec les services secrets égyptiens à l’ambassade britannique au Caire. Ce plan a utilisé des fonds pour l’aide au « développement » de l’Union Européenne et de la Grande-Bretagne afin d’enrôler ces forces. Il est cependant quelque peu douteux que la Grande-Bretagne ait également fourni armes et entraînement. Ces forces ont été chaleureusement accueillies par les Israéliens et les Américains, mais « elles causent quelques problèmes… parce qu’elles torturent les gens » (déclaration du général K. Dayton).
Rien de tout cela ne nous amène à accorder la moindre crédibilité au Hamas, lui-même co-négociateur avec les services secrets israéliens lorsque le besoin s’en fait sentir, constituant lui aussi une force répressive et un nid de tortionnaires dans sa propre enclave. Son rôle impérialiste est très clair quand on sait qu’il est soutenu par l’Iran et la Syrie.
Tout le processus des « partenaires pour la paix » n’a pas été seulement une cruelle plaisanterie pour les masses palestiniennes, ainsi qu’une défense de l’impérialisme, il a également constitué une vaste attaque idéologique menée contre la classe ouvrière partout dans le monde. Mais les événements font bouger les choses et la manifestation pro-palestinienne, pro-Fatah que nous avons déjà rappelée n’a pas été la seule qui ait eu lieu en janvier. C’est Human Rights Watch qui le rapporte : « le 20 janvier, un groupe de jeunes de Ramallah qui voulaient manifester leur soutien aux Tunisiens en ont été empêchés par la police de l’Autorité palestinienne. » Une semaine à peu près plus tard, la même source ajoute : « Dans la bande de Gaza, les autorités du Hamas ont empêché les manifestations qui voulaient exprimer leur solidarité avec les manifestants anti-gouvernementaux d’Egypte. » La police du Hamas a arrêté trois femmes et, dans une démonstration de force disproportionnée, a menacé tous ceux qui voulaient manifester1. Nous voyons clairement ici l’unité d’intérêts de tous ces gangs bourgeois : l’Autorité palestinienne, le Hamas, les États d’Israël et d’Egypte, en réprimant les manifestations, répriment aussi leurs opposants et défendent « leurs » territoires. C’est là une leçon bien connue de la Commune de Paris, de la Révolution russe, de l’Italie et de la France après la Seconde Guerre mondiale et de la Pologne en 1980, tous ces événements étant exemplaires de la capacité des forces impérialistes à mettre leurs antagonismes sous le boisseau dès lors qu’il s’agit d’affronter la menace de la lutte de classe. Fin janvier, cela a été mis en évidence par le fait que les Etats-Unis, avec l’accord d’Israël, ont facilité l’envoi de forces spéciales égyptiennes à travers le Sinaï démilitarisé afin de réprimer les soulèvements aux alentours de Rafah et de renforcer la frontière avec Gaza ; dans ce cas, Etats-Unis, Hamas, Fatah, Israël et Egypte ont coordonné en parfaite harmonie leurs forces de répression, permettant le maintien de la frontière et de l’ordre capitaliste. Cette « trêve » ne durera que tant qu’ils sont tous préoccupés par une possible généralisation des manifestations ; lorsqu’ils en seront venus à bout, ils retourneront à leurs rivalités et affrontements habituels.
Baboon (03 février)
1 Il y a également eu de petites manifestations de soutien aux masses tunisiennes et égyptiennes au nord de Tel-Aviv.
Géographique:
- Palestine [127]
ICConline - avril 2011
- 1513 lectures
Condamnation de militants coréens
- 1457 lectures
Les camarades coréens arrêtés et accusés en vertu de l’infâme "Loi de sécurité nationale" [128] font part de leurs condamnations par le court texte suivant :
1) Oh Se-cheol, Yang Hyo-sik, Yang Joon-seok et Choi Young-ik : un an et demi d'emprisonnement, plus trois ans avec sursis, et une amende de 500 000 wons (500 $).
2) Park Joon-seon, Jeong Won-hyun, Nam-Won goong et Oh Min-gyu : un an d'emprisonnement, plus deux ans avec sursis, et une amende de 500 000 wons.
La signification de cette décision est la suivante :
1) Le SWLK (Socialist Workers League of Korea) est jugé comme étant une organisation qui fait de la propagande et de l'agitation pour troubler l'ordre national, en violation de l'article 7 de la loi de sécurité nationale.
Cela montre la nature politique du pouvoir judiciaire coréen, qui est une partie de l'appareil étatique au service de la classe capitaliste.
2) L'emprisonnement avec sursis peut être considéré comme la conséquence des mouvements de protestation coréens et internationaux. La condamnation avec sursis de 3 ans signifie que l'emprisonnement est suspendu pour 3 ans, à la condition qu'il n'y aura aucune autre peine pour un autre crime ; elle signifie aussi que la validité de la sentence expire au bout de 3 ans. Mais s'il y a une autre condamnation, au cours des 3 prochaines années, l'emprisonnement qui s’en suivra sera indépendant de toute peine d'emprisonnement pour d'autres condamnations. Ainsi, l'emprisonnement avec sursis est à peine mieux que l'emprisonnement immédiat.
3) Nous, les 8 accusés, faisons appel de cette sentence devant la Haute Cour. Nous allons vivre et agir en toute confiance conformément à des socialistes révolutionnaires, sans nous soucier de l'oppression politique de l'appareil d'Etat coréen.
Merci à tous les socialistes et à tous les travailleurs du monde entier qui ont soutenu le combat judiciaire des socialistes coréenns.
S'il vous plaît, transmettez notre gratitude aux camarades du monde entier.
Géographique:
- Corée du Sud [115]
Réunion publique du Comité de Lutte sur le Japon
- 1842 lectures
Nous venons de recevoir le texte d'une réunion publique tenu le 25 mars sur "Les causes de la situation au Japon et ses effets sur la population" par le "Comité de Lutte des Travailleurs Interpro" issu de l'AG Interpro de la Gare de l'Est (Paris). De par sa qualité, nous pensons que ce texte mérite la plus large diffusion possible et nous nous associons aux idées qui y sont défendues.
Tous ceux qui voudraient se tenir informés des débats et des réunions du Comité peuvent le faire en souscrivant à sa liste de diffusion: [email protected] [129]
Le Japon a subi un tremblement de terre de grande ampleur, mais ce n’était pas une surprise. Il est, rappelons le, situé dans une zone de subduction de 4 plaques tectoniques, et de nombreux volcans y sont actifs. Aussi le tsunami ne pouvait pas y être une surprise totale: ce terme est japonais et provient des pêcheurs qui n’ayant rien vu venir, car ils étaient pleine mer , retrouvaient leur ville portuaire ravagée. De plus, un rapport publié par le PNUE démontre que le tsunami du 26 décembre 2004 a causé moins de dégâts dans les zones où les barrières naturelles, telles que les mangroves, récifs coralliens, végétations côtières étaient présentes. Or, le Japon, pays insulaire, est composé de 71% de montagnes ce qui implique que les plaines y sont rares à l’exception des littoraux ce qui à pour conséquence leur surpopulation et la proximité des zones agricoles des zones urbaines. Aussi, les littoraux n’ont plus les barrières naturelles qui auraient pu freiner la catastrophe. En effet, au nom du mirage du nationalisme on entasse les travailleurs, et on détruit les milieux naturels pour produire intensivement là où aurait pu subsister un rempart à la vague. Donc installer des centrales nucléaires en bordure de mer dans une pareille zone, c’est un véritable crime...
De plus, on peut ajouter que les risques liés aux tsunamis avaient été sous-évalués pour ne pas entraver le développement des villes et du secteur du bâtiment mais aussi ... du nucléaire en bord de mer... car la prévention est de rigueur dans ce pays. Il y a normalement un système d’alerte qui se met en place quelques heures avant et la population est sensibilisée aux risques et aux gestes de survie et une sécurisation des habitats est requise. Le Japon ne dispose d’aucun système national d’avertissement contre les tsunamis et les plus démunis ont des maisons anciennes sans protection sismique. Si elles étaient en bois, elles ont été balayées par le tsunami....Cette catastrophe souligne là encore qu’il est question de classes sociales pour survivre à cette épreuve. Jusqu’en 2006 le japon a connu un long cycle de déflation qui a fait s’accroitre les licenciements, la pauvreté, lessans domiciles fixes et les travailleurs précaires. Depuis la crise de 2008 le taux de chômage est de nouveau à la hausse.
Loin d’utiliser sa capacité économique pour aider massivement la population, le troisième pays le plus riche du monde a abandonné à eux-mêmes les survivants du cataclysme, dans le froid, sans couverture, sans nourriture, sans médicament. La population est menacée par la contamination des eaux, de l’air et de la nourriture par la radioactivité. Quant au gouvernement, il est mobilisé pour aider les banques, les trusts, la bourse et la monnaie.... et il dépense pour cela des sommes colossales !!!
Le Japon n’avait rien prévu concernant le risque nucléaire. Les risques pour les centrales nucléaires avaient été systématiquement niés par le pouvoir et les classes dirigeantes japonais malgré l’aggravation des risques dus aux séismes et aux tsunamis... Au Japon, dans les centrales nucléaires, l’Etat japonais n’avait pas son mot à dire et acceptait de ne rien vérifier même en cas d’accident grave. De la fin des années 1980 aux années 1990, Tepco le premier producteur mondial privé d’électricité, avait falsifié une trentaine de rapports d’inspection de réacteurs nucléaires. Au Japon, Tepco a en charge le tiers des réacteurs nucléaires, dont ceux de Daiichi et Daini à Fukushima. Au résultat : des profits fabuleux et de l’énergie à bon marché pour son industrie. Par conséquent aucune information sur ce qui se passe dans les centrales en grave dysfonctionnement. TEPCO, dès le début des catastrophes nucléaires, a caché les faits autant qu’elle l’a pu. Essayant de mettre le drame sur le dos du tsunami alors que ce sont les secousses qui sont à l’origine de la catastrophe, à FUKUSHIMA elles ont fait s’effondrer le toit et des murs ce qui a fait s’embraser l’installation. La société s’est d’abord retirée du site, laissant la gestion des problèmes à des employés de filiales. Afin de pouvoir ensuite leur refiler la responsabilité de l’échec... Ensuite cela a été silence radio... Ce qu’on souligne peu c’est le dysfonctionnement du système de refroidissement qui était déjà défaillant auparavant ainsi qu’une élévation anormale de la pression interne. Tout cela avait été signalé mais rien n’avait été fait. Les autorités ont donné comme instruction à ses employés de laisser s’échapper des vapeurs comportant des substances radioactives pour faire descendre la pression et aux habitants de rester chez eux portes et fenêtres
fermées pour se protéger pour enfin évacuer ceux qui habitent dans un rayon de 10 km. Mais subsistent 14000 personnes vivants autours des deux centrales . Les taux de radioactivité relevés sur le lait et des épinards consommés dans la région d’Ibaraki, située entre Tokyo et Fukushima, sont très alarmants, indique la Criirad. Cette Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité a réussi à se procurer des relevés fournis par des scientifiques japonais. Ces taux, « 15 000 becquerels par kilo, ce qui est largement au dessus des normes japonaises fixées à un maximum de 2 000 becquerels pour l’iode 131 », signifient que « dans cette région (...), la population a respiré de l’air contaminé et mange désormais des produits tout aussi contaminés », selon la Criirad.
Pendant ce temps là, en france: Le ministre de l’Industrie et de l’Energie, Eric Besson, a évoqué de son côté "un accident grave mais pas une catastrophe nucléaire" au Japon."Le nucléaire n’est qu’une petite partie et certainement pas la plus importante de ce drame national qui a frappé le Japon", a-t-il déclaré à la presse.Il ne faut pas "sonner un tocsin qui n’existe pas. A ce stade, nous ne sommes pas dans une configuration de Tchernobyl", en Ukraine en 1986, a-t-il insisté.Selon Eric Besson, il faut "dire et redire à nos concitoyens que toutes les centrales (françaises) ont été conçues en intégrant les risques sismiques et d’inondation"."Il y a des révisions régulières", a-t-il ajouté.Le président de l’Autorité de sûreté du nucléaire (ASN), André-Claude Lacoste, a quant à lui précisé qu’il n’y avait pas lieu de renforcer la sécurité de la centrale de Fessenheim, située dans une zone à risque sismique en Alsace.De nouvelles mesures ne sont "pas du tout" nécessaires, a-t-il dit aux journalistes."Ça n’a rien à voir avec Tchernobyl", lance Eric Besson au lendemain du tremblement de terre suivi d’un tsunami qui a frappé le Japon et mis à mal la sécurité des installations nucléaires, avec une première explosion signalée à la centrale de Fukushima Dai-Ichi. Il précise qu’à "ce stade et selon les informations dont on dispose, [on est en présence] d’un accident grave mais pas une catastrophe nucléaire".Plus tard, lors d’une conférence de presse à laquelle assistent des dirigeants d’Areva et d’EDF, ainsi que la secrétaire d’Etat à l’écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, il appelle "à ne pas sonner un tocsin qui n’existe pas à l’heure où l’on parle", dans une allusion aux
écologistes. "La question nucléaire n’est qu’une petite partie, certainement pas la plus importante de ce drame qui a frappé le Japon", ajoute Eric Besson. Il insiste aussi sur la sûreté du nucléaire français : "Toutes les centrales françaises ont été conçues en intégrant le risque sismique et le risque inondation", dit-il. Excluant un risque pour les populations des territoires d’outre-mer, Nathalie Kosciusko-Morizet estime que la France va s’efforcer de "comprendre, évaluer ce qui est en train de se passer au Japon".
"Le risque majeur, c’est une explosion du cœur du réacteur, et là ce serait une catastrophe nucléaire ; pour l’instant, ce risque n’existe pas ou plus exactement il est maîtrisé par les autorités japonaises et par l’opérateur japonais", explique Eric Besson sur Europe 1, dimanche. "Pour l’heure, il faut rester prudent, le cœur du réacteur et son enveloppe n’ont pas cédé", ajoute-t-il. Sur BFM-TV, il regrette de n’avoir que des "informations fragmentaires". Eric Besson évoque les dégazages faits par les Japonais, précisant : "Ils acceptent de laisser partir dans l’atmosphère (...) de la vapeur faiblement radioactive pour protéger ce qui est le plus sensible, le cœur du réacteur." Déjà, le ministre doit répondre de ses propos jugés trop rassurants la veille : il affirme qu’il n’est "pas là pour atténuer quoi que ce soit". "Si c’était très inquiétant, je le dirais de la même façon, assure-t- il. Si aujourd’hui se produisait la catastrophe nucléaire que tout le monde redoute, il faudrait le dire". Il martèle cependant à l’attention de ses détracteurs : "Je ne suis pas pour sonner le tocsin avant que quelque chose de très important se soit produit." Plus tôt dimanche, le premier ministre, François Fillon, est intervenu pour faire savoir que la France allait "tirer les enseignements utiles des événements japonais". Tout en précisant que la France avait toujours "privilégié le maximum de sécurité pour ses centrales". Nathalie Kosciusko-Morizet affirme, elle, dans un débat sur BFM TV, que "l’électricité nucléaire bien maîtrisée reste une bonne énergie".
Le grand mot d’ordre est que cet accident est très différent de l’accident de Tchernobyl "par rapport à ce que j’ai entendu ou vu
sur beaucoup télévisions ou de radios, ça n’a strictement rien à voir, à ce stade, avec Tchernobyl, ni dans les explications, ni dans l’enchainement des faits, ni à fortiori, au moment où nous nous parlons, dans les conséquences.", "Nous ne sommes pas dans une configuration de Tchernobyl". Tchernobyl est bien entendu l’horreur absolue, l’épouvantail du nucléaire civile. Pas question que l’on commence à comparer cet accident avec Tchernobyl. Pourtant, les conséquences risquent d’être les même. L’accident, d’un point de vu technique serait beaucoup plus comparable à celui de "Three Mile island". Une fuite de réfrigérant avait conduit le cœur à commencer à fondre. Finalement, l’explosion a été évitée de justesse. C’est cet accident qui avait fait geler les constructions de nouvelles centrales aux États-Unis durant 30 ans !
Rappelons tout de même que ce n’est pas la première catastrophe sanitaire à laquelle le capitalisme nous expose même si c’est certainement pour l’instant la plus grave. Il y a eu la grippe A, les farines animales et la vache folle, l’histoire du sang contaminé, le sida.... Prenons l’exemple de ce dernier :26 millions de morts, 40 millions de personnes contaminées. L’épidémie la plus dévastatrice de l’histoire ravage notre planète depuis plus de 20 ans et pourtant son origine reste encore un mystère. Cependant la communauté scientifique est unanime : le virus du sida est né en Afrique et son ancêtre direct est présent chez les chimpanzés. Reste une énigme : comment le virus est-il passé de l’animal à l’homme ? De nombreuses théories ont été avancées et réfutées... Aujourd’hui, seules deux hypothèses subsistent. La première suggère qu’en 1931, selon les calculs de la généticienne américaine Bette Korber, le virus du chimpanzé aurait contaminé un être humain qui consommait l’animal. Mais alors que les Africains mangent du singe depuis la nuit des temps, pourquoi cette transmission soudaine ? La seconde suggère que le virus du sida serait le produit accidentel d’un vaccin oral contre la polio administré à un million d’Africains dans l’ex-Congo belge de 1957 à 1960 aux endroits mêmes où, une décennie plus tard, on détecte les premiers cas de sida dans le monde. Face à cette dernière théorie qui dérange, le petit univers de la grande Science est partagé entre l’examen de conscience et la dénégation : difficile d’admettre que la médecine ait pu, en combattant une maladie, créer un fléau bien pire encore. Ressuscitant les souvenirs des témoins, exhumant des archives inédites et suivant une incroyable quête de la vérité, ce film plonge le spectateur dans
l’histoire d’une controverse scientifique sans précédent.Chacun sait que l’épidémie est partie d’Afrique. Mais il est souvent ignoré que les autorités sanitaires mondiales n’ont pas levé le petit doigt tant que l’épidémie n’avait pas atteint les pays riches !!! La population d’Afrique n’était pas un objectif financier pour l’industrie du médicament ... Le démarrage de l’épidémie daterait de 1957 au Rwanda, Burundi et au Congo. Une forte probabilité pèse sur le fait que ce serait le produit d’expérimentations "scientifiques" sur le dos des populations locales. Pour scientifiques, traduisez "dans l’intérêt des laboratoires et trusts pharmaceutiques"... Pourtant, l’Occident ne la "découvre" que dans les années 1980-1990 !!! On peut penser que l’épidémie ne concernant que des régions reculées d’Afrique à cette époque, alors pendant vingt ans environ les laboratoires ne s’en soucient pas !!!! Cele nous montre comment cela est liée à l’organisation sociale de la société capitaliste.
Nous n’oublions pas d’ailleurs que le nucléaire avant d’être civile était militaire. Quelles causes à l’entrée massive dans le nucléaire civil?
Examinons la situation militaire du Japon au moment où l’Allemagne capitule en 45, on constate que celui-ci est déjà totalement vaincu. L’aviation est réduite à un petit nombre d’appareils généralement pilotés par une poignée d’adolescents aussi fanatisés qu’inexpérimentés. La marine, tant marchande que militaire, est pratiquement détruite. La défense antiaérienne n’est plus qu’une gigantesque passoire. Et cela, c’est Churchill lui- même qui le souligne dans le tome 12 de ses mémoires .Une étude des services secrets US de 1945, publiée par le New York Times en 1989, révèle quant à elle que : « Conscient de la défaite, l’empereur du Japon avait décidé dès le 20 juin 1945 de cesser toute hostilité et d’entamer à partir du 11 juillet des pourparlers en vue de la cessation des hostilités ».Churchill écrivait le 22 Juillet 1945 au sujet de la bombe : « nous avons désormais en mains quelque chose qui rétablira l’équilibre avec les russes. Le secret de cet explosif et la capacité de l’utiliser modifieront complètement l’équilibre diplomatique qui était à la dérive depuis
la défaite de l’Allemagne ». La thèse de l’utilisation de l’arme atomique pour forcer le Japon à capituler ne correspond à aucune réalité. C’est un mensonge pour mettre en place le gigantesque bourrage de crâne qu’a nécessité la justification idéologique du plus grand massacre de l’histoire que fut la guerre de 1939-45, voir même à la préparation idéologique de la guerre froide. En effet, puissance économique mineure, la Russie peut accéder, grâce à la seconde guerre mondiale, à un rang impérialiste de dimension mondiale, ce qui ne peut que menacer la super puissance américaine et dès le printemps 1945, l’URSS utilise sa force militaire pour se constituer un bloc dans l’Est de l’Europe. Or, ce qu’un rapport de forces instaure, un autre peut le défaire. Ainsi, à l’été 1945, la véritable question qui se pose à l’Etat américain n’est pas de faire capituler le Japon le plus vite possible comme on nous l’enseigne dans les manuels scolaires, mais bien de s’opposer et de contenir la poussée impérialiste du « grand allié russe » ! L’holocauste nucléaire qui s’est abattu sur le Japon en août 1945, a pour véritable objectif d’adresser un message de terreur à l’URSS pour forcer cette dernière à limiter ses prétentions impérialistes et à accepter les conditions de la « pax americana ». Plus concrètement, il fallait immédiatement signifier à l’URSS qui déclarait au même moment la guerre au Japon, qu’il était hors de question pour elle de tenter de participer à l’occupation de ce pays, contrairement au cas de l’Allemagne. Et c’est pour que ce message soit suffisamment fort que l’Etat américain lança une deuxième bombe contre une ville d’importance mineure sur le plan militaire, à savoir Nagasaki, où l’explosion anéantit le principal quartier ouvrier ! C’est aussi la raison du refus de Truman de se ranger à l’avis de certains de ses conseillers pour lesquels l’explosion d’une bombe nucléaire sur une zone peu peuplée du Japon eut été amplement suffisante pour amener le Japon à capituler. Non, dans la logique meurtrière de l’impérialisme, la vitrification nucléaire de deux villes était nécessaire pour intimider Staline, pour rabattre les ambitions impérialistes de l’ex-allié soviétique. A son origine le nucléaire avait également pour but au sortir de la 2eme guerre mondiale d’effrayer les populations si ce n’est de les terroriser mais aussi écraser toute velléité de révolte, révolution
comme cela avait été le cas après la première guerre mondiale. Aussi,en 1945 la destruction d'Hiroshima et Nagasaki a déclenché dans la presse française un hymne à la gloire de la Science et des scientifiques. Plus la destruction était grande,
plus la preuve était faite de la justesse des travaux scientifiques. La matière était une réserve inépuisable d'énergie. La peur de la bombe a mis quelques années à toucher les gens. Dans les années 50-60 s'est développé un assez fort mouvement contre la bombe (non exempt d'ambiguïtés) qui a servi de tremplin au nucléaire civil. "Non à la bombe, oui à l'atome pour la paix a été un mot d'ordre largement clamé dans bon nombre de manifestations. Quand on aborde la relation entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil ce point n'est jamais évoqué. On pourrait dire qu'une des justifications de l'énergie nucléaire civile a été fondée sur une forte opposition à la bombe. D'autre part il faut bien voir qu'en France le nucléaire militaire a été géré par le CEA dans une perspective mixte civile-militaire. Lorsqu'en 1973-1974 EDF se décide à une nucléarisation massive de son parc électrique, EDF adopte la filière américaine Westinghouse. Mais, si pour les pays en voie de développement l'acquisition de la technologie civile est un préalable évident à leur accès à la bombe, il n'en est pas de même pour les pays développés où l'énergie nucléaire civile s'est imposée. Les dangers de ces deux aspects du nucléaire sont assez différents. Rien ne justifie de défendre la bombe mais il faut constater que nombre d'opposants à l'énergie nucléaire militaire (en particulier dans la communauté scientifique) ont été de farouches défenseurs de l'énergie nucléaire civile, celle de "l'atome pour la paix et certains le sont toujours. Alors que les opposants au nucléaire civil sont aussi, quasi naturellement, des opposants au nucléaire militaire.Les représentants d'EDF ont, dès le début, insisté dans leurs interventions publiques sur les énormes précautions prises pour assurer la sûreté des réacteurs et le discours n'a pas varié depuis. La "défense en profondeur venait en tête sans que la signification en soit clairement définie sinon qu'il fallait soigner la fabrication de tous les éléments d'un réacteur avant leur assemblage. Mais quasiment aucun texte administratif contraignant ne menaçait de poursuites les fabricants en cas de faute grave. Ce vide juridique est passé inaperçu. Ensuite venait la "redondance: chaque élément important était mis en double mais d'une façon indépendante, afin qu'en cas de défaillance de l'un, l'autre vienne en secours. Cela montrait clairement la nécessité pour la sûreté d'avoir toutes les composantes en état de marche.
Enfin venait la "triple barrière". S'il fallait une troisième barrière c'est qu'il était possible que les deux premières soient traversées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La dernière barrière (l'enceinte de confinement) pouvant être menacée par une surpression interne lors d'un accident grave, on l'a munie d'une soupape de sûreté. On y ajouta un filtre, sorte de gamelle remplie de sable qui fut baptisée "filtre rustique", non pas pour empêcher de contaminer l'environnement mais pour réduire cette contamination à un niveau dit "acceptable (cette acceptabilité officielle n'est d'ailleurs pas bien définie). Il est curieux que ce discours qui se voulait sécurisant n'ait pas déclenché de l'inquiétude au sein de la population.
Assimiler un réacteur nucléaire à une vulgaire cocotte-minute comme le faisaient certains responsables n'était guère compréhensible vu l'énorme complexité imposée par la sûreté. Et ce n'était pas de simples pannes de fonctionnement que craignaient les constructeurs. Seule la possibilité de catastrophes pouvait justifier un tel luxe de précautions. Le discours sécurisant paradoxalement a bien fonctionné.
Il apparaît clairement que l’objectif n’est pas de fournir « une énergie bon marché » ou encore plus propre car moins de rejet de co2 (contribution moindre au
réchauffement ,que l’on nous scande, de la planète) comme nous le vendent les areva, edf, et autre tepco.
A l’heure où en Lybie, les impérialistes envoient leurs troupes se targuant d’y intervenir au nom du peuple et de la démocratie. Comment croire en effet à
une « aide » désintéressée aux insurgés libyens quand ces mêmes États continuent, au nom du contrôle des ressources pétrolières, à soutenir ouvertement la répression armée quand elle est le fait de leurs alliés, comme en Irak, au Bahreïn, en Arabie Saoudite, au Yémen. L’exemple de l’Irak, de l’Afghanistan, et de bien d’autres pays nous montrent ce qu’il faut penser de ce genre de discours, et à quel point la prétention « d’exporter la démocratie » ne masque en réaité que le fait que les bourgeois et les états n’ont d’intérêt que le maintien du système capitaliste afin de conserver leur pouvoir sur les populations.
Catastrophe nucléaire et Lybie même lutte! La plus grande catastrophe pour l’humanité c’est de laisser perdurer un instant de plus ce système social.
Géographique:
- Japon [130]
Récent et en cours:
- Séisme au Japon [131]
Rubrique:
ICConline - mai 2011
- 1714 lectures
Affaire DSK : la bourgeoisie est une classe de pourris
- 1972 lectures
L'arrestation et l'incarcération de Dominique Strauss-Kahn, directeur général en exercice du puissant Fonds Monétaire International, caracolant sous la casaque social-démocrate en tête de tous les sondages pour les primaires du PS et ultérieurement pour l'élection présidentielle de 2012 en France, ne pouvait que faire sensation et provoquer un énorme scandale. Le voilà désormais sous l'inculpation de 7 chefs d'accusation différents dont le harcèlement, sexuel et la tentative de viol d'une femme de chambre d'origine guinéenne dans l'hôtel où il se trouvait, cueilli et menotté par la police new-yorkaise dans l'avion qui devait le ramener en Europe.
Une nouvelle illustration des moeurs de la bourgeoisie décadente
Les moeurs libertines de DSK (qui ne sont un secret pour personne) ont-elles été exploitées à l'extrême et poussées à la caricature pour diaboliser le personnage, le virer du FMI et saboter sa candidature aux présidentielles en France ? DSK a-t-il été victime d'un « complot » ou de règlements de comptes au sein de différentes cliques de la bourgeoisie ? C'est tout à fait possible. Cette classe de requins et de gangsters ne se fait pas de cadeaux. Elle n'a jamais hésité à « flinguer » (au sens propre comme au sens figuré) l'un des siens. Cela a été le ,cas, entre autres exemples, en France avec la mort en octobre 1979 du ministre de Giscard, Robert Boulin, en passe de devenir Premier ministre, présentée comme un suicide alors qu'il a été retrouvé noyé sous quelques centimètres d'eau dans un étang de la forêt de Rambouillet et, selon plusieurs témoignages, le visage tuméfié par les coups. Ou encore l'ex-premier ministre de Mitterrand Pierre Bérégovoy qui se suicide le 1er mai 1993 après une énorme campagne l'accusant de corruption. Et, aux Etats-Unis, personne n'a oublié l'assassinat à Dallas de John-Fitzgerald Kennedy (« JFK ») en novembre 1963, probablement commandité- on le sait aujourd'hui- par la CIA ni le gigantesque scandale du Watergate où le camp républicain avait mis sur écoutes téléphoniques le siège de leurs rivaux démocrates qui a forcé le président Richard Nixon à démissionner en 1975...
« L'affaire DSK » est tout à fait révélatrice des moeurs banalement dépravées de la bourgeoisie et elle va de pair avec les comportements « naturels » de prédateurs de leurs dirigeants. Ce n'est d'ailleurs pas une première : on se souvient que, lorsqu'il était président des USA, Bill Clinton s'est fait épingler et a fait l'objet d'une procédure d'empeachment lors de l'affaire Monica Lewinski. De même, les scandales pleuvent sur Berlusconi qui recrute à tour de bras de jeunes call girls ou cover girls pour des « parties fines », y compris des mineures de moins de 16 ans en achetant le silence de leurs parents, tout en s'enorgueillissant de sa « verdeur » de chaud latin. Les grands de ce monde, souvent grisés par un sentiment de toute puissance, ont tendance à se croire tout permis et ils étalent ce pouvoir avec morgue et arrogance. DSK lui-même avait déjà été confronté en 2008 à une histoire sordide avec une subordonnée sur laquelle il avait exercé un chantage et qui avait failli lui coûter sa place à la tête du FMI. La « morale bourgeoise » s'accommode parfaitement « d'écarts » ou d'agissements de ses dirigeants, de gauche comme de droite, qui relèvent des comportements de voyous et de grands truands mafieux. En France, ces dernières années, les « scandales » ou les « affaires » nauséabondes ont été particulièrement nombreux, de Giscard à Sarkozy, en passant par Mitterrand ou Chirac et leurs ministres : subornations, détournements de fonds publics dans les caisses des partis, implication de ministres dans des affaires louches ou frauduleuses, comme l'étalage d'un luxe ostentatoire dans laquelle ils se vautrent. DSK avec son goût du luxe est aussi bling-bling que Sarkozy ; même Christine Lagarde présentée comme la « meilleure » représentante de l'Europe pour succéder à DSK à la tête du FMI est nantie de casseroles (elle est notoirement intervenue plusieurs fois à la rescousse de l'homme d'affaires Bernard Tapie quand celui-ci était en procès dans l'affaire du Crédit Lyonnais).
Pourquoi en parle-t-on autant aujourd'hui ?
Ce qui est plus inusité, c'est l'ampleur de la publicité qui est donnée à « l'affaire DSK ». Depuis qu'elle a éclaté le 15 mai , elle a accaparé la Une de toute la presse internationale et, dans la plupart des médias, on nous abreuve quasiment heure par heure en direct des péripéties de ce qui nous est présenté désormais comme un grand feuilleton à suspense. Tous les journaux télévisés y consacrent les ¾ de leur temps, des débats animés les relaient quotidiennement, c'est devenu le principal sujet de conversation de l'homme de la rue, sur les lieux de travail, dans les cafés. Chacun est invité à donner son avis. On parle de surprise, d'incrédulité, de honte, d'humiliation. On n'hésite pas à évoquer complaisamment la thèse déjà évoquée ci-dessus du « complot orchestré » contre DSK, du « piège qui lui a été tendu ». Les médias et les politiques n'hésitent pas à jouer la surenchère pour critiquer ou se justifier sous couvert de déontologie. Ceux qui se sont tus et ont couvert pendant des années le « problème de DSK avec les femmes » balancent hypocritement aujourd'hui leurs « révélations » sur des turpitudes notoirement connues dans le cercle fermé du pouvoir et des médias.
La vraie question à se poser est pourquoi la bourgeoisie et ses médias donnent une telle publicité à ce scandale qui l'éclabousse et la compromet pourtant gravement toute entière, brisant la carrière d'un de leurs représentants patentés les plus éminents ? Quel intérêt la classe dominante trouve-t-elle dans la médiatisation outrancière de ce scandale ?
Aujourd'hui, il est clair que les divers épisodes de cette sordide affaire sont mis délibérément sous les projecteurs pour une raison majeure. La polarisation spectaculaire sur cet épisode permet pour un temps d'occulter les vrais problèmes sociaux, de créer un écran de fumée afin de tenter de reléguer au second plan et de minimiser dans la tête des prolétaires une réalité sociale quotidienne douloureuse et dramatique engendrée par l'aggravation de la crise mondiale du capitalisme : hausse vertigineuse du chômage, de la précarité, des produits de première nécessité, aggravation tous azimuts des attaques contre nos conditions de vie, réduction de tous les budgets et amputation des programmes sociaux, qui mettent de plus en plus à nu la faillite irrémédiable du capitalisme. Il est particulièrement édifiant de voir que l'affaire DSK est montée en épingle au moment même où les plans d'austérité concertés du FMI et des gouvernements sont redoublés en Grèce ou au Portugal, et surtout au moment même où les jeunes chômeurs, les étudiants et de nombreux travailleurs, précaires ou non, manifestent leur colère et leur ras-le-bol non seulement sur la Place Puerta del Sol à Madrid mais dans toutes les principales villes d'Espagne, se réclamant d'un mouvement explicitement dans la lignée des révoltes en Tunisie et en Egypte, ou des autres luttes en Europe (Grèce, France, Grande-Bretagne).
Bien sûr, les sommes astronomiques lâchées comme caution pour obtenir la « libération conditionnelle » de DSK ou pour alimenter son procès sont choquantes et révoltantes pour tous les travailleurs et les chômeurs qui n'ont même plus de quoi se loger, se nourrir, se vêtir. Un responsable du PS (proche de DSK) Manuel Valls a même piqué une colère dans un débat accusant avec une certaine lucidité les journalistes d'alimenter ainsi « un fossé qui se creuse entre les politiques et la société civile ».
Mais cet aspect est provisoirement noyé sous les flots de reportages, d'interviews, de propagande, de polémiques (c'est pourquoi on laisse même des associations féministes monter au créneau pour fustiger le sexisme et la misogynie-réelles- des dirigeants et des élites) qui servent à entretenir les divisions et la confusion dans l'opinion publique : on souligne les différences d'opinions ou de lois, on met en demeure chacun de se prononcer : faut-il défendre la présomption d'innocence ou défendre les droits de la victime ? On compare et on oppose les méthodes juridiques et les moyens d'investigation entre la France et les Etats-Unis, on compare et on oppose le traitement "éthique" de l'information entre journalistes français et la presse anglo-saxonne. Et surtout on essaie ainsi de canaliser les spéculations sur les « nouvelles donnes » afin de relancer l'intérêt pour les supposés enjeux électoraux de 2012 en France. Tout ce barouf n'est que de la poudre aux yeux, une campagne de diversion visant à éloigner les exploités de la défense de leurs intérêts de classe. Ce n'est pas vers l'affaire DSK qu'il faut se tourner mais vers les luttes sociales qui se déroulent actuellement contre le chômage, la misère, les plans d'austérité imposés par le FMI (sans DSK comme avant avec lui) et par tous les gouvernements de gauche comme de droite.
W. (22 mai)
Géographique:
- France [132]
Anarchistes et communistes débattent sur le "black bloc"
- 2309 lectures
« Je pense que nous sommes autorisés à organiser deux formes futiles de protestation – un, une marche ennuyeuse comme dans les bonnes vieilles journées d'actions syndicales allant d'un point A à un point B pré-établi, et deux, un petit «drame » de ‘violence’ révolutionnaire (naturellement, je ne le vois pas réellement comme violence) qui sera utilisé pour effrayer les gens avec les « casseurs ».1
Lors de la manifestation londonienne du 26 mars, les médias capitalistes n’ont été, c’était prévisible, que trop heureux de focaliser sur les actions de la « minorité violente » qui « a pris en otage » l’autre marche, pacifique, responsable, organisée par les vrais représentants des gens qui travaillent, le TUC. Le terme ‘anarchiste’ a été utilisé très largement pour décrire les jets de peinture, les bris de vitrine, les bombages de graffiti sur les murs des banques et des magasins chics par de jeunes gens habillés en noirs et portant des masques.
En fait, tous les gens qui ont pris part à ces actions ne se décriraient pas eux-mêmes comme des anarchistes. Quelques uns étaient probablement maoïstes ou autres gauchistes. Un plus grand nombre étaient probablement des étudiants sans attaches politiques ou des jeunes qui voulaient retrouver l’esprit combatif des manifestations et des occupations de l’automne dernier.
Cependant, il ne fait aucun doute que le cœur de cette minorité était constitué d’un « black bloc » qui est certainement inspiré par l’anarchisme et que beaucoup d’anarchistes le défendraient en tant que tactique valable dans les manifestations. Mais ce qui réfute réellement l’étiquette facile « d’anarchiste » attribuée par les médias à la « minorité violente », c’est l’existence de réels désaccords entre anarchistes et communistes libertaires au sujet de ce qui est arrivé à la manifestation du 26 mars spécifiquement, et au sujet de l’activité black bloc en général. Un exemple très clair de cette controverse est fourni pas le fil « Pris en otage par les anarchistes » sur le forum de discussion Libcom.org.
Le post qui est au début de ce fil, de « Optician de GuyDebord », pose la question du point de vue des besoins du mouvement anarchiste :
« il semble, sans surprise, que l’argument « pris en otage par les anarchistes » soit une fois de plus répandu dans la plupart des agences de médias en ce qui concerne la protestation d’hier. L’effet – à en juger d’après ma conversation avec des espèces de libéraux-gauchistes et en surfant sur Twitter – est d’avoir divisé avec succès le mouvement entre les moyens inutiles d’une marche de A à B, et le spectre terrifiant des anarchistes jeteurs de bombes, et de l’avoir enfermé à jamais dans une condamnation mutuelle. De nouveau, les anarchistes doivent-ils essayer de s’exprimer ? De toute évidence, nous savons tous que les médias appartiennent à la classe dominante etc ; mais si l’AFED ou quelqu’un envoyait une lettre, nous pourrions – pardon pour la formulation – argumenter ». (AFED ou AF est la Fédération Anarchiste, un des principaux groupes anarchistes organisés en Grande-Bretagne aujourd’hui).
Ce souci de répondre à la propagande de la bourgeoisie est repris de différentes façons. Nombre de posts disent que, quoique ce soit que fassent les révolutionnaires, ils sont confrontés à une réponse hystérique de la classe dominante et de ses médias. Quelques posts – dont certains sont des camarades impliqués dans le collectif libcom et peuvent aussi être membres de l’AF et de la fédération Solidarity, l’autre principal groupe anarchiste (‘anarcho-syndicaliste’) – ont le sentiment que les actions dans Picadilly Circus et sur Oxford Street, ont été un prolongement direct de la combativité que nous avions vue dans les manifestations étudiantes et qui a réellement poussé un assez grand nombre de gens qui n’étaient pas contents de suivre passivement la marche syndicale. Quelques uns de ces intervenants étaient impliqués dans la mise en place du Bloc des Ouvriers radicaux qui a commencé la marche à Kennington Park et s’étaient fixés comme tache, avant la manifestation, d’assurer une présence à la manif du 26 mars, « en tant que partie distincte et critique du mouvement ouvrier, comme un mouvement contre la stratégie essayée, testée, et discréditée des syndicats de négocier avec l’Etat dans notre intérêt. La faillite de cette démarche est illustrée par l’appel des TUC à une « marche pour l’alternative, emplois, croissance et justice » qui rate complètement les questions sur ce qui ne va pas dans le capitalisme. Ce ne peut être fixé par l’Etat, c’est causé par la collaboration de l’Etat et du capitalisme que les syndicats ne font rien pour ébranler. » (prise de position de la Fédération Anarchiste).
Ces intervenants n’ont vu aucune contradiction entre le travail de propagande qu’ils faisaient vis-à-vis de la marche dans son ensemble (par exemple, donner des tracts et des documents de l’AF et de la Solfed) et ce qui est arrivé un peu plus tard ce jour là, quand le Bloc des Ouvriers Radicaux semble s’être dispersé pour prendre part à ce qui se passait dans Oxford Street. Un intervenant, Raw, qui a joué un rôle clef dans la formation d’un « Bloc d’Ouvriers Combatifs » séparé, qui est parti de Malet Street en compagnie des étudiants les plus combatifs, voyait très positivement les actions de ce qui est effectivement devenu le black bloc et a absorbé en grande partie les deux blocs formés par les groupes anarchistes/libertaires et d'autres éléments, avec la conclusion que « les gens ne voulaient à aucun prix une autre grande manifestation passive où il ne se passe rien, c’était un mouvement politique audacieux de former le black bloc, qu’il puisse ou doive se produire de nouveau a besoin d’être discuté, mais je pense qu’à ce moment là, c’était la chose à faire de la journée ».
Ce qui est le plus intéressant pour nous, cependant, sur ce fil, est le fait que beaucoup d’intervenants étaient extrêmement critiques vis-à-vis de l’action minoritaire « spectaculaire » que le black bloc personnifie. Quelques uns sont de « nouveaux » intervenants dont les soucis politiques sont très éloignés de ceux du principal courant de ce forum (anarchistes communistes/anarcho-syndicalistes/communistes de conseil/communistes de gauche, etc.) ; et dans un cas (activiste syndicaliste) les arguments avancés défendent ouvertement les syndicats et sont très proches de la ligne officielle du TUC sur la légitimité de la marche contre les anarchistes illégitimes. Mais la majorité de ceux qui mettent en question la tactique du black bloc se situeraient eux-mêmes dans la tradition anarchiste et, dans quelques cas, font partie de groupes organisés comme AF et Solfed.
L’intervenant Cobbler, par exemple, écrit :
« je vais me jeter à l'eau en disant que je ne pense pas que la plus grande partie de la violence arrive à grand chose et qu'elle est probablement contre-productive.
J’ai porté le drapeau rouge et noir hier, bien que j’ai mis un point d’honneur à ne pas m’habiller en noir, et on m’a demandé plein de fois ce qu’était ce drapeau. Chaque fois, j’ai pu parler à une personne de plus de l’idéal et des objectifs anarchistes. Mais quand ces gens rentrent à la maison et voient le drapeau comme synonyme des gens habillés en noir qui cassent les vitrines et font d’autres actes de violence, alors ils perdent beaucoup de leur sympathie.
C’était déjà le même chose avec des membres de ma famille qui connaissent mes engagements politiques : tout ce dont ils veulent parler, c’est de la violence.
Je sais que marcher simplement de A à B en agitant des banderoles et en faisant du bruit n’aboutit pas à grand-chose, sauf peut être à un éveil de la conscience, et qu’il y a sans aucun doute une occasion de porter la lutte directement contre le mur capitaliste, mais je pense que nous avons besoin d’être plus avisés dans notre façon de faire ».
Bien que Cobbler ait eu l’impression de se jeter à l’eau, une dizaine d'autres intervenants « anarchistes » ont exprimé des doutes semblables, et pas d’un point de vue pacifiste ou légaliste outré.
Un membre de AF, Axiom, n’était pas content parce que, d’après ce qu’il avait vu, ceux qui cassaient des vitrines de magasin ne faisaient aucun effort pour discuter avec les travailleurs qui étaient à l’intérieur des boutiques qu’ils attaquaient. Un membre de Solfed, Rum Lad, a ressenti une différence significative entre ce qui est arrivé à Millbanks au début du mouvement étudiant et ce qui s’est passé le 26 mars : « entre les bravades d’autosatisfaction du black bloc et la passivité libérale-réformiste implicite dans le ton général donné à la marche du TUC, je pense que nous avons un chemin diablement long à faire.
Ce qui était enthousiasmant dans les manifestations étudiantes de novembre/décembre, c’était le dynamisme de beaucoup de couches sociales disparates qui s’unifiaient et qui, dans un certain sens, combattaient réellement ensemble dans les manifestations. Quand il a été affirmé que Millbanks était l’action d’un groupe minoritaire d’anarchistes, il était clair que c’était pour dire que c’était un tas de merde. Je n’ai pas vraiment eu ce sentiment hier. Chaque groupe jouait réellement son rôle pré-ordonné et je pense que chaque groupe est parti en ayant le sentiment qu’ils avaient réussi quelque chose qu’en réalité il n’avait pas fait.
Les gagnants hier ont été la police, l’Etat et les directions syndicales ».
Dans un post écrit après, Axiom donne une analyse intéressante de la tactique de la police dans la manifestation des TUC :
« Ce qui est arrivé samedi a été, je pense, en partie un résultat d’une action policière très intelligente (peut être tirée des leçons apprises de l’année dernière ?) et en partie de quelque chose dont je ne suis pas très sûr. La police voulait être absolument sûre qu’il n’y aurait pas de trouble dans la marche du TUC, comme il y avait eu avec les étudiants. Ceci s'est illustré par l’effort fait pour encadrer la marche. Je pense que la police était très heureuse de laisser un petit groupe s’attaquer à quelques boutiques parce que ça créait la division et faisait passer l’idée rébarbative d’une manifestation pacifique comme juste et positive. Je pense que plus tard dans la journée, la police a réellement été débordée par un black bloc actif et intelligent. Il est clair que la taille du black bloc s’était accrue et qu’il y avait probablement beaucoup de nouveaux et plus jeunes participants. Cependant, je pense vraiment que la gauche radicale a besoin de beaucoup discuter sur quels sont nos objectifs, et comment nous nous organisons. Cela ne signifie pas nécessairement la même chose que de se prostituer à quelque conception abstraite de la « classe ouvrière » ou à ce que notre image dans les médias devrait être. Cela veut dire que si nous croyons vraiment que le travail salarié doit être aboli, parce qu’il est la cause de la souffrance des hommes, comment enlevons nous ce joug et concrétisons le désir latent de changement social qui existe en tant que résultat de cette souffrance ?
Je ne pense pas qu’avoir un black bloc plus grand, meilleur et plus efficace soit adapté à la concrétisation des principes radicaux ».
Les posts du CCI (Miles et Alf) et un post proche de nos positions (Slothjabber) ont fait écho à ce sentiment de n’avoir eu qu’un faux choix le 26 mars. Nous avions soutenu au début la formation du Bloc des Ouvriers Radicaux à cause de ses objectifs proclamés de fournir un point de convergence pour tous ceux qui étaient en faveur des méthodes de lutte de la classe ouvrière en opposition avec les méthodes des syndicats. Mais nous avions déjà exprimé notre malaise à propos du manque de discussion publique pour préparer la manifestation et de réelle clarté sur les objectifs concrets du Bloc pendant la manifestation. Cela a conduit simplement, assez logiquement, à ce que le Bloc se disperse et aille là où « il y avait de l’action » plutôt que de mettre l’accent sur la nécessité de rentrer en contact avec la grande masse des ouvriers qui continuent à suivre la ligne syndicale. Naturellement, une minorité révolutionnaire doit toujours établir des relations avec une couche radicale plus large qui est prête à défier les syndicats et les autres formes d’autorité. Le problème, c’est que les méthodes « guerilléristes » du black bloc, plutôt que d’offrir une ouverture à la participation de grandes masses d’ouvriers – ce qui est le cas avec les grèves, les occupations, les assemblées et autres – élargissent simplement le fossé entre la minorité « radicale » et l’énorme majorité qui est encore sous le joug des syndicats et de la gauche officielle. Cette vision a été répercutée par un intervenant qui s’identifie comme communiste libertaire ou communiste de conseil, Harrison Myers : « je pense cependant qu’il aurait été beaucoup mieux de renforcer les rangs des manifestants qui ne bloquent pas, mais cherchent à établir des contacts avec les autres et à inciter les masses à l’action et à être autonomes (et pas à recruter juste comme le fait le SWP), exactement le but, comme disait Alf, pour lequel s’étaient constitués le Bloc des Ouvriers Radicaux et le Bloc des Ouvriers Combatifs ».2
En réponse à un post antérieur qui essayait de faire une distinction entre « anarchisme social de masse » et la « démarche insurrectionnelle de la minorité avant-gardiste », Raw répondait que « ce dont on a besoin, c’est d’une justification politique de ce qui arrive plus que de diviser le mouvement. « L’anarchisme social de masse » versus « la minorité insurrectionnelle avant-gardiste » est une fausse division, surtout quand c’étaient les black blocs qui étaient clairement la représentation de masse des politiques anarchistes ce jour là et qu’il n’étaient rien de moins que minoritaires dans ce contexte.
Si les communistes libertaires veulent participer au débat, ils doivent le faire plutôt de l’intérieur que de l’extérieur. Défendre ceux qui ont mené l’action et proposer quelque chose pour la stratégie à venir. Les blocages économiques et les actions pendant les grèves peuvent être la prochaine phase qui aura besoin de l’implication de beaucoup de ceux ont été attirés par le black bloc. »
Le premier paragraphe exprime très précisément le problème avec le black bloc. Même si des centaines de personnes ont été attirées par l’action du black bloc, elles sont restées « avant-gardistes » dans le pire sens du terme, un exemple de « propagande par l’acte » qui ne représente en rien un effort pour se relier à la masse des prolétaires qui étaient venus pour exprimer leur colère à l’égard de la politique de l’Etat, ni pour leur expliquer pourquoi suivre les syndicats ne peut mener qu’à une impasse.
Le second paragraphe, cependant, peut ouvrir un débat plus fructueux : d’abord, nous sommes d’accord avec le fait que nous avons à défendre les prolétaires qui sont confrontés à la répression de l’Etat même si nous ne sommes pas d’accord avec leurs actions et les considérons comme contre-productives et même irresponsables. Plus important, nous devons commencer un débat très ouvert (et pas seulement on-line) sur ce qui arrive après. La tactique des ‘blocages économiques pendant les actions de grève’ peut souvent dissimuler la même logique substitutionniste que celle des actions du black bloc qu’on a vu le 26 mars. Mais dans la mesure où des camarades, comme Raw, sont conscients qu’il est nécessaire de discuter plus largement pour préparer la nouvelle phase de la lutte de classe, et sont ouverts à l’idée que nous ne pouvons pas simplement continuer à tourner en rond en répétant le dilemme « procession domestiquée ou cassage de vitrine », un débat fructueux peut commencer à avoir lieu.
Amos(2 avril)
1 Post signé Slothjabber, sur le forum de discussion suivant: https://libcom.org/forums/news/hijacked-anarchists-27032011 [133]
2 Le même intervenant rejetait également un appel à « bannir le CCI » par un intervenant qui a tendance à répéter cette demande avec une régularité monotone. De quoi nous étions accusés en cette occasion n’est pas très clair, bien qu’il y ait eu un ou deux essais de nous accuser de répercuter la propagande des médias dans nos critiques du black bloc. Cette attaque n’a pas progressé précisément parce que nous exprimions des sentiments qui sont partagés par nombre d’autres camarades qui ne sont pas nécessairement proches de nous politiquement.
Vie du CCI:
Comprendre la période - une analyse sur la classe et sur les événements dans le monde arabe
- 1727 lectures
Nous publions ici un texte analytique de la section du CCI en Turquie sur l'actuelle vague de révoltes et de manifestations en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le texte vise à donner un aperçu général de ces mouvements, comme l'article publié dans notre dernière Revue Internationale. Que se passe-t-il au Moyen-Orient ? Le texte des camarades de Turquie offre une analyse un peu différente sur certains points, notamment sur le niveau atteint par la lutte de classes en Egypte, et si oui ou non la 'guerre civile' en cours inter-bourgeoise en Libye a été précédée par une forme de révolte sociale d'en bas. Depuis, la situation est toujours en mouvement et soulève encore beaucoup de questions, il est d'autant plus important de développer le débat sur la signification et les perspectives contenues dans ces événements.
1. Ce qui se passe et pourquoi il est important de le comprendre.
'Révolution', aujourd'hui, avec les événements actuellement en cours dans le monde arabe, ce mot semble être sur toutes les lèvres. La première chose qu'il est nécessaire de comprendre en discutant du sujet, c'est que tout le monde ne donne pas le même sens à ce mot. Le terme de révolution semble avoir été complètement dévalué, aujourd'hui, au point que toute modification dans l'équipe dirigeante est considérée comme une révolution, de la 'révolution des roses' en Géorgie à ce qu'on appelle maintenant 'la Révolution du Lotus', en Egypte, où dix-sept des vingt-sept anciens membres du cabinet sont encore au gouvernement, nous avons affaire, selon les médias, à toute une série de soi-disant 'révolutions' : la 'Révolution Orange' en Ukraine, la 'Révolution Rose' au Kirghizistan, accompagnée d'une purification ethnique, la 'Révolution du Cèdre' au Liban, la 'Révolution Pourpre' en Irak (l'expression a effectivement été utilisée par Bush, ce qui ne l'a pas rendue du tout populaire) et la 'Révolution Verte' en Iran,… la liste s'allonge encore et encore.
Pour nous, en tant que communistes, une révolution n'est pas un simple changement dans la gestion du système en place. Cela signifie un changement fondamental du système et le renversement de la classe capitaliste, et pas seulement un changement de visage. C'est pourquoi nous rejetons totalement l'idée que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe et en Iran ressemble en quoi que ce soit à une révolution. S'il ne s'agit donc pas de révolutions, cela soulève la question de ce que sont en réalité ces événements. Ce ne sont pas seulement les grands médias qui parlent de révolutions, mais aussi beaucoup ceux à gauche. Ont-ils tous tort ? Et si tous ont tort, qu'est-ce que ces événements signifient pour la classe ouvrière ?
2. Mettre les événements dans un contexte historique.
Si nous voulons essayer de comprendre les événements actuels, il est nécessaire de pouvoir les placer dans un contexte historique qui nous permet de comprendre l'équilibre des pouvoirs entre les différentes classes, et la dynamique de la situation. Certes, au cours de la dernière décennie, la classe ouvrière a commencé un lent retour à la combativité après ces terribles années qu'ont été les années 1990. Cependant, ce serait une grave erreur de penser que la lutte de classes est aujourd'hui au même niveau qu'elle était dans les années 1980, et encore moins dans les années 1970.
Alors que les dix dernières années ont montré le début d'un retour à la lutte de classes, il faut reconnaître que c'est un processus très lent. Pour la placer dans son contexte, nous devons nous reporter quelques années en arrière. La vague de luttes internationales qui a débuté en 1968 a atteint son sommet à la fin des années 1970. La grève de masse était une possibilité très réelle au niveau international. Peut-être les trois points forts de la période, dans l'ordre chronologique, sont 'L'Hiver du Mécontentement' au Royaume-Uni en 1978-79, la grève de masse en Iran en 1978-79 et les grèves polonaise de 1980-81. La défaite de ces mouvements a été catastrophique pour la classe ouvrière et a conduit aux années 1980 où la classe n'a, en général, pas été à l'offensive mais est restée dans des actions défensives. Les luttes des années 1980, bien que parfois très intense, ont essentiellement impliqué différents groupes de travailleurs isolés, et vaincus.
La période a également vu la montée du néo-conservatisme, représenté au niveau international par Reagan, Thatcher, Kohl et en Turquie, par Turgut Ozal. La fin de la décennie a vu l'effondrement de l'Union soviétique, et toute la campagne idéologique qui l'a accompagnée, avec des universitaires et des idéologues bourgeois proclamant la fin des sociétés de classes et même "la fin de l'histoire". Ils avaient certes tort, mais le manque d'activité de la classe, dans les années 1990, a semblé leur donner raison.
Au tournant du siècle, il devenait évident que les choses n'allaient pas dans le sens qu'ils avaient imaginé. Après la première défaite de Saddam Hussein, et qu'ait explosé cette illusion de "nouvelle ère de paix mondiale", le reste de la décennie a vu, malgré la"'fin de l'histoire", plus de cinquante guerres à travers le monde, une crise qui s'aggravait, non pas ouvertement comme dans ces dernières années, mais lentement, de façon rampante, frappant de façon spectaculaire certains pays, comme la Turquie et l'Argentine, et nous avons commencé à voir la classe ouvrière reprendre le chemin de la lutte.
Bien sûr, c'est arrivé lentement : dix ans sans lutte des classes, après dix années de défaite, c'est un terrible tribut pour la classe ouvrière. Une génération perdue. Souvenez-vous de ce que les gens disaient en Turquie : « Il ne faut pas parler de politique, c'est dangereux. » Cela a entraîné une perte de l'expérience vitale de la classe ouvrière.
Bien que la dernière décennie ait vu un lent accroissement des luttes, celles-ci, encore récemment ont été généralement menées par des groupes isolés de travailleurs. Ces dernières années, cependant, ont vu la prise de conscience que, pour gagner, les travailleurs doivent se battre ensemble, comme en témoigne le mouvement de TEKEL, en Turquie, ou même aux Etats-Unis, où c'était depuis tellement longtemps le calme plat par rapport à la lutte de classes, où on voit aujourd'hui que des attaques généralisées tendent vers une réponse généralisée, avec une foule de travailleurs pour soutenir les enseignants du Wisconsin (voir RI 421) et de nombreux appels à la grève générale. C'est dans ce cadre que nous devons essayer de comprendre les événements qui se déroulent aujourd'hui, et pour ce, nous devons examiner quelques luttes récentes de grande envergure.
3. Placer les événements dans le contexte des luttes récentes.
Les luttes actuelles dans le monde arabe ne sont, à notre avis, certainement pas les luttes où la classe ouvrière est la force dirigeante. Cela ne signifie pas que des masses de travailleurs ne participent pas à celles-ci, mais que la classe ouvrière n'est pas en mesure de s'affirmer en tant que classe, et a fini par être entraînée dans un combat qui n'est pas le sien, et en Libye, aujourd'hui, nous en voyons les conséquences désastreuses avec des travailleurs des deux camps participer, avec enthousiasme, à ce qui est effectivement une guerre civile, dans l'intérêt de différents chefs de cliques. Nous pensons qu'il serait utile à ce stade d'essayer de situer les événements en relation avec le mouvement récent en Grèce et en Iran.
4. Grèce
Le mouvement en Grèce en décembre 2008 a éclaté après qu'un anarchiste de quinze ans ait été abattu par deux policiers, un samedi soir. Moins d'une heure après l'assassinat, de violents affrontements avec la police ont commencé autour de la place Exarchia à Athènes, un domaine qui est traditionnellement un bastion du mouvement anarchiste. A la fin de la soirée, il y a eu des affrontements dans près de trente lieux différents à travers la Grèce. Le lendemain, les manifestations se sont poursuivies, et le lundi matin des milliers d'élèves du secondaire sont sortis et ont manifesté devant des postes de police.
Le mercredi, il y a eu une grève générale impliquant plus d'un million de travailleurs. Cette grève, ayant été organisée avant ces événements, n'était pas en réponse à l'assassinat et n'était pas liée aux manifestations. En fait, le pays était aussi dans une période de troubles sociaux importants à cause de la politique économique du gouvernement. C'est dans ce contexte que nous devons essayer de comprendre la faiblesse du mouvement grec.
Malgré la colère généralisée contre la politique du gouvernement et les protestations massives contre l'assassinat d'un enfant, les deux mouvements semblent ne s'être jamais rencontrés. Le seul soutien au mouvement de protestation a été une demi-journée de grève des enseignants du primaire. Même s'il y avait bien sûr beaucoup de travailleurs impliqués dans les manifestations, les ouvriers ne s'impliquaient pas en tant que travailleurs mais à un niveau individuel. Cela ne veut pas dire que des tentatives n'ont pas été faites pour relier cette lutte à la classe ouvrière. Des éléments combatifs ont occupé le siège de la Confédération Générale des Travailleurs Grecs à Athènes et ont appelé à une grève générale. Et pourtant, la classe ouvrière n'a pas agi en tant que classe et, finalement, les manifestations ont disparu.
Nous voyons cela comme un thème récurrent dans les luttes d'aujourd'hui: des mouvements de protestation de grande ampleur sans aucun apport véritable de la part de la classe ouvrière. Si l'on remonte aux luttes que nous avons mentionnées plus haut, au Royaume-Uni, en Iran et en Pologne, il est clair que la classe ouvrière y a joué un rôle central. Dans ces luttes d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Avant d'essayer de l'analyser, nous allons d'abord examiner un autre exemple, les luttes en Iran après les élections de l'été 2009.
5. Iran
En juin 2009, à la suite d'allégations de fraude électorale, des manifestations massives ont éclaté dans les rues de Téhéran et se sont rapidement répandues dans tout le pays. L'Etat a réagi violemment et a lancé ses forces de répression qui ont fait des centaines de morts. Alors que les protestations initiales avaient clairement pour cause la colère provoquée par la fraude électorale évidente, des slogans plus radicaux ont commencé à émerger rapidement.
De façon similaire au mouvement en Grèce, nous avons vu des affrontements massifs et violents avec les forces de l'Etat, cette fois à une échelle encore plus grande, mais encore une fois nous avons vu les travailleurs intervenir en tant qu'individus et non en tant qu'ouvriers. Bien que l'information ait circulé avec difficulté, il semble qu'il n'y avait qu'une seule grève, à l'usine automobile Khodro, qui est la plus grande usine d'Iran. Les trois quarts des ouvriers ont débrayé pendant une heure, en signe de protestation contre la répression étatique. Comme en Grèce, le mouvement dans les rues a duré quelques semaines et puis a disparu.
En mars 2007, il y a eu des luttes massives de travailleurs qui ont commencé par une forte grève de 100 000 enseignants, qui s'est propagée, pendant des mois, vers de nombreux autres secteurs. Pourtant, il y a deux ans, la classe ouvrière na pas bougé, malgré la répression massive que l'Etat avait déclenchée contre les manifestants dont la plupart appartenaient à la classe ouvrière.
Sans la force de la classe ouvrière derrière eux, les mouvements de ce genre ont tendance à s'épuiser. Ainsi, si nous nous reportons à la période de la fin des années 1970 à Téhéran, à l'automne 1978, nous avons vu un mouvement populaire, semblable à ceux que nous voyons aujourd'hui, qui, à bout de souffle, semblait s'épuiser. C'est en octobre, lorsque la classe ouvrière est entrée dans la lutte avec des grèves massives, notamment celles dans le secteur vital du pétrole, que la situation a changé et que la révolution asemblé être une possibilité réelle. Des conseils ouvriers se sont formés et le gouvernement est tombé. Ensuite, Khomeni a pris le pouvoir et l'Etat a passé plusieurs années à lutter contre les comités de travailleurs dans les usines.
Bien sûr, nous aurions pu parler d'autres luttes populaires, le mouvement des 'chemises rouges' en Thaïlande étant un exemple typique, encore un autre mouvement massif contre l'Etat, mobilisant des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, dont beaucoup étaient des travailleurs, un autre mouvement qui a duré plusieurs semaines, puis s'est éteint, car les ouvriers n'y étaient pas impliqués en tant que classe.
6. Quel est notre point de vue devant le mouvement dans le monde arabe ?
Comment avons-nous, le CCI, caractérisé la période qui a précédé la récente série de révoltes qui s'est répandue à travers le monde arabe, et dans quelle mesure avons-nous eu raison ? Nous l'avons fondamentalement perçue comme celle dans laquelle la classe ouvrière retrouve lentement sa volonté de lutter. La crise économique mondiale, réapparue en 2007, a certainement un peu changé cette dynamique, mais pas sensiblement. Il est très clair qu'elle a causé une baisse momentanée de confiance au sein de la classe ouvrière, avec la peur de lutter à cause de la possibilité de perdre son emploi. Cependant, cela peut être compensé par le grand nombre de travailleurs qui ont été obligés de lutter à cause de la gravité des attaques économiques des patrons comme de l'Etat. Ce qui est aussi important c'est le manque d'expérience au sein de la classe ouvrière elle-même et le manque de conscience des travailleurs dans leur pouvoir en tant que classe.
L'explosion de luttes massives dans des pays, y compris, mais pas seulement, la Grèce et l'Iran a été vue dans ce contexte. Les programmes d'austérité massifs qui se déroulent à travers le monde ont été considérés comme susceptibles de forcer la classe ouvrière à lutter et non pas seulement la classe ouvrière, mais aussi d'autres couches non-exploiteuses de la population poussées à des émeutes massives de la faim, dans différents pays, à travers le monde, en 2007-08. Cependant, nous avons pensé que la classe ouvrière n'était pas encore assez forte pour jouer un rôle déterminant dans ces luttes. Bien sûr, il était toujours possible que quelque chose d'autre se produise et que la classe ouvrière s'affirme en tant que telle dans la lutte. « Le jour qui précède une révolution, rien ne parait plus improbable. Le lendemain de la révolution, rien ne paraît plus probable. », a déclaré Rosa Luxemburg. Cependant nous avons estimé que le développement de la conscience ouvrière et de sa force serait un processus lent, ponctué par des révoltes massives où la classe ouvrière ne serait pas en mesure d'y jouer un rôle central.
Puis, le 17 décembre, l'an dernier, un jeune homme s'est immolé par le feu, à Idi Bouzid en Tunisie, et le monde a semblé changer.
7. Tunisie
A la suite de l'immolation de Bouaziz Mohamed, devant l'hôtel de ville, des centaines de jeunes se sont rassemblés pour protester et ont été accueillis par des gaz lacrymogènes et la violence. Des émeutes ont éclaté. Comme l'ampleur des manifestations augmentait, la ville a été bouclée par l'Etat. C'était trop tard : le feu avait déjà été mis aux poudres. Quatre jours plus tard, il y avait des émeutes à Menzel Bouzaiene, puis c'était dans la capitale Tunis. 28 jours après, le Président Ben Ali s'est enfui à Malte avant d'aller se réfugier en Arabie saoudite.
La seule chose que nous devons analyser ici en tant que communistes est la nature de classe de cette révolte. De nombreux commentateurs dans la presse grand public ont établi une analogie avec les événements d'Europe de l'Est, il y a vingt ans, où tous les leaders avaient été changés, et avec les 'révolutions de couleur', plus récentes. Pour nous, la nature de classe de ces mouvements est d'une importance centrale.
Les causes de la révolte est un mécontentement généralisé dans la classe ouvrière, le chômage de masse et les bas salaires ainsi que la colère contre un gouvernement corrompu. Le mouvement avait certainement pour centre les revendications de la classe ouvrière concernant les emplois et les salaires, et évidemment, la colère contre la répression policière a joué un rôle énorme. Le chômage de masse chez les jeunes qui représentent une écrasante majorité de la population a fait que la plus grande partie du mouvement a pris la forme d'émeutes de rue, principalement, avec de jeunes chômeurs. Cependant, il y a eu aussi de grandes grèves ouvrières, en particulier chez les enseignants et les mineurs ainsi qu'une grève générale à Sfax. L'Etat a également utilisé le lock-out pour tenter d'arrêter la propagation de la grève, une tactique que nous verrons à de nouveau été utilisée en Egypte. En outre, on a vu l'UGTT, la confédération syndicale tunisienne, prendre parti pour la lutte et faire semblant de se 'radicaliser', un signe certain qu'il y avait une combativité importante dans la classe ouvrière.
Il nous semble clair que les événements en Tunisie ont, dans l'ensemble, représenté un mouvement de la classe ouvrière. En Egypte, elle y a joué un rôle important, même si c'est dans une moindre mesure et, en Libye, elle a brillé par son absence.
Pour revenir aux événements en Tunisie, si, après la chute de Ben Ali, un 'Gouvernement d'Unité Nationale' a été annoncé : avec 12 membres du RCD de Ben Ali, ainsi que le Président et le Premier ministre qui venait de quitter le parti pour tenter de gagner en crédibilité, trois représentants des syndicats et quelques représentants individuels de petits partis d'opposition. Malgré l'assurance du Premier ministre que tous les membres du RCD dans le gouvernement avaient les 'mains propres', les manifestations se sont poursuivies. Les représentants syndicaux ont démissionné après une journée au ministère, évidemment pour conserver leur nouvelle crédibilité, et les rats ont commencé à quitter le RCD comme un navire en perdition (son comité central s'est lui-même dissout le 20).
Et alors que les protestations se poursuivaient en Tunisie et que les gouvernements continuaient à sombrer, une étincelle avait été allumée.
8. Egypte
L'Algérie a vu les premiers embrasements avec des émeutes à grande échelle frapper de nombreuses villes au début de janvier, mais c'est en Egypte que le feu a vraiment commencé à brûler. Les premières manifestations ont eu lieu lors de la Journée Nationale de la Police, le 25 janvier. Les protestations ont été largement diffusées sur les médias sociaux, et notamment avec Asmaa Mahfouz, une femme journaliste, qui a publié une vidéo sur Facebook. Les médias ont repris tout cela en l'appelant la 'révolution Facebook', mais il est préférable de rappeler que des centaines de milliers de tracts ont été distribués par divers groupes.
Les manifestations le 25 ont attiré des dizaines de milliers de personnes au Caire, et beaucoup d'autres dans les villes à travers l'Egypte. Comme le mouvement se développait, il devenait vraiment possible que Moubarak tombe tout comme Ben Ali. Le gouvernement a fait fermer les lieux de travail avec la claire intention d'arrêter l'explosion des grèves ouvrières. Il semble y avoir eu des scissions au sein de l'Etat étant donné que l'armée en tant que base organisée du pouvoir, et non pas les troupes individuelles sur le terrain, a refusé de tirer à balles réelles. Moubarak a promis de former un nouveau gouvernement, puis a promis de démissionner lors des prochaines élections en septembre. Pendant ce temps, les manifestations continuaient. Le 2 février, le ministère de l'Intérieur a organisé une attaque des manifestations par des partisans de Moubarak. L'armée est intervenue, bien que parfois du bout des lèvres, pour séparer les deux camps, préparant bien le terrain pour le cas où Moubarak serait contraint de partir. La semaine suivante, la réouverture des lieux de travail a signifié la réapparition des grèves ouvrières. Les travailleurs, dans de nombreux secteurs différents, au Caire et à travers le delta du Nil, ont entamé une grève. Ces grèves et la possibilité très réelle de leur propagation semblent être le dernier point qui a convaincu les militaires que Moubarak devait partir.
Le 11 février, le représentant de l'armée, Omar Suleiman, nouveau vice-président, annonçait que Moubarak avait démissionné et deux jours plus tard, l'armée adoptait un coup d'Etat constitutionnel. Les grévistes ont été invités à retourner au travail, et les grèves ont été interdites. Elles ont continué pendant un certain temps, mais ensuite ça a été le retour au travail, en général, après avoir obtenu des augmentations de salaire et des concessions.
La nature de classe des événements égyptiens semble différente de celles en Tunisie. Alors que le mouvement en Tunisie semble avoir eu un caractère essentiellement ouvrier, les événements en Egypte semblent avoir eu un caractère de classe largement en éventail, englobant toutes les classes sociales. Alors que la classe ouvrière y a joué un rôle important, voire crucial, elle n'en a jamais été la force dirigeante.
Beaucoup de gens de gauche ont parlé de grève de masse en Egypte. Les protestations en Egypte ont vu beaucoup plus de grèves qu'en Tunisie. Nous pouvons attribuer cela au fait que l'Egypte a une classe ouvrière plus expérimentée et combative. Même si nous croyons que le potentiel de la grève de masse était là, et que c'est ce qui a très probablement effrayé les militaires au point de se débarrasser de Moubarak, nous ne croyons pas qu'elle se soit vraiment matérialisée. En tout, environ 50 000 travailleurs ont participé à des grèves, dont plus de 20 000 travaillaient en usine. Bien que cela caractérise un mouvement important, ce n'était pas la grève de masse, et ce n'était même pas sur une aussi grande échelle que la vague de grèves en Egypte quelques années plus tôt. La rapidité avec laquelle le mouvement s'est dissipé a montré qu'il n'était pas aussi fort que beaucoup à gauche le pensaient.
9. Libye
Les protestations en Libye ont commencé le 15 janvier, et dès le début, il était clair que leur nature était très différente. Ce qui a déclenché le mouvement a été l'arrestation de Fathi Terbil, un avocat représentant des militants islamistes massacrés dans une prison, à Benghazi. La police a violemment dispersé les manifestations à Benghazi, mais cela ne les a pas empêchées de se propager à proximité de al-Bayda, ainsi que de Az Zitan à l'Ouest de Tripoli. Dans un effort visant à faire des concessions devant la propagation des manifestations, l'Etat a accordé certaines des revendications des manifestants et a libéré 110 membres d'Al-Jama'a al-Islamiyah al-Muqatilah bi-Libye, un groupe jihadiste. Les manifestations ont malgré tout continué.
L'Etat a réagi de manière extrêmement violente en utilisant ses escadrons de la mort pour démoraliser les manifestants. Des massacres de part et d'autre ont été signalés et des personnalités islamiques et des chefs tribaux ont publié des déclarations contre le régime, et ont appelé le gouvernement à démissionner. Ayant été écrasées brutalement par l'Etat à Tripoli, les manifestations se sont propagées vers l'Ouest. Au Sud, le peuple touareg a été appelé à la révolte, à la demande de la puissante tribu Warfalla.
Le 22, Kadhafi est apparu à la télévision d'Etat pour dénoncer les déclarations suivant lesquelles il aurait fui au Venezuela, et il a juré de se battre jusqu'à la dernière goutte de son sang . Le lendemain, avec l'augmentation de la taille des manifestations, de nombreux chefs tribaux qui, jusque là, avaient été silencieux, ont commencé à appeler au départ de Kadhafi. William Hague, le ministre britannique des Affaires Etrangères, a commencé à parler d'intervention humanitaire nécessaire. A partir de ce moment-là, la situation s'est clairement développée comme une guerre civile.
Et où était la classe ouvrière dans tout cela ? Dans une large mesure, la Libye, comme la plupart des Etats pétroliers du Golfe, s'appuie sur des immigrés pour accomplir la majorité de ses tâches manuelles. La grande majorité de la classe ouvrière en Libye a désespérément essayé de sortir du pays quand la situation s'est dégradée et que la violence s'est accrue. Contrairement à la Tunisie et à l'Egypte, la classe ouvrière n'a pas du tout semblé jouer un rôle important. Le mouvement, dès le départ, a semblé être dominé par l'islamisme et le tribalisme. A notre connaissance, il n'y avait pas de grèves de travailleurs, et la prétendue grève des travailleurs du pétrole dont ont parlé les médias arabes a été, par la suite, simplement une décision de fermeture de la production par la direction.
Bien sûr, il y a aussi des travailleurs libyens. Mais ils sont évidemment trop faibles pour jouer un rôle dans ces luttes en tant que classe. Cela ne signifie pas que les travailleurs n'ont eu aucun rôle dans les événements. Les manifestations qui ont eu lieu à Tripoli ont toutes semblé se produire dans des quartiers ouvriers. Cependant, la classe ouvrière était trop faible pour imposer ses propres intérêts et elle a été essentiellement utilisée comme chair à canon dans une guerre civile dans laquelle elle n'avait aucun intérêt à défendre, et elle est maintenant en train de mourir sous les bombardements américains et ceux de leurs alliés. Avant de poursuivre pour comprendre comment la guerre s'est développée et comment les puissances impérialistes s'y sont impliquées, nous allons rapidement examiner ce qui s'est passé dans d'autres pays arabes.
10. Les manifestations dans d'autres Etats et la réaction à Bahreïn
Le premier pays à suivre l'exemple de la Tunisie a été l'Algérie voisine. Les manifestations ont commencé le 3 janvier, en réponse à l'augmentation du prix des denrées alimentaires de base. Alors que les émeutes isolées étaient une chose courante en Algérie au cours des dernières années, le dernier mouvement a pris une tournure différente en ce sens qu'il s'est étendu sur l'ensemble du pays en une semaine. Les manifestations ont été essentiellement des revendications de classe, et elles ont été repoussées par un mélange de répression et de concessions.
En janvier, des manifestations sur une vaste échelle ont également débuté en Jordanie et au Yémen. En Jordanie, les protestations contre l'inflation des prix et le chômage ont été organisées par les Frères Musulmans. Elles se sont terminées lorsque le Roi a changé quelques têtes au sein du gouvernement, et a fait des concessions économiques très importantes.
Les manifestations au Yémen sont toujours en cours au moment où nous écrivons. Il semble actuellement que l'armée soit en train de changer de camp avec Ali Mohsen al-Ahmar, un général de premier plan tristement célèbre pour les massacres dans la guerre civile de 1994 qui est passé du côté des manifestants.
En dehors du monde arabe, l'Iran et la RTCN (République Turque de Chypre du Nord) ont également vu les manifestations avec la relance du 'mouvement vert' en Iran et des manifestants tués dans les rues. Bahreïn a également été un autre point focal de manifestations qui ont finalement permis à l'Arabie saoudite et au Conseil de Coopération du Golfe l'envoi de troupes pour aider à 'stabiliser' la situation, étant donné que l'Etat de Bahreïn a envoyé ses forces de répression contre les manifestants. Le mouvement à Bahreïn semble avoir pris de plus en plus une dimension sectaire avec les membres de la majorité chiite qui a été la force de premier plan dans les manifestations contre la monarchie sunnite, qui maintenant appellent ouvertement à l'intervention iranienne. Il faut ajouter que des manifestations dans les régions du nord de l'Arabie saoudite, à majorité chiite, ont eu lieu en soutien aux rebelles de Bahreïn. Bahreïn a également vu des attaques lancées contre des travailleurs étrangers, principalement d'Asie du Sud-Est par les manifestants. Des événements de ce genre ont également été signalés en Libye.
Enfin, l'armée syrienne vient de massacrer 15 manifestants devant une mosquée dans la petite ville du Sud de Daraa, qui a été le centre d'un mouvement de protestation, à cause de la colère locale après l'arrestation d'un groupe d'enfants dans une école pour avoir fait des graffitis pro-égyptiens sur un mur de l'école.
Presque inaperçues parmi tout cela ont été les manifestations en Irak, où au moins 35 personnes ont été assassinées par l'Etat. Bien sûr, l'Irak est déjà une 'démocratie' occupée par des conseillers militaires américains, ce qui explique probablement pourquoi ces meurtres sont moins médiatisés que d'autres.
11. La Libye et l'enfermement dans une guerre totale
Revenons, maintenant, à la Libye où, aujourd'hui, nous avons en cours une campagne de bombardements de l'OTAN grandeur nature. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que la Libye est bombardée par les puissances occidentales, comme lors du bombardement de Tripoli de 1986 par les Etats-Unis. En fait, le premier bombardement aérien de l'histoire a été réalisé en 1911, par l'armée italienne, dans la guerre italo-turque. Les Italiens ont bientôt mise à la mode l'utilisation de bombes et d'armes chimiques.
Fin février, il semblait que Kadhafi avait perdu l'initiative, mais, vers la mi-mars, il a repris le dessus avec treize des vingt districts qui retournaient sous le contrôle de l'Etat et deux autres qui semblaient être sur le point d'être repris. La route vers Bengahzi semblait être ouverte et la fin de la rébellion en vue. C'est à ce moment-là, le 17 mars, que la résolution 1973 des Nations Unies a été adoptée, autorisant une 'zone d'exclusion aérienne'. Après avoir obtenu de la réunion de la Ligue arabe, pauvrement représentée, avec seulement environ la moitié de ses membres qui étaient présent, l'autorisation de revenir à la campagne de bombardement, ce qui lui donnait une sorte de 'légitimité', les opérations militaires sont désormais sous contrôle de l'OTAN avec la Ligue arabe qui critique maintenant les bombardements. Il semblerait que, comme beaucoup de gens, ils avaient imaginé qu'une 'zone d'exclusion aérienne' impliquait de seulement abattre tout avion qui essaierait de bombarder des civils, et non pas une campagne de bombardements massifs assassinant des civils. C'est presque comme si l'Irak n'avait jamais eu lieu. Pour ceux qui ont la mémoire courte, il faut leur rappeler les 110 missiles Tomahawk et les bombardements par les forces aériennes britanniques et françaises, le 19 mars.
Maintenant il n'y a plus aucun doute que les événements en Libye ont dégénéré en une guerre civile tous azimuts avec les travailleurs des deux côtés qui se font massacrer au nom de ceux qui contrôlent ou qui voudraient contrôler la Libye.
12. Où en sommes-nous?
Il semble maintenant que la réaction s'est fermement installée. Les événements en Libye montrent le pire niveau de la faiblesse de la classe ouvrière et son incapacité à s'imposer en tant que classe. Dans quelle mesure le régime de Kadhafi peut-il conserver le pouvoir, cela reste à voir. Nous pensons qu'il ne faut pas oublier que, mi-février, les gens lui donnaient seulement quelques jours de survie, mais il est encore au pouvoir à Tripoli. Nous soupçonnons qu'il tiendra pendant plus longtemps qu'on ne l'imagine à l'Ouest. En ce moment, il fait appel à l'idée de protéger la patrie et de défendre la nation. La tribu Warfalla, forte d'un million de personnes et représentant près de 20% de la population est en train de pousser à la réconciliation, affirmant, de façon presque incroyable, qu'aucune personnalité tribale significative n'est impliquée dans la rébellion. A ce qu'on dit, avec d'importantes quantités d'argent liquide, la loyauté change de mains.
Au Yémen, il est de plus en plus clair que ce qui va seulement arriver sera un simple remaniement des dirigeants. Bahreïn a déjà vu une autre rébellion écrasée dans les années 1990. La Syrie réussira sans doute à vaincre le mouvement, même si cela nécessitera plus de massacres. Après tout, ceux qui se souviennent des dizaines de milliers de civils assassinés dans la ville de Hama, au début des années 1980, savent que le régime de Assad n'est pas défavorable à faire couler le sang.
Enfin, il semble que ce mouvement, qui a débuté en Tunisie, touche maintenant à sa fin. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus de meurtres de manifestants, ni même d'étranges chutes de dictateurs, comme celle, peut-être, de Ali Abdullah Saleh, au Yémen, pour être remplacés par un homme fort, un militaire. Mais le mouvement qui a éclaté à la fin de l'année dernière, avec de telles promesses, semble être plus ou moins mort pour la classe ouvrière.
13. Quelles conclusions pouvons-nous tirer ?
Pour nous, notre analyse générale de la période reste inchangée. La classe ouvrière retourne à la lutte, lentement mais sûrement, mais elle n'est pas encore assez forte pour marquer fermement son empreinte sur l'époque. Nous espérons que l'avenir nous montrera plus de luttes du même genre que les révoltes dans les Etats arabes et celles de Grèce et d'Iran. Comme l'économie continue à se dégrader, un processus qui ne peut qu'être favorisé par la hausse des prix du pétrole provoquée par la guerre en cours en Libye et le retrait massif de capitaux du Japon, qui est presque inévitable à la suite du tremblement de terre et du tsunami du 11 mars, les Etats n'auront pas d'autre solution que de recourir à une austérité et à une répression croissantes.
La classe ouvrière dans certains des pays arabes, notamment en Tunisie et en Egypte, mais aussi en Algérie, a fait un pas vers la récupération de son expérience de la lutte. Mais par ailleurs, la faiblesse de la classe ouvrière, brutalement mise en évidence par la répression et l'aggravation des tensions sectaires qui en ont résulté, sans parler de la Libye entraînée dans une guerre civile, vont presque certainement agir comme un poids important pendu autour du cou de la classe ouvrière.
Les gens de gauche qui ont parlé de révolutions ouvrières dans le monde arabe se sont avérés être dans l'erreur. La classe ouvrière est encore loin de s'affirmer. La route de la reconstruction de l'expérience perdue et de la conscience de classe sera longue. Pourtant, il y a des raisons d'espérer. La rapidité avec laquelle les militaires égyptiens ont largué Moubarak après les grèves qui ont éclaté montre que la classe dirigeante est toujours bien consciente du potentiel de la classe ouvrière. Et dans un pays lointain où les luttes ouvrières, depuis des années, brillent par leur absence, les travailleurs du Wisconsin se sont battus contre les réductions, dans la plus grande lutte que les USA ont connu depuis des années; les travailleurs y ont brandi des bannières en soutien aux travailleurs égyptiens, reconnaissant implicitement que la lutte de classes est internationale, les travailleurs du monde entier devant faire face aux mêmes attaques.
Dünya Devrimi, section du CCI en Turquie
Récent et en cours:
- Monde arabe [135]
Egypte : un changement de régime n'est pas une révolution
- 1654 lectures
Nous publions ci-dessous un article réalisé par World Revolution, organe de presse du CCI en Grande-Bretagne
Le 23 mars, l'Etat égyptien a adopté une loi interdisant les grèves et les manifestations. Combien de personnes, réfléchissant sur les bouleversements de janvier et février, ont pensé qu'il s'est simplement agi d'un 'miracle de 18 jours' ?
En réalité, les événements qui ont amené à la démission de Moubarak ne sont pas juste un feu de paille, mais ils ont des racines qui remontent à plusieurs années et ils ont impliqué des forces qui sont encore intactes aujourd'hui. Pour commencer, il convient de souligner que la révocation de Moubarak est survenue après l'action de la classe ouvrière. Parmi toutes les actions des nombreuses couches sociales réunies sur la Place Tahir, ce sont les grèves ouvrières qui ont convaincu la faction dominante de la classe dirigeante égyptienne qu'elle devait se débarrasser de ce personnage impopulaire.
Comme nous l'avons dit dans un article publié en ligne à la mi-février "la puissance de ce mouvement ne s'est pas acquise en une nuit. Pendant les sept dernières années, ce sont les travailleurs qui ont été en première ligne de résistance contre la pauvreté et la répression imposées à toute la population. Il y a eu un certain nombre de mouvements de grève en 2004, 2006-07 et 2007-08, avec les ouvriers du textile de Mahalla qui ont joué un rôle particulièrement important, mais avec de nombreux autres secteurs qui les ont rejoints." Mais aussi, comme nous l'avons dit dans Que se passe-t-il au Moyen-Orient ? , publié sur notre site à la mi-mars, se référant aux divers mouvements récents dans la région, "Nous pouvons les caractériser comme des mouvements des classes non-exploiteuses, de révoltes sociales contre l'Etat. La classe ouvrière n'a, en général, pas été à la tête de ces rébellions, mais elle a certainement eu une présence et une influence considérables."
Ainsi, bien que la classe ouvrière soit, en Egypte, une force puissante, elle n'est pas la seule classe non-exploiteuse. Et toutes sortes d'idées qui ont été avancées ces dernières années, comme celle d'offrir une 'alternative' à Moubarak, peuvent toujours être employées par la classe dirigeante capitaliste.
Observations à partir des barricades
Face à une situation complexe, il y aura toujours une variété d'explications disponibles. Fin 2009, Zed Books a publié Egypte : le moment du changement. Plus récemment, cette année, Zed a fait une réédition du livre à la lumière des derniers événements en disant qu'"avec la plupart des chapitres écrits par des universitaires égyptiens et des militants qui sont maintenant sur la première ligne des barricades, c'est le seul livre qui contient toutes les réponses." Les 'réponses' données sont assez conventionnelles : une opposition au 'néo-libéralisme', un soutien à une politique réformiste - mais quelques-unes des observations contenues donnent une bonne impression de la complexité de la situation.
Le livre décrit, par exemple, qu'il y avait de nombreux courants en concurrence dans l'opposition au président Moubarak, mais qu'ils ont pu parvenir à un consensus : "Des gens avec des aspirations radicalement différentes, allant de l'Etat laïque et socialiste à la théocratie islamiste, se sont entendus sur la nécessité de mettre fin au régime de Moubarak" (p. 98). La manière avec laquelle l'opposition manœuvrait a permis à des groupes ayant " des tendances idéologiques divergentes, des intérêts de classe divergents et des projets à long terme divergents de travailler ensemble" (p. 98). Ce fut effectivement le point de vue d'une opposition qui a vu l'élimination de Moubarak comme la priorité numéro un. Bien que la classe ouvrière ait montré sa force et sa capacité à s'organiser en dehors des syndicats officiels, il serait erroné d'ignorer les nombreuses illusions des travailleurs. A l'heure actuelle, celles sur la mise en place éventuelle de syndicats libres ou les potentialités du capitalisme post-Moubarak sont particulièrement répandues. Dans le passé, il y avait aussi des illusions sur ce que l'Etat pouvait offrir. Il y a eu des slogans populaires comme "Dans les jours de défaite, le peuple pouvait encore manger" (entonné par les grévistes en 1975) ou "Nasser a toujours dit 'prenez soin des travailleurs' (entendu en 1977)" (p. 71) qui montrent l'emprise que les mythes et l'idéologie modernes peuvent avoir. Pendant une grève en 2005, il y a eu la prétention selon laquelle "les travailleurs et le grand public étaient les véritables propriétaires des entreprises, et non les patrons" (p.78). Bien que ce soit juste une impression livrée par l'auteur, elle correspond vraiment aux idées que de nombreux travailleurs ont accepté la démagogie du capitalisme d'Etat.
Les actions des autres groupes de la société montrent la situation dans laquelle se trouvent les travailleurs. En 2006, lorsque les juges dissidents qui avaient critiqué la corruption et les malversations ont été conduits au tribunal, la foule scandait "Les juges, les juges, sauvez-nous des tyrans" (p. 99). Quelle que soit la composition sociale de la foule, il y avait visiblement des illusions sur la possibilité d'un pouvoir judiciaire indépendant, dans le processus judiciaire, plutôt que dans une lutte contre l'Etat.
Le livre décrit un autre incident où, en 1986, "des milliers de policiers en formation ont abandonné leurs casernes et marché sur le Caire et Alexandrie, démolissant de nombreux hôtels, magasins et restaurants pour protester contre leurs conditions d'esclavage .... le régime a été obligée d'amener les chars dans les rues pour vaincre ce qui était en, en effet, un soulèvement de paysans en uniforme" (p.32).
En 2007, aux côtés de protestations contre la pénurie alimentaire, il y a eu des protestations contre la pénurie d'eau potable. "Pendant plusieurs mois, il y a eu des manifestations dans le delta du Nil , impliquant un grand nombre de personnes parmi les plus pauvres du pays dans ce que les journaux du Caire appelaient une 'révolution de la soif'" (p.32-3).
Toutes ces expressions de mécontentement, toutes ces actions des différentes forces sociales sont dans l'ensemble décrites comme "différentes formes de contestations", celles-ci incluant "les mouvements sociaux, les révolutions, les vagues de grève, le nationalisme, la démocratisation, et plus encore" (p. 101).
Qu'est-ce qui fait une révolution ?
Les formes énumérées de 'contestation' couvrent un large éventail de phénomènes. Lorsque des groupes de travailleurs entrent en lutte, ils peuvent en inspirer d'autres, une grève conduisant à d'autres grèves, jusqu'à ce que toute une vague de grèves se déploie. Ce n'est pas une 'politique' ouvrière mais une expression de la solidarité et des intérêts communs de la classe ouvrière. Lorsque les travailleurs luttent, ils se heurtent à des idées nationalistes et démocratiques qui ne peuvent que saper la lutte pour la défense de leurs intérêts propres. Lorsque les mouvements sociaux des autres couches émergent, les travailleurs doivent aller à leur rencontre, tout en comprenant que la classe qui dépend du travail salarié est la seule classe qui peut défier le capitalisme.
La classe ouvrière n'a que deux armes, sa conscience et sa capacité d'organisation. Chaque question à laquelle elle est confrontée doit être considérée en termes de développement de la conscience et des implications par rapport à son auto-organisation. Comment la classe ouvrière s'organise-t-elle ? Quelles sont les idées qui contribuent au développement de la lutte et quelles sont celles qui sont pour elle un obstacle? Quelles institutions et quelles idéologies la classe dominante utilise-t-elle contre les luttes des travailleurs et le développement de sa conscience? Comment les travailleurs se rapprochent-ils des autres couches sociales non-exploiteuses ? Et, comme nous sommes actuellement inondés de références superficielles à la 'révolutions' comme une autre 'forme de contestation', qu'est-ce qu'est, réellement, une révolution ?
Au cours des deux dernières décennies toutes sortes de phénomènes sociaux ont été appelés 'révolutions', malgré le fait que la domination capitaliste n'a nulle part été renversée et que l'Etat capitaliste est partout bien établi. Si nous considérons la contribution de quelqu'un qui peut s'appuyer sur l'expérience d'une véritable révolution, celle de la Russie de 1917, les remarques de Lénine sur des situations révolutionnaires sont particulièrement pertinentes. "Pour que la révolution ait lieu, il ne suffit pas que les masses exploitées prennent conscience de l'impossibilité de vivre comme autrefois, et réclament des changements. Pour que la révolution ait lieu, il faut que les exploiteurs ne puissent pas vivre et gouverner comme autrefois. C'est seulement lorsque 'ceux d'en bas' ne veulent plus et que 'ceux d'en haut' ne peuvent plus continuer de vivre à l'ancienne manière que la révolution peut triompher" (Le gauchisme, maladie infantile du communisme, 1920).
Si l'on regarde l'Egypte, nous pouvons voir que, par rapport à tous les changements qui sont survenus et à ceux qui sont promis pour l'avenir, la classe dirigeante capitaliste reste en sécurité par rapport à sa position. Les nationalistes, les démocrates et l'opposition islamiste ont leurs divergences, mais ils ne contestent pas la domination de la bourgeoisie. Quant à la classe ouvrière, elle a montré sa force, en particulier par opposition à d'autres couches, mais elle n'est pas encore en mesure de défier le règne de ses exploiteurs. Comme partout ailleurs dans le monde, plus nous voyons des foyers de luttes ouvrières, des évolutions dans l'organisation de la lutte, et la preuve de l'abandon des illusions, plus nous pouvons nous attendre à des grèves massives et à une confrontation ouverte entre la classe ouvrière et la bourgeoisie au pouvoir.
Barrow (1er avril)
Récent et en cours:
- Monde arabe [135]
Tolstoï, penseur social
- 4607 lectures
Voici un peu plus de cent ans, en novembre 1910, disparaissait un géant de la littérature mondiale, Léon Tolstoï.1 A cette occasion, nous republions un article, à notre connaissance inédit en français, que Rosa Luxembourg lui consacra en 1908 pour le 80e anniversaire de la naissance du grand romancier.
La célébration de cet anniversaire fut un évènement de portée mondiale, provoquant de nombreuses manifestations et des prises de position de tous les courants politiques en Russie et en Europe. En effet, connu pour son messianisme mystique, ses critiques radicales de l’ordre établi et pour prôner l’insoumission non-violente au tsarisme, Tolstoï, avait, peu de temps auparavant, lancé un appel contre les exécutions massives pratiquées par le gouvernement du tsar après la révolution de 1905.
Nombreux furent donc également les militants du mouvement ouvrier à avoir dédié articles et commentaires à Tolstoï tout autant sur la signification de son œuvre littéraire que sur son message politique. Lénine, qui vouait une profonde admiration à Tolstoï l’artiste, organisa en 1911 plusieurs conférences publiques en France et en Allemagne sur « l’importance historique de Tolstoï ». Plékhanov, lui, ne voyait schématiquement en celui-ci qu’un grand seigneur ayant « tranquillement joui des biens de la vie que lui procurait sa situation privilégiée »2 et finalement incapable d’échapper, malgré sa révolte, à l’idéal de la classe sociale supérieure. et Trotski tendait unilatéralement à considérer Tolstoï uniquement comme un vestige de l’aristocratie et comme l’expression d’un passé révolu3 ; Lénine s’attacha ainsi, au-delà des aspects réactionnaires de Tolstoï et, contrairement encore aux nombreux sociaux-démocrates qui, confondant Tolstoï et le tolstoïsme, rejetaient en bloc l’œuvre et son idéologie, à comprendre l’œuvre de Tolstoï comme une expression des contradictions de la société russe de l'époque et à mettre en lumière la force de sa protestation sociale. Ce qui lui importait avant tout, c’était de juger Tolstoï à partir de « sa protestation contre l’intrusion du capitalisme, contre le ruine des masses dépouillées de leur terre, protestation qui devait venir de la campagne patriarcale russe. » En suivant la même démarche, Rosa Luxembourg propose une vision de Tolstoï encore plus large et plus audacieuse. Tout en exerçant une critique acérée des faiblesses politiques de Tolstoï, elle perce à jour la véritable nature du projet pour l’humanité qui gît dans le cœur du grand écrivain et reconnaît en lui, dans la critique radicale de l’ordre établi, dans sa vision et ses rêves d’émancipation de l’homme, une démarche identique à celle des socialistes utopistes, c'est-à-dire de ce socialisme du tout début du mouvement ouvrier, qui, sans comprendre ni le rôle de la classe ouvrière ni celui de la révolution communiste pour l’émancipation de l’humanité, se place pourtant dans cette même perspective de la libération du joug du capital.
TOLSTOÏ, PENSEUR SOCIAL
Depuis toujours, le romancier le plus génial du temps présent a aussi été un infatigable artiste et un infatigable penseur social. Les questions fondamentales de l’existence humaine, les relations entre les hommes, les rapports sociaux ont depuis toujours profondément préoccupé la sensibilité la plus intime de Tolstoï, et l’ensemble de sa longue vie et de son œuvre a été en même temps une inlassable réflexion sur « la vérité » dans l’existence humaine. Ordinairement, on prête également la même quête infatigable de la vérité à un autre célèbre contemporain de Tolstoï, Ibsen. Mais, alors que dans les drames d’Ibsen la grande lutte entre les idées s’exprime de façon grotesque dans un théâtre de marionnettes pleines de suffisance et presque incompréhensibles, où Ibsen l’artiste succombe pitoyablement à l’insuffisance des efforts d’Ibsen le penseur, la pensée de Tolstoï ne nuit jamais à son génie artistique. Dans chacun de ses romans, cette tâche du penseur incombe à quelqu’un qui, dans le remue-ménage des personnages débordants de vie, joue le rôle un peu gauche et un peu ridicule de l’individu en quête de la vérité, du raisonneur perdu dans ses rêves, tels Pierre Bézoukhov dans Guerre et Paix , Lévine dans Anna Karénine ou le prince Nekhlioudov dans Résurrection . Ces personnages, qui, constamment, expriment les pensées, les doutes et les problèmes propres de Tolstoï, ne sont en général sur le plan artistique qu’extrêmement faiblement et vaguement décrits ; ils sont plus des observateurs de la vie que des acteurs de celle-ci. Mais la puissance créatrice de Tolstoï est à elle seule si forte, qu’il se trouve lui-même incapable de galvauder ses propres œuvres, quelle que soit la manière dont, en insouciant créateur comblé par le ciel, il les maltraite. Et lorsqu’avec le temps Tolstoï le penseur l’emporte sur l’artiste, cela arrive, non pas parce que son génie artistique se tarit, mais parce que la gravité profonde du penseur lui commande le silence. Si, dans la dernière décennie, Tolstoï, au lieu de sublimes romans, n’a écrit que des traités ou des essais sur la religion, l’art, la morale, le mariage, l’éducation, la question ouvrière, désolants sur le plan artistique, c’est parce qu’au terme du ressassement de ses réflexions, il est parvenu à des conclusions qui lui font considérer sa création artistique personnelle comme une futilité.
Quelles sont ces conclusions, quelles sont les idées que le vieux poète défend et défendra encore jusqu’à son dernier souffle ? En résumé, l’optique de Tolstoï est connue comme renonciation aux conditions existantes, y compris la renonciation à toute forme de lutte sociale, en faveur d’un « véritable christianisme ». A première vue, cette orientation spirituelle semble réactionnaire. Tolstoï est cependant garanti contre toute suspicion que le christianisme qu’il prêche ait quoi que ce soit à voir avec la foi de l’Eglise officielle établie, du fait de l’excommunication publique dont l’Eglise d’Etat orthodoxe russe l’a frappé. Mais même l’opposition à l’ordre établi s’irise de couleurs réactionnaires quand elle se drape de formes mystiques. Mais un mysticisme chrétien, qui exècre toute lutte et toute forme de recours à la violence et qui prêche la « non rétorsion », apparaît doublement suspect dans un milieu social et politique comme celui de la Russie absolutiste. En fait, l’influence de la doctrine tolstoïenne sur la jeune intelligentsia russe – une influence du reste qui n’eut jamais une grande portée et s’exerça seulement sur de petits cercles – se manifeste à la fin des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix, c’est-à-dire dans une période de stagnation de la lutte révolutionnaire, par la diffusion d’un courant éthique et individualiste indolent qui aurait pu constituer un danger direct pour le mouvement révolutionnaire, s’il ne s’était pas cantonné dans le temps et dans l’espace à une simple péripétie. Et finalement, confronté directement au drame de la révolution russe, Tolstoï se tourne ouvertement contre la Révolution, tout comme il avait déjà dans ses écrits pris position explicitement et abruptement contre le socialisme et combattu la doctrine marxiste comme une aberration et un aveuglement monstrueux.
Certainement, Tolstoï n’est pas et n’a jamais été un social-démocrate ; il n’a jamais montré la moindre compréhension pour la social-démocratie et le mouvement ouvrier moderne. Mais il est vain d’aborder un phénomène spirituel de l’envergure et de la singularité de Tolstoï à l’aide d’une piètre scolastique rigide et de le juger d’après ses règles. Le rejet du socialisme en tant que mouvement et système théorique peut, selon les circonstances, émaner non de la faiblesse, mais de la force d’un intellect ; et c’est justement le cas en ce qui concerne Tolstoï.
D'une part, ayant grandi dans l’ancienne Russie de Nicolas 1er et du servage, à une époque où, dans l’empire des tsars, il n’existait ni mouvement ouvrier moderne, ni sa nécessaire pré-condition économique et sociale, un puissant développement capitaliste, Tolstoï fut, en plein âge mûr, témoin de l’échec d’abord des piètres commencements d’un mouvement libéral, puis du mouvement révolutionnaire sous la forme du terrorisme de la « Narodnaïa Volia », pour connaître presque septuagénaire les premiers pas vigoureux du prolétariat industriel et finalement, comme vieillard à l’âge avancé, la révolution. Ainsi, n’est-il pas étonnant que, pour Tolstoï, le prolétariat russe moderne avec sa vie spirituelle et ses aspirations n’existe pas et que, pour lui, le paysan, et même l’ancien paysan russe profondément croyant et passivement tolérant, qui ne connaît qu’une seule passion, posséder plus de terre, représente définitivement le type même du peuple.
Mais d’autre part, Tolstoï, qui a vécu toutes les phases critiques et l’ensemble du processus douloureux du développement de la pensée publique russe, fait partie de ces esprits indépendants et géniaux qui ont beaucoup plus de mal que les intelligences moyennes à se plier à des formes de pensées étrangères et à des systèmes idéologiques constitués. Pour ainsi dire autodidacte-né – non pas en ce qui concerne l’éducation formelle et la connaissance mais en ce qui concerne la réflexion – il se doit de parvenir à chacune de ses idées selon sa propre voie. Et si ces voies paraissent à d’autres généralement incompréhensibles, et leurs résultats bizarres, l’audacieux solitaire parvient cependant ainsi à une largeur de vues impressionnante.
Comme chez tous les esprits de cette trempe, la force de Tolstoï et le centre de gravité de sa réflexion ne résident pas dans la propagande positive mais dans la critique de l’ordre établi. Et là, il atteint une polyvalence, une exhaustivité et une audace qui rappellent les vieux classiques du socialisme utopiste, tels Saint-Simon, Fourier et Owen. Il n'y a aucune des institutions sacrées de l'ordre social établi qu’il n’ait impitoyablement décortiquée et dont il n’ait démontré l’hypocrisie, la perversion et la corruption. L’Église et l’État, la guerre et le militarisme, le mariage et l’éducation, la richesse et l’oisiveté, la dégradation physique et spirituelle des ouvriers, l'exploitation et l'oppression des masses populaires, les rapports entre les sexes, l’art et la science dans leur forme actuelle – il les soumet toutes à une critique impitoyable et dévastatrice, et cela du point de vue des intérêts communs et du progrès culturel de la grande masse. Si on lit par exemple les premières phrases de La Question ouvrière, on a l’impression de tenir en main une brochure d'agitation socialiste populaire :
« Dans le monde entier, il y a plus d’un milliard, des milliers de millions de travailleurs. L’ensemble des céréales, des marchandises du monde entier, tout ce dont les hommes vivent et tout ce qui fait leur richesse, sont le produit du peuple travailleur. Cependant, ce n’est pas uniquement le peuple travailleur, mais le gouvernement et les riches qui jouissent de tout ce qu'il produit. Le peuple laborieux vit dans une détresse perpétuelle, l’ignorance, l’esclavage et le mépris de tous ceux qu’il vêtit, nourrit, pour qui il bâtit et qu’il sert. Il a été spolié de sa terre devenue la propriété de ceux qui ne travaillent pas, si bien que l’ouvrier est dans l’obligation de faire tout ce que le propriétaire terrien exige de lui pour vivre de ses terres. Si toutefois le travailleur quitte le pays et va à l'atelier, il tombe dans l'esclavage des riches, chez lesquels il devra accomplir toute sa vie 10, 12, 14 heures ou plus encore par jour d’un travail étranger, monotone et souvent préjudiciable à la vie. Mais même s’il réussit à s’installer au pays ou à émigrer pour ne parvenir à vivre qu’à grand-peine, on ne le laisse pourtant pas tranquille, mais on lui réclame des impôts, on le réquisitionne pour trois, cinq ans de service militaire, on le contraint à payer des taxes extraordinaires pour l’effort de guerre. S’il veut utiliser la terre sans payer de rentes, faire grève ou empêcher les non-grévistes de prendre sa place ou refuser les impôts, alors on envoie contre lui l’armée qui le blesse, le tue ou le contraint par la force, après comme avant, à travailler et à payer… Et c’est ainsi que la plupart des hommes vivent dans le monde entier, non seulement en Russie, mais aussi en France, en Allemagne, en Angleterre, en Chine, en Inde, en Afrique, partout. »
L’acuité de sa critique du militarisme, du patriotisme, du mariage est à peine surpassée par la critique socialiste et se meut dans la même direction qu’elle. L’originalité et la profondeur de l’analyse sociale de Tolstoï se révèlent par exemple dans la comparaison entre son point de vue et celui de Zola sur le sens et la valeur morale du travail. Tandis que ce dernier, dans un esprit vraiment petit-bourgeois, met le travail sur un piédestal, ce pour quoi il est considéré par maints sociaux-démocrates français et autres comme un socialiste de la plus belle eau, Tolstoï, en peu de mots, frappe dans le mille en remarquant tranquillement que :
« Monsieur Zola dit que le travail rend l’homme bon ; j'ai toujours remarqué le contraire : le travail en tant que tel, la fierté de la fourmi de son travail, rendent non seulement la fourmi, mais aussi l’homme, cruels… Mais si même la diligence au travail n'est pas un vice déclaré, elle ne peut en aucun cas être une vertu. Le travail peut tout aussi peu être une vertu que l’alimentation. Le travail est un besoin qui, s'il n'est pas satisfait, constitue une souffrance et non pas une vertu. Faire du travail une vertu est tout aussi faux que de faire de l’alimentation de l’homme une dignité ou une vertu. Le travail n’a pu acquérir la signification qu’on lui attribue dans notre société que comme réaction à l’oisiveté, dont on a fait le caractère distinctif de l'aristocratie et que l’on considère encore comme un critère de dignité parmi les classes riches et peu éduquées… Le travail non seulement n'est pas une vertu, mais dans notre société mal organisée, c’est en grande partie un agent mortifère de la sensibilité morale. »
Ce à quoi la formule du Capital « La vie du prolétariat commence quand cesse son travail », forme un sobre complément. La comparaison entre les deux jugements de Zola et de Tolstoï sur le travail, révèle justement le rapport entre ces derniers dans le domaine de la pensée comme dans celui de la création artistique : celui d’un artisan probe et talentueux à un génie créateur.
Tolstoï critique tout ce qui est établi, déclare que tout est voué à dépérir et il prédit l’abolition de l’exploitation, l’obligation générale du travail, l’égalité économique, l’abolition de la coercition dans l’organisation de l’Etat comme dans les relations entre les sexes, la complète égalité entre les hommes, les sexes, les nations et la fraternisation entre les peuples. Mais quelle voie peut nous conduire à ce bouleversement radical de l’organisation sociale ? Le retour des hommes au seul et simple principe du christianisme : l’amour de son prochain comme de soi-même. On constate que Tolstoï est ici un pur idéaliste. Il veut par la renaissance morale des hommes la transformation de leurs rapports sociaux et l’accomplissement de cette renaissance par la prédication et l’exemple. Et il ne se lasse pas de répéter la nécessité et l'utilité de cette « résurrection morale » avec une ténacité, une certaine pauvreté de moyens et un art mi-naïf mi-rusé de la persuasion, qui rappellent vivement les formulations impérissables de Fourier concernant l’intérêt personnel de l’homme, qu’il chercha sous les formes les plus diverses à mobiliser pour ses plans sociaux.
L'idéal social de Tolstoï n’est ainsi rien d'autre que le socialisme. Pour appréhender de la manière la plus frappante le noyau social et la profondeur de ses idées, on ne doit pas s'adresser à ses traités sur les questions économiques et politiques, mais à ses écrits sur l'art qui comptent d'ailleurs aussi parmi ses œuvres les moins connues en Russie. Le raisonnement que Tolstoï développe brillamment est le suivant : l’art - contrairement à l’opinion de toutes les écoles philosophiques et esthétiques - n’est pas un luxe destiné à déclencher dans les belles âmes les sentiments de beauté, la joie ou autres choses semblables, mais il est au contraire une importante forme historique de la communication sociale des hommes entre eux, comme le langage. Après avoir dégagé ce critère vraiment matérialiste historique par une savoureuse mise en pièces de toutes les définitions de l’art de Winckelmann à Kant en passant par Taine, Tolstoï, à l’aide de celui-ci, s’attaque à l’art contemporain et constate, vu qu’il ne s’accorde à la réalité dans aucun domaine ni à aucun point de vue, que l’art existant dans son ensemble – mis à part quelques petites exceptions – est incompréhensible à la grande masse de la société, à savoir le peuple laborieux. Au lieu d’en conclure suivant l’opinion commune à la barbarie spirituelle de la grande masse et à la nécessité de son « élévation » à la compréhension de l’art actuel, Tolstoï en tire la conclusion inverse. Il déclare l’ensemble de l’art existant comme « faux art ». Et la question, comment se fait-il que nous ayons depuis des siècles un « faux art » au lieu d’un art « véritable », c'est-à-dire populaire, l’amène à un autre point de vue audacieux : il y eut un art véritable dans les temps très anciens lorsque l’ensemble du peuple avait une vision du monde commune – que Tolstoï nomme « religion » – d’où sont nées les œuvres telles que l’épopée d’Homère ou les Evangiles. Depuis que la société s’est divisée entre une grande masse exploitée et une petite minorité dominante, l’art ne sert plus qu’à exprimer les sentiments de la minorité riche et oisive, mais comme celle-ci a aujourd’hui perdu toute vision du monde, c’est pourquoi nous avons la dégénérescence et le déclin qui caractérisent l’art moderne. Selon Tolstoï, l’« art véritable » ne pourra réémerger que si, d’un moyen d’expression de la classe dominante, il redevient un art populaire, c'est-à-dire une expression de la vision du monde commune de la société laborieuse. Et, d’un énergique revers de main, il expédie aux enfers du « mauvais faux art » les œuvres mineures comme majeures des étoiles les plus connues de la musique, de la peinture, de la poésie et, pour finir, l’ensemble admirable de ses œuvres personnelles. « L'heureux monde ! (…) Il est en ruines ! Un demi-dieu l'a renversé! »4 Dés lors il n’écrivit plus qu’un dernier roman – Résurrection – sinon il tint seulement pour respectable de n’écrire que de simples et courts contes populaires ou des essais « compréhensibles à chacun ».
Le point faible de Tolstoï – la conception de toute la société de classes comme une « aberration » plutôt que comme une nécessité historique qui réunit les deux extrémités de sa perspective historique, le communisme primitif et l’avenir socialiste – est évident. Comme tous les idéalistes, il croit aussi à la toute-puissance de la force et explique toute l'organisation de classe de la société comme le simple produit d’une longue chaîne de purs actes de violence. Mais il y a une grandeur véritablement classique dans la réflexion de Tolstoï sur l’avenir de l’art qu’il voit à la fois comme l’union de l’art, en tant que moyen d’expression, aux sentiments sociaux de l’humanité laborieuse et à la pratique de celui-ci ; c'est-à-dire la fusion de la carrière d’artiste avec la vie normale de tout membre laborieux de la société. Les phrases avec lesquelles Tolstoï fustige l’anormalité du mode de vie de l’artiste actuel qui ne fait rien d’autre que « vivre son art » possèdent une force lapidaire, et il y a là un radicalisme vraiment révolutionnaire quand il brise les espoirs qu’une réduction du temps de travail et une élévation de l’éducation des masses leur procurent une compréhension de l’art tel qu’il existe aujourd’hui :
« C’est tout ce que disent avec passion les défenseurs de l’art actuel, cependant je suis convaincu qu’eux-mêmes ne croient pas à ce qu’ils disent. Ils savent bien que l’art tel qu’ils le comprennent a pour condition nécessaire l’oppression des masses et qu’il ne peut même se maintenir que par le maintien de cette oppression. Il est impératif que les masses d’ouvriers s’épuisent au travail pour que nos artistes, écrivains, chanteurs et peintres atteignent ce degré de perfection qui leur permette de nous procurer du plaisir… Même en supposant possible cette impossibilité et que l’on trouve un moyen de rendre accessible au peuple cet art tel qu’on le comprend, une considération s’impose qui prouve qu’il ne peut pas être un art universel : le fait qu’il est complètement incompréhensible pour le peuple : auparavant les poètes écrivaient en latin, et cependant les productions de nos poètes aujourd’hui sont tout aussi peu compréhensibles pour le peuple que si elles étaient écrites en sanscrit.
On répondra maintenant que c’est la faute du manque de culture et de développement du peuple, et que notre art pourra être compris de tous dés que celui-ci aura bénéficié d’une éducation satisfaisante. C’est à nouveau une réponse absurde, car nous constatons que de tout temps l’art des classes supérieures n’a jamais été pour elles qu’un simple passe-temps, sans que le reste de l’humanité en comprenne quoi que ce soit. Les classes inférieures peuvent se civiliser tant et plus, l’art, qui dés le départ n’a pas été créé pour elles, leur restera constamment inaccessible… Pour l’homme pensant et sincère, c’est un fait incontestable que l'art des classes supérieures ne pourra jamais devenir l’art de l’ensemble de la nation. »
L’auteur de ces mots est dans l’âme plus socialiste et matérialiste historique que ces membres du parti, qui, se mêlant à la dernière extravagance artistique, veulent avec un zèle irréfléchi « éduquer » les ouvriers sociaux-démocrates à la compréhension du barbouillage décadent d’un Slevogt ou d’un Hodler.
C’est ainsi que Tolstoï, pour sa force comme pour ses faiblesses, pour le regard profond et aigu de sa critique, le radicalisme audacieux de ses perspectives comme pour sa foi idéaliste en la puissance de la conscience subjective doit être placé parmi les grands utopistes du socialisme. Ce n’est pas sa faute, mais sa malchance historique que sa longue vie s’étende du seuil du 19e siècle, époque où Saint-Simon, Fourier et Owen se tenaient comme précurseurs du prolétariat moderne, au seuil du 20e siècle où, solitaire, il se trouve sans le comprendre face à face avec le jeune géant. Mais pour sa part, la classe ouvrière révolutionnaire mûre peut avec un sourire de connivence serrer la main honnête du grand artiste et de l’audacieux révolutionnaire et socialiste malgré lui, auteur de ces bonnes paroles : « Chacun parvient à la vérité selon sa propre voie, il faut, cependant, que je dise ceci : ce que j'écris ne sont pas seulement des mots, mais je le vis, c’est mon bonheur, et je mourrai avec. »
Paru dans la Leipziger Volkszeitung, N°. 209 du 9 Septembre 1908
1 Pour plus de détails biographiques sur Tolstoï, voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Léon_Tolstoï [136]
2 Plekhanov, L’art et la vie sociale, Editions Sociales, p. 313
3 Trotski, Léon Tolstoï, 15 septembre 1908, https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/litterature/tolstoi.htm [137]
4 Goethe, Faust, 1808, (NdT)
Personnages:
- Tolstoï [138]
Une perte douloureuse pour le CCI : la mort du camarade Enzo
- 1763 lectures
C’est avec une grande douleur que nous donnons cette nouvelle à nos lecteurs et contacts de la mort de notre camarade Enzo le dimanche 15 mai. Malgré la maladie, rien ne laissait prévoir une fin aussi tragique que soudaine. La nouvelle de sa mort a frappé tout le monde comme la foudre, nous laissant hébétés et en même temps, avec le regret de ne pas avoir pu lui apporter notre présence dans les derniers moments de sa vie.
Quelques contacts du CCI en Italie ont connu Enzo et ont exprimé le même désarroi et la même douleur face à sa disparition, pas seulement comme militant communiste mais aussi parce que dans son activité politique, dans ses interventions dans les réunions publiques, dans les discussions, il exprimait toute sa peine face aux souffrances que le capitalisme fait subir au genre humain, quelquefois les larmes aux yeux. Enzo était un jeune prolétaire qui a subi dans sa propre chair l’exploitation, le chômage et finalement le licenciement mais qui, en même temps, était aussi convaincu qu’on peut réagir, qu’on peut lutter contre toute cette barbarie et construire une société véritablement humaine. Son militantisme dans le CCI a toujours été caractérisé par cette conviction et sa détermination, même dans des situations difficiles, à contribuer à ce combat. Sa mort est une perte pour le CCI et pour l’ensemble de la classe ouvrière.
Nous voulons cependant dès maintenant renouveler notre solidarité à la famille d’Enzo, ses parents, ses amis dans un moment qui nous rapproche dans le chagrin et redire notre détermination à continuer le combat pour une société humaine pour laquelle Enzo a combattu à nos côtés.
CCI (19 mai 2011)
ICConline - juin 2011
- 1815 lectures
A Madison (Wisconsin) comme ailleurs, la défense des syndicats prépare la défaite ouvrière
- 2143 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d'un article repris d' Internationalism, organe du CCI aux Etats-Unis sur notre site en langue anglaise.
Après des semaines de manifestations qui ont attiré l'attention de la presse nationale et même internationale, les rues de Madison sont à nouveau vides. Le projet de loi Scott Walker de sauvetage du budget d'Etat est passé (en attente d'un recours à la cour d'appel), et où, une fois que les cris de 'grève générale' eurent retenti dans une foule de milliers de manifestants, le silence est retombé et les travailleurs sont de nouveau retournés au travail. Les dirigeants syndicaux se démènent pour faire passer toutes les exigences économiques du gouverneur du Wisconsin en échange du droit à la 'négociation collective' d'un contrat précédent. l'action des travailleurs a été réduite à la signature de pétitions pour en appeler à la révocation des sénateurs de l'Etat. Alors que certains essaient de raviver le mouvement, il a été largement vaincu. La question est : pourquoi ?
Partout aux Etats-Unis, les travailleurs du secteur public sont pris pour cible et attaqués au nom de la solvabilité budgétaire de chaque Etat. La plupart des gouverneurs d'Etat sont en attente de coupes budgétaires représentant des centaines de millions de dollars, escomptées à travers le non-renouvellement des accords de conventions collectives avec les syndicats des employés du secteur public, pour couvrir leurs déficits budgétaires colossaux. Pour atteindre au mieux cet objectif, la bourgeoisie a lancé une vaste campagne visant à diaboliser les travailleurs syndiqués du secteur public comme jouissant d'une surcompensation et de privilèges au détriment du 'contribuable'. Les Etats de l'Ohio et du Nebraska ont adopté une législation similaire à celle de Walker pour le Wisconsin, et de nombreux autres Etats envisagent des projets de loi similaires. Pendant ce temps, les syndicats ont appelé à des rassemblements de solidarité dans tout le pays pour la défense du 'droit' à la négociation des conventions collectives, se présentant comme le dernier et meilleur recours que les ouvriers ont pour entretenir la défense de la 'démocratie' et des 'emplois de la classe moyenne'. Pour comprendre la défaite du mouvement dans le Wisconsin et se préparer à de nouvelles attaques à venir, nous devons examiner ces campagnes idéologiques. Nous devons comprendre comment elles ont contribué à faire dérailler le mouvement dans le Wisconsin et comment elles peuvent seulement livrer la classe ouvrière pieds et poings liés aux attaques de la bourgeoisie.
Les médias officiels présentent la vague d'austérité comme étant des mesures nécessaires au niveau de l'Etat, et le mouvement de masse dans le Wisconsin comme une épreuve de force entre les gouverneurs nouvellement élus du très réactionnaire Tea Party républicain mettant à l'ordre du jour le démantèlement des syndicats, et les syndicats des employés du secteur public, alignés sur le parti démocrate. Les syndicats et la gauche ont aussi colporté ce récit. Ils ont mis l'accent sur la défense du 'droit à la négociation collective des salariés' dans leurs rassemblements de solidarité, dans leurs lettres officielles, et maintenant dans leur campagne pour faire révoquer les sénateurs républicains dans l'Etat du Wisconsin. Ce récit occulte la réalité de la situation pour les travailleurs, et pousse les travailleurs qui l'acceptent à être plus favorables aux 'solutions' avancées par la bourgeoisie.
Le secteur public aux USA
Même s'il est vrai que le gouverneur Walker, le gouverneur Kasich de l'Ohio, et quelques autres gouverneurs soutenus par le Tea Party sont idéologiquement motivés dans leurs tentatives de mettre fin à la négociation collective et pour démanteler les syndicats, les problèmes de leur propre état financier et leur besoin d'attaquer le niveau de vie des employés du secteur public, sont bien réels. Ils sont aux Etats-Unis sous le contrôle des deux partis. Tous, sauf 6 Etats américains font face à des déficits budgétaires massifs pour l'année fiscale 20111 . Les déficits cumulés des Etats fédéraux, pour l'année 2013, devrait atteindre 175 milliards de $, ce qui est un chiffre proportionnellement bien plus élevé que les 230 milliards de $ qui est le déficit total des trois derniers exercices2. Les gouverneurs des deux partis se préparent à des attaques sur les salaires travailleurs de l'Etat et sur leurs pensions, et même à mettre fin au droit de négociation collective, pour les aider à combler ces lacunes budgétaires. Le gouverneur nouvellement élu du Connecticut, le démocrate Daniel Malloy, exige 1 milliard de dollars d'économies provenant des employés de l'Etat pour chacune des deux prochaines années, soit la réduction la plus importante par habitant de tous les Etats. Le démocrate Jerry Brown en Californie a imposé un gel de l'embauche dès février 2015, dans la négociation de son budget, et un autre démocrate Andrew Cuomo de l'Etat de New York a annoncé un gel des salaires d'un an pour les travailleurs de l'Etat dans le cadre d'un plan d'urgence financière, au-dessus des 450 millions de dollars déjà concédés, au nom des travailleurs, par les syndicats du secteur public.
Les enseignants des universités publiques qui ont de mauvais résultats sont blâmés pour les tests scolaires et les taux d'obtention des diplômes, et les conseils de classe comme les syndicats d'enseignants sont en train de débattre de la rémunération au mérite et de le remise en cause de la sécurité d'emploi. Les enseignants sont dressés les uns contre les autres, avec de jeunes enseignants à qui on dit que la rémunération au mérite leur donnera tous les avantages liés à la jeunesse, tandis qu'aux enseignants plus âgés on dit que l'acceptation de nouveaux niveaux pour les pensions protégera leur emploi dans le cas de licenciement. La bourgeoisie tente de désamorcer une forte démonstration de solidarité entre les jeunes et les anciens, entre les étudiants et les ouvriers. La classe ouvrière a démontré cette solidarité dans nombre de ses grandes mobilisations puisque les travailleurs des transports en commun à New York City ont fait grève contre les réductions de pensions qui touchent principalement les travailleurs non encore embauchés.
Dans tous ces cas, les deux partis se sont unis dans la poursuite et l'adoption des mesures d'austérité draconiennes contre les travailleurs du secteur public. Contrairement au récit des médias, des syndicats et de la gauche, les syndicats travaillent en collaboration avec les gouverneurs des Etats, par le biais des négociations collectives, pour décider comment mettre en œuvre les attaques. Ils exercent ainsi une pression sur les travailleurs en leur promettant de mener une lutte ou d'élire des gouverneurs différents et leur assurent qu'un avenir meilleur est juste au coin de la rue, s'ils acceptent les 'sacrifices' d'aujourd'hui. Dans l'Etat de New York, les syndicats ont organisé un nombre incalculable de rassemblements de 'solidarité' en faveur de la négociation collective dans le Wisconsin, mais ils n'ont rien dit quant à la perspective des licenciements dans l'éducation. Ils ont même soutenu des initiatives de rémunération au mérite pour les enseignants. Les syndicats, au milieu de la leur campagne nationale sur le besoin de solidarité, font des rassemblements avec des travailleurs déjà résignés dans le Wisconsin, dont le seul combat actuel est une campagne de réélection à laquelle seuls les résidents du Wisconsin peuvent participer, et déjà ils acceptent tous les licenciements et augmentations des cotisations proposés pour leurs propres membres. Quel rôle les syndicats jouent-ils vraiment?
Les syndicats du secteur public, loin de défendre les travailleurs qu'ils représentent, ne remettent pas en question la nécessité pour les travailleurs de 'faire des sacrifices'. Ils ont seulement mobilisé afin de maintenir leur position en tant que « partenaires privilégiés » de l'Etat pour l'application des réductions nécessaires à la santé du capitalisme américain. Depuis le début du mouvement dans le Wisconsin, les deux plus grands syndicats du secteur public de l'Etat, le AFSCME et le WEAC, le syndicat des enseignants, ont offert d'accepter toutes les exigences économiques, et d'aider à 'négocier' les attaques, tant que leur droit à participer aux conventions collective , que le 'closed shop' (l'obligation pour le patron de n'embaucher que des salariés syndiqués) et que le système de retenue sur le salaire pour les cotisations syndicales, seront laissés indemnes . En effet, depuis l'adoption du projet de loi, les syndicats du secteur public se sont empressés dans tout l'Etat de faire passer les contrats contenant toutes les exigences économiques du projet de loi Walker, sachant que, si leur contrat est ratifié avant, le nouveau projet de loi devient loi, ils n'auront pas à tenir une autre élection l'année prochaine pour permettre à leur argent d'affluer dans les caisses, car le 'closed shop' sera alors maintenu pendant la durée de ce contrat. Cela explique aussi l'opposition très répandue des politiciens du Parti Démocrate à mettre fin au droit à la négociation collective, étant donné que les Démocrates comptent sur les syndicats du secteur public comme leur principale source de contributions de campagne pour les élections locales et d'Etat.
Le mouvement dans le Wisconsin
Le lundi 14 février, premier jour ouvrable après l'annonce du projet de loi Walker, plus de 100 étudiants ont spontanément quitté la classe à Stoughton, Wisconsin. Le lendemain, ils ont été suivis par plus de 800 étudiants de Madison, qui ont quitté les cours et ont défilé dans la ville pour manifester devant les bâtiments du gouvernement. Le mercredi suivant, les universités publiques de Madison ont dû fermer, car les enseignants se sont mis en arrêt de travail pour maladie (ce qui constitue une action illégale, NDT) et nombre d'entre eux ont rejoint leurs élèves pour marcher sur le Capitol Building. Dès jeudi, la présidente du syndicat Wisconsin Educators Association Council (WEAC), Mary Bell, a dit aux journalistes: « Ce n'est pas sur la protection de nos salaires et de nos avantages sociaux. Il s'agit de protéger notre droit à la négociation collective ». Dans une déclaration à la presse le lendemain, Marty Beil du syndicat AFSCME Council 24 a expliqué sans ambages : « Nous sommes prêts à mettre en œuvre les concessions financières proposées pour aider à l'équilibrage du budget de notre Etat, mais on ne nous privera pas de notre droit donné par Dieu à former un véritable syndicat »3. Les enseignants et les étudiants ont poursuivi leurs actions tout au long de la semaine, et les travailleurs du secteur public et les sympathisants de la région environnante se sont joints aux manifestations. Celles-ci ont grossi jusqu'à la fin de semaine, lorsque le Capitol Building a été occupé. Le lundi, le WEAC a ordonné aux enseignants de retourner au travail, mais les enseignants de Madison ont voté pour rester en congé de maladie une journée supplémentaire, au mépris de l'ordre donné par le président du syndicat (4)4.
Des célébrités gauchistes (y compris, entre autres, Michael Moore et Jesse Jackson) ont afflué dans la ville pour louer les 14 sénateurs démocrates de l'Etat qui avaient quitté la Chambre pour empêcher le passage du projet de loi comme des héros du travail, et pour appuyer la rhétorique syndicale suivant laquelle la lutte a été entièrement consacrée aux droits sur la convention collective. La présence de politiciens de haut niveau et de célébrités militantes a également contribué à soutenir toutes sortes d'illusions sur le Parti Démocrate et la plupart des actions sans danger en opposition à la vraie lutte de classe. Les syndicats avaient dit, dès le début, qu'ils n'étaient pas intéressés par des grèves. Pendant ce temps, les IWW de Madison et d'autres ont tenté de gagner l'approbation de la South Central Wisconsin Council pour organiser une grève générale à l'échelle de l'Etat, en cas de passage du projet de loi. Une grande partie de la propagande a été menée auprès des travailleurs sur ce que signifierait une grève générale, et en fait, la veille du jour de l'adoption du projet de loi, des slogans en faveur d'une grève générale ont été parmi les plus fortement entendus à l'intérieur du Capitol Building et dans les rues5. Cependant, le jour où le projet de loi a été adopté, les syndicats et le Parti Démocrate ont dévoilé leur nouvelle stratégie : canaliser toutes les énergies de la contestation dans une campagne prolongée pour faire révoquer les 16 sénateurs Républicains, dont le remplacement par des Démocrates inverserait finalement le projet de loi.
Le slogan de la « grève générale »
Les USA n'ont pas assisté à une grève générale depuis des années, ce qui fait que le slogan dans le Wisconsin paraît au mieux surprenant au mieux et au pire mystificateur. Malgré son image de puissance qu'évoque l'appel à une grève générale, nous devons nous demander à quoi peut ressembler une grève générale, ou ce qu'elle peut accomplir si elle permet aux syndicats, qui ont déjà accepté de mener des attaques sur les conditions de vie de la classe ouvrière, d'y tenir un rôle de leadership. Au cours des deux dernières années dans toute l'Europe, les syndicats ont appelé à des grèves générales au niveau national contre les mesures d'austérité présentées comme des solutions aux dettes de l'Etat et elles ont toutes mené à la défaite. L'automne dernier en France, 14 grèves générales menées par la 'radicale' CGT et d'autres syndicats, ainsi que le blocage des raffineries, ont été incapables d'empêcher le passage de la réforme des retraites et les seuls mouvements significatifs d'auto-organisation et de luttes au niveau de la classe ont tous été effectués en opposition directe même avec les plus radicaux des syndicats. Le problème est que la 'grève générale', en tant que débrayage massif de tous les travailleurs, est un slogan extrêmement ambigu . Qui doit appeler à la grève ? Qui va la diriger et décider combien de temps elle durera, comment installer un piquet de grève, et comment étendre la grève ? Si des semaines de grèves et de manifestations à travers une France plus fortement syndiquée que les USA ont été incapables, à l'automne dernier, d'arrêter les attaques sur les retraites, que penser d'une journée de grève générale ou de 'Journée d'Action' par des travailleurs américains syndiqués, qui représentent moins de 12% de la main-d'œuvre américaine ?
Contrairement au slogan de 'grève générale', pour que les travailleurs se défendent, ils ont besoin de développer une dynamique similaire à ce que Rosa Luxembourg a appelé la 'grève de masse'6 , une vague de grèves qui n'est pas prévue pour une seule journée ou une période précise. Dans la grève de masse, les travailleurs syndiqués et non syndiqués de divers secteurs entrent en lutte pour leurs revendications propres et les revendications de leurs frères et sœurs de lutte. La dynamique de la grève de masse cherche toujours à élargir l'ampleur du mouvement et à élaborer collectivement ses objectifs et ses exigences. Un tel mouvement, organisé par les travailleurs eux-mêmes, coordonné par des comités auxquels ils doivent leur mandat, et peuvent être révoqués par l'assemblée générale de tous les travailleurs, serait une menace immédiate pour l'Etat. Il ne serait pas entre les mains de négociateurs qui ont la confiance de l'Etat et il pourrait, au moins temporairement, repousser certaines des mesures d'austérité proposées. En outre, une telle expérience développerait la combativité, la créativité et la confiance de la classe ouvrière à une échelle sans précédent, rendrait les travailleurs d'autant plus prêts à se défendre à l'avenir, au point de poser des questions sur comment la société est dirigée et dans l'intérêt de qui ?
L'obstacle syndical
Au printemps dernier, dans le New Jersey, très peu de temps après que les étudiants de l'Université de Californie eurent commencé leur lutte, les élèves du secondaire ont organisé des débrayages dans tout l'Etat contre les réductions de dépenses d'éducation et les attaques dirigées contre leurs enseignants. Les élèves se sont souvent tournés vers ces mêmes enseignants pour faire avancer la lutte. En dépit de l'admiration et de la gratitude ressentie par la majorité des enseignants devant ce spectacle de solidarité, le syndicat des enseignants a découragé les étudiants de se mobiliser et était d'accord avec l'administration pour que les étudiants concernés soient punis7. Une histoire très similaire s'est déroulée dans le Wisconsin. Les élèves, qui craignaient que ce système n'apporte pas d'avenir pour eux, ont décidé de prendre des mesures à la fois pour leurs propres revendications et en solidarité avec les travailleurs qui n'avaient pas encore commencé à lutter. Sachant qu'ils ne pouvaient pas à eux seuls obtenir ces revendications, les élèves ont demandé à ces travailleurs de se joindre au combat. C'est la croyance, encore présente chez de nombreux enseignants et leurs élèves, que les syndicats existent pour les défendre, et qu'ils devront se battre à leurs côtés, qui a empêché cette solidarité de s'étendre.
Les syndicats, dans le monde capitaliste moribond d'aujourd'hui, ne défendent pas du tout, même a minima, la classe ouvrière. Les syndicats, alors qu'ils ont été construits par les travailleurs et qu'ils pouvaient être contrôlés par les ouvriers au 19e et au début du 20e siècle, existent désormais en tant qu'agents de l'Etat. Leur tâche consiste à maintenir l'ordre pendant les luttes de la classe ouvrière, à les enchaîner au légalisme, aux illusions démocratiques et aux intérêts du capital national. Grâce à un millier de mécanismes de reconnaissance de l'Etat, de structures juridiques, et de mécanismes structurels, l'Etat a complètement absorbé en son sein ces organisations et les utilise pour prévenir et faire dérailler toute contestation qui risque de se développer en une véritable lutte de classe contre classe. Les syndicats en ont fait une parfaite démonstration, lorsque, alors qu'ils étaient menacés d'une totale castration par le nouveau projet de loi, ils ont préféré canaliser la colère des ouvriers dans une campagne infructueuse de révocation électorale qui pouvait prendre plus d'un an. Les syndicats préfèrent être réduits à des groupes de pression électorale que d'attiser la lutte de classes avec une action de grève, même sous leur contrôle. Une nouvelle preuve de la nature des syndicats : lorsque la section locale de l'AFSCME de Madison s'est précipitée pour signer un nouveau contrat qui allait écraser les conditions de vie des travailleurs au niveau du projet de loi haï que Walker avait exigé pour 2014. le maire de Madison a salué la coopération du syndicat. « Nous l'avons fait avec une négociation collective » , a-t-il dit. « Le système a fonctionné exactement comme il était censé fonctionner »8
Lorsque les enseignants et les travailleurs du secteur public, légitimement menacés par une législation qui s'attaque directement à leurs salaires, à leur santé et à leurs retraites, luttent pour la défense des syndicats, plutôt que de mobiliser pour la défense de leur niveau de vie, se montrent ouvertement comme des fantassins au service d'une lutte de faction entre les différentes parties de la classe dirigeante. Les ouvriers ne doivent pas baisser leur garde contre les syndicats qui mettent en œuvre des réductions, qui négocient les licenciements, et dressent un rideau de fumée pour détourner les travailleur d'une véritable lutte contre ces mesures, sous le prétexte que certaines secteurs de la classe dirigeante s ?en prennent aux syndicats. Alors que de nombreux travailleurs ont des illusions sur les syndicats, les révolutionnaires devraient chercher à les aider à les en débarrasser. Ils doivent être clairs sur le fait que les syndicats ne sont pas simplement 'ce que nous avons de mieux' , ou simplement conservateurs, sclérosés et bureaucratiques : ils appartiennent, corps et âme, au camp de l'ennemi de classe, et la véritable lutte de classe devra se mener contre eux, tout comme elle sera menée contre le patronat et l'Etat.
JJ (10 avril 2011).
1- Elizabeth McNichol, Oliff Phil Johnson et Nicholas : « Les Etats continuent de ressentir l'impact de la récession », Centre du budget et des priorités de la politique, 9 mars 2011 https://www.cbpp.org/cms/?fa=view&id=711 [139]
2- Fletcher, Michael A. « Les gouverneurs des deux Partis planifient de douloureuses coupes budgétaires au milieu de la crise à travers les Etats-Unis », Washington Post, 7 février 2011 https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02 [140] / 07/AR2011020703650.html. hpid moreheadlines =
3- Jason Stein, Patrick Marley et Schultze Steve. « L'ajournement brutal de l'assemblée cause d'une journée chaotique dans le Capitole », Milwaukee Journal Sentinel, 18 février 2011 https://www.jsonline.com/news/statepolitics/116470423.html [141]?
4- « Les enseignants discutent de leur reprise du travail après les protestations du Wisconsin », CNN.Com, 20 Février 2011 https://articles.cnn.com/2011-02-20/politics/wisconsin.protests_1_unions... [142] ?)
5- Pour une description plus détaillée de ce sujet, visitez le fil libcom.org, « Wisconsin, le retrait du droit de négociation collective des travailleurs de l'Etat. Le gouverneur menace d'utiliser la Garde Nationale ». Sur https://libcom.org/forums/news/wisconsin-withdrawing-collective-bargaini... [143]
6- Rosa Luxemburg oppose la grève de masse dynamique à la grève générale prévue appelé par les organisations pré-existantes pour une période de temps déterminée dans son livre Grève de masse, partis et syndicats.
7- Heyboer, Kelly. « Les élèves du NJ qui ont quitté les cours pour protester contre les coupes budgétaires du gouverneur Chris Christie ont écopé de peines mineures », Newark Star-Ledger, 28 avril 2010 https://www.nj.com/news/index.ssf/2010/04/minor_punishments_given_to_stu... [144]
8- Mosiman Dean. « Madison sur la point de prolonger le contrat qui le lie à son plus grand syndicat ouvrier », Wisconsin State Journal, 16 mars 2011 https://host.madison.com/wsj/news/local/govt-and-politics/article_d04b3a... [145] 001cc4c002e0.html
Géographique:
- Etats-Unis [83]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]
Compte-rendu d'une réunion publique à New-York sur les révoltes dans le monde arabe
- 1558 lectures
Nous publions ci-dessous un article publié dans Internationalism, organe de presse du CCI aux Etats-Unis.
Etant donné le peu d'attention porté par les médias aux Etats-Unis sur les révoltes en Tunisie, en Algérie et en Egypte, et plus tard dans une grande partie du reste du monde arabophone, Internationalism, organe du CCI aux Etats6unis a estimé qu'il était important de tenir une réunion publique sur les perspectives de ces révoltes le 19 mars dernier à New-York. Il y a eu une courte présentation, suivie de quelques heures de discussion ouverte sur l'histoire des événements, les similitudes et les différences entre chaque situation nationale, ainsi que les similitudes avec les mouvements contre l'austérité en Europe et avec le mouvement ouvrier sur le plan historique. La plupart des participants connaissaient bien Internationalism, et un camarade était plus familiarisé avec le travail des groupes Mouvement Communiste et GCI.
Avant la présentation, quelques mots ont été dit sur les tremblements de terre et la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon, où les camarades ont noté la tendance à ce que les puissances nucléaires soient dans une situation impérialiste de plus en plus chaotique, où les ressources en combustibles importés sont de moins en moins fiables pour chaque bourgeoisie nationale. La présentation a souligné la rapidité de l'évolution des événements en Egypte, en Tunisie, au Bahreïn, et en Libye et l'importance d'un examen critique des potentialités des révoltes dans les différents pays, mais aussi de rester vigilant par rapport aux régions où ils pourraient s'étendre. En effet, le jour suivant, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont commencé les frappes aériennes en Libye, en démontrant comment la bourgeoisie peut réagir différemment suivant les révoltes, bien que celles-ci aient des racines communes qui sont les conditions de pauvreté et de répression. Il est important d'examiner ces différents facteurs.
Le facteur le plus important est que ces révoltes ne sont pas ce que prétendent les médias de la bourgeoisie, c'est-à-dire des mouvements qui se limiteraient à demander plus de démocratie contre la dictature, des mouvements qui se satisferaient d'une 'révolution de couleurs variées' comme en Ukraine et dans d'autres pays, ces dernières années. Chaque révolte a commencé pour des motifs économiques et sociaux : misère et chômage élevé (surtout chez les jeunes travailleurs), inflation vertigineuse et une indignation bouillonnante contre la répression. Dans le cas de la Tunisie, qui a connu l'essentiel des grèves avant les événements en Egypte, il a été dit que c'est le harcèlement par la police d'un marchand ambulant de fruits, qui s'est immolé pour cette raison, qui a déclenché les révoltes. Celui-ci était un diplômé de l'université, au chômage et incapable de trouver un travail régulier. Malgré le fait qu'il existe beaucoup d'illusions par rapport à la démocratie dans les mouvements autour de ces révoltes, et que la classe ouvrière n'a pas clairement mis en avant ses propres exigences, ces révoltes ne sont pas simplement des révoltes démocratiques contre la dictature, mais elles contiennent aussi des expressions d'indignation réelle des travailleurs devant les conditions dans lesquelles ils sont forcés de vivre.
En Egypte, nous avons vu l'émergence de véritables méthodes de lutte de la classe ouvrière : des comités de protection de quartier, la tendance à l'extension rapide de la grève, les assemblées de rue où les gens discutent ouvertement et prennent des décisions sur la façon de pousser en avant la lutte, et des tentatives de fraternisation avec l'armée. Malgré le fait que cela montre les illusions sur la 'loyauté' de l'Etat, le point important est qu'au début, l'armée a répondu favorablement. L'entrée de la classe ouvrière dans la lutte a aidé à surmonter certaines des divisions, ce dont les autres couches sociales étaient incapables : des divisions fondées sur le sectarisme religieux, par exemple, et le début des grèves politiques dans les usines textiles a été le principal facteur de l'accélération de la démission de Moubarak Cela démontre que la classe ouvrière est le sujet de la révolution et qu'elle a la capacité de paralyser la société et d'unifier les révoltes des autres couches non exploiteuses. La Libye, où la majorité de la classe ouvrière est constituée d'immigrants du monde entier, a été un exemple négatif. Les travailleurs immigrés ont refusé de se laisser entraîner dans ce qui est devenu très vite un combat entre factions nationalistes et ils se sont amassé à la frontière pour fuir la Libye, ne voyant aucun avenir dans ces révoltes.
Dans les discussions qui ont suivi, l'idéologie démocratique a été une question importante abordée, avec de nombreux camarades qui ont montré le besoin de la classe dominante de décrire toutes les révoltes dans les pays de langue arabe comme étant des mouvements nationalistes et pro-démocratiques, sans tenir compte du fait que, du moins au début, la classe ouvrière dans les différents pays est entrée en lutte, principalement contre les conditions d'exploitation et de misère, sans agiter aucun drapeau particulier. On a également noté que, même en Egypte, la classe ouvrière n'était pas encore en mesure de s'affirmer comme une classe indépendante, mais qu'elle commençait tout juste à essayer d'entrer en mouvement et qu'elle était attirée par les idéologies des autres couches sociales, malgré le fait que l'entrée des travailleurs dans la lutte avec les grèves dans les usines de textile a été décisive pour aller de l'avant. En 2007, il y avait eu d'autres grèves massives en Egypte, qui avaient vu le surgissement d'assemblées générales et des tentatives de convergence des luttes, mais la situation actuelle montre une difficulté des travailleurs à faire valoir leurs revendications indépendamment du mouvement 'pro-démocratique' et 'anti-dictature' et à être capables de se mettre à la tête de la révolte comme classe ayant un avenir historique. Des questions ont été soulevées quant à savoir si le nouveau gouvernement d'Egypte renforcera les illusions démocratiques ou si, sous le poids croissant de la crise, il s'usera plus rapidement.
À la fin de la discussion, les camarades présents ont fait le lien entre la domination de l'idéologie démocratique et le manque de confiance de la classe à l'échelle internationale. De nombreux travailleurs estiment que la révolution est nécessaire, mais ne savent pas si elle est encore possible.
L'organisation de la production a radicalement changé depuis les dernières grandes batailles de classe et des grands centres industriels ont été démantelés par la désindustrialisation dans les métropoles capitalistes et la délocalisation de la production vers les pays 'périphériques', sans compter les campagnes autour de la 'mort du communisme' dans les années 1990. On a beaucoup parlé du poids de la décomposition du système capitaliste et de l'érosion du tissu de base de la vie sociale qui rend plus difficile pour la classe ouvrière la récupération de son identité et la confiance en soi. Malgré toutes ces difficultés, il a été reconnu par les participants que ces révoltes, du moins en Egypte et en Tunisie, sont une partie du processus lent et difficile de la classe ouvrière internationale qui se bat pour retrouver le chemin de la lutte de classes. Il y a eu aussi des débats sur les forums du CCI, sur la nature de classe ou non des révoltes en Libye, par rapport à celles de l'Egypte ou de la Tunisie, et c'est un sujet que les révolutionnaires doivent essayer de clarifier et de mieux comprendre, afin de pousser en avant et de développer ce processus de récupération de l'identité de classe et de la confiance.
JJ (3 mai)
Vie du CCI:
- Réunions publiques [146]
Récent et en cours:
- Monde arabe [135]
Explosion à la raffinerie de Chevron : le capitalisme est dangereux pour la classe ouvrière
- 2841 lectures
Dans la soirée du 2 juin, une explosion à la raffinerie de pétrole Chevron sur le quai Pembroke au Pays de Galles a tué quatre ouvriers et un autre est à l'hôpital avec des blessures graves. Le temps qu'il a fallu pour identifier les ouvriers indique que les malheureux ont été réduits en cendres. La nuit suivante, la BBC a fait état d'un « énorme » incendie à l'usine Eco de stockage de pétrole près de la centrale électrique de Kingsnorth dans le Kent. Le moment où ont eu lieu les deux accidents indique que la majorité des travailleurs, 1400 à Chevron, n'étaient pas sur le site. Un porte-parole de la police a d'abord qualifié l'explosion de Pembroke de « tragique accident industriel», formule qui a ensuite été remplacée par celle de « tragique incident industriel », et une nouvelle déclaration ajoutait: « bien que ne présentant pas une menace » (de contamination). Incident ou accident, une chose est sûre, en Grande-Bretagne, comme ailleurs, le capitalisme est de plus en plus une menace mortelle pour les travailleurs ainsi que pour la population ouvrière vivant à proximité des installations industrielles. Un certain nombre de facteurs permettent cela : le premier est que le capitalisme met systématiquement le profit avant les vies humaines et notamment avant les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière. Ensuite, avec le développement inexorable de sa crise économique la classe dirigeante réduit de plus en plus les mesures de sécurité, les inspections de sécurité, l'entretien et le remplacement des usines vétustes et dangereuses. Et les catastrophes se succèdent, invariablement accompagnées des écœurantes déclarations d'usage à propos de 'condoléances', de 'fatalité des accidents' et 'des leçons seront tirées'.
L'explosion et l'incendie, avec la contamination qui en ont résulté, à la raffinerie comme au dépôt de Coryton et dans un autre dépôt dans l'Essex en 2007, nous montrent comment le vent souffle. Ici, 20 ordonnances de conformité par rapport à la santé et à la sécurité sont toujours en suspens depuis l'événement, avec un projet de sécurisation extrêmement important qui est toujours dans sa phase de conception, qui ne sera réalisé qu'en décembre 2012, d'après ce que dit la Thurrock Gazette du 13/05/2011. Avec cette non-conformité persistante, il y a eu d'autres incidents graves dans les raffineries, comme cela a été enregistré en janvier de cette année. Dans une analyse de 2006 des catastrophes dans le milieu du travail, intitulée Catastrophes au travail, Dave Whyte parle de «l'idéologie de collusion qui domine le paysage réglementaire ».
Coryton a fait suite à l'explosion de l'installation pétrolière Total à Buncefield, dans le Hertfordshire en décembre 2005, qui avait été appelée «le plus grand incendie d'Europe en temps de paix» (Wikipedia). Cela a été une explosion air-combustible et les effets de la contamination et les dommages environnementaux demeurent toujours inconnus, cinq ans plus tard. Tout comme dans de nombreux autres cas, l'Etat a contourné le problème de la contamination initiale des eaux souterraines en relevant simplement les doses limites permises de produits contaminants autorisées pour l'eau potable (Hemel Hempstead Today, mai 2006). L'explosion, aux effets similaires aux bombes air-combustible utilisées au cours de la première guerre en Irak, enregistrée sur l'échelle de Richter s'est produite tôt le dimanche matin. Si c'était arrivé pendant que l'usine était entièrement occupée, le bilan du nombre de victimes aurait été bien pire que les 42 blessés constatés. Un an plus tard, toutes les casernes de pompiers qui avaient été les premières à réagir par rapport à l'incendie de Buncefield (qui avaient à l'époque reçu l'éloge de Tony Blair comme un 'grands corps de fonctionnaires') ont été menacées de fermeture et de réduction des effectifs (The Guardian, 05/12/2006).
Une explosion similaire, air-carburant, s'est produite à l'usine chimique près de Scunthorpe Flixborough en 1974. Encore une fois, l'accident a eu lieu le week-end et il a tué 18 ouvriers. Si c'était était arrivé un jour de semaine, la plupart, sinon la totalité, des 500 travailleurs auraient été calcinés.
Et tout ceci est arrivé après qu'on nous a dit que les ‘leçons avaient été tirées' de l'affaire toujours bouleversante de l'explosion de Piper Alpha sur une plate-forme pétrolière en Mer du Nord, où 167 des 226 travailleurs à bord avaient été tués dans les circonstances les plus horribles, au cours de l'été 1988. Ici encore, les remarques de HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) concernant la mise en application et l'amélioration ont été à nouveau ignorées, alors que des dizaines de travailleurs ont été tués dans l'industrie pétrolière de la Mer du Nord au cours des 20 années suivantes et les travailleurs sont intimidés ou congédiés et sont mis à l'index comme 'fauteurs de troubles', s'ils font la moindre récrimination sur les questions de sécurité. Et comme dit ci-dessus Whyte, «l'idéologie de collusion » traverse les entreprises, HSE et les syndicats. Vingt ans après Piper Alpha, HSE a détecté que 50% de plates-formes avaient de 'pauvres' conditions de sécurité et qu'il y avait un arriéré de 15 000 heures de travaux sur des 'problèmes critiques de sécurité'.
Le gouvernement de coalition a montré qu'il suivra la politique des Travaillistes et des Conservateurs par rapport aux menaces qui pèsent sur la vie des ouvriers et qu'il donnera le feu vert aux procédures qui ne respectent pas la sécurité pour tenir son programme de réduction des coûts. Des compressions budgétaires récentes montrent que les 98 inspecteurs sur les plateformes en Mer du Nord ont été réduits à 83 à la fin de cette année (Hasards n° 113). Les carnets de bord des procédures de sécurité des compagnies doivent rester secrets et nul, à l'exception des cadres supérieurs, ne peut avoir un accès complet à ces dossiers. Dans toute l'industrie pétrolière, au fur et à mesure que la tuyauterie s'oxyde, elle reste en l'état ; alors que les soupapes et les connexions deviennent plus vulnérables aux dysfonctionnements et aux dégradations, leur contrôle d'entretien est supprimé, les mesures de sécurité sont de moins en moins prises en compte, des composants essentiels sont négligés, et tandis que les avocats des entreprises et des syndicats s'enrichissent à coups de procédures et en réclamant une nouvelle juridiction, les vies des travailleurs sont de plus en plus mises en danger. Les compressions budgétaires à venir ainsi que la priorité déjà accordée aux bénéfices des entreprises par rapport aux préoccupations des conditions de travail et à la vie-même des travailleurs impliquent que ces terribles risques qui menacent la classe ouvrière deviendront de plus en plus grands.
Baboon (7 juin 2011)
Géographique:
- Grande-Bretagne [98]
Le drame du coton génétiquement modifié en Inde : 10 ans de profits, 10 ans de misère et de mort.
- 1925 lectures
Le miracle technologique du coton génétiquement modifié en Inde n'aura pas eu lieu. Bien au contraire, c'est un véritable désastre qui s'est déroulé en moins d'une décennie.
En 2002, l'Inde autorise la plantation de semences de coton modifiées pour résister au ver de la capsule, parasite ravageur qui détruit les plantations si aucun épandage d'insecticide coûteux n'est pas opéré régulièrement. La semence miracle s'appelle le « coton BT » et elle est fabriquée par la société Monsanto.
Monsanto est une société américaine spécialisée dans la chimie et plus récemment dans la biotechnologie, principalement la production de semences hybrides et génétiquement modifiées, notamment pour résister aux insectes et parasites.
Bien que jusqu'à dix fois plus chère que la graine classique, la « BT » a de quoi séduire : Monsanto ne promet rien de moins que le triplement des rendements. Si on économise l'insecticide, la mise importante de départ sera récupérée et même dépassée sans souci. De ce fait, les paysans indiens investissent au maximum, s'endettent s'il le faut et en quelques années, c'est 90% des surfaces cotonnières du pays qui sont couvertes du coton magique.
Il n'y en a qu'un finalement qui n'a pas cru au miracle : c'est le ver de la capsule. Lui, il a rapidement développé des résistances, tellement rapidement qu'on se demande même s'il a un jour été touché par la substance insecticide délivrée par la plante. Et finalement, le coton BT ne fait pas mieux que n'importe quelle autre graine de coton. Pour contrer la baisse inévitable de rendement, il faut maintenant passer par l'épandage massif d'insecticides, augmentant la facture d'au moins 30%.
Sans compter que cette belle plante voit son prix augmenter sans cesse. Aujourd'hui, elle coûte cent fois plus cher que le coton classique !
Sans compter, bien sûr, que comme toute plante génétiquement modifiée, cette jolie fleur est stérile et que donc chaque saison, il faut racheter les semences.
Sans compter enfin que cette douceur de la nature aime l'eau et les nutriments plus que le coton ordinaire : la terre s'appauvrit et se dessèche, et là encore, le maintien des rendements passe par l'enrichissement artificiel et l'arrosage... tout cela coûte cher, et l'eau est une denrée fragile, surtout si le ciel s'en mêle.
Et c'est ce qui s'est passé en 2009, avec une saison de mousson la plus faible depuis 37 ans. Faute d'eau en quantité suffisante, les rendements ont chuté irrémédiablement.
Il ne fait aucun doute que le coton BT aura été un succès commercial pour Monsanto. Mais techniquement, c'est un échec complet. Et humainement, le résultat est un véritable drame. On estime aujourd'hui que depuis 1991, près de 20 millions de paysans ont quitté la campagne pour venir remplir les bidonvilles des grandes métropoles. Mais ce chiffre ahurissant n'est encore rien face à l'incontrôlable vague de suicides qui ravage le milieu rural touché par le désastre du coton BT. Au moins 150 000 personnes auraient mis fin à leurs jours, certains parlent de plus de 200 000 depuis quinze ans. En 2009, un suicide collectif impliquait 1500 personnes. 1500 personnes qui, sans aucune issue face à la faillite complète qui les touche, n'ont même plus la force de se battre et décident ensemble de se donner la mort.
Depuis, après avoir tenté de faire porter la responsabilité aux paysans indiens qui auraient mal utilisé leur produit, Monsanto a reconnu l'inefficacité de sa semence. Pour tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont partis crever dans la boue des bidonvilles et tous ceux qui tentent encore de survivre en s'endettant pour acheter une graine aux rendements minables, cela ne « modifie » rien du tout.
Cette histoire est écoeurante, révoltante, poignante. Elle n'est pourtant qu'un exemple parmi un nombre incommensurable d'autres du prix que le capitalisme donne à la vie humaine, du prix qu'il donne à la sauvegarde et au développement de nos ressources.
Le coton BT est une illustration éclatante de comment le capitalisme manipule la nature dans le seul but de dégager des profits. Il est clair que cette semence a été mise sur le marché sans disposer des garanties suffisantes sur son efficacité sur toutes les espèces de ravageurs susceptibles de s'attaquer à la plante. Ce qui comptait avant tout, c'était de la vendre, et pour cela, la promesse de rendements supérieurs suffisait.
La misère humaine, les ravages sur la nature ne compromettent finalement que l'avenir commercial du produit ; ce qui a été encaissé reste dans les caisses. C'est la logique d'un système qui vit au jour le jour et accumule ses richesses en détruisant toujours plus de ressources, y compris la vie humaine.
Ce n'est pas seulement le procès de Monsanto qu'il convient de faire, mais celui du capitalisme. C'est lui le vrai coupable.
G (25 mai)
Géographique:
- Inde [147]
Le sabotage contre la classe ouvrière de la part du Syndicat mexicain d’électriciens (SME) continue
- 1670 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d'un article de Revolucion Mundial, organe de presse du CCI au Mexique.
Tout d’un coup, comme s’ils voulaient nous rappeler qu’ils sont toujours là, lundi 11 avril un groupe de quelques 300 membre du SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) ont agressé une équipe de travailleurs de l’entreprise CFE à Mexico, ont frappé et volé des journalistes, et ont endommagé des véhicules de cette entreprise et de particuliers. Le procureur de la république a entamé une action pénale contre 11 militants de ce syndicat pour des délits fédéraux : atteinte à la propriété, vol collectif et rébellion. Martín Esparza, dirigeant du SME, a dit que ces actions sont « un échantillon de celles que son organisation va entreprendre pour exiger le droit de réintégration au travail », que les personnes arrêtées « sont innocentes et, par conséquent, ce sont ‘des prisonniers politiques’, dont on va exiger la liberté par le biais des mobilisations », tout en présentant des plaintes pour violation des droits de l’homme. Pour couronner le tout, « plusieurs commissions du SME vont se présenter aux sièges nationaux des partis politiques pour dénoncer l’offense ». Ce genre d’actions revendiquées et menées par ce syndicat suit mot pour mot le scénario qui a commencé il y un an et demi et dont le seul but est d’assommer en profondeur la classe ouvrière.
Bref rappel d’un piège contre les ouvriers1
Depuis octobre 2009, lorsque l’Etat a fermé la compagnie Luz y Fuerza del Centro2 en mettant à la rue près de 44 000 travailleurs, c’est le SME, avec l’aide de quelques autres syndicats, qui s’est chargé de mettre les travailleurs pieds et poings liés pour ainsi s’assurer que ceux-ci ne ripostent pas avec leurs propres moyens d’organisation et de lutte :
- Ils ont créé une division et un affrontement entre électriciens par le biais d’élections internes, dans le but de les détourner de la défense qu’ils devaient assurer de leurs emplois ; ils ont transformé ce qui n'était ni plus ni moins qu’une attaque sournoise contre les conditions de vie et de travail des ouvriers en « une attaque contre le syndicat et les libertés démocratiques », en entraînant la majorité d’électriciens à « lutter pour la défense du syndicat » et « la défense de l’entreprise publique et l’économie nationale » ; ce sabotage a empêché que les ouvriers ne se consacrent dès le début à discuter dans des assemblées générales, sur les actions nécessaires pour mener la lutte, sur quelles formes d’organisation propres devaient être mises en place, sur comment élire leurs délégués lors de ces assemblées et sur quel type de comité de lutte devrait être organisé pour que les ouvriers conservent le contrôle de la grève entre leurs propres mains.
- la recherche de solidarité avec d’autres travailleurs s’était imposée d'emblée en poussant à l’extension du mouvement à d’autres secteurs quelle que soit la branche professionnelle, en mettant en avant le fait que l’attaque contre les électriciens était une attaque dirigée contre toute la classe ouvrière. Cette nécessité est apparue à la suite de la grande manifestation du 15 octobre 2009 où s’étaient exprimés une grande préoccupation sociale et un sentiment de solidarité chez beaucoup de travailleurs, mais encore une fois, le SME et d’autres syndicats « solidaires » se sont chargés de faire avorter cette dynamique positive naissante en mettant en avant comme moyens de lutte, une controverse sur la légalité constitutionnelle et les demandes de protection institutionnelle, en cultivant l’illusion selon laquelle le prolétariat pouvait se défendre grâce aux institutions bourgeoises et en faisant avorter cette dynamique positive qui commençait à poindre ;
- ces syndicats ont tout fait pour empêcher l’extension solidaire de la lutte et de l’unité, et, ensuite, ils ont continué leurs manœuvres avec des actions totalement en dehors du véritable terrain de la lutte ouvrière : des grèves de la faim parfaitement impuissantes et passablement humiliantes imposées par le SME, des demandes d’aide aux grands pontes du pouvoir législatif ou judiciaire « pour qu’ils obligent l’exécutif à reculer », poussant à des actions « très radicales » comme celle de « ne pas payer l’électricité » tout en portant plainte auprès du Défenseur fédéral du consommateur (Profeco) pour faire pression sur l’État ; et, évidemment, « l’occupation » des lieux de travail de l’entreprise fut une proposition centrale du syndicat, qui s'est donné ainsi à bon compte, une image combative alors qu'il n’ont mis en avant que des actions anti-ouvrières à répétition, des occupations qui ne cherchaient, en réalité, qu’à enfermer les ouvriers en les maintenant isolés et passifs, sans la moindre relation avec les autres travailleurs ;
- six mois après ces événements, un grand nombre de syndicats ont appelé à une énième pantomime de « grève générale », action ostentatoire destinée à faire passer un message à l’ensemble de la classe selon lequel le seul qui puisse organiser une « lutte », c’est l’appareil syndical et que les prolétaires n’ont autre chose à faire qu’accepter passivement ces actions, et aussi le message selon lequel la seule « solidarité » possible est celle qui s’établit entre les dirigeants syndicaux qui s’envoient mutuellement des messages d’encouragement et qui signent des documents « critiques » contre le gouvernement. Les mois suivants, nous avons pu voir toujours ce rôle de premier plan des syndicats avec l’intention d’occuper le terrain social et de donner un coup fatal face à un mécontentement général dû, en partie, à cette attaque contre ce secteur ouvrier, mais aussi, plus en profondeur, à cause d’une misère en augmentation galopante ; c’est ainsi qu’on a assisté à quelques mobilisations promues par les syndicats et la gauche du capital qui ont mis en avant une série de revendications qui ont complètement dilué le problème central qu'affronte la classe ouvrière : respect de l’autonomie syndicale, défense de l’économie populaire, respect de la constitution, non à la privatisation du pétrole et de l’électricité, respect de l’autonomie des populations indiennes, défense des droits de l’homme, infliger une punition politique à Calderón [Président du Mexique]... tout un patchwork d’exigences dont la seul but patent était d’enterrer la priorité centrale pour les travailleurs.
- enfin, au cours de cette année et demie, nous avons pu vérifier comment ce scénario s’est réalisé à la lettre, avec des actions intermittentes de la part du SME qui s’est chargé de donner le coup final, en épuisant et en enfonçant les ouvriers dans une démoralisation générale. Les derniers événements sont la suite du chemin piégé suivi depuis le début. Maintenant, l’Etat et son appareil politico-syndical ont un sujet d'actualité entre les mains et un très bon filon à exploiter, alors que les attaques pleuvent sur les travailleurs et qu’il est nécessaire de distraire encore une fois leur attention avec des scandales en tout genre et, surtout, en organisant des mobilisations pour libérer les « prisonniers politiques », autrement dit, encore une fois, défendre le syndicat. Ainsi on ajoute, au passage, un peu de piquant à la journée syndicale du 1er Mai quui s'annonçait plutôt terne et sans sujet intéressant pour les orateurs, lesquels pourront ainsi haranguer les travailleurs en agitant encore l’épouvantail de « l’attaque contre le syndicat ».
Ce bref rappel des manoeuvres anti-ouvrières des syndicats contre les électriciens et contre l’ensemble de leurs frères de classe illustre bien quel genre de pièges les syndicats utilisent pour éviter que ne se développe un mouvement qui, en brandissant ses véritables besoins, puisse étende sa force, en réveillant la solidarité des autres secteurs, des exploités qui subissent les mêmes attaques, de sorte qu’une extension généralisée à l’ensemble des travailleurs pour arriver à devenir une action de masse grâce à son courage et sa combativité, mais qui est aussi capable de développer une conscience qui lui permettra de prendre le contrôle de sa lutte directement entre ses propres mains. Dans les prochains mois, le prolétariat va recevoir un nouveau coup dans le dos avec le projet de réforme du droit du travail et ces besoins de lutte vont réapparaître tandis que les syndicats de toute obédience vont tout faire pour éviter encore une fois que les véritables méthodes d’organisation et de lutte ouvrière ne se développent.
RM (Avril 2011)
1 Nous avons publié en décembre 2009 « Solidarité avec les travailleurs de “Luz y Fuerza del Centro” au Mexique », avec des extraits de trois textes : le premier signé par 3 organisations au Mexique (Revolución mundial, le CCI au Mexique, Grupo socialista libertario et Proyecto anarquista metropolitano). Les deux autres sont des expressions vivantes de solidarité lancés par deux groupes prolétariens depuis le Pérou. Ces trois textes sont disponibles dans leur intégralité sur notre site internet. Voir : https://fr.internationalism.org/files/fr/RI_407.pdf [148], et https://fr.internationalism.org/icconline/2009/solidarite_avec_les_travailleurs_de_luz_y_fuerza_del_centro_au_mexique.html [149]
2 Luz y Fuerza del Centro (LyFC) était une entreprise publique de distribution d’électricité opérant surtout dans la capitale Mexico et sa province. À la suite de grosses pertes, l’Etat mexicain l’a mise en liquidation le 11 octobre 2009 après l'investissement de tous ses locaux par la police le 10 octobre.
Géographique:
- Mexique [150]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]
ICConline - juillet 2011
- 1472 lectures
Déclaration de solidarité avec le personnel du groupe de soins Viva! de IJmond et Haarlem (Pays-Bas)
- 1549 lectures
Introduction
Les “Etudiants critiques de Utrecht” (KSU), la Fédération Anarcho-Syndicaliste (ASB) et le Courant Communiste International (CCI), ont publié aux Pays-Bas, le 21 juin, la déclaration commune reprise ci-dessous pour souligner leur solidarité avec les grévistes du groupe de soin de santé à domicile Viva! de IJmond et Haarlem. Cette déclaration a été largement diffusée au cours de la manifestation de protestation contre les coupes sombres dans les soins de santé, qui a eu lieu le 23 juin à la Haye, et que les grévistes du groupe de soin de santé Viva! avaient rejointe par solidarité.
L’initiative de produire, de publier et de distribuer une déclaration commune de solidarité mérite toute notre attention, dans la mesure où, pour la première fois aux Pays-Bas, des groupes, qui se basent sur des positions internationalistes, ont développé ensemble une activité de soutien et de solidarité envers un secteur de la classe ouvrière. Quel que soit l’aboutissement de la lutte de ces aides-soignants à domicile, cette initiative réussie des trois groupes constitue une étape importante dans le renforcement politique de la lutte de la classe ouvrière.
Après la diffusion de la déclaration de solidarité par les trois groupes et l’expression de solidarité de la part du personnel soignant envers ceux qui perdent leurs droits aux soins, la lutte du groupe de grévistes « Le soin à domicile, c’est nous » s’est poursuivie. Ils refont grève du 28 au 30 juin et organisent une occupation de la Grand Place à Haarlem.
Nous avons appelé à ce que cette combativité les amène aussi à rechercher la solidarité avec les travailleurs des transports publics qui se mettent en grève à partir du mercredi 29 et se réunissent à La Haye pour protester ; à ce qu'ils rejoignent également en délégation, la manifestation des pompiers à Amsterdam pour les convaincre qu'il vaut mieux mener la lutte ensemble. Car ce n'est qu'en solidarité avec les autres travailleurs dans d'autres institutions, dans d'autres entreprises et dans d'autres secteurs que l'unité dans la lutte peut se réaliser, que la lutte peut se renforcer sur le terrain de classe lui-même. (25.06.2011)
Déclaration
Grèves, actions, occupations : à la recherche de l’extension de la lutte !
Pourquoi est-ce que le personnel soignant à domicile du groupe d’aides-soignants Viva ! de IJmond et Haarlem mène-t-il des actions depuis le début de cette année? Parce que leur patron a eu l’idée de leur faire effectuer le même travail pour un salaire réduit. Le 15 avril dernier, chacun d’entre eux recevait une enveloppe contenant une nouvelle proposition salariale. Une proposition scandaleuse ! Cela revenait à ce que le salaire moyen de 13,10 euro brut par heure soit réduit à 9,92 euro brut par heure. En cas de refus, ils seraient licenciés !!!
Le comité d’action des aides-soignants à domicile « Le soin à domicile, c’est nous » qui s’était créé pendant ce temps, a appelé tous les 650 collègues à ne pas signer et au contraire à mener des actions. Cet appel a plus tard été soutenu par les syndicats (Abvakabo/FNV et la CNV). Ces travailleurs défendent leurs droits en ne veulent pas se faire licencier. Depuis, ils sont allés manifester plus de sept fois aux conseils communaux, afin de présenter leurs revendications et se faire entendre en public. Le comité d’action s’est aussi présenté avec toute une série de questions à la réunion d’information du conseil d’administration de l’entreprise, mais l’entrée lui a été refusée.
Puisque le comité d’action a appelé à ne pas signer le nouveau contrat et que personne ne veut être licencié, les travailleurs sont vite arrivés à la conclusion qu’il ne leur reste pas d’autre moyen que de faire grève. Ils en sont à leur septième jour de grève. Pourtant, faire grève est une exception dans le secteur des soins. D’ailleurs, ils soulignent que « Nous utilisons ce moyen de lutte avec prudence. Nous traitons nos clients avec respect. Aujourd’hui, ils ont du respect pour nous ».
Jeudi après-midi, le 16 juin dernier, ils ont tenu un rassemblement réussi sur la Grand place de Haarlem. Anita Kuipers du comité d’action a donné un aperçu de la lutte jusqu’alors, ainsi qu’un compte-rendu d’une visite qu’elle a faite avec 8 de ces collègues de Viva ! dans le cadre d’une recherche de solidarité auprès d’autres aides-soignants à domicile à Utrecht.
Après 3 visites à Haarlem, 2 à Ijmuiden et 1 à Velsen-Noord ils ont décidé qu’il était temps d’aller là où les mesures d’austérité sont dictées : à La Haye ; Ce jeudi prochain, le 23 juin, ils vont massivement à La Haye pour se joindre la manifestation de protestation contre des réductions dans les budgets des soins de santé. En opérant la jonction de leur lutte avec celle d’autres secteurs ils font savoir de façon claire qu’ils ne se laisseront pas faire, mais qu’ils veulent ouvrir les fenêtres et donner à leur lutte une assise plus grande. « De cette manière, nous élargissons notre action pour de bons soins, pour nos clients et pour les travailleurs », affirmait un des membres du comité d’action.
Les travailleurs du groupe d’aides-soignants à domicile Viva ! de IJmond en de Haarlem ont fait un pas courageux et important. C’est un exemple pour tous les travailleurs dans le secteur des soins de santé au Pays-Bas. Car c’est partout la même chose, réduction des salaires, licenciements, coupes sombres dans les soins de santé et flexibilité accrue. Nous devons lutter pour des soins plus humains, où il ne fait pas seulement bon de travailler, mais où on assure aussi des soins chaleureux et humains. Des soins ou les personnes se font soigner à une échelle humaine par leur aide-soignant habituel, ayant un contrat fixe, suffisamment d’heures de prestation et un salaire permettant de se loger et de vivre décemment.
Les actions des aides-soignants à domicile de Haarlem et de IJmond méritent notre plein soutien. Venez donc jeudi prochain à La Haye et concrétisez votre soutien tant à la lutte contre les coupes sombres dans les soins de santé qu’à celle des aides-soignants à domicile.
Leur travail est nécessaire ! Ils font du bon boulot !
C’est pourquoi : nous ne pouvons plus accepter de détérioration des conditions de vie et de travail !
Dans l’intérêt de notre vie et de celle des clients !
C’est pas eux le problème, le problème c’est le système !
Texte signé le 21 juin, par la ASB, les KSU et le CCI
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]
ICConline - août 2011
- 1465 lectures
Guerre en Libye: une position internationaliste du KRAS
- 1813 lectures
Nous publions ici la prise de position contre la guerre en Libye écrit par le KRAS, la section de l’AIT en Russie. Le CCI veut d`abord saluer fortement l’internationalisme qui anime clairement cette prise de position. Cela ne nous surprend pas, parce que le KRAS a dans le passé constamment défendu une position clairement internationaliste : en 2008 contre la guerre en Géorgie, et auparavant encore face aux guerres en Tchétchénie dans les années 1990, rejetant tout soutien politique aux différents camps bourgeois en guerre.
Ce que nous avons en commun, et ce qui compte vraiment pour nous, c’est le fait qu’une organisation comme le KRAS se situe sur la question la plus significative pour le prolétariat, la guerre impérialiste, sans aucun doute dans le camp de la classe ouvrière internationale.
Alors que la guerre entre les Etats russe et géorgien, une grande puissance et un micro-Etat, manifestait ouvertement sa nature impérialiste de confrontation entre gangs bourgeois, le caractère impérialiste de la guerre en Libye se voile du mensonge d’une intervention « humanitaire ». La bourgeoisie des états qui interviennent depuis des semaines par des bombardements massifs contre le régime brutal et irrationnel de Kadhafi, utilise et dévoie les sympathies existantes dans la classe ouvrière pour les révoltes en Afrique du Nord en faveur de sa guerre prétendument de « défense du souffle démocratique contre les dictateurs capitalistes » existant dans la masse de la jeune génération et les ouvrières au Maghreb. Rien n’est effectivement plus mensonger comme le dénonce clairement la prise de position du KRAS !
Néanmoins nous voulons faire deux courts commentaires, essentiellement pour stimuler le débat au sein de notre classe :
- Nous partageons avec le KRAS la position qu’effectivement dans les pays d’Afrique du Nord comme en Tunisie ou en Egypte il n’y a pas eu de « révolution prolétarienne » comme celle qui a eu lieu au sortir de la Première Guerre mondiale, lorsque la classe ouvrière a pu se constituer comme classe et prendre le pouvoir, comme en Russie. La situation en Egypte, par exemple, présentée dans la presse bourgeoise comme une grande « révolution pour la démocratie », montre clairement que la bourgeoisie a maintenu son pouvoir à l’aide d’une adroite stratégie d’abandon du clan Moubarak pour se doter d’un gouvernement au visage plus démocratique.
Mais par contre, nous pensons que même si la classe ouvrière dans ces pays est encore enchaînée à des illusions envers la démocratie, le nationalisme ou même la religion, elle a fait dans cette période passée une expérience de lutte qui possède une grande valeur historique sur la voie qui conduit à la conscience révolutionnaire. Les méthodes de luttes de la classe ouvrière ont eu un impact sur les révoltes sociales dans le monde arabe : tendances à l’auto-organisation, occupation de lieux centraux pour se rassembler et s’organiser massivement, organisation de la défense contre les voyous et la police, rejet de la violence gratuite et des pillages efforts délibérés pour surmonter les divisions religieuses, etc., tentatives de fraternisations avec les soldats du rang… « Ce n'est pas un hasard si ces tendances se sont le plus fortement développées en Egypte, là où la classe ouvrière a une longue tradition de luttes et où, à une étape cruciale du mouvement, elle a émergé comme une force distincte, pour se livrer à une vague de luttes qui, comme celles de 2006-2007, peuvent être considérées comme des 'germes' de la grève de masse à venir, contenant un certain nombre de ses caractéristiques parmi les plus importantes : l'extension spontanée des grèves et des exigences d'un secteur à l'autre, le rejet intransigeant des syndicats d'Etat, certaines tendances à l'auto-organisation, le développement de revendications à la fois économiques et politiques. Ici, nous voyons, dans ses grandes lignes, la capacité de la classe ouvrière à se présenter comme le porte-parole de tous les opprimés et exploités et la seule classe qui offre la perspective d'une société nouvelle. »1
Sur la base des faiblesses politiques, les illusions démocratiques et nationalistes, la situation particulière en Libye a évolué d’un soulèvement de la population contre le régime de Kadhafi au départ vers une guerre entre plusieurs cliques bourgeoises pour le contrôle de l’Etat libyen, sur laquelle vient ensuite se greffer l’action impérialiste sanglante des grandes puissances. Cette transformation en une guerre entre différentes fractions bourgeoises a d’autant plus été aisée que la classe ouvrière en Libye est très faible. Essentiellement constituée d’une main d’œuvre immigrée, celle-ci a fini par fuir les massacres, notamment à cause de la difficulté à se reconnaître dans un mouvement aux accents nationalistes. L’exemple de la Libye illustre tragiquement a contrario la nécessité que la classe ouvrière occupe une place centrale au sein des révoltes populaires : son effacement explique en grande partie l’évolution de la situation.
2- La prise de position du KRAS appelle les ouvriers des pays de d’Europe de l’Ouest et des Etats-Unis à manifester contre cette guerre soi-disant « humanitaire ». Cet appel est fondamentalement tout à fait juste parce que seule la classe ouvrière dans les pays qui participent à la guerre en Libye peut arrêter la boucherie sanglante. Pour le moment, il faut constater que cette option n’existe (malheureusement !) pas immédiatement. Même s’il y a des manifestations de protestation contre l’intervention de l’OTAN, elles sont très minoritaires. En France par exemple, l’impérialisme le plus offensif dans cette guerre, les bombardements sont très peu mis en question. La guerre est aussi fortement défendue par les partis de la gauche du capital. Pour le moment il est facile pour la bourgeoisie de faire accepter leur guerre grâce à la justification de la solidarité avec les populations opprimés par le régime de Kadhafi.
CCI
Prise de position du KRAS contre la nouvelle guerre en Afrique du Nord
A bas la nouvelle guerre en Afrique du Nord !
L'intervention « humanitaire » des Etats au sein de l'OTAN en Libye, essentiellement dans le but d'apporter un soutien militaire à l'une des parties d'une guerre civile locale, a démontré une fois de plus qu'il n'existe pas de « révolutions » en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Il s'y déroule seulement une féroce lutte sans merci pour le pouvoir, les bénéfices, l'influence et le contrôle sur les ressources pétrolières et les zones stratégiques.
Le mécontentement profond et les revendications socio-économiques des masses travailleuses de la région, engendrés par la crise économique globale (attaques contre les conditions de vie des travailleurs, augmentation du chômage et de la misère, prolifération des emplois précaires) sont utilisés par les groupes politiques d'opposition pour faire un coup d'Etat, détrôner la tyrannie de dictateurs corrompus et séniles et occuper leur place. En mobilisant les chômeurs, les travailleurs et les populations miséreuses comme chair à canon, les fractions mécontentes de la classe dirigeante les détournent ainsi du terrain de leurs revendications économiques et sociales en leur promettant « la démocratie » et « le changement ». En fait, l'arrivée au pouvoir de ce bloc hétéroclite composé de « la fine fleur » de la classe dominante, de libéraux et de religieux fondamentalistes, n'apportera aucune amélioration au sort des travailleurs. Nous connaissons bien les conséquences de la victoire des fractions libérales : privatisations nouvelles, renforcement du chaos de la libre-concurrence sur les marchés, émergence de nouveaux milliardaires et nouvelle aggravation de la pauvreté, de la souffrance et de la misère pour les opprimés et les pauvres. Le triomphe des religieux fondamentalistes signifiera la croissance de la réaction cléricale, la suppression des droits des femmes et des minorités et le délitement inévitable provoquera une nouvelle guerre arabo-israélienne qui sera à nouveau un fardeau sur les épaules des masses laborieuses. Mais dans le paquet-cadeau « idéal » de l'institution d' un régime de démocratie parlementaire dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la population ouvrière ne gagnera rien. Le travailleur prêt à risquer sa vie pour l'avènement de la démocratie est comme un esclave prêt à mourir pour conquérir le droit de « choisir » son esclavagiste. La démocratie parlementaire ne mérite pas de lui sacrifier une seule goutte de sang humain !
Dans la lutte pour le pouvoir qui se mène dans la région, les Etats européens membres de l’OTAN et les Etats-Unis ont pris encore plus ouvertement position pour les groupes politiques d’opposition dans l’espoir que la victoire de ces forces et du modèle de « démocratisation » de leur domination politique leur rapportera davantage de bénéfices et de privilèges. En soutenant « la démocratie » en Tunisie et en Egypte, elles espèrent renforcer leur influence, libérer leurs « investissements » capitalistes de la corruption des dictateurs et prendre leur part lors de la prochaine privatisation par les riches des clans tribaux dominants. En aidant l’opposition libérale, monarchiste et religieuse fondamentaliste, qui s’est alliée avec une bandes d’anciens caciques officiels du régime de Kadhafi, elles espèrent prendre le contrôle des riches réserves pétrolifères. Liés à eux, d’autres Etats arabes sont entrés en lutte pour défendre leur influence et leurs propres ambitions dans la région.
Les pouvoirs – qui une fois de plus ne viennent avec des bombes et des missiles que pour « sauver » la vie du peuple et les « libérer » des dictatures- sont en train de tuer les populations. Les gouvernements des pays d’Europe occidentale et des Etats-Unis sont des menteurs et des hypocrites. Hier, ils soutenaient les dictateurs, leur donnaient l’accolade et leur vendaient des armes. Aujourd’hui, ils demandent que les dictateurs s’en aillent, en se prétendant « à l’écoute » des vœux du peuple mais ils n’hésitent pas à éliminer les protestations de la population dans leur propre pays, ignorant totalement leurs revendications. Quand la grande majorité des habitants de France ou de Grande-Bretagne, de Grèce ou d’Espagne, du Portugal ou d’Irlande disent qu’ils ne veulent pas payer de leurs poches l’aide des Etats aux banques et aux entreprises, tout en réclamant l’abrogation des mesures d’austérité, des réformes des retraites et des conditions de travail anti-sociales, les autorités leur répondent que la démocratie, ce n’est pas “la rue qui gouverne”. L’intervention “humanitaire” donne aux dirigeants d’Europe occidentale et des Etats-Unis un grand prétexte à leur pouvoir pour détourner l’attention des populations de ces pays des conséquences de la crise actuelle. La guerre “courte et victorieuse” pour “sauver le peuple et la démocratie” vise à faire oublier aux ouvriers européens et nord-américains les politiques anti-sociales des gouvernements et des capitalistes et à refaire l'expérience de l'arrogance de leurs dirigeants “humains” et “justes” à travers une prochaine “joyeuse union sacrée” entre les oppresseurs et les opprimés.
Nous appelons les travailleurs du monde entier à ne pas soutenir cette fraude “démocratique” et “humanitaire” et à s’opposer fermement à cette nouvelle escalade dans la barbarie capitaliste en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
Si nous pouvions apporter notre message aux masses pauvres opprimées et exploitées de la région, par delà les distances de milliers de kilomètres et par delà les barrières de la langue, nous les encouragerions à revenir à leurs motivations sociales et économiques de départ et aux thèmes de leurs revendications, à se rebeller, à partir en grève ou en manifestations contre leurs bas salaires, la hausse des prix et le chômage, pour leurs revendications sociales, mais en aucun cas à s’impliquer dans les jeux politiciens dans les luttes pour le pouvoir entre les différentes factions des classes dominantes.
Nous appelons les ouvriers d’Europe et d’Amérique à gagner la rue pour protester contre cette nouvelle guerre “humanitaire” qui sert les seuls intérêts des Etats et des capitalistes. Nous appelons les sections de l’Association Internationale des travailleurs (AIT) à développer leur agitation internationaliste et anti-militariste et à prendre l’initiative de manifestations et de grèves anti-guerre.
A BAS LA GUERRE !
A BAS TOUS LES ETATS ET TOUTES LES ARMEES !
PAS UNE SEULE GOUTTE DE SANG POUR LA DICTATURE OU LA DEMOCRATIE !
NON A TOUS LES GOUVERNEMENTS ET A TOUTES LES “OPPOSITIONS” !
SOLIDARITE AVEC LA LUTTE DES TRAVAILLEURS POUR POUR L’EMANCIPATION SOCIALE !
VIVE L’AUTO-ORGANISATION GENERALISEE DES TRAVAILLEURS !
Confédération des anarcho-syndicalistes révolutionnaires, section de l’AIT en Russie.
1� Voir notre article « Que se passe-t-il au Moyen-Orient ? [152] », Revue Internationale n°145
Géographique:
- Libye [120]
Courants politiques:
L'expérience de la grève de masse en Grande-Bretagne et en Irlande (1910-1914)
- 5006 lectures
Il va y avoir 100 ans, en août 1911, la classe dominante britannique était forcée de déployer des troupes et des bateaux de guerre à Liverpool pour écraser un grève générale presque insurrectionnelle. Le maire de la ville mettait en garde la gouvernement contre « une révolution en marche ».1
Ces événements extraordinaires représentaient le point culminant de toute une série de luttes en Grande-Bretagne et en Irlande avant la Première Guerre mondiale, passées à la popularité sous le nom de « grande fièvre ouvrière ». Comme le montre l’article qui suit, ces luttes étaient en fait une expression spectaculaire de la grève de masse, et faisaient intégralement partie d’une vague internationale qui allait finalement culminer dans la révolution de 1917 en Russie. Même si aujourd’hui, elles ne sont pas largement connues, elle restent riches en leçons pour les luttes d’aujourd’hui et de demain.
Le contexte international
Entre 1910 et 1914, la classe ouvrière en Grande-Bretagne et en Irlande déclencha des vagues successives de grèves massives avec un souffle et une hargne sans précédent contre tous les secteurs-clefs du capital, grèves qui balayèrent tous les mythes soigneusement fabriqués sur la passivité de la classe ouvrière anglaise qui avaient fleuri pendant la précédente époque de prospérité capitaliste.
Les mots utilisés pour décrire ces luttes dans l’histoire officielle vont de « unique », « sans précédent », à « explosion », « tremblement de terre »… En opposition aux grèves organisées par les syndicats largement pacifiques de la dernière moitié du XIXe siècle, les grèves d’avant la guerre s’étendirent rapidement et sauvagement aux différents secteurs – mines, chemins de fer, docks et transports, ingénierie, construction – et menacèrent de déborder tout l'appareil syndical et de s’affronter directement à l’Etat capitaliste.
C’était la grève de masse que Rosa Luxembourg a analysé si brillamment, dont le développement marquait la fin de la phase progressiste du capitalisme et l’apparition d’une nouvelle période révolutionnaire. Bien que l’expression la plus achevée de la grève de masse ait été celle de 1905 en Russie, Rosa Luxembourg montra que ce n’était pas un produit spécifiquement russe mais comme « une forme universelle de la lutte de classe prolétarienne déterminée par le stade actuel du capitalisme et des rapports de classe » (Grève de masse, Parti et Syndicats, Petite Collection Maspero, p. 154). Sa description des caractéristiques générales de ce nouveau phénomène décrit de façon très vivante « la grande fièvre ouvrière » :
« La grève de masse …voit tantôt la vague du mouvement envahir tout l'Empire, tantôt se diviser en un réseau infini de minces ruisseaux; tantôt elle jaillit du sol comme une source vive, tantôt elle se perd dans la terre. Grèves économiques et politiques, grèves de masse et grèves partielles, grèves de démonstration ou de combat, grèves générales touchant des secteurs particuliers ou des villes entières, luttes revendicatives pacifiques ou batailles de rue, combats de barricades - toutes ces formes de lutte se croisent ou se côtoient, se traversent ou débordent l'une sur l'autre c'est un océan de phénomènes éternellement nouveaux et fluctuants. » (Id., p.127)
Loin d’être le produit de conditions particulières à la Grande-Bretagne, la grève de masse en Angleterre et en Irlande faisait partie intégrante de la vague internationale de luttes qui se sont développées dans toute l’Europe de l’Ouest et en Amérique après 1900 : la grève générale de 1902 à Barcelone, les grèves de 1903 des cheminots en Hollande, la grève massive des mineurs de 1905 dans la Ruhr…
Les révolutionnaires ont encore à tirer toutes les leçons des grèves massives en Grande-Bretagne – en partie à cause de l’aspect abrupt et de la complexité des événements eux-mêmes, mais aussi parce que la bourgeoisie a rapidement essayé de les enterrer tranquillement comme étant un épisode oublié2. Ce n’est pas par hasard si aujourd’hui, c’est la grève générale de 1926, et pas la vague de grèves d'avant-guerre, qui a l’honneur d’avoir une place dans l’histoire officielle du « mouvement ouvrier » anglais : 1926 représentait une véritable défaite, alors que 1910-1914 a vu la classe ouvrière anglaise à l’offensive contre le capital.
La renaissance des luttes
Le détonateur des grèves massives en Angleterre et en Irlande peut être attribué à la dépression de 1908-1909. L’année précédente, la classe ouvrière s’était unie au-delà des divisions corporatistes pour déclencher une grève générale qui devait être défaite par l'armée et des forces de police spéciales3. Dans le Nord-Est de l’Angleterre, il y eut des grèves des ouvriers du coton, des métallurgistes et dans les chantiers navals. Une grève des chemins de fer fut évitée de justesse. Quand la dépression diminua, arriva l’explosion.
La première phase de grèves massives eut comme centre d’activité les mines de charbon auparavant peu combatives au Sud du Pays de Galles. Une grève illégale toucha nombre de puits entre septembre 1910 et août 1911, impliquant environ 30 000 mineurs à son point culminant. Les revendications initiales portaient sur les salaires et les conditions d’emploi. Les mineurs étendirent la grève grâce à des piquets de grève massifs. Il y eut aussi des grèves non officielles dans les mines de charbon normalement conservatrices au début de 1910 et des grèves spontanées dans les chantiers navals du Nord-Est.
Dans la seconde phase, le coeur du mouvement se déplaça dans le secteur des transports. Entre juin et septembre 1911, il y eut une vague d’actions combatives, non-officielles, dans les principaux ports et dans les chemins de fer qui faisaient là leur première expérience de grève nationale. Dans les ports, les syndicats locaux furent pris par surprise quand des piquets de grève massifs étendirent la grève de Southampton à Hull, Goole, Manchester et Liverpool et entraînèrent les ouvriers des autres industries portuaires qui mettaient en avant leurs propres revendications. Dès que les syndicats eurent négocié la fin de ces grèves, une autre vague de luttes éclata dans ce secteur, cette fois à Londres qui n’avait pas été encore touché. Des actions non-officielles s’étendirent à tout le système des docks contre un compromis sur les salaires négocié par les syndicats, les obligeant à appeler officiellement à une grève générale du port. Les grèves sauvages continuèrent pendant le mois d’août, malgré d’autres accords sur les salaires.
Alors que la grève sur les docks londoniens retombait, l’action de masse reprit dans les chemins de fer de façon sauvage en commençant au Merseyside où 8000 dockers et cheminots se rejoignirent au bout de 5 jours par solidarité. Vers le 15 août, 70 000 travailleurs étaient en grève au Merseyside. Un comité de grève se mit en place alors que la grève des gens de mer reprenait. Après le lock-out imposé par les employeurs, le comité déclencha une grève générale qui ne s’arrêta qu’après deux semaines de violents affrontements avec la police et l’armée.
Pendant ce temps, le mouvement sauvage dans les chemins de fer s’étendait rapidement de Liverpool à Manchester, Hull, Bristol et Swansea, obligeant les leaders syndicaux à appeler à la grève générale dans les chemins de fer, la première grève nationale du rail. Il y avait un soutien actif de la part des mineurs et d’autres ouvriers (y compris des grèves d’écoliers dans les villes où il y avait beaucoup de cheminots). Quand les leaders syndicaux appelèrent soudainement à arrêter la grève après des négociations avec le gouvernement, des milliers de travailleurs laissèrent éclater leur colère et la combativité persista.
Pendant l’hiver 1911-1912, le principal centre de la grève de masse passa à l’industrie minière, dans laquelle une action non-officielle directe conduisit à une grève nationale de 4 semaines impliquant 1 million d’ouvriers – la plus grande grève que la Grande-Bretagne ait jamais enregistrée. L’agitation à la base grandit lorsque les leaders syndicaux appelèrent au retour au travail et des grèves éclatèrent de nouveau dans le secteur des transports à Londres en juin-juillet. Le mouvement retomba en partie à cause du manque de soutien en dehors de Londres, mais pendant l’été 1912, il y eut d’autres grèves de dockers, dans le Meyerside par exemple.
A la différence de la précédente vague de grèves relativement pacifique de 1887-1893, les travailleurs se montraient plus que déterminés à utilisés la force pour étendre leur grève, et les grèves de masse d’avant-guerre ont vu des actes de sabotage largement répandus, des attaques dans le charbonnage, les docks, et les installations des chemins de fer, des affrontements violents avec les employeurs, les briseurs de grève, la police et l’armée, dans lesquels au moins 5 ouvriers furent tués et beaucoup d'autres blessés .
La bourgeoisie, comprenant la signification de ces luttes, prit des mesures sans précédent pour y mettre un terme. Le cas le plus fameux : 5000 soldats et des centaines de policiers furent envoyés à Liverpool en août 1911, tandis que deux bateaux de guerre dirigeaient leurs canons vers la ville. Le point culminant fut le « dimanche sanglant » : la dispersion violente d’une manifestation massive et pacifique d’ouvriers par la police et l’armée. En réponse, les ouvriers surmontèrent leur divisions sectorielles traditionnelles pour défendre leurs communautés pendant plusieurs jours se livrant à une espèce de « guérilla » en dressant des barricades et des protections en barbelés.
En 1912, l’Etat fut forcé de prendre des précautions encore plus élaborées, en déployant des troupes contre la menace d’une agitation généralisée et en instituant la loi martiale dans des zones entières du pays. De façon alarmante pour la bourgeoisie, il y eut des petits mais significatifs efforts de militants pour faire de la propagande antimilitariste dans l’armée, en particulier avec le fameux tract « Ne tirez pas ! », ce qui entraîna une répression rapide.
La classe ouvrière était alors confrontée à une contre-attaque de la classe capitaliste, qui était déterminée à infliger une défaite pour donner une leçon au prolétariat dans son ensemble. En 1913, plus de 11 millions de journées de grève accumulées furent perdus pour la classe dominante et il y eut plus de grèves individuelles que pendant toutes les autres années de « la fièvre », dans des secteurs jusque là non touchés comme ceux des ouvriers d’industrie semi et non qualifiés, du bâtiment, des travailleurs agricoles et des employés municipaux ; mais cette année fut celle d’un tournant définitif, marqué entre autre, par la défaite des ouvriers irlandais pendant le lock-out de Dublin.
La bureaucratie syndicale commença aussi à reprendre son contrôle sur les luttes ouvrières. La formation de « la triple alliance » en 1914, soi-disant conçue pour coordonner l’action des mineurs, des cheminots et des ouvriers du transport, était en réalité une mesure bureaucratique pour récupérer l’action spontanée et non officielle des grèves massives, et empêcher d’autres explosions incontrôlables de combativité à la base. De la même façon, la formation d’un Syndicat National des Cheminots en tant que seul « syndicat industriel reconnu » dans ce secteur, n’était pas tant une victoire des travailleurs qu’une manœuvre de la bureaucratie syndicale contre la combativité spontanée.
Néanmoins, le mécontentement persistait sans aucune défaite décisive, et à la veille de la Première Guerre mondiale, le ministre du gouvernement Libéral, Llyod George, faisait finement remarquer qu’avec l’agitation menaçante dans les chemins de fer, les mines, les industries et la construction, « l’automne serait témoin d’une série de troubles sans précédent » 4. Le déclenchement de la guerre en 1914 est certainement tombé au bon moment pour la bourgeoisie anglaise, freinant effectivement le développement des grèves massives et jetant la classe ouvrière dans une confusion profonde, bien que temporaire. Mais cette défaite s’avéra provisoire, et dès février 1915, les luttes ouvrières en Grande-Bretagne ressurgirent, sous l’impact de l’austérité due à la guerre, et se développèrent en tant que partie intégrante d’une vague internationale qui allait culminer dans la Révolution russe de 1917.
L’importance des grèves massives
Fondamentalement, les grèves d’avant-guerre étaient une réponse de la classe ouvrière à l’entrée en décadence du capitalisme, qui révélait toutes les plus importantes caractéristiques de la lutte de classe dans la nouvelle période :
- un caractère spontané, explosif ;
- une tendance à l’auto-organisation ;
- une extension rapide au-delà des différents secteurs ;
- une tendance à passer par-dessus tout l'appareil syndical et à s’affronter directement à l’Etat capitaliste.
Plus spécifiquement, les grèves massives étaient une réponse au développement du capitalisme d’Etat, et à l’intégration du Parti travailliste et des syndicats dans l'appareil d’Etat en vue de contrôler plus efficacement la lutte de classe. Parmi les militants combatifs, la perte d’illusion sur le socialisme parlementaire était largement répandue, du fait du soutien loyal du Labour aux programmes des Libéraux qui restreignaient la protection sociale et du rôle actif des syndicats dans l’administration de ces programmes.
De façon plus significative, pour la première fois dans son histoire, la classe ouvrière britannique déclenchait des luttes massives qui allaient au-delà des organisations syndicales existantes, et dans qcertains cas, directement contre elles. Les leaders syndicaux nationaux et locaux perdirent très souvent le contrôle du mouvement, en particulier pendant la grève des dockers et dans les transports (selon les rapports de police eux-mêmes, à Hull, les syndicats perdirent le contrôle sur la grève des dockers).
L’emprise des syndicats avait décliné, en partie à cause du mécontentement de la base vis-à-vis des dirigeants syndicaux. Certes, les grèves massives eurent comme résultat une augmentation de 50 % du nombre des adhésions aux syndicats entre 1910 et 1914, mais, contrairement à ce qui s’était passé dans les luttes de 1887-1893, la reconnaissance des syndicat n’était pas un thème majeur dans ces luttes, qui voyaient au contraire, des grèves sauvages et des actions directes contre les directions syndicales qui soutenaient « la conciliation » avec le gouvernement et étaient ouvertement hostiles à l’action de grève : par exemple, le dirigeant syndical des cheminots, Jimmy Thomas, fut hué pour sa son attitude conciliatrice et au cours d'un meeting de masse à Trafalgar Square en juillet 191, des ouvriers combatifs du bâtiment s’emparèrent du podium et refusèrent de donner la parole aux porte-paroles officiels des syndicats.
L’énorme pression de la base s’exerçait même sur des leaders syndicalistes plus combatifs : dans le Meyerside, par exemple, même le dirigeant syndicaliste Tom Mann fut chahuté et hué par les animateurs du mouvement et par les grévistes, et il fallut une semaine aux syndicats dans les assemblées générales pour saper la résistance des ouvriers et les contraindre à retourner au travail.
Les grèves massives virent aussi le développement de comités de grève sauvages, quelques uns continuant après la défaite des grèves en tant que groupes politiques exigeant de réformer les syndicats existant : par exemple, le Unofficial Reform Committee en Galles du Sud qui se battait pour la réforme du syndicat local des mineurs sur « des axes de combat ». Un groupe analogue surgit dans le syndicat d’usine en 1910 qui engagea une violente bataille avec les leaders de l’époque. Des groupes informels de militants apparurent aussi chez les dockers en lutte de Liverpool, proches de Jim Larkin, qui défendaient les idées syndicalistes, alors qu’à Londres, un « Comité Provisoire pour la formation d’un syndicat national des ouvriers des transports », syndicaliste, se formait sur la base du mécontentement à l’égard de la direction syndicale.
Nous pouvons voir dans ces épisodes un réel approfondissement de la conscience de classe et la diffusion de leçons importantes sur la nouvelle période au sein des masses de travailleurs entrés en lutte, par exemple :
- la perception d’un changement dans les conditions économiques et politiques de la lutte de classe ;
- le besoin d’une action directe des travailleurs pour défendre les conditions de vie de la classe ouvrière ;
- l’incapacité des syndicats, tels qu’ils sont organisés actuellement, de défendre les intérêts de la classe ouvrière et le besoin de se battre pour contrôler l’action des syndicats ;
- le besoin de nouvelles formes d’organisations plus adaptées aux nouvelles conditions.
Par-dessus tout, les luttes en Grande-Bretagne et en Irlande faisaient partie intégrante de la grève de masse internationale, et étaient donc importantes pour la classe ouvrière dans son ensemble. Les ouvriers britanniques n’étaient pas les premiers à entrer en lutte mais leur arrivée sur la scène en tant que fraction la plus ancienne et la plus expérimentée du prolétariat mondial était d’un grand poids pour le mouvement, donnant un exemple inestimable de lutte contre une bourgeoisie très sophistiquée et ses mystifications démocratiques. Ces luttes ont inévitablement montré aussi toutes les difficultés auxquelles se confrontent la classe ouvrière dans le développement et la transformation de ses luttes immédiates en mouvement révolutionnaire, surtout quand le changement de période et l’impossibilité de lutter pour des réformes au sein du capitalisme n’étaient pas encore clairement établis. Mais elles montraient la route à suivre.
MH (31/01/2011)
1 www.btinternet.com/~m.royden/mrlhp/students/transportstrike/transportstr... [154].
2 Un très bon compte-rendu de ces grèves d’avant-guerre peut être lu dans Le Syndicalisme britannique (1900-1914) de Bob Holton (Pluto Press, 1976) dont on s’est servi pour cet article.
3 https://en.internationalism.org/icconline/2007/sept/belfast-1907 [155]
4 Cité par Walter Kendall, The Revolutionary Movement in Britain (1900-1921), 1969, p.28.
Géographique:
- Grande-Bretagne [98]
Les émeutes en Grande-Bretagne et la perspective sans avenir du capitalisme
- 2337 lectures
Suite aux émeutes qui ont éclaté à travers le pays cette semaine, les porte-paroles de la classe dominante- le gouvernement, les politiciens, les médias, etc.- nous demandent de participer à la défense d'une campagne ayant pour but de soutenir leur « programme » : accroissement de l'austérité et répression accrue contre quiconque s'y opposerait.
Une austérité accrue parce qu'ils n'ont aucune solution à apporter pour remédier à la crise économique de leur système en phase terminale. La seule chose qu'ils puissent faire, c'est de supprimer des emplois, de baisser les salaires, de sabrer les aides sociales, d'amputer les dépenses sur les retraites, dans la santé, l'éducation. Tout cela ne peut signifier qu'une aggravation considérable des conditions sociales mêmes qui ont précisément poussé à ces émeutes, conditions entraînant la conviction chez une partie importante de toute une génération qu'ils n'ont plus d'avenir devant eux. C'est pourquoi toute discussion sérieuse sur les causes économiques et sociales des émeutes a été dénoncée comme voulant trouver « une excuse » aux émeutiers. On nous a raconté que c'étaient des criminels et qu'ils seraient traités comme tels. Point final. Ce qui est très pratique parce que l'Etat n'a aucune intention de donner de l'argent pour les centres urbains, comme elle l'avait fait après les émeutes des années 1980.
Une répression accentuée parce que c'est la seule chose que la classe dominante puisse nous offrir. Elle tire au maximum avantage de l'inquiétude des populations concernant les destructions causées par les émeutes pour accroître les dépenses de la police, pour l'équiper de balles en caoutchouc, de canons à eau et même pour mettre en avant l'idée d'imposer des couvre-feu et l'armée dans la rue. Ces armes, en même temps que la surveillance accrue des réseaux sociaux sur Internet et la « justice » expéditive qui s'est abattue sur ceux qui ont été arrêtés après les émeutes, ne seront pas seulement utilisées contre les pillages et les saccages. Nos dirigeants savent très bien que la crise ne peut que déboucher sur un torrent de révoltes sociales et de luttes ouvrières qui s'est déjà répandu de l'Afrique du Nord à l'Espagne et de la Grèce jusqu'en Israël. Ils sont parfaitement conscients qu'ils seront confrontés à l'avenir à des mouvements massifs et que toutes leurs prétentions démocratiques servent uniquement à justifier le recours à la violence contre ces mouvements, de la même manière que l'ont fait les régimes ouvertement dictatoriaux, comme en Egypte, au Bahreïn ou en Syrie. Il l'ont déjà démontré lors de la lutte des étudiants en Grande-Bretagne l'an dernier.
La « haute moralité » de la classe dominante
La campagne sur les émeutes est basée sur la proclamation de nos dirigeants qu'ils défendent ainsi la moralité de la société. Cela vaut la peine de considérer le contenu de ces déclarations.
Les porte-paroles de l'Etat condamnent la violence des émeutes. Mais c'est l'Etat lui-même qui exerce aujourd'hui la violence, à une bien plus large échelle, contre les populations en Afghanistan et en Libye. Une violence qui chaque jour est présentée comme héroïque et altruiste alors qu'elle sert uniquement les intérêts de nos dirigeants.
Le gouvernement et les médias condamnent les hors-la-loi et la criminalité. Mais c'est la brutalité de leurs propres forces de répression au nom du maintien de la loi et de l'ordre, la police, qui, dès le début, a mis le feu aux poudres, avec l'assassinat de Mark Duggan et le comportement méprisant envers sa famille et ses amis qui manifestaient autour du poste de police de Tottenham afin de savoir ce qui s'était réellement passé. Et cela fait suite à toute une longue série de gens morts dans des commissariats situés dans des quartiers similaires à celui de Tottenham ou subissant quotidiennement le harcèlement policier dans les rues.
Le gouvernement et les médias condamnent l'avidité et l'égoïsme des émeutiers. Mais ce sont eux les gardiens et les propagandistes d'une société qui fonctionne sur la base de l'avidité organisée, de l'accumulation de richesses entre les mains d'une petite minorité. Alors que nous sommes sans cesse encouragés à consommer davantage pour réaliser leurs profits, à identifier notre valeur sociale à la quantité de biens que l'on peut s'acheter. Puisque non seulement ce système repose sur l'inégalité, et que celle-ci devient de pire en pire, il n'est pas surprenant que ceux qui sont au bas de l'échelle sociale, qui ne peuvent pas s'offrir les « belles choses » dont on leur vante le besoin, pensent que la réponse à leur problème est de piquer tout ce qu'ils peuvent, quand ils le peuvent.
Les dirigeants condamnent ce pillage « à la petite semaine » alors qu'eux mêmes participent à une vaste opération de pillage à l'échelle planétaire : les compagnies pétrolières ou forestières qui détruisent la nature pour leur profit, les spéculateurs qui s'engraissent en faisant grimper le cours des produits alimentaires, les trafiquants d'armes qui vivent de la mort et des destructions, les respectables institutions financières qui blanchissent des milliards du trafic de drogue. Une contrepartie essentielle de ce pillage est qu'une partie croissante de la classe exploitée est jetée dans la pauvreté, dans le désespoir et la délinquance. La différence, c'est que les petits délinquants sont habituellement punis alors que les grands criminels ne le sont pas.
En résumé : la moralité de la classe dominante ? Elle n'existe pas.
La vraie question : comment se défendre ?
La question réelle à laquelle est confrontée l'immense majorité qui ne profite pas de cette gigantesque entreprise criminelle appelée capitalisme, est celle-ci : comment pouvons-nous nous défendre réellement alors que ce système, maintenant en train de crouler sous les dettes, est contraint de tout nous prendre ?
Est-ce que les émeutes que nous avons vues début août 2011 en Grande-Bretagne nous donnent une méthode pour lutter, pour prendre le contrôle de ces luttes, pour unir nos forces, pour créer un futur différent pour nous-mêmes ?
Beaucoup de ceux qui ont pris part aux émeutes ont clairement exprimé leur colère contre la police et contre les possesseurs de richesses qui sont ressentis comme la cause essentielle de leur misère. Mais, presque immédiatement, les émeutiers ont sécrété les aspects les plus négatifs, les comportements les plus troubles, alimentés par des décennies de désintégration sociale dans les quartiers urbains les plus pauvres, par des moeurs propres aux gangs, allant puiser dans la philosophie dominante du « chacun pour soi » et du « sois riche ou crève en essayant de le devenir ! » C'est ainsi qu'au début une manifestation contre la répression policière a dégénéré dans un chaos franchement anti-social et dans des actions anti-prolétariennes : intimidation et agression vis-à-vis d'individus, mise à sac de boutiques dans le voisinage, attaques contre les ambulanciers et les pompiers, incendies d'immeubles sans discrimination, alors que souvent les occupants se trouvaient encore à l'intérieur.
De telles actions n'offrent absolument aucune perspective permettant de se dresser contre ce système de rapine dans lequel nous vivons. Au contraire, elles servent uniquement à élargir les divisions parmi ceux qui souffrent de ce système. Face aux attaques contre les boutiques et les immeubles, des habitants se sont armés eux-mêmes de battes de base-ball et ont formé des « unités d'auto-défense ». D'autres se sont portés volontaires pour des opérations de nettoyage au lendemain des émeutes. Beaucoup se sont plaints du manque de présence policière et ont demandé des mesures plus fortes.
Qui profitera le plus de ces divisions ? La classe dominante et son Etat. Comme nous l'avons dit, ceux qui sont au pouvoir se revendiqueront maintenant d'un mandat populaire pour renforcer l'appareil répressif policier et militaire, pour criminaliser toute forme de manifestations et de désaccords politiques. Déjà les émeutes ont été imputées à « des anarchistes » et, il y a une semaine ou deux, la police londonienne (le MET) a fait l'erreur de publier des enquêtes sur des personnes militant pour une société sans Etat.
Les émeutes sont le reflet de l'impasse atteint par le système capitaliste; Elles ne sont pas une forme de la lutte de la classe ouvrière ; elles sont plutôt une expression de rage et de désespoir dans une situation où la classe ouvrière est absente en tant que classe. Les pillages ne sont pas un pas vers une forme de lutte supérieure, mais un obstacle sur ce chemin. D'où la frustration justifiée d 'une femme du quartier londonien d'Hackney qui a été regardée par des milliers de gens sur Youtube [1], dénonçant les pillages parce que cela empêchait les gens de se regrouper et de réfléchir ensemble sur comment mener la lutte. « Vous me faites chier... nous ne sommes pas rassemblés pour nous battre autour de la défense d' une cause. Nous sommes en train de piller Footlocker... » (NDT : un magasin de chaussures à Londres ).
Se rassembler et lutter pour une cause : ce sont là les méthodes de la classe ouvrière ; c'est la morale de la lutte de classe prolétarienne mais ces méthodes courent le danger d'être happées par l'atomisation et le nihilisme au point que des pans entiers de la classe ouvrière oublient qui ils sont.
Mais il existe une alternative. On peut la percevoir dans les mouvements massifs qui se déroulent en Tunisie, en Egypte, en Espagne, en Grèce ou en Israël avec la re-émergence d'une identité de classe, avec la résurgence de la lutte de classe. Ces mouvements, avec toutes leurs faiblesses, nous donnent un aperçu sur une manière toute différente de mener le combat prolétarien : à travers des assemblées de rues où chacun peut prendre la parole ; à travers un intense débat politique où chaque décision peut être discutée ; à travers une défense organisée contre les attaques de la police et des voyous ; à travers les manifestations et les grèves des travailleurs ; à travers la montée de la question de la révolution, de l'interrogation sur une forme de société totalement différente, non pas basée sur la vision que l'homme est un loup pour l'homme mais sur la solidarité entre les êtres humains, basée non sur une production en vue de la vente de marchandises et du profit mais sur une production qui corresponde à nos réels besoins.
A court terme, à cause des divisions créées par les émeutes, parce que l'Etat a réussi son coup en matraquant le message selon lequel toute lutte contre le système actuel est vouée à finir dans des destructions gratuites, il est probable que le développement d'un réel mouvement de classe au Royaume-Uni se confrontera à des difficultés encore plus grandes qu'auparavant. Mais à l'échelle mondiale, la perspective reste la même : l'enfoncement dans la crise de cette société vraiment malade, la résistance de plus en plus consciente et organisée des exploités. La classe dominante en Grande-Bretagne ne pourra être épargnée ni par l'un ni par l'autre.
CCI (14/08/2011)
Géographique:
- Grande-Bretagne [98]
Récent et en cours:
- Emeutes [157]
- Grande Bretagne [158]
Rubrique:
Notes sur le mouvement anarchiste internationaliste en Grande-Bretagne
- 3151 lectures
(World Revolution, organe de presse du CCI en Grande-Bretagne - mai 2011)
Ce texte ne prétend pas reprendre de manière exhaustive, d’un point de vue marxiste, l’histoire du mouvement anarchiste en Grande-Bretagne écrite d’un point de vue marxiste, ni ses relations avec les traditions marxistes. Une telle tâche est nécessaire mais elle prendra du temps, de la réflexion et de la discussion. Le but de ces notes est beaucoup plus modeste : servir de base à une reconnaissance et une compréhension que l’anarchisme en Grande-Bretagne, comme ailleurs, a son aile révolutionnaire internationaliste, donc capable de nous permettre alors de corriger certaines erreurs significatives que nous avons faites à l’égard de plusieurs de ses expressions organisées. Centrer son attention sur ces expressions organisées ne pourra jamais donner une complète image de l’anarchisme, qui, presque par définition, contient un grand nombre d’individus « inorganisés »1, mais c’est une voie nécessaire pour comprendre les principaux courants historiques du mouvement anarchiste du Royaume-Uni.
1) L’anarchisme en Grande-Bretagne se réclame de ses prédécesseurs spécifiques : Winstanley pendant la Guerre civile anglaise, William Goldwin et William Blake à la fin du 18e siècle, le poète Shelley. Mais il n’y a pas d’équivalents aux figures majeures de l’anarchisme dans la période ascendante, comme Proudhon, dont la vision d’artisan avait déjà été dépassée par le développement de l’industrie capitaliste et celui d’un mouvement ouvrier organisé en Grande-Bretagne. De même, le bakouninisme a eu peu d’impact dans les sections britanniques de l’Internationale des années 1869 et 1870. Cependant, une variante du bakouninisme – avec sa mise en avant d’une organisation conspirative et d’un insurrectionisme violent se fondant dans le terrorisme – s’est implantée au Royaume-Uni dans le mouvement des années 1880, via des « immigrants » comme Johann Most. Ce type d’anarchisme était très fort dans les clubs d’exilés qui surgirent dans l’East End de Londres en particulier, et devait avoir un impact largement négatif sur le développement de l’anarchisme en Grande-Bretagne. Ce milieu était un sol fertile pour les flics et les informateurs de tout poil, comme on voit par exemple dans le rôle joué par Auguste Coulon dans le procès et l’emprisonnement des anarchistes de Walsall, qu'il avait attirés dans un complot ridicule avec des bombes artisanales .
2) Mais chez de nombreux anarchistes qui tentèrent de se relier au mouvement ouvrier, à la fois dans ses dimensions économiques et historiques, dans les années 1880, en Grande-Bretagne et partout en Europe, il n’y avait pas de ligne de démarcation rigide entre anarchistes et socialistes. Des éléments comme Joseph Lane et Frantz Kitz étaient plus ou moins des communistes libertaires, et étaient depuis le début opposés à toute forme de parlementarisme. Ils rejoignirent néanmoins la Fédération social-démocrate et s’en séparèrent ensuite en compagnie de William Morris, d’Eléanor Marx et d’autres pour former la Ligue Socialiste (Socialist League – SL) en 1885. La SL était elle-même déjà déchirée par des désaccords entre le courant autour de Marx et Aveling – soutenue par Engels – et le courant anti-parlementaire qui était conduit au début par Morris mais qui s’orientait de plus en plus dans une direction anarchiste. Le Manifeste Communiste anti-étatique (Anti-statist Communist Manifesto) fut la position la plus représentative de cette tendance. Le fossé grandissant entre ces deux tendances fut une manifestation classique des difficultés à élaborer une orientation révolutionnaire claire dans cette période de croissance capitaliste triomphante. D’un côté, Engels, Eléanor Marx et Aveling insistaient justement sur le besoin des groupes socialistes de rompre avec l’isolement sectaire et de s’impliquer dans l’évolution réelle du mouvement ouvrier, qui dans les années 1880 se développait sous la forme de grèves et de formation de nouveau « trade-unions » qui recrutaient sur une base plus large. Le côté négatif de cette insistance se solda par une difficulté à résister à la poussée du réformisme et de l’opportunisme, qui étaient un danger particulièrement fort dans les sphères parlementaires et municipales, comme on le vit à travers le développement de courants purement réformistes comme celui des Fabiens. En retour, cela renforça la tentation de Morris et d’autres de retomber dans une sorte de purisme abstrait qui – comme le SPGB2 d’aujourd’hui – voyait dans son principal champ d’action comme étant de “faire concurrence aux socialistes » ; parallèlement à cela, nombre d’éléments anarchistes au sein de la Ligue étaient tirés vers les pires sortes d’aventurisme et de positions violentes, ce qui conduisit Morris à quitter la Ligue en 1890.
3) Aux côtés de ces développements, l’anarchisme en Grande-Bretagne vers la fin du 19e siècle trouva d’autres expressions. Il y avait le communisme anarchiste plus sobre, plus théorique de Kropotkine, dont les réflexions sur l’évolution dans L’entraide mutuelle et sur la société future dans ses travaux comme Champs, Usines et Ateliers (Fields, Factories and Workshops) sont toujours à prendre en considération. En contraste avec le « mutualisme » de Proudhon, qui envisageait une société future explicitement fondée sur des relations d’échange, et au « collectivisme » de Bakounine, qui était une sorte de moyen terme entre Proudhon et le communisme, Kropotkine défendait explicitement un mode communiste de production fondé sur l’abolition du travail salarié et de la production marchande. Kroptkine et Morris étaient certainement d'accord sur la nature de la société qu’ils voulaient atteindre et le “Prince anarchiste” (Kropotkine) était un orateur occasionnel dans les meetings de la Société Socialiste d’Hammersmith dans laquelle Morris maintînt son activité militante après s’être séparé de la Ligue. Aussi importante fut la contribution de l’anarchiste allemand Rudolf Rocker dont le domaine principal d’activité se déroulait dans le milieu des anarchistes juifs de l’East End et sa publication Arbeter Fraint. Comme cela est relaté dans le livre de William Fishmann, East End Jewish Radicals 1875-1914, le groupe Arbeter Fraint était directement relié à de réelles luttes ouvrières, spécialement dans les grandes grèves de l’industrie textile des années 1900. Rocker prit une position internationaliste face à la Première Guerre mondiale, s’opposant ouvertement aux positions de Kropotkine. Une autre catégorie de l’anarchisme au Royaume-Uni est celle représentée par les formes plus artistiques et utopistes de figures telles qu’Edward Carpenter.
4) L’approche d’une nouvelle époque de la vie du capitalisme et de la lutte des classes a amené des développements significatifs pour le mouvement anarchiste. Les années 1900 ont vu un surgissement majeur dans la lutte des classes et la recherche de nouvelles formes d’organisation qui pouvaient aller au-delà à la fois de la bureaucratie et du réformisme des syndicats établis, et de strict parlementarisme de groupes comme le SDF.3 La réponse de nombreux militants ouvriers a été de se tourner vers le syndicalisme ou l’unionisme industriel, bien qu’il n’existât pas d’équivalent soit comme la CNT en Espagne, la CGT en France ou les IWW aux Etats-Unis, qui auraient pu remplir la fonction de réels organes de lutte. Des groupes comme la Ligue d’Education Industrielle Syndicaliste (Industrial Syndicalist Education League), formée en 1910, ne furent jamais réellement plus que des groupes de propagande pour les syndicats révolutionnaires. Malgré cela, ce syndicalisme a développé une réelle présence dans certaines dans l’apparition du mouvement des shop-stewards pendant la guerre. La majorité des éléments impliqués dans ce mouvement étaient de vrais internationalistes, participant activement dans les grèves de l’industrie d’armement et ailleurs, et vinrent soutenir la révolution d’Octobre et la Troisième Internationale dans sa phase initiale.
5) La Première Guerre mondiale divisa le mouvement anarchiste comme elle le fit pour les marxistes. Le plus connu, Kropotkine, abandonna ouvertement l’internationalisme, soutenant la France « démocratique » contre le militarisme allemand, et d’autres suivirent inévitablement ce sillon. La majorité des anarchistes s’y opposèrent, bien que certains d’un point de vue essentiellement pacifiste. Les pages de Freedom, le journal que Kropotkine avait aidé à fonder, donnaient lieu à de violentes polémiques sur la question de la guerre. Il est notable, cependant, qu’il semblait y avoir eu peu de choses dans la voie d’une d'opposition organisée à la guerre, sur des bases spécifiquement anarchistes. La période de la guerre est mise en valeur dans le livre de Woodcock, et son chapitre traitant de l’anarchisme en Grande-Bretagne4 passe rapidement sur la période de la guerre, vue comme une période de déclin de cette mouvance, du fait de la répression d’Etat, et l’histoire tout à fait détaillée de l’anarcho-communisme publiée par la Fédération Anarchiste en Grande-Bretagne5 parle principalement du travail que les anarchistes firent dans des groupes comme la North London Herald League aux côtés des socialistes, ou du groupe animé par Guy Aldred. L’histoire du syndicalisme publiée par de la Fédération de la Solidarité ( Solidarity Federation) en Grande-Bretagne6 est encore moins explicite quand elle traite de cette période cruciale. Ceci met en valeur l’importance du groupe d’Adred basé à Glasgow qui publiait L’Eperon (The Spur) (et plus tard la Commune Rouge-Red Commune). Au sein du mouvement anarchiste de Grande-Bretagne, le groupe d’Aldred prit la position la plus claire sur la guerre et essaya de jeter un pont au dessus du fossé creusé entre l’anarchisme et le marxisme, travaillant avec des éléments du Parti Socialiste Travailliste (Socialist Labour Party) et soutenant ardemment les Bolcheviks dans la première phase de la Révolution russe. Aldred peut être considéré comme l’équivalent britannique de la tendance « anarchiste soviétique » pendant la vague révolutionnaire et comme un élément-clé de la tradition « communiste anti-parlementaire » qui unifia des éléments de l’anarchisme internationaliste et du communisme de conseils. La Fédération Communiste Anti-Parlementaire (Anti-Parliamentary Communist Federation – APCF) fut formée en 1921 et maintînt son activité pendant plus de 20 ans, malgré le fait qu’Aldred s’en soit séparé en 1934 et qu’il en vint à rechercher une unité plus large via le Mouvement Socialiste unifié (United Socialist Movement), s'égarant parfois dans des directions plutôt douteuses. L’APCF, qui changea son nom en Ligue des Ouvriers Révolutionnaires (Workers' Revolutionary League) en 1941, prit une position rigoureusement internationaliste contre la Seconde Guerre mondiale, la définissant comme impérialiste des deux côtés : cela est rapporté par le livre de Mark Shipway, Communisme anti-parlementaire, Le mouvement des conseils ouvriers en Grande-Bretagne 1917-1945, Anti-Parliamentary Communism, The Movement for Workers Councils in Britain 1917-1945, publié en 1988, tout comme dans notre propre livre sur La Gauche communiste britannique. Cette tradition communiste de conseils disparaîtra essentiellement autour de 1945, mais elle renaquit brièvement dans les années 1980 avec la publication Etoile noire (Black Star).
6) Le mouvement anarchiste, comme les communistes de gauche autour du Workers’ Dreadnought, semble être entrés dans une période de déclin du milieu des années 1920 au milieu des années 1930, ce qui correspond à la victoire de la contre-révolution. La guerre d’Espagne conduisit à un renouveau des idées anarchistes mais il est remaquable de constater que le mouvement en Grande-Bretagne abritait une aile gauche autour de Marie-Louise Berneri et de Vernon Richards, qui étaient très critiques envers les compromissions et les trahisons de droite des plus hauts responsables de la CNT au sein de l’Etat républicain, et ce fut la même tendance, à travers le magazine Commentaire de guerre (War Commentary), qui maintint une attitude internationaliste pendant la Seconde Guerre mondiale (cela est également relaté dans notre livre sur La Gauche communiste britannique)7. En 1944, les éditeurs de War Commentary furent envoyés devant les tribunaux pour sédition. Après 1945, War Commentary fut remplacé par une nouvelle série, Freedom, qui a continué depuis lors, bien que pas nécessairement avec la même politique de classe. Parallèlement à cela, une Fédération Anarchiste de Grande-Bretagne (Anarchist Federation of Britain – AFB), organisation clandestine, était mise sur pied au début de la guerre ; en 1944, l’AFB était fortement influencée par un groupe d’anarcho-syndicalistes qui forma en 1954 la Fédération Ouvrière Syndicaliste (Syndicalist Workers' Federation, qui publiait l’Association Internationale Ouvrière (International Workers’ Association), publiant Action Directe (Direct Action) et s’alignait sur l’Association Internationale Ouvrière des Travailleurs. Ce groupe prit une position claire sur le programme de nationalisation d’après-guerre du Labour Party et publia un des rares compte-rendus contemporains sur l’insurrection ouvrière en Hongrie écrit d'un point de vue prolétarien. Les difficultés de l’engagement politique des années 1950 conduisirent aussi au rétrécissement du SWF en un seul groupe à Manchester, mais il se joignit plus tard à d’autres éléments pour former le Mouvement d’Action Directe (Direct Action Movement) en 1979, qui se transforma en Fédération de Solidarité (Solidarity Federation - Solfed) en 1994. Aussi, contrairement à l’article publié dans WR n° 109 de novembre 1987, qui argumentait le fait que le DAM était à la racine une variété gauchiste du syndicalisme de base, Solfed est de fait l’héritage d’une tradition ouvrière qui –malgré toutes ses ambiguïtés sur les syndicats et d’autres questions – plonge ses racines dans l’internationalisme.
L’anarchisme internationaliste des années 1950 à aujourd’hui
7) Les années 1950 ont été décrites comme une “période de somnolence” pour l’anarchisme en Grande-Bretagne8. Mais les bouleversements des années 1960 apportèrent une renaissance des idées libertaires sur différents fronts, par exemple comme aile radicale des manifestations du CND9 ou comme élément dans l’émergence des « mouvements » autour de la politique sur les questions sexuelles, de l’environnement, et de la vie quotidienne en général. L’anarchisme britannique dans les années 1960 et au début des années 1970 a aussi connu un bref flirt avec la Propagande par le Fait sous la forme de la "Angry Brigade" ("Brigade de la Colère"). Tout aussi important fut le travail du groupe Solidarity émanant de Socialisme ou Barbarie, et initié par des gens qui avaient rompu tardivement avec le trotskisme. Plus proches du conseillisme que de l’anarchisme, les publications de Solidarity ont connu un impact important avec une audience anarchiste/libertaire plus large10. En 1963, une nouvelle Fédération Anarchiste de Grande-Bretagne (Anarchist Federation of Britain) fut créée pour regrouper toutes les différentes variétés de l’activité anarchiste, mais comme Nick Heath (membre fondateur de l’actuelle AF) le rappelle dans son essai sur le mouvement anarchiste depuis les années 196011, ce n’était même pas une fédération mais un patchwork de tendances contradictoires allant des anarcho-syndicalistes aux communistes-anarchistes, des individualistes aux pacifistes et aux défenseurs de « la vie quotidienne». Heath utilise même le terme « marais » pour décrire le poids de l’anarcho-libéralisme et de la théorisation de « lubies » de toutes sortes dans l’AFB.
8) Sous l’impact du réveil international des luttes ouvrières après Mai 1968, il y eut une réaction contre ce marais et différentes tentatives pour développer une tendance anarchiste de lutte de classe avec une forme plus effective d’organisation. L’Organisation des Anarchistes Révolutionnaires (Organisation of Revolutionary Anarchists), formée autour de 1970, fut une tentative de mettre cet effort en pratique, en se reliant principalement à La Plateforme Organisationnelle des Communistes Libertaires (The Organizational Platform of the Libertarian Communists [159] [2]) produite en 1926 par Archinov, Ida Mett, Makhno et d’autres réfugiés de la défaite en Russie. La Plateforme avait, tout à fait correctement, argumenté qu’une des raisons à l’écrasement de la résistance à la contre-révolution en Russie s’était trouvée dans le fait que ceux qui avaient résisté, et en particulier les anarchistes, avaient totalement manqué de cohérence organisationnelle et politique. Cela était fondamentalement une saine réponse de classe au problème de s’opposer à la dégénérescence de la révolution. Hélas, l’histoire du « plateformisme » semble avoir été que la recherche d’une telle cohérence avait conduit à la constitution d'un gauchisme sur un terrain bourgeois, généralement sous sa forme trotskiste. La faillite de l’ORA a souligné la force de cette difficulté, une grande part de ses éléments glissant vers différentes formes de gauchisme – certains vers le trotskisme pur et simple, d’autres vers une forme plus libertaire de la même approche, comme l’exprime l’exemple du Libertarian Communist Group (Groupe Libertaire Communiste) des années 1970, dont une partie fusionna avec les néo-maoïstes de « Grande Flamme » (Big Flame). Des formes plus récentes de cette sorte « d’anarcho-trotskisme » incluent le Groupe Anarchiste Ouvrier (Anarchist Workers Group [160] [3]), qui a soutenu le régime de Saddam Hussein contre « l’impérialisme » dans la Guerre du Golfe, et l’actuel Mouvement de Solidarité Ouvrière (Workers’ Solidarity Movement [161] [4]) en Irlande qui n’hésite pas à appeler à la nationalisation des matières premières irlandaises et plaide le soutien à « l’anti-impérialisme » (c’est-à-dire au nationalisme) en Irlande.
9) Au milieu de la fin des années 1980, nous avons assisté à deux principaux développements du mouvement anarchiste organisé : la montée spectaculaire de Guerre de Classe (Class War), et le plus modeste mais beaucoup plus substantiel développement de la Fédération Communiste Anarchiste (Anarchist Communist Federation), aujourd’hui l’AF. A propos de Class War, la partie du livre de Nick Heath concernant ce groupe peut être citée entièrement : « Class War, qui a émergé en tant que groupe autour du journal du même nom au milieu des années 1980, s’est transformé en Fédération de Guerre de Classe (Class War Federation) en 1986. Le groupe ultérieur était fait d’activistes qui rejetaient le pacifisme, l'ancrage à la vie quotidienne et le mouvement hippy qui étaient les tendances dominantes au sein de l’anarchisme britannique. En cela, il représentait un salutaire coup de pied au cul à ces mouvements. De plus, comme dans les actions de « Stop the War ! », il rejetait l’apathie comme la routine. Il poussait vers l'apport de solutions organisationnelles dans sa recherche de développement d'une Fédération. Mais il s'englua dans un populisme qui fut parfois crasse, dans sa recherche de « trucs spectaculaires » pour attirer l’attention des médias. Dans sa quête de publicité, il alla assez loin pour s’immerger dans un électoralisme populiste comme par exemple à travers son engagement dans les primaires électorales de Kensington. Ces contradictions devaient bien sûr conduire à la rupture avec la vieille CWF, avec une critique parfois tranchante. Cependant, aucune alternative organisationnelle ne fut proposée au-delà d’une conférence à Bradford qui tenta d’atteindre d’autres anarchistes et d’offrir une approche non-sectaire vers l’unité de ceux qui étaient sérieusement intéressés à faire avancer le mouvement. Hélas, ces mouvements étaient morts-nés et la plupart de ceux qui avaient avancé des critiques sur l’ancienne façon d’opérer sortirent ensemble et abandonnèrent toute activité. Un groupe croupion survécut, qui a été soutenu par le maintien de Class War à la fois comme groupe et comme journal dans la même vieille veine. »
La citation qui suit est de “ACF- Les premières dix années” (ACF- The first ten years) : “Le naufrage du communisme anarchiste de la fin des années 1970 a signifié qu’il n’y avait pas d’organisation communiste anarchiste, pas même à l'état de squelette, qui aurait pu se relier aux émeutes de 1981 et à la grève des mineurs de 1984-85 aux mobilisations comme les actions de Stop the City de 1984. Mais à l’automne 1984, deux camarades, dont un vétéran de l’ORA/AWA/LCG, sont revenus de France où ils avaient vécu et travaillé et où ils avaient été impliqués dans le mouvement communiste libertaire. La décision fut prise de mettre sur pied le Groupe de Discussion Libertaire Communiste [Libertarian Communist Discussion Group, LCDG] avec l’objectif de créer une organisation spécifique. Des copies de la Plateforme Organisationnelle des Communistes Libertaires [Organisational Platform of the Libertarian Communists] furent distribuées dans les librairies, avec une adresse de contact pour le Groupe de Discussion Anarchiste-Communiste (Anarchist-Communist Discussion Group, ACDG). Les progrès étaient lents, jusqu’à un contact avec le camarade qui produisait un magazine dupliqué qui se définissait comme “anarcho-socialiste”. Ce camarade avait rompu avec la politique du SWP12 et s’engageait rapidement dans une direction anarchiste. Mis à part son sens de l’humour, Virus se signalait par ses critiques du léninisme et du marxisme – rien d’étonnant étant données les expériences passées du camarade. A partir du numéro 5, Virus devint la pièce maîtresse du LCDG, et publia une série d’articles sur l’organisation libertaire. D’autres personnes étaient attirées par le groupe, et il se transforma en ACDG, qui proclamait que son but à long terme était de mettre en place une organisation anarchiste-communiste. Cela arriva plus tôt que prévu, avec la croissance du groupe, et une partie du Mouvement d’Action Directe (Direct Action Movement), Syndicalist Fight (Combat Syndicaliste) fusionnant avec le groupe. En mars 1986, la Fédération Anarchiste Communiste était officiellement fondée, avec accord d’ensemble sur les buts et les principes et la structure constitutionnelle qui avait été développé dans les six mois précédents13. »
10) Etant donné que certains des éléments impliqués dans la formation de l’AF se sont trouvés dans la mouvance qui conduisit de l’ORA au Groupe Libertaire Communiste néo-gauchiste (Libertarian Communist Group), il n’est pas surprenant que le CCI vit à l’origine la Fédération Communiste Anarchiste (Anarchist Communist Federation) comme une autre expression de ce type gauchiste de l’anarchisme14, spécialement parce que, depuis le début, nombre de ses activités paraissait offrir peu de choses d’autre qu’un vernis anarchiste recouvrant la participation à une pléthore de campagnes gauchistes, dont l'implication dans l’anti-fascisme n'était pas le moindre. Cependant, ce que cette position a raté s’est trouvé dans le fait que l’ACF contenait certains éléments qui indiquaient une tentative d’éviter de sombrer complètement dans le gauchisme. La désertion vers le trotskisme de membres fondateurs de l’ORA n’allait pas à l’époque sans une certaine opposition et donna lieu à des ruptures qui donnèrent naissance à différents groupes à la vie éphémère, telle l’Association des Ouvriers Anarchistes (Anarchist Workers’ Association) ; mais peut-être plus important, ceux qui formèrent l’ACF essayèrent de tirer des leçons-clé de toute cette expérience, au moins sur les questions des syndicats et des libérations nationales : « Ce qui est surtout remarquable, c’est la saut qualitatif que l’ACF a fait dans sa critique des syndicats. Une critique de l’anarcho-syndicalisme était approfondie et renforcée. En meme temps, l’ACF rompait avec les idées du syndicalisme de base qui avaient caractérisé la période ORA/AWA/LCG, tout comme avec des notions sur la libération nationale et l’auto-détermination des peuples. (ACF – the first ten years) De même, plutôt que d’adhérer dogmatiquement à la tradition “plateformiste”, l’ACF vit nombre de ses différents courants comme faisant partie de son héritage historique, comme on peut le voir dans la série d’articles « Dans la Tradition » qui commence dans Organise 52. Ces derniers incluaient la « plateforme 26 », Les Amis de Durruti, Socialisme ou Barbarie et les communistes de Gauche allemands, hollandais et anglais. Mais, manquant d’une réelle compréhension des tendances internationalistes dans l’anarchisme, et convaincus que l’ACF était issue du gauchisme sans nous questionner réellement sur ses origines, nous avons répondu à ces développements en interprétant l’intérêt de l’ACF envers la Gauche communiste comme une forme de parasitisme, alors même que l’ACF était loin de correspondre à notre définition d’une organisation parasitaire15. Ces fausses assertions ont été renforcées par la décision de l’ACF de retirer “communiste” de son nom à la fin des années 1990.
11) A Londres en 1886, lors d’un congrès houleux de l’Internationale Socialiste, la tentative des délégations anarchistes de rejoindre l’organisation fut rejetée, marquant l’exclusion définitive des anarchistes de l’Internationale. Le vote pour les exclure était mené sur une base qui avait été discutée dans certaines sections que certains trouvaient douteuses, et nombre des socialistes présents, soit physiquement soit en suivant ce qui s'y passait (y compris Keir Hardie et William Morris) s’opposèrent à cette décision. Nous n’évaluerons pas ici ces évènements ; mais ils illustrent la difficile et souvent traumatique relation entre les ailes anarchistes et marxistes du mouvement ouvrier, qui était encore actuelle à travers la rupture entre Marx et Bakounine à la fin de la Première Internationale. Des moments d’attraction et de répulsion continuèrent à perdurer à travers l’histoire du mouvement. Les énormes perspectives ouvertes par la vague révolutionnaire qui débuta en 1917 donna naissance à des espoirs que la rupture traditionnelle entre les révolutionnaires marxistes et anarchistes soient remise en cause, avec les anarcho-syndicalistes assistant au premier congrès de la Troisième Internationale et les anarchistes combattant aux côtés des bolcheviks pour le renversement du pouvoir bourgeois en Russie. Ces espoirs furent très rapidement déçus, d’abord parce que les bolcheviks, pris dans le carcan du nouvel Etat soviétique, commencèrent à supprimer les autres expressions du mouvement révolutionnaire en Russie, principalement chez les anarchistes. Il est certainement vrai que certains anarchistes – comme ceux qui avaient tenté de faire sauter le quartier général bolchevique de Moscou en 1918 – manquèrent d’un certain sens des responsabilités révolutionnaires, mais la répression mise en œuvre par les bolcheviks attaquait les tendances clairement prolétariennes comme celle des anarcho-syndicalistes autour de Maximoff. Le triomphe mondial de la contre-révolution renforça ensuite l’isolement et la séparation des minorités révolutionnaires qui restaient, bien qu’il y eut des moments de convergence, par exemple entre les communistes de conseils et des expressions de l’anarchisme, entre la Gauche italienne et le groupe autour de Camillo Berneri en Espagne (Camillo était le père de Marie-Louise Berneri, qui avait été active dans le groupe War Commentary en Grande-Bretagne, comme nous le mentionnons au début de cet article). Mais le rôle de la CNT en Espagne et la participation ouverte de certaines tendances anarchistes dans la Résistance et même dans les armées officielles de la « Libération », accentua la division entre l’anarchisme et les marxistes, particulièrement ceux qui venaient de la Gauche communiste italienne, enclins à conclure que l’anarchisme dans son ensemble avait pris le chemin du trotskisme en abandonnant définitivement l’internationalisme, et donc le mouvement ouvrier, pendant la guerre16.
12) Les batailles de Mai 68 se firent souvent sous les drapeaux rouges et noirs – exprimant symboliquement une tentative de retrouver ce qui était à l’origine révolutionnaire dans les traditions anarchiste et marxiste. Un certain nombre des groupes qui formèrent le CCI avaient commencé leur existence dans l’anarchisme d’une façon ou d’une autre, aussi depuis le début de notre organisation, il y a eu une compréhension que l’anarchisme était tout sauf un bloc monolithique et que beaucoup de la nouvelle génération, dans leur rejet ardent de la social-démocratie et du stalinisme, avaient été initialement attirés par les idéaux de l’anarchisme. En même temps, cette attitude plus ouverte était accompagnée d’un besoin de se démarquer en tant que tendance distincte avec des positions cohérentes ; et, sous l’influence de l’immaturité politique et d’un manque de connaissance historique, cette réponse nécessaire allait souvent de pair avec une attitude quelque peu sectaire. Le débat du CCI sur les groupes prolétariens dans les années 1970 fut la première tentative consciente de dépasser ces réactions sectaires. Mais le milieu politique prolétarien traversa une phase de crise au début des années 1980 et celle-ci inclut l’affaire « Chénier » dans le CCI. Dans une large mesure, la crise qui affecta le CCI avait son épicentre en Grande-Bretagne, et ses conséquences furent de créer un mur de suspicion autour du CCI, plus particulièrement parmi les courants libertaires qui tendirent à voir nos efforts pour défendre l’organisation comme des expressions d’un stalinisme congénital. Ce mur n’a jamais été réellement brisé. Malgré des moments de dialogue17, les relations entre le CCI et le milieu anarchiste/libertaire en Grande-Bretagne ont été particulièrement difficiles : à la fin des années 1990, le CCI avait été exclu du groupe Not War but the Class War formé en réponse à la guerre des Balkans et banni des réunions de AF à Londres. Il faut aussi admettre que les propres erreurs du CCI contribuèrent à ce piteux état des relations : en particulier, une caractérisation erronée comme groupes gauchistes du Mouvement d’Action Directe et d’AF , basée sur l’ignorance de leur fondement historique, et une application schématique et un peu lourde de la notion de parasitisme politique dans le contexte du groupe « Not War but the Class War ». En même temps, l’attitude suspicieuse et parfois non-fraternelle des anarchistes envers le CCI a des racines plus profondes dans l’histoire et la théorie, surtout en relation avec la question de l’organisation des révolutionnaires, et ces racines ont aussi besoin d’être soigneusement réexaminées. Malgré tous ces obstacles, l’apparition depuis le début des années 2000 d’une nouvelle génération de révolutionnaires a attiré vers les idées révolutionnaires, largement médiatisée à travers le communisme libertaire, a fourni la possibilité d’un air frais nouveau. Par notre participation dans les forums de discussion en ligne, comme libcom, il est devenu évident pour nous qu’il y a de nombreux camarades s’appelant anarchistes ou libertaires qui défendent des positions prolétariennes sur les syndicats, le nationalisme et la guerre impérialiste, et que cela inclut des membres de groupes ou de traditions que nous avions considéré par le passé comme gauchistes, tels AF ou Solfed. Ceci a conduit à une réévaluation de notre part, renforcé par nos discussions internationales, et même un travail commun, avec des groupes en Amérique latine. Cette réévaluation a été bien saluée par certains anarchistes, bien que beaucoup la voient comme une tactique opportuniste de « recrutement » de notre part, et nos relations avec ce milieu connaissent toujours des hauts et des bas. Mais pour nous, le maintien d’un dialogue avec les éléments prolétariens dans l’anarchisme est la seule base de dépassement possible des méfiances qui existent entre les ailes marxiste et anarchiste du mouvement révolutionnaire, et pour parvenir à une clarification permettant d'exercer une activité commune en dépit de nos différences.
Amos (Avril 2011)
1Un exemple premier étant l’extraordinaire Dan Chatterton, qui a écrit de sa propre main et publié Le Brulôt Communiste athée (Atheistic Communist Scorcher) de 1884 jusqu’à sa mort en 1895.
2Socialist Party of Great Britain
3Social Democratic Federation
4 George Woodcock, L’anarchisme : une histoire des idées et des mouvements libertaires (Anarchism: A history of libertarian ideas and movements), publié pour la première fois en 1962, édition revue en 1986.
5 www.afed.org.uk/org/issue42/acbrit.html [162] [1]
6 www.solfed.org.uk/?q=a-short-history-of-british-anarcho-syndicalism [163] [2]
7 Un recueil d’articles de War Commentary a été publiée dans un ouvrage intitulé Ni Est ni Ouest, sélection des écrits de Marie-Louise Berneri (Neither East nor West, selected writings of Marie Louise Berneri aux éditions Freedom Press, 1952.
8 George Woodcock, Anarchism, A history of libertarian ideas and movements, 1986 edition, p 386. Décrivant la même période en France, il utilise le terme “d’anarchisme officiel” pour décrire les restes fossilisés du mouvement.
9Campaign for Nuclear Disarmament
10 Un phénomène similaire peut être vu dans l’influence du groupe Wildcat et son heir Subversion dans les années 1980 et 1990 : ils ont aussi développé un mélange de conseillisme et d’anarchisme qui eut une résonnance fairly large sur la scène libertaire en général. Une histoire plus développée de l’anarchisme au Royaume-Uni devrait inclure une évaluation de ces groupes, dont les origines se trouvent plus comme branche du communisme de gauche que dans l’anarchisme en soi.
11 https://libcom.org/article/uk-anarchist-movement-looking-back-and-forward [164] [6]
12Socialist Workers' Party – trotskyste, de la tendance Tony Cliff
13 www.afed.org.uk/org/issue42/acbrit.html [162] [1]
14 https://en.internationalism.org/wr/238_leftcom.htm [165] [7]
15 Nous avons ainsi défini un groupe parasitaire comme un groupe qui a la même plateforme qu’une organisation communiste existante et existe principalement pour l’attaquer et la saper. Mais la plateforme de l’ACF n’était nulle part proche de celle des groupes de la Gauche communiste et montrait un manque d’intérêt consistent à l’égard de ces organisations. D’un autre côté, il y a eu des groupes gauchistes qui ont agi comme des parasites destructeurs sur la Gauche communiste, tels l’UCM iranienne ou le groupe Hilo Rojo, et nous basions notre position de l’ACF sur notre expérience vis-à-vis de ces groupes. En d’autres termes, la notion de l’ACF comme parasitaire était une conséquence du fait que nous la voyions comme étant gauchiste.
16 Il y eut des exceptions. Par exemple, Marc Chirik de la Gauche communiste en France a maintenu une relation très fraternelle avec Voline pendant la guerre : le groupe de Voline était certainement internationaliste. De même, bien que la Gauche communiste de France se soit vigoureusement opposée à l’invitation des principales organisations anarchistes à la conférence d’après-guerre des internationalistes en Hollande, ils n’eurent pas d’objection à ce qu’un vieux militant anarchiste, contemporain d’Engels, dirige la réunion.
17 Par exemple la participation du CCI dans des reunions du London Worker’s Group dans les années 1980 et la “troisième” incarnation de « No War but the Class War » au sujet de la guerre en Afghanistan en 2001.
Géographique:
- Grande-Bretagne [98]
Courants politiques:
ICConline - septembre 2011
- 1695 lectures
Changement de régime au Bengale Occidental : une mystification de changement !
- 1326 lectures
Une partie assez importante des différents secteurs de la population dans cette partie de l'Inde semble être enthousiasmée par la possibilité du changement. Ils célèbrent la défaite électorale décisive de la coalition dirigeante de gauche et la victoire écrasante de la coalition de droite. Certains sont enthousiasmé par la simple pensée que la coalition dirigeante stalinienne a enfin été évincée du pouvoir gouvernemental. Les gens étaient tellement dégoûtés par l'arrogance et la corruption sans bornes de presque tous ceux qui étaient liés d'une manière ou autre à la clique dirigeante stalinienne. Certains ont dit ouvertement, «Nous ne nous soucions pas de ce qui va se passer dans la période à venir. Nous nous soucions seulement de l'éviction du CPI (M) du pouvoir gouvernemental. Ils sont insupportables. ». Ainsi cette jubilation instantanée de cette partie de la masse des gens, y compris de la classe ouvrière et des secteurs exploités est tout à fait compréhensible. Ces gens semblent savourer un profond sentiment de soulagement.
La presque totalité de la presse imprimée et Internet fait tout son possible pour propager et renforcer l'idée de changement. Elle dépeint le CPI (M) {Parti Communiste d'Inde (Marxiste)}, comme le méchant le plus notoire de tout le film, l'incarnation de tout ce qui est négatif, la source de tous les maux. A l'inverse, la coalition victorieuse de droite, et en particulier son chef suprême, est représentée comme le symbole de l'honnêteté et de l'héroïsme. Elle ne cesse non plus pas de chanter des hymnes à la louange de la puissance illimitée de la démocratie et en particulier de la pureté et de la maturité de la démocratie indienne. Une partie assez importante de la population semble avaler avec délectation tous ces matériaux diffusés par la presse, dans ce contexte. On dirait que celle-ci fait des heures supplémentaires pour bien enfoncer le clou. La nouvelle alliance au pouvoir, non seulement met en scène, presque tous les jours, des scénarios d'un populisme hautement théâtral, pour montrer qu'elle est fondamentalement différente de l'ancien régime à chaque occasion presque tous les jours, mais elle semble aussi y prendre tout son plaisir. La bourgeoisie semble avoir assez bien réussi, au moins temporairement, dans sa tâche de mystification.
Mais elle n'a pas réussi à mystifier tout le monde. Une partie importante de la population n'a pas du tout été émue par cette propagande de changement. Selon certains rapports d'enquêtes fiables, un grand nombre de jeunes qui étaient électeurs pour la première fois ont refusé de voter.
Il est urgent que nous réfléchissions un moment sur le contenu réel du changement pour en finir avec ce rêve.
Nous ne pouvons pas ne pas remarquer que quel que soit le battage médiatique sur la vertu et la puissance de la démocratie, cette élection a montré très clairement qu'elle est à l'agonie. Sans la protection directe de la machine bureaucratique militaire, elle est absolument incapable de se maintenir de façon régulière et de fonctionner. Dans sa phase juvénile, au XIXe siècle, elle avait la haute main sur la machine bureaucratique militaire et elle la contrôlait complètement. Mais maintenant, dans sa phase de sénilité, elle est sous le contrôle et la protection totales de cette dernière. Quelle chute terrible! Le centre de gravité du pouvoir capitaliste n'est plus aujourd'hui au parlement: il se déplace de plus en plus vers la machine permanente, bureaucratique, militaires et judiciaires. Différents secteurs de la bourgeois se lamentent très souvent sur cette transformation inévitable et sur la dégénérescence de la démocratie.
Dans ce contexte, il convient de mentionner que la démocratie, y compris sous ses formes les plus pures, les plus anciennes et les plus mûres, est basé sur trois choses qui sont l'utilisation de l'argent, de la puissance musculaire et de la mystification. Dans les pays arriérés comme l'Inde l'utilisation de l'argent et la puissance musculaire est prédominante. En plus de cela, le pouvoir de mystification sur la classe ouvrière et sur les masses laborieuses joue également un rôle très important. Chaque parti politique et son leader, à l'occasion des batailles électorales recourent au mensonge et à la mystification. C'est quelque chose qui ressemble à une compétition dans le mensonge. Ceux qui sont capables de faire croire au peuple que les mensonges sont des vérités sont victorieux dans le jeu électoral. Dans les pays plus avancés, l'utilisation du pouvoir de mystification est particulièrement prédominant. De nos jours, des accusations d'intimidation de l'électorat sont également proférées, même aux Etats-Unis.
Illusion et réalité du changement
La coalition de gauche, aujourd'hui évincée, était arrivée au pouvoir gouvernemental après une victoire électorale écrasante en 1977, entraînant une défaite écrasante au Congrès du parti de droite, alors au pouvoir. La coalition de gauche avait alors prétendu entamer une croisade des plus déterminées contre les méthodes répressives et toute la corruption du parti au pouvoir sortant. Ils avaient proclamés avec fracas qu'ils étaient pour le changement et le développement économiques. Ils s'étaient engagés à travailler pour la défense de l'intérêt de la classe ouvrière et des couches exploitées de la société. Ils avaient demandé à leurs cadres de ne pas être revanchards contre ceux du parti précédemment au pouvoir qui les avaient terrorisés, chassés de leurs maisons et contraints à fuir très loin. Puis, la population a été pareillement dégoûtée de l'arrogance, de l'extrême corruption et par l'ambiance de terreur créée par des gorilles intouchables, utilisés par le parti du Congrès. Et la population est à nouveau devenue avide de changement par rapport à une atmosphère sociale étouffante et insupportable. Il n'avait pas fallu beaucoup de temps pour que le nuage d'illusion se dissipe progressivement et que se révèle la vraie réalité du régime de gauche. Les protagonistes et les défenseurs de ce régime ont commencé à recourir de plus en plus aux mêmes méthodes répressives et se sont plongés de plus en plus dans la même mer de corruption. Ils ont joué non seulement un rôle actif, mais aussi un rôle de leader dans le massacre des masses paysannes et dans l'assassinat de la classe ouvrière luttant contre les attaques sur ses conditions de vie et de travail, dans différentes régions du Bengale Occidental. Tous ces mouvements ont été sévèrement réprimées, non seulement par les forces de police officielles, mais aussi par des bandes de nervis non officiels. Les problèmes socio-économiques, en particulier les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière et des divers secteurs des masses laborieuses de la population ont commencé à s'aggraver de jour en jour. Le problème du chômage s'est lui aussi de plus en plus aggravé.
Les partis victorieux d'aujourd'hui font donner de la voix contre la corruption et toutes les méthodes répressives de la coalition de gauche sortante. Ils se prétendent être à l'avant-garde du changement. Leur slogan le plus important est 'le changement n'est pas la vengeance, mais le développement économique'. Ils se sont également engagés à travailler pour défendre les intérêts des pauvres.
Mais ces partis mêmes sont les descendants du parti du Congrès qui avait recouru à des méthodes répressives depuis le transfert du pouvoir politique en sa faveur par les britanniques en 1947 et en particulier dans les années soixante-dix. Les gens avaient même peur de voter selon leur volonté. Les membres du Parti du Congrès étaient alors à l'avant-garde des plus grands massacres de sympathisants du mouvement maoïste en 1971, au cœur de Calcutta. La machine d'Etat avait été utilisée sans vergogne pour ce massacre par le premier ministre du congrès de l'époque. Beaucoup de dirigeants, de jeunes militants et sympathisants du mouvement maoïste avaient ensuite été tués juste après leur arrestation, même en l'absence de la farce de tout procès. Beaucoup avaient été tués dans des prétendues rencontres avec la police. Les maisons de beaucoup de paysans pauvres et sans terre, dans diverses parties de l'ouest du Bengale, qui avaient soutenu le mouvement maoïste furent démolies par les gorilles du parti du Congrès. De nombreuses personnes terrorisées avaient fui loin de leurs lieux d'habitation.
Tout une partie importante des dirigeants qui avaient été directement impliqués dans ces meurtres et massacres sont toujours aujourd'hui les dirigeants de la coalition de droite victorieuse. Mais le massacre du peuple en lutte pour ses diverses revendications contre un gouvernement qui recourait à des méthodes de plus en plus répressives et à toutes sortes de corruptions a donné une bonne occasion pour les dirigeants de droite pour effacer le passé et pour peaufiner leur image politique. Et c'est le même scénario qui peut aujourd'hui se répéter, avec une gauche sévèrement déshonorée et humiliée dans l'opposition, et, après un certain temps, il est assez probable dans la situation actuelle nationale et internationale que la nouvelle coalition sera obligée de recourir à des mesures répressives similaires, sous un prétexte ou sous un autre, contre les inévitables mouvements de la classe ouvrière, de la paysannerie et des chômeurs, répression qui peut même se montrer encore plus barbare que par le passé, ce qui serait susceptible de fournir les conditions nécessaires pour que la gauche, aujourd'hui déshonorée, efface les taches de son passé et polisse son image politique. C'est de cette façon que la gauche et la droite de capital s'entraident et permettent au capital de rester en vie.
Classe ouvrière et démocratie bourgeoise
Selon Marx et Lénine, la classe ouvrière, ainsi que les masses exploitées ont le droit, tous les quatre, cinq ou six ans, de choisir par qui ils aimeraient être exploitée et réprimée lors des prochaines années. Donc, quelque soit le gagnant, c'est fondamentalement la même chose pour la classe ouvrière et le peuple exploité. L'histoire n'a jamais cessé de prouver la validité de cette affirmation. Il ne peut pas mettre fin à l'exploitation et à la répression de la classe ouvrière par un changement de l'équipe dirigeante ou de parti. C'est seulement la direction politique du système économique et politique capitaliste qui change à travers les élections. La véritable dictature du système capitaliste reste inchangée et intacte. Toujours selon Marx, la démocratie est la meilleure forme de la dictature bourgeoise. Cette dictature se tient cachée dans le rapport de production du capital basé sur l'exploitation et la répression de la classe ouvrière et des masses laborieuses de la population. Ce rapport n'a nulle part et jamais été déterminé par des moyens démocratiques. Les usines ne sont nulle part gérées de façon démocratique. Aucun aspect de la production, y compris les prix n'est déterminé de façon démocratique.
La machine bureaucratique militaire, celle qui est permanente, le pilier le plus important et le plus puissant de l'Etat, la seule arme pour mener à bien l'exploitation et la répression, ne change jamais. 'L'excroissance parasitaire sur le corps social', non seulement restera intacte, mais elle sera beaucoup plus boursouflée dans la période à venir. Cela ne signifie rien d'autre qu'une intensification de l'exploitation de la classe ouvrière et du peuple laborieux, dans la période à venir. Cela ne peut jamais se réduire à un seul pays ou à une partie d'un pays.
Il n'y a pas de différence fondamentale entre les appareils politiques de gauche ou de droite, pour autant que la défense de l'intérêt du capital est concernée. Et pour cela l'appareil politique de gauche du capital est indispensable, en particulier dans cette phase historique de la vie du capital mondial, alors qu'il a été transformé en l'obstacle le plus important à la révolution prolétarienne dont la survie et le progrès de l'humanité ont un besoin urgent. La phase actuelle de sénilité avancée et de décadence du système capitaliste va conduire l'humanité progressivement vers sa destruction totale, si la révolution prolétarienne mondiale n'a pas lieu. Seule la révolution peut détruire le capitalisme et sauver l'humanité. Dans une telle situation, les appareils de gauche, dans toutes leurs variétés stalinienne, trotskiste ou maoïste, sans aucune exception, sont et seront l'unique sauveur du système capitaliste mondial.
La bourgeoisie mondiale a très clairement et profondément réalisé que l'appareil politique de gauche lui est indispensable dans cette période historique de barbarie illimitée, de destruction totale de l'humanité ou de révolution prolétarienne mondiale ouvrant la porte à la création d'une société communiste mondiale, sans frontières, libre de toute exploitation et de toute répression. Elle peut montrer du doigt les régimes staliniens, maoïstes et 'les partis communistes' pour discréditer la perspective du communisme. Elle sait très bien que si cette réalité est comprise par les masses ouvrières, son existence sera fatalement en danger. Les bourgeois ont eu besoin et ont encore besoin urgent de 'pays socialistes' pour discréditer le socialisme scientifique pour lequel la classe ouvrière mondiale et les populations laborieuses ont eu et ont encore une grande attraction. Leur seul objectif est de porter un coup fatal à cette attraction. Dans cette tâche réactionnaire pour la défense et la prolongation de la durée de vie d'un système totalement anachronique et historiquement inutile, l'appareil politique de gauche est absolument indispensable. Par ailleurs, avec ce même objectif en vue, c'est de façon très calculée qu'ils permettent aux staliniens, maoïstes et trotskistes de se présenter comme les véritables défenseurs de l'intérêt des masses de la population contre les attaques de l'Etat bourgeois, pour faire dérailler le vrai combat pour la libération de toutes sortes d'exploitation et de répression.
Bonne volonté individuelle contre conditions matérielles
Le cours de l'histoire n'a pas été déterminé par la bonne ou la mauvaise volonté de tel ou tel individu, mâle ou femelle, groupe ou parti politique à la tête des affaires. Il est déterminé par les conditions matérielles du rapport de production prédominant dans une phase historique particulière et par les conditions de la lutte de classe dans cette phase.
Quel que soit le niveau des promesses qui sont faites au cours de la période de propagande électorale, quelle que soit la bonne volonté qu'il a manifestée, sous forme de mots, en faveur des masses, le nouveau gouvernement aura à servir l'intérêt du système capitaliste dans le Bengale Occidental, comme partout ailleurs. Il peut crier bien fort que son seul but est de servir l'intérêt de l'ensemble de l'humanité. La coalition de droite victorieuse ne se lasse jamais d'affirmer que sa victoire est la victoire de l'humanité, indifférenciée et sans classes. Mais, l'intérêt du capital et celui de l'ensemble de l'humanité et particulièrement celui de la classe ouvrière et des masses exploitées de la population peut-il être le même et être défendu simultanément, notamment dans cette phase historique?
Le système capitaliste mondial est entré dans sa phase de décadence ou de sénilité depuis le début du siècle dernier. La Première Guerre Mondiale en a été la preuve définitive. Depuis lors, il passe par des crises permanentes, comme celle qui s'est exprimée dans le déclenchement de la grande dépression de 1929. Celle-ci a conduit à l'éclatement de la Seconde Guerre Mondiale. Cet état de crise a été supprimé dans une certaine mesure, après la guerre, dans la nouvelle configuration impérialiste internationale, avec la division du monde en deux blocs impérialistes dirigés par deux superpuissances victorieuses, les USA et l'URSS. La crise est réapparue dans les années soixante, pour mettre fin aux soi-disant 'trente glorieuses'. Depuis la crise s'intensifie de plus en plus, au fur et à mesure que la saturation relative du marché mondial s'approfondit. Dans une telle situation internationale la seule condition pour l'existence du capital est plus d'exploitation et de répression de la classe ouvrière et des masses laborieuses. Plus un gouvernement d'Etat capitaliste sera en mesure d'assurer cela, plus brillante sera la possibilité de la poursuite de l'existence d'un système historiquement inutile, au moins dans cet Etat. La tâche de tout gouvernement de gauche ou de droite est d'assurer cela. La tâche du nouveau gouvernement au Bengale Occidental ne peut jamais être autre chose. Quelle que soit sa bonne volonté, authentique ou simulée, il sera contraint par l'évolution des conditions matérielles du capital mondial et par la lutte de classes à intensifier toujours plus l'exploitation et la répression de la classe ouvrière et des masses laborieuses et de recourir à des méthodes encore plus fascistes. Les attaques sur les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière ne peuvent pas encore s'intensifier dans la période à venir. Il y a peu d'espoir pour la moindre solution au problème du chômage. Cette situation est susceptible de se dégrader encore plus dans les jours à venir. Il est fort possible que le rôle des partis politiques et des alliances soient intervertis. La droite au gouvernement va montrer ses véritables couleurs et la gauche dans l'opposition va également montrer ses couleurs premières. Cette dernière ne négligera aucun effort pour se présenter comme les véritables défenseurs de la classe ouvrière et du peuple travailleur et elle fera donc de son mieux pour faire dérailler la lutte de classe hors du terrain de classe et du processus de prise de conscience. Il y a une unité fondamentale entre la gauche et la droite de capital pour autant que la cause de la défense des intérêts fondamentaux du capital est concernée. Il y a bien sûr des différences: de méthodes.
La tâche de la classe ouvrière
La classe ouvrière ne doit pas se laisser emporter par le battage médiatique, l'hystérie et l'illusion du changement. Elle ne doit pas prendre parti dans le duel entre l'appareil politique de droite du capital et celui de gauche pour s'accaparer le poste convoité de gestion politique des affaires du capital. Tous deux sont les ennemis jurés de la classe ouvrière.
Elle devrait plutôt concentrer toute son attention sur l'intensification de sa lutte de classe contre les attaques contre les conditions de vie et de travail, sur l'auto-organisation et sur le contrôle de la lutte et son extension à tous les secteurs et sur son unification. Une lutte collective et constante contre toutes sortes de mystifications de la part de la gauche et de la droite de capital et pour que se lève la conscience prolétarienne est indispensable. C'est la seule façon de résister aux attaques et de défendre ses intérêts de classe.
Saki, 16 Juillet 2011
La terreur meurtrière en Norvège, une expression de la décomposition sociale
- 2786 lectures
La réaction naturelle la plus immédiate aux meurtres perpétrés par Anders Behring Breivik est un sentiment d’horreur. L’attentat et le meurtre de 77 personnes (dont 55 adolescents) ont provoqué des expressions de répulsion de la part des principaux médias et des politiciens à travers le monde. Mais alors que les différentes parties de la classe dominante s’unissaient dans leur condamnation de cet exemple particulier de terrorisme, elles ont fourni différentes explications sur ce qui s’était passé.
Il ne s'agit pas seulement d'un tueur psychopathe
La réponse de la droite a été de décrire Breivik comme un malade mental, comme un monstre et un maniaque, un psychopathe et un suppôt de Satan. Enfin, il a été présenté comme un individu dont il fallait expliquer la psychologie et la morale. L’idée que sa folie soit séparée de toute réalité sociale doit être rejetée. L’aliénation de Breivik et sa haine envers le reste de l’humanité est certainement exceptionnelle. Tuer plusieurs douzaines de jeunes gens de sang-froid parce qu’il croyait que seule la déportation forcée des musulmans d’Europe pouvait rectifier les erreurs de la société montre clairement une personnalité avec des problèmes profonds. Mais aucun individu n’agit isolément dans la société dans laquelle il a grandi. Pour prendre l’aspect le plus significatif : nous vivons dans un monde où chaque fraction de la classe capitaliste participe à une campagne perpétuelle tentant d’inciter aux divisions raciales et religieuses. Depuis les groupes fascistes qui prêchent ouvertement la haine des autres races et la violence contre les minorités, jusqu'aux insistances des gauchistes sur les méfaits de l'ultra-libéralisme pour susciter le besoin de nous tous d’être loyaux envers une identité ethnique, la bourgeoisie a créé un réseau idéologique utilisant les mots-clés d’assimilation et de séparatisme, de nationalisme et de multiculturalisme, pour soutenir l’idée que l’humanité est divisée selon des frontières raciales plutôt que de classe.
La différence d'appréciation entre un membre du parti anti-immigrant suédois disant des attaques en Norvège que « la faute en incombait au multiculturalisme de la société » et David Cameron disant que le « multiculturalisme avait failli » n’est pas bien grande. Lorsque la gauche a appelé à la défense du statu quo au nom de la défense de ce même multiculturalisme, l’entourloupe a été complète.
Breivik a semblé avoir passé beaucoup de temps à surfer sur la nébuleuse Internet et s’être immergé dans certaines de ses plages les plus aventureusement délirantes. Il a été clairement exposé à toutes sortes d’expressions de la désintégration de la solidarité humaine la plus élémentaire. Ses actions ont démontré l’aliénation la plus extrême, mais cela doit être compris comme la plus proche de la base des divisions raciales et religieuses mises en avant par l’idéologie bourgeoise, qui est supposée être « normale » et faisant seulement partie du « sens commun ».
En particulier, la propagande qui décrit les musulmans comme une menace omni-présente n’est que la dernière expression en vogue de la stratégie du « bouc-émissaire » si répandu dans le monde capitaliste. Depuis des décennies, celle-ci a nourri la cause de l’anti-sémitisme, ou la description caricaturale des immigrants à peau noire venant d’Afrique et des Caraïbes « menacer » la civilisation, ou encore l’arrivée de groupes parlant une langue différente ou pratiquant une religion différente ayant un pouvoir de briser l’ordre social. A travers l’Europe, il existe un consensus parmi les partis politiques bourgeois et dans les médias capitalistes pour dire que l’immigration est une menace en soi. Les mensonges changent, et la propagande peut être plus ou moins sophistiquée, mais le capitalisme a trouvé ainsi une voie pour pointer de façon constante le danger de « l’autre », de l’étranger. Cette idéologie peut avoir un impact sur certaines personnalités fragiles ; en ce sens, Breivik n’était pas du tout un cas unique.
Le capitalisme pousse à vivre dans un monde irrationnel
Pour la gauche, Breivik est considéré comme un ultra-traditionnaliste chrétien, comme une évidence du danger de l’extrémisme fasciste et raciste grandissant, comme un produit de l’islamophobie. Elle met en avant des explications psychologiques. D’après les termes du Socialist Worker du 30 juillet 2011 : « Ces meurtres ne sont pas l’œuvre d’un psychopathe – elles sont celles des actions d’un homme suivant la logique d’une idéologie raciste qui diabolise les musulmans. » Suivant cette « logique », « Breivik voulait déclencher une guerre entre races et pensait que les conditions s’y prêtaient. » Cela s'inscrit en effet dans une certaine logique, mais c’est la logique de l’irrationnel. Contre ces explications psychologiques de la gauche, il est nécessaire de rétablir l’évidence – les attaques en Norvège n’étaient pas celles d’un être rationnel. Comment pouvait-il « déclencher une guerre entre races » en s'attaquant d'abord à ceux dans lequel « coule un sang norvégien » ? Les actions de Breivik n’étaient pas rationnelles, mais cela pose la question de comparer son comportement avec celui du reste des hommes politiques bourgeois. Par exemple, de nombreux groupes palestiniens ont depuis des décennies cru qu’attaquer Israël provoquerait une réponse qui persuaderait finalement les Etats arabes dans la région de déployer leurs forces militaires contre l’Etat juif. Cela n’est pas rationnel, cela sonne comme le Livre des Révélations, mais c’est de la politique. En économie, pendant un siècle des experts auront apporté des solutions à la crise permanente du capitalisme qui ne cesse pas, sans jamais être découragés par l’économie capitaliste, tellement ils baignent dans l’idéologie dominante. Aux Etats-Unis, ce ne sont pas seulement le Tea Party et les marges fondamentalistes du camp républicain, mais toute une série d’idéologies religieuses, créationnistes et autres qui pèse de tout leur poids sur le fonctionnement de la bourgeoisie et sur les consciences du reste de la population.
Où que l’on regarde, le capitalisme, automatiquement dirigé vers la recherche du profit, le Graal de sa quête, connaît de plus en plus le frisson du culte de l’irraisonné. La gauche peut penser que le capitalisme contemporain subsiste sur une base rationnelle, mais l’expérience présente de la société moderne révèle une décomposition aggravée, une partie de celle-ci qui s’exprime dans une irrationalité grandissante où les intérêts matériels ne sont plus le seul guide de son comportement.
Dans le cas de Breivik, il est bien sûr possible qu’il soit un pion inconscient dans une stratégie plus vaste, mais les expériences de Columbine, de Virginia Tech et de tous les autres massacres perpétrés par des individus isolés montre qu’on n’a pas besoin d’un motif politique pour commencer à tuer au hasard n’importe lesquels de nos semblables.
Ce à quoi nous assistons avec des événements comme ces massacres en Norvège est quelque chose qui démontre, à de nombreux niveaux, la décomposition de la société capitaliste. On peut constater la profondeur de l’aliénation du comportement d’un seul individu, qui hélas n’est pas si inhabituel. On y voit l’attaque consciente de la bourgeoisie pour annihiler la solidarité de base et pour fomenter la haine. Le comportement irrationnel marque les groupes comme les individus. La classe dominante encourage les divisions : la culture capitaliste promeut et renforce la peur des autres. De nombreux commentateurs ont montré en exemple la réponse du Premier ministre norvégien, en particulier la façon dont il a spécifiquement dit qu’il ne se servirait pas des ces attaques pour renforcer l’appareil répressif de l’Etat. Il n’a pas besoin de le faire. Au nom de l’opposition à ces récentes atrocités, toute une campagne appelant à l’union nationale norvégienne s’est développée. C’est une des forces de la démocratie bourgeoise. La réalité de la société de classes est capable faire croire qu'elle peut mettre aussi bien une partie de la société comme son ensemble sous la « protection » de l’Etat capitaliste. En tant que classe, la bourgeoisie est toujours à même de se servir de l’évidence de la désintégration sociale contre le développement potentiel de la classe ouvrière vers une réelle unité et une réelle solidarité de classe.
Dans les premiers moments de ces événements en Norvège, la plupart des médias ont essayé de nous convaincre qu'Al-Qaïda¨ pouvait être désigné comme à l'origine de ces attaques, mais ils n'ont eu aucun problème pour changer de direction quand il s’est avéré qu'il s'agissait d’un terroriste « natif du pays ». Ce talent pour la propagande est une des quelques armes dont la bourgeoisie dispose contre nous, au même titre que celle de l'utilisation de la terreur capitaliste.
Barrow (02 août)
Répression brutale et manœuvres impérialistes en Syrie
- 3199 lectures
Après quatre mois de manifestations et de contestation populaire contre le chômage, la répression et l'absence d'avenir, les événements en Syrie prennent un tour nettement plus sombre et dangereux. Sous couvert de lutte contre les 'bandes armées' et les 'terroristes', le régime syrien a déclenché sa propre terreur sur la population : frappes aériennes, tirs de blindés, batteries antiaériennes, tirs de snipers, torture, privation d'eau, d'électricité, d'aliments pour bébés, entassement des gens dans des stades pour 'interrogatoire', rappellent les régimes les plus sinistres d'Afrique et d'Amérique latine. Au moins 2000 manifestants, la plupart non armés, ont été tués à ce jour, avec des dizaines de milliers de réfugiés et de nombreux sans-abri restés dans leur pays. Il y a eu aussi un grand nombre de soldats déserteurs qui ont refusé de tirer sur leur propre peuple.
Il y a seulement quelques années, des hommes politiques comme David Miliband (alors secrétaire d’Etat au Foreign Office) et Nicolas Sarkozy ciraient les pompes du président syrien Bachar el-Assad et de son régime d'assassins et de tortionnaires, mais aujourd'hui les démocraties occidentales font la queue pour lui demander de démissionner. Les puissances américaine, de Grande-Bretagne, d'Allemagne et de France se sont toutes, jusqu'à présent, montrées d'une complicité très prudente, mais bien réelle, dans la répression et les atrocités de l'armée syrienne, permettant aux pouvoirs régionaux plus petits d'exercer des pressions, tout en soutenant leurs propres forces 'd'opposition' au sein du régime (par exemple, le soutien de la Grande-Bretagne au dissident de premier plan, Walid al-Bunni et à son entourage). A la mi-août, les grandes puissances nommées ci-dessus, avec l'Union Européenne, ont conjointement appelé Assad à se retirer et menacé d'une arrestation possible de plusieurs figures de proue du régime. Des comptes-rendus indiquent que les Etats-Unis ont demandé à la Turquie de ne pas maintenir sa 'zone tampon' entre les deux pays et de prendre du recul par rapport à une telle provocation. Cependant, les Etats-Unis ont considérablement renforcé leur présence navale en Méditerranée face aux côtes syriennes, sur la mer Egée, sur l'Adriatique et sur la mer Noire, avec une concentration particulière en termes de missiles antimissiles et de marines. Les démocraties occidentales se moquent bien des souffrances de la population syrienne : entre autres, cela fait des années que la Grande-Bretagne fournit des armes à l'armée syrienne pour lui permettre de réprimer. Ce qu'elles craignent le plus est que l'élimination possible d'Assad crée davantage d'instabilité et de dangers de la part de 'diables que l'on ne connaît pas encore' : l'Iran, en particulier, occupe une place particulièrement importante dans les cauchemars des ministères des affaires étrangères des pays occidentaux. Cependant, l'Arabie Saoudite, qui a envoyé ses troupes à Bahreïn pour écraser les manifestations, est de plus en plus concernée par la relation stratégique croissante entre la Syrie et l'Iran, y compris leur soutien au Hezbollah et au Hamas. En outre, « Depuis quelque temps, il y a des rumeurs selon lesquelles l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït, financent tranquillement des éléments en opposition à la Syrie. » 1
Le chaos des relations impérialistes et les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran
A l'époque du monde bipolaire de l'OTAN et du Pacte de Varsovie, tout était relativement simple dans les relations impérialistes, mais l'effondrement des blocs a libéré des forces centrifuges. Aujourd'hui, les alliances ou les rivalités entre nations changent au gré des vents impérialistes dominants. Même si les relations entre Turquie, Iran, Israël, Syrie, dans leurs différentes combinaisons, ont montré des évolutions dans un passé récent, la pierre angulaire de la politique américaine et de ses nécessaires plans de guerre est de protéger Israël comme de prendre pour cible l'Iran. Un rapprochement entre l'Iran et les États-Unis n'est pas impossible, mais, avec le cours des événements, une confrontation militaire semble bien plus probable, surtout étant donné la politique agressive que l'impérialisme américain est poussée à conduire, afin de maintenir son rôle de parrain dans le monde.
Les difficultés américaines incessantes en Irak, ainsi que leur tendance à un affaiblissement général, maintiennent en ébullition l'influence iranienne dans ce pays, principalement de la part de la force la plus puissante en Iran, le Corps des Gardes Révolutionnaires d'Al-Qods. Selon un rapport publié dans The Guardian (28 juillet), cette force tire pratiquement les ficelles du gouvernement irakien par rapport à ce qui a été véritablement une guerre entre les États-Unis et les mandataires de l'Iran en Irak au cours des 8 dernières années. L'année dernière, lors de la réunion à Damas qui a formé le gouvernement irakien actuel, le général Suleimani, le chef d' Al-Qods, « était présent (...) avec les dirigeants de la Syrie, de la Turquie, d'Iran et du Hezbollah : il les a tous forcés à changer d'avis et à sacrer Malaki comme leader pour un second mandat. » Le rapport poursuit en disant « qu'à l'exception de deux soldats tués en Irak en juin, le plus grand nombre de soldats US tués depuis deux ans l'a été par des milices sous contrôle (de La Garde Révolutionnaire): les Brigades du Hezbollah et du Keta'ib du Jour Promis. » L'ambassadeur américain en Irak avait déjà rapporté que les mandataires iraniens sont responsables d'environ un quart des pertes américaines en Irak (1100 morts et des milliers de blessés).
L'influence iranienne croissante en Irak, l'est aussi en Syrie. Selon le Wall Street Journal du 14 avril, des responsables américains anonymes ont d'emblée déclaré que l'Iran aidait les forces de sécurité syriennes dans leur répression contre toutes sortes de manifestants. La Syrie est depuis longtemps un couloir pour les armes et l'influence iraniennes en direction du Hamas à Gaza et du Hezbollah au Liban. Cette influence s'est accentuée depuis le retrait syrien en 2005 et avec l'affaiblissement des forces pro-américaines dans le pays. Bien qu'ils aient leurs propres intérêts nationaux à défendre, et bien qu'il y ait quelques divergences – par rapport à Israël, par exemple - Damas et l'Iran voient leur alliance plus forte que jamais et bien que le second préfèrerait que la clique Assad reste au pouvoir, si celui-ci tombait, alors leurs 'partenaires' œuvreraient à installer un régime encore plus pro-iranien.
En mai 2007, l'Institut Américain pour la Paix avait rapporté que les relations entre l'Iran et la Syrie s'étaient approfondies. Il n'y a aucun doute que l'Iran met de plus en plus son empreinte sur le pays. En 2006, a été signé un pacte de défense mutuelle inédit, plus un accord de coopération militaire supplémentaire au milieu de 2007. Les investissements et le commerce entre les deux pays se sont également accrus et les difficultés économiques de la Syrie, avec l'aggravation des effets de la crise, ne peuvent que renforcer l'emprise iranienne sur le pays. En fait, le développement de la crise économique semble rendre plus improbable que les États-Unis soient en mesure de chasser l'Iran de la Syrie.
Le rôle de la Turquie
Rien dans tout cela ne constitue une bonne nouvelle pour les intérêts de l'impérialisme turc et pour ses aspirations à jouer un rôle majeur dans la région. Les vagues de réfugiés syriens ont été un casse-tête pour la bourgeoisie turque et le Premier ministre Erdogan avait condamné la 'sauvagerie' du régime syrien. Tout aussi préoccupant est le coup porté à ses efforts pour éliminer le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le Sud-Est du pays. The Guardian rapporte (Simon Tisdall, World Briefing, 09/08/11) que beaucoup de combattants du PKK dans la région englobant la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak sont d'origine syrienne et rappelle la poudrière des années 1990, lorsque la Turquie et la Syrie ont failli entrer en guerre par rapport à cette question. Les attaques du PKK contre les troupes turques et les frappes aériennes qui en ont résulté, les 17 et 18 août dans le Nord de l'Irak ne sont sûrement pas sans rapport avec une aggravation des tensions. Téhéran a également repoussé toutes les tentatives turques pour agir comme médiateur avec les puissances occidentales.
Evidemment, la population qui se bat en Syrie contre la misère et la pauvreté fait preuve d'un extraordinaire courage mais l'extrême faiblesse de la classe ouvrière dans cette région du monde rend tous ces combattants vulnérables à la pire idéologie bourgeoise : l'embrigadement impérialiste. Car toutes les fractions en présence, au pouvoir ou dans l'opposition, comme les "grandes démocraties" qui interviennent dans ce conflit, utilisent sans aucune vergogne les populations locales comme de la chair à canon pour défendre leurs sordides intérêts de cliques.
Baboun (20/08/11)
1 Ian Black, analyse récente dans The Guardian.
Géographique:
- Moyen Orient [166]
Solidarité avec les travailleurs en lutte de Verizon (Etats-Unis) !
- 1492 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d'un article réalisé par Internationalism, organe de presse du CCI aux Etats-Unis.
Depuis l'écriture de ce texte, les syndicats et les patrons de Verizon, un des plus importants opérateurs de téléphonie des Etats-Unis, ont décidé de rouvrir les négociations et la grève a pris fin (peu avant la période de deux semaines après laquelle les travailleurs avaient droit à une indemnité de grève !). Cet article a été distribué sur les piquets de grève par nos camarades aux Etats-Unis, qui ont eu de nombreuses discussions avec eux.
Pour la première fois en onze ans, 45 000 travailleurs de Verizon sur la côte Atlantique ont renoué avec la lutte des classes, ayant courageusement refusé de se soumettre à la logique des patrons qui consiste à faire payer à la classe ouvrière la crise économique du capitalisme ! Nos exploiteurs disent que nous devrions nous sacrifier pour permettre à l'économie de repartir, ou pour soutenir la rentabilité d'une entreprise afin de sauvegarder les emplois. Mais le dernier assaut draconien sur les prestations de retraites est une preuve que plus les travailleurs renoncent, plus ils retardent leur réponse aux attaques des patrons, plus hardie et brutale sera la prochaine série d'attaques. Cela est évident chez Verizon Wireline (spécialisé dans les mobiles) qui considère sans humanité les ouvriers fabriquant encore des câbles téléphoniques jugés comme 'obsolètes'. Lorsque les sacrifices déjà réalisés ne sont plus suffisants pour satisfaire la faim insatiable de profit, les patrons disposent simplement de nous, comme si nous étions de simples marchandises. Contrairement à ce que raconte la classe dirigeante, les sacrifices qu'ils nous demandent n'ouvre pas la voie à un avenir meilleur. La vérité est que le seul avenir que le système capitaliste a à offrir est celui de la disparition des pensions, des prestations sociales, des salaires gelés, d'une augmentation du chômage et des attaques sauvages sur nos conditions de vie en tant que travailleurs.
Lorsque les syndicats CWA et l'IBEW ont mis en avant que Verizon ne devrait pas, à l'heure actuelle, demander aux ouvriers des concessions importantes par rapport aux soins de santé, aux pensions, aux congés de maladie ou d'invalidité, etc., parce que la compagnie avait estimée à 6 milliards de $ le profit de l'entreprise pour le reste de l'année ( elle a fait 9.6 milliards de $ de bénéfices dans la première période), ils ont vraiment caché la gravité de la crise économique capitaliste. En agissant ainsi, ils ont consciemment affaibli la capacité des travailleurs à affronter les attaques avec une idée claire des perspectives à venir. La gravité de la crise économique et la réalité de la concurrence imposent effectivement que chaque entreprise demande toujours plus de concessions, aujourd'hui comme demain. Comme les entreprises perdent leur avantage concurrentiel à cause des ravages de la crise économique capitaliste, leurs opérations perdent leur rentabilité. Face à la concurrence, les entreprises doivent moderniser leur technologie ou se retirer des affaires. Verizon, comme toutes les autres sociétés capitalistes, l'avait fait avec les sacrifices imposés à ses travailleurs, par rapport aux retraites, aux soins de santé et aux prestations sociales, la plupart négociés à l'époque de la grève de 2000. Pour illustrer comment, en cette période de décadence capitaliste, aggravée par la crise économique actuelle, les syndicats travaillent main dans la main avec les patrons pour négocier un accord en faveur de ces derniers, démoraliser les travailleurs et pour mieux affaiblir leur combativité dans les luttes à venir, nous devons nous rappeler ce que la CWA et la FIOE ont fait en 2000. A cette époque, lorsque 86 000 travailleurs de Verizon étaient entrés en grève par rapport à leurs prestations sociales et à leurs salaires, les syndicats CWA et FIOE avaient d'abord séparé les grévistes en deux groupes, puis, ils ont négocié deux contrats distincts, chacun des deux cédant aux exigences de la direction, avec pour résultat que même le Financial Times avait salué le nouveau contrat parce qu'il faisait gagner Verizon en compétitivité en favorisant le développement du marché de la téléphonie sans fil. L'une des clauses les plus notoires de ce contrat permettait à Verizon de transférer chaque année 800 travailleurs du réseau de téléphonie fixe au secteur du sans fil, où les travailleurs travaillaient déjà sans forfait de retraite. Le contrat n'a rien fait non plus pour satisfaire les griefs des travailleurs concernant les heures supplémentaires imposées. Les syndicats jouent, dans les négociations, le rôle d'un courtier qui favorise toujours les patrons, et ils piègent nos luttes en nous enfermant dans les directives strictes fixées dans le cahier des charges des règles syndicales : pas de réunions massives, aucune tentative pour organiser ou étendre la grève. En fait, l'actuel appel au vote de la grève par la CWA n'a pas été lancé pour répondre à l'attaque projetée, mais seulement parce que l'entreprise ne négociait pas avec 'bonne foi.'
Les syndicats CWA et IBEW mettent en avant l'idée des patrons selon laquelle une grève n'est légitime que lorsqu'une entreprise n'est pas en faillite et que si celle-ci est en difficulté, les ouvriers doivent en quelque sorte 'couler avec le navire'. Le gouvernement et les syndicats tiennent le même discours aux travailleurs du secteur public : les sacrifices sont inévitables parce que les Etats sont en faillite. Du point de vue de la classe ouvrière, cependant, il est clair que les intérêts des patrons, impulsés par le profit, sont en conflit ouvert avec les intérêts des travailleurs, poussés par la nécessité de la sauvegarde de leurs moyens de subsistance.
Donc, si les syndicats sont le faire-valoir des patrons, quelles sont les perspectives pour la grève actuelle ? Les travailleurs de Verizon ne devraient avoir aucune illusion sur le fait qu'ils gagneront ce combat en se laissant conduire par le syndicat. Mais ce que les travailleurs peuvent faire est de l'utiliser comme un moyen pour se réunir et discuter sur la façon de rendre le mouvement plus efficace et généralisé. Il est clair que les autres travailleurs sont favorables à la grève de Verizon, mais pour vraiment gagner, les travailleurs ont besoin d'étendre la grève et d'en faire vraiment un mouvement qui interpelle l'ensemble de la classe ouvrière. Un exemple de base de cela est le piquet de grève. D'un point de vue historique, quand les ouvriers sont en grève, ils encerclent les lieux de travail pour empêcher les travailleurs de remplacement d'entrer ou de sortir, et pour appeler les travailleurs embauchés pour les remplacer à ne pas prendre leurs emplois. Aujourd'hui, le piquet de grève est isolé derrière une clôture d'où les ouvriers ne peuvent que crier après les « jaunes ». Les travailleurs ont besoin de discuter des moyens de lutte, de comment ils peuvent utiliser les piquets de grève de façon créative pour les rendre efficace et encourager la solidarité. Les travailleurs syndiqués devraient essayer de convaincre les travailleurs non syndiqués de la nécessité de la grève. Ils devraient les arrêter et parler avec eux en expliquant les raisons de la grève, en répandant l'idée que c'est seulement grâce à l'unité la plus large des travailleurs que l'on peut résister aux attaques des patrons. Des piquets volants pourraient être créés pour aller parler avec les travailleurs dans les magasins de téléphonie mobile de Verizon (qui travaillent déjà avec des très pauvres allocations et presque pas de retraite), pendant les pauses déjeuner, pour discuter avec eux de leurs revendications, de ce qu'on peut faire pour les intégrer à la lutte, et pour souligner que la grève actuelle concerne aussi la protection de leurs propres intérêts, ce qui pourrait inciter plus de travailleurs à se défendre eux-mêmes, à travers le pays et à travers le monde. De cette façon, même si les patrons sortent vainqueurs de cette grève particulière (ce qui est vraisemblable si les ouvriers suivent les syndicats et leur laissent les mains libres), les travailleurs auront gagné de l'expérience et de la confiance en soi, ingrédients nécessaires pour mener les luttes à venir que la crise capitaliste va inévitablement les forcer à mener.
Dans le contexte de la crise économique la plus profonde du capitalisme, avec le risque de perdre son emploi ou de subir des conditions de travail encore pires, la lutte des travailleurs de Verizon est une lueur d'espoir pour toute la classe ouvrière. Mais les travailleurs, dans tous les secteurs, et dans tous les pays sont en difficulté à cause des attaques sur leurs conditions de vie et de travail. Coupes accrues par rapport aux soins de santé, licenciements, gels des salaires, chômage endémique et exploitation accrue au travail ont cours depuis déjà longtemps, et ne font que s'aggraver. Face à cela, la classe ouvrière est à la recherche de moyens pour résister. Les travailleurs, les étudiants et les chômeurs de tous les Etats-Unis comme du monde entier cherchent des moyens pour exprimer leurs revendications. En ce sens, la grève actuelle des travailleurs de Verizon est en continuité avec les grèves et les manifs d'étudiants en Californie d'il y a seulement un an, avec la grève des infirmières des hôpitaux de Philadelphie et de Minneapolis, avec la grève des ouvriers de Mott, avec celle des dockers de la côte Est, à l'automne dernier, et les manifestations dans le secteur public, à Madison, dans le Wisconsin, et aussi au niveau international avec la vague de révoltes qui a balayé l'Afrique du Nord et le Moyen Orient, qui résonne maintenant à travers la Grèce et l'Espagne. Mais ce n'est que lorsque les travailleurs seront en mesure de prendre leur lutte dans leurs propres mains, et qu'ils les arracheront des mains des syndicats, que leur résistance deviendra vraiment efficace.
Internationalism (août 2011)
Géographique:
- Etats-Unis [83]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]
ICConline - octobre 2011
- 1574 lectures
Comment intervenir dans la lutte de classe ?
- 1632 lectures
Nous publions ici une discussion entre les camarades qui se sont impliqués dans l’intervention vis-à-vis des ouvriers en grève de Verizon aux Etats-Unis, certains étant militants du CCI, d’autres des sympathisants. Ils ont travaillé en étroite collaboration dès le début, de l’échange d’idées sur les axes dans l'écriture du tract qui allait être distribué, jusqu’à la diffusion du tract et aux discussions avec les ouvriers en grève, en passant par la réflexion après l’intervention que nous publions ici.
Nous ne soulignerons jamais assez l’importance de la nature collective de ce travail. Il est important pour les sympathisants puisqu’ils acquièrent une expérience « concrète » de comment intervenir réellement dans la lutte de classe dans un cadre collectif qui est le produit de discussions ouvertes. Il est important pour le CCI car il continue à écouter et à s’enrichir de la vision de jeunes – et même de pas si jeunes – générations d’éléments et de groupes en recherche d’une orientation politique, de façons nouvelles et créatives d’aborder différentes questions.
Camarade H : quand nous dénonçons les syndicats, cela peut vraiment être ressenti comme les attaques que livre contre eux l’aile droite de la bourgeoisie. Il peut être difficile pour des gens qui n’ont pas entendu avant les syndicats être attaqués par la gauche, de faire la distinction. En fait, on finit souvent par dire la même chose que l’aile droite (les syndicats vous prennent de l’argent, mais ne font rien pour vous, ils ne font que défendre leurs propres intérêts, etc.). Peut-être, étant donné le rapport entre les classes aux Etats-Unis, devrions nous donc moins insister sur notre attaque contre les syndicats – ou au moins ne pas en faire le cœur de notre intervention – et se concentrer à la place sur le développement des revendications de classe. Bien sûr, les syndicats vont les saboter, mais les travailleurs doivent peut-être apprendre cela au cours de la lutte. Il est possible qu'une dénonciation trop forte des syndicats ne puisse que renforcer la tendance à s’identifier à eux. Les ouvriers n’arrivent pas encore à voir la différence entre les syndicats et eux-mêmes. Quand ils entendent qu'il y a des attaques contre les syndicats, ils pensent qu’ils sont eux-mêmes attaqués. Peut-être qu’il n’y a pas de perspective immédiate aux Etats-Unis de prise en main de leurs luttes par les ouvriers ? En ce sens, Le Wisconsin était peut-être une véritable exception et nous avons vu comment les syndicats ont pris rapidement le contrôle de la situation là-bas. La chose la plus importante n’est-elle pas que les ouvriers soient réellement en train d’essayer de lutter, et nous devrions peut-être nous concentrer sur la volonté de lutter plutôt que sur la dénonciation des syndicats ? Cela ne veut pas dire qu’on donne un blanc-seing aux syndicats, mais on ne devrait pas donner l’impression que notre principal but est de détruire les syndicats.
Camarade A : personnellement, j’ai eu un moment vraiment difficile pour comprendre comment intervenir de façon adéquate, de manière à ce que, d’un côté, cela aide, développe et favorise la conscience de classe et que d’un autre, cela ne soit pas vraiment une dénonciation des syndicats que la grande masse des travailleurs ne comprend pas encore. Je ne sais pas non plus comment les ouvriers peuvent être d’accord pour faire ce qu’on a dit avant sans se poser la question de pourquoi tout cela devrait être fait en dehors du cadre syndical. C’est une énigme à laquelle je suis toujours confronté sur mon lieu de travail, où beaucoup de collègues sont d’accord avec les idées et les propositions, mais finissent toujours par dire quelque chose comme : c’est bien, allons proposer cela aux syndicats… en dernière analyse, les travailleurs ont besoin de sentir qu’ils peuvent faire ce qui précède (développer la lutte, etc.) sans les syndicats. C’est ce sentiment d’impuissance, mais aussi cette reconnaissance d’identité de classe encore inexistante, je pense, que la classe n’a pas encore surmontée et développée. Et cela, comme nous le savons, se produit dans les luttes elles mêmes. Je me demande si le tract n’aurait pas eu un impact tout différent si les trois premiers paragraphes n’avaient pas été là du tout, ou s’ils avaient été écrits à la fin, après avoir présenté ce que les travailleurs pouvaient réellement faire dans de telles circonstances.
Camarade H : tous ces questionnements et ces sentiments sont très justes, Je pense souvent, que notre intervention se réduit à la chose suivante : les ouvriers ont besoin de se rassembler pour décider par eux-mêmes ce qu’il faut faire. Au delà de quelques choses très générales, et de beaucoup sur ce qu’il ne faut pas faire, nous ne pouvons pas réellement par principe dire aux travailleurs ce qu’il faut faire, ou réellement comment lutter, en dehors de quelques leçons de base de l’histoire. C’est réellement une situation difficile pour toute la Gauche communiste. Les ouvriers doivent le trouver par eux-mêmes. En tant que telle, notre intervention apparaît souvent comme négative, c’est-à-dire : « Nous ne savons pas exactement quelle est la réponse mais les syndicats ne l’ont sûrement pas, pourquoi n’allez-vous pas discuter entre vous de ce qu’il faut faire alors que les syndicats ne s’en occupent pas ?» . En même temps, les syndicats semblent avoir des réponses concrètes qui ne se dévoilent être des illusions que très lentement. Cela demandera du temps et de l’expérience pour que les ouvriers brisent l’étreinte du syndicat. En ce moment même, les tentatives absurdes d’éléments de la bourgeoisie de détruire les syndicats ne semblent que renforcer ce mythe syndical. Les syndicats sont capables de jouer la carte de la victimisation. Ce n’est pas le meilleur moment pour faire une intervention qui condamne les syndicats en des termes aussi austères. En Europe ou ailleurs, c’est peut-être une autre histoire. J’entends bien la frustration qu’éprouve A. par rapport à l’accord que les travailleurs semblent donner à quelques uns de nos concepts de base, mais pensent encore qu’ils peuvent les réaliser à travers le syndicat. C’est comme quand vous avez une liste de doléances contre la société et qu’un type quelconque en costume cravate vous dit d’écrire à votre député. C’est comme s’ils ne comprenaient pas que le cadre que vous mettez est fondamentalement différent. De fait, ils ne comprennent pas. Ce n’est que l’expérience qui leur apprendra. Nous ne pouvons réellement qu’espérer avoir semé des germes de doute, le creuset d’un paradigme différent parmi les éléments les plus ouverts et qui pensent à plus long terme, de façon à préparer le terrain pour la prochaine lutte. Nous n’en sommes encore qu’à un tout premier stade du retour à la lutte, un retour qui ne balise que très lentement le terrain de classe.
Camarade J : J’ai énormément apprécié votre aide pour l’intervention. Je pense que j’ai appris beaucoup et j’ai aussi été surprise par l’ouverture à la discussion et encouragée par la solidarité qu’ont montré les autres travailleurs. En même temps, je suis vraiment d’accord avec ce que dit H. Pour le moment, les ouvriers pensent encore en termes « les syndicats se battent pour nous ». Je pense que dix ans d’endoctrinement peuvent éroder ce que les ouvriers ont appris de la dernière grève, surtout quand la majeure partie de la classe ne lutte pas et que, - bien que la solidarité ait été appréciée comme nous l’avons vu – la classe ouvrière a encore peur et reste conservatrice dans toutes ses tentatives de se défendre, et jusqu’à ce qu’il y ait des luttes plus fréquentes, il y a peu de chance probablement que nous convaincrons beaucoup de monde de notre position sur les syndicats, mais nous pouvons sans doute convaincre les ouvriers du fait que :
- la crise ne mène nulle part et il y aura davantage de luttes dans le futur ;
- chaque travailleur mérite de jouer un rôle actif dans ces luttes et de discuter de ce que sont exactement les revendications, et de comment se battre pour elles ;
- d’autres travailleurs sont intéressés par notre lutte et veulent nous aider et on peut donc discuter avec eux aussi ;
- ce que font les syndicats ne marche pas à long terme et ce que nous devons faire avec cette lutte, c’est d’en discuter, en dehors de la boîte, avec d’autres ouvriers, discuter des luttes des autres ouvriers – pour construire une espèce d’identité de classe ;
- ce n’est pas tel ou tel patron mais le système capitaliste tout entier qui attaque, pas seulement les ouvriers de Verizon (ou d’autres) mais la classe ouvrière toute entière et nous devons répondre en nous battant en tant que classe.
Camarade A : il y a un tas de choses que nous pouvons dire aux ouvriers et J. en a cité quelques-unes ici, mais je suis d’accord avec le fait que nous ne devons pas mettre en avant la dénonciation des syndicats quand on va dans les piquets de grèves, dans les marches de protestation ou dans les manifestations et autres formes de lutte. Je ne pense pas que nous devions cacher ou mentir à propos de nos positions, mais ce ne doit pas être la première chose qui sorte de notre bouche. Ce ne devrait pas être en première ligne de notre tract. Je pense que pour la presse, c’est une autre histoire. L’audience est différente. Quand nous intervenons dans un piquet, nous allons vers les ouvriers ; toutefois, quand quelqu’un achète un journal ou prend le temps d’aller sur le site, il prend l’initiative d’en savoir plus sur nos positions. En théorie, notre presse n’est lue que par les éléments les plus avancés de la classe alors qu’un tract est beaucoup plus largement distribué. Je suis d’accord avec J. qu’à ce stade, il est probablement plus important d’intervenir sur la question de la crise, en mettant en avant la perspective marxiste qui dit qu’il n’y a pas de solution à cette pagaille au sein du capitalisme, quoi que que fassent les ouvriers dans les syndicats, ils ne vont pas au-delà de l’horizon des alternatives bourgeoises, qui ne sont en réalité pas du tout des alternatives. Les travailleurs ont besoin de voir que réformer le système n’est pas possible, qu’aucune fraction de la bourgeoisie n’a de réponse : le futur est sinistre sans leur action indépendante. En théorie, la remise en question de l’hégémonie syndicale devrait suivre.
Discussion répercutée par le CCI ( 24 septembre 2011)
Géographique:
- Etats-Unis [83]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]
La crise économique déchaîne sa colère sur la classe ouvrière
- 1601 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article réalisé par Internationalism, organe de presse du CCI aux Etats-Unis.
A l’heure où, en Europe, tous les médias affirment que la principale cause à la crise de l’Euro est la faiblesse de sa banque centrale, la BCE, que celle-ci devrait copier son homologue américain, la Fed, et émettre elle-même sans limite sa propre monnaie, cet article de nos camarades vivant aux Etats-Unis démontre qu’en réalité, de l’autre côté de l’Atlantique, la même crise économique et la même impuissance de la bourgeoisie à trouver une réelle solution à cette crise, font rage.
Les événements de juillet et août se sont produits à la suite les uns des autres si rapidement que la classe dominante a paru avoir le vertige devant leur vitesse et leur profondeur : la crise du plafond de la dette, la rétrogradation de la note américaine de AAA à AA+ par Standard & Poor's, les hauts et les bas et la volatilité des bourses, les nouvelles de l’insolvabilité de pays comme l’Espagne et l’Italie et le FMI dans une impasse par rapport à ce qu’il faut faire, la fuite de capitaux avec les bons du trésor américain transformés en or. La classe dominante est à court d’argument pour rassurer une classe ouvrière de plus en plus incertaine quant à ses espoirs d’un meilleur futur. Comble de l’infortune, ses options sur comment répondre à une crise économique qui ne fait que s’aggraver se réduisent de plus en plus. Que se passe-t-il ?
La crise du crédit qui a suivi l’éclatement de la bulle immobilière en 2008 a été une menace si sérieuse de blocage de l’activité économique que la bourgeoisie a été obligée de monter des plans de récupération sous la forme de « plan de relance économique » et de consolider l’industrie financière en absorbant les actifs toxiques des banques et de se porter caution. Le petit répit accordé par ces mesures est à la base de la soi-disant « récupération » qui s’est déroulée ces deux dernières années. Du point de vue de la classe ouvrière, comme elle continue à subir le poids de la crise, il est évident qu’il n’y a pas de fin ni de solution à la détérioration de ses conditions de vie et de travail. Comme le capitalisme ne peut plus tirer sur sa corde, et que les mesures employées par la classe dominante pour ralentir les pires effets de la crise s’épuisent, la classe ouvrière ne peut attendre que des attaques encore plus brutales contre elle.
Comment s’en sort la classe ouvrière ?
Vendredi 2 septembre, le gouvernement faisait un rapport sur l’embauche alors que le Bureau des Statistiques du Travail publiait des données pour le mois d’août. Le New York Times faisait la Une de l’édition du samedi 3 septembre avec : « zéro job, mauvais signal pour l’économie américaine avec la croissance récente ». Ce qu’on peut réaliser sombrement en lisant les données, c’est que les nouvelles personnes qui rentrent sur le marché du travail ne seront pas intégrées et que les sans- emploi continueront à être au chômage dans un futur prévisible : c’est la première fois que cela arrive depuis les années 1940. Il faut se rappeler que le taux officiel du chômage, stable à 9,1 %, est basé sur le nombre de gens qui ont activement recherché un travail au cours des quatre semaines précédentes. Cela n’inclut pas les ouvriers découragés qui ont laissé tomber la recherche d’un travail, ni ceux qui sont employés à temps partiel mais voudraient travailler à plein temps. En ajoutant tous ceux là, le taux de chômage grimpe immédiatement à 16,1%, et même ce chiffre est une donnée très peu actualisée, parce qu’il recense dans les employés la population non civile qui est intégrée dans l’armée.
Ce qui est aussi vraiment inquiétant, c’est le caractère à long terme du chômage dans la récession actuelle. Les suppressions d’emploi n’ont pas seulement été pires depuis le début de la dernière récession que dans les précédentes, mais cela prend beaucoup plus longtemps pour trouver un travail. La « croissance zéro » qui vient d’être publiée confirme que l’économie est dans un état de mauvaise santé chronique. Si l'on examine la composition de la classe ouvrière aux Etats-Unis, le gros des chômeurs est constitué par la population noire qui subit un chômage de 16,2 à 16,7%, ce qui est encore une confirmation de la maladie chronique du capitalisme, totalement incapable de relever le niveau de vie misérable de secteurs de la population qui ont été historiquement désavantagés. Les ressortissants d'origine latino-américaine suivent avec un taux de chômage de 11,3%. Une autre donnée très parlante est celle qui concerne le chômage des jeunes, qui atteint 25,4%. Dans le contexte d’une impasse économique et où il n’y a pas d’embauche, cela crée des conditions inédites dans lesquelles les parents qui bénéficient encore d’une pension ou de l’aide sociale vont se faire du souci pour la stabilité financière des enfants quand leurs parents partiront à la retraite.
Cette économie continue à perdre des emplois dans le secteur gouvernemental, alors que la manufacture et le commerce de détail, qui avaient bénéficié d’un petit répit l’année dernière, perdent aussi des emplois. Cette tendance va se poursuivre, car le seul secteur où les emplois sont en augmentation est l’agriculture ; or, la saison des récoltes touche à sa fin. Ces données sont assez décourageantes, mais pour les « veinards » qui ont encore un travail, aller au travail devient de plus en plus une activité très semblable à de la torture, avec une oppression, un contrôle et une intensification de l’exploitation intolérables. Les enseignants ont été tout particulièrement accusés et vilipendés du fait de leur salaire « privilégié » et de leurs avantages sociaux, mais leurs conditions de travail se sont particulièrement détériorées depuis le début de la crise. Il n’est pas étonnant qu’on trouve dans les statistiques publiées par le Bureau du Travail que le nombre de démissions est presque équivalent au nombre de licenciements, avec le plus grand nombre de démissions dans le secteur de l’éducation ! Cela amène à penser que les conditions de travail sont tellement exténuantes qu’un travailleur peut choisir la perspective de l’instabilité financière plutôt qu’une pression insupportable au travail ! Confrontés à la réalité de la crise, les économistes bourgeois abaissent maintenant leurs perspectives pour la croissance.
Comment s’en sort le capitalisme et que fera la classe dominante ?
Ces convulsions de l’économie ne sont ni le résultat de la cupidité des entreprises ni de la spéculation boursière, comme on nous l’a dit en 2008, quand elles ont commencé à se manifester. Les causes ne se trouvent pas dans l’imprudence des « consommateurs » qui contractent des dettes qu’ils ne peuvent pas rembourser. Pas plus qu’elles ne sont la cause des querelles incessantes à Washington entre factions de la classe dominante américaine divisée par le dilemme de ce qu’il faut faire face à la plus grave récession de l’histoire des Etats-Unis. Ces facteurs aggravent sûrement la situation, mais plutôt que d’en être la cause, ils sont des symptômes d’un malaise pour lequel la classe dominante n’a aucun remède. Comme nous l’avions écrit dans la Revue Internationale n°133 : « Pendant quatre décennies, …, l'ensemble de l'économie n'a conservé un semblant de fonctionnement que grâce à des politiques capitalistes d'État monétaires et fiscales…. Pendant toutes ces années de crise et d'intervention de l'État pour la gérer, l'économie a accumulé tant de contradictions qu'aujourd'hui, il existe une menace réelle de catastrophe économique ». (Les Etats-Unis, locomotive de l’économie mondiale… vers l’abîme.1 2e trimestre 2008)
La monstrueuse dette publique des Etats, le déficit du budget fédéral, la dette privée nationale, le déficit commercial énorme, sont tous le résultat de l’intervention capitaliste d’Etat au cours des quatre dernières décennies pour maintenir à flot son économie malade. Tout cela a conduit le capitalisme aujourd’hui au point auquel il a dépassé ses possibilités de freiner son endettement. Les multiples contradictions accumulées au cours des quatre dernières décennies ont toutes mûri à la fois et la classe dominante est incapable de s’y confronter avec un projet cohérent. Les plans d’austérité risquent d’affaiblir une économie déjà bien malade, encourager la consommation devient difficile et exacerbe le risque de banqueroute. Pomper de l’argent dans le marché financier – comme la politique de la banque centrale appelée « Quantitative Easing » d’inonder le marché financier avec du liquide via l’achat direct de dettes du Trésor, à hauteur de 600 milliards comme cela a été le cas la dernière fois – va entraîner une dépréciation de la monnaie en circulation et relancer l’inflation. La classe dominante va encore devoir continuer à s’appuyer sur l’appareil d’Etat pour intervenir massivement dans l’économie et administrer le même remède qui est déjà un véritable poison. Mais toutes ces manipulations financières et monétaires ne font que repousser le jour des règlements de compte à un petit peu plus tard. La banque centrale, par exemple, peut commencer à vendre des titres du Trésor des Etats-Unis arrivant prochainement à échéance et à acheter ceux à échéance plus tardive pour tenter d’accroître la demande d’investir dans des actions à plus long terme. De cette manière, leurs prix vont monter et les taux d’intérêt sur ces titres tomber, ce qui fera que les Etats-Unis paieront moins cher pour rembourser leurs dettes. Mais cela ne peut qu’encourager la spéculation sur des actifs encore plus à risque, puisque les investisseurs recherchent les plus gros profits à la Bourse et que les titres du Trésor ne seront pas d’un grand rapport.
On trouve aussi un exemple de l’incohérence croissante de la classe dominante américaine dans le discours du président de la Banque centrale, Ben Bernanke, le 26 août à Jackson Hole, dans le Wyoming, quand il a dit que l’état actuel de l’économie ne s’est pas détérioré au point d’avoir un troisième tour du « Quantitative Easing ». Quelques jours plus tard, les statistiques produites par le Bureau du Travail allaient de nouveau accroître la pression sur le capitalisme américain pour qu’il actionne davantage la planche à billets. Mais celà ne va pas guérir le patient en phase terminale, le capitalisme dans les affres de la mort. Pourquoi ?
Comme nous l’avions écrit dans la Revue Internationale n°144 : « Le apitalisme souffre par nature d'un manque de débouchés car l'exploitation de la force de travail de la classe ouvrière aboutit forcément à la création d'une valeur plus grande que la somme des salaires versés, vu que la classe ouvrière consomme beaucoup moins que ce qu'elle a produit. »2 (Face à la crise capitaliste, il n'existe aucune voie de sortie, 1er trimestre 2011). Les travailleurs et les capitalistes ne peuvent constituer un marché suffisant pour redémarrer le processus de production capitaliste. Or, il faut un marché pour valoriser la part de plus-value extraite de l’exploitation de la classe ouvrière et destinée à la reproduction du capital. La valeur d’échange entre capitalistes perd de vue le fait que le capital doit augmenter, pas consommer, sa plus-value. Pour les ouvriers qui représentent un marché solvable, la contradiction la plus puissante – et mortelle – du capitalisme tient en ce la lutte du capital contre la tendance à la baisse du taux de profit, résultat de la concurrence, pousse vers l’amélioration de la technologie, remplaçant ainsi des ouvriers et augmentant la productivité sans élévation correspondante des salaires. Il en résulte une contraction de la demande, puisque la capacité de consommation des ouvriers est de plus en plus réduite. Les discours actuels sur la consommation anémique, le manque d’investissements, la baisse de la productivité, sont l’expression de cette contradiction fondamentale du capitalisme. Dans ces conditions, le capitalisme ne peut pas et ne peut avoir de solution à sa crise. En opprimant et en imposant des plans d’austérité brutaux contre la classe ouvrière, la bourgeoisie risque de hâter le moment où les ouvriers du monde entier s’affronteront directement au capitalisme et le relégueront aux poubelles de l’histoire.
Ana (4 septembre)
1 https://en.internationalism.org/ir/133/editorial [167]
2 https://en.internationalism.org/ir/144/economic-crisis [168]
Géographique:
- Etats-Unis [83]
Récent et en cours:
- Crise économique [169]
Les ouvriers de Guayana (Venezuela) luttent contre le chavisme
- 1823 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d'un article d'Internationalismo, organe de presse du CCI au Venezuela.
Que se passe-t-il au Guayana ?
Soumettre les ouvriers de Guayana1 à des conditions de vie précaires est devenu une priorité pour la bourgeoisie nationale et plus particulièrement pour sa fraction chaviste au pouvoir, tel que cela a déjà été fait avec les travailleurs de l’industrie pétrolière. Il en est ainsi parce que la réduction des coûts, surtout de la main-d’œuvre dans les industries de base de la région, celles du fer, de l’acier, de l’aluminium, etc., est une nécessité impérative pour affronter la concurrence internationale, à cause de l’aggravation de la crise du système capitaliste.
Pour atteindre cet objectif, les ouvriers de la province de Guayana, à l’instar de ce qui est arrivé aux ouvriers de l’industrie pétrolière, ont été soumis à une campagne où ils ont été accusés de faire partie d’une « aristocratie ouvrière » qui gagne des salaires et des primes que l’industrie ne peut plus payer sous peine d’être acculée à la faillite. Le chemin proposé est celui de du nivellement par le bas, c'est-à-dire, la baisse brutale des salaires et des primes, comme ce fut le cas là aussi pour les travailleurs du pétrole.
Cependant, avec les ouvriers de Guayana, la bourgeoisie, en ce qui concerne la lutte, a face à elle un problème autrement plus aigü : le risque pour la bourgeoisie est bien plus grand à cause de leur grande concentration et de leurs traditions de lutte, d’ailleurs menée souvent contre l’État. La vaste concentration d’activités industrielles, de service et commerciales en lien avec ce grand conglomérat industriel, renforce d’autant la puissance de la riposte de la classe ouvrière contre les attaques à ses conditions de vie.2
Quelle stratégie déploie l’État ?
L’État vénézuélien a échafaudé la stratégie dite « Plan Guayana Socialiste », réalisant ainsi le slogan trotskiste du « contrôle ouvrier de la production ». Ce faisant, l’État a voulu convaincre les travailleurs que c’est eux-mêmes qui contrôleraient la production, et que, par conséquent, le renforcement des industries dépendrait de leurs efforts et de leurs sacrifices. Ils ne devaient donc dorénavant plus faire grève puisque l'industrie se trouve, selon la propagande officielle, entre leurs propres mains. La défense de ce Plan représenterait un pas vers le « Socialisme du 21e Siècle », autrement dit le « grand truc » manipulé par Chavez et sa coterie.
Il est bon de rappeler que ce Plan a été précédé de l’échec d’un autre plan pour développer la cogestion chez ALCASA, entreprise étatique de fabrication d’aluminium. L’objectif de ce plan, dirigé par le sociologue Carlos Lanz Rodriguez, était de faire croire aux travailleurs :
que l’État dirigé par Chavez mène une « politique orientée vers le socialisme ». Déjà par rapport à un tel « cap », les travailleurs de Guayana avaient flairé qu'un tel « socialisme » n’était pas très différent du contrôle que l’État capitaliste exerçait lors des gouvernements précédents.
que cogestion signifie « changement dans les rapports de production ». Le seul « changement » qui s’est produit, c’est que les ouvriers devaient se laisser « auto-exploiter » pour consolider la gestion de l’Etat-patron capitaliste,
que « justice serait faite » en ce qui concerne les rapports salariaux. Nous savons très bien que la seule chose que ce régime ait mené à bien, c’est l’accroissement de la précarisation de la force de travail,
enfin, qu’on accomplirait la réalisation d’une « humanisation de la journée de travail et la réduction du temps de travail, contre la division du travail et le despotisme dans l’usine ». Pour ce qui est de l’humanisation, cil s'agit d'un cocktail d’emprisonnements, d’accusations devant les tribunaux, de gaz lacrymogènes, de coups de feu, de morts et de blessés ; et, pour couronner le tout, maintenant, c'est le vaste déploiement de bandes armées, de sicaires essayant de terroriser les ouvriers.
Ce plan est un échec parce qu'en général, les travailleurs, devant les résultats désastreux pour leurs intérêts, n’ont pas gobé les belles paroles avec lesquelles Carlos Lanz voulait introduire le poison de la soumission à l’État capitaliste au sein des ouvriers et le renoncement à leurs revendications. Et c’est ainsi que la résistance des travailleurs de l’aluminium a réussi à briser la vitrine que l’État vénézuélien avait soigneusement installée pour montrer les magnificences de son « Socialisme du 21e siècle » aux autres travailleurs du pays.
Le « Plan Guayana Socialiste » : est-ce l’œuvre des travailleurs ?
Le nouveau « Plan Guayana Socialiste », qui consiste fondamentalement à :
Essayer de convaincre les ouvriers, encore une fois, du fait que les entreprises seraient sous leur contrôle et que leur exploitation va disparaître.
Faire payer à l’ensemble de la classe ouvrière de Guayana la grave situation financière et la détérioration des infrastructures des industries de base, ce qui veut dire qu’on exige des sacrifices pour restaurer leur compétitivité ; autrement dit, qu’il faut accepter une dégradation des conditions de vie.
Et, par conséquent, les ouvriers devraient renoncer à lutter pour leurs revendications.
Ce plan a été présenté comme le résultat de la participation de quelque « 600 travailleurs représentants de la classe ouvrière de Guayana » à des « tables rondes de travail » dirigées par les actuels « travailleurs-directeurs » des entreprises de base, Elio Sayago et Rada Gameluch, entre autres. Ce groupe de travailleurs, choisis entre ceux qui avaient participé à un stage d’endoctrinement sur le « Socialisme du 21e Siècle » et sur le « développement endogène » y ont été aussi convaincus du fait qu’il fallait combattre ceux qui s’opposent à ce Plan parce qu’ils feraient partie de « l’aristocratie ouvrière ».
Par la suite, on a essayé de mystifier les travailleurs en les polarisant entre ceux qui soutiennent les syndicats, quelle que soit leur tendance (même le syndicat du parti officiel chaviste, le Parti Socialiste Uni de Venezuela), et ceux qui soutiennent le prétendu « contrôle ouvrier ».
Quels sont les obstacles sur le chemin du prolétariat pour retrouver son identité de classe ?
L’État fait feu de tout bois pour créer des divisions au sein des travailleurs. En créant, en premier lieu, une polarisation entre les dirigeants défendus par les syndicats et les représentants du soi-disant « contrôle ouvrier ». Et aussi, entre les travailleurs qui feraient partie de la supposée « aristocratie ouvrière », qui ne défendraient que leurs « intérêts égoïstes », qui ne chercheraient « qu’à préserver ou améliorer leur salaire » et, de l’autre coté, ceux qui encouragent les travailleurs à se joindre aux défenseurs de la patrie, à ceux qui défendent les nationalisations comme une étape décisive vers le « Socialisme du 21e Siècle », à ceux qui ne sont pas égoïstes et qui se sacrifient pour « la patrie de Bolivar ».
Dernièrement, l’État a déployé une armada constituéel de bandes armées, de mafias et d'hommes de main les plus divers pour semer la terreur au sein des travailleurs. Ceci est la conséquence du fait que les pressions judiciaires sur les travailleurs envoyés devant les tribunaux, n’ont pas suffi pour que les ouvriers cessent leurs actions en défense de leurs intérêts, mais c’est plutôt le contraire qui s’est produit. L'inefficacité de ce qu’on appelle la « criminalisation de la protestation » a été mise en évidence lorsque l’État a été obligé de libérer certains détenus pour amadouer la colère des ouvriers, une colère qui a amené des syndicats et des syndicalistes pro-gouvernementaux, surtout ceux du courant de Maspero (dirigent syndicaliste « officiel »), à soutenir la lutte pour la libération du dirigeant syndical Ruben González, favorable pourtant au « processus », emprisonné pendant quelques mois. L’État a voulu aussi, avec cette mesure, montrer son visage « ouvriériste » et cacher son penchant vers la « dictature totalitaire ».
Cette action a eu comme effet celui de redorer le blason de certains syndicats qui peuvent ainsi mieux exercer leur contrôle sur la classe ouvrière, en essayant, surtout, de tenir celle-ci enfermée dans le corset corporatiste, dans une lutte pour le défense de telle ou telle clause des conventions collectives ou dans la lutte contre la corruption, dont la puanteur délétère rend insupportable l’atmosphère dans le travail.
Par ailleurs, il y a la volonté de piéger les ouvriers dans les luttes intestines entre les mafias syndicales et celles qui défendent le dit « contrôle ouvrier », qui à leur tour font partie des différentes camarillas du pouvoir autour du gouverneur de la province de Bolivar [où se trouve l’agglomération Ciudad-Guayana], les maires, les militaires et des secteurs du capital privé, qui y mènent tous leurs juteuses petites affaires, contribuant ainsi à l’écroulement des industries de base, expression de la décomposition régnante dans tous les secteurs et dans tous les coins du pays.
Que faire pour contribuer au processus de prise de conscience ?
Pour les représentants de l’État, qu’ils s’appellent gouverneur, maire, ministre, directeur d’entreprise, syndicaliste, le mot d’ordre parait être : « si tu ne peux pas les convaincre, mystifie-les ». Cependant, là où se concrétise l’intervention des représentants de différents organismes de l’Etat, en défense de leurs intérêts personnels ou pour le compte de leurs mafias, que ce soit par la répression directe ou par le biais de tueurs, c’est le chaos sanglant qu’est devenue, sous le capitalisme en décomposition, la forme des rapports que le patronat entretient avec les ouvriers.
Pour les minorités révolutionnaires, il s’agit de montrer le chemin vers la prise de conscience de la classe ouvrière. En premier lieu, contre le chantage qui consiste à dire que les ouvriers qui luttent contre la réduction de leurs salaires ou la perte de leurs primes feraient partie d’une aristocratie sans conscience de classe. Nous devons y opposer, d’un coté, que la lutte pour les revendications immédiates fait partie du processus de prise de conscience du prolétariat. Par ce biais, la classe s’unifie, elle réussit à bien définir quel est son ennemi de classe, que celui-ci soit un patron privé ou l'État-patron, elle réalise quel est son rôle dans la société en tant que seule classe capable de mettre fin au chaos capitaliste. D’un autre coté, il n’agit pas en vérité, de lutter pour un « salaire juste » -c’est l’État qui détermine en réalité cette « justesse »-, mais de lutter contre le salariat qui est l’essence même du système dexploitation capitaliste.
Si la poudrière prolétarienne qui existe au Guayana n’a pas encore explosé, cela est dû en grande partie à la polarisation et à la confusion des propositions de toutes sortes faites par les différents « représentants » syndicaux ou professionnels de l’État, chacun défendant son fief, s'efforçant chacun par tous les moyens que les discussions au sein des assemblées servent à annuler toute action que le prolétariat uni devra prendre pour en finir avec le chaos qui règne dans la région. Nous devrons, en conséquence, reconquérir les discussions dans les assemblées et mettre en avant, avant toute chose, l’unification nécessaire des luttes.
Quelles perspectives ?
La classe ouvrière de Guayana n’a pas cessé de lutter. Il arrive souvent que devant l'entrée principale de l’une des grandes entreprises, une assemblée soit organisée pour riposter face à telle ou telle attaque contre les conditions de vie imposées. Et il est souvent arrivé que ces assemblées sont parvenues à neutraliser les attaques du pouvoir, lequel essaye par tous les moyens d’opposer les intérêts « de la collectivité » aux luttes ouvrières, comme ce fut le cas lorsqu’on a envoyé les « conseils communaux » contre les assemblées.
Le surgissement de minorités au sein de la classe ouvrière qui tentent de renouer le fil du mouvement historique de la classe se renforce avec la persévérance et l’amplitude des luttes. Ces minorités luttent contre une vision déformée du socialisme, non seulement sous sa version trotskiste et leur soutien critique au chavisme, mais aussi sous sa version ultraréactionnaire du « Socialisme du 21e siècle », ornement d’un nationalisme exacerbé, enrobé de haine anti-yankee et d’un fondamentalisme quasi-religieux qui se concrétise dans ce « Socialisme bolivarien ».
Les nouvelles générations ouvrières de Guayana essayent de mener leur propre expérience de lutte et d’apprendre des générations précédentes d’ouvriers de la région, qui affrontèrent avec détermination l’État pendant les années 60 et 70 du siècle dernier. Malgré les entraves que la bourgeoisie met en travers des ouvriers de Guayana, ceux-ci sont en train de montrer aux autres ouvriers qu’ils sont aussi déterminés à mener la bataille contre le capitalisme chaviste derrière le masque du « socialisme » avec lequel il se camoufle.
Internacionalismo (juillet 2011)
1 L’agglomération industrielle de Ciudad-Guayana est située dans la province de Bolivar au Venezuela, sur l’Orénoque, avec une population proche du million d’habitants dont une grande partie est formée de familles ouvrières.
2 Lire « ‘Guayana est une poudrière’ : le prolétariat à la recherche de son identité de classe à travers la lutte [170] », (mai 2010)
Géographique:
- Vénézuela [171]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]
Les « primaires » du PS, un bon filon pour toute la bourgeoisie
- 1263 lectures
Le dimanche 16 octobre 2011, vers 19h, alors même que les chances de victoire de sa pouliche Martine Aubry étaient déjà définitivement enterrées, Bertrand Delanoë, maire socialiste de Paris déclarait à la presse : “Ces primaires sont une victoire pour la démocratie.” Evidemment, cette petite phrase cache une réelle déception par ce que les professionnels de la communication appellent un « discours positif ». Mais pas seulement. Il y a derrière ces quelques mots désabusés, une vérité fondamentale dont leur auteur n'a sans doute pas bien mesuré l'importance.
A quoi ont servi les primaires, finalement ? A unir le PS ? On en doute, et nos doutes risquent fort de s'envoler très vite, sitôt les embrassades de ce dimanche oubliées. A moderniser l'image du PS ? C'est sûrement vrai même si ce n'est là qu'affaire de paillettes. A montrer la diversité existant au sein du PS ? Sûrement pas : après tout le parti n'a pas attendu les primaires pour voter son programme, censé être donc repris par tous.
Alors à quoi ont servi ces débats soporifiques, cette organisation gigantesque, ces millions de pièces de un euro versés par les « citoyens électeurs » ? A la base, à désigner le candidat qui représentera le PS aux présidentielles. Mais bien au-delà, les primaires ont aussi servi, tout comme aux Etats-Unis par exemple où le système existe depuis longtemps pour les deux grands partis de pouvoir, à remettre une couche, toute fraîche et brillante, à la mystification démocratique. Ce n’est d‘ailleurs pas tant l’intérêt pour les idées d’un PS qui n’a rien à dire que ce souffle démocratique est venu presque faire la pige à la coupe du monde de rugby, mais la mobilisation de près de trois millions de personnes exaspérées par Sarkozy et dont la perspective essentielle est de ne plus le voir à la tête du pays.
Mais cela, c'est en définitive au service de toute la classe bourgeoise. C'est bien pour cela que la droite a patiemment et sagement attendu la proclamation des résultats avant de sortir ses armes lourdes et entrer en campagne. L'UMP avait-elle à ce point besoin de connaître l'identité de son adversaire pour s'adonner, comme elle l'a fait deux jours après, à la démolition en règle du programme socialiste, particulièrement sur la question économique où Hollande ne brille certainement pas plus que les autres par l’innovation ou le scoop qui viendrait renverser la vapeur de l’enfoncement inéluctable dans la crise ? Comme on vient de le dire, le programme socialiste est connu depuis longtemps. Qu'il y ait des nuances entre François Hollande et Martine Aubry, certes, on veut bien l'admettre. Mais c’est le programme d’un parti de la bourgeoisie, qui ne pourra faire de toutes façons qu’une politique d’austérité, emballée sous forme de cadeau aux ouvriers, comme à l’époque où Martine Aubry faisait avaler la réforme sur les 35 heures comme une avancée sociale sans précédent. On connaît la suite : aux embauches promises ont succédé des cadences de travail de plus en plus exténuantes et des licenciements massifs, une précarisation généralisée et des suppressions de postes tous azimuts.
Si la droite a laissé se dérouler les primaires sans intervenir autrement que par de molles critiques, voire au contraire des réflexions sur l'intérêt de procéder de même dans son camp, c'est parce qu'en sa qualité de fraction bourgeoise responsable, elle avait tout intérêt à ce que la classe ouvrière se retrouve embringuée en partie dans ces primaires socialistes et surtout focalisant l’attention sur le suspense de leurs résultats de façon à donner du grain à moudre à l’idée qu’il faudra se mobiliser dans les présidentielles de 12012. Le discours plus « radical », anti-pouvoir des banques et altermondialiste (ou « démondialiste » comme il l’a rebaptisé) de Montebourg comme sa rhétorique sur la nécessité dune opération « mains propres » et des 17% des voix du premier tour qui en a fait l’arbitre le plus courtisé. L'idée même que des primaires apportent un surcroît de pouvoir au « peuple » en maîtrisant une étape supplémentaire en amont du processus électoral, ont permis de ramener vers les urnes et de ranimer surtout les illusions d’un électorat de gauche qui se lassait de l’image de corruption donné par l’ensemble de la classe politique et des querelles internes entre les éléphants du parti social-démocrate. La publicité tapageuse des médias pour ces « primaires » pendant un mois où elles ont servi d’écran de fumée pour masquer les attaques s’est révélée très intéressante pour toute la bourgeoisie : elle a permis d’occuper la scène plus tôt sur le terrain électoral et elle redore le blason d'une démocratie passablement terni, même cl'argument de l'alternance : alors même que de plus en plus d'électeurs doutent , à juste titre de la pertinence du choix entre droite et gauche, la bourgeoisie cherche à lui faire croire que, non, en dépit de l’évidence, tout n’est pas joué d’avance et que c'est à lui de choisir !
Maintenant, suite au battage médiatique des primaires, et à son réel succès, l’anti-Sarkozysme a pris une meilleure consistance et va pouvoir tenir le haut du pavé jusqu’en mai prochain. L'occupation du terrain médiatique par la campagne présidentielle permettra de détourner au mieux les consciences ouvrières de la réalité catastrophique de la situation qui amènera le pouvoir, qu'il soit de droite ou de gauche, porté désormais par Hollande, à taper toujours et encore plus fort sur la force de travail. Hollande l'a dit lors de la campagne des primaires : « Je vais redresser la situation mais ça va être dur. » S'il est élu, on peut lui faire confiance pour qu’il ne redresse rien du tout mais pour qu’il tienne la seconde partie de sa promesse. En résumé, que le PS revienne ou pas au gouvernement, on a vu qu’il restait plus que jamais un fidèle serviteur du capitalisme et un des ses meilleurs propagandistes.
GD (19 octobre)
ICConline - novembre 2011
- 1914 lectures
Chris Knight: Marxisme et Science – Première partie
- 3273 lectures
Nous publions ci-dessous une contribution de l’anthropologue Chris Knight sur la relation entre marxisme et science. Chris a été invité au 19e congrès du CCI, qui s’est tenu en mai, afin de participer au débat sur ce même sujet, que nous avons développé au sein de l’organisation depuis quelque temps. Ce débat s’est exprimé dans des articles sur Freud, Darwin, et également sur les propres théories de Chris concernant les origines de la culture humaine ; par la même occasion, nous avons l’intention de publier certains des textes internes qui ont été écrits pour ouvrir plus avant ce débatre objectif dans ce débat, qui a découlé logiquement de discussions antérieures sur l’éthique, la nature humaine et le communisme primitif, n’est pas d’arriver à une simple vision homogène du lien entre le marxisme et la science, ou de faire adhérer à une théorie psychologique ou anthropologique particulière équivalente à un des points de notre plateforme. Pas plus que notre intérêt en engageant des discussions avec des scientifiques comme Chris Night, ou Jean-Louis Dessalles qui s’est exprimé lors de notre précédent congrès, n’exige que nous partagions avec eux un niveau important d’accord avec les positions politiques que notre organisation défend. Nous recherchons plutôt à continuer une tradition du mouvement ouvrier qui consiste à être ouvert à tous les authentiques développements de la recherche scientifique, particulièrement ceux qui concernent les origines et l’évolution de la société humaine. C’est ce qui a essentiellement motivé l’enthousiasme de Marx et d’Engels par rapport aux théories de Charles Darwin et de LH Morgan, comme la reconnaissance de Trotski sur l’importance des idées de Freud, etc. Et malgré la décadence du capitalisme et l’impact profondément négatif qu’elle a eu sur les avancées et l’utilisation de la science, la pensée scientifique n’a cependant pas connu un arrêt complet au siècle dernier et depuis.
Pendant le congrès lui-même, tout en prenant part à la discussion général sur marxisme et science, Chris a aussi fait une présentation succincte mais extrêmement bien argumentée des théories anthropologiques qu’il a élaborées dans son livre Blood relations sur les origins de la culture et d’autres travaux. Cette présentation et la discussion qui s’en sont suivies ont apporté une démonstration concrète que la recherche scientifique fructueuse et la réflexion sur les origines de l’humanité et la réalité du « communisme originel » continuent d'être d'actualité.
Le texte qui suit n’est pas directement sur l‘anthropologie, mais sur la relation plus générale qu’il y a entre le marxisme et la science. Il offre une démarche pour appréhender la relation entre les deux qui est fondamentalement révolutionnaire, affirmant l’internationalisme essentiel de la vraie science, la façon dialectique dont elle avance, et son opposition nécessaire à toutes les formes d’idéologie. Nous invitons nos lecteurs à se servir de notre forum de discussion sur le site web pour nous envoyer leurs réactions sur ce texte de Chris Knight, comme sur ses théories anthropologiques. Chris a dit qu’il serait très désireux de prendre part à toute discussion que ses contributions auraient pu générer sur ce site.
CCI (Juin 2011)
“La science”, selon Trotski, “est la connaissance qui nous donne le pouvoir".1 Dans les sciences naturelles, poursuit-il, la recherche a été dirigée vers la maîtrise des forces et des processus de la nature. L’astronomie a rendu possible les premiers calendriers, les prédictions des éclipses, la navigation marine précise. Le développement de la science médicale a permis une liberté grandissante par rapport et pour la conquête de la maladie. Les avancées de la physique, de la chimie et des autres sciences naturelles ont fourni aujourd’hui à l’humanité un immense pouvoir pour exploiter les forces naturelles de toutes sortes et ont hautement transformé le monde dans lequel nous vivons.
Potentiellement, au moins, la puissance qui en résulte nous appartient à tous – l’espèce humaine entière. La science est l’auto-connaissance et la force de l’humanité à cette étape de notre évolution sur cette planète – et pas simplement la puissance politique d’un seul groupe d’êtres humains sur d’autres. Pour Trotski, comme pour Marx avant lui, c’est cet internationalisme intrinsèque de la science – la nature globale, à l’échelle de l’espèce, qu’elle représente – qui est sa force, et qui distingue la science des formes simplement locales, nationales, territoriales, ou basées sur les classes (c’est-à-dire religieuses, politiques, etc.) des formes de conscience. Les idéologies n’expriment que le pouvoir de certaines parties de la société ; la science appartient à l’espèce humaine en tant que telle.
Dans cette mesure, la science sociale a toujours été un paradoxe : d’un côté, prétendument scientifique, de l’autre, fondée par la bourgeoisie dans l’espoir de conforter son contrôle politique et social. Même le développement de la science naturelle elle-même – bien qu’intrinsèquement internationale et d’une valeur pour l’humanité – a nécessairement prit place dans ce contexte social limité et limitant. Elle a toujours été déchirée entre ces deux exigences en conflit – entre les besoins humains d’un côté et ceux des corporations, des intérêts financiers et des élites dirigeantes de l’autre.
Les intérêts particuliers et les intérêts de l’espèce – la science a toujours oscillé entre ces forces en conflit. Entre les deux extrêmes, les différentes formes de connaissance ont formé un continuum. A un extrême, il y a eu les sciences moins directement concernées par les problèmes sociaux – les mathématiques, l’astronomie et la physique, par exemple. A l’autre, on a vu des champs tels que l’histoire, la politique et la sociologie (relativement récemment) – des champs où les implications sociales ont été immédiates et directes. Plus les implications sociales d’un champ ont été directes, et plus directes et inévitables ont été les pressions politiques sur celui-ci. Et, là où de telles pressions ont prévalu, la connaissance a été distordue et déviée de son cours.
Les conditions sociales de l’objectivité scientifique
Le marxisme est-il une idéologie ? Ou est-il une science ? Dans une attaque virulente lancée au plus fort de la guerre froide, Karl Wittfogel – auteur du Despotisme oriental – dénonçait Marx comme un idéologue. Il concédait que Marx aurait rejeté avec indignation cette description de lui-même, et aurait été outragé de l’utilisation de ses travaux par Staline et ses successeurs. Les autorités soviétiques, écrivait Wittfogel en 1953, ont toujours cité le concept de Lénine de « partisanship » (partiinost, ou le fait de 'prendre parti pour', NDT) pour justifier le fait de « tordre » la science – même au point de falsifier les données – afin de la rendre plus adaptée à l’utilisation politique. Cette idée « d’utilité » ou de « manipulation » semblait découler naturellement, selon Wittfogel, des prémisses initiaux de Marx selon lesquels toute connaissance était socialement conditionnée – produites par les classes sociales uniquement pour convenir à leurs besoins politiques et économiques. Pour les autorités soviétiques, la vérité scientifique était toujours quelque chose à manipuler à des fins politiques. Mais Wittfogel continue : “Marx, cependant, n’avait pas cette vision. Non seulement il a souligné qu'un membre d'une classe donnée pourrait adopter des idées contraires à ses intérêts de classe – ce que Lénine et ceux qui le suivent ne nient pas – il exigeait également qu'un véritable savant soit orienté vers les intérêts de l'humanité dans son ensemble et qu'il cherche la vérité en accord avec les besoins immanents de la science, peu importe la manière dont cela pourrait toucher le sort d'une classe particulière, que ce soit la bourgeoisie, les propriétaires fonciers, ou la classe ouvrière. Marx a loué Ricardo parce qu'il adoptait cette attitude, qu'il disait 'non seulement scientifiquement honnête, mais exigée par la science'. Pour la même raison, il considérait comme 'mesquin' une personne qui subordonnait l'objectivité scientifique à des buts étrangers : 'celui qui essaie d'accommoder la science à un point de vue qui n'est pas dérivé des intérêts de la science elle-même, aussi erronés soient-ils, mais des intérêts étrangers, extérieurs, je l'appelle mesquin (gemein)'.
Marx était parfaitement cohérent quand il décrivait le refus d'accommoder la science aux intérêts d'une classe – y compris de la classe ouvrière – comme 'stoïque, objectif, scientifique'. Et il était tout aussi cohérent quand il condamnait le comportement inverse comme un 'pêché contre la science'.
Ce sont des paroles fortes. Elles montrent un Marx déterminé de maintenir la fière tradition qui a caractérisé l'érudition de toute époque. Il est vrai que l'auteur du Capital n'était pas toujours – et surtout dans ses écrits politiques – à la hauteur de ses principes scientifiques. Son attitude reste néanmoins fort significatif. Les supporters de la science 'partisane' ne peut guère être condamnés pour le fait d'ignorer une objectivité scientifique dont ils se moquent. Mais on peut légitimement critiquer Marx lorsqu'il viole ces principes, puisqu'il y adhère sans réserves."
Karl Marx, écrit Wittfogel, a joué deux rôles mutuellement incompatibles. Il fut un grand scientifique, mais il était aussi un révolutionnaire politique. Il a soutenu – comme chaque scientifique doit le faire – « les intérêts de l’humanité dans son ensemble », mais il a aussi soutenu la classe ouvrière internationale. L’incompatibilité évidente (selon Wittfogel) de ces deux activités a signifié que « les propres théories de Marx … sont, sur certains points décisifs, affectées par ce qu’il a appelé lui-même des 'intérêts accessoires' ».2
Wittfogel est cité par l’anthropologue social Marvin Harris, dont la vision sur ce problème semble être tout à fait similaire. Harris oppose le composant « scientifique » du marxisme et son aspect « dialectique et révolutionnaire », son but étant de rendre le premier utilisable en le décontaminant de toute trace du dernier. Selon Harris, « Marx lui-même a pris la peine d’élever la responsabilité scientifique au-dessus des intérêts de classe ». Mais ceci n’était que dans son travail scientifique. La plupart des travaux de Marx étaient politiques, et là, la science était subordonnée aux fins politiques – et donc mal utilisés. Si la science est défendue pour des raisons politiques, ceci doit conduire à la trahison de la propre objectivité de la science et de ses buts, dit Harris : « Si la question est de changer le monde, plutôt que de l’interpréter, le sociologue marxiste ne doit pas hésiter à falsifier les faits afin de le rendre plus utile. »3
L'idée de Wittfogel que Marx essaie de baser sa science sur “les intérêts de l’humanité dans son ensemble » a de la valeur. On peut aussi être d’accord avec Harris sur le fait que Marx « a pris la peine d’élever la responsabilité scientifique au-dessus des intérêts de classe » - si par « intérêts de classe » on veut dire les intérêts particuliers, opposés à l’humain universel. Mais la difficulté se tient précisément ici. Comme Einstein, et comme tous les grands scientifiques de tous les âges, Marx croyait que c’était sa responsabilité en tant que scientifique de mettre les intérêts généraux de l’humanité avant les intérêts particuliers. La question à laquelle il a dû faire face est celle à laquelle nous nous confrontons aujourd’hui : sous quelle forme concrète, dans le monde moderne, s’expriment les intérêts généraux ?
Marx est venu à la conclusion, sur la base de ses études scientifiques, que les intérêts généraux de l’humanité n’étaient pas représentés par les différentes classes dominantes du 19e siècle en Europe. Ces intérêts n’étaient pas seulement en conflit les uns avec les autres, mais aussi avec ceux de l’espèce humaine en tant que telle. Ils ne pouvaient donc pas former la base sociale pour une science sociale authentiquement objective. La faiblesse de la position à la fois de Wittfogel et de Harris est qu’ils n’ont rien à dire sur la question. Ils se trouvent dans la position étrange à la fois d’être d’accord avec les prémisses de base de Marx et tout en refusant même de discuter la possibilité que ses conclusions puissent être correctes. Ils sont pleinement d’accord avec le fait que la science doive se baser sur les intérêts généraux de l’humanité. Marx, se fondant sur cette idée, est arrivé aux conclusions (a) que la science était elle-même politiquement révolutionnaire dans la mesure où elle était authentiquement fidèle à elle-même et universelle ; (b) que c’était de cette sorte de « politique » (c’est-à-dire la politique de la science elle-même) dont le mouvement révolutionnaire moderne avait besoin ; et (c) que la seule base sociale possible pour une telle politique inspirée par la science était la seule classe dans la société qui était elle-même un produit de la science, qui était déjà aussi intrinsèquement internationale que le développement scientifique et dont les intérêts contraient tous les intérêts particuliers existants. Mais ni Wittfogel ni Harris n’ont pu opposer un argument sur cette question. Ils ont simplement posé comme une évidence que les intérêts de l’humanité sont une chose, et que les intérêts de classe en sont une autre.
Karl Marx savait – et chaque marxiste digne de ce nom le sait – qu’il n’est pas valable de s’associer à une force sociale sans qu’elle représente authentiquement de par sa propre existence les intérêts plus larges de l’humanité. Et tout marxiste digne de ce nom sait que ce n’est qu’une vraie science – les réelles découvertes des scientifiques travaillant indépendamment et pour les fins propres autonomes de la science - qui peut être utilisée par l’humanité comme un moyen de son auto-clarification et son auto-émancipation. Partant de ce point de départ, on peut voir l’absurdité de l’argument de Harris selon lequel si le problème est de changer le monde le sociologue marxiste « ne doit pas hésiter à falsifier les données afin de les rendre plus utiles ». Comment peut être « falsifié une donnée » de façon qu’elle convienne à l’humanité ? Comment cela peut-il être utile à quiconque est intéressé à changer le monde ?
Harris a raison d’insister sur le fait que lorsqu’un intérêt particulier – qu’il soit « marxiste » ou pas – prend le pas sur le travail scientifique, la science elle-même en souffrira. Un parti national particulier et donc limité politiquement ou un groupe particulier dirigeant un Etat particulier (comme, par exemple, la bureaucratie soviétique et l’appareil « communiste » pendant la Guerre Froide) peut très bien se sentir avoir des intérêts particuliers, qui vont au-delà des intérêts plus larges qu’il prétend représenter. Dans ce cas, tant que les scientifiques y sont impliqués, la science sera certainement distordue. Mais une distorsion de la science (c’est-à-dire sa transformation partiale en idéologie) ne peut qu’impliquer une limitation à long terme de son appel ultime à l’utilité envers l’humanité. Aussi, là où de telles choses se sont passées, le groupe particulier concerné a réduit bien plus que renforcé son pouvoir de « changer le monde ».
Toutes les distorsions, les falsifications ou les mystifications n’expriment que le pouvoir d’intérêts sociaux particuliers en opposition à d’autres plus larges. Marx n’a à aucun moment retaillé la science pour convenir aux besoins de tel ou tel autre intérêt particulier – que ce soit la classe ouvrière ou pas : « Le problème n’est pas de savoir ce que tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat dans son ensemble, conçoit comme ses buts à un moment particulier. La question est de savoir ce qu’est le prolétariat, et de ce qu’il doit accomplir historiquement en accord avec sa nature »4
Pour Marx, savoir “ce qu’est le prolétariat” a constitué une question scientifique, qui ne peut trouver une réponse scientifique qu’en complète indépendance de tout intérêt ou de toute pression politique immédiats. Loin de subordonner la science à la politique, Marx insistait sur la subordination de la politique à la science.
Autonomie et intérêt de classe
Engels écrit : “…plus la science procède avec intransigeance et sans préventions, plus elle se trouve en accord avec les intérêts et les aspirations de la classe ouvrière. »5
On peut être confiant du fait que cette citation exprime exactement les propres vues de Marx. La science, comme forme de connaissance de l’humanité, universelle, internationale, unifiant l’espèce, devait venir en premier. Si elle a dû s’enraciner dans les intérêts de la classe ouvrière, c’était seulement dans le sens que toute science doit s’enraciner dans les intérêts de l’espèce humaine dans son ensemble, la classe ouvrière internationale englobant ses intérêts dans l’époque moderne tout comme les exigences de la production ont toujours englobé ces intérêts dans les périodes précédentes.
Il n’était pas question ici d’une quelconque subordination à des besoins particuliers. En se plaçant en premier, la science était destinée à briser les divisions sectorielles et à devenir le moyen d’expression d’une nouvelle forme de conscience politique. En ce sens, la science a même été destinée à créer « le classe ouvrière internationale » elle-même. Sans la science, il ne peut y avoir que des mouvements sectoriels de la classe ouvrière ; ce n’est qu’à travers l’analyse scientifique que les intérêts généraux de la classe peuvent être mis à nu.
Il faut reconnaître que la science – en tant que produit social – ne peut (selon la vision de Marx) rien ajouter à la force de la classe ouvrière qui n’est pas déjà là. Elle ne peut s’imposer sur le mouvement ouvrier comme venant de l’extérieur.6 C’est dans et à travers la science seule que les ouvriers peuvent internationalement devenir conscients de la force global, au niveau de l’espèce, qui est déjà leur. Et ce n’est qu’en devenant conscient de cette propre force que « la classe ouvrière internationale » peut exister politiquement.7
Il n’est pas question, donc, de science subordonnée à une force politique pré-existante. La force politique est le propre de la science et ne peut exister sans elle. Les relations prévalentes précédemment entre la science et la politique sont renversées.
Pour Marx, la science sociale - y compris la sienne – est autant le produit des relations de classe que toute autre forme de conscience sociale. Sa formulation générale est bien connue :
" Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes, autrement dit la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est aussi la puissance dominante spirituelle. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose, du même coup, des moyens de la production intellectuelle, si bien que, l'un dans l'autre, les pensées de ceux à qui sont refusés les moyens de production intellectuelle sont soumises du même coup à cette classe dominante. Les pensées dominantes ne sont pas autre chose que l'expression idéale des rapports matériels dominants, elles sont ces rapports matériels dominants saisis sous forme d'idées, donc l'expression des rapports qui font d'une classe la classe dominante; autrement dit, ce sont les idées de sa domination. "8
Pour cette raison, Marx ne considérait pas qu’il était possible de changer les idées prévalentes dans une société – ou de produire une science acceptée universellement de la société – sans rompre la puissance matérielle des ces forces qui distordaient la science. C’était parce que Marx avait vu les contradictions sociales comme source des contradictions mythologiques et idéologiques qu’il a pu insister sur le fait que seule la résolution des contradictions sociales elles-mêmes pouvait résoudre leurs expressions dans l’idéologie et la science.
C’est ce que Marx voulait dire en écrivant : "Toute vie sociale est essentiellement pratique. Tous les mystères qui détournent la théorie vers le mysticisme trouvent leur solution rationnelle dans la pratique humaine et dans la compréhension de cette pratique. »9 Ou encore : "La résolution des contradictions théoriques n’est possible qu’à travers des moyens pratiques, qu’à travers l’énergie pratique de l’homme. Leur résolution n’est donc, en aucune façon, la seule tâche de comprendre, mais est une tâche réelle de la vie, une tâche que la philosophie était incapable d’accomplir précisément parce qu’elle ne voyait là qu’un problème purement théorique."10
Aussi, du point de vue de Marx et d’Engels, c’était afin de rester fidèle aux intérêts de la science – pour résoudre ses contradictions théoriques internes – qu’ils se sentaient obligés, en tant que scientifiques, (a) de s’identifier avec une force matérielle sociale qui pouvait résoudre « les intérêts étrangers » distordant l’objectivité de la science et (b) de prendre la direction de cette force matérielle eux-mêmes. Leur idée n’était pas que la science est inadéquate, et que la politique doit y être ajoutée. Leur idée était que la science – quand elle est fidèle à elle-même – est intrinsèquement révolutionnaire, et qu’elle ne doit pas connaître de projet politique autre qu’elle-même.
Marx et Engels croyaient que la science pouvait acquérir cette autonomie politique sans précédent pour une raison sociale : pour la première fois – et en tant que résultat direct du développement scientifique lui-même – une « classe » est né au sein de la société qui n’était pas réellement une classe en tant que telle, qui n’avait pas de statut ou d’intérêts spéciaux à protéger, sans pouvoir de dispenser des avantages, sans pouvoir de diviser les hommes les uns contre les autres et donc sans pouvoir de distordre la science de quelque façon que ce soit. « Ici, » écrit Engels à propos de la classe ouvrière, « il n’est pas question de carrières, de faire du profit ou de gracieux avantages venant du dessus. » Seule ici la science peut être réelle à elle-même, pour être seulement une force sociale d’une sorte vraiment sociale universelle, capable d’unifier les espèces dans leur ensemble.
C’était la condition pour une science vraiment indépendante, vraiment autonome, vraiment universelle de l’humanité – l’existence « d’une classe de la société bourgeoise qui ne soit pas une classe de la société bourgeoise, une classe qui soit la dissolution de toutes les classes, une sphère qui ait un caractère universel par ses souffrances universelles et ne revendique pas de droit particulier, parce qu'on ne lui a pas fait de tort particulier, mais un tort en soi,". "Il doit donc être formé", continue Marx, "une sphère enfin qui ne puisse s'émanciper, sans s'émanciper de toutes les autres sphères de la société et sans, par conséquent, les émanciper toutes, qui soit, en un mot, la perte complète de l'homme, et ne puisse donc se reconquérir elle-même que par le regain complet de l'homme." Introduction à la Contribution à la critique de la Philosophie du Droit de Hegel »11
La validation du marxisme
L’ensemble de l’argumentation précédente peut sembler en elle-même tendancieuse. La plupart des philosophes politiques ou sociaux diront, après tout, que leurs théories expriment les intérêts humains généraux plus que ceux d’ordre sectoriel. Se servir de la « fidélité aux intérêts de l’humanité » comme mesure permettant d’évaluer la valeur scientifique d’un système conceptuel n’est donc pas possible – à moins que quelque test objectif puisse être trouvé pour cela. Mais quel sorte de test peut être alors possible ? En dernière analyse, sans aucun doute, la preuve du pudding est qu’on le mange. Que se passe-t-il quand on essaie une nouvelle hypothèse ? Nous renforce-t-elle ? Est-ce que cela réduit l’effort mental pour résoudre les problèmes intellectuels ? En d’autres termes, est-ce que l’hypothèse ajoute à la capacité – qu’elle soit purement intellectuelle ou bien pratique – des scientifiques dans le champ en question ?
Si c’est le cas, alors n’importe qui devrait en venir à en reconnaître le fait. Assumer l’efficacité intellectuelle d’être notre critère (et nous ne serions pas autrement des scientifiques), soutenir la théorie s’étendra. La cohérence interne (l’accord entre les parties de la théorie) trouvera son expression dans un accord social élargi. Une telle capacité de produire cet accord est l’ultime test social de la science.12
Dans le long terme, pour le marxisme et pour la science sociale, un test similaire doit être subi. La science diffère de la connaissance simplement ad hoc, de la technique et du sens commun par la vertu des ses caractéristiques abstraites, symboliques, formelles. La science est un système symbolique. Comme tout système, ses moyens dépendent de ses accords. Le chiffre « 2 » signifie « deux » seulement parce que nous le disons tous. Il pourrait aussi équivaloir à « neuf ». Tous les systèmes symboliques – y compris les idéologies et les mythes – dépendent en ce sens d’un accord avant tout social. Mais, dans le cas des mythes et des idéologies, on ne peut maintenir un accord que jusqu'à un certain point. Un point est atteint lorsque des désaccords surgissent – un désaccord enraciné dans les contradictions sociales. Et, lorsque cela se produit, le besoin de réconcilier les positions incompatibles conduit à des contradictions internes – dans le système symbolique lui-même. La mythologie et l’idéologie sont des expressions de la division sociale. C’est la configuration essentielle qui distingue ces formes de connaissance de la science. La science exprime le pouvoir et l’unité de l’espèce humaine – une puissance que, dans les sociétés divisées en classes, les êtres humains ont de plus en plus pris sur la nature même si ce n’était pas en lien avec leur propre monde social. Une science de la société, afin de se prouver comme science, aurait à prouver qu’elle est sans contradictions internes, et qu’elle est logique avec la science naturelle et avec la science dans son ensemble. Au long terme, elle devrait juste prouver cela pratiquement. Elle aurait à démontrer sa logique interne en démontrant ses racines dans l’accord social d’une sorte d’unification de la race humaine. Elle aurait à démontrer en pratique, en d’autres termes, qu’elle forme une partie d’un système symbolique – un « langage » global entrelacé avec les concepts de science – qui serait capable en pratique et en dernière instance politiquement d’unifier le globe.13
Et encore, ce n’est pas le seul test. Dans le cas de toute avancée scientifique, le premier test est théorique. Copernic savait que la Terre bougeait. Et il savait bien avant que ce fait soit prouvé à la satisfaction d’autres et universellement reconnu. Einstein savait que la lumière était assujettie aux lois de la gravitation. Et il savait cela bien avant qu'il ne soit démontré en 1919 pendant une éclipse observée depuis les observatoires de Cambridge et Greenwich (lorsqu’il a été démontré que les rayons de lumière depuis une étoile était déviés par l’attraction gravitationnelle du soleil). Dans la découverte scientifique, il en a toujours été de même. Une révolution scientifique est validée au niveau de la théorie pure bien avant de passer le test final de la pratique.
L’ultime validation du marxisme comme science serait la démonstration de sa capacité à produire un accord à un niveau global – sa capacité d’unifier l’humanité. Mais le marxisme est une science récente, il devrait être possible de démontrer au préalable son potentiel en termes purement théoriques. La question qui se pose est : comment ? J’examinerai ce problème dans la deuxième parie de cet article.
Chris Knight
1 “Un scientifique peut ne pas être du tout concerné par les applications pratiques de sa recherche. Plus large est sa vision, plus son vol est audacieux, plus grande est sa liberté dans ses opérations mentales par rapport à la nécessité pratique quotidienne, au mieux. Mais la science n’est pas une fonction de scientifiques individuels ; c’est une fonction sociale. L’évaluation sociale de la science, son évaluation historique, est déterminée par sa capacité à augmenter le pouvoir de l’homme à prévoir les évènements et à maîtriser la nature.” L D Trotsky, Le Matérialisme dialectique et la Science in I. Deutscher (ed) The Age of Permanent Revolution : a Trotsky Anthology. New York 1964, p. 344. (Notre traduction)
2 Wittfogel, p. 356.
3 M Harris, The Rise of Anthropological Theory, London 1969, pp. 4-5; 220-21 (Notre traduction).
4 K Marx et F Engels, La Sainte Famille, www.marxists.org [172]
5 F Engels, 'Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande'. IV: Le matérialisme dialectique, 1888, www.marxists.org [172]
6 Tant que la classe ouvrière est faible, écrit Marx, les théoriciens s’efforcent de l’aider “à improviser des systèmes et à poursuivre une science nouvelle”. Mais, lorsque la classe ouvrière est forte, ses théoriciens « n’ont rien de plus à faire que de chercher une science dans leurs propres esprits ; ils n’ont qu’à observer ce qui se passe devant leurs yeux et à se faire le véhicule de ses expressions … à partir de ce moment, la science produite par le mouvement historique, et qui s’associe consciemment elle-même avec ce mouvement, a cessé d’être doctrinaire et est devenue révolutionnaire. (K. Marx, Misère de la philosophie, www.marxists.org [172]).
7 Comme Trotski le dit, “ la conscience de sa force est l’élément le plus important de la force actuelle (L D Trotsky Whither France? New York 1968, p116 – Notre traduction)). Marx avait la même idée en tête lorsqu’il écrivit : “.... nous devons forcer ces relations pétrifiées à la danse en leur jouant leur propre thème ! S’il faut leur donner du courage, nous devons apprendre aux gens à être choqués par eux-mêmes’” (Pour une critique de la philosophie du Droit de Hegel; noté dans i D McLellan (ed) Karl Marx: Early Texts. Oxford 1972, p. 118 – notre traduction).
8 K Marx,“L’idéologie allemande, Chapitre “Feuerbach, opposition de la conception matérialiste et idéaliste ». www.marxists.org [172].
9 K Marx, Thèses sur Feuerbach ; www.marxists.org [172].
10 K Marx,Manuscrits de 1844; www.marxists.org [172].
11 En fait, Marx avait une piètre opinion de la “pensée politique” en général précisément à cause de son caractère inévitablement subjectif, non-scientifique : “L’intelligence politique n’est politique que parce qu’elle pense dans les limites de la politique. Plus aiguisée et plus vivante est-elle, moins elle est capable de comprendre les maux sociaux… le principe de la politique est la volonté. Plus l’intelligence politique est partiale et donc plus parfaite, plus elle croit à l’omnipotence de la volonté, et plus elle est incapable de découvrir les sources des maux sociaux. (K Marx‘Le Roi de Prusse et la réforme sociale; McLellan, p. 214). Si Marx croyait dans la nécessité de la lutte politique, c’était parce qu’il avait compris la nature politique des obstacles à l’émancipation humaine et à l’autonomie de la science. Ce n’est pas à cause de quelque chose d’intrinsèquement politique sur son émancipation ou de sa science. Le socialisme une fois réalisé n’est pas politique : « La révolution en général – le renversement d’un pouvoir existant et la dissolution des relations antérieures – est un acte politique. Le socialisme ne peut être réalisé sans révolution. Mais quand son activité organisée commence, quand ses buts particuliers, son âme, se porte en avant, alors le socialisme rejette de côté le cloaque politique. » (McLellan, p. 221 – notre traduction)
12 Voir T. S. Kuhn, 'La structure des révolutions scientifiques' in International Encyclopaedia of Unified Science Vol 2, No. 2, Chicago 1970, p. viii. Marx a probablement repris cette idée en partie de Feuerbach, bien qu’elle soit aussi un thème puissant des écrits de Hegel. Feuerbach écrit : « Il est vrai qu’un autre est d’accord avec moi – l’accord est le premier critère de la vérité ; mais seulement parce que l’espèce est la mesure ultime de la vérité. Ce que je pense uniquement selon le critère de mon individualité n’est pas lié à une autre : elle peut être vu autrement ; c’est une vision accidentelle, simplement subjective. Mais ce que je pense selon le critère de l’espèce, je le pense comme un homme en général ne peut que le penser, et donc comme tout individu doit penser s’il pense normalement… Il est vrai que je suis d’accord avec la nature de l’espèce ; (…) Il n’y a pas d’autre règle de vérité. » (L Feuerbach, L’Essence du Christianisme. cité par E Kamenka : The Philosophy of Ludwig Feuerbach. London 1970, pp. 101-02) (Notre traduction)
13 K Marx,Contribution à une critique de la Philosophie du Droit de Hegel ; in Bottomore et Rubel, p. 190.
Récent et en cours:
- Marxisme et science [173]
Exposé de Réunion Publique : crise économique et lutte de classe
- 2377 lectures
Nous publions ci-dessous l'exposé qui a lancé les débats lors de notre Réunion Publique (RP) du 19 novembre à Paris, sur "la crise économique et la lutte de classe dans le monde".
Ce texte n'est qu'une trame, une prise de notes sur laquelle s'est appuyée le camarade pour faire son exposé oral. Le style est donc forcément particulier, plus "parlé" qu'écrit ; il y a parfois des imprécisions ou des raccourcis. Son intérêt est de montrer avec quel état d'esprit nous réalisons les introductions à nos RP et comment nous essayons de favoriser les questionnements, les échanges et la discussion.
Exposé
La semaine dernière, je discutais avec mes voisins et voilà qu'ils se mettent à causer de la crise économique en termes techniques, des "agences de notation" qui d'après eux devraient être plus contrôlées, des "ventes à découvert" à la bourse qui devraient être interdites, des « émissions d’Etat » et des « taux d'emprunt » qui s'envolent de façon injustifié… bon, j'en passe et des meilleures. Moi, je les connais mes voisins, il y a deux ans encore les sujets de discussion c'était plutôt sur le match de foot de la veille ou des trucs du genre.
Au-delà de la surprise d’entendre le jargon financier sortir de la bouche de mes voisins, ce qui m'a le plus marqué, c'est la charge d'angoisse qu'il y avait derrière. Ils semblaient tous crier : "Mais qu'est-ce qu'on va devenir?" Il faut dire qu'on entend plus que ça dans les médias : "La crise de la dette". Au journal du 20h ? "La crise de la dette". A la radio ? "La crise de la dette". En gros titre dans les journaux ? "La crise de la dette".
1 - La misère explose
Après tout, il y a de quoi s'angoisser. Quand on regarde ce qui se passe en Grèce, ça colle même des sueurs froides. Il faut imaginer ce que c'est un pays en faillite, un pays économiquement en ruines. En Grèce, de très nombreuses écoles sont purement et simplement fermées, les enfants restent chez eux. Et celles qui restent ouvertes n'ont plus de chauffage et plus de cantine. Sur le web, les témoignages d'instituteurs se multiplient sur des enfants qui s'évanouissent en cours, qui tombent d'inanition… Il y a des rues entières où tous les magasins sont fermés, les gens ne payent plus les péages, les transports… La semaine dernière, il y avait un reportage à la télé qui montrait une fonctionnaire des finances (le ministère qui paye le mieux là-bas), cadre A (le grade le plus élevé, plus haut il faut être chef) qui touchait 2200 euros il y a un an et qui ne touchera plus que 800 euros d'ici l'été… ça s'appelle le "salaire dégressif", c'est nouveau, ça vient de sortir… Non mais vous vous imaginez, de 2200 euros à 800 ! Et on parle là des mieux lotis en Grèce. Faut être clair : c'est la misère qui se développe, la vraie, celle qui tord les boyaux, celle qui fait que les gamins tombent dans les pommes d'inanition…
Et la Grèce n'est pas une exception… elle est seulement plus avancée dans la crise… elle préfigure de ce qui va se passer partout dans les années à venir. Pour paraphraser une expression triviale, "pour connaître l'avenir, vas voir chez les Grecs". Actuellement, en Espagne, les hôpitaux ferment les uns après les autres. Ceux qui restent ouverts, ne le sont qu'à moitié. Des chambres, des étages et parfois des services entiers sont fermés. En Catalogne, les urgences ne sont ouvertes que le matin ; faut pas être cardiaque l'après-midi. Les délais pour être opérés s'allongent démesurément, il faut 2 mois pour être opéré d'une tumeur, et encore, seulement quand il s'agit d'une question de vie ou de mort ! Et ce n'est pas tout, en ce moment même en Espagne, des milliers de familles sont en train d’être expulsées alors que plus d'un million de logements sont vides !
Et il ne s'agit pas là non plus d'une particularité européenne. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est le même constat accablant. L’Etat du Minnesota est officiellement en faillite. Depuis le 4 juillet, ses 22 000 fonctionnaires ne sont plus payés et restent chez eux. Idem pour les fonctionnaires de Harrisburg – capitale de l’Etat de Pennsylvanie – et de ceux de la ville de Central Falls, près de Boston. Le rêve américain est en train de virer au cauchemar : aux Etats-Unis, 45,7 millions de personnes ont besoin pour manger des bons alimentaires versés par l’Administration.
Et vous avez dû tous entendre qu'aujourd'hui c'est l'Italie qui est en train de plonger et qu'après ce sera le tour de la France.
2 – La "crise de la dette", pourquoi ?
Tout le monde le sait aujourd’hui, et même la bourgeoisie le dit, la décennie qui est devant nous va être terrible. Le capitalisme, au niveau mondial, est entré dans une ère de convulsions économiques de plus en plus violentes. La bourgeoisie est incapable de trouver une solution réelle et durable à la crise. C’est pour ça d’ailleurs qu’elle n’arrête pas de gesticuler dans tous les sens de Sommets européens en Sommet du G20, de déclarations de Sarkozy ou d’Obama en annonces triomphantes comme quoi ça y est, promis, juré, cette fois-ci, « tout est réglé, les décisions nécessaires et courageuses ont été prises, blabla-blabla »… pour qu’à chaque fois, après chacun de ces discours fumeux, parfois même dès le lendemain matin, patatras, une nouvelle mauvaise nouvelle vienne rétablir la vérité et provoquer un nouveau mini-krach boursier. Alors répétons-le, la bourgeoisie est incapable de trouver une solution réelle et durable à la crise, elle ne fait depuis des mois qu’étaler toujours un peu plus son impuissance. Pas parce qu’elle est devenue soudainement incompétente mais parce que c’est un problème qui n’a pas de solution. La crise du capitalisme ne peut pas être résolue par le capitalisme. Pour une raison simple, le problème, c’est le capitalisme… ce ne sont pas les traders ou les financiers véreux, ce ne sont pas les banques ou les agences de notation… c’est le système capitaliste comme un tout.
Pour le comprendre, il faut savoir d’où vient cette « crise de la dette ». Cette question est importante, c’est justement parce que la bourgeoisie a peur que l’on trouve la vraie réponse à cette question que ses médias nous causent en permanence de la crise, ils embrument notre réflexion, ils nous empêchent d’y voir clair, ils saturent les débats (comme celui que j’ai eu avec mes voisins) de mensonges et autres fausses explications. La Grèce va mal ? C’est parce que c’est un peuple de fraudeurs ! L’Italie va mal ? Mais Berlusconi, c’est le roi des bunga-bunga, comment voulez-vous que ça aille bien ! Une banque française va mal ? pfffuuu, certainement encore un coup de Jérome Kerviel ! (vous savez c’est le trader en prison à cause des pertes de la Société Générale). La propagande de la bourgeoisie ressemble de plus en plus à une devise Shadock : « Quand un phénomène se produit partout en même temps, c'est parce qu'il y a 1000 causes locales différentes ! ». Eh bien non, si cela va mal partout sur la planète, c’est pour une cause unique : le capitalisme est malade et sa maladie est incurable.
Je vous ai mis sur la table deux graphiques. Le premier représente la dette totale des Etats-Unis (« Dette totale », ça signifie celle de l’Etat, des entreprises et des ménages), le second représente l’endettement public du Royaume-Uni.
Qu'est-ce qu'on y voit ? Des années 1950 jusqu'à aujourd'hui, l'endettement n'a fait qu'augmenter. Et de manière exponentielle ! Aujourd'hui, la pente est à la verticale, c'est ce que les économistes appellent le « mur de la dette ». Et c’est ce mur que le capitalisme vient de percuter en pleine face.
Alors pourquoi, depuis les années 1950, dans tous les pays, sous tous les gouvernements, de droite comme de gauche, d'extrême droite comme d'extrême gauche, à tendance déclarée "étatiste" ou "ultra-libérale", l'endettement n'a fait que croître ? Il était facile de voir que l'économie mondiale allait finir par heurter ce mur, c'était une évidence, alors pourquoi tous les gouvernements de la planète depuis plus d'un demi-siècle n'ont quand même fait que faciliter le crédit, creuser les déficits, agir activement en faveur de l'augmentation des dettes des Etats, des entreprises et des ménages ? La réponse est simple : ils n'avaient pas le choix. S'ils n'avaient pas agit ainsi, l'effroyable récession dans laquelle nous entrons, aurait commencé dès les années 1950. Pourquoi ? Parce que le capitalisme produit en permanence plus de marchandises que ses marchés ne sont capables d'en absorber. Permettez moi juste de répéter cette phrase car c'est la clef pour comprendre non seulement la crise actuelle, l'évolution de l'économie depuis 50 ans mais aussi l'histoire économique du capitalisme depuis sa naissance : le capitalisme produit en permanence plus de marchandises que ses marchés ne sont capables d'en absorber. Ça a été sa chance au 18ème et 19ème siècle, quand ce système ne recouvrait qu'une infime partie de la planète. Toutes ces marchandises qu'il avait en trop, il les a déversés (pas gratuitement évidemment mais en les vendant), il les a déversés en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, mais aussi dans les campagnes européennes ou américaines, dans toutes les économies arriérées, non capitalistes. Il a connu ainsi un incroyable développement, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Mais voilà, la terre est ronde et pas si grande que ça. Le capitalisme en a vite fait le tour et transformé toutes les économies à son image. Le capitalisme a conquis la planète. Il n'y avait donc plus de marchés arriérés, de marchés extra-capitalistes, en dehors du capitalisme, où vendre sa surproduction. Il a donc créé un marché artificiel, le marché du crédit ! C'est grâce au crédit, à la dette, que le capitalisme a évité pendant des décennies que son économie ne se bloque, ne soit paralysée par des tonnes de marchandises invendues. Mais toute dette doit un jour être remboursée et aujourd'hui, où l’endettement est généralisé, l'heure de la facture a sonné.
3 – Un autre monde est-il possible ?
Bon désolé pour ce passage un peu théorique, les arcanes de l'économie ne sont pas faciles à expliquer, pour moi en tout cas. J'espère ne pas avoir été trop confus. Mais nous voulions que ressorte cette idée, à notre avis, essentielle : le capitalisme ne peut pas vivre éternellement, il est condamné à disparaître, il porte en lui une sorte de maladie génétique dégénérescente et incurable. C'est pourquoi Marx disait que le capitalisme était un système né dans la boue et le sang qui périra dans la boue et le sang. L'avenir qui est devant nous, c'est une crise économique de plus en plus grave, de plus en plus violente, de plus en plus ravageuse. La misère ne va plus cesser de se répandre comme un fléau. Vous devez penser "ah bah super, super cette réunion, on va rentrer chez nous tous complètement déprimés et effrayés"…
Alors comme on a envie que vous reveniez, on va essayer d'éviter ça. Marx disait qu'il ne faut pas voir dans la misère que la misère. Individuellement, nous avons tous peur de nous appauvrir, pour nous ou nos enfants, pour nos proches. Mais là, ensemble, collectivement, nous devons surtout être persuadés que face à ces conditions de vie terrible à venir, des luttes vont émerger, la solidarité, l'entraide, l'envie et le besoin de combattre ensemble, massivement, vont se développer. Le capitalisme est en train d'agoniser, d'accord, la bourgeoisie nous le fait payer au prix fort, par mille souffrances, d'accord, mais ensemble, les exploités peuvent et doivent saisir cette occasion pour bâtir un nouveau monde, car un autre monde est possible, un monde sans classe ni exploitation, sans argent ni crise, sans misère ni guerre.
Cela peut paraître idéaliste, mais en réalité, être idéaliste aujourd'hui c'est croire que le capitalisme peut continuer de fonctionner comme avant ou se réformer. Et être réaliste, c'est savoir que la révolution est non seulement absolument nécessaire mais qu’elle est tout à fait possible.
Regardez ce qui se passe en Espagne, en Israël, aux Etats-Unis… tous ces mouvement des Indignés ou des Occupy Wall Street. Evidemment, ce ne sont pas encore des mouvements révolutionnaires. On pourrait ne voir uniquement que les faiblesses de ces mouvements de contestation. Au sein des discussions en assemblée générale, il y a c’est vrai encore beaucoup d'illusions, justement sur les possibilités de réformer le système, de l'améliorer grâce à une meilleure démocratie et un meilleur contrôle du monde de la finance. D'ailleurs, la bourgeoisie pousse de toute ses forces pour que la réflexion s'engage dans ce genre d'impasse, c'est à ces idées qu'elle fait la pub dans ses médias ; il suffit de lire ce titre "Oui, un autre capitalisme est possible !" du magazine Marianne pour s'en rendre compte.
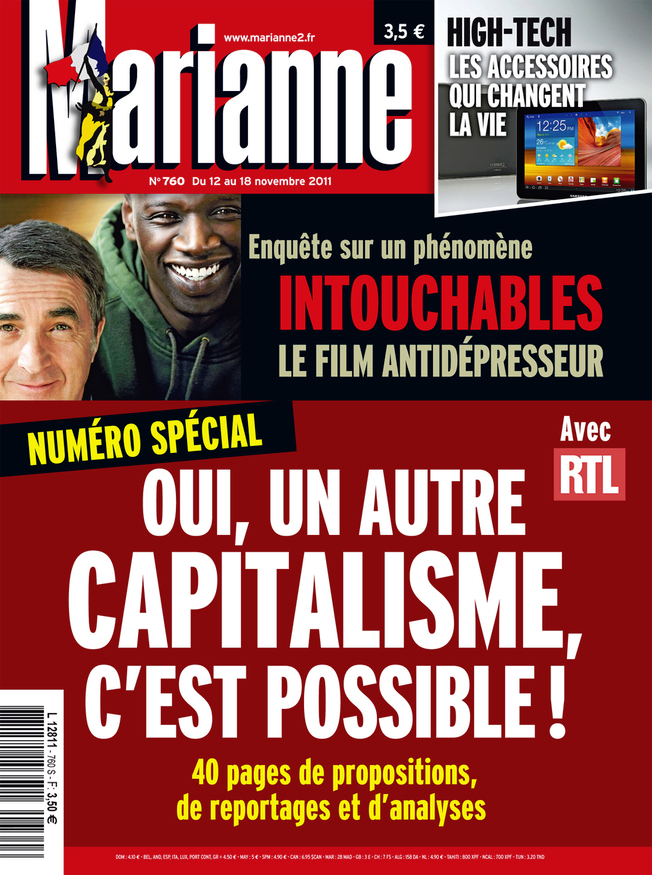
Au sein même de ces mouvements, dans les Assemblées Générales (AG), il y a un combat entre une aile prolétarienne, à tendance plus révolutionnaire, et une aile ouvertement réformiste. Une partie de ces réformistes ont d'ailleurs tendance ne pas être très honnête dans l'organisation collective de la lutte et le processus de prise de décision : ils noyautent les débats pour qu'ils se cantonnent aux requêtes pour plus de démocratie dans les élections et moins de libéralisme, pour taxer les banques… et certains sont mêmes proches du sabotage quand ils endiguent toute tentative d'extension aux entreprises. Par exemple, aux Etats-Unis, les tentatives de certaines AG d'Occupy d'aller à la rencontre de travailleurs sur leur lieu de travail pour les entraîner dans la lutte et la grève, ont été systématiquement sabotées par les organisateurs auto-proclamés. Ok, il s'agit là de vraies faiblesses. Les pessimistes ne voient toujours que la moitié du verre vide, les optimistes la moitié pleine, mais les révolutionnaires doivent surtout voir si le verre est en train de se vider ou de se remplir, car finalement c'est ça qui est important quand on a soif. En d’autres termes, c'est la dynamique qui compte dans la lutte de classe. Tous ces mouvements de contestations qui se développent depuis des mois révèlent la volonté grandissante de notre classe de prendre ses luttes en main, de s'auto-organiser, de vivre et de lutter ensemble, collectivement, de tourner le dos à l'individualisme du capitalisme pour occuper ensemble un lieu et y discuter ; ces mouvements révèlent la volonté de débattre collectivement et de réfléchir collectivement. Plus important encore est la dimension internationale de ces mouvements. Il y a un lien explicite des occupations à l'échelle internationale, de l'Espagne aux Etats-Unis, de l'Israël à la Grande-Bretagne. La crise est mondiale et l'idée que la solution doit être, elle aussi, mondiale fait peu à peu son petit bonhomme de chemin dans les têtes. Dans tous les pays, la même exploitation, les mêmes attaques, les mêmes injustices et donc… la même lutte, les mêmes espoirs. La bourgeoisie se divise et se bat entre elle, divisée en nation concurrentes, notre classe, elle, est internationale, elle a un monde unifié à construire. Voilà ce qui émerge aussi de la vague de contestation actuelle.
Tout cela est extrêmement important pour l'avenir car l'expérience historique montre que notre classe devient dangereuse pour la bourgeoise justement quand elle prend en main ses luttes, quand elle commence à vouloir discuter et comprendre ensemble, en masse ! Il manque encore une ou deux marches pour que des luttes massives et auto-organisées se développent réellement et pleinement mais le chemin pris aujourd'hui par notre classe est le bon. Car ce chemin, nous le savons, mène à une contestation de plus en plus grande et radicale de ce système d'exploitation. Et il n'y a pas besoin de remonter à la Commune de Paris de 1871 ou à la révolution russe de 1917 pour le savoir. Il y a 30 ans, en Europe, en Pologne exactement, des centaines de milliers d'ouvriers donnaient des sueurs froides à la bourgeoisie dans tous les pays en organisant des luttes massives, en organisant des assemblées générales partout, en prenant même en main la production pour la mettre au service de la lutte ! Notre force à nous les exploités, c'est notre unité et notre solidarité dans la lutte, notre capacité à nous auto-organiser massivement et à créer les conditions d'un développement général des consciences et de la réflexion grâce aux débats ouverts et permanents de nos assemblées générales, c'est notre dévouement et notre désintéressement. Les mouvements de contestation actuels portent tout ceci déjà en eux, en petit ou, plus exactement, en germe. Nous pouvons donc avoir confiance en l'avenir, avec l'aggravation de la crise, le terreau va devenir de plus en plus fertile pour que ces germes poussent, s'épanouissent et fleurissent !
Vie du CCI:
- Réunions publiques [146]
Récent et en cours:
- Crise économique [169]
« La crise de la dette », pourquoi ?
- 3400 lectures
L’économie mondiale semble au bord du gouffre. La menace d’une grande dépression, bien pire que celle de 1929, se fait de plus en plus pressante, voire oppressante. Des banques, des entreprises, des communes, des régions, même des Etats sont aujourd’hui poussés vers la faillite, la banqueroute. Les médias ne parlent d’ailleurs plus que de ça, de ce qu’ils nomment "la crise de la dette".
Quand le capitalisme se heurte au mur de la dette
Le graphique ci-dessous représente l’évolution de la dette mondiale1 de 1960 à nos jours. Cette dette est exprimée en pourcentage du PIB mondial.
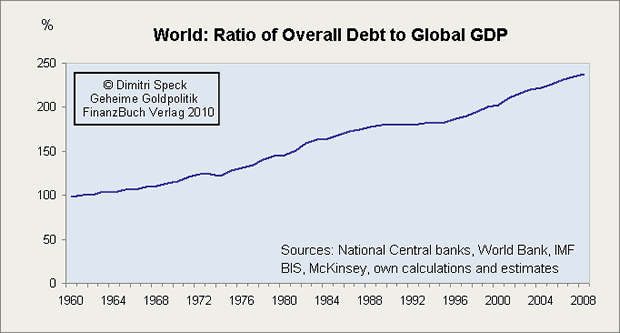
Selon ce graphique, en 1960, la dette était égale au PIB (100%). En 2008, elle lui est 2,5 fois supérieure (250%). Autrement dit, aujourd’hui, un remboursement intégral des dettes mondiales contractées depuis 1960 engloutirait la totalité des richesses produites en un an et demi par l’économie mondiale !
Cette évolution est spectaculaire au sein des pays dits « développés » comme l'illustre le graphique suivant qui représente la dette publique des Etats-Unis.
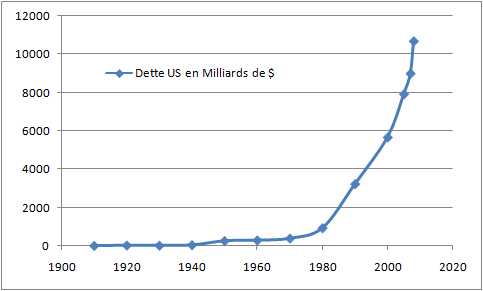
Ces dernières années, l’accumulation des dettes publiques est telle que la courbe de leur évolution, visible sur le graphique précédent, est à la verticale ! C'est ce que les économistes appellent le « mur de la dette ». Et c’est ce mur que le capitalisme vient de percuter de plein fouet.
La dette, produit du déclin du capitalisme
Il était facile de voir que l'économie mondiale allait finir par heurter ce mur, c'était une évidence. Alors pourquoi tous les gouvernements de la planète, qu’ils soient de gauche ou de droite, d’extrême gauche ou d’extrême droite, prétendument « libéraux » ou « étatistes », n'ont fait que faciliter le crédit, creuser les déficits, agir activement en faveur de l'augmentation des dettes des Etats, des entreprises et des ménages, depuis plus d'un demi-siècle ? La réponse est simple : ils n'avaient pas le choix. S'ils n'avaient pas agi ainsi, l'effroyable récession, dans laquelle nous entrons aujourd’hui, aurait commencé dès les années 1960. En vérité, cela fait des décennies que le capitalisme vit, ou plutôt survit, à crédit. Pour comprendre l'origine de ce phénomène, il faut percer, comme le disait Marx, « le grand secret de la société moderne : "la fabrication de plus-value ». Ici, un petit détour théorique s’impose donc.
Le capitalisme porte en lui, depuis toujours, une sorte de maladie congénitale : il produit une toxine en abondance que son organisme n’arrive pas à éliminer, la surproduction. Il fabrique plus de marchandises que son marché ne peut en absorber. Pourquoi ? Prenons un exemple uniquement didactique : un ouvrier travaillant sur une chaîne de montage ou derrière un micro-ordinateur et qui, à la fin du mois, est payé 800 euros. En fait, il a produit non pas pour l'équivalent de 800 euros, ce qu'il reçoit, mais pour la valeur de 1600 euros. Il a effectué un travail non payé ou, autrement dit, une plus-value. Que fait le capitaliste des 800 euros qu'il a volés à l'ouvrier (à condition qu'il soit parvenu à vendre la marchandise) ? Il en affecte une partie à sa consommation personnelle, admettons 150 euros. Les 650 euros restants, il les réinvestit dans le capital de son entreprise, le plus souvent sous forme de l'achat de machines plus modernes, etc. Mais pourquoi le capitaliste procède-t-il ainsi ? Parce qu'il y est économiquement contraint. Le capitalisme est un système concurrentiel, il faut vendre les produits moins chers que le voisin qui fabrique le même type de produits. En conséquence, le patron doit non seulement baisser ses coûts de production, c'est-à-dire les salaires, mais encore utiliser une part croissante du travail non payé à l'ouvrier pour le réinvestir prioritairement dans des machines plus performantes, afin d'augmenter la productivité. S'il ne le fait pas, il ne peut pas se moderniser, et, tôt ou tard, son concurrent, qui, lui, le fera, vendra moins cher et remportera le marché. Le système capitaliste est ainsi affecté par un phénomène contradictoire : en ne rétribuant pas les ouvriers à l'équivalent de ce qu'ils ont effectivement fourni comme travail et en contraignant les patrons à renoncer à consommer une grande part du profit ainsi extorqué, le système produit plus de valeur qu'il ne peut en distribuer. Jamais ni les ouvriers ni les capitalistes réunis ne pourront donc à eux seuls absorber toutes les marchandises produites. Le capitalisme doit de ce fait vendre ce surplus de marchandises en dehors de la sphère de sa production, à des marchés non encore conquis par les rapports de production capitalistes, ce qu'on appelle les marchés extra-capitalistes. S’il n’y parvient pas, c’est la crise de surproduction.
Se trouve ici résumée en quelques lignes une partie des conclusions auxquelles mènent les travaux de Karl Marx dans Le Capital et de Rosa Luxembourg dans L’accumulation du capital. Pour être plus succinct encore, voici synthétisée cette théorie de la surproduction en quelques points :
-
Le Capital exploite ses ouvriers (autrement dit leurs salaires sont moins importants que la valeur réelle qu’ils créent par leur travail).
-
Le Capital peut ainsi vendre ses marchandises avec profit, à un prix qui, au-delà du salaire de l'ouvrier et la plus-value, inclura également l'amortissement des moyens de production. Mais la question est : à qui ?
-
Evidemment, les ouvriers achètent ces marchandises… à la hauteur de leurs salaires. Il en reste donc une bonne partie encore à vendre. Sa valeur est équivalente à celle du travail des ouvriers qui ne leur a pas été payée. Elle seule a ce pouvoir magique pour le Capital de générer du profit.
-
Les capitalistes eux aussi consomment… et ils ne sont d’ailleurs en général pas trop malheureux. Mais ils ne peuvent pas à eux seuls acheter toutes les marchandises porteuses de plus-value. Cela n’aurait d’ailleurs aucun sens. Le Capital ne peut s’acheter à lui-même, pour faire du profit, ses propres marchandises ; ce serait comme s’il prenait l’argent de sa poche gauche pour le mettre dans sa poche droite. Personne ne s’enrichit ainsi, les pauvres vous le diront.
-
Pour accumuler, se développer, le Capital doit donc trouver des acheteurs autres que les ouvriers et les capitalistes. Autrement dit, il doit impérativement trouver des débouchés en-dehors de son système, sinon il se retrouve avec des marchandises invendables sur les bras qui engorgent le marché : c’est alors la “crise de surproduction” !
Cette “contradiction interne” (cette tendance naturelle à la surproduction et cette obligation à trouver sans cesse des débouchés extérieurs) est l’une des racines de l’incroyable dynamisme de ce système des premiers temps de son existence. Dès sa naissance au cours du 16e siècle, le capitalisme a dû lier commerce avec toutes les sphères économiques qui l’entouraient : les anciennes classes dominantes, les paysans et les artisans du monde entier. Aux 18e et 19e siècles, les principales puissances capitalistes se livrent ainsi à une véritable course à la conquête du monde ; elles se partagent progressivement la planète en colonies et forment de véritables empires. De temps à autre, elles se retrouvent à convoiter un même territoire. Le moins puissant doit alors s'incliner et aller trouver un autre coin de terre où forcer la population à acheter ses marchandises. C'est ainsi que les économies archaïques sont transformées et intégrées peu à peu au capitalisme. Non seulement les économies des colonies deviennent de moins en moins susceptibles de représenter des débouchés pour les marchandises d’Europe et des Etats-Unis mais, à leur tour, elles génèrent même une surproduction.
Cette dynamique du Capital aux 18e et 19e siècles, cette alternance de crises de surproduction et de longues périodes de prospérité et d’expansion, ainsi que cette progression inexorable du capitalisme vers son déclin, Marx et Engels l’ont magistralement décrit :
-
« Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société, l'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentanée ; on dirait qu'une famine, une guerre d'extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance ; l'industrie et le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. »"2
-
A cette époque néanmoins, parce que le capitalisme était en pleine croissance, qu’il pouvait justement conquérir de nouveaux territoires, chaque crise laissait ensuite la place à une nouvelle période de prospérité. « Poussée par le besoin de débouchés toujours plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe. Partout elle doit s'incruster, partout il lui faut bâtir, partout elle établit des relations... Le bas prix de ses marchandises est la grosse artillerie avec laquelle elle démolit toutes les murailles de Chine et obtient la capitulation des barbares les plus opiniâtrement xénophobes. Elle contraint toutes les nations, sous peine de courir à leur perte, d'adopter le mode de production bourgeois ; elle les contraint d’importer chez elles ce qui s'appelle la civilisation, autrement dit : elle fait des nations de bourgeois. En un mot, elle crée un monde à son image... »3
-
Mais déjà à ce moment-là, Marx et Engels percevaient dans ces crises périodiques quelque chose de plus qu'un simple cycle éternel qui déboucherait toujours sur la prospérité. Ils y voyaient l'expression des contradictions profondes qui minent le capitalisme. En « s’emparant de marchés nouveaux", la bourgeoisie "prépare des crises plus générales et plus profondes, tout en réduisant les moyens de les prévenir. »4 Ou encore ::« C'est que la masse des produits et donc le besoin de débouchés s'accroît, alors que le marché mondial se rétrécit ; c'est que chaque crise soumet au monde commercial un marché non encore conquis ou peu exploité et restreint ainsi les débouchés »"5
Or, notre planète n’est qu’une petite boule ronde.
Au début du 20e siècle, tous les territoires sont conquis, les grandes nations historiques du capitalisme se sont partagées le globe. Dès lors, il n’est plus question pour elles de nouvelles découvertes mais de prendre, par la force armée, les territoires dominés par les nations concurrentes. Il ne s’agit plus pour elles de faire la course en Afrique, en Asie ou en Amérique, mais de se livrer une guerre impitoyable pour défendre leurs aires d’influence et s’emparer, à la force des canons, de celles de leurs concurrents impérialistes. Il s’agit ici d’une véritable question de survie pour les nations capitalistes. Ce n’est donc pas un hasard si c’est l’Allemagne qui, n’ayant que très peu de colonies et étant dépendante du bon vouloir de l’Empire britannique pour commercer sur ses terres (dépendance insoutenable pour une bourgeoisie nationale), déclenche en 1914, la Première Guerre mondiale. L’Allemagne se montre ainsi la plus agressive en raison de cette nécessité que formulera explicitement plus tard Hitler dans la marche vers la Seconde Guerre mondiale : “Exporter ou mourir”. Dès lors, le capitalisme, après quatre siècles d’expansion, devient un système décadent. L’horreur des deux guerres mondiales et la Grande Dépression des années 1930 en seront des preuves dramatiques irréfutables. Pourtant, même après avoir épuisé dans les années 1950 les marchés extra-capitalistes qui subsistaient encore, le capitalisme n’a pas sombré dans une crise de surproduction mortelle. Après plus de cent années de lente agonie, ce système est toujours debout, titubant, mal en point, mais debout. Comment fait-il pour survivre ? Pourquoi son organisme n’est-il pas encore totalement paralysé par la toxine de la surproduction ? C’est ici que le recours à l’endettement entre en jeu. L'économie mondiale est parvenue à éviter un effondrement fracassant en recourant de plus en plus massivement à la dette. Il a su ainsi créer un marché artificiel. Ces quarante dernières années se résument à une série de récessions et de relances financées à coups de crédit. Et il ne s’agit pas là de soutenir seulement la “consommation des ménages” par le biais d’aides étatiques… Non, les Etats se sont aussi endettés pour maintenir artificiellement la compétitivité de leur économie face aux autres nations (en finançant directement un investissement infra-structurel, en prêtant aux banques à des taux le plus bas possible pour qu’elles puissent à leur tour prêter aux entreprises et aux ménages…). Les vannes du crédit ayant été toutes grandes ouvertes, l’argent a coulé à flots et, peu à peu, tous les secteurs de l’économie se sont retrouvés en situation classique de surendettement : chaque jour de plus en plus de nouvelles dettes ont dû être contractées pour… rembourser les dettes d’hier. Cette dynamique menait forcément à une impasse. Le capitalisme mondial est aujourd’hui au fond de cette impasse, nez à nez avec le « mur de la dette ».
« La crise de la dette » est au capitalisme ce que « l’overdose » de morphine est au mourant
Pour prendre une image, la dette est au capitalisme ce que la morphine est au malade condamné. En y recourant, le souffrant surpasse momentanément ses crises, se calme et s’apaise. Mais peu à peu, la dépendance à ces doses quotidiennes augmente. Le produit, dans un premier temps salvateur, devient à son tour nocif… jusqu’à l’overdose !
La dette mondiale est un symptôme du déclin historique du capitalisme. L’économie mondiale a survécu sous perfusion de crédits depuis les années 1960, mais aujourd’hui les dettes sont partout dans l’organisme, elles saturent le moindre organe, la moindre cellule du système. De plus en plus de banques, d’entreprises, de communes, d’Etats sont et seront en cessation de paiement, incapables de rembourser les traites de leurs prêts.
L’été 2007 a ainsi ouvert un nouveau chapitre au sein de l’histoire de la décadence du capitalisme qui a débuté en 1914 avec la Première Guerre mondiale. La capacité de la bourgeoisie à ralentir le développement de la crise par un recours de plus en plus massif au crédit a pris fin. Dorénavant, les secousses vont se succéder les unes aux autres sans qu’il n’y ait entre elles ni répit ni véritable relance. La bourgeoisie sera incapable de trouver une solution réelle et durable à cette crise, non pas parce qu’elle serait devenue soudainement incompétente mais parce que c’est un problème qui n’a pas de solution. La crise du capitalisme ne peut pas être résolue par le capitalisme. Car, comme nous venons d’essayer de le démontrer, le problème, c’est le capitalisme, le système capitaliste comme un tout. Et ce système est aujourd’hui en faillite.
Pawel (26 novembre)
1 Il s’agit de la dette totale mondiale, c’est à dire de la dette des ménages, des entreprises et des Etats de tous les pays.
2 Le Manifeste communiste de 1848
3 Idem
4 Idem
5 Dans Travail Salarié et Capital
Récent et en cours:
- Crise économique [169]
ICConline - décembre 2011
- 1539 lectures
Grève des électriciens en Grande-Bretagne : la solidarité entre ouvriers de toutes les industries est la solution
- 1654 lectures
Nous publions ci-dessous un article de World Revolution, organe presse du CCI en Grande-bretagne.
Il n’y a aucun doute à avoir sur le niveau des attaques contre les emplois des électriciens, leur salaire et les conditions de travail qu’implique la fin de la convention du Joint Industry Board (JIB) , qui va conduire à des baisses de salaires allant jusqu’à 35 % et à un reclassement de beaucoup d’emplois en semi-qualifiés ou sans qualification. Allez à n’importe laquelle de leur manifestation hebdomadaire devant les différents sites de construction, ou lisez leur forum de discussion, et vous verrez comment tout cela va être désastreux pour des travailleurs qui font déjà de longues heures supplémentaires pour atteindre un salaire décent. « Pensezr que nous pouvons dire au revoir à nos maisons, nos voitures, notre vie de famille, etc. », « Il n’y aura plus de vacances ou de football ou de tours au pub. Il va falloir se battre pour que nos enfants aient de nouvelles chaussures à se mettre. »1 Quand 8 grandes entreprises d’électricité travaillant sur des projets de constructions ont annoncé qu’elles prévoyaient de se sortir de la convention JIB et d’imposer de plus mauvaises conditions (Balfour Beatty a ainsi envoyé à ses employés un avertissement pour qu'ils acceptent un changement de contrat dans les 90 jours !), il y a eu un silence assourdissant du syndicat Unite. L’indignation des travailleurs était évidente : « Je pense que les syndicats trempent là dedans jusqu'au cou », « les syndicats ont été très tranquilles là-dessus, çà pue un peu. »2
La difficulté de développer une lutte
Demandez leur quelle a été la riposte : les ouvriers ont souvent été exaspérés parce que rien ne semble se passer. Unite a tout retardé et certains craignent que d’autres flammes n’aient plus l’ardeur de mener une lutte. Les rassemblements chaque matin de 300 à 400 ouvriers devant les sites de construction, l’effort pour persuader les ouvriers de la nécessité de se joindre à la lutte, l’occasion de discuter et de faire des blocages temporaires aux entrées des sites, chaque semaine pendant trois mois, tout cela n'est pas insignifiant, mais les électriciens n’ont aucune illusion sur le fait que cela va repousser l’attaque.
Les électriciens font clairement face à d’importantes difficultés pour développer leur lutte. Rentrer en lutte aujourd’hui, dans un contexte de crise économique, avec un chômage élevé, des salaires gelés ou en baisse, avec l’inflation qui grignote les conditions de vie, demande du courage aux ouvriers dans toutes les industries. Dans la construction, avec les divisions entre ceux qui sont employés directement par les boîtes et les sous-traitants, et avec les listes noires des ouvriers combatifs, il y a des difficultés particulières. Il est important de revenir sur les expériences de lutte dans les années 1970 et 1980 : « J’ai passé un an de ma vie à votre âge à faire une grève qui a été perdue et vous faites la même chose. Une épreuve dont vous ne connaissez pas la signification, j’ai vu des hommes pleurer parce qu’ils ne pouvaient plus nourrir leurs enfants, et qui se demandaient comment ils allaient survivre… Nous avons mené notre combat et nous avons perdu… », « ce qu’il y avait dans les années 70 et 80, c’était des membres qui étaient prêts à accepter les votes majoritaires ou à main levée, mais même alors, personne ne se montrait dans les piquets, et je n’ai jamais vu un officiel du syndicat dans les piquets où je suis allé un peu partout dans le pays. ..Aussi, si les soudeurs et les monteurs manifestaient, nous y allions aussi, et vice versa ! » Pour mener une lutte aujourd’hui, on doit se confronter aux défaites du passé et en tirer les leçons, et aussi bien, revenir aux expériences positives de ce que représente une lutte de la classe ouvrière. Une grève longue, confinée à une seule industrie, a vraiment été un piège qui mène à des défaites amères, comme celle des mineurs en 1984 ou des imprimeurs à Wapping. Il y a eu des moments où tout le monde ne manifestait pas ensemble, même quand différents secteurs se battaient au même moment – en 1984, les dockers et les ouvriers de l’automobile étaient en grève alors que les mineurs avaient arrêté le travail – et ils n’ont pas réussi à se rejoindre.
Développer la solidarité
Une action sauvage avait commencé l’été dernier quand l’attaque a été annoncée et elle a continué avec des rassemblements tôt le matin devant les sites de construction gérés par les employeurs de la BESNA (ceux qui voulaient abandonner la convention JIB), surtout à Londres, Manchester et Newcastle. Ces rassemblements étaient l’occasion pour les travailleurs de se retrouver, de discuter de leur lutte, avec un micro ouvert à tous, et les ouvriers qui écoutaient ce qui se disait. Les travailleurs des autres industries, les retraités ou les étudiants et quelques manifestants anticapitalistes pouvaient venir et témoigner leur solidarité – quand un groupe de Occupy London est venu avec une banderole qu’ils avaient faite, ils ont été accueillis avec des cris d’approbation. Ces rassemblements étaient une occasion pour ceux qui étaient convaincus de la nécessité de lutter, de discuter et de persuader d’autres travailleurs de les rejoindre et souvent avec succès. A Londres, les personnels en lutte ont souvent été d’un site à l’autre – de Blackfriars à Cannon Street, par exemple. Plusieurs de ceux qui ont refusé de revenir au travail ont été persécutés. Cela a aussi été l’occasion de bloquer temporairement les entrées des sites.
Mais la solidarité avec qui ? Pour Unite, il faudrait faire pression sur le parlement, pour chercher la solidarité des grands et des bons contre « les employeurs voyous » (tract de Unite de la manifestation du 9 novembre). D’ailleurs, Jeremy Corbyn s’était pointé à Blackfriars le 12 octobre pour nous parler d’une motion tôt le matin. Est-ce qu’on attend sérieusement de nous qu’on croie qu’en pleine crise économique, avec des travailleurs dans le secteur public – y compris dans le NHS et dans l’éducation – qui sont confrontés à des attaques, que c’est juste une question d’employeurs voyous qui ont besoin d’être rappelés à l’ordre par le gouvernement ?
Unite n’ignore pas cette aspiration à la solidarité mais sa méthode est de se mettre à la remorque du général député secrétaire-adjoint général du PCS (syndicat des services publics et commerciaux), Chris Baugh, pour assurer les ouvriers qu’ils ont la solidarité de son syndicat et de proposer que le secteur public et le secteur privé mènent une action ensemble le 30 novembre. Et pourtant ni Unite, ni le PCS, et pas un seul autre syndicat, n’ont fait quoi que ce soit pour lutter contre le black-out des medias sur les attaques ou sur la lutte. Qu’est ce que les ouvriers du secteur public peuvent bien savoir des attaques contre les électriciens et des efforts qu’ils font pour résister ? Les travailleurs ont besoin d’agir ensemble maintenant et de créer des liens sans passer par l’intermédiaire de dirigeants syndicaux et de leurs discours creux qui peuvent, et sont vraisemblablement faits pour, donner l’impression que quelqu’un d’autre peut le faire pour eux.
Pour Siteworker, qui se décrit lui même comme un journal pour les ouvriers sur les sites et les syndicalistes, il est clair que ce n’est pas simplement l’affaire de 7 ou 8 patrons voyous : « Nous serions naïfs de penser que les compagnies géantes de construction qui dirigent et contrôlent totalement l’industrie, n'ont pas donné leur accord à ce groupe qui s’est individualisé… » et donc, « nous ne pouvons réussir que si d’autres ouvriers du bâtiment viennent renforcer nos rangs, se mettre à nos côtés en solidarité avec la classe ouvrière industrielle, syndiquée ou non, pour un but et une cause commune. » Il est vital de comprendre qu'il faut s’unir au-delà des divisions pour que la lutte puisse se développer, mais ici, ce n’est vu qu’en termes d'union des travailleurs de l’industrie du bâtiment, alors que c’est toute la classe ouvrière qui est attaquée et qui doit lutter ensemble.
Un numéro spécial actualisé de Siteworkers, notant que les rassemblements tôt le matin ne suffisent pas, a proposé : « arrêter la production est ce qui amènera les grandes firmes à la table des négociations » mais jusque-là, les blocages doivent continuer – leur site jibelectrician.blogspot.com note ce que les différentes firmes ont perdu du fait des perturbations dues aux blocages. En même temps, après 3 mois de manifestations régulières, Unite commence juste à voter pour une action dans l’industrie – mais seulement chez les électriciens à Balfour Beatty, couramment considérés comme les suppôts des patrons. On est encore en train de créer une autre division entre les ouvriers appelés à lutter et les autres. Faire grève pour « obliger » les employeurs à négocier avec les dirigeants syndicaux, c’est comme demander que les patrons aillent négocier avec une autre bande de patrons, ou avec le gouvernement, et s’attendre à ne rien gagner d’autre qu’une autre trahison « comme c’est arrivé dans le passé » (Siteworkers).
Si fortes que soient les illusions restantes sur Unite, ou au moins dans ses méthodes de lutte, ces étincelles ont montré une réelle combativité et une réelle détermination. On a pu le voir dans l’effort de discuter aux rassemblements de protestation, l’effort de convaincre les autres travailleurs, et les tentatives d’aller chercher la solidarité dans et au-delà de l’industrie du bâtiment- les appels aux étudiants et aux travailleurs du secteur public à rejoindre la lutte, l’accueil des autres travailleurs qui manifestaient leur solidarité, et en rentrant en contact le 18 octobre avec Occupy à Saint Paul. Ce n’est que la solidarité du reste de la classe ouvrière et pas les députés ou les bureaucrates syndicaux, qui fera peur aux patrons et leur fera retirer leurs attaques.
Alex (5 novembre)
1 Interventions faites sur le forum des électriciens en lutte : www.electriciansforum.co.uk [174].
2 Idem.
Géographique:
- Grande-Bretagne [98]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [84]

