Revue Int. 2008 - 132 à 135
- 4113 lectures
Revue Internationale n° 132 - 1er trimestre 2008
- 2795 lectures
Partout dans le monde, face aux attaques du capitalisme en crise : une même classe ouvrière, la même lutte de classe !
- 3108 lectures
Depuis cinq ans, le développement de la lutte de classe se confirme à l’échelle internationale. Face à des attaques simultanées et de plus en plus profondes partout dans le monde auxquelles elle est confrontée, la classe ouvrière réagit en manifestant sa combativité et en affirmant sa solidarité de classe aussi bien dans les pays les plus développés que dans ceux qui le sont nettement moins.
La confirmation du développement international de la lutte de classe
Ainsi, au cours des derniers mois de l’année 2007, de nombreux pays ont été le théâtre de luttes ouvrières.
En Egypte. De nouveau, au sein d'une puissante vague de luttes, les 27 000 ouvrières et ouvriers de l’usine Ghazl-Al-Mahallah, à une centaine de kilomètres du Caire, qui avaient déjà été au cœur de la vague de luttes de décembre 2006 et du printemps 2007, ont repris le combat à partir du 23 septembre. En effet, les promesses du gouvernement du versement à chacun de l’équivalent de 150 jours de salaire, qui avaient mis fin à leur grève, n’ont pas été tenues. Un gréviste, un temps arrêté par la police, déclarait : "On nous a promis 150 jours de prime, nous voulons seulement faire respecter nos droits ; nous sommes déterminés à aller jusqu’au bout". Les ouvriers de l’entreprise dressaient alors la liste de leurs revendications : recevoir l’équivalent de 150 livres égyptiennes en prime (représentant moins de 20 euros alors que les salaires mensuels varient entre 200 et 250 livres) ; retirer la confiance au comité syndical et au PDG de l’entreprise ; inclure les primes dans le salaire de base comme pourcentage non lié à la production ; augmenter les primes pour la nourriture ; en allouer une autre pour le logement ; fixation d’un salaire minimum indexé sur la hausse des prix ; fournir des moyens de transport aux ouvriers habitant loin de l’entreprise ; améliorer les services médicaux. Les ouvriers d’autres usines textiles, comme ceux de Kafr-Al-Dawar qui avaient déjà déclaré en décembre 2006 "Nous sommes dans le même bateau que vous et embarquons pour le même voyage", ont à nouveau manifesté leur solidarité dès fin septembre et se sont remis en grève à leur tour. Dans d’autres secteurs, comme celui des minoteries au Caire, les ouvriers ont décidé de faire un sit-in et ont transmis un message de solidarité soutenant les revendications des ouvriers du textile. Ailleurs, comme aux usines de Tanta Linseed and Oil, des ouvriers ont suivi l’exemple de Mahalla en exposant publiquement une série de revendications similaires. Parallèlement, ces luttes ont affirmé un puissant rejet des syndicats officiels, perçus comme les fidèles chiens de garde du gouvernement et du patronat : "Le représentant du syndicat officiel, contrôlé par l’Etat, venu demander à ses collèges de stopper la grève, est à l’hôpital, passé à tabac par les ouvriers en colère. "Le syndicat est aux ordres, nous voulons élire nos vrais représentants" expliquent les ouvriers" (cité par le quotidien Libération du 1/10/07). Le gouvernement a été contraint de proposer aux ouvriers le paiement de 120 jours de primes et de promettre des sanctions contre la direction. Mais les prolétaires ont démontré qu’ils ne se fiaient plus à de simples promesses et, prenant peu à peu confiance en leur force collective, leur détermination à se battre jusqu’à satisfaction de leurs revendications demeure intacte.A Dubaï. Avec plus de force qu’au printemps 2006, en octobre 2007, 4 000 ouvriers, la plupart immigrés d’origine indienne, pakistanaise, bangladaise ou chinoise et affectés à la construction de gratte-ciel gigantesques et de palaces hyper-luxueux, traités comme du bétail, gagnant une centaine d’euros par mois, logeant entassés dans des cabanons de fortune ont pris l’initiative de descendre dans la rue pour exprimer leur révolte face à des conditions de surexploitation inhumaines, bravant l’illégalité, malgré leur exposition à la répression, à la perte de leur salaire, de leur emploi et à leur bannissement à vie. Ils ont entraîné pendant deux jours la mobilisation de 400 000 travailleurs du bâtiment.
En Algérie. Pour faire face au mécontentement croissant, les syndicats autonomes de la fonction publique ont appelé à une grève nationale des fonctionnaires, et en particulier les enseignants, pour les 12 et 15 janvier 2008, contre le laminage du pouvoir d’achat et le nouveau statut de l’enseignement qui remet en cause leur grille de salaires. Mais cette grève a également largement impliqué et mobilisé les autres fonctionnaires et le secteur de la santé. La ville de Tizi Ouzou s’est retrouvée totalement paralysée et la grève des enseignants à été particulièrement suivie à Oran, Constantine, Annaba, Bechar, Adrar et Saïda.
Au Venezuela. Les travailleurs du pétrole, après s’être opposés fin mai 2007 aux licenciements d’ouvriers d’une entreprise d’Etat, se sont mobilisés à nouveau en septembre pour réclamer des hausses salariales lors du renouvellement des conventions collectives du secteur. Parallèlement, en mai, le mouvement de protestation des étudiants contre le régime réclamait une amélioration du sort des populations et des travailleurs les plus pauvres. Pour cela, les étudiants ont organisé des assemblées générales ouvertes à tous et élu des comités de grève. En chaque occasion, le gouvernement de Chavez, "l’apôtre de la révolution bolivarienne" a fourni la même réponse : la répression qui s’est soldée par des morts et des centaines de blessés.
Au Pérou. En avril, une grève illimitée, partie depuis une entreprise chinoise, s’est propagée à l’échelle nationale dans les mines de charbon, pour la première fois depuis 20 ans. A Chimbote, l’entreprise Sider Pérou a été totalement paralysée, malgré les manœuvres de sabotage de la grève et les tentatives d’isolement de la part des syndicats. Les femmes de mineurs ont manifesté avec eux ainsi qu’une grande partie de la population de la ville, paysans et chômeurs inclus. Près de Lima, les mineurs de Casapalca ont séquestré les ingénieurs de la mine qui les menaçaient de licenciement s’ils abandonnaient leur poste. Des étudiants de Lima et une partie de la population sont venus apporter de la nourriture et leur soutien aux grévistes. En juin, ce sont une partie importante des 325 000 enseignants qui se sont largement mobilisés, avec aussi le soutien d’une grande partie de la population, malgré là encore un partage du travail entre les syndicats pour faire capoter la lutte. En chaque occasion, le gouvernement a réagi par des arrestations, des menaces de licenciement, une utilisation de "précaires" pour remplacer les mineurs grévistes, en organisant de vastes campagnes médiatiques de dénigrement contre la grève des enseignants.
En Turquie. Face à la perte de garantie de salaire et d’emploi, suite à leur privatisation et au transfert de 10 000 d’entre eux vers des entreprises sous-traitantes, la grève massive de 26 000 ouvriers, pendant 44 jours, à Türk Telekom en fin d’année a représenté la plus importante grève de l’histoire de la Turquie après la grève des mineurs de 1991. En pleine campagne de mobilisation guerrière anti-kurde sur le front irakien, certains "meneurs" ont été arrêtés et accusés de sabotage, voire de haute trahison de l’intérêt national, menacés de licenciements et de sanctions. Ils ont été finalement réintégrés et des hausses de salaires de 10% ont été négociées.
En Grèce. La grève générale, le 12 décembre 2007, contre un projet de réforme des "régimes spéciaux" des retraites (déjà portées pour le régime général à 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes) concernant 700 000 travailleurs (32 % de la population active) a rassemblé des employés du privé et des fonctionnaires : banques, écoles, tribunaux, administrations, employés des postes, de l’électricité, du téléphone, des hôpitaux ainsi que des transports publics (métros, tramways, ports, aéroports) avec plus de 100 000 manifestants à Athènes, Thessalonique ainsi que dans les principales villes du pays.
En Finlande. Dans ce pays, où la bourgeoisie a poussé très loin le démantèlement de la protection sociale, plus de 70 000 salariés de la santé (pour la plupart des infirmières) se sont mis en grève en octobre pendant un mois pour réclamer une hausse des salaires (qui varient entre 400 et 600 euros mensuels) d’au moins 24 % alors que le très bas niveau de ceux-ci, en particulier dans le secteur de la santé, pousse nombre de travailleurs à aller travailler en Suède. 12 800 infirmières ont menacé de démissionner collectivement si les négociations entre le gouvernement, qui ne propose qu’une revalorisation de 12 % en deux ans et demi, et le syndicat Tehy n’aboutissaient pas. Des services hospitaliers entiers sont menacés de fermeture.
En Bulgarie. Après une grève symbolique le jour de la rentrée scolaire, les enseignants se sont mis en grève illimitée, fin septembre, pour réclamer une augmentations des salaires : 100% pour les enseignants du secondaire (touchant en moyenne 174 euros par mois) et une augmentation de 5% du budget de l’éducation nationale. La promesse du gouvernement de revoir les salaires de l’enseignement en 2008 a mis provisoirement fin à la grève.
En Hongrie. Après une grève pour protester contre la fermeture de lignes ferroviaires déclarées non rentables ainsi que contre les réformes des retraites et du système de santé mises en place par le gouvernement, les cheminots sont parvenus à entraîner derrière eux, le 17 décembre, 32 000 salariés mécontents de différents secteurs (enseignants, personnels de santé, chauffeurs de bus, employés de l’aéroport de Budapest). Mais, à l’occasion de cette mobilisation interprofessionnelle, les syndicats ont réussi à étouffer dans l’œuf la lutte des cheminots, alors que le Parlement venait de voter la réforme, et les ont appelés à la reprise du travail dès le lendemain.
En Russie. Bravant la répression, qui rend illégale toute grève de plus de 24 heures, malgré la condamnation systématique des grévistes par les cours de justice, le recours systématique à la violence policière et l’utilisation de bandes de gangsters contre les ouvriers combatifs, pour la première fois depuis 10 ans, une vague de grève a balayé le pays depuis le printemps dernier, de la Sibérie Orientale jusqu’au Caucase. De multiples secteurs ont été touchés, tels des chantiers de construction en Tchétchénie, une usine de la filière bois à Novgorod, un hôpital dans la région de Tchita, le service de maintenance des logements à Saratov, des "fast-food" à Irkousk, l’usine General Motors à Togliattigrad et une importante usine métallurgique en Carélie. Mais ce mouvement a culminé en novembre avec la grève de 3 jours des dockers de Tuapse sur la Mer Noire, puis de ceux de 3 compagnies du port de Saint-Petersbourg du 13 au 17 tandis que les salariés des postes cessaient le travail le 26 octobre, ainsi que ceux du secteur de l’énergie. Les conducteurs de chemins de fer menaçaient à leur tour d’entrer en grève pour la première fois depuis 1988. Mais c’est la grève des ouvriers de l’usine Ford de Vsevolojsk, dans la région de Saint-Petersbourg, à partir du 20 novembre qui contribuait à rompre le black-out total sur cette vague de luttes, notamment provoquée par le développement vertigineux de l’inflation et la hausse de 50 à 70% des produits alimentaires de base. Face à cela, la Fédération des Syndicats Indépendants de Russie, ouvertement inféodée au gouvernement et hostile à tout mouvement de grève, est incapable de jouer le moindre rôle d’encadrement des luttes ouvrières. Par contre, avec l’aide de la bourgeoisie occidentale, les directions des grandes multinationales cherchent à exploiter au maximum les illusions sur un syndicalisme "libre" et "de lutte" en favorisant l’émergence et le développement de nouvelles structures syndicales comme le Syndicat inter-régional des Travailleurs de l’automobile, fondé à l’instigation du Comité syndical de Ford et regroupant des syndicats indépendants de plusieurs grandes entreprises comme celle de AvtoVAZ-General Motors à Togliattigrad et Renault-Autoframos à Moscou. Ce sont ces nouveaux "syndicats indépendants" qui, en enfermant et en isolant totalement les ouvriers dans "leur" usine, en restreignant les expressions de solidarité des autres secteurs à l’envoi de messages de sympathie et au soutien financier, ont précipité les ouvriers dans la plus amère des défaites. Au bout d’un mois de grève, épuisés, exsangues, ceux-ci ont dû reprendre le travail sans rien avoir obtenu, en se pliant aux conditions de la direction : la vague promesse de négociations après la cessation de la grève.
En Italie. Le 23 novembre, les syndicats de base (Confédération Unitaire de Base-CUB, Cobas, et différents "syndicats de lutte" inter-catégoriels) ont lancé une journée de grève générale suivie par 2 millions de salariés contre l’accord signé le 23 juillet dernier entre le gouvernement de centre gauche et les 3 grandes centrales syndicales (CGIL/CISL/UIL) qui légalise la précarisation accrue du travail, la réduction drastique des pensions de retraites et de la protection sociale sur les dépenses de santé. 25 manifestations organisées dans tout le pays ce jour-là ont rassemblé 400 000 personnes, les plus nombreuses étant à Rome et à Milan. Tous les secteurs ont été touchés en particulier les transports (chemins de fer, aéroports bloqués), la métallurgie (90% de grévistes chez Fiat à Pomigliano), et les hôpitaux. La grève a été particulièrement suivie par des jeunes en emploi précaire (ils sont plus de 6 millions) et par des non syndiqués. La colère liée à la chute du pouvoir d’achat a également joué un rôle important dans l’ampleur de cette mobilisation.
En Grande-Bretagne. Dans les postes, notamment à Liverpool et dans le secteur sud de Londres, les employés ont commencé spontanément, pour la première fois depuis plus d’une décennie, une série de grèves contre la baisse des salaires réels et les nouvelles menaces de réduction d’effectifs, alors que le syndicat des ouvriers de la communication (CWU) isolait les ouvriers en les maintenant dans des piquets de grève sur chaque site. En même temps, ce syndicat signait un accord avec la direction prévoyant une flexibilité plus forte des emplois et des salaires.
En Allemagne. La grève "perlée" des cheminots pour des hausses de salaire aura duré 10 mois sous la houlette du syndicat des roulants GDL. Les syndicats ont joué un rôle majeur pour diviser les ouvriers à travers un partage des tâches entre syndicats partisans de la légalité et ceux plus radicaux prêts à la transgresser. Une vaste campagne a été organisée par les médias pour dénigrer le caractère "égoïste" de la grève alors que celle-ci a bénéficié de la sympathie d’une grande partie des autres ouvriers "usagers", de plus en plus nombreux à s’identifier eux aussi comme victimes des mêmes "injustices sociales". Alors que le nombre d’employés des chemins de fer a été réduit de moitié en 20 ans, que les conditions de travail s'y sont fortement dégradées, et que les salaires y sont bloqués depuis 15 ans, ce secteurs devient un des plus mal payés (en moyenne moins de 1500 euros mensuels). Sous la pression des cheminots, une nouvelle grève de 3 jours en novembre a été légalisée par les tribunaux, parallèlement à celle, très populaire en Allemagne, qui se déroulait en France. Elle a débouché, en janvier, sur des augmentations de salaire de 11% (assez loin des 31% revendiqués et en partie déjà rognés) et, afin de faire échapper un peu de pression de la cocotte-minute sociale, sur la réduction de la durée travail hebdomadaire pour les 20 000 conducteurs de train. Celle-ci passerait ainsi de 41 à 40 heures, mais seulement à partir de … février 2009.
Plus récemment, le constructeur finnois de téléphonie mobile Nokia a annoncé la fermeture, pour fin 2008, de son site à Bochum qui emploie 2300 ouvriers. Cela impliquera, en prenant en compte les répercussions sur les entreprises sous-traitantes, la perte de 4000 emplois pour cette ville. Le 16 janvier, au lendemain de cette annonce, les ouvriers ont refusé de prendre leur poste de travail et des ouvriers de l’usine voisine d’Opel, d’autres de chez Mercedes, des sidérurgistes de l’entreprise Hoechst à Dortmund, des métallos venus de Herne, des mineurs de la région ont afflué aux portes de l’usine Nokia pour apporter soutien et solidarité à leurs camarades. Le prolétariat allemand, au cœur de l’Europe, en systématisant ses expériences récentes de combativité et de solidarité, tend à redevenir un phare pour le développement de la lutte de classe au niveau international. Déjà en 2004, les ouvriers de l’usine Daimler-Benz à Brême s’étaient mis spontanément en grève en refusant le chantage à la concurrence de la direction entre sites de production et par solidarité à l’égard des ouvriers de Stuttgart de la même entreprise menacés de licenciements. Quelques mois plus tard, d’autres ouvriers de l’automobile, précisément déjà ceux d’Opel à Bochum déclenchaient spontanément une grève à leur tour face à une pression de la direction du même type. C’est pourquoi, aujourd’hui, pour dévoyer cette manifestation de solidarité et cette large mobilisation intersectorielle, la bourgeoisie allemande a immédiatement entrepris de focaliser l’attention sur cet énième cas de délocalisation (l’usine doit être transférée à Cluj en Roumanie), en orchestrant une grande campagne médiatique (dans un vaste front commun réunissant le gouvernement, les élus locaux ou régionaux, l’église et les syndicats) accusant le constructeur finnois d’avoir trahi le gouvernement après avoir profité de ses subventions pour permettre le maintien en activité du site de Bochum.
Ainsi, à la lutte contre les licenciements et les réductions d’effectifs, se mêlent de plus en plus d’autres revendications pour des hausses de salaire et contre la perte de pouvoir d’achat, alors que l’ensemble de la classe ouvrière de ce pays est particulièrement exposé aux attaques incessantes de la bourgeoisie (âge de la retraite repoussée jusqu’à 67 ans, plans de licenciements, coupes dans toutes les prestations sociales de l’Agenda 2010, …). En 2007, l’Allemagne a d’ailleurs connu le plus grand nombre de jours de grèves cumulés (dont 70% à cause des grèves du printemps contre "l’externalisation" de 50 000 emplois dans les télécoms) depuis 1993, au lendemain de la réunification.
En France. Mais c’est surtout la grève des cheminots et des traminots dans ce pays, en octobre novembre, qui a révélé les potentialités nouvelles pour l’avenir, un an et demi après la lutte du printemps 2006, principalement animée par la jeunesse scolarisée, qui avait contraint le gouvernement à retirer un dispositif (le CPE) qui visait à augmenter encore la précarité des jeunes travailleurs. Déjà en octobre, la grève pendant 5 jours des hôtesses et des stewards à Air France contre la détérioration de leurs conditions de travail avait démontré la combativité et la montée générale du mécontentement social.
Les cheminots, loin de s’accrocher à un "régime spécial de retraites", revendiquaient le retour à 37,5 années de cotisations pour tous. Chez les jeunes ouvriers de la SNCF, en particulier, s’est affirmée une volonté d’extension de la lutte en rupture avec le poids du corporatisme des cheminots et des "roulants" qui avait dominé lors des grèves de 1986/87 et de 1995, démontrant l’existence d’un très fort sentiment de solidarité au sein de l’ensemble de la classe ouvrière.
Quant au mouvement étudiant mobilisé contre la Loi de Réforme des Universités (ou loi Pécresse), visant à former les universités d’élite de la bourgeoisie et à rejeter davantage la majorité des étudiants vers des "facultés-poubelles" et le travail précaire, il a continué à se situer dans le prolongement du mouvement anti-CPE du printemps 2006 dans la mesure où sa plateforme revendicative inscrivait non seulement le retrait de la loi Pécresse mais aussi le rejet de toutes les attaques du gouvernement. Des liens réels de solidarité se sont d’ailleurs tissés entre étudiants et cheminots ou traminots, qui se sont traduits, même si cela s’est manifesté de façon très limitée à certains endroits et dans les moments les plus forts de la lutte, par le fait qu’ils se sont retrouvés dans des assemblées et des actions communes, partageant aussi des repas en commun.
Les luttes se heurtent partout et se confrontent au travail de sabotage et de division par les syndicats qui, contraints de se porter aux avant-postes des attaques anti-ouvrières, dévoilent de plus en plus ouvertement leur rôle et leur fonction réelle au service de l’Etat bourgeois. Dans la lutte des cheminots et des traminots en France en octobre-novembre 2007, la collusion des syndicats avec le gouvernement pour faire passer ses attaques était manifeste Et chaque syndicat a pris sa part dans la division et l’isolement des luttes.1
Aux Etats-Unis. Le syndicat UAW a saboté la grève à General Motors en septembre puis à Chrysler en octobre, en négociant avec la direction de ces entreprises le transfert de la gestion "de la couverture médico-sociale" au syndicat en échange du "maintien" des emplois de l’entreprise et du gel des salaires pendant 4 ans. Ce qui est une véritable arnaque puisque le maintien du nombre d’emplois prévoit le remplacement des ouvriers par des intérimaires soumis à des conditions d’embauche plus précaires, avec des salaires inférieurs et en outre obligés de s’affilier au syndicat. Ainsi l'action syndicale a permis un résultat inverse à celui obtenu par la lutte exemplaire des ouvriers des transports de New York qui, en décembre 2005, avaient refusé la mise en place, pour leurs enfants et les générations futures, d’un système de conditions d’embauche et de salaires différents.
De plus en plus, la bourgeoisie est amenée à mettre en place des contre-feux face à l’usure et au discrédit des appareils syndicaux. C’est pourquoi, selon les pays, apparaissent des syndicats de base, des syndicats plus "radicaux", des syndicats prétendus "libres et indépendants" pour encadrer les luttes, freiner la prise en mains de celles-ci par les ouvriers eux-mêmes et, surtout, bloquer et enliser le processus de réflexion, de discussion et de prise de conscience au sein de la classe ouvrière.
Le développement des luttes se heurte également à une vaste entreprise haineuse de la bourgeoisie visant à discréditer celles-ci et il suscite une accentuation de la répression. Non seulement une grande campagne a été organisée, en France, pour rendre la grève des transports impopulaires afin de monter les "usagers" contre les grévistes, diviser la classe ouvrière, briser l’élan de solidarité au sein de celle-ci, empêcher toute tentative d’élargissement de la lutte et culpabiliser les grévistes. Mais aussi, tout est fait, de plus en plus, pour criminaliser les grévistes. Ainsi une campagne a été montée à la fin de la grève, le 21 novembre, autour du sabotage de voies ferrées et d’incendie de câbles électriques, tentant de faire apparaître les grévistes comme des "terroristes" ou des "assassins irresponsables". La même "criminalisation" s’est exercée à l’encontre des étudiants "bloqueurs" que certains présidents d’université ont qualifiés de "Khmers rouges" ou de "délinquants". Par ailleurs, les étudiants ont été la cible d'une violente répression lors des interventions policières au moyen de charges pour "débloquer" les universités occupées. Des dizaines d'étudiants ont été blessés ou arrêtés, avec jugement en comparution immédiate, et de lourdes peines de prison.
Les principales caractéristiques des luttes actuelles
Ces récentes luttes confirment cependant pleinement des caractéristiques que nous mettions en avant dans la résolution sur la situation internationale que le CCI a adoptée en mai 2007 lors de son 17e Congrès (publiée dans la Revue Internationale n°130, 3e trimestre 2007) :
- Ainsi, elles "incorporent de façon croissante un profond sentiment de solidarité ouvrière qui représente un pas en avant dans la confiance de la classe en ses propres forces et constitue le 'contrepoison' par excellence du "chacun pour soi" propre à la décomposition sociale dominant le capitalisme et surtout elle est au cœur de la capacité du prolétariat mondial non seulement de développer ses combats actuels mais aussi d’ouvrir la perspective de renverser le capitalisme". 11 Malgré l’acharnement de la bourgeoisie à différencier les revendications, dans les luttes d’octobre-novemebre en France, l’aspiration à la solidarité était dans l’air que l’on respirait.
- Elles traduisent aussi une perte d’illusion sur l’avenir que réserve le capitalisme : "quatre décennies de crise ouverte et d’attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière, notamment la montée du chômage et de la précarité, ont balayé les illusions que "ça ira mieux demain" : les vieilles générations de prolétaires (d’autant plus inquiètes pour l’avenir de leurs enfants) aussi bien que les nouvelles sont de plus en plus conscientes que "demain sera pire qu’aujourd’hui"".
"Aujourd’hui, ce n’est pas la possibilité de la révolution qui constitue l’aliment principal du processus de réflexion au sein de la classe ouvrière, mais, au vu des perspectives catastrophiques que nous offre le capitalisme, sa nécessité". La réflexion sur l’impasse qu’offre le capitalisme est de plus en plus un élément déterminant de la maturation de la conscience de classe.
- "En 1968, le mouvement des étudiants et celui des ouvriers, s’ils s’étaient succédés dans le temps et s’il existait une sympathie entre eux, exprimaient deux réalités différentes : (…) [Du côté étudiant,] 1968 exprimait la révolte de la petite bourgeoisie intellectuelle face à la perspective d’une dégradation de son statut et exprimait une part de refus de sa prolétarisation alors que pour la classe ouvrière mai 68 s’affirmait comme une lutte économique de résistance face à une nouvelle phase d’accélération de la dégradation de ses conditions d’existence ; en 2006, le mouvement des étudiants était un mouvement de la classe ouvrière". Aujourd’hui, une large majorité d’étudiants sont d’emblée intégrés au prolétariat : la plupart doivent exercer une activité salariée pour payer leurs études ou leur logement, ils sont en permanence confrontés à la précarité, à de petits boulots, souvent sans autre perspective que le chômage, l’avenir bouché. L’université à deux vitesses que le gouvernement leur prépare contribue à les enraciner davantage dans le prolétariat. En ce sens, la mobilisation des étudiants à l’automne 2007 confirme le sens de leur engagement contre le CPE en 2006, lequel s’était pleinement exprimé sur le terrain de la lutte ouvrière, reprenant spontanément ses méthodes : AG souveraines et ouvertes à tous les ouvriers.
Aujourd’hui, le processus de développement de la lutte de classe est également marqué par le développement de discussions au sein de la classe ouvrière, par le besoin de réflexion collective, la politisation d’éléments en recherche qui s’effectue aussi bien à travers le surgissement ou la réactivation de groupes prolétariens, de cercles de discussion, face à des événements importants (déclenchement de conflits impérialistes) ou suite à des grèves. Il existe une tendance, partout dans le monde, à s’approcher des positions internationalistes. Une illustration caractéristique de ce phénomène est constituée par l’exemple en Turquie des camarades d’EKS qui, à travers leur prise de position internationaliste se situant clairement sur un terrain de classe, ont assumé leur rôle de militants de défense des positions de la Gauche communiste face à l’aggravation de la guerre en Irak, marquée par l’intervention directe de leur pays dans le conflit.
Des minorités révolutionnaires font leur apparition, aussi bien dans des pays moins développés comme le Pérou ou les Philippines que dans les pays hautement industrialisés mais où les traditions historiques de lutte de classe font défaut comme au Japon ou, à un degré moindre, en Corée. C’est dans ce contexte que le CCI assume également ses responsabilités envers de tels éléments comme en témoignent ses interventions récentes dans différents pays où il a impulsé, organisé ou participé à des réunions publiques dans des endroits aussi divers que le Pérou, le Brésil, Saint-Domingue, le Japon ou la Corée du Sud.
"La responsabilité des organisations révolutionnaires, et du CCI en particulier, est d’être partie prenante de la réflexion qui se mène d’ores et déjà au sein de la classe, non seulement en intervenant activement dans les luttes qu’elle commence à développer mais également en stimulant la démarche des groupes et éléments qui se proposent de rejoindre son combat". L’écho croissant, au sein de ces minorités, que recevront la propagande et les positions de la Gauche communiste constituera un facteur essentiel dans la politisation de la classe ouvrière en vue du renversement du capitalisme.
W (19 janvier)
1 Pour des informations détaillées concernant les manœuvres de sabotage syndical, consulter les articles de notre presse territoriale "Face aux multiples attaques, refusons de nous laisser diviser" et "Lutte des cheminots, mouvement des étudiants : gouvernement et syndicats main dans la main contre la classe ouvrière" parus dans Révolution internationale de novembre et décembre 2008 et disponibles sur notre site Internet.
Récent et en cours:
- Crise économique [1]
- Luttes de classe [2]
Décadence du capitalisme (I) : la révolution est nécessaire et possible depuis un siècle
- 2903 lectures
La Guerre mondiale représente un tournant pour le monde
Le SPD s'était formé en tant que parti marxiste dans les années 1870 et symbolisait l'influence grandissante du courant du "socialisme scientifique" au sein du mouvement ouvrier. En apparence, le SPD de 1914 conservait son attachement à la lettre du marxisme, même s'il en piétinait l'esprit. Marx n'avait-il pas, à son époque, mis en garde contre le danger que constituait l'absolutisme tsariste comme rempart de la réaction en Europe ? La Première Internationale n'avait-elle pas été formée lors d'un rassemblement de soutien à la lutte pour l'indépendance de la Pologne vis-à-vis du joug tsariste ? Engels n'avait-il pas exprimé l'idée que les socialistes allemands devraient adopter une position "révolutionnaire défensive" en cas d'agression franco-russe contre l'Allemagne, tout en mettant en garde contre les dangers d'une guerre en Europe ? Maintenant, le SPD appelait à l'unité nationale à tout prix face au principal danger auquel était confrontée l'Allemagne - la puissance du despotisme tsariste dont la victoire, disait-il, détruirait tous les acquis économiques et politiques durement gagnés par la classe ouvrière au cours d'années de luttes patientes et tenaces. Il se présentait donc comme l'héritier légitime de Marx et Engels et de leur défense résolue de tout ce qui était progressif dans la civilisation européenne.
Mais selon les termes de Lénine, cet autre révolutionnaire qui n'eut aucune hésitation à dénoncer la trahison honteuse des "social chauvins" : "Invoquer aujourd'hui l'attitude de Marx à l'égard des guerres de l'époque de la bourgeoisie progressive et oublier les paroles de Marx : “Les ouvriers n'ont pas de patrie”, paroles qui se rapportent justement à l'époque de la bourgeoisie réactionnaire qui a fait son temps, à l'époque de la révolution socialiste, c'est déformer cyniquement la pensée de Marx et substituer au point de vue socialiste le point de vue bourgeois" ("Le socialisme et la guerre", chapitre 1 "Les principes du socialisme et la guerre de 1914-1915", 1915). Les arguments de Rosa Luxemburg portaient exactement sur les mêmes questions. La guerre actuelle n'était pas du tout du même type que celles qu'on avait vues en Europe au milieu du siècle précédent. Ces guerres avaient été de courte durée, limitées dans l'espace et dans leurs objectifs, et principalement menées par des armées professionnelles. De plus, elles ont pris place au cours d'une longue période de paix, d'expansion économique sans précédent et d'augmentation régulière du niveau de vie de la population dont a bénéficié le continent européen pendant la plus grande partie du siècle à partir de 1815 et de la fin des guerres napoléoniennes. En outre, ces guerres, loin de ruiner leurs protagonistes, avaient le plus souvent servi à accélérer le processus global d'expansion capitaliste en balayant les obstacles féodaux qui entravaient l'unification nationale et en permettant que de nouveaux États nationaux se créent en tant que cadre le plus adapté au développement du capitalisme (les guerres pour l'unité italienne et la guerre franco-prussienne de 1870 en sont des exemples typiques).
Désormais, ces guerres - des guerres nationales qui pouvaient encore jouer un rôle progressif pour le capital - appartenaient au passé. Par sa capacité de destruction meurtrière - 10 millions d'hommes ont péri sur les champs de bataille européens, la plupart englués dans un bourbier sanglant et vain, tandis que des millions de civils mouraient aussi, en grande partie à cause de la misère et de la famine imposées par la guerre ; par l'ampleur de ses conséquences en tant que guerre impliquant des puissances d'envergure mondiale et se donnant, de ce fait, des objectifs de conquête littéralement illimités et de défaite complète de l'ennemi ; par son caractère de guerre "totale" ayant mobilisé non seulement des millions de prolétaires appelés sur les fronts mais aussi la sueur et le sacrifice de millions d'ouvriers qui travaillaient dans les industries à l'arrière, c'était une guerre d'un type nouveau qui a démenti toutes les prévisions de la classe dominante selon lesquelles "elle serait terminée à Noël". Le carnage monstrueux de la guerre fut évidemment énormément intensifié par les moyens technologiques extrêmement développés à la disposition des protagonistes et qui avaient déjà largement dépassé les tactiques et les stratégies enseignées dans les écoles de guerre traditionnelles ; ils augmentèrent encore le niveau du carnage. Mais la barbarie de la guerre exprimait quelque chose de bien plus profond que le seul développement technologique du système bourgeois. C'était l'expression d'un mode de production qui était entré dans une crise fondamentale et historique, révélant la nature obsolescente des rapports sociaux capitalistes et mettant l'humanité devant l'alternative crue : révolution socialiste ou rechute dans la barbarie. D'où le passage le plus souvent cité de la Brochure de Junius : "Friedrich Engels a dit un jour : 'La société bourgeoise est placée devant un dilemme : ou bien passage au socialisme ou rechute dans la barbarie'. Mais que signifie donc une 'rechute dans la barbarie' au degré de civilisation que nous connaissons en Europe aujourd'hui ? Jusqu'ici nous avons lu ces paroles sans y réfléchir et nous les avons répétées sans en pressentir la terrible gravité. Jetons un coup d'œil autour de nous en ce moment même, et nous comprendrons ce que signifie une rechute de la société bourgeoise dans la barbarie. Le triomphe de l'impérialisme aboutit à l'anéantissement de la civilisation - sporadiquement pendant la durée d'une guerre moderne et définitivement si la période des guerres mondiales qui débute maintenant devait se poursuivre sans entraves jusque dans ses dernières conséquences. C'est exactement ce que Friedrich Engels avait prédit, une génération avant nous, voici quarante ans. Nous sommes placés aujourd'hui devant ce choix : ou bien triomphe de l'impérialisme et décadence de toute civilisation, avec pour conséquences, comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière ; ou bien victoire du socialisme, c'est-à-dire de la lutte consciente du prolétariat international contre l'impérialisme et contre sa méthode d'action : la guerre. C'est là un dilemme de l'histoire du monde, un ou bien - ou bien encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. Le prolétariat doit jeter résolument dans la balance le glaive de son combat révolutionnaire : l'avenir de la civilisation et de l'humanité en dépendent. Au cours de cette guerre, l'impérialisme a remporté la victoire. En faisant peser de tout son poids le glaive sanglant de l'assassinat des peuples, il a fait pencher la balance du côté de l'abîme, de la désolation et de la honte. Tout ce fardeau de honte et de désolation ne sera contrebalancé que si, au milieu de la guerre, nous savons retirer de la guerre la leçon qu'elle contient, si le prolétariat parvient à se ressaisir et s'il cesse de jouer le rôle d'un esclave manipulé par les classes dirigeantes pour devenir le maître de son propre destin." (chapitre " Socialisme ou Barbarie")
Ce changement d'époque a rendus obsolètes les arguments de Marx en faveur du soutien à l'indépendance nationale (qu'il avait de toutes façons déjà jetés au rebut après la Commune de Paris de 1871 pour ce qui concernait les pays avancés d'Europe). Il ne s'agissait plus de chercher les causes nationales les plus progressives dans ce conflit car les luttes nationales avaient elles-mêmes perdu tout rôle progressiste et étaient devenues de simples instruments de la conquête impérialiste et de la marche du capitalisme vers la catastrophe : "Le programme national n'a joué un rôle historique, en tant qu'expression idéologique de la bourgeoisie montante aspirant au pouvoir dans l'État, que jusqu'au moment où la société bourgeoise s'est tant bien que mal installée dans les grands États du centre de l'Europe et y a créé les instruments et les conditions indispensables de sa politique. Depuis lors, l'impérialisme a complètement enterré le vieux programme bourgeois démocratique : l'expansion au-delà des frontières nationales (quelles que soient les conditions nationales des pays annexés) est devenue la plate-forme de la bourgeoisie de tous les pays. Certes, la phrase nationale est demeurée, mais son contenu réel et sa fonction se sont mués en leur contraire. Elle ne sert plus qu'à masquer tant bien que mal les aspirations impérialistes, à moins qu'elle ne soit utilisée comme cri de guerre, dans les conflits impérialistes, seul et ultime moyen idéologique de capter l'adhésion des masses populaires et de leur faire jouer leur rôle de chair à canon dans les guerres impérialistes."(Brochure de Junius, chapitre "Invasion et lutte des classes")
Ce n'est pas seulement la "tactique nationale" qui avait changé ; toute la situation avait également été profondément transformée par la guerre. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, à l'époque antérieure durant laquelle la social-démocratie avait patiemment et systématiquement lutté pour s'établir, tout comme le prolétariat dans son ensemble, en tant que force organisée au sein de la société bourgeoise : "Une chose est certaine, la guerre mondiale représente un tournant pour le monde. C'est une folie insensée de s'imaginer que nous n'avons qu'à laisser passer la guerre, comme le lièvre attend la fin de l'orage sous un buisson pour reprendre ensuite gaiement son petit train. La guerre mondiale a changé les conditions de notre lutte et nous a changés nous-mêmes radicalement. Non que les lois fondamentales de l'évolution capitaliste, le combat de vie et de mort entre le capital et le travail, doivent connaître une déviation ou un adoucissement. Maintenant déjà, au milieu de la guerre, les masques tombent et les vieux traits que nous connaissons si bien nous regardent en ricanant. Mais à la suite de l'éruption du volcan impérialiste, le rythme de l'évolution a reçu une impulsion si violente qu'à côté des conflits qui vont surgir au sein de la société et à côté de l'immensité des tâches qui attendent le prolétariat socialiste dans l'immédiat, toute l'histoire du mouvement ouvrier semble n'avoir été jusqu'ici qu'une époque paradisiaque." (chapitre "Socialisme ou Barbarie")
Si ces tâches sont immenses c'est qu'elles réclament bien plus que la lutte défensive obstinée contre l'exploitation ; elles appellent une lutte révolutionnaire offensive, pour abolir l'exploitation une fois pour toutes, pour "donner à l'action sociale des hommes un sens conscient, introduire dans l'histoire une pensée méthodique et, par là, une volonté libre" (ibid.). L'insistance de Rosa Luxemburg sur l'ouverture d'une époque radicalement nouvelle dans la lutte de la classe ouvrière devait rapidement devenir une position commune du mouvement révolutionnaire international qui se reconstituait sur les ruines de la social-démocratie et qui a, en 1919, fondé le parti mondial de la révolution prolétarienne : l'Internationale communiste (IC). A son Premier Congrès à Moscou, l'IC a adopté dans sa plate-forme la formule célèbre : "Une nouvelle époque est née. Époque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. Époque de la révolution communiste du prolétariat." Et l'IC partageait l'avis de Rosa Luxemburg sur le fait que si la révolution prolétarienne - qui, à ce moment-là, était à son zénith sur l'ensemble de la planète à la suite de l'insurrection d'Octobre 1917 en Russie et de la marée révolutionnaire qui balayait l'Allemagne, la Hongrie et beaucoup d'autres pays - ne parvenait pas à renverser le capitalisme, l'humanité serait plongée dans une autre guerre, en fait dans une époque de guerres incessantes qui mettrait en question l'avenir même de l'humanité.
Presque 100 ans plus tard, le capitalisme est toujours là et, selon la propagande officielle, il constitue la seule forme possible d'organisation sociale. Qu'est devenu le dilemme, énoncé par Luxemburg, "socialisme ou barbarie" ? A nouveau, si l'on s'en tient toujours aux discours de l'idéologie dominante, le socialisme a été tenté au cours du 20e siècle et ça n'a pas marché. Les espoirs lumineux soulevés par la Révolution russe de 1917 se sont fracassés sur les récifs du stalinisme et ont été enterrés près du cadavre de ce dernier quand le bloc de l'Est s'est effondré à la fin des années 1980. Non seulement le socialisme s'est avéré être au mieux une utopie et au pire un cauchemar, mais même la lutte de classe, que les marxistes considéraient comme son fondement essentiel, a disparu dans le brouillard atone d'une "nouvelle" forme de capitalisme dont on prétend qu'il vivrait non plus grâce à l'exploitation d'une classe productrice, mais au moyen d'une masse infinie de "consommateurs" et d'une économie plus souvent virtuelle que matérielle.
C'est ce qu'on nous dit en tous cas. Il est sûr que si R. Luxemburg revenait de chez les morts, elle serait plutôt surprise de voir que la civilisation capitaliste domine toujours la planète ; à une autre occasion, nous examinerons de plus près comment le système a fait pour survivre malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées au cours du siècle passé. Mais si nous ôtons les lunettes déformantes de l'idéologie dominante et regardons avec un minimum de sérieux le cours du 20e siècle, nous verrons que les prévisions de Rosa Luxemburg et de la majorité des socialistes révolutionnaires de l'époque, ont été confirmées. Cette époque - en l'absence de victoire de la révolution prolétarienne - a déjà été la plus barbare de toute l'histoire de l'humanité et porte en elle la menace d'une descente encore plus profonde dans la barbarie dont le point ultime ne serait pas seulement "l'annihilation de la civilisation" mais l'extinction de la vie humaine sur la planète.
L'époque des guerres et des révolutions
En 1915, seule une minorité de socialistes s'est élevée clairement contre la guerre. Trotsky plaisantait en disant que les internationalistes qui se réunirent cette année là, à Zimmerwald, auraient tous pu rentrer dans un seul taxi. Cependant la Conférence de Zimmerwald elle-même qui regroupa une poignée de socialistes s'opposant à la guerre, constituait un signe que quelque chose bougeait dans les rangs de la classe ouvrière internationale. En 1916, le désenchantement vis-à-vis de la guerre, tant sur le front qu'à l'arrière, devenait de plus en plus ouvert, comme le montrèrent les grèves en Allemagne et en Grande-Bretagne ainsi que les manifestations qui saluèrent la sortie de prison du camarade de Luxemburg, Karl Liebknecht, dont le nom était devenu synonyme du slogan : "l'ennemi principal est dans notre propre pays". En février 1917, la révolution éclata en Russie, mettant fin au règne des Tsars ; mais loin d'être un 1789 russe, une nouvelle révolution bourgeoise, même à retardement, Février a ouvert la voie à Octobre : la prise du pouvoir par la classe ouvrière organisée en soviets et qui proclama que cette insurrection ne constituait que le premier coup porté par la révolution mondiale devant mettre fin non seulement à la guerre mais au capitalisme lui-même.
La Révolution russe, comme Lénine et les Bolcheviks n'ont eu de cesse de le répéter, tiendrait ou chuterait avec la révolution mondiale. Et au début, son appel aux armes semblait avoir trouvé une réponse : les mutineries dans l'armée française en 1917 ; la révolution en Allemagne en 1918 qui a précipité les gouvernements bourgeois du monde à conclure une paix hâtive de peur que l'épidémie bolchevique ne se répande plus loin ; la république des soviets en Bavière et en Hongrie en 1919 ; les grèves générales à Seattle aux États-Unis et à Winnipeg au Canada ; l'envoi de tanks pour répondre à l'agitation ouvrière sur la Clyde en Ecosse la même année ; les occupations d'usines en Italie en 1920. C'était une confirmation frappante de l'analyse de l'IC : une nouvelle époque était née, époque de guerres et de révolutions. Le capitalisme, en entraînant l'humanité derrière le rouleau compresseur du militarisme et de la guerre, rendait aussi nécessaire la révolution prolétarienne.
Mais la conscience qu'en avaient les éléments les plus dynamiques et les plus clairvoyants de la classe ouvrière, les communistes, coïncidait rarement avec le niveau atteint par l'ensemble de la classe ouvrière. La majorité de cette dernière ne comprenait pas encore qu'un retour à l'ancienne période de paix et de réformes graduelles n'était plus possible. Elle voulait avant tout que la guerre se termine et, bien qu'elle ait dû imposer cette décision à la bourgeoisie, cette dernière a su tirer profit de l'idée qu'on pouvait revenir au status quo ante bellum, au statu quo d'avant guerre, bien qu'avec un certain nombre de changements qui étaient alors présentés comme des "acquis ouvriers" : en Grande-Bretagne, le "homes fit for heroes", des "foyers pour les héros" qui revenaient de la guerre, le droit de vote pour les femmes, et la Clause quatre dans le programme du parti travailliste qui promettait la nationalisation des entreprises les plus importantes de l'économie ; en Allemagne, où la révolution avait déjà eu une forme concrète, les promesses étaient plus radicales et utilisaient des termes comme la socialisation et les conseils ouvriers ; elles s'engageaient sur l'abdication du Kaiser et la mise en place d'une république basée sur le suffrage universel.
Quasiment partout, c'étaient les sociaux-démocrates, les spécialistes expérimentés de la lutte pour les réformes, qui vendaient ces illusions aux ouvriers, illusions qui leur permettaient de déclarer qu'ils étaient pour la révolution même lorsqu'ils utilisaient des groupes protofascistes pour massacrer les ouvriers révolutionnaires de Berlin et de Munich, et Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht eux-mêmes ; en même temps, ils soutenaient l'étouffement économique et l'offensive militaire contre le pouvoir soviétique en Russie avec l'argument fallacieux selon lequel les Bolcheviks auraient forcé la main de l'histoire en menant une révolution dans un pays arriéré où la classe ouvrière n'était qu'une minorité, offensant ainsi les principes sacrés de la démocratie.
Bref, au moyen d'un mélange de tromperies et de répression brutale, la vague révolutionnaire fut étouffée dans une série de défaites successives. Coupée de l'oxygène de la révolution mondiale, la révolution en Russie commença à suffoquer et à se dévorer elle-même ; ce processus est symbolisé par le désastre de Kronstadt où les ouvriers et les marins mécontents, qui demandaient de nouvelles élections des soviets, furent écrasés par le gouvernement bolchevique. Le "vainqueur" de ce processus de dégénérescence interne fut Staline et la première victime en fut le Parti bolchevique lui-même qui s'est finalement et irrévocablement transformé en instrument d'une nouvelle bourgeoisie d'État, ayant abandonné tout semblant d'internationalisme au profit de la notion frauduleuse de "socialisme en un seul pays".
Le capitalisme a donc survécu à l'effroi engendré par la vague révolutionnaire, malgré d'ultimes répliques comme la grève générale en Grande-Bretagne en 1926 et le soulèvement ouvrier à Shanghai en 1927. Il a proclamé sa ferme intention de revenir à la normale. Pendant la guerre, le principe des profits et pertes avait été temporairement (et partiellement) suspendu puisque quasiment toute la production avait été orientée vers l'effort de guerre et que l'appareil d'État avait pris le contrôle direct de l'ensemble des secteurs de l'économie. Dans un rapport au Troisième Congrès de l'Internationale communiste, Trotsky a noté comment la guerre avait introduit une nouvelle façon de fonctionner du capitalisme, essentiellement basée sur la manipulation de l'économie par l'État et la création de montagnes de dettes, de capital fictif : "Le capitalisme en tant que système économique est, vous le savez, plein de contradictions. Pendant les années de guerre, ces contradictions ont atteint des proportions monstrueuses. Pour trouver les ressources nécessaires à la guerre, l'État a fait principalement appel à deux mesures : d'abord, l'émission de papier monnaie ; deuxièmement, l'émission d'obligations. Aussi une quantité toujours croissante de prétendues 'valeurs papier' (obligations) est entrée en circulation, comme moyen par lequel l'État a soutiré des valeurs matérielles réelles du pays pour les détruire dans la guerre. Plus grandes ont été les sommes dépensées par l'État, c'est-à-dire plus les valeurs réelles ont été détruites, plus grande a été la quantité de pseudo richesse, de valeurs fictives accumulées dans le pays. Les titres d'État se sont accumulés comme des montagnes. A première vue, il pourrait sembler qu'un pays est devenu extrêmement riche mais, en réalité, on a miné son fondement économique, le faisant vaciller, l'amenant au bord de l'effondrement. Les dettes d'État sont montées jusqu'environ 1000 milliards de marks or qui s'ajoutent aux 62% des ressources nationales actuelles des pays belligérants. Avant la guerre, le total mondial de papier monnaie et de crédit approchait 28 milliards de marks. Or, aujourd'hui il se situe entre 220 et 280 milliards, dix fois plus. Et ceci bien sûr n'inclut pas la Russie car nous ne parlons que du monde capitaliste. Tout ceci s'applique surtout, mais pas exclusivement, aux pays européens, principalement à l'Europe continentale et, en particulier à l'Europe centrale. Dans l'ensemble, au fur et à mesure que l'Europe s'appauvrit - ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui - elle s'est enveloppée et continue à s'envelopper de couches toujours plus épaisses de valeurs papier ou ce qu'on appelle capital fictif. Cette monnaie fictive de capital papier, ces notes du trésor, ces bonds de guerre, ces billets de banque, etc. représentent soit des souvenirs d'un capital défunt ou l'attente de capital à venir. Mais aujourd'hui, ils ne sont en aucune façon reliés à du capital véritablement existant. Cependant, ils fonctionnent comme capital et comme monnaie et cela tend à donner une image incroyablement déformée de la société et de l'économie moderne dans son ensemble. Plus cette économie s'appauvrit, plus riche est l'image reflétée par ce miroir qu'est le capital fictif. En même temps, la création de ce capital fictif signifie, comme nous le verrons, que les classes partagent de différentes façons la distribution du revenu national et de la richesse qui se contractent graduellement. Le revenu national aussi s'est contracté mais pas autant que la richesse nationale. L'explication en est simple : la bougie de l'économie capitaliste a été brûlée par les deux bouts." (2 juin 1921 ; traduit de l'anglais par nous).
Ces méthodes étaient le signe du fait que le capitalisme ne pouvait opérer qu'en bafouant ses propres lois. Les nouvelles méthodes étaient décrites comme du "socialisme de guerre", mais c'était en fait un moyen de préserver le système capitaliste dans une période où il était devenu obsolète et constituait un rempart désespéré contre le socialisme, contre l'ascension d'un mode de production sociale supérieur. Mais comme le "socialisme de guerre" était vu comme nécessaire essentiellement pour gagner la guerre, il fut effectivement démantelé après celle-ci. Au début des années 1920, dans une Europe ravagée par la guerre, débuta une difficile période de reconstruction, mais les économies du Vieux Monde restèrent stagnantes : les taux de croissance spectaculaires qui avaient caractérisé les premiers pays capitalistes dans la période d'avant-guerre ne se reproduisirent pas. Le chômage s'installa de façon permanente dans des pays comme la Grande-Bretagne tandis que l'économie allemande, saignée à blanc par de cruelles réparations, battait tous les records d'inflation connus et était presque totalement alimentée par l'endettement.
La principale exception fut l'Amérique qui s'était développée pendant la guerre en jouant le rôle d'"intendant de l'Europe", selon les termes de Trotsky dans le même rapport. Elle se caractérisa alors définitivement comme étant l'économie la plus puissante du monde et s'épanouit précisément parce que ses rivaux avaient été terrassés par le coût gigantesque de la guerre, les troubles sociaux d'après-guerre et la disparition effective du marché russe. Pour l'Amérique, ce fut l'époque du jazz, les années folles ; les images de la Ford "Model T", produite en masse dans les usines de Henry Ford, reflétaient la réalité de taux de croissance vertigineux. Ayant atteint le bout de son expansion interne et bénéficiant grandement de la stagnation des vieilles puissances européennes, le capital américain commença a envahir le globe avec ses marchandises, en inondant l'Europe et les pays sous développés, souvent jusque dans des régions encore pré-capitalistes. Après avoir été débiteurs au 19e siècle, les États-Unis devinrent le principal créditeur mondial. Bien que, dans une grande mesure, l'agriculture américaine n'ait pas été entraînée dans le boom, il y avait une augmentation perceptible du pouvoir d'achat de la population urbaine et prolétarienne. Tout cela constituait apparemment la preuve qu'on pouvait revenir au monde du capitalisme libéral, du "laisser-faire", qui avait permis l'expansion extraordinaire au 19e siècle. La philosophie rassurante du président des États-Unis de l'époque, Calvin Coolidge, triomphait. C'est en ces termes qu'il s'adressait au Congrès américain en décembre 1928 : "Aucun Congrès des États-Unis jamais rassemblé, faisant un rapide survol de l'état de l'Union, ne s'est trouvé face à une perspective plus plaisante que celle qui se présente aujourd'hui. Sur le plan intérieur, c'est la tranquillité et la satisfaction, des rapports harmonieux entre les patrons et les salariés, libérés des conflits sociaux, et le niveau le plus élevé de prospérité de ces années. Sur le plan extérieur, il y a la paix, la bonne volonté qui vient de la compréhension mutuelle, et la reconnaissance que les problèmes qui, il y a peu de temps encore, apparaissaient si menaçants, disparaissent sous l'influence d'un comportement clairement amical. La grande richesse créée par notre esprit d'entreprise et notre travail, et épargnée par notre sens de l'économie, a connu la distribution la plus large dans notre population et son flux continu a servi les œuvres caritatives et l'industrie du monde. Les besoins de l'existence ne sont plus limités au domaine de la nécessité et appartiennent aujourd'hui à celui du luxe. L'élargissement de la production est consommé par une demande intérieure croissante et un commerce en expansion à l'extérieur. Le pays peut regarder le présent avec satisfaction et anticiper le futur avec optimisme."
On ne peut qu'être frappés par la pertinence de ces paroles ! Moins d'un an après, en octobre 1929, c'était le crash. La croissance fébrile de l'économie américaine avait rencontré les limites inhérentes du marché et bien de ceux qui avaient cru à la croissance illimitée, à la capacité du capitalisme à créer ses propres marchés pour toujours et avaient investi leurs économies sur la base de ce mythe, tombèrent de très haut. De plus, ce n'était pas une crise du même type que celles qui avaient ponctué le 19e siècle, des crises si régulières pendant la première moitié de ce siècle qu'il avait été possible de parler de "cycle décennal". A l'époque, après une brève période d'effondrement, on trouvait de nouveaux marchés dans le monde et une nouvelle phase de croissance, encore plus vigoureuse, commençait ; de plus dans la période de 1870 à 1914, caractérisée par une poussée impérialiste accélérée pour la conquête des régions non capitalistes restantes, les crises qui ont frappé les centres du système furent beaucoup moins violentes que pendant la jeunesse du capitalisme, malgré ce qui avait été appelé la "longue dépression", entre les années 1870 et 1890, et qui avait reflété, dans une certaines mesure, le début de la fin de la suprématie économique mondiale de la Grande-Bretagne. Mais, de toutes façons, il n'y a pas de comparaison possible entre les problèmes commerciaux du 19e siècle et l'effondrement qui a eu lieu pendant les années 1930. On se trouvait sur un plan qualitativement différent : quelque chose de fondamental dans les conditions de l'accumulation capitaliste avait changé. La dépression était mondiale - de son cœur aux États-Unis, elle a ensuite frappé l'Allemagne qui était maintenant quasiment totalement dépendante des États-Unis, puis le reste de l'Europe. La crise était également dévastatrice pour les régions coloniales ou semi-dépendantes qui avaient été contraintes en grande partie, par leurs grands "propriétaires" impérialistes, de produire en premier lieu pour les métropoles. La chute soudaine des prix mondiaux a ruiné la majorité de ces pays.
On peut mesurer la profondeur de la crise par le fait que la production mondiale avait décliné d'environ 10% avec la Première Guerre mondiale, alors qu'à la suite du crash, elle chuta d'au moins 36,2% (ce chiffre exclut l'URSS ; chiffres tirés du livre de Sternberg Le conflit du siècle, 1951). Aux États-Unis qui avaient été les grands bénéficiaires de la guerre, la chute de la production industrielle atteignait 53,8%. Les estimations des chiffres du chômage sont variables, mais Sternberg l'évalue à 40 millions dans les principaux pays développés. La chute du commerce mondial est également catastrophique, se réduisant à 1/3 du niveau d'avant 1929. Mais la différence la plus importante entre l'effondrement des années 1930 et les crises du 19e siècle provient du fait qu'il n'y avait plus, désormais, de processus "automatique" de reprise d'un nouveau cycle de croissance et d'expansion en direction de ce qui subsistait comme régions non capitalistes sur la planète. La bourgeoisie s'est vite rendu compte qu'il n'y aurait plus la "main invisible" du marché pour faire repartir l'économie dans un futur poche. Elle devait donc abandonner le libéralisme naïf de Coolidge et de son successeur, Hoover, et reconnaître qu'à partir de maintenant, l'État devrait intervenir de façon autoritaire dans l'économie afin de préserver le système capitaliste. C'est avant tout Keynes qui a théorisé un telle politique ; il avait compris que l'État devait soutenir les industries déclinantes et générer un marché artificiel pour compenser l'incapacité du système à en développer de nouveaux. Tel a été le sens des "travaux publics" à grande échelle entrepris par Roosevelt sous le nom de New Deal, du soutien que lui a apporté la nouvelle centrale syndicale, la CIO, afin de stimuler la demande des consommateurs, etc. En France, la nouvelle politique a pris la forme du Front populaire. En Allemagne et en Italie, elle a pris la forme du fascisme et en Russie, du stalinisme. Toutes ces politiques avaient la même cause sous-jacente. Le capitalisme était entré dans une nouvelle époque, l'époque du capitalisme d'État.
Mais le capitalisme d'État n'existe pas dans chaque pays isolément des autres. Au contraire, il est déterminé, dans une grande mesure, par la nécessité de centraliser et de défendre l'économie nationale contre la concurrence des autres nations. Dans les années 1930, cela contenait un aspect économique - le protectionnisme était considéré comme un moyen de défendre ses industries et ses marchés contre l'empiètement des industries et des marchés des autres pays ; mais le capitalisme d'État contenait aussi un volet militaire, bien plus significatif, parce que la concurrence économique aggravait la poussée vers une nouvelle guerre mondiale. Le capitalisme d'État est, par essence, une économie de guerre. Le fascisme, qui vantait bruyamment les bienfaits de la guerre, constituait l'expression la plus ouverte de cette tendance. Sous le régime d'Hitler, le capital allemand répondit à sa situation économique catastrophique en se lançant dans une course effrénée au réarmement. Cela eut pour effet "bénéfique" d'absorber rapidement le chômage, mais ce n'était pas le but véritable de l'économie de guerre qui était de se préparer à un nouveau repartage violent des marchés. De même, le régime stalinien en Russie et la subordination impitoyable du niveau de vie des prolétaires au développement de l'industrie lourde, répondait au besoin de faire de la Russie une puissance militaire mondiale à prendre en compte et, comme pour l'Allemagne nazie et le Japon militariste (qui avait déjà lancé une campagne de conquête militaire en envahissant la Mandchourie en 1931 et le reste de la Chine en 1937), ces régimes ont résisté à l'effondrement avec "succès" parce qu'ils ont subordonné toute la production aux besoins de la guerre. Mais le développement de l'économie de guerre est aussi le secret des programmes massifs de travaux publics dans les pays du New Deal et du Front populaire, même si ces derniers ont mis plus de temps à réadapter les usines à la production massive d'armes et de matériel militaire.
Victor Serge a qualifié la période des années 1930 de "Minuit dans le siècle". Tout comme la guerre de 1914-18, la crise économique de 1929 confirmait la sénilité du mode de production capitaliste. A une échelle bien plus grande que tout ce qu'on avait pu voir au 19e siècle, on assistait à "une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé un paradoxe, [s'abattre] sur la société - l'épidémie de la surproduction" (Le Manifeste communiste). Des millions de gens avaient faim et subissaient un chômage forcé dans les nations les plus industrialisées du monde, non pas parce que les usines et les champs ne pouvaient pas produire suffisamment mais parce qu'ils produisaient "trop" par rapport à la capacité d'absorption du marché. C'était une nouvelle confirmation de la nécessité de la révolution socialiste.
Mais la première tentative du prolétariat d'accomplir le verdict de l'histoire avait été définitivement vaincue à la fin des années 1920 et, partout, la contre-révolution avait triomphé. Elle a atteint les profondeurs les plus terrifiantes précisément là où la révolution était allée le plus haut. En Russie, elle prit la forme de camps de travail et d'exécutions massives ; des populations entières furent déportées, des millions de paysans délibérément affamés ; dans les usines, les ouvriers furent soumis à la surexploitation stakhanoviste. Sur le plan culturel, toutes les expériences sociales et artistiques des premières années de la révolution furent supprimées et, au nom du "Réalisme socialiste", on imposa officiellement un retour aux normes bourgeoises les plus philistines.
En Allemagne et en Italie, le prolétariat avait été plus proche de la révolution que dans aucun autre pays d'Europe occidentale et sa défaite eut pour conséquence l'instauration d'un régime policier brutal. Le fascisme était caractérisé par une immense bureaucratie d'informateurs, la persécution féroce des dissidents et des minorités sociales et ethniques, les Juifs en Allemagne en étant le cas typique. Le régime nazi piétina des centaines d'années de culture et se vautra dans des théories occultistes pseudo scientifiques sur la mission civilisatrice de la race aryenne, brûlant les livres qui contenaient des idées "non Allemandes" et exaltant les vertus du sang, de la terre et de la conquête. Trotsky considérait la destruction de la culture en Allemagne nazie comme une preuve particulièrement éloquente de la décadence de la culture bourgeoise.
"Le fascisme a amené à la politique les bas-fonds de la société. Non seulement dans les maisons paysannes, mais aussi dans les gratte-ciel des villes vivent encore aujourd'hui, à côté du XX° siècle, le X° et le XII° siècles. Des centaines de millions de gens utilisent le courant électrique, sans cesser de croire à la force magique des gestes et des incantations. Le pape à Rome prêche à la radio sur le miracle de la transmutation de l'eau en vin. Les étoiles de cinéma se font dire la bonne aventure. Les aviateurs qui dirigent de merveilleuses mécaniques, créées par le génie de l'homme, portent des amulettes sous leur combinaison. Quelles réserves inépuisables d'obscurantisme, d'ignorance et de barbarie ! Le désespoir les a fait se dresser, le fascisme leur a donné un drapeau. Tout ce qu'un développement sans obstacle de la société aurait dû rejeter de l'organisme national, sous la forme d'excréments de la culture, est maintenant vomi : la civilisation capitaliste vomit une barbarie non digérée. Telle est la physiologie du national-socialisme." ("Qu'est-ce que le national-socialisme ?", 1933)
Mais du fait, précisément, que le fascisme était une expression concentrée du déclin du capitalisme en tant que système, penser qu'on pouvait le combattre sans combattre le capitalisme dans son ensemble, comme le défendaient les différentes sortes d'"antifascistes", constituait une pure mystification. Ceci fut très clairement démontré en Espagne en 1936 : les ouvriers de Barcelone répondirent au premier coup d'État du Général Franco, avec leurs propres méthodes de lutte de classe - la grève générale, la fraternisation avec les troupes, l'armement des ouvriers - et, en quelques jours, paralysèrent l'offensive fasciste. C'est quand ils remirent leur lutte aux mains de la bourgeoisie démocratique incarnée par le Front populaire qu'ils furent vaincus et entraînés dans une lutte inter impérialiste qui s'avéra être une répétition générale du massacre bien plus vaste à venir. Comme la Gauche italienne en tira la conclusion sobrement : la guerre d'Espagne constituait une terrible confirmation du fait que le prolétariat mondial avait été défait ; et puisque le prolétariat constituait le seul obstacle à l'avancée du capitalisme vers la guerre, le cours à une nouvelle guerre mondiale était maintenant ouvert.
Une nouvelle étape de la barbarie
Le tableau de Picasso, Guernica, est célébré à juste raison comme une représentation sans précédent des horreurs de la guerre moderne. Le bombardement aveugle de la population civile de cette ville espagnole par l'aviation allemande qui soutenait l'armée de Franco, constitua un grand choc car c'était un phénomène encore relativement nouveau. Le bombardement aérien de cibles civiles avait été limité durant la Première Guerre mondiale et très inefficace. La grande majorité des tués pendant cette guerre étaient des soldats sur les champs de bataille. La Deuxième Guerre mondiale a montré à quel point la capacité de barbarie du capitalisme en déclin s'était accrue puisque, cette fois, la majorité des tués furent des civils :"L'estimation totale en pertes de vies humaines causées par la Deuxième Guerre mondiale, indépendamment du camp dont elles faisaient partie, est en gros de 72 millions. Le nombre de civils atteint 47 millions, y compris les morts de faim et de maladie à cause de la guerre. Les pertes militaires se montent à environ 25 millions, y compris 5 millions de prisonniers de guerre" (https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties [3]). L'expression la plus terrifiante et la plus concentrée de cette horreur est le meurtre industrialisé de millions de Juifs et d'autres minorités par le régime nazi, fusillés, paquets par paquets, dans les ghettos et les forêts d'Europe de l'Est, affamés et exploités au travail comme des esclaves jusqu'à la mort, gazés par centaines de milliers dans les camps d'Auschwitz, Bergen-Belsen ou Treblinka. Mais le nombre de morts civils victimes du bombardement des villes par les protagonistes des deux côtés prouve que cet Holocauste, ce meurtre systématique d'innocents, était une caractéristique générale de cette guerre. En fait, à ce niveau, les démocraties ont certainement surpassé les puissances fascistes, et les tapis de bombes, notamment de bombes incendiaires, qui ont recouvert les villes allemandes et japonaises confèrent, en comparaison, un air plutôt "amateur" au Blitz allemand sur le Royaume-Uni. Le point culminant et symbolique de cette nouvelle méthode de massacre de masse a été le bombardement atomique des villes d'Hiroshima et de Nagasaki ; mais en termes de morts civils, le bombardement "conventionnel" de villes comme Tokyo, Hambourg et Dresde a été encore plus meurtrier.
L'utilisation de la bombe atomique par les États-Unis a ouvert de deux façons une nouvelle période. D'abord, cela a confirmé que le capitalisme était devenu un système de guerre permanente. Car si la bombe atomique marquait l'effondrement final des puissances de l'Axe, elle ouvrait aussi un nouveau front de guerre. La véritable cible derrière Hiroshima n'était pas le Japon qui était déjà à genoux et demandait des conditions pour sa reddition, mais l'URSS. C'était un avertissement pour que cette dernière modère ses ambitions impérialistes en Extrême-Orient et en Europe. En fait "les chefs d'état-major américains élaborèrent un plan de bombardement atomique des vingt principales villes soviétiques dans les dix semaines qui suivirent la fin de la guerre" (Walker, The Cold War and the making of the Modern World, cité par Hobsbawm, L'âge des extrêmes, p. 518). En d'autres termes, l'utilisation de la bombe atomique ne mit fin à la Seconde Guerre mondiale que pour établir les lignes de front de la troisième. Et elle a apporté une signification nouvelle et effrayante aux paroles de Rosa Luxemburg sur les "dernières conséquences" d'une période de guerres sans entraves. La bombe atomique démontrait que le système capitaliste avait maintenant la capacité de mettre fin à la vie humaine sur terre.
Les années 1914-1945 - que Hobsbawm appelle "l'ère des catastrophes" - confirment clairement que le diagnostic selon lequel le capitalisme était devenu un système social décadent - tout comme c'était arrivé à la Rome antique ou au féodalisme avant lui. Les révolutionnaires qui avaient survécu aux persécutions et à la démoralisation des années 1930 et 1940 et avaient maintenu des principes internationalistes contre les deux camps impérialistes avant et pendant la guerre, étaient très peu nombreux ; mais, pour la plupart d'entre eux, c'était une donnée définitive. Deux guerres mondiales et la menace immédiate d'une troisième ainsi qu'une crise économique mondiale d'une échelle sans précédent semblaient l'avoir confirmé une fois pour toutes.
Dans les décennies suivantes, cependant, des doutes commencèrent à sourdre. Il était sûr que l'humanité vivait désormais sous la menace permanente de son annihilation. Durant les 40 années suivantes, même si les deux nouveaux blocs impérialistes n'entraînèrent pas l'humanité dans une nouvelle guerre mondiale, ils demeurèrent en état de conflit et d'hostilité permanents, menant une série de guerres par procuration en Extrême-orient, au Moyen-Orient et en Afrique ; et, à plusieurs occasions, en particulier pendant la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, ils menèrent la planète au bord de la catastrophe. Une estimation approximative officielle fait état de 20 millions de morts, tués pendant ces guerres, et d'autres estimations sont bien plus élevées.
Ces guerres ravagèrent les régions sous-développées du monde et, durant la période d'après guerre, ces zones furent confrontées à des problèmes épouvantables de pauvreté et de malnutrition. Cependant, dans les principaux pays capitalistes, eut lieu un boom spectaculaire que les experts de la bourgeoisie appelèrent rétrospectivement les "Trente Glorieuses". Les taux de croissance égalaient ou dépassaient même ceux du 19e siècle, des augmentations de salaire avaient lieu régulièrement, des services sociaux et de santé furent institués sous la direction bienveillante des États… En 1960, en Grande-Bretagne, le député britannique Harold Macmillan disait à la classe ouvrière "La vie n'a jamais été aussi belle" et, chez les sociologues, de nouvelles théories florissaient sur la transformation du capitalisme en "société de consommation" dans laquelle la classe ouvrière s'était "embourgeoisée" grâce à un tapis roulant incessant de télévisions, machines à laver, voitures et vacances organisées. Pour beaucoup de gens, y compris certains dans le mouvement révolutionnaire, cette période infirmait l'idée selon laquelle le capitalisme était entré en décadence, et prouvait la capacité de ce dernier de se développer de façon quasi illimitée. Les théoriciens "radicaux" comme Marcuse commencèrent à chercher ailleurs que dans la classe ouvrière le sujet du changement révolutionnaire : chez les paysans du Tiers-monde ou les étudiants révoltés des centres capitalistes.
Une société en décomposition
Nous examinerons ailleurs les bases réelles de ce boom d'après-guerre et, en particulier, quels moyens le capitalisme en déclin a adoptés pour conjurer les conséquences immédiates de ses contradictions. Cependant, ceux qui déclaraient que le capitalisme avait fini par surmonter ses contradictions allaient se révéler être des empiristes superficiels, lorsque, à la fin des années 1960, les premiers symptômes d'une nouvelle crise économique apparurent dans les principaux pays occidentaux. Dès le milieu des années 1970, la maladie était déclarée : l'inflation commença à ravager les principales économies, incitant à abandonner les méthodes keynésiennes d'utilisation de l'État pour soutenir directement l'économie, méthodes qui avaient si bien fonctionné durant les décennies précédentes. Les années 1980 furent donc les années du Thatcherisme et des Reaganomics - politiques prônées par le premier ministre britannique, Margaret Thatcher et le président américain, Ronald Reagan - qui consistaient fondamentalement à laisser la crise atteindre son niveau réel et à abandonner les industries les plus faibles. L'inflation fut soignée par la récession. Depuis, nous avons traversé une série de mini-booms et de mini-récessions et le projet du Thatcherisme continue à exister au niveau idéologique dans les perspectives du néolibéralisme et des privatisations. Mais, malgré toute la rhétorique sur le retour aux valeurs économiques de l'époque de la reine Victoria sur la libre entreprise, le rôle de l'État capitaliste reste toujours aussi crucial ; ce dernier continue de manipuler la croissance économique au moyen de toutes sortes de manœuvres financières, toutes fondées sur une montagne croissante de dettes, symbolisées par dessus tout par le fait que les États-Unis - dont le développement de la puissance avait été marqué par le fait que, de débiteurs, ils étaient devenus créditeurs - croulent maintenant sous une dette supérieure à 36 000 milliards de dollars 1 "Cette montagne de dettes qui s'accumulent, non seulement au Japon mais aussi dans les autres pays développés, constitue un véritable baril de poudre potentiellement déstabilisateur à terme. Ainsi, une grossière estimation de l'endettement mondial pour l'ensemble des agents économiques (États, entreprises, ménages et banques) oscille entre 200 et 300`% du produit mondial. Concrètement, cela signifie deux choses : d'une part, que le système a avancé l'équivalent monétaire de la valeur de deux à trois fois le produit mondial pour pallier à la crise de surproduction rampante et, d'autre part, qu'il faudrait travailler deux à trois années pour rien si cette dette devait être remboursée du jour au lendemain. Si un endettement massif peut aujourd'hui encore être supporté par les économies développées, il est par contre en train d'étouffer un à un les pays dits "émergents". Cet endettement phénoménal au niveau mondial est historiquement sans précédent et exprime à la fois le niveau d'impasse dans lequel le système capitaliste s'est enfoncé mais aussi sa capacité à manipuler la loi de la valeur afin d'assurer sa pérennité." ("Crise économique : les oripeaux de la "prospérité économique" arrachés par la crise", Revue internationale n° 114, 3e trimestre 2003)
Et tandis que la bourgeoisie nous demande de faire confiance à toutes sortes de remèdes bidon comme "l'économie de l'information" ou autres "révolutions technologiques", la dépendance de l'ensemble de l'économie mondiale vis-à-vis de l'endettement voit s'accumuler les pressions souterraines qui auront fatalement des conséquences volcaniques dans le futur. Nous les entrevoyons de temps en temps : le moteur qui alimentait la croissance des "Tigres" et des "Dragons" asiatiques a calé en 1997 ; c'est peut-être l'exemple le plus significatif. Aujourd'hui, en 2007, on nous répète de nouveau que les taux de croissance spectaculaires que connaissent l'Inde et la Chine nous montrent le futur. Mais juste après, on a bien du mal à cacher la peur que tout ceci finira mal. La croissance de la Chine, après tout, se base sur des exportations bon marché vers l'Occident et la capacité de l'Occident à les consommer se base sur des dettes énormes… Aussi qu'arrivera-t-il quand les dettes devront être remboursées ? Et derrière la croissance alimentée par la dette des deux dernières décennies et plus, apparaît la fragilité de toute l'entreprise dans certains de ses aspects les plus ouvertement négatifs : la véritable désindustrialisation de pans entiers de l'économie occidentale, la création d'une multitude d'emplois improductifs et très souvent précaires, de plus en plus liés aux domaines les plus parasitaires de l'économie ; l'écart grandissant entre les riches et les pauvres, non seulement entre les pays capitalistes centraux et les régions les plus pauvres du monde, mais au sein même des économies les plus développées ; l'incapacité évidente à absorber véritablement la masse de chômeurs qui devient permanente et dont on cache la véritable ampleur par toute une série de tricheries (les stages qui ne mènent nulle part, les changements constants dans les modes de calcul du chômage, etc.).
Ainsi, sur le plan économique, le capitalisme n'a, en aucune façon, inversé son cours vers la catastrophe. Et il en va de même sur le plan impérialiste. Quand le bloc de l'Est s'est effondré à la fin des années 1980, mettant fin de façon spectaculaire à quatre décennies de "Guerre froide", le président des États-Unis, George Bush senior, a prononcé sa phrase célèbre où il annonçait l'ouverture d'un nouvel ordre mondial de paix et de prospérité. Mais comme le capitalisme décadent signifie la guerre permanente, la configuration des conflits impérialistes peut changer mais ils ne disparaissent pas. Nous l'avons vu en 1945 et nous le voyons depuis 1991. A la place du conflit relativement "discipliné" entre les deux blocs, nous assistons à une guerre bien plus chaotique de tous contre tous, avec la seule superpuissance restante, les États-Unis, qui a de plus en plus recours à la force militaire pour tenter d'imposer son autorité déclinante. Et pourtant, chaque déploiement de cette supériorité militaire incontestable n'est parvenu qu'à accélérer l'opposition à son hégémonie. Nous l'avons vu dès la première Guerre du Golfe en 1991 : bien que les États-Unis aient momentanément réussi à contraindre leurs anciens alliés, l'Allemagne et la France, à rallier leur croisade contre Saddam Hussein en Irak, les deux années suivantes ont montré clairement que l'ancienne discipline du bloc occidental avait disparu pour toujours : pendant les guerres qui ont ravagé les Balkans durant la décennie, l'Allemagne d'abord (à travers son soutien à la Croatie et à la Slovénie), puis la France (à travers son soutien à la Serbie tandis que les États-Unis décidaient de soutenir la Bosnie) se sont trouvées, dans les faits, à mener une guerre par procuration contre les États-Unis. Même le "lieutenant" des États-Unis, la Grande-Bretagne, s'est positionné à cette occasion dans le camp adverse et a soutenu la Serbie jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus empêcher l'offensive américaine et ses bombardements. La récente "guerre contre le terrorisme", préparée par la destruction des Twin Towers, le 11 septembre 2001, par un commando suicide très probablement manipulé par l'État américain (une autre expression de la barbarie du monde actuel) a exacerbé les divergences et la France, l'Allemagne et la Russie ont formé une coalition d'opposants à l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Les conséquences de l'invasion de l'Irak en 2003 ont été encore plus désastreuses. Loin de consolider le contrôle du Moyen-Orient par les États-Unis et de favoriser la "Full spectrum dominance", la domination technologique des États-Unis dont rêvent les Néo-conservateurs de l'Administration Bush et leurs adeptes, l'invasion a plongé toute la région dans le chaos avec une instabilité grandissante en Israël/Palestine, au Liban, en Iran, en Turquie, en Afghanistan et au Pakistan. Pendant ce temps, l'équilibre impérialiste était encore plus miné par l'émergence de nouvelles puissances nucléaires, l'Inde et le Pakistan ; il est possible que l'Iran en devienne une bientôt et ce dernier a de toutes façons largement accru ses ambitions impérialistes à la suite de la chute de son grand rival, l'Irak. L'équilibre impérialiste est aussi miné par la position hostile que prend la Russie de Poutine à l'égard de l'Occident, par le poids grandissant de l'impérialisme chinois dans les affaires mondiales, par la prolifération d'États en désagrégation et d'"États voyous" au Moyen-Orient, en Extrême-Orient et en Afrique, par l'extension du terrorisme islamiste à l'échelle mondiale, parfois au service de telle ou telle puissance mais, souvent, agissant comme puissance imprévisible en son propre nom… Depuis la fin de la Guerre froide, le monde n'est donc pas moins mais plus dangereux encore.
Et si tout au long du 20e siècle, des dangers dont la crise économique et la guerre impérialiste menaçaient la civilisation humaine n'ont fait que s'accroître, ce n'est qu'au cours des dernières décennies que s'est révélée une troisième dimension du désastre que le capitalisme réserve à l'humanité : la crise écologique. Ce mode de production, aiguillonné par une concurrence toujours plus fébrile à la recherche de la dernière opportunité de trouver un marché, doit continuer à s'étendre dans tous les recoins de la planète, à en piller les ressources à n'importe quel prix. Mais cette "croissance" frénétique se révèle de plus en plus être un cancer pour la planète Terre. Durant les deux dernières décennies, la population a peu à peu pris conscience de l'étendue de cette menace parce que, même si ce dont nous sommes témoins aujourd'hui est le point culminant d'un processus bien plus ancien, le problème commence à se poser à un niveau bien supérieur. La pollution de l'air, des rivières et des mers par les émissions de l'industrie et des transports, la destruction des forêts tropicales et de nombreux autres habitats sauvages ou la menace d'extinction d'espèces animales sans nombre atteignent des niveaux alarmants et viennent maintenant se combiner au problème du changement climatique qui menace de dévaster la civilisation humaine par une succession d'inondations, de sécheresses, de famines et de fléaux de tous ordres. Et le changement climatique lui-même peut déclencher une spirale croissante de désastres comme le reconnaît, entre autres, le célèbre physicien Stephen Hawking. Dans une interview à ABC News, en août 2006, il expliquait que "le danger est que le réchauffement global peut s'auto-alimenter s'il ne l'a déjà fait. La fonte des glaces des pôles de l'Arctique et de l'Antarctique réduit la part de l'énergie solaire qui est réfléchie dans l'espace et accroît encore la température. Le changement climatique peut détruire l'Amazonie et d'autres forêts tropicales et éliminer ainsi l'un des principaux moyens par lesquels le dioxyde de carbone de l'atmosphère est absorbé. La montée de la température des océans peut déclencher la libération de grandes quantités de méthane qui sont emprisonnées sous forme d'hydrates dans le fond des océans. Ces deux phénomènes augmenteraient l'effet de serre et accentueraient le réchauffement global. Il est urgent de renverser le réchauffement climatique si on le peut encore".
Les menaces économique, militaire et écologique ne constituent pas des aspects séparés - elles sont intimement liées. Surtout, il est évident que les nations capitalistes confrontées à la ruine économique et à des catastrophes écologiques ne subiront pas paisiblement leur propre désintégration mais seront poussées à adopter des solutions militaires aux dépens des autres nations.
Plus que jamais, l'alternative socialisme ou barbarie se pose à nous. Et tout comme, selon les termes de Rosa Luxemburg, la Première Guerre mondiale était déjà la barbarie, le danger qui menace l'humanité, et en particulier l'unique force qui peut la sauver, le prolétariat, est que ce dernier soit entraîné dans la barbarie croissante qui se répand sur la planète avant de pouvoir réagir et apporter sa propre solution.
La crise écologique pose très clairement ce danger : la lutte de classe prolétarienne ne peut guère l'influencer avant que le prolétariat n'ait pris le pouvoir et se trouve en position de réorganiser la production et la consommation à l'échelle mondiale. Et, plus la révolution tarde, plus s'accroît le danger que la destruction de l'environnement ne sape les bases matérielles de la transformation communiste. Mais il en va de même des effets sociaux qu'engendre la phase actuelle de la décadence. Dans les villes, il existe une tendance réelle à ce que la classe ouvrière perde son identité de classe et qu'une génération de jeunes prolétaires soit victime de la mentalité de bandes, d'idéologies irrationnelles et de désespoir nihiliste. Cela aussi contient le danger qu'il soit trop tard pour que le prolétariat se reconstitue comme force sociale révolutionnaire.
Pourtant, le prolétariat ne doit jamais oublier son véritable potentiel. Il est certain que la bourgeoisie, elle, en a toujours été consciente. Dans la période qui a mené à la Première Guerre mondiale, la classe dominante attendait avec anxiété la réponse qu'allait apporter la social-démocratie car elle savait très bien qu'elle ne pourrait contraindre les ouvriers à aller à la guerre sans le soutien actif de cette dernière. La défaite idéologique dénoncée par Rosa Luxemburg était la condition sine qua non pour déclencher la guerre ; et c'est la reprise des combats du prolétariat, à partir de 1916, qui allait y mettre un terme. A l'inverse, la défaite et la démoralisation après le reflux de la vague révolutionnaire ont ouvert le cours à la Deuxième Guerre mondiale, même s'il a fallu une longue période de répression et d'intoxication idéologique avant de pouvoir mobiliser la classe ouvrière pour ce nouveau carnage. Et la bourgeoisie était très consciente de la nécessité de mener des actions préventives pour éteindre tout danger d'une répétition de 1917 à la fin de la guerre. Cette "conscience de classe" de la bourgeoisie fut avant tout incarnée par le "Greatest Ever Briton", "le plus grand britannique de l'histoire", Winston Churchill, qui avait beaucoup appris du rôle qu'il avait joué pour étouffer la menace bolchevique en 1917-20. A la suite des grèves massives dans le Nord de l'Italie en 1943, c'est Churchill qui a formulé la politique de "laisser (les Italiens) mijoter dans leur jus", c'est-à-dire retarder l'arrivée des Alliés qui montaient du sud du pays pour permettre aux Nazis d'écraser les ouvriers italiens ; c'est aussi Churchill qui a le mieux compris la sinistre signification de la terreur des bombardements sur l'Allemagne dans la dernière phase de la guerre ; ils avaient pour but de détruire dans l'œuf toute possibilité de révolution là où la bourgeoisie en avait le plus peur.
La défaite mondiale et la contre-révolution durèrent quatre décennies. Mais ce n'était pas la fin de la lutte de classe comme certains avaient commencé à le penser. Avec le retour de la crise à la fin des années 1960, une nouvelle génération de prolétaires luttant pour leurs propres revendications réapparut : les "événements" de Mai 1968 en France auxquels on se réfère officiellement comme étant un "soulèvement étudiant", ne purent amener l'État français au bord de l'abîme que parce que la révolte dans les universités fut accompagnée de la plus grande grève générale de l'histoire. Dans les années qui ont suivi, l'Italie, l'Argentine, la Pologne, l'Espagne, la Grande-Bretagne et beaucoup d'autres pays connurent à leur tour des mouvements massifs de la classe ouvrière, laissant souvent les représentants officiel du "Travail", les syndicats et les partis de gauche, à leur remorque. Les grèves "sauvages" devinrent la norme, en opposition à la mobilisation syndicale "disciplinée", et les ouvriers commencèrent à développer de nouvelles formes de lutte pour échapper à l'emprise paralysante des syndicats : les assemblées générales, les comités de grève élus, les délégations massives vers les autres lieux de travail. Dans de gigantesques grèves en Pologne, en 1980, les ouvriers utilisèrent ces moyens pour coordonner leur lutte à l'échelle du pays tout entier.
Les luttes de la période 1968-89 se terminèrent très souvent en défaites par rapport aux revendications mises en avant. Mais il est sûr que si elles n'avaient pas eu lieu, la bourgeoisie aurait eu les mains libres pour imposer une attaque bien plus grande contre les conditions de vie de la classe ouvrière, surtout dans les pays avancés du système. Et, surtout, le refus du prolétariat de payer les effets de la crise capitaliste signifiait également qu'il n'accepterait pas de se laisser embrigader sans résistance dans une nouvelle guerre, même si la réapparition de la crise avait aiguisé de façon sensible les tensions entre les deux grands blocs impérialistes à partir des années 1970 et, en particulier, dans les années 1980. La guerre impérialiste est une donnée implicite de la crise économique du capitalisme, même si elle ne constitue pas une "solution" à celle-ci mais une plongée encore plus profonde dans la désagrégation de ce système. Mais pour aller à la guerre, la bourgeoisie doit disposer d'un prolétariat soumis et idéologiquement loyal, et cela, elle ne l'avait pas. Peut-être que c'est dans le bloc de l'Est qu'on pouvait le voir le plus clairement : la bourgeoisie russe, la plus poussée vers une solution militaire par l'effondrement économique et l'encerclement militaire croissants, en vint à réaliser qu'elle ne pouvait s'appuyer sur son prolétariat comme chair à canon dans une guerre contre l'Occident, en particulier après la grève de masse en Pologne en 1980. C'est cette impasse qui, en bonne partie, mena à l'implosion du bloc de l'Est en 1989-91.
Le prolétariat, cependant, fut incapable de développer sa propre solution authentique aux contradictions du système : la perspective d'une nouvelle société. Il est sûr que Mai 1968 a posé cette question à une échelle massive et a donné naissance à une nouvelle génération de révolutionnaires, mais ces derniers restèrent une infime minorité. Face à l'aggravation de la crise économique, la grande majorité des luttes ouvrières des années 1970 et 80 ne restèrent qu'à un niveau économique défensif et des décennies de désillusionnement envers les partis "traditionnels" de gauche ont répandu dans les rangs de la classe ouvrière une profonde méfiance vis-à-vis de "la politique" quelle qu'elle soit.
Ainsi, il y eut une sorte de blocage dans la lutte entre les classes : la bourgeoisie n'avait aucun avenir à offrir à l'humanité, et le prolétariat n'avait pas encore redécouvert son propre futur. Mais la crise du système ne reste pas immobile et le résultat du blocage est une décomposition croissante de la société à tous les niveaux. Sur le plan impérialiste, cela a abouti à la désintégration des deux blocs impérialistes et de ce fait, la perspective d'une guerre mondiale a disparu pour une période indéterminée. Mais comme nous l'avons vu, maintenant le prolétariat et l'humanité sont exposés à un nouveau danger, une sorte de barbarie rampante qui, sous beaucoup d'aspects, est encore plus pernicieuse.
L'humanité se trouve donc à la croisée des chemins. Les années et les décennies devant nous peuvent être cruciales pour toute son histoire parce qu'elles détermineront si la société humaine va plonger dans une régression sans précédent ou même arriver à son extinction totale ou bien si elle fera le saut vers un nouveau niveau d'organisation dans lequel l'humanité sera finalement capable de contrôler sa propre puissance sociale et de créer un monde en harmonie avec ses besoins.
Comme communistes, nous sommes convaincus qu'il n'est pas trop tard pour cette dernière alternative, que la classe ouvrière, malgré toutes les attaques économiques, politiques et idéologiques qu'elle a subies dans les dernières décennies, est toujours capable de résister et constitue encore la seule force qui puisse empêcher la descente dans l'abîme. En fait, depuis 2003, il y a eu un développement perceptible des luttes ouvrières à travers le monde ; et, au même moment, nous assistons à l'émergence de toute une nouvelle génération de groupes et d'éléments qui mettent en question les bases mêmes du système social actuel et qui cherchent sérieusement quelles sont les possibilités d'un changement fondamental. En d'autres termes, nous voyons les signes d'une véritable maturation de la conscience de classe.
Face à un monde plongé dans le chaos, ce ne sont pas les explications fausses à la crise actuelle qui manquent. Le fondamentalisme religieux, sous ses variantes chrétienne ou musulmane, ainsi que tout un panel d'explications occultistes ou conspiratrices de l'histoire, fleurissent aujourd'hui, précisément parce que les signes d'une fin apocalyptique de la civilisation mondiale sont de plus en plus difficiles à nier. Mais ces régressions vers la mythologie ne servent qu'à renforcer la passivité et le désespoir parce qu'elles subordonnent invariablement la capacité de l'homme à avoir une activité propre à lui aux décrets fatals de puissances régnant au-dessus de lui. L'expression la plus caractéristique de ces cultes est bien les bombes humaines islamiques dont les actions sont la quintessence du désespoir, ou les évangélistes américains qui glorifient la guerre et la destruction écologique comme autant de jalons vers l'extase à venir. Et tandis que le "bons sens" bourgeois rationnel se rit des absurdités des fanatiques, il inclut dans ses moqueries tous ceux qui, pour les raisons les plus rationnelles et les plus scientifiques, sont de plus en plus convaincus que le système social actuel ne peut durer et ne durera pas toujours. Contre les invectives des religieux et le déni vide des bourgeois à l'optimisme facile, il est plus que jamais vital de développer une compréhension cohérente de ce que Rosa Luxemburg appelait "le dilemme de l'histoire". Et, comme elle, nous sommes convaincus qu'une telle compréhension ne trouve son fondement que dans la théorie révolutionnaire du prolétariat - dans le marxisme et la conception matérialiste de l'histoire.
Gerrard
Questions théoriques:
- Décadence [4]
Heritage de la Gauche Communiste:
Il y a soixante ans, une conférence de révolutionnaires internationalistes
- 3440 lectures
L’initiative
de la Conférence de 1947 revient au Communistenbond
"Spartacus" de Hollande, un groupe "communiste de
conseils" qui avait survécu à la guerre de 1939-45
malgré une répression féroce lors de sa
participation dans les mouvements ouvriers sous l’occupation. 3
La Conférence elle-même se tient à un moment
terriblement sombre pour les trop rares révolutionnaires qui
sont restés fidèles aux principes de
l’internationalisme prolétarien et ont refusé de se
battre pour la défense de la démocratie bourgeoise et
de la "patrie socialiste" de Staline. En 1943, une vague de
grèves en Italie du Nord avait ranimé les espoirs de
voir la Deuxième Guerre mondiale finir comme la Première :
avec un soulèvement ouvrier qui se répandrait de pays
en pays et qui pourrait, cette fois, non seulement mettre fin à
la guerre mais ouvrir la voie à une nouvelle révolution
prolétarienne qui balayerait le capitalisme et son cortège
d’horreurs une fois pour toutes. Mais la bourgeoisie avait tiré
les leçons de l’expérience de 1917 et la Deuxième
Guerre mondiale se termina par l’écrasement systématique
du prolétariat avant même qu’il ait pu se soulever :
la répression sanglante déchaînée par
l’occupant allemand contre les quartiers ouvriers italiens ;
l'écrasement par l’armée allemande du soulèvement
de la ville de Varsovie sous l’œil "bienveillant" de son
adversaire soviétique 4 ;
le bombardement massif des quartier ouvriers en Allemagne par
l’aviation américaine et britannique, n’en sont que
quelques exemples. La GCF a compris que dans cette période, la
voie à la révolution n’était plus ouverte dans
l’immédiat : comme elle l’écrit en réponse
au Communistenbond dans une lettre de préparation à la
Conférence :
"Il était naturel, quelque part, que la monstruosité de la guerre ouvrît les yeux et fît ressurgir de nouveaux militants révolutionnaires. C’est ainsi qu’en 1945 se sont formés, un peu partout, des petits groupes qui, malgré l’inévitable confusion et leur immaturité politique, présentaient néanmoins dans leur orientation des éléments sincères tendant à la reconstruction du mouvement révolutionnaire du prolétariat.
La deuxième guerre ne s’est pas soldée comme la première par une vague de luttes révolutionnaires de classe. Au contraire. Après quelques faibles tentatives, le prolétariat a essuyé une désastreuse défaite, ouvrant un cours général réactionnaire dans le monde. Dans ces conditions, les faibles groupes qui ont surgi au dernier moment de la guerre risquent d’être emportés et disloqués. Ce processus peut déjà être constaté par l’affaiblissement de ces groupes un peu partout et par la disparition de certains autres, comme celle du groupe des "Communistes révolutionnaires" en France". 5
La GCF n’avait aucune illusion sur les possibilités ouvertes par la Conférence : "Dans une période comme la nôtre de réaction et de recul, il ne peut être question de constituer des partis et une Internationale – comme le font les trotskistes et consort – car le bluff de telles constructions artificielles n’a jamais servi qu’a embrouiller un peu plus le cerveau des ouvriers" (ibid). Ce n’est pas pour autant qu’elle considéra la Conférence comme inutile ; au contraire, il s’agissait de la survie même des groupes internationalistes : "Aucun groupe ne possède en exclusivité la 'vérité absolue et éternelle' et aucun groupe ne saurait résister par lui-même et isolément à la pression du terrible cours actuel. L’existence organique des groupes et leur développement idéologique sont directement conditionnés par les liaisons inter-groupes qu’ils sauraient établir et par l’échange de vues, la confrontation des idées, la discussion qu’ils sauraient entretenir et développer à l’échelle internationale.
Cette tâche nous paraît être de la première importance pour les militants à l’heure présente et c’est pourquoi nous nous sommes prononcés et sommes décidés à œuvrer et à soutenir tout effort tendant à l’établissement de contacts, à multiplier des rencontres et des correspondances élargies." (Ibid.)
Le contexte historique
L'importance de cette conférence tient au moins en ceci qu’elle était la première rencontre internationale de révolutionnaires après six années terribles de guerre, de répression et d’isolement. Mais, en fin de compte, le contexte historique – la "période de réaction et de recul" – a eu le dessus sur l’initiative de 1947. La conférence n’a guère connu de suite. En octobre 1947, la GCF a écrit au Communistenbond pour lui demander de prendre en charge une nouvelle conférence ainsi que l’édition d’un bulletin de discussion préparatoire, dont un seul numéro sera publié ; la deuxième conférence ne s’est jamais tenue. Dans les années qui ont suivi, la plupart des groupes participants ont disparu, y compris la GCF réduite à quelques camarades isolés qui maintenaient tant bien que mal des contacts épistolaires. 6
Aujourd’hui, le contexte historique est très différent. Après des années de contre-révolution, la vague mondiale de luttes qui a suivi mai 1968 en France a marqué le retour sur la scène historique de la classe révolutionnaire. Les luttes n’ont pas réussi à se hisser au niveau exigé par la profondeur des attaques du capitalisme notamment pendant les années 1980. Ensuite elles ont connu un arrêt brutal avec l’effondrement du bloc de l’Est en 1989, suivi d'une période très difficile de déboussolement et de découragement pour le prolétariat et ses minorités révolutionnaires pendant les années 1990. Mais avec le nouveau millénaire, les choses bougent de nouveau : d’un côté les dernières années ont vu un développement des luttes ouvrières qui mettent de plus en plus en avant la question fondamentale de la solidarité. Parallèlement, la présence des groupes invités au congrès du CCI témoigne d’une évolution appelée à s'amplifier dans le futur, et qui consiste dans le développement d’une réflexion politique véritablement mondiale parmi des petites minorités qui se réclament d’une vision internationaliste et qui cherchent à nouer des contacts entre elles.
Dans cette situation, l’expérience de 1947 reste vivante et actuelle. Comme une graine restée cachée dans le sol hivernal, elle porte une potentialité pour les internationalistes d’aujourd’hui. Dans cette courte introduction, nous voulons souligner les leçons principales que nous pensons devoir tirer de la Conférence et de la participation de la GCF à celle-ci.
Le besoin de critères d’adhésion
Depuis 1914 et la trahison des partis socialistes et des syndicats, encore plus dans les années 1930 quand les partis communistes ont emprunté la même voie, suivis par les groupes trotskystes en 1939, il existe une prolifération de groupes et de partis qui se réclament de la classe ouvrière mais dont la raison d’être n’est, en réalité, que de soutenir la domination de la classe capitaliste et de son État. Dans ce sens, la GCF écrit en 1947 : "Il ne s’agit pas de discussions en général, mais bien de rencontres qui permettent des discussions entre des groupes prolétariens révolutionnaires. Cela implique forcément des discriminations sur la base de critères politiques idéologiques. Il est absolument nécessaire, afin d’éviter des équivoques et afin de ne pas rester dans le vague de préciser autant que possible ces critères" (ibid). La GCF identifie quatre critères clés :
1. Exclusion du courant trotskyste du fait de son soutien à l’État russe et de sa participation de fait à la guerre impérialiste de 1939-45, du même côté que les puissances impérialistes démocratiques et staliniennes.
2. Exclusion des anarchistes (en l’occurrence la Fédération anarchiste française) ayant participé au "Frente Popular" et au gouvernement capitaliste républicain espagnol en 1936-38, ainsi qu’à la Résistance de 1939-45 sous le drapeau de l’anti-fascisme.
3. Exclusion de tous les autres groupes qui, sous un prétexte ou un autre, ont participé à la Deuxième Guerre mondiale.
4. Reconnaissance de la nécessité de "la destruction violente de l’État capitaliste" et, en ce sens, de la signification historique de la révolution d’octobre 1917.
Suite à la conférence, les critères proposés dans la lettre d’octobre 1947 de la GCF se résument à deux :
1. La volonté d’œuvrer et de lutter en vue de la révolution du prolétariat, par la destruction violente de l’État capitaliste pour l’instauration du socialisme.
2. La condamnation de toute acceptation ou participation à la Seconde Guerre impérialiste avec tout ce qu’elle a pu comporter de corruption idéologique de la classe ouvrière, telles les idéologies fascistes et anti-fascistes ainsi que leurs appendices nationaux : le maquis, les libérations nationales et coloniales, leur aspect politique : la défense de l’URSS, des démocraties, du national socialisme européen.
Comme on peut voir, ces critères se centrent sur les deux questions de la guerre et de la révolution et, à notre avis, ils restent entièrement d’actualité aujourd’hui. 7 Par contre, ce qui a changé, c’est le contexte historique dans lequel elles sont posées. Pour les générations qui viennent à la politique aujourd’hui, la Deuxième Guerre mondiale et la révolution russe sont des évènements lointains qu’on connaît à peine à partir des livres d’histoire. Ces questions restent critiques pour l’avenir révolutionnaire de la classe ouvrière et déterminantes pour un engagement profond dans la voie révolutionnaire. Cependant, la problématique de la guerre est aujourd’hui posée aux générations actuelles à travers la nécessaire dénonciation de toutes les guerres qui prolifèrent sur la planète : Irak, conflit israélo-arabe, Tchétchénie, essais nucléaire en Corée du Nord, etc. ; dans l’immédiat, la question de la révolution se pose plus à travers la dénonciation des simulacres de "révolution" à la Chavez que par rapport à la révolution russe.
De même, il n'existe plus aujourd'hui un danger fasciste à même d'embrigader massivement la classe ouvrière en vue d'un conflit impérialiste même si, dans certains pays (notamment de l'ex bloc de l'Est), des bandes fascisantes, plus ou moins pilotées par les officines de l’État, sèment la terreur dans la population et posent un réel problème pour les révolutionnaires. De ce fait, l'anti-fascisme ne peut, dans les circonstances actuelles, constituer un des principaux moyens d’embrigadement idéologique du prolétariat, comme lors de la guerre de 1939-45, derrière la défense de l'État "démocratique" bourgeois, même si cette idéologie continue à être utilisée contre le prolétariat pour tenter de le dévier de la défense de ses intérêts de classe.
L’attitude par rapport à l’anarchisme
Une discussion importante, aussi bien lors de préparation de la Conférence que durant son déroulement, fut l’attitude à adopter par rapport à l’anarchisme. Pour la GCF, il est alors clair que "le mouvement anarchiste aussi bien que les trotskistes ou toute autre tendance qui a participé ou participe à la guerre impérialiste, au nom de la défense d’un pays (défense de la Russie) ou d’une forme de domination bourgeoise contre une autre (défense de la République et de la démocratie contre le fascisme) n’avait pas de place dans une conférence des groupes révolutionnaires". Cette position "fut soutenue par la majorité des participants". L’exclusion des groupes anarchistes est donc déterminée non pas par rapport au fait qu’ils se réclament de l’anarchisme, mais par rapport à leur attitude vis-à-vis de la guerre impérialiste. Cette précision, de la plus haute importance, se trouve en particulier illustrée par ce fait, relaté dans un "Rectificatif" au rapport publié dans Internationalisme n°24, que la Conférence fut présidée par un anarchiste.
L’hétérogénéité du courant anarchiste fait que, de nos jours, la question ne peut être posée de façon aussi simple. En effet, sous le même vocable "anarchiste" nous trouvons à la fois des groupes qui ne se distinguent des trotskistes que sur la question du "parti" alors qu’ils soutiennent toute la gamme des revendications de ces derniers (jusqu’au soutien à un État palestinien !), et des groupes véritablement internationalistes avec lesquels il est possible, pour les communistes, non seulement de discuter mais d’engager une activité commune sur une base internationaliste. 8 Il ne saurait être question, à notre avis, de rejeter aujourd’hui la discussion avec des groupes ou des individus du simple fait qu’ils se réclament de "l’anarchisme".
Quelques points supplémentaires
Nous voulons, enfin, souligner trois autres éléments significatifs :
- Le premier, c’est l’absence de toute déclaration ronflante et creuse émanant de la Conférence, laquelle a su rester modeste quant à son importance et à ses capacités. Cela ne veut pas dire que la GCF à l'époque rejetait toute possibilité d'adopter des positions communes, au contraire. Mais après 6 années de guerre, la conférence ne pouvait constituer qu'une première prise de contact dans laquelle, inévitablement "les discussions ne furent pas assez avancées pour permettre et justifier le vote de résolution quelconque". Les révolutionnaires d’aujourd’hui doivent savoir garder à la fois une vision claire de l'immensité de leurs responsabilités et, en même temps, une très grande modestie quant à leurs capacités et leurs moyens, et une compréhension du travail qui se profile devant eux.
- Le deuxième, c’est l’importance accordée à la discussion sur la question syndicale. Bien que, de notre point de vue, la question syndicale est aujourd'hui réglée depuis longtemps, ce n'était pas encore pleinement le cas pour la GCF qui en 1947, venait tout juste de s'approprier les positions des gauches hollandaise et allemande sur cette question. Mais, derrière la question syndicale, en 1947 comme aujourd'hui, se pose la question beaucoup plus large de "comment lutter". Ce problème de "comment lutter" et de l’attitude à adopter face aux syndicats est d’une actualité brûlante pour beaucoup d’ouvriers et de militants de par le monde aujourd’hui. 9
- Troisièmement, enfin, nous voulons répéter le passage que nous avons déjà cité au début de cet article : "Aucun groupe ne possède en exclusivité la "vérité absolue et éternelle" (…) L’existence organique des groupes et leur développement idéologique sont directement conditionnés par les liaisons inter-groupes qu’ils sauraient établir et par l’échange de vues, la confrontation des idées, la discussion qu’ils sauraient entretenir et développer à l’échelle internationale". Cela est bien notre devise pour les années à venir et c'est une des raisons pour laquelle le CCI s'est penché avec une grande attention sur la question de la culture du débat, notamment lors de son 17e congrès. 10
CCI, 6 janvier 2008
Une conférence
internationale
des groupements révolutionnaires
Les 25 et 26 Mai s’est réunie une Conférence Internationale de contact des groupements révolutionnaires. Ce ne fut pas uniquement pour des raisons de sécurité que cette Conférence ne fut pas annoncée à tambour battant à la mode stalinienne et socialiste. Les participants à la Conférence avaient profondément conscience de la terrible période de réaction que traverse présentement le prolétariat, et de leur propre isolement –inévitable en période de réaction sociale. Aussi ne se livrèrent-ils pas aux bluffs spectaculaires tant goûtés, d’ailleurs de fort mauvais goût, de tous les groupements trotskistes.
Cette Conférence ne s’est fixé aucun objectif concret immédiat, impossible à réaliser dans la situation présente, ni une formation artificielle d’Internationale, ni des proclamations incendiaires au prolétariat.
Elle n’avait uniquement pour but qu’une première prise de contact entre les groupes révolutionnaires dispersés, la confrontation de leurs idées respectives sur la situation présente et les perspectives de la lutte émancipatrice du prolétariat.
En prenant l’initiative de cette Conférence le Communistenbond "Spartacus" de Hollande (mieux connu sous le nom de Communistes de Conseils) 11 a rompu l’isolement néfaste dans lequel vivent la plupart des groupes révolutionnaires, et a rendu possible la clarification d’un certain nombres de questions.
Les Participants
Les groupes suivants furent représentés à la Conférence et ont pris part au débat :
- Hollande : le Communistenbond "Spartacus".
- Belgique : les groupes apparentés au "Spartacus" de Bruxelles et de Gand.
- France : La Gauche Communiste de France et le groupe du "Prolétaire".
- Suisse : le groupe "Lutte de classe".
En outre, quelques camarades révolutionnaires n’appartenant à aucun groupe participèrent, directement par leur présence ou par l’envoi d’interventions écrites, aux débats de la Conférence.
Notons encore une longue lettre du "Parti socialiste de Grande-Bretagne" adressée à la Conférence et dans laquelle il a expliqué longuement ses positions politiques particulières.
La FFGC a également fait parvenir une courte lettre dans laquelle elle souhaite "bon travail" à la Conférence mais à laquelle elle s’excuse de ne pouvoir participer à cause du manque de temps, d’occupations urgentes 12.
Le travail de la Conférence
L’ordre du jour suivant fut adopté comme plan de discussion à la Conférence
1. L’époque actuelle
2. Les formes nouvelles de lutte du prolétariat (des formes anciennes aux formes nouvelles)
3. Tâches et organisation de l’avant-garde révolutionnaire.
4. État - Dictature du prolétariat - Démocratie ouvrière.
5. Questions concrètes et conclusions (accord de solidarité internationale, contacts, informations internationales, etc.)
Cet ordre du jour s’est avéré bien trop chargé pour pouvoir être épuisé par cette première Conférence insuffisamment préparée et trop limitée par le temps. N’ont été effectivement abordés que les trois premiers points à l’ordre du jour. Chaque point a donné lieu à d’intéressants échanges de vues.
Il serait évidemment présomptueux de prétendre que cet échange de vues a abouti à une unanimité. Les participants à la Conférence n’ont jamais émis une telle prétention. Cependant on peut affirmer que les débats, parfois passionnés, ont révélé une plus grande communauté d’idées qu’on n'aurait pu le soupçonner.
Sur le premier point de l’ordre du jour comprenant l’analyse générale de l’époque présente du capitalisme, la majorité des interventions rejetait aussi bien les théories de Burnham sur l’éventualité d’une révolution et d'une société directoriales, que celle de la continuation de la société capitaliste par un développement possible de la production. L’époque présente fut définie comme étant celle du capitalisme décadent, de la crise permanente, trouvant dans le capitalisme d’État son expression structurelle et politique.
La question de savoir si les syndicats et la participation aux campagnes électorales en tant que forme d’organisation et d’action pouvaient encore être utilisés par le prolétariat dans la période présente a donné lieu à un débat animé et fort intéressant. Il est regrettable que les tendances qui préconisent encore ces formes de la lutte de classe -sans se rendre compte que ces formes dépassées et périmées ne peuvent exprimer aujourd’hui qu’un contenu anti-prolétarien-, et tout particulièrement le PCI d’Italie, ne furent pas présentes à la Conférence pour défendre leur position. Il y avait bien la Fraction belge et la Fédération autonome de Turin, mais la conviction de ces groupes dans cette politique qui était la leur récemment, est à ce point ébranlée et incertaine qu’ils ont préféré garder le silence sur ces points.
Le débat portait donc, non sur une défense possible du syndicalisme et de la participation électorale en tant que formes de lutte du prolétariat, mais exclusivement sur les raisons historiques, sur le pourquoi de l’impossibilité de l’utilisation de ces formes de lutte dans la période présente. Ainsi, des syndicats, le débat s’est élargi et la discussion a porté non spécialement sur la forme organisationnelle en général -qui, en somme, n’est qu’un aspect secondaire- mais a mis en question les objectifs qui les déterminent -la lutte pour des revendications économiques corporatistes et partielles, dans les conditions présentes du capitalisme décadent, ne peuvent être réalisés et encore moins servir de plateforme de mobilisation de la classe.
La question de Comités ou Conseils d’usines comme forme nouvelle d’organisation unitaire des ouvriers acquiert sa pleine signification et devient compréhensible en liaison étroite et inséparable avec les objectifs qui se posent aujourd’hui au prolétariat : les objectifs sont non de réformes économiques dans le cadre du régime capitaliste, mais de transformation sociale contre le régime capitaliste.
La troisième point ; les tâches et l’organisation de l’avant-garde révolutionnaire, qui posent les problèmes de la nécessité ou non de la constitution d’un parti politique de classe, du rôle de ce parti dans la lutte émancipatrice de la classe et des rapports entre la classe et le parti, n’a malheureusement pas pu être approfondi comme il aurait été souhaitable.
Une brève discussion n’a permis aux différentes tendances que d’exposer dans les grandes lignes leurs positions sur ce point. Tout le monde sentait pourtant qu’on touchait là une question décisive aussi bien pour un éventuel rapprochement des divers groupes révolutionnaires que pour l’avenir et les succès du prolétariat dans sa lutte pour la destruction de la société capitaliste et l’instauration du socialisme. Cette question, à notre avis fondamentale, n’a été qu’à peine effleurée et demandera encore des discussions pour l’approfondir et la préciser. Mais il est important de signaler que déjà à cette Conférence, il est apparu que si des divergences existaient sur l’importance du rôle d’une organisation des militants révolutionnaires conscients, les Communistes de Conseils pas plus que les autres ne niaient la nécessité même de l’existence d’une telle organisation, qu’on l’appelle Parti ou autrement, pour le triomphe final du socialisme. C’est là un point commun qu’on ne saurait trop souligner.
Le temps manquait à la Conférence pour aborder les autres points à l’ordre du jour. Une courte discussion très significative a eu encore lieu, vers la fin, sur la nature et la fonction du mouvement anarchiste. C’est à l’occasion de la discussion sur les groupes à inviter dans de prochaines conférences que nous avons pu mettre en évidence le rôle social-patriote du mouvement anarchiste, en dépit de sa phraséologie révolutionnaire creuse, dans la guerre de 1939-45, leur participation à la lutte partisane pour la "libération nationale et démocratique" en France, en Italie et actuellement encore en Espagne, suite logique de leur participation dans le Gouvernement bourgeois "républicain et antifasciste", et dans la guerre impérialiste en Espagne en 1936-38.
Notre position : que le mouvement anarchiste aussi bien que les trotskistes ou toute autre tendance qui a participé ou participe à la guerre impérialiste, au nom de la défense d’un pays (défense de la Russie) ou d’une forme de domination bourgeoise contre une autre (défense de la République et de la démocratie contre le fascisme) n’avait pas de place dans une conférence des groupes révolutionnaires, fut soutenue par la majorité des participants. Seul le représentant du "Prolétaire" se faisait l’avocat de l’invitation de certaines tendances non orthodoxes de l’anarchisme et du trotskisme.
Conclusion
La conférence s’est terminée comme nous l’avons dit sans avoir épuisé l’ordre du jour, sans avoir pris aucune décision pratique, et sans avoir voté de résolution d’aucune sorte. Il ne pouvait en être autrement. Cela, non pas tant comme le disaient certains camarades pour ne pas reproduire le cérémonial religieux de toute Conférence et consistant dans le vote final obligatoire de résolutions qui ne signifient pas grand-chose, mais à notre avis parce que les discussions ne furent pas suffisamment avancées pour permettre et justifier le vote d'une résolution quelconque.
"Alors, la Conférence ne fut qu’une réunion de discussion habituelle et ne présente pas autrement d’intérêt", penseront certains malins et sceptiques. Rien ne serait plus faux. Au contraire, nous considérons que la Conférence a eu un intérêt et que son importance ne manquera pas de se faire sentir à l’avenir sur les rapports entre les divers groupes révolutionnaires. Il faut se souvenir que depuis 20 ans ces groupes vivent isolés, cloisonnés, repliés sur eux-mêmes, ce qui a inévitablement produit chez chacun des tendances à un esprit de chapelle et de secte, que tant d’années d’isolement ont déterminé dans chaque groupe une façon de penser, de raisonner et de s’exprimer, qui le rend souvent incompréhensible aux autres groupes. C’est là non la moindre des raisons de tant de malentendus et d’incompréhensions entre les groupes. C’est surtout la nécessité de se rendre soi-même perméable aux idées et aux arguments des autres et de soumettre ses idées propres à la critique des autres. C’est là une condition essentielle de non encroûtement dogmatique et du continuel développement de la pensée révolutionnaire vivante- qui donne tout l’intérêt à ce genre de Conférence.
Le premier pas, le moins brillant mais le plus difficile, est fait. Tous les participants à la Conférence, y compris la Fraction Belge qui n’a consenti à participer qu’après bien des hésitations et beaucoup de scepticisme, ont exprimé leur satisfaction et se sont félicités de l’atmosphère fraternelle et de la discussion sérieuse. Tous ont également exprimé le vœu d’une convocation prochaine pour une nouvelle Conférence plus élargie et mieux préparée pour continuer le travail de clarification et de confrontation commune.
C’est là un résultat positif qui permet d’espérer qu’en persévérant dans cette voie, les militants et groupes révolutionnaires sauront dépasser le stade actuel de la dispersion et parviendront ainsi à œuvrer plus efficacement pour l’émancipation de leur classe qui a la mission de sauver l’humanité toute entière de la terrible destruction sanglante que prépare et dans laquelle l’entraîne le capitalisme décadent.
Marco.
Notes de la rédaction
1. Un "rectificatif" publié dans Internationalisme n°24 indique également la présence de la "Section autonome de Turin" du PCI (c'est-à-dire le Partito Comunista Internazionale et non pas le PC d’Italie, stalinien). La Section écrit entre autre pour corriger l’impression donnée dans le rapport à propos de certaines de ses positions : la Section "s’est déclarée autonome précisément pour des divergences sur la question électorale et sur la question clé de l’unité des forces révolutionnaires".
2. La soi-disante "Fraction française de la Gauche communiste" avait rompu avec la GCF sur des bases politiques peu claires qui devaient beaucoup plus à des griefs et à des ressentiments personnels qu'à des désaccords politiques de fond. Voir notre brochure La Gauche communiste de France pour plus de détails.
1 Voir la Revue Internationale n°130.
2 Les autres textes que nous citons dans cette introduction sont reproduits en entier dans notre brochure La Gauche communiste de France.
3 Voir notre livre La Gauche hollandaise, notamment l’avant-dernier chapitre. Le Communistenbond Spartacus trouve ses origines dans le "Marx-Lenin-Luxemburg Front" qui participa énergiquement dans la grève des ouvriers hollandais en 1941 contre la persécution des juifs par l’occupant allemand, et diffusait des tracts appelant à la fraternisation jusqu’à l’intérieur des casernes allemandes pendant la guerre.
4 Churchill dira qu’il fallait "laisser les italiens mijoter dans leur jus". Staline a stoppé plusieurs mois l'avance des armées soviétiques juste devant Varsovie, de l'autre côté de la Vistule, jusqu'à ce que la répression allemande soit terminée.
5 Publié dans Internationalisme n°23. Les mots en gras le sont dans l'original. Les "Communistes révolutionnaires" étaient un groupe dont les origines remontent aux RKD, un groupe de trotskystes autrichiens qui s’étaient réfugiés en France. Ils avaient été les seuls délégués à s’opposer à la fondation de la 4e Internationale, au congrès de Périgny en 1938, qu’il considéraient comme "aventuriste".
6 Ce n’est pas le lieu ici pour écrire l’histoire du Communistenbond Spartakus après la guerre (voir pour cela le dernier chapitre de notre livre La Gauche hollandaise). Nous nous limiterons ici à quelques faits marquants : très rapidement après la conférence de 1947, le Communistenbond prit un tournant nettement plus "conseilliste" dans la lignée de l’ancien GIC (Groepen van internationale communisten) sur le plan organisationnel. En 1964 le groupe scissionna pour former désormais le "Spartacusbond" et le groupe autour de la revue Daad en Gedachte ("Acte et Pensée") inspirée en particulier par Cajo Brendel. Le Spartacusbond tomba dans l’activisme après 1968 et finit par disparaître en 1980. Daad en Gedachte est allé au bout de la logique conseilliste, pour disparaître enfin en 1998 faute de rédacteurs pour la revue.
7 C’est la même démarche que nous avons adoptée en 1976 lorsque le groupe Battaglia Comunista a lancé un appel à des conférences de la Gauche communiste, mais sans y apposer le moindre critère discriminatoire de participation. Nous avons répondu positivement à l’appel tout en insistant : "Pour que cette initiative soit une réussite, pour qu’elle soit un véritable pas vers le rapprochement des révolutionnaires, il est vital d’établir clairement les critères politiques fondamentaux qui doivent servir de base et de cadre, pour que la discussion et l’affrontement des idées soient fructueux et constructifs" (voir "Un bluff opportuniste" dans la Revue Internationale n°40).
8 Le CCI par exemple, a engagé à plusieurs reprises des discussions et même un travail en commun avec le groupe anarcho-syndicaliste KRAS (rattaché à l'AIT) à Moscou.
9 Voir l’article de notre site Internet sur les luttes dans le MEPZA aux Philippines.
10 Voir notamment nos articles "17e congrès du CCI : un renforcement international du camp prolétarien" et "La culture du débat : une arme de la lutte de classe" dans les numéros 130 et 131 de la Revue Internationale.
11 Nous trouvons dans le Libertaire du 29 mai un article fantaisiste sur cette Conférence. L’auteur qui signe AP et qui passe dans le Libertaire pour le spécialiste en histoire du mouvement ouvrier communiste, prend vraiment trop de libertés avec l’histoire. Ainsi représente-t-il cette conférence – à laquelle il n’a pas assisté et dont il ne sait absolument rien- comme une Conférence des Communistes des Conseils alors que ces derniers, qui l’ont effectivement convoqués, participaient au même titre que toute autre tendance. AP ne se contente pas seulement de prendre de la liberté avec l’histoire du passé mais il se croit autorisé d’écrire au passé l’histoire à venir. A la manière de ces journalistes qui ont décrit à l’avance avec force détails la pendaison de Goering, sans supposer que ce dernier aurait le mauvais goût de se suicider à la dernière minute, l’historien du Libertaire AP annonce la participation à la conférence de groupes anarchistes alors qu’il n’en est rien. Il est exact que le Libertaire fut invité à assister, mais il s’est abstenu de venir et, à notre avis, avec raison. La participation des anarchistes au Gouvernement Républicain et à la guerre impérialiste en Espagne en 1936-38, la continuation de leur politique de collaboration de classe avec toutes les formations politiques bourgeoises espagnoles dans l’immigration, sous prétexte de lutte contre le fascisme et contre Franco, la participation idéologique et physique des anarchistes dans la "Résistance" contre l’occupation "étrangère" font d’eux, en tant que mouvement un courant absolument étranger à la lutte révolutionnaire du prolétariat. Le mouvement anarchiste n’avait donc pas sa place à cette Conférence et son invitation était, en tout état de cause, une erreur.
12 Les "occupations urgentes" de la FFGC dénotent bien son état d’esprit concernant les rapports avec les autres groupes révolutionnaires. De quoi souffre exactement la FFGC, du "manque de temps" ou du manque d’intérêt et de compréhension pour les contacts et les discussions entre groupes révolutionnaires ? A moins que ce ne soit son manque d’orientation politique suivie (à la fois pour et contre la participation aux élections, pour et contre le travail dans les syndicats, pour et contre la participation dans les comités antifascistes etc.) qui la gène à venir confronter ses positions avec celles des autres groupes.
Conscience et organisation:
Personnages:
- Marc Chirik [8]
Courants politiques:
Le communisme, l'entrée de l'humanité dans sa véritable histoire (VIII) : les problèmes de la période de transition
- 2564 lectures
L'article suivant a été publié pour la première fois dans Bilan n °37 (novembre-décembre 1936), publication théorique de la Fraction italienne de la Gauche communiste. C'est le quatrième article de la série "Les problèmes de la période de transition" réalisée par un camarade belge qui signait ses contributions "Mitchell". Les trois précédentes ont été publiées dans les trois derniers numéros de la Revue internationale.
Cet article prend pour point de départ la révolution prolétarienne en Russie considérée, non pas comme un schéma rigide applicable à toutes les expériences révolutionnaires futures, mais comme un laboratoire vivant de la guerre de classe, requerrant qu'en soient réalisées la critique et l'analyse en vue de fournir des leçons valables pour l'avenir. Comme la plupart des meilleurs travaux du marxisme, il se présente comme un débat polémique avec d'autres interprétations de cette expérience, qu'il considère inadéquates, dangereuses ou même franchement contre-révolutionnaires. Au sein de cette dernière catégorie, il range les arguments staliniens ("centristes", pour employer le terme quelque peu trompeur encore utilisé par la Gauche italienne à cette époque) selon lesquels le socialisme était en construction dans les limites de l'URSS. L'article ne s'étend pas longuement dans la réfutation de cette position puisqu'il suffit de montrer que la théorie du "socialisme en un seul pays" est incompatible avec le principe le plus fondamental de l'internationalisme et que la "construction du socialisme" en URSS requiert en pratique l'exploitation la plus féroce du prolétariat.
Plus consistantes sont les critiques faites par l'article aux points de vue défendus par l'Opposition trotskiste et qui partagent avec le stalinisme l'idée que l'État ouvrier en Russie prouverait sa supériorité par rapport aux régimes bourgeois en place en s'engageant dans une compétition économique avec eux. Évidemment, Mitchell souligne que le programme d'industrialisation rapide d'après 1928 était un plagia des mesures politiques de l'Opposition de gauche.
Pour Mitchell et la Gauche italienne, la révolution prolétarienne ne peut réellement engager une transformation économique dans un sens communiste qu'après avoir conquis le pouvoir politique à l'échelle mondiale. C'était donc une erreur de juger du succès ou de l'échec de la révolution en Russie sur la base des mesures politiques entreprises sur un plan économique. Au mieux, la victoire du prolétariat dans un seul pays pouvait seulement permettre un gain de temps sur un plan économique, toutes les énergies devant être canalisées dans l'extension politique de la révolution à d'autres pays. L'article est fortement critique à propos de toute notion selon laquelle des mesures relevant du "communisme de guerre" représenteraient une réelle avancée en direction de rapports sociaux communistes. Pour Mitchell, la disparition apparente de l'argent et la réquisition du grain par la force dans les années 1918-20 n'exprimaient rien de plus que la pression des nécessités contingentes sur le pouvoir prolétarien dans le contexte de la dure réalité de la guerre civile, et étaient accompagnées par une distorsion bureaucratique dangereuse de l'État soviétique. Selon le point de vue de Mitchell, il aurait été plus juste de considérer la NEP (Nouvelle Politique Économique) de 1921, en dépit de ses défauts, comme un modèle plus "normal" d'un régime économique de transition dans un seul pays.
L'aspect polémique du texte est également dirigé contre d'autres courants du mouvement révolutionnaire. L'article mène le débat avec Rosa Luxemburg qui avait critiqué la politique agraire des Bolcheviks en 1917 ("la terre aux paysans"). Selon Mitchell, Rosa avait sous-estimé la nécessité politique, comprise par les bolcheviks, de renforcer la dictature du prolétariat par le soutien des petits paysans en leur permettant de s'emparer des terres. L'article revient également sur la discussion avec les internationalistes hollandais du GIK que nous avions commentée dans l'article précédent de la Revue internationale. Dans ce texte, Mitchell défend l'idée que la focalisation exclusive des camarades hollandais sur le problème de la gestion de la production par les ouvriers conduit ces camarades à conclure de façon erronée que le principe du centralisme avait été la cause principale de la dégénérescence de la révolution et, dans le même temps, à évacuer totalement le problème de l'État de transition qui, dans la vision marxiste, est inévitable tant que les classes n'ont pas été abolies.
En conclusion de son article, lorsqu'il traite de "l'État prolétarien", Mitchell exprime à la fois les forces et les faiblesses du cadre d'analyse de la Gauche italienne. Mitchell réitère la conclusion principale de la Gauche italienne tirée de l'expérience russe, laquelle demeure pour nous une de ses contributions les plus importantes à la théorie marxiste : la compréhension du fait que l'État de transition est un mal inévitable que la classe ouvrière va devoir utiliser. Pour cette thèse, le prolétariat ne peut de ce fait pas s'identifier avec l'État de transition et va devoir maintenir une vigilance permanente afin de s'assurer qu'il ne se retourne pas contre lui comme ce faut le cas en Russie.
D'un autre côté, l'article révèle aussi certaines inconsistances au sein des positions de la Gauche italienne à l'époque. Sa conscience de la nécessité du parti communiste la conduit à défendre la notion de "dictature du parti", une vision contraire à la nécessité de l'indépendance du parti et des organes prolétariens vis-à-vis de l'État de transition. Et Mitchell insiste également sur le fait que l'État soviétique en Russie avait un caractère prolétarien, en dépit de son orientation contre-révolutionnaire, car il avait éliminé la propriété privée des moyens de production. Dans le même sens, il ne caractérise pas la bureaucratie en Russie comme nouvelle classe bourgeoise. Cette position, proche d'une certaine manière de l'analyse développée par Trotski, ne conduisait cependant pas aux mêmes conclusions politiques : contrairement au courant trotskiste, la Gauche italienne plaçait les intérêts internationaux de la classe ouvrière avant toute autre considération et rejetait toute défense de l'URSS dont elle comprenait déjà qu'elle était intégrée dans le jeu sordide de l'impérialisme mondial. De plus, on peut déjà trouver dans l'article de Mitchell des éléments qui auraient certainement permis à la Gauche italienne de parvenir à une caractérisation plus consistante du régime stalinien. Ainsi, dans une partie précédente de son article, Mitchell met en garde contre le fait que les "collectivisations" ou les nationalisations ne constituent, en elles-mêmes, en rien des mesures socialistes, en citant même un passage d'Engels d'une grande prescience sur le capitalisme d'État. Cela prit quelques années et quelques débats approfondis pour que ces inconsistances soient résolues par la Gauche italienne, en partie à travers la discussion avec d'autres courants révolutionnaires tels que la Gauche germano-hollandaise. Néanmoins, l'article fournit la preuve de la profondeur et de la rigueur de l'approche de la Gauche italienne concernant l'enrichissement du programme communiste.
Bilan n°37 (novembre - décembre 1936)
Quelques données pour une gestion prolétarienne
La Révolution russe d'octobre 1917, dans l'Histoire, doit être incontestablement considérée comme une révolution prolétarienne parce qu'elle a détruit un État capitaliste de fond en comble et qu'à la domination bourgeoise elle a substitué la première dictature achevée du prolétariat 1 (la Commune de Paris n'ayant créé que les prémices de cette dictature). C'est à ce titre qu'elle doit être analysée par les marxistes, c'est-à-dire en tant qu'expérience progressive (en dépit de son évolution contre-révolutionnaire), en tant que jalon sur la route qui mène à l'émancipation du prolétariat comme de l'humanité toute entière.
Conditions matérielles et politiques de la révolution prolétarienne
De l'amas considérable des matériaux accumulés par cet événement gigantesque, des directives définitives — dans l'état actuel des recherches — ne peuvent pas encore être dégagées pour une sûre orientation des futures révolutions prolétariennes. Mais une confrontation de certaines notions théoriques, de certaines inductions marxistes avec la réalité historique, permet d'aboutir à une première conclusion fondamentale que les problèmes complexes qui relèvent de la construction de la société sans classes doivent être indissolublement liés à un ensemble de principes fondés sur l'universalité de la société bourgeoise et de ses lois, sur la prédominance de la lutte internationale des classes.
D'autre part, la première révolution prolétarienne n'a pas, selon la perspective tracée, explosé dans les pays les plus riches et les plus évolués matériellement et culturellement, dans les pays "mûrs" pour le socialisme, mais dans un secteur retardataire, semi féodal du capitalisme. D'où la seconde conclusion — bien qu'elle ne soit pas absolue — que les conditions révolutionnaires les meilleures ont été réunies là où, à une déficience matérielle correspondait une moindre capacité de résistance de la classe dominante à la poussée des contradictions sociales. En d'autres termes, ce sont les facteurs politiques qui ont prévalu sur les facteurs matériels. Une telle affirmation, loin d'être en contradiction avec la thèse de Marx déterminant les conditions nécessaires à l'avènement d'une nouvelle société, ne fait qu'en souligner la signification profonde ainsi que nous l'avons déjà marqué dans le premier chapitre de cette étude.
La troisième conclusion, corollaire de la première, est que le problème essentiellement international de l'édification du socialisme — préface au communisme — ne peut être résolu dans le cadre d'un État prolétarien, mais sur la base d'un écrasement politique de la bourgeoisie mondiale, tout au moins dans les centres vitaux de sa domination, dans les pays les plus avancés.
S'il est indéniable qu'un prolétariat national ne peut aborder certaines tâches économiques qu'après avoir instauré sa propre domination, à plus forte raison, la construction du socialisme ne peut s'amorcer qu'après la destruction des États capitalistes les plus puissants, bien que la victoire d'un prolétariat "pauvre" puisse acquérir une immense portée, pourvu qu'elle soit intégrée dans la ligne de développement de la révolution mondiale. En d'autres termes, les tâches d'un prolétariat victorieux, par rapport à sa propre économie, sont subordonnées aux nécessités de la lutte internationale des classes.
Il est caractéristique de constater que, bien que tous les véritables marxistes aient rejeté la thèse du "socialisme en un seul pays", la plupart des critiques de la Révolution russe se sont surtout exercées sur les modalités de construction du socialisme, en partant de critères économiques et culturels plutôt que politiques, et en omettant de tirer à fond les conclusions logiques qui découlent de l'impossibilité du socialisme national.
Cependant, le problème est capital car la première expérience pratique de dictature du prolétariat doit contribuer, précisément, à dissiper les brumes qui enveloppaient encore la notion de socialisme. Et, en fait d'enseignements fondamentaux, la Révolution russe ne posa-t-elle pas — sous la forme la plus exacerbée, parce qu'étant l'expression d'une économie arriérée — la nécessité historique pour un État prolétarien, temporairement isolé, de limiter strictement son programme de construction économique ?
Le rapport de forces à l'échelle internationale détermine le rythme et les modalités de la construction du socialisme
La négation du "socialisme en un seul pays" ne peut signifier que ceci : qu'il ne s'agit pas pour l'État prolétarien d'orienter l'économie vers un développement productif qui engloberait toutes les activités de fabrication, qui répondrait aux besoins les plus variés, d'édifier, en somme, une économie intégrale qui, juxtaposée à d'autres économies semblables, constituerait le socialisme mondial. Il s'agit au maximum et seulement après le triomphe de la révolution mondiale, de développer les branches trouvant dans chaque économie nationale leur terrain spécifique et qui sont appelées à s’intégrer dans le communisme futur (le capitalisme a déjà, imparfaitement il est vrai, réalisé cela par la division internationale du travail). Avec la perspective moins favorable d'un ralentissement du mouvement révolutionnaire (situation de la Russie en 1920-21) il s'agit [remplace un mot manquant dans l'original – ndlr] d'adapter le processus de l'économie prolétarienne au rythme de la lutte mondiale des classes, mais toujours dans le sens d'un renforcement de la domination de classe du prolétariat, point d'appui pour le nouvel afflux révolutionnaire du prolétariat international.
Trotski, notamment, a souvent perdu de vue cette ligne fondamentale, bien qu'il n'ait pas manqué, quelquefois, d'assigner aux objectifs prolétariens, non la réalisation du socialisme intégral, mais la préparation des éléments de l’économie socialiste mondiale, en fonction du renforcement politique de la dictature prolétarienne.
En effet, dans ses analyses du développement de l'économie soviétique et en partant de la base juste de la dépendance de cette économie du marché mondial capitaliste, Trotski, maintes fois, traita la question comme s'il s'agissait d'un "match" sur le plan économique, entre l'État prolétarien et le capitalisme mondial.
S'il est vrai que le socialisme ne peut affirmer sa supériorité comme système de production que s'il produit plus et mieux que le capitalisme, une telle vérification historique ne peut cependant s'établir qu'au terme d'un long processus se déroulant au sein de l'économie mondiale, au terme d'une lutte acharnée entre la bourgeoisie et le prolétariat, et non du choc de la confrontation d'une économie prolétarienne et de l’économie capitaliste, car il est certain que sur la base de la compétition économique, l'État prolétarien sera inévitablement acculé à devoir recourir aux méthodes capitalistes d'exploitation du travail qui l'empêcheront de transformer le contenu social de la production. Or, fondamentalement, la supériorité du socialisme ne peut résider dans la production à "meilleur marché" — bien que ce sera là une conséquence certaine de l'expansion illimitée de la productivité du travail — mais elle doit s'exprimer par la disparition de la contradiction capitaliste entre la production et la consommation.
Trotski nous parait avoir incontestablement fourni des armes théoriques à la politique du Centrisme en partant de critères tels que : "la course économique avec le capital mondial", "l'allure du développement comme facteur décisif"; la "comparaison des vitesses de développement", "le critérium du niveau d'avant guerre", etc., qui, tous, s'apparentent étroitement au mot d'ordre centriste : "rattraper les pays capitalistes". C'est pourquoi l'industrialisation monstrueuse qui a poussé dans la misère des ouvriers russes, si elle est le produit direct de la politique centriste, est aussi l'enfant "naturel" de l'opposition russe "Trotskiste". Cette position de Trotski résulte, d'ailleurs, des perspectives qu'il traça pour l'évolution capitaliste, après le recul de la lutte révolutionnaire internationale. C'est ainsi que toute son analyse de l'économie soviétique telle qu'elle évolua après la NEP fit, de son propre aveu, volontairement abstraction du facteur politique international : "il faut trouver les solutions pratiques du moment en tenant compte, autant que possible, de tous les facteurs dans leur conjonction instantanée. Mais quand il s’agit de la perspective du développement pour toute une époque, il faut absolument séparer les facteurs "saillants", c’est-à-dire, avant tout, le facteur politique" (Vers le Capitalisme ou vers le Socialisme). Une méthode d'analyse aussi arbitraire entraînait naturellement à considérer "en soi" les problèmes de gestion de l'économie soviétique plutôt qu'en fonction du déroulement du rapport mondial des classes.
La question que Lénine posait après la NEP : "lequel battra l'autre !" était ainsi transposée du terrain politique — où il l’avait placée — sur le terrain strictement économique. L'accent était mis sur la nécessité d'égaler les prix du marché mondial par la diminution des prix de revient (donc, en pratique, surtout du travail payé ou salaires). Ce qui revenait à dire que l'État prolétarien ne devait pas se borner à subir comme un mal inévitable une certaine exploitation de la force de travail, mais qu'il devait, par sa politique, favoriser [remplace le mot "sanctionner" dans l'original – ndlr] une exploitation plus grande encore en faisant de celle-ci un élément déterminant du processus économique acquérant ainsi un contenu capitaliste. En fin de compte, la question n’était-elle pas ramenée dans le cadre d’un socialisme national lorsqu'on envisageait la perspective de "vaincre la production capitaliste sur le marché mondial avec les produits de l'économie socialiste" (c’est à dire de l’URSS) et qu’on considérerait qu'il s'agissait là d'une "lutte du socialisme (!) contre le capitalisme" (?). Avec une telle perspective, il était évident que la bourgeoisie mondiale pouvait sereinement se rassurer sur le sort de son système de production.
Le communisme de guerre et la NEP
Nous voudrions ouvrir ici une parenthèse pour essayer d'établir la véritable signification théorique et historique de deux phases capitales de la Révolution Russe ; le "communisme de guerre" et la NEP. La première correspondant à la tension sociale extrême de la guerre civile, la seconde, à la substitution de la lutte armée et à une situation internationale de reflux de la révolution mondiale.
Cet examen nous parait d'autant plus nécessaire que ces deux phénomènes sociaux, indépendamment de leurs aspects contingents, peuvent fort bien réapparaître dans d'autres révolutions prolétariennes avec une intensité et un rythme correspondant, certes, en rapport inverse, au degré de développement capitaliste des pays en cause. Il importe donc de déterminer leur place exacte dans la période de transition.
Il est certain que le "communisme de guerre", version russe, ne sortit pas d'une gestion prolétarienne "normale" s’exerçant en vertu d'un programme préétabli, mais d'une nécessité politique correspondant à une poussée irrésistible de la lutte armée des classes. La théorie dut temporairement céder la place à la nécessite d'écraser politiquement la bourgeoisie ; c’est pourquoi l'économique se subordonna au politique, mais au prix de l'effondrement de la production et des échanges. Donc, en réalité, la politique du "communisme de guerre" entra progressivement en contradiction avec toutes les prémisses théoriques développées par les bolcheviks dans leur programme de la révolution, non pas que ce programme se fut révélé erroné, mais parce que sa modération même, fruit de la "raison économique" (contrôle, ouvrier, nationalisation des banques, capitalisme d'État) encouragea la bourgeoisie à la résistance armée. Les ouvriers ripostèrent par des expropriations massives et accélérées que des décrets de nationalisation ne durent que consacrer. Lénine ne manqua pas de jeter l'alarme contre ce "radicalisme" économique en prédisant qu’à cette allure le prolétariat serait vaincu. Effectivement, au printemps de 1921, les bolcheviks durent constater, non pas qu'ils étaient vaincus, mais qu'ils avaient échoué dans leur tentative bien involontaire de "prendre le socialisme d'assaut". Le "communisme de guerre" avait été essentiellement une mobilisation coercitive de l'appareil économique en vue d’éviter la famine du prolétariat et d’assurer le ravitaillement des combattants. Ce fut surtout un "communisme" de consommation ne contenant, sous sa forme égalitaire, aucune substance socialiste. La méthode de réquisition des excédents agricoles n'avait pu qu'abaisser considérablement la production : le nivellement des salaires avait fait s'effondrer la productivité du travail et le centralisme autoritaire et bureaucratique, imposé par les circonstances, ne fut qu'une déformation du centralisme rationnel. Quant à l'étouffement des échanges (auquel correspondit un épanouissement du marché clandestin) et la disparition pratique de la monnaie (payements en nature et gratuité des services), c'était là des phénomènes accompagnant, au sein de la guerre civile, l'effondrement de toute vie économique proprement dite, et non pas des mesures issues d'une gestion prolétarienne tenant compte des conditions historiques. En bref, le prolétariat russe paya l'écrasement en bloc de son ennemi de classe d'un appauvrissement économique que la révolution triomphante, dans des pays hautement développés, aurait considérablement atténué, même si elle n'aurait [remplace "n'avait" dans l'original – ndlr] pas modifié profondément la signification du "communisme de guerre", en aidant la Russie à "sauter" des phases de son développement.
Les marxistes n'ont jamais nié que la guerre civile — qu'elle précédât, accompagnât ou suivît la prise du pouvoir par le prolétariat — contribuerait à abaisser temporairement le niveau économique, car ils savent maintenant jusqu'à quel degré ce niveau peut descendre pendant la guerre impérialiste. C’est ainsi que, d'une part, dans les pays retardataires, la rapide dépossession politique d'une bourgeoisie organiquement faible fut et sera suivie d'une longue lutte désorganisatrice, si cette bourgeoisie conserve la possibilité d’épuiser des forces dans de larges couches sociales (en Russie, ce fut l'immense paysannerie, inculte et manquant d'expérience politique, qui les lui procura) ; d'autre part, dans les pays capitalistes développés où la bourgeoisie est politiquement et matériellement puissante, la victoire prolétarienne très probablement suivra — et non précédera — une phase plus ou moins longue d'une guerre civile, violente, acharnée, matériellement désastreuse tandis que la phase de "communisme de guerre" consécutive à la Révolution, pourra fort bien ne pas survenir.
La NEP, considérée sous l'angle absolu, et pour autant qu'on se borne à la placer brutalement en opposition avec le "communisme de guerre", apparaît incontestablement comme marquant un recul sérieux vers le capitalisme, au travers du retour au marché "libre", a la petite production "libre", à la monnaie.
Mais ce "recul" est rétabli sur ses véritables bases si nous nous rapportons aux considérations que nous avons émises en traitant des catégories économiques, c’est-à-dire, que nous devons caractériser la NEP (indépendamment de ses traits accentués et spécifiquement russes) comme un rétablissement de conditions "normales" d'évolution de l'économie transitoire et, pour la Russie, comme un retour au programme initial des bolcheviks, bien que la NEP se maintînt bien au delà de ce programme, après le passage du "rouleau compresseur" de la guerre civile.
La NEP, dégagée de ses aspects contingents est la forme de gestion économique à laquelle devra recourir toute autre révolution prolétarienne.
Telle est la conclusion qui s'impose à ceux qui ne subordonnent pas les possibilités de gestion prolétarienne à l'anéantissement préalable de toutes les catégories et formes capitalistes (idée qui procède de l'idéalisme et non du marxisme) mais font, au contraire, découler cette gestion de la survivance inévitable, mais temporaire, de certaines servitudes bourgeoises.
Il est vrai qu'en Russie, l'adoption d'une politique économique adaptée aux conditions historiques de transition du capitalisme au communisme se réalisa dans le plus lourd et le plus menaçant des climats sociaux, issu d'une situation internationale d'affaissement révolutionnaire et d'une détresse intérieure exprimée par la famine et l'épuisement total des masses ouvrières paysannes. C'est pourquoi, sous ses traits historiques et particuliers, la NEP russe dissimula sa signification générale.
Sous la pression même des événements, la NEP représenta la condition sine qua non du maintien de la dictature prolétarienne, qu'elle sauvegarda en effet. Pour cette raison, il ne pouvait être question de capitulation du prolétariat, lequel ne réalisa aucun compromis politique avec la bourgeoisie mais seulement une retraite économique de nature à faciliter le rétablissement de positions de départ pour une évolution progressive de l'économie. En réalité, la guerre des classes, en se déplaçant du terrain de la lutte armée sur celui de la lutte économique, en prenant d'autres formes, moins brutales, plus insidieuses, mais plus redoutables aussi, n'était nullement condamnée à s'atténuer, bien au contraire. Le point capital, pour le prolétariat, était de la conduire dans le sens de son propre renforcement et toujours en liaison avec les fluctuations de la lutte internationale. Dans son acceptation générale de la phase de la période transitoire, la NEP est génératrice d'agents de l’ennemi capitaliste, au même titre que l’économie de transition elle-même — pas davantage — dans la mesure donc où elle ne s'est pas maintenue sur une ferme ligne le classe. C'est encore et toujours la politique prolétarienne qui reste le facteur décisif. C'est [mot ajouté par la rédaction] sur cette base seulement que peut être analysée l'évolution de l'état soviétique. Nous y reviendrons.
Le programme économique d'une révolution prolétarienne
Dans les limites historiques assignées au programme économique d'une révolution prolétarienne, ses points fondamentaux peuvent être résumés comme suit : a) la collectivisation des moyens de production et d'échange déjà "socialisés" par le capitalisme ; b) la monopolisation du commerce extérieur par l'État prolétarien, arme économique d'une importance décisive ; c) un plan de production et de répartition des forces productives s’inspirant des caractéristiques structurelles de l'économie et de la fonction spécifique qu'elle sera appelée à exercer au sein de la division mondiale et sociale du travail, mais qui doit mettre en évidence la réalisation de normes vitales destinées à renforcer la position matérielle du prolétariat dans le processus économique et social ; d) un plan de liaison avec le marché capitaliste mondial, appuyé sur le monopole du commerce extérieur et visant à l'obtention des moyens de production et des objets de consommation déficients, et qui doit être subordonné au plan fondamental de production. Les deux directives essentielles devant être de contenir la pression et les fluctuations du marché mondial et d’empêcher l'intégration de l'économie prolétarienne à ce marché.
Il est évident que si la marche de réalisation d'un tel programme dépend, dans une certaine mesure, du degré de développement des forces productives et du niveau culturel des masses ouvrières, là se règle cependant essentiellement la puissance politique du prolétariat, la solidité de son pouvoir, le rapport des classes à l'échelle nationale et internationale sans qu'aucune dissociation puisse évidemment être faite entre facteurs matériels, culturels, politiques, qui s'interpénètrent étroitement. Mais nous répétons que, pour ce qui est par exemple du mode d'appropriation des richesses sociales, si la collectivisation est une mesure juridique aussi nécessaire à l'instauration du socialisme que le fut l'abolition de la propriété féodale à l'instauration du capitalisme, elle n'entraîne pas automatiquement le bouleversement du processus de la production. Engels nous avait déjà mis en garde contre cette tendance à considérer la propriété collective comme la panacée sociale, lorsqu'il montra qu'au sein de la société capitaliste "ni la transformation en sociétés par actions, ni la transformation en propriété d'État ne supprime la qualité de capital des forces productives. Pour les sociétés par actions, cela est évident. Et l'État moderne n'est à son tour que l'organisation que la société bourgeoise se donne pour maintenir les conditions extérieures générales du mode de production capitaliste contre des empiètements venant des ouvriers comme des capitalistes isolés. L'État moderne, quelle qu'en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l'État des capitalistes, le capitaliste collectif en idée. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble. Mais, arrivé à ce comble, il se renverse. La propriété d'État sur les forces productives n'est pas la solution du conflit, mais elle renferme en elle le moyen formel, la façon d'accrocher la solution". (Anti Duhring - Troisième partie : Socialisme ; notions théoriques). Et Engels ajoute que la solution consiste à saisir la nature et la fonction des forces sociales qui agissent sur les forces productives, pour ensuite les soumettre à la volonté de tous et transformer les moyens de production de "maîtres despotiques en serviteurs dociles".
Celte volonté collective, c'est évidemment le pouvoir politique du prolétariat qui peut seul la déterminer et faire que le caractère social de la propriété soit transformé, qu'elle perde son caractère de classe.
Les effets juridiques de la collectivisation peuvent d'ailleurs être singulièrement limités par une économie arriérée et celle-ci par conséquent, rend encore plus décisif le facteur politique.
En Russie il existait une masse énorme d'éléments capables d’engendrer une nouvelle accumulation capitaliste et une différentiation dangereuse des classes auxquelles le prolétariat ne pouvait parer que par la plus énergique des politiques de classe, seule capable de garder l’État pour la lutte prolétarienne.
Il est indéniable qu'avec le problème agraire, celui de la petite industrie constitue la pierre d’achoppement pour toute dictature prolétarienne, un lourd héritage que le capitalisme transmet au prolétariat et qui ne disparaît pas par simples décrets. On peut même affirmer que [mot ajouté par la rédaction] le problème central qui s'imposera à la révolution prolétarienne dans tout les pays capitalistes (sauf peut être en Angleterre), c'est la lutte la plus implacable contre les petits producteurs de marchandises et les petits paysans, lutte d'autant plus ardue qu'il ne pourra être question d'exproprier ces couches sociales par la violence. L'expropriation de la production privée n'est économiquement réalisable que par rapport aux entreprises qui sont déjà centralisées et "socialisées" et non par rapport aux entreprises individuelles que le prolétariat est encore incapable de gérer à moindres frais et de rendre plus productives, auxquelles donc il ne peut se relier et qu'il ne peut contrôler que par la voie du marché ; c'est là un truchement nécessaire pour organiser la transition du travail individuel au travail collectif. De plus, il est impossible d'envisager la structure de l'économie prolétarienne d'une manière abstraite, comme une juxtaposition de types de production à l'état pur, basés sur des rapports sociaux opposés, "socialistes", capitalistes ou précapitalistes et qui évolueraient uniquement sous l'action de la concurrence. C'est là la thèse du centrisme qui fut reprise de Boukharine qui considérait que tout ce qui était collectivisé devenait "ipso facto" socialiste et que par là, le secteur petit-bourgeois et paysan était inévitablement entraîné dans le giron du socialisme. Mais en réalité, chaque sphère de production porte plus ou moins profondément l'empreinte de son origine capitaliste et il n'y a donc pas juxtaposition, mais interpénétration d’éléments contradictoires qui se combattent sous la poussée d'une lutte des classes se développant avec encore plus d'acharnement, bien que sous des formes moins brutales que pendant la période de guerre civile ouverte. Dans cette bataille, le prolétariat, appuyé sur l'industrie collectivisée, doit avoir pour directive de soumettre à son contrôle, jusqu'à leur anéantissement total, toutes les forces économiques et sociales du capitalisme, déchu politiquement. Mais il ne peut commettre la mortelle erreur de croire que, parce qu'il a nationalisé la terre et les moyens de production fondamentaux, il a élevé un barrage infranchissable à l'activité des agents bourgeois : le processus, aussi bien politique qu'économique poursuit son cours dialectique et le prolétariat ne peut l'orienter vers la société sans classes qu’à la condition de se renforcer intérieurement comme extérieurement.
La question agraire
La question agraire est certainement une des données essentielles du problème complexe des rapports entre prolétariat et petite bourgeoisie tel qu'il se pose après la Révolution. Rosa Luxemburg marquait fort justement que même le prolétariat occidental au pouvoir, agissant dans les conditions les plus favorables dans ce domaine "se casserait plus d'une dent sur cette dure noix, avant, d'être seulement sorti des plus grosses parmi les mille difficultés complexes de cette besogne gigantesque."
Il n'est donc pas question pour nous de trancher ce problème, même dans ses lignes essentielles, et nous nous bornerons à en poser les éléments fondamentaux : la nationalisation intégrale du sol et la fusion de l'industrie et de l'agriculture.
La première mesure est un acte juridique parfaitement réalisable, immédiatement après la prise du pouvoir, parallèlement avec la collectivisation des grands moyens de production, tandis que la seconde ne peut être qu'un produit du processus d'ensemble de l'économie, un résultat qui s'intègre à l'organisation socialiste mondiale. Ce ne sont donc pas deux actes simultanés, mais échelonnés dans le temps, le premier conditionnant le second et les deux réunis, conditionnant la socialisation agraire. En soi, la nationalisation du sol ou abolition de la propriété privée n'est pas une mesure spécifiquement socialiste, mais avant tout bourgeoise, permettant de parachever la révolution bourgeoise démocratique.
Conjuguée avec la jouissance égale de la terre, elle constitue l'étape la plus révolutionnaire, la plus extrême de cette révolution, mais tout en étant donc, suivant l'expression de Lénine, "le fondement le plus parfait du point de vue du développement du capitalisme, elle est en même temps le régime agraire le plus souple pour le passage au socialisme". La faiblesse des critiques de R. Luxemburg à l'égard du programme agraire des bolcheviks (La Révolution russe) porte précisément sur les points suivants : en premier lieu, elle n'a pas souligné que "la prise immédiate de la terre par les paysans" tout en n'ayant absolument rien de commun avec une société socialiste — ce en quoi nous sommes parfaitement d'accord — représentait cependant une étape inévitable et transitoire (surtout en Russie) du capitalisme au socialisme, et bien qu'elle ait dû considérer que c'était "la formule la plus courte, la plus simple et la plus lapidaire pour atteindre un double but : briser la grande propriété et attacher du premier coup les paysans au gouvernement révolutionnaire et que, comme mesure politique pour la consolidation du gouvernement socialiste prolétarien, c'était une tactique de premier ordre", ce qui était évidemment l'élément fondamental de la situation. En second lieu, elle n'a pas mis en évidence que le mot d'ordre "la terre aux paysans", repris par les bolcheviks du programme des socialistes révolutionnaires avait été appliqué sur la base de la suppression intégrale de la propriété privée foncière et non pas, comme R. Luxemburg l'affirme, sur la base du passage de la grande propriété foncière à une multitude de petites propriétés paysannes individuelles. Il n'est pas juste de dire (il suffit de revoir les décrets sur la nationalisation) que le partage des terres s'est étendu aux grandes exploitations techniquement développées, puisque celles-ci ont au contraire, dans la suite, formé la structure des "sovkhozes" ; elles étaient, il est vrai, fort peu importantes par rapport à l'ensemble de l'économie agraire.
Remarquons, en passant, que R. Luxemburg en traçant son programme agraire, passait sous silence l'expropriation intégrale du sol qui faisait cependant place nette aux mesures ultérieures, tandis qu'elle visait uniquement la nationalisation de la grande et moyenne propriété.
Enfin, eu troisième lieu, R. Luxemburg s'est bornée à montrer les côtés négatifs du partage des terres (mal inévitable), à dénoncer qu'il ne pouvait supprimer "mais seulement accroître l'inégalité sociale et économique au sein de la paysannerie, y aggraver les oppositions de classes", alors que ce fut justement le développement de la lutte des classes à la campagne qui permit au pouvoir prolétarien de se consolider en attirant à lui les prolétaires et semi prolétaires paysans et que se forma la prémisse sociale qui, avec une ferme direction de la lutte, aurait étendu de plus en plus l'influence du prolétariat et assuré sa victoire à la campagne. R. Luxemburg sous-estima incontestablement cet aspect politique du problème agraire et le rôle fondamental qu'avait à jouer le prolétariat, s'appuyant sur la domination politique et la possession de la grande industrie.
Il serait vain de méconnaître que le prolétariat russe se trouvait devant des données extrêmement complexes. Du fait de la dispersion innombrable des petits paysans, les effets de la nationalisation se trouvèrent très limités. Il ne faut pas oublier que la collectivisation du sol n'entraîne pas nécessairement celle des moyens de production qui y sont [mots ajoutés par la rédaction] rattachés. Ce ne fut vrai en Russie que pour 8%. seulement de ces derniers tandis que 92% restèrent la possession privée des paysans alors que, par contre, dans l'industrie, la collectivisation atteignit 89% des forces productives, 97% en y ajoutant les chemins de fer, et 99% pour l'industrie lourde seule 2.
Bien que l'outillage agricole ne représentât qu'un peu plus du tiers de l'outillage total, il existait là une base étendue pour un développement favorable des rapports capitalistes, en tenant compte de la masse énorme des paysans. Et il est évident qu'au point de vue économique, l'objectif central capable de contenir et de résorber ce développement ne pouvait être que l'organisation de la grande production agricole industrialisée, à technique élevée. Mais cela était subordonné à l'industrialisation générale et, par conséquent, à l'aide prolétarienne des pays avancés. Pour ne pas se laisser enfermer dans le dilemme : périr ou apporter des outils et des objet de consommation aux petits paysans, le prolétariat — tout en faisant le maximum pour amener l'équilibre entre la production agricole et la production industrielle — avait donc à porter son effort principal sur le terrain de la lutte des classes à la campagne, aussi bien qu'à la ville, avec devant lui, toujours, la perspective du rattachement de cette lutte au moment révolutionnaire mondial. S'allier au paysan pauvre pour lutter contre le paysan capitaliste tout en poursuivant, l'anéantissement des petits producteurs, seule condition pour créer la production collective, voilà la tâche apparemment paradoxale qui s'imposait an prolétariat dans la politique au village.
Pour Lénine, cette alliance était seule capable de sauvegarder la révolution prolétarienne jusqu'à l'insurrection d'autres prolétariats, mais elle impliquait, non pas la capitulation du prolétariat devant la paysannerie, mais l’unique condition pour vaincre l'hésitation petite bourgeoisie des paysans oscillant entre la bourgeoisie et le prolétariat de par leur situation économique et sociale et leur incapacité de mener une politique indépendante, et finalement les entraîner dans le procès du travail collectif. "Anéantir" les petits producteurs ne signifie pas les écraser par la violence mais, comme le disait Lénine (en 1918) "les aider à aller jusqu'au capitalisme "idéal" car l'égalité dans la jouissance du sol, c'est le capitalisme porté à son idéal au point de vue du petit producteur ; en même temps, il faut leur faire toucher du doigt les côtés défectueux de ce système et la nécessité du passage à la culture collective." Il n'est pas étonnant que durant les trois années terribles de guerre civile, la méthode expérimentale n'ait pu éclairer la conscience "socialiste" des paysans russes. Si, pour garder la terre contre les bandes blanches, ils soutinrent le prolétariat, ce fut au prix de leur appauvrissement économique et des réquisitions, vitales pour l'État prolétarien.
Et la NEP, bien que rétablissant un champ d'expérience plus normal, dut aussi rétablir la "liberté et le capitalisme" mais ce fut surtout en faveur des paysans capitalistes, rançon énorme qui fit dire à Lénine qu'avec l'impôt en nature, "les koulaks allaient pousser là où ils ne pouvaient pousser auparavant". Sous la direction du centrisme, incapable de résister à cette pression de la bourgeoisie renaissante sur l'appareil économique, les organes étatiques et le parti, mais incitant au contraire les paysans moyens à l'enrichissement, rompant avec les paysans pauvres et le prolétariat, le résultat ne pouvait être que celui que nous connaissons. Coïncidence parfaitement logique : 10 ans après l'insurrection prolétarienne, le déplacement considérable du rapport des forces en faveur des éléments bourgeois correspondit à l'introduction des plans quinquennaux sur la réalisation desquels allait se greffer une exploitation inouïe du prolétariat.
La révolution russe a tenté de résoudre le problème complexe des rapports entre prolétariat et paysannerie. Elle a échoué non parce que, en l'occurrence, une révolution prolétarienne ne pouvait, parait-il, aboutir, et qu'on se trouvait uniquement en présence d'une révolution bourgeoise, ainsi que les Otto Bauer et autres Kautsky se sont plus à nous affirmer, mais parce que les bolcheviks n'étaient pas armés des principes de gestion fondés sur l'expérience historique, qui leur auraient assuré la victoire économique et politique.
Pour avoir exprimé et dégagé l'importance politique du problème agraire, la révolution russe représente toutefois un apport à la somme des acquisitions historiques du prolétariat mondial. Il faut ajouter que les thèses du 2e Congrès de l'I.C. sur cette question ne paraissent pas pouvoir être maintenues intégralement et que notamment le mot d'ordre de "la terre aux paysans" doit être réexaminé et restreint dans sa portée.
En s'inspirant des travaux de Marx sur la Commune de Paris et développés par Lénine, les marxistes ont réussi à faire la nette démarcation entre le centralisme exprimant la forme nécessaire et progressive de l'évolution sociale et ce centralisme oppressif cristallisé dans l'État bourgeois. Tout en s'appuyant sur le premier, ils luttèrent pour la destruction du second. C'est sur cette position matérialiste indestructible qu'ils ont vaincu scientifiquement l'idéologie anarchiste. Et pourtant, la révolution russe a fait rebondir cette célèbre controverse qui paraissait bien enterrée.
Maintes critiques qui s'en inspirèrent ont cru pouvoir rejeter la responsabilité de l'évolution contre-révolutionnaire de l’URSS, notamment sur le fait que le centralisme économique et social ne fut pas aboli en même temps que la machine étatique du capitalisme et remplacé par un sorte de système "d'auto détermination des masses ouvrières". C'était en somme exiger du prolétariat russe, pour ce qui était de sa conscience sociale, qu'il fît le saut par dessus la période transitoire, tout comme lorsqu'on préconisait la suppression de la valeur, du marché, des inégalités de salaires et autres scories bourgeoises. Autrement dit, c’était confondre deux notions du Centralisme, absolument opposées dans le temps, en même temps que rejoindre — qu’on le voulut ou non — l'opposition utopique des anarchistes à "l'autoritarisme" régissant toute la période transitoire (bien que sous des formes dégressives). Il est abstrait d’opposer le principe d'autonomie au principe d'autorité. Comme le faisait remarquer Engels, en 1873, ce sont des notions toutes relatives liées à l'évolution historique et au processus de la production.
Le centralisme économique et politique de la dictature du prolétariat
Sur la base d'une évolution qui va du communisme primitif, au capitalisme impérialiste et "retournera" au communisme civilisé, les formes organiques centralisées du "cartellisme" et de la "trustisation" capitalistes poussent sur l'autonomie sociale primitive pour se diriger vers "l’administration des choses", qui est bien l'organisation "anarchique" en dépit du fait que l'autorité y résistera quand même dans une certaine mesure, mais sera "restreinte aux seules limites à l'intérieur desquelles les conditions de la production la rendent inévitable" (Engels). L'essentiel est [mot illisible dans l'original et interprété par la rédaction] donc de ne pas vouloir brûler utopiquement les étapes, ni de croire qu'on a changé la nature du centralisme et le principe d'autorité lorsqu'on en aura changé le nom. Les internationalistes hollandais, par exemple, n'ont échappé ni à l'analyse fondée sur l'anticipation xxx [mot illisible dans l'original et ininterprétable ; ndlr] ni à la "commodité" théorique qu’une telle analyse assure (cf. leur ouvrage déjà cité, Essai sur le développement de la société communiste).
Leur critique du centralisme sur la base de l'expérience russe fut d'autant plus facile qu'elle s'attacha uniquement à [mot illisible dans l'original et interprété par la rédaction] la phase du "communisme de guerre" engendrant la dictature bureaucratique sur l'économie, alors que nous savons que, par après, la NEP favorisa, au contraire, une large "décentralisation" économique. Les bolcheviks auraient "voulu" supprimer le marché (nous savons qu'il n'en fut rien) en y substituant le Conseil économique supérieur et, ainsi, ils auraient porté [remplace "porteraient" dans l'original ; ndlr] la responsabilité d'avoir transformé la dictature du prolétariat en dictature sur le prolétariat. Donc pour les camarades hollandais, parce que en fonction des nécessités de la guerre civile le prolétariat russe dut s'imposer un appareil économique et politique centralisé et simplifié à l'extrême, il aurait perdu le contrôle de sa dictature alors que justement, dans le même temps, il exterminait politiquement la classe ennemie. A cet aspect politique de la question, qui pour nous est fondamental, les camarades hollandais ne se sont malheureusement pas attardés !
D'autre part, répudiant l'analyse dialectique en sautant l'obstacle du centralisme, ils en sont arrivés à se payer réellement de mots eu considérant non la période transitoire, la seule intéressant les marxistes du point de vue des solutions pratiques, mais la phase évoluée du communisme. Il est dès lors facile de parler d'une "comptabilité sociale générale en tant que centrale économique où affluent tous les courants de la vie économique, mais qui n'a pas la direction de l'administration ni le droit de disposition sur la production et la répartition qui n'a que la disposition d'elle-même" (!) (P 100/101.)
Et ils ajouteront que "dans l’association des producteurs libres et égaux, le contrôle de la vie économique n'émane pas de personnes ou d'instances mais résulte de l'enregistrement public du cours réel de la vie économique. Cela signifie : la production est contrôlée par la reproduction" (P. 135) ; autrement dit : "la vie économique se contrôle par elle-même au moyen du temps de production social moyen." (!)
Avec de telles formulations, les solutions relatives à la gestion prolétarienne ne peuvent évidemment avancer d'un pas, car la question brûlante qui se pose au prolétariat n'est pas de chercher à deviner le mécanisme de la société communiste, mais la voie qui y conduit.
Les camarades hollandais ont, il est vrai, proposé une solution immédiate : pas de centralisation économique ni politique qui ne peut revêtir que des formes oppressives, mais le transfert de la gestion aux organisations d'entreprises qui coordonnent la production au moyen d'une "loi économique générale". Pour eux, l'abolition de l'exploitation (donc des classes) ne paraît pas se réaliser dans un long processus historique, enregistrant une participation sans cesse croissante des masses à l'administration sociale, mais dans la collectivisation des moyens de production, pourvu que celle-ci implique pour les conseils d'entreprises le droit de disposer, et de ces moyens de production, et du produit social. Mais outre qu'il s'agit ici d'une formulation qui contient sa propre contradiction, puisqu'elle revient à opposer la collectivisation intégrale (propriété à tous, mais à personne en particulier) à une sorte de "collectivisation" restreinte, dispersée entre groupes sociaux (la société anonyme est aussi une forme partielle de collectivisation), elle ne tend tout simplement qu'à substituer une solution juridique (le droit de disposition des entreprises) à l'autre solution juridique qu'est l'expropriation de la bourgeoisie. Or, nous avons vu précédemment que cette expropriation de la bourgeoisie n'est que la condition initiale de la transformation sociale (encore que la collectivisation intégrale ne soit pas immédiatement réalisable), alors que la lutte des classes se poursuit, comme avant la Révolution, mais sur des hases politiques qui permettent au prolétariat de lui imprimer un cours décisif.
L'analyse des internationalistes hollandais s'éloigne incontestablement du marxisme parce qu'elle ne met jamais en évidence cette vérité, pourtant fondamentale, que le prolétariat est encore obligé de supporter le "fléau" de l'État jusqu'à la disparition des classes, c'est-à-dire jusqu’à l'abolition du capitalisme mondial. Mais souligner une telle nécessité historique, c'est admettre que les fonctions étatiques se confondent encore temporairement avec la centralisation, bien que celle-ci, sur la base de la destruction de la machine oppressive du capitalisme, ne s'oppose plus nécessairement au développement de la culture et de la capacité de gestion des masses ouvrières. Au lieu de rechercher la solution de ce développement dans les limites des données historiques et politiques, les internationalistes Hollandais ont cru la trouver dans une formule d'appropriation à la fois utopique et rétrograde qui, de plus, n'est pas aussi nettement opposée au "droit bourgeois" qu'ils pourraient se l'imaginer. De plus, si on admet que le prolétariat, dans son ensemble n'est nullement préparé culturellement à résoudre par "lui-même" les problèmes complexes de gestion sociale (et c'est une réalité s'appliquant au prolétariat le plus avancé comme au plus inculte) que vaut alors concrètement le "droit de disposition" sur les usines et la production qui lui serait "garanti" ?
Les ouvriers russes ont eu effectivement les usines en mains et ils n'ont pas pu les gérer. Cela signifie-t-il qu'ils n'avaient pas à exproprier les capitalistes ni à prendre le pouvoir ? Auraient-ils dû "attendre" d'avoir pu se mettre à l'école du capitalisme occidental, d'avoir acquis la culture de l'ouvrier anglais ou allemand ?... S'il est vrai que ceux-ci sont déjà cent fois plus aptes à affronter les tâches gigantesques de la gestion prolétarienne que ne l'était l'ouvrier russe en 1917, il est également vrai qu'il leur est impossible de forger, dans l'ambiance pestilentielle du capitalisme et de l'idéologie bourgeoise, une conscience sociale "intégrale" qui, pour leur permettre de résoudre "par eux-mêmes" tous les problèmes posés, devrait être celle-là même qu'ils posséderont seulement dans le communisme achevé. Historiquement, c'est le parti qui concentre cette conscience sociale et encore ne peut-il la développer que sur la base de l'expérience ; c'est-à-dire qu'il n'apporte pas des solutions toutes faites, mais qu'il les élabore au feu de la lutte sociale, après (surtout après) comme avant la Révolution. Et dans cette tâche colossale, loin de s'opposer au prolétariat, le parti se confond avec lui, parce que sans la collaboration active et grandissante des masses, il doit lui-même devenir la proie des forces ennemies. "L'administration par tous" est la pierre d'achoppement de toute révolution prolétarienne. Mais l'Histoire pose la seule alternative : ou bien nous commençons la révolution socialiste "avec les hommes tels qu'ils sont aujourd’hui et qui ne se passeront ni de subordination ni de contrôle ni de contremaître ni de comptables" (Lénine) ou bien la Révolution ne sera pas.
La dualité de l'Etat de la période de transition dans l'analyse marxiste
Au chapitre traitant de l'État transitoire, nous avions déjà rappelé que l'État doit son existence à la division de la société en classes. Dans le communisme primitif, il n'y avait pas d’État. Dans le communisme supérieur, il n'y en aura pas davantage. L'État disparaîtra avec l’objet qui l'a fait naître : l'exploitation de classe. Mais tant que l'État existe, quel qu'il soit il conserve ses traits spécifiques, il ne peut changer de nature et ne peut pas ne pas être l'État, c’est-à-dire un organisme oppressif, coercitif, corruptif. Ce qui change, dans le cours de l'Histoire, c’est sa fonction. Au lieu d’être l'instrument des maîtres d’esclaves, il sera celui des féodaux, puis celui de la bourgeoisie. Il sera l'instrument de fait de la conservation des privilèges de la classe dominante. Celle ci ne pourra donc être menacée par son propre État, mais par de nouveaux privilèges se développant au sein de la société au profit d’une classe montante. La révolution politique qui s'ensuivra sera la conséquence juridique d'une transformation de la structure économique déjà amorcée, triomphe de la nouvelle forme d’exploitation sur l'ancienne. C'est pourquoi la classe révolutionnaire, sur la base des conditions matérielles qu'elle aura fondées et consolidées au sein de l'ancienne société pendant des siècles pourra sans crainte ni méfiance, s'appuyer sur son État qui ne sera que le perfectionnement du précédent pour organiser et développer son système de production. Cela est d'autant plus vrai pour la classe bourgeoise qu’elle est la première classe dans l'histoire exerçant une domination mondiale et que son État concentre tout ce qu’une classe exploiteuse peut accumuler de moyens d'oppression. Il n'y a pas opposition mais collusion intime, indestructible entre la bourgeoisie et son État. Cette solidarité ne s'arrête pas à des frontières nationales, elle les déborde, parce qu’elle dépend de racines profondes dans le capitalisme international.
Au contraire, avec la fondation de l’État prolétarien, le rapport historique entre la classe dominante et l'État se trouve modifié. Il est vrai que l'État prolétarien, bâti sur les ruines de l’État bourgeois est cependant l'instrument de la domination du prolétariat. Cependant il ne se pose pas en défenseur de privilèges sociaux dont les bases matérielles auraient été jetées à l’intérieur de la société bourgeoise, mais en destructeur de tout privilège. Il exprime un nouveau rapport de domination (de la majorité sur la minorité) comme un nouveau rapport juridique (l'appropriation collective). Par contre, puisqu'il reste sous l'influence du climat de la société capitaliste (parce qu'il ne peut y avoir de simultanéité dans la révolution), il est encore représentatif "du droit bourgeois". Celui-ci vît toujours, non seulement dans le déroulement social et économique, mais dans le cerveau de millions de prolétaires. C’est ici que se révèle la dualité de l'État transitoire : d'une part, comme arme dirigée contre la classe expropriée, il révèle son côté "fort" ; d'autre part, comme organisme appelé, non pas à consolider un nouveau système d'exploitation mais à les abolir tous, il découvre son côté "faible" parce que, par nature et par définition, il tend à redevenir le pôle d'attraction des privilèges capitalistes. C'est pourquoi, alors qu'entre la bourgeoisie et l'État bourgeois il ne peut y avoir d'antagonisme, il en surgit un entre le prolétariat et l'État transitoire.
Ce problème historique trouve son expression négative dans le fait que l'État transitoire peut fort bien être amené à jouer un rôle contre-révolutionnaire dans la lutte internationale des classes, alors qu’il conserve le type prolétarien si les bases sociales sur lesquelles il a été édifié ne sont pas modifiées. Le prolétariat ne peut s'opposer au développement de cette contradiction latente que par la politique de classe de son parti et l'existence vigilante de ses organisations de masses (syndicats. soviets, etc.) au moyen desquelles il exercera un contrôle indispensable sur l'activité étatique et défendra ses intérêts spécifiques. Ces organisations ne pourront disparaître qu'avec la nécessité qui les a fait naître, c'est-à-dire la lutte des classes. Une telle conception s'inspire uniquement des enseignements marxistes, car la notion de l'antidote prolétarien dans l'État transitoire a été défendue par Marx et Engels aussi bien que par Lénine, ainsi que nous l'avons établi précédemment.
La présence agissante d'organismes prolétariens est la condition pour que l'État reste asservi au prolétariat et non le témoignage qu'il s'est retourné contre les ouvriers. Nier le dualisme contradictoire de l'État prolétarien, c'est fausser la signification historique de la période de transition.
Certains camarades considèrent, au contraire, que cette période doit exprimer l’identification des organisations ouvrières avec l'État (camarade Hennaut, Nature et évolution de l'État russe - Cf. Bilan, p. 1121 n° 34). Les internationalistes hollandais vont même plus loin lorsqu'ils disent que puisque "le temps de travail" est la mesure de la répartition du produit social et que la distribution entière reste en dehors de toute "politique", les syndicats n'ont plus aucune fonction dans le communisme et la lutte pour l'amélioration des conditions d'existence a cessé. (p. 115 de leur ouvrage.)
Le centrisme également est parti de cette conception que, puisque l'État soviétique était un État ouvrier, toute revendication des prolétaires devenait un acte d'hostilité envers "leur" État, justifiant ainsi l'assujettissement total des syndicats et comités d’usines au mécanisme étatique.
Si maintenant, sur la base des considérations qui précèdent, nous disons que l'État soviétique a conservé un caractère prolétarien, bien qu'il soit dirigé contre le prolétariat, s'agit-il là seulement d'une distinction subtile, n'ayant rien de commun avec la réalité et que nous-mêmes nous répudierons en rejetant la défense de l'URSS ? Non ! Et nous croyons que cette thèse doit être maintenue : en premier lieu parce qu'elle est juste du point de vue de la théorie du matérialisme historique ; en second lieu parce que les conclusions sur l'évolution de la Révolution russe que l'on peut en tirer ne sont pas viciées dans leurs prémisses du fait qu'est niée l'identification entre le prolétariat et l'État et qu'aucune confusion n'est créée entre le caractère de l'État et sa fonction.
Mais si l'État soviétique n'était plus un État prolétarien, que serait-il ? Les négateurs ne s'évertuent pas à faire la démonstration qu'il s'agit d'un État capitaliste, car ils s'y buteraient. Mais réussissent-ils mieux en parlant d'État bureaucratique et en découvrant en la bureaucratie russe une classe dominante tout à fait originale dans l'histoire, se rapportant aussi a un nouveau mode d'exploitation et de production. En vérité, une telle explication tourne le dos an matérialisme marxiste.
Bien que la bureaucratie ait été l'instrument indispensable au fonctionnement de tout système social, il n'existe aucune trace dans l'Histoire d'une couche sociale qui ne soit transformée en une classe exploiteuse, pour son propre compte. Les exemples abondent cependant de bureaucraties puissantes et omnipotentes au sein d'une société ; mais jamais elles ne se confondirent avec la classe agissant sur la production, si ce n'est sous des formes individuelles. Dans Le Capital, Marx, traitant de la colonisation aux Indes, montre que la bureaucratie y apparut sous les traits de la "Compagnie des Indes Orientales" ; que celle-ci eut des attaches économiques avec la circulation — non avec la production — tandis qu'elle exerça réellement le pouvoir politique, mais pour le compte du capitalisme métropolitain.
Le marxisme a fourni une définition scientifique de la classe. Si l'on s'y tient, il faut pouvoir affirmer que la bureaucratie russe n'est pas une classe, encore moins une classe dominante, étant donné qu'il n'existe pas de droits particuliers sur la production en dehors de la propriété privée des moyens de production et qu'en Russie, la collectivisation subsiste dans ses fondements. Il est bien vrai que la bureaucratie russe consomme une large portion du travail social : mais il en fut ainsi pour tout parasitisme social qu'il ne faut pas confondre pour cela avec l'exploitation de classe.
S'il est incontestable qu'en Russie, le rapport social exprime une exploitation colossale des ouvriers, celle-ci ne résulte pas de l'exercice d'un droit de propriété individuel ou de groupe, mais de tout un processus économique et politique dont la bureaucratie n'est même pas la cause, mais une manifestation, encore que secondaire d'après nous, tandis que cette évolution est le produit de la politique du centrisme qui se révéla incapable de contenir la poussée des forces ennemies à l'intérieur comme sur le terrain international. C’est ici que réside l'originalité du contenu social en Russie, due à une situation historique sans précédent : l'existence d'un État prolétarien au sein du monde capitaliste.
L'exploitation du prolétariat grandit dans la mesure où la pression des classes non prolétariennes s'exerça et s'accrut sur l'appareil étatique, puis sur l'appareil du parti, et par répercussion sur la politique du parti.
Il n'est nul besoin de justifier cette exploitation par l'existence d'une classe bureaucratique vers laquelle serait revenu le surtravail spolié aux ouvriers. Mais il faut l'expliquer par l'influence ennemie sur les déterminations du parti qui, par surcroît, s'intégrait dans le mécanisme étatique au lieu de poursuivre sa mission politique et éducative au sein des masses. Trotski (L’IC après Lénine) souligna le caractère de classe du joug pesant de plus en plus sur le parti : collusion unissant tous les gens de l’appareil du parti; soudure entre de nombreux chaînons de celui-ci d'une part et de la bureaucratie de l'État, les intellectuels bourgeois, la petite bourgeoisie, les koulaks d'autre part; pression de la bourgeoisie mondiale sur le mécanisme des forces agissantes. C'est pourquoi les racines de la bureaucratie et les germes de la dégénérescence politique sont à rechercher dans ce phénomène social d'interpénétration du parti et de l'État aussi bien que dans une situation internationale défavorable, et non dans le "communisme de guerre" qui porta la puissance politique du prolétariat à son plus haut niveau, pas plus que dans la NEP. Ce fut à la fois une expression des connivences et le régime normal de l'économie prolétarienne. Sauf que dans son Aperçu su le Bolchevisme, Souvarine renversa le rapport réel entre le parti et l’État en considérant que ce fut l’emprise mécanique de l'appareil du parti qui s'exerça sur tous les rouages de l’État. Il caractérisa très justement la révolution russe comme "une métamorphose du régime qui s'accomplit peu à peu à l’insu de ses bénéficiaires, sans aspect prémédité ni plan préconçu, par le triple effet de l'inculture générale, de l'apathie des masses épuisées et de l’effort des bolcheviks pour maîtriser le chaos" (p. 245).
Mais alors, si les révolutionnaires ne veulent pas sombrer dans un fatalisme qui serait aux antipodes du marxisme, "l'immaturité" des conditions matérielles et de "l'incapacité" culturelle des masses, ils ne veulent pas déduire que la révolution russe ne fut pas une révolution prolétarienne (alors que les conditions historiques et objectives existaient et existent toujours sur le plan mondial pour la révolution prolétarienne, ce qui est la seule base valable du point de vue marxiste), il faudra bien qu'ils concentrent leur attention sur l'élément central du problème à résoudre : le facteur politique, c'est-à-dire, le parti, instrument indispensable au prolétariat du point de vue des nécessités historiques. Il faudra bien aussi qu'ils en arrivent à conclure que, dans la révolution, la seule forme d'autorité possible pour le parti, est la forme dictatoriale. Et qu'on n’essaye pas de rétrécir le problème en le ramenant à une opposition irréductible entre la dictature du parti et le prolétariat parce qu'alors on ne fait que tourner le dos à la révolution prolétarienne elle-même. Nous le répétons, la dictature du parti est une expression inévitable de la période transitoire, dans un pays puissamment développé par le capitalisme comme dans la plus retardataire des colonies. La tâche fondamentale des marxistes est précisément d'examiner, en se fondant sur la gigantesque expérience russe, sur quelles bases politiques cette dictature peut être maintenue au service du prolétariat, c'est-à-dire comment la révolution prolétarienne peut et doit se déverser dans la révolution mondiale.
Malheureusement, les "fatalistes" en puissance n'ont même pas essayé de l'aborder. D'autre part, si la solution n'a pas encore beaucoup progressé, les difficultés tiennent autant à l'isolement pénible des faibles noyaux révolutionnaires qu'à la complexité énorme des données du problème. En réalité, celui-ci pose essentiellement la liaison du parti avec la lutte des classes, en fonction de laquelle doivent être résolues les questions d'organisation et de vie intérieure du parti.
Les camarades de Bilan ont eu raison de s'attacher dans leurs recherches à deux activités du parti, considérées comme fondamentales pour la préparation de la révolution (ainsi que l'histoire du parti bolchevik le démontre) : la lutte fractionnelle intérieure et la lutte au sein des organisations de masses. La question est de savoir si ces formes d'activité doivent disparaître ou se transformer radicalement après la révolution, dans une situation où la lutte de classe ne s'atténue nullement mais se développe tout en prenant d'autres aspects. Ce qui est évident, c'est qu’aucune méthode, aucune formule organisatoire ne peut empêcher la lutte de classes d'exercer sa répercussion à l'intérieur du parti, par la croissance de tendances ou de fractions.
L'unité à tout prix de l'opposition russe Trotskiste, tout comme le "monolithisme" du Centrisme font fi de la réalité historique. Par contre, la reconnaissance des fractions nous parait être beaucoup plus dialectique. Mais simple affirmation ne résout pas le problème, elle ne fait que le poser ou plutôt le reposer dans toute son ampleur. Les camarades de Bilan seront certainement d’accord pour dire que quelques phrases lapidaires ne sont pas une solution. Il reste à examiner à fond comment la lutte des fractions et l’opposition des programmes qui en résulte peuvent se concilier avec la nécessité d’une direction homogène et d’une discipline révolutionnaire. De même il faut voir dans quelle mesure la liberté des fractions à l’intérieur des organisations syndicales peut coïncider avec l’existence du parti unique du prolétariat. Il n’est pas exagéré de dire que de la réponse donnée dépend pour une grande part le sort des révolutions prolétariennes à venir.
(A suivre)
Mitchell
1 Le scepticisme affiché aujourd'hui par certains communistes internationalistes ne peut nullement ébranler notre conviction à ce sujet. Le cam. Hennaut, dans Bilan (p. 1124 n°34) déclare froidement que : "La révolution bolchevique a été faite par le prolétariat mais n'a pas été une révolution prolétarienne". Une telle affirmation est tout simplement stupéfiante lorsqu'on la rapproche de cette constatation historique d'une révolution "non prolétarienne" qui parvient à forger l'arme prolétarienne la plus redoutable (l'Internationale Communiste) qui jusqu'ici ait menacé la bourgeoisie mondiale.
2 Situation en 1925
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [10]
Personnages:
- Mitchell [11]
Questions théoriques:
L'échec de l'anarchisme pour empêcher l'intégration de la CNT à l'État bourgeois (1931-1934)
- 4885 lectures
Si les épousailles n'eurent pas lieu à ce moment-là, ce fut le résultat de la conjonction de deux facteurs :
- l’État républicain rejeta les offres de la CNT et poursuivit les habituelles et brutales persécutions contre elle ;
- la base ouvrière de la CNT résista à cette perspective.
C'est l’anarchisme qui avait pris la tête de cette résistance en se regroupant majoritairement dans une organisation, la Fédération anarchiste ibérique (FAI), en 1927. L’objet de cet article est de tenter de tirer le bilan de cette tentative de garder la CNT au le prolétariat.
L’anarchisme et la République
La FAI est née de la lutte contre l’influence croissante de l’aile syndicaliste dans la CNT. Même si elle a été constituée formellement en 1927 à Valence, elle avait pris son origine dans un Comité de relations anarchistes qui avait convoqué un congrès clandestin en avril 1925 à Barcelone. Ce congrès devait se prononcer sur trois points :
1. La nécessité d’une action pour mettre à bas la dictature de Primo de Rivera. Francisco Olaya 2 l’expose ainsi : "L’anarchisme espagnol est-il capable de provoquer à court terme une révolution sans liens avec les partis politiques ? Prenant en compte les féroces et fréquentes persécutions subies, il fut répondu que non, qu’il convenait d’agir en accord avec la CNT et avec les forces qui tendaient au renversement de la dictature par la violence, sans limiter la portée et le développement de la révolution". On laissait donc la porte ouverte à l’alliance "tactique" avec toutes les forces bourgeoises d’opposition et, de fait, le Congrès se proposa "de poursuivre les rapports conspiratifs avec Francisco Macia 3, lui donnant un délai jusqu’au 31 juillet pour entreprendre une action décisive contre le régime". Il fut également décidé de "suspendre toute relation avec le républicain Rodrigo Soriano, étant donné son incapacité à remplir ses engagements". Quels engagements avaient bien pu s’établir avec cet individu à l’idéologie notoirement droitière ?
2. La nécessité d’une organisation anarchiste, le Congrès se proposant d’orienter ses efforts vers la formation d’une Fédération anarchiste ibérique, en intégrant les groupes portugais ;
3. Le thème "Le syndicalisme et nous". Selon Olaya, "il fut décidé d’agir activement dans le but d’accentuer progressivement l’idéologie anarchiste de la CNT".
Le Congrès anarchiste se situa sur le même terrain que les syndicalistes qu’il prétendait combattre : il se donna comme objectif "tactique" le remplacement de la dictature par un régime de libertés et l’alliance avec les forces républicaines d’opposition. Olaya cite une intervention de Garcia Oliver 4 au cours d’une réunion qui se tint à la Bourse du travail de Paris, qui affirmait "que le changement de régime était imminent en Espagne et que tous les soutiens devraient être utilisés, sans distinction d’idéologie".
Cette position de Garcia Oliver fut formellement rejetée par le Congrès de Marseille de 1926, qui adopta cependant comme conclusion qu’il fallait "rompre toutes les relations avec les partis politiques et préparer le renversement de la dictature en collaboration avec la CNT". C'est-à-dire que l’objectif "tactique" de se joindre à la "lutte contre la dictature" restait maintenu, mais tout en proclamant qu’il n’y aurait pas de relations avec les partis politiques. D’ailleurs, les contacts de militants avec les partis républicains se poursuivront même après la constitution de la FAI 5.
Suite à la proclamation de la République, un long éditorial de Tierra y libertad 6 (Terre et liberté) du 19 avril 1931, intitulé "la Position de l’anarchisme sur la République", salue "cordialement l’avènement de la République", salue explicitement "les nouveaux gouvernants" et formule une série de revendications qui, reconnaît Olaya, "coïncident avec les promesses électorales faites par beaucoup d’entre eux". C’était la moindre des choses, puisque parmi ces revendications figurent la suppression des titres aristocratiques, la limitation des dividendes des actionnaires des grandes entreprises, la fermeture de couvents de nonnes, moines et jésuites ! Ni plus ni moins qu’un programme cent pour cent bourgeois qu’il faut appliquer… par l’action politique tant vilipendée !
Ainsi, loin de rompre avec la tendance majoritaire dans la CNT qui donnait la priorité à la lutte pour le régime bourgeois de la République, l’anarchisme et la FAI sautaient dedans à pieds joints ! Ils maintenaient cependant l’illusion de pouvoir déborder ce cadre en impulsant la radicalisation des masses. Ils reproduisaient en cela l’ambiguïté classique de l’anarchisme par rapport à la République, qui s’était déjà manifestée en 1873 avec la Première République espagnole (1873-1874) 7.
La scission de la CNT
Le 8 juin 1931, il se tint un Plénum péninsulaire anarchiste au cours duquel furent sanctionnés les "compagnons" du Comité péninsulaire, pour avoir eu des contacts avec des "politiques". Il s’y affirma alors la nécessité "d’orienter les activités dans un sens révolutionnaire et anarchiste, sachant que la démocratie est le dernier refuge du capitalisme" 8.
Comment comprendre ce revirement radical ? Deux mois auparavant, la démocratie était saluée, puis à présent on la dénonce. Ce sont en réalité les fondements même de l’anarchisme qui le poussent à faire une chose et son contraire. Ces fondements proclament que les individus ont une tendance naturelle à la liberté et à rejeter toute forme d’autorité. Avec des postulats aussi abstraits et généraux, on peut justifier le rejet absolu de toute forme d’autorité ou d’État - ce qui permet alors de comprendre que la démocratie est le dernier refuge du capitalisme - et tout aussi bien soutenir une autorité "plus respectueuse des libertés individuelles" ou "moins autoritaire" que la précédente comme pouvait prétendre l’être la République.
Ces "principes", en outre, mènent à la personnalisation la plus totale. On fait démissionner les membres du dernier Comité péninsulaire pour avoir eu des contacts avec des éléments politiques. Mais on ne se penche pas sur les causes qui ont conduit à soutenir ce que l’on rejette à présent, on ne tente pas de comprendre comment il a pu être possible que l’organe central, le Comité péninsulaire, mène une politique contraire aux principes de l’organisation. On change les membres du Comité suivant le principe "morte la bête, mort le venin". Cette personnalisation permet que la lutte contre le secteur syndicaliste ne se mène pas à travers le débat et la clarification, mais par des campagnes contre les militants du secteur opposé, des tentatives de "gagner" des comités locaux ou régionaux, des mesures administratives d’expulsion, etc. Pour la majorité des militants de la CNT, le combat contre le secteur "syndicaliste" n’est pas vécu comme un combat pour la clarification, mais comme une guerre entre groupes de pression dans laquelle règnent les insultes, le mépris et les interdictions. Les événements atteignirent un rare niveau de violence. Olaya témoigne que régnait "au sein de la CNT une ambiance de guerre civile". Le 25 octobre 1932, "un groupe de scissionnistes attaqua sur leur lieu de travail deux militants de la CNT qui étaient opposés à la scission, tuant l’un et blessant l’autre gravement".
"Lors du Plenum régional des syndicats, organisé à Sabadell pendant la répression, l’affrontement entre les deux tendances fut retentissant. Les "Trentistes", réformistes, commencèrent à être dégagés de toutes leurs responsabilités organisationnelles. Pestaña et Arín, signataires du Manifeste des 30, furent démis de leurs fonctions au Comité national. Les syndicats liés à la Fédération locale de Sabadell se retirèrent du Congrès régional pour protester contre la supposée dictature de la FAI. Les syndicats en question, qui comptaient plus de 20 000 adhérents, furent postérieurement expulsés par le Comité régional. Tout ceci aboutit à la scission organisationnelle qui est à l’origine des "Syndicats d’opposition"" 9. La division fut très grave en Catalogne et dans la région de Valence (où il y avait plus de membres dans les syndicats d’opposition que dans la CNT officielle), mais eut aussi d’importantes répercussions à Huelva, aux Asturies et en Galice.
Même si – comme nous allons voir par la suite - la CNT va suivre l’orientation imposée par l’anarchisme, une partie importante de celle-ci, le secteur syndicaliste, fonctionnera de façon autonome sous le nom de Syndicats d’Opposition jusqu’au rassemblement définitif de 1936 (voir le prochain article). Les Syndicats d’Opposition agiront sur une ligne de collaboration plus ou moins ouverte avec l’UGT (le syndicat socialiste) tout en prônant l’unité syndicale.
En 1931-32, la FAI finit par convaincre la CNT de s’orienter vers des tentatives révolutionnaires. Ce virage à 180° répond à une réelle radicalisation des ouvriers, journaliers et paysans fortement déçus par l’aggravation de la misère et la brutale répression de la République. Ce virage se fait cependant dans la confusion la plus totale, d’une part à cause de la scission et des méthodes employées 10, et d’autre part parce qu’il ne se basait sur aucune réflexion sérieuse : on passe d’une politique de soutien à la République à une vague "lutte pour la révolution" sans répondre collectivement à des questions de base : pour quelle révolution fallait-il lutter ? Les conditions historiques et internationales étaient-elles réunies ? Pour quelles raisons tant les syndicalistes que la FAI avaient-ils soutenu l’avènement de la République ? Il n’y eut donc pas de réponse à ces questions, on changea simplement d’orientation : on passa de la voie de droite de l’appui "critique" à la République à la voie de gauche de la "lutte insurrectionnelle pour la révolution". Les principes éternels de l’anarchisme permettaient d’avaliser tant une voie que l’autre.
La période insurrectionnelle, 1932-34
La période 1932-1934 a été nommée "période insurrectionnelle" par Gomez Casas. Les épisodes les plus significatifs en sont les tentatives de grève générale de 1932, de janvier 1933 et de décembre de la même année. Une très forte combativité s’exprima dans ces mouvements, un désir ardent de sortir d’une situation intolérable de pauvreté et d’oppression, mais cela se fit dans la dispersion la plus totale, chaque secteur ouvrier affrontant isolément l’État capitaliste. L’armée fut bien sûr systématiquement envoyée pour écraser les luttes. La réponse de la République était toujours la même : massacres, arrestations massives, incarcérations, tortures, bagne et déportations. Les principales victimes étaient bien sûr les militants de la CNT.
Il s’agit souvent de mouvements surgis de la propre initiative des travailleurs et que la bourgeoisie attribue à un "complot insurrectionnel perpétré par des anarchistes" 11. Un exemple de cela nous est donné lors de la grève du Alto Llobregat12 en janvier 1932. Le 17, les ouvriers de l’industrie textile Berga se mettent en grève pour protester contre la non-application d’accords obtenus 6 mois auparavant. Le lendemain, les travailleurs et mineurs de la zone (Balsareny, Suria, Sallent, Figols…) se mettent en grève en solidarité avec leurs camarades. Les travailleurs désarment les Somatenes (milices civiles auxiliaires des forces de répression de l’État en Catalogne). La grève est totale dans toute la zone dès le 22 janvier. Le drapeau de la CNT est hissé au fronton des mairies de quelques localités. La Garde civile s’enferme dans ses quartiers. Le gouvernement envoie alors des renforts de la Garde civile, stationnés à Lerida et Saragosse, et aussi des unités de l’armée pour écraser la lutte.
Pour justifier la barbarie de la répression, le gouvernement lance une campagne de mensonges, présentant la grève du Alto Llobrega comme étant l’œuvre de la CNT-FAI 13 "traitant les confédérés (confédérés : membres de la CNT) de bandits encartés, étendant la répression à la Catalogne, le Levant et l’Andalousie. Des centaines de prisonniers sont entassés dans les cales des bateaux qui vont les conduire en déportation" 14. Parmi les prisonniers figure notamment Fransisco Ascaso, un des leaders de la FAI. Pour parachever la confusion, dans un article devenu célèbre, une des dirigeantes de cette organisation, Federica Montseny, attribue le mouvement à l’initiative de la FAI.
Le mouvement était revendicatif et solidaire, il surgit des ouvriers eux-mêmes, et en cela fut très différent des mouvements insurrectionnels impulsés par des groupes anarchistes. Bien qu’ils soient généralement motivés par un sentiment de solidarité, en particulier avec les nombreux détenus victimes de la répression républicaine, et par une claire volonté révolutionnaire, ces mouvements n’étaient que des actions minoritaires, très localisées, séparées de la dynamique réelle de la lutte ouvrière, souffrant en outre d’une forte dispersion.
L’action insurrectionnelle la plus importante commença en janvier 1933 et se propagea de la Catalogne jusqu’à de nombreuses localités de Valence et d’Andalousie. Peirats montre que ce mouvement avait eu comme origine les provocations continues du Gouvernement autonome de Catalogne présidé par les "radicaux" d’Esquerra republicana (Gauche républicaine). Ces señoritos (fils de bonne famille) qui, à l’origine, avaient flirté avec la CNT dans les années 20 et qui, plus ou moins secrètement, avaient passé des accords avec les dirigeants syndicalistes pour qu’ils soutiennent le Gouvernement autonome et que "la CNT devienne un syndicat domestiqué comme l’était l’UGT à Madrid" (Federica Montseny), furent très déçus par l’exclusion des Trentistes et, avec plus de rage encore que leurs confrères espagnolistes, tentèrent "d’écraser la CNT par la fermeture systématique de ses syndicats, l’interdiction de sa presse, le régime des prisons gouvernementales et la politique terroriste de la police et des escamots 15. Les Casals de Esquerra 16 se transformèrent en cachots clandestins où étaient séquestrés, bastonnés et torturés les travailleurs confédérés" 17.
L’improvisation et le désordre qui présidèrent à l’organisation de ce mouvement le transformèrent rapidement en déroute que, tant le pouvoir catalan que le pouvoir central, parachevèrent par une incroyable et inqualifiable répression, dont le point d’orgue fut le massacre de Casas Viejas perpétré par ordre direct du Premier ministre Azaña qui donna l’ignoble et célèbre ordre : "Ni blessés ni prisonniers, tirez au ventre !"
"Le mouvement révolutionnaire du 8 janvier 1933 fut organisé par les Cadres de défense, groupes de choc formés par les groupes d’action de la CNT et de la FAI. Ces groupes, mal armés, plaçaient leurs espoirs sur quelques troupes engagées et la contagion populaire qui devait s’ensuivre. La grève générale des chemins de fer reposait sur la Fédération nationale de cette branche des transports qui, malheureusement minoritaire face au Syndicat national ferroviaire de l’UGT, ne parvint pas à la déclencher (…) Les casernes n’ouvrirent pas leurs portes par l’enchantement des révolutionnaires. Le peuple resta indifférent ou, plutôt, accueillit le mouvement de façon très réservée" 18.
Peirats distingue cinq phases dans le mécanisme de ces actions insurrectionnelles :
"1) À l’heure dite, les conjurés pénètrent chez les citoyens "respectables" susceptibles de posséder des armes. Ils les prennent et sortent dans la rue, appelant le peuple à la révolte. Il n’y a pas de victimes. Les éléments désarmés sont laissés en liberté. La révolution sociale déteste les représailles et les prisons. Effrayé, le peuple reste neutre. Le maire donne les clefs de la mairie.
2) La caserne de la Garde civile est assiégée avec les quelques armes récupérées.
3) Les révolutionnaires proclament le communisme libertaire depuis la mairie convertie en commune libre. Le drapeau noir et rouge est hissé. Les archives et titres de propriété sont brûlés sur la place publique devant les curieux. Des bans sont publiés déclarant abolies la monnaie, la propriété privée et l’exploitation de l’homme par l’homme.
4) Arrivée des renforts de gardes et de policiers. Les insurgés résistent plus ou moins, en fonction du temps qui leur est nécessaire pour réaliser que le mouvement n’a pas embrasé l’Espagne entière et qu’ils sont isolés dans leur splendide tentative.
5) Pendant la retraite vers la montagne, les forces de répression poursuivent leur chasse à l’homme. C’est l’épilogue macabre d’assassinats sans distinction de sexe ni d’âge. Arrestations massives, passages à tabac et tortures dans les antres policières…".
Ce témoignage est terriblement éloquent. Les forces les plus combatives du prolétariat espagnol furent mobilisées dans des batailles absurdes condamnées à la déroute. L’héroïsme et la haute valeur morale 19 des combattants furent gaspillés par une idéologie, l’anarchisme, qui en tentant de se réaliser conduisait à l’opposé de ce qu’elle se proposait : l’action consciente et collective de la majorité des ouvriers est remplacée par l’action irréfléchie d’une minorité ; la révolution n’est plus le résultat de l’action des ouvriers eux-mêmes mais celui d’une minorité qui la décrète.
Pendant que la FAI lançait ses militants dans des batailles fantaisistes, les luttes réelles du prolétariat passaient totalement inaperçues. Gérald Brenan, dans le Labyrinthe espagnol, observe que "la cause de presque toutes les grèves de la CNT d’alors était la solidarité, c’est-à-dire que les grèves se lançaient pour réclamer la liberté des prisonniers ou contre des licenciements injustes. Ces grèves n’étaient pas dirigées par la FAI, elles étaient de véritables manifestations spontanées des syndicats" 20.
Cette conception catastrophique de "la révolution" 21 est décrite dans le fameux Manifeste des 30 rédigé par Pestaña et ses amis : "L’histoire nous dit que les révolutions ont toujours été faites par des minorités audacieuses qui ont stimulé le peuple contre les pouvoirs constitués. Suffit-il que ces minorités le veuillent, qu’elles se le proposent, pour que dans une telle situation la destruction du régime en place et de ses forces défensives soit effective ? C’est à voir. Ces minorités, pourvues un beau jour de quelques éléments agressifs ou profitant de l’effet de surprise, s’affrontent à la force publique et provoquent l'événement violent qui peut nous conduire à la révolution (…) Elles confient la victoire de la révolution aux qualités de quelques individus et à la problématique intervention des masses qui les appuieront quand ils prendront la rue. Il est inutile de prévoir quoi que ce soit, de compter sur quoi que ce soit, ni de penser à autre chose que de se jeter dans la rue pour vaincre un mastodonte : l’État (…) Tout est confié au hasard,onespère tout de l’imprévu, on croit aux miracles de la Sainte Révolution".
L’insurrection des Asturies en octobre 1934
Selon les propres termes de Peirats, des milliers et des milliers d’ouvriers ne furent plus que "des grappes de chair torturée éparpillées dans toutes les geôles d’Espagne". La sauvagerie de la répression perpétrée par l’alliance républicano-socialiste n’empêcha cependant pas la droite de gagner les élections générales de novembre 1933 : "Le mouvement ouvrier, qui manifestait des symptômes de reprise, fut coupé net et recula après l’aventure anarchiste. La réaction, au contraire, sortit de sa prudence craintive et passa énergiquement à l’offensive. Les anarchistes n’avaient pas réussi à entraîner les masses, mais leur défaite fut celle des masses. Le gouvernement et la réaction l’avaient parfaitement compris : elle s’affirma et s’organisa au grand jour" 22.
Cependant, ce changement politique était lié à l’évolution de la situation internationale, et plus concrètement à la perspective de Seconde Guerre mondiale vers laquelle le capital s’orientait inexorablement. Deux conditions étaient indispensables pour la préparer : écraser préalablement les secteurs du prolétariat qui avaient encore des réserves de combativité, et encadrer l’ensemble du prolétariat mondial dans l’idéologie antifasciste. Contre l’offensive fasciste, c’est-à-dire celle du camp impérialiste constitué par l’Allemagne et l’Italie, il fallait embrigader les ouvriers dans la défense de la démocratie, c’est-à-dire du camp opposé organisé autour de la Grande-Bretagne et de la France, camp auxquels se rallieront plus tard tant l’URSS 23 que les États-Unis.
Enchaîner le prolétariat au char de la démocratie et de l’antifascisme exigeait d’entraîner sa lutte hors de son terrain de classe vers des objectifs qui lui étaient étrangers, au service exclusif de l’un des camps impérialistes en présence. Dans cet objectif, la social-démocratie (secondée à partir de 1934 par le stalinisme) combina méthodes légales, pacifiques, et politique "violente" pour entraîner le prolétariat vers des combats insurrectionnels condamnés à d’amères défaites et à la répression barbare qui s’ensuivait.
Cette perspective internationale explique l’incroyable virage que réalisa le PSOE en Espagne après sa défaite aux élections de 1933. Largo Caballero, qui avait été rien de moins que Conseiller d’État du dictateur Primo de Rivera et qui avait participé, en tant que ministre du Travail, au gouvernement républicain de 1931 à 1933 24, se transforma du jour au lendemain en révolutionnaire maximaliste 25 et fit sienne la politique insurrectionnelle défendue jusqu’alors par la FAI.
Cette cynique manœuvre reproduisait celle des sociaux-démocrates autrichiens qui avaient réussi à mobiliser les ouvriers de ce pays dans une insurrection-suicide contre le chancelier profasciste Dollfuss et qui se solda par une défaite cruelle. De son côté, Largo Caballero entreprit de défaire un secteur particulièrement combatif du prolétariat espagnol, celui des Asturies. La montée au pouvoir de la partie la plus profasciste de la droite espagnole de l’époque – dirigée par Gil Robles et dont le mot d’ordre était : "Tout le pouvoir au Chef" – provoqua l’insurrection des mineurs des Asturies en octobre 1934. Les socialistes leurs avaient promis un vaste mouvement de grève générale dans toute l’Espagne, mais ils se gardèrent soigneusement de tout mouvement de solidarité à Madrid ou dans les zones dans lesquelles ils avaient de l’influence.
Les ouvriers asturiens étaient victimes d’un piège dont ils ne pouvaient se sortit que par la solidarité de leurs frères de classe des autres régions, qui se serait basée non sur une lutte contre le nouveau gouvernement de droite mais contre l’État républicain qu’il servait. Les tentatives de grèves spontanées qui émergèrent en plusieurs endroits du pays furent annulées et désavouées non seulement par les socialistes, mais aussi par la CNT et la FAI : "En réalité, la FAI et par conséquent la CNT, a été contre la grève générale, et quand des militants ont participé de leur propre initiative et, comme toujours, héroïquement à la lutte, elle en a appelé à la cessation à Barcelone, et n’a pas cherché à l’élargir aux régions où elle était la force prédominante" 26.
En Catalogne, le Gouvernement autonome d’Esquerra republicana profita de l’occasion pour organiser sa propre "insurrection", dans l’objectif de proclamer "l'État catalan au sein de la République fédérale espagnole". Pour accomplir cette exaltante "action révolutionnaire", il interdit préalablement les publications de la CNT, ferma ses locaux et arrêta ses militants les plus connus, parmi lesquels Durruti. La "grève" fut imposée les armes à la main par la police autonomiste. La radio du Gouvernement "révolutionnaire" catalan ne se lassait pas de dénoncer les "provocateurs anarchistes vendus à la réaction". Dans cette terrible confusion qui s’acheva glorieusement dès le lendemain avec la reddition honteuse du Gouvernement catalan confronté à deux régiments restés fidèles à Madrid, la réaction de la CNT fut réellement lamentable. Elle affirma dans un manifeste : "le mouvement déclenché ce matin doit se transformer en héroïsme populaire par l’action prolétarienne, sans accepter la protection de la force publique qui devrait couvrir de honte ceux qui l’admettent et la réclament. Victime depuis longtemps d’une répression sanglante, la CNT ne peut se cantonner plus longtemps dans l’espace réduit que lui laissent ses oppresseurs. Nous réclamons le droit d’intervenir dans cette lutte et nous le prenons. Nous sommes la meilleure garantie contre le fascisme, et ceux qui prétendent le contraire le favorisent au contraire en empêchant notre action" 27.
Le piège de l’antifascisme
Ce qui se dégage de ce manifeste de la CNT est très clair :
– il ne dit pas un mot de solidarité avec les travailleurs des Asturies ;
– il se place sur un terrain ambigu de soutien plus ou moins nuancé au mouvement nationalistes du Gouvernement catalan, à qui il se propose de donner de "l’héroïsme populaire" ;
– il ne dénonce à aucun moment le piège antifasciste, mais se présente au contraire comme le meilleur rempart au fascisme et affirme son droit à contribuer à la lutte antifasciste.
Ce manifeste marque un pas en avant dans une politique très grave. Contre toutes les traditions de la CNT et contre beaucoup de militants anarchistes, il quitte le terrain de la solidarité ouvrière pour s’engager sur le terrain de l’antifascisme et de l’appui "critique" au catalanisme.
Que la CNT, en tant que syndicat, adopte ce terrain anti-ouvrier est parfaitement logique. Dans le contexte de répression et de marginalisation que lui imposait l’État républicain, elle avait impérativement besoin d’un régime de "libertés" qui lui permette de jouer son rôle "d’interlocuteur reconnu". Mais que la FAI, chantre de l’anarchisme et propagandiste de la lutte "contre toute forme d’État", qui dénonçait "toute alliance" avec les partis politiques, appuie cette orientation, est moins facilement explicable.
Une analyse plus profonde permet cependant de comprendre ce paradoxe. La FAI avait fait de la CNT, un syndicat, son organisation de "mobilisation des masses", ce qui lui imposait des servitudes toujours plus grandes. Ce n’était plus la logique des principes anarchistes qui commandait l’action de la FAI, mais toujours plus les "réalités" du syndicalisme déterminées par le besoin impérieux de s’intégrer à l’État.
En outre, les principes anarchistes ne se considèrent pas eux-mêmes comme expression des aspirations, des revendications générales et des intérêts historiques d’une classe sociale, le prolétariat. Ils ne s'enracinent donc pas sur le terrain délimité par sa lutte historique. Ils prétendent au contraire être bien plus "libres". Leur terrain est intemporel et a-historique, se situant davantage par rapport à la liberté de l’individu en général. La logique de ce type de raisonnement est implacable : l’intérêt du libre individu peut être tant le rejet de toute autorité, de tout État et de toute centralisation comme il peut être l’acceptation tactique d’un "moindre mal" : contre le danger fasciste, qui nie simplement et strictement tout droit, il est préférable un régime démocratique qui reconnaît formellement les droits de l'individu.
Enfin, Gomez Casas souligne dans son livre que "la mentalité du secteur radical de l’anarchosyndicalisme comprenait le processus comme une gymnastique révolutionnaire, par laquelle seraient atteintes les conditions optimum pour la révolution sociale" (op. cit.). Cette vision considère comme essentiel de maintenir les masses dans un état de mobilisation, quel que soit l’objectif de celle-ci. Le terrain de "l’antifascisme" semble apparemment propice pour "radicaliser les masses" pour les mener à la "révolution sociale", comme le voyaient et propageaient alors les socialistes "de gauche". En réalité, la vision de l’antifascisme de Largo Caballero et celle de la FAI semblaient convergentes, mais les intentions étaient radicalement différentes : Largo Caballero cherchait à saigner le prolétariat espagnol à travers ses appels "insurrectionnels", alors que la majorité des militants de la FAI croyaient sincèrement à la possibilité de révolution sociale. Sur la République, Largo Caballero pouvait affirmer, en 1934 (en totale contradiction avec ce qu’il avait affirmé en 1931) : "La classe ouvrière veut la République démocratique [non] pour ses vertus intrinsèques, non comme idéal de gouvernement, mais parce qu’en son sein la lutte de classe étouffée sous les régimes despotiques peut trouver une plus grande liberté d’action et de mouvement pour atteindre ses objectifs immédiats et à moyen terme. S’il n’en était pas ainsi, pourquoi donc les travailleurs voudraient de la République et de la démocratie ?" 28. Pour sa part, Durruti disait : "La République ne nous intéresse pas, mais nous l’acceptons comme point de départ d’un processus de démocratisation sociale. A condition bien sûr que cette République garantisse les principes selon lesquels la liberté et la justice sociale ne soient pas des mots creux. Si la République dédaigne les aspirations des travailleurs, alors le peu d’intérêt qu’elle suscite parmi eux sera réduit à néant, car cette institution ne répondrait pas aux espoirs qu’elle a réveillés le 14 avril" 29.
Comment l’État du XXe siècle, avec sa bureaucratie, son armée, sons système de répression et de manipulation totalitaire, pourrait-il être "le point de départ d’un processus de démocratisation sociale" ? Comment peut-on ne serait-ce que rêver qu’il soit le garant de la "liberté et de la justice sociale" ? C’est pour le moins aussi absurde qu’illusoire…
Conclusion
Cette contradiction vient cependant de loin. Déjà, quand le général Sanjurjo se souleva le 10 août 1932 contre la République et provoqua la mobilisation des ouvriers de Séville impulsée par la CNT, celle-ci vit déjà la lutte comme se situant sur un terrain ouvertement antifasciste. Elle déclarait dans un manifeste : "Ouvriers ! Paysans ! Soldats ! Un assaut factieux et criminel du secteur le plus sombre et réactionnaire de l’armée, de la caste autocrate et militaire qui enfonce l’Espagne dans les plus sombres horreurs de la période ténébreuse de la dictature […] finit par nous surprendre tous, souillant notre histoire et notre conscience, enterrant la souveraineté nationale dans la plus funeste des choix" 30.
Le prolétariat se devait de bloquer la main assassine du général Sanjurjo, mais sa lutte ne pouvait aller que dans le sens de ses intérêts de classe et donc, en perspective, de ceux de l’ensemble de l’humanité, et il devait alors combattre tant le fascisme que son soi-disant antagoniste républicain. Le manifeste cénétiste met surtout en avant… la souveraineté nationale !, appelant à choisir entre dictature et République. Une République qui, déjà à cette époque, avait assassiné par la répression plus de mille ouvriers et paysans ! Une République qui avait rempli les prisons et les bagnes de militants ouvriers, d’ailleurs essentiellement cénétistes !
Le bilan est très clair et nous le ferons en laissant la parole à nos ancêtres de la Gauche communiste italienne : "Nous considérerons maintenant l’action de la Fédération anarchiste ibérique (FAI) qui contrôle aujourd’hui la CNT. Après la chute d’Azaña, elle réclama une amnistie sans limites, donc aussi pour les généraux des pronunciamientos militaires, amis du général Sanjurjo, et elle désavoua les ouvriers de la CNT qui avaient mis en échec les tentatives de ce dernier à Séville, en proclamant qu’ils devaient rester passifs. En octobre 1934, elle prit d’ailleurs la même position en écrivant qu’il s’agissait d’une lutte pour le pouvoir entre marxistes et fascistes qui n’intéressait pas le prolétariat, lequel devait attendre pour intervenir que les uns et les autres se soient entredéchirés" 31.
La tentative de la FAI de récupérer la CNT pour la classe ouvrière fut un échec. Ce ne fut pas la FAI qui parvint à redresser la CNT, mais la CNT qui prit la FAI au piège des engrenages de l’État capitaliste, comme on le vit clairement en 1936 avec la collaboration ministérielle de membres reconnus de la FAI agissant au nom de la CNT.
"Au moment de février 1936, toutes les forces agissant au sein du prolétariat se trouvaient derrière un seul front : le nécessité d’arriver à la victoire du Front populaire pour se débarrasser des droites et obtenir l’amnistie. De la social-démocratie au centrisme 32, jusqu’à la CNT et au POUM, sans oublier tous les partis de la gauche républicaine, partout l’on était d’accord pour déverser l’explosion des contrastes de classe sur l’arène parlementaire" 33.
Dans le prochain article de la série, nous analyserons la situation en 1936 et comment furent définitivement célébrées les noces de la CNT avec l’État bourgeois.
RR – C.Mir 10-12-07
1 Cf. Revue internationale no 131, "La contribution de la CNT à l’instauration de la République espagnole (1921-1931)".
2 Historien anarchiste, auteur de l’ouvrage Histoire du mouvement ouvrier espagnol (2 tomes en espagnol). Les citations que nous traduisons ici sont extraites du second tome.
3 Rappelons que Macía était un militaire catalan nationaliste.
4 Juan García Oliver (1901-1980). Il fût un des fondateurs de la FAI et un de ses dirigeants les plus en vue. En 1936, il fût nommé ministre de la République au sein du gouvernement du socialiste Largo Caballero (on abordera ce sujet dans un prochain article).
5 Olaya témoigne qu’en 1928, "les républicains, de leur côté, entrèrent en rapport avec Arturo Parera, José Robusté, Elizalde et Hernandez, membres de la FAI et du Comité régional catalan de la CNT".
6 Journal anarchiste espagnol que parût par première fois en 1888. En 1923, il fût supprimé par la dictature de Primo de Rivera. En 1930, il réapparût comme organe de presse de la FAI.
7 Dans sa brochure les Bakouninistes au travail, Engels montre comment les dirigeants de la section espagnole de l’AIT "[trouvèrent] ce pitoyable échappatoire de recommander l’abstention de l’Internationale en corps, mais de laisser ses membres, à titre individuel, voter selon leur gré. La suite de cette déclaration de faillite politique fut que les ouvriers, comme toujours en pareil cas, votèrent pour les gens qui s’affichaient comme les plus radicaux, pour les intransigeants, et de ce fait endossèrent plus ou moins la responsabilité des actes ultérieurs de leurs élus, et s’y trouvèrent impliqués”.
8 Olaya, op. cit.
9 Gómez Casas, auteur anarchiste d’une Histoire de l’anarcho-syndicalisme espagnol, livre dont nous avons parlé dans les articles précédents de cette série et dont nous traduisons les citations.
10 Cette tentative d’imposer une orientation "juste" par le biais de campagnes d’intimidations et des manœuvres bureaucratiques provoqua des situations tragi-comiques dues à la volonté de chaque Comité d’être "plus insurrectionnel" que le voisin. Olaya raconte la pagaille provoquée en octobre 1932 par le Comité national, "qui avait besoin de prouver qu’il n’était pas influencé par la tendance Pestaña, sollicita dans sa Circulaire no 31 les syndicats pour savoir s’ils seraient d’accord pour ratifier ou rectifier les accords du Plénier d’août concernant la grève générale révolutionnaire". Le Comité du Levante (Valence) répondit qu’il était prêt à l’action. Cette réponse ferme effraya le Comité national qui fit machine arrière et annula l’ordre, ce qui mit le Comité levantin en colère. Ce dernier exigea que soit fixée une date pour "descendre dans la rue". Un Plenum fut alors convoqué et, après une série de zigzags, il fut convenu que la "grève générale" aurait lieu en janvier 1933 (nous en reparlerons plus loin).
11 Les campagnes lancinantes de la République quant à "la menace de la FAI" ne servaient qu’à alimenter le mythe entretenu par quelques militants de la FAI qui s’attribuaient le mérite d’avoir fomenté telle ou telle action révolutionnaire. A propos d’un appel échevelé à la grève générale à Séville (juillet 1931) et qui fut annulé deux jours plus tard, Olaya écrit : "en réalité, il ne s’agissait que d’une fanfaronnade, la FAI à ce moment-là n’étant qu’un fantôme utilisé par la bourgeoisie pour effrayer les bigotes de quartier".
12 Quartier industriel et minier de la province de Barcelone.
13 En réalité, s’il est certain que les militants de la CNT jouèrent un rôle très actif dans le mouvement, l’attitude organisationnelle de la CNT fut par contre plutôt tiède et contradictoire : le 21 janvier "se réunit à Barcelone le Plenum départemental, convoqué par Emilio Mira, secrétaire du Comité régional de la CNT, décidant d’envoyer un autre délégué et, bien que quelques délégués soient favorables à la solidarité avec les grévistes, la majorité s’abstint sous prétexte de n’avoir pas de mandat de leur base organique" (Olaya, op. cit.). Cette décision fut réexaminée le lendemain mais fut à nouveau annulée le 24, avec l’adoption d’un manifeste appelant à arrêter la grève.
14 Peirats, La CNT dans la Révolution espagnole, op. cit.
15 Les escamots étaient des "groupes d’action catalanistes xénophobes envers tout ce qui n’était pas catalan" (Peirats, op. cit.).
16 Locaux des escamots.
17 Peirats, op. cit.
18 Peirats, op. cit.
19 L’honnêteté et la droiture de bien des militants de la FAI étaient proverbiales. Buenaventura Durruti, par exemple, n’avait parfois pas de quoi se nourrir mais ne toucha jamais la caisse qui lui avait été confiée.
20 Éditions Ruedo ibérico, 1977, Madrid. Brenan n’est pas un auteur lié au mouvement ouvrier, mais il envisage la période historique de 1931-39 avec beaucoup d’honnêteté, ce qui l’amène à des observations souvent très justes.
21 En dénonçant, de manière plus que caricaturale, le caractère absurde de la "méthode insurrectionnelle" de ses opposants de la FAI, les rédacteurs du Manifeste – qui appartenaient à l'aile syndicaliste de CNT – n'ont pas pour objectif d'éclairer les consciences mais d'apporter de l'eau à leur moulin réformiste et capitulard.
22 Munis, Jalones de derrota, promesas de victoria. Munis fut un révolutionnaire espagnol (1911-1988) qui rompit avec le trotskisme en 1948 et s’approcha des positions de la Gauche communiste. Il fut à l’origine du groupe Fomento obrero revolucionario (FOR). Voir une analyse de sa contribution dans la Revue internationale no 58. Le chapitre V de notre livre 1936 : Franco y la República masacran al proletariado est consacré à la critique de ses positions sur la prétendue Révolution espagnole de 1936.
23 Rappelons ici qu’un pacte secret avait dans un premier temps allié l’URSS à Hitler en 1939-41.
24 Cf. Revue internationale no 131, le quatrième article de cette série.
25 Les Jeunesses socialistes le vénéraient comme le "Lénine espagnol".
26 Bilan, organe de la Fraction italienne de la Gauche communiste, "Quand manque un parti de classe", no 14, déc. 34-janv. 35. Cette analyse est corroborée par un passage du livre Historia de la FAI, de Juan Gomez Casas : "J.M. Molina affirme que bien que la CNT et la FAI ne soient pour rien dans la grève (il se réfère aux Asturies 1934), les comités de ces deux organisations étaient réunis en permanence. Il affirme que "toutes ces réunions convenaient de notre inhibition, mais sans commettre une des erreurs les plus graves et incompréhensibles de l’histoire de la CNT". Molina fait référence aux prises de position de certains organismes de la CNT en faveur du retour au travail et aux consignes que donna à la radio Patricio Navarro, membre du Comité régional, en ce sens (à Barcelone, le Comité régional réunit en Plenum, avec Ascaso à sa tête, fut contraint de démissionner)".
27 Cité par Peirats, op. cit.
28 Cité par Bolloten, auteur sympathisant de l’anarchisme, dans son très intéressant ouvrage la Guerre civile espagnole : révolution et contre-révolution.
29 Juan Gomez Casas, Histoire de la FAI, op. cit.
30 Cité par Peirats, op. cit.
31 Bilan, no 34, "Quand manque un parti de classe", op. cit.
32 C'est par ce terme ambigu que la Gauche italienne désignait le stalinisme à l'époque.
33 Bilan, no 36, oct.-nov. 36, "La Leçon des événements d’Espagne”.
Evènements historiques:
- Espagne 1936 [13]
Courants politiques:
- Anarchisme officiel [14]
Approfondir:
Revue Internationale n° 133 - 2e trimestre 2008
- 2592 lectures
Les Etats-Unis, locomotive de l'économie mondiale ... vers l'abîme
- 3272 lectures
- la crise de l'immobilier aux États-Unis s'est en effet transformée en crise financière internationale, ponctuée par des alertes retentissantes d'insolvabilité d'établissements bancaires américains et européens1. Ceux des établissements menacés qui n'ont pas fait faillite le doivent à des plans de sauvetage impliquant l'intervention de l'État et il existe les pires craintes que de nombreux établissements financiers, qui étaient jusque là réputés à l'abri de tout risque de ce type, se trouvent à leur tour en situation de faillite potentielle, nourrissant ainsi les conditions d'un Krach financier majeur.
- les perspectives sont clairement au ralentissement de l'activité économique, voire à la récession pour certains pays comme les États-Unis. La bourgeoisie a surmonté les différentes récessions qu'elle a dû affronter depuis les années 1970 au moyen d'un endettement supplémentaire, à chaque fois plus important que les précédents, pour des résultats toujours plus modestes. Pourra-t-elle une nouvelle fois juguler la future récession alors qu'il n'existe pour cela pas d'autre moyen qu'une augmentation considérable de la dette mondiale avec le risque que cela comporte d'un effondrement du système international de crédit ?
- la baisse des cours de la Bourse, ponctuée par des chutes brutales, ébranle la confiance dans la base même de la spéculation boursière dont les succès avaient pourtant permis, en grande partie, de masquer les difficultés de l'économie réelle. Ces succès avaient notamment contribué fortement à la hausse des taux de profit des entreprises depuis le milieu des années 1980, et se trouvaient également à l'origine du mythe solidement ancré, mais aujourd'hui mis à mal, selon lequel les valeurs boursières ne pourraient en définitive que monter, quels que soient les aléas.
- les dépenses militaires, comme on le voit clairement dans le cas des Etats-Unis, constituent un fardeau de plus en plus insupportable pour l'économie. Cependant, celles-ci ne peuvent être réduites à volonté. En effet, elles sont la conséquence du poids croissant que prend le militarisme dans la vie de la société alors que, confrontée à des difficultés de plus en plus insurmontables sur le plan économique, chaque nation est poussée dans la fuite en avant vers la guerre.
- le retour de l'inflation constitue, à double titre, une hantise pour la bourgeoisie. D'une part, elle contribue à freiner les échanges commerciaux du fait qu'elle entraîne des fluctuations, de plus en plus difficilement prévisibles, du coût des marchandises produites. D'autre part, bien plus que la riposte aux attaques comme les licenciements, la lutte revendicative de la classe ouvrière pour l'augmentation des salaires en permanence rognés par la hausse des prix est propice à la généralisation des combats par delà les secteurs. Or, les leviers dont dispose la bourgeoisie pour contenir l'inflation, politiques de rigueur et de réduction des dépenses de l'État, s'ils étaient actionnés de façon conséquente, ne pourraient qu'aggraver le cours actuel vers la récession.
Ainsi la situation actuelle n'est pas seulement la répétition en pire de toutes les manifestations de la crise depuis la fin des années 1960, elle concentre ces dernières de façon beaucoup plus simultanée et explosive conférant à la catastrophe économique une qualité nouvelle propice à la remise en question de ce système. Autre signe des temps, distinctif des décennies précédentes : alors que, jusque là, il avait incombé à l'économie de la première puissance économique mondiale de jouer le rôle de locomotive pour éviter des récessions ou en sortir, le principal effet d'entraînement que les États-Unis apparaissent aujourd'hui en mesure d'imprimer au monde, c'est celui vers la récession et l'abîme.
L'aggravation de la crise économique aux États-Unis
George Bush est certainement l'homme le plus optimiste d'Amérique - d'ailleurs, il est peut-être le seul à être optimiste quant à la situation économique du pays. Le 28 février, tout en reconnaissant l'existence d'un risque de ralentissement économique, le président déclarait : "Je ne pense pas que nous allions vers la récession... Je crois que les éléments fondamentaux de notre économie sont en bonne santé... que la croissance se poursuit et va se poursuivre d'une façon encore plus robuste que c'est le cas aujourd'hui. Aussi nous sommes toujours en faveur d'un dollar fort."2 Deux semaines plus tard, le 14 mars, devant une réunion d'économistes à New York, le président a réitéré son point de vue optimiste et a exprimé sa confiance dans la capacité de "résilience" de l'économie américaine. C'était le jour même où la Réserve fédérale et la banque JP Morgan Chase ont été forcées de collaborer à un plan de sauvetage d'urgence de Bear Stearns, grande banque d'affaires de Wall Street, menacée par un retrait massif de fonds de la part de ses clients, scénario qui n'était pas sans rappeler la Grande Dépression de 1929. Le même jour se produisaient les évènements suivants : le prix du baril de pétrole brut atteignait la somme record de 111 dollars malgré une offre bien supérieure à la demande ; le gouvernement annonçait une augmentation de 60% des saisies de biens immobiliers en février ; la chute du dollar atteignait une baisse record par rapport à l'euro. En dépit du déni de la réalité de Monsieur Bush, il est clair que la prospérité apparente qui a accompagné le boom de l'immobilier et la bulle immobilière de ces dernières années a ouvert la voie à une catastrophe économique de première grandeur dans l'économie la plus puissante du monde, mettant ainsi la crise économique au premier plan de la situation internationale.
La crise de l'immobilier symptôme d'un système en état de crise chronique
Depuis début 2007, date des premiers symptômes indiquant que le boom de l'immobilier arrivait à son terme, les économistes bourgeois discutaient la possibilité que l'économie américaine entre en récession. Il y a trois mois à peine, début 2008, il existait un éventail considérable de prévisions économiques, allant des "pessimistes" qui pensaient que la récession avait déjà commencé en décembre, aux "optimistes" qui attendaient toujours le miracle qui permettrait de l'éviter. Entre eux, les experts qui ne se mouillaient pas, affirmaient que "l'économie pouvait littéralement évoluer dans un sens ou dans l'autre". Mais les choses sont allées si vite ces deux derniers mois que, sauf pour Bush, il n'y a plus de place pour l'optimisme ou le "centrisme". Il existe maintenant un consensus sur le fait que les beaux jours sont finis. En d'autres termes, l'économie américaine est maintenant en récession ou, au mieux, au bord de celle-ci.
Cependant, la reconnaissance par la bourgeoisie que le capitalisme américain est en difficulté, n'apporte pas grand-chose à la compréhension de l'état réel du système. La définition officielle que donne la bourgeoisie d'une récession, c'est une croissance économique négative pendant deux trimestres consécutifs. Le National Bureau of Economic Research (Bureau national de recherche économique) utilise un autre critère, un peu plus utile, définissant la récession comme un déclin significatif et prolongé de l'activité touchant toute l'économie et affectant des indicateurs tels que le revenu, l'emploi, la vente au détail et la production industrielle. Sur la base de cette définition, la bourgeoisie ne peut identifier la récession tant qu'elle n'a pas commencé depuis un certain temps, souvent tant que le pire n'a pas déjà eu lieu. Aussi, selon certaines estimations, on doit attendre encore plusieurs mois avant de savoir, d'après ces critères, s'il y a une récession ou quand elle a commencé.
En ce sens, les prévisions diverses qui remplissent les pages économiques des journaux et des magazines sont très trompeuses. En dernière instance, elles ne font que contribuer à cacher l'état catastrophique du capitalisme américain qui ne peut qu'empirer dans les mois à venir, quelle que soit la date officielle de l'entrée de l'économie en récession.
Ce qu'il est important de souligner, c'est que la crise actuelle est loin de refléter une supposée "bonne santé" de l'économie américaine qui traverserait une mauvaise passe dans un cycle commercial, par ailleurs normal, d'expansion et de récession. Ce à quoi nous assistons, c'est aux convulsions d'un système en état de crise chronique, ne connaissant quelques moments éphémères de rémission que grâce à des remèdes toxiques qui aggravent la prochaine rechute catastrophique.
Telle a été l'histoire du capitalisme américain - et du capitalisme dans son ensemble - depuis la fin des années 1960 et le retour de la crise économique ouverte. Pendant quatre décennies, à travers des périodes de reprise et de récession officiellement reconnues, l'ensemble de l'économie n'a conservé un semblant de fonctionnement que grâce à des politiques capitalistes d'État monétaires et fiscales que le gouvernement est obligé d'appliquer pour combattre les effets de la crise. Cependant, la situation n'est pas restée statique. Pendant toutes ces années de crise et d'intervention de l'État pour la gérer, l'économie a accumulé tant de contradictions qu'aujourd'hui, il existe une menace réelle de catastrophe économique comme nous n'en avons jamais vue dans l'histoire du capitalisme.
A la suite de l'éclatement de la bulle Internet et technologique en 2000-2001, la bourgeoisie s'en est sortie en créant une nouvelle bulle basée, cette fois, sur l'immobilier. Malgré le fait que des industries clé du secteur industriel, comme l'automobile et l'aviation par exemple, aient continué à connaître des faillites, le boom immobilier des cinq dernières années a donné l'illusion d'une économie en expansion. Mais ce boom s'est à présent transformé en un crash qui secoue tout l'édifice du système capitaliste et qui, dans l'avenir, va avoir des répercussions que personne ne peut encore prévoir.
D'après les dernières données, l'activité liée à l'immobilier des particuliers est en total désarroi. La construction de nouveaux logements a déjà chuté d'environ 40% depuis le pic atteint en 2006, et les ventes ont chuté encore plus vite entraînant avec elles une chute des prix. Le prix des maisons a baissé de 13% dans l'ensemble du pays depuis le pic de 2006 et il est prévu qu'il baisse encore de 15 à 20% avant d'avoir atteint le fond. Le boom de l'immobilier laisse une quantité énorme de logements vacants, non vendus - environ 2,1 millions, à peu près 2,6% du parc immobilier national. L'an dernier, les saisies ont été principalement limitées aux prêts sur hypothèques appelés subprimes, accordés à des gens qui n'avaient fondamentalement pas les moyens de rembourser. Environ un quart de ces prêts était en cessation de paiement en novembre dernier. Les cessations de paiement commencent à présent et de façon croissante à concerner également ceux dont la situation financière est encore relativement bonne.En novembre, 6,6% de ces prêts soit étaient en retard, soit avaient déjà fait l'objet de saisies. Comme un signe du pire à venir, ce pic dans les saisies immobilières a lieu avant même que les taux d'intérêt sur les crédits hypothécaires ait été revus à la hausse. Avec la chute des valeurs immobilières qui accompagne la crise, pour beaucoup de gens, la valeur présente de leur logement ne permet pas de rembourser leur dette immobilière, ce qui signifie que la vente de leur bien non seulement ne leur apportera aucun bénéfice mais encore leur laissera une dette. Ceci crée une situation dans laquelle il est financièrement plus sage d'abandonner ses obligations hypothécaires et de se déclarer en faillite.
L'éclatement de la bulle immobilière fait des ravages dans le secteur financier. Jusqu'à présent, la crise de l'immobilier a généré plus de 170 milliards de dollars de pertes au niveau des plus grandes institutions financières. Des milliards de dollars de valeurs boursières ont été anéanties, ébranlant Wall Street. Parmi les grands noms qui ont perdu au moins un tiers de leur valeur en 2007, on peut citer Fannie Mae, Freddie Mac, Bear Stearns, Moody's et Citigroup.3 MBIA, une compagnie qui est spécialisée dans la garantie de la santé financière des autres compagnies, a perdu presque trois quarts de sa valeur ! Plusieurs compagnies dont l'activité était en rapport avec des crédits hypothécaires particulièrement bien côtés auparavant ont fait faillite.
Et ce n'est que le début. Avec l'accélération des saisies, dans les mois qui viennent, les banques vont connaître de nouvelles pertes et la pénurie subite de crédit (le credit crunch) va s'aggraver davantage, ce qui aura un impact sur d'autres secteurs de l'économie.
De la crise de l'immobilier à la crise du crédit
De plus, la crise financière liée aux prêts hypothécaires ne constitue que le sommet de l'iceberg. Les pratiques imprudentes de crédit, qui ont dominé sur le marché immobilier, constituent aussi la norme dans le domaine des cartes de crédits et des prêts automobile où les problèmes se développent également. Et c'est là que réside l'essence de la "santé" capitaliste actuelle. Son petit secret inavouable, c'est la perversion du mécanisme du crédit afin de se sortir du manque de marchés solvables auxquels vendre ses marchandises. Le crédit est essentiellement devenu le moyen de maintenir artificiellement l'économie à flot et d'empêcher l'effondrement du système sous le poids de sa crise historique. Un moyen qui a déjà montré ses limites et ses risques : déjà, dans les années 1980, la crise financière avait fait suite à la faillite des économies d'Amérique latine terrassées par les énormes dettes qu'elles n'avaient aucun moyen de rembourser ; l'effondrement des tigres et des dragons asiatiques en 1997 et en 1998 avait enseigné la même leçon. En fait, la bulle immobilière elle-même avait constitué une réaction à l'éclatement de la bulle Internet et technologique et une tentative de la surmonter.
La crise financière actuelle comporte une autre dimension qui résulte de la spéculation rampante qui a accompagné la bulle immobilière. Il ne s'agit pas ici de la spéculation de seconde importance d'un investisseur qui achète une maison et la revend pour se faire immédiatement de l'argent sur la base d'une appréciation rapide de la valeur de la propriété. Ce sont des broutilles. Ce qui compte, c'est la spéculation à grande échelle dans laquelle se sont engagées toutes les institutions financières via la titrisation4 et la vente de créances hypothécaires sur les marchés boursiers. Les mécanismes exacts de ces procédés ne sont pas complètement connus, mais de ce qu'on en sait, ils ressemblent beaucoup aux vieux procédés de Ponzi5. De toutes façons, ce que montre ce niveau monstrueux de spéculation, c'est à quel point l'économie est devenue une "économie de casino" dans laquelle le capital n'est pas investi dans l'économie réelle mais est utilisé dans des paris.
La crise actuelle révèle le bluff du libéralisme et la réalité du capitalisme d'État
La bourgeoisie américaine aime à se présenter comme le champion idéologique du libéralisme. Ce n'est qu'une posture idéologique. L'économie est dominée par l'omniprésente intervention de l'État. C'est le sens du "débat" actuel au sein de la bourgeoisie sur la façon de gérer le bourbier économique d'aujourd'hui. Dans le fond, on ne met en avant rien de nouveau. On applique les mêmes vieilles politiques monétaires et fiscales dans l'espoir de stimuler l'économie.
Pour le moment, ce qui est fait pour atténuer la crise actuelle relève toujours de la même chose - on applique les mêmes vieilles politiques d'argent facile et de crédit bon marché pour consolider l'économie. La réponse américaine au credit crunch (resserrement du crédit), c'est encore plus de crédit ! La Réserve fédérale a baissé 5 fois son taux d'intérêt depuis septembre 2007 et semble prête à le faire une fois de plus à la réunion prévue en mars. Reconnaissant clairement que ce remède ne marche pas, la Réserve fédérale a régulièrement augmenté son intervention sur les marchés financiers et offert de l'argent bon marché - 200 milliards de dollars en plus des milliards déjà offerts en décembre dernier - aux institutions financières à court de liquidités.
Pour leur part, la Maison blanche et le Congrès ont aussi rapidement proposé un plan de relance (appelé "economic stimulus package") qui, essentiellement, approuve des réductions d'impôts pour les familles et des abattements d'impôts pour les entreprises, et adopte une loi en vue d'atténuer l'épidémie de non remboursement hypothécaire et de revitaliser le marché immobilier exsangue. Cependant, étant donnée l'étendue de la crise immobilière et financière, la solution d'un renflouage massif par l'État de l'ensemble de la débâcle immobilière est de plus en plus envisagée. L'énormité de son coût ferait pâlir les montants investis en 1990 par l'État - 124,6 milliards de dollars - pour sauver la Saving and Loans Industry (système des caisses d'épargne).
A combien s'élèveront les efforts de l'État pour gérer la crise, cela reste à voir. Ce qui est évident, c'est que, plus que jamais, la marge de manœuvre pour les politiques économiques de la bourgeoisie se restreint. Après des décennies de gestion de la crise, la bourgeoisie américaine gouverne une économie très malade. La monstrueuse dette nationale et privée, le déficit budgétaire fédéral, la fragilité du système financier et l'énorme déficit du commerce extérieur, tout cela accentue les difficultés de la bourgeoisie pour faire face à l'effondrement du système. En fait, jusqu'ici les remèdes gouvernementaux traditionnels pour insuffler un sursaut dans l'économie n'ont produit aucun résultat positif. Au contraire, ils semblent aggraver la maladie qu'ils cherchent à soigner. Malgré les efforts de la Réserve fédérale pour desserrer le crédit, stabiliser le secteur financier et revitaliser le marché immobilier, les crédits sont difficiles à obtenir et sont chers. Wall Street connaît sans relâche des mouvements de montagnes russes, avec des oscillations énormes et une tendance dominante à la baisse.
De plus, la politique de la Réserve fédérale d'argent bon marché contribue à la plongée du dollar qui atteint toutes les semaines de nouveaux records de baisse vis-à-vis de l'euro et d'autres monnaies et fait monter le prix des marchandises comme le pétrole. L'augmentation du prix de l'énergie, de la nourriture et d'autres marchandises simultanément à un ralentissement grave de l'activité économique alimente la peur chez les "experts" de l'entrée dans une période de "stagflation" de l'économie américaine. L'inflation actuelle restreint déjà la consommation de la population qui tente de vivre avec des revenus qui, eux, n'augmentent pas et oblige la classe ouvrière et d'autres secteurs de la population à se serrer la ceinture.
Les attaques contre la classe ouvrière aux États-Unis
L'annonce, le 7 mars, par le Département du Travail américain, que 63 000 emplois ont été perdus dans le pays au cours du mois de février a alarmé le monde bourgeois. Sûrement pas parce qu'il se préoccupe du sort des travailleurs licenciés, mais parce que ce fort déclin confirme les pires cauchemars des économistes sur l'aggravation de la crise. C'était la seconde baisse consécutive de l'emploi et la troisième dans le secteur privé. Pourtant, comme une sorte de mauvaise blague aux dépens des chômeurs, le taux de chômage global est passé de 4,9 à 4,8%. Comme est-ce possible ? C'est uniquement grâce à une habile astuce statistique utilisée par la bourgeoisie pour sous-évaluer le nombre de chômeurs. Pour le gouvernement américain, vous n'êtes chômeur que si vous n'avez pas de travail et avez activement cherché un emploi durant le mois passé et êtes prêt à travailler au moment du sondage. Aussi les chiffres officiels du chômage sous-estiment de façon significative la crise de l'emploi. Ils ignorent les millions d'ouvriers américains "découragés" qui ont perdu leur travail et abandonné la possibilité d'en trouver un nouveau et n'ont pas cherché un nouvel emploi dans les 30 jours précédent le sondage, ou qui veulent travailler mais sont trop découragés pour essayer puisque la situation de l'emploi est trop accablante ou qui, simplement, ne veulent pas travailler pour la moitié du salaire qu'ils gagnaient dans leur emploi précédent, ou encore les millions de travailleurs qui veulent travailler à plein temps mais ne trouvent que des temps partiels. Si l'on incluait tous ces travailleurs dans les statistiques du chômage, le taux serait nettement supérieur. Afin de minimiser encore les chiffres du chômage, le personnel militaire américain aux États-Unis est inclus dans la force de travail du pays depuis le tour de passe-passe statistique de Ronald Reagan (auparavant, le chômage n'était calculé que sur la force de travail civile). Cette manœuvre fait augmenter d'environ deux millions le nombre de personnes "employées" par le secteur militaire américain.
L'effondrement économique actuel amène une avalanche de licenciements dans tous les secteurs de l'économie mais il faut dire que la période du boom immobilier aujourd'hui défunt n'a pas été un paradis pour la classe ouvrière. Les revenus, les retraites, la couverture des dépenses de santé, les conditions de travail, tout cela continuait à se détériorer pendant que le marché de l'immobilier était en plein essor. Ceci avait conduit certains économistes bourgeois à souligner qu'il s'agissait d'une reprise "sans travail" et "sans salaire". La réalité, c'est que, pour la classe ouvrière, les conditions de vie et de travail n'ont cessé de se détériorer depuis quatre décennies de crise économique ouverte, quels qu'aient été ses hauts et ses bas. Avec l'aggravation de la crise économique aujourd'hui, la bourgeoisie n'a rien à offrir à la classe ouvrière sinon encore plus de misère.
L'état actuel de l'économie américaine laisse présager d'une situation économique catastrophique au niveau mondial. L'économie la plus importante du monde ne manquera pas d'entraîner ses partenaires économiques dans sa chute. Il n'y a pas de locomotive économique qui puisse compenser la plongée aux États-Unis et maintenir l'économie globale à flot. La restriction sur le crédit va miner le commerce mondial, l'effondrement du dollar va réduire les importations vers les États-Unis, aggravant la situation économique pays après pays et les attaques contre le niveau de vie du prolétariat vont partout redoubler de violence. S'il existe un rayon de lumière dans ce sombre panorama, c'est que cette situation va accélérer le retour du prolétariat sur le terrain de la lutte de classe contre le capitalisme en le contraignant à se défendre contre les ravages de la crise capitaliste.
La perspective
d'accélération et d'aggravation de la crise du
capitalisme porte avec elle la promesse d'un développement de
la lutte de classe qui, lui aussi, devra constituer un dépassement
des pas déjà accomplis par le prolétariat depuis
la reprise historique des combats de classe à la fin des
années 1960.
ES/JG, 14 mars 2008
1 Lire notre article de la Revue internationale n° 131, "De la crise des liquidités à la liquidation du capitalisme ! [16]"
2 L'optimisme mal placé semble être une caractéristique des présidents américains. Ainsi Richard Nixon déclara en 1969, juste deux ans avant la crise qui allait obliger les États-Unis à abandonner la convertibilité du dollar et tout le système de Bretton Woods, "Nous avons enfin appris à gérer une économie moderne afin d'en assurer la croissance continue". Son prédécesseur Calvin Coolidge avait déclaré devant le Congrès américain le 4 décembre 1928, c'est-à-dire peu avant la crise de 1929 : "Aucun congrès des États-Unis jamais réuni, en regardant l'état de l'Union, n'a pu contempler une situation plus plaisante que celle d'aujourd'hui (...) [Le pays] peut regarder le présent avec satisfaction et anticiper l'avenir avec optimisme".
3 Cet article a été écrit juste avant l'annonce que Bear Stearns - la cinquième banque commerciale du pays - serait vendu à JP Morgan Chase pour 2 dollars l'action, ce qui veut dire que la banque a perdu 98% de sa valeur.
4 La Titrisation permet à un cédant (société, entreprise ou personne physique) de céder à un organisme les risques liés à des créances, ou à d'autres biens en émettant des valeurs mobilières dont la valorisation ou le rendement dépend de ces risques.
5 Un schéma de Ponzi, ou chaîne de Ponzi, ou dynamique de Ponzi, ou jeux de Ponzi, est le nom donné à un système mettant en jeu un effet boule de neige qui n'est pas viable sur le long terme. Par exemple, rembourser des emprunts en empruntant à nouveau, et pour un montant plus élevé, fait partie d'une dynamique de Ponzi : il ne devient progressivement plus possible de rembourser la totalité des emprunts. Ce nom est utilisé aussi concernant la création d'une bulle spéculative, à visée d'escroquerie. Charles Ponzi a historiquement donné son nom au système, après la mise en œuvre d'une opération immobilière en Californie. (Wikipedia)
Récent et en cours:
- Crise économique [1]
Mai 68 et la perspective révolutionnaire (1) : le mouvement étudiant dans le monde dans les années 1960
- 3994 lectures
En janvier 1969, lors de l’inauguration de son premier mandat de Président des États-Unis, Richard Nixon avait déclaré : “Nous avons appris enfin à gérer une économie moderne de façon à assurer sa croissance continue”. Avec le recul, on peut voir à quel point un tel optimisme a été cruellement démenti par la réalité : dès le début de son second mandat, à peine quatre ans plus tard, les États-Unis allaient connaître leur récession la plus violente depuis la seconde guerre mondiale, une récession qui allait être suivie de nombreuses autres, de plus en plus graves. Mais il faut reconnaître que, dans le domaine de l’optimisme hors de propos, Nixon avait été précédé un an auparavant par un autre chef d’État autrement plus expérimenté que lui : le général de Gaulle, Président de la République française depuis 1958 et chef de la “France libre” lors de la Seconde Guerre mondiale. Le Grand Homme, dans ses vœux à la nation n’avait-il pas déclaré : “L’année 1968, je la salue avec sérénité”. Il n’a pas fallu attendre quatre ans pour que cet optimisme soit balayé ; quatre mois ont suffi pour que la sérénité du Général cède la place au plus grand désarroi. C’est vrai que de Gaulle devait faire face non seulement à une révolte étudiante particulièrement violente et massive mais aussi, et surtout, à la plus grande grève de l’histoire du mouvement ouvrier international. C’est donc peu de dire que 1968 n’a pas été une année “sereine” pour la France : ce fut même, et elle reste à ce jour, l’année la plus agitée depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais il n’y a pas que la France qui ait connu des soubresauts d’importance au cours de cette année, loin de là. Deux auteurs qu’on ne peut soupçonner de “franco-centrisme”, l’anglais David Caute et l’américain Mark Kurlansky sont clairs à ce sujet : “1968 fut l’année la plus turbulente depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des soulèvements en chaîne affectèrent l’Amérique et l’Europe de l’Ouest, gagnèrent jusqu’à la Tchécoslovaquie ; ils remirent en cause l’ordre mondial de l’après-guerre.”1 “Aucune année n’avait encore ressemblé à 1968 et il est probable qu’il n’y en aura jamais d’autre pareille. En un temps où les nations et les cultures étaient encore séparées et très distinctes (…) un esprit de rébellion s’est enflammé spontanément aux quatre coins du globe. Il y avait eu d’autres années de révolution : 1848, par exemple, mais contrairement à 1968, les événements étaient restés circonscrits à l’Europe…” 2.
Quarante ans après cette “année chaude”, alors que dans un certain nombre de pays on assiste à un déferlement éditorial et télévisuel massif à son sujet, il appartient aux révolutionnaires de revenir sur les principaux événements de cette année, non pas pour en faire un récit détaillé ou exhaustif3 mais pour en dégager la véritable signification. En particulier, il leur appartient de porter un jugement sur une idée très répandue aujourd’hui qui figure d’ailleurs sur la page 4 de couverture du livre de Kurlansky : “Qu’ils soient historiens ou politologues, les spécialistes en sciences humaines du monde entier s’accordent à dire : il y a un avant et un après 1968”. Disons tout de suite que nous partageons entièrement ce jugement mais certainement pas pour les mêmes raisons que celles qui sont généralement invoquées : la “libération sexuelle”, la “libération des femmes”, la remise en cause de l’autoritarisme dans les relations familiales, la “démocratisation” de certaines institutions (comme l’Université), les nouvelles formes artistiques, etc. En ce sens, cet article se propose de mettre en évidence ce qui, pour le CCI constitue, le véritable changement opéré au cours de l’année 1968.
A côté de toute une série de faits assez considérables en eux-mêmes (tel, par exemple, l’offensive du Têt du Vietcong en février qui, si elle a été finalement repoussée par l’armée américaine, a mis en évidence que celle-ci ne parviendrait jamais à gagner la guerre au Vietnam ou bien encore l’intervention des chars soviétiques en Tchécoslovaquie en août), ce qui marque l’année 1968, comme le soulignent Caute et Kurlansky, c’est bien cet “esprit de rébellion qui s’est enflammé spontanément aux quatre coins du globe”. Et dans cette remise en cause de l’ordre régnant, il importe de distinguer deux composantes d’inégale amplitude et, aussi, d’inégale importance. D’une part, la révolte étudiante qui a frappé la presque totalité des pays du bloc occidental, et qui s’est même propagée, d’une certaine façon, dans des pays du bloc de l’Est. D’autre part, la lutte massive de la classe ouvrière qui, cette année-là, n’a touché fondamentalement qu’un seul pays, la France.
Dans ce premier article, nous allons aborder uniquement la première de ces composantes non pas qu’elle soit la plus importante, loin de là, mais parce qu’elle précède, pour l’essentiel, la seconde et que cette dernière, en elle même, revêt une signification historique de premier plan allant bien au delà de celle des révoltes étudiantes.
Le mouvement étudiant dans le monde…
C’est dans la première puissance mondiale que vont se dérouler, à partir de 1964, les mouvements les plus massifs et significatifs de cette période. C’est plus précisément à l’université de Berkeley, dans le nord de la Californie, que la contestation étudiante va prendre, pour la première fois, un caractère massif. La revendication qui, la première, mobilise les étudiants est celle du “free speech movement” (mouvement pour la liberté de parole) en faveur de la liberté d’expression politique dans l’enceinte de l’université. Face aux recruteurs de l’armée américaine qui ont pignon sur rue, les étudiants contestataires veulent pouvoir faire de la propagande contre la guerre du Vietnam et aussi contre la ségrégation raciale (c’est un an après la “marche pour les droits civiques” du 28 août 1963 à Washington où Martin Luther King a prononcé son fameux discours “I have a dream”). Dans un premier temps, les autorités réagissent de façon extrêmement répressive, notamment avec l’envoi des forces de police contre les “sit-in”, l’occupation pacifique des locaux, faisant 800 arrestations. Finalement, début 1965, les autorités universitaires autorisent les activités politiques dans l’université qui va devenir un des principaux centres de la contestation étudiante aux États-Unis, alors que c’est notamment avec le slogan de “nettoyer le désordre à Berkeley” que Ronald Reagan est élu, contre toute attente, gouverneur de Californie fin 1965. Le mouvement va se développer massivement et se radicaliser dans les années suivantes autour de la protestation contre la ségrégation raciale, pour la défense des droits des femmes et surtout contre la guerre du Vietnam. En même temps que les jeunes américains, surtout les étudiants, fuient massivement à l’étranger pour éviter d’être envoyés au Vietnam, la plupart des universités du pays sont touchées par des mouvements anti-guerre massifs et des émeutes se développent dans les ghettos noirs des grandes villes (la proportion des jeunes noirs parmi les soldats envoyés au Vietnam est très supérieure à la moyenne nationale). Ces mouvements de protestation sont souvent réprimés avec férocité ; ainsi, fin 1967, 952 étudiants sont condamnés à de lourdes peines de prison pour avoir refusé de partir au front et le 8 février 1968, trois étudiants sont tués en Caroline du Sud lors d’une manifestation pour les droits civiques.
L’année 1968 est celle où les mouvements connaîtront leur plus grande ampleur. En mars, des étudiants noirs de l’université Howard à Washington occupent les locaux pendant 4 jours. Du 23 au 30 avril 1968, l’université de Columbia, à New York, est occupée, en protestation contre la contribution de ses départements aux activités du Pentagone et en solidarité avec les habitants du ghetto noir voisin de Harlem. Un des éléments qui a radicalisé le mécontentement est aussi l’assassinat de Martin Luther King, le 4 avril, qui avait été suivi de nombreuses et violentes émeutes dans les ghettos noirs du pays. L’occupation de Columbia est un des sommets de la contestation étudiante aux États-Unis qui va relancer de nouveaux affrontements. En mai, 12 universités se mettent en grève pour protester contre le racisme et la guerre au Vietnam. La Californie s’embrase pendant l’été, avec notamment de violents affrontements opposant des étudiants aux policiers à l’Université de Berkeley pendant deux nuits, ce qui va conduire le gouverneur de Californie, Ronald Reagan, à déclarer l’état d’urgence et le couvre feu. Cette nouvelle vague d’affrontements va connaître ses moments les plus violents entre le 22 et le 30 août à Chicago, avec de véritables émeutes, lors de la Convention du Parti démocrate.
Les révoltes des étudiants américains se propagent au cours de la même période en de nombreux autres pays.
Sur le continent américain, lui-même, c’est au Brésil et au Mexique que les étudiants sont les plus mobilisés.
Au Brésil, les manifestations anti-gouvernementales et anti-américaines ponctuent l’année 1967. Le 28 mars 1968, la police intervient lors d’une réunion d’étudiants, faisant un mort parmi eux, Luis Edson, et plusieurs blessés graves, dont un meurt quelques jours plus tard. L’enterrement de Luis Edson, le 29 mars, donne lieu à une importante manifestation. De l’université de Rio de Janeiro, qui se met en grève générale illimitée, le mouvement s’étend à l’université de Sao-Paulo, où des barricades sont érigées. Les 30 et 31 mars, de nouvelles manifestations ont lieu dans tout le pays. Le 4 avril, 600 personnes sont arrêtées à Rio. Malgré la répression et les arrestations en série, les manifestations sont quasi quotidiennes jusqu’en octobre.
Quelques mois après, c’est le Mexique qui est touché. Fin juillet, la révolte étudiante éclate à Mexico et la police réplique en employant des tanks. Le chef de la police du “district fédéral” de Mexico justifie ainsi la répression : il s’agit de faire barrage à “un mouvement subversif” qui “tend à créer une ambiance d’hostilité envers notre gouvernement et notre pays à la veille des Jeux de la 19e Olympiade”. La répression se poursuit et s’intensifie. Le 18 septembre, la cité universitaire est occupée par la police. Le 21 septembre, 736 personnes sont arrêtées lors de nouveaux affrontements dans la capitale. Le 30 septembre, l’université de Veracruz est occupée. Le 2 octobre, enfin, le gouvernement fait tirer (en utilisant des forces paramilitaires sans uniformes) sur une manifestation de 10 000 étudiants, sur la place des Trois-Cultures à Mexico. Cet événement, qui restera dans les mémoires comme le “massacre de Tlatelolco”, se solde par au moins deux cents morts, 500 blessés graves, et 2000 arrestations. Le président Díaz Ordaz a ainsi fait en sorte que les Jeux Olympiques puissent se dérouler “dans le calme” à partir du 12 octobre. Cependant, après la trêve des Jeux Olympiques, les étudiants reprendront le mouvement pendant plusieurs mois.
Le continent américain n’est pas seul à être touché par cette vague de révoltes étudiantes. En fait, ce sont TOUS les continents qui sont concernés.
En Asie, le Japon est le théâtre de mouvements particulièrement spectaculaires. De violentes manifestations contre les États-Unis et la guerre du Vietnam, menées principalement par la Zengakuren (Union nationale des comités autonomes des étudiants japonais), ont lieu dès 1963 et tout au long des années 60. A la fin du printemps 1968, la contestation estudiantine investit massivement les écoles et les universités. Un mot d’ordre est lancé : “transformons le Kanda [quartier universitaire de Tokyo] en Quartier latin”. En octobre, le mouvement, renforcé par les ouvriers, atteint son apogée. Le 9 octobre, à Tokyo, Osaka et Kyoto, des heurts violents entre policiers et étudiants se soldent par 80 blessés et 188 arrestations. La loi anti-émeute est remise en vigueur et 800 000 personnes descendent dans la rue pour protester contre cette décision. En réaction à l’intervention de la police dans l’université de Tokyo pour mettre fin à son occupation, 6000 étudiants se mettent en grève le 25 octobre. L’université de Tokyo, le dernier bastion encore entre les mains du mouvement, tombe à la mi-janvier 1969.
En Afrique, deux pays se distinguent, le Sénégal et la Tunisie.
Au Sénégal, les étudiants dénoncent l’orientation à droite du pouvoir et l’influence néocoloniale de la France, et demandent la restructuration de l’université. Le 29 mai 1968, la grève générale des étudiants et des ouvriers est sévèrement réprimée par Léopold Sédar Senghor, membre de “l’Internationale socialiste”, avec l’aide de l’armée. La répression fait 1 mort et 20 blessés à l’université de Dakar. Le 12 juin, une manifestation d’étudiants et de lycéens dans les faubourgs de Dakar se solde par une nouvelle victime.
En Tunisie, le mouvement a débuté en 1967. Le 5 juin, à Tunis, lors d’une manifestation contre les États-Unis et la Grande-Bretagne, accusés de soutenir Israël contre les pays arabes, le centre culturel américain est mis à sac et l’ambassade de Grande-Bretagne attaquée. Un étudiant, Mohamed Ben Jennet, est arrêté et condamné à 20 ans de prison. Le 17 novembre, les étudiants manifestent contre la guerre du Vietnam. Du 15 au 19 mars 68, ils se mettent en grève et manifestent pour obtenir la libération de Ben Jennet. Le mouvement est réprimé par des arrestations en série.
… en Europe…
Mais c’est en Europe que le mouvement étudiant connaîtra ses développements les plus importants et spectaculaires.
En Grande-Bretagne, l’effervescence commence dès octobre 1966 dans la très respectable “London School of Economics” (LSE), une des Mecque de la pensée économique bourgeoise, où les étudiants protestent contre la nomination comme président d’un personnage connu pour ses liens avec les régimes racistes de Rhodésie et d’Afrique du Sud. Par la suite, la LSE continue à être affectée par des mouvements de protestation. Par exemple, en mars 1967, il y a un sit-in de cinq jours contre des mesures disciplinaires qui conduit à la formation d’une “université libre”, à l’image des exemples américains. En décembre 1967 des sit-in ont lieu à la Regent Street Polytechnic et au Holborn College of Law and Commerce, avec la revendication, dans les deux cas, d’une représentation étudiante dans les institutions de direction. En mai et juin 1968 ont lieu des occupations à l’université d’Essex, au Hornsey College of Art, à Hull, Bristol et Keele suivi d’autres mouvements de protestation à Croydon, Birmingham, Liverpool, Guildford, et au Royal College of Arts. Les manifestations les plus spectaculaires (qui impliquent de nombreuses personnes d’horizons divers et avec des approches également variées) sont celles protestant contre la guerre du Vietnam : en mars et octobre 1967, en mars et octobre 1968 (cette dernière étant la plus massive), qui toutes donnent lieu à de violents affrontements avec la police avec des centaines de blessés et d’arrestations devant l’ambassade américaine à Grosvenor Square.
En Belgique, dès le mois d’avril 1968, les étudiants descendent à plusieurs reprises dans la rue, pour clamer leur opposition à la guerre du Vietnam et demander une refonte du fonctionnement du système universitaire. Le 22 mai, ils occupent l’Université libre de Bruxelles, la déclarant “ouverte à la population”. Ils libèrent les locaux fin juin, après la décision du Conseil de l’Université de prendre en compte certaines de leurs revendications.
En Italie, dès 1967, les étudiants multiplient les occupations d’universités et les heurts avec la police sont réguliers. L’université de Rome est occupée en février 1968. La police évacue les locaux, ce qui décide les étudiants à s’installer dans la faculté d’architecture, dans la Villa Borghese. Des affrontements violents, connus sous le nom de “bataille de Valle Giulia”, ont lieu avec les forces de l’ordre, qui chargent les étudiants. Parallèlement, on assiste à des mouvements spontanés de colère et de révolte dans des industries où le syndicalisme est faible (usine Marzotto en Vénétie), ce qui conduit les syndicats à décréter une journée de grève générale dans l’industrie qui est massivement suivie. Finalement, les élections de mai donneront le coup d’arrêt de ce mouvement qui avait commencé à décroître dès le printemps.
L’Espagne franquiste, connaît une vague de grèves ouvrières et d’occupations d’universités dès 1966. Le mouvement prend de l’ampleur en 1967 et se poursuit tout au long de 1968. Étudiants et ouvriers montrent leur solidarité, comme lorsque le 27 janvier 1967, 100 000 ouvriers manifestent en réaction à la répression brutale d’une journée de manifestation à Madrid, qui a poussé les étudiants, réfugiés dans l’immeuble des Sciences économiques, à combattre la police pendant 6 heures. Les autorités répriment par tous les moyens les contestataires : la presse est contrôlée, les militants des mouvements et syndicats clandestins sont arrêtés. Le 28 janvier 1968, le gouvernement instaure une “police universitaire” dans chaque université. Cela n’empêche pas l’agitation étudiante de reprendre, contre le régime franquiste et aussi contre la guerre du Vietnam, ce qui contraint les autorités à fermer “sine die” l’Université de Madrid en mars.
De tous les pays d’Europe, c’est en Allemagne que le mouvement étudiant est le plus puissant.
Dans ce pays, il s’est formé une “opposition extraparlementaire” à la fin de 1966, notamment en réaction contre la participation de la Social-démocratie au gouvernement, se basant en particulier sur des assemblées étudiantes de plus en plus nombreuses se tenant dans les universités et animées par des discussions sur les buts et les moyens de la protestation. Suivant l’exemple des États-Unis, de nombreux groupes universitaires de discussion se forment ; en tant que pôle d’opposition aux universités bourgeoises “établies”, une “Université critique” est constituée. Une vieille tradition de débat, de discussions dans des assemblées générales publiques, revit. Même si beaucoup d’étudiants sont attirés par des actions spectaculaires, l’intérêt pour la théorie, pour l’histoire du mouvement ouvrier refait surface et, avec cet intérêt, le courage d’envisager le renversement du capitalisme. Beaucoup d’éléments expriment l’espoir de l’émergence d’une nouvelle société. Dès ce moment-là, à l’échelle internationale, le mouvement de protestation en Allemagne est considéré comme le plus actif dans les discussions théoriques, le plus profond dans ces discussions, le plus politique.
Parallèlement à cette réflexion, de nombreuses manifestations ont lieu. La guerre du Vietnam constitue évidemment le motif principal de celles-ci dans un pays dont le gouvernement apporte un plein soutien à la puissance militaire américaine mais aussi qui a été particulièrement marqué par la Seconde Guerre mondiale. Les 17 et 18 février, se tient à Berlin un Congrès international contre la guerre du Vietnam suivi d’une manifestation de quelque 12 000 participants. Mais ces manifestations, débutées en 1965, dénoncent également le développement du caractère policier de l’État, notamment les projets de lois d’exception donnant à l’État la possibilité d’imposer la loi martiale dans le pays et d’intensifier la répression. Le SPD, qui a rejoint la CDU en 1966 dans un gouvernement de “grande coalition”, reste fidèle à sa politique de 1918-19, lorsqu’il avait conduit l’écrasement sanglant du prolétariat allemand. Le 2 juin 1967, une manifestation contre la venue à Berlin du Shah d’Iran est réprimée avec la plus grande brutalité par l’État “démocratique” allemand qui entretient les meilleures relations du monde avec ce dictateur sanguinaire. Un étudiant, Benno Ohnesorg, est assassiné d’un coup de feu dans le dos tiré par un policier en uniforme (qui sera acquitté par la suite). Après cet assassinat, les campagnes répugnantes de diffamation contre les mouvements de protestation s’intensifient, en particulier contre leurs dirigeants. Le tabloïd à grand tirage Bild-Zeitung demande qu’on “Arrête la terreur des jeunes rouges maintenant”. Lors d’une manifestation proaméricaine organisée par le Sénat de Berlin, le 21 février 1968, les participants proclament “L’ennemi du peuple n° 1 : Rudi Dutschke”, le principal porte-parole du mouvement de protestation. Un passant, ressemblant à “Rudi le rouge” est pris à partie par des manifestants qui menacent de le tuer. Une semaine après l’assassinat de Martin Luther King, cette campagne haineuse atteint son sommet avec la tentative d’assassinat contre Dutschke, le 11 avril, par un jeune excité, Josef Bachmann, notoirement influencé par les campagnes hystériques déchaînées par la presse du magnat Axel Springer, patron du Bild-Zeitung4. Des émeutes s’ensuivent qui prennent pour cible principale ce sinistre individu et son groupe de presse. Pendant plusieurs semaines, avant que les regards ne se tournent vers la France, le mouvement étudiant en Allemagne conforte ainsi son rôle de référence pour l’ensemble des mouvements qui touchent la plupart des pays d’Europe.
… et en France
L’épisode majeur de la révolte étudiante en France débute le 22 mars 1968 à l’université de Nanterre, dans la banlieue ouest de Paris. En eux-mêmes, les faits qui se sont déroulés ce jour-là n’avaient rien d’exceptionnel : pour protester contre l’arrestation d’un étudiant d’extrême-gauche de cette université soupçonné d’avoir participé à une attaque contre l’American Express à Paris lors d’une manifestation violente contre la guerre du Vietnam, 300 de ses camarades tiennent un meeting dans un amphithéâtre et 142 d’entre eux décident d’occuper pendant la nuit la salle du Conseil d’Université, dans le bâtiment administratif. Ce n’est pas la première fois que les étudiants de Nanterre manifestent leur mécontentement. Ainsi, juste un an auparavant, on avait déjà assisté dans cette université à un bras de fer entre étudiants et forces de police à propos de la libre circulation dans la résidence universitaire des filles qui était interdite aux garçons. Le 16 mars 1967, une association de 500 résidents, l’ARCUN, avait décrété l’abolition du règlement intérieur qui, entre autres, considérait les étudiantes, même majeures (de plus de 21 ans à cette époque), comme des mineures. A la suite de quoi, le 21 mars 1967, la police avait encerclé, à la demande de l’administration, la résidence des filles avec le projet d’arrêter les 150 garçons qui s’y trouvaient et qui s’étaient barricadés au dernier étage du bâtiment. Mais, le matin suivant, les policiers avaient eux-mêmes été encerclés par plusieurs milliers d’étudiants et avaient finalement reçu l’ordre de laisser sortir sans les inquiéter les étudiants barricadés. Mais, pas plus cet incident que d’autres manifestations de colère des étudiants, notamment contre le “plan Fouchet” de réforme de l’université à l’automne 1967, n’avait eu de lendemain. Il en fut tout autrement après le 22 mars 1968. En quelques semaines, une succession d’événements allait conduire non seulement à la plus forte mobilisation étudiante depuis la guerre, mais surtout à la plus grande grève de l’histoire du mouvement ouvrier international.
Avant de ressortir, les 142 occupants de la salle du Conseil décident, afin de maintenir et développer l’agitation, de constituer le Mouvement du 22 mars (M22). C’est un mouvement informel, composé au départ par des trotskistes de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) et des anarchistes (dont Daniel Cohn-Bendit), rejoints fin avril par les maoïstes de l’Union des jeunesses communistes marxistes-léniniste (UJCML), et qui va rallier, au cours des semaines suivantes, plus de 1200 participants. Les murs de l’université se couvrent d’affiches et de graffitis : “Professeurs, vous êtes vieux et votre culture aussi”, “Laissez-nous vivre”, “Prenez vos désirs pour des réalités”. Le M22 annonce pour le 29 mars une journée “université critique” à l’image des actions des étudiants allemands. Le doyen décide de fermer l’université jusqu’au 1er avril mais l’agitation reprend dès sa réouverture. Devant 1000 étudiants, Cohn-Bendit déclare : “Nous refusons d’être les futurs cadres de l’exploitation capitaliste”. La plupart des enseignants réagissent de façon conservatrice : le 22 avril, 18 d’entre eux, dont des gens de “gauche”, réclament “les mesures et les moyens pour que les agitateurs soient démasqués et sanctionnés”. Le doyen fait adopter toute une série de mesures répressives, notamment la libre circulation de la police dans les allées du campus alors que la presse se déchaîne contre les “enragés”, les “groupuscules” et les “anarchistes”. Le Parti “communiste” français, lui emboîte le pas : le 26 avril, Pierre Juquin, membre du Comité central, vient tenir un meeting à Nanterre : “Les agitateurs-fils à papa empêchent les fils de travailleurs de passer leurs examens”. Il ne peut pas terminer son discours et il doit s’enfuir. Dans l’Humanité du 3 mai, Georges Marchais, numéro 2 du PCF, se déchaîne à son tour : “Ces faux révolutionnaires doivent être énergiquement démasqués car objectivement ils servent les intérêts du pouvoir gaulliste et des grands monopoles capitalistes”.
Sur le campus de Nanterre, les bagarres sont de plus en plus fréquentes entre les étudiants d’extrême-gauche et les groupes fascistes d’Occident venus de Paris pour “casser du bolcho”. Devant cette situation, le doyen décide le 2 mai de fermer une nouvelle fois l’université qui est bouclée par la police. Les étudiants de Nanterre décident de tenir le lendemain un meeting dans la cour de la Sorbonne pour protester contre la fermeture de leur université et contre le passage en conseil de discipline de 8 membres du M22, dont Cohn-Bendit.
Le meeting ne rassemble que 300 participants : la plupart des étudiants préparent activement leurs examens de fin d’année. Cependant, le gouvernement, qui veut en finir avec l’agitation, décide de frapper un grand coup en faisant occuper le Quartier latin et encercler la Sorbonne par les forces de police, lesquelles pénètrent dans celle-ci, ce qui n’était pas arrivé depuis des siècles. Les étudiants qui sont repliés dans la Sorbonne obtiennent l’assurance qu’ils pourront sortir sans être inquiétés mais, si les filles peuvent partir librement, les garçons sont systématiquement conduits dans des “paniers à salade” dès qu’ils franchissent le portail. Rapidement, des centaines d’étudiants se rassemblent sur la place de la Sorbonne et insultent les policiers. Les grenades lacrymogènes commencent à pleuvoir : la place est dégagée mais les étudiants, de plus en plus nombreux, commencent alors à harceler les groupes de policiers et leurs cars. Les affrontements se poursuivent dans la soirée durant 4 heures : 72 policiers sont blessés et 400 manifestants sont arrêtés. Les jours suivants, les forces de police bouclent complètement les abords de la Sorbonne alors que 4 étudiants sont condamnés à des peines de prison ferme. Cette politique de fermeté, loin de faire taire l’agitation va au contraire lui donner un caractère massif. A partir du lundi 6 mai, des affrontements avec les forces de police déployées autour de la Sorbonne alternent avec des manifestations de plus en plus suivies, appelées par le M22, l’UNEF et le SNESup (syndicat des enseignants du Supérieur) et regroupant jusqu’à 45 000 participants aux cris de “La Sorbonne aux étudiants”, “Les flics hors du Quartier latin” et surtout “Libérez nos camarades”. Les étudiants sont rejoints par un nombre croissant de lycéens, d’enseignants, d’ouvriers et de chômeurs. Le 7 mai, les cortèges franchissent la Seine par surprise et parcourent les Champs-Élysées, à deux pas du palais présidentiel. L’Internationale retentit sous l’Arc de Triomphe, là où on entend, d’habitude, la Marseillaise ou la Sonnerie aux morts. Les manifestations gagnent aussi certaines villes de province.
Le gouvernement veut donner un gage de bonne volonté en rouvrant... l’université de Nanterre le 10 mai. Le soir du même jour, des dizaines de milliers de manifestants se retrouvent dans le Quartier latin devant les forces de police qui bouclent la Sorbonne. A 21 heures, certains manifestant commencent à édifier des barricades (il y en aura une soixantaine). A minuit, une délégation de 3 enseignants et de 3 étudiants (dont Cohn-Bendit) est reçue par le recteur de l’Académie de Paris mais ce dernier, s’il accepte la réouverture de la Sorbonne, ne peut rien promettre sur la libération des étudiants arrêtés le 3 mai. A 2 heures du matin, les CRS partent à l’assaut des barricades après les avoir arrosées copieusement de gaz lacrymogènes. Les affrontements sont d’une extrême violence provoquant des centaines de blessés de part et d’autre. Près de 500 manifestants sont arrêtés. Au Quartier latin, de nombreux habitants témoignent de leur sympathie en les recueillant chez eux ou en jetant de l’eau dans la rue pour les protéger des gaz lacrymogènes et des grenades offensives. Tous ces événements, et notamment les témoignages sur la brutalité des forces de répression, sont suivis à la radio, minute après minute, par des centaines de milliers de personnes. A 6 heures du matin, “l’ordre règne” au Quartier latin qui semble avoir été balayé par une tornade.
Le samedi 11 mai, l’indignation est immense à Paris et dans toute la France. Des cortèges spontanés se forment un peu partout regroupant non seulement des étudiants mais des centaines de milliers de manifestants de toutes origines, notamment beaucoup de jeunes ouvriers ou de parents d’étudiants. En province, de nombreuses universités sont occupées ; partout, dans la rue, sur les places, on discute et on condamne l’attitude des forces de répression.
Face à cette situation, le Premier ministre, Georges Pompidou, annonce dans la soirée qu’à partir du lundi 13 mai, les forces de police seront retirées du Quartier latin, que la Sorbonne sera rouverte et que les étudiants emprisonnés seront libérés.
Le même jour, toutes les centrales syndicales, y compris la CGT (centrale dirigée par le PCF qui n’avait cessé jusque-là de dénoncer les étudiants “gauchistes”), de même que les syndicats de policiers, appellent à la grève et à des manifestations pour le 13 mai, afin de protester contre la répression et contre la politique du gouvernement.
Le 13 mai, toutes les villes du pays connaissent les manifestations les plus importantes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La classe ouvrière est présente massivement aux côtés des étudiants. Un des mots d’ordre qui fait le plus recette est : “Dix ans, ça suffit !” par référence à la date du 13 mai 1958 qui avait vu le retour de de Gaulle au pouvoir. A la fin des manifestations, pratiquement toutes les universités sont occupées non seulement par les étudiants mais aussi par beaucoup de jeunes ouvriers. Partout, la parole est libérée. Les discussions ne se limitent pas aux questions universitaires, à la répression. Elles commencent à aborder tous les problèmes sociaux : les conditions de travail, l’exploitation, l’avenir de la société.
Le 14 mai, dans beaucoup d’entreprises, les discussions se poursuivent. Après les immenses manifestations de la veille, avec l’enthousiasme et le sentiment de force qui s’en sont dégagés, il est difficile de reprendre le travail comme si de rien n’était. A Nantes, les ouvriers de Sud-Aviation, entraînés par les plus jeunes d’entre eux, déclenchent une grève spontanée et décident d’occuper l’usine. La classe ouvrière a commencé à prendre le relais…
La signification des révoltes étudiantes des années 60
Ce qui caractérise l’ensemble de ces mouvements, c’est évidemment, avant tout, le rejet de la guerre du Vietnam. Mais, alors que les partis staliniens, alliés au régime de Hanoï et de Moscou, auraient dû logiquement se trouver à leur tête, tout au moins dans les pays où ils avaient une influence significative, comme ce fut le cas dans les mouvements anti-guerre lors de la guerre de Corée au début des années 1950, ce n’est nullement le cas ici. Au contraire, ces partis n’ont pratiquement aucune influence et, bien souvent, ils sont en complète opposition à ces mouvements5. C’est une des caractéristiques des mouvements étudiants de la fin des années 1960 qui révèle la signification profonde qu’ils recouvrent
C’est cette signification que nous allons tenter de dégager maintenant. Et pour ce faire, il est évidemment nécessaire de rappeler quels furent les principaux thèmes de mobilisation des étudiants à cette période.
Les thèmes des révoltes étudiantes des années 60 aux États-Unis...
Si l’opposition à la guerre menée par les États-Unis au Vietnam fut le thème le plus répandu et mobilisateur dans tous les pays occidentaux, ce n’est certainement pas un hasard, évidemment, si c’est d’abord dans le premier d’entre eux qu’ont commencé à se développer les révoltes étudiantes. La jeunesse américaine était confrontée de façon directe et immédiate à la question de la guerre puisque c’est elle qui était envoyée sur place défendre le “monde libre”. Des dizaines de milliers de jeunes américains ont payé de leur vie la politique de leur gouvernement, des centaines de milliers d’entre eux sont revenus du Vietnam avec des blessures et des handicaps, des millions ont été marqués à vie par ce qu’ils ont vécu dans ce pays. Outre l’horreur qu’ils ont connue sur place, et qui est propre à toutes les guerres, beaucoup d’entre eux ont été confrontés à la question : “Que faisions-nous au Vietnam ?” Le discours officiel était qu’ils étaient partis défendre la “démocratie”, le “monde libre” et la “civilisation”. Mais la réalité qu’ils avaient vécue contredisait de façon flagrante ces discours : le régime qu’ils étaient chargés de protéger, celui de Saigon, n’avait rien de “démocratique” ni de “civilisé” : c’était un régime militaire, dictatorial et particulièrement corrompu. Sur le terrain, les soldats américains avaient beaucoup de mal à comprendre qu’ils défendaient la “civilisation” lorsqu’on leur demandait de se conduire eux-mêmes comme des barbares, terrorisant et massacrant de pauvres paysans désarmés, femmes, enfant, vieillards compris. Mais ce n’était pas uniquement les soldats sur place qui étaient révulsés par les horreurs de la guerre, c’était aussi le cas d’une partie croissante de la jeunesse américaine. Non seulement les garçons craignaient de devoir partir à la guerre et les filles d’y perdre leurs compagnons, mais tous étaient de plus en plus informés par les “vétérans” qui en revenaient, ou tout simplement par les chaînes de télévision6, de la barbarie qu’elle représentait. La contradiction criante entre les discours sur la “défense de la civilisation et de la démocratie” dont se réclamait le gouvernement américain et ses agissements au Vietnam fut un des premiers aliments d’une révolte contre les autorités et les valeurs traditionnelles de la bourgeoisie américaine7. Cette révolte avait alimenté, dans un premier temps le mouvement Hippie, un mouvement pacifiste et non violent qui revendiquait le “Flower Power” (Pouvoir des fleurs) et dont un des slogans était “Make Love, not War” (“Faites l’amour, pas la guerre”). Ce n’est probablement pas un hasard si la première mobilisation étudiante d’envergure eut lieu à l’Université de Berkeley, dans la banlieue de San Francisco qui était justement la Mecque des hippies. Les thèmes et surtout les moyens de cette mobilisation avaient encore des ressemblances avec ce mouvement : emploi de “sit-in” non violents pour revendiquer le “Free Speech”. Cependant, comme dans beaucoup d’autres pays par la suite, et notamment en France en 1968, la répression qui s’est déchaînée à Berkeley a constitué un facteur important de “radicalisation” du mouvement. À partir de 1967, avec la fondation du Youth International Party (Parti international de la jeunesse), par Abbie Hoffman et Jerry Rubin qui avaient fait un passage dans la mouvance de la non-violence, le mouvement de révolte s’est donné une perspective “révolutionnaire” contre le capitalisme. Les nouveaux “héros” du mouvement n’étaient plus Bob Dylan ou Joan Baez, mais des figures comme Che Guevara (que Rubin avait rencontré en 1964 à La Havane). L’idéologie de ce mouvement était des plus confuses. Elle comportait des ingrédients anarchistes (comme le culte de la liberté, notamment de la liberté sexuelle ou de la consommation des drogues) mais aussi des ingrédients staliniens (Cuba et l’Albanie étaient considérées comme des modèles). Les moyens d’action empruntaient grandement à ceux des anarchistes, comme la dérision et la provocation. Ainsi, un des premiers faits d’armes du tandem Hoffman-Rubin fut de balancer des paquets de faux billets de banque à la Bourse de New York provoquant une ruée des occupants pour s’en emparer. De même, lors de la Convention démocrate de l’été 68, il présenta la candidature du cochon Pigasus à la présidence des États-Unis8 en même temps qu’il préparait un affrontement violent avec la police.
Pour résumer les caractéristiques principales des mouvements de révolte qui ont agité les États-Unis au cours des années 1960, on peut dire qu’ils se présentaient comme une protestation à la fois contre la guerre du Vietnam, contre la discrimination raciale, contre l’inégalité entre les sexes et contre la morale et les valeurs traditionnelles de l’Amérique. Comme la plupart de ses protagonistes le constataient (en s’affichant comme des enfants de bourgeois révoltés), ce mouvement n’avait aucunement un caractère de classe prolétarien. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si un de ses “théoriciens”, le professeur de philosophie Herbert Marcuse, considérait que la classe ouvrière avait été “intégrée” et que les forces de la révolution contre le capitalisme étaient à trouver parmi d’autres secteurs comme les Noirs victimes de la discrimination, les paysans du Tiers-monde ou les intellectuels révoltés.
... et dans les autre pays
Dans la plupart des autres pays occidentaux, les mouvements qui ont agité le monde étudiant pendant les années 1960 présentent de fortes ressemblances avec celui des États-Unis : rejet de l’intervention américaine au Vietnam, révolte contre les autorités, notamment universitaires, contre l’autorité en général, contre la morale traditionnelle, notamment sexuelle. C’est une des raisons pour lesquelles les partis staliniens, symboles d’autoritarisme, n’ont eu aucun écho au sein de ces révoltes alors qu’elles étaient parties de la dénonciation de l’intervention américaine au Vietnam contre des forces militaires portées à bout de bras par le bloc soviétique et qu’elles se réclamaient de “l’anti-capitalisme”. Il est vrai que l’image de l’URSS avait été grandement ternie par la répression de l’insurrection hongroise de 1956 et que le portrait du vieil apparatchik Brejnev ne faisait pas rêver. Les révoltés des années 1960 préféraient afficher dans leur chambre des posters de Ho Chi Minh (un autre vieil apparatchik, mais plus présentable et “héroïque”) et plus encore le visage romantique de Che Guevara (un autre membre d’un parti stalinien mais “exotique”) ou d’Angela Davis (elle aussi membre du parti stalinien américain, mais qui avait le double avantage d’être noire et femme, avec de plus un beau “look” comme Che Guevara).
Cette composante à la fois anti-guerre du Vietnam et “libertaire” s’est notamment retrouvée en Allemagne. Le principal porte-parole du mouvement, Rudi Dutschke, venait de la RDA sous tutelle soviétique où, très jeune, il s’était opposé à la répression de l’insurrection hongroise. Il condamnait le stalinisme comme une déformation bureaucratique du marxisme et considérait l’URSS comme appartenant à une même chaîne de régimes autoritaires qui gouvernaient le monde entier. Ses références idéologiques étaient le “jeune Marx” de même que l’École de Francfort (dont faisait partie Marcuse), et aussi l’Internationale situationniste (dont se revendique le groupe Subversive Aktion dont il fonde la section berlinoise en 1962) 9.
En fait, au cours des discussions qui se sont développées à partir de 1965 dans les universités allemandes, la recherche d’un “véritable marxisme anti-autoritaire” a connu un grand succès, ce qui explique que de nombreux textes du mouvement conseilliste aient été republiés à ce moment-là.
Les thèmes et revendications du mouvement étudiant qui s’est développé en France en 1968 sont fondamentalement les mêmes. Cela dit, au cours du mouvement, les références à la guerre du Vietnam sont largement éclipsées par toute une série de slogans d’inspiration situationniste ou anarchiste (voire surréaliste) qui couvrent les murs (“Les murs ont la parole”).
Les thèmes anarchistes se retrouvent notamment dans :
– La passion de la destruction est une joie créatrice (Bakounine)
– Il est interdit d’interdire
– La liberté est le crime qui contient tous les crimes
– Élections pièges à cons !
– L’insolence est la nouvelle arme révolutionnaire
Ils sont complétés par ceux qui appellent à la “révolution sexuelle” :
– Aimez-vous les uns sur les autres
– Déboutonnez votre cerveau aussi souvent que votre braguette
– Plus je fais l’amour, plus j’ai envie de faire la révolution. Plus je fais la révolution, plus j’ai envie de faire l’amour
La référence situationniste se retrouve dans :
– À bas la société de consommation !
– À bas la société spectaculaire marchande !
– Abolition de l’aliénation !
– Ne travaillez jamais !
– Je prends mes désirs pour la réalité car je crois en la réalité de mes désirs
– Nous ne voulons pas d’un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s’échange contre le risque de mourir d’ennui
– L’ennui est contre-révolutionnaire
– Vivre sans temps mort et jouir sans entrave
– Soyons réalistes, demandons l’impossible.
Par ailleurs le thème du conflit de générations (qui était très répandu aux États-Unis et en Allemagne) se retrouve (y compris sous des formes assez odieuses) dans :
– Cours camarade, le vieux monde est derrière toi !
– Les jeunes font l’amour, les vieux font des gestes obscènes.
De même, dans la France de mai 1968 qui se couvre régulièrement de barricades, il ne faut pas s’étonner de trouver :
– La barricade ferme la rue mais ouvre la voie
– L’aboutissement de toute pensée, c’est le pavé dans ta gueule, CRS
– Sous les pavés, la plage !
Enfin, la grande confusion de la pensée qui accompagne cette période est bien résumée par ces deux slogans :
– Il n’est pas de pensées révolutionnaires. Il n’est que des actes révolutionnaires.
– J’ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas quoi.
La nature de classe des mouvements étudiants des années 1960
Ces slogans, comme la plupart de ceux qui ont été mis en avant dans les autres pays, indiquent clairement que le mouvement étudiant des années 1960 n’avait nulle nature de classe prolétarienne, même si en plusieurs endroits (comme en France, évidemment, et aussi en Italie, en Espagne ou au Sénégal) il y eut la volonté d’établir un pont avec les luttes de la classe ouvrière. Cette démarche manifestait d’ailleurs une certaine condescendance envers cette dernière mêlée d’une fascination envers cet être mythique, l’ouvrier en bleu de chauffe, héros des lectures mal digérées des classiques du marxisme.
Fondamentalement, le mouvement des étudiants des années 1960 était de nature petite-bourgeoise, un des aspects les plus clairs en étant, outre son caractère anarchisant, la volonté de “changer la vie tout de suite”, l’impatience et l’immédiatisme étant une des marques de fabrique d’une couche sociale, comme la petite bourgeoisie, qui n’a pas d’avenir à l’échelle de l’histoire.
Le radicalisme “révolutionnaire” de l’avant-garde de ce mouvement, y compris le culte de la violence promu par certains de ses secteurs, est aussi une autre illustration de sa nature petite-bourgeoise 10. En fait, les préoccupations “révolutionnaires” des étudiants de 1968 étaient incontestablement sincères mais elles étaient fortement marquées par le tiers-mondisme (guévarisme ou maoïsme) sinon par l’anti-fascisme. Elles avaient une vision romantique de la révolution sans la moindre idée du processus réel de développement du mouvement de la classe ouvrière qui y conduit. En France, pour les étudiants qui se croyaient “révolutionnaires”, le mouvement de Mai 68 était déjà la Révolution, et les barricades qui se dressaient jour après jour étaient présentées comme les héritières de celles de l'insurrection de juin 1848 et de la Commune de 1871.
Une des composantes du mouvement étudiant des années 1960 est le “conflit de générations”, le clivage très important entre la nouvelle génération et celle de ses parents à laquelle étaient adressées de multiples critiques. En particulier, du fait que cette génération avait travaillé dur pour se sortir de la situation de misère, voire de famine, résultant de la Seconde Guerre mondiale, il lui était reproché de ne se préoccuper que de bien-être matériel. D’où le succès des fantaisies sur la “société de consommation” et de slogans tels que “Ne travaillez jamais !”. Fille d’une génération qui avait subi de plein fouet la contre-révolution, la jeunesse des années 1960 lui reprochait son conformisme et sa soumission aux exigences du capitalisme. Réciproquement, beaucoup de parents ne comprenaient pas et avaient du mal à accepter que leurs enfants traitent avec mépris les sacrifices qu’ils avaient consentis pour leur donner une situation économique meilleure que la leur.
Cependant, il existait une réelle détermination économique à la révolte étudiante des années 1960. A l’époque, il n’y avait pas de menace majeure de chômage ou de précarité à la fin des études comme c’est le cas aujourd’hui. L’inquiétude principale qui affectait alors la jeunesse estudiantine était de ne pouvoir désormais accéder au même statut social que celui dont avait bénéficié la génération précédente de diplômés de l’université. En fait, la génération de 1968 était la première à être confrontée avec une certaine brutalité au phénomène de “prolétarisation des cadres” abondamment étudiée par les sociologues de l’époque. Ce phénomène avait débuté quelques années auparavant, avant même que la crise ouverte ne vienne se manifester, à la suite d’une augmentation très sensible du nombre d’étudiants dans les universités (par exemple, le nombre d’étudiants en Allemagne est passé de 330 000 à 1,1 million entre 1964 et 1974). Cette augmentation résultait des besoins de l’économie mais aussi de la volonté et de la possibilité pour la génération de leurs parents de pourvoir ses enfants d’une situation économique et sociale supérieure à la sienne. C’est entre autres cette “massification” de la population étudiante qui avait provoqué le malaise grandissant résultant de la permanence au sein de l’Université de structures et de pratiques héritées d’un temps où seule une élite pouvait la fréquenter, notamment un fort autoritarisme.
Cependant, si le mouvement étudiant qui débute en 1964 se développe dans une période de “prospérité” pour le capitalisme”, il n’en est plus de même à partir de 1967 où la situation économique de celui-ci a commencé à se dégrader sérieusement renforçant le malaise de la jeunesse étudiante. C’est une des raisons qui permet de comprendre pourquoi ce mouvement a connu en 1968 son apogée. C’est ce qui permet d’expliquer pourquoi, en mai 1968, le mouvement de la classe ouvrière a pris le relais.
C’est ce que nous verrons dans le prochain article.
Fabienne
1 David Caute, 1968 dans le monde. Paris : Laffont, 1988 ; traduit de Sixty-Eight: The Year of the Barricades, London: Hamilton, 1988 ; également paru aux États-Unis sous le titre : The Year of the Barricades: A Journey through 1968, New York: Harper & Row, 1988.
2 Mark Kurlansky, 1968 : l’année qui ébranla le monde. Paris : Presses de La Cité, 2005 ; traduit de 1968: The Year That Rocked the World. New York: Ballantine Books, 2004.
3 Un certain nombre de nos publications territoriales a déjà ou va publier des articles sur les événements qui se sont déroulés dans leurs pays respectifs.
4 Rudi Dutschke a survécu à l'attentat mais en a conservé de graves séquelles neurologiques qui sont en partie responsables de sa mort prématurée à 39 ans, le 24 décembre 1979, 3 mois avant la naissance de son fils, Rudi Marek. Bachmann a été condamné à 7 ans de prison pour tentative de meurtre. Dutschke a pris contact avec son agresseur par écrit pour lui expliquer qu'il n'avait pas de ressentiment personnel à son égard et pour tenter de le convaincre de la justesse d'un engagement socialiste. Bachmann s'est suicidé en prison le 24 février 1970. Dutschke a regretté de ne pas lui avoir écrit plus fréquemment : “la lutte pour la libération vient juste de commencer ; malheureusement, Bachmann ne pourra plus y participer…”.
5 Des mouvements d’étudiants ont également affecté des pays à régime stalinien en 1968. En Tchécoslovaquie, ils étaient partie prenante du “Printemps de Prague” promu par un secteur du parti stalinien et ne peuvent donc être considérés comme des mouvements remettant en cause le régime. Tout autre est la situation en Pologne. Des manifestations d’étudiants contestataires, déclenchées par l’interdiction d’un spectacle considéré comme anti-soviétique, sont réprimées le 8 mars par la police. Pendant le mois de mars, la tension monte, les étudiants multipliant occupation des universités et manifestations. Sous la houlette du ministre de l’Intérieur, le général Moczar, chef de file du courant des “partisans” dans le parti stalinien, ils sont réprimés brutalement en même temps que les juifs du parti sont expulsés pour “sionisme”.
6 Lors de la guerre du Vietnam, les médias américains n’étaient pas assujettis aux autorités militaires. C’est une “erreur” que n’a pas renouvelée le gouvernement américain lors des guerres contre l’Irak en 1991 et à partir de 2003.
7 Un tel phénomène n’eut pas lieu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : les soldats américains avaient également vécu l’enfer, notamment ceux qui ont débarqué en Normandie en 1944, mais leurs sacrifices furent acceptés par la presque totalité d’entre eux et par la population grâce à l’exposition par les autorités et les médias de la barbarie du régime nazi.
8 Au début du xxe siècle, des anarchistes français avaient présenté un âne aux élections législatives.
9 Pour une présentation synthétique des positions politiques du situationnisme, voir notre article “Guy Debord : La deuxième mort de l’Internationale situationniste” publié dans la Revue internationale n° 80, https://fr.internationalism.org/rinte80/debord.htm [17].
10 Il faut noter que, dans la plupart des cas (aussi bien dans les pays à régime “autoritaire” que dans les plus “démocratiques”), les autorités ont réagi de façon extrêmement brutale aux manifestations étudiantes, même lorsqu’elles étaient au départ pacifiques. Pratiquement partout, la répression, loin d’intimider les protestataires, a constitué un facteur de mobilisation massive et de radicalisation du mouvement. Beaucoup d’étudiants qui, au départ, ne se considéraient nullement comme “révolutionnaires” n’ont pas hésité à se nommer ainsi au bout de quelques jours ou semaines à la suite du déchaînement d’une répression qui a plus fait pour révéler le véritable visage de la démocratie bourgeoise que tous les discours de Rubin, Dutschke ou Cohn-Bendit.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [18]
Les causes de la prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (débat interne au CCI)
- 6023 lectures
Même si, dans la réalité,
les développements de la crise avant et depuis la fin des
"Trente glorieuses" ont largement montré que cette
période ne constituait qu'une exception au sein d'un siècle
de décadence du capitalisme, l'importance des questions
débattues n'est néanmoins pas à négliger.
En effet, ces questions renvoient au cœur de l'analyse marxiste
permettant de comprendre aussi bien le caractère
historiquement limité du mode de production capitaliste, que
l'entrée en décadence de ce système et le
caractère insoluble de sa crise actuelle ; c'est-à-dire
qu'elles concernent un des principaux fondements objectifs matériels
de la perspective révolutionnaire du prolétariat.
Le contexte du débat : certaines contradictions de nos analyses
La relecture critique de notre brochure, La décadence du capitalisme 2, a suscité une réflexion au sein de notre organisation et a donné naissance à un débat contradictoire dont les termes étaient déjà posés dans le mouvement ouvrier - et notamment au sein de la Gauche communiste - concernant les implications économiques de la guerre en phase de décadence du capitalisme. En effet, La décadence du capitalisme développe explicitement l'idée que les destructions provoquées par les guerres de la phase de décadence, et en particulier les guerres mondiales, sont à même de constituer un débouché à la production capitaliste, celui de la reconstruction :
"... les débouchés se sont rétrécis de façon vertigineuse. De ce fait, le capitalisme a dû recourir à la destruction et à la production de moyens de destruction comme palliatifs pour tenter de compenser ses pertes accélérées en 'espace vital'" (Chapitre : Quel développement des forces productive ? Paragraphe : La "croissance" mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale)
"Dans la destruction massive en vue de la reconstruction, le capitalisme découvre une issue dangereuse et provisoire, mais efficace, pour ses nouveaux problèmes de débouchés.
Au cours de la première guerre, les destructions n'ont pas été "suffisantes" (...) Dès 1929, le capitalisme mondial se heurte de nouveau à une crise.
Tout comme si la leçon avait été retenue, les destructions de la Seconde Guerre mondiale sont beaucoup plus importantes en intensité et en étendue (...) une guerre qui, pour la première fois, se donne le but conscient de détruire systématiquement le potentiel industriel existant. La "prospérité" de l'Europe et du Japon après la guerre semble déjà systématiquement prévue au lendemain de la guerre. (Plan Marshall, etc.)" (Paragraphe : Le cycle guerre-reconstruction)
Une telle idée est également présente
dans certains textes de l'organisation (notamment de la Revue
internationale) de même que chez nos prédécesseurs
de Bilan qui, dans un article intitulé "Crises
et cycles dans l'économie du capitalisme agonisant",
affirmaient : "Le massacre va dès lors constituer
pour la production capitaliste un immense débouché
ouvrant de "magnifiques" perspectives (...) Si la guerre
est le grand débouché de la production capitaliste,
dans la "paix" le militarisme (en tant qu'ensemble des
activités préparant la guerre) réalisera la
plus-value des productions fondamentales contrôlées par
le capital financier " (Bilan n° 11 ;
septembre 1934 - republié dans la Revue internationale
n° 103).
Par contre, d'autres textes de l'organisation, parus avant et après la brochure sur La décadence du capitalisme, développent une analyse opposée du rôle de la guerre en période de décadence, rejoignant en cela le "Rapport adopté à la Conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France", pour qui la guerre :
"fut le moyen indispensable au capitalisme lui ouvrant des possibilités de développement ultérieur, à l'époque où ces possibilités existaient et ne pouvaient être ouvertes que par le moyen de la violence. De même, le croulement du monde capitaliste ayant épuisé historiquement toutes les possibilités de développement, trouve dans la guerre moderne, la guerre impérialiste, l'expression de ce croulement qui, sans ouvrir aucune possibilité de développement ultérieur pour la production, ne fait qu'engouffrer dans l'abîme les forces productives et accumuler à un rythme accéléré ruines sur ruines." (Souligné par nous).
Le rapport sur le Cours historique adopté au 3e congrès du CCI 3, se réfère explicitement à ce passage du texte de la GCF de même que l'article Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme publié en 1988 4, où il est souligné :
"Et ce qui caractérise toutes ces
guerres, comme les deux guerres mondiales, c'est qu'à aucun
moment, contrairement à celles du siècle dernier, elles
n'ont permis un quelconque progrès dans le développement
des forces productives, mais n'ont eu d'autre résultat que des
destructions massives laissant complètement exsangues les pays
où elles se sont déroulées (sans compter les
horribles massacres qu'elles ont provoqués)."
Le cadre du débat
Pour importantes que soient ces questions, puisque
la réponse que leur donnent les révolutionnaires
participe directement de la cohérence de leur cadre politique
général, il convient néanmoins de préciser
qu'elles sont d'une nature différente de certaines autres qui
participent directement à délimiter le camp du
prolétariat de celui de la bourgeoisie, comme
l'internationalisme, le rôle anti-ouvrier des syndicats, de la
participation au jeu parlementaire, etc. Autrement dit, les
différentes analyses en présence sont entièrement
compatibles avec la plate-forme du CCI.
Si des idées de La décadence du capitalisme se sont ainsi trouvé critiquées, remises en cause, c'est cependant avec la même méthode et le même cadre global d'analyse auxquels le CCI se référait déjà au moment de l'écriture de cette brochure et qu'il a enrichis depuis lors 5. Nous en rappelons les éléments constitutifs essentiels :
1. La reconnaissance de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence avec l'éclatement de la Première Guerre mondiale au début du 20e siècle et du caractère dorénavant insurmontable des contradictions qui assaillent ce système. Il s'agit ici de la compréhension des manifestations et des conséquences politiques du changement de période tel que le caractérisait le mouvement ouvrier à cette époque, notamment lorsqu'il parlait à son propos de "l'ère des guerres et des révolutions" au sein de laquelle le système était désormais entré.
2. Lorsqu'on analyse la dynamique du mode de production capitaliste sur toute une période, ce n'est pas à l'étude séparée des différents acteurs capitalistes (nations, entreprises, etc.) qu'il convient de procéder, mais bien à celle de l'entité capitalisme mondial prise comme un tout, laquelle fournit la clé pour comprendre les spécificités de chacune de ses parties. C'était aussi la méthode de Marx lorsque, étudiant la reproduction du capital, il précise : "Pour débarrasser l'analyse générale d'incidents inutiles, il faut considérer le monde commerçant comme une seule nation." (Livre I du Capital).
3. "Contrairement à ce que prétendent les adorateurs du capital, la production capitaliste ne crée pas automatiquement et à volonté les marchés nécessaires à sa croissance. Mais en généralisant ses rapports à l'ensemble de la planète et en unifiant le marché mondial, il a atteint un degré critique de saturation des mêmes débouchés qui lui avaient permis sa formidable expansion du 19ème siècle. De plus la difficulté croissante pour le capital de trouver des marchés où réaliser sa plus-value, accentue la pression à la baisse qu'exerce sur son taux de profit l'accroissement constant de la proportion entre la valeur des moyens de production et celle de la force de travail qui les met en œuvre. De tendancielle, cette baisse du taux de profit devient de plus en plus effective, ce qui entrave d'autant le procès d'accumulation du capital, et donc le fonctionnement de l'ensemble des rouages du système" (Plate-forme du CCI)
4. Il revient à Rosa Luxemburg, en s'appuyant sur les travaux de Marx et critiquant ce qu'elle considérait être certaines insuffisances de ceux-ci, d'avoir mis en évidence de façon centrale que l'enrichissement du capitalisme, comme un tout, dépendait des marchandises produites en son sein et échangées avec des économie précapitalistes, c'est-à-dire pratiquant l'échange marchand mais n'ayant pas encore adopté le mode de production capitaliste : "Mais dans la réalité les conditions concrètes de l'accumulation du capital total diffèrent des conditions de la reproduction simple du capital social total comme de celles de l'accumulation du capital individuel. Le problème se pose ainsi : comment s'effectue la reproduction sociale si l'on pose le fait que la plus-value n'est pas tout entière consommée par les capitalistes, mais qu'une part croissante en est réservée à l'extension de la production ? Dans ces conditions, ce qui reste du produit social, déduction faite de la partie destinée au renouvellement du capital constant, ne peut a priori être entièrement consommé par les ouvriers et par les capitalistes ; et ce fait est la donnée essentielle du problème. Il est donc exclu que les ouvriers et les capitalistes puissent réaliser le produit total eux-mêmes. Ils ne peuvent réaliser que le capital variable, la partie usée du capital constant et la partie consommée de la plus-value ; ce faisant ils recréent seulement les conditions nécessaires à la continuation de la reproduction à la même échelle. Mais ni les ouvriers ni les capitalistes ne peuvent réaliser eux-mêmes la partie de la plus-value destinée à la capitalisation. La réalisation de la plus-value aux fins d'accumulation se révèle comme une tâche impossible dans une société composée exclusivement d'ouvriers et de capitalistes". (Rosa Luxemburg, L'accumulation du Capital ; Chapitre : La reproduction du capital et son milieu). Le CCI reprend à son compte cette position, ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse pas exister au sein de notre organisation d'autres positions qui critiquent l'analyse économique de Rosa, comme nous le verrons en particulier à propos de l'une des positions en présence dans le débat. De la même façon, ces analyses avaient été combattues en leur temps, non seulement par les courants réformistes, qui estimaient que le capitalisme n'était pas condamné à provoquer des catastrophes croissantes, mais aussi par des courants révolutionnaires, et non des moindres, représentés notamment par Lénine et Pannekoek, qui considéraient que le capitalisme était devenu un mode de production historiquement obsolète, même si leurs explications différaient de celle de Rosa Luxemburg.
5. Le phénomène de l'impérialisme découle justement de l'importance que représente, pour les pays développés, l'accès aux marchés extra-capitalistes : "L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde." (Rosa Luxemburg, L'accumulation du Capital ; Chapitre : Le protectionnisme et l'accumulation)
6. Le caractère historiquement limité des débouchés extra-capitalistes constitue le fondement économique de la décadence du capitalisme. La Première Guerre mondiale est l'expression d'une telle contradiction. Le partage du monde par les grandes puissances étant achevé, les plus mal loties en colonies parmi ces puissances n'ont alors d'autre choix, pour accéder aux marchés extra-capitalistes, que d'entreprendre un repartage du monde par la force militaire. L'entrée du capitalisme dans sa phase de déclin signifie que les contradictions qui assaillent ce système sont désormais insurmontables.
7. La mise en place de mesures de capitalisme d'Etat constitue un moyen que se donne la bourgeoisie, dans la décadence du capitalisme, pour faire en sorte, à travers différents palliatifs, de freiner l'enfoncement dans la crise et d'en atténuer les manifestations les plus brutales, afin d'éviter qu'elles ne se manifestent à nouveau sous la forme brutale qu'avait revêtu la crise de 1929.
8. Dans la période de décadence, le crédit constitue un moyen essentiel par lequel la bourgeoisie tente de pallier à l'insuffisance de débouchés extra-capitalistes. L'accumulation d'une dette mondiale de moins en moins contrôlable, l'insolvabilité croissante des différents acteurs capitalistes et les menaces de déstabilisation profonde de l'économie mondiale qui en résultent illustrent l'impasse de ce palliatif.
9. Une manifestation typique de la
décadence du capitalisme est constituée, sur le plan
économique, par l'envol des dépenses improductives.
Celles-ci sont la manifestation du fait que le développement
des forces productives se trouve de plus en plus entravé par
les contradictions insurmontables du système : les
dépenses militaires (armements, opérations militaires)
pour faire face à l'exacerbation mondiale des tensions
impérialistes ; les dépenses pour entretenir et
équiper les forces de répression pour faire face, en
dernière instance, à la lutte de classe ; la
publicité, arme de la guerre commerciale pour vendre sur un
marché sursaturé, etc. Du point de vue économique,
de telles dépenses constituent une pure perte pour le capital.
L'articulation des
positions en présence
Au sein du CCI, il existe une position qui, tout en étant d'accord avec notre plate-forme, est en désaccord avec de nombreux aspects de la contribution de Rosa Luxemburg sur les fondements économiques de la crise du capitalisme 6. Pour cette position, les fondements de la crise se situent dans cette autre contradiction mise en évidence par Marx, la baisse du taux de profit. Tout en rejetant les conceptions (bordiguistes et conseillistes notamment) qui imaginent que le capitalisme peut générer automatiquement et éternellement l'expansion de son propre marché à la simple condition que le taux de profit soit suffisamment élevé, elle souligne que la contradiction fondamentale du capitalisme ne se situe pas tant dans les limites du marché en elles-mêmes (c'est-à-dire la forme sous laquelle se manifeste la crise), mais bien dans celles qui s'imposent à l'expansion de la production.
Le débat
de fond dont relève la discussion de cette position est plus
celui déjà mené en polémique avec
d'autres organisations (même s'il existe des différences
dans les positions en présence) à propos de la baisse
du taux de profit et de la saturation des marchés7.
Néanmoins, comme nous allons le voir par la suite, dans le
débat actuel il existe une certaine convergence entre cette
position et une autre dite du "capitalisme d'Etat
keynésiano-fordiste" qui est présentée
ci-après. Ces deux positions reconnaissent l'existence d'un
marché interne aux rapports de production capitalistes qui a
constitué un facteur de prospérité au cours de
la période des "Trente Glorieuses", et analysent la
fin de cette dernière comme le produit de la contradiction
"baisse du taux de profit".
Les autres positions qui se sont exprimées dans le débat se revendiquent de la cohérence développée par Rosa Luxemburg, accordant à la question de l'insuffisance des marchés extra-capitalistes un rôle central dans la crise du capitalisme.
C'est justement en s'appuyant sur ce cadre d'analyse qu'une partie de l'organisation a estimé qu'il existait des contradictions dans la brochure sur La décadence du capitalisme, qui se revendique aussi d'un tel cadre, dans la mesure où cette brochure fait résulter l'accumulation ayant été à la base de la prospérité des Trente glorieuses de l'ouverture d'un marché, celui de la reconstruction, qui n'a rien d'extra-capitaliste.
Face à ce désaccord exprimé en notre sein, il s'est développé une position - présentée sous le titre "L'économie de guerre et le capitalisme d'Etat" - qui, quoique critique par rapport à certains aspects de notre brochure, lui reprochant notamment des manques de rigueur de même qu'une absence de référence au plan Marshall pour expliquer la reconstruction proprement dite, n'en constitue pas moins, sur le fond, "une défense de l'idée que la prospérité de la période des années 50 et 60 est déterminée par la situation globale des rapports impérialistes et l'instauration d'une économie de guerre permanente suite à la deuxième guerre mondiale".
Au sein de cette partie de l'organisation remettant en cause l'analyse effectuée par La décadence du capitalisme de la phase des Trente Glorieuses, il existe en fait deux interprétations de la prospérité de cette période.
La première interprétation, présentée ci-dessous sous le titre "Marchés extra-capitalistes et endettement", ne fait que reprendre à son compte, en les revalorisant, ces deux facteurs déjà avancés par l'organisation à différentes étapes de son existence8. Selon cette position, "ces deux facteurs sont suffisants pour expliquer la prospérité des Trente Glorieuses".
La seconde
interprétation, présentée sous le titre "Le
capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste",
"part du même constat établi dans
notre brochure sur La décadence - le constat de la
saturation relative des marchés en 1914 eu égard aux
besoins de l'accumulation atteint à l'échelle
mondiale -, et développe l'idée que le système
y a répondu en instaurant une variante de capitalisme d'Etat
qui s'appuie sur une tri-répartition contrainte
(keynésianisme) de forts gains de productivité
(fordisme) au bénéfice des profits, des revenus de
l'Etat et des salaires réels".
L'objectif de
ce premier article à propos du débat en notre sein sur
les Trente Glorieuses est de se limiter à une présentation
générale de celui-ci, comme nous venons de le faire, et
de procéder à l'exposé synthétique de
chacune des trois positions principales ayant alimenté la
discussion, comme nous le faisons ci-après 9.
Plus tard seront publiées des contributions contradictoires
entre les différents points de vue, ceux évoqués
ici, ou bien encore d'autres s'ils devaient en apparaître au
cours du débat. A cette occasion les différentes
positions en présence pourront être également
être explicitées davantage.
L'économie
de guerre et le capitalisme d'Etat
Le point de départ de cette position a déjà été explicité par la Gauche communiste de France en 1945. Celle-ci considère qu'à partir de 1914 les marchés extra-capitalistes qui ont fourni au capitalisme son nécessaire champ d'expansion pendant sa période ascendante ne sont plus capables de remplir ce rôle : "Cette période historique est celle de la décadence du système capitaliste. Qu'est-ce que cela signifie ? La bourgeoisie qui, avant la première guerre impérialiste, vivait et ne peut vivre que dans une extension croissante de sa production, est arrivée à ce point de son histoire où elle ne peut plus dans son ensemble réaliser cette extension. (...) Aujourd'hui à part des contrées lointaines inutilisables, à part des débris dérisoires du monde non capitaliste, insuffisants pour absorber la production mondiale, il se trouve maître du monde, il n'existe plus devant lui les pays extra-capitalistes qui pouvaient constituer pour son système des nouveaux marchés : ainsi son apogée est aussi le point où commence sa décadence".10
L'histoire économique depuis 1914 est celle des tentatives de la classe bourgeoise, dans différents pays et à différents moments, de surmonter ce problème fondamental : comment continuer à accumuler la plus-value produite par l'économie capitaliste dans un monde déjà partagé entre les grandes puissances impérialistes et dont le marché est incapable d'absorber l'ensemble de cette plus-value ? Et puisque les puissances impérialistes ne peuvent plus s'étendre qu'aux dépens de leurs rivales, dès qu'une guerre se termine il faut se préparer à la suivante. L'économie de guerre devient le mode de vie permanent de la société capitaliste. "La production de guerre n'a pas pour objectif la solution d'un problème économique. A l'origine elle est le fruit d'une nécessité de l'Etat capitaliste de se défendre contre les classes dépossédées et de maintenir par la force leur exploitation, d'une part, et d'assurer par la force ses positions économiques et de les élargir aux dépens des autres Etats impérialistes (...) La production de guerre devient ainsi l'axe de la production industrielle et le principal champ économique de la société" (Internationalisme, "Rapport sur la situation internationale", Juillet 1945).
La période de la Reconstruction - les "30 Glorieuses" - est un moment particulier de cette histoire.
Trois caractéristiques économiques du monde en 1945 sont à souligner ici :
-
Premièrement, il y a l'énorme prépondérance économique et militaire des Etats-Unis, fait quasiment sans précédent dans l'histoire du capitalisme. Les Etats-Unis à eux seuls représentent la moitié de la production mondiale et détiennent presque 80% des réserves mondiales d'or. Ils sont le seul pays belligérant dont l'appareil productif est sorti indemne de la guerre : son PIB a doublé entre 1940 et 1945. Ils ont absorbé tout le capital accumulé de l'empire britannique pendant des siècles d'expansion coloniale, plus une bonne partie de celui de l'empire français.
-
Deuxièmement, il y a une conscience aiguë parmi les classes dominantes du monde occidental qu'il est indispensable d'élever le niveau de vie de la classe ouvrière si elles veulent écarter le danger de troubles sociaux pouvant faire le jeu des Staliniens et donc du bloc impérialiste russe adverse. L'économie de guerre intègre donc un nouveau volet, dont nos prédécesseurs de la GCF n'avaient pas vraiment conscience à l'époque : l'ensemble des prestations sociales (santé, allocations chômage, retraites, etc.) que la bourgeoisie - et surtout la bourgeoisie du bloc occidental - met en place à partir du début de la Reconstruction dans les années 1940.
-
Troisièmement, le capitalisme d'Etat qui, avant la deuxième guerre mondiale, avait exprimé une tendance vers l'autarcie des différentes économies nationales est maintenant encadré dans une structure de blocs impérialistes qui déterminent les relations économiques entre les Etats (système Bretton Woods pour le bloc américain, Comecon pour le bloc russe).
Pendant la Reconstruction le capitalisme d'Etat connaît une évolution qualitative : la part de l'Etat dans l'économie nationale devient prépondérante.11 Même aujourd'hui, après 30 années de prétendu « libéralisme », les dépenses de l'Etat continuent de représenter entre 30 et 60% des PIB des pays industrialisés.
Ce nouveau poids de l'Etat représente une transformation de quantité en qualité. L'Etat n'est plus seulement le « comité exécutif » de la classe dominante, il est aussi le plus grand employeur et le plus grand marché. Aux Etats-Unis, par exemple, le Pentagone devient le principal employeur du pays (entre trois et quatre millions de personnes, civils et militaires compris). En tant que tel, il joue un rôle critique dans l'économie et permet l'exploitation plus à fond des marchés existants.
La mise en place du système Bretton Woods permet également la mise en place de mécanismes de crédit plus sophistiqués et moins fragiles que par le passé : le crédit à la consommation se développe et les institutions économiques mises en place par le bloc américain (FMI, Banque Mondiale, GATT) permettent d'éviter des crises financières et bancaires.
L'énorme prépondérance économique
des Etats-Unis a permis à la bourgeoisie américaine de
dépenser sans compter afin d'assurer sa domination militaire
face au bloc russe : elle a soutenu deux guerres sanglantes et
coûteuses (en Corée et au Vietnam) ; les plans de
type Marshall et les investissements à l'étranger ont
financé la reconstruction des économies ruinées
en Europe et en Asie (notamment en Corée et au Japon). Mais
cet énorme effort - déterminé non pas par le
fonctionnement « classique » du capitalisme
mais par l'affrontement impérialiste qui caractérise
la décadence du système - a fini par ruiner
l'économie américaine. En 1958 la balance de
paiements américaine est déjà déficitaire
et, en 1970, les Etats-Unis ne détiennent plus que 16% des
réserves mondiales d'or. Le système Bretton Woods
prend l'eau de toutes parts, et le monde plonge dans une crise dont
il n'est plus sorti jusqu'à nos jours.
Les marchés extra-capitalistes et
l'endettement
Loin de participer au développement des forces productives sur des bases comparables à celles de l'ascendance du capitalisme, la période des Trente Glorieuses se caractérise par un énorme gaspillage de plus-value qui signale l'existence des entraves au développement des forces productives propres à la décadence de ce système.
La reconstruction consécutive à la Première Guerre mondiale ouvrit une phase de prospérité de seulement quelques années pendant lesquelles, comme avant l'éclatement du conflit, la vente aux marchés extra-capitalistes a constitué le débouché nécessaire à l'accumulation capitaliste. En effet, même si le monde était alors partagé entre les plus grandes puissances industrielles, il était cependant encore loin d'être dominé par les rapports de production capitalistes. Néanmoins, la capacité d'absorption des marchés extra-capitalistes devenant insuffisante au regard de la masse des marchandises produites par les pays industrialisés, la reprise se brisa rapidement sur l'écueil de la surproduction avec la crise de 1929.
Toute différente fut la période ouverte par la reconstruction consécutive à la Seconde Guerre mondiale qui surpassa les meilleurs indicateurs économiques de l'ascendance du capitalisme. Pendant plus de deux décennies, une croissance soutenue a été portée par les gains de productivité les plus importants de l'histoire du capitalisme, dus en particulier au perfectionnement du travail à la chaîne (fordisme), à l'automatisation de la production et leur généralisation partout où c'était possible.
Mais il ne suffit pas de produire des marchandises, il faut aussi les écouler sur le marché. En effet, la vente des marchandises produites par le capitalisme sert à couvrir le renouvellement des moyens de productions usés et de la force de travail (salaires des ouvriers). Elle assure donc la reproduction simple du capital (c'est-à-dire sans augmentation des moyens de production ou de consommation) mais elle doit aussi financer les dépenses improductives - qui vont des dépenses d'armement à l'entretien des capitalistes, en incluant également de nombreux autres postes sur lesquels nous allons revenir. Ensuite, s'il subsiste un solde positif, il peut être affecté à l'accumulation du capital.
Au sein des ventes effectuées annuellement par le capitalisme, la partie qui peut être dédiée à l'accumulation du capital, et qui participe ainsi à l'enrichissement réel de celui-ci, est nécessairement limitée du fait qu'elle est le solde de toutes les dépenses obligatoires. Historiquement, elle ne représente qu'un faible pourcentage de la richesse produite annuellement 12 et correspond essentiellement aux ventes réalisées dans le commerce avec des marchés extra-capitalistes (intérieurs ou externes) 13. C'est effectivement le seul moyen permettant au capitalisme de se développer (en dehors du pillage, légal ou non, des ressources des économies non capitalistes), c'est-à-dire de ne pas se trouver dans cette situation où "des capitalistes s'échangent entre eux et consomment leur production", ce qui, comme le dit Marx, "ne permet en rien une valorisation du capital" : "Comment est-il possible que parfois des objets manquant incontestablement à la masse du peuple ne fassent l'objet d'aucune demande du marché, et comment se fait-il qu'il faille en même temps chercher des commandes au loin, s'adresser aux marchés étrangers pour pouvoir payer aux ouvriers du pays la moyenne des moyens d'existence indispensables ? Uniquement parce qu'en régime capitaliste le produit en excès revêt une forme telle que celui qui le possède ne peut le mettre à la disposition du consommateur que lorsqu'il se reconvertit pour lui en capital. Enfin, lorsque l'on dit que les capitalistes n'ont qu'à échanger entre eux et consommer eux-mêmes leurs marchandises, on perd de vue le caractère essentiel de la production capitaliste, dont le but est la mise en valeur du capital et non la consommation"14
Avec l'entrée en décadence du capitalisme, les marchés extra-capitalistes sont tendanciellement de plus en plus insuffisants, mais ils ne disparaissent pas pour autant et leur viabilité dépend également, tout comme en ascendance, des progrès de l'industrie. Or, que se passe-t-il lorsque les marchés extra capitalistes sont de moins en moins capables d'absorber les quantités croissantes de marchandises produites par le capitalisme. C'est alors la surproduction et, avec elle, la destruction d'une partie de la production, sauf si le capitalisme parvient à utiliser le crédit comme palliatif à cette situation. Mais, plus les marchés extra-capitalistes se raréfient et moins le crédit ainsi utilisé comme palliatif pourra être remboursé.
Ainsi, le débouché solvable à
la croissance des Trente Glorieuses a été constitué
par la combinaison de l'exploitation des marchés
extra-capitalistes encore existants à cette époque et
de l'endettement à mesure que les premiers ne suffisaient plus
à absorber toute l'offre. Il n'existe aucun autre moyen
possible (sauf de nouveau le pillage des richesses
extra-capitalistes) permettant l'expansion du capitalisme, à
cette époque comme à tout autre d'ailleurs. De
ce fait, les Trente Glorieuses apportent déjà leur
petite contribution à la formation de la masse actuelle des
dettes qui ne seront jamais remboursées et qui constituent une
véritable épée de Damoclès au dessus de
la tête du capitalisme.
Une autre caractéristique des Trente glorieuses est le poids des dépenses improductives dans l'économie. Celles-ci constituent notamment une part importante des dépenses de l'Etat qui, à partir de la fin des années 1940 et dans la plupart des pays industrialisés, connaissent une augmentation considérable. C'est une conséquence de la tendance historique au développement du capitalisme d'Etat, notamment du poids du militarisme dans l'économie qui se maintient à haut niveau après la Guerre mondiale, et également des politiques keynésiennes alors pratiquées et destinées à soutenir artificiellement la demande. Si une marchandise ou un service est improductif, cela signifie que sa valeur d'usage ne lui permet pas de s'intégrer dans le processus de la production 15 en participant à la reproduction simple ou élargie du capital. Il faut également considérer comme improductives des dépenses relatives à une demande au sein du capitalisme non nécessitée par les besoins de la reproduction simple ou élargie. Ce fut le cas en particulier durant les Trente Glorieuses d'augmentations de salaire à des taux s'approchant parfois de celui de la croissance de la productivité du travail dont ont "bénéficié" certaines catégories d'ouvriers, dans certains pays, en application des mêmes doctrines keynésiennes. En effet, le versement d'un salaire plus important que ce qui est strictement nécessaire à la reproduction de la force de travail a pour corollaire, au même titre que les allocations de misère versées au chômeurs ou que les dépenses improductives de l'Etat, le gaspillage de capitaux qui ne peuvent être consacrés à la valorisation du capital global. En d'autres termes, le capital affecté aux dépenses improductives, quelles qu'elles soient, est stérilisé.
La création par le keynésianisme d'un marché intérieur capable de donner une solution immédiate à l'écoulement d'une production industrielle massive a pu donner l'illusion d'un retour durable à la prospérité de la phase d'ascendance du capitalisme. Mais, ce marché étant totalement déconnecté des besoins de valorisation du capital, il a eu pour corollaire la stérilisation d'une portion significative de capital. Son maintien avait pour condition une conjonction de facteurs tout à fait exceptionnelle qui ne pouvait durer : la croissance soutenue de la productivité du travail qui, tout en finançant les dépenses improductives, était suffisante pour dégager un excédent permettant que se poursuive l'accumulation ; l'existence de marchés solvables - qu'il soient extra-capitalistes ou résultant de l'endettement - permettant la réalisation de cet excédent.
Une croissance de la productivité du travail comparable à celles des Trente Glorieuses n'a jamais été rééditée depuis lors. Cependant, même si cela pouvait advenir, l'épuisement total des marchés extra-capitalistes, les limites presque atteintes de la relance de l'économie au moyen de nouvelles augmentations de la dette mondiale déjà démesurée, signent l'impossibilité de la répétition d'une telle période de prospérité.
Dans les facteurs de la prospérité des
Trente Glorieuses ne figure pas, contrairement à l'analyse
effectuée dans La décadence du capitalisme, le
marché de la reconstruction. Suite à la Seconde Guerre
mondiale, la remise sur pieds de l'appareil productif n'a pas en
elle-même constitué un marché extra-capitaliste
ni été créatrice de valeur. Elle fut en bonne
partie le résultat d'un transfert de richesse, déjà
accumulée aux Etats-Unis, vers les pays à reconstruire
puisque le financement de l'opération a été
effectué au moyen du plan Marshall, constitué
essentiellement des dons du Trésor américain. Un tel
marché de la reconstruction ne peut pas non plus être
invoqué pour expliquer la courte phase de prospérité
ayant suivi la Première Guerre mondiale. C'est la raison pour
laquelle le schéma "guerre - reconstruction/prospérité",
qui, de façon empirique, a effectivement correspondu à
la réalité du capitalisme en décadence, n'a
cependant pas valeur d'une loi économique selon laquelle il
existerait un marché de la reconstruction permettant un
enrichissement du capitalisme.
Le
capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste
L'analyse que nous faisons des forces motrices derrières les Trente glorieuses part d'un ensemble de constats objectifs dont les principaux sont les suivants.
Le produit
mondial par habitant double durant la phase ascendante du capitalisme
16
et le taux de croissance industrielle ne fera qu'augmenter pour
culminer à la veille de la Première Guerre 17.
A ce moment, les marchés qui lui avaient fourni son champ
d'expansion arrivent à saturation eu égard aux
besoins atteints par l'accumulation à l'échelle
internationale. C'est le début de la phase de décadence
signalée par deux guerres mondiales, la plus grande crise de
surproduction de tout les temps (1929-33), et un frein très
brutal à la croissance des forces productives (tant la
production industrielle que le produit mondial par habitant seront
quasiment divisés par deux entre 1913 et 1945 :
respectivement 2,8% et 0,9% l'an).
Ceci
n'empêchera nullement le capitalisme de connaître une
formidable croissance durant les Trente glorieuses :
le produit mondial par habitant triple, tandis que la production
industrielle fera plus que doubler (respectivement 2,9% et 5,2%
l'an). Non seulement ces taux sont bien supérieurs à
ce qu'ils étaient durant la période ascendante, mais
les salaires réels augmenteront aussi quatre fois plus
rapidement (ils sont multipliés par quatre alors qu'ils
avaient à peine doublé durant une période deux
fois plus longue entre 1850 et 1913) !
Comment un tel ‘miracle' a-t-il pu se produire ?
* ni par une demande extra-capitaliste résiduelle puisqu'elle était déjà insuffisante en 1914 et qu'elle a encore diminué ensuite 18 ;
* ni par l'endettement étatique ou les déficits budgétaires puisqu'ils diminuent très fortement durant les Trente glorieuses 19 ;
* ni par le crédit qui n'augmente sensiblement que suite au retour de la crise 20 ;
* ni par l'économie de guerre puisqu'elle est improductive : les pays les plus militarisés sont les moins performants et inversement ;
* ni par le plan Marshall dont l'impact est limité en importance et dans le temps 21 ;
* ni par les destructions de guerre puisque celles consécutives à la première n'avaient guère engendré de prospérité 22 ;
* ni par
le seul accroissement du poids de l'Etat dans l'économie,
puisque son plus que doublement durant l'entre-deux guerres n'avait
pas eu un tel effet 23,
qu'en 1960 son niveau (19%) est inférieur à celui de
1937 (21%), et qu'il comprend nombre de dépenses
improductives.
Le ‘miracle'
et son explication restent donc entiers, d'autant plus que :
(a) les économies sont exsangues au lendemain de la guerre,
(b) le pouvoir d'achat de tous les acteurs économiques est
au plus bas, (c) que ces derniers sont tous lourdement endettés,
(d) que l'énorme puissance acquise par les Etats-Unis est
fondée sur une économie de guerre improductive et
présentant de grandes difficultés de reconversion, et
(e) que ce ‘miracle' aura néanmoins lieu malgré la
stérilisation de masses croissantes de plus-value dans des
dépenses improductives !
En réalité, ce mystère n'en n'est plus un si l'on allie les analyses de Marx sur les implications des gains de productivité 24 et les apports de la Gauche Communiste sur le développement du capitalisme d'Etat en décadence. En effet, cette période se caractérise par :
a) Des gains de productivité jamais vus durant toute l'histoire du capitalisme, gains qui s'appuient sur la généralisation du travail à la chaîne et en continu (fordisme).
b) Des hausses très conséquentes de salaires réels, un plein emploi et la mise en place d'un salaire indirect fait d'allocations sociales diverses. Ce sont d'ailleurs les pays où ces hausses sont les plus fortes qui seront les plus performants et inversement.
c) Une prise en main de pans entiers de l'économie par l'Etat et une forte intervention de celui-ci dans les rapports capital-travail 25.
d) Toutes ces politiques keynésiennes ont également été encadrées sur certains plans au niveau international par l'OCDE, le GATT, le FMI, la Banque Mondiale, etc.
e) Enfin,
contrairement aux autres périodes, les Trente
glorieuses ont été
caractérisées par une croissance autocentrée
(c'est-à-dire avec relativement peu d'échanges
entre les pays de l'OCDE et le reste du monde), et
sans délocalisations malgré de très fortes
hausses de salaires réels et le plein emploi. En effet, la
mondialisation et les délocalisations sont des phénomènes
qui n'adviendront qu'à partir des années 1980 et
surtout 90.
Ainsi, en garantissant de façon contraignante et proportionnée la tri-répartition des gains de productivité entre les profits, les impôts et les salaires, le capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste va assurer le bouclage du cycle d'accumulation entre une offre démultipliée de biens et services à prix décroissants (fordisme) et une demande solvable grandissante car indexée sur ces mêmes gains de productivité (keynésianisme). Les marchés étant ainsi assurés, le retour de la crise se manifestera par un retournement à la baisse du taux de profit qui, suite à l'épuisement des gains fordistes de productivité, diminuera de moitié entre la fin des années 1960 et 1982 26. Cette baisse drastique de la rentabilité du capital pousse au démantèlement des politiques d'après guerre au profit d'un capitalisme d'Etat dérégulé au début des années 1980. Si ce tournant a permis un rétablissement spectaculaire du taux de profit, grâce à la compression de la part salariale, la réduction de la demande solvable qui en découle maintien le taux d'accumulation et la croissance à l'étiage 27. Dès lors, dans un contexte désormais structurel de faibles gains de productivité, le capitalisme est contraint de faire pression sur les salaires et conditions de travail pour garantir la hausse de ses profits mais ce faisant, il restreint d'autant ses marchés solvables. Telles sont les racines :
a) des surcapacités et de la surproduction endémique ;
b) de l'endettement de plus en plus effréné pour pallier à la demande contrainte ;
c) des délocalisations à la recherche de main d'œuvre à faible coût ;
d) de la mondialisation pour vendre un maximum à l'exportation ;
e) de l'instabilité financière à répétition découlant des placements spéculatifs de capitaux qui n'ont plus d'occasions de procéder à des investissements d'élargissement.
Aujourd'hui, le taux de croissance est redescendu au niveau de l'entre-deux guerres, et un remake des Trente glorieuses est désormais impossible. Le capitalisme est condamné à s'enfoncer dans une barbarie croissante.
N'ayant pas
encore eu l'occasion d'être présentées en
tant que telles, les racines et implications de cette analyse seront
développées ultérieurement, car elle requiert un
retour sur certaines de nos analyses afin de parvenir à une
compréhension plus ample et cohérente du fonctionnement
et des limites du mode de production capitaliste 28.
Un
débat ouvert aux éléments en recherche
A l'image de
nos prédécesseurs de Bilan
ou de la Gauche communiste de France, nous ne prétendons pas
être les détenteurs de la vérité "absolue
et éternelle" 29
et sommes tout à fait conscients que les débats qui
surgissent au sein de notre organisation ne peuvent que bénéficier
des apports et critiques constructives s'exprimant en dehors de
celle-ci. C'est la raison pour laquelle toutes les contributions qui
nous seront adressées seront les bienvenues et prise en compte
dans notre réflexion collective.
C.C.I.
1 Entre 1950 et 1973, le PIB mondial par habitant a augmenté à un rythme annuel voisin de 3% alors qu'entre 1870 et 1913 il augmentait au rythme de 1,3% (Maddison Angus, L'économie mondiale, OCDE, 2001 : 284).
2 Recueil d'articles de la presse du CCI publié en janvier 1981.
3 Troisième congrès du CCI [19], Revue internationale n°18, 3e trimestre 1979.
4 Revue internationale n°52 [20], 1e trimestre 1988.
5 Notamment à travers la publication dans la Revue internationale de la série "Comprendre la décadence du capitalisme" et en particulier l'article du n°56 [21], de même que la publication dans la Revue internationale n° 59 (4e trimestre 1989) de la présentation [22] de la résolution sur la situation internationale du 8e congrès du CCI relative au poids pris par l'endettement dans l'économie mondiale.
6 Le fait que cette position minoritaire existe depuis longtemps déjà au sein de notre organisation - les camarades qui la défendent actuellement la défendaient déjà en entrant dans le CCI - tout en permettant la participation à l'ensemble de nos activités, tant d'intervention que d'élaboration politique-théorique, illustre le bien fondé de la décision du CCI de ne pas avoir fait de son analyse du lien entre saturation des marchés et baisse du taux de profit et du poids respectifs de ces deux facteurs une condition d'adhésion à l'organisation.
7 Voir notamment à ce propos l'article "Réponse à la CWO sur la guerre dans la phase de décadence du capitalisme" publié en deux parties dans les n° 127 [23] et 128 [24] de la Revue internationale.
8 La meilleure exploitation des marchés extra-capitalistes est déjà présente dans La décadence du capitalisme. Elle est reprise et soulignée dans le 6e article [21] de la série "Comprendre la décadence du capitalisme" publié dans la Revue internationale n° 56, au sein duquel le facteur de l'endettement est également avancé alors que le "marché de la reconstruction" n'est pas repris.
9 Il existe au sein de chacune de ces trois positions des nuances qui ont été exprimées dans le débat. Nous ne pouvons pas, dans le cadre de cet article, en rendre compte ici. Elles pourront apparaître, en fonction de l'évolution du débat, dans de futures contributions que nous publierons.
10 Internationalisme n°1, janvier 1945 : "Thèses sur la situation internationale".
11 Rien que pour les Etats-Unis, les dépenses de l'Etat fédéral qui ne représentaient que 3% du PIB en 1930, s'élèvent à environ 20% du PIB pendant les années 1950-60.
12 A titre d'exemple, durant la période 1870-1913, la vente aux marchés extra-capitalistes a dû représenter un pourcentage moyen annuel voisin de 2,3% du PIB mondial (chiffre calculé en fonction de l'évolution du PIB mondial entre ces deux dates ; source : https://www.theworldeconomy.org/publications/worldeconomy/frenchpdf/Madd... [25]). S'agissant d'un chiffre moyen, il est évidemment inférieur à la réalité des années ayant connu la plus forte croissance comme c'est le cas avant la Première Guerre mondiale.
13 A ce sujet, peu importe si ses ventes sont productives ou non, comme les armes, pour le destinataire final.
14 Livre III, section III : la loi tendancielle de la baisse du taux de profit, Chapitre X : Le développement des contradictions immanentes de la loi, Pléthore de capital et surpopulation.
15 Pour illustrer ce fait, il suffit de considérer la différence d'utilisation finale entre, d'une part, une arme, une annonce publicitaire, un cours de formations syndicale et, d'autre part, un outil, de la nourriture, des cours scolaires ou universitaires, des soins médicaux, etc.
16 De 0,53 % l'an entre 1820-70 à 1,3 % entre 1870-1913 (Angus Maddison, L'économie mondiale, OCDE : 284).
Taux de croissance annuel de la production industrielle mondiale1786-18202,5 %1820-18402,9 %1840-18703,3 %1870-18943,3 %1894-19134,7 %W.W. Rostow, The world economy : 662
18 Très important à la naissance du capitalisme, ce pouvoir d'achat interne aux pays développés ne représentait déjà plus que 5% à 20% en 1914, et était devenu marginal en 1945 : 2% à 12% (Peter Flora, State, Economy and Society in Western Europe 1815-1975, A Data Handbook, Vol II, Campus, 1987). Quand à l'accès au Tiers-Monde, il est amputé des deux tiers avec le retrait du marché mondial de la Chine, du bloc de l'Est, de l'Inde et de divers autres pays sous-développés. Quant au commerce avec le tiers restant, il chute de moitié entre 1952 et 1972 (P. Bairoch, Le Tiers-Monde dans l'impasse : 391-392) !
19 Les données sont publiées dans le n°114.
20 Les données sont publiées dans le n°121.
21 Le plan Marshall n'a eu qu'un très faible impact sur l'économie américaine : « Après la deuxième guerre mondiale... le pourcentage des exportations américaines par rapport à l'ensemble de la production a diminué dans une mesure non négligeable. Le Plan Marshall lui-même n'a pas provoqué dans ce domaine de changements bien considérables » (Fritz Sternberg, Le conflit du siècle : 577), l'auteur en conclut que c'est donc le marché intérieur qui a été déterminant dans la reprise.
22 Les données et l'argumentation sont développées dans notre article du n°128. Nous y reviendrons car, conformément à Marx, la dévalorisation et destruction de capitaux permettent effectivement de régénérer le cycle d'accumulation et d'ouvrir de nouveaux marchés. Cependant, une étude minutieuse nous a montré que, si ce facteur a pu jouer, il fut relativement faible, limité dans le temps et à l'Europe et au Japon.
23 La part des dépenses publiques totales dans le PIB des pays de l'OCDE passe de 9% à 21% de 1913 à 1937 (cf. n°114).
24 En effet, la productivité n'est qu'une autre expression de la loi de la valeur - puisqu'elle représente l'inverse du temps de travail -, et elle est à la base de l'extraction de la plus-value relative si caractéristique de cette période.
25 La part des dépenses publiques dans les pays de l'OCDE fait plus que doubler entre 1960 à 1980 : de 19% à 45% (n°114).
26 Graphiques dans les n°115, 121 et 128.
27 Graphiques et données dans le n°121 ainsi que dans notre analyse de la croissance en Asie de l'Est : https://fr.internationalism.org/ICConline/2008/crise_economique_Asie_Sud_est.htm [26].
28 Le lecteur pourra néanmoins trouver nombre d'éléments factuels, ainsi que certains développements théoriques dans nos divers articles parus dans les n°114 [27], 115 [28], 121 [29], 127 [30], 128 [31], et dans notre analyse de la croissance en Asie de l'Est.
29 "Aucun groupe ne possède en exclusivité la 'vérité absolue et éternelle'" comme le disait la GCF. Voir à ce propos notre article "Il y a 60 ans : une conférence de révolutionnaires internationalistes [32]" dans la Revue internationale n° 132.
Questions théoriques:
- L'économie [33]
Il y a 90 ans, la révolution allemande : face à la guerre le prolétariat renoue avec ses principes internationalistes
- 3153 lectures
Il y a 90 ans, la révolution prolétarienne culminait de façon tragique en Allemagne dans les luttes de 1918 et 1919. Après la prise héroïque du pouvoir par le prolétariat en Russie en Octobre 1917, le cœur de la bataille pour la révolution mondiale se déplaça vers l'Allemagne. C'est là que fut menée la bataille décisive, et elle fut perdue. La bourgeoisie mondiale a toujours voulu ensevelir ces événements dans l'oubli. Comme elle ne peut nier que des luttes se sont déroulées, elle prétend qu'elles avaient pour but "la démocratie" et "la paix" - en d'autres termes, les mêmes "merveilleuses" conditions qui règnent aujourd'hui en Allemagne capitaliste.
Le but de la série que nous commençons avec cet article est de montrer que la bourgeoisie en Allemagne fut à deux doigts de perdre le pouvoir face au mouvement révolutionnaire. Malgré sa défaite, la révolution allemande, comme la révolution russe, doit être un encouragement pour nous aujourd'hui. Elle nous rappelle qu'il n'est pas seulement nécessaire mais aussi possible de renverser la domination du capitalisme mondial.
Cette série sera constituée de cinq articles. Le premier est dédié à la façon dont le prolétariat révolutionnaire s'est rallié à son principe internationaliste face à la Première Guerre mondiale. Le deuxième traitera les luttes révolutionnaires de 1918. Le troisième sera consacré au drame qui s'est joué lors de la fondation du Parti communiste fin 1918. Le quatrième examinera la défaite de 1919. Le dernier traitera de la signification historique de l'assassinat de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht, ainsi que de l'héritage que ces révolutionnaires nous ont transmis.
La défaite et le désarroi
La vague révolutionnaire internationale qui a débuté contre la Première Guerre mondiale, se produisit quelques années à peine après la plus grande défaite politique subie par le mouvement ouvrier : l'effondrement de l'Internationale socialiste en août 1914. Examiner pourquoi la guerre a pu éclater et pourquoi l'Internationale a failli, constitue donc un élément essentiel pour comprendre la nature et le cours des révolutions en Russie et en Allemagne.
La route vers la guerre
Depuis le début du xxe siècle, la menace de la guerre mondiale était dans l'air. Les grandes puissances la préparaient fiévreusement. Le mouvement ouvrier la prévoyait et mettait en garde contre elle. Mais son éclatement fut retardé par deux facteurs. L'un d'eux était l'insuffisance de la préparation militaire des principaux protagonistes. L'Allemagne, par exemple, achevait la construction d'une marine de guerre capable de rivaliser avec celle de la Grande-Bretagne, maîtresse des océans. Elle convertit l'île de Helgoland en base navale de haute mer, termina la construction du canal entre la Mer du Nord et la Baltique, etc. A la fin de la première décennie du siècle, ces préparatifs étaient arrivés à leur terme. Cela confère d'autant plus d'importance au second facteur : la peur de la classe ouvrière. Cette peur n'était pas une hypothèse purement spéculative du mouvement ouvrier. D'importants représentants de la bourgeoisie l'exprimaient explicitement. Von Bulow, Chancelier d'Allemagne, déclara que c'était principalement à cause de la peur à l'égard de la Social-démocratie que la guerre était reportée. Paul Rohrbach, infâme propagandiste des cercles bellicistes ouvertement impérialistes de Berlin, écrivait : "à moins qu'une catastrophe élémentaire n'ait lieu, la seule chose qui puisse contraindre l'Allemagne à maintenir la paix, c'est la faim de ceux qui n'ont pas de pain." Le général von Bernhardi, éminent théoricien militaire de l'époque, soulignait dans son livre La guerre d'aujourd'hui (1913) que la guerre moderne comportait des risques élevés du fait qu'elle devait mobiliser et discipliner des millions de personnes. Ce point de vue ne se fondait pas seulement sur des considérations théoriques mais sur l'expérience pratique de la première guerre impérialiste du xxe siècle entre pays de première importance. Cette guerre, qui avait mis aux prises la Russie et le Japon (1904-1905), avait donné naissance au mouvement révolutionnaire de 1905 en Russie.
Ce genre de considérations nourrissait au sein du mouvement ouvrier l'espoir que la classe dominante n'oserait pas déclencher la guerre. Cet espoir dissimulait les divergences au sein de l'Internationale socialiste, au moment même où la clarification dans le prolétariat requérait un débat ouvert. Le fait qu'aucune composante du mouvement socialiste international ne "voulait" la guerre donnait une impression de force et d'unité. Pourtant l'opportunisme et le réformisme ne s'opposaient pas à la guerre par principe mais craignaient simplement qu'elle ne leur fasse perdre leur statut légal et financier si elle éclatait. Pour sa part, le "centre marxiste" autour de Kautsky redoutait la guerre principalement parce qu'elle détruirait l'illusion d'unité du mouvement ouvrier qu'il voulait maintenir à tout prix.
Ce qui parlait en faveur de la capacité de la classe ouvrière d'empêcher la guerre, c'était surtout l'intensité de la lutte de classe en Russie. Ici, les ouvriers n'avaient pas mis longtemps à se remettre de la défaite du mouvement de 1905. À la veille de la Première Guerre mondiale, une nouvelle vague de grèves de masse atteignait un sommet dans l'empire des Tsars. Dans une certaine mesure, la situation de la classe ouvrière dans ce pays ressemblait à celle de la Chine aujourd'hui : elle constituait une minorité de l'ensemble de la population, mais était hautement concentrée dans des usines modernes financées par le capital international, férocement exploitée dans un pays arriéré ne disposant pas des mécanismes de contrôle politique du libéralisme parlementaire bourgeois. Il y a cependant une différence importante : le prolétariat russe avait été éduqué dans les traditions socialistes de l'internationalisme tandis que les ouvriers chinois d'aujourd'hui souffrent toujours du cauchemar de la contre-révolution nationaliste stalinienne.
Tout cela faisait de la Russie une menace pour la stabilité capitaliste.
Mais la Russie n'était pas un exemple significatif du rapport de force international entre les classes. Le cœur du capitalisme, et des tensions impérialistes se situait en Europe occidentale et centrale. Ce n'est pas en Russie mais en Allemagne que se trouvait la clé de la situation mondiale. L'Allemagne était le pays qui contestait l'ordre mondial des anciennes puissances coloniales. Et c'était aussi le pays dont le prolétariat était le plus fort, le plus concentré, avec l'éducation socialiste la plus développée. Le rôle politique de la classe ouvrière allemande s'illustrait notamment par le fait que les principaux syndicats y avaient été fondés par le parti socialiste, tandis qu'en Grande-Bretagne - l'autre nation capitaliste dominante en Europe - le socialisme n'apparaissait que comme un appendice du mouvement syndical. En Allemagne, les luttes quotidiennes des ouvriers avaient traditionnellement lieu dans l'optique du grand but socialiste final.
A la fin du xixe siècle cependant, un processus de dépolitisation des syndicats socialistes, d'"émancipation" de ces derniers vis-à-vis du parti socialiste, avait commencé en Allemagne. Les syndicats mettaient ouvertement en cause l'unité entre le mouvement et le but final. Le théoricien du parti, Edouard Bernstein, ne fit que généraliser cette orientation avec sa formule célèbre : "le mouvement est tout, le but n'est rien". Cette mise en question du rôle dirigeant de la Social-démocratie au sein du mouvement ouvrier, de la primauté du but sur le mouvement, provoqua un conflit entre le parti socialiste, le SPD, et ses propres syndicats. Après la grève de masse de 1905 en Russie, ce conflit s'intensifia. Il se termina par la victoire des syndicats sur le parti. Sous l'influence du "centre" autour de Kautsky - qui voulait maintenir "l'unité" du mouvement ouvrier à tout prix - le parti décida que la question de la grève de masse était l'affaire des syndicats1. Mais dans la grève de masse était contenue toute la question de la révolution prolétarienne à venir ! Ainsi, à la veille de la première Guerre mondiale, la classe ouvrière allemande et internationale se trouvait politiquement désarmée.
Déclarer le caractère non politique des syndicats constituait une préparation à l'intégration du mouvement syndical dans l'État capitaliste. Cela fournit à la classe dominante l'organisation de masse dont elle avait besoin pour mobiliser les ouvriers pour la guerre. A son tour, cette mobilisation dans le cœur du capitalisme allait permettre de démoraliser et désorienter les ouvriers en Russie - pour qui l'Allemagne constituait la principale référence - et briser le mouvement de grèves de masse qui s'y déroulait.
Le prolétariat russe qui menait des grèves de masse depuis 1911, avait déjà derrière lui une expérience récente de crises économiques, de guerres et de luttes révolutionnaires. Ce n'était pas le cas en Europe occidentale et centrale. Là, la guerre éclata au terme d'une longue période de développement économique, où la classe ouvrière avait connu de véritables améliorations de ses conditions d'existence, des augmentations de salaires et la baisse du chômage, mais aussi le développement d'illusions réformistes ; une période durant laquelle c'est à la périphérie du capitalisme mondial que les guerres s'étaient principalement déroulées. La première grande crise économique mondiale n'allait éclater que 15 ans plus tard, en 1929. La phase de décadence du capitalisme n'a pas commencé par une crise économique comme l'attendait traditionnellement le mouvement ouvrier, mais par la crise de la guerre mondiale. Avec la défaite et l'isolement de l'aile gauche du mouvement ouvrier sur la question de la grève de masse, il n'y avait plus de raison pour la bourgeoisie de reporter plus longtemps sa course à la guerre impérialiste. Au contraire, tout retard ne pouvait que lui être fatal. Attendre ne pouvait que signifier attendre que se développent la crise économique, la lutte de classe et la conscience révolutionnaire de son fossoyeur !
L'effondrement de l'Internationale
Le cours à la guerre mondiale était ainsi ouvert. Son éclatement provoqua l'effondrement de l'Internationale socialiste. A la veille de la guerre, la Social-démocratie organisa des manifestations de protestation dans toute l'Europe. La direction du SPD envoya Friedrich Ebert (futur assassin de la révolution) à Zürich en Suisse avec les fonds du parti pour empêcher qu'ils soient confisqués, et Bruno Haase, éternel hésitant, à Bruxelles pour organiser la résistance internationale contre la guerre. Mais une chose est de s'opposer à la guerre avant qu'elle n'éclate, autre chose est de se positionner contre elle une fois qu'elle a commencé. Et là, les serments de solidarité prolétarienne, solennellement prononcés aux congrès internationaux de Stuttgart en 1907 et de Bâle en 1912, s'avérèrent en grande partie platoniques. Même certains membres de l'aile gauche qui avaient soutenu des actions immédiates apparemment radicales contre la guerre - Mussolini en Italie, Hervé en France - se rallièrent à ce moment-là au camp du chauvinisme.
L'étendue du fiasco de l'Internationale surprit tout le monde. Il est bien connu qu'au début Lénine pensait que les déclarations de la presse du parti allemand en faveur de la guerre étaient l'œuvre de la police pour déstabiliser le mouvement socialiste à l'étranger. Même la bourgeoisie semblait avoir été surprise par l'étendue de la trahison de ses principes par la Social-démocratie. Elle avait principalement misé sur les syndicats pour mobiliser les ouvriers et avait passé des accords secrets avec leur direction à la veille de la guerre. Dans certains pays, de grandes parties de la Social-démocratie s'opposèrent réellement à la guerre. Cela montre que l'ouverture politique du cours à la guerre ne signifiait pas automatiquement la trahison des organisations politiques. Mais la faillite de la Social-démocratie dans les principaux pays belligérants en était d'autant plus frappante. En Allemagne, dans certains cas, même les éléments plus résolument opposés à la guerre ne firent pas entendre leur voix au début. Au Reichstag où 14 membres de la fraction parlementaire de la Social-démocratie étaient contre le vote des crédits de guerre et 78 pour, même Karl Liebknecht se soumit au début à la discipline traditionnelle de la fraction.
Comment l'expliquer ?
Pour cela, il faut évidemment commencer par situer les évènements dans leur contexte objectif. A cet égard, le changement fondamental dans les conditions de la lutte de classe du fait de l'entrée dans une nouvelle époque historique de guerres et de révolutions est décisif. C'est dans ce contexte qu'on peut pleinement comprendre que le passage des syndicats dans le camp de la bourgeoisie était historiquement inévitable. Puisque ces organisations étaient l'expression d'une étape particulière de la lutte de classe au cours de laquelle la révolution n'était pas encore à l'ordre du jour, ils n'ont jamais été des organes révolutionnaires par nature ; avec la nouvelle période, durant laquelle la défense des intérêts immédiats de n'importe quelle partie du prolétariat impliquait désormais une dynamique vers la révolution, ils ne pouvaient plus servir leur classe d'origine et ne pouvaient survivre qu'en rejoignant le camp ennemi.
Mais ce qui s'explique clairement pour les syndicats s'avère insuffisant quand on examine le cas des partis sociaux-démocrates. Il est clair qu'avec la Première Guerre mondiale, les partis perdirent leur ancien centre de gravité, la mobilisation pour les élections. Et il est également vrai que le changement des conditions faisait aussi disparaître les fondements mêmes de l'existence de partis politiques de masse de la classe ouvrière. Face à la guerre et à la révolution, un parti prolétarien doit être capable de nager contre le courant et même d'aller contre l'état d'esprit dominant dans la classe dans son ensemble. Mais la tâche principale d'une organisation politique de la classe ouvrière - la défense du programme et, en particulier, de l'internationalisme prolétarien - ne change pas avec le changement d'époque. Au contraire, elle prend encore plus d'importance. Aussi, bien qu'il fût historiquement inévitable que les partis socialistes connaissent une crise face à la guerre mondiale et que les courants en leur sein infestés par le réformisme et l'opportunisme trahissent, cela ne suffit cependant pas à expliquer ce que Rosa Luxemburg qualifie de "crise de la Social-démocratie".
Il est également vrai qu'un changement historique fondamental provoque nécessairement une crise programmatique ; les anciennes tactiques éprouvées depuis longtemps et même les principes apparaissent soudainement périmés - comme la participation aux élections parlementaires, le soutien aux mouvements nationaux ou aux révolutions bourgeoises. Mais sur ce point, nous devons nous rappeler que beaucoup de révolutionnaires de l'époque, tout en ne comprenant pas encore les implications programmatiques et tactiques de la nouvelle période, furent néanmoins capables de rester fidèles à l'internationalisme prolétarien.
Chercher à expliquer ce qui est arrivé uniquement à partir des conditions objectives revient à considérer que tout ce qui se passe dans l'histoire est dès le départ inévitable. Avec un tel point de vue, on remet en question la possibilité de tirer des leçons de l'histoire puisque nous sommes nous-mêmes le produit des "conditions objectives". Aucun véritable marxiste ne niera l'importance de ces conditions objectives. Mais si nous examinons l'explication que les révolutionnaires de l'époque ont donnée eux-mêmes de la catastrophe qu'a connue le mouvement socialiste en 1914, on voit qu'ils ont avant tout mis en avant l'importance des facteurs subjectifs.
L'une des raisons principales de la faillite du mouvement socialiste réside dans son sentiment illusoire d'invincibilité, sa conviction erronée que la victoire était certaine. La Seconde Internationale fondait cette conviction sur trois éléments essentiels déjà identifiés par Marx qui étaient la concentration du capital et des moyens de production à un pôle de la société et du prolétariat dépossédé à l'autre ; l'élimination des couches sociales intermédiaires dont l'existence brouillait la principale contradiction sociale ; et l'anarchie croissante du mode de production capitaliste, s'exprimant en particulier sous la forme de la crise économique et contraignant le fossoyeur du capitalisme, le prolétariat, à mettre en question le système lui-même. En lui-même, ce point de vue était tout à fait valable. Ces trois conditions pour le socialisme sont le produit de contradictions objectives qui se développent indépendamment de la volonté des classes sociales et, à long terme, s'imposent inévitablement. Néanmoins, elles donnent naissance à deux conclusions très problématiques. La première, c'est que la victoire est inéluctable. La seconde, c'est que la victoire ne peut être contrecarrée que si la révolution éclate de façon prématurée, si le mouvement ouvrier cède aux provocations.
Ces conclusions étaient d'autant plus dangereuses qu'elles étaient profondément, bien que partiellement, justes. Il est vrai que le capitalisme crée inévitablement les conditions matérielles de la révolution et du socialisme. Et le danger de la provocation, par la classe dominante, de confrontations prématurées est très réel. Nous verrons toute l'importance tragique revêtue par cette dernière question dans les troisième et quatrième parties de cette série.
Mais le problème de ce schéma de l'avenir socialiste est qu'il n'accorde aucune place aux phénomènes nouveaux tels que les guerres impérialistes entre les puissances capitalistes modernes. La question de la guerre mondiale n'entrait pas dans ce schéma. Nous avons déjà vu que le mouvement ouvrier reconnaissait l'inévitabilité de la guerre longtemps avant qu'elle n'éclate réellement. Mais pour l'ensemble de la Social-démocratie, le reconnaître ne l'amena pas du tout à conclure que la victoire du socialisme n'était pas inévitable. Ces deux parties de l'analyse de la réalité restèrent séparées l'une de l'autre d'une façon qui peut apparaître quasiment schizophrénique. Cette incohérence, tout en pouvant être fatale, n'est pas inhabituelle. Beaucoup des grandes crises et des grandes désorientations dans l'histoire du mouvement ouvrier proviennent de l'enfermement dans les schémas du passé, du retard de la conscience sur l'évolution de la réalité. On peut par exemple citer le soutien au Gouvernement provisoire et à la poursuite de la guerre par le Parti bolchevique après Février 1917 en Russie. Le Parti était prisonnier du schéma de la révolution bourgeoise légué par 1905 et qui se révéla inadéquat dans le contexte nouveau de la guerre mondiale. Il a fallu les Thèses d'avril de Lénine et des mois de discussions intenses pour sortir de la crise.
Peu avant sa mort en 1895, Friedrich Engels fut le premier à tenter de tirer les conclusions nécessaires de la perspective d'une guerre généralisée en Europe. Il déclara qu'elle poserait l'alternative historique : socialisme ou barbarie. L'inévitabilité de la victoire du socialisme était ouvertement mise en question. Mais même Engels ne parvint pas à tirer immédiatement toutes les conclusions de cette vision. De ce fait, il ne parvint pas à comprendre que l'apparition du courant oppositionnel des Die Jungen ("les Jeunes") dans le parti allemand, malgré toutes ses faiblesses, était une expression authentique d'un mécontentement justifié vis-à-vis du cadre des activités du parti (principalement orientées vers le parlementarisme) devenu largement insuffisant. Face à la dernière crise du parti qu'il a connue avant sa mort, Engels pesa de tout son poids en faveur de la défense du maintien du statu quo dans le parti, au nom de la patience et de la nécessité d'éviter les provocations.
C'est Rosa Luxemburg qui, dans sa polémique contre Bernstein au tournant du siècle, allait tirer les conclusions décisives de la vision mise en avant par Engels sur la perspective "socialisme ou barbarie". Bien que la patience constitue l'une des principales vertus du mouvement ouvrier et qu'il faille éviter les confrontations prématurées, historiquement, le principal danger qui se présentait n'était plus que la révolution ait lieu trop tôt mais qu'elle ait lieu trop tard. Ce point de vue porte toute son insistance sur la préparation active de la révolution, sur l'importance centrale du facteur subjectif.
Cette condamnation du fatalisme qui commençait à dominer la Seconde Internationale, cette restauration du marxisme, allait devenir l'une des lignes de démarcation de toute l'opposition de gauche révolutionnaire avant et pendant la Première Guerre mondiale 2.
Comme Rosa Luxemburg allait l'écrire dans sa brochure La crise de la Social-démocratie : "Le socialisme scientifique nous a appris à comprendre les lois objectives du développement historique. Les hommes ne font pas leur histoire de toutes pièces. Mais ils la font eux-mêmes. Le prolétariat dépend dans son action du degré de développement social de l'époque, mais l'évolution sociale ne se fait pas non plus en dehors du prolétariat, celui-ci est son impulsion et sa cause, tout autant que son produit et sa conséquence."
Précisément parce qu'elle a découvert les lois objectives de l'histoire, pour la première fois une force sociale, la classe du prolétariat conscient, peut mettre en pratique de façon délibérée sa volonté. Elle ne fait pas seulement l'histoire, elle peut en influencer consciemment le cours.
"Dans l'histoire, le socialisme est le premier mouvement populaire qui se fixe comme but, et qui soit chargé par l'histoire, de donner à l'action sociale des hommes un sens conscient, d'introduire dans l'histoire une pensée méthodique et, par là, une volonté libre. Voilà pourquoi Friedrich Engels dit que la victoire définitive du prolétariat socialiste constitue un bond qui fait passer l'humanité du règne animal au règne de la liberté. Mais ce 'bond' lui-même n'est pas étranger aux lois d'airain de l'histoire, il est lié aux milliers d'échelons précédents de l'évolution, une évolution douloureuse et bien trop lente. Et ce bond ne saurait être accompli si, de l'ensemble des prémisses matérielles accumulées par l'évolution, ne jaillit pas l'étincelle de la volonté consciente de la grande masse populaire" (ibid.).
Le prolétariat doit faire "son apprentissage (...) et [tenter] de prendre en main son propre destin, de s'emparer du gouvernail de la vie sociale. Lui qui était le jouet passif de son histoire, il tente d'en devenir le pilote lucide" (ibid.).
Pour le marxisme, reconnaître l'importance des lois objectives de l'histoire et des contradictions économiques - ce que les anarchistes nient ou ignorent - va de pair avec la reconnaissance des éléments subjectifs 3. Ils sont intimement liés et s'influencent réciproquement. On peut l'observer par rapport aux facteurs les plus importants qui ont peu à peu sapé la vie prolétarienne dans l'Internationale. L'un des ces facteurs était l'érosion de la solidarité au sein du mouvement ouvrier. Celle-ci était évidemment favorisée par l'expansion économique qui a précédé 1914 et les illusions réformistes que cette dernière a engendrées. Mais elle résultait également de la capacité de la classe ennemie à apprendre de son expérience. Bismarck avait introduit des procédés d'assurance sociale (en même temps que les lois anti-socialistes) afin de remplacer la solidarité entre les travailleurs par leur dépendance individuelle vis-à-vis ce qui allait devenir plus tard "l'État providence". Après que la tentative de Bismarck de détruire le mouvement ouvrier en le mettant hors la loi eut échoué, le gouvernement de la bourgeoisie impérialiste qui lui succéda à la fin du xixe siècle, renversa sa tactique. Ayant pris conscience que les conditions de répression stimulaient la solidarité ouvrière, le gouvernement retira les lois anti-socialistes et invita de façon répétée la Social-démocratie à participer à "la vie politique" (c'est-à-dire à la direction de l'État), l'accusant de renoncer de façon "sectaire" aux "seuls moyens pratiques" permettant une réelle amélioration de la vie des ouvriers.
Lénine a montré le lien qui existe entre les niveaux objectif et subjectif concernant un autre facteur décisif dans la déliquescence des principaux partis socialistes. C'est la transformation de la lutte pour la libération de l'humanité en une routine quotidienne vide. Identifiant trois courants au sein de la Social-démocratie, il présentait le second courant "dit du "centre", qui hésite entre les social-chauvins et les véritables internationalistes", en le caractérisant ainsi : "Le 'centre', ce sont des hommes de routine, rongés par un légalisme pourri, corrompus par l'atmosphère du parlementarisme, etc., des fonctionnaires habitués aux sinécures et à un travail 'de tout repos'. Historiquement et économiquement parlant, ils ne représentent pas une couche distincte. Ils représentent simplement la transition entre une phase révolue du mouvement ouvrier, celle de 1871-1914 (...) et une phase nouvelle, devenue objectivement nécessaire depuis la Première Guerre impérialiste mondiale, qui a inauguré l'ère de la révolution sociale" 4.
Pour les marxistes de l'époque, la "crise de la Social-démocratie" n'était pas quelque chose qui se déroulait en dehors de leur champ d'action. Ils se sentaient responsables personnellement de ce qui était arrivé. Pour eux, la faillite du mouvement ouvrier de l'époque était leur propre faillite. Comme le dit Rosa Luxemburg, "nous avons les victimes de la guerre sur la conscience".
Ce qui est remarquable dans la faillite de l'Internationale socialiste, c'est qu'elle n'était due en premier lieu ni à une inadéquation du programme, ni à une analyse erronée de la situation mondiale.
"Le prolétariat mondial ne souffre pas d'un manque de principes, de programmes ou de slogans mais d'un manque d'action, de résistance efficace, de capacité d'attaquer l'impérialisme au moment décisif."5
Pour Kautsky, l'incapacité à maintenir l'internationalisme prouvait l'impossibilité de le faire. Il en déduisait que l'Internationale était essentiellement un instrument des temps de paix qui devait être mis de côté en temps de guerre. Pour Rosa Luxemburg comme pour Lénine, le fiasco d'août 1914 venait par dessus tout de l'érosion de l'éthique de la solidarité prolétarienne internationale au sein de la direction de l'Internationale.
"Alors se produisit l'horrible, l'incroyable 4 août 1914. Devait-il avoir lieu ? Un événement d'une telle importance ne peut être un simple accident. Il doit avoir des causes objectives profondes, significatives. Mais peut-être que ces causes se trouvent dans les erreurs des dirigeants du prolétariat, dans la Social-démocratie elle-même, dans le fait que notre volonté de lutter avait fléchi, que notre courage et nos convictions nous ont abandonnés" (ibidem., souligné par nous).
Le renversement du courant
La faillite de l'Internationale socialiste fut un événement d'une importance historique et une défaite politique cruelle. Mais elle ne constitua pas une défaite décisive, c'est-à-dire irréversible, pour toute une génération. Une première indication de cela fut que les couches les plus politisées de prolétariat restèrent loyales envers l'internationalisme prolétarien. Richard Müller, dirigeant du groupe "Revolutionäre Obleute", des délégués d'usines de la métallurgie, rappelait : "Dans la mesure où les grandes masses populaires, déjà avant la guerre, avaient été éduquées sous l'influence de la presse socialiste et des syndicats, et avaient des opinions précises sur l'Etat et la société, et bien qu'au début, elles n'aient rien exprimé ouvertement, elles rejetèrent directement la propagande de guerre et la guerre" 6. Cela constitue un contraste frappant avec la situation des années 1930, à la suite de la victoire du stalinisme en Russie et du fascisme en Allemagne, où les ouvriers les plus avancés furent entraînés sur le terrain politique du nationalisme et de la défense de la patrie (impérialiste) "anti-fasciste" ou "socialiste".
La mise en œuvre de la mobilisation pour la guerre n'était donc pas la preuve d'une défaite profonde mais d'un accablement temporaire des masses. Cette mobilisation s'accompagna de scènes d'hystérie de masse. Mais il ne faut pas confondre ces manifestations avec un engagement actif de la population comme on en avait vu pendant les guerres nationales de la bourgeoisie révolutionnaire en Hollande ou en France. L'intense agitation publique de 1914 trouve ses racines avant tout dans le caractère massif de la société bourgeoise moderne et dans des moyens de propagande et de manipulation à la disposition de l'Etat capitaliste inconnus jusqu'alors. En ce sens, l'hystérie de 1914 n'était pas complètement nouvelle. En Allemagne, on avait déjà assisté à un phénomène semblable lors de la Guerre franco-prussienne de 1870. Mais elle prenait une nouvelle qualité avec le changement de nature de la guerre moderne.
La folie de la guerre impérialiste
Il semble que le mouvement ouvrier ait sous-estimé la puissance du gigantesque séisme politique, économique et social provoqué par la guerre mondiale. Des événements d'une échelle et d'une violence si colossales, au-delà du contrôle de toute force humaine, sont propres à susciter les émotions les plus extrêmes. Certains anthropologues pensent que la guerre réveille un instinct de défense d'"auto-préservation", chose que les êtres humains partagent avec d'autres espèces. Que ce soit vrai ou non, ce qui est certain, c'est que la guerre moderne réveille de très anciennes peurs qui sommeillent dans notre mémoire historique collective, qui ont été transmises de génération en génération par la culture et les traditions, de façon consciente ou non : la peur de la mort, de la faim, du viol, du bannissement, de l'exclusion, de la privation, de l'asservissement. Le fait que la guerre impérialiste généralisée moderne ne soit plus limitée aux militaires professionnels mais entraîne toute la société et introduise des armements ayant une puissance destructrice sans précédent, ne peut qu'augmenter la panique qu'elle crée. À cela il faut ajouter les profondes implications morales. Dans la guerre mondiale, non seulement une caste particulière de soldats mais des millions de travailleurs enrôlés dans l'armée sont amenés à s'entretuer. Le reste de la société, à l'arrière du front, doit travailler au même but. Dans cette situation, la morale fondamentale qui rend toute société humaine possible, ne s'applique plus. Comme le dit Rosa Luxemburg : "tous les peuples qui entreprennent le meurtre organisé se transforment en une horde barbare."7
Tout cela produisit au moment de l'éclatement de la guerre une véritable psychose de masse et une atmosphère de pogrom généralisé. Rosa Luxemburg rend compte de la façon dont les populations de villes entières se transformèrent en populace affolée. Les germes de toute la barbarie du xxe siècle, y compris Auschwitz et Hiroshima, étaient déjà contenus dans cette guerre.
Comment le parti des ouvriers aurait-il dû réagir à l'éclatement de la guerre ? En décrétant la grève de masse ? En appelant les soldats à déserter ? Non-sens, répond Rosa Luxemburg. La première tâche des révolutionnaires était de résister à ce que, par le passé, Wilhelm Liebknecht avait qualifié de cyclone de passions humaines en se référant à la guerre de 1870.
"De telles explosions de 'l'âme populaire' sont stupéfiantes, sidérantes, écrasantes par leur fureur élémentaire. On se sent impuissant, comme devant une puissance supérieure. C'est comme une force majeure. Elle n'a pas d'adversaire tangible. Elle est comme une épidémie, chez les gens, dans l'air, partout. (...) Aussi, ce n'était pas rien à l'époque de nager contre le courant" 8.
En 1870, la Social-démocratie nagea contre le courant. Commentaire de Rosa Luxemburg : "Ils sont restés à leur poste et pendant quarante ans, la Social-démocratie a vécu sur la force morale avec laquelle elle s'était opposée à un monde d'ennemis" 9.
Et là, elle en arrive au cœur, au point crucial de son argumentation : "La même chose aurait pu arriver aujourd'hui. Au départ, nous n'aurions peut-être rien accompli d'autre que de sauver l'honneur du prolétariat, et les milliers de prolétaires qui meurent dans les tranchées dans une obscurité mentale, ne seraient pas morts dans une confusion spirituelle mais avec la certitude que ce qui avait été tout pour eux au cours de leur vie, l'Internationale, la Social-démocratie libératrice était autre chose qu'un lambeau de rêve. La voix de notre parti aurait agi comme rabat-joie face à l'intoxication chauvine de masses. Elle aurait préservé le prolétariat intelligent du délire, elle aurait freiné la capacité de l'impérialisme à empoisonner et abrutir les masses en un temps incroyablement court. Et avec le déroulement de la guerre, (...) tous les éléments vivants, honnêtes, progressifs et humains se seraient ralliés à l'étendard de la Social-démocratie" 10.
Conquérir ce "prestige moral incomparable" constitue la première tâche des révolutionnaires face à la guerre.
Pour Kautsky et ses semblables, il était impossible de comprendre de telles préoccupations envers les dernières pensées que pouvaient avoir les prolétaires en uniforme avant de mourir. Pour lui, provoquer la colère de la foule et la répression de l'Etat une fois que la guerre avait éclaté n'était qu'un geste inutile et vain. Le socialiste français Jaurès avait déclaré dans le passé : l'Internationale représente toute la force morale du monde. Maintenant, beaucoup de ses anciens dirigeants ne savaient plus que l'internationalisme n'est pas un geste vain mais l'épreuve de vie ou de mort du socialisme international.
Le tournant et le rôle des révolutionnaires
La faillite du Parti socialiste conduisit à une situation véritablement dramatique. La première conséquence, c'est qu'elle permettait une perpétuation apparemment indéfinie de la guerre. La stratégie militaire de la bourgeoisie allemande était la suivante : éviter l'ouverture d'un deuxième front, gagner une victoire rapide sur la France, puis envoyer toutes ses forces sur le front oriental pour que la Russie capitule. Sa stratégie contre la classe ouvrière suivait le même principe : la prendre par surprise et obtenir la victoire avant qu'elle ait le temps de recouvrer une orientation.
Dès septembre 1914 (Bataille de la Marne), l'invasion de la France avait totalement échoué et, avec elle, l'ensemble de la stratégie fondée sur une victoire rapide. Non seulement la bourgeoisie allemande mais toute la bourgeoisie mondiale se trouvait maintenant prise au piège d'un dilemme face auquel elle ne pouvait ni reculer, ni abandonner. Il s'ensuivit des massacres sans précédent de millions de soldats, complètement insensés même du point de vue capitaliste. Le prolétariat lui-même était piégé sans que n'existe aucune perspective immédiate qu'il puisse mettre fin à la guerre de sa propre initiative. Le danger qui surgit alors, c'était la destruction de la condition matérielle et culturelle la plus essentielle pour le socialisme : le prolétariat lui-même.
Les révolutionnaires sont rattachés à leur classe comme la partie l'est au tout. Les minorités de la classe ne peuvent jamais remplacer l'auto-activité et la créativité des masses, mais il y a des circonstances dans l'histoire où l'intervention des révolutionnaires peut avoir une influence décisive. De tels circonstances existent dans un processus vers la révolution quand les masses luttent pour la victoire. Il est alors décisif d'aider la classe à trouver le bon chemin, à contourner les pièges tendus par l'ennemi, à éviter d'arriver trop tôt ou trop tard au rendez-vous de l'histoire. Mais elles existent aussi dans les moments de défaite, quand il est vital de tirer les bonnes leçons. Cependant, ici, nous devons établir des distinctions. Face à une défaite écrasante, cette tâche est décisive sur le long terme pour la transmission des leçons aux générations futures. Dans le cas de la défaite de 1914, l'impact décisif que les révolutionnaires pouvaient avoir était aussi immédiat que pendant la révolution elle-même, et cela pas seulement à cause du caractère non définitif de la défaite subie, mais parce que les conditions de la guerre, en faisant littéralement de la lutte de classe une question de vie ou de mort, ont donné naissance à une accélération extraordinaire de la politisation.
Face aux privations de la guerre, il était inévitable que la lutte de classe économique se développe et prenne immédiatement un caractère ouvertement politique, mais les révolutionnaires ne pouvaient se contenter d'attendre que cela arrive. La désorientation de la classe, comme nous l'avons vu, était avant tout le produit d'un manque de direction politique. C'était donc la responsabilité de tous ceux qui restèrent révolutionnaires dans le mouvement ouvrier d'initier eux-mêmes le renversement du courant. Même avant les grèves sur le "front intérieur", bien avant les révoltes des soldats dans les tranchées, les révolutionnaires devaient se montrer et affirmer le principe de la solidarité prolétarienne internationale.
Ils commencèrent ce travail au Parlement en dénonçant la guerre et en votant contre les crédits de guerre. Ce fut la dernière fois où cette tribune fut utilisée à des fins révolutionnaires. Mais cela fut accompagné, dès le début, par la propagande et l'agitation révolutionnaires illégales et par la participation aux premières manifestations pour réclamer du pain. Une tâche de la plus haute importance pour les révolutionnaires était aussi de s'organiser pour clarifier leur point de vue et, par-dessus tout, d'établir des contacts avec les révolutionnaires à l'étranger et de préparer la fondation d'une nouvelle Internationale. Le Premier Mai 1916, le Spartakusbund (la Ligue Spartakus), noyau du futur parti communiste (KPD), se sentit pour la première fois assez fort pour descendre dans la rue ouvertement et massivement. C'était le jour où, traditionnellement, la classe ouvrière célébrait sa solidarité internationale. Le Spartakusbund appela à des manifestations à Dresde, Iéna, Hanau, Braunschweig et surtout à Berlin. 10 000 personnes se rassemblèrent sur la Postdamer Platz pour écouter Karl Liebknecht dénoncer la guerre impérialiste. Une bataille de rue éclata dans une tentative vaine d'empêcher son arrestation.
Les protestations du Premier Mai privèrent l'opposition internationaliste de son leader le plus connu. D'autres arrestations suivirent. Liebknecht fut accusé d'irresponsabilité et même de vouloir se mettre au premier plan. En réalité, son action du Premier Mai avait été décidée collectivement par la direction du Spartakusbund. Il est vrai que le marxisme critique les actes vains du terrorisme et de l'aventurisme. Il compte sur l'action collective des masses. Mais le geste de Liebknecht était bien plus qu'un acte d'héroïsme individuel. Il incarnait les espoirs et les aspirations de millions de prolétaires face à la folie de la société bourgeoise. Comme Rosa Luxemburg allait l'écrire, plus tard : "N'oublions pas ceci cependant. L'histoire du monde ne se fait pas sans grandeur d'âme, sans morale élevée, sans gestes nobles" 11. Cette grandeur d'âme s'étendit rapidement du Spartakusbund aux métallos. Le 27 juin 1916 à Berlin, à la veille du procès de Karl Liebknecht arrêté pour avoir mené une agitation publique contre la guerre, une réunion de délégués d'usines fut prévue à la suite de la manifestation illégale de protestation appelée par le Spartakusbund. A l'ordre du jour il y avait la solidarité avec Liebknecht ; contre la résistance de Georg Ledebour, seul représentant présent du groupe oppositionnel au sein du Parti socialiste, l'action fut proposée pour le lendemain. Il n'y eut pas de discussion. Tout le monde se leva et resta silencieux.
Le lendemain à 9 heures, les tourneurs arrêtèrent les machines des grandes usines d'armement du capital allemand. 55 000 ouvriers de Löwe, AEG, Borsig, Schwarzkopf posèrent leurs outils et s'assemblèrent devant les portes des usines. Malgré la censure militaire, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers tout l'empire : les ouvriers des usines d'armement sortirent en solidarité avec Liebknecht ! Et pas seulement à Berlin, mais à Braunschweig, sur les chantiers navals de Brême, etc. Des actions de solidarité eurent lieu même en Russie.
La bourgeoisie envoya des milliers de grévistes sur le front. Les syndicats lancèrent dans les usines une chasse aux "meneurs". Mais à peine en avaient-ils arrêtés quelques-uns que la solidarité des ouvriers augmentait encore. Solidarité prolétarienne internationale contre la guerre impérialiste : c'était le début de la révolution mondiale, la première grève de masse dans l'histoire de l'Allemagne.
La flamme qui s'était allumée sur la Postdamer Platz se répandit plus vite encore parmi la jeunesse révolutionnaire. Inspirés par l'exemple de leurs chefs politiques, avant même les métallos expérimentés, les jeunes avaient lancé la première grève majeure contre la guerre. À Magdeburg et, surtout, à Braunschweig qui était un bastion de Spartakus, les manifestations illégales de protestation du Premier Mai se transformèrent en un mouvement de grève contre la décision du gouvernement de verser d'autorité une partie des salaires des apprentis et des jeunes ouvriers sur un compte spécial en vue de financer l'effort de guerre. Les adultes partirent en grève de soutien. Le 5 mai, les autorités militaires durent retirer cette mesure pour empêcher une extension plus grande du mouvement.
Après la bataille du Skagerrak en 1916, seule et unique confrontation de toute la guerre entre les marines britannique et allemande, un petit groupe de marins révolutionnaires projeta de s'emparer du cuirassé Hyäne et de le détourner vers le Danemark pour faire "une manifestation devant le monde entier" contre la guerre 12. Bien que ce projet ait été révélé et déjoué, il préfigurait les premières révoltes ouvertes qui eurent lieu dans la marine de guerre, début août 1917. Celles-ci démarrèrent à propos de la solde et des conditions de vie des équipages. Mais, très rapidement, les marins posèrent un ultimatum au gouvernement : ou vous arrêtez la guerre, ou nous partons en grève. L'État répondit par une vague de répression. Deux dirigeants révolutionnaires, Albin Köbis et Max Reichpietsch, furent exécutés.
Dès la mi-avril 1917, une vague de grèves massives avait eu lieu à Berlin, Leipzig, Magdeburg, Halle, Braunschweig, Hanovre, Dresde et dans d'autres villes. Bien que les syndicats et le SPD n'aient plus osé s'y opposer ouvertement, ils tentaient de limiter le mouvement à des questions économiques ; mais les ouvriers de Leipzig avaient formulé une série de revendications politiques - en particulier arrêter la guerre - qui furent reprises dans d'autres villes.
Les ingrédients d'un profond mouvement révolutionnaire existaient donc début 1918. La vague de grèves d'avril 1917 constituait la première intervention massive de centaines de milliers d'ouvriers dans tout le pays pour défendre leurs intérêts matériels sur un terrain de classe et s'opposer directement à la guerre impérialiste. Ce mouvement était aussi inspiré par la révolution qui avait commencé en Russie en février 1917 et se solidarisait ouvertement avec celle-ci. L'internationalisme prolétarien s'était emparé des cœurs de la classe ouvrière.
D'autre part, avec le mouvement contre la guerre, la classe ouvrière avait recommencé à produire sa propre direction révolutionnaire. Il ne s'agissait pas seulement des groupes politiques comme le Spartakusbund ou la Gauche de Brême qui allaient former le KPD (Parti communiste d'Allemagne) fin 1918. Nous parlons aussi de l'émergence de couches hautement politisées et de centres de vie et de lutte de la classe, liés aux révolutionnaires et qui sympathisaient avec leurs positions. L'un des ces centres se trouvait dans les villes industrielles, en particulier dans la métallurgie, et se cristallisait dans le phénomène des Obleute, délégués d'usines. "Dans la classe ouvrière industrielle existait un petit noyau de prolétaires qui non seulement rejetait la guerre, mais voulait aussi empêcher son éclatement à tout prix ; et lorsqu'elle éclata, ils considéraient que c'était leur devoir d'y mettre fin par tous les moyens. Ils étaient peu nombreux. Mais c'étaient des gens d'autant plus déterminés et actifs. Ils constituaient le contrepoint de ceux qui allaient au front mourir pour leurs idéaux. La lutte contre la guerre dans les usines et les bureaux n'a pas connu la même célébrité que la lutte sur le front mais elle comportait les mêmes dangers. Ceux qui la menèrent étaient motivés par les plus hauts idéaux de l'humanité" 13.
Il existait un autre de ces centres dans la nouvelle génération d'ouvriers, chez les apprentis et les jeunes ouvriers qui n'avaient d'autre perspective que d'être envoyés mourir dans les tranchées. Le centre de gravité de cette fermentation était constitué par les organisations de la jeunesse socialiste qui, déjà avant la guerre, s'étaient caractérisées par leur révolte contre "la routine" qui avait commencé à caractériser la vieille génération.
Au sein des forces armées, où la révolte contre la guerre mit bien plus de temps à se développer que sur le front "intérieur", s'établit aussi une position politique avancée. Comme en Russie, le centre de résistance naquit chez les marins qui étaient en lien direct avec les ouvriers et les organisations politiques dans leurs ports d'attache et dont le travail et les conditions de vie ressemblaient beaucoup à ceux des ouvriers des usines, dont ils étaient en général issus. De plus, beaucoup de marins étaient recrutés dans la marine marchande "civile", c'étaient de jeunes hommes qui avaient voyagé dans le monde entier et pour qui la fraternité internationale n'était pas une formule mais un mode de vie.
De plus, l'émergence et la multiplication de ces concentrations de vie politique s'accompagnaient d'une intense activité théorique. Tous les témoins directs de cette période rendent compte du haut niveau théorique des débats dans les réunions et les conférences illégales. Cette vie théorique trouve son expression dans la brochure de Rosa Luxemburg La crise de la Social-démocratie, dans les écrits de Lénine contre la guerre, dans les articles de la revue de Brême Arbeiterpolitik et, aussi, dans la masse de tracts et de déclarations qui circulaient dans la plus totale illégalité et qui font partie des productions les plus profondes et les plus courageuses de la culture humaine réalisées au xxe siècle.
On avait atteint l'étape pour que s'ouvre la tempête révolutionnaire contre l'un des bastions les plus puissants et les plus importants du capitalisme mondial.
La deuxième partie de cette série traitera des luttes révolutionnaires de 1918. Elles démarrèrent par les grèves massives de janvier 1918 et la première tentative de former des conseils ouvriers en Allemagne et culminèrent dans les événements révolutionnaires du 9 novembre qui mirent fin à la Première Guerre mondiale.
Steinklopfer
1 Décision prise par le Congrès du Parti allemand à Mannheim, en 1906.
2 Dans ses mémoires sur le mouvement de la jeunesse prolétarienne, Willi Münzenberg qui était à Zürich pendant la guerre, rappelle le point de vue de Lénine : "Lénine nous a expliqué l'erreur de Kautsky et de son école théorique de marxisme falsifié qui attend tout du développement historique des rapports économiques et quasiment rien des facteurs subjectifs d'accélération de la révolution. A l'inverse, Lénine soulignait la signification de l'individu et des masses dans le processus historique. Il soulignait avant tout la thèse marxiste selon laquelle ce sont les hommes qui, dans le cadre de rapports économiques déterminés, font l'histoire. Cette insistance sur la valeur personnelle des individus et des groupes dans les luttes sociales nous fit la plus grande impression et nous incita à faire les plus grands efforts imaginables." (Münzenberg, Die Dritte Front ("Le troisième front") traduit de l'allemand par nous.)
3 Tout en défendant avec justesse, contre Bernstein, l'existence d'une tendance à la disparition des couches intermédiaires et de la tendance à la crise et à la paupérisation du prolétariat, la gauche cependant ne parvenait pas à saisir à quel point le capitalisme était temporairement parvenu, dans les années précédant la guerre, à atténuer ces tendances. Ce manque de clarté s'exprime, par exemple, dans la théorie de Lénine sur "l'aristocratie ouvrière" selon laquelle seule une minorité privilégiée et non de larges secteurs de la classe ouvrière, avait obtenu des augmentations de salaires substantielles. Cela amena à sous-estimer l'importance de la base matérielle sur laquelle s'étaient développées les illusions réformistes qui ont permis à la bourgeoisie de mobiliser le prolétariat dans la guerre.
4 "Les tâches du prolétariat dans notre révolution", 28 mai 1917.
5 "Rosa Luxemburg Speaks" ("Discours de Rosa Luxemburg"), dans The crisis of Social Democracy, Pathfinder Press 1970, traduit de l'anglais par nous.
6 Richard Müller, Vom Kaiserreich zur Republik, 1924-25 ("De l'Empire à la République"), traduit de l'allemand par nous.
7 "Rosa Luxemburg Speaks", ibid. note 5
8 Ibid., note 5.
9 Ibid., note 5.
10 Ibid., note 5.
11 "Against Capital Punishment", novembre 1918, ibid., note 5
12 Dieter Nelles : Proletarische Demokratie und Internationale Bruderschaft - Das abenteuerliche Leben des Hermann Knüfken,
www.anarchismus.at/txt5/nellesknuefken.htm [34].
(Dieter Nelles : "La démocratie prolétarienne et la fraternité internationale - La vie aventureuse d'Hermann Knüfken")
13 Richard Müller, Vom Kaiserreich zur Republik, ibid. note 6.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [35]
L'antifascisme, la voie de la trahison de la CNT (1934-1936)
- 4358 lectures
Nous avons vu, dans le précédent article de cette série (1), comment la FAI tenta d'empêcher l'intégration définitive de la CNT au sein des structures capitalistes. Ce fut un échec. La politique insurrectionnelle de la FAI (1932-33) pour tenter de corriger les graves déviations opportunistes - dans lesquelles elles s'étaient toutes deux engagées en appuyant activement l'instauration de la République en 1931 (2) - provoqua une terrible saignée dans les rangs du prolétariat espagnol, épuisé par les violents combats dispersés et désespérés qu'elle impliquait.
Mais un tournant spectaculaire eut lieu en 1934 : le PSOE fit une volte-face et s'érigea, sous la direction de Largo Caballero et avec l'appui de son appendice syndical, l'UGT, en véritable champion de la "lutte révolutionnaire", poussant les ouvriers des Asturies dans le piège dévastateur de l'insurrection d'octobre. Ce mouvement fut réprimé par l'Etat républicain, qui déchaîna une véritable orgie de meurtres, de tortures et de déportations venant s'ajouter aux sanglantes répressions de l'année précédente.
Cette volte-face s'inscrit clairement dans l'évolution de la situation mondiale et ne peut se comprendre à travers le prisme étroit des événements nationaux. Après l'ascension d'Hitler en 1933, 1934 se caractérise par l'extension et la généralisation des massacres d'ouvriers. En Autriche, la main gauche du capital, la social-démocratie, pousse le prolétariat à une insurrection prématurée et condamnée à la défaite, ce qui permet à sa main droite - les partisans des nazis - de se livrer à un massacre innommable.
Mais 1934 est aussi l'année qui voit l'URSS signer des accords avec la France, s'intégrant avec tous les honneurs au sein de la "haute société" impérialiste, ce qui sera formellement confirmé par son admission dans la Société des nations (l'ancêtre de l'ONU). Les PC opèrent alors un changement radical : la politique "extrémiste" de la "troisième période", qui se caractérisait par une parodie grossière de la politique de "classe contre classe", se voit du jour au lendemain remplacée par une politique "modérée" de main tendue aux socialistes, de participation aux fronts populaires interclassistes dans lesquels le prolétariat doit se soumettre aux fractions "démocratiques" bourgeoises pour parvenir à l'objectif "suprême", "barrer la route au fascisme".
Les alliances ouvrières, arme du front antifasciste
Ce contexte international a influencé fortement la FAI et la CNT, les poussant vers l'intégration au sein de l'Etat capitaliste au moyen de la conjonction des antifascistes avec le reste des forces "démocratiques". L'idéologie antifasciste est devenue un ouragan qui a détruit les derniers restes de conscience prolétarienne, absorbé implacablement les organisations prolétariennes les unes après les autres, laissant dans un terrible isolement les quelques rares qui parvinrent à maintenir une position de classe. Dans le contexte de l'époque (défaite du prolétariat, développement de régimes totalitaires comme voie à l'instauration du capitalisme d'Etat), c'était l'idéologie qui permettait le mieux à la bourgeoisie "démocratique" de préparer la marche vers la guerre généralisée qui finit par être déclarée en 1939 et qui eut comme prélude la guerre d'Espagne en 1936.
Nous ne pouvons dans ces pages développer une analyse de cette idéologie (3), nous nous limiterons à tenter de comprendre l'influence qu'elle eut sur la CNT et sur la FAI, les précipitant dans la trahison en 1936. Les Alliances ouvrières ("Alianzas obreras") déblayèrent le chemin. Elles se présentaient comme un moyen pour atteindre l'unité ouvrière au travers d'accords entre les organisations (4). Mais "l'unité ouvrière" n'était en fait que l'hameçon qui conduisait à "l'unité antifasciste", laquelle encadrait le prolétariat vers la défense de la démocratie bourgeoise pour "barrer la route" au fascisme. L'Alliance ouvrière de Madrid (1934) le proclamait sans détours : "elle a comme objectif principal la lutte contre le fascisme dans toutes ses manifestations et la préparation de la classe ouvrière pour qu'elle instaure la paix publique socialiste fédérale en Espagne" (sic) (5).
Si les syndicats d'opposition de la CNT (6), qui voulaient se comporter comme des syndicats purs et durs et laisser de côté les "niaiseries anarchistes" (sic) participèrent activement aux Alliances ouvrières dès 1934 avec l'UGT-PSOE, ce ne fut cependant pas sans provoquer de fortes réticences au sein de la CNT et de la FAI, ce qui indubitablement exprimait un instinct prolétarien certain. Mais ces résistances tombèrent progressivement, soumises à une situation générale dominée par l'antifascisme, par le travail de sape d'amples secteurs de la CNT et par les manœuvres de séduction du PSOE.
Ce fut la Fédération Régionale asturienne de la CNT qui prit la tête du combat contre ces résistances. L'insurrection des Asturies d'octobre 1934 fut préparée par un pacte préalable entre la CNT régionale et l'UGT-PSOE (7). Bien que le PSOE n'ait que très peu armé les grévistes et ait marginalisé la CNT dans le mouvement, cette Régionale persista obstinément à faire partie de l'Alliance ouvrière. Au cours du Congrès décisif de Saragosse (8), son délégué rappela "qu'un camarade avait écrit dans CNT (9) un article qui reconnaissait la nécessité de l'alliance avec les socialistes pour réaliser l'action révolutionnaire. Une autre réunion plénière se tint un mois plus tard et cet article fut cité pour exiger l'application de sanctions. Nous avons déclaré alors que nous soutenions les positions défendues par cet article. Et nous avons réaffirmé notre point de vue sur l'importance de faire quitter le pouvoir aux socialistes pour les obliger à avancer dans la voie révolutionnaire. Nous avons envoyé des communiqués contre la position anti-socialiste défendue par le Comité national dans un Manifeste" (10).
De son côté, lors d'un discours prononcé à Madrid, Largo Caballero (11) tend de grosses perches à la CNT et à la FAI : "[je m'adresse] à ces groupes de travailleurs qui nous combattent par erreur. Leur objectif comme le nôtre est un système d'égalité sociale. Certains nous accusent d'inciter à croire que l'Etat est au-dessus de la classe ouvrière. Ceux-là n'ont pas bien étudié nos idées. Nous voulons que l'Etat disparaisse en tant qu'instrument d'oppression. Nous voulons le transformer en une entité purement administrative" (12).
Comme on peut le voir, la manœuvre de séduction est assez grossière. Il ne parle de "disparition de l'Etat" que pour dire que l'Etat sera réduit à n'être qu'un "simple organe administratif", c'est-à-dire qu'il reprend la vieille rengaine que nous vendent les démocrates qui chantent que l'Etat démocratique n'est pas un "instrument de répression" mais une "administration", que seuls les Etats totalitaires, les dictatures, seraient des "organes de répression".
Venant en outre d'un individu aussi peu sympathique que Caballero, puisqu'il avait été ministre du Travail au sein du gouvernement républicano-socialiste de 1931-33 et, à ce titre, directement responsable d'un nombre considérable de morts et de victimes dans la classe ouvrière, après avoir été conseiller d'Etat du dictateur Primo de Rivera, ces flatteries trouvèrent cependant un écho dans la CNT et la FAI qui étaient de plus en plus disposées à se laisser mener en bateau. Au cours d'un plenum sur le fascisme tenu en août 1934, le rapport adopté commence par une dénonciation claire du PSOE et de l'UGT et s'achève par une ouverture à l'entente avec eux : "Ceci ne signifie pas, évidemment, que si ces organisations [il parle de l'UGT et du PSOE], poussées par les événements, se voient obligées à lancer une action insurrectionnelle, nous devrions rester passifs, en aucun cas (...) nous voulons prévoir que ce sera là le moment pour tenter d'insuffler au mouvement antifasciste le caractère libertaire de nos principes" (13).
L'un des principes depuis toujours défendu par l'anarchisme - qu'il partage avec le marxisme - est que l'Etat, qu'il soit démocratique ou dictatorial, est un organe autoritaire d'oppression ; mais ce principe est foulé aux pieds dès qu'il s'agit de spéculer sur la possibilité "d'insuffler" ce principe au mouvement antifasciste, mouvement qui se fonde précisément sur le choix en faveur de la forme d'Etat démocratique, c'est-à-dire la variante la plus retorse et cynique qu'adopte cet organe autoritaire de répression !
Cet abandon progressif des principes par la combinaison de positions antagoniques ne fait alors que semer la confusion, affaiblir les convictions et préparer progressivement à la fameuse "unité antifasciste". Dès 1935, les syndicats d'opposition s'empressèrent d'apporter de l'eau à ce moulin de confusion en engageant une campagne de rapprochement avec la CNT et en proposant une réunification basée sur l'unité antifasciste avec l'UGT.
La pression ne faisait qu'augmenter. Peirats remarque que "le drame asturien a alimenté le programme allianciste au sein de la CNT. L'alliancisme commence à se propager en Catalogne, une des régions confédérales qui y était parmi les plus opposées" 14). Le PSOE et Largo Caballero redoublèrent leurs chants de sirène, Peirats rappelle que "pour la première fois depuis très longtemps, le socialisme espagnol invoquait publiquement le nom de la CNT et la fraternité dans la révolution prolétarienne" (idem). Bien que soit maintenue la réticence à tout type d'alliance politique, l'idée de pactiser avec l'UGT devint de plus en plus majoritaire dans la CNT. Elle était vue comme une façon de déjouer le principe "de l'apolitisme". C'est ainsi que l'UGT est devenue le cheval de Troie qui finit par embrigader la CNT dans l'alliance antifasciste de toutes les fractions "démocratiques" du capital. Les dirigeants de la CNT et de la FAI pouvaient ainsi sauver la face puisqu'ils maintenaient le "principe" de rejeter tout pacte avec les partis politiques. L'antifascisme n'entra pas par la grande porte des accords politiques bruyamment rejetés, mais par la petite porte de derrière, celle de l'unité syndicale.
Les élections de février 1936
Ces élections, présentées comme "décisives" pour la lutte contre le fascisme, balayèrent les dernières résistances qui existaient encore dans la CNT et la FAI. Le 9 janvier, le secrétaire du Comité régional de Catalogne transmet une circulaire aux syndicats qui les convoque le 25 à une Conférence régionale au cinéma Meridiana, à Barcelone, "pour discuter de deux thèmes concrets : 1) Quelle doit être la position de la CNT sur la question de l'alliance avec des institutions qui, sans être voisines, ont une coloration ouvrière ? 2) Quelle attitude concrète doit adopter la CNT face à la période électorale ?" 15(idem). Peirats souligne que, pour la plupart des délégations, "abandonner la position anti-électorale de la CNT était plutôt une question de tactique que de principe" et que "la discussion révéla une situation d'hésitation idéologique"16) (idem).
Les positions favorables à l'abandon de l'abstentionnisme traditionnel de la CNT grandissent. Miguel Abós, de la Régionale de Saragosse, déclare dans un meeting que "tomber dans la maladresse de faire une campagne abstentionniste revient à favoriser le triomphe de la droite. Et nous savons tous, après l'amère expérience de deux ans de persécutions, ce que veut la droite. Si elle triomphe, je vous assure que la féroce répression des Asturies s'étendrait à toute l'Espagne" (17) .
La réalité était déformée systématiquement dans cette intervention. La répression barbare de la gauche capitaliste de 1931-33 était oubliée, pour ne mettre en avant que la répression de droite de 1934. La nature répressive de l'Etat capitaliste dans son ensemble, quelle que soit la fraction au pouvoir, est soigneusement passée sous silence, sans aucune rationalité, en évitant toute analyse, pour n'attribuer son monopole qu'à la fraction fasciste du capital.
Emportée par l'antifascisme qui proposait une analyse aussi irrationnelle et aberrante que celle du fascisme lui-même, la CNT choisit clairement son camp, celui de la défense de l'Etat bourgeois, en soutenant le vote en faveur du Front populaire dont le programme avait été dénoncé en son temps par Solidaridad obrera comme étant "profondément conservateur", qui détonnait avec "la fièvre révolutionnaire qui poussait en Espagne" (18). Le Manifeste publié par le Comité national deux jours avant les élections constitua un pas crucial : "Nous, qui ne défendons pas la République mais qui combattons sans trêve le fascisme, mettrons à contribution toutes les forces dont nous disposons pour défaire les bourreaux historiques du prolétariat espagnol (...) L'action insurrectionnelle [des militaires, ndlr] dépend du résultat des élections. Ils mettront leurs plans en pratique si la gauche gagne les élections. Nous n'hésitons pas à appeler, en outre, à la collaboration avec les secteurs antifascistes partout où se manifesteront les légionnaires de la tyrannie par l'insurrection armée, pour faire en sorte que l'action défensive des masses évolue vers la révolution sociale sous les auspices du communisme libertaire" (19).
Cette déclaration eut d'énormes répercussions car elle se fit au moment le plus opportun, à quelques jours des élections, pour influencer clairement le vote de beaucoup d'ouvriers. Elle traduit l'engagement de la CNT dans l'énorme mystification électorale à laquelle fut soumis le prolétariat espagnol et qui permit tant le triomphe du Front populaire qu'une adhésion pratiquement inconditionnelle au mouvement antifasciste.
Cette position de la CNT fut clairement partagée par la FAI puisque, selon Gómez Casas : "En accord avec les procès-verbaux du Plénum national de la FAI, cette organisation confirma son attitude antiparlementaire et anti-électorale. Mais à la différence de 1933, la façon dont fut menée la campagne fit que l'abstentionnisme fut pratiquement nul dans la pratique. Se référant à l'accord entre les militants de la CNT et ceux de la FAI quant à la nécessité de ne pas mettre l'accent sur l'anti-électoralisme, Santillán lui-même dira que ‘l'initiative de ce changement circonstanciel avait été donné par le Comité péninsulaire de la FAI, l'entité qui pouvait encore grâce à la plus rigoureuse des clandestinités faire face à la situation et qui se disposait à réaliser les actions offensives les plus risquées'" (20).
Alors que le secteur syndicaliste de la CNT, malgré une opposition coriace (entre autres de la part de la FAI), avait fait de la haute voltige en 1931 pour que la CNT participe aux élections, c'était à présent l'ensemble de la CNT - pourtant formellement libérée du poids du secteur syndicaliste qui était parti avec les Syndicats d'opposition - et la FAI qui, ne prenant plus la peine de faire encore des simagrées, allaient bien plus loin en soutenant le Front populaire dont le nouveau gouvernement fera tout pour retarder l'amnistie de plus de 30 000 prisonniers politiques (dont la plupart étaient d'ailleurs membres à la CNT (21)), poursuivra avec la même férocité que les précédents la répression brutale des grèves et s'opposera à la réintégration des ouvriers licenciés à leur poste de travail (22). Le gouvernement que la CNT soutenait, comme rempart à l'avancée du fascisme, conserva aussi à leurs postes tous les généraux connus pour leurs velléités putschistes, parmi lesquels l'illustre Franco, qui devint par la suite le "Grand dictateur".
La CNT et la FAI avaient planté un poignard dans le dos du prolétariat. Dans le précédent article, nous disions que la CNT s'était préparée à consommer ses noces avec l'Etat bourgeois lors du Congrès de 1931 mais qu'elles avaient été retardées. L'heure était à présent venue ! On trouve une preuve de la conscience qu'avaient les dirigeants de la CNT du pas qu'ils venaient d'accomplir dans les déclarations faites, à peine un mois après les élections de février, le 6 mars, par Buenaventura Durruti, un des éléments les plus radicaux de la CNT, à propos des grèves des transports et de l'eau potable à Barcelone que le gouvernement s'apprêtait à réprimer. On trouve dans ces déclarations tous ces reproches complices qu'utilisent régulièrement les syndicalistes et parfois les partis d'opposition : "Nous venons dire aux hommes de gauche que c'est nous qui avons été déterminants dans leur victoire et que c'est nous qui soutenons deux conflits qui doivent être immédiatement résolus". Pour que ce soit encore plus clair, il rappelait les services rendus aux nouveaux gouvernants : "La CNT, les anarchistes - et les hommes d'Esquerra le savent très bien -nous étions dans la rue après le récent triomphe électoral pour empêcher la rébellion des fonctionnaires qui n'ont pas accepté le résultat de la volonté populaire. Tant qu'ils occupaient les ministères et les postes de commandement, la CNT fut présente dans la rue pour empêcher la victoire d'un régime que nous refusons tous"23 (idem).
Ces déclarations furent citées par la délégation du Port de Sagunto, une des rares qui osèrent exprimer une réflexion critique au cours du Congrès de Saragosse : "Après avoir écouté ces paroles, quelqu'un peut-il encore douter de la direction tortueuse, saugrenue et collaborationniste au moins d'une grande partie de l'organisation confédérale ? Les paroles de Durruti semblent indiquer que l'organisation de Catalogne s'est transformée en quelques jours en laquais honoraire de Esquerra catalana" (idem).
Le Congrès de Saragosse : le triomphe du syndicalisme
Célébré en mai 1936, ce Congrès a été présenté comme celui du triomphe de la position révolutionnaire la plus extrême pour avoir adopté le fameux rapport sur le communisme libertaire.
Ce rapport mériterait en soi d'être étudié, mais notre intérêt ici est de voir comment s'était déroulé ce Congrès, analyser l'ambiance qui y régnait, considérer ses décisions et ses résultats. De ce point de vue, le Congrès vit le triomphe indubitable du syndicalisme et paracheva l'implication de la CNT dans la politique bourgeoise par le biais de l'antifascisme (dont nous avons traité antérieurement). On y fit taire les tendances et positions prolétariennes qui tentèrent de s'y exprimer, les affaiblissant radicalement par la démagogie liant la "révolution sociale" et "l'implantation du communisme libertaire" au syndicalisme, à l'antifascisme et à l'union avec l'UGT.
Une des rares délégations qui exprima un semblant de lucidité à ce Congrès, celle du Port de Sagunto dont nous avons déjà parlé, fut pratiquement la seule à mettre en garde sur le fait que "l'organisation, entre octobre et aujourd'hui, a radicalement changé : la sève anarchiste qui coulait dans ses artères a fortement diminué, quand elle n'a pas disparu. A défaut d'une réaction salutaire, la CNT avance à pas de géant vers le réformisme le plus castrateur. La CNT d'aujourd'hui n'est plus la même qu'en 1932 et 33, ni dans son essence ni dans sa vitalité révolutionnaire. Les virus morbides de la politique ont laissé de profondes traces dans son organisme. Elle est malade de l'obsession de recruter toujours plus d'adhérents, sans examiner tous les torts causés par beaucoup d'individus en son sein. Nous avons laissé de côté la formation idéologique de l'individu et nous ne visons qu'à la croissance numérique, alors que la première est plus essentielle que la seconde"24 (idem).
La CNT de Saragosse n'a rien à voir avec la CNT de 1932-33 (pourtant déjà considérablement affaiblie en tant qu'organe prolétarien, comme nous l'avons vu dans le précédent article) mais, surtout, n'a plus rien à voir avec la CNT de 1910-23 qui était un organisme vivant, qui se consacrait aux luttes immédiates et à la réflexion pour une révolution prolétarienne authentique. Ce n'est plus qu'un syndicat totalement absorbé par l'antifascisme.
C'est ainsi que la délégation du Syndicat des cheminots de la CNT put affirmer tranquillement sans provoquer la moindre protestation que "les cheminots résoudront leurs problèmes comme les autres ouvriers qui revendiquent, mais jamais en mettant en avant que nous avons pour principe d'aller vers un mouvement révolutionnaire" (Procès-verbal, op. cit., p.152).
Cette déclaration à propos du bilan des mouvements insurrectionnels de décembre 1933 qui s'étaient vu privés de la force qu'aurait pu apporter l'entrée en grève des cheminots annulée par les syndicats au dernier moment, montre bien ce qu'est le syndicalisme : l'enfermement de chaque secteur ouvrier dans "ses problèmes", le laissant prisonnier des structures de la production capitaliste qui empêche toute solidarité ou unité de la classe ouvrière. Le mot d'ordre syndical "Que chacun commence par régler ses propres problèmes !" n'est que la forme "ouvriériste" pour enchaîner les ouvriers au capital et empêcher toute solidarité de classe.
La délégation de Gijon dénonça, lors de ce Congrès, un cas flagrant de refus de la plus élémentaire solidarité envers les camarades cénétistes exilés, victimes de la répression lors de l'insurrection des Asturies en 1934 (idem, p. 132). Impensable ne serait-ce que quelques années plus tôt, cette grave faute du Comité national ne souleva pas la moindre réflexion. Visiblement embarrassée, la délégation des Textiles (Barcelone) tenta d'esquiver l'affaire par la diplomatie ; "Nous avons des bases suffisamment solides pour clore ce débat de façon totalement satisfaisante. La Régionale asturienne a visiblement tiré un trait sur l'incident, puisque les ex-exilés sont présents dans ce Congrès en tant que délégués. Par ailleurs, s'il existe une lettre du Comité national dans laquelle l'aide à porter est déconseillée, il en existe une autre postérieure où il revient sur cette position (25). Les délégués qui posent ce problème veulent en fait qu'on les reconnaisse comme des camarades et qu'on leur rende notre entière confiance. Le Congrès satisfait cette requête et la question est résolue".
Cet abandon de la plus élémentaire solidarité ouvrière donna lieu à des attitudes réellement incroyables, comme le dénonça la délégation de Sagunto : "Nous protestons contre le passage qui fait référence à l'attitude du Comité national auprès du gouvernement à propos de la "loi des vagabonds et malfaiteurs", pour qu'elle ne soit pas appliquée contre la Confédération nationale du travail. Nous devons exiger l'abrogation de cette loi pour tous, il n'est pas acceptable que ce que nous considérons mauvais pour nous soit bon pour les autres" (idem, p. 106). Cette loi inique et répugnante, dénoncée dans l'intervention de cette délégation, accordait d'énormes pouvoirs répressifs au gouvernement et fut adoptée par la "très démocratique" République espagnole "des travailleurs" et conservée quasi intégralement par la dictature franquiste.
On entendit même dans ce Congrès une intervention préconisant que "en ce qui concerne les grèves, nous n'avons pas eu la prudence d'économiser les énergies qui doivent se concentrer sur d'autres luttes. Ce défaut peut être corrigé si, au moment où les travailleurs présentent des revendications à la bourgeoisie, on prenait en compte les Sections et Comités des relations industrielles afin, grâce à l'étude préalable de la situation, d'éviter des situations de grèves désordonnées" (idem, p. 196, déclaration de Hospitalet). En d'autres termes, c'est le retour de ce qui avait été le cheval de bataille du secteur syndicaliste en 1919-23 : la régulation des grèves par le biais "d'organismes paritaires". C'est le retour des tribunaux mixtes par lesquels le gouvernement républicano-socialiste de 1931-33 avait tenté de juguler les luttes mais aussi la CNT elle-même.
Mais la délégation du bâtiment de Madrid va plus loin encore : "Les circonstances sont à présent différentes et il devient nécessaire de freiner les mouvements de grèves et de profiter des énergies pour franchir le pas vers d'autres réalisations au moyen de ce courant subversif" (idem, p. 197).
Ces interventions sont le produit typique de la mentalité syndicaliste qui tente de contrôler et de dominer la lutte ouvrière pour la saboter de l'intérieur. Quand les ouvriers tentent de défendre leurs revendications, le syndicalisme devient pessimiste et dénonce partout les "conditions défavorables", il devient mesuré et insiste pour "économiser les énergies". Mais quand il s'agit de ses propres mouvements planifiés, généralement destinés à refroidir la combativité ouvrière pour la conduire vers une défaite toujours amère, alors il devient soudain optimiste et exagère les potentialités de victoire, allant jusqu'à reprocher aux ouvriers leur manque de mobilisation.
Une des manifestations les plus flagrantes de cette mentalité syndicale fut le rapport sur le chômage, adopté par le Congrès. Il contient des réflexions plus ou moins justes sur les causes du chômage et insiste avec raison sur la nécessité de la "révolution sociale" pour mettre un terme à la misère du prolétariat. Ces affirmations de principe deviennent malheureusement des phrases creuses dès qu'est abordé le "programme minimum", qui propose "la semaine de 36 heures", "l'abolition du travail à la tâche", la "retraite obligatoire à 60 ans pour les hommes et 40 pour les femmes avec 70 % du salaire". Au-delà de la radinerie des mesures proposées, le problème central se trouve dans le maintien même d'un programme minimum qui contredit ces affirmations de principe en maintenant l'illusion que des améliorations durables pourraient s'obtenir au sein du capitalisme. Le syndicalisme est incapable d'échapper à cette illusion, car celle-ci se trouve au cœur même de son activité : œuvrer au sein des rapports de production capitalistes pour améliorer la condition ouvrière. Ce qui était possible durant la période ascendante du capitalisme est devenu impossible pendant sa décadence.
Mais on trouve dans ce rapport une affirmation bien plus grave, d'autant plus qu'elle ne suscita ni commentaire ni amendement. Il affirme le plus tranquillement du monde dans son préambule que "l'Angleterre a tenté de recourir à des allocations contre le chômage et cette politique a été un échec absolu, car parallèlement à la misère des masses secourue par ces allocations indignes, se développe la ruine économique du pays, qui doit soutenir de façon parasitaire ses millions de chômeurs avec des sommes qui, bien qu'elles ne soient pas fabuleuses par leur importance, représentent néanmoins l'investissement de réserves économiques du pays dans une œuvre philanthropique" (idem, p. 215).
Voilà que le même Congrès qui consacre une partie de ses travaux à définir la "révolution sociale" et le "communisme libertaire" adopte, en même temps, un préambule dont la préoccupation est de sauver l'économie nationale, qui traite de parasitaires les allocations de chômage et se lamente sur le gaspillage dans de "bonnes œuvres philanthropiques" des richesses de la nation !
Comment une organisation qui se prétend "ouvrière" peut-elle traiter de parasitaires les allocations chômage ? Ne comprend-elle pas l'ABC qui consiste dans le fait que les allocations perçues par un chômeur sont le fruit des quantités d'heures que lui et ses camarades de classe ont passé à travailler et en aucun cas une œuvre philanthropique ? De tels raisonnements sont plus le fait d'hommes politiques de droite ou de patrons que de syndicalistes ou d'hommes politiques de gauche, qui ne se distinguent de toute façon des premiers que parce qu'ils sauvent les apparences, ne disent pas franchement ce qu'ils pensent, et qu'ils sont plus retors.
On ne doit cependant pas être surpris qu'un syndicat qui s'apprêtait dans ses discours à "réaliser la révolution sociale" adopte de telles positions. Le syndicat ne peut avoir comme terrain que celui de l'économie nationale et son objectif est la défense des intérêts globaux de celle-ci, plus encore que ses partenaires et adversaires du patronat. Le syndicat ne se propose d'obtenir des améliorations qu'au sein des rapports de production capitalistes. Cela lui permit durant toute la phase ascendante du système capitaliste d'être un instrument de la lutte ouvrière dans la mesure où, globalement et malgré de fortes contradictions, l'amélioration de la condition ouvrière et la prospérité de l'économie pouvaient avoir un développement parallèle. L'entrée du système dans sa phase de déclin met un terme à cette possibilité : dans une société marquée par des crises constantes, par l'effort de guerre permanent et par les guerres elles-mêmes, la sauvegarde de l'économie nationale exige comme condition absolue l'augmentation permanente de l'exploitation des travailleurs et leur sacrifice.
En 1931, la scission de la tendance syndicaliste organisée en Syndicats d'opposition fit croire aux anarchistes que le danger syndicaliste avait disparu. Ils pensèrent que la bête était morte et avec elle le venin. Mais la réalité était tout autre : le sang qui courait dans les veines de la CNT était syndicaliste et loin de s'affaiblir, la mentalité syndicaliste se renforça progressivement. L'activisme de la période insurrectionnelle 1932-33 ne fut qu'un dangereux mirage. A partir de 1934, la réalité s'imposa inexorablement : le syndicalisme et l'antifascisme, se renforçant mutuellement, avaient piégé la CNT - et avec elle la FAI - dans les engrenages de l'Etat bourgeois. La délégation de Métiers divers d'Igualada le reconnaissait amèrement : "Beaucoup de ceux que nous pensions être de vigoureux défenseurs des thèses de la CNT sont devenus insensiblement, inconsciemment, les défenseurs d'un régime républicain profondément bourgeois" (idem, p. 71).
Le Congrès de Saragosse consacra une bonne partie de ses sessions à la réunification avec les Syndicats d'opposition. De nombreux reproches mutuels fusèrent, quoique accompagnés d'échanges plutôt rhétoriques "saluant" et "tendant la main", mais le sol sur lequel se faisait cette réunification était celui du syndicalisme et de l'antifascisme. Pour se mentir à soi-même et mentir aux autres, le secteur anarchiste accentua les proclamations sur la "révolution sociale" et fit adopter sans presque de discussion le fameux rapport sur le communisme libertaire. Ce dernier était destiné, à travers de grandes déclarations radicales sur le communisme libertaire, à faire passer dans la pratique quotidienne la camelote réformiste de soumission à l'idéologie du capital. Il s'agissait en fait de la même manœuvre que le secteur syndicaliste avait pratiquée en 1919 puis en 1931, manœuvre alors fortement critiquée par le secteur anarchiste et que ce dernier à son tour reprenait à son propre compte : emballer la politique syndicaliste de collaboration avec le capital dans une enveloppe attractive à base de "rejet de la politique" et de "révolution".
Les deux secteurs, anarchistes et syndicalistes, se réunissaient sur le terrain du capitalisme. Le délégué de l'Opposition de Valence put alors défier l'assemblée sans provoquer la moindre objection.
Conclusion
Les événements spectaculaires qui se produisent à partir de 1936, et où la CNT joua un rôle de premier plan, sont suffisamment connus : l'annulation et le sabotage du mouvement de lutte des ouvriers à Barcelone et ailleurs en Espagne en riposte au pronunciamiento fasciste ; soutien inconditionnel à la Generalitat catalane et participation, indirectement puis ouvertement, à son gouvernement ; envoi de ministres au gouvernement républicain, etc. (26).
Ces faits démontrent largement la trahison de la CNT. Mais ils ne sont pas une tempête qui surgit dans un ciel d'azur. Tout au long de cette série d'articles, nous nous sommes efforcés de comprendre les raisons qui conduisirent à cette terrible et tragique situation, la perte d'un organisme qui avait tant coûté d'efforts au prolétariat. Il ne s'agit pas de lancer de grands anathèmes mais d'analyser à l'aide d'une méthode globale et historique le processus et les causes qui favorisèrent ce dénouement. La série d'articles sur le syndicalisme révolutionnaire et la série sur la CNT (27) tentent de fournir les matériaux pour ouvrir un débat qui nous permette de tirer les leçons afin de nous armer pour les futurs combats. Face à la tragédie de la CNT, il nous faut faire nôtres les paroles du philosophe, "ni rire, ni pleurer, mais comprendre".
RR y C.Mir 12-3-08
1 Voir en particulier le cinquième article de cette série dans la Revue internationale no 132, "L'échec de l'anarchisme pour empêcher l'intégration de la CNT dans l'Etat bourgeois (1931-1934) [36]".
2 Voir le quatrième article de cette série dans la Revue internationale no 131, "La contribution de la CNT à l'instauration de la République espagnole (1921-1931) [37]".
3 Parmi les différents textes que nous avons publiés, le lecteur peut aussi consulter ceux qui furent écrits par les rares groupes révolutionnaires qui résistèrent alors à la marée "antifasciste" : "Le fascisme, formule de confusion [38]", Revue internationale no 101 ; "Les origines économiques, politiques et sociales du fascisme [39]", Revue internationale no 3 ; "Nationalisme et antifascisme [40]", Revue internationale no 72.
4 Il faut ici préciser que l'unité ouvrière ne peut s'atteindre au moyen d'accords entre les organisations politiques ou syndicales. L'expérience de la Révolution russe de 1905 montre que l'unité ouvrière se réalise directement, à travers la lutte massive, et qu'elle s'organise par les Assemblées générales dans un premier temps, puis par les Conseils ouvriers quand s'ouvre une période révolutionnaire.
5 Olaya, Historia del movimiento obrero español, T. II, op. cit.
6 Scission qui dura de 1931 à 1936, dominée par les éléments ouvertement syndicalistes de la CNT. Voir Revue internationale no 132, op. cit.
7 Ce Pacte avait été caché au Comité national de la CNT qui se trouva placé devant le fait accompli.
8 Tenu en mai 1936. Voir plus loin.
9 Second journal quotidien, le premier étant la légendaire Solidaridad obrera.
10 El Congreso Confederal de Zaragoza, Editions ZYX, 1978.
11 Ce personnage était alors le principal dirigeant du PSOE et de l'UGT.
12 Cité par Olaya, op. cit.
13 Olaya, op. cit., p. 887.
14 Peirats, La CNT en la revolución española, T. I, p. 106. Op. cit.
15 Idem.
16 Idem.
17 Cité dans El Congreso Confederal de Zaragoza,Le Congrès de Saragosse, op. cit., p. 171.
18 Articles publiés le 17 janvier et le 2 avril 1936.
19 Cité par Peirats, op. cit., p. 113.
20 Gómez Casas, Historia de la FAI, p. 210.
21 Il faut rappeler que l'amnistie des emprisonnés syndicalistes fut alors un des motifs les plus fréquemment invoqués sans la moindre honte par les leaders de la CNT et de la FAI pour préconiser le soutien au Front populaire.
22 Ajoutons à ceci que la timide et restreinte loi sur la réforme agraire fut repoussée sine die malgré les promesses faites, et que le gouvernement "populaire", entre février et juillet, maintint pratiquement l'état d'exception ainsi qu'une censure rigide qui affectait surtout la CNT.
23 Cité dans les procès-verbaux du Congrès de Saragosse de la CNT, en espagnol, page 171.
24 Procès-verbal du Congrès de Saragosse, op. cit., p. 171
25 Ceci reste incertain et confus dans le procès-verbal du congrès. Pendant le débat, le Comité national en arrive cependant à affirmer: "Nous avons tout au plus dit que nous ne pouvions conseiller aucun type de solidarité".
26 Nous les avons amplement analysés dans notre livre (en espagnol) Franco y la República masacran a los trabajadores.
27 La première commence dans la Revue internationale no 118 et la seconde dans la 128.
Courants politiques:
- Anarchisme officiel [14]
Ressorts, contradictions et limites de la croissance en Asie de l’Est
- 3348 lectures
La croissance asiatique : une expression de la crise et de la décadence du capitalisme
Jusqu'ici, le capitalisme avait démontré son échec patent à développer les deux-tiers de l'humanité. Avec la formidable croissance économique en Inde et en Chine - et plus généralement dans l'ensemble de l'Asie de l'Est -, il est clamé sur tous les toits qu'il serait capable d'en développer plus de la moitié. Et ses capacités seraient d'autant plus grandes si on le libérait de toutes ses entraves ! Ainsi, est-il prétendu qu'avec des salaires et conditions de travail alignés au niveau chinois, la croissance en occident atteindrait également les 10% l'an !
L'enjeu théorique et idéologique est donc immense : est-ce que le développement en Asie de l'Est exprimerait un renouveau du capitalisme, ou bien ne serait-ce qu'une simple vicissitude dans le cours de sa crise ? C'est à cette question cruciale que nous allons tenter de répondre. Pour ce faire, tout en considérant l'ensemble du phénomène à l'échelle du sous-continent asiatique, nous examinerons plus particulièrement son point d'appui emblématique et le plus médiatisé : la Chine.
Ce sont ces enjeux, ces questions, que nous développons dans les chapitres qui suivent.Géographique:
- Chine [41]
- Corée du Sud [42]
- Inde [43]
Récent et en cours:
- Crise économique [1]
- Asie de l'Est [44]
Quelques questions posées à la théorie révolutionnaire par le développement du sous-continent asiatique
- 2963 lectures
1) En 25 années de crise économique et de "mondialisation"[1] (1980-2005), alors que l'Europe n'a multiplié son PIB (Produit Intérieur Brut) que par 1,7, les Etats-Unis par 2,2 et le Monde par 2,5, l'Inde est parvenue à le multiplier par 4, l'Asie en développement par 6 et la Chine par 10 ! Ce dernier pays a donc progressé quatre fois plus rapidement que la moyenne mondiale et ce en pleine période de crise. Ceci signifie que, ces deux dernières décennies, la croissance dans le sous continent-asiatique est venue amortir la chute continue du taux de croissance du PIB mondial par habitant depuis la fin des années 1960 : 3,7% (1960-69) ; 2,1% (1970-79) ; 1,3% (1980-89) ; 1,1% (1990-1999) et 0,9% pour 2000-2004 [2]. La première question qui se pose à nous est donc la suivante : cette région du monde échapperait-elle à la crise qui mine le reste de l'économie mondiale ?
2) Les Etats-Unis ont mis cinquante ans pour doubler leur revenu par tête entre 1865 et la première guerre mondiale (1914) ; la Chine y est parvenue en deux fois moins de temps en pleine période de décadence et de crise du capitalisme ! Alors que l'Empire du milieu était rural à 84% en 1952, le nombre d'ouvriers dans le secteur industriel chinois est aujourd'hui (170 millions) de 40% plus important que dans l'ensemble des pays de l'OCDE (123 millions) ! Ce pays devient l'atelier du monde et l'emploi tertiaire y augmente à pas de géant. La transformation de la structure de l'emploi est l'une des plus rapides qui ait jamais eu lieu dans toute l'histoire du capitalisme [3]. Ainsi, la Chine est d'ores et déjà devenue la quatrième économie du monde si l'on calcule son PIB en dollars au taux de change et la seconde calculée en parités de pouvoir d'achat [4]. Tous ces éléments posent clairement la question de savoir si ce pays ne connaîtrait pas une véritable accumulation primitive et révolution industrielle comme celles qui eurent lieu dans les pays développés au cours des XVIIIè et XIXè siècles. Formulé autrement : y aurait-il une marge pour l'émergence de capitaux et pays neufs au cours de la décadence du capitalisme ? Voire même, un rattrapage serait-il possible, comme ce fut le cas durant sa phase ascendante ? En effet, si l'allure de la croissance actuelle se poursuit, la Chine deviendrait l'une des plus grandes puissances mondiales dans moins de deux décennies. C'est aussi ce que les Etats-Unis et l'Allemagne avaient réussi à faire au XIXè siècle en rattrapant et supplantant l'Angleterre et la France, et ce, malgré le fait qu'ils aient démarré plus tardivement.
3) La progression du PIB chinois est également la plus vigoureuse de toute l'histoire du capitalisme : avec une progression annuelle moyenne de 8 à 10% durant ces 25 dernières années de crise au niveau mondial, la croissance chinoise dépasse encore les records atteints durant la période de prospérité d'après-guerre puisque le Japon a progressé de 8,2% l'an entre 1950 et 73 et la Corée du sud de 7,6% l'an entre 1962 et 1990. De plus, ce rythme est actuellement bien plus important et plus stable que ceux de ses voisins déjà bien industrialisés (Corée du Sud, Taiwan et Hong-Kong) ! Dès lors, la Chine serait-elle en train de vivre ses propres Trente glorieuses ?
4) De surcroît, la Chine ne se contente plus de produire et d'exporter des produits de base, ou de réexporter des produits assemblés dans ses ateliers à bas salaires : elle produit et exporte de plus en plus de biens à haute valeur ajoutée, comme de l'électronique et du matériel de transport. Dès lors, assisterait-on en Chine à un processus de remontée des filières technologiques analogue à se qui s'est produit dans les NPI (Nouveaux Pays Industrialisés : Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong et Singapour) ? La Chine pourra-t-elle, comme ces derniers, réduire sa dépendance envers ses exportations et se tourner vers le développement de son marché intérieur ? En d'autres mots, est-ce que l'Inde et la Chine ne sont que des étoiles filantes, dont l'éclat s'effacera à terme, ou seront-ils amenés à devenir de nouveaux acteurs majeurs sur la scène mondiale ?
5) La rapide constitution d'un énorme bastion de la classe ouvrière mondiale dans le sous-continent asiatique, certes extrêmement jeune et inexpérimenté, pose néanmoins de multiples questions quant au développement de la lutte de classe dans cette partie du monde et quant à son incidence au niveau du rapport de force entre les classes à l'échelle internationale. La multiplication des combats de classe et l'émergence de minorités politiques en sont des signes non ambigus [5]. En retour, les bas salaires et conditions extrêmement précaires de travail en Asie de l'Est sont utilisés par la bourgeoisie des pays développés pour exercer un chantage à l'emploi (par la menace de délocalisation) et effectuer une formidable pression à la baisse sur les salaires et conditions de travail.
On ne peut répondre à toutes ces questions et dégager les véritables ressorts, contradictions et limites de la croissance asiatique, que si on est capable de les situer dans le contexte général de l'évolution du capitalisme à l'échelle historique et internationale. Dès lors, ce n'est qu'en replaçant l'actuel développement en Asie de l'Est, d'une part, dans le cadre de l'ouverture de la phase de décadence du capitalisme depuis 1914 (Ière partie) et, d'autre part, dans la dynamique de crise qui est réapparue à la fin des années 1960 au niveau international (IIème partie), que l'on pourra correctement dégager les éléments essentiels de réponse à la croissance asiatique (IIIème partie). Tels seront les axes de l'analyse développée dans cet article. [6]
[1] Lire notre article Derrière la mondialisation de l'économie, l'aggravation de la crise dans le numéro 86 de cette revue.
[2] Sources : Banque Mondiale : Indicateurs du développement dans le monde 2003 (version en ligne) et Perspectives économiques mondiales 2004.
|
Tableau 1 : Répartition structurelle en % de la valeur produite et en emploi |
||||||
|
|
Primaire (agriculture) |
Secondaire (industrie) |
Tertiaire (services) |
|||
|
|
Valeur |
Emploi |
Valeur |
Emploi |
Valeur |
Emploi |
|
1952 |
51 |
84 |
21 |
7 |
29 |
9 |
|
1978 |
28 |
71 |
48 |
17 |
24 |
12 |
|
2001 |
15 |
50 |
51 |
22 |
34 |
28 |
|
Source : China Statistical Yearbook, 2002. |
[4] Ce mode de calcul est nettement plus fiable dans la mesure où il s'appuie, non plus sur les valeurs respectives des monnaies tirées des seuls échanges de biens sur le marché mondial, mais de la comparaison des prix d'un panier de biens et de services standard entre pays.
[5] Nous renvoyons le lecteur à notre Rapport sur la conférence en Corée qui réunissait une série de groupes et d'éléments se revendiquant de l'internationalisme prolétarien et de la Gauche Communiste (Revue Internationale n°129) ainsi qu'au site Web d'un nouveau groupe politique internationaliste qui est apparu aux Philippines et qui se revendique également de la filiation politique des groupes de la Gauche Communiste (consulter notre site Web).
[6] Notre 17e congrès international (cf. Revue Internationale n° 130) avait consacré une part importante de ses travaux à la crise économique du capitalisme en se penchant notamment sur la croissance actuelle de certains pays "émergents", tels l'Inde ou la Chine, qui semble contredire les analyses faites par notre organisation, et les marxistes en général, sur la faillite définitive du mode de production capitaliste. A ce sujet, il avait pris comme décision de faire paraître dans sa presse, et notamment dans la Revue Internationale, des articles approfondis sur ce thème. Le présent texte est une concrétisation de cette orientation et nous pensons qu'il contribue de façon tout à fait valable à la compréhension du phénomène de la croissance chinoise envisagé dans le cadre de la décadence du capitalisme. Cela dit, les débats que nous menons actuellement en notre sein sur l'analyse des mécanismes qui ont permis au capitalisme de connaître sa croissance spectaculaire après la seconde guerre mondiale se répercutent sur la façon de comprendre le dynamisme actuel de l'économie de certains pays "émergents", notamment la Chine. Le présent article fait justement l'objet d'un désaccord qui porte sur l'idée qu'il défend selon laquelle la masse salariale serait à même de constituer un débouché solvable à la production capitaliste, lorsqu'elle n'est pas "comprimée" à l'extrême. Cela se traduit par la formulation suivante à propos de l'actuelle mondialisation qui "est pervertie en ce sens qu'elle comprime relativement cette masse salariale et qu'elle restreint d'autant les bases de l'accumulation à l'échelle mondiale". Ceci n'est pas le point de vue aujourd'hui majoritaire au sein de l'organe central du CCI qui considère que si, pour des raisons dans lesquelles nous n'entrerons pas ici, le capitalisme est amené à faire "bénéficier" la classe ouvrière d'un pouvoir de consommation surpassant ce qui est strictement nécessaire à la reproduction de sa force de travail, la consommation ouvrière qui s'en trouve ainsi augmentée ne favorise pas pour autant durablement l'accumulation.
Récent et en cours:
- Crise économique [1]
- Asie de l'Est [44]
Une trajectoire caractéristique de la décadence du capitalisme
- 4907 lectures
Marquée par le joug colonial et l'inaboutissement de sa révolution bourgeoise plusieurs fois avortée, la trajectoire de la Chine est typique de ces pays qui n'ont pu prendre le train de la révolution industrielle en marche au cours de la phase ascendante du capitalisme. Alors que la Chine était encore la première puissance économique mondiale jusqu'en 1820 avec un PIB s'élevant au tiers de la richesse produite dans l'ensemble du monde, ce même PIB chinois ne représentera plus que 4,5% en 1950, soit une division par un facteur sept !
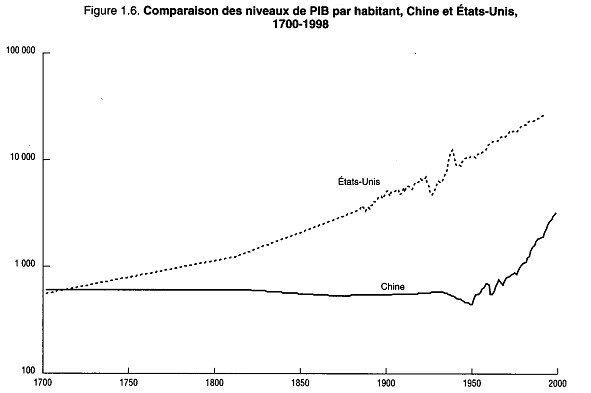
Graphique 1, source : Angus Maddison, L’économie mondiale, OCDE, 2001 : 45.
Le graphique ci-dessus indique une diminution du PIB par habitant chinois de 8% durant toute la phase ascendante du capitalisme : il passe de 600$ en 1820 à 552$ en 1913. Ceci est la marque d'une absence de véritable révolution bourgeoise, de conflits endémiques entre Seigneurs de la guerre au sein d'une classe dominante affaiblie, ainsi que du terrible joug colonial que va subir ce pays après la défaite de la guerre de l'opium en 1840, défaite qui marque le début d'une série de traités humiliants qui dépecèrent la Chine au profit des puissances coloniales. Déjà affaiblie, la Chine sera mal armée pour résister aux conditions de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence. La saturation relative des marchés et leur domination par les grandes puissances qui caractérisent l'ensemble de la phase de décadence du capitalisme, ont confiné la Chine dans un sous-développement absolu durant la majeure partie de cette période, puisque son PIB par habitant régresse encore plus rapidement (-20%) entre 1913 (552$) et 1950 (439$) !
Toutes ces données viennent pleinement confirmer l'analyse développée par la Gauche Communiste selon laquelle, en décadence, il n'est plus possible pour de nouveaux pays et puissances d'émerger dans un contexte de marché mondial globalement saturé [1]. Ce n'est que pendant les années 1960 que le PIB par habitant chinois retrouve son niveau de 1820 (600 $) ! Ensuite, il augmente sensiblement, mais ce n'est que durant ces trente dernières années que la croissance explosera à des taux jamais vus dans toute l'histoire du capitalisme [2]. C'est cette parenthèse toute récente et exceptionnelle dans l'histoire de la Chine qu'il s'agit d'expliquer, parenthèse qui, en apparence, semble contredire nombre de certitudes à propos de l'évolution du capitalisme.
Les soubassements généraux du capitalisme d'Etat en décadence
Comme nous le disions en 1974 dans une longue étude sur le capitalisme d'Etat : « La tendance à l'étatisation est l'expression de la crise permanente du capitalisme depuis 1914. C'est une forme d'adaptation du système pour survivre dans une période où le moteur économique du capitalisme n'a plus de possibilité historique. Quand les contradictions du capitalisme ne peuvent que déchirer le monde dans d'inévitables rivalités et guerres impérialistes, le Capitalisme d'Etat est l'expression de la tendance à l'autarcie, à l'économie de guerre permanente, à la concentration nationale, pour protéger le Capital National. (...) dans la période de décadence, due à la relative saturation des marchés, la crise permanente du système a imposé certains changements dans la structure organisationnelle du capitalisme. (...) Parce qu'il n'y a pas de solutions purement économiques à ces difficultés, on ne peut permettre le libre fonctionnement des lois aveugles du capitalisme. La bourgeoisie essaie d'en maitriser les conséquences par l'intervention de l'Etat : subventions, nationalisation des secteurs déficitaires, contrôle des matières premières, planning national, manœuvre monétaire, etc. » (Revue Internationale ancienne série n° 10, p.13-14).
Ces tendances à la prise en main des intérêts nationaux par l'Etat et au repli sur le cadre national marqueront un coup d'arrêt brutal à l'expansion et l'internationalisation du capitalisme qui ont prévalu durant toute sa phase ascendante. Ainsi, au cours de cette dernière, la part des exportations des pays développés dans le produit mondial n'a fait que croître, et ce, jusqu'à plus que doubler, puisqu'elle passe de 5,5% en 1830 à 12,9% à la veille de la première guerre mondiale (tableau 2). Ceci illustre la conquête effrénée du monde par le capitalisme à cette époque.
L'ouverture de la phase de décadence du capitalisme, par contre, va marquer un brutal coup d'arrêt à cette pénétration capitaliste dans le monde. La stagnation du commerce mondial entre 1914 et 1950 (cf. graphique 2), la régression de moitié de la part des exportations des pays développés dans le produit mondial (de 12,9% en 1913 à 6,2% en 1938 - tableau 2), et le fait que la croissance du commerce mondial sera bien souvent inférieure à celle de la production, illustrent chacun à leur manière ce puissant repli relatif dans le cadre de l'Etat nation durant la phase de décadence. Même durant les années fastes des Trente glorieuses qui connaissent une vigoureuse reprise du commerce international jusque dans les années 1970, la part des exportations des pays développés (10,2%) restera toujours inférieure à son niveau de 1914 (12,9%) et même à celui atteint dès 1860 (10,9% - cf. tableau 2 [3]) ! Ce ne sera qu'à la faveur du phénomène de "mondialisation" à partir des années 80, que cette part des exportations dépassera son niveau atteint plus d'un siècle auparavant !
Cette même opposition de dynamique entre la phase ascendante et décadente du capitalisme se retrouve au niveau du flux des investissements entre pays. La part des Investissements Directs à l'Etranger (IDE) augmente jusqu'à représenter 2% du PIB mondial en 1914 alors que malgré leur considérable développement suite à la mondialisation, ils n'atteignent que la moitié (1%) en 1995 ! Il en va également au niveau du stock des IDE des pays développés. Alors qu'il a doublé suite à la mondialisation en passant de 6,6% en 1980 à 11,5% en 1995, ce pourcentage ne dépasse pas celui atteint en 1914 (entre 12% et 15%). Ce recentrage économique sur le cadre national et les pays développés en période de décadence peut encore s'illustrer par le fait suivant : « A la veille de la Première Guerre mondiale, 55 à 65% des IDE se trouvaient dans le Tiers-Monde et seulement 25 à 35% dans les pays développés ; à la fin des années 1960, ces proportions se sont inversées, puisque, en 1967, seulement 31% su stock des IDE des pays développés occidentaux se trouvaient dans le Tiers-Monde et 61% dans les pays développés occidentaux. Et, depuis cette date, la tendance s'est encore renforcée. (...) Vers 1980, ces proportions sont passées à 78% d'IDE dans les pays développés et 22% dans le Tiers-Monde. (...) De ce fait, l'importance par rapport au PIB des investissements directs se trouvant à l'intérieur des pays développés occidentaux était de l'ordre de 8,5% à 9,0% au milieu de la décennie 1990, contre 3,5 à 4% vers 1913, soit plus du double » [4].
Alors que le capitalisme ascendant modelait le monde à son image en entraînant de plus en plus de nations dans son sillage, la décadence figera en quelque sorte la situation au moment de son apogée : « Cette incapacité de surgissement de nouvelles grandes unités capitalistes s'exprime entre autres dans le fait que les six plus grandes puissances industrielles d'aujourd'hui l'étaient déjà (bien que dans un ordre différent) à la veille de la première guerre mondiale » (Revue Internationale n°23, p.27). Tout ceci illustre ce spectaculaire repli sur le cadre national qui a caractérisé toute la phase de décadence du capitalisme au travers du recours massif aux politiques de capitalisme d'Etat.
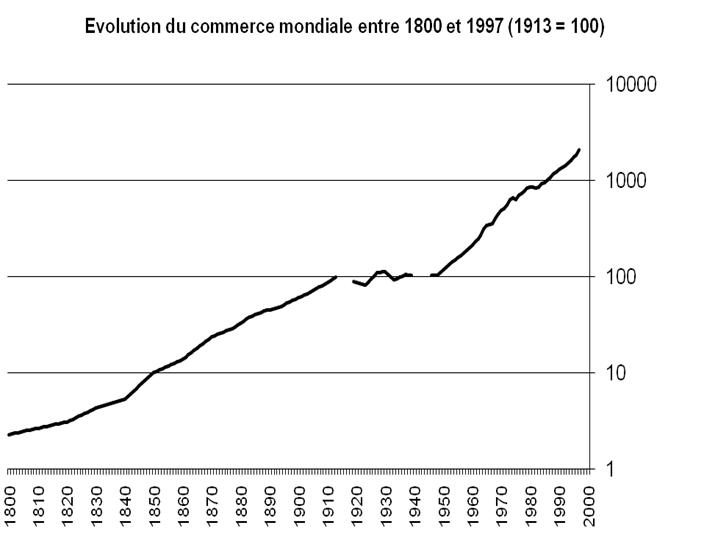
Graphique 2, source : Rostow, The World Economy, History and Prospect, University of Texas Press, 1978 : 662
|
Tableau 2 : Taux d'exportation des pays développés occidentaux en valeur (% du PIB) |
|
|
1830 |
5,5 |
|
1860 |
10,9 |
|
1890 |
11,7 |
|
1913 |
12,9 |
|
1929 |
9,8 |
|
1938 |
6,2 |
|
1950 |
8 |
|
1960 |
8,6 |
|
1970 |
10,2 |
|
1980 |
15,3 |
|
1990 |
14,8 |
|
1996 |
15,9 |
|
Philippe Norel, L'invention du marché, Seuil, 2003 : 431. |
Toute l'Asie de l'Est sera particulièrement concernée par ce vaste mouvement de repli sur le cadre de l'Etat nation. Après la seconde guerre mondiale, c'est près de la moitié de la population du monde qui se verra retirée du marché mondial et enserrée dans la bipolarisation du monde en deux blocs géostratégiques qui ne prendra réellement fin qu'avec les années 80 : ont été concernés les pays du bloc de l'Est, la Chine, l'Inde et plusieurs pays du Tiers-Monde comme Cuba, le Vietnam, le Cambodge, l'Algérie, l'Egypte, etc.. Ce retrait brutal du marché pour la moitié du monde est une parfaite illustration de la saturation relative du marché mondial, saturation qui a obligé chaque capital national à prendre directement en main ses intérêts à l'échelle nationale et à s'intégrer sous la tutelle et dans les politiques menées par les deux grandes puissances pour survivre dans l'enfer de la décadence. Cette politique, contrainte et forcée, mena cependant à un échec patent. En effet, toute cette période se soldera par une croissance relativement médiocre pour l'Inde et la Chine, surtout pour le premier qui a encore moins bien fait que l'Afrique :
|
Tableau 3 : PIB par habitant (Indice 100 = 1950) |
||
|
|
1950 |
1973 |
|
Japon |
100 |
594 |
|
Europe occidentale |
100 |
251 |
|
Etats-Unis |
100 |
243 |
|
Monde |
100 |
194 |
|
Chine |
100 |
191 |
|
Afrique |
100 |
160 |
|
Inde |
100 |
138 |
|
Source : Angus Maddison, L'économie mondiale, annexe C, OCDE, 2001. |
Il est vrai que la croissance de la Chine fut supérieure à celle de l'ensemble du Tiers-Monde entre 1950 et 73, elle resta cependant inférieure à la moyenne mondiale, fut marquée par une terrible surexploitation des paysans et travailleurs, n'a été rendue possible que par l'intense soutien du bloc de l'Est jusqu'aux années 60, et par l'intégration dans la sphère d'influence américaine ensuite. De plus, elle fut ponctuée par deux reculs significatifs durant les dites périodes de ‘grand bond en avant' (1958-61) et de ‘révolution culturelle' (1966-70) qui ont fauché plusieurs dizaines de millions de paysans et prolétaires chinois dans d'atroces famines et souffrances matérielles. Cet échec global des politiques de capitalisme d'Etat autarcique est ce que nous constations également il y a plus d'un quart de siècle : « Les politiques protectionnistes connaissent au 20ème siècle une faillite totale. Loin de constituer une possibilité de respiration pour les économies moins développées, elles conduisent à l'asphyxie de l'économie nationale » (Revue Internationale, n°23, p.27), il résulte du fait que le capitalisme d'Etat ne constitue pas une solution aux contradictions du capitalisme mais un emplâtre sur une jambe de bois lui permettant de repousser ses manifestations dans le temps.
La Chine dans l'orbite successive des deux grands blocs impérialistes
Seule face à la terrible concurrence sur un marché mondial globalement saturé et contrôlé par les grandes puissances, la Chine ne pourra défendre au mieux ses intérêts nationaux qu'en s'intégrant d'abord au sein du bloc soviétique jusqu'au tout début des années 1960, pour évoluer ensuite dans l'orbite américaine à partir des années 1970. Evoluant dans un contexte qui ne permettait plus à de nouvelles puissances d'émerger et de rattraper leur retard comme en phase ascendante, la défense d'un projet nationaliste de ‘développement' en décadence (maoïsme) n'était possible qu'à cette condition. C'est à ce prix que la Chine se vendra au plus offrant dans le contexte de bipolarisation inter-impérialiste du temps de la guerre froide (1945-89). L'isolement par rapport au marché mondial, l'intégration au bloc soviétique, et l'aide massive apportée par ce dernier, ont permis une croissance chinoise, certes modeste - puisque tout juste inférieure à la moyenne mondiale -, mais relativement meilleure que celle de l'Inde et du reste du Tiers-Monde. En effet, l'Inde ne s'étant que partiellement retirée du marché mondial, et s'étant même aventurée comme chef de fil du mouvement des ‘pays non-alignés' [5], en paiera le prix par une croissance économique inférieure à celle de l'Afrique durant cette même période (1950-73) ! L'implosion des grands blocs impérialistes après la chute du mur de Berlin (1989) et la perte continuelle du leadership américain sur le monde, ont levé cette contrainte à la bipolarisation internationale, laissant ainsi plus de latitude à l'expression d'intérêts propres à chacun des pays.
[1] « La période de décadence du capitalisme se caractérise par l'impossibilité de tout surgissement de nouvelles nations industrialisées. Les pays qui n'ont pas réussi leur ‘décollage' industriel avant la 1ère guerre mondiale sont, par la suite, condamnés à stagner dans le sous-développement total, ou à conserver une arriération chronique par rapport aux pays qui ‘tiennent le haut du pavé'. Il en est ainsi de grandes nations comme l'Inde ou la Chine dont ‘l'indépendance nationale' ou même la prétendue ‘révolution' (lire l'instauration d'un capitalisme d'Etat draconien) ne permettent pas la sortie du sous-développement et du dénuement. (...) Cette incapacité des pays sous-développés à se hisser au niveau des pays les plus avancés s'explique par les faits suivants : 1) Les marchés représentés par les secteurs extra-capitalistes des pays industrialisés sont totalement épuisés par la capitalisation de l'agriculture et la ruine presque complète de l'artisanat. (...) 3) Les marchés extra-capitalistes sont saturés au niveau mondial. Malgré les immenses besoins et le dénuement total du tiers-monde, les économies qui n'ont pu accéder à l'industrialisation capitalistes ne constituent pas un marchés solvable parce que complètement ruinées. 4) La loi de l'offre et de la demande joue contre tout développement de nouveaux pays. Dans un monde où les marchés sont saturés, l'offre dépasse la demande et les prix sont déterminés par les coûts de production les plus bas. De ce fait, les pays ayant les coûts de production les plus élevés [les pays sous-développés] sont contrains de vendre leurs marchandises avec des profits réduits quand ce n'est pas à perte. Cela ramène le taux d'accumulation à un niveau extrêmement bas et, même avec une main d'œuvre très bon marché, ils ne parviennent pas à réaliser les investissements nécessaires à l'acquisition d'une technologie moderne, ce qui a pour résultat de creuser encore plus le fossé qui sépare ces pays des grandes puissances industrielles. (...) 6) Aujourd'hui, la production industrielle moderne fait appel à une technologie incomparablement plus sophistiquée qu'au siècle dernier et donc à des investissements considérables que seuls les pays déjà développés sont en mesure d'assumer » (Revue Internationale n°23, 1980, p.27-28).
[2] Maddison, OCDE, 2001 : 283, 322.
[3] Le commerce mondial va très rapidement se développer après 1945, et ce, encore plus fortement qu'en phase ascendante puisque ce commerce est multiplié par 5 entre 1948 et 1971 (23 années) alors qu'il n'est multiplié que par 2,3 entre 1890 et 1913 (23 années également) ! La croissance du commerce mondiale a donc été deux fois plus forte durant les Trente glorieuses que pendant la meilleure période en phase ascendante (Source : Rostow, The World Economy, History and Prospect, University of Texas Press, 1978 : 662). Or, malgré cette formidable croissance du commerce mondial, la part des exportations dans la richesse produite dans le monde reste inférieure au niveau atteint en 1913 et même à celui de 1860 : les pays développés n'exportent pas plus en 1970 qu'un siècle auparavant ! Ceci est la marque indubitable de l'existence d'une croissance autocentrée restant repliée sur le cadre national. Et encore, ce constat de forte reprise du commerce international après 1945 est en réalité moins intense que ce que nous montre le graphique. En effet, une part de plus en plus importante de celui-ci va concerner non des ventes réelles mais des échanges entre filiales du fait de l'accroissement de la division internationale du travail : « d'après les estimations réalisée par l'UNCTAD, les firmes multinationales à elles seules réalisent actuellement les deux tiers du commerce mondial. Et la moitié de ce commerce mondial est le fait de transferts entre filiales du même groupe » (Bairoch Paul, Victoires et déboires, III : 445). Ce constat vient donc renforcer notre conclusion générale selon laquelle la décadence se caractérise essentiellement par un repli général de chaque pays dans son cadre national et non, comme en phase ascendante, par une extension et une prospérité fondée sur une conquête effrénée de par le monde..
[4] Toutes les données sur les IDE proviennent de : Bairoch Paul, 1997, Victoires et déboires, III : 436-443.
[5] C'est sur l'île indonésienne de Java que, du 18 au 24 avril 1955, eu lieu à Bandung la première conférence afro-asiatique, qui réunit vingt-neuf pays dont la plupart ont été décolonisés depuis peu et appartiennent tous au Tiers Monde. L'initiative de ce sommet revient au Premier ministre indien Nehru, soucieux de créer sur la scène internationale un ensemble de puissances qui échapperait aux deux Grands et à la logique de guerre froide. Cependant, jamais ces dits ‘non-alignés' ne parviendront réellement à être ‘indépendants' et à s'abstraire de la logique d'affrontement des deux grands blocs impérialistes en présence (le bloc américain et soviétique). Ainsi, ce mouvement contiendra à la fois des pays pro-occidentaux comme le Pakistan ou la Turquie, et d'autre comme la Chine et le Vietnam du Nord qui sont prosoviétiques.
Géographique:
- Etats-Unis [45]
- Chine [41]
Récent et en cours:
- Crise économique [1]
- Asie de l'Est [44]
Questions théoriques:
- L'économie [33]
La place et l'évolution de l'Asie de l'Est dans l'histoire du développement capitaliste
- 5309 lectures
L'évolution en ciseau de l'Asie de l'Est à l'échelle historique (1700-2006)
Après avoir replacé l'évolution de l'Asie de l'Est dans le contexte historique de l'ascendance et de la décadence du capitalisme, ainsi que dans le cadre du développement du capitalisme d'Etat et de l'intégration aux blocs impérialistes au cours de cette dernière phase, il nous faut maintenant essayer de comprendre pourquoi cette région du monde a pu inverser sa tendance historique à la marginalisation. En effet, le tableau ci-dessous nous montre qu'en 1820, l'Inde et la Chine concentraient près de la moitié de la richesse produite dans le monde (48,9%) et n'en représente plus que 7,7% en 1973 ! Le poids du joug colonial, puis l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, vont diviser la part de l'Inde et de la Chine dans le PIB mondial par un facteur six ! Autrement dit, lorsque l'Europe et les pays neufs se développent, l'Inde et la Chine reculent relativement. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, lorsque les pays développés entrent en crise, l'Asie de l'Est se développe au point de remonter sa part à 20% de la production mondiale de richesse en 2006. Il y a donc là une très nette évolution en ciseaux à l'échelle historique : quand les pays industrialisés se développent puissamment, l'Asie recule relativement et, lorsque la crise s'installe durablement dans les pays développés, l'Asie connaît un boom économique :
| Tableau 4 : Part des différentes zones dans le monde en % du PIB mondial |
|
||||||||
|
|
1700 |
1820 |
1870 |
1913 |
1950 |
1973 |
1998 |
2001 |
|
|
Europe et pays neufs (*) |
22,7 |
25,5 |
43,8 |
55,2 |
56,9 |
51 |
45,7 |
44,9 |
|
|
Reste du monde |
19,7 |
18,3 |
20,2 |
22,9 |
27,6 |
32,6 |
24,8 |
(°) |
|
|
Asie |
57,6 |
56,2 |
36,0 |
21,9 |
15,5 |
16,4 |
29,5 |
|
|
|
Inde |
24,4 |
16,0 |
12,2 |
7,6 |
4,2 |
3,1 |
5,0 |
5,4 |
|
|
Chine |
22,3 |
32,9 |
17,2 |
8,9 |
4,5 |
4,6 |
11,5 |
12,3 |
|
|
Reste Asie |
10,9 |
7,3 |
6,6 |
5,4 |
6,8 |
8,7 |
13,0 |
(°) |
|
|
(*) Pays neufs = Etats-Unis, Canada, Australie et Nouvelle Zélande (°) = 37,4 : Reste du monde + Reste Asie |
|
||||||||
|
Source : Angus Maddison, L'économie mondiale, OCDE, 2001 : 280 |
|
L'évolution de l'Asie de l'Est après la seconde guerre mondiale
Cette dynamique en ciseau peut encore s'illustrer par l'évolution du taux de croissance de la Chine comparativement au reste du monde après la seconde guerre mondiale. Les tableaux 3 (ci-dessus) et 5 (ci-dessous) montrent que, lorsque les pays développés connaissent une croissance soutenue, l'Inde et la Chine sont à la traîne : entre 1950 et 1973, l'Europe fait deux fois mieux que l'Inde, le Japon trois fois mieux que la Chine et quatre fois mieux que l'Inde, et la croissance de ces deux derniers pays est inférieure à la moyenne mondiale. Par contre, ce sera exactement l'inverse ensuite : entre 1978 et 2002, la croissance annuelle moyenne du PIB chinois par habitant est plus de quatre fois plus élevée (5,9%) que la croissance moyenne mondiale (1,4%), et l'Inde multiplie son PIB par 4, alors que le monde ne le multiplie que par 2,5 entre 1980 et 2005.
Le retour de la crise économique signe la faillite de tous les palliatifs d'après-guerre
Ce n'est donc que lorsque les pays centraux du capitalisme entrent en crise que l'Inde et la Chine décollent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique cette évolution en ciseau ? Pourquoi, lorsque le reste du monde s'enfonce dans la crise, l'Asie de l'Est connaît-elle un regain de croissance ? Pourquoi cette inversion de tendance ? Comment expliquer cette parenthèse de forte expansion en Asie de l'Est à la faveur de la poursuite de la crise économique au niveau international ? C'est ce que nous allons à présent examiner.
Le retour de la crise économique dès la fin des années 60 viendra balayer tous les modèles de croissance qui avaient fleuri de par le monde après la seconde guerre mondiale : le modèle stalinien à l'Est, le modèle keynésien à l'Ouest et le modèle nationaliste-militariste dans le Tiers-Monde. Elle mettra à bas leurs prétentions respectives à se présenter comme une solution aux contradictions insurmontables du capitalisme. L'aggravation de celles-ci tout au long des années 70 signera la faillite des recettes néo-keynésiennes dans les pays de l'OCDE, mènera jusqu'à l'implosion du bloc de l'Est au cours de la décennie suivante et révèlera l'impuissance de toutes les alternatives ‘tiers-mondistes' (Algérie, Vietnam, Cambodge, Iran, Cuba, etc.). Tous ces modèles qui ont pu faire illusion durant les années grasses des Trente glorieuses sont venus s'échouer sous les coups de buttoir des récessions successives et démontrer ainsi qu'ils ne constituaient en rien un dépassement des contradictions intrinsèques du capitalisme.
Les conséquences et réactions à ces faillites seront fort diverses. C'est dès les années 1979-80 que les pays occidentaux réorienteront leur politique en direction d'un capitalisme d'Etat dérégulé (le ‘tournant néolibéral' comme l'appellent les médias et gauchistes). Par contre, engoncés dans un capitalisme d'Etat d'une rigidité stalinienne, ce n'est qu'à la suite de l'implosion de ce système que les pays de l'Est s'engageront sur un chemin analogue. C'est également sous cette terrible pression de la crise économique que divers pays et ‘modèles' dans le tiers-monde s'enfonceront, soit dans une barbarie sans fins (Algérie, Iran, Afghanistan, Soudan, etc.), soit dans une banqueroute pure et simple (Argentine, nombre de pays africains, etc.), soit dans des difficultés telles qu'elles remettront à leur place leurs prétentions à être des modèles de réussite (tigres et dragons asiatiques). Par contre, en parallèle, un certains nombre d'autres pays en Asie de l'Est, comme l'Inde, la Chine et le Vietnam, parviendront à entamer des réformes progressives qui les ramèneront dans le giron du marché mondial en les insérant dans le circuit de l'accumulation à l'échelle internationale qui va progressivement se mettre en place à partir des années 1980.
Ces différentes réactions auront des fortunes diverses. Nous nous limiterons ici à celles qui ont eu cours dans les pays occidentaux et en Asie de l'Est. Disons que, tout comme le retour de la crise est d'abord apparu dans les pays centraux pour se reporter ensuite dans les pays de la périphérie, ce sera encore le tournant économique opéré au début des années 80 dans les pays développés qui va déterminer la place que prendront les pays du sous continent est-asiatique dans le circuit de l'accumulation à l'échelle mondiale.
L'avènement d'un capitalisme d'Etat dérégulé et d'une mondialisation pervertie
Toutes les mesures néokeynésiennes de relance économique utilisées durant les années 70 ne sont pas parvenues à redresser un taux de profit qui a été divisé par deux entre la fin des années 60 et 1980 (cf. graphique 6 infra [1]). Ce déclin ininterrompu de la profitabilité du capital mènera un bon nombre d'entreprises au bord de la banqueroute. Les Etats, qui s'étaient eux-mêmes largement endettés pour soutenir l'économie, se retrouvèrent en quasi cessation de paiements. Cette situation de faillite virtuelle à la fin des années 70 est la raison essentielle du passage à un capitalisme d'Etat dérégulé et à la mondialisation pervertie qui en est le corolaire. L'axe essentiel de cette nouvelle politique consiste en une attaque massive et frontale contre la classe ouvrière afin de rétablir la rentabilité du capital. Dès le début des années 80, la bourgeoisie se lance dans un programme d'attaques massives contre les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière : nombre de recettes keynésiennes sont démantelées et la force de travail est directement mise en concurrence à l'échelle internationale par le biais des délocalisations et de l'ouverture à la concurrence internationale (dérégulation). Cette régression sociale massive permettra un spectaculaire rétablissement du taux de profit à des niveaux qui, aujourd'hui, dépassent même ceux atteint durant les Trente glorieuses (cf. graphique 6 infra).
Le graphique 3 ci-dessous illustre cette politique de dérégulation tous azimuts, politique qui a déjà permis à la bourgeoisie de diminuer la part de la masse salariale dans le PNB de +/-10% à l'échelle internationale. Cette diminution n'est autre que la matérialisation de la tendance spontanée à augmenter le taux de plus value ou taux d'exploitation de la classe ouvrière [2]. Ce graphique nous montre aussi la stabilité du taux de plus-value durant la période qui précède les années 1970, stabilité qui, conjuguée à d'important gains de productivité ont fait le succès des Trente glorieuses. Ce taux a même diminué durant les années 70 comme produit de la pression de la lutte de classe qui a fait sa réapparition massive dès la fin des années 60 :
Graphique 3. Part des salaires dans le PIB : USA et Union Européenne, 1960-2005
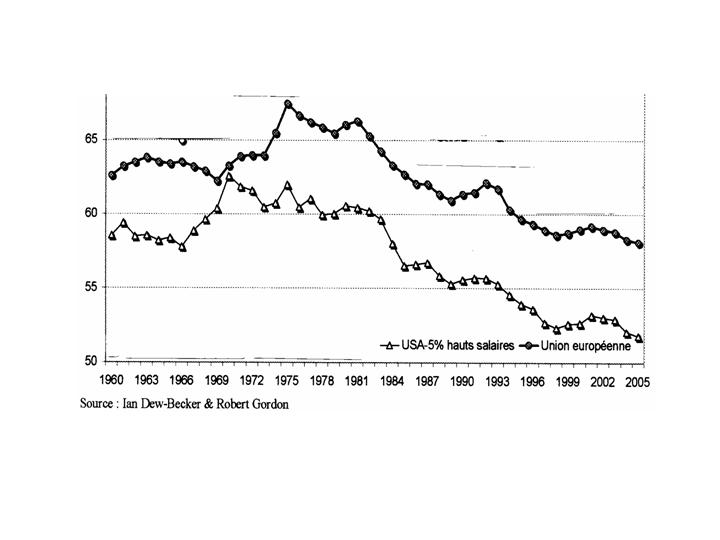
Cette réduction de la part salariale de la classe ouvrière dans le produit total est en réalité bien plus considérable que ne le suggère ce graphique puisque ce dernier inclut toutes les catégories de salaires, y compris ceux rémunérant la bourgeoisie [3] ! Alors qu'il s'était restreint durant les Trente glorieuses, l'éventail des revenus s'accroît à nouveau ; dès lors, ce recul de la part salariale est encore bien plus significatif pour les travailleurs. En effet, les statistiques par catégories sociales montrent que, pour des fractions significatives d'ouvriers - les moins qualifiés en général -, ce recul est de grande ampleur puisqu'il ramène l'état de leurs rémunérations au niveau de celui de 1960 comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis pour les travailleurs de production (gains hebdomadaires). Alors que leur salaire réel avait presque doublé entre 1945 et 1972, il est redescendu pour se stabiliser ensuite au niveau atteint en 1960 :
Graphique 4. Gains hebdomadaires d'un travailleur de production (dollars de 1990) : Etats-Unis
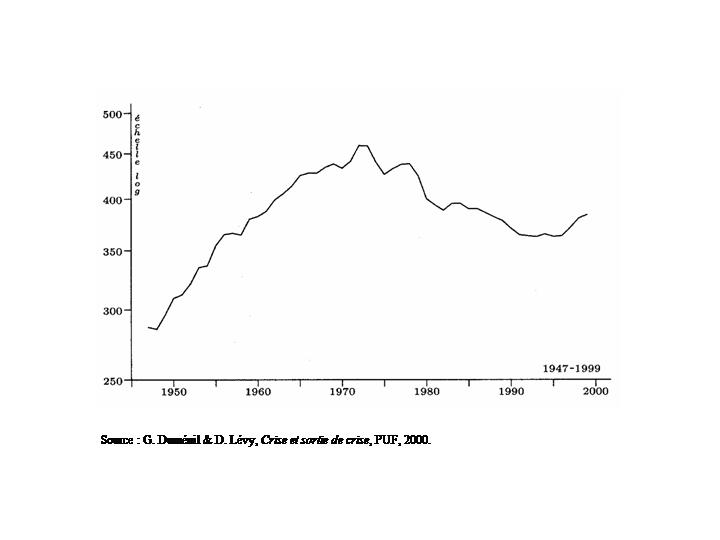
Nous assistons donc bel et bien, depuis un quart de siècle, à un mouvement massif et de plus en plus généralisé de paupérisation absolue de la classe ouvrière à l'échelle mondiale. L'on peut estimer la perte moyenne de sa part relative dans le PIB à +/- 15 à 20%, ce qui est considérable, et cela sans considérer l'importante dégradation de ses conditions de vie et de travail. Comme le disait Trotski au 3ème congrès le l'IC : « La théorie de la paupérisation des masses était regardée comme enterrée sous les coups de sifflets méprisants des eunuques occupant les tribunes universitaires de la bourgeoisie et des mandarins de l'opportunisme socialiste. Maintenant ce n'est pas seulement la paupérisation sociale, mais un appauvrissement physiologique, biologique, qui se présente à nous dans toute sa réalité hideuse ». En d'autres termes, ce que le capitalisme d'Etat keynésien à pu concéder durant les Trente glorieuses - puisque les salaires réels ont plus que triplé en moyenne entre 1945 et 1980 -, le capitalisme d'Etat dérégulé est en train de le récupérer à vive allure. A l'exception de cette parenthèse d'après-guerre, ceci vient confirmer l'analyse de l'Internationale Communiste et de la Gauche Communiste selon laquelle il ne peut plus exister de réformes réelles, mais surtout durables, dans la phase de décadence du capitalisme.
Cette réduction massive des revenus des salariés a une double conséquence. D'une part, elle a permis une formidable hausse du taux de plus-value permettant à la bourgeoisie de rétablir son taux de profit. Celui-ci a désormais retrouvé et même dépassé le niveau qu'il avait atteint durant les Trente glorieuses (cf. graphique 6 [46]). D'autre part, en comprimant drastiquement la demande salariale de +/-10 à 20%, elle diminue considérablement le niveau relatif des marchés solvables au niveau mondial. Ce fait est directement à l'origine de la formidable aggravation de la crise de surproduction à l'échelle internationale et de la chute du taux d'accumulation (la croissance du capital fixe) à un niveau historiquement très bas (cf. graphique 6 [46]). C'est ce double mouvement de recherche d'une rentabilité croissante afin de redresser le taux de profit, ainsi que la nécessité de trouver de nouveaux marchés où écouler sa production, qui est à la racine du phénomène de mondialisation apparu dès les années 80. Cette mondialisation ne résulte pas, comme veulent nous le faire croire les gauchistes et autres altermondialistes, de la domination du (méchant) capital financier improductif sur le (bon) capital industriel productif, capital financier qu'il faudrait abolir selon la variante présentée par les gauchistes (qui appellent indûment le Lénine de L'impérialisme stade suprême du capitalisme à la rescousse pour se faire), ou réguler et taxer (taxe Tobin) selon la variante altermondialiste ou sociale-démocrate de gauche, etc.
La signification historique de la mondialisation aujourd'hui
En effet, toute la littérature sur la mondialisation, qu'elle soit de droite ou de gauche, altermondialiste ou gauchiste, présente celle-ci comme un remake de la conquête du monde par les rapports marchands. Il est même très fréquent d'y retrouver les célèbres passages du Manifeste Communiste où Marx y décrit le rôle progressif de la bourgeoisie et de l'extension du capitalisme à l'échelle planétaire. Elle nous est présentée comme un vaste processus de domination et de marchandisation de tous les aspects de la vie par les rapports capitalistes. L'on nous dit même que ce serait la seconde mondialisation après celle de 1875-1914.
Selon cette présentation de la mondialisation actuelle, toute la période allant de la première guerre mondiale aux années 1980 ne serait qu'une immense parenthèse, isolationniste (1914-45) ou régulée (1945-80), période qui aurait permis de mener des politiques sociales pour la classe ouvrière - selon les dires des gauchistes -, ou qui aurait empêché le capitalisme de donner la pleine mesure de ses moyens, dans sa variante libérale ! Revenons à ces ‘jours heureux' pour les premiers ou ‘dérégulons' et ‘libéralisons' au maximum pour les seconds. Ces derniers proclamant qu'en donnant ‘toute la liberté et le pouvoir aux marchés', le monde entier connaîtrait des taux de croissance comme en Chine ! En acceptant les conditions de travail et les salaires des ouvriers chinois, nous ouvririons les portes d'un paradis de croissance fulgurante ! Rien n'est plus erroné, que ce soit dans sa présentation gauchiste ou libérale, et ce, pour plusieurs bonnes raisons qui peuvent toutes se résumer au fait suivant que les racines actuelles du phénomène de mondialisation n'ont rien à voir avec la dynamique d'internationalisation du capitalisme au XIXè siècle :
1) La première mondialisation (1880-1914) correspondait à la constitution du marché mondial et à la pénétration en profondeur des rapports marchands de par le monde. Elle exprimait l'extension géographique du capitalisme et sa domination à l'échelle de la planète, elle élargissait constamment l'échelle de l'accumulation en tirant les salaires et la demande mondiale vers le haut. Alors que la dynamique du capitalisme au XIXème siècle l'entraînait dans un tourbillon vers des sommets de plus en plus hauts, l'actuelle mondialisation n'est qu'un avatar d'un capitalisme de plus en plus poussif dont les taux d'accumulation et de croissance à l'échelle mondiale ne font que décliner, elle déprime la croissance en comprimant la masse salariale et donc les marchés solvables. Aujourd'hui, la mondialisation et la dérégulation à outrance ne sont que des moyens mis en œuvre pour pallier aux effets ravageurs de la crise historique du capitalisme. Les politiques de dérégulations ‘néolibérales' et de globalisation ne sont que des nièmes tentatives de surseoir aux échecs de palliatifs antérieurs : keynésianisme et néo keynésianisme. Aujourd'hui, nous n'empruntons pas les traces du capitalisme triomphant du XIXème siècle, mais nous continuons le chemin de sa lente agonie depuis les années 1970. Que le nouveau bouclage du circuit de l'accumulation qui s'est installé à l'échelle mondiale depuis les années 1980 passe par le développement localisé du sous-continent asiatique ne change rien à cette caractérisation de mondialisation pervertie, car, ce développement ne concerne qu'une partie du monde, n'est possible que pour un temps donné, et est le corollaire d'une vaste et massive régression sociale à l'échelle internationale.
2) Alors que la première mondialisation marquait la conquête et la pénétration du monde par les rapports capitalistes de production, entrainant dans son sillage de plus en plus de nouvelles nations et permettant de renforcer la domination des anciennes puissances coloniales, aujourd'hui, elle ne concerne fondamentalement que le sous-continent asiatique et elle fragilise et met en péril tant l'économie des pays développés que celle des pays du reste du Tiers-Monde. Alors que la première mondialisation marquait l'extension géographique et en profondeur des rapports capitalistes, aujourd'hui, elle n'est qu'une vicissitude dans le processus général d'aggravation de la crise à l'échelle mondiale. Elle ne développe qu'une partie du monde - l'Asie de l'Est -, tout en laissant les autres à la dérive. De plus, cette parenthèse de développement très localisée dans le sous-continent asiatique ne pourra durer que le temps que perdurent les conditions qui l'ont mise en place. Or, ce temps est compté (cf. infra et les parties suivantes de cet article).
3) Alors que la première mondialisation s'était accompagnée d'une hausse généralisée des conditions de vie de la classe ouvrière, avec un doublement des salaires réels, la mondialisation actuelle engendre une régression sociale massive : pression à la baisse sur les salaires, paupérisation absolue pour des dizaines de millions de prolétaires, dégradation massive des conditions de travail, hausse vertigineuse du taux d'exploitation, etc. Alors que la première mondialisation était porteuse de progrès pour l'humanité, celle d'aujourd'hui répand la barbarie à l'échelle du globe.
4) Alors que la première mondialisation signifiait une intégration de masses de plus en plus larges de travailleurs au sein des rapports salariés de production, celle d'aujourd'hui, même si elle fait naître un prolétariat jeune et inexpérimenté en périphérie, détruit des emplois et déstructure le tissu social parmi les pays et les couches les plus expérimentés de la classe ouvrière mondiale. Si la première mondialisation tendait à unifier les conditions et le sentiment de la solidarité au sein de la classe ouvrière, celle d'aujourd'hui a pour conséquence d'accroître la concurrence et le ‘chacun pour soi' dans un contexte de décomposition généralisée des rapports sociaux.
Pour toutes ces raisons, il est totalement abusif de présenter la mondialisation actuelle comme un remake de la période de gloire du capitalisme et de citer, pour ce faire, les célèbres passages du Manifeste Communiste où Marx décrivait le rôle progressif de la bourgeoisie à son époque. Aujourd'hui, le capitalisme a fait son temps, il a engendré le XXème siècle - siècle le plus barbare de toute l'histoire de l'humanité - et ses rapports sociaux de production n'œuvrent plus dans un sens de progrès pour l'humanité, mais ils enfoncent de plus en plus celle-ci dans la barbarie et le danger d'une destruction écologique planétaire. La bourgeoisie était une classe progressive qui développait les forces productives au XIXème siècle, elle est aujourd'hui obsolète, détruit la planète et ne répand que la misère jusqu'à hypothéquer l'avenir même du monde. C'est en ce sens qu'il faut parler, non de mondialisation, mais de mondialisation pervertie.
La signification politique de la dérégulation et de la mondialisation
Tous les médias et critiques de gauche caractérisent les nouvelles politiques de dérégulation et de libéralisation, menées par la bourgeoisie depuis les années 80, sous les vocables de tournant néolibéral et de mondialisation. En fait, ces dénominations sont chargées d'un contenu idéologique totalement mystificateur. D'une part, la dite dérégulation ‘néolibérale' a été mise en place à l'initiative et sous le contrôle de l'Etat, et elle est très loin d'impliquer un ‘Etat faible' et une régulation par le seul marché comme il est prétendu. D'autre part, comme nous l'avons vu en détail ci-dessus, la mondialisation à laquelle nous assistons aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que Marx a pu décrire dans ses ouvrages. Elle correspond à une étape dans l'approfondissement de la crise à l'échelle mondiale et non à une réelle extension progressive du capitalisme comme cela avait cours durant la phase ascendante du capitalisme : c'est une mondialisation pervertie. Ceci n'exclu évidemment pas que les rapports marchands et le salariat puissent ponctuellement et localement se développer (comme en Asie de l'Est par exemple), mais la différence fondamentale est que ces processus se déroulent dans une dynamique radicalement différente de celle qui prévalait durant la phase ascendante du capitalisme.
Ces deux politiques (le capitalisme d'Etat dérégulé et la mondialisation pervertie) n'expriment donc, ni un renouveau du capitalisme, ni la mise en place d'un nouveau ‘capitalisme financiarisé', comme nous le racontent la vulgate gauchiste et altermondialiste. Elles sont avant tout révélatrices de l'aggravation de la crise économique mondiale en ce qu'elles sont l'aveu de l'échec de toutes les mesures de capitalisme d'Etat classiques utilisées jusqu'alors. De même, les appels permanents de la part de la bourgeoisie à amplifier et généraliser encore davantage ces politiques, constituent également un clair aveu de leur échec. En effet, plus d'un quart de siècle de capitalisme dérégulé et mondialisé n'a pu redresser la situation économique au niveau international : depuis que ces politiques sont menées, le PIB mondial par habitant n'a toujours fait que décroître décennie après décennie, même si, localement, et pour un temps donné, cela a permis à l'Asie de l'Est d'en bénéficier et de connaître une spectaculaire croissance.
L'avènement du capitalisme d'Etat dérégulé et de la mondialisation pervertie constitue une claire expression de la décadence du capitalisme
La poursuite de la crise et la chute continue du taux de profit tout au long des années 70 ont mis à mal la rentabilité du capital et des entreprises. Vers la fin des années 70, celles-ci se sont très fortement endettées et bon nombre d'entre elles sont au bord de la faillite. Conjuguée à l'échec des mesures néokeynésiennes pour relancer l'économie, cette situation de banqueroute imposera l'abandon des recettes keynésiennes au profit d'un capitalisme d'Etat dérégulé et d'une mondialisation pervertie, dont les objectifs essentiels seront le rétablissement du taux de profit, la rentabilité des entreprises et l'ouverture des marchés au niveau mondial. Cette réorientation de la politique économique de la bourgeoisie exprimait donc avant tout une étape dans l'aggravation de la crise au niveau international et non l'ouverture d'une nouvelle phase de prospérité portée par la dite ‘nouvelle économie' comme se plaît à nous le raconter en permanence la propagande médiatique. La gravité de la crise était telle que la bourgeoisie n'a eu d'autre choix que d'en revenir à des mesures plus ‘libérales', alors même que celles-ci n'ont fait qu'accélérer la crise et le ralentissement de la croissance ! Vingt-sept ans de capitalisme d'Etat dérégulé et de mondialisation n'ont rien résolu, mais aggravé la crise économique !
Les deux piliers de la mondialisation pervertie qui accompagnent la mise en place du capitalisme d'Etat dérégulé dès 1980 reposent, d'une part, sur la recherche effrénée de lieux de production à faibles coûts salariaux afin de rétablir le taux de profit des entreprises (sous-traitance, délocalisation, etc.), et, d'autre part, sur la recherche débridée d'une demande ‘externe' à chaque pays pour pallier à la réduction massive de la demande salariale interne consécutive aux politiques d'austérité prises pour rétablir ce taux de profit. Cette politique a directement profité à l'Asie de l'Est qui a su s'adapter pour bénéficier de cette évolution. Dès lors, la très spectaculaire croissance en Asie de l'Est, au lieu de contribuer au redressement de la croissance économique internationale, a en réalité participé à la dépression de la demande finale par la réduction de la masse salariale au niveau mondial. En ce sens, ces deux politiques ont puissamment contribué à l'aggravation de la crise internationale du capitalisme. Ceci se perçoit très clairement sur le graphique ci-dessous qui montre un parallélisme logique et constant entre l'évolution de la production et celle du commerce mondial depuis la seconde guerre mondiale, sauf à compter des années 1990 qui voient, et ce pour la première fois depuis une soixantaine d'années, une divergence s'installer entre un commerce mondial qui reprend vigueur, et une production qui reste atone :
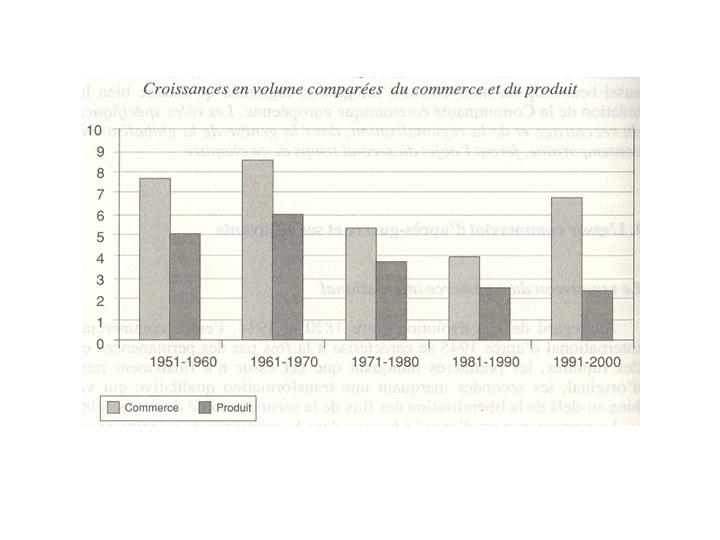
Graphique 5. Source : L’invention du marché, Philippe Norel, Seuil, 2004, p.430.
Ainsi, le commerce avec le Tiers-Monde, qui avait relativement reculé de moitié durant les Trente glorieuses, reprendra à partir des années 1990 suite à la mondialisation. Cependant, il ne concerne essentiellement que quelques pays du Tiers-Monde, ceux justement qui se sont transformés en ‘ateliers du monde' pour marchandises à bas coûts salariaux [4].
Que la reprise du commerce mondial et de la part des exportations depuis les années 80 ne s'accompagnent pas d'un regain de croissance économique, ceci illustre très clairement ce que nous mettions en évidence : contrairement à la première mondialisation au XIXème siècle qui élargissait la production et la masse salariale, celle d'aujourd'hui est pervertie en ce sens qu'elle comprime relativement cette masse salariale et qu'elle restreint d'autant les bases de l'accumulation à l'échelle mondiale. Que la ‘mondialisation' actuelle se résume à une lutte acharnée pour diminuer les coûts de production par une réduction massive des salaires réels exprime à l'évidence que le capitalisme n'a plus rien à offrir à l'humanité que la misère et une barbarie croissante de la vie. La dite ‘mondialisation néolibérale' n'a donc rien à voir avec un retour à la conquête du monde par un capitalisme triomphant comme au XIXème siècle, mais exprime avant tout la faillite de tous les palliatifs utilisés pour faire face à une crise économique qui mène lentement, mais inexorablement, le capitalisme à la faillite.
[1] Dans le numéro 128 [24] de cette revue, nous avons publié deux graphiques illustrant l'évolution du taux de profit sur un siècle et demi pour les Etats-Unis et la France. Nous pouvons très clairement y distinguer cette chute de moitié du taux de profit entre la fin des années 1960 et 1980. C'est l'une des chutes les plus spectaculaires du taux de profit dans toute l'histoire du capitalisme, et ce, au niveau mondial.
[2] Le taux de plus-value n'est autre que le taux d'exploitation qui rapporte la plus-value (PV) accaparée par le capitaliste à la masse salariale (CV = Capital Variable) qu'il verse aux salariés : Taux d'exploitation = Plus-Value / Capital Variable.
[3] Ce graphique provient de l'étude réalisée par Ian Dew-Becker & Robert Gordon : Where did the Productivity Growth Go? Inflation Dynamics and the Distribution of Income, Washington DC, September 8-9, 2005, et disponible sur le Web à l'adresse : zfacts.com/metaPage/lib/gordon-Dew-Becker.pdf. Le graphique indique l'évolution de l'importance de la masse salariale dans le PNB. Il concerne l'ensemble des salaires pour l'Union européenne et les salaires déduits des 5% les plus élevés aux Etats-Unis.
[4] C'est ce ‘bas coût' des marchandises qui explique la stabilisation à un haut niveau de la part du produit qui est exportée entre 1980 (15,3%) et 1996 15,9%) ; en effet, cette même part explose lorsqu'on la calcule non plus en valeur, mais en volume : 19,1% en 1980 et 28,6% en 1996.
Géographique:
- Asie [47]
Récent et en cours:
- Crise économique [1]
- Asie de l'Est [44]
Questions théoriques:
- L'économie [33]
L'Asie de l'Est dans le circuit de l'accumulation à l'échelle mondiale
- 3438 lectures
Un double mouvement a donc permis à l'Asie de l'Est de s'insérer avec profit dans le circuit de l'accumulation à l'échelle mondiale à partir des années 1990. D'une part, la crise économique a contraint l'Inde et la Chine à abandonner leur modèle respectif de capitalisme d'Etat stalinien et nationaliste et, d'autre part, le développement de la mondialisation a offert l'opportunité pour l'Asie de l'Est de se réinsérer dans le marché mondial en proposant de réceptionner les investissements et délocalisations des pays développés à la recherche d'une main d'œuvre à bas salaires. C'est ce double mouvement qui explique l'évolution en ciseaux que nous avons mis en évidence entre une croissance mondiale qui tend toujours vers l'étiage et une forte croissance localisée dans le sous-continent asiatique.
C'est donc l'approfondissement de la crise du capitalisme qui est à l'origine de ce bouclage de l'accumulation au niveau mondial tel qu'il a permis à l'Asie de l'Est de s'y insérer comme atelier du monde. Ceci s'est fait en réceptionnant les investissements, délocalisations et sous-traitances en provenance de pays plus développés qui recherchaient des bassins de main d'œuvre à faibles coûts, en réexportant dans ces pays les biens de consommation produit à bas salaires et, enfin, en vendant des marchandises à haute valeur ajoutée à l'Asie ainsi que des biens de luxe à la nouvelle classe de riches asiatiques en provenance des pays développés.
La croissance en Asie de l'Est exprime la crise et non le renouveau du capitalisme
L'échec des mesures néokeynésiennes utilisées durant les années 70 dans les pays centraux ont donc marqué une étape significative dans l'aggravation de la crise au niveau international. C'est cet échec qui sera à la base de l'abandon du capitalisme d'Etat keynésien au profit d'une variante plus dérégulée dont l'axe essentiel consistera en une attaque massive et frontale contre la classe ouvrière afin de rétablir un taux de profit qui avait été divisé par deux depuis la fin des années 1960 (cf. graphique 6). Cette régression sociale massive prendra notamment la forme d'une politique systématique de mise en concurrence des salariés au niveau mondial. En s'insérant dans cette nouvelle division internationale du travail et des salaires, l'Inde et la Chine ont pu en bénéficier avec grand profit. En effet, alors que les capitaux délaissaient quasi totalement les pays de la périphérie durant les Trente glorieuses, ils s'y investissement aujourd'hui à raison d'un tiers et se concentrent essentiellement sur quelques pays asiatiques. Ceci va permettre à ces deux pays de se positionner comme plateforme de montage et de réexportation de biens assemblés dans des usines déjà relativement productives, mais dont les conditions sociales sont dignes des premiers temps du capitalisme. Tel est fondamentalement ce qui a fait et fait toujours le succès de ces pays.
A partir des années 1990, ces deux pays accueilleront massivement capitaux et délocalisations d'entreprises pour se transformer en ateliers du monde et inonder le marché mondial de leurs marchandises produites à faible coût. Contrairement à la période précédente où les différentiels de salaires dans des usines obsolètes et les politiques protectionnistes ne permettaient pas aux pays sous-développés de concurrencer la production sur les marchés des pays centraux, aujourd'hui, la libéralisation permet de produire à très faible coût salarial dans des usines productives délocalisées et, ainsi, de venir battre en brèche nombre de segments productifs sur les marchés occidentaux.
La spectaculaire croissance en Asie de l'Est n'exprime donc pas un renouveau du capitalisme, mais un sursaut momentané dans sa lente dégradation au niveau international. Dès lors, que cette vicissitude ait pu dynamiser une partie non négligeable du monde (l'Inde et la Chine), et même contribuer à soutenir la croissance mondiale, n'est qu'un paradoxe apparent lorsqu'on le comprend dans le contexte du lent développement international de la crise et de la phase historique de décadence du capitalisme [1]. Ce n'est qu'en prenant du recul, et en replaçant tous les événements particuliers dans leur contexte plus global, que l'on peut parvenir à leur donner du sens et les comprendre. Ce n'est pas parce que l'on se trouve dans un méandre que l'on peut en conclure que la rivière coule de la mer vers la montagne [2].
La conclusion qui apparaît avec évidence et qu'il faut affirmer avec force est donc que la croissance en Asie de l'Est n'exprime en rien un quelconque renouveau du capitalisme, elle n'efface en rien l'approfondissement de la crise au niveau international et dans les pays centraux en particulier. Au contraire, elle en constitue un de ses rouages, une de ses étapes. Le paradoxe apparent s'explique par le fait que l'Asie de l'Est est venue au bon moment pour profiter d'un stade dans l'approfondissement de la crise internationale lui permettant de se transformer en atelier du monde à faible coût salariaux.
La croissance asiatique accélère la dépression à l'échelle mondiale
Ce nouveau bouclage de l'accumulation à l'échelle mondiale participe à l'accentuation de la dynamique économique dépressive au niveau international puisque ses ressorts accroissent formidablement la surproduction en déprimant la demande finale suite à la réduction relative de la masse salariale mondiale et la destruction d'un bon nombre de zones ou de secteurs non compétitifs de par le monde.
En effet, Marx nous a appris qu'il y a fondamentalement deux façons de rétablir le taux de profit : soit par le haut, en réalisant des gains de productivité par l'investissement dans de nouvelles machines et procédés de fabrication, soit par le bas, en diminuant les salaires. Comme le retour de la crise à la fin des années 1960 s'est manifesté par un déclin quasi ininterrompu des gains de productivité, la seule façon de rétablir le taux de profit fut de procéder à une attaque massive des salaires [3]. Le graphique ci-dessous illustre très clairement cette dynamique dépressive : durant les Trente glorieuses, le taux de profit et d'accumulation évoluaient parallèlement à un haut niveau. Dès la fin des années soixante les taux de profit et d'accumulation chutent de moitié. Après le passage aux politiques de capitalisme d'Etat dérégulé à partir des années 80, le taux de profit est spectaculairement remonté et a même dépassé son niveau durant les Trente glorieuses. Cependant, malgré le rétablissement du taux de profit, le taux d'accumulation n'a pas suivi et reste à un niveau extrêmement bas. Ceci découle directement de la faiblesse de la demande finale engendrée par la réduction massive de la masse salariale qui est à la base du rétablissement du taux de profit. Aujourd'hui, le capitalisme est engagé dans une lente spirale récessive : ses entreprises sont désormais rentables, mais elles fonctionnent sur des bases de plus en plus restreintes car confrontées à une surproduction qui limite les bases de leur accumulation.
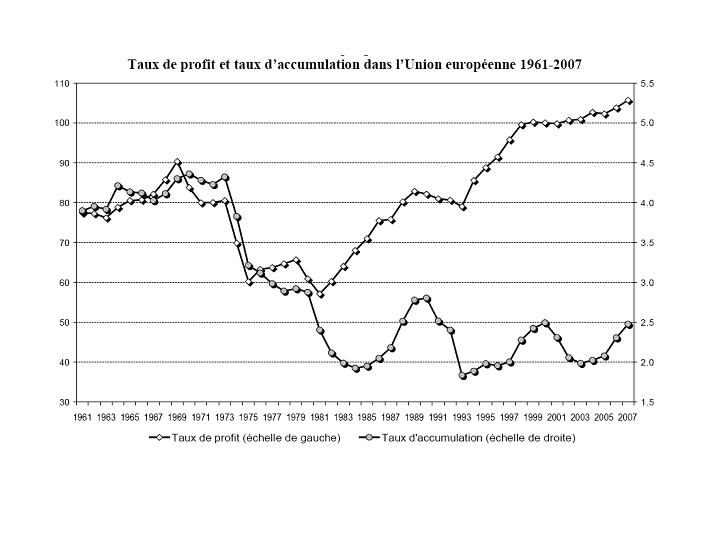
Graphique 6. Source : Michel Husson.
C'est en ce sens que l'actuelle croissance en Asie de l'Est n'est en rien comparable à des Trente glorieuses asiatiques, ni à un renouveau du capitalisme à l'échelle mondiale, mais est une expression de son enfoncement dans la crise.
Conclusion
L'origine, le cœur et la dynamique de la crise viennent des pays centraux. Le ralentissement de la croissance, le chômage, la dégradation des conditions de travail sont des phénomènes bien antérieurs au développement en Asie de l'Est. Ce sont justement les conséquences de la crise dans les pays développés qui ont impulsé un bouclage de l'accumulation au niveau mondial tel qu'il a permis à l'Asie de s'y insérer comme atelier du monde. Ce nouveau bouclage participe cependant, en retour, à l'accentuation de la dynamique économique dépressive dans les pays centraux puisqu'il accroît la surproduction à l'échelle internationale (l'offre) et déprime les marchés solvables (la demande) en tirant la masse salariale mondiale vers le bas (facteur essentiel au niveau économique) et en détruisant bon nombre d'économies moins compétitives au sein du Tiers-Monde (facteur marginal au niveau économique mais dramatique au niveau humain).
Le retour de la crise historique du capitalisme dès la fin des années 1960, son aggravation tout au long des années 1970 ainsi que l'échec des palliatifs néokeynésiens utilisés alors, ont ouvert la voie à l'instauration d'un capitalisme d'Etat dérégulé qui, à sa suite, a impulsé une mondialisation pervertie dans les années 1990. Quelques pays ont alors pu jouer le rôle d'atelier à bas salaires. Tel est le fondement de la spectaculaire croissance en Asie de l'Est qui, en conjonction avec la crise du modèle stalinien et nationaliste de développement autarcique, a pu s'insérer au bon moment dans ce nouveau cycle d'accumulation à l'échelle mondiale.
[1] En effet, alors que le PIB mondial par habitant n'a fait que décliner décennie après décennie depuis les années 60 : 3,7% (1960-69) ; 2,1% (1970-79) ; 1,3% (1980-89) ; 1,1% (1990-1999) et 0,9% pour 2000-2004, il apparaît aujourd'hui, à moins qu'une grave récession ne se déploie avant la fin de cette décennie - ce qui est tout à fait probable -, que la moyenne pour la décennie des années 2000 pourrait être pour la première fois sensiblement supérieure à la décennie précédente. Cette amélioration s'explique en grande partie par le dynamisme économique en Asie de l'Est. Ce sursaut doit cependant être très fortement relativisé car, lorsqu'on en analyse les paramètres, l'on constate que la croissance mondiale depuis le crash de la ‘nouvelle économie' (2001-02) a eu comme principaux points d'appui un fort endettement des ménages et une balance commerciale américaine qui atteint des déficits records. En effet, les ménages américains (mais également de plusieurs pays européens) ont fortement soutenu la croissance grâce à leur énorme endettement sur la base d'une renégociation de leurs emprunts hypothécaires (permis par la politique de baisse des taux d'intérêt pour relancer la croissance), à tel point que l'on parle aujourd'hui d'un possible crash immobilier. D'autre part, les déficits publics, mais surtout commerciaux, ont atteint des niveaux record qui ont également très fortement soutenu la croissance mondiale. A y regarder de plus près, cette probable amélioration durant la décennie des années 2000 aura été obtenue en tirant énormément de traites sur l'avenir.
[2] Ce genre de sursauts n'est guère surprenant et ont même été relativement fréquents au cours de la décadence du capitalisme. Tout au long de cette phase, la raison d'être des politiques de la bourgeoisie, et en particulier des politiques de capitalisme d'Etat, est d'intervenir dans le cours même du déroulement des lois économiques pour tenter de sauver un système qui tend irrémédiablement à la faillite. C'est, notamment, ce que le capitalisme a déjà massivement mis en place au cours des années 30. A cette époque aussi, de puissantes politiques de capitalisme d'Etat, ainsi que des programmes de réarmement massif, ont pu momentanément faire croire à une maîtrise de la crise, et même à un retour à la prospérité : New Deal aux Etats-Unis, Front populaires en France, plan De Man en Belgique, plans quinquennaux en URSS, fascisme en Allemagne, etc.
[3] Nous renvoyons le lecteur à notre article du numéro 121 [48] de cette Revue qui décrit ce processus et en donne tous les éléments empiriques.
Géographique:
Récent et en cours:
- Crise économique [1]
- Asie de l'Est [44]
Revue Internationale n° 134 - 3e trimestre 2008
- 2404 lectures
Crise alimentaire, émeutes de la faim : Seule la lutte de classe du prolé́tariat peut mettre fin aux famines
- 2402 lectures
La crise alimentaire signe la faillite du capitalisme
Le dénominateur commun des émeutes de la faim qui ont explosé depuis ce début d'année un peu partout dans le monde est la flambée du prix des denrées alimentaires ou leur pénurie criante qui ont frappé brutalement les populations pauvres et ouvrières dans de nombreux pays. Pour donner quelques chiffres particulièrement éclairants, le prix du maïs a quadruplé depuis l'été 2007, le prix du blé a doublé depuis le début 2008 et les denrées alimentaires ont globalement augmenté de 60% en deux ans dans les pays pauvres. Signe des temps, les effets dévastateurs de la hausse de 30 à 50% des prix alimentaires au niveau mondial ont touché violemment non seulement les populations des pays pauvres mais aussi celles des pays "riches". Ainsi par exemple, aux États-Unis, première puissance économique de la planète, 28 millions d'américains ne pourraient plus survivre sans les programmes de distribution de nourriture des municipalités et des États.
D'ores et déjà, 100 000 personnes meurent de faim chaque jour dans le monde, un enfant de moins de 10 ans meurt toutes les 5 secondes, 842 millions de personnes souffrent de malnutrition chronique aggravée, réduites à l'état d'invalides. Et dès à présent, deux des six milliards d'êtres humains de la planète (c'est-à-dire un tiers de l'humanité) se trouvent en situation de survie quotidienne du fait du prix des denrées alimentaires.
Les experts de la bourgeoisie eux-mêmes - FMI, FAO, ONU, G8, etc. - annoncent qu'un tel état de fait n'est pas passager et que, tout au contraire, il va devenir non seulement chronique mais empirer avec, à la fois, une augmentation vertigineuse du prix des denrées de première nécessité et leur raréfaction au regard des besoins de la population de la planète. Alors que les capacités productives de la planète permettraient de nourrir 12 milliards d'être humains, ce sont des millions et des millions d'entre eux qui meurent de faim du fait, justement, des propres lois du capitalisme qui est le système dominant partout dans le monde, un système de production destiné, non pas à la satisfaction des besoins humains, mais au profit, un système totalement incapable de répondre aux besoins de l'humanité. D'ailleurs, tous les éléments d'explication de la crise alimentaire actuelle qui nous sont donnés convergent dans la même direction, celle d'une production obéissant aux lois aveugles et irrationnelles du système :
1. La flambée vertigineuse du prix du pétrole qui accroît le coût des transports et de la production des produits alimentaires, etc. Ce phénomène est bien une aberration propre au système et non pas un facteur qui lui serait extérieur.
2. La croissance significative de la demande alimentaire, résultant d'une certaine augmentation du pouvoir d'achat des classes moyennes et de nouvelles habitudes alimentaires dans les pays dits "émergents" comme l'Inde et la Chine. S'il existe une parcelle de vérité dans cette explication, elle est tout à fait significative de la réalité du "progrès économique" qui, en augmentant le pouvoir de consommation de quelques uns, condamne à mourir de faim des millions d'autres du fait de la pénurie actuelle sur le marché mondial qui en résulte.
3. La spéculation effrénée sur les produits agricoles. Celle-ci aussi est un pur produit du système et son poids économique est d'autant plus important que l'économie réelle est de moins en moins prospère. Des exemples : les stocks de céréales étant au plus bas depuis trente ans, la folie spéculatrice des investisseurs se fixe à présent sur la manne alimentaire, avec l'espoir de bons placements, qui ne peuvent désormais plus être réalisés dans l'immobilier depuis la crise de celui-ci ; à la Bourse de Chicago, "le volume d'échange des contrats sur le soja, le blé, le maïs, la viande de porc et même le bétail vivant" (Le Figaro du 15 avril) a augmenté de 20% au cours des trois premiers mois de cette année.
4. Le marché en plein développement des biocarburants, aiguillonné par l'envolée des prix du pétrole et qui, lui aussi, fait l'objet d'une spéculation effrénée. Cette nouvelle source de gain est à l'origine de l'explosion de ce type de culture au détriment des végétaux destinés à la consommation alimentaire. De nombreux pays producteurs de produits de première nécessité ont transformé des pans entiers de l'économie agricole vivrière pour cultiver des biocarburants en masse, sous prétexte de lutter contre l'effet de serre, réduisant ainsi de façon drastique les produits de première nécessité et augmentant leur prix de façon dramatique. C'est le cas au Congo Brazzaville qui développe de façon extensive la canne à sucre dans cette optique, tandis que sa population crève de faim. Au Brésil, alors que 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté et a du mal à se nourrir, le choix de la politique agricole est orienté vers la production de biocarburants à outrance.
5. La guerre commerciale et le protectionnisme, qui sont aussi le propre du capitalisme, en sévissant dans le domaine agricole, ont fait que les agriculteurs les plus productifs des pays industrialisés exportent (souvent grâce aux subventions gouvernementales), une partie importante de leur production vers les pays du "Tiers-monde", ruinant ainsi la paysannerie de ces régions désormais coupées de toute capacité propre de subvenir aux besoins alimentaires des populations. En Afrique, par exemple, de nombreux fermiers locaux ont été ruinés par les exportations européennes de poulets ou de bœufs. Le Mexique ne peut plus produire assez de biens de première nécessité pour nourrir sa population si bien que ce pays doit maintenant importer pour 10 milliards de dollars de produits alimentaires.
6. L'utilisation irresponsable des ressources de la planète, mue par le profit immédiat, conduit à l'épuisement de celles-ci. La sur-utilisation des engrais cause des dommages à l'équilibre du sol, si bien que l'Institut de Recherche International du Riz prévoit que la culture de cette denrée en Asie sera menacée à relativement moyen terme. La pêche à outrance dans les océans conduit à une raréfaction de nombreuses espèces de poissons comestibles.
7. Quant
aux conséquences du réchauffement de la planète
comme, notamment, les inondations ou la sécheresse, elles sont
invoquées avec raison pour expliquer la baisse de la
production de certaines surfaces cultivables. Mais, elles aussi, sont
en dernière analyse les conséquences sur
l'environnement d'une industrialisation effectuée par le
capitalisme aux dépens des besoins immédiats et à
long terme de l'espèce humaine. Ainsi, les récentes
vagues de chaleur en Australie ont conduit à de sévères
dommages et à des baisses significatives dans les productions
agricoles. Et le pire est devant nous puisque, selon des estimations,
une hausse de un degré Celsius de température aurait
pour effet de faire chuter de 10% la production de riz, de blé
et de maïs. Les premières recherches montrent que
l'augmentation des températures menace la capacité de
survie de nombreuses espèces animales et végétales
et réduit la valeur nutritionnelle des plantes.
La famine
n'est pas la seule conséquence des aberrations en matière
d'exploitation des ressources terrestres. Ainsi, la production de
biocarburants conduit à l'épuisement des terres
cultivables. De plus, ce marché "juteux" pousse à
des conduites délirantes et contre-nature : dans les
Montagnes Rocheuses, aux États-Unis, où les
cultivateurs ont déjà orienté 30% de leur
production de maïs vers la fabrication d'éthanol, des
superficies gigantesques sont consacrées au maïs
"énergétique" sur des terres impropres à
sa culture, entraînant un gâchis incroyable en termes
d'utilisation d'engrais et d'eau pour un résultat bien
maigre. Jean Ziegler1
explique : "Pour faire un plein de 50 litres avec du
bioéthanol, il faut brûler 232 kilos de maïs"
et, pour produire un kilo de maïs, il faut 1000 litres d'eau !
Selon de récentes études, non seulement le bilan
"pollution" des biocarburants est négatif (une
recherche récente montrerait qu'ils augmentent plus la
pollution de l'air que le carburant normal), mais leurs
conséquences globales au niveau écologique et
économique sont désastreuses pour l'ensemble de
l'humanité. Par ailleurs, dans maintes régions du
globe, le sol est de plus en plus pollué ou même
totalement empoisonné. C'est le cas de 10% du sol chinois et,
dans ce pays, 120 000 paysans meurent chaque année de
cancers liés à la pollution du sol.
Toutes les explications qui nous sont données à propos de la crise alimentaire contiennent chacune une parcelle de vérité. Mais aucune d'entre elles, en elle-même, ne peut constituer une explication. S'agissant des limites de son système, notamment lorsque celles-ci se manifestent sous la forme de crise, la bourgeoisie n'a d'autre choix que de mentir aux exploités qui sont les premiers à en subir les conséquences, pour masquer le caractère nécessairement transitoire de celui-ci, comme de tous les autres systèmes d'exploitation qui l'ont précédé. D'une certaine manière elle est aussi contrainte de se mentir à elle-même, en tant que classe sociale, pour n'avoir pas à reconnaître que son règne est condamné par l'histoire. Or, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est le contraste entre l'assurance affichée par la bourgeoisie et son incapacité à réagir de façon un tant soit peu crédible et efficace face à la crise alimentaire.
Les
différentes explications et solutions proposées -
indépendamment de leur caractère cynique et hypocrite -
correspondent toutes aux intérêts propres et immédiats
de telle ou telle fraction de la classe dirigeante, au détriment
d'autres fractions. Quelques exemples parmi d'autres. Au dernier
sommet du G8, les principaux dirigeants du monde ont invité
les représentants des pays pauvres à réagir face
aux révoltes de la faim en préconisant que soient
immédiatement abaissés les droits de douane sur les
importations agricoles. En d'autres termes, la première pensée
de ces fins représentants de la démocratie capitaliste
était de profiter de la crise pour augmenter leurs propres
possibilités d'exportation ! Le lobby industriel
européen a provoqué un tollé au sujet du
protectionnisme agricole de l'Union européenne accusé,
entre autres, d'être responsable de la ruine de l'agriculture
de subsistance dans le "Tiers-monde"2.
Et pourquoi ? Se sentant menacé par la concurrence
industrielle de l'Asie, il veut réduire les subventions
agricoles payées par l'Union européenne qui sont
désormais au-dessus de ses moyens. Le lobby agricole,
quant à lui, voit dans les révoltes de la faim la
preuve de la nécessité d'augmenter ces mêmes
subventions. L'Union européenne a saisi l'occasion pour
condamner le développement de la production agricole au
service de "l'énergie renouvelable"... au Brésil,
un de ses principaux rivaux dans ce secteur.
Le capitalisme a, comme nul autre système l'ayant précédé, développé les forces productives à un point tel qu'elles permettraient l'instauration d'une société où l'ensemble des besoins humains seraient satisfaits. Cependant, ces forces énormes ainsi mises en mouvement, tant qu'elles restent prisonnières des lois du capitalisme, non seulement ne peuvent être mises au service de la grande majorité mais se retournent contre elle. "Dans les pays industriels les plus avancés, nous avons dompté les forces de la nature et les avons contraintes au service des hommes ; nous avons ainsi multiplié la production à l'infini, si bien qu'actuellement, un enfant produit plus qu'autrefois cent adultes. Et quelle en est la conséquence ? Surtravail toujours croissant et misère de plus en plus grande des masses [...] Seule une organisation consciente de la production sociale, dans laquelle production et répartition sont planifiées, peut élever les hommes au-dessus du règne animal au point de vue social de la même façon que la production elle-même les a élevés en tant qu'espèce." (Introduction à La Dialectique de la Nature, Friedrich Engels, Éditions Sociales, 1952, p. 42). Depuis que le capitalisme est entré dans sa phase de déclin, non seulement les richesses produites ne participent toujours pas à libérer l'espèce humaine du règne de la nécessité mais encore elles menacent son existence même. Ainsi, un nouveau danger menace aujourd'hui l'humanité : celui de la famine généralisée, dont il était dit encore récemment qu'il ne s'agissait plus que d'un cauchemar du passé. En fait, comme l'illustre le cas du réchauffement de la planète, l'ensemble de l'activité productive - y compris de produits alimentaires - étant soumis aux lois aveugles du capitalisme, ce sont les bases même de la vie sur la terre, notamment à travers le gaspillage des ressources de la planète, qui se trouvent compromises.
La différence entre les émeutes de la faim et les émeutes des banlieues
Ce sont les masses les plus pauvres des pays du "Tiers-monde" qui sont aujourd'hui frappées par la disette. Les pillages de magasins sont une réaction tout à fait légitime face à une situation insupportable, de survie, pour les acteurs de tels actes et leur famille. En ce sens, les émeutes de la faim, même lorsqu'elles provoquent des destructions et des violences, ne sont pas à mettre sur le même plan et n'ont pas la même signification que les émeutes urbaines (comme celles de Brixton en Grande-Bretagne en 1981 et celles des banlieues françaises en 2005) ou les émeutes raciales (comme celles de Los Angeles, en 1992 )3.
Bien qu'elles troublent "l'ordre public" et provoquent des dégâts matériels, ces dernières ne servent en fin de compte que les intérêts de la bourgeoisie qui est tout à fait capable de les retourner non seulement contre les émeutiers eux-mêmes, mais aussi contre l'ensemble de la classe ouvrière. En particulier, ces manifestations de violence désespérées (et dans lesquelles sont souvent impliquées des éléments du lumpenprolétariat) offrent toujours une occasion à la classe dominante pour renforcer son appareil de répression par le quadrillage policier des quartiers les plus pauvres dans lesquels vivent les familles ouvrières.
Ce type d'émeutes est un pur produit de la décomposition du système capitaliste. Elles sont une expression du désespoir et du "no future" qu'il engendre et qui se manifeste par leur caractère totalement absurde. Il en est ainsi par exemple des émeutes qui ont embrasé les banlieues en France en novembre 2005 où ce ne sont nullement dans les quartiers riches habités par les exploiteurs que les jeunes ont déchaîné leur actions violentes mais dans leurs propres quartiers qui sont devenus encore plus sinistrés et invivables qu'auparavant. De plus, le fait que ce soit leur propre famille, leurs voisins ou leurs proches qui aient été les principales victimes des déprédations révèle le caractère totalement aveugle, désespéré et suicidaire de ce type d'émeutes. Ce sont en effet les voitures des ouvriers vivant dans ces quartiers qui ont été incendiées, des écoles ou des gymnases fréquentées par leurs frères, leurs sœurs ou les enfants de leurs voisins qui ont été détruits. Et c'est justement du fait de l'absurdité de ces émeutes que la bourgeoisie a pu les utiliser et les retourner contre la classe ouvrière. C'est ainsi que leur médiatisation à outrance a permis à la classe dominante de pousser un maximum d'ouvriers des quartiers populaires à considérer les jeunes émeutiers non pas comme des victimes du capitalisme en crise, mais comme des "voyous". Au delà du fait que ces émeutes ont permis un renforcement de la "chasse au faciès" parmi les jeunes issus de l'immigration, elles ne pouvaient que venir saper toute réaction de solidarité de la classe ouvrière envers ces jeunes exclus de la production, qui ne voient aucune perspective d'avenir et sont soumis en permanence aux vexations des contrôles de police.
Pour leur part, les émeutes de la faim sont d'abord et avant tout une expression de la faillite de l'économie capitaliste et de l'irrationalité de sa production. Celle-ci se traduit aujourd'hui par une crise alimentaire qui frappe non seulement les couches les plus défavorisées des pays "pauvres" mais de plus en plus d'ouvriers salariés, y compris dans les pays dits "développés". Ce n'est pas un hasard si la grande majorité des luttes ouvrières qui se développent aujourd'hui aux quatre coins de la planète ont comme revendication essentielle des augmentations de salaires. L'inflation galopante, la flambée des prix des produits de première nécessité conjuguées à la baisse des salaires réels et des pensions de retraite rognés par l'inflation, à la précarité de l'emploi et aux vagues de licenciements sont des manifestations de la crise qui contiennent tous les ingrédients pour que la question de la faim, de la lutte pour la survie, commence à se poser au sein de la classe ouvrière. D'ores et déjà, plusieurs enquêtes ont révélé que, en France, les supermarchés et les grandes surfaces où les ouvriers viennent faire leurs achats arrivent de moins en moins à vendre leurs produits et sont obligés de diminuer leurs commandes.
Et c'est justement parce que la question de la crise alimentaire frappe déjà les ouvriers des pays "pauvres" (et va toucher de plus en plus ceux des pays centraux du capitalisme) que la bourgeoisie aura les plus grandes difficultés à exploiter les émeutes de la faim contre la lutte de classe du prolétariat. La disette généralisée et les famines, voilà l'avenir que le capitalisme réserve à l'ensemble de l'humanité et c'est cet avenir que révèlent les émeutes de la faim qui ont éclaté récemment dans plusieurs pays du monde.
Évidemment, ces émeutes sont elles aussi des réactions de désespoir des masses les plus paupérisées des pays "pauvres" et ne portent en elles-mêmes aucune perspective de renversement du capitalisme. Mais, contrairement aux émeutes urbaines ou raciales, les émeutes de la faim constituent un concentré de la misère absolue dans laquelle le capitalisme plonge des pans toujours plus grands de l'humanité. Elles montrent le sort qui attend toute la classe ouvrière si ce mode de production n'est pas renversé. En ce sens, elles contribuent à la prise de conscience du prolétariat de la faillite irrémédiable de l'économie capitaliste. Enfin, elles montrent avec quel cynisme et quelle férocité la classe dominante répond aux explosions de colère de ceux qui se livrent aux pillages de magasins pour ne pas crever de faim : la répression, les gaz lacrymogènes, les matraques et la mitraille.
Par ailleurs, contrairement aux émeutes des banlieues, ces émeutes de la faim ne sont pas un facteur de division de la classe ouvrière.
Au contraire, malgré les violences et les destructions qu'elles peuvent occasionner, les émeutes de la faim tendent spontanément à susciter un sentiment de solidarité de la part des ouvriers dans la mesure où ces derniers sont aussi parmi les principales victimes de la crise alimentaire et ont de plus en plus de difficultés à nourrir leur famille. En ce sens, les émeutes de la faim sont beaucoup plus difficiles à exploiter par la bourgeoisie pour monter les ouvriers les uns contre les autres ou pour créer des clivages dans les quartiers populaires.
Face aux émeutes de la faim, seules les luttes ouvrières peuvent offrir une perspective
Pour autant, bien que dans les pays "pauvres" se développent aujourd'hui, simultanément, des luttes ouvrières contre la misère capitaliste et des émeutes de la faim, il s'agit de deux mouvements parallèles et de nature bien différente.
Même si des ouvriers peuvent être amenés à participer aux émeutes de la faim en pillant des magasins, ce terrain n'est pas celui de la lutte de classe. Ce terrain est celui dans lequel le prolétariat est inévitablement noyé au milieu d'autres couches "populaires" parmi les plus pauvres et marginalisées. Dans ce type de mouvement, le prolétariat ne peut que perdre son autonomie de classe et abandonner ses propres méthodes de luttes : les grèves, manifestations, assemblées générales.
Par ailleurs, les émeutes de la faim ne sont qu'un feu de paille, une révolte sans lendemain qui ne peut en aucune façon résoudre le problème des famines. Elles ne sont rien d'autre qu'une réaction immédiate et désespérée à la misère la plus absolue. En effet, une fois que les magasins ont été vidés par les pillages, il ne reste plus rien, alors que les hausses de salaires résultant des luttes ouvrières peuvent se maintenir plus longtemps (même si elles seront rattrapées à terme). Il est évident que, face à la famine qui frappe aujourd'hui les populations des pays de la périphérie du capitalisme, la classe ouvrière ne peut pas rester indifférente ; et cela d'autant plus que, dans ces pays, les ouvriers sont eux-mêmes également touchés par la crise alimentaire et ont de plus en plus de difficultés à nourrir leur propre famille avec leurs salaires misérables.
Les manifestations actuelles de la faillite du capitalisme, et notamment la flambée des prix et l'aggravation de la crise alimentaire, vont tendre de plus en plus à niveler par le bas les conditions de vie des prolétaires et des masses les plus paupérisées. De ce fait, les luttes ouvrières dans les pays "pauvres" ne peuvent que se multiplier en même temps que les émeutes de la faim. Mais si les émeutes de la faim ne contiennent aucune perspective, les luttes ouvrières, elles, constituent le terrain à partir duquel les ouvriers peuvent développer leur force et leur perspective. Le seul moyen pour le prolétariat de résister aux attaques de plus en plus violentes du capitalisme réside dans sa capacité à préserver son autonomie de classe en développant ses luttes et sa solidarité sur son propre terrain. En particulier, c'est dans les assemblées générales et les manifestations massives que doivent être mises en avant des revendications communes à tous, intégrant la solidarité avec les masses affamées. Dans ces revendications, les prolétaires en lutte doivent exiger non seulement des augmentations de salaire et la baisse des prix des denrées de base, mais ils doivent aussi ajouter à leur plate-forme revendicative la distribution gratuite du minimum vital pour les plus démunis, les chômeurs et les masses d'indigents.
Ce n'est qu'en développant ses propres méthodes de lutte et en renforçant sa solidarité de classe avec les masses affamées et opprimées que le prolétariat pourra entraîner derrière lui les autres couches non exploiteuses de la société.
Le capitalisme n'a aucune perspective à offrir à l'humanité, sinon celle des guerres toujours plus barbares, de catastrophes toujours plus tragiques, d'une misère toujours croissante pour la grande majorité de la population mondiale. La seule possibilité pour la société de sortir de la barbarie du monde actuel est le renversement du système capitaliste. Et la seule force capable de renverser le capitalisme est la classe ouvrière mondiale. C'est parce que, jusqu'à présent, celle-ci n'a pas encore trouvé la force d'affirmer cette perspective, à travers un développement et une extension massive de ses luttes, que des masses croissantes de la population mondiale dans les pays du "Tiers monde" sont amenées à s'engager dans des émeutes désespérées de la faim pour pouvoir survivre. La seule véritable solution à la "crise alimentaire" est le développement des luttes du prolétariat vers la révolution communiste mondiale qui permettra de donner une perspective et un sens aux révoltes de la faim. Le prolétariat ne pourra entraîner derrière lui les autres couches non exploiteuses de la société qu'en s'affirmant comme classe révolutionnaire. Ce n'est qu'en développant et unifiant ses luttes que la classe ouvrière pourra montrer qu'elle est la seule force sociale capable de changer le monde et d'apporter une réponse radicale au fléau de la famine, mais aussi de la guerre et de toutes les manifestations de désespoir qui contribuent au pourrissement de la société.
Le capitalisme a réuni les conditions de l'abondance mais, tant que ce système ne sera pas renversé, elles ne peuvent déboucher que sur une situation absurde où la surproduction de marchandises côtoie la pénurie des biens les plus élémentaires.
Le fait que le capitalisme ne soit plus capable de nourrir des pans entiers de l'humanité constitue un appel au prolétariat pour qu'il assume sa responsabilité historique. Ce n'est que par la révolution communiste mondiale qu'il pourra poser les bases d'une société d'abondance où les famines seront à jamais éradiquées de la planète.
LE (5 juillet 08)
1 Rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation (des populations) du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies de 2000 à mars 2008.
2 Le terme "Tiers-Monde" a été inventé par l'économiste et démographe français Alfred Sauvy en 1952, en pleine Guerre froide, pour désigner à l'origine les pays qui ne se rattachaient directement ni au bloc occidental ni au bloc russe, mais ce sens a été pratiquement abandonné, surtout depuis la chute du mur de Berlin. Mais il a été également utilisé pour désigner les pays qui connaissent les indices de développement économique les plus faibles, autrement dit les pays les plus pauvres de la planète en particulier en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Et c'est évidemment dans ce sens, plus que jamais d'actualité, que nous l'utilisons encore.
3 Concernant les émeutes raciales de Los Angeles, voir notre article "Face au chaos et aux massacres, seule la classe ouvrière peut apporter une réponse [50]" dans la Revue Internationale n°70. Sur les émeutes dans les banlieues françaises de l'automne 2005, lire "Emeutes sociales : Argentine 2001, France 2005,... Seule la lutte de classe du prolétariat est porteuse d'avenir [51]" (Revue Internationale n° 124) et "Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [52]" (Revue Internationale n° 125).
Mai 68 et la perspective révolutionnaire (II) : Fin de la contre-révolution, reprise historique du prolétariat mondial
- 3182 lectures
C'est ce que nous avons commencé à faire dans notre revue en publiant un article qui revient sur la première des composantes des "événements de Mai 68", la révolte étudiante, au niveau international et en France. Nous revenons ici sur la composante essentielle de ces événements : le mouvement de la classe ouvrière.
Dans le premier article, nous avions conclu ainsi le récit des événements en France : "Le 14 mai, dans beaucoup d'entreprises, les discussions se poursuivent. Après les immenses manifestations de la veille [en solidarité avec les étudiants victimes de la répression], avec l'enthousiasme et le sentiment de force qui s'en sont dégagés, il est difficile de reprendre le travail comme si de rien n'était. A Nantes, les ouvriers de Sud-Aviation, entraînés par les plus jeunes d'entre eux, déclenchent une grève spontanée et décident d'occuper l'usine. La classe ouvrière a commencé à prendre le relais."
C'est ce récit que nous allons poursuivre ici.
La grève généralisée en FranceL'extension de la grève
A Nantes, ce sont les jeunes ouvriers, du même âge que les étudiants, qui ont lancé le mouvement ; leur raisonnement est simple : "si les étudiants, qui pourtant ne peuvent pas faire pression avec la grève, ont eu la force de faire reculer le gouvernement, les ouvriers pourront aussi le faire reculer". Pour leur part, les étudiants de la ville viennent apporter leur solidarité aux ouvriers, se mêlent à leur piquet de grève : fraternisation. Ici, il est clair que les campagnes du PCF1 et de la CGT2 mettant en garde contre les "gauchistes provocateurs à la solde du patronat et du ministère de l'Intérieur" qui auraient infiltré le milieu étudiant ont un impact bien faible.
Au total, il y a 3100 grévistes au soir du 14 mai.
Le 15 mai le mouvement gagne l'usine Renault de Cléon, en Normandie ainsi que deux autres usines de la région : grève totale, occupation illimitée, séquestration de la Direction, drapeau rouge sur les grilles. En fin de journée, il y a 11 000 grévistes.
Le 16 mai, les autres usines Renault entrent dans le mouvement : drapeau rouge sur Flins, Sandouville, le Mans et Billancourt (proche banlieue de Paris). Ce soir-là, il n'y a que 75 000 grévistes au total, mais l'entrée de Renault-Billancourt dans la lutte est un signal : c'est la plus grande usine de France (35 000 travailleurs) et depuis longtemps, il y a un proverbe : "Quand Renault éternue, la France s'enrhume".
Le 17 mai on compte 215 000 grévistes : la grève commence à toucher toute la France, surtout en province. C'est un mouvement totalement spontané ; les syndicats ne font que suivre. Partout, ce sont les jeunes ouvriers qui sont devant. On assiste à de nombreuses fraternisations entre étudiants et jeunes ouvriers : ces derniers viennent dans les facultés occupées et ils invitent les étudiants à venir manger à leur cantine.
Il n'y a pas de revendications précises : c'est un "ras le bol" qui s'exprime : sur un mur d'usine, en Normandie, il est écrit "Le temps de vivre et plus dignement !" Ce jour-là, craignant d'être "débordée par la base" et aussi par la CFDT3 beaucoup plus présente dans les mobilisations des premiers jours, la CGT appelle à l'extension de la grève : elle a "pris le train en marche" comme on disait à l'époque. Son communiqué ne sera connu que le lendemain.
Le 18 mai, il y a 1 million de travailleurs en grève à midi, avant même que ne soient connues les consignes de la CGT. Il y en a 2 millions le soir.
Ils seront 4 millions le lundi 20 mai et 6 millions et demi le lendemain.
Le 22 mai, il y a 8 millions de travailleurs en grève illimitée. C'est la plus grande grève de l'histoire du mouvement ouvrier international. Elle est beaucoup plus massive que les deux références précédentes : la "grève générale" de mai 1926 en Grande-Bretagne (qui a duré une semaine) et les grèves de mai-juin 1936 en France.
Tous les secteurs sont concernés : industrie, transports, énergie, postes et télécommunications, enseignement, administrations (plusieurs ministères sont complètement paralysés), médias (la télévision nationale est en grève, les travailleurs dénoncent notamment la censure qu'on leur impose), laboratoires de recherche, etc. Même les pompes funèbres sont paralysées (c'est une mauvaise idée que de mourir en Mai 68). On peut même voir les sportifs professionnels entrer dans le mouvement : le drapeau rouge flotte sur le bâtiment de la Fédération française de football. Les artistes ne sont pas en reste et le Festival de Cannes est interrompu à l'instigation des réalisateurs de cinéma.
Au cours de cette période, les facultés occupées (de même que d'autres bâtiments publics, comme le Théâtre de l'Odéon à Paris) deviennent des lieux de discussion politique permanente. Beaucoup d'ouvriers, notamment les jeunes mais pas seulement, participent à ces discussions. Certains ouvriers demandent à ceux qui défendent l'idée de la révolution de venir défendre leur point de vue dans leur entreprise occupée. C'est ainsi qu'à Toulouse, le petit noyau qui va fonder par la suite la section du CCI en France est invité à venir exposer l'idée des conseils ouvriers dans l'usine JOB (papier et carton) occupée. Et le plus significatif, c'est que cette invitation émane de militants... de la CGT et du PCF. Ces derniers devront parlementer pendant une heure avec des permanents de la CGT de la grande usine Sud-Aviation venus "renforcer" le piquet de grève de JOB pour obtenir l'autorisation de laisser entrer des "gauchistes" dans l'usine. Pendant plus de six heures, ouvriers et révolutionnaires, assis sur des rouleaux de carton, discuteront de la révolution, de l'histoire du mouvement ouvrier, des soviets de même que des trahisons... du PCF et de la CGT...
Beaucoup de discussions ont lieu aussi dans la rue, sur les trottoirs (il a fait beau dans toute la France en mai 68 !). Elles surgissent spontanément, chacun a quelque chose à dire ("On se parle et on s'écoute" est un slogan). Un peu partout, il règne une ambiance de fête, sauf dans les "beaux quartiers" où la trouille et la haine s'accumulent.
Partout en France, dans les quartiers, dans certaines grandes entreprises ou autour, surgissent des "Comités d'action" : on y discute de comment mener la lutte, de la perspective révolutionnaire. Ils sont en général animés par les groupes gauchistes ou anarchistes mais ils rassemblent beaucoup plus de monde que les membres de ces organisations. Même, à l'ORTF, la radio-télévision d'État, il se crée un Comité d'action animé notamment par Michel Drucker4 et auquel participe même l'inénarrable Thierry Rolland5.
La réaction de la bourgeoisie
Devant une telle situation, la classe dominante connaît une période de désarroi ce qui s'exprime par des initiatives brouillonnes et inefficaces.
C'est ainsi que, le 22 mai, l'Assemblée nationale, dominée par la droite, discute (pour finalement la rejeter) une motion de censure déposée par la gauche deux semaines auparavant : les institutions officielles de la République française semblent vivre dans un autre monde. Il en est de même du gouvernement qui prend ce même jour la décision d'interdire le retour de Cohn-Bendit qui était allé en Allemagne. Cette décision ne fait qu'accroître le mécontentement : le 24 mai on assiste à de multiples manifestations, notamment pour dénoncer l'interdiction de séjour de Cohn-Bendit : "Les frontières on s'en fout !", "Nous sommes tous des juifs allemands !" Malgré le cordon sanitaire de la CGT contre les "aventuriers" et les "provocateurs" (c'est-à-dire les étudiants "radicaux") beaucoup de jeunes ouvriers rejoignent ces manifestations.
Le soir, le Président de la République, le général de Gaulle fait un discours : il propose un référendum pour que les Français se prononcent sur la "participation" (une sorte d'association capital-travail). On ne saurait être plus éloigné des réalités. Ce discours fait un bide complet qui révèle le désarroi du gouvernement et de la bourgeoisie en général6.
Dans la rue, les manifestants ont écouté le discours sur les radios portables, la colère augmente encore : "Son discours, on s'en fout !". On assiste à des affrontements et à des barricades durant toute la nuit à Paris et dans plusieurs villes de province. Il y a de nombreuses vitrines brisées, des voitures incendiées, ce qui a pour effet de retourner une partie de l'opinion contre les étudiants considérés désormais comme des "casseurs". Il est probable, d'ailleurs, que parmi les manifestants se soient mêlés des membres des milices gaullistes ou des policiers en civil afin "d'attiser le feu" et faire peur à la population. Il est clair aussi que nombre d'étudiants s'imaginent "faire la révolution" en construisant des barricades ou en brûlant des voitures, symboles de la "société de consommation". Mais ces actes expriment surtout la colère des manifestants, étudiants et jeunes ouvriers, devant les réponses risibles et provocantes apportées par les autorités face à la plus grande grève de l'histoire. Illustration de cette colère contre le système : le symbole du capitalisme, la Bourse de Paris, est incendié.
Finalement, ce n'est que le jour suivant que la bourgeoisie commence à reprendre des initiatives efficaces : le samedi 25 mai s'ouvrent au ministère du Travail (rue de Grenelle) des négociations entre syndicats, patronat et gouvernement.
D'emblée, les patrons sont prêts à lâcher beaucoup plus que ce que s'imaginaient les syndicats : il est clair que la bourgeoisie a peur. Le premier ministre, Pompidou, préside. Il rencontre seul à seul, pendant une heure le dimanche matin, Séguy, patron de la CGT7 : les deux principaux responsables du maintien de l'ordre social en France ont besoin de discuter sans témoin des moyens de rétablir celui-ci8.
Dans la nuit du 26 au 27 mai sont conclus les "accords de Grenelle" :
- augmentations de salaires pour tous de 7% le 1er juin, plus 3% le 1er octobre ;
- augmentation du salaire minimum de l'ordre de 25% ;
- réduction du "ticket modérateur" de 30% à 25% (montant des dépenses de santé non pris en charge par la Sécurité sociale) ;
- reconnaissance de la section syndicale au sein de l'entreprise ;
- plus une série de promesses floues d'ouverture de négociations, notamment sur la durée du travail (qui est de l'ordre de 47 heures par semaine en moyenne).
Vu l'importance et la force du mouvement, c'est une véritable provocation :
- les 10 % seront effacés par l'inflation (qui est importante à cette période) ;
- rien sur la compensation salariale de l'inflation ;
- rien de concret sur la réduction du temps de travail ; on se contente d'afficher l'objectif du "retour progressif aux 40 heures" (déjà obtenues officiellement en 1936 !) ; au rythme proposé par le gouvernement, on y arriverait en... 2008 ! ;
- les seuls qui gagnent quelque chose de significatif sont les ouvriers les plus pauvres (on veut diviser la classe ouvrière en les poussant à reprendre le travail) et les syndicats (on les rétribue pour leur rôle de saboteurs).
Le lundi 27 mai les "accords de Grenelle" sont rejetés de façon unanime par les assemblées ouvrières.
à Renault Billancourt, les syndicats ont organisé un grand "show" amplement couvert par la télévision et les radios : en sortant des négociations, Séguy avait dit aux journalistes : "La reprise ne saurait tarder" et il espère bien que les ouvriers de Billancourt donneront l'exemple. Cependant, 10 000 d'entre eux, rassemblés depuis l'aube, ont décidé de poursuivre le mouvement avant même l'arrivée des dirigeants syndicaux.
Benoît Frachon, dirigeant "historique" de la CGT (déjà présent aux négociations de 1936) déclare : "Les accords de la rue de Grenelle vont apporter à des millions de travailleurs un bien-être qu'ils n'auraient pas espéré" : silence de mort !
André Jeanson, de la CFDT, se félicite du vote initial en faveur de la poursuite de la grève et parle de la solidarité des ouvriers avec les étudiants et les lycéens en lutte : applaudissements à tout rompre.
Séguy, enfin, présente "un compte rendu objectif" de ce qui "a été acquis à Grenelle" : sifflements puis huée générale de plusieurs minutes. Séguy fait alors une pirouette : "Si j'en juge par ce que j'entends, vous ne vous laisserez pas faire" : applaudissements mais dans la foule on entend : "Il se fout de notre gueule !".
La meilleure preuve du rejet des "accords de Grenelle" : le nombre des grévistes augmente encore le 27 mai pour atteindre les 9 millions.
Ce même jour se tient au stade Charléty, à Paris, un grand rassemblement appelé par le syndicat étudiant UNEF, la CFDT (qui fait de la surenchère par rapport à la CGT) et les groupes gauchistes. La tonalité des discours y est très révolutionnaire : il s'agit en fait de donner un exutoire au mécontentement croissant envers la CGT et le PCF. A côté des gauchistes, on note la présence de politiciens sociaux-démocrates comme Mendès-France (ancien chef du gouvernement dans les années 50). Cohn-Bendit, les cheveux teints en noir, y fait une apparition (on l'avait déjà vu la veille à la Sorbonne).
La journée du 28 mai est celle des grenouillages des partis de gauche :
Le matin, François Mitterrand, président de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (qui regroupe le Parti socialiste, le Parti radical et divers petits groupements de gauche) tient une conférence de presse : considérant qu'il y a vacance du pouvoir, il annonce sa candidature à la présidence de la République. Dans l'après-midi, Waldeck Rochet, patron du PCF, propose un gouvernement "à participation communiste" : il s'agit d'éviter que les sociaux-démocrates n'exploitent la situation à leur seul bénéfice. Il est relayé le lendemain 29 mai par une grande manifestation appelée par la CGT réclamant un "gouvernement populaire". La droite crie immédiatement au "complot communiste".
Ce même jour, on constate la "disparition" du général de Gaulle. Certains font courir le bruit qu'il se retire mais, en fait, il s'est rendu en Allemagne pour s'assurer auprès du général Massu, qui y commande les troupes françaises d'occupation, de la fidélité des armées.
Le 30 mai constitue une journée décisive dans la reprise en main de la situation par la bourgeoisie. De Gaulle fait un nouveau discours :
"Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. (...) Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale..."
En même temps se tient à Paris, sur les Champs-Élysées, une énorme manifestation de soutien à de Gaulle. Venu des beaux quartiers, des banlieues cossues et aussi de la "France profonde" grâce aux camions de l'armée, le "peuple" de la trouille et du fric, des bourgeois et des institutions religieuses pour leurs enfants, des cadres supérieurs imbus de leur "supériorité", des petits commerçants tremblant pour leur vitrine, des anciens combattants ulcérés par les atteintes au drapeau tricolore, des "barbouzes" en mèche avec la pègre, mais aussi des anciens de l'Algérie française et de l'OAS9, les jeunes membres du groupe fascisant Occident, les vieux nostalgiques de Vichy (qui tous pourtant détestent de Gaulle) ; tout ce beau monde vient clamer sa haine de la classe ouvrière et son "amour de l'ordre". Dans la foule, à côté d'anciens combattants de la "France libre", on entend des "Cohn-Bendit à Dachau !".
Mais le "Parti de l'ordre" ne se réduit pas à ceux qui manifestent sur les Champs-Élysées. Le même jour, la CGT appelle à des négociations branche par branche pour "améliorer les acquis de Grenelle" : c'est le moyen de diviser le mouvement afin de le liquider.
La reprise du travail
D'ailleurs, à partir de cette date (c'est un jeudi), le travail commence à reprendre, mais lentement car, le 6 juin, il y aura encore 6 millions de grévistes. La reprise du travail se fait dans la dispersion :
- 31 mai : sidérurgie lorraine, textiles du Nord ;
- 4 juin : arsenaux, assurances ;
- 5 juin : EDF10, mines de charbon ;
- 6 juin : poste, télécommunications, transports (à Paris, la CGT fait le forcing pour faire reprendre : dans chaque dépôt les dirigeants syndicaux annoncent que les autres dépôts ont repris le travail, ce qui est faux) ;
- 7 juin : enseignement primaire ;
- 10 juin : occupation de l'usine Renault de Flins par les forces de police ; un lycéen de 17 ans, Gilles Tautin, venu apporter sa solidarité aux ouvriers, tombe dans la Seine alors qu'il est chargé par les gendarmes et se noie ;
- 11 juin : intervention des CRS11 à l'usine Peugeot de Sochaux (2e usine de France) : 2 ouvriers sont tués, dont un par balles.
On assiste alors à de nouvelles manifestations violentes dans toute la France : "Ils ont tué nos camarades !" A Sochaux, devant la résistance déterminée des ouvriers, les CRS évacuent l'usine : le travail ne reprendra que 10 jours plus tard.
Craignant que l'indignation ne relance la grève (il reste encore 3 millions de grévistes), les syndicats (CGT en tête) et les partis de gauche conduits par le PCF appellent avec insistance à la reprise du travail "pour que les élections puissent se tenir et compléter la victoire de la classe ouvrière". Le quotidien du PCF, l'Humanité, titre : "Forts de leur victoire, des millions de travailleurs reprennent le travail".
L'appel systématique à la grève par les syndicats à partir du 20 mai trouve maintenant son explication : non seulement il fallait éviter d'être débordé par la "base" mais il fallait contrôler le mouvement afin de pouvoir, le moment venu, provoquer la reprise des secteurs les moins combatifs et démoraliser les autres secteurs.
Waldeck Rochet, dans ses discours de campagne électorale déclare que "Le Parti communiste est un parti d'ordre". Et "l'ordre" bourgeois revient peu à peu :
- 12 juin : reprise dans l'enseignement secondaire ;
- 14 juin : Air France et Marine marchande ;
- 16 juin : la Sorbonne est occupée par la police ;
- 17 juin : reprise chaotique à Renault Billancourt ;
- 18 juin : de Gaulle fait libérer les dirigeants de l'OAS qui étaient encore en prison ;
- 23 juin : 1er tour des élections législatives avec une très forte progression de la droite ;
- 24 juin : reprise du travail à l'usine Citroën Javel, en plein Paris (Krasucki, numéro 2 de la CGT, intervient avec insistance dans l'assemblée générale pour appeler à la fin de la grève) ;
- 26 juin : Usinor Dunkerque ;
- 30 juin : 2e tour des élections avec une victoire historique de la droite.
Une des dernières entreprises à reprendre le travail, le 12 juillet, est l'ORTF : de nombreux journalistes ne veulent pas voir revenir la tutelle et la censure qu'ils subissaient auparavant de la part du gouvernement. Après la "reprise en main", nombre d'entre eux seront licenciés. L'ordre est revenu partout, y compris dans les informations qu'on juge utile de diffuser dans la population.
Ainsi, la plus grande grève de l'histoire s'est terminée par une défaite, contrairement aux affirmations de la CGT et du PCF. Une défaite cuisante sanctionnée par le retour en force des partis et des "autorités" qui avaient été vilipendées au cours du mouvement. Mais le mouvement ouvrier sait depuis longtemps que : "Le résultat véritable de leurs luttes est moins le succès immédiat que l'union grandissante des travailleurs" (le Manifeste communiste). Aussi, derrière leur défaite immédiate, les ouvriers ont remporté en 1968 en France une grande victoire, non pas pour eux-mêmes mais pour l'ensemble du prolétariat mondial. C'est ce que nous allons voir maintenant en même temps que nous allons tenter de mettre en évidence les causes profondes ainsi que les enjeux historiques et mondiaux du "joli mois de Mai" français.
La portée internationale de la grève de mai 1968
Dans la plupart des nombreux livres et émissions de télévision sur Mai 1968 qui ont occupé l'espace médiatique de plusieurs pays au cours de la dernière période, il est souligné le caractère international du mouvement étudiant qui a touché la France au cours de ce mois-là. Tout le monde s'entend pour constater, comme nous l'avons également souligné dans notre précédent article, que les étudiants français n'étaient pas les premiers à se mobiliser massivement ; qu'ils ont, en quelque sorte, "pris le train en marche" d'un mouvement qui avait démarré dans les universités américaines à l'automne 1964. A partir des États-Unis, ce mouvement avait touché la plupart des pays occidentaux et il avait connu en Allemagne, dès 1967, ses développements les plus spectaculaires faisant des étudiants de ce pays la "référence" pour ceux des autres pays européens. Cependant, les mêmes journalistes ou "historiens" qui se plaisent à souligner l'ampleur internationale de la contestation étudiante des années 60 ne disent en général pas un mot des luttes ouvrières qui se sont déroulées dans le monde au cours de cette période. Évidemment, ils ne peuvent pas faire l'impasse sur l'immense grève qui constitue l'autre volet, évidemment le plus important, des "événements" de 68 en France : il leur est difficile de faire passer à la trappe la plus grande grève de l'histoire du mouvement ouvrier. Mais, si on les suit, ce mouvement du prolétariat constitue une sorte "d'exception française", encore une.
En réalité, au même titre, et peut-être encore plus, que le mouvement étudiant, le mouvement de la classe ouvrière en France était partie intégrante d'un mouvement international et on ne peut le comprendre réellement que dans ce contexte international.
Le contexte de la grève ouvrière en France...
C'est vrai qu'il a existé en France en mai 1968 une situation qu'on n'a retrouvée dans aucun autre pays, sinon de façon très marginale : un mouvement massif de la classe ouvrière prenant son essor à partir de la mobilisation étudiante. Il est clair que la mobilisation étudiante, la répression qu'elle a subie - et qui l'a alimentée- de même que le recul final du gouvernement après la "nuit des barricades" du 10-11 mai, ont joué un rôle, non seulement dans le déclenchement, mais aussi dans l'ampleur de la grève ouvrière. Cela dit, si le prolétariat de France s'est engagé dans un tel mouvement, ce n'est sûrement pas uniquement pour "faire comme les étudiants", c'est qu'il existait en son sein un mécontentement profond, généralisé, et aussi la force politique pour engager le combat.
Ce fait n'est en général pas occulté par les livres et programmes de télévision traitant de Mai 68 : il est souvent rappelé que, dès 1967, les ouvriers avaient mené des luttes importantes dont les caractéristiques tranchaient avec celles de la période précédente. En particulier, alors que les "grévettes" et les journées d'action syndicales ne suscitaient pas de grand enthousiasme, on a assisté à des conflits très durs, très déterminés face à une violente répression patronale et policière et où les syndicats ont été débordés à plusieurs reprises. C'est ainsi que, dès le début 1967, se produisent des affrontements importants à Bordeaux (à l'usine d'aviation Dassault), à Besançon et dans la région lyonnaise (grève avec occupation à Rhodia, grève à Berliet conduisant les patrons au lock-out et à l'occupation de l'usine par les CRS), dans les mines de Lorraine, dans les chantiers navals de Saint-Nazaire (qui est paralysée par une grève générale le 11 avril).
C'est à Caen, en Normandie, que la classe ouvrière va livrer un de ses combats les plus importants avant mai 68. Le 20 janvier 1968, les syndicats de la Saviem (camions) avaient lancé un mot d'ordre de grève d'une heure et demie mais la base, jugeant cette action insuffisante, est partie spontanément en grève le 23. Le surlendemain, à 4 heures du matin, les CRS démantèlent le piquet de grève permettant aux cadres et aux "jaunes" d'entrer dans l'usine. Les grévistes décident d'aller au centre ville où ils sont rejoints par des ouvriers d'autres usines qui sont également partis en grève. A 8 heures du matin, 5000 personnes convergent pacifiquement vers la place centrale : les Gardes mobiles12 les chargent brutalement, notamment à coups de crosse de fusil. Le 26 janvier, les travailleurs de tous les secteurs de la ville (dont les enseignants) ainsi que de nombreux étudiants manifestent leur solidarité : un meeting sur la place centrale rassemble 7000 personnes à 18 heures. A la fin du meeting, les Gardes mobiles chargent pour évacuer la place mais sont surpris par la résistance des travailleurs. Les affrontements dureront toute la nuit ; il y aura 200 blessés et des dizaines d'arrestations. Six jeunes manifestants, tous des ouvriers, écopent de peines de prison ferme de 15 jours à trois mois. Mais loin de faire reculer la classe ouvrière, cette répression ne fait que provoquer l'extension de sa lutte : le 30 janvier, on compte 15 000 grévistes à Caen. Le 2 février, les autorités et le patronat sont obligés de reculer : levée des poursuites contre les manifestants, augmentations des salaires de 3 à 4 %. Le lendemain, le travail reprend mais, sous l'impulsion des jeunes ouvriers, les débrayages se poursuivent encore pendant un mois à la Saviem.
Saint-Nazaire en avril 67 et Caen en janvier 68 ne sont pas les seules villes à être touchées par des grèves générales de toute la population ouvrière. C'est aussi le cas dans d'autres villes de moindre importance comme Redon en mars et Honfleur en avril. Ces grèves massives de tous les exploités d'une ville préfigurent ce qui va se passer à partir du milieu du mois de mai dans tout le pays.
Ainsi, on ne peut pas dire que l'orage de Mai 1968 ait éclaté dans un ciel d'azur. Le mouvement des étudiants a mis "le feu à la plaine", mais celle-ci était prête à s'enflammer.
Évidemment, les "spécialistes", notamment les sociologues, ont essayé de mettre en évidence les causes de cette "exception" française. Ils ont en particulier mis en avant le rythme très élevé du développement industriel de la France au cours des années 1960, transformant ce vieux pays agricole en puissance industrielle moderne. Ce fait explique notamment la présence et le rôle d'un nombre important de jeunes ouvriers dans les usines qui, souvent, avaient été construites peu avant. Ces jeunes ouvriers, issus fréquemment du milieu rural, sont très peu syndiqués et supportent difficilement la discipline de caserne de l'usine alors qu'ils reçoivent la plupart du temps des salaires dérisoires, même lorsqu'ils ont un Certificat d'aptitude professionnelle. Cette situation permet de comprendre pourquoi ce sont les secteurs les plus jeunes de la classe ouvrière qui ont les premiers engagé le combat, et également pourquoi la plupart des mouvements importants qui ont précédé Mai 68 ont eu lieu dans l'Ouest de la France, une région essentiellement rurale tardivement industrialisée. Cependant, les explications des sociologues échouent à expliquer pourquoi ce ne sont pas seulement les jeunes travailleurs qui sont entrés en grève en 1968 mais la très grande majorité de toute la classe ouvrière, tous âges confondus.
... et internationalement
En fait, derrière un mouvement de l'ampleur et de la profondeur de celui de mai 68, il y avait nécessairement des causes beaucoup plus profondes, des causes qui dépassaient, de très loin, le cadre de la France. Si l'ensemble de la classe ouvrière de ce pays s'est lancé dans une grève quasi générale, c'est que tous ses secteurs commençaient à être touchée par la crise économique qui, en 1968 n'en était qu'à son tout début, une crise non pas "française" mais de l'ensemble du capitalisme mondial. Ce sont les effets en France de cette crise économique mondiale (montée du chômage, gel des hausses salariales, intensification des cadences de production, attaques contre la Sécurité sociale) qui expliquent en bonne partie la montée de la combativité ouvrière dans ce pays à partir de 1967 :
"Dans tous les pays industriels, en Europe et aux USA, le chômage se développe et les perspectives économiques s'assombrissent. L'Angleterre, malgré une multiplication de mesures pour sauvegarder l'équilibre, est finalement réduite fin 1967 à une dévaluation de la Livre Sterling, entraînant derrière elle des dévaluations dans toute une série de pays. Le gouvernement Wilson proclame un programme d'austérité exceptionnel : réduction massive des dépenses publiques..., blocage des salaires, réduction de la consommation interne et des importations, effort pour augmenter les exportations. Le 1er janvier 1968, c'est au tour de Johnson [Président des États-Unis] de pousser un cri d'alarme et d'annoncer des mesures sévères indispensables pour sauvegarder l'équilibre économique. En mars, éclate la crise financière du dollar. La presse économique chaque jour plus pessimiste, évoque de plus en plus le spectre de la crise de 1929 (...) Mai 1968 apparaît dans toute sa signification pour avoir été une des premières et une des plus importantes réactions de la masse des travailleurs contre une situation économique mondiale allant en se détériorant" (Révolution internationale (ancienne série) n° 2, printemps 1969).
En fait, des circonstances particulières ont permis que ce soit en France que le prolétariat mondial mène son premier combat d'ampleur contre les attaques croissantes que le capitalisme en crise ne pouvait que multiplier. Mais, assez rapidement, les autres secteurs nationaux de la classe ouvrière allaient entrer à leur tour dans la lutte. Aux mêmes causes devaient succéder les mêmes effets.
C'est ainsi qu'à l'autre bout du monde, en Argentine, mai 1969 allait être marqué par ce qui est resté depuis dans les mémoires comme le "cordobazo". Le 29 mai, à la suite de toute une série de mobilisations dans les villes ouvrières contre les violentes attaques économiques et la répression de la junte militaire, les ouvriers de Cordoba avaient complètement débordé les forces de police et l'armée (pourtant équipées de tanks) et s'étaient rendus maîtres de la ville (la deuxième du pays). Le gouvernement n'a pu "rétablir l'ordre" que le lendemain grâce à l'envoi massif de troupes militaires.
En Italie, au même moment, débute le mouvement de luttes ouvrières le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Les grèves commencent à se multiplier chez Fiat à Turin, d'abord dans la principale usine de la ville, Fiat-Mirafiori, pour s'étendre ensuite aux autres usines du groupe à Turin et aux alentours. Le 3 juillet 1969, lors d'une journée d'action syndicale contre la hausse des loyers, les cortèges ouvriers, rejoints par des cortèges étudiants, convergent vers l'usine de Mirafiori. Face à celle-ci, de violentes bagarres éclatent avec la police. Elles durent pratiquement toute la nuit et s'étendent à d'autres quartiers de la ville.
Dès la fin du mois d'août, lorsque les ouvriers rentrent des congés d'été, les grèves reprennent à Fiat, mais aussi à Pirelli (pneumatiques) à Milan et dans bien d'autres entreprises.
Cependant, la bourgeoisie italienne, instruite par l'expérience de Mai 68, ne se laisse pas surprendre comme cela était arrivé à la bourgeoisie française l'année précédente. Il lui faut absolument empêcher que le mécontentement social profond qui se fait jour ne débouche sur un embrasement généralisé. C'est pour cela que son appareil syndical va mettre à profit l'échéance des contrats collectifs, notamment dans la métallurgie, la chimie et le bâtiment, pour développer ses manœuvres de dispersion des luttes en fixant aux ouvriers comme objectif un "bon contrat" dans leurs secteurs respectifs. Les syndicats mettent au point la tactique dite des grèves "articulées" : tel jour les métallos font grève, tel autre les travailleurs de la chimie, tel autre ceux du bâtiment. Des grèves "générales" sont appelées mais par province ou même par ville, contre la vie chère ou la hausse des loyers. Au niveau des entreprises, les syndicats prônent les grèves tournantes, un atelier après l'autre, avec le prétexte de causer le plus de dommages possible aux patrons à moindres frais pour les ouvriers. En même temps, les syndicats font le nécessaire pour reprendre le contrôle d'une base qui tend à leur échapper : alors que, dans beaucoup d'entreprises, les ouvriers, mécontents des structures syndicales traditionnelles, élisent des délégués d'atelier, ces derniers sont institutionnalisés sous forme de "conseils d'usine" présentés comme "organes de base" du syndicat unitaire que les trois confédérations, CGIL, CISL et UIL affirment vouloir construire ensemble. Après plusieurs mois où la combativité ouvrière s'épuise dans une succession de "journées d'action" par secteur et de "grèves générales" par province ou par ville, les contrats collectifs de secteur sont signés successivement entre début novembre et fin décembre. Et c'est peu avant la signature du dernier contrat, le plus important puisqu'il concerne la métallurgie du privé, secteur à l'avant-garde du mouvement, qu'une bombe explose, le 12 décembre, dans une banque de Milan, tuant 16 personnes. L'attentat est attribué à des anarchistes (l'un d'eux, Giuseppe Pinelli, meurt entre les mains de la police milanaise) mais on apprendra bien plus tard qu'il provenait de certains secteurs de l'appareil d'État. Les structures secrètes de l'État bourgeois sont venu prêter main forte aux syndicats pour semer la confusion dans les rangs de la classe ouvrière en même temps que se renforçaient les moyens de la répression.
Le prolétariat d'Italie n'a pas été le seul à se mobiliser au cours de cet automne 1969. A une échelle bien moindre mais très significative, celui d'Allemagne est entré aussi dans la lutte puisqu'en septembre ont éclaté dans ce pays des grèves sauvages contre la signature par les syndicats d'accords de "modération salariale". Ces derniers étaient censés être "réalistes" face à la dégradation de la situation de l'économie allemande qui, malgré le "miracle" d'après guerre, n'a pas été épargnée par les difficultés du capitalisme mondial qui s'accumulent à partir de 1967 (cette année-là, l'Allemagne a connu sa première récession depuis la guerre).
Ce réveil du prolétariat d'Allemagne, même s'il est encore timide, revêt une signification toute particulière. D'une part, il s'agit du plus important et du plus concentré d'Europe. Mais surtout, ce prolétariat a eu dans l'histoire, et sera appelé à retrouver dans le futur, une position de premier plan au sein de la classe ouvrière mondiale. C'est en Allemagne que c'était joué le sort de la vague révolutionnaire internationale qui, à partir d'Octobre 1917 en Russie, avait menacé la domination capitaliste sur le monde. La défaite subie par les ouvriers allemands au cours de leurs tentatives révolutionnaires, entre 1918 et 1923, avait ouvert les portes à la plus terrible contre-révolution qui se soit abattue sur le prolétariat mondial au cours de son histoire. Et c'est là où la révolution était allée le plus loin, la Russie et l'Allemagne, que cette contre-révolution avait pris les formes les plus profondes et barbares : le stalinisme et le nazisme. Cette contre-révolution avait duré près d'un demi-siècle et elle avait culminé avec la Seconde Guerre mondiale qui, contrairement à la première, n'avait pas permis au prolétariat de relever la tête mais l'avait enfoncé encore plus, grâce, notamment, aux illusions créées par la victoire du camps de la "démocratie" et du "socialisme".
L'immense grève de Mai 1968 en France, puis "l'automne chaud" italien, avaient fait la preuve que le prolétariat mondial était sorti de cette période de contre-révolution, que contrairement à la crise de 1929, celle qui était en train de se développer n'allait pas déboucher sur la guerre mondiale mais sur un développement des combats de classe qui allaient empêcher la classe dominante d'apporter sa réponse barbare aux convulsions de son économie. Les luttes des ouvriers allemands de septembre 1969 l'ont confirmé, de même que l'ont confirmé, et à échelle encore plus significative, les luttes des ouvriers polonais au cours de l'hiver 1970-71.
En décembre 1970, la classe ouvrière de Pologne a réagi spontanément et massivement à une hausse des prix de plus de 30%. Les ouvriers détruisent les sièges du parti stalinien à Gdańsk, Gdynia et Elbląg. Le mouvement de grève s'étend de la côte baltique à Poznań, Katowice, Wrocław et Cracovie. Le 17 décembre, Gomulka, Secrétaire général du parti stalinien au pouvoir, envoie ses tanks dans les ports de la Baltique. Plusieurs centaines d'ouvriers sont tués. Des batailles de rue ont lieu à Szczecin et à Gdańsk. La répression ne réussit pas à écraser le mouvement. Le 21 décembre une vague de grèves éclate à Varsovie. Gomulka est renvoyé. Son successeur, Gierek, va immédiatement négocier personnellement avec les ouvriers du chantier naval de Szczecin. Gierek fait quelques concessions mais refuse d'annuler les hausses de prix. Le 11 février une grève de masse éclate à Łódź, déclenchée par 10 000 ouvriers du textile. Gierek finit par céder : les hausses de prix sont annulées.
Les régimes staliniens ont constitué la plus pure incarnation de la contre-révolution : c'est au nom du "socialisme" et des "intérêts de la classe ouvrière" que celle-ci subissait une des pires terreurs qui soient. L'hiver "chaud" des ouvriers polonais, de même que les grèves qui se sont produites à l'annonce des luttes en Pologne de l'autre côté de la frontière, notamment dans les régions de Lvov (Ukraine) et Kaliningrad (Russie de l'Ouest) faisaient la preuve que même là où la contre-révolution maintenait sa chape de plomb la plus lourde, les régimes "socialistes", elle était battue en brèche.
On ne peut énumérer ici l'ensemble des luttes ouvrières qui, après 1968, ont confirmé cette modification fondamentale du rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat à l'échelle mondiale. Nous ne citerons que deux exemples, celui de l'Espagne et celui de l'Angleterre.
En Espagne, malgré la répression féroce exercée par le régime franquiste, la combativité ouvrière s'exprime de façon massive au cours de l'année 1974. La ville de Pampelune, en Navarre, connaît un nombre de jours de grève par ouvrier supérieur à celui des ouvriers français de 1968. Toutes les régions industrielles sont touchées (Madrid, Asturies, Pays Basque) mais c'est dans les immenses concentrations ouvrières de la banlieue de Barcelone que les grèves prennent leur plus grande extension, touchant toutes les entreprises de la région, avec des manifestations exemplaires de solidarité ouvrière (souvent, la grève démarre dans une usine uniquement en solidarité avec les ouvriers d'autres usines).
L'exemple du prolétariat d'Angleterre est également très significatif puisqu'il s'agit du plus vieux prolétariat du monde. Tout au long des années 1970, celui-ci a mené des combats massifs contre l'exploitation (avec 29 millions de journées de grève en 1979, les ouvriers anglais se sont placés en seconde position des statistiques, derrière les ouvriers français en 1968). Cette combativité a même obligé la bourgeoisie anglaise à changer par deux fois de Premier ministre : en avril 1976 (Callaghan remplace Wilson) et au début 1979 (Callaghan est renversé par le Parlement).
Ainsi, la signification historique fondamentale de Mai 68 n'est à rechercher ni dans les "spécificités françaises", ni dans la révolte étudiante, ni dans la "révolution des mœurs" qu'on nous chante aujourd'hui. C'est dans la sortie du prolétariat mondial de la contre-révolution et son entrée dans une nouvelle période historique d'affrontements contre l'ordre capitaliste. Une période qui s'est également illustrée par un nouveau développement des courants politiques prolétariens, dont le nôtre, que la contre-révolution avait pratiquement éliminés ou réduits au silence, comme nous le verrons maintenant.
Le resurgissement international des forces révolutionnaires
Les ravages de la contre-révolution dans les rangs communistes
Au début du 20e siècle, pendant et après la Première Guerre mondiale, le prolétariat a livré des combats titanesques qui ont failli venir à bout du capitalisme. En 1917, il a renversé le pouvoir bourgeois en Russie. Entre 1918 et 1923, dans le principal pays européen, l'Allemagne, il a mené de multiples assauts pour parvenir au même but. Cette vague révolutionnaire s'est répercutée dans toutes les parties du monde, partout où il existait une classe ouvrière développée, de l'Italie au Canada, de la Hongrie à la Chine. C'était la réponse qu'apportait le prolétariat mondial à l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence dont la guerre mondiale avait constitué la première grande manifestation.
Mais la bourgeoisie mondiale a réussi à contenir ce mouvement gigantesque de la classe ouvrière, et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a déchaîné la plus terrible contre-révolution de toute l'histoire du mouvement ouvrier. Cette contre-révolution a pris les formes d'une barbarie inimaginable, dont le stalinisme et le nazisme furent les deux représentants les plus significatifs, justement dans les pays où la révolution était allée le plus loin, la Russie et l'Allemagne.
Dans ce contexte, les partis communistes qui s'étaient trouvés à l'avant-garde de la vague révolutionnaire se sont convertis en partis de la contre-révolution.
Évidemment, la trahison des partis communistes a suscité le surgissement en leur sein de fractions de gauche en défense des véritables positions révolutionnaires. Un processus similaire s'était déjà déroulé au sein des partis socialistes lors de leur passage dans le camp bourgeois en 1914 avec leur soutien à la guerre impérialiste. Cependant, alors que ceux qui avaient lutté au sein des partis socialistes contre leur dérive opportuniste et leur trahison, avaient gagné des forces et une influence croissante dans la classe ouvrière jusqu'à être capables, après la révolution russe, de fonder une nouvelle Internationale, il n'en fut rien, du fait du poids croissant de la contre-révolution, des courants de gauche surgis au sein des partis communistes. Ainsi, alors qu'ils regroupaient au départ une majorité de militants dans les partis allemand et italien, ces courants ont progressivement perdu de leur influence dans la classe et la plus grande partie de leurs forces militantes, quand ils ne se sont pas éparpillés en de multiples petits groupes, comme ce fut le cas en Allemagne avant même que le régime hitlérien n'en extermine ou contraigne à l'exil les derniers militants.
En fait, au cours des années 30, à côté du courant animé par Trotski de plus en plus gagné par l'opportunisme, les groupes qui ont continué à défendre fermement les positions révolutionnaires, tel le Groupe des Communistes internationalistes (GIC) en Hollande (qui se réclamait du "Communisme de conseils" et rejetait la nécessité d'un parti prolétarien) et la Fraction de Gauche du Parti communiste d'Italie (qui publiait la revue Bilan) ne comptaient que quelques dizaines de militants et n'avaient plus aucune influence sur le cours des luttes ouvrières.
La Seconde Guerre mondiale n'a pas permis, contrairement à la première, un renversement du rapport de forces entre prolétariat et bourgeoisie. Bien au contraire. Instruite par l'expérience historique, et grâce au soutien précieux des partis staliniens, la classe dominante a veillé à tuer dans l'œuf tout nouveau surgissement du prolétariat. Dans l'euphorie démocratique de la "Libération", les groupes de la Gauche communiste sont encore plus isolés que dans les années 1930. En Hollande, le Communistenbond Spartacus prend la relève du GIC dans la défense des positions "conseillistes", positions qui seront également défendues, à partir de 1965 par Daad en Gedachte, une scission du Bond. Ces deux groupes font tout un travail de publication bien qu'ils soient handicapés par la position conseilliste qui rejette le rôle d'une organisation d'avant-garde pour le prolétariat. Cependant, le plus grand handicap est constitué par le poids idéologique de la contre-révolution. C'est le cas aussi en Italie où la constitution en 1945, autour de Damen et Bordiga (deux anciens fondateurs de la Gauche italienne dans les années 1920) du Partito Comunista Internazionalista (qui publie Battaglia Comunista et Prometeo), ne tient pas les promesses auxquelles avaient cru ses militants. Alors que cette organisation comptait 3000 membres à sa fondation, elle s'affaiblit progressivement, victime de la démoralisation et de scissions, notamment celle de 1952 animée par Bordiga qui va constituer le Parti Communiste International (et qui publie Programma comunista), scissions dont une des causes réside aussi dans la confusion qui avait présidé au regroupement de 1945, lequel s'était fait sur la base de l'abandon de toute une série d'acquis élaborés par Bilan dans les années 1930.
En France, le groupe qui s'était constitué en 1945, la Gauche Communiste de France (GCF), dans la continuité des positions de Bilan (mais en intégrant un certain nombre de positions programmatiques de la Gauche germano-hollandaise) et qui a publié 42 numéros de la revue Internationalisme, disparaît en 1952.
Dans ce même pays, outre les quelques éléments rattachés au Parti Communiste International et qui publiaient Le Prolétaire, un autre groupe a défendu jusqu'au début des années 1960 des positions de classe avec la revue Socialisme ou Barbarie (SouB). Mais ce groupe, issu d'une scission du trotskisme au lendemain de la seconde guerre mondiale, a progressivement et explicitement abandonné le marxisme ce qui a conduit à sa disparition en 1966. A la fin des années 1950 et au début des années 1960, plusieurs scissions de SouB, notamment face à son abandon du marxisme, avait conduit à la formation de petits groupes qui avaient rejoint la mouvance conseilliste, notamment ICO (Informations et Correspondances Ouvrières).
Nous pourrions encore citer l'existence d'autres groupes dans d'autres pays mais ce qui marque la situation des courants qui ont continué à défendre des positions communistes au cours de années 1950 et au début des années 1960, c'est leur extrême faiblesse numérique, le caractère confidentiel de leurs publications, leur isolement international ainsi que des régressions qui ont conduit soit à leur disparition pure et simple soit à un enfermement sectaire comme ce fut notamment le cas du Parti Communiste International qui se considérait comme la seule organisation communiste dans le monde.
Le renouveau des positions révolutionnaires
La grève générale de 1968 en France, puis les différents mouvements massifs de la classe ouvrière dont nous avons rendu compte plus haut, ont remis à l'ordre du jour l'idée de la révolution communiste dans de nombreux pays. Le mensonge du stalinisme qui se présentait comme "communiste" et "révolutionnaire" a commencé à craquer de toutes parts. Cela a profité évidemment aux courants qui dénonçaient l'URSS comme "Patrie du socialisme", telles les organisations maoïstes et trotskistes. Le mouvement trotskiste, du fait notamment de son histoire de lutte contre le stalinisme, a connu une nouvelle jeunesse à partir de 1968 et est sorti de l'ombre portée jusqu'alors par les partis staliniens. Ses rangs se sont remplis de façon quelquefois spectaculaires, notamment dans des pays comme la France, la Belgique ou la Grande-Bretagne. Mais ce courant avait cessé depuis la seconde guerre mondiale d'appartenir au camp prolétarien, notamment du fait de sa position de "défense des acquis ouvriers en URSS", c'est-à-dire de défense du camp impérialiste dominé par ce pays.
En fait, la mise en évidence par les grèves ouvrières qui se sont développées à partir de la fin des années 60 du rôle anti-ouvrier des partis staliniens et des syndicats, de la fonction de la farce électorale et démocratique comme instrument de la domination bourgeoise, a conduit de nombreux éléments de par le monde à se tourner vers les courants politiques qui, par le passé, avaient dénoncé le plus clairement le rôle des syndicats et du parlementarisme, qui avaient le mieux incarné la lutte contre le stalinisme, ceux de la Gauche communiste.
A la suite de Mai 1968, les écrits de Trotski ont connu une diffusion massive, mais aussi ceux de Pannekoek, Gorter13, Rosa Luxemburg qui, une des premières, peu avant son assassinat en janvier 1919, avait mis en garde ses camarades bolcheviks de certains dangers qui menaçaient la révolution en Russie.
De nouveaux groupes sont apparus qui se penchaient sur l'expérience de la Gauche communiste. En fait, c'est beaucoup plus vers le conseillisme que vers la Gauche italienne que se sont tournés les éléments qui comprenaient que le trotskisme était devenu une sorte d'aile gauche du stalinisme. Il y avait à cela plusieurs raisons. D'une part, le rejet des partis staliniens s'accompagnait souvent du rejet de la notion même de parti communiste. D'une certaine façon, c'était le tribut que payaient les nouveaux éléments qui se tournaient vers la perspective de la révolution prolétarienne au mensonge stalinien de la continuité entre le bolchevisme et le stalinisme, entre Lénine et Staline. Cette idée fausse était en outre en partie alimentée par les positions du courant bordiguiste, le seul issu de la Gauche italienne ayant une extension internationale, qui défendait l'idée de la prise du pouvoir par le parti communiste et se revendiquait du "monolithisme" dans ses rangs. D'un autre côté, c'était la conséquence du fait que les courants qui continuaient à se réclamer de la Gauche italienne sont passés pour l'essentiel à côté de Mai 1968, ne comprenant pas sa signification historique, n'y voyant que la dimension estudiantine.
En même temps que de nouveaux groupes inspirés par le conseillisme apparaissaient, ceux qui existaient auparavant ont connu un succès sans précédent, voyant leurs rangs se renforcer de façon spectaculaire en même temps qu'ils étaient capables se servir de pôle de référence. Ce fut particulièrement le cas pour ICO qui, en 1969 organisa une rencontre internationale à Bruxelles à laquelle participèrent notamment Cohn-Bendit, Mattick (ancien militant de la gauche allemande qui avait émigré aux États-Unis où il a publié diverses revues conseillistes) et Cajo Brendel, animateur de Daad en Gedachte.
Cependant, les succès du conseillisme "organisé" ont été de courte durée. Ainsi, ICO a prononcé son autodissolution en 1974. Les groupes hollandais ont cessé d'exister en même temps que leurs principaux animateurs.
En Grande-Bretagne, le groupe Solidarity, inspiré par les positions de Socialisme ou Barbarie, après un succès semblable à celui d'ICO, a connu scission sur scission jusqu'à exploser en 1981 (bien que le groupe de Londres ait continué à publier la revue jusqu'en 1992).
En Scandinavie, les groupes conseillistes qui s'étaient développés après 1968 ont été capables d'organiser une conférence à Oslo en septembre 1977 mais qui est restée sans lendemain.
En fin de compte, le courant qui s'est le plus développé au cours des années 1970 est celui qui se rattachait aux positions de Bordiga (décédé en juillet 1970). Il a notamment bénéficié d'un "afflux" d'éléments issus des crises qui ont agité certains groupes gauchistes (notamment les groupes maoïstes) à cette période. En 1980, le Parti communiste international était l'organisation se réclamant de la Gauche communiste la plus importante et influente à l'échelle internationale. Mais cette "ouverture" du courant bordiguiste à des éléments fortement marqués par le gauchisme a conduit à son explosion en 1982, le réduisant depuis à l'état d'une multitude de petites sectes confidentielles.
Les débuts du Courant communiste international
En fait, la manifestation la plus significative, sur le long terme, de ce renouveau des positions de la Gauche communiste a été le développement de notre propre organisation14.
Celle-ci s'est principalement constituée il y a juste 40 ans, en juillet 1968 à Toulouse, avec l'adoption d'une première déclaration de principes par un petit noyau d'éléments qui avaient formé un cercle de discussion l'année précédente autour d'un camarade, RV, qui avait fait ses débuts en politique dans le groupe Internacionalismo au Venezuela. Ce groupe avait été fondé en 1964 par le camarade MC15 qui avait été le principal animateur de la Gauche communiste de France (1945-52) après avoir été membre de la Fraction italienne de la Gauche communiste à partir de 1938 et qui était entré dans la vie militante dès 1919 (à l'âge de 12 ans) d'abord dans le Parti communiste de Palestine, puis au PCF.
Pendant la grève générale de Mai 1968, les éléments du cercle de discussion avaient publié plusieurs tracts signés Mouvement pour l'Instauration des Conseils Ouvriers (MICO) et avaient entrepris des discussions avec d'autres éléments avec qui s'était finalement formé le groupe qui allait publier Révolution internationale à partir de décembre 1968. Ce groupe était entré en contact et en discussion suivie avec deux autres groupes appartenant à la mouvance conseilliste, l'Organisation conseilliste de Clermont-Ferrand et celui publiant les Cahiers du Communisme de Conseils basé à Marseille.
Finalement, en 1972, les trois groupes ont fusionné pour constituer ce qui allait devenir la section en France du CCI et qui a commencé la publication de Révolution Internationale (nouvelle série).
Ce groupe, dans la continuité de la politique menée par Internacionalismo, la GCF et Bilan, a engagé des discussions avec différents groupes qui avaient également surgi après 1968, notamment aux États-Unis (Internationalism). En 1972, Internationalism envoie une lettre à une vingtaine de groupes se réclamant de la Gauche communiste appelant à la constitution d'un réseau de correspondance et de débat international. Révolution internationale a répondu chaleureusement à cette initiative tout en proposant qu'elle se donne la perspective de la tenue d'une conférence internationale. Les autres groupes ayant donné une réponse positive appartenaient tous à la mouvance conseilliste. Les groupes se réclamant de la Gauche italienne pour leur part, soit ont fait la sourde oreille, soit ont jugé cette initiative prématurée.
Sur la base de cette initiative se sont tenues plusieurs rencontres en 1973 et 1974 en Angleterre et en France auxquelles ont participé notamment, pour la Grande-Bretagne (World Revolution, Revolutionary Perspective et Workers' Voice, les deux premiers issus de scissions de Solidarity et le dernier issu d'une scission du trotskisme).
Finalement, ce cycle de rencontres a abouti en janvier 1975 à la tenue d'une conférence où les groupes qui partageaient la même orientation politique - Internacionalismo, Révolution Internationale, Internationalism, World Revolution, Rivoluzione Internazionale (Italie) et Accion Proletaria (Espagne) - ont décidé de s'unifier au sein du Courant Communiste International.
Celui-ci a décidé de poursuivre cette politique de contacts et de discussions avec les autres groupes de la Gauche communiste ce qui l'a conduit à participer à la conférence d'Oslo de 1977 (en même temps que Revolutionary Perspective) et à répondre favorablement à l'initiative lancée en 1976 par Battaglia Comunista en vue de la tenue d'une conférence internationale de groupes de la Gauche communiste.
Les trois conférences qui se tenues en mai 1977 (Milan), novembre 1978 (Paris) et mai 1980 (Paris) avaient suscité un intérêt croissant parmi les éléments qui se réclamaient de la Gauche communiste mais la décision de Battaglia Comunista et de la Communist Workers' Organisation (issu d'un regroupement de Revolutionary Perspective et Workers' Voice en Grande-Bretagne) d'en exclure désormais le CCI sonna le glas de cet effort.16 D'une certaine façon, le repliement sectaire (tout au moins envers le CCI) de BC et de la CWO (qui se sont regroupés en 1984 dans le Bureau International pour le Parti Révolutionnaire - BIPR) était un indice que s'était épuisée l'impulsion initiale qu'avait donné au courant de la Gauche communiste le surgissement historique du prolétariat mondial en Mai 1968.
Cependant, malgré les difficultés qu'a rencontrées la classe ouvrière au cours des dernières décennies, notamment les campagnes idéologiques sur la "mort du communisme" après l'effondrement des régimes staliniens, la bourgeoisie mondiale n'a pas réussi à lui infliger une défaite décisive. Cela s'est traduit par le fait que le courant de la Gauche communiste (représenté principalement par le BIPR17 et surtout le CCI) a maintenu ses positions et connaît aujourd'hui un intérêt croissant auprès des éléments qui, avec la lente reprise des combats de classe depuis 2003, se tournent vers une perspective révolutionnaire.
Le chemin du prolétariat vers la révolution communiste est long et difficile. Il ne peut en être autrement puisqu'il échoit à cette classe la tache immense de faire passer l'humanité du "règne de la nécessité au règne de la liberté". La bourgeoisie ne perd aucune occasion de proclamer que "le communisme est mort !" mais l'acharnement qu'elle met à l'enterrer est significatif de la crainte qu'elle continue d'éprouver devant cette perspective. Quarante ans après, elle nous invite à "liquider" Mai 68 (Sarkozy) ou à "l'oublier" (Cohn-Bendit, devenu un notable "vert" du Parlement européen et qui a publié récemment un livre au titre significatif : "Forget 68") et c'est normal : Mai 68 a ouvert une brèche dans son système de domination, une brèche qu'elle n'a pas réussi à colmater et qui ira en s'élargissant à mesure que deviendra plus évidente la faillite historique de ce système.
Fabienne (6/07/2008)
1 Parti communiste français
2 Confédération générale du Travail. C'est la centrale syndicale le plus puissante, notamment parmi les ouvriers de l'industrie et des transports ainsi que parmi les fonctionnaires. Elle est contrôlée par le PCF.
3 Confédération française démocratique du Travail. Cette centrale syndicale était à l'origine d'inspiration chrétienne mais au début des années 1960, elle a rejeté les références au christianisme et elle est fortement influencée par le Parti socialiste ainsi que par un petit parti socialiste de gauche, le Parti socialiste unifié, aujourd'hui disparu.
4 Animateur vedette d'émissions on ne peut plus "consensuelles".
5 Commentateur sportif au chauvinisme débridé.
6 Le lendemain de ce discours, les employés municipaux annoncent en beaucoup d'endroits qu'ils refuseront d'organiser le référendum. De même, les autorités ne savent pas comment imprimer les bulletins de vote : l'Imprimerie nationale est en grève et les imprimeries privés qui ne sont pas en grève refusent : leurs patrons ne veulent pas avoir d'ennuis supplémentaires avec leurs ouvriers.
7 Georges Séguy est également membre du Bureau politique du PCF.
8 On apprendra plus tard que Chirac, secrétaire d'État aux Affaires sociales, a également rencontré (dans un grenier !) Krasucki, numéro 2 de la CGT.
9 Organisation armée secrète : groupe clandestin de militaires et de partisans du maintien de la France en Algérie qui s'est illustré au début des années 60 par des attentats terroristes, des assassinats et même une tentative d'assassinat de de Gaulle.
10 Électricité de France.
11 Compagnies républicaines de Sécurité : forces de la Police nationale spécialisées dans la répression des manifestations de rue.
12 Forces de la Gendarmerie nationale (c'est-à-dire l'armée) ayant le même rôle que les CRS.
13 Les deux principaux théoriciens de la Gauche hollandaise.
14 Pour une histoire plus détaillée du CCI, lire nos articles "Construction de l'organisation révolutionnaire : les 20 ans du Courant communiste international" (Revue internationale no 80) et "Les trente ans du CCI : s'approprier le passé pour construire l'avenir" (Revue internationale no 123).
15 Sur la contribution de MC au mouvement révolutionnaire, voir notre article "Marc" dans les numéros 65 et 66 de la Revue internationale.
16 A propos de ces conférences voir notre article "Les conférences internationales de la Gauche Communiste (1976-1980) - Leçons d'une expérience pour le milieu prolétarien" dans la Revue internationale n° 122.
17 Le moindre développement du BIPR comparé à celui du CCI est à mettre principalement au compte de son sectarisme ainsi qu'à sa politique opportuniste de regroupement (qui le conduit souvent à construire sur du sable). Voir à ce sujet notre article "Une politique opportuniste de regroupement qui ne conduit qu'à des 'avortements'" (Revue internationale n° 121)
Situations territoriales:
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [18]
Il y a 90 ans, la révolution allemande. 1918-19 : De la guerre à la révolution
- 3709 lectures
Dans la première partie de cette série d'articles publiée à l'occasion de l'anniversaire de la tentative révolutionnaire en Allemagne, nous avons examiné le contexte historique mondial dans lequel la révolution s'est déroulée. Ce contexte, c'était la catastrophe de la Première Guerre mondiale et l'incapacité de la classe ouvrière et de sa direction politique à en prévenir l'éclatement. Bien que les premières années du 20e siècle aient été marquées par les premières manifestations d'une tendance générale au développement de grèves de masse, ces mouvements ne furent pas assez puissants, sauf en Russie, pour saper le poids des illusions réformistes. Quant au mouvement ouvrier internationaliste organisé, il s'avéra être théoriquement, organisationnellement et moralement impréparé face à une guerre mondiale qu'il avait prévue depuis longtemps. Prisonnier des schémas du passé selon lesquels la révolution prolétarienne serait le résultat, plus ou moins inéluctable, du développement économique du capitalisme, il postulait que la tâche primordiale des socialistes était d'éviter des confrontations prématurées et de laisser passivement les conditions objectives mûrir. A l'exception de son opposition révolutionnaire de gauche, l'Internationale socialiste ne parvint pas à - ou refusa de - prendre en compte la possibilité que le premier acte de la période de déclin du capitalisme soit la guerre mondiale et non la crise économique mondiale. Et, surtout, ignorant les signaux de l'histoire : l'urgence de l'alternative qui approchait de socialisme ou barbarie, l'Internationale sous-estima complètement le facteur subjectif de l'histoire, en particulier son rôle et sa responsabilité propres. Le résultat fut la faillite de l'Internationale face à l'éclatement de la guerre et à la frénésie chauvine de la part de sa direction, des syndicats en particulier. Les conditions de la première tentative révolutionnaire prolétarienne mondiale étaient donc déterminées par le passage relativement soudain et cataclysmique du capitalisme dans sa phase de décadence à travers une guerre impérialiste mondiale mais, aussi, par une crise catastrophique sans précédent du mouvement ouvrier.
Il apparut très vite clairement qu'il ne pouvait y avoir de réponse révolutionnaire à la guerre sans la restauration de la conviction que l'internationalisme prolétarien n'était pas une question tactique mais bien le principe le plus "sacré" du socialisme, la seule et unique "patrie" de la classe ouvrière (comme l'écrit Rosa Luxemburg). Nous avons donc vu, dans le précédent article, comment la déclaration publique de Karl Liebknecht contre la guerre, le Premier Mai 1916 à Berlin - au même titre que les conférences socialistes internationalistes qui se sont tenues dans cette période, comme celles de Zimmerwald et de Kienthal - et l'étendue des sentiments de solidarité qu'elle suscita, constituèrent un tournant indispensable vers la révolution. Face aux horreurs de la guerre dans les tranchées et à la paupérisation et à l'exploitation forcenée de la classe ouvrière sur le "front intérieur", balayant d'un seul coup des décennies d'acquis des luttes, nous avons vu le développement de grèves de masse et la maturation des couches politisées et des centres de la classe ouvrière capables de mener un assaut révolutionnaire.
La responsabilité du prolétariat pour en finir avec la guerre
Comprendre les causes de l'échec du mouvement socialiste face à la guerre était donc l'objectif principal de l'article précédent, tout comme cela avait été la préoccupation première des révolutionnaires pendant la première phase de la guerre. Le texte de Rosa Luxemburg, La crise de la Social-démocratie - appelé "Brochure de Junius" - en est une expression des plus claires. Au cœur des événements que nous traitons dans ce deuxième article, se pose une seconde question décisive, conséquence de la première : Quelle force sociale mettra fin à la guerre et comment ?
Richard Müller, l'un des leaders des "délégués révolutionnaires", les Obleute de Berlin et, plus tard, l'un des principaux historiens de la révolution en Allemagne, a formulé ainsi la responsabilité de la révolution : empêcher "l'effondrement de la culture, la liquidation du prolétariat et du mouvement socialiste comme tels" 1.
Comme cela fut souvent le cas, c'est Rosa Luxemburg qui posa avec la plus grande clarté la question historique de l'époque : "Qu'y aura-t-il après la guerre, quelles conditions et quel rôle attend la classe ouvrière, cela dépend entièrement de la façon dont la paix sera advenue. Si elle a été le résultat de l'épuisement mutuel des puissances militaires ou même - et ce serait pire - de la victoire d'un des belligérants, en d'autres termes si elle advient sans la participation du prolétariat, avec un calme social au sein des différents États, alors une telle paix scellerait la défaite historique mondiale du socialisme par la guerre. (...) Après la banqueroute du 4 août 1914, le second test décisif pour la mission historique du prolétariat est le suivant : sera-t-il capable de mettre fin à la guerre qu'il a été incapable d'empêcher, non de recevoir la paix des mains de la bourgeoisie impérialiste comme résultat de la diplomatie de cabinet, mais de la conquérir, de l'imposer à la bourgeoisie."2
Rosa Luxemburg décrit ici trois scénarios possibles sur la façon dont la guerre pourrait se terminer. Le premier, c'est la ruine et l'épuisement des belligérants impérialistes des deux camps. Elle reconnaît d'emblée la possibilité que l'impasse de la concurrence capitaliste, dans sa période de déclin historique, mène à un processus de pourrissement et de désintégration - si le prolétariat est incapable d'imposer sa propre solution. Cette tendance à la décomposition de la société capitaliste ne devait devenir manifeste que des décennies plus tard avec "l'implosion" en 1989 du bloc de l'Est et des régimes staliniens, et le déclin qui s'en est suivi du leadership de la superpuissance restante, les États-Unis. Rosa Luxemburg avait déjà compris qu'une telle dynamique, en elle-même, n'est pas favorable au développement d'une alternative révolutionnaire.
Le second scénario était que la guerre soit menée jusqu'à son terme et aboutisse à la défaite d'un des deux blocs en présence. Dans ce cas, le résultat serait l'inévitable clivage au sein du camp victorieux, produisant un nouvel alignement pour une seconde guerre mondiale encore plus destructrice, à laquelle la classe ouvrière serait encore moins capable de s'opposer.
Dans les deux cas, le résultat serait non une défaite momentanée mais une défaite historique mondiale du socialisme pour une génération au moins, ce qui pourrait, à long terme, saper la possibilité même d'une alternative prolétarienne à la barbarie capitaliste. Les révolutionnaires de l'époque avaient déjà compris que "la Grande guerre" avait ouvert un processus qui avait la potentialité de saper la confiance de la classe ouvrière dans sa mission historique. Comme telle, "la crise de la Social-démocratie" constituait une crise de l'espèce humaine elle-même puisque, dans le capitalisme, seul le prolétariat porte la possibilité d'une société alternative.
La révolution russe et la grève de masse de janvier 1918
Comment mettre fin à la guerre impérialiste par des moyens révolutionnaires ? Les vrais socialistes du monde entier comptaient sur l'Allemagne pour apporter une réponse à cette question. L'Allemagne était la principale puissance économique continentale d'Europe, le leader - en fait la seule puissance majeure - de l'un des deux blocs impérialistes en lutte. C'était aussi le pays qui comportait le plus grand nombre d'ouvriers éduqués, formés au socialisme, ayant une conscience de classe et qui, au cours de la guerre, se rallièrent de façon grandissante à la cause de la solidarité internationale.
Mais le mouvement prolétarien est international par nature. La première réponse à la question posée ci-dessus ne fut pas apportée en Allemagne mais en Russie. La révolution russe de 1917 constitua un tournant dans l'histoire mondiale. Elle participa aussi à la transformation de la situation en Allemagne. Jusqu'à février 1917 et au début du soulèvement en Russie, les ouvriers allemands qui avaient une conscience de classe se donnaient pour but de développer la lutte afin d'obliger les gouvernements à réclamer la paix. Même au sein de la Ligue Spartakus (Spartakusbund), au moment de sa fondation le Jour de l'An 1916, personne ne croyait à la possibilité d'une révolution imminente. Avec l'expérience russe, en avril 1917, les cercles révolutionnaires clandestins d'Allemagne avaient adopté le point de vue selon lequel le but n'était pas seulement de mettre fin à la guerre mais, en même temps, de renverser le capitalisme. Très vite la victoire de la révolution à Petrograd et à Moscou en octobre 1917 clarifia, pour ces cercles de Berlin et de Hambourg, non tant le but que les moyens d'y parvenir : l'insurrection armée organisée et menée par les conseils ouvriers.
Paradoxalement, l'effet immédiat de l'Octobre rouge russe sur les grandes masses en Allemagne allait dans un sens plutôt contraire. Une sorte d'euphorie innocente éclata à l'idée que la paix approchait, basée sur l'hypothèse que le gouvernement allemand ne pourrait qu'accepter la main tendue de l'Orient pour "une paix sans annexion". Cette réaction montre à quel point la propagande de ce qui était devenu le parti "socialiste" fauteur de guerre, le SPD - selon qui la guerre aurait été imposée à l'Allemagne qui n'en voulait pas - avait encore de l'influence. Concernant les masses populaires, le tournant dans leur attitude envers la guerre induit par la Révolution russe, n'eut lieu que trois mois plus tard, avec les négociations de paix entre la Russie et l'Allemagne à Brest-Litovsk.3 Ces négociations furent intensément suivies par les ouvriers dans toute l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois. Leur résultat - le Diktat impérialiste de l'Allemagne et l'occupation par celle-ci de grandes parties des régions occidentales de ce qui était devenu la République soviétique, et la répression sauvage des mouvements révolutionnaires qui y avaient lieu - convainquit des millions d'ouvriers de la justesse du slogan de Spartakus : le principal ennemi est dans son propre pays, c'est le système capitaliste lui-même. Brest-Litovsk donna lieu à une grève de masse gigantesque qui démarra en Autriche-Hongrie, à Vienne. Elle s'étendit immédiatement à l'Allemagne, paralysa la vie économique dans plus de vingt villes principales, avec un demi million d'ouvriers en grève à Berlin. Les revendications étaient les mêmes que celles de la délégation soviétique à Brest : arrêt immédiat de la guerre, sans annexions. Les ouvriers s'organisèrent au moyen d'un système de délégués élus, suivant dans l'ensemble les propositions très concrètes d'un tract de Spartakus tirant les leçons de la Russie.
Un témoignage rapporté dans le quotidien du SPD, le Vorwärts, dans son numéro du 28 janvier 1918, décrit les rues de Berlin, désertes ce matin-là, ensevelies dans un brouillard qui enveloppait et déformait les contours des bâtiments, de la ville entière en fait. Quand les masses envahirent les rues avec une détermination silencieuse, le soleil sortit et dissipa le brouillard, écrit le reporter.
Divisions et divergences au sein de la direction de la grève
Cette grève donna lieu à un débat au sein de la direction révolutionnaire sur les buts immédiats du mouvement ; mais il touchait de plus en plus le cœur de la question : comment le prolétariat peut-il mettre fin à la guerre ? Le centre de gravité de la direction se trouvait, à l'époque, au sein de l'aile gauche de la Social-démocratie qui, après avoir été exclue du SPD pour son opposition à la guerre, avait formé un nouveau parti, l'USPD (le SPD "indépendant"). Ce parti qui regroupait la plupart des dirigeants les plus connus qui s'étaient opposés à la trahison de l'internationalisme par le SPD - y compris beaucoup d'éléments hésitants et vacillants, plus petits-bourgeois que prolétariens - comportait aussi une opposition révolutionnaire radicale, le Spartakusbund, fraction qui disposait d'une structure et d'une plate-forme propres. Déjà au cours de l'été et de l'automne 1917, le Spartakusbund et d'autres courants au sein de l'USPD avaient appelé à des manifestations de protestation en réponse au mécontentement, et témoignant l'enthousiasme grandissant pour la révolution russe. Les Obleute, "délégués révolutionnaires" d'usine s'opposaient à cette orientation ; leur influence était particulièrement forte dans les usines d'armement de Berlin. Soulignant les illusions des masses envers la "volonté de paix" du gouvernement allemand, ces cercles voulaient attendre que le mécontentement soit plus intense et plus généralisé pour qu'il puisse s'exprimer alors en une action de masse unique et unifiée. Quand, dans les premiers jours de 1918, les appels à la grève de masse dans toute l'Allemagne atteignirent Berlin, les Obleute décidèrent de ne pas inviter le Spartakusbund aux réunions où cette action massive centrale se préparait et se décidait. Ils avaient peur que ce qu'ils appelaient "l'activisme" et "la précipitation" de Spartakus - qui, à leur avis, dominaient le groupe depuis que sa principale animatrice et théoricienne, Rosa Luxemburg, avait été emprisonnée - mettent en danger le lancement d'une action unifiée dans toute l'Allemagne. Quand les Spartakistes découvrirent cela, ils lancèrent leur propre appel à la lutte sans attendre la décision des Obleute.
Ce manque de confiance réciproque s'intensifia alors à propos de l'attitude à adopter envers le SPD. Quand les syndicats découvrirent qu'un comité de grève secret avait été constitué et ne comportait aucun membre du SPD, ce dernier réclama immédiatement d'y être représenté. A la veille de la grève du 28 janvier, une réunion clandestine de délégués d'usines à Berlin vota contre dans sa majorité. Néanmoins, les Obleute qui dominaient le comité de grève, décidèrent d'admettre des délégués du SPD avec l'argument que les sociaux-démocrates n'étaient plus dans une position où ils pouvaient empêcher la grève mais que leur exclusion pourrait créer une note de discorde et donc saper l'unité de l'action à venir. Spartakus condamna vigoureusement cette décision.
Le débat atteignit des sommets au cours de la grève elle-même. Face à la force élémentaire de cette action, le Spartakusbund commença à défendre l'orientation vers l'intensification de l'agitation en faveur du déclenchement de la guerre civile. Le groupe pensait que le moment était déjà venu pour mettre fin à la guerre par des moyens révolutionnaires. Les Obleute s'y opposèrent fortement, préférant prendre la responsabilité de mettre fin, de façon organisée, au mouvement une fois qu'il eut atteint ce qu'ils considéraient être son point culminant. Leur argument principal était qu'un mouvement insurrectionnel, même s'il réussissait, resterait limité à Berlin et que les soldats n'avaient pas encore été gagnés à la révolution.
La place de la Russie et de l'Allemagne dans la révolution mondiale
Derrière cette divergence sur la tactique résident deux questions plus générales et plus profondes. L'une d'elles concerne le critère permettant de juger la maturité des conditions pour une insurrection révolutionnaire. Nous reviendrons sur cette question plus tard dans cette série d'articles.
L'autre concerne le rôle du prolétariat russe dans la révolution mondiale. Le renversement de la domination bourgeoise en Russie pouvait-il être immédiatement facteur déclencheur d'un soulèvement révolutionnaire en Europe centrale et occidentale ou, au moins, contraindre les principaux protagonistes impérialistes à arrêter la guerre ?
La même discussion avait eu lieu dans le Parti bolchevique en Russie à la veille de l'insurrection d'Octobre 1917, puis à l'occasion des négociations de paix avec le gouvernement impérial allemand à Brest-Litovsk. Dans le Parti bolchevique, les opposants à la signature du traité avec l'Allemagne, menés par Boukharine, défendaient que la principale motivation du prolétariat quand il avait pris le pouvoir en Octobre 1917 en Russie, avait été de déclencher la révolution en Allemagne et en Occident et que signer un traité avec l'Allemagne maintenant équivalait à abandonner cette orientation. Trotsky adopta une position intermédiaire de temporisation qui ne résolut pas vraiment le problème. Ceux qui défendaient la nécessité de signer ce traité, comme Lénine, ne mettaient absolument pas en question la motivation internationaliste de l'insurrection d'Octobre. Ce qu'ils contestaient, c'était que la décision de prendre le pouvoir aurait été basée sur l'idée que la révolution s'étendrait immédiatement à l'Allemagne. Au contraire : ceux qui étaient pour l'insurrection avaient déjà mis en avant, à l'époque, que l'extension immédiate de la révolution n'était pas certaine et que le prolétariat russe prenait donc le risque d'être isolé, de connaître des souffrances inouïes en prenant l'initiative de commencer la révolution mondiale. Ce risque, avait argumenté Lénine en particulier, était justifié parce que ce qui était en jeu, c'était l'avenir, pas seulement celui du prolétariat russe mais celui du prolétariat mondial ; pas seulement celui du prolétariat mais l'avenir de toute l'humanité. Cette décision devait donc être prise en pleine conscience et de la façon la plus responsable. Lénine a répété ces arguments par rapport à Brest : le prolétariat russe avait la justification morale de signer le traité avec la bourgeoisie allemande, même le plus défavorable, afin de gagner du temps puisqu'il n'était pas certain que la révolution en Allemagne commence immédiatement.
Isolée du monde dans sa prison, Rosa Luxemburg intervint dans ce débat à travers trois articles - "La responsabilité historique", "Vers la catastrophe" et "La tragédie russe", rédigés respectivement en janvier, juin et septembre 1918 - et qui constituent trois des plus importantes "Lettres de Spartakus", lettres célèbres diffusées clandestinement pendant la guerre. Elle y met clairement en évidence qu'on ne peut blâmer ni le parti bolchevique, ni le prolétariat russe du fait qu'ils aient été contraints de signer un traité avec l'impérialisme allemand. Cette situation était le résultat de l'absence de révolution ailleurs et, avant tout, en Allemagne. Sur la base de cette compréhension, elle fit ressortir le tragique paradoxe suivant : bien que la révolution russe ait été le plus haut sommet conquis par l'humanité jusqu'à ce jour et, comme tel, ait constitué un véritable tournant dans l'histoire, sa première conséquence, dans l'immédiat, ne fut pas de raccourcir mais de prolonger les horreurs de la guerre mondiale. Et cela pour la simple raison qu'elle libéra l'impérialisme allemand de l'obligation de mener la guerre sur deux fronts.
Si Trotsky croit à la possibilité d'une paix immédiate sous la pression des masses à l'Ouest, écrit Rosa Luxemburg en 1918, "il faudra verser beaucoup d'eau dans le vin mousseux de Trotsky". Et elle continue : "Première conséquence de l'armistice à l'Est : les troupes allemandes seront tout simplement transférées d'Est en Ouest. Je dirais même plus : c'est déjà fait."4 En juin, elle tire une deuxième conclusion de cette dynamique : l'Allemagne est devenue le gendarme de la contre-révolution en Europe orientale, massacrant les forces révolutionnaires de la Finlande jusqu'à l'Ukraine. Paralysé par cette évolution, le prolétariat "faisait le mort". En septembre 1918, elle explique que la guerre mondiale menace d'engloutir la Russie révolutionnaire elle-même : "Le cercle d'airain de la guerre mondiale qui semblait brisé à l'Est se referme autour de la Russie et du monde entier sans la moindre faille : l'Entente s'avance au Nord et à l'Est avec les Tchécoslovaques et les Japonais - conséquence naturelle et inévitable de l'avance de l'Allemagne à l'Ouest et au Sud. Les flammes de la guerre mondiale lèchent déjà le sol russe et convergeront sous peu sur la révolution russe. En fin de compte, il s'est avéré impossible pour la Russie de se retrancher isolément de la guerre mondiale, fût-ce au prix des plus grands sacrifices."5
Pour Rosa Luxemburg, il était clair que l'avantage militaire immédiat gagné par l'Allemagne, du fait de la révolution en Russie, permettrait pendant quelques mois de renverser le rapport de forces en Allemagne en faveur de la bourgeoisie. Malgré l'inspiration qu'avait insufflée la révolution russe aux ouvriers allemands et bien que la "paix des brigands" imposée par l'impérialisme allemand après Brest leur ait ôté beaucoup d'illusions, il allait falloir presque un an pour que cela mûrisse et se transforme en une révolte ouverte contre l'impérialisme.
La raison en est liée à la nature particulière d'une révolution qui naît dans le contexte d'une guerre mondiale. "La Grande Guerre" de 1914 n'était pas seulement une boucherie à une échelle jamais vue. C'était aussi l'organisation de la plus gigantesque opération économique, matérielle et humaine qu'on n'ait jamais connue dans l'histoire jusqu'alors. Littéralement, des millions d'êtres humains ainsi que toutes les ressources de la société étaient devenus les rouages d'une machine infernale dont la dimension même défiait toute imagination. Cela avait provoqué deux sentiments d'une grande intensité au sein du prolétariat : la haine de la guerre et un sentiment d'impuissance. Dans ces circonstances, il a fallu des souffrances et des sacrifices incommensurables avant que la classe ouvrière ne reconnaisse qu'elle seule pouvait mettre fin à la guerre. Ce processus prit du temps et se développa de façon heurtée et hétérogène. Deux de ses aspects les plus importants furent la prise de conscience que les véritables motivations de l'effort de guerre impérialiste étaient des motivations de brigands et que la bourgeoisie elle-même ne contrôlait pas la machine de guerre qui, en tant que produit du capitalisme, était devenue indépendante de la volonté humaine. En Russie 1917, comme en Allemagne et en Autriche-Hongrie 1918, la reconnaissance que la bourgeoisie était incapable de mettre fin à la guerre, même si elle allait à la défaite, s'avéra décisive.
Ce que Brest-Litovsk et les limites de la grève de masse en Allemagne et en Autriche-Hongrie en janvier 1918 ont révélé avant tout, est ceci : la révolution mondiale pouvait commencer en Russie mais seule une action prolétarienne décisive dans l'un des principaux pays protagonistes - l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France - pouvait arrêter la guerre.
La course pour arrêter la guerre
Bien que le prolétariat allemand "ait fait le mort" comme le dit Rosa Luxemburg, sa conscience de classe a continué à mûrir pendant la première moitié de 1918. De plus, à partir de l'été 1918, les soldats commencèrent pour la première fois à être sérieusement infectés par le bacille de la révolution. Deux facteurs y contribuèrent en particulier. En Russie, les prisonniers allemands qui étaient simples soldats, furent libérés et eurent le choix de rester en Russie et de participer à la révolution, ou de retourner en Allemagne. Ceux qui choisirent de rentrer furent évidemment immédiatement renvoyés au front comme chair à canon par l'armée allemande. Mais ils apportaient des nouvelles de la révolution russe. En Allemagne même, en représailles de leur action, des milliers de dirigeants de la grève de masse de janvier furent envoyés au front où ils apportèrent les nouvelles de la révolte grandissante de la classe ouvrière contre la guerre. Mais ce qui fut décisif pour le changement d'atmosphère dans l'armée, c'était la prise de conscience croissante de la futilité de la guerre et du fait que la défaite de l'Allemagne était inévitable.
A l'automne débuta quelque chose qui aurait été inimaginable quelques mois plus tôt : une course contre le temps entre le prolétariat conscient d'un côté et les dirigeants de la bourgeoisie allemande de l'autre, pour déterminer laquelle des deux grandes classes de la société moderne mettrait fin à la guerre.
Du côté de la classe dominante allemande, il fallait d'abord résoudre deux problèmes majeurs dans ses propres rangs. L'un d'eux était la totale incapacité de beaucoup de ses principaux représentants à envisager la possibilité de la défaite qui pourtant leur sautait aux yeux. L'autre, c'était comment faire la paix sans discréditer l'appareil d'État de façon irréparable. Sur cette dernière question, nous devons garder à l'esprit qu'en Allemagne, la bourgeoisie avait accédé au pouvoir et le pays avait été unifié, non par une révolution d'en bas mais par les militaires, avant tout par l'armée royale prussienne. Comment mettre fin à la guerre sans mettre en question ce pilier et ce symbole de la force et de l'unité nationales ?
15 septembre 1918 : les puissances alliées rompent le front austro-hongrois dans les Balkans.
27 septembre : la Bulgarie, allié important de Berlin, capitule.
29 septembre : le commandant en chef de l'armée allemande, Erich Ludendorff, informe le haut commandement que la guerre est perdue, que ce n'est plus qu'une question de jours, ou même d'heures, avant que tout le front militaire ne s'effondre.
En fait, la description que Ludendorff fit de la situation immédiate était plutôt exagérée. Nous ne savons pas s'il paniqua ou s'il dépeignit délibérément la réalité plus noire qu'elle n'était afin que les dirigeants du pays acceptent ses propositions. En tous cas, celles-ci furent adoptées : la capitulation et l'instauration d'un gouvernement parlementaire.
Ce faisant, Ludendorff voulait éviter une défaite totale de l'Allemagne et faire tomber le vent de la révolution. Mais il poursuivait aussi un autre but. Il voulait que ce soit un gouvernement civil qui capitule, de sorte que les militaires puissent continuer à nier la défaite publiquement. Il préparait le terrain pour le Dolchstosslegende, "la légende du coup de poignard dans le dos", selon laquelle l'armée allemande victorieuse aurait été vaincue par les traîtres de l'intérieur. Mais cet ennemi, le prolétariat, ne pouvait évidemment pas être appelé par son nom car cela n'aurait fait qu'élargir l'abîme grandissant qui séparait la bourgeoisie et la classe ouvrière. Pour cette raison, il fallait trouver un bouc émissaire à blâmer pour avoir "trompé" les ouvriers. A cause de l'histoire de la civilisation occidentale depuis deux mille ans, la victime la plus adaptée pour jouer le rôle de bouc émissaire était à portée de main : les Juifs. C'est ainsi que l'anti-sémitisme dont l'influence avait déjà grandi, surtout dans l'Empire russe, durant les années qui avaient précédé la guerre, revint au centre de la politique européenne. La route qui mène à Auschwitz commence là.
1er octobre 1918 : Ludendorff et Hindenburg proposent la paix immédiate à l'Entente. Au même moment, une conférence des groupes révolutionnaires les plus intransigeants, le Spartakusbund et la Gauche de Brême, appelaient à développer l'agitation chez les soldats et à la formation de conseils ouvriers. Au même moment aussi, des centaines de milliers de déserteurs étaient en fuite derrière le front. Et, comme allait l'écrire plus tard le révolutionnaire Paul Frölich (dans sa biographie de Rosa Luxemburg), le changement d'attitude des masses se lisait dans leurs yeux.
Dans le camp de la bourgeoisie, la volonté de terminer la guerre était retardée par deux nouveaux facteurs. D'une part, aucun des impitoyables dirigeants de l'État allemand qui n'avaient pas eu la moindre hésitation à envoyer leurs "sujets" par millions à une mort certaine et absurde, n'avait le courage d'informer le Kaiser Guillaume II qu'il devait renoncer au trône. D'autre part, l'autre camp impérialiste continuait à chercher des raisons de repousser l'armistice, car il n'était pas convaincu qu'une révolution était probable dans l'immédiat, ni du danger que celle-ci présentait pour sa propre domination. La bourgeoisie perdait du temps.
Mais tout cela ne l'empêcha pas de préparer la répression sanglante des forces révolutionnaires. Elle avait notamment déjà choisi les parties de l'armée qui, de retour du front, devraient occuper les principales villes. Dans le camp du prolétariat, les révolutionnaires préparaient de plus en plus intensément un soulèvement armé pour mettre fin à la guerre. Les Obleute à Berlin fixèrent au 4 novembre, puis au 11 le jour de l'insurrection.
Mais entre temps, les événements prirent une tournure à laquelle ne s'attendaient ni la bourgeoisie, ni le prolétariat et qui eut une profonde influence sur le cours de la révolution.
Les mutineries dans la marine, la dissolution de l'armée
Afin de remplir les conditions de l'armistice stipulées par le camp militaire adverse, le gouvernement de Berlin mit fin à toute opération militaire navale, en particulier à la guerre sous-marine, le 20 octobre. Une semaine plus tard, il déclarait le cessez-le feu sans condition.
Face à ce "début de la fin", la folie s'empara des officiers de la flotte basée sur la côte nord de l'Allemagne. Ou, plutôt, la "folie" de leur ancienne caste militaire - avec sa défense de "l'honneur", sa tradition du duel - fut mise à jour par la folie de la guerre impérialiste moderne. Dans le dos de leur propre gouvernement, ils décidèrent de lancer la marine de guerre dans la grande bataille navale contre la flotte britannique qu'ils avaient vainement attendue pendant toute la guerre. Ils préféraient mourir avec honneur plutôt que de capituler sans se battre. Ils supposaient que les marins et les équipages - 80 000 personnes au total - sous leur commandement étaient prêts à les suivre.6
Mais ce n'était pas le cas. Les équipages se mutinèrent contre la mutinerie de leurs chefs. Ou du moins certains d'entre eux. Durant un moment dramatique, les navires dont les équipages avaient pris le contrôle et ceux où ce n'était pas (encore) le cas pointèrent leurs canons les uns contre les autres. Les équipages mutinés capitulèrent alors, probablement pour éviter de tirer sur leurs frères de classe.
Mais ce n'est pas encore cela qui déclencha la révolution en Allemagne. Ce qui fut décisif, c'est que les équipages arrêtés furent amenés comme prisonniers à Kiel où ils allaient probablement être condamnés à mort comme traîtres. Les marins qui n'avaient pas eu le courage de se joindre à la première rébellion en haute mer, exprimèrent alors sans peur leur solidarité avec ces équipages. Et, par-dessus tout, toute la classe ouvrière de Kiel sortit des usines et se mobilisa dans la rue en solidarité pour fraterniser avec les marins. Le social-démocrate, G. Noske, envoyé pour écraser sans pitié le soulèvement, arriva à Kiel le 4 novembre et trouva la ville aux mains des ouvriers, des marins et des soldats armés. De plus, des délégations massives avaient déjà quitté Kiel dans toutes les directions pour enjoindre la population à faire la révolution, sachant très bien qu'un seuil sans retour possible avait été franchi : la victoire ou la mort certaine. Noske fut totalement déconcerté et par la rapidité des événements et par le fait que les révoltés de Kiel l'accueillirent comme un héros.7
Sous les coups de boutoir de ces événements, le puissant appareil militaire allemand finit par se désintégrer. Les divisions qui revenaient de Belgique et que le gouvernement avait prévu d'utiliser pour "rétablir l'ordre" à Cologne, désertèrent. Le soir du 8 novembre, tous les regards étaient tournés vers Berlin, siège du gouvernement, où étaient concentrées les principales forces armées contre-révolutionnaires. La rumeur qui courait, rapportait que la bataille décisive allait avoir lieu le lendemain dans la capitale.
Richard Müller, dirigeant des Obleute à Berlin, rapporta plus tard : "Le 8 novembre, j'étais à Hallisches Tor8. Des colonnes d'infanterie lourdement armées, de mitrailleuses et d'artillerie légère avançaient en rangées sans fin vers le centre ville. Les hommes ressemblaient à des voyous. On s'en était déjà servi avec "succès" pour écraser les ouvriers et les paysans en Russie et en Finlande. Il ne faisait aucun doute qu'ils allaient être utilisés à Berlin pour noyer la révolution dans le sang." (Op. cité) Müller décrit ensuite comment le SPD envoyait des messages à tous ses fonctionnaires, leur demandant de s'opposer à l'éclatement de la révolution par tous les moyens. Il continue : "J'ai été à la tête du mouvement révolutionnaire depuis que la guerre a éclaté. Jamais, même face aux pires revers, je n'ai douté de la victoire du prolétariat. Mais maintenant que l'heure décisive approchait, j'étais assailli par un sentiment d'appréhension, une grande inquiétude pour mes camarades de classe, le prolétariat. Moi-même, face à la grandeur du moment, je me trouvais honteusement petit et faible." (Ibid.)
La révolution de novembre : le prolétariat met fin à la guerre
On dit souvent que le prolétariat allemand, pétri par les valeurs culturelles traditionnelles d'obéissance et de soumission que, pour des raisons historiques, lui avaient inculqué les classes dominantes de ce pays pendant plusieurs siècles, était incapable de faire une révolution.
Le 9 novembre 1918 a prouvé le contraire. Au matin, des centaines de milliers de manifestants venant des grands faubourgs ouvriers qui entourent les quartiers du gouvernement et des affaires sur trois côtés, marchèrent vers le centre de Berlin. Ils organisèrent leurs trajets de façon à passer devant les principales casernes afin de gagner les soldats à leur cause, et devant les principales prisons afin de libérer leurs camarades. Ils étaient équipés de fusils et de grenades. Et ils étaient prêts à mourir pour la cause de la révolution. L'organisation s'était faite sur le tas, de façon spontanée.
Ce jour-là, 15 personnes seulement furent tuées. La révolution de novembre 1918 en Allemagne fut aussi peu sanglante que celle d'octobre 1917 en Russie. Mais personne ne le savait à l'avance ni ne s'y attendait. Le prolétariat de Berlin montra ce jour là un grand courage et une détermination inébranlable.
A midi, les dirigeants du SPD, Ebert et Scheidemann, étaient au Reichstag, siège du Parlement, en train de manger. Friedrich Ebert était fier de lui car il venait juste d'être appelé par les riches et les nobles à former un gouvernement pour sauver le capitalisme. Quand ils entendirent du bruit dehors, Ebert, refusant d'être interrompu par la foule, poursuivit son déjeuner en silence ; Scheidemann, accompagné de fonctionnaires alarmés à l'idée que le bâtiment soit pris d'assaut, sortit sur le balcon pour voir ce qu'il se passait. Ce qu'il vit, c'est quelque chose comme un million de manifestants sur les pelouses entre le Reichstag et la Porte de Brandebourg. Une foule qui se tut quand elle vit Scheidemann au balcon, supposant qu'il était venu faire un discours. Obligé d'improviser, il proclama "la République allemande libre". Quand il revint dire à Ebert ce qu'il avait fait, celui-ci fut furieux car il avait l'intention de sauver non seulement le capitalisme mais aussi la monarchie.9
A peu près au même moment, Karl Liebknecht qui se trouvait au balcon d'un palais de cette même monarchie, proclamait la république socialiste et appelait la classe ouvrière de tous les pays à la révolution mondiale. Quelques heures plus tard, les Obleute révolutionnaires occupaient l'une des principales salles de réunion du Reichstag. Là, ils formulèrent l'appel à la tenue d'assemblées générales massives le lendemain pour élire des délégués et constituer des conseils révolutionnaires d'ouvriers et de soldats.
La guerre était terminée, la monarchie renversée, mais la domination de la bourgeoisie était loin d'avoir pris fin.
Après la victoire, la guerre civile
Au début de cet article, nous avons rappelé les enjeux de l'histoire tels que Rosa Luxemburg les avait formulés, concentrés sur la question : quelle classe pourra mettre fin à la guerre ? Nous avons rappelé les trois scénarios possibles pour que la guerre se termine : par le prolétariat, par la bourgeoisie ou par l'épuisement mutuel des belligérants. Les événements ont clairement montré qu'au bout du compte, c'est le prolétariat qui a joué le rôle principal pour mettre fin à "la Grande Guerre". Ce seul fait illustre la puissance potentielle du prolétariat révolutionnaire. Il explique pourquoi la bourgeoisie, aujourd'hui encore, enfouit dans le silence et l'oubli la révolution de novembre 1918.
Mais ce n'est pas toute l'histoire. Dans une certaine mesure, les événements de novembre combinèrent les trois scénarios dépeints par Rosa Luxemburg. Dans une certaine mesure, ces événements furent aussi le résultat de la défaite militaire de l'Allemagne. Début novembre 1918, celle-ci était vraiment à la veille d'une défaite militaire totale. De façon ironique, seul le soulèvement du prolétariat épargna à la bourgeoisie allemande le sort d'une occupation militaire, en obligeant ses adversaires impérialistes à mettre fin à la guerre pour empêcher l'extension de la révolution. Novembre 1918 révéla aussi des éléments de "la ruine mutuelle" et de l'épuisement, surtout en Allemagne, mais aussi en Grande-Bretagne et en France. En fait, c'est l'intervention des États-Unis aux côtés des alliés occidentaux à partir de 1917 qui fit pencher la balance en faveur de ces derniers et permit de sortir de l'impasse mortelle dans laquelle les puissances européennes étaient enferrées.
Si nous mentionnons le rôle de ces autres facteurs, ce n'est pas pour minimiser celui du prolétariat. C'est qu'il est important d'en tenir compte car ils aident à comprendre le caractère des événements. La révolution de novembre a gagné une victoire comme une force contre laquelle aucune résistance véritable n'est possible. Mais c'est aussi parce que l'impérialisme allemand avait déjà perdu la guerre, parce que son armée était en pleine décomposition et parce que, non seulement la classe ouvrière, mais aussi de vastes secteurs de la petite bourgeoisie et même de la bourgeoisie voulaient désormais la paix.
Le lendemain de son grand triomphe, la population de Berlin élut des conseils d'ouvriers et de soldats. Ceux-ci, à leur tour, nommèrent, en même temps que leur propre organisation, ce qui était considéré comme une sorte de gouvernement provisoire socialiste, formé par le SPD et l'USPD, sous la direction de Friedrich Ebert. Le même jour, Ebert scellait un accord secret avec le nouveau commandement militaire pour écraser la révolution.
Dans le prochain article, nous examinerons les forces de l'avant-garde révolutionnaire dans le contexte du début de guerre civile et à la veille d'événements décisifs pour la révolution mondiale.
Steinklopfer
1 Richard Müller, Vom Kaiserreich Zur Republik ("De l'Empire à la République"), première partie de sa trilogie sur la révolution allemande.
2 Rosa Luxemburg, "Liebknecht", Spartakusbriefe n°1, septembre 1916
3 Le Traité de Brest-Litovsk fut signé le 3 mars 1918 entre l'Allemagne, ses alliés et la toute nouvelle République des Soviets. Les négociations pour y aboutir durèrent 3 mois. Lire également à propos de cet évènement notre article La Gauche communiste en Russie : 1918 - 1930 (1ere partie) dans la Revue internationale n° 8
4 Spartakusbriefe n° 8, janvier 1918, "Die geschichtliche Verantwortung" ("La responsabilité historique")
5 Spartakusbriefe n° 11, septembre 1918, "Die russische Tragödie" ("La tragédie russe")
6 Les actions kamikazes de l'aviation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et les attentats-suicide des fondamentalistes islamiques ont donc des précurseurs européens.
7 Voir l'analyse de ces événements par l'historien allemand Sebastian Haffner dans 1918/19, Eine deutsche Revolution ("1918/19, une révolution allemande").
8 Station du métro aérien de Berlin, au sud du centre ville
9 On trouve des anecdotes de ce style, venant de l'intérieur de la contre-révolution, dans les mémoires des dirigeants de la social-démocratie. Philipp Scheidemann : Memoiren eines Sozialdemokraten ("Mémoires d'un social-démocrate"), 1928 - Gustav Noske : Von Kiel bis Kapp - Zur Geschichte der deutschen Revolution ("De Kiel à Kapp - Sur l'histoire de la révolution allemande"), 1920.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [35]
Heritage de la Gauche Communiste:
Décadence du capitalisme (II) : Quelle méthode scientifique pour comprendre l'ordre social existant, les conditions et moyens de son dépassement
- 2645 lectures
Dans la première partie de cette série, nous avons examiné la succession d'événements : guerres mondiales, révolutions et crises économiques globales, qui ont marqué l'entrée du capitalisme dans sa phase de déclin au cours de la première partie du 20e siècle et qui ont posé à l'humanité l'alternative historique : avènement d'un mode de production supérieur ou chute dans la barbarie. Pour comprendre quelles sont les origines et les causes de la crise que connaît la civilisation humaine, une théorie qui embrasse l'ensemble du mouvement de l'histoire est absolument nécessaire. Mais les théories historiques générales n'ont plus guère la faveur des historiens officiels qui, de plus en plus déroutés par l'évolution du capitalisme dans son déclin, s'avèrent incapables d'offrir la moindre vision globale, la moindre explication profonde des causes de la spirale de catastrophes qui ont marqué cette période. Les grandes visions historiques n'ont plus cours ; elles seraient l'apanage du 19e siècle et de philosophes idéalistes allemands comme Hegel, ou des libéraux anglais - et de leur optimisme exagéré - qui, à la même époque, pensaient que l'histoire était celle d'un progrès continu, allant de l'obscurantisme et la tyrannie vers la merveilleuse liberté dont jouissaient désormais les citoyens de l'État constitutionnel moderne (ce qu'on appelle la théorie "Whig" de l'histoire)
En fait, cette incapacité à envisager le mouvement de l'histoire dans son ensemble est caractéristique d'une classe qui ne représente plus aucun progrès historique et dont le système social n'a plus aucun avenir à offrir à l'humanité. La bourgeoisie a pu développer une ample vision du passé et de l'avenir tant qu'elle était convaincue que son mode de production constituait une avancée fondamentale pour l'humanité par rapport aux anciennes formes sociales et qu'elle pouvait regarder le futur avec la confiance d'une classe ascendante. Les horreurs de la première moitié du 20e siècle ont porté un coup mortel à cette confiance. Non seulement des lieux aussi symboliques que ceux de la Somme et Passhendale où des centaines de milliers de jeunes conscrits ont servi de chair à canon sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, ou que ceux de Auschwitz et Hiroshima, synonymes du meurtre de masse de civils par l'État, ou des dates tout aussi symboliques que celles de 1914, 1929 et 1939 ont mis en question toutes les hypothèses passées sur le progrès moral de la société ; ils ont aussi indiqué de façon alarmante pour l'ordre social existant que celui-ci ne serait peut-être pas aussi éternel qu'il y avait paru jusqu'ici. En somme, face à la perspective de sa propre fin - soit par l'anéantissement de sa société à travers son effondrement et sa chute dans l'anarchie, soit - ce qui pour la bourgeoisie revient au même - par son renversement par la classe ouvrière - l'historiographie bourgeoise préfère mettre des œillères, se borner à l'étude empirique de périodes courtes et d'événements locaux, ou bien développer des théories, comme le relativisme et le post-modernisme, qui rejettent toute notion de développement progressif entre une période et une autre et toute tentative de dégager une trame dans l'évolution de l'histoire humaine. De plus, la mise en avant de la culture people conforte tous les jours cette répression de la conscience historique, en lien avec les besoins désespérés du marché : ce qui a de la valeur est ce qui est nouveau et qui se passe maintenant, cela ne doit venir de nulle part et aller nulle part.
Vu l'étroitesse d'esprit de la plus grande partie de "la connaissance établie", on ne peut s'étonner que les charlatans, vendeurs de religion et d'occultisme, séduisent ceux qui cherchent encore à saisir le sens global de l'histoire. Le nazisme a constitué l'une des premières manifestations de cette tendance - son idéologie étant composée d'un bric-à-brac de théosophie occultiste et de théorie raciste du complot fournissant une solution fourre-tout à tous les problèmes du monde, supprimant ainsi réellement tout besoin de penser. Le fondamentalisme chrétien et islamique, ou encore les nombreuses théories du complot selon lesquelles des sociétés secrètes manipuleraient l'histoire, jouent le même rôle aujourd'hui. Non seulement la raison bourgeoise officielle n'a aucune réponse à offrir aux problèmes de la société mais, le plus souvent, elle ne cherche même plus à les soulever et laisse le champ libre à la déraison pour mitonner ses propres solutions mythologiques.
Dans une certaine mesure, la conscience de cette situation s'exprime dans le bon sens commun et dominant. On est prêt à reconnaître qu'on a perdu l'ancienne confiance en soi. On ne chante pas vraiment les louanges du capitalisme libéral comme réalisation la plus formidable de l'esprit humain mais, plutôt, comme "la moins pire", imparfaite certes, mais infiniment préférable à toutes les formes de fanatisme qui semblent se déployer contre lui. Et dans le camp des fanatiques, sont rangés non seulement le fascisme ou le terrorisme islamique mais aussi le marxisme, définitivement réfuté aujourd'hui sous l'étiquette de messianisme utopique. Combien de fois nous a-t-on dit - souvent par des penseurs de troisième classe qui prétendent apporter quelque chose de nouveau : la vision marxiste de l'histoire ne serait que la vision inversée du mythe judéo-chrétien de l'histoire, une histoire de salut de l'humanité ; le communisme primitif serait le jardin d'Eden, le communisme futur le paradis à venir ; le prolétariat le peuple élu ou le messie souffrant ; les communistes les prophètes. Mais on nous dit également que ces projections religieuses sont loin d'être inoffensives : la réalité des "gouvernements marxistes" aurait montré que toute tentative de créer le paradis sur terre est vouée à finir dans la tyrannie et les camps de travail, que ce serait un projet insensé voulant façonner une humanité imparfaite selon sa vision de la perfection.
A l'appui de cette analyse, il y a ce qu'on nous présente comme la trajectoire du marxisme au cours du 20e siècle : en effet, qui peut nier que le Guépéou de Staline rappelait la Sainte Inquisition, ou que Lénine, Staline, Mao et d'autres grands dirigeants ont été transformés en nouveaux dieux ? Mais cette représentation est profondément trompeuse. Elle s'appuie sur le plus grand mensonge du 20e siècle selon lequel le stalinisme serait le communisme alors qu'il en est la négation totale. Si le stalinisme est une forme de la contre-révolution capitaliste, ce que tous les marxistes révolutionnaires authentiques affirment, il faut mettre en question l'argument selon lequel la théorie marxiste de l'histoire mène inévitablement au Goulag.
Et l'on peut aussi répondre, comme Engels l'a fait dans ses écrits sur l'histoire du christianisme primitif, que les similitudes entre les idées du mouvement ouvrier moderne et les adages des prophètes bibliques et des premiers chrétiens n'ont rien d'étrange car ces derniers représentaient aussi les efforts des classes opprimées et exploitées et l'espoir qu'elles mettaient dans un monde basé sur la solidarité humaine et non sur la domination de classe. Du fait des limites imposées par les systèmes sociaux au sein desquels ils sont apparus, ces premiers communistes ne pouvaient dépasser la vision religieuse ou mythique de la société sans classe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui car l'évolution historique a fait de la société communiste une possibilité rationnelle et une nécessité urgente. Aussi, plutôt que de considérer le communisme à la lumière des anciens mythes, nous pouvons comprendre ces anciens mythes à la lumière du communisme moderne.
Pour nous, le marxisme, le matérialisme historique, n'est pas autre chose que la vision théorique d'une classe qui, pour la première fois dans l'histoire, est à la fois classe exploitée et classe révolutionnaire, une classe qui porte en elle un ordre social nouveau et supérieur. Son effort et, en fait, son besoin d'examiner l'histoire passée et les perspectives du futur sont donc totalement dégagés des préjugés portés par les classes dominantes qui sont toujours, en fin de compte, contraintes de nier et de cacher la réalité dans l'intérêt de leur système d'exploitation. Et, contrairement aux inclinations poétiques des anciennes classes exploitées, la théorie marxiste est aussi fondée sur une méthode scientifique. Ce n'est peut-être pas une science exacte du même type que les sciences naturelles, car on ne peut faire rentrer l'humanité et son histoire vaste et complexe dans une série d'expériences de laboratoire reproductibles - mais la théorie de l'évolution est elle aussi sujette aux mêmes contraintes. La question, c'est que seul le marxisme est capable d'appliquer la méthode scientifique à l'étude de l'ordre social existant et aux sociétés qui l'ont précédé, et d'utiliser de façon rigoureuse les meilleures connaissances que la classe dominante peut offrir, de les dépasser et d'esquisser une synthèse supérieure.
La Préface à l'Introduction à la Critique de l'économie politique
En 1859, alors qu'il travaillait assidûment à ce qui allait devenir Le Capital, Marx a rédigé un court texte qui résume de façon magistrale toute sa méthode historique. C'est la Préface à un travail intitulé Introduction à la Critique de l'économie politique qui a été largement supplanté ou, du moins, éclipsé par la parution du Capital. Après avoir expliqué de façon condensée l'évolution de sa pensée, depuis ses premières études de droit jusqu'à ses préoccupations actuelles concernant l'économie politique, Marx arrive au cœur de la question - au "fil conducteur" qui guide ses études. La théorie marxiste de l'histoire y est résumée de main de maître avec précision et clarté. Nous voulons donc examiner ce passage d'aussi près que possible afin de jeter les bases d'une véritable compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons. Nous publions en totalité en appendice le passage le plus crucial de ce texte mais ici, nous voulons examiner en détail chacune des parties qui le composent : "Jamais une société n'expire avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir ; jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les conditions matérielles de leur existence ne soient écloses dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre, car, à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que le problème lui-même ne surgit que là où les conditions matérielles pour le résoudre existent déjà ou, du moins, sont en voie de devenir. A grands traits, les modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne peuvent être qualifiés d'époques progressives de la formation économique de la société. Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme antagoniste du processus social de la production, antagoniste non pas dans le sens d'un antagonisme individuel, mais d'un antagonisme qui naît des conditions sociales d'existence des individus ; cependant les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles propres à résoudre cet antagonisme. Avec ce système social, s'achève donc la préhistoire de la société humaine."
Les rapports de production et les forces productives
"Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et à quoi correspondent des formes déterminées de conscience sociale. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de la vie sociale, politique et intellectuelle en général."
Selon la caricature qu'en font ses détracteurs, bourgeois conventionnels ou pseudo-radicaux, le marxisme serait une théorie mécaniste, "objectiviste", qui chercherait à réduire la complexité du processus historique à une série de lois d'airain sur lesquelles les êtres humains n'auraient aucun contrôle et qui les entraîneraient comme un rouleau compresseur vers un résultat final, déterminé par la fatalité. Lorsqu'on ne parle pas du marxisme comme d'une nouvelle forme de religion, on nous dit que la pensée marxiste serait "un produit typique du 19e siècle", de son adoration non critique pour la science, de ses illusions sur le progrès, et chercherait à appliquer les lois prévisibles et vérifiables de la nature - la physique, la chimie, la biologie - à l'évolution fondamentalement imprévisible de la vie sociale. On nous présente alors Marx comme l'auteur d'une théorie d'une évolution, inévitable et linéaire, entre un mode de production et un autre, menant inexorablement de la société primitive au communisme, en passant par l'esclavage, le féodalisme et le capitalisme. Et l'ensemble de ce processus serait d'autant plus déterminé que c'est un développement purement technique des forces productives qui en serait la cause.
Il est vrai qu'il a existé, au sein du mouvement ouvrier, des travers relevant d'une telle vision. Par exemple, durant la période de la Seconde Internationale, lorsque les partis ouvriers tendaient de plus en plus à "s'institutionnaliser", un processus théorique de ce type a eu lieu et s'est manifesté par une vulnérabilité vis-à-vis des conceptions dominantes sur le progrès et par une certaine tendance à considérer la "science" comme une chose en soi, détachée des rapports de classe réels de la société. L'idée qu'avait Kautsky du socialisme scientifique comme étant l'invention d'intellectuels qui devait être ensuite injectée dans les masses prolétariennes, constituait une des expressions de cette tendance. C'est encore plus vrai pour le 20e siècle, quand beaucoup de ce qui avait été le marxisme dans le passé, a été transformé en une apologie ouverte de l'ordre capitaliste, que des visions mécanistes du progrès historique ont été officiellement codifiées. Il n'y en a pas de démonstration plus claire que dans le livre de Staline d'apprentissage du "marxisme-léninisme", L'histoire du parti communiste de l'Union soviétique (version abrégée), où la théorie de la primauté des forces productives est considérée comme la vision matérialiste de l'histoire : "La deuxième particularité de la production, c'est que ses changements et son développement commencent toujours par le changement et le développement des forces productives et, avant tout, des instruments de production. Les forces productives sont, par conséquent, l'élément le plus mobile, le plus révolutionnaire de la production. D'abord se modifient et se développent les forces productives de la société ; ensuite, en fonction et en conformité de ces modifications, se modifient les rapports de production entre les hommes, leurs rapports économiques."
Cette conception de la primauté des forces productives coïncidait parfaitement avec le projet fondamental du stalinisme, "développer les forces productives" de l'URSS aux dépens du prolétariat dans le but de faire de la Russie une grande puissance mondiale. C'était entièrement dans l'intérêt du stalinisme de présenter l'accumulation d'industrie lourde qui a eu lieu dans les années 1930 comme autant d'étapes vers le communisme et d'empêcher toute recherche concernant les rapports sociaux qui sous-tendaient ce "développement" - l'exploitation féroce de la classe des travailleurs salariés, en d'autres termes, l'extraction de la plus-value dans le but d'accumuler le capital.
Cette démarche va à l'encontre du Manifeste communiste de Marx qui, dès ses premières lignes, présente la lutte de classe comme la force dynamique de l'évolution historique, en d'autres termes la lutte entre les différentes classes sociales ("Homme libre et esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître de jurande et compagnon") pour l'appropriation du surtravail. Elle est également niée sans détour dans les premières lignes de notre citation de la Préface : "Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, ..."
Ce sont les êtres humains en chair et en os qui "nouent des rapports déterminés", qui font l'histoire, pas des "forces productives", pas des machines, même s'il existe nécessairement un lien étroit entre les rapports de production et les forces productives qui leur "correspondent". Comme l'écrit Marx dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, dans un autre passage célèbre : "Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé."
Notons bien : dans des conditions qu'ils n'ont pas choisies, les hommes entrent dans des rapports déterminés "indépendants de leur volonté". Jusqu'à aujourd'hui tout au moins. Dans les conditions qui ont dominé toutes les formes de société ayant existé jusqu'à présent, les rapports sociaux que les hommes ont noués entre eux leur étaient flous, opaques, plus ou moins brouillés par des représentations mythiques et idéologiques ; de même, avec l'avènement de la société de classe, les formes de richesse que les hommes ont produites à travers ces rapports sociaux, tendent à leur échapper, à devenir une force étrangère située au dessus d'eux. De ce point de vue, les hommes ne sont pas le produit passif de leur environnement ni des outils qu'ils produisent pour satisfaire leurs besoins mais, en même temps, ils ne maîtrisent pas encore leurs propres forces sociales ni les produits de leur travail.
Être social et conscience sociale
"Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience... Lorsqu'on considère ces bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel - qu'on peut constater d'une manière scientifiquement rigoureuse - des conditions de production économiques et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref les formes idéologiques au sein desquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu'au bout. Pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement d'après la conscience qu'elle a d'elle-même. Il faut, au contraire, expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et les rapports de production."
En somme, les hommes font l'histoire, mais pas encore avec une pleine conscience de ce qu'ils font. De ce fait, lorsqu'on étudie l'évolution historique, on ne peut se contenter d'étudier les idées et les croyances d'une époque, ni d'examiner les modifications des systèmes politiques et juridiques ; pour saisir comment ces idées et ces systèmes évoluent, il est nécessaire de chercher les antagonismes sociaux fondamentaux qui les sous-tendent.
Répétons-le, cette démarche vis-à-vis de l'histoire n'écarte pas le rôle actif de la conscience, de la croyance et des institutions politiques et juridiques, ni la réalité de leur impact sur les rapports sociaux et le développement des forces productives. Par exemple, dans l'idéologie de la classe propriétaire d'esclaves de l'antiquité, le travail était considéré avec mépris ; cette attitude a directement joué un rôle en empêchant les avancées scientifiques considérables des penseurs grecs de se traduire dans le développement pratique de la science par des inventions ou par la création d'outils et de techniques qui auraient accru la productivité du travail. Mais ce qui constituait l'obstacle sous-jacent, c'était le mode de production esclavagiste lui-même : c'est l'existence de l'esclavage au cœur de la création de richesse dans la société classique qui était la source du mépris des propriétaires d'esclaves vis-à-vis du travail et le fait que, pour eux, accroître le surtravail, passait nécessairement par l'augmentation du nombre des esclaves.
Dans des écrits ultérieurs, Marx et Engels ont dû défendre leur démarche théorique tant vis-à-vis des critiques que vis-à-vis de leurs partisans qui interprétaient la formule "l'être social détermine la conscience sociale" de la façon la plus sommaire, prétendant, par exemple, que cela signifiait que tous les membres de la bourgeoisie étaient fatalement conduits à penser d'une certaine manière à cause de leur position économique dans la société, ou encore, de façon plus absurde, que tous les membres du prolétariat avaient obligatoirement une claire conscience de leurs intérêts de classe puisqu'il étaient assujettis à l'exploitation. C'est précisément ce genre de vision réductionniste qui a amené Marx à proclamer : "je ne suis pas marxiste". Il existe beaucoup de raisons qui font que, dans la classe ouvrière telle qu'elle est dans la "normalité" du capitalisme, seule une minorité reconnaît sa véritable situation de classe : non seulement à cause des différences qui existent dans l'histoire et dans la psychologie de chaque individu mais, de façon plus fondamentale, du fait du rôle exercé par l'idéologie dominante qui empêche les dominés de comprendre leurs propres intérêts de classe - une idéologie dominante dont la longévité des effets est bien plus étendue que la propagande immédiate de la classe dominante puisqu'elle est profondément intériorisée dans l'esprit des exploités. "La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants" écrit Marx, juste après le passage précédemment cité du 18 Brumaire à propos des hommes qui font l'histoire dans des conditions qu'ils n'ont pas choisies.
En fait, la comparaison entre l'idéologie d'une époque et ce que pense chaque individu de lui-même, loin d'exprimer du réductionnisme chez Marx, manifeste en réalité une profondeur psychologique : le psychologue qui ne montrerait aucun intérêt envers ce qu'un patient lui dit de ses sentiments et de ses convictions serait un bien mauvais thérapeute, mais il le serait tout autant s'il s'en tenait à la conscience immédiate que le patient a de lui-même et ignorait la complexité d'éléments cachés et inconscients dans son profil psychologique. Il en va de même pour l'histoire des idées ou l'histoire "politique". Elle peut nous apprendre beaucoup sur ce qui se passait à une époque donnée mais, en elle-même, elle ne nous apporte qu'un reflet distordu de la réalité. D'où le fait que Marx rejetait toutes les démarches historiques qui se limitaient à l'apparence des événements.
"Jusqu'ici, toute conception historique a, ou bien laissé complètement de côté cette base réelle de l'histoire, ou l'a considérée comme une chose accessoire, n'ayant aucun lien avec la marche de l'histoire. De ce fait, l'histoire doit toujours être écrite d'après une norme située en dehors d'elle. La production réelle de la vie apparaît à l'origine de l'histoire, tandis que ce qui est proprement historique apparaît comme séparé de la vie ordinaire, comme extra et supraterrestre. Les rapports entre les hommes et la nature sont de ce fait exclus de l'histoire, ce qui engendre l'opposition entre la nature et l'histoire. Par conséquent, cette conception n'a pu voir dans l'histoire que les grands événements historiques et politiques, des luttes religieuses et somme toute théoriques, et elle a dû, en particulier, partager pour chaque époque historique l'illusion de cette époque. Mettons qu'une époque s'imagine être déterminée par des motifs purement "politiques" ou "religieux", bien que "politique" et "religion" ne soient que des formes de ses moteurs réels : son historien accepte alors cette opinion. L'"imagination", la "représentation" que ces hommes déterminés se font de leur pratique réelle, se transforme en la seule puissance déterminante et active qui domine et détermine la pratique de ces hommes. Si la forme rudimentaire sous laquelle se présente la division du travail chez les Indiens et chez les Égyptiens suscite chez ces peuples un régime de castes dans leur État et dans leur religion, l'historien croit que le régime des castes est la puissance qui a engendré cette forme sociale rudimentaire." (L'idéologie allemande, chapitre : "L'idéologie en général et en particulier l'idéologie allemande")
Les époques de révolution sociale
Nous arrivons maintenant au passage de la Préface qui mène le plus clairement à comprendre la phase historique actuelle de la vie du capitalisme :
"A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. De formes de développement des forces productives, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. "
Ici encore, Marx montre que l'élément actif du processus historique est constitué par les rapports sociaux que nouent les êtres humains pour produire ce qui est nécessaire à la vie. Si on regarde le mouvement entre une forme sociale et une autre, il est évident qu'il y a une dialectique constante entre les périodes au cours desquelles ces rapports donnent naissance à un véritable développement des forces productives et les périodes pendant lesquelles ces mêmes rapports deviennent une entrave à un développement ultérieur.
Dans Le Manifeste communiste, Marx et Engels ont montré que les rapports de production capitalistes, surgissant du déclin de la société féodale, ont eu une action profondément révolutionnaire, balayant toutes les anciennes formes stagnantes, statiques de la vie économique et sociale qui leur faisaient obstacle. La nécessité d'entrer en concurrence et de produire aussi bon marché que possible a contraint la bourgeoisie à révolutionner constamment les forces productives ; la nécessité permanente de trouver de nouveaux marchés pour ses marchandises l'a forcée à conquérir toute la planète et à créer un monde à son image.
En 1848, il était clair que les rapports sociaux capitalistes constituaient une "forme de développement" et ne s'étaient jusqu'alors établis fermement que dans un ou deux pays. Cependant, la violence des crises économiques du premier quart du 19e siècle avait initialement conduit les auteurs du Manifeste à conclure que le capitalisme était déjà devenu une entrave au développement des forces productives et à considérer que la révolution communiste (ou au moins une transition rapide de la révolution bourgeoise à la révolution prolétarienne) était à l'ordre du jour.
"Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces productives déjà existantes elles-mêmes. Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société, - l'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentanée ; on dirait qu'une famine, une guerre d'extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance; l'industrie et le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. Les forces productives dont elle dispose ne favorisent plus le régime de la propriété bourgeoise ; au contraire, elles sont devenues trop puissantes pour ce régime qui alors leur fait obstacle ; et toutes les fois que les forces productives sociales triomphent de cet obstacle, elles précipitent dans le désordre la société bourgeoise tout entière et menacent l'existence de la propriété bourgeoise. Le système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir les richesses créées dans son sein." (Le Manifeste communiste ; chapitre : "Bourgeois et prolétaires")
Avec la défaite des révolutions de 1848 et l'énorme expansion du capitalisme mondial qui a eu lieu dans la période suivante, Marx et Engels ont revu ce point de vue même si, de façon compréhensible, ils étaient toujours impatients qu'arrive l'ère de révolution sociale attendue depuis longtemps, le jour du jugement pour l'arrogant ordre capitaliste mondial. Mais ce qui est central dans cette démarche, c'est la méthode : la reconnaissance qu'un ordre social ne peut être balayé tant qu'il n'est pas entré définitivement en conflit avec le développement des forces productives, précipitant toute la société dans une crise, non pas momentanée, pas une crise de jeunesse, mais dans toute une "ère" de crise, de convulsions, de révolution sociale ; en d'autres termes une crise de décadence.
En 1858, Marx revient une nouvelle fois sur la question : "La tâche propre de la société bourgeoise, c'est l'établissement du marché mondial, du moins dans ses grandes lignes, et d'une production fondée sur cette base. Comme le monde est rond, la colonisation de la Californie et de l'Australie et l'ouverture de la Chine et du Japon semblent parachever cette tâche. La question difficile à résoudre pour nous est la suivante : sur le continent, la révolution est imminente et prendra aussi immédiatement un caractère socialiste. Dans ce petit coin, ne va-t-elle pas être nécessairement écrasée étant donné que sur un secteur bien plus vaste, le mouvement de la société bourgeoise est encore ascendant ?" (Lettre à Engels, à Manchester, 8 octobre 1858)
Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est précisément la question qu'il pose : quels sont les critères historiques pour déterminer le passage à une époque de révolution sociale dans le capitalisme ? Une révolution communiste peut-elle être victorieuse tant que le capitalisme est encore globalement un système en expansion ? Marx se trompait en pensant que la révolution en Europe était imminente. En fait, dans une lettre à Vera Zassoulitch sur le problème de la Russie, écrite en 1881, il semble avoir à nouveau modifié son point de vue : "Le système capitaliste a dépassé son apogée à l'ouest, approchant du moment où il ne sera plus qu'un système social régressif" (2e brouillon de lettre à Vera Zassoulitch). Ainsi, plus de 20 ans après 1858, le système ne fait encore qu'"approcher" sa période de "régression" y compris dans les pays avancés. Encore une fois, ces réflexions expriment les difficultés rencontrées par Marx dans la situation historique où il vivait. Il s'est avéré que le capitalisme avait encore devant lui une dernière phase de développement, la phase de l'impérialisme, qui allait déboucher dans une période de convulsions à l'échelle mondiale, indiquant que le système dans son ensemble, et non pas une partie de celui-ci, avait plongé dans sa crise de sénilité. Cependant, les préoccupations de Marx dans ces lettres montrent le sérieux avec lequel il traitait le problème : pour fonder une perspective révolutionnaire, il fallait savoir si le capitalisme avait ou non atteint cette étape.
L'abandon d'outils usés : la nécessité de périodes de décadence
"Jamais une société n'expire avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir ; jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les conditions matérielles de leur existence ne soient écloses dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre, car, à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que le problème lui-même ne surgit que là où les conditions matérielles pour le résoudre existent déjà ou, du moins, sont en voie de devenir."
Dans ce passage, Marx insiste encore sur l'importance de fonder les perspectives de révolution sociale non pas sur une aversion purement morale - que tout système d'exploitation inspire - mais sur l'inaptitude de ce dernier à développer la productivité du travail et, de façon générale, la capacité des hommes à satisfaire leurs besoins matériels.
L'argument selon lequel une société ne peut expirer tant qu'elle n'a pas déployé toutes ses capacités de développement, a été utilisé pour contredire l'idée selon laquelle le capitalisme serait entré en décadence, puisque celui-ci a connu une croissance depuis 1914 ; on ne peut donc dire qu'il est décadent tant que cette croissance n'a pas pris fin. Des théories comme celle de Trotsky dans les années 1930 qui affirmait que les forces productives avaient cessé de croître, ont semé beaucoup de confusion. Comme le capitalisme à l'époque était en proie à la plus grande dépression jamais connue, ce point de vue semblait plausible ; de plus, l'idée selon laquelle la décadence est caractérisée par un arrêt complet du développement des forces productives et même par une régression de celles-ci peut, dans une certaine mesure s'appliquer aux précédentes sociétés de classe dans lesquelles les crises étaient toujours le résultat d'une sous-production, d'une incapacité absolue à produire suffisamment pour faire face aux besoins fondamentaux de la société (et, même dans ces sociétés, le processus de déclin a connu des phases de reprise apparente et même de croissance vigoureuse). Mais le problème fondamental contenu dans ce point de vue est qu'il ignore la réalité fondamentale du capitalisme - la nécessité de la croissance pour l'accumulation, pour la reproduction élargie de la valeur. Comme nous le verrons, dans la décadence de ce système, cette nécessité ne peut être remplie qu'en trichant de plus en plus avec les lois-mêmes de la production capitaliste mais, comme nous le verrons aussi, le moment où l'accumulation capitaliste est totalement impossible d'un point de vue purement économique ne sera probablement jamais atteint. Comme Rosa Luxemburg l'a mis en évidence dans La critique des critiques, "il s'agit à vrai dire d'une fiction théorique, pour la raison précise que l'accumulation du capital n'est pas seulement un processus économique mais un processus politique." (2e partie, chapitre 5) De plus, Marx avait déjà ébauché l'idée d'une non identité entre phase de déclin du capitalisme et la stagnation des forces productives : "Le point d'épanouissement le plus haut de cette base elle-même (la fleur en laquelle la plante se transforme ; mais c'est toujours la même base, cette plante devenue fleur ; et donc celle-ci se fane après la floraison et c'est la conséquence de la floraison) constitue le moment où elle est elle-même arrivée à son terme, développée, en une forme correspondant au plus haut développement des forces productives, et donc au plus grand développement des individus. Dès que ce point est atteint, la suite de son développement apparaît comme un déclin et le nouveau développement part d'une nouvelle base" (Gründrisse, cahier V, "Différence entre le mode de production capitaliste et tous les modes antérieurs" ; souligné par nous)
Il est certain que le capitalisme a développé des forces productives suffisantes pour que surgisse un mode de production nouveau et supérieur. En fait, à partir du moment où les conditions matérielles du communisme sont développées, le système entre dans sa phase de déclin. En créant une économie mondiale - fondamentale pour le communisme - le capitalisme a aussi atteint les limites d'un développement sain. La décadence du capitalisme ne s'exprime donc pas par un arrêt complet des forces productives mais par une série de convulsions croissantes et de catastrophes qui démontrent l'absolue nécessité de son renversement.
Le principal point que Marx souligne ici, c'est la nécessité d'une période de décadence. Les hommes ne font pas la révolution pour se faire plaisir mais parce qu'ils y sont contraints par la nécessité, par les souffrances intolérables qu'apporte la crise du système. De même, leur conscience est profondément attachée à ce que les choses ne changent pas et ce n'est que le conflit social croissant entre cette idéologie et la réalité matérielle qu'ils affrontent qui poussera les hommes à mettre en question le système existant. C'est d'autant plus vrai pour la révolution prolétarienne qui requiert pour la première fois une transformation consciente de tous les aspects de la vie sociale.
On accuse quelquefois les révolutionnaires de penser que "le pire est le mieux" parce qu'ils considèreraient que plus les masses soufrent, plus elles seront disposées à être révolutionnaires. Mais il n'y a pas de lien mécanique entre la souffrance et la conscience révolutionnaire. La souffrance contient une dynamique qui mène à la réflexion et à la révolte, mais elle contient aussi le danger d'émousser et d'épuiser la capacité de révolte, et elle peut, tout autant, mener à adopter des formes de révolte tout à fait fausses comme la montée actuelle du fondamentalisme islamique le montre. Une période de décadence est nécessaire pour convaincre la classe ouvrière qu'elle doit construire une nouvelle société mais, d'un autre côté, une période de décadence indéfiniment prolongée peut menacer la possibilité même de la révolution et entraîner le monde dans une spirale de désastres qui ne font que détruire les forces productives accumulées et, en particulier, la force productive la plus importante de toutes, le prolétariat. C'est en fait le danger que pose la phase finale de la décadence, cette phase que nous appelons décomposition et qui a, selon nous, déjà commencé.
Le problème de la société pourrissant sur pied est particulièrement aigu dans le capitalisme car, contrairement aux précédents systèmes, la maturation des conditions matérielles d'une nouvelle société - le communisme - ne coïncide pas avec le développement de nouvelles formes économiques au sein de l'ancienne société. Pendant le déclin de la société romaine esclavagiste antique, le développement de domaines féodaux était souvent mis en œuvre par d'anciens propriétaires d'esclaves qui s'étaient éloignés de l'État central afin d'éviter le poids écrasant des impôts. Pendant la décadence féodale, la nouvelle classe bourgeoise est née dans les villes - qui ont toujours constitué les centres commerciaux de l'ancien système - et a jeté les bases d'une nouvelle économie basée sur la manufacture et le commerce. L'émergence de ces nouvelles formes constituait à la fois une réponse à la crise de l'ordre ancien et un facteur qui poussait activement à la disparition de celui-ci.
Avec le déclin du capitalisme, il est certain que les forces productives qu'il a mises en mouvement entrent de plus en plus en conflit avec les rapports sociaux dans lesquels il opère. Ceci s'exprime par dessus tout dans le contraste entre l'énorme capacité productive du capitalisme et son incapacité à absorber toutes les marchandises qu'il produit : en un mot, dans la crise de surproduction. Mais, tandis que cette crise rend l'abolition des rapports marchands de plus en plus urgente et contraint à enfreindre de plus en plus les lois de la production marchande, cela n'aboutit pas dans l'émergence spontanée de formes économiques communistes. Contrairement aux classes révolutionnaires précédentes, la classe ouvrière n'a pas de propriété, c'est une classe exploitée et elle ne peut construire son propre ordre économique et social au sein de l'ancienne société. Le communisme ne peut qu'être le résultat d'une lutte de plus en plus consciente contre l'ancien ordre, menant au renversement politique de la bourgeoisie comme condition de la transformation communiste de la vie économique et sociale. Si le prolétariat ne parvient pas à hisser ses luttes aux niveaux élevés de conscience et d'organisation nécessaires, les contradictions du capitalisme n'amèneront pas à l'avènement d'un ordre supérieur mais "à la ruine mutuelle des classes en présence".
Gerrard
Appendice
Préface à l'Introduction à la Critique de l'économie politique
(Totalité du passage cité) :
"Le résultat général auquel j'arrivai et qui, une fois acquis, servit de fil conducteur à mes études, peut brièvement se formuler ainsi. Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et auquel correspondent des formes déterminées de conscience sociale. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de la vie sociale, politique et intellectuelle en général.
Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. De formes de développement des forces productives, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale.
Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement tout cet énorme édifice.
Lorsqu'on considère ces bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel - qu'on peut constater d'une manière scientifiquement rigoureuse - des conditions de production économiques et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref les formes idéologiques au sein desquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu'au bout. Pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement d'après la conscience qu'elle a d'elle-même. Il faut, au contraire, expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et les rapports de production.
Jamais une société n'expire avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir ; jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les conditions matérielles de leur existence ne soient écloses dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre, car, à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que le problème lui-même ne surgit que là où les conditions matérielles pour le résoudre existent déjà ou du moins sont en voie de devenir. A grands traits, les modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne peuvent être qualifiés d'époques progressives de la formation économique de la société. Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme antagoniste du processus social de la production, antagoniste non pas dans le sens d'un antagonisme individuel, mais d'un antagonisme qui naît des conditions sociales d'existence des individus ; cependant les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles propres à résoudre cet antagonisme. Avec ce système social, s'achève donc la préhistoire de la société humaine."
Questions théoriques:
- Décadence [4]
Le communisme : l'entrée de l'humanité dans sa véritable histoire (IX) . Les problèmes de la période de Transition
- 2332 lectures
Quelle que soit la réponse à ce problème, le texte de Mitchell soulève une série de questions importantes sur la politique économique du prolétariat ; en particulier, comment surmonter la domination de la production sur la consommation qui caractérise les rapports sociaux capitalistes, et comment éliminer la loi de la valeur qui leur est intimement liée. Nous ne traiterons pas ces questions ici mais nous y reviendrons ultérieurement dans un autre article qui cherchera à étudier plus profondément les divergences entre les communistes membres de la Gauche italienne et ceux de la Gauche hollandaise, puisque ce débat reste, jusqu'à aujourd'hui, un point de départ fondamental pour aborder le problème de la façon dont la classe ouvrière peut mettre fin à l'accumulation capitaliste et créer un mode de production capable de répondre aux véritables besoins de l'Humanité.
Bilan n°38 (décembre 1936 - janvier 1937)
Il nous reste à examiner quelques normes de gestion économiques qui, d'après nous, conditionnent le lien du parti avec les masses, base du renforcement de la dictature du prolétariat.
Il est vrai, pour tout système de production, qu'il ne peut se développer que sur la base de la reproduction élargie, c'est-à-dire, de l'accumulation de richesses. Mais un type de société se manifeste moins par ses formes et manifestations extérieures que par son contenu social, par les mobiles qui dominent dans la production, c'est-à-dire, par les rapports de classe. Dans l'évolution historique, les deux processus, interne et externe, se meuvent d'ailleurs en une constante contradiction. Le développement capitaliste a démontré à l'évidence que la progression des forces productives engendrait en même temps son contraire, le recul des conditions matérielles du prolétariat, phénomène qui se traduisit par la contradiction entre la valeur d'échange et la valeur d'usage, entre la production et la consommation. Nous avons déjà indiqué ailleurs que le système capitaliste ne fut pas un système progressiste par nature, mais par nécessité (sous l'aiguillon de l'accumulation et de la concurrence). Marx souligna ce contraste en disant que le "développement de la force productive n'a d'importance que dans la mesure où il accroît le surtravail de la classe ouvrière et non pas dans la mesure où il diminue le temps nécessaire à la production matérielle." (Le Capital, Tome X)
En partant de la constatation valable pour tous les types de sociétés, à savoir que le surtravail est inévitable, le problème se concentre donc essentiellement sur le mode d'appropriation (...) du surtravail, la masse de surtravail et sa durée, le rapport de cette masse avec le travail total, enfin le rythme de son accumulation. Et immédiatement, nous pouvons mettre en évidence cette autre remarque de Marx que "la véritable richesse de la société et la possibilité d'un élargissement continu du procès de reproduction ne dépend pas de la durée du surtravail, mais de sa productivité et des conditions, plus ou moins avantageuses où cette productivité travaille." (Le Capital, Tome XIV.) Et il ajoute que la condition fondamentale pour l'instauration du "régime de la liberté", c'est la réduction de la journée de travail.
Ces considérations nous permettent d'apercevoir la tendance qui doit être imprimée à l'évolution de l'économie prolétarienne. Elles nous autorisent également à rejeter la conception qui voit la preuve absolue du "socialisme" dans l'accroissement des forces productives. Elle fut non seulement défendue par le Centrisme, mais aussi par Trotski : "le libéralisme fait semblant de ne pas voir les énormes progrès économiques du régime soviétique, c'est-à-dire les preuves concrètes des avantages incalculables du socialisme. Les économistes des classes dépossédées passent tout simplement sous silence les rythmes de développement industriel sans précédent dans l'histoire mondiale." (Lutte des classes, juin 1930)
Nous l'avons déjà mentionné au début de ce chapitre, cette question de "rythme" resta au premier plan des préoccupations de Trotski et de son Opposition alors qu'elle ne répond en rien à la mission du prolétariat, laquelle consiste à modifier le mobile de la production et non à accélérer son rythme sur la misère du prolétariat, tout comme cela se passe dans le capitalisme. Le prolétariat a d'autant moins de raisons de s'attacher au facteur "rythme" que, d'une part, il ne conditionne en rien la construction du socialisme, puisque celui-ci est d'ordre international et que, d'autre part, son néant sera révélé par l'apport de la haute technique capitaliste à l'économie socialiste mondiale.
Réorienter la production au service de la consommation
Quand nous posons comme tâche économique primordiale la nécessité de changer le mobile de la production, c'est-à-dire de l'orienter vers les besoins de la consommation, nous en parlons évidemment comme d'un procès et non comme d'un produit immédiat de la Révolution. La structure même de l'économie transitoire, telle que nous l'avons analysée, ne peut engendrer cet automatisme économique, car la survivance du "droit bourgeois" laisse subsister certains rapports sociaux d'exploitation et la force de travail conserve encore, dans une certaine mesure, le caractère de marchandise. La politique du parti, stimulée par l'activité revendicative des ouvriers, au travers de leurs organisations syndicales doit précisément tendre à abolir la contradiction entre force de travail et travail, qui fut développée à l'extrême par le capitalisme. En d'autres termes, à l'usage capitaliste de la force de travail en vue de l'accumulation de capital doit se substituer l'usage "prolétarien" de cette force de travail vers des besoins purement sociaux, ce qui favorisera la consolidation politique et économique du prolétariat.
Dans l'organisation de la production, l'État prolétarien doit donc s'inspirer, avant tout, des besoins des masses, développer les branches productives qui peuvent y répondre, en fonction évidemment des conditions spécifiques et matérielles qui prévalent dans l'économie envisagée.
Si le programme économique élaboré reste dans le cadre de la construction de l'économie socialiste mondiale, par conséquent reste relié à la lutte internationale des classes, l'État prolétarien pourra d'autant mieux se confiner dans sa tâche de développer la consommation. Par contre, si ce programme prend un caractère autonome visant directement ou indirectement au "socialisme national", une part croissante du surtravail s'engloutira dans la construction d'entreprises qui, dans l'avenir, ne trouveront pas leur justification dans la division internationale du travail ; par contre ces entreprises seront appelées inévitablement à devoir produire des moyens de défense pour "la société socialiste" en construction. Nous verrons que c'est là précisément le sort qui échut à la Russie soviétique.
Il est certain que toute amélioration de la situation matérielle des masses prolétariennes dépend en premier lieu de la productivité du travail, et celle-ci du degré technique des forces productives, par conséquent de l'accumulation. Elle est liée, en second lieu, au rendement du travail correspondant à l'organisation et à la discipline au sein du procès du travail. Tels sont les éléments fondamentaux, tels qu'ils existent aussi dans le système capitaliste, avec cette caractéristique que là les résultats concrets de l'accumulation sont détournés de leur destination humaine au profit de l'accumulation en "soi". La productivité du travail ne se traduit pas en objets de consommation, mais en capital.
Il serait vain de se dissimuler que le problème est loin d'être résolu par la proclamation d'une politique tendant à élargir la consommation. Mais il faut commencer par l'affirmer parce qu'il s'agit d'une directive majeure qui s'oppose irréductiblement à celle poussant au premier plan l'industrialisation et sa croissance accélérée et sacrifiant inévitablement une ou plusieurs générations de prolétaires (le Centrisme1 l'a déclaré ouvertement). Or, un prolétariat "sacrifié", même pour des objectifs qui peuvent paraître correspondre à son intérêt historique (la réalité en Russie a démontré qu'il n'en était cependant rien) ne peut constituer une force réelle pour le prolétariat mondial ; il ne peut que s'en détourner, sous l'hypnose des objectifs nationaux.
Il y a, il est vrai, l'objection qu'il ne peut y avoir élargissement de la consommation sans accumulation, et d'accumulation sans un prélèvement plus ou moins considérable sur la consommation. Le dilemme sera d'autant plus aigu qu'il correspondra à un développement restreint des forces productives et à une médiocre productivité du travail. C'est dans ces pires conditions que le problème se posa en Russie et qu'une des manifestations les plus dramatiques en fut le phénomène des "ciseaux".
Toujours sur la base des considérations internationalistes que nous avons développées, il faut donc affirmer (si l'on ne veut pas tomber dans l'abstraction) que les tâches économiques du prolétariat, dans leur diminution historique, sont primordiales. Les camarades de Bilan, animés par la juste préoccupation de mettre en évidence le rôle de l'État prolétarien sur le terrain mondial de la lutte des classes, ont singulièrement rétréci l'importance du problème en question, en considérant que "les domaines économique et militaire2 ne pourront être qu'accessoires et de détail dans l'activité de l'État prolétarien, alors qu'il sont d'un ordre essentiel pour une classe exploiteuse" (Bilan, p. 612). Nous le répétons, le programme est déterminé et limité par la politique mondiale de l'État prolétarien, mais cela étant établi, il reste que le prolétariat n'aura pas de trop de toute sa vigilance et de toute son énergie de classe pour seulement essayer de trouver la solution essentielle à ce redoutable problème de la consommation qui conditionnera quand même son rôle de "simple facteur de la lutte du prolétariat mondial".
Les camarades de Bilan commettent, d'après nous, une autre erreur 3 en ne faisant pas la distinction entre une gestion tendant à la construction du "socialisme" et une gestion socialiste de l'économie transitoire, en déclarant notamment que "loin de pouvoir envisager la possibilité de la gestion socialiste de l'économie dans un pays (...), nous devons commencer par proclamer l'impossibilité même de cette gestion socialiste." Mais, qu'est-ce qu'une politique qui poursuit le relèvement des conditions de vie des ouvriers si ce n'est une politique de gestion véritablement socialiste visant précisément à renverser le processus de la production par rapport au processus capitaliste. Dans la période de transition, il est parfaitement possible de faire surgir ce nouveau cours économique d'une production s'effectuant pour les besoins, alors même que les classes survivent.
Mais il reste que le changement du mobile de la production ne dépend pas uniquement de l'adoption d'une politique juste, mais surtout de la pression sur l'économie des organisations du prolétariat comme de l'adaptation de l'appareil productif à ses besoins. En outre, l'amélioration des conditions de vie ne tombe pas du ciel. Elle est fonction du développement de la capacité productive, qu'il soit la conséquence de l'augmentation de la masse de travail social, d'un rendement plus grand du travail, résultant de sa meilleure organisation ou encore de la plus grande productivité du travail donné par des moyens de production plus puissants.
Pour ce qui est de la masse de travail social - si nous supposons invariable le nombre d'ouvriers occupés - nous avons dit qu'elle est donnée par la durée et l'intensité d'emploi de la force de travail. Or ce sont justement ces deux factions alliées à la baisse de valeur de la force de travail comme effet de sa plus grande productivité, qui déterminent le degré d'exploitation imposé au prolétariat dans le régime capitaliste.
Dans la phase transitoire, la force de travail conserve encore, il est vrai, son caractère de marchandise dans la mesure où le salaire se confond avec la valeur de la force-travail ; par contre elle dépouille ce caractère dans la mesure où le salaire se rapproche de l'équivalent du travail total fourni par l'ouvrier (abstraction étant faite du surtravail nécessaire aux besoins sociaux).
A l'encontre de la politique capitaliste, une véritable politique prolétarienne, pour augmenter les forces productives, ne peut certainement pas se fonder sur le surtravail qui proviendrait d'une plus grande durée ou d'une plus grande intensité du travail social, qui, sous sa forme capitaliste, constitue la plus-value absolue. Elle se doit, au contraire, de fixer des normes de rythme et de durée de travail compatibles avec l'existence d'une véritable dictature du prolétariat et elle ne peut que présider à une organisation plus rationnelle du travail, à l'élimination du gaspillage des activités sociales, bien que dans ce domaine les possibilités pour augmenter la masse de travail utile soient vite épuisées.
Dans ces conditions, l'accumulation "prolétarienne" doit trouver sa source essentielle dans le travail devenu disponible par une technique plus élevée.
Cela signifie que l'accroissement de la productivité du travail pose l'alternative suivante : ou bien une même masse de produits (ou valeurs d'usage) détermine une diminution du volume total de travail consommé, ou bien si ce dernier reste invariable (ou même s'il diminue suivant l'importance du progrès technique réalisé) la quantité de produits à répartir augmentera. Mais dans les deux cas, une diminution du surtravail relatif (relatif par rapport au travail strictement nécessaire à la reproduction de la force de travail) peut parfaitement se conjuguer avec une plus grande consommation et se traduire par conséquent par une hausse réelle des salaires et non pas fictive comme dans le capitalisme. C'est dans l'utilisation nouvelle de la productivité qu'apparaît la supériorité de la gestion prolétarienne sur la gestion capitaliste plutôt qu'au travers de la compétition entre les prix de revient, base sur laquelle le prolétariat doit être inévitablement battu, comme nous l'avons déjà indiqué.
C'est en effet le développement de la productivité du travail qui précipite le capitalisme dans sa crise de décadence où, d'une façon permanente (et plus seulement au cours de crises cycliques), la masse des valeurs d'usage s'oppose à la masse des valeurs d'échange. La bourgeoisie est débordée par l'immensité de sa production et elle ne peut l'écouler vers les immenses besoins insatisfaits, sous menace de suicide.
Dans la période de transition, la productivité du travail est certes encore loin de répondre à la formule "à chacun selon ses besoins", mais cependant la possibilité de pouvoir l'utiliser intégralement, à des fins humaines, renverse les données du problème social. Marx avait déjà établi qu'avec la production capitaliste, la productivité du travail reste bien au dessous du maximum théorique. Par contre, après la révolution, il devient possible de réduire, puis de supprimer l'antagonisme capitaliste entre le produit et sa valeur si la politique prolétarienne tend non pas à ramener le salaire à la valeur de la force travail - méthode capitaliste qui détourne le progrès technique au profit du capital - mais à l'élever de plus en plus au dessus de cette valeur, sur la base même de la productivité développée.
Il est évident qu'une certaine fraction du surtravail relatif ne peut retourner directement à l'ouvrier, en vertu des nécessités mêmes de l'accumulation sans laquelle il n'y a pas de progrès technique possible. Et encore une fois se repose le problème du rythme et du taux de l'accumulation. Et s'il parait se résoudre à une question de mesure, l'arbitraire sera en tout cas exclu sur la base principielle délimitant les tâches économiques du prolétariat, telle que nous l'avons définie.
La détermination du rythme de l'accumulation
D'autre part, il va de soi que la détermination du taux de l'accumulation relève du centralisme économique et non pas de décisions des producteurs dans leurs entreprises, suivant l'opinion des internationalistes hollandais (p. 116 de leur ouvrage cité). Ils sont d'ailleurs fort peu convaincus de la valeur pratique d'une telle solution, puisqu'ils la font suivre immédiatement de cette considération que le "taux d'accumulation ne peut être laissé au libre jugement des entreprises séparées et c'est le Congrès général des conseils d'entreprises qui déterminera la norme obligatoire", formule qui répond somme toute à du centralisme déguisé.
Si nous nous reportons maintenant à ce qui s'est réalisé en Russie, alors éclate toute l'imposture du Centrisme faisant découler la suppression de l'exploitation du prolétariat de la collectivisation des moyens de production. On enregistre ce phénomène historique que le processus de l'économie soviétique et celui de l'économie capitaliste, tout en partant de bases différentes, ont fini par confluer et par se diriger ensemble vers la même issue : la guerre impérialiste. Tous deux se déroulent sur le fond d'un prélèvement croissant de plus-value qui ne retourne pas à la classe ouvrière. En URSS, le procès de travail est capitaliste par sa substance, sinon par ses aspects sociaux et les rapports de production. On y pousse à l'augmentation de la masse de plus-value absolue, obtenue par l'intensification du travail qui a pris les formes du "stakhanovisme". Les conditions matérielles des ouvriers ne sont nullement solidaires des améliorations techniques et du développement des forces productives, et en tout cas la participation relative du prolétariat au patrimoine social n'augmente pas, mais diminue ; phénomène analogue à celui qu'engendre constamment le système capitaliste, même dans ses plus belles périodes de prospérité. Nous manquons d'éléments pour établir dans quelle mesure est réel l'accroissement de la part absolue des ouvriers.
En outre, il se pratique une politique d'abaissement des salaires qui tend à substituer des ouvriers non qualifiés (provenant de l'immense réservoir de la paysannerie) aux prolétaires qualifiés qui sont en même temps les plus conscients.
A la question de savoir où s'engloutit cette masse énorme de surtravail, on donnera la réponse facile qu'elle va en majeure partie à la "classe" bureaucratique. Mais une telle explication est démentie par l'existence même d'un énorme appareil productif qui reste bel et bien propriété collective et au regard duquel les beefsteaks, automobiles et villas des bureaucrates font piètre figure !! Les statistiques officielles et autres aussi bien que les enquêtes, confirment cette disproportion énorme - qui va croissant - entre la production des moyens de production (outillage, bâtiments, travaux publics, etc.) et celle des objets de consommation destinés à la "bureaucratie" comme à la masse ouvrière et paysanne, même en y englobant la consommation sociale. S'il est vrai que c'est la bureaucratie qui, en tant que classe, dispose de l'économie et de la production et s'approprie le surtravail, on n'explique pas comment ce dernier se transforme dans sa plus grande partie en richesse collective et non en propriété privée. Ce paradoxe ne peut être expliqué qu'en découvrant pourquoi cette richesse, tout en restant dans la communauté soviétique, s'oppose à celle-ci, par sa destination. Signalons qu'aujourd'hui un phénomène semblable se déroule au sein de la société capitaliste, c'est-à-dire que la majeure partie de la plus-value ne s'écoule pas dans la poche des capitalistes mais s'accumule en biens qui ne restent propriété privée que du point de vue purement juridique. La différence, c'est qu'en URSS le phénomène ne prend pas un caractère proprement capitaliste. Les deux évolutions partent également d'une origine différente : en URSS, elle ne surgit pas d'un antagonisme économique, mais politique, d'une scission entre le prolétariat russe et le prolétariat international ; elle se développe sous le drapeau de la défense du "socialisme national" et de son intégration au mécanisme du capitalisme mondial. Par contre, dans les pays capitalistes, l'évolution se déplace sous le signe de la décadence de l'économie bourgeoise. Mais les deux développements sociaux aboutissent à un objectif commun : la construction d'économies de guerre (les dirigeants soviétiques se vantent d'avoir édifié la plus formidable machine de guerre du monde). Telle nous parait être la réponse à "l'énigme russe". Cela explique pourquoi la défaite de la Révolution d'Octobre ne provient pas du bouleversement du rapport de force entre les classes, à l'intérieur de la Russie, mais sur l'arène internationale.
Examinons quelle est la politique qui orienta le cours de la lutte des classes vers la guerre impérialiste plutôt que vers la révolution mondiale.
L'exploitation des ouvriers russes au service de l'économie de guerre
Pour certains camarades, nous l'avons déjà dit, la révolution russe ne fut pas prolétarienne et son évolution réactionnaire était préjugée du fait qu'elle fut réalisée par un prolétariat culturellement arriéré (bien que par sa conscience de classe, il se plaça à l'avant-garde du prolétariat mondial) qui, par surcroît, dut diriger un pays retardataire. Nous nous bornerons à opposer une telle attitude fataliste à celle de Marx, vis-à-vis de la Commune : bien que celle-ci exprimât une immaturité historique du prolétariat à prendre le pouvoir, Marx lui attribue cependant une portée immense et il y puisa des enseignements féconds et progressifs dont s'inspirèrent précisément les bolcheviks en 1917. Tout en agissant de même vis-à-vis de la révolution russe, nous n'en déduisons pas pour cela que les futures révolutions seront la reproduction photographique d'octobre, mais nous disons qu'octobre, par ses traits fondamentaux se retrouvera dans ces révolutions, en nous souvenant uniquement de ce que Lénine entendait par "valeur internationale de la révolution russe" (dans La maladie infantile du communisme). Un marxiste ne "refait" évidemment pas l'histoire mais il l'interprète pour forger des armes théoriques au prolétariat, pour lui éviter la répétition d'erreurs et lui faciliter le triomphe final sur la bourgeoisie. Rechercher les conditions qui auraient placé le prolétariat russe dans la possibilité de vaincre définitivement c'est donner à la méthode marxiste d'investigation toute sa valeur parce que c'est permettre d'ajouter une pierre à l'édifice du matérialisme historique.
S'il est vrai que le reflux de la première vague révolutionnaire contribua à "isoler" temporairement le prolétariat russe, nous croyons que ce n'est pas là qu'il faut chercher la cause déterminante de l'évolution de l'URSS, mais dans l'interprétation qui fut donnée par la suite des événements de cette époque et de la fausse perspective qui en découla, quant à l'évolution du capitalisme, à l'époque des guerres et des révolutions. La conception de la "stabilisation" du capitalisme engendra naturellement par la suite la théorie du "socialisme en un seul pays" et par voie de conséquence la politique de "défense" de l'URSS.
Le prolétariat international devint un instrument de l'État prolétarien pour sa défense contre une agression impérialiste, tandis que la révolution mondiale passait à l'arrière plan en tant qu'objectif concret. Si Boukharine parle encore de celle-ci en 1925, c'est parce que "la révolution mondiale a pour nous cette importance, qu'elle représente la seule garantie contre les interventions, contre une nouvelle guerre".
Il s'élabora ainsi une théorie de la "garantie contre les interventions" dont l'IC [Internationale communiste] s'empara pour devenir l'expression des intérêts particuliers de l'URSS et non plus des intérêts de la révolution mondiale. La "garantie" on ne la chercha plus dans la liaison avec le prolétariat international mais dans la modification du caractère et du contenu des rapports de l'État prolétarien avec les États capitalistes. Le prolétariat mondial restait seulement une force d'appoint pour la défense du "socialisme national".
Pour ce qui est de la NEP [Nouvelle Économie politique], en nous basant sur ce que nous avons dit précédemment, nous ne pensons pas qu'elle offrit un terrain spécifique pour une inévitable dégénérescence, bien qu'elle détermina une recrudescence très grande des velléités capitalistes au sein de la paysannerie notamment, et que par exemple, sous le signe du centrisme, l'alliance (smytchka) avec les paysans pauvres dans laquelle Lénine voyait un moyen pour raffermir la dictature prolétarienne, devint un but, en même temps qu'une union avec la paysannerie moyenne et le koulak.
Contrairement à l'opinion des camarades de Bilan, nous ne croyons pas non plus que l'on peut inférer des déclarations de Lénine basées sur la NEP, qu'il aurait préconisé une politique affranchissant l'évolution économique russe du cours de la révolution mondiale.
Au contraire, pour Lénine, la NEP signifiait une politique d'attente, de répit, jusqu'à la reprise de la lutte internationale des classes : "quand nous adoptons une politique qui doit durer de longues années, nous n'oublions pas un seul instant que la révolution internationale, la rapidité et les conditions de son développement peuvent tout modifier". Pour lui il s'agissait de rétablir un certain équilibre économique, moyennant rançon aux forces capitalistes (sans lequel la dictature croulait), mais non de "faire appel à la collaboration des classes ennemies en vue de la construction des fondements de l'économie socialiste". (Bilan, p. 724.)
Tout comme il nous paraît injuste de faire de Lénine un partisan du "socialisme en un seul pays" sur la base d'un document apocryphe.
Par contre, l'opposition russe "trotskiste" contribue à accréditer l'opinion que la lutte se cristallisait entre les États capitalistes et l'État soviétique. En 1927, elle considérait comme inévitable la guerre des impérialistes contre l'URSS juste au moment où l'I.C. arrachait les ouvriers de leurs positions de classe pour les lancer sur le front de la défense de l'URSS en même temps qu'elle présidait à l'écrasement de la révolution chinoise. Sur cette base, l'opposition s'engagea sur la voie de la préparation de l'URSS - "bastion du socialisme" - à la guerre. Cette position équivalait à sanctionner théoriquement l'exploitation des ouvriers russes en vue de la construction d'une économie de guerre (plans quinquennaux). L'Opposition alla même jusqu'à agiter le mythe de l'unité à "tout prix" du parti, comme condition de la victoire militaire de l'URSS. En même temps elle était équivoque sur la lutte "pour la paix" (!) en considérant que l'URSS devait chercher à "retarder la guerre", à payer même une rançon pendant qu'il fallait "préparer au maximum toute l'économie, le budget, etc. en prévision d'une guerre" et considérer la question de l'industrialisation comme décisive pour assurer les ressources techniques indispensables pour la défense (Plate-forme de l'Opposition).
Par la suite Trotski, dans sa Révolution permanente, reprit cette thèse de l'industrialisation sur le rythme "le plus rapide", qui représentait, paraît-il une garantie contre les "menaces du dehors" en même temps qu'elle aurait favorisé l'évolution du niveau de vie des masses. Nous savons d'une part, que la "menace du dehors" se réalisa, non par la "croisade" contre l'URSS, mais par l'intégration de celle-ci au front de l'impérialisme mondial ; d'autre part, que l'industrialisme ne coïncida nullement avec une meilleure existence du prolétariat, mais avec son exploitation la plus effrénée, sur la base de la préparation à la guerre impérialiste.
Dans la prochaine révolution, le prolétariat vaincra, indépendamment de son immaturité culturelle et de la déficience économique, pourvu qu'il mise, non sur la "construction du socialisme", mais sur l'épanouissement de la guerre civile internationale.
MITCHELL.
1 Il faut noter qu'à l'époque où Bilan a publié cette contribution, l'ensemble de la Gauche italienne qualifiait encore la conception stalinienne qui guidait la politique de l'IC de « Centrisme ». Ce n'est que par la suite, et notamment Internationalisme après-guerre, que le courant hérité de la Gauche italienne l'a clairement qualifiée de contre-révolutionnaire. Nous renvoyons le lecteur à la présentation critique de ces textes publiée dans la Revue Internationale n° 132 (NDLR.).
2 Nous sommes d'accord avec les camarades de Bilan pour dire que la défense de l'État prolétarien ne se pose pas sur le terrain militaire mais sur le plan politique, par sa liaison avec le prolétariat international.
3 Qui n'est peut-être que de pure formulation, mais qu'il importe de relever quand même parce qu'elle se relie à leur tendance à minimiser les problèmes économiques.
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [10]
Questions théoriques:
Revue Internationale n° 135 - 4ème trimestre 2008
- 2536 lectures
Une seule alternative : la lutte du prolétariat pour le renversement du capitalisme
- 2668 lectures
Une fois encore, l'été a été marqué par le déchaînement de la barbarie guerrière. Au moment même où chaque nation comptait ses médailles aux Jeux Olympiques, les attentats terroristes n'ont cessé de se multiplier au Moyen-Orient, en Afghanistan, au Liban, en Algérie, en Turquie, en Inde. En moins de deux mois, 16 attentats se sont enchaînés au rythme effréné d'une danse macabre faisant des dizaines de morts dans la population urbaine tandis qu'en Afghanistan et en Irak, la guerre a continué a faire rage.
Mais c'est surtout en Géorgie que cette barbarie guerrière s'est déchaînée.
Une fois de plus, le Caucase a été mis à feu et à sang. Au moment même où Bush et Poutine assistaient à l'ouverture des Jeux Olympiques, prétendus symboles de paix et de réconciliation entre les peuples, le président géorgien Saakachvili, protégé de la Maison Blanche, et la bourgeoisie russe envoyaient leurs soldats se livrer à un effroyable massacre de populations.
Cette guerre entre la Russie et la Géorgie a donné lieu à une véritable épuration ethnique de chaque côté qui a fait plusieurs milliers de morts essentiellement dans la population civile.
Comme à chaque fois, ce sont les populations locales (qu'elles soient russe, ossète, abkhase ou géorgienne) qui ont été prises en otage par toutes les fractions nationales de la classe dominante.
Des deux côtés, on a vu les mêmes scènes d'horreur et de tuerie. Dans toute la Géorgie, le nombre de réfugiés démunis de tout s'est élevé à 115 000 personnes en une semaine.
Et comme dans toutes les guerres, chaque camp accuse l'autre d'être le responsable du déclenchement des hostilités.
Mais la responsabilité de cette nouvelle guerre et de ces massacres ne se limite pas à ses protagonistes les plus directs. Les autres États qui jouent aujourd'hui hypocritement les pleureuses sur le sort de la Géorgie ont tous trempé les mains dans le sang des pires atrocités, qu'il s'agisse des États-Unis vis-à-vis de l'Irak, ou de la France dans le génocide au Rwanda en 1994 ou encore de l'Allemagne qui, en promouvant la sécession de la Slovénie et de la Croatie, a poussé résolument au déclenchement de la terrible guerre en ex-Yougoslavie en 1992.
Et si aujourd'hui, les États-Unis envoient des navires de guerre dans la région du Caucase, au nom de l'aide "humanitaire", ce n'est certainement pas par souci des vies humaines, mais uniquement pour y défendre leurs intérêts de vautours impérialistes.
Allons-nous vers une troisième guerre mondiale ?
Ce qui caractérise surtout le conflit dans le Caucase, c'est une montée des tensions militaires entre les grandes puissances. Les deux ex-têtes de bloc, la Russie et les États-Unis, se retrouvent de nouveau dangereusement face à face aujourd'hui : les destroyers de l'US Navy venus "ravitailler" la Géorgie mouillent désormais à quelques encablures de la base navale russe de Gudauta en Abkhasie comme du port de Poti occupé par les chars russes.
Ce face-à-face est très inquiétant et l'on peut légitimement se poser plusieurs questions : quel est objectif de cette guerre ? Va-t-elle déboucher sur une troisième guerre mondiale ?
Depuis l'effondrement du bloc de l'Est, la région du Caucase a toujours été un enjeu géostratégique pour les grandes puissances. Le conflit couvait donc depuis longtemps. Le président géorgien, partisan inconditionnel de Washington, héritait d'ailleurs d'un État entièrement porté à bout de bras dès sa création en 1991 par les États-Unis comme tête de pont du "nouvel ordre mondial" annoncé par Bush père.
Si Poutine, en tendant un piège à Saakhachvili, dans lequel ce dernier est tombé, a saisi l'occasion de restaurer son autorité dans le Caucase, c'est en réponse à l'encerclement déjà effectif depuis 1991 de la Russie par les forces de l'OTAN.
En effet, depuis l'effondrement du bloc de l'Est en 1989, la Russie s'est retrouvée de plus en plus isolée, en particulier depuis que les anciens pays de son glacis (comme la Pologne) sont entrés dans l'OTAN.
Mais cet encerclement est devenu insupportable pour Moscou depuis que l'Ukraine et la Géorgie ont demandé elles aussi leur adhésion à l'OTAN.
Et surtout la Russie ne pouvait pas accepter le projet de déploiement d'un bouclier anti-missiles prévu en Pologne et en République Tchèque. La Russie savait pertinemment que derrière ce programme de l'OTAN, soi-disant dirigé contre l'Iran, c'est elle qui était visée.
L'offensive russe menée contre la Géorgie est en fait une réplique de Moscou pour tenter de desserrer l'étau de cet encerclement.
La Russie a profité du fait que les États-Unis (dont les forces militaires se retrouvent enlisées dans un bourbier en Irak et en Afghanistan) avaient les mains liées pour lancer une contre-offensive militaire dans le Caucase, quelques temps après avoir rétabli à grand peine son autorité dans des guerres atrocement meurtrières en Tchétchénie.
Cependant, malgré l'aggravation des tensions militaires entre la Russie et les États-Unis, la perspective d'une troisième guerre mondiale n'est pas à l'ordre du jour.
En effet, aujourd'hui il n'existe pas deux blocs impérialistes constitués, pas d'alliances militaires stables comme c'était le cas dans les deux guerres mondiales du 20e siècle ou dans la période de la guerre froide.
De même, le face-à-face entre les États-Unis et la Russie ne signifie nullement que nous sommes entrés dans une nouvelle guerre froide.
Il n'y a pas de retour en arrière possible et l'histoire ne se répète jamais deux fois.
Contrairement à la dynamique des tensions impérialistes entre les grandes puissances pendant la guerre froide, ce nouveau face-à-face entre la Russie et les États-Unis est marqué par la tendance au "chacun pour soi", à la dislocation des alliances, qui caractérise la période de décomposition du système capitaliste.
Ainsi, le "cessez-le-feu" en Géorgie ne fait qu'entériner le triomphe des maîtres du Kremlin et la supériorité de la Russie sur le plan militaire, entraînant une quasi-capitulation humiliante pour la Géorgie aux conditions dictées par Moscou.
C'est aussi un nouveau revers retentissant que vient d'essuyer le "parrain" de la Géorgie, les États-Unis. Alors que la Géorgie a payé un lourd tribut pour son allégeance aux États-Unis (un contingent de 2000 hommes envoyés en Irak et en Afghanistan), en retour l'Oncle Sam n'a pu qu'apporter un soutien moral à son allié en prodiguant de vaines condamnations purement verbales envers la Russie, sans pouvoir lever le petit doigt.
Mais l'aspect le plus significatif de cet affaiblissement du leadership américain réside dans le fait que la Maison Blanche a été contrainte d'avaliser le "plan européen" de cessez-le-feu et, pire encore, un plan dicté par Moscou.
Si les États-Unis étalent leur impuissance, l'Europe illustre à l'occasion de ce conflit le niveau atteint par le "chacun pour soi". Face à la paralysie américaine, c'est la diplomatie européenne qui est entrée en action, avec à sa tête le président français Sarkozy qui, une fois de plus, n'a représenté que lui-même dans ses prestations de m'as-tu-vu, dénué de toute cohérence et champion de la navigation à courte vue.
L'Europe est apparue une fois encore comme un panier de crabes qui abrite les positions et les intérêts les plus diamétralement opposés. Il n'y a, en effet, pas la moindre once d'unité dans ses rangs avec d'un côté la Pologne et les États baltes, fervents défenseurs de la Géorgie (du fait qu'ils ont subi pendant un demi-siècle la tutelle de la Russie et craignent par dessus tout le renforcement actuel des menées impérialistes de ce pays) et de l'autre, l'Allemagne qui était parmi le opposants les plus résolus à l'intégration de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'OTAN, notamment pour faire obstacle au développement de l'influence américaine dans la région.
Mais la raison la plus fondamentale pour laquelle les grandes puissances ne peuvent pas déclencher une troisième guerre mondiale réside dans le rapport de forces entre les deux principales classes de la société : la bourgeoisie et le prolétariat. Contrairement à la période qui a précédé les deux guerres mondiales, la classe ouvrière des principaux pays du capitalisme, ceux d'Europe et d'Amérique, n'est pas prête à servir de chair à canon et à sacrifier sa vie sur l'autel du capital.
Avec le resurgissement de la crise permanente du capitalisme à la fin des années 1960 et la reprise historique de la lutte du prolétariat, un nouveau cours aux affrontements de classe a été ouvert : dans les pays déterminants du monde capitaliste, notamment ceux d'Europe et d'Amérique du Nord, la classe dominante ne peut plus embrigader massivement des millions de prolétaires derrière la défense des drapeaux nationaux.
Cependant, bien que les conditions ne soient pas réunies pour le déchaînement d'une troisième guerre mondiale, il ne faut pas pour autant sous-estimer la gravité de la situation historique présente.
La guerre en Géorgie accroît le risque d'embrasement et de déstabilisation non seulement à l'échelle régionale, mais elle aura des conséquences inévitables au niveau mondial sur l'équilibre des forces impérialistes pour l'avenir. Le "plan de paix" n'est que de la poudre aux yeux. Il concentre en réalité tous les ingrédients d'une nouvelle et dangereuse escalade guerrière, menaçant d'ouvrir une chaîne continue de foyers d'embrasement, du Caucase au Moyen-Orient.
Avec le pétrole et le gaz de la mer Caspienne ou des pays de l'Asie Centrale souvent turcophones, les intérêts de la Turquie et de l'Iran sont engagés dans cette région mais le monde entier est partie prenante dans le conflit. Ainsi, un des objectifs des États-Unis et des pays d'Europe de l'Ouest en soutenant une Géorgie indépendante de Moscou est de permettre de soustraire à la Russie le monopole de l'acheminement vers l'Ouest du pétrole de la mer caspienne grâce au pipeline BTC (du nom de Bakou en Azerbaïdjan, Tbilissi et Ceyhan en Turquie). Ce sont donc des enjeux stratégiques considérables qui sont présents dans cette région du monde. Et les grands brigands impérialistes peuvent d'autant plus facilement se servir des hommes comme chair à canon dans le Caucase que cette région est une mosaïque d'enchevêtrements multiethniques. Avec un tel enchevêtrement, il est facile d'attiser le feu guerrier du nationalisme.
D'autre part, le passé dominateur de la Russie continue à peser d'un poids très lourd et annonce d'autres tensions impérialistes encore plus graves. C'est ce dont témoignent l'inquiétude et la mobilisation des États baltes et surtout de l'Ukraine qui est une puissance militaire d'une toute autre envergure que la Géorgie et qui dispose d'un arsenal nucléaire.
Ainsi, bien que la perspective ne soit pas à une troisième guerre mondiale, la dynamique du "chacun pour soi" exprime tout autant la folie meurtrière du capitalisme : ce système moribond, peut, dans sa décomposition, conduire à la destruction de l'humanité avec le déchaînement du chaos sanglant.
Quelle alternative face à la faillite du capitalisme ?
Face au déchaînement du chaos et de la barbarie guerrière, l'alternative historique est plus que jamais "socialisme ou barbarie", '"révolution communiste mondiale ou destruction de l'humanité". La paix est impossible dans le capitalisme; le capitalisme porte avec lui la guerre. Et la seule perspective d'avenir pour l'humanité, c'est la lutte du prolétariat pour le renversement du capitalisme.
Mais cette perspective ne pourra se concrétiser que si les prolétaires refusent de servir de chair à canon pour les intérêts de leurs exploiteurs, et s'ils rejettent fermement le nationalisme.
Partout la classe ouvrière doit faire vivre dans la pratique le vieux mot d'ordre du mouvement ouvrier : "Les prolétaires n'ont pas de patrie. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !"
Face aux massacres des populations et au déchaînement de la barbarie guerrière, il est évident que le prolétariat ne peut pas rester indifférent. Il doit manifester sa solidarité avec ses frères de classe des pays en guerre d'abord en refusant de soutenir un camp contre un autre. Ensuite, en développant ses luttes de façon solidaire et unie contre ses propres exploiteurs dans tous les pays. C'est le seul moyen de lutter véritablement contre le capitalisme, de préparer le terrain pour son renversement et de construire une autre société sans frontières nationales et sans guerres.
Cette perspective de renversement du capitalisme n'est pas une utopie parce que partout le capitalisme fait la preuve aujourd'hui qu'il est un système en faillite.
Lors de l'effondrement du bloc de l'Est, Bush père et toute la bourgeoisie de l'Occident "démocratique" nous avaient promis que le "nouvel ordre mondial" (instauré sous l'égide des États-Unis) allait ouvrir une ère de "paix et de prospérité".
Toute la bourgeoisie mondiale avait déchaîné de gigantesques campagnes sur la prétendue "faillite du communisme" en cherchant à faire croire aux prolétaires que le seul avenir possible c'était le capitalisme à l'occidentale avec son économie de marché.
Aujourd'hui, il est de plus en plus évident que c'est le capitalisme qui est en faillite, et notamment la première puissance mondiale qui est devenue maintenant la locomotive de l'effondrement de toute l'économie capitaliste (voir notre l'éditorial de la Revue internationale n° 133).
Cette faillite se révèle jour après jour par la dégradation croissante des conditions de vie de la classe ouvrière, non seulement dans les pays "pauvres" mais aussi dans les pays les plus "riches".
Pour ne citer que l'exemple des États-Unis, le chômage augmente à toute allure et aujourd'hui 6% de la population est sans emploi. De plus, depuis le début de la crise des "subprimes", 2 millions de travailleurs ont été expulsés de leur maison parce qu'ils ne peuvent pas rembourser leur crédit immobilier (et d'ici début 2009, 1 million de personnes supplémentaires risque de se retrouver à la rue).
Quant aux pays les plus pauvres, n'en parlons pas : avec l'augmentation des prix des denrées alimentaires de base, les couches les plus démunies ont été confrontées à l'horreur de la famine. C'est pour cela que des émeutes de la faim ont explosé cette année au Mexique, au Bengladesh, en Haïti, en Égypte, aux Philippines.
Aujourd'hui, face à l'évidence des faits, les porte-parole de la bourgeoisie ne peuvent plus se voiler la face. Dans les librairies paraissent régulièrement de plus en plus d'ouvrages aux titres alarmistes. Et surtout, les déclarations des responsables des institutions économiques comme celles des analystes financiers ne peuvent même plus aujourd'hui dissimuler leur inquiétude :
"Nous sommes confrontés à l'un des environnements économiques et de politique monétaire les plus difficiles jamais vus" (d'après le Président de la Réserve fédérale américaine, la FED, le 22 août) ;
"Pour l'économie, la crise est un tsunami qui approche" (Jacques Attali, économiste et homme politique français, dans le journal Le Monde du 8 août) ;
"La conjoncture actuelle est la plus difficile depuis plusieurs décennies" (d'après HSBC, la plus grande banque du monde, citée dans le journal Libération du 5 août).
La perspective de développement des combats de la classe ouvrière
En fait, l'effondrement des régimes staliniens n'a pas signifié la faillite du communisme mais, au contraire, la nécessité du communisme.
L'effondrement du capitalisme d'État en URSS était, en réalité, la manifestation la plus spectaculaire de la faillite historique du capitalisme mondial. C'était la première grande secousse de l'impasse du système. Aujourd'hui, la seconde grande secousse touche de plein fouet la première puissance "démocratique", les États-Unis.
Avec l'aggravation de la crise économique et des conflits guerriers, on assiste donc aujourd'hui à une accélération de l'histoire.
Mais cette accélération se manifeste aussi et surtout sur le plan des luttes ouvrières même si elle apparaît de façon beaucoup moins spectaculaire.
Si l'on avait une vision photographique, on pourrait penser qu'il ne se passe rien et que les ouvriers ne bougent pas. Les luttes ouvrières ne semblent pas être à la hauteur de la gravité des enjeux et l'avenir semble bien noir.
Mais ce n'est là que la partie visible de l'iceberg.
En réalité, et comme nous l'avons souligné à maintes reprises dans notre presse, les luttes du prolétariat mondial sont entrées dans une nouvelle dynamique depuis 2003.1
Ces luttes qui se sont développées au quatre coins du monde ont été marquées en particulier par la recherche de la solidarité active et par l'entrée des jeunes générations dans le combat prolétarien (comme on a pu le voir notamment avec la lutte des étudiants en France contre le CPE au printemps 2006).
Cette dynamique montre que la classe ouvrière mondiale a bien retrouvé le chemin de sa perspective historique, un chemin dont les traces avaient été momentanément effacées par les gigantesques campagnes sur la "mort du communisme" après l'effondrement des régimes staliniens.
Aujourd'hui, l'aggravation de la crise et la dégradation des conditions de vie de la classe ouvrière ne peuvent que pousser les prolétaires à développer leurs luttes, à rechercher la solidarité, à les unifier partout dans le monde.
En
particulier, le spectre de l'inflation qui vient de nouveau hanter le
capitalisme, avec l'augmentation vertigineuses des prix conjuguée
à la baisse des revenus (salaires, retraites, pensions...) ne
peut que contribuer à l'unification des luttes ouvrières.
Mais surtout deux questions vont participer à accélérer la prise de conscience du prolétariat de la faillite du système et de la nécessité du communisme.
La première question, c'est celle de la faim et de la généralisation de la pénurie alimentaire qui révèle de toute évidence que le capitalisme n'est plus en mesure de nourrir l'humanité et qu'il faut donc passer à un autre mode de production.
La deuxième question fondamentale, c'est celle de l'absurdité de la guerre, de la folie meurtrière du capitalisme qui détruit de plus en plus de vies humaines dans des massacres sans fin.
Il est vrai que, de façon immédiate, la guerre fait peur et la bourgeoisie fait tout pour paralyser la classe ouvrière, pour lui inoculer un sentiment d'impuissance et lui faire croire que la guerre est une fatalité contre laquelle on ne peut rien. Mais en même temps, l'engagement des grandes puissances dans les conflits guerriers (notamment en Irak et en Afghanistan) provoque de plus en plus de mécontentement.
Face à l'enfoncement des États-Unis dans le bourbier irakien, le sentiment anti-guerre se développe de plus en plus dans la population américaine. Ce sentiment anti-guerre on l'a vu également se manifester dans "l'opinion publique" et les sondages après l'hommage que la bourgeoisie française a rendu aux 10 soldats français tués dans une embuscade le 18 août en Afghanistan.
Mais au-delà de ce mécontentement au sein de la population, il existe aujourd'hui une réflexion qui se développe en profondeur dans la classe ouvrière.
Et les signes les plus clairs de cette réflexion, c'est le surgissement d'un nouveau milieu politique prolétarien qui s'est développé autour de la défense des positions internationalistes face à la guerre (notamment en Corée, aux Philippines, en Turquie, en Russie, en Amérique latine).2
La guerre n'est pas une fatalité face à laquelle l'humanité serait impuissante. Le capitalisme n'est pas un système éternel. Il ne porte pas seulement en son sein la guerre. Il porte aussi les conditions de son dépassement, les germes d'une nouvelle société sans frontières nationales et donc sans guerres.
En créant une classe ouvrière mondiale, le capitalisme a donné naissance à son propre fossoyeur. Parce que la classe exploitée, contrairement à la bourgeoisie, n'a pas d'intérêts antagoniques à défendre, elle est la seule force de la société qui puisse unifier l'humanité en édifiant un monde basé sur la solidarité et la satisfaction des besoins humains.
Le chemin
est encore long avant que le prolétariat mondial puisse hisser
ses combats à la hauteur des enjeux posés par la
gravité de la situation présente. Mais dans le contexte
de l'accélération de la crise économique
mondiale, la dynamique des luttes ouvrières actuelle, de même
que l'entrée des nouvelles générations dans le
combat de classe, montre que le prolétariat est bien sur la
bonne voie.
Aujourd'hui les révolutionnaires internationalistes sont encore une petite minorité. Mais ils ont le devoir de mener le débat pour surmonter leurs divergences et faire entendre leur voix le plus clairement possible partout où ils le peuvent. C'est justement en étant capables de mener une intervention claire contre la barbarie guerrière qu'ils pourront se regrouper et contribuer à la prise de conscience par le prolétariat de la nécessité de partir à l'assaut de la forteresse capitaliste.
SW (12-09-08)
1 Lire à ce propos les articles suivants en particulier : "Partout dans le monde, face aux attaques du capitalisme en crise : une même classe ouvrière, la même lutte de classe ! [55]" de la Revue Internationale n° 132 ; "17e congrès du CCI : résolution sur la situation internationale [56]." de la Revue Internationale n° 130.
2 En plus de la résolution sur la situation internationale [56] du 17e congrès du CCI, citée dans la note précédente, le lecteur pourra consulter, également dans la Revue Internationale n° 130, l'article relatif à ce même congrès "17e congrès du CCI : un renforcement international du camp prolétarien [57]".
Récent et en cours:
- Crise économique [1]
- Luttes de classe [2]
- Guerre [58]
Il y a 90 ans, la révolution allemande : 1918-19, la formation du parti, l'absence de l'Internationale
- 3970 lectures
Lorsqu'a éclaté la Première Guerre mondiale, des socialistes se sont réunis à Berlin, le soir du 4 août 1914, pour engager le combat internationaliste : ils étaient sept dans l'appartement de Rosa Luxemburg. De cette évocation qui nous rappelle que l'une des qualités les plus importantes des révolutionnaires est de savoir aller à contre-courant, il ne faut pas conclure que le parti prolétarien a joué un rôle secondaire dans les événements qui ont ébranlé le monde à l'époque. C'est le contraire qui est vrai comme nous avons cherché à le montrer dans les deux précédents articles de cette série qui commémore le 90e anniversaire des luttes révolutionnaires en Allemagne. Dans le premier article, nous avons défendu la thèse selon laquelle la crise de la social-démocratie, en particulier du SPD d'Allemagne - parti leader de la 2e Internationale - a constitué l'un des facteurs les plus importants ayant permis à l'impérialisme d'embrigader le prolétariat dans la guerre. Dans le deuxième article, nous avons montré que l'intervention des révolutionnaires a constitué un facteur crucial pour que la classe ouvrière retrouve, en plein milieu de la guerre, ses principes internationalistes et parvienne finalement à mettre un terme au carnage impérialiste par des moyens révolutionnaires (la révolution de novembre 1918). Ce faisant, les révolutionnaires ont jeté les bases de la fondation d'un nouveau parti et d'une nouvelle internationale.
Et nous avons souligné que, durant ces deux phases, la capacité des révolutionnaires de comprendre quelles étaient les priorités du moment constituait la condition préalable pour pouvoir jouer ce rôle actif et positif. Après l'effondrement de l'Internationale face à la guerre, la tâche de l'heure était de comprendre les raisons du fiasco et d'en tirer les leçons. Dans la lutte contre la guerre, la responsabilité des vrais socialistes était d'être les premiers à lever le drapeau de l'internationalisme, à éclairer le chemin vers la révolution.
Les conseils et le parti de classe
Le soulèvement des ouvriers du 9 novembre 1918 a pour conséquence la fin de la Guerre mondiale, dés le 10 novembre au matin. La couronne de l'Empereur allemand tomba et, avec elle, quantité de petits trônes allemands - une nouvelle phase de la révolution commençait. Bien que le soulèvement de novembre eût été mené par les ouvriers, Rosa Luxemburg l'a appelé La révolution des soldats, parce que ce qui dominait, c'était une profonde aspiration à la paix. Un désir que les soldats, après quatre ans dans les tranchées, incarnaient plus que tout autre. C'est ce qui donna à cette journée inoubliable sa couleur particulière, sa gloire et, aussi, ce qui alimenta ses illusions. Comme certains secteurs de la bourgeoisie aussi étaient soulagés que la guerre se termine enfin, l'état d'esprit du moment était à la fraternisation générale. Même les deux principaux protagonistes de la lutte sociale, la bourgeoisie et le prolétariat, étaient affectés par les illusions du 9 novembre. L'illusion de la bourgeoisie, c'était qu'elle pourrait encore utiliser les soldats de retour du front contre les ouvriers. Cette illusion se dissipa en quelques jours. Les soldats voulaient rentrer chez eux, pas se battre contre les ouvriers. L'illusion du prolétariat, c'était que les soldats étaient déjà de leur côté et qu'ils voulaient la révolution. Lors des premières sessions des conseils d'ouvriers et de soldats, élus à Berlin le 10 novembre, les délégués des soldats étaient prêts à lyncher les révolutionnaires qui défendaient la nécessité de poursuivre la lutte de classe et qui dénonçaient le nouveau gouvernement social-démocrate comme l'ennemi du peuple.
De façon générale, ces conseils d'ouvriers et de soldats étaient empreints d'une certaine inertie qui, curieusement, marque le début de tous les grands soulèvements sociaux. En très grande partie, les soldats élurent leurs officiers comme délégués, et les ouvriers nommèrent les candidats sociaux-démocrates pour qui ils avaient voté avant la guerre. Aussi, ces conseils n'avaient rien de mieux à faire que de nommer un gouvernement dirigé par les bellicistes du SPD et de décider de leur propre suicide à l'avance en appelant des élections générales à un système parlementaire.
Malgré l'inadéquation de ces premières mesures, les conseils ouvriers étaient le cœur de la révolution de novembre. Comme Rosa Luxemburg l'a souligné, c'est avant tout l'apparition même de ces organes qui manifestait et incarnait le caractère fondamentalement prolétarien du soulèvement. Mais maintenant, une nouvelle phase de la révolution s'ouvrait dans laquelle la question n'était plus celle des conseils mais celle du parti de classe. La phase des illusions prenait fin, le moment de vérité, l'éclatement de la guerre civile approchait. Les conseils ouvriers, par leur fonction et leur structure mêmes en tant qu'organes des masses, sont capables de se renouveler et de se révolutionner d'un jour à l'autre. A présent, la question centrale était : la vision prolétarienne, révolutionnaire et déterminée, allait-elle prendre le dessus au sein des conseils ouvriers, dans la classe ouvrière ?
Pour gagner, la révolution prolétarienne a besoin d'une avant-garde politique centralisée et unie qui a la confiance de l'ensemble de la classe. C'était peut-être la leçon la plus importante qu'avait apportée la révolution d'Octobre en Russie l'année précédente. Comme Rosa Luxemburg l'avait développé en 1906 dans sa brochure sur la grève de masse, la tâche de ce parti n'était plus d'organiser les masses mais de leur donner une direction politique et une confiance réelle dans leurs propres capacités.
Les difficultés du regroupement des révolutionnaires
Mais fin 1918 en Allemagne, il n'y avait pas de parti de ce type en vue. Les socialistes qui s'étaient opposés à la politique pro-guerrière du SPD, se trouvaient principalement dans l'USPD, l'ancienne opposition qui avait été exclue du SPD. C'était un regroupement hétéroclite comportant des dizaines de milliers de membres, qui allaient des pacifistes et des éléments qui voulaient une réconciliation avec les bellicistes, jusqu'aux vrais internationalistes révolutionnaires. La principale organisation de ces derniers, le Spartakusbund, constituait une fraction indépendante au sein de l'USPD. D'autres groupes internationalistes plus petits, comme "les communistes internationaux d'Allemagne", les IKD (qui venaient de l'opposition de gauche de Brême), étaient organisés en dehors de l'USPD. Le Spartakusbund était bien connu et respecté parmi les ouvriers. Mais les dirigeants reconnus des mouvements de grève contre la guerre n'appartenaient pas à ces groupes politiques, mais à la structure informelle des délégués d'usines, les revolutionäre Obleute. En décembre 1918, la situation devenait dramatique. Les premières escarmouches menant à la guerre civile ouverte avaient déjà eu lieu. Mais les différentes composantes d'un parti de classe révolutionnaire potentiel - le Spartakusbund, d'autres éléments de gauche de l'USPD, les IKD, les Obleute constituaient encore des entités séparées et toujours très hésitantes.
Sous la pression des événements, la question de la fondation du parti commença à se poser plus concrètement. Finalement, elle fut traitée en toute hâte.
Le Premier Congrès national des Conseils d'ouvriers et de soldats s'était réuni à Berlin le 16 décembre. Alors que 250 000 ouvriers radicaux manifestaient au dehors pour mettre la pression sur les 489 délégués (dont seulement 10 représentaient Spartakus et 10 les IKD), Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht n'eurent pas le droit d'intervenir dans la réunion (sous le prétexte qu'ils n'avaient pas de mandat). Quand la conclusion du Congrès fut de remettre le pouvoir entre les mains d'un futur système parlementaire, il devint clair que les révolutionnaires devaient répondre à cela de façon unie.
Le 14 décembre 1918, le Spartakusbund publia une déclaration de principes programmatique : Que veut Spartakus ? Le 17 décembre, les IKD tinrent une Conférence nationale à Berlin qui appela à la dictature du prolétariat et à la formation du parti à travers un processus de regroupement. La Conférence ne parvint pas à un accord sur la participation ou non dans les élections à venir à une Assemblée parlementaire nationale.
A peu près en même temps, des dirigeants de la gauche de l'USPD, comme Georg Ledebour, et des délégués d'usine comme Richard Müller commencèrent à poser la question de la nécessité d'un parti uni des ouvriers.
Au même moment, des délégués du mouvement international de la jeunesse se réunissaient à Berlin où ils établirent un secrétariat. Le 18 décembre se tint une Conférence internationale de la jeunesse, suivie d'un meeting de masse dans le quartier Neukölln de Berlin où intervinrent Karl Liebknecht et Willi Münzenberg.
C'est dans ce contexte que le 29 décembre, à Berlin, une réunion de délégués de Spartakus décida de rompre avec l'USPD et de former un parti séparé. Trois délégués votèrent contre cette décision. La réunion appela aussi à une conférence de Spartakus et des IKD pour le jour suivant, à laquelle 127 délégués de 56 villes et sections participèrent. Cette Conférence fut en partie rendue possible grâce à la médiation de Karl Radek, délégué des Bolcheviks. Beaucoup des délégués n'avaient pas compris, avant leur arrivée, qu'ils avaient été convoqués pour former un nouveau parti. 1 Les délégués d'usine n'étaient pas invités car le sentiment était qu'il ne serait pas encore possible de les associer aux positions révolutionnaires très déterminées défendues par une majorité de membres et de sympathisants, souvent très jeunes, de Spartakus et des IKD. A la place, on espérait que les délégués d'usine se joindraient au parti une fois celui-ci constitué.2
Ce qui allait devenir le Congrès de fondation du Parti communiste d'Allemagne (KPD) réunit des dirigeants de Brême (y compris Karl Radek, bien qu'il représentât les Bolcheviks à cette réunion) qui pensaient que la fondation du parti était très en retard, et du Spartakusbund comme Rosa Luxemburg et surtout, Leo Jogisches, dont l'inquiétude principale était que cette étape était peut-être prématurée. Paradoxalement, les deux parties avaient de bons arguments pour justifier leur position.
Le Parti communiste de Russie (bolchevique) envoya six délégués à la Conférence ; d'eux d'entre eux furent empêchés de participer par la police. 3
Le Congrès de fondation : une grande avancée programmatique
Deux des principales discussions dans ce qui allait devenir le Congrès de fondation du KPD portèrent sur la question des élections parlementaires et les syndicats. C'étaient des questions qui avaient déjà joué un rôle important dans les débats avant 1914, mais qui étaient passées au second plan au cours de la guerre. Maintenant, elles redevenaient centrales. Karl Liebknecht souleva la question parlementaire dès sa présentation d'ouverture sur "La crise de l'USPD". Le premier Congrès national des Conseils ouvriers à Berlin avait déjà posé la question qui allait inévitablement mener à une scission de l'USPD : Assemblée nationale ou République des Conseils ? C'était la responsabilité de tous les révolutionnaires de dénoncer les élections bourgeoises et le système parlementaire comme contre-révolutionnaires, comme représentant la fin et la mort des conseils ouvriers. Mais la direction de l'USPD avait refusé les appels lancés par le Spartakusbund et les Obleute pour que cette question soit débattue et décidée dans un congrès extraordinaire.
Dans son intervention pour la délégation du Parti russe, Karl Radek expliqua que c'étaient les événements historiques eux-mêmes qui déterminaient non seulement la nécessité d'un congrès de fondation mais, également, son ordre du jour. Avec la fin de la guerre, la logique de la révolution en Allemagne allait nécessairement être différente de celle de Russie. La question centrale n'était plus la paix, mais l'approvisionnement en nourriture, les prix et le chômage.
En mettant la question de l'Assemblée nationale et des "luttes économiques" à l'ordre du jour des deux premiers jours du Congrès, la direction du Spartakusbund espérait que soit prise une position claire sur les conseils ouvriers contre le système bourgeois parlementaire et contre la forme dépassée de la lutte syndicale, comme base programmatique solide du nouveau parti. Mais les débats allèrent plus loin. La majorité des délégués se déclara contre toute participation aux élections bourgeoises, même comme moyen d‘agitation contre celles-ci et contre le travail dans les syndicats. Sur ce plan, le Congrès constitua l'un des moments forts de l'histoire du mouvement ouvrier. Il permit de formuler, pour la première fois au nom d'un parti de classe révolutionnaire, ces positions radicales correspondant à la nouvelle époque du capitalisme décadent. Ces idées allaient fortement influencer le Manifeste de l'Internationale communiste, rédigé quelques mois plus tard par Trotsky. Et elles allaient devenir des positions de base de la Gauche communiste - jusqu'à nos jours.
Les interventions des délégués qui défendaient ces positions étaient souvent marquées par l'impatience et un certain manque d'argumentation ; elles furent critiquées par les militants expérimentés, y compris par Rosa Luxemburg qui ne partageait pas leurs conclusions les plus radicales. Mais les procès-verbaux de la réunion illustrent bien que ces nouvelles positions n'étaient pas le produit d'individus et de leurs faiblesses, mais d'un profond mouvement social impliquant des centaines de milliers d'ouvriers conscients.4 Gelwitzki, délégué de Berlin, appela le Congrès, au lieu de participer aux élections, à aller dans les casernes convaincre les soldats que c'est l'assemblée des conseils qui est "le gouvernement du prolétariat mondial", l'Assemblée nationale celui de la contre-révolution. Eugen Leviné, délégué du Neukölln (Berlin), souligna que la participation des communistes aux élections ne pouvait que renforcer les illusions des masses. 5 Dans le débat sur les luttes économiques, Paul Frölich, délégué de Hambourg, défendit que l'ancienne forme syndicale de lutte était maintenant dépassée puisqu'elle se basait sur une séparation entre les dimensions économique et politique de la lutte de classe. 6 Hammer, délégué de Essen, rapporta comment les mineurs de la Ruhr jetaient leurs cartes syndicales. Quant à Rosa Luxemburg, qui, pour sa part, était toujours en faveur du travail dans les syndicats pour des raisons tactiques, elle déclara que la lutte du prolétariat pour sa libération se confondait avec la lutte pour la liquidation des syndicats.
La grève de masse et l'insurrection
Les débats programmatiques du Congrès de fondation revêtaient une grande importance historique, par dessus tout pour l'avenir.
Mais au moment même où se fondait le Parti, Rosa Luxemburg avait profondément raison de dire que la question des élections parlementaires comme celle des syndicats étaient d'une importance secondaire. D'une part, la question du rôle de ces institutions dans ce qui était devenu l'époque de l'impérialisme, de la guerre et de la révolution, était encore trop nouvelle pour le mouvement ouvrier. Le débat comme l'expérience pratique étaient encore insuffisants pour qu'elles soient pleinement clarifiées. Pour le moment, reconnaître et être d'accord sur le fait que les organes unitaires de masse de la classe, les conseils ouvriers et pas le parlement ou les syndicats, constituaient les moyens de la lutte ouvrière et de la dictature du prolétariat, était suffisant.
D'autre part, ces débats tendaient à distraire de la tâche principale du Congrès qui était d'identifier les prochaines étapes de la classe sur le chemin du pouvoir. De façon tragique, le Congrès ne parvint pas à clarifier cette question. La discussion clé de cette question fut introduite par Rosa Luxemburg dans une présentation sur "Notre programme" l'après-midi du deuxième jour (31 décembre 1918). Elle y explore la nature de ce qui avait été appelé la seconde phase de la révolution. La première, disait-elle, avait été immédiatement politique puisque dirigée contre la guerre. Pendant la révolution de novembre, la question des revendications économiques spécifiques des ouvriers avait été mise de côté. Ceci expliquait à son tour le niveau relativement bas de conscience de classe qui avait accompagné ces événements et s'était exprimé dans un désir de réconciliation et de "réunification" du "camp socialiste". Pour Rosa Luxemburg, la principale caractéristique de la deuxième phase de la révolution devait être le retour des revendications économiques sur le devant de la scène.
Elle n'oubliait pas pour autant que la conquête du pouvoir est avant tout un acte politique. Mais elle éclairait une autre différence importante entre le processus révolutionnaire en Russie et en Allemagne. En 1917, le prolétariat russe prit le pouvoir sans grand déploiement de l'arme de la grève. Mais, soulignait Rosa Luxemburg, ce fut possible parce que la révolution russe n'a pas commencé en 1917 mais en 1905. En d'autres termes, le prolétariat russe était déjà passé par l'expérience de la grève de masse avant 1917.
Au Congrès, elle ne répéta pas les principales idées développées par la gauche de la social-démocratie sur la grève de masse après 1905. Elle supposait à juste titre que les délégués les avaient toujours à l'esprit. Rappelons brièvement : la grève de masse est la condition préalable indispensable à la prise du pouvoir, précisément parce qu'elle brise la séparation entre lutte économique et lutte politique. Et, tandis que les syndicats, même à leurs moments les plus forts en tant qu'instrument des ouvriers, n'organisent que des minorités de la classe, la grève de masse, elle, active "la masse compacte des Hilotes" du prolétariat, les masses inorganisées, dénuées d'éducation politique. La lutte ouvrière ne combat pas seulement la misère matérielle. C'est une insurrection contre la division du travail existante elle-même, menée par ses principales victimes, les esclaves salariés. Le secret de la grève de masse réside dans le combat des prolétaires pour devenir des êtres humains à part entière. Last but not least, la grève de masse sera menée par des conseils ouvriers revitalisés, donnant à la classe les moyens de centraliser sa lutte pour le pouvoir.
C'est pourquoi Rosa Luxemburg, dans son discours au Congrès, insistait sur le fait que l'insurrection armée était le dernier, non le premier acte de la lutte pour le pouvoir. La tâche de l'heure, dit-elle, n'est pas de renverser le gouvernement mais de le miner. La principale différence avec la révolution bourgeoise, défendait-elle, est son caractère massif, venant "d'en bas". 7
L'immaturité du Congrès
Mais c'est précisément ce qui ne fut pas compris au Congrès. Pour beaucoup de délégués, la prochaine phase de la révolution ne se caractérisait pas par des mouvements de grève de masse mais par la lutte immédiate pour le pouvoir. Otto Rühle 8 exprima particulièrement clairement cette confusion quand il déclara qu'il était possible de prendre le pouvoir d'ici deux semaines. Mais Rühle n'était pas le seul ; Karl Liebknecht lui-même, tout en admettant la possibilité d'un cours plus long de la révolution, ne voulait pas exclure la possibilité d' "une victoire extrêmement rapide" dans "les semaines à venir". 9
Nous avons toutes les raisons de croire ce qu'ont rapporté les témoins oculaires d'après lesquels Rosa Luxemburg en particulier était choquée et alarmée par les résultats du Congrès. Tout comme Leo Jogisches dont on dit que la première réaction fut de conseiller à Luxemburg et à Liebknecht de quitter Berlin et d'aller se cacher quelques temps. 10 Il avait peur que le parti et le prolétariat ne soient en train d'aller à la catastrophe.
Ce qui alarmait le plus Rosa Luxemburg, ce n'est pas les positions programmatiques adoptées mais l'aveuglement de la plupart des délégués à l'égard du danger que représentait la contre-révolution et l'immaturité générale avec laquelle les débats étaient menés. Beaucoup d'interventions prenaient leurs désirs pour des réalités, donnant l'impression qu'une majorité de la classe était déjà derrière le nouveau parti. La présentation de Rosa Luxemburg fut saluée dans la liesse. Une motion, présentée par seize délégués, fut immédiatement adoptée ; elle demandait de publier cette présentation aussi rapidement possible comme "brochure d'agitation". Mais le Congrès ne discuta pas sérieusement de celle-ci. Notamment, quasiment aucune intervention ne reprit son idée principale : la conquête du pouvoir n'était pas encore à l'ordre du jour. A une exception louable, la contribution d'Ernst Meyer qui parla de sa récente visite dans les provinces à l'Est de l'Elbe. Il rapporta que de larges secteurs de la petite-bourgeoisie parlaient de la nécessité de donner une leçon à Berlin. Il poursuivit : "J'ai été encore plus choqué par le fait que même les ouvriers des villes n'avaient pas encore compris les nécessités de la situation. C'est pourquoi nous devons développer, avec toute notre puissance, notre agitation pas seulement à la campagne mais aussi dans les petites villes et dans les villes moyennes." Meyer répondit aussi à l'idée de Paul Frölich d'encourager la création de républiques locales de conseils : "C'est absolument typique de la contre-révolution de propager l'idée de la possibilité de républiques indépendantes, qui n'exprime rien d'autre que le désir de diviser l'Allemagne en zones de différenciation sociale, d'éloigner les régions arriérées de l'influence des régions socialement progressistes." 11
L'intervention de Fränkel, délégué de Königsberg, fut particulièrement significative : il proposa que la présentation ne soit pas discutée du tout. "Je pense qu'une discussion sur le magnifique discours de la camarade Luxemburg ne ferait que l'affaiblir", déclara-t-il. 12
Cette intervention fut suivie par celle de Bäumer qui affirma que la position prolétarienne contre toute participation aux élections était si évidente qu'il "regrettait amèrement" qu'il y ait même eu une discussion sur ce sujet. 13
Rosa Luxemburg devait faire la conclusion de la discussion. Finalement, il n'y eut pas de conclusion. Le président annonça : "la camarade Luxemburg ne peut malheureusement pas faire la conclusion, elle ne se sent pas bien". 14
Ce que Karl Radek allait décrire par la suite comme "l'immaturité de jeunesse" du Congrès de fondation 15 était donc caractérisé par l'impatience et la naïveté, mais aussi par un manque de culture du débat. Rosa Luxemburg avait parlé de ce problème le jour précédent. "J'ai l'impression que vous prenez votre radicalisme trop à la légère. L'appel à "voter rapidement" le prouve en particulier. Ce n'est pas la maturité ni l'esprit de sérieux qui domine dans cette salle... Nous sommes appelés à accomplir les plus grandes tâches de l'histoire mondiale, et nous ne pouvons être ni trop mûrs, ni trop profonds quand nous pensons aux étapes qui sont devant nous pour atteindre notre but sans risque. Des décisions d'une telle importance ne peuvent être prises à la légère. Ce qui manque ici, c'est une attitude de réflexion, le sérieux qui n'exclut nullement l'élan révolutionnaire mais doit aller de pair avec lui." 16
Les négociations avec "les délégués d'usine"
Les revolutionäre Obleute de Berlin envoyèrent une délégation au Congrès pour négocier la possibilité de leur adhésion au Parti. Une particularité de ces négociations était que la majorité des sept délégués se considérait comme les représentants des usines où ils travaillaient et votait sur des questions spécifiques sur la base d'une sorte de système proportionnel, seulement après avoir consulté "leur" force de travail qui semblait s'être assemblée pour l'occasion. Liebknecht qui menait les négociations pour Spartakus, rapporta au Congrès que, par exemple, sur la question de la participation aux élections à l'Assemblée nationale, il y avait eu 26 voix pour et 16 contre. Liebknecht ajouta : "mais dans la minorité, il y a les représentants d'usines extrêmement importantes à Spandau qui ont 60 000 ouvriers derrière eux." Däumig et Ledebour qui représentaient la gauche de l'USPD, non les Obleute, ne participèrent pas au vote.
Un autre sujet de litige était la demande par les Obleute d'une parité dans les commissions du programme et d'organisation nommées par le Congrès. Ceci fut rejeté sur la base du fait que si les délégués représentaient une grande partie de la classe ouvrière de Berlin, le KPD représentait la classe dans tout le pays.
Mais le différend principal qui semble avoir empoisonné l'atmosphère des négociations qui avaient commencé de façon très constructive, concernait la stratégie et la tactique dans la période à venir, c'est-à-dire la question même qui aurait dû être au centre des délibérations du Congrès. Richard Müller demanda que le Spartakusbund abandonne ce qu'il appelait sa tactique putschiste. Il semblait se référer en particulier à la tactique de manifestations armées quotidiennes dans Berlin, menées par le Spartakusbund, à un moment où, selon Müller, la bourgeoisie cherchait à provoquer une confrontation prématurée avec l'avant-garde politique à Berlin. Ce à quoi Liebknecht répondit : "on dirait un porte-parole du Vorwärts" 17 (journal contre-révolutionnaire du SPD).
D'après le récit qu'en fit Liebknecht au Congrès, ceci semble avoir constitué le tournant négatif des négociations. Les Obleute qui avaient été jusque là satisfaits d'avoir cinq représentants dans les commissions mentionnées plus haut, en demandèrent alors 8, etc. Les délégués d'usine menacèrent même de former leur propre parti.
Le Congrès se poursuivit et adopta une résolution blâmant "les éléments pseudo-radicaux de l'USPD en faillite" pour l'échec des négociations. Sous différents "prétextes", ces éléments tentaient de "capitaliser leur influence sur les ouvriers révolutionnaires." 18
L'article sur le Congrès, paru dans le Rote Fahne le 3 janvier 1919 et écrit par Rosa Luxemburg, exprimait un état d'esprit différent. L'article parle de début de négociations vers l'unification avec les Obleute et les délégués des grandes usines de Berlin, commencement d'un processus qui "évidemment conduira irrésistiblement à un processus d'unification de tous les vrais éléments prolétariens et révolutionnaires dans un cadre organisationnel unique. Que les Obleute révolutionnaires du grand Berlin, représentants moraux de l'avant-garde du prolétariat berlinois, s'allieront avec le Spartakusbund est prouvé par la coopération des deux parties dans toutes les actions révolutionnaires de la classe ouvrière à Berlin jusqu'à aujourd'hui."19
Le prétendu "luxemburgisme" du jeune KPD
Comment expliquer ces faiblesses à la naissance du KPD ?
Après la défaite de la révolution en Allemagne, toute une série d'explications furent mises en avant, à la fois dans le KPD et dans l'Internationale communiste, qui mirent l'accent sur les faiblesses spécifiques du mouvement en Allemagne, en particulier en comparaison avec la Russie. Le Spartakusbund était accusé de défendre une théorie "spontanéiste" et prétendument luxemburgiste de la formation du parti. On y trouvait les origines de tout, depuis les prétendues hésitations des Spartakistes à rompre avec les bellicistes du SPD jusqu'à la prétendue indulgence de Rosa Luxemburg envers les jeunes "radicaux" du parti.
Cette supposition d'une "théorie spontanéiste" du parti de Rosa Luxemburg remonte habituellement à la brochure qu'elle avait écrite sur la révolution de 1905 en Russie - Grève de masse, parti et syndicats - et dans laquelle elle aurait présenté et appelé l'intervention des masses contre l'opportunisme et le réformisme de la Social-démocratie, comme une alternative à la lutte politique et organisationnelle dans le parti lui-même. En réalité, la thèse fondamentale du mouvement marxiste qui considère que la progression du parti de classe dépend d'une série de facteurs "objectifs" et "subjectifs" dont l'évolution de la lutte de classe est l'un des plus important, date de bien avant Rosa Luxemburg. 20
De plus, Rosa Luxemburg proposa une lutte très concrète au sein du parti. La lutte pour rétablir le contrôle politique du parti sur les syndicats social-démocrates. C'est une opinion commune, des syndicalistes en particulier, que la forme organisationnelle du parti politique est plus encline à capituler à la logique du capitalisme que les syndicats qui organisent directement les ouvriers en lutte. Rosa Luxemburg avait très bien compris que c'était le contraire qui était vrai, puisque les syndicats reflètent la division du travail qui règne et qui est la base la plus fondamentale de la société de classe. Elle avait compris que les syndicats, non le SPD, étaient les principaux porteurs de l'idéologie opportuniste et réformiste dans la social-démocratie d'avant-guerre et que, sous couvert du slogan pour leur "autonomie", les syndicats étaient en réalité en train de prendre la place du parti politique des ouvriers. Il est vrai que la stratégie proposée par Rosa Luxemburg s'est avérée insuffisante. Mais cela n'en fait pas une théorie "spontanéiste" ou anarcho-syndicaliste comme il est parfois prétendu ! De même, l'orientation prise par Spartakus pendant la guerre de former une opposition dans le SPD d'abord, puis dans l'USPD, n'était pas l'expression d'une sous-estimation du parti mais d'une détermination indéfectible de lutter pour le parti, d'empêcher ses meilleurs éléments de tomber entre les mains de la bourgeoisie.
Dans une intervention au 4e Congrès du KPD, en avril 1920, Clara Zetkin dit que dans la dernière lettre qu'elle avait reçue de Rosa Luxemburg, celle-ci avait écrit que le Congrès avait eu tort de ne pas faire de l'acceptation de la participation aux élections une condition d'appartenance au nouveau parti. Il n'y a pas de raison de douter de la sincérité de Clara Zetkin dans cette déclaration. La capacité de lire ce que les autres écrivent vraiment et non ce qu'on voudrait ou s'attend à lire, est probablement plus rare qu'on ne le pense généralement. La lettre de Luxemburg à Zetkin, datée du 11 janvier 1919, fut publiée par la suite. Voici ce que Rosa Luxemburg avait écrit : "Mais surtout, concernant la question de la non participation aux élections : tu surestimes énormément l'importance de cette décision. Aucun "pro-Rühle" n'était présent, Rühle n'a pas été un leader à la Conférence. Notre "défaite" était seulement le triomphe d'un radicalisme indéfectible un peu immature et puéril... Nous avons tous décidé unanimement de ne pas faire de cette question une affaire de cabinet, de ne pas la prendre au tragique. En réalité, la question de l'Assemblée nationale sera directement repoussée à l'arrière-plan par l'évolution tumultueuse et si les choses continuent comme maintenant, il semble douteux que des élections à l'Assemblée nationale ne se tiennent jamais." 21
Le fait que les positions radicales étaient souvent défendues par les délégués qui montraient le plus d'impatience et d'immaturité, donna l'impression que cette immaturité était le produit du refus de participer aux élections bourgeoises ou aux syndicats. Cette impression allait avoir des conséquences tragiques environ un an plus tard quand la direction du KPD, à la Conférence de Heidelberg, a exclu la majorité à cause de sa position sur les élections et sur les syndicats. 22 Ce n'était pas l'attitude de Rosa Luxemburg qui savait qu'il n'y avait pas d'alternative à la nécessité pour les révolutionnaires de transmettre leur expérience à la génération suivante et qu'on ne peut fonder un parti de classe sans la nouvelle génération.
Le prétendu caractère déclassé des "jeunes radicaux"
Après que les radicaux eurent été exclus du KPD, puis le KAPD exclu de l'Internationale communiste, on a commencé à théoriser l'idée selon laquelle le rôle des "radicaux" au sein de la jeunesse du parti était l'expression du poids d'éléments "déracinés" et "déclassés". Il est sûrement vrai que parmi les supporters du Spartakusbund au cours de la guerre et, en particulier, au sein des groupes de "soldats rouges", des déserteurs, des invalides, etc., il existait des courants qui ne rêvaient que de destructions et de "terreur révolutionnaire totale". Certains de ces éléments étaient très douteux et les Obleute avaient raison de s'en méfier. D'autres étaient des têtes brûlées ou, simplement, de jeunes ouvriers qui s'étaient politisés avec la guerre et ne connaissaient d'autre forme d'expression que de se battre avec des fusils et qui aspiraient à une sorte de campagnes de "guérilla" comme Max Hoelz allait bientôt en mener. 23
Cette interprétation fut reprise dans les années 1970 par des auteurs tels que Fähnders et Rector, dans leur livre Linksradikalismus und Literatur. 24 Ils ont cherché à illustrer leur thèse sur le lien entre le communisme de gauche et la "lumpenisation" à travers l'exemple de biographies d'artistes radicaux qui, comme le jeune Maxime Gorki ou Jack London, avaient rejeté la société existante en se situant en dehors d'elle. A propos d'un des membres les plus influents du KAPD, ils écrivent : "Adam Scharrer était l'un des représentants les plus radicaux de la révolte internationale... ce qui l'amena à la position extrême et rigide de la Gauche communiste." 25
En réalité, bien des jeunes militants du KPD et de la Gauche communiste s'étaient politisés dans le mouvement de la jeunesse socialiste avant 1914. Politiquement, ils n'étaient pas le produit du "déracinement" ni de la "lumpenisation" causés par la guerre. Mais leur politisation gravitait autour de la question de la guerre. Contrairement à la vieille génération d'ouvriers socialistes qui avaient subi des décennies de routine politique à une époque de relative stabilité du capitalisme, la jeunesse socialiste avait été mobilisée directement par le spectre de la guerre qui approchait et avait développé une forte tradition "anti-militariste". 26 Et, alors que la Gauche marxiste se réduisit dans la Social-démocratie à une minorité isolée, son influence au sein des organisations radicales de la jeunesse était bien plus grande. 27
Quant à l'accusation selon laquelle les «radicaux" auraient été des vagabonds pendant leur jeunesse, elle ne prend pas en compte que ces années d'"errance" faisaient typiquement partie de la vie des prolétaires à cette époque. Vestige en partie de la vieille tradition du compagnonnage, de l'artisan qui voyageait, qui caractérisait les premières organisations politiques en Allemagne comme la Ligue des communistes, cette tradition était avant tout le fruit de la lutte des ouvriers pour interdire le travail des enfants à l'usine. Beaucoup de jeunes ouvriers partaient "voir le monde" avant d'être soumis au joug de l'esclavage salarié. Ils partaient à pied explorer les pays de langue allemande, l'Italie, les Balkans et même le Moyen-Orient. Ceux qui étaient liés au mouvement ouvrier trouvaient à se loger à bon marché ou gratuitement dans les Maisons des syndicats dans les grandes villes, avaient des contacts sociaux et politiques et soutenaient les organisations de jeunesse locales. C'est ainsi que se développèrent des centres internationaux d'échange sur les développements politiques, culturels, artistiques et scientifiques. 28 D'autres prirent la mer, apprirent des langues et établirent des liens socialistes à travers toute la planète. On n'a pas à se demander pourquoi cette jeunesse est devenue l'avant-garde de l'internationalisme prolétarien à travers l'Europe ! 29
Qui étaient les "délégués révolutionnaires" ?
La contre-révolution a accusé les Obleute d'être des agents payés par les gouvernements étrangers, par l'Entente, puis par le "bolchevisme mondial". En général, ils sont connus dans l'histoire comme une sorte de courant syndicaliste de base, localiste, centré sur l'usine et anti-parti. Dans les cercles operaïstes, on les admire comme une sorte de conspirateurs révolutionnaires qui avaient pour but de saboter la guerre impérialiste. Comment expliquer autrement la façon dont ils ont "infiltré" des secteurs et des usines clés de l'industrie d'armement allemande ?
Examinons les faits. Les Obleute ont commencé comme un petit cercle de fonctionnaires du parti et de militants social-démocrates qui ont gagné la confiance de leurs collègues par leur opposition indéfectible à la guerre. Ils étaient notamment fortement ancrés dans la capitale, Berlin, et dans l'industrie métallurgique, surtout chez les tourneurs. Ils appartenaient aux ouvriers éduqués, les plus intelligents, avec les salaires les plus hauts. Mais ils étaient renommés pour leur sens du soutien et de la solidarité envers les autres, envers les secteurs plus faibles de la classe comme les femmes mobilisées pour remplacer les hommes envoyés au front. Au cours de la guerre, tout un réseau d'ouvriers politisés grandit autour d'eux. Loin d'être un courant anti-parti, ils étaient quasiment exclusivement composés d'anciens social-démocrates, devenus maintenant membres ou sympathisants de l'aile gauche de l'USPD, y compris du Spartakusbund. Ils participèrent passionnément à tous les débats politiques qui eurent lieu dans la clandestinité au cours de la guerre.
Dans une grande mesure, la forme particulière que prit cette politisation était déterminée par les conditions du travail clandestin, rendant les assemblées de masse rares et les discussions ouvertes impossibles. Dans les usines, les ouvriers protégeaient leurs dirigeants de la répression, souvent avec un succès remarquable. Le vaste système d'espionnage des syndicats et du SPD échoua régulièrement à trouver le nom des "meneurs". Au cas où ils étaient arrêtés, chaque délégué avait nommé un remplaçant qui comblait immédiatement son absence.
Le "secret" de leur capacité à "infiltrer" les secteurs clés de l'industrie était très simple. Ils faisaient partie des "meilleurs" ouvriers, aussi les capitalistes se les disputaient. De cette façon, les patrons eux-mêmes, sans le savoir, mettaient ces internationalistes révolutionnaires à des postes névralgiques de l'économie de guerre.30
L'absence de l'Internationale
Le fait que les trois forces que nous avons mentionnées aient joué un rôle crucial dans le drame de la formation du parti de classe n'est pas une particularité de la situation allemande. L'une des caractéristiques du bolchevisme pendant la révolution en Russie est la façon dont il unifia fondamentalement les même forces qui existaient au sein de la classe ouvrière : le parti d'avant-guerre qui représentait le programme et l'expérience organisationnelle ; les ouvriers avancés, ayant une conscience de classe, des usines et sur les lieux de travail, qui ancraient le parti dans la classe et jouèrent un rôle positif décisif en résolvant les différentes crises dans l'organisation ; et la jeunesse révolutionnaire politisée par la lutte contre la guerre.
Ce qui est frappant en Allemagne, en comparaison, c'est l'absence de la même unité et de la même confiance mutuelle entre ces composants essentiels. C'est cela, et non une quelconque qualité inférieure des éléments eux-mêmes, qui était crucial. Ainsi les Bolcheviks possédaient les moyens de clarifier leurs confusions tout en maintenant et renforçant leur unité. Ce n'était pas le cas en Allemagne.
L'avant-garde révolutionnaire en Allemagne souffrait d'un manque d'unité et de confiance dans sa mission bien plus profondément ancré.
L'une des principales explications en est que la révolution allemande s'affrontait à un ennemi bien plus puissant. La bourgeoisie allemande était certainement plus impitoyable que la bourgeoisie russe. De plus, la phase inaugurée par la Guerre mondiale lui avait apporté des armes nouvelles et puissantes. En effet, avant 1914, l'Allemagne était le pays qui comportait le plus grand nombre de grandes organisations ouvrières de tout le mouvement ouvrier mondial. Dans la nouvelle période où les syndicats et les partis social-démocrates de masse ne pouvaient plus servir la cause du prolétariat, ces instruments devinrent d'énormes obstacles. Ici, la dialectique de l'histoire était à l'œuvre. Ce qui fut une force de la classe ouvrière allemande à un moment donné, tournait maintenant à son désavantage.
Il faut du courage pour s'en prendre à une forteresse si formidable. La tentation est grande d'ignorer la force de l'ennemi pour se rassurer. Mais le problème n'était pas seulement la force de la bourgeoisie allemande. Quand le prolétariat russe anéantit l'Etat bourgeois en 1917, le capitalisme mondial était encore divisé par la guerre impérialiste. C'est un fait bien connu que les militaires allemands aidèrent en fait Lénine et d'autres chefs bolcheviques à rentrer en Russie, car ils espéraient que cela affaiblirait la résistance militaire de leur adversaire sur le front de l'Est.
Maintenant, la guerre était terminée et la bourgeoisie mondiale s'unissait contre le prolétariat. L'un des moments forts du Congrès du KPD a été l'adoption d'une résolution identifiant et dénonçant la collaboration de l'armée britannique et de l'armée allemande avec les propriétaires locaux dans les Etats baltiques pour entraîner sur leurs terres des unités paramilitaires contre-révolutionnaires dirigées contre "la révolution russe aujourd'hui" et "la révolution allemande demain".
Dans cette situation, seule une nouvelle Internationale aurait pu donner aux révolutionnaires et à tout le prolétariat d'Allemagne la confiance et l'assurance nécessaires. La révolution pouvait encore être victorieuse en Russie sans la présence d'un parti de classe mondial parce que la bourgeoisie russe était relativement faible et isolée - pas en Allemagne. L'Internationale communiste n'était pas encore fondée quand la confrontation décisive de la révolution allemande eut lieu à Berlin. Seule une telle organisation, en rassemblant les acquis théoriques et l'expérience de l'ensemble du prolétariat, aurait pu affronter la tâche de mener une révolution mondiale.
C'est seulement l'éclatement de la grande guerre qui a fait prendre conscience aux révolutionnaires de la nécessité d'une opposition de gauche internationale vraiment unie et centralisée. Mais dans les conditions de la guerre, il était extrêmement difficile d'avoir des liens organisationnels et tout autant de clarifier les divergences politiques qui séparaient toujours les deux principaux courants de la gauche d'avant-guerre : les Bolcheviks autour de Lénine, et la gauche allemande et la gauche polonaise autour de Luxemburg. Cette absence d'unité avant la guerre rendit d'autant plus difficile de transformer les capacités politiques des courants des différents pays en un héritage commun à tous et d'atténuer les faiblesses de chacun.
Le choc de l'effondrement de l'Internationale socialiste n'a été nulle part aussi fort qu'en Allemagne. Là, la confiance dans des qualités comme la formation théorique, la direction politique, la centralisation et la discipline du parti fut profondément ébranlée. Les conditions de la guerre, la crise du mouvement ouvrier ne facilitèrent pas la restauration de cette confiance. 31
Conclusion
Dans cet article, nous nous sommes concentrés sur les faiblesses qui se manifestèrent lors de la formation du Parti. C'était nécessaire pour comprendre la défaite du début de 1919, sujet du prochain article. Mais malgré ces faiblesses, ceux qui se regroupèrent lors de la fondation du KPD étaient les meilleurs représentants de leur classe, incarnant tout ce qui est noble et généreux dans l'humanité, les vrais représentants d'un avenir meilleur. Nous reviendrons sur cette question à la fin de la série.
L'unification des forces révolutionnaires, la formation d'une direction du prolétariat digne de ce nom étaient devenue une question centrale de la révolution. Personne ne comprenait cela mieux que la classe sociale qui était directement menacée par ce processus. A partir de la révolution du 9 novembre, le principal objectif de la vie politique de la bourgeoisie était dirigé vers la "liquidation" de Spartakus. Le KPD fut fondé en plein milieu de cette atmosphère de pogrom dans laquelle se préparaient les coups décisifs contre la révolution qui allaient bientôt suivre.
Ce sera le sujet du prochain article.
Steinklopfer
1 L'ordre du jour dans la lettre d'invitation était le suivant :
-
La crise de l'USPD
-
Le programme du Spartakusbund
-
L'Assemblée nationale
-
La Conférence internationale
2 Contrairement à cette position, il semble qu'une des préoccupations de Leo Jogiches ait été d'associer les Obleute à la fondation du parti.
3 Six des militants présents à cette Conférence furent assassinés par les autorités allemandes dans les mois qui suivirent.
4 Der Gründungsparteitag der KPD, Protokoll und Materalien. publié par Hermann Weber. (« Congrès de fondation du KPD, procès-verbaux et documents »)
5 Eugen Leviné fut exécuté quelques mois plus tard comme dirigeant de la République des Conseils de Bavière.
6 Frölich, un représentant connu de la gauche de Brême, devait écrire plus tard une biographie célèbre de Rosa Luxemburg.
7 Voir le procès-verbal en allemand, op. cit. (note 4), p. 196 à 199
8 Bien que, rapidement par la suite, il ait totalement rejeté toute notion de parti de classe comme étant bourgeoise et développé une vision plutôt individuelle du développement de la conscience de classe, Otto Rühle est resté fidèle au marxisme et à la classe ouvrière. Lors du Congrès, il était déjà partisan des Einheitorganisationen (groupes politico-économiques) qui devaient, à son avis, remplacer à la fois le parti et les syndicats. Dans le débat sur « les luttes économiques », Luxemburg répond à son point de vue en disant que l'alternative aux syndicats, ce sont les conseils ouvriers et les organes de masse, pas les Einheitorganisationen.
9 Voir le procès-verbal en allemand, op.cit., p. 222
10 Selon Clara Zetkin, Jogisches, en réaction aux discussions, voulait que le Congrès échoue, c'est-à-dire que la fondation du parti soit reportée.
11 Voir le procès-verbal en allemand, op.cit., p. 214
12 D'après le procès-verbal, cette suggestion fut accueillie par des exclamations : « Très juste ! ». Heureusement, la motion de Fränkel ne fut pas adoptée.
13 Op.cit., p. 209. Le jour précédent, pour la même raison, Gelwitzki, avait dit qu'il se sentait « honteux » d'avoir discuté de cette question. Et quand Fritz Heckert, qui n'avait pas la même réputation révolutionnaire que Luxemburg et Liebknecht, tenta de défendre la position du comité central sur la participation aux élections, il fut interrompu par une exclamation de Jakob : « C'est l'esprit de Noske qui parle ici ! » (Op.cit., p. 117) Noske, ministre des armées social-démocrate du gouvernement bourgeois du moment, est entré dans l'histoire sous le nom de « chien sanglant de la contre-révolution ».
14 Op.cit., p. 224
15 « Le Congrès a démontré fortement la jeunesse et l'inexpérience du Parti. Le lien avec les masses était extrêmement faible. Le Congrès a adopté une attitude ironique envers les Indépendants de gauche. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir déjà un Parti face à moi. » (Ibid., p. 47)
16 Ibid., p. 99-100
17 Ibid., p. 271
18 Ibid., p. 290
19 Ibid, p. 302
20 Voir les arguments de Marx et Engels au sein de la Ligue des communistes, après la défaite de la révolution de 1848-49.
21 Cité par Hermann Weber dans les documents sur le Congrès de fondation, op.cit., p. 42,43
22 Une grande partie des exclus fonda le KAPD. Soudain, il y avait deux Partis communistes en Allemagne, une tragique division des forces révolutionnaires !
23 Max Hoelz était sympathisant du KPD et du KAPD ; lui et ses supporters, armés, furent actifs en « Allemagne centrale » au début des années 20.
24 Walter Fähnders, Martin Rector, Linksradikalismus und Literatur, Untersuchungen zur Geschichte der sozialistischen Literatur in der Weimarer Republik (« Radicalisme de gauche et littérature, Etudes de l'Histoire de la littérature socialiste dans la république de Weimar »).
25 P. 262. Adam Scharrer, grande figure du KAPD, continua à défendre la nécessité d'un parti de classe révolutionnaire jusqu'à l'écrasement des organisations communistes de gauche en 1933.
26 La première apparition d'un mouvement de jeunes socialistes radicaux eut lieu en Belgique dans les années 1860, lorsque les jeunes militants firent de l'agitation (avec un certain succès) auprès des soldats des casernes pour les empêcher d'être utilisés contre les ouvriers en grève.
27 Voir le roman de Scharrer, Vaterlandslose Gesellen (qui signifie quelque chose comme « La fripouille antipatriotique »), écrit en 1929, ainsi que la biographie et le commentaire de Arbeitskollektiv proletarisch-revolutionärer Romane, republié par Oberbaumverlag, Berlin.
28 L'un des principaux témoins de ce chapitre de l'histoire est Willi Münzenberg, notamment dans son livre Die Dritte Front (« Le Troisième Front ») : « Souvenirs de quinze années dans le mouvement prolétarien de la jeunesse », publié pour la première fois en 1930.
29 Le leader le plus connu du mouvement de la jeunesse socialiste en Allemagne avant la guerre était Karl Liebknecht ; en Italie, c'était Amadeo Bordiga.
31 L'exemple de la maturation de la jeunesse socialiste en Suisse sous l'influence de discussions régulières avec les Bolcheviks pendant la guerre montre que c'était possible dans des circonstances plus favorables. « Avec une grande capacité psychologique, Lénine regroupa les jeunes autour de lui, participant à leurs discussions le soir, les encourageant et les critiquant toujours dans un esprit d'empathie. Ferdy Böhny allait se rappeler plus tard : « la façon dont il discutait avec nous ressemblait au dialogue socratique ». » (Babette Gross : Willi Münzenberg, Eine politische Biografie, p.93)
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [35]
Décadence du capitalisme (III) : Ascension et déclin dans les anciens modes de production
- 3903 lectures
Dans cet article, nous poursuivons l'examen de la méthode scientifique et historique que Marx, Engels et leurs successeurs ont développée dans leur œuvre (voir la Revue internationale n°134 [59]).
Ascension et déclin dans les anciens modes de production
- « A grands traits, les modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne peuvent être qualifiés d'époques progressives de la formation économique de la société. » 1
Ce bref passage pourrait donner lieu à plusieurs livres d'explications puisqu'il embrasse pratiquement toute l'histoire écrite. Pour les buts que nous poursuivons ici, nous étudierons deux aspects : la question générale du progrès historique et les caractéristiques de l'ascendance et de la décadence des formations sociales antérieures au capitalisme.
I. Peut-on parler de progrès ?
Nous avons signalé2 que les catastrophes qui ont marqué le 20e siècle ont suscité un scepticisme général envers la notion de progrès, notion qui n'était pas mise en doute tout au long du 19e siècle. Certains penseurs « radicaux » en ont conclu que la vision marxiste du progrès historique n'est elle-même qu'une des idéologies du 19e siècle servant à faire l‘apologie de l'exploitation capitaliste. Bien qu'elles se présentent souvent comme nouvelles, ces critiques ne font, la plupart du temps, que remettre au goût du jour les vieux arguments de Bakounine et des anarchistes : pour eux, la révolution était possible à tout moment ; ils accusaient les marxistes d'être de vulgaires réformistes du fait que, pour ces derniers, l'époque de la révolution n'était pas encore arrivée et la classe ouvrière devait s'organiser à long terme pour défendre ses conditions de vie au sein de l'ordre social existant. Les anti-progressistes commencent parfois par critiquer, d'un point de vue « marxiste », l'idée selon laquelle, aujourd'hui, le système capitaliste serait décadent ; ils insistent sur le fait que très peu de choses auraient changé dans la vie du capital depuis l'époque de Marx, sauf peut-être au niveau quantitatif - l'économie est plus développée, les crises sont plus vastes, les guerres plus importantes. Mais les plus conséquents de ces critiques se débarrassent vite du fardeau du matérialisme historique ; en fin de compte, pour eux, le communisme aurait pu surgir à n'importe quel moment de l'histoire passée. En fait, les plus cohérents de ces courants sont les primitivistes pour qui il n'y a eu aucun progrès dans l'histoire depuis l'émergence de la civilisation et, en fait, depuis la découverte de l'agriculture qui a permis cette civilisation : ils considèrent tout cela comme une évolution terriblement erratique vu que l'époque la plus heureuse de la vie humaine a été, selon eux, l'étape nomade des chasseurs-cueilleurs. Ils désirent ardemment l'effondrement final de la civilisation et l'élimination de l'humanité ; alors, la chasse et la cueillette pourraient être à nouveau pratiquées par les quelques survivants.
Il est sûr que Marx était très ferme par rapport à l'idée que seul le capitalisme avait ouvert la voie permettant de dépasser les antagonismes sociaux et de créer une société qui permettrait à l'humanité de se développer pleinement. Comme il poursuit dans la Préface : « Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme antagoniste du processus social de la production, antagoniste non pas dans le sens d'un antagonisme individuel, mais d'un antagonisme qui naît des conditions sociales d'existence des individus ; cependant les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles propres à résoudre cet antagonisme. »
Pour la première fois, le capitalisme créait les conditions nécessaires à une société communiste mondiale : il unifiait l'ensemble du monde à travers son système de production ; il révolutionnait les instruments de production de sorte que, désormais, une société d'abondance était possible ; et il donnait naissance à une classe qui ne pourrait s'émanciper qu'en émancipant l'humanité tout entière - le prolétariat, première classe exploitée de l'histoire à porter les germes d'une nouvelle société. Pour Marx, il était inconcevable que l'humanité puisse se passer de cette étape dans l'histoire et faire naître une société communiste, globale et durable, au cours des époques de despotisme, d'esclavage et de servage.
Mais le capitalisme n'est pas venu de nulle part : les modes de production qui se sont succédés avant le capitalisme, lui ont, à leur tour, préparé la voie et, en ce sens, l'ensemble du développement de ces systèmes sociaux antagoniques, c'est-à-dire divisés en classes, a représenté un mouvement progressif dans l'histoire de l'humanité, aboutissant finalement à la possibilité matérielle d'une communauté mondiale sans classe. Il est donc contradictoire de se réclamer de l'héritage de Marx et, simultanément, de rejeter la notion de progrès historique.
Mais en fait, il y a différentes visions du progrès : une vision bourgeoise et une vision marxiste qui s'oppose à cette dernière.
Pour commencer, tandis que la bourgeoisie considérait que l'histoire menait inexorablement au triomphe du capitalisme démocratique suivant un cours ascendant et linéaire au cours duquel toutes les sociétés précédentes étaient à tous égards inférieures au nouvel ordre de choses, le marxisme a affirmé le caractère dialectique du mouvement historique. En fait, la notion même d'ascendance et de déclin des modes de production signifie qu'il peut y avoir des régressions autant que des avancées au cours du processus historique. Dans Socialisme utopique et socialisme scientifique (1880), parlant de Fourier et de son anticipation du matérialisme historique, Engels attire l'attention sur le lien entre la vision dialectique de l'histoire et la notion d'ascendance et de déclin : « Mais là où (Fourier) apparaît le plus grand, c'est dans sa conception de l'histoire de la société. (...) Fourier, comme on le voit, manie la dialectique avec la même maîtrise que son contemporain Hegel. Avec une égale dialectique, il fait ressortir que, contrairement au bavardage sur la perfectibilité indéfinie de l'homme, toute phase historique a sa branche ascendante, mais aussi sa branche descendante, et il applique aussi cette conception à l'avenir de l'humanité dans son ensemble. » (chapitre 1)
Ce que Engels dit ici, c'est qu'il n'y a rien d'automatique dans le processus d'évolution historique. Tout comme le processus d'évolution naturelle, la « perfectibilité humaine » n'est pas programmée à l'avance. Comme nous le verrons, la société peut se trouver dans une impasse, comme c'est arrivé aux dinosaures ; il se peut que des sociétés non seulement déclinent mais disparaissent complètement et ne donnent naissance à rien de nouveau.
De plus, même lorsqu'il y a progrès, il a généralement un caractère profondément contradictoire. Un exemple frappant en est la destruction de la production artisanale ; dans celle-ci, le producteur trouvait une satisfaction, à la fois dans le processus de production et dans le but de celle-ci ; la production industrielle qui l'a remplacée, et sa routine abrutissante en est un exemple typique. Mais Engels l'explique avec encore plus de force lorsqu'il décrit la transition du communisme primitif à la société de classe. Dans L origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat, ayant mis en évidence à la fois les immenses forces de la vie tribale et ses limites intrinsèques, Engels parvient aux conclusions suivantes sur la façon d'envisager l'avènement de la civilisation :
« La puissance de cette communauté primitive devait être brisée - elle le fut. Mais elle fut brisée par des influences qui nous apparaissent de prime abord comme une dégradation, comme une chute originelle du haut de la candeur et de la moralité de la vieille société gentilice. Ce sont les plus vils intérêts - rapacité vulgaire, brutal appétit de jouissance, avarice sordide, pillage égoïste de la propriété commune - qui inaugurent la nouvelle société civilisée, la société de classes ; ce sont les moyens les plus honteux - vol, violence, perfidie, trahison - qui sapent l'ancienne société gentilice sans classe, et qui amènent sa chute. Et la société nouvelle elle-même, pendant les deux mille cinq cents ans de son existence, n'a jamais été autre chose que le développement de la petite minorité aux frais de la grande majorité des exploités et des opprimés, et c'est ce qu'elle est de nos jours, plus que jamais. » (chapitre 3 : La gens iroquoise)
Cette vision dialectique porte également sur la société communiste du futur que Marx, dans le beau passage des Manuscrits économiques et philosophiques de 1844 décrit comme «le retour total de l'homme à soi en tant qu'homme social, c'est-à-dire humain, retour conscient et qui s'est accompli avec toute la richesse du développement antérieur. » (Troisième Manuscrit) De même, le communisme du futur est vu comme une renaissance, à un niveau supérieur, du communisme du passé. Engels conclut donc son livre sur les origines de l'Etat par la formule éloquente, reprise de l'anthropologue Lewis Morgan, anticipant un communisme qui sera «une reviviscence -mais sous une forme supérieure - de la liberté, de l'égalité et de la fraternité des antiques gentes. »3
Mais avec toutes ces précisions, il est évident dans la Préface que la notion de progrès, « d'époques progressives » est fondamentale dans la pensée marxiste. Dans la vision grandiose du marxisme, qu'il s'agisse (au moins !) de l'émergence de l'humanité, de l'apparition de la société de classes jusqu'au développement du capitalisme et au grand saut dans le royaume de la liberté qui nous attend dans le futur, « le monde ne doit pas être considéré comme un complexe de choses achevées, mais comme un complexe de processus où les choses, en apparence stables, - tout autant que leurs reflets intellectuels dans notre cerveau, les concepts, se développent et meurent en passant par un changement ininterrompu au cours duquel, finalement, malgré tous les hasards apparents et tous les retours en arrière momentanés, un développement progressif finit par se faire jour. » (Engels, Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, chapitre 4 : le matérialisme dialectique). Vu de cette distance, en quelque sorte, il est évident qu'il y a un réel processus de développement : sur le plan de la capacité de l'homme à transformer la nature à travers le développement d'outils plus sophistiqués ; sur celui de la compréhension subjective d'elle-même par l'humanité et du monde qui l'entoure ; et donc au niveau de la capacité de l'homme à libérer ses pouvoirs en sommeil et à vivre une vie en accord avec ses besoins les plus profonds.
II. La succession des modes de production
Du communisme primitif à la société de classe
Quand Marx présente « à grands traits» les principaux modes de production qui se sont succédés dans l'histoire, il n'a pas la prétention d'être exhaustif. Pour commencer, il ne mentionne que les formations sociales « antagonistes », c'est-à-dire les principales formes de sociétés de classe et il ne mentionne pas les diverses formes de sociétés non exploiteuses qui les ont précédées. De plus, l'étude des formations sociales pré-capitalistes était encore dans l'enfance à l'époque de Marx, de sorte qu'il était tout simplement impossible de faire une liste exhaustive de toutes les sociétés qui avaient existé jusqu'alors. En fait, même en l'état actuel des connaissances historiques, cette tâche est toujours extrêmement difficile à réaliser. Dans la longue période qui va de la dissolution des rapports sociaux communistes primitifs - dont les chasseurs nomades du paléolithique sont l'expression la plus claire - aux sociétés de classe pleinement formées constituées par les civilisations historiques, il y eut nombre de formes intermédiaires et transitoires ainsi que des formes qui aboutirent simplement à une impasse historique : mais notre connaissance de celles-ci reste extrêmement limitée.4
Le fait que Marx n'ait pas inclus les sociétés communistes primitives et antérieures à la société de classe dans la Préface ne signifie pas qu'il considérait leur étude sans importance, au contraire. Dès le début, les fondateurs de la méthode du matérialisme historique reconnaissaient que l'histoire de l'humanité ne commence pas avec la propriété privée, mais avec la propriété communale : « La première forme de la propriété est la propriété tribale. Elle correspond à ce stade rudimentaire de la production où un peuple se nourrit de la chasse et de la pêche, de l'élevage du bétail ou, à la rigueur, de l'agriculture. Dans ce dernier cas, cela suppose une grande quantité de terres incultes. À ce stade, la division du travail est encore très peu développée et se borne à une plus grande extension de la division naturelle telle que l'offre la famille. » (L'idéologie allemande, Feuerbach, A - l'idéologie en général et en particulier l'idéologie allemande)
Lorsque ce point de vue fut confirmé par des recherches ultérieures - notamment par les travaux de Lewis Morgan sur les tribus d'Amérique du Nord - Marx fut extrêmement enthousiaste, et passa une grande partie de ses dernières années à se plonger dans le problème des rapports sociaux primitifs, en particulier par rapport aux questions qui lui étaient posées par le mouvement révolutionnaire en Russie (voir le chapitre « Communisme du passé, communisme du futur » dans notre livre à paraître Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle). Pour Marx, Engels et, aussi, pour Rosa Luxemburg qui a beaucoup écrit à ce sujet dans son livre Introduction à l'économie politique, la découverte que les formes originelles des relations humaines n'étaient pas basées sur l'égoïsme et la compétition mais sur la solidarité et la coopération, et que des siècles et même des millénaires après l'avènement de la société de classe, il existait toujours un attachement profond et persistant aux formes sociales communales, en particulier chez les classes opprimées et exploitées, constituait une confirmation éclatante de la vision communiste et une arme puissante contre les mystifications de la bourgeoisie pour qui le pouvoir et la propriété sont inhérents à la nature humaine.
Dans L‘origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat de Engels, dans les Cahiers ethnographiques de Marx, dans l' Introduction à l'économie politique de Rosa Luxemburg, ils expriment donc un profond respect pour le courage, la morale et la créativité artistique des peuples « sauvages » et « barbares ». Mais il n'y a pas d'idéalisation de ces sociétés. Le communisme pratiqué dans les premières formes de la société humaine n'était pas engendré par l'idée d'égalité mais le produit de la nécessité. C'était la seule forme possible d'organisation sociale dans des conditions où les capacités productives de l'homme n'avaient pas encore permis la constitution d'un surplus social suffisant pour maintenir une élite privilégiée, une classe dominante.
Les relations communistes primitives émergèrent très probablement avec le développement de l'humanité - c'est-à-dire d'une espèce que la capacité de transformer son environnement pour satisfaire ses besoins matériels distinguait de tous les autres membres du règne animal. Elles ont permis aux êtres humains de devenir l'espèce dominante sur la planète. Mais si nous faisons une généralisation à partir de ce que nous connaissons de la forme la plus archaïque de communisme primitif - chez les Aborigènes d'Australie - il apparaît que les formes d'appropriation du produit social, y étant entièrement collectives5, ont aussi empêché le développement de la productivité individuelle ; le résultat en a été que les forces productives n'ont quasiment pas évolué pendant des millénaires. De toutes façons, le changement des conditions matérielles et environnementales, comme l'augmentation de la population, a rendu de plus en plus intenable, à un moment donné, le collectivisme extrême des premières formes de société humaine qui faisait obstacle au développement de techniques de production (comme l'élevage et l'agriculture) pouvant nourrir un plus grand nombre de personnes ou des populations vivant désormais dans des conditions sociales et environnementales ayant changé.6
Comme le note Marx, «L'histoire de la décadence des communautés primitives est encore à écrire. Jusqu'ici on n'a fourni que de maigres ébauches. Mais en tout cas l'exploration est assez avancée pour affirmer que (...) les causes de leur décadence dérivent de données économiques qui les empêchaient de dépasser un certain degré de développement. » (Premier brouillon de lettre à Vera Zassoulitch, 1881). Le déclin du communisme primitif et la montée des divisions de classe n'échappent pas aux règles générales mises en lumière dans la Préface : les relations que les hommes ont nouées entre eux pour satisfaire leurs besoins, parviennent de moins en moins à remplir leur fonction d'origine et entrent donc dans une crise fondamentale ; le résultat est que les communautés qu'ils soutiennent ou bien disparaissent complètement, ou bien remplacent les anciens rapports par de nouveaux, plus capables de développer la productivité du travail humain. Nous avons déjà vu qu'Engels insistait sur le fait que : « La puissance de cette communauté primitive devait être brisée - elle le fut. »
Pourquoi ? Parce que «La tribu restait pour l'homme la limite, aussi bien en face de l'étranger que vis-à-vis de soi-même: la tribu, la gens et leurs institutions étaient sacrées et intangibles, constituaient un pouvoir supérieur donné par la nature, auquel l'individu restait totalement soumis dans ses sentiments, ses pensées et ses actes. Autant les hommes de cette époque nous paraissaient imposants, autant ils sont indifférenciés les uns des autres, ils tiennent encore, comme dit Marx, au cordon ombilical de la communauté primitive. » (L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat, ibid.)
A la lumière des découvertes anthropologiques, on pourrait contester l'affirmation d'Engels selon laquelle les peuples des sociétés tribales manquaient à ce point d'individualité. Mais le point de vue qui sous-tend ce passage reste valable : à plusieurs moments clé, les anciennes méthodes et les anciennes relations communales s'avérèrent une entrave au développement et, aussi contradictoire que cela puisse paraître, la montée graduelle de la propriété individuelle, l'exploitation de classe et une nouvelle phase de l'auto-aliénation de l'homme, devinrent tous « facteurs de développement ».
Le mode de production « asiatique »
Le terme « mode de production asiatique » est controversé. Engels omet malheureusement d'inclure ce concept dans son œuvre de référence sur la montée des sociétés de classe, L'origine de la famille, de la propriété et de l'Etat, bien que les précédents travaux de Marx aient contenu de nombreuses références à celui-ci. L'erreur d'Engels fut ultérieurement aggravée par les staliniens qui rejetèrent le concept lui-même et proposèrent une vision linéaire et très mécanique de l'histoire, comme si celle-ci avait évolué partout suivant les phases du communisme primitif, de l'esclavage, du féodalisme et du capitalisme. Ce schéma comportait des avantages certains pour la bureaucratie stalinienne : d'une part, bien après que la révolution bourgeoise eut cessé d'être à l'ordre du jour de l'histoire mondiale, il leur permettait de considérer comme « progressistes » les bourgeoisies qui se développaient dans des pays comme l'Inde ou la Chine dont ils définissaient les anciennes sociétés "despotiques orientales" comme « féodales » ; et cela leur permettait aussi d'éviter des critiques embarrassantes concernant leur propre forme de despotisme, puisque, dans le concept de despotisme asiatique, c'est l'Etat et non une classe de propriétaires individuels, qui assure directement l'exploitation de la force de travail ; le parallèle avec l'Etat stalinien est évident.
Des chercheurs plus sérieux comme Perry Anderson dans l'Appendice à son livre Lineages of the Absolutist State (1979), pense que caractériser, comme l'a fait Marx, des sociétés comme l'Inde et d'autres sociétés contemporaines de l'époque de formes d'un « mode asiatique » défini, était basé sur des informations fausses et que, de toutes façons, le concept est tellement général qu'il manque de signification précise.
Il est certain que l'épithète « asiatique » lui-même crée une confusion. Dans une certaine mesure, toutes les premières formes de société de classe ont pris la forme analysée par Marx sous cette rubrique, que ce soit à Sumer, en Egypte, en Inde ou en Chine et dans des régions plus reculées, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, en Afrique et dans le Pacifique. Elles étaient fondées sur la communauté villageoise héritée de l'époque qui a précédé l'émergence de l'Etat. Le pouvoir d'Etat, souvent personnifié par une caste de prêtres, est basé sur le surproduit extirpé des communautés villageoises sous la forme de tribut ou, dans le cas de grands projets de construction (voies d'irrigation, construction de temples, etc.), sur le travail obligatoire (la « corvée »). L'esclavage pouvait exister mais il ne constituait pas la forme dominante du travail. Nous pensons que, bien que ces sociétés aient présenté entre elles des différences significatives, leur similarité et leur unité se manifestaient sur le plan le plus crucial dans la classification des modes de production «antagoniques » : le type de rapports sociaux à travers lesquels le surtravail est extrait de la classe exploitée.
Lorsqu'on examine ces formes sociales et leur décadence, elles comportent, comme les sociétés « primitives », un certain nombre de caractéristiques spécifiques ; ces sociétés semblent présenter un stabilité extraordinaire et ont rarement, sinon jamais, « évolué » vers un nouveau mode de production sans avoir été battues de l'extérieur. Ce serait néanmoins une erreur de considérer que la société asiatique n'a pas d'histoire. Il existe une grande différence entre les premières formes despotiques qui ont surgi à Hawaï ou en Amérique du Sud qui sont très proches de leurs origines tribales et les gigantesques empires qui se sont développés en Inde ou en Chine et qui ont donné lieu à des formes culturelles extrêmement sophistiquées.
Néanmoins, les caractéristiques sous-jacentes - le caractère central de la communauté villageoise - demeure et fournit la clé de la compréhension de la nature « immuable» de ces sociétés.
- «Ces petites communautés indiennes, dont on peut suivre les traces jusqu'aux temps les plus reculés, et qui existent encore en partie, sont fondées sur la possession commune du sol, sur l'union immédiate de l'agriculture et du métier et sur une division du travail invariable, laquelle sert de plan et de modèle toutes les fois qu'il se forme des communautés nouvelles. Etablies sur un terrain qui comprend de cent à quelques milles acres, elles constituent des organismes de production complets se suffisant à elles-mêmes. La plus grande masse du produit est destinée à la consommation immédiate de la communauté; elle ne devient point marchandise, de manière que la production est indépendante de la division du travail occasionnée par l'échange dans l'ensemble de la société indienne. L'excédent seul des produits se transforme en marchandise, et va tout d'abord entre les mains de l'État auquel, depuis les temps les plus reculés, en revient une certaine partie à titre de rente en nature.(...) La simplicité de l'organisme productif de ces communautés qui se suffisent à elles mêmes, se reproduisent constamment sous la même forme, et une fois détruites accidentellement, se reconstituent au même lieu et avec le même nom, nous fournit la clef de l'immutabilité des sociétés asiatiques, immutabilité qui contraste d'une manière si étrange avec la dissolution et reconstruction incessantes des Etats asiatiques, les changements violents de leurs dynasties. La structure des éléments économiques fondamentaux de la société, reste hors des atteintes de toutes les tourmentes de la région politique. » (Le Capital, Livre I, section 4, chapitre 14, Division du travail dans la manufacture et dans la société)
Dans ce mode de production, les entraves au développement de la production marchande étaient bien plus puissantes que dans la Rome antique ou dans le féodalisme, et c'est certainement la raison pour laquelle, dans les régions où il est devenu dominant, le capitalisme n'apparaît pas comme un produit de l'ancien système mais comme un envahisseur étranger. On peut noter également que la seule société « orientale » qui ait développé, dans une certaine mesure, son propre capitalisme indépendant est le Japon où existait auparavant un système féodal.
Ainsi, dans cette forme sociale, le conflit entre les rapports de production et l'évolution des forces productives apparaît souvent comme une stagnation plutôt qu'un déclin parce que, alors que les dynasties montaient et chutaient, se consumant dans des conflits internes incessants et écrasant la société sous le poids de projets étatiques improductifs « pharaoniques », la structure fondamentale de la société continuait à se maintenir ; et si de nouveaux rapports de production n'émergeaient pas, alors les périodes de déclin de ce mode de production à strictement parler ne constituaient pas vraiment des époques de révolution sociale. C'est tout à fait cohérent avec la méthode d'ensemble utilisée par Marx qui ne suppose pas que toutes les formes de société suivent une évolution linéaire ou prédéterminée et envisage la possibilité que des sociétés se trouvent dans une impasse d'où aucune évolution ultérieure n'est possible. Nous devons aussi rappeler que certaines des expressions les plus isolées de ce mode de production se sont complètement effondrées, souvent parce qu'elles avaient atteint les limites de croissance possible dans un milieu écologique donné. Cela semble avoir été le cas de la culture Maya qui a détruit sa propre base agricole par une déforestation excessive. Dans ce cas, il y a même eu une « régression » délibérée de la part de grandes parties de la population qui a abandonné les villes et est retournée à la chasse et à la cueillette, même si la mémoire des anciens calendriers et des traditions mayas fut préservée de façon assidue. D'autres cultures comme celle de l'Île de Pâques, semblent avoir disparu entièrement, très probablement à cause de conflits de classe insurmontables, de la violence et de la famine.
L'esclavage et le féodalisme
Marx et Engels n'ont jamais nié qu'ils étaient très peu familiers des formations sociales primitives et asiatiques du fait des limites de la connaissance de l'époque. Ils étaient beaucoup plus confiants pour écrire sur la société « antique » (c'est-à-dire les sociétés esclavagistes de la Grèce et de Rome) et sur le féodalisme européen. En fait, l'étude de ces sociétés a joué un rôle significatif dans l'élaboration de leur théorie de l'histoire puisqu'elles fournissaient des exemples très clairs du processus dynamique au cours duquel un mode de production avait succédé à un autre. C'est évident dans les premiers écrits de Marx (L'idéologie allemande) où il situe la montée du féodalisme précisément dans les conditions entraînées par le déclin de Rome.
- « La troisième forme est la propriété féodale ou celle des divers ordres. Tandis que l'antiquité partait de la ville et de son petit territoire, le moyen âge partait de la campagne. Ce point de départ tenait à la dispersion et à l'éparpillement, sur de vastes espaces des populations existantes et que les conquérants ne vinrent guère grossir. À l'encontre de celui de la Grèce et de Rome, le développement féodal débute donc sur un terrain bien plus étendu, préparé par les conquêtes romaines et par l'extension de l'agriculture qu'elles entraînèrent initialement. Les derniers siècles de l'Empire romain en déclin et les conquêtes mêmes des barbares anéantirent une masse de forces productives : l'agriculture avait sombré, l'industrie dépérissait faute de débouchés, le commerce languissait ou était interrompu par la violence, la population urbaine et rurale avait diminué. Cette situation et le mode d'organisation de la conquête qui en découla, développèrent, sous l'influence de l'organisation militaire des Germains, la propriété féodale. Comme la propriété tribale et communale, celle-ci repose à son tour sur une communauté, sauf que ce ne sont plus les esclaves, comme dans l'Antiquité, mais les petits paysans asservis qui en constituent la classe directement productrice. » (L'Idéologie allemande, ibid.)
Le terme de décadence lui-même évoque l'image de la fin de l'Empire romain - les orgies et les empereurs assoiffés de pouvoir, les combats mortels des gladiateurs face à d'immenses foules de spectateurs réclamant du sang. Il est certain que ces images portent sur des éléments « superstructurels » de la société romaine mais elles reflètent une réalité qui se déroulait aux fondements mêmes du système esclavagiste ; aussi des révolutionnaires comme Engels et Rosa Luxemburg se sentaient en droit de présenter le déclin de l'Empire romain comme une sorte de présage de ce qui était réservé à l'humanité si le prolétariat ne parvenait pas à renverser le capitalisme : «la décadence de toute civilisation, avec pour conséquences, comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière .» (Brochure de Junius, Socialisme ou Barbarie ?)
La société esclavagiste antique était une formation sociale bien plus dynamique que le mode asiatique, même si ce dernier a contribué au développement de la culture grecque antique et donc au mode de production esclavagiste en général (l'Egypte en particulier était considérée comme un dépositaire vénérable de la sagesse). Ce dynamisme provenait dans une large mesure du fait que, comme l'a dit un contemporain de l'époque, « tout est à vendre à Rome » : la forme marchande s'était développée à un tel point que les anciennes communautés agraires n'étaient plus que le doux souvenir d'un âge d'or révolu et des masses d'êtres humains étaient devenues elles-mêmes des marchandises à acheter et vendre sur le marché des esclaves. Même lorsqu'il subsistait de vastes domaines de l'économie où les petits paysans et les artisans accomplissaient encore du travail productif, de vastes armées d'esclaves assumaient un rôle de plus en plus prépondérant dans la production centrale de l'économie antique - les grands domaines agricoles, les travaux publics et les mines. L'esclavage, cette grande « invention » du monde antique fut, pendant une très longue période, une « forme de développement » formidable, permettant aux citoyens libres de s'organiser en armées puissantes qui, en conquérant de nouvelles terres pour l'Empire, fournissaient sans cesse de nouveaux esclaves. Mais de même, à un moment donné, l'esclavage se transforma en entrave à tout développement ultérieur. La faiblesse inhérente de sa productivité réside dans le fait que le producteur (l'esclave) n'a aucune raison de consacrer au travail le meilleur de ses capacités productives, et le propriétaire d'esclave aucune raison d'investir pour développer de meilleures techniques de production puisque l'option la moins coûteuse était toujours un apport de nouveaux esclaves. D'où le décalage extraordinaire entre les avancées philosophiques/scientifiques de la classe des penseurs dont le loisir était fondé sur une plate-forme portée par des esclaves, et l'application extrêmement limitée des avancées théoriques ou techniques qui étaient faites. Ce fut le cas, par exemple, pour le moulin à eau qui a joué un rôle crucial dans le développement de l'agriculture féodale. En fait, il a été inventé en Palestine au tournant du Premier siècle après J.C., mais son utilisation ne fut jamais généralisée à tout l'Empire. A un moment donné, donc, le mode de production esclavagiste s'est trouvé incapable d'augmenter la productivité du travail de façon radicale, ce qui l'empêcha de maintenir les vastes armées qui étaient nécessaires pour le faire fonctionner. L'expansion de Rome était allée au-delà de ses capacités, prise dans une contradiction insoluble qui s'exprimait dans toutes les caractéristiques qu'on connaît de son déclin.
Dans Passages from Antiquity to Feudalism (« Passage de l'antiquité au féodalisme") (1974), l'historien Perry Anderson énumère certaines des expressions économiques, politiques et militaires de ce blocage des forces productives de la société romaine par les relations esclavagistes au début du 3e siècle : « Au milieu du siècle, le système monétaire s'effondra complètement, les prix du blé étaient montés en flèche jusqu'à 200 fois leur taux au début du Principat. La stabilité politique dégénéra en même temps que la stabilité monétaire. Au cours des cinquante années chaotiques qui vont de 235 à 284, il n'y eut pas moins de vingt empereurs, dont dix-huit moururent de mort violente, un fut fait prisonnier à l'étranger, l'autre fut victime de la peste - des destins à l'image de l'époque. Les guerres civiles et les usurpations furent quasiment ininterrompues, depuis Maximin Le Thrace jusqu'à Dioclétien. Elles furent aggravées par des invasions étrangères dévastatrices régulières et des attaques le long des frontières avec de profondes incursions à l'intérieur... Les troubles politiques intérieurs et les invasions étrangères apportèrent dans leur sillage des épidémies successives qui affaiblirent et diminuèrent la population de l'Empire, déjà réduite par la destruction due aux guerres. Les terres furent désertées et la pénurie de produits agricoles se développa. Le système d'impôts se désintégra avec la dépréciation de la monnaie et les impôts fiscaux redevinrent des tributs en nature. La construction dans les villes s'arrêta brusquement, ce que les fouilles archéologiques attestent dans tout l'Empire ; dans certaines régions, les centres urbains disparurent et diminuèrent.»
Anderson poursuit en montrant comment, face à cette crise profonde, le pouvoir d'Etat romain, fondamentalement sur la base d'une armée réorganisée et agrandie, enfla dans des proportions gigantesques et parvint à une certaine stabilisation qui dura cent ans. Mais comme « le gonflement de l'Etat s'accompagnait d'un rétrécissement de l'économie... », ce renouveau ne fit qu'ouvrir la voie à ce qu'il appelle « la crise finale de l'Antiquité », imposant la nécessité d'abandonner progressivement le rapport esclavagiste. Un autre facteur-clé dans le destin du mode de production esclavagiste fut la généralisation des révoltes d'esclaves et d'autres classes exploitées et opprimées dans tout l'Empire au 5e siècle après J.C. (comme ce qu'on appelle « Bacudae » qui eurent lieu à une échelle bien plus grande que la révolte de Spartacus au premier siècle - bien qu'on se rappelle justement cette dernière pour son audace incroyable et le désir ardent d'un nouveau monde qui l'inspira.
Ainsi, la décadence de Rome correspond de façon précise à la formulation de Marx et a eu clairement un caractère catastrophique. Malgré les récents efforts des historiens bourgeois pour la présenter comme un processus graduel et imperceptible, elle s'est manifestée comme une crise de sous-production dévastatrice ; la société était de moins en moins capable de produire de quoi satisfaire les besoins élémentaires de la vie - il y eut une véritable régression des forces productives et de nombreux domaines de la connaissance et de la technique furent effectivement enterrés et perdus pour des siècles. Ce ne fut pas un processus unilatéral -comme nous l'avons noté, la grande crise du 3e siècle fut suivie par un renouveau relatif qui ne prit fin qu'avec la vague finale d'invasions barbares - mais il était inexorable.
L'effondrement du système romain constituait la condition pour l'émergence de nouveaux rapports de production ; une grande partie des propriétaires terriens prit la décision révolutionnaire d'éliminer l'esclavage en faveur du système des colons - précurseur du servage féodal, dans lequel le producteur tout en étant directement contraint de travailler pour la classe des propriétaires, se voyait attribuer son propre lopin de terre à cultiver. Le second ingrédient du féodalisme, mentionné par Marx dans le passage de l'Idéologie allemande, fut l'élément barbare « germanique » qui combinait l'apparition d'une aristocratie guerrière avec des vestiges de propriété communale, obstinément maintenue par la paysannerie. Une longue période de transition s'ensuivit au cours de laquelle les relations esclavagistes n'avaient pas complètement disparu et où le système féodal s'affirmait graduellement ; il atteignit sa véritable ascendance seulement au début du nouveau millénaire. Et bien que, , dans différents domaines (l'urbanisation, l'indépendance relative de l'art et de la pensée philosophique vis-à-vis de la religion, la médecine, etc.) la montée de la société féodale ait représenté une régression marquée par rapport aux réalisations de l'Antiquité, les nouveaux rapports sociaux donnèrent au seigneur et au serf un intérêt direct dans l'accroissement de la production de leur part de terre et permirent la généralisation d'un nombre important d'avancées techniques dans l'agriculture : la charrue à soc de fer, les harnais de fer qui permettaient de conduire les chevaux, le moulin à eau, le système de rotation des cultures dans trois champs (la jachère), etc. Le nouveau mode de production permit ainsi un renouveau des villes et la floraison d'une nouvelle culture, qui s'exprime de la façon la plus caractéristique dans les grandes cathédrales et les universités qui sont nées aux 12e et 13e siècles.
Mais comme le système esclavagiste avant lui, le féodalisme atteignit aussi ses limites « externes » :
- « Dans les cent années suivantes [du 13e siècle], une crise générale massive frappa tout le continent... le facteur déterminant le plus profond de cette crise générale réside probablement... dans une exploitation des mécanismes de reproduction du système au point limite de leurs capacités ultimes. En particulier, il semble clair que le moteur des défrichements qui avaient permis à l'ensemble de l'économie féodale de se développer pendant trois siècles, finit par dépasser les limites objectives de la terre et de la structure sociale. La population continuait à augmenter alors que le rendement chutait dans les terres marginales qu'on pouvait encore convertir au niveau existant de technique, et le sol se détériorait du fait de la précipitation et de sa mauvaise utilisation. Les dernières réserves de nouvelles terres défrichées étaient en général de mauvaise qualité, humides ou avec une terre légère, qu'il était plus difficile de cultiver et sur lesquelles des cultures inférieures comme l'avoine étaient semées. Les anciennes terres cultivées subissaient pour leur part l'influence du temps et connaissaient un déclin du fait de la durée de leur culture... » (P. Anderson, Ibid.)
Comme l'expansion de l'économie féodale agricole se heurtait à ces barrières, des conséquences désastreuses s'ensuivirent pour la vie de la société : les mauvaises récoltes, les famines, l'effondrement du prix du grain combiné à l'augmentation vertigineuse des biens produits dans les centres urbains :
- « Ce processus contradictoire affecta très fortement la noblesse car son mode de vie était devenu de plus en plus dépendant des marchandises de luxe produites dans les villes... alors que la culture des domaines et les taxes de servage de ses propriétés rapportaient progressivement de moins en moins. Le résultat fut la baisse des revenus seigneuriaux qui, à son tour, déchaîna une vague sans précédent de guerres puisque les chevaliers cherchaient partout à refaire fortune par le pillage. En Allemagne, en Italie, cette quête de butin à une époque de disette produisit le phénomène de banditisme désorganisé et anarchique des seigneurs... En France surtout, « la Guerre de Cent ans » - combinaison meurtrière de guerre civile entre les Capétiens et la Maison de Bourgogne et de conflit international entre l'Angleterre et la France, impliquant également les puissances des Flandres et d'Espagne - plongea le plus riche pays d'Europe dans un état de désordre et de misère jamais connus. En Angleterre, l'épilogue de la défaite finale du continent en France fut le gangstérisme des barons dans les Guerres des Roses... Pour compléter ce panorama de désolation, à cette crise structurelle vint s'ajouter une catastrophe conjoncturelle : l'arrivée en 1348 de la peste venant d'Asie. » (Ibid.)
La peste qui réduisit la population européenne d'un tiers, précipita la fin du servage. Elle provoqua un manque chronique de main d'œuvre dans les campagnes, obligeant la noblesse à passer des corvées féodales traditionnelles au paiement de salaires ; mais, en même temps, la noblesse tentait de faire tourner la roue de l'histoire à l'envers en imposant des restrictions draconiennes sur les salaires et le mouvement des travailleurs ; cette tendance européenne fut codifiée notamment dans l'exemple typique du Statute of Labourers (« Loi sur le statut des travailleurs ») décrété en Angleterre immédiatement après la grande peste. Le résultat de cette réaction de la noblesse fut de provoquer et d'étendre la lutte de classe. La manifestation la plus connue est l'énorme Révolte des paysans de 1381 en Angleterre. Mais il y eut des soulèvements comparables dans toute l'Europe pendant cette période (les Jacqueries en France, les révoltes des Labourers en Flandres, la rébellion des Ciompi à Florence, etc.).
Comme pendant le déclin de la Rome antique, les contradictions croissantes du système féodal au niveau économique eurent donc des répercussions au niveau politique (guerres et révoltes sociales) et dans les rapports entre l'homme et la nature ; tous ces éléments accélérèrent et aiguisèrent à leur tour la crise générale. Comme à Rome, le déclin général du féodalisme fut le résultat d'une crise de sous-production, de l'incapacité des anciens rapports sociaux à permettre la production des moyens de base de l'existence quotidienne. Il est important de noter que, bien que la lente émergence des rapports marchands dans les villes ait constitué un facteur dissolvant des liens féodaux et ait été accélérée par les effets de la crise générale (les guerres, les famines, la peste), les nouveaux rapports sociaux ne pouvaient pas véritablement prendre leur envol tant que l'ancien système n'avait pas atteint une situation de contradiction interne aboutissant à un grave déclin des forces productives :
- « L'une des conclusions les plus importantes à laquelle on parvient lorsqu'on examine le grand crash du féodalisme européen est que - contrairement aux convictions largement répandues chez les marxistes -le « trait » caractéristique d'une crise d'un mode de production n'est pas celui où de vigoureuses forces (économiques) de production surgissent triomphalement à travers des rapports (sociaux) de production rétrogrades et établissent promptement un niveau de productivité et une société supérieurs sur leurs ruines. Au contraire, les forces productives tendent à stagner et à reculer au sein des rapports de production existants ; ces derniers doivent donc être radicalement transformés et réorganisés avant que de nouvelles forces productives puissent être créées et combinées globalement dans un nouveau mode de production. En d'autres termes, ce sont les rapports de production qui changent en général avant les forces productives au cours d'une période de transition, et non l'inverse. » (Ibid.).Comme dans la Rome antique, une période de régression de l'ancien système constituait une condition pour qu'un nouveau mode de production se développe.
Comme dans la période de décadence romaine aussi, la classe dominante chercha à préserver son système chancelant par des moyens de plus en plus artificiels. L'adoption de lois féroces pour contrôler la mobilité du travail et prévenir la tendance des travailleurs agricoles à s'enfuir vers les villes, la tentative de contrecarrer les tendances centrifuges de l'aristocratie par la centralisation du pouvoir monarchique, l'utilisation de l'Inquisition pour imposer un contrôle idéologique rigide sur toutes les expressions de pensée hérétiques ou dissidentes, la dépréciation de la monnaie afin de « résoudre » le problème de l'endettement royal... toutes ces tendances représentaient les tentatives d'un système agonisant pour repousser sa mort, mais elles ne pouvaient l'empêcher. En fait, dans une large mesure, les moyens mêmes utilisés pour préserver l'ancien système se transformèrent en têtes de pont du nouveau : ce fut le cas, par exemple, des monarchies centralisées de l'Angleterre des Tudor qui, en grande partie, créèrent les conditions nécessaires à l'émergence de l'Etat national capitaliste.
Bien plus clairement que pendant la décadence romaine, l'époque de déclin féodal fut également une époque de révolution sociale dans le sens où une classe authentiquement nouvelle et révolutionnaire naquit de ses entrailles, une classe avec une vision mondiale, qui défiait les anciennes idéologies et institutions, et dont le mode économique trouvait dans les rapports féodaux un obstacle intolérable à son expansion. La révolution bourgeoise a fait son entrée triomphale sur la scène de l'histoire en Angleterre en 1640, même s'il a fallu encore un siècle et demi avant qu'elle ne remporte d'autres victoires, plus spectaculaires encore, comme lors de la révolution en France dans les années 1790. Il était possible pour la révolution bourgeoise de se développer sur une période aussi longue car elle constituait le couronnement politique d'un long processus de développement économique et social au sein de l'ancien système et parce qu'elle suivait un rythme différent dans des nations différentes.
La transformation des formes idéologiques
- «Lorsqu'on considère ces bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel - qu'on peut constater d'une manière scientifiquement rigoureuse - des conditions de production économiques et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref les formes idéologiques au sein desquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu'au bout.» (Préface à l'Introduction à la Critique de l'économie politique)
Toutes les sociétés de classe se maintiennent par une combinaison de répression directe et de contrôle idéologique exercé par la classe dominante au moyen de ses nombreuses institutions : la famille, la religion, l'éducation, etc. Les idéologies ne sont jamais un reflet passif de la base économique mais ont une dynamique propre qui, à certains moments, peut avoir un impact actif sur les rapports sociaux sous-jacents. En affirmant la conception matérialiste de l'histoire, Marx était obligé de « distinguer » entre « le bouleversement matériel des conditions économiques » et « les formes idéologiques au sein desquelles les hommes prennent conscience de ce conflit » parce que, jusqu'alors, la démarche historique qui prévalait avait été d'insister sur ces dernières au détriment de la première.
Quand on analyse les transformations idéologiques qui ont lieu dans une époque de révolution sociale, il est important de se rappeler que, tandis qu'elles sont en dernière instance déterminées par les conditions économiques de production, cela n'a pas lieu de façon mécanique , notamment parce qu'une telle époque n'est jamais marquée par une descente ou une déchéance pure mais par un conflit croissant entre des forces sociales contradictoires. Il est caractéristique de telles époques que l'ancienne idéologie dominante, correspondant de moins en moins à la réalité sociale changeante, tende à se décomposer et à laisser la place à de nouvelles visions du monde capables d'inspirer et de mobiliser les classes sociales opposées à l'ancien ordre. Dans le processus de décomposition, les anciennes idéologies - religieuse, philosophique, artistique - succombent fréquemment au pessimisme, au nihilisme, sont obsédées par la mort, tandis que les idéologies des classes montantes ou révoltées sont plus souvent optimistes, affirmant la vie, attendant l'aube d'un monde radicalement transformé.
Pour prendre un exemple : dans la période dynamique du système esclavagiste, la philosophie tendait, dans les limites de l'époque, à exprimer les efforts de l'humanité pour « se connaître soi-même » selon la formule immortelle de Socrate - pour saisir la véritable dynamique de la nature et de la société à travers la pensée rationnelle, sans l'intermédiaire du divin. Dans sa période de déclin, la philosophie elle-même tendait à reculer et à justifier le désespoir et l'irrationalité, comme chez les néoplatoniciens auxquels étaient liés les nombreux cultes du mystère qui fleurirent dans l'Empire plus tard.
Cette tendance ne peut être comprise de façon unilatérale cependant : dans les périodes de décadence, les anciennes religions et les anciennes philosophies étaient également confrontées à la montée de nouvelles classes révolutionnaires ou à la révolte des exploités, et celles-ci prenaient aussi, en règle générale, une forme religieuse. Ainsi dans la Rome antique, la religion chrétienne, quoique certainement influencée par les cultes ésotériques orientaux, commença comme un mouvement de protestation des dépossédés contre l'ordre dominant et, plus tard, en tant que puissance établie, fournit un cadre pour préserver beaucoup d'acquis de l'ancien monde. Cette dialectique entre l'ancien et le nouveau a constitué également une caractéristique des transformations idéologiques qui ont eu lieu pendant le déclin du féodalisme. D'une part, « la période de stagnation a vu la montée du mysticisme sous toutes ses formes. La forme intellectuelle avec le « Traité sur l'art de bien mourir» (Ars moriendi, 15e et 16e siècles) et, surtout, « L'imitation de Jésus Christ » (fin 14e début 15e). La forme émotionnelle avec ses grandes expressions de piété populaire fut exacerbée par l'influence d'éléments radicaux incontrôlés du clergé mendiant : les « flagellants » erraient dans les campagnes, se fouettant le corps sur les places de village, afin de frapper la sensibilité humaine et d'appeler les chrétiens au repentir. Ces manifestations donnèrent lieu à une imagerie d'un goût souvent douteux, comme les fontaines de sang qui symbolisaient le rédempteur. Très vite le mouvement atteignit l'hystérie et la hiérarchie ecclésiastique dut intervenir contre les fauteurs de trouble afin d'empêcher que leurs prêches ne développent le nombre de vagabonds... L'art macabre se développa... le texte sacré le plus apprécié des esprits les plus éclairés était l'Apocalypse. » (J. Favier, De Marco Polo à Christophe Colomb)
D'autre part, la fin du féodalisme vit aussi la montée de la bourgeoisie et de sa vision mondiale s'exprimer dans la floraison magnifique des arts et des sciences pendant la Renaissance. Et même des mouvements mystiques et millénaristes tels que celui des Anabaptistes, furent, comme le souligne Engels, souvent intimement liés aux aspirations communistes des classes exploitées. Ces mouvements ne pouvaient pas encore présenter une alternative historiquement viable à l'ancien système d'exploitation et leurs rêves millénaristes étaient plus souvent orientés vers un passé primitif que vers un futur avancé : néanmoins, ils jouèrent un rôle clé dans les processus qui entraînèrent la destruction de la hiérarchie médiévale décadente.
Dans une époque de décadence, le déclin culturel n'est jamais absolu : sur le plan artistique, par exemple, la stagnation des anciennes écoles peut aussi être contrecarrée par de nouvelles formes qui expriment avant tout la protestation des hommes contre un ordre de plus en plus inhumain. On peut dire la même chose de la morale. Si en dernière instance, la morale est une expression de la nature sociale de l'humanité et si les périodes de décadence sont des expressions de la panne des rapports sociaux, ceux-ci seront alors caractérisés généralement par une panne concomitante de la morale, par une tendance à l'effondrement des liens humains fondamentaux et par le triomphe des impulsions anti-sociales. La perversion et la prostitution du désir sexuel, le développement des meurtres gratuits, du vol et de la fraude et, par dessus tout, la mise sous le boisseau de l'ordre moral dans la guerre deviennent l'ordre du jour. Mais une fois encore, on ne peut regarder cela d'une façon mécanique et schématique selon laquelle les périodes d'ascendance seraient marquées par un comportement humain supérieur et celles de déclin par un plongeon soudain dans l'épouvante et la dépravation. Le fait que l'ancienne morale soit sapée et vole en éclats peut également exprimer la montée d'un nouveau système d'exploitation vis-à-vis duquel, en comparaison, l'ancien ordre peut sembler bienveillant comme le souligne Le Manifeste communiste à propos du capitalisme : «Partout où (la bourgeoisie) a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissent l'homme féodal à ses "supérieurs naturels", elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d'autre lien, entre l'homme et l'homme, que le froid intérêt, les dures exigences du "paiement au comptant". Elle a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite-bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange ; elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement conquises, l'unique et impitoyable liberté du commerce. »
Et pourtant, dans la pensée de Marx et Engels, la compréhension de «la ruse de la raison» de Hegel était telle qu'ils furent capable de comprendre que ce «déclin» moral, cette marchandisation du monde, constituait en réalité une force de progrès qui permettait de se débarrasser de l'ordre féodal et statique, de le laisser derrière et d'ouvrir la voie à un ordre moral authentiquement humain qui se présentait devant.
Gerrard
1 Préface à l'Introduction à la Critique de l'économie politique, Marx 1859, voir la Revue internationale n°134 [59]
2 Voir la première partie [59] de cet article.
3 Morgan, Ancient society.
4 Par exemple, les sociétés de chasseurs établies et déjà très hiérarchisées qui étaient capables de faire des stocks importants, les différentes formes semi-communistes de production agricole, les « empires de tribut » formés par des barbares semi-pastoraux comme les Huns et les Mongols, etc.
5 Dans les tribus australiennes lorsque le mode de vie traditionnel avait encore toute sa force, le chasseur qui rapportait du gibier ne gardait rien pour lui mais remettait immédiatement le produit à la communauté selon des structures complexes de parenté. Selon les travaux de l'anthropologue Alain Testart (Le communisme primitif, 1985), le terme de communisme primitif ne doit s ‘appliquer qu'aux australiens qu'il considère comme les derniers vestiges d'un rapport social qui était probablement généralisé à l'époque du paléolithique. C'est un sujet à débattre. Il est certain que même parmi les peuples de chasseurs-cueilleurs nomades, il existe de grandes différences dans la façon dont le produit social est distribué, mais toutes donnent priorité au maintien de la communauté et, comme Chris Knight le souligne dans son livre Blood relations, Menstruation and the Origins of Culture, 1991 [« les relations de sang, les menstruations et l'origine de la culture »], ce qu'il appelle le « droit sur sa proie » (c'est à dire les limites prescrites dans lesquelles le chasseur peut consumer son gibier) est extrêmement répandu chez les peuples chasseurs.
6 Il faut bien sûr garder à l'esprit que la dissolution des relations primitives ne constitua pas un événement unique et simultané mais qu'elle suivit différents rythmes dans les différentes parties de la planète ; c'est un processus qui a couvert des millénaires et qui atteint aujourd'hui ses derniers chapitres tragiques dans les régions les plus reculées du globe comme en Amazonie et à Bornéo.
Questions théoriques:
- Décadence [4]
Le monde à la veille d'une catastrophe environnementale (I)
- 3774 lectures
"Les famines se développent dans les pays du Tiers Monde et, bientôt, atteindront les pays qu'on prétendait "socialistes", alors qu'en Europe occidentale et en Amérique du Nord on détruit les stocks de produits agricoles, qu'on paye les paysans pour qu'ils cultivent moins de terres, qu'on les pénalise s'ils produisent plus que les quotas imposés. En Amérique latine, les épidémies, comme celle du choléra, tuent des milliers de personnes, alors qu'on avait chassé ce fléau depuis longtemps. Partout dans le monde, les inondations ou les tremblements de terre continuent de tuer des dizaines de milliers d'êtres humains en quelques heures alors que la société est parfaitement capable de construire des digues et des maisons qui pourraient éviter de telles hécatombes. Au même moment, on ne peut même pas invoquer la "fatalité" ou les "caprices de la nature", lorsque, à Tchernobyl, en 1986, l'explosion d'une centrale atomique tue des centaines (sinon des milliers) de personnes et contamine plusieurs provinces, lorsque, dans les pays les plus développés, on assiste à des catastrophes meurtrières au coeur même des grandes villes : 60 morts dans une gare parisienne, plus de 100 morts dans un incendie du métro de Londres, il y a peu de temps. De même, ce système se révèle incapable de faire face à la dégradation de l'environnement, les pluies acides, les pollutions de tous ordres et notamment nucléaire, l'effet de serre, la désertification qui mettent en jeu la survie même de l'espèce humaine." (1991, Révolution communiste ou destruction de l'humanité 1)
La question de l'environnement a toujours été présente dans la propagande des révolutionnaires, depuis la dénonciation que faisaient Marx et Engels des conditions invivables à Londres au milieu du 19e siècle, jusqu'à celle de Bordiga sur les désastres environnementaux dus à l'irresponsabilité du capitalisme. Aujourd'hui cette question est encore plus cruciale et demande un effort accru de la part des organisations révolutionnaires pour montrer comment l'alternative historique devant laquelle est placée l'humanité : socialisme ou barbarie, n'oppose pas la perspective du socialisme à celle de la barbarie uniquement constituée par les guerres, locales ou généralisées, cette barbarie inclut également la menace d'une catastrophe écologique et environnementale qui se profile de plus en plus clairement à l'horizon.
Avec cette série d'articles, le CCI veut développer la question de l'environnement en abordant successivement les aspects suivants :
Ce premier article dresse un état des lieux aujourd'hui et cherche à mettre en évidence la globalité du risque qui pèse sur l'humanité et, en particulier, les phénomènes les plus destructeurs qui existent au niveau planétaire tels que :
- l'accroissement de l'effet de serre,
- la gestion des déchets,
- la diffusion sans cesse accrue de contaminants et les processus qui l'amplifient au niveau biologique
- l'épuisement des ressources naturelles et/ou leur altération par les contaminations.
Dans le second article, nous chercherons à montrer comment les problèmes d'environnement ne peuvent être attribués à des individus - bien qu'il existe aussi bien sûr des responsabilités individuelles - dans la mesure où c'est le capitalisme et sa logique du profit maximum qui sont les véritables responsables. A ce propos, nous verrons comment l'évolution même de la science et de la recherche scientifique ne se fait pas au hasard, mais est soumise à l'impératif capitaliste du profit maximum.
Dans le troisième article, nous analyserons les réponses apportées par les différents mouvements verts, écologistes, etc., pour montrer que, malgré la bonne foi et toute la bonne volonté d'un grand nombre de ceux qui y participent, non seulement elles sont totalement inefficaces mais participent de nourrir les illusions sur une solution possible à ces questions au sein du capitalisme alors que l'unique solution est la révolution communiste internationale.
Les prodromes de la catastrophe
On parle de plus en plus des problèmes environnementaux, ne serait ce que parce que sont apparus récemment, dans les différent pays du monde, des partis qui ont pris la défense de l'environnement pour bannière. Est-ce rassurant? Pas du tout ! Tout le bruit à ce sujet n'a pour fonction que de nous embrouiller encore plus les idées. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé en premier lieu de décrire des phénomènes particuliers qui, en se conjuguant, emportent de plus en plus directement notre société vers la catastrophe environnementale. Comme nous le verrons - et contrairement à ce qu'on nous raconte à la télévision ou dans les revues sur papier glacé plus ou moins spécialisées - la situation est bien plus grave et menaçante que ce qu'on veut nous faire croire. Et ce n'est pas tel ou tel capitaliste, avide et irresponsable, tel ou tel maffioso ou homme de la Camorra, qui en porte la responsabilité, mais bien le système capitaliste en tant que tel.
L'accroissement de l'effet de serre
L'effet de serre est une chose dont tout le monde parle, mais pas toujours en connaissance de cause. En premier lieu, il convient d'être clair sur le fait que l'effet de serre est un phénomène tout à fait bénéfique à la vie sur terre - au moins pour le type de vie que nous connaissons - dans la mesure où il permet que règne à la surface de notre planète une température moyenne (moyenne prenant en compte les quatre saisons et les différentes latitudes) de 15°C environ, au lieu de - 17°C, température estimée en absence de l'effet de serre. Il faut s'imaginer ce que serait un monde dont la température serait en permanence au dessous de 0°C, les mers et les fleuves gelés... A quoi devons nous ce surplus de plus de 32°C ? A l'effet de serre : la lumière du soleil traverse les plus basses couches de l'atmosphère sans être absorbée (le soleil ne réchauffe pas l'air), et alimente l'énergie de la terre. La radiation qui émane de cette dernière (comme de n'importe quel corps céleste) étant essentiellement constituée de rayonnement infrarouge, est alors interceptée et abondamment absorbée par certains constituants de l'air comme l'anhydride carbonique, la vapeur d'eau, le méthane et d'autres composés de synthèse comme les Chlorofluorocarbures (CFC). Il s'ensuit que le bilan thermique de la terre tire profit de cette chaleur produite dans les basses couches de l'atmosphère et qui a pour effet d'augmenter la température à la surface de la terre de 32°C. Le problème n'est donc pas l'effet de serre en tant que tel, mais le fait qu'avec le développement de la société industrielle, ont été introduites dans l'atmosphère beaucoup de substances "à effet de serre" dont la concentration s'accroît sensiblement et qui ont par conséquent pour effet d'accroître l'effet de serre. Il a été démontré, par exemple, grâce à des études menées sur l'air piégé dans des carottes de glace polaire et remontant à 650 000 ans, que la concentration actuelle en CO2, de 380 ppm (parties par millions ou milligrammes par décimètre cube) est la plus élevée de toute cette période, et peut être même aussi des 20 derniers millions d'années. De plus, les températures enregistrées au cours du 20e siècle sont les plus élevées depuis 20 000 ans. Le recours forcené aux combustibles fossiles comme source d'énergie et la déforestation croissante de la surface terrestre ont compromis, à partir de l'ère industrielle, l'équilibre naturel du gaz carbonique dans l'atmosphère. Cet équilibre est le produit de la libération de CO2 dans l'atmosphère d'une part, via la combustion et la dégradation de la matière organique et, d'autre part, de la fixation de ce même gaz carbonique de l'atmosphère par la photosynthèse, processus qui le transforme en glucide et donc en matière organique complexe. Le déséquilibre entre libération (combustion) et fixation (photosynthèse) de CO2, à l'avantage de la libération, est à la base de l'accentuation actuelle de l'effet de serre.
Comme on l'a dit plus haut, il n'y a pas que le gaz carbonique mais aussi la vapeur d'eau et le méthane qui entrent en jeu. La vapeur d'eau est à la fois facteur et produit de l'effet de serre puisque, présente dans l'atmosphère, elle est d'autant plus abondante que la température est plus élevée, du fait de l'évaporation accrue de l'eau qui en résulte. L'augmentation de la quantité de méthane dans l'atmosphère provient, elle, de toute une série de sources naturelles, mais résulte aussi de l'utilisation accrue de ce gaz comme combustible et des fuites au niveau des différents gazoducs disséminés à la surface de la terre. Le méthane, appelé aussi "gaz des marais", est un type de gaz qui est issu de la fermentation de la matière organique en absence d'oxygène. L'inondation des vallées boisées pour la construction de barrages pour les centrales hydroélectriques est à l'origine de productions locales croissantes de méthane. Mais le problème du méthane, qui contribue actuellement pour un tiers à l'augmentation de l'effet de serre, est bien plus grave qu'il n'y paraît à partir des éléments exposés ci-dessus. D'abord et avant tout, le méthane a une capacité d'absorption des infrarouges 23 fois plus grande que celle du CO2, ce qui n'est pas rien. Mais il y a plus grave ! Toutes les prévisions actuelles, déjà assez catastrophiques, ne tiennent pas compte du scenario qui pourrait se dérouler à la suite de la libération de méthane à partir de l'énorme réservoir naturel de la terre. Celui-ci est constitué par des poches de gaz piégé, à environ 0°C et à une pression de quelques atmosphères, dans des structures particulières de glace (gaz hydraté), un litre de cristal étant capable de renfermer quelques 50 litres de gaz méthane. De tels gisements se trouvent surtout en mer, le long du talus continental et à l'intérieur du permafrost dans diverses zones de la Sibérie, de l'Alaska et du nord de l'Europe. Voici le sentiment de quelques experts de ce secteur : "Si le réchauffement global dépassait certaines limites (3-4°C) et si la température des eaux côtières et du permafrost s'élevait, il pourrait y avoir une énorme émission, dans un temps court (quelques dizaines d'années), de méthane libéré par les hydrates rendus instables et cela donnerait lieu à un accroissement de l'effet de serre de type catastrophique. (...) au cours de la dernière année, les émissions de méthane à partir du sol suédois au nord du cercle polaire ont augmenté de 60% et que l'augmentation de température ces quinze dernières années est limitée en moyenne globale, mais est beaucoup plus intense (quelques degrés) dans les zones septentrionales de l'Eurasie et de l'Amérique (en été, le passage mythique au nord-ouest qui permet d'aller en bateau de l'Atlantique au Pacifique, s'est ouvert)." 2
Même sans cette "cerise sur le gâteau", les prévisions élaborées par des instances reconnues au niveau international comme l'Agence IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) de l'ONU et le MIT (Massachussets Institute of Technology) de Boston, annoncent déjà, pour le siècle en cours, une augmentation de la température moyenne qui va d'un minimum de 0.5°C à un maximum de 4.5°C, dans l'hypothèse où, comme cela se passe, rien ne bouge à un niveau significatif. De plus, ces prévisions ne tiennent même pas compte de l'émergence des deux nouvelles puissances industrielles, gloutonnes en énergie, que sont la Chine et l'Inde.
"Un réchauffement supplémentaire de quelques degrés centigrades provoquerait une évaporation plus intense des eaux océaniques, mais les analyses les plus sophistiquées suggèrent qu'il y aurait une disparité accentuée de la pluviosité dans différentes régions. Les zones arides s'étendraient et deviendraient encore plus arides. Les zones océaniques avec des températures de surface supérieures à 27°C, valeur critique pour la formation de cyclones, augmenteraient de 30 à 40%. Cela créerait des événements météorologiques catastrophiques en continu avec des inondations et des désastres récurrents. La fonte d'une bonne partie des glaciers antarctiques et du Groenland, l'augmentation de la température des océans, feraient monter le niveau de ces derniers (...) avec des entrées d'eaux salées dans beaucoup de zones côtières fertiles et la submersion de régions entières (Bengladesh en partie, beaucoup d'îles océaniques)." 3.
Nous n'avons pas la place ici de développer ce thème mais cela vaut la peine au moins de souligner le fait que le changement climatique, provoqué par l'accroissement de l‘effet de serre, même sans arriver à l'effet feed-back produit par la libération du méthane de la terre, risquerait tout autant d'être catastrophique car il produirait :
- une plus grande intensité des événements météorologiques, un lessivage plus grand des terrains par des pluies beaucoup plus fortes, entraînant une diminution de la fertilité, et le déclenchement de processus de désertification même dans des zones à climat moins tempéré, comme cela se produit déjà dans le Piémont (Italie).
- la création, en Méditerranée et dans d'autres mers jadis tempérées, des conditions environnementales favorables à la survie d'espèces marines tropicales, et donc à la migration d'espèces non autochtones, ce qui provoquerait des perturbations de l'équilibre écologique.
- le retour d'anciennes maladies, déjà éradiquées, comme la malaria, du fait de l'instauration de conditions climatiques favorables à la croissance et à la dissémination de leurs organismes vecteurs comme les moustiques, etc.
Le problème de la production et de la gestion des déchets
Un deuxième type de problème, typique de cette phase de la société capitaliste, est la production excessive de déchets et la difficulté qui s'ensuit à les traiter de façon adéquate. Si, récemment, la nouvelle de la présence de monceaux de déchets dans toutes les rues de Naples et de la Campanie a défrayé la chronique internationale, cela n'est dû qu'au fait que cette région du monde est encore considérée, tout compte fait, comme faisant partie d'un pays industriel et donc avancé. Mais le fait que les périphéries de nombreuses grandes villes des pays du Tiers Monde soient devenues elles-mêmes des décharges libres à ciel ouvert, est maintenant une réalité avérée.
Cette accumulation énorme de déchets est le résultat de la logique de fonctionnement du capitalisme. S'il est vrai que l'humanité a toujours produit des déchets, dans le passé ceux-ci étaient toujours réintégrés, récupérés et réutilisés. Il n'y a qu'aujourd'hui, avec le capitalisme, que les déchets deviennent un problème pour les rouages spécifiques du fonctionnement de cette société, des mécanismes tous basés sur un principe fondamental : tout produit de l'activité humaine est considéré comme une marchandise, c'est-à-dire quelque chose qui est destiné à être vendu pour réaliser le maximum de profit sur un marché où l'unique loi est celle de la concurrence. Cela ne peut que produire une série de conséquences néfastes :
1. La production de marchandises ne peut être planifiée dans l'espace et le temps du fait de la concurrence entre capitalistes ; elle suit donc une logique irrationnelle, selon laquelle chaque capitaliste tend à élargir sa propre production pour vendre à plus bas prix et réaliser son profit, ce qui conduit à des excédents de marchandises non vendues. Par ailleurs, c'est justement cette nécessité de vaincre la concurrence et d'abaisser les prix qui conduit les producteurs à diminuer la qualité des produits manufacturés, ce qui fait que leur durée de vie se réduit de façon drastique et qu'ils se transforment plus rapidement en déchets ;
2. Une production aberrante d'emballages et de conditionnements, souvent à partir de substances toxiques, non dégradables, s'accumule dans l'environnement. Ces emballages qui, souvent, n'ont aucune utilité sinon celle de rendre la marchandise plus attrayante pour les acquéreurs éventuels, représentent presque toujours une part prédominante, au niveau du poids et du volume, par rapport au contenu de la marchandise vendue. On estime qu'aujourd'hui, un sac de poubelle non trié, en ville, est à moitié rempli par du matériel provenant des emballages.
3. La production de déchets est accentuée par les nouveaux styles de vie inhérents à la vie moderne. Manger hors de chez soi, dans un self-service, dans des assiettes en plastique et boire de l'eau minérale en bouteille en plastique, est dorénavant devenu le quotidien de centaines de millions de personnes dans le monde entier. De même, l'utilisation de sacs plastique pour faire ses courses est une commodité à laquelle presque personne n'échappe. Tout cela n'arrange pas l'environnement évidemment mais arrange bien le porte-monnaie du gérant du self-service qui économise la main d'œuvre nécessaire au nettoyage de conditionnements non jetables. Le gérant du supermarché ou même le commerçant de quartier y trouve son compte, le client pouvant acheter ce qu'il veut à tout moment, même s'il n'avait pas prévu de le faire, parce que un sachet est prêt à lui servir d'emballage. Tout cela conduit à une augmentation considérable de la production de déchets dans le monde entier, avoisinant le kilo par jour par citoyen, soit à des millions ... de tonnes de déchets divers par jour !
On estime que, rien qu'en Italie, durant les 25 dernières années, à population égale, la quantité de déchets a plus que doublé grâce aux emballages.
Le problème des déchets est l'un de ceux que tous les politiciens pensent pouvoir résoudre mais qui, en fait, rencontre des obstacles insurmontables dans le capitalisme. De tels obstacles ne sont cependant pas liés à un manque de technologie, au contraire, mais, une fois de plus, à la logique selon laquelle cette société est gérée. En réalité, la gestion des déchets, pour les faire disparaître ou en réduire la quantité générée, est, elle aussi, soumise à la loi du profit. Même lorsque le recyclage et la réutilisation de matériaux, via le tri sélectif, sont possibles, tout cela requiert des moyens et une certaine capacité politique de coordination, laquelle fait en général défaut aux économies les plus faibles. C'est pour cela que dans les pays les plus pauvres et là où les activités des entreprises sont en déclin à cause de la crise galopante de ces dernières décennies, gérer les déchets constitue bien plus qu'une dépense supplémentaire.
Mais certains objecteront : si dans les pays avancés, la gestion des déchets fonctionne, cela veut dire que ce n'est qu'une question de bonne volonté, de sens civique et d'aptitude à la gestion de l'entreprise. Le problème, c'est que, comme dans tous les secteurs de la production, les pays les plus forts reportent sur les pays plus faibles (ou en leur sein, sur les régions les plus défavorisées économiquement) le poids d'une partie de la gestion de leurs déchets.
"Deux groupes d'environnementalistes américains, Basel Action Network et Silicon Valley Toxics, ont récemment publié un rapport qui affirme que de 50 à 80 % des déchets de l'électronique des Etats américains de l'ouest sont chargés dans des containers sur des bateaux en partance pour l'Asie (surtout l'Inde et la Chine) où les coûts de leur élimination sont nettement plus bas et les lois sur l'environnement moins sévères. Il ne s'agit pas de projet d'aide, mais d'un commerce de rejets toxiques que les consommateurs ont décidé de jeter. Le rapport des deux associations fait référence par exemple à la décharge de Guiyu, qui accueille surtout des écrans et des imprimantes. Les ouvriers de Guiyu utilisent des instruments de travail rudimentaires pour en extraire les composants destinés à être vendus. Une quantité impressionnante de rejets électroniques n'est pas recyclée mais est simplement abandonnée à ciel ouvert dans les champs, sur les berges des fleuves, dans les étangs, les marais, les rivières et les canaux d'irrigation. Parmi ceux qui travaillent sans aucune précaution, il y a des femmes, des hommes et des enfants". 4
"En Italie (...), on estime que les éco mafias ont un volume d'affaire de 26 000 milliards par an, dont 15 000 pour le trafic et l'élimination illégale des déchets (Rapport Ecomafia 2007, de la Lega Ambiente). (...) L'Office des douanes a confisqué environ 286 containers, avec plus de 9000 tonnes de rejets en 2006. Le traitement légal d'un container de 15 tonnes de rejets dangereux coûte environ 60 000 euros ; pour la même quantité, le marché illégal en Orient n'en demande que 5000. Les principales destinations des trafics illégaux sont de nombreux pays d'Asie en voie de développement ; les matériaux exportés sont d'abord travaillés e,t ensuite, réintroduits en Italie ou dans d'autres pays occidentaux, comme dérivés de ces mêmes déchets pour être destinés, en particulier, aux usines de matière plastique.
En juin 1992, la FAO (Food and Agricultural Organisation) a annoncé que les Etats en voie de développement, les pays africains surtout, étaient devenus une "poubelle" à la disposition de l'occident. La Somalie semble être aujourd'hui l'un des Etats africains le plus "à risque", un véritable carrefour d'échanges et de trafic de ce genre : dans un rapport récent, l'UNEP (United Nations Environment Programme) fait remarquer l'augmentation constante du nombre de nappes phréatiques polluées en Somalie, ce qui est la cause de maladies incurables dans la population. Le port de Lagos, au Nigeria, est l'escale la plus importante du trafic illégal de composants technologiques obsolètes envoyés en Afrique.
En mai dernier, le parlement panafricain (PAP) a demandé aux pays occidentaux un dédommagement pour les dégâts provoqués par l'effet de serre et le dépôt de rejets sur le continent africain, deux problèmes qui, selon les autorités africaines, sont de la responsabilité des pays les plus industrialisés du monde.
Chaque année dans le monde, on produit de 20 à 50 millions de tonnes de "balayures électroniques" ; en Europe, on parle de 11 millions de tonnes dont 80 % finissent à la décharge. On estime que vers 2008, on comptera dans le monde au moins un milliard d'ordinateurs (un pour six habitants) ; vers 2015, il y en aura plus de deux milliards. Ces chiffres représenteront un nouveau danger gravissime au niveau de l'élimination des produits de technologie obsolètes". 5
Comme nous l'avons dit plus haut, le report du problème des déchets vers les régions défavorisées existe aussi à l'intérieur d'un même pays. C'est justement le cas pour la Campanie, en Italie, qui a défrayé la chronique internationale avec ses amas de déchets qui sont restés pendant des mois le long des rues. Mais peu savent que la Campanie, comme - au niveau international - la Chine, l'Inde ou les pays d'Afrique du Nord, est le réceptacle de tous les déchets toxiques des industries du nord qui ont transformé des zones agricoles fertiles et riantes, comme celle de Caserta, en l'une des zones les plus polluées de la planète. Malgré les diverses actions en justice qui se succèdent les unes aux autres, le massacre continue sans encombre. Ce ne sont pas la Camorra, la mafia, la pègre, qui provoquent ces dégâts, mais bien la logique du capitalisme. Tandis que la procédure officielle pour éliminer correctement un kilo de rejets toxiques représente une dépense qui peut être supérieure à 60 centimes, le même service coûte plus ou moins une dizaine de centimes quand on utilise des canaux illégaux. C'est ainsi que chaque année, chaque grotte abandonnée devient une décharge à ciel ouvert. Dans un petit village de la Campanie, où on va justement construire un incinérateur, ces matériaux toxiques, mélangés à de la terre pour les camoufler, ont été utilisés pour construire le soubassement d'un long boulevard "en terre battue". Comme le dit Saviano, dans son livre, qui est devenu un livre culte en Italie : "si les rejets illégaux gérés par la Camorra étaient regroupés, cela ferait une montagne de 14 600 mètres de haut, sur une base de trois hectares : la plus grande montagne qui ait jamais existé sur la terre". 6
Par ailleurs, comme nous le verrons plus en détail dans le prochain article, le problème des déchets est avant tout lié au type de production que développe la société actuelle. Au-delà du "jetable", le problème vient souvent des matériaux utilisés pour la fabrication des objets. Le recours à des matériaux synthétiques, le plastique en particulier, pratiquement indestructibles, pose d'immenses problèmes à l'humanité de demain. Et cette fois, il ne s'agit même pas de pays riches ou pauvres parce que le plastique est non dégradable dans n'importe quel pays du monde, comme cet extrait d'article le met en évidence :
"On l'appelle le Trash Vortex, l'île des déchets de l'Océan Pacifique, qui a un diamètre d'à peu près 2500 km, une profondeur de 30 mètres et qui est composée à 80% de plastique et le reste par d'autres déchets qui arrivent de toutes parts. C'est comme s'il y avait une île immense au milieu du Pacifique, constituée de poubelles au lieu de rochers. Ces dernières semaines, la densité de ce matériau a atteint une valeur telle que le poids total de cette "île" de déchets atteint les 3,5 millions de tonnes explique Chris Parry de la Commission Côtière Californienne de San Francisco (...) Cette décharge incroyable et peu connue s'est formée à partir des années 50, suite à l'existence de la gyre subtropicale Pacifique nord, un courant océanique lent qui se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre et en spirale, sous l'effet d'un système de courants à haute pression. (...). La majeure partie du plastique arrive des continents, 80% environ ; il n'y a que le reste qui provient des bateaux, privés commerciaux ou de pêche. On produit dans le monde environ 100 milliards de kilos de plastique par an, duquel grosso modo 10 % aboutit en mer. 70% de ce plastique finira par aller au fond des océans, causant des dégâts dans les populations de ces fonds. Le reste continue à flotter. La majeure partie de ces plastiques est peu biodégradable et finit par se fragmenter en minuscules morceaux qui aboutissent ensuite dans l'estomac de beaucoup d'animaux marins et causent leur mort. Ce qui reste ne se décomposera que dans des centaines d'années, provoquant pendant ce temps des dégâts dans la vie marine." 7
Une masse de déchets avec une étendue deux fois plus grande que celle des Etats-Unis ! Ils ne l'auraient vue que maintenant ? En vérité, non ! Elle a été découverte en 1997 par un capitaine de recherches océanographiques qui revenait d'une course de yacht et on apprend aujourd'hui qu'un rapport de l'ONU de 2006 "calculait qu'un million d'oiseaux de mer et plus de 100 000 poissons et mammifères marins meurent chaque année à cause des détritus de plastique et que chaque mile marin carré de l'océan contient au moins 46 000 fragments de plastique flottant". 8.
Mais qu'est ce qui a été fait pendant ces dix années par ceux qui tiennent les rênes de la société ? Absolument rien ! Des situations similaires, même si elles ne sont pas aussi dramatiques, sont d'ailleurs aussi à déplorer en Méditerranée, dans les eaux de laquelle on déverse chaque année 6,5 millions de tonnes de détritus, dont 80% sont du plastique, et sur les fonds de laquelle on arrive à compter environ 2000 morceaux de plastique au km2. 9
Et pourtant des solutions existent. Le plastique lorsqu'il est composé de 85% d'amidon de maïs est complètement biodégradable, par exemple. C'est déjà une réalité aujourd'hui : il existe des sachets, des crayons et différents objets fabriqués avec ce matériau. Mais, sous le capitalisme, l'industrie emprunte difficilement une route si celle-ci n'est pas la plus rentable, et comme le plastique à base d'amidon de maïs a un coût plus élevé, personne ne veut assumer les prix plus élevés du matériel biodégradable afin de ne pas se trouver évincé du marché. 10. Le problème, c'est que les capitalistes sont habitués à faire des bilans économiques qui excluent systématiquement tout ce qui ne peut être chiffré, parce qu'on ne peut ni le vendre ni l'acheter, même s'il s'agit de la santé de la population et de l'environnement. Chaque fois qu'un industriel produit un matériau qui, à la fin de sa vie, devient un déchet, les dépenses pour la gestion de ces déchets ne sont pratiquement jamais prévues et, surtout, ce qui n'est jamais prévu, ce sont les dégâts qu'implique la permanence de ce matériau sur la terre.
Il faut faire un autre constat sur le problème des déchets : c'est que le recours à des décharges ou même aux incinérateurs, représente un gaspillage de toute la valeur énergétique et des matériaux utiles que contiennent ces déchets. Il est prouvé, par exemple, que produire des matériaux comme le cuivre et l'aluminium, à partir de ce matériau recyclé représente une diminution des coûts de production qui peut dépasser les 90 %. De ce fait, dans les pays périphériques, les décharges deviennent une véritable source de subsistance pour des milliers de personnes qui ont quitté la campagne mais qui ne réussissent pas à s'intégrer dans le tissu économique des villes. On cherche dans les déchets ce qui pourrait être revendu :
"De véritables "villes poubelles" sont apparues. En Afrique, le bidonville de Korogocho à Nairobi - décrit à maintes reprises par le père Zanotelli - et ceux moins connus de Kigali au Rwanda ; mais aussi en Zambie, où 90 % des poubelles ne sont pas ramassées et s'accumulent dans les rues, tandis que la décharge d'Olososua au Nigéria accueille chaque jour plus de mille camions de déchets. En Asie, près de Manille, Payatas à Quezon City est tristement célèbre : ce bidonville où vivent plus de 25 000 personnes est apparu sur les pentes d'une colline de déchets, "la montagne fumante", où adultes et enfant se disputent les matériaux à revendre. Il y a aussi Paradise Village, qui n'est pas un village touristique, mais bien un bidonville qui a grandi sur un marécage où les inondations sont ponctuelles comme les pluies de mousson. Il y a encore Dumpsite Catmon, la décharge sur laquelle s'est construit le bidonville qui surplombe Paradise Village. En Chine, à Pékin, les décharges sont habitées par des milliers de gens qui recyclent les déchets non autorisés, tandis que l'Inde, avec ses taudis métropolitains, est le pays qui a la plus grande densité de "survivants" grâce aux déchets". 11
La diffusion des contaminants
Les contaminants sont des substances, naturelles ou synthétiques, qui sont toxiques pour l'homme et/ou pour le monde vivant. A côté de substances naturelles présentes depuis toujours sur notre planète et utilisées de différentes façons par la technologie industrielle, parmi lesquelles les métaux lourds, l'amiante, etc., l'industrie chimique en a produit des dizaines de milliers d'autres et en quantité... industrielle. Le manque de connaissance concernant la dangerosité de toute une série de substances et, surtout, le cynisme du capitalisme, ont provoqué des désastres inimaginables, créant une situation environnementale qui sera difficile à restaurer, une fois la classe dominante actuelle éliminée.
Un des épisodes les plus catastrophiques de l'industrie chimique a été sans conteste celui de Bhopal, en Inde, qui s'est produit entre le 2 et le 3 décembre 1984 dans l'usine de l'Union Carbide, multinationale chimique américaine. Un nuage toxique de 40 tonnes de pesticides a tué, immédiatement et dans les années suivantes, au moins 16 000 personnes, causant des dommages corporels irrémédiables à un million d'autres. Les enquêtes successives ont alors révélé que, contrairement à l'entreprise du même type située en Virginie, dans celle de Bhopal aucune mesure de pression n'était effectuée et il n'y avait pas de système de réfrigération. La tour de refroidissement était temporairement fermée, les systèmes de sécurité n'étaient pas adaptés à la dimension de l'usine. Mais la vérité, c'est que l'usine indienne, avec sa main d'œuvre très peu coûteuse, représentait pour ses propriétaires américains un investissement net à revenu exceptionnel, ne nécessitant qu'un investissement réduit en capital fixe et variable...
Un autre événement historique a ensuite été celui de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. "Il a été estimé que les émissions radioactives du réacteur 4 de Tchernobyl ont été d'environ 200 fois supérieures aux explosions de Hiroshima et Nagasaki mises ensemble. En tout, il y a eu des zones sérieusement contaminées dans lesquelles vivent 9 millions de personnes, entre la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie où 30 % du territoire est contaminé par le césium 137. Dans les 3 pays, 400 000 personnes environ ont été évacuées, alors que 270 000 autres vivent dans des zones où l'usage d'aliments produits localement est soumis à des restrictions". 12
Il y a eu encore, évidemment, des myriades de désastres environnementaux dus à la mauvaise gestion des usines ou à des incidents, comme les innombrables marées noires, parmi lesquelles celle provoquée par le pétrolier Exxon Valdez le 24 mars 1989, dont le naufrage sur la côte de l'Alaska a entraîné la fuite d'au moins 30 000 tonnes de pétrole, ou encore la Première Guerre du Golfe qui s'est achevée avec l'incendie des différents puits de pétrole et en un désastre écologique dû à la dispersion du pétrole dans le Golfe persique, le plus grave de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Plus généralement, on pense, selon l'Académie Nationale des Sciences des Etats-Unis, que la quantité d'hydrocarbures qui se perd chaque année en mer tournerait autour d'une moyenne de 3-4 millions de tonnes, avec une tendance à l'augmentation, malgré les différentes interventions préventives, du fait de l'accroissement continu des besoins.
En plus de l'action des contaminants qui, lorsqu'ils se trouvent à haute dose dans l'environnement, provoquent des intoxications aiguës, il existe un autre mécanisme d'intoxication, plus lent, plus discret, celui de l'empoisonnement chronique. De fait, une substance toxique absorbée lentement et à petites doses, si elle est chimiquement stable, peut s'accumuler dans les organes et les tissus des organismes vivants, jusqu'à atteindre des concentrations qui finissent par être létales. C'est ce que, du point de vue de l'écotoxicologie, on appelle la bioaccumulation. On trouve également à l'oeuvre un autre mécanisme à travers lequel une substance toxique se transmet le long de la chaîne alimentaire (le réseau trophique), des stades inférieurs à des stades trophiques supérieurs, en augmentant chaque fois sa concentration de deux ou trois ordres de grandeur. Pour être plus explicites, référons nous à un cas concret qui s'est produit en 1953 dans la baie de Minamata au Japon, baie où vivait une communauté de pêcheurs pauvres qui se nourrissaient essentiellement des produits de leur pêche. A proximité de cette baie, il y avait un complexe industriel qui produisait de l'acétaldéhyde, un composé chimique de synthèse dont la préparation nécessite l'emploi d'un dérivé du mercure. Les rejets en mer de cette industrie étaient légèrement contaminés par le mercure dont la concentration n'était pourtant que de l'ordre de 0,1 microgramme par litre d'eau de mer, c'est-à-dire une concentration qui, même avec les instruments bien plus sophistiqués disponibles aujourd'hui, est encore difficile à déceler. Quelle fut la conséquence de cette contamination apparemment à peine détectable ? 48 personnes moururent en quelques jours, 156 restèrent intoxiquées avec des conséquences graves et même les chats des pêcheurs, qui se nourrissaient eux-mêmes constamment de restes de poissons, finirent par se "suicider" en mer, comportement tout à fait inhabituel pour un félin. Qu'était-il arrivé ? Le mercure présent dans l'eau de mer avait été absorbé et fixé par le phytoplancton, s'était ensuite déplacé de ce dernier au zooplancton, puis aux petits mollusques et, à la suite, aux poissons de petite et moyenne taille, en suivant toute la chaîne trophique au sein de laquelle le même contaminant, chimiquement indestructible, se transmettait au nouvel hôte à une concentration croissante et inversement proportionnelle au rapport entre la taille du prédateur et la masse de nourriture ingérée pendant sa vie. On a ainsi découvert que chez les poissons, ce métal avait atteint une concentration de 50 mg/kilo, ce qui correspond à une concentration multipliée par plus de 500 000. On a découvert aussi que chez certains pêcheurs présentant le "syndrome de Minamata", il s'était produit une augmentation de la concentration du métal dans leurs organes et notamment leurs cheveux à hauteur de plus d'un demi gramme par kilo de ceux-ci.
Bien qu'au début des années 1960, le monde scientifique ait été conscient du fait que, en matière de substances toxiques, il ne suffit pas d'utiliser des méthodes de dilution dans la nature parce que, comme çà a été démontré, les mécanismes biologiques sont capables de concentrer ce que l'homme dilue, l'industrie chimique a continué à contaminer notre planète en long et en large et, cette fois, sans le prétexte de "on ne savait pas ce qui pouvait arriver". C'est ainsi qu'un second Minamata s'est produit beaucoup plus récemment à Priolo (Sicile), sur une bande de terre empoisonnée sur un rayon de quelques km2 par au moins 5 raffineries, où il est avéré que l'Enichem décharge illégalement le mercure de l'usine de production de chlore et de soude. Entre 1991 et 2001, 1000 enfants environ sont nés avec de gros handicaps mentaux et de sérieuses malformations aussi bien du cœur que de l'appareil urogénital, des familles entières présentaient des tumeurs et de nombreuses femmes désespérées ont été obligées d'avorter pour se libérer d'enfants monstrueux qu'elles avaient conçus. Et pourtant, l'épisode de Minamata avait déjà montré tous les risques du mercure pour la santé humaine ! Priolo n'est donc pas un phénomène imprévu, une erreur tragique, mais un acte de banditisme pur et simple, perpétué par le capitalisme italien et plus encore, par le "capitalisme d'Etat" que d'aucuns voudraient faire passer pour "plus à gauche" que le privé. En réalité, on a découvert que la direction de l'Enichem se comportait comme la pire des écomaffias : pour économiser les coûts de la "décontamination" (on parle de plusieurs millions d'euros économisés), les rejets contenant le mercure étaient mélangés avec d'autres eaux usées et rejetés en mer, sur des tombants ou enterrés. En plus, en faisant de faux certificats, on utilisait des citernes à double fond pour camoufler le trafic de déchets dangereux et tout à l'avenant ! Quand la justice s'est finalement remuée en arrêtant les dirigeants de cette industrie, la responsabilité était tellement évidente que l'Enichem a décidé de rembourser 11 000 euros par famille touchée, un chiffre équivalent à celui qu'elle aurait dû payer si elle avait été condamnée par le tribunal.
A côté des sources accidentelles de contaminants, c'est toute la société qui, du fait de son mode de fonctionnement, produit continuellement des contaminants qui vont s'accumuler dans l'air, les eaux et le sol et - comme on l'a déjà dit - dans toute la biosphère, y compris chez nous les humains. L'usage massif de détergents et d'autres produits a abouti à des phénomènes d'eutrophisation (enrichissement excessif) des fleuves, des lacs et des mers. Dans les années 90, la mer du Nord a reçu 6000-11 000 tonnes de plomb, 22 000-28 000 de zinc, 4200 de chrome, 4000 de cuivre, 1450 de nickel, 530 de cadmium, 1,5 million de tonnes d'azote combiné et quelques 100 000 tonnes de phosphates. Ces rejets, si riches en matériel polluant, sont particulièrement dangereux dans des mers qui se caractérisent par l'étendue de leur plateau continental (c'est-à-dire qu'elles sont peu profondes même au large), comme le sont justement la mer du Nord mais aussi la Baltique, la mer Adriatique au Sud, la mer Noire. En effet, la masse réduite d'eau marine, combinée avec la difficulté de mélange entre eaux douces des fleuves et eaux marines salées et denses, ne permet pas une dilution adéquate des contaminants.
Des produits de synthèse comme le fameux insecticide DDT, interdit dans les pays industrialisés depuis une trentaine d'années, ou encore les PCB (polychlorures de biphenyl), utilisés auparavant dans l'industrie électrique, interdits eux aussi de production parce que non conformes aux normes actuelles, tous pourvus d'une solidité chimique indescriptible, se retrouvent actuellement un peu partout, inaltérés, dans les eaux, les sols et ... les tissus des organismes vivants. Grâce encore à la bioaccumulation, ces matériaux se sont concentrés dangereusement dans quelques espèces animales dont ils provoquent la mort ou des perturbations de la reproduction, entraînant le déclin de la population. C'est dans ce contexte, naturellement, qu'on doit considérer ce qui est rapporté plus haut à propos des trafics de rejets dangereux qui, entreposés souvent de manière abusive dans des endroits où le milieu est dépourvu de toute protection, causent des dommages incalculables à l'écosystème et à toute la population de la région.
Pour terminer sur cette partie - mais de toute évidence, on pourrait encore rapporter des centaines et des centaines de cas concrets qui se présentent au niveau mondial - il faut aussi rappeler que c'est justement cette contamination diffuse du sol qui est responsable d'un phénomène nouveau et dramatique : la création de zones mortes, comme par exemple en Italie le triangle entre Priolo, Mellili et Augusta en Sicile - une zone où le pourcentage de bébés avec des malformations congénitales est de 4 fois supérieur à la moyenne nationale, ou encore l'autre triangle de la mort près de Naples entre Giuliano, Qualiano et Villaricca, zone où le nombre de cas de tumeurs est irrémédiablement supérieur à la moyenne nationale.
L'épuisement des ressources naturelles et/ou la menace de pollution
Le dernier exemple de phénomène global qui conduit le monde à la catastrophe est celui concernant les ressources naturelles qui, en partie, s'épuisent et, en partie, sont menacées par des problèmes de pollution. Avant de développer en détail ce phénomène, nous voulons souligner que des problèmes de ce type, le genre humain en a déjà rencontrés, à échelle réduite, avec des conséquences catastrophiques. Si nous sommes ici aujourd'hui à pouvoir en parler, ce n'est que parce que la région concernée par ce désastre ne représente encore qu'une petite partie de la terre. Citons ici quelques passages tirés d'un traité de Jared Diamond, Effondrement, qui concernent l'histoire de Rapa Nui, l'île de Pâques, fameuse pour ses grandes statues de pierre. On sait que l'île a été découverte par l'explorateur hollandais Jacob Roggeveen le jour de Pâques 1772 (d'où son nom) et il est admis aujourd'hui scientifiquement que l'île "était recouverte d'une forêt subtropicale épaisse, riche en gros arbres et arbres ligneux" et qu'elle était riche en oiseaux et bêtes sauvages. Mais, à l'arrivée des colonisateurs, l'impression qu'elle donnait était bien différente :
"Roggeveen se creusait la cervelle pour comprendre comment avaient été érigées ces énormes statues. Pour citer encore une fois son journal : les figures de pierre nous étonnaient grandement parce que nous ne réussissions pas à comprendre comment ce peuple, dépourvu de bois abondant et solide nécessaire pour construire un quelconque instrument mécanique, et complètement privé de cordes résistantes, avait été capable d'ériger des effigies de pierre hautes de 9 mètres (...). Au début, à une certaine distance, nous avions cru que l'île de Pâques était un désert, puis nous avons vu qu'il n'y avait que du sable et de l'herbe jaunie, du foin et des arbustes séchés et brûlés (...) Qu'était-il arrivé à tous les arbres qui devaient être là auparavant ? Pour sculpter, transporter et ériger les statues, il fallait beaucoup de gens, qui vivaient donc dans un milieu suffisamment riche pour subvenir à la subsistance (...) L'histoire de l'île de Pâques est le cas le plus éclatant de déforestation jamais vu dans le Pacifique, sinon dans le monde entier : tous les arbres ont été abattus et toutes les espèces arborées se sont éteintes". 13
"La déforestation a commencé très tôt, a atteint son point culminant dans les années 1400 et a été complète, à des dates différentes selon les zones, se concluant à la fin du XVIIème siècle. Les conséquences immédiates en ont été la perte de matières premières pour la construction de moais (les grandes statues, ndlr) et de canoës pour la navigation en haute mer. A partir de 1500, privés de canoës, les habitants de l'île ne purent plus chasser les dauphins et les thons.
La déforestation a appauvri l'agriculture en exposant le sol à l'action corrosive et de lessivage du vent et de la pluie, éliminant par ailleurs l'humus provenant des feuilles, des fruits et des arbres.
Le manque de protéines animales et la diminution des terres cultivables ont conduit à une mode de survie extrême : le cannibalisme. Dans la tradition orale des habitants de l'île revenait souvent le souvenir de cette façon de se nourrir. L'insulte typique portée à un ennemi était : la viande de ta mère est restée entre mes dents". 14.
"Du fait de leur isolement complet, les habitants de l'île de Pâques constituent un exemple éclatant de société qui s'autodétruit en exploitant ses ressources de manière excessive. (...) Le parallèle que l'on peut faire entre l'île de Pâques et le monde moderne est tellement évident qu'on en est glacé. Grâce à la globalisation, au commerce international, aux avions à réaction et à Internet, tous les pays sur terre partagent aujourd'hui leurs ressources et interagissent, comme les douze clans de l'île de Pâques, perdue dans l'Océan Pacifique, tout comme la terre est perdue dans l'espace. Quand les indigènes se sont trouvés en difficulté, ils n'ont pas pu s'enfuir ni chercher de l'aide en dehors de l'île, comme nous ne pourrons pas, nous, habitants de la terre, chercher du secours ailleurs si les problèmes devaient empirer. La faillite de l'île de Pâques, selon les plus pessimistes, pourrait nous indiquer quel va être le destin de l'humanité dans le futur proche." 15.
Ces éléments tiré en totalité du traité de Diamond nous alertent sur le fait que la capacité de l'écosystème Terre n'est pas illimitée et que, comme cela fut vérifié à un moment donné, sur une échelle réduite, pour l'île de Pâques, quelque chose de similaire peut se reproduire dans le futur proche si l'humanité ne sait pas administrer ses ressources de façon adéquate.
En vérité, nous pourrions faire immédiatement un parallèle au niveau de la déforestation, qui a lieu depuis les origines de la communauté primitive jusqu'à aujourd'hui à un niveau soutenu et qui continue à se développer malheureusement en détruisant les derniers poumons verts de la Terre, comme la forêt amazonienne. Comme on le sait, le maintien de ces zones vertes à la surface de la terre est important, non seulement pour préserver une série d'espèces animales et végétales, mais aussi pour assurer un bon équilibre entre le CO2 et l'oxygène (la végétation se développe en consommant du CO2 et en produisant du glucose et de l'oxygène).
Comme nous l'avons déjà vu à propos de la contamination par le mercure, la bourgeoisie connaît très bien les risques encourus, ainsi que le montre la noble intervention d'un scientifique du 19e siècle, Rudolf Julius Emmanuel Clausius, qui s'était exprimé sur le problème de l'énergie et des ressources de façon très claire, bien un siècle en avance sur les discours sur la soi-disant préservation de l'environnement : "Dans l'économie d'une Nation, il y a une loi qui est toujours valable : il ne faut pas consommer pendant une période plus que ce qui a été produit pendant cette même période. Pour cela, nous ne devrons consommer de combustible qu'autant qu'il est possible à celui-ci de se reproduire grâce à la croissance des arbres" 16
Mais si on en juge par ce qui se passe aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on fait juste le contraire de ce que recommandait Clausius et nous nous précipitons directement dans la direction fatale de l'île de Pâques.
Pour affronter le problème des ressources de façon adéquate, il faut tenir compte aussi d'une autre variable fondamentale qui est la variation de la population mondiale :
"Jusqu'en 1600, la croissance de la population mondiale était tellement lente qu'on enregistrait une augmentation de 2-3 % par siècle : il a bien fallu 16 siècles pour que des 250 millions d'habitants au début de l'ère chrétienne, on passe à environ 500 millions. A partir de ce moment, et après, le temps de doublement de la population a diminué sans arrêt au point que, aujourd'hui, dans certains pays du monde, il se rapproche de la soi-disant "limite biologique" dans la vitesse de croissance d'une population (3-4 % par an). Selon l'ONU, on dépassera les 8 milliards d'habitants autour de 2025. (...) Il faut considérer les différences notables qu'on enregistre actuellement entre pays avancés, presque arrivés au "point zéro" de la croissance, et les pays en voie de développement qui contribuent à 90 % de l'accroissement démographique actuel. (...) En 2025, selon les prévisions de l'ONU, le Nigeria, par exemple, aura une population supérieure à celle des Etats-Unis et l'Afrique dépassera de trois fois l'Europe en nombre d'habitants. La surpopulation, combinée à l'arriération, l'analphabétisme et au manque de structures hygiéniques et de santé, représente sûrement un grave problème, pas seulement pour l'Afrique du fait des conséquences inévitables d'un tel phénomène à l'échelle mondiale. Il apparaît, de fait, un déséquilibre entre demande et offre de ressources disponibles, qui est dû aussi à l'utilisation d'environ 80 % des ressources énergétiques mondiales par les pays industrialisés.
La surpopulation comporte une forte baisse des conditions de vie du fait qu'elle diminue la productivité par travailleur et la disponibilité, par tête, d'aliments, d'eau potable, de services de santé et de médicaments. La forte pression anthropique actuelle conduit à une dégradation de l'environnement qui, inévitablement, se répercute sur les équilibres du système-terre.
Le déséquilibre, ces dernières années, va en s'accentuant : la population continue non seulement à croître de façon non homogène mais devient de plus en plus dense dans les zones urbaines." 17
Comme on le voit d'après ces quelques informations, l'accroissement de la population ne fait qu'exacerber le problème de l'épuisement des ressources, d'autant plus que comme le montre ce document, leur carence se rencontre surtout là où l'explosion démographique est la plus forte, ce qui laisse augurer pour le futur toujours plus de calamités touchant une multitude de personnes.
Commençons par examiner la première ressource naturelle par excellence, l'eau, un bien universellement nécessaire qui est aujourd'hui fortement menacé par l'action irresponsable du capitalisme.
L'eau est une substance qui se trouve en abondance à la surface de la terre (pour ne parler que des océans, des calottes polaires et eaux souterraines) mais une toute petite partie seulement est potable, celle qui se trouve confinée dans les nappes souterraines et dans quelques cours d'eau non pollués. Le développement de l'activité industrielle, sans aucun respect pour l'environnement, et la dispersion diffuse des rejets urbains ont pollué des parties importantes des nappes phréatiques qui sont le réservoir naturel des eaux potables de la collectivité. Cela a conduit, d'une part, à l'apparition de cancers et de pathologies de nature variée dans la population et, d'autre part, à la réduction croissante des sources d'approvisionnement d'un bien aussi précieux.
"A la moitié du XXIème siècle, selon les prévisions les plus pessimistes, 7 milliards de personnes dans 60 pays n'auront plus assez d'eau. Si les choses se passaient au mieux, cependant, il n'y aurait "que" deux milliards de personnes dans 48 pays qui souffriraient du manque d'eau. (...) Mais les données les plus préoccupantes dans le document de l'ONU sont probablement celles qui concernent les morts dues à l'eau polluée et les mauvaises conditions d'hygiène : 2,2 millions par an. De plus, l'eau est le vecteur de nombreuses maladies, parmi lesquelles la malaria qui tue chaque année environ un million de personnes". 18
La revue scientifique anglaise New Scientist, tirant les conclusions du symposium sur l'eau de Stockholm, de l'été 2004, établit que : "dans le passé, on a fait des dizaines de millions de puits, la plupart sans aucun contrôle, et les quantités d'eaux qui en sont extraites par de puissantes pompes électriques sont de loin supérieures aux eaux pluviales qui alimentent les nappes. (...) Pomper l'eau permet à beaucoup de pays de faire d'abondantes récoltes de riz et de sucre de canne (semences qui ont de grands besoins en eau pour pouvoir se développer, ndlr), mais le boom est destiné à peu durer (...). L'Inde est l'épicentre de la révolution des forages d'eau souterrain. En utilisant la technologie de l'industrie pétrolière, les petits cultivateurs ont foré 21 millions de puits dans leurs champs et le nombre augmente chaque année d'environ un million. (...) En Chine : dans les plaines du nord, où on produit la plus grande partie des produits agricoles, les cultivateurs extraient chaque année 30 km3 d'eau en plus de celle qui est amenée par les pluies (...). Dans la dernière décennie, le Vietnam a multiplié par quatre le nombre de puits. ( ...) Au Pendjab, région du Pakistan où on produit 90 % des ressources alimentaires du pays, les nappes phréatiques commencent à s'assécher" 19.
Si la situation est grave en général, et même très grave, dans des pays dits émergents comme l'Inde et la Chine, la situation est catastrophique et risque d'être un désastre à court terme.
"La sécheresse qui sévit dans la province du Sichuan et de Chongqing a entraîné des pertes au niveau économique, au moins 9,9 milliards de yuans, et des restrictions d'eau potable pour plus de 10 millions de personnes, alors que dans la nation toute entière, il y a au moins 18 millions de personnes qui manquent d'eau." 20
"La Chine est frappée par les pires inondations de ces dernières années, avec 60 millions de personnes concernées en Chine centrale et méridionale, au moins 360 morts et des pertes économiques directes qui atteignent déjà 7,4 milliards de yuans, 200 000 maisons détruites ou endommagées, 528 000 hectares de terres agricoles détruites et 1,8 million submergés. En même temps, la désertification progresse rapidement, concernant un cinquième des terres et provoquant des tempêtes de sable qui arrivent jusqu'au Japon. (...) Si la Chine centrale et méridionale souffrent d'inondations, au nord le désert continue à s'étendre, couvre désormais un cinquième des terres le long du cours supérieur du Fleuve Jaune, sur le haut plateau du Qinghai-Tibet et une partie de la Mongolie intérieure et du Gansu.
La population de la Chine représente environ 20 % de la population mondiale, mais il n'y a que 7% de terre cultivable.
Selon Wang Tao, membre de l'Académie chinoise des Sciences à Lanzhou, les déserts de Chine ont augmenté de 950 Km2 par an au cours de la dernière décennie. Chaque printemps, les tempêtes de sable s'abattent sur Pékin et toute le Chine septentrionale et atteignent la Corée du Sud et le Japon" 21
Tout cela doit nous faire réfléchir sur la puissance tant vantée du capitalisme chinois. En réalité, le développement récent de l'économie chinoise, plutôt que de revitaliser le capitalisme mondial sénescent, exprime bien l'horreur de son agonie avec ses villes dévastées par les brouillards (à peine masqués pour les derniers Jeux olympiques), ses cours d'eau qui s'assèchent et sont pollués et des ouvriers qui sont décimés par milliers dans les mines et dans des usines où les conditions de travail sont effroyables et dépourvues de toute exigence de sécurité.
Il y a beaucoup d'autres ressources en voie d'extinction et, pour terminer ce premier article, nous ne ferons qu'en souligner brièvement deux.
La première, on s'en doute, c'est le pétrole. Comme on le sait, c'est depuis les années 1970 qu'on parle de l'épuisement des réserves naturelles de pétrole, mais aujourd'hui, en 2008, il semble que l'on en soit vraiment arrivé à un pic de production de pétrole, le pic dit de Hubbert, c'est-à-dire le moment où nous aurons déjà épuisé et consommé la moitié des ressources naturelles de pétrole estimées par les différentes prospections géologiques. Le pétrole représente aujourd'hui à peu près 40% de l'énergie de base et environ 90 % de l'énergie utilisée dans les transports ; ses applications sont également importantes dans l'industrie chimique, en particulier pour la fabrication des fertilisants pour l'agriculture, des plastiques, des colles et des vernis, des lubrifiants et des détergents. Tout cela est possible parce que le pétrole a constitué une ressource à faible coût et apparemment sans limite. La modification de cette perspective participe dès à présent à en faire augmenter le prix, obligeant le monde capitaliste à se tourner vers des solutions de substitution moins onéreuses. Mais, une fois encore, la recommandation de Clausius de ne pas consommer en une génération plus que ce que la nature est capable de reproduire n'a aucun écho et le monde capitaliste est précipité dans une course folle à la consommation d'énergie, des pays comme la Chine et l'Inde en tête, brûlant tout ce qu'il y a à brûler, revenant au carbone fossile toxique pour produire de l'énergie et générant tout autour une pollution sans précédent.
Naturellement, même le recours "miraculeux" au soi-disant biodiesel a fait son temps et a montré toutes ses insuffisances. Produire du combustible à partir de la fermentation alcoolique d'amidon de maïs ou de produits végétaux oléagineux, non seulement ne permet pas de couvrir les besoins actuels du marché en combustible, mais fait surtout augmenter le prix des aliments, ce qui conduit à affamer les populations pauvres. Ceux qui sont avantagés, encore une fois, ce sont les entreprises capitalistes, comme les entreprises alimentaires qui se sont reconverties dans le business des biocarburants. Mais pour les simples mortels, cela signifie que de vastes zones de forêts sont abattues pour faire place aux plantations (des millions et des millions d'hectares). La production de biodiesel requiert effectivement l'utilisation de grandes étendues de terrain. Pour avoir une idée du problème, il suffit de penser qu'un hectare de terre cultivée en colza ou tournesol, ou autres semi-oléagineux, produit environ 1000 litres de biodiesel, qui peuvent faire marcher une automobile sur environ 10 000 km. Si nous faisons l'hypothèse qu'en moyenne les automobiles d'un pays parcourent 10 000 km par an, chaque voiture consommera tout le biodiesel produit par un hectare de terrain. Ca veut dire que pour un pays comme l'Italie, où circulent 34 millions de voitures, s'il fallait obtenir tout le carburant à partir de l'agriculture, il faudrait une surface cultivable de 34 millions d'hectares. Si nous ajoutons aux voitures les 4 millions de camions environ, qui ont des moteurs plus gros, la consommation serait double, et impliquerait une superficie d'à peu près 70 millions d'hectares, ce qui correspond à une surface presque deux fois plus grande que celle de la péninsule italienne, y compris les montagnes, les villes, etc.
Bien qu'on n'en parle pas de la même manière, un problème analogue à celui des combustibles fossiles se pose naturellement à propos des autres ressources de type minéral, par exemple les minerais dont on extrait les métaux. Il est vrai que, dans ce cas, le métal n'est pas détruit par l'usage, comme c'est le cas pour le pétrole ou le gaz méthane, mais l'incurie de la production capitaliste finit par disperser à la surface de la terre et dans les décharges des quantités significatives de métaux, ce qui fait que l'approvisionnement en métaux va lui aussi, tôt ou tard, s'épuiser. L'usage, entre autre, de certains alliages et multi stratifiés, rend encore plus ardue l'éventuelle entreprise de récupération d'un matériel "pur".
L'ampleur du problème est révélée par des estimations selon lesquelles, en l'espace de quelques décennies, les ressources suivantes seront épuisées : uranium, platine, or, argent, cobalt, plomb, manganèse, mercure, molybdène, nickel, étain, tungstène et zinc. Il s'agit manifestement de matériaux pratiquement indispensables à l'industrie moderne et leur pénurie pèsera gravement sur le proche avenir. Mais il y a aussi d'autres matières qui ne sont pas inépuisables : le calcul a été fait qu'il y a encore de disponible (dans le sens où il est possible économiquement de les extraire) 30 milliards de tonnes de fer, 220 millions de tonnes de cuivre, 85 millions de tonnes de zinc. Pour avoir une idée des quantités, il suffit de penser que pour amener les pays les plus pauvres au niveau des pays avancés, il faudrait 30 milliards de tonnes de fer, 500 millions de cuivre, 300 millions de zinc, c'est-à-dire carrément plus que ce que toute la planète Terre pourrait nous offrir.
Face à cette catastrophe annoncée, il faut se demander si le progrès et le développement doivent nécessairement se conjuguer avec la pollution et la perturbation de l'écosystème Terre. Il faut se demander si de tels désastres sont à attribuer à la mauvaise éducation des hommes ou à quelque chose d'autre. C'est ce que nous verrons dans le prochain article.
Ezechiele (août 2008)
1 Manifeste [60] adopté par le 9e Congrès du CCI en juillet 1991.
2 G. Barone et al., Il metano e il futuro del clima, in Biologi Italiani, n° 8 de 2005.
3 idem
4 G. Pellegri, Terzo mondo, nueva pattumiera creata dal buonismo tecnologico, voir http:/www.caritas-ticino.ch/rivista/elenco%20rivista/riv_0203/08%20-%20Terzo%m... [61]
5 Vivere di rifiuti, http:/www.scuolevi-net:scuolevi/valdagno /marzotto/mediateca.nsf/9bc8ecfl790d... [62]
6 Roberto Saviano, Gomorra, Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra, Arnoldo Montaldi, 2006.
7 La Repubblica on-line, 29/10/2007
8 La Repubblica, 6/02/2008. Rien qu'aux Etats Unis, plus de 100 milliards de sacs plastique sont utilisés, 1,9 milliards de tonnes de pétrole sont nécessaires pour les produire, la plupart d'entre eux finissent par être jetés et mettent des années à se décomposer. La production américaine de quelques 10 milliards de sacs plastique requiert l'abattage d'environ 15 millions d'arbres.
9 Voir l'article Mediterraneo, un mare di plastica, in La Repubblica du 19 Juillet 2007.
10 Il n'est pas exclu naturellement que le renchérissement vertigineux du pétrole auquel nous assistons depuis la fin de l'année dernière ne remette en discussion l'usage de cette matière première pour la production de matière plastique synthétique non biodégradable, provoquant dans le futur proche une conversion à la nouvelle foi écologique chez ces entrepreneurs vigilants, vigilants pour sauvegarder leurs propres intérêts.
11 R. Troisi : la discarica del mondo luogo di miseria e di speranza nel ventunesimo secolo. villadelchancho.splinder.com/tag/discariche+del+mondo
12 Voir l'article : "Alcuni effetti collaterali dell'industria, La chimica, la diga e il nucleare".
13 Jared Diamond, Collasso, edizione Einaudi
14 Tiré des Archives Historiques de la Nouvelle Gauche "Marco Pezzi", Ancora su petrolio e capitalismo. diligander.libero.it/alterantiveinfo/petrolio_criticaeconflitto_giugno2006.pdf
15 Jared Diamond, Colasso, edizione Einaudi
16 R.J.E Clausius (1885), né à Koslin (Prusse et aujourd'hui en Pologne) en 1822 et mort à Bonn en 1888.
17 Associazione Italiana Insegnanti Geografia, La crescita della popolazione.
www.aiig.it/Un%20quaderno%20per%l [63]'ambiente/offline/crescita-pop.htm
18 G. Carchella, Acqua : l'oro blu del terzo millenario, su "Lettera 22, associazione indipendente di giornalisti". www.lettera22.it/showart.php?id=296&rubrica=9 [64]
19 "Asian Farmers sucking the continent dry [65]", 28 août 2004, Newscientist.
20 PB, Cina : oltre 10 milioni di persone assetate dalla siccità, Asianews,
www.asianews.it/index.php?l=it&art=6977 [66]
21 La Cina stretta tra le inondazioni e il deserto che avanza, 18/08/2006, in Asianews. www.asianews.it/index.php?l=it&art=9807 [67]
Récent et en cours:
- Catastrophes [68]
- Ecologie [69]
Débat interne au CCI : les causes de la prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (II)
- 4435 lectures
Dans le n° 133 [70] de la Revue internationale nous avons commencé à ouvrir à l'extérieur de notre organisation un débat ayant lieu au sein de celle-ci et portant sur l'explication de la période de prospérité des années 1950 et 60, une exception dans la vie du capitalisme depuis la Première Guerre mondiale. Nous en avions alors posé les termes, le cadre, et présenté les principales positions en présence. Nous publions ci-dessous une nouvelle contribution à cette discussion.
Cette contribution vient en soutien à la thèse qui avait été présentée sous le titre "Le capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste", faisant essentiellement découler la demande solvable durant la période considérée de la mise en place par la bourgeoisie des mécanisme keynésiens.
Dans un prochain numéro de notre revue paraîtra une réponse à cette contribution, en particulier concernant les facteurs déterminants de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence et la nature de l'accumulation capitaliste.
(pour des raisons techniques, les graphiques n'ont pu être insérés dans le texte. Ils sont accessibles en cliquant sur leur titre)
Origine, dynamique, et limites du capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste
En 1952, nos ancêtres de la Gauche Communiste de France décidaient d'arrêter leur activité de groupe parce que : "La disparition des marchés extra-capitalistes entraîne une crise permanente du capitalisme (...) ...il ne peut plus élargir sa production. On verra là l'éclatante confirmation de la théorie de Rosa Luxemburg : le rétrécissement des marchés extra-capitalistes entraîne une saturation du marché proprement capitaliste. (...) En fait, les colonies ont cessé de représenter un marché extra-capitaliste pour la métropole, elles sont devenues de nouveaux pays capitalistes. Elles perdent donc leur caractère de débouchés. (...) la perspective de guerre ... tombe à échéance. Nous vivons dans un état de guerre imminente..." (1). Le paradoxe veut que cette erreur de perspective ait été énoncée à la veille des Trente glorieuses ! Dès lors, appréhender correctement "les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale", comme le titre l'article introductif à ce débat (n°133), ainsi que les enjeux posés par l'évolution actuelle du capitalisme, nécessite de dépasser "l'éclatante infirmation de la théorie de Rosa Luxemburg", et d'en revenir à "une compréhension plus ample et cohérente du fonctionnement et des limites du mode de production capitaliste". Telle était la conclusion que nous tirions dans le précédent numéro de cette revue, tel est l'objet de cet article. A cette fin, nous examinerons successivement (I.) quels sont les ressorts et contradictions internes au capitalisme ; (II.) une validation de ce cadre théorique pour les 60 dernières années ; (III.) les rapports que le capitalisme entretient avec sa sphère extérieure ; (IV.) l'obsolescence du mode de production capitaliste et les conditions de son dépassement ; (V.) et, dans ce cadre, le capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste qui était à la base de la période de forte croissance d'après-guerre, ainsi que ses limites.
I. Ressorts et contradictions internes au capitalisme
1) La contrainte de la reproduction élargie et ses limites
Comme toutes les autres sociétés d'exploitation, le capitalisme s'articule autour de l'appropriation de surtravail : "En étudiant le procès de production, nous avons vu que toute la tendance, tout l'effort de la production capitaliste consiste à s'accaparer le plus possible de surtravail..." (2). Cependant, cette appropriation va désormais bien au-delà de la seule satisfaction des besoins de la classe dominante, elle s'impose comme une contrainte pour sa survie : tout capital laissé en friche se dévalorise et est évincé du marché. Tel est le moteur de "...la tendance à l'accumulation, la tendance à agrandir le capital et à produire de la plus-value sur une échelle élargie. C'est là, pour la production capitaliste, une loi, imposée par les constants bouleversements des méthodes de production elles-mêmes, par la dépréciation du capital existant que ces bouleversements entraînent toujours, la lutte générale de la concurrence et la nécessité de perfectionner la production et d'en étendre l'échelle, simplement pour se maintenir et sous peine de disparaître" (3).
Contrairement aux sociétés antérieures, cette appropriation contient désormais une dynamique intrinsèque et permanente d'élargissement de l'échelle de production qui dépasse de loin la reproduction simple. En effet, l'aiguillon du profit, l'extraction du maximum de surtravail, ainsi que la nécessité permanente d'assurer la rentabilité du capital, contraignent chaque capitaliste à développer sa production, et donc, à générer une demande sociale croissante par l'embauche de nouveaux travailleurs et par le réinvestissement en moyens de production et de consommation supplémentaires : "retransformer sans cesse en capital la plus grande partie possible de la plus-value ou du produit net ! Accumuler pour accumuler, produire pour produire, tel est le mot d'ordre de l'économie politique proclamant la mission historique de la période bourgeoise. (...) Assurément produire, produire toujours de plus en plus, tel est notre mot d'ordre..." (4). C'est une "fatalité historique" dira Marx.
Cette "tendance à agrandir le capital sur une échelle élargie" se matérialise au sein d'une succession de cycles plus ou moins décennaux où l'alourdissement périodique en capital fixe vient régulièrement infléchir le taux de profit et provoquer des crises : "A mesure que la valeur et la durée du capital fixe engagé se développent avec le mode de production capitaliste, la vie de l'industrie et du capital industriel se développe dans chaque entreprise particulière et se prolonge sur une période, disons en moyenne dix ans. (...) ... ce cycle de rotations qui s'enchaînent et se prolongent pendant une série d'années, où le capital est prisonnier de son élément fixe, constitue une des bases matérielles des crises périodiques" (5).
Lors de chacune de ces crises, faillites et dépréciations de capitaux recréent les conditions d'une reprise qui élargi les marchés et le potentiel productif : "Les crises ne sont jamais que des solutions momentanées et violentes qui rétablissent pour un moment l'équilibre troublé (...) La stagnation survenue dans la production aurait préparé - dans les limites capitalistes - une expansion subséquente de la production. Ainsi le cycle aurait été, une fois de plus, parcouru. Une partie du capital déprécié par la stagnation retrouverait son ancienne valeur. Au demeurant, le même cercle vicieux serait à nouveau parcouru, dans des conditions de production amplifiées, avec un marché élargi, et avec un potentiel productif accru" (6).
Le graphique ci-dessous illustre parfaitement tous les éléments de ce cadre théorique d'analyse élaboré par Marx : la dizaine de cycles à la hausse et à la baisse du taux de profit est chaque fois ponctué par une crise (récession) :
Graphique n°1 : Etats-Unis (1948-2007) : taux de profit par trimestre et récessions [71] (7)
Marx avait déjà identifié sept cycles de son vivant, la IIIème Internationale seize (8), et les gauches à celle-ci complèteront ce tableau durant l'entre-deux-guerres (9). Avec la dizaine d'autres depuis la seconde guerre mondiale, plus de deux siècles d'accumulation capitaliste ont été rythmés par une petite trentaine de cycles et de crises.
Par sa dynamique intrinsèque d'élargissement, le capitalisme génère en permanence la demande sociale qui est à la base du développement de son propre marché. Cependant, Marx nous a aussi montré que ses contradictions internes restreignent périodiquement ce même marché (la demande finale) par rapport à la production : "Alors que les forces productives s'accroissent en progression géométrique, l'extension des marchés se poursuit tout au plus en progression arithmétique" (10). Telle est la base matérielle et récurrente de cette trentaine de cycles et de crises de surproduction dont il nous faut maintenant examiner la genèse.
2) Le circuit de l'accumulation : une pièce en deux actes
Extraire un maximum de surtravail se cristallisant en une quantité croissante de marchandises constitue ce que Marx appelle "le premier acte du procès de production capitaliste". Ensuite, ces marchandises doivent être vendues pour transformer ce surtravail en plus-value accumulable en vue du réinvestissement : c'est "le deuxième acte du procès". Chacune de ces deux étapes contient ses propres contradictions et limites. En effet, bien que s'influençant mutuellement, l'acte premier est surtout aiguillonné par le taux de profit, et le second dépendant des diverses tendances qui restreignent la demande finale (le marché) : "Dès que la quantité de surtravail qu'on peut tirer de l'ouvrier est matérialisée en marchandises, la plus-value est produite. Mais avec cette production de la plus-value, c'est seulement le premier acte du procès de production capitaliste, du procès de production immédiat qui s'est achevé. Le capital a absorbé une quantité déterminée de travail non payé. A mesure que se développe le procès qui se traduit par la baisse du taux de profit, la masse de plus-value ainsi produite s'enfle démesurément. Alors s'ouvre le deuxième acte du procès. La masse totale des marchandises, le produit total, aussi bien la portion qui remplace le capital constant et le capital variable que celle qui représente de la plus-value, doivent être vendues. Si cette vente n'a pas lieu ou n'est que partielle, ou si elle a lieu seulement à des prix inférieurs aux prix de production, l'ouvrier certes est exploité, mais le capitaliste ne réalise pas son exploitation en tant que telle : cette exploitation peut s'allier pour le capitaliste à une réalisation seulement partielle de la plus-value extorquée ou à l'absence de toute réalisation et même aller de pair avec la perte d'une partie ou de la totalité de son capital" (11).
3) La nécessaire réalisation des marchandises
Marx nous montre bien ici que la production n'engendre pas automatiquement une demande finale (un marché) à la hauteur de celle-ci : "La surproduction a spécialement pour condition la loi générale de production du capital : produire à mesure des forces productives (c'est-à-dire selon la possibilité qu'on a d'exploiter la plus grande masse possible de travail avec une masse donnée de capital) sans tenir compte des limites existantes du marché ou des besoins solvables..." (12). Ce décalage périodique entre la production et les marchés découle des lois de l'économie capitaliste qui, spontanément, conduit à une dynamique insuffisante de la demande solvable.
Or, de quoi dépend ce deuxième acte du circuit de l'accumulation (les "conditions de réalisation de la production", ou la grandeur de la demande solvable, c'est-à-dire des marchés) ? Marx nous en fournit les trois paramètres principaux :
a) Des capacités de consommation de la société, capacités restreintes car réduites par les rapports antagoniques de répartition du surtravail (c'est-à-dire la lutte de classe) : "La raison ultime de toutes les crises réelles, c'est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendance de l'économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n'avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolu de la société" (13).
b) Des limites imposées par le processus d'accumulation qui réduit la demande lorsque le taux de profit s'infléchit : insuffisance de plus-value extraite par rapport au capital engagé entrainant un frein dans les investissements et les embauches de nouvelles forces de travail. En retour, ceci a pour conséquence de déprimer encore plus fortement la demande finale : "La limite du mode de production se manifeste dans les faits que voici : 1° Le développement de la productivité du travail engendre, dans la baisse du taux de profit, une loi qui, à un certain moment, se tourne brutalement contre ce développement et doit être constamment surmontée par des crises" (14)
c) Des défauts de réalisation du produit total lorsque les proportionnalités entre les branches de la production ne sont pas respectées : en effet, les disproportionnalités entre branches productives rendent la réalisation du produit total incomplète (15).
Autrement dit, l'on peut résumer ce qui conditionne principalement la demande finale par les deux grands facteurs suivants :
A) Le développement de la production et de ses contradictions (b et c) : Durant la première moitié du cycle décennal d'accumulation, le capitalisme élargit sa propre demande finale par l'embauche de travailleurs et le réinvestissement en nouveaux moyens de production et de consommation : "Les limites de la consommation sont élargies par la tension du procès de reproduction lui-même ; d'une part, celle-ci augmente la dépense du revenu par les ouvriers et les capitalistes ; d'autre part, elle est identique à la tension de la consommation productive" (16). Ensuite, durant la seconde moitié, comme nous l'avons expliqué ci-dessus, les disproportionnalités entre les branches de production, et l'infléchissement du taux de profit engendrent une restriction de cette demande finale.
B) Les lois de répartition du surtravail entre le capital et le travail (a) : La seconde source des crises de surproduction plonge ses racines dans la tendance immanente du capitalisme à accaparer un maximum de plus-value, c'est-à-dire dans les "rapports de distribution antagoniques" du surtravail entre le capital et le travail, rapports qui dépendent de l'état de la lutte des classes, et qui ont pour résultat de relativement comprimer la demande finale : "la capacité de consommation de la société ... déterminée par des rapports de distribution antagoniques, cette consommation de la grande masse de la société en est réduite à un minimum" (17).
4) Une triple conclusion sur la dynamique et les contradictions internes au capitalisme
a) La double racine des crises : Marx a toujours souligné cette double nécessité pour le capitalisme, d'une part, de produire de façon suffisamment rentable - c'est-à-dire d'extraire suffisamment de surtravail - et, d'autre part, de réaliser celui-ci sur le marché. Que l'un ou l'autre de ces "deux actes" vienne à manquer, en tout ou en partie, et le capitalisme est alors confronté à des crises de surproduction : "L'essence de la production capitaliste implique donc une production qui ne tienne pas compte des limites du marché" (18).
b) Deux racines fondamentalement indépendantes : Le plus souvent, ces deux racines des crises se conjuguent. En effet, le niveau et la baisse récurrente du taux de profit influe sur la répartition de la plus-value, et inversement. Cependant, Marx insistera constamment sur l'idée que ces deux racines sont fondamentalement "indépendantes", "non théoriquement liées", "ne sont pas identiques" (19). Pourquoi ? Tout simplement parce que la production de profit et les marchés sont, pour l'essentiel, différemment conditionnés : "les conditions de l'exploitation immédiate ... n'ont pour limite que la force productive de la société", alors que "le marché" a pour limite "la capacité de consommation de la société", or, "cette capacité de consommation est déterminée par des rapports de distribution antagoniques, cette consommation de la grande masse de la société en est réduite à un minimum" (20). C'est pourquoi, Marx rejette catégoriquement toute théorie mono-causale des crises (21). Il est donc théoriquement erroné de faire strictement découler l'importance des marchés de l'évolution du taux de profit et inversement, il en va de même empiriquement comme nous le verrons ci-dessous (22).
c) Des temporalités différentes : De ceci découle que les temporalités de ces deux racines sont forcément différentes. La première contradiction (le taux de profit) plonge ses racines dans les nécessités d'accroître le capital constant au détriment du capital variable, sa temporalité est donc essentiellement liée aux cycles de rotation du capital fixe (plus ou moins décennaux en moyenne). La seconde (la contradiction contenue dans le rapport salarié) découle de l'enjeu autour de la répartition du surtravail, sa temporalité est donc avant tout fonction du rapport de force entre les classes qui porte sur de plus longues périodes (23). Encore une fois, précisons bien que ces deux temporalités se conjuguent mutuellement, puisque le processus d'accumulation influence le rapport de force entre les classes et inversement. Cependant, elles sont fondamentalement "indépendantes", "non identiques", "non théoriquement liées", car la lutte de classe n'est pas strictement liée aux cycles décennaux, ni ces derniers aux rapports entre les classes. C'est ce que nous allons maintenant vérifier par une validation empirique de ce cadre théorique d'analyse des crises élaboré par Marx.
II. Une validation empirique de la théorie marxiste des crises de surproduction
La période allant de la seconde guerre mondiale à aujourd'hui constitue un bon exemple pour valider empiriquement le cadre théorique d'analyse des crises de surproduction développé par Marx, et aussi de ses trois implications majeures concernant la racine double des crises, leurs caractères indépendants, et leurs temporalités différentes. En effet, les tenants de la mono-causalité des crises par la baisse du taux de profit sont incapables d'expliquer pourquoi l'accumulation et la croissance ne redémarrent pas, alors que ce taux ne fait que remonter depuis plus d'un quart de siècle ! Inversement, les tenants de la mono-causalité par la saturation des marchés ne peuvent expliquer cette remontée, puisque ces derniers n'ont fait que se restreindre jusqu'à leur "total épuisement" aujourd'hui (Revue n°133) ... ce qui alors devrait se traduire par un taux de profit égal à zéro ! Tout ceci se lit et se comprend aisément sur les deux graphiques d'évolution du taux de profit (n°1 et n°3). Nous pouvons clairement y distinguer la succession des cycles plus ou moins décennaux reliés à la dynamique du taux de profit, ainsi que les grandes tendances d'évolution à moyen terme de ce dernier : de 1945 à 1965 où il est stabilisé à un haut niveau, de 1965 à 1982 où il décline, et de 1982 à aujourd'hui où il remonte. La compréhension de ces trois évolutions renvoie surtout à la contradiction découlant de la moindre dynamique de la demande par rapport à la production.
1) La fin des Trente glorieuses
Nous expliquerons plus avant dans ce texte comment, durant les Trente glorieuses, le capitalisme a momentanément pu assurer cette double contrainte consistant à devoir produire avec profit, et à vendre toutes ses marchandises produites. Cependant, dans les pays de l'OCDE, cette configuration commence à s'épuiser, dès la fin des années 60 (24), suite à un infléchissement des gains de productivité qui entraine le taux de profit à la baisse (25). En effet, ce dernier chutera de moitié entre 1969 et 1982 (cf. graphique n°3). L'épuisement de cette longue période de forte croissance économique au lendemain de la seconde guerre mondiale est donc fondamentalement le produit d'un retournement à la baisse du taux de profit. La dégradation du climat économique durant toutes ces années (1969-82) résulte alors, avant tout, de cette baisse de la rentabilité des entreprises (26) ! C'est donc la contrainte du profit qui n'est plus assurée, alors que la régulation de la demande finale fonctionne encore largement compte-tenu du maintien des mécanismes d'indexation des salaires et de soutien à la demande (27).
2) Le passage au capitalisme d'Etat dérégulé
Dès lors, le rétablissement du taux de profit ne pourra plus se faire grâce à un redressement des gains de productivité, puisque c'est la chute de ceux-ci qui avaient infléchi l'évolution du taux de profit. Seule l'augmentation du taux de plus-value, par des compressions salariales et un accroissement de l'exploitation, allait permettre de le faire. Ceci impliquait une inévitable dérégulation des mécanismes clés assurant la croissance de la demande finale durant les Tente glorieuses (cf. infra). Cet abandon a commencé au début des années 1980 et s'illustre, notamment, par la diminution constante de la part des salaires dans le total de la richesse produite :
Graphique n°2 : Evolution de la part salariale dans le total de la richesse produite : G7, Europe, France [72] (28)
Globalement donc, durant les années 70, c'est la contradiction ‘taux de profit' qui pèse sur le fonctionnement du capitalisme, alors que la demande finale était toujours assurée. Ce sera exactement l'inverse ensuite. Après 1982, le taux de profit est spectaculairement rétabli, mais au prix d'une compression drastique de la demande finale (des marchés) : essentiellement de la masse salariale (cf. graphique n°2), mais aussi des investissements (dans une moindre mesure), puisque le taux d'accumulation est resté à l'étiage (cf. graphique n°3).
Dès lors, nous pouvons maintenant comprendre pourquoi la dégradation économique se poursuit toujours, et ce, malgré un taux de profit rétabli : c'est la compression de la demande finale (salaires et investissements) qui explique que, malgré un spectaculaire redressement de la rentabilité des entreprises, l'accumulation et la croissance n'ont pu redémarrer (29). Cette réduction drastique de la demande finale engendre une atonie des investissements en vue de l'élargissement, la poursuite des rationalisations par rachats et fusions d'entreprises, un déversement des capitaux en friche dans la spéculation financière, une délocalisation à la recherche de main d'œuvre bon marché, ... ce qui déprime encore plus la demande finale (30).
Quand au rétablissement de cette dernière, elle n'est guère possible dans les conditions présentes, puisque c'est de sa baisse que dépend l'accroissement du taux de profit (31) ! Depuis 1982, dans un contexte de rentabilité retrouvée des entreprises, c'est donc la temporalité ‘restriction des marchés solvables' qui joue le rôle principal à moyen terme pour expliquer le maintien d'une atonie de l'accumulation et de la croissance, même si les fluctuations du taux de profit peuvent encore jouer un rôle majeur à court terme dans le déclenchement des récessions comme l'illustre très bien les graphiques n°1 et n°3 :
Graphique n°3 : Profit, accumulation et croissance économique dans la Triade (USA, Europe et Japon) : 1961-2006 [73] (32)
Tout ceci vient pleinement confirmer le cadre théorique d'analyse élaboré par Marx, ainsi que les trois conséquences majeures qui en découle : (1) la double racine des crises de surproduction ; (2) l'indépendance relative entre la production de profit et les marchés ; (3) et la temporalité différente de ces deux dynamiques.
III. Le capitalisme et sa sphère extérieure
De tout ce que Marx a développé (et que nous avons trop brièvement résumé) découle le fait que le capitalisme est un système foncièrement expansif : "Il faut donc que le marché s'agrandisse sans cesse, si bien que ses connexions internes et les conditions qui le règlent prennent de plus en plus l'allure de lois de la nature indépendantes des producteurs et échappent de plus en plus à leur contrôle. Cette contradiction interne cherche une solution dans l'extension du champ extérieur de la production. Mais plus la force productive se développe, plus elle entre en conflit avec la base étroite sur laquelle sont fondés les rapports de consommation" (33). Or, toutes les dynamiques et limites du capitalisme dégagées par Marx ne l'ont été qu'en faisant abstraction de ses rapports avec sa sphère extérieure (non capitaliste). Il nous faut donc maintenant comprendre quelle est la place et l'importance de cet environnement dans le cours de son développement. En effet, historiquement, le capitalisme est d'abord né et s'est développé dans le cadre de rapports sociaux féodaux. C'est progressivement qu'il développera sa base marchande, puis capitaliste.
Né dans un environnement non-capitaliste par définition, le capitalisme ne pouvait qu'établir d'importants liens avec celui-ci pour l'obtention des moyens matériels à son accumulation, et pour l'écoulement de ses marchandises. De 1500 à 1825 (34), le capitalisme s'est abondamment nourri de cet environnement dans le cadre de son accumulation primitive : comme source de profits (pillages divers, importation de métaux précieux, etc.), de marchés (ventes de ses marchandises, commerce triangulaire, etc.), et de main d'œuvre.
Une fois ses bases assurées après trois siècles d'accumulation primitive, cet environnement lui a cependant encore fourni toute une série d'opportunités tout au long de sa phase ascendante (1825-1914). D'une part, en ce qui concerne ses profits : (a) par l'exportation de capitaux ; (b) l'obtention de surprofits ; (c) et un "surprofit par escroquerie" comme l'appelait Marx (35). D'autre part, comme exutoire pour la vente de ses marchandises en surproduction. Enfin, comme source de main d'œuvre (36). C'est l'ensemble de ces raisons qui explique la curée impérialiste durant le dernier tiers de sa phase ascendante (1880-1914 (37)). En ce sens, un tel environnement lui a servi, à la fois, de sources de profits, de milieu lui permettant d'atténuer la portée de ses crises (marchés), et de réservoir de main d'œuvre (38). Cependant, l'existence d'opportunités de régulations externes, à une partie de ses contradictions internes, ne signifie, ni qu'elles seraient les plus efficaces pour le développement du capitalisme, ni que ce dernier serait dans l'impossibilité structurelle de dégager des modes de régulations internes (comme le postule la théorie de Rosa Luxemburg) ! En effet, c'est d'abord et avant tout l'extension et la domination du salariat sur ses propres bases qui a progressivement permis au capitalisme de dynamiser sa croissance, et si les relations de diverses natures entre le capitalisme et sa sphère extra-capitaliste lui a bien offert toute une série d'opportunités, l'importance de ce milieu, et le bilan global des échanges avec lui, n'en constituaient pas moins un frein à sa croissance (39) ! L'épuisement de ces opportunités de régulations externes ouvrira la voie pour la recherche de régulations internes dont le capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste en a constitué un exemple prototypique (cf. infra).
IV. L'obsolescence historique du mode de production capitaliste et les bases de son dépassement
Ce formidable dynamisme d'extension interne et externe du capitalisme n'est cependant pas éternel. En effet, comme tout mode de production dans l'histoire, le capitalisme connaît aussi une phase d'obsolescence où ses rapports sociaux freinent le développement de ses forces productives : "...le système capitaliste devient un obstacle pour l'expansion des forces productives du travail. Arrivé à ce point, le capital, ou plus exactement le travail salarié, entre dans le même rapport avec le développement de la richesse sociale et des forces productives que le système des corporations, le servage, l'esclavage, et il est nécessairement rejeté comme une entrave" (40). C'est donc au sein des transformations et de la généralisation du rapport social de production salarié qu'il faut rechercher le caractère historiquement limité du mode de production capitaliste. Arrivé à un certain stade, l'extension du salariat et sa domination par le biais de la constitution du marché mondial, marquent l'apogée du capitalisme (41). Au lieu de continuer à puissamment éradiquer les anciens rapports sociaux et développer les forces productives, le caractère désormais obsolète du rapport salarié à tendance à figer les premiers, et freiner les seconds : il est toujours incapable d'intégrer en son sein une bonne partie de l'humanité, il engendre des crises, des guerres, et catastrophes d'ampleur croissante, et va jusqu'à menacer l'humanité de disparition.
1) L'obsolescence du capitalisme
Si la généralisation et la domination progressive du salariat ont dynamisé le capitalisme, elles ont aussi engendré une instabilité croissante où toutes ses contradictions s'expriment alors à pleine puissance. Ceci ne signifie pas que le salariat s'est implanté partout, loin de là, mais cela veut dire que le monde vit désormais au rythme de ses contradictions. La première guerre mondiale ouvre cette ère des crises majeures à dominante mondiale et salariale : (a) le cadre national est devenu trop étroit pour contenir les assauts des contradictions capitalistes ; (b) le monde n'offre plus assez d'opportunités ou d'amortisseurs lui permettant d'assurer une régulation externe à ses contradictions internes ; (c) à postériori, l'échec de la régulation instaurée durant les Trente glorieuses indique l'incapacité historique du capitalisme à trouver des ajustements internes à long terme à ses propres contradictions qui explosent alors avec une violence de plus en plus barbare.
Dans la mesure où elle est devenue un conflit planétaire, non plus pour la conquête, mais pour le repartage des sphères d'influence, des zones d'investissement, et des marchés, la première guerre mondiale marque définitivement l'entrée du mode de production capitaliste dans sa phase d'obsolescence. Les deux conflits mondiaux d'intensité croissante, la plus grande crise de surproduction de tous les temps (1929-1933), le formidable frein à la croissance des forces productives durant les Trente piteuses (1914-45), l'incapacité du capitalisme à intégrer en son sein une bonne partie de l'humanité, le développement du militarisme et du capitalisme d'Etat sur la planète entière, la croissance de plus en plus grande des frais improductifs, ainsi que l'incapacité historique du capitalisme à stabiliser en interne une régulation de ses propres contradictions, tous ces phénomènes matérialisent cette obsolescence historique du rapport social de production salarié qui n'a plus rien d'autre à offrir à l'humanité qu'une perspective de barbarie croissante (42).
2) Effondrement catastrophique, ou vision matérialiste, historique et dialectique de l'histoire ?
Cependant, l'obsolescence historique du capitalisme ne signifie aucunement que ce dernier serait condamné à mourir de façon mécaniste lors d'un inéluctable effondrement catastrophique. En effet, les mêmes tendances et dynamiques qui se dégagent de l'analyse de Marx continuent de s'exercer, mais au sein d'un contexte général qui a profondément changé. Comme le disait Trotski parlant de la phase de décadence du capitalisme au 3ème congrès de l'Internationale Communiste : "Tant que le capitalisme n'aura pas été brisé par une révolution prolétarienne, il vivra les mêmes périodes de hausse et de baisse, il connaîtra les mêmes cycles (...) Les oscillations cycliques vont continuer, mais, en général, la courbe du développement capitaliste aura tendance à baisser et non pas à remonter". En effet, durant cette phase, toutes les contradictions économiques, sociales et politiques du capitalisme débouchent inévitablement à des niveaux toujours supérieures, soit sur des conflits sociaux qui posent régulièrement la question de la révolution, soit sur des déchirements impérialistes qui posent l'avenir même de l'humanité. Autrement dit, le monde entier est pleinement entré dans cette "ère des guerres et des révolutions" comme l'énonçait la troisième internationale.
Cette conception n'a donc rien à voir avec une vision catastrophiste ‘force-productiviste' : il n'existe pas de limites quantitatives qui seraient prédéfinies au sein des forces productives du capitalisme (que ce soit un pourcentage de taux de profit ou une quantité donnée de marchés extra-capitalistes), et qui détermineraient un point alpha précipitant le mode de production capitaliste dans la mort. Les limites des modes de production sont avant tout sociales, produites de leurs contradictions internes, et relatives à un état donné de la société. Elles résident au sein de leurs rapports sociaux, et dans la collision entre ces rapports devenus obsolètes et les forces productives. Il n'a jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité de limites matérielles quantitativement prédéfinies aux modes de production telles que, à un moment donné, leurs ressorts seraient totalement épuisés et les précipiteraient dans un effondrement catastrophique. Dès lors, c'est le prolétariat qui abolira le capitalisme, et pas ce dernier qui mourra de lui-même par ses limites ‘objectives'.
Cette vision d'un effondrement catastrophique procède d'un matérialisme vulgaire et mécaniste, ainsi que d'un finalisme téléologique qui a déjà fait beaucoup de dégâts au sein du mouvement ouvrier. Elle a désarmé des générations entières de révolutionnaires, car c'est une vision qui fonde la conviction militante sur une base immédiatiste et ‘force-productiviste', au lieu d'une compréhension matérialiste, historique et dialectique de l'histoire. Toutes ces prévisions récurrentes de fin du monde se sont d'ailleurs systématiquement révélées vaines depuis près d'un siècle :
1) Catastrophisme luxemburgiste du KAPD (tendance Essen) au début du XXè siècle.
2) Faillite de nombreux groupes politiques oppositionnels à la IIIème Internationale prédisant la fin du capitalisme en 1929 sur des bases analogues.
3) Paralysie et dispersion de la Gauche italienne (Bilan) en 1940 suite à sa théorie catastrophiste sur l'économie de guerre.
4) Disparition de la Gauche Communiste de France (Internationalisme) prédisant la crise permanente et la 3ème guerre mondiale en 1952 sur la base de l'analyse de Rosa Luxemburg.
5) Multiples scissions chez les bordiguistes suite à la prévision de crise catastrophique en 1975 par Bordiga.
Tout ceci montre le danger qu'il y a à professer ce genre de vision fausse du matérialisme historique : elle désarme politiquement les générations futures. Le rejet de ces multiples erreurs à répétition dépend d'une claire vision de la dynamique et de la nature des limites des modes de production dans l'histoire. Une bonne compréhension de la parenthèse des Trente glorieuses dans le cours général du capitalisme obsolescent peut grandement nous y aider. Elle permettra de clarifier quelles sont les perspectives réellement contenues dans la situation présente de crise du capitalisme. Tel est l'objet de la suite de cet article.
V. Le capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste à la base des Trente glorieuses
Aucun révolutionnaire dans le passé n'aurait imaginé que le capitalisme serait encore sur pied un siècle après. Ainsi, en 1952, au moment même où le cadre théorique de nos ancêtres politiques de la Gauche Communiste de France les amenait à pronostiquer la "crise permanente du capitalisme (...) l'éclatante confirmation de la théorie de Rosa Luxemburg" et la "guerre imminente...", le capitalisme était à la veille de connaître ses Trente glorieuses ! En réalité, de tels phénomènes de reprises au cours de l'obsolescence d'un mode de production ne devraient pas surprendre les marxistes : une classe aux abois tente toujours de prolonger la survie de son système par tous les moyens. Tel fut le cas lors de la reconstitution de l'empire romain sous Charlemagne, ou de la constitution des grandes monarchies de l'Ancien Régime. Cependant, ce n'est pas parce qu'on se trouve dans un méandre qu'il faut en conclure que la rivière coule de la mer à la montagne ! Il en va de même pour les Trente glorieuses : la bourgeoisie a momentanément pu insérer une parenthèse de forte croissance dans le cours général de sa décadence.
En effet, la crise de 1929 aux Etats-Unis illustre bien toutes les caractéristiques spontanément prises par les crises économiques durant la phase d'obsolescence du capitalisme. Elle a montré qu'une économie dominée par le salariat est foncièrement instable : les contradictions du système capitaliste s'y expriment alors dans toute leur violence. On aurait donc pu s'attendre à ce qu'elle soit suivie de crises économiques de plus en plus rapprochées et de plus en plus violentes. C'est ce que tous les groupes révolutionnaires de l'époque pronostiquaient, mais il n'en fut rien. C'est que la situation avait notablement évolué : les processus productifs (fordisme), et les rapports de force entre les classes (et au sein de celles-ci), avaient notablement changé. De même, certaines leçons avaient été tirées par la bourgeoisie et ses divers représentants. Ainsi, aux Trente piteuses et aux affres barbares de la seconde guerre mondiale a succédé une bonne trentaine d'années de forte croissance, un quadruplement des salaires réels, le plein emploi, la mise en place d'un salaire social, et une capacité du système, non à éviter, mais à réagir aux crises cycliques. Comment tout cela fut-il possible ?
1) Les bases du capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste
Désormais, en l'absence de possibilités significatives de régulation externe de ses contradictions, le capitalisme devra trouver une régulation interne à sa double contrainte : tant au niveau de ses profits, que de la demande solvable requise. Ainsi, le niveau et le taux de profit seront rendus possibles par le développement de forts gains de productivité du travail engendrés par la généralisation du fordisme dans le secteur industriel, c'est-à-dire la chaine de montage couplée avec le travail en trois équipes de huit heures. Tandis que les marchés où écouler cette énorme masse de marchandises seront garantis par divers systèmes indexant les salaires réels sur la productivité. Ceci permettra de faire augmenter la demande parallèlement à la production (cf. graphique n°4 ci-dessous). Autrement dit, en stabilisant la part salariale dans le total de la richesse produite, le capitalisme a pu éviter pour un temps "une surproduction qui provient justement du fait que la masse du peuple ne peut jamais consommer davantage que la quantité moyenne des biens de première nécessité, que sa consommation n'augmente donc pas au rythme de l'augmentation de la productivité du travail" (43).
Graphique n°4 : Salaires et productivité aux Etats-Unis [74] (44)
Commentaire du graphique : Le parallélisme entre l'augmentation des gains de productivité et des salaires réels est quasi parfait depuis la seconde guerre mondiale jusqu'aux années 1970, et encore largement durant celles-ci. Le décalage deviendra patent et croissant à partir de 1982. Dans le fonctionnement du capitalisme depuis ses origines, c'est l'écart entre les deux courbes qui constitue la règle, et le parallélisme durant les Trente glorieuses l'exception. En effet, cet écart matérialise la tendance permanente du capitalisme à faire croître sa production (courbe supérieure de la productivité) au-delà de la croissance de sa demande solvable la plus importante : les salaires réels (courbe inférieure).
Compte-tenu des dynamiques spontanées du capitalisme (concurrence, compression des salaires, etc.), un tel système n'était viable que dans le cadre d'un capitalisme d'Etat contraignant qui a contractuellement garanti le respect d'une politique de tri-répartition des gains de productivité entre les profits, les salaires et les revenus de l'Etat (45).
Dans une société désormais dominée par le salariat qui impose, de fait, la dimension sociale dans toute politique menée par la bourgeoisie, ceci supposait également la mise en place de multiples contrôles économiques et sociaux de la classe ouvrière : salaire social, création et contrôle syndical accru, amortisseurs sociaux, etc. Ceci implique un développement sans précédant du capitalisme d'Etat afin de maintenir les contradictions désormais explosives du système dans les limites de l'ordre : prédominance de l'exécutif sur le législatif au niveau politique, croissance faramineuse de l'interventionnisme étatique au sein de l'économie (qui atteint près de la moitié du PNB dans les pays de l'Ocde), très fort contrôle social de la classe ouvrière, etc. C'est ce que nos ancêtres de la Gauche Communiste de France analysaient déjà (correctement cette fois) dans une étude toute entière consacrée au développement du capitalisme d'Etat durant la décadence du capitalisme : "Le salaire même est intégré à l'Etat. La fixation, à sa valeur capitaliste, en est dévolue à des organismes étatiques" (46).
De plus, cette régulation momentanée des contradictions internes du capitalisme dans le cadre national n'aurait pas pu fonctionner si elle n'avait pas été instaurée à l'échelle internationale (dans le cadre des pays de l'OCDE du moins). Ceci c'est déroulé au sein d'un contexte inter-impérialiste caractéristique de l'obsolescence du capitalisme, qui se marque par une polarisation extrême entre deux blocs antagoniques, tant sur le plan militaire (Otan <-> Pacte de Varsovie), qu'économique (Ocde <-> Comecon). Polarisation qui induira une très forte discipline au sein de chacun d'eux, y compris sur le plan économique par la mise en place d'organismes et de politiques structurelles d'intégration et règlements communs, mais sous la direction et en fonction des intérêts de chaque tête de bloc (USA et URSS).
2) Origine, contradictions et limites du capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste
Compte-tenu de l'ensemble conséquent de conditions requises au fonctionnement du capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste (cf. supra), sa mise en place ne peut se réduire à une question technique, ou à un cocktail de recettes purement économiques. Elle requiert un ensemble de paramètres, et, notamment, une configuration particulière du rapport de force entre les classes (et au sein de chacune d'elles) qui permettent l'instauration et l'imposition d'un nouveau mode de régulation du capitalisme à toutes ses composantes, paramètres que nous allons brièvement évoquer au travers de la genèse et de la mise en place de ce système dans l'immédiat après-guerre.
Dès la défaite des troupes allemandes à Stalingrad (janvier 1943), gouvernements, représentants patronaux, et délégués syndicaux en exil à Londres discuteront intensément de la réorganisation de la société au lendemain d'une chute désormais inéluctable des forces de l'Axe. Le souvenir des affres des Trente piteuses (1914-45), la peur de mouvements sociaux à la fin de la guerre, les leçons tirées de la crise de 29, l'acceptation désormais très largement partagée de l'intervention étatique, et la bipolarisation de la guerre froide, constitueront autant d'éléments poussant toutes les fractions de la bourgeoisie à modifier les règles du jeu et à élaborer plus ou moins consciemment ce capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste qui sera pragmatiquement et progressivement implanté dans tous les pays développés (OCDE). Le partage des gains de productivité était d'autant plus facilement accepté par tous, (a) qu'ils s'accroissaient fortement, (b) que cette redistribution garantissait l'élargissement de la demande solvable en parallèle à la production, (c) qu'il offrait une paix sociale, (d) paix sociale d'autant plus facile à obtenir que le prolétariat sortait en réalité défait de la seconde guerre mondiale, et embrigadé derrière des partis et syndicats tous nationalistes et chauds partisans de la reconstruction dans le cadre du système, (e) mais qu'il garantissait aussi la rentabilité à long terme des investissements, (f) ainsi qu'un taux de profit stabilisé à un haut niveau.
Ce système a donc momentanément pu garantir la quadrature du cercle consistant à faire croître la production de profit et les marchés en parallèle dans un monde désormais largement dominé par la demande salariale (celle-ci s'est même élevée à plus ou moins 70% de la richesse produite à la fin des Trente glorieuses). L'accroissement assuré des profits, des dépenses de l'Etat, et de l'augmentation des salaires réels, a pu garantir la demande finale si indispensable au succès du bouclage de l'accumulation capitaliste. Le capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste est la réponse que le système a pu temporairement trouver à l'actualité de ses crises à dominante mondiale et salariale si typiques de la phase historique d'obsolescence du capitalisme. Et pour cause, il a permis un fonctionnement autocentré du capitalisme, sans nécessités de délocalisations malgré les hauts salaires et le plein emploi, en se débarrassant de colonies n'ayant plus d'utilité économique que résiduelle, ainsi qu'en éliminant ses sphères extra-capitalistes agricoles internes dont il devra désormais subventionner l'activité plutôt qu'en tirer avantage.
Mais, comme les roses, la forte croissance ne durera que l'espace d'un matin. En effet, dès la fin des années 1960, et jusqu'à 1982, toutes les conditions qui ont fait son succès vont se dégrader, à commencer par le déclin progressif des gains de productivité qui seront globalement divisés par trois et qui entraineront toutes les autres variables économiques à la baisse. C'est donc bien l'infléchissement du taux de profit qui signale le retour des difficultés économiques comme le montrent clairement les graphiques n°1 et n°3. La dérégulation de pans significatifs du capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste au début des années 1980 a été rendue nécessaire pour rétablir le taux de profit. Cependant, compte-tenu de la faiblesse structurelle des gains de productivité qui restent à l'étiage, ce rétablissement n'a pu se faire que par le bas, en comprimant la part salariale (cf. graphique n°2).
La régulation interne temporairement trouvée par l'instauration du capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste n'avait donc aucune base éternelle. Pourtant, l'exigence qui avait nécessité la mise en place de ce système est toujours présente : le salariat est prépondérant dans la population active, le capitalisme doit donc impérativement trouver un moyen de stabiliser la demande finale pour éviter que sa compression ne se transforme en dépression. En effet, les investissements des entreprises étant également contraints avec la demande, il faut alors trouver d'autres moyens d'assurer la consommation. La réponse actuelle tient nécessairement dans le doublon : de moins en moins d'épargne, de plus en plus de dettes. A revenu constant, la baisse du taux d'épargne des ménages accroît la consommation sans bourse délier ; quant à la montée du taux d'endettement, elle augmente les dépenses de ces derniers sans passer par les hausses de salaires réels. Nous sommes donc en présence d'une formidable machine à fabriquer des bulles financières et à alimenter la spéculation. L'aggravation constante des déséquilibres n'est donc pas le résultat d'erreurs dans la conduite de la politique économique : elle est partie intégrante du modèle.
3) Conclusion : et demain ?
Cette descente aux enfers est d'autant plus inscrite dans la situation présente que les conditions pour un redressement des gains de productivité et un retour à leur tri-répartition ne sont socialement pas présentes, même si certains éléments sont techniquement là. En effet, compte-tenu du glissement progressif des besoins de la population vers des biens tertiaires et sociaux à productivité plus faible, le capitalisme a de plus en plus de mal à concilier la satisfaction de la demande avec ses propres critères de rentabilité. De même, la tendance au chacun pour soi consécutive au capitalisme d'Etat dérégulé, la remise en cause du rôle économiquement régulateur de l'Etat, les pressions sociales, etc. sont autant de facteurs qui n'offrent plus de contexte favorable à la réintroduction d'un système analogue aux Trente glorieuses. Ceci n'implique pas que le capitalisme va s'effondrer tout seul, mais qu'il ne peut perdurer que sous des formes régressives et de plus en plus barbares. Rien dans l'état actuel du rapport de force entre les classes, et de la concurrence inter-impérialiste archarnée au niveau international, ne laissent entrevoir une quelconque sortie possible : tout concourt à une inexorable descente aux enfers. Il revient donc aux révolutionnaires de contribuer à féconder les combats de classe qui surgiront inévitablement de plus en plus de cet approfondissement des contradictions du capitalisme.
C.Mcl
1 Internationalisme n° 46, 1952, revue de la Gauche Communiste de France (1942-52).
2 Marx, Théories sur la plus-value, Éditions sociales, tome II : 621.
3 Marx, Le Capital, Livre III, Éditions sociales, tome I : 257-258.
4 Marx, Le Capital, livre I, Éditions sociales, tome III : 36.
5 Marx, Le Capital, Livre II, La Pléiade II : 614.
6 Marx, Le Capital, Livre III, La Pléiade II : 1031 & 1037.
7 Les neufs récessions qui ponctuent la dizaine de cycles s'identifient sur le graphique n°1 par les groupes de traits qui s'étendent sur toute leur hauteur : 1949, 1954, 1958, 1960, 1970-71, 1974, 1980-81, 1991, 2001.
8 "L'alternance des crises et des périodes de développement, avec tous leurs stades intermédiaires, forme un cycle ou un grand cercle du développement industriel. Chaque cycle embrasse une période de 8, 9, 10, 11 ans. Si nous étudions les 138 dernières années, nous nous apercevrons qu'à cette période correspondent 16 cycles. A chaque cycle correspond par conséquent un peu moins de 9 ans" (Trotski, "Rapport sur la crise économique mondiale et les nouvelles tâches de l'Internationale Communiste" : 3e congrès).
9 Lire en particulier l'étude de Mitchell dans Bilan n°10, intitulée justement "Crises et cycles dans le capitalisme agonisant", où il explique que "recommencer un cycle pour produire de la nouvelle plus-value reste le suprême objectif du capitaliste", et que "cette périodicité quasi mathématique des crises constitue un des traits spécifiques du syste capitaliste de production".
10 Engels, préface à l'édition anglaise (1886) du livre I du Capital, La Pléiade, Economie II : 1802.
11 Marx, Le Capital, Livre III, Éditions sociales, tome I : 257-258.
12 Marx, Théories sur la plus-value, Éditions sociales, tome II : 637.
13 Marx, Le Capital, Livre III, La Pléiade, Économie II : 1206. Cette analyse élaborée par Marx n'a évidemment strictement rien à voir avec la théorie sous-consommationniste des crises qu'il critique par ailleurs : "...on prétend que la classe ouvrière reçoit une trop faible part de son propre produit et que l'on pourrait remédier à ce mal en lui accordant une plus grande part de ce produit, donc des salaires plus élevés. Mais il suffit de rappeler que les crises sont chaque fois préparées précisément par une période de hausse générale des salaires, où la classe ouvrière obtient effectivement une plus grande part de la fraction du produit annuel qui est destiné à la consommation" (Marx, Le Capital, Livre II, La Pléiade, Économie II : 781).
14 Marx, Le Capital, livre III, La Pléiade II : 1041. Marx exprime cette idée dans de nombreux autres passages dans tout son ouvrage dont voici encore un exemple : "Surproduction de capital ne signifie jamais que surproduction de moyens de production ... une baisse du degré d'exploitation au-dessous d'un certain point provoque, en effet, des perturbations et des arrêts dans le processus de production capitaliste, des crises, voire la destruction de capital" (Marx, Le Capital, livre III, La Pléiade II : 1038).
15 Chacun de ces trois facteurs (a), (b) et (c) ont été identifié de la sorte dans la citation suivante de Marx : "Les conditions de l'exploitation immédiate et celles de sa réalisation ne sont pas identiques. Elles ne diffèrent pas seulement par le temps et le lieu, théoriquement non plus elles ne sont pas liées. Les unes n'ont pour limite que la force productive de la société, les autres [(c)] les proportions respectives des diverses branches de production et [(a)] la capacité de consommation de la société. Or celle-ci n'est déterminée ni par la force productive absolue, ni par la capacité absolue de consommation, mais par la capacité de consommation sur la base de rapports de distribution antagoniques, qui réduit la consommation de la grande masse de la société à un minimum susceptible de varier seulement à l'intérieur de limites plus ou moins étroites. [(b)] Elle est en outre limitée par la tendance à l'accumulation, la tendance à agrandir le capital et à produire de la plus-value sur une échelle élargie" (Marx, Le Capital, Livre III, Éditions sociales, tome I : 257-258).
16 Marx, Le Capital, livre III, Éditions sociales, tome 7, p. 144. De ceci découle que notre plateforme contient une première erreur théorique en affirmant que "...c'est dans ce monde non-capitaliste qu'il [le capitalisme] trouve les débouchés qui permettent son développement".
17 Marx, Le Capital, Livre III, Éditions sociales, tome I ; 257-258.
18 Marx, Théories sur la plus-value, Éditions sociales, tome II : 621.
19 "En effet, le marché et la production étant des facteurs indépendants, l'extension de l'un ne correspond pas forcément à l'accroissement de l'autre" (Marx, Gründrisse, La Pléiade, Economie II : 489). Ou encore : "Les conditions de l'exploitation immédiate et celles de sa réalisation ne sont pas identiques. Elles ne différent pas seulement par le temps et le lieu, théoriquement non plus elles ne sont pas liées" (Marx, Le Capital, Livre III, Éditions sociales, tome I ; 257-258).
20 Marx, Le Capital, Livre III, Éditions sociales, tome I ; 257-258.
21 Toute idée de mono-causalité des crises de surproduction est d'autant plus importante à rejeter que leurs origines sont bien plus complexes et multiples chez Marx et dans la réalité : anarchie de la production, disproportionnalité entre les deux grands secteurs de l'économie, oppositions entre ‘capital de prêt' et ‘capital productif', disjonctions entre l'achat et la vente consécutives à la thésaurisation, etc. Néanmoins, les deux racines les plus amplement analysées par Marx, et aussi les plus effectives en pratique, sont bien celles que nous avons rappelées : la baisse du taux de profit et les lois de répartition du surtravail.
22 C'est pourquoi notre plateforme [75] contient une seconde erreur théorique lorsqu'elle fait dépendre l'évolution du taux de profit de la grandeur des marchés : "De plus, la difficulté croissante pour le capital de trouver des marchés où réaliser sa plus-value, accentue la pression à la baisse qu'exerce sur son taux de profit l'accroissement constant de la proportion entre la valeur des moyens de production et celle de la force de travail qui les met en œuvre". Cette proposition est formellement infirmée par de multiples exemples durant l'histoire économique du capitalisme, et, en particulier, depuis un quart de siècle, puisque le taux de profit ne fait que remonter depuis 1982, alors que les marchés sont de plus en plus saturés !
23 Comme, par exemple, la longue phase de hausse progressive des salaires réels lors de la seconde moitié de la phase ascendante du capitalisme (1870-1914), durant les ‘Trente glorieuses' (1945-82), ou leurs baisses relatives - et même absolues - depuis lors (1982-2008).
24 Un peu plus tôt, vers le milieu des années 60, pour les États-Unis (cf. graphique n°1). Quand au Japon, son taux de profit ne s'infléchira à la baisse, à moyen terme, qu'une dizaine d'années plus tard.
25 Notre article sur la crise [76] dans la Revue n°115, contient un graphique de l'évolution de la productivité du travail entre 1961 et 2003 pour le G6 (États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie). Il montre très clairement l'antériorité de sa baisse sur toutes les autres variables qui évolueront à sa suite, ainsi que son maintien à un faible niveau depuis lors. Pour mémoire, rappelons au lecteur que la productivité du travail constitue, chez Marx, la variable clé de l'évolution du capitalisme, puisqu'elle n'est autre que l'inverse de la loi de la valeur, c'est-à-dire du temps de travail social moyen pour produire les marchandises.
26 Il va de soi qu'une crise de rentabilité abouti forcément à un état endémique de surproduction, tant de capitaux que de marchandises. Cependant, ces phénomènes de surproduction étaient subséquents et faisaient l'objet de politiques de résorptions, tant par les acteurs publics (quotas de production, restructurations, etc.) que privés (fusions, rationalisations, rachats, etc.).
27 Durant les années 70, la classe ouvrière subira la crise essentiellement sous les formes d'une dégradation de ses conditions de travail, de restructurations et licenciements, et donc, d'une croissance spectaculaire du chômage. Contrairement à la crise de 1929, ce chômage n'entraînera cependant pas de spirale récessive grâce à l'utilisation des amortisseurs sociaux keynésiens : allocations de chômage, indemnités de reconversion, préavis de licenciement, etc.
28 Source du graphique : M. Husson, hussonet.free.fr [77]. Notons également la stabilité de cette part salariale durant les ‘Trente glorieuses', et sa hausse à la faveur de la poursuite des politiques d'indexation salariale - alors que la productivité du travail ralentissait brusquement - dans un contexte de reprise de la lutte des classes dès la fin des années 1960 et durant toutes les années 1970.
29 Le graphique n°3 nous indique que la croissance et l'accumulation oscillent entre 2% à 3% depuis 1982, alors qu'elles oscillaient deux fois plus fortement durant les belles années d'après-guerre (entre 4% à 6%), et plus spectaculairement encore pour certains grands pays comme l'Allemagne et le Japon.
30 De là le paradoxe ‘scandaleux' d'entreprises qui licencient, rationalisent, et restructurent, alors qu'elles font de faramineux profits.
31 En effet, la faiblesse des gains de productivité, la dérégulation des mécanismes keynésiano-fordistes, et le chacun pour soi, rendent cette remontée socio-économiquement et politiquement impossible à l'heure actuelle. Et ce, contrairement aux "Trente glorieuses" où l'augmentation de la productivité a permis de rendre compatible - dans le cadre d'un capitalisme d'Etat contraignant - la croissance parallèle des salaires et des profits (cf. infra).
32 Source du graphique : M. Husson, hussonet.free.fr [77].
33 Marx, Le Capital, Livre III, Éditions sociales, tome I : 257-258. Ceci n'est autre que ce qu'il énonçait déjà dans Le Manifeste : "Poussée par le besoin de débouchés toujours plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe. Partout elle doit s'incruster, partout il lui faut bâtir, partout elle établit des relations (...) Le bas prix de ses marchandises est la grosse artillerie avec laquelle elle démolit toutes les murailles de Chine... Elle contraint toutes les nations, sous peine de courir à leur perte, d'adopter le mode de production bourgeois ; elle les contraint d'importer chez elles ce qui s'appelle la civilisation, autrement dit : elle en fait des nations de bourgeois. En un mot, elle crée un monde à son image. La bourgeoisie a soumis la campagne à la domination de la ville" (La Pléiade I : 165).
34 "...l'ère capitaliste ne date que du XVIe siècle. (...) La révolution qui allait jeter les premiers fondements du régime capitaliste eut son prélude dans le dernier tiers du XVe siècle et au commencement du XVIe" (Marx, La Pléiade I : 1170, 1173) ; "...ce n'est qu'avec la crise de 1825 que s'ouvre le cycle périodique de sa vie moderne" (Marx, Postface à la seconde édition allemande du Capital, La Pléiade I : 553).
35 "Le profit peut être obtenu également par escroquerie dans la mesure où l'un gagne ce que l'autre perd. La perte et le gain à l'intérieur d'un pays s'égalisent. Il n'en va pas de même entre plusieurs pays. ...trois journées de travail d'un pays peuvent s'échanger contre une journée d'un autre pays. La loi de la valeur subit ici des modifications essentielles. Ou bien, de même qu'à l'intérieur d'un pays du travail qualifié, du travail complexe, se rapporte à du travail non qualifié, simple, de même les journées de travail des différents pays peuvent se rapporter mutuellement. Dans ce cas, le pays riche exploite le pays pauvre, même si ce dernier gagne dans l'échange..." (Marx, Theorien über den Mehrwert, vol. III : 279-280). Ou encore : "On peut avoir la même situation vis-à-vis du pays où l'on expédie et d'où l'on reçoit des marchandises ; celui-ci fournissant plus de travail matérialisé in natura qu'il n'en reçoit, et malgré tout obtenant la marchandise à meilleur marché qu'il ne pourra la produire lui-même. Tout comme le fabricant qui, utilisant une invention nouvelle avant sa généralisation, vend à meilleur marché que ses concurrents et néanmoins au-dessus de la valeur individuelle de sa marchandise, c'est-à-dire met en valeur, comme surtravail, la productivité spécifiquement supérieure du travail qu'il emploie. Il réalise de la sorte un surprofit" (Marx, Le Capital, livre III, Editions sociales, tome VI : 250).
36 Quoique le renouvellement endogène de la classe ouvrière (reproduction naturelle et volant du chômage) prenait progressivement le pas sur ses sources externes (exode rural, etc.).
37 Ici, il faut clairement distinguer deux notions trop souvent confondues : les rapports que le capitalisme entretient avec son milieu extérieur, d'une part, et l'impérialisme, d'autre part. Ce dernier constitue une des formes que ces rapports peuvent prendre, mais c'est loin d'être la seule, et l'impérialisme peut se manifester dans bien d'autres domaines que dans le cadre de ces rapports.
38 Il n'existe pas de mécanismes univoques et atemporels qui détermineraient les rapports entre le capitalisme et sa sphère extérieure (comme la recherche de surprofits ou la conquête de marchés extra-capitalistes). Chaque régime d'accumulation rythmant le développement historique du capitalisme engendre des rapports spécifiques avec sa sphère extérieure : du mercantilisme des pays de la péninsule ibérique, au capitalisme autocentré durant les Trente glorieuses, en passant par le colonialisme de l'Angleterre victorienne, il n'existe pas de rapports uniformes entre le cœur et la périphérie du capitalisme, mais un mélange successif de rapports qui tous trouvent leurs ressorts spécifiques dans ces différentes nécessités internes à l'accumulation du capital. C'est pourquoi, l'article introductif à ce débat paru dans le numéro précédant de cette revue (mais aussi tous nos textes de base) commet une grosse erreur théorique en reprenant la définition beaucoup trop restrictive de l'impérialisme donnée par Rosa Luxemburg. En effet, selon cette définition, tous les conflits entre grandes puissances, pour d'autres raisons que la lutte pour des marchés extra-capitalistes, ne rentreraient pas dans cette caractérisation d'impérialistes !
39 Au XIXe siècle, là où les marchés coloniaux interviennent le plus, TOUS les pays capitalistes NON-coloniaux ont connu des croissances nettement plus rapides que les puissances coloniales (71% plus rapide en moyenne). Ce constat est en réalité valable pour toute l'histoire du capitalisme : "en comparant les taux de croissance pour le XIXe siècle, il apparaît qu'en règle générale les pays non coloniaux ont connu un développement économique plus rapide que les puissances coloniales. (...) Cette règle reste en grande partie valable au XXe siècle" (Paul Bairoch, "Mythes et paradoxes de l'histoire économique", p. 111). Ceci s'explique aisément pour plusieurs raisons sur lesquelles nous ne pouvons nous étendre ici. Signalons simplement, qu'en règle générale, toute vente de marchandise sur un marché extra-capitaliste sort du circuit de l'accumulation, et donc, tend à freiner cette dernière. En quelque sorte, tout comme la vente d'armement profite au capitaliste individuel, mais correspond à une perte sèche pour le capital global (car ce type de marchandise n'est pas réinsérée dans le circuit de l'accumulation), la vente de marchandises à l'extérieur du capitalisme pur permet bien aux capitalistes individuels de réaliser leurs marchandises, mais elle freine l'accumulation globale du capitalisme, car cette vente correspond à une sortie de moyens matériels du circuit de l'accumulation. Dès lors, notre plateforme contient une troisie erreur théorique et factuelle lorsqu'elle affirme que la prospérité du capitalisme serait due aux débouchés extra-capitalistes : "Le capitalisme se développe dans un monde non-capitaliste, et c'est dans ce monde qu'il trouve les débouchés qui permettent ce développement. Mais en généralisant ses rapports à l'ensemble de la planète et en unifiant le marché mondial, il a atteint un degré critique de saturation des mêmes débouchés qui lui avaient permis sa formidable expansion du 19e siècle".
40 Marx, Grundrisse (Manuscrits de 1857-58), La Pléiade, Économie II : 272-273.
41 Dès lors, notre plateforme contient une quatrième erreur théorique en liant strictement l'avènement de la décadence du capitalisme à la saturation des marchés extra-capitalistes : "Le capitalisme se développe dans un monde non-capitaliste, et c'est dans ce monde qu'il trouve les débouchés qui permettent ce développement. Mais en généralisant ses rapports à l'ensemble de la planète et en unifiant le marché mondial, il a atteint un degré critique de saturation des mêmes débouchés qui lui avaient permis sa formidable expansion du 19e siècle".
42 Sur toutes ces questions - qu'il est impossible de développer dans le cadre de cet article -, nous renvoyons le lecteur à nos deux séries d'articles sur ‘La décadence du capitalisme' parues dans les Revues Internationales n°54 [78], 55 [79], 56 [21], et n°118 [80], 119 [81], 121 [82] et 123. [83]
43 Marx, Théories sur la plus-value, livre IV, Éditions sociales, tome 2 : 559-560.
44 Source : A. Parienty, Productivité, croissance, emploi, collection CIRCA, A. Colin 2005, p.94.
45 Certaines de ces idées étaient déjà développées il y a une vingtaine d'années dans notre article [21] du n°56 de cette revue : "C'est également au cours de la seconde guerre mondiale que la bourgeoisie aux Pays-Bas planifie avec les syndicats la hausse progressive des salaires selon un coefficient qui est fonction de la hausse de la productivité tout en lui étant inférieure (...) C'est au cours de la seconde guerre mondiale, c'est-à-dire au somment de la défaite ouvrière qu'est conçu, discuté et planifié au sein des pays développés la mise en place du système actuel de sécurité sociale ... A la demande du gouvernement anglais, le député libéral Sir William Beveridge rédige un rapport, publié en 1942, qui servira de base pour édifier le système de sécurité sociale en GB mais inspirera également tous les systèmes de sécurité sociale des pays développés". Pourtant acceptées de publication, elles n'avaient ni été comprises, ni suscité de débat à l'époque.
46 Tiré de l'article publié dans Internationalisme n°46 (mai 1952) : L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective et rédigé par notre fondateur Marc Chirik (cf. Revue n°65 et 66 pour une évocation de son apport théorique et organisationnel dans le mouvement ouvrier).
Questions théoriques:
- Décadence [4]
- L'économie [33]