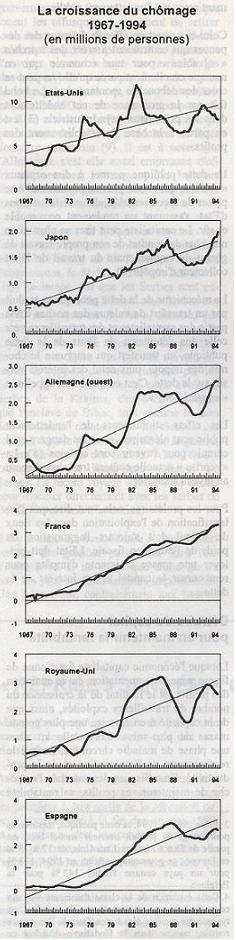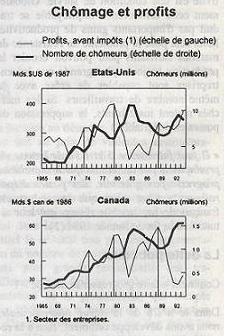Revue Int. 1995 - 80 à 83
- 4352 lectures
Revue Internationale no 80 - 1e trimestre 1995
- 3388 lectures
Crise économique : une « reprise » sans emplois
- 4137 lectures
Apparemment, presque tous les indicateurs économiques statistiques sont clairs : l'économie mondiale est enfin en train de sortir de la pire récession qu'elle ait connue depuis la guerre. La production augmente, les profits sont de retour. L'assainissement semble avoir été payant. Et pourtant aucun gouvernement n'ose chanter victoire, tous appellent à encore de nouveaux sacrifices, tous restent extrêmement prudents et, surtout, tous disent que, de toutes façons, pour ce qui est du chômage, c'est-à-dire l'essentiel, il n'y a pas grand chose de vraiment bon à attendre. ([1] [1])
Mais, qu'est-ce qu'une « reprise » qui ne crée pas d'emplois ou qui ne crée que des emplois précaires ?
Au cours des deux dernières années, dans les pays anglo-saxons, qui sont censés être les premiers à être sortis de la récession ouverte commencée à la fin des années 1980, la « reprise » s'est concrétisée essentiellement par une modernisation extrême de l'appareil productif dans les entreprises qui ont survécu au désastre. Celles qui survivent l'ont fait au prix de violentes restructurations, entraînant des licenciements massifs et des dépenses non moins massives pour remplacer le travail vivant par du travail mort, par des machines. L'augmentation de la production que les statistiques enregistrent dans les derniers mois, est pour l'essentiel le résultat non pas d'une augmentation du nombre de travailleurs intégrés mais d'une plus grande productivité des travailleurs ayant déjà un emploi. Cette augmentation de la productivité, qui compte pour 80 % dans la hausse de la production au Canada, par exemple, un des pays les plus avancés dans la «reprise», est due pour l'essentiel à de très forts investissements pour moderniser les machines, les communications, développer l'automatisation, et non à l'ouverture de nouvelles usines. Aux Etats-Unis ce sont les investissements en biens d'équipement, principalement l'informatique, qui expliquent pour l'essentiel la croissance de l'investissement au cours des dernières années. L'investissement en construction non-résidentielle est resté presque stagnant. Ce qui veut dire qu'on modernise les usines existantes mais qu'on n'en construit pas de nouvelles.
Une reprise « Mickey Mouse »
Actuellement en Grande-Bretagne, où le gouvernement ne cesse de claironner ses statistiques faisant état d'une baisse continue du chômage, environ 6 millions de personnes travaillent une moyenne de seulement 14,8 heures par semaine. C'est ce genre d'emplois, aussi précaires que mal payés, qui dégonfle les statistiques du chômage. Les travailleurs britanniques appellent ça les « Mickey Mouse jobs ».
Pendant ce temps, les programmes de restructuration des grandes entreprises continuent : 1 000 suppressions d'emplois dans une des plus grandes compagnies d'électricité en Grande-Bretagne, 2 500 dans la deuxième entreprise de télécommunications.
En France, la Société nationale des chemins de fer annonce, pour 1995, 4 800 suppressions de postes, Renault 1 735, Citroën 1 180. En Allemagne, le géant Siemens annonce qu'il supprimera « au moins » 12 000 emplois en 1994-1995, après les 21 000 qu'il a déjà supprimés en 1993.
L'insuffisance de marchés
Pour chaque entreprise, accroître sa productivité est une condition de survie. Globalement cette concurrence impitoyable se traduit par d'importants gains de productivité. Mais cela pose le problème de l'existence de marchés suffisants pour pouvoir écouler la production toujours plus grande que les entreprises sont capables de créer avec le même nombre de travailleurs. Si les marchés restent insuffisants, la suppression de postes est inévitable.
« Il faut faire entre 5 et 6 % de hausse de productivité par an, et tant que le marché ne progresse pas plus vite, des postes disparaissent. » C'est ainsi que les industriels français de l'automobile résumaient leur situation à la fin de l'année 1994 ([2] [2]).
La dette publique
Comment « faire progresser le marché » ?
Dans le n° 78 de la Revue internationale, nous avons développé comment, face à la récession ouverte depuis la fin des années 1980, les gouvernements ont eu massivement recours à l'endettement public.
Celui-ci permet en effet de financer des dépenses qui contribuent à créer des marchés « solvables » pour une économie qui en manque cruellement parce qu'elle ne peut se créer des débouchés spontanément. Le bond fait par la croissance de cet endettement dans les principaux pays industriels ([3] [3]) est en partie à la base du rétablissement des profits.
La dette publique permet à des capitaux « oisifs », qui ont de plus en plus de mal à se placer de façon rentable, de le faire en Bons d'Etat, s'assurant un rendement convenable et sûr. Le capitaliste peut tirer sa plus-value non plus du résultat de son propre travail de gérant du capital, mais du travail de l'Etat collecteur d'impôts ([4] [4]).
Le mécanisme de la dette publique se traduit par un transfert de valeurs des poches d'une partie des capitalistes et des travailleurs vers celle des détenteurs de Bons de la dette publique, un transfert qui emprunte le chemin des impôts, puis celui des intérêts versés sur la dette. C'est ce que Marx appelle le « capital fictif ».
Les effets stimulateurs de l'endettement public sont aléatoires, mais les dangers qu'il cumule pour l'avenir sont certains ([5] [5]). La « reprise » actuelle coûtera très cher demain au niveau financier.
Pour les prolétaires, cela veut dire qu'à l'intensification de l'exploitation dans les lieux de travail doit s'ajouter l'aggravation du poids de l'extorsion fiscale. L'Etat doit prélever une masse croissante d'impôts pour rembourser le capital et les intérêts de la dette.
Détruire du capital pour en maintenir la rentabilité
Lorsque l'économie capitaliste fonctionne de façon saine, l'augmentation ou le maintien des profits est le résultat de la croissance du nombre de travailleurs exploités, ainsi que de la capacité à en extraire une plus grande masse de plus-value. Lorsqu'elle vit dans une phase de maladie chronique, malgré le renforcement de l'exploitation et de la productivité, l'insuffisance des marchés l'empêche de maintenir ses profits, sa rentabilité sans réduire le nombre d'exploités, sans détruire du capital.
Alors que le capitalisme tire son profit de l'exploitation du travail, celui-ci se trouve dans « l'absurdité » de payer des chômeurs, des ouvriers qui ne travaillent pas, ainsi que des paysans pour qu'ils ne produisent pas et mettent leurs terres en jachère.
Les frais sociaux de « maintien du revenu » atteignent jusqu'à 10% de la production annuelle de certains pays industrialisés. Du point de vue du capital c'est un « péché mortel », une aberration, du gaspillage, de la destruction de capital. C'est avec toute la sincérité d'un capitaliste convaincu que le nouveau porte-parole des républicains à la Chambre des représentants, aux Etats-Unis, Newt Gingrich, est parti en guerre contre toutes « les aides du gouvernement aux pauvres ».
Mais, le point de vue du capital est celui d'un système sénile, qui s'auto-détruit dans des convulsions entraînant le monde dans un désespoir et une barbarie sans fin. Ce qui est une aberration, ce n'est pas que l'Etat bourgeois jette quelques miettes à des hommes qui ne travaillent pas, mais qu'il y ait des hommes qui ne puissent participer au processus productif alors que le cancer de la misère matérielle s'étend chaque jour un peu plus sur la planète.
C'est le capitalisme qui est devenu une aberration historique. L'actuelle « reprise » sans emplois en est encore une confirmation. Le seul « assainissement » possible de l'organisation « économique » de la société c'est la destruction du capitalisme lui-même, l'instauration d'une société où l'objectif de la production n'est plus le profit, la rentabilité du capital, mais la satisfaction pure et simple des besoins humains.
RV, 27 décembre 94
« Il va de soi que l'économie politique ne considère le prolétaire qu'en tant que travailleur : c'est celui qui, n'ayant ni capital ni rente foncière, vit uniquement de son travail, d'un travail abstrait et monotone. Elle peut donc affirmer que, tout comme une bête de somme quelconque, le prolétaire mérite de gagner suffisamment pour pouvoir travailler. Quand il ne travaille pas, elle ne le considère pas comme un être humain ; cette considération, elle l'abandonne à la justice criminelle, aux médecins, à la religion, aux statistiques, à la politique, à la charité publique. »
Marx, Ebauche d'une critique de l'économie politique, Ed. La Pléiade, II
25 ans d'augmentation du chômage
Depuis un quart de siècle, depuis la fin des années 1960, le fléau du chômage n'a cessé de s'étendre et de s'intensifier dans le monde. Ce développement s'est fait de façon plus ou moins régulière, connaissant des accélérations et des reculs plus ou moins violents. Mais la tendance générale à la hausse s'est confirmée récession après récession.
Les données représentées dans ces graphiques sont les chiffres officiels du chômage. Elles sous-estiment fortement la réalité puisqu'elles ne prennent pas en compte les chômeurs en « stage de formation », ni les jeunes participant à des programmes de travail à peine rémunérés, ni les travailleurs « préretraités », ni les travailleurs contraints à se vendre « à temps partiel », de plus en plus nombreux, ni ceux que les experts appellent les « travailleurs découragés », c'est-à-dire les chômeurs qui n'ont plus l'énergie de continuer à chercher du travail.
Ces courbes ne rendent en outre pas compte des aspects qualitatifs de ce chômage. Elles ne montrent pas que, parmi les chômeurs, la proportion de ceux de « longue durée » ne cesse de croître, ou que les allocations de chômage sont de plus en plus maigres, de courte durée et difficiles à obtenir.
Non seulement le nombre de chômeurs a augmenté pendant plus de 25 ans, mais en outre la situation de chômeur est devenue de plus en plus intenable.
Le chômage massif et chronique est devenu partie intégrante de la vie des hommes de la fin du 20e siècle et ce faisant, il a entrepris de détruire le peu de sens que le capitalisme pouvait encore donner à cette vie. On interdit aux jeunes d'entrer dans le monde des adultes, et on devient « vieux » plus vite. Le manque d'avenir historique du capitalisme prend la forme de l'angoisse du désespoir chez les individus.
Le fait que le chômage soit devenu massif et chronique constitue la preuve la plus indiscutable de la faillite historique du capitalisme comme mode d'organisation de la société.
Pourquoi les capitalistes suppriment-ils des emplois ?
Ce n'est pas par plaisir que les capitalistes refusent d'exploiter un plus grand nombre de prolétaires ou de continuer à exploiter les anciens. Leur profit, ils le tirent du travail vivant, digéré par la machine d'exploitation salariale. Le travail des autres est la « poule aux oeufs d'or » du capital. Celui-ci ne tient pas, en soi, à la tuer. Mais le capital n'a qu'une seule religion : le profit. Un capitaliste qui ne fait pas de profit est condamné à disparaître. Le capital n'embauche pas par humanisme mais parce que ça lui rapporte. Et si ses profits sont insuffisants, il licencie, il supprime des postes de travail. Le profit est l'alpha et l'oméga de la bible du capital.
Les graphiques ci-dessous reproduisent, pour les Etats-Unis et le Canada, l'évolution simultanée des profits des entreprises et du nombre de chômeurs depuis 1965. Ils montrent comment les chutes de la masse des profits commencées en 1973-74, puis en 1979 et en 1988, se sont accompagnées d'une hausse du chômage. Lorsque les profits baissent, et parce que les profits baissent, les capitalistes licencient. Le chômage ne diminue que lorsque ces profits augmentent à nouveau. Mais, comme on peut le voir sur les courbes, le nombre de chômeurs ne redescend jamais aux niveaux antérieurs. Les périodes d'embauche ne sont que des répits dans une tendance générale à l'augmentation du chômage.
Le capital ne peut assurer l'existence de son profit qu'en rejetant dans le chômage un nombre toujours plus grand de prolétaires.
[1] [6] Les prévisions officielles de l'OCDE annoncent une diminution des taux de chômage en 1995 et 1996. Mais le niveau de ces baisses est ridicule : elle serait de 0,3 % en Italie (11,3 % de chômage officiel en 1994, 11 % prévu pour 1996) ; de 0,5 % aux Etats-Unis (de 6,1 % en 1994 à 5,6 % en 1996) ; de 0,7 % en Europe Occidentale (de 11,6 % à 10,9 %) ; au Japon aucune diminution n'est prévue.
[2] [7] Libération, 16/12/1994.
[3] [8] Entre 1989 et 1994, la dette publique, mesurée en pourcentage du produit intérieur annuel brut, est passée de 53 à 65 % aux Etats-Unis, de 57 à 73 % en Europe ; ce pourcentage atteint, en 1994, 123 % pour un pays comme l'Italie, 142 % pour la Belgique.
[4] [9] Cette évolution de la classe dominante vers un corps parasite qui vit aux dépens de son Etat est typique des sociétés décadentes. Dans le Bas-empire romain, comme dans le féodalisme décadent ce phénomène fut un des principaux facteurs du développement massif de la corruption.
[5] [10] Voir « Vers une nouvelle tourmente financière », Revue Intarnationale, n° 78.
Récent et en cours:
- Crise économique [11]
Questions théoriques:
- Décadence [12]
La première et la deuxième internationale devant le problème de la guerre - Bilan n°21, juillet-août 1935
- 6212 lectures
Document
C'est à propos de la guerre des Balkans, à la veille de la 1re guerre mondiale que les révolutionnaires, en particulier Rosa Luxemburg et Lénine, affirment au congrès de Bâle en 1912 la position internationaliste caractéristique de la nouvelle phase historique du capitalisme : « Il n'y a plus de guerres défensives ou offensives ». Dans la phase « impérialiste », « décadente » du capitalisme, toutes les guerres entre puissances sont également réactionnaires. Contrairement à ce qui se passait au 19e siècle, lorsque la bourgeoisie pouvait encore mener des guerres contre le féodalisme, les prolétaires n'ont plus de camp à soutenir dans ces guerres. La seule réponse possible à la barbarie guerrière du capitalisme décadent est la lutte pour la destruction du capitalisme lui-même. Ces positions, ultra-minoritaires en 1914, au moment de l'éclatement de la 1re guerre mondiale, allaient cependant constituer la base des plus grands mouvements révolutionnaires de ce siècle : la révolution russe de 1917, la révolution allemande de 1919, qui mirent fin au bain de sang commencé en 1914.
Aujourd'hui que pour la première fois depuis la fin de la 2e guerre mondiale, la guerre sévit en Europe, encore dans les Balkans, il est indispensable de se réapproprier l'expérience de la lutte des révolutionnaires contre la guerre. C'est pourquoi nous publions cet article qui résume de façon remarquable un aspect crucial de l'action des révolutionnaires face à un des pires fléaux du capitalisme.
CCI, décembre 1994
BILAN n°21, juillet-août 1935
La première et la deuxième internationale devant le problème de la guerre - BILAN n°21, juillet-août 1935
Ce serait fausser l'histoire que d'affirmer que la lre et la 2e Internationale n'ont pas songé au problème de la guerre et qu'elles n'ont pas essayé de le résoudre dans l'intérêt de la classe ouvrière. On pourrait même dire que le problème de la guerre fut à l'ordre du jour dès le début de la lre Internationale (guerre de 1859 de la France et du Piémont contre l'Autriche ; de 1864 : la Prusse et l'Autriche contre le Danemark ; de 1866 : la Prusse et l’Italie contre l'Autriche et l'Allemagne du Sud ; 1870 : la France contre l'Allemagne et nous ne mentionnons pas la guerre de Sécession de 1861-65 aux Etats-Unis, l'insurrection de la Bosnie-Herzégovine, en 1878 contre l'annexion autrichienne -qui passionna beaucoup les internationalistes de l'époque- etc., etc.)
Ainsi, si on considère le nombre de guerres qui surgirent pendant cette période, il est permis d'affirmer que le problème fut plus «brûlant» pour la lre Internationale que pour la 2e qui fut surtout l'époque des expéditions coloniales, du partage de l'Afrique, car pour les guerres européennes - exception faite de la courte guerre de 1897 entre la Turquie et la Grèce- il faut attendre les guerres balkaniques, celle entre l’Italie et la Turquie pour la Libye, qui sont déjà des signes avant-coureurs de la conflagration mondiale.
Tout cela explique - et nous écrivons après une expérience vécue - le fait que nous, de la génération qui lutta avant la guerre impérialiste de 1914, avons peut-être considéré le problème de la guerre, plus comme une lutte idéologique que comme un danger réel et imminent ; le dénouement de conflits aigus, sans le recours aux armes, tels Fachoda ou Agadir nous avait influencés dans le sens de croire fallacieusement que grâce à « l'interdépendance » économique, aux liens toujours plus nombreux et plus étroits entre pays, il s'était ainsi constitué une sûre défense contre l'éclosion d'une guerre entre puissances européennes et que l'augmentation des préparatifs militaires des différents impérialistes au lieu de conduire inévitablement à la guerre, vérifiait le principe romain « si vis pacem para bellum » si tu veux la paix prépare la guerre.
A l'époque de la lre Internationale la panacée universelle pour empêcher la guerre était la suppression des armées permanentes et leur remplacement par des milices (type suisse). C'est d'ailleurs ce qu'affirma la 2e Conférence de Lausanne - en 1867 - de l'Internationale envers un mouvement de pacifistes bourgeois qui avaient constitué une Ligue pour la Paix qui tenait des congrès périodiques. L'Internationale décida d'y participer (ce congrès se tint à Genève où Garibaldi fit son intervention pathétiquement théâtrale avec sa célèbre phrase « l'esclave seul a le droit de faire la guerre aux tyrans ») et fit souligner par ses délégués « qu'il ne suffit pas de supprimer les armées permanentes pour en finir avec la guerre, mais qu'une transformation de tout l'ordre social était à cette fin également nécessaire »
Au 3e congrès de l'Internationale -tenu à Bruxelles en 1868 - on vota une motion sur l'attitude des travailleurs dans le cas d'un conflit entre les grandes puissances d'Europe où ils étaient invités à empêcher une guerre de peuple à peuple et où on leur recommandait de cesser tout travail en cas de guerre. Deux ans après, l'Internationale se trouva devant le fait de la guerre franco-allemande qui éclata en juillet 1870.
Le premier manifeste de l'Internationale est assez anodin : «... sur les ruines que vont faire les deux armées ennemies, est-il écrit, il ne restera d'autre puissance réelle que le socialisme. Ce sera alors pour l'Internationale le moment de se demander ce qu'elle doit faire. D'ici là, soyons calmes et veillons. »(!!!)
Le fait que la guerre fut menée par Napoléon « le petit », détermina une orientation plutôt défaitiste parmi les larges couches de la population française dont les internationalistes se firent l'écho dans leur opposition à la guerre.
D'autre part, parce que l'on considère généralement l'Allemagne comme « injustement » attaquée par « Bonaparte », on fournit ainsi une certaine justification - puisqu'il s'agissait d'une guerre « défensive » - à la position de défense du pays des travailleurs allemands.
La chute de l'Empire, après le désastre de Sedan, apporta un bouleversement de ces positions.
« Nous répétons ce que nous déclarions en 1793 à l'Europe coalisée, écrivaient les internationalistes français dans leur manifeste au peuple allemand : le peuple français ne fait pas la paix avec un ennemi qui occupe notre territoire, seulement sur les rives du fleuve contesté (le Rhin) les ouvriers se tendront les mains pour créer les Etats-Unis d'Europe, la République Universelle. »
La fièvre patriotique s'intensifia jusqu'à présider à la naissance même de la glorieuse Commune de Paris.
D'un autre côté pour le prolétariat allemand c'était maintenant une guerre de la monarchie et du militarisme prussiens contre la « république française », le « peuple français ». De là vint le mot d'ordre de « paix honorable et sans annexions » qui en déterminant la protestation de Liebknecht et Bebel contre l'annexion de l'Alsace-Lorraine au Reichstag les fit condamner pour « haute trahison ».
Au sujet de la guerre franco-allemande de 1870, et de l'attitude du mouvement ouvrier, il reste encore à élucider un autre point.
En réalité à cette époque Marx envisageait la possibilité de « guerres progressives » - la guerre contre la Russie du tsar avant tout - dans une époque où le cycle des révolutions bourgeoises n'était pas encore clos, de même qu'il envisageait la possibilité d'un croisement du mouvement révolutionnaire bourgeois avec la lutte révolutionnaire du prolétariat avec l'intervention de ce dernier, fut-ce au cours d'une guerre, pour hâter son triomphe final.
« La guerre de 1870, écrivit Lénine dans sa brochure sur Zimmerwald, fut une "guerre progressive" comme celles de la révolution française qui tout en portant en elles, incontestablement, des éléments de pillage et de conquêtes eurent la fonction historique de détruire ou d'ébranler le féodalisme et l'absolutisme de la vieille Europe dont les fondements reposaient encore sur le servage. »
Mais si une telle perspective était admissible pour l'époque où vécut Marx, bien que déjà elle s'avéra dépassée par les événements, bavarder sur la guerre « progressive » ou « nationale » ou «juste », c'est plus qu'une tromperie, c'est une trahison dans la dernière étape du capitalisme, dans sa phase impérialiste. En effet, comme l'écrivit Lénine, l'union avec la bourgeoisie nationale de son propre pays c'est l'union contre l'union du prolétariat révolutionnaire international, c'est en un mot l'union avec la bourgeoisie contre le prolétariat, la trahison de la révolution, du socialisme.
D'autre part, on ne doit pas oublier d'autres problèmes qui en 1870 influencèrent le jugement de Marx et qu'il mit d'ailleurs en évidence dans une lettre à Engels, le 20 juillet 1870. La concentration du pouvoir de l'Etat, suite à la victoire de la Prusse, ne pouvait qu'être utile à la concentration de la classe ouvrière allemande, favorable à ses luttes de classe et aussi, écrivit Marx « la prépondérance allemande transportera le centre de gravité du mouvement ouvrier européen de France en Allemagne et en conséquence déterminera le triomphe définitif du socialisme scientifique sur le proudhonisme et le socialisme utopique. » ([1] [13])
Pour en terminer avec la lre Internationale, nous marquerons encore que, chose étrange, la Conférence de Londres de 1871 de cette dernière ne traita pas de ces problèmes pourtant d'actualité pas plus d'ailleurs que le Congrès de La Haye en septembre 1872, où une relation fut donnée par Marx en langue allemande sur les événements s'étant déroulés depuis 1869 -date du dernier Congrès de l'Internationale. On traita, en réalité, très superficiellement des événements de l'époque pour se limiter à exprimer : l'admiration du Congrès pour les héroïques champions tombés victimes de leur dévouement et ses salutations fraternelles aux victimes de la réaction bourgeoise.
Le premier Congrès de l'Internationale reconstituée à Paris en 1889 reprit l'ancien mot d'ordre de la « substitution des milices populaires aux armées permanentes » et le congrès suivant, tenu à Bruxelles en 1891, adopta une résolution appelant tous les travailleurs à protester par une agitation incessante, contre toutes les tentatives de guerre en y ajoutant comme une sorte de consolation, que la responsabilité des guerres retomberait en tout cas, sur les classes dirigeantes...
Le Congrès de Londres de 1896 - où eut lieu la séparation définitive avec les anarchistes - dans une résolution programmatique sur la guerre affirma génériquement que « la classe ouvrière de tous les pays doit s'opposer à la violence provoquée par les guerres ».
En 1900, à Paris, en conséquence de l'accroissement de la force politique des partis socialistes, fut élaboré le principe - qui devint l'axiome de toute agitation contre la guerre : « les députés socialistes de tous les pays sont tenus à voter contre toutes les dépenses militaires, navales et contre les expéditions coloniales ».
Mais c'est à Stuttgart (1907) qu'eurent lieu les plus amples débats sur le problème de la guerre.
A côté des fanfaronnades de l'histrion Hervé sur le devoir de « répondre à la guerre par la grève générale et l'insurrection » fut présentée la motion de Bebel d'accord substantiellement avec Guesde, laquelle bien que juste dans ses prévisions théoriques était insuffisante par rapport au rôle et aux tâches du prolétariat.
Ce fut à ce Congrès que pour « empêcher de lire les déductions orthodoxes de Bebel à travers les lunettes opportunistes » (Lénine), Rosa Luxemburg - en accord avec les bolcheviks russes - fit ajouter des amendements qui soulignaient que le problème consistait non seulement à lutter contre l'éventualité de la guerre ou de la faire cesser le plus rapidement possible, mais aussi et surtout à utiliser la crise causée par la guerre pour accélérer la chute de la bourgeoisie ; « à tirer de toute façon parti de la crise économique et politique pour soulever le peuple et précipiter, par là même, la chute de la domination capitaliste ».
En 1910, à Copenhague, on confirma la résolution précédente surtout pour ce qui regarde le strict devoir des élus socialistes de refuser tous les crédits de guerre.
Finalement, comme on le sait, pendant la guerre des Balkans et devant le danger imminent d'une conflagration mondiale surgissant de cette poudrière de l'Europe - aujourd'hui les poudrières se sont multipliées à l'infini - un congrès spécial tenu à Bâle en novembre 1912 rédigea le célèbre manifeste qui en reprenant toutes les affirmations de Stuttgart et de Copenhague, flétrissait la future guerre européenne comme « criminelle » et comme « réactionnaire » pour tous les gouvernements et ne pouvant qu' « accélérer la chute du capitalisme en provoquant immanquablement la révolution prolétarienne ».
Mais le manifeste tout en affirmant que la guerre qui menaçait était une guerre de rapines, une guerre impérialiste pour tous les belligérants et qu'elle devait conduire à la révolution prolétarienne, s'efforçait avant tout à démontrer que cette guerre imminente ne pouvait être justifiée par l'ombre d'un intérêt de défense nationale. Cela signifiait implicitement que l'on admettait qu'en régime capitaliste et en pleine expansion impérialiste pouvaient exister des cas de participation justifiée à une guerre de « défense nationale » de la classe exploitée.
Deux ans après éclatait la guerre impérialiste et avec elle l'effondrement de la 2e Internationale. Cette débâcle était la conséquence directe des équivoques et des contradictions insurmontables contenues dans toutes les résolutions. Plus particulièrement l'interdiction de voter les crédits de guerre ne résolvait pas le problème de la « défense du pays » devant l'attaque d'un pays « agresseur ». C'est par cette brèche que se rua toute la meute des chauvins et des opportunistes. « L'Union sacrée » était scellée sur l'effondrement de l'entente de classe internationale des travailleurs.
Comme nous l'avons vu pour la seconde Internationale, si on regarde superficiellement le langage de ses résolutions, elle aurait adopté envers la guerre non seulement une position de principe de classe, mais aussi aurait donné des moyens pratiques en arrivant jusqu'à la formulation, plus ou moins explicite de la transformation de la guerre impérialiste en révolution prolétarienne. Mais si l'on va au fond des choses, on constate que la seconde Internationale dans son ensemble, tout en posant le problème de la guerre, l'a résolu d'une façon formaliste et simpliste. Elle dénonça la guerre avant tout pour ses horreurs et atrocités, parce que le prolétariat devait fournir la chair à canon aux classes dominantes. L'antimilitarisme de la seconde Internationale eut une forme purement négative et fut laissé presque exclusivement à la jeunesse socialiste et dans certains pays avec l'hostilité manifeste du parti lui-même.
Aucun parti, excepté les bolcheviks pendant la révolution russe de 1904-05, n'a pratiqué ou même envisagé la possibilité d'un travail illégal systématique dans l'armée. On s'est borné à des manifestes ou à des journaux contre la guerre et contre l'armée au service du capital, que l'on collait sur les murs ou que l'on distribuait à la rentrée des classes, en invitant les ouvriers à se rappeler que malgré l'uniforme de soldat ils devaient rester des prolétaires. Devant l'insuffisance et la stérilité de ce travail Hervé eut beau jeu, surtout dans les pays latins, avec sa démagogie verbale du « drapeau dans le fumier » et en propageant la désertion, le rejet des armes et le fameux « tirez sur vos officiers ».
En Italie - où seul exemple dans la 2e Internationale le parti socialiste devait en octobre
1912 protester par une grève générale de 24 heures contre une expédition coloniale, celle de la Tripolitaine - un jeune ouvrier, Masetti, sut être conséquent avec les suggestions de Hervé et soldat à Boulogne tira sur son colonel pendant les exercices militaires. C'est l'unique fait positif de toute la comédie hervéiste.
Moins d'un mois après, le 4 août, momentanément ignoré des masses ouvrières englouties dans le carnage, le manifeste du Comité central bolchevik relevait le drapeau de la continuité de la lutte ouvrière avec ses affirmations historiques : la transformation de la guerre impérialiste actuelle en guerre civile.
La révolution d'Octobre était en marche.
Gatto Mammone
[1] [14] Si l'on tient compte de tous ces éléments qui eurent une influence décisive surtout dans la première phase de la guerre franco-allemande, sur le jugement et la pensée de Marx-Engels, on peut expliquer certaines expressions hâtives et très peu heureuses de ces derniers telles : « Les Français ont besoin d'être rossés », « C'est nous qui avons gagné les premières batailles », « Ma confiance dans la force militaire prussienne croît chaque jour » et enfin le fameux « Bismarck comme en 1866 travaille pour nous ».
Toutes ces expressions extraites d'une correspondance strictement intime de Marx et Engels fournirent aux chauvins de 1914 -entre autre au vieux James Guillaume qui ne pouvait oublier son exclusion de l'Internationale avec Bakounine en 1872 - l'occasion de transformer les fondateurs du socialisme scientifique en précurseurs du pangermanisme et de l’hégémonie allemande...
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [17]
Questions théoriques:
- Guerre [18]
- Impérialisme [19]
Enseignements de 1917-23 : La première vague révolutionnaire du prolétariat mondial
- 7230 lectures
Il y a de cela 80 ans, la Première Guerre mondiale inaugurait la période de décadence du capitalisme mondial, « l’ère des guerres et des révolutions » comme l'avait définie l'Internationale communiste. Si la guerre impérialiste mettait en lumière la réalité et l'avenir qu'offrait le capitalisme décadent à l'humanité, la vague révolutionnaire qui s'ensuivit et qui mit un terme à la boucherie impérialiste, secouant l'ordre bourgeois de fond en comble, d'Afrique du Sud jusqu'en Allemagne, de Russie jusqu'au Canada, montra quelle était la seule alternative à cette barbarie capitaliste : la révolution prolétarienne mondiale.
Cette vague révolutionnaire dont le point culminant fut la Révolution russe (voir Revue internationale n° 72, 73 et 75) constitue une véritable mine d'enseignements pour le mouvement ouvrier. Véritable vitrine à l'échelle mondiale de la lutte de classe dans la période de décadence capitaliste, la vague révolutionnaire de 1917-23 confirma pleinement et définitivement la plupart des positions politiques que défendent aujourd'hui les révolutionnaires (contre les syndicats et les partis « socialistes », contre les luttes de « libération nationale », la nécessité de l'organisation générale de la classe ouvrière en conseils ouvriers, etc.). Cet article se concentre sur quatre questions :
-comment la vague révolutionnaire transforma la guerre impérialiste en guerre civile entre les classes ;
- comment elle démontra la thèse historique des communistes quant à la nature mondiale de la révolution prolétarienne ;
-comment la guerre, tout en étant le facteur à l'origine de cette vague révolutionnaire, ne pose cependant pas les conditions les plus favorables pour la révolution prolétarienne ;
- l'importance déterminante de la lutte du prolétariat dans les pays les plus industrialisés du capitalisme.
La vague révolutionnaire met un terme à la Première Guerre mondiale
Dans la Revue internationale n° 78 («Polémique
avec Programme communiste », IIe partie), nous démontrons que la
déclaration de guerre en 1914 n'obéit pas directement à des causes
économiques, mais qu'elle survient parce que la bourgeoisie est parvenue, grâce
au réformisme dominant dans les partis sociaux-démocrates, à défaire
idéologiquement la classe ouvrière. Dans le même sens, la fin de la guerre
n'est pas le fruit d'une décision de la bourgeoisie mondiale qui, pour ainsi
dire, aurait «fait un bilan » et conclu que l'hécatombe était «
suffisante », qu'il fallait faire évoluer les «affaires », passant
de la destruction à la reconstruction. En novembre 1918, on ne relève pas la
moindre défaite significative des puissances centrales ([1] [20]). Ce
qui met vraiment le Kaiser dans l'obligation de demander l'armistice, c'est
le besoin urgent de faire face à la révolution qui s'étendait en Allemagne. Et
si, pour leur part, les forces de l'Entente ne profitent pas alors de cette faiblesse
de leur ennemi impérialiste, c'est parce qu'elles sont conscientes de la nécessité
de resserrer les rangs contre l'ennemi commun, contre le danger représentant,
pour tout le capitalisme, l'extension de la révolution prolétarienne qui mûrit
jusque dans les propres pays composant l'Entente, même si à un niveau plus
embryonnaire.
Comment s'est développée cette réponse du prolétariat à la guerre ?
Avec l'accroissement de la barbarie de la boucherie mondiale, le prolétariat se défaisait progressivement du poids de la défaite d'août 1914([2] [21]). Dès février 1915, les ouvriers de la vallée de la Clyde (Grande-Bretagne) lancent une grève sauvage (c'est-à-dire contre l'avis du syndicat), et cet exemple sera repris par les ouvriers des usines d'armement et les métallos de Liverpool. Des grèves éclatent en France, celles des travailleurs du textile de Vienne et de Lagors. En 1916, les ouvriers de Petrograd empêchent par la grève générale une tentative par le gouvernement de militarisation des travailleurs. En Allemagne, la Ligue Spartakus appelle à une manifestation d'ouvriers et de soldats, qui joint rapidement le mot d'ordre « A bas le gouvernement ! » à celui de « A bas la guerre ! ». C'est dans ce climat d'accumulation de signes de mécontentement que parviennent les premières nouvelles de la Révolution de février en Russie...
Une vague de grèves se répand en avril 1917 en Allemagne (Halle, Kiel, Berlin...). L'insurrection est évitée de justesse à Leipzig et les premiers conseils ouvriers se constituent tout comme en Russie. Sur le front oriental, le Premier mai, les drapeaux rouges flottent sur les tranchées russes et allemandes. Un tract circule parmi les soldats allemands : « Nos frères héroïques de Russie ont mis à terre dans leur pays le joug maudit des bouchers (...) Votre bonheur, votre progrès, dépendent de votre capacité à poursuivre et mener plus loin l'exemple de vos frères russes... Une révolution victorieuse demande moins de sacrifices qu'une guerre sauvage... »
En France, ce même Premier mai, dans un climat de grèves ouvrières (celle des métallos de Paris s'étend à 100 000 travailleurs d'autres secteurs), un meeting de solidarité avec les ouvriers russes proclame : « La révolution russe est le signal de la révolution universelle ». Sur le front, des conseils clandestins de soldats font circuler de la propagande révolutionnaire et collectent de l'argent pris sur la solde misérable pour soutenir les grèves à l'arrière.
De grandes manifestations contre la guerre se déroulent aussi en Italie. L'une d'elles, à Turin, voit surgir le mot d'ordre «Faisons comme en Russie » qui est repris rapidement dans tout le pays. Et effectivement, quand les regards de tous les ouvriers et soldats du monde entier se tourneront vers Petrograd en octobre 1917, ce mot d'ordre deviendra un puissant stimulant à des mobilisations destinées à en finir une fois pour toutes avec la boucherie impérialiste.
Ainsi, les ouvriers en Finlande, qui avaient déjà tenté une première insurrection quelques jours après Petrograd, prennent les armes en janvier 1918 et occupent les édifices publics à Helsinki et dans le sud du pays. Dans le même temps, une rébellion dans la flotte de la Mer noire oblige la Roumanie, où la Révolution russe avait un écho immédiat, à signer l'armistice avec les puissances centrales. En Russie même, la Révolution met un terme à l'implication du pays dans la guerre impérialiste, la révolution se trouvant à la merci - dans l'attente de son extension sur le plan international - de la rapine des puissances centrales sur de vastes territoires russes, lors de la paix dite « de Brest-Litovsk ».
En janvier 1918, les travailleurs de Vienne connaissent les conditions « de paix » draconiennes que leur gouvernement veut imposer à la Russie révolutionnaire. Face à la menace d'intensification de la guerre, les ouvriers de Daimler provoquent une grève qui en quelques jours va s'étendre et toucher 700 000 travailleurs dans tout l'Empire, au cours de laquelle s'organisent les premiers conseils ouvriers. A Budapest, le mot d'ordre de ralliement de la grève est : « A bas la guerre ! Vivent les ouvriers russes ! ». Il faut les appels au calme incessants des « socialistes » pour parvenir, non sans mal, à apaiser cette vague de luttes et écraser les révoltes de la flotte basée à Carthage ([3] [22]). Fin janvier, on compte 1 million de grévistes en Allemagne. Malheureusement, les ouvriers laissent la direction de leur lutte entre les mains des « socialistes » qui s'allient avec les syndicats et l’Etat-major militaire pour y mettre fin et envoyer au front plus de 30 000 travailleurs qui s'étaient illustrés dans le combat prolétarien. C'est dans cette même période que surgissent les premiers conseils ouvriers en Pologne, dans les mines de Dombrowa et Lublin...
Le mouvement de solidarité avec la Révolution russe se développe aussi en Angleterre. La visite du délégué soviétique Litvinov, en janvier 1918, coïncide avec une grande vague de grèves et provoque de telles manifestations à Londres qu'un journal bourgeois, The Herald, les qualifie « d'ultimatum pour la paix des ouvriers au gouvernement ». En mai 1918 éclate en France la grève de Renault, qui s'étend rapidement à 250 000 travailleurs de Paris. En solidarité, les travailleurs de la région de la Loire se remettent en grève, contrôlant la région pendant dix jours.
Les dernières offensives militaires provoquent cependant une paralysie momentanée des luttes, mais leur échec convainc les ouvriers que la lutte de classe est le seul moyen de mettre un terme à la guerre. En octobre, en Autriche, éclatent les luttes des journaliers et la révolte contre l'envoi au front des régiments les plus « rouges » de Budapest, ainsi que des grèves et des manifestations massives. Le 4 novembre, la bourgeoisie de la « double couronne » se désengage enfin de la guerre.
En Allemagne, le Kaiser tente une « démocratisation » du régime (libération de Liebknecht, participation des « socialistes » au gouvernement) pour exiger du peuple allemand « qu'il verse jusqu'à la dernière goutte de son sang ». Mais les marins de Kiel refusent, le 3 novembre, d'obéir aux officiers qui veulent tenter une ultime bataille suicide de la flotte ; ils hissent le drapeau rouge sur l'ensemble de la flotte et organisent un conseil ouvrier avec les ouvriers de la ville. L'insurrection s'étend en quelques jours aux principales villes d'Allemagne ([4] [23]). Le 9 novembre, quand l'insurrection gagne Berlin, la bourgeoisie allemande ne commet pas l'erreur du Gouvernement provisoire russe (qui avait maintenu sa participation dans la guerre, ce qui avait été un facteur de fermentation et de radicalisation de la révolution) et sollicite l'armistice. Le 11 novembre, la bourgeoisie met fin à la guerre impérialiste pour s'affronter à la classe ouvrière.
Le caractère international de la classe ouvrière et de sa révolution
Alors que les révolutions bourgeoises se limitaient à implanter le capitalisme dans le cadre de la nation, la révolution prolétarienne est nécessairement mondiale. Si les révolutions bourgeoises pouvaient s'échelonner sur plus d'un siècle, la lutte révolutionnaire du prolétariat, de par sa propre nature, tend à prendre la forme d'une gigantesque vague qui parcours la planète. Telle est depuis toujours la thèse historique des révolutionnaires. Dans ses Principes du communisme, Engels soulignait déjà :
« Cette révolution pourra-t-elle se produire en un seul pays ?
Réponse : non. La grande industrie, en créant le marché mondial, a déjà établi entre tous les peuples de la terre, principalement entre les peuples civilisés, des relations telles que chaque peuple ressent le contrecoup de ce qui se passe chez les autres. Elle a par ailleurs amené tous les pays civilisés à un même stade d'évolution sociale : dans tous ces pays la bourgeoisie et le prolétariat sont devenus les deux classes les plus importantes de la société et la lutte entre ces deux classes est devenue la lutte capitale de notre époque. La révolution communiste ne sera donc pas une révolution nationale uniquement, elle se fera simultanément dans tous les pays civilisés c'est-à-dire au moins en Angleterre, en Amérique, en France et en Allemagne. (...) Ce sera une révolution universelle, dont le terrain sera lui aussi universel. »
La vague révolutionnaire de 1917-23 a confirmé cela de façon éclatante. En 1919, le premier ministre britannique Lloyd George écrit : « L'Europe entière est envahie par l'esprit de la révolution. Il existe un sentiment profond parmi les ouvriers contre les conditions existantes, non de mécontentement mais de colère et de révolte (...). L'ensemble de l'ordre politique, social et économique est remis en question par les masses de la population, d'un bout à l'autre d'Europe » (cité par E.H. Carr, La Révolution bolchevique).
Mais le prolétariat ne parvient pas à transformer cette formidable vague de luttes en combat unifié. Nous verrons d'abord les faits pour mieux pouvoir par la suite analyser les obstacles sur lesquels a trébuché le prolétariat dans la généralisation de la révolution.
De novembre 1918 à août 1919 : les tentatives insurrectionnelles dans les pays vaincus...
Quand la révolution démarre en Allemagne, trois importants détachements du prolétariat d'Europe sont déjà pratiquement neutralisés (Hollande, Suisse et Autriche). En octobre 1918 éclatent des mutineries dans l'armée en Hollande (le propre commandement militaire coule sa flotte plutôt que de laisser les marins s'en emparer) et des conseils ouvriers se forment à Rotterdam et Amsterdam. Les « socialistes » prennent part à la révolte pour mieux pouvoir la neutraliser. Leur leader, Troëlstra, le reconnaît plus tard : « Si je n'étais pas intervenu révolutionnairement, les éléments ouvriers les plus énergiques auraient pris le chemin du bolchevisme » (P.-J. Troëlstra, De Revolutie en de SDAP). Désorganisée par ses propres « organisateurs », privée de l'appui des soldats, la lutte prend fin avec le mitraillage des ouvriers qui, le 13 novembre, s'étaient réunis dans un meeting près d'Amsterdam. La « Semaine rouge » se conclut par 5 morts et des dizaines de blessés.
Ce même jour, en Suisse, une grève générale de 400 000 ouvriers a lieu pour protester contre l'usage de la troupe contre les manifestations de commémoration du premier anniversaire de la Révolution russe. Le journal Volksrecht proclame : « Résister jusqu'au bout. Sont en notre faveur la révolution en Autriche et en Allemagne, les actions des ouvriers en France, le mouvement des prolétaires de Hollande et, principalement, le triomphe de la révolution en Russie ».
Là aussi, les « socialistes » et les syndicats donnent la consigne de cesser la lutte « pour ne pas jeter les masses désarmées sous les balles de l'ennemi », alors que c'est précisément ce pas en arrière qui va désorienter les masses et les diviser, ouvrant alors les vannes de la terrible répression qui mettra fin à la « Grande grève ». De son côté, le gouvernement de la « paisible » Suisse militarise les cheminots, organise une garde contre-révolutionnaire, rase sans scrupule les locaux des ouvriers, en emprisonne des centaines et instaure la peine de mort contre les « subversifs ».
La République est proclamée en Autriche le 12 novembre. Au moment de hisser le drapeau national rouge et blanc, des groupes de manifestants arrachent la frange blanche.
Hissés sur les épaules de la statue de Pallas Athénée, dans le centre de Vienne, les divers orateurs appellent l'assemblée composée de dizaines de milliers de travailleurs à passer directement à la dictature du prolétariat. Mais les « socialistes », appelés en renfort parce qu'ils sont les seuls à avoir une influence sur les masses ouvrières, déclarent : « Le prolétariat détient déjà le pouvoir. Le parti ouvrier gouverne la république » et entreprennent systématiquement d'affaiblir les conseils ouvriers, les transformant en conseils de production, comme ils transforment les comités de soldats en comités de régiments (massivement infiltrés par les officiers). Cette contre-offensive de la bourgeoisie va paralyser le prolétariat en Autriche, et servir de modèle de la contre-révolution pour la bourgeoisie allemande.
En Allemagne, l'armistice et la proclamation de la République vont provoquer un sentiment naïf de « victoire » que paiera très cher le prolétariat. Alors que les travailleurs ne parviennent pas à unifier les différents foyers de lutte et hésitent à se lancer dans la destruction de l'appareil d'Etat bourgeois ([5] [24]), la contre-révolution s'organise et coordonne les syndicats, les partis « socialistes » et le haut-commandement militaire. A partir de décembre, la bourgeoisie passe à l'offensive par de constantes provocations au prolétariat de Berlin, dans le but de le faire partir en lutte et de l'isoler du reste du prolétariat allemand. Le 4 janvier 1919, le gouvernement destitue le préfet de police Eischorn, défiant l'opinion des travailleurs. Le 6 janvier, un demi million de prolétaires berlinois sort dans la rue. Le lendemain même, à la tête des corps-francs (officiers et sous-officiers démobilisés payés par le gouvernement), le « socialiste » Noske écrase les ouvriers de Berlin. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont assassinés quelques jours plus tard.
Bien que les événements de Berlin alertent les ouvriers d'autres villes (en particulier à Brème où les locaux syndicaux sont pris d'assaut et le contenu de leurs caisses distribué entre les chômeurs), le gouvernement parvient malgré tout à diviser cette riposte, de façon à concentrer ses forces dans un premier temps sur Brème, ensuite sur les ouvriers de Rhénanie et de la Ruhr, pour finir par revenir éteindre les dernières braises à Berlin, au cours de la tristement célèbre « Semaine sanglante » au cours de laquelle sont assassinés 1 200 ouvriers en mars. Ensuite seront écrasés les ouvriers de Mansfeld, de Leipzig et la République des Conseils de Magdebourg...
En avril 1919, les travailleurs proclament à Munich la République des Conseils de Bavière, qui constitue avec la Révolution hongroise et l'Octobre russe les seules expériences de prise de pouvoir par le prolétariat. Les ouvriers bavarois en armes sont même capables de défaire la première armée contre-révolutionnaire envoyée contre eux par le Président destitué Hoffmann. Mais hélas, comme nous l'avons vu, le reste du prolétariat allemand a déjà subi de sévères défaites et ne peut apporter son soutien à ses frères, cependant que la bourgeoisie lève une armée qui écrasera l'insurrection au cours des premiers jours de mai. Parmi les troupes qui sèment la terreur à Munich s'illustrent alors des noms tels que Himmler, Rudolf Hess, Von Epp..., futurs dignitaires du nazisme encouragés dans leur furie anti-prolétarienne par un gouvernement qui se proclame « socialiste ».
Le 21 mars 1919, à la suite d'une formidable vague de grèves et de meetings, les conseils ouvriers prennent le pouvoir en Hongrie. Par une erreur tragique, les communistes s'unifient dans ce même temps avec les « socialistes » qui vont s'employer à saboter la révolution, alors même que les «démocraties » occidentales (et en particulier la France et l'Angleterre) imposent un blocus économique auquel s'ajoute une intervention militaire des armées roumaine et tchèque. En mai, alors que sont vaincus les conseils ouvriers de Bavière, la situation de la révolution hongroise est désespérée. Une formidable réaction ouvrière parvient toutefois à rompre l'encerclement militaire, réaction à laquelle participent aussi bien des travailleurs hongrois, autrichiens, polonais et russes, que des tchèques ou des roumains. A la longue, cependant, le sabotage des « socialistes » et l'isolement de la révolution vont avoir raison de la résistance prolétarienne et les troupes roumaines prennent Budapest le 1er août, instaurant un gouvernement syndical qui liquidera les conseils ouvriers. Mission accomplie, les syndicats confient le pouvoir à l'amiral Horty (lui aussi futur collaborateur des nazis) qui déchaînera alors une terreur sanglante contre les ouvriers (8 000 exécutions, 100 000 déportations...). La chaleur de la révolution hongroise pousse les mineurs de Dombrowa (Pologne) à prendre le pouvoir dans la région et ils forment une Garde ouvrière pour se défendre de la sanglante répression d'un autre « socialiste », Pilsudski. La République rouge de Dombrowa s'éteint avec les conseils ouvriers hongrois.
La révolution hongroise provoque les dernières réactions ouvrières en Autriche et en Suisse, en juin 1919. La police de Vienne, forte des leçons apprises de ses acolytes allemands, machine une provocation (l'assaut du local du PC) pour précipiter l'insurrection alors que le prolétariat est encore faible et désorganisé. Les ouvriers tombent dans ce piège et laissent dans les rues de Vienne plus de 30 morts. Il advient la même chose en Suisse, après la grève générale des ouvriers de Zurich et Bâle.
...et dans les pays « vainqueurs »
A nouveau dans la région de La Clyde en Grande-Bretagne, plus de 100 000 ouvriers sont en grève dès janvier 1919. Le 31 janvier (le « Vendredi rouge »), au cours d'une concentration ouvrière à Glasgow, les prolétaires s'affrontent durement aux régiments appuyés par l'artillerie que le gouvernement à dépêchés sur place. Les mineurs sont prêts à entrer en lutte, mais les syndicats parviennent à stopper ce mouvement pour « donner une marge de confiance au gouvernement afin que celui-ci étudie la nationalisation (!) des mines » (Hinton et Hyman, Trade Unions and Révolution).
A Seattle, aux Etats-Unis, éclate une grève dans les chantiers navals qui s'étend à toute la ville en quelques jours. Grâce à des assemblées massives et un comité de grève élu et révocable, les ouvriers contrôlent le ravitaillement et la défense contre les troupes envoyées par le gouvernement. La « Commune de Seattle » restera cependant isolée et, un mois plus tard, au prix de centaines d'emprisonnements, les travailleurs des chantiers navals reprendront le travail. Plus tard éclateront d'autres luttes comme celle des mineurs de Buttle (Montana), qui va jusqu'à s'organiser en conseil d'ouvriers et de soldats, et la grève de 400 000 ouvriers de la sidérurgie. Mais, là non plus, les luttes ne parviennent pas à s'unifier.
Au Canada, pendant la grève générale de Winnipeg, en mai 1919, le gouvernement local organise un meeting patriotique pour tenter de contrecarrer la pression ouvrière avec le chauvinisme de la victoire. Mais les soldats, après avoir décrit les horreurs de la guerre, proclament la nécessité de « transformer la guerre impérialiste en guerre de classes », et cette radicalisation pousse le mouvement jusqu'à s'étendre aux travailleurs de Toronto. Les travailleurs laissent une fois de plus la direction de la lutte entre les mains des syndicats, ce qui les conduit immanquablement à l'isolement et à la défaite, puis à subir la terreur du « lumpen » de la ville dont le gouvernement a nommé certains éléments « commissaires extraordinaires ».
Mais la vague révolutionnaire ne reste pas cantonnée aux pays directement concernés par la boucherie impérialiste. En Espagne éclate en 1919 une grève à La Canadien se qui s'étend rapidement à tout le cordon industriel de Barcelone. Sur les murs des haciendas andalouses, les journaliers à moitié analphabètes écrivent « Vivent les soviets ! » et « Vive Lénine ! ». Les mobilisations des journaliers durant les années 1918-19 resteront dans l'histoire sous le nom des « deux années bolcheviques ».
Mais des épisodes de cette vague se déroulent également loin des grandes concentrations ouvrières d'Europe et d'Amérique du Nord. En Argentine, en 1919, durant la « Semaine sanglante » de Buenos Aires, les ouvriers répliquent par la grève générale à la répression déchaînée par le gouvernement contre les ouvriers de l'usine « Talleres Vasena ». Après cinq jours de combats de rue, l'artillerie bombarde les quartiers ouvriers causant 3 000 morts. Au Brésil, la grève de 200 000 travailleurs à Sao Paolo fraternise avec les régiments envoyés par le gouvernement pour les réprimer. Dans les favelas de Rio de Janeiro, une «République ouvrière » est proclamée en 1918, qui reste isolée et cède sous la pression de l'état de siège décrété par le gouvernement.
En Afrique du Sud, pays de la « haine raciale », les luttes ouvrières mettent en évidence la nécessité et la possibilité de lutter unis : « La classe ouvrière d'Afrique du Sud ne pourra s'émanciper tant qu'elle n'aura pas dépassé les préjugés racistes et l'hostilité envers les travailleurs d'une autre couleur » (The International, journal des Ouvriers industriels d'Afrique). En mars 1919, la grève des tramways s'étend à tout Johannesburg, avec assemblées et meetings de solidarité avec la Révolution russe. Et au Japon, en 1918, se déroulèrent les fameux « meetings du riz » contre l'expédition de riz aux troupes japonaises envoyées contre la révolution en Russie.
1919-1921 : le redressement tardif du prolétariat des pays « vainqueurs » et le poids de la défaite en Allemagne
Le prolétariat jouait très gros durant cette première phase de la vague révolutionnaire. D'abord, il fallait que le bastion révolutionnaire russe sorte de l'asphyxie de l'isolement ([6] [25]). Mais se jouait aussi le cours même de la révolution, puisque des détachements du prolétariat (Allemagne, Autriche, Hongrie...) s'étaient engagés dans le combat, ce qui était déterminant pour le futur de la révolution mondiale du fait de leur force et de leur expérience. Mais la première phase de la vague révolutionnaire va se solder, nous l'avons vu, par de profondes défaites que le prolétariat ne parviendra pas à surmonter.
Les travailleurs d'Allemagne appuient en 1920 la grève générale convoquée par les syndicats contre le « putsch de Kapp », pour rétablir le soi-disant gouvernement démocratique de Scheidemann. Les travailleurs de la Ruhr refusent cependant de remettre au pouvoir celui qui a déjà assassiné 30 000 ouvriers, prennent les armes et forment « l'Armée rouge de la Ruhr ». Dans certaines villes (Duisbourg), ils vont jusqu'à emprisonner les leaders socialistes et les syndicalistes. Mais la lutte reste à nouveau isolée. Début avril, l'armée allemande réorganisée écrase la révolte de la Ruhr.
En 1921, la bourgeoisie allemande va se consacrer à « nettoyer » les révolutionnaires irréductibles en Allemagne centrale, utilisant toujours de nouvelles provocations (l'assaut des usines Leuna à Mansfeld). Les communistes du KAPD, en pleine désorientation, tombent dans le piège et appellent à « l'action de mars », au cours de laquelle les ouvriers de Mansfeld, Halle, etc., ne parviennent pas à vaincre la bourgeoisie malgré des combats héroïques. Celle-ci profitera de la dispersion du mouvement pour d'abord massacrer les ouvriers en Allemagne centrale, ensuite les ouvriers qui à Hambourg, Berlin et dans la Ruhr s'étaient solidarisés avec le mouvement.
Pour la lutte de la classe ouvrière, internationale par nature, ce qui advient dans une partie du monde a des répercussions dans les autres. C'est ce qui explique que quand le prolétariat des pays vainqueurs de la guerre (Angleterre, France, Italie...) entre massivement en lutte, une fois passée l'euphorie chauvine de la « victoire », les répercussions des défaites successives du prolétariat en Allemagne le rendront plus vulnérable aux pires mystifications : nationalisations, « contrôle ouvrier » de la production, confiance aux syndicats, manque de confiance en ses propres forces...
Une grève générale des cheminots, extrêmement dure, éclate en Angleterre en septembre 1919. Malgré les manoeuvres d'intimidation de la bourgeoisie (navires de guerre à l'embouchure de la Tamise, patrouilles de soldats dans les rues de Londres), les ouvriers ne cèdent pas. Bien au contraire, les ouvriers des transports veulent à leur tour partir en grève, mais les syndicats les en empêchent. Il adviendra la même chose plus tard, quand les mineurs appelleront à la solidarité des cheminots. Le bonze syndical de service proclamera : « A quoi bon l'aventure d'une grève générale, puisque nous avons à notre disposition un moyen plus simple, moins coûteux et certainement moins dangereux. Nous devons montrer à tous les travailleurs que le meilleur moyen est d'utiliser intelligemment le pouvoir que nous offre la Constitution la plus démocratique du monde, qui leur permet d'obtenir tout ce qu'ils désirent » ([7] [26]).
Comme les travailleurs peuvent le constater immédiatement, la « bourgeoisie la plus démocratique du monde » n'hésite pas à engager des tueurs, des briseurs de grève, des provocateurs, et la vague de licenciements qui s'ensuit touche un million d'ouvriers.
Malgré tout, les ouvriers continuent à faire confiance aux syndicats. Ils le paieront très cher: en avril 1921, les mineurs décident une grève générale, mais le syndicat fait machine arrière en laissant les ouvriers isolés et désorientés (le 15 avril reste le « Vendredi noir » dans la mémoire ouvrière), à la merci des attaques gouvernementales. Une fois qu'elle aura défait les principaux bastions ouvriers, cette bourgeoisie qui « permet aux ouvriers d'obtenir tout ce qu'ils désirent » réduira les salaires de plus de 7 millions d'ouvriers.
En France, l'aggravation des conditions de vie de la classe ouvrière (essentiellement la pénurie d'aliments et de combustible) provoquera une vague de luttes ouvrières au cours des premiers mois de 1920. Dès février, les cheminots constituent le centre du mouvement de grèves qui parvient à s'étendre et provoquer la solidarité d'autres secteurs malgré l'opposition des syndicats. Prenant le train en marche, si l'on peut dire, le syndicat CGT décide de prendre la tête de la lutte et décide alors d'une tactique de « vagues d'assaut », qui consiste à faire débrayer un jour les mineurs, le lendemain les métallos, etc. ; de cette façon, ils parviennent à empêcher le mouvement de s'unifier, l'éparpillent et le font péricliter. Le 22 mai, il ne reste plus que les cheminots en grève, c'est la défaite : 18 000 licenciements disciplinaires. Les syndicats sont bien sûr déconsidérés à l'issue de cette bataille (plus de 60 % de démissions) mais leur sabotage des luttes a porté ses fruits : le prolétariat français est défait et se trouve à la merci des expéditions punitives des « Ligues civiques».
En Italie, où s'étaient développées de formidables luttes ouvrières contre la guerre impérialiste tout au long de 1917-18, et d'autres encore contre l'expédition d'approvisionnement aux armées qui combattaient la révolution en Russie ([8] [27]), le prolétariat est cependant incapable de se lancer à l'assaut de l'Etat bourgeois. En réaction à la faillite de nombreuses entreprises, l'été 1920 voit une fièvre « d'occupations » embraser le pays, impulsées par les syndicats : elles dévient le prolétariat de la perspective d'affrontement contre l’Etat, tout en l'enchaînant au « contrôle de la production » dans chaque usine. Il suffit de rappeler que le propre gouvernement Giolitti prévient les chefs d'entreprise qu'il «n'utilisera pas l'armée pour déloger les ouvriers, car cela déplacerait la lutte de l'usine vers la rue » (cité par M. Ferrara, Conversations avec Togliatti). La combativité ouvrière s'effiloche dans ces occupations d'usines. La défaite de ce mouvement, quoiqu'il soit prolongé par de nouvelles mais isolées grèves en Lombardie, à Venise, etc., ouvrira les vannes de la contre-révolution qui, dans ce cas précis, a pris la forme du fascisme.
La classe ouvrière subit aussi d'importantes défaites aux Etats-Unis (grèves dans les mines de charbon, dans les mines de lignite d'Alabama, dans les chemins de fer) en 1920. La contre-offensive capitaliste impose les « conventions ouvertes » (impossibilité de conventions collectives) qui aboutissent à une baisse des salaires de l'ordre de 30 %.
Les derniers soubresauts de la vague révolutionnaire
Bien qu'elle continue à exploser dans d'héroïques combats, la vague révolutionnaire est entrée dans sa phase finale à partir de 1921. D'autant plus que le poids des défaites conduit les révolutionnaires de l'Internationale communiste à commettre des erreurs toujours plus graves (application de la politique de «front unique », soutien aux luttes de « libération nationale », expulsion de 1’IC des fractions révolutionnaires de la Gauche communiste...), qui provoquent encore plus de confusions et à leur tour, dans une spirale dramatique, provoquent de nouvelles défaites.
En Allemagne; la combativité ouvrière est toujours plus dévoyée vers « l’antifascisme » (par exemple lorsque l'extrême-droite assassine Ersberger, ou quand un belliciste exige que Kiel soit rasée de la carte en novembre 1918) ou vers le nationalisme. Quand la Ruhr est envahie par les armées belge et française en 1923, le KPD brandit le drapeau abject du « national-bolchèvisme » en appelant le prolétariat à défendre la « patrie allemande », soi-disant progressiste, contre l'impérialisme représenté par les puissances de l'Entente. En octobre de cette même année, le Parti communiste, qui siège au gouvernement en Saxe et Thuringe, prend la décision de provoquer des insurrections, dont la première a lieu le 20 octobre à Hambourg. Le KPD revient sur sa décision quand les ouvriers sont déjà dans la rue, et ces derniers doivent seuls faires face à une terrible répression. Exsangue, démoralisé, cruellement réprimé, le prolétariat allemand est défait. Quelques jours plus tard, Hitler lancera son fameux «putsch de la bière », tentative de coup d’Etat lancée depuis une brasserie de Munich, qui échouera (comme on sait, Hitler parviendra au pouvoir par la « voie parlementaire » dix ans plus tard).
Le prolétariat polonais, qui en 1920 avait fait front avec sa bourgeoisie contre l'invasion du pays par l'Armée rouge, retrouve son terrain de classe en 1923 avec une nouvelle vague de grèves. Mais l'isolement international permet à la bourgeoisie de garder le contrôle de la situation et de monter toute une série de provocations (l'incendie de la poudrerie de Varsovie, dont seront accusés les communistes) pour s'affronter aux travailleurs tant que ceux-ci sont encore dispersés. Une insurrection éclate le 6 novembre à Cracovie, mais les mensonges des « socialistes » parviennent à désorienter et démoraliser les travailleurs (notamment en parvenant à ce que ceux-ci leur rendent les amies). Malgré la vague de grèves de solidarité avec Cracovie (Dombrowa, Gornicza, Tarnow...), la bourgeoisie parvient en quelques jours à éteindre cette flambée ouvrière.
En 1926, le prolétariat polonais servira de chair à canon dans la rivalité entre fractions de la bourgeoisie qui opposa le gouvernement « philo-fasciste » et Pilsudski soutenu par la gauche en tant que « défenseur de la liberté ».
En Espagne, les vagues de luttes seront systématiquement freinées par le PSOE (Parti socialiste) et le syndicat UGT, ce qui permettra au général Primo de Rivera d'imposer sa dictature en 1923 ([9] [28]).
En Angleterre, après quelques mouvements divisés et très isolés (marche des chômeurs sur Londres en 1921 et 1923, grève générale dans le bâtiment en 1924), la bourgeoisie confirmera sa victoire en 1926. Face à une nouvelle vague de luttes des mineurs, les syndicats organisent une « grève générale » qu'ils annuleront 10 jours plus tard, abandonnant les mineurs qui reprendront le travail en décembre au prix de milliers de licenciements. La défaite de cette lutte consacrera la victoire de la contre-révolution en Europe.
Dans cette phase définitive de déclin de la vague révolutionnaire, les mouvements révolutionnaires du prolétariat dans les pays de la périphérie du capitalisme sont à leur tour défaits. En Afrique du Sud, c'est le cas avec la « Révolte rouge du Transvaal » contre le remplacement des travailleurs de race blanche par des travailleurs de race noire moins payés, en 1922, qui s'était étendue à d'autres secteurs d'industrie (mines de charbon, chemins de fer...), toutes races confondues, et qui avait pris parfois des tournures insurrectionnelles. En 1923, l'armée hollandaise et les tueurs à gage engagés par les planteurs locaux s'unissent pour venir à bout de la grève des chemins de fer à Java, qui s'était étendue à Surabaj et à Jemang (Indonésie).
En Chine, le prolétariat avait été conduit (par la néfaste thèse de 1’IC sur l'appui aux mouvements de « libération nationale ») à soutenir les actions de la bourgeoisie nationaliste organisée dans le Kuomintang, qui pourtant n'hésitait pas à réprimer sauvagement les travailleurs quand ceux-ci luttaient sur leur terrain de classe, comme à Canton en 1925, lors de la grève générale. En février et mars 1927, les ouvriers de Shanghaï préparent par des insurrections l'entrée dans la ville du général nationaliste Tchang Kaï-Chek. Ce leader « progressiste » (selon 1’IC) n'hésite pas non plus, sitôt la ville prise, à s'allier avec les commerçants, les paysans, les intellectuels et surtout le « lumpen » pour réprimer par le sang et le feu la grève générale décrétée par le Conseil ouvrier de Shanghaï pour protester contre l'interdiction du droit de grève décrétée par le « libérateur ». Et malgré les horreurs commises dans les quartiers ouvriers de Shanghaï pendant les deux mois de la répression, 1’IC appellera encore à soutenir « l'aile gauche » du Kuomintang, installée à Wuhan. Cette gauche nationaliste a fusillé sans sourciller les ouvriers qui, par leurs grèves, « irritaient les industriels étrangers (...), en gênant leurs intérêts commerciaux » (M. N. Roy, Révolution et contre-révolution en Chine). Quand le PC décide enfin l'insurrection, alors que le mouvement ouvrier est défait, il ne fait qu'augmenter les dégâts : lors de la Commune de Canton, en décembre 1927, 2 000 ouvriers périssent assassinés.
Cette lutte du prolétariat en Chine n'est que l'épilogue tragique de la vague révolutionnaire mondiale et, comme l'analysèrent les révolutionnaires de la Gauche communiste, elle marque une étape décisive dans le passage des partis « communistes » dans les rangs de la contre-révolution. Cette contre-révolution s'étend comme une immense et profonde nuit qui durera plus de 40 ans, pour s'achever avec le resurgissement des combats de la classe ouvrière à la fin des années 1960.
La guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à la révolution
Pourquoi cette vague révolutionnaire a-t-elle échoué ? Il ne fait pas de doute que les incompréhensions du prolétariat et de ses minorités révolutionnaires quant aux conditions de la nouvelle période historique ont pesé lourdement ; mais il faut aussi comprendre que les conditions objectives créées par la guerre impérialiste ont empêché ces torrents de luttes de se rejoindre dans un combat unifié. Dans l'article « Les conditions historiques de la généralisation de la lutte de la classe ouvrière » (Revue Internationale n° 26), nous disions : « La guerre est un grave moment de la crise du capitalisme, mais nous ne pouvons pour autant nier que c'est également une réponse du capitalisme à sa propre crise, un moment avancé de sa barbarie et que, en tant que tel, il ne joue pas forcément en faveur des conditions de la généralisation de la révolution ».
On peut le vérifier à la lumière des faits de cette vague révolutionnaire.
La guerre suppose un bain de sang pour le prolétariat
Comme l'explique Rosa Luxemburg :
« Mais pour que le socialisme puisse faire sa trouée et remporter la victoire, il faut qu'existent des masses dont la puissance réside tant dans leur niveau culturel que dans leur nombre. Et ce sont ces masses précisément qui sont décimées dans cette guerre. La fleur de l'âge viril et de la jeunesse, des centaines de milliers de prolétaires dont l'éducation socialiste, en Angleterre et en France, en Belgique, en Allemagne et en Russie, était le produit d'un travail d'agitation et d'instruction d'une dizaine d'années, d'autres centaines de milliers qui demain pouvaient être acquis au socialisme - ils tombent et ils tuent misérablement sur les champs de bataille. Le fruit de dizaines d'années de sacrifices et d'efforts de plusieurs générations est anéanti en quelques semaines, les troupes d'élite du prolétariat international sont décimées » (Rosa Luxemburg, La crise de la social-démocratie, Chap. VII).
Une très grande partie des 70 millions de soldats était constituée de prolétaires qui avaient dû laisser leur place dans les usines aux femmes, aux enfants, à la main d'œuvre immigrée des colonies n'ayant que très peu d'expérience des luttes. En outre, l'armée dilue ces prolétaires dans une masse inter-classiste avec les paysans, le lumpen... C'est ce qui fait que les actions de ces soldats (désertions, insubordinations...) ne se si tuent pas sur un terrain de lutte authentiquement prolétarien, même si, pour autant, la bourgeoisie n'en profite pas. Les désertions dans l'armée austro-hongroise, par exemple, sont en grande partie dues au refus des tchèques et des hongrois... de se battre pour l'Empereur de Vienne. Les mutineries dans l'armée française ne se dirigent pas contre la guerre elle-même, mais contre « une certaine façon de mener la guerre » (l'inefficacité de certaines manoeuvres, etc.). La radicalité et la conscience qui se développent chez certains soldats (fraternisations, refus de réprimer des luttes ouvrières...) sont surtout la conséquence de la mobilisation à l'arrière. Et quand la question se pose, après l'armistice, de détruire le capitalisme pour en finir une bonne fois avec les guerres, les soldats sont le secteur le plus hésitant et rétrograde. C'est d'ailleurs pour cela que la bourgeoisie allemande, par exemple, fait en sorte de surdimensionné le poids des Conseils de soldats face aux Conseils ouvriers.
Le prolétariat « ne contrôle pas » la guerre
La guerre mondiale exige une défaite préalable du prolétariat. Et même dans les pays où le poids de l'idéologie réformiste qui a présidé à cette défaite est le plus faible, les luttes cessent en 1914 : en Russie, par exemple, la vague croissante de luttes qui s'était développée en 1912-1913 s'interrompt brusquement.
Mais en outre, au cours même de la guerre, la lutte de classe est mise au second plan derrière le vacarme des opérations militaires. Quand bien même les défaites militaires accentuent le mécontentement (l'échec de l'offensive de l'armée russe en juin 17 provoque les Journées de juin), il n'en est pas moins vrai que les offensives du rival impérialiste et les succès militaires de son propre impérialisme poussent le prolétariat dans les bras des « intérêts de la Patrie ». C'est ainsi qu'en automne 1918 ont lieu les dernières offensives militaires allemandes, à un moment historique crucial pour la révolution mondiale (quelques mois à peine après le Révolution russe) :
- elles paralysent la vague de grèves qui se propageait depuis janvier en Allemagne et en Autriche, grâce aux « conquêtes » réalisées en Russie et en Ukraine, présentées comme étant « la paix du pain » par les propagandistes des armées ;
- elles poussent les soldats français, qui commençaient à fraterniser avec les ouvriers de la Loire, à resserrer les rangs derrière leur bourgeoisie ; ces mêmes soldats seront ceux qui réprimeront les grèves dès l'été.
Et surtout, lorsque la bourgeoisie voit menacée sa domination de classe par le prolétariat, elle peut priver la révolution montante de son principal stimulant. Si la bourgeoisie russe n'avait pas compris cela, tel n'est pas le cas de la bourgeoisie en Allemagne qui est beaucoup plus expérimentée (et avec elle l'ensemble de la bourgeoisie mondiale). Pour intenses que soient les antagonismes impérialistes entre les fractions capitalistes nationales, c'est la solidarité qui les unit dès qu'il s'agit de manifester une solidarité de classe pour s'affronter au prolétariat.
Le sentiment de soulagement que provoque l'Armistice parmi les ouvriers affaiblit leurs luttes (en Allemagne par exemple) mais renforce par contre le poids des mystifications bourgeoises. En présentant la guerre impérialiste comme une « anomalie » du fonctionnement du capitalisme (la Grande guerre devait être la « der des der »), la bourgeoisie tente de faire croire aux ouvriers que la révolution n'est pas nécessaire, que tout « redevient comme avant ». Cette sensation de « retour à la normale » renforce les moyens de la contre-révolution : les partis « socialistes » et leur fameuse « évolution progressive vers le socialisme » et les syndicats avec leurs armes habituelles (« contrôle ouvrier de la production », nationalisations...).
La guerre brise la généralisation des luttes
Enfin, la guerre brise la généralisation des luttes en divisant la riposte ouvrière entre pays vainqueurs et pays vaincus. Les gouvernements de ces derniers sont certainement affaiblis par la défaite militaire, mais l'effondrement d'un gouvernement ne signifie pas forcément un renforcement du prolétariat. Après la chute de l'Empire hongrois, par exemple, le «prolétariat des nations opprimées » est entraîné à la guerre pour « l'indépendance » de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Yougoslavie... ([10] [29]). Les ouvriers hongrois qui ont pris Budapest le 30 octobre, la grève générale en Slovaquie de 1918..., sont dévoyés de leur cours et entraînés sur le terrain pourri de la « libération nationale ». En Galicie (alors en Autriche), les mouvements qui s'étaient développés contre la guerre cèdent le pas aux manifestations « pour l'indépendance de la Pologne et la défaite de l'Allemagne ! ». Le prolétariat de Vienne se retrouve pratiquement isolé lors de sa tentative insurrectionnelle de novembre 1918.
Dans les pays vaincus, la révolte est plus immédiate mais aussi plus désespérée, et en conséquence dispersée et inorganisée. Parce qu'isolée de la lutte des ouvriers des pays vainqueurs, la rage des prolétaires dans les pays vaincus peut finalement être facilement déviée vers le « revanchardisme ». Tel sera le cas en Allemagne en 1923, après l'invasion de la Ruhr par les années franco-belges.
Par contre, dans les pays vainqueurs, la combativité ouvrière se voit étouffée par l'euphorie chauvine de la victoire ([11] [30]), ce qui fait que les luttes ne peuvent se développer que plus lentement, comme si les ouvriers attendaient les « dividendes de la victoire » ([12] [31]). Il faudra attendre que les mystifications s'évanouissent au feu des terribles conditions de vie de l'après-guerre (en particulier quand le capitalisme entrera en 1920 dans une phase de crise économique) pour que les ouvriers entrent massivement en lutte, en Angleterre, France, Italie... Mais alors le prolétariat des pays vaincus a déjà subi des défaites décisives, comme nous l'avons vu. La fragmentation des luttes ouvrières entre pays vainqueurs et pays vaincus permet en outre à la bourgeoisie de coordonner l'ensemble de ses forces, les engageant en renfort dans les pays où se mène ponctuellement le combat contre le prolétariat. Comme le dénonçait Karl Marx après l'écrasement de la Commune de Paris : « Le fait sans précédent qu'après la guerre la plus terrible des temps modernes, le vaincu et le vainqueur fraternisent pour massacrer en commun le prolétariat (...) La domination de classe ne peut plus se cacher sous un uniforme national, les gouvernements nationaux ne font qu'UN contre le prolétariat » (Marx, La Guerre civile en France, Chap. IV).
Les exemples ne manquent pas :
- Avant même la fin de la guerre, les pays de l'Entente ferment les yeux quand l'armée allemande écrase la révolution ouvrière de Finlande en mars 1918, et aussi quand elle écrase, en septembre 1918, la révolte dans l'armée hongroise à Vladai.
- Contre la révolution en Allemagne, c'est le président des USA Wilson lui-même qui impose au Kaiser l'entrée des « socialistes » au gouvernement, car c'est la seule force capable de s'affronter à la révolution. L'Entente fournit peu après 5 000 mitrailleuses au gouvernement allemand pour massacrer les révoltes ouvrières. Et en mars 1919, l'armée de Noske manoeuvrera avec le complet accord de Clemenceau à travers la zone « démilitarisée » de la Ruhr pour écraser l'un après l'autre tous les foyers de révolution.
- Sous les ordres du colonel anglais Cunningham, de sinistre mémoire, un centre coordinateur de la contre-révolution fonctionne dès la fin de 1918 à Vienne ; c'est lui qui coordonne l'action des armées tchèque et roumaine en Hongrie. Quand en juillet 1919 l'armée des Conseils en Hongrie tente une action militaire sur le front roumain, l'armée roumaine l'attend, prévenue de cette opération par les « socialistes » hongrois qui en avaient avisé le « centre anti-bolchevique » de Vienne.
- Le chantage de « l'aide humanitaire » de l'Entente s'ajoute à la collaboration militaire, pour forcer le prolétariat à accepter sans rechigner l'exploitation et la misère. Quand les Conseils hongrois appellent, en mars 1919, les ouvriers autrichiens à se joindre à la lutte, le « révolutionnaire » F. Adler leur répond : « Vous nous appelez à suivre votre exemple. Nous le ferions de tout coeur mais nous ne le pouvons malheureusement pas. Il n'y a plus trace de nourriture dans notre pays. Nous sommes totalement les esclaves de l'Entente ». (Arbeiter-Zeitung, 23 mars 1919).
En conclusion, nous pouvons donc affirmer que, contrairement à ce que pensaient nombre de révolutionnaires ([13] [32]), la guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à la généralisation de la révolution. Cela ne veut en rien dire que nous serions « pacifistes », comme le colportent les groupes révolutionnaires bordiguistes. Au contraire, nous défendons avec Lénine que « la lutte pour la paix sans action révolutionnaire n'est qu'une phrase creuse et mensongère ». C'est précisément notre rôle d'avant-garde de cette lutte révolutionnaire qui exige de nous que nous tirions les leçons des expériences ouvrières, et d'affirmer (Op. cit., Revue internationale n° 26.) que le mouvement de luttes contre la crise économique du capitalisme qui s'est développé à partir de la fin des années 1960, s'il peut paraître moins « radical », plus tortueux et contradictoire, établit une base matérielle autrement plus ferme pour la révolution mondiale du prolétariat :
- La crise économique frappe tous les pays sans exception. Indépendamment du niveau de dévastation que la crise peut provoquer dans les différents pays, il est absolument sûr qu'il n'y a ni « vainqueurs », ni « vaincus », pas plus qu'il n'y a de pays « neutre ».
- Contrairement aux conditions créées par la guerre impérialiste, qui font que la bourgeoisie peut décréter la paix pour contrer le danger d'une révolution ouvrière, la crise économique ne peut être interrompue, pas plus que ne peuvent être évitées les attaques toujours plus violentes contre les travailleurs.
- Il est très significatif que ces groupes qui nous taxent de « pacifistes » soient les mêmes qui tendent à sous-estimer les luttes ouvrières contre la crise.
Le rôle décisif des principales concentrations ouvrières
Quand le prolétariat prend le pouvoir en Russie, les mencheviks et, avec eux, l'ensemble des « socialistes » et centristes dénoncent « l'aventurisme » des bolcheviks : d'après eux, la Russie est un pays « sous-développé », pas encore mûr pour la révolution socialiste. C'est précisément la juste défense du caractère prolétarien de la Révolution d'Octobre qui conduit les bolcheviks à expliquer le « paradoxe » du surgissement de la révolution mondiale à partir de la lutte d'un prolétariat « sous-développé » comme le prolétariat russe ([14] [33]), au moyen de la thèse erronée selon laquelle la chaîne de l'impérialisme mondial se briserait d'abord en ses maillons les plus faibles ([15] [34]). Mais une analyse de la vague révolutionnaire permet de réfuter d'une manière marxiste aussi bien le mythe selon lequel le prolétariat des pays du tiers-monde ne serait pas prêt pour la révolution socialiste que son apparente « antithèse », selon laquelle il disposerait de plus grandes facilités.
1) Précisément, la Première Guerre mondiale marque le moment historique de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence. Cela signifie que les conditions de la révolution prolétarienne (développement suffisant des forces productives, mais aussi de la classe révolutionnaire chargée d'enterrer la société moribonde) existent au niveau mondial.
Le fait que la vague révolutionnaire s'étende aux quatre coins de la planète et que, dans tous les pays, les luttes ouvrières affrontent l'action contre-révolutionnaire de toutes les fractions de la bourgeoisie, met clairement en évidence que le prolétariat (indépendamment du degré de développement qu'il ait pu atteindre dans chaque pays) n'a pas de tâches différentes en Europe et dans le « tiers-monde ». Il n'y a donc pas un prolétariat « prêt » pour le socialisme (dans les pays développés) et un prolétariat « immature pour la révolution » qui devrait encore traverser la «phase démocratico-bourgeoise ». Précisément, la vague révolutionnaire internationale que nous sommes en train d'analyser montre comment les ouvriers d'un pays en retard, comme la Norvège, découvrent que : « les revendications des travailleurs ne peuvent être satisfaites par des moyens parlementaires, mais par les actions révolutionnaires de tout le peuple travailleur » (Manifeste du conseil ouvrier de Cristiania, mars 1918). Cette vague révolutionnaire montre aussi comment les ouvriers des plantations indonésiennes, ou bien ceux des favelas de Rio, construisent des Conseils ouvriers ; comment les travailleurs berbères s'unissent aux immigrés européens contre la bourgeoisie « nationaliste » dans une grève générale dans les ports d'Algérie en 1923...
Proclamer aujourd'hui, comme le font certains groupes du milieu révolutionnaire, que le prolétariat de ces pays sous-développés, contrairement à celui des pays avancés, devrait construire des syndicats, ou soutenir la révolution « nationale des fractions progressistes » de la bourgeoisie, équivaut à jeter par dessus bord les leçons des défaites sanglantes subies par ces prolétaires de la main de l'alliance de toutes les fractions (« progressistes » et « réactionnaires ») de la bourgeoisie, ou de syndicats (y compris dans leurs variantes les plus radicales comme les syndicats anarchistes en Argentine) qui ont montré qu'ils étaient devenus des agents anti-ouvriers de l'Etat capitaliste, autant dans le centre comme à la périphérie du capitalisme.
2) Cependant, le fait que l'ensemble du capitalisme et du prolétariat mondial soient « mûrs » pour la révolution socialiste ne signifie pas que la révolution mondiale puisse commencer dans n'importe quel pays, ou que la lutte des travailleurs des pays plus retardés du capitalisme aient la même responsabilité, le même caractère déterminant, que les combats du prolétariat dans les pays plus avancés. Précisément, la vague révolutionnaire de 1917-23 démontre d'une manière frappante que la révolution ne pourra partir dans l'avenir que du prolétariat des concentrations plus développées, c'est-à-dire de ces bataillons de la classe ouvrière qui, de par leur poids sur la société, de par l'expérience historique accumulée au fil des années de combat contre l'Etat capitaliste et ses mystifications, jouent un rôle central et décisif dans la confrontation mondiale entre le prolétariat et la bourgeoisie.
Eclairés par la lutte du prolétariat de ces pays plus développés, les travailleurs forment des Conseils ouvriers jusqu'en Turquie (où en 1920 existera un groupe spartakiste), en Grèce, en Indonésie même, au Brésil... En Irlande (où d'après Lénine le prolétariat devait encore lutter pour la « libération nationale », ce qui était une analyse erronée), l'influx de la vague révolutionnaire ouvre une parenthèse lumineuse, quand les travailleurs, au lieu de lutter avec la bourgeoisie irlandaise pour son « indépendance » vis-à-vis de la Grande-Bretagne, luttent sur le terrain du prolétariat international. Durant l'été 1920 surgissent des Conseils ouvriers à Limerick, et des révoltes de journaliers éclatent à l'ouest du pays, en butte à la répression autant des troupes anglaises que de l'IRA (quand ces ouvriers occupent des propriétés appartenant à des irlandais).
Quand la bourgeoisie parvient à défaire les bataillons ouvriers décisifs en Allemagne, France, Angleterre, Italie..., la classe ouvrière mondiale se trouve gravement affaiblie, et les luttes ouvrières dans les pays de la périphérie capitaliste ne pourront pas renverser le cours de la défaite du prolétariat mondial. Les énormes preuves de courage et de combativité que donnent les ouvriers en Amérique, Asie..., privés de la contribution des bataillons centraux de la classe ouvrière, se perdront, comme nous l'avons vu, dans de gravissimes confusions (comme par exemple lors de l'insurrection en Chine) qui vont les conduire inévitablement à la défaite. Dans les pays où le prolétariat est plus faible, ses maigres forces et expériences sont cependant confrontées à l'action combinée des bourgeoisies qui ont plus d'expérience dans leur lutte de classe contre le prolétariat ([16] [35]), quand les bourgeoisies française, anglaise et américaine entreprennent d'une manière coordonnée une action contre-révolutionnaire. En Chine aussi, les « démocraties » occidentales apportent leur appui financier et militaire tout d'abord aux « seigneurs de la guerre », puis aux leaders du Kuomintang.).
De ce fait, le maillon crucial où se jouait le devenir de la vague révolutionnaire était l'Allemagne, dont le prolétariat représentait un authentique phare pour les travailleurs du monde entier. Mais en Allemagne, le prolétariat plus développé et aussi plus conscient affrontait, et c'est logique, la bourgeoisie qui avait accumulé une vaste expérience de confrontations avec le prolétariat. Il suffit de voir la « puissance » de l'appareil spécifiquement anti-ouvrier de l'Etat capitaliste allemand : un Parti socialiste et des syndicats qui se sont maintenus à tous moments organisés et coordonnés pour saboter et écraser la révolution.
Pour rendre possible l'unification mondiale du prolétariat, il faut dépasser les mystifications les plus subtiles de la classe ennemie, il faut affronter les appareils anti-ouvriers les plus sophistiqués... En fait, il faut défaire la fraction la plus forte de la bourgeoisie mondiale. Seuls les bataillons les plus développés et conscients de la classe ouvrière mondiale peuvent être à la hauteur de cette tâche.
La thèse selon laquelle la révolution devait surgir nécessairement de la guerre, ainsi que celle du « maillon le plus faible », furent des erreurs des révolutionnaires dans cette période-là, dans leur désir de défendre la révolution prolétarienne mondiale. Ces erreurs, cependant, furent transformées en dogmes par la contre-révolution triomphante après la défaite de la vague révolutionnaire, et aujourd'hui elles font malheureusement partie du « corps de doctrine » des groupes bordiguistes.
La défaite de la vague révolutionnaire du prolétariat de 1917-23 ne signifie pas que la révolution prolétarienne soit impossible. Au contraire, presque 80 ans plus tard, le capitalisme a prouvé, guerre après guerre, barbarie après barbarie, qu'il ne peut sortir du bourbier historique de sa décadence. Et le prolétariat mondial a dépassé la nuit de la contre-révolution, débutant malgré ses limitations un nouveau cours ouvert vers des affrontements de classe décisifs, vers une nouvelle tentative révolutionnaire. Dans ce nouvel assaut mondial contre le capitalisme, la classe ouvrière devra, pour pouvoir triompher, s'approprier les leçons de ce qui constitue sa principale expérience historique. Il est de la responsabilité de ses minorités révolutionnaires d'abandonner le dogmatisme et le sectarisme pour pouvoir discuter et clarifier le bilan indispensable de cette expérience.
Etsoem
[1] [36] Le retrait des troupes allemandes de leurs positions en France et en Belgique coûta 378 000 hommes à la Grande-Bretagne et 750 000 à la France.
[2] [37] La défaite idéologique du prolétariat en 1914 n'avait pas été une défaite physique, ce qui explique que réapparaissent immédiatement les grèves, les assemblées, la solidarité... Celle de 1939, par contre, est complète, joignant la défaite physique (l'écrasement de la vague révolutionnaire) à la défaite idéologique (l'antifascisme).
[3] [38] Cf. « De l’austromarxisme à l’austrofascisme », Revue Internationale, n° 10.
[4] [39] Cf. « Il y a 70 ans, la révolution en Allemagne », Revue Internationale, n° 55 et 56.
[5] [40] Hésitations qui malheureusement touchèrent aussi les révolutionnaires. Cf. noire brochure La Gauche hollandaise.
[6] [41] Cf. «r L'Isolement est la mort de la révolution », Revue Internationale, n° 75.
[7] [42] Cité par Edouard Dolléans, Histoire du mouvement ouvrier.
[8] [43] Cf. « Révolution et contre-révolution en Italie », Revue Internationale, n° 2 et 3.
[9] [44] Cf. Bilan de 70 ans de "libération nationale', Revue Internationale, n° 66
[10] [45] Cf. « Bilan de 70 ans de "libération nationale" », Revue Internationale, n° 66
[11] [46] En France, ce n'est que dans la partie <r vaincue » (l'Alsace et la Lorraine) qu'éclatèrent des grèves importantes en novembre 1918 (dans les chemins de fer et les mines) et qu'il y eut des Conseils de soldats.
[12] [47] Le pays capitaliste le plus faible, celui qui perd la guerre, est précisément celui qui l'avait déclarée, ce qui permet à la bourgeoisie de renforcer le chauvinisme par des campagnes sur les « indemnités de guerre ».
[13] [48] Même les groupes révolutionnaires qui tirèrent le bilan le plus sérieux et lucide de cette vague révolutionnaire se trompèrent sur cette question ; ce qui fut le cas par exemple de la Gauche communiste de France qui attendait de la Seconde Guerre mondiale une nouvelle vague révolutionnaire.
[14] [49] Dans notre brochure Russie 1917, début de la révolution mondiale, nous montrons d'une part, que la Russie n'était pas un pays si en retard (5e puissance industrielle au niveau mondial), et que d'autre part, le fait qu'elle ait été en avant par rapport au reste du prolétariat ne peut être attribué à ce supposé « retard » du capitalisme russe, mais plutôt au fait que, la révolution surgissant de la guerre, la bourgeoisie mondiale n'a pas pu venir en aide à la bourgeoisie russe (de la même façon qu'elle put le faire en 1918-20 durant la «guerre civile »)t ceci ajouté à l'absence d'amortisseurs sociaux (syndicats, démocratie...) du tsarisme.
[15] [50] Nous avons exposé notre critique de cette « théorie du maillon le plus faible » dans « Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classes », et dans « A propos de la théorie du maillon le plus faible », Revue Internationale n° 31 et 37.
[16] [51] Comme on le vit dans la Révolution russe elle-même (Cf. Revue Internationale, n° 75).
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Internationalisme [53]
Heritage de la Gauche Communiste:
Guy Debord : La deuxième mort de l’« Internationale situationniste »
- 8592 lectures
Guy Debord s'est donné la mort le 30 novembre 1994. En France, où il vivait, toute la presse a parlé de ce suicide car Debord, bien qu'il ait toujours limité ses apparitions publiques, était un personnage connu. Sa célébrité, il ne la devait pas aux « oeuvres » qu'il avait produites dans ce qui constituait le « métier » que lui ont attribué les médias, cinéaste, et qui ont toujours eu une diffusion limitée, mais en tant qu'écrivain (La société du spectacle, 1967) et surtout comme fondateur et principal animateur de l'Internationale Situationniste. En tant qu'organisation révolutionnaire, c'est ce dernier aspect de la vie de Guy Debord qui nous intéresse dans la mesure où l'IS, si elle a disparu il y a plus de 20 ans, a eu, en son temps, une certaine influence sur des groupes et éléments qui s'orientaient vers des positions de classe.
Nous ne ferons pas ici une histoire de l’IS ni l'exégèse des 12 numéros de sa revue publiée entre 1958 et 1969. Nous nous contenterons de rappeler que l’IS est née non pas en tant que mouvement politique à proprement parler, mais en tant que mouvement culturel regroupant un certain nombre « d'artistes » (peintres, architectes, etc.) provenant de diverses tendances (Internationale Lettriste, Mouvement pour un Bauhaus Imaginiste, Comité psycho géographique de Londres, etc.) qui se proposaient de faire une critique « révolutionnaire » de l'art tel qu'il existe dans la société actuelle. C'est ainsi que dans le premier numéro de la revue de l'IS (juin 1958) on trouve reproduite une Adresse distribuée lors d'une assemblée générale des critiques d'art internationaux où l'on peut lire : «Dispersez-vous, morceaux de critiques d'art, critiques de fragments d'art. C'est maintenant dans l'Internationale situationniste que s'organise l'activité artistique unitaire de l'avenir. Vous n'avez plus rien à dire. L'Internationale situationniste ne vous laissera aucune place. Nous vous réduirons à la famine. »
Il faut remarquer que, même si l'IS se revendique d'une révolution radicale, elle estime qu'il est possible d'organiser au sein même de la société capitaliste « l'activité artistique de l'avenir ». Plus : cette activité est conçue comme une sorte de marchepied vers cette révolution puisque : « Des éléments d'une vie nouvelle doivent être déjà en formation parmi nous - dans le champ de la culture -, et c'est à nous de nous en servir pour passionner le débat. » ([1] [55]). L'auteur de ces dernières lignes était d'ailleurs un peintre danois relativement célèbre.
Le type de préoccupations qui animait les fondateurs de l’IS révélait qu'il ne pouvait s'agir d'une organisation exprimant un effort de la classe ouvrière vers sa prise de conscience, mais bien une manifestation de la petite bourgeoisie intellectuelle radicalisée. C'est pour cela d'ailleurs que les positions proprement politiques de 1’IS, si elles voulaient se réclamer du marxisme tout en rejetant le stalinisme et le trotskisme, étaient de la plus grande confusion. C'est ainsi qu'en annexe du n°1 de la publication paraît une prise de position à propos du coup d'Etat du 13 mai 1958 qui a vu l'armée française basée en Algérie se dresser contre le pouvoir du gouvernement de Paris : on y parle du « peuple français », des « organisations ouvrières » pour désigner les syndicats et les partis de gauche, etc. Deux ans plus tard, on trouve encore des accents tiers-mondistes dans le n°4 de la revue : « Nous saluons dans l'émancipation des peuples colonisés et sous-développés, réalisée par eux-mêmes, la possibilité de s'épargner les stades intermédiaires parcourus ailleurs, tant dans l'industrialisation que dans la culture et l'usage même d'une vie libérée de tout » ([2] [56]). Quelques mois plus tard, Debord est un des 121 signataires (principalement artistes et intellectuels) de la « Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie » où l'on peut lire : « La cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est la cause de tous les hommes libres ». L’IS n° 5 revendique collectivement ce geste sans même la moindre critique aux concessions à l'idéologie démocratique et nationaliste que contient la «Déclaration ».
Notre but ici n'est pas d'accabler l'IS ni de tirer sur l'ambulance (ou plutôt sur le cercueil de l'IS). Mais il est important qu'il reste clair, notamment pour ceux qui ont pu être influencés par les positions de cette organisation, que la réputation de « radicalisme » dont elle était entourée, son intransigeance et son refus de toute compromission étaient très fortement exagérés. C'est avec les plus grandes peines que l'IS a commencé à se dégager des aberrations politiques de ses origines, et en particulier des concessions aux conceptions gauchistes ou anarchistes. Ce n'est que progressivement qu'elle va se rapprocher des positions communistes de gauche, en fait celles du conseillisme, en même temps que les pages de sa publication font une place croissante aux questions politiques au détriment des divagations « artistiques ». Debord qui pendant une période est en lien étroit avec le groupe qui publie Socialisme ou Barbarie (S. ou B.), est l'instigateur de cette évolution. C'est ainsi qu'en juillet 1960, il publie un document, « Préliminaires pour une définition de l’unité du programme révolutionnaire », en compagnie de P. Canjuers, membre de S. ou B. Cependant, S. ou B. qui pendant un temps inspire l'évolution de l’IS, est lui-même un courant politique des plus confus. Issu d'une scission tardive (1949) au sein de la « 4e internationale » trotskiste, ce courant ne sera jamais capable de rompre son cordon ombilical avec le trotskisme pour rejoindre les positions de la Gauche communiste. Après avoir engendré à son tour plusieurs scissions qui donneront le « Groupe de Liaison pour l'Action des travailleurs », la revue Information et Correspondance Ouvrières et le groupe « Pouvoir Ouvrier », S. ou B. va terminer sa trajectoire, sous la haute autorité de Cornélius Castoriadis (qui au début des années 1980 apportera sa caution aux campagnes reaganiennes sur la prétendue « supériorité militaire de l'URSS ») en cénacle d'intellectuels rejetant explicitement le marxisme.
La confusion extrême des positions politiques de l'IS, on la retrouve encore en 1966 quand elle essaie de prendre position sur le coup d'Etat militaire de Boumédienne en Algérie et qu'elle ne trouve rien d'autre à faire que de défendre de façon « radicale » l'autogestion (c'est-à-dire la vieille recette anarchiste d'origine proudhonienne qui conduit à faire participer les ouvriers à leur propre exploitation) :
« Le seul programme des éléments socialistes algériens est la défense du secteur autogéré, pas seulement comme il est, mais comme il doit devenir... De l'autogestion maintenue et radicalisée peut partir le seul assaut révolutionnaire contre le régime existant... L'autogestion doit devenir la solution unique aux mystères du pouvoir en Algérie, et doit savoir qu'elle est cette solution. » ([3] [57]). Et même en 1967, avec le n°11 de sa revue qui contient pourtant les positions politiques les plus claires, l'IS continue encore à cultiver l'ambiguïté sur un certain nombre de points, particulièrement sur les prétendues luttes de « libération nationale ». C'est ainsi qu'à côté d'une dénonciation vigoureuse du tiers-mondisme et des groupes gauchistes qui s'en font les promoteurs, l'IS finit par faire des concessions à ce même tiers-mondisme : « Il est évidemment impossible de chercher, aujourd'hui, une solution révolutionnaire à la guerre du Vietnam. Il s'agit avant tout de mettre fin à l'agression américaine, pour laisser se développer, d'une façon naturelle, la véritable lutte sociale du Vietnam, c'est-à-dire de permettre aux travailleurs vietnamiens de retrouver leurs ennemis de l'intérieur : la bureaucratie du Nord et toutes les couches possédantes et dirigeantes du Sud. » (...) « Seul un mouvement révolutionnaire arabe résolument internationaliste et anti-étatiste, peut à la fois dissoudre l'Etat d'Israël et avoir pour lui la masse de ses exploités. Seul, par le même processus, il pourra dissoudre tous les Etats arabes existants et créer l'unification arabe par le pouvoir des Conseils » ([4] [58]).
En fait, les ambiguïtés dont ne s'est jamais départie l'IS, notamment sur cette question, permettent en partie d'expliquer le succès qu'elle a connu à un moment où les illusions tiers-mondistes étaient particulièrement fortes au sein de la classe ouvrière et surtout dans le milieu étudiant et intellectuel. Il ne s'agit pas de dire que l’IS a recruté ses adeptes sur la base de ses concessions au tiers-mondisme mais de considérer que si l’IS avait été parfaitement claire sur la question des prétendues « luttes de libération nationale », il est probable que beaucoup de ses admirateurs de l'époque se seraient détournés d'elle. ([5] [59])
Une autre raison du « succès » de l’IS dans le milieu des intellectuels et des étudiants consiste évidemment dans le fait qu'elle a adressé en priorité sa critique aux aspects idéologiques et culturels du capitalisme. Pour elle, la société actuelle est celle du « spectacle », ce qui est un nouveau terme pour désigner le capitalisme d'Etat, c'est-à-dire un phénomène spécifique de la période de décadence du capitalisme déjà analysé par les révolutionnaires : l'omniprésence de l'Etat capitaliste dans toutes les sphères du corps social, y compris dans la sphère culturelle. De même, si l’IS est très claire pour affirmer que seul le prolétariat constitue une force révolutionnaire dans la société actuelle, elle donne une définition de cette classe qui permet à la petite bourgeoisie intellectuelle révoltée de se considérer comme en faisant partie et donc d'être une force « subversive » : « Suivant la réalité qui s'esquisse actuellement, on pourra considérer comme prolétaires les gens qui n'ont aucune possibilité de modifier l'espace-temps social que la société leur alloue à consommer... » ([6] [60]). Et la vision typiquement petite-bourgeoise de l’IS sur cette question est confirmée par son analyse, proche de celle de Bakounine, du « lumpenproletariat » qui serait appelé à constituer une force pour la révolution puisque « ... le prolétariat nouveau tend à se définir négativement comme un "Front contre le travail forcé" dans lequel se trouvent réunis tous ceux qui résistent à la récupération par le pouvoir » ([7] [61]).
Ce qui plaît particulièrement aux éléments révoltés de « l'intelligentsia », ce sont les méthodes qu'emploie l’IS pour sa propagande : le sabotage spectaculaire des manifestations culturelles et artistiques ou le détournement de bandes dessinées et de photos-romans (par exemple, on fait dire à une pin up nue le slogan célèbre du mouvement ouvrier : « L'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes »). De même, les slogans situationnistes ont un franc succès dans cette couche sociale : « Vivre sans temps mort et jouir sans entrave », « Demandons l'impossible », « Il faut prendre ses désirs pour la réalité ». L'idée d'une mise en application immédiate des thèses situationnistes sur la « critique de la vie quotidienne » ne fait en réalité qu'exprimer l'immédiatisme d'une couche sociale sans avenir, la petite bourgeoisie. Enfin, une brochure écrite par un situationniste, en 1967 : De la misère en milieu étudiant, où les étudiants sont présentés comme les êtres les plus méprisés au monde avec les curés et les militaires, contribue à la notoriété de l’IS dans une couche de la population dont le masochisme est à la mesure de l'absence de tout rôle sur la scène sociale et historique.
Les événements de mai 1968 en France, c'est-à-dire le pays où l'IS a le plus d'écho, constituent une sorte d'apogée du mouvement situationniste : les slogans « situs » sont sur tous les murs ; dans les médias, « situationniste » est synonyme de « révolutionnaire radical » ; le premier Comité d'Occupation de la Sorbonne est composé en bonne partie de membres ou de sympathisants de l'IS. A cela, il n'est rien de surprenant. En effet, ces événements marquent à la fois les derniers feux des révoltes étudiantes qui avaient débuté en 1964, en Californie, et inaugurent, de façon magistrale, la reprise historique du prolétariat après 4 décennies de contre-révolution. La simultanéité des deux phénomènes et le fait que la répression de l’Etat contre la révolte étudiante a constitué le déclic d'un mouvement de grève massif dont les conditions avaient mûri avec les premières atteintes de la crise économique, a permis aux situationnistes d'exprimer les aspects les plus radicaux de cette révolte tout en ayant un certain impact sur certains des secteurs de la classe ouvrière qui commençaient à rejeter les structures bourgeoises d'encadrement que sont les syndicats ainsi que les partis de gauche et gauchistes.
Cependant, la reprise des combats de classe, qui a provoqué l'apparition et la floraison de toute une série de groupes révolutionnaires, dont notre propre organisation, a signé l'arrêt de mort de 1’IS. Elle s'avère incapable de comprendre la signification véritable des combats de 1968. En particulier, persuadée que c'est contre le « spectacle » que les ouvriers s'étaient dressés et non contre les premières atteintes d'une crise ouverte et sans issue de l'économie capitaliste, elle écrit stupidement: «L'éruption révolutionnaire n'est pas venue d'une crise économique... ce qui a été attaqué de front en Mai, c'est l'économie capitaliste FONCTIONNANT BIEN» ([8] [62]) ([9] [63]). Partant d'une telle vision, il n'est pas surprenant qu'elle puisse considérer, de façon totalement mégalomane, que: «L'agitation déclenchée en janvier 68 à Nanterre par quatre ou cinq révolutionnaires qui allaient constituer le groupe des enragés [influencé par les idées situationnistes], devait entraîner, sous cinq mois, une quasi liquidation de l'Etat » ([10] [64]) A partir de là, l’IS va entrer dans une période de crise qui va aboutir à sa dissolution en 1972.
C'est « par défaut » que 1’IS avait pu avoir un impact, avant et au cours des événements de 1968, sur les éléments Rapprochant vers les positions de classe, du fait de la disparition ou de la sclérose des courants communistes du passé au cours de la période de contre-révolution. Dès lors que s'étaient constituées, sur la lancée de 1968, des organisations se rattachant à l'expérience de ces courants, et alors que la révolte étudiante était morte, il n'existait plus de place pour l’IS. Son auto-dissolution était la conclusion logique de cette faillite, de la trajectoire d'un mouvement qui, en refusant de se rattacher fermement aux fractions communistes du passé, ne pouvait avoir un avenir. Le suicide de Guy Debord ([11] [65]) appartient probablement à cette même logique.
Fabienne.
[1] [66] IS n° 1, p.23, « Les situationnistes et l'automation », par Asger Jorn.
[2] [67] « La chute de Paris », IS n°4, page 9.
[3] [68] IS n° 10, page 21, mars 66
[4] [69] IS n° 11, « Deux guerres locales », pp. 21 -22
[5] [70] La meilleure preuve du manque de rigueur (pour ne pas dire plus) de l'IS sur cette question nous a été donnée par le fait que celui à qui elle avait confié le soin d'exposer ses thèses sur ce sujet (voir « Contributions servant à rectifier l'opinion du public sur la révolution dans les pays sous-développés », IS n° 11, pp. 38-40), Mustapha Khayati, s'est engagé peu après dans les rangs du Front Populaire Démocratique de Libération Palestinien sans que cela provoque son exclusion immédiate de l'IS, puisque c'est lui-même qui en a démissionné. A sa conférence de Venise, en septembre 1969, l'IS s'est contentée d'accepter cette démission avec l'argument qu'elle n'acceptait pas la « double appartenance ». En somme, que Khayati devienne membre d'un groupe conseilliste comme ICO ou bien qu'il s'enrôle dans une année bourgeoise (pourquoi pas dans la police, c'est la même chose), cela ne fait pas de différence pour l'IS.
[6] [71] IS n° 8, « Domination de la nature, idéologie et classes »
[7] [72] « Banalités de base », IS n° 8, page 42
[8] [73] Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations, René Viennet, p. 209.
[9] [74] Dans une polémique contre notre publication en France, l'IS écrit : « Quant aux débris du vieil ultra-gauchisme non trotskyste, il leur fallait au moins une crise économique majeure. Ils subordonnaient tout mouvement révolutionnaire à son retour, et ne voyaient rien venir. Maintenant qu'ils ont reconnu une crise révolutionnaire en mai, il leur faut prouver qu'il y avait donc là, au printemps 68, cette crise économique "invisible". Ils s'y emploient sans crainte du ridicule, en produisant des schémas sur la montée du chômage et des prix. Ainsi, pour eux, la crise économique n'est plus cette réalité objective, terriblement voyante, qui fut tant vécue et décrite jusqu'en 1929, mais une sorte de présence eucharistique qui soutient leur religion. » (IS n° 12, p. 6) Si cette crise était « invisible » pour l'IS, elle ne l'était pas pour notre courant puisque notre publication au Venezuela (la seule qui existait à l'époque), Internacionalismo, y avait consacré un article en janvier 1968, et l'histoire s'est chargée de donner raison au CCI sur la réalité de la crise du système capitaliste.
[10] [75] Ibidem, page 25
[11] [76] Si toutefois il s'est suicidé... Une autre hypothèse est toujours envisageable : son ami Gérard Lebovici a été assassiné en 1984.
Géographique:
- France [77]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [78]
Courants politiques:
Construction de l'organisation révolutionnaire : les 20 ans du Courant Communiste International.
- 10555 lectures
Il y a 20 ans, en janvier 1975, était constitué le Courant Communiste International. C'est une durée importante pour une organisation internationale du prolétariat si l'on pense que l'AIT n'avait vécu que 12 ans (1864-1876), l'Internationale Socialiste 25 ans (1889-1914) et l'Internationale Communiste 9 ans (1919-1928). Evidemment, nous ne prétendons pas que notre organisation ait joué un rôle comparable à celui des internationales ouvrières. Cependant, l'expérience des vingt années d'existence du CCI appartient pleinement au prolétariat dont notre organisation est une émanation au même titre que les internationales du passé et que les autres organisations qui défendent aujourd'hui les principes communistes. En ce sens, il est de notre devoir, et cet anniversaire nous en donne l'occasion, de livrer à notre classe quelques uns des enseignements que nous tirons de ces deux décennies de combat.
Lorsqu'on compare le CCI aux organisations qui ont marqué l'histoire du mouvement ouvrier, notamment les internationales, on peut être saisi d'un certain vertige : alors que des millions ou des dizaines de millions d'ouvriers appartenaient, ou étaient influencés par ces organisations, le CCI n'est connu de par le monde que par une infime minorité de la classe ouvrière. Cette situation, qui est aujourd'hui d'ailleurs le lot de toutes les autres organisations révolutionnaires, si elle doit nous inciter à la modestie, n'est pas pour nous, cependant, un motif de sous-estimation du travail que nous accomplissons, encore moins de découragement. L'expérience historique du prolétariat, depuis que cette classe est apparue comme un acteur de la scène sociale, il y a un siècle et demi, nous a montré que les périodes où les positions révolutionnaires ont exercé une réelle influence sur les masses ouvrières sont relativement réduites. C'est d'ailleurs en s'appuyant sur cette réalité que les idéologues de la bourgeoisie ont prétendu que la révolution prolétarienne est une pure utopie puisque la majorité des ouvriers ne croit pas qu'elle soit nécessaire ou possible. Mais ce phénomène, qui était déjà sensible lorsqu'il existait des partis ouvriers de masse, comme à la fin du siècle dernier et au début du 20e siècle, s'est encore amplifié après la défaite de la vague révolutionnaire qui a surgi au cours et à la suite de la première guerre mondiale.
Après que la classe ouvrière ait fait trembler la bourgeoisie mondiale, celle-ci a pris sa revanche en lui faisant subir la plus longue et profonde contre-révolution de son histoire. Et ce sont justement les organisations que la classe s'était données pour son combat, les syndicats ainsi que les partis socialistes et les partis communistes, qui ont constitué, en passant dans le camp bourgeois, le fer de lance de cette contre-révolution. Les partis socialistes, dans leur grande majorité, s'étaient déjà mis au service de la bourgeoisie lors de la guerre elle-même, appelant les ouvriers à « l’Union nationale », participant même, dans certains pays, aux gouvernements qui déchaînaient la boucherie impérialiste. Puis, quand la vague révolutionnaire s'est déployée, avec et à la suite de la révolution d'octobre 1917 en Russie, ces mêmes partis se sont faits les exécuteurs des hautes oeuvres de la bourgeoisie, soit en sabotant délibérément le mouvement, comme en Italie en 1920, soit en jouant directement le rôle de « chien sanglant », en prenant la direction du massacre des ouvriers et des révolutionnaires, comme en Allemagne en 1919. Par la suite, les partis communistes, constitués autour des fractions des PS qui avaient refusé de marcher dans la guerre impérialiste et qui avaient pris la tête de la vague révolutionnaire en se ralliant à l'Internationale Communiste (fondée en mars 1919), ont suivi le chemin de leurs prédécesseurs socialistes. Entraînés par la défaite de la révolution mondiale et par la dégénérescence de la révolution en Russie, ils ont rejoint au cours des années 1930 le camp capitaliste pour se faire, au nom de l'antifascisme et de la «défense de la Patrie socialiste », les meilleurs sergents recruteurs pour la seconde guerre mondiale. Principaux artisans des mouvements de « résistance » contre les armées occupantes d'Allemagne et du Japon, ils ont poursuivi leur sale besogne en encadrant férocement les prolétaires dans la reconstruction des économies capitalistes détruites.
Tout au cours de cette période, l'influence massive que pouvaient avoir les partis socialistes ou « communistes » sur la classe ouvrière était à la mesure de la chape idéologique qui étouffait la conscience des prolétaires saoulés de chauvinisme et qui, soit s'étaient détournés de toute perspective de renversement du capitalisme, soit étaient conduits à confondre cette perspective avec le renforcement de la démocratie bourgeoise, soit subissaient le mensonge suivant lequel les Etats capitalistes du bloc de l'Est étaient des incarnations du « socialisme ». Alors qu'il était « minuit dans le siècle », les forces réellement communistes qui avaient été chassées de l'Internationale communiste dégénérescente se sont retrouvées dans un isolement extrême, quand elles n'étaient pas, purement et simplement, exterminées par les agents staliniens ou fascistes de la contre-révolution. Dans les pires conditions de l'histoire du mouvement ouvrier, les quelques poignées de militants qui ont réussi à échapper au naufrage de l'IC ont poursuivi un travail de défense des principes communistes afin de préparer le futur resurgissement historique du prolétariat. Beaucoup y ont laissé leur vie ou s'y sont épuisés à tel point que leurs organisations, les fractions et groupes de la Gauche communiste, ont disparu ou bien ont été frappées de sclérose.
La terrible contre-révolution qui a écrasé la classe ouvrière après ses combats glorieux du premier après-guerre s'est prolongée pendant près de 40 ans. Mais lorsque les derniers feux de la reconstruction du second après-guerre se sont éteints et que le capitalisme a de nouveau été confronté à la crise ouverte de son économie, à la fin des années 1960, le prolétariat a redressé la tête. Mai 1968 en France, le « Mai rampant » de 1969 en Italie, les combats ouvriers de l'hiver 1970 en Pologne et toute une série de luttes ouvrières en Europe et sur d'autres continents : c'en était fini de la contre-révolution. Et la meilleure preuve de ce changement fondamental du cours historique a été le surgissement et le développement en de nombreux endroits du monde de groupes se rattachant, souvent de façon confuse, à la tradition et aux positions de la Gauche communiste. Le CCI s'est constitué en 1975 comme regroupement d'un certain nombre de ces formations que la reprise historique du prolétariat avait fait surgir. Le fait que, depuis cette date, le CCI non seulement se soit maintenu, mais qu'il se soit étendu, en doublant le nombre de ses sections territoriales, constitue la meilleure preuve de cette reprise historique du prolétariat, le meilleur indice que celui-ci n'ait pas été battu et que le cours historique reste toujours aux affrontements de classe. C'est là la première leçon qu'il s'agit de tirer de ces 20 ans d'existence du CCI ; en particulier contre l'idée partagée par beaucoup d'autres groupes de la Gauche communiste qui considèrent que le prolétariat n'est pas encore sorti de la contre-révolution.
Dans la Revue Internationale n° 40, à l'occasion du 10e anniversaire du CCI, nous avions déjà tiré un certain nombre d'enseignements de notre expérience au cours de cette première période. Nous ne les rappellerons que brièvement ici afin de souligner plus particulièrement ceux que nous tirons de la période qui a suivi. Cependant, avant de dresser un tel bilan, il faut revenir rapidement sur l'histoire du CCI. Et pour les lecteurs qui n'ont pu prendre connaissance de l'article d'il y a dix ans, nous en reproduisons ici de larges extraits qui traitent justement de cette histoire.
Revue Internationale n° 80
La constitution d'un pôle de regroupement international
La « préhistoire » du CCI
« La première expression organisée de notre courant a surgi au Venezuela en 1964. Elle consistait en un petit noyau d'éléments très jeunes qui ont commencé à évoluer vers les positions de classe à travers des discussions avec un camarade plus âgé [il s'agit du camarade Marc dont nous reparlerons plus loin] ayant derrière lui toute une expérience militante au sein de l'Internationale Communiste, dans les fractions de gauche qui en avaient été exclues à la fin des années 1920, et notamment dans la "Fraction de gauche du Parti Communiste d'Italie", et qui avait fait partie de la "Gauche Communiste de France" jusqu'à sa dissolution en 1952. D'emblée donc, ce petit groupe du Venezuela - qui, entre 1964 et 1968, a publié une dizaine de numéros de la revue Internacionalismo- s'est situé en continuité politique avec les positions qui avaient été celles de la Gauche communiste et notamment de la GCF. Cela s'est particulièrement exprimé par un rejet très net de toute politique de soutien aux prétendues "luttes de libération nationale" dont le mythe, dans ce pays d'Amérique latine, pesait très lourdement sur les éléments qui essayaient de s'approcher vers les positions de classe. Cela s'est exprimé également par une attitude d'ouverture et de contact vers les autres groupes communistes, attitude qui avait déjà caractérisé la Gauche Communiste Internationale avant la seconde guerre mondiale et la GCF après celle-ci. C'est ainsi que le groupe Internacionalismo a établi ou tenté d'établir des contacts et des discussions avec le groupe américain News and Letters... et, en Europe, avec toute une série de groupes se situant sur des positions de classe (...) Avec le départ de plusieurs de ses éléments vers la France en 1967 et 1968, ce groupe a interrompu pendant plusieurs années sa publication avant de reprendre Internacionalismo Nouvelle Série (en 1974) et d'être une partie constitutive du CCI en 1975.
La deuxième expression organisée de notre courant est apparue en France sur la lancée de la grève générale de mai 1968 qui marque le resurgissement historique du prolétariat mondial après plus de 40 ans de contre-révolution. Un petit noyau se forme à Toulouse autour d'un militant d’Internacionalismo, noyau qui participe activement dans les discussions animées du printemps 1968, adopte une déclaration de principes en juin et publie le premier numéro de la revue Révolution Internationale à la fin de la même année. Immédiatement, ce groupe reprend la politique d'Internacionalismo de recherche des contacts et discussions avec les autres groupes du milieu prolétarien tant au niveau national qu'international (...) A partir de 1970, il établira des liens plus étroits avec deux groupes qui surnagent au milieu de la décomposition générale du courant conseil liste qui a suivi mai 1968 : l’ "Organisation Conseil liste de Clermont-Ferrand" et les Cahiers du Communisme de Conseil (Marseille) après une tentative de discussion avec le "Groupe de Liaison pour l'Action des Travailleurs" (GLAT) qui avait fait apparaître que ce groupe s'éloignait de plus en plus du marxisme. La discussion avec les deux groupes précédents s'avérera par contre beaucoup plus fructueuse et, après toute une série de rencontres où ont été examinées de façon systématique les positions de base de la gauche communiste, aboutira à une unification en 1972 de RI de l' "Organisation Communiste de Clermont" et des Cahiers du Communisme de Conseil autour d'une plate-forme qui reprend de façon plus précise et détaillée la déclaration de principes de RI de 1968. Ce nouveau groupe va publier la revue Révolution Internationale (Nouvelle Série) ainsi qu'un Bulletin d'Etude et de Discussion et va constituer l'animateur du travail de contacts et discussions internationales en Europe, jusqu'à la fondation du CCI deux ans et demi plus tard.
Sur le continent américain, les discussions engagées par Internacionalismo avec News and Letters ont laissé des traces aux USA et, en 1970, se constitue à New York un groupe (dont font partie d'anciens militants de News and Letters...,) autour d'un texte d'orientation reprenant les mêmes positions fondamentales que Internacionalismo et RL Ce groupe commence la publication de la revue Internationalism et s'engage dans la même orientation que ses prédécesseurs d'établissement de discussions avec les autres groupes communistes. C'est ainsi qu'il maintient des contacts et discussions avec Root and Branch de Boston (qui est inspiré par les positions conseillistes de Paul Mattick) mais qui se révèlent infructueux, ce groupe évoluant de plus en plus vers un cénacle de marxologie. C'est ainsi surtout qu'en 1972, Internationalism envoie à une vingtaine de groupes une proposition de correspondance internationale dans les termes suivants :
(...) "Avec le réveil de la classe ouvrière, il y a eu un développement considérable de groupes révolutionnaires qui se revendiquent d'une perspective communiste internationaliste. Cependant, les contacts et la correspondance entre groupes ont été malheureusement négligés et laissés au hasard. C'est pourquoi Internationalism propose, en vue d'une régularisation et d'un élargissement de ces contacts, une correspondance suivie entre groupes se réclamant de cette perspective..."
Dans sa réponse positive RI précise : "Comme vous, nous sentons la nécessité de ce que les activités et la vie de nos groupes aient un caractère aussi international que les luttes actuelles de la classe ouvrière. C'est pour cette raison que nous avons entrepris des contacts épistolaires ou directs avec un certain nombre de groupes européens auxquels a été envoyée votre proposition (...) Nous pensons que votre initiative permettra d'élargir le champ de ces contacts et, tout au moins, de mieux connaître et faire connaître nos positions respectives. Nous pensons également que la perspective d'une éventuelle conférence internationale est la suite logique de cette correspondance (...)"
Par sa réponse RI soulignait donc la nécessité de s'acheminer vers la tenue de conférences internationales de groupes de la gauche communiste. Cette proposition se trouvait en continuité des propositions répétées (en 1968, 69 et 71) qui avaient été faites au "Partito Comunista Internazionalista" (Battaglia) d'appeler à de telles conférences dans la mesure où cette organisation était à l'époque en Europe la plus importante et sérieuse dans le camp de la Gauche Communiste (à côté du PC/-Programma qui, lui, se confortait dans son "splendide isolement". Mais ces propositions, en dépit de l'attitude ouverte et fraternelle de Battaglia, avaient été à chaque fois repoussées...
En fin de compte, l'initiative l’Internationalism et la proposition de RI devaient aboutir à la tenue, en 1973 et en 1974, d'une série de conférences et rencontres en Angleterre et en France au cours desquelles s'étaient opérées une clarification et une décantation qui se sont traduites notamment par une évolution vers les positions de Rl-Internationalism, du groupe anglais World Révolution (issu d'une scission de Solidarity London qui allait publier le premier numéro de sa revue en mai 1974. Cette clarification et cette décantation avaient également et surtout créé les bases qui allaient permettre la constitution du CCI en janvier 1975. Pendant cette même période, en effet, RI avait poursuivi son travail de contacts et discussions au niveau international, non seulement avec des groupes organisés mais également avec des éléments isolés, lecteurs de sa presse et sympathisant avec ses positions. Ce travail avait conduit à la constitution de petits noyaux en Espagne et en Italie autour de ces mêmes positions et qui, en 1974, ont commencé la publication de Action Proletaria et Rivoluzione Internazionale.
Ainsi, à la conférence de janvier 1975, étaient présents Internacionalismo, Révolution Internationale, Internationalism, World Révolution, Accion Proletaria et Rivoluzione Internazionale partageant les orientations politiques développées à partir de 1964 par Internacionalismo. Etaient également présents Revolutionary Perpectives (qui avait participé aux conférences de 1973-74), le "Revolutionary Workers Group" de Chicago (avec qui RI et Internationalism avaient engagé des discussions en 1974) et "Pour une Intervention Communiste" (qui publiait la revue Jeune Taupe et était constitué de camarades ayant quitté RI en 1973...). Quant au groupe Workers Voice qui avait participé activement aux conférences des années précédentes, il avait rejeté l'invitation à cette conférence car il estimait désormais que RI, WR, etc. étaient des groupes bourgeois (sic) à cause de la position de la majorité de leurs militants (...) sur la question de l'Etat dans la période de transition du capitalisme au communisme. Cette question figurait d'ailleurs à l'ordre du jour de la conférence de janvier 1975... Cependant, elle n'y fut pas discutée, la conférence préférant consacrer un maximum de temps et d'attention à des questions beaucoup plus cruciales à ce moment là :
- l'analyse de la situation internationale ;
- les tâches des révolutionnaires dans celle-ci ;
- l'organisation dans le courant international.
Finalement, les six groupes dont les plates-formes étaient basées sur les mêmes orientations décidaient de s'unifier en une organisation unique dotée d'un organe central international et publiant une revue trimestrielle en trois langues anglais, français et espagnol (...) qui prenait la relève du Bulletin d'Etude et de Discussion de RI. Le CCI était fondé. Comme l'écrivait la présentation du n° 1 de la Revue Internationale "Un grand pas vient d'être fait". En effet, la fondation du CCI constituait l'aboutissement d'un travail considérable de contacts, de discussions, de confrontations entre les différents groupes que la reprise historique des combats de classe avait fait surgir... Mais surtout, elle jetait les bases pour un travail bien plus considérable encore. »
Les dix premières années : la consolidation du pôle international
« Ce travail, les lecteurs de la Revue Internationale (ainsi que de notre presse territoriale) ont pu le constater depuis 10 ans et vient confirmer ce que nous écrivions dans la présentation du numéro 1 de la Revue : "D'aucuns pensent que c'est là [la constitution du CCI et la publication de la Revue] une action précipitée. Rien de tel. On nous connaît assez pour savoir que nous n'avons rien de ces braillards activistes dont l'activité ne repose que sur un volontarisme aussi effréné qu'éphémère." ([1] [80]) (...) Tout au long de ses dix années d'existence, le CCI a évidemment rencontré de nombreuses difficultés, a dû surmonter de nombreuses faiblesses, dont la plupart étaient liées à la rupture d'une continuité organique avec les organisations communistes du passé, à la disparition ou à la sclérose des fractions de gauche qui s'étaient détachées de l'Internationale Communiste lors de sa dégénérescence. Il a également dû combattre l'influence délétère de la décomposition et de la révolte des couches de la petite bourgeoisie intellectuelle, influence particulièrement sensible après 1968, à la suite des mouvements estudiantins. Ces difficultés et faiblesses se sont par exemple traduites par plusieurs scissions (dont nous avons rendu compte dans notre presse) et par des soubresauts importants en 1981, en même temps que l'ensemble du milieu révolutionnaire et qui ont notamment abouti à la perte de la moitié de notre section en Grande-Bretagne. Face à ses difficultés de 1981, le CCI a même été conduit à organiser une conférence extraordinaire en janvier 1982 en vue de réaffirmer et de préciser ses bases programmatiques, en particulier sur la fonction et la structure de l'organisation révolutionnaire. De même, certains des objectifs que s'était fixés le CCI n'ont pu être atteints. C'est ainsi que la diffusion de notre presse est restée en deçà de nos espérances. (...)
Cependant, s'il nous faut faire un bilan global de ces 10 années, il faut affirmer qu'il est nettement positif. Il est particulièrement positif si on le compare à celui des autres organisations communistes qui existaient au lendemain de 1968. Ainsi, les groupes du courant conseilliste, même ceux qui avaient fait un effort pour s'ouvrir au travail international, comme ICO, ont soit disparu, soit sombré dans la léthargie : le GLAT, ICO, l'Internationale Situationniste, le Spartacusbond, Root and Branch, le PIC, les groupes conseillistes du milieu Scandinave, la liste est longue (et non exhaustive) ... Quant aux organisations se rattachant à la gauche italienne et qui, toutes, s'auto-proclamaient LE PARTI, soit elles ne sont pas sorties de leur provincialisme, soit elles se sont disloquées ou ont dégénéré en groupes gauchistes, tel Programme Communiste ([2] [81]), soit elles en sont aujourd'hui encore à imiter ce que le CCI a réalisé il y a dix ans, et ceci de façon poussive et dans la confusion comme c'est le cas de Battaglia Comunista et de la CWO (avec le BIPR). Aujourd'hui, après l'effondrement comme un château de cartes du (prétendu) Parti Communiste International, après les échecs du FOR... aux USA (Focus), le CCI reste la seule organisation communiste vraiment implantée au niveau international.
Depuis sa fondation en 1975, le CCI non seulement a renforcé ses sections territoriales d'origine, mais il s'est implanté dans d'autres pays. La poursuite du travail de contacts et de discussions à l'échelle internationale, l'effort de regroupement des révolutionnaires ont permis l'établissement de nouvelles sections du CCI : -1975, constitution de la section en Belgique qui publie en deux langues la revue, puis le journal Internationalisme et qui comble le vide laissé par la disparition, au lendemain de la seconde guerre, de la Fraction Belge de la Gauche Communiste Internationale.
-1977, constitution du noyau aux Pays-Bas qui entreprend la publication de la revue Wereld Revolutie ; c'est un événement de premier plan dans ce pays qui fut la terre d'élection du conseillisme.
-1978, constitution de la section en Allemagne qui commence la publication de la Revue Internationale en langue allemande et l'année suivante de la revue territoriale Weltrevolution ; la présence d'une organisation communiste en Allemagne est évidemment de la plus haute importance compte tenu de la place prise par le prolétariat de ce pays dans le passé et qu'il prendra dans l'avenir.
- 1980, constitution de la section en Suède qui publie la revue Internationell Révolution (...).
Si nous soulignons le contraste entre la relative réussite de l'activité de notre courant et l'échec des autres organisations c'est parce que cela met en évidence la validité des orientations qui furent les nôtres depuis 20 ans (1964) dans le travail de regroupement des révolutionnaires, de construction d'une organisation communiste, orientations qu'il est de notre responsabilité de dégager pour l'ensemble du milieu communiste (...) »
Les principales leçons des dix premières années
« Les bases sur lesquelles s'est appuyé, dès avant sa constitution formelle, notre courant dans son travail de regroupement ne sont pas nouvelles. Elles ont toujours, par le passé, constitué les piliers de ce type de travail. On peut les résumer ainsi :
- la nécessité de rattacher l'activité révolutionnaire aux acquis passés de la classe, à l'expérience des organisations communistes qui ont précédé, de concevoir l'organisation présente comme un maillon de toute une chaîne d'organismes passés et futurs de la classe ;
- la nécessité de concevoir les positions et analyses communistes, non comme un dogme mort, mais comme un programme vivant, en constant enrichissement et approfondissement ;
- la nécessité d'être armés d'une conception claire et solide sur l'organisation révolutionnaire, sur sa structure et sa fonction au sein de la classe. »
Ces enseignements que nous tirions il y a déjà dix ans (et qui étaient plus développés dans la Revue Internationale n° 40 à laquelle nous recommandons à nos lecteurs de se reporter) restent évidemment toujours valables et notre organisation a veillé en permanence à les mettre en pratique. Cependant, alors que sa tâche centrale au cours de sa première décennie d'existence était de construire un pôle de regroupement international des forces révolutionnaires, sa responsabilité essentielle, dans la période qui a suivi, a consisté à faire face à toute une série d'épreuves (à « l'épreuve du feu », en quelque sorte) découlant en particulier des bouleversements qui allaient se produire sur la scène internationale.
L'épreuve du feu
Ainsi, lors du 6e congrès du CCI, qui s'est tenu en novembre 1985, quelques mois après les dix ans du CCI, nous disions : « A la veille des années 1980, le CCI a désigné celles-ci comme les "années de vérité", celles où les enjeux majeurs de toute la société allaient clairement se révéler dans leur formidable ampleur. A la moitié de cette décennie, l'évolution de la situation internationale a pleinement confirmé cette analyse :
-par une nouvelle aggravation des convulsions de l'économie mondiale qui se manifeste dès le début des années 1980 par la récession la plus importante depuis celle des années 1930; - par une intensification des tensions entre blocs impérialistes qui se révèle notamment durant ces mêmes années, tant par un bond considérable des dépenses militaires que par le développement d'assourdissantes campagnes bellicistes dont s'est fait le chantre Reagan, chef de fie du bloc le plus puissant; - par la reprise, dans la seconde moitié de 1983, des combats de classe après leur repli momentané de 1981 à 1983 à la veille et à la suite de la répression des ouvriers de Pologne, reprise qui se caractérise, en particulier, par une simultanéité des combats sans exemple par le passé, notamment dans les centres vitaux du capitalisme et de la classe ouvrière en Europe occidentale" (Résolution sur la situation internationale, Revue internationale n° 44, page 9).
Ce cadre s'est révélé valable jusqu'à la fin des années 1980, même si, évidemment, la bourgeoisie s'est fait, pendant un temps, un devoir de présenter la « reprise » de 1983 à 1990, basée sur un formidable endettement de la première puissance mondiale, comme une « sortie définitive » de la crise. Les faits sont têtus, comme disait Lénine, et depuis le début des aimées 1990, les tricheries capitalistes ont débouché sur une récession ouverte encore plus longue et brutale que les précédentes et qui est venue transformer l'euphorie du bourgeois moyen en une profonde morosité.
De même, la vague des luttes ouvrières ouverte en 1983 s'est poursuivie, avec des moments de répit et des moments de plus grande intensité jusqu'en 1989, obligeant notamment la bourgeoisie à mettre en avant des formes variées du syndicalisme de base (telles les coordinations) afin de suppléer au discrédit croissant des structures syndicales officielles.
Cependant, il est un des aspects de ce cadre qui a été radicalement remis en cause en 1989 : celui des conflits impérialistes, non pas que la théorie marxiste ait été brusquement mise en défaut par leur « dépassement », mais parce qu'un des deux principaux protagonistes de ces conflits, le bloc de l'Est, s'est brutalement effondré. Ce que nous avions appelé les « années de vérité » ont été fatales à un régime aberrant établi sur les ruines de la révolution de 1917 et au bloc sur lequel il imposait son emprise. Un événement historique d'une telle ampleur, qui a bouleversé la carte du monde, a créé une situation nouvelle, inédite dans l'histoire, dans le domaine des conflits impérialistes. Ceux-ci n'ont pas disparu, mais ils ont pris des formes inconnues jusqu'à présent que les révolutionnaires avaient le devoir de comprendre et d'analyser.
En même temps, ces bouleversements qui affectaient les pays qui se présentaient comme « socialistes » ont porté un coup très dur à la conscience et à la combativité de la classe ouvrière internationale laquelle a dû faire face au recul le plus important depuis sa reprise historique de la fin des années 1960.
Ainsi, la situation internationale depuis dix ans a imposé au CCI de faire face aux défis suivants :
- être partie prenante des combats de classe qui se sont déroulés entre 1983 et 1989 ;
-comprendre la nature des événements de 1989 et les conséquences qu'ils allaient avoir, tant dans le domaine des conflits impérialistes que dans celui de la lutte de classe ;
-plus généralement, élaborer un cadre de compréhension de la période de la vie du capitalisme dont l'effondrement du bloc de l'Est a constitué la première grande manifestation.
Etre partie prenante des combats de classe
A la suite du 6e congrès de la section en France (la plus importante du CCI) tenu en 1984, le 6e congrès du CCI a inscrit cette préoccupation au centre de son ordre du jour. Cependant, l'effort que faisait notre organisation internationale depuis plusieurs mois pour se porter à la hauteur de ses responsabilités face à la classe s'était heurté, dès le début de 1984, à la survivance, en notre sein, de conceptions qui sous-estimaient la fonction de l'organisation des révolutionnaires comme facteur actif du combat prolétarien. Le CCI a identifié ces conceptions comme participant de glissements centristes vers le conseillisme résultant, pour une bonne partie, des conditions historiques qui avaient présidé à sa constitution alors qu'il existait, parmi les groupes et éléments qui avaient participé à celle-ci une forte méfiance envers tout ce qui pouvait ressembler au stalinisme. Dans la lignée du conseillisme, ces éléments avaient tendance à mettre sur un même plan le stalinisme, les conceptions de Lénine en matière d'organisation et l'idée même du parti prolétarien. Dans les années 1970, le CCI avait fait la critique des conceptions conseillistes, mais de façon encore insuffisante, si bien qu'elles continuaient de peser sur certaines parties de l'organisation. Lorsque le combat contre les vestiges de conseillisme a débuté, à la fin de 1983, un certain nombre de camarades ont refusé de voir la réalité de leurs faiblesses conseillistes s'imaginant que le CCI était en train de mener une « chasse aux sorcières ». Pour esquiver le problème qui était posé, celui de leur centrisme envers le conseillisme, ils ont fait la « découverte » que le centrisme ne pouvait plus exister dans la période de décadence du capitalisme ([3] [82]). A ces incompréhensions politiques, il s'ajoutait de la part de ces camarades, dont la plupart étaient des intellectuels peu préparés à subir la critique, un sentiment d'orgueil blessé ainsi que de « solidarité » envers leurs amis qu'ils estimaient injustement « attaqués ». C'était une sorte de « remake » du 2e congrès du POSDR, comme nous le faisions apparaître dans la Revue Internationale n° 45, où le centrisme en matière d'organisation et le poids de l'esprit de cercle, dans lequel les liens affinitaires priment sur les liens politiques, avaient conduit à la scission des mencheviks. La « tendance » qui s'est formée au début de 1985 allait suivre le même chemin pour scissionner lors du 6e Congrès du CCI et constituer une nouvelle organisation, la « Fraction Externe du CCI » (FECCI). Cependant, il existe une différence majeure entre la fraction des mencheviks et la FECCI puisque si la première allait prospérer en rassemblant les courants les plus opportunistes de la social-démocratie Russe pour finir dans le camp de la bourgeoisie, la FECCI, pour sa part, s'est contentée de jouer un rôle de parasite, consacrant l'essentiel de ses énergies à discréditer les positions et les organisations communistes sans être capable de regrouper autour d'elle. Pour finir, la FECCI a rejeté la plate-forme du CCI alors qu'elle expliquait, au moment de sa constitution, qu'elle se donnait comme tâche principale de défendre cette plateforme que le CCI, « dégénérescent » à ses dires, était en train de trahir.
En même temps que le CCI menait le combat en son sein contre les vestiges de conseillisme, il participait activement aux combats de la classe ouvrière comme notre presse territoriale en a rendu compte régulièrement au cours de cette période. Malgré ses faibles forces, notre organisation était présente dans les différentes luttes. Non seulement elle y a diffusé sa presse et des tracts, mais elle a participé directement, chaque fois que c'était possible, aux assemblées ouvrières pour y défendre la nécessité de l'extension des luttes et de leur prise en main par les ouvriers en dehors des différentes formes de syndicalisme, syndicalisme « officiel » ou syndicalisme « de base ». Ainsi, en Italie, lors de la grève de l'école de 1987, l'intervention de nos camarades avait eu un impact non négligeable dans les COBAS (Comités de Base) où ils étaient présents, avant que ces organismes, avec le reflux du mouvement, ne soient récupérés par le syndicalisme de base.
Au cours de cette période, un des meilleurs indices du début d'impact que nos positions commençaient à rencontrer parmi les ouvriers consistait dans le fait que le CCI était devenu une sorte de « bête noire » pour certains groupes gauchistes. Ce fut particulièrement le cas en France où, lors de la grève des chemins de fer de la fin 1986 et lors de la grève des hôpitaux de l'automne 1988, le groupe trotskiste « Lutte Ouvrière » avait mobilisé ses « gros bras » pour empêcher nos militants d'intervenir lors des assemblées convoquées par les « coordinations ». En même temps, les militants du CCI ont participé activement -et souvent ils en étaient les animateurs - à plusieurs comités de lutte rassemblant les travailleurs qui ressentaient la nécessité de se regrouper en dehors des syndicats pour pousser en avant le combat.
Il ne s'agit évidemment pas de « gonfler » l'impact que les révolutionnaires, et notre organisation en particulier, ont pu avoir sur les luttes ouvrières entre 1983 et 1989. Globalement, le mouvement est resté prisonnier du syndicalisme, ses variantes « de base » venant prendre le relais des syndicats officiels là où ils étaient trop discrédités. Notre impact est resté très ponctuel et était de toutes façons limité par le fait que nos forces sont encore très réduites. Mais s'il est une leçon que nous devons tirer de cette expérience, c'est que, au moment où se développent les luttes, les révolutionnaires rencontrent un écho là où ils sont présents car les positions qu'ils défendent et les perspectives qu'ils mettent en avant apportent une réponse aux questions que se posent les ouvriers. Et pour cela, ils n'ont nullement besoin de « cacher leur drapeau », de faire la moindre concession aux illusions qui peuvent encore peser sur la conscience des ouvriers, en particulier concernant le syndicalisme. C'est un enseignement qui vaut pour tous les groupes révolutionnaires qui, souvent, restent paralysés face aux luttes parce que celles-ci ne se posent pas encore la question du renversement du capitalisme, ou bien qui se croient obligés, pour « se faire entendre », de travailler dans les structures du syndicalisme de base, apportant par ce fait leur caution à ces organismes capitalistes.
Comprendre la nature des événements de 1989
Autant il est de la responsabilité des révolutionnaires d'être présents « sur le terrain » au moment des luttes ouvrières, autant il leur revient d'être capables, à chaque instant, de donner à l'ensemble de la classe ouvrière un cadre d'analyse clair des événements qui se déroulent dans le monde.
Cette tâche concerne au premier chef la compréhension des contradictions économiques qui affectent le système capitaliste : les groupes révolutionnaires qui n'ont pas été capables de mettre en évidence le caractère insoluble de la crise dans laquelle est plongé ce système, montrant par là qu'ils n'avaient pas compris le marxisme dont pourtant ils se revendiquent, n'ont été d'aucune utilité pour la classe ouvrière. Ce fut le cas, par exemple, d'un groupe comme le « Ferment Ouvrier Révolutionnaire » qui s'est même refusé à reconnaître qu'il y avait une crise. Les yeux braqués sur les caractéristiques spécifiques de la crise de 1929, il a nié l'évidence pendant des années... jusqu'à en disparaître.
Il appartient aussi aux révolutionnaires d'être en mesure d'évaluer les différents pas qu'accomplit le mouvement de la classe, de reconnaître ses moments d'avancée comme aussi ses moments de recul. C'est un tâche qui conditionne étroitement le type d'intervention qu'ils mènent parmi les ouvriers puisque leur responsabilité, lorsque le mouvement va de l'avant, est de pousser celui-ci le plus loin possible et, en particulier, d'appeler à son extension, alors qu'aux moments de repli, appeler à la lutte revient à pousser les ouvriers à se battre dans l'isolement et appeler à l'extension contribue à l'extension... de la défaite. C'est d'ailleurs souvent à ce moment-là que les syndicats appellent, pour leur part, à l'extension.
Enfin, le suivi et la compréhension des différents conflits impérialistes constituent aussi une responsabilité de premier ordre des communistes. Une erreur dans ce domaine peut avoir des conséquences dramatiques. Ainsi, à la fin des années 1930, la majorité de la Fraction communiste italienne, avec à sa tête son principal animateur, Vercesi, considère que les différentes guerres de l'époque, notamment la guerre d'Espagne, n'augurent en aucune façon un conflit généralisé. L'éclatement de la guerre mondiale, en septembre 1939, laissera la Fraction complètement désemparée et il faudra deux années pour qu'elle puisse se reconstituer, dans le sud de la France, et reprendre un travail militant.
Pour ce qui concerne la période actuelle, il était de la plus grande importance de comprendre clairement la nature des événements qui se sont déroulés au cours de l'été et de l'automne 1989 dans les pays du bloc de l'Est. Pour sa part, dès l'arrivée de Solidarnosc au gouvernement en Pologne, en plein coeur de l'été, dans une période où habituellement « l'actualité est en vacances », le CCI se mobilise pour comprendre cet événement ([4] [83]). Il adopte la position que ce qui se passe en Pologne signe l'entrée de l'ensemble des régimes staliniens d'Europe dans une crise sans commune mesure avec les précédentes : « La perspective pour l'ensemble des régimes staliniens n'est... nullement celle d'une "démocratisation pacifique" ni d'un "redressement" de l'économie. Avec l'aggravation de la crise mondiale du capitalisme, ces pays sont entrés dans une période de convulsions d'une ampleur inconnue dans leur passé pourtant déjà "riche" de soubresauts violents. » (Revue Internationale n° 59, « Convulsions capitalistes et luttes ouvrières»). Cette idée est développée dans des « Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est» rédigées dès le 15 septembre (près de 2 mois avant la chute du mur de Berlin) et adoptées début octobre par le CCI. Dans ces thèses ont peut lire (voir la Revue Internationale n° 60) :
« ... dans la mesure même où le facteur pratiquement unique de cohésion du bloc russe est la force armée, toute politique tendant à faire passer au second plan ce facteur porte avec elle l'éclatement du bloc. Dès à présent, le bloc de l'Est nous présente le tableau d'une dislocation croissante... Dans cette zone, les forces centrifuges sont tellement fortes qu'elles se déchaînent dès qu'on leur en laisse l'occasion. (...)
C'est un phénomène similaire qu'on retrouve dans les républiques périphériques de l'URSS... Les mouvements nationalistes qui, à la faveur du relâchement du contrôle central du parti russe, s'y développent aujourd'hui... portent avec eux une dynamique de séparation d'avec la Russie. » (Point 18) « ... quelle que soit l'évolution future de la situation dans les pays de l'Est, les événements qui les agitent actuellement signent la crise historique, l'effondrement définitif du stalinisme... Dans ces pays s'est ouverte une période d'instabilité, de secousses, de convulsions, de chaos sans précédent dont les implications dépasseront très largement leurs frontières. En particulier, l'effondrement qui va encore s'accentuer du bloc russe ouvre les portes à une déstabilisation du système de relations internationales, des constellations impérialistes qui étaient sorties de la seconde guerre mondiale avec les accords de Yalta. » (point 20)
Quelques mois plus tard (janvier 1990), cette dernière idée est précisée dans les termes suivants :
« La configuration géopolitique sur laquelle a vécu le monde depuis la seconde guerre mondiale est désormais complètement remise en cause par les événements qui se sont déroulés au cours de la seconde moitié de l'année 1989. Il n'existe plus aujourd'hui deux blocs impérialistes se partageant la mainmise sur la planète. Le bloc de l'Est, c'est une évidence (...) a cessé d'exister. (...) Cette disparition du bloc de l'Est signifie-t-elle que, désormais, le monde sera dominé par un seul bloc impérialiste ou que le capitalisme ne connaîtra plus d'affrontements impérialistes ? De telles hypothèses seraient tout à fait étrangères au marxisme. (...) Aujourd'hui, l'effondrement de ce bloc ne saurait remettre en selle ce genre d'analyses : cet effondrement porte avec lui, à terme, celui du bloc occidental. (...) La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux "partenaires" d'hier, ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l'heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial... En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d'être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible...
La disparition des deux constellations impérialistes qui étaient sorties de la seconde guerre mondiale porte, avec elle, la tendance à la recomposition de deux nouveaux blocs. Cependant, une telle situation n'est pas encore à l'ordre du jour... » (Revue Internationale n°61, «Après l'effondrement du bloc de l'Est, déstabilisation et chaos »)
Les événements qui se sont déroulés par la suite, en particulier la crise et la guerre du Golfe en 1990-91 ([5] [84]), sont venus confirmer notre analyse. Aujourd'hui, l'ensemble de la situation mondiale, notamment ce qui se passe dans l'ex-Yougoslavie, fait la preuve plus qu'évidente de la disparition complète de tout bloc impérialiste en même temps que certains pays d'Europe, notamment la France et l'Allemagne, essayent péniblement d'impulser la reconstitution d'un nouveau bloc, basé sur l'Union Européenne, qui pourrait tenir tête à la puissance américaine.
Pour ce qui concerne l'évolution de la lutte de classe, les « thèses » de l'été 1989 se prononçaient également dessus : « Même dans sa mort, le stalinisme rend un dernier service à la domination capitaliste : en se décomposant, son cadavre continue encore à polluer l'atmosphère que respire le prolétariat... C'est donc à un recul momentané de la conscience du prolétariat... qu'il faut s'attendre... En particulier, l'idéologie réformiste pèsera très fortement sur les luttes de la période qui vient, favorisant grandement l'action des syndicats... Compte tenu de l'importance historique des faits qui le déterminent, le recul actuel du prolétariat, bien qu'il ne remette pas en cause le cours historique, la perspective générale aux affrontements de classe, se présente comme bien plus profond que celui qui avait accompagné la défaite de 1981 en Pologne » (point 22)
Là aussi, les cinq dernières années ont amplement confirmé cette prévision. Depuis 1989, nous avons assisté au recul le plus important de la classe ouvrière depuis son surgissement historique, à la fin des années 1960. C'est une situation à laquelle les révolutionnaires devaient être préparés afin de pouvoir y adapter leur intervention et, surtout, ne pas «jeter l'enfant avec Veau du bain » en considérant que ce long recul remettait en cause de façon définitive la capacité du prolétariat à mener et développer ses combats contre le capitalisme. En particulier, les manifestations de regain de la combativité ouvrière, notamment à l'automne 1992 en Italie et à l'automne 1993 en Allemagne (voir la Revue Internationale n° 72 et n° 75) ne devaient être ni surestimées (compte tenu de la profondeur du recul prolétarien) ni sous-estimées en ce qu'elles constituent les signes avant-coureurs d'une reprise inévitable des combats et du développement de la conscience de la classe dans tous les pays industrialisés.
Le marxisme est une méthode scientifique. Cependant, à l'opposé des sciences de la nature, il ne peut vérifier la validité de ses thèses en les soumettant à l'expérience de laboratoire ou en faisant appel à des moyens d'observation plus puissants. Son « laboratoire », c'est la réalité sociale, et il démontre sa validité en étant capable de prévoir l'évolution de celle-ci. Ainsi, le fait que le CCI ait été capable de prévoir, dès les premiers symptômes de l'effondrement du bloc de l'Est, les principaux événements qui allaient bouleverser le monde depuis 5 ans n'est pas à considérer comme une aptitude particulière à lire dans le marc de café où à interpréter la configuration des astres. C'est tout simplement la preuve de son attachement à la méthode marxiste, et c'est donc à celle-ci qu'il faut attribuer le succès de nos prévisions.
Cela dit, il ne suffit pas de se réclamer du marxisme pour être capable de l'utiliser efficacement. En fait, notre capacité à comprendre rapidement les enjeux de la situation mondiale découlait de la mise en application de la même méthode que nous avions reprise de Bilan et dont soulignions il y a déjà dix ans qu'elle était un des enseignements principaux de notre propre expérience : la nécessité de se rattacher fermement aux acquis du passé, la nécessité de concevoir les positions et analyses communistes, non comme un dogme mort mais comme un programme vivant.
Ainsi, les thèses de 1989 commencent par rappeler, dans les dix premiers points, quel est le cadre que s'était donné notre organisation au début des années 1980, à la suite des événements de Pologne, pour la compréhension des caractéristiques des pays et du bloc de l'Est. C'est à partir de cette analyse que nous avons été en mesure de mettre en évidence que c'en était fini des régimes staliniens d'Europe et du bloc de l'Est. Et c'est en nous appuyant sur un acquis encore plus ancien du mouvement ouvrier (notamment mis en évidence par Lénine contre Kautsky) : il ne peut exister un seul bloc impérialiste, que nous avons annoncé que l'effondrement du bloc de l'Est ouvrait la porte à la disparition du bloc occidental.
De même, il nous fallait, pour comprendre ce qui était en train de se passer, remettre en cause le schéma qui avait été valable pendant plus de quarante ans : le partage du monde entre le bloc occidental dirigé par les Etats-Unis et le bloc de l'Est dirigé par 1’URSS. Il nous fallait également être en mesure de considérer que ce dernier pays, progressivement constitué depuis Pierre le Grand, ne survivrait pas à l'effondrement de son empire. Encore une fois, nous n'avons aucun mérite particulier d'avoir fait preuve de la capacité à remettre en cause les schémas du passé. Cette démarche, nous ne l'avons pas inventée. Elle nous a été enseignée par l'expérience vivante du mouvement ouvrier et particulièrement par ses principaux combattants : Marx, Engels, Rosa Luxemburg, Lénine...
Enfin, la compréhension des bouleversements de la fin des années 1980 devait être replacée dans une analyse générale de l'étape actuelle de la décadence du capitalisme.
Le cadre de compréhension de la période présente du capitalisme
C'est ce travail que nous avions commencé à faire depuis 1986 en indiquant que nous étions entrés dans une phase nouvelle de la décadence capitaliste, celle de la décomposition de ce système. Cette analyse a été précisée au début de 1989 dans les termes suivants :
« Jusqu'à présent, les combats de classe qui, depuis vingt ans, se sont développés sur tous les continents, ont été capables d'empêcher le capitalisme décadent d'apporter sa propre réponse à l'impasse de son économie : le déchaînement de la folie ultime de sa barbarie, une nouvelle guerre mondiale. Pour autant, la classe ouvrière n'est pas encore en mesure d'affirmer, par des luttes révolutionnaires, sa propre perspective ni même de présenter, au reste de la société ce futur qu'elle porte en elle. C'est justement cette situation d'impasse momentanée, où, à l'heure actuelle, ni l'alternative bourgeoise, ni l'alternative prolétarienne ne peuvent s'affirmer ouvertement, qui est à l'origine de ce phénomène de pourrissement sur pied de la société capitaliste, qui explique le degré particulier et extrême atteint aujourd'hui par la barbarie propre à la décadence de ce système. Et ce pourrissement est amené à s'amplifier encore avec l'aggravation inexorable de la crise économique. » (Revue Internationale n° 57, « La décomposition du capitalisme »)
Evidemment, dès que s'est annoncé l'effondrement du bloc de l'Est, nous avons replacé un tel événement dans ce cadre de la décomposition :
«En réalité, l'effondrement actuel du bloc de l'Est constitue une des manifestations de la décomposition générale de la société capitaliste dont l'origine se trouve... dans l'incapacité pour la bourgeoisie d'apporter sa propre réponse, la guerre généralisée, à la crise ouverte de l'économie mondiale. » (Revue Internationale n° 60, « Thèses... », point 20)
De même, en janvier 1990, nous avons dégagé les implications pour le prolétariat de la phase de décomposition et de la nouvelle configuration de l'arène impérialiste : « Dans un tel contexte de perte de contrôle de la situation par la bourgeoisie mondiale, il n'est pas dit que les secteurs dominants de celle-ci soient aujourd'hui en mesure de mettre en oeuvre l'organisation et la discipline nécessaires à la reconstitution de blocs militaires. (...) C'est pour cela qu'il est fondamental de mettre en évidence que, si la solution du prolétariat - la révolution communiste - est la seule qui puisse s'opposer à la destruction de l'humanité (qui constitue la seule "réponse" que la bourgeoisie puisse apporter à sa crise), cette destruction ne résulterait pas nécessairement d'une troisième guerre mondiale. Elle pourrait également résulter de la poursuite, jusqu 'à ses conséquences extrêmes (catastrophes écologiques, épidémies, famines, guerres locales déchaînées, etc.) de cette décomposition. (...) la poursuite et l'aggravation du phénomène de pourrissement de la société capitaliste exercera, encore plus qu'au cours des années 1980, ses effets nocifs sur la conscience de la classe. Par l'ambiance générale de désespoir qui pèse sur toute la société, par la décomposition même de l'idéologie bourgeoise dont les émanations putrides viennent empoisonner l'atmosphère que respire le prolétariat, ce phénomène va constituer pour lui, jusqu'à la période prérévolutionnaire, une difficulté supplémentaire sur le chemin de sa prise de conscience. » (Revue Internationale n°61, « Après l'effondrement du bloc de l'Est, déstabilisation et chaos »)
Ainsi, notre analyse sur la décomposition nous permet de mettre en évidence l'extrême gravité des enjeux de la situation historique présente. En particulier, elle nous conduit à souligner que le chemin du prolétariat vers la révolution communiste sera beaucoup plus difficile que les révolutionnaires n'avaient pu le prévoir dans le passé. C'est là aussi un autre enseignement qu'il s'agit de tirer de l'expérience du CCI au cours des dix dernières années et qui rejoint une préoccupation mise en avant par Marx au milieu du siècle dernier : les révolutionnaires n'ont pas pour rôle de consoler la classe ouvrière mais au contraire de souligner aussi bien l'absolue nécessité de son combat historique que la difficulté de celui-ci. Ce n'est qu'en ayant une claire conscience de cette difficulté que le prolétariat (et avec lui les révolutionnaires eux-mêmes) sera en mesure de ne pas se démoraliser face aux embûches qu'il affrontera, qu'il trouvera la force et la lucidité pour les surmonter pour parvenir au renversement de la société d'exploitation ([6] [85]).
Dans le bilan des dix dernières années du CCI, nous ne pouvons passer sous silence deux faits très importants touchant à notre vie organisationnelle.
Le premier fait est très positif. C'est l'extension de la présence territoriale du CCI avec la constitution en 1989 d'un noyau en Inde qui publie, en langue hindi, Communist Internationalist et d'une nouvelle section au Mexique, pays de la plus haute importance sur le continent américain, et qui publie Révolution Mundial.
Le deuxième fait est beaucoup plus désolant : c'est la disparition de notre camarade Marc, le 20 décembre 1990. Nous ne reviendrons pas ici sur le rôle de premier plan qu'il a joué dans la constitution du CCI et, avant cela, dans le combat des fractions communistes aux moments les plus noirs de la contre-révolution. La Revue Internationale (n° 65 et 66) y a consacré un long article. Disons simplement que, à côté de « l'épreuve du feu » qu'ont représenté pour le CCI, comme pour l'ensemble du milieu révolutionnaire, les convulsions du capitalisme mondial depuis 1989, la perte de notre camarade était aussi pour nous une autre « épreuve du feu ». Beaucoup de groupes de la gauche communiste n'ont pas survécu à la disparition de leur principal animateur. Cela a été le cas du FOR, par exemple. Et d'ailleurs, certains « amis » nous ont prédit avec « sollicitude » que le CCI ne survivrait pas à Marc. Pourtant, le CCI est encore là, et il a réussi à tenir le cap depuis 4 ans malgré les tempêtes qu'il a rencontrées.
Là dessus non plus nous ne nous accordons aucun mérite particulier : l'organisation révolutionnaire n'existe pas grâce à tel ou tel de ses militants, aussi valeureux soit-il. Elle est un produit historique du prolétariat et si elle ne survit pas à l'un de ses militants, c'est qu'elle n'a pas correctement assumé la responsabilité que la classe lui a confiée et que ce militant lui-même a failli d'une certaine façon. Si le CCI a réussi à franchir avec succès les épreuves qu'il a rencontrées, c'est avant tout parce qu'il a eu le souci permanent de se rattacher à l'expérience des organisations communistes qui l'ont précédé, de concevoir son rôle comme un combat à long terme et non en vue de « succès » immédiats. Depuis le siècle dernier, cette démarche a été celle des militants révolutionnaires les plus lucides et solides : nous nous en revendiquons et c'est notre camarade Marc qui, en grande partie, nous a appris à le faire. Il nous a aussi appris, par son exemple, ce que veut dire le dévouement militant sans lequel une organisation révolutionnaire ne peut survivre, aussi claire qu'elle puisse être :
« Sa grande fierté, ce n'est pas dans sa contribution exceptionnelle qu'il l'a placée mais dans le fait que, jusqu'au bout, il est resté fidèle, de tout son être, au combat du prolétariat. Et cela aussi était un enseignement précieux pour les nouvelles générations de militants qui n'ont pas eu l'occasion de connaître l'énorme dévouement à la cause révolutionnaire qui était celui des générations du passé. C'est en premier lieu sur ce plan que nous voulons être à la hauteur du combat que, désormais sans sa présence vigilante et lucide, chaleureuse et passionnée, nous sommes déterminés à poursuivre. » (« Marc », Revue Internationale n°66).
Vingt après la constitution du CCI, nous poursuivons le combat.
FM
[1] [86] Le fait que nous en soyons aujourd'hui au n° 80 de la Revue Internationale démontre donc que sa régularité a été maintenue sans défaillance.
[2] [87] Au début des années 1980, le PCl-Programma avait changé le titre de sa publication en Combat qui dériva assez rapidement vers le gauchisme. Depuis, quelques éléments de ce groupe ont repris la publication de Programma Comunista qui défend les positions bordiguistes classiques.
[3] [88] Voir à ce sujet les articles que nous avons publiés dans les n° 41 à 45 de notre Revue Internationale.
[4] [89] Il faut noter que pratiquement tous les groupes du milieu prolétarien sont passes à côté de la compréhension des événements de 1989 comme nous le mettons en évidence dans nos articles « Le vent d'Est et la réponse des révolutionnaires» et « Face aux bouleversements à l'Est, une avant-garde en retard» dans la Revue Internationale n°61 et 62. La palme revient sans contestation possible à la FECCI (qui avait quitté le CCI en prétextant que celui-ci dégénérait et était incapable de faire un travail théorique) : il lui a fallu DEUX ANS pour se rendre compte que le bloc de l'Est avait disparu (voir notre article « A quoi sert la FECCI ? » dans la Revue internationale n° 70).
[5] [90] Nous avons rendu compte de ces événements dans la Revue Internationale n° 64 et 65. En particulier, nous écrivions, avant même la « tempête du désert » : « Dans la nouvelle période historique où nous sommes entrés, et les événements du Golfe viennent de le confirmer, le monde se présente comme une immense foire d'empoigne, où jouera à fond la tendance au "chacun pour soi", où les alliances entre Etats n'auront pas, loin de là, le caractère de stabilité qui caractérisait les blocs, mais seront dictés par les nécessités du moment. Un monde de désordre meurtrier, de chaos sanglant, dans lequel le gendarme américain tentera de faire régner un minimum d'ordre par l'emploi de plus en plus massif et brutal de sa puissance militaire. » («Militarisme et décomposition », Revue Internationale n° 64, p. 13). De même nous rejetions l'idée, colportée par les gauchistes mais partagée par la plupart des groupes du milieu prolétarien, que la guerre du Golfe était une «r guerre pour le pétrole » (« Le milieu politique prolétarien face à la guerre du Golfe»).
[6] [91] Il n'est pas nécessaire ici de revenir plus longuement sur notre analyse sur la décomposition. Elle apparaît dans chacun de nos textes traitant de la situation internationale. Ajoutons simplement que, à travers un débat en profondeur dans notre organisation, cette analyse a été progressivement précisée (voir à ce propos nos textes : « La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme», «Militarisme et décomposition» et « Vers le plus grand chaos de l'histoire » publiés respectivement dans les n° 62, 64 et 68 de la Revue internationale).
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [17]
Revue Internationale no 81 - 2e trimestre 1995
- 3859 lectures
Editorial : guerre et mensonges de la « démocratie »
- 3196 lectures
En cette année où la bourgeoisie célèbre à grand renfort de propagande médiatique le cinquantenaire de la fin de la seconde guerre mondiale, les guerres se déchaînent dans le monde, jusqu'aux portes de l'Europe la plus développée, avec le conflit ouvert depuis près de quatre ans dans l'ex-Yougoslavie. La « paix » n'est pas plus au rendez-vous avec la disparition du bloc de l'Est et de l'URSS qu'elle ne l'a été il y a cinquante ans au lendemain de la défaite de l'Allemagne et du Japon face aux Alliés. La nouvelle « ère de paix », promise il y a cinq ans par les vainqueurs de la « guerre froide », n'a pas plus d'existence que la « paix » promise par les vainqueurs de la seconde guerre mondiale. Pire : alors que l'existence de deux blocs impérialistes pouvait imposer une certaine « discipline » dans la situation internationale au lendemain de la 2e guerre mondiale et lors des années de « reconstruction », aujourd'hui, c'est la tendance au chaos généralisé qui domine dans les relations internationales.
« Paix » d'hier et « paix » d'aujourd'hui : toujours la guerre
Il y a cinquante ans, dès la signature des accords de Yalta qui scellèrent, en février 1945, le repartage du monde en zones d'influence dominées par les vainqueurs et leurs alliés, Etats-Unis et Grande-Bretagne d'un côté, URSS de l'autre, la nouvelle ligne des affrontements inter-impérialistes était tracée. A peine la guerre était-elle terminée que s'enclenchait la confrontation entre le bloc de l'Ouest emmené par les Etats-Unis et le bloc de l'Est sous la houlette de l'URSS. Cette confrontation allait se développer pendant plus de quarante ans, certes avec la « paix » en Europe (une « paix » essentiellement imposée par la nécessité de la reconstruction), mais surtout avec la guerre : guerre de Corée, guerre du Vietnam, conflits meurtriers où chacun des protagonistes locaux recevait le soutien de l'un ou l'autre bloc, quand il n'était pas poussé par eux. Et si cette « guerre froide » n'a pas débouché sur la 3e guerre mondiale, c'est parce que la classe ouvrière a réagi internationalement contre les conséquences de la crise économique, sur le terrain de la défense de ses conditions d'existence, à partir de la fin des années 1960, entravant l'embrigadement nécessaire à un affrontement généralisé, en particulier dans les pays les plus industrialisés.
En 1989, la disparition du bloc de l'Est engendrée par la perte de contrôle par le stalinisme, forme de capitalisme d'Etat devenue inapte à faire face aux conditions de la crise économique, et par l'incapacité de l'URSS à maintenir la discipline de son bloc, puis la dislocation de l'URSS elle-même, ont mis un terme définitif à la « guerre froide » et ont totalement bouleversé la situation planétaire héritée de la seconde guerre mondiale. Cette nouvelle situation a provoqué à son tour l'éclatement du bloc de l'Ouest qui ne devait sa cohésion qu'à la menace de T « ennemi commun ». Tout comme les vainqueurs de la 2e guerre mondiale se sont retrouvés être les protagonistes de la nouvelle division du monde, ce sont désormais les vainqueurs de la « guerre froide », les anciens alliés de l'ex-bloc de l'ouest, qui se retrouvent être les nouveaux adversaires de la confrontation impérialiste inhérente à la perpétuation du capitalisme et de ses lois de l'exploitation, du profit et de la concurrence. Et si, à la différence de la situation de l'après-guerre, il ne s'est pas déjà constituée une nouvelle division en deux blocs impérialistes, du fait des conditions historiques de la période actuelle ([1] [93]) les tensions impérialistes n'en ont pas pour autant disparu. Elles n'ont fait que s'aiguiser. Dans tous les conflits qui surgissent de la décomposition dans laquelle plongent de plus en plus de pays, ce ne sont pas seulement les caractéristiques locales qui dessinent la forme et l'ampleur des affrontements, mais surtout les nouveaux clivages entre grandes puissances ([2] [94]).
Il ne peut pas y avoir de « paix » dans le capitalisme. La « paix » n'est qu'un moment de la préparation à la guerre impérialiste. Les commémorations de la fin de la 2e guerre mondiale, qui présentent la politique des pays « démocratiques » dans la guerre comme celle qui permit le retour de la « paix », font partie des campagnes idéologiques destinées à masquer leur véritable responsabilité de pourvoyeurs de chair à canon et de principaux fauteurs de guerre.
Mensonges d'hier et mensonges d'aujourd'hui
L'an dernier la bourgeoisie avait fêté la « Libération », le « Débarquement de Normandie » et d'autres épisodes de 1944 ([3] [95]) par des articles de presse, des programmes de télévision et de radio, des cérémonies politico-médiatiques et des défilés militaires. Les commémorations se poursuivent en 1995 pour rappeler les dernières batailles de 1945, la capitulation de l'Allemagne et du Japon, 1' « armistice », le tout pour raconter une fois encore l'édifiante histoire de comment les régimes « démocratiques » parvinrent à vaincre la « bête immonde » du nazisme et à instaurer durablement la « paix » dans une Europe dévastée par la barbarie hitlérienne.
Ce n'est pas simplement l'opportunité du calendrier qui explique tout le battage fait autour de la fin de la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, alors que les conflits se multiplient, alors que la crise économique entraîne un chômage de plus en plus massif et de longue durée, alors que la décomposition sociale fait des ravages, la classe dominante, la classe capitaliste, a besoin de tout son arsenal idéologique pour défendre les vertus de la « démocratie » bourgeoise, en particulier sur la question de la guerre. L'histoire de la fin de la 2e guerre mondiale, qui présente les faits avec l'apparence de l'objectivité, fait partie de cet arsenal. Les appels répétés à se « souvenir » de cette histoire, à l'occasion des anniversaires des événements de 1945, visent à faire passer l'idée que le camp « démocratique », en mettant fin à la guerre, ramena la « paix » et la « prospérité » en Europe. Un tel «jugement de l'Histoire» est bien sûr fait pour décerner un certificat de bonne conduite à la « démocratie », à lui donner une caution « historique », destinée à crédibiliser les discours sur les « opérations humanitaires », les « accords de paix » et la « défense des droits de l'homme » qui couvrent la réalité de la barbarie capitaliste actuelle. Les mensonges d'aujourd'hui se trouvent ainsi renforcés par les mensonges d'hier.
Les « grandes démocraties » ne mènent pas plus aujourd'hui qu'hier une politique de « paix ». Au contraire, aujourd'hui comme hier, ce sont les grandes puissances capitalistes qui portent la plus grande responsabilité dans la guerre. Les commémorations à répétition de la fin de la deuxième guerre mondiale, et leur message sur le retour de la « paix en Europe », prétendent nous rappeler l'histoire et honorer la mémoire des cinquante millions de victimes du plus grand massacre que le monde ait connu. Elles sont en fait un des aspects des campagnes idéologiques de « défense de la démocratie ». Elles servent à détourner l'attention de la classe ouvrière de la politique actuelle de cette même « démocratie » : le développement des tensions impérialistes et le « chacun pour soi » qui ramènent aujourd'hui la guerre en Europe, avec le conflit dans l'ex-Yougoslavie ([4] [96]). Elles sont de plus une gigantesque falsification de l'histoire en mentant sur les causes, le déroulement et le dénouement de la 2e guerre mondiale et sur les cinquante ans de « paix » qui l'ont suivie.
Nous ne reviendrons pas longuement dans cet article sur la question de la nature de la guerre impérialiste dans la période de décadence du capitalisme, sur les véritables causes de la 2e guerre mondiale et sur le rôle qu'y ont joué les « grandes démocraties » qui se présentent comme les garants de la « paix » du monde. Nous avons souvent traité cette question dans la Revue Internationale ([5] [97]), montrant notamment comment, contrairement à la propagande qui présente la 2e guerre mondiale comme le résultat de la folie d'un Hitler, la guerre est le résultat inéluctable de la crise historique du mode de production capitaliste. Et si par deux fois, pour des raisons historiques, c'est l'impérialisme allemand qui donna le signal de la guerre, la responsabilité des Alliés est entière dans le déchaînement des destructions et du carnage. « La seconde boucherie mondiale constitua pour la bourgeoisie une formidable expérience, pour tuer et massacrer des millions de civils sans défense, mais aussi pour dissimuler, masquer, justifier ses propres crimes de guerre monstrueux, en "diabolisant" ceux de la coalition impérialiste antagoniste. Au sortir de la seconde guerre mondiale, les "grandes démocraties", malgré tous leurs efforts pour se donner un air respectable, apparaissent plus que jamais maculées des pieds à la tête par le sang de leurs innombrables victimes. » ([6] [98]) L'engagement des Alliés dans la guerre mondiale n'était en rien déterminé par une volonté de « paix » et d' « harmonie entre les peuples », il était le produit de la défense de leurs intérêts impérialistes. Leur première préoccupation était de gagner la guerre, la deuxième d'enrayer tout risque de soulèvement ouvrier, comme cela s'était produit en 1917-18, ce qui explique le soin et la minutie qu'ils mirent dans leur stratégie de bombardements et d'occupation militaire ([7] [99]), la troisième de se partager les bénéfices de la victoire.
La fin de la guerre sonna ainsi l'heure du repartage du monde entre les vainqueurs. En février 1945, les accords de Yalta signés par Roosevelt, Churchill et Staline, devaient symboliser l'unité des vainqueurs et le retour définitif de la « paix » pour l'humanité. Nous avons déjà dit plus haut ce qu'il en était de 1' « unité » des vainqueurs et « il est clair que l'ordre de Yalta n'était rien d'autre qu'une redistribution des cartes sur la scène impérialiste mondiale, laquelle ne pouvait déboucher que sur un déplacement de la guerre sous une autre forme : celle de la guerre "froide" entre l'URSS et l'alliance du camp "démocratique" (...). » Quant à la « paix » d'après-guerre « rappelons simplement que durant ce qu'on a appelé la "guerre froide", puis la "détente", autant de vies humaines ont été sacrifiées dans les massacres impérialistes opposant l'URSS et les Etats-Unis que durant la seconde boucherie mondiale. » ([8] [100]) Et surtout, à la fin de la guerre on compte cinquante millions de victimes, en grande majorité dans la population civile, essentiellement dans les principaux pays belligérants (Russie, Allemagne, Pologne, Japon), et les destructions sont considérables, massives et systématiques. C'est ce « prix » de la guerre qui révèle la vraie nature du capitalisme au 20e siècle, quelle que soit sa forme : « fasciste », « stalinienne » ou « démocratique », et non la « paix » des cimetières et des ruines qui va régner pendant la période de la reconstruction. Le fait que les cinquante ans écoulés depuis 1945 n'ont plus vu de développement de la guerre en Europe n'a pas pour explication le caractère pacifique de la « démocratie » rétablie à la fin de la 2e guerre mondiale. La « paix » est revenue en Europe avec la victoire de l'alliance militaire des pays « démocratiques » et de l'URSS « socialiste » dans une guerre qu'ils ont menée jusqu'au bout, massacrant des millions de civils, sans plus d'égard pour les vies humaines que leur ennemi.
Au cas où la construction des mensonges d'aujourd'hui risquerait de se fissurer sous les coups d'une réalité qui parvient parfois à se dévoiler, le rappel et le martelage des mensonges d'hier viennent à point nommé pour consolider l'image des hauts faits de la « démocratie », garante de la « paix » et de la « stabilité » du .monde, alors que les événements de la situation mondiale ne cessent de contredire tous les discours de « paix ».
Les guerres de la décomposition capitaliste
Comme nous l'avons souvent analysé depuis les événements de 1989, la réunification de l'Allemagne et la destruction du mur de Berlin, la fin de la division du monde en deux blocs impérialistes rivaux n'a pas apporté la « paix », mais au contraire le déchaînement du chaos. La nouvelle situation historique n'a pas apaisé les rivalités impérialistes entre les grandes puissances. Si elle a fait disparaître l'ancienne rivalité est-ouest, issue du traité de Yalta, du fait de la disparition du bloc impérialiste russe, elle a par contre aiguisé les conflits entre les anciens alliés du bloc de l'ouest, qui ne sont plus désormais tenus par la discipline de bloc face à l'ennemi commun.
Cette nouvelle situation a ainsi engendré des massacres à répétition. Les Etats-Unis ont donné le signal avec la guerre du Golfe, en 1990-91. Puis, l'Allemagne, suivie par la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ainsi que la Russie, ont transformé l'ex-Yougoslavie en un champ de bataille meurtrier, aux frontières de l'Europe « démocratique ». Ce pays est ainsi devenu depuis près de quatre ans le « laboratoire » de la capacité des puissances européennes à faire triompher leurs nouvelles ambitions impérialistes : l'accès à la Méditerranée pour l’Allemagne ; l'opposition de la France et de la Grande-Bretagne à ces visées ; et pour tous, la tentative de s'affranchir de la pesante tutelle des Etats-Unis, qui font tout pour garder leur rôle de gendarme du monde.
Ce sont les grandes puissances « démocratiques » qui ont allumé le brasier de l'ex-Yougoslavie. Ce sont ces mêmes grandes puissances qui mettent à feu et à sang des régions entières de l'Afrique, comme le Libéria ou le Rwanda ([9] [101]), qui attisent les massacres comme en Somalie ou en Algérie, qui multiplient les foyers de guerre et de tension où les affrontements ne s'éteignent que pour s'embraser de nouveau avec une violence redoublée, comme en témoigne ce qui se passe maintenant au Burundi voisin du Rwanda. Au Moyen-Orient, après la guerre du Golfe, les Etats-Unis ont imposé leur domination sans partage sur la région, une « paix » armée qui constitue une poudrière prête à tout moment à s'embraser : entre Israël et les territoires palestiniens, au Liban ; autour du Kurdistan, en Turquie ([10] [102]), en Irak, en Iran. En Amérique latine, pourtant « chasse gardée » des Etats-Unis, les nouvelles oppositions impérialistes des anciens alliés sont également présentes dans les conflits qui surgissent. Aussi bien la « révolte » des « zapatistes » de l'Etat du Chiapas au Mexique, soutenue en sous-main par les puissances européennes, que le regain de la guerre frontalière entre Pérou et Equateur, où les Etats-Unis poussent ce dernier à l'affrontement au régime péruvien ouvert à l'influence du Japon, manifestent que les grandes puissances sont prêtes à utiliser toutes les opportunités pour défendre leurs sordides intérêts impérialistes. Même si elles ne visent pas un gain immédiat pour leurs intérêts économiques et politiques dans tous les lieux de conflit, elles sont toujours prêtes à semer le désordre et fomenter la déstabilisation du terrain de leur adversaire. La prétendue « impuissance » à « contenir les conflits » et les « opérations humanitaires » ne sont que la couverture idéologique des agissements impérialistes pour la défense, chacun pour soi, de ses intérêts stratégiques.
Il existe des lignes de force majeures qui tendent à polariser la stratégie des impérialismes au niveau international : les Etats-Unis d'un côté, qui cherchent à maintenir leur leadership et leur statut de super-puissance; l'Allemagne de l'autre, qui assume le rôle de principal prétendant à la constitution d'un nouveau bloc. Mais ces tendances majeures ne parviennent pas à « ordonner » la situation : les Etats-Unis perdent de leur influence, ils n'ont plus la menace de l'ennemi commun à faire prévaloir pour tenir leurs « alliés » ; l'Allemagne n'a pas encore la stature d'une tête de bloc après cinquante ans d'allégeance obligée aux Etats-Unis et au « parapluie » de l'OTAN ainsi que de partition du pays entre les deux grands vainqueurs de la seconde guerre mondiale. Cette situation, conjuguée au fait que, dans les principaux pays développés, la classe ouvrière n'est pas acquise à la défense des intérêts du capital national et n'est pas embrigadée dans les visées impérialistes de la bourgeoisie, est à la base du désordre qui domine aujourd’hui les relations internationales.
Ce désordre n'est pas près de s'achever. Au contraire, il s'est encore accentué ces derniers mois avec les distances qu'est en train de prendre la Grande-Bretagne, le plus fidèle « lieutenant » des Etats-Unis depuis la première guerre mondiale, avec la politique américaine. La rupture est encore loin d'être consommée entre ces deux anciens alliés de toujours, mais l'évolution de la politique britannique de ces dernières années va clairement dans ce sens, constituant un fait historique de première importance qui manifeste la domination de la tendance au « chacun pour soi » au détriment de la discipline des alliances internationales. L'alliance entre France et Grande-Bretagne dans l'ex-Yougoslavie, visant à contrer la poussée allemande mais en même temps à tenir les Etats-Unis hors du jeu, a été une première étape de cette évolution. La création d'une force inter-africaine de « maintien de la paix et de prévention des crises en Afrique » entre ces mêmes pays a marqué un net revirement de la politique britannique qui, quelques mois auparavant, aidait encore les Etats-Unis à éliminer la présence française du Rwanda. Enfin l'accord franco-britannique de coopération militaire, par la constitution d'une unité commune de l'armée de l'air, vient de sanctionner le choix de plus en plus tranché de la Grande-Bretagne de prendre ses distances avec les Etats-Unis. Les Etats-Unis pour leur part ne cessent de faire pression sur la Grande-Bretagne contre cette évolution, par leur politique de soutien ouvert et désormais officiel au Sinn Fein qui développe depuis toujours le terrorisme séparatiste en Irlande du nord ; la tension entre les deux pays sur cette question n'a jamais été aussi forte. Le rapprochement franco-britannique n'est cependant pas pour autant un facteur de renforcement de la tendance à la constitution d'un nouveau bloc impérialiste autour de l'Allemagne. Au contraire, même s'il n'a pas provoqué un relâchement de l'alliance franco-allemande aussi important que celui qui mine désormais les relations entre Etats-Unis et Grande-Bretagne, il ne fait pas l'affaire de l'Allemagne. La Grande-Bretagne ne se rapprochera pas de l'Allemagne, par contre la France, forte de ce nouvel appui pour tenir tête à son encombrant tuteur germanique, risque de se montrer plus difficilement contrôlable par celui-ci.
Ainsi, loin des discours de « paix et de prospérité » qui avaient salué l'effondrement du bloc de l'Est et de l'URSS, les dernières années ont au contraire montré le hideux visage de guerres meurtrières, l'aiguisement des tensions impérialistes et un marasme grandissant de la situation économique et sociale, et cela pas seulement dans les pays de la périphérie du monde capitaliste, mais au coeur des pays les plus industrialisés.
Crise et « démocratie »
La « prospérité » n'est pas plus à l'ordre du jour que la « paix ». Dans les pays développés, la « reprise » économique de ces derniers mois est surtout spectaculaire en ce qu'elle n'entrave en rien la montée inexorable du chômage ([11] [103]). Dans ces pays, ce n'est pas vers une amélioration mais vers une détérioration toujours plus grande des conditions de vie que s'achemine la société. Et en même temps que le chômage massif et les attaques sur les salaires qui rognent les conditions de vie des travailleurs, la décomposition sociale apporte chaque jour son lot de « faits divers » et de ravages destructeurs, parmi les sans- travail, chez les jeunes en particulier, mais également dans les comportements aberrants qui se développent comme une gangrène au sein de la population, que ce soit le fait des institutions rongées par une corruption de plus en plus évidente ou celui des individus entraînés par l'ambiance de désespoir qui envahit! Tous les pores de la vie sociale. Tous ces éléments ne sont pas le tribut à payer pour la « modernisation » du système capitaliste mondial ou les dernières manifestations de l'héritage d'une situation passée. Tout cela est au contraire le résultat de la perpétuation des lois de ce système capitaliste, la loi du profit et de l'exploitation de la force de travail, la loi de la concurrence et de guerre, que porte en lui le capitalisme comme mode de production dominant la planète et régissant les rapports sociaux, tout cela est la manifestation de la faillite définitive du capitalisme Dans la classe ouvrière, la conscience de cette faillite, si elle est loin d'être entièrement inexistante, est complètement obscurcie par l'idéologie que déverse en permanence la classe dominante. A travers ses moyens de propagande que sont les médias aux ordres, par les discours et les activités des partis, des syndicats, et de toutes les institutions au service de la bourgeoisie, cette dernière, au-delà des divergences qui opposent ses diverses fractions, martèle ses thèmes :
- « le système capitaliste n'est pas parfait, mais il est le seul système viable » ;
- « la démocratie a ses brebis galeuses, mais c'est le seul régime politique qui possède les bases et les principes nécessaires à la paix, aux droits de l'homme et à la liberté » ;
- « le marxisme a fait faillite ; la révolution communiste a mené à la barbarie stalinienne, la classe ouvrière doit se détourner de l'internationalisme et de la lutte de classe, et s'en remettre au capital, seul capable de subvenir à ses besoins ; toute tentative de bouleversement révolutionnaire de la société est au mieux une utopie, et revient, au pire, à faire le jeu de dictateurs cupides et sanguinaires qui ne respectent pas les lois de la démocratie. »
Bref, il faudrait croire en la « démocratie » bourgeoise ; elle seule aurait un avenir. Et face à l'inquiétude profonde qu'engendre la situation actuelle, face à la brutalité des événements de la situation internationale et de la réalité quotidienne, face à l'angoisse de l'avenir que le chômage massif provoque dans la population, dans les familles, dans un contexte où la classe ouvrière n'est pas prête au sacrifice du sang pour les intérêts du capitalisme, ce message n'est pas simple à faire passer. Le battage sur les «opérations humanitaires», supposées démontrer la capacité des « grandes démocraties » à maintenir la « paix », a ses limites : celle de l'inévitable poursuite des guerres et des massacres. Les opérations en Somalie et la prestation des troupes de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie en sont une claire illustration. Le battage sur la « reprise économique » a lui aussi ses limites : celui du chômage persistant et des attaques sur les salaires. Les « opérations mains propres» à l'italienne, visant à redonner de la moralité à la vie politique ont elles aussi leurs limites : ce sont toujours les mêmes qui sont aux commandes et les affaires et scandales, s'ils visent à faire croire à la moralisation de la politique bourgeoise, ont aussi leurs revers, celui de dévoiler la corruption généralisée. C'est pourquoi la commémoration de la fin de la 2e guerre mondiale est autant d' « actualité » ([12] [104]), pour venir renforcer la propagande de la « défense de la démocratie » qui est aujourd'hui le thème principal de l'idéologie de soumission du prolétariat aux intérêts de la bourgeoisie, contre le développement de la prise en main de ses luttes contre le capitalisme.
MG, 23/3/95.
[1] [105] Voir « Militarisme el décomposition », Revue Internationale n° 64. 1er trim. 91.
[2] [106] Voir « Les grandes puissances, 1 auteurs de guerre », Revue Internationale n° 77, 2e trim. 94, et « Derrière les mensonges de "paix", la barbarie capitaliste », Revue Internationale n° 78.
[3] [107] Voir « Commémorations de 1944 : 50 ans de mensonges impérialistes », Revue Internationale n° 78 et 79.
[4] [108] Voir « Tous contre tous », Revue Internationale n° 80.
[5] [109] Quelques articles : « Guerre, militarisme et blocs impérialistes », Revue Internationale n° 52 et 53, 1er-2ème trim. 88 ; « Les vraies causes de la 2e guerre mondiale » (Gauche communiste de France, 1945), Revue Internationale n° 59, 4e trim. 89 ; « Les massacres et les crimes des "grandes démocraties" », Revue Internationale n° 66, 3e trim. 91.
[6] [110] « Les massacres et les crimes des "grandes démocraties" »,
[7] [111] « Commémorations de 1944 : 50 ans de mensonges impérialistes », Revue Internationale n° 79, « Les luttes ouvrières en Italie 1943 », Revue Internationale n° 75, 4e trim. 93.
[8] [112] « Un demi-siècle de conflits guerriers et de mensonges pacifistes », Révolution internationale n° 242, février 95.
[9] [113] « Les grandes puissances répandent le chaos », Revue Internationale n° 79.
[10] [114] A l'heure où nous bouclons ce numéro, la Turquie vient de lancer une vase opération militaire au Kurdistan. 35 000 soldats « nettoient » actuellement le nord de l'Irak. Il est sûr qu'une telle invasion a l'aval des grandes puissances. La Turquie, allié « naturel » de l'Allemagne mais également place- forte du dispositif de l'impérialisme américain, n'agit certainement pas seule. Voir les articles dans notre presse territoriale sur ces événements.
[11] [115] Voir « Une reprise sans emplois », Revue Internationale n° 80.
[12] [116] II est significatif à cet égard que c'est non seulement dans les pays vainqueurs, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en France, ainsi qu'en Russie, que se déroulent des célébrations de l'année 1945, mais également en Allemagne et au Japon, les grands vaincus de la guerre. En Allemagne par exemple, la propagande officielle a utilisé le douloureux souvenir des bombardements massifs de la ville de Dresde par l'aviation des Alliés en février 1945, qui firent plusieurs dizaines milliers de victimes (35 000 victimes dénombrées, en réalité entre 135 000 et 200 000), en rappelant en partie l'inanité et l'inutilité du point de vue de la stratégie militaire d'un tel massacre, ce qui est un fait officiellement reconnu aujourd'hui, mais surtout en justifiant la « leçon » que la « démocratie » infligea à l'Allemagne : « Nous voulons que le bombardement de Dresde soit un jour anniversaire pour tous les morts de la Seconde guerre mondiale. Nous ne devons pas oublier que c'est Hitler qui a commencé la guerre, et que c'est Goering qui rêvait de "coventryser" [référence au bombardement de Coventry par l'Allemagne] toutes les villes britanniques. Nous ne pouvons nous permettre aujourd'hui de dire que nous sommes les victimes des bombardements alliés. Savoir si ce bombardement était nécessaire est l'affaire des historiens. » (Ulrich Hôver, porte-parole du maire de Dresde, Libération, 13/2/95). De même au Japon où se prépare la célébration de l'anniversaire de la capitulation d'août 1945, le gouvernement veut faire passer un projet de résolution reconnaissant que le Japon était l'agresseur. Là aussi c'est significatif du besoin de la bourgeoisie, au niveau international, de rallier la mystification la plus efficace aujourd'hui que représente la « défense de la démocratie ».
Questions théoriques:
- Guerre [18]
- Impérialisme [19]
Heritage de la Gauche Communiste:
Tourmente financière : La folie ?
- 2838 lectures
Un mot revient de plus en plus souvent dans les commentaires des médias à propos de la situation financière mondiale : « folie ». Folie de la spéculation monétaire qui fait circuler plus de 1000 milliards de dollars par jour, soit à peu près la valeur de la production annuelle de la Grande-Bretagne ; folie des « produits dérivés », ces investissements destinés à spéculer en bourse, basés sur des mécanismes qui n'ont rien à voir avec les réalités économiques, utilisant des modèles mathématiques si complexes que seuls quelques jeunes experts arrivent à les comprendre, mais qui mobilisent des masses de plus en plus énormes d'argent et peuvent en quelques jours faire s'écrouler les plus « respectables » des institutions bancaires; folie de la spéculation immobilière qui rend actuellement le mètre carré de bureau dans certains quartiers de Bombay plus cher qu'à New York, mais qui par ailleurs pousse une grande partie des banques françaises vers la faillite : folie des fluctuations monétaires qui en quelques semaines déstabilisent le commerce mondial....
Ces manifestations de « folie » nous sont présentées comme le produit des nouvelles libertés de circulation des capitaux au niveau international, des progrès de l'informatique et des communications ou encore de la trop grande avidité de certains « spéculateurs ». // suffirait de remettre un peu d'ordre dans tout cela, en renforçant les contrôles sur « les spéculateurs » et sur certains mouvement de capitaux pour que tout se calme et que l'on profite en paix de la prétendue « reprise » de l'économie mondiale. Mais la réalité est beaucoup plus grave et dramatique que ce que les « experts » veulent bien se raconter et nous faire croire.
Le début d'une nouvelle tourmente financière
Depuis le début de 1995, le monde financier a été secoué par des événements aussi spectaculaires que significatifs. Parmi eux, il faut citer :
-aux Etats-Unis, la banqueroute de l'Orange County en Californie, haut lieu du libéralisme économique pur et dur (c'est de là qu'était partie la candidature de Reagan au nom du « moins d'Etat »). Le gouvernement local avait placé une grande partie de ses avoirs en produits spéculatifs à haut risque. La hausse des taux d'intérêt a provoqué sa banqueroute totale ;
-en France, la découverte de l'énorme déficit du Crédit Lyonnais, une des plus grandes banques européennes, confrontée à des pertes gigantesques du fait d'opérations spéculatives mineuses, en particulier dans l'immobilier. L'évaluation du coût de l'opération de « sauvetage » atteint des chiffres pharamineux, de l'ordre de 26 milliards de dollars ;
- la faillite d'une des plus vieilles et « respectables » banques de Grande-Bretagne, la Barings, où la Reine elle-même a une partie de ses dépôts, sous l'effet d'un mauvais placement spéculatif réalisé par un de ses jeunes « génies de la finance » de son agence de Singapour sur la bourse de Tokyo ;
- l'effondrement de la SASEA, la plus grande faillite bancaire dans l'histoire de ce temple de la finance mondiale qu'est la Suisse ;
- la mise en cessation de paiement du principal courtier de la Bourse de Bombay, capitale financière de l'Inde, qui vient de contraindre les autorités à fermer celle-ci pendant plusieurs jours pour éviter que la catastrophe n'entraîne une réaction en chaîne ;
-on pourrait encore citer cette scène surréaliste, significative de la folie qui se développe dans le monde financier, où l'on a vu, au mois de mars, à la Bourse de Karachi (Pakistan), dix chèvres noires être égorgées après avoir été le plus solennellement du monde promenées dans les salles de change, pour tenter de conjurer le sort qui faisait plonger les valeurs à leur niveau le plus bas depuis 16 mois...
Parmi les événements qui marquent ce qui constitue le début d'une véritable nouvelle tourmente financière mondiale, il en est un qui a revêtu une importance particulière et qui mérite qu'on s'y arrête : la crise mexicaine.
La crise financière mexicaine
La crise de paiement qu'a connu le Mexique au début de 1995 n'est pas un soubresaut comme un autre dans les convulsions qui régulièrement secouent les pays du « tiers-monde ». Déjà, en 1982, en pleine récession mondiale, c'est l'insolvabilité de ce pays qui avait déclenché une puissante crise financière mondiale. Aujourd'hui, avec ses 90 millions d'habitants, le Mexique représente la 13e économie mondiale, et se situe au 6e rang mondial pour les réserves pétrolières. Il y a encore quelques mois, ce pays était présenté comme un modèle de réussite économique, sinon « le modèle », et c'est avec les félicitations des « experts » du monde entier qu'il venait de faire son entrée dans l'ALENA et l'OCDE à côté des pays les plus industrialisés.
La fuite soudaine d'une grande partie des capitaux étrangers du Mexique, la violente dévaluation du Peso à laquelle ce pays a dû recourir, la menace d'insolvabilité pour rembourser les 7 milliards de dollars d'intérêts qu'il doit payer sur sa dette publique avant le mois de juin prochain, ont été déclenchés par la hausse des taux d'intérêt américains. Sa banqueroute n'est pas tant le produit de ses seules faiblesses internes que de la fragilité et instabilité du système financier mondial, rongé jusqu'à la moelle par des années de spéculations et manipulations en tout genre. L'ampleur et la rapidité sans précédents de la réaction des principales puissances économiques en sont une preuve indiscutable.
Lorsque dans la Revue Internationale n° 78 (3e trimestre 94) nous tracions la perspective d'une prochaine tourmente financière mondiale, nous nous fondions sur le fait que les déficits des Etats et surtout le développement des dettes publiques (en particulier dans les pays développés) constituaient une bombe a retardement qui tôt ou tard devrait exploser, l'élément déclencheur devant être l'inévitable hausse des taux d'intérêt que le financement de ces dettes devrait entraîner. La crise mexicaine constitue une première vérification de cette perspective.
La panique internationale déclenchée par l'insolvabilité potentielle du Mexique est significative de la fragilité et du degré de maladie du système financier mondial. Le prêt consenti au départ par le FMI au Mexique, 7,75 milliards de dollars, est le plus important jamais accordé par cet organisme. Le « paquet » de crédits internationaux rassemblé par l'ensemble des plus grandes puissances financières sous la pression des Etats-Unis, 50 milliards de dollars, est sans précédent. La déclaration de Michel Camdessus, directeur du FMI, pour justifier l'urgence et l'ampleur de l'opération de sauvetage donnait la mesure de l'événement en parlant du risque d'une « véritable catastrophe mondiale ».
La dévaluation du Peso mexicain ne pouvait pas ne pas avoir de conséquences sur le système monétaire international. Les monnaies ont constitué au cours des dernières années un des domaines privilégiés de la spéculation. A la suite du Peso, le dollar canadien a chuté à son niveau le plus bas depuis 9 ans. La lire italienne, la peseta, l'escudo, sans parler des monnaies d'Amérique latine ont été soumis a de fortes pressions. Mais surtout, le dollar US, la monnaie mondiale, a commencé à être fortement attaqué.
La crise mexicaine a eu aussi d'autres répercussions. Depuis décembre dernier, les Bourses latino-américaines ont connu une chute spectaculaire de leurs valeurs. ([1] [118]) L'effondrement mexicain a provoqué une accélération de cette chute, en particulier en Argentine. L'indice de l’International Herald Tribune, qui mesure l'évolution moyenne de l'ensemble des Bourses du sous-continent est passé de 160 à 80 entre décembre 1994 et le début de février 1995. Les « experts » ont raison de craindre la possibilité de contagion à partir du Mexique et la nécessité de nouvelles opérations de sauvetage. La situation de certaines de économies dites « émergentes » est, à ce niveau, particulièrement dangereuse pour l'économie mondiale dans la mesure où elles disposent de très peu de réserves de devises. C'est le cas en particulier pour la Chine, l'Indonésie et les Philippines. ([2] [119])
Un avertissement
Lors du 25e forum de Davos, en janvier, en Suisse, où se sont retrouvés pendant une semaine un millier d'hommes d'affaires et ministres de tous les pays pour analyser la situation économique mondiale, la crise mexicaine a clairement été identifiée comme un « avertissement » et la crainte de la contagion était sur toutes les lèvres. Voici comment un journal français rendait compte de l'ambiance de cette « Mecque du libéralisme économique » :
« Désormais, tous les regards sont tournés vers l'Asie, où la perspective d'une crise chinoise entretient le spectre d'un grand tourbillon des capitaux... Déjà, certaines banques occidentales se plaignent de problèmes de remboursement posés par certaines entreprises d'Etat chinoises. Une étincelle pourrait tout faire sauter. Zhu Rongu, vice-premier ministre chinois, chargé de l'économie est venu à Davos rassurer les milieux d'affaires : "Nous sommes sûrs de faire redescendre le taux d'inflation cette année (...) La Chine honorera ses engagements internationaux !" Mais les chiffres qu'il a assenés pour montrer la place que tenait désormais la Chine dans l'économie mondiale ont plus inquiété l'auditoire qu'ils ne l'ont rassuré : "En hausse de 32 %, les investissements étrangers directs ont atteint 32 milliards de dollars en 1994, ce qui place la Chine au second rang derrière les Etats-Unis (...) Sur les 500 plus grandes entreprises du monde recensées par le magazine Fortune, plus de 100 ont investi en Chine." Des chiffres qui montrent à quel point un choc sur l'économie chinoise pourrait affecter l'économie mondiale, à commencer parles pays asiatiques dont le développement rapide était jusque là réputé solide. »([3] [120]).
Un récent rapport du Pentagone craint que la mort de Deng soit suivie d'un démembrement des provinces dans un affrontement entre « conservateurs » et « réformateurs ». Ce rapport affirme explicitement: « La Chine constitue le plus grand facteur d'incertitude pour l'Asie. »
Une autre source d'inquiétude pour les financiers internationaux c'est la Russie. L'économie de ce pays continue sa plongée dans le chaos le plus total, illustrant on ne peut mieux l'idée du développement de la folie (la deuxième puissance militaire du monde, disposant d'un arsenal nucléaire capable de détruire plusieurs fois la planète, a comme chef d'Etat un alcoolique dont on estime qu'il n'a que deux ou trois heures de lucidité par jour). Noyé dans d'énormes dettes internationales, le capital russe continue de supplier le F.M.I. et autres bailleurs de fonds internationaux de lui venir en aide, sans résultat. Sa situation sur le marché international est pourtant plus que dangereuse : ses réserves de devises sont tombées à 2 milliards de dollars. Le budget de 1995 est calculé sur la base d'une aide de 10 milliards de dollars venant de l'étranger. Mais personne, et en premier lieu le F.M.I. n'a envie de jeter l'argent dans ce qui apparaît comme un trou sans fond.
La crise monétaire
Un autre aspect des turbulences financières actuelles se situe au niveau des monnaies. Comme on l'a vu, l'effondrement du Peso mexicain a eu des répercussions immédiates sur le cours d'autres monnaies, en particulier le dollar. Mais, depuis lors, le calme n'est toujours par revenu dans ce domaine. Au contraire. La lire italienne, la peseta espagnole ont continué de se dévaluer, battant des records historiques face au mark allemand. La livre britannique et même le franc français continuent d'être fortement sous pression. Le SME, ce système destiné à maintenir un minimum d'ordre entre les principales monnaies de l'Union Européenne, et qui avait déjà récemment été soumis à rude épreuve (il n'a pu survivre qu'au prix d'un très fort élargissement des marges de fluctuation entre les monnaies qui en font partie), se voit de nouveau battu en brèche. Quant au dollar, il poursuit sa chute, encouragée en partie par l'intérêt qu'y voient les capitalistes américains pour accroître la compétitivité de leurs produits à l'exportation. Mais la dévaluation de la principale monnaie de la planète traduit tout d'abord la réalité du développement des déficits et de l'endettement de la première économie mondiale : la dette publique américaine, le déficit du gouvernement fédéral ainsi que le déficit du commerce extérieur n'ont cessé de croître, et c'est fondamentalement cette réalité que sanctionne la faiblesse du dollar.
La valeur, la solidité des monnaies repose, en dernière instance, sur la « confiance » qu'ont les capitalistes en leur propre économie, et en leurs propres institutions financières, au premier rang desquelles se trouve l'organisme émetteur de la monnaie : l'Etat. Or, ni pour l'une, ni pour les autres il n'y a de fondements pour une quelconque « confiance ». L'économie mondiale reste étouffée par le manque de débouchés solvables, noyée dans la surproduction, et l'accroissement de la productivité du travail n'a fait qu'aggraver le problème. Quant aux institutions financières, la débauche spéculative des dernières années, la fuite en avant dans l'endettement depuis deux décennies, les multiples « tricheries » auxquelles elles se sont livrées pour survivre, ont définitivement ruiné la « confiance » qu'elles pouvaient mériter. C'est pourquoi, les actuelles secousses du système monétaire international ne constituent pas un simple réajustement momentané, mais une manifestation du délabrement croissant du système financier international et de l'impasse du capitalisme lui même.
Un krach financier est inévitable. Sous certains aspects, il est même déjà en cours. Même du point de vue du capitalisme, une forte « purge » de la « bulle spéculative » est indispensable. Celle du krach de l'automne 1987 n'eut pas de conséquences négatives immédiates sur la croissance de la production. Au contraire. Elle n'en fut pas moins le signe annonciateur de la récession qui s'est ouverte à la fin de 1989. Aujourd'hui, la bulle spéculative et, surtout, l'endettement des Etats ont augmenté de façon inouïe. Dans ces circonstances, nul ne peut prévoir où s'arrêtera la violence d'une telle purge. Mais, en tout état de cause, elle se traduira par une destruction massive de capital fictif qui jettera dans la ruine des pans entiers du capital mondial, ouvrant la voie à une nouvelle aggravation de la récession économique au niveau réel.
Spéculation et surproduction
Les dégâts financiers provoqués par les contrecoups d'années de « folie » spéculative sont tellement importants que même les plus acharnés défenseurs du capitalisme sont contraints de constater que quelque chose de grave se passe dans leur économie. Mais, il n'en déduisent pas pour autant que ce pourrait être le système lui-même qui est profondément malade, mortellement condamné par son incapacité à dépasser ses contradictions fondamentales, en particulier son incapacité à créer des débouchés solvables suffisants pour sa production. Ils ne voient la crise au niveau de la spéculation que pour mieux se la cacher au niveau réel. Ils croient, et font croire, que les difficultés au niveau réel de la production (surproduction, chômage, entre autres) sont le produit des excès spéculatifs, alors qu'en dernière instance, s'il y a eu « folie spéculative » c'est parce qu'il y avait déjà des difficultés réelles. Marx dénonçait déjà cette mystification au siècle dernier :
« La crise elle même éclate d'abord dans le domaine de la spéculation, et ce n'est que plus tard qu'elle s'installe dans la production. A l'observation superficielle, ce n'est pas la surproduction, mais la sur-spéculation pourtant simple symptôme de la surproduction -qui paraît être la cause de la crise. La désorganisation ultérieure de la production n'apparaît pas comme un résultat nécessaire de sa propre exubérance antérieure, mais connue une simple réaction de la spéculation en train de s'effondrer. » ([4] [121])
Les forces de « gauche » de l'appareil politique bourgeois, les partis « ouvriers », les syndicats et les gauchistes, reprennent aujourd'hui cette façon mystifiée de voir la réalité en disant aux exploités que, pour résoudre leurs problèmes, il suffit d'exiger des gouvernements une plus grande sévérité contre les « spéculateurs ». Comme toujours, elles détournent sur de fausses cibles le mécontentement qui normalement se développe contre les fondements mêmes du système. Là où la réalité met en évidence l'impasse historique du mode de production capitaliste, l'incompatibilité totale entre les intérêts de la classe exploitée et ceux de la classe dominante, elles posent les problèmes en termes de « meilleure gestion » du système par cette dernière. Elles ne dénoncent la spéculation que pour mieux défendre le système qui l'engendre.
La « folie » que les différents « observateurs critiques » constatent au niveau financier mondial n'est pas le produit de quelques dérapages de spéculateurs avides de profit immédiat. Cette folie n'est que la manifestation d'une réalité beaucoup plus profonde et tragique : la décadence avancée, la décomposition du mode de production capitaliste, incapable de dépasser ses contradictions fondamentales et empoisonné par plus de deux décennies de manipulations de ses propres lois.
La véritable folie ce n'est pas la spéculation mais le maintien du mode de production capitaliste. L'issue pour la classe ouvrière, et pour l'humanité ne réside pas dans une quelconque politique des Etats contre la spéculation et quelques agents financiers, mais dans la destruction du capitalisme lui-même.
RV.
[1] [122] Le développement de la spéculation dans les Bourses de certains pays sous-développés, au cours de la période récente, est une manifestation évidente de la folie financière qui n'a cessé de se développer pendant la « reprise ». Les profits qui y ont été réalisés sont aussi fabuleux qu'artificiels. En 1993, aux Philippines, la performance boursière a été de + 146,3%, à Hongkong de +131 %, au Brésil de +91,3 %. En 1994 les Philippines et Hongkong perdent -9,6 % et -37,8 % mais le Brésil gagne encore +50,9% (en francs français, mais +1112% en monnaie locale), le Pérou +37,69 %, le Chili +33,8 %. Les capitaux spéculatifs s'y précipitent avec d'autant plus d'intérêt qu'en 1994 certaines Bourses occidentales s'érodent fortement : -13 % en Grande Bretagne. -17 % en France.
[2] [123] Le cas du Mexique résume la réalité du mirage des soi-disant « économies émergentes » (certains pays d'Amérique Latine, tels le Chili, ou d'Asie, tels l'Inde et surtout la Chine) qui ont connu dans les dernières années un certain développement économique grâce à d'importants afflux de capitaux étrangers. Les « économies émergentes » ne sont pas la nouvelle espérance de l'économie mondiale. Elles ne sont que des manifestations aussi fragiles qu'aberrantes d'un système en folie.
[3] [124] Libération, 30 janvier 1995.
[4] [125] Marx, « Revue de mai à octobre 1850 », publié par Maximilien Rubel, dans Etudes de Marxologie, n° 7, août 1963.
Questions théoriques:
- L'économie [126]
- Décadence [12]
REVOLUTION ALLEMANDE(I) : les débuts de la révolution
- 3728 lectures
Les révolutionnaires en Allemagne pendant la première guerre mondiale
Lorsqu'en août 1914 est déclenchée la première guerre mondiale, qui causera plus de vingt millions de victimes, le rôle déterminant que jouent les syndicats, et surtout la social-démocratie, est clair aux yeux de tous.
Au Reichstag, le SPD approuve unanimement le vote des crédits de guerre. Simultanément, les syndicats appellent à l'Union Sacrée interdisant toute grève et se prononçant pour la mobilisation de toutes les forces dans la guerre.
Voila comment la social-démocratie justifie le vote des crédits de guerre par son groupe parlementaire : « A l'heure du danger, nous n'abandonnons pas notre propre pairie. Nous nous sentons par là en concordance de vues avec l'Internationale, qui a reconnu de tous temps le droit de chaque peuple à l'indépendance nationale et à l'autodéfense, de même que nous condamnons en accord avec elle toute guerre de conquête. Inspirés par ces principes, nous votons les crédits de guerre demandés. » Patrie en danger, défense nationale, guerre populaire pour la civilisation et la liberté, tels sont les « principes » sur lesquels s'appuie la représentation parlementaire de la social-démocratie.
Dans l'histoire du mouvement ouvrier, cet événement représente la première grande trahison d'un parti du prolétariat. Comme classe exploitée, la classe ouvrière est une classe internationale. C'est pourquoi l'internationalisme est le principe le plus fondamental pour toute organisation révolutionnaire du prolétariat ; la trahison de ce principe conduit inéluctablement l'organisation qui la commet dans le camp ennemi, celui du capital.
Alors que le capital en Allemagne n'aurait jamais déclenché la guerre s'il n'avait pas été certain de pouvoir compter sur le soutien des syndicats et de la direction du SPD, alors que la trahison de ceux-ci n'est pas une surprise pour la bourgeoisie, elle provoqua un énorme choc dans les rangs du mouvement ouvrier. Même Lénine, au début, ne veut pas croire que le SPD a voté les crédits de guerre. Il considère les premières informations comme une manipulation visant à diviser le mouvement ouvrier. ([1] [127])
En effet, vu l'accroissement des tensions impérialistes depuis des années, la II° Internationale est intervenue précocement contre ces préparatifs guerriers. Lors des congrès de Stuttgart en 1907 et de Bâle en 1912 - et jusqu'aux derniers jours de juillet 1914 même - elle se prononce contre la propagande et les visées guerrières de la classe dominante ; et cela, malgré une résistance acharnée de son aile droite, déjà très puissante.
« Au cas où la guerre viendrait cependant à éclater, il est du devoir de la social-démocratie d'agir pour la faire cesser promptement et de s'employer, de toutes ses forces, à exploiter la crise économique et politique créée par la guerre pour agiter le peuple et précipiter ainsi l'abolition de la domination capitaliste. » (Résolution adoptée en 1907 et confirmée en 1912.)
« Il y a péril en la demeure, la guerre mondiale menace ! Les classes dominantes qui, en temps de paix, vous étranglent, vous méprisent, vous exploitent, veulent vous transformer en chair à canon. Partout il doit résonner aux oreilles des despotes : Nous refusons la guerre ! A bas la guerre ! Vive la fraternisation internationale des peuples ! » (Appel du comité directeur du SPD du 25 juillet 1914, c'est-à-dire dix jours avant l'approbation de la guerre le 4 août 1914.)
Quand les députés du SPD votent en faveur de la guerre, c'est en tant que représentants du plus grand parti ouvrier d'Europe, parti dont l'influence dépasse largement le cadre de l'Allemagne, parti qui est le produit de plusieurs décennies de travail et d'effort (souvent dans les conditions les plus défavorables, comme ça a été le cas sous la loi anti-socialiste, lorsqu'il était interdit), parti qui détient plusieurs dizaines de quotidiens et d'hebdomadaires. En 1899, le SPD possédait 73 journaux dont le tirage global atteignait 400.000 exemplaires et 49 d'entre eux paraissaient six fois par semaine. En 1900, ce parti comptait plus de 100.000 membres.
Ainsi, au moment de la trahison de la direction du SPD, le mouvement révolutionnaire se trouve face à une question fondamentale : faut-il laisser cette organisation ouvrière de masse passer corps et biens dans le camp de l'ennemi ?
Mais la direction du SPD en Allemagne n'est pas la seule à avoir trahi. En Belgique, le président de l'Internationale, Vandervelde, devient ministre du gouvernement bourgeois, ainsi que le socialiste Jules Guesde en France. Dans ce pays, le Parti Socialiste va se déterminer unanimement en faveur de la guerre. En Angleterre, où le service militaire n'existait pas, le Labour Party prend en mains l'organisation du recrutement. Même si, en Autriche, le Parti Socialiste ne vote pas formellement pour la guerre, il fait une propagande effrénée en sa faveur. En Suède, en Norvège, en Suisse, aux Pays-Bas les dirigeants socialistes votent les crédits de guerre. En Pologne, le Parti Socialiste se prononce, en Galicie-Silésie, en faveur du soutien à la guerre, mais contre, en Pologne russe. La Russie offre une image partagée : les anciens dirigeants du mouvement ouvrier de ce pays, comme Plekhanov, le chef des anarchistes russes, Kropotkine, mais aussi une poignée de membres du Parti Bolchevik de l'émigration en France, appellent à la défense contre le militarisme allemand. En Russie, la fraction sociale-démocrate de la Douma fait une déclaration contre la guerre. C'est la première déclaration officielle contre la guerre de la part d'un groupe parlementaire de l'un des principaux pays belligérants. Le Parti Socialiste italien prend, dès le début, position contre la guerre. En décembre 1914 le parti exclut de ses rangs un groupe de renégats qui, sous la direction de Benito Mussolini, se rangent du côté de la bourgeoisie favorable à l'Entente et font de la propagande pour la participation de l'Italie à la guerre mondiale. Le Parti Social-démocrate Ouvrier de Bulgarie (Tesniaks) adopte aussi une position internationaliste conséquente.
L'Internationale, l'orgueil de la classe ouvrière, s'effondre dans les flammes de la guerre mondiale. Le SPD devient un « cadavre puant ». L'Internationale se désintégre et se transforme, comme l'écrit Rosa Luxemburg, en « un amas de bêtes fauves prises de rage nationaliste qui s'entre-déchirent mutuellement pour la plus grande gloire de la morale et de l'ordre bourgeois ». Seuls quelques groupes en Allemagne - Die Internationale, « Lichtstrahlen », la Gauche de Brème -, le groupe de Trotsky, Martov, une partie des syndicalistes français, le groupe De Tribune (avec Gorter, Pannekoek) en Hollande, ainsi que les Bolcheviks, défendent le point de vue résolument internationaliste.
Parallèlement à cette trahison décisive de la majorité des partis de la II° Internationale, la classe ouvrière subit un matraquage idéologique qui parvient à lui inoculer la dose fatale de poison nationaliste. En août 1914, ce n'est pas seulement la plus grande partie de la petite-bourgeoise qui est embrigadée derrière les visées expansionnistes de l'Allemagne, mais aussi des secteurs entiers de la classe ouvrière, galvanisés par le nationalisme. De plus, la propagande bourgeoise entretient l'illusion qu’ « en l'espace de quelques semaines, au plus tard d'ici Noël », la guerre sera terminée et tout le monde rentré chez soi.
A la veille de la guerre, malgré ses conditions particulièrement défavorables, la minorité de révolutionnaires qui reste intransigeante sur le principe de l'internationalisme prolétarien ne va ni se résigner ni abandonner le combat.
Les révolutionnaires et leur lutte contre la guerre
Alors que la grande majorité de la classe ouvrière reste grisée par le nationalisme, le soir du quatre août 1914 les principaux représentants de la Gauche de la social-démocratie organisent une réunion dans l'appartement de Rosa Luxemburg, rassemblant K. et H. Duncker, H. Eberlein, J. Marchlewski, F. Mehring, E. Meyer, W. Pieck. Même si leur nombre ce soir-là est réduit, leur action au cours des quatre années suivantes va connaître un immense rayonnement.
Plusieurs questions essentielles sont à l'ordre du jour de cette conférence :
- l'évaluation du rapport de force entre les classes,
- l'évaluation du rapport de force au sein du SPD,
- les objectifs de la lutte contre la trahison de la direction du parti,
- les perspectives et les moyens de cette lutte.
La situation générale, à l'évidence très défavorable, ne constitue en rien un motif de résignation pour les révolutionnaires. Leur attitude n'est pas de rejeter l'organisation mais, au contraire, de continuer, développer le combat en son sein et lutter avec détermination pour lui conserver ses principes prolétariens.
Au sein du groupe parlementaire social-démocrate au Reichstadt il y a eu, avant le vote en faveur des crédits de guerre, un débat interne au cours duquel 78 députés se sont prononcés pour, et 14 autres contre ce vote. Par discipline de fraction, les 14 députés - dont Liebknecht- se sont plies à la majorité et ont voté les crédits. Ce fait a été tenu secret par la direction du SPD.
Au niveau local dans le parti, les choses apparaissent bien moins unitaires. Des protestations contre la direction s'élèvent aussitôt de la part de nombreuses sections (Ortsvereine). Le 6 août, l'écrasante majorité de rassemblée de la section locale de Stuttgart exprime sa défiance à la fraction parlementaire. La gauche réussit même à exclure la droite du parti, à lui arracher le journal local. A Hambourg, Laufenberg et Wolfheim rassemblent l'opposition autour d’eux, à Brème, le Bremer-Burger-Zeitung intervient avec détermination contre la guerre ; le Bramschweiger Volksfreund, le Gothaer Volksblat, Der Kampf de Duisburg, des journaux de Nuremberg, Halle, Leipzig et Berlin élèvent également des protestations, reflétant l'opposition de larges parties de la base du parti. Lors d'une assemblée à Stuttgart le 21 septembre 1914, une critique est adressée à l'altitude de Liebknecht. Lui-même dira par la suite que d'avoir agi comme il l'avait fait, par discipline de fraction, avait été une erreur désastreuse. Comme, dès le début de la guerre, tous les journaux sont soumis à la censure, les expressions de protestations sont immédiatement réduites au silence. L'opposition dans le SPD s'appuie alors sur la possibilité de faire entendre sa voix à l'étranger. Le Berner Tagwacht va devenir le porte-parole de la gauche du SPD ; de même, les internationalistes vont exprimer leur position dans la revue Lichtstrahlen, éditée par Borchardt de septembre 1913 à avril 1916.
Un examen de la situation au sein du SPD montre que si la direction a trahi, l'ensemble de l'organisation ne s'est pas laissé embrigader dans la guerre. C'est pourquoi la perspective apparaît clairement : pour défendre l'organisation, pour ne pas l'abandonner aux mains des traîtres, il faut décider leur expulsion et rompre clairement avec eux.
Au cours de la conférence dans l'appartement de Rosa Luxemburg est discutée la question : doit-on, en signe de protestation ou par dégoût face à la trahison, quitter le parti ? Unanimement, cette idée est rejetée pour la raison qu'il ne faut pas abandonner l'organisation, l'offrir, pour ainsi dire en cadeau, à la classe dominante. On ne peut pas, en effet, quitter le parti, qui a été bâti au prix d'énormes efforts, tout comme des rats quittent un navire. C'est pourquoi se battre pour l'organisation ne signifie pas alors en sortir mais combattre pour sa reconquête.
Personne ne pense, à ce moment-là, à quitter l'organisation. Le rapport de forces ne contraint pas la minorité à le faire. De même il ne s'agit pas, pour l'instant, de construire une nouvelle organisation indépendante. Rosa Luxemburg et ses camarades, par leur attitude, font ainsi partie des défenseurs les plus conséquents de la nécessité de l'organisation.
Le fait est que, longtemps avant que la classe ouvrière n'émerge de son abrutissement, les internationalistes ont déjà engagé le combat. Comme avant-garde, ils n'attendent pas les réactions de la classe ouvrière dans son ensemble mais se portent à la tête du combat de leur classe. Alors que le poison nationaliste poursuit son effet sur la classe ouvrière, que celle-ci est livrée idéologiquement et physiquement au feu de la guerre impérialiste, les révolutionnaires - dans les conditions les plus difficiles de l'illégalité - ont eux-mêmes déjà démasqué la nature impérialiste du conflit. Là aussi, dans leur travail contre la guerre, les révolutionnaires ne se mettent pas en position d'attendre que le processus de prise de conscience de plus larges parties de la classe ouvrière se fasse seul. Les internationalistes assument leurs responsabilités de révolutionnaires, en tant que membres d'une organisation politique du prolétariat. Il ne s'est pas passé un jour de guerre sans qu'ils ne se réunissent, autour des futurs Spartakistes, pour entreprendre aussitôt la défense de l'organisation et poser les bases effectives pour la rupture avec les traîtres. On est loin du prétendu spontanéisme des Spartakistes et de Rosa Luxemburg.
Les révolutionnaires entrent aussitôt en contact avec les internationalistes des autres pays. Ainsi, Liebknecht est envoyé à l'étranger en tant que représentant le plus éminent. Il prend contact avec les Partis Socialistes de Belgique et de Hollande.
La lutte contre la guerre est impulsée sur deux plans : d'une part sur le terrain parlementaire, où les Spartakistes peuvent encore utiliser la tribune du Parlement, d'autre part - c'est le plus important - par le développement de la résistance au niveau local dans le parti et au contact direct avec la classe ouvrière.
C'est ainsi qu'en Allemagne, Liebknecht lui-même devient le porte-flambeau de la lutte.
Au sein du Parlement, il parvient à attirer de plus en plus de députés de son côté. Il est clair qu'au début, la crainte et les hésitations dominent. Mais le 22 octobre 1914, cinq députés SPD quittent la salle en signe de protestation ; le 2 décembre, Liebknecht est le seul à voter ouvertement contre les crédits de guerre; en mars 1915, lors du vote de nouveaux crédits, environ 30 députés quittent la salle et une année plus tard, le 19 août 1915, 36 députés votent contre les crédits.
Mais le véritable centre de gravité se trouve, naturellement, dans l'activité de la classe ouvrière elle-même, à la base des partis ouvriers d'une part, et dans les actions de masse de la classe ouvrière dans les usines et dans la rue, d'autre part.
Immédiatement après le déclenchement de la guerre, les révolutionnaires avaient énergiquement et clairement pris position sur la nature impérialiste de celle-ci. ([2] [128]) En avril 1915 est imprimé le premier et unique numéro de Die Internationale à 9 000 exemplaires, dont 5 000 sont vendus dés le premier soir (D'où le nom du groupe « Die Internationale »).
A partir de l'hiver 1914-15, les premiers tracts illégaux contre la guerre sont diffusés, dont le plus célèbre d'entre eux : » L'ennemi principal se trouve dans notre propre pays ».
Le matériel de propagande contre la guerre circule dans de nombreuses assemblées locales de militants. Le fait que Liebknecht ait refusé de voter les crédits de guerre est publiquement connu et fait rapidement de lui l'adversaire de la guerre le plus célèbre, d'abord en Allemagne, puis dans les pays voisins par la suite. Toutes les prises de positions des révolutionnaires sont considérés comme « hautement dangereuses » par les services de sécurité bourgeois. Dans les assemblées locales de militants, les représentants des dirigeants traîtres du parti dénoncent les militants qui distribuent du matériel de propagande contre la guerre. Souvent ces derniers sont ensuite arrêtés ! Le SPD est divisé au plus profond de lui-même !
Hugo Eberlein rapportera plus tard, lors du congrès de fondation du KPD le 31 décembre 1918, qu'il existait une liaison avec plus de 300 villes. Pour mettre fin au danger croissant de la résistance à la guerre dans les rangs du parti, la direction décide, en janvier 1915, en commun accord avec le commandement militaire de la bourgeoisie, de faire taire définitivement Liebknecht en le mobilisant dans l'année. Il est ainsi interdit de prise de parole et ne peut plus se rendre dans les assemblées de militants. Le 18 février 1915, Rosa Luxemburg est incarcérée jusqu'en février 1916 et, à l'exception de quelques mois entre février et juillet 1916, elle restera en prison jusqu'en octobre 1918. En septembre 1915 Ernst Meyer, Hugo Eberlein et, par la suite, Franz Mehring - âgé de 70 ans - et beaucoup d'autres encore, sont également incarcérés.
Mais, même dans ces conditions particulièrement difficiles, ils vont poursuivre leur travail contre la guerre et tout entreprendre pour continuer à développer un travail organisationnel.
Entre-temps, la réalité de la guerre commence à sortir de plus en plus d'ouvriers de leur ivresse nationaliste. L'offensive allemande en France est rapidement tombée en panne et une longue guerre de positions prend place. Rien que fin 1914, 800 000 soldats sont déjà tombés. La guerre de positions en France et en Belgique coûte, au printemps 1915, des centaines de milliers de morts. Sur la Somme, 60 000 soldats trouvent la mort le même jour. Sur le front, la désillusion s'installe rapidement, mais surtout, sur le «front de l'intérieur », la classe ouvrière est précipitée dans la misère. Les femmes sont mobilisées dans la production d'armements, les produits alimentaires augmentent terriblement, puis sont rationnés. Le 18 mars 1915 se produit la première manifestation de femmes contre la guerre. Du 15 au 18 octobre on signale des affrontements sanglants entre la police et des manifestants contre la guerre, à Chemnitz. En novembre 1915 entre 10 000 et 15 000 manifestants défilent contre la guerre à Berlin. Dans d'autres pays, il se produit également des mouvements dans la classe ouvrière. En Autriche, de nombreuses « grèves sauvages », contre la volonté des syndicats, sont déclenchées. En Grande-Bretagne 250 000 mineurs, dans le sud du Pays de Galles, font grève ; en Ecosse, dans la vallée de la Clyde, ce sont les ouvriers de la construction mécanique. En France des grèves se produisent dans le secteur du textile.
La classe ouvrière commence lentement à s'arracher aux brumes nationalistes dans lesquelles elle se trouve, et manifeste de nouveau sa volonté de défendre ses intérêts de classe exploitée. L'union sacrée, un peu partout, commence à vaciller.
La réaction des révolutionnaires au niveau international
Avec le déclenchement de la première guerre mondiale et la trahison des différents partis de la 2e Internationale, une époque se termine. L'Internationale meurt car plusieurs de ses partis-membres ne représentent plus une orientation internationaliste. Ils sont passés du côté de leurs bourgeoisies nationales respectives. Une Internationale, composée de différents partis nationaux membres, ne trahit pas en tant que telle ; elle meurt et perd son rôle pour la classe ouvrière. Elle ne peut plus être redressée en tant que telle.
Mais la guerre a permis une clarification au sein du mouvement ouvrier international : d'un côté les partis qui ont trahi, de l'autre la gauche révolutionnaire qui continue de défendre de façon conséquente et inflexible les positions de classe, mais qui au début ne forme qu'une petite minorité. Entre les deux se trouve un courant centriste, oscillant entre les traîtres et les internationalistes, hésitant constamment à prendre position sans ambiguïté et refusant la rupture claire avec les social-patriotes.
En Allemagne même, l'opposition à la guerre est au départ divisée en plusieurs regroupements :
- les hésitants, dont la plupart appartiennent à la fraction parlementaire social-démocrate au Reichstag : Haase, Ledebour sont les plus connus ;
- le groupe autour de Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, « Die Internationale », qui prend le nom de Spartakusbund à partir de 1916 ;
- les groupes autour de la Gauche de Brème (le Bremer Burgerzeitung paraît à partir de juillet 1916), avec J. Knief et K. Radek à leur tête, le groupe autour de J. Borchardt (« Lichtstrahlen »), plus ceux qui existent dans d'autres villes (à Hambourg autour de Wolfheim et Laulenberg, à Dresde autour de O. Ruhle). Fin 1915 la Gauche de Brème et le groupe de Borchardt fusionnent et prennent le nom d'Internationale Sozialisten Deutschlands (1SD).
Après une première phase de désorientation et de rupture des contacts, à partir du printemps 1915, les conférences internationales des Femmes Socialistes (du 26 au 28 mars) et des Jeunes Socialistes (du 5 au 7 avril) se tiennent à Bénie. Et après plusieurs ajournements, du 5 au 8 septembre, 37 délégués de 12 pays européens se réunissent à Zimmerwald (non loin de Berne). La délégation la plus importante numériquement est celle d'Allemagne, comprenant dix représentants, délégués par trois groupes oppositionnels : les Centristes, le groupe « Die Internationale » (E. Meyer, B. Thalheimer), les ISD (J. Borchardt). Alors que les Centristes se prononcent pour mettre fin à la guerre sans bouleversement des rapports sociaux, la Gauche fait du lien entre guerre et révolution la question centrale. La conférence de Zimmerwald, après d'âpres discussions, se sépare en adoptant un Manifeste appelant les ouvriers de tous les pays à lutter pour l'émancipation de la classe ouvrière et pour les buts du socialisme, au moyen de la lutte de classe prolétarienne la plus intransigeante. En revanche, les Centristes refusent d'y faire figurer la nécessité de la rupture organisationnelle avec le social-chauvinisme et l'appel au renversement de son propre gouvernement impérialiste. Le Manifeste de Zimmerwald va cependant connaître un énorme retentissement dans la classe ouvrière et parmi les soldats. Même s'il s'agit d'un compromis critiqué par la gauche, vu que les Centristes hésitent encore très fortement devant des prises de positions tranchées, il constitue néanmoins un pas décisif vers l'unification des forces révolutionnaires.
Dans un article déjà paru de la Revue Internationale nous avons fait la critique du groupe « Die Internationale » qui, au début, hésite encore à reconnaître la nécessité de transformer la guerre impérialiste en guerre civile.
Le rapport de forces est ébranlé
Les révolutionnaires impulsent ainsi le processus vers leur unification et leur intervention rencontre un écho de plus en plus grand.
Le 1° mai 1916 à Berlin, environ 10 000 ouvriers manifestent contre la guerre. Liebknecht prend la parole pour crier « A bas la guerre ! A bas le gouvernement ! » A ces paroles il est arrêté, ce qui va déclencher une grande vague de protestation. L'intervention courageuse de Liebknecht sert à ce moment-là de stimulant et d'orientation aux ouvriers. La détermination des révolutionnaires à lutter contre le courant social-patriote et à poursuivre la défense des principes prolétariens ne les conduit pas à un isolement plus important, mais a un effet d'encouragement sur le reste de la classe ouvrière pour entrer en lutte.
En mai 1916, les mineurs du district de Beuthen entrent en grève pour des hausses de salaires. A Leipzig, Brunswick et Coblence se produisent des manifestations ouvrières contre la faim et des rassemblements contre la vie chère. L'état de siège est décrété à Leipzig. Les actions des révolutionnaires, le fait que malgré la censure et l'interdiction de se réunir l'information au sujet de la riposte croissante contre la guerre se répande, va donner une impulsion supplémentaire à la combativité de la classe ouvrière dans son ensemble.
Le 27 mai 1916, 25 000 ouvriers manifestent à Berlin contre l'arrestation de Liebknecht. Un jour plus tard se produit la première grève de masse politique contre son emprisonnement, rassemblant 55 000 ouvriers. A Brunswick, Brème, Leipzig et dans de nombreuses autres villes, il y a aussi des rassemblements de solidarité et des manifestations de la faim. Dans une douzaine de villes il y a des rassemblements ouvriers. Nous avons ici une claire concrétisation des rapports existants entre les révolutionnaires et la classe ouvrière. Les révolutionnaires ne se trouvent pas en dehors de la classe ouvrière, ou au dessus d'elle, mais n'en sont que sa partie la plus claire, la plus déterminée et rassemblée dans des organisations politiques. Mais leur rayonnement dépend de la « réceptivité » de la classe ouvrière dans son ensemble. Même si le nombre des éléments organisés dans le mouvement spartakiste est encore réduit, des centaines de milliers d'ouvriers suivent cependant leurs mots d'ordre. Ils sont de plus en plus les porte-parole de l'état d'esprit des masses.
De ce fait, la bourgeoisie va tout faire pour isoler les révolutionnaires de la classe ouvrière en déclenchant, dans cette phase, une vague de répression. De nombreux membres de la Ligue Spartakiste sont alors placés en détention préventive. R. Luxemburg et presque toute la Centrale de Spartakus sont arrêtés au cours de la seconde moitié de 1916. De nombreux Spartakistes sont dénoncés par les fonctionnaires du SPD pour avoir distribué des tracts dans des réunions du SPD ; les cachots de la police se remplissent de militants spartakistes.
Tandis que les massacres sur le front de l'Ouest (Verdun) causent de plus en plus de victimes, la bourgeoisie exige de plus en plus des ouvriers sur « le front de l'intérieur », dans les usines. Toute guerre ne peut être faite que si la classe ouvrière est prête à faire le sacrifice de toute sa vie au profit du capital. Or, à ce moment-là, la classe dominante se heurte à une résistance de plus en plus forte.
Les protestations contre la faim ne cessent de se développer (la population n'obtient que le tiers de ses besoins en calories !). A l'automne 1916 il y a, quasiment tous les jours, des protestations ou des manifestations dans les grandes villes - en septembre à Kiel, en novembre à Dresde, en janvier 1917, un mouvement des mineurs de la Ruhr. Le rapport de forces entre le capital et le travail commence lentement à se renverser. Au sein du SPD, la direction social-patriote rencontre de plus en plus de difficultés. Même si, grâce à une collaboration étroite avec la police, elle fait embarquer et envoyer au front tout ouvrier oppositionnel, même si, dans les votes à l'intérieur du parti, elle maintient des rapports de majorité en sa faveur grâce aux manipulations, elle ne parvient plus à mater la résistance croissante face à son attitude. La minorité révolutionnaire gagne progressivement en influence dans le parti. A partir de l'automne 1916, de plus en plus de sections locales (Ortsvereine) décident la grève des cotisations versées à la direction.
L'opposition tend dès ce moment-là, en cherchant à unifier ses forces, à éliminer le comité directeur pour reprendre le parti en main.
Le comité directeur du SPD voit clairement le rapport de forces se développer à son désavantage. Suite à la réunion, le 7 janvier 1917, d'une conférence nationale de l'opposition, le comité directeur décide alors l'exclusion de tous les oppositionnels. La scission s'accomplit. La rupture organisationnelle est inévitable. Les activités internationalistes et la vie politique de la classe ouvrière ne peuvent plus se développer au sein du SPD mais, désormais, seulement à l'extérieur de celui-ci. Toute vie prolétarienne au sein du SPD s'est éteinte suite à l'expulsion des minorités révolutionnaires. Le travail au sein du SPD n'est plus possible ; les révolutionnaires doivent s'organisera l'extérieur. ([3] [129])
L'opposition se trouve désormais face à la question : quelle organisation ériger ? Disons seulement ici qu'à partir de cette période du printemps 1917, les différents courants au sein de la Gauche en Allemagne empruntent différentes directions.
Dans un prochain article nous aborderons plus en profondeur la question de l'appréciation du travail organisationnel de ce moment-là.
La Révolution russe, début de la vague révolutionnaire
Au même moment, au niveau international, la pression de la classe ouvrière est en train de franchir un seuil décisif.
En février (mars pour le calendrier occidental), les ouvriers et les soldats, en Russie, créent à nouveau, dans leur lutte contre la guerre, comme en 1905, des conseils ouvriers et de soldats. Le Tsar est renversé. Un processus révolutionnaire, qui va très rapidement connaître un écho dans les pays voisins et dans le monde entier, s'enclenche dans ce pays. Cet événement va faire naître un espoir immense dans les rangs ouvriers.
Le développement ultérieur des luttes ne peut pleinement être compris qu'à la lumière de la révolution en Russie. Car le fait que la classe ouvrière ait renversé la classe dominante dans un pays, qu'elle commence à ébranler les fondements capitalistes, agit comme un phare qui éclaire la direction à suivre. Et c'est dans cette direction que la classe ouvrière du monde entier commence à braquer les yeux.
Les luttes de la classe ouvrière en Russie ont un puissant retentissement, surtout en Allemagne.
Dans la Ruhr il y a, du 16 au 22 février 1917, une vague de grèves. D'autres actions de masse se produisent dans de nombreuses villes allemandes. Il ne va plus se passer de semaines sans d'importantes actions de résistance, revendiquant des hausses de salaires et un meilleur ravitaillement. Dans presque toutes les grandes cités sont signalés des troubles dus aux difficultés d'approvisionnement. Lorsqu'en avril une nouvelle réduction des rations alimentaires est annoncée, la colère de la classe ouvrière déborde. A partir du 16 avril, il se produit une grande vague de grèves de masse à Berlin, Leipzig, Magdebourg, Hanovre, Brunswick, Dresde. Les chefs de l'armée, les principaux politiciens bourgeois, les dirigeants des syndicats et du SPD, notamment Ebert et Scheidemann, se concertent pour tenter de maîtriser le mouvement de grèves.
Les ouvriers sont plus de 300 000, dans plus de 30 usines, à faire grève. C'est, après les luttes contre l'arrestation de Liebknecht en juillet 1916, la seconde grande grève de masse.
« D'innombrables assemblées eurent lieu dans des salles ou en plein air, des discours furent prononcés et des résolutions adoptées. L'état de siège fut ainsi rompu en un clin d'oeil et réduit à néant dès que la masse se fut mise en mouvement et, déterminée, eût pris possession de la rue. » (Spartakusbriefe, avril 1917)
La classe ouvrière en Allemagne emboîte ainsi le pas de ses frères de classe de Russie, qui s'affrontent au capital dans un gigantesque combat révolutionnaire.
Ils luttent exactement avec les moyens décrits par Rosa Luxemburg dans sa brochure Grève de masse, écrite suite aux luttes de 1905 : assemblées massives, manifestations, rassemblements, discussions et résolutions communes dans les usines, assemblées générales, jusqu'à la formation des conseils ouvriers.
Depuis que les syndicats ont été intégrés à l'Etat à partir de 1914, ils lui servent de rempart contre les réactions ouvrières. Ils sabotent les luttes par tous les moyens. Le prolétariat se doit de se mettre lui-même en activité, s'organiser par lui-même, s'unifier par lui-même. Aucune organisation construite à l'avance ne peut lui épargner cette tâche. Et les ouvriers d'Allemagne, le pays industriel le plus développé d'alors, ont démontré leur capacité à s'organiser par eux-mêmes. Contrairement au discours que l'on nous sert sans cesse aujourd'hui, la classe ouvrière est parfaitement capable d'entrer massivement en lutte et de s'organiser pour cela. Dans cette perspective, sa lutte ne doit plus se dérouler dans le cadre syndical et réformiste, c'est à dire par branches d'activité séparées les unes des autres. La classe ouvrière montre qu'elle est désormais capable de s'unifier au delà des secteurs professionnels et des branches d'activité et d'entrer en action pour des revendications partagées par tous : le pain et la paix, la libération de ses militants révolutionnaires. De partout, en effet, résonne l'appel pour la libération de Liebknecht.
Les luttes ne peuvent plus être soigneusement préparées à l'avance, à la façon d'un état-major comme au siècle précédent. La tâche de l'organisation politique est d'assumer, dans les luttes, un rôle de direction politique et non d'organiser les ouvriers.
Lors de la vague de grèves de 1917 en Allemagne, les ouvriers, pour la première fois, s'affrontent directement aux syndicats. Alors que ceux-ci, au siècle précédent, ont été créés par la classe ouvrière elle-même, depuis le début de la guerre ils sont devenus des défenseurs du capital dans les usines et ils constituent désormais un obstacle pour la lutte prolétarienne. Les ouvriers en Allemagne font les premiers l'expérience que désormais, dans leur lutte, ils ne peuvent aller de l'avant que contre les syndicats.
Les effets du commencement de la révolution en Russie se propagent d'abord parmi les soldats. Ces événements révolutionnaires sont discutés avec le plus grand enthousiasme ; de fréquentes fraternisations ont lieu sur le front de l'est entre soldats allemands et russes. Durant l'été 1917 se produisent les premières mutineries dans la flotte allemande. La répression sanglante est sans doute, encore ici, en mesure d'étouffer les premières flammes mais il ne lui est plus possible de stopper l'extension de l'élan révolutionnaire à long terme.
Les partisans de Spartakus et les membres des Linksradikale de Brème disposent d'une large influence parmi les marins.
Dans les villes industrielles, la riposte ouvrière continue à se développer : de la région de la Ruhr à l'Allemagne centrale, de Berlin à la Baltique, partout la classe ouvrière fait front à la bourgeoisie. Le 16 avril, les ouvriers de Leipzig publient un appel aux ouvriers des autres villes pour qu'ils s'unissent à eux.
L'intervention des révolutionnaires
Les Spartakistes se trouvent aux avant-postes dans ces mouvements. Depuis le printemps 1917, en reconnaissant la signification du mouvement en Russie, ils jettent un pont en direction de la classe ouvrière russe et mettent en évidence la perspective de l'extension internationale des luttes révolutionnaires. Dans leurs brochures, dans des tracts, dans des polémiques, face à la classe ouvrière, ils interviennent sans cesse contre les centristes, oscillants et hésitants, qui esquivent les prises de position claires ; ils contribuent à la compréhension de la nouvelle situation, démasquent sans cesse la trahison des social-patriotes et montrent à la classe ouvrière comment retrouver la voie de son terrain de classe.
Les Spartakistes, notamment, mettent constamment en avant que :
- si la classe ouvrière développe un rapport de forces suffisant, elle sera en mesure de mettre un tenue à la guerre et de provoquer le renversement de la classe capitaliste ;
- dans cette perspective, il est nécessaire de reprendre le flambeau révolutionnaire allumé par la classe ouvrière en Russie. A ce niveau, le prolétariat en Allemagne occupe une place centrale et décisive !
« En Russie les ouvriers et les paysans (...) ont renversé le vieux gouvernement tsariste et ont pris en main la conduite de leur destin. Les grèves et les arrêts de travail d'une telle ténacité et unité nous garantissent actuellement non seulement de petits succès mais la fin du génocide, le renversement du gouvernement allemand et de la domination des exploiteurs ...La classe ouvrière ne fut jamais aussi puissante au cours de la guerre que maintenant quand elle se manifeste unie et solidaire dans son action et son combat ; la classe dominante, jamais aussi mortelle ... Seule la révolution allemande peut apporter à tous les peuples la paix ardemment désirée et la liberté. La révolution russe victorieuse unie à la révolution allemande victorieuse sont invincibles. A partir du jour où s'effondrera le gouvernement allemand -y compris le militarisme allemand - sous les coups révolutionnaires du prolétariat, s'ouvrira une ère nouvelle : une ère dans laquelle les guerres, l'exploitation et l'oppression capitalistes devront disparaître à tout jamais. » (Tract spartakiste, avril 1917)
« Il s'agit de briser la domination de la réaction et des classes impérialistes en Allemagne, si nous voulons mettre fin au génocide ... Ce n'est que par la lutte des masses, par le soulèvement des masses, par les grèves de masse qui arrêtent toute l'activité économique et l'ensemble de l'industrie de guerre, ce n'est que par la révolution et la conquête de la république populaire en Allemagne qu'il sera mis un ternie au génocide et que la paix générale sera instaurée. Et ce n'est qu'ainsi que la révolution russe pourra aussi être sauvée. »
« La catastrophe internationale ne peut que dompter le prolétariat international. Seule la révolution prolétarienne mondiale peut liquider la guerre impérialiste mondiale. » {Lettre de Spartacus n°6, août 1917)
La Gauche radicale est consciente de sa responsabilité et comprend pleinement tout ce qui est en jeu si la révolution en Russie reste isolée : « ... Le destin de la révolution russe : elle atteindra son objectif exclusivement comme prologue de la révolution européenne du prolétariat. Si en revanche les ouvriers européens, allemands, continuent à rester spectateurs de ce drame captivant et jouent les badauds, alors le pouvoir russe des soviets ne devra pas s'attendre à autre chose qu'au destin de la Commune de Paris (C'est à dire la défaite sanglante). » (Spartakus, janvier 1918)
C'est pourquoi le prolétariat en Allemagne, qui se trouve à une position-clé pour l'extension de la révolution, doit prendre conscience de son rôle historique.
« Le prolétariat allemand est le plus fidèle, le plus sûr allié de la révolution russe et de la révolution internationale prolétarienne. » (Lénine)
En examinant l'intervention des Spartakistes dans son contenu, nous pouvons constater qu'elle est clairement internationaliste et qu'elle donne une juste orientation au combat des ouvriers : le renversement du gouvernement bourgeois avec le renversement mondial de la société capitaliste comme perspective, la mise à nu de la tactique de sabotage des forces au service de la bourgeoisie.
L'extension de la révolution aux pays centraux du capitalisme : une nécessité vitale
Si le mouvement révolutionnaire en Russie, à partir de février 1917, est dirigé principalement contre la guerre, il n'a pas la force, par lui-même, d'y mettre fin. Pour cela, il est indispensable que la classe ouvrière des grands bastions industriels du capitalisme entre en scène. Et c'est avec la conscience profonde de cette nécessité que, dès la prise de pouvoir des soviets en Octobre 1917, le prolétariat de Russie lance un appel à tous les ouvriers des pays belligérants:
« Le gouvernement des ouvriers et des paysans créé par la révolution des 24/25 octobre et s'appuyant sur les soviets ouvriers, de soldats et de paysans propose à tous les peuples belligérants et à leurs gouvernements d'entamer des négociations sur une paix équitable et démocratique. » (26 novembre 1917)
La bourgeoisie mondiale, de son côté, est consciente du danger que recèle une telle situation pour sa domination. Voilà pourquoi il s'agit pour elle, à ce moment-là, de tout faire pour étouffer la flamme qui s'est allumée en Russie. Voilà pourquoi la bourgeoisie allemande, avec la bénédiction générale, poursuivra son offensive guerrière contre la Russie après avoir signé un accord de paix avec le gouvernement des soviets à Brest-Litovsk en janvier 1918. Dans leur tract intitulé « L'heure de la décision », les Spartakistes lancent, dans ce sens, un avertissement aux ouvriers :
« Pour le prolétariat allemand sonne désormais l'heure de la décision ! Soyez sur vos gardes ! Car avec ces négociations le gouvernement allemand vise justement à jeter de la poudre aux yeux au peuple, à prolonger et aggraver la misère et la détresse du génocide. Le gouvernement et les impérialistes allemands ne font que poursuivre par de nouveaux moyens leurs anciens buts. Sous couvert du droit à l'autodétermination des nations doivent être créés dans les provinces russes occupées des états fantoches - condamnés à une pseudo-existence, dépendants économiquement et politiquement des "libérateurs" allemands - qui bien entendu les avaleront ensuite à la première occasion favorable. »
Cependant, une année supplémentaire s'écoulera avant que la classe ouvrière des centres industriels soit suffisamment forte pour repousser le bras assassin de l'impérialisme.
Mais, dès 1917, le retentissement de la révolution victorieuse en Russie d'une part, comme l'intensification de la guerre par les impérialistes d'autre part, poussent de plus en plus les ouvriers à vouloir mettre un tenue à la guerre.
La flamme de la révolution se propage, en effet, dans les autres pays.
- En Finlande, en janvier 1918, un comité exécutif ouvrier est créé, préparant la prise du pouvoir. Ces luttes vont être ensuite défaites militairement en mars 1918. L'année allemande mobilisera à elle seule plus de 15 000 soldats. Le bilan des ouvriers massacrés s'élèvera à plus de 25 000 morts.
- Le 15 janvier 1918 débute à Vienne une grève de masse politique qui s'étend quasiment à l'ensemble de l'empire des Habsbourg. A Brünn, Budapest, Graz, Prague, Vienne, et dans d'autres villes, se produisent de gigantesques manifestations pour la paix.
Un conseil ouvrier est formé, unissant les actions de la classe ouvrière. Le 1er février 1918 les marins de la flotte austro-hongroise se soulèvent, dans le port de guerre de Cattaro, contre la poursuite de la guerre et fraternisent avec les ouvriers en grève de l'arsenal.
- A la même période, des grèves ont lieu en Angleterre, en France et en Hollande. (Voir à ce sujet l'article de la Revue Internationale n° 80)
Les luttes de janvier : le SPD, fer de lance de la bourgeoisie contre la classe ouvrière
Après la poursuite de l'offensive allemande contre le jeune pouvoir révolutionnaire ouvrier en Russie, la colère dans les rangs de la classe ouvrière déborde. Le 28 janvier 400 000 ouvriers de Berlin entrent en grève, notamment dans les usines d'armement. Le 29 janvier le nombre des grévistes s'élève même à 500 000. Le mouvement se propage dans d'autres villes : à Munich, une assemblée générale de grévistes lance l'appel suivant : « Les ouvriers de Munich en grève adressent leurs saints fraternels aux ouvriers belges, français, anglais, italiens, russes et américains. Nous nous semons un avec eux dans la détermination à mettre de suite un terme à la guerre mondiale ... Nous voulons solidairement imposer la paix mondiale ... Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » (Cité par R. Millier, p. 148.)
Dans ce mouvement de masse, le plus important de la guerre, les prolétaires forment un conseil ouvrier à Berlin. Un tract des Spartakistes y appelle de la façon suivante :
« Nous devons créer une représentation librement élue sur le modèle russe et autrichien et ayant pour tâche de diriger cette lutte-ci et les prochaines. Chaque usine élit un homme de confiance pour 1000 ouvriers. » Au total plus de 1800 délégués se réunissent.
Par ailleurs, ce même tract déclare : « Les dirigeants des syndicats, les socialistes de gouvernement et autres piliers de l'effort de guerre ne doivent sous aucun prétexte être élus dans les délégations ... Ces hommes de paille et ces agents volontaires du gouvernement, ces ennemis mortels de la grève de masse n'ont rien à faire parmi les ouvriers en lutte ! (...) Lors de la grève de masse d'avril 1917 ils ont cassé les reins du mouvement de grève de la façon la plus perfide en exploitant les confusions de la masse et en orientant le mouvement dans de fausses voies. (...) Ces loups déguisés en agneaux menacent le mouvement d'un danger bien plus grave que la police impériale-prussienne. »
Au coeur des revendications on trouve : la paix, l'adjonction de représentants ouvriers de tous les pays aux négociations de paix... L'assemblée des conseils ouvriers, de son côté, déclare : « Nous adressons aux prolétaires d'Allemagne, ainsi qu'à ceux des autres pays belligérants dans leur ensemble, l'appel pressant, comme nos camarades d'Autriche-Hongrie nous v ont déjà précédé avec succès, à désormais entrer pareillement dans des grèves de masse, car seule la lutte de classe internationale solidaire nous apportera définitivement la paix, la liberté et le pain. »
Un autre tract des Spartakistes souligne : « Nous devons parler russe à la réaction. » Il appelle à des manifestations de rue en solidarité.
La lutte ayant entraîné un million d'ouvriers, la classe dominante va choisir une tactique qu'elle réutilisera sans cesse par la suite contre la classe ouvrière. C'est le SPD qui est le fer de lance de la bourgeoisie pour torpiller le mouvement de l'intérieur. Ce parti traître, tirant profit de son influence encore importante en milieu ouvrier, parvient à envoyer dans le Comité d'action, à la direction de la grève, trois de ses représentants qui mettent toute leur énergie en oeuvre pour briser le mouvement. Ils jouent le rôle de saboteurs de l'intérieur. Ebert reconnaît carrément : « Je suis entré dans la direction de la grève avec l'intention délibérée d'y mettre fin rapidement et de préserver le pays de tout dommage. (...) C'était finalement le devoir des travailleurs que de soutenir leurs frères et leurs pères du front et de leur fournir de meilleures armes. Les travailleurs de France et d'Angleterre ne perdent pas une heure de travail pour aider leurs frères du front. La victoire est évidemment le voeu de tous les Allemands. » (Ebert, 30 janvier 1918) Les ouvriers paieront très cher leurs illusions vis à vis de la social-démocratie et de ses dirigeants.
Après avoir mobilisé les ouvriers dans la guerre depuis 1914, le SPD s'oppose maintenant, de toutes ses forces, aux grèves. Cela montre la clairvoyance et l'instinct de survie de la classe dominante, sa conscience du danger que constitue pour elle la classe ouvrière. Les Spartakistes, de leur côté, dénoncent haut et fort le danger mortel représenté par la social-démocratie contre laquelle ils mettent en garde le prolétariat. Aux méthodes perfides de la social-démocratie, la classe dominante ajoute des interventions directes et brutales, à l'aide de l'année, contre les grévistes. Une douzaine d'ouvriers sont abattus et plusieurs dizaines de milliers incorporés de force... quoique ceux-ci, faisant de l'agitation au sein de l'année dans les mois qui vont suivre, contribueront à sa déstabilisation.
Les grèves sont finalement brisées le 3 février.
Nous pouvons constater que la classe ouvrière en Allemagne applique exactement les mêmes moyens de lutte qu'en Russie : grève de masse, conseils ouvriers, délégués élus et révocables, manifestations de rue massives, qui constituent depuis les armes « classiques » de la classe ouvrière.
Les Spartakistes développent une orientation juste pour le mouvement mais ne disposent pas encore d'une influence déterminante. « Une foule des nôtres s'étaient trouvés parmi les délégués, mais ils étaient dispersés, n'avaient pas de plan d'action et se perdaient dans la masse. » (Barthel, p. 591)
Cette faiblesse des révolutionnaires et le travail de sabotage de la social-démocratie sont les facteurs décisifs dans le coup d'arrêt que subit le mouvement de la classe à ce moment-là.
« Si nous n'étions pas entrés dans le comité de grève, je suis convaincu que la guerre et tout le reste auraient été liquidés dès janvier. Il y avait le danger d'un effondrement total et de l'irruption d'une situation à la russe. Par notre action il fut bientôt mis fin à la grève et tout fut remis en ordre. » (Scheidemann.)
Le mouvement en Allemagne se heurte à un ennemi bien plus fort qu'en Russie. La classe capitaliste dans ce pays a, en effet, déjà tiré les leçons pour agir, par tous les moyens, contre la classe ouvrière.
Déjà, à cette occasion, le SPD fait la preuve de sa capacité à poser des chausse-trapes et à briser le mouvement en se plaçant à sa tête. Dans les luttes ultérieures cela va se révéler encore plus destructeur.
La défaite de janvier 1918 offre aux forces du capital la possibilité de continuer sa guerre encore quelques mois.
Au cours de l'année 1918, l'armée va engager d'autres offensives. Celles-ci coûtent, pour la seule Allemagne et uniquement pour 1918, 550 000 morts et pratiquement un million de blessés.
Suite aux événements de janvier 1918, la combativité n'est malgré tout pas brisée. C'est précisément sous la pression de la situation militaire qui va s'aggravant, qu'un nombre croissant de soldats désertent et que le front commence à se désagréger. A partir de l'été, non seulement la disposition à lutter, dans les usines, recommence à se développer mais, de plus, les chefs de l'armée sont obligés de reconnaître ouvertement qu'ils n'arrivent plus à tenir les soldats sur le front. Pour la bourgeoisie, de ce fait, le cessez-le-feu devient une nécessité pressante.
La classe dominante montre ainsi qu'elle a tiré des leçons de ce qui s'est passé en Russie.
Alors qu'en avril 1917, la bourgeoisie allemande fait traverser l'Allemagne à Lénine en wagon plombé, dans l'espoir que l'action des révolutionnaires russes permette un développement du chaos en Russie et, ainsi, facilite la réalisation des buts impérialistes allemands (l'année allemande ne s'attend pas, à ce moment-là, à ce qu'il se produise ensuite une révolution prolétarienne en octobre 1917), il lui faut maintenant éviter, à tout prix, un développement révolutionnaire identique à celui de la Russie.
Le SPD entre alors dans le gouvernement bourgeois, nouvellement formé, pour servir de frein.
« Si nous refusons notre collaboration dans ces circonstances, il faudrait alors compter avec le danger très sérieux (...) que le mouvement nous passe sur le corps et qu' ensuite un régime bolchevik prenne momentanément place chez nous aussi. » (G. Noske, 23 septembre 1918)
En cette fin de 1918, les usines sont à nouveau en ébullition, des grèves éclatent sans cesse en différents lieux. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le mouvement de grèves de masse n'atteigne l'ensemble du pays. La combativité montante fournit le sol nourricier à l'action des soldats eux-mêmes. Lorsque l'armée commande une nouvelle offensive de la Hotte en octobre, des mutineries éclatent. Les marins de Kiel et d'autres ports de la Baltique refusent de partir en mer. Le 3 novembre s'élève une vague de protestations et de grèves contre la guerre. Partout, des conseils ouvriers et de soldats sont créés. En l'espace d'une semaine, l'ensemble de l'Allemagne est « submergée » par une vague de conseils ouvriers et de soldats.
Si en Russie, après février 1917, ce fut la poursuite de la guerre par le gouvernement Kerenski qui donna une impulsion décisive au combat du prolétariat, au point que celui-ci s'est emparé du pouvoir en octobre pour mettre fin définitivement à la boucherie impérialiste, en Allemagne, la classe dominante, mieux armée que la bourgeoisie russe, va tout faire pour défendre son pouvoir.
Ainsi, le 11 novembre, soit une semaine après le développement des luttes ouvrières et leur extension fulgurante, après l'apparition des conseils ouvriers, elle signe l'armistice. Tirant les leçons de la Russie, elle ne commet pas l'erreur de provoquer une radicalisation fatale de la vague ouvrière en continuant la guerre coûte que coûte. En y mettant fin, elle tente de couper l'herbe sous les pieds du mouvement, afin que l'extension de la révolution ne se produise pas. De plus, elle fait entrer en campagne sa principale pièce d'artillerie : le SPD, et les syndicats à ses côtés.
« Le socialisme de gouvernement, par son entrée au ministère, se pose en défenseur du capitalisme et barre le chemin à la révolution prolétarienne montante. La révolution prolétarienne marchera sur son cadavre. » (Spartakusbrief n°12, octobre 1918)
A la fin du mois de décembre, Rosa Luxemburg précise : « Dans toutes les révolutions antérieures, les combattants s'affrontaient de façon ouverte, classe contre classe, épée contre bouclier... Dans la révolution d'aujourd'hui les troupes qui défendent l'ordre ancien se rangent non sous leur propre drapeau et dans l'uniforme de la classe dominante... mais sous le drapeau de la révolution. C'est un parti socialiste qui est devenu l'instrument le plus important de la contre-révolution bourgeoise. »
Nous aborderons, dans un prochain article, le rôle contre-révolutionnaire du SPD face au développement ultérieur des luttes.
La fin de la guerre permise par l'action des révolutionnaires
La classe ouvrière en Allemagne n'aurait jamais pu développer cette capacité de mettre fin à la boucherie impérialiste sans la participation constante et l'intervention des révolutionnaires dans ses rangs. Le passage de la situation d'ivresse nationaliste, dans laquelle pataugeait la classe ouvrière en 1914, au soulèvement de novembre 1918, qui met fin à la guerre, n'a été possible que grâce à l'activité inlassable des révolutionnaires. Ce n'est pas le pacifisme qui a permis la fin des massacres mais le soulèvement révolutionnaire du prolétariat.
Si les internationalistes n'avaient pas courageusement, dès le début, mis en évidence la trahison des social-patriotes, s'ils n'avaient pas fait entendre leur voix fortement et clairement dans les assemblées, dans les usines, dans la rue, s'ils n'avaient pas démasqué avec détermination les saboteurs de la lutte de classe, la riposte ouvrière n'aurait pu se développer, et encore moins aboutir.
En jetant un regard lucide sur cette période de l'histoire du mouvement ouvrier, et en tirant un bilan du point de vue du travail des révolutionnaires, nous pouvons dégager des leçons cruciales pour aujourd'hui.
La poignée de révolutionnaires, qui a continué de défendre les principes internationalistes en août 1914, ne s'est pas laissée intimider ou démoraliser par son nombre réduit et l'ampleur de la tâche qu'elle avait à assumer. Elle conservait la confiance en sa classe et a continué à intervenir résolument, malgré d'immenses difficultés, pour tenter de renverser le rapport de forces, pourtant particulièrement défavorable. Dans les sections du parti, à la base, les révolutionnaires ont regroupé le plus rapidement possible leurs forces sans jamais renoncer à leurs responsabilités.
En défendant face aux ouvriers des orientations politiques capitales, sur la base d'une analyse juste de l'impérialisme et des rapports de forces entre les classes, ils ont indiqué, avec la plus grande clarté, la véritable perspective et ils ont servi de boussole politique à leur classe.
Leur défense de l'organisation politique du prolétariat a été, elle aussi, conséquente. Autant quand il s'agissait de ne pas abandonner, sans combattre, le SPD aux mains des traîtres que lorsqu'il a fallu construire une nouvelle organisation. Nous aborderons, dans notre prochain numéro, les éléments essentiels de ce combat.
Les révolutionnaires sont, dès le début de la guerre, intervenus pour défendre l'internationalisme prolétarien et l'unification internationale des révolutionnaires (Zimmerwald et Kienthal), ainsi que celle de la classe ouvrière dans son ensemble.
En reconnaissant que la fin de la guerre ne pouvait être obtenue par des moyens pacifistes, mais uniquement par la guerre de classe, la guerre civile, qu'il était donc nécessaire de renverser la domination capitaliste pour émanciper le monde de la barbarie, ils sont intervenus concrètement pour le dépassement de la société capitaliste.
Ce travail politique n'aurait pas été possible sans la clarification théorique et programmatique effectuée avant la guerre. Leur combat, à la tête duquel se trouvaient Rosa Luxemburg et Lénine, était en continuité avec les positions de la Gauche au sein de la 2e Internationale.
Nous pouvons constater que, même si le nombre des révolutionnaires et leur influence étaient réduits au début de la guerre (l'appartement de Rosa Luxemburg disposait d'une place suffisante pour accueillir les principaux militants de la gauche le 4 août 1914 ; les délégués de Zimmerwald tenaient tous dans trois taxis), leur travail allait s'avérer déterminant. Même si, au départ, leur presse ne circulait qu'en très faible nombre, les prises de position et les orientations qu'elle contenait étaient cruciales pour le développement ultérieur de la conscience et du combat de la classe ouvrière.
Tout cela doit nous servir d'exemple et nous ouvrir les yeux sur l'importance du travail des révolutionnaires. En 1914, la classe a eu besoin de quatre années pour se remettre de sa défaite et pour s'opposer massivement à la guerre. Aujourd'hui, les ouvriers des centres industriels ne s'entre-déchirent pas dans une boucherie impérialiste mais doivent se défendre contre les conditions de vie de plus en plus misérables que leur fait subir le capitalisme en crise.
Mais, de la même manière qu'au début du siècle elle n'aurait jamais été capable de mettre fin à la guerre si les révolutionnaires, en son sein, n'avaient pas combattu clairement et de façon décidée, la classe ouvrière, pour mener son combat d'aujourd'hui et assumer ses responsabilités de classe révolutionnaire, a un besoin vital de ses organisations politiques et de leur intervention. C'est ce que nous concrétiserons dans d'autres articles.
DV.
[1] [130] « Mais non. c'est un mensonge ! C'est une falsification de ces messieurs les impérialistes ! le vrai Vorwàrts est vraisemblablement sous séquestre ' » (Zinoviev au sujet de Lénine)
[2] [131] A. Pannekoek : Le Socialisme et la grande guerre européenne : F. Mehring : Sur la nature de la guerre ; Lénine : L'Effondrement de la II° Internationale. Le Socialisme et la guerre. Les Tâches de la social-démocratie révolutionnaires dans la guerre européenne ; C. Zelkin et K. Duncker : Thèses sur la guerre ; R. Luxemburg : La Crise de la social-démocratie {Brochure de Junius) ; K. Liebknecht : L'Ennemi principal se trouve dans notre propre pays.
[3] [132] De 1914 à 1917. le nombre des membres du SPD est passé de un million à environ 200 000.
Géographique:
- Allemagne [133]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [134]
Conscience et organisation:
Approfondir:
- Révolution Allemande [136]
Heritage de la Gauche Communiste:
Chine 1928-1949 : maillon de la guerre imperialiste (I)
- 5136 lectures
Selon l'histoire officielle, une « révolution populaire » aurait triomphé en Chine en 1949. Cette idée, répandue autant par la démocratie occidentale que par le maoïsme, fait partie de la monstrueuse mystification, mise en place avec la contre-révolution stalinienne, sur la soi-disant création des « Etats socialistes ». Il est vrai que la Chine connut durant la période de 1919 à 1927 un imposant mouvement de la classe ouvrière, partie intégrante de la vague révolutionnaire internationale qui secouait le monde capitaliste à cette époque; ce mouvement, cependant, se solda par un massacre de la classe ouvrière. Par contre, ce que les idéologues de la bourgeoisie présentent comme le « triomphe de la révolution chinoise » n'est que l'instauration d'un régime de capitalisme d'Etat dans sa variante maoïste, la culmination de la période de conflits impérialistes en territoire chinois, période ouverte à partir de 1928, après la défaite de la révolution prolétarienne.
Dans la première partie de cet article, nous exposerons les conditions dans lesquelles a surgi la révolution prolétarienne en Chine, en en tirant quelques unes des principales leçons. Nous consacrerons prochainement une deuxième partie à la période des conflits impérialistes, durant laquelle apparut le maoïsme, et à la dénonciation des aspects fondamentaux de cette forme de l'idéologie bourgeoise.
La 3e Internationale et la révolution en Chine
L'évolution de l'Internationale communiste (IC) et son action en Chine jouèrent un rôle crucial dans le cours de la révolution dans ce pays. L'IC représente le plus grand effort, réalisé à ce jour par la classe ouvrière, pour se doter d'un parti mondial capable de guider sa lutte révolutionnaire. Cependant, sa formation tardive au cours même de la vague révolutionnaire mondiale, sans avoir eu au préalable le temps suffisant pour se consolider organiquement et politiquement, la conduisit, malgré la résistance de ses fractions de gauche ([1] [137]), vers une dérive opportuniste. En effet, devant le recul de la révolution et l'isolement de la Russie soviétique, le Parti bolchevique - le plus influent au sein de l'Internationale - commença à hésiter entre la nécessité d'asseoir les bases pour une nouvelle montée de la révolution dans le futur, même au prix du sacrifice du triomphe en Russie, ou bien celle de défendre l'Etat russe surgi de la révolution, au prix d'accords et d'alliances conclues avec les bourgeoisies nationales. Ces accords et alliances représentèrent une énorme source de confusion pour le prolétariat international et contribuèrent à accélérer sa défaite dans de nombreux pays. La dérive opportuniste de l'IC, l'abandon des intérêts historiques de la classe ouvrière au profit d'une politique de collaboration entre les classes, la conduisit à une dégénérescence progressive qui culmina en 1928, avec l'abandon de l'internationalisme prolétarien au nom de la prétendue « défense du socialisme dans un seul pays » ([2] [138]).
La perte de confiance dans la classe ouvrière conduisit progressivement l'IC, devenue de plus en plus un instrument du gouvernement russe, à vouloir créer une barrière de protection contre la pénétration des grandes puissances impérialistes, au moyen de l'appui aux bourgeoisies des « pays opprimés » d'Europe orientale, du Moyen et d'Extrême-Orient. Cette politique s'avéra désastreuse pour la classe ouvrière internationale. En effet, pendant que l'IC et le gouvernement russe soutenaient politiquement et matériellement les bourgeoisies nationalistes supposées « révolutionnaires » de Turquie, de Perse, de Palestine, d'Afghanistan... et finalement de Chine, ces mêmes bourgeoisies, qui acceptaient en toute hypocrisie l'aide soviétique sans rompre leurs liens avec les puissances impérialistes ni avec la noblesse foncière qu'elles étaient censées combattre, écrasaient les luttes ouvrières et anéantissaient les organisations communistes avec les armes mêmes que leur fournissait la Russie. Idéologiquement, cet abandon des positions prolétariennes trouvait sa justification dans les « Thèses sur la question nationale et coloniale » du 2e Congrès de la 3e internationale (dans la rédaction desquelles Lénine et Roy avaient eu un rôle prépondérant). Ces Thèses contiennent assurément une ambiguïté théorique de principe, en opérant une distinction erronée entre bourgeoisies « impérialistes » et « anti-impérialistes », ce qui allait ouvrir la voie aux plus grandes erreurs politiques. En effet, à cette époque, la bourgeoisie avait cessé d'être révolutionnaire et avait pris partout un caractère impérialiste, y compris dans les « pays opprimés » : non seulement de par les nombreux liens qu'elle avait avec l'une ou l'autre des grandes puissances impérialistes, mais aussi parce qu'à partir de la prise de pouvoir par la classe ouvrière en Russie, la bourgeoisie internationale avait formé un front commun contre tout mouvement révolutionnaire de masse. Le capitalisme était entré dans sa phase de décadence, et l'ouverture de l'ère de la révolution prolétarienne avait définitivement clos l'ère des révolutions bourgeoises.
Les Thèses, malgré cette erreur, étaient cependant capables de prévenir certains glissements opportunistes, qui malheureusement iraient en se généralisant peu de temps après. Le rapport présenté par Lénine reconnaissait que, dans cette nouvelle période, « un certain rapprochement se produit entre la bourgeoisie des pays exploiteurs et celle des pays coloniaux, de telle façon que, très fréquemment, la bourgeoisie des pays opprimés, tout en appuyant les mouvements nationaux, est en même temps d'accord avec la bourgeoisie impérialiste, c'est-à-dire qu'elle lutte avec celle-ci contre les mouvements révolutionnaires » ([3] [139]). C'est pourquoi les Thèses appelaient à s'appuyer essentiellement sur les paysans et insistaient avant tout sur la nécessité pour les organisations communistes de maintenir leur indépendance organique et de principe face à la bourgeoisie : « L'Internationale communiste ne doit soutenir les mouvements révolutionnaires dans les colonies et les pays arriérés, qu'à la condition que les éléments des plus purs partis communistes - et communistes en fait - soient groupés et instruits de leurs tâches particulières, c'est-à-dire de leur mission de combattre le mouvement bourgeois et démocratique... consentant toujours le caractère indépendant de mouvement prolétarien même dans sa forme embryonnaire » ([4] [140]). Mais le soutien inconditionnel, ignominieux, de l'Internationale au Kuomintang en Chine allait manifester l'oubli de tout cela : tant du fait que la bourgeoisie nationale n'était plus révolutionnaire et se trouvait étroitement liée aux puissances impérialistes, que de la nécessité de forger un Parti communiste capable de lutter contre la démocratie bourgeoise, en même temps que de l'indispensable indépendance du mouvement de la classe ouvrière.
La « Révolution » de 1911 et le Kuomintang
Le développement de la bourgeoisie chinoise et son mouvement politique durant les premières décennies du 20e siècle, loin de montrer ses aspects prétendument « révolutionnaires », nous donne plutôt une illustration de l'extinction du caractère révolutionnaire de la bourgeoisie et de la transformation de l'idéal national et démocratique en pure mystification, au moment où le capitalisme entre dans sa phase de décadence. L'inventaire des faits nous montre, non pas une classe révolutionnaire, mais une classe conservatrice, conciliante, dont le mouvement politique ne cherchait ni à expulser complètement la noblesse ni à rejeter les « impérialistes », mais plutôt à se faire une place à leur côté.
Les historiens ont coutume de souligner les différences d'intérêts, censées exister, entre les différentes fractions de la bourgeoisie chinoise. Ainsi, il est courant d'identifier la fraction spéculatrice commerçante comme une alliée de la noblesse et des « impérialistes », tandis que la bourgeoisie industrielle et l'intelligentsia composeraient la fraction « nationaliste », « moderne », « révolutionnaire ». En réalité, ces différences n'étaient pas aussi marquées. Non seulement parce que ces fractions étaient intimement liées, pour raisons de négoce ou par liens familiaux, mais surtout parce que les attitudes, autant de la fraction commerçante que de la fraction industrielle et de l'intelligentsia, n'étaient pas très différentes : toutes deux cherchaient en permanence l'appui des « seigneurs de la guerre » liés à la noblesse foncière ainsi que celui des gouvernements des grandes puissances.
Vers 1911, la dynastie mandchoue était déjà complètement pourrie et sur le point de tomber. Ce n'était pas le produit d'une quelconque action révolutionnaire de la bourgeoisie nationale, mais la conséquence du partage de la Chine entre les mains des grandes puissances impérialistes qui avait mené au dépeçage du vieil Empire. La Chine tendait de plus en plus à resté divisée en régions contrôlées par des militaristes possédant des armées mercenaires plus ou moins puissantes, toujours prêts à se vendre au plus offrant et derrière lesquels se trouvait l'une ou l'autre grande puissance. La bourgeoisie chinoise, de son côté, se sentait appelée à prendre la place de la dynastie, en tant qu'élément unificateur du pays, bien que ce ne fut pas dans le sens de briser le régime de production, dans lequel se mêlaient les intérêts des propriétaires fonciers et des impérialistes avec les siens propres, mais plutôt dans le but de le maintenir. C'est dans ce cadre que se déroulèrent les événements qui vont de ce qu'on a appelé la « Révolution de 1911 » jusqu'au « Mouvement du 4 mai 1919».
La «Révolution de 1911 » commença par une conspiration des militaristes conservateurs soutenus par l'organisation bourgeoise nationaliste de Sun Yat-sen, la Toung Meng-houi. Les militaristes renièrent l'Empereur et proclamèrent un nouveau régime à Wou-Tchang. Sun Yat-sen, qui se trouvait aux Etats-Unis en quête d'un soutien financier pour son organisation, fut appelé à occuper la présidence d'un nouveau gouvernement, des négociations entre les deux gouvernements commencèrent et, au bout de quelques semaines, on décida le retrait de l'Empereur ainsi que celui de Sun Yat-sen, en échange d'un gouvernement unifié avec à sa tête Yuan Che-kai qui était le chef des troupes impériales, le véritable homme fort de la dynastie, tout ceci signifie que la bourgeoisie laissait de côté ses prétentions « révolutionnaires » et « anti-impérialistes » en échange du maintien de l'unité du pays.
Fin 1912 se forme le Kuomintang, la nouvelle organisation de Sun Yat-sen représentant cette bourgeoisie. En 1913, le Kuomintang participe à des élections présidentielles, restreintes aux classes sociales possédantes, desquelles il sort vainqueur. Cependant, le tout nouveau président, Sun Chao-yen est assassiné. Sun Yat-sen essaya alors de former un nouveau gouvernement en s'alliant avec quelques militaristes sécessionnistes du centre-sud du pays, mais il fut défait par les forces de Pékin.
Comme on peut le voir, les velléités nationalistes de la bourgeoisie chinoise étaient soumises au jeu des seigneurs de la guerre et, par conséquent, à celui des grandes puissances. L'éclatement de la Première Guerre mondiale assujettit encore davantage le mouvement poli tique de la bourgeoisie chinoise au jeu des intérêts impérialistes. En 1915, plusieurs provinces devinrent « indépendantes », les seigneurs de la guerre se partagèrent le pays, soutenus par l'une ou l'autre des grandes puissances. Dans le Nord, le gouvernement de Anfou - soutenu par le Japon - disputait la première place à celui de Chili - soutenu par la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. De son côté, la Russie tsariste essayait de faire de la Mongolie un protectorat. On se disputait aussi le Sud. Sun Yat-sen réalisa de nouvelles alliances avec certains seigneurs de la guerre. Le décès de l'homme fort de Pékin aiguisa encore davantage la lutte entre les militaristes.
C'est dans ce contexte, à la fin de la guerre en Europe, que vit le jour en Chine le « Mouvement du 4 mai 1919 », tant vanté par les idéologues comme un « véritable mouvement anti-impérialiste ». En réalité, ce mouvement de la petite-bourgeoisie n'était pas dirigé contre l'impérialisme en général, mais plutôt contre le Japon en particulier : en effet, celui-ci avait réussi à obtenir la province chinoise de Chan-Tong lors de la Conférence de Versailles (la conférence au cours de laquelle les pays démocratiques vainqueurs se partagèrent le monde), ce à quoi les étudiants chinois s'opposaient. Cependant il faut noter que l'objectif de ne pas céder de territoires chinois au Japon répondait également aux intérêts d'une autre puissance rivale : les Etats-Unis, qui parvinrent finalement à « libérer » la province de Chan-Tong de la domination exclusivement japonaise en 1922. C'est-à-dire qu'indépendamment de l'idéologie radicale du mouvement du 4 mai, celui-ci resta également dans le cadre des conflits impérialistes. Et il ne pouvait en être autrement.
Par contre, il faut souligner que pendant le mouvement du 4 mai, dans un sens différent, la classe ouvrière fit sa première apparition dans les manifestations, arborant non seulement les mots d'ordre nationalistes du mouvement, mais aussi ses propres revendications de classe.
La fin de la guerre en Europe ne mettra un terme ni aux guerres entre les militaristes ni aux luttes entre grandes puissances pour le partage de la Chine. Cependant, peu à peu vont prendre forme deux gouvernements plus ou moins instables : l'un dans le nord, dont le siège était à Pékin, sous les ordres du militariste Wou Pei-fou ; l'autre au sud, ayant pour siège Canton et ayant à sa tête Sun Yat-sen et le Kuomintang. L'histoire officielle présente le gouvernement du nord comme l'expression des forces « réactionnaires », de la noblesse et des impérialistes, et le gouvernement du sud comme l'expression des forces nationalistes et « révolutionnaires », à savoir la bourgeoisie, la petite-bourgeoisie et les travailleurs. Il s'agit d'une scandaleuse mystification.
En réalité Sun Yat-sen et le Kuomintang ont toujours été soutenus par les seigneurs de la guerre du sud : en 1920 Tchen Choung-ming, qui avait occupé Canton, invita Sun Yat-sen à former un autre gouvernement. En 1922, Sun Yat-sen suivant la tendance des militaristes du sud tenta pour la première fois d'avancer vers le nord ; il fut défait et expulsé du gouvernement mais, en 1923, il retourna à Canton avec l'appui des militaristes. D'un autre côté, on parle beaucoup de l'alliance du Kuomintang avec l'URSS. En réalité, l'URSS entretenait des relations et des alliances avec tous les gouvernements proclamés de Chine, y compris ceux du nord. Ce fut le penchant définitif du nord pour le Japon qui obligea l'URSS à privilégier sa relation avec le gouvernement de Sun Yat-sen ; lequel, par ailleurs, n'abandonna jamais son jeu consistant à demander de l'aide à différentes puissances impérialistes. Ainsi en 1925, peu avant sa mort et alors qu'il se rendait dans le nord pour négocier, Sun Yat-sen, passa par le Japon à la recherche d'appuis pour son gouvernement.
C'est ce parti, le Kuomintang, représentant crime bourgeoisie nationale (commerçante, industrielle et intellectuelle) intégrée dans le jeu des grandes puissances impérialistes et des seigneurs de la guerre, que l'Internationale communiste arrivera à déclarer « Parti sympathisant ». C'est à ce parti que devront se soumettre jour après jour les communistes en Chine, au nom de la prétendue « révolution nationale », et, pour lui, ils devront «jouer les Coolies » ([5] [141]).
Le Parti communiste de Chine » à la croisée des chemins
L'histoire officielle présente le surgissement du Parti communiste en Chine comme un sous-produit du mouvement de l'intelligentsia bourgeoisie des débuts du siècle. Le marxisme aurait été importé d'Europe parmi d'autres « philosophies » occidentales, et la fondation du Parti communiste ferait parti du surgissement de beaucoup d'autres organisations littéraires, philosophiques et politiques de cette époque. Avec ce genre d'idées, les historiens bourgeois créent un pont entre le mouvement politique de la bourgeoisie et celui de la classe ouvrière et donnent finalement, à la formation du Parti communiste, une signification spécifiquement nationale. En réalité, le surgissement du parti communiste en Chine - comme dans beaucoup d'autres pays à l'époque - n'est pas fondamentalement lié au développement de l'intelligentsia chinoise, mais à l'avancée du mouvement révolutionnaire international de la classe ouvrière.
Le Parti communiste de Chine (PCC) fut créé en 1920 et 1921, à partir de petits groupes marxistes, anarchistes et socialistes, sympathisants de la Russie soviétique. Comme tant d'autres partis, le PCC naquit directement en tant que composante de l'IC et sa croissance fut liée au développement des luttes ouvrières qui ne manquèrent pas de surgir suivant l'exemple des mouvements insurrectionnels en Russie et en Europe Occidentale. C'est ainsi que, de quelques dizaines de militants en 1921, le parti se développera en quelques années pour en compter un millier ; durant la vague de grèves de 1925 il atteint 4000 membres et, au moment de la période insurrectionnelle de 1927, il en comptait près de 60 000. Ce rapide accroissement numérique exprime, d'une certaine façon, la volonté révolutionnaire qui animait la classe ouvrière chinoise durant la période de 1919 à 1927 (la majorité des militants, à cette époque, sont des ouvriers des grandes villes industrielles). Cependant il faut dire que l'accroissement numérique n'exprimait pas un renforcement équivalent du parti. L'admission hâtive des militants contredisait la tradition du parti bolchevique de former une organisation solide, bien trempée, de l'avant-garde de la classe ouvrière, plutôt qu'une organisation de masse. Mais ce qui s'avéra pire que tout fut l'adoption, à partir de son second congrès, d'une politique opportuniste dont il n'allait plus parvenir à se défaire.
Vers le milieu de 1922, à la demande de l'Exécutif de l'Internationale, le PCC lance le malencontreux mot d'ordre du « Front unique anti-impérialiste avec le Kuomintang », et de l'adhésion individuelle des communistes à ce dernier. Cette politique de collaboration de classes (qui commença à s'étendre en Asie à partir de la « Conférence des peuples d'Orient » de janvier 1922) était le résultat des négociations, engagées en secret, entre l'URSS et le Kuomintang. Dès juin 1923 (3° congrès du PCC) est votée l'adhésion des membres du parti au Kuomintang. Le Kuomintang lui-même est admis dans l'IC en 1926 comme organisation sympathisante et participe au 7e Plénum de l'IC, alors même que l'opposition unifiée (Trotsky, Zinoviev,..) n'est pas autorisée à y participer. En 1926, tandis que le Kuomintang préparait le coup final contre la classe ouvrière, à Moscou on élaborait l'infâme théorie selon laquelle le Kuomintang était un « bloc anti-impérialiste comprenant quatre classes » (le prolétariat, la paysannerie, la petite-bourgeoisie et la bourgeoisie).
Cette politique eut les plus funestes conséquences sur le mouvement de la classe ouvrière en Chine. Tandis que le mouvement de grèves et les manifestations se développaient spontanément et impétueusement, le parti communiste, noyé au sein du Kuomintang, s'avérait incapable d'orienter la classe ouvrière, de faire preuve d'une politique de classe indépendante. La classe ouvrière, dépourvue également d'organisations unitaires comme les conseils ouvriers pour sa lutte politique, s'en remit, à la demande du PCC lui-même, au Kuomintang, c'est-à-dire accorda sa confiance à la bourgeoisie.
Cependant, il est certain que la politique opportuniste de subordination au Kuomintang a rencontré, dès le début, une résistance constante au sein du PCC (comme ce fut le cas du courant représenté par Chen Tou-hsiou). Déjà, dès le 2° congrès du PCC, une opposition s'était dressée contre les thèses défendues par le délégué de l'Internationale (Sneevliet), suivant lesquelles le Kuomintang ne serait pas un parti bourgeois, mais un front de classes auquel le PCC devrait se soumettre. Pendant toute la période d'union avec le Kuomintang, les voix n'ont pas manqué de se faire entendre, au sein du parti communiste, pour dénoncer les préparatifs anti-prolétariens de Chang Kai-chek ; demandant, par exemple, que les armes fournies par l'URSS soient destinées à l'armement des ouvriers et des paysans, plutôt que de venir renforcer l'armée de Chang Kai-chek, comme cela fut le cas, affirmant, enfin, l'urgence de sortir de la souricière que constituait le Kuomintang pour la classe ouvrière : « La révolution chinoise a deux chemins possibles : l'un est celui que le prolétariat peut tracer et par lequel nous pourrons atteindre nos objectifs révolutionnaires ; l'autre est celui de la bourgeoisie, et cette dernière trahira la révolution au cours de son développement ». ([6] [142])
Cependant il s'avéra impossible, pour un parti jeune et sans expérience, de passer outre les directives erronées de l'Exécutif de l'Internationale, et il retomba dedans. Le résultat fut que, tandis que le prolétariat s'engageait dans un combat contre les fractions des classes possédantes adversaires du Kuomintang, celui-ci lui préparait déjà le coup de poignard dans le dos : ce que la classe ouvrière s'avéra incapable d'empêcher parce que son parti ne l'avait pas prévenue. Et s'il est vrai que la révolution en Chine avait peu de chance de triompher - en effet au niveau international la colonne vertébrale de la révolution mondiale, le prolétariat en Allemagne, était cassée depuis 1919- l'opportunisme de la 3e Internationale précipita la défaite.
La classe ouvrière se soulève
Le maoïsme a prétexté de la faiblesse de la classe ouvrière en Chine pour justifier le déplacement du PCC vers les campagnes à partir de 1927. Certes, la classe ouvrière en Chine, au début du siècle, était minuscule en nombre comparativement à la paysannerie (une proportion de 2 à 100), mais son poids politique ne suivait pas la même proportion.
D'une part, il y avait déjà environ 2 millions d'ouvriers urbains hautement concentrés dans le bassin du fleuve Yang-Tseu avec la cité côtière de Shanghai et la zone industrielle de Wou-Han (la triple ville Han-Keou, Wou-Tchang, Han-Yang) , dans le complexe Canton-Hong-Kong et dans les mines de la province du Yunnan (sans compter les 10 millions d'artisans plus ou moins prolétarisés qui peuplaient les villes). Cette concentration donnait à la classe ouvrière une force extraordinaire, capable de paralyser et de prendre en mains les centres vitaux de la production capitaliste. De plus, dans les provinces du sud (surtout à Kouang-Tong) existait une paysannerie étroitement liée aux ouvriers, en effet elle fournissait en forces de travail les villes industrielles et pouvait constituer une force d'appoint pour le prolétariat urbain.
D'autre part, il serait erroné de considérer la force de la classe ouvrière en Chine en se basant exclusivement sur son nombre en comparaison avec les autres classes du pays. Le prolétariat est une classe historique qui puise sa force dans son existence mondiale, et l'exemple de la révolution en Chine en est une preuve concrète. Le mouvement de grèves n'avait pas son épicentre en Chine mais en Europe, c'était une manifestation de l'onde d'expansion de la révolution mondiale. Les ouvriers de Chine, comme ceux d'autres parties du monde, se lançaient dans la lutte face à l'écho de la révolution triomphante en Russie et des tentatives insurrectionnelles en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe.
Au début, comme la majorité des usines de Chine étaient d'origine étrangère, les grèves ont une teinte « anti-étrangers » et la bourgeoisie nationale pensa s'en servir comme instrument de pression. Cependant, le mouvement de grèves prendra de plus en plus un caractère de classe affirmé, contre la bourgeoisie en général, qu'elle soit nationale ou étrangère. Les grèves revendicatives se succèdent de façon croissante à partir de 1919, malgré la répression (il n'était pas rare que des ouvriers soient décapités ou brûlés dans les chaudières des locomotives). Vers le milieu de 1921, éclate la grève dans les textiles de Hou-Nan. Au début de 1922, une grève des marins de Hong-Kong se poursuit durant trois mois jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Dans les premiers mois de 1923 éclate une vague d'une centaine de grèves dans lesquelles prennent part plus de 300 000 ouvriers ; en février, le militariste Wou Pei-fou ordonne la répression de la grève des chemins de fer au cours de laquelle sont assassinés 35 ouvriers, et laissant de nombreux blessés. En juin 1924 éclate une grève générale à Canton - Hongkong qui durera trois mois. En février 1925 les ouvriers du coton de Shanghai se mettent en grève. C'est le prélude du gigantesque mouvement de grèves qui allait parcourir toute la Chine durant l'été 1925.
Le mouvement du 30 mai
En 1925, la Russie soutenait fermement le gouvernement de Canton du Kuomintang. Déjà depuis 1923, l'alliance entre l'URSS et le Kuomintang avait été déclarée ouvertement ; une délégation militaire du Kuomintang commandée par Chang Kai-chek s'était rendue à Moscou et, dans le même temps, une délégation de l'Internationale donnait au Kuomintang des statuts et une structure organisationnelle et militaire. En 1924, le premier Congrès officiel du Kuomintang approuva l'alliance et, en mai, s'établit l'Académie Militaire de Wham-poa avec des armes et des conseillers militaires soviétiques, dirigée par Chang Kai-chek. En fait, ce que faisait le Gouvernement russe, c'était former une armée moderne, au service de la fraction de la bourgeoisie groupée au sein du Kuomintang, ce dont celle-ci avait jusqu'alors manqué. En mars 1925; Sun Yat-sen se rend à Pékin (l'URSS continuait aussi à maintenir des relations avec le gouvernement de Pékin) pour essayer de construire une alliance visant à unifier le pays, mais il meurt des suites d'une maladie avant d'avoir atteint son but.
C'est dans ce contexte d'alliance idyllique que surgit, de toutes ses forces, le mouvement de la classe ouvrière, rappelant à la bourgeoisie du Kuomintang et aux opportunistes de l'Internationale l'existence de la lutte de classe.
Au début de 1925 monta la vague d'agitations et de grèves. Le 30 mai, la police anglaise de Shanghai ouvrit le feu sur une manifestation d'étudiants et d'ouvriers : 12 manifestants furent tués. Ce fut le détonateur d'une grève générale à Shanghai qui commença à s'étendre rapidement aux principaux ports commerciaux du pays. Le 19 juin éclate également la grève générale à Canton. Quatre jours plus tard les troupes britanniques de la concession britannique de Shameen (proche de Canton) ouvrirent le feu contre une autre manifestation. En riposte, les ouvriers de Hongkong se mirent en grève. Le mouvement s'étendit, arrivant jusqu'à la lointaine Pékin où, le 30 juillet, eut lieu une manifestation de quelques 200 000 travailleurs, et renforçant l'agitation paysanne dans la province de Kouang-Tong.
A Shanghai les grèves durèrent trois mois ; à Canton-Hong-Kong éclata une grève-boycott qui dura jusqu'en octobre de l'année suivante. A ce moment-là, commencèrent à se créer des milices ouvrières. Des milliers d'ouvriers rallièrent les rangs du parti communiste. La classe ouvrière en Chine se montrait pour la première fois en tant que force réellement capable de menacer le régime capitaliste dans son ensemble.
Malgré le fait que le mouvement du 30 mai eut comme conséquence directe la consolidation et l'extension dans le sud du pouvoir du gouvernement de Canton, ce même mouvement réveilla l'instinct de classe de la bourgeoisie nationaliste groupée dans le Kuomintang, et qui jus qu'alors avait « laissé faire » les grévistes tant qu'ils dirigeaient leurs luttes essentiellement contre les usines et les concessions étrangères. Les grèves de l'été 1925 avaient revêtu un caractère anti-bourgeois, ne « respectant » même pas les capitalistes nationaux. Ainsi, la bourgeoisie nationaliste et «révolutionnaire », avec à sa tête le Kuomintang (soutenu par les grandes puissances et avec l'appui aveugle de Moscou), se lança rageusement avant tout dans l'affrontement avec celui qu'elle avait identifié comme étant son ennemi de classe mortel : le prolétariat.
Le coup de force et l'expédition au nord de Chang Kai-chek
Entre les derniers mois de 1925 et les premiers de 1926 se déroule ce que les historiens ont décidé de nommer la «polarisation entre la gauche et la droite du Kuomintang », celle qui selon eux comporterait le fractionnement de la bourgeoisie en deux parties, l'une demeurant fidèle au nationalisme, l'autre virant vers une alliance avec l'impérialisme. Cependant nous avons déjà vu que, même les fractions de la bourgeoisie les plus « anti-impérialistes », ne cessèrent jamais leurs relations avec les impérialistes. Ce qui se passait en réalité ce n'était pas que la bourgeoisie se fractionnait, mais qu'elle se préparait à affronter la classe ouvrière, se débarrassant des éléments gênants au sein du Kuomintang (les militants communistes, une partie de la petite-bourgeoisie et quelques généraux fidèles à l'URSS). Ainsi donc, le Kuomintang, se sentant suffisamment de force politique et militaire, ôtait son masque de « bloc de classes » et apparaissait pour ce qu'il avait toujours réellement été : le parti de la bourgeoisie.
Fin 1925 le chef de la «gauche », Liao Ching-hai, fut assassiné et le harcèlement contre les communistes commença. Ceci constitua le prélude du coup de force de Chang Kai-chek, devenu l'homme fort du Kuomintang, qui marqua le début de la réaction de la bourgeoisie contre le prolétariat. Le 20 mars, Chang Kai-chek à la tête des cadets de l'Académie de Whampoa, proclame la loi martiale à Canton, ferme les locaux des organisations ouvrières, désarme les piquets de grève et fait arrêter nombre de militants communistes. Dans les mois suivants, les communistes seront éjectés de tous les postes à responsabilité du Kuomintang.
L'Exécutif de l'Internationale, à la botte de Boukharine et de Staline, demeure « aveugle » devant la réaction du Kuomintang et, malgré l'opposition insistante d'une grande partie du PCC, il donne l'ordre de maintenir l'alliance, cachant les événements aux membres de l'Internationale et des PC ([7] [143]). Enhardi, Chang Kai-chek exige de l'URSS un soutien militaire dans son expédition vers le nord qui commence en juillet 1926.
Comme tant d'autres actions de la bourgeoisie, l'expédition dans le nord est faussement présentée par l'histoire officielle comme un « événement révolutionnaire », comme une tentative d'étendre le régime « révolutionnaire » et d'unifier la Chine. Mais les intentions du Kuomintang de Chang Kai-chek étaient loin d'être aussi altruistes. Son grand rêve (à l'égal d'autres militaristes) consistait en l'appropriation du port de Shanghai et l'obtention, de la part des grandes puissances, de l'administration de sa riche douane. Pour ce faire, il pouvait compter sur un argument de chantage extrêmement puissant : sa capacité à contenir et soumettre le mouvement ouvrier.
Dès le début de l'expédition militaire du Kuomintang, la loi martiale est décrétée dans les régions qu'il contrôle déjà. Ainsi, au moment même où les travailleurs du nord préparaient avec enthousiasme l'appui aux forces du Kuomintang, celui-ci interdisait formellement les grèves ouvrières dans le sud. En septembre, une force de gauche du Kuomintang prend Han-Keou, mais Chang Kai-chek refuse de la soutenir et s'établit à Nanchang. En octobre, on donne l'ordre aux communistes de freiner le mouvement paysan dans le sud et l'armée met un terme à la grève-boycott de Canton/Hong-Kong. Ceci constitua pour les grandes puissances (au premier rang desquelles l'Angleterre) la preuve la plus tangible que l'avancée vers le nord du Kuomintang n'avait aucune prétention anti-impérialiste et, peu de temps après, commencèrent les négociations secrètes avec Chang Kai-chek.
Fin 1926, le bassin industriel du fleuve Yang-Tseu bouillonnait d'agitation. En octobre, le militariste Sia-chao (qui venait de rejoindre le Kuomintang) avança sur Shanghai, mais il s'arrêta à quelques kilomètres de la ville, laissant les troupes « ennemies » du nord (sous les ordres de Sun Chouan-fang) entrer les premières dans la ville, étouffant ainsi un soulèvement imminent. En janvier 1927, les masses travailleuses occupèrent au moyen d'actions spontanées les concessions britanniques de Han-Keou (dans la triple ville de Wou-Han) et de Jiujiang. Alors, l'armée du Kuomintang ralentit son avance pour permettre, dans la plus pure tradition des armées réactionnaires, que les seigneurs de la guerre locaux puissent réprimer les mouvements ouvrier et paysan. Au même moment, Chang Kai-chek se lance publiquement à l'attaque des communistes et le mouvement paysan de Kouang-Tong (dans le sud) est étouffé. Voila le scénario selon lequel se déroula le mouvement insurrectionnel de Shanghai.
L'insurrection de Shanghai
Le mouvement insurrectionnel de Shanghai est le point culminant d'une décennie de luttes constantes et ascendantes de la classe ouvrière. Il constitue le point le plus élevé atteint par la révolution en Chine. Cependant, les conditions dans lesquelles il mûrissait ne pouvaient guère être plus défavorables pour la classe ouvrière. Le parti communiste se trouvait pieds et poings liés, désarticulé, frappé et soumis par le Kuomintang. La classe ouvrière, trompée par la mystification du « bloc des quatre classes », ne s'était pas non plus dotée d'organismes unitaires, chargés de centraliser effectivement sa lutte, de type conseils ouvriers ([8] [144]). Pendant ce temps, les canonnières des puissances impérialistes étaient pointées sur la ville, et le Kuomintang lui-même s'approchait de Shanghai, paraissant arborer la bannière de la « révolution anti-impérialiste », mais avec le véritable but d'écraser les ouvriers. Seuls, la volonté révolutionnaire et l'héroïsme de la classe ouvrière peuvent expliquer sa capacité à s'emparer dans de telles conditions, et même si ce n'est que pour quelques jours, de la ville qui représente le coeur du capitalisme en Chine.
En février 1927, le Kuomintang reprend son avancée. Le 18, l'armée nationaliste se trouve à Chiaching, à 60 kilomètres de Shanghai. A ce moment-là, devant la défaite imminente de Sun Chouan-fang, éclata la grève générale à Shanghai : « ...le mouvement du prolétariat de Shanghai, du 19 au 24 février, constitua objectivement une tentative du prolétariat de Shanghai d'assurer son hégémonie. Aux premières nouvelles de la défaite de Sun Chouan-fang, à Zhejiang, l'atmosphère de Shanghai devint brûlante et, pendant les deux jours, éclata avec la puissance d'une force élémentaire une grève de 300 000 travailleurs qui se transforma irrésistiblement en insurrection armée pour rapidement sombrer dans le néant, par manque de direction... » ([9] [145]).
Le Parti communiste, pris par surprise, hésitait à lancer le mot d'ordre de l'insurrection alors que celle-ci se déroulait dans les rues. Le 20, Chang Kai-chek ordonna d'un coup de suspendre l'attaque contre Shanghai. Ce fut le signal pour les forces de Sun Chouan-fang de déchaîner la répression dans laquelle des dizaines d'ouvriers furent assassinés et qui parvint à contenir momentanément le mouvement.
Durant les semaines qui suivirent, Chang Kai-chek manoeuvra habilement pour éviter d'être relevé du commandement de l'armée et pour faire taire les rumeurs d'une alliance avec la droite et les puissances, et sur ses préparatifs anti-ouvriers.
Enfin, le 21 mars 1927 éclate la tentative insurrectionnelle finale. Ce jour-là, on proclame une grève générale à laquelle participent pratiquement tous les ouvriers de Shanghai : 800 000 ouvriers. « Tout le prolétariat était en grève, ainsi que la majeure partie de la petite-bourgeoisie (épiciers, artisans, etc.) (...) en une dizaine de minutes, toute la police fut désarmée. A deux heures, les insurgés possédaient déjà quelques 1500 fusils. Immédiatement après, les forces insurgées se dirigèrent vers les principaux édifices gouvernementaux et s'employèrent à désarmer les troupes. De sérieux combats s'engagèrent dans le quartier ouvrier de Tchapei... Finalement, le deuxième jour de l'insurrection, à quatre heures de l'après-midi, l'ennemi (environ 3000 soldats) était définitivement défait. Une fois ce rempart mis à bas, tout Shanghai (excepté les concessions et le quartier international) se trouvait entre les mains des insurgés » ([10] [146]). Cette action, après la révolution en Russie et les tentatives insurrectionnelles en Allemagne et dans d'autres pays européens, constitua une nouvelle secousse contre l'ordre capitaliste mondial. Elle montra tout le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière. Cependant, la machine répressive de la bourgeoisie était déjà en marche et le prolétariat n'était pas en état de l'affronter.
La bourgeoisie « révolutionnaire » massacre le prolétariat
Les ouvriers prirent la ville de Shanghai... seulement pour en ouvrir les portes à l'armée nationale « révolutionnaire » du Kuomintang qui finit par entrer dans la ville. Elle finissait à peine de s'installer à Shanghai quand Chang Kai-chek commença à préparer la répression, en accord avec la bourgeoisie spéculatrice et les bandes mafieuses de la ville. Ainsi commença un rapprochement ouvert avec les représentants des grandes puissances et avec les seigneurs de la guerre du nord. Le 6 avril Chang Tso-lin (en accord avec Chang Kai-chek) attaqua l'ambassade de Russie à Pékin et arrêta des militants du Parti communiste qui furent, par la suite, assassinés.
Le 12 avril se déchaîna à Shanghai la répression massive et sanglante préparée par Chang Kai-chek. Les bandes du lumpenproletariat des sociétés secrètes, qui avaient toujours joué le rôle de briseurs de grèves, furent envoyées contre les ouvriers. Les troupes du Kuomintang prétendument « alliées » des ouvriers -furent directement utilisées pour désarmer et arrêter les milices prolétariennes. Le jour suivant, le prolétariat essaya de réagir en lançant une grève, mais les contingents des manifestants furent interceptés par la troupe, occasionnant de nombreuses victimes. Immédiatement la loi martiale fut appliquée et toutes les organisations ouvrières interdites. En peu de jours 5 000 ouvriers furent assassinés, parmi lesquels de nombreux militants du parti communiste. Les rafles et les assassinats allaient continuer pendant des mois.
Simultanément, par une manoeuvre conjointe, les militaires du Kuomintang qui étaient restés à Canton déchaînèrent un autre massacre, exterminant encore des milliers d'ouvriers.
La révolution prolétarienne, noyée dans le sang des ouvriers de Shanghai et de Canton, résistait encore de façon précaire à Wou-Han. Cependant, de nouveau, le Kuomintang, et plus particulièrement son aile gauche, ôta son masque « révolutionnaire » et, en juillet, rejoignit les rangs de Chang Kai-chek, déchaînant là aussi la répression. Ainsi, les hordes militaires se livrèrent à la destruction et au massacre dans les campagnes des provinces du centre et du sud. Les travailleurs furent assassinés par dizaines de milliers dans toute la Chine.
L'Exécutif de l'Internationale, tentant de masquer sa politique néfaste et criminelle de collaboration de classe, se déchargea de toute responsabilité sur le PCC et ses organes centraux et, plus particulièrement, sur le courant qui, justement, s'était opposé à cette politique (celui de Chen Tou-hsiou). Pour parachever le tout, il ordonna au Parti communiste de Chine, déjà affaibli et démoralisé, de s'engager dans une politique aventureuse qui se termina par la soi-disant « insurrection de Canton ». Cette tentative absurde de coup de force « planifié » ne fut pas suivie par le prolétariat de Canton et n'aboutit qu'à soumettre encore plus ce dernier à la répression. Cela marque pratiquement la fin du mouvement ouvrier en Chine, dont on ne verra plus d'expression significative pendant les quarante années suivantes.
La politique de l'Internationale face à la Chine fut un des axes de dénonciation du stalinisme montant, qui se trouve à l'origine de 1' « Opposition de gauche », le courant incarné par Trotsky (dans lequel ce même Chen Tou-hsiou finit par s'engager). Ce courant, confus et tardif, d'opposition à la dégénérescence de la 3e Internationale, bien qu'il se soit maintenu sur un terrain de classe prolétarien à propos de la Chine - dénonçant la soumission du PCC au Kuomintang comme étant la cause de la défaite de la révolution - ne parvint jamais à dépasser le cadre erroné des Thèses du deuxième congrès de l'Internationale sur la question nationale. Ce qui à son tour, sera un des facteurs qui le mèneront à une dérive opportuniste (par une ironie de l'histoire, Trotsky soutiendra le nouveau front de classes résultant, en Chine, des luttes impérialistes à partir des années 30), jusqu'à son passage dans le camp de la contre-révolution, au cours de la deuxième guerre mondiale ([11] [147]). D'une façon ou d'une autre, tout ce qui demeurait révolutionnaire internationaliste en Chine, fut appelé désormais « trotskisme » (des années après, Mao Tsé-tung poursuivra comme « agents trotskistes de l'impérialisme japonais » les quelques internationalistes qui s'opposaient à sa politique contre-révolutionnaire).
Quant au Parti communiste de Chine, il fut littéralement anéanti, après que près de 25 000 de ses militants aient été assassinés des mains du Kuomintang et les autres emprisonnés ou persécutés. Sans doute, des rescapés du parti communiste, ainsi que quelques détachements du Kuomintang, purent se réfugier à la campagne. Mais, à ce déplacement géographique, correspondait un déplacement politique toujours plus profond : dans les années suivantes, le parti adopta une idéologie bourgeoise, sa base sociale - dirigée par la petite-bourgeoisie et la bourgeoise devint à prédominante paysanne et il participa aux campagnes de guerres impérialistes. Au prix du maintien de son nombre, le parti communiste de Chine cessa d'être un parti de la classe ouvrière et se convertit en organisation de la bourgeoisie. Mais cela est déjà une autre histoire, objet de la seconde partie de cet article.
Signalons, en guise de conclusion, quelques enseignements tirés du mouvement révolutionnaire en Chine :
* La bourgeoisie chinoise ne cessa pas d'être révolutionnaire au moment où elle se lança contre le prolétariat en 1927. Déjà depuis la «révolution de 1911 », la bourgeoisie nationaliste avait montré son aptitude à partager le pouvoir avec la noblesse, à s'allier avec les militaristes et à se soumettre aux puissances impérialistes. Ses aspirations démocratiques, « anti-impérialistes » et même « révolutionnaires », n'étaient que le masque qui cachait ses intérêts réactionnaires ; ceux-ci furent mis à nu quand le prolétariat commença à représenter un menace. Dans la période de décadence du capitalisme, les bourgeoisies des pays faibles sont aussi réactionnaires et impérialistes que celles des grandes puissances.
* La lutte de classe du prolétariat en Chine de 1919 à 1927 ne peut être analysée dans un contexte purement national. Elle constitue un moment de la vague révolutionnaire mondiale qui ébranla le capitalisme au début du siècle. La force élémentaire avec laquelle se souleva le mouvement ouvrier en Chine, secteur du prolétariat mondial considéré alors comme faible, au point d'être capable de prendre spontanément entre ses mains les grandes villes, montre le potentiel que la classe ouvrière possède pour abattre la bourgeoisie, même si pour ce faire elle a besoin de sa conscience et de son organisation révolutionnaires.
Le prolétariat ne peut plus s'allier avec une fraction de la bourgeoisie quelle qu'elle soit. Par contre, il peut entraîner dans son mouvement révolutionnaire des secteurs de la petite-bourgeoisie urbaine et rurale (comme le montrèrent l'insurrection de Shanghai et le mouvement paysan de Kouang-Tong). Cependant, le prolétariat ne doit pas fusionner organiquement avec ces secteurs dans un quelconque «front », il doit au contraire maintenir à tous moments son autonomie de classe.
Pour vaincre, le prolétariat a besoin d'un parti politique qui l'oriente dans les moments déterminants, ainsi que d'une organisation unitaire en conseils ouvriers. Il doit en particulier se doter à temps de son Parti communiste mondial, ferme dans les principes et trempé par la lutte, avant que n'éclate la prochaine vague révolutionnaire internationale. Ce parti doit être capable de combattre en permanence l'opportunisme qui sacrifie l'avenir de la révolution au nom de « résultats immédiats »
Leonardo.
[1] [148] Nous ne pouvons, dans le cadre de cet article, développer sur la lutte menée par les Fractions de gauche de l'Internationale contre l'opportunisme et la dégénérescence de celle-ci. lutte qui se déroulait à la même époque que les événements en Chine. Ces derniers sont d'ailleurs les seuls, à notre connaissance, qui aient donné lieu à un manifeste signé en commun par toute l'Opposition, y compris la gauche italienne. Il s'agit du Manifeste « Aux communistes chinois et du monde entier!» (La Vérité, 12 septembre 1930). Sur cette question, nous recommandons notre brochure La Gauche communiste d'Italie et la série d'articles sur La Gauche hollandaise.
[2] [149] Cette dégénérescence allait de pair avec celle de l'Etat surgi de la révolution, qui mena à la reconstitution de l'Etat capitaliste sous sa forme stalinienne. Cf. Manifeste du 9e Congrès du CCI.
[3] [150] Lénine, Rapport de la Commission nationale et coloniale pour le Deuxième congrès de l'Internationale communiste, 26 juillet 1920. Extrait de La Question chinoise dans l'Internationale communiste, présentation et compilation de Pierre Broué.
[4] [151] « Thèses et additions sur la question nationale et coloniale », 2e congrès, Les quatre premiers congrès mondiaux de l'Internationale communiste, 19i'9-23, Ed. Maspéro.
[5] [152] Autrement dit les porteurs d'eau. Expression utilisée par Borodine, délégué de l'IC en Chine en 1926. E.-Il. Carr, Le Socialisme dans un seul pays.
[6] [153] Chen Tou-hsiou ; cité par lui-même dans sa «Lettre à tous les membres du PCC» 1929; Extrait de La question chinoise... op. cit.
[7] [154] Chang Kai-chek avait été nommé membre honoraire quelques semaines auparavant, et le Kuomintang « parti sympathisant » de l'Internationale. Même après le coup de force, les conseillers russes refusèrent de fournir 5000 fusils aux ouvriers et paysans du sud, les réservant pour l'année de Chang Kai-chek.
[8] [155] On parle beaucoup du rôle d'organisation joué par les syndicats dans le mouvement révolutionnaire en Chine. Il est vrai que durant cette période, les syndicats surgissent et se développent au rythme du développement du mouvement de grèves. Cependant, dans la mesure où ils n'essaient pas de contenir le mouvement dans le cadre de revendications économiques, leur politique restera soumise au Kuomintang (y compris les syndicats influencés par le PCC). Le mouvement de Shanghai se donnera ainsi comme objectif d'ouvrir la voie à l'armée nationaliste. En décembre 1927, les syndicats du Kuomintang iront même jusqu'à participer à la répression contre les ouvriers. Que les seules organisations de masse dont disposent les ouvriers soient les syndicats ne constitue évidemment pas un avantage, mais traduit leur faiblesse.
[9] [156] Lettre de Shanghai de trois membres de la mission de TIC en Chine, datée du 17 mars 1927. Extraite de La Question chinoise, op. cit
[10] [157] Neuberg, L'Insurrection armée. Ce livre, écrit semble-t-il aux alentours de 1929 (après le 6e congrès de l'IC), contient quelques informations valables sur les événements de l'époque. Cependant, il tend à voir l'insurrection comme un coup de main et fait une apologie grossière du stalinisme. D'autre part, on ne doit pas s'étonner du fait que la tentative insurrectionnelle de Shanghai, malgré son ampleur et son écrasement sanglant, soit à peine mentionnée (quand elle n'est pas totalement occultée), aussi bien dans les livres historiques - qu'ils soient « pro-occidentaux » ou « pro-maoïstes » - que dans les manuels maoïstes. C'est sur la base de cette occultation qu'il a été possible de maintenir le mythe selon, lequel ce qui était en jeu dans les années 1920, c'était une « révolution bourgeoise ».
[11] [158] Pour connaître plus complètement notre position sur Trotsky et le trotskisme, on peut lire notre brochure Le trotskisme contre la classe ouvrière.
Géographique:
- Chine [159]
Conscience et organisation:
Personnages:
- Chang-Kai-Shek [160]
- Sun-Yat-Sen [161]
Courants politiques:
- Maoïsme [162]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le communisme n'est pas un bel idéal, mais une nécessite matérielle [11e partie]
- 3929 lectures
MARX DE LA MATURITE :
COMMUNISME DU PASSE, COMMUNISME DE L'AVENIR
Au cours de cette série, nous avons montré comment le travail révolutionnaire de Marx est passé par plusieurs phases, correspondant aux changements de conditions de la société bourgeoise et de la lutte de classes en particulier. La dernière décennie de sa vie, suite à la défaite de la Commune de Paris et à la dissolution de la Première Internationale, a été en conséquence, comme dans les années 1850, consacrée en priorité à la recherche scientifique et à la réflexion théorique, plutôt qu'à l'activité militante ouverte.
Pendant cette période, une partie considérable des énergies de Marx a été orientée vers sa gigantesque critique de l'économie politique bourgeoise, aux volumes restants du Capital, qu'il n'a jamais pu terminer lui-même. Une santé défectueuse a sans doute joué un rôle considérable là-dedans. Mais ce qui a été mis en lumière récemment, c'est le niveau jusqu'auquel Marx, dans cette période, a été « distrait » par des questions qui, à première vue, pourraient apparaître comme étant une diversion par rapport à l'aspect noeudal du travail de sa vie : nous faisons référence à ses préoccupations anthropologiques et ethnologiques, stimulées par la parution en 1877 du livre Ancient society ([1] [163]) de Henry Morgan. Le degré auquel Marx a été absorbé par ces questions a été révélé par la publication en 1974 de ses Cahiers ethnologiques, sur lesquels il a travaillé dans la période 1881-82 et qui sont la base de L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat, de Engels. Engels a écrit ce livre comme un « legs » de Marx, autrement dit en reconnaissance de l'importance que Marx accordait à l'élude scientifique des premières formes de sociétés humaines, en particulier celles précédant la formation des classes et de l'Etat.
En lien étroit avec ces recherches, Marx manifestait un intérêt croissant pour la question russe, intérêt qui s'était développé depuis le début des années 1870, mais auquel la publication du livre de Morgan avait donné une impulsion considérable. Il est bien connu que les réflexions de Marx sur les problèmes posés par le mouvement révolutionnaire naissant en Russie l'ont incité à apprendre le russe et à accumuler une immense bibliothèque de livres sur la Russie. Il a même été amené à dissimuler à Engels -qui devait le harceler constamment pour le presser de terminer Le Capital - la quantité de temps qu'il consacrait à la question russe.
Les préoccupations du Marx de la maturité ont fait surgir des interprétations contradictoires et des controverses qui s'appuient sur la comparaison avec les arguments des travaux du «jeune» Marx. C'est par exemple la vision de Riazanov qui, au nom de l'Institut Marx-Engels de Moscou, a publié la lettre de Marx à Vera Zassoulitch (et les brouillons de cette lettre) en 1924, après qu'elles aient été « enterrées » par certains éléments du mouvement marxiste russe (Zassoulitch, Axelrod, Plekhanov, etc.) D'après Riazanov, l'absorption de Marx dans ces questions, en particulier la question russe, était essentiellement due aux capacités intellectuelles déclinantes de Marx. D'autres, en particulier des éléments qui avaient été à la « pointe » du mouvement politique prolétarien, tels que Raya Dunayevskaya et Franklin Rosement ([2] [164]), ont justement répondu à de telles idées et ont tenté de dégager l'importance des préoccupations du Marx d'âge mûr. Mais, ce faisant, ils ont introduit de nombreuses confusions qui ont ouvert la porte en grand à l'utilisation frauduleuse de cette phase des travaux de Marx.
L'article qui suit n'est pas du tout une tentative d'examiner les Cahiers ethnologiques, les écrits de
Marx sur la Russie ni même L'origine de la famille de Engels au niveau de
profondeur requis. Les Cahiers, en
particulier, sont un territoire presque inexploré et requièrent une immense
exploration et un « décodage » : ils sont, en grande partie, sous forme de
notes, une série de notes marginales et d'extraits et, pour la plupart d'entre
eux, écrits en un curieux mélange d'anglais et d'allemand. De plus, la majorité
des «fouilles » qui y ont été faites concernent le livre de Morgan. C'est sans
doute la partie la plus importante et elle a servi de base principale pour
L'origine de la famille. Mais les Cahiers
contiennent aussi les notes de Marx sur Le
village aryen de J.-P. Phear (une étude des formes sociales communautaires
en Inde), sur les Lectures sur les
institutions de l'histoire primitive de H.-S. Maine (qui sont centrées sur
les vestiges des formations sociales communautaires en Irlande) et sur Les origines de la civilisation de J.
Lubbock, ce qui révèle l'intérêt de Marx pour les créations idéologiques des
sociétés primitives, en particulier le développement de la religion. Il y
aurait beaucoup à dire, spécialement à propos de cette dernière, mais nous
n'avons pas l'intention de nous engager sur ces problèmes ici. Notre but,
beaucoup plus limité, est d'affirmer l'importance et la pertinence des travaux
de Marx sur ces sujets en même temps que de critiquer certaines fausses
interprétations qui en ont été faites.
La propriété privée, l'Etat et la famille ne sont pas éternels
Ce n'est pas la première fois que l'intérêt de Marx pour la question du « communisme primitif» est évoqué dans cette série d'articles. Nous avons montré, par exemple, dans la Revue Internationale n° 75, que les Grundrisse et Le Capital défendent déjà l'idée que les premières sociétés humaines étaient caractérisées par l'absence d'exploitation de classe et de propriété privée ; que des vestiges de ces formes communautaires avaient persisté dans tous les systèmes de classe pré-capitalistes ; et que ces vestiges, de concert avec les souvenirs à demi distordus qui survivent dans la conscience populaire, ont souvent fourni les bases des révoltes des classes exploitées de ces systèmes. Le capitalisme, en généralisant les rapports marchands et la guerre économique de tous contre tous, a effectivement dissout ces restes communautaires (au moins dans les pays où il a pris racine) ; mais ce faisant, il jetait les fondements d'une forme de communisme plus élevé. La reconnaissance du fait que plus on remonte loin dans l'histoire de la société humaine, plus on se rend compte qu'elle est basée sur les formes de propriété communautaire, était déjà un argument vital contre la vision bourgeoise selon laquelle le communisme va, d'une façon ou d'une autre, à rencontre les fondements de la nature humaine.
La publication de l'étude de Morgan sur la société américaine « indienne » (en particulier les Iroquois) a donc été d'une importance considérable pour Marx et Engels. Bien que Morgan ne fût pas révolutionnaire, ses études empiriques ont apporté une confirmation éclatante de la thèse du communisme primitif, rendant évident que des institutions qui, comme les fondations de l'ordre bourgeois, étaient considérées comme éternelles et immuables, ont une histoire : qu'elles avaient été totalement inexistantes à des époques reculées, n'avaient émergé qu'au travers d'un processus long et tortueux, que leur forme avait changé quand la forme de la société changeait et qu'elles pouvaient donc changer encore et même être abolies dans une société différente.
La conception de l'histoire de Morgan n'était pas tout à fait la même que celle de Marx et Engels, mais elle n'était pas incompatible avec la conception matérialiste. En fait, il a insisté fortement sur l'importance centrale de la production des moyens d'existence comme facteur d'évolution d'une forme sociale vers une autre et a tenté de systématiser une série de stades dans l'histoire humaine {« sauvagerie », « barbarie », « civilisation », ainsi que divers sous-phases au sein de ces époques) qu'Engels a, pour l'essentiel, repris dans L'origine de la famille. Cette périodisation a été extrêmement importante pour comprendre l'ensemble du processus de développement historique et les origines de la société de classe. De plus, dans les travaux antérieurs de Marx, le matériel de base utilisé pour étudier le communisme primitif était principalement tiré de formes sociales européennes archaïques et disparues (par exemple, teutonnes et classiques) ou bien des vestiges communautaires qui persistaient dans le système asiatique et qui furent anéanties par le développement colonial. Maintenant, Marx et Engels pouvaient élargir le champ en étendant leur étude à des peuples qui étaient encore à un stade « pré-civilisé », mais dont les institutions étaient assez avancées pour permettre de comprendre les mécanismes de la transition d'une société primitive, ou plutôt barbare, à une société basée sur les divisions de classe. En somme, c'était un laboratoire vivant pour l'étude de formes sociales en évolution. Pas étonnant que Marx ait été aussi enthousiaste et se soit efforcé de le comprendre avec tant de profondeur. Des pages et des pages de ses notes traitent dans le moindre détail du mode de parenté, des coutumes et de l'organisation sociale des tribus que Morgan étudie. C'est comme si Marx cherchait à se faire une image aussi claire que possible d'une formation sociale qui apporte la preuve empirique que le communisme n'est pas un rêve futile mais une possibilité concrète, enracinée dans les conditions matérielles de l'humanité.
L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat : le titre de Engels reflète les principales subdivisions des notes de Marx sur Morgan, dans lesquelles Marx cherche à établir comment, d'un côté, ces piliers « sacrés » de l'ordre bourgeois n'ont pas toujours existé et comment, d'autre part, ils ont évolué depuis l'intérieur des communautés archaïques.
Ainsi, les notes de Marx se centrent sur le fait que, dans la société sauvage (c'est-à-dire les société de chasse-cueillette), il n'y a virtuellement pas d'idée de propriété à part pour quelques objets personnels. Dans les sociétés plus avancées (barbares), en particulier avec le développement de l'agriculture, la propriété reste d'abord essentiellement collective, il n'y a pas encore de classe vivant du travail d'une autre. Mais les germes de la différenciation peuvent être distingués dans l'organisation de la « gens », des systèmes de clans, au sein de la tribu, où la propriété peut être transmise dans un groupe plus restreint. « L'héritage : son premier grand règne commença avec l'institution de la gens, qui distribua les effets d'une personne morte parmi ses gentilices. » ([3] [165]) Le « ver » de la propriété privée est donc déjà présent « dans le fruit » de l'ancien système communautaire, dont l'existence n'est pas causé par la bonté innée de l'humanité, mais parce que les conditions matérielles dans lesquelles les premières communautés humaines évoluaient ne permettaient aucune autre forme ; en changeant les conditions matérielles, en lien avec le développement des forces productives, la propriété communautaire se transformait éventuellement en barrière au développement et était remplacée par des formes plus compatibles avec l'accumulation des richesses. Mais le prix à payer pour ce développement a été l'apparition de la division en classes, l'appropriation des richesses sociales par une minorité privilégiée. Et, là encore, c'est à travers la transformation du clan, ou de la gens, en castes puis en classes que ce développement fatidique eut lieu.
L'apparition des classes aboutit aussi à l'apparition de l'Etat. La reconnaissance par Marx d'une tendance, au sein des institutions « de gouvernement » iroquoises, vers la séparation entre la fiction publique et la pratique réelle est développée par Engels dans la thèse selon laquelle l'Etat « n'est en aucune façon une puissance imposée de l'extérieur à la société » (L'origine de la famille) ; qu'il n'est pas le résultat d'une conspiration imposée par une minorité mais émerge du sol de la société à un certain niveau de développement (une thèse magnifiquement confirmée par l'expérience de la révolution russe et l'émergence de l'Etat transitoire des Soviets, du sein de la situation post-révolutionnaire). Comme la propriété privée et les classes, l'Etat surgit des contradictions apparaissant dans l'ordre communautaire originel. Mais en même temps, et cela ne fait aucun doute, avec l'expérience de la Commune de Paris encore très présente à son esprit, Marx est à l'évidence fasciné par les système des « conseils » iroquois, s'intéressant en détail à la structure des prises de décision et des coutumes et traditions qui accompagnent les assemblées tribales : « Le Conseil - instrument de gouvernement et autorité suprême sur la gens, la confédération tribale (...) la forme du Conseil la plus simple et la plus basse - celle de la Gens ; une assemblée démocratique, où chaque membre adulte mâle et femelle avait une voix sur toutes les questions posées devant elle ; elle élisait et déposait ses sachems et chefs (...) Elle était le germe du conseil de la tribu, plus élevé, et de celui, encore plus élevé, de la confédération, chacun d'eux étant composé exclusivement de chefs et de représentants. » ([4] [166])
Ainsi, de même que la notion de propriété, qui était à l'origine collective, porta un coup aux notions bourgeoises d'économie politique - les « Robinsonnades » qui voyaient l'envie de propriété privée comme inhérente à la nature humaine - les travaux de Morgan ont confirmé que les être humains n'ont pas toujours eu besoin d'une autorité contrôlée par une minorité spécialisée, un pouvoir d'Etat, pour diriger leur vie sociale. Comme la Commune, les conseils iroquois étaient la preuve de la capacité de l'humanité à se gouverner elle-même.
La citation ci-dessus mentionne l'égalité des hommes et des femmes dans la démocratie tribale. De nouveau, Marx note que, même là, on peut voir des signes de différenciation : « Dans cette aire comme ailleurs, Marx distingue des germes de stratification au sein de l'organisation gentilice, à nouveau en termes de séparation entre sphères "publique" et "privée", ce qu'il voit à son tour comme un reflet de l'émergence graduelle d'une caste tribale propriétaire et privilégiée. Après avoir reproduit l'observation de Morgan selon laquelle, dans le Conseil des Chefs, les femmes sont libres d'exprimer leurs souhaits et opinions "par l'intermédiaire d'un orateur de leur choix", // ajoute, en le soulignant, que la "décision (était) prise par le Conseil (composé d'hommes)". » ([5] [167])
Mais Rosemont continue en disant « Marx était néanmoins indubitablement impressionné par le fait que, chez les Iroquois, les femmes bénéficiaient d'une liberté et d'un niveau d'implication sociale beaucoup plus élevé que les femmes (ou les hommes !) de toute nation civilisée. » Cette compréhension participe de la véritable percée que les recherches de Morgan ont permis à Marx et Engels de faire, sur la question de la famille.
Dès le Manifeste Communiste, la tendance autour de Marx et Engels a dénoncé la nature hypocrite et oppressive de la famille bourgeoise et a ouvertement défendu son abolition dans une société communiste. Mais désormais, les travaux de Morgan permettaient aux marxistes de démontrer, par l'exemple historique, le fait que la famille patriarcale monogame n'était pas le fondement moral irremplaçable de tout ordre social ; en fait, son arrivée est assez tardive dans l'histoire de l'humanité et, là encore, plus on regarde loin en arrière, plus il devient évident que le mariage, l'éducation des enfants étaient à l'origine des fonctions communautaires, qu'un « communisme vivant » ([6] [168]) prévalait au sein des peuples tribaux. Ce n'est pas le lieu ici de rentrer dans les détails complexes sur l'évolution des institutions du mariage relevés par Marx et résumés par Engels, ou de juger la vision de Engels à la lumière de recherches ethnologiques plus récentes. Mais, même si certaines de leurs hypothèses sur l'histoire de la famille étaient fausses, le point essentiel reste : la famille patriarcale, où l'homme considère la femme comme sa propriété privée, n'est pas « la façon dont les choses ont toujours été », mais le produit d'un type particulier de société - une société fondée sur la propriété privée (en fait, comme Engels le souligne dans L'origine de la famille, le terme même de famille, venant du latin «familias », est totalement lié à l'esclavage, dans la mesure où à l'origine, dans la Rome Antique, il désignait la maisonnée d'un propriétaire d'esclaves, ceux sur qui il avait le pouvoir de vie et de mort ( esclaves et femmes compris). Dans une société où n'existaient ni les classes ni la propriété privée, les femmes ne pouvaient pas être considérées comme des biens ou des servantes mais jouissaient réellement d'un statut bien plus élevé que dans les société « civilisées » ; l'oppression des femmes se développe donc avec l'émergence graduelle de la société de classe même si, comme pour la propriété privée et l'Etat, les germes peuvent déjà en être relevés dans la vieille communauté.
Cette vision sociale et historique de l'oppression des femmes a été une
réfutation de toutes les visions ouvertement réactionnaires qui admettaient
une quelconque base inhérente, biologique, au statut « inférieur » des femmes. La clef du statut inférieur de la femme à
travers les âges ne se trouve pas dans la biologie (même si des différences
biologiques ont eu un effet sur le développement de la domination mâle), mais
dans l'histoire - dans l'évolution de formes sociales particulières,
correspondant au développement matériel des forces productives. Mais cette
analyse va aussi à l'encontre de l'interprétation féministe qui (bien qu'elle
emprunte beaucoup à la position marxiste) tend aussi inévitablement à faire de
l'oppression des femmes quelque chose de biologiquement inhérent, bien que
cette fois ce soit chez le mâle plutôt que chez la femelle. En tout cas, à la
fois le féminisme et la vision réactionnaire achevée conduisent à la même
conclusion : que l'oppression des femmes ne pourra jamais être abolie tant que
la société sera composée d'hommes et de femmes (le « séparatisme radical », malgré toute son absurdité, est réellement
la forme la plus consistante du féminisme). Pour les communistes, par contre,
si l'oppression des femmes a eu son début dans l'histoire, elle peut aussi y
avoir sa fin - par la révolution communiste qui procure aux hommes et aux
femmes les conditions matérielles pour entrer en relation les uns avec les
autres et pour éduquer les enfants, en dehors des pressions sociales et
économiques qui les ont jusqu'ici enfermés dans leurs rôles respectifs et
restrictifs. Nous reviendrons sur ce point dans un article ultérieur.
La dialectique de
l'histoire : Marx contre Engels ?
Dunayevskaya et Rosemont ont tous deux noté, dans leurs commentaires sur les Cahiers, que l'intérêt du Marx de la maturité pour le communisme primitif représentait un retour à certains des thèmes de sa jeunesse, en particulier ceux des Manuscrits économiques et philosophiques de 1844. Ces derniers représentaient une anthropologie plutôt « philosophique » ; dans les Cahiers, Marx s'orientait vers une anthropologie historique, mais sans renoncer aux préoccupations de ses travaux antérieurs. De même que le thème des rapports homme-femme avait été posé de façon un peu abstraite en 1844, et qu'il était traité maintenant « dans la chair ». Ces commentaires sont justes tant que l'on garde en tête, comme nous l'avons montré dans la Revue Internationale n° 75, que les « thèmes de 1844 » ont continué d'être un élément vital de la pensée de Marx dans ses travaux de la maturité, comme Le Capital et les Grundrisse, et qu'ils n'ont pas soudain ressurgi en 1881. En tout cas, ce qui ressort d'une lecture des Cahiers, c'est le respect de Marx, non seulement pour l'organisation sociale des « sauvages » et des « barbares », mais aussi pour leur réussite culturelle, leur mode de vie, leur « vitalité », qu'il considérait comme étant « incomparablement supérieure (...) à celle des Sémites, des Grecs, des Romains et a fortiori à celle des sociétés capitalistes modernes » ([7] [169]). Ce respect peut se constater dans sa défense fréquente de leur intelligence, contre les « têtes de pioche » bourgeois (et racistes) comme Lubbock et Maine, des qualités imaginatives inhérentes à leurs mythes et légendes ; on peut le voir, surtout, dans la description détaillée de leurs coutumes, de leurs banquets, fêtes et danses, d'un mode de vie dans lequel travail et jeu, politique et célébration ne sont pas encore devenus des catégories totalement séparées. C'est là une concrétisation d'un des thèmes centraux qui ont vu le jour dans les Manuscrits de 1844 et dans les Grundrisse : que dans les sociétés pré-capitalistes, et en particulier dans les pré-civilisées, la vie humaine était, sous bien des aspects, moins aliénée que ce qu'elle est devenue sous le capitalisme ; que les peuples du communisme primitif nous donnent une idée de l'être humain complet du communisme de demain. Ainsi Marx, dans sa réponse à Vera Zassoulitch sur la commune russe (voir plus loin) était tout disposé à souscrire à la vision selon laquelle « le nouveau système vers lequel tend la société moderne "sera une reprise, sous une forme supérieure, d'un type social archaïque". » ([8] [170]) Marx citait ici, probablement de mémoire, les lignes de Morgan par lesquelles Engels clos L'origine de la famille.
Ce concept de « reprise » à un niveau supérieur est partie intégrante de la pensée dialectique, mais constitue un véritable casse-tête pour la perspective bourgeoise qui nous propose le choix entre une vision linéaire de l'histoire et une idéalisation naïve du passé. A l'époque où Marx écrivait, la tendance dominante de la pensée bourgeoise était un évolutionnisme simpliste dans lequel le passé, et surtout le passé primitif, était rejeté dans un brouillard d'ombre et de superstition infantile, le plus à même de justifier la « civilisation actuelle » et la soumission ou l'extermination des primitifs qui se trouvaient sur son chemin. Aujourd'hui la bourgeoisie continue d'exterminer ce qui reste de peuples primitifs, mais elle n'a plus la même foi inébranlable dans sa mission civilisatrice et il y a une forte contre-tendance, en particulier au sein de la petite-bourgeoisie, vers le « primitivisme », le désire désespéré de retourner au mode de vie primitif, imaginé maintenant comme une sorte de paradis perdu.
Dans ces deux perspectives, il est impossible de voir la société primitive avec lucidité en reconnaissant à la fois sa « grandeur », comme Engels l'a montré, et ses limites : l'absence d'individualité et de liberté réelles dans une communauté dominée par la pénurie ; la restriction de la communauté à la tribu et donc la fragmentation essentielle de l'espèce à cette époque; l'incapacité pour l'espèce humaine, dans ces formations, de se saisir elle-même comme un être actif, créateur, et donc sa soumission aux projections mythiques et aux traditions ancestrales immuables. La vision dialectique est résumée par Engels dans L'origine de la famille : « La puissance de ces communautés primordiales devait être brisée, et elle a été brisée », permettant ainsi à l'humanité de se libérer des limites énumérées ci-dessus. « Mais elle a été brisée par des influences qui, depuis le début, nous apparaissent comme une dégradation, une chute de la grandeur morale simple de l'ancienne société gentilice ». Une chute qui est aussi une avancée ; ailleurs dans la même oeuvre, Engels écrit : « La monogamie a été une grande avancée historique mais en même temps elle a inauguré, de concert avec l'esclavage et le bien-être privé, cette époque, qui dure jusqu'à aujourd'hui, dans laquelle chaque avancée est en même temps une régression relative, dans laquelle le bien être et le développement d'un groupe sont atteint par la misère et la répression de l'autre. » Ce sont là des concepts scandaleux pour le sens commun bourgeois mais, exactement comme « la reprise à un niveau supérieur » qui les complète, ils sont parfaitement sensés du point de vue dialectique qui voit l'histoire avancer à travers le heurt des contradictions.
Il est important de citer Engels à ce propos parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il a dévié de la vision de l'histoire de Marx vers une version de l'évolutionnisme bourgeois. C'est une question plus large que nous devrons aborder ailleurs ; qu'il nous suffise de dire pour le moment que toute une masse de littérature, allant du « marxisme » académique à l'anti-marxisme académique et à diverses tendances du modernisme et du conseillisme, a éclos dans les dernières années pour essayer de prouver le niveau auquel Engels était accusé d'être tombé dans le déterminisme économique, le matérialisme mécanique et même le réformisme, faisant subir une distorsion à la pensée de Marx sur tout un ensemble de questions vitales. L'argument est souvent étroitement lié à l'idée d'une rupture totale de continuité entre la Première et la Deuxième Internationale, conception chère au conseillisme. Mais ce qui est particulièrement significatif à ce propos c'est le fait que Raya Dunayevskaya. à qui Rosemont fait écho, a aussi accusé Engels d'avoir échoué dans la transmission du legs de Marx en transposant les Cahiers ethnologiques dans L'origine de la famille.
D'après Dunayevskaya, le livre de Engels est coupable quand il parle d'une « défaite historique mondiale du sexe féminin » coïncidant avec l'apparition de la civilisation. Pour elle, il s'agit là d'une simplification de la pensée de Marx ; dans les Cahiers, ce dernier dit que les germes de l'oppression des femmes sont déjà en cours de développement dans la stratification de la société barbare, avec le pouvoir croissant des chefs et la transformation, qui en résulte, des conseils tribaux en organes de décision formels, plus que réels. Plus généralement, elle pense que Engels perd de vue la vision dialectique de Marx, réduisant sa vision du développement historique complexe, multilinéaire, en une vision unilinéaire du progrès, à travers des stades définis de façon rigide.
Il est possible que l'utilisation par Engels de la phrase « défaite historique mondiale du sexe féminin » (qu'il a prise à Bachofen plutôt qu'à Marx) donne l'impression d'un événement historique concret et unique au lieu d'un processus très long, qui avait déjà son origine dans la communauté primitive, et en particulier dans les dernières phases de celle-ci. Mais cela ne prouve pas que l'approche fondamentale de Engels dévie de celle de Marx ; tous les deux sont conscients du fait que « la famille, la propriété privée et l'Etat » émergent des contradictions du vieil ordre gentilice. En réalité, dans le cas de l'Etat, Engels a fait des avancées considérables au niveau théorique : les Cahiers eux-mêmes ne contiennent que très peu de matériel brut pour les arguments importants sur l'émergence de l'Etat, contenus dans L'origine de la famille. Et nous avons déjà montré comment, sur ces questions, Engels était complètement d'accord avec Marx sur la vision de l'Etat comme produit d'une longue évolution historique au sein des vieilles communautés.
Nous avons aussi montré que Engels était en accord avec Marx pour réfuter l'évolutionnisme linéaire bourgeois qui ne parvient pas à comprendre le « prix » que l'humanité a payé pour le progrès, et la possibilité de réappropriation, à un niveau supérieur, de ce qui a été « perdu ».
C'est plutôt Dunayevskaya qui ne parvient pas à faire la critique la plus pertinente à la présentation de l'histoire de la société de classe par Engels dans son livre : son échec à intégrer le concept de mode de production asiatique, l'image d'un mouvement rectiligne et universel depuis la société primitive jusqu'à l'esclavage, la féodalité et le capitalisme. Même en tant que description des origines de la civilisation « occidentale », c'est simplificateur, dans la mesure où les sociétés esclavagistes de l'antiquité étaient influencées, sur de nombreux plans, par les formes asiatiques qui les précédaient et étaient contemporaines. L'omission de Engels, ici, ne fait pas que biffer un vaste chapitre de l'histoire de la civilisation, mais elle donne aussi l'impression d'une évolution fixe, unilinéaire, valable pour toutes les parties du globe et, en ce sens, apporte de l'eau au moulin de l'évolutionnisme bourgeois. Plus important encore, son erreur a été exploitée, par la suite, par les bureaucrates staliniens qui étaient directement intéressés à obscurcir toute la conception du despotisme asiatique, dans la mesure où celle-ci prouvait qu'une exploitation de classe peut exister sans aucune forme discernable de propriété privée « individuelle » - et donc que le système stalinien pouvait être considéré lui-même comme un système d'exploitation de classe. Et bien sûr, en tant que penseurs bourgeois, les staliniens se sentaient beaucoup plus sur leur terrain avec une vision linéaire, d'un progrès avançant inexorablement de l'esclavage au féodalisme et au capitalisme, et culminant dans la réussite suprême de l'histoire : le « socialisme réel » de l'URSS. En dépit de cette erreur importante, la tentative d'enfoncer un coin entre Marx et Engels est en contradiction fondamentale avec la longue histoire de collaboration entre eux. En réalité, quand il a été question d'expliquer le mouvement dialectique de l'histoire, et de la nature elle-même, Engels nous a donné certaines des explications les plus claires de toute la littérature marxiste. L'évidence historique et celle des textes donnent peu de base à ce « divorce » entre Marx et Engels. Ceux qui défendent cela se posent souvent en défenseurs radicaux de Marx et en fustigateurs du réformisme. Mais ils finissent généralement par détruire la continuité essentielle du mouvement marxiste.
Marxisme et question coloniale
La défense de la notion de communisme primitif était une défense du projet communiste en général. Mais ce n'était pas seulement le cas au niveau le plus historique et global. Cela avait aussi une signification politique plus concrète et immédiate. Il est nécessaire de rappeler ici le contexte historique dans lequel Marx et Engels ont élaboré leurs travaux sur la question « ethnologique ». Dans les années 1870 et 1880, une nouvelle phase de la vie du capitalisme s'ouvrait. La bourgeoisie venait juste de vaincre la Commune de Paris ; et, si cela ne signifiait pas déjà que tout le système capitaliste était entré dans son époque de sénilité, cela mettait sans aucun doute un terme définitif à la période des guerres nationales dans les centres du capitalisme et, plus généralement, à la période dans laquelle la bourgeoisie pouvait jouer un rôle révolutionnaire sur la scène de l'histoire. Le système capitaliste entrait alors dans sa dernière phase d'expansion et de conquête mondiales, non plus à travers la lutte de classes bourgeoises naissantes, cherchant à établir des Etats nationaux viables, mais à travers la méthode de l'impérialisme, des conquêtes coloniales. Les trois dernières décennies du 19e siècle ont ainsi vu virtuellement la totalité du globe être conquise et partagée entre les grandes puissances impérialistes.
Et partout, les victimes les plus immédiates de cette conquête ont été les « peuples coloniaux » - essentiellement des paysans encore liés aux vieilles formes de production communautaires et de nombreux groupes tribaux. Comme Rosa Luxemburg l'explique, dans son livre L'accumulation du capital : « Le capitalisme a besoin de couches sociales non-capitalistes comme débouchés pour sa plus-value, comme source d'approvisionnement pour ses moyens de production et comme réservoir de main d'oeuvre pour son système de salariat. Pour toutes ces raisons, les formes de production basées sur l'économie naturelle ne sont d'aucune utilité pour le capital. » ([9] [171])
D'où la nécessité pour le capital de balayer, par tous les moyens militaires et économiques dont il dispose, ces restes de production communiste qu'il rencontre partout dans les territoires nouvellement conquis. Parmi ces victimes du monstre impérialiste, les « sauvages », ceux vivant dans la forme de communisme primitif la plus élémentaire, sont de loin les plus nombreux : comme l'a montré Luxemburg, tandis que les communautés paysannes pouvaient être détruites par le « colonialisme de la marchandise », par les impôts et autres pressions économiques, les chasseurs primitifs ne pouvaient être qu'exterminés ou mis de force au travail parce que, non seulement, ils occupaient de vastes territoires convoités par l'agriculture capitaliste, mais qu'ils ne produisaient pas de plus-value susceptible d'entrer dans le processus de circulation capitaliste.
Les « sauvages » ne se sont pas couchés et soumis à ce processus. L'année avant que Morgan ne publie son étude sur les iroquois, tribu indienne de la partie est des Etats-Unis, les tribus de « l’ouest » ont vaincu Custer à Little Big Horn. Mais la « dernière résistance de Custer » fut en réalité la dernière résistance des indigènes américains contre la destruction définitive de leur ancien mode de vie.
La question de la compréhension de la nature de la société primitive était donc d'une importance politique immédiate pour les communistes dans cette période. D'abord parce que, de même que le christianisme avait été l'excuse idéologique pour les conquêtes coloniales dans la première période de la vie du capitalisme, les théories ethnologiques bourgeoises du 19e siècle étaient souvent utilisées comme justification « scientifiques » de l'impérialisme. C'est la période qui a vu le début des théories racistes sur la Responsabilité de l'Homme Blanc et sur la nécessité d'apporter la civilisation aux sauvages plongés dans les ténèbres. L'ethnologie évolutionniste bourgeoise, qui posait comme principe l'ascension linéaire des sociétés primitives aux sociétés modernes, fournissait une justification plus subtile pour la même « mission civilisatrice ». Ensuite, ces notions commençaient déjà à infiltrer le mouvement ouvrier, bien qu'elles n'aient atteint leur plein épanouissement qu'avec la théorie du « colonialisme socialiste » à la période de la Deuxième Internationale, avec le socialisme « chauvin » de figures telles que Hynderman en Grande-Bretagne. En fait, la question de la politique coloniale devait être une ligne de démarcation claire entre les fractions de droite et de gauche de la social-démocratie, un test d'identité internationaliste, comme dans le cas du Parti Socialiste Italien. ([10] [172])
Quand Marx et Engels écrivaient sur les questions ethnologiques, ces problèmes ne faisaient que commencer à émerger. Mais les contours de l'avenir prenaient déjà forme. Marx avait déjà compris que la Commune de Paris marquait la fin de la période des guerres nationales révolutionnaires. Il avait reconnu la conquête britannique de l'Inde, la politique coloniale française en Algérie (où il se rendit pour une cure de repos peu avant sa mort), le pillage de la Chine, le massacre des indigènes américains; tout cela montre que son intérêt croissant pour la communauté primitive n'était pas simplement un intérêt « archéologique »; pas plus qu'il se ramenait à la nécessité bien réelle de dénoncer l'hypocrisie et la cruauté de la bourgeoisie et de sa « civilisation ». En fait, cet intérêt était directement lié à la nécessité d'élaborer une perspective communiste pour la période qui s'ouvrait alors. Cela est surtout montré par l'attitude de Marx sur la question russe.
La question russe et la perspective communiste
L'intérêt de Marx pour la question russe ressurgit au début des années 1870. Mais l'aspect le plus curieux du développement de sa pensée sur cette question est fourni par sa réponse à Vera Zassoulitch alors membre de cette fraction du populisme révolutionnaire qui plus tard, avec Plékhanov, Axelrod et d'autres, forma le groupe Emancipation du travail, le premier courant vraiment marxiste en Russie. La lettre de Zassoulitch, datée du 16 février 1881, demandait à Marx de clarifier sa position sur l'avenir de la commune rurale, l'obschina : devait-elle être dissoute par l'avancée du capitalisme en Russie ou était-elle capable, « libérée des impôts exorbitants, des paiements à la noblesse et à une administration arbitraire ..., de se développer dans une direction socialiste, c'est-à-dire d'organiser graduellement sa production et sa distribution sur une base collective. »
Les écrits précédents de Marx tendaient à voir la commune russe comme une source directe de la « barbarie » russe : et dans une réponse au jacobin russe Tkachev (1875), Engels avait souligné la tendance à la dissolution de l'obschina.
Marx passa de nombreuses semaines à réfléchir à sa réponse, qui occupa quatre brouillons séparés, tout ceux qu'il a rejetés étant beaucoup plus longs que la lettre de réponse qu'il envoya finalement. Ces brouillons sont pleins de réflexions importantes sur la commune archaïque et le développement du capitalisme, et montrent explicitement le niveau auquel ses lectures de Morgan l'avaient conduit à repenser certaines suppositions qu'il avait faites auparavant. A la fin, admettant que sa santé défectueuse l'empêchait d'achever une réponse plus élaborée, il résuma sa réflexion, premièrement en rejetant l'idée que sa méthode d'analyse conduisait à la conclusion que chaque pays ou région était mécaniquement condamnée à passer par la phase bourgeoise de production ; et deuxièmement en concluant que « l'étude spéciale que j'en ai faite, y compris une recherche de sources matérielles originales, m'a convaincu que la commune est le pivot de la régénérescence sociale en Russie. Mais pour qu'elle puisse jouer ce rôle, les influences néfastes l'assaillant de tous côtés doivent d'abord être éliminées, et elle doit ensuite être assurée des conditions normales pour un développement spontané. » (8 mars 1881)
Les brouillons de la réponse n'ont été découverts qu'en 1911 et n'ont pas été publiés avant 1924 ; la lettre elle-même a été « enterrée » par les marxistes russes pendant des décennies. Riazanov, qui était responsable de la publication des brouillons, a essayé de trouver des motifs psychologiques à cette « omission » mais il apparaît que les «fondateurs du marxisme russe » n'étaient pas très satisfaits de cette lettre du «fondateur du marxisme ». Une telle interprétation est renforcée par le fait que Marx tendait à soutenir l'aile terroriste du populisme russe, la Volonté du Peuple, contre ce à quoi il faisait référence comme les « doctrines assommantes » du groupe Répartition Noire de Plékhanov et Zassoulitch, même si, comme nous l'avons vu, c'est ce dernier qui a constitué la base du groupe Emancipation du Travail sur un programme marxiste.
Les gauchistes académistes qui sont spécialisés dans l'étude du Marx de la maturité, se sont beaucoup occupés de cette modification de la position de Marx dans les dernières années de sa vie. Shanin, l'éditeur de Marx de la maturité et le chemin de la Russie, la principale compilation de textes sur cette question, voit correctement les brouillons et la lettre finale comme un magnifique exemple de la méthode scientifique de Marx, de son refus d'imposer des schémas rigides à la réalité, de sa capacité à changer d'avis quand les théories précédentes ne correspondent pas aux faits. Mais, comme pour toutes les formes de gauchisme, cette vérité de base est alors déformée au service de fins capitalistes.
Pour Shanin, les interrogations de Marx sur l'idée linéaire, évolutionniste, selon laquelle la Russie devait passer par la phase de développement capitaliste, avant de pouvoir être intégrée au socialisme, prouve que Marx était un maoïste avant Mao ; ce socialisme pourrait être le résultat de révolutions paysannes dans la périphérie. « Tandis que, au niveau de la théorie, Marx allait être "engelsisé" et Engels, par la suite, "kautskisé" et "plékhanovisé" dans un moule évolutionniste, les révolutions se développaient, au tournant du siècle, dans les sociétés arriérées/ « en développement » .- Russie 1905 et 1917, Turquie 1906, Iran 1909, Mexique 1910, Chine 1910 et 1927. Les insurrections paysannes étaient centrales dans la plupart d'entre elles. Aucune n'était une "révolution bourgeoise" au sens ouest-européen et certaines d'entre elles se sont révélées, en fin de compte, être socialistes dans la direction et les résultats. Dans la vie politique des mouvements socialistes du vingtième siècle il y avait un besoin urgent de réviser les stratégies ou de disparaître. Lénine, Mao et Ho ont choisi la première solution. Cela signifiait parler un "double langage" - un pour la stratégie et la tactique, l'autre pour les ersatz conceptuels et de doctrine, au nombre desquels les "révolutions prolétariennes" en Chine ou au Viêt-nam, réalisées par des paysans et des "cadres", sans ouvriers d'industrie, ne sont que des exemples particulièrement dramatiques. » ([11] [173])
Toutes les rêvasseries sophistiquées de Shanin à propos de la dialectique et de la méthode scientifique révèlent alors leur véritable objet : faire une apologie de la contre-révolution stalinienne dans les pays périphériques du capital et rattacher les horribles distorsions du marxisme, de Mao ou Ho, à rien moins que Marx lui-même.
Des écrivains comme Dunayevskaya et Rosement considèrent le stalinisme comme une forme de capitalisme d'Etat. Mais ils sont pleins d'admiration pour le livre de Shanin : « un travail d'une impeccable érudition qui est aussi une contribution majeure pour la clarification de la perspective révolutionnaire aujourd'hui. » ([12] [174]). Et cela pour une bonne raison : ces écrivains peuvent ne pas partager l'admiration de Shanin pour Ho, Mao et leurs semblables, mais ils considèrent eux aussi que le coeur de la synthèse du Marx « de la maturité » est la recherche d'un sujet révolutionnaire autre que la classe ouvrière. Pour Rosemont, le Marx de la maturité était «plongé jusqu'au cou dans l'étude d'expériences nouvelles (pour lui) de résistance et de révolte contre l'oppression - par les indiens nord-américains, les aborigènes australiens, les paysans égyptiens et russes » ; et cet intérêt « concerne aussi l'avenir des mouvements révolutionnaires d'aujourd'hui, pleins de promesse dans le tiers-monde, le quart-monde et le notre. » ([13] [175]) Le « quart-monde » est celui des peuples tribaux restant ; ainsi, les peuples primitifs d'aujourd'hui, comme ceux de l'époque de Marx, font partie d'un nouveau sujet révolutionnaire. Les écrits de Dunayevskaya sont, eux aussi, remplis d'une recherche de nouveaux sujets révolutionnaires et ils sont généralement constitués d'un fatras de catégories comme les femmes, les homosexuels, les ouvriers d'industrie, les noirs et les mouvements de « libération nationale » du tiers-monde.
Mais toutes ces lectures du Marx « de la maturité » sortent ses contributions de leur contexte historique. La période dans laquelle Marx se débattait avec le problème de la communauté archaïque était, comme nous l'avons vu, une période de « transition » dans la mesure où, alors qu'elle montrait la mort future de la société bourgeoise (la Commune de Paris étant le signe avant-coureur de la future révolution prolétarienne), il y avait encore de vastes étendues pour l'expansion du capital à la périphérie. La reconnaissance, par Marx, de la nature ambiguë de cette période est résumée dans une phrase du « second brouillon » de sa réponse à Zassoulitch : « le système capitaliste a dépassé son apogée à l'Ouest, approchant du moment où il ne sera plus qu'un système social régressif. » ([14] [176])
Dans cette situation, où les symptômes du déclin sont déjà apparents dans le centre du système mais où le système comme un tout continue à s'étendre à une allure extraordinaire, les communistes étaient confrontés à un véritable dilemme. Parce que, comme nous l'avons déjà dit, cette expansion ne peut plus prendre la forme de révolutions bourgeoises contre les féodaux ou d'autres classes dépassées, mais la forme de conquêtes coloniales, d'annexions impérialistes toujours plus violentes, vis-à-vis des zones du globes restées non-capitalistes. Il ne peut pas être question que le prolétariat « soutienne » le colonialisme comme il avait soutenu la bourgeoisie contre la féodalité ; la préoccupation de Marx dans ses investigations sur la question russe était plutôt celle-là : l'humanité pouvait-elle, dans ces zones, s'épargner le passage par l'enfer du développement capitaliste ? Il est certain que rien, dans l'analyse de Marx, ne suggère que chaque pays particulier doive mécaniquement passer par la phase du développement capitaliste avant que la révolution communiste mondiale soit possible ; il avait, en fait, rejeté la déclaration de son critique russe, Mikhailovsky, selon laquelle sa théorie serait « une théorie historico-philosophique du Progrès Universel » ([15] [177]), et qui insistait sur le fait que le processus par lequel les paysans étaient expropriés et transformés en prolétaires devait inévitablement être le même dans tous les pays. Pour Marx et Engels la question clef était la révolution prolétarienne en Europe, comme Engels l'avait déjà montré dans sa réponse à Tkachev et comme cela avait été rendu parfaitement explicite dans l'introduction à l'édition russe du Manifeste Communiste, publié en 1882. Si la révolution était victorieuse dans les centres industrialisés du capital, alors l'humanité pourrait s'épargner quantité de souffrances sur tout le globe et les formes vestiges de propriété communautaire pourraient être directement intégrées dans le système communiste mondial : « Si la révolution russe devient le signal d'une révolution prolétarienne à l'Ouest, de telle sorte que les deux peuvent se compléter, alors l'actuelle propriété communautaire du sol russe pourra servir de point de départ à un développement communiste. »
C'était une hypothèse parfaitement raisonnable à cette époque. En fait, il est évident aujourd'hui que, si les révolutions prolétariennes de 1917-23 axaient été victorieuses - si la révolution prolétarienne à l'Ouest était venue en aide à la révolution russe -, les terribles ravages du « développement » capitaliste à la périphérie auraient pu être évités, les formes résiduelles de la propriété communautaire auraient pu être intégrées à un communisme global et nous ne serions pas confrontés aujourd'hui à la catastrophe sociale, économique et écologique qui est le lot du « tiers-monde ».
En outre, il y a une bonne part de vision prophétique dans la préoccupation de Marx à propos de la Russie. Déjà, depuis la guerre de Crimée, Marx et Engels avaient la profonde conviction qu'une espèce de soulèvement social était sur le point d'avoir lieu en Russie (ce qui explique en partie leur soutien à La Volonté du Peuple, qu'ils jugeaient comme le plus sincère et le plus dynamique des mouvements révolutionnaires de Russie) ; et que, même s'il ne revêtait pas un caractère clairement prolétarien, il serait indubitablement l'étincelle qui allumerait l'affrontement révolutionnaire général en Europe. ([16] [178])
Marx se trompait à propos de l'imminence de ce soulèvement. Le capitalisme s'est développé en Russie, même sans l'émergence d'une classe bourgeoise forte et indépendante ; il a en grande partie, même si incomplètement, dissout la communauté paysanne archaïque ; et le principal protagoniste de la véritable révolution russe a été, en fait, la classe ouvrière industrielle. Mais surtout, la révolution en Russie n'a pas éclaté avant que le capitalisme, comme un tout, ne soit devenu un « régime social régressif», c'est-à-dire qu'il soit entré dans sa phase de décadence, réalité démontrée par la guerre de 1914-18.
Néanmoins, le rejet par Marx de la nécessité pour chaque pays de passer mécaniquement par des stades, sa répugnance à soutenir les formes naissantes du capitalisme en Russie, son intuition d'après laquelle un soulèvement social en Russie serait le coup d'envoi de la révolution prolétarienne internationale ; dans tout cela il anticipait brillamment la critique du gradualisme menchevik et du « phasisme » initié par Trotski, continué par les bolcheviks et justifié pratiquement par la révolution d'Octobre.
Dans le même sens, ce n'est pas un hasard si les marxistes russes, qui avaient eu formellement raison en voyant que le capitalisme se développerait en Russie, ont « perdu » la lettre de Marx : la majorité d'entre eux, après tout, furent les pères fondateurs du menchevisme.
Mais, ce qui pour Marx était une série d'anticipations profondes dans une période particulièrement complexe de l'histoire du capitalisme devient, avec les « interprètes » actuels du Marx de la maturité, une apologie a-historique des nouvelles « voies de la révolution » et des nouveaux « sujets révolutionnaires », à une époque où le capitalisme est dans un profond déclin depuis huit décennies. Un des plus clairs indicateurs de ce déclin est précisément la manière suivant laquelle le capitalisme, à la périphérie, a détruit les vieilles économies paysannes, les vestiges de l'ancien système communautaire, sans être capable d'intégrer la masse des paysans sans terre, qui en résultait, au travail productif. La misère, les taudis, les famines et les guerres qui ravagent le « tiers-monde » aujourd'hui sont une conséquence directe de cette limite atteinte par le « développement » capitaliste. En conséquence, il ne peut pas être question aujourd'hui d'utiliser les vestiges de la communauté archaïque comme tremplin pour la production communiste, parce que le capitalisme les a effectivement détruit sans rien mettre d'autre à la place. Et il n'y a pas de nouveau sujet révolutionnaire attendant d'être découvert parmi les paysans ou parmi les restes tragiques de peuples primitifs. L'implacable « progrès » de la décadence, au cours de ce siècle, a au moins rendu plus évident que, non seulement la classe ouvrière est le seul sujet révolutionnaire, mais encore que la classe ouvrière des nations capitalistes les plus développées est la clef de la révolution pour le monde entier.
CDW.
Le prochain article de cette série examinera de plus près la façon dont les fondateurs du marxisme ont traité la question de la «femme ».
[1] [179] Ancient society, or Researches in the line of Human Progress from Savagery. through Barbarism to Civilisation. H-L. Morgan. London 1877.
[2] [180] Raya Dunayevskaya était une dirigeante de la tendance Johnson-Forest qui a rompu avec le trotskysme après la deuxième guerre mondiale sur la question du capitalisme d'Etat et de la défense de l'URSS Mais c'était une rupture très partielle qui a conduit Dunayevskaya dans l'impasse du groupe News and Letters. groupe qui a amalgamé de l'hégelianisme, du conseillisme, du féminisme et le vieux gauchisme ordinaire, en un mélange aboutissant à un étrange culte de la personnalité autour des innovations « philosophiques » de Raya. Elle a écrit sur les Cahiers ethnologiques dans son livre RosaLuxemburg, la libération de la femme et la philosophie de la révolution de Marx (New-Jersey, 1981), où elle cherchait à récupérer à la fois Luxemburg et les Cahiers ethnologiques derrière l'Idée de la Libération de la Femme. Rosemont, dont l'article Karl Marx et les iroquois' contient un tas d'éléments intéressants, est un dirigeant du Groupe Surréaliste Américain, qui a défendu certaines positions prolétariennes mais qui, de par sa nature même, a été incapable de faire une critique claire du gauchisme et, encore moins, de l'esprit de rébellion petit-bourgeois duquel il a émergé au début des années 70.
[3] [181] Les Cahiers ethnologiques de Karl Marx, édités par Lawrence Krader aux Pays-Bas en 1974, p. 128.
[4] [182] Ibid p. 150.
[5] [183] Rosement, « Karl Marx et les Iroquois » in Arsenal. Surrealist Subversion, n° 4, 1989.
[6] [184] Cahiers, p. 115.
[7] [185] « Brouillons de réponse » à Vera Zassoulitch. in Théodore Shanin. Marx de la maturité et le chemin de la Russie : Marx et la périphérie du capitalisme. New-York 1983. p. 107 et suivantes.
[8] [186] Ibid p.107.
[9] [187] Chapitre 27.
[10] [188] Voir notre brochure sur La Gauche Communiste d'Italie.
[11] [189] Marx de la maturité et le chemin de la Russie, pp. 24-25.
[12] [190] Rosemont. Karl Marx et les Iroquois.
[13] [191] Ibid.
[14] [192] Karl Marx et le chemin de la Russie, p. 103.
[15] [193] Lettre à l'éditeur de Otechesvenneye Zapiski, 1878.
[16] [194] D'après un autre gauchiste académiste cité dans le livre de Shanin. Haruki Wada. Marx et Engels auraient même soutenu la perspective d'une sorte de développement socialiste « séparé » en Russie, basé sur la commune paysanne et plus ou moins indépendant de la révolution ouvrière européenne. Il prétend que la formulation du Manifeste n'est pas défendue dans les brouillons pour Zassoulitch et que ces derniers correspondent plus au point de vue particulier de Engels qu'à celui de Marx. L'indigence de l'argumentation de Wada sur le sujet est déjà exposée dans un autre article du livre - « Marx de la maturité, continuité, contradiction et enseignements », par Derek Sayer et Philip Corrigan. En tout cas comme nous t'avons montré dans notre article de la Revue Internationale n° 72 (« 1848 : Le communisme comme programme politique ») l'idée du socialisme dans un seul pays, même quand il est basé sur une révolution prolétarienne, est complètement étranger à la fois à Marx et à Engels.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [196]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 82 - 3e trimestre 1995
- 3287 lectures
Aggravation de la guerre en ex-Yougoslavie : Plus les puissances parlent de paix, plus elles sèment la guerre
- 6668 lectures
La barbarie guerrière qui depuis quatre ans répand la mort, la destruction et la misère dans l'ex-Yougoslavie a connu au cours du printemps 1995 un nouvel enfoncement dans l'horreur. Pour la première fois les deux fronts principaux de cette guerre, en Croatie et en Bosnie, après une brève période de moindre intensité guerrière, se sont rallumés simultanément, menaçant d'entraîner un embrasement généralisé sans précédent. Derrière leurs discours « pacifistes » et « humanitaires », les grandes puissances, véritables responsables et instigateurs de la plus sanglante guerre en Europe depuis le deuxième conflit mondial, franchissent de nouvelles étapes dans leur engagement. Les deux plus importantes, par le nombre de soldats déjà envoyés sur place sous l'uniforme de l'ONU, la Grande-Bretagne et la France, ont entrepris d'accroître fortement leur présence, qui plus est, en constituant une force militaire spéciale, la Force de réaction rapide (FRR), dont la spécificité est d'être moins dépendante de l'ONU et plus directement sous le commandement de leurs gouvernements nationaux.
L'épais tissu de mensonges qui recouvre l'action criminelle des principaux impérialismes de la planète dans cette guerre s'est encore déchiré un peu plus, laissant entrevoir le caractère sordide des intérêts et des motifs qui les animent.
Pour les prolétaires, en particulier en Europe, la sourde inquiétude que développe cette boucherie ne doit pas être un sujet de lamentations impuissantes, mais doit développer leur prise de conscience de la responsabilité de leurs propres gouvernements nationaux, de l'hypocrisie des discours que les classes dominantes entretiennent ; prise de conscience du fait que la classe ouvrière des principaux pays industrialisés constitue la seule force capable de mettre un terme à cette guerre, et à toutes les guerres.
Les femmes, les enfants, les vieillards qui, à Sarajevo comme dans tant d'autres villes en ex-Yougoslavie, sont obligés de se terrer dans les caves et les souterrains, sans électricité, sans eau, pour échapper à l'enfer des bombardements et des « snipers », les hommes qui en Bosnie comme en Croatie ou en Serbie sont mobilisés de force pour aller risquer leur vie sur le front ont-ils quelque raison d'espérer en apprenant l'actuel afflux massif de nouveaux « soldats de la paix » vers leur pays ? Les 2 000 marines américains qui accompagnent le porte-avions Roosevelt dépêché en mai dans l'Adriatique, les 4 000 soldats français et britanniques qui ont déjà commencé à débarquer avec des tonnes de nouvelles armes en ex-Yougoslavie, viennent-ils, comme le prétendent leurs gouvernements, pour soulager les souffrances d'une population qui a déjà connu plus de 250 000 morts et 3 millions et demi de personnes « déplacées u pour fait de guerre ?
Les Casques bleus de l'ONU apparaissent comme des bienfaiteurs lorsqu'ils escortent des convois de vivres pour les populations de villes assiégées, lorsqu'ils se présentent comme une force d'interposition entre belligérants. Ils apparaissent comme des victimes lorsque, comme récemment, ils sont pris en otages par une des armées locales. Mais derrière cette apparence se cache en réalité l'action cynique des classes dominantes des grandes puissances qui les commandent, et pour qui la population de l'ex-Yougoslavie n'est que de la chair à canon dans la guerre qui les oppose pour se partager les zones d'influence dans cette partie stratégiquement cruciale de l'Europe. La nouvelle aggravation que vient de connaître cette guerre au cours du printemps dernier en est une flagrante illustration. L'offensive de l'armée croate commencée début mai, en Slavonie occidentale, l'offensive bosniaque déclenchée au même moment juste à la fin de la « trêve u signée en décembre dernier, mais aussi la mascarade des Casques bleus pris en otages par les Serbes de Bosnie, ne sont pas des incidents locaux déterminés par la seule logique des combats sur place, mais des actions préparées et réalisées avec la participation active, sinon l'initiative, des grandes puissances impérialistes.
Comme nous l'avons mis en évidence tout au long des articles consacrés depuis quatre ans dans cette revue à la guerre dans les Balkans, les cinq pays qui constituent le dit «groupe de contact » (Etats-Unis, Russie, Allemagne, France, Grande-Bretagne), entité supposée chercher les moyens de mettre un terme à ce conflit, ont soutenu et soutiennent activement chacune l'un des camps en présence localement. Et l'actuelle recrudescence de la guerre ne peut être comprise en dehors de la logique et de l'action de gangsters à la tête des ces puissances. C'est l'Allemagne, en poussant la Slovénie et la Croatie à proclamer leur indépendance vis-à-vis de l'ancienne confédération yougoslave, qui a fait éclater ce pays et joué un rôle primordial dans le déclenchement de la guerre en 1991. Face à cette poussée de l'impérialisme allemand, ce sont les quatre autres puissances qui ont soutenu et encouragé le gouvernement de Belgrade à mener une contre-offensive. Ce fut la première phase de la guerre, particulièrement meurtrière. Elle aboutit en 1992 à ce que la Croatie vit près d'un tiers de son territoire contrôlé par les armées et les milices Serbes. La France et la Grand-Bretagne, sous couvert de l'ONU, avaient alors envoyé les plus importants contingents de Casques bleus qui, sous prétexte d'empêcher les affrontements, se sont systématiquement employés à assurer le maintien du statu quo en faveur de l'armée serbe. En 1992 le gouvernement des Etats-Unis s'est prononcé pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine et a soutenu le secteur musulman de cette province, dans une guerre contre l'armée croate (toujours soutenue par l'Allemagne) et l'armée serbe (soutenue par la GrandeBretagne, la France et la Russie). En 1994, l'administration de Clinton est parvenue à imposer un accord pour la constitution d'une fédération entre la Bosnie et la Croatie contre la Serbie et, à la fin de l'année, sous l'égide de l'exprésident Carier, à obtenir la signature d'une trêve entre la Bosnie et la Serbie. Au début 1995, les principaux fronts en Croatie et en Bosnie semblent donc relativement apaisés. Et Washington ne se prive pas de présenter cet état de choses comme le triomphe de l'action pacificatrice des puissances, en particulier de la sienne. Mais, en réalité, il ne s'agit que d'un répit partiel en vue de permettre le réarmement de la Bosnie, essentiellement par les Etats-Unis, préparant une contre-offensive contre les armées serbes. En effet, après quatre ans de guere, celles-ci, avec l'appui des Etats britannique, français et russe, contrôlent toujours 70 % du territoire de la Bosnie et plus du quart de celui de la Croatie. Le gouvernement de Belgrade lui-même reconnaît que son camp, qui inclut les u Républiques serbes » de Bosnie et de Croatie (Krajina), récemment a réunifiées o, devra reculer. Mais, malgré des négociations où l'on retrouve tous les différends entre puissances, aucun accord n'est atteint. ([1] [198]) Ce qui ne peut être obtenu par la négociation, le sera donc par la force militaire. Ainsi, ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est rien d'autre que la suite logique, préméditée, d'une guerre où les grandes puissances n'ont cessé de jouer en sous-main un rôle prépondérant.
Et contrairement à ce qu'affirment hypocritement les gouvernements de celles-ci, qui présentent le renforcement actuel de leur piésence dans le conflit comme une action en vue de limiter la violence des nouveaux affrontements, ces derniers sont le produit direct de leur propre action guerrière.
L'invasion d'une partie de la Slavonie occidentale par la Croatie, au début du mois de mai, ainsi que la reprise des combats en divers points du front de 1 200 kilomètres qui oppose le gouvernement de Zagreb aux Serbes de Krajina ; le déclenchement, au même moment, d'une offensive de l'armée bosniaque se déployant au nord de la Bosnie dans l'enclave de Bihac, dans la région du corridor serbe de Brcko et enfin autour de Sarajevo en vue de forcer l'armée serbe à relâcher la pression sur le siège de la ville ; tout cela n'a pas été fait en dehors de la volonté des puissances, encore moins contre une soi-disant volonté pacificatrice de ces dernières. Il est clair que ces actions ont été entreprises avec l'accord et à l'initiative des gouvernements américain et allemand. ([2] [199])
La mascarade des otages
La réaction du camp adverse n'est pas moins significative de l'engagement des autres puissances : la Grande-Bretagne, la France et la Russie, aux côtés de la Serbie. Mais ici les choses ont été moins apparentes. Parmi les alliés au camp serbe, seule la Russie clame ouvertement son engagement. La France et la Grande-Bretagne ont, par contre, jusqu'à présent, toujours entretenu un discours de a neutralité » dans le conflit. Qui plus est, en de nombreuses occasions, leurs gouvernements ont fait de grandes déclarations d'hostilité aux Serbes. Cela ne les a jamais empêchés de leur prêter main forte sur le terrain militaire comme sur le terrain diplomatique.
On connaît les faits : suite à l'offensive croato-bosniaque, l'armée des Serbes de Bosnie répond par une intensification des bombardements en Bosnie et plus particulièrement sur Sarajevo. L'OTAN, c'est-à-dire essentiellement le gouvernement Clinton, effectue, en représailles, deux bombardements aériens d'un dépôt de munitions près de Pale, la capitale des Serbes de Bosnie. Le gouvernement de Pale riposte en prenant en otage 343 Casques bleus, en majorité français et britanniques, dont quelquesuns sont placés comme o boucliers humains u, enchaînés prés d'objectifs militaires susceptibles d'être bombardés. Immédiatement une grande opération médiatique est mise en place exposant les photos de soldats enchaînés. Les gouvernements français et britannique dénoncent u l'odieuse action terroriste » contre les forces de l'ONU, et en premier lieu contre les pays qui fournissent le plus grand nombre de soldats dans les rangs des Casques bleus: la France et la Grande-Bretagne. Le gouvernement serbe de Milosevic, à Belgrade, se déclare en désaccord avec l'action des Serbes de Bosnie, tout en dénonçant les bombardements de l'OTAN. Mais, rapidement, ce qui au départ pouvait apparaître comme un affaiblissement de l'alliance franco-britannique avec le camp serbe, comme une vérification dans la pratique du rôle o humanitaire u, neutre, non-pro-serbe des forces de l'ONU, va révéler sa réalité : celle d'une imposture, une de plus, qui sert aussi bien les gouvernements serbes que les alliés de la FORPRONU.
Pour les gouvernements de ces deux puissances, la prise en otage de leurs soldats a apporté deux avantages majeurs pour leur action dans cette guerre. Premièrement, de façon immédiate, cela a contraint l'OTAN, c'est-à-dire les Etats-Unis à cesser tout bombardement supplémentaire sur leurs alliés serbes. Au début de la crise, le gouvernement français avait été contraint d'accepter le premier bombardement, mais il avait ouvertement exprimé une vigoureuse désapprobation du second. L'utilisation par le gouvernement serbe des otages comme boucliers, a permis de régler la question de façon immédiate. Deuxièmement, et surtout, la prise d'otages, présentée comme une « insupportable humiliation », a constitué un excellent prétexte pour justifier l'envoi immédiat par les deux pays de milliers de nouveaux soldats en ex-Yougoslavie. La Grande-Bretagne, à elle seule, a annoncé le triplement du nombre de ses soldats en mission.
Le coup a été bien monté. D'un côté, les gouvernements britannique et français, exigeant de pouvoir envoyer sur place de nouveaux renforts pour o sauver l'honneur et la dignité de nos soldats humiliés par les Serbes de Bosnie » ; de l'autre, Karadzic, chef du gouvernement de Pale, justifiant son attitude par la nécessité de protéger ses troupes contre les bombardements de l'OTAN ; au centre, Milosevic, chef du gouvernement de Belgrade, jouant les « médiateurs ». Le résultat fut spectaculaire. Alors que depuis des semaines les gouvernements britannique et français o menaçaient » de retirer leurs troupes de l'ex-Yougoslavie si l'ONU ne leur accordait pas une plus grande indépendance de mouvement et d'action (en particulier la possibilité de se regrouper a pour mieux se défendre »), ils décident d'augmenter massivement leurs effectifs sur place grâce à cette justification. ([3] [200])
Au début de la mascarade, au moment des premières prises d'otages, la presse suggéra que peut-être certains des otages avaient été torturés. Quelques jours plus tard, lorsque les premiers otages français furent libérés, certains ont livré leur témoignage : « Nous avons fait de la musculation et du tennis de table... On a visité toute la Bosnie, on s'est promenés... (Les Serbes) ne nous considéraient pas- comme des ennemis. » ([4] [201]) Tout aussi parlante est l'attitude conciliante prise par le commandement français des forces de l'ONU sur place, quelques jours seulement après que le gouvernement français ait crié sur tous les toits qu'il avait donné des a consignes de fermeté » contre les Serbes : « Nous appliquerons strictement les principes du maintien de la paix jusqu'à nouvel avis... Nous pouvons essaver d'établir des contacts avec les Serbes de Bosnie, nous pouvons es-sa - ver d'acheminer l'aide alimentaire, nous pouvons essayer de ravitailler nos troupes. » ([5] [202]) Le journal français Le Monde s'en offusquait ouvertement : « Tranquillement, tandis que 144 soldats de l'ONU étaient toujours otages des Serbes, la FORPRONU revendiquait solennellement sa paralvsie. » Et de citer un officier de la FORPRONU : « Depuis quelques jours nous sentions une tendance au relâchement. L'émotion provoquée par les images des boucliers humains s'estompe, et nous craignons que nos gouvernements n'aient envie de passer l'éponge, d'éviter l'affrontement. »
Si les Serbes de Bosnie ne considéraient pas les o otages » français « comme des ennemis », si cet officier de la FORPRONU avait l'impression que les gouvernements français et britannique avaient envie o d'éviter l'affrontement » c'est tout simplement parce que, quels que soient les dérapages qui peuvent se produire entre les troupes serbes et celles de l'ONU sur le terrain, leurs gouvernements sont alliés dans cette guerre, et parce que « l'affaire des otages » n'a été qu'un chapitre de plus dans la série des mensonges et des manipulations auxquelles se livrent les classes dominantes pour couvrir leur oeuvre meurtrière et barbare.
La signification de la constitution de la Force de Réaction Rapide
Le résultat principal du coup monté des otages aura été la constitution de la FRR. La définition de la fonction de cc nouveau corps militaire franco-britannique, supposé venir en aide aux forces de l'ONU en ex-Yougoslavie, a varié au cours des semaines où les gouvernements des deux puissances tutélaires se sont attachées à en faire accepter, difficilement, l'existence et le financement par leurs o partenaires » au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. ([6] [203]) Mais, quels que soient les méandres des formulations diplomatiques employées dans ces débats d'hypocrites, ce qui est important c'est la signification profonde de cette initiative. Sa portée doit être comprise sur deux plans : la volonté des grandes puissances de renforcer leur engagement militaire dans ce conflit, d'une part ; d'autre part, la nécessité pour ces puissances de se dégager, ou du moins de prendre leurs distances par rapport au carcan que constitue, pour leur action, le cadre de la comédie « humanitaire onusienne ».
Les bourgeoisies française et britannique savent que leur prétention à continuer de jouer un rôle comme puissance impérialiste sur la planète, dépend, en grande mesure, de leur capacité à affirmer leur présence dans cette zone, cruciale stratégiquement. Les Balkans, tout comme la zone du Moyen-Orient, constituent un enjeu majeur dans la lutte que se livrent au niveau mondial les grandes puissances. En être absent, c'est renoncer au statut de grande puissance. La réaction du gouvernement allemand, face à la constitution de la FRR, est particulièrement significative de ce souci commun à tous les principaux Etats européens : « L'Allemagne ne pourra plus longtemps demander à ses alliés français et britanniques de faire le sale boulot, tandis qu'elle se réserve les places de spectateur dans l’Adriatique, tout en revendiquant un rôle politique mondial. Elle doit aussi assumer sa part de risque. » ([7] [204]) Cette déclaration des milieux gouvernementaux de Bonn est particulièrement hypocrite : comme on l'a vu, lé capital allemand a, depuis le début de la guerre en ex-Yougoslavie, largement pris sa part dans le « sale boulot » des grandes puissances dans cette guerre. Elle illustre de plus clairement le véritable esprit qui anime les soi-disant « pacificateurs humanitaires » lorsqu'ils prétendent « venir en aide » à la population civile dans les Balkans.
L'autre aspect important dans la constitution de la FRR est la volonté de la France et de la Grande-Bretagne de se donner les moyens d'assurer plus librement la défense de leurs propres intérêts impérialistes spécifiques. Ainsi, à la fin du mois de mai, un porte-parole du ministère de la défense britannique, interrogé sur la question de savoir si la FRR serait placée sous l'égide de l'ONU, répondait que les « renforts seraient sous le commandement de l'ONU », mais il ajoutait aussitôt : « ils disposeront aussi de leur propre commandement » ([8] [205]). Au même moment, des officiers français affirmaient que ces forces auraient « leurs propres peintures de guerre et leurs insignes », n'agiraient plus sous le Casque bleu et que leurs engins ne seraient pas obligatoirement peints en blanc. Au moment où nous écrivons, la question de savoir de quelle couleur seront les « peintures de guerre » des soldats de la FRR reste encore dans le flou. Mais, la signification de la constitution de cette nouvelle force militaire est parfaitement claire : les grandes puissances affirment plus clairement qu'auparavant l'autonomie de leur action impérialiste.
Non, la population de l'ex-Yougoslavie, qui subit depuis quatre ans les horreurs de la guerre, n'a rien de positif à attendre de la venue de ces nouvelles « forces de la paix ». Celles-ci ne viennent que pour continuer et intensifier l'action barbare et sanguinaire que les grandes puissances y mènent depuis le début du conflit.
Vers l'extension et l'intensification de la barbarie guerrière
Tous les gouvernements en ex-Yougoslavic se sont dès à présent engagés dans une nouvelle flambée guerrière. Izetbegovic, chef du gouvernement bosniaque, a clairement annoncé l'ampleur de l'offensive que son armée a déclenchée : Sarajcvo ne doit plus passer un hiver assiégée par les armées serbes. Des experts de l'ONU ont estimé qu'une tentative de briser ce siège devrait coûter près de 15 000 morts aux forces bosniaques. Tout aussi clairement, le gouvernement croate a signifié que l'offensive en Slavonie occidentale n'était que le point de départ d'une opération qui doit s'étendre sur tout le front qui l'oppose aux Serbes de Krajina, en particulier sur la côte dalmate. Quant au gouvernement des Serbes de Bosnie, il a déclaré l'état de guerre dans la zone de Sarajcvo et mobilise toute sa population. A la mi juin, alors que les diplomates américains s'attachaient à négocier une reconnaissance de la Bosnie par les gouvernements serbes, Slavisa Rakovic, un des conseillers du gouvernement de Pale, déclarait froidement qu'il était o pessimi.sle à court terme u et qu'il croyait o plus en une recrudescence de la guerre qu'en une possibilité d'aboutissement des négociations, car l'été est idéal pour se battre. » ([9] [206])
Les Serbes de Bosnie ne se battent et ne se battront évidemment pas seuls. Les « Républiques serbes » de Bosnie et de Krajina viennent de proclamer leur unification. Quant au gouvernement de Belgrade, qui est supposé appliquer un embargo sur les armes vis-à-vis des Serbes de Bosnie, il est connu qu'il n'en a jamais rien été et que, quelles que soient les divergences plus ou moins réelles qui peuvent exister entre les différents partis serbes au pouvoir, leur coopération militaire face aux armées croate et bosniaque sera totale. ([10] [207])
Mais les antagonismes entre le différents nationalismes de l'ex-Yougoslavie ne suffiraient pas à entretenir et développer la guerre, si les grandes puissances mondiales ne les alimentaient et ne les exacerbaient, si les discours a pacifistes » de ces dernières étaient autre chose que la couverture idéologique de leur propre politique impérialiste. Le pire ennemi de la paix en ex-Yougoslavie n'est autre que la guerre impitoyable à laquelle se livrent les grandes puissances. Celles-ci trouvent toutes, à des degrés divers, un intérêt au maintien de la guerre dans les Balkans. Au delà des positions géo-stratégiques que chacune d'elles défend ou essaie de conquérir_ elles y voient d'abord et avant tout un moyen d'empêcher ou de détruire les alliances des autres puissances concurrentes. « Dans une telle situation d'instabilité, il est plus facile pour chaque puissance de créer des troubles chez ses adversaires, de saboter les alliances qui lui portent ombrage, que de développer pour sa part des alliances solides et assurer une stabilité sur ses terres. »([11] [208])
Cette guerre a constitué pour le capital allemand ou français un puissant instrument pour briser l'alliance entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, tout comme pour saboter la structure de l'OTAN, instrument de domination du capital américain sur les anciens membres du bloc occidental. Un haut fonctionnaire du Département d'Etat américain le reconnaissait explicitement récemment : « La guerre en Bosnie a créé les pires tensions dans l'OTAN depuis la crise de Suez. » (International Herald Tribune, 13.06.95). Parallèlement, pour Washington, cette guerre constitue un moyen d'entraver la consolidation de l'Union européenne autour de l'Allemagne. Santer, le nouveau président de la commission de l'Union européenne s'en est amèrement plaint, début juin, en commentant l'évolution de la situation dans les Balkans.
L'aggravation actuelle de la barbarie guerrière en Yougoslavie est ainsi la concrétisation de l'avancée de la décomposition capitaliste telle qu'elle exacerbe tous les antagonismes entre fractions du capital, imposant le règne du « chacun pour soi » et du « tous contre tous ».
La guerre comme facteur de prise de conscience du prolétariat
La guerre dans l'ex-Yougoslavie, constitue le conflit le plus sanglant en Europe depuis la dernière guerre mondiale. Depuis un demi-siècle, l'Europe, avait été épargnée par les multiples guerres entre les deux principaux camps impérialistes. Ces affrontements ensanglantaient les zones du « tiers-monde », par luttes de « libération nationale » interposées. L'Europe était demeurée un « havre de paix ». La guerre en ex-Yougoslavie, en mettant fin à cette situation, revêt une importance historique majeure. Pour le prolétariat européen, la guerre est de moins en moins une réalité exotique qui se déroule à des milliers de kilomètres et dont on suit les développements sur les écrans de télévision à l'heure des repas.
Cette guerre n'avait jusqu'à présent que faiblement constitué un facteur de préoccupation dans l'esprit des prolétaires des pays industrialisés d'Europe occidentale. Les bourgeoisies européennes ont su présenter ce conflit comme une autre guerre « éloignée », où les Etats « démocratiques » se doivent de remplir une mission « humanitaire » et « civilisatrice », dans le but de pacifier des « ethnies » qui s'entre-tuent sans raison. Même si quatre ans d'images médiatiques manipulées n'ont pas pu cacher la réalité sordide et sauvage de la guerre, même si dans l'esprit des prolétaires cette guerre apparaît comme une des horreurs qui se développent actuellement sur toute la planète, le sentiment prédominant généralement parmi les exploités a été celui d'une relative indifférence résignée. Sans enthousiasme on s'est efforcé de croire à la réalité des discours officiels sur les « missions humanitaires » des soldats de l'ONU et de l'OTAN.
L'évolution actuelle de ce conflit, avec le changement d'attitude auquel sont contraints les gouvernements des principales puissances impliquées va entraîner un changement cet état d'esprit. Le fait que les gouvernements de France et de Grande-Bretagne décident d'envoyer des milliers de nouveaux soldats sur le terrain, et que ceux-ci soient désormais envoyés non plus seulement comme des représentants d'une organisation internationale comme l'ONU, mais comme des soldats portant l'uniforme et le drapeau de leur patrie, est en train de donner une nouvelle dimension à la guerre et à la façon de la percevoir. La participation active des « Grands » au conflit se dévoile sous son vrai jour. Le voile « humanitaire » dont ils recouvrent leur action se déchire de plus en plus, laissant apparaître la sordide réalité des motivations impérialistes.
L'intensification actuelle de la guerre en ex-Yougoslavie se produit à un moment où les perspectives économiques mondiales connaissent une nouvelle dégradation importante, annonçant de nouvelles attaques sur les conditions d'existence de la classe ouvrière, en particulier dans les pays les plus industrialisés. Guerre et crise économique, barbarie et misère, chaos et paupérisation, plus que jamais la faillite du capitalisme, le désastre qu'entraîne la survie de ce système en décomposition, mettent la classe ouvrière mondiale devant ses responsabilités historiques. Dans ce contexte, la brutale accélération de la guerre en ex-Yougoslavie doit constituer un facteur supplémentaire de prise de conscience de ces responsabilités.
Il revient aux révolutionnaires de contribuer de toute leur énergie au processus de cette prise de conscience dont ils sont un élément indispensable. Ils doivent en particulier mettre en évidence que la compréhension du rôle joué par les grandes puissances dans cette guerre permet de combattre le sentiment d'impuissance que la classe dominante distille depuis le début de celle-ci. Les gouvernements des grandes puissances industrielles et militaires ne peuvent faire la guerre que parce que la classe ouvrière de leur pays le leur permet, en ne parvenant pas encore à y unifier consciemment ses forces contre le capital. C'est le prolétariat des grands pays industrialisés qui, par son expérience historique, par le fait que la bourgeoisie n'y est pas parvenue à l'embrigader suffisamment idéologiquement pour l'envoyer à une nouvelle guerre mondiale, qui est le seul capable de faire obstacle aux guerres et de mettre fin à la la barbarie capitaliste en général. C'est cela que l'aggravation de la guerre en ex-Yougoslavie doit rappeler aux prolétaires.
RV, 19 juin 95
[1] [209] Il est particulièrement significatif que les négociations avec les différents gouvernements serbes sur la reconnaissance de la Bosnie, soient menées non pas par des représentants bosniaques, mais par des diplomates de Washington. Tout aussi significative de l'engagement des puissances dans cette guerre aux côtés de tel ou tel belligérant, sont les positions défendues par chacune d'entre elles à propos de cette négociation. Un des marchandages proposé au gouvernement de Milosevic est qu'il reconnaisse la Bosnie en échange d'une levée des sanctions économiques internationales qui pèsent toujours sur la Serbie. Mais lorsqu'il s'agit de définir cette levée des sanctions, on retrouve les clivages qui divisent les puissances : pour les Etats-Unis cette levée doit être entièrement conditiomielle et pouvoir être suspendue à tout moment en fonction de chaque action du gouvernement serbe ; pour la France et la Grande-Bretagne, par contre, cette levée doit être garantie pendant une période d'au moins six mois ; pour la Russie, elle doit être inconditionnelle et sans limite de temps.
[2] [210] Le 6 mars de cette année, un accord militaire a été signé entre le gouvernement de la Croatie et celui des Musulmans de Bosnie en vue de se rc défendre contre l'agresseur commun s. Cependant, cet accord entre la Croatie et la Bosnie, et parallèlement entre les Etats-Unis et l'Allemagne, pour mener une contre-offensive contre les armées serbes ne peut étre que provisoire et circonstanciel. Dans la partie de la Bosnie contrôlée par la Croatie, les deux armées se font face et à tout moment les affrontements peuvent reprendre comme ce fut le cas dans les premières années de la guerre. La situation dans la ville de Mostar, la plus importante de la région, qui fut l'objet d'affrontements particulièrement sanglants entre Croates et Musulmans, est à cet égard éloquente. Bien que supposée vivre sous un gouvernement croato-bosniaque commun, avec une présence active de représentants de IUnion européenne, la ville reste divisée en deux parties bien distinctes et les hommes musulmans, en âge de combattre, sont strictement interdits de séjour dans la partie croate. Mais par ailleurs et surtout, l'antagonisme qui oppose le capital américain au capital allemand en ex-Yougoslavie, comme dans le reste du monde, constitue la principale ligne de fracture dans les tensions inter-impérialistes depuis l'effondrement du bloc de l'Est (voir en particulier, K Tous contre tous N dans Revue internationale n° 80, 1 er trimestre 1995)
[3] [211] L'exigence de la France et de la Grande-Bretagne que les forces de l'ONU sur place soient regroupées afin de « mieux se défendre contre les Serbes v est, elle aussi, une manceuvre hypocrite. Loin de traduire une action contre les armées serbes, une telle mesure impliquerait l'abandon de la présence des Casques bleus dans presque toutes les enclaves encerclées par celles-ci en Bosnie (à l'exception des trois principales). Cela impliquerait leur laisser toute possibilité de s'en emparer de façon plus définitive, tout en permettant de concentrer K l'aide s des Casques bleus dans les zones les plus importantes.
[4] [212] Libération, 7.06.95
[5] [213] Le Monde, 14.0G.95
[6] [214] La discussion qui a eu lieu à ce propos entre le président français Chirac, lors de son voyage pour le sommet du G7 en juin, et le speaker de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Newl Gingrich, fut qualifié de x directe ,u et K musclée ». Le gouvernement russe, n'en a accepté le principe qu'après avoir ouvertement marqué son opposition et sa méfiance.
[7] [215] Libération, 12.06.95
[8] [216] Libération, 31.05.95
[9] [217] Le Monde, 14.06.9 5
[10] [218] Le gouvernement de Belgrade avait obtenu un allégement de l'embargo économique international à son égard en échange de l'engagement de ne plus fournir des amies au gouvernement de Pale. Mais les salaires des officiers serbes de Bosnie sont, et ont toujours été payés par Belgrade. Celle-ci n'a jamais cessé de fournir en secret des armes aux x frères de Bosnie s et, par exemple, le système de défense radar anti-aérien des deux e Républiques » est toujours resté lié.
[11] [219] Résolution sur la situation internationale, l le congrès du CCI (publiée dans ce numéro).
Géographique:
- Europe [220]
Questions théoriques:
- Guerre [18]
- Impérialisme [19]
11e Congrès du CCI : Le combat pour la défense et la construction de l'organisation
- 3092 lectures
Le CCI vient de tenir son 11e Congrès international. Dans la mesure où les organisations communistes sont une partie du prolétariat, un produit historique de celui-ci de même que partie prenante et facteur actif de son combat pour son émancipation, leur Congrès, qui représente leur instance suprême, est un fait de première importance pour la classe ouvrière. C'est pour cette raison qu'il appartient aux communistes de rendre compte de ce moment essentiel de la vie de leur organisation.
Pendant plusieurs jours, les délégations venues de 12 pays ([1] [221]) représentant plus d'un milliard et demi d'habitants et surtout les plus grandes concentrations prolétariennes du monde (Europe occidentale et Amérique du nord) ont débattu, tiré des enseignements, tracé des orientations sur les questions essentielles auxquelles est confrontée notre organisation. L'ordre du jour de ce congrès comprenait essentiellement deux points : les activités et le fonctionnement de notre organisation, la situation internationale. ([2] [222]) Cependant, c'est de très loin le premier point qui a occupé le plus grand nombre de séances et suscité les débats les plus passionnés. Il en a été ainsi parce que le CCI a été confronté à des difficultés organisationnelles de premier plan qui nécessitaient une mobilisation toute particulière de toutes les sections et de tous les militants.
Les problèmes organisationnels dans l'histoire du mouvement ouvrier...
L'expérience historique des organisations révolutionnaires du prolétariat démontre que les questions touchant à leur fonctionnement sont des questions politiques à part entière méritant la plus grande attention, la plus grande profondeur.
Les exemples de cette importance de la question organisationnelle sont nombreux dans le mouvement ouvrier mais on peut plus particulièrement évoquer celui de l'AIT (Association Internationale des Travailleurs, appelée également plus tard 1re Internationale) et celui du 2e congrès du Parti Ouvrier Social Démocrate Russe (POSDR) tenu en 1903.
L'AIT avait été fondée en septembre 1864 à Londres à l'initiative d'un certain nombre d'ouvriers anglais et français. Elle s'était donnée d'emblée une structure de centralisation, le Conseil central qui, après le congrès de Genève en 1866, s'appellera Conseil général. Au sein de cet organe, Marx va jouer un rôle de premier plan puisque c'est à lui qu'il est revenu de rédiger un grand nombre de ses textes fondamentaux comme l'Adresse inaugurale de l'AIT, ses statuts ainsi que l'Adresse sur la Commune de Paris (La guerre civile en France) de mai 1871. Rapidement, l'AIT (« L'Internationale », comme l'appelaient alors les ouvriers) est devenue une « puissance » dans les pays avancés (en premier lieu ceux d'Europe occidentale). Jusqu'à la Commune de Paris de 1871, elle a regroupé un nombre croissant d'ouvriers et a constitué un facteur de premier plan de développement des deux armes essentielles du prolétariat, son organisation et sa conscience. C'est à ce titre, d'ailleurs, qu'elle fera l'objet d'attaques de plus en plus acharnées de la part de la bourgeoisie : calomnies dans la presse, infiltration de mouchards, persécutions contre ses membres, etc. Mais ce qui a fait courir le plus grand danger à l'AIT, ce sont des attaques qui sont venues de certains de ses propres membres et qui ont porté contre le mode d'organisation de l'Internationale elle-même.
Déjà, au moment de la fondation de l'AIT, les statuts provisoires qu'elle s'est donnée sont traduits par les sections parisiennes, fortement influencées par les conceptions fédéralistes de Proudhon, dans un sens qui atténue considérablement le caractère centralisé de l'Internationale. Mais les attaques les plus dangereuses viendront plus tard avec l'entrée dans les rangs de l'AIT de l'« Alliance de la démocratie socialiste », fondée par Bakounine et qui allait trouver un terrain fertile dans des secteurs importants de l'Internationale, du fait des faiblesses qui pesaient encore sur elle et qui résultaient de l'immaturité du prolétariat à cette époque, un prolétariat qui ne s'était pas encore dégagé des vestiges de l'étape précédente de son développement.
« La première phase dans la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie est marquée par le mouvement sectaire. Il a sa raison d'être à une époque où le prolétariat n'est pas encore assez développé pour agir comme classe. Des penseurs individuels font la critique des antagonismes sociaux, et en donnent des solutions fantastiques que la masse des ouvriers n'a qu'à accepter, à propager, et à mettre en pratique. Par leur nature même, les sectes formées par ces initiateurs sont abstentionnistes, étrangères à toute action réelle, à la politique, aux grèves, aux coalitions, en un mot à tout mouvement d'ensemble. La masse du prolétariat reste toujours indifférente ou même hostile à leur propagande... Ces sectes, leviers du mouvement à leurs origines, lui font obstacle dès qu'il les dépasse ; alors elles deviennent réactionnaires... Enfin, c'est là l'enfance du mouvement prolétaire, comme l'astrologie et l'alchimie sont l'enfance de la science. Pour que la fondation de l'Internationale fut possible, il fallait que le prolétariat eût dépassé cette phase.
En face des organisations fantaisistes et antagonistes des sectes, l'Internationale est l'organisation réelle et militante de la classe des prolétaires dans tous les pays, liés les uns avec les autres, dans leur lutte commune contre les capitalistes, les propriétaires fonciers et leur pouvoir de classe organisé dans l'Etat. Aussi les statuts de l'Internationale ne connaissent-ils que de simples sociétés "ouvrières" poursuivant toutes le même but et acceptant toutes le même programme qui se limite à tracer les grands traits du mouvement prolétaire et en laisse l'élaboration théorique à l'impulsion donnée par les nécessités de la lutte pratique, et à l'échange des idées qui se fait, dans les sections, admettant indistinctement toutes les convictions socialistes dans leurs organes et leurs congrès.
De même que, dans toute nouvelle phase historique, les vieilles erreurs reparaissent un instant pour disparaître bientôt après ; de même, l'Internationale a vu renaître dans son sein des sections sectaires... » (Les prétendues scissions dans l'Internationale, chapitre IV, circulaire du Conseil général du 5 mars 1872)
Cette faiblesse était particulièrement accentuée dans les secteurs les plus arriérés du prolétariat européen, là où il venait à peine de sortir de l'artisanat et de la paysannerie, notamment dans les pays latins. Ce sont ces faiblesses que Bakounine, qui n'est entré dans l'Internationale qu'en 1868, après l'échec de la « Ligue de la Paix et de la Liberté » (dont il était un des principaux animateurs et qui regroupait des républicains bourgeois), a mises à profit pour essayer de la soumettre à ses conceptions « anarchistes » et pour en prendre le contrôle. L'instrument de cette opération était l'« Alliance de la démocratie socialiste », qu'il avait fondée comme minorité de la « Ligue de la Paix et de la Liberté ». C'était une société à la fois publique et secrète et qui se proposait en réalité de former une internationale dans l'Internationale. Sa structure secrète et la concertation qu'elle permettait entre ses membres devait lui assurer le « noyautage » d'un maximum de sections de l'AIT, celles où les conceptions anarchistes avaient le plus d'écho. En soi, l'existence dans l'AIT de plusieurs courants de pensée n'était pas un problème. ([3] [223]) En revanche, les agissements de l'Alliance, qui visait à se substituer à la structure officielle de l'Internationale, ont constitué un grave facteur de désorganisation de celle-ci et lui ont fait courir un danger de mort. L'Alliance avait tenté de prendre le contrôle de l'Internationale lors du Congrès de Bâle, en septembre 1869. C'est en vue de cet objectif que ses membres, notamment Bakounine et James Guillaume, avaient appuyé chaleureusement une résolution adminitrative renforçant les pouvoirs du Conseil général. Mais ayant échoué, l'Alliance, qui pour sa part s'était donnée des statuts secrets basés sur une centralisation extrême, ([4] [224]) a commencé à faire campagne contre la « dictature » du Conseil général qu'elle voulait réduire au rôle « d'un bureau de correspondance et de statistiques » (suivant les termes des alliancistes), d'une « boîte aux lettres » (comme leur répondait Marx). Contre le principe de centralisation exprimant l'unité internationale du prolétariat, l'Alliance préconisait le « fédéralisme », la complète « autonomie des sections » et le caractère non obligatoire des décisions des congrès. En fait, elle voulait pouvoir faire ce qu'elle voulait dans les sections dont elle avait pris le contrôle. C'était la porte ouverte à la désorganisation complète de l'AIT.
C'est à ce danger que devait parer le Congrès de la Haye de 1872 qui a débattu de la question de l'Alliance sur base du rapport d'une commission d'enquête et a finalement décidé l'exclusion de Bakounine ainsi que de James Guillaume, principal responsable de la fédération jurassienne de l'AIT qui se trouvait complètement sous le contrôle de l'Alliance. Ce congrès fut à la fois le point d'orgue de l'AIT (c'est d'ailleurs le seul congrès où Marx se soit rendu, ce qui situe l'importance qu'il lui attribuait) et son chant du cygne du fait de l'écrasement de la Commune de Paris et de la démoralisation qu'il avait provoquée dans le prolétariat. De cette réalité, Marx et Engels étaient conscients. C'est pour cela que, en plus des mesures visant à soustraire l'AIT de la main mise de l'Alliance, ils ont proposé que le Conseil général soit installé à New-York, loin des conflits qui divisaient de plus en plus l'Internationale. C'était aussi un moyen de permettre à l'AIT de mourir de sa belle mort (entérinée par la conférence de Philadelphie de juillet 1876) sans que son prestige ne soit récupéré par les intrigants bakouninistes.
Ces derniers, et les anarchistes ont par la suite perpétué cette légende, prétendaient que Marx et le Conseil général ont obtenu l'exclusion de Bakounine et Guillaume à cause des différences dans la façon d'envisager la question de l'Etat ([5] [225]) (quand ils n'ont pas expliqué le conflit entre Marx et Bakounine par des questions de personnalité). En somme, Marx aurait voulu régler par des mesures administratives un désaccord portant sur des questions théoriques générales. Rien n'est plus faux.
Ainsi, au Congrès de la Haye, aucune mesure n'a été requise contre les membres de la délégation espagnole qui partageaient la vision de Bakounine, qui avaient appartenu à l'Alliance, mais qui ont assuré ne plus en faire partie. De même, l'AIT « anti-autoritaire » qui s'est formée après le congrès de la Haye avec les fédérations qui ont refusé ses décisions, n'était pas constituée des seuls anarchistes puisqu'on y a retrouvé, à côté de ces derniers, des lassaliens allemands grands défenseurs du « socialisme d'Etat » suivant les propres termes de Marx. En réalité, la véritable lutte au sein de l'AIT était entre ceux qui préconisaient l'unité du mouvement ouvrier (et par conséquent le caractère obligatoire des décisions des congrès) et ceux qui revendiquaient le droit de faire ce que bon leur semblait, chacun dans son coin, condidérant les congrès comme de simples assemblées où l'on devait se contenter « d'échanger des points de vue » mais sans prendre de décisions. Avec ce mode d'organisation informel, il revenait à l'Alliance d'assurer, de façon secrète, la véritable centralisation entre toutes les fédérations, comme il était d'ailleurs explicitement dit dans nombre de correspondances de Bakounine. La mise en oeuvre des conceptions « anti-autoritaires » dans l'AIT constituait le meilleur moyen de la livrer aux intrigues, au pouvoir occulte et incontrôlé de l'Alliance, c'est-à-dire des aventuriers qui la dirigeaient.
Le 2e congrès du POSDR allait être l'occasion d'un affrontement similaire entre les tenants d'une conception prolétarienne de l'organisation révolutionnaire et les tenants d'une conception petite bourgeoise.
Il existe des ressemblances entre la situation du mouvement ouvrier en Europe occidentale du temps de l'AIT et celle du mouvement en Russie au début du siècle. Dans les deux cas nous nous trouvons à une étape d'enfance de celui-ci, le décalage dans le temps s'expliquant par le retard du développement industriel de la Russie. L'AIT avait eu comme vocation de rassembler au sein d'une organisation unie les différentes sociétés ouvrières que le développement du prolétariat faisait surgir. De même, le 2e congrès du POSDR avait comme objectif de réaliser une unification des différents comités, groupes et cercles se réclamant de la Social-Démocratie qui s'étaient développés en Russie et en exil. Entre ces différentes formations, il n'existait pratiquement aucun lien formel après la disparition du comité central qui était sorti du 1er congrès du POSDR en 1897. Dans le 2e congrès, comme dans l'AIT, on a vu donc s'affronter une conception de l'organisation représentant le passé du mouvement, celle des « mencheviks » (minoritaires) et une conception exprimant ses nouvelles exigences, celle des « bolcheviks » (majoritaires) :
- « Sous le nom de "minorité" se sont groupés dans le Parti, des éléments hétérogènes qu'unit le désir conscient ou non, de maintenir les rapports de cercle, les formes d'organisation antérieures au Parti. Certains militants éminents des anciens cercles les plus influents, n'ayant pas l'habitude des restrictions en matière d'organisation, que l'on doit s'imposer en raison de la discipline du Parti, sont enclins à confondre machinalement les intérêts généraux du Parti et leurs intérêts de cercle qui, effectivement, dans la période des cercles, pouvaient coïncider. » (Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière)
D'une façon qui s'est confirmée par la suite (déjà lors de la révolution de 1905 et encore plus, bien entendu, au moment de la révolution de 1917, où les mencheviks se sont placés du côté de la bourgeoisie), la démarche des mencheviks était déterminée par la pénétration, dans la Social-Démocratie russe, de l'influence des idéologies bourgeoises et petites-bourgeoises. En particulier, comme le note Lénine : « Le gros de l'opposition [les mencheviks] a été formé par les éléments intellectuels de notre Parti » qui ont donc constitué un des véhicules des conceptions petites bourgeoises en matière d'organisation. De ce fait, ces éléments « ... lèvent naturellement l'étendard de la révolte contre les restrictions indispensables qu'exige l'organisation, et ils érigent leur anarchisme spontané en principe de lutte, qualifiant à tort cet anarchisme... de revendication en faveur de la "tolérance", etc. » (Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière). Et, de fait, il existe beaucoup de similitudes entre le comportement des mencheviks et celui des anarchistes dans l'AIT (à plusieurs reprises, Lénine parle de « l'anarchisme de grand seigneur » des mencheviks).
C'est ainsi que, comme les anarchistes après le congrès de La Haye, les mencheviks se refusent à reconnaître et à appliquer les décisions du 2e congrès en affirmant que « le congrès n'est pas une divinité » et que « ses décisions ne sont pas sacro-saintes ». En particulier, de la même façon que les bakouninistes entrent en guerre contre le principe de centralisation et la « dictature du conseil général » après qu'ils aient échoué à en prendre le contrôle, une des raisons pour lesquelles les mencheviks, après le congrès, commencent à rejeter la centralisation réside dans le fait que certains d'entre eux ont été écartés des organes centraux qui ont été nommés à celui-ci. On retrouve des ressemblances même dans la façon dont les mencheviks mènent campagne contre la « dictature personnelle » de Lénine, sa « poigne de fer » qui fait écho aux accusations de Bakounine contre la « dictature » de Marx sur le Conseil général.
« Lorsque je considère la conduite des amis de Martov après le congrès, (...) je puis dire seulement que c'est là une tentative insensée, indigne de membres du Parti, de déchirer le Parti... Et pourquoi ? Uniquement parce qu'on est mécontent de la composition des organismes centraux, car objectivement, c'est uniquement cette question qui nous a séparés, les appréciations subjectives (comme offense, insulte, expulsion, mise à l'écart, flétrissure, etc.) n'étant que le fruit d'un amour-propre blessé et d'une imagination malade. Cette imagination malade et cet amour-propre blessé mènent tout droit aux commérages les plus honteux : sans avoir pris connaissance de l'activité des nouveaux centres, ni les avoir encore vus à l'oeuvre, on va répandant des bruits sur leur "carence", sur le "gant de fer" d'Ivan Ivanovitch, sur la "poigne" d'Ivan Nikiforovitch, etc. (...) Il reste à la social-démocratie russe une dernière et difficile étape à franchir, de l'esprit de cercle à l'esprit de parti ; de la mentalité petite-bourgeoise à la conscience de son devoir révolutionnaire ; des commérages et de la pression des cercles, considérés comme moyens d'action, à la discipline. » (« Relation du 2e Congrès du POSDR », Oeuvres, Tome 7)
Avec l'exemple de l'AIT et celui du 2e congrès du POSDR, ont peut voir toute l'importance des questions liées au mode d'organisation des formations révolutionnaires. En effet, c'est autour de ces questions qu'allait se produire en premier lieu une décantation décisive entre, d'un côté, le courant prolétarien et, de l'autre, les courants petits-bourgeois ou bourgeois. Cette importance n'est pas fortuite. Elle découle du fait qu'un des canaux privilégiés par lesquels s'infiltrent au sein de ces formations les idéologies des classes étrangères au prolétariat, bourgeoisie et petite bourgeoisie, est justement celui de leur mode de fonctionnement.
L'histoire du mouvement ouvrier est riche d'autres exemples de ce type. Si nous n'avons évoqué ici que ces deux-là, c'est évidemment pour une question de place mais aussi parce qu'il existe des similitudes importantes, comme nous le verrons plus loin, entre les circonstances historiques de la constitution de l'AIT, du POSDR et du CCI lui-même.
... et dans l'histoire du CCI
Le CCI a déjà été conduit à plusieurs reprises à se pencher avec attention sur ce type de question. Ce fut le cas, par exemple, lors de sa conférence de fondation, en janvier 1975, où il avait examiné la question de la centralisation internationale (voir le « Rapport sur la question de l'organisation de notre courant », Revue internationale n° 1). Un an après, au moment de son premier congrès, notre organisation est revenue là-dessus avec l'adoption de statuts (voir l'article « Les statuts des organisations révolutionnaires du prolétariat », Revue internationale n° 5). Enfin, le CCI, en janvier 1982, a consacré une conférence internationale extraordinaire à cette question suite à la crise qu'il avait traversée en 1981. ([6] [226]) Face à la classe ouvrière et au milieu politique prolétarien, le CCI ne s'était pas caché des difficultés qu'il avait rencontrées au début des années 1980. C'est ainsi qu'en parlait la résolution adoptée par le 5e Congrès et citée par la Revue internationale n° 35 :
- « Depuis son 4e Congrès (1981), le CCI a connu la crise la plus grave de son existence. Une crise qui, au delà des péripéties particulières de "l'affaire Chénier" ([7] [227]), a secoué profondément l'organisation, lui a fait frôler l'éclatement, a provoqué directement ou indirectement le départ d'une quarantaine de ses membres, a réduit de moitié les effectifs de sa deuxième section territoriale. Une crise qui s'est traduite par tout un aveuglement, une désorientation comme le CCI n'en avait pas connue depuis sa création. Une crise qui a nécessité, pour être dépassée, la mobilisation de moyens exceptionnels : la tenue d'une Conférence Internationale extraordinaire, la discussion et l'adoption de textes d'orientation de base sur la fonction et le fonctionnement de l'organisation révolutionnaire, l'adoption de nouveaux statuts. »
Une telle attitude de transparence à l'égard des difficultés que rencontrait notre organisation ne correspondait nullement à un quelconque « exhibitionnisme » de notre part. L'expérience des organisations communistes est partie intégrante de l'expérience de la classe ouvrière. C'est pour cela qu'un grand révolutionnaire comme Lénine a pu consacrer tout un livre, Un pas en avant, deux pas en arrière, à tirer les leçons politiques du 2e Congrès du POSDR. C'est pour cela également que nous portons ici à la connaissance de nos lecteurs de larges extraits de la résolution adoptée à l'issue de notre 11e Congrès. En rendant compte de sa vie organisationnelle, le CCI ne fait donc pas autre chose qu'assumer sa responsabilité face à la classe ouvrière.
Evidemment, la mise en évidence par les organisations révolutionnaires de leurs problèmes et discussions internes constituent un plat de choix pour toutes les tentatives de dénigrement dont celles-ci font l'objet de la part de leurs adversaires. C'est le cas aussi et particulièrement pour le CCI. Certes, ce n'est pas dans la presse bourgeoise que l'on trouve des manifestations de jubilation lorsque nous faisons état des difficultés que notre organisation peut rencontrer aujourd'hui, celle-ci est encore trop modeste en taille et en influence parmi les masses ouvrières pour que les officines de propagande bourgeoise aient intérêt a parler d'elle pour essayer de la discréditer. Il est préférable pour la bourgeoisie de faire un mur de silence autour des positions et de l'existence des organisations révolutionnaires. C'est pour cela que le travail de dénigrement de celles-ci et de sabotage de leur intervention est pris en charge par toute une série de groupes et d'éléments parasitaires dont la fonction est d'éloigner des positions de classe les éléments qui s'approchent de celles-ci, de les dégoûter de toute participation au travail difficile de développement d'un milieu politique prolétarien.
L'ensemble des groupes communistes a été confronté aux méfaits du parasitisme, mais il revient au CCI, parce que c'est aujourd'hui l'organisation la plus importante du milieu prolétarien, de faire l'objet d'une attention toute particulière de la part de la mouvance parasitaire. Dans celle-ci on trouve des groupes constitués tels le « Groupe Communiste Internationaliste » (GCI) et ses scissions (comme « Contre le Courant »), le défunt « Communist Bulletin Group » (CBG) ou l'ex-« Fraction Externe du CCI » qui ont tous été constitués de scissions du CCI. Mais le parasitisme ne se limite pas à de tels groupes. Il est véhiculé par des éléments inorganisés, ou qui se retrouvent de temps à autre dans des cercles de discussion éphémères, dont la préoccupation principale consiste à faire circuler toutes sortes de commérages à propos de notre organisation. Ces éléments sont souvent d'anciens militants qui, cédant à la pression de l'idéologie petite-bourgeoise, n'ont pas eu la force de maintenir leur engagement dans l'organisation, qui ont été frustrés que celle-ci n'ait pas « reconnu leurs mérites » à la hauteur de l'idée qu'ils s'en faisaient eux-mêmes ou qui n'ont pas supporté les critiques dont ils ont été l'objet. Il s'agit également d'anciens sympathisants que l'organisation n'a pas voulu intégrer parce qu'elle jugeait qu'ils n'avaient pas la clarté suffisante ou qui ont renoncé à s'engager par crainte de perdre leur « individualité » dans un cadre collectif (c'est le cas, par exemple du défunt « collectif Alptraum » au Mexique ou de « Kamunist Kranti » en Inde). Dans tous les cas, il s'agit d'éléments dont la frustration résultant de leur propre manque de courage, de leur veulerie et de leur impuissance s'est convertie en une hostilité systématique envers l'organisation. Ces éléments sont évidemment absolument incapables de construire quoi que ce soit. En revanche, ils sont souvent très efficaces, avec leur petite agitation et leurs bavardages de concierges pour discréditer et détruire ce que l'organisation tente de construire.
Cependant, ce ne sont pas les grenouillages du parasitisme qui vont empêcher le CCI de faire connaître à l'ensemble du milieu prolétarien les enseignements de sa propre expérience. En 1904, Lénine écrivait, dans la préface de Un pas en avant, deux pas en arrière :
- « Ils [nos adversaires] exultent et grimacent à la vue de nos discussions ; évidemment, ils s'efforceront, pour les faire servir à leurs fins, de brandir tels passages de ma brochure consacrés aux défauts et aux lacunes de notre Parti. Les social-démocrates russes sont déjà suffisamment rompus aux batailles pour ne pas se laisser troubler par ces coups d'épingle, pour poursuivre, en dépit de tout, leur travail d'autocritique et continuer à dévoiler sans ménagement leurs propres lacunes qui seront comblées nécessairement et sans faute par la croissance du mouvement ouvrier. Que messieurs nos adversaires essaient donc de nous offrir, de la situation véritable de leurs propres "partis", une image qui ressemblerait même de loin à celle que présentent les procès-verbaux de notre deuxième congrès ! » (Oeuvres, Tome 7, page 216)
C'est exactement avec le même état d'esprit que nous portons ici à la connaissance de nos lecteurs de larges extraits de la résolution adoptée à l'issue de notre 11e Congrès. Ce n'est pas une manifestation de faiblesse du CCI mais, au contraire, un témoignage de sa force.
Les problèmes affrontés par le CCI dans la dernière période
« Le 11e congrès du CCI l'affirme donc clairement : le CCI se trouvait dans une situation de crise latente, une crise bien plus profonde que celle qui a frappé l'organisation au début des années 80, une crise qui, si la racine des faiblesses n'avait pas été identifiée, risquait d'emporter l'organisation. » (Résolution d'activités, point 1)
« Les causes de la gravité du mal qui risquait d'engloutir l'organisation sont multiples, mais on peut en mettre en évidence les principales :
- le fait que la conférence extraordinaire de janvier 82, destinée à remonter la pente après la crise de 1981, ne soit pas allée jusqu'au bout de l'analyse des faiblesses qui affectaient le CCI ;
- plus encore, le fait que le CCI n'ait pas pleinement intégré les acquis de cette conférence elle-même (...) ;
- le renforcement de la pression destructrice que la décomposition du capitalisme fait peser sur la classe et sur ses organisations communistes.
En ce sens, la seule façon dont le CCI pouvait affronter efficacement le danger mortel qui le menaçait consistait :
- dans l'identification de l'importance de ce danger (...) ;
- dans une mobilisation de l'ensemble du CCI, des militants, des sections et des organes centraux autour de la priorité de la défense de l'organisation ;
- dans la réappropriation des acquis de la conférence de 1982 ;
- dans un approfondissement de ces acquis, sur la base du cadre qu'ils avaient donné. » (Ibid, point 2)
Le combat pour le redressement du CCI a débuté à l'automne 1993 par la mise en discussion dans toute l'organisation d'un texte d'orientation qui rappelait et actualisait les enseignements de 1982 tout en se penchant sur l'origine historique de nos faiblesses. Au centre de notre démarche se trouvaient donc les préoccupations suivantes : la réappropriation des acquis de notre propre organisation et de l'ensemble du mouvement ouvrier, la continuité avec les combats de celui-ci et particulièrement de sa lutte contre la pénétration en son sein des idéologies étrangères, bourgeoises et petites-bourgeoises.
- « Le cadre de compréhension que s'est donné le CCI pour mettre à nu l'origine de ses faiblesses s'inscrivait dans le combat historique mené par le marxisme contre les influences de l'idéologie petite-bourgeoise pesant sur les organisations du prolétariat. Plus précisément, il se référait au combat du Conseil général de l'AIT contre l'action de Bakounine et de ses fidèles, ainsi que de celui de Lénine et des bolcheviks contre les conceptions opportunistes et anarchisantes des mencheviks lors du 2e congrès du POSDR et à la suite de celui-ci. En particulier, il importait pour l'organisation d'inscrire au centre de ses préoccupations, comme l'ont fait les bolcheviks à partir de 1903, la lutte contre l'esprit de cercle et pour l'esprit de parti. Cette priorité du combat était donnée par la nature des faiblesses qui pesaient sur le CCI du fait de son origine dans les cercles apparus dans la foulée de la reprise historique du prolétariat à la fin des années 1960 ; des cercles fortement marqués par le poids des conceptions affinitaires, contestataires, individualistes, en un mot des conceptions anarchisantes, particulièrement marquées par les révoltes étudiantes qui ont accompagné et pollué la reprise prolétarienne. C'est en ce sens que le constat du poids particulièrement fort de l'esprit de cercle dans nos origines était partie prenante de l'analyse générale élaborée depuis longtemps et qui situait la base de nos faiblesses dans la rupture organique des organisations communistes du fait de la contre-révolution qui s'était abattue sur la classe ouvrière à partir de la fin des années 1920. Cependant, ce constat nous permettait d'aller plus loin que les constats précédents et de nous attaquer plus en profondeur à la racine de nos difficultés. Il nous permettait en particulier de comprendre le phénomène, déjà constaté dans le passé mais insuffisamment élucidé, de la formation de clans au sein de l'organisation : ces clans étaient en réalité le résultat du pourrissement de l'esprit de cercle qui se maintenait bien au-delà de la période où les cercles avaient constitué une étape incontournable de la reformation de l'avant-garde communiste. Ce faisant, les clans devenaient, à leur tour, un facteur actif et le meilleur garant du maintien massif de l'esprit de cercle dans l'organisation. » (Ibid, point 4)
Ici, la résolution fait référence à un point du texte d'orientation de l'automne 1993 qui met en évidence la question suivante :
- « En effet, un des graves dangers qui menacent en permanence l'organisation, qui remettent en cause son unité et risquent de la détruire, est la constitution, même si elle n'est pas délibérée ou consciente, de "clans". Dans une dynamique de clan, les démarches communes ne partent pas d'un réel accord politique mais de liens d'amitié, de fidélité, de la convergence d'intérêts "personnels" spécifiques ou de frustrations partagées. Souvent, une telle dynamique, dans la mesure où elle ne se fonde pas sur une réelle convergence politique, s'accompagne de l'existence de "gourous", de "chefs de bande", garants de l'unité du clan, et qui peuvent tirer leur pouvoir soit d'un charisme particulier, pouvant même étouffer les capacités politiques et de jugement d'autres militants, soit du fait qu'ils sont présentés, ou qu'ils se présentent, comme des "victimes" de telle ou telle politique de l'organisation. Lorsqu'une telle dynamique apparaît, les membres ou sympathisants du clan ne se déterminent plus, dans leur comportement ou les décisions qu'ils prennent, en fonction d'un choix conscient et raisonné basé sur les intérêts généraux de l'organisation, mais en fonction du point de vue et des intérêts du clan qui tendent à se poser comme contradictoires avec ceux du reste de l'organisation. »
Cette analyse se basait sur des précédents historiques dans le mouvement ouvrier (par exemple, l'attitude des anciens rédacteurs de l'Iskra, regroupés autour de Martov et qui, mécontents des décisions du 2e congrès du POSDR, avaient formé la fraction des mencheviks) mais aussi sur des précédents dans l'histoire du CCI. Nous ne pouvons entrer en détail dans celle-ci mais nous pouvons affirmer que les « tendances » qu'a connues le CCI (celle qui allait scissionner en 1978 pour former le « Groupe Communiste Internationaliste », la « tendance Chénier » en 1981, la « tendance » qui a quitté le CCI lors de son 6e Congrès pour former la « Fraction Externe du CCI ») correspondaient bien plus à des dynamiques de clan qu'à de réelles tendances basées sur une orientation positive alternative. En effet, le moteur principal de ces « tendances » n'était pas constitué par les divergences que leurs membres pouvaient avoir avec les orientations de l'organisation (ces divergences étaient on ne peut plus hétéroclites, comme l'a démontré la trajectoire ultérieure des « tendances ») mais par un rassemblement des mécontentements et des frustrations contre les organes centraux et par les fidélités personnelles envers des éléments qui se considéraient comme « persécutés » ou insuffisamment reconnus.
Le redressement du CCI
Si l'existence de clans dans l'organisation n'avait plus le même caractère spectaculaire que par le passé, il n'en continuait pas moins à miner sourdement mais dramatiquement le tissu organisationnel. En particulier, l'ensemble du CCI (y compris les militants directement impliqués) a mis en évidence qu'il était confronté à un clan occupant une place de premier plan dans l'organisation et qui, même s'il n'était pas un simple « produit organique des faiblesses du CCI », avait « concentré et cristallisé un grand nombre des caractéristiques délétères qui affectaient l'organisation et dont le dénominateur commun était l'anarchisme (vision de l'organisation comme somme d'individus, approche psychologisante et affinitaire des rapports politiques entre militants et des questions de fonctionnement, mépris ou hostilité envers les conceptions politiques marxistes en matière d'organisation) » (Résolution d'activités, point 5)
C'est pour cela que :
- « La compréhension par le CCI du phénomène des clans et de leur rôle particulièrement destructeur lui a permis en particulier de mettre le doigt sur un grand nombre des dysfonctionnements qui affectaient la plupart des sections territoriales (...). Elle lui a permis également de comprendre les origines de la perte, signalée par le rapport d'activités du 10e congrès, de "l'esprit de regroupement" qui caractérisait les premières années du CCI... » (Ibid, point 5)
Finalement, après plusieurs jours de débats très animés, avec une profonde implication de toutes les délégations et une très grande unité entre elles, le 11e Congrès du CCI a pu parvenir aux conclusions suivantes :
- « ... le congrès constate le succès global du combat engagé par le CCI à l'automne 1993 (...) le redressement, quelquefois spectaculaire, des sections parmi les plus touchées par les difficultés organisationnelles en 1993 (...), les approfondissements provenant de nombreuses parties du CCI (...), tous ces faits confirment la pleine validité du combat engagé, de sa méthode, de ses bases théoriques aussi bien que de ses aspects concrets (...) Le Congrès souligne en particulier les approfondissements réalisés par l'organisation dans la compréhension de toute une série de questions auxquelles se sont confrontées et se confrontent les organisations de la classe : avancées dans la connaissance du combat de Marx et du Conseil général contre l'Alliance, du combat de Lénine et des bolcheviks contre les mencheviks, du phénomène de l'aventurisme politique dans le mouvement ouvrier (représentés notamment par les figures de Bakounine et de Lassalle), porté par des éléments déclassés, ne travaillant pas à priori pour les services de l'Etat capitaliste, mais finalement plus dangereux que les agents infiltrés de celui-ci. » (Ibid, point 10)
« Sur base de ces éléments, le 11e Congrès constate donc que le CCI est aujourd'hui bien plus fort qu'il n'était au précédent congrès, qu'il est incomparablement mieux armé pour affronter ses responsabilités face aux futurs surgissements de la classe, même si, évidemment, il est encore en convalescence » (Ibid, point 11)
Ce constat de l'issue positive du combat mené par l'organisation depuis l'automne 1993 n'a cependant créé aucun sentiment d'euphorie dans le Congrès. Le CCI a appris à se méfier des emballements qui sont bien plus tributaires de la pénétration dans les rangs communistes de l'impatience petite-bourgeoise que d'une démarche prolétarienne. Le combat mené par les organisations et les militants communistes est un combat à long terme, patient, souvent obscur, et le véritable enthousiasme qui habite les militants ne se mesure pas à des envolées euphoriques mais à la capacité de tenir, contre vents et marées, à résister face à la pression délétère que l'idéologie de la classe ennemie fait peser sur leurs têtes. C'est pour cela que le constat du succès qui a couronné le combat de notre organisation au cours de la dernière période ne nous a conduits à nul triomphalisme :
- « Cela ne signifie pas que le combat que nous avons mené soit appelé à cesser. (...) Le CCI devra le poursuivre à travers une vigilance de chaque instant, la détermination d'identifier chaque faiblesse et de l'affronter sans attendre. (...) En réalité, l'histoire du mouvement ouvrier, y compris celle du CCI, nous enseigne, et le débat nous l'a amplement confirmé, que le combat pour la défense de l'organisation est permanent, sans répit. En particulier, le CCI doit garder en tête que le combat mené par les bolcheviks pour l'esprit de parti contre l'esprit de cercle s'est poursuivi durant de longues années. Il en sera de même pour notre organisation qui devra veiller à débusquer et éliminer toute démoralisation, tout sentiment d'impuissance résultant de la longueur du combat. » (Ibid, point 13)
Avant de conclure cette partie sur les questions d'organisation qui ont été discutées lors du congrès, il importe de préciser que les débats menés par le CCI durant un an et demi n'ont donné lieu à aucune scission (contrairement à ce qui s'était passé, par exemple, lors du 6e congrès, ou en 1981). Il en est ainsi parce que, d'emblée, l'organisation s'est retrouvée en accord avec le cadre théorique qui avait été donné pour la compréhension des difficultés qu'elle rencontrait. L'absence de divergences sur ce cadre a permis que ne se cristallise pas une quelconque « tendance » ou même une quelconque « minorité » théorisant ses particularités. Pour une grande part, les discussions ont porté sur comment il convenait de concrétiser ce cadre dans le fonctionnement quotidien du CCI tout en conservant le souci permanent de rattacher ces concrétisations à l'expérience historique du mouvement ouvrier. Le fait qu'il n'y ait pas eu de scission est un témoignage de la force du CCI, de sa plus grande maturité, de la volonté manifestée par la très grande majorité de ses militants de mener résolument le combat pour sa défense, pour assainir son tissu organisationnel, pour dépasser l'esprit de cercle et toutes les conceptions anarchisantes considérant l'organisation comme une somme d'individus ou de petits groupes affinitaires.
Les perspectives de la situation internationale
L'organisation communiste, évidemment, n'existe pas pour elle-même. Elle n'est pas spectateur mais acteur des luttes de la classe ouvrière et sa défense intransigeante vise justement à lui permettre de tenir son rôle. C'est avec cet objectif que le Congrès a consacré une partie de ses débats à l'examen de la situation internationale. Il a discuté et adopté plusieurs rapports sur cette question ainsi qu'une résolution qui en fait la synthèse et qui est publiée dans ce même numéro de la Revue Internationale. C'est pour cela que nous ne nous étendrons pas sur cet aspect des travaux du congrès. Nous nous contenterons d'évoquer ici, et de façon brève, uniquement le dernier des trois aspects de la situation internationale (évolution de la crise économique, conflits impérialistes et rapports de force entre les classes) qui ont été discutés au congrès.
Cette résolution l'affirme clairement :
- « Plus que jamais, la lutte du prolétariat représente le seul espoir d'avenir pour la société humaine. » (point 14)
Cependant, le Congrès a confirmé ce que le CCI avait annoncé dès l'automne 1989 :
- « Cette lutte, qui avait ressurgi avec puissance à la fin des années 1960, mettant un terme à la plus terrible contre-révolution qu'aie connue la classe ouvrière, a subi un recul considérable avec l'effondrement des régimes staliniens, les campagnes idéologiques qui l'ont accompagné et l'ensemble des événements (guerre du Golfe, guerre en Yougoslavie, etc.) qui l'ont suivi. » (Ibid)
Et c'est principalement pour cette raison qu'aujourd'hui :
- « C'est de façon sinueuse, avec des avancées et des reculs, dans un mouvement en dents de scie que se développent les luttes ouvrières. » (Ibid)
Cependant, la bourgeoisie sait très bien que l'aggravation de ses attaques contre la classe ouvrière ne pourra qu'impulser de nouveaux combats de plus en plus conscients. Elle s'y prépare en développant toute une série de manœuvres syndicales de même qu'en confiant à certains de ses agents le soin de renouer avec des discours encensant la « révolution », le « communisme » ou le « marxisme ». C'est pour cela que :
- « Il appartient aux révolutionnaires, dans leur intervention, de dénoncer avec la plus grande vigueur aussi bien les manoeuvres crapuleuses des syndicats que ces discours prétendument "révolutionnaires". Il leur revient de mettre en avant la véritable perspective de la révolution prolétarienne et du communisme comme seule issue pouvant sauver l'humanité et comme résultat ultime des combats ouvriers. » (point 17)
Après avoir reconstitué et rassemblé ses forces, le CCI est à nouveau prêt, à la suite de son 11e Congrès, pour assumer cette responsabilité.
[2] [229]. Il était également prévu un point sur l'examen du milieu politique prolétarien qui constitue une préoccupation permanente de notre organisation. Faute de temps, il a dû être supprimé mais cela ne signifie nullement que nous relâchions notre attention sur cette question. Bien au contraire : c'est en ayant surmonté nos propres difficultés organisationnelles que nous pourrons apporter notre meilleure contribution au développement de l'ensemble du milieu prolétarien.
[3] [230]. « Les sections de la classe ouvrière dans les divers pays se trouvant placées dans des conditions diverses de développement, il s'ensuit nécessairement que leurs opinions théoriques, qui reflètent le mouvement réel, sont aussi divergentes. Cependant, la communauté d'action établie par l'Association internationale des travailleurs, l'échange des idées facilité par la publicité faite par les organes des différentes sections nationales, enfin les discussions directes aux congrès généraux, ne manqueront pas d'engendrer graduellement un programme théorique commun. » (Réponse du Conseil général à la demande d'adhésion de l'Alliance, 9 mars 1869). Il faut noter que l'Alliance avait déposé une première demande d'adhésion avec des statuts où il était prévu qu'elle se dotait d'une structure internationale parallèle à celle de l'AIT (avec un comité central et la tenue d'un congrès dans un local séparé lors des congrès de l'AIT). Le Conseil général avait refusé cette demande en faisant valoir que les statuts de l'Alliance étaient contraires à ceux de l'AIT. Il avait précisé qu'il était prêt à admettre les différentes sections de l'Alliance si celle-ci renonçait à sa structure internationale. L'Alliance avait accepté cette condition mais elle s'était maintenue conformément à ses statuts secrets.
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
11e congrès du CCI : Résolution sur la situation internationale
- 2545 lectures
1) La reconnaissance par les communistes du caractère historiquement limité du mode de production capitaliste, de la crise irréversible dans laquelle ce système est plongé aujourd'hui, constitue la base de granit sur laquelle se fonde la perspective révolutionnaire du combat du prolétariat. En ce sens, toutes les tentatives, comme celles que l'on voit à l'heure actuelle, de la part de la bourgeoisie et de ses agents pour accréditer que l'économie mondiale « sort de la crise » ou que certaines économies nationales « émergentes » pourront prendre le relais des vieux secteurs économiques essoufflés, constituent une attaque en règle contre la conscience prolétarienne.
2) Les discours officiels sur la « reprise » font grand cas de l'évolution des indices de la production industrielle ou du redressement des profits des entreprises. Si effectivement, en particulier dans les pays anglo-saxons, on a assisté récemment à de tels phénomènes, il importe de mettre en évidence les bases sur lesquelles ils se fondent :
- le retour des profits découle bien souvent, notamment pour beaucoup de grandes entreprises, des bénéfices spéculatifs ; il a comme contrepartie une nouvelle flambée des déficits publics ; il résulte enfin de l'élimination par les entreprises des « branches mortes », c'est-à-dire de leurs secteurs les moins productifs ;
- le progrès de la production industrielle résulte pour une bonne partie d'une augmentation très importante de la productivité du travail basée sur une utilisation massive de l'automatisation et de l'informatique.
C'est pour ces raisons qu'une des caractéristiques majeures de la « reprise » actuelle, c'est qu'elle n'a pas été capable de créer des emplois, de faire reculer le chômage de façon significative de même que le travail précaire qui, au contraire, n'a fait que s'étendre, car le capital veille en permanence à garder les mains libres pour pouvoir jeter à la rue, à tout instant, la force du travail excédentaire.
3) S'il constitue avant tout une attaque contre la classe ouvrière, un facteur brutal de développement de la misère et de l'exclusion, le chômage constitue aussi un indice de premier plan de la faillite du capitalisme. Le capital vit de l'exploitation du travail vivant : au même titre que la mise au rebut de pans entiers de l'appareil industriel, et plus encore, la mise sur la touche d'une proportion considérable de la force de travail constitue une réelle automutilation de la part du capital. Il rend compte de la faillite définitive du mode de production capitaliste dont la fonction historique était justement d'étendre le salariat à l'échelle mondiale. Cette faillite définitive du capitalisme, elle s'illustre également dans l'endettement dramatique des Etats qui a connu, au cours des dernières années, une nouvelle flambée : entre 1989 et 1994, la dette publique est passée de 53% à 65% du produit intérieur brut aux Etats-Unis, de 57% à 73% en Europe jusqu'à atteindre 142% dans le cas de la Belgique. En fait, les Etats capitalistes sont en cessation de paiement. S'ils étaient soumis aux mêmes lois que les entreprises privées, ils seraient déjà déclarés officiellement en faillite. Cette situation ne fait qu'exprimer le fait que le capitalisme d'Etat constitue la réponse que le système oppose à son impasse, mais une réponse qui n'est en aucune façon une solution et qui ne peut servir éternellement.
4) Les taux de croissance, quelques fois à deux chiffres, des fameuses « économies émergentes » ne viennent nullement contredire le constat de faillite générale de l'économie mondiale. Ils résultent d'une arrivée massive de capitaux attirés par le coût incroyablement bas de la force de travail dans ces pays, d'une exploitation féroce des prolétaires, de ce que la bourgeoisie pudiquement appelle les « délocalisations ». Cela signifie que ce développement économique ne peut qu'affecter la production des pays les plus avancés, dont les Etats, de façon croissante, se dressent contre les « pratiques commerciales déloyales » de ces pays « émergents ». En outre, les performances spectaculaires qu'on se plaît à y relever recouvrent bien souvent un délabrement de secteurs entiers de l'économie de ces pays : le « miracle économique » de la Chine signifie plus de 250 millions de chômeurs en l'an 2000. Enfin, le récent effondrement financier d'un autre pays « exemplaire », le Mexique, dont la monnaie a perdu la moitié de sa valeur du jour au lendemain, qui a nécessité l'injection d'urgence de près de 50 milliards de $ de crédits (de très loin la plus grande opération de « sauvetage » de l'histoire du capitalisme) résume la réalité du mirage que constitue « l'émergence » de certains pays du tiers-monde. Les économies « émergentes » ne sont pas la nouvelle espérance de l'économie mondiale. Elles ne sont que des manifestations, aussi fragiles qu'aberrantes, d'un système en folie. Et cette réalité ne sera pas contredite par la situation des pays d'Europe de l'Est, dont l'économie était sensée, il y a peu encore, s'épanouir au soleil du libéralisme. Si quelques pays (comme la Pologne) réussissent pour le moment à sauver les meubles, le chaos qui déferle sur l'économie de la Russie (chute de près de 30% de la production sur 2 ans, plus de 2000% de hausse des prix sur cette même période) vient illustrer de façon saisissante à quel point les discours qu'on avait entendus en 1989 étaient mensongers. L'état de l'économie russe est tellement catastrophique, que la Mafia qui en contrôle une bonne partie des rouages, fait figure, non pas de parasite comme c'est le cas dans certains pays occidentaux, mais comme un des piliers lui assurant un minimum de stabilité.
5) Enfin, l'état de faillite potentielle dans lequel se trouve le capitalisme, le fait qu'il ne peut vivre éternellement en tirant des traites sur l'avenir, en essayant de contourner la saturation générale et définitive des marchés par une fuite en avant dans l'endettement, fait peser des menaces de plus en plus fortes sur l'ensemble du système financier mondial. L'émoi provoqué par la faillite de la banque britannique Barings suite aux acrobaties d'un « golden boy », l'affolement qui a suivi l'annonce de la crise du peso mexicain, sans commune mesure avec le poids de l'économie du Mexique dans l'économie mondiale, sont des indices indiscutable de la véritable angoisse qui étreint la classe dominante devant la perspective d'une « véritable catastrophe mondiale » de ses finances, suivant les mots du directeur du FMI. Mais cette catastrophe financière n'est pas autre chose que le révélateur de la catastrophe dans laquelle est plongé le mode de production capitaliste lui-même et qui précipite le monde entier dans les convulsions les plus considérables de son histoire.
6) Le terrain sur lequel se manifestent le plus cruellement ces convulsions est celui des affrontements impérialistes. Cinq ans à peine se sont écoulés depuis l'effondrement du bloc de l'Est, depuis les promesses d'un « nouvel ordre mondial » tenues par les dirigeants des principaux pays d'Occident, et jamais le désordre des relations entre Etats n'a été aussi flagrant. S'il était basé sur la menace d'un affrontement terrifiant entre superpuissances nucléaires, si ces deux superpuissances n'avaient de cesse de s'affronter par pays interposés, « l'ordre de Yalta » contenait un certain élément « d'ordre », justement. En l'absence de possibilité d'une nouvelle guerre mondiale du fait du non embrigadement du prolétariat des pays centraux, les deux gendarmes du monde veillaient à maintenir dans un cadre « acceptable » les affrontements impérialistes. Il leur fallait notamment éviter qu'ils ne viennent semer le chaos et les destructions dans les pays avancés et particulièrement sur le terrain principal des deux guerres mondiales, l'Europe. Cet édifice a volé en éclats. Avec les affrontements sanglants dans l'ex-Yougoslavie, l'Europe a cessé d'être un « sanctuaire ». En même temps, ces affrontements ont mis en évidence combien était désormais difficile que se mette en place un nouvel « équilibre », un nouveau « partage du monde » succédant à celui de Yalta.
7) Si l'effondrement du bloc de l'Est était pour une bonne part imprévisible, la disparition de son rival de l'Ouest ne l'était nullement. Il fallait ne rien comprendre au marxisme (et admettre la thèse kautskyste, balayée par les révolutionnaires dès la première guerre mondiale, d'un « super-impérialisme ») pour penser qu'il pourrait se maintenir un seul bloc. Fondamentalement, toutes les bourgeoisies sont rivales les unes des autres. Cela se voit clairement dans le domaine commercial où domine « la guerre de tous contre tous ». Les alliances diplomatiques et militaires ne sont que la concrétisation du fait qu'aucune bourgeoisie ne peut faire prévaloir ses intérêts stratégiques seule dans son coin contre toutes les autres. L'adversaire commun est le seul ciment de telles alliances, et non une quelconque « amitié entre les peuples » dont on peut voir aujourd'hui à quel point elles sont élastiques et mensongères alors que les ennemis d'hier (comme la Russie et les Etats-Unis) se sont découvert une soudaine « amitié » et que les amitiés de plusieurs décennies (comme celle entre l'Allemagne et les Etats-Unis) font place à la brouille. En ce sens, si les événements de 1989 signifiaient la fin du partage du monde issu de la seconde guerre mondiale, la Russie cessant définitivement de pouvoir diriger un bloc impérialiste, ils portaient avec eux la tendance à la reconstitution de nouvelles constellations impérialistes. Cependant, si sa puissance économique et sa localisation géographique désignaient l'Allemagne comme seul pays pouvant succéder à la Russie dans le rôle de leader d'un éventuel futur bloc opposé aux Etats-Unis, sa situation militaire est très loin de lui permettre dès à présent de réaliser une telle ambition. Et en l'absence d'une formule de rechange des alignements impérialistes pouvant succéder à ceux qui ont été balayés par les bouleversements de 1989, l'arène mondiale est soumise comme jamais par le passé, du fait de la gravité sans précédent de la crise économique qui attise les tensions militaires, au déchaînement du « chacun pour soi », d'un chaos que vient aggraver encore la décomposition générale du mode de production capitaliste.
8) Ainsi la situation résultant de la fin des deux blocs de la « guerre froide » est dominée par deux tendances contradictoires - d'un côté, le désordre, l'instabilité dans les alliances entre Etats et de l'autre le processus de reconstitution de deux nouveaux blocs - mais qui sont néanmoins complémentaires puisque la deuxième ne vient qu'aggraver la première. L'histoire de ces dernières années l'illustre de façon claire :
- la crise et la guerre du Golfe de 90-91, voulues par les Etats-Unis, participent de la tentative du gendarme américain de maintenir sa tutelle sur ses anciens alliés de la guerre froide, tutelle que ces derniers sont conduits à remettre en cause avec la fin de la menace soviétique ;
- la guerre en Yougoslavie est le résultat direct de l'affirmation des nouvelles ambitions de l'Allemagne principal instigateur de la sécession slovène et croate qui met le feu aux poudres dans la région ;
- la poursuite de cette guerre sème la discorde aussi bien dans le couple franco-allemand, associé dans le leadership de l'Union européenne (qui constitue une première pierre de l'édifice d'un potentiel nouveau bloc impérialiste), que dans le couple anglo-américain, le plus ancien et le plus fidèle que le 20e siècle ait connu.
9) Plus encore que les coups de bec entre le coq français et l'aigle allemand, l'ampleur des infidélités actuelles dans le mariage vieux de 80 ans entre la Blanche Albion et l'oncle Sam constitue un indice irréfutable de l'état de chaos dans lequel se trouve aujourd'hui le système des relations internationales. Si, après 1989, la bourgeoisie britannique s'était montrée dans un premier temps la plus fidèle alliée de sa consoeur américaine, notamment au moment de la guerre du Golfe, le peu d'avantages qu'elle avait retiré de cette fidélité de même que la défense de ses intérêts spécifiques en Méditerranée et dans les Balkans, qui lui dictait une politique pro-Serbe, l'ont conduite à prendre des distances considérables avec son alliée et à saboter systématiquement la politique américaine de soutien à la Bosnie. Avec cette politique, la bourgeoisie britannique a réussi à mettre en oeuvre une solide alliance tactique avec la bourgeoisie française avec comme objectif de renforcer la discorde dans le tandem franco-allemand, démarche à laquelle cette dernière s'est complaisamment prêtée dans la mesure où la montée en puissance de son alliée allemande lui crée des inquiétudes. Cette situation nouvelle s'est notamment concrétisée par une intensification de la collaboration militaire entre les bourgeoisies britannique et française, par exemple avec le projet de création d'une unité aérienne commune et surtout avec l'accord créant une force inter-africaine « de maintien de la paix et de prévention des crises en Afrique » qui constitue un revirement spectaculaire de l'attitude britannique après son soutien à la politique américaine au Rwanda visant à chasser l'influence française dans ce pays.
10) Cette évolution de l'attitude de la Grande-Bretagne envers son grand allié, dont le mécontentement s'est exprimé notamment le 17 mars à travers l'accueil par Clinton de Jerry Addams, le chef du Sinn Fein irlandais, est un des événements majeurs de la dernière période sur l'arène mondiale. Il est révélateur de l'échec que représente pour les Etats-Unis l'évolution de la situation dans l'ex-Yougoslavie où l'occupation directe du terrain par les armées britanniques et françaises sous l'uniforme de la FORPRONU a contribué grandement à déjouer les tentatives américaines de prendre position solidement dans la région via son allié bosniaque. Il est significatif du fait que la première puissance mondiale éprouve de plus en plus de difficultés à jouer son rôle de gendarme du monde, rôle que supportent de moins en moins les autres bourgeoisies qui tentent d'exorciser le passé où la menace soviétique les obligeait à se soumettre aux diktats venus de Washington. Il existe aujourd'hui un affaiblissement majeur, voire une crise du leadership américain qui se confirme un peu partout dans le monde et dont le départ piteux des GI's de Somalie, 2 ans après leur arrivée spectaculaire et médiatique, donne une image. Cet affaiblissement du leadership des Etats-Unis permet d'expliquer pourquoi certaines autres puissances se permettent de venir les narguer dans leur pré-carré d'Amérique latine :
- tentative des bourgeoisies française et espagnole de promouvoir une « transition démocratique » à Cuba AVEC Castro, et non SANS lui, comme le voudrait l'Oncle Sam ;
- rapprochement de la bourgeoisie péruvienne avec le Japon, confirmée avec la réélection récente de Fujimori ;
- soutien de la bourgeoisie européenne, notamment par le biais de l'Eglise, à la guérilla zapatiste du Chiapas, au Mexique.
11) En réalité, cet affaiblissement majeur du leadership américain exprime le fait que la tendance dominante, à l'heure actuelle, n'est pas tant celle à la constitution d'un nouveau bloc, mais bien le « chacun pour soi ». Pour la première puissance mondiale, dotée d'une supériorité militaire écrasante, il est beaucoup plus difficile de maîtriser une situation marquée par l'instabilité généralisée, la précarité des alliances dans tous les coins de la planète, que par la discipline obligée des Etats sous la menace des mastodontes impérialistes et de l'apocalypse nucléaire. Dans une telle situation d'instabilité, il est plus facile pour chaque puissance de créer des troubles chez ses adversaires, de saboter les alliances qui lui portent ombrage, que de développer pour sa part des alliances solides et s'assurer une stabilité sur ses terres. Une telle situation favorise évidemment le jeu des puissances de second plan dans la mesure même où il est toujours plus facile de semer le trouble que de maintenir l'ordre. Et une telle réalité est encore accentuée par la plongée de la société capitaliste dans la décomposition généralisée. C'est pour cela que les Etats-Unis eux-mêmes sont appelés à user abondamment de ce type de politique. C'est comme cela qu'on peut expliquer, par exemple, le soutien américain à la récente offensive turque contre les nationalistes kurdes dans le Nord de l'Irak, offensive que l'allié traditionnel de la Turquie, l'Allemagne a considérée comme une provocation et a condamnée. Il ne s'agit pas d'une sorte de « renversement d'alliance » entre la Turquie et l'Allemagne, mais d'une pierre (de grosse taille) jetée par les Etats-Unis dans le jardin de cette « alliance » et qui révèle l'importance de l'enjeu que représente pour les deux caïds impérialistes un pays comme la Turquie. De même, il est significatif de la situation mondiale actuelle que les Etats-Unis soient amenés à employer, dans un pays comme l'Algérie par exemple, les mêmes armes qu'un Khaddafi ou un Khomeiny : le soutien du terrorisme et de l'intégrisme islamique. Cela dit, dans cette pratique réciproque de déstabilisation des positions respectives entre les Etats-Unis et les autres pays, il n'y a pas un trait d'égalité : si la diplomatie américaine peut se permettre d'intervenir dans le jeu politique intérieur de pays comme l'Italie (soutien à Berlusconi), l'Espagne (scandale du GAL attisé par Washington), la Belgique (affaire Augusta) ou la Grande-Bretagne (opposition des « euro-sceptiques » à Major), le contraire ne saurait exister. En ce sens, le trouble qui peut se manifester au sein de la bourgeoisie américaine face à ses échecs diplomatiques ou aux débats internes sur des choix stratégiques délicats (par exemple vis-à-vis de l'alliance avec la Russie) n'a rien à voir avec les convulsions politiques pouvant affecter les autres pays. C'est ainsi, par exemple, que les dissensions étalées lors de l'envoi de 30 000 GI's à Haïti relevaient non de réelles divisions mais essentiellement d'un partage des tâches entre cliques bourgeoises accentuant les illusions démocratiques et qui a facilité l'arrivée d'une majorité républicaine au Congrès américain souhaitée par les secteurs dominants de la bourgeoisie.
12) Malgré leur énorme supériorité militaire et le fait que celle-ci ne puisse pas leur servir au même degré que par le passé, malgré qu'ils soient obligés de réduire quelque peu leurs dépenses de défense face à leurs déficits budgétaires, les Etats-Unis n'en renoncent pas moins à poursuivre la modernisation de leurs armements en faisant appel à des armes toujours plus sophistiquées, notamment en poursuivant le projet de « la guerre des étoiles ». L'emploi de la force brute, ou sa menace, constitue le moyen essentiel pour la puissance américaine de faire respecter son autorité (même si elle ne se prive pas d'employer les moyens de la guerre économique : pressions sur les institutions internationales comme l'OMC, sanctions commerciales, etc.). Que cette carte s'avère impuissante, voire facteur d'un chaos plus grand encore, comme on l'a vu dès le lendemain de la guerre du Golfe et comme la Somalie l'a illustré encore récemment, ne fait que confirmer le caractère insurmontable des contradictions qui assaillent le monde capitaliste. Le renforcement considérable auquel on assiste aujourd'hui du potentiel militaire de puissances comme la Chine et le Japon, qui viennent concurrencer les Etats-Unis dans l'Asie du sud-est et dans le Pacifique, ne peut évidemment que pousser ce dernier pays vers le développement et l'emploi de ses armements.
13) Le chaos sanglant dans les rapports impérialistes qui caractérise la situation du monde d'aujourd'hui, trouve dans les pays de la périphérie son terrain de prédilection, mais l'exemple de l'ex-Yougoslavie à quelques centaines de kilomètres des grandes concentrations industrielles d'Europe fait la preuve que ce chaos se rapproche des pays centraux. Aux dizaines de milliers de morts provoqués par les troubles en Algérie ces dernières années, au million de cadavres des massacres du Rwanda font pièce les centaines de milliers de tuées en Croatie et en Bosnie. En fait, c'est aujourd'hui par dizaines que se comptent les zones d'affrontements sanglants de par le monde en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe, témoignant de l'indicible chaos que le capitalisme en décomposition engendre dans la société. En ce sens, la complicité a peu près générale qui entoure les massacres perpétrés en Tchétchénie par l'armée russe, qui tente de freiner l'éclatement de la Russie faisant suite à la dislocation de l'ancienne URSS, sont révélateurs de l'inquiétude qui saisit la classe dominante devant la perspective de l'intensification de ce chaos. Il faut l'affirmer clairement : seul le renversement du capitalisme par le prolétariat peut empêcher que ce chaos croissant n'aboutisse à la destruction de l'humanité.
14) Plus que jamais, la lutte du prolétariat représente le seul espoir d'avenir pour la société humaine. Cette lutte, qui avait resurgi avec puissance à la fin des années 60, mettant un terme à la plus terrible contre-révolution qu'ai connue la classe ouvrière, a subi un recul considérable avec l'effondrement des régimes staliniens, les campagnes idéologiques qui l'ont accompagné et l'ensemble des événements (guerre du Golfe, guerre en Yougoslavie, etc.) qui l'ont suivi. C'est sur les deux plans de sa combativité et de sa conscience que la classe ouvrière a subi, de façon massive, ce recul, sans que cela remette en cause toutefois, comme le CCI l'avait déjà affirmé à ce moment-là, le cours historique vers les affrontements de classe. Les luttes menées au cours des dernières années par le prolétariat sont venues confirmer ce qui précède. Elles ont témoigné, particulièrement depuis 1992, de la capacité du prolétariat à reprendre le chemin du combat de classe, confirmant ainsi que le cours historique n'avait pas été renversé. Elles ont témoigné aussi des énormes difficultés qu'il rencontre sur ce chemin, du fait de la profondeur et de l'extension de son recul. C'est de façon sinueuse, avec des avancées et des reculs, dans un mouvement en dents de scie que se développent les luttes ouvrières.
15) Les mouvements massifs en Italie, à l'automne 1992, ceux en Allemagne de 1993 et beaucoup d'autres exemples ont rendu compte du potentiel de combativité qui croissait dans les rangs ouvriers. Depuis, cette combativité s'est exprimée lentement, avec de longs moments de mise en sommeil, mais elle ne s'est pas démentie. Les mobilisations massives à l'automne 94 en Italie, la série de grèves dans le secteur public en France au printemps 95, sont des manifestations, parmi d'autres, de cette combativité. Cependant, il importe de mettre en évidence que le tendance vers le débordement des syndicats qui s'était exprimée en 92 en Italie ne s'est pas confirmée, bien au contraire, en 1994 où la manifestation « monstre » de Rome était un chef d'oeuvre de contrôle syndical. De même, la tendance à l'unification spontanée, dans la rue, qui était apparue (bien que de façon embryonnaire) à l'automne 93 dans la Ruhr en Allemagne a, depuis, laissé la place à des manoeuvres syndicales de grande envergure, telle la « grève » de la métallurgie du début 95, parfaitement maîtrisées par la bourgeoisie. De même, les récentes grèves en France, en fait des journées d'action des syndicats, ont constitué un succès pour ces derniers.
16) Outre de la profondeur du recul subi en 1989, les difficultés qu'éprouve aujourd'hui la classe ouvrière pour avancer sur son terrain sont le résultat de toute une série d'obstacles supplémentaires promus ou exploités par la classe ennemie. C'est dans le cadre du poids négatif qu'exerce la décomposition générale du capitalisme sur les consciences ouvrières, sapant la confiance du prolétariat en lui-même et dans la perspective de sa lutte, qu'il importe de placer ces difficultés. Plus concrètement, le chômage massif et permanent qui se développe aujourd'hui, s'il est un signe indiscutable de la faillite du capitalisme, a pour effet majeur de provoquer une forte démoralisation, un fort désespoir dans des secteurs importants de la classe ouvrière dont certains sont plongés dans l'exclusion sociale et même la lumpenisation. Ce chômage a également pour effet de servir d'instrument de chantage et de répression de la bourgeoisie envers les secteurs ouvriers qui ont encore du travail. De même, les discours sur la « reprise », et les quelques résultats positifs (en termes de profits et de taux de croissance) que connaît l'économie des principaux pays, sont amplement mis à profit pour développer les discours des syndicats sur le thème : « les patrons peuvent payer ». Ces discours sont particulièrement dangereux en ce sens qu'ils amplifient les illusions réformistes des ouvriers, les rendant beaucoup plus vulnérables à l'encadrement syndical, qu'ils contiennent l'idée qui si les patrons « ne peuvent pas payer », il ne sert à rien de lutter ce qui est un facteur supplémentaire de division (outre la division entre chômeurs et ouvriers au travail) entre les différents secteurs de la classe ouvrière travaillant dans des branches affectées de façon inégale par les effets de la crise.
17) Ces obstacles ont favorisé la reprise en main par les syndicats de la combativité ouvrière, la canalisant dans des « actions » qu'ils contrôlent entièrement. Cependant, les manoeuvres présentes des syndicats ont aussi, et surtout, un but préventif : il s'agit pour eux de renforcer leur emprise sur les ouvriers avant que ne se déploie beaucoup plus leur combativité, combativité qui résultera nécessairement de leur colère croissante face aux attaques de plus en plus brutales de la crise. De même, il faut souligner le changement récent dans un certain nombre de discours de la classe dominante. Alors que les premières années après l'effondrement du bloc de l'Est ont été dominées par les campagnes sur le thème de « la mort du communisme », « l'impossibilité de la révolution », on assiste aujourd'hui à un certain retour à la mode de discours favorables au « marxisme », à la « révolution », au « communisme » de la part des gauchistes, évidemment, mais même au-delà d'eux. Il s'agit là aussi d'une mesure préventive de la part de la bourgeoisie destinée à dévoyer la réflexion de la classe ouvrière qui tendra à se développer face à la faillite de plus en plus évidente du mode de production capitaliste. Il appartient aux révolutionnaires, dans leur intervention, de dénoncer avec la plus grande vigueur aussi bien les manoeuvres crapuleuses des syndicats que ces discours prétendument « révolutionnaires ». Il leur revient de mettre en avant la véritable perspective de la révolution prolétarienne et du communisme comme seule issue pouvant sauver l'humanité et comme résultat ultime des combats ouvriersVie du CCI:
- Résolutions de Congrès [237]
Conscience et organisation:
REVOLUTION ALLEMANDE (II) : les débuts de la révolution
- 3400 lectures
Dans le dernier article de la Revue Internationale, nous avons démontré que la riposte de la classe ouvrière se fit de plus en plus forte au fur et à mesure du développement de la 1re guerre mondiale. Début 1917 - après deux ans et demi de barbarie -, la classe ouvrière parvenait à développer au niveau international un rapport de forces permettant de soumettre de plus en plus la bourgeoisie à sa pression. En février 1917, les ouvriers de Russie se soulevaient et renversaient le tsar. Mais pour mettre un terme à la guerre ils durent déposer le gouvernement bourgeois et prendre le pouvoir en octobre 1917. La Russie avait démontré que l'établissement de la paix était impossible sans le renversement de la classe dominante. La prise de pouvoir victorieuse devait connaître un puissant retentissement dans la classe ouvrière des autres pays. Pour la première fois dans l'histoire, la classe ouvrière était parvenue à s'emparer du pouvoir dans un pays. Cela devait être un fanal pour les ouvriers des autres pays, en particulier d'Autriche, de Hongrie, de toute l'Europe Centrale, mais principalement d'Allemagne.
Ainsi, dans ce pays, après la vague de patriotisme chauvin initiale, la classe ouvrière lutte de façon croissante contre la guerre. Aiguillonnée par le développement révolutionnaire en Russie et faisant suite à plusieurs mouvements avant-coureurs, une grève de masse éclate en avril 1917. En janvier 1918 environ un million d'ouvriers se jettent dans un nouveau mouvement de grève et fondent un conseil ouvrier à Berlin. Sous l'influence des événements de Russie la combativité sur les fronts militaires s'effrite de plus en plus au cours de l'été 1918. Les usines bouillonnent ; de plus en plus d'ouvriers s'assemblent dans les rues afin d'intensifier la riposte à la guerre. La classe dominante d'Allemagne, consciente du rayonnement de la révolution russe parmi les ouvriers, s'évertue - dans le but de sauver sa propre peau - à élever un rempart contre l'extension de la révolution.
Tirant la leçon des événements révolutionnaires en Russie et confrontée à un exceptionnel mouvement de luttes ouvrières, l'armée contraint fin septembre le Kaiser à l'abdication et investit un nouveau gouvernement. Mais la combativité de la classe ouvrière reste sur sa lancée et l'agitation continue sans trêve.
Le 28 octobre débute en Autriche, dans les provinces tchèques et slovaques comme à Budapest, une vague de grèves qui conduit au renversement de la monarchie. Partout apparaissent des conseils ouvriers et de soldats, à l'image des soviets russes.
En Allemagne, la classe dominante, mais aussi les révolutionnaires, se préparent désormais à la phase déterminante des affrontements. Les révolutionnaires préparent le soulèvement. Bien que la plupart des dirigeants spartakistes (Liebknecht, Luxemburg, Jogiches) se trouvent en prison et bien que, durant quelque temps, l'imprimerie illégale du parti se trouve paralysée par un coup de filet de la police, les révolutionnaires n'en continuent pas moins de préparer l'insurrection autour du groupe Spartakus.
Début octobre les Spartakistes tiennent une conférence avec les Linksradikale de Brême et d'autres villes. Au cours de cette conférence on signale le début des affrontements révolutionnaires ouverts et un appel est adopté et largement diffusé à travers tout le pays ainsi que sur le front. Ses principales idées sont : les soldats ont commencé à se libérer de leur joug, l'armée s'effondre ; mais ce premier élan de la révolution trouve la contre-révolution à son poste. Les moyens de répression de la classe dominante faisant défaillance, la contre-révolution cherche à endiguer le mouvement en accordant les pseudo-droits « démocratiques ». Le parlementarisme et le nouveau mode de scrutin ont pour but d'amener le prolétariat à continuer à supporter sa situation.
« Au cours de la discussion sur la situation internationale fut exprimé le fait que la révolution russe a apporté au mouvement en Allemagne un soutien moral essentiel. Les délégués décident de transmettre aux camarades de Russie l'expression de leur gratitude, de leur solidarité et de leur sympathie fraternelle et promettent de confirmer cette solidarité non par des paroles, mais par des actions correspondant au modèle russe.
Il s'agit pour nous de soutenir par tous les moyens les mutineries des soldats, de passer à l'insurrection armée, d'élargir l'insurrection armée à la lutte pour tout le pouvoir au profit des ouvriers et des soldats et d'assurer la victoire grâce aux grèves de masses des ouvriers. Voilà la tâche des tout prochains jours et semaines à venir. »
Dés le début de ces affrontements révolutionnaires, nous pouvons affirmer que les Spartakistes percent aussitôt à jour les manoeuvres politiques de la classe dominante. Ils mettent à nu le caractère mensonger de la démocratie et reconnaissent sans hésitation les pas indispensables à l'avancée du mouvement : préparer l'insurrection c'est soutenir la classe ouvrière en Russie non seulement en paroles mais aussi en actes. Ils comprennent que la solidarité de la classe ouvrière dans cette nouvelle situation ne peut se limiter à des déclarations mais nécessite que les ouvriers eux-mêmes entrent en lutte. Cette leçon constitue depuis lors un fil rouge dans l'histoire du mouvement ouvrier et de ses luttes.
La bourgeoisie elle aussi fourbit ses armes. Le 3 octobre 1918, elle dépose le Kaiser pour le remplacer par un nouveau prince, Max von Baden et fait entrer le SPD au gouvernement.
La direction du SPD (parti fondé au siècle précédent par la classe ouvrière elle-même) avait trahi en 1914 et avait exclu les internationalistes regroupés autour des Spartakistes et des Linksradikale ainsi que les Centristes. Le SPD ne recèle depuis lors plus aucune vie prolétarienne en son sein. Il soutient depuis le début de la guerre la politique impérialiste. Il va également agir contre le soulèvement révolutionnaire de la classe ouvrière.
Pour la première fois, la bourgeoisie appelle au gouvernement un parti issu de la classe ouvrière et récemment passé dans le camp du Capital afin d'assurer, dans cette situation révolutionnaire, la protection de l'Etat capitaliste. Alors que de nombreux ouvriers entretiennent encore des illusions, les révolutionnaires comprennent immédiatement le rôle nouvellement échu à la social-démocratie. Rosa Luxemburg écrit en octobre 1918 : « Le socialisme de gouvernement, par son entrée au ministère, se pose en défenseur du capitalisme et barre le chemin à la révolution prolétarienne montante. »
A partir de janvier 1918, lorsque le premier conseil ouvrier apparaît au cours des grèves de masse à Berlin, les « Délégués » révolutionnaires (Revolutionnäre Obleute) et les Spartakistes se rencontrent secrètement régulièrement. Les « Délégués » révolutionnaires sont très proches de l'USPD. Sur cette toile de fond d'accroissement de la combativité, de désagrégation du front, de poussée des ouvriers pour passer à l'action, ils commencent fin octobre, au sein d'un comité d'action formé après la conférence mentionnée ci-dessus, à discuter des plans concrets en vue d'une insurrection.
Le 23 octobre Liebknecht est libéré de prison. Plus de 20 000 ouvriers viennent le saluer à son arrivée à Berlin.
Après l'expulsion de Berlin des membres de l'ambassade russe par le gouvernement allemand sous l'insistance du SPD, après les rassemblements de soutien à la révolution russe organisés par les révolutionnaires, le comité d'action discute de la situation. Liebknecht insiste sur la nécessité de la grève générale et sur les manifestations de masse qui doivent s'armer dans la foulée. Lors de la réunion des « Délégués » du 2 novembre, il propose même la date du 5 avec les mots d'ordre de : « Paix immédiate et levée de l'état de siège, Allemagne république socialiste, formation d'un gouvernement des conseils ouvriers et de soldats. » (Drabkin, p. 104)
Les « Délégués » révolutionnaires qui pensent que la situation n'est pas mûre plaident pour une attente supplémentaire. Pendant ce temps les membres de l'USPD, dans les différentes villes, attendent de nouvelles instructions car personne ne veut entrer en action avant Berlin. La nouvelle d'un soulèvement imminent se répand cependant dans d'autres villes du Reich.
Tout cela va être accéléré par les événements de Kiel.
Alors que le 3 novembre la flotte de Kiel doit prendre la mer pour continuer la guerre, les marins se révoltent et se mutinent. Des conseils de soldats sont aussitôt créés, suivis dans le même élan par la formation de conseils ouvriers. Le commandement de l'armée menace de bombarder la ville. Mais, après avoir compris qu'il ne materait pas la mutinerie par la violence, il fait appel à son cheval de Troie : le dirigeant du SPD Noske. Celui-ci parvient après son arrivée sur les lieux à s'introduire frauduleusement dans le conseil ouvrier.
Mais ce mouvement des conseils ouvriers et de soldats a déjà lancé un signal à l'ensemble du prolétariat. Les conseils forment des délégations massives d'ouvriers et de soldats qui se rendent dans d'autres villes. D'énormes délégations sont envoyées à Hambourg, Brême, Flensburg, dans la Ruhr et même jusqu'à Cologne. Celles-ci s'adressent aux ouvriers réunis en assemblées et appellent à la formation de conseils ouvriers et de soldats. Des milliers d'ouvriers se déplacent ainsi des villes du nord de l'Allemagne jusqu'à Berlin et dans d'autres villes en province. Nombre d'entre eux sont arrêtés par les soldats restés loyaux au gouvernement (plus de 1300 arrestations rien qu'à Berlin le 6 novembre) et enfermés dans les casernes - dans lesquelles ils poursuivent cependant leur agitation.
En une semaine des conseils ouvriers et de soldats surgissent dans les principales villes d'Allemagne et les ouvriers prennent eux-mêmes l'extension de leur mouvement en main. Ils n'abandonnent pas leur sort aux syndicats ou au parlement. Ils ne combattent plus par branches, isolés les uns des autres, avec des revendications de secteur spécifiques ; au contraire, dans chaque ville, ils s'unissent et formulent des revendications communes. Ils agissent par eux-mêmes et recherchent l'union des ouvriers des autres villes ! ([1] [238])
Moins de deux ans après leurs frères de Russie, les ouvriers allemands donnent un exemple clair de leur capacité à diriger eux-mêmes leur lutte. Jusqu'au 8 novembre, dans presque toutes les villes - à l'exception de Berlin - des conseils d'ouvriers et de soldats sont mis sur pieds.
Le 8 novembre des « hommes de confiance » du SPD rapportent : « Il est impossible d'arrêter le mouvement révolutionnaire ; si le SPD voulait s'opposer au mouvement, il serait tout simplement renversé par le flot. »
Lorsque les premières nouvelles de Kiel arrivent à Berlin le 4 novembre, Liebknecht propose au Comité exécutif l'insurrection pour le 8 novembre. Alors que le mouvement s'étend spontanément dans tout le pays, il apparaît évident que le soulèvement à Berlin (siège du gouvernement) exige de la part de la classe ouvrière une démarche organisée, clairement orientée vers un objectif : celui de rassembler l'ensemble de ses forces. Mais le Comité exécutif continue à hésiter. Ce n'est qu'après l'arrestation de deux de ses membres en possession du projet d'insurrection qu'on se décide à passer à l'action le lendemain. Les Spartakistes publient le 8 novembre 1918 l'appel suivant :
« Maintenant que l'heure d'agir est arrivée, il ne doit plus y avoir d'hésitation. Les mêmes "socialistes" qui ont accompli quatre années durant leur rôle de souteneur au service du gouvernement (...) mettent aujourd'hui tout en oeuvre afin d'affaiblir Votre lutte et miner le mouvement.
Ouvriers et soldats ! Ce que Vos camarades ont réussi à accomplir à Kiel, Hambourg, Brême, Lübeck, Rostock, Flensburg, Hanovre, Magdebourg, Brunswick, Munich et Stuttgart, Vous devez aussi réussir à l'accomplir. Car de ce que Vous remporterez de haute lutte, de la ténacité et du succès de Votre lutte, dépend la victoire de Vos frères là-bas et dépend la victoire du prolétariat du monde entier. Soldats ! Agissez comme Vos camarades de la flotte, unissez-vous à Vos frères en tenue de travail. Ne Vous laissez pas utiliser contre Vos frères, n'obéissez pas aux ordres des officiers, ne tirez pas sur les combattants de la Liberté. Ouvriers et soldats ! Les objectifs prochains de Votre lutte doivent être :
1) La libération de tous les prisonniers civils et militaires.
2) L'abolition de tous les Etats et la suppression de toutes les dynasties.
3) L'élection de conseils ouvriers et de soldats, l'élection de délégués dans toutes les usines et les unités de la troupe.
4) L'établissement immédiat de relations avec les autres conseils ouvriers et de soldats allemands.
5) La prise en charge du gouvernement par les commissaires des conseils ouvriers et de soldats.
6) La liaison immédiate avec le prolétariat international et tout spécialement avec la République Ouvrière russe.
Vive la République socialiste !
Vive l'Internationale ! »
Le groupe « Internationale » (Groupe Spartakus), le 8 novembre.
Les événements du 9 novembre
Aux premières heures du matin du 9 novembre le soulèvement révolutionnaire commence à Berlin.
« Ouvriers, soldats, camarades !
L'heure de la décision est là ! Il s'agit d'être à la hauteur de la tâche historique...
Nous exigeons non pas l'abdication d'un seul homme mais la république !
La république socialiste et toute ses conséquences. En avant pour la lutte pour la paix, la liberté et la pain.
Sortez des usines ! Sortez des casernes ! Tendez Vous les mains ! Vive la république socialiste. » (Tract spartakiste)
Des centaines de milliers d'ouvriers répondent à l'appel du groupe Spartakus et du Comité exécutif, cessent le travail et affluent en de gigantesques cortèges de manifestations vers le centre de la ville. A leur tête marchent des groupes d'ouvriers armés. La grande majorité des troupes s'unit aux ouvriers manifestants et fraternise avec eux. A midi Berlin se trouve aux mains des ouvriers et des soldats révolutionnaires. Les lieux importants sont occupés par les ouvriers. Une colonne de manifestants, ouvriers et soldats, se rend devant la demeure des Hohenzollern. Liebknecht y prend la parole :
« La domination du capitalisme qui a transformé l'Europe en cimetière est désormais brisée. (...) Ce n'est pas parce que le passé est mort que nous devons croire que notre tâche est terminée. Il nous faut tendre toutes nos forces pour construire le gouvernement des ouvriers et des soldats (...). Nous tendons la mains (aux ouvriers du monde entier) et les invitons à achever la révolution mondiale (...). Je proclame la libre république socialiste d'Allemagne. » (Liebknecht, le 9 novembre)
De plus, il met en garde les ouvriers afin qu'ils ne se contentent pas de ce qui est atteint et il les appelle à la prise du pouvoir et à l'unification internationale de la classe ouvrière.
Le 9 novembre, l'ancien régime n'utilise pas la force pour se défendre. Cependant si cela se produit ainsi c'est non pas parce qu'il hésite à verser le sang (il a des millions de morts sur la conscience) mais parce que la révolution lui a désorganisé l'armée en lui retirant un grand nombre de soldats qui auraient pu tirer sur le peuple. Tout comme en Russie, en février 1917, lorsque les soldats se sont rangés du côté des ouvriers en lutte, la réaction des soldats allemands est un facteur important dans le rapport de force. Mais ce n'est que par l'auto-organisation, la sortie des usines et « l'occupation de la rue », par l'unification massive de la classe ouvrière, que la question nodale des prolétaires en uniforme pouvait se résoudre. En réussissant à les convaincre de la nécessité de la fraternisation, les ouvriers montrent que ce sont eux qui détiennent le rôle dirigeant !
L'après-midi du 9 novembre des milliers de délégués se réunissent au Cirque Busch. R. Müller, l'un des principaux dirigeants des « Délégués » révolutionnaires lance un appel pour que : « le 10 novembre soit organisée dans toutes les usines et dans toutes les unités des troupes de Berlin l'élection de conseils ouvriers et de soldats. Les conseils élus devant tenir une assemblée au Cirque Busch à 17 heures pour élire le gouvernement provisoire. Les usines doivent élire un membre au conseil ouvrier pour 1000 ouvriers et ouvrières, de même tous les soldats doivent élire un membre au conseil de soldats par bataillon. Les usines plus petites (de moins de 500 employés) doivent élire chacune un délégué. L'assemblée insiste sur la nomination par l'assemblée des conseils d'un organe de pouvoir. »
Les ouvriers effectuent ainsi les premiers pas pour créer une situation de double pouvoir. Parviendront-ils à aller aussi loin que leurs frères de classe de Russie ?
Les Spartakistes, pour leur part, soutiennent que la pression et les initiatives provenant des conseils locaux doivent être renforcées. La démocratie vivante de la classe ouvrière, la participation active des ouvriers, les assemblées générales dans les usines, la désignation de délégués responsables devant elles et révocables, voilà ce que doit être la pratique de la classe ouvrière !
Les ouvriers et les soldats révolutionnaires occupent le soir du 9 novembre l'imprimerie du Berliner-Lokal-Anzeiger et impriment le premier numéro du journal Die rote Fahne qui, immédiatement, met en garde : « Il n'y a aucune communauté d'intérêt avec ceux qui vous ont trahi quatre années durant. A bas le capitalisme et ses agents ! Vive la révolution ! Vive l'Internationale ! »
La question de la prise
du pouvoir par la classe ouvrière :
la bourgeoisie l'arme au pied
Le premier conseil ouvrier et de soldats de Berlin (surnommé l'Exécutif) se considère rapidement comme organe de pouvoir. Dans sa première proclamation du 11 novembre, il se proclame instance suprême de contrôle de toutes les administrations publiques des communes, des Länder et du Reich ainsi que de l'administration militaire.
Mais la classe dominante ne cède pas de plein gré le terrain à la classe ouvrière. Au contraire, elle va opposer la résistance la plus acharnée.
En effet, tandis que Liebknecht proclame la république socialiste devant la demeure des Hohenzollern, le prince Max von Baden abdique et confie les affaires gouvernementales à Ebert nommé chancelier. Le SPD proclame la « libre république d'Allemagne ».
Ainsi, officiellement le SPD prend en charge les affaires gouvernementales et appelle aussitôt « au calme et à l'ordre » en annonçant la tenue de prochaines « élections libres » ; il se rend compte qu'il ne peut s'opposer au mouvement qu'en le sapant de l'intérieur.
Il proclame son propre conseil ouvrier et de soldats composé uniquement de fonctionnaires du SPD et à qui personne n'a conféré aucune sorte de légitimité.
Après cela, le SPD déclare que le mouvement est dirigé en commun par lui et l'USPD.
Cette tactique d'investir le mouvement et de le détruire de l'intérieur a, depuis lors, toujours été réutilisée par les gauchistes avec leurs comités de grève bidons, auto-proclamés, et leurs coordinations.
La social-démocratie et ses successeurs, les groupes de l'extrême gauche capitaliste, sont des spécialistes pour se placer à la tête du mouvement et faire en sorte d'apparaître comme s'ils en sont les représentants légitimes.
Alors qu'il cherche à couper l'herbe sous le pied de l'Exécutif en agissant directement en son sein, le SPD annonce la formation d'un gouvernement commun avec l'USPD. Celui-ci accepte alors qu'en revanche les Spartakistes (qui en sont encore membres à ce moment-là) repoussent cette offre. Si aux yeux de la grande majorité des ouvriers la différence entre l'USPD et les Spartakistes est peu nette, ces derniers ont cependant une attitude claire vis-à-vis de la formation du gouvernement. Ils sentent le piège et comprennent qu'on ne s'assoit pas dans la même barque que l'ennemi de classe.
Le meilleur moyen pour combattre les illusions des ouvriers sur les partis de gauche n'est pas, comme le répètent aujourd'hui sans cesse les trotskistes et autres gauchistes, de les porter au gouvernement pour que se déchire le voile de leurs mensonges. Pour développer la conscience de classe, c'est la démarcation de classe la plus claire et la plus stricte qui est indispensable et rien d'autre.
Le soir du 9 novembre, le SPD et la direction de l'USPD se font proclamer commissaires du peuple et gouvernement investi par le Conseil Exécutif.
Le SPD a fait la démonstration de toute son adresse. Il peut maintenant agir contre la classe ouvrière aussi bien depuis les bancs du gouvernement qu'au nom de l'Exécutif des conseils. Ebert est en même temps chancelier du Reich et commissaire du peuple élu par l'Exécutif des conseils ; il peut ainsi donner l'apparence d'être du côté de la révolution. Le SPD avait déjà la confiance de la bourgeoisie mais en parvenant à capter celle des ouvriers avec autant d'adresse il montre ses capacités de manoeuvres et de mystification. C'est aussi une leçon, pour la classe ouvrière, sur la manière trompeuse dont les forces de la gauche du Capital peuvent agir.
Examinons de plus près la manière d'agir du SPD notamment lors de l'assemblée du conseil ouvrier et de soldats du 10 novembre où environ 3 000 délégués sont présents. Aucun contrôle des mandats n'est effectué et de ce fait les représentants des soldats se retrouvent en majorité.
Ebert prend la parole en premier. D'après lui, « le vieux différend fratricide » aurait pris fin, le SPD et l'USPD ayant formé un gouvernement commun, il s'agirait maintenant « d'entreprendre en commun le développement de l'économie sur la base des principes du socialisme. Vive l'unité de la classe ouvrière allemande et des soldats allemands. » Au nom de l'USPD Haase célèbre « l'unité retrouvée » : « Nous voulons consolider les conquêtes de la grande révolution socialiste. Le gouvernement sera un gouvernement socialiste. »
« Ceux qui hier encore travaillaient contre la révolution, ne sont maintenant plus contre elle. » (E. Barth, le 10 novembre 1918) « Tout doit être fait pour que la contre-révolution ne se soulève pas. »
Ainsi, alors que le SPD emploie tous les moyens pour mystifier la classe ouvrière, l'USPD contribue à servir de couverture à ses manoeuvres. Les Spartakistes se rendant compte du péril, Liebknecht déclare au cours de cette assemblée :
« Je dois verser de l'eau dans le vin de votre enthousiasme. La contre-révolution est déjà en marche, elle est déjà en action... Je vous le dis : les ennemis vous entourent ! (Il énumère les intentions contre-révolutionnaires de la social-démocratie) Je sais combien vous est désagréable ce dérangement, mais même si vous me fusillez, j'exprimerai ce que je tiens pour indispensable de dire. »
Les Spartakistes mettent ainsi en garde contre l'ennemi de classe qui est présent et insistent sur la nécessité de renverser le système. Pour eux l'enjeu n'est pas un changement de personnes mais le dépassement du système lui-même.
A l'inverse, le SPD, avec l'USPD à sa remorque, agit pour que le système reste en place faisant croire qu'avec un changement de dirigeants et l'investiture d'un nouveau gouvernement la classe ouvrière a remporté la victoire.
Là aussi le SPD donne une leçon aux défenseurs du Capital par la manière de détourner la colère sur des personnalités dirigeantes pour éviter que ne soit porté atteinte au système dans son ensemble. Cette manière d'agir a constamment été mise en pratique par la suite. ([2] [239])
Le SPD enfonce le clou dans son journal du 10 novembre où il écrit sous le titre « L'unité et non la lutte fratricide » :
« Depuis hier le monde du travail a le sentiment de faire flamboyer la nécessité de l'unité interne. De pratiquement toutes les villes, de tous les Länder, de tous les Etats de la fédération nous entendons que le vieux Parti et les Indépendants se sont à nouveau retrouvés le jour de la révolution et se sont réunifiés dans l'ancien Parti. (...) L'oeuvre de réconciliation ne doit pas faillir à cause de quelques aigris dont le caractère ne serait pas suffisamment fort pour dépasser les vieilles rancoeurs et les oublier. Le lendemain d'un tel triomphe magnifique (sur l'ancien régime) doit-on offrir au monde le spectacle du déchirement mutuel du monde du travail dans une absurde lutte fratricide ? » (Vorwærts, 10 novembre 1918)
Les deux armes du capital pour assumer le sabotage politique
A partir de là le SPD met en campagne tout un arsenal d'armes contre la classe ouvrière. A côté de « l'appel à l'unité », il injecte surtout le poison de la démocratie bourgeoise. Selon lui, l'introduction du « suffrage universel, égal, direct et secret pour tous les hommes et femmes d'âge adulte fut à la fois présenté comme la plus importante conquête politique de la révolution et comme le moyen de transformer l'ordre de la société capitaliste vers le socialisme suivant la volonté du peuple selon un plan méthodique. » Ainsi, avec la proclamation de la république et du fait que des ministres SPD soient au pouvoir, il fait croire que le but est atteint et avec l'abdication du Kaiser et la nomination d'Ebert à la chancellerie que le libre Etat Populaire est créé. En réalité ce n'est qu'un anachronisme de peu d'importance qui vient d'être éliminé en Allemagne car la bourgeoisie est depuis longtemps la classe politiquement dominante ; à la tête de l'Etat se trouve désormais non plus un monarque mais un bourgeois. Cela ne change pas grand chose... Aussi il est clair que l'appel à des élections démocratiques est directement dirigé contre les conseils ouvriers. De plus, c'est avec une propagande idéologique intensive, fallacieuse et criminelle que le SPD bombarde la classe ouvrière :
« Qui veut le pain, doit vouloir la paix. Qui veut la paix, doit vouloir la Constituante, la représentation librement élue de l'ensemble du peuple allemand. Qui contrecarre la Constituante ou bien tergiverse, vous ôte la paix, la liberté et le pain, vous dérobe les fruits immédiats de la victoire de la révolution : c'est un contre-révolutionnaire. »
« La socialisation aura lieu et devra avoir lieu (...) de par la volonté du peuple du travail qui, fondamentalement, veut abolir cette économie animée par l'aspiration des particuliers au profit. Mais cela sera mille fois plus facile à imposer si c'est la Constituante qui le décrète, que si c'est la dictature d'un quelconque comité révolutionnaire qui l'ordonne (...). »
« L'appel à la Constituante est l'appel au socialisme créateur, constructeur, à ce socialisme qui augmente le bien-être du peuple, qui élève le bonheur et la liberté du peuple et pour lequel seul il vaut de lutter. »
« L'unité allemande exige l'Assemblée Nationale. Ce n'est que sous sa protection que pourra se développer la nouvelle culture allemande, qui a constamment formé le but et le coeur de notre volonté nationale. »
« Les conquêtes de la révolution sont si fermement ancrées dans la volonté de tout le peuple, que seuls les poltrons peuvent avoir des cauchemars à cause de la contre-révolution. » (Tract du SPD)
Si nous citons aussi exhaustivement le SPD, ce n'est que pour mieux se faire une réelle idée des arguties et de la ruse qu'utilise la gauche du Capital.
Nous avons ici encore une caractéristique classique de l'action de la bourgeoisie contre la lutte de classe dans les pays hautement industrialisés : lorsque le prolétariat exprime sa force et aspire à son unification, ce sont toujours les forces de gauche qui interviennent avec la plus adroite des démagogies. Ce sont elles qui prétendent agir au nom des ouvriers et cherchent à saboter les luttes de l'intérieur empêchant le mouvement de franchir les étapes décisives.
La classe ouvrière révolutionnaire en Allemagne trouve face à elle un adversaire incomparablement plus fort que celui que les ouvriers russes ont affronté. Pour la tromper le SPD est amené à adopter un langage radical dans le sens supposé des intérêts de la révolution et se place ainsi à la tête du mouvement, alors qu'il est, en réalité, le principal représentant de l'Etat bourgeois. Il n'agit pas contre la classe ouvrière en tant que parti extérieur à l'Etat, mais comme fer de lance de celui-ci.
Les premiers jours de l'affrontement révolutionnaire montrent déjà à l'époque le caractère général de la lutte de classe dans les pays hautement industrialisés : une bourgeoisie rompue à toutes les ruses s'affrontant à une classe ouvrière forte. Il serait illusoire de penser que la victoire puisse facilement revenir à la classe ouvrière.
Comme nous le verrons plus tard, les syndicats, de leur côté, agissent comme second pilier du Capital et collaborent avec les patrons immédiatement après le déclenchement du mouvement. Après avoir organisé durant le conflit la production de guerre, ils doivent intervenir avec le SPD pour défaire le mouvement. Quelques concessions sont faites, parmi lesquelles la journée de huit heures, afin d'empêcher la radicalisation ultérieure de la classe ouvrière.
Mais, même le sabotage politique, le travail de sape de la conscience de la classe ouvrière par le SPD ne suffit pas : simultanément ce parti traître scelle un accord avec l'armée pour une action militaire.
La répression
Le commandant en chef de l'armée, le général Groener, qui au cours de la guerre avait collaboré quotidiennement avec le SPD et les syndicats, en tant que responsable des projets d'armements, explique :
« Nous nous sommes alliés pour combattre le Bolchevisme. La restauration de la monarchie était impossible. (...) J'avais conseillé au Feldmarschall de ne pas combattre la révolution par les armes, parce qu'il était à craindre que compte tenu de l'état des troupes un tel moyen irait à l'échec. Je lui ai proposé que le haut commandement militaire s'allie avec le SPD vu qu'il n'y avait aucun parti disposant de suffisamment d'influence dans le peuple, et parmi les masses pour reconstruire une force gouvernementale avec le commandement militaire. Les partis de droite avaient complètement disparu et il était exclu de travailler avec les extrémistes radicaux. Il s'agissait en premier lieu d'arracher le pouvoir des mains des conseils ouvriers et de soldats de Berlin. Dans ce but une entreprise fut prévue. Dix divisions devaient entrer dans Berlin. Ebert était d'accord. (...) Nous avons élaboré un programme qui prévoyait, après l'entrée des troupes, le nettoyage de Berlin et le désarmement des Spartakistes. Cela fut aussi convenu avec Ebert, auquel je suis particulièrement reconnaissant pour son amour absolu de la patrie. (...) Cette alliance fut scellée contre le danger bolchevik et le système des conseils. » (octobre-novembre 1925, Zeugenaussage)
Dans ce but, Groener, Ebert et consorts sont chaque jour en liaison téléphonique entre 23 heures et une heure du matin sur des lignes secrètes et se rencontrent pour se concerter sur la situation.
Contrairement à la Russie où, en octobre, le pouvoir tomba aux mains des ouvriers quasiment sans une goutte de sang, la bourgeoisie en Allemagne s'apprête immédiatement, à côté du sabotage politique, à déclencher la guerre civile. Dés le premier jour, elle réunit tous les moyens nécessaires à la répression militaire.
L'intervention
des révolutionnaires
Pour évaluer l'intervention des révolutionnaires nous devons examiner leur capacité à analyser correctement le mouvement de la classe, l'évolution du rapport de forces, ce « qui a été atteint », et leur capacité à donner les perspectives les plus claires. Que disent les Spartakistes ?
« La révolution est commencée. L'heure n'est ni à la jubilation devant ce qui est accompli, ni au triomphe devant l'ennemi abattu, mais à la plus sévère autocritique et au rassemblement de fer des énergies afin de poursuivre le travail entamé. Car ce qui est accompli est minime et l'ennemi N'EST PAS vaincu. Qu'est-ce qui est atteint ? La monarchie a été balayée, le pouvoir gouvernemental suprême est passé dans les mains des représentants des ouvriers et des soldats. Mais la monarchie n'a jamais été le véritable ennemi, elle n'était que la façade, que l'enseigne de l'impérialisme. (...) Rien moins que l'abolition de la domination du Capital, la réalisation de l'ordre de la société socialiste constituent l'objectif historique de l'actuelle révolution. C'est une tâche considérable qui ne s'accomplit pas en un tour de main à l'aide de quelques décrets venus d'en haut mais qui ne peut être menée heureusement à son terme à travers toutes les tempêtes que par l'action propre et consciente de la masse des travailleurs des villes et des campagnes, et grâce à la maturité spirituelle la plus élevée et à l'idéalisme inépuisable des masses populaires.
- Tout le pouvoir dans les mains des conseils ouvriers et de soldats, sauvegarde de l'oeuvre révolutionnaire contre ses ennemis aux aguets : telle est l'orientation de toutes les mesures du gouvernement révolutionnaire.
- Le développement et la réélection des conseils locaux d'ouvriers et de soldats pour que le premier geste impulsif et chaotique de leur surgissement puisse être remplacé par le processus conscient d'auto-compréhension des buts, des tâches et de la marche de la révolution ;
- Le rassemblement permanent de ces représentants des masses et transfert du pouvoir politique effectif du petit comité du comité exécutif (Vollzugsrat) à la base plus large du conseil ouvrier et de soldats ;
- La convocation dans les plus brefs délais du parlement des ouvriers et des soldats afin que les prolétaires de toute l'Allemagne se constituent en classe, en pouvoir politique compact et se mettent derrière l'oeuvre de la révolution pour en former le rempart et la force de frappe ;
- L'organisation sans retard, non pas des "paysans", mais des prolétaires de la campagne et des petits paysans, qui jusqu'alors se trouvent encore en dehors de la révolution ;
- La formation d'une Garde Rouge prolétarienne pour la protection permanente de la révolution et d'une Milice Ouvrière pour que l'ensemble du prolétariat soit en permanence vigilant ;
- La suppression des organes de l'état policier absolutiste et militaire de l'administration, de la justice et de l'armée, (...)
- La convocation immédiate d'un congrès ouvrier mondial en Allemagne pour indiquer nettement et clairement le caractère socialiste et international. L'Internationale, la révolution mondiale du prolétariat sont les seuls points d'ancrage du futur de la révolution allemande. »
(R. Luxemburg, « Le début », Die Rote Fahne, 18 novembre 1918)
Destruction des positions du pouvoir politique de la contre-révolution, érection et consolidation du pouvoir prolétarien, voilà quelles sont les deux tâches que les Spartakistes mettent au premier plan avec une remarquable clarté.
« Le bilan de la première semaine de la révolution est que dans l'Etat des Hohenzollern rien n'a été fondamentalement changé, le conseil ouvrier et de soldats fonctionne comme représentant du gouvernement impérialiste qui a fait banqueroute. Tous ses faits et gestes sont inspirés par la peur de la masse des ouvriers. (...)
L'état réactionnaire du monde civilisé ne se transformera pas en état populaire révolutionnaire en 24 heures. Des soldats qui, hier encore, se faisaient les gendarmes de la réaction et assassinaient des prolétaires révolutionnaires en Finlande, en Russie, en Ukraine, dans les pays baltes et des ouvriers qui ont laissé faire cela tranquillement ne sont pas devenus en 24 heures les porteurs conscients des buts du socialisme. » (18 novembre)
L'analyse des Spartakistes affirmant qu'il ne s'agit pas d'une révolution bourgeoise mais de la contre-révolution bourgeoise déjà en marche, leur capacité à analyser la situation avec clairvoyance et selon une vue d'ensemble, concrétisent le caractère indispensable, pour le mouvement de la classe, de ses organisations politiques révolutionnaires.
Les conseils ouvriers,
fer de lance de la révolution
Comme nous l'avons décrit plus haut, dans les grandes villes, pendant les premiers jours de novembre, des conseils ouvriers et de soldats ont été formés partout. Même si les conseils surgissent « spontanément », leur apparition n'est nullement une surprise pour les révolutionnaires. Ils sont déjà apparus en Russie, de même qu'en Autriche et en Hongrie. Comme le disait l'Internationale Communiste par la voix de Lénine en mars 1919 : « Cette forme, c'est le régime des soviets avec la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat : ces mots étaient du "latin" pour les masses jusqu'à nos jours. Maintenant, grâce au système des soviets, ce latin est traduit dans toutes les langues modernes ; la forme pratique de la dictature est trouvée par les masses ouvrières. » (Discours d'ouverture au premier congrès de l'Internationale Communiste)
L'apparition des conseils ouvriers reflète la volonté de la classe ouvrière de prendre en main son destin. Les conseils ouvriers peuvent seulement apparaître lorsque dans l'ensemble de la classe il y a une activité massive et qu'un développement profond de la conscience de classe se soit mis en marche. C'est pourquoi les conseils ne sont que le fer de lance d'un mouvement profond et global de la classe, et ils sont fortement dépendants des activités de l'ensemble de la classe. Si la classe affaiblit ses activités dans les usines, si la combativité se tasse et la conscience recule dans la classe, cela se répercute sur la vie même des conseils. Ils sont le moyen de centraliser les luttes de la classe et ils sont le levier par lequel la classe réclame et impose le pouvoir dans la société.
Dans beaucoup de villes les conseils ouvriers commencent, en effet, à prendre des mesures pour s'opposer à l'Etat bourgeois. Dés le début de l'existence des conseils, les ouvriers tentent de paralyser l'appareil d'Etat bourgeois, de prendre leurs propres décisions à la place du gouvernement bourgeois et de les mettre en pratique. C'est le début de la période de double pouvoir, comme en Russie après la révolution de février. Ce phénomène apparaît partout mais il est le plus visible à Berlin où siège le gouvernement.
Le sabotage de la bourgeoisie
Parce que les conseils ouvriers sont le levier de la centralisation de la lutte ouvrière, parce que toutes les initiatives des masses ouvrières convergent en leur sein, il est vital pour la classe de maintenir son contrôle sur eux.
En Allemagne la classe capitaliste utilise un véritable cheval de Troie contre les conseils grâce au SPD. Celui-ci, qui a été jusqu'en 1914 un parti ouvrier, les combat, les sabote de l'intérieur et les détourne de leur objectif au nom de la classe ouvrière.
Déjà au niveau de leur composition, il utilise toutes les ruses pour y faire introduire ses délégués. Le Conseil Exécutif de Berlin au début est composé de six représentants respectivement du SPD et de l'USPD et de douze délégués des soldats. Cependant, à Berlin, le SPD réussit - sous prétexte d'une nécessaire parité de voix et de la nécessaire unité de la classe ouvrière - à faire pénétrer un nombre important de ses hommes dans le Conseil Exécutif sans que la décision soit prise par une quelconque assemblée ouvrière. Grâce à cette tactique d'insistance sur la « parité (des voix) entre les partis » le SPD reçoit plus de délégués qu'il n'a d'influence réelle dans la classe. En province les choses ne sont pas très différentes : pour quelques 40 grandes villes, quasiment trente conseils ouvriers et de soldats se retrouvent sous l'influence dominante des dirigeants du SPD et de l'USPD. Ce n'est que dans les villes où les Spartakistes ont une plus grande influence que les conseils ouvriers s'engagent dans une voie radicale.
En ce qui concerne les tâches des conseils, le SPD essaie de les stériliser. Alors que les conseils de par leur nature tendent à agir comme contre-pouvoir face au pouvoir de l'Etat bourgeois, voire même à le détruire, le SPD s'arrange pour affaiblir et assujettir ces organes de la classe à l'Etat bourgeois. Il le fait en propageant l'idée que les conseils doivent se concevoir comme des organes transitoires jusqu'à la tenue des élections pour l'assemblée nationale, mais aussi, pour leur faire perdre leur caractère de classe, qu'ils doivent s'ouvrir à toute la population, à toutes les couches du peuple. Dans beaucoup de villes le SPD crée des « comités de salut public » qui incluent toutes les parties de la population -des paysans aux petits commerçants jusqu'aux ouvriers- ayant les mêmes droits dans ces organismes.
Alors que les Spartakistes poussent dès le début à la formation de Gardes Rouges pour pouvoir imposer si nécessaire par la force les mesures prises, le SPD torpille cette initiative dans les conseils de soldats en disant que cela « exprime une méfiance vis à vis des soldats ».
Dans le Conseil Exécutif de Berlin il y a constamment des confrontations sur les mesures et la direction à prendre. Bien que l'on ne puisse pas dire que tous les délégués ouvriers aient une clarté et une détermination suffisante sur toutes les questions, le SPD fait tout pour saper l'autorité du conseil de l'intérieur comme de l'extérieur.
C'est ainsi que :
- dès que le Conseil Exécutif donne des instructions, le Conseil des Commissaires du Peuple (dirigé par le SPD) en impose d'autres ;
- l'Exécutif ne possédera jamais sa propre presse et devra aller mendier de la place dans la presse bourgeoise pour la publication de ses résolutions. Les délégués du SPD ont tout fait pour qu'il en soit ainsi ;
- lorsqu'en novembre et décembre des grèves éclatent dans les usines de Berlin, le Comité Exécutif, sous l'influence du SPD, prend position contre elles, bien qu'elles expriment la force de la classe ouvrière et qu'elles auraient pu permettre de corriger des erreurs du Comité Exécutif ;
- finalement le SPD -en tant que force dirigeante du gouvernement bourgeois- utilise la menace des Alliés, soi-disant prêts à intervenir militairement et à occuper l'Allemagne pour empêcher sa « bolchévisation », pour faire hésiter les ouvriers et freiner le mouvement. Ainsi, par exemple, il fait croire que, si les conseils ouvriers vont trop loin, les USA vont cesser toute livraison de produits alimentaires à la population affamée.
Que ce soit à travers la menace directe de l'extérieur ou par le sabotage de l'intérieur, le SPD utilise tous les moyens contre la classe ouvrière en mouvement.
Dès le départ, il s'évertue à isoler les conseils de leur base dans les usines.
Ceux-ci se composent, dans chaque entreprise, de délégués élus par les assemblées générales et qui sont responsables devant celles-ci. Si les ouvriers perdent ou abandonnent leur pouvoir de décision dans les assemblées générales, si les conseils se détachent de leur « racines », de leur « base » dans les entreprises ils sont eux-mêmes affaiblis et deviendront inévitablement les victimes de la contre-offensive de la bourgeoisie. C'est pourquoi dés le départ le SPD pousse à ce que leur composition se fasse sur la base d'une répartition proportionnelle des sièges entre les partis politiques. L'éligibilité et la révocabilité des délégués par les assemblées n'est pas un principe formel de la démocratie ouvrière, mais le levier, le « volant » avec lequel le prolétariat peut - en partant de sa plus petite cellule de vie - diriger et contrôler sa lutte. L'expérience en Russie avait déjà montré combien est essentielle l'activité des comités d'usines. Si les conseils ouvriers n'ont plus à rendre des comptes devant la classe, devant les assemblées qui les ont élus, si la classe n'est pas capable d'exercer son contrôle sur eux cela signifie que son mouvement est affaibli, que le pouvoir lui échappe.
Déjà en Russie, Lénine l'avait clairement mis en évidence :
« Pour contrôler, il faut détenir le pouvoir. (...) Si je mets au premier plan le contrôle, en masquant cette condition fondamentale, je dis une contre-vérité et je fais le jeu des capitalistes et des impérialistes. (...) Sans pouvoir, le contrôle est une phrase petite-bourgeoise creuse qui entrave la marche et la développement de la révolution. »
(Conférence d'avril, Rapport sur la situation actuelle, 7 mai, Oeuvres complètes, tome 24, p. 230)
Alors qu'en Russie, dès les premières semaines, les conseils qui s'appuyaient sur les ouvriers et les soldats disposaient d'un réel pouvoir, l'Exécutif des conseils de Berlin, lui, en est dépossédé. Rosa Luxemburg le constate avec justesse :
« L'Exécutif des conseils unis de Russie est - quoi que l'on puisse écrire contre lui - assurément une tout autre chose que l'exécutif de Berlin. L'un est la tête et le cerveau d'une puissante organisation prolétarienne révolutionnaire, l'autre est la cinquième roue du carrosse d'une clique gouvernementale crypto-capitaliste ; l'un est la source inépuisable de la toute-puissance prolétarienne, l'autre est sans force et sans orientation ; l'un est l'esprit vivant de la révolution, l'autre est son sarcophage. » (R. Luxemburg, 12 décembre 1918)
Le Congrès national des conseils
Le 23 novembre l'Exécutif de Berlin appelle à la tenue d'un congrès national des conseils à Berlin pour le 16 décembre. Cette initiative, censée réunir toutes les forces de la classe ouvrière, va en réalité être utilisée contre elle. Le SPD impose que, dans les différentes régions du Reich, soit élu un « délégué ouvrier » pour 200 000 habitants et un représentant des soldats pour 100 000 soldats, moyen par lequel la représentation des ouvriers est amoindrie alors que celle des soldats est largement majorée. Au lieu d'être un reflet de la force et de l'activité de la classe dans les usines, ce congrès national, sous l'impulsion du SPD, va échapper à l'initiative ouvrière.
De plus, selon les mêmes saboteurs, ne doivent être désignés « délégués ouvriers » que les « travailleurs manuels et intellectuels ». Ainsi tous les fonctionnaires du SPD et des syndicats sont présentés avec la « mention de leur profession » ; par contre les membres de la Ligue Spartakus, qui apparaissent ouvertement, sont exclus. En utilisant toutes les ficelles possibles les forces de la bourgeoisie réussissent à s'imposer tandis que les révolutionnaires, qui agissent à visage découvert, se voient interdits de parole.
Lorsque le congrès des conseils se réunit le 16 décembre il rejette, en premier lieu, la participation des délégués russes. « L'assemblée générale réunie le 16 décembre ne traite pas de délibérations internationales mais seulement d'affaires allemandes dans lesquelles les étrangers ne peuvent bien sûr pas participer... La délégation russe n'est rien d'autre qu'un représentant de la dictature bolchevik. » Telle est la justification que donne le Vorwærts n°340 (11 décembre1918). En faisant adopter cette décision, le SPD prive d'emblée la conférence de ce qui aurait du être son caractère le plus fondamental : être l'expression de la révolution prolétarienne mondiale qui avait commencé en Russie.
Dans la même logique de sabotage et de dévoiement, le SPD fait voter l'appel à l'élection d'une assemblée constituante pour le 19 janvier 1919.
Les Spartakistes, ayant compris la manoeuvre, appellent à une manifestation de masse devant le congrès. Plus de 250 000 manifestants se rassemblent sous le mot d'ordre :« Pour les conseils ouvriers et de soldats, non à l'assemblée nationale ! »
Alors que le congrès est en train d'agir contre les intérêts de la classe ouvrière, Liebknecht s'adresse aux participants de la manifestation : « Nous demandons au congrès qu'il prenne tout le pouvoir politique dans ses mains pour réaliser le socialisme et qu'il ne le transfère pas à la constituante qui ne sera nullement un organe révolutionnaire. Nous demandons au congrès des conseils qu'il tende la main à nos frères de classe en Russie et qu'il appelle des délégués russes à venir se joindre aux travaux du congrès. Nous voulons la révolution mondiale et l'unification de tous les ouvriers de tous les pays dans les conseils ouvriers et de soldats. » (17 décembre 1918)
Les révolutionnaires ont compris la nécessité vitale de la mobilisation des masses ouvrières, la nécessité d'exercer une pression sur les délégués, d'en élire de nouveaux, de développer l'initiative des assemblées générales dans les usines, de défendre l'autonomie des conseils contre l'assemblée nationale bourgeoise, d'insister sur l'unification internationale de la classe ouvrière.
Mais, même après cette manifestation massive, le congrès continue de rejeter la participation de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht, sous prétexte qu'ils ne sont pas ouvriers, alors que la bourgeoisie, elle, a déjà réussi à faire pénétrer ses hommes dans les conseils. Pendant le congrès les représentants du SPD défendent l'armée pour la protéger d'un délitement encore plus grand par les conseils de soldats. Le congrès décide également de ne plus recevoir aucune délégation d'ouvriers et de soldats pour ne plus devoir se plier à leur pression.
A la fin de ses travaux, il va jusqu'à accentuer la confusion en déblatérant sur de prétendues premières mesures de socialisation alors que les ouvriers n'ont même pas encore pris le pouvoir. « Réaliser des mesures socio-politiques dans des entreprises individuelles, isolées est une illusion, tant que la bourgeoisie a encore le pouvoir politique dans ses mains. » (IKD, Der Kommunist). La question centrale du désarmement de la contre-révolution et du renversement du gouvernement bourgeois, tout cela est mis de côté.
Que doivent faire les révolutionnaires contre un tel développement ?
Le 16 décembre à Dresde, Otto Rühle, qui a entre-temps viré au conseillisme, jette l'éponge vis à vis du conseil ouvrier et de soldats local dès que les forces social-démocrates de la ville ont pris le dessus. Les Spartakistes, par contre, n'abandonnent pas le terrain à l'ennemi. Après avoir dénoncé le congrès national des conseils, ils en appellent à l'initiative de la classe ouvrière :
« Le congrès des conseils a outrepassé ses pleins pouvoirs, il a trahi le mandat qui lui avait été remis par les conseils d'ouvriers et de soldats, il a supprimé le sol sur lequel son existence et son autorité étaient fondées. Les conseils d'ouvriers et de soldats vont désormais développer leur pouvoir et défendre leur droit à l'existence avec une énergie décuplée. Ils déclareront nulle et non avenue l'oeuvre contre-révolutionnaire de leurs hommes de confiance indignes. » (Rosa Luxemburg, Les Mamelouks d'Ebert, 20 décembre 1918)
Le sang de la révolution c'est l'activité des masses
La responsabilité des Spartakistes est de pousser en avant l'initiative des masses, d'intensifier leurs activités. C'est cette orientation qu'ils vont mettre en avant dix jours plus tard lors du congrès de fondation du KPD. Nous reprendrons les travaux de ce congrès de fondation dans un prochain article.
Les Spartakistes ont, en effet, compris que le pouls de la révolution bat dans les conseils ; la révolution prolétarienne est la première révolution qui est faite par la grande majorité de la population, par la classe exploitée. Contrairement aux révolutions bourgeoises qui peuvent être faites par des minorités, la révolution prolétarienne peut seulement être victorieuse si elle est constamment alimentée, nourrie et poussée en avant par la source de l'activité de toute la classe. Les délégués des conseils, les conseils ne sont pas une partie isolée de la classe qui peut et doit s'isoler, voire se protéger de celle-ci, ou qui devrait tenir le reste de la classe dans la passivité. Non, la révolution peut seulement avancer par la participation consciente, vigilante, active et critique de la classe.
Pour la classe ouvrière en Allemagne, cela signifie, à ce moment-là, qu'elle doit entrer dans une nouvelle phase où il lui faut renforcer la pression à partir des usines. Quant aux Communistes, leur agitation dans les conseils locaux est la priorité absolue. Ainsi les Spartakistes suivent la politique que Lénine avait déjà prônée en avril 1917 lorsque la situation en Russie était comparable à celle que connaît l'Allemagne : « Expliquer aux masses que les Soviets des députés ouvriers sont la seule forme possible de gouvernement révolutionnaire, et que, par conséquent, notre tâche, tant que ce gouvernement se laisse influencer par la bourgeoisie, ne peut être que d'expliquer patiemment, systématiquement, opiniâtrement aux masses les erreurs de leur tactique, en partant essentiellement de leurs besoins pratiques.
Tant que nous sommes en minorité, nous nous appliquons à critiquer et à expliquer les erreurs commises, tout en affirmant la nécessité du passage de tout le pouvoir aux Soviets des députés ouvriers, afin que les masses s'affranchissent de leurs erreurs par l'expérience. » (Thèses d'avril, n°4)
Nous ne pouvons pas vraiment comprendre la dynamique dans les conseils si nous n'analysons pas de plus près le rôle des soldats.
Le mouvement révolutionnaire de la classe a été initié par la lutte contre la guerre. Mais c'est fondamentalement le mouvement de résistance des ouvriers dans les usines qui « contamine » les millions de prolétaires en uniforme qui se trouvent sur le front (le pourcentage d'ouvriers parmi les soldats est beaucoup plus élevé en Allemagne qu'il ne l'était en Russie). Finalement les mutineries de soldats ainsi que les soulèvements des ouvriers dans les usines créent un rapport de forces obligeant la bourgeoisie à mettre terme à la guerre. Tant que la guerre dure, les ouvriers en uniforme sont les meilleurs alliés des ouvriers en lutte à l'arrière. C'est grâce à leur résistance croissante qu'un rapport de forces favorable est créé sur le front intérieur ; comme le rapporte Liebknecht : « ceci avait eu comme conséquence la déstabilisation dans l'armée. Mais dés que la bourgeoisie mit fin à la guerre une scission au sein de l'armée se fit jour. La masse des soldats est révolutionnaire contre le militarisme, contre la guerre et contre les représentants ouverts de l'impérialisme. Par rapport au socialisme, elle est encore indécise, hésitante, immature. » (Liebknecht, 19 novembre 1918) Tant que perdure la guerre et que les troupes restent encore mobilisées, des conseils de soldats sont formés.
« Les conseils de soldats sont l'expression d'une masse composée de toutes les classes de la société, au sein de laquelle le prolétariat l'emporte sans doute de loin, mais certainement pas le prolétariat conscient des buts et disposé à la lutte de classe. Ils sont souvent formés directement d'en haut par l'entremise des officiers et des cercles de la haute noblesse, qui, ainsi, s'adaptant adroitement, cherchaient à conserver leur influence sur les soldats en se faisant élire comme leurs représentants. » (Liebknecht, 21 novembre 1918)
En tant que telle l'armée est un instrument classique de répression et de conquête impérialiste, contrôlée et dirigée par des officiers soumis à l'Etat exploiteur. Dans une situation révolutionnaire, où des milliers de soldats sont en effervescence, où les rapports hiérarchiques classiques ne sont plus respectés, mais où les ouvriers en uniforme décident collectivement, tout cela peut entraîner la désagrégation de l'armée d'autant plus qu'ils sont armés. Mais pour atteindre une telle situation, il faut que la classe ouvrière, par son mouvement, soit un pôle de référence suffisamment fort pour les soldats.
Lors de la phase finale de la guerre cette dynamique existe. C'est pour cela que la bourgeoisie, sentant ce danger se développer, arrête la guerre pour empêcher une radicalisation encore plus importante. La nouvelle situation ainsi créée permet à la classe dominante de « calmer » les soldats et de les éloigner de la révolution alors que, de son côté, le mouvement de la classe ouvrière n'est pas encore suffisamment fort pour attirer de son côté la majorité d'entre eux. Cela permettra à la bourgeoisie de mieux manipuler les soldats à sa faveur.
Si pendant la phase ascendante du mouvement les soldats ont eu un poids important et, en fait, étaient indispensables pour mettre un terme à la guerre, leur rôle va changer quand la bourgeoisie engage sa contre-offensive.
L'oeuvre révolutionnaire ne peut se réaliser qu'internationalement
Alors que les capitalistes se sont combattus quatre années durant dans la guerre et ont sacrifié des millions de vies humaines, immédiatement après l'éclatement de la révolution en Russie et surtout lorsque le prolétariat en Allemagne commence à se lancer à l'assaut, ils se retrouvent unis contre la classe ouvrière. Les Spartakistes comprennent quel danger il peut résulter de l'isolement de la classe ouvrière en Russie et en Allemagne. Le 25 novembre ils lancent l'appel suivant :
« Aux prolétaires de tous les pays ! L'heure des comptes avec la domination capitaliste a sonné. Mais cette grande tâche ne peut pas être accomplie par le seul prolétariat allemand. Il ne peut lutter et vaincre qu'en faisant appel à la solidarité des prolétaires du monde entier. Camarades des pays belligérants, nous connaissons votre situation. Nous savons bien que vos gouvernements, parce qu'ils ont obtenu la victoire, aveuglent maintes parties du peuple de l'éclat de la victoire. (...) Vos capitalistes victorieux se tiennent prêts à abattre dans le sang notre révolution qu'ils craignent tout autant que la Vôtre. La "victoire" ne Vous a Vous-mêmes pas rendus plus libres, elle n'a fait que Vous rendre plus esclaves. Si Vos classes dominantes réussissent à étrangler la révolution prolétarienne en Allemagne et en Russie, elles se retourneront contre Vous avec une férocité redoublée. (...) L'Allemagne accouche de la révolution sociale mais seul le prolétariat mondial peut réaliser le socialisme. » (Aux prolétaires de tous les pays, Spartakusbund, 25 novembre 1918).
Alors que le SPD met tout en oeuvre pour séparer les ouvriers d'Allemagne de ceux de Russie, les révolutionnaires s'engagent de toutes leurs forces pour l'unification de la classe ouvrière.
A cet égard les Spartakistes sont conscients qu' « Aujourd'hui il règne naturellement parmi les peuples de l'Entente une puissante griserie de la victoire ; et la liesse à propos de la ruine de l'impérialisme allemand et de la libération de la France et de la Belgique est si bruyante que nous n'attendons pas pour le moment d'écho révolutionnaire de la part de la classe ouvrière de nos ennemis jusqu'à ce jour. » (Liebknecht, 23 décembre 1918) Ils savent que la guerre a creusé une dangereuse division dans les rangs de la classe ouvrière. Les défenseurs du Capital, notamment le SPD, commencent à dresser les ouvriers en Allemagne contre ceux des autres pays. Ils brandissent même la menace d'interventions étrangères. Tout cela a depuis lors été souvent utilisé par la classe dominante.
La bourgeoisie a tiré les leçons de la Russie
La signature par la bourgeoisie, sous la direction du SPD, de l'armistice mettant fin à la guerre le 11 novembre, par crainte que la classe ouvrière ne poursuive sa radicalisation et n'emprunte « les voies russes », inaugure une nouvelle situation.
Comme le dit R. Müller, l'un des principaux membres des « Délégués » révolutionnaires : « L'ensemble de la politique de guerre avec tous ses effets sur la situation des ouvriers, l'Union Sacrée avec la bourgeoisie, tout ce qui avait attisé la colère noire des ouvriers était oublié. »
La bourgeoisie a tiré les leçons de la Russie. Si la bourgeoisie de ce pays avait mis fin à la guerre en avril ou mars 1917, la révolution d'octobre n'aurait sûrement pas été possible ou en tous cas aurait été bien plus difficile. Il est donc nécessaire d'arrêter la guerre pour espérer couper l'herbe sous le pied du mouvement révolutionnaire de la classe. Là aussi les ouvriers en Allemagne se trouvent face à une situation différente de celle qu'ont connue leurs frères de classe de Russie.
Les Spartakistes comprennent que la fin de la guerre constitue un tournant dans les luttes et que l'on ne doit pas s'attendre à une victoire immédiate contre le Capital.
« Si l'on se situe sur le terrain du développement historique, on ne peut pas, dans une Allemagne qui a offert l'image épouvantable du 4 août et des quatre années qui ont suivi, s'attendre à voir surgir soudain le 9 novembre 1918 une révolution de classe grandiose et consciente de ses buts ; ce que nous a fait vivre le 9 novembre, c'était pour les trois-quarts plus l'effondrement de l'impérialisme existant, plutôt que la victoire d'un principe nouveau. Simplement pour l'impérialisme, colosse aux pieds d'argile, pourri de l'intérieur, l'heure était venue, il devait s'écrouler ; ce qui suivit fut un mouvement plus ou moins chaotique sans plan de bataille, très peu conscient ; le seul lien cohérent, le seul principe constant et libérateur était résumé dans le mot d'ordre : création de conseils d'ouvriers et de soldats. » (Congrès de fondation du KPD, R. Luxemburg)
C'est pourquoi il ne faut pas confondre le début du mouvement avec son terme, son but final, car « aucun prolétariat dans le monde, même le prolétariat allemand, ne peut du jour au lendemain se débarrasser des stigmates d'un asservissement millénaire. Pas plus politiquement que spirituellement, la situation du prolétariat trouve son état le plus élevé le PREMIER jour de la révolution. Ce ne sont que les luttes de la révolution qui élèveront en ce sens le prolétariat à sa complète maturité. » (R. Luxemburg, 3 décembre 1918)
Le poids du passé
Les causes de ces grandes difficultés de la classe se trouvent, à juste titre selon les Spartakistes, dans le poids du passé. La confiance encore très importante que beaucoup d'ouvriers ont envers la politique du SPD est une dangereuse faiblesse. Nombreux sont ceux qui considèrent que la politique de guerre de ce parti était grandement due à un déboussolement passager. Bien plus encore, pour eux la guerre n'est le résultat que d'une manigance ignoble de la clique gouvernementale qui vient d'être renversée. Et se souvenant de la situation tant soit peu supportable qu'ils connaissaient dans la période d'avant-guerre, ils espérant se sortir bientôt et définitivement de la misère présente. D'ailleurs, les promesses de Wilson annonçant l'union des nations et la démocratie semblent offrir des garanties contre de nouvelles guerres. La république démocratique qui leur est « proposée » n'apparaît pas, à leurs yeux, comme la république bourgeoise mais comme le terrain duquel va éclore le socialisme. Bref, la pression des illusions démocratiques, le manque d'expérience dans la confrontation avec les saboteurs que sont les syndicats et le SPD sont déterminants.
« Dans toutes les révolutions antérieures, les combattants s'affrontaient de façon ouverte, classe contre classe, programme contre programme, épée contre bouclier. (...) (Auparavant) c'était toujours des partisans du système renversé ou menacé qui, au nom de ce système et dans le but de le sauver, prenaient des mesures contre-révolutionnaires. (...) Dans la révolution d'aujourd'hui les troupes qui défendent l'ordre ancien se rangent non sous leur propre drapeau et dans l'uniforme de la classe dominante, mais sous le drapeau du parti social-démocrate. (...) La domination de classe bourgeoise mène aujourd'hui sa dernière lutte historique mondiale sous un drapeau étranger, sous le drapeau de la révolution elle-même. C'est un parti socialiste, c'est à dire la création la plus originale du mouvement ouvrier et de la lutte des classe qui s'est lui-même transformé en instrument le plus important de la contre-révolution bourgeoise. Le fond, la tendance, la politique, la psychologie, la méthode, tout cela est capitaliste de bout en bout. Seuls restent le drapeau, l'appareil et la phraséologie du socialisme. » (R. Luxemburg, Une victoire à la Pyrrhus, 21 décembre 1918)
On ne peut formuler plus clairement le caractère contre-révolutionnaire du SPD.
C'est pourquoi les Spartakistes définissent la prochaine étape du mouvement ainsi : « Le passage de la révolution de soldats prédominante le 9 novembre 1918 à une révolution ouvrière spécifique, le passage d'un bouleversement superficiel, purement politique à un processus de longue haleine d'une confrontation économique générale entre le Travail et le Capital, réclame de la classe ouvrière révolutionnaire un tout autre degré de maturité politique, d'éducation et de ténacité que celui qui a suffi pour la première phase du début. » (R. Luxemburg, 3 janvier 1919)
Le mouvement de début novembre n'a sans doute pas été uniquement une « révolution de soldats » car, sans les ouvriers dans les usines, les soldats ne seraient jamais parvenu à une telle radicalisation. Les Spartakistes voient la perspective d'un véritable pas en avant lorsque, dans la seconde moitié de novembre et en décembre, des grèves éclatent dans la Ruhr et en Haute Silésie. Cela révèle une activité de la classe ouvrière dans les usines mêmes, un recul du poids de la guerre et du rôle des soldats. Après la fin des hostilités, l'effondrement de l'économie conduit à une détérioration encore plus importante des conditions de vie de la classe ouvrière. Dans la Ruhr de nombreux mineurs cessent le travail et pour imposer leurs revendications ils se rendent souvent dans les autres mines afin de trouver la solidarité de leurs frères de classe et construire ainsi un front puissant. Les luttes vont ainsi se développer, connaître des reculs pour se redévelopper avec une nouvelle force.
« Dans la révolution d'aujourd'hui les grèves qui viennent d'éclater (...) sont le tout début d'un affrontement général entre Capital et Travail, elles annoncent le commencement d'une lutte de classe puissante et directe, dont l'issue ne saurait être autre que l'abolition des rapports du salariat et l'introduction de l'économie socialiste. Elles sont le déclenchement de la force sociale vivante de la révolution actuelle : l'énergie de classe révolutionnaire des masses prolétariennes. Elles ouvrent une période d'activité immédiate des masses les plus larges. »
C'est pourquoi, R. Luxemburg souligne justement :
« Suite à la première phase de la révolution, celle de la lutte principalement politique, vient la phase de lutte renforcée, intensifiée essentiellement économique. (...) Dans la phase révolutionnaire à venir, non seulement les grèves s'étendront de plus en plus, mais elles se trouveront au centre, au point décisif de la révolution, refoulant les questions purement politiques. » (R. Luxemburg, Congrès de fondation du KPD)
Après que la bourgeoisie ait mis fin à la guerre sous la pression de la classe ouvrière, qu'elle soit passée à l'offensive pour parer les premières tentatives de prise de pouvoir par le prolétariat, le mouvement entre dans une nouvelle étape. Ou bien la classe ouvrière est en mesure de développer une nouvelle force de poussée à l'initiative des ouvriers dans les usines et de parvenir à « passer à une révolution ouvrière spécifique », ou bien la bourgeoisie pourra poursuivre sa contre-offensive.
Nous aborderons dans le prochain article la question de l'insurrection, les conceptions fondamentales de la révolution ouvrière, le rôle que doivent y jouer les révolutionnaires et qu'ils y ont effectivement joué.
DV.
Géographique:
- Allemagne [133]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [134]
Conscience et organisation:
Approfondir:
- Révolution Allemande [136]
Heritage de la Gauche Communiste:
Réponse au BIPR [l° partie] : La nature de la guerre impérialiste
- 4020 lectures
Le BIPR a répondu à notre article de polémique «La conception du BIPR sur la décadence du capitalisme» (Revue Internationale n° 79) dans l’Internationalist Communist Review n 13. Cette réponse expose les positions de façon réfléchie. En ce sens, c'est une contribution au nécessaire débat qui doit exister entre les organisations de la Gauche communiste qui ont une responsabilité décisive dans la construction du parti communiste du prolétariat.
Le débat entre le BIPR et le CCI se situe à l'intérieur du cadre de la Gauche communiste :
- ce n'est pas un débat académique et abstrait, mais il constitue une polémique militante pour nous doter de positions claires, épurées de toute ambiguïté ou concession à l'idéologie bourgeoise, et en particulier, sur des questions telles que la nature des guerres impérialistes ou les fondements matériels de la nécessité de la révolution communiste ;
- c'est un débat entre partisans de l'analyse de la décadence du capitalisme : depuis le début du siècle, le système est entré dans une crise sans issue qui présente une menace croissante d'anéantissement de l'humanité et de la planète.
Dans ce cadre, l'article de réponse du BIPR insiste sur leur vision de la guerre impérialiste comme moyen de dévalorisation du capital et reprise du cycle d'accumulation, et justifie cette position par une explication de la crise historique du capitalisme basée sur la baisse tendancielle du taux de profit.
Ces deux questions sont l'objet de notre réponse. ([1] [242])
Ce qui nous unit avec le BIPR
Dans une polémique entre révolutionnaires, à cause précisément de son caractère militant, nous devons partir de ce qui nous unit afin d'aborder, dans ce cadre global, ce qui nous sépare. C'est la méthode qu'a toujours appliqué le CCI, à la suite de Marx, Lénine, Bilan, etc., et que nous avons employée dans la polémique avec le PCI (Programma) ([2] [243]) sur la même question que nous discutons maintenant avec le BIPR. Souligner cela nous paraît très important parce que, en premier lieu, les polémiques entre révolutionnaires ont toujours comme fil conducteur la lutte pour la clarification et le regroupement, dans la perspective de la constitution du parti mondial du prolétariat. En second lieu parce que, entre le BIPR et le CCI, sans nier ni relativiser l'importance et les conséquences des divergences que nous avons sur la compréhension de la nature de la guerre impérialiste, ce que nous partageons est beaucoup plus important :
1. Pour le BIPR, les guerres impérialistes n'ont pas des objectifs limités mais sont des guerres totales dont les conséquences dépassent de loin celles qu'elles pouvaient avoir dans la période ascendante.
2. Les guerres impérialistes unissent les facteurs économiques et politiques en un tout inséparable.
3. Le BIPR rejette l'idée selon laquelle le militarisme et la production d'armement seraient des moyens de « l'accumulation du capital ». ([3] [244])
4. En tant qu'expression de la décadence du capitalisme, les guerres impérialistes contiennent la menace de la destruction de l'humanité.
5. Il existe actuellement dans le capitalisme des tendances importantes au chaos et à la décomposition (même si, comme nous le verrons plus loin, le BIPR ne leur accorde pas la même importance que nous).
Ces éléments de convergence expriment la capacité commune que nous avons de dénoncer et de combattre les guerres impérialistes comme moments ultimes de la crise historique du capitalisme, engageant le prolétariat à ne pas choisir entre les différents loups impérialistes, appelant à la révolution prolétarienne mondiale comme seule solution à l'impasse sanglante à laquelle le capitalisme conduit l'humanité, combattant à mort les endormeurs pacifistes et dénonçant les mensonges capitalistes selon lesquels « nous sommes en train de sortir de la crise. »
Ces éléments, expression et patrimoine commun de la Gauche communiste, rendent nécessaire et possible que, face à des événements d'envergure comme les guerres du Golfe ou de l'ex-Yougoslavie, les groupes de la Gauche communiste fassent des manifestes communs qui expriment, face à la classe, la voix unie des révolutionnaires. C'est pour cela que nous avions proposé, dans le cadre des Conférences internationales de 1977-80, de faire une déclaration commune face à la guerre d'Afghanistan et nous avons regretté que ni BC, ni la CWO (qui plus tard constituèrent le BIPR) n'acceptent cette initiative. Loin d'être une proposition « d'union circonstancielle et opportuniste », ces initiatives communes sont des instruments de la lutte pour la clarification et la délimitation des positions au sein de la Gauche communiste, parce qu'elles établissent un cadre concret et militant (l'engagement aux côtés de la classe ouvrière face à des situations importantes de l'évolution historique) dans lequel il est possible de débattre sérieusement des divergences. Ce fut la méthode de Marx et de Lénine à Zimmerwald. Alors qu'il existait des divergences beaucoup plus importantes que celles qui peuvent exister aujourd'hui entre le CCI et le BIPR, Lénine a accepté de souscrire au Manifeste de Zimmerwald. D'autre part, au moment de la constitution de la 3e Internationale, il y avait entre les fondateurs des désaccords importants, non seulement sur l'analyse de la guerre impérialiste, mais aussi sur des questions comme l'utilisation du parlement ou des syndicats et pourtant, cela ne les empêcha pas de s'unir pour combattre pour la révolution mondiale qui était en marche. Ce combat en commun ne fut pas le moyen de faire taire les divergences, mais au contraire donna la plate-forme militante au sein de laquelle les aborder de façon sérieuse et non de façon académique, ou selon des impulsions sectaires.
La fonction de la guerre impérialiste
Les divergences entre Le BIPR et le CCI ne portent pas sur les causes générales de la guerre impérialiste. Nous en tenant au patrimoine commun de la Gauche communiste, nous voyons la guerre impérialiste comme expression de la crise historique du capitalisme. Cependant, la divergence surgit au moment de voir le rôle de la guerre au sein du capitalisme décadent. Le BIPR pense que la guerre remplit une fonction économique : permettre une dévalorisation du capital et, en conséquence, ouvrir la possibilité que le capitalisme entreprenne un nouveau cycle d'accumulation.
Cette appréciation paraît complètement logique : n'y a-t-il pas, avant une guerre mondiale, une crise générale, comme en 1929 par exemple ? Crise de surproduction d'hommes et de marchandises. La guerre impérialiste n'est-elle pas une « solution » en détruisant en grand nombre des ouvriers, des machines et des bâtiments ? Après cela, la reconstruction ne reprend-elle pas et, avec elle, le dépassement de la crise ? Pourtant, cette vision, apparemment si simple et cohérente, est profondément superficielle. Elle saisit - comme nous verrons plus loin - une partie du problème (effectivement, le capitalisme décadent se meut dans un cycle infernal de crise - guerre - reconstruction -nouvelle crise, etc) mais cela n'aborde pas le fond du problème : d'une part, la guerre est beaucoup plus qu'un simple moyen de rétablissement du cycle de l'accumulation capitaliste et, d'autre part, ce cycle se trouve profondément perverti et dégénéré, et il est très loin d'être un cycle classique de la période ascendante.
Cette vision superficielle de la guerre impérialiste a des conséquences militantes importantes que le BIPR n'est pas capable de percevoir. En effet, si la guerre permet de rétablir le mécanisme de l'accumulation capitaliste, en réalité cela veut dire que le capitalisme pourra toujours sortir de la crise à travers le mécanisme douloureux et brutal de la guerre. C'est la vision, qu'au fond, nous propose la bourgeoisie : la guerre est un moment horrible que n'apprécie aucun gouvernant, mais c'est le moyen inévitable qui permet de retrouver une nouvelle ère de paix et de prospérité.
Le BIPR dénonce ces supercheries mais il ne se rend pas compte que cette dénonciation se trouve affaiblie par sa théorie de la guerre comme « moyen de dévalorisation du capital ». Pour comprendre les conséquences dangereuses qu'entraîné sa position, il faut examiner cette déclaration du PCI (Programma) : « La crise tire son origine de l'impossibilité de poursuivre l'accumulation, impossibilité qui se manifeste quand l'accroissement de la masse de production ne réussit plus à compenser la chute du taux de profit. La masse du surtravail total n'est plus à même d'assurer du profit au capital avancé, de reproduire les conditions de rentabilité des investissements. En détruisant du capital constant (travail mort) à grande échelle, la guerre joue alors un rôle économique fondamental : grâce aux épouvantables destructions de l'appareil productif, elle permet en effet une future expansion gigantesque de la production pour remplacer ce qui a été détruit, donc une expansion parallèle du profit, de la plus-value totale, c'est-à-dire du surtravail dont est friand le capital. Les conditions de reprise du processus d'accumulation sont rétablies. Le cycle économique repart. (...) Le système capitaliste mondial, entre vieux dans la guerre, mais y trouve un bain de jouvence dans le bain de sans qui lui donne une nouvelle jeunesse et il en ressort avec la vitalité d'un robuste nouveau-né. » ([4] [245])
Dire que le capitalisme « retrouve la jeunesse » chaque fois qu'il sort d'une guerre mondiale comporte quelques claires conséquences révisionnistes : la guerre mondiale ne mettrait pas à l'ordre du jour la nécessité de la révolution prolétarienne mais la reconstruction d'un capitalisme revenu à ses origines. C'est mettre par terre l'analyse de la 3e Internationale qui disait clairement : « une nouvelle époque surgit. Epoque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. Epoque de la révolution communiste du prolétariat. » Cela signifie, purement et simplement, rompre avec une position fondamentale du marxisme : le capitalisme n'est pas un système éternel, mais un mode de production auquel les limites historiques imposent une époque de décadence dans laquelle la révolution communiste est à l'ordre du jour.
Cette déclaration, nous la citons et nous la critiquons dans notre polémique sur la conception de la guerre et de la décadence du PCI (Programma) dans la Revue Internationale n° 77 et 78. Cela est ignoré par le BIPR qui, dans sa réponse, semble défendre le PCI (Programma) quand il affirme : « Leur débat avec les bordiguistes se centre sur un point de vue apparent selon lequel il existe un rapport mécanique entre guerre et cycle d'accumulation. Nous disons "apparent" parce que, comme d'habitude, le CCI ne donne aucune citation montrant que la vision historique des bordiguistes serait aussi schématique. Nous sommes peu enclins à accepter leurs assertions sur Programme Communiste au vu de la manière dont ils interprètent nos points de vue. » ([5] [246])
La citation que nous donnons dans la Revue Internationale n° 77 parle d'elle-même et met en évidence que, dans la position du PCI (Programma), il y a un peu plus que du « schématisme » : si le BIPR prend la tangente avec des pleurnicheries sur nos « mauvaises interprétations » c'est parce que, sans oser reprendre les aberrations du PCI (Programma), ses ambiguïtés y conduisent : « Nous disons, nous, que la fonction (souligné dans l'original) économique de la guerre mondiale (c'est-à-dire ses conséquences pour le capitalisme) est de dévaloriser le capital comme prélude nécessaire pour un possible nouveau cycle d'accumulation. » ([6] [247])
Cette vision de la «fonction économique de la guerre impérialiste » vient de Boukharine. Celui-ci, dans un livre qu'il écrivit en 1915 (L'économie mondiale et l’impérialisme) et qui constitue un apport sur des questions comme le capitalisme d'Etat ou la libération nationale, glisse cependant vers une erreur importante en voyant les guerres impérialistes comme un instrument de développement capitaliste : « la guerre ne peut arrêter le cours général du développement du capitalisme mondial mais, au contraire, elle est l'expression de l'expansion au maximum du processus de centralisation... La guerre rappelle, par son influence économique, sur beaucoup d'aspects, les crises industrielles desquelles elle se distingue, de beaucoup, par l'intensité supérieure des commotions et des ravages qu'elle produit. » ([7] [248])
La guerre impérialiste n'est pas un moyen de « dévalorisation du capital » mais une expression du processus historique de destruction, de stérilisation de moyens de production et de vie, qui caractérise globalement le capitalisme décadent.
Destruction et stérilisation de capital n'est pas la même chose que dévalorisation de capital. La période ascendante du capitalisme comportait des crises cycliques périodiques qui conduisaient à des dévalorisations périodiques de capitaux. C'est le mouvement signalé par Marx : « En même temps que baisse le taux de profit, la masse de capital s'accroît. Parallèlement se produit une dépréciation du capital existant qui arrête cette baisse et imprime un mouvement plus rapide à l'accumulation de valeur-capital. .. La dépréciation périodique du capital existant, qui est un moyen immanent au mode de production capitaliste, d'arrêter la baisse du taux de profit et d'accélérer l'accumulation de valeur-capital par la formation de capital neuf, perturbe les conditions données, dans lesquelles s'accomplissent les procès de circulation et de reproduction du capital et, par suite, s'accompagne de brusques interruptions et de crises du procès de production. » ([8] [249])
Le capitalisme, par sa nature même, depuis ses origines, aussi bien dans la période ascendante que dans la période décadente, tombe constamment dans la surproduction et, en ce sens, les périodes de ponction de capital lui sont nécessaires pour reprendre avec plus de force son mouvement normal de production et de circulation de marchandises. Dans la période ascendante, chaque étape de dévalorisation de capital se résolvait par une expansion à une échelle supérieure des rapports de productions capitalistes. Et cela était possible parce que le capitalisme trouvait des nouveaux territoires pré-capitalistes qu'il pouvait intégrer dans sa sphère et soumettre aux rapports salariaux et mercantiles qui lui sont propres. Pour cette raison « les crises du 19e siècle que Marx décrit sont encore des crises de croissance, des crises dont le capitalisme sort à chaque fois renforcé... Après chaque crise, il y a encore des débouchés nouveaux à conquérir par les pays capitalistes. » ([9] [250])
Dans la période décadente, ces crises de dévalorisation du capital se poursuivent et deviennent plus ou moins chroniques ([10] [251]). Cependant, à cet aspect inhérent et consubstantiel du capitalisme, se superpose une autre caractéristique de sa période de décadence et qui est le fruit de l'aggravation extrême des contradictions que contient cette époque : la tendance à la destruction et à la stérilisation de capital.
Cette tendance provient de la situation de blocage historique qui détermine l'époque de décadence du capitalisme : « Qu'est-ce que la guerre impérialiste mondiale ? C'est la lutte par des moyens violents, à laquelle sont obligés de se livrer les différents groupes capitalistes, non pour conquérir de nouveaux marchés et sources de matières premières, mais pour le repartage de ceux qui existent, un repartage au bénéfice de certains et au détriment des autres. Le cours à la guerre s'ouvre, et a ses racines, dans la crise économique générale et permanente qui éclate, et marque par là la fin des possibilités de développement à laquelle a conduit le régime capitaliste. » Dans le même sens « le capitalisme décadent est la phase dans laquelle la production ne peut plus continuer qu'à condition (souligné dans l'original) de prendre la forme matérielle de produits et moyens de production qui ne servent pas au développement et à l'amplification de la production mais à sa limitation et à sa destruction. » ([11] [252])
Dans la décadence, le capitalisme ne change, en aucune façon, de nature. Il continue à être un système d'exploitation, il continue d'être affecté (à une échelle bien supérieure) par la tendance à la dépréciation du capital (tendance qui devient permanente). Cependant, l'essentiel de la décadence est le blocage historique du système duquel naît une tendance puissante à l'autodestruction et au chaos : « L'absence d'une classe révolutionnaire présentant la possibilité historique d'engendrer et de présider à l'instauration d'un système économique correspondant à la nécessité historique, conduit la société et sa civilisation à une impasse où l'écroulement, l'effondrement interne, sont inévitables. Marx donnait comme exemples d'une telle impasse historique les civilisations Grecque et Romaine dans l'antiquité. Engels, appliquant cette thèse à la société bourgeoise, arrive à la conclusion que l'absence ou l'incapacité du prolétariat appelé à résoudre, dépasser, les contradictions antithétiques qui surgissent de la société capitaliste, ne peut aboutir qu'au retour à la barbarie. » ([12] [253])
La position de l'Internationale Communiste sur la guerre impérialiste
Le BIPR ironise sur notre insistance sur ce trait crucial du capitalisme décadent : « Pour le CCI tout se réduit au "chaos" et à la "décomposition" et avec eux on n'a pas besoin de trop s'embarrasser d'une analyse détaillée des choses. C'est la clé de leur position. » ([13] [254]) Nous reviendrons sur cette question, cependant, nous voulons préciser sur cette accusation de simplisme que, ce qu'elle suppose de l'avis du BIPR (une négation du marxisme comme méthode d'analyse de la réalité!), ce dernier devrait l'appliquer au 1er congrès de l'IC, à Lénine et à Rosa Luxemburg.
Ce n'est pas l'objet de cet article de mettre en évidence les limites de la position de l'IC ([14] [255]), mais de nous appuyer sur les points clairs de celle-ci. En examinant les documents fondateurs de l'Internationale Communiste, nous y voyons des indications claires rejetant l'idée de la guerre comme « solution » à la crise capitaliste et la vision d'un capitalisme d'après-guerre qui fonctionne « normalement » suivant les cycles d'accumulation propres à sa période d'ascendance.
« La politique de paix de l'Entente dévoile ici définitivement aux yeux du prolétariat international la nature de l'impérialisme de l'Entente et de l'impérialisme en général. Elle prouve en même temps que les gouvernements impérialistes sont incapables de conclure une paix 'juste et durable" et que le capital financier est incapable de rétablir l'économie détruite. Le maintien de la domination du capital financier mènerait soit à la destruction totale de la société civilisée ou à l'augmentation de l'exploitation, de l'esclavage, de la réaction politique, des armements et finalement à de nouvelles guerres destructrices. » ([15] [256])
L'IC établit clairement que le capital ne peut pas rétablir l'économie détruite, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rétablir, par la guerre, un cycle d'accumulation « normal », sain, qu'il ne peut pas trouver en somme une « nouvelle jeunesse » comme le dit le PCI (Programma). Qui plus est, au lieu provoquer un « rétablissement », cette situation profondément viciée et altérée permet le développement « des armements, de la réaction politique, de l'accroissement de l'exploitation. »
Dans le Manifeste du 1er congrès, l'IC explique que : « La répartition des matières premières, l'exploitation du naphte de Bakou ou de Roumanie, de la houille du Donetz, du froment d'Ukraine, l'utilisation des locomotives, des wagons et des automobiles d'Allemagne, l'approvisionnement en pain et en viande de l'Europe affamée, toutes ces questions fondamentales de la vie économiques du monde ne sont plus réglées par la libre concurrence, ni même par des combinaisons de trusts ou de consortiums nationaux et internationaux. Elles sont tombées sous le joug de la tyrannie militaire pour lui servir de sauvegarde désormais. Si l'absolue sujétion du pouvoir politique au capital financier a conduit l'humanité à la boucherie impérialiste, cette boucherie a permis au capital financier, non seulement de militariser jusqu'au bout l'Etat, mais de se militariser lui-même, de sorte au 'il ne peut plus remplir ses fonctions essentielles que par le fer et le sang. » ([16] [257])
La perspective que trace l'IC est celle d'une « militarisation de l'économie »; question que toutes les analyses marxistes mettent en évidence comme expression de l'aggravation des contradictions capitalistes et non comme leur allégement ou leur relativisation, fussent-elles momentanées (le BIPR dans sa réponse rejette le militarisme comme moyen d'accumulation). De même l'IC insiste sur le fait que l'économie mondiale ne peut revenir à la période libérale ni même à celle des trusts, et finalement exprime une idée très importante : « le capitalisme ne put déjà plus remplir ses fonctions économiques essentielles si ce n'est au moyen du fer et du sang. » Cela ne peut s'interpréter que d'une manière : à travers la guerre mondiale, le mécanisme de l'accumulation ne peut plus fonctionner normalement, pour le faire il a besoin « du fer et du sang ».
La perspective que l'IC retient pour l'après-guerre c'est l'aggravation des guerres : « Les opportunistes qui, avant la guerre, invitaient les ouvriers à modérer leurs revendications sous le prétexte du passage progressif au socialisme et qui, pendant la guerre, les ont obligés à renoncer à la lutte de classe au nom de l'Union Sacrée et de la défense nationale, exigent du prolétariat un nouveau sacrifice, cette fois avec la proposition d'en finir avec les conséquences horribles de la guerre. Si de telles prêches parvenaient à influencer les masses ouvrières, le développement du capitalisme se poursuivrait, sacrifiant de nombreuses générations sous des formes nouvelles de sujétion, encore plus concentrées et plus monstrueuses, avec la perspective fatale d'une nouvelle guerre mondiale. » ([17] [258])
Ce fut une tragédie historique que l'IC ne développe pas ce corps d'analyse clair et que, de plus, dans son étape de dégénérescence, elle le contredise ouvertement avec des positions insinuant la conception d'un capitalisme « revenu à la normale », réduisant les analyses sur le déclin et la barbarie du système à de simples proclamations rhétoriques. Cependant, la tâche de la Gauche communiste consiste à préciser et à détailler ces lignes générales léguées par l'IC et il est clair que, des citations ci-dessus, ne se dégage pas une orientation qui va dans le sens d'un capitalisme qui revient à un cycle constant d'accumulation -crise - guerre dévalorisante - nouvelle accumulation... mais bien dans le sens d'une économie mondiale profondément altérée, incapable de retrouver les conditions normales de l'accumulation et à deux doigts de nouvelles convulsions et destructions.
L'irrationalité de la guerre impérialiste
Cette sous-estimation de l'analyse fondamentale de l'IC (et de Rosa Luxemburg et Lénine) est manifeste dans le rejet, par le BIPR, de notre notion de l'irrationalité de la guerre : « Mais l'article du CCI altère la signification de cette affirmation (de la fonction de la guerre, ndt) parce que leur commentaire suivant est que cela signifierait que nous serions d'accord avec le fait qu'"i\ y a une rationalité dans le phénomène de la guerre mondiale". Cela impliquerait que nous voyons la destruction de valeurs comme l'objectif du capitalisme, c'est-à-dire que ce serait la cause (souligné dans l'original) directe de la guerre. Mais les causes ne sont pas la même chose que les conséquences. La classe dominante des Etats impérialistes ne va pas à la guerre consciemment pour dévaloriser le capital. » ([18] [259])
Dans la période ascendante du capitalisme, les crises cycliques ne sont pas provoquées consciemment par la classe dominante. Pourtant, les crises cycliques ont une « rationalité économique » : elles permettent de dévaloriser le capital et, en conséquence, de reprendre l'accumulation capitaliste à un autre niveau. Le BIPR pense que les guerres mondiales de la décadence remplissent un rôle de dévalorisation du capital et de reprise de l'accumulation. C'est-à-dire qu'il leur attribue une rationalité économique de nature similaire à celle des crises cycliques de la période ascendante.
Et c'est là justement l'erreur centrale comme nous en avions averti la CWO voilà seize ans, dans notre article « Théories économiques et lutte pour le socialisme » : « On peut voir l'erreur de Boukharine répétée dans l'analyse de la CWO : "Chaque crise mène (à travers la guerre) à une dévalorisation du capital constant, élevant ainsi le taux de profit et permettant au cycle de reconstruction - le boom, dépression, guerre - de se répéter encore." RP n° 6. Ainsi pour la CWO, les crises du capitalisme décadent sont vues en terme économique, comme les crises cycliques du capitalisme ascendant répétées au plus, haut niveau.» ([19] [260])
Le BIPR situe la différence entre ascendance et décadence uniquement dans l'amplitude des interruptions périodiques du cycle de l'accumulation : « Les causes de la guerre viennent des efforts de la bourgeoisie pour défendre ses valeurs de capital face à celles de ses rivales. Sous le capitalisme ascendant de telles rivalités s'expriment au niveau économique et entre firmes rivales. Celles qui peuvent atteindre un niveau de concentration de capital plus élevé (tendance capitaliste à la concentration et au monopole) sont en position de pousser leurs concurrents contre le mur. Cette rivalité conduit aussi à une sur-accumulation de capital qui débouchait sur les crises décennales du 20e siècle. Le capitalisme pouvait se dévaloriser à chaque crise et ainsi une nouvelle phase d'accumulation pouvait recommencer, bien que le capital soit plus centralisé et concentré... A l'époque du capitalisme monopoliste, dans laquelle la concentration a atteint le niveau de l'Etat national, l'économique et le politique s'interpénètrent dans l'étape décadente ou impérialiste du capitalisme. A cette époque, les politiques que requiert la défense des intérêts du capital impliquent les Etats eux-mêmes et aboutissent à des rivalités entre les puissances impérialistes. » ([20] [261]) Comme conséquence de cela « les guerres impérialistes n'ont pas des objectifs aussi limités (que ceux de la période ascendante, ndt). La bourgeoisie,... une fois embarquée dans la guerre, la fait jusqu'à l'anéantissement d'une nation ou d'un bloc de nations. Les conséquences de la guerre ne se limitent pas à une destruction physique de capital, mais aussi à une dévalorisation massive du capital existant. » ([21] [262])
Au fond de cette analyse, il y a une forte tendance à l'économisme qui ne conçoit la guerre que comme un produit immédiat et mécanique de l'évolution économique. Dans l'article de la Revue Internationale n° 79, nous montrions que la guerre a une cause économique globale (la crise historique du capitalisme), mais cela n'implique pas que chaque guerre a une motivation économique immédiate et directe. Le BIPR cherche dans la guerre du Golfe une cause économique et tombe dans le terrain de l'économisme le plus vulgaire en disant que c'est une guerre pour les puits de pétrole. Il explique également la guerre yougoslave par la soif d'on ne sait quels marchés de la part des grandes puissances. ([22] [263]) II est vrai que par la suite, sous la pression de nos critiques et des évidences empiriques, il a corrigé ces analyses, mais cela ne l'a jamais conduit à remettre en cause cet économisme vulgaire qui ne peut pas concevoir la guerre sans une cause immédiate et mécanique de type « économique ». ([23] [264])
Le BIPR confond rivalité commerciale et rivalité impérialiste, qui ne sont pas nécessairement identiques. La rivalité impérialiste a pour cause fondamentale une situation économique de saturation du marché mondial, mais cela ne veut pas dire qu'elle a pour origine directe la simple concurrence commerciale. Son origine est économique, stratégique et militaire, et en elle se concentrent des facteurs historiques et politiques.
De même, dans la période ascendante du capitalisme, les guerres (de libération nationale ou coloniales) si elles ont bien une finalité économique globale (la constitution de nouvelles nations ou l'expansion du capitalisme à travers la formation de colonies) ne sont pas dictées directement par des rivalités commerciales. Par exemple, la guerre franco-prussienne avait des origines dynastiques et stratégiques mais ne venait ni d'une crise commerciale insoluble pour aucun belligérants ni d'une particulière rivalité commerciale. Cette question, le BIPR est capable de la comprendre jusqu'à un certain point quand il dit : « Même si les guerres post-napoléoniennes du 19e siècle avaient leurs horreurs (comme le voit correctement le CCI) la véritable différence était qu'on luttait pour des objectifs spécifiques qui permettaient d'arriver à des solutions rapides et négociées. La bourgeoisie du 19e siècle avait encore la mission programmatique de détruire les résidus du vieux mode de production et de créer de véritables nations. » ([24] [265]) De plus, il voit très bien la différence avec la période décadente : « le coût d'un développement capitaliste supérieur des forces productives n'est pas inévitable. De plus, ce coût a atteint une telle échelle qu'il a causé la destruction de la vie civilisée aussi bien à court terme (milieu ambiant, famines, génocides) qu'à long terme (guerre impérialiste généralisée). » ([25] [266])
Les constatations sont correctes et nous les partageons pleinement, mais nous devons leur poser une question très simple : que signifie le fait que les guerres de la décadence ont des « objectifs totaux » et que le prix du maintien du capitalisme peut aller jusqu'à supposer la destruction de l'humanité ? Est-ce que ces situations de convulsion et de destruction, dont le BIPR reconnaît qu'elles sont qualitativement différentes de celles de la période ascendante, peuvent correspondre à une situation économique de reproduction normale et saine des cycles d'accumulation du capital, qui seraient identiques à celle de la période ascendante ?
La maladie mortelle du capitalisme décadent, le BIPR la situe seulement dans les moments de guerre généralisée, mais ne la voit pas dans les moments d'apparente normalité, dans les périodes où, selon lui, se développe le cycle d'accumulation du capital. Cela le conduit à une dangereuse dichotomie : d'un côté il conçoit des époques de développement des cycles normaux d'accumulation du capital où nous assistons à une croissance économique réelle, où se produisent des « révolutions technologiques », où le prolétariat croît. Dans ces époques de pleine vigueur du cycle d'accumulation, le capitalisme paraît revenir à ses origines, sa croissance semble le montrer dans une position analogue à celle de sa jeunesse (cela, le BIPR n'ose pas le dire, tandis que le PCI (Programma) le dit ouvertement). D'un autre côté, il y a les époques de guerre généralisée dans lesquelles la barbarie du capitalisme décadent se manifeste dans toute sa brutalité et toute sa violence.
Cette dichotomie rappelle fortement celle qu'exprimait Kautsky avec sa thèse du « super-impérialisme » : d'un côté il reconnaissait que, à travers la 1ère guerre mondiale, le capitalisme était entré dans une période où pouvaient se produire de grandes catastrophes et convulsions mais, en même temps, il établissait qu'il y avait une tendance « objective » à la concentration suprême du capitalisme en un grand trust impérialiste qui permettrait un capitalisme pacifique. Dans l'introduction au livre de Boukharine déjà cité (L'économie mondiale et l'impérialisme), Lénine dénonçait cette contradiction centriste de Kautsky : « Kautsky s'est promis d'être marxiste dans l'époque des graves conflits et des catastrophes qu'il s'est vu contraint de prévoir et de définir très nettement quand, en 1909, il a écrit son œuvre sur ce thème. Maintenant qu'il est absolument hors de doute que cette période est arrivée, Kautsky se contente de continuer à promettre d'être marxiste dans une époque future, qui n'arrivera peut-être jamais, celle du super-impérialisme. En un mot, il promet d'être marxiste, quand on voudra, mais dans une autre époque, pas à présent, dans les conditions actuelles, dans l'époque que nous vivons.»
Nous nous gardons bien de dire qu'il arrivera la même chose au BIPR. L'analyse marxiste de la décadence du capitalisme, il la garde jalousement pour la période où la guerre éclate, tandis que pour la période d'accumulation il se permet une analyse qui fait des concessions aux mensonges bourgeois sur la « prospérité » et la « croissance » du système.
La sous-estimation de la gravité du processus de décomposition du capitalisme
Cette tendance à garder l'analyse marxiste de la décadence pour la période de la guerre généralisée explique la difficulté qu'a le BIPR à comprendre l'étape actuelle de la crise historique du capitalisme : « Le CCI a été conséquent depuis sa fondation voilà 20 ans en laissant de côté toute tentative d'analyse sur la façon dont le capitalisme s'est conduit dans la crise actuelle. Il pense que toute tentative de voir les traits spécifiques de la crise présente revient à dire que le capitalisme a résolu la crise. Il ne s'agit pas de cela. Ce qui incombe aux marxistes actuellement c'est d'essayer de comprendre pourquoi la crise présente dépasse en durée la Grande Dépression de 1873-96. Mais, tandis que cette dernière était une crise alors que le capitalisme entrait dans sa phase monopoliste et qu'il était encore possible de la résoudre par une simple dévalorisation économique, la crise actuelle menace l'humanité d'une catastrophe beaucoup plus grande. » ([26] [267])
II n'est pas certain que le CCI ait renoncé à analyser les détails de la crise présente. Le BIPR peut s'en convaincre en étudiant les articles que nous publions régulièrement, dans chaque numéro de la Revue Internationale, sur la crise dans tous ses aspects. Pour nous, la crise ouverte en 1967 est la réapparition de façon ouverte d'une crise chronique et permanente du capitalisme en décadence, c'est la manifestation d'un freinage profond et toujours plus incontrôlable du mécanisme d'accumulation capitaliste. Les « traits spécifiques » de la crise actuelle constituent les diverses tentatives du capital, à travers le renforcement de l'intervention de l'Etat, la fuite en avant dans l'endettement et les manipulations monétaires et commerciales, pour éviter une explosion incontrôlable de sa crise de fond et, en même temps, la mise en évidence de l'échec de telles remèdes et leurs effets pervers qui aggravent encore plus le mal incurable du capitalisme.
Le BIPR voit comme la «grande tâche » des marxistes d'expliquer la longue durée de la crise actuelle. Cela ne nous surprend pas qu'il soit étonné par la durée de la crise, dans la mesure où il ne comprend pas le problème de fond : nous n'assistons pas à la fin d'un cycle d'accumulation mais à une situation historique de blocage prolongé, d'altération profonde du mécanisme d'accumulation, une situation, comme disait l'IC, où le capitalisme ne peut plus assurer ses fonctions économiques essentielles autrement que par le fer et le sang.
Ce problème de fond qu'a le BIPR le conduit à ironiser une fois de plus à propos de notre position sur la situation historique actuelle de chaos et de décomposition du capitalisme : « Même si on peut être d'accord sur le fait qu'il y a des tendances à la décomposition et au chaos (vingt ans après la fin du cycle d'accumulation, il est difficile de voir comment il pourrait en être autrement) celles-ci ne peuvent être utilisées comme slogans pour éviter une analyse concrète de ce qui se passe. » ([27] [268])
Comme on le voit, ce qui préoccupe le plus le BIPR c'est notre supposé « simplisme », une sorte de « paresse intellectuelle » qui trouverait refuge dans des cris radicaux sur la gravité et le chaos de la situation du capitalisme, comme un tic pour ne pas engager une analyse concrète de ce qui est en train de se passer.
La préoccupation du BIPR est juste. Les marxistes ne se gênent pas et nous ne nous gênons pas (c'est une de nos obligations dans le combat du prolétariat) pour analyser en détails les événements en évitant de tomber dans les généralités rhétoriques dans le style du « marxisme orthodoxe » de Longuet en France ou des imprécisions anarchistes qui réconfortent mais qui, dans les moments décisifs, conduisent à de graves divagations opportunistes, si ce n'est à des trahisons éhontées.
Cependant, pour pouvoir faire une analyse concrète de « ce qui se passe », il faut avoir un cadre global clair, et c'est sur ce terrain que le BIPR a des problèmes. Comme il ne comprend pas la gravité et la profondeur des altérations et le degré de dégénérescence et des contradictions du capitalisme dans les « moments normaux », dans les phases du cycle d'accumulation, tout le procès de décomposition et de chaos du capitalisme mondial qui s'est considérablement accéléré avec l'effondrement du bloc de l'Est en 1989, leur échappe des mains, il est incapable de le comprendre.
Le BIPR devrait se rappeler les stupidités lamentables qu'il a dit au moment de l'effondrement des pays staliniens, spéculant sur les «fabuleux marchés » que ces champs de ruines pourraient offrir aux pays occidentaux et croyant qu'ils apporteraient un allégement de la crise capitaliste. Par la suite, face au poids de l'évidence empirique et grâce à nos critiques, le BIPR a corrigé ses erreurs. Cela est très bien et montre son sens des responsabilités et son sérieux face au prolétariat. Mais le BIPR devrait aller au fond des choses. Pourquoi tant de gaffes ? Pourquoi doit-il changer sous la pression des faits eux-mêmes ? Quelle est cette avant-garde qui doit changer de position à la suite des événements, incapable, à chaque fois, de les prévoir ? Le BIPR devrait étudier attentivement les documents où nous avons exposé les lignes générales du processus de décomposition du capitalisme. ([28] [269]) II constaterait qu'il n'y a pas de problème de « simplisme » de notre part mais du retard et de l'incohérence de la sienne.
Ces problèmes trouvent une nouvelle démonstration dans la spéculation suivante : « Une preuve de plus de l'idéalisme du CCI est l'accusation finale qu'il porte au Bureau qui "n'a pas une vision unitaire et globale de la guerre" ce qui conduirait à 'l'aveuglement et l'irresponsabilité" (sic) de ne pas voir qu'une prochaine guerre pourrait signifier "rien de moins que l'anéantissement complet de la planète". Le CCI pourrait avoir raison, encore qu'il nous plairait de connaître les bases scientifiques de cette prévision. Nous-mêmes avons toujours dit que la prochaine guerre menaçait l'existence de l'humanité. Cependant, il n'y a pas de certitude absolue de cette destruction totale de tout ce qui existe. La prochaine guerre impérialiste pourrait ne pas aboutir à la destruction finale de l'humanité. Il y a des armes de destruction massive qui n'ont pas été utilisées dans les conflits antérieurs (comme par exemple les armes chimiques ou biologiques) et il n'y a pas de garantie qu'un holocauste nucléaire pourrait embraser toute la planète. En fait, les préparatifs actuels des puissances impérialistes comprennent l'élimination des armes de destruction massive en même temps que se développent les armes conventionnelles. Même la bourgeoisie comprend qu'une planète détruite ne sert à rien (même si les forces qui mènent à la guerre et la nature de la guerre échappent, en dernière instance, à son contrôle). » ([29] [270])
Le BIPR devrait apprendre un peu de l'histoire : pendant la 1ère guerre mondiale, toutes les armées ont employé les forces maximum de destruction, on chercherait vainement un génie plus meurtrier. Pendant la 2e guerre mondiale, alors que l'Allemagne était déjà vaincue il y eu les bombardements massifs de Dresde, utilisant les bombes incendiaires et à fragmentation et enuite, contre le Japon, lui aussi vaincu, les Etats-Unis utilisèrent la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Par la suite, la masse de bombes qui en 1971 est tombée sur Hanoi en une nuit dépassait la masse de bombes tombée sur l'Allemagne pendant toute l'année 1945. A son tour, le « tapis de bombes » que les « alliés » ont largué sur Bagdad a battu le triste record de Hanoi. Dans la même guerre du Golfe, ont été testées, par l'expérimentation sur les propres soldats nord-américains, de nouvelles armes de type nucléaire-conventionnel et chimique. On commence à savoir maintenant que les Etats-Unis ont fait, dans les années 1950, des expérimentations d'armes bactériologiques sur leur propre population... Et, face à cette masse d'évidences qu'on peut lire dans une quelconque publication bourgeoise, le BIPR a la bêtise et l'ignorance de spéculer sur le degré de contrôle de la bourgeoisie, sur son « intérêt » à éviter un holocauste total ! De manière suicidaire le BIPR rêve que soient utilisées des armes « moins destructrices » alors que 80 années d'histoire prouvent l'exact contraire.
Dans cette spéculation stupide le BIPR non seulement ne comprend pas la théorie, mais encore ignore superbement l'évidence écrasante et répétée des fait. Il devrait comprendre le caractère gravement erroné et révisionniste de ces illusions stupides de petits-bourgeois impuissants qui cherchent à s'en tirer coûte que coûte, sous prétexte que « la bourgeoisie elle-même comprend qu'une planète détruite ne sert à rien. »
Le BIPR doit dépasser le centrisme, les oscillations entre une position cohérente sur la guerre et la décadence du capitalisme et les théorisations spéculatives, que nous avons critiquées, sur la guerre comme moyen de dévalorisation du capital et de reprise de l'accumulation. En effet ces erreurs conduisent le BIPR à ne pas considérer et prendre au sérieux comme instrument cohérent d'analyse ce qu'il dit lui-même : « même si les forces qui mènent à la guerre et la nature de la guerre échappent, en dernière instance, à son contrôle. »
Cette phrase est pour le BIPR une simple parenthèse rhétorique alors que, s'il veut être pleinement fidèle à la Gauche communiste et comprendre la réalité historique, il devra la prendre pour guide d'analyse, pour axe de réflexion pour comprendre concrètement les faits et les tendances historiques du capitalisme actuel.
Adalen
[1] [271] Dans sa réponse, le BIPR développe d'autres questions, comme celle d'une conception particulière du capitalisme d'Etat, que nous ne traiterons pas ici.
[2] [272] Voir Revue Internationale n° 77 et 78 : « Le rejet de la notion de décadence conduit à la démobilisation du prolétariat face à la guerre ».
[3] [273] Le BIPR affirme son accord avec notre position, mais au lieu de reconnaître l'importance et les conséquences de cette convergence d'analyse, il réagit de façon sectaire et nous accuse d'être malhonnête dans la manière de prendre position contre l'erreur commise par Rosa Luxemburg sur « le militarisme comme secteur de l'accumulation du capital ». En réalité, comme nous le montrerons plus loin, la compréhension du fait que le militarisme n'est pas un moyen d'accumulation du capital est un argument en faveur de notre thèse fondamentale sur le freinage croissant de l'accumulation dans la période de décadence, et non un démenti de cette thèse. D'autre part, le BIPR se trompe quand il dit que c'est grâce à sa critique que nous avons changé de position sur la question du militarisme. Il devrait lire les documents de nos prédécesseurs (la Gauche Communiste de France) qui ont contribué de façon fondamentale à l'analyse de l'économie de guerre à partir d'une critique systématique de l'idée de Ver-cesi sur « la guerre comme solution à la crise capitaliste ». Voir « Le renégat Vercesi », 1944.
[4] [274] PC n° 90 page 24, cité dans la Revue Internationale n° 77.
[5] [275] « Les Bases Matérielles de la Guerre Impérialiste », Internationalist Communist Review n° 13, p. 29.
[6] [276] « Les Bases Matérielles de la Guerre Impérialiste », Internationalist Communist Review n° 13, p. 29.
[7] [277] Traduit par nous de l'édition espagnole
[8] [278] Le Capital, Livre III, section 3, chapitre 15.
[9] [279] « Les théories des crises, de Marx à l'Internationale communiste », Revue Internationale n° 22.
[10] [280] Voir l'article polémique avec le BIPR dans la Revue Internationale n° 79, paragraphe « La nature des cycles d'accumulation dans la décadence du capitalisme ».
[11] [281] .«Le renégat Vercesi », mai 1944 dans le Bulletin international de la Fraction Italienne de la Gauche Communiste n° 5. 11.
[12] [282] . Idem
[13] [283] « Les Bases Matérielles de la Guerre Impérialiste », p. 30.
[14] [284] L'IC, à son premier congrès, considérait comme tâche urgente et prioritaire de pousser en avant les tentatives révolutionnaires du prolétariat mondial et de regrouper ses forces d'avant-garde. En ce sens, son analyse sur la guerre et l'après-guerre, sur l'évolution du capitalisme, etc., ne pouvait pas aller plus loin que l'élaboration de quelques lignes générales. Le cours postérieur des événements, la défaite du prolétariat et la progression rapide de la gangrène opportuniste au sein de PIC, ont conduit à contrecarrer ces lignes générales et les tentatives d'élaboration théorique (en particulier la polémique de Boukharine contre Rosa Luxemburg dans son livre L'impérialisme et l'accumulation du capital en 1924) et ont constitué une régression brutale par rapport à la clarté des deux premiers congrès.
[15] [285] « Thèses sur la situation internationale et la politique de l'Entente », documents du 1er congrès de l’IC
[16] [286] . Idem.
[17] [287] . Idem.
[18] [288] . « Les Bases Matérielles de la Guerre Impérialiste », p. 29.
[19] [289] . Revue Internationale n° 16 p.14-15.
[20] [290] . « Les Bases Matérielles de la Guerre Impérialiste », p.29-30.
[21] [291] . Idem.
[22] [292] Voir « Le milieu politique prolétarien face à la guerre du Golfe », Revue Internationale n° 64.
[23] [293] .Battaglia Comunista de janvier 1991, à propos de la guerre du Golfe, annonçait : « la 3e guerre mondiale a commencé le 17 janvier » (jour des premiers bombardements directs des « alliés » sur Bagdad). Le n° suivant mit un voile sur cette gaffe mais, au lieu de tirer les leçons de cette erreur, persista : « en ce sens, affirmer que la guerre qui a commencé le 17 janvier marque le début du 3e conflit mondial n'est pas un accès de fantaisie, mais prend acte de ce que s'est ouverte la phase dans laquelle les conflits commerciaux, qui se sont accentués depuis le début des années 70, ne peuvent trouver de solution si ce n'est dans la guerre généralisée. » Voir Revue Internationale n°72, « Comment ne pas comprendre le développement du chaos et des conflits impérialistes », où nous analysions et critiquions ces dérapages lamentables, ainsi que d'autres.
[24] [294] « Les Bases Matérielles de la Guerre Impérialiste ».
[25] [295] . Idem.
[26] [296] . Idem.
[27] [297] . Idem.
[28] [298] . Voir Revue Internationale n° 60, « Thèses sur les pays de l'Est » au sujet de l'effondrement du stalinisme, Revue Internationale n° 62, « La décomposition du capitalisme » et Revue Internationale n° 64, « Militarisme et décomposition ».
[29] [299] . « Les Bases Matérielles de la Guerre Impérialiste », p. 36.
Courants politiques:
- TCI / BIPR [300]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Guerre [18]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 83 - 4e trimestre 1995
- 3139 lectures
Ex-YOUGOSLAVIE : un nouveau cran dans l’escalade guerriere
- 2958 lectures
Face à l’anarchie et au chaos grandissant qui caractérisent les rapports de la bourgeoisie au niveau international depuis l’effondrement du bloc de l’Est il y a six ans, on assiste à une nouvelle pression très forte des Etats-Unis, comme lors de la guerre du Golfe, pour réaffirmer leur leadership menacé et leur rôle de gendarme du « nouvel ordre mondial ». Parmi les expressions les plus significatives de cette pression, le Proche-Orient reste un terrain privilégié des manoeuvres de la bourgeoisie américaine. Les Etats-Unis profitent à la fois de leur solide tutelle sur un Etat israélien isolé dans la région, obligé de marcher derrière eux, et de la situation de dépendance d’Arafat, placé sur un siège éjectable, pour accélérer le processus de « pax americana » et renforcer leur contrôle et leur mainmise sur cette zone stratégique essentielle, plus que jamais soumise à des convulsions.
De même, le régime affaibli de Saddam Hussein se retrouve la cible favorite des manoeuvres de la Maison Blanche. La bourgeoisie américaine se prépare également à accroître sa pression militaire sur « le boucher de Bagdad » au moment où les rats quittent le navire pour rallier la Jordanie (autre solide base des intérêts américains au Moyen-Orient), en particulier deux de ses gendres dont l’un était le responsable des programmes militaires irakiens. Ce ralliement permet aux Etats-Unis de raviver le souvenir de sa démonstration de force dans la guerre du Golfe et de justifier le renfort de troupes américaines massées à la frontière koweïtienne, en relançant les rumeurs d’arsenaux d’armes bactériologiques et de préparatifs d’invasion par l’Irak du Koweït et de l’Arabie Saoudite. Mais la principale réaffirmation de cette pression reste, après trois ans d’échecs, le rétablissement spectaculaire de la situation américaine dans l’ex-Yougoslavie, zone centrale de conflits où la première puissance impérialiste ne peut se permettre d’être absente.
En fait, la multiplication et l’ampleur grandissante de ces opérations de police ne sont que l’expression d’une fuite en avant dans la militarisation du système capitaliste tout entier et de son enfoncement dans la barbarie guerrière.
Le mythe que la guerre et la barbarie qui se déchaînent dans l’ex-Yougoslavie depuis quatre ans serait une simple affaire d’affrontements interethniques entre cliques nationalistes locales est démenti de façon cinglante par la réalité.
Le nombre de frappes aériennes contre les positions serbes autour de Sarajevo et des autres « zones de sécurité », près de 3 500 « actions » en douze jours d’une opération baptisée « Deliberate Force », fait de cette opération le plus important engagement militaire de l’OTAN depuis sa création en 1949.
Les grandes puissances sont les vrais responsables du déchaînement de la barbarie
Ce sont les mêmes puissances qui n’ont cessé de pousser depuis quatre ans leurs pions les uns contre les autres sur l’échiquier yougoslave. Il n’y a qu’à remarquer la composition du « groupe de contact » qui prétend chercher les moyens de mettre un terme au conflit : les Etats-Unis, l’Allemagne, la Russie, la Grande-Bretagne et la France, pour constater que c’est tout le gratin des grandes puissances impérialistes de la planète (à l’exception du Japon et de la Chine, trop éloignés du théâtre des opérations) qui y sont représentés.
Comme nous l’avons déjà mis en évidence, « c’est l’Allemagne, en poussant la Slovénie et la Croatie à proclamer leur indépendance vis-à-vis de l’ancienne confédération yougoslave, qui a fait éclater ce pays et joué un rôle primordial dans le déclenchement de la guerre en 1991. Face à cette poussée de l’impérialisme allemand, ce sont les quatre autres puissances qui ont soutenu et encouragé le gouvernement de Belgrade à mener une contre-offensive (...) particulièrement meurtrière ». Ce sont « la France et la Grande-Bretagne, sous couvert de l’ONU, qui ont alors envoyé les plus importants contingents de Casques bleus et, sous prétexte d’empêcher les affrontements, se sont systématiquement employés à assurer le maintien du statu quo en faveur de l’armée serbe. En 1992, c’est “ le gouvernement des Etats-Unis qui s’est prononcé pour l’indépendance de la Bosnie-Herzegovine et a soutenu le secteur musulman de cette province, dans une guerre contre l’armée croate (toujours soutenue par l’Allemagne) et l’armée serbe (soutenue par la Grande-Bretagne, la France et la Russie). En 1994, c’est l’administration de Clinton qui est parvenue à imposer un accord pour la constitution d’une fédération entre la Bosnie et la Croatie contre la Serbie. A la fin de l’année, c’est sous l’égide de l’ex-président Carter, qu’a été obtenue la signature d’une trêve entre la Bosnie et la Serbie (...) Mais malgré des négociations où l’on a retrouvé tous les différends entre grandes puissances, aucun accord n’a été atteint. Ce qui ne pouvait être obtenu par la négociation, devait donc l’être par la force militaire. Il est clair que l’invasion d’une partie de la Krajina occidentale par la Croatie, au début du mois de mai, ainsi que la reprise des combats en divers points du front ou le déclenchement au même moment d’une offensive de l’armée bosniaque ont été entreprises avec l’accord et à l’initiative des gouvernements américain et allemand. » ([1] [302]). La réaction du camp adverse n’est pas moins significative de l’engagement des autres puissances.
Nous avons largement développé, dans les colonnes de notre précédente revue (1), le contenu et le sens de la manoeuvre franco-britannique de concert avec les forces serbes qui avaient abouti à la création de la FRR et à l’expédition sur place, sous couleur nationale, de troupes de ces deux puissances. Cette manoeuvre, à travers une opération de sabotage des forces de l’OTAN, représentait un cinglant camouflet pour la puissance impérialiste qui prétend jouer le rôle de gendarme du monde.
Les Etats-Unis avaient besoin de frapper un grand coup pour rétablir la situation à leur profit. Pour cela, ils ont utilisé les populations civiles avec le même cynisme que leurs adversaires.
Tous ces brigands impérialistes se combattent les uns les autres, par cliques slaves interposées, et poursuivent, chacun de leur côté, la défense de leurs sordides intérêts particuliers, au détriment direct des populations, partout transformées en otages permanents, en victimes de leurs règlements de compte.
Ce sont en effet les grandes puissances qui sont les véritables responsables des massacres et d’un exode qui, depuis 1991, a précipité plus de 4 millions et demi de réfugiés en de longs cortèges d’hommes , de femmes, de vieillards et d’enfants hagards, démunis, ballottés le long des routes, de zones de combat en zones de combat. Ce sont les grandes puissances capitalistes, à travers leurs sanglantes rivalités impérialistes, qui ont encouragé, chacune de leur côté, les opérations de « nettoyage » et de « purification ethnique » pratiquées par les cliques nationalistes rivales sur le terrain.
C’est ainsi que la Forpronu, sous l’égide de la France et de la Grande-Bretagne, a donné son aval aux Serbes de Bosnie pour éliminer les poches de Srebrenica et de Zepa en juillet 1995. Tandis que ces deux puissances polarisaient l’attention sur leur « mission de protection » autour de Gorazde et de Sarajevo, la Forpronu prêtait main-forte aux Serbes pour vider les enclaves de leurs occupants. Sans cette aide, l’éjection de tous ces réfugiés n’aurait jamais été possible. De fait, la « protection » ces enclaves par l'ONU avait permis aux Serbes de porter leurs efforts militaires sur des zones de confrontation plus vitales. Et pour que ces enclaves puissent être récupérées par les forces serbes au moment le plus opportun, l’ONU avait même préalablement désarmé leur population, bien entendu sous couvert de « sa mission pour la paix ». Le gouvernement bosniaque lui-même s’est fait le complice de ce forfait, démontrant le peu de cas qu’il faisait aussi de sa chair à canon, en parquant les populations déplacées à l’intérieur des zones de combat.
La bourgeoisie américaine a recouru aux mêmes méthodes crapuleuses. C’est ainsi que, pour couvrir l’offensive croate en Krajina, les Etats-Unis inondaient au même moment les médias de photos prises par satellite montrant de la terre fraîchement remuée supposés révéler l’existence de charniers oeuvre des troupes serbes dans la région de Srebrenica. Ce sont encore les images d’horreur venant des obus tirés sur le marché de Sarajevo qui ont justifié la riposte de l’OTAN. Le prétexte de la réponse militaire apparaît cousue de fil blanc. Il est en effet peu probable que Karadzic ait été assez fou pour aller s’exposer à des lourdes représailles en tirant des obus sur le marché de Sarajevo qui ont fait 37 morts et une centaine de blessés. Quand on sait que ces tirs ont été effectués juste sur la ligne de front séparant les armées serbes et bosniaques (chaque camp a rejeté la responsabilité de ce massacre sur l’autre), on peut supposer qu’il s’agissait d’une « provocation » montée de toutes pièces. Une opération de l’envergure des bombardements de l’OTAN ne s’improvise pas et cela servait trop bien les intérêts de la Maison Blanche. Ce ne serait pas la première fois que la première puissance impérialiste mondiale organise une telle mise en scène. Il faut se rappeler, entre autres exemples, que le président Lyndon Johnson avait prétexté l’attaque d’un navire américain par un bateau nord-viêtnamien pour déclencher la guerre du Vietnam. On devait apprendre quelques années plus tard qu’il n’en était rien et que l’opération avait été montée entièrement par le Pentagone. Il est donc tout à fait dans les méthodes de gangsters des grandes puissances de créer de toutes pièces de semblables prétextes pour justifier leurs actions.
A la provocation franco-britannique, dont les prétentions de « trouble fête » arrogants et l’ardeur belliqueuse grandissante, devenaient de plus en plus intolérables, il s’agissait de répliquer par d’autres manoeuvres, de tendre d’autres pièges, démontrant une capacité impérialiste supérieure, une véritable suprématie militaire.
Face à son échec et à l’enlisement de la situation en Bosnie depuis trois ans, la bourgeoisie américaine était placée devant la nécessité de réaffirmer son leadership à l’échelle mondiale.
Il ne pouvait être admissible pour la première puissance mondiale ayant longtemps misé sur le soutien à la fraction musulmane qui s’est révèlée être la plus faible, d’être mise hors jeu dans un conflit primordial, situé sur le sol européen et un des plus cruciaux pour affirmer son hégémonie.
Cependant, les Etats-Unis sont confrontés à une difficulté majeure qui souligne la faiblesse fondamentale de leur situation en Yougoslavie. Le recours à des changements de tactique succsssifs qui s’est traduit par leur soutien à la Serbie en 1991, à la Bosnie en 1992 et à la Croatie en 1994 (sous condition de collaboration de celle-ci avec les forces bosniaques) démontre qu’ils ne peuvent disposer d’alliés attitrés dans la région.
Derrière l’offensive croate, l’action conjuguée des Etats-Unis et de l'Allemagne
Dans un première phase, elle s’est retrouvée contrainte, pour sortir de l’impasse et se remettre en selle au centre du jeu impérialiste, en conservant un rôle de premier plan, de s’appuyer sur la partie la plus forte, la Croatie et d'abandonner son allié d’hier, la Bosnie. La Maison Blanche a utilisé la fédération croato-musulmane et la confédération de cette dernière avec la Croatie qu’elle avait supervisée au printemps 1994. Leur rôle et l’appui logistique du Pentagone ont été déterminants pour assurer le succès de la « guerre éclair » en trois jours de l’armée croate en Krajina (grâce à la localisation précise par satellite des positions serbes). Les Etats-Unis ont d’ailleurs été les seuls à saluer publiquement le succès de l’offensive croate. Ainsi, l’offensive croate dans la Krajina a-t-elle été préparée à l'avance, organisée et dirigée avec maestria à la fois par l’Allemagne et par les Etats-Unis. Car, pour cela, la bourgeoisie américaine a accepté de pactiser paradoxalement avec le « diable » en s’alliant conjoncturellement avec son plus dangereux grand adversaire impérialiste, l’Allemagne, en favorisant les intérêts les plus véritablement antagoniques à ceux des Etats-Unis.
La constitution d’une véritable armée croate (100 000 hommes pour investir la Krajina) a été puissamment aidée par l’Allemagne, qui lui a manifesté un soutien discret mais constant et efficace, notamment à travers la livraison de matériel militaire lourd en provenance de l’ex-RDA, via la Hongrie. La reconquête de la Krajina correspond à un succès et à une avancée indiscutables pour l’Allemagne. Elle permet en priorité à la bourgeoisie germanique de faire un grand pas dans la direction de son objectif stratégique essentiel : l’accès aux ports dalmates sur toute la côte adriatique qui lui libèrent un débouché en eau profonde vers la Méditerranée. La libération de la Krajina, et de Knin en particulier, ouvre en même temps à la Croatie et à sa vieille alliée, l’Allemagne un carrefour routier comme ferroviaire, reliant le sud et le nord de la Dalmatie. La bourgeoisie allemande était de même particulièrement intéressée comme la Croatie par l’élimination de la menace serbe pesant sur la poche de Bihac, faisant office de verrou à toute la côte dalmate.
En infligeant une première défaite aux troupes serbes ([2] [303]), cette stratégie était fondamentalement dirigée contre les « seconds couteaux » français et britanniques.). La FRR s’est ridiculisée et son utilité est apparue d’autant plus dérisoire qu’elle s’occupait à percer inutilement une étroite voie d’accès vers Sarajevo pendant que le bulldozer croate abattait le mur serbe dans la Krajina. Coincée sur le mont Igman autour de la pseudo-défense de Sarajevo, elle se retrouvait non seulement momentanément discréditée sur la scène internationale, mais aussi auprès des Serbes eux-mêmes, ce qui ne pouvait profiter qu’à un autre rival, la Russie qui se confirmait ainsi dès lors comme un bien meilleur et plus sûr allié à leurs yeux.
Derrière les frappes anti-serbe, le bras-de-fer des Etats-Unis envers les autres puissances impérialistes
Dans une autre étape, la réponse de la bourgeoisie américaine s’inscrivait dans un scénario qui rappelle la guerre du Golfe. Toujours dirigé contre les positions serbes, le bombardement intensif de l’OTAN réaffirmait la suprématie américaine en s’adressant encore plus directement à toutes les autres grandes puissances.
Il fallait en particulier mettre un terme à tous les stratagèmes guerriers ([3] [304]) et toutes les manigances diplomatiques avec la Serbie du couple franco-anglais.
Cependant, en passant à la deuxième phase de leur initiative, les Etats-Unis prenaient un nouveau risque de se déconsidérer. Le plan de paix, sur lequel débouchait l’offensive en Krajina apparaissait ouvertement comme une « trahison de la cause bosniaque », en consacrant le dépeçage du territoire bosniaque avec l’octroi de 49 % aux conquêtes militaires de la Serbie et 51 % à la confédération croato-musulmane qui relègue de fait avec l’aide germano-américaine le reste de la Bosnie au rang de quasi-protectorat de la Croatie. Ce plan, véritable poignard planté dans le dos par ses alliés, ne pouvait que susciter l’hostilité du président bosniaque Izetbegovic. Alors que l’émissaire américain court-circuitait la France et la Grande-Bretagne, seuls interlocuteurs accrédités par la Serbie parmi les puissances occidentales depuis trois ans, en allant négocier directement à Belgrade, c’est avec un culot monstre pour des alliés patentés de Milosevic ([4] [305]), que la France et la Grande-Bretagne ont cru pouvoir saisir l’occasion de prendre les Etats-Unis à contre-pied en se présentent comme les grands et indéfectibles défenseurs de la cause bosniaque et de la population assiégée de Sarajevo ([5] [306]). C’est ainsi que le gouvernement français a tenté de se présenter comme un allié inconditionnel d’Izetbegovic en le recevant à Paris. Mais c’était là sauter à pieds joints dans un piège tendu par les Etats-Unis pour donner à ces deux larrons une leçon magistrale. En utilisant le prétexte des obus tirés sur le marché de Sarajevo, les Etats-Unis ont immédiatement mobilisé les forces de l’OTAN et ont mis au pied du mur le couple franco-britannique en lui déclarant en substance très probablement : « Vous voulez aider les Bosniaques ? Très bien. Nous aussi. Alors vous nous suivez, nous sommes les seuls à avoir les moyens de le faire, nous sommes les seuls à pouvoir imposer un rapport de force efficace aux Serbes. Nous l’avons déjà prouvé en réalisant en trois jours le dégagement de la poche de Bihac, à travers la reconquête de la Krajina, ce que vous n’avez pu accomplir pendant trois ans. Nous allons le prouver encore en libérant Sarajevo de l’étau serbe, ce que votre FRR n’a pas réussi non plus à faire. Si vous vous dégonflez, si vous ne nous suivez pas, vous démontrerez que vous ne faites que du bluff avec vos rodomontades guerrières, que vous n’êtes que des braillards incapables et vous perdrez tout le crédit qui vous reste encore sur la scène internationale. » Ce chantage ne laissait plus le moindre choix au tandem franco-britannique, que de participer à l’opération en étant contraint de bombarder ses alliés serbes, tout en replaçant la FRR sous le patronage direct de l’OTAN. Tout en évitant l’une et l’autre de causer des pertes importantes ou irréparables à leurs alliés serbes, chacune des deux puissances réagit alors à sa manière. Alors que la Grande-Bretagne se fait discrète, la France, au contraire, ne peut s’empêcher de continuer à jouer les fiers-à-bras militaristes et cherche désormais à se présenter, en faisant de la surenchère antiserbe verbale, comme le plus résolu partisan de la manière forte, le meilleur lieutenant des Etats-Unis et le plus fidèle comme indispensable allié de la Bosnie. Cette forfanterie qui va même jusqu’à se targuer d’être l’artisan essentiel du « plan de paix » ne change rien au fait que le gouvernement français s’est fait proprement « moucher » et a dû rentrer dans le rang.
De fait, pour cette deuxième partie de l’opération, les Etats-Unis ont agi pour leur propre compte en contraignant tous ses concurrents impérialistes à se plier à leur volonté. Si l’aviation germanique a participé pour la première fois à une action de l’OTAN, c’est sans enthousiasme et en faisant grise mine. Placée devant le fait accompli du cavalier seul américain, la bourgeoisie allemande ne pouvait que suivre une action qui ne servait en rien ses projets. De même, la Russie, principal soutien des Serbes, malgré ses bruyants renâclements et ses gesticulations (saisie du conseil de sécurité de l’ONU) face à la poursuite des bombardements de l’OTAN apparaît comme impuissante face à la situation qui lui est imposée.
A travers cette entreprise, les Etats-Unis ont marqué un point important. Ils sont parvenus à réaffirmer leur suprématie impérialiste en affichant leur supériorité militaire écrasante. Ils ont montré une fois de plus que la force de leur diplomatie reposait sur la force de leurs armes. Ils ont démontré qu’ils étaient les seuls à pouvoir imposer une véritable négociation parce qu’ils étaient capables de mettre sur la balance des tractations la menace de leurs armes, avec un impressionnant arsenal guerrier derrière eux.
Ce que confirme cette situation, c’est que, dans la logique de l’impérialisme, la seule force réelle se trouve sur le terrain militaire. Quand le gendarme intervient, il ne peut le faire qu’en frappant encore plus fort que les autres puissances impérialistes ne peuvent le faire.
Cependant, cette offensive se heurte à plusieurs obstacles et la force de frappe de l’OTAN n’apparaît plus que comme une pâle réplique de la guerre du Golfe.
- L’efficacité des raids aériens ne peut être que limitée et a permis aux troupes serbes d’enterrer sans trop de dommages la majeure partie de leur artillerie. Dans la guerre moderne, l'aviation est une arme décisive, mais elle ne peut permettre, à elle seule, de gagner la guerre. L'utilisation des blindés et de l'infanterie reste indispensable.
- La stratégie américaine elle-même est limitée : les Etats-Unis ne sont nullement intéressés à anéantir les forces serbes en leur livrant une guerre totale, dans la mesure où elle entend préserver le potentiel militaire de la Serbie pour pouvoir l’utiliser et se retourner ultérieurement contre la Croatie, dans l’optique de son antagonisme fondamental avec l’Allemagne. De plus, une guerre à outrance contre la Serbie comporterait le risque d’envenimer les frictions avec la Russie et de compromettre leur alliance privilégiée avec le gouvernement d’Eltsine.
Ces limites favorisent les manoeuvres de sabotage des « alliés » contraints et forcés de marcher dans les raids américains, manoeuvres qui se révèlent quatre jours à peine après l’accord de Genève, qui aurait dû constituer le couronnement de l’habilité diplomatique américaine.
D’une part, la bourgeoisie française s'est retrouvée en première ligne de ceux qui demandaient l’arrêt des bombardements de l’OTAN « pour permettre l’évacuation des armes lourdes par les Serbes », alors que l’ultimatum américain exige précisément l’inverse : l’arrêt des bombardements conditionné par le retrait des armes lourdes des abords immédiats de Sarajevo. D’autre part, alors que les Etats-Unis cherchaient à passer à un degré plus élevé de pression sur les Serbes de Bosnie en bombardant le quartier général de Karadzic à Pale, c’est la Forpronu qui lui a mis des bâtons dans les roues en manifestant des états d’âme et en s’opposant au déclenchement de bombardement prenant pour cible des « objectifs civils » ([6] [307]).
L’accord de Genève signé le 8 septembre par les belligérants, sous l’égide de la bourgeoisie américaine et en présence de tous les membres du « groupe de contact », ne constitue donc nullement un « premier pas vers la paix », contrairement à ce que proclamait le diplomate américain Holbrooke. Il ne fait que sanctionner un moment d’un rapport de forces qui, de fait, constitue un pas supplémentaire vers le déchaînement d’une barbarie dont les populations locales vont faire atrocement les frais. Ce sont elles qui paient la note de l’opération par de nouveaux massacres.
Comme lors de la guerre du Golfe, les médias osent nous parler cyniquement de guerre propre, de « frappes chirurgicales ». Odieux mensonges ! Il faudra des mois ou des années pour lever un coin du voile sur l’ampleur et l’horreur que représentent pour la population ces nouveaux massacres perpétrés par les nations les plus « démocratiques » et « civilisées ».
Dans leur affrontement, chaque grande puissance alimente aussi crapuleusement l’une que l’autre sa propagande belliciste sur la Yougoslavie En Allemagne, de virulentes campagnes anti-serbe sont organisées évoquant les atrocités commises par les partisans tchechniks. En France, au milieu d’une odieuse campagne belliciste à géométrie variable, et ailleurs, selon le camp soutenu, tantôt on ne perd pas jamais une occasion de rappeler le rôle joué par les « oustachis » croates aux côtés des forces nazies dans la seconde guerre mondiale, tantôt on évoque la folie sanguinaire des Serbes de Bosnie ou tantôt on vilipende le fanatisme musulman des combattants bosniaques..
L’hypocrite concert international des pleureuses et des intellectuels de tout poil qui n’ont cessé de jouer de la corde humanitaire pour réclamer « des armes pour la Bosnie » ne sert qu’à faire avaliser dans la population occidentale la politique impérialiste de leur bourgeoisie nationale. Ce sont ces laquais de la bourgeoisie qui peuvent maintenant se féliciter à travers les bombardements de l’OTAN « d’ajouter la paix à la guerre », selon l’expression du mitterrandien amiral Sanguinetti. Venant renforcer les campagnes médiatiques montrant à la une les images des carnages les plus horribles dans la population civile, ces bonnes âmes volant au secours de la veuve et de l’orphelin ne sont que de vulgaires sergents-recruteurs pour la guerre. Ce sont les plus dangereux rabatteurs de la bourgeoisie. Ils sont de la même espèce que les antifascistes de 1936 qui enrôlaient les ouvriers pour la guerre d’Espagne. L’histoire a démontré leur fonction réelle : celle de pourvoyeurs de chair à canon dans la préparation de la guerre impérialiste.
Une expression de l’enfoncement du capitalisme dans sa décomposition
La situation actuelle est devenue un véritable détonateur qui risque de mettre le feu aux poudres dans les Balkans.
Jamais, avec l’intervention de l’OTAN, l’accumulation et la concentration d’engins de mort n’ont été aussi impressionnantes sur le sol yougoslave.
La nouvelle perspective est celle d’un affrontement direct des armées serbes et croates et plus seulement de milices formées de bric et de broc.
La poursuite des opérations militaires par les armées croates, bosniaques et serbes le prouve déjà, l’accord de Genève comme ses conséquences ne font qu’aviver et relancer les tensions entre les belligérants qui entendent chacun modifier la nouvelle donne à leur profit, en particulier :
- alors que les bombardements massifs et meurtriers de l’OTAN visaient à réduire les ambitions des forces serbes, celles-ci vont chercher à résister au recul qu’elles ont subi et se préparent à disputer de plus belle le sort non réglé des enclaves de Sarajevo, de Gorazde ou du corridor de Brcko ;
- les nationalistes croates, encouragés par leurs succès militaires antérieurs et poussés par l’Allemagne, ne peuvent que chercher à affirmer leurs visées pour reconquérir la riche Slavonie orientale, région située au contact de la Serbie ;
- les forces bosniaques vont tout faire pour ne pas être les laissés pour compte du « plan de paix » et poursuivre leur offensive en cours dans le nord de la Bosnie vers la région serbe de Banja Luka.
L’afflux de réfugiés de toutes sortes constitue un risque majeur d’entraîner d’autres régions, comme surtout le Kosovo ou la Macédoine, dans l’embrasement guerrier mais aussi d’autres nations sur le sol européen, de l’Albanie à la Roumanie, en passant par la Hongrie.
Par effet de « boule de neige », la situation est porteuse d’une implication impérialiste plus importante des grandes puissances européennes, y compris de la part de voisins d’une importance stratégiques majeure, comme surtout la Turquie et l’Italie ([7] [308]).
La France et la Grande-Bretagne, puissances réduites à jouer pour l’heure les mouches du coche, ne peuvent que multiplier les tentatives pour mettre des bâtons dans les roues des autres protagonistes, en particulier vis-à-vis des Etats-Unis ([8] [309]).
C’est un nouveau cran qui est franchi dans l’escalade de la barbarie. Loin de s’orienter vers un règlement du conflit, ce sont au contraire vers des désordres de plus en plus guerriers et sanglants que se dirige l’ex-Yougoslavie, sous l’action « musclée » des grandes puissances. Tous ces éléments confirment la prépondérance et l’accélération de la dynamique du « chacun pour soi » à l’oeuvre depuis la dissolution des blocs impérialistes et ils traduisent en même temps une accélération de la dynamique impérialiste et une fuite en avant dans l’aventure guerrière.
La prolifération, le développement multiforme de toutes ces entreprises guerrières est le pur produit de la décomposition du capitalisme, comme les métastases d’un cancer généralisé qui gangrène d’abord les organes les plus faibles de la société, là où le prolétariat n’a pas de moyens suffisants pour s’opposer au déchaînement du nationalisme le plus abject et hystérique. La bourgeoisie des pays avancés cherche à profiter de l’imbroglio yougoslave, de la brume « humanitaire » dans laquelle elle enrobe son implication pour distiller une atmosphère d'union sacrée. Pour la classe ouvrière, il doit être clair qu’il n’y a pas à choisir, ni se laisser entraîner sur ce terrain pourri.
La prise de conscience par les prolétaires des pays centraux de la responsabilité primordiale des grandes puissances, de leur propre bourgeoisie dans le déchaînement de cette barbarie guerrière, qu’il s’agit d’un règlement de compte entre brigands impérialistes est une condition indispensable pour comprendre leurs propres responsabilités historiques. C’est bien parce que c’est la même bourgeoisie qui, d’un côté, pousse les populations à s’exterminer entre elles, et qui, de l’autre, précipite la classe ouvrière vers le chômage, la misère ou un seuil d’exploitation insupportable, que seul le développement des luttes ouvrières sur leur propre terrain de classe, sur le terrain de l’internationalisme prolétarien peut en même temps s’opposer aux attaques de la bourgeoisie et à ses menées guerrières.
CB, 14 septembre 95.
[6] [315]. Comme le notait Le Monde du 14 septembre, avec de délicats euphémismes : « Les forces de l’ONU, composées essentiellement de troupes françaises, ont le sensation, jour après jour, que les opérations leur échappent au profit de l’OTAN. L’Alliance atlantique mène , certes, des raids aériens sur des cibles déterminées conjointement avc l’ONU. Mais les détails des opérations sont planifiés par les bases de l’OTAN en Italie et par le Pentagone. L’utilisation, dimanche dernier, de missiles Tomahawk contre des installations serbes, dans la région de Banja Luka (sans passer par une consultation préalable de l’ONU ni des autres gouvernements des puissances associées aux raids, NDLR) n’a fait que renforcer ces craintes. »
[7] [316] Il est particulièrement significatif de voir l’Italie réclamer une part plus importante dans la gestion du conflit bosniaque et refuser d’accueillir sur son territoire où sont installées les bases de l’OTAN les bombardiers furtifs F-117 américains pour protester contre sa mise à l’écart du « groupe de contact » et des instances décisionnelles de l’OTAN.
[8] [317] En tout premier lieu, pour être capable de riposter à l’offensive américaine au niveau requis, sous peine d’être évincé de cette région, le couple actuel franco-britannique ne peut qu’être poussé dans cet engrenage guerrier, à renforcer son engagement militaire dans le conflit.
Géographique:
- Europe [220]
Questions théoriques:
- Décomposition [318]
- Impérialisme [19]
50 ans après : Hiroshima, Nagasaki, ou les mensonges de la bourgeoisie
- 6497 lectures
-
Avec le cinquantième anniversaire des bombes d’Hiroshima et de Nagasaki, la bourgeoisie franchit un nouveau sommet dans le cynisme et le mensonge. Car ce summum de la barbarie ne fut pas perpétré par un dictateur ou un fou sanguinaire, mais par la « très vertueuse démocratie » américaine. Pour justifier ce crime monstrueux, l’ensemble de la bourgeoisie mondiale a répété sans vergogne le mensonge colporté à l’époque de ces sinistres évènements, selon lequel la bombe atomique n’aurait été utilisée que pour abréger et limiter les souffrances causées par la poursuite de la guerre avec le Japon. La bourgeoisie américaine a même récemment poussé le cynisme jusqu’à vouloir faire éditer un timbre anniversaire ainsi légendé : « les bombes atomiques ont accéléré la fin de la guerre. Août 1945 ». Même si au Japon cet anniversaire fut une occasion supplémentaire pour marquer l’opposition croissante à l’ex-parrain US, le premier ministre a cependant apporté sa contribution précieuse au mensonge de la nécessité de la bombe pour que triomphent la paix et la démocratie, en présentant et ce, pour la première fois, les excuses du Japon pour les crimes commis durant la seconde guerre mondiale. Ainsi, vainqueurs et vaincus se retrouvent unis pour développer cette campagne répugnante visant à justifier un des plus grands crimes de l’histoire.
LA JUSTIFICATION D’HIROSHIMA ET NAGASAKI : UN GROSSIER MENSONGE
Les deux bombes atomiques lâchées sur le Japon en août 1945 firent, au total, 522 000 victimes. De nombreux cancers du poumon et de la thyroïde ne se déclarèrent que dans les années 1950 et 1960 et, aujourd’hui, les effets de l’irradiation continuent encore de faire des victimes : les leucémies sont dix fois plus nombreuses à Hiroshima que dans le reste du Japon !
Pour justifier un tel crime et répondre au choc légitime provoqué par l’horreur des effets de la bombe, Truman, le président américain qui ordonna l’holocauste nucléaire, ainsi que son complice Winston Churchill répandirent une fable aussi cynique que mensongère. A les en croire, l’emploi de l’arme atomique aurait épargné la vie d’environ un million de vies humaines, pertes qu’aurait selon eux nécessairement entraîné l’invasion du Japon par les troupes US. En somme, malgré les apparences, les bombes qui ont ravagé Hiroshima et Nagasaki et qui continuent encore cinquante ans après à dispenser la mort, seraient des bombes pacifistes ! Or, ce mensonge particulièrement odieux est totalement démenti par de nombreuses études historiques émanant de la bourgeoisie elle-même.
Lorsqu’on examine la situation militaire du Japon au moment où l’Allemagne capitule, on constate que celui-ci est déjà totalement vaincu. L’aviation, arme essentielle de la seconde guerre mondiale, y est exsangue, réduite à un petit nombre d’appareils généralement pilotés par une poignée d’adolescents aussi fanatisés qu’inexpérimentés. La marine, tant marchande que militaire, est pratiquement détruite. La défense antiaérienne n’est plus qu’une gigantesque passoire, ce qui explique que les B 29 US aient pu se livrer à des milliers de raids durant tout le printemps 1945 sans pratiquement essuyer de pertes. Et cela, c’est Churchill lui-même qui le souligne dans le tome 12 de ses mémoires !
Une étude des services secrets US de 1945, publiée par le New York Times en 1989, révèle quant à elle que : « Conscient de la défaite, l’empereur du Japon avait décidé dès le 20 juin 1945 de cesser toute hostilité et d’entamer à partir du 11 juillet des pourparlers en vue de la cessation des hostilités »[1] [319].
Or, bien que parfaitement au courant de cette réalité, Truman, après avoir été informé du succès du premier tir expérimental nucléaire dans les sables du désert du nouveau Mexique en Juillet 1945[2] [320], et ce au moment même où se tient la conférence de Potsdam entre lui-même, Churchill et Staline[3] [321], décide alors d’utiliser l’arme atomique contre les villes japonaises. Qu’une telle décision ne soit en aucune façon motivée par la volonté de précipiter la fin de la guerre avec le Japon est également attesté par une conversation entre le physicien Léo Szilard, l’un des pères de la bombe, et le secrétaire d’Etat américain, J. Byrnes. A Szilard qui s’inquiétait des dangers de l’utilisation de l’arme atomique, J. Byrnes répond qu’il « ne prétendait pas qu’il était nécessaire d’utiliser la bombe pour gagner la guerre. Son idée était que la possession et l’utilisation de la bombe rendraient la Russie plus contrôlable ».1
Et s’il était encore besoin d’une argumentation supplémentaire, laissons parler certains des plus hauts dirigeants de l’armée américaine elle-même. Pour l’amiral W. Leahy, chef d’état major, « Les japonais étaient déjà battus et prêts à capituler. L’usage de cette arme barbare n’a apporté aucune contribution matérielle à notre combat contre le Japon. »1 C'est un avis que partageait aussi Eisenhower.
La thèse de l’utilisation de l’arme atomique pour forcer le Japon à capituler et stopper la boucherie ne correspond à aucune réalité. C’est un mensonge forgé de toutes pièces pour les besoins de la propagande guerrière de la bourgeoisie, un des fleurons du gigantesque bourrage de crâne qu’a nécessité la justification idéologique de ce plus grand massacre de l’histoire que fut la guerre de 1939-45, de même que la préparation idéologique de la guerre froide.
Et il convient de souligner que, quels que soient les états d’âme de certains membres de la classe dominante, devant l’utilisation de cette arme terrifiante qu’est la bombe nucléaire, la décision du président Truman, est tout sauf celle d’un fou ou d’un individu isolé. Elle est au contraire l’expression d’une logique implacable, celle de l’impérialisme, celle de tous les impérialismes, et cette logique signifie la mort et la destruction de l’humanité pour que survive une classe, la bourgeoisie, confrontée à la crise historique de son système d’exploitation et à sa décadence irréversible.
L’OBJECTIF RÉEL DES BOMBES D’HIROSHIMA ET NAGASAKI
A l’opposé des tombereaux de mensonges colportés depuis 1945 sur la prétendue victoire de la Démocratie synonyme de paix, la seconde boucherie mondiale est à peine terminée que se dessine déjà la nouvelle ligne d’affrontement impérialiste qui va ensanglanter la planète. De la même façon que dans le traité de Versailles de 1919 était inscrite l’inéluctabilité d’une nouvelle guerre mondiale, Yalta contenait la fracture impérialiste majeure entre le grand vainqueur de 1945, les Etats-Unis, et son challenger russe. Puissance économique mineure, la Russie peut accéder, grâce à la seconde guerre mondiale, à un rang impérialiste de dimension mondiale, ce qui ne peut que menacer la super puissance américaine. Dès le printemps 1945, l’URSS utilise sa force militaire pour se constituer un bloc dans l’Est de l’Europe. Yalta n’avait fait que sanctionner le rapport de forces existant entre les principaux requins impérialistes qui étaient sortis vainqueurs du plus grand carnage de l’histoire. Ce qu’un rapport de forces avait instauré, un autre pouvait le défaire. Ainsi, à l’été 1945, la véritable question qui se pose à l’Etat américain n’est pas de faire capituler le Japon le plus vite possible comme on nous l’enseigne dans les manuels scolaires, mais bien de s’opposer et de contenir la poussée impérialiste du « grand allié russe » !
W. Churchill, le véritable dirigeant de la seconde guerre mondiale, du côté des« Alliés », a pris très vite la mesure du nouveau front en train de s’ouvrir et va exhorter sans relâche les Etats-Unis à y faire face. Il écrit dans ses mémoires : « Plus une guerre menée par une coalition approche de sa fin, plus les aspects politiques prennent d’importance. A Washington surtout on aurait du voir plus grand et plus loin... La destruction de la puissance militaire de l’Allemagne avait provoqué une transformation radicale des rapports entre la Russie communiste et les démocraties occidentales. Elles avaient perdu l’ennemi commun qui était à peu près leur seul trait d’union. » Et il en conclut que : « la Russie soviétique était devenue un danger mortel pour le monde libre, qu’il fallait créer sans retard un nouveau front pour arrêter sa marche en avant et qu’en Europe ce front devait se trouver le plus à l’Est possible »[4] [322]. On ne saurait être plus clair : par ces mots, Churchill analyse fort lucidement que, alors que la seconde guerre mondiale n’est pas encore terminée, une nouvelle guerre est d’ores et déjà en train de commencer !
Dès le printemps 1945, Churchill fait tout pour s’opposer aux avancées de l’armée russe en Europe de l'est (en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, etc.). Il cherche avec obstination à faire adhérer à ses vues le nouveau président américain, Truman, lequel, après certaines hésitations[5] [323] se ralliera pleinement à la thèse de Churchill selon laquelle « la menace soviétique avait déjà remplacé l’ennemi nazi » (Ibid.).
On comprend dès lors aisément le total soutien que Churchill et son gouvernement unanime apportèrent à la décision de Truman de faire procéder à des bombardements atomiques sur les villes japonaises. Churchill écrivait le 22 Juillet 1945 : « [avec la bombe] nous avons désormais en mains quelque chose qui rétablira l’équilibre avec les russes. Le secret de cet explosif et la capacité de l’utiliser modifieront complètement l’équilibre diplomatique qui était à la dérive depuis la défaite de l’Allemagne ». Que cela entraîne la mort, dans d’atroces souffrances, de centaines de milliers d’êtres humains laissait de marbre ce « grand défenseur du monde libre », ce « sauveur de la démocratie ». Lorsqu’il apprit la nouvelle de l’explosion d’Hiroshima, il... sauta de joie et l’un de ses conseillers, Lord Alan Brooke, précise même : « Churchill fut enthousiaste et se voyait déjà en mesure d’éliminer tous les centres industriels de la Russie et toutes les zones à forte concentration de population »[6] [324]. Voilà ce que pensait ce défenseur de la civilisation et des irremplaçables valeurs humanistes à l’issue d’une boucherie ayant fait 50 millions de morts !
L’holocauste nucléaire qui s’est abattu sur le Japon en août 1945, cette manifestation terrifiante de la barbarie absolue qu’est devenue la guerre dans la décadence du capitalisme, ne fut donc en aucune façon perpétrée par la « blanche démocratie » américaine pour limiter les souffrances dues à la poursuite de la guerre avec le Japon, pas plus qu’elle ne correspondait à un besoin militaire. Son véritable objectif était d’adresser un message de terreur à l’URSS pour forcer cette dernière à limiter ses prétentions impérialistes et à accepter les conditions de la « pax americana ». Plus concrètement, il fallait immédiatement signifier à l'URSS qui, conformément aux accords de Yalta, déclarait au même moment la guerre au Japon, qu'il était hors de question pour elle de tenter de participer à l'occupation de ce pays, contrairement au cas de l'Allemagne. Et c’est pour que ce message soit suffisamment fort que l’Etat américain lança une deuxième bombe contre une ville d’importance mineure sur le plan militaire, à savoir Nagasaki, où l’explosion anéantit le principal quartier ouvrier ! C’est aussi la raison du refus de Truman de se ranger à l’avis de certains de ses conseillers pour lesquels l’explosion d’une bombe nucléaire sur une zone peu peuplée du Japon eut été amplement suffisante pour amener le Japon à capituler. Non, dans la logique meurtrière de l’impérialisme, la vitrification nucléaire de deux villes était nécessaire pour intimider Staline, pour rabattre les ambitions impérialistes de l’ex-allié soviétique.
LES LECONS DE CES TERRIBLES EVENEMENTS
Quelles leçons la classe ouvrière doit-elle tirer de cette terrible tragédie et de sa répugnante utilisation par la bourgeoisie ?
En premier lieu, que ce déchaînement inouï de la barbarie capitaliste est tout sauf une fatalité, dont l’humanité serait la victime impuissante. L’organisation scientifique d’un tel carnage n’a été possible que parce que le prolétariat était vaincu à l’échelle mondiale par la contre-révolution la plus terrible et la plus implacable de toute son histoire. Brisé par la terreur stalinienne et fasciste, totalement déboussolé par l’énorme et monstrueux mensonge identifiant stalinisme et communisme, il s’est laissé finalement embrigader dans le piège mortel de la défense de la démocratie avec la complicité aussi active qu’irremplaçable des staliniens. Cela jusqu’à finir transformé en une gigantesque masse de chair à canon que la bourgeoisie pouvait utiliser à merci. Aujourd’hui, quelles que soient les difficultés que connaît le prolétariat pour approfondir son combat, la situation est tout autre. Dans les grandes concentrations prolétariennes, ce qui est à l'ordre du jour, en effet, ce n'est pas, comme au cours des années 30, l’union sacrée avec les exploiteurs, mais bel et bien l’élargissement et l’approfondissement de la lutte de classe.
A l’opposé du grand mensonge développé jusqu’à l’écoeurement par la bourgeoisie, lequel présente la guerre inter-impérialiste de 1939-45 comme une guerre entre deux « systèmes », l’un fasciste, l’autre démocratique, les cinquante millions de victimes de cet immense carnage ne sont autres que celles du système capitaliste comme un tout. La barbarie, les crimes contre l’humanité n’ont pas été l’apanage du seul camp fasciste. Les prétendus « défenseurs de la civilisation » rassemblés sous la bannière de la Démocratie, à savoir nos fameux « Alliés » ont les mains tout aussi souillées de sang que celles des « puissances de l’Axe » et le déchaînement du feu nucléaire en août 1945, même s’il est particulièrement atroce, n’est qu’un des nombreux crimes perpétrés tout au long de la guerre par ces « chevaliers blancs de la démocratie »[7] [325].
L’horreur d’Hiroshima signifie aussi le début d’une nouvelle période dans l’enfoncement du capitalisme dans sa décadence. Elle exprime que désormais la guerre permanente est devenue le mode de vie quotidien du capitalisme. Si le traité de Versailles annonçait la prochaine guerre mondiale, la bombe sur Hiroshima marquait, quant à elle, le réel début de ce qu’on a appelé « la guerre froide » mettant aux prises l’URSS et les Etats-Unis et qui allait ensanglanter les quatre coins de la planète pendant plus de 40 ans. C’est pourquoi les lendemains de 1945, contrairement aux années qui suivirent 1918, ne voient aucun désarmement mais au contraire un accroissement gigantesque des dépenses d’armement chez tous les vainqueurs du conflit (dès 1949, l’URSS se dote de sa première bombe atomique). Dans ce cadre, l’ensemble de l’économie, sous la houlette du capitalisme d’Etat - quelles que soient les formes revêtues par ce dernier - est mise au service de la guerre. Et contrairement, là aussi, à la période qui suit la fin du premier conflit mondial le capitalisme d’Etat ne va cesser partout de se renforcer et d’exercer son emprise totalitaire sur l’ensemble de la société. Seul l’Etat peut en effet mobiliser les gigantesques ressources nécessaires pour notamment développer l’arsenal nucléaire. Ainsi le projet Manhattan ne fut que le premier d’une longue et funeste série conduisant à la plus folle et gigantesque course aux armements de l’histoire.
Loin de sanctionner l’avènement d’une ère de paix, 1945 ouvre au contraire une période de barbarie exacerbée par la menace constante d’une destruction nucléaire de la planète. Si Hiroshima et Nagasaki hantent toujours aujourd’hui la mémoire de l’humanité, c’est parce qu’ils symbolisent, ô combien tragiquement, comment et en quoi, la survie du capitalisme décadent menace directement jusqu’à la survie même de l’espèce humaine.
Cette terrible épée de Damoclès suspendue sur la tête de l’humanité confère donc au prolétariat, seule force capable de s’opposer réellement à la barbarie guerrière du capitalisme, une immense responsabilité. Car, bien que cette menace se soit momentanément éloignée avec la fin des blocs russe et américain, cette responsabilité reste entière et le prolétariat ne doit en aucune façon baisser la garde. En effet, la guerre n’a jamais été aussi présente qu’aujourd’hui, que ce soit en Afrique, en Asie, aux confins de l’ex-URSS ou à travers le conflit sanglant qui en déchirant la Yougoslavie porte la guerre en Europe, et, ce, pour la première fois depuis 1945[8] [326] ! Et il n’est que de constater l’acharnement de la bourgeoisie à justifier l’emploi de la bombe en août 1945 pour comprendre que lorsqu’un Clinton déclare « si c’était à refaire, nous le referions »[9] [327], il n’exprime ici rien d’autre que le sentiment de l’ensemble de sa classe. Derrière les discours hypocrites sur le danger de la prolifération nucléaire, chaque Etat met tout en oeuvre, qui, pour se doter d’un tel arsenal, qui, pour perfectionner l’arsenal existant. Plus encore, les recherches en vue d’une miniaturisation de l’arme atomique et donc de la banalisation de son usage, ne cessent de se multiplier. Pour preuve cet extrait d’un article paru dans Libération du 5 août 1995 : « Les réflexions des états-majors occidentaux autour de la riposte "du fort au fou" remettent en selle l’idée d’un usage tactique, limité du nucléaire. Après Hiroshima, le passage à l’acte devenait tabou. Après la guerre froide, l’absolu du tabou vacille. »
L’horreur de l’utilisation de l’arme nucléaire n’appartient donc pas à un passé révolu, mais représente au contraire, si le prolétariat laissait faire, le futur que réserve le capitalisme en décomposition à l’humanité. La décomposition ne supprime ni n’atténue l’omniprésence de la guerre. Elle ne fait que rendre son danger plus incontrôlable de par le chaos et le « tous contre tous » que génère la décomposition. Partout déjà on voit les grandes puissances impérialistes attiser le chaos pour défendre leurs sordides intérêts impérialistes, et l’on peut être sûr que si la classe ouvrière ne s’oppose pas à leurs actions criminelles, elles n’hésiteront pas à utiliser toutes les armes dont elles disposent, des bombes à fragmentation (elles ont été largement employées contre l’Irak) aux armes chimiques et nucléaires. Face à la seule perspective qu’offre le capitalisme en décomposition, celle de la destruction morceau par morceau de la planète et de ses habitants, le prolétariat ne doit céder ni à l’appel des sirènes du pacifisme, ni à celles de la défense de la démocratie au nom de laquelle furent vitrifiées les villes d’Hiroshima et de Nagasaki. Il doit au contraire rester fermement sur son terrain de classe : celui de la lutte contre le système d’exploitation et de mort qu’est le capitalisme. Du spectacle des horreurs, des atrocités présentes et passées que les médias étalent aujourd'hui complaisamment, qu'il provienne des images d'archives de la guerre mondiale ou de celles tirées des conflits actuels, le classe ouvrière ne doit pas tirer un sentiment d'impuissance. C'est ce que veulent justement la bourgeoisie avec cet étalage : terroriser les prolétaires, leur communiquer l'idée qu'ils ne peuvent rien faire à cela, que l'Etat capitaliste, avec ses énormes moyens de destruction, est de toutes façons le plus fort, que lui seul peut apporter la paix puisqu'aussi bien il commande à la guerre. Tout au contraire, le tableau de la barbarie que déchaîne le capitalisme doit servir à la classe ouvrière pour renforcer, dans ses luttes, sa conscience et sa volonté d'en finir avec ce système.
RN, 24 août 95.
[1] [328] Le Monde Diplomatique, août 1990.
[2] [329] Pour la mise au point de la bombe atomique, l’Etat américain a mobilisé toutes les ressources de la science et les a mises au service de l’armée. Deux milliards de dollars de l'époque furent consacrés au projet « Manhattan » mis sur pied par ce grand humaniste qu'était Roosevelt. Toutes les universités du pays apportèrent leur concours. Y participèrent directement ou indirectement les plus grands physiciens, de Einstein à Oppenheimer. Six prix Nobel travaillèrent à l’élaboration de la bombe. Cette gigantesque mobilisation de toutes les ressources scientifiques pour la guerre exprime un trait général de la décadence du capitalisme. Le capitalisme d’Etat, qu’il soit ouvertement totalitaire ou qu’il revête les oripeaux démocratiques, colonise et militarise toute la science. Sous son règne, cette dernière ne se développe et ne vit que par et pour la guerre. Depuis 1945, cette réalité n’a cessé de s’exacerber.
[3] [330] Cette conférence avait pour but essentiel, notamment pour Churchill, qui en fut le véritable initiateur, de signifier à l’URSS de Staline qu’elle devait réfréner ses ambitions impérialistes et qu’il y avait des limites à ne pas franchir.
[4] [331] Mémoires, Tome 12, Mai 1945.
[5] [332] Pendant tout le printemps 1945, Churchill ne cesse de tempêter face à ce qu’il appelle la mollesse américaine devant le grignotage de tout l’Est de l’Europe par les troupes russes. Si cette hésitation du gouvernement US à s’opposer frontalement aux appétits impérialistes de l’Etat russe traduit la relative inexpérience de la bourgeoisie américaine dans ses nouveaux habits de superpuissance mondiale, alors que la bourgeoisie britannique disposait sur ce plan d’une expérience séculaire, elle est aussi l’expression d’arrière-pensées pas très amicales à l’égard du « frère » britannique. Le fait que la Grande-Bretagne sorte très affaiblie de la guerre et que ses positions en Europe soient menacées par « l’ours russe » ne peut que la rendre plus docile face aux diktats que l’Oncle Sam ne vas pas tarder à imposer, y compris à ses plus proches alliés. C’est un exemple supplémentaire des rapports « francs et harmonieux » régnant entre les différents requins impérialistes.
[6] [333] Le Monde Diplomatique, août 1990.
[7] [334] Voir Revue internationale n° 66, « Les crimes des grandes démocraties ».
[8] [335] Au lendemain de 1945, la bourgeoisie a présenté la « guerre froide » comme une guerre entre deux systèmes de nature différentes : la démocratie face au communisme totalitaire. Par ce mensonge, elle continuait à gravement déboussoler la classe ouvrière tout en dissimulant la nature classiquement et sordidement impérialiste de la nouvelle guerre opposant les alliés d’hier. D’une certaine façon, elle a refait le coup en 1989 en clamant qu’avec la « chute du communisme » la paix allait enfin pouvoir régner. Or, depuis lors, du Golfe à la Yougoslavie, on a vu ce que valait cette promesse des Bush, Gorbatchev et consorts.
[9] [336] Libération, 11 avril 1995.
Géographique:
- Japon [337]
Questions théoriques:
- Guerre [18]
FRIEDRICH ENGELS : il y a cent ans disparaissait un « grand forgeron du socialisme »
- 4509 lectures
« Friedrich Engels s'est éteint à Londres le 5 août 1895. Après son ami Karl Marx (mort en 1883), [...] Marx et Engels ont été les premiers à montrer que la classe ouvrière et ses revendications sont un produit nécessaire du régime économique actuel qui crée et organise inéluctablement le prolétariat en même temps que la bourgeoisie ; ils ont montré que ce ne sont pas les tentatives bien intentionnées d'hommes au coeur généreux qui délivreront l'humanité des maux qui l'accablent aujourd'hui, mais la lutte de classe du prolétariat organisé. Marx et Engels ont été les premiers à expliquer, dans leurs oeuvres scientifiques, que le socialisme n'est pas une chimère, mais le but final et le résultat nécessaire du développement des forces productives de la société actuelle. »
C'est par ces lignes que Lénine commençait, un mois après le décès du compagnon de Marx, une courte biographie d'un des meilleurs militants du combat communiste.
Un combattant exemplaire du prolétariat
Engels, né à Barmen en 1820 dans la province rhénane de la Prusse, fut en effet un exemple de militant dévoué toute sa vie au combat de la classe ouvrière. Issu d'une famille d'industriels il aurait pu vivre richement et confortablement sans se soucier du combat politique. Or, comme Marx et beaucoup de jeunes étudiants révoltés par la misère du monde dans lequel ils vivaient, il va très jeune acquérir une maturité politique exceptionnelle au contact de la lutte des ouvriers en Angleterre, en France puis en Allemagne. Il était inévitable que dans la période historique où le prolétariat se constituait en classe, développait son combat politique il attirât un certain nombre d'éléments intellectuels dans ses rangs.
Engels fut toujours modeste sur sa trajectoire individuelle, ne manquant jamais de saluer l'apport considérable de son ami Marx. Cependant, à peine âgé de 25 ans, il agit en précurseur. Il est témoin en Angleterre de la marche catastrophique de l'industrialisation et du paupérisme. Il perçoit les promesses, en même temps que les faiblesses, du mouvement ouvrier dans ses balbutiements (le Chartisme). Il prend conscience que « l'énigme de l'histoire » réside dans ce prolétariat méprisé et méconnu, il fréquente les meetings ouvriers à Manchester où il voit les prolétaires s'attaquer franchement au christianisme et prétendre s'occuper de leur avenir.
En 1844, Engels écrit un article, Contribution à la critique de l'économie politique, pour les Annales franco-allemandes, revue publiée en commun à Paris par Arnold Ruge, un jeune démocrate, et par Marx qui, à ce moment-là, se situe encore sur le terrain de la lutte pour la conquête de la démocratie contre l'absolutisme prussien. C'est ce texte qui ouvre véritablement les yeux à Marx sur la nature profonde de l'économie capitaliste. Puis, l'ouvrage d'Engels, La condition de la classe laborieuse en Angleterre, publié en 1845, devient un livre de référence pour toute une génération de révolutionnaires. Comme l'écrit Lénine, Engels fut donc le premier à déclarer que le prolétariat « n'est pas seulement » une classe qui souffre, mais que la situation économique intolérable où il se trouve le pousse irrésistiblement en avant et l'oblige à lutter pour son émancipation finale. Deux ans plus tard, c'est aussi Engels qui rédige sous forme de questionnaire Les principes du communisme qui servira de canevas à la rédaction du mondialement connu Manifeste communiste, signé par Marx et Engels.
En fait, l'essentiel de l'immense contribution que Engels a faite au mouvement ouvrier est le fruit d'une étroite collaboration avec Marx, et réciproquement. Ils font véritablement connaissance à Paris durant l'été 1844. Dès lors commencera un travail commun pour toute une vie, une confiance réciproque rare, mais qui ne reposera pas simplement sur une amitié hors du commun, mais sur une communion d'idées, une conviction partagée du rôle historique du prolétariat et un combat constant pour l'esprit de parti, pour gagner de plus en plus d'éléments au combat révolutionnaire.
Ensemble, dès leur rencontre, Marx et Engels vont très vite dépasser leurs visions philosophiques du monde pour se consacrer à cet événement sans précédent dans l'histoire, le développement d'une classe, le prolétariat, à la fois exploitée et révolutionnaire. Une classe d'autant plus révolutionnaire qu'elle a cette particularité d'acquérir une claire « conscience de classe » débarrassée des préjugés et des auto-mystifications qui pesaient sur les classes révolutionnaires du passé, telle la bourgeoisie. De cette réflexion commune sortiront deux livres : La Sainte Famille publié en 1844 et L'idéologie allemande écrit entre 1844 et 1846, mais qui ne sera publié qu'au 20e siècle. Dans ces livres, Marx et Engels règlent leur compte aux conceptions philosophiques des « jeunes hégéliens », leurs premiers compagnons de combat, qui n'ont pas su dépasser une vision bourgeoise ou petite bourgeoise du monde. En même temps, ils y font l'exposé d'une vision matérialiste et dialectique de l'histoire, une vision qui rompt avec l'idéalisme (qui considère que « ce sont les idées qui gouvernent le monde ») mais aussi avec le matérialisme vulgaire qui ne reconnaît aucun rôle actif à la conscience. Pour leur part, Marx et Engels considèrent que « quand la théorie s'empare des masses, elle devient force matérielle ». C'est ainsi que les deux amis, totalement convaincus de cette unité entre l'être et la conscience, ne vont jamais séparer le combat théorique du prolétariat de son combat pratique, ni leur propre participation à ces deux formes du combat.
En effet, contrairement à l'image que la bourgeoisie en a souvent donnée, Marx et Engels ne furent jamais des « savants en chambre », coupés des réalités et des combats pratiques. En 1847, le Manifeste qu'ils rédigent ensemble s'appelle en réalité Manifeste du Parti communiste et doit servir de programme à la « Ligue des Communistes », une organisation qui s'apprête à prendre part aux combats qui s'annoncent. En 1848, lorsqu'éclate une série de révolutions bourgeoises sur le continent européen, Marx et Engels y participent activement afin de contribuer à l'éclosion des conditions qui permettront le développement économique et politique du prolétariat. Rentrés en Allemagne, ils publient un quotidien, La Nouvelle Gazette Rhénane qui devient un instrument de combat. Plus concrètement encore, Engels s'engage dans les troupes révolutionnaires qui mènent le combat dans le pays de Bade.
Après l'échec et la défaite de cette vague révolutionnaire européenne, la participation à celle-ci vaudra à Engels, aussi bien qu'à Marx, d'être poursuivis par toutes les polices du continent, ce qui les contraint de s'exiler en Angleterre. Marx s'installe définitivement à Londres alors qu'Engels va travailler jusqu'en 1870 dans l'usine de sa famille à Manchester. L'exil ne paralyse nullement leur participation aux combats de la classe. Ils poursuivent leur activité au sein de la Ligue des communistes jusqu'en 1852, date à laquelle, pour éviter à celle-ci une dégénérescence suite au reflux des luttes, ils se prononcent pour sa dissolution.
En 1864, lorsque se constitue, dans la foulée d'une reprise internationale des combats ouvriers, l'Association internationale des travailleurs, ils y participent activement. Marx devient membre du Conseil général de l'AIT et Engels l'y rejoint en 1870 lorsqu'il peut enfin se libérer de son travail à Manchester. C'est un moment crucial dans la vie de l'AIT et c'est côte à côte que les deux amis vont participer aux combats que mène l'Internationale : la Commune de Paris de 1871, la solidarité aux réfugiés après celle-ci (au Conseil Général, c'est Engels qui anime le service d'aide matérielle aux communards émigrés à Londres) et surtout la défense de l'AIT contre les menées de l'Alliance de la Démocratie socialiste animée par Bakounine. Marx et Engels sont présents, en septembre 1872, au Congrès de La Haye qui barre la route de l'Alliance et c'est Engels qui rédige la plus grande partie du rapport, confié par le Congrès au Conseil général, sur les intrigues des bakouninistes.
L'écrasement de la Commune a porté un coup très brutal au prolétariat européen et l'AIT, la « vieille internationale » comme l'appelleront désormais Marx et Engels, s'éteint en 1876. Les deux compagnons ne cessent pas pour autant le combat politique. Ils suivent de très près les partis socialistes qui se constituent et se développent dans la plupart des pays d'Europe, une activité que Engels poursuivra énergiquement après la mort de Marx en 1883. Ils sont particulièrement attentifs au mouvement qui se développe en Allemagne et qui devient le phare du prolétariat mondial. Ils y interviennent pour combattre toutes les confusions qui pèsent sur le Parti social-démocrate comme en témoignent la Critique du Programme de Gotha (rédigée par Marx en 1875) et la Critique du Programme d'Erfurt (Engels, 1891).
Ainsi, Engels, tout comme Marx, fut avant tout un militant du prolétariat, partie prenante des différents combats menés par celui-ci. Au soir de sa vie, Engels confia que rien n'avait été plus passionnant que le combat de propagande militante. Il évoquait, en particulier sa joie de collaborer à une presse quotidienne dans l'illégalité, avec La Nouvelle Gazette Rhénane en 1848, puis avec le Sozialdemocrat dans les années 1880, lorsque le parti subissait les rigueurs de la loi de Bismark contre les socialistes.
La collaboration d'Engels et de Marx fut particulièrement féconde ; même éloignés l'un de l'autre, ou lorsque leurs organisations étaient dissoutes, ils continuèrent à lutter, entourés de compagnons fidèles eux aussi au travail de fraction indispensable dans les périodes de reflux, maintenant cette activité de minorité par de multiples correspondances.
C'est à cette collaboration également qu'on doit les ouvrages théoriques majeurs rédigés aussi bien par Engels que par Marx. Ceux écrits par Engels résultaient grandement de l'échange permanent d'idées et de réflexions qu'il avait avec Marx. Il en est ainsi de L'Anti-Dühring (publié en 1878 et qui a constitué un des instruments essentiels de la formation des militants socialistes d'Allemagne) comme de L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat (1884) qui expose le plus précisément la conception communiste de l'Etat sur laquelle se baseront par la suite les révolutionnaires (notamment Lénine dans L'Etat et la révolution). Même Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, publié après la mort de Marx, n'a pu être écrit qu'à la suite de la réflexion menée en commun, depuis leur jeunesse, par les deux amis.
Réciproquement, sans la contribution d'Engels, l'ouvrage majeur de Marx, Le Capital, n'aurait jamais vu le jour. Déjà, c'est Engels, comme on l'a vu, qui en 1844 avait fait comprendre à Marx la nécessité de s'attaquer à une critique de l'économie politique. Par la suite, toutes les avancées, toutes les hypothèses contenues dans Le Capital ont fait l'objet de longues correspondances : c'est ainsi par exemple qu'Engels, directement impliqué dans la fonctionnement d'une entreprise capitaliste, a pu fournir des informations de première main sur ce fonctionnement. De même, les encouragements et les conseils permanents d'Engels ont contribué beaucoup à ce que le premier livre de l'ouvrage soit publié en 1867. Enfin, alors que Marx avait laissé à sa mort une masse considérable de brouillons, c'est Engels qui les a mis en forme pour en faire les livres II et III du Capital (publiés en 1885 et 1894).
Engels et la 2e Internationale
Ainsi, Engels, qui n'a jamais prétendu qu'au rôle de « second violon », a laissé cependant au prolétariat une oeuvre à la fois profonde et d'une grande lisibilité. Mais il a aussi et surtout permis, après la mort de Marx, que soient légués un « esprit de parti », une expérience et des principes organisationnels qui on valeur de continuité et qui ont été transmis jusqu'à la IIIe Internationale.
Engels avait participé à la fondation, en 1847, de la Ligue des Communistes puis de l'AIT en 1864. Après la dissolution de la 1ère Internationale, Engels joua un rôle important dans le maintien des principes lors de la reconstitution d'une deuxième Internationale à laquelle il ne ménagea jamais ses conseils. Il avait estimé prématurée la fondation de cette nouvelle Internationale, mais pour combattre la réapparition d'intrigants comme Lassalle ou la résurgence de l'opportunisme anarchisant, il avait mis tout son poids pour vaincre l'opportunisme au congrès international de fondation à Paris en 1889. En fait, jusqu'à sa mort, Engels s'efforcera de lutter contre l'opportunisme qui ressurgira, notamment dans la social-démocratie allemande, contre la veulerie de l'influence petite-bourgeoise, contre l'élément anarchiste destructeur de toute vie organisationnelle et contre l'aile réformiste de plus en plus séduite par les chants de sirène de la démocratie bourgeoise.
A la fin du siècle dernier, la bourgeoisie avait toléré le développement du suffrage universel. En Allemagne, en particulier, le nombre d'élus socialistes put donner une impression de force dans le cadre de la légalité aux éléments réformistes et opportunistes du parti. L'historiographie bourgeoise et les ennemis du marxisme se sont servis de déclarations d'Engels, en partie justifiées, contre les vieilleries barricadières, pour laisser croire que le vieux militant était devenu un pacifiste réformiste lui aussi ([1] [338]). En particulier, la préface qu'il écrivit, en 1895, au texte de Marx sur Les luttes de classe en France, était invoquée comme démonstration qu'Engels jugeait périmé le temps des révolutions. C'est vrai que cette introduction contenait des formulations fausses (2), [339] mais le texte publié n'avait presque plus rien à voir avec l'original. En effet, ce document avait été tronqué une première fois par Kautsky pour éviter des poursuites judiciaires, puis, une autre fois, le texte avait été vraiment expurgé par Wilhem Liebknecht. Engels écrivit à Kautsky pour exprimer son indignation de trouver dans le Vorwärts un extrait de son introduction qui le faisait « apparaître comme un partisan à tout prix de la légalité » (1er avril 1895). Deux jours après, il se plaignait également à Lafargue : « Liebknecht vient de me jouer un joli tour. Il a pris de mon introduction aux articles de Marx sur la France de 1848-1850 tout ce qui a pu lui servir pour soutenir la tactique à tout prix paisible et antiviolente qu'il lui plaît de prêcher depuis quelques temps. »
Malgré les multiples mises en garde d'Engels, l'inféodation à l'opportunisme des Bernstein, Kautsky et compagnie allait déboucher sur l'éclatement de la deuxième Internationale en 1914 contre la vague social-chauviniste. Mais, cette internationale avait bien été un lieu du combat révolutionnaire contrairement aux dénégations des modernes conteurs d'histoire à la GCI (3). [340] Ses acquis politiques, l'internationalisme qu'elle avait affirmé à ses congrès (notamment ceux de 1907 à Stuttgart et de 1912 à Bâle), les principes organisationnels (défense de la centralisation, combat contre les intrigants et les jeunes arrivistes, etc.) n'étaient pas perdus pour l'aile gauche de l'Internationale d'Engels, puisque les Lénine, Rosa Luxemburg, Pannekoek et Bordiga, parmi tant d'autres, allaient reprendre l'étendard révolutionnaire farouchement défendu par le vieux combattant jusqu'au bout.
oOo
La fille de Marx, Eleanor, dans un article que lui avait demandé une revue socialiste allemande pour les 70 ans d'Engels, a rendu un hommage mérité à l'homme et au militant : « Il n'y a qu'une chose qu'Engels n'a jamais pardonné - la fausseté. Un homme qui n'est pas vrai envers lui, plus encore celui qui n'est pas fidèle à son parti, ne trouve aucune pitié auprès d'Engels. Ce sont, pour lui, des péchés impardonnables. Engels ne connaît pas d'autres péchés... Engels, qui est l'homme le plus exact du monde, qui a plus que n'importe qui, un sentiment très vif du devoir et surtout de la discipline envers le parti, n'est pas le moins du monde un puritain. Personne, comme lui, n'est capable de tout comprendre, et, partant, personne ne pardonne aussi aisément nos petites faiblesses ». En republiant ce texte, la presse socialiste de l'époque (numéro d'août 1895 du Devenir social), presse socialiste de l'époque salua la mémoire du grand combattant : « Un homme est mort qui s'est volontairement maintenu au second plan, pouvant être au premier. L'idée, son idée, est debout, partout vivante, plus vivante que jamais, et défiant toutes les attaques, grâce aux armes qu'il a, avec Marx, contribué à lui fournir. On n'entendra plus retentir sur l'enclume le marteau de ce vaillant forgeron ; le bon ouvrier est tombé ; le marteau échappé de ses mains puissantes est à terre et y restera peut-être longtemps ; mais les armes qu'il a forgées sont toujours là, solides et brillantes. S'il n'est pas donné à beaucoup d'en pouvoir forger de nouvelles, ce que, du moins, nous pouvons tous faire, ce que nous devons faire, c'est de ne pas laisser rouiller celles qui nous ont été livrées ; et, à cette condition, elles nous gagneront la victoire pour laquelle elles ont été faites ».
F. Médéric
(3) [343]Sur la défense du caractère prolétarien de la deuxième internationale, voir notre article « La continuité des organisations politiques du prolétariat : la nature de classe de la social-démocratie », Revue Internationale n° 50.
Heritage de la Gauche Communiste:
REVOLUTION ALLEMANDE (III) : l'insurrection prématurée
- 3912 lectures
Ce troisième article consacré aux luttes révolutionnaires en Allemagne de 1918-1919 ([1] [344]) aborde une des questions les plus délicates du combat prolétarien : les conditions et l’opportunité de l’insurrection. L’expérience allemande, pour négative qu’elle fut, constitue dans ce domaine une très riche source d’enseignements pour les combats révolutionnaires à venir.
En novembre 1918, en se soulevant, la classe ouvrière contraint la bourgeoisie en Allemagne à mettre fin à la guerre. Pour saboter la radicalisation du mouvement et la répétition des “ événements de Russie ”, la classe capitaliste utilise, au sein des luttes le SPD ([2] [345]) comme fer de lance contre la classe ouvrière. Grâce à une politique de sabotage particulièrement habile, le SPD, avec l'aide des syndicats, a tout fait pour saper la force des conseils ouvriers.
Face au développement explosif du mouvement, voyant partout des mutineries de soldats et le passage de ceux-ci du côté des ouvriers en insurrection, il est impossible, à la bourgeoisie, d'envisager une politique de répression immédiate. Elle se doit d'abord d'agir politiquement contre la classe ouvrière pour ensuite obtenir la victoire militaire. Nous avons analysé en détails dans la Revue internationale n° 82 le sabotage politique qu'elle a accompli. Nous voulons aborder ici son action au niveau de l'insurrection ouvrière.
Les préparatifs en vue d'une action militaire sont engagés depuis le premier jour. Ce ne sont pas les partis de droite de la bourgeoisie qui organisent cette répression mais celui qui passe encore pour “ le grand parti du prolétariat ”, le SPD, et cela en étroite collaboration avec l'armée. Ce sont ces “ démocrates ” tant célébrés qui entrent en action comme dernière ligne de défense du capitalisme. Ce sont eux qui se révèlent le rempart le plus efficace du capital. Le SPD commence par mettre systématiquement sur pieds des corps-francs dans la mesure où les unités des troupes régulières infestées par le “ virus des luttes ouvrières ” suivent de moins en moins le gouvernement bourgeois. Ainsi des unités de volontaires, bénéficiant de soldes spéciales, vont servir d'auxiliaires à la répression.
Les provocations militaires des 6 et 24 décembre 1918
Le 6 décembre, juste un mois après le début des luttes, le SPD donne l'ordre à ses sbires d'entrer en force dans les locaux du journal de Spartakus, Die Rote Fahne. K. Liebknecht, R. Luxemburg, quelques autres Spartakistes, mais aussi des membres du Conseil exécutif de Berlin sont arrêtés. Simultanément, les troupes loyales au gouvernement attaquent une manifestation de soldats démobilisés et de déserteurs ; quatorze manifestants sont tués. En réaction plusieurs usines entrent en grève le 7 décembre ; partout des assemblées générales se tiennent dans les usines. Le 8 décembre se produit pour le première fois une manifestation d'ouvriers et de soldats en armes rassemblant plus de 150 000 participants. Dans des villes de la Ruhr, comme à Mülheim, les ouvriers et les soldats arrêtent des patrons de l'industrie.
Face aux provocations du gouvernement les révolutionnaires ne poussent pas à l'insurrection immédiate mais appellent à la mobilisation massive des ouvriers. Les Spartakistes analysent, en effet, que les conditions nécessaires au renversement du gouvernement bourgeois ne sont pas encore réunies notamment au niveau des capacités de la classe ouvrière. ([3] [346])
Le Congrès national des conseils qui se tient à la mi-décembre 1918 illustre cette situation et la bourgeoisie va en tirer profit (voir le dernier article dans la Revue internationale n° 82). Lors de ce Congrès, les délégués décident de soumettre leurs décisions à une Assemblée nationale qu'il faut élire. Simultanément est mis en place un “ Conseil central ” (Zentralrat) composé exclusivement de membres du SPD prétendant parler au nom des conseils d’ouvriers et de soldats d'Allemagne. Après ce congrès la bourgeoisie se rend compte qu'elle peut utiliser immédiatement cette faiblesse politique de la classe ouvrière en déclenchant une seconde provocation militaire : les corps-francs et les troupes gouvernementales passent à l'offensive le 24 décembre. Onze marins et plusieurs soldats sont tués. De nouveau une grande indignation s'élève parmi les ouvriers. Ceux de la “ Société des moteurs Daimler ” et de nombreuses autres usines berlinoises réclament la formation d'une Garde Rouge. Le 25 décembre ont lieu de puissantes manifestations en riposte à cette attaque. Le gouvernement est contraint de reculer. Suite au discrédit grandissant qui frappe l'équipe au pouvoir, l'USPD ([4] [347]), qui en faisait partie jusqu'alors aux côtés du SPD, se retire.
Cependant la bourgeoisie ne lâche pas pied. Elle continue à vouloir procéder au désarmement du prolétariat à Berlin et se prépare à lui porter un coup décisif.
Le SPD appelle au meurtre des communistes
Afin de dresser la population contre le mouvement de la classe ouvrière, le SPD se fait le porte-voix d'une ignoble et puissante campagne de calomnie contre les révolutionnaires et va même jusqu'à appeler au meurtre des Spartakistes : “ Vous voulez la paix ? Alors chacun doit faire en sorte que la tyrannie des gens de Spartakus prenne fin ! Vous voulez la liberté ? Alors mettez les fainéants armés de Liebknecht hors d'état de nuire ! Vous voulez la famine ? Alors suivez Liebknecht ! Vous voulez devenir les esclaves de l'Entente ? Liebknecht s'en occupe ! A bas la dictature des anarchistes de Spartakus ! Seule la violence peut être opposée à la violence brutale de cette bande de criminels ! ” (Tract du conseil municipal du Grand-Berlin du 29 décembre 1918)
“ Les agissements honteux de Liebknecht et de Rosa Luxemburg salissent la révolution et mettent en péril toutes ses conquêtes. Les masses ne doivent plus tolérer une minute de plus que ces tyrans et leurs partisans paralysent ainsi les instances de la République. (...) C'est par le mensonge, la calomnie et la violence qu'ils renverseront et abattront tout obstacle qui osera s'opposer à eux.
Nous avons fait la révolution pour mettre fin à la guerre ! Spartakus veut une nouvelle révolution pour commencer une nouvelle guerre. ” (tract du SPD, janvier 1919)
Fin décembre, le groupe Spartakus quitte l'USPD et s'unit aux IKD ([5] [348]) pour former le KPD. La classe ouvrière dispose ainsi d'un Parti communiste qui est né en plein mouvement et qui, d'emblée, est la cible des attaques du SPD, le principal défenseur du capital.
Pour le KPD c'est l'activité des masses ouvrières les plus larges qui est indispensable pour s'opposer à cette tactique du capital. “ Après la première phase de la révolution, celle de la lutte essentiellement politique, s'ouvre la phase de la lutte renforcée, intensifiée et principalement économique. ” (R. Luxemburg au Congrès de fondation du KPD). Le gouvernement SPD “ ne viendra pas à bout des flammes de la lutte de classe économique. ” (Ibid.) C'est pourquoi le capital, avec le SPD à sa tête, va tout faire pour empêcher tout élargissement des luttes sur ce terrain en provoquant des soulèvements armés prématurés des ouvriers et en les réprimant. Il s'agit, pour lui, dans un premier temps d'affaiblir le mouvement en son centre, à Berlin, pour ensuite s'attaquer au reste de la classe ouvrière.
Le piège de l'insurrection prématurée à Berlin
En janvier la bourgeoisie réorganise les troupes stationnées à Berlin. En tout, elle masse plus de 80 000 soldats autour de la ville dont 10 000 forment des troupes de choc. Au début du mois, elle lance une nouvelle provocation contre les ouvriers afin de les amener à en découdre militairement. Le 4 janvier, en effet, le préfet de police de Berlin, Eichhorn, est démis de ses fonctions par le gouvernement bourgeois. Ceci est aussitôt ressenti comme une agression par la classe ouvrière. Le soir du 4 janvier, les “ hommes de confiance révolutionnaires ” ([6] [349]) se réunissent en une séance à laquelle participent Liebknecht et Pieck au nom du KPD, fondé quelques jours auparavant. Un “ Comité révolutionnaire provisoire ”, qui s'appuie sur le cercle des “ hommes de confiance ”, est créé. Mais dans le même temps le Comité exécutif des conseils de Berlin (Vollzugsrat) et le Comité central (Zentralrat) nommé par le congrès national des conseils -tous deux dominés par le SPD- continuent d'exister et d'agir au sein de la classe.
Le Comité d'action révolutionnaire appelle à un rassemblement de protestation pour le dimanche 5 janvier. Environ 150 000 ouvriers s'y rendent après une manifestation devant la préfecture de police. Le soir du 5 janvier quelques manifestants occupent les locaux du journal du SPD Vorwærts et d'autres maisons d'édition. Ces actions sont probablement suscitées par des agents provocateurs, en tout cas elles se produisent sans que le Comité n'en ait connaissance et sans son approbation.
Mais les conditions pour le renversement du gouvernement ne sont pas réunies et c'est ce que met en évidence le KPD dans un tract au tout début du mois de janvier :
“ Si les ouvriers de Berlin dispersaient aujourd'hui l'Assemblée nationale, s'ils jetaient en prison les Ebert-Scheidemann alors que les ouvriers de la Ruhr, de Haute-Silésie et les ouvriers agricoles des pays de l'est de l'Elbe restent calmes, les capitalistes seraient alors en mesure de soumettre Berlin dés le lendemain en l'affamant. L'offensive de la classe ouvrière contre la bourgeoisie, le combat pour la prise du pouvoir par les conseils d’ouvriers et de soldats doivent être l'oeuvre de l'ensemble du peuple travailleur dans tout le Reich. Seule la lutte des ouvriers des villes et des campagnes en tout lieu et en permanence, s'accélérant et allant croissant, à condition qu'elle se transforme en un flot puissant traversant toute l'Allemagne à grand fracas, seule la vague initiée par les victimes de l'exploitation et de l'oppression, submergeant tout le pays, permettront de faire éclater le gouvernement du capitalisme, de disperser l'Assemblée nationale et d'installer sur leurs ruines le pouvoir de la classe ouvrière qui conduira le prolétariat à la complète victoire dans la lutte ultérieure contre la bourgeoisie. (...)
Ouvriers et ouvrières, soldats et marins ! Convoquez partout des assemblées et éclairez les masses sur le bluff de l'Assemblée nationale. Dans chaque atelier, dans chaque unité de troupe, dans chaque ville, voyez et examinez si votre conseil d’ouvriers et de soldats a vraiment été élu, s'il ne comporte pas en son sein des représentants du système capitaliste, des traîtres à la classe ouvrière comme les hommes de Scheidemann, ou des éléments inconsistants et oscillants comme les Indépendants. Convainquez alors les ouvriers et faites élire des communistes. (...) Là où vous possédez la majorité dans les conseils ouvriers, faites que ces conseils ouvriers établissent immédiatement des liaisons avec les autres conseils ouvriers de la région. (...) Si ce programme est réalisé (...) l'Allemagne de la république des conseils aux côtés de la république des conseils des ouvriers russes entraînera les ouvriers d'Angleterre, de France, d'Italie sous le drapeau de la révolution... ”. Cette analyse montre que le KPD voit clairement que le renversement de la classe capitaliste n'est pas encore possible dans l'immédiat et que l'insurrection n'est pas encore à l'ordre du jour.
Après la gigantesque manifestation de masse du 5 janvier, se tient à nouveau le soir même une séance des “ hommes de confiance ” avec la participation de délégués du KPD et de l'USPD ainsi que de représentants des troupes de la garnison. Marqués par l'impression laissée par la puissante manifestation de la journée, les présents élisent un comité d'action (Aktionsauschuß) comprenant 33 membres à la tête duquel sont placés Ledebour comme président, Scholze pour les “ hommes de confiance révolutionnaires ” et K. Liebknecht pour le KPD. Pour le lendemain 6 janvier la grève générale et une nouvelle manifestation sont décidés.
Le Comité d'action distribue un tract d'appel à l'insurrection avec le mot d'ordre : “ Luttons pour le pouvoir du prolétariat révolutionnaire ! A bas le gouvernement Ebert-Scheidemann ! ”
Des soldats viennent proclamer leur solidarité au Comité d'action. Une délégation de soldats assure qu'elle se mettra du côté de la révolution dès la déclaration de la destitution de l'actuel gouvernement Ebert-Scheidemann. Là-dessus, K. Liebknecht pour le KPD, Scholze pour les “ hommes de confiance révolutionnaires ” signent un décret proclamant cette destitution et la prise en charge des affaires gouvernementales par un comité révolutionnaire. Le 6 janvier, environ 500 000 personnes manifestent dans la rue. Dans tous les quartiers de la ville ont lieu des manifestations et des rassemblements ; les ouvriers du Grand-Berlin réclament des armes. Le KPD exige l'armement du prolétariat et le désarmement des contre-révolutionnaires. Alors que le mot d'ordre “ A bas le gouvernement ! ” a été donné par le Comité d'action, celui-ci ne prend aucune initiative sérieuse pour réaliser cette orientation. Dans les usines, aucune troupe de combat n'est organisée, aucune tentative n'est faite pour prendre en mains les affaires de l'Etat et pour paralyser l'ancien gouvernement. Non seulement le Comité d'action ne possède aucun plan d'action, mais le 6 janvier il est lui même mis en demeure, par des soldats de la marine, de quitter le bâtiment où il siège, ce qu'il fait effectivement !
Les masses d'ouvriers en manifestation attendent des directives dans les rues pendant que les dirigeants siègent désemparés. Alors que la direction du prolétariat demeure dans l'expectative, hésite, ne possède même aucun plan, la gouvernement mené par le SPD, de son côté, se remet rapidement du choc causé par cette première offensive ouvrière. De toutes parts se rassemblent autour de lui des forces qui lui viennent en aide. Le SPD appelle à des grèves et à des manifestations de soutien en faveur du gouvernement. Une campagne acharnée et perfide est lancée contre les communistes : “ Là où règne Spartakus, toute liberté et sécurité individuelle sont abolies. Les périls les plus graves menacent le peuple allemand et en particulier la classe ouvrière allemande. Nous ne voulons pas nous laisser terroriser plus longtemps par ces criminels à l'esprit égaré. L'ordre doit enfin être établi à Berlin et la construction paisible d'une Allemagne révolutionnaire nouvelle doit être garantie. Nous vous convions à cesser le travail en protestation contre les brutalités des bandes spartakistes et à vous rassembler immédiatement devant l'hôtel du gouvernement du Reich. ” (...)
“ Nous ne devons pas trouver le repos tant que l'ordre n'est pas rétabli à Berlin et tant que la jouissance des conquêtes révolutionnaires n'est pas garantie à l'ensemble du peuple allemand. A bas les meurtriers et les criminels ! Vive la république socialiste ! ” (Comité exécutif du SPD, 6 janvier 1919)
La cellule de travail des étudiants berlinois écrit : “ Vous, citoyens, sortez de vos demeures et mettez vous aux côtés des socialistes majoritaires ! La plus grande hâte est nécessaire ! ” (Tract du 7-8 janvier 1919).
De son côté Noske déclare avec cynisme le 11 janvier : “ Le gouvernement du Reich m'a transmis le commandement des soldats républicains. Un ouvrier se trouve donc à la direction des forces de la République socialiste. Vous me connaissez, moi et mon passé dans le Parti. Je me porte garant qu'aucun sang inutile ne sera versé. Je veux assainir, non anéantir. L'unité de la classe ouvrière doit être faite contre Spartakus pour que la démocratie et le socialisme ne sombrent pas. ”
Le Comité central (Zentralrat), “ nommé ” par le Congrès national des conseils et surtout dominé par le SPD, proclame : “ ... une petite minorité aspire à l'instauration d'une tyrannie brutale. Les agissements criminels de bandes armées mettant en danger toutes les conquêtes de la révolution, nous contraignent à conférer les pleins pouvoirs extraordinaires au gouvernement du Reich afin que l'ordre (...) soit enfin rétabli dans Berlin. Toutes les divergences d'opinions doivent s'effacer devant le but (...) de préserver l'ensemble du peuple travailleur d'un nouveau et terrible malheur. Il est du devoir de tous les conseils d'ouvriers et de soldats de nous soutenir dans notre action, nous et le gouvernement du Reich, par tous les moyens (...) ” (Edition spéciale du Vorwærts, 6 janvier 1919).
Ainsi, c'est au nom de la révolution et des intérêts du prolétariat que le SPD (avec ses complices) se prépare à massacrer les révolutionnaires du KPD. C'est avec la plus ignoble duplicité qu'il appelle les conseils à se ranger derrière le gouvernement pour agir contre ce qu'il nomme “ les bandes armées ”. Le SPD fournit même une section militaire qui reçoit des armes dans les casernes et Noske est placé à la tête des troupes de répression : “ Il faut un chien sanglant, je ne recule pas devant cette responsabilité. ”
Dés le 6 janvier se produisent des combats isolés. Tandis que le gouvernement ne cesse de masser des troupes autour de Berlin, le soir du 6, siège l'Exécutif des conseils de Berlin. Celui-ci, dominé par le SPD et l'USPD, propose au Comité d'action révolutionnaire des négociations entre les “ hommes de confiance révolutionnaires ” et le gouvernement, au renversement duquel le Comité révolutionnaire vient justement d'appeler. L’Exécutif des conseils joue le rôle de “ conciliateur ” en proposant de concilier l'inconciliable. Cette attitude déboussole les ouvriers et en particulier les soldats déjà hésitants. C'est ainsi que les marins décident d'adopter une politique de “ neutralité ”. Dans les situations d'affrontement direct entre les classes, toute indécision peut rapidement conduire la classe ouvrière à une perte de confiance dans ses propres capacités et à adopter une attitude de méfiance vis à vis de ses organisations politiques. Le SPD, en jouant cette carte, contribue à affaiblir le prolétariat de façon dramatique. Simultanément, par l'intermédiaire d'agents provocateurs (comme cela sera révélé par la suite), il pousse les ouvriers à l’affrontement. C'est ainsi que le 7 janvier, ceux-ci occupent par la force les locaux de plusieurs journaux.
Face à cette situation, la direction du KPD, contrairement au Comité d'action révolutionnaire, a une position très claire : se basant sur l'analyse de la situation faite au cours de son congrès de fondation, elle considère l'insurrection comme prématurée.
Le 8 janvier Die Rote Fahne écrit : “ Il s'agit aujourd'hui de procéder à la réélection des conseils d’ouvriers et de soldats, de reprendre l'Exécutif des conseils de Berlin sous le mot d'ordre : dehors les Ebert et consorts ! Il s'agit aujourd'hui de tirer les leçons des expériences des huit dernières semaines dans les conseils d’ouvriers et de soldats et d'élire des conseils qui correspondent aux conceptions, aux buts et aux aspirations des masses. Il s'agit en un mot de battre les Ebert-Scheidemann dans ce qui forme les fondements de la révolution, les conseils d'ouvriers et de soldats. Ensuite, mais seulement ensuite, les masses de Berlin et aussi de l'ensemble du Reich auront dans les conseils d’ouvriers et de soldats de véritables organes révolutionnaires qui leur donneront, dans tous les moments décisifs, de véritables dirigeants, de véritables centres pour l'action, pour les luttes et pour la victoire. ”
Les Spartakistes appellent ainsi la classe ouvrière à se renforcer d'abord au niveau des conseils en développant les luttes sur son propre terrain de classe, dans les usines, et en en délogeant les Ebert, Scheidemann et Cie. C'est par l'intensification de sa pression, à travers ses conseils, qu'elle pourra donner une nouvelle impulsion à son mouvement pour ensuite se lancer dans la bataille de la prise du pouvoir politique.
Ce jour même, R. Luxemburg et L. Jogisches critiquent violemment le mot d'ordre de renversement immédiat du gouvernement lancé par le Comité d'action mais aussi et surtout le fait que celui-ci, par son attitude hésitante voire capitularde, se montre incapable de diriger le mouvement de la classe. Ils reprochent plus particulièrement à K. Liebknecht d'agir de sa propre autorité, de se laisser entraîner par son enthousiasme et son impatience au lieu d'en référer à la direction du Parti et de prendre appui sur le programme et les analyses du KPD.
Cette situation montre que ce n'est ni le programme ni les analyses politiques de la situation qui font défaut mais la capacité du parti, en tant qu'organisation, à jouer son rôle de direction politique du prolétariat. Fondé depuis quelques jours seulement, le KPD n'a pas l'influence dans la classe ni encore moins la solidité et la cohésion organisationnelles qu'avait notamment le parti bolchevik un an auparavant en Russie. Cette immaturité du parti communiste en Allemagne est à la base de la dispersion qui existe dans ses rangs, laquelle va peser lourdement et de façon dramatique dans la suite des événements.
Dans la nuit du 8 au 9 janvier, les troupes gouvernementales se lancent à l'assaut. Le Comité d'action qui n'analyse toujours pas correctement le rapport de forces, pousse à agir contre le gouvernement : “ Grève générale ! Aux armes ! Il n'y a pas le choix ! Il faut combattre jusqu'au dernier. ” De nombreux ouvriers suivent l'appel, mais à nouveau, ils attendent des directives précises du Comité. En vain. En effet, rien n'est fait pour organiser les masses, pour provoquer la fraternisation entre les ouvriers révolutionnaires et les soldats... C'est ainsi que les troupes gouvernementales entrent dans Berlin et livrent pendant plusieurs jours de violents combats de rue contre les ouvriers armés. Nombre d'entre eux sont tués et blessés dans des affrontements qui ont lieu, de façon dispersée, dans différents quartiers de Berlin. Le 13 janvier la direction de l'USPD proclame la fin de la grève générale et le 15 janvier Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont assassinés par les sbires du régime dirigé par les Social-démocrates ! La campagne criminelle lancée par le SPD sur le thème “ Tuez Liebknecht ! ” se conclut sur un succès de la bourgeoisie. Le KPD est, à ce moment-là, privé de ses plus importants dirigeants.
Alors que le KPD fraîchement fondé a correctement analysé le rapport de forces et a mis en garde contre une insurrection prématurée, produit d'une provocation de l'ennemi, le Comité d'action dominé par les “ hommes de confiance révolutionnaires ” a une appréciation fausse de la situation. C'est falsifier l'histoire que de parler d'une prétendue “ semaine de Spartakus ”. Les Spartakistes se sont au contraire prononcé contre toute précipitation. La rupture de la discipline de parti par Liebknecht et Pieck en est la preuve à contrario. C'est l'attitude précipitée des “ hommes de confiance dés révolutionnaires ”, brûlant d'impatience et en définitive manquant de réflexion, qui est à l'origine de cette défaite sanglante. Le KPD, quant à lui, ne possède pas, à ce moment-là, la force de retenir le mouvement comme les Bolcheviks étaient parvenus à le faire en juillet 1917. Comme l'avouera le social-démocrate Ernst, nouveau Préfet de police qui a remplacé Eichorn démis de ses fonctions : “ Tout succès des gens de Spartakus était dés le départ exclu compte tenu que par nos préparatifs nous les avions contraints à frapper prématurément. Leurs cartes furent découvertes plus tôt qu'ils ne le souhaitaient et c'est pourquoi nous étions en mesure de les combattre. ”
La bourgeoisie, suite à ce succès militaire, comprend immédiatement qu'elle doit accentuer son avantage. Elle lance une vague de répression sanglante où des milliers d'ouvriers berlinois ainsi que de communistes sont assassinés, suppliciés et jetés en prisons. Le meurtre perpétré contre R. Luxemburg et K. Liebknecht n'est pas une exception mais révèle la détermination bestiale de la bourgeoisie à éliminer ses ennemis mortels, les révolutionnaires.
Le 19 janvier, la “ démocratie ” triomphe : les élections à l'Assemblée nationale ont lieu. Sous la pression des luttes ouvrières, le gouvernement a, entre temps, transféré son siège à Weimar. La république de Weimar s'instaure ainsi sur des milliers de cadavres ouvriers
L'insurrection est-elle l'affaire du parti ?
Sur cette question de l'insurrection le KPD s'appuie clairement sur les positions du marxisme et particulièrement sur ce qu'avait écrit Engels après l'expérience des luttes de 1848 :
“ L'insurrection est un art. C'est une équation aux données les plus incertaines, dont les valeurs peuvent changer à tout moment ; les forces de l'adversaire ont de leur côté tous les avantages de l'organisation, de la discipline et de l'autorité ; dés que l'on n'est plus en mesure de s'opposer à elles en position de forte supériorité, on est battu et anéanti. Deuxièmement, dés que l'on s'est engagé sur le chemin de l'insurrection, il faut agir avec la plus grande détermination et passer à l'offensive. La défensive est la mort de toute insurrection armée ; l'issue est perdue avant même de s'être mesuré à l'ennemi. Prends ton adversaire en défaut tant que ses forces sont dispersées ; fais en sorte d'obtenir quotidiennement de nouvelles victoires, si menues soient-elles ; conserve toi la suprématie morale que t'a créée la première victoire du soulèvement ; attire à toi les éléments hésitants qui suivent toujours l'élan le plus fort et se mettent toujours du côté le plus sûr ; contraint tes ennemis à la retraite avant même qu'ils ne soient en mesure de rassembler leurs forces contre toi... ” (Révolution et contre-révolution en Allemagne)
Les spartakistes utilisent la même démarche vis à vis de la question de l'insurrection que Lénine en avril 1917 :
“ Pour réussir, l'insurrection doit s'appuyer non pas sur un complot, non pas sur un parti, mais sur la classe d'avant-garde. Voilà le premier point. L'insurrection doit s'appuyer sur l'élan révolutionnaire du peuple. Voilà le second point. L'insurrection doit surgir à un tournant de l'histoire de la révolution ascendante où l'activité de l'avant-garde du peuple est la plus forte, où les hésitations sont fortes dans les rangs de l'ennemi et faibles dans ceux des amis de la révolution. Voilà le troisième point. Telles sont les trois conditions qui font que, dans la façon de poser la question de l'insurrection, le marxisme se distingue du blanquisme. ” (Lettre au comité central du POSDR, septembre 1917)
Qu'en est-il concrètement en janvier 1919 sur cette question fondamentale ?
L'insurrection s'appuie sur l'élan révolutionnaire de la classe
La position du KPD lors de son congrès de fondation est que la classe n'est pas encore mûre pour l'insurrection. En effet, après le mouvement dominé au départ par les soldats, une nouvelle impulsion provenant des usines, des assemblées et des manifestations est indispensable. C'est la condition pour que la classe acquière, dans son mouvement, plus de force et plus de confiance en elle-même. C'est la condition pour que l'insurrection ne soit pas l'affaire d'une minorité, l'affaire de quelques éléments désespérés et impatients, mais au contraire qu'elle puisse s'appuyer sur “ l'élan révolutionnaire ” de l'immense majorité des ouvriers.
De plus, en janvier, les conseils ouvriers n'exercent pas un réel double pouvoir dans la mesure où le SPD a réussi à les saboter de l'intérieur. Comme nous l'avons présenté dans le dernier numéro, le Congrès national des conseils à la mi-décembre a été une victoire pour la bourgeoisie et malheureusement aucune nouvelle stimulation des conseils ne s'est produite depuis. L'appréciation qu'a le KPD du mouvement de la classe et du rapport de forces est parfaitement lucide et réaliste.
Pour certains, c'est le parti qui prend le pouvoir. Alors, il faut expliquer comment une organisation révolutionnaire, aussi forte soit-elle, pourrait le faire alors que la grande majorité de la classe ouvrière n'a pas encore développé suffisamment sa conscience de classe, hésite et oscille, alors qu'elle n'a pas été capable de se doter de conseils ouvriers suffisamment puissants pour s'opposer au régime bourgeois. Développer une telle position c'est totalement méconnaître les caractéristiques fondamentales de la révolution prolétarienne et de l'insurrection que soulignait en premier Lénine : “ L'insurrection doit s'appuyer non pas sur un parti, mais sur la classe d'avant-garde. ” Même en octobre 1917 les Bolcheviks tenaient particulièrement à ce que ce ne soit pas le parti bolchevik qui prenne le pouvoir mais le Soviet de Pétrograd.
L'insurrection prolétarienne ne peut “ se décréter d'en haut ”. Elle est, au contraire, une action consciente des masses qui doivent auparavant développer leur propre initiative et la maîtrise de leurs luttes. C'est sur cette base que les directives et orientations données par les conseils et le parti seront suivies.
L'insurrection prolétarienne ne peut être un putsch, comme essaient de le faire croire les idéologues bourgeois. Elle est l'oeuvre de l'ensemble de la classe ouvrière. Pour secouer le joug du capitalisme, la seule volonté de quelques-uns, même s'il s'agit des éléments les plus clairs et déterminés de la classe, ne suffit pas. “ (...) le prolétariat insurgé ne peut compter que sur son nombre, sur sa cohésion, sur ses cadres, sur son état-major. ” (Trotsky, Histoire de la Révolution Russe, “ L'art de l'insurrection ”)
Ce degré de maturité n'avait pas été atteint, en janvier, dans la classe ouvrière en Allemagne.
Le rôle des communistes est central
Le KPD est conscient, à ce moment-là, que sa responsabilité essentielle est de pousser au renforcement de la classe ouvrière et en particulier au développement de sa conscience de la même manière que Lénine l'a fait auparavant en Russie dans ses “ Thèses d'Avril ” :
“ Travail de propagande 'et rien de plus', semblerait-il. C'est en réalité un travail révolutionnaire éminemment pratique ; car on ne saurait faire progresser une révolution qui s'est arrêtée, grisée de phrases, et qui 'marque le pas' non point à cause d'obstacles extérieurs, non point à cause de la violence qu'exercerait la bourgeoisie (...), mais à cause de l'aveugle crédulité des masses.
C'est uniquement en combattant cette aveugle crédulité (...) que nous pouvons nous dégager de l'emprise de la phraséologie révolutionnaire déchaînée et stimuler réellement aussi bien la conscience prolétarienne que la conscience des masses, leur initiative audacieuse et décidée (...). ” (Lénine, “ Les tâches du prolétariat dans notre révolution ”, point 7, avril 1917)
Lorsque le point d'ébullition est atteint, le parti doit justement “ au moment opportun surprendre l'insurrection qui monte ”, pour permettre à la classe de passer à l'insurrection au bon moment. Le prolétariat doit sentir “ au dessus de lui une direction perspicace, ferme et audacieuse ” sous la forme du parti. (Trotsky, Histoire de la Révolution Russe, “ L'art de l'insurrection ”)
Mais à la différence des Bolcheviks en juillet 1917, le KPD, en janvier 1919, ne possède pas encore suffisamment de poids pour être en mesure de peser de façon décisive sur le cours des luttes. Il ne suffit pas, en effet, que le parti ait une position juste, encore faut-il qu’il est une influence importante dans la classe. Et ce n'est pas le mouvement insurrectionnel prématuré à Berlin ni encore moins la défaite sanglante qui s'en est suivie qui vont permettre à celle-ci de se développer. La bourgeoisie, au contraire, réussit à affaiblir de façon dramatique l'avant-garde révolutionnaire en éliminant ses meilleurs militants mais également en faisant interdire son principal outil d'intervention dans la classe, Die Rote Fahne. Dans une situation où l'intervention la plus large du parti est absolument indispensable, le KPD se retrouve, pendant des semaines entières, sans pouvoir disposer de son organe de presse.
Le drame des luttes dispersées
Au cours de ses semaines, au niveau international, la classe ouvrière dans plusieurs pays affronte le capital. Alors qu'en Russie l'offensive des troupes blanches contre-révolutionnaires se renforce contre le pouvoir ouvrier, la fin de la guerre entraîne une certaine accalmie sur le front social dans les “ pays vainqueurs ”. En Angleterre et en France il y a une série de grèves, mais les luttes ne prennent pas la même orientation radicale qu'en Russie et en Allemagne. Les luttes en Allemagne et en Europe centrale restent ainsi relativement isolées de celles des autres centres industriels européens. En mars les ouvriers de Hongrie établissent une république des conseils qui est rapidement écrasée dans le sang par les troupes contre-révolutionnaires, grâce, ici encore à l’habile travail de la Social-démocratie locale.
A Berlin, après avoir défait l'insurrection ouvrière, la bourgeoisie poursuit une politique en vue de dissoudre les conseils de soldats et de créer une armée destinée à la guerre civile. Par ailleurs, elle s'attaque au désarmement systématique du prolétariat. Mais la combativité ouvrière continue de s'exprimer un peu partout dans le pays. Le centre de gravité du combat, au cours des mois qui suivent, va se déplacer à travers l'Allemagne. Dans presque toutes les grandes villes vont se produire des affrontements extrêmement violents entre la bourgeoisie et le prolétariat mais malheureusement isolés les uns des autres.
Brême en janvier...
Le 10 janvier, par solidarité avec les ouvriers berlinois, le conseil d’ouvriers et de soldats de Brême proclame l'instauration de la République des conseils. Il décide l'éviction des membres du SPD de son sein, l'armement des ouvriers et le désarmement des éléments contre-révolutionnaires. Il nomme un gouvernement des conseils responsable devant lui. Le 4 février le gouvernement du Reich rassemble des troupes autour de Brême et passe à l'offensive contre la ville insurgée, restée isolée. Le jour même, Brême tombe aux mains des chiens sanglants.
La Ruhr en février...
Dans la Ruhr, la plus grande concentration ouvrière, la combativité n'a cessé de s'exprimer depuis la fin de la guerre. Déjà avant la guerre, il y avait eu, en 1912, une longue vague de grèves. En juillet 1916, en janvier 1917, en janvier 1918, en août 1918 les ouvriers réagissent contre la guerre par d'importants mouvements de luttes. En novembre 1918, les conseils d'ouvriers et de soldats se trouvent pour la plupart sous l'influence du SPD. A partir de janvier et février 1919, de nombreuses grèves sauvages éclatent. Les mineurs en lutte se rendent dans les puits voisins pour élargir et unifier le mouvement. Souvent des oppositions violentes se produisent entre les ouvriers en lutte et les conseils encore dominés, par des membres du SPD. Le KPD intervient :
“ La prise du pouvoir par le prolétariat et l'accomplissement du socialisme ont pour présupposé que la grande majorité du prolétariat s'élève à la volonté d'exercer la dictature. Nous ne pensons pas que ce moment soit déjà arrivé. Nous pensons que le développement des prochaines semaines et des prochains mois fera mûrir dans l’ensemble du prolétariat la conviction que c'est seulement dans sa dictature que réside son salut. Le gouvernement Ebert-Scheidemann épie la moindre occasion pour étouffer dans le sang ce développement. Comme à Berlin, comme à Brême il va tenter d'étouffer isolément les foyers de la révolution, pour ainsi éviter la révolution générale. Le prolétariat a le devoir de faire échouer ces provocations en évitant de s'offrir de plein gré en sacrifice aux bourreaux dans des soulèvements armés. Il s'agit bien plus, jusqu'au moment de la prise du pouvoir, d'élever à son plus haut point l'énergie révolutionnaire des masses grâce aux manifestations, aux rassemblements, à la propagande, à l'agitation et à l'organisation, de gagner les masses dans une proportion de plus en plus importante et de préparer les esprits pour l'heure venue. Surtout il faut partout pousser à la réélection des conseils ouvriers sous le mot d'ordre :
Les Ebert-Scheidemann hors des conseils !
Dehors les bourreaux ! ”
(Appel de la Centrale du KPD du 3 février pour la réélection des conseils ouvriers)
Le 6 février, 109 délégués des conseils siègent et réclament la socialisation des moyens de production. Derrière cette revendication, il y a la reconnaissance croissante par les ouvriers que le contrôle des moyens de production ne doit pas rester aux mains du capital. Mais, tant que le prolétariat ne détient pas le pouvoir politique, tant qu'il n'a pas renversé le gouvernement bourgeois, cette revendication peut se retourner contre lui. Toutes les mesures de socialisation sans disposer du pouvoir politique ne sont pas seulement de la poudre aux yeux mais aussi un moyen que peut utiliser la classe dominante pour étrangler la lutte. C'est ainsi que le SPD promet une loi de socialisation qui prévoit une “ participation ” et un pseudo-contrôle de la classe ouvrière sur l'Etat. “ Les conseils ouvriers sont constitutionnellement reconnus comme représentation d'intérêts et de participation économique et sont ancrés dans la Constitution. Leur élection et leurs prérogatives seront réglementées par une loi spéciale qui prendra effet immédiatement. ”
Il est prévu que les conseils soient transformés en “ comités d'entreprise ” (Betribräte) et qu'ils aient pour fonction de participer au processus économique par la cogestion. Le but premier de cette proposition est de dénaturer les conseils et de les intégrer dans l'Etat. Ils ne sont plus ainsi des organes de double pouvoir contre l'Etat bourgeois mais au contraire servent à la régulation de la production capitaliste. De plus, cette mystification entretient l'illusion d'une transformation immédiate de l'économie dans “ sa propre usine ” et les ouvriers sont ainsi facilement enfermés dans une lutte locale et spécifique au lieu de s'engager dans un mouvement d'extension et d'unification du combat. Cette tactique, utilisée pour la première fois par la bourgeoisie en Allemagne, s'illustre à travers quelques occupations d'usines. Dans les luttes en Italie de 1919-1920 elle sera appliquée par la classe dominante avec grand succès.
A partir du 10 février, les troupes responsables des bains de sang de Brême et de Berlin marchent sur la Ruhr. Les conseils d'ouvriers et de soldats de l'ensemble du bassin décident la grève générale et appellent à la lutte armée contre les corps-francs. De partout s'élève l'appel “ Sortez des usines ! ” Un nombre très important d'affrontements armés a lieu et toujours sur le même schéma. La rage des ouvriers est telle que les locaux du SPD sont souvent attaqués, comme le 22 février à Mülheim-Ruhr où une réunion social-démocrate est mitraillée. A Gelsenkirchen, Dortmund, Bochum, Duisburg, Oberhausen, Wuppertal, Mülheim-Ruhr et Düsseldorf des milliers d'ouvriers sont en armes. Mais là aussi, comme à Berlin, l'organisation du mouvement fait cruellement défaut, il n'y a pas de direction unie pour orienter la force de la classe ouvrière, alors que l'Etat capitaliste, avec le SPD à sa tête, agit de façon organisée et centralisée.
Jusqu'au 20 février, 150 000 ouvriers sont en grève. Le 25 février, la reprise du travail est décidée et la lutte armée est suspendue. La bourgeoisie peut à nouveau déchaîner sa répression et les corps-francs investissent la Ruhr ville par ville. Cependant, début avril, une nouvelle vague de grèves reprend : le 1er, il y a 150 000 grévistes ; le 10, 300 000 et à la fin du mois leur nombre retombe à 130 000. A la mi-avril, à nouveau, la répression et la chasse aux communistes se déchaînent. Le rétablissement de l'ordre dans la Ruhr devient une priorité pour la bourgeoisie car simultanément à Brunswick, Berlin, Francfort, Dantzig et en Allemagne centrale d'importantes masses entrent en grève.
l'Allemagne centrale en février et en mars...
A la fin février, au moment où le mouvement se termine dans la Ruhr écrasé par l’armée, le prolétariat d'Allemagne centrale entre en scène. Alors que le mouvement dans la Ruhr s'est cantonné aux secteurs du charbon et de l'acier, ici il concerne tous les ouvriers de l'industrie et des transports. Dans presque toutes les villes et les grosses usines les ouvriers se joignent au mouvement.
Le 24 février la grève générale est proclamée. Les conseils d'ouvriers et de soldats lancent immédiatement un appel à ceux de Berlin pour unifier le mouvement. Une fois encore, le KPD met en garde contre toute action précipitée : “ Tant que la révolution n'a pas ses organes d'action centraux, nous devons opposer l'action d'organisation des conseils qui se développe localement en mille endroits. ” (Tract de la Centrale du KPD). Il s'agit de renforcer la pression à partir des usines, d'intensifier les luttes économiques et de renouveler les conseils ! Aucun mot d'ordre appelant au renversement du gouvernement n'est formulé.
Grâce à un accord sur la socialisation, la bourgeoisie parvient, ici aussi, à briser le mouvement. Les 6 et 7 mars le travail reprend. Et à nouveau la même action commune entre l'armée et le SPD se met en place : “ Pour toutes les opérations militaires (...) il est opportun de prendre contact avec les membres dirigeants du SPD fidèles au gouvernement. ” (Märcker, dirigeant militaire de la répression en Allemagne centrale). La vague de grève ayant débordé sur la Saxe, la Thüringe et l'Anhalt, les sbires de la bourgeoisie exercent leur répression jusqu'en mai.
Berlin, à nouveau, en mars...
Le mouvement dans la Ruhr et en Allemagne centrale touchant à sa fin, le prolétariat de Berlin entre à nouveau en lutte le 3 mars. Ses principales orientations sont : le renforcement des conseils d’ouvriers et de soldats, la libération de tous les prisonniers politiques, la formation d'une garde ouvrière révolutionnaire et l'établissement de contacts avec la Russie. La dégradation rapide de la situation de la population après la guerre, l'explosion des prix, le développement du chômage massif suite à la démobilisation, poussent les ouvriers à développer des luttes revendicatives. A Berlin, les communistes réclament de nouvelles élections aux conseils ouvriers pour accentuer la pression sur le gouvernement. La direction du KPD de la circonscription du Grand-Berlin écrit : “ Croyez vous atteindre vos objectifs révolutionnaires grâce au bulletin de vote ? (...) Si vous voulez faire progresser la révolution, alors engagez toutes vos forces dans le travail au sein des conseils d’ouvriers et de soldats. Faites en sorte qu'ils deviennent de véritables instruments de la révolution. Procédez à de nouvelles élections aux conseils d’ouvriers et de soldats. ”
Le SPD, de son côté, se prononce contre un tel mot d'ordre. Encore une fois, il se livre au sabotage du mouvement au niveau politique mais aussi, comme nous le verrons, au niveau répressif. Lorsque les ouvriers berlinois entrent en grève début mars, le conseil exécutif composé de délégués du SPD et de l'USPD prend la direction de la grève. Le KPD, lui, refuse d'y siéger : “ Accepter les représentants de cette politique dans le comité de grève signifie la trahison de la grève générale et de la révolution. ”
Comme le font aujourd'hui les socialistes, staliniens et autres représentants de la gauche du capital, le SPD a réussi à investir le comité de grève grâce à la crédulité d'une partie des ouvriers mais surtout grâce à toutes sortes de manoeuvres, magouilles et duperies. C'est pour ne pas avoir les mains liées que les spartakistes refusent, à ce moment-là, de siéger aux côtés de ces bourreaux de la classe ouvrière.
Le gouvernement fait interdire Die Rote Fahne alors que le SPD arrive à faire imprimer son journal. Les contre-révolutionnaires peuvent ainsi développer leur propagande répugnante tandis que les révolutionnaires sont condamnés au silence. Avant d'être interdit, Die Rote Fahne met en garde les ouvriers :
“ Cessez le travail ! Restez pour l'instant dans les usines. Rassemblez vous dans les usines. Convainquez les hésitants et ceux qui traînent. Ne vous laissez pas entraîner dans d'inutiles fusillades que guette Noske pour faire à nouveau couler le sang ”.
Rapidement, en effet, la bourgeoisie suscite des pillages, grâce à ses agents provocateurs, qui servent de justification officielle à l'engagement de l'armée. Les soldats de Noske détruisent en tout premier lieu les locaux de la rédaction de Die Rote Fahne. Les principaux membres du KPD sont à nouveau jetés en prison. Léo Jogisches est fusillé. C'est justement parce que Die Rote Fahne a mis en garde la classe ouvrière contre les provocations de la bourgeoisie, qu'il est la cible immédiate des troupes contre-révolutionnaires.
La répression à Berlin commence le 4 mars. Environ 1 200 ouvriers sont passés par les armes. Pendant des semaines la Sprée rejette des cadavres sur ses rives. Quiconque se trouve en possession d'un portrait de Karl et de Rosa est arrêté. Nous le répétons : ce ne sont pas les fascistes qui sont responsables de cette répression sanglante mais le SPD !
Alors que le 6 mars la grève générale est brisée en Allemagne centrale, celle de Berlin prend fin le 8.
En Saxe, en Bade et en Bavière aussi il y a, durant ces mêmes semaines, des luttes importantes mais jamais le lien ne réussit à se faire entre ces différents mouvements.
La république des conseils de Bavière en avril 1919
En Bavière aussi la classe ouvrière est en lutte. Le 7 avril le SPD et l'USPD, cherchant “ à regagner la faveur des masses par une action pseudo-révolutionnaire ” (Léviné), proclament la République des conseils. Comme en janvier à Berlin, le KPD constate que le rapport de forces n'est pas favorable aux ouvriers et prend position contre l'instauration de cette République. Pourtant les communistes de Bavière appellent les ouvriers à élire un “ conseil véritablement révolutionnaire ” en vue de la mise en place d'une véritable République des conseils communiste. E. Léviné se retrouve, le 13 avril, à la tête d'un nouveau gouvernement qui prend, sur les plans économique, politique et militaire, des mesures énergiques contre la bourgeoisie. Malgré cela, cette initiative est une lourde erreur des révolutionnaires de Bavière qui agissent à l'encontre des analyses et orientations du Parti.
Maintenu dans un total isolement par rapport au reste de l'Allemagne, le mouvement voit se développer une contre-offensive d'ampleur de la part de la bourgeoisie. Munich est affamée et 100 000 soldats s'amassent dans ses alentours. Le 27 avril le Conseil exécutif de Munich est renversé. De nouveau le bras de la répression sanglante s'abat et frappe : des milliers d'ouvriers sont fusillés ou tués dans les combats ; les communistes sont pourchassés et Léviné est condamné à mort.
oOo
Les générations actuelles du prolétariat ont du mal à imaginer ce que peut représenter la puissance d'une vague de luttes quasi-simultanées dans les grandes concentrations du capitalisme et la pression gigantesque que cela exerce sur la classe dominante.
A travers son mouvement révolutionnaire en Allemagne, la classe ouvrière a prouvé qu'elle est en mesure, face à une bourgeoisie parmi les plus expérimentées, d'établir un rapport de force qui aurait pu conduire au renversement du capitalisme. Cette expérience montre que le mouvement révolutionnaire du début du siècle n'était pas réservé au prolétariat de “ pays arriérés ” comme la Russie mais qu'il a impliqué massivement les ouvriers du pays le plus développé industriellement d'alors.
Mais la vague révolutionnaire, de janvier à avril 1919, s'est développée dans la dispersion. Ces forces, concentrées et unies, auraient suffi au renversement du pouvoir bourgeois. Elles se sont au contraire éparpillées et le gouvernement est ainsi parvenu à les affronter et à les anéantir paquet par paquet. L'action de celui-ci, dès janvier à Berlin, avait décapité et brisé les reins de la révolution.
Richard Müller, l'un des dirigeants des “ hommes de confiance révolutionnaires ”, qui se sont caractérisés pendant longtemps par leurs grande hésitation, ne peut s'empêcher de constater : “ Si la répression des luttes de janvier à Berlin ne s'était pas produite, alors le mouvement aurait pu obtenir plus d'élan ailleurs au printemps et la question du pouvoir se serait posée plus précisément dans toute sa portée. Mais la provocation militaire avait en quelque sorte coupé l'herbe sous le pied du mouvement. L'action de janvier avait fourni des arguments pour les campagnes de calomnies, le harcèlement et la création d'une atmosphère de guerre civile. ”
Sans cette défaite, le prolétariat de Berlin aurait pu opportunément soutenir les luttes qui se sont développées dans les autres régions d'Allemagne. Par contre, cet affaiblissement du bataillon central de la révolution a permis aux forces du capital de passer à l'offensive et d'entraîner partout les ouvriers dans des affrontements militaires prématurés et dispersés. La classe ouvrière, en effet, n'est pas parvenue à mettre sur pied un mouvement large, uni et centralisé. Elle n'a pas été capable d'imposer un double pouvoir dans tout le pays à travers le renforcement des conseils et de leur centralisation.
Seul l'établissement d'un tel rapport de force peut permettre de se lancer dans une action insurrectionnelle, celle-ci exigeant la plus grande conviction et coordination dans l’action. Et cette dynamique ne peut se développer sans l'intervention claire et déterminée d’un parti politique au sein du mouvement. C'est ainsi que le prolétariat peut se sortir victorieusement de son combat historique.
La défaite de la révolution en Allemagne durant les premiers mois de l'année 1919 n'est pas seulement le fait de l'habileté de la bourgeoisie autochtone. Elle est aussi le résultat de l'action concertée de la classe capitaliste internationale. Cette dernière qui, pendant 4 années, s'est entre-déchirée avec la plus extrême violence, a dépassé ses profondes divisions et retrouvé une unité pour faire face au prolétariat révolutionnaire. Lénine le met clairement en évidence quand il affirme que tout a été
Alors que la classe ouvrière en Allemagne offre des luttes dispersées, les ouvriers en Hongrie en mars se dressent contre le capital dans des affrontements révolutionnaires. Le 21 mars 1919 la République des conseils est proclamée en Hongrie mais elle est cependant écrasée dans l'été par les troupes contre-révolutionnaires.
La classe capitaliste internationale se tenait unie derrière la bourgeoisie en Allemagne. Alors que pendant quatre années auparavant elle s'était entre-déchirée le plus violemment, elle s'affrontait unie à la classe ouvrière. Lénine pensait que tout avait été “ fait pour s'entendre avec les conciliateurs allemands afin d'étouffer la révolution allemande. ” (Rapport du Comité central pour le 9e Congrès du PCR). C'est une leçon que la classe ouvrière doit retenir : chaque fois qu'elle met en danger le capitalisme, elle trouve face à elle non pas une classe dominante divisée mais des forces du capital unies internationalement.
Cependant si le prolétariat en Allemagne avait pris le pouvoir, le front capitaliste aurait été enfoncé et la révolution russe ne serait pas restée isolée.
Lorsque la 3e Internationale est fondée à Moscou en mars 1919, pendant que se développent encore les luttes en Allemagne, cette perspective semble à portée de main à l'ensemble des communistes. Mais la défaite ouvrière en Allemagne va entamer le déclin de la vague révolutionnaire internationale et notamment celui de la révolution russe. C'est l'action de la bourgeoisie, avec le SPD comme tête de pont qui va permettre l'isolement puis la dégénérescence de la révolution bolchevik et accoucher ultérieurement du stalinisme.
***
Dans le prochain article on abordera l'intervention des révolutionnaires dans les luttes depuis 1914 et on examinera à nouveau la question si l'échec de la révolution doit exclusivement être mis au compte de la faiblesse ou de l'absence d'un parti.
DV.
[6] [355]. Les “ hommes de confiance révolutionnaires ”, Revolutionnäre Obleute (RO), sont constitués, à l’origine, essentiellement de délégués syndicaux élus dans les usines, mais qui ont rompu avec les directions social-chauvines des centrales syndicales. Ils sont le produit direct de la résistance de la classe ouvrière contre la guerre et contre la trahison des partis ouvriers et des syndicats. Malheureusement, la révolte contre la direction syndicale, les conduit souvent à être rétifs à l’idée de centralisation et à développer un point de vue trop localiste, voire usiniste. Ils seront toujours mal à l’aise dans les questions politiques générales et souvent une proie facile pour la politique de l’USPD.
Géographique:
- Allemagne [133]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [134]
Conscience et organisation:
Approfondir:
- Révolution Allemande [136]
Heritage de la Gauche Communiste:
Réponse au BIPR [2° partie] : Les théories sur la crise historique du capitalisme
- 4694 lectures
Dans l’Internationalist Communist Review n° 13, le BIPR répond à notre article de polémique "La conception du BIPR sur la décadence du capitalisme" paru dans le n° 79 de la Revue Internationale. Dans la Revue Internationale n° 82 nous avons publié la 1re partie de cet article, montrant les implications négatives qu'a la conception du BIPR sur le. guerre impérialiste comme moyen de dévalorisation du capital et de renaissance des cycles d'accumulation. Dans cette 2e partie, nous allons analyser la théorie économique qui sous-tend cette conception : la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit.
L'explication de la crise historique du capitalisme dans le mouvement marxiste,
Les économistes bourgeois, depuis les classiques (Smith, Ricardo, etc.), s'appuient sur deux dogmes intangibles :
1. L'ouvrier est un citoyen libre qui vend sa force de travail en échange d'un salaire. Le salaire est sa participation à la rente sociale, au même titre que le bénéfice qui rémunère l'entrepreneur.
2. Le capitalisme est un système éternel. Ses crises sont temporaires ou conjoncturelles, et proviennent des disproportions entre les différentes branches de production, des déséquilibres dans la distribution ou d'une mauvaise gestion. Cependant, à la longue, le capitalisme n'a pas de problème de réalisation des marchandises : la production trouve toujours son marché, atteignant l'équilibre entre l'offre (la production) et la demande (la consommation).
Marx a combattu à mort ces dogmes de l'économie bourgeoise. 11 a démontré que le capitalisme n'est pas un système éternel : "Dans le cours de leur développement, les forces productives de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété dans lesquels elles se sont mues jusqu'alors. De forme de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports se transforment en frein de ces forces. Alors s'ouvre une période de révolution sociale. " (Préface à la Contribution à la critique de l'économie politique). Cette période de crise historique, de décadence irréversible du capitalisme, s'est ouverte avec la première guerre mondiale. Depuis lors, une fois vaincue la tentative révolutionnaire mondiale du prolétariat de 1917-23, la survie du capitalisme coûte à l'humanité des océans de sang (100 millions de morts dans des guerres impérialistes entre 1914 et 1968), de sueur (accroissement brutal de l'exploitation de la classe ouvrière) et de larmes (la terreur du chômage, les barbaries de toutes sortes, la déshumanisation des rapports sociaux).
Cependant cette analyse fondamentale, patrimoine commun de la Gauche communiste, n'est pas expliquée de la même manière au sein du milieu politique révolutionnaire actuel. Il existe deux théories pour expliquer la décadence du capitalisme, la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit et celle que l'on appelle la "théorie des marchés", basée essentiellement sur la contribution de Rosa Luxemburg.
Le BIPR adhère à la première théorie, tandis que nous nous revendiquons de la seconde ([1] [356]). Pour que la polémique entre les deux théories soit fructueuse, il est nécessaire de la baser sur une compréhension de l'évolution du débat au sein du mouvement marxiste.
Marx vivait à l'époque de l'apogée du capitalisme. Bien qu'à cette époque la crise historique du système ne se posait pas de manière aussi dramatique qu'aujourd'hui, il fut capable de voir dans les crises cycliques de croissance qui secouaient périodiquement le capitalisme une manifestation de ses contradictions et l'annonce des convulsions qui le conduiraient à la ruine.
"(...) Marx a mis en évidence deux contradictions fondamentales qui se trouvaient à la base des crises de croissance que le capitalisme a traversées au 19e siècle, et qui allaient, à un moment donné, pousser le capitalisme dans une phase de déclin historique, le plonger dans une crise mortelle qui mettrait la révolution communiste à l'ordre du jour. Ces deux contradictions sont : 1) la tendance du taux de profit à baisser, avec l'inévitabilité de l'élévation constante de la composition organique du capital, et 2) le problème de la surproduction, une maladie innée du système capitaliste qui produit plus que le marché ne peut absorber. " ([2] [357])
Comme nous verrons plus loin, "Bien que Marx ait élaboré un cadre dans lequel ces deux phénomènes sont intimement liés, il n'a jamais terminé son examen du système capitaliste de sorte que, selon ses différents écrits, il donne plus ou moins d'importance à l'un ou l'autre phénomène comme cause fondamentale de la crise (...) C'est le caractère inachevé de la pensée de Marx sur ce sujet crucial - qui n'est pas déterminé par l'incapacité personnelle de Marx à achever Le Capital mais, comme nous l'avons dit, par les limites de la période historique dans laquelle il écrivait - qui a amené la controverse au sein du mouvement ouvrier sur les fondements économiques du déclin du capitalisme. " ([3] [358])
A la fin du siècle dernier, les conditions du capitalisme commencèrent à changer : l'impérialisme comme politique de rapine et d'affrontement entre puissances se développait à pas de géant et, d'autre part, le capitalisme montrait des signes croissants de maladie (inflation, développement du militarisme dans les pays "arrivés trop tard" tels l'Allemagne ou la Russie) qui venaient contrecarrer fortement une croissance et une prospérité ininterrompues depuis la décennie 1870. Dans ce contexte apparût, au sein de la 2e Internationale, un courant opportuniste qui mettait en question la thèse marxiste de l'effondrement du capitalisme et misait sur une transition graduelle vers le socialisme à travers des réformes successives d'un capitalisme dont "les contradictions s'amenuisaient". Les théoriciens de ce courant concentraient leur artillerie, précisément contre la deuxième des contradictions relevées par Marx : la tendance à la surproduction. Ainsi Bernstein disait : "Marx se contredit en reconnaissant que la cause ultime des crises est la limitation de la consommation des masses. En réalité, la théorie de Marx sur la crise ne diffère pas beaucoup du sous-consumérisme de Rodbertus. " ([4] [359])
En 1902, Tugan-Baranovski, un révisionniste russe, attaqua la théorie de Marx sur la crise du capitalisme, niant que celui-ci puisse rencontrer un problème de marché et affirmant que les crises se produisent en conséquence "disproportion" entre les différents secteurs.
Tugan-Baranovski alla même plus loin que ses collègues révisionnistes allemands (Bernstein, Schmidt, Vollmar, etc.).Il revint aux dogmes de l'économie bourgeoise, reprit concrètement l'idée de Say (amplement critiquée par Marx), basée sur la thèse selon laquelle "le capitalisme n'a aucun problème de réalisation si ce n'est quelques troubles conjoncturels " ([5] [360]). Il y eut une réponse très ferme de la 2e Internationale par Kautsky, qui alors se situait encore dans les rangs révolutionnaires : "Les capitalistes et les ouvriers qu'ils exploitent constituent un marché pour les moyens de consommation produits par l'industrie, marché qui s'agrandit avec l'accroissement de la richesse des premiers et le nombre des seconds, mais moins vite cependant que l'accumulation du capital et que la productivité du travail, et qui ne suffit pas à lui seul pour absorber les moyens de consommation produits par la grande industrie capitaliste. L'industrie doit chercher des débouchés supplémentaires à l'extérieur de sa sphère dans les professions et les nations qui ne produisent pas encore selon le mode capitaliste. (...) Ces débouchés supplémentaires ne possèdent pas, et de loin, l'élasticité et la capacité d'extension de la production capitaliste... Telle est, en quelques mots, la théorie des crises adoptée généralement, pour autant que nous le sachions, par les "marxistes orthodoxes" et fondée par Marx. " ([6] [361])
Cependant, la polémique s'est radicalisée quand Rosa Luxemburg a publié L'accumulation du capital. Dans ce livre, Rosa Luxemburg essaie d'expliquer le développement vertigineux de l'impérialisme et la crise toujours plus profonde du capitalisme. Elle démontre que le capitalisme s'est développé historiquement en étendant, à des régions ou secteurs pré-capitalistes, ses rapports de production basés sur le travail salarié et qu'il atteint ses limites historiques quand ces rapports embrassent toute la planète. Dès lors, il n'existe plus de territoires nouveaux correspondant aux nécessités d'expansion qu'imposé la croissance de la productivité du travail et de la composition organique du capital : "Ainsi le capitalisme ne cesse de croître grâce à ses relations avec les couches sociales et les pays non capitalistes, poursuivant l'accumulation à leurs dépens mais en même temps les décomposant et les refoulant pour s'implanter à leur place. Mais à mesure qu'augmenté le nombre des pays capitalistes participant à la chasse aux territoires d'accumulation et à mesure que se rétrécissent les territoires encore disponibles pour l'expansion capitaliste la lutte du capital pour ses territoires d'accumulation devient de plus en plus acharnée et ses campagnes engendrent à travers le monde une série de catastrophes économiques et politiques : crises mondiales, guerres, révolutions. " ([7] [362])
Les critiques de Rosa Luxemburg nient que le capitalisme ait un problème de réalisation, c'est-à-dire oublient cette contradiction du système que Marx a affirmé avec acharnement contre les économistes bourgeois, et qui constitue la base de "¡a théorie de la crise fondée par Marx", comme l'a rappelé, quelques années auparavant, Kautsky contre le révisionniste Tugan-Baranovski.
Les contradicteurs de Rosa Luxemburg s'érigent en défenseurs "orthodoxes et inconditionnels " de Marx et, plus particulièrement, de ses schémas de la reproduction élargie présentés dans le tome II du Capital. C'est-à-dire qu'ils affaiblissent la pensée de Marx en interprétant faussement un aspect du Capital en l'isolant du reste de l'analyse globale ([8] [363]). Leurs arguments sont très variés. Eckstein disait qu'il n'y a pas de problème de réalisation parce que les tableaux de la reproduction élargie de Marx expliquent "parfaitement" qu'il n'y a aucune partie de la production qui ne soit pas vendue. Hilferding ressuscite la théorie de la "proportionnalité entre les secteurs " disant que les crises sont dues à l'anarchie de la production et que la tendance du capitalisme à la concentration réduit cette anarchie et, partant, les crises. Finalement, Bauer dit que Rosa Luxemburg avait signalé un problème réel mais que celui-ci avait une solution dans le capitalisme : l'accumulation suit la croissance de la population.
A cette époque, seul un rédacteur d'un périodique socialiste local opposa à Rosa Luxemburg la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit. A ses objections celle-ci répondit ainsi.: "Ou alors, il reste la consolation vague du petit "expert" de la Dresdener Volkszeitung, qui, après avoir exécuté mon livre, déclare que le capitalisme finira par s'effondrer "à cause de la baisse du taux de profit". Comment le brave homme imagine-t-il les choses ? Arrivé à un certain point, la classe capitaliste, désespérée de l'insignifiance du taux de profit se pendra-t-elle collectivement, ou bien déclarera-t-elle que, puisque les affaires vont si mal, il ne vaut pas la peine de s'embarrasser de soucis et de tourments, passera-t-elle la main au prolétariat ? En tout cas cette consolation est réduite à néant par une seule phrase de Marx : "Pour les grands capitalistes, la baisse du taux de profit est compensée par sa masse." // coulera encore de l'eau sous les ponts avant que la baisse du taux de profit ne provoque l'effondrement du capitalisme. " ([9] [364])
Lénine et les bolcheviks ne participaient pas à cette polémique ([10] [365]). Il est certain que Lénine avait combattu la théorie des populistes sur les marchés, une théorie sous-consumériste dans la lignée des erreurs de Sismondi. Pourtant, jamais Lénine n'a nié le problème des marchés : dans son analyse du problème de l'impérialisme, bien qu'il s'appuie principalement sur la théorie de Hilferding sur la concentration du capital financier ([11] [366]), il ne manque pas de reconnaître que celle-ci surgit sous la pression de la saturation générale du marché mondial. Ainsi, dans L'impérialisme stade suprême du capitalisme, il répond à Kautsky en soulignant que "la caractéristique de l'impérialisme est précisément la tendance à l'annexion non seulement des région agraires, mais aussi des plus industrielles, car, la division du monde une fois terminée, oblige à procédera un nouveau partage, à étendre la main sur tout type de territoire. "
Dans la 3e Internationale dégénérescente Boukharine, dans le livre L'impérialisme et l'accumulation du capital, attaque la thèse de Rosa Luxemburg dans le contexte du développement d'une théorie qui ouvrira les portes au triomphe du stalinisme : la théorie de la "stabilisation" du capitalisme (qui présupposait la thèse révisionniste selon laquelle il était capable de dépasser les crises) et de la "nécessité" pour l'URSS de "coexister" pour un temps prolongé avec le système capitaliste. La critique fondamentale de Boukharine à Rosa Luxemburg est que celle-ci se serait limitée à privilégier la contradiction concernant le marché, oubliant toutes les autres, dont celle de la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit. ([12] [367])
A la fin des années 1920 et au début des années 1930 "Paul Mattick, qui appartenait au mouvement des Communistes de Conseils, reprenait la critique d’Henrik Grossman à Rosa Luxemburg et l'idée que la crise permanente du capitalisme a lieu lorsque la composition organique du capital atteint une telle ampleur qu'il y a de moins en moins de plus-value pour relancer l'accumulation. Cette idée de base - tout en étant davantage élaborée sur de nombreux points - est aujourd'hui défendue par de nombreux groupes révolutionnaires comme la CWO. Battaglia Comunista et certains des groupes qui surgissent en Scandinavie. " ([13] [368])
La théorie marxiste de la crise ne se base pas uniquement sur la baisse tendancielle du taux de profit.
II doit être clair que la contradiction dont souffre le capitalisme dans la réalisation de la plus-value joue un rôle fondamental dans la théorie marxiste de la crise, et que les tendances révisionnistes attaquent cette thèse avec une rage particulière. Le BIPR prétend le contraire. Ainsi, dans sa Réponse, il nous dit : "Pour Marx, la source de toute crise authentique se trouve au sein même du système capitaliste, dans les rapports entre capitalistes et ouvriers. Il l'a présentée quelques fois comme une crise née de la capacité limitée des ouvriers à consommer le produit de leur propre travail (...) Il continuait en ajoutant que cela n'est pas dû à la surproduction "en soi" (...) Et Marx continue en expliquant que celles-ci sont causées par la chute du taux de profit (...) La crise dévalorise le capital et permet un nouveau cycle d'accumulation. " ([14] [369]). L'assurance du BIPR est telle qu'il se permet d'ajouter que "les "cycles schématiques de l'accumulation" dont nous sommes heureux d'être prisonniers, se produisent exactement comme Marx les avait prévus. " ([15] [370])
C'est une déformation de la pensée de Marx de dire qu'il expliquait la crise historique du capital uniquement par la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit. Pour trois raisons fondamentales :
1) Marx mettait l'accent sur les deux contradictions (baisse du taux de profit et surproduction) :
- Il a établi que le processus de production capitaliste comporte deux parties, la production proprement dite et sa réalisation. Dit simplement, le profit inhérent à l'exploitation n'est rien pour le capitaliste individuel ni non plus pour le capitalisme dans sa globalité si les marchandises produites ne sont pas vendues : "La masse totale des marchandises, le produit total, la partie qui représente le capital constant et le capital variable comme celle qui représente la plus-value, doivent être vendues. Si cette vente n'est pas effective ou si elle ne se réalise que de façon partielle ou se fait à des prix inférieurs aux prix de production, l'ouvrier, bien entendu, est exploité, mais le capitaliste ne réalise pas cette exploitation comme telle. " ([16] [371])
- Il a souligné l'importance vitale du marché dans le développement du capitalisme : "// est nécessaire que le marché augmente sans cesse, de façon que ses connexions internes et les conditions qui le régulent acquièrent toujours plus la forme de lois naturelles (...) Cette contradiction interne trouve sa solution dans l'extension du champs extérieur de la production" ([17] [372]). Mais plus loin, il s'interroge : "Comment serait-il possible que la demande de ces marchandises, de celles dont manque la grande masse de la population, soit insuffisante et qu'il faille chercher cette demande à l'étranger, dans des marchés éloignés, pour pouvoir payer aux ouvriers du pays la quantité moyenne de subsistances indispensables ? Parce que le système spécifiquement capitaliste, avec ses interdépendances internes, est le seul où le produit excédentaire acquiert une forme telle que son possesseur ne peut se permettre de le consommer tant qu'il n'est pas transformé en capital. " ([18] [373])
- Il a condamné sans rémission la thèse de Say selon laquelle il n'y aucun problème de réalisation dans le capitalisme : "La conception que Ricardo a repris du vide et insubstantiel Say que la surproduction ou, pour le moins, la saturation générale du marché, est impossible, se base sur le principe que les produits s'échangent toujours contre des produits ou, comme l'a dit Mill, la demande n'est déterminée que par la production. " ([19] [374])
- Il a insisté sur le fait que la surproduction permanente exprime les limites historiques du capitalisme : "Si l'on admet que le marché doit se développer en même temps que la production, on admet, d'un autre côté, la possibilité de surproduction, parce que le marché est extrêmement limité au sens géographique (...) Il est parfaitement possible que les limites du marché ne puissent se développer assez rapidement pour la production ou que les nouveaux marchés puissent être rapidement absorbés par la production de façon que le marché élargi représente une entrave pour la production, comme l'était le marché antérieur plus limité." ([20] [375])
2) Marx a établi l'ensemble des causes qui contrecarrent la baisse tendancielle du taux de profit. Dans le chapitre XTV du Livre 3 du Capital, il analyse les six causes qui contrecarrent cette tendance : augmentation du niveau d'exploitation du travail, réduction du salaire en dessous de sa valeur, réduction du coût du capital constant, surpopulation relative, commerce extérieur, augmentation du capital-actions.
- Il concevait la baisse tendancielle du taux de profit comme une expression de l'augmentation constante de la productivité du travail, tendance que le capitalisme développe à un niveau jamais vu dans les modes de productions antérieurs : "A mesure que diminue progressivement le capital variable relativement au capital constant, la composition organique de l'ensemble du capital s'élève de plus en plus, et la conséquence immédiate de cette tendance c'est que le taux de plus-value se traduit par un taux de profit général en baisse continuelle ... Par conséquent, la tendance progressive à la baisse du taux de profit général est tout simplement une manière, propre au mode de production capitaliste, d'exprimer le progrès de la productivité sociale du travail. " ([21] [376])
- Il a précisé que ce n'est pas une loi absolue, mais une tendance qui contient toute une série d'effets contraires (exposés plus haut) qui naissent de cette tendance même : "Et ainsi donc nous avons vu qu'en général les mêmes causes qui provoquent la baisse du taux de profit général suscitent des effets contraires qui freinent, ralentissent et paralysent partiellement cette baisse. Ils ne suppriment pas la loi, mais en affaiblissent l'effet. Sinon ce n'est pas la baisse du taux de profit général qui serait incompréhensible, mais inversement la lenteur relative de cette baisse. C'est ainsi que la loi n'agit que sous forme de tendance dont l'effet n'apparaît d'une façon frappante que dans des circonstances déterminées et sur de longues périodes de temps. " ([22] [377])
- En rapport avec la baisse tendancielle du taux de profit, Marx souligne l'importance primordiale du "commerce extérieur" et surtout de la recherche continue de nouveaux marchés : "Mais ce même commerce extérieur favorise dans la métropole le développement du mode de production capitaliste et entraîne ainsi la réduction du capital variable par rapport au capital constant ; et d'un autre côté il crée par rapport à l'étranger une surproduction et donc il finirá de nouveau par agir en sens opposé. " ([23] [378])
3) Finalement, au contraire de ce que pense le BIPR, Marx ne voyait pas la dévalorisation de capital comme l'unique moyen dont dispose le capitalisme pour surmonter les crises, il a insisté à plusieurs reprises sur l'autre moyen : la conquête de nouveaux marchés.
"Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle cette crise ? D'une part par la destruction obligée d'une masse de forces productives ; et d'autre part par la conquête de not veaux marchés et l'exploitation plus intensives des précédents. " ([24] [379])
"La production capitaliste est une phase économique de transition pleine de contradictions internes qui ne se développent et deviennent perceptibles que dans le cours de sa propre évolution. Cette tendance à se créer un marché et à l'annuler en même temps est justement une de ces contradictions. Une autre contradiction est la "situation sans issue" à quoi cela conduit, et qui dans un pays sans marché extérieur comme la Russie, survient plus avant que dans des pays qui ont plus ou moins de capacités pour rivaliser sur le marché mondial. Cependant, dans ces derniers pays, cette situation apparemment sans issue trouve un remède dans les moyens héroïques de la politique commerciale; c'est-à-dire, dans l'ouverture violente de nouveaux marchés. Le dernier en date des nouveaux marchés que s'est ouvert de cette façon le commerce anglais et qui s'est montré apte à animer temporairement le dit commerce, est la Chine. " ([25] [380])
Le problème de l'accumulation
Cependant, le BIPR nous donne un autre argument "de poids " : "comme nous l'avons souligné plus haut, cette théorie (il se réfère à celle de Rosa Luxemburg) réduit à un non-sens Le Capital de Marx, puisque celui-ci développe son analyse en considérant un système capitaliste fermé qui n'a pas d"'acheteurs tiers" (et cependant, il fut capable de découvrir le mécanisme de la crise)". ([26] [381])
II est tout à fait certain que Marx soulignait que "l'introduction du commerce extérieur dans l'analyse de la valeur des marchandises annuellement produites ne peut créer que de la confusion, sans apparier aucun élément nouveau ni au problème ni à sa solution " ([27] [382]). Il est vrai que, dans le dernier chapitre du 2e livre, Marx, essayant de comprendre les mécanismes de la reproduction élargie du capitalisme, affirme que l'on doit faire abstraction des "éléments extérieurs ", que l'on doit supposer qu'il n'y a que des capitalistes et des ouvriers et, partant de ces présupposés, il élabore les schémas de la reproduction élargie du capital. Ces fameux schémas ont servi de "bible" aux révisionnistes pour "démontrer" que "Marx donnait dans le 3e Livre du Capital une explication suffisante de l'accumulation, que les schémas prouvaient clairement que le capital peut parfaitement croître et la production s'étendre, sans qu'il y ait dans le monde d'autre mode de production que la production capitaliste ; celle-ci trouve en elle-même, d'après eux, ses propres débouchés ; c'est seulement mon incompréhension absolue des schémas de Marx qui m'a conduite à voir là un problème. " ([28] [383])
Il est absurde de prétendre que l'explication des crises capitalistes est contenue dans les fameux schémas de l'accumulation. Le centre de la critique de Rosa Luxemburg est précisément la supposition sur laquelle elle est élaborée : "la réalisation de la plus-value aux fins d'accumulation est un problème insoluble pour une société qui ne compte que des capitalistes et des ouvriers. " ([29] [384]). Partant de là, elle en démontre l'inconsistance : "Pour qui les capitalistes produisent-ils ce qu'ils ne consomment pas ; ce dont ils se 'privent', c'est-à-dire ce qu'ils accumulent ? Ce ne peut pas être pour l'entretien d'une armée toujours plus importante d'ouvriers, puisqu'en régime capitaliste la consommation des ouvriers est une conséquence de l'accumulation ; jamais son moyen ni sa fin (...) Qui donc réalise la plus-value qui croît constamment ? Le schéma répond : les capitalistes eux-mêmes et seulement eux ([30] [385]). Et que font-ils de leur plus-value croissante ? Le schéma répond ils l'utilisent pour élargir de plus en plus leur production. Ces capitalistes sont fanatiques de la production pour elle-même, ils font construire de nouvelles machines pour construire avec elles, à son tour, de nouvelles machines. Mais ce qui résultera de là n'est pas une accumulation de capital, mais une production croissante de moyens de production sans fin et il faut avoir l'audace de Tugan-Baranovski pour supposer que ce carrousel incessant, dans le vide, peut être un miroir théorique fidèle de la réalité capitaliste et une véritable conscience de la doctrine marxiste. " ([31] [386])
De là, elle conclut que "Marx a exposé de façon très détaillée et claire, sa propre conception du cours caractéristique de l'accumulation capitaliste dans toute son œuvre, en particulier dans le Livre III. Et il a suffisamment approfondi cette conception pour s'apercevoir que les schémas insérés à la fin du Livre II sont insuffisants. Si l'on examine le schéma de la reproduction élargie, du point de vue de la théorie de Marx, on s'aperçoit nécessairement qu'il se trouve en contradiction avec elle sur divers aspects. " ([32] [387])
Le capitalisme dépend, pour son développement historique, d'un milieu ambiant pré capitaliste avec lequel il établit une relation qui comprend, de façon indissociable, trois éléments : échange (acquisition de matières premières en échange de produits manufacturés), destruction de ces formes sociales (destruction de l'économie naturelle de subsistance, séparation des paysans et artisans de leur moyens de travail) et intégration à la production capitaliste (développement du travail salarié et de l'ensemble des institutions capitalistes).
Ces rapports d'échange-destruction-intégration embrasse le long processus de formation (16e et 17e siècles), apogée (19e siècle) et décadence (20e siècle) du système capitaliste et constitue une nécessité vitale pour l'ensemble de ses rapports de production : "le processus d'accumulation du capital est lié, par ses rapports de valeur et de marchandises : capital constant, capital variable et plus-value, à des formes de production non capitalistes. L'accumulation du capital ne peut pas être ignorée sous le prétexte de la domination exclusive et absolue du mode de production capitaliste, puisque, sans le milieu non capitaliste, elle est inconcevable de toute façon. " ([33] [388])
Pour Battaglia Comunista ce processus historique qui se développe au niveau du marché mondial n'est rien d'autre que le reflet d'un processus beaucoup plus profond : "bien qu'on parte du marché et des contradiction qui s'y manifestent (production-circulation, déséquilibre entre l'offre et la demande) il faut revenir aux mécanismes qui règlent l'accumulation pour avoir une vision plus juste du problème. Le capitalisme en tant qu'unité production-circulation nous oblige à considérer ce qui se passe sur le marché comme conscience de la maturation des contradictions qui sont à la base des rapports de production, et non l'inverse. C'est le cycle économique et la nécessité de la valorisation du capital qui conditionnent le marché. Ce n'est qu'en partant des lois contradictoires qui règlent le processus d'accumulation qu'il est possible d'expliquer les lois du marché. " ([34] [389])
La réalisation de la plus-value, le fameux "saut périlleux de la marchandise" dont parlait Marx, constituerait la "surface" du phénomène, la "caisse de résonance" des contradictions de l'accumulation. Cette vision avec ses airs de "profondeur" ne renferme pas autre chose qu'un profond idéalisme : les "lois du marché " seraient le résultat "extérieur" des lois "internes" du processus d'accumulation. Ce n'est pas la vision de Marx, pour qui les deux moments de la production capitaliste (la production et la réalisation) ne sont pas le reflet l'un de l'autre, mais les deux parties inséparables de l'unité globale qu'est l'évolution historique du capitalisme : "la marchandise entre dans le processus de circulation non seulement comme une valeur d'usage particulière, par exemple une tonne de fer, mais aussi comme une valeur d'usage ayant un prix déterminé, supposons une once d'or. Ce prix qui est, pour partie, l'exposant du "quantum" de temps de travail contenu dans le fer, c'est-à-dire de sa quantité de valeur, exprime en même temps la capacité qu'a le fer de se convertir en or (...) Si cette transsubstantiation ne s'opère pas, la tonne de fer non seulement cesse d'être une marchandise, mais aussi un produit, car précisément elle est une marchandise parce qu'elle constitue une non valeur pour son possesseur, ou dit autrement, parce que son travail n'est pas un travail réel tant qu'il n'est pas un travail utile pour les autres (...) La mission du fer ou de son possesseur consiste donc à découvrir dans le monde des marchandises le lieu oit le fer attire l'or. Cette difficulté, le "saut périlleux" de la marchandise, sera vaincue si la vente s'effectue réellement. " ([35] [390])
Toute tentative de séparer la production de la réalisation empêche de comprendre le mouvement historique du capitalisme qui le mène à son apogée (formation du marché mondial) et à sa crise historique (saturation chronique du marché mondial) : "Les capitalistes se voient forcés d'exploiter à une échelle toujours plus élevée les gigantesques moyens de production déjà existants (...) A mesure que croît la masse de production et, par conséquent, la nécessité de marchés plus étendus, le marché mondial se réduit de plus en plus et il reste de moins en moins de marchés nouveaux à exploiter, parce que chaque crise antérieure soumet au marché mondial un nouveau marché non encore conquis ou que le marché exploitait superficiellement. " ([36] [391]) Ce n'est que dans le cadre de cette unité que l'on peut intégrer de façon cohérente la tendance à l'élévation continue de la productivité du travail : "Le capital ne consiste pas à ce que le travail accumulé serve le travail vivant comme moyen pour une nouvelle production. Il consiste à ce que le travail vivant serve au travail accumulé comme moyen pour conserver et augmenter la valeur d'échange. " ([37] [392])
Quand Lénine étudie le développement du capitalisme en Russie, il utilise la même méthode : "L'important c'est que le capitalisme ne peut subsister et se développer sans un accroissement constant de sa sphère de domination, sans coloniser de nouveaux pays et enrôler les vieux pays non capitalistes dans le tourbillon de l'économie mondiale. Et cette particularité du capitalisme s'est manifestée et continue de sa manifester avec une force énorme dans la Russie postérieure à la Réforme. " ([38] [393])
Les limites historiques du capitalisme
Le BIPR pense cependant que Rosa Luxemburg s'est acharnée à chercher des causes "extérieures" à la crise du capitalisme : "à l'origine, Luxemburg défendait l'idée que la cause de la crise devait être cherchée dans les rapports de valeur inhérents au mode de production capitaliste lui-même (...) Mais la lutte contre le révisionnisme au sein de la social-démocratie allemande semble l'avoir conduite, en 1913, à chercher une autre théorie économique avec laquelle contrecarrer l'affirmation révisionniste selon laquelle la baisse tendancielle du taux de profit ne serait pas valide. Dans L'accumulation du capital elle conclut qu'il y a un défaut dans l'analyse de Marx et elle décide que la cause de la crise capitaliste est extérieure aux rapports capitalistes."([39] [394])
Les révisionnistes ont reproché à Rosa Luxemburg d'avoir soulevé un problème inexistant alors que, selon eux, les tableaux de la reproduction élargie de Marx "démontrent" que toute la plus-value se réalise à l'intérieur du capitalisme. Le BIPR n'a pas recours à ces tableaux, mais sa méthode revient au même : pour lui, Marx, avec son schéma des cycles de l'accumulation, avait donné la solution. Le capitalisme se produit et se développe jusqu'à ce que le taux de profit chute et alors le blocage de la production que provoque cette tendance se transforme "objectivement" en une dépréciation massive des capitaux. A travers cette dépréciation, le taux de profit se restaure, le processus reprend, et ainsi de suite. Il est vrai que le BIPR admet que, historiquement, du fait de l'augmentation de la composition organique du capital et de la tendance à la concentration et à la centralisation du capital, l'évolution est beaucoup plus compliquée : au 20e siècle ce processus de concentration fait que les dévalorisations nécessaires de capital ne peuvent plus se limiter à des moyens strictement économiques (fermetures d'entreprises, licenciement d'ouvriers) mais requièrent d'énormes destructions réalisées par la guerre mondiale (voir la première partie de cet article).
Cette explication est, dans le meilleur des cas, une description des mouvements conjoncturels du capital mais ne permet pas de comprendre le mouvement global, historique, du capitalisme. Avec elle, nous avons un thermomètre pas très fiable (nous avons expliqué, en suivant Marx, les causes qui contrarient la loi) des convulsions et de la marche du capitalisme mais on ne comprend pas, ni même on ne commence à présenter, le pourquoi, la cause profonde de la maladie. Avec le fait aggravant que, dans la décadence, l'accumulation est profondément bloquée et ses mécanismes (y compris, par conséquent, la tendance à la baisse du taux de profit) ont été altérés et pervertis par l'intervention massive de l'Etat. ([40] [395])
Le BIPR nous rappelle que, pour Marx, les causes de la crises sont internes au capitalisme.
Le BIPR voit-il quelque chose de "plus interne" au capitalisme que la nécessité impérieuse qu'il a d'élargir constamment la production au-delà des limites du marché ? Le capitalisme n'a pas pour fin la satisfaction des besoins de consommation (au contraire de la féodalité qui avait pour fin de satisfaire les besoins de consommation des nobles et des curés). Ce n'est pas non plus un système de production simple de marchandises (formes que l'on a pu voir dans l'antiquité et, jusqu'à un certain point, au 14e et 15e siècles). Son but est la production d'une plus-value toujours supérieure à partir des rapports de valeur basés sur le travail salarié. Cela l'oblige à chercher constamment de nouveaux marchés. Pourquoi ? Pour établir un régime d'échanges simples de marchandises ? Pour la rapine et l'obtention d'esclaves ? Non, bien que ces formes aient accompagné le développement du capitalisme, elles ne constituent pas son essence interne, laquelle réside dans la nécessité pour lui d'étendre toujours plus les rapports de production basés sur le travail salarié : "le capital, par malheur pour lui, ne peut pas commercer avec des clients non capitalistes sans les ruiner. Qu'il lui vende des biens de consommation, qu'il lui vende des biens de production, il détruit automatiquement l'équilibre précaire de toute économie pré-capitaliste. Introduire des vêtements bon marché, implanter le chemin de fer, installer une usine, suffît à détruire toute la vieille organisation économique. Le capitalisme aime ses clients pré-capitalistes comme l'ogre aime les enfants : en les dévorant. Le travailleur des économies pré-capitalistes qui a la malchance de se voir touché par le commerce avec les capitalistes sait que, tôt ou tard, il finira, dans le meilleur des cas, prolétarisé par le capital et, dans le pire - et c'est ce qui est de plus en plus fréquent depuis que le capitalisme est entré en décadence - dans la misère et l'indigence. " ([41] [396])
Dans la phase ascendante, au 19e siècle, ce problème de la réalisation paraissait secondaire dans la mesure où le capitalisme trouvait toujours de nouvelles aires pré-capitalistes à intégrer dans sa sphère et, par conséquent, à vendre ses marchandises. Cependant, le problème de la réalisation est devenu décisif au 20e siècle, quand les territoires pré-capitalistes sont chaque fois plus insignifiants par rapport à ses nécessités d'expansion. C'est pourquoi nous disons que la théorie de Rosa Luxemburg "fournit une explication des conditions historiques concrètes qui déterminent l'ouverture de la crise permanente du système : plus le capitalisme intègre à lui-même les aires d'économie non-capitalistes restantes, plus il crée un monde à sa propre image, moins il peut étendre son marché de façon permanente et trouver de nouveaux débouchés pour la réalisation de cette partie de la plus-value qui ne peut être réalisée ni par les capitalistes, ni par le prolétariat. L'incapacité du système à continuer de s'étendre comme auparavant a ouvert la nouvelle époque de l’impérialisme et des guerres impérialistes qui ont constitué le signal de la fin de la mission historique progressiste du capitalisme, menaçant l'humanité de retourner dans la barbarie. " ([42] [397])
Nous ne nions pas, quant à nous, la baisse tendancielle du taux de profit, nous voyons son efficience en fonction d'une vision historique de l'évolution du capitalisme. Celui-ci est secoué par toute une série de contradictions ; la contradiction entre le caractère social de la production et le caractère privé de son appropriation, entre l'augmentation incessante de la productivité du travail et la diminution proportionnelle du travail vivant, la baisse tendancielle du taux de profit susmentionnée. Mais ces contradictions purent être un stimulant au développement du capitalisme tant que celui-ci avait la possibilité d'étendre son système de production à l'échelle mondiale. Quand le capitalisme atteignit ses limites historiques, ces contradictions, de stimulantes qu'elles étaient, se transformèrent en entraves pesantes, en facteurs d'accélération des difficultés et convulsions du système.
L'accroissement de la production dans la décadence capitaliste
Le BIPR nous fait une objection réellement choquante : "Si les marchés étaient déjà saturés en 1913, si toutes les possibilités pré capitalistes étaient épuisées et que l'on ne pouvait en créer de nouvelles (à part en allant sur Mars). Si le capitalisme est allé beaucoup plus loin au niveau de la croissanee qu'au siècle précédent ; comment tout cela est-il possible d'après la théorie de Luxemburg ? " ([43] [398])
Quand, dans l'article polémique de la Revue Internationale n° 79, nous mettions en évidence la nature et la composition de "la croissance économique " réalisée après la 2e guerre mondiale, le BIPR nous a critiqué, laissant entendre qu'il y avait eu une "véritable croissance du capitalisme dans la décadence" et, contre notre défense des positions de Rosa Luxemburg, il disait "nous avons déjà vu comment le CCI règle le problème : en niant empiriquement qu'il y avait eu une réelle croissance. " ([44] [399])
Nous ne pouvons pas répéter ici l'analyse de la nature de la "croissance" depuis 1945. Nous invitons les camarades à lire l'article "Le mode de vie du capitalisme dans la décadence ", paru dans la Revue Internationale n° 56, qui montre clairement que "les taux de croissance d'après 1945 (les plus élevés de l'histoire du capitalisme) " [ont été] "un soubresaut drogué qui constitue une fuite en avant d'un système aux abois. Les moyens mis en œuvre (crédits massifs, interventions étatiques, production militaire croissante, frais improductifs, etc.) pour sa réaliser viennent à épuisement. ". Ce que nous voulons aborder est quelque chose d'élémentaire pour le marxisme : la croissance quantitative de la production ne signifie pas nécessairement le développement du capitalisme.
Le problème chronique, sans issue, du capitalisme dans la décadence est l'absence de nouveaux marchés qui soient au niveau de la croissance qu'imposé à la production l'augmentation constante de la productivité du travail et de la composition organique du capital. Cette croissance constante aggrave toujours plus le problème de la surproduction, puisque la proportion de travail accumulé (capital constant) est de plus en plus supérieure au travail vivant (capital variable, moyens de vie des ouvriers).
Toute l'histoire de la survie du capitalisme au 20e siècle depuis la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23, est l'histoire d'un effort désespéré pour manipuler la loi de la valeur, via l'endettement, l'hypertrophie des dépenses improductives, le développement des armements, pour pallier cette absence chronique de nouveaux marchés. Et l'histoire a montré que ces efforts n'ont pas fait autre chose qu'aggraver les problèmes et aviver les tendances du capitalisme décadent à l'autodestruction : l'aggravation de la crise chronique du capitalisme accentue les tendances permanentes à la guerre impérialiste, à la destruction généralisée. ([45] [400])
En réalité, les chiffres de croissance "fabuleux" de la production, qui éblouissent tellement le BIPR, illustrent la contradiction insoluble qu'impliqué, pour le capitalisme, sa tendance à développer la production de façon illimitée, bien au-delà des capacités d'absorption du marché. Ces chiffres, loin de démentir les théories de Rosa Luxemburg, les confirment pleinement. Quand on voit le développement débridé et incontrôlé de la dette, sans comparaison dans l'histoire humaine, quand on le compare à l'existence d'une inflation permanente et structurelle, quand on voit que depuis l'abandon de l'étalon-or le capitalisme a allègrement éliminé toute référence aux monnaies (Actuellement, Fort-Knox ne couvre que 3 % des dollars qui circulent aux Etats-Unis), quand on le compare avec l'intervention massive des Etats pour contrôler artificiellement l'édifice économique (et cela depuis plus de 50 ans), n'importe quel marxiste tant soit peu sérieux doit rejeter cette "fabuleuse croissance" comme fausse monnaie et conclure qu'il s'agit d'une croissance droguée et frauduleuse.
Le BIPR, au lieu de s'affronter à cette réalité, préfère spéculer sur les "nouvelles réalités " du capitalisme. Ainsi, dans sa réponse, il se propose d'aborder : "la restructuration (et, osons le dire, la croissance) de la classe ouvrière, la tendance des Etats capitalistes à être économiquement diminués par le volume du marché mondial et l'augmentation du capital qui est contrôlé par les institutions financières (lesquelles sont, au moins, quatre fois supérieures à ce que seraient l'ensemble des Etats) ont produit une extension de l'économie mondiale depuis l'époque de Rosa Luxemburg et Boukharine jusqu'à l'économie globalisée. " ([46] [401])
Quand il y a dans le monde 820 millions de chômeurs (chiffres du BIT, décembre 1994), le BIPR parle de croissance de la classe ouvrière ! Quand le travail précaire croît de façon irréversible, le BIPR, tel un nouveau Don Quichotte, voit les moulins à vent de la "croissance" et de la "restructuration" de la classe ouvrière. Quand le capitalisme se rapproche de plus en plus d'une catastrophe financière aux proportions incalculables, le BIPR spécule allègrement sur "l'économie globale" et le "capital contrôlé par les institutions financières". Une fois de plus, il voit le monde selon ses rêves : sa Dulcinée de Toboso de I"'économie globale" consiste en la prosaïque réalité d'un effort désespéré des ces Etats "toujours plus diminués " pour contrôler l'escalade de la spéculation, provoquée justement par la saturation des marchés ; ses gigantesques constructions d'un "capital contrôlé par les institutions financières" sont des bulles monstrueusement gonflées par la spéculation et qui peuvent déchaîner une catastrophe pour l'économie mondiale.
Le BIPR nous annonce que "tout le passé doit être soumis à une analyse marxiste rigoureuse qui demande du temps pour être développée" ([47] [402]). Ne serait-il pas plus efficace pour le travail de la Gauche Communiste que le BIPR consacre son temps à expliquer les phénomènes qui démontrent la paralysie et la maladie mortelle de l'accumulation tout au long de la décadence capitaliste ? Marx disait que l'erreur n'était pas dans la réponse, mais dans la question elle-même. Se poser la question de "l'économie globale " ou de la "restructuration de la classe ouvrière " c'est s'enfoncer dans les sables mouvants du révisionnisme, alors qu'il y a "d'autres questions ", comme la nature du chômage massif de notre époque, l'endettement, etc., qui permettent d'affronter les problèmes de fond dans le cadre de la compréhension de la décadence capitaliste.
Conclusions militantes
Dans la première partie de cet article, nous avons insisté sur l'importance de ce qui nous unit au BIPR : la défense intransigeante de la position marxiste de la décadence du capitalisme, base de granit de la nécessité de la révolution communiste. Ce qui est fondamental c'est la défense de cette position et la compréhension, jusqu'au bout, de ses implications. Comme nous l'expliquons dans "Marxisme et théorie des crises", on peut défendre la position sur la décadence du capitalisme sans partager pleinement notre théorie de la crise basée sur l'analyse de Rosa Luxemburg ([48] [403]). Cependant, une telle attitude comporte le risque de défendre cette position sans véritable cohérence, de "donner des coups d'épée dans l'eau ". La cible militante de notre polémique est justement celle-là : les inconséquences et les déviations des camarades qui les portent à affaiblir la position de classe sur la décadence du capitalisme.
Avec son rejet viscéral et sectaire de la thèse de Rosa Luxemburg (et de Marx lui-même) sur la question des marchés, le BIPR ouvre la porte de ses analyses aux courants révisionnistes des Tugan-Baranovski et Cie.
Ainsi, il nous dit que "les cycles d'accumulations sont inhérents au capitalisme et il explique pourquoi, aux différents moments, la production capitaliste et la croissance capitaliste peuvent être plus hautes ou plus basses que dans des périodes précédentes. " ([49] [404]). Il reprend là une vieille affirmation de Battaglia Comunista, lors de la Conférence internationale des Groupes de la gauche communiste, selon laquelle "le marché n'est pas une entité physique existant en dehors du système de production capitaliste qui, une fois saturé, arrêterait le mécanisme productif, au contraire, c'est une réalité économique, à l'intérieur et à l'extérieur du système, qui se dilate et se contracte suivant le cours contradictoire du processus d'accumulation. " ([50] [405])
Le BIPR ne se rend-il pas compte qu'avec cette "méthode", il entre de plain-pied dans le monde de Say où, en dehors de différences conjoncturelles, "tout le produit est consommé et tout ce qui est consommé est produit" ? Le BIPR ne comprend-il pas qu'avec cette analyse la seule chose qu'il fait c'est rejoindre la noria de ceux qui "constatent" que le marché "se contracte ou se dilate selon le rythme de l'accumulation", mais qui n'expliquent absolument rien sur l'évolution historique de l'accumulation capitaliste ? Le BIPR ne voit-il pas qu'il est en train de tomber dans les mêmes erreurs que Marx a critiquées : "l'équilibre métaphysique entre les achats et les ventes se réduit à ce que chaque achat est une vente et chaque vente un achat, ce qui est une médiocre consolation pour les possesseurs de marchandises qui ne peuvent pas vendre et, par conséquent acheter. " ([51] [406])
Cette porte que le BIPR laisse entrouverte aux théories révisionnistes explique la propension qu'il a à se perdre dans des spéculations absurdes et stériles sur la "restructuration de la classe ouvrière" ou "l'économie globale". Cela rend compte aussi de sa tendance à se laisser guider par les chants de sirène de la bourgeoisie : ce fut d'abord la "révolution technologique", puis vint le fabuleux marché des pays de l'Est, plus tard ce fut la guerre yougoslave "négociée". Il est vrai que le BIPR corrige ses erreurs après coup sous la pression des critiques du CCI et de l'écrasante évidence des faits. Cela démontre sa responsabilité et ses liens solides avec la Gauche communiste, mais le BIPR nous accordera que ces erreurs montrent que sa position sur la décadence du capitalisme n'est pas suffisamment consistante, qu'elle aboutit à "donner des coup d'épée dans l'eau" et qu'il doit l'établir sur des bases beaucoup plus solides.
Le BIPR se retrouve avec les révisionnistes adversaires de Rosa Luxemburg dans leur refus de considérer sérieusement le problème de la réalisation, mais il diverge radicalement d'eux dans le rejet de la vision d'une tendance à la diminution des contradictions du capitalisme. Au contraire, à juste titre, le BIPR voit que chaque phase de la crise dans le cycle de l'accumulation suppose une aggravation beaucoup plus importante et plus profonde des contradictions du capitalisme. Le problème concerne précisément les périodes au cours lesquelles, selon lui, l'accumulation capitaliste se rétablit pleinement. Sur ces périodes, en considérant uniquement la tendance la baisse tendancielle du taux de profit et en refusant de voir la saturation chronique du système, le BIPR oublie ou relativise la position révolutionnaire sur la décadence du capitalisme.
Adalen
[1] [407] .Nous avons développé notre position dans de nombreux articles de la Revue Internationale, en particulier: "Marxisme et théories des crises" (n° 13), "Théories économiques et lutte pour le socialisme" (n° 16), "Les théories des crises depuis Marx jusqu'à l'IC" (n°22), "Critique de Boukharine" (n°29 et 30), la 7e partie de la série "Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle" (n° 76). Le BIPR, dans sa réponse, dit que le CCI ne poursuit pas la critique de ses positions annoncée dans l'article "Marxisme et théories des crises" de la Revue Internationale n° 13. La simple énumération de la liste des articles exposée ci-dessus démontre qu'il se trompe totalement, ce qui réduit à néant son affirmation selon laquelle le CCI n'aurait aucun argument à opposer à ses propres articles.
[2] [408] « Marxisme et théorie des crises », Revue Internationale n° 13.
[3] [409] « Marxisme et théorie des crises », Revue Internationale n° 13
[4] [410] Bernstein, Socialisme théorique et social-démocratie pratique. (Rodbertus était un socialiste bourgeois du milieu du siècle passé qui formula sa "loi" de la part décroissante des salaires. Selon lui, les crises du capitalisme sont dues à cette loi et, pour cette raison, il défend l'intervention de l'Etat pour augmenter les salaires comme remède à la crise. Les révisionnistes de la 3e Internationale accusèrent Marx d'avoir cédé à la thèse de Rodbertus, appelée "sous-consumériste", et ils en vinrent i répéter ces accusations contre Rosa Luxemburg.)
[5] [411] Say était un économiste bourgeois français du début du 19e siècle qui, dans son apologie du capitalisme, insistait sur le fait que celui-ci n'avait aucun problème de marché puisqu'il "crée son propre marché ". Une telle théorie équivaut i poser le capitalisme comme un système éternel sans aucune possibilité de crise autre que des convulsions temporaires provoquées par "la mauvaise gestion" ou par des "disproportions entre les divers secteurs productifs ". Comme on le voit, les campagnes actuelles de la bourgeoisie sur la "reprise" n'ont rien d'original !
[6] [412] Cité par Rosa Luxemburg dans son livre L'accumulation du capital, chapitre "Critique des critiques".
[7] [413] . Idem.
[8] [414] Cette technique de l'opportunisme a été, par la suite, reprise à son compte par le stalinisme et la social-démocratie, puis par les forces de gauche du capital (particulièrement les gauchistes), qui utilisent effrontément tel ou tel passage de Lénine, de Marx, etc., pour justifier des positions qui n'ont rien à voir avec ces derniers.
[9] [415] Rosa Luxemburg, Op. cit.
[10] [416] Il convient de préciser que, dans la polémique suscitée par le livre de Rosa Luxemburg, Pannekoek, qui n'était ni opportuniste ni révisionniste i cette époque, mais au contraire avec la Gauche de la 2e Internationale, a pris parti contre la thèse de Rosa Luxemburg.
[11] [417] . Nous avons expliqué à de nombreuses reprises que Lénine, face au problème de la 1ère guerre mondiale, et en particulier dans son livre L'impérialisme stade suprême du capitalisme, défendait correctement la position révolutionnaire sur la crise historique du capitalisme (il l'appelait crise de décomposition et de parasitisme du capital) et la nécessité de la révolution prolétarienne mondiale. C'est là l'essentiel, même s'il s'appuyait sur les théories erronées sur le capital financier et la "concentration du capital" de Hilferding qui, en particulier par ses épigones, a affaibli la cohérence de sa position contre l'impérialisme. Voir notre critique dans la Revue Internationale n° 19, "A propos de l'impérialisme".
[12] [418] . Pour une critique de Boukharine, voir "Le véritable dépassement du capitalisme c'est l'élimination du salariat" dans la Revue Internationale n° 29 et 30.
[13] [419] . "Marxisme et théories des crises" Revue Internationale n° 13.
[14] [420] . "The Material Basis of Imperialist War, A Brief Reply to the ICC", Internationalist Communist Review, n° 13, p. 32-33.
[15] [421] . Idem, p. 32.
[16] [422] Le Capital, livre III, section 3, chapitre XV
[17] [423] . Idem.
[18] [424] . Idem.
[19] [425] . Marx, Théories sur la plus-value
[20] [426] . Idem.
[21] [427] . Le Capital, Livre III, section 3, chapitre XIII. 1\.Le Capital, Livre III, section 3, Chap.XIV.
[22] [428] Le Capital, Livre III, section 3, chapitre XIII. 1\.Le Capital, Livre III, section 3, Chap.XV.
[23] [429] . Idem.
[24] [430] . Le Manifeste Communiste.
[25] [431] . Lettres de Marx et Engels à Nikolai
[26] [432] . "A Brief Reply to the ICC ", p. 33.
[27] [433] . Le Capital, Livre II, section 3, chapitre XX.
[28] [434] . Rosa Luxemburg, L'Accumulation du capital, chap. "Critique des critiques ".
[29] [435] . Idem.
[30] [436] . Dans le Livre III, Marx souligne que "dire que les capitalistes peuvent échanger et consommer leurs marchandises rien qu'entre eux, c'est oublier complètement qu'il s'agit de valoriser le capital, pas de le consommer. " (section 3, chapitre XV).
[31] [437] . Rosa Luxemburg, L'accumulation du Capital
[32] [438] . Idem.
[33] [439] . Idem.
[34] [440] 2e Conférence Internationale des Groupes de la Gauche Communiste, Textes préparatoires, tome l,p. 7.
[35] [441] . Marx : Contribution à la critique de l'économie politique, chapitre II.
[36] [442] . Marx, Travail salarié et capital
[37] [443] . Idem.
[38] [444] . Lénine, Le développement du capitalisme en Russie
[39] [445] . "A Brief Reply to the ICC", p. 33.
[40] [446] . Voir la Revue Internationale n° 79 et 82
[41] [447] . "Critique de Boukharine", 2e partie, Revue Internationale n° 30.
[42] [448] . "Le capitalisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle" VII, Revue Internationale a" 76.
[43] [449] . "A Brief Reply to the ICC", p. 33.
[44] [450] . Idem.
[45] [451] . Voir la lre partie de cet article dans la Revue Internationale n° 82.
[46] [452] . "A Brief Reply to the ICC", p. 35.
[47] [453] . Idem.
[48] [454] La plate-forme du CCI admet que des camarades défendent l'explication de la crise sur la base de la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit.
[49] [455] . "A Brief Reply to the ICC ", p. 31.
[50] [456] 2ème Conférence des Groupes de la Gauche Communiste, Textes préparatoires. Vol. 1.
[51] [457] . Marx, Contribution à la critique de l'économie politique.
Courants politiques:
- TCI / BIPR [300]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Guerre [18]
Heritage de la Gauche Communiste:
Parasitisme politique : le “C.B.G” fait le travail de la bourgeoisie
- 2977 lectures
Dans la Revue Internationale n° 82 et dans sa presse territoriale dans 12 pays, le CCI a publié des articles sur son 11e congrès. Ces articles informent le milieu révolutionnaire et la classe ouvrière de la lutte politique qui a eu lieu récemment dans le CCI pour l'établissement d'un fonctionnement marxiste réel à tous les niveaux de notre vie organisationnelle. Au centre de ce combat se situait le dépassement de ce que Lénine appelait “l'esprit de cercle”. Cela requiert, en particulier, la liquidation des groupements informels basés sur des fidélités personnelles et sur l'individualisme petit-bourgeois, ce à quoi Rosa Luxemburg se référait comme des “tribus” ou des “clans”. Les articles que nous avons publiés situaient le combat actuel dans la continuité de ceux menés par les marxistes contre les bakouninistes dans la 1ère Internationale, par les bolchéviks contre le menchévisme dans le Parti russe, mais aussi par le CCI tout au long de son histoire. En particulier, nous affirmions la base anti-organisationnelle petite-bourgeoise des différentes ruptures qui ont eu lieu dans l'histoire du CCI, et qui n'étaient ni motivées ni justifiées par des divergences politiques. Elles étaient le résultat de comportements organisationnels non marxistes, non prolétariens, de ce que appelait l'anarchisme de l'intelligentsia et de la bohème littéraire.
UN PROBLEME DE TOUT LE MILIEU POLITIQUE PROLETARIEN
Si nous avons rapporté nos débats internes dans notre presse, ce n'est pas par exhibitionnisme, mais parce que nous sommes convaincus que les problèmes que nous avons rencontrés ne sont pas du tout spécifiques au CCI. Nous sommes convaincus que le CCI n'aurait pu survivre s'il n'avait éradiqueé de ses rangs des concessions à des idées anarchistes sur les questions organisationnelles. Nous voyons que le même danger menace le milieu révolutionnaire dans son ensemble. Le poids des idées et des comportements de la petite-bourgeoisie, la résistance à la discipline organisationnelle et aux principes collectifs, ont affecté tous les groupes à un niveau plus ou moins élevé. La rupture de la continuité organique avec les organisations révolutionnaires du passé pendant les 50 ans de contre-révolution, l'interruption du processus de transmission de l'expérience organisationnelle inappréciable d'une génération marxiste à la suivante, ont rendu les nouvelles générations de militants prolétariens de l'après-68 particulièrement vulnérables à l'influence de la petite-bourgeoisie révoltée (mouvements étudiants, contestataires, etc).
Aussi, notre lutte actuelle n'est pas une affaire interne au CCI. Les articles sur le congrès ont pour but la défense de l'ensemble du milieu prolétarien. Ils constituent un appel à tous les groupes marxistes sérieux pour clarifier la conception prolétarienne du fonctionnement et pour faire connaître les leçons de leur lutte contre la désorganisation petite-bourgeoise. Le milieu révolutionnaire comme un tout a besoin d'être beaucoup plus vigilant vis-à-vis de l'intrusion des modes de comportement étrangers au prolétariat. Il a besoin d'organiser consciemment et ouvertement sa propre défense.
L'ATTAQUE DU PARASITISME CONTRE LE CAMP PROLETARIEN
La première réaction publique à nos articles sur le 11e congrès est venue, non pas du milieu prolétarien, mais d'un groupe qui lui est ouvertement hostile. Sous le titre “Le CCI atteint Waco”, le soi-disant “Communist Bulletin Group” (CBG), dans son 16e et dernier Bulletin n'a pas honte de dénigrer les organisations marxistes, dans la meilleure tradition bourgeoise.
“Salem ou Waco auraient été des lieux appropriés pour ce congrès particulier. Alors qu'il serait tentant de railler ou de ridiculiser ce congrès-procès truqué où, entre autre, Bakounine et Lassale furent dénoncés comme étant `pas nécessairement' des agents de la police et Martov caractérisé "d'anarchiste", le sentiment dominant est une grande tristesse de voir qu'une organisation autrefois dynamique et positive en soit réduite à ce triste état.”
“Dans la meilleure tradition stalinienne, le CCI a alors procédé à la ré-écriture de l'histoire (comme il l'a fait après la scission de 1985), pour montrer que toutes les divergences majeures (...) ont été provoquées non pas par des militants ayant des avis divergents sur une question, mais par l'intrusion d'idéologies étrangères dans le corps du CCI.”
“Ce que le CCI ne peut pas saisir c'est que c'est sa propre pratique monolithique qui cause problème. Ce qui s'est sans doute passé au 11e congrès est simplement le triomphe bureaucratique d'un clan sur un autre, une empoignade pour le contrôle des organes centraux, ce qui était largement prévisible après la mort de leur membre fondateur MC.”
Pour le CBG, ce qui s'est passé au congrès du CCI a dû être “deux jours, ou plus, de bataille psychologique. Les lecteurs qui ont quelques connaissances sur les techniques de lavage de cerveaux pratiquées par les sectes religieuses comprendront ce processus. Ceux qui ont eu des lectures sur les tortures mentales infligées à ceux qui confessaient d'impossibles "crimes" lors des procès spectacles de Moscou saisiront, de même, ce qui s'est passé.”
Et là, le CBG se cite lui-même dans un texte de 1982, après que ses membres eurent quitté le CCI :
“Pour chaque militant se posera toujours la question : jusqu'où puis-je aller dans la discussion avant d'être condamné comme une force étrangère, une menace, un petit-bourgeois ? Jusqu'où puis-je aller avant d'être considéré avec suspicion ? Jusqu'où avant d'être un agent de la police ?”
Ces citations parlent d'elles-mêmes. Elles révèlent mieux que tout la vraie nature, non pas du CCI, mais du CBG. Leur message est clair : les organisations révolutionnaires sont comme la mafia. Les “luttes de pouvoir” y ont lieu exactement comme dans la bourgeoisie.
La lutte contre les clans, que tout le 11e congrès a unanimement soutenue, est transformée par le CBG, “sans aucun doute”, en une lutte entre clans. Les organes centraux sont inévitablement “monolithiques”, l'identification de la pénétration d'influences non-prolétariennes, tâche primordiale des révolutionnaires, est présentée comme un moyen de briser les “opposants”. Les méthodes de clarification des organisations prolétariennes - débat ouvert dans toute l'organisation, publication de ses résultats pour informer la classe ouvrière - deviennent la méthode de “lavage du cerveau” des sectes religieuses.
Ce n'est pas seulement l'ensemble du milieu révolutionnaire d'aujourd'hui qui est attaqué ici. C'est toute l'histoire et les traditions du mouvement ouvrier qui sont insultés.
En réalité, les mensonges et les calomnies du CBG sont tout à fait dans la ligne de la campagne de la bourgeoisie mondiale sur la prétendue mort du communisme et du marxisme. Au centre de cette propagande, se trouve une seule idée qui porte en elle le plus grand mensonge de l'histoire : la rigueur organisationnelle de Lénine et des bolcheviks conduit nécessairement au stalinisme. Dans la version du CBG de cette propagande c'est le bolchévisme du CCI qui conduit “nécessairement” à son prétendu “stalinisme”. Evidemment, le CBG ne sait ni ce qu'est le milieu révolutionnaire, ni ce qu'il en est du stalinisme.
Ce qui a provoqué la frénésie petite-bourgeoise du CBG c'est, encore une fois, la façon résolue, indubitable avec laquelle le CCI a affirmé sa fidélité à l'approche organisationnelle de Lénine. Nous pouvons rassurer tous les éléments parasites : plus la bourgeoisie attaque l'histoire de notre classe, plus nous affirmerons fièrement notre fidélité au bolchévisme.
En déversant des ordures sur l'avant-garde prolétarienne, le CBG a démontré une fois de plus qu'il ne fait pas partie du milieu révolutionnaire, mais qu'il y est opposé. Le fait que le CCI ait mené le combat organisationnel le plus important de son histoire ne l'intéresse pas le moins du monde.
En soi, il n'y a rien de nouveau à ce que les révolutionnaires qui défendent la rigueur organisationnelle contre la petite-bourgeoisie soient attaqués, et même dénigrés. Marx devint l'objet d'une campagne de toute la bourgeoisie à cause de sa résistance à l'Alliance de Bakounine. Lénine a été personnellement insulté à cause de son opposition aux menchéviks en 1903 : pas seulement par les réformistes et les opportunistes avérés, mais même par des camarades tels que Trotsky. Mais personne, au sein du mouvement ouvrier, ni Trotsky ni même les réformistes, n'a jamais parlé de la lutte de Marx ou de Lénine dans les termes employés par le CBG . La différence est que la “polémique” du CBG a pour but la destruction du milieu révolutionnaire, pas seulement du CCI.
LA NATURE DU PARASITISME
Nous allons décevoir le CBG qui déclare que le CCI traite ceux qui sont en désaccord avec lui d'agents de la police. Bien que le CBG soit en “désaccord” avec nous, nous considérons qu'ils ne sont ni des espions ni une organisation bourgeoise. Les gens du CBG n'ont pas une plate-forme politique bourgeoise. Programmatiquement, ils adhèrent même à certaines positions prolétariennes. Ils sont contre les syndicats et le soutien aux luttes de “libération nationale”.
Mais, si leurs positions politiques tendent à leur éviter de rejoindre la bourgeoisie, leur comportement organisationnel leur interdit toute participation dans la vie du prolétariat. Leur activité principale consiste à attaquer les groupes marxistes révolutionnaires. Le Communist Bulletin n° 16 l'illustre parfaitement. Depuis plusieurs années, le groupe n'a rien publié. L'éditorial du n° 16 nous informe : “C'est un secret de polichinelle que depuis au moins deux ans, l'organisation a cessé de fonctionner de façon significative (...) ça n'a de groupe que le nom.”
Le groupe prétend qu'après une telle inactivité et une telle insignifiance organisationnelle, il a tout à coup produit un nouveau “bulletin” dans le but d'informer le monde qu'il avait décidé de... cesser d'exister ! Mais il est clair qu'en réalité, la vraie raison de sa publication était d'attaquer encore une fois le CCI et son congrès. Il est révélateur que le n° 16 ne s'attaque pas à la bourgeoisie : par exemple, il n'y a pas de défense de l'internationalisme prolétarien face à la guerre des Balkans. C'est tout-à-fait dans la lignée des 15 précédents numéros qui étaient aussi essentiellement consacrés à calomnier les groupes prolétariens. Et nous sommes sûrs qu'en dépit de leur dissolution annoncée ils continueront à faire de même. En fait, l'abandon de leur prétention à être un groupe politique leur permettra de centrer encore plus exclusivement leur travail nuisible et d'allié objectif de la bourgeoisie sur le dénigrement du camp marxiste.
L'existence de groupes qui, bien que n'étant ni mandatés ni payés par la bourgeoisie, font cependant, de leur plein gré, une partie du travail de la classe dominante, est un phénomène hautement significatif. Dans le mouvement marxiste, nous appelons de tels gens des parasites, des vampires vivant sur le dos des forces révolutionnaires. Ils n'attaquent pas le camp marxiste par allégeance au capital, mais du fait de leur haine aveugle et impuissante du mode de vie de la classe ouvrière, la nature collective et impersonnelle de cette lutte. De tels éléments petits-bourgeois et déclassés sont motivés par un esprit de vengeance vis-à-vis d'un mouvement politique qui ne peut se permettre de faire des concessions à leurs besoins individuels, à leur soif de gloriole, de flatteries et de pompe.
LA TRAJECTOIRE DU “CBG”
Afin de saisir la nature de ce parasitisme (qui n'est pas nouveau dans le mouvement ouvrier) il est nécessaire d'étudier son origine et son développement. Le CBG peut servir d'exemple type. ses origines se situent dans la phase des cercles de la nouvelle génération de révolutionnaires qui se sont développés après 1968, donnant naissance à un petit groupe de militants liés par un mélange de fidélités politiques et personnelles. Le groupe informel en question rompît avec la Communist Workers Organisation (CWO) et se rapprocha du CCI vers la fin des années 1970. Dans les discussions à cette époque, nous critiquions le fait qu'ils voulaient entrer dans le CCI “en tant que groupe” plutôt qu'individuellement. Cela présentait le risque qu'ils forment une organisation au sein de l'organisation, sur une base non politique, affinitaire et menaçant ainsi l'unité organisationnelle prolétarienne. Nous condamnions aussi le fait que, en quittant la CWO, ils avaient emmené une partie de son matériel - en violation des principes révolutionnaires.
Au sein du CCI, le groupe essaya de maintenir son identité informelle séparée, malgré le fait que la pression, au sein d'une organisation internationale centralisée, pour soumettre chaque partie au tout a été beaucoup plus forte que dans la CWO. Cependant, “l'autonomie” des “amis” qui formeront plus tard le CBG a pu survivre du fait qu'au sein du CCI d'autres regroupements du même type, les restes des cercles à partir desquels le CCI s'était formé, continuaient d'exister. Cela est particulièrement le cas de notre section britannique, World Revolution, que les ex-membres de la CWO ont rejoint, et qui était déjà divisée par l'existence de deux “clans”. Ces clans devinrent rapidement un obstacle à l'application pratique des statuts du CCI dans toutes ses parties.
Quand le CCI, aux alentours de cette période, a été infiltré par un agent de l'Etat, Chénier, membre du parti socialiste français de Mitterrand qui, après son exclusion, du CCI, rejoignit ce parti, la section britannique devint la cible principales de ses manipulations. Comme résultat de ces manipulations, et avec la découverte de l'agent Chénier, la moitié de notre section britannique quittaé le CCI. Aucun d'entre eux n'a été exclu, contrairement aux assertions du CBG. ([1] [458])
Les ex-membres de la CWO, qui démissionnèrent à cette époque, formèrent alors le CBG.
Nous pouvons en tirer les leçons suivantes :
- Bien qu'ils n'aient pas de positions politiques particulières les distinguant des autres, fondamentalement la même clique est entrée et a quitté à la fois la CWO et le CCI, avant de former le CBG. Cela révèle le refus et l'incapacité de ces gens de s'intégrer dans le mouvement ouvrier, de soumettre leur identité de petit groupe à quelque chose de plus grand qu'eux.
- Bien qu'il proclament avoir été exclus du CCI, ou qu'ils ne pouvaient pas y rester à cause de “l'impossibilité de débattre”, en réalité ces gens ont fui le débat politique qui se tenait dans l'organisation. Au nom du “combat contre le sectarisme” ils ont tourné le dos aux deux organisations communistes les plus importantes existant en Grande-Bretagne, la CWO et le CCI, malgré l'absence de toute divergence politique majeure. C'est la façon dont ils “combattent le sectarisme”.
Le milieu politique ne devrait pas se laisser tromper par les phrases vides sur le “monolithisme” et la prétendue “peur du débat” du CCI. Le CCI se situe dans la tradition de la Gauche Italienne et de Bilan, courant qui, pendant la guerre d'Espagne a même refusé d'exclure ou de rompre avec sa minorité qui appelait ouvertement à la participation à la guerre impérialiste dans les milices républicaines, ([2] [459]) parce que la clarification politique doit toujours précéder toute séparation politique.
- Ce que le CBG reprochait au CCI, c'était sa méthode prolétarienne rigoureuse dans le débat, par la polémique et la polarisation, où “on appelle un chat un chat” et où les positions petites-bourgeoises ou opportunistes sont appelées par leur nom. Une atmosphère difficilement acceptable pour les cercles et les clans, avec leur double langage et leur fausse diplomatie, leur fidélités et leurs trahisons personnelles. Et qui, certainement, ne plaisait pas aux “copains”, aux lâches petits-bourgeois qui ont fui la confrontation politique et se sont retirés de la vie de la classe.
- Plus grave encore, et pour la deuxième fois, le CBG a participé au vol de matériel de l'organisation en la quittant. Ils l'ont justifié avec la vision du parti marxiste comme étant une société par action : quiconque investit son temps dans le CCI a le droit de prendre sa part des ressources quand il le quitte. Qui plus est, ils se sont permis de déterminer quelle “part” leur revenait. Il devrait aller sans dire que si de telles méthodes devaient être tolérées, cela signifierait la fin de toute possibilité d'existence pour les organisation marxistes. Les principes révolutionnaires sont là remplacés part la loi de la jungle bourgeoise.
- Quand le CCI vint récupérer le matériel volé à l'organisation ces courageux “révolutionnaires” nous menacèrent d'appeler la police.
- Les membres du futur CBG étaient les principaux collaborateurs de l'agent provocateur Chénier au sein de l'organisation, et ses principaux défenseurs après son exclusion. C'est ce qui est derrière les allusions à la soit-disant attitude du CCI d'étiqueter ses “dissidents” comme agents de la police. Les CCI est, selon les mensonges du CBG, supposé avoir dénoncé Chénier parce qu'il était en désaccord avec la majorité du CCI sur l'analyse des élections françaises de 1981. Une telle accusation à l'aveuglette est tout autant un crime contre les organisations révolutionnaires que d'envoyer la police contre elles. Dans une telle situation, les révolutionnaires qui sont en désaccord avec un jugement de l'organisation et en particulier le militant accusé lui-même, n'ont pas seulement le droit mais le devoir de faire objection à cela s'ils le jugent nécessaire ou illégitime, et même de demander qu'un tribunal d'honneur, avec la participation d'autres groupes révolutionnaires, reconsidère une telle accusation. Dans le mouvement ouvrier du passé il aurait été impensable de suggérer qu'une organisation ouvrière soulève de telles accusations contre un individu pour tout autre motif que sa défense contre l'Etat. De telles accusations ne peuvent que détruire la confiance dans l'organisation et ses organes centraux, une confiance indispensable pour la défense contre les infiltrations de l'Etat.
UNE HAINE AVEUGLE ET IMPUISSANTE
C'est cette résistance jusqu'au bout des éléments anarchistes petits-bourgeois et déclassés contre leur intégration et leur subordination à la grande mission historique et mondiale du prolétariat, bien qu'il y ait de la sympathie pour certaines de ses positions politiques, qui conduit au parasitisme, à la haine ouverte et au sabotage politique du mouvement marxiste.
La réalité sordide et corrosive du CBG lui-même montre le mensonge de ses déclarations selon lesquelles il a quitté le CCI “afin de pouvoir discuter”. Là encore, nous laisserons les parasites parler d'eux-mêmes. D'abord leur abandon de toute fidélité au prolétariat commence à être théorisée ouvertement. “Une vision très sombre de la nature de la période a commencé à s'exprimer”, nous disent-ils ; “des éléments au sein du CBG se demandent si la classe pourra maintenant émerger APRES TOUT ?”.
En face du “difficile débat” voilà comment le CBG, ce géant “anti-monolithique”, se “débrouille” avec les “divergences”.
“Nous étions mal armés pour affronter ces questions. Il y avait un silence plus ou moins assourdissant en réponse ... le débat ne tournait pas vraiment en eau de boudin parce qu'il restait largement ignoré. C'était profondément malsain pour l'organisation. Le CBG se flattait d'être ouvert à toute discussion au sein du mouvement révolutionnaire, mais là c'était un de ses propres débats, sur un sujet au coeur même de son existence, qui lui bouchait les oreilles et lui fermait la bouche.”
Il est donc tout-à-fait logique que, à la fin de sa croisade contre la conception marxiste de la rigueur organisationnelle et méthodologique comme préalable à tout réel débat, le CBG “découvre” que l'organisation elle-même bloque le débat :
“Afin de permettre au débat d'avoir lieu ... nous avons décidé de mettre fin à la vie du CBG.”
L'organisation comme entrave au débat ! Vive l'anarchisme ! Vive le liquidationnisme organisationnel ! Imaginez la gratitude de la classe dominante face à la propagation de tels “principes” au nom du “marxisme” !
LE PARASITISME : FER DE LANCE CONTRE LES FORCES PROLETARIENNES
Bien que la domination de classe de la bourgeoisie ne soit, pour le moment, certainement pas menacée, les aspects essentiels de la situation mondiale actuelle l'obligent à être particulièrement vigilante dans la défense de ses intérêts. L'approfondissement inexorable de sa crise économique, le développement des tensions impérialistes et la résistance d'une génération d'ouvriers qui n'a pas encore subi de défaite décisive contiennent la perspective d'une déstabilisation dramatique de la société bourgeoise. Tout cela impose à la bourgeoisie la tâche historique et mondiale de détruire l'avant-garde marxiste révolutionnaire du prolétariat. Aussi insignifiant qu'apparaisse le camp marxiste aujourd'hui, la classe dominante est déjà obligée d'essayer sérieusement d'y semer la confusion et de l'affaiblir.
A l'époque de la 1re Internationale, la bourgeoisie se chargea elle-même de la tâche de dénigrer publiquement l'organisation des révolutionnaires. Toute la presse de la bourgeoisie calomniait l'Association Internationale des Travailleurs et son Conseil Général, opposant au prétendu “centralisme dictatorial” de Marx les charmes de son propre passé progressiste et révolutionnaire.
Aujourd'hui, au contraire, la bourgeoisie des puissances dominantes n'a pas intérêt à attirer l'attention sur les organisations révolutionnaires qui sont, pour le moment, si minoritaires que même leurs noms sont en général inconnus des ouvriers. De plus, une attaque directe de l'Etat contre eux, que ce soit par ses médias ou par ses organes de répression, pourrait provoquer un réflexe de solidarité au sein d'une minorité politiquement significative d'ouvriers à la conscience de classe plus élevée. Dans cette situation, la bourgeoisie préfère garder un profil bas et laisser le travail de dénigrement aux parasites politiques. Ces parasites, sans le vouloir ni même sans s'en rendre compte, sont intégrés dans la stratégie anti-prolétarienne de la classe dominante. La bourgeoisie sait très bien que le meilleur moyen, en même temps que le plus efficace, pour détruire le camp révolutionnaire c'est de l'intérieur, en dénigrant, démoralisant et divisant celui-ci. Les parasites accomplissent cette tâche sans même qu'on leur ait demandé. En présentant les groupes marxistes comme staliniens, comme des sectes bourgeoises dominées par les luttes de pouvoir, à l'image de la bourgeoisie elle-même, comme historiquement insignifiants, ils soutiennent l'offensive du capital contre le prolétariat. En détruisant la réputation du milieu, le parasitisme ne contribue pas seulement aux attaques des forces prolétariennes d'aujourd'hui - il prépare le terrain pour la répression politique effective du camp marxiste dans l'avenir. Si la bourgeoisie reste à l'arrière-plan aujourd'hui afin de permettre au parasitisme de faire son sale boulot, c'est avec l'intention de sortir de l'ombre demain pour décapiter l'avant-garde révolutionnaire.
L'incapacité de la plupart des groupes révolutionnaires de reconnaître le caractère réel des groupes parasites est l'une des plus grandes faiblesses du milieu aujourd'hui. Le CCI est déterminé à assumer ses responsabilités en combattant cette faiblesse. Il est grand temps pour les groupes sérieux du milieu politique prolétarien, pour le milieu comme un tout, d'organiser sa propre défense contre les éléments les plus pourris de la petite-bourgeoisie revancharde. Au lieu de flirter avec de tels groupes de façon opportuniste, il est de la responsabilité du milieu de mener une lutte sans merci et implacable contre le parasitisme politique. La formation du futur parti de classe, le succès de la lutte libératrice du prolétariat, dépendront à un degré non négligeable de notre capacité à mener ce combat à bonne fin.
KR.
[2] [461]. Voir La Gauche communiste d'Italie.
Courants politiques:
Questions théoriques:
- Décomposition [318]