Revue Internationale 2011 - n° 144 - 147
- 3213 lectures
Revue Internationale n° 144 - 1er trimestre 2011
- 1938 lectures
Mobilisation sur les retraites en France, riposte étudiante en Grande-Bretagne, révolte ouvrière en Tunisie.
L'avenir est au développement international et à la prise en main de la lutte de classe
Les grèves et les manifestations de septembre, octobre et novembre en France qui se sont déroulées à l’occasion de la réforme des retraites ont témoigné d’une forte combativité dans les rangs des prolétaires, même si elles n’ont pas réussi à faire reculer la bourgeoisie.
Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique internationale de notre classe qui retrouve progressivement le chemin de la lutte, chemin jalonné en 2009 et 2010 par la révolte des jeunes générations de prolétaires contre la misère en Grèce et par la volonté d'étendre leur lutte des ouvriers de Tekel en Turquie en s'opposant de façon déterminée au sabotage des syndicats.
Ainsi, les étudiants se sont largement mobilisés contre le chômage et la précarité que leur réserve le monde capitaliste comme en Grande-Bretagne, en Italie ou aux Pays-Bas. Aux États-Unis, bien que restant enfermées dans le carcan syndical, plusieurs grèves d'envergure se sont succédées en divers points du pays depuis le printemps 2010 pour résister aux attaques : dans le secteur de l'éducation en Californie, infirmiers à Philadelphie et Minneapolis-Saint-Louis, ouvriers du bâtiment à Chicago, secteur agro-alimentaire dans l'État de New York, enseignants dans l'Illinois, ouvriers de Boeing et d'une usine Coca-Cola à Bellevue (État de Washington), dockers dans le New Jersey et à Philadelphie.
A l'heure où nous mettons sous presse, au Maghreb, en particulier en Tunisie, la colère ouvrière accumulée depuis des décennies s'est propagée comme une traînée de poudre après l'immolation publique, le 17 décembre, d'un jeune chômeur diplômé qui s'était vu confisquer par la police municipale de Sidi Bouzid, au centre du pays, son étal de fruits et légumes, son unique gagne-pain. Des manifestations spontanées de solidarité se sont propagées à travers tout le pays face à l'ampleur du chômage et à la hausse brutale des produits alimentaires de première nécessité. La répression brutale et féroce de ce mouvement social a fait plusieurs dizaines de morts, la police tirant à balles réelles sur les manifestants désarmés. Cela n'a fait que renforcer l'indignation et la détermination des prolétaires pour réclamer d'abord du travail, du pain et un peu de dignité, puis le départ de Ben Ali. "On n'a plus peur", scandaient les manifestants en Tunisie. Les enfants de prolétaires en tête ont utilisé les réseaux d'Internet ou leur téléphone portable comme armes de combat, pour montrer et dénoncer la répression, et comme moyens de communication et d'échange assurant ainsi un lien entre eux mais aussi avec leurs famille ou amis en dehors du pays, notamment en Europe, brisant ainsi partiellement la conspiration du silence de toutes les bourgeoisies et de leurs médias. Partout, nos exploiteurs se sont efforcés de masquer la nature de classe de ce mouvement social, cherchant à le dénaturer tantôt en le présentant comme des émeutes comme celles de 2005 en France ou comme l'œuvre de casseurs et de pillards, tantôt en le faisant passer pour une "lutte héroïque et patriotique du peuple tunisien" pour la "démocratie" animée par des intellectuels diplômés et les "classes moyennes".
La crise économique et la bourgeoisie portent leurs coups de boutoir partout dans le monde. En Algérie, en Jordanie, en Chine, d'autres mouvements sociaux similaires face à l'enfoncement dans la misère ont été durement réprimés. Cette situation doit pousser les prolétaires des pays centraux, plus expérimentés, à prendre conscience de l'impasse et de la faillite dans laquelle le système capitaliste entraîne partout l'humanité et à apporter leur solidarité à leurs frères de classe en développant leurs luttes. D'ailleurs les travailleurs commencent peu à peu à réagir et à refuser l’austérité, la paupérisation et les "sacrifices" imposés.
Pour l’instant, cette riposte est nettement en deçà des attaques que nous subissons. C’est incontestable. Mais une dynamique est enclenchée, la réflexion ouvrière et la combativité vont continuer de se développer. Pour preuve, ce fait nouveau : des minorités cherchent aujourd’hui à s’auto-organiser, à contribuer activement au développement de luttes massives et à se dégager de l’emprise syndicale.
La mobilisation contre la réforme des retraites en France
Le mouvement social de l'automne dernier en France est pleinement révélateur de cette dynamique enclenchée par le précédent mouvement contre le CPE 1.
C’est par millions que les ouvriers et employés de tous les secteurs sont descendus régulièrement dans la rue en France. Parallèlement, depuis la rentrée de septembre, des mouvements de grève plus ou moins radicaux sont apparus ici et là, exprimant un mécontentement profond et grandissant. Cette mobilisation constitue le premier combat d’envergure en France depuis la crise qui a secoué le système financier mondial en 2007-2008. Elle n’est pas seulement une réponse à la réforme des retraites elle-même mais, par son ampleur et sa profondeur, elle est une réponse claire à la violence des attaques subies ces dernières années. Derrière cette réforme et les autres attaques simultanées ou en préparation, se manifeste le refus grandissant d'un enfoncement aggravé de tous les prolétaires et d‘autres couches de la population dans la pauvreté, la précarité et la misère la plus sombre. Et avec l’approfondissement inexorable de la crise économique, ces attaques ne sont pas près de s’arrêter. Il est clair que cette lutte en annonce d’autres et qu’elle s’inscrit en droite ligne de celles qui se sont développées en Grèce et en Espagne face aux mesures drastiques d’austérité.
Cependant, malgré la massivité de la riposte, le gouvernement en France n’a pas cédé. Au contraire, il est resté intraitable, affirmant sans relâche et malgré la pression de la rue sa ferme détermination à faire passer son attaque sur les retraites, se permettant de surcroît de répéter avec cynisme qu’elle était "nécessaire", au nom de la "solidarité" entre les générations.
Pourquoi cette mesure qui frappe au cœur toutes nos conditions de vie et de travail, et alors que l’ensemble de la population a exprimé amplement et puissamment son indignation et son opposition, est-elle passée malgré tout ? Pourquoi cette mobilisation massive n’a-t-elle pas réussi à faire reculer le gouvernement ? Parce que le gouvernement avait la certitude du contrôle de la situation par les syndicats, lesquels ont toujours accepté, comme également les partis de gauche, le principe d’une "réforme nécessaire" des retraites ! On peut faire la comparaison avec le mouvement de 2006 contre le CPE. Ce mouvement, que les médias avaient traité au début avec le plus grand mépris comme une "révolte étudiante" sans lendemain, a fini par faire reculer le gouvernement qui n’a eu d’autre recours que de retirer le CPE.
Où est la différence ? Elle réside d’abord en ceci que les étudiants s’étaient organisés en assemblées générales ouvertes à tous, sans distinction de catégories ou de secteurs, du public ou du privé, au travail ou au chômage, travailleurs précaires, etc. Cet élan de confiance dans les capacités de la classe ouvrière et dans sa force, de profonde solidarité dans la lutte, avait créé une dynamique d’extension du mouvement imprimant à celui-ci une massivité impliquant toutes les générations. Car, tandis que, d’un côté, les assemblées générales voyaient se dérouler des débats et des discussions les plus larges, ne restant pas cantonnées au seul problème des étudiants, de l’autre côté, on voyait au fil des manifestations les travailleurs eux-mêmes se mobiliser de plus en plus avec les étudiants et de nombreux lycéens.
Mais c’est aussi parce que la détermination et l’esprit d’ouverture des étudiants, tout en entraînant des fractions de la classe ouvrière vers la lutte ouverte, n’arrivaient pas à être battus en brèche par les manœuvres des syndicats. Au contraire, alors que ces derniers, notamment la CGT, s’efforçaient de se placer en tête des manifestations pour en prendre le contrôle, c’est à plusieurs reprises que les étudiants et les lycéens ont débordé les banderoles syndicales pour affirmer clairement qu’ils ne voulaient pas se voir ravaler en arrière-plan d’un mouvement dont ils étaient à l’initiative. Mais surtout ils affirmaient leur volonté de garder le contrôle eux-mêmes de la lutte, avec la classe ouvrière, et de ne pas se laisser avoir par les centrales syndicales.
En fait, un des aspects qui inquiétait le plus la bourgeoisie, c’est que les formes d’organisation que s’étaient données les étudiants en lutte, ces assemblées générales souveraines, élisant leurs comités de coordination et ouvertes à tous, dans lesquelles les syndicats étudiants faisaient souvent profil bas, ne fassent tâche d’huile parmi les salariés si ces derniers entraient en grève. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, au cours de ce mouvement, Thibault 2 a affirmé à plusieurs reprises que les salariés n’avaient pas de leçons à recevoir des étudiants sur comment s’organiser. D'après lui, si ces derniers avaient leurs assemblées générales et leurs coordinations, les salariés avaient leurs syndicats en qui ils avaient confiance. Dans un tel contexte de détermination chaque fois réaffirmée et de danger d’un débordement des syndicats, il fallait que l'État français lâche du lest car c’est le dernier rempart de protection de la bourgeoisie contre l’explosion de luttes massives qui risquait d’être battu en brèche.
Avec le mouvement contre la réforme des retraites, les syndicats, soutenus activement par la police et les médias, ont fait les efforts nécessaires pour tenir le haut du pavé, en sentant venir le vent et s’organiser en conséquence.
D'ailleurs le mot d'ordre des syndicats n'était pas "retrait de l'attaque sur les retraites" mais "aménagement de la réforme". Ils appelaient à se battre pour une meilleure négociation État-Syndicats et pour une réforme plus "juste", plus "humaine". On les a vus jouer dès le début la division malgré l'apparente unité de l'intersyndicale clairement constituée pour faire barrage aux "risques" de débordements ; le syndicat FO 3 organisait au début ses manifestations dans son coin, tandis que l’intersyndicale qui organisait la journée d’action du 23 mars préparait le "ficelage" de la réforme, après tractations avec le gouvernement, en programmant deux autres journées d’action le 26 mai, et surtout le 24 juin, à la veille des vacances d’été. On sait qu’habituellement une journée d’action, à cette époque de l’année, signe le coup de grâce pour la classe ouvrière lorsqu’il s’agit de faire passer une attaque majeure. Pourtant, cette dernière journée d’action a montré une mobilisation inattendue, avec plus du double d’ouvriers, de chômeurs, de précaires, etc., dans les rues. Et, alors qu’une morosité, largement soulignée par la presse, avait marqué les deux premières journées d’action, la colère et le ras-le-bol étaient au rendez-vous du 24 juin où le succès de la mobilisation a regonflé le moral du prolétariat. L'idée qu'une lutte d'ampleur est possible gagne du terrain. Les syndicats sentent évidemment eux aussi le vent tourner, ils savent que la question "Comment lutter ?" trotte dans les têtes. Ils décident donc d'occuper immédiatement le terrain et les esprits, il n'est pas question pour eux que les prolétaires se mettent à penser et à agir par eux-mêmes, en dehors de leur contrôle. Ils décident donc d'appeler à une nouvelle journée d'action pour le 7 septembre, dès le retour des congés d'été. Et pour être bien sûrs d'endiguer le mouvement de réflexion, ils vont jusqu'à faire passer en pleines vacances d'été des avions au-dessus des plages tirant des banderoles publicitaires appelant à la manifestation du 7 !
Pour leur part, les partis de gauche, qui étaient pourtant bien d’accord eux aussi sur l’impérieuse nécessité d’attaquer la classe ouvrière sur la question des retraites, sont venus se greffer à la mobilisation afin de ne pas se discréditer totalement.
Mais un autre événement, un fait divers, vient durant l'été alimenter la colère ouvrière : "l’affaire Woerth" (il s'agit d'une connivence entre les hommes politiques actuellement au pouvoir et la plus riche héritière du capital français, Madame Bettencourt, patronne du groupe L'Oréal, sur fond de fraudes fiscales et arrangements illégaux en tous genres). Or, Éric Woerth n'est autre que le ministre chargé de la réforme des retraites. Le sentiment d'injustice est total : la classe ouvrière doit se serrer la ceinture pendant que les riches et les puissants mènent "leurs petites affaires". C’est donc sous la pression de ce mécontentement ouvert et de la prise de conscience grandissante des implications de cette réforme sur nos conditions de vie que se présente la journée d’action du 7 septembre, obligeant cette fois-ci les syndicats à entonner le credo de l’unité d'action. Depuis, pas un syndicat n’a manqué à l’appel des journées d’action qui ont regroupé dans les manifestations environ trois millions de travailleurs à plusieurs reprises. La réforme des retraites devient le symbole de la dégradation brutale des conditions de vie.
Mais cette unité de "l’intersyndicale" a constitué un leurre pour la classe ouvrière. Elle visait en fait à lui faire croire que les syndicats étaient déterminés à organiser une offensive d’ampleur contre la réforme et qu’ils s’en donnaient les moyens avec des journées d’action à répétition dans lesquelles on pouvait voir et entendre à satiété leurs leaders, bras dessus, bras dessous, égrener leurs discours sur la "poursuite" du mouvement et autres mensonges. Ce qu’ils redoutaient par-dessus tout, c’est que les travailleurs sortent du carcan syndical et qu’ils s’organisent par eux-mêmes. C’est ce que disait Thibault, le secrétaire général de la CGT, qui faisait "passer un message" au gouvernement dans une interview au journal le Monde du 10 septembre : "On peut aller vers un blocage, vers une crise sociale d’ampleur. C’est possible. Mais ce n’est pas nous qui avons pris ce risque", donnant l’exemple suivant pour mieux affirmer où se trouvait l’enjeu auquel étaient confrontés les syndicats : "On a même trouvé une PME sans syndicat où 40 salariés sur 44 ont fait grève. C’est un signe. Plus l’intransigeance dominera, plus l’idée de grèves reconductibles gagnera les esprits."
En clair, si les syndicats ne sont pas là, les ouvriers s’organisent eux-mêmes et non seulement décident réellement de ce qu’ils veulent faire mais risquent de le faire massivement. Et c’est contre quoi les centrales syndicales, et particulièrement la CGT et SUD 4, se sont attelées avec un zèle exemplaire : occuper le terrain sur la scène sociale et dans les médias, tout en empêchant avec la même résolution sur le terrain toute réelle expression de solidarité ouvrière. En bref, un battage à tout crin d’une part, et de l’autre une activité visant à stériliser et entraîner le mouvement dans de fausses alternatives, afin de créer la division, la confusion, et mieux le mener à la défaite.
Le blocage des raffineries de pétrole en est un exemple des plus évidents. Alors que les ouvriers de ce secteur, dont la combativité était déjà très vive, avaient la volonté grandissante de manifester leur solidarité envers l’ensemble de la classe ouvrière contre la réforme des retraites, ouvriers par ailleurs particulièrement confrontés à des mesures drastiques de réductions de personnels, la CGT a fait en sorte de transformer cet élan de solidarité en grève-repoussoir. Ainsi, le blocage des raffineries n’a jamais été décidé dans de véritables assemblées générales, où les travailleurs pouvaient exprimer réellement leur point de vue, mais il a été décidé suite à des manœuvres dont les leaders syndicaux sont spécialistes et qui ont fait adopter, en pourrissant la discussion, des actions stérilisantes. Cependant, malgré cet enfermement verrouillé par les syndicats, certains ouvriers de ce secteur ont cherché à créer des contacts et des liens avec des ouvriers d’autres secteurs. Mais, globalement pris dans l’engrenage du "blocage jusqu’au bout", la plupart des ouvriers des raffineries se sont vu piégés dans une logique syndicale d’enfermement dans l’usine, véritable poison utilisé contre l’élargissement du combat. En effet, bien que les ouvriers des raffineries avaient pour objectif de renforcer le mouvement, d’en être un des bras armés, afin de faire reculer le gouvernement, le blocage des dépôts, tel qu’il s’est déroulé sous la houlette syndicale, s’est surtout révélé être une arme de la bourgeoisie et de ses syndicats contre les ouvriers. Non seulement pour isoler ceux des raffineries, mais pour rendre leur grève impopulaire, en créant un vent de panique et en agitant la menace d’une pénurie de carburant généralisée ; la presse a abondamment déversé son fiel contre ces "preneurs d’otages empêchant les gens de se rendre à leur travail ou de partir en congés". Mais c’est aussi physiquement que les travailleurs de ce secteur se sont trouvés isolés ; alors même qu’ils voulaient contribuer par la lutte solidaire à la construction d’un rapport de forces favorable au retrait de la réforme, ce blocage particulier s’est en fait retourné contre eux et contre l’objectif qu’ils s’étaient donné initialement.
Il y a eu de nombreuses actions syndicales similaires, dans certains secteurs comme les transports, et de préférence dans des régions peu ouvrières, car il fallait à tout prix pour les syndicats prendre le moins de risques possibles d’extension et de mise en œuvre active de la solidarité. Il leur fallait faire semblant, pour la galerie, d’orchestrer les luttes les plus radicales et de jouer la partition de l’unité syndicale dans les manifestations, tout en pourrissant en réalité la situation.
Partout, on a donc vu les syndicats, réunis dans une "intersyndicale" pour mieux promouvoir le simulacre de l’unité, mettre en œuvre des semblants d’assemblées générales, sans véritable débat, enfermées dans les préoccupations les plus corporatistes, tout en affichant publiquement la prétendue volonté de se battre "pour tous" et "tous ensemble"… mais organisées chacun dans son coin, derrière son petit chef syndicaliste, en faisant tout pour empêcher la mise en œuvre de délégations massives en recherche de solidarité vers les entreprises les plus proches géographiquement.
Les syndicats n’ont d’ailleurs pas été les seuls à entraver la possibilité d’une telle mobilisation, car la police de Sarkozy, réputée pour sa prétendue débilité et son esprit anti-gauche, a su se faire l’auxiliaire indispensable des syndicats à plusieurs reprises par ses provocations. Exemple : les incidents de la place Bellecour à Lyon, où la présence d’une poignée de "casseurs" (probablement manipulés par les flics) a servi de prétexte à une violente répression policière contre des centaines de jeunes lycéens dont la plupart ne cherchaient qu’à venir discuter à la fin d’une manifestation avec les travailleurs.
Un mouvement riche de perspectives
En revanche, il n’a pas du tout été question dans les médias des nombreux Comités ou Assemblées générales interprofessionnels (AG interpros), qui se sont formés durant cette période, comités et AG dont le but affiché était et reste de s’organiser en-dehors des syndicats et de développer des discussions réellement ouvertes à tous les prolétaires, ainsi que des actions dans lesquelles c’est toute la classe ouvrière qui pourrait, non seulement se reconnaître, mais aussi et surtout s’impliquer massivement.
On voit ici ce que la bourgeoisie a craint particulièrement : que des contacts se nouent et se multiplient le plus largement possible dans les rangs de la classe ouvrière, jeunes, vieux, au travail ou au chômage.
Il faut tirer les leçons de l'échec du mouvement.
Le premier constat après l'échec du mouvement est que ce sont les appareils syndicaux qui ont permis de faire passer l’attaque auprès des prolétaires et qu’il ne s’agit nullement de quelque chose de conjoncturel. C’est qu’ils ont fait leur sale boulot, pour lequel tous les spécialistes et autres sociologues, ainsi que le gouvernement et Sarkozy en personne, les saluent pour leur "sens des responsabilités". Oui, sans hésitation, la bourgeoisie peut se féliciter d’avoir des "responsables" syndicaux capables de briser un mouvement d’une telle ampleur en faisant en même temps croire qu’ils ont pourtant fait tout leur possible pour lui permettre de se développer. Ce sont encore ces mêmes appareils syndicaux qui sont parvenus à étouffer et marginaliser les véritables expressions de lutte autonome de la classe ouvrière et de tous les travailleurs.
Cependant, cet échec est porteur de nombreux fruits car tous les efforts déployés par l’ensemble des forces de la bourgeoisie n’ont pas réussi à entraîner le mouvement dans une défaite cuisante de tout un secteur, comme ce fut le cas en 2003 avec la lutte contre la réforme des retraites du secteur public qui avait donné lieu à un cinglant recul parmi les travailleurs de l’Éducation nationale après plusieurs semaines de grève.
Ensuite, ce mouvement a permis le surgissement convergent en plusieurs endroits de minorités exprimant une vision claire des besoins réels de la lutte pour l'ensemble du prolétariat : la nécessité d'une prise en mains de la lutte pour pouvoir l'étendre et la développer, traduisant un réel mûrissement de la réflexion, tout en exprimant l'idée que le développement de la lutte n'en est qu'à son début et manifestant une volonté de tirer les leçons de ce qui s'est passé et de rester mobilisées pour l'avenir.
Comme le dit un tract de "l’AG interpro" parisienne de la Gare de l’Est daté du 6 novembre : "Il aurait fallu, dès le départ, s’appuyer sur les secteurs en grève, ne pas limiter le mouvement à la seule revendication sur les retraites alors que les licenciements, les suppressions de postes, la casse des services publics, les bas salaires continuent dans le même temps. C'est cela qui aurait pu permettre d’entraîner d’autres travailleurs dans la lutte et d’étendre le mouvement gréviste et de l’unifier. Seule une grève de masse qui s'organise à l'échelle locale et se coordonne nationalement, au travers de comités de grève, d'assemblées générales interprofessionnelles, de comités de lutte, pour que nous décidions nous-mêmes des revendications et des moyens d'action tout en contrôlant le mouvement, peut avoir une chance de gagner."
"La force des travailleurs n'est pas seulement de bloquer, ici ou là, un dépôt pétrolier ou même une usine. La force des travailleurs, c'est de se réunir sur leurs lieux de travail, par-delà les professions, les sites, les entreprises, les catégories et de décider ensemble" Car "l'attaque ne fait que commencer. Nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. C'est la guerre de classe que la bourgeoisie nous déclare et nous avons encore les moyens de la mener" (tract intitulé "Personne ne peut lutter, décider et gagner à notre place", signé par des travailleurs et précaires de "l’AG interpro" de la Gare de l’Est et d’Île-de-France, déjà cité plus haut). Nous n’avons pas d’autre choix pour nous défendre que d’étendre et de développer massivement nos luttes et pour cela de les prendre dans nos propres mains.
Cette volonté s'est donc clairement affirmée à travers en particulier :
- des véritables AG interpros qui ont émergé, même de façon très minoritaire, dans le développement de la lutte en affichant leur détermination à rester mobilisées en vue de préparer de futurs combats ;
- la tenue ou les tentatives de former des assemblées de rues ou des assemblées populaires en fin de manifestations s'est également affirmée, en particulier à Toulouse.
Cette volonté de s'auto-organiser exprimée par des minorités révèle que l'ensemble de la classe commence à se poser des questions sur la stratégie syndicale, sans oser tirer encore toutes les conséquences de ses doutes et questionnements. Dans toutes les AG (syndicales ou non), la plupart des débats sous diverses formes ont tourné autour de questions essentielles sur "comment lutter ?", "comment aider les autres travailleurs ?", "comment exprimer notre solidarité ?", "quelle autre AG interpro pouvons-nous rencontrer ?", "comment briser l'isolement et toucher le maximum d'ouvriers pour discuter avec eux des moyens de lutter ?"… Et dans les faits, quelques dizaines de travailleurs de tous secteurs, de chômeurs, de précaires, de retraités se sont rendues effectivement chaque jour devant les portes des 12 raffineries paralysées, pour "faire nombre" face aux CRS, apporter des paniers-repas aux grévistes, un peu de chaleur morale.
Cet élan de solidarité est un élément important, il révèle une nouvelle fois la nature profonde de la classe ouvrière.
"Prendre confiance en nos propres forces" devra être le mot d’ordre de demain.
Cette lutte est en apparence une défaite, le gouvernement n'a pas reculé. Mais en fait, elle constitue un pas en avant supplémentaire pour notre classe. Les minorités qui ont émergé et qui ont essayé de se regrouper, de discuter en AG interpro ou en assemblée populaire de rue, ces minorités qui ont essayé de prendre en main leurs luttes en se méfiant comme de la peste des syndicats, révèlent le questionnement qui mûrit en profondeur dans toutes les têtes ouvrières. Cette réflexion va continuer de faire son chemin et elle portera, à terme, ses fruits. Il ne s'agit pas là d'un appel à attendre, les bras croisés, que le fruit mûr tombe de l'arbre. Tous ceux qui ont conscience que l'avenir va être fait d'attaques ignobles du capital, d'une paupérisation croissante et de luttes nécessaires, doivent œuvrer à préparer les futurs combats. Nous devons continuer à débattre, à discuter, à tirer les leçons de ce mouvement et à les diffuser le plus largement possible. Ceux qui ont commencé à tisser des liens de confiance et de fraternité dans ce mouvement, au sein des cortèges et des AG, doivent essayer de continuer de se voir (en Cercles de discussion, Comités de lutte, Assemblées populaires ou "lieux de parole") car des questions restent entières, telles que :
- Quelle est la place du "blocage économique" dans la lutte de classe ?
- Quelle est la différence entre la violence de l'État et celle des travailleurs en lutte ?
- Comment faire face à la répression ?
- Comment prendre en main nos luttes ? Comment nous organiser ?
- Quelles différences entre une AG syndicale et une AG souveraine ? etc.
Ce mouvement est déjà riche en enseignements pour le prolétariat mondial. Sous une forme différente, les mobilisations étudiantes en Grande-Bretagne sont également porteuses de promesses pour le développement des luttes à venir.
Grande-Bretagne : la jeune génération renoue avec la lutte
Le premier samedi après l’annonce du plan de rigueur gouvernemental de réduction drastique des dépenses publiques, le 23 octobre, se sont déroulées de nombreuses manifestations contre les coupes budgétaires, partout dans le pays, appelées par divers syndicats. Le nombre de participants, très variable (allant jusqu'à 15 000 à Belfast ou 25 000 à Edimbourg) révèle la profondeur de la colère. Une autre démonstration de ce ras-le-bol généralisé est la rébellion des étudiants contre la hausse de 300 % des frais d’inscription dans les universités.
Déjà ces frais les contraignaient à s’endetter lourdement pour rembourser après leurs études des sommes astronomiques (pouvant aller jusqu’à 95 000 euros !). Ces nouvelles hausses ont donc provoqué toute une série de manifestations du Nord au Sud du pays (5 mobilisations en moins d’un mois : les 10, 24 et 30 novembre, les 4 et 9 décembre). Cette hausse a tout de même été définitivement votée à la chambre des Communes le 8 décembre.
Les foyers de lutte se sont multipliés : dans la formation continue, dans les écoles supérieures et les lycées, occupations d’une longue liste d’universités, de nombreuses réunions sur les campus ou dans la rue pour discuter de la voie à suivre... les étudiants ont reçu le soutien et la solidarité de la part de nombreux enseignants, notamment en fermant les yeux devant les absences des grévistes en classe (l’assiduité au cours est ici strictement réglementée) ou en allant rendre visite aux étudiants et en discutant avec eux. Les grèves, manifestations et occupations ont été tout sauf ces sages événements que les syndicats et les "officiels" de la gauche ont habituellement pour mission d’organiser. Cet élan de résistance à peine contrôlé a inquiété les gouvernants. Un signe clair de cette inquiétude est le niveau de la répression policière utilisée contre les manifestations. La plupart des rassemblements se sont terminés par des affrontements violents avec la police anti-émeutes pratiquant une stratégie d’encerclement, n’hésitant pas à matraquer les manifestants, ce qui s’est traduit par de nombreux blessés et de nombreuses arrestations, surtout à Londres, alors que des occupations se déroulaient dans une quinzaine d’universités avec le soutien d’enseignants. Le 10 novembre, les étudiants avaient envahi le siège du Parti conservateur et le 8 décembre, ils ont tenté de pénétrer dans le ministère des finances et à la Cour suprême, tandis que des manifestants s’en sont pris à la Rolls-Royce transportant le prince Charles et son épouse Camilla. Les étudiants et ceux qui les soutiennent étaient venus aux manifestations de bonne humeur, fabriquant leurs propres bannières et leurs propres slogans, certains d’entre eux rejoignant pour la première fois un mouvement de protestation. Les débrayages spontanés, l’investissement du QG du Parti conservateur à Millbank, le défi face aux barrages de police, ou leur contournement inventif, l’occupation des mairies et autres lieux publics, ne sont que quelques expressions de cette attitude ouvertement rebelle. Les étudiants ont été écœurés et révoltés par l'attitude de Porter Aaron, le président du NUS (le syndicat national des étudiants) qui avait condamné l'occupation du siège du Parti conservateur, l'attribuant à la violence pratiquée par une infime minorité. Le 24 novembre à Londres, des milliers de manifestants ont été encerclés par la police quelques minutes après leur départ de Trafalgar Square, et malgré quelques tentatives réussies pour percer les lignes de police, les forces de l’ordre ont bloqué des milliers d’entre eux pendant des heures dans le froid. A un moment, la police montée est passée directement à travers la foule. A Manchester, à Lewisham Town Hall et ailleurs, mêmes scènes de déploiement de la force brutale. Après l’irruption au siège du parti conservateur à Millbank, les journaux ont tenu leur partition habituelle en affichant des photos de présumés "casseurs", faisant courir des histoires effrayantes sur les groupes révolutionnaires qui prennent pour cible les jeunes de la nation avec leur propagande maléfique. Tout cela montre la vraie nature de la "démocratie" sous laquelle nous vivons.
La révolte étudiante au Royaume-Uni est la meilleure réponse à l’idée que la classe ouvrière dans ce pays reste passive devant le torrent d’attaques lancées par le gouvernement sur tous les aspects de notre niveau de vie : emplois, salaires, santé, chômage, prestations d’invalidité ainsi que l’éducation. Toute une nouvelle génération de la classe exploitée n’accepte pas la logique de sacrifices et d’austérité qu'imposent la bourgeoisie et ses syndicats. Ce n'est qu'en prenant en main ses luttes, en développant sa solidarité et son unité internationales que la classe ouvrière, notamment dans les pays "démocratiques" les plus industrialisés, pourra offrir une perspective d'avenir à la société. Ce n'est qu'en refusant de faire les frais de la faillite du capitalisme partout dans le monde, que la classe exploitée pourra mettre un terme à la misère et à la terreur de la classe exploiteuse en renversant le capitalisme et en construisant une autre société basée sur la satisfaction des besoins de toute l'humanité et non sur le profit et l'exploitation.
W. (14 janvier)
1. Lire notre article de la Revue internationale n° 125, "Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [2]".
2. Secrétaire général de la CGT, principale centrale syndicale du pays et proche du Parti "communiste".
3 FO : "Force ouvrière". Syndicat issu d'une scission de la CGT en 1947, au début de la Guerre froide, appuyée et financée par l'AFL-CIO des États-Unis. Jusqu'aux années 1990, cette centrale se distingue par sa "modération" mais, depuis, elle a "radicalisé" ses postures en essayant de "tourner" la CGT sur sa gauche.
4 SUD : "Solidaires Unitaires Démocratiques". Syndicat minoritaire se situant à l'extrême gauche de l'éventail des forces d'encadrement de la classe ouvrière et animé principalement par des groupes gauchistes.
Face à la crise capitaliste, il n'existe aucune voie de sortie
- 2993 lectures
Économies nationales surendettées, les plus faibles devant être secourues pour leur éviter la banqueroute et celle de leurs créanciers ; plans de rigueur pour tenter de contenir l'endettement qui ne fait qu'accroître les risques de récession et, ce faisant, les risques de faillites en série ; tentatives de relance au moyen de la planche à billets… qui relancent l'inflation. C'est l'impasse au niveau économique et la bourgeoisie s'avère dans l'incapacité totale de proposer des politiques économiques un tant soit peu cohérentes.
Le "sauvetage" d'États en Europe
Au moment même où l'Irlande négociait son plan de "sauvetage", les autorités du FMI admettaient que la Grèce ne pourrait pas rembourser le plan qu'elles-mêmes et l'Union Européenne avaient mis en place en avril 2010 et que, de fait, la dette de ce dernier pays devait être restructurée, même si le mot n'a pas été employé par les autorités financières. D'après D. Strauss Khan, le chef du FMI, il devrait être permis à la Grèce de finir de rembourser la dette résultant de son plan de sauvetage, non pas en 2015 mais en 2024 ; c'est-à-dire, au train où va la crise des États en Europe, dans une éternité. C'est là un véritable symbole de la fragilité d'un certain nombre de pays européens minés par la dette, pour ne pas dire la plupart d'entre eux.
Bien sûr, ce nouveau "cadeau" à la Grèce doit s'accompagner de mesures d'austérité supplémentaires. Après le plan d'austérité d'avril 2010 qui s'était soldé par la suppression du paiement de deux mois de retraites, de la baisse des indemnités dans le secteur public, d'une augmentation des prix, elle-même conséquence d'une augmentation des taxes sur l'électricité, les carburants, les alcools, le tabac, etc., des décisions sont en cours de préparation pour supprimer des emplois publics.
C'est un scénario analogue qui se déroule en Irlande où les ouvriers subissent leur quatrième plan d'austérité : en 2009, les salaires des fonctionnaires avaient subi une baisse comprise entre 5 et 15%, des allocations sociales avaient été supprimées et les départs à la retraite n'étaient plus remplacés. Le nouveau plan d'austérité négocié en échange du plan de "sauvetage" du pays contient la baisse du salaire minimum de 11,5%, la diminution des allocations sociales et familiales, la suppression de 24 750 postes de fonctionnaire et l'augmentation de la TVA de 21% à 23%. Et, comme pour la Grèce, il est évident qu'un pays de 4,5 millions d'habitants, dont le PIB était en 2009 de 164 milliards d'euros, ne parviendra pas à rembourser un prêt de 85 milliards d'euros. Pour ces deux pays, il ne fait pas de doute non plus que ces plans d'austérité particulièrement violents appellent l'adoption de futures mesures enfonçant la classe ouvrière et la majeure partie de la population dans une misère telle que, faire face aux fins de mois, va devenir impossible.
L'incapacité de nouveaux pays (Portugal, Espagne, etc.) à faire face à leur dette est déjà annoncée alors que, pour éviter une telle issue, ces pays avaient déjà adopté des mesures d'austérité particulièrement draconiennes qui, comme en Grèce et en Irlande, en annoncent d'autres.
Que cherchent à sauver les différents plans d'austérité ?
La question est d'autant plus légitime que la réponse ne s'impose pas d'elle-même. Une chose est certaine, c'est qu'ils n'ont pas pour objet de sauver de la misère les millions de personnes qui sont les premières à en subir les conséquences. Une indication concernant la réponse recherchée est fournie par l'angoisse qui étreint les autorités politiques et financières devant le risque que de nouveaux pays soient à leur tour exposés à un défaut de paiement sur leur dette publique. C'est en fait plus qu'un risque dans la mesure où l’on ne voit guère comment ce scénario ne se produirait pas.
A l'origine de la faillite de la l'État grec se trouve un déficit budgétaire considérable dû à une masse exorbitante de dépenses publiques (en particulier d'armements) que les ressources fiscales du pays, affaiblies par l'aggravation de la crise en 2008, ne permettent pas de financer. Quant à l'État irlandais, son système bancaire avait accumulé une quantité de créances de 1 432 milliards d'euros (à comparer avec le montant du PIB de 164 milliards d'euros - déjà mentionné précédemment - pour mesurer l'absurdité de la situation économique présente !) que l'aggravation de la crise a rendu impossible à recouvrir. En conséquence de quoi, le système bancaire en question a dû être en grande partie nationalisé, les créances étant ainsi transférées à l'État. Après avoir payé une partie, pourtant relativement faible, des dettes du système bancaire, l'État irlandais s'est retrouvé en 2010 avec un déficit public correspondant à 32% du PIB ! Au-delà du caractère délirant de tels chiffres, il faut souligner que, même si les déboires de ces deux économies nationales ont des histoires différentes, le résultat est le même. En effet, dans un cas comme dans l'autre, face à l'endettement démentiel de l'État ou des institution privées, c'est l'État qui doit assumer la fiabilité du capital national en montrant sa capacité à rembourser la dette et payer les intérêts de celle-ci.
La gravité de ce qu'impliquerait une incapacité des économies grecque et irlandaise à assumer leur dette déborde largement le périmètre des frontières de ces deux pays. C'est d'ailleurs bien ce dernier aspect qui explique la panique qui, à cette occasion, s'est emparée des hautes instances de la bourgeoisie mondiale. De la même manière que les banques irlandaises possédaient des créances considérables sur toute une série d'États du monde, les banques des grands pays développés possèdent des créances colossales sur les États grec et irlandais. Concernant le montant des créances des grandes banques mondiales sur l'État irlandais, les différentes sources ne concordent pas. Parmi celles-ci, retenons, à titre indicatif, des évaluations qui apparaissent "moyennes" : "Selon le quotidien économique les Échos de lundi, les banques françaises seraient exposées à hauteur de 21,1 milliards en Irlande, derrière les banques allemande (46 milliards), britanniques (42,3) et américaines (24,6)" 1. Et concernant l'engagement des banques à l'égard de la Grèce : "Les établissements français sont les plus exposés, avec 75 milliards de dollars (55 milliards d'euros) d'encours. Les établissements suisses ont investi 63 milliards de dollars (46 milliards d'euros), les Allemands 43 milliards (31 milliards d'euros)" 2. Le non-renflouement de la Grèce et de l'Irlande aurait mis dans une situation très difficile les banques créditrices, et donc les États dont elles dépendent. C'est tout particulièrement le cas pour des pays dont la situation financière est très critique (Portugal, Espagne), qui sont, eux aussi, engagés en Grèce et en Irlande, et pour qui une telle situation aurait été fatale.
Ce n'est pas tout. Le non-renflouement de la Grèce et de l'Irlande aurait signifié que les autorités financières de l'UE et du FMI ne garantissaient pas les finances des pays en difficulté, qu'il s'agisse de la Grèce, de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne, etc. Il en aurait résulté un véritable sauve-qui-peut des créanciers de ces États, la faillite garantie des plus faibles parmi ces derniers, l'effondrement de l'euro et une tempête financière, en comparaison de laquelle les conséquences de la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008 auraient fait figure de légère brise de mer. En d'autres termes, en venant au secours de la Grèce et de l'Irlande, les autorités financières de l'UE et du FMI n'ont pas eu comme préoccupation de sauver ces deux États, encore moins les populations de ces deux pays, mais bien d'éviter la déroute du système financier mondial.
Dans la réalité, ce ne sont pas que la Grèce, l'Irlande et quelques autres pays du sud de l'Europe dont la situation financière est fortement détériorée, comme le traduisent les chiffres suivants : "On obtient les statistiques suivantes (janvier 2010) [montant de la dette totale en pourcentage du PIB] : 470% pour le Royaume-Uni et le Japon, médailles d’or de l’endettement total ; 360% pour l’Espagne ; 320% pour la France, l’Italie et la Suisse ; 300% pour les États-Unis et 280% pour l’Allemagne" 3. En fait, l'ensemble des pays, qu'ils soient situés dans la zone euro ou hors de celle-ci, ont un endettement considérable qui, de manière évidente, ne permet pas qu'il puisse être remboursé. Néanmoins, les pays de la zone euro ont sur ce plan à faire face à une difficulté supplémentaire dans la mesure où un État qui s'endette n'a pas la possibilité de créer lui-même les moyens monétaires pour "financer" ses déficits puisqu’une telle possibilité est exclusivement du ressort d'une institution qui lui est extérieure, à savoir la Banque Centrale Européenne. D'autres pays, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, également très endettés, n'ont pas ce problème puisqu'ils ont toute autorité pour créer leur propre monnaie.
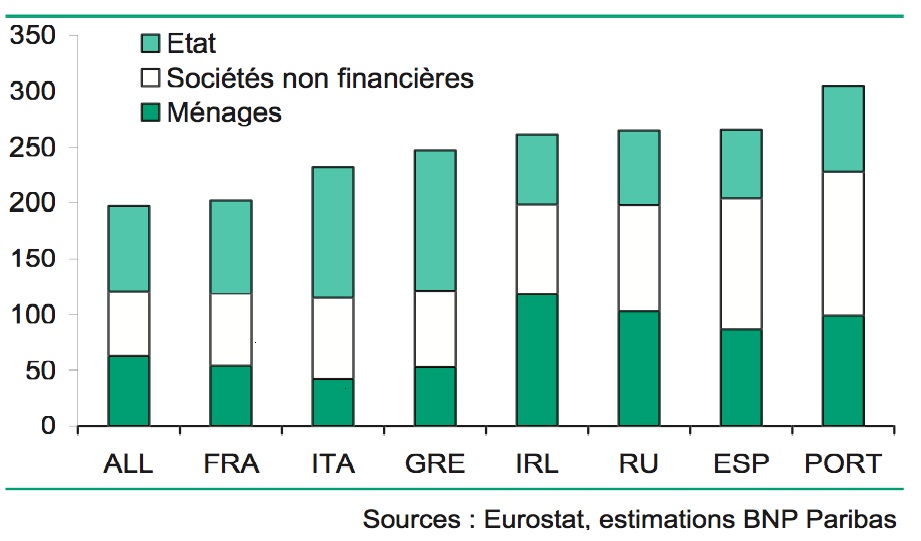
Endettement public et privé (en % du PIB) hors institutions financières, en 2009
Quoi qu'il en soit, les niveaux d'endettement de tous ces États montre que leurs engagements dépassent leurs possibilités de remboursement, et ce jusqu'à l'absurde. Des calculs ont été faits qui montrent que la Grèce devrait – au bas mot - parvenir à un excédent budgétaire de 16 ou 17% pour stabiliser sa dette publique. En fait, ce sont tous les pays du monde qui se sont endettés à un point tel que leur production nationale ne permet pas le remboursement de leur dette. En d'autres termes, cela signifie que des États et institutions privées possèdent des créances qui ne pourront jamais être honorées 4. Le tableau ci-dessous, qui indique l'endettement de chaque pays européen (hors institutions financières, contrairement aux chiffres mentionnés plus haut), permet de se faire une bonne idée de l'immensité des dettes contractées de même que de la fragilité des pays les plus endettés.
Les plans de sauvetage n'ayant aucune chance d'aboutir, leur existence a-t-elle une autre signification ?
Le capitalisme ne peut survivre que grâce à des plans de soutien économique permanents
Le plan de "sauvetage" de la Grèce a coûté 110 milliards d'euros et celui de l'Irlande 85 milliards. Ces masses financières apportées par le FMI, la zone euro et le Royaume-Uni (pour 8,5 milliards d'euros alors que le gouvernement Cameron a par ailleurs mis en œuvre son propre plan d'austérité visant à diminuer les dépenses publiques de 25% en 2015 5) ne sont autres que de la monnaie émise sur la base de la richesse des différents États.
En d'autres termes, l'argent dépensé dans le plan de sauvetage n'est pas basé sur de nouvelles richesses créées mais il est bel et bien le produit de la planche à billets, ce qui en fait de la "monnaie de singe".
Un tel soutien au secteur financier, lequel finance l'économie réelle, est en fait un soutien à l'activité économique réelle. Ainsi, alors que d'un côté se mettent en place des plans d'austérité draconiens, qui annoncent d'autres plans d'austérité encore plus draconiens, on voit les États être obligés, sous peine d'effondrement du système financier et de blocage de l'économie mondiale, d'adopter ce qu'il faut bien appeler des plans de soutien – dont le contenu est très proche de ce qui s'appelle des "plans de relance".
En fait, ce sont les États-Unis qui sont allés le plus loin dans cette direction : le Quantitative Easing n° 2 de 900 milliards de dollars 6 n'a pas d'autre sens que de tenter de sauver un système financier américain dont les livres de compte demeurent remplis de mauvaises créances, et de soutenir la croissance économique des États-Unis dont le caractère poussif montre qu'elle ne peut pas se passer d'un déficit budgétaire important.
Les États-Unis, bénéficiant toujours de l'avantage que leur confère le statut du dollar comme monnaie d'échange mondiale, ne subissent pas les même contraintes que la Grèce, l'Irlande ou d'autres pays européens et, de ce fait, il n'est pas exclu, comme beaucoup le pensent, que devra être adopté un Quantitative Easing n° 3.
Ainsi, le soutien de l'activité économique par les mesures budgétaires est beaucoup plus fort aux États-Unis qu'il ne l'est dans les pays européens. Mais cela n'empêche pas les États-Unis de chercher aussi à diminuer de manière drastique le déficit budgétaire, comme l'illustre le fait que B. Obama lui-même a proposé de bloquer le salaire des fonctionnaires fédéraux. En fait, c'est dans tous les pays du monde que l'on trouve de telles contradictions dans les politiques mises en œuvre
La bourgeoisie a dépassé les limites de l'endettement que le capitalisme peut supporter
Nous avons donc des plans d'austérité et des plans de relance menés en même temps ! Quelle est la raison de telles contradictions ?
Comme l'avait montré Marx, le capitalisme souffre par nature d'un manque de débouchés car l'exploitation de la force de travail de la classe ouvrière aboutit forcément à la création d'une valeur plus grande que la somme des salaires versés, vu que la classe ouvrière consomme beaucoup moins que ce qu'elle a produit. Pendant toute une période qui va jusqu'à la fin du XIXe siècle, la bourgeoisie a pu réellement faire face à ce problème par la colonisation de territoires qui n'étaient pas capitalistes, territoires sur lesquels elle forçait, par de multiples moyens, la population à acheter les marchandises produites par son capital. Les crises et les guerres du XXe siècle ont illustré que cette manière de faire face au problème de la surproduction, inhérent à l'exploitation capitaliste des forces productives, atteignait ses limites. En d'autres termes, les territoires non capitalistes de la planète n'étaient plus suffisants pour permettre à la bourgeoisie d'écouler ce surplus de marchandises qui permet l'accumulation élargie et résulte de l'exploitation de la classe ouvrière. Le dérèglement de l'économie qui s'est produit à la fin des années 1960 et qui s'est manifesté par des crises monétaires et par des récessions signait la quasi absence des marchés extra-capitalistes comme moyen d'absorber le surproduit de la production capitaliste. La seule solution qui se soit alors imposée a été la création d'un marché artificiel alimenté par la dette. Il permettait à la bourgeoisie de vendre à des États, des ménages ou des entreprises des marchandises sans que ces derniers disposent des moyens réels pour les acheter.
Nous avons souvent abordé ce problème en soulignant que le capitalisme avait utilisé l'endettement comme un palliatif à la crise de surproduction dans laquelle il est enfoncé depuis la fin des années 1960. Mais il ne faut pas confondre endettement et miracle. En effet, la dette doit être progressivement remboursée et ses intérêts payés systématiquement sinon le créancier, non seulement n'y trouve pas son intérêt, mais encore il risque lui-même de faire faillite.
Or, la situation d'un nombre croissant de pays européens montre qu'ils ne peuvent plus s'acquitter de la partie de leur dette exigée par leurs créanciers. En d'autres termes, ces pays se retrouvent devant l'exigence de devoir diminuer leur dette, notamment en réduisant leurs dépenses, alors que quarante années de crise ont montré que l'augmentation de celle-ci était une condition absolument nécessaire à ce que l'économie mondiale n'entre pas en récession. C'est là une même contradiction insoluble à laquelle sont confrontés, de façon plus ou moins aigüe, tous les États.
Les secousses financières qui se manifestent en ce moment en Europe sont ainsi le produit des contradictions fondamentales du capitalisme et illustrent l'impasse absolue de ce mode de production. D'autres caractéristiques de la situation actuelle, que nous n'avons pas encore évoquées dans cet article, entrent également en jeu.
L'inflation se développe
Au moment même où beaucoup de pays du monde mettent en place des politiques d'austérité plus ou moins violentes, ayant pour effet de réduire la demande intérieure, y inclus les produits de première nécessité, le prix des matières premières agricoles connait de très fortes augmentations : plus de 100 % pour le coton en un an 7, plus de 20% pour le blé et le maïs entre juillet 2009 et juillet 2010 8 et 16% pour le riz entre la période avril-juin 2010 et fin octobre 2010 9 ; une tendance analogue concerne les métaux et le pétrole. Bien sûr, les facteurs climatiques ont un rôle dans l'évolution du prix des produits alimentaires, mais l’augmentation est tellement généralisée qu'elle a nécessairement des causes qui sont autres. Plus généralement, l'ensemble des États sont préoccupés par le niveau de l'inflation qui affecte de plus en plus leur économie. Quelques exemples concernant les pays "émergents" :
- Officiellement l'inflation en Chine atteignait, au mois de novembre 2010, le rythme annuel de 5,1% (en fait tous les spécialistes s'accordent à dire que les chiffres réels de l'inflation dans ce pays se situent entre 8 et 10%) ;
- En Inde, l'inflation était de 8,6% au mois d'octobre ;
- En Russie, où l'inflation a été de 8,5% en 2010 10.
Le développement de l’inflation n'est pas un phénomène exotique réservé aux pays émergents puisque les pays développés sont aussi de plus en plus concernés : les 3,3% en novembre au Royaume-Uni ont été qualifiés de dérapage par le gouvernement ; le 1,9% dans la vertueuse Allemagne est qualifié de préoccupant parce qu'il s'insère au sein d'une croissance rapide.
Quelle est donc la cause de ce retour de l'inflation ?
L'inflation n'a pas toujours pour cause une demande excédentaire par rapport à l'offre permettant aux vendeurs d'augmenter les prix sans craindre de ne pas vendre toutes leurs marchandises. Un autre facteur tout à fait différent peut être à l'origine de ce phénomène : il s'agit de l'augmentation de la masse monétaire qui se produit effectivement depuis trois décennies. En effet, l'utilisation de la planche à billets, c'est-à-dire l'émission de nouvelle monnaie sans que la richesse nationale lui correspondant augmente dans les mêmes proportions, aboutit inévitablement à une dépréciation de la valeur de la monnaie en service, ce qui se traduit par une hausse des prix. Or, toutes les données communiquées par les organismes officiels font apparaître, depuis 2008, de fortes augmentations de la masse monétaire dans les grandes zones économiques de la planète.
Ces augmentations encouragent le développement de la spéculation, avec des conséquences désastreuses pour la vie de la classe ouvrière. La demande étant trop faible, notamment du fait de la stagnation ou de la baisse des salaires, les entreprises ne peuvent pas augmenter le prix des marchandises sur le marché sous peine de ne pouvoir les écouler et d'enregistrer des pertes. Ces mêmes entreprises, ou les investisseurs, se détournent ainsi de l'activité productive, trop peu rentable et donc trop risquée, et orientent les quantités de monnaie créées par les banques centrales vers la spéculation : concrètement, cela signifie achat de produits financiers, de matières premières ou de monnaies avec l'espoir qu'ils pourront être revendus avec un profit substantiel. Ce faisant, ces "produits de consommation" vont se trouver transformés en actifs. Le problème, c'est qu'une bonne partie de ces produits, en particulier les matières premières agricoles, sont aussi des marchandises qui entrent dans la consommation du plus grand nombre d'ouvriers, de paysans, de chômeurs, etc. Finalement, en plus de la baisse de ses revenus, une grande partie de la population mondiale va aussi se trouver aux prises avec l'augmentation du prix du riz, du pain, des vêtements, etc.
Ainsi, la crise qui oblige la bourgeoisie à sauver ses banques au moyen de la création de monnaie aboutit à ce que les ouvriers subissent deux attaques :
-
la baisse du niveau de leur salaire,
l'augmentation du prix des produits de première nécessité.
C'est pour ces raisons que l'on a connu une augmentation du prix des produits de première nécessité depuis le début des années 2000 et les mêmes causes ont, aujourd'hui, les mêmes effets. En 2007-2008 (juste avant la crise financière), de grandes masses de la population mondiale se retrouvant dans une situation de disette avaient été à l'origine d'émeutes de la faim. Les conséquences de l'actuelle flambée des prix ne se sont pas fait attendre comme l'illustrent les révoltes actuelles en Tunisie et en Algérie.
Le niveau actuel de l'inflation ne cesse de s'élever. D’après le Cercle Finance du 7 décembre, le taux des T bonds 11 à 10 ans est passé de 2,94% à 3,17% et le taux des T bonds à trente ans est passé 4,25% à 4,425%. Cela signifie clairement que les capitalistes anticipent une perte de valeur de l'argent qu’ils placent en exigeant un taux plus élevé pour leurs placements.
Les tensions entre capitaux nationaux
Lors de la crise des années 1930, le protectionnisme, moyen de la guerre commerciale, s’était développé massivement à tel point qu’on avait pu alors parler de "régionalisation" des échanges : chacun des grands pays impérialistes se réservant une zone planétaire qu’il dominait et qui lui permettait de trouver un minimum de débouchés. Contrairement aux pieuses intentions publiées par le récent G20 de Séoul, et selon lesquelles les différents pays participant ont déclaré vouloir bannir le protectionnisme, la réalité n'est pas celle-là. Des tendances protectionnistes sont clairement à l’œuvre actuellement et on préfère chastement parler, à leur propos, de "patriotisme économique". La liste des mesures protectionnistes adoptées par les différents pays serait trop fastidieuse pour être rapportée. Mentionnons simplement le fait que les États-Unis en étaient, en septembre 2010, à 245 mesures anti-dumping ; que le Mexique avait pris, dès mars 2009, 89 mesures de rétorsion commerciale contre les États-Unis et que la Chine a récemment décidé la limitation drastique de l’exportation de ses "terres rares" qui rentrent dans la production d’une grande partie des produits de haute technologie.
Mais, dans la période actuelle, c'est la guerre des monnaies qui se trouve constituer la manifestation majeure de la guerre commerciale. Nous avons vu plus haut que le Quantitative Easing n° 2 était une nécessité pour le capital américain, mais en même temps, dans la mesure où la création de monnaie qui l'accompagne ne peut que se traduire par la baisse de la valeur de celle-ci, et donc aussi du prix des produits "made in USA" sur le marché mondial (relativement aux produits des autres pays), il constitue une mesure protectionniste particulièrement agressive. De même, la sous-évaluation du yuan chinois poursuit des objectifs similaires.
Et pourtant, malgré la guerre économique, les différents États ont été obligés de s’entendre pour permettre à la Grèce et à l’Irlande de ne pas faire défaut sur leur dette. Cela signifie que dans ce domaine aussi, la bourgeoisie ne peut pas faire autrement que de prendre des mesures très contradictoires, dictées par l’impasse totale dans laquelle se trouve son système.
La bourgeoisie a-t-elle des solutions à proposer ?
Pourquoi, dans le contexte de la situation catastrophique actuelle de l'économie mondiale, voit-on apparaître des articles comme ceux de La Tribune ou du Monde titrant respectivement "Pourquoi la croissance sera au rendez-vous" 12 et "Les États-Unis veulent croire à la reprise économique" 13 ? De tels titres, qui ne relèvent que de la propagande, visent à nous endormir et, surtout, à nous faire croire que les autorités économiques et politiques de la bourgeoisie ont encore une certaine maîtrise de la situation. En fait, la bourgeoisie n’a le choix qu’entre deux politiques qui sont comme la peste et le choléra :
- Soit elle procède comme elle l’a fait pour la Grèce et l’Irlande à de la création de monnaie, car tant les fonds de l'UE que ceux du FMI proviennent de la planche à billets des divers États membres ; mais alors on se dirige vers une dévalorisation des monnaies et une tendance inflationniste qui ne peut que devenir de plus en plus galopante ;
- Soit elle pratique une politique d'austérité particulièrement draconienne visant à une stabilisation de la dette. C'est la solution qui est préconisée par l'Allemagne pour la zone euro, les particularités de cette zone faisant que, en fin de compte, c'est le capital allemand qui supporte le plus gros du coût du soutien aux pays en difficulté. L'aboutissement d'une telle politique ne peut être que la chute vertigineuse dans la dépression, à l’image de la chute de la production que l’on a vu en 2010 en Grèce, en Irlande et en Espagne suite aux plans "de rigueur" qui ont été adoptés.
Un certains nombre d'économistes dans toute une série d'ouvrages publiés récemment proposent tous leur solution à l'impasse actuelle, mais toutes procèdent soit de la méthode Coué, soit de la plus pure propagande pour faire croire que cette société a, malgré tout, un avenir. Pour ne prendre qu'un exemple, selon le professeur M. Aglietta 14, les plans d’austérité adoptés en Europe vont coûter un pour cent de croissance dans l’Union Européenne ramenant celle-ci à un niveau d'environ 1% en 2011. Sa solution alternative est révélatrice du fait que les plus grands économistes n'ont plus rien de réaliste à proposer : il n’a pas peur d’affirmer qu’une nouvelle "régulation" basée sur "l’économie verte" serait la solution. Il "oublie" seulement une chose : une telle "régulation" impliquerait des dépenses considérables et donc une création monétaire bien plus gigantesque que l'actuelle, et ce alors que l’inflation redémarre de façon particulièrement préoccupante pour la bourgeoisie.
La seule vraie solution à l'impasse capitaliste est celle qui se dégagera des luttes, de plus en plus nombreuses, massives et conscientes que la classe ouvrière est contrainte de mener de par le monde, pour résister aux attaques économiques de la bourgeoisie. Elle passe naturellement par le renversement de ce système dont la principale contradiction est celle de produire pour le profit et l'accumulation et non pour la satisfaction des besoins humains.
Vitaz - 2 janvier 2011
1. lexpansion.lexpress.fr/entreprises/que-risquent-les-banques-francaises_1341874.html [3]
2. https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/02/12/04016-20100212ARTFIG00395-grece-ce-que-risquent-les-banques-.php [4]
3. Bernard Marois, professeur émérite à HEC : www.abcbourse.com/analyses/chronique-l_economie_shadock_analyse_des_dettes_totales_des_pays-456 [5]
4. J. Sapir "L'euro peut-il survivre à la crise", Marianne, 31 décembre 2010
5. Mais il est révélateur que M. Cameron commence à avoir peur de l'effet dépressif sur l'économie anglaise du plan qu'il a concocté.
6. Le QE n° 2 a été fixé à 600 milliards de dollars, mais il faut ajouter le droit qu'a la FED depuis cet été de renouveler l'achat de créances arrivées à échéance pour 35 milliards de dollars par mois.
7. blog-oscar.com/2010/11/la-flambee-du-cours-du-coton (les chiffres rapportés sur ce site datent de début novembre ; aujourd'hui ces chiffres sont largement dépassés).
8. C. Chevré, MoneyWeek, 17 novembre 2010
9. Observatoire du riz de Madagascar ; iarivo.cirad.fr/doc/dr/hoRIZon391.pdf
10. Le Figaro du 16 décembre 2010, https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2010/12/16/97002-20101216FILWWW00522-russie-l-inflation-a-85-en-2010.php [6]
11. Bons du Trésor américains.
12. La Tribune, 17 décembre 2010
13. Le Monde, 30 décembre 2010
14. M. Aglietta dans l'émission "L'esprit public" sur la chaine radio "France Culture", 26 décembre 2010.
Récent et en cours:
- Crise économique [7]
La crise en Grande-Bretagne
- 4620 lectures
Le texte ci-dessous est, à quelques modifications mineures près, la partie économique du rapport sur la situation en Grande-Bretagne réalisé pour le 19e congrès de World Revolution (section du CCI en Grande-Bretagne). Nous avons jugé utile sa publication à l'extérieur de notre organisation dans la mesure où ce document fournit un ensemble de données et analyses permettant de saisir la manière dont la crise économique mondiale se manifeste dans la plus ancienne puissance économique du capitalisme.
Le contexte international
En 2010, la bourgeoisie a annoncé la fin de la récession et prédit que l'économie mondiale repartira dans les deux années à venir grâce aux économies émergentes. Cependant, il existe de grandes incertitudes sur la situation globale qui se reflètent dans des projections de croissance contradictoires. Le FMI, dans sa World Outlook Update de juillet 2010, prévoit une croissance globale de 4,5% pour l'année en cours et de 4,25% pour l'année suivante. Le rapport sur les Global Economic Prospects de la Banque mondiale de l'été 2010 envisage une croissance de 3,3% pour 2010 et 2011, et de 3,5% pour 2012, si les choses vont bien. Si elles ne vont pas bien, 3,1% pour 2010, 2,9% l'année suivante et 3,2% en 2012. Leurs préoccupations concernent particulièrement l'Europe pour laquelle la Banque mondiale fait dépendre son estimation la moins pessimiste d'hypothèses qui sont loin d'être réalisées : "les mesures prises empêchent le marché, du fait de sa nervosité actuelle, de ralentir les prêts des banques" et "on parvient à éviter un défaut de paiement ou une restructuration de la dette souveraine européenne". 1 Si ces conditions ne sont pas réalisées, alors l'Europe connaîtra un taux de croissance inférieur, estimé à 2,1, 1,9 et 2,2 pour cent respectivement entre 2010 et 2012.
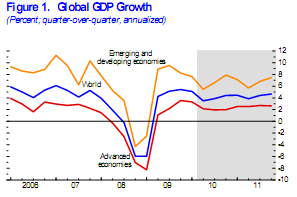
Légende : Orange : Economies émergentes ou en développement ; Rouge : Economies développées ; Bleu : Economie mondiale
Croissance globale du PIB
(Source: FMI, World Economic Outlook Update, Juillet 2010)
La situation reste fragile du fait du haut niveau de dettes et du bas niveau de prêts bancaires, et de la possibilité de nouveaux chocs financiers comme celui qu'on a connu en mai de cette année (2010) où les marchés boursiers ont globalement perdu entre 8 et 17% de leur valeur. L'échelle du renflouage est en elle-même l'une des causes des préoccupations : "La dimension du plan de sauvetage de l'Union européenne et du FMI (près de 1 trillion de dollars) ; l'ampleur de la réaction initiale du marché à la possibilité de défaut de paiement de la Grèce et au danger de contagion ; et la poursuite de la volatilité sont des indicateurs de la fragilité de la situation financière... un nouvel épisode d'incertitude du marché pourrait avoir des conséquences sérieuses pour la croissance à la fois sur les pays de haut revenu et sur les pays en développement." 2 Comme on pouvait s'y attendre, le FMI prescrit une réduction des dépenses étatiques, avec le résultat inévitable d'imposer l'austérité à la classe ouvrière : "Les pays à haut revenu devront faire des coupes dans les dépenses gouvernementales (ou augmenter leur revenu) de 8,8% du PIB pendant une période de 20 ans afin de ramener le niveau de la dette à 60% du PIB d'ici 2030."
Malgré leur objectivité apparente et la sobriété de leurs analyses, les rapports du FMI et de la Banque mondiale laissent à penser qu'il existe une profonde incertitude et une grande peur au sein de la classe dominante concernant sa capacité à surmonter la crise. Il est prévisible que d'autres pays suivront l'Irlande dans sa chute dans la récession.
L'évolution de la situation économique en Grande-Bretagne
Cette partie, basée sur des données officielles, est destinée à donner une vue d'ensemble du cours de la récession. Cependant, il est important de rappeler que la crise a commencé dans le secteur financier, à la suite de la crise du marché immobilier aux Etats-Unis, et qu'elle a affecté les grandes banques et les instituts financiers impliqués dans des prêts à risques sur toute la planète. Elle a été la plus forte sur le marché des subprimes aux Etats-Unis et s'est répandue à travers le système financier du fait que le commerce est basé sur des produits financiers dérivés de ces prêts. Cependant d'autres pays, en particulier la Grande-Bretagne et l'Irlande, ont trouvé le moyen de développer leur propre bulle immobilière ce qui a contribué, de pair avec une augmentation massive de l'endettement non sécurisé des particuliers, à créer un niveau de dette tel qu'en fin de compte, en Grande-Bretagne, il a dépassé le PIB annuel du pays. La crise qui se développait submergeait l'économie "réelle" et préparait la récession. Cette situation a suscité une réponse très forte de la classe dominante britannique qui a injecté des sommes d'argent sans précédent dans le système financier et a baissé les taux d'intérêt à un niveau jamais vu.
Les chiffres officiels montrent que la Grande-Bretagne est entrée en récession au cours du 2e trimestre 2008 et en est sortie au 4e trimestre 2009 avec un pic de recul du PIB de 6,4%. 3 Ce chiffre qui vient d'être révisé à la baisse, fait de cette récession la pire depuis la Seconde Guerre mondiale (les récessions du début des années 1990 et des années 1980 ont respectivement été accompagnées de taux négatifs de croissance de 2,5% et de 5,9%). La croissance du 2e trimestre 2010 a été de 1,2%, une augmentation significative par rapport au 0,4% du 4e trimestre 2009 et au 0,3% du premier trimestre 2010. Cependant, elle est toujours en dessous des 4,7% de la période précédant la récession.
Le secteur manufacturier a été le plus affecté par la récession, enregistrant une chute maximale de 13,8% entre le 4e trimestre 2008 et le 3e trimestre 2009. Depuis, ce secteur a enregistré une croissance de 1,1% au dernier trimestre 2009 et de 1,4% et 1,6% au cours des deux trimestres suivants.
L'industrie du bâtiment a connu un fort rebond de croissance, de 6,6%, au cours du 2e trimestre 2010 et contribué de 0,4% au taux de croissance global de ce trimestre. Mais ceci fait suite à un déclin très substantiel tant dans la construction (tombée de 37,2% entre 2007 et 2009) que dans l'activité industrielle et commerciale (tombé de 33,9% entre 2008 et 2009).
Le secteur des services a enregistré une chute de 4,6%, les services financiers et d'affaires chutant de 7,6% "bien plus que lors des précédents reculs et contribuant le plus à la chute". 4 Au cours du dernier trimestre de 2009, ce secteur a retrouvé une croissance de 0,5% mais au cours du premier trimestre 2010, celle-ci est tombée à 0,3%. Bien que le déclin de ce secteur soit moindre que celui des autres, sa position dominante dans l'économie signifie que c'est lui qui a le plus contribué au déclin global du PIB au cours de cette récession. Au cours de celle-ci, le déclin du secteur des services a été également supérieur à ce qu'il avait été dans les récessions du début des années 1980 et du début des années 1990 où les chutes ont été respectivement de 2,4% et de 1%. Plus récemment, le secteur de la finance et des affaires a connu une plus forte croissance et a contribué de 0,4 point au chiffre du PIB global.
Comme on pouvait s'y attendre, les exportations comme les importations ont diminué au cours de la récession. Cela a été le plus marqué dans le commerce de marchandises (bien que la balance se soit légèrement améliorée dernièrement) : "En 2009, le déficit est passé de 11,2 milliards de £ à 81,9 milliards. Il y a eu une chute des exportations de 9,7% - de 252,1 milliards de £ à 227,5 milliards. Cependant cela s'est accompagné d'une chute des importations de 10,4%, la plus grande chute annuelle depuis 1952, qui a eu un impact bien plus grand puisque le total des importations est significativement supérieur à celui des exportations. Les importations sont tombées de 345,2 milliards de £ en 2008 à 309,4 milliards de £ en 2009. Ces chutes importantes, tant dans les exportations que dans les importations, sont le résultat d'une contraction générale du commerce en plus de la crise financière mondiale qui a commencé fin 2008". 5
Le déclin dans les services a été plus réduit, les importations chutant de 5,4% et les exportations de 6,9%, la balance commerciale restant toutefois positive de 55,4 milliards de £ en 2008 et 49,9 milliards de £ en 2009. Le total du commerce dans les services était en 2009 de 159,1 milliards de £ d'exportations et de 109,2 milliards d'importations, ce qui est significativement moins que celui du commerce de marchandises.
Entre 2008-09 et 2009-10, le déficit des comptes courants a doublé, de 3,5% du PIB à 7,08%. Les demandes d'emprunt du secteur public qui incluent l'emprunt pour des dépenses en investissements sont passées de 2,35% du PIB en 2007- 08, à 6,04% en 2008 - 09 et 10,25% en 2009 - 10. En 2008, elles se montaient à 61,3 milliards de £ et en 2009 à 140,5 milliards. Il était prévu que la dette nette totale du gouvernement se monte à 926,9 milliards de £ en juillet de cette année soit 56,1% du PIB, alors qu'elle avait été de 865,5 milliards en 2009 et de 634,4 milliards en 2007. En mai 2009, Standard and Poor’s (organisme de notation) a soulevé la question de rétrograder la notation de la dette britannique en dessous du niveau AAA (le plus élevé). Une telle baisse aurait renchéri de façon significative le coût des emprunts.
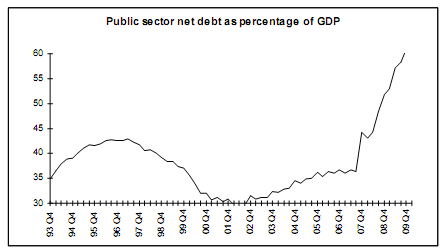
Dette nette du secteur public en pourcentage du PIB
Le nombre de faillites a augmenté pendant la récession, de 12 507 en 2007 (ce qui était un des chiffres les plus bas de la décennie) à 15 535 en 2008 et 19 077 en 2009. Le nombre de rachats et de fusions a augmenté au cours de la deuxième moitié de la décennie pour atteindre 869 en 2007 avant de tomber au cours des deux années suivantes respectivement à 558 et 286. Les chiffres du premier trimestre 2010 n'indiquent pas une quelconque augmentation. Ceci semble signifier que l'insolvabilité des entreprises et la destruction de capital n'ont pas engendré le processus général de consolidation qui intervient en général en sortie d'une crise, ce qui, en soi, peut indiquer que la vraie crise est toujours là.
Pendant la crise, la livre sterling a beaucoup chuté par rapport aux autres devises, perdant plus d'un quart de sa valeur entre 2007 et début 2009, ce qui a suscité le commentaire suivant de la banque d'Angleterre : "Cette chute de plus de 25% est la plus forte sur une période comparable depuis la fin des Accords de Bretton Woods au début des années 1970." 6 Il y a eu une reprise depuis mais la livre reste environ 20% en dessous de son taux de change de 2007.
Le prix du logement a beaucoup chuté après l'éclatement de la bulle immobilière et bien que les prix recommencent à augmenter cette année, ils sont nettement en-dessous de leur maximum et ont à nouveau chuté de 3,6% en septembre dernier. Le nombre de ventes reste à un niveau historiquement bas.
La Bourse a connu de fortes chutes depuis mi-2007 et bien qu'elle ait remonté depuis, l'incertitude existe toujours. Les préoccupations liées à la dette de la Grèce et d'autres pays avant l'intervention de l'Union européenne et du FMI ont provoqué une chute significative en mai cette année comme le montre le graphique ci-après.
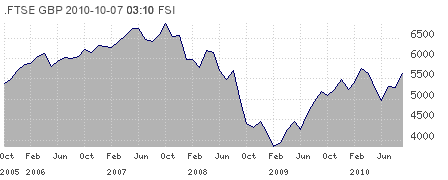
Evolution des valeurs boursières
L'inflation a atteint presque 5% en septembre 2008 avant de retomber à 2% l'année suivante. Elle est depuis passée à plus de 3% en 2010, au-dessus de l'objectif de 2% établi par la Banque d'Angleterre.
L'augmentation du chômage est estimée à 900 000 pendant la récession, ce qui est bien plus bas qu'au cours des précédentes récessions. En juillet 2010, les chiffres officiels étaient de 7,8% de la force de travail, un total d'environ 2,47 millions de personnes.
L'intervention de l'Etat
Le gouvernement britannique est intervenu avec force pour limiter la crise, mettant en oeuvre une série de mesures qui ont également été prises dans beaucoup d'autres pays. Gordon Brown a eu son heure de gloire pendant quelques mois ; son lapsus au cours d'un débat à la Chambre des Communes comme quoi il avait sauvé le monde, est célèbre. L'intervention de l'Etat a comporté plusieurs volets :
- des baisses des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre. Entre 2007 et mars 2009, le taux a été progressivement abaissé de 5,5% à 0,5%, l'amenant au niveau le plus bas jamais enregistré et au-dessous du taux d'inflation ;
- une intervention de soutien direct aux banques, conduisant à des nationalisations totales ou partielles, à commencer par Northern Rock en février 2008, suivie ensuite par Bradford and Bingley. En septembre, le gouvernement négociait le rachat de HBOS par la Lloyds TSB. En octobre, 50 milliards de livres étaient mises à la disposition des banques pour leur recapitalisation. En novembre 2009, une nouvelle injection de 73 nouveaux milliards de livres a abouti à la nationalisation de fait de RBS/NatWest et à la nationalisation partielle de Lloyds TSB/HBOS ;
- une politique de détente du crédit par l'augmentation de la masse monétaire et par l'octroi de subventions au secteur bancaire, connue sous le nom de l'Asset purchase facility. En mars 2009, un plan d'injection de 75 milliards de livres sur trois mois a été annoncé. Le montant s'est élevé jusqu'à atteindre aujourd'hui un total de 200 milliards. La Banque d'Angleterre explique que le but de la détente du crédit est d'injecter plus d'argent dans l'économie sans pour autant devoir réduire le taux de base de 0,5%, déjà au plancher, en vue de maintenir l'objectif d'une inflation à 2%. Cela se fait par l'achat d'avoirs par la Banque d'Angleterre (principalement des gilts 7) aux institutions du secteur privé, ce qui procure des liquidités aux vendeurs. C'est simple en apparence mais, selon le Financial Times, "Personne ne sait très bien si la politique de détente du crédit ou d'autres politiques monétaires non orthodoxes marchent, ni comment elles marchent." 8
- un encouragement à la consommation. En janvier 2009, la TVA a été abaissée de 17,5% à 15% et, en mai 2009, un système de rabais sur les ventes d'automobiles a été introduit. L'augmentation des garanties sur les dépôts de banque à 50 000 £ en octobre 2008 peut être vue comme un élément de cette politique puisque son but est de rassurer les consommateurs sur le fait que leur argent ne disparaîtra pas purement et simplement en cas d'effondrement de la banque.
Cette politique a permis de contenir la crise dans l'immédiat et d'éviter de nouveaux effondrements bancaires. Le prix en a été une augmentation substantielle de la dette comme on l'a indiqué plus haut. Les chiffres officiels donnent le coût de l'intervention du gouvernement, de 99,8 milliards de £ en 2007, 121,5 milliards de £ en 2009 et 113,2 en juillet cette année. Ces chiffres n'incluent ni les coûts de la détente du crédit (ce qui ajouterait environ 250 milliards de £ au total) ni le coût de l'achat d'avoirs comme la participation dans les banques sous le prétexte que ces avoirs ne seront détenus que provisoirement par le gouvernement avant d'être revendus. Cela reste à voir, même si Lloyds TSB a déjà remboursé une partie des sommes reçues. Selon certains commentateurs, l'action du gouvernement a par ailleurs contribué au fait que l'augmentation du chômage a été plus faible que prévu, pendant la récession. Nous y reviendrons plus en détail plus loin.
Cependant, les prospectives à long terme semblent plus contestables :
- les interventions pour prévenir l'inflation et, en théorie, encourager les dépenses n'ont pas permis d'atteindre leur but bien qu'il semble que les tendances de fond soient meilleures que ce qui était prévu. Cependant, le coût des aliments augmente globalement ce qui ne pourra que pousser l'inflation à la hausse et les ventes à la baisse ;
- les tentatives d'injecter des liquidités dans le système en réduisant le coût de l'emprunt et en augmentant l'argent disponible n'ont pas eu la conséquence attendue, amenant les politiciens à réitérer leurs appels pour que "les banques en fassent plus" ;
- l'impact de la baisse de la TVA et du système de rabais sur les automobiles a contribué à un début de reprise fin 2009, mais à présent cette mesure n'est plus en vigueur. Il y a eu une légère baisse des ventes d'automobiles au premier trimestre 2010 alors que le système de rabais existait encore. En fin de compte, il y a eu des réductions concernant la plupart des domaines de consommation des ménages, mais cela s'est traduit par le ralentissement de l'endettement individuel et l'augmentation du taux d'épargne. Etant donné le rôle central joué par la consommation des ménages, basée sur l'endettement, au sein du boom économique, il est clair que sa baisse a des implications négatives, dans cette reprise comme dans toute reprise.
Les prévisions pour la croissance du PIB en 2010 et 2011 en Grande-Bretagne se montent respectivement à 1,5% et 2%. C'est au dessus des 0,9% et 1,7% prévus dans la zone euro, mais en dessous des 1,9% et 2,5% prévus pour l'ensemble de l'OCDE 9 et en dessous des prévisions du FMI pour l'Europe citées au début de ce rapport.
Cependant, pour saisir la signification réelle de la crise, il est nécessaire d'aller au-delà de la surface des phénomènes et d'examiner des aspects de la structure et du fonctionnement de l'économie britannique.
Les questions économiques et structurelles
Changement dans la composition de l'économie britannique : de la production aux services
Pour comprendre la situation du capitalisme britannique et la signification de la récession, il est nécessaire d'examiner les principaux changements structurels intervenus dans l'économie au cours des récentes décennies. Un article publié par Bilan en 1934/1935 (numéros 13 et 14) notait qu'en 1851, 24% des hommes étaient employés dans l'agriculture alors qu'ils n'étaient plus que 7% en 1931, et qu'au cours de la même période, la proportion d'hommes employés dans l'industrie a décliné de 51% à 42%. Aujourd'hui, on est clairement bien en deçà. Dans les années 1930, la Grande-Bretagne avait encore un empire, même sur le déclin, sur lequel elle pouvait s'appuyer. C'est fini depuis la Seconde Guerre mondiale. La tendance historique s'est modifiée passant du secteur de la production vers celui des services et, au sein de ce dernier, vers la finance en particulier comme le montrent les deux tableaux ci-dessous.
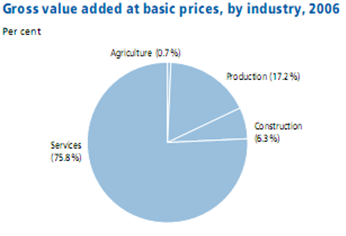
Valeur ajoutée brute totale par secteur en 2006, aux prix de base
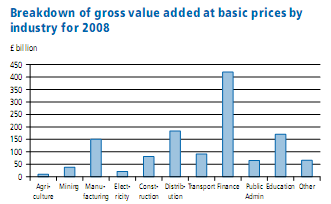
Répartition de la valeur ajoutée brute totale par secteur en 2008,
aux prix de base
Ces deux tableaux proviennent du Blue Book de 2010 qui établit les comptes de la nation. Il fait le commentaire suivant : "En 2006, dernière année de référence, un peu plus de 75% de la valeur ajoutée brute totale provenait du secteur des services, alors que celle issue de la production était de 17%. La partie restante venait majoritairement du secteur de la construction". 10 En 1985, le secteur des services ne constituait que 58% de la valeur ajoutée brute. "Une analyse des 11 grands secteurs industriels montre qu'en 2008, l'intermédiation financière et autres secteurs des services fournissaient la plus grande contribution à la valeur ajoutée brute aux prix de base courants, à 420 milliards de livres sur un total de 1 295,7 milliards (32,4%). Les secteurs de la distribution et de l'hôtellerie ont contribué à hauteur de 14,2% ; ceux de l'éducation, de la santé et du social se montaient à 13,1% ; et celui de la manufacture à 11,6%." 11 Il faut noter qu'en l'espace de deux ans (de 2006 à 2008, le secteur manufacturier a chuté d'environ un tiers (de 17% à 11,6%).
Le tableau ci-dessous intitulé "Changements structurels dans les services au Royaume-Uni" donne une idée de cette évolution au cours des trente dernières années en cherchant à quantifier le développement des différents secteurs qui constituent le secteur des services. "Le rendement total des services a plus que doublé au cours de cette période alors que, dans le secteur des affaires et de la finance, il a été multiplié quasiment par cinq." 12 En comparaison, le même tableau concernant la manufacture montre que ce secteur n'a augmenté que de 18,1% au cours de la même période avec de grandes variations selon les industries.
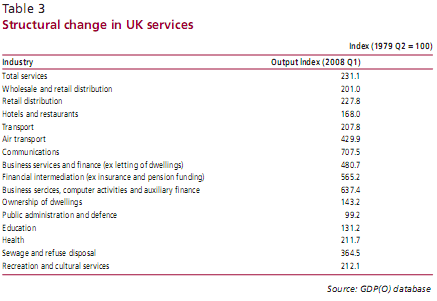
Changements structuraux dans les services au Royaume-Uni.
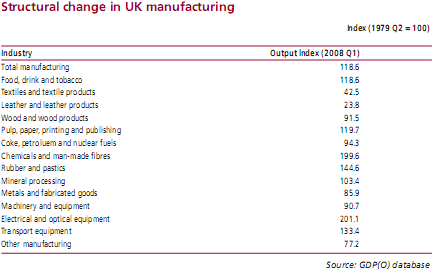
Changements structuraux dans le secteur manufacturier au Royaume-Uni
Le secteur des services dans son ensemble est plus rentable que celui de la manufacture comme le montre le tableau ci-dessous. Au cours du premier trimestre 2010, le taux net de rendement dans la manufacture était de 6,4% et dans les services de 14,4%. Cependant, ce sont les taux de rendement les plus bas respectivement depuis 1991 et 1995.
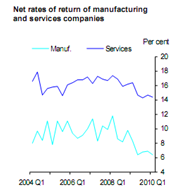
Taux net de rendement dans le secteur manufacturier et dans les services
La montée du secteur financier
Les chiffres publiés sur la profitabilité du secteur des services cités plus haut concernent les compagnies privées non financières et une caractéristique particulière de la situation en Grande-Bretagne est l'importance du secteur de la finance. Celui-ci nécessite donc un examen plus détaillé. Cinq des dix premières banques en tête par capitalisation en Europe en 2004, dont les deux premières, étaient basées en Grande-Bretagne. Globalement, les quatre plus grandes banques britanniques sont dans les sept premières mondiales (les banques américaines Citicorp et UBS sont les deux premières). Selon le directeur de la Stabilité financière à la Banque d'Angleterre : "La part du secteur financier du Royaume uni dans la production total a augmenté de 9% au dernier trimestre 2008. L'excédent brut d'exploitation des entreprises financières (la valeur ajoutée brute moins la compensation pour les employés et d'autres taxes sur la production) a augmenté de 5 milliards de livres à 20 milliards, ce qui est aussi la plus grande augmentation jamais enregistrée". 13 Ceci reflète la tendance en Grande-Bretagne depuis un siècle et demi : "Au cours des 160 dernières années, la croissance de l'intermédiation financière a dépassé l'ensemble de la croissance économique de plus de 2 points de pourcentage par an. Ou, dit autrement, la croissance de la valeur ajoutée du secteur financier a été plus du double de celle de l'ensemble de l'économie nationale au cours de la même période." 14 Alors qu'il représentait environ 1,5% des profits de l'économie entre 1948 et 1970, le secteur représente maintenant 15%. C'est un phénomène global avec des profits avant impôts sur les 1000 principales banques mondiales atteignant 800 milliards de livres en 2007-08, une augmentation de 150% depuis 2000-01. De façon cruciale, le rendement du capital dans le secteur bancaire a largement dépassé celui du reste de l'économie comme le montre le tableau ci-dessous.
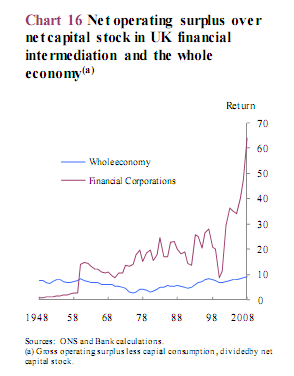
Le ratio de l'excédent net d'exploitation par rapport au capital net dans le secteur d'intermédiation financière et pour l'économie dans son ensemble au Royaume-Uni
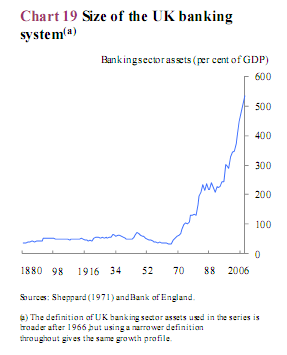
Taille du système bancaire au Royaume-Uni
Le poids du secteur bancaire au sein de l'économie peut se mesurer en comparant ses avoirs par rapport à l'ensemble du PIB du pays. On peut le voir dans le tableau ci-dessus. En 2006, les avoirs de la banque d'Angleterre dépassaient 500% du PIB. Aux Etats-Unis au cours de la même période, les avoirs sont passés de 20% à 100% du PIB, le poids du secteur bancaire en Grande-Bretagne est donc bien supérieur. Cependant son ratio de capital (c'est-à-dire le capital détenu par la banque relativement à celui qui est prêté) ne s'est pas maintenu, tombant de 15-25% au début du 20e siècle à 5% à la fin de celui-ci. Ceci s'est considérablement amplifié au cours de la dernière décennie. Juste avant le krach, le taux de couverture des principales banques était environ de 1 pour 50. Ceci souligne que l'économie globale s'est construite sur une tour de capital fictif au cours des dernières décennies. La crise de 2007 a menacé de faire basculer l'ensemble de l'édifice et cela aurait été catastrophique pour la Grande-Bretagne vu sa dépendance envers ce secteur. C'est pourquoi la bourgeoisie britannique a dû répondre comme elle l'a fait.
La nature du secteur des services
Cela vaut aussi la peine d'examiner de plus près le secteur des services. Il est réparti de différentes façons dans les publications officielles qui fournissent des informations plus ou moins détaillées. Ici, nous nous référerons à la liste des services qui sont cités dans le tableau présenté plus haut ("Changement structurel dans les services au Royaume-Uni"). Il faut toutefois noter à ce sujet que, parfois, la construction qui est une activité productive est incluse dans le secteur des services. La bourgeoisie enregistre la valeur que chaque industrie est supposée ajouter à l'économie, mais ça ne nous dit pas si elles produisent vraiment de la plus-value ou si, tout en remplissant une fonction nécessaire, elles n'ajoutent pas de valeur.
Certains de ces secteurs sont ce que Marx décrivait comme "les frais de circulation". 15 Il y distingue ceux qui sont liés à la transformation de la marchandise d'une forme en une autre, c'est-à-dire de la forme marchandise en monnaie ou vice-versa, et ceux qui sont la continuation du processus de production.
Les changements de forme de la marchandise, bien qu'ils fassent partie du processus global de la production n'ajoutent pas de valeur et constituent un coût sur la plus-value extraite. Dans la liste que nous examinons, sont inclus la distribution de détail et de gros (quand elle ne comprend pas le transport des marchandises – voir plus loin), les hôtels et les restaurants (dans la mesure où ils sont le point de vente de marchandises finies – la préparation des repas peut être considérée comme un processus productif produisant de la plus-value), une grande partie des télécommunications (quand elles sont concernées par l'achat de matières premières ou la vente de produits finis), les ordinateurs et services d’affaires (quand ils sont concernés par des activités telles que la commande et le contrôle des stocks et la stratégie de marché). Toute l'industrie du marketing et de la publicité, qui n'est pas signalée de façon distincte ici, tombe dans cette catégorie puisque son rôle est de maximaliser les ventes.
Marx défend que ces activités qui sont la continuation du processus productif incluent des activités comme le transport qui achemine la marchandise à son point de consommation, ou comme le stockage qui préserve la valeur de la marchandise. Ces activités tendent à augmenter le coût de la marchandise sans ajouter à sa valeur d'usage ; ce sont des coûts improductifs pour la société mais elles peuvent produire de la plus-value pour les capitalistes individuels. Dans notre liste, cette catégorie inclut le transport, la distribution de détail et en gros quand elles impliquent le transport ou le stockage des marchandises.
Un troisième domaine concerne les activités liées à l'appropriation d'une part de la plus-value grâce aux intérêts ou à la rente. Une grande part des activités dans les services d’affaires, la finance, l'intermédiation et les services financiers d’affaires, l'informatique (…) sont des aspects de l'administration de la Bourse et des banques où des honoraires et des commissions sont perçus ainsi que des intérêts. Les organismes financiers investissent aussi de l'argent et spéculent pour leur compte. La propriété des logements est probablement reliée à la location d'où l'enregistrement de plus-value sous forme de rente.
Un quatrième domaine est l'activité de l'Etat qui couvre la plus grande part des cinq derniers éléments de notre liste. Puisqu'ils se fondent sur la plus-value issue de la taxation de l'industrie, aucun ne produit de plus-value, bien que les commandes de l'Etat puissent produire des profits pour les entreprises individuelles. Dans la Revue internationale n° 114, nous soulignions que la façon dont "la bourgeoisie produit ses comptes nationaux [tend] à surestimer le PIB parce que la comptabilité nationale prend partiellement en compte deux fois la même chose. En effet, le prix de vente des produits marchands incorpore les impôts dont le montant sert à payer les dépenses de l'Etat, à savoir le coût des services non marchands (enseignement, sécurité sociale, personnel des services publics). L'économie bourgeoise évalue la valeur de ces services non marchands comme étant égale à la somme des salaires versés au personnel qui est chargé de les produire. Or, dans la comptabilité nationale, cette somme est rajoutée à la valeur ajoutée produite dans le secteur marchand (le seul secteur productif) alors qu'elle est déjà incluse dans le prix de vente des produits marchands (répercussion des impôts et des cotisations sociales dans le prix des produits)." 16
Si on prend l'ensemble du secteur des services, il est clair qu'il n'apporte pas à l'économie la valeur qu'on prétend. Certains services participent à réduire le total de plus-value produite, et les autres, ceux de la finance et des affaires en particulier, prennent leur part de la plus-value produite, y compris lorsqu'elle est produite dans d'autres pays.
Quelles sont les raisons du changement de structure de l'économie britannique ? D'abord, une augmentation de la productivité signifie qu'une masse croissante de marchandises est produite par un nombre de plus en plus faible d'ouvriers. C'est la réalité que montrent les chiffres de Bilan cités plus haut. Deuxièmement, l'augmentation de la composition organique et la chute du taux de profit ont pour résultat que la production se déplace vers des régions où les coûts du travail et du capital constant sont plus bas. 17 Troisièmement, les mêmes facteurs poussent le capital à orienter ses activités là où les rendements sont plus forts, notamment le secteur financier et bancaire dans lequel la domination de longue date de la Grande-Bretagne (Bilan parlait de la Grande-Bretagne comme du "banquier mondial") lui permettait d'extraire plus de plus-value. La dérégulation de ce secteur dans les années 1980 n'a pas réduit les coûts mais a renforcé la domination des principales banques et des compagnies financières, et la dépendance de la bourgeoisie vis-à-vis des profits qu'elles produisent. Quatrièmement, avec l'augmentation de la masse de marchandises, augmente aussi la contradiction entre l'échelle de la production et la capacité des marchés, ce qui mobilise davantage de ressources pour transformer le capital de sa forme de marchandise en sa forme d'argent. Cinquièmement, la complexité croissante de l'économie et des contraintes sociales a pour conséquence le développement de l'Etat qui doit gérer l'ensemble de la société dans l'intérêt du capital national. Ceci inclut les forces de contrôle direct, mais aussi les secteurs de l'Etat qui ont pour tâche de produire des ouvriers qualifiés, de les maintenir à peu près en bonne santé et de gérer les différents problèmes sociaux qui surgissent dans une société d'exploitation.
Conclusion
Deux conclusions quelque peu contradictoires peuvent être tirées de cette partie du rapport. La première et la plus importante est que l'évolution du capitalisme britannique l'a exposé de plein fouet à la crise lorsqu'elle a éclaté et il y a eu un vrai danger que l'effondrement du secteur financier paralyse l'économie. La perspective était à une accélération aiguë du déclin du capitalisme britannique avec toutes ses conséquences au niveau économique, impérialiste et social. Dire que la bourgeoisie britannique était au bord de l'abîme en 2007 et 2008 n'est pas une exagération. La réponse que la classe dominante a apportée confirme qu'elle est toujours capable et déterminée ; elle a uni toutes ses forces pour faire face au danger immédiat ; pour les conséquences à plus long terme c'est autre chose.
La seconde conclusion est que ce serait une erreur de négliger les secteurs manufacturiers et de penser que la Grande-Bretagne n'a quasiment plus d'industrie. Deux raisons à cela. D'abord, le secteur industriel participe toujours de façon importante à l'économie dans son ensemble, même si le taux de profit y est plus bas. La contribution de 17% ou même 11,6% à l'économie totale n'est pas insignifiante (et est en réalité probablement plus grande une fois que les composantes non productives des services sont prises en compte). De plus, même si dans ce secteur la balance commerciale est négative depuis des décennies, la production constitue une composante importante des exportations de la Grande-Bretagne. Deuxièmement, la crise actuelle met à nu le danger de ne s'appuyer que sur une partie de l'économie. Cela explique pourquoi le gouvernement de Cameron met en avant le rôle que la manufacture peut jouer dans une reprise économique et pourquoi la promotion du commerce britannique est devenue récemment une priorité de la politique étrangère de la Grande-Bretagne. Que celle-ci soit réaliste est une autre question car elle requiert une attaque sur les coûts de production plus importante que tout ce qui a été fait par Thatcher et ira contre les tendances historique et immédiate de l'économie globale. La Grande-Bretagne ne peut entrer directement en compétition avec la Chine et ses semblables, aussi devra-t-elle trouver des créneaux particuliers.
Tout cela nous amène à la question : "quel espoir de reprise économique ?"
IV. Quel espoir de reprise économique ?
Le contexte global
"... des données récentes indiquent que la reprise globale ralentit après une reprise initiale relativement rapide. La production occidentale est toujours bien en dessous des tendances d'avant 2008. Le chômage obstinément haut aux Etats-Unis gâche des vies et aigrit la politique. L'Europe a frôlé la déroute d'une seconde crise mondiale en mai lorsque ses principales économies ont accepté de renflouer la Grèce et d'autres pays très endettés risquant le défaut de leur dette souveraine. Le Japon est intervenu sur le marché des monnaies pour la première fois en six ans pour arrêter une montée du yen mettant en péril ses exportations." Cette citation du Financial Times 18 à la veille de la réunion biannuelle du FMI et de la Banque mondiale début octobre reflète les préoccupations de la bourgeoisie.
On peut constater que les plans de reprise en Europe ont jusqu'à présent échoué à produire de forts taux de croissance et on doit souligner avant tout l'augmentation de la dette publique qui, dans certains pays, a amené à mettre en question la capacité de l'Etat à rembourser ses dettes. La Grèce est aux avant-postes de ce groupe de pays, mais la Grande-Bretagne fait aussi partie de ceux dont le niveau d'endettement présente un risque. Le graphique ci-dessous, malgré son intitulé rassurant, montre qu'aux Etats-Unis et dans beaucoup de pays d'Europe, le niveau d'endettement présente un risque. La Grande-Bretagne n'a peut-être pas un niveau de dette aussi considérable que d'autres (axe horizontal), mais son déficit courant est le plus élevé (axe vertical), indiquant à quelle rapidité elle a récemment accumulé de la dette.
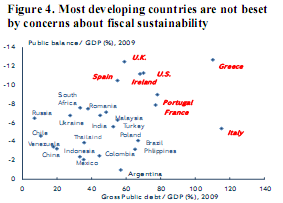
La plupart des pays en voie de développement n'ont pas de problème de viabilité fiscale
Deux stratégies distinctes ont été adoptées pour faire face à la récession : celle qui a les faveurs des Etats-Unis et consiste à poursuivre l'endettement et celle qui est de plus en plus adoptée en Europe consistant à diminuer les déficits en imposant des programmes d'austérité. Les Etats-Unis sont en position de mener cette politique parce que le dollar continue à être la monnaie de référence, ce qui leur permet de financer leur déficit en imprimant des billets, une option à laquelle leurs rivaux ne peuvent recourir. Les autres pays sont plus contraints par leur dette et ce fait en lui-même apporte des éléments de réponse à la question qui se pose concernant les limites de l'endettement. Une évolution récente au niveau international a été l'augmentation des efforts pour utiliser les taux de change afin d'être plus compétitif, ce qui est crucial pour utiliser les exportations en vue de restaurer la situation économique d'un pays. Une deuxième cause est la lutte qui oppose les pays excédentaires aux pays déficitaires sur la question des taux de change. Elle s'exerce entre la Chine et les Etats-Unis où la dévaluation du dollar par rapport au yuan non seulement réduirait la compétitivité des marchandises chinoises mais dévaluerait également ses énormes avoirs en dollars américains (c'est l'une des raisons pour lesquelles la Chine a utilisé une partie de ses réserves pour acheter des avoirs dans différents pays, y compris en GB). La politique d'assouplissement monétaire ("quantitative easing", QE) joue un rôle dans la dévaluation des monnaies puisqu'elle participe d'augmenter la création de monnaie, ce qui donne un nouvel éclairage à l'annonce récente par le Japon d'un nouveau round sur le QE. Les Etats-Unis et la GB envisagent la même chose. Ce que cela implique, c'est une perte de l'unité qu'on a connue en pleine crise et son remplacement par l'attitude du chacun pour soi. Un journaliste du Financial Times commentant ces événements écrivait récemment : "Comme dans les années 1930, tout le monde cherche à sortir de la crise grâce aux exportations ce que, par définition, tous ne peuvent faire. Aussi des déséquilibres globaux se développent à nouveau, comme le risque de protectionnisme." 19 Les pressions grandissent mais nous ne pouvons pas encore dire si la bourgeoisie y succombera.
Ce que cela signifie, c'est que toutes les options sont porteuses de véritables dangers et qu'il n'existe pas de sortie évidente de la crise. Le manque de demande solvable va renouveler la pression qui a mené à l'escalade de l'endettement et va réanimer les réflexes protectionnistes qui avaient été depuis longtemps contenus, tandis que les politiques d'austérité risquent de réduire encore la demande et de provoquer une nouvelle récession, un plus grand protectionnisme et de renforcer la pression pour un retour à l'utilisation de l'endettement. Dans cette perspective, le recours à de nouvelles dettes semble le plus évident dans l’immédiat puisque ce sera la poursuite des politiques des dernières décennies mais cela pose la question des limites de l'endettement et, si de telles limites existent, ce qu’elles sont et si nous les avons atteintes. Pour ce rapport, nous pouvons conclure des récents développements et de la crise qui a éclaté en Grèce qu'il existe des limites à l'endettement – ou, plutôt, un point où les conséquences d'une dette accrue se mettent à saper son efficacité et déstabiliser l'économie mondiale. Si la Grèce s'avérait incapable de rembourser, il y aurait non seulement une dépression sérieuse dans le pays, mais il y aurait également des perturbations sérieuses de tout le système financier international. La chute de la Bourse avant le renflouage de l'Europe et du FMI a montré la sensibilité de la bourgeoisie à cette question.
Les options du capitalisme britannique
La bourgeoisie britannique est aux avant-postes de celles qui ont choisi l'austérité avec son plan pour éliminer le déficit en quatre ans, ce qui requiert une coupe d'environ ¼ des dépenses de l'Etat. Au-delà du secteur étatique, son plan de suppression des allocations pour rendre le travail plus attractif a clairement pour objectif de baisser le coût du travail dans toute l'économie afin d'augmenter la compétitivité et la profitabilité du capitalisme britannique. Elle présente cela sous le drapeau de l'intérêt national et cherche à suggérer que la crise est la faute du gouvernement travailliste et pas du capitalisme.
Nous avons analysé, dans des rapports antérieurs, que le capitalisme britannique avait récemment produit de la plus-value en augmentant le taux d'exploitation absolue de la classe ouvrière et avait réalisé cela au moyen d'une augmentation de la dette, en particulier de la dette privée alimentée par le boom immobilier et l'explosion des prêts non sécurisés. Sur cette base, le rapport du dernier congrès de la section en Grande-Bretagne soulignait l'importance du secteur des services et le présent rapport le confirme tout en précisant que ce n'est pas l'ensemble du secteur qui est concerné mais celui des finances. Dans ce cadre, cela vaut la peine d'examiner comment les trois éléments de réponse à la crise – l'endettement, l'austérité et les exportations – se présentent dans la situation rencontrée par la Grande-Bretagne.
Avant la crise, l'endettement des ménages a été à la base de la croissance économique pendant plusieurs années, à la fois directement à travers la dette accumulée par les ménages britanniques et indirectement à travers le rôle des institutions financières dans le marché global de la dette. Avec l'éclatement de la crise, l'Etat s'est endetté pour protéger les institutions financières et, dans une bien moindre mesure, pour protéger les ménages (l'augmentation de la protection de l'épargne jusqu'à 50 000 £), tandis que la croissance de l'endettement des ménages déclinait et que certaines personnes se trouvaient insolvables. A présent, le niveau de l'endettement privé diminue légèrement tandis que l'épargne augmente et que le gouvernement a annoncé qu'il était déterminé à diminuer le déficit de moitié. A moins qu'il n'y ait un renversement, il semble peu probable que l'endettement puisse contribuer en quoi que ce soit à la reprise. L'austérité qui se profile peut avoir deux effets sur la classe ouvrière. D'une part, elle peut amener beaucoup de travailleurs à limiter leurs dépenses et à chercher à rembourser leurs dettes afin de se protéger. D'autre part, elle peut en amener d'autres à s'endetter pour boucler les fins de mois. Cependant, ce dernier cas de figure serait certainement limité par la réticence des banques à prêter. Le secteur financier était dépendant du développement de la dette globale pour la plus grande part de sa croissance avant le krach et, à présent, il y a des tentatives de trouver des alternatives, qui se concrétisent par exemple par l'activité accrue dans le marché alimentaire. Cependant ce type d'activités continue à dépendre en dernière instance de la présence d'une demande solvable, ce qui nous ramène au point de départ. Si les Etats-Unis continuent sur le chemin d'une augmentation de l'endettement, le capital britannique pourrait en bénéficier étant donné sa position au sein du système financier global, ce qui semble indiquer que, malgré toute la rhétorique d'un Vince Cable 20 et ses semblables, aucune action ne sera entreprise pour freiner les banquiers et que la stratégie de dérégulation initiée sous Thatcher continuera.
L'austérité semble être actuellement la stratégie principale. Le but avoué est de réduire le déficit, avec la promesse implicite qu'après, les choses reviendront à la normale. Mais pour avoir un quelconque impact durable sur la compétitivité du capital britannique, des changements durables devront avoir lieu. Les espoirs peuvent être placés dans une grande augmentation de la productivité mais cela ne s'est pas concrétisé depuis des décennies. Cela n'arrivera probablement pas, à moins qu'il y ait un investissement substantiel dans les domaines liés à une productivité croissante, comme la recherche et le développement, l'éducation et l'infrastructure. Ce qui est déjà évident, c'est qu'il y a des coupes dans ces domaines, aussi l'effort le plus probable sera de réduire en permanence la proportion de plus-value engrangée par l'Etat et la proportion de la valeur totale assignée à la classe ouvrière. Bref, une réduction de la taille de l'Etat et des salaires plus bas. Cependant, pour être efficace, les attaques contre la classe ouvrière devront être massives et la réduction de la taille de l'Etat va à l'encontre de la tendance que nous avons connu au cours de la période de décadence au sein de laquelle l'Etat doit accroître sa domination sur la société afin de défendre ses intérêts économiques et impérialistes et d'empêcher les contradictions au cœur de la société bourgeoisie de la faire éclater.
Les exportations ne peuvent jouer un rôle que si la bourgeoisie réussit à rendre le capital britannique plus compétitif. Tous ses rivaux font de même. Le secteur des services en Grande-Bretagne rapporte et il serait possible d'augmenter son niveau relativement bas d'exportations. Mais l'ennui c'est que les parties les plus rentables de ce secteur semblent être celles qui sont liées au système financier ce qui rend son développement dépendant d'une reprise globale.
Pour résumer, il n'y a pas de voie facile pour le capitalisme britannique. La direction la plus probable semble être de continuer à s'appuyer sur sa position au sein du système financier global en même temps qu'un programme d'austérité pour soutenir les profits. A long terme cependant, il ne peut que se trouver face à une détérioration continue de sa position.
V. Les conséquences de la crise sur la classe ouvrière
L'impact de la crise sur la classe ouvrière fournit la base objective pour notre analyse de la lutte de classe. Cette partie se concentrera sur la situation matérielle de la classe ouvrière. Les questions de l'offensive idéologique de la classe dominante et du développement de la conscience de classe seront traitées dans d'autres parties du rapport (...)
L'un des impacts immédiats de la crise sur la classe ouvrière a été une augmentation du chômage. Le taux a augmenté sans interruption durant la plus grande partie de 2008 et 2009, augmentant de 842 000 et atteignant 2,46 millions ou 7,8% de la population active. Cependant, c'est en-dessous des augmentations connues au cours des récessions des années 1980 et 90, quand les taux ont augmenté respectivement jusqu'à 8,9% (une augmentation de 932 000) et 9,2% (une augmentation de 622 000), ceci en dépit du fait que la chute du PIB ait été supérieure dans la récession actuelle à celle des précédentes.
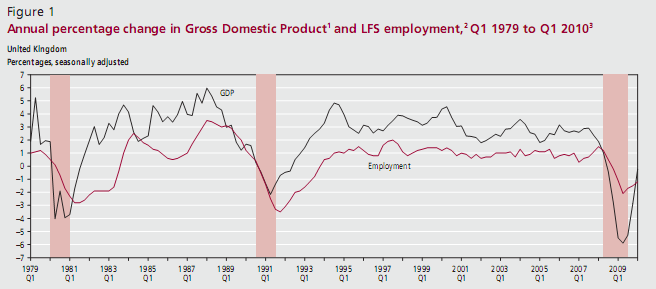
Variation annuelle du PIB et de l'emploi (chiffres 'Labour Force Survey') du premier trimestre 1979 au premier trimestre 2010
Une étude récente indique que la chute du PIB pendant cette récession aurait pu donner lieu à une augmentation supplémentaire du chômage de l’ordre d’un million 21 ; on peut se demander pourquoi cela n'est pas arrivé. L'étude citée avance que c'est dû au fait de "la forte position financière des entreprises au début de la récession et du resserrement financier plus modéré sur les entreprises au cours de cette récession" ce qui à son tour est dû à trois facteurs : "Premièrement, les politiques d'assistance du système bancaire, la baisse des taux d'intérêt et le grand déficit gouvernemental, créant un fort stimulant. Deuxièmement, la flexibilité des ouvriers qui a permis une véritable diminution des coûts salariaux pour les entreprises, accompagnée par des taux d'intérêt bas qui ont soutenu la croissance du salaire réel des consommateurs. Enfin, le fait que les entreprises se sont abstenues de licencier la main d'œuvre qualifiée tout en faisant face à la pression sur les profits et à la sévérité de la crise financière."
La baisse des coûts salariaux est attestée par les faits et elle a été réalisée grâce à la réduction des heures travaillées (et donc payées) et à une augmentation des salaires inférieure à l'inflation. Le travail à temps partiel a augmenté depuis la fin des années 1970 où il constituait un peu plus de 16% de la force de travail, et a atteint 22% en 1995. Au cours de cette récession il s'est encore accru et la majorité des travailleurs à temps partiel le sont parce qu'ils n'ont aucune autre alternative. 22 Le nombre de personnes sous-employées dépasse le million. Il y a eu une légère chute de la moyenne des heures de travail par semaine, de 32,2 à 31,7 mais sur l'ensemble de la force de travail, cela équivaut à 450 000 emplois basés chacun sur la moyenne de la durée du travail dans le pays.
La réduction des salaires réels provient à la fois d'accords sur les salaires défavorables aux salariés et de la montée de l'inflation. Le résultat est que les entreprises ont économisé 1% des coûts salariaux réels.
Mais ce n'est pas tout. Alors qu'on a vu dans les dernières années des efforts pour radier les gens du système d'allocations, cette tendance ne s'est pas accentuée au cours de la récession. En fait, l'utilisation de l'allocation d'incapacité ou autre continue à permettre de masquer le chômage comme le montre le graphique ci-dessous.
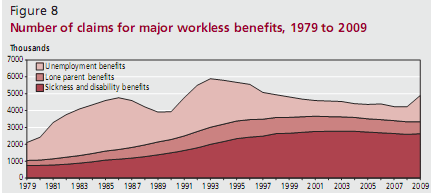
Evolution du nombre de demandes des principales allocations chômage
De plus, au cours des deux dernières récessions, le chômage a continué à augmenter longtemps après que, formellement, la récession fut terminée. Dans les années 1980, il a fallu 8 ans pour que les niveaux de chômage retrouvent ceux qui avaient précédé la récession, et dans les années 1990, presque 9. Alors que le taux d'augmentation du chômage dans la présente récession pourrait se stabiliser plus rapidement que dans les deux précédentes, il y a de bonnes raisons de penser que ce ne pourrait être qu’un interlude temporaire. En effet, non seulement les mesures d'austérité prévoient le licenciement de centaines de milliers de fonctionnaires, mais aussi la récession en W (double plongée) que ces mesures pourraient provoquer, en plus de l'incertitude de la situation générale, signifie que le chômage pourrait bien recommencer à augmenter. On considère qu'il faudrait des taux de croissance annuels de 2% pour que l'emploi augmente et de 2,5% en cas d'une modeste augmentation de la population. Or de tels taux ne font pas partie des projections pour le futur.
Ceux qui se retrouvent au chômage y restent plus longtemps puisque le nombre d'emplois vacants est substantiellement inférieur au nombre de ceux qui cherchent du travail. Plus la période de chômage dure, plus la probabilité est grande qu'un chômeur qui a trouvé du travail connaîtra de nouveau le chômage dans le futur. Début 2010, 700 000 personnes étaient dans la catégorie chômeur de longue durée, n'ayant pas travaillé depuis 12 mois ou plus. Il vaut la peine de souligner ici l'impact du chômage sur la population : "Une indication des coûts réels de cette flexibilité a été fournie par une étude récente de l'impact de la récession sur la santé mentale. Elle montrait que 71% des personnes ayant perdu leur emploi l'an dernier ont connu des symptômes de dépression, les plus affectés ayant entre 18 et 30 ans. La moitié d'entre eux dit avoir connu le stress et l'anxiété." 23
Un aspect de la réduction des salaires et de l'aggravation générale des conditions de vie est une chute de la consommation. Bien que certaines des études citées avancent que celle-ci s’est réduite faiblement, d'autres affirment qu'il y a eu une chute de 5% au cours de 2008 et 2009. Evidemment, pour la plupart des gens, ce n'est pas une question de choix mais la simple conséquence de la perte d’emploi, d'une diminution des heures de travail ou d'une baisse directe du salaire.
Les chiffres officiels montrent une chute de la pauvreté chez les enfants et les retraités au cours de la période du gouvernement travailliste, le niveau de vie moyen augmentant par ailleurs de 2% par an. Cependant, il y a eu un ralentissement ces dernières années. En même temps l'inégalité a augmenté et la pauvreté chez les adultes en âge de travailler est à son plus haut niveau depuis 1961. 24 Globalement, la pauvreté relative s'est accrue entre 1% et 1,8% (ce qui représente entre 0,9 et 1,4 million de personnes) pour atteindre 18,1% ou 22,3% (la différence des estimations résulte de l'inclusion ou non des coûts du logement).
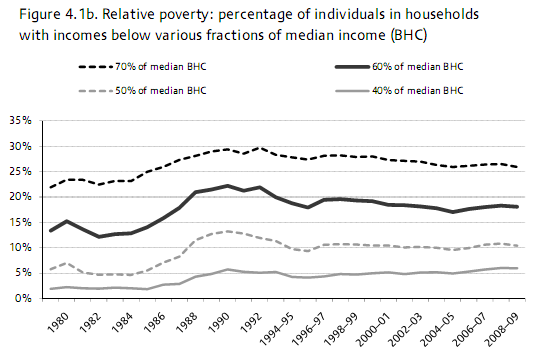
La pauvreté relative: pourcentage d'individus dans des ménages dont le revenu se situe en-deça de diverses fractions du revenu médian
Bien qu'il y ait eu récemment un léger déclin du niveau d'endettement personnel (au rythme de 19 pence par jour), en juillet de cette année le taux de croissance annuel était toujours de 8% et le total de la dette de 1 456 milliards de livres 25, ce qui, comme nous l'avons souligné auparavant, est supérieur à la production annuelle totale du pays. Cette somme inclut 1 239 milliards de livres de prêts sécurisés pour le logement et 217 milliards de crédit à la consommation. On estime qu'une famille moyenne doit dépenser 15% de son revenu net à rembourser ses dettes.
Ceci a eu pour résultat l'augmentation des banqueroutes personnelles et des Arrangements Volontaires Individuels (IVA). Ces derniers sont passés, de façon significative, de 67 000 en 2005, à 106 000 en 2006 et 107 000 en 2008 avant de monter à nouveau pour atteindre 134 000 en 2009. Le premier trimestre de cette année a vu 36 500 IVA supplémentaires, ce qui, si cela devait continuer ainsi, signifierait une nouvelle augmentation. 26 Cette augmentation est très substantiellement supérieure à celle que nous avons vue au cours des précédentes récessions, bien que les changements légaux rendent difficiles les comparaisons directes. 27
A côté de la diminution de la croissance de la dette personnelle, l'ONS rapporte une évolution du taux d'épargne des ménages, passant de – 0,9% début 2008 à + 8,5% à la fin 2009. 28 Il semble que beaucoup d'ouvriers cherchent à se préparer pour les jours difficiles à venir.
Perspectives
Bien que l'impact de la crise sur la classe ouvrière soit plus important que les publications de la bourgeoisie tendent à la présenter, il a néanmoins été relativement contenu à la fois au niveau de l'emploi et du revenu. C'est dû en partie aux circonstances, en partie à la stratégie adoptée par la bourgeoisie - y compris à travers l'utilisation de l'endettement - et, en partie, à la réponse de la classe ouvrière qui semble s'être plus focalisée sur la façon de survivre à la récession que sur la nécessité de la combattre. Mais il est peu probable que cette situation continue. Premièrement, la situation économique globale va rester très difficile puisque la bourgeoisie est incapable de résoudre les contradictions fondamentales qui minent les fondements de son économie. Deuxièmement, la stratégie de la classe dominante britannique a maintenant évolué vers l'instauration de l'austérité, du fait, en partie, de la situation globale. Elle pourrait revenir à l'utilisation de la dette à court terme mais cela ne ferait qu'empirer les problèmes à plus long terme. Troisièmement, l'impact sur la classe ouvrière va s'accroitre dans la période à venir et contribuera à développer les conditions objectives pour l'essor de la lutte de classe.
10/10/2010
1 World Bank, Global Economic Prospects, été 2010, Key Messages.
2 Ibid.
3 La plupart des données de cette partie sont tirées de la Economic and Labour Market Review d'août 2010, publiée par le Bureau national des Statistiques (Office for National Statistics, ONS). D'autres chiffres proviennent du Blue Book qui traite des comptes nationaux de la Grande-bretagne, du Pink Book qui traite de la balance des paiements et de Financial Statistics ; tous sont publiés par L'ONS.
4 Economic and Labour Market Review, août 2010.
5 ONS, Pink Book, Edition 2010
6 Banque d’Angleterre, Inflation Report, février 2009.
7 "Les gilts, abréviation de gilt-edged securities, soit littéralement "valeurs mobilières dorées sur tranche", sont les emprunts d'État émis par le Royaume-Uni." (Wikipedia)
8 Financial Times, "That elusive spark" ("Cette étincelle insaisissable"), 06/10/2010
9 Ces chiffres sont tirés du Economic and Labour Market Review, septembre 2010. La revue reprend les prévisions pour la zone euro et l'OCDE de l'Economic Outlook de l'OCDE de novembre 2009.
10 Blue Book 2010
11 Ibid.
12 Economic and Labour Market Review, août 2010
13 Andrew Haldane, "The Contribution of the Financial Sector Miracle or Mirage", Banque d'Angleterre, juillet 2010.
14 Ibid.
15 Voir Le Capital, livre II, chapitre IV, "Les frais de circulation"
16 Revue internationale n° 114, "Crise économique : Les oripeaux de la "prospérité économique" arrachés par la crise".
17 On attribue au développement de la production en Chine et à d'autres producteurs à bas coût le maintien de la stabilité relative du taux de l'inflation globale au cours des dernières décennies ainsi que la réduction des coûts du travail dans le monde entier, y compris dans les pays développés, puisque le nombre d'ouvriers s'est massivement accru (il a été indiqué que l'entrée de la Chine dans l'économie mondiale a doublé la main d'œuvre à disposition). Par conséquent, non seulement le taux de profit peut être plus élevé dans les pays à bas coût eux-mêmes, mais on peut également faire baisser le coût du travail et remonter le taux de profit dans les pays développés, ce qui résulte dans l'augmentation du taux de profit moyen que nous avons noté dans plusieurs numéros de la Revue internationale. Mais que cela suffise à créer la masse nécessaire de profit est une autre question.
18 "That elusive spark", 06/10/2010
19 John Plender, "Currency demands make a common ground elusive", 06/10/2010
20 Membre du Parti Libéral-Démocrate et actuellement secrétaire d'Etat pour l'Entreprise et l'Innovation ("Secretary of State for Business, Innovation and Skills") au sein du gouvernement de coalition Cameron-Clegg.
21 "Employment in the 2008-2009 recession", Economic and Labour Market Review, août 2010
22 Voir Economic and Labour Market Review, septembre 2010
23 Rapport original dans The Guardian, 01/04/2010
24 Institute for Fiscal Studies, Poverty and Inequality in UK, 2010.
25 Les chiffres de ce paragraphe proviennent de Debt Facts and Figures de septembre 2010 compilés par Credit Action.
26 Source : ONS, Financial Statistics, août 2010
27 Economic and Labour Market Review, août 2010. Entre 1979 et 1984, la hausse a été de 3 500 à 8 229, et entre 1989 et 1993, de 9 365 à 36 703.
28 Ibid.
Géographique:
- Grande-Bretagne [8]
Récent et en cours:
- Crise économique [7]
La révolution hongroise de 1919 : l'exemple de la Russie inspire des ouvriers hongrois (II)
- 5146 lectures
Dans ce second article nous verrons comment cette manœuvre échoua, et comment la situation révolutionnaire continuant de mûrir, le Parti social-démocrate lança une autre manœuvre aussi risquée mais qui finalement fut un succès pour le capitalisme : fusionner avec le Parti communiste, "prendre le pouvoir" et organiser "la dictature du prolétariat", ce qui bloqua le processus ascendant de lutte et d’organisation du prolétariat et le conduisit dans une impasse qui permit sa défaite totale.
Mars 1919 : crise de la République bourgeoise
La vérité sur l’affaire de l’assaut du journal finit bientôt par éclater. Les ouvriers se sentirent trompés et leur indignation grandit quand ils apprirent les tortures infligées aux communistes. La crédibilité du Parti social-démocrate en prit un sérieux coup. Tout ceci favorisait la popularité des communistes. Les luttes revendicatives se multipliaient depuis fin février, les paysans prenaient les terres sans attendre la sempiternelle promesse de "réforme agraire"2, l’affluence aux réunions du Conseil ouvrier de Budapest grandissait et des discussions tumultueuses portaient des critiques acerbes aux dirigeants sociaux-démocrates et syndicaux. La République bourgeoise, qui avait suscité tant d’illusions en octobre 1918, décevait à présent. Les 25 000 soldats rapatriés des champs de bataille étaient enfermés dans leurs casernes et organisés en conseils ; la première semaine de mars, non seulement les assemblées de casernes renouvelaient leurs représentants – avec une augmentation significative de délégués communistes – mais, en outre, votaient des motions par lesquelles il était affirmé qu’"il ne sera obéi aux ordres du gouvernement que s’ils ont préalablement été ratifiés par le Conseil de soldats de Budapest".
Le 7 mars, une session extraordinaire du Conseil ouvrier de Budapest adopta une résolution qui "exigeait la socialisation de tous les moyens de production et le passage de leur direction aux conseils". Même si la socialisation sans destruction de l’appareil d’État bourgeois ne peut être qu'une mesure boiteuse, cet accord exprimait cependant la grande confiance en soi des conseils et était une réponse à deux questions pressantes : 1) le sabotage effectué par le patronat sur une production totalement désorganisée par l’effort de guerre ; 2) la terrible pénurie de vivres et de produits de première nécessité.
Les événements se radicalisent. Le Conseil ouvrier des métallos lance un ultimatum au gouvernement : il lui accorde cinq jours pour céder le pouvoir aux partis du prolétariat 3. Le 19 mars se déroule la plus grande manifestation ayant eu lieu jusqu’alors, convoquée par le Conseil ouvrier de Budapest ; les chômeurs revendiquent une allocation et une carte de ravitaillement, ainsi que la suppression des loyers. Le 20, les typographes partent en grève, et celle-ci se généralise dès le lendemain avec deux revendications : libération des dirigeants communistes et "gouvernement ouvrier".
Si ces faits démontrent la maturation d’une situation révolutionnaire, ils mettent aussi en évidence que celle-ci était encore loin du niveau politique qui permet au prolétariat de se lancer à l’assaut du pouvoir. Pour le prendre et le conserver, le prolétariat doit compter sur deux forces indispensables : les conseils ouvriers et le parti communiste. En mars 1919, les conseils ouvriers en Hongrie n'en étaient qu'à leurs premiers pas, ils commençaient à peine à sentir leur force et leur autonomie et ils en étaient encore à tenter de se libérer de la tutelle étouffante de la social-démocratie et des syndicats. Leurs deux principales faiblesses étaient :
– leurs illusions sur la possibilité d’un "gouvernement ouvrier" qui unirait les sociaux-démocrates et les communistes, ce qui, comme nous le verrons, sera le tombeau du développement révolutionnaire ;
– leur organisation était encore celle des secteurs économiques : conseils de métallos, de typographes, d’ouvriers du textile, etc. En Russie, depuis 1905, l’organisation des conseils était totalement horizontale, organisant les ouvriers comme un tout par-dessus les divisions par secteur, région, nationalité, etc. ; en Hongrie coexistent les conseils sectoriels et les conseils horizontaux par villes, avec les dangers que cela représente au niveau du corporatisme et de la dispersion.
Nous soulignions dans le premier article de cette série que le Parti communiste était encore très faible et hétérogène, que le débat commençait à peine à se développer en son sein. Il souffrait de l’absence d’une structure internationale solide pour le guider – l’Internationale communiste célébrait à peine son Premier Congrès. Pour ces raisons, comme nous allons le voir, il manifesta une énorme faiblesse et une absence de clarté qui fera de lui une victime facile du piège que lui tendra la social-démocratie.
La fusion avec le Parti social-démocrate et la proclamation de la République soviétique
Le colonel Vix, représentant l’Entente4, remet un ultimatum dans lequel il est stipulé la création d’une zone démilitarisée dans le territoire hongrois directement gouvernée par le commandement allié, d’une profondeur de 200 kilomètres, ce qui revient à occuper la moitié du pays.
La bourgeoisie n’affronte jamais le prolétariat à visage découvert ; l’histoire nous enseigne qu’elle tente de le prendre entre deux feux, la gauche et la droite. Nous voyons là comment la droite ouvre le feu avec la menace de l’occupation militaire, qui se concrétisera par l’invasion en bonne et due forme dès le mois d’avril. De son côté, la gauche entre en action dès le lendemain à partir d’une déclaration pathétique du Président Karolyi : "La patrie est en danger. L'heure la plus grave de notre histoire a sonné. (…) Le moment est venu où la classe ouvrière hongroise, avec sa force, la seule force organisée du pays, et avec ses relations internationales, doit sauver la patrie de l'anarchie et de la mutilation. Je vous propose donc un gouvernement social-démocrate homogène qui fera face aux impérialistes. Il s'agira d'une lutte dont l'enjeu est le sort de notre pays. Pour mener à bien cette lutte, il est indispensable que la classe ouvrière retrouve son unité, et que l'agitation et le désordre provoqués par les extrémistes cessent. A cette fin les sociaux-démocrates doivent trouver un terrain d'entente avec les communistes" 5.
Le feu croisé contre la lutte de classe de la droite, avec l’occupation militaire, et de la gauche, avec la défense nationale, convergent vers le même objectif : sauver la domination capitaliste. L’occupation militaire – le pire affront que puisse souffrir un État national – a comme objectif réel l’écrasement des tendances révolutionnaires du prolétariat hongrois. En outre, elle offre la possibilité à la gauche d’encadrer les ouvriers vers la défense de la patrie. C’est un piège qui s’était déjà présenté en octobre 1917 en Russie quand, confrontée à son incapacité à écraser le prolétariat, la bourgeoisie russe avait préféré que les troupes allemandes occupent Petrograd. La classe ouvrière déjoua alors habilement cette manœuvre en s'engageant dans la prise de pouvoir. Dans le sillage du comte Karolyi, le social-démocrate de droite Garami expose la stratégie à suivre : "confier le gouvernement aux communistes, attendre leur faillite totale et alors, alors seulement, dans une situation libérée de ces déchets de la société, nous pourrons former un gouvernement homogène" 6. L’aile centriste du Parti 7 précisait cette politique : "Constatant en effet que la Hongrie se trouve être sacrifiée par l'Entente, qui manifestement a décidé de liquider la Révolution, il en résulte que les seuls atouts dont celle-ci dispose sont la Russie soviétique et l'Armée rouge. Pour obtenir l'appui de ces dernières, il faut que la classe ouvrière hongroise soit effectivement maîtresse du pouvoir et que la Hongrie soit une véritable république populaire et soviétique." Et elle ajoutait "pour éviter que les communistes n'abusent du pouvoir, il vaut mieux le prendre avec eux !" 8.
L’aile gauche du Parti social-démocrate défend une position prolétarienne et tend à converger vers les communistes. Face à elle, les droitiers de Garami et les centristes de Garbai manœuvrent avec habileté. Garami démissionne de toutes ses responsabilités. L’aile droite se sacrifie en faveur de l’aile centriste qui "se déclarant favorable au programme communiste" parvient à séduire la gauche 9.
Après ce virage, la nouvelle direction centriste propose la fusion immédiate avec le Parti communiste et rien de moins que la prise de pouvoir ! Une délégation du Parti social-démocrate se rend à la prison erncontrer Bela Kun et lui propose la fusion des deux partis, la formation d’un "parti ouvrier", l’exclusion de tous les "partis bourgeois" et l’alliance avec la Russie. Les conversations durent à peine une journée au terme de laquelle Bela Kun rédige un protocole en six points parmi lesquels sont soulignés "Les comités directeurs du Parti social-démocrate Hongrois et du Parti Communiste Hongrois ont décidé l'unification totale et immédiate de leurs organisation respectives. Le nom de la nouvelle organisation sera Parti Socialiste Unifié de Hongrie (PSUH). (…) Le P.S.U.H. prend immédiatement le pouvoir au nom de la dictature du prolétariat. Cette dictature est exercée par les conseils d'ouvriers, de paysans et de soldats. Il n'y aura plus d'Assemblée Nationale (…) Une alliance militaire et politique la plus complète possible sera conclue avec la Russie" 10.
Le Président Karolyi, qui suit de près les négociations, présente sa démission et fait une déclaration adressée "au prolétariat du monde pour obtenir aide et justice. Je démissionne et je remets le pouvoir au prolétariat du peuple de Hongrie" 11.
Lors de la manifestation du 22 mars, "l’ex-homo-regius, le ci-devant archiduc François-Joseph, tel Philippe Egalité, lui aussi viendra se ranger aux côtés des ouvriers, au cours de la manifestation" 12. Le nouveau gouvernement, formé dès le lendemain, avec Bela Kun et d'autres dirigeants communistes récemment libérés, est présidé par le social-démocrate centriste Garbai 13. Il dispose d’une majorité centriste avec deux postes réservés à l’aile gauche et deux autres aux communistes, parmi lesquels Bela Kun. Alors commence une opération à haut risque qui consiste à prendre les communistes en otages de la politique social-démocrate et à saboter les conseils ouvriers à peine naissants avec le cadeau empoisonné de la "prise de pouvoir". Les sociaux-démocrates laisseront le rôle principal à Bela Kun qui – totalement pris au piège – deviendra le porte-voix et la caution de toute une série de mesures qui ne feront que le décrédibiliser 14.
"L’unité" crée la division des forces révolutionnaires
La proclamation du parti "unifié" parvint en premier lieu à stopper le rapprochement des sociaux-démocrates de gauche et des communistes, habilement séduits par la radicalisation des centristes. Mais le pire fut l’ouverture d’une boîte de Pandore parmi les communistes qui se divisèrent en plusieurs tendances. La majorité, autour de Bela Kun, se transforma en otage des sociaux-démocrates ; une autre tendance se forma autour de Szamuelly, demeurant dans le parti mais tentant de mener une politique indépendante ; la majorité des anarchistes se séparèrent, formant l’Union anarchiste qui soutiendra cependant le gouvernement avec une posture d’opposition 15.
Le Parti, formé quelques mois auparavant et qui commençait à peine à développer une organisation et une intervention, se volatilisa complètement. Le débat devint impossible et une confrontation permanente opposait ses anciens membres. Celle-ci ne se basait pas sur des principes ou une analyse indépendante de la situation, mais était toujours à la remorque de l’évolution des événements et des subtiles manœuvres auxquelles se livraient les centristes sociaux-démocrates.
La désorientation sur la réalité de la situation en Hongrie affecta même un militant aussi expérimenté et lucide que Lénine. Dans ses œuvres complètes apparaît la transcription des discussions avec Bela Kun des 22 et 23 mars 1919 (16). Lénine demande à Bela Kun : "Ayez la bonté de communiquer quelles garanties réelles avez-vous pour que le nouveau Gouvernement hongrois soit effectivement communiste et non pas seulement socialiste, c’est-à-dire social-traître. Les communistes ont-ils la majorité dans le Gouvernement ? Quand se tiendra le Congrès des conseils ? En quoi consiste réellement la reconnaissance de la dictature du prolétariat par les socialistes ?". Lénine pose les questions élémentaires correctes. Cependant, comme tout repose sur des contacts personnels et non sur un débat collectif international, Lénine conclut : "Les réponses de Bela Kun furent pleinement satisfaisantes et dissipèrent nos doutes. Il en ressortait que les socialistes de gauche avaient rendu visite à Bela Kun en prison et eux seuls, sympathisants des communistes, ainsi que des personnes du centre, furent ceux qui formèrent le nouveau gouvernement, pensant que les socialistes de droite, les sociaux-traîtres pour ainsi dire, incorrigibles et intransigeants, abandonnèrent le parti sans être suivis par aucun ouvrier". On voit ici que Lénine était pour le moins mal informé ou n’évaluait pas correctement la situation, car le centre de la social-démocratie était majoritaire au gouvernement et les sociaux-démocrates de gauche étaient entre les mains de leurs "amis" du centre.
Emporté par un optimisme démobilisateur, Lénine conclut : "La propre bourgeoisie a donné le pouvoir aux communistes de Hongrie. La bourgeoisie a démontré au monde entier que lorsque survient une crise grave, quand la nation est en danger, elle est incapable de gouverner. Et le seul pouvoir réellement souhaité par le peuple est le pouvoir des Conseils de députés ouvriers, soldats et paysans".
Hissés au "pouvoir", les conseils ouvriers sont sabotés
Ce pouvoir n’existait réellement que sur le papier. En premier lieu, c’est le Parti socialiste unifié qui prend le pouvoir sans que le Conseil de Budapest ou aucun autre conseil du pays n’y participe en aucune façon (17). Même si le Gouvernement se déclare formellement "subordonné" au Conseil ouvrier de Budapest, dans la pratique, c’est lui qui présente les décrets, ordres et décisions de toutes sortes comme des faits avérés, par rapport auxquels le Conseil ne dispose que d’un relatif droit de veto. Les conseils ouvriers sont pris dans le corset faisandé de la pratique parlementaire. "Les affaires du prolétariat continuèrent à être administrées – ou pour mieux dire sabotées – par l’ancienne bureaucratie et non par les conseils ouvriers eux-mêmes, qui ne parvinrent donc jamais à devenir des organismes actifs" 18.
Le coup le plus violent porté aux conseils est la convocation par le Gouvernement à des élections afin de constituer une "Assemblée nationale des Conseils ouvriers". Le système d’élections qu’impose alors le Gouvernement consiste à concentrer les élections sur deux dates (7 et 14 avril 1919), "suivant les modalités de la démocratie formelle (vote au scrutin de listes, avec isoloirs, etc.)" 19. C’est là la reproduction du mécanisme typique des élections bourgeoises, qui ne fait que saboter l’essence même des conseils ouvriers. Alors que dans la démocratie bourgeoise les organes élus sont le résultat d’un vote effectué par une somme d’individus atomisés et totalement séparés entre eux, les Conseils ouvriers supposent un concept radicalement nouveau et différent de l’action politique : les décisions, les actions à mener, sont pensées et discutées lors de débats auxquels participent d’énormes masses organisées, et celles-ci ne se contentent pas de prendre des décisions mais les mettent elles-mêmes en pratique.
Le triomphe de la manœuvre électorale n’est pas que le produit de l’habileté manœuvrière des sociaux-démocrates ; ceux-ci ne font qu’exploiter les confusions existantes non seulement parmi les masses mais aussi dans la propre majorité des militants communistes et particulièrement dans le groupe de Bela Kun. Des années de participation à des élections et au Parlement – activité nécessaire pour les progrès du prolétariat durant la période ascendante du capitalisme – avaient provoqué des habitudes et des visions liées à un passé définitivement révolu qui entravaient une riposte claire face à la nouvelle situation, laquelle exigeait la rupture complète avec le parlementarisme et l’électoralisme.
Le mécanisme électoral et la discipline du parti "unifié" font que "dans la présentation des candidats aux élections des conseils, les communistes durent défendre la cause des sociaux-démocrates et même ainsi, plusieurs ne furent pas élus", constate Szantó, qui ajoute que ceci permettait aux sociaux-démocrates de se livrer "au verbalisme révolutionnaire et communiste, afin d’apparaître plus révolutionnaires que les communistes !" 20.
Ces politiques provoquèrent une vive résistance. Les élections d’avril furent contestées dans le 8e district de Budapest, Szamuelly parvenant à faire annuler la liste officielle de son propre parti (!) et à imposer des élections se basant sur les débats lors d’assemblées massives, lesquelles donnèrent la victoire à une coalition de dissidents du propre PSUH et à des anarchistes, regroupés autour de Szamuelly.
D’autres tentatives de donner vie à d’authentiques conseils ouvriers eurent lieu à la mi-avril. Un mouvement de conseils de quartiers parvint à tenir une Conférence de ces derniers à Budapest qui critiqua sévèrement le "gouvernement soviétique" et avança toute une série de propositions quant à l’approvisionnement, la répression des contre-révolutionnaires, les rapports avec la paysannerie, la poursuite de la guerre et proposa – à peine un mois après les élections ! – une nouvelle élection des Conseils. Otage des sociaux-démocrates, Bela Kun apparût lors de la dernière session de la Conférence dans le rôle du pompier de service, son discours frisant la démagogie : "Nous sommes déjà tellement à gauche qu’il est impossible d’aller plus loin. Un tournant encore plus à gauche ne pourrait être qu'une contre-révolution" 21.
La réorganisation économique s’appuie sur les syndicats contre les conseils
La tentative révolutionnaire se heurtait au chaos économique, à la pénurie et au sabotage patronal. S’il est vrai que le centre de gravité de toute révolution prolétarienne est le pouvoir politique des conseils, ceci ne veut pas pour autant dire qu’ils doivent négliger le contrôle de la production. Même s’il est impossible de commencer une transformation révolutionnaire de la production vers le communisme tant que la révolution n'est pas victorieuse au niveau mondial, il ne faut pas en déduire que le prolétariat n’ait pas à mener une politique économique dès le début de la révolution. Celle-ci doit en particulier aborder deux questions prioritaires : la première est d’adopter toutes les mesures possibles en vue de diminuer l’exploitation des travailleurs et de garantir qu’ils disposent du maximum de temps libre pour pouvoir consacrer leur énergie à la participation active dans les conseils ouvriers. Sur ce plan, et sous la pression du Conseil ouvrier de Budapest, le Gouvernement adopta des mesures telles que la suppression du travail à la tâche et la réduction de la journée de travail, avec comme objectif de "permettre aux ouvriers de participer à la vie politique et culturelle de la révolution" 22. La seconde est la lutte pour l’approvisionnement et contre le sabotage, de sorte que la faim et le chaos économique inévitables ne sonnent le glas de la révolution. Confrontés à ce problème, les ouvriers créèrent dès janvier 1919 des conseils d’usine, des conseils sectoriaux et, comme nous l’avons vu dans le premier article de cette série, le Conseil de Budapest adopta un plan audacieux de contrôle de l’approvisionnement des produits de première nécessité. Mais le Gouvernement, qui devait s’appuyer sur eux, mena une politique systématique pour leur enlever le contrôle de la production et de l’approvisionnement, le confiant de plus en plus aux syndicats. Bela Kun commit alors de graves erreurs. Il déclara ainsi en mai 1919 : "L'appareil de notre industrie repose sur les syndicats. Ces derniers doivent s'émanciper davantage et se transformer en puissantes entreprises qui comprendront la majorité, puis l'ensemble des individus d'une même branche industrielle. Les syndicats prenant part à la direction technique, leur effort, tend à saisir lentement tout le travail de direction. Ainsi ils garantissent que les organes économiques centraux du régime et la population laborieuse travaillent en accord et que les ouvriers s'habituent à la conduite de la vie économique." 23. Roland Bardy commente cette analyse de façon critique : "Prisonnier d’un schéma abstrait, Bela Kun ne pouvait se rendre compte que la logique de sa position conduisait à redonner aux socialistes un pouvoir dont ils avaient été progressivement dépossédés (…) Durant toute une période, les syndicats seront le bastion de la social-démocratie réformiste et se trouveront constamment en concurrence directe avec les soviets" 24.
Le Gouvernement parvint à imposer que seuls les ouvriers et les paysans syndiqués auraient accès aux coopératives et aux économats de consommation. Ceci donnait aux syndicats un levier essentiel de contrôle. Bela Kun le théorisa : "le régime communiste est celui de la société organisée. Celui qui veut vivre et réussir doit adhérer à une organisation, aussi les syndicats ne doivent-ils pas faire des difficultés aux admissions" 25. Comme Bardy le signale : "Ouvrir le syndicat à tous était le meilleur moyen pour liquider la prépondérance du prolétariat en son sein et à long terme permettre le rétablissement "démocratique" de la société de classe" ; de fait, "les anciens patrons, rentier et, leurs grands valets ne participaient pas dans la production active (industrie et agriculture,) mais dans les services administratifs ou juridiques. Le gonflement de ce secteur permit à l’ancienne bourgeoisie de survivre en tant que classe parasite, et d’avoir accès à la répartition des produits, sans être intégrée cependant dans le processus productif, actif" 26. Ce système favorisa la spéculation et le marché noir, sans jamais parvenir à résoudre les problèmes de famine et de pénurie qui torturaient les ouvriers des grandes villes.
Le Gouvernement impulsa la formation de grandes exploitations agricoles régies par un système de "collectivisation". Ce fut une grande escroquerie. Des "Commissaires de production" furent placés à la tête des fermes collectives et ceux-là, quand ils n’étaient pas d’arrogants bureaucrates, étaient… les anciens propriétaires terriens ! Ces derniers occupaient d’ailleurs toujours leurs demeures et exigeaient des paysans qu’ils continuent à les appeler "maître".
Les Fermes collectives étaient supposées étendre la révolution dans les campagnes et garantir l’approvisionnement, mais elles ne firent ni l’un ni l’autre. Les travailleurs journaliers et les paysans pauvres, profondément déçus par la réalité des Fermes collectives, s’éloignaient de plus en plus du régime ; par ailleurs, leurs dirigeants exigèrent un troc que le gouvernement était incapable de tenir : fournir des produits agricoles en échange d’engrais, de tracteurs et de machines. Ils vendaient donc à des spéculateurs et à des accapareurs, ce qui eut pour conséquence que la faim et la pénurie parvinrent à de tels niveaux que le Conseil ouvrier de Budapest organisa désespérément la transformation des parcs et jardins en zones de culture agraires.
L’évolution de la lutte révolutionnaire mondiale et la situation en Hongrie
La seule possibilité permettant au prolétariat hongrois de briser le piège dans lequel il était tombé résidait dans l’avancée de la lutte du prolétariat mondial. La période qui va de mars à juin 1919 était porteuse de grands espoirs malgré le coup de massue qu’avait provoqué l’écrasement de l’insurrection de Berlin en janvier 27. En mars 1919 se constitue l’Internationale communiste, en avril est proclamée la République des conseils de Bavière qui finit tragiquement écrasée par le gouvernement social-démocrate. L’agitation révolutionnaire en Autriche, où se consolidaient les conseils ouvriers, fut aussi avortée par la manœuvre d’un provocateur, Bettenheim, qui incita le jeune parti communiste à une insurrection prématurée qui fut facilement écrasée (mai 1919). En Grande-Bretagne éclata la grande grève des chantiers navals de la Clyde, au cours de laquelle apparurent des conseils ouvriers et qui provoqua des mutineries dans l’armée. Des mouvements de grève apparurent en Hollande, Norvège, Suède, Yougoslavie, Roumanie, Tchécoslovaquie, Pologne, Italie et même aux États-Unis. Mais ces mouvements étaient encore trop embryonnaires. Cette situation conférait ainsi une marge de manœuvre importante aux armées de France et de Grande-Bretagne qui étaient restées mobilisées après la fin de la guerre mondiale et se chargeaient maintenant de la sale besogne de gendarmes et écrasaient les foyers révolutionnaires. Leur intervention se concentra sur la Russie (1918-20) et la Hongrie (dès avril 1919). Quand éclatèrent les premières mutineries dans l’armée et, confrontées aux campagnes qui se faisaient jour contre la guerre livrée à la Russie révolutionnaire, les troupes d’appelés furent rapidement remplacées par des troupes coloniales, bien plus résistantes face au prolétariat.
Contre la Hongrie, le commandement français tira les leçons du refus des soldats de réprimer l’insurrection de Szeged. La France resta au second plan et attisa les États voisins contre la Hongrie : la Roumanie et la Tchécoslovaquie seront le fer de lance de ces opérations. Ces États combinaient le travail de gendarme avec la conquête de territoires au détriment de l’État hongrois.
La Russie soviétique, assiégée, ne put accorder le moindre soutien militaire. La tentative de l’Armée rouge et des guérilléros de Nestor Makhno de lancer en juin 1919 une offensive par l’ouest afin d’ouvrir une voie de communication vers la Hongrie, fut réduite à néant par la violente contre-attaque du général Denikine.
Mais le problème central était que le prolétariat avait son ennemi dans sa propre maison 28. Le 30 mars, le Gouvernement de la "dictature du prolétariat" créait pompeusement l’Armée rouge. C’était la même vieille armée rebaptisée. Tous ses postes de commandement restaient aux mains des anciens généraux, supervisés par un corps de commissaires politiques dominé par les sociaux-démocrates, dont les communistes étaient exclus.
Le gouvernement rejeta une proposition des communistes de dissoudre les forces policières. Les ouvriers, cependant, désarmèrent par eux-mêmes les gardes et plusieurs usines de Budapest adoptèrent des résolutions sur ce sujet qui furent immédiatement appliquées : "Alors seulement les sociaux-démocrates donnèrent la permission. Mais ils n’autorisèrent pas que s’effectuent leur désarmement, ce n’est qu’après une longue résistance qu’ils consentirent à approuver le licenciement de la police, de la gendarmerie et de la garde de sécurité" 29. La formation de l’Armée rouge fut décrétée, intégrant dans ses rangs les policiers licenciés !
L’Armée et la police, colonne vertébrale de l’État bourgeois, restèrent donc intactes grâce à ces tours de passe-passe. Il n’est donc pas surprenant que l’Armée rouge se décomposât si facilement lors de l’offensive d’avril lancée par les troupes roumaines et tchèques. Plusieurs régiments passèrent même à l’ennemi.
Contre les troupes d’envahisseurs aux portes de Budapest, le 30 avril, la mobilisation ouvrière parvint à retourner la situation. Les anarchistes et le groupe de Szamuelly menèrent une forte agitation. La manifestation du Premier Mai connut un succès massif, les slogans demandant "l’armement du peuple" furent lancés et le groupe de Szamuelly réclama "tout le pouvoir aux conseils ouvriers". Le 2 mai se tint un meeting gigantesque qui demanda la mobilisation volontaire des travailleurs. En quelques jours, rien qu’à Budapest, 40 000 d’entre eux s’engagent dans l’Armée rouge.
L’Armée rouge, renforcée par l’incorporation massive des ouvriers et par l’arrivée de Brigades internationales de volontaires français et russes, lança alors une grande offensive qui obtint toute une série de victoires sur les troupes roumaines, serbes et particulièrement sur les tchèques qui subirent une grande défaite et dont les soldats désertèrent massivement. En Slovaquie, l’action des ouvriers et des soldats rebelles conduisit à la formation d’un Conseil ouvrier qui, appuyé par l’Armée rouge, proclama la République slovaque des Conseils (16 juin). Le Conseil conclut une alliance avec la République hongroise et lança un manifeste dirigé à tous les ouvriers tchèques.
Ce succès alerta la bourgeoisie mondiale : "La Conférence de la Paix à Paris, alarmée par les succès de l’Armée rouge, lança le 8 juin un nouvel ultimatum à Budapest, dans lequel elle exigeait que l’Armée rouge interrompe son avancée, invitant le gouvernement hongrois à Paris pour "discuter des frontières de la Hongrie". Il y eut ensuite un second ultimatum, dans lequel l’usage de la force était évoqué si l’ultimatum n’était pas respecté" 30.
Le social-démocrate Bohm, soutenu par Bela Kun, ouvrit "à n’importe quel prix" des négociations avec l’État français, qui exigea comme premier pas l’abandon de la République des Conseils de Slovaquie, ce qui fut accepté le 24 juin. Cette République fut alors écrasée le 28 du même mois et tous ses militants connus pendus dès le lendemain.
L’Entente opèra alors un changement de tactique. Les exactions des troupes roumaines et leurs prétentions territoriales avaient été à l’origine d’un resserrement des rangs autour de l’Armée rouge, ce qui avait en mai favorisé ses victoires. Un Gouvernement provisoire hongrois fut formé à la hâte autour de deux frères de l’ancien Président Karolyi, qui s’installa dans la zone occupée par les roumains mais dut cependant se retirer en maugréant pour donner l’apparence d’un "gouvernement indépendant". L’aile droite de la social-démocratie réapparut alors, soutenant ouvertement ce gouvernement.
Le 24 janvier eut lieu une tentative de soulèvement à Budapest, organisé par la social-démocratie de droite. Le Gouvernement négocia avec les insurgés et cèda à sa revendication d’interdire les Gars de Lénine, les Brigades internationales et les régiments contrôlés par les anarchistes. Cette répression précipita la décomposition de l’Armée rouge : de violents affrontements éclatèrent en son sein, les désertions et les mutineries se multiplièrent.
La défaite finale et la répression brutale
La démoralisation atteint son comble parmi la population ouvrière de Budapest. Beaucoup d’ouvriers et leur famille fuient la ville. Les révoltes paysannes contre le Gouvernement se multiplient dans les campagnes. La Roumanie reprend son offensive militaire. Dès la mi-juin, retrouvant leur unité, les sociaux-démocrates réclament la démission de Bela Kun et la formation d’un nouveau gouvernement sans la présence des communistes. Le 20 juillet, Bela Kun lance une offensive militaire désespérée contre les troupes roumaines avec ce qui reste de l’Armée rouge, qui se rend le 23. Le 31 juillet, finalement, Bela Kun démissionne et un nouveau gouvernement avec les sociaux-démocrates et les syndicats est formé, qui déchaîne une violente répression contre les communistes, les anarchistes et tout militant ouvrier qui n’a pu prendre la fuite. Szamuelly est assassiné le 2 août.
Le 6 août, ce gouvernement est à son tour renversé par une poignée de militaires qui ne rencontrent aucune résistance. Les troupes roumaines entrent à Budapest. Les prisonniers sont soumis à des tortures moyenâgeuses avant d’être assassinés. Les soldats blessés ou malades sont arrachés des hôpitaux et traînés dans les rues où ils sont soumis à tout type d’humiliations avant d’être tués. Dans les villages, les troupes obligent les paysans à organiser des procès contre leurs propres voisins considérés comme suspects, à les torturer pour ensuite les assassiner. Les refus sont châtiés par l’incendie des maisons avec leurs occupants à l’intérieur.
Alors que 129 contre-révolutionnaires furent exécutés pendant les 133 jours que dura la République soviétique, plus de 5 000 personnes furent assassinées entre le 15 et le 31 août. Il y eut 75 000 arrestations. Les procès de masse commencèrent en octobre.15 000 ouvriers furent jugés par les tribunaux militaires qui infligeaient les peines de mort et les travaux forcés.
Entre 1920 et 1944, la féroce dictature de l’amiral Horty bénéficia du soutien des démocraties occidentales malgré ses sympathies pour le fascisme, en remerciement de ses services rendus contre le prolétariat.
C. Mir, 4-9-2010
1 Cf. Revue internationale no 139, https://fr.internationalism.org/rint139/1914_23_dix_annees_qui_ebranlerent_le_monde_la_revolution_hongroise_de_1929.html [9]
2 Par une action coordonnée, les comités de paysans prirent les terres du principal aristocrate du pays, le comte Esterhazy.
3 Ceci révèle la politisation croissante des ouvriers mais aussi les insuffisances de leur prise de conscience, puisqu’ils demandent un gouvernement où seraient ensemble les traîtres sociaux-démocrates et les communistes, qui avaient été incarcérés au moyen des manœuvres de premiers.
4 Pendant la Première Guerre mondiale, l’Entente regroupait le camp impérialiste formé par la Grande-Bretagne, la France et la Russie, du moins jusqu’à la Révolution d’Octobre.
5 Roland Bardy, 1919, la Commune de Budapest, p. 83. La majeure partie des informations utilisées dans cet article est extraite de l’édition française de cet ouvrage, qui contient une abondante documentation.
6 Ibidem.
7 L’aile centriste du parti hongrois était formée par des cadres aussi réactionnaires que ceux de l’aile droite, mais beaucoup plus rusés et capables de s’adapter à la situation.
8 Roland Bardy, op. cit., p. 84.
9 Bela Szanto, dans son livre la Révolution hongroise de 1919, page 88 de l’édition espagnole, chapitre "Avec qui auraient dû s’unir les communistes ?", cite un social-démocrate, Buchinger, qui reconnaît que "l’union avec les communistes sur la base de leur programme intégral fut réalisée sans la moindre conviction".
10 Roland Bardy, op. cit., p. 85.
11 Idem, p. 86.
12 Idem, p. 99.
13 Cet individu avait crié, en février 1919 : "les communistes doivent être mis face aux canons des fusils", et il déclarera en juillet 1919 : "je suis incapable de m’intégrer à l’univers mental sur lequel se base la dictature du prolétariat" (Szanto, op. cit., p. 99).
14 Bela Szanto, op. cit., p. 82 de l’édition espagnole, rapporte que dès le lendemain, Bela Kun confessa à ses camarades du Parti : "Les choses vont trop bien. Je n’ai pu dormir, je n’ai cessé de penser toute la nuit où nous avons pu nous tromper", chapitre "Au pas de charge vers la dictature du prolétariat".
15 Au sein de l’Union anarchiste se distingue une tendance organisée de façon autonome, qui se fait appeler Les Gars de Lénine et qui proclame "la défense du pouvoir des conseils ouvriers". Elle jouera un rôle significatif au cours des actions militaires en défense de la révolution.
16 Tome 38 de l’édition espagnole, pages 228, 229 et 246. Les documents s’intitulent "Salut par radio au gouvernement de la République des conseils hongroise", radiogramme envoyé à Bela Kun, et "Communiqué sur les conversations radio avec Bela Kun".
17 Le Conseil ouvrier de Szeged – ville de la zone "démilitarisée" mais occupée en réalité par 16 000 soldats français – agit de façon révolutionnaire. Le 21 mars, le Conseil organisa l’insurrection, occupant tous les points stratégiques. Les soldats français refusèrent de les combattre et le commandement décida alors la retraite. Le 23, le Conseil élit un Conseil de gouvernement formé par un ouvrier du verre, un autre du bâtiment et un avocat. Il prend contact dès le 24 avec le nouveau Gouvernement de Budapest.
18 Szantó, op. cit., p. 106, chapitre "Contradictions théorique et de principe et leurs conséquences".
19 Roland Bardy, op. cit., p. 101.
20 Bela Szanto, op. cit., page 91, chapitre "Avec qui auraient dû s’unir les communistes ?".
21 Roland Bardy, op. cit., p. 105.
22 Idem, p. 117.
23 Idem, p. 111.
24 Idem, p. 112.
25 Idem, p. 127.
26 Idem, p. 126
27 Cf. le quatrième chapitre [10] de notre série sur la Révolution en Allemagne, Revue internationale, no 136.
28 Bela Szanto, op. cit., page 146 : "La contre-révolution se sentit si forte qu’elle pouvait dans ses brochures et opuscules présenter comme siens des hommes qui étaient à la tête du mouvement ouvrier ou qui occupaient des postes importants dans la dictature des Conseils."
29 Idem, p. 104, chapitre "Contradictions théorique et de principe et leurs conséquences".
30 Alan Woods, La République soviétique hongroise de 1919, la révolution oubliée. En espagnol : https://marxist.com/republica-sovietica-hungara-1919.htm [11].; en anglais : https://marxist.com/hungarian-soviet-republic-1919.htm [12]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le Manifeste du Groupe ouvrier du Parti communiste russe (3e partie)
- 1820 lectures
Nous avons vu dans la partie précédente [14] du Manifeste (publiée dans la Revue internationale n° 143) comment celui-ci s'opposait violemment à tout front unique avec les sociaux-démocrates. En contrepartie, il appelait à un front unique de tous les éléments véritablement révolutionnaires, parmi lesquels il incluait les partis de la Troisième Internationale au même titre que les partis communistes ouvriers (KAPD en Allemagne). Face à la question nationale qui se pose dans les républiques soviétiques, traitée dans la troisième publication que nous faisons de ce document, celui-ci préconise la réalisation du Front unique avec les PC des ces républiques qui, dans l'IC, "auraient les mêmes droits que le parti bolchevique".
Toutefois, le point le plus important abordé dans cette avant-dernière partie du Manifeste est celui consacré à la NEP.
La position du Manifeste sur cette question est la suivante : "La NEP est le résultat direct de la situation des forces productives dans notre pays (…) Ce qu’a fait le capitalisme des petites productions et propriétés dans l’agriculture et l’industrie des pays capitalistes avancés (en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne), le pouvoir du prolétariat doit le faire en Russie." En fait, ce point de vue n'est pas très éloigné de celui de Lénine pour qui la NEP était une forme de capitalisme d'État. En 1918, Lénine défendait déjà que le capitalisme d'État constituait un pas en avant, un pas vers le socialisme pour l'économie arriérée de la Russie. Dans le discours au Congrès du parti bolchevique de 1922, il reprend ce thème, en insistant sur la différence fondamentale à faire entre le capitalisme d'État sous la direction de la bourgeoisie réactionnaire, et le capitalisme d'État administré par l'État prolétarien. Le Manifeste énonce une série de suggestions pour "l'amélioration" de la NEP, dont l'indépendance vis-à-vis des capitaux étrangers.
Là où le Manifeste diverge de Lénine et de la position officielle du parti bolchevique c'est lorsqu'il souligne que "Le plus grand péril lié à la Nouvelle Politique économique, c’est que le niveau de vie d’une très grande partie de ses cadres dirigeants a commencé à changer rapidement". Les mesures qu'il préconise sont la régénérescence du système des soviets : "Pour prévenir le risque de dégénérescence de la Nouvelle Politique économique en Nouvelle politique d’exploitation du prolétariat, il faut conduire le prolétariat vers l’accomplissement des grandes tâches qui sont devant lui par une réalisation cohérente des principes de la démocratie prolétarienne, ce qui donnera les moyens à la classe ouvrière de défendre les conquêtes de la Révolution d’octobre contre tous les périls d’où qu’ils viennent. Le régime interne du parti et les rapports du parti avec le prolétariat doivent être radicalement transformés dans ce sens."
La question nationale
La réalisation de la tactique du front uni fut surtout difficile à cause de la variété nationale et culturelle des peuples en URSS.
L’influence pernicieuse de la politique du groupe dirigeant du PCR (bolchevique) se révéla en particulier sur la question nationale. À toute critique et à toute protestation, des proscriptions sans fin ("division méthodique du parti ouvrier") ; des nominations qui parfois ont un caractère autocratique (personnes impopulaires qui n’ont pas la confiance des camarades locaux du parti) ; des ordres donnés aux républiques (aux mêmes populations demeurées pendant des décennies et des siècles sous le joug ininterrompu des Romanov personnifiant la domination de la nation grand-russe), qui peuvent finir par donner une nouvelle vigueur aux tendances chauvines dans les larges masses travailleuses, pénétrant même les organisations nationales du parti communiste.
La Révolution russe, dans ces républiques soviétiques, fut indubitablement accomplie par les forces locales, par le prolétariat local avec l’appui actif des paysans. Et si tel ou tel parti communiste national développa un travail nécessaire et important, celui-ci consista essentiellement à appuyer les organisations locales du prolétariat contre la bourgeoisie locale et ses soutiens. Mais une fois accomplie la révolution, la praxis du parti, du groupe dirigeant du PCR (bolchevique), inspirée par la défiance vis-à-vis des revendications locales, ignore les expériences locales et impose aux partis communistes nationaux divers contrôleurs, souvent de nationalité différente, ce qui exaspère les tendances chauvines et donne aux masses ouvrières l’impression que ces territoires sont soumis à un régime d’occupation. La réalisation des principes de la démocratie prolétarienne, avec l’institution des organisations locales étatiques et de parti, éliminera dans toutes les nationalités les racines de la différence entre ouvriers et paysans. Réaliser ce "front unique" dans les républiques qui ont accompli la révolution socialiste, réaliser la démocratie prolétarienne, signifie instituer l’organisation nationale avec des partis communistes ayant dans l’Internationale les mêmes droits que le PCR (bolchevique) et constituant une section particulière de l’Internationale. Mais puisque toutes les républiques socialistes ont certaines tâches communes et que le parti communiste développe dans toutes un rôle dirigeant, on doit convoquer – pour les discussions et les décisions sur les problèmes communs à toutes les nationalités de l’Union des républiques socialistes soviétiques – des congrès généraux de parti qui élisent, en vue d’une activité stable, un exécutif des partis communistes de l’URSS. Une telle structure organisationnelle des partis communistes de l’URSS peut déraciner et déracinera indubitablement la méfiance au sein du prolétariat et elle présentera en outre une énorme importance pour l’agitation du mouvement communiste dans tous les pays.
La NEP (Nouvelle Politique économique)
La NEP est le résultat direct de la situation des forces productives dans notre pays.
Et vraiment, supposons que notre pays soit couvert d’une épaisse forêt de tuyaux d’usine, la terre cultivée par des tracteurs et non par des charrues, que le blé soit moissonné à l’aide de moissonneuses et non d’une faucille et d’une faux, battu par une batteuse et non par un fléau, vanné par un tarare et non par une pelle aux quatre vents ; de plus toutes ces machines mises en marche par un tracteur – est-ce que dans ces conditions nous aurions besoin d’une Nouvelle Politique économique ? Pas du tout.
Et imaginez-vous maintenant que l’année dernière, en Allemagne, en France et en Angleterre il y ait eut une révolution sociale et que chez nous, en Russie, la massue et l’araire n’aient pas pris leur retraite, remplacés par la reine machine, mais règnent sans rivaux. Tout comme ils règnent aujourd’hui (surtout l’araire, et le manque de bêtes oblige l’homme à s’y atteler lui-même avec ses enfants, sa femme suivant l’araire). Aurait-on alors besoin d’une Nouvelle Politique économique ? Oui.
Et pour quoi ? Pour la même chose, pour s’appuyer sur une culture familiale paysanne avec son araire et, par là, pour passer de l’araire au tracteur, donc pour changer la base matérielle d’une économie petite-bourgeoise de la campagne en vue d’élargir la base économique de la révolution sociale.
Ce qu’a fait le capitalisme des petites productions et propriétés dans l’agriculture et l’industrie des pays capitalistes avancés (en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne), le pouvoir du prolétariat doit le faire en Russie.
Mais comment accomplir cette tâche ? En décrétant, en criant : "eh vous, petit-bourgeois, disparaissez !" ? On pourrait prendre de pareils décrets réprimandant un élément petit-bourgeois autant qu’on voudrait, la petite-bourgeoisie vivrait quand même comme un coq en pâte. Et qu’est-ce que les purs prolétaires feraient sans elle dans un pays comme la Russie ? Ils mourraient de faim ! Pourrait-on rassembler tous les petit-bourgeois dans une commune collective ? Impossible. Ce ne sera donc pas par décrets que l’on combattra l’élément petit-bourgeois, mais en le soumettant aux nécessités d’une économie rationnelle, mécanisée, homogène. Par la lutte libre des économies basées sur l’utilisation des machines et des nouveaux perfectionnements techniques contre tous les autres modes de production archaïques qui dominent encore dans une petite économie artisanale. On ne peut pas construire le communisme avec un araire.
Mais imaginez que la révolution socialiste ait eu lieu en Allemagne ou en Angleterre. Est-ce qu’une Nouvelle Politique économique y serait possible à un quelconque moment du processus révolutionnaire ?
Ça dépend totalement de l’importance et de l’échelle de la production petite-bourgeoise. Si son rôle dans la vie du pays est insignifiant, on pourra se passer de Nouvelle Politique économique et, en accélérant l’activité législative de la dictature prolétarienne, introduire de nouvelles méthodes de travail.
Donc là où la production petite-bourgeoise exerce une influence considérable sur la vie économique du pays et où l’industrie de la ville et de la campagne ne peut pas s’en passer, la Nouvelle Politique économique aura lieu. Plus la grande industrie dépendra de la petite production, plus l’échelle de la NEP sera grande et sa durée conditionnée à la vitesse de la marche triomphante d’une industrie socialiste nationale.
En Russie, la Nouvelle Politique économique durera longtemps – non parce que quelqu’un le veut, mais parce que personne ne peut agir autrement. Jusqu’au moment où notre industrie socialiste cessera de dépendre de la production et de la propriété petites-bourgeoises, il n’y sera pas question de suspendre la NEP.
La NEP et la campagne
La question du changement de politique économique, de la suspension de la NEP, sera posée à l’ordre du jour après la disparition de la domination petite-bourgeoise dans l’agriculture.
Actuellement, la force et la puissance de la révolution socialiste sont totalement conditionnées par la lutte pour l’industrialisation, du tracteur contre l’araire. Si le tracteur arrache la terre russe à l’araire, alors le socialisme vaincra, mais si l’araire chasse le tracteur, le capitalisme l’emportera. La Nouvelle Politique économique ne disparaîtra qu’avec l’araire.
Mais avant que le soleil ne se lève, la rosée peut crever les yeux 1 ; et pour que nos yeux, ceux de la révolution socialiste, restent sains et saufs, il nous faut suivre une ligne juste envers le prolétariat et la paysannerie.
Notre pays est agraire. Nous ne devons pas oublier que le paysan y est le plus fort, il faut l’attirer de notre côté. Nous ne pouvons pas l’abandonner à une idéologie bourgeoise, car ce serait la mort de la Russie soviétique et la paralysie pour longtemps de la révolution mondiale. La question des formes d’une organisation de paysans est une question de vie et de mort pour la Révolution russe et internationale.
La Russie est entrée dans la voie de la révolution socialiste alors que 80 % de sa population vivait encore dans des exploitations individuelles. Nous avons poussé le paysan à exproprier les expropriateurs, à s’emparer des terres. Mais lui ne comprenait pas cette expropriation comme l’ouvrier industriel la comprend. Son être à la campagne déterminait sa conscience. Chaque paysan, ayant son exploitation individuelle, rêvait de l’accroître. Les propriétés foncières n’avaient pas la même organisation interne que les entreprises industrielles des villes, c’est pourquoi il fallut "socialiser la terre" bien que ce fût une régression, un recul des forces productives, un pas en arrière. En expropriant peu ou prou les expropriateurs, nous n’avons pas pu penser à changer tout de suite un mode de production avec les forces productives existantes, le paysan ayant son exploitation individuelle. Il ne faut jamais oublier que la forme de l’économie est entièrement déterminée par le degré de développement des forces productives, et notre charrue araire ne peut en rien prédisposer au mode de production socialiste.
Il n’y a pas lieu de penser que nous puissions influencer un propriétaire par notre propagande communiste et qu'il se retrouve dans une commune ou une collectivité.
Pendant trois ans, prolétariat et bourgeoisie se sont affrontés pour récupérer la paysannerie. Celui qui gagna l’ascendant sur cette dernière gagna la lutte. Nous avons vaincu parce que nous étions les plus forts, les plus puissants. Il faut affermir cette puissance, mais en même temps réaliser une chose : elle ne sera pas consolidée par la qualité ou la quantité de discours de nos bavards, mais au fur et à mesure de la croissance des forces productives, au fur et à mesure que triomphera le tarare sur la pelle, la faucheuse sur la faux, la moissonneuse sur la faucille, le tracteur sur la charrue. Au fur et à mesure que triomphera l’économie socialisée de la production et de la propriété petite-bourgeoise.
Qui peut prouver que le paysan soit opposé aux faucheuses, aux tarares, aux moissonneuses, aux lieuses et aux tracteurs ? Personne. Personne ne peut donc prouver que le paysan n’arrivera jamais aux formes socialisées de l’économie, mais nous savons qu’il y arrivera en tracteur et non en s’attelant lui-même à l’araire.
G.V. Plekhanov raconte qu’une tribu africaine sauvage en voulait aux Européens et considérait abominable tout ce qu’ils faisaient. L’imitation des mœurs, des coutumes et des façons européennes de travailler était considérée comme péché capital. Mais les mêmes sauvages, qui utilisaient des haches de pierre, ayant vu les Européens manier les haches d’acier, ont bientôt commencé à se procurer ces dernières, quoiqu'en récitant des formules magiques et en se cachant.
Certes, pour le paysan, tout ce que les communistes font et qui sent la commune est abominable. Mais il faut le forcer à substituer le tracteur à la charrue, tout comme les sauvages ont substitué la hache d’acier à celle de pierre. C’est beaucoup plus facile à faire pour nous que pour les Européens en Afrique.
Si on veut développer l’influence du prolétariat en milieu paysan, il ne faut pas rappeler trop souvent au cultivateur que c’est la classe ouvrière qui lui a donné la terre, car il peut bien répondre : "Merci, mon brave, et maintenant, pourquoi es-tu venu ? Pour prélever un impôt en nature ? Cet impôt, tu l’auras, mais ne dis surtout pas qu’hier tu étais très bien, dis si aujourd’hui tu veux faire du bien. Sinon, mon colon, va te faire voir !"
Tous les partis contre-révolutionnaires, des mencheviks aux SR et aux monarchistes inclus, basent leurs théories pseudo-scientifiques de l’avènement inévitable d’un paradis bourgeois sur la thèse qu’en Russie le capitalisme n’a pas encore épuisé tout son potentiel, qu’il y reste de grandes possibilités de développement et de prospérité, qu’il va embrasser peu à peu toute l’agriculture en y introduisant des méthodes industrielles de travail. C’est pourquoi, concluent-ils, si les bolcheviks ont fait un coup d’État, s’ils ont pris le pouvoir pour construire le socialisme sans attendre les conditions matérielles nécessaires, ils devront soit se transformer eux-mêmes en vraie démocratie bourgeoise, soit les forces développées à l’intérieur exploseront politiquement, renverseront les communistes résistant aux lois économiques et mettront à leur place une coalition des Martov, Tchernov, Milioukov, dont le régime donnera libre champ au développement des forces productives du pays.
Certes, chacun sait que la Russie est un pays plus arriéré que l’Angleterre, les États-Unis, l’Allemagne, la France etc. Mais tous doivent comprendre : si le prolétariat dans ce pays a eu assez de force pour prendre le pouvoir, pour exproprier les expropriateurs, supprimer la résistance acharnée des oppresseurs soutenue par la bourgeoisie du monde entier, ce prolétariat aura d’avantage encore de force pour suppléer le processus anarchique de mécanisation de l’agriculture du capitalisme par une mécanisation conséquente et planifiée grâce à l’industrie et au pouvoir prolétarien, soutenue par les aspirations conscientes des paysans à voir facilité leur travail.
Qui dit que c’est facile à faire ? Personne. Surtout après les ravages immenses que les SR, les mencheviks, la bourgeoisie et les propriétaires fonciers ont fait en déclenchant la guerre civile. C’est difficile à faire mais ce sera fait, même si les mencheviks et les SR, alliés aux Cadets et aux monarchistes, feront flèche de tout bois en vociférant en faveur du retour de la bourgeoisie.
Il nous faut poser cette question dans un cadre pratique. Il n’y a pas longtemps, le camarade Lénine a écrit une lettre aux camarades émigrés américains en les remerciant de l’aide technique qu’ils nous prêtent en organisant des sovkhozes et des kolkhozes exemplaires, où sont utilisés des tracteurs américains pour le labour et la moisson. Ainsi, la Pravda a publié un rapport du travail d’une telle commune à Pierm.
Comme tout communiste, nous sommes ravis que les prolétaires d’Amérique viennent à notre secours, là où on le nécessite le plus. Mais notre attention fut involontairement attirée par un fragment de ce rapport disant que les tracteurs avaient chômé pendant longtemps parce que : 1) l’essence s’était révélée impure ; 2) on avait été obligé de l’importer de loin, avec retard ; 3) les chauffeurs du village avaient mis beaucoup de temps à étudier le maniement des tracteurs ; 4) les routes et surtout les ponts n’étaient pas bons pour les tracteurs.
Si la mécanisation de l’agriculture détermine le sort de notre révolution et n’est de ce fait pas étrangère au prolétariat du monde entier, il faut la développer sur une base plus solide. Sans renoncer à une aide d’une telle ampleur (que nous accordent les camarades d’outre-mer) ni diminuer son importance, nous avons pourtant à penser les résultats qu’elle nous permettra d’obtenir.
Il nous faut avant tout attirer l’attention sur le fait que ces tracteurs ne sont pas produits dans nos usines. Peut-être n’a-t-on pas besoin de les produire en Russie, mais si cette aide prend de l’envergure, notre agriculture sera liée à l’industrie des États-Unis.
Maintenant il faut déterminer quel type de tracteur, quel moteur est applicable aux conditions russes. 1) il doit utiliser le pétrole comme combustible et ne pas faire de caprices à cause de la mauvaise qualité de l’essence ; 2) il doit être simple d’utilisation pour que non seulement les chauffeurs professionnels sachent le conduire, mais pour qu’on puisse former ces chauffeurs facilement et autant qu’il en faudra ; 3) il faut avoir des niveaux de force : 100, 80, 60, 40, 30, 25, selon le type de terre : à labourer, vierge ou déjà cultivée ; 4) il faut que ce soit un moteur universel pour le labour, le battage, le fauchage, le transport du blé ; 5) il faut qu’on le fabrique dans les usines russes et non qu’on aille le chercher quelque part outre-mer ; sinon, au lieu de l’alliance de la ville et de la campagne, ce serait l’alliance de la campagne et des négociants étrangers ; 6) il doit utiliser un combustible local.
Après les horreurs de la guerre et de la famine, notre pays promet à la machine dans l’agriculture un triomphe plus grand et plus proche que jamais dans le monde. Car actuellement, même la simple charrue araire, l’instrument principal de travail dans notre campagne, commence à manquer et lorsqu’il y en a, on n’a pas de bêtes à y atteler. Les machines pourraient faire des choses impossibles à imaginer.
Nos spécialistes estiment que l’imitation aveugle des États-Unis serait nuisible à notre économie ; ils pensent aussi que malgré tout, la production en série des moteurs indispensables à notre agriculture est possible avec nos moyens techniques. Cette tâche est d’autant plus facile à résoudre que notre industrie métallurgique se plaint toujours de l’absence de commandes, que les usines fonctionnent à la moitié de leur potentiel, donc à perte ; on leur passerait des commandes.
La production en série d’une machine universelle agricole simple, que des mécaniciens préparés rapidement pourraient conduire, qui fonctionnerait au pétrole et ne ferait donc pas de caprices à cause d’une essence de qualité médiocre, doit être organisée dans les régions de Russie où il est facile de transporter le pétrole soit par train, soit par bateau. On pourra utiliser le moteur à pétrole au sud de la Russie, en Ukraine, au centre de la Russie, dans les régions de la Volga et de la Kama ; ça ne marcherait pas en Sibérie, car le transport du pétrole y reviendrait très cher. L’immense espace de la Sibérie est un problème pour notre industrie. Mais il y a d’autres types de combustible en Sibérie, notamment du bois ; c’est pourquoi les moteurs à vapeur pourront y occuper une place importante. Si nous réussissons à résoudre le problème de la distillation du bois, de l’extraction de l’esprit de bois en Sibérie, on pourra utiliser des moteurs à bois. Lequel des deux moteurs sera le plus rentable, les spécialistes techniques devront le décider d’après les résultats pratiques.
Le 10 novembre 1920, la Pravda, sous le titre "Entreprise gigantesque", rapportait la nouvelle de la constitution de la Société internationale de secours pour la renaissance de l’industrie dans l’Oural. De très importants trusts d’État et le Secours ouvrier international contrôlent cette société qui dispose d’ores et déjà d’un capital de deux millions de roubles-or et est entrée en rapport d’affaires avec l’entreprise américaine Keith en acquérant une grande quantité de tracteurs, affaire jugée évidemment avantageuse.
La participation du capital étranger est nécessaire, mais dans quel domaine ? Nous voulons, ici, soumettre à tous les questions suivantes : si le Secours ouvrier international peut nous aider grâce à ses rapports avec l’entreprise Keith, pourquoi ne pourrait-il pas, avec une quelconque autre entreprise, organiser chez nous, en Russie, la production des machines nécessaires à l’agriculture ? Ne serait-il pas préférable d’employer les deux millions de roubles-or que la société possède dans la production de tracteurs, ici, chez nous ? A-t-on justement envisagé toutes les possibilités ? Est-il réellement nécessaire d’enrichir de notre or l’entreprise Keith et de lier à elle le sort de notre économie agricole ?
Dans un livre technique, nous avons lu qu’en voulant soumettre les régions agricoles des pays occupés à leur domination économique certaine, les firmes allemandes étaient venues avec leurs tracteurs, avaient labouré les terres et puis avaient vendu les machines aux laboureurs pour un sou. Il va de soi que par la suite, ces firmes ont demandé un haut prix, mais les tracteurs se vendaient déjà. C’était la conquête sans verser une goutte de sang.
La volonté de la firme Keith de nous aider et de nous accorder un crédit semble être du même genre et il faut y être très prudent.
Certes, il est relativement douteux que la firme Keith puisse nous fournir des tracteurs adaptés aux conditions russes, mais même les tracteurs qui y sont peu accommodés remporteront un succès assuré au vu des conditions lamentables de notre agriculture, car n’importe quoi aurait du succès dans une pareille situation. Si la production des moteurs nécessaires et adaptés aux conditions russes est possible de toute façon, pourquoi a-t-on besoin de la firme Keith ? Car, autant qu’on sache, il n’est pas définitif que nous ne puissions pas organiser nous-mêmes la production des machines nécessaires.
Si les idées et les calculs des ingénieurs de Petrograd sont réellement justes, les deux millions de roubles-or accordés par cette Société seraient un investissement bien plus solide pour un redressement de l’économie dans l’Oural que l’aide de la firme Keith.
En tout cas, il faut discuter sérieusement cette question, parce qu’elle a une portée non seulement économique, mais aussi politique, non seulement pour la Russie soviétique mais pour toute la révolution mondiale. Et on ne peut pas la résoudre d’un seul coup. Il faut savoir ce que nous pourrions faire de cet or, et réfléchir : si les personnes compétentes et les autorités décident que ça ne vaut même pas la peine d’essayer et qu’il vaut mieux s’adresser directement outre-mer, soit.
Nous avons peur d’avoir l’esprit d’escalier : d’abord nous donnerons de l’or à monsieur Keith, puis nous ferons publiquement notre mea-culpa, tout en nous vantant de ne pas avoir peur de reconnaître nos fautes.
Si on mécanise l’agriculture en Russie, par la production des machines nécessaires par nos usines et non par l’achat à la bonne firme d’outre-mer Keith, la ville et la campagne seront indissolublement liées par la croissance des forces productives, rapprochées l’une de l’autre ; il faudra alors consolider ce rapprochement idéologique en organisant "des syndicats de type particulier" (d’après le programme du PCR). Ce sont des conditions indispensables pour l’abolition paisible des rapports capitalistes, l’élargissement d’une base de la révolution socialiste à l’aide d’une nouvelle politique économique 2.
Notre révolution socialiste détruira la production et la propriété petite-bourgeoise non en décrétant la socialisation, la municipalisation, la nationalisation, mais par la lutte consciente et conséquente des modes modernes de production au détriment des modes dépassés, désavantageux, par l’instauration évolutive du socialisme. C’est exactement l’essence du saut de la nécessité capitaliste à la liberté socialiste.
La Nouvelle Politique économique et la politique tout simplement
Et quoi qu’en disent les gens "bien-pensants", c’est en premier lieu la classe ouvrière active et en second la paysannerie (et non les fonctionnaires communistes, même les meilleurs et les plus intelligents) qui sont en mesure de mener cette politique.
La Nouvelle Politique économique déterminée par l’état des forces productives de notre pays cache en elle des dangers pour le prolétariat. Nous ne devons pas seulement montrer que la révolution sait affronter un examen pratique sur le plan de l’économie et que les formes économiques socialistes sont en fait meilleures que les capitalistes, mais nous devons aussi affirmer notre position socialiste sans engendrer pour autant une caste oligarchique qui détienne le pouvoir économique et politique, qui finisse par craindre par-dessus tout la classe ouvrière. Pour prévenir le risque de dégénérescence de la Nouvelle Politique économique en Nouvelle politique d’exploitation du prolétariat, il faut conduire le prolétariat vers l’accomplissement des grandes tâches qui sont devant lui par une réalisation cohérente des principes de la démocratie prolétarienne, ce qui donnera les moyens à la classe ouvrière de défendre les conquêtes de la Révolution d’octobre contre tous les périls d’où qu’ils viennent. Le régime interne du parti et les rapports du parti avec le prolétariat doivent être radicalement transformés dans ce sens.
Le plus grand péril lié à la Nouvelle Politique économique, c’est que le niveau de vie d’une très grande partie de ses cadres dirigeants a commencé à changer rapidement. Les membres de l’administration de certains trusts, par exemple celui du sucre, reçoivent un salaire mensuel de 200 roubles-or, jouissent gratuitement ou pour un prix modique d’un bel appartement, possèdent une automobile pour leurs déplacements et ont bien d’autres avantages pour satisfaire leurs besoins à prix moindre que celui payé par les ouvriers adonnés à la culture de la betterave à sucre, alors même que ces ouvriers, bien qu’ils soient communistes, ne reçoivent (outre les modestes rations alimentaires qui leurs sont accordées par l’État), que 4 ou 5 roubles par mois en moyenne (et avec ce salaire ils doivent également payer le loyer et l’éclairage) ; il est bien évident qu’on entretient vraiment une différence profonde dans le mode de vie des uns et des autres. Si cet état de chose ne change pas au plus vite mais se maintient encore dix ou vingt ans, la condition économique des uns comme des autres déterminera leur conscience et ils se heurteront en deux camps opposés. Nous devons considérer que les postes dirigeants, souvent renouvelés, sont occupés par des personnes de très basse extraction sociale mais qu’il s’agit toujours d’éléments non prolétariens. Ils forment une très mince couche sociale. Déterminés par leur condition, ils se considèrent comme étant les seuls aptes à certaines tâches réservées, les seuls capables de transformer l’économie du pays, de satisfaire le programme revendicatif de la dictature du prolétariat, des conseils d’usine, des délégués ouvriers, à l’aide du verset : "Ne nous exposez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal".
Ils considèrent en réalité ces revendications comme les expressions de l’influence d’éléments petits-bourgeois contre-révolutionnaires. Il y a donc ici sans le moindre doute un danger qui couve sur les conquêtes du prolétariat, qui vient du côté où l’on pouvait le moins s’y attendre. Pour nous, le danger est que le pouvoir prolétarien dégénère en hégémonie d’un groupe puissant décidé à tenir dans ses propres mains le pouvoir politique et économique, sous le voile de très nobles intentions, naturellement, "dans l’intérêt du prolétariat, de la révolution mondiale et autres idéaux très élevés". Oui, le danger existe vraiment d’une dégénérescence oligarchique.
Mais dans le pays où la production petite-bourgeoise exerce une influence décisive, où de plus la politique économique permet d’accélérer, de renforcer au maximum les vues individualistes d’un petit propriétaire, il faut exercer une pression permanente sur la base même de l’élément petit-bourgeois. Et qui l’exercera ? Seront-ce les mêmes fonctionnaires, ces sauveurs de l’humanité affligée ? Qu’ils aient tous la sagesse de Salomon – ou de Lénine – ils ne pourront quand même pas le faire. Seule la classe ouvrière en est capable, dirigée par le parti qui vit sa vie, souffre de ses souffrances, de ses maladies, un parti qui n’ait pas peur de la participation active du prolétariat à la vie du pays.
Il ne faut pas, il est nuisible et contre-révolutionnaire de raconter des fables au prolétariat pour endormir sa conscience. Mais qu’est-ce qu’on nous dit ? "Tiens-toi coi, va aux manifestations lorsqu’on t’y invite, chante l’Internationale quand il le faut, le reste sera fait sans toi par de braves garçons, presque des ouvriers comme toi, mais qui sont plus intelligents que toi et connaissent tout sur le communisme, reste donc tranquille et tu entreras bientôt au royaume socialiste". C’est du pur socialisme-révolutionnaire. Ce sont eux qui défendent que des individus brillants, pleins de dynamisme et armés de talents variés, issus de toutes les classes de la société (et ce semble être le cas) font de cette masse de couleur grise (la classe ouvrière) un royaume élevé et parfait où il n’y aura ni maladies, ni peines, ni soupirs, mais la vie éternelle. C’est tout à fait le style des "saints pères" socialistes-révolutionnaires.
Il faut substituer à la pratique existante une pratique nouvelle qui se baserait sur l’activité autonome de la classe ouvrière et non sur l’intimidation du parti.
En 1917, on avait besoin d’une démocratie développée et en 1918, 1919 et 1920, il fallut réduire tous les appareils dirigeants en les suppléant partout par le pouvoir autocratique de fonctionnaires nommés par en haut qui décrétaient tout ; en 1922, face aux tâches bien différentes qu’auparavant, il est hors de doute qu’on ait besoin d’autres formes d’organisation et méthodes de travail. Dans les fabriques et les usines (nationales) il faut organiser des conseils de députés ouvriers servant de noyaux principaux du pouvoir d’État ; il faut mettre en pratique le point du programme du PCR qui dit : "L’État soviétique rapproche l’appareil étatique et les masses, y compris par le fait que l’unité de production (l’usine, la fabrique) devient le noyau principal de l’État au lieu du district" (cf. le Programme du PCR, division politique, point 5). C’est ce noyau principal du pouvoir d’État aux fabriques et usines qu’il faut restaurer en Conseils de députés ouvriers qui prendront la place de nos sages camarades qui dirigent actuellement l’économie et le pays.
Peut-être certains lecteurs lucides vont-ils nous accuser de faction (article 102 du Code pénal), d’ébranler les bases sacrées du pouvoir prolétarien. Il n’y a rien à dire à de pareils lecteurs.
Mais d’autres diront : "Montrez-nous un pays où les ouvriers jouissent de mêmes droits et libertés qu’en Russie". Ceci dit, ils penseront mériter l’ordre du Drapeau rouge pour avoir écrasé une faction, sans peine et sans verser le sang qui plus est. Et à ceux-là, on peut dire quelque chose. Montrez donc, chers amis, encore un pays où le pouvoir appartient à la classe ouvrière ? Un tel pays n’existe pas, donc la question est absurde. Le problème, ce n’est pas d’être plus libéral, plus démocratique qu’une puissance impérialiste (d’ailleurs ce ne serait pas un grand mérite) ; le problème consiste à résoudre les tâches qui se posent au seul pays au monde qui ait fait le coup d’État d’Octobre, faire en sorte que la NEP (Nouvelle Politique économique) ne devienne une "NEP" (Nouvelle exploitation du prolétariat) et que, dans dix ans, ce prolétariat ne soit pas, Gros-Jean comme devant, forcé de recommencer sa lutte, peut-être sanglante, pour renverser l’oligarchie et garantir ses conquêtes principales. Le prolétariat peut le garantir en participant directement à la résolution de ces tâches, en instaurant une démocratie ouvrière, en mettant en pratique un des points principaux du programme du PCR qui dit : "La démocratie bourgeoise s’est bornée à proclamer formellement les droits et libertés politiques", à savoir les libertés d’association, de presse, égales pour tous les citoyens. Mais en réalité, la pratique administrative et surtout l’esclavage économique des travailleurs ne permettent pas à ces derniers de jouir pleinement de ces droits et libertés.
Au lieu de les proclamer formellement, la démocratie prolétarienne les accorde en pratique avant tout aux classes de la population opprimées jadis par le capitalisme, c’est-à-dire au prolétariat et à la paysannerie. Pour cela, le pouvoir soviétique exproprie les locaux, les imprimeries, les dépôts de papier de la bourgeoisie en les mettant à la disposition des travailleurs et de leurs organisations.
La tâche du PCR (bolchevique) consiste à permettre aux grandes masses de la population laborieuse de jouir des droits et libertés démocratiques sur une base matérielle de plus en plus développée (cf. le Programme du PCR, division politique, point 3).
Il aurait été absurde et contre-révolutionnaire de revendiquer la réalisation de ces thèses programmatiques en 1918, 1919 ou 1920 ; mais il est encore plus absurde et contre-révolutionnaire de se prononcer contre leur réalisation en 1922.
Veut-on améliorer la position de la Russie soviétique dans le monde, ou restaurer notre industrie, ou élargir la base matérielle de notre révolution socialiste en mécanisant l’agriculture, ou faire face aux effets dangereux d’une Nouvelle Politique économique, on en revient inévitablement à la classe ouvrière qui seule est capable de faire tout ça. Moins elle est forte, plus fermement doit-elle s’organiser.
Et les bons garçons qui occupent les bureaux ne peuvent résoudre de pareilles tâches grandioses, n’est-ce pas ?
Malheureusement, la majorité des chefs du PCR ne pense pas de la même façon. À toutes les questions sur la démocratie ouvrière, Lénine, dans un discours prononcé au IXe congrès panrusse des soviets, répondit ainsi : "A tout syndicat qui pose, en général, la question de savoir si les syndicats doivent participer à la production, je dirai : mais cessez donc de bavarder (applaudissements), répondez-moi plutôt pratiquement et dites-moi (si vous occupez un poste responsable, si vous avez de l’autorité, si vous êtes un militant du Parti communiste ou d’un syndicat) : où avez-vous bien organisé la production, en combien d’années, combien de personnes vous sont subordonnées, un millier ou une dizaine de milliers ? Donnez-moi la liste de ceux à qui vous confiez un travail économique que vous avez mené à bonne fin, au lieu de vous attaquer à vingt affaires à la fois pour ne faire aboutir aucune d’elles, faute de temps. Chez nous, avec nos mœurs soviétiques, il est rare qu’on mène une affaire à terme, qu’on puisse parler d’un succès durant quelques années ; on craint de s’instruire auprès du marchand qui empoche 100 % de bénéfices et plus encore, on préfère écrire une belle résolution sur les matières premières et se targuer du titre de représentants du Parti communiste, d’un syndicat, du prolétariat. Je vous demande bien pardon. Qu’est-ce qu’on appelle prolétariat ? C’est la classe qui travaille dans la grande industrie. Mais où est-elle, la grande industrie ? Quel est donc ce prolétariat ? Où est votre grande industrie ? Pourquoi est-elle paralysée ? Parce qu’il n’y a plus de matières premières ? Est-ce que vous avez su vous en procurer ? Non. Vous écrirez une résolution ordonnant de les collecter, et vous serez dans le pétrin ; et les gens diront que c’est absurde ; vous ressemblez à ces oies dont les ancêtres ont sauvé Rome", et qui, pour continuer le discours de Lénine (selon la morale de la fable bien connue de Krylov) doivent être guidées avec une longue baguette au marché pour y être vendues.
Supposons que le point de vue de l’ancienne Opposition ouvrière sur le rôle et les tâches des syndicats soit erroné. Que ce ne soit pas la position de la classe ouvrière au pouvoir, mais celle d’un ministère professionnel. Ces camarades veulent récupérer la gestion de l’économie en l’arrachant des mains des fonctionnaires soviétiques, sans pour autant impliquer la classe ouvrière dans cette gestion, à travers la démocratie prolétarienne et l’organisation des Conseils de députés ouvriers des entreprises conçus comme noyaux principaux du pouvoir étatique, à travers la prolétarisation de ces nids bureaucratiques. Et ils ont tort.
On ne peut pas parler à la façon de Lénine de la démocratie prolétarienne et de la participation du prolétariat à l’économie populaire ! La très grande découverte faite par le camarade Lénine est que nous n’avons plus de prolétariat. Nous nous réjouissons avec toi, camarade Lénine ! Tu es donc le chef d’un prolétariat qui n’existe même pas ! Tu es le chef du gouvernement d’une dictature prolétarienne sans prolétariat ! Tu es le chef du Parti communiste mais non du prolétariat !
à l’inverse du camarade Lénine, son collègue du Comité central et du Bureau politique Kamenev voit le prolétariat partout. Il dit : "1) Le bilan de la conquête d’Octobre consiste en ce que la classe ouvrière organisée en bloc dispose des richesses immenses de toute l’industrie nationale, du transport, du bois, des mines, sans parler du pouvoir politique. 2) L’industrie socialisée est le bien principal du prolétariat", etc., etc. On peut citer beaucoup d’autres exemples. Kamenev voit le prolétariat chez tous les fonctionnaires qui, depuis Moscou, se sont installés par voie bureaucratique et lui-même est, selon ses propres dires, encore plus prolétaire que n’importe quel ouvrier. Il ne dit pas, en parlant du prolétariat : "LUI, le prolétariat..." mais "NOUS, le prolétariat...". Trop de prolétaires du type de Kamenev participent à la gestion de l’économie populaire ; c’est pourquoi il arrive que de semblables prolétaires tiennent d’étranges discours sur la démocratie prolétarienne et sur la participation du prolétariat à la gestion économique ! "S’il vous plaît, dit Kamenev, de quoi parlez-vous ? Ne sommes-nous pas le prolétariat, un prolétariat organisé en tant qu’unité compacte, en tant que classe ?".
Le camarade Lénine considère tout discours sur la participation du prolétariat à la gestion de l’économie populaire comme un bavardage inutile parce qu’il n’y a pas de prolétariat ; Kamenev est du même avis, mais parce que le prolétariat "en tant qu’unité compacte, en tant que classe" gouverne déjà le pays et l’économie, dans la mesure où tous les bureaucrates sont considérés par lui comme prolétaires. Eux, naturellement, se mettent d’accord et s’entendent particulièrement bien, déjà sur quelques points, parce que depuis la Révolution d’octobre Kamenev a pris l’engagement de ne pas prendre position contre le camarade Lénine, de ne pas le contredire. Ils se mettront d’accord sur le fait que le prolétariat existe – naturellement pas seulement celui de Kamenev – mais aussi sur le fait que son bas niveau de préparation, sa condition matérielle, son ignorance politique imposent que "les oies soient tenues loin de l’économie avec une longue baguette". C’est ainsi que cela se passe en réalité !
Le camarade Lénine a appliqué ici la fable de façon plutôt impropre. Les oies de Krylov crient que leurs ancêtres sauvèrent Rome (leurs ancêtres, camarade Lénine) tandis que la classe ouvrière ne parle pas de ses ancêtres, mais d’elle-même, parce qu’elle (la classe ouvrière, camarade Lénine) a accompli la révolution sociale et de ce fait veut diriger elle-même le pays et son économie ! Mais le camarade Lénine a pris la classe ouvrière pour les oies de Krylov et, la poussant avec sa baguette, lui dit : "Laissez vos aïeux en paix ! Vous, qu’avez-vous fait ?". Que peut répondre le prolétariat au camarade Lénine ?
On peut nous menacer avec une baguette et cependant nous déclarerons à haute voix que la réalisation cohérente et sans hésitation de la démocratie prolétarienne est aujourd’hui une nécessité que la classe prolétarienne russe ressent jusqu’à la moelle ; car elle est une force. Advienne que pourra, mais le diable ne sera pas toujours à la porte du pauvre ouvrier. (A suivre)
1. Proverbe russe.
2. Il va de soi que dans la période transitoire les formes existantes d’organisation de la paysannerie sont historiquement inévitables.
Géographique:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [16]
Revue Internationale n° 145 - 2e trimestre 2011
- 1701 lectures
Révoltes sociales au Maghreb et au Moyen-Orient, catastrophe nucléaire au Japon, guerre en Libye
Seule la révolution prolétarienne peut sauver l'humanité du désastre capitaliste
Les derniers mois ont été riches en événements historiques. Si les révoltes au Maghreb et au Moyen-Orient n’ont aucun lien avec le tsunami qui a ravagé le Japon et la crise nucléaire consécutive, tous ces évènements font néanmoins ressortir avec acuité l’alternative qui s’offre plus que jamais à l’humanité : socialisme ou barbarie. Tandis que l’écho des soulèvements résonne encore dans de nombreux pays, la société capitaliste croupit lamentablement au coin de son petit feu nucléaire. Inversement, l’héroïsme des ouvriers nippons qui sacrifient leur vie aux abords de la centrale de Fukushima tranche avec l’écœurante hypocrisie des puissances impérialistes en Libye.
La mobilisation des masses fait chuter les gouvernements
Depuis plusieurs mois, des mouvements de protestation, inédits de par leur ampleur géographique 1, secouent plusieurs pays. Les premières révoltes du Maghreb ont ainsi rapidement produit des émules puisque des manifestations touchaient, quelques semaines plus tard, la Jordanie, le Yémen, Bahreïn, l’Iran, l’Afrique sub-saharienne, etc. Il est impossible d’établir une stricte identité entre tous ces mouvements, tant en termes de contenu de classe que de riposte de la bourgeoisie, mais la crise économique qui plonge les populations dans une misère de plus en plus intenable depuis 2008 rend assurément insupportables les régimes corrompus et répressifs de la région.
La classe ouvrière ne s’y est jusque-là jamais présentée comme une force autonome en mesure d’assumer la direction des luttes qui ont souvent pris la forme d’une révolte de l’ensemble des classes non-exploiteuses, de la paysannerie ruinée aux couches moyennes en voie de prolétarisation. Mais, d’une part, l’influence ouvrière sur les consciences était sensible à la fois dans les mots d’ordre et les formes d’organisation des mouvements. Une tendance à l’auto-organisation s’est, par exemple, manifestée au travers des comités de protection des quartiers, apparus en Egypte et en Tunisie pour faire face à la répression policière et aux bandes de voyous opportunément libérés des prisons pour semer le chaos. Surtout, beaucoup de ces révoltes ont ouvertement cherché à amplifier le mouvement à travers des manifestations de masse, des assemblées et des tentatives pour coordonner et centraliser les prises de décisions. D’autre part, la classe ouvrière a parfois eu un rôle décisif dans le déroulement des événements. C’est en Egypte, où la classe ouvrière est la plus concentrée et la plus expérimentée de la région, que les grèves ont été les plus massives. L’extension rapide et le rejet de l’encadrement syndical ont largement contribué à pousser les chefs militaires, sous la pression des États-Unis, à chasser Hosni Moubarak du pouvoir.
Alors que les mobilisations sont encore nombreuses et que le vent de la révolte souffle à nouveau dans d’autres pays, la bourgeoisie semble avoir toutes les peines du monde pour éteindre l’incendie. Surtout en Egypte et en Tunisie, où le "printemps des peuples" est censé avoir triomphé, les grèves et les affrontements avec "l’Etat démocratique" se poursuivent. L’ensemble de ces révoltes constitue une formidable expérience sur la voie qui conduit à la conscience révolutionnaire. Néanmoins, si cette vague de révoltes, pour la première fois depuis longtemps, a explicitement lié les problèmes économiques aux enjeux politiques, la réponse à cette question s’est heurtée aux illusions qui pèsent encore sur la classe ouvrière, en particulier les mirages démocratique et nationaliste. Ces faiblesses ont souvent permis aux pseudo-oppositions démocratiques de se présenter comme une alternative aux cliques corrompues en place. En fait, ces "nouveaux" gouvernements sont essentiellement constitués du sérail des vieux régimes au point que la situation frise parfois la bouffonnerie. En Tunisie, la population a même contraint une partie du gouvernement à démissionner tant il apparaissait comme une redite exacte du régime Ben Ali. En Egypte, l’armée, soutien historique de Moubarak, tient l’ensemble des leviers de l’Etat et manœuvre déjà pour assurer sa position. En Libye, le "conseil national de transition" est dirigé par… l’ancien ministre de l’intérieur de Kadhafi, Abdel Fattah Younes, et une bande d’anciens hauts-fonctionnaires qui, après avoir organisé la répression et bénéficié de la générosité pécuniaire de leur maitre, se sont piqués d’un goût soudain pour les droits de l’homme et la démocratie.
En Libye, la guerre impérialiste fait rage sur les ruines de la révolte populaire
Sur la base de ces faiblesses, la situation en Libye a évolué d’une manière particulière dans la mesure où ce qui est très justement apparu au départ comme un soulèvement de la population contre le régime de Kadhafi s’est transformé en guerre entre plusieurs fractions bourgeoises sur laquelle sont venues se greffer les grandes puissances impérialistes dans une cacophonie surréaliste et sanglante. Le déplacement du terrain de la lutte vers la poursuite d’intérêts bourgeois, celui du contrôle de l’Etat libyen par l’une ou l’autre des fractions en présence, fut d’autant plus aisé que la classe ouvrière en Libye est très faible. L’industrie locale est notablement arriérée et presque réduite à la production de pétrole, directement pilotée par la clique de Kadhafi qui n’a jamais été en mesure de mettre un tant soit peu l’intérêt national au-dessus de ses intérêts particuliers. La classe ouvrière en Libye est, à ce titre, une main d’œuvre souvent étrangère qui, en débrayant dès le début des événements, a fini par fuir les massacres, notamment à cause de la difficulté de se reconnaitre dans une "révolution" aux accents nationalistes. C'est a contrario que la Libye illustre tragiquement la nécessité que la classe ouvrière occupe une place centrale au sein des révoltes populaires ; son effacement explique en grande partie l’évolution de la situation.
Depuis le 19 mars, après plusieurs semaines de massacres, sous le prétexte d’une intervention humanitaire pour "sauver le peuple libyen martyrisé", une coalition un peu trouble, constituée du Canada, des Etats-Unis, de l’Italie, de la France, du Royaume-Uni, etc. a directement engagé ses forces militaires afin de soutenir le Conseil national de transition. Chaque jour, des missiles sont tirés et des avions décollent pour larguer des tapis de bombes sur toutes les régions abritant des forces armées fidèles au régime de Kadhafi. En langage clair, c’est la guerre. Ce qui, d’emblée, est frappant, c’est l’incroyable hypocrisie des grandes puissances impérialistes qui, d’un côté, brandissent le drapeau déjà mité de l’humanitarisme et, dans le même temps, cautionnent le massacre des masses qui se révoltent à Bahreïn, au Yémen, en Syrie, etc. Où était cette même coalition quand Kadhafi a fait massacrer 1000 détenus dans la prison Abu Salim de Tripoli en 1996 ? En réalité, c’est depuis quarante ans que ce régime enferme, torture, terrorise, fait disparaître, exécute… en toute impunité. Où était hier cette même coalition quand Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Egypte ou Bouteflika en Algérie faisaient tirer sur la foule lors des soulèvements de janvier et février ? Derrière cette infâme rhétorique, les morts continuent à s’entasser dans les morgues. Et déjà, l’OTAN prévoit de prolonger les opérations pendant plusieurs semaines afin d’assurer le triomphe de la paix et de la démocratie.
En réalité, chaque puissance intervient en Libye pour ses intérêts particuliers. La cacophonie de la coalition, incapable de seulement établir une chaîne de commandement, illustre à quel point ces pays partent dans cette aventure guerrière en ordre dispersé afin de renforcer leur propre place dans la région, tels des vautours sur un cadavre. Du point de vue des Etats-Unis, la Libye ne représente pas un intérêt stratégique majeur dans la mesure où ils disposent déjà d’alliés de poids sur place, notamment l’Egypte et l’Arabie Saoudite. Ceci explique leur perplexité initiale lors des négociations à l’ONU. Néanmoins, les Etats-Unis, soutien historique d’Israël, ont une image catastrophique dans le monde arabe, que les invasions de l’Irak et de l’Afghanistan ne sont pas venues améliorer. Or, les révoltes commencent à faire émerger des gouvernements plus sensibles à l’opinion anti-américaine et, si les Etats-Unis veulent assurer leur avenir dans la région, il est impératif de redorer leur blason vis-à-vis des nouvelles équipes. Surtout, le gouvernement américain ne pouvait pas laisser les mains libres au Royaume-Uni et à la France sur le terrain. Ces derniers ont également, d’une manière ou d’une autre, une image à améliorer, notamment la Grande-Bretagne suite à ses interventions en Irak et en Afghanistan. Le gouvernement français, malgré ses multiples maladresses, jouit encore d'une certaine popularité dans les pays arabes acquise sous De Gaulle et renforcée par son refus de participer à la guerre d’Irak en 2003. Une intervention contre un Kadhafi beaucoup trop incontrôlable et imprévisible au goût de ses voisins ne pouvait être qu'appréciée par ceux-ci et permettre de renforcer l'influence de la France. Derrière les belles paroles et les faux sourires, chaque fraction bourgeoise intervient donc pour ses propres intérêts, et participe, avec Kadhafi, à cette macabre danse de la mort.
Au Japon comme ailleurs, la nature produit des phénomènes, le capitalisme des catastrophes
A plusieurs milliers de kilomètres de la Libye, sur les terres de la troisième puissance économique mondiale, le capitalisme sème également la mort et démontre que nulle part, même au cœur des pays industrialisés, l’humanité n’est à l’abri de l’irresponsabilité et de l’incurie de la bourgeoisie. Les médias aux ordres ont, comme toujours, présenté le tremblement de terre et le tsunami qui ont ravagé le Japon comme une fatalité contre laquelle personne ne peut rien. Il est bien sûr impossible d’empêcher la nature de se déchaîner, mais l’installation de populations sur des zones à risque dans des maisons en bois n’est pas une "fatalité", tout comme l’exploitation de centrales nucléaires hors d’âge au milieu de ce triste tableau.
La bourgeoisie est, en effet, directement responsable de l’ampleur meurtrière de la catastrophe. Pour les besoins de la production, le capitalisme a concentré les populations et les industries de manière délirante. Le Japon est une caricature de ce phénomène historique : des dizaines de millions de personnes sont massées sur les rivages d’une petite bande de terre particulièrement sujette aux séismes et donc aux tsunamis. Evidemment, les structures résistantes antisismiques ont été bâties pour les plus riches et les immeubles de bureaux ; du simple béton suffisant à se prémunir des raz-de-marée, la classe ouvrière a néanmoins dû se contenter de cages à lapins en bois sur des territoires dont tout le monde sait qu’ils sont hautement dangereux. En toute logique, la population pourrait au moins être installée plus loin des côtes mais le Japon est un pays exportateur et, pour maximiser le profit, il vaut mieux construire les usines près des ports. Certaines usines ont d’ailleurs été balayées par les eaux, surajoutant à la catastrophe nucléaire une catastrophe industrielle à peine imaginable. Dans ce contexte, une crise humanitaire menace un des centres du capitalisme mondial, et devrait encore alourdir l’hécatombe. Tandis que de nombreux équipements et infrastructures sont hors d’usage, des dizaines de milliers de personnes sont abandonnées à leur sort, sans nourriture et sans eau.
Mais la bourgeoisie ne pouvait manifestement s’arrêter là dans l’irresponsabilité et l’impunité ; il lui fallait bâtir 17 centrales nucléaires à l’entretient douteux. La situation autour de la centrale de Fukushima, victime d’avaries sévères, est encore incertaine, mais la communication confuse des autorités laisse présager le pire. Il semble déjà acquis qu’une catastrophe nucléaire digne de l’explosion, en 1986, de la centrale de Tchernobyl se déroule sous les yeux d’un gouvernement impuissant, réduit à bricoler ses installations en sacrifiant de nombreux ouvriers. La fatalité et la nature n’ont encore rien à voir avec la catastrophe. La construction de centrales sur des rivages sensibles ne paraît pas être la plus brillante des idées, en particulier lorsqu’elles ont souvent plusieurs décennies de service et qu’elles bénéficient d’un entretien réduit au minimum. A titre d’exemple stupéfiant, en 10 ans, la centrale de Fukushima a été victime de plusieurs centaines d’incidents liés à une maintenance laborieuse qui a réussi à pousser à la démission des cadres scandalisés.
La nature n’a rien à voir dans ces catastrophes ; les lois, devenues absurdes, de la société capitaliste en sont responsables de bout en bout, dans les pays les plus pauvres comme au sein des plus puissants. La situation en Libye et les évènements au Japon illustrent à quel point le seul avenir que nous réserve la bourgeoisie est un chaos croissant et permanent. A ce titre, les révoltes dans les pays arabes, malgré toutes leurs faiblesses, nous montrent le chemin, celui de la lutte des exploités contre l’Etat capitaliste, seule à même d’éviter la catastrophe généralisée qui menace l’humanité.
V. (27-03-2011)
1 En fait, jamais depuis 1848 ou 1917-19, nous n'avons vu une telle marée de révoltes simultanées aussi étendue. Lire à ce propos l'article suivant de cette revues, "Que se passe-t-il au Moyen Orient ?"
Révoltes sociales au Maghreb et au Moyen-Orient, catastrophe nucléaire au Japon, guerre en Libye : seule la révolution prolétarienne peut sauver l'humanité du désastre capitaliste
- 1987 lectures
Les derniers mois ont été riches en événements historiques. Si les révoltes au Maghreb et au Moyen-Orient n’ont aucun lien avec le tsunami qui a ravagé le Japon et la crise nucléaire consécutive, tous ces évènements font néanmoins ressortir avec acuité l’alternative qui s’offre plus que jamais à l’humanité : socialisme ou barbarie. Tandis que l’écho des soulèvements résonne encore dans de nombreux pays, la société capitaliste croupit lamentablement au coin de son petit feu nucléaire. Inversement, l’héroïsme des ouvriers nippons qui sacrifient leur vie aux abords de la centrale de Fukushima tranche avec l’écœurante hypocrisie des puissances impérialistes en Libye.
La mobilisation des masses fait chuter les gouvernements
Depuis plusieurs mois, des mouvements de protestation, inédits de par leur ampleur géographique 1, secouent plusieurs pays. Les premières révoltes du Maghreb ont ainsi rapidement produit des émules puisque des manifestations touchaient, quelques semaines plus tard, la Jordanie, le Yémen, Bahreïn, l’Iran, l’Afrique sub-saharienne, etc. Il est impossible d’établir une stricte identité entre tous ces mouvements, tant en termes de contenu de classe que de riposte de la bourgeoisie, mais la crise économique qui plonge les populations dans une misère de plus en plus intenable depuis 2008 rend assurément insupportables les régimes corrompus et répressifs de la région.
La classe ouvrière ne s’y est jusque-là jamais présentée comme une force autonome en mesure d’assumer la direction des luttes qui ont souvent pris la forme d’une révolte de l’ensemble des classes non-exploiteuses, de la paysannerie ruinée aux couches moyennes en voie de prolétarisation. Mais, d’une part, l’influence ouvrière sur les consciences était sensible à la fois dans les mots d’ordre et les formes d’organisation des mouvements. Une tendance à l’auto-organisation s’est, par exemple, manifestée au travers des comités de protection des quartiers, apparus en Egypte et en Tunisie pour faire face à la répression policière et aux bandes de voyous opportunément libérés des prisons pour semer le chaos. Surtout, beaucoup de ces révoltes ont ouvertement cherché à amplifier le mouvement à travers des manifestations de masse, des assemblées et des tentatives pour coordonner et centraliser les prises de décisions. D’autre part, la classe ouvrière a parfois eu un rôle décisif dans le déroulement des événements. C’est en Egypte, où la classe ouvrière est la plus concentrée et la plus expérimentée de la région, que les grèves ont été les plus massives. L’extension rapide et le rejet de l’encadrement syndical ont largement contribué à pousser les chefs militaires, sous la pression des États-Unis, à chasser Hosni Moubarak du pouvoir.
Alors que les mobilisations sont encore nombreuses et que le vent de la révolte souffle à nouveau dans d’autres pays, la bourgeoisie semble avoir toutes les peines du monde pour éteindre l’incendie. Surtout en Egypte et en Tunisie, où le "printemps des peuples" est censé avoir triomphé, les grèves et les affrontements avec "l’Etat démocratique" se poursuivent. L’ensemble de ces révoltes constitue une formidable expérience sur la voie qui conduit à la conscience révolutionnaire. Néanmoins, si cette vague de révoltes, pour la première fois depuis longtemps, a explicitement lié les problèmes économiques aux enjeux politiques, la réponse à cette question s’est heurtée aux illusions qui pèsent encore sur la classe ouvrière, en particulier les mirages démocratique et nationaliste. Ces faiblesses ont souvent permis aux pseudo-oppositions démocratiques de se présenter comme une alternative aux cliques corrompues en place. En fait, ces "nouveaux" gouvernements sont essentiellement constitués du sérail des vieux régimes au point que la situation frise parfois la bouffonnerie. En Tunisie, la population a même contraint une partie du gouvernement à démissionner tant il apparaissait comme une redite exacte du régime Ben Ali. En Egypte, l’armée, soutien historique de Moubarak, tient l’ensemble des leviers de l’Etat et manœuvre déjà pour assurer sa position. En Libye, le "conseil national de transition" est dirigé par… l’ancien ministre de l’intérieur de Kadhafi, Abdel Fattah Younes, et une bande d’anciens hauts-fonctionnaires qui, après avoir organisé la répression et bénéficié de la générosité pécuniaire de leur maitre, se sont piqués d’un goût soudain pour les droits de l’homme et la démocratie.
En Libye, la guerre impérialiste fait rage sur les ruines de la révolte populaire
Sur la base de ces faiblesses, la situation en Libye a évolué d’une manière particulière dans la mesure où ce qui est très justement apparu au départ comme un soulèvement de la population contre le régime de Kadhafi s’est transformé en guerre entre plusieurs fractions bourgeoises sur laquelle sont venues se greffer les grandes puissances impérialistes dans une cacophonie surréaliste et sanglante. Le déplacement du terrain de la lutte vers la poursuite d’intérêts bourgeois, celui du contrôle de l’Etat libyen par l’une ou l’autre des fractions en présence, fut d’autant plus aisé que la classe ouvrière en Libye est très faible. L’industrie locale est notablement arriérée et presque réduite à la production de pétrole, directement pilotée par la clique de Kadhafi qui n’a jamais été en mesure de mettre un tant soit peu l’intérêt national au-dessus de ses intérêts particuliers. La classe ouvrière en Libye est, à ce titre, une main d’œuvre souvent étrangère qui, en débrayant dès le début des événements, a fini par fuir les massacres, notamment à cause de la difficulté de se reconnaitre dans une "révolution" aux accents nationalistes. C'est a contrario que la Libye illustre tragiquement la nécessité que la classe ouvrière occupe une place centrale au sein des révoltes populaires ; son effacement explique en grande partie l’évolution de la situation.
Depuis le 19 mars, après plusieurs semaines de massacres, sous le prétexte d’une intervention humanitaire pour "sauver le peuple libyen martyrisé", une coalition un peu trouble, constituée du Canada, des Etats-Unis, de l’Italie, de la France, du Royaume-Uni, etc. a directement engagé ses forces militaires afin de soutenir le Conseil national de transition. Chaque jour, des missiles sont tirés et des avions décollent pour larguer des tapis de bombes sur toutes les régions abritant des forces armées fidèles au régime de Kadhafi. En langage clair, c’est la guerre. Ce qui, d’emblée, est frappant, c’est l’incroyable hypocrisie des grandes puissances impérialistes qui, d’un côté, brandissent le drapeau déjà mité de l’humanitarisme et, dans le même temps, cautionnent le massacre des masses qui se révoltent à Bahreïn, au Yémen, en Syrie, etc. Où était cette même coalition quand Kadhafi a fait massacrer 1000 détenus dans la prison Abu Salim de Tripoli en 1996 ? En réalité, c’est depuis quarante ans que ce régime enferme, torture, terrorise, fait disparaître, exécute… en toute impunité. Où était hier cette même coalition quand Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Egypte ou Bouteflika en Algérie faisaient tirer sur la foule lors des soulèvements de janvier et février ? Derrière cette infâme rhétorique, les morts continuent à s’entasser dans les morgues. Et déjà, l’OTAN prévoit de prolonger les opérations pendant plusieurs semaines afin d’assurer le triomphe de la paix et de la démocratie.
En réalité, chaque puissance intervient en Libye pour ses intérêts particuliers. La cacophonie de la coalition, incapable de seulement établir une chaîne de commandement, illustre à quel point ces pays partent dans cette aventure guerrière en ordre dispersé afin de renforcer leur propre place dans la région, tels des vautours sur un cadavre. Du point de vue des Etats-Unis, la Libye ne représente pas un intérêt stratégique majeur dans la mesure où ils disposent déjà d’alliés de poids sur place, notamment l’Egypte et l’Arabie Saoudite. Ceci explique leur perplexité initiale lors des négociations à l’ONU. Néanmoins, les Etats-Unis, soutien historique d’Israël, ont une image catastrophique dans le monde arabe, que les invasions de l’Irak et de l’Afghanistan ne sont pas venues améliorer. Or, les révoltes commencent à faire émerger des gouvernements plus sensibles à l’opinion anti-américaine et, si les Etats-Unis veulent assurer leur avenir dans la région, il est impératif de redorer leur blason vis-à-vis des nouvelles équipes. Surtout, le gouvernement américain ne pouvait pas laisser les mains libres au Royaume-Uni et à la France sur le terrain. Ces derniers ont également, d’une manière ou d’une autre, une image à améliorer, notamment la Grande-Bretagne suite à ses interventions en Irak et en Afghanistan. Le gouvernement français, malgré ses multiples maladresses, jouit encore d'une certaine popularité dans les pays arabes acquise sous De Gaulle et renforcée par son refus de participer à la guerre d’Irak en 2003. Une intervention contre un Kadhafi beaucoup trop incontrôlable et imprévisible au goût de ses voisins ne pouvait être qu'appréciée par ceux-ci et permettre de renforcer l'influence de la France. Derrière les belles paroles et les faux sourires, chaque fraction bourgeoise intervient donc pour ses propres intérêts, et participe, avec Kadhafi, à cette macabre danse de la mort.
Au Japon comme ailleurs, la nature produit des phénomènes, le capitalisme des catastrophes
A plusieurs milliers de kilomètres de la Libye, sur les terres de la troisième puissance économique mondiale, le capitalisme sème également la mort et démontre que nulle part, même au cœur des pays industrialisés, l’humanité n’est à l’abri de l’irresponsabilité et de l’incurie de la bourgeoisie. Les médias aux ordres ont, comme toujours, présenté le tremblement de terre et le tsunami qui ont ravagé le Japon comme une fatalité contre laquelle personne ne peut rien. Il est bien sûr impossible d’empêcher la nature de se déchaîner, mais l’installation de populations sur des zones à risque dans des maisons en bois n’est pas une "fatalité", tout comme l’exploitation de centrales nucléaires hors d’âge au milieu de ce triste tableau.
La bourgeoisie est, en effet, directement responsable de l’ampleur meurtrière de la catastrophe. Pour les besoins de la production, le capitalisme a concentré les populations et les industries de manière délirante. Le Japon est une caricature de ce phénomène historique : des dizaines de millions de personnes sont massées sur les rivages d’une petite bande de terre particulièrement sujette aux séismes et donc aux tsunamis. Evidemment, les structures résistantes antisismiques ont été bâties pour les plus riches et les immeubles de bureaux ; du simple béton suffisant à se prémunir des raz-de-marée, la classe ouvrière a néanmoins dû se contenter de cages à lapins en bois sur des territoires dont tout le monde sait qu’ils sont hautement dangereux. En toute logique, la population pourrait au moins être installée plus loin des côtes mais le Japon est un pays exportateur et, pour maximiser le profit, il vaut mieux construire les usines près des ports. Certaines usines ont d’ailleurs été balayées par les eaux, surajoutant à la catastrophe nucléaire une catastrophe industrielle à peine imaginable. Dans ce contexte, une crise humanitaire menace un des centres du capitalisme mondial, et devrait encore alourdir l’hécatombe. Tandis que de nombreux équipements et infrastructures sont hors d’usage, des dizaines de milliers de personnes sont abandonnées à leur sort, sans nourriture et sans eau.
Mais la bourgeoisie ne pouvait manifestement s’arrêter là dans l’irresponsabilité et l’impunité ; il lui fallait bâtir 17 centrales nucléaires à l’entretient douteux. La situation autour de la centrale de Fukushima, victime d’avaries sévères, est encore incertaine, mais la communication confuse des autorités laisse présager le pire. Il semble déjà acquis qu’une catastrophe nucléaire digne de l’explosion, en 1986, de la centrale de Tchernobyl se déroule sous les yeux d’un gouvernement impuissant, réduit à bricoler ses installations en sacrifiant de nombreux ouvriers. La fatalité et la nature n’ont encore rien à voir avec la catastrophe. La construction de centrales sur des rivages sensibles ne paraît pas être la plus brillante des idées, en particulier lorsqu’elles ont souvent plusieurs décennies de service et qu’elles bénéficient d’un entretien réduit au minimum. A titre d’exemple stupéfiant, en 10 ans, la centrale de Fukushima a été victime de plusieurs centaines d’incidents liés à une maintenance laborieuse qui a réussi à pousser à la démission des cadres scandalisés.
La nature n’a rien à voir dans ces catastrophes ; les lois, devenues absurdes, de la société capitaliste en sont responsables de bout en bout, dans les pays les plus pauvres comme au sein des plus puissants. La situation en Libye et les évènements au Japon illustrent à quel point le seul avenir que nous réserve la bourgeoisie est un chaos croissant et permanent. A ce titre, les révoltes dans les pays arabes, malgré toutes leurs faiblesses, nous montrent le chemin, celui de la lutte des exploités contre l’Etat capitaliste, seule à même d’éviter la catastrophe généralisée qui menace l’humanité.
V. (27-03-2011)
1 En fait, jamais depuis 1848 ou 1917-19, nous n'avons vu une telle marée de révoltes simultanées aussi étendue. Lire à ce propos l'article suivant de cette revues, "Que se passe-t-il au Moyen Orient ?"
Géographique:
Récent et en cours:
- Catastrophes [21]
- Guerre [22]
Que se passe-t-il au Moyen-Orient ?
- 2712 lectures
Les événements actuels au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont d'une importance historique majeure, dont les conséquences sont encore difficiles à cerner. Néanmoins, il est important de développer à leur propos un cadre d'analyse cohérent. Les remarques qui suivent ne constituent pas ce cadre lui-même et encore moins une description détaillée des événements, mais simplement quelques points de référence de base visant à stimuler la réflexion sur cette question.1
1. Jamais, depuis 1848 ou 1917-19, nous n'avons vu une telle marée de révoltes simultanées aussi étendue. Bien que l'épicentre du mouvement ait été en Afrique du Nord (Tunisie, Egypte et Libye, mais aussi Algérie et Maroc), les protestations contre les régimes existants ont aussi éclaté dans la Bande de Gaza, en Jordanie, en Irak, en Iran, au Yémen, à Bahreïn et en Arabie, tandis qu'un certain nombre d'Etats répressifs d'autres pays arabes, notamment la Syrie, sont en état d'alerte. Il en est de même pour le régime stalinien de la Chine. Il y a aussi de clairs échos de protestations dans le reste de l'Afrique : Soudan, Tanzanie, Zimbabwe, Swaziland... Nous pouvons aussi voir l'impact direct de la révolte dans les manifestations contre la corruption gouvernementale et les effets de la crise économique en Croatie, dans les banderoles et les slogans des manifestations d'étudiants au Royaume-Uni, dans les luttes ouvrières dans le Wisconsin et sans doute dans beaucoup d'autres pays. Cela ne veut pas dire que tous ces mouvements dans le monde arabe soient identiques, que ce soit dans leur contenu de classe, leurs revendications, ou dans la riposte de la classe dirigeante, mais il y a évidemment un certain nombre de caractéristiques communes qui permettent de parler d'un phénomène global.
2. Le contexte historique dans lequel ces événements se déroulent est le suivant :
- Une crise économique profonde, la plus grave de l'histoire du capitalisme, qui a frappé les économies les plus faibles du monde arabe avec une force particulière et qui a déjà plongé des millions d'êtres humains dans une pauvreté indécente, avec pour perspective des conditions de vie encore pires. Contrairement à beaucoup de pays centraux qui connaissent le 'vieillissement', les jeunes, qui constituent un très grand pourcentage de la population totale, sont particulièrement touchés par le chômage, avec un avenir totalement bouché, qu'ils soient instruits ou non. Dans tous les cas, ce sont les jeunes qui sont à la pointe de ces mouvements.
- Une nature corrompue et répressive de tous les régimes de la région qui est devenu insupportable. Alors que pendant longtemps l'activité impitoyable de la police secrète ou des forces armées a maintenu la population dans un état d'atomisation et de peur, ces armes mêmes de l'Etat ont servi à généraliser la volonté de se réunir et de résister. Cela a été très clair en Egypte, par exemple, lorsque Moubarak a envoyé son armée de voyous et de policiers en civil pour terroriser les masses qui occupaient la place Tahrir : ces provocations ont seulement renforcé la détermination des manifestants à se défendre et en ont attiré des milliers d'autres. De même, la corruption scandaleuse et la cupidité des cliques dirigeantes, qui avaient amassé d'immenses fortunes privées, alors que la grande majorité avait du mal à survivre au jour le jour, ont attisé les flammes de la rébellion, une fois que les populations ont commencé à surmonter leurs craintes.
- Cette soudaine disparition de la peur, évoquée par de nombreux participants, est non seulement le produit de changements au niveau local et régional, mais aussi d'un climat de mécontentement croissant et d'une manifestation de la lutte des classes au niveau international. Partout, face à la crise économique, les exploités et les opprimés sont de plus en plus réticents à faire les sacrifices qu'on leur demande. Là encore, le rôle joué par la nouvelle génération est essentiel, et, en ce sens, la rébellion de la jeunesse en Grèce il y a deux ans, les luttes des étudiants au Royaume-Uni et en Italie, la lutte contre la réforme des retraites en France ont aussi eu leur impact dans le monde 'arabe', en particulier à l'ère de Facebook et Twitter, où il est beaucoup plus difficile pour la bourgeoisie de maintenir un black-out cohérent des luttes contre le statu quo.
3. La nature de classe de ces mouvements n'est pas uniforme et varie d'un pays à l'autre et selon les différentes phases. On peut, cependant, dans l'ensemble les caractériser comme des mouvements des classes non-exploiteuses, comme des révoltes sociales contre l'Etat. En général, la classe ouvrière n'a pas été à la tête de ces rébellions, mais elle a certainement eu une présence et une influence considérables qui peuvent être perçues tant dans les méthodes et les formes d'organisation adoptées par le mouvement que, dans certains cas, par le développement spécifique des luttes ouvrières, comme les grèves en Algérie et surtout la grande vague de grèves en Egypte qui a été un facteur clé dans la décision de se débarrasser de Moubarak (sur laquelle nous reviendrons plus loin). Dans la majorité de ces pays, le prolétariat n'est pas la seule classe opprimée. La paysannerie et d'autres couches provenant de modes de production encore plus anciens, bien que largement éclatées et ruinées par des décennies de déclin du capitalisme, ont encore un poids dans les zones rurales, tandis que dans les villes, où les révoltes ont toujours été concentrées, la classe ouvrière coexiste avec une vaste classe moyenne qui est en voie de prolétarisation, mais qui a gardé ses traits spécifiques et une masse d'habitants de taudis qui sont constitués, d'une part, de prolétaires et d'autre part de petits commerçants et d'éléments 'lumpenisés'. Même en Egypte, où se trouve la classe ouvrière la plus concentrée et la plus expérimentée, des témoins oculaires sur la place Tahrir ont souligné que les protestations avaient mobilisé toutes les classes, à l'exception des échelons supérieurs du régime. Dans d'autres pays, le poids des couches non prolétariennes a été beaucoup plus fort qu'il ne l'a été dans la majorité des luttes des pays centraux.
4. Lorsqu'on essaie de comprendre la nature de classe de ces rébellions, nous devons donc éviter deux erreurs symétriques : d'une part, une identification générale de toutes les masses en lutte avec le prolétariat (la position la plus caractéristique de cette vision est celle du Groupe Communiste Internationaliste), et d'autre part, un rejet de ce qui peut être positif dans des révoltes qui ne sont pas explicitement celles de la classe ouvrière. La question posée ici nous ramène à des événements antérieurs, comme ceux de l'Iran à la fin des années 1970, où, là encore, nous avons vu une révolte populaire au cours de laquelle, pendant un certain temps, la classe ouvrière a été en mesure d'assumer un rôle de premier plan, bien que finalement ce dernier n'ait pas été suffisant pour empêcher la récupération du mouvement par les islamistes. À un niveau plus historique, le problème de la classe ouvrière, qui émerge d'un mouvement de révoltes englobant toutes les classes sociales non-exploiteuses, mais qui, face à elles, a besoin de maintenir son autonomie de classe, rappelle aussi le problème de l'Etat dans la période de transition entre le capitalisme et le communisme.
5. Dans la révolution russe, la forme d'organisation en soviet a été engendrée par la classe ouvrière, mais elle a également fourni un modèle d'organisation pour tous les opprimés. Sans perdre le sens des proportions - parce qu'il y a encore un long chemin avant d'arriver à une situation révolutionnaire dans laquelle la classe ouvrière serait capable d'apporter une direction politique claire aux autres couches sociales - nous pouvons voir que les méthodes de lutte de la classe ouvrière ont eu un impact sur les révoltes sociales dans le monde arabe :
- Dans les tendances à l'auto-organisation, qui sont apparues plus clairement dans les comités de protection des quartiers, qui ont émergé comme une réponse à la tactique du régime égyptien qui lâchait des bandes de criminels contre la population, dans la structure du 'délégué' de certaines des assemblées massives sur la place Tahrir, dans l'ensemble du processus de discussion et de prises de décisions collectives ;
- Dans l'occupation d'espaces normalement contrôlés par l'Etat pour se donner un lieu central afin de se rassembler et de s'organiser à une échelle massive ;
- Dans la prévision consciente de la nécessité de se défendre contre les voyous et la police envoyés par les régimes, mais en même temps dans le rejet de la violence gratuite, de la destruction et du pillage, dans leur propre intérêt ;
- Dans des efforts délibérés pour surmonter les divisions sectaires et autres qui ont été cyniquement manipulées par les régimes : divisions entre chrétiens et musulmans, chiites et sunnites, religieux et laïcs, hommes et femmes ;
- Dans les nombreuses tentatives pour fraterniser avec les soldats du rang.
Ce n'est pas un hasard si ces tendances se sont le plus fortement développées en Egypte, là où la classe ouvrière a une longue tradition de luttes et où, à une étape cruciale du mouvement, elle a émergé comme une force distincte, pour se livrer à une vague de luttes qui, comme celles de 2006-2007, peuvent être considérées comme des 'germes' de la grève de masse à venir, contenant un certain nombre de ses caractéristiques parmi les plus importantes : l'extension spontanée des grèves et des exigences d'un secteur à l'autre, le rejet intransigeant des syndicats d'Etat, certaines tendances à l'auto-organisation, le développement de revendications à la fois économiques et politiques. Ici, nous voyons, dans ses grandes lignes, la capacité de la classe ouvrière à se présenter comme le porte-parole de tous les opprimés et exploités et la seule classe qui offre la perspective d'une société nouvelle.
6. Toutes ces expériences sont de vrais tremplins pour le développement d'une conscience véritablement révolutionnaire. Mais la route dans cette direction est encore longue, elle est parsemée de nombreuses et indéniables illusions et faiblesses idéologiques :
- Des illusions, surtout dans la démocratie, qui sont extrêmement fortes dans les pays qui ont été régis par une combinaison de tyrannie militaire et de monarchies corrompues, où la police secrète est omniprésente et où l'arrestation, la torture et l'exécution des dissidents sont monnaie courante. Ces illusions ouvrent une porte pour que 'l'opposition' démocratique se présente comme une équipe alternative pour la gestion de l'Etat : El Baradei et les Frères Musulmans en Egypte, le Gouvernement de Transition en Tunisie, le Conseil National en Libye ... En Egypte, les illusions dans l'armée comme étant celle du 'peuple' sont particulièrement fortes, même si les récentes actions de répression de l'armée contre les manifestants sur la place Tahrir, conduiront certainement une minorité vers la réflexion. Un aspect important du mythe démocratique en Egypte est la demande de syndicats indépendants, dans laquelle se sont sans doute impliqués de nombreux travailleurs parmi les plus combatifs qui ont, avec raison, appelé à la dissolution des syndicats officiels discrédités ;
- Des illusions par rapport au nationalisme et au patriotisme, avec l'exhibition largement répandue du drapeau national comme le symbole de la 'révolution' en Egypte et en Tunisie, ou, comme en Libye, du vieux drapeau monarchique, comme emblème de tous ceux qui s'opposent au règne de Kadhafi. Une fois encore, l'image de marque de Moubarak comme un agent du sionisme sur un certain nombre de bannières en Egypte montre que la question du conflit Israël/Palestine reste comme un levier potentiel pour détourner les conflits de classe vers un conflit impérialiste. Cela dit, il y avait peu d'intérêt à soulever la question palestinienne, compte tenu du fait que la classe dirigeante a si longtemps utilisé les souffrances des Palestiniens comme un moyen de détourner l'attention des souffrances qu'elle a imposées à sa propre population, et il y avait sûrement quelque chose d'internationaliste dans le fait de brandir des drapeaux d'autres pays, comme expression de solidarité avec leurs rébellions. L'ampleur même de la révolte à travers le monde 'arabe' et au-delà est une démonstration de la réalité matérielle de l'internationalisme, mais l'idéologie patriotique a des capacités très fortes d'adaptation et, dans ces événements, nous voyons comment elle peut se transformer en des formes plus populistes et plus démocratiques ;
- Des illusions sur la religion, avec l'utilisation fréquente de la prière publique et l'utilisation de la mosquée en tant que centre d'organisation de la rébellion. En Libye, il est prouvé que ce sont plus spécifiquement les groupes islamistes (du terroir plutôt que liés à Al-Qaïda, comme le prétend Kadhafi) qui ont joué, dès le début, un rôle important dans la révolte. Ceci, ainsi que le rôle des loyautés tribales, est un reflet de la faiblesse relative de la classe ouvrière libyenne et du retard du pays et de ses structures étatiques. Toutefois, dans la mesure où l'islamisme radical du type Ben Laden s'est présenté comme la réponse à la misère des masses 'en terre musulmane', les révoltes en Tunisie et en Egypte, et même en Libye et dans les Etats du Golfe comme le Yémen et le Bahreïn, ont montré que les groupes jihadistes, avec leur pratique de petites cellules terroristes et leurs idéologies nocives et sectaires, ont été presque entièrement marginalisés par le caractère massif des mouvements et par les efforts véritables de ces dernières pour surmonter les divisions sectaires.
7. La situation actuelle en Afrique du Nord et au Moyen-Orient est toujours sous pression. Au moment où nous écrivons, il faut s'attendre à des manifestations à Riyad, alors même que le régime saoudien a déjà décrété que toutes les manifestations sont contraires à la charia. En Egypte et en Tunisie, où la 'révolution' est censée avoir déjà triomphé, il y a des affrontements permanents entre les manifestants et l'Etat, maintenant 'démocratique', qui est administré par des forces qui sont plus ou moins les mêmes que celles qui ont mené la danse avant le départ des 'dictateurs'. La vague de grèves en Egypte, qui a rapidement conquis bon nombre de ses revendications, semble avoir diminué. Mais, ni la lutte ouvrière, ni le mouvement social plus large, n'ont subi de contrecoup et de défaite dans ces pays, et il y a, certainement en Egypte, des signes d'un large débat et d'une réflexion en cours. Cependant, les événements en Libye ont pris une tournure très différente. Ce qui semble avoir commencé comme une véritable révolte de « ceux d'en bas », avec des civils, sans armes, partant courageusement à l'assaut des casernes des militaires et incendiant les QG des soi-disant 'Comités du Peuple', en particulier dans l'est du pays, a été rapidement transformé en une totale et très sanglante 'guerre civile' entre des fractions de la bourgeoisie, avec les puissances impérialistes rôdant à l'affut comme des vautours au-dessus du carnage. En termes marxistes, il s'agit en fait, d'un exemple de la transformation d'une guerre civile naissante - dans son sens véritable d'une confrontation directe et violente entre les classes - en une guerre impérialiste. L'exemple historique de l'Espagne en 1936 - en dépit des différences considérables dans l'équilibre global des forces entre les classes, et dans le fait que la révolte initiale contre le coup d'Etat de Franco ait été, sans équivoque, de nature prolétarienne - montre comment la bourgeoisie nationale et internationale peut vraiment intervenir dans de telles situations à la fois en poursuivant ses rivalités de factions, nationales et impérialistes et en écrasant toute possibilité de révolte sociale.
8. Le contexte de cette tournure des événements en Libye est lié au retard extrême du capitalisme libyen, qui a été gouverné pendant plus de 40 ans par la clique de Kadhafi, principalement à travers un appareil de terreur, directement sous son commandement. Cette organisation a freiné le développement d'une armée en tant que force capable de mettre l'intérêt national au-dessus de l'intérêt d'un chef particulier ou d'une faction, comme cela a a été le cas en Tunisie et en Egypte. Dans le même temps, le pays est déchiré par les divisions régionales et tribales et celles-ci ont joué un rôle clé par rapport au soutien ou à l'opposition à Kadhafi. Une forme 'nationale' d'islamisme semble avoir également joué, dès le début, un rôle dans la révolte, bien que la rébellion ait été à l'origine plus générale et sociale que simplement tribale ou islamique. La principale industrie de la Libye est le pétrole et les turbulences qu'il a subies ont un effet très sévère sur les prix mondiaux du pétrole. Mais une grande partie de la population active occupée dans l'industrie pétrolière est constituée d'immigrants venant d'Europe, du reste du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique, et même s'il y a eu très tôt des compte-rendus de grèves dans ce secteur, l'exode massif des travailleurs 'étrangers' fuyant les massacres est un signe clair qu'ils se reconnaissaient peu dans une 'révolution' qui hisse le drapeau national. En fait, il y a eu des compte-rendus sur la persécution de travailleurs noirs entre les mains des forces 'rebelles', car il y avait de nombreuses rumeurs selon lesquelles certains mercenaires avaient été recrutés par le régime pour écraser les manifestations dans des Etats africains, ce qui jetait la suspicion sur tous les immigrants noirs. La faiblesse de la classe ouvrière en Libye est donc un élément crucial dans l'évolution négative de la situation dans ce pays.
9. Une preuve manifeste que la 'rébellion' est devenue une guerre entre camps bourgeois est fournie par la désertion très hâtive du régime de Kadhafi par de nombreux hauts fonctionnaires, y compris des ambassadeurs étrangers, des officiers de l'armée et de la police et des hauts fonctionnaires. Les commandants militaires ont, notamment, mis en avant la 'régularisation' des forces armées anti-Kadhafi. Mais peut-être le signe le plus frappant de ce changement est-il la décision de la majeure partie de la 'communauté internationale' de s'aligner à côté des 'rebelles'. Le Conseil National de Transition, basé à Benghazi, a déjà été reconnu par la France comme la voix de la nouvelle Libye., Et une petite intervention militaire sur le terrain a déjà pris forme par l'envoi de 'conseillers' pour aider les forces anti-Kadhafi. Etant déjà intervenus diplomatiquement pour accélérer le départ de Ben Ali et de Moubarak, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres puissances ont été encouragées par le vacillement, au début, du régime de Kadhafi : William Hague, par exemple, a prématurément annoncé que Kadhafi était en route vers le Venezuela. Alors que les forces de Kadhafi commençaient à reprendre le dessus, les voix pour imposer une zone d'exclusion aérienne ou pour utiliser d'autres formes d'intervention militaire directe devenaient plus fortes. Cependant, au moment où nous écrivons, il semble y avoir de profondes divisions au sein de l'UE et de l'OTAN, avec la Grande-Bretagne et la France plus fortement favorables à une action militaire et les Etats-Unis et l'Allemagne plus réticents. L'administration Obama n'est bien sûr pas opposée, sur le principe, à une intervention militaire, mais elle n'a nullement envie de s'exposer au danger d'être entraînée dans un autre bourbier insoluble, dans le monde arabe. Il se peut également que certaines parties de la bourgeoisie mondiale se demandent si la terreur de masse employée par Kadhafi ne serait pas un 'remède' pour décourager de nouveaux troubles dans la région. Une chose est certaine cependant : les événements libyens, et même tout le développement de la situation dans la région, ont révélé l'hypocrisie grotesque de la bourgeoisie mondiale. Après avoir, pendant des années, vilipendé la Libye de Kadhafi comme un foyer du terrorisme international (ce qu'elle était, bien sûr), les dirigeants de pays comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, qui avaient du mal à justifier leur position sur les présumées armes de destruction massive de Saddam Hussein, ont eu leur coeur réchauffé par la décision de Kadhafi, en 2006, de larguer ses propres armes de destruction massive. Tony Blair, en particulier, avait montré une hâte indécente en embrassant l'ex- 'leader terroriste fou'. Seulement quelques années plus tard, Kadhafi est à nouveau un 'leader terroriste fou'' et ceux qui l'ont soutenu doivent se hâter de prendre leurs distances par rapport à lui. Et ce n'est là qu'une version de la même histoire: presque tous les 'dictateurs arabes', d'hier ou d'aujourd'hui, ont bénéficié de l'appui fidèle des Etats-Unis et d'autres puissances, qui ont jusqu'à présent manifesté très peu d'intérêt pour les aspirations démocratiques de la population de Tunisie, d'Egypte, de Bahreïn ou d'Arabie. La flambée de manifestations de rue, provoquée par la hausse des prix et les pénuries de biens de première nécessité et, dans certains cas, violemment réprimées, contre le gouvernement de l'Irak, imposé par les États-Unis, y compris les dirigeants actuels du Kurdistan irakien, révèle encore plus la vacuité des promesses fabriquées par 'l'Occident démocratique'.
10. Certains anarchistes internationalistes de Croatie (du moins avant qu'ils ne commencent à prendre part aux manifestations en cours à Zagreb et ailleurs) sont intervenus sur libcom.org pour faire valoir que les événements dans le monde arabe se sont présentés à leurs yeux comme une répétition des événements en Europe de l'Est en 1989, au cours desquels toutes les aspirations de changement ont été dévoyées vers la voie de garage qui porte le nom de 'démocratie', et qui n'apporte absolument rien pour la classe ouvrière. C'est une préoccupation très légitime, étant donné la force évidente des mystifications démocratiques au sein de ce nouveau mouvement, mais il manque la différence essentielle entre les deux moments historiques, surtout au niveau de la configuration des forces de classes à l'échelle mondiale. Au moment de l'effondrement du bloc de l'Est, la classe ouvrière des pays de l'Ouest atteignait les limites d'une période de luttes qui n'avaient pas été en mesure de se développer sur le plan politique. L'effondrement du bloc de l'Est, avec ses campagnes sur la "mort du communisme" et la "fin de la lutte de classes", et avec l'incapacité de la classe ouvrière de l'Est de riposter sur son propre terrain de classe, a contribué à plonger la classe ouvrière internationale dans une longue période de recul. Dans le même temps, bien que les régimes staliniens aient été en réalité les victimes de la crise économique mondiale, à l'époque, c'était loin de paraître évident et il y avait encore assez de marge de manœuvre dans les économies occidentales pour alimenter l'illusion qu'une ère nouvelle s'ouvrait pour le capitalisme mondial. La situation est aujourd'hui très différente. La nature mondiale de la crise capitaliste n'a jamais été aussi évidente, ce qui rend beaucoup plus facile pour les prolétaires du monde entier de comprendre que, pour l'essentiel, ils sont tous confrontés aux mêmes problèmes : le chômage, la hausse des prix, l'absence de tout avenir dans le système. Et au cours des sept ou huit dernières années, nous avons pu voir une reprise lente, mais réelle, des luttes ouvrières à travers le monde, des luttes généralement dirigées par une nouvelle génération de prolétaires qui est moins marquée par les échecs des années 80 et 90 et qui donne naissance à une minorité croissante d'éléments politisés, encore une fois à l'échelle mondiale. Compte tenu de ces différences profondes, il y a une réelle possibilité que les événements dans le monde arabe, loin d'avoir un impact négatif sur la lutte de classes dans les pays centraux, soient intégrés à son développement futur :
- En réaffirmant la puissance de l'action massive et illégale dans les rues, sa capacité à ébranler la sérénité des souverains de la terre ;
- En annihilant la propagande bourgeoise sur 'les Arabes' considérés comme une masse uniforme de fanatiques sans cervelle et en démontrant la capacité des masses, dans ces régions, de discuter, de réfléchir et de s'organiser ;
- En renforçant la perte de crédibilité des dirigeants des pays centraux dont la vénalité et le manque de scrupules ont été mis en évidence par leurs attitudes de girouettes à l'égard des régimes dictatoriaux du monde arabe.
Ces éléments et d'autres seront tout d'abord beaucoup plus évidents pour la minorité politisée que pour la majorité des travailleurs des pays centraux, mais, sur le long terme, ils contribueront à une véritable unification de la lutte de classe, par delà les frontières nationales et continentales. Rien de tout cela, cependant, ne diminue la responsabilité de la classe ouvrière des pays avancés, qui a expérimenté, pendant des années, les délices de la 'démocratie' et d'un 'syndicalisme indépendant', une classe dont les traditions politiques et historiques sont profondément ancrées, même si elles ne sont pas encore très répandues, et qui est concentrée au coeur du système impérialiste mondial. La capacité de la classe ouvrière en Afrique du Nord et au Moyen-Orient d'en finir avec les illusions démocratiques et d'offrir une véritable perspective aux masses déshéritées de la population est toujours fondamentalement conditionnée par la capacité des travailleurs des pays centraux de leur fournir un exemple clair de lutte prolétarienne auto-organisée et politisée.
CCI (11 Mars)
1 Ce document a été rédigé le 11 mars, c'est-à-dire plus d'une semaine avant le début de l'intervention de la "coalitions" en Libye. C'est pour cette raison qu'il ne fait pas référence à cette intervention, tout en la laissant pressentir.
Géographique:
- Moyen Orient [23]
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique
- 3328 lectures
Pendant plusieurs générations, l’Afrique a été synonyme de catastrophes, de guerres et de massacres permanents, de famine, de maladies incurables, de gouvernements corrompus, bref de misère absolue sans issue. Tout au plus, quand on évoque son histoire (en dehors des aspects "exotiques" ou "folkloriques"), on désigne ses "braves" tirailleurs sénégalais ou maghrébins, les célèbres supplétifs de l’armée coloniale française lors des deux guerres mondiales et du maintien de l’ordre dans les anciennes colonies. Mais jamais on ne prononce les mots "classe ouvrière" et moins encore on évoque ses luttes, tout simplement parce que cela n’est jamais entré véritablement dans l’imaginaire des masses au niveau mondial comme au niveau africain.
Pourtant, le prolétariat mondial est bien présent en Afrique et a déjà montré par ses luttes qu’il fait partie de la classe ouvrière porteuse d’une mission historique. Cependant, son histoire a été délibérément occultée par l’ancienne bourgeoisie coloniale, puis étouffée par la nouvelle bourgeoisie africaine après la "décolonisation".
Par conséquent, le but principal de cette contribution est de fournir des éléments attestant la réalité bien vivante de l’histoire du mouvement ouvrier africain à travers ses combats contre la classe exploiteuse. Certes, il s’agit de l’histoire d’une classe ouvrière à la dimension d’un contient historiquement sous développé.
Mais, comment et pourquoi cette occultation de l'histoire du prolétariat en Afrique ?
"L’Afrique a-t-elle une histoire ? Il n’y a pas si longtemps, l’on répondait encore à cette question négativement. Dans un passage devenu célèbre, l’historien anglais Hugh Trevor-Roper comparait en 1965 l’histoire de l’Europe et elle de l’Afrique, et en concluait qu’au fond la seconde n’existait pas. Le passé africain, écrivait-il ne présentait aucun intérêt hormis "les tribulations de tribus barbares dans des endroits du globe pittoresques certes, mais sans la moindre importance". Trevor-Roper peut certes être qualifié de conservateur, mais il se trouve que le marxiste hongrois Endre Sik défendait plus ou moins le même point de vue en 1966 : "Avant d’entrer en contact avec les Européens, la plupart des Africains menaient encore une existence primitive et barbare, et nombre d’entre eux n’avaient même pas dépassé le stade de la barbarie la plus primitive. (…) Aussi est-t-il irréalise de parler de leur "histoire" - dans la conception scientifique du terme - avant l’arrivée des envahisseurs européens ?
Ce sont là des propos particulièrement musclés, mais la majorité des historiens de l’époque y souscrivait jusqu’à un certain point".1
Voilà comment, par le mépris raciste, les penseurs de la bourgeoisie coloniale européenne décrétèrent la non existence de l’histoire du continent noir. Et, en conséquence, pourquoi la classe ouvrière, elle non plus, n’a, aux yeux du monde, aucune histoire.
Mais surtout, ce qui frappe encore à la lecture de ces propos, c’est de voir unis dans leurs préjugés a-historiques sur l’Afrique, les "bon penseurs" des deux ex-blocs impérialistes de l’époque, à savoir le "bloc démocratique" de l’Ouest et le bloc "socialiste" de l’Est. En effet, celui qui est qualifié de "marxiste", Endre Sik, n’est rien d’autre qu’un stalinien de bon teint dont l’argumentaire n’est pas moins fallacieux que celui de son rival (ou compagnon) anglais Trevor- Roper. Par leur déni de l’histoire de l’Afrique (et de ses luttes de classes), ces messieurs, représentants de la classe dominante, expriment une vision de l’histoire encore plus barbare que la "barbarie des tribulations des tribus africaines". En réalité, ces auteurs font partie des "savants" qui avaient donné leur "bénédiction scientifique" aux thèses ouvertement racistes des pays colonisateurs. Ce qui n’est pas le cas de l’auteur qui a relevé leurs propos, Henri Wesseling, car il se démarque de ses collègues "historiens" en ces termes :
"(…) La vérité est tout autre. Un certain nombre d’Africains, tels que le khédive d’Egypte, le sultan du Maroc, le roi zoulou Cetwayo, le roi des Matabélés Lobengula, l’almami Samori et le Makoko des Batékés, ont considérablement influencé le cours des choses".
Certes, par sa réaction, Henri Wesseling s’honore assurément en rétablissant la vérité historique dans le cas d’espèce face aux falsificateurs bien intentionnés. Reste que d’autres "scientifiques" qui, après avoir admis la réalité de l’histoire de l’Afrique et celle de la classe ouvrière, persistent eux aussi dans la vision très idéologique de l’histoire, en particulier de la lutte des classes. En effet, ils excluent ni plus ni moins la possibilité d’une révolution prolétarienne sur le continent noir avec des arguments pas moins aussi douteux que ceux employés par les historiens racistes 2:
"(…) Rebelles, les travailleurs africains le sont aussi à la prolétarisation : le témoignage de leur résistance permanente au salariat intégral (…) rend fragile la théorie importée d’une classe ouvrière porteuse d’une mission historique. L’Afrique n’est pas une terre de révolutions prolétariennes, et les quelques copies catastrophiques de ce modèle ont toutes eu, peu ou prou, à affronter violemment la dimension sociale vivante du "prolétariat"".
Précisons tout de suite que les auteurs de cette citation sont des sociologues universitaires composés de chercheurs anglophones et francophones. Par ailleurs, le titre de leur ouvrage, Classes ouvrières d’Afrique noire, en dit long sur leurs préoccupations de fond. D’autre part, si c’est clair qu’ils ne nient pas, eux, la réalité de l’histoire du continent africain comme le font leurs homologues historiens, en revanche, comme eux, leur démarche procède de la même idéologie qui consiste à prendre son point de vue pour "vérité scientifique" sans l’avoir confronté à l’histoire réelle. Déjà, en parlant de "quelques copies catastrophiques de ce modèle", ils confondent (involontairement ?) la révolution prolétarienne, comme celle de 1917 en Russie, avec les coups de force de type stalinien ou des luttes de "libération nationale" qui ont surgi partout dans le monde au lendemain de la seconde boucherie impérialiste mondiale, sous le vocable "socialiste" ou "progressiste". Ce sont bien ces modèles-là qui ont eu à affronter violemment le prolétariat qui leur résistait. Que cela soit en Chine, à Cuba, dans les anciens pays du bloc soviétique ou dans le "Tiers monde" en général et en Afrique en particulier. Mais surtout, ces sociologues virent carrément à la contre-révolution quand ils mettent en garde contre la "théorie importée d’une classe ouvrière porteuse d’une mission historique", d’où logiquement leur conclusion suivant laquelle l’Afrique n’est pas une terre de révolutions prolétariennes. De fait, ce groupe de "savants", en niant la possibilité de toute lutte révolutionnaires sur le continent noir, semble exclure de fait l’extension de toute autre révolution ("exportée") à Afrique. Du coup, ils ferment la porte à toute perspective de sortie de la barbarie capitaliste dont sont victimes les classes exploitées et les populations africaines en général. Finalement, ils n’apportent aucun éclairage par rapport à l’histoire véritable de la classe ouvrière.
Pour ce qui nous concerne, n’en déplaise à "nos" sociologues, la classe ouvrière reste encore la seule classe porteuse d'une mission historique face à la faillite du capitalisme qui s’accélère de jour en jour, y compris en Afrique comme l’atteste l’historien. Iba Der Thiam 3 , lorsqu'il fait le bilan des luttes ouvrières du début 19e au début des années 1930 :
"Dans le domaine syndical, la période 1790-1929 fut, nous l’avons vu, une étape décisive. Période de réveil, d’éveil, et puis d’affirmation, elle fut pour la classe ouvrière l’occasion souvent renouvelée de donner la preuve de sa détermination et de son esprit de lutte et d’abnégation.
De l’apparition d’une conscience présyndicale, jusqu’à la veille de la crise économique mondiale, nous avons suivi toutes les phases, d’une prise de conscience dont la rapidité du processus comparée au long cheminement de la classe ouvrière française, dans le même domaine, paraît tout à fait exceptionnelle.
L’idée de grève, c'est-à-dire d’un moyen de lutte, d’une forme d’expression consistant à se croiser les bras, et à interrompre provisoirement le déroulement normal de la vie économique pour faire valoir des droits, contraindre un patronat à se pencher sur des revendications salariales par exemple, ou accepter de négocier avec les grévistes ou leurs représentants, fit, en moins de quinze années, des progrès considérables, acquit même droit de cité, nonobstant les dispositions d’une législation restrictive, et fut reconnue comme une pratique sinon légale, du moins légitime.
(…) La résistance patronale, mises à part quelques exceptions, ne fit que rarement preuve d’une rigidité extrême. D’un réalisme lucide, les propriétaires des moyens de production ne mettaient en général, non seulement aucune réticence à préconiser et à rechercher le dialogue avec les grévistes, mais il leur arrivait même de pousser le Gouverneur à diligenter ses procédures d’intervention, et ne se gênaient pas, lorsque leurs intérêts étaient gravement menacés, à prendre fait et cause pour les travailleurs, dans les conflits qui les opposaient au chemin de fer par exemple, où il est vrai, la part de l’Etat dans les capitaux, était considérable".
Non seulement cet exposé suffit amplement pour caractériser une classe ouvrière porteuse d’espoir, mais celle qui a une histoire en Afrique qu’elle partage de surcroît avec la bourgeoisie à travers des confrontations historiques de classes, comme cela s’est passé souvent dans le monde depuis que le prolétariat s’est constitué en classe sous le régime capitaliste.
Avant de poursuivre sur l’histoire du mouvement ouvrier africain, nous attirons l’attention des lecteurs sur le fait que nous allons nous heurter aux difficultés liées au déni de l’histoire de l’Afrique par les historiens et les autres penseurs des anciennes puissances coloniales. En effet, cela s’est traduit, par exemple, chez les administrateurs coloniaux par une politique de censure systématique des faits et gestes les plus importants de la classe ouvrière, notamment ceux qui mettaient en relief la force de la classe ouvrière. De ce fait, nous sommes réduits ici à nous appuyer sur des sources rares d’auteurs plus ou moins connus mais dont la rigueur des travaux nous semble globalement prouvée et convaincante. D’autre part, si nous reconnaissons largement le sérieux des chercheurs qui transmettent les sources de référence, en revanche nous ne partageons pas forcément certaines de leurs interprétations des évènements historiques. Il en est de même sur certaines notions, par exemple quand les mêmes parlent de "conscience syndicale" à la place de "conscience de classe" (ouvrière), ou encore "mouvement syndical" (au lieu de mouvement ouvrier). Reste que, jusqu’à nouvel ordre, nous avons confiance en leur rigueur scientifique tant que leurs thèses ne se heurtent pas aux faits historiques ou n’empêchent pas d’autres interprétations.
Quelques éléments du contexte
Le Sénégal fut la plus ancienne des colonies françaises en Afrique, la France s’y installa officiellement de 1659 à 1960.
Un historien situe le début de l’histoire du mouvement ouvrier africain à la fin du 18e siècle, d’où le titre de son ouvrage "Histoire du Mouvement syndical africain 1790- 1929".
Les premiers ouvriers professionnels (artisans charpentiers, menuisiers, maçons, etc.) furent des européens installés à Saint- Louis du Sénégal (ancienne capitale des colonies africaines).
Avant la seconde guerre mondiale, la population ouvrière de la colonie francophone d'Afrique Occidentale Française (AOF) se trouvait essentiellement au Sénégal, entre Saint-Louis et Dakar qui furent respectivement capitale de l’AOF et capitale de la fédération qui regroupait l'AOF, l'Afrique Equatoriale Française (AEF), le Cameroun et le Togo. Surtout à Dakar qui était le "poumon économique" de la colonie AOF, avec le port, le chemin de fer, et évidemment le gros des fonctionnaires et des employés des services.
Au plan numérique, la classe ouvrière a toujours été historiquement faible en Afrique en général, cela étant dû évidemment au faible développement économique du continent, lequel s’explique à son tour par le faible investissement sur place des pays colonisateurs. De ce fait, la population ouvrière était estimée en 1927, par le Gouverneur de la colonie, à 60 000 personnes. Certes, certains disent que la moitié des ouvriers était exclue de ce chiffre, à savoir les éternels "journaliers" et autres apprentis.
Depuis ses premiers combats jusqu’aux années 1960, le prolétariat s’est toujours confronté systématiquement à la bourgeoisie française qui détenait les moyens de production à côté de l’administration coloniale. Cela signifie que la bourgeoisie sénégalaise naquit et évolua à l’ombre de sa "grande sœur française" (au moins jusqu’aux années 1960).
Luttes de classes au Sénégal
"L’histoire du mouvement syndical africain n’a, jusqu’à ce jour, jamais été globalement écrite. (…) La raison fondamentale de cette carence nous paraît résider, d’une part, dans l’indigence des recherches consacrées aux différents segments de la classe ouvrière africaine dans une perspective qui soit à la fois synchronique et diachronique ; d’autre part, dans l’absence d’une étude systématique des différents conflits sociaux qui ont été enregistrés, conflits sociaux dont chacun referme des gisements d’informations sur les préoccupations des travailleurs, leurs formes d’expression, les réactions de l’administration coloniale et du patronat, celles de la classe politique, les conséquence de tous ordres que ces épreuves ont eues sur l’histoire intérieure des colonies au quadruple plan économique, social, politique et culturel (…)".(Thiam. ibid.)
Comme vient de le souligner Iba Der Thiam, plusieurs facteurs expliquent les difficultés d’écrire l’histoire du mouvement ouvrier en Afrique. Reste que l’obstacle majeur sur lequel les chercheurs ont buté est sans conteste lié au fait que les véritables détenteurs des informations sur la classe ouvrière, à savoir les autorités coloniales françaises, elles, se gardèrent longtemps de leur ouvrir les archives de l’Etat. Et pour cause : elles avaient intérêt à cacher des choses .
En effet, avec la levée partielle des archives coloniales en AOF (au lendemain de la chute du mur de Berlin), on apprend que, non seulement la classe ouvrière existait en Afrique depuis le 19e siècle mais, très naturellement, elle a pu mener des combats souvent victorieux contre son ennemi de classe. 1855 marqua la première expression d’une organisation ouvrière où, à Saint Louis du Sénégal, un groupe de 140 ouvriers africains (charpentiers, maçons,) décida de se battre contre les vexations des maîtres européens qui leur imposaient des conditions de travail inacceptables. De même, on peut lire dans les archives l’existence d’un syndicat (clandestin) des "Charpentiers du Haut-Fleuve" en 1885. Surtout un nombre important de grèves et d’affrontements très durs eurent lieu entre la classe ouvrière et la bourgeoisie coloniale française, à l’instar de la grève générale avec émeute en 1914 à Dakar où, durant 5 jours, la vie économique et sociale fut totalement paralysée et où le Gouverneur fédéral de l’AOF William Ponti, lui-même, reconnut (dans ses notes secrètes) que "La grève était parfaitement organisée et eut un plein succès". Il y eut aussi de nombreuses autres grèves victorieuses, notamment celle d’avril 1919 et celle de 1938 menées par les cheminots (européens et africains unis) mais aussi où l’Etat dut recourir à la répression policière avant d’être contraint de satisfaire les revendications des grévistes. Ajoutons l’exemple de la grève générale de 6 mois (entre octobre 1947 et mars 1948) des cheminots de toute l’AOF, où les grévistes durent subir les balles du gouvernement PS (SFIO) avant de sortir victorieux du combat.
Enfin, il y a aussi ce fameux "Mai 68" mondial qui fit tache d’huile en Afrique et au Sénégal, venant rompre brutalement le "consensus national" ou patriotique qui régnait jusqu’alors depuis "l’indépendance" des années 1960. Et où, de par leur lutte sur un terrain de classe prolétarien, les ouvriers et les jeunes scolarisés ont dû affronter violemment le régime profrançais de Senghor en réclamant une amélioration de leurs conditions de vie et d’études. Ce faisant, le mouvement ouvrier a repris le chemin de la lutte qu’il connaissait depuis le début du 20e siècle mais qui fut obstrué par la perspective trompeuse de "l’indépendance nationale".
Ce sont là quelques exemples pour illustrer l’existence réelle d’une classe ouvrière, combative et souvent consciente de ses intérêts de classe ayant, certes, rencontré d’immenses difficultés de toutes sortes depuis sa naissance.
Naissance du prolétariat africain
Il convient de préciser d’emblée qu’il s’agit du prolétariat émergeant sous le régime du capitalisme colonial, étant entendu que, faute d’avoir accompli sa propre révolution contre le féodalisme, la bourgeoisie africaine doit son existence, elle aussi, à la présence du colonialisme européen sur son sol.
En d’autres termes, il s’agit de la naissance du prolétariat, moteur du développement des forces productives sous le règne du capitalisme triomphant du régime féodal, l’ancien système dominant, dont les résidus sont encore bien visibles aujourd’hui à maints endroits sur le continent noir.
"Au cours des siècles ayant précédé l’arrivée des colonisateurs, dans leur continent, les sociétés africaines, comme toutes les autres sociétés humaines, connaissaient le travail et utilisaient une main-d’œuvre, dans des conditions qui leur étaient particulières. (…)
L’économie était essentiellement agricole ; une agriculture d’ailleurs à prédominance vivrière, parce qu’utilisant des techniques rudimentaires, ne parvenait que rarement à dégager des surplus importants ; une économie fondée également sur des activités de chasse, de pêche, et de cueillette, auxquelles, pouvaient, dans certains cas, s’ajouter soit l’exploitation de quelques mines, soit un artisanat local de faible rentabilité, enfin des activités d’échanges, d’ampleur relative, qui se déroulaient à cause de la modicité et l’indigence des moyens de communication, à l’intérieur du groupe, de la région, et plus rarement du royaume, dans des marchés à périodicité régulière.
Dans un tel contexte, les modes de production étaient souvent lignagers et secrétaient rarement des antagonismes suffisamment vigoureux et assez conflictuels pour déterminer l’existence de classes sociales véritables au sens marxiste du terme.
(…) Autant la notion de biens dans les sociétés sénégambiennes précoloniales y était différente de sa notion européenne moderne, autant celle de travail et de service l’était plus encore. En effet, si dans les sociétés modernes fondées sur le développement industriel et le travail salarié, le travail est négocié comme bien économique, et comme tel, soumis forcément aux mécanismes inéluctables des lois du marché, où les rapports entre l’offre et la demande détermine les prix des services, dans les sociétés précoloniales négro-africaines, sénégambiennes, le travail ne nous paraît pas avoir eu une fonction autonome, indépendante de la personne. Il est une sorte d’activité communautaire découlant logiquement des normes de vie collective, une activité imposée par le statut social et les nécessités économiques (…).
La conquête coloniale essentiellement fondée sur l’esprit de puissance, la recherche de l’accumulation du profit par l’exploitation des ressources humaines, matérielles et minières, eut largement recours à la main-d’œuvre indigène, et n’hésitait pas à faire appel aux moyens que mettait à sa disposition, l’exercice du pouvoir étatique pour utiliser d’abord gratuitement le travail des populations locales, avant d’introduire le salariat, créant ainsi des conditions et des rapports nouveaux aussi bien pour le travail que pour le travailleur" (Thiam. ibid.).
Dans l’ensemble, l’exposé de l’auteur est suffisamment clair et pertinent dans son approche théorique et dans sa description du contexte historique de la naissance du prolétariat en Afrique. Effectivement, il est convaincant dans son argumentation visant à démontrer que le travail dans les sociétés négro-africaines ou sénégambiennes pré coloniales n’avait pas la même signification que dans les sociétés modernes de type occidental. De même, par rapport à son propos sur le salariat, nous pouvons affirmer effectivement que la notion de travail salarié fut sans doute introduite au Sénégal par l’appareil colonial français, le jour où celui-ci décida de "salarier" les hommes qu’il exploitait pour s’assurer du profit et étendre sa domination sur le territoire conquis. C’est ainsi que s’ouvrirent les premiers chantiers agricoles, industriels, miniers, des chemins de fer, des voies navigables, des routes, des usines, des imprimeries, etc. Autrement dit, voilà comment le capitalisme colonial français put introduire de nouveaux rapports de production dans sa première colonie africaine en créant en conséquence les conditions de la naissance de la classe ouvrière. Mais, ce fut d’abord sous le régime du travail obligatoire (le monstrueux "système de la corvée") que les premiers travailleurs se faisaient exploiter. Ce qui veut dire qu’à cette époque ils ne purent même pas négocier la vente de leur force de travail, comme l’atteste cette citation :
"Au titre des travaux civils, Blanchot par exemple exigea du maire des corvées de travailleurs chargés d’assurer les travaux de construction des quais à partir du 1e janvier 1790, puis du débarcadère de Saint- Louis. Le personnel demandé se composait originellement de "20 personnes avec gourmet et un habitant qui sera chargé de les rassembler, de les conduire au travail et de les y contenir". Il s’agissait d’abord d’une réquisition obligatoire, à laquelle nul ne pouvait se dérober, une fois désigné, sous peine de sanction. Il s’agissait, ensuite, d’un travail presque gratuit. Les travailleurs étaient choisis, convoqués, employés, surveillés, sans aucune condition de prix, de salaires, sans disposer, le moins du monde, du droit de discuter les modalités de leur utilisation, voire même de contester les circonstances du choix dont ils avaient été l’objet. Cette dépendance du travailleur vis-à-vis de son employeur était attestée par le fait que l’ordre n° 1 du 18 décembre 1789 instituant la corvée affectée à la construction des quais et du débarcadère ne stipulait aucune durée et pouvait, par conséquent, s’appliquer tant que durerait la nécessité qui lui avait donné naissance. Tout au plus y était-il fait allusion à une "gratification" de deux bouteilles d’eau de vie, et, pour bien montrer qu’il ne s’agissait point d’un salaire attaché à la rémunération ou simplement à la compensation du travail fourni, le texte faisait nettement comprendre qu’il s’agissait d’une simple faveur, due au bon vouloir des autorités, à l’exclusion de toute obligation de droit, ou de morale et dont la dite corvée "pouvait être privée lorsque les travaux seront retardés par négligence" ". (Thiam. ibid.)
Réquisition obligatoire sans aucune négociation, ni sur le prix, ni sur les conditions de travail, bref une dépendance totale de l’employé vis-à-vis de l’employeur, qui, tout au plus, était à peine incité à offrir à son exploité, comme seule "nourriture", une gratification sous forme d’eau de vie. Tel fut le statut et les conditions dans lesquelles le prolétariat, futur salarié, émergea sous le capitalisme colonial français au Sénégal.
Quatre ans plus tard, en 1794, le même Blanchot (commandant d’alors du Sénégal) décida une nouvelle "gratification" en donnant l’ordre de fournir aux travailleurs réquisitionnés "le couscous et le sanglès". Certes, on peut noter une "légère amélioration" de la gratification, car on passait de deux bouteilles d’eau de vie à un couscous, mais il n‘était toujours pas question de "compensation" et moins encore de salaire proprement parler. Il fallut attendre jusqu’en 1804 pour qu'existe officiellement la rémunération comme contrepartie du travail fourni, l’année où l’économie de la colonie connaissait une forte crise due à l’effort de guerre soutenu alors par l’appareil colonial pour la conquête de l’empire du Fouta (région voisine de Saint- Louis). En effet, la guerre se traduisit par l’arrêt provisoire du commerce sur le fleuve, d'où s'ensuivirent la rareté des produits et la spéculation sur les prix des denrées de première nécessité, ce qui provoqua le renchérissement du coût de la vie et, avec lui, de fortes tensions sociales.
1804 : l’instauration du salariat et première expression d’antagonisme de classes
Pour faire face à la dégradation du climat social, le Commandant de la ville de Saint- Louis dut intervenir en lançant l’ordre suivant :
"(…) qu’en conséquence de l’arrêt du conseil de la colonie sur les plaintes relatives à la cherté des ouvriers qui ont successivement porté leurs journées de travail à des prix exorbitants, et intolérables, plus longtemps...(…) Les maîtres, ouvriers, charpentiers ou maçons devaient désormais être payés au salaire d’une barre de fer par jour ou 4 francs 16 sols ; les compagnons trois quarts de barre ou 3 francs 12 sols, les manœuvres un quart de barre ou 1 franc, 4 sols".
"Dans cet arrêt, qui était l’un des plus anciens documents écrits que nous possédons sur le travail salarié, nous apprenons que la ville de Saint- Louis comptait dès ce moment- là, c'est-à-dire en 1804, "des ouvriers, charpentiers, calfats et maçons" employés par des particuliers, selon des normes et dans des circonstances qui ne nous sont pas malheureusement indiquées, mis à part le montant des salaires appliqués à ces personnels". (Thiam, ibid.)
Par détour d’arbitrage du conflit entre employeurs et employés, l’Etat décida de réglementer leurs rapports en fixant lui-même le montant des salaires selon les catégories et les niveaux de qualification. Notons par ailleurs que cette intervention de l’Etat colonial était d’abord orientée contre les employés car elle répondait aux doléances déposées auprès du Chef de la colonie par les employeurs qui se plaignaient des "prix exorbitants" des journées de travail des ouvriers.
En effet, pour faire face aux effets de la crise, les ouvriers durent décider de majorer le prix de leur travail afin de préserver leur pouvoir d’achat détérioré par l’augmentation du coût de la vie. Et avant cette date, l’établissement des conditions de travail était encore une affaire purement privée, se trouvant exclusivement entre les mains des négociateurs socioéconomiques, c'est-à-dire, sans aucune législation formelle de l’Etat.
Reste que cette intervention ouverte de l’autorité étatique fut la première du genre dans un conflit opposant les ouvriers aux employeurs. Plus généralement, cette période (1804) atteste la réalité de la première expression ouverte dans la colonie d’un antagonisme entre les deux principales classes sociales historiques qui s’affrontent sous le capitalisme, à savoir la bourgeoisie et le prolétariat. Cette date marque aussi l’histoire du travail au Sénégal, où fut actée officiellement l’instauration du salariat, permettant enfin aux ouvriers de vendre "normalement" leur force de travail et d’être rémunérés le cas échéant.
Pour ce qui concerne la "composition ethnique" des ouvriers (qualifiés), ces derniers étaient très majoritairement d’origine européenne, de même, les employeurs étaient quasi exclusivement venus de la métropole. Parmi ces derniers figuraient les Potin, Valantin, Pellegrin, Morel, D’Erneville, Dubois, Prévost, etc. Ce furent ceux-là qu’on appela les premiers la "crème de la bourgeoisie commerçante" de la colonie. Enfin, soulignons au passage l’extrême faiblesse numérique de la classe ouvrière (quelques milliers), comme conséquence du bas niveau du développement économique du pays, et ceci un siècle et demi après l’arrivée des premiers colons dans cette zone. De plus, il s’agissait d’une "économie de comptoir" (ou de traite), basée essentiellement sur le commerce des matières premières et du bois d’ébène 4.
L’économie de comptoir en crise de main-d’œuvre
"Tant que le Sénégal demeura un comptoir d’importance secondaire dont l’activité principale portait sur le commerce du bois d’ébène, et sur l’exploitation des produits tels que la gomme, l’or, l’ivoire, la cire jaune, les cuirs tirés par les commerçants saint-louisiens et goréens du commerce sur le fleuve ou le long de la côte occidentale d’Afrique, cette question [de la main d'oeuvre] ne connut jamais une dimension inquiétante. Pour faire face aux rares travaux d’équipement et d’infrastructures sommaires, le Gouverneur pouvait faire appel accessoirement au concours de la population civile ou militaire des deux comptoirs et, dans les travaux n’exigeant pas une main-d’œuvre spécialisée, à celui beaucoup plus fréquent des travailleurs de condition servile, sur la base des normes laissées le plus souvent, si ce n’était toujours, à sa seule discrétion.
Mais la suppression de l’esclavage avait profondément modifié les données de la situation. La principale ressource économique de la colonie étant désormais menacée de tarissement, la France ayant de plus perdu certaines de ses colonies agricoles, l’expérience de la colonisation européenne tentée dans le Cap-Vert ayant échoué, le Gouvernement de la Restauration pensa qu’il était désormais nécessaire d’amorcer la mise en valeur agricole du Sénégal par la culture d’un certain nombre de produits coloniaux susceptibles d’alimenter l’industrie française, de reconvertir les activités commerciales de la colonie, de fournir du travail à la main-d’œuvre indigène libérée". (Thiam, ibid.)
Il faut souligner d’emblée que la suppression de l’esclavage répondait d’abord et avant toute considération humanitaire à un besoin économique. En fait, la bourgeoisie coloniale manquait de force de travail du fait qu’une grande partie des hommes et des femmes en âge de travailler était constituée d’esclaves entre les mains de leurs maîtres locaux, étant entendu par ailleurs que la suppression de l’esclavage se fit en deux étapes.
Dans un premier temps, une loi datant d’avril 1818 interdisait seulement le commerce maritime du bois d’ébène et son transport vers l’Amérique, mais pas à l’intérieur des terres, c'est-à-dire, le marché restant libre pour les commerçants coloniaux. Cependant, on se rendit compte très vite que cela restait insuffisant pour remédier à la situation de pénurie de main-d’œuvre. Dès lors, le chef de la colonie décida d’y apporter sa contribution personnelle en demandant au chef du premier bataillon de lui fournir "des hommes de corvée sur les demandes qui lui seraient faites pour les diverses parties du service". Grâce à ces mesures, les autorités coloniales et les commerçants purent ainsi combler momentanément le manque de main-d’œuvre. De leur côté, les travailleurs disponibles prenaient conscience du profit qu’ils pouvaient tirer de la rareté de la main-d’œuvre en devenant de plus en plus exigeants vis-à-vis des employeurs. Et cela provoqua une nouvelle confrontation sur les prix de la main d'œuvre avec ces derniers, d’où une nouvelle intervention de l’autorité coloniale qui procéda à la "régulation" du marché en faveur des commerçants.
Dans un deuxième temps, en février 1821, le Ministère de la Marine et des colonies, tout en envisageant de recourir à une politique d’immigration active de la population d’origine européenne, ordonna la fin de l’esclavage sous "toutes ses formes".
En fait, une fois encore, pour les autorités coloniales, il s’agissait de trouver les bras nécessaires au développement de l’économie agricole :
"Il s’agissait(…) du rachat par le Gouverneur ou les particuliers d’individus maintenus en esclavage dans des contrées proches des possessions de l’Ouest-africain ; de leur affranchissement, par un acte authentique, à la condition qu’ils travaillent pour l’engagiste pendant un certain laps de temps. Ce serait (…) une sorte d’apprentissage à la liberté, familiarisant l’autochtone avec la civilisation européenne, lui donnant le goût des nouvelles cultures industrielles, tout en faisant diminuer le nombre des captifs. On obtient ainsi, (…) de la main-d’œuvre, tout en restant dans les vues humanitaires des abolitionnistes". (Thiam,. ibid)
Autrement dit, il s’agissait avant tout de "civiliser" pour mieux exploiter les "affranchis" et non point de les libérer au nom d’une vision humanitaire. D’ailleurs, comme cela ne suffisait pas, l’administration coloniale instaura, deux ans plus tard, en 1823, un "régime des engagés à temps", c'est-à-dire une sorte de contrat liant l’employé à l’employeur pour une longue durée.
"Les engagés à temps étaient utilisés pour une période pouvant aller jusqu’à quatorze ans dans les ateliers publics, dans l’administration, dans les plantations agricoles (ils étaient 300 sur 1500 utilisés par le baron Roger), dans les hôpitaux où ils servaient comme garçons de salle, infirmiers ou comme personnel domestique, dans la sécurité municipale, et dans l’armée ; rien que dans le Régiment d’Infanterie de Marine, on en dénombrait 72 en 1828, 115, quatre années après, 180 en 1842, tandis que le relevé des rachats en comptabilisait 1629 en 1835, 1768 en 1828, 2545, en 1839. A cette date la seule ville de Saint- Louis comptait environ 1600 engagés à temps". (Thiam, ibid.)
A ce propos, soulignons d’entrée l’existence formelle de contrats de travail de longue durée (14 ans) assimilable à un CDI (contrat à durée indéterminée) d’aujourd’hui. On voit là le besoin permanent de main-d’œuvre ouvrière correspondant au rythme du développement économique de la colonie. De même, le régime des engagés à temps avait été conçu dans le but d’accélérer la colonisation agricole et cette politique se traduisit réellement par un début de développement conséquent des forces productives et plus généralement de l’économie locale. Mais le bilan fut cependant très contrasté car, s’il permit un essor réel du mouvement commercial (import/export) qui passa de 2 millions de francs en 1818 à 14 millions en 1844, en revanche, la politique de l’industrialisation agricole fut un échec. En effet, le projet de développement de l’agriculture initié par le baron Roger fut abandonné (3 ans après son lancement) par les successeurs du baron en raison de divergences d’orientation économique au sein de l’Etat. Un autre facteur ayant pesé sur la décision d’annuler le projet de développement de l’agriculture fut le refus d’un grand nombre d’anciens cultivateurs, devenus employés salariés, de retourner à la terre. Cependant les deux volets de cette politique, à savoir, le rachat d’esclaves et le "régime des engagés", furent maintenus jusqu’en 1848, date du décret de leur suppression totale.
"Telle était la situation vers le milieu du XIXe siècle, une situation caractérisée par l’existence, désormais avérée, du travail salarié, apanage d’un prolétariat sans défense, et presque sans droit, qui, s’il connaît des formes primaires de concertation et de coalition, s’il avait donc une conscience pré-syndicale, n’avait jamais encore osé soutenir un conflit avec ses employeurs, servis par un gouvernement autoritaire". (Thiam. Ibid)
Voilà donc constituées les bases d'un prolétariat salarié, évoluant sous le régime du capitalisme moderne, précurseur de la classe ouvrière africaine et qui, désormais, va faire l’apprentissage de la lutte de classe au début de la deuxième moitié du 19e siècle.
Les premières formes embryonnaires de lutte de classe en 1855
L'émergence de la classe ouvrière
Selon les sources disponibles (Mar Fall, L’Etat et la Question Syndicale au Sénégal) 5,, il fallut attendre 1855 pour voir l’apparition d’une première organisation professionnelle en vue de la défense des intérêts spécifiques du prolétariat. Sa constitution fut consécutive à mouvement lancé par un charpentier autochtone (habitant Saint- Louis) qui se mit à la tête de 140 ouvriers pour rédiger une pétition contre les maîtres menuisiers européens qui leur imposaient des conditions de travail inacceptables. En effet :
"Les premiers artisans qui avaient entrepris les grands travaux coloniaux étaient des européens ou des militaires du génie auxquels on avait adjoint des auxiliaires et de la main-d’œuvre indigène. C’étaient des charpentiers, menuisiers, des maçons, des forgerons, des cordonniers. Constituant alors le personnel techniquement plus qualifié, bénéficiant, dans un certain nombre de cas, d’une instruction plus ou moins élémentaire, ils régnaient sur les corporations existantes dont ils constituaient l’élite dirigeante ; c’étaient eux, sans doute, qui décidaient des marchés, fixaient les prix, répartissaient la tâche, choisissaient les ouvriers qu’ils embauchaient et payaient à un tarif largement inférieur à celui qu’ils réclamaient aux employeurs".(Thiam.ibid)
Dans cette lutte, ce qui frappe d’abord, c’est de voir que la première expression de "lutte de classe" dans la colonie opposait deux fractions de la même classe (ouvrière) et non directement bourgeoisie et prolétariat. Autrement dit, une fraction ouvrière dite de base (dominée) en lutte contre une autre fraction ouvrière dite "élite dirigeante" (dominante). Un autre trait caractéristique de ce contexte est le fait que la classe exploiteuse était issue exclusivement de la bourgeoisie coloniale, faute de "bourgeoisie autochtone". Bref, on avait là une classe ouvrière en constitution sous un capitalisme colonial en développement. Dès lors on peut comprendre pourquoi la première expression de lutte ouvrière ne put éviter d’être marquée par une triple connotation "corporatiste", "ethnique" et "hiérarchique". C’est ce qu’illustre le cas du leader de ce groupe d’ouvriers indigènes, lui-même maître charpentier, à ce titre formateur de nombreux jeunes ouvriers en apprentissage auprès de lui, alors que dans le même temps il exerçait sous la dépendance tutélaire des maîtres-menuisiers européens qui décidaient de tout (cf. citation précédente).
Dans ce contexte, la décision du leader autochtone de se regrouper avec les ouvriers africains de base (moins qualifiés que lui) pour faire face à l’attitude arrogante des maîtres artisans occidentaux est compréhensible et peut être interprétée comme une réaction saine de défense d’intérêts prolétariens.
Par ailleurs, selon des sources (archives), ce même maître ouvrier indigène fut impliqué plus tard dans la constitution en 1885 du premier syndicat africain alors même que la loi de Jules Ferry de 1884, autorisant la création de syndicats, avait exclu son instauration dans les colonies. D’ailleurs, c’est pour cette raison que le syndicat des ouvriers indigènes dut exister et fonctionner clandestinement, d’où le peu d’information sur son histoire, comme l’indique le passage suivant :
"La série K 30 des Archives de la République du Sénégal renferme un document manuscrit, inédit, qui n’avait auparavant été cité dans aucune source, classé dans une chemise sur laquelle on a écrit : syndicat des charpentiers du Haut-Fleuve. Malheureusement cette pièce d’archives d’une importance capitale, pour l’histoire du mouvement syndical au Sénégal n’est accompagnée d’aucun autre document susceptible d’en éclairer la compréhension". (Thiam, ibid)
Donc, malgré l’interdiction de toutes formes d’organe d’expression prolétarienne et en dépit de la pratique systématique de la censure visant la vraie histoire du mouvement ouvrier dans les colonies, le constat a pu être fait de l’existence des premières organisations embryonnaires de lutte de classe, de type syndical. Certes, ce fut un "syndicat corporatiste", des charpentiers, mais de toute façon l’Etat capitaliste à cette époque interdisait tout regroupement interprofessionnel.
Voilà ce que les investigations dans les écrits relatifs à ce thème et cette période permettent de connaître aujourd’hui sur le mode d'expressions de lutte de la classe ouvrière sur cette période allant de 1855 à 1885.
Les luttes des immigrés sénégalais au Congo belge en 1890/1892
"Rappelons tout d’abord que lorsqu’intervint en 1848 la suppression du régime des engagés à temps, ce système, loin d’avoir complètement disparu, avait essayé de s’adapter à la nouvelle situation en se transformant progressivement. Mais cette solution ne parvint nullement à résoudre l’épineux problème de la main-d’œuvre.
Les milieux économiques coloniaux ne pouvant donc plus acheter des esclaves qu’ils feraient travailler servilement, et les plantations risquant d’être abandonnées faute de bras, poussèrent les dirigeants administratifs et les autorités politiques, à autoriser l’immigration des travailleurs africains récemment libérés vers des contrées où leurs services étaient appréciés, moyennant un salaire et des conditions discutés d’un commun accord avec les patrons. Pour donner suite à cette requête, le Gouverneur avait fait proclamer le décret du 27 mars 1852 réorganisant l’émigration des travailleurs dans les colonies ; c’est ainsi que le 3 juillet 1854, un navire dénommé "Les cinq frères" affrété pour assurer le transport de 3000 ouvriers destinés aux plantations de la Guyane avait jeté l’ancre à Dakar et pris des contacts en vue de l’embauche de 300 sénégalais. Les conditions fixées seraient les suivantes : "une expatriation de six ans contre un cadeau d’une valeur de 30 à 50 f, un salaire de 15 f par mois, le logement, la nourriture, les soins médicaux, la jouissance d’un petit jardin et le rapatriement gratuit à l’issue de leur séjour américain" ". (Thiam.ibid)
On voit là, avec le cas des 300 sénégalais destinés aux plantations d’Amérique (en Guyane), que la classe ouvrière existait réellement, au point de constituer une "main-d’œuvre de réserve", dans laquelle puisa la bourgeoisie pour en exporter une partie.
En effet, ayant fait preuve de compétence et d’efficacité par exemple en parvenant à achever (en 1885) les durs travaux du chemin de fer Dakar- Saint- Louis, les ouvriers de cette colonie française suscitèrent particulièrement l'intérêt des milieux économiques coloniaux, soit en tant que main-d’œuvre exploitable sur place, soit en qualité de force de travail exportables vers les concurrents extérieurs.
C’est dans ce même cadre et dans des conditions analogues que fut recruté et envoyé au Congo belge un grand nombre de travailleurs sénégalais pour exercer sur divers chantiers, notamment sur le chemin de fer congolais de Matadi.
Mais, dès leur arrivée sur place, les ouvriers immigrés se heurtèrent aux dures conditions de travail et d’existence, en constatant tout de suite que les autorités coloniales belges n’avaient aucune intention de respecter leur contrat. En effet, comme ils le signalaient, eux-mêmes, dans un courrier de protestation à l’adresse du Gouverneur du Sénégal, les ouvriers se disaient "mal nourris, mal logés, mal payés, malades mal soignés", ils mourraient comme des mouches et ils avaient l’impression que le choléra les frappait car "on enterrait 4 ou 5 personnes par jour". D’où la pétition de février 1892 adressée aux autorités coloniales franco-belges exigeant fermement leur rapatriement collectif au Sénégal, et conclue de la sorte : "Maintenant personne entre nous ne veux plus rester à Matadi".
Les ouvriers furent ainsi victimes d’une exploitation particulièrement odieuse de la part du capitalisme colonial qui leur imposa des conditions d’autant plus barbares que, pendant ce temps-là, les deux Etats coloniaux se renvoyaient la balle, ou fermaient carrément les yeux sur le sort des travailleurs immigrés :
"C’est ainsi qu’encouragées par l’impunité, les autorités belges ne firent rien pour améliorer le sort des malheureux protestataires. La distance qui séparait le Congo belge du Sénégal, la querelle de préséance qui empêchait le représentant du Gouvernement français dans la région d’intercéder en leur faveur, les complicités dont bénéficiait la compagnie de chemin de fer du Bas Congo au niveau de la rue Oudinot (cf. Ministère des colonies), le cynisme de certains milieux coloniaux que les malheurs des pauvres sénégalais amusaient, exposèrent les ouvriers sénégalais à un abandon presque total, et en faisaient une main-d’œuvre à demi-désarmée, sans véritable moyen de défense, taillable et corvéable, dès lors, à merci".(Thiam, ibid)
Toujours est-il que, par leur combativité, en refusant de travailler dans les conditions que l’on sait et en exigeant fermement leur évacuation du Congo, les immigrés de la colonie française obtinrent satisfaction. Aussi, dès leur retour au pays, ils purent compter sur le soutien de la population et de leurs camarades ouvriers, en obligeant ainsi le Gouverneur à engager des nouvelles réformes en vue de la protection des travailleurs, à commencer par l’instauration d’une nouvelle réglementation de l’émigration. En effet, le drame subi au Congo par les immigrés avait suscité débats et prise de conscience par rapport à la condition ouvrière. Ce fut dans ce cadre, entre 1892 et 1912, que toute une série de mesures furent prises en faveur des salariés, par exemple, le repos hebdomadaire, les retraites ouvrières, l’assistance médicale, bref de vraies réformes.
Par ailleurs, en s’appuyant sur leur "expérience congolaise", les anciens immigrés se firent particulièrement remarquer lors d’une nouvelle opération de recrutement pour de nouveaux chantiers du chemin de fer du Sénégal en se montrant très exigeants sur les conditions de travail. Dans ce sens, ils décidèrent de créer, en 1907, une association professionnelle dénommée "Association des ouvriers de Kayes" en vue de mieux défendre leurs conditions de travail et de vie face à l’appétit des charognards capitalistes. Et l’autorité coloniale, tenant compte du rapport de force d’alors qui était en train de lui échapper, accepta de légaliser l’association des cheminots.
En fait, la naissance de ce regroupement au sein des cheminots n’étonne guère quand on sait que, depuis l’ouverture du réseau (1885), ce secteur était devenu l’un des complexes industriels parmi les plus importants de la colonie, à la fois par son chiffre d’affaires et le nombre de ses employés. De même, on verra plus loin que les ouvriers du chemin de fer seront de tous les combats de la classe ouvrière de l’AOF.
Plus généralement, la période qui suit le retour des immigrés au pays (entre 1892 et 1913) fut marquée par une forte agitation sociale, notamment dans la fonction publique où les commis et les travailleurs des PTT protestaient contre la dégradation de leurs conditions de travail et les bas salaires. Dans ce cadre, les fonctionnaires et assimilés décidèrent de créer leurs propres associations pour se défendre par "tous les moyens à leur disposition", suivis aussitôt par les employés de commerce qui en profitèrent pour demander l’application dans leur secteur de la loi sur le repos hebdomadaire. Bref, on assistait à un bouillonnement de combativité chez les salariés du privé comme du public d’où l’inquiétude grandissante des autorités coloniales. En effet, non seulement, les problèmes sociaux brûlants ne purent être réglés à la fin de 1913, mais culminèrent avec le contexte de crise résultant de la Première Guerre mondiale.
Lassou (à suivre)
1 Henri Wesseling, Le partage de l’Afrique, 1991, Editions Denoel, 1996, pour la traduction française.
2 M. Agier, J. Copans et A. Morice, Classes ouvrières d’Afrique noire, Karthala- ORSTOM, 1987
3 Histoire du Mouvement syndical africain 1790-1929, Editions L’Harmattan, 1991
4 Euphémisme utilisé par les négriers pour désigner les esclaves noirs déportés aux Amériques. Source Wikipédia.
5 L'Harmattan, Paris, 1989
Géographique:
- Afrique [18]
Qu'est-ce que les conseils ouvriers (V) : 1917-21 : les soviets face à la question de l'Etat
- 2235 lectures
Dans l’article précédent [24] de cette série (Revue internationale n° 143), nous avons vu comment les soviets, qui avaient pris le pouvoir en Octobre 1917, le perdirent progressivement au point de ne plus être qu’une façade, maintenue en vie artificiellement pour occulter le triomphe de la contre-révolution capitaliste qui s’était instaurée en Russie. Le but de cet article est de comprendre les causes de ce processus et de tirer les leçons qui sont indispensables aux futures tentatives révolutionnaires.
La nature de l’État qui naît de la révolution
Marx et Engels, analysant la Commune de Paris de 1871, tirèrent quelques leçons sur la question de l’État que nous pouvons brièvement résumer : 1) Il est nécessaire de détruire l’appareil d’État bourgeois de fond en comble ; 2) au lendemain de la révolution, l’État se reconstitue, pour deux raisons principales : a) la bourgeoisie n’a pas encore été complètement défaite et éradiquée ; b) dans la société de transition subsistent encore des classes non exploiteuses (petite bourgeoisie, paysannerie, marginaux urbains…), dont les intérêts ne coïncident pas avec ceux du prolétariat.
Cet article n’a pas pour but d’analyser la nature de ce nouvel État (1), néanmoins, pour éclairer le sujet que nous traitons, nous devons mettre en évidence que si ce nouvel État n’est pas identique à ceux qui l’ont précédé dans l’histoire, il garde cependant des caractéristiques qui constituent un obstacle pour le développement de la révolution ; c’est bien pour cela que, comme Engels l’avait déjà signalé et comme insistait Lénine dans l’État et la Révolution, le prolétariat doit commencer un processus d’extinction du nouvel État le jour même de la révolution.
Après la prise du pouvoir, le principal obstacle sur lequel trébuchèrent les soviets en Russie fut l’État qui en était issu. Celui-ci "malgré l'apparence de sa plus grande puissance matérielle, (…) est mille fois plus vulnérable à l'ennemi que les autres organismes ouvriers. En effet, l'État doit sa plus grande puissance matérielle à des facteurs objectifs qui correspondent parfaitement aux intérêts des classes exploiteuses mais ne peuvent avoir aucun rapport avec la fonction révolutionnaire du prolétariat" (2), "La menace redoutable d’un retour au capitalisme se trouvera essentiellement dans le secteur étatisé. Cela d’autant plus que le capitalisme se trouve ici sous sa forme impersonnelle pour ainsi dire éthérée. L’étatisation peut servir à camoufler longtemps un processus opposé au socialisme" (3).
Dans l’article précédent, nous avons décrit les faits qui favorisèrent l’affaiblissement des soviets: la guerre civile, la famine, le chaos général de l’économie dans son ensemble, l’épuisement et la décomposition progressive de la clase ouvrière, etc. La "conspiration silencieuse" de l’État soviétique, qui participa aussi de l'affaiblissement des soviets, est intervenue selon trois axes : 1) le poids croissant que prenaient les institutions par excellence étatiques : l’armée, la Tcheka (la police politique) et les syndicats ; 2) "l’interclassisme" des soviets et la bureaucratisation accélérée qui en résultait ; 3) l’absorption progressive du Parti bolchevique par l'État. Nous avons abordé le premier point dans l’article précédent, cet article est consacré aux deux derniers.
L’irrésistible renforcement de l’État
L’État des soviets excluait la bourgeoisie mais n’était pas l’État exclusif du prolétariat. Il comprenait des classes sociales non exploiteuses comme la paysannerie, la petite-bourgeoisie, les diverses couches moyennes. Ces classes tendent à préserver leurs petits intérêts et posent inévitablement des obstacles à la marche vers le communisme. Cet "interclassisme" inévitable pousse le nouvel État, comme le dénonça l’Opposition ouvrière 4 en 1921, à ce que "la politique soviétique pousse dans plusieurs directions et que sa configuration par rapport à la classe soit défigurée",et à ce que se constitue le terreau de la bureaucratie étatique.
Peu de temps après Octobre, les anciens fonctionnaires tsaristes commençaient à occuper des postes dans les institutions soviétiques, en particulier lorsqu'il fallait prendre des décisions improvisées face aux problèmes qui se présentaient. Ainsi, par exemple, face à l’impossibilité d’organiser l’approvisionnement de produits de première nécessité en février 1918, le Commissariat du peuple dut recourir à l’aide des commissions qui avaient été mises en place par l’ancien Gouvernement provisoire. Leurs membres acceptèrent à condition de ne dépendre d’aucun bolchevik, ce que ces derniers acceptèrent. De façon similaire, la réorganisation du système éducatif en 1918-19 dut se faire en recourant à d’anciens fonctionnaires tsaristes qui finirent par altérer progressivement les programmes d’enseignement proposés.
En outre, les meilleurs éléments prolétariens se convertissaient progressivement en bureaucrates éloignés des masses. Les impératifs de la guerre absorbèrent de nombreux cadres ouvriers aux tâches de commissaires politiques, inspecteurs ou chefs militaires. Les ouvriers les plus capables devinrent des cadres de l’administration économique. Les anciens bureaucrates impériaux et les nouveaux-venus d’origine prolétarienne formèrent une couche bureaucratique qui s’identifiait à l’État. Mais cet organe a sa propre logique, et ses chants de sirène parvinrent à séduire des révolutionnaires aussi expérimentés que Lénine et Trotski.
Les anciens fonctionnaires provenant des élites bourgeoises étaient les porteurs de cette logique, et ils pénétrèrent dans la forteresse soviétique par la porte que leur ouvrait le nouvel État : "des milliers d’individus, plus ou moins intimement liés à la bourgeoisie expropriée, par des liens routiniers et culturels, recommencèrent à jouer un rôle (…) fusionnés avec la nouvelle élite politico-administrative, dont le noyau était le Parti lui-même, les secteurs les plus "ouverts" et les plus capables techniquement de la classe expropriée, ne tardèrent pas à revenir à des positions dominantes" (5). Ces individus, comme le signale l'historien soviétique Kritsman, "dans leur travail administratif, faisaient preuve de désinvolture et d'hostilité envers le public" 6
Mais le danger principal venait de l’engrenage étatique lui-même, avec le poids croissant mais imperceptible de son inertie. Comme conséquence de cela, même les fonctionnaires les plus dévoués tendaient à se séparer des masses, à se méfier d’elles, adoptant des méthodes expéditives, imposant sans écouter, expédiant les affaires qui concernaient des milliers de personnes comme de simples questions administratives, gouvernant à coups de décrets. "En laissant de côté ses tâches de destruction pour celles d’administration, le Parti découvre les vertus de la loi, de l’ordre et de la soumission à la juste autorité du pouvoir révolutionnaire" (7).
La logique bureaucratique de l’État va comme un gant à la bourgeoisie, qui est une clase exploiteuse et peut tranquillement déléguer l’exercice du pouvoir à un corps spécialisé de politiciens et de fonctionnaires professionnels. Mais elle est fatale au prolétariat qui ne peut à aucun moment l’abandonner à de tels spécialistes, qui doit apprendre par lui-même, commettre des erreurs et les corriger, qui non seulement prend des décisions et les applique mais en outre, ce faisant, se transforme lui-même. La logique du pouvoir du prolétariat n’est pas dans la délégation de ce pouvoir mais dans la participation directe à la prise en charge de celui-ci.
La révolution en Russie se trouva face à un dilemme en avril 1918 : la révolution mondiale n’avançait pas et l’invasion impérialiste menaçait d’écraser le bastion soviétique. Le pays entier sombrait dans le chaos, "l’organisation administrative et économique déclinait dans des proportions alarmantes. Le danger ne venait pas tant de la résistance organisée que de l’effondrement de toute autorité. L’appel à détruire l’organisation étatique bourgeoise de l’État et la Révolution devenait singulièrement anachronique maintenant que cette partie du programme révolutionnaire avait triomphé au-delà des espérances" (8).
L’État soviétique se confrontait à des questions dramatiques : mettre sur pieds l’Armée rouge dans la précipitation, organiser les transports, relancer la production, assurer l’approvisionnement alimentaire des villes affamées, organiser la vie sociale. Tout ceci devait se résoudre malgré le sabotage total des entrepreneurs et des managers, ce qui poussa à la confiscation généralisée d’industries, de banques, de commerces, etc. C’était un défi supplémentaire lancé au pouvoir soviétique. Un débat passionné anima alors le Parti et les soviets. Tout le monde était d’accord pour résister militairement et économiquement jusqu’à l’explosion de la révolution prolétarienne dans d’autres pays et principalement en Allemagne. La divergence portait sur la façon d’organiser la résistance : à partir de l’État en renforçant ses mécanismes ou en développant l’organisation et les capacités des masses ouvrières ? Lénine prit la tête de ceux qui défendaient la première solution alors que certaines tendances de gauche du Parti bolchevique incarnaient la seconde.
Dans la brochure Les tâches immédiates du pouvoir soviétique, Lénine "défend que la première tâche à laquelle la révolution devait faire face (…) était celle de (…) reconstruire une économie ruinée, d'imposer une discipline du travail et de développer la productivité, d'assurer un rapport et un contrôle strict du processus de production et de distribution, d'éliminer la corruption et le gaspillage et, peut-être plus que tout, de lutter contre la mentalité petite-bourgeoise (…) Il n'hésite pas à utiliser ce qu'il traitait lui-même de méthodes bourgeoises, y compris l'utilisation de spécialistes techniques bourgeois (…), le recours au travail aux pièces ; l'adoption du "système de Taylor" (…) Il a donc appelé à la 'direction d'un seul homme'" (9).
Pourquoi Lénine défendit-il cette orientation ? La première raison était l’inexpérience : le pouvoir soviétique s’affrontait en effet à des tâches gigantesques et urgentes sans recours possible à une quelconque expérience et sans qu'une réflexion théorique préalable ait pu être menée sur ces questions. La seconde raison était la situation désespérée et insoutenable que nous avons décrite. Mais nous devons aussi considérer que Lénine était à son tour victime de la logique étatique et bureaucratique, se convertissant peu à peu en son interprète. Cette logique le poussait à faire confiance aux vieux techniciens, administrateurs et fonctionnaires formés dans le capitalisme et, par ailleurs, aux syndicats chargés de discipliner les ouvriers, de réprimer leurs initiatives et leur mobilisation indépendante, les liant à la division capitaliste du travail et à la mentalité corporatiste et étroite qu’elle suppose.
Les adversaires de gauche dénonçaient cette conception selon laquelle "La forme du contrôle de l'État sur les entreprises doit se développer dans la direction de la centralisation bureaucratique, de la domination de différents commissaires, de la privation d'indépendance des soviets locaux et du rejet dans la pratique du type d’"État-Commune" dirigé par en bas (...) L'introduction de la discipline du travail en lien avec la restauration de la direction capitaliste dans la production ne peut pas accroître fondamentalement la productivité du travail, mais elle affaiblira l'autonomie de classe, l'activité et le degré d'organisation du prolétariat" (10).
L’Opposition ouvrière dénonçait : "au vu de l’état catastrophique de notre économie, qui repose encore sur le système capitaliste (salaire payé avec de l’argent, tarifs, catégories de travail, etc.), les élites de notre Parti, se méfiant de la capacité créatrice des travailleurs, cherchent le salut au chaos économique dans les héritiers du capitaliste bourgeois passé, à travers des hommes d’affaires et des techniciens dont la capacité créatrice est corrompue sur le terrain de l’économie par la routine, les habitudes et les méthodes de production et de direction du mode capitaliste" (11).
Loin d’avancer sur la voie de son extinction, l’État se renforçait de façon alarmante : "Un professeur "blanc" qui arriva à Omsk venant de Moscou en automne 1919 racontait qu’à la tête de plusieurs centres et des glavski se trouvaient les anciens patrons, fonctionnaires et directeurs. Quiconque connaît personnellement le vieux monde des affaires sera surpris, en visitant les centres, de retrouver dans les Glavkoh les anciens propriétaires des grandes industries de la peau et, dans les organisations centrales du textile, les grands fabricants." (12) En mars 1919, pendant le débat du Soviet de Petrograd, Lénine reconnût : "Nous avons chassé les anciens bureaucrates, mais ils sont revenus avec la fausse étiquette de communistes ; ils arborent un ruban rouge à la boutonnière et cherchent une sinécure" (13).
La croissance de la bureaucratie soviétique finit par écraser les soviets. Elle comptait 114 259 employés en juin 1918, 529 841 un an plus tard, et 5 820 000 en décembre 1920 ! La raison d’État s’imposait implacablement à la raison du combat révolutionnaire pour le communisme, "les considérations étatiques de caractère général commencèrent à sourdre face aux intérêts de classe des travailleurs" (14).
L’absorption du Parti bolchevique par l’État
Le renforcement de l’État entraîna l’absorption du Parti bolchevique. Celui-ci a priori n'envisageait pas de se convertir en parti étatique. Selon les chiffres de février 1918, le Comité central des bolcheviks ne comptait que six employés administratifs contre 65 pour le Conseil des Commissaires, les soviets de Petrograd et de Moscou en comptant plus de 200. "Les organisations bolcheviques dépendaient financièrement de l'aide que leur apportaient les institutions soviétiques locales et, dans l'ensemble, leur dépendance était compète. Il arriva même que des bolcheviks en vue – comme ce fut le cas de Preobrajensky – suggérassent devant le nouvel état des choses, que le parti acceptât de se dissoudre complètement pour se fondre dans l'appareil soviétique". L’anarchiste Leonard Schapiro reconnaît que "les meilleurs cadres du parti s'étaient intégrés dans l'appareil, central et local, des soviets". Beaucoup de bolcheviks considéraient que "les comités locaux du parti bolchevique n'étaient rien de plus que les sections de propagande des soviets locaux" (15). Les bolcheviks eurent même des doutes sur leur compétence pour exercer le pouvoir à la tête des soviets. "Au lendemain de l'insurrection d'octobre, quand le personnel du gouvernement soviétique s'est formé, Lénine a eu une hésitation avant d'accepter le poste de président du soviet des commissaires du peuple. Son intuition politique lui disait que cela freinerait sa capacité à agir comme avant-garde de l'avant-garde, à être à la gauche du parti révolutionnaire comme il l'avait si clairement été entre avril et octobre 1917" (16). Lénine craignait, non sans raisons, que si le parti et ses membres les plus avancés se mobilisent au jour le jour dans le gouvernement soviétique, ils ne finissent attrapés dans ses engrenages et perdent de vue les objectifs globaux du mouvement prolétarien qui ne peuvent être liés aux contingences quotidiennes de la gestion étatique (17).
Les bolcheviks ne recherchaient pas non plus le monopole du pouvoir, partageant le premier Conseil des Commissaires du peuple avec les Socialistes-révolutionnaires de gauche. Certaines délibérations de ce Conseil furent même ouvertes à des délégués mencheviques internationalistes et à des anarchistes.
Le gouvernement ne devient définitivement bolchevique qu’à partir de juillet 1918, date du soulèvement des socialistes-révolutionnaires de gauche opposés à la création de Comités de paysans pauvres : "Le 6 juillet, deux jeunes tchékistes membres du Parti s.r. de gauche et pièces maîtresses de la conspiration, A. Andreiev et Ia. G. Blumkine, se présentaient à l'ambassade d'Allemagne munis de documents officiels attestant de leur qualité et de leur mission. Admis dans le bureau de l'ambassadeur, le comte von Mirbach, ils l'abattirent et prirent la fuite. Dans la foulée, un détachement de tchékistes commandés par un s.r. de gauche, Popov, procéda par surprise à plusieurs arrestations, dont celles des dirigeants de la Tcheka, Dzejinski et Latsis, du président du soviet de Moscou, Smidovitch, et du commissaire du peuple aux Postes, Podbielsky. Il s'empara aussi des locaux centraux de la Tcheka et du bâtiment central des Postes" (18).
Comme conséquence de ceci, le Parti se voit alors envahi par toute sorte d’opportunistes et d’arrivistes, d’anciens fonctionnaires tsaristes ou de dirigeants mencheviques reconvertis. Noguine, un vieux bolchevik, "avait exprimé l'horreur que lui inspiraient l'ivrognerie, la débauche, la corruption, les cas de vol et le comportement irresponsable que l'on rencontrait parmi beaucoup de permanents du parti. Vraiment, ajoutait-il, les cheveux se dressent sur la tête" (19). En mars 1918, devant le Congrès du Parti, Zinoviev raconta l’anecdote de ce militant qui, recevant un nouvel adhérent, lui dit de revenir le lendemain retirer sa carte de membre ; celui-ci lui répondit que "non, camarade, j’en ai besoin de suite pour obtenir une place au bureau".
Comme le signale Marcel Liebman, "Si tant d'hommes qui n'avaient de communiste que le nom tentaient de pénétrer les rangs du parti, c'est que celui-ci était devenu le centre du pouvoir, l'institution la plus influente de la vie sociale et politique, celle qui réunissait la nouvelle élite, sélectionnait les cadres et les dirigeants et constituait l'instrument et le canal de l'ascension sociale et de la réussite" ; et il ajoute que "les privilèges des cadres moyens et subalternes soulevaient des protestations dans les rangs du parti" (20), alors que tout ceci est normal et courant dans un parti bourgeois.
Le Parti tenta alors de combattre cette vague en réalisant de nombreuses campagnes d’épuration. Mais ce ne pouvait être que des mesures impuissantes puisqu’elles ne s’attaquaient pas à la racine du problème dans la mesure où la fusion du Parti et de l’État se renforçait inexorablement. Ce danger en contenait un autre, parallèle, l’identification du Parti avec la nation russe. En effet, le Parti prolétarien est international et sa section dans un ou plusieurs pays où le prolétariat occupe un bastion avancé ne peut en aucun cas s’identifier avec la nation, mais uniquement et exclusivement avec la révolution mondiale.
La transformation du bolchevisme en un parti-État finit par être théorisée par la thèse selon laquelle le Parti exerce le pouvoir au nom de la classe, la dictature du prolétariat étant la dictature du parti (21), ce qui le désarma théoriquement et politiquement, achevant de le précipiter dans les bras de l’État. Dans une de ses résolutions, le 8e Congrès du Parti (mars 1919) accorde que le Parti doit "s’assurer la domination politique complète au sein des soviets et le contrôle pratique de toutes leurs activités" (22). Cette résolution se concrétise les mois suivants par la formation de cellules du Parti dans tous les soviets pour les contrôler. Kamenev proclama que "le Parti communiste est le gouvernement de Russie. Ce sont ses 600 000 membres qui gouvernent le pays" (23). La cerise sur le gâteau fut apportée par Zinoviev au cours du 2e Congrès de l’Internationale communiste (1920) qui déclara que "tout ouvrier conscient doit comprendre que la dictature de la classe ouvrière ne peut être réalisée que par la dictature de son avant-garde, c’est-à-dire par le Parti communiste" 24 et par Trotski au Xe Congrès du Parti (1921), qui affirma, en réponse à l’Opposition ouvrière : "Comme si le parti n'avait pas le droit d'affirmer sa dictature même si celle-ci heurte momentanément l'humeur velléitaire de la Démocratie ouvrière ! Le parti a le droit de maintenir sa dictature sans tenir compte des vacillations passagères de la classe ouvrière. La dictature n'est pas fondée à chaque instant sur le principe formel de la démocratie ouvrière" (25).
Le parti bolchevique fut perdu en tant qu’avant-garde du prolétariat. Ce n’était plus lui qui utilisait l’État au bénéfice du prolétariat, mais l’État qui fit du parti son bélier contre le prolétariat. Comme le dénonça la Plate-forme des Quinze, groupe d’opposition qui surgit au sein du Parti bolchevique au début de 1920, "La bureaucratisation du parti, la dégénérescence de ses éléments dirigeants, la fusion de l'appareil du parti avec l'appareil bureaucratique du gouvernement, la perte d'influence de la partie prolétarienne du parti, l'introduction de l'appareil gouvernemental dans les luttes intérieures du parti -tout cela montre que le comité central a déjà dépassé dans sa politique les limites du bâillonnement du parti et commence la liquidation- et la transformation de ce dernier en un appareil auxiliaire de l'État. L'exécution de cette liquidation du parti signifierait la fin de la dictature prolétarienne dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Le parti est l'avant-garde et l'arme essentielle dans la lutte de la classe prolétarienne. Sans cela, ni sa victoire, ni le maintien de la dictature prolétarienne ne sont possibles." 26.
La nécessité de l’organisation autonome du prolétariat face à l’État transitoire
Comment le prolétariat pouvait-il en Russie renverser le rapport de forces, revitaliser les soviets, mettre un frein à l’État surgi après la révolution, ouvrir la voie à son extinction effective et avancer dans le processus révolutionnaire mondial vers le communisme ?
Cette question ne pouvait se résoudre que par le développement de la révolution mondiale. "En Russie, le problème ne pouvait être que posé" (27). "Il était évident qu'il est bien plus difficile de commencer la révolution en Europe et bien plus facile de la commencer chez nous, mais qu'ici il sera plus difficile de la continuer" (28).
Dans le cadre de la lutte pour la révolution mondiale, il y avait en Russie deux tâches concrètes : récupérer le parti pour le prolétariat en l’arrachant aux griffes de l’État et s’organiser en conseils ouvriers capables de redresser les soviets. Nous ne traiterons ici que ce dernier point.
Le prolétariat doit s’organiser indépendamment de l’État transitoire et exercer sur lui sa dictature. Ceci peut passer pour une stupidité pour ceux qui s’en tiennent aux formules faciles et propres du syllogisme selon lesquelles le prolétariat est la classe dominante et l’État ne peut être que son organe le plus fidèle. Dans l’État et la Révolution, revenant sur la Critique du Programme de Gotha faite par Marx en 1875, Lénine écrit :
"Dans sa première phase, à son premier degré, le communisme ne peut pas encore, au point de vue économique, être complètement mûr, complètement affranchi des traditions ou des vestiges du capitalisme. De là, ce phénomène intéressant qu'est le maintien de l''horizon borné du droit bourgeois', en régime communiste, dans la première phase de celui-ci. Certes, le droit bourgeois, en ce qui concerne la répartition des objets de consommation, suppose nécessairement un État bourgeois, car le droit n'est rien sans un appareil capable de contraindre à l'observation de ses normes.
Il s'ensuit qu'en régime communiste subsistent pendant un certain temps non seulement le droit bourgeois, mais aussi l'État bourgeois – sans bourgeoisie !" (29).
L’État de la période de transition au communisme (30) est un "État bourgeois sans bourgeoisie" (31) ou, pour parler plus précisément, est un État qui conserve des traits profonds de la société de classes et de l’exploitation : subsistent encore le droit bourgeois (32), la loi de la valeur, l’influence spirituelle et morale du capitalisme, etc. La société de transition rappelle encore par beaucoup d’aspects la vieille société, mais elle a subi un changement fondamental qui est précisément ce qu’il faut conserver à tout prix car c’est la seule chose qui puisse amener au communisme : l’activité massive, consciente et organisée de la grande majorité de la classe ouvrière, son organisation en classe politiquement dominante, la dictature du prolétariat.
L'expérience tragique de la Révolution russe montre que l’organisation du prolétariat en classe dominante ne peut être réalisée à travers l’État transitoire (l'État des soviets), "la classe ouvrière elle-même en tant que classe, considérée unitairement et non comme unité sociale diffuse, avec des nécessités de classe unitaires et semblables, avec des tâches et des intérêts univoques et une politique semblable, conséquente, formulée de façon claire et nette, joue un rôle politique de moins en moins important dans la République des soviets" (33).
Les soviets étaient l’État-Commune dont parlait Engels comme association politique des classes populaires. Cet État-Commune joue un rôle indispensable dans la répression de la bourgeoisie, dans la guerre défensive contre l’impérialisme et dans le maintien d’un minimum de cohésion sociale, mais n’a pas et ne peut avoir comme horizon la lutte pour le communisme. Marx l’avait déjà entrevu. Dans son ébauche de la Guerre civile en France, il argumentait : "...la Commune n'est pas le mouvement social de la classe ouvrière, et, par suite, le mouvement régénérateur de toute l'humanité, mais seulement le moyen organique de son action. La Commune ne supprime pas les luttes de classes, par lesquelles la classe ouvrière s'efforce d'abolir toutes les classes, et par suite toute domination de classe..." (34). De plus, L'histoire de la Commune de Paris de Lissagaray en particulier "contient beaucoup de critiques des hésitations, confusions et, dans certains cas, des positions creuses de certains délégués au Conseil de la Commune dont beaucoup incarnaient, en fait, un radicalisme petit-bourgeois obsolète qui était fréquemment mis en question par les assemblées des quartiers plus prolétariens. Un des clubs révolutionnaires locaux au moins déclara qu'il fallait dissoudre la Commune parce qu'elle n'était pas assez révolutionnaire !" 35
"l'État est entre nos mains ; eh bien sur le plan de la Nouvelle Politique économique, a-t-il fonctionné comme nous l'entendions ? Non. Nous ne voulons pas l'avouer : l'État n'a pas fonctionné comme nous l'entendions. Et comment a-t-il fonctionné ? La voiture n'obéit pas : un homme est bien au volant, qui semble la diriger, mais la voiture ne roule pas dans la direction voulue ; elle va où la pousse une autre force, -force illégale, force illicite …" (36).
Pour résoudre ce problème, le Parti bolchevique appliqua une série de mesures. D’un côté, la Constitution soviétique adoptée en 1918 estima que "Le Congrès panrusse des Soviets est formé de représentants des Soviets locaux, les villes étant représentées par 1 député pour chaque 25 000 habitants et les campagnes par 1 député pour chaque 125 000. Cet article consacre l'hégémonie du prolétariat sur les ruraux" (37), et d’un autre, le Programme du Parti bolchevique, adopté en 1919, préconisait que "1) Chaque membre du soviet doit assumer un travail administratif ; 2) Il doit y avoir une rotation continue des postes, chaque membre du soviet doit acquérir de l'expérience dans les différentes branches de l'administration. Progressivement, l'ensemble de la classe ouvrière doit être incité à participer dans les services administratifs". 38
Ces mesures étaient inspirées des leçons de la Commune de Paris. Elles étaient destinées à limiter les privilèges et prérogatives des fonctionnaires étatiques mais, pour qu'elles soient effectives et efficaces, seul le prolétariat organisé de façon autonome en conseils ouvriers indépendants de l’État (39) était qualifié pour les faire appliquer .
Le marxisme est une théorie vivante, qui a besoin de réaliser, à partir des faits historiques, des rectifications et de nouveaux approfondissements. Tirant les leçons léguées par Marx et Engels sur la Commune de Paris de 1871, les bolcheviks comprirent que l’État-Commune, qui devait aller vers l'extinction, est l’expression des soviets. Mais ils l’avaient en même temps identifié de façon erronée comme un État prolétarien (40), croyant que son extinction pourrait se réaliser de l’intérieur (41). L’expérience de la Révolution russe démontre l’impossibilité pour l’État de s'éteindre de lui-même et rend nécessaire de distinguer les conseils ouvriers et les soviets, les premiers étant le siège de l’authentique organisation autonome du prolétariat qui doit exercer sa dictature de classe sur l’État-Commune transitoire représenté par les seconds.
Après la prise du pouvoir par les soviets, le prolétariat devait conserver et développer ses propres organisations qui agissaient de façon indépendante dans les soviets : la Garde rouge, les conseils d’usine, les conseils de quartier, les sections ouvrières des soviets, les assemblées générales.
Les conseils d’usine, cœur de l'organisation de la classe ouvrière
Nous avons déjà vu que les conseils d'usine avaient joué un rôle décisif lors de la crise des soviets en juillet (42), et comment ils les avaient délivrés de la mainmise de la bourgeoisie, leur permettant d'assumer leur rôle d'organes de l’insurrection d’Octobre (43). En mai 1917, la Conférence des Conseils d’usine de Jarkov (Ukraine) avait réclamé que ceux-ci "se convertissent en organes de la révolution dédiés à consolider ses victoires" (44). Entre le 7 et le 12 octobre, une Conférence des Conseils d’usine de Petrograd décida de créer un Conseil central des Conseils d’usine qui prit le nom de Section ouvrière du Soviet de Petrograd, coordonna immédiatement toutes les organisations soviétiques de base et intervint activement dans la politique du Soviet, la radicalisant progressivement. Dans son ouvrage les Syndicats soviétiques, Deutscher reconnaît que "les instruments les plus puissants et redoutables de subversion étaient les conseils d’usine et non les syndicats" (45).
Avec les autres organisations de base émanant directement et organiquement de la classe ouvrière, les conseils d’usine exprimaient beaucoup plus naturellement et authentiquement que les soviets les pensées, les tendances, les avancées de la classe ouvrière, maintenant avec elle une profonde symbiose.
Durant la période de transition au communisme, le prolétariat n'acquiert en rien un statut de classe dominante sur le plan économique. C'est la raison pour laquelle, contrairement à la bourgeoisie sous le capitalisme, il ne peut déléguer le pouvoir à une structure institutionnelle, en l'occurrence à un État. De plus, celui-ci, malgré ses particularités d'État-commune, ne présente néanmoins pas les intérêts spécifiques de la classe ouvrière, déterminés par la transformation révolutionnaire du monde, mais celui de l'ensemble des couches non exploiteuses. Enfin, l'inéluctable tendance bureaucratique de l'État tend à autonomiser cet organe par rapport aux masses et à leur imposer sa domination. C'est pourquoi, la dictature du prolétariat ne peut venir d’un organe étatique mais d’une force de combat, de débats et de mobilisation permanente, d'un organe qui, à la fois, assure l'autonomie de classe du prolétariat, reflète les besoins des masses ouvrières et permet leur transformation dans l'action et la discussion.
Nous avons montré dans le quatrième article de cette série comment, après la prise de pouvoir, les organisations soviétiques de base et instruments de lutte de la classe ouvrière disparurent progressivement. Ce fut un épisode tragique qui affaiblit le prolétariat et accéléra le processus de décomposition sociale dont il souffrait.
La Garde rouge, venue au monde de façon éphémère en 1905, ressurgit en février sous l’impulsion et le contrôle des conseils d’usine, parvenant à mobiliser quelques 100 000 membres. Elle se maintint active jusque vers le milieu de 1918, mais la guerre civile la plongea dans une grave crise. La puissance énormément supérieure des armées impérialistes mit en évidence l’incapacité de la Garde rouge à faire front. Les unités du sud de la Russie, commandées par Antonov Ovseenko, opposèrent une résistance héroïque mais furent balayées et défaites. Victimes de la peur de la centralisation, les unités qui tentèrent de rester opérationnelles manquaient des fournitures les plus élémentaires, des cartouches par exemple. C’était surtout une milice urbaine, avec une instruction et un armement limités, sans expérience d’organisation, qui pouvait tout au plus fonctionner comme unités d’urgence ou comme auxiliaire d’une armée organisée, mais incapable de livrer une guerre en bonne et due forme. Les nécessités du moment rendirent nécessaire la constitution en toute urgence d’une Armée rouge avec toute la rigide structure militaire requise (46). Celle-ci absorba de nombreuses unités de la Garde rouge qui se sont dissoutes en tant que telles. Il y eut des tentatives de reconstituer la Garde rouge jusqu’en 1919, certains soviets offrirent la collaboration de leurs unités avec l’Armée rouge mais celle-ci les rejeta systématiquement quand elle ne les dissolvait pas par la force.
La disparition de la Garde rouge rendit à l’État soviétique une des prérogatives classiques de l’État, le monopole des armes, ce qui ôta au prolétariat une grande partie des moyens de sa défense puisqu’il ne disposait plus de force militaire qui lui soit propre.
Les conseils de quartier disparurent fin 1919. Ils intégraient dans l’organisation prolétarienne les travailleurs des petites entreprises et des commerces, les chômeurs, les jeunes, les retraités, les familles qui faisaient partie de la classe ouvrière comme un tout. C’était aussi un moyen essentiel pour œuvrer progressivement à diffuser la pensée et l’action prolétarienne au sein des couches de marginaux urbains, aux artisans, aux petits paysans, etc.
La disparition des conseils d’usine fut un coup décisif. Comme nous l’avons vu dans le quatrième article de la série, elle fut rapide et ils avaient cessé d’exister fin 1918. Les syndicats eurent un rôle décisif dans leur destruction.
Le conflit se déclara clairement lors d’une tumultueuse Conférence panrusse des conseils d’usine, célébrée la veille de la Révolution d’Octobre. Pendant les débats s’affirma l'idée selon laquelle "lorsque se sont formés les conseils de fabrique, les syndicats ont cessé d'exister et les conseils ont rempli le vide". Un délégué anarchiste déclara que: "les syndicats veulent absorber les conseils de fabrique, mais les gens ne sont pas mécontents de ceux-ci alors qu'ils le sont des syndicats. Pour l'ouvrier, le syndicat est une forme d'organisation imposée de l'extérieur alors que le conseil de fabrique est très proche de lui". L’une des résolutions adoptées par la Conférence disait: "le contrôle ouvrier n'est possible que dans un régime où la classe ouvrière détient le pouvoir politique et économique (…) où sont déconseillées les activités isolées et désorganisées (…) et le fait que les ouvriers confisquent les fabriques au profit même de ceux qui y travaillent est incompatible avec les objectifs du prolétariat" (47).
Les bolcheviks continuèrent à défendre comme un dogme la thèse suivant laquelle "les syndicats sont les organes économiques du prolétariat", et ils prirent partie en leur faveur dans le conflit qui les opposait aux conseils d’usine. Lors de cette même Conférence, un délégué bolchevique défendit que : "les conseils de fabrique devaient exercer leurs fonctions de contrôle au bénéfice des syndicats et, de plus, devaient dépendre financièrement d'eux" (48).
Le 3 novembre 1917, le Conseil des Commissaires du peuple soumit un projet de décret sur le contrôle ouvrier qui stipulait que les décisions des conseils d’usine "pouvaient être annulées par les syndicats ou par les congrès syndicaux" 49. Cette décision provoqua de vives protestations parmi les Conseils d’usine et des membres du Parti. Le projet fut finalement modifié : sur les 21 délégués qui constituaient le Conseil du Contrôle ouvrier, 10 représentaient les syndicats et 5 seulement les conseils d’usine ! Ce déséquilibre non seulement mit ces derniers dans une position de faiblesse, mais les enferma en outre dans la logique de la gestion de la production, ce qui les rendait encore plus vulnérables aux syndicats.
Bien que le Soviet des Conseils d’usine se soit maintenu actif pendant quelques mois, tentant même d’organiser un Congrès général (voir le 4e article de notre série), les syndicats parvinrent finalement à dissoudre les conseils d'usine. Le IIe Congrès syndical, célébré du 25 au 27 janvier 1919, réclama que soit donné un "un statut officiel aux prérogatives des syndicats dans la mesure où leurs fonctions sont chaque fois plus étendues et se confondent avec celles de l'appareil gouvernemental d'administration et de contrôle étatiques" (50).
Avec la disparition des conseils d’usine, "dans la Russie soviétique de 1920, les ouvriers étaient de nouveau soumis à l'autorité de la direction, à la discipline du travail, aux stimulants financiers, au management scientifique, à toutes les formes traditionnelles de l'organisation industrielle, aux anciens directeurs bourgeois, la seule différence étant que le propriétaire était à présent l'État" (51), les ouvriers se retrouvaient complètement atomisés, n’avaient plus la moindre organisation propre qui les réunisse et la participation au soviet s’assimila à l’électoralisme classique de la démocratie bourgeoise et les soviets devinrent de simples chambres parlementaires.
Après la révolution, l'abondance n'existe pas encore et la classe ouvrière continue de subir les conditions du règne de la nécessité, y inclus l'exploitation pendant toute la période pendant laquelle la bourgeoisie mondiale n'est pas vaincue. Après celle-ci et tant que l'intégration des autres couches de la société au travail associé n'est pas achevée, c'est sur le prolétariat que repose l'effort essentiel de production des richesses pour toute la société. La marche vers le communisme inclut donc, pendant tout un temps, une lutte sans trêve pour diminuer l’exploitation jusqu’à la faire disparaître (52). "Afin de maintenir sa domination politique collective, la classe ouvrière a besoin d'assurer au moins les besoins matériels fondamentaux de la vie et, en particulier, d'avoir le temps et l'énergie de s'engager dans la vie politique" (53). Marx disait que "si la classe ouvrière lâchait pied dans son conflit quotidien avec le capital, elle se priverait certainement elle-même de la possibilité d'entreprendre tel ou tel mouvement de plus grande envergure" (54). Si le prolétariat, après avoir pris le pouvoir, acceptait l’augmentation croissante de son exploitation, il se rendrait incapable de continuer le combat pour le communisme.
C’est ce qui se passa dans la Russie révolutionnaire. L’exploitation de la clase ouvrière augmenta jusqu’à atteindre des limites extrêmes, au rythme de sa désorganisation en tant que classe autonome. Ce processus devint irréversible quand il s’avéra que l’extension internationale de la révolution avait échouée. Le groupe Vérité ouvrière (55) exprima clairement la situation : "La révolution a abouti à une défaite de la classe ouvrière. La bureaucratie et les hommes de la NEP sont devenus une nouvelle bourgeoisie qui vit de l’exploitation des ouvriers et profite de leur désorganisation. Avec les syndicats aux mains de la bureaucratie, les ouvriers sont plus désemparés que jamais. Après s’être converti en parti dirigeant, en parti de dirigeants et organisateurs de l’appareil d’État et de l’activité économique de type capitaliste, le Parti communiste a irrévocablement perdu tout type de lien et de parenté avec le prolétariat".
C. Mir, 28-12-10
1 Voir les articles publiés sur le thème : "La Période de transition [25]", Revue internationale no 1 ; "L’État et la dictature du prolétariat [26]", Revue internationale no 11. Voir aussi les articles de notre série sur le communisme : Revue internationale nos 77 [27]-78 [28], 91 [29], 95 [30]-96 [31], 99 [32], 127 [33]-130 [34], 132 [35], 134 [36] et 135 [37].
2 Bilan, no 18, organe de la Fraction de la Gauche communiste d’Italie, p. 612. Bilan poursuivit les travaux de Marx, Engels et Lénine sur la question de l’État et plus particulièrement sur son rôle dans la période de transition du capitalisme au communisme qu’il considéra, reprenant la formulation d’Engels, comme "fléau dont hérite le prolétariat, nous garderons à son égard, une méfiance presque instinctive" (Bilan n° 26 p 874 .
3 Internationalisme, no 10, organe de la Gauche communiste de France (GCF), 1945-1953. La Gauche communiste de France poursuivit l’œuvre de Bilan et fut l’ancêtre de notre organisation.
4 Tendance de gauche qui surgit au sein du Parti bolchevique en 1920-21. Le but de cet article n’est pas d’analyser les différentes fractions de gauche qui surgirent du Parti bolchevique en réaction à sa dégénérescence. Nous renvoyons le lecteur aux nombreux articles que nous avons déjà publiés sur cette question.
Citons entre autres "La Gauche communiste en Russie", Revue internationale nos 8 [38]-9 [39] ; "Manifeste du Groupe ouvrier du Parti communiste russe", Revue internationale nos 142 [40],143 [14], 144 [41] et 145. La citation, traduite par nous, est reprise de l’ouvrage Démocratie des travailleurs ou Dictature du Parti ?, chapitre "Qu’est-ce que l’opposition ouvrière", page 179 de l’édition espagnole. Il faut souligner que si l’Opposition ouvrière eut le mérite et la lucidité de constater les problèmes que connaissait la révolution, la solution qu’elle proposait ne faisait qu’empirer les choses. Elle pensait que les syndicats devaient avoir toujours plus de pouvoir. Partant de l’idée juste que "l’appareil des soviets est un composé de différentes couches sociales" (p. 177 op. cit.), elle conclut par le besoin que "les rênes de la dictature du prolétariat dans le domaine de la construction économique doivent être les organes qui, de par leur composition, sont des organes de classe, unis par les liens vitaux avec la production de façon immédiate, c’est-à-dire les syndicats" (idem). Elle restreint d’un côté l’activité du prolétariat au domaine étroit de la "construction économique" et, de l’autre, donne à des organes bureaucratiques et annihilateurs des capacités du prolétariat, les syndicats, la mission utopique de développer l’activité autonome des masses.
5 Cf. M. Brinton, Les Bolcheviks et le Contrôle ouvrier, "Introduction", page 17 de l’édition espagnole, traduit par nous.
6 Citation du livre de Marcel Liebman Le léninisme sous Lénine, p 167.
7 E. H. Carr, la Révolution bolchevique, Chap. VIII, "L’ascension du parti", p. 203 de l'édition espagnole.
8 Idem, note A, "La théorie de Lénine sur l’État", page 264 de l’édition espagnole.
9 Cf. Revue internationale, no 99, "Comprendre la défaite de la Révolution russe [32]" (1re partie).
10 Idem. Citation de Ossinski, membre d’une des premières tendances de gauche dans le Parti.
11 Démocratie des travailleurs ou Dictature du Parti ?, op. cit., p. 181 de l’édition espagnole, traduit par nous.
12 Brinton, op. cit., note 7, p. 121 de l’édition espagnole, traduit par nous. Les Glavki étaient les organes étatiques de gestion étatique économique.
13 Lénine, mars 1919, Intervention au Soviet de Petrograd.
14 Démocratie des travailleurs ou Dictature du Parti ?, op. cit., p. 213 de l’édition espagnole, traduit par nous.
15 Citations empruntées à l’ouvrage de Marcel Liebman, le Léninisme sous Lénine, p. 109.
16 Revue internationale, no 99, op. cit.
17 Cette préoccupation fut reprise par les communistes de gauche qui "exprimèrent, en 1919, le désir d'accentuer la distinction entre Etat et parti. Il leur semblait que celui-ci avait plus que celui-là une préoccupation internationaliste qui répondait à leur propre inclination. Le parti eût dû, en quelque sorte, jouer le rôle de conscience du gouvernement et de l'Etat" (Marcel Liebman, P. 112). Bilan insiste sur ce risque que le Parti soit absorbé par l’État, faisant perdre à la classe ouvrière, son avant-garde, et aux organes soviétiques, leurs principaux animateurs : "La confusion ente ces deux notions de parti et d'Etat est d'autant plus préjudiciable qu'il n'existe aucune possibilité de concilier ces deux organes, alors qu'une opposition inconciliable existe entre la nature, la fonction et les objectifs de l'Etat et du parti. L'adjectif de prolétarien ne change pas la nature de l'Etat qui reste un organe de contrainte économique et politique, alors que le parti est l'organe dont le rôle est, par excellence, celui d'arriver non pas par la contrainte, mais par l'éducation politique à l'émancipation des travailleurs" (Bilan n° 26, p. 871)
18 Pierre Broué, Trotski, p. 255. L’auteur rapporte le récit de l’auteur anarchiste Léonard Schapiro.
19 Marcel Liebman, op. cit., p. 149.
20 Idem, p. 151.
21 Cette théorisation s’enracinait dans les confusions que traînaient tous les révolutionnaires par rapport au parti, ses rapports avec la classe et la question du pouvoir, comme nous le signalons dans un article de notre série sur le communisme, Revue internationale no 91 : "les révolutionnaires de l'époque, malgré leur engagement envers le système de délégation des soviets qui avait rendu obsolète le vieux système de représentation parlementaire, étaient encore tirés en arrière par l'idéologie parlementaire au point qu'ils considéraient que c'était le parti ayant la majorité dans les soviets centraux, qui devait former le gouvernement et administrer l’État". En réalité, les vieilles confusions se virent renforcées et poussées à l’extrême par la théorisation de la réalité toujours plus évidente de la transformation du parti bolchevique en Parti-État.
22 Marcel Liebman, op. cit., p. 109.
23 Idem, p. 110.
24 Idem, p. 110
25 Cité dans la brochure de Brinton, p. 138, note 7, traduit par nous. Trotski a raison de dire que la classe peut passer par des moments de confusion et d’hésitation et que le Parti, au contraire, armé par un rigoureux cadre théorique et programmatique, est porteur des intérêts historiques de la classe et doit les lui transmettre. Mais cela, il ne peut le faire au moyen d’une dictature sur le prolétariat, laquelle ne fait qu’affaiblir celui-ci, augmentant encore plus ses hésitations.
26 La plateforme du "Groupe des quinze” fut initialement publiée hors de Russie par la branche de la Gauche italienne qui publiait le journal Réveil communiste à la fin des années 1920. Elle parut en allemand et en français sous le titre A la veille de Thermidor, révolution et contre-révolution dans la Russie des soviets -Plate-forme de l'Opposition de gauche dans le parti bolchevique (Sapranov, Smirnov, Obhorin, Kalin, etc.) au début de 1928
27 Rosa Luxemburg, la Révolution russe.
28 Lénine, "Rapport sur la guerre et la paix” au VIIe Congrès du Parti. 7 Mars 1918.
29 Chapitre V, "La phase supérieure de la société communiste, p. 375.
30 Comme Marx, Lénine utilise de façon impropre le terme "phase inférieure du communisme", quand en réalité, une fois détruit l’État bourgeois, nous sommes encore sous "un capitalisme avec une bourgeoisie défaite", ce qui nous fait considérer plus exact de parler de "période de transition du capitalisme au communisme".
31 Dans la Révolution trahie, Trotski reprend la même idée lorsqu’il parle du caractère "double" de l’Etat, "socialiste" d’un côté mais aussi "bourgeois sans bourgeoisie" de l’autre. Voir notre article [42] de la série sur le communisme, Revue internationale no 105.
32 Comme le disait Marx dans la Critique au Programme de Gotha, le principe dominant "à travail égal, salaire égal" n’a rien de socialiste.
33 Alexandra Kollontai, dans une intervention au Xe Congrès du parti, Op cit page 171 de l'édition espagnole, traduit par nous. Anton Ciliga, dans son livre Au pays du grand mensonge, va dans le même sens : "Ce qui séparait cette Opposition du trotskisme, ce n'était pas seulement la façon de juger le régime et de comprendre les problèmes actuels. C'était avant tout la façon de comprendre le rôle du prolétariat dans la révolution. Pour les trotskistes, c'était le parti, pour les groupes d'extrême gauche, c'était la classe ouvrière qui était le moteur de la révolution. La lutte entre Staline et Trotsky concernait la politique du parti, le personnel dirigeant du parti; pour l'un comme pour l'autre le prolétariat n'était qu'un objet passif. Les groupes de l'extrême gauche communiste au contraire s'intéressaient avant tout à la situation et au rôle de la classe ouvrière, à ce qu'elle était en fait dans la société soviétique et à ce qu'elle devait être dans une société qui se donnerait sincèrement pour tâche d'édifier le socialisme". (traduit par nous)
34 Revue internationale no 77, "1871 : la première révolution prolétarienne – Le communisme, une société sans État".
35 Idem
36 Lénine, "Rapport politique du Comité central au XIe Congrès". 27 mars 1922.
37 Víctor Serge, l’An I de la Révolution russe, Tome II, La constitution soviétique.
38 Lénine. Brouillon du projet du programme du parti communiste bolchevique. "Les thèses fondamentales de la dictature du prolétariat en Russie". Point 9. Traduit par nous à partir de la version espagnole des œuvres complètes, Tome 38.
39 Dans sa lettre à la République des Conseils ouvriers de Bavière – qui ne vécut que trois semaines car écrasée par les troupes du gouvernement social-démocrate en mai 1919 – Lénine semble orienter vers l’organisation indépendante des conseils ouvriers : "L'application la plus urgente et la plus large de ces mesures, ainsi que d'autres semblables, faite en s'appuyant sur l'initiative des soviets d'ouvriers, de journaliers, et, séparément, de petits paysans, doit renforcer votre position" (27 avril 1919)
40 Sur cette question, Lénine exprima cependant des doutes, puisqu’en maintes occasions il signala avec raison qu’il s’agissait "d’un État ouvrier et paysan avec des déformations bureaucratiques” et, par ailleurs, lors du débat sur les syndicats (1921), il argumenta que le prolétariat devait être organisé en syndicats et avoir le droit de grève pour se défendre de "son" État : "[Trotsky] prétend que, dans un État ouvrier, le rôle des syndicats n'est pas de défendre les intérêts matériels et moraux de la classe ouvrière. C'est une erreur. Le camarade Trotski parle d'un "État ouvrier". Mais c'est une abstraction ! Lorsque nous parlions de l'État ouvrier en 1917, c'était normal; mais aujourd'hui, lorsque l'on vient nous dire : "Pourquoi défendre la classe ouvrière, et contre qui, puisqu'il n'y a plus de bourgeoisie, puisque l'État est un État ouvrier", on se trompe manifestement car cet État n'est pas tout à fait ouvrier, voilà le hic. C'est l'une des principales erreurs du camarade Trotski. Des principes généraux, nous sommes passés aujourd'hui à la discussion pratique et aux décrets, et l'on veut nous détourner de ce travail pratique et concret pour nous tirer en arrière. C'est inadmissible. En fait, notre État n'est pas un État ouvrier, mais ouvrier-paysan, c'est une première chose. De nombreuses conséquences en découlent. (Boukharine [43] : "Comment ? Ouvrier-paysan ?"). Et bien que le camarade Boukharine, crie derrière : "Comment ? Ouvrier-paysan ?", je ne vais pas me mettre à lui répondre sur ce point. Que ceux qui en ont le désir se souviennent du Congrès des Soviets qui vient de s'achever ; il a donné la réponse.
Mais ce n'est pas tout. Le programme de notre Parti, document que l'auteur de l'"ABC du communisme [44]" connaît on ne peut mieux, ce programme montre que notre État est un État ouvrier présentant une déformation bureaucratique. Et c'est cette triste, comment dirais-je, étiquette, que nous avons dû lui apposer. Voilà la transition dans toute sa réalité. Et alors, dans un État qui s'est formé dans ces conditions concrètes, les syndicats n'ont rien à défendre ? On peut se passer d'eux pour défendre les intérêts matériels et moraux du prolétariat entièrement organisé ? C'est un raisonnement complètement faux du point de vue théorique. Il nous reporte dans le domaine de l'abstraction ou de l'idéal que nous atteindrons d'ici quinze ou vingt ans, et encore, je ne suis pas sûr que nous y parvenions dans ce délai. Nous sommes en face d'une réalité que nous connaissons bien, si toutefois nous ne nous grisons pas, nous ne nous laissons pas entraîner par des discours d'intellectuels ou des raisonnements abstraits, ou encore, par ce qui semble parfois être une "théorie", mais n'est en fait qu'une erreur, une fausse appréciation des particularités de la période de transition. Notre État est tel aujourd'hui que le prolétariat totalement organisé doit se défendre, et nous devons utiliser ces organisations ouvrières pour défendre les ouvriers contre leur État et pour que les ouvriers défendent notre État." (https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/12/vil19201230.htm [45])
41 Lénine impulsa une Inspection ouvrière et paysanne (1922) qui échoua rapidement dans sa mission de contrôle et se convertit en une structure bureaucratique supplémentaire.
42 Cf. Revue internationale no 141, "Qu'est-ce que les conseils ouvriers ? (II) : de février à juillet 1917 : resurgissement et crise [46]".
43 Cf. Revue internationale no 142, "Qu'est-ce que les conseils ouvriers (III) : la révolution de 1917 (de juillet à octobre), du renouvellement des conseils ouvriers à la prise du pouvoir [47]".
44 Brinton, op. cit., voir note 10 p. 32 de l’édition espagnole, traduit par nous.
45 Idem, p. 47 de l’édition espagnole, traduit par nous.
46 Sans entrer dans une discussion sur la nécessité ou non d’une Armée rouge pendant cette partie de la période de transition, que nous pouvons appeler période de guerre civile mondiale (c’est-à-dire tant que le prolétariat n’a pas pris le pouvoir dans le monde entier), quelque chose apparaît comme évident dans l’expérience russe : la formation de l’Armée rouge, sa rapide bureaucratisation et affirmation comme organe étatique, la totale absence de contrepoids prolétariens en son sein, tout ceci reflète un rapport de forces avec la bourgeoisie très défavorable au prolétariat au niveau mondial. Comme nous le remarquions dans l’article de la série sur le communisme publié dans la Revue internationale no 96, "plus la révolution s’étend mondialement, plus elle sera directement dirigée par les conseils ouvriers et leurs milices, plus les aspects politiques de la lutte prédomineront sur le militaire, moins il y aura besoin d’une 'Armée rouge' pour mener la lutte".
47 Cité par Brinton, op. cit., p. 48 de l’édition espagnole, traduit par nous. Enthousiasmé par les résultats de la Conférence, Lénine déclara : "nous devons transférer le centre de gravité vers les conseils de fabrique. Ils doivent devenir les organes de l'insurrection. Il nous faut changer de mot d'ordre et, au lieu de dire, "tout le pouvoir aux soviets", nous devons dire "tout le pouvoir aux conseils de fabrique".
48 Idem, p. 35 de l’édition espagnole.
49 Cité par Brinton, op. cit., p. 50 de l’édition espagnole, traduit par nous
50 L’expérience russe montre de façon concluante la nature réactionnaire des syndicats, leur tendance indéfectible à se convertir en structures étatiques et leur antagonisme radical aux nouvelles formes organisationnelles que, depuis 1905, le prolétariat avait développées en dans le contexte des nouvelles conditions du capitalisme décadent et face à la nécessité de la révolution.
51 R.V. Daniels, cité par Brinton, op. cit., p. 120 de l’édition espagnole, traduit par nous.
52 "Une politique de gestion prolétarienne (…) aura un contenu socialiste seulement si le cours économique reçoit une orientation diamétralement opposée à celle du capitalisme, si donc il se dirige vers une élévation progressive et constante des conditions de vie des masses et non vers leur abaissement" (Bilan, no 28, "Les problèmes de la période de transition", cité dans la Revue internationale no 128).
53 Cf. Revue internationale no 95, "1919 – Le programme de la dictature du prolétariat [30]".
54 K. Marx, Salaire, prix et profits.
55 Né en 1922, il fut une des dernières fractions de gauche sécrétées par le Parti bolchevique dans le combat pour sa régénération et sa récupération par la classe.
11
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [48]
Heritage de la Gauche Communiste:
Décadence du capitalisme (IX) : le Comintern et le virus du "Luxemburgisme" en 1924
- 2603 lectures
Dans le précédent article de la série, nous avons montré la rapidité avec laquelle les espoirs en une victoire révolutionnaire immédiate suscités par les soulèvements de 1917-1919 avaient, en deux ans à peine, dès 1921, cédé la place chez les révolutionnaires à une réflexion plus réaliste sur le cours de la crise historique du capitalisme. Au Troisième Congrès de l’IC, l’une des questions centrales qui se posait était : il est certain que le système capitaliste est entré dans une époque de déclin, mais que va-t-il se passer si le prolétariat ne répond pas immédiatement à la nouvelle période en renversant le système ? Et quelle est la tâche des organisations communistes dans une phase où la lutte de classe et la compréhension subjective de la situation par le prolétariat refluent, alors que les conditions historiques objectives de la révolution existent toujours ?
Cette accélération de l’histoire, qui donna lieu à différentes réponses souvent conflictuelles de la part des organisations révolutionnaires, se poursuivit au cours des années suivantes, avec la dégénérescence de la révolution en Russie due à son isolement croissant qui ouvrit la porte au triomphe d’une forme sans précédent de contre-révolution. L’année 1921 constitua un tournant fatidique : confrontés à un mécontentement largement répandu dans le prolétariat de Petrograd et de Kronstadt ainsi qu’à une vague de révoltes paysannes, les Bolcheviks prirent la décision catastrophique de réprimer massivement la classe ouvrière et, simultanément, d’interdire les fractions au sein du parti. La Nouvelle Politique Economique (NEP), introduite immédiatement après la révolte de Kronstadt, faisait certaines concessions sur le plan économique, mais aucune au niveau politique : l’appareil du parti-Etat ne devait permettre aucun assouplissement de sa domination sur les soviets. Et pourtant, un an après, Lénine protestait contre le fait que l’Etat échappait au contrôle du parti prolétarien, l’entraînant dans une voie qu’il ne pouvait prévoir. La même année, à Rapallo, l’Etat "soviétique" concluait un accord secret avec l’impérialisme allemand à un moment où existait encore en Allemagne une fermentation sociale : c’était un symptôme évident du fait que l’Etat russe commençait à mettre ses intérêts nationaux au-dessus de ceux de la lutte de classe internationale. En 1923, en Russie, de nouvelles grèves ouvrières eurent lieu et des groupements de communistes de gauche se formèrent illégalement, comme le Groupe ouvrier de Miasnikov, en même temps que se créait une opposition de gauche "légale", regroupant non seulement d’anciens dissidents comme Ossinski mais également Trotsky lui-même.
Lénine mourut en janvier 1924 et en décembre Staline tenta de lancer le slogan du "socialisme dans un seul pays". En 1925-1926, c’était devenu la politique officielle du parti russe. Cette nouvelle orientation était le symbole d’une rupture décisive avec l’internationalisme.
La bolchevisation contre le "luxemburgisme"
Tous les communistes qui s’étaient regroupés en 1919 pour former la nouvelle Internationale partageaient l’idée que le capitalisme était devenu historiquement un système en déclin, même s’ils n’étaient pas d’accord sur les implications politiques de la nouvelle période ni sur les moyens dont avait besoin la lutte révolutionnaire pour se développer – par exemple, sur la possibilité d’utiliser les parlements comme une "tribune" pour la propagande révolutionnaire, ou la nécessité de les boycotter en faveur d’actions de rue et sur les lieux de travail. Concernant les fondements théoriques de la nouvelle époque, ils avaient disposé de peu de temps pour en discuter de façon soutenue. La seule analyse vraiment cohérente de "l’économie en décadence" avait été fournie par Rosa Luxemburg juste avant l’éclatement de la Guerre mondiale. Comme nous l’avons vu précédemment 1, la théorie de Luxemburg sur l’effondrement du capitalisme avait provoqué beaucoup de critiques de la part des réformistes ainsi que des révolutionnaires, mais ces critiques étaient pour la plus grande part négatives – il existait peu d’élaboration d’un cadre alternatif pour comprendre les contradictions fondamentales qui propulsaient le capitalisme dans sa phase de déclin. Quoi qu’il en soit, les désaccords sur cette question n’étaient pas considérés, à juste raison, comme fondamentaux. La question essentielle était d’accepter l’idée que le système était entré dans une phase où la révolution était devenue à la fois possible et nécessaire.
En 1924, cependant, au sein de l’Internationale communiste, la controverse autour de l’analyse économique de Luxemburg se raviva. Le point de vue de Luxemburg avait toujours eu une influence considérable dans le mouvement communiste allemand, tant dans le Parti communiste officiel (KPD) que dans le parti communiste de gauche (Parti communiste ouvrier d’Allemagne, KAPD). Mais maintenant, du fait de la pression grandissante pour que les partis communistes en dehors de la Russie soient plus fermement rattachés aux besoins de l’Etat russe, un processus de "bolchevisation" fut lancé dans toute l’IC, avec le but de se débarrasser de toutes les divergences indésirables en termes de théorie et de tactique. Il arriva un moment de la campagne de "bolchevisation" où la persistance du "luxemburgisme" dans le parti allemand fut considérée comme la source d’une multitude de déviations – en particulier ses "erreurs" sur la question nationale et coloniale et une démarche spontanéiste vis-à-vis du rôle du parti. Sur un plan plus "théorique" et abstrait, cette orientation contre le "luxemburgisme" donna lieu à l’écriture par Boukharine du livre L’impérialisme et l’accumulation du Capital, en 1924. 2
La dernière fois que nous avons parlé de Boukharine, c’était un porte-parole de la gauche du Parti bolchevique pendant la guerre – son analyse quasi-prophétique du capitalisme d’Etat et le fait qu’il défendait la nécessité de détruire l’Etat capitaliste et de revenir à Marx le mettaient vraiment à l’avant-garde du mouvement international ; il était également très proche de la position de Luxemburg par son rejet du slogan de "l’auto-détermination nationale", au grand mécontentement de Lénine. En Russie en 1918, il avait été l’un des instigateurs du Groupe communiste de gauche qui s’était opposé au Traité de Brest-Litovsk et, de façon plus significative, il s’était opposé à la bureaucratisation précoce de l’Etat soviétique 3. Mais une fois que la controverse sur la question de la paix se fût dissipée, l’admiration de Boukharine pour les méthodes du Communisme de guerre l’emporta sur ses facultés critiques et il se mit à théoriser ces méthodes comme l’expression d’une forme authentique de transition vers le communisme 4. Au cours du débat sur les syndicats en 1921, Boukharine partageait la position de Trotsky qui réclamait la subordination des syndicats à l’appareil d’Etat. Mais avec l’introduction de la NEP, Boukharine changea à nouveau de position. Il rejeta les méthodes extrêmes de coercition favorisées par le Communisme de guerre, en particulier à l’égard de la paysannerie, et commença à considérer la NEP comme le modèle "normal" de la transition vers le communisme, avec son mélange de propriété individuelle et de propriété d’Etat ainsi que sa politique consistant à s’appuyer sur les forces du marché plutôt que sur les décrets de l’Etat. Mais tout comme il s’était emballé pour le Communisme de guerre, Boukharine considérait de plus en plus cette phase de transition en termes nationaux, contrairement à ce qu’il avait défendu pendant la guerre, quand il avait souligné la nature globalement interdépendante de l’économie mondiale. En fait, on peut en un sens considérer Boukharine comme l’instigateur de la thèse du socialisme dans un seul pays reprise par Staline et utilisée par ce dernier pour se débarrasser finalement de Boukharine, politiquement d’abord, puis physiquement.5
L’impérialisme et l'accumulation du capital de Boukharine se donnait clairement pour but de justifier théoriquement la dénonciation des "faiblesses" du KPD sur les questions nationale, coloniale et paysanne – il l’affirme hardiment à la fin du livre, bien qu’il ne fasse aucun lien entre les attaques contre la vision économique de Luxemburg et ses prétendues conséquences politiques. Pourtant, certains révolutionnaires ont considéré l’assaut tous azimuts contre Luxemburg sur la question de l’accumulation capitaliste comme si la question était indépendante des buts douteux du livre.
Nous pensons que c’est une erreur pour plusieurs raisons. On ne peut séparer le ton agressif et le contenu théorique du livre de Boukharine de son but politique.
Le ton du texte indique de façon certaine que son but est une entreprise de démolissage de Luxemburg afin de la discréditer. Comme le souligne Rosdolsky : "Le lecteur d’aujourd’hui peut trouver le ton agressif et souvent frivole de Boukharine plutôt déplaisant si on se rappelle que Rosa Luxemburg avait été victime de meurtriers fascistes à peine quelques années auparavant. L’explication est que ce ton était dicté par des intérêts politiques plus que par un intérêt scientifique. Boukharine considérait que sa tâche était d’anéantir l’influence encore très grande du "luxemburgisme" dans le Parti communiste allemand (KPD), et par tous le moyens."6. Il faut s’enfiler des pages de sarcasmes et d’apartés condescendants avant que Boukharine admette à contrecœur, tout à la fin du livre, que Rosa avait fourni une excellente vue d’ensemble de la façon dont le capitalisme avait traité les autres systèmes sociaux qui constituent son milieu. Il n’y a aucun effort dans cette "polémique" de commencer par se référer aux véritables questions que Rosa Luxemburg avait abordées dans son livre – l’abandon par les révisionnistes de la perspective de la faillite du capitalisme et la nécessité de comprendre la tendance à l’effondrement inhérente au processus d’accumulation capitaliste. Au contraire, un bon nombre d’arguments de Boukharine donnent l’impression qu’il s’en prend à tout ce qui lui tombe sous la main, même si cela signifie la distorsion totale de la thèse de Luxemburg.
Par exemple, que faire de l’accusation selon laquelle Luxemburg nous proposerait une théorie dans laquelle l’impérialisme vivrait en harmonie avec le monde pré-capitaliste à travers un échange pacifique d’équivalents, ce qui, dans la formulation de Boukharine, s’écrit : "Les deux parties sont très satisfaites. Les loups ont mangé, les moutons sont saufs" ? Nous venons de mentionner que Boukharine lui-même admet ailleurs qu’une qualité majeure du livre de Luxemburg est la manière dont il rend compte de la façon dont le capitalisme "intègre" le milieu non-capitaliste – par le pillage, l’exploitation et la destruction – et le dénonce. C’est tout le contraire de moutons et de loups vivant en harmonie. Soit les moutons sont mangés, soit grâce à leur propre croissance économique, ils se transforment en loups capitalistes et leur entrée dans la compétition restreint l’apport de nourriture...
Tout aussi grossier est l’argument selon lequel, selon la définition de l’impérialisme par Luxemburg, seules les luttes pour certains marchés non capitalistes constitueraient des conflits impérialistes et "une lutte pour des territoires qui sont déjà devenus capitalistes ne serait pas de l’impérialisme, ce qui est totalement faux". En réalité, l’argument de Luxemburg selon lequel "L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde" 7 a pour but de décrire l’ensemble d’une période, un contexte général dans lequel se déroulent les conflits impérialistes. Le retour du conflit impérialiste au cœur du système, l’évolution vers des rivalités militaires directes entre les puissances capitalistes développées est déjà indiqué dans L’Accumulation et est considérablement développé dans La brochure de Junius.
Toujours au sujet de l’impérialisme, Boukharine met en avant l’argument selon lequel, puisqu’il existe encore beaucoup d’aires de production non capitalistes dans le monde, le capitalisme aurait un brillant avenir : "C’est un fait que l’impérialisme signifie catastrophe, que nous sommes entrés dans la période de l’effondrement du capitalisme, rien de moins. Mais c’est aussi un fait que la majorité écrasante de la population mondiale appartient à "la troisième personne"... ce ne sont pas les ouvriers de l’industrie et de l’agriculture qui composent la majorité de la population mondiale actuelle... Même si la théorie de Rosa Luxemburg était ne serait-ce qu’approximativement correcte, la cause de la révolution serait en très mauvaise posture."
Paul Frölich (l’un des "luxemburgistes" qui est resté dans le KPD après l’exclusion de ceux qui allaient fonder le KAPD) répond très bien à cet argument dans sa biographie de Luxemburg, publiée en 1939 pour la première fois :
"Divers critiques, et Boukharine en particulier, croyaient jouer un atout contre Rosa Luxemburg lorsqu’ils soulignaient les immenses possibilités de l’expansion capitaliste dans des zones non capitalistes. Mais l’auteur de la théorie de l’accumulation avait déjà ôté à cet argument son dard en soulignant de façon répétée que l’agonie du capitalisme aurait lieu bien avant que sa tendance inhérente à étendre ses marchés ait atteint ses limites objectives. Les possibilités expansionnistes ne résident pas dans une conception géographique : ce n’est pas le nombre de km2 qui est décisif. Ni non plus dans une conception démographique : ce n’est pas une comparaison statistique des populations capitalistes et non-capitalistes qui indique la maturité du processus historique. Il s’agit d’un problème socio-économique et tout un ensemble complexe d’intérêts, de forces et de phénomènes contradictoires doit être pris en compte." 8 En somme, Boukharine a confondu de façon patente la géographie et la démographie avec la capacité réelle des systèmes non capitalistes restants de générer de la valeur d’échange et donc de constituer un marché effectif pour la production capitaliste.
Les contradictions capitalistes
Si nous examinons maintenant la façon dont Boukharine traite la question centrale de la théorie de Luxemburg - le problème soulevé par les schémas de la reproduction de Marx - nous voyons de nouveau que la démarche de Boukharine est loin d’être déconnectée de sa vision politique. Dans un article en deux parties publié en 1982 dans les Revue internationale n° 29 et 30, "Théories des crises : le véritable dépassement du capitalisme, c’est l’élimination du salariat (A propos de la critique des thèses de Rosa Luxemburg par Nicolas Boukharine)"9, il est argumenté à juste titre que les critiques portées par Boukharine à Luxemburg révèlent de profondes divergences sur le contenu du communisme.
Au centre de la théorie de Luxemburg se trouve l’argument selon lequel les schémas de la reproduction élargie, dans le Volume II du Capital, qui, pour les besoins de l’argument, supposent une société exclusivement composée de capitalistes et d’ouvriers, doivent précisément être considérés comme un schéma abstrait et non comme une démonstration de la possibilité réelle d’une accumulation harmonieuse du capital dans un système fermé. Dans la vie réelle, le capitalisme a été constamment amené à s’étendre au-delà des frontières de ses propres rapports sociaux. Pour Luxemburg, à la suite de l’argumentation de Marx dans d’autres parties du Capital, le problème de la réalisation se pose au capital dans son ensemble même si pour les ouvriers et les capitalistes individuels, d’autres ouvriers et d’autres capitalistes peuvent parfaitement constituer un marché pour toute leur plus-value. Boukharine accepte évidemment que pour que la reproduction élargie ait lieu, il faut une source constante de demande additionnelle. Mais il dit que cette demande additionnelle est fournie par les ouvriers ; peut-être pas les ouvriers qui absorbent le capital variable avancé par les capitalistes au début du cycle de l’accumulation, mais par les ouvriers supplémentaires : "L’emploi d’ouvriers supplémentaires produit une demande additionnelle ce qui réalise précisément la partie de la plus-value qui doit être accumulée, pour être exact, la partie qui doit nécessairement être convertie en capital variable additionnel de fonctionnement." Ce à quoi notre article répond : "Appliquer l’analyse de Boukharine à la réalité mène à ceci : que doivent faire les capitalistes pour éviter de licencier les ouvriers quand leurs entreprises ne trouvent plus de débouchés ? C’est simple ! Embaucher des "ouvriers supplémentaires" ! Il fallait y penser. Le problème, c’est que le capitaliste qui suivra ce conseil, fera rapidement faillite." 10
Cet argument est du même niveau que celui d’Otto Bauer en réponse à Luxemburg, argument qu’elle met en pièces dans l’Anticritique : pour Bauer, la simple croissance de la population constitue les nouveaux marchés nécessaires à l’accumulation. Le capitalisme serait certainement florissant aujourd’hui si l’augmentation de la population résolvait le problème de la réalisation de la plus-value. Mais de façon étrange, au cours des dernières décennies, l’augmentation de la population a été constante tandis que la crise du système a également augmenté à des niveaux vertigineux. Comme le soulignait Frölich, le problème de la réalisation de la plus-value n’est pas une question démographique mais de demande effective, demande soutenue par la capacité à payer. Et puisque la demande des ouvriers ne peut pas absorber plus que le capital variable avancé au départ par les capitalistes, embaucher de nouveaux ouvriers se révèle une non-solution dès qu’on considère le capitalisme comme une totalité.
- Il y a cependant un autre aspect dans l’argument de Boukharine puisqu’il dit également que les capitalistes eux-mêmes constituent le marché additionnel pour l’accumulation à venir en investissant dans la production des moyens de production. "Les capitalistes eux-mêmes achètent les moyens additionnels de production, les ouvriers supplémentaires, qui reçoivent de l’argent des capitalistes, achètent les moyens de consommation additionnels."
Cet aspect de l’argument a les faveurs de ceux qui considèrent, comme Boukharine, que Luxemburg a soulevé un problème qui n’existe pas : produire et vendre des moyens de production additionnels résout le problème de l’accumulation. Luxemburg avait déjà répondu à l’essentiel de cet argument dans la critique de Tougan-Baranovski qui cherchait à prouver que le capitalisme ne se confrontait pas à des barrières insurmontables au cours du processus d’accumulation ; elle soutenait son argument en se référant à Marx lui-même : "En outre, comme nous l’avons vu au livre II, section III 11, une circulation continuelle se fait entre capital constant et capital variable (même si l’on ne tient pas compte de l’accumulation accélérée) ; cette circulation est d’abord indépendante de la consommation individuelle dans la mesure où elle n’y entre pas ; néanmoins, elle est définitivement limitée par cette dernière parce que la production de capital constant ne se fait jamais pour elle-même, mais uniquement parce qu’il s’en utilise davantage dans les sphères de production qui produisent pour la consommation individuelle." 12
Pour Luxemburg, une interprétation littérale des schémas de la reproduction comme le fait Tougan-Baranovski aurait pour résultat "[non] pas une accumulation de capital, mais une production croissante de moyens de production sans aucun but". 13
Boukharine est conscient que la production de biens de production ne constitue pas une solution au problème car il fait intervenir des "ouvriers supplémentaires" pour acheter les masses de marchandises produites par les moyens de production additionnels. En fait, il prend Tougan-Baranovski à partie pour ne pas comprendre que "la chaîne de la production doit toujours finir par la production de moyens de consommation...qui entrent dans le processus de la consommation personnelle" 14. Mais il n’utilise cet argument que pour accuser Luxemburg de confondre Tougan et Marx. Et pour finir, il répond à Luxemburg, comme tant d’autres le feront après lui, en citant Marx d’une façon erronée qui semble impliquer que le capitalisme pourrait être parfaitement satisfait en basant son expansion sur une production infinie de biens d’équipement :
- "Accumuler pour accumuler, produire pour produire, tel est le mot d’ordre de l’économie politique proclamant la mission historique de la période bourgeoise." 15
C’est une citation de Marx en effet, mais la référence qu’y fait Boukharine est trompeuse. Le langage utilisé ici par Marx est polémique et non exact : il est vrai que le capital est basé sur l’accumulation pour elle-même, c’est-à-dire sur l’accumulation de richesses sous sa forme historiquement dominante de valeur ; mais il ne peut réaliser cela en produisant simplement pour lui-même. Ceci parce qu’il ne produit que des marchandises et qu’une marchandise ne réalise aucun profit pour les capitalistes si elle n’est pas vendue. Il ne produit pas pour remplir simplement ses entrepôts ou jeter ce qu’il a produit (même si cela est souvent le résultat malheureux de son incapacité à trouver un marché pour ses produits).
Les solutions capitalistes d’Etat de Boukharine
Stephen Cohen, biographe de Boukharine qui a cité les commentaires de Boukharine sur Tougan, note une autre contradiction fondamentale dans la démarche de Boukharine.
- "A première vue, sa démarche inflexible vis-à-vis des arguments de Tougan-Baranovsky semble curieuse. Boukharine lui-même, après tout, avait souvent souligné le pouvoir régulateur des systèmes capitalistes d’Etat, théorisant même plus tard que sous un "pur" capitalisme d’Etat (sans libre marché), la production pourrait se poursuivre sans crise alors que la consommation serait à la traîne." 16
Cohen met le doigt sur un élément crucial de l’analyse de Boukharine. Il se réfère au passage suivant de L’impérialisme et l’Accumulation du Capital.
- "Imaginons trois formations socio-économiques : l’ordre social collectif capitaliste (le capitalisme d’Etat) dans lequel la classe capitaliste est unie en un trust unifié et nous nous trouvons dans une économie organisée bien qu’en même temps, du point de vue des classes, antagoniste ; puis la société capitaliste "classique" qu’analyse Marx ; et, finalement, la société socialiste. Suivons (1) le développement de la reproduction élargie ; donc les facteurs qui rendent une "accumulation" possible (nous mettons le mot "accumulation" entre guillemets parce que ce terme, "accumulation", suppose par sa nature même des rapports capitalistes seulement) ; (2) comment, où et quand les crises peuvent surgir.
1. Le capitalisme d’Etat. Une accumulation y est-elle possible ? Evidemment. Le capital constant s’accroît parce que la consommation des capitalistes s’accroît. De nouvelles branches de la production correspondant à de nouveaux besoins émergent continuellement. Même si elle connaît certaines limites, la consommation des travailleurs augmente. En dépit de cette sous-consommation des masses, aucune crise ne peut surgir car la demande mutuelle de toutes les branches de la production comme la demande des consommateurs, celle des capitalistes comme celle des ouvriers, sont données au départ. Au lieu de "l’anarchie de la production", on a un plan qui est rationnel du point de vue du Capital. S’il y a de "mauvais calculs" dans les moyens de production, le surplus est stocké, et une correction sera apportée dans la période suivante de production. Si, d’un autre côté, il y a eu de mauvais calculs concernant les moyens de consommation pour les ouvriers, cet excédent est utilisé comme "fourrage" en le distribuant aux ouvriers, ou la portion correspondante du produit sera détruite. Même dans le cas de mauvais calculs dans la production d’articles de luxe, la "voie de sortie" est claire. Ainsi, aucune crise de surproduction ne peut avoir lieu ici. La consommation des capitalistes constitue une incitation pour la production et le plan de production. De ce fait, il n’y a pas de développement particulièrement rapide de la production (petit nombre de capitalistes)."
Frölich comme Cohen souligne ce passage et fait le commentaire suivant :
- "La solution (de Boukharine) s’avère une confirmation de sa thèse centrale... Et cette solution est étonnante. On nous présente un "capitalisme" qui n’est pas une anarchie économique mais une économie planifiée dans laquelle il n’y a pas de compétition mais qui est plutôt un trust mondial global et dans laquelle les capitalistes n’ont pas à se soucier de la réalisation de leur plus-value..."
Notre article aussi est cinglant vis à vis de cette idée de se débarrasser de la surproduction :
- "Boukharine prétend résoudre théoriquement le problème en l’éliminant. Le problème des crises de surproduction du capitalisme, c’est la difficulté à vendre. Boukharine nous dit : on n’a qu’à procéder à "une distribution gratuite" ! Si le capitalisme avait la possibilité de distribuer gratuitement ce qu’il produit, il ne connaîtrait effectivement jamais de crise majeure. Sa principale contradiction étant de ce fait résolue. Mais un tel capitalisme ne peut exister que dans la tête d’un Boukharine en mal d’arguments. La distribution "gratuite" de la production, c’est-à-dire l’organisation de la société de sorte que les hommes produisent directement pour eux-mêmes, cela constitue effectivement la seule solution pour l’humanité. Seulement, cette solution, ce n’est pas un capitalisme "organisé" mais le communisme."
Lorsqu’il revient sur la société capitaliste "classique" dans le paragraphe qui suit, Boukharine accepte que des crises de surproduction puissent avoir lieu – mais elles sont simplement le produit d’un déséquilibre temporaire entre les branches de la production (un point de vue précédemment exprimé par les économistes "classiques" et critiqué par Marx comme nous l’avons montré dans un article précédent 17), Boukharine dédie ensuite quelques maigres lignes au socialisme en tant que tel et nous sert l’évidence selon laquelle une société qui ne produit que pour la satisfaction des besoins humains ne subirait pas de crise de surproduction. Mais ce qui semble intéresser Boukharine avant tout, c’est le capitalisme hyper-planifié où l’Etat aplanit tous les problèmes de disproportion ou de mauvais calculs. En d’autres termes, la sorte de société qu’en URSS au milieu des années 1920, il décrivait déjà comme du socialisme... Il est vrai que le capitalisme d’Etat de science-fiction de Boukharine est devenu un trust mondial, un colosse qui n’est plus entouré d’aucun vestige pré-capitaliste et ne connaît aucun conflit entre capitaux nationaux. Mais sa vision du socialisme en Union soviétique était une utopie cauchemardesque du même genre, un trust quasiment autosuffisant ne connaissant aucune concurrence interne et seulement une paysannerie docile, partiellement et temporairement en dehors de sa juridiction économique.
Ainsi, comme nous l’avions dit plus haut, l’article de la Revue internationale n° 29 conclut à juste titre que l’attaque de Boukharine contre la théorie économique de Rosa Luxemburg révèle deux visions fondamentalement opposées du socialisme. Pour Luxemburg, la contradiction fondamentale de l’accumulation capitaliste découle de la contradiction entre la valeur d’usage et la valeur d’échange, inhérente à la marchandise – et par dessus tout à la force de travail, marchandise qui a la caractéristique unique d’engendrer une valeur additionnelle source du profit capitaliste mais aussi source de son problème d’insuffisance de marchés pour réaliser son profit. Par conséquent, cette contradiction, et toutes les convulsions qui en résultent, ne peut être surmontée que par l’abolition du travail salarié et de la production de marchandises – prérequis essentiels du mode de production communiste.
D’un autre côté, Boukharine critique Luxemburg pour s’être facilité les choses et "avoir choisi une contradiction" alors qu’il y en a beaucoup : la contradiction entre les branches de la production, entre l’industrie et l’agriculture, l’anarchie du marché et la concurrence 18. Tout cela est vrai mais la solution capitaliste d’Etat de Boukharine montre que pour lui, il existe un problème fondamental dans le capitalisme : son absence de planification. Si l’Etat pouvait prendre en charge la production et la distribution, on aurait alors une accumulation sans crise.
Quelles qu’aient été les confusions au sein du mouvement ouvrier avant la Révolution russe sur la transition au communisme, ses éléments les plus clairs avaient toujours défendu que le communisme/socialisme ne pourrait être créé qu’à l’échelle mondiale parce que chaque pays, chaque nation capitaliste est inévitablement dominée par le marché mondial ; et la libération des forces productives mises en mouvement par la révolution prolétarienne ne pourra devenir effective que lorsque la tyrannie du capital global aura été renversée dans tous les principaux centres. Contrairement à cette vision, la vision stalinienne du socialisme dans un seul pays pose l’accumulation dans un système clos – quelque chose qui avait été impossible pour le capitalisme classique et n’était pas davantage possible pour un Etat totalement régulé, même si la vaste taille (et l’énorme secteur agricole) de la Russie a permis temporairement un développement autarcique. Mais si, comme insistait Luxemburg, le capitalisme en tant qu’ordre mondial ne peut opérer dans le cadre d’un système fermé, c’est encore moins le cas des capitaux nationaux et l’autarcie stalinienne des années 1930 – basée sur le développement frénétique d’une économie de guerre – fut essentiellement une préparation à son expansion impérialiste militaire inévitable qui s’est réalisée dans le deuxième holocauste impérialiste et les conquêtes qui l’ont suivi.
Entre 1924, moment où Boukharine écrivit son livre et 1929, année du grand krach, le capitalisme connut une phase de stabilité relative et, dans certaines régions, de croissance spectaculaire – avant tout aux Etats-Unis. Mais c’était simplement le calme avant la tempête de la plus grande crise économique que le capitalisme ait jamais connu jusqu’alors.
Dans le prochain article de cette série, nous examinerons certaines des tentatives des révolutionnaires pour comprendre les origines et les implications de cette crise et, surtout, sa signification en tant qu’expression du déclin du mode de production capitaliste.
Gerrard
1 Revue internationale n° 142 [50].
2 Toutes les citations du livre Imperialism and the Accumulation of Capital dans cet article sont traduites de l’anglais par nous.
3 Même si la plupart des positionnements de Boukharine que nous venons d'énoncer l'avaient placé à l'avant-garde marxiste à cette époque, ce n'était pas le cas de son attitude face au traité de Brest-Litovsk. Lire à ce sujet au sein de notre série Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, l'article "La révolution critique ses erreurs [32]" dans la Revue internationale n° 99.
4 Voir l’article "1920 : Boukharine et la période de transition [31]" dans la Revue internationale n° 96.
5 Dans sa biographie de Boukharine, Bukharin and the Bolshevik Revolution, London 1974, Stephen Cohen fait remonter la version initiale de la théorie à la date précoce de 1922.
6 Roman Rosdolsky, The Making of Marx’s Capital, Pluto Press 1989 edition, vol 2 p 458. Traduit de l’anglais par nous.
Comme nous l’avons noté dans un article précédent ("Rosa Luxemburg et les limites de l’expansion du capitalisme", Revue internationale n° 142), Rosdolsky porte aussi des critiques à Luxemburg, mais il n’écarte pas les problèmes qu’elle soulève ; par rapport à la façon dont Boukharine traite les schémas de la reproduction, il défend que si Rosa Luxemburg a fait des erreurs mathématiques, Boukharine également et, de plus, que ce dernier a pris la formulation par Marx du problème de la reproduction élargie pour sa solution : "Boukharine a complètement oublié que la reproduction élargie du capital social global ne mène pas seulement à l’augmentation de c et de v mais également de a, c’est-à-dire l’augmentation de la consommation individuelle des capitalistes. Néanmoins, cette erreur élémentaire est passée inaperçue pendant presque deux décennies, et Boukharine a été généralement considéré comme la plus grande autorité en défense de l’ "orthodoxie" marxiste contre Rosa Luxemburg et ses attaques envers "ces parties de l’analyse de Marx que le maître incomparable nous a transmises comme produit achevé de son génie" (L’impérialisme, p.58, London edition 1972). Néanmoins, la formule générale par Boukharine de l’équilibre est très utile, même si lui aussi (comme beaucoup des critiques de Rosa Luxemburg) a pris la simple formulation du problème pour sa solution". (The Making of Marx’s Capital, p 450) – Traduit de l’anglais par nous.
7 L’Accumulation du Capital. Chapitre Le protectionnisme et l'accumulation.
8 Traduit de l’anglais par nous.
9 https://fr.internationalism.org/rinte29/crise.htm [51]
10 International review n°29. Ce passage a malencontreusement sauté des deux articles mentionnés de la Revue internationale en Français.
11 Trad. Éditions Sociales, tome 5, pp. 73-76.
12 Le Capital, I. I, I° partie, p. 289. Trad. Éditions Sociales, tome 6, p. 314, cité par Luxemburg, L’Accumulation, chapitre XXV.
https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/rl_accu_k_25.htm [52]
13 Ibid.
14 Traduit de l’anglais par nous. L’Impérialisme, cité par S. Cohen.
15 Le Capital, Livre I, 7e section, chapitre XXIV, III, https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/rl_accu_k_25.htm [52]
16 Cohen utilise le terme "à première vue" parce qu’il poursuit en disant que ce que Boukharine avait vraiment en tête, était moins l’ancienne controverse avec Tougan que la nouvelle controverse dans le parti russe, entre les "super-industrialistes" (au départ Préobrajensky et l’opposition de gauche, plus tard Staline) qui se centraient sur l’accumulation forcée de moyens de production dans le secteur étatique et son propre point de vue qui (ironiquement, en considérant son rejet de l’importance accordée par Luxemburg à la demande non capitaliste) soulignait continuellement la nécessité de fonder l’expansion de l’industrie étatique sur le développement graduel du marché paysan plutôt que sur une exploitation directe des paysans et le pillage de leurs biens, comme les super-industrialistes le préconisaient de façon choquante.
17 Revue internationale n° 139, "Les contradictions mortelles de la société bourgeoise [53]".
18 Cela vaut la peine de noter que Grossman critique aussi Boukharine pour ne parler que vaguement des contradictions, sans situer la contradiction essentielle qui mène à l’effondrement du système. Voir Grossman, The Law of Accumulation and Breakdown of the Capitalist System, London 1992, p 48-9.
Questions théoriques:
- Décadence [54]
Rubrique:
Le Manifeste du Groupe ouvrier du Parti communiste russe (4e partie)
- 1868 lectures
Nous publions la quatrième et dernière partie du Manifeste (les trois premières parties sont publiées dans les trois numéros précédents de la Revue internationale). Dans celle-ci, il traite deux questions en particulier : d'une part, l'organisation des ouvriers en conseils pour la prise du pouvoir et la transformation de la société ; d'autre part, la nature de la politique oppositionnelle au parti bolchevique menée par d'autres groupes constitués en réaction à la dégénérescence de celui-ci.
Le Manifeste opère clairement la distinction entre le prolétariat organisé en conseils, et les autres couches non exploiteuses de la société qu'il entraine derrière lui : "Où les conseils sont-ils nés ? Dans les usines et dans les fabriques. (…) Les conseils ouvriers se présentent en 1917 comme guides de la révolution, non seulement dans leur substance mais aussi formellement : soldats, paysans, cosaques se subordonnent à la forme organisationnelle du prolétariat". Une fois achevée la guerre civile contre la réaction blanche internationale, c'est encore au prolétariat organisé sur ses bases propres que le Manifeste attribue le rôle de transformation de la société. Dans ce cadre, il accorde une importance de premier ordre à l'organisation autonome de la classe ouvrière qui a été considérablement affaiblie par les années de guerre civile à tel point que : "On ne doit pas parler d'une amélioration des soviets, mais de leur reconstitution. Il faut reconstituer les conseils dans toutes les fabriques et usines nationalisées pour résoudre une nouvelle tâche immense".
Le Manifeste est très critique par rapport à l'activité d'autres groupes d'opposition à la politique du parti bolchevique, en particulier la Vérité Ouvrière et un autre qui n'a pu être identifié autrement que par ses écrits qui sont cités. Le Manifeste dénonce le radicalisme de façade des critiques portées par ces groupes (qu'il qualifie de "libéraux") au Parti bolchevique, à tel point que, selon lui, ce dernier pourrait reprendre à son compte de telles critiques, en plus radical, pour les utiliser comme paravent à sa politique d'étouffement de la liberté de parole du prolétariat. 1
Enfin, l'article rappelle comment se positionne Le Manifeste par rapport au parti bolchevique dont les déficiences menacent de le transformer "en une minorité de détenteurs du pouvoir et des ressources économiques du pays, qui s'entendra pour s'ériger en une caste bureaucratique" : "exercer une influence décisive sur la tactique du PCR, en conquérant la sympathie de larges masses prolétariennes, de façon telle qu'elle contraigne le parti à abandonner sa ligne directrice".
La Nouvelle Politique économique
En fait la Nouvelle Politique économique a partagé l'industrie entre, d'un côté, l'État (les trusts, les syndicats, etc.) et, de l'autre, le capital privé et les coopératives. Notre industrie nationalisée a pris le caractère et les aspects de l'industrie capitaliste privée, dans le sens où elle fonctionne sur la base des besoins du marché.
Depuis le IXe congrès du PCR (bolchevique), l'organisation de la gestion de l'économie est réalisée sans participation directe de la classe ouvrière, à l'aide de nominations purement bureaucratiques. Les trusts sont constitués suivant le même système adopté pour la gestion de l'économie et la fusion des entreprises. La classe ouvrière ne sait pas pourquoi tel ou tel directeur a été nommé, ni pour quel motif une usine appartient à ce trust plutôt qu'à un autre. A cause de la politique du groupe dirigeant du PCR, elle ne prend aucune part à ces décisions.
Il va de soi que l'ouvrier regarde avec inquiétude ce qui se passe. Il se demande souvent comment il a pu en arriver là. Il se souvient fréquemment du moment où est apparu et s'est développé le Conseil des députés ouvriers dans son usine. Il se pose la question : comment a-t-il pu se faire que son soviet, le soviet qu'il avait lui-même institué et auquel ni Marx, ni Engels, ni Lénine ni aucun autre n'avait pensé, comment se fait-il que ce soviet soit mort ? Et d'inquiètes pensées le hantent... Tous les ouvriers se souviennent de la façon dont furent organisés les conseils des députés ouvriers.
En 1905, quand personne encore dans le pays ne parlait de conseils ouvriers et que, dans les livres, il était seulement question de partis, d'associations, de ligues, la classe ouvrière russe réalisa les soviets dans les usines.
Comment ces conseils furent-ils organisés ? Au moment de l'apogée de la montée révolutionnaire, chaque atelier de l'usine élut un député pour présenter ses revendications à l'administration et au gouvernement. Pour coordonner les revendications, ces députés des ateliers se rassemblèrent en conseils et constituèrent ainsi le Conseil des députés.
Où les conseils sont-ils nés ? Dans les usines et dans les fabriques. Les ouvriers des fabriques et des usines, de tout sexe, religion, ethnie, conviction ou métier s'unissent en une organisation où se forme une volonté commune. Le Conseil des députés ouvriers est donc l'organisation des ouvriers des entreprises de production.
C'est de la même manière que sont réapparus les conseils en 1917. Ils sont décrits ainsi dans le programme du PCR(b) : "L'arrondissement électoral et noyau principal de l'État est l'unité de production (la fabrique, l'usine) et non plus le district". Même après la prise du pouvoir, les conseils ont gardé le principe selon lequel leur base est le lieu de production, et c'était leur trait distinctif par rapport à toute autre forme du pouvoir étatique, leur avantage, car une pareille organisation de l'État rapproche l'appareil étatique des masses prolétariennes.
Les conseils des députés ouvriers de toutes les fabriques et usines se réunissent en assemblées générales et forment des conseils de députés ouvriers des villes dirigés par leur Comité exécutif (CE). Les congrès des conseils des provinces et des régions forment des comités exécutifs des conseils provinciaux et régionaux. Enfin, tous les conseils de députés des usines élisent leurs mandataires au Congrès panrusse des conseils en formant une organisation panrusse des conseils de députés ouvriers, son organe permanent étant le Comité exécutif panrusse des conseils de députés ouvriers.
Dès les premiers jours de la Révolution de février, les besoins de la guerre civile ont exigé l'engagement dans le mouvement révolutionnaire de la force armée, par l'organisation de conseils de députés des soldats. Les besoins révolutionnaires du moment leur ont dicté de s'unir, ce qui fut fait. Ainsi se sont formés les conseils de députés ouvriers et de soldats.
Dès que les conseils prirent le pouvoir, ils attirèrent à leurs côtés la paysannerie représentée par les conseils de députés paysans et ensuite des cosaques. Ainsi s'organisa le Comité exécutif central panrusse (CECP) des conseils de députés ouvriers, paysans, de soldats et des cosaques.
Les conseils ouvriers se présentent en 1917 comme guides de la révolution, non seulement dans leur substance mais aussi formellement : soldats, paysans, cosaques se subordonnent à la forme organisationnelle du prolétariat.
Lors de la prise du pouvoir par les conseils, il s'est tout d'un coup révélé que ces conseils, surtout ceux de députés ouvriers, seraient obligés de s'occuper presque entièrement d'une lutte politique contre les anciens esclavagistes qui s'étaient soulevés, fortement appuyés par "les fractions bourgeoises à la phraséologie socialiste obscure". Et jusqu'à la fin de 1920, les conseils se sont occupés de l'écrasement de la résistance des exploiteurs.
Au cours de cette période, les conseils perdirent leur caractère lié à la production et déjà, en 1920, le IXe congrès du PCR(b) décréta la direction par un seul des fabriques et des usines. Pour Lénine, cette décision était motivée par le fait que la seule chose qu'on ait bien faite était l'Armée rouge avec une direction unique.
Et où sont-ils maintenant les conseils de députés ouvriers des fabriques et des usines ? Ils n'existent plus et sont complètement oubliés (même si on continue à parler du pouvoir des conseils). Non, il n'y en a plus et nos conseils ressemblent aujourd'hui beaucoup aux maisons communes ou aux zemstvos 2 (avec une inscription au-dessus de la porte : "C'est un lion, pas un chien").
Tout ouvrier sait que les conseils de députés ouvriers avaient organisé une lutte politique pour la conquête du pouvoir. Après avoir pris le pouvoir, ils ont écrasé la résistance des exploiteurs. La guerre civile que les exploiteurs entreprirent contre le prolétariat au pouvoir, avec les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks, prit un caractère si intense et si âpre qu'elle engagea à fond la classe ouvrière toute entière ; c'est pourquoi les ouvriers furent éloignés tant des problèmes du pouvoir des soviets que des problèmes de la production pour lesquels ils s'étaient battus jusqu'alors. Ils pensaient : nous gérerons plus tard la production. Pour reconquérir la production, il faut tout d'abord l'arracher aux exploiteurs rebelles. Et ils avaient raison.
Mais fin 1920, la résistance des exploiteurs est anéantie. Le prolétariat, couvert de blessures, usé, souffrant de faim et de froid, va jouir des fruits de ses victoires. Il a repris la production. Et devant lui s'impose la nouvelle tâche immense, à savoir l'organisation de cette production, celle de l'économie du pays. Il faut produire le maximum de biens matériels pour démontrer l'avantage de ce monde prolétarien.
Le sort de toutes les conquêtes du prolétariat est étroitement lié au fait de réussir à s'emparer de la production et de l'organiser.
"La production est l'objectif de la société et c'est pourquoi ceux qui dirigent la production ont gouverné et gouverneront toujours la société".
Si le prolétariat ne réussit pas à se mettre à la tête de la production et à mettre sous son influence toute la masse petite-bourgeoise des paysans, des artisans et des intellectuels corporatistes, tout sera à nouveau perdu. Les fleuves de larmes et de sang, les monceaux de cadavres, les souffrances indicibles du prolétariat pendant la révolution ne serviront que d'engrais au terrain où le capitalisme se restaurera, où s'élèvera le monde d'exploitation, d'oppression d'un homme par son semblable si le prolétariat ne récupère pas la production, ne s'impose pas à l'élément petit-bourgeois personnifié par le paysan et l'artisan, ne change pas la base matérielle de la production.
Les conseils des députés ouvriers, qui forgeaient auparavant la volonté du prolétariat dans la lutte pour le pouvoir, ont triomphé sur le front de la guerre civile, sur le front politique, mais leur triomphe même les a affaiblis au point qu'on ne doit pas parler d'une amélioration des soviets, mais de leur reconstitution.
Il faut reconstituer les conseils dans toutes les fabriques et usines nationalisées pour résoudre une nouvelle tâche immense, pour créer ce monde de bonheur pour lequel tant de sang a coulé.
Le prolétariat est affaibli. La base de sa force (la grande industrie) est dans un état lamentable ; mais plus faibles sont les forces du prolétariat, plus ce dernier doit avoir d'unité, de cohésion, d'organisation. Le Conseil des députés ouvriers est une forme d'organisation qui a montré sa force miraculeuse et a surmonté non seulement les ennemis et les adversaires du prolétariat en Russie, mais a ébranlé aussi la domination des oppresseurs dans le monde entier, la révolution socialiste menaçant toute la société d'oppression capitaliste.
Ces nouveaux soviets, s'ils se portent au sommet dirigeant de la production, de la gestion des usines, seront non seulement capables d'appeler les masses les plus vastes de prolétaires ou semi-prolétaires à la résolution des problèmes qui se posent à elles, mais ils emploieront aussi directement dans la production tout l'appareil étatique, non en paroles mais en actes. Quand, ensuite, le prolétariat aura organisé, pour la gestion des entreprises et des industries, les soviets comme cellules fondamentales du pouvoir étatique, il ne pourra y rester inactif : il passera à l'organisation des trusts, des syndicats et des organes directeurs centraux, y compris les fameux soviets suprêmes pour l'économie populaire, et donnera un nouveau contenu au travail du Comité exécutif central panrusse. Les soviets désigneront comme membres du Comité central panrusse des soviets ceux qui combattirent sur les fronts de la guerre civile, sur le front de l'économie au travail. Naturellement tous les bureaucrates, tous les économistes qui se considèrent les sauveurs du prolétariat (dont ils craignent par-dessus tout la parole et le jugement) de même que tous les gens qui occupent des postes douillets dans les divers organismes, pousseront de hauts cris. Ils soutiendront que cela signifie l'écroulement de la production, la banqueroute de la révolution sociale, parce que beaucoup savent qu'ils doivent leur poste non à leurs capacités, mais à la protection, aux connaissances, aux "bonnes relations", en aucun cas à la confiance du prolétariat, au nom duquel ils administrent. Du reste, ils ont plus peur du prolétariat que des spécialistes, des nouveaux dirigeants d'entreprise et des Slastchovs.
La comédie panrusse avec ses directeurs rouges est orchestrée de façon à pousser le prolétariat à sanctifier la gestion bureaucratique de l'économie et à bénir la bureaucratie ; c'est une comédie également parce que les noms des directeurs de trusts, fortement protégés, n'apparaissent jamais dans la presse en dépit de leur ardent désir de publicité. Toutes nos tentatives pour démasquer un provocateur qui, il n'y a pas si longtemps, recevait de la police tsariste 80 roubles – le salaire le plus élevé pour ce genre d'activité – et qui se trouve maintenant à la tête du trust du caoutchouc, ont rencontré une résistance insurmontable. Nous voulons parler du provocateur tsariste Lechava-Murat (le frère du Commissaire du peuple pour le commerce intérieur, NDLR). Ceci éclaire suffisamment la nature du groupe qui avait imaginé la campagne pour les directeurs rouges.
Le Comité exécutif central panrusse des soviets, qui est élu pour un an et se réunit pour des conférences périodiques, constitue le ferment de la pourriture parlementaire. Et on dit : camarades, si on vient, par exemple, à une réunion où les camarades Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Boukharine parlent deux heures sur la situation économique, que peut-on faire d'autre, sinon s'abstenir ou approuver rapidement la résolution proposée par le rapporteur ? Étant donné que le Comité central panrusse ne s'occupe pas d'économie, il écoute de temps en temps quelques exposés sur ce sujet pour se dissoudre ensuite et chacun s'en va de son côté. Il est même arrivé le fait curieux qu'un projet présenté par les commissaires du peuple fût approuvé sans qu'il ait été lu au préalable. Dans quel but faut-il le lire avant de l'approuver ? On ne peut pas être, certes, plus instruit que le camarade Kurski (commissaire à la justice). On a transformé le Comité exécutif panrusse en une simple chambre d'enregistrement des décisions. Et son président ? Il est, avec votre permission, l'organe suprême ; mais eu égard aux tâches qui s'imposent au prolétariat, il est occupé à des broutilles. Il nous semble au contraire que le Comité exécutif central panrusse des soviets devrait plus que tout autre être lié aux masses, et cet organe législatif suprême devrait décider sur les questions les plus importantes de notre économie.
Notre Conseil des commissaires du peuple est, selon l'avis même de son chef, le camarade Lénine, un véritable appareil bureaucratique. Mais il voit les racines du mal dans le fait que les gens qui participent à l'Inspection ouvrière et paysanne sont corrompus et il propose simplement de changer les hommes qui occupent les postes dirigeants ; après ça tout ira mieux. Nous avons ici sous les yeux l'article du camarade Lénine paru dans la Pravda du 15 janvier 1923 : c'est un bel exemple de "politicaillerie". Les meilleurs parmi les camarades dirigeants affrontent en réalité cette question en tant que bureaucrates puisqu'ils voient le mal dans le fait que ce soit Tsiurupa (Rinz) et non Soltz (Kunz) qui préside l'Inspection ouvrière et paysanne. Il nous vient à l'esprit le dicton d'une fable : "Ce n'est pas en vous y obligeant que vous deviendrez musiciens". Ils se sont corrompus sous l'influence du milieu ; le milieu les a rendus bureaucrates. Que l'on change le milieu et ces gens travailleront bien.
Le Conseil des commissaires du peuple est organisé à l'image d'un conseil des ministres de tout pays bourgeois et a tous ses défauts. Il faut cesser de réparer les mesures douteuses qu'il prend ou de le liquider en gardant seulement le Présidium du CECP avec ses différents départements, tout comme on fait dans les provinces, districts et communes. Et transformer le CECP en organe permanent avec des commissions permanentes qui s'occuperaient des questions diverses. Mais pour qu'il ne devienne pas une institution bureaucratique, il faut changer le contenu de son travail et ce ne sera possible qu'au moment où sa base ("le noyau principal du pouvoir d'État"), les conseils des députés ouvriers seront rétablis à toutes les fabriques et usines, où les trusts, les syndicats, les directions des fabriques seront réorganisés sur base d'une démocratie prolétarienne, par les congrès des conseils, du district jusqu'au CECP. Alors on n'aura plus besoin du bavardage sur la lutte contre le bureaucratisme et la chicane. Car on sait bien que ce sont les pires bureaucrates qui critiquent le plus le bureaucratisme.
En réorganisant ainsi les organes dirigeants, en y introduisant les éléments réellement étrangers au bureaucratisme (et cela ira de soi), nous résoudrons effectivement la question qui nous préoccupe dans les conditions de la Nouvelle Politique économique. Alors, ce sera la classe ouvrière qui dirigera l'économie et le pays et non un groupe de bureaucrates qui menace de se transformer en oligarchie.
Quant à l'Inspection ouvrière et paysanne (la Rabkrine) 3, il vaut mieux la liquider que d'essayer d'améliorer son fonctionnement par le changement de ses fonctionnaires. Les syndicats (à travers leurs comités) devront se charger d'un contrôle de toute la production. Nous (l'État prolétarien) n'avons pas à craindre un contrôle prolétarien et ici il n'y a de place pour aucune objection réelle, si ce n'est la crainte même que le prolétariat inspire aux bureaucrates de toute sorte.
Donc il faut comprendre enfin que le contrôle doit être indépendant de celui qui y est soumis ; et pour l'obtenir, les syndicats ont à jouer le rôle de notre Rabkrine ou de l'ancien Contrôle d'État.
Ainsi les noyaux syndicaux locaux dans les usines et fabriques d'État se transformeraient en organes de contrôle.
Les comités des provinces réunis en conseils des syndicats des provinces deviendraient organes du contrôle dans les provinces et de même le Conseil central panrusse des syndicats aurait une telle fonction au centre.
Les conseils dirigent, les syndicats contrôlent, voici l'essence des rapports entre ces deux organisations dans l'État prolétarien.
Dans les entreprises privées (gérées à travers un bail ou une concession), les comités syndicaux jouent le rôle du contrôle étatique, veillant au respect des lois du travail, à l'acquittement des engagements pris par le gérant, le concessionnaire, etc. envers l'État prolétarien.
Quelques mots sur deux groupes
Deux documents que nous avons devant nous, [l'un] signé par un groupe clandestin Le groupe central la Vérité Ouvrière, l'autre ne portant aucune signature, sont une expression frappante de nos errements politiques.
Même les divertissements littéraires innocents que se permettait toujours une partie libérale du PCR (le soi-disant "Centralisme Démocratique"), ne peuvent absolument pas paraître dans notre presse. De tels documents, dénués de fondements théoriques et pratiques, du genre liquidateur comme l'appel du groupe "La Vérité Ouvrière", n'auraient aucune portée en milieu ouvrier s'ils étaient publiés légalement, mais, dans le cas contraire, ils peuvent attirer les sympathies non seulement du prolétariat, mais aussi des communistes.
Le document non signé, réalisé sans doute par les libéraux du PCR, constate justement :
1) Le bureaucratisme de l'appareil des conseils et du parti.
2) La dégénérescence des effectifs du parti.
3) La rupture entre les élites et les masses, la classe ouvrière, les militants de base du parti.
4) La différenciation matérielle entre les membres du parti.
5) L'existence du népotisme.
Comment combattre tout cela ? Il faut, voyez-vous :
1) Réfléchir sur des problèmes théoriques dans un cadre strictement prolétarien et communiste.
2) Assurer, dans le même cadre, une unité idéologique et une éducation de classe aux éléments sains et avancés du parti.
3) Lutter au sein du parti comme condition principale de son assainissement intérieur, l'abolition de la dictature et la mise en pratique de la liberté de discussion.
4) Lutter au sein du parti en faveur de telles conditions du développement des conseils et du parti, ce qui faciliterait l'élimination des forces et d'une influence petite-bourgeoises et affermirait davantage la force et l'influence d'un noyau communiste.
Voilà les idées principales de ces libéraux.
Mais, dites donc, qui du groupe dirigeant du parti s'opposerait à ces propositions ? Personne. Mieux encore, il n'a pas d'égal pour une démagogie de ce genre.
Les libéraux ont toujours servi au groupe dirigeant du parti justement en jouant le rôle des opposants "radicaux" et en dupant ainsi la classe ouvrière et beaucoup de communistes qui ont vraiment de bonnes raisons d'être mécontents. Et leur mécontentement est si grand que, pour le canaliser, les bureaucrates du parti et des conseils ont besoin d'inventer une opposition. Mais ils n'ont pas à se fatiguer, car les libéraux les aident chaque fois avec la grandiloquence qui leur est propre, en répondant à des questions concrètes par des phrases générales.
Qui, parmi le personnel actuel du Comité Central, ira protester contre le point le plus radical ? : "Lutter au sein du parti en faveur de telles conditions du développement des conseils et du parti, ce qui faciliterait l'élimination des forces et de l'influence petite-bourgeoises et affermirait davantage la force et l'influence d'un noyau communiste".
Non seulement ils ne protesteront pas, mais ils formuleront ces propos avec beaucoup plus de vigueur. Regardez le dernier article de Lénine et vous verrez qu'il dit "des choses très radicales" (du point de vue des libéraux) : à l'exception du Commissariat des affaires étrangères, notre appareil d'État est par excellence une survivance du passé qui n'a subi aucune modification sérieuse. Puis il tend la main aux libéraux, promet de les faire entrer aux CC et Commission centrale de Contrôle (CCC) élargis – et ils ne demanderaient pas mieux. Et cela va de soi, dès qu'ils entreront au CC, la paix universelle s'instaurera partout. En pérorant à propos de la libre discussion dans le parti, ils oublient un petit détail – le prolétariat. Car sans la liberté de parole accordée au prolétariat, aucune liberté dans le parti n'était et ne sera possible. Ce serait étrange d'avoir une liberté d'opinion dans le parti et en même temps en priver la classe dont ce parti représente les intérêts. Au lieu de proclamer la nécessité de réaliser les bases de la démocratie prolétarienne selon le programme du parti, ils jasent sur la liberté pour les communistes les plus avancés. Et il ne fait aucun doute que les plus avancés soient Sapronov, Maximovski et Co et si Zinoviev, Kamenev, Staline, Lénine se considèrent les plus avancés, alors ils s'entendront sur le fait qu'ils sont tous "les meilleurs", augmenteront les effectifs du CC et de la CCC et tout ira pour le mieux.
Nos libéraux sont incroyablement… libéraux, et ils demandent tout au plus la liberté d'association. Mais pour quoi faire ? Que veulent-ils nous dire, nous expliquer ? Seulement ce que vous avez écrit en deux petites pages ? Donc à la bonne heure ! Mais si vous feignez d'être un innocent opprimé, un persécuté politique, alors vous duperez ceux qu'il faut duper.
La conclusion de ces thèses est tout à fait "radicale", même "révolutionnaire" : voyez-vous, leurs auteurs voudraient bien que le XIIe congrès du parti fasse sortir du CC un ou deux (quelle audace !) fonctionnaires qui ont le plus contribué à la dégénérescence des effectifs du parti, au développement de la bureaucratie tout en cachant leurs desseins derrière de belles phrases (Zinoviev, Staline, Kamenev).
C'est chic ! Dès qu'au CC Staline, Zinoviev, Kamenev céderont la place à Maximovski, Sapronov, Obolenski, tout ira bien, même très bien. Nous répétons que vous n'avez rien à craindre, camarades libéraux ; au XIIème congrès vous entrerez au CC et, ce qui sera essentiel pour vous, ni Kamenev, ni Zinoviev, ni Staline ne vous en empêcheront. Bonne chance !
Selon ses dires, le groupe La Vérité Ouvrière est composé de communistes.
Comme tous les prolétaires auxquels ils s'adressent, nous les croirions volontiers, mais le problème est que ce sont des communistes d'un type particulier. D'après eux, la signification positive de la révolution russe d'Octobre consiste en ceci qu'elle a ouvert à la Russie des perspectives grandioses d'une transformation rapide en un pays de capitalisme avancé. Comme le prétend ce groupe, c'est sans aucun doute une conquête immense de la révolution d'Octobre.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est ni plus ni moins qu'un appel à revenir en arrière, au capitalisme, en renonçant aux mots d'ordre socialistes de la révolution d'Octobre. Ne pas consolider les positions du socialisme, du prolétariat en tant que classe dirigeante, mais les affaiblir en ne laissant à la classe ouvrière que la lutte pour un sou.
En conséquence, le groupe prétend que les rapports capitalistes classiques sont déjà restaurés. Il conseille donc à la classe ouvrière de se débarrasser "des illusions communistes" et l'invite à combattre le "monopole" du droit de vote par les travailleurs, ce qui veut dire que ceux-ci doivent y renoncer. Mais, messieurs les communistes, permettez-nous de demander en faveur de qui ?
Mais ces messieurs-là ne sont pas des imbéciles au point de dire ouvertement que c'est en faveur de la bourgeoisie. Quelle confiance des prolétaires auraient-ils alors en eux ? Les ouvriers comprendraient tout de suite qu'il s'agit de la même ancienne rengaine des mencheviks, SR et KD 4, ce qui n'entre pas dans les vues du groupe. Pourtant il n'a pas laissé échapper son secret. Car il prétend être attaché à la lutte contre "l'arbitraire administratif", mais "avec réserve": "Autant que c'est possible en l'absence d'institutions législatives élues". Le fait que les travailleurs russes élisent leurs conseils et CE, ce n'est pas une élection, figurez-vous, car une vraie élection doit être effectuée avec la participation de la bourgeoisie et des communistes de La Vérité Ouvrière, et pas celle des travailleurs. Comme tout cela est "communiste" et "révolutionnaire" ! Pourquoi, chers "communistes", vous arrêtez-vous à mi-chemin et n'expliquez-vous pas qu'il faudrait le droit de vote général, égal, direct et secret, celui qui est propre aux rapports capitalistes normaux ? Que ce serait une véritable démocratie bourgeoise ? Voulez-vous pêcher en eau trouble ?
Messieurs les communistes, espérez-vous dissimuler vos desseins réactionnaires et contre-révolutionnaires en répétant sans cesse le mot "révolution" ? Au cours des six dernières années, la classe ouvrière de Russie a vu suffisamment d'ultra-révolutionnaires pour comprendre votre intention de la duper. La seule chose qui pourrait vous faire obtenir gain de cause, c'est l'absence d'une démocratie prolétarienne, le silence imposé à la classe ouvrière.
Nous laissons de côté d'autres propos démagogiques de ce groupe, en notant seulement que le mode de pensée de cette "Vérité Ouvrière" est emprunté à A. Bogdanov.
Le Parti
Il ne fait aucun doute que, même maintenant, le PCR(b) est le seul parti qui représente les intérêts du prolétariat et de la population laborieuse russe qui se range de se son côté. Il n'y en a pas d'autre. Le programme et les statuts du parti sont l'ultime expression d'une pensée communiste. À partir du moment où le PCR organisa le prolétariat en vue de l'insurrection et de la prise du pouvoir, à partir de ce moment-là, il devint un parti de gouvernement et fut, durant la rude guerre civile, la seule force capable d'affronter les vestiges du régime absolutiste et agraire, les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks. Durant ces trois années de lutte, les organes dirigeants du parti ont assimilé des méthodes de travail adaptées à une guerre civile terrible mais qu'ils étendent maintenant à une phase toute nouvelle de la révolution sociale et dans laquelle le prolétariat avance des revendications tout-à-fait différentes.
De cette contradiction fondamentale découlent toutes les déficiences du parti et du mécanisme des soviets. Ces déficiences sont si graves qu'elles menacent d'annuler tout ce que le travail du PCR a produit de bon et d'utile. Mais plus encore, elles risquent d'anéantir ce parti en tant que parti d'avant-garde de l'armée prolétarienne internationale ; elles menacent – à cause des rapports actuels avec la N.E.P. – de transformer le parti en une minorité de détenteurs du pouvoir et des ressources économiques du pays, qui s'entendra pour s'ériger en une caste bureaucratique.
Ce n'est que le prolétariat lui-même qui peut réparer ces défauts de son parti. Il a beau être faible et ses conditions de vie ont beau être difficiles, il aura cependant assez de force pour réparer son bateau naufragé (son parti) et atteindre enfin la Terre promise.
On ne peut plus soutenir aujourd'hui qu'il soit vraiment nécessaire que le régime interne du parti continue à appliquer la méthode valable au temps de la guerre civile. C'est pourquoi, pour défendre les buts du parti, il faut s'efforcer – même si c'est à contrecœur – d'utiliser des méthodes qui ne sont pas celles du parti.
Dans la situation actuelle, il est objectivement indispensable de constituer un Groupe Ouvrier Communiste, qui ne soit pas lié organiquement au PCR, mais qui en reconnaisse pleinement le programme et les statuts. Un tel groupe est en train de se développer malgré l'opposition obstinée du parti dominant, de la bureaucratie des soviets et des syndicats. La tâche de ce groupe consistera à exercer une influence décisive sur la tactique du PCR, en conquérant la sympathie de larges masses prolétariennes, de façon telle qu'elle contraigne le parti à abandonner sa ligne directrice.
Conclusion
1. Le mouvement du prolétariat de tous les pays, surtout de ceux du capitalisme avancé, a atteint la phase de la lutte pour abolir l'exploitation et l'oppression, la lutte de classe pour le socialisme.
Le capitalisme menace de plonger toute l'humanité dans la barbarie. La classe ouvrière se doit de remplir sa mission historique et de sauver le genre humain.
2. L'histoire de la lutte des classes montre explicitement que, dans des situations historiques différentes, les mêmes classes prêchèrent soit la guerre civile, soit la paix civile. La propagande de la guerre civile et de la paix civile par la même classe, fut soit révolutionnaire et humaine, soit contre-révolutionnaire et strictement égoïste, défendant les intérêts d'une classe concrète à l'encontre des intérêts de la société, de la nation, de l'humanité.
Seul le prolétariat est toujours révolutionnaire et humain, qu'il prône la guerre ou la paix civiles.
3. La révolution russe donne des exemples frappants sur comment les différentes classes se transformèrent de partisanes de la guerre civile en partisanes de la paix civile et vice versa.
L'histoire de la lutte des classes en général et celle des 20 dernières années en Russie en particulier nous enseignent que les classes dirigeantes actuelles qui prônent la paix civile prôneront la guerre civile, impitoyable et sanglante, dès que le prolétariat prendra le pouvoir ; on peut dire la même chose des "fractions bourgeoises ayant une phraséologie socialiste obscure", des partis de la IIe Internationale et de ceux de l'Internationale II ½.
Dans tous les pays du capitalisme avancé, le parti du prolétariat doit, avec toute sa force et sa vigueur, prôner la guerre civile contre la bourgeoisie et ses complices – et la paix civile partout où le prolétariat triomphe.
4. Dans les conditions actuelles, la lutte pour un sou et pour une diminution de la journée de travail à travers les grèves, le Parlement etc. a perdu son ancienne portée révolutionnaire et ne fait qu'affaiblir le prolétariat, le détourner de sa tâche principale, ranimer les illusions sur une possibilité d'améliorer ses conditions au sein de la société capitaliste. Il faut soutenir les grévistes, aller au Parlement, non pour prôner une lutte pour un sou, mais pour organiser des forces prolétariennes en vue d'un combat décisif et final contre le monde de l'oppression.
5. La discussion de la question d'un "front unique" à la façon militaire (comme on en discute tous les aspects en Russie) et la conclusion singulière qui lui a été donnée n'ont pas permis, jusqu'ici, d'aborder sérieusement ce problème, car [dans le contexte actuel] il est tout à fait impossible de critiquer quoi que ce soit.
La référence à l'expérience de la révolution russe ne vaut que pour les ignorants et n'est confirmée d'aucune façon par cette même expérience tant que celle-ci demeure fixée dans les documents historiques (les résolutions des congrès, des conférences etc.).
La vision marxiste et dialectique des problèmes de la lutte de classe y est substituée par une vision dogmatique.
L'expérience d'une époque concrète avec ses buts et tâches est automatiquement transportée à une autre qui a des traits particuliers qui lui sont propres, ce qui conduit inévitablement à imposer, aux partis communistes du monde entier, une tactique opportuniste du "front unique". La tactique du "front unique" avec la IIe Internationale et l'Internationale II ½ contredit totalement l'expérience de la révolution russe et le programme du PCR(b). C'est une tactique d'entente avec des ennemis ouverts de la classe ouvrière.
Il faut former un front unique avec toutes les organisations révolutionnaires de la classe ouvrière qui sont prêtes (aujourd'hui et non "un jour ou l'autre") à lutter pour la dictature du prolétariat, contre la bourgeoisie et ses fractions.
6. Les thèses du CC de l'Internationale Communiste sont un déguisement classique de la tactique opportuniste par des phrases révolutionnaires.
7. Ni les thèses, ni les discussions menées dans les congrès de l'Internationale Communiste n'ont abordé la question du front unique dans les pays qui ont accompli la révolution socialiste et dans lesquels la classe ouvrière exerce la dictature. Cela est dû au rôle que le parti communiste russe assume dans l'Internationale et dans la politique interne de la Russie. La particularité de la question du "front unique" dans de tels pays tient au fait qu'elle est résolue de façons diverses au cours des différentes phases du processus révolutionnaire : dans la période de répression de la résistance des exploiteurs et de leurs complices, une certaine solution est valable, une autre s'impose au contraire quand les exploiteurs sont déjà battus et que le prolétariat a progressé dans la construction de l'ordre socialiste, même avec l'aide de la N.E.P. et les armes à la main.
8. La question nationale. Les nominations arbitraires multiples, la négligence d'une expérience locale, l'imposition des tuteurs et les exils ("les permutations planifiées"), tout ce comportement du groupe dirigeant du PCR(b) envers les partis nationaux des pays adhérents à l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, a aggravé, dans les masses laborieuses de la plupart des petites ethnies, des tendances chauvines qui pénètrent les partis communistes.
Pour se débarrasser une fois pour toutes de ces tendances, il faut réaliser les principes de la démocratie prolétarienne dans le domaine de l'organisation des partis communistes nationaux, chacun dirigé par son CC, adhérant à la IIIe Internationale Communiste, au même titre que le PCR(b) et en y formant une section autonome. Pour résoudre des tâches communes, les partis communistes des pays de l'URSS doivent convoquer leur congrès périodique qui élit un comité exécutif permanent des partis communistes de l'URSS.
9. La N.E.P est une conséquence directe de l'état des forces productives de notre pays. Il faut l'utiliser pour maintenir les positions du prolétariat conquises en Octobre.
Même dans le cas d'une révolution dans un des pays capitalistes avancés, la N.E.P serait une phase de la révolution socialiste dont il est impossible de se passer. Si la révolution avait éclaté dans un des pays du capitalisme avancé, cela aurait eu une influence sur la durée et le développement de la N.E.P.
Mais dans tous les pays du capitalisme avancé, la nécessité d'une Nouvelle Politique économique, à un certain stade de la révolution prolétarienne, dépendra du degré d'influence du mode petit-bourgeois de production par rapport à celle de l'industrie socialisée.
10. L'extinction de la N.E.P. en Russie est liée à la mécanisation rapide du pays, à la victoire des tracteurs sur les charrues en bois. Sur ces bases de développement des forces productives s'institue un nouveau rapport réciproque entre les villes et les campagnes. Compter sur l'importation de machines étrangères pour les besoins de l'économie agricole n'est pas juste. Ceci est politiquement et économiquement nocif dans la mesure où cela lie notre économie agricole au capital étranger et affaiblit l'industrie russe.
La production des machines nécessaires en Russie est possible, cela renforcera l'industrie et soudera la ville et la campagne d'une façon organique, fera disparaître l'écart matériel et idéologique entre elles et formera bientôt des conditions qui permettront de renoncer à la N.E.P.
11. La Nouvelle Politique économique contient des menaces terribles pour le prolétariat. Hormis le fait que, à travers elle, la révolution socialiste subit un examen pratique de son économie, en dehors du fait que nous devons démontrer en pratique les avantages des formes socialistes de la vie économique par rapport aux formes capitalistes – à part tout cela, il faut se tenir aux positions socialistes sans devenir une caste oligarchique qui s'emparerait de tout le pouvoir économique et politique et aurait peur de la classe ouvrière plus que de toute autre chose.
Pour empêcher de transformer la Nouvelle Politique économique en "Nouvelle Exploitation du Prolétariat", il faut que le prolétariat participe directement à la résolution des tâches immenses qui se posent à lui en ce moment, sur base des principes d'une démocratie prolétarienne ; ce qui donnera à la classe ouvrière la possibilité de mettre ses conquêtes d'Octobre à l'abri de tous les dangers, d'où qu'ils viennent, et de modifier radicalement le régime intérieur du parti et ses rapports avec celui-ci.
12. La réalisation du principe de la démocratie prolétarienne doit correspondre aux tâches fondamentales du moment.
Après la résolution des tâches politico-militaires (prise du pouvoir et répression de la résistance des exploiteurs), le prolétariat est amené à résoudre la tâche la plus difficile et importante : la question économique de la transformation des vieux rapports capitalistes en nouveaux rapports socialistes. C'est seulement après l'accomplissement d'une telle tâche qu'un prolétariat peut se considérer vainqueur, sinon tout aura été vain encore une fois, et le sang et les morts serviront seulement de fumier à la terre sur laquelle continuera à s'élever l'édifice de l'exploitation et de l'oppression, la domination bourgeoise.
Pour accomplir cette tâche, il est absolument nécessaire que le prolétariat participe réellement à la gestion de l'économie. "Qui se trouve au sommet de la production se trouve également au sommet de la ‘société' et de l'l'État'".
Il est donc nécessaire :
que dans toutes les fabriques et les entreprises se constituent les conseils des délégués ouvriers ;
que les congrès des conseils élisent les dirigeants des trusts, des syndicats et les autorités centrales ;
que l'Exécutif panrusse soit transformé en un organe qui gère l'agriculture et l'industrie. Les tâches qui s'imposent au prolétariat doivent être abordées avec en vue l'actualité de la démocratie prolétarienne. Celle-ci doit s'exprimer dans un organe qui travaille de façon assidue et institue en son sein des sections et des commissions permanentes prêtes à affronter tous les problèmes. Mais le Conseil des commissaires du peuple qui est la copie d'un quelconque conseil des ministres bourgeois doit être aboli et son travail confié au Comité exécutif panrusse des soviets.
Il est nécessaire, en outre, que l'influence du prolétariat soit renforcée sur d'autres plans. Les syndicats, qui doivent être une véritable organisation prolétarienne de classe, doivent en tant que tels se constituer en organes de contrôle ayant le droit et les moyens pour effectuer l'inspection ouvrière et paysanne. Les comités d'usine et d'entreprise doivent remplir une fonction de contrôle dans les usines et les entreprises. Les sections dirigeantes des syndicats qui sont unies dans l'Union dirigeante centrale doivent contrôler les directions tandis que les directions des syndicats réunies dans une Union centrale panrusse, doivent être les organes de contrôle au centre.
Mais les syndicats accomplissent aujourd'hui une fonction qui ne leur revient pas dans l'État prolétarien, ce qui fait obstacle à leur influence et contraste avec le sens de leurs positions au sein du mouvement international.
Celui qui a peur devant un tel rôle des syndicats témoigne de sa peur devant le prolétariat et perd tout lien avec lui.
13. Sur le terrain de l'insatisfaction profonde de la classe ouvrière, divers groupes se forment qui se proposent d'organiser le prolétariat. Deux courants : la plate-forme des libéraux du Centralisme Démocratique et celle de Vérité Ouvrière témoignent, d'un côté, d'un manque de clarté politique, de l'autre, de l'effort de se relier à la classe ouvrière. La classe ouvrière cherche une forme d'expression à son insatisfaction.
L'un et l'autre groupes, auxquels appartiennent très probablement des éléments prolétariens honnêtes, jugeant insatisfaisante la situation actuelle, se dirigent vers des conclusions erronées (de type menchevique).
14. Il persiste dans le parti un régime qui est nocif aux rapports du parti avec la classe prolétarienne et qui, pour le moment, ne permet pas de soulever des questions qui soient, d'une quelconque façon, gênantes pour le groupe dirigeant le PCR (b). De là provient la nécessité de constituer le Groupe ouvrier du PCR (b) sur la base du programme et des statuts du PCR, afin d'exercer une pression décisive sur le groupe dirigeant du parti lui-même.
Nous faisons appel à tous les éléments prolétariens authentiques (également à ceux du Centralisme démocratique et de Vérité Ouvrière, d'Opposition ouvrière) et à ceux qui se trouvent à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur du parti, afin qu'ils s'unissent sur la base du Manifeste du Groupe ouvrier du PCR(b).
Plus vite ils reconnaîtront la nécessité de s'organiser, moindres seront les difficultés que tous nous devrons surmonter.
En avant, camarades !
L'émancipation des ouvriers est l'œuvre des ouvriers eux-mêmes !
Moscou, février 1923.
Le Bureau central provisoire d'organisation du Groupe ouvrier du PCR (b).
1 Nous conseillons au lecteur de replacer cette question de l'activité des groupes critiqués par Le Manifeste dans le contexte plus large que nous lui donnons dans l'article "La gauche communiste en Russie" des Revues internationales n° 8 (lire en particulier ce qui concerne le groupe Centralisme démocratique) et n° 9 (lire en particulier ce qui concerne le groupe Vérité Ouvrière)
2 Assemblée provinciale de la Russie impériale représentant, avant leur abolition par le pouvoir soviétique, la noblesse locale et les riches artisans et commerçants (source Wikipédia). NDLR
3 Organisme qui avait en principe pour responsabilité de contrôler le bon fonctionnement de l'État et de lutter contre sa bureaucratisation mais qui était devenu à son tour une caricature de bureaucratie.
4 SR : Socialistes révolutionnaires. KD : Constitutionnels démocrates. NDLR
Géographique:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [16]
Revue Internationale n° 146 - 3e trimestre 2011
- 3104 lectures
La mobilisation des indignés en Espagne et ses répercussions dans le monde : un mouvement porteur d'avenir
- 76 lectures
Le Mouvement "15M" en Espagne – dont le nom correspond à la date de sa création, le 15 mai – est un événement de grande importance aux caractéristiques inédites. Nous voulons dans cet article en raconter les épisodes marquants et, à chaque fois, tirer les leçons et tracer les perspectives pour le futur.
Rendre compte de ce qui s’est réellement passé est une contribution nécessaire à la compréhension de la dynamique que prend la lutte de classes internationale vers des mouvements massifs de la classe ouvrière, qui l’aideront à reprendre confiance en elle et lui donneront les moyens de présenter une alternative à cette société moribonde 1.
Le "No Future" du capitalisme, toile de fond du Mouvement 15M
Le mot "crise" contient une connotation dramatique pour des millions de personnes, frappées par une avalanche de misère qui va de détérioration croissante des conditions de vie, en passant par le chômage à durée indéterminée et la précarité qui rendent impossible la moindre stabilité quotidienne, jusqu’aux situations les plus extrêmes qui renvoient directement à la grande pauvreté et à la faim 2.
Mais ce qui est le plus angoissant est l’absence de futur. Comme le dénonçait l’Assemblée des Emprisonnés de Madrid 3 dans un communiqué qui, comme nous allons le voir, fut l’étincelle qui mit le feu aux poudres du mouvement : "nous nous trouvons face à un horizon privé du moindre espoir et sans un futur qui nous permette de vivre tranquilles et de pouvoir nous consacrer à ce qui nous plaît" 4. Lorsque l’OCDE nous déclare qu’il faudra 15 ans pour que l’Espagne retrouve le niveau d’emploi qu’elle avait en 2007 – presque une génération entière privée de travail ! –, lorsque des chiffres similaires peuvent être extrapolés pour les États-Unis ou la Grande-Bretagne, on peut réaliser à quel point cette société est précipitée dans un tourbillon sans fin de misère, de chômage et de barbarie.
Le mouvement s’est, à première vue, polarisé contre le système politique bipartite dominant en Espagne (deux partis, à droite le Parti Populaire et à gauche le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, qui représentent 86 % des élus) 5. Ce facteur a joué un rôle, en rapport précisément avec cette absence d’avenir, puisque dans un pays où la droite jouit de la réputation méritée d’être d’autoritaire, arrogante et anti-ouvrière, d’amples secteurs de la population ont vu avec inquiétude comment, avec les attaques gouvernementales portées par les faux-amis – le PSOE –, les ennemis déclarés – le PP – menaçaient de s’installer au pouvoir pour de longues années, sans alternative aucune au sein du jeu électoral, reflétant ainsi le blocage général de la société.
Ce sentiment a été renforcé par l’attitude des syndicats qui commencèrent par convoquer une "grève générale" le 29 septembre, qui ne fut qu’une gesticulation démobilisatrice, puis signèrent avec le gouvernement un Pacte social en janvier 2011 qui acceptait la brutale réforme des retraites et fermait la porte à toute possibilité de mobilisations massives sous leur direction.
A ces facteurs s'est joint un profond sentiment d’indignation. Une des conséquences de la crise, comme cela fut dit dans l’assemblée de Valence, c’est que "les rares qui possèdent beaucoup sont encore plus rares et possèdent beaucoup plus, alors que le grand nombre qui possède peu est beaucoup plus nombreux et possède beaucoup moins". Les capitalistes et leur personnel politique se font de plus en plus arrogants, voraces et corrompus. Ils n’hésitent pas à accumuler d’immenses richesses, alors qu’autour d’eux se répandent la misère et la désolation. Tout cela fait comprendre, bien plus aisément qu'une démonstration, que les classes sociales existent et que nous ne sommes pas des "citoyens égaux".
Dès la fin de 2010, face à cette situation, des collectifs ont surgi, affirmant qu’il fallait s’unir dans la rue, agir en marge des partis et des syndicats, s’organiser en assemblées… La vieille taupe évoquée par Marx préparait dans les entrailles de la société une maturation souterraine qui éclata en plein jour au mois de mai ! La mobilisation de "Jeunes Sans Avenir" au mois d’avril regroupa 5 000 jeunes à Madrid. Par ailleurs, le succès de manifestations de jeunes au Portugal – Geração à Rasca (génération à la dérive) – qui rassemblèrent plus de 200 000 personnes, et l’exemple très populaire de la place Tahrir en Égypte ont fait partie des stimulateurs du mouvement.
Les assemblées : un premier regard vers l’avenir
Le 15 mai, un cartel de plus de 100 organisations – baptisé Democracia Real Ya (DRY) 6 – convoqua des manifestations dans les grandes villes de province "contre les politiciens", réclamant une "véritable démocratie".
De petits groupes de jeunes (chômeurs, précaires et étudiants), en désaccord avec le rôle de soupape du mécontentement social que les organisateurs voulaient faire jouer au mouvement, tentèrent de mettre en place un campement sur la place centrale à Madrid, à Grenade et autres villes afin de poursuivre le mouvement. DRY les désavoua et laissa les troupes policières se livrer à une brutale répression, perpétrée en particulier dans les commissariats. Cependant, ceux qui en ont été victimes se constituèrent en Assemblée des Emprisonnés de Madrid et produisirent rapidement un communiqué dénonçant clairement les traitements dégradants infligés par la police. Celui-ci fit forte impression et encouragea de nombreux jeunes à se joindre aux campements.
Le mardi 17 mai, alors que DRY tentait d’enfermer les campements dans un rôle symbolique de protestation, l’énorme masse qui affluait vers eux imposa la tenue d’assemblées. Le mercredi et le jeudi, les assemblées massives se répandaient dans plus de 73 villes. Il s’y exprimait des réflexions intéressantes, des propositions judicieuses, traitant de tous les aspects de la vie sociale, économique, politique et culturelle. Rien de ce qui est humain n’était étranger à cette immense agora improvisée !
Une manifestante madrilène disait : "ce qu’il y a de mieux c’est les assemblées, la parole se libère, les gens se comprennent, on peut penser à haute voix, des milliers d’inconnus peuvent parvenir à être d’accord. N’est-ce pas merveilleux ?". Les assemblées étaient un tout autre monde, à l’opposé de l’ambiance sombre qui règne dans les bureaux de vote et à cent lieues de l’enthousiasme de marketing des périodes électorales : "Accolades fraternelles, cris d'enthousiasme et de ravissement, chants de liberté, rires joyeux, gaieté et transports de joie : c'était tout un concert qu'on entendait dans cette foule de milliers de personnes allant et venant à travers la ville du matin au soir. Il régnait une atmosphère d'euphorie ; on pouvait presque croire qu'une vie nouvelle et meilleure commençait sur la terre. Spectacle profondément émouvant et en même temps idyllique et touchant" 7. Des milliers de personnes discutaient passionnément dans une ambiance de profond respect, d’ordre admirable, d’écoute attentive. Elles étaient unies par l’indignation et l’inquiétude face au futur mais, surtout, par la volonté de comprendre ses causes ; de là cet effort pour le débat, pour l’analyse d’une foule de questions, les centaines de réunions et la création de bibliothèques de rue… Un effort apparemment sans résultat concret, mais qui a bouleversé tous les esprits et a semé des graines de conscience dans les champs de l’avenir.
Subjectivement, la lutte de classe repose sur deux piliers : d’une part la conscience, de l’autre, la confiance et la solidarité. Sur ce dernier aspect, les assemblées ont aussi été porteuses pour l’avenir : les liens humains qui se tissaient, le courant d’empathie qui animait les places, la solidarité et l’unité qui fleurissaient avaient au moins autant d’importance que le fait de prendre des décisions ou de converger sur une revendication. Les politiciens et la presse enrageaient, eux qui réclamaient, avec l’immédiatisme et l’utilitarisme caractéristiques de l’idéologie bourgeoise, que le mouvement condense ses revendications dans un "protocole", ce que DRY tentait de convertir en "décalogue" regroupant toutes les mesures démocratiques ridicules et poussives telles que les listes des candidats ouvertes, les initiatives législatives populaires et la réforme de la loi électorale.
La résistance acharnée à laquelle se heurtèrent ces mesures précipitées est venue illustrer en quoi le mouvement exprimait le devenir de la lutte de classes. A Madrid, les gens criaient : "Nous n’allons pas lentement, c’est que nous allons très loin !". Dans une Lettre ouverte aux assemblées, un groupe de Madrid disait : "Le plus difficile est de synthétiser ce que veulent nos manifestations. Nous sommes convaincus que ce n’est pas à la légère, comme le veulent de façon intéressée les politiciens et tous ceux qui veulent que rien ne change ou, pour mieux dire, ceux qui veulent changer quelques détails pour que tout reste identique. Que ce ne sera pas en proposant soudain un "Grenelle de revendications" que nous parviendrons à synthétiser ce pourquoi nous luttons, ce n’est pas en créant un petit tas de revendications que notre révolte s’exprimera et se renforcera" 8.
L’effort pour comprendre les causes d’une situation dramatique et d’un futur incertain, et trouver la façon de lutter en conséquence, a constitué l’axe des assemblées. D'où leur caractère délibératif qui a désorienté tous ceux qui espéraient une lutte centrée sur des revendications précises. L’effort de réflexion sur des thèmes éthiques, culturels, artistiques et littéraires (il y eut des interventions sous forme de chansons ou de poèmes) a créé le sentiment trompeur d’un mouvement petit-bourgeois "d’indignés". Nous devons ici séparer le bon grain de l’ivraie. Cette dernière est bien sûr présente dans la coquille démocratique et citoyenne qui a souvent enveloppé ces préoccupations. Mais celles-ci sont du bon grain, car la transformation révolutionnaire du monde s’appuie, et à la fois le stimule, sur un gigantesque changement culturel et éthique ; "changer le monde et changer la vie en nous transformant nous-mêmes", telle est la devise révolutionnaire que Marx et Engels formulèrent dans l’Idéologie allemande voilà plus d’un siècle et demi : "... Une transformation massive des hommes s'avère nécessaire pour la création en masse de cette conscience communiste, comme aussi pour mener la chose elle-même à bien ; or, une telle transformation ne peut s'opérer que par un mouvement pratique, par une révolution ; cette révolution n'est donc pas seulement rendue nécessaire parce qu'elle est le seul moyen de renverser la classe dominante, elle l'est également parce que seule une révolution permettra à la classe qui renverse l'autre de balayer toute la pourriture du vieux système qui lui colle après et de devenir apte à fonder la société sur des bases nouvelles" 9.
Les assemblées massives ont été une première tentative de réponse à un problème général de la société que nous avons mis en évidence il y a plus de 20 ans : la décomposition sociale du capitalisme. Dans les "Thèses sur la décomposition" que nous avions alors écrites 10, nous signalons la tendance à la décomposition de l'idéologie et des superstructures de la société capitaliste et, allant de pair avec celle-ci, la dislocation croissante des relations sociales qui affecte aussi bien la bourgeoisie que la petite bourgeoisie. La classe ouvrière n'y échappe pas du fait, entre autres, qu'elle côtoie la petite bourgeoisie. Nous mettions en garde dans ce document contre les effets de ce processus : "1) 'l'action collective, la solidarité, trouvent en face d'elles l'atomisation, le 'chacun pour soi', la 'débrouille individuelle' ; 2) le besoin d'organisation se confronte à la décomposition sociale, à la déstructuration des rapports qui fondent toute vie en société ; 3) la confiance dans l'avenir et en ses propres forces est en permanence sapée par le désespoir général qui envahit la société, par le nihilisme, par le 'no future' ; 4) la conscience, la lucidité, la cohérence et l'unité de la pensée, le goût pour la théorie, doivent se frayer un chemin difficile au milieu de la fuite dans les chimères, la drogue, les sectes, le mysticisme, le rejet de la réflexion, la destruction de la pensée qui caractérisent notre époque."
Cependant, ce que montrent les assemblées massives en Espagne – de même que ce qu'ont mis en évidence celles qui sont apparues durant le mouvement des étudiants en France en 2006 11 - c'est que les secteurs les plus vulnérables aux effets de la décomposition – les jeunes, les chômeurs, du fait en particulier du peu d'expérience du travail qu'il ont acquis – se sont retrouvés à l'avant-garde des assemblées et de l'effort de prise de conscience d'une part, de solidarité et d'empathie d'autre part.
Pour toutes ces raisons, les assemblées massives ont constitué une première anticipation de ce qui est devant nous. Cela peut paraître très peu à ceux qui attendent que le prolétariat, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, se manifeste clairement et sans ambages comme la classe révolutionnaire de la société. Cependant, d’un point de vue historique et en prenant en compte les difficultés énormes qu’il rencontre pour atteindre cet objectif, il s’agit là d’un bon début, puisqu’il a commencé à préparer rigoureusement le terrain subjectif.
Paradoxalement, ces caractéristiques ont aussi été le talon d’Achille du mouvement "15M" tel qu'il s'est exprimé dans une première étape de son développement. N’ayant pas surgi avec un objectif concret, la fatigue, la difficulté pour aller au-delà de premières approximations des graves problèmes qui se posent, l’absence de conditions pour que le prolétariat entre en lutte depuis les lieux de travail, ont plongé le mouvement dans une sorte de vide et de terrain vague qui ne pouvait se maintenir longtemps en l'état, et que DRY a tenté d'investir avec ses objectifs de "réforme démocratique" soi-disant "faciles" et "réalisables" mais qui ne sont qu’utopiques et réactionnaires.
Les pièges que le mouvement a dû affronter
Pendant presque deux décennies, le prolétariat mondial a réalisé une traversée du désert caractérisée par l’absence de luttes massives et, surtout, par une perte de confiance en lui-même et une perte de sa propre identité de classe 12. Même si cette atmosphère est allée en se diluant progressivement depuis 2003, avec l’apparition de luttes significatives dans bon nombre de pays et d’une nouvelle génération de minorités révolutionnaires, l’image stéréotypée d’une classe ouvrière "qui ne bouge pas", "complètement absente", continuait de dominer.
L’irruption soudaine de grandes masses dans l’arène sociale devait être entravée par ce poids du passé, difficulté accrue par la présence dans le mouvement de couches sociales en voie de prolétarisation, plus vulnérables aux pièges démocratique et citoyen. À cela s'est ajouté le fait que le mouvement n'ayant pas surgi à partir de la lutte contre une mesure concrète, il en a résulté un paradoxe, qui n’est pas nouveau dans l’histoire 13, à savoir que les deux grandes classes de la société – le prolétariat et la bourgeoisie – ont semblé esquiver le corps à corps ouvert, donnant ainsi l’impression d’un mouvement pacifique, jouissant de "l’approbation de tous" 14.
Mais en réalité, la confrontation entre les classes était présente dès les premiers jours. Le gouvernement PSOE ne répliqua-t-il pas d’emblée par la répression brutale contre une poignée de jeunes ? N’est-ce pas la réponse rapide et passionnée de l’Assemblée des Emprisonnés de Madrid qui déchaîna le mouvement ? N’est-ce pas cette dénonciation qui ouvrit les yeux à bien des jeunes qui, dès lors, scandèrent "ils l'appellent démocratie mais ce n’en est pas une !", mot d’ordre ambigu qui fut transformé par une minorité en "ils la nomment dictature et c’en est une !" ?
Pour tous ceux qui pensent que la lutte de classes est une succession "d’émotions fortes", l’aspect "paisible" que revêtaient les assemblées les a poussés à croire que celles-ci n’étaient rien de plus que l’exercice d’un "inoffensif droit constitutionnel", peut-être même beaucoup de participants croyaient-ils que leur mouvement se limitait à cela.
Cependant, les assemblées massives sur la place publique, le mot d’ordre "Prends la place !", expriment un défi en règle à l’ordre démocratique. Ce que déterminent les rapports sociaux et que sanctifient les lois, c’est que la majorité exploitée s’occupe de "ses affaires" et, si elle veut "participer" aux affaires publiques, elle utilise le vote et la protestation syndicale qui l’atomisent et l’individualisent davantage encore. S’unir, vivre la solidarité, discuter collectivement, commencer à agir en tant que corps social indépendant, sont de fait une violence irrésistible contre l’ordre bourgeois.
La bourgeoisie a fait l’impossible pour en finir avec les assemblées. Pour la vitrine, avec l’écœurante hypocrisie qui la caractérise, ce n’étaient que louanges et clins d’œil complices vers les Indignés, mais les faits – qui sont ce qui compte réellement – démentaient cette apparente complaisance.
A cause de la proximité de la journée électorale – le dimanche 22 mai –, l’Assemblée électorale centrale décida d’interdire les assemblées dans tout le pays le samedi 21, considéré comme un "jour de réflexion". Dès samedi à 0 heure, un énorme déploiement policier encercle le campement de la Puerta del Sol, mais il est à son tour encerclé par une foule gigantesque, qui oblige le ministre de l’Intérieur lui-même à ordonner le repli. Plus de 20 000 personnes occupent alors la place dans une grande explosion de joie. Nous voyons là un autre épisode de confrontation de classe, même si la violence explicite s’est réduite à quelques algarades.
DRY propose de maintenir les campements tout en gardant le silence afin de respecter la "journée de réflexion", donc de ne pas tenir d’assemblées. Mais personne ne l’écoute, et les assemblées du samedi 21, formellement illégales, enregistrent les plus hauts niveaux d’assistance. Dans l’assemblée de Barcelone, des panneaux, des slogans repris en chœur et des pancartes proclament ironiquement en réponse à l’Assemblée électorale : "Nous réfléchissons !".
Le dimanche 22, jour d’élections, a lieu une nouvelle tentative d’en finir avec les assemblées. DRY proclame que "les objectifs sont atteints" et que le mouvement doit s’achever. La riposte est unanime : "Nous ne sommes pas ici pour les élections !". Lundi 23 et mardi 24, tant en nombre de participants que par la richesse des débats, les assemblées atteignent leur point culminant. Les interventions, les mots d’ordre, les pancartes prolifèrent qui démontrent une profonde réflexion : "Où se trouve la gauche ? Au fond à droite !", "Les urnes ne peuvent contenir nos rêves !", "600 euros par mois, ça c’est de la violence !", "Si vous ne nous laissez pas rêver, nous vous empêcheront de dormir !", "Sans travail, sans logement, sans peur !", "Ils ont trompé nos grands-parents, ils ont trompé nos enfants, qu’ils ne trompent pas nos petits-enfants !". Ils démontrent aussi une conscience des perspectives : "Nous sommes le futur, le capitalisme c’est le passé !", "Tout le pouvoir aux assemblées !", "Il n’y a pas d’évolution sans révolution !", "Le futur commence maintenant !", "Tu crois encore que c’est une utopie ?"…
A partir de ce sommet, les assemblées commencent à décliner. En partie à cause de la fatigue, mais aussi au bombardement incessant de DRY pour faire adopter son "Décalogue démocratique". Les points du décalogue sont loin d’être neutres, ils sont dirigés directement contre les assemblées. La revendication la plus "radicale", l’"Initiative législative populaire" 15, outre qu’elle implique d’interminables démarches parlementaires qui décourageraient les plus tenaces, remplace surtout le débat massif, où tous peuvent se sentir partie prenante d’un corps collectif, par des actes individuels, purement citoyens, de protestation enfermée entre les quatre murs du Moi 16.
Le sabotage de l’intérieur s’est conjugué avec les attaques répressives de l’extérieur, démontrant par-là à quel point la bourgeoisie est hypocrite lorsqu'elle prétend que les assemblées constituent "un droit constitutionnel de réunion". Le vendredi 27, le Gouvernement catalan – en coordination avec le gouvernement central – tente un coup de force : les "mossos de esquadra" (forces de police régionale) envahissent la Place de Catalogne à Barcelone et répriment sauvagement, provoquant de nombreux blessés et de multiples arrestations. L’Assemblée de Barcelone – jusqu’alors la plus orientée vers des positionnements de classe – est prise au piège des revendications démocratiques classiques : pétitions pour exiger la démission du conseiller de l’Intérieur, rejet de la répression "disproportionnée" 17, revendication d’un "contrôle démocratique de la police". Sa volte-face est d'autant plus évidente qu’elle cède au poison nationaliste et inclut dans ses revendications le "droit à l’autodétermination".
Les scènes de répression se multiplient dans la semaine du 5 au 12 juin : Valence, Saint-Jacques-de-Compostelle, Salamanque… Le coup le plus brutal est cependant porté du 14 au 15 à Barcelone. Le Parlement catalan discutait une loi dite Omnibus qui prévoyait de violentes coupes sociales en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé (entre autres 15 000 licenciements dans ce dernier). DRY, en dehors de toute dynamique de discussion en assemblées de travailleurs, convoqua une "manifestation pacifique" qui consistait à encercler le Parlement pour "empêcher les députés de voter une loi injuste". Il s’agit là d'une action purement symbolique typique qui, au lieu de combattre une loi et les institutions dont elle émane, s’adresse à la "conscience" des députés. Aux manifestants ainsi piégés, il ne reste plus que le faux choix : ou bien le terrain démocratique et les pleurnicheries impuissantes et passives de la majorité, ou bien son pendant, la violence "radicale" d’une minorité.
Les insultes et bousculades de quelques députés sont l'occasion d'une campagne hystérique qui criminalise les "violents" (mettant dans ce sac ceux qui défendent des positions de classe) et appelle à "défendre les institutions démocratiques menacées". Pour que la boucle soit bouclée, DRY arbore son pacifisme pour demander aux manifestants d’exercer la violence sur les éléments "violents" 18, et va encore plus loin : elle demande ouvertement que les "violents" soient livrés à la police et que les manifestants applaudissent cette dernière pour ses "bons et loyaux services" !
Les manifestations du 19 juin et l’extension à la classe ouvrière
Dès le début, le mouvement a eu deux âmes : une âme démocratique très large, alimentée par les confusions et les doutes, résultant de son caractère socialement hétérogène et sa tendance à fuir la confrontation directe. Mais il y avait aussi une âme prolétarienne, qui se matérialisait par les assemblées 19 et par une tendance toujours présente à "aller vers la classe ouvrière".
À l’Assemblée de Barcelone, des travailleurs des télécommunications et de la santé, des pompiers, des étudiants de l’université, mobilisés contre les coupes sociales, participent activement. Ils créent une Commission d’extension et de grève générale, dont les débats sont très animés et organisent un réseau des Travailleurs indignés de Barcelone qui convoque une assemblée d’entreprises en lutte pour le samedi 11 juin, puis une Rencontre le samedi 3 juillet. Vendredi 3 juin, chômeurs et actifs manifestent autour de la place de Catalogne derrière une banderole qui affiche : "A bas la bureaucratie syndicale ! Grève générale !". A Valence, l’Assemblée soutient une manifestation des travailleurs des transports publics et aussi une manifestation de quartier protestant contre les coupes dans l’enseignement. A Saragosse, les travailleurs des transports publics se joignent à l’assemblée avec enthousiasme 20. Les assemblées décident de former des assemblées de quartier 21.
La manifestation du 19 juin voit une nouvelle poussée de "l’âme prolétarienne". Cette manifestation a été convoquée par les Assemblées de Barcelone, Valence et Malaga et est orientée contre les coupes sociales. DRY tente de la dénaturer en proposant uniquement des mots d’ordre démocratiques. Cela provoque une réaction qui se concrétise, à Madrid, par l’initiative spontanée d’aller au Congrès manifester contre les coupes sociales, manifestation qui regroupe plus de 5 000 personnes. Par ailleurs, une Coordination des assemblées de quartier du sud de Madrid, née à la suite du fiasco de la grève du 29 septembre et ayant une orientation très similaire à celle des Assemblées générales interprofessionnelles créées en France à la chaleur des événements de l'automne 2010, lance un appel : "Depuis les populations et les quartiers de travailleurs de Madrid, allons au Congrès où se décident sans nous consulter les coupes sociales, pour dire : basta ! (…) Cette initiative provient d’une conception assembléiste de base de la lutte ouvrière, contre ceux qui prennent des décisions dans le dos des travailleurs sans les soumettre à leur approbation. Parce que la lutte est longue, nous t’encourageons à t’organiser dans les assemblées de quartier ou locales, comme dans les lieux de travail ou d’études".
Les manifestations du 19 juin connaissent un réel succès, l’assistance est massive dans plus de 60 villes, mais leur contenu est encore plus important. Il répond à la brutale campagne contre "les violents". Exprimant une maturation née des nombreux débats dans les milieux les plus actifs 22, le mot d’ordre le plus repris, par exemple à Bilbao, est "La violence, c’est de ne pas boucler les fins de mois !" et à Valladolid : "La violence, c’est aussi le chômage et les expulsions !".
Cependant, c'est surtout la manifestation à Madrid qui exprime le virage du 19 juin vers la perspective du futur. Elle est convoquée par un organisme directement lié à la classe ouvrière et né de ses minorités les plus actives 23. Le thème de ce rassemblement est "Marchons ensemble contre la crise et contre le capital". Les revendications sont : "Non aux réductions de salaires et des pensions ; pour lutter contre le chômage : la lutte ouvrière, contre l’augmentation des prix, pour l’augmentation des salaires, pour l’augmentation des impôts de ceux qui gagnent le plus, en défense des services publics, contre les privatisations de la santé, de l’éducation... Vive l’unité de la classe ouvrière !" 24.
Un collectif d’Alicante adopte le même Manifeste. À Valence, un "Bloc autonome et anticapitaliste" de plusieurs collectifs très actifs dans les assemblées diffuse un Manifeste qui dit : "Nous voulons une réponse au chômage. Que les chômeurs, les précaires, ceux qui connaissent le travail au noir, se réunissent en assemblées, qu’ils décident collectivement de leurs revendications et que celles-ci soient satisfaites. Nous demandons le retrait de la loi de réforme du Code du travail et de celle qui autorise des plans sociaux sans contrôle et avec une indemnisation de 20 jours. Nous demandons le retrait de la loi sur la réforme des pensions de retraites car, après une vie de privations et de misère, nous ne voulons pas sombrer dans encore plus de misère et d’incertitude. Nous demandons que cessent les expulsions. Le besoin humain d’avoir un logement est supérieur aux lois aveugles du commerce et de la recherche du profit. Nous disons NON aux réductions qui touchent la santé et l’éducation, NON aux licenciements à venir que préparent les gouvernements régionaux et les mairies suite aux dernières élections". 25
La marche de Madrid s’est organisée en plusieurs colonnes qui partent de sept banlieues ou quartiers de la périphérie différents ; au fur et à mesure que ces colonnes avancent, elles sont rejointes par une foule toujours plus dense. Ces foules reprennent la tradition ouvrière des grèves de 1972-76 en Espagne (mais aussi la tradition de 1968 en France) où, à partir d’une concentration ouvrière ou d’une usine "phare", comme à l’époque la Standard de Madrid, les manifestations voyaient des masses croissantes d’ouvriers, d’habitants, de chômeurs, de jeunes les rejoindre, et toute cette masse convergeait vers le centre de la ville. Cette tradition était d’ailleurs déjà réapparue dans les luttes de Vigo de 2006 et 2009 26.
A Madrid, le Manifeste lu pendant le rassemblement appelle à tenir des "Assemblées afin de préparer une grève générale", ce qui est accueilli par des cris massifs de "Vive la classe ouvrière !".
La nécessité d’un enthousiasme réfléchi
Les manifestations du 19 juin provoquent un sentiment d’enthousiasme ; une manifestante à Madrid déclare : "L’ambiance était celle d’une fête authentique. On marchait ensemble, des gens très variés et de tous les âges : des jeunes autour de 20 ans, des retraités, des familles avec leurs enfants, d’autres personnes encore différentes... et cela, alors que des gens se mettaient à leur balcon pour nous applaudir. Je suis rentrée à la maison épuisée, mais avec un sourire rayonnant. Non seulement j’avais la sensation d’avoir contribué à une cause juste, mais en plus, j’ai passé un moment vraiment extra". Un autre dit : "C’est vraiment important de voir tous ces gens rassemblés sur une place, parlant politique ou luttant pour leurs droits. N’avez-vous pas la sensation que nous sommes en train de récupérer la rue ?".
Après les premières explosions caractérisées par des assemblées "en recherche", le mouvement commence à présent à chercher la lutte ouverte, commence à entrevoir que la solidarité, l’union, la construction d’une force collective peuvent être menées à bien 27. L’idée commence à se répandre que "Nous pouvons être forts face au capital et à son État !", et que la clé de cette force sera donnée par l’entrée en lutte de la classe ouvrière. Dans les assemblées de quartier de Madrid, un débat a eu pour thème la convocation d’une grève générale en octobre pour "rejeter les coupes sociales". Les syndicats CCOO et UGT poussèrent des hauts cris en disant que cette convocation serait "illégale" et qu’eux seuls étaient autorisés à la faire, ce à quoi beaucoup de secteurs ripostèrent haut et fort : "seules les assemblées massives peuvent la convoquer".
Nous ne devons cependant pas nous laisser aller à l’euphorie, l’entrée en lutte de la classe ouvrière ne sera pas un processus facile. Les illusions et confusions sur la démocratie, le point de vue citoyen, les "réformes", pèsent lourdement, renforcées par la pression de DRY, des politiciens, des médias, qui exploitent les doutes et l’immédiatisme poussant à chercher des "résultats rapides et palpables", mais aussi la peur face à l’ampleur des questions qui se posent. Il importe surtout de comprendre que la mobilisation des ouvriers sur leur lieu de travail est aujourd’hui réellement très difficile, à cause du risque élevé de perdre son emploi, de se retrouver sans ressources, ce qui pour beaucoup ferait franchir la frontière entre une vie misérable mais supportable et une vie misérable et d’extrême pauvreté.
Les critères démocratiques et syndicaux voient la lutte comme une addition de décisions individuelles. N’êtes-vous pas mécontents ? Ne vous sentez-vous pas piétinés ? Si, vous l'êtes ! Alors pourquoi ne vous révoltez-vous pas ? Ce serait si simple s’il s’agissait pour l’ouvrier de choisir entre être "courageux" ou "lâche", seul avec sa conscience, comme dans un bureau de vote ! La lutte de classe ne suit pas ce genre de schéma idéaliste et falsificateur, elle est le résultat d’une force et d’une conscience collectives qui proviennent non seulement du malaise que provoque une situation insoutenable, mais aussi de la perception qu’il est possible de lutter ensemble et qu’il existe un minimum de solidarité et de détermination le permettant.
Une telle situation est le produit d’un processus souterrain qui repose sur trois piliers : l’organisation en assemblées ouvertes qui permettent de prendre conscience des forces dont on dispose et de la marche à suivre pour les accroître ; la conscience pour définir ce que nous voulons et comment le conquérir ; la combativité face au travail de sape des syndicats et de tous les organes de mystification.
Ce processus est en marche, mais il reste difficile de savoir quand et comment il aboutira. Une comparaison peut éventuellement nous y aider. Lors de la grande grève massive de Mai 68 28, il y eut le 13 mai une manifestation gigantesque à Paris en soutien aux étudiants brutalement réprimés. Le sentiment de force qu’elle dégagea se traduisit, dès le lendemain, par l'éclatement d'une série de grèves spontanées, comme celle de Renault à Cléon puis Paris. Ceci ne s’est pas produit après les grandes manifestations du 19 juin en Espagne. Pourquoi ?
La bourgeoisie, en mai 1968, était peu préparée politiquement pour affronter la classe ouvrière, la répression ne fit que jeter de l’huile sur le feu ; aujourd’hui, elle peut s'appuyer dans un grand nombre de pays sur un appareil super-sophistiqué de syndicats, de partis, et peut déployer des campagnes idéologiques basées précisément sur la démocratie, et qui de plus permettent un usage politique très efficace de la répression sélective. De nos jours, le surgissement d’une lutte requiert un effort bien supérieur de conscience et de solidarité que ce n'était le cas dans le passé.
En mai 1968, la crise n'en était qu'à ses prémices, elle plonge aujourd’hui clairement le capitalisme dans une impasse. Cette situation est intimidante, elle rend difficile l’entrée en grève ne serait-ce que pour une raison aussi "simple" que l’augmentation des salaires. La gravité de la situation fait qu’éclatent des grèves parce que "la coupe est pleine", mais alors doit pouvoir s'ensuivre la conclusion que "le prolétariat n'a que ses chaînes à perdre et un monde à gagner".
Ce mouvement n’a pas de frontières
Si la route semble donc plus longue et douloureuse qu’en mai 1968, les bases qui se forgent sont cependant beaucoup plus solides. L’une d’entre elles, déterminante, c’est de se concevoir comme partie d’un mouvement international. Après toute une période "d’essais" avec quelques mouvements massifs (le mouvement des étudiants en France en 2006 et la révolte de la jeunesse en Grèce en 2008 29), cela fait à présent neuf mois que se succèdent des mouvements bien plus larges et laissant entrevoir la possibilité de paralyser la main barbare du capitalisme : France à l'automne 2010, Grande-Bretagne en novembre et décembre 2010, Égypte, Tunisie, Espagne et Grèce en 2011.
La conscience que le mouvement "15M" fait partie de cette chaîne internationale commence à se développer de façon embryonnaire. Le slogan "Ce mouvement n’a pas de frontières" fut repris par une manifestation à Valence. Des manifestations "pour une Révolution européenne" furent organisées par plusieurs campements, il y eut le 15 juin des manifestations en soutien à la lutte en Grèce, et elles se répétèrent le 29. Le 19, les slogans internationalistes commencèrent à apparaître minoritairement : une pancarte disait : "Heureuse union mondiale !", et une autre affichait en anglais : "World Revolution".
Pendant des années, ce qu’elle nommait "globalisation de l’économie" servit de prétexte à la bourgeoisie de gauche pour susciter des réactions nationalistes, son discours consistant à revendiquer la "souveraineté nationale" face aux "marchés apatrides". Elle proposait aux ouvriers rien de moins que d’être plus nationalistes que la bourgeoisie ! Avec le développement de la crise, mais aussi grâce à la popularisation d’Internet, aux réseaux sociaux, etc., la jeunesse ouvrière commence à retourner ces campagnes contre leurs promoteurs. L’idée fait son chemin selon laquelle, "face à la globalisation de l’économie il faut riposter par la globalisation internationale des luttes", que face à la misère mondiale l’unique riposte possible est la lutte mondiale.
Le "15M" a eu une ample répercussion au niveau international. Les mobilisations en Grèce depuis deux semaines suivent le même "modèle" d’assemblées massives sur les places principales ; elles se sont inspirées consciemment des événements en Espagne 30. Selon Kaosenlared du 19 juin, "c’est le quatrième dimanche consécutif que des milliers de personnes, de tous âges, manifestent place Syntagma devant le Parlement grec, à l'appel du mouvement paneuropéen des 'Indignés', pour protester contre les mesures d’austérité".
En France, en Belgique, au Mexique, au Portugal ont lieu des assemblées régulières très minoritaires où se font jour la solidarité avec les Indignés et la tentative d’impulser le débat et la riposte. Au Portugal, "Quelque 300 personnes, jeunes dans leur majorité, marchèrent dimanche après-midi au centre de Lisbonne à l’appel de Democracia Real Ya, inspirés par les Indignés espagnols. Les manifestants portugais marchèrent dans le calme derrière une banderole où l’on pouvait lire : "Espagne, Grèce, Irlande, Portugal : notre lutte est internationale !" 31.
Le rôle des minorités actives dans la préparation de nouvelles luttes
La crise mondiale de la dette illustre la réalité de la crise sans issue du capitalisme. En Espagne comme dans les autres pays, pleuvent les attaques frontales et l’on ne peut apercevoir le moindre répit, sinon de nouveaux et pires coups-bas contre nos conditions de vie. La classe ouvrière doit riposter et, pour cela, elle doit s’appuyer sur l’impulsion donnée par les assemblées de mai et les manifestations du 19 juin.
Pour préparer ces ripostes, la classe ouvrière secrète en son sein des minorités actives, des camarades qui tentent de comprendre ce qui se passe, se politisent, animent les débats, actions, réunions, assemblées, tentent de convaincre ceux qui doutent encore, apportent des arguments à ceux qui cherchent. Comme nous l’avons vu au début, ces minorités contribuèrent au surgissement du "15M".
Avec ses modestes forces, le CCI a participé au mouvement, tentant de donner des orientations. "Lors d'une épreuve de force entre les classes, on assiste à des fluctuations importantes et rapides face auxquelles il faut savoir s'orienter, guidé par les principes et les analyses sans se noyer. Il faut être dans le flot du mouvement, sachant comment concrétiser des 'buts généraux' pour répondre aux préoccupations réelles d'une lutte, pour pouvoir appuyer et stimuler les tendances positives qui se font jour" 32. Nous avons écrit de nombreux articles tentant de comprendre les diverses phases par lesquelles est passé le mouvement tout en faisant des propositions concrètes et réalisables : l’émergence des assemblées et leur vitalité, l’offensive de DRY contre elles, le piège de la répression, le tournant que représentent les manifestations du 19 juin 33.
Une autre des nécessités du mouvement étant le débat, nous avons ouvert une rubrique sur notre page web en Espagnol "Debates del 15 M" où ont pu s’exprimer des camarades avec différentes analyses et positions.
Travailler avec d’autres collectifs et minorités actives a été une autre de nos priorités. Nous nous sommes coordonnés et avons participé à des initiatives communes avec le Círculo obrero de debate de Barcelona, avec la Red de Solidaridad de Alicante et divers collectifs assembléistes de Valence.
Dans les assemblées, nos militants sont intervenus sur des points concrets : défense des assemblées, orienter la lutte vers la classe ouvrière, impulsion des assemblées massives dans les centres de travail et d’études, rejet des revendications démocratiques pour les remplacer par la lutte contre les coupes sociales, l’impossibilité de réformer ou de démocratiser le capitalisme, la seule possibilité réaliste étant sa destruction 34. Dans la mesure de nos possibilités, nous avons aussi participé activement à des assemblées de quartier.
Suite au "15M", la minorité favorable à une orientation de classe s’est élargie et s’est rendue plus dynamique et influente. Elle doit à présent se maintenir unie, articuler un débat, se coordonner au niveau national et international. Face à l’ensemble de la classe ouvrière, il doit s’affirmer une position qui recueille ses besoins et aspirations les plus profonds : contre le mensonge démocratique, montrer ce qui se profile derrière le mot d’ordre "Tout le pouvoir aux assemblées !" ; contre les revendications de réformes démocratiques, montrer la lutte conséquente contre les coupes sociales ; contre d’illusoires "réformes" du capitalisme, montrer la lutte tenace et persévérante dans la perspective de la destruction du capitalisme.
L’important est que se développent dans ce milieu un débat et un combat. Un débat sur les nombreuses questions qui se sont posées ces derniers mois : Réforme ou révolution ? Démocratie ou assemblées ? Mouvement citoyen ou mouvement de classe ? Revendications démocratiques ou revendications contre les attaques sociales ? Grève générale ou grève de masse ? Syndicats ou assemblées ? etc. Un combat pour impulser l’auto-organisation et la lutte indépendante mais surtout pour savoir déjouer et dépasser les multiples pièges qui ne vont pas manquer de nous être tendus.
C. Mir
1 Lire, dans la Revue internationale no 144, "Mobilisation sur les retraites en France, riposte étudiante en Grande-Bretagne, révolte ouvrière en Tunisie – L'avenir est au développement international et à la prise en main de la lutte de classe [56]".
2 Un responsable de Cáritas en Espagne, ONG ecclésiastique qui se consacre à la pauvreté, signalait que "nous parlons à présent de 8 millions de personnes en cours d’exclusion et de 10 millions sous le seuil de pauvreté". Cf. https://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/230828-tenemo... [57]. 18 millions de personnes, c’est un tiers de la population de l’Espagne ! Ceci n’est évidemment en rien une particularité espagnole, le niveau de vie des Grecs a baissé en un an de 8 %.
3 Nous reviendrons sur celle-ci plus en détail au paragraphe suivant.
4 Nous avons publié ce communiqué [58] en plusieurs langues (dont le français [59]).
5 Deux slogans étaient très repris "PSOE-PP, c’est la même merde !" et "Avec des roses ou des mouettes, ils nous prennent pour des crêpes !", sachant que la rose est le symbole du PSOE et la mouette celle du PP.
6 Pour se faire une idée de ce mouvement et de ses méthodes, voir notre article "Le mouvement citoyen "Democracia Real Ya !" : une dictature sur les assemblées massives [60]", traduit en plusieurs langues.
7 Cette citation de Rosa Luxemburg, extraite de Grève de masse, parti et syndicats [61] et qui fait référence à la grande grève du sud de la Russie en 1903, va comme un gant à l’ambiance exaltée des assemblées, un siècle plus tard.
8 Voir "Carta abierta a las Asambleas [62]".
9 Cf. première partie [63], "Feuerbach – Opposition de la conception matérialiste et idéaliste", B, "La base réelle de l'idéologie".
10 Voir la Revue internationale no 62, "La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme [64]".
11 "Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [2]" dans la Revue internationale n° 125.
12 A notre avis, la cause fondamentale de ces difficultés se trouve dans les événements de 1989 qui balayèrent les régimes étatiques identifiés faussement comme "socialistes" et qui permirent à la bourgeoisie de développer une campagne écrasante sur la "fin du communisme", "la fin de la lutte des classes", "l’échec du communisme", etc., qui affectèrent brutalement plusieurs générations ouvrières. Cf. Revue internationale n° 60, "Des difficultés accrues pour le prolétariat [65]".
13 Rappelons comment, entre février et juin 1848 en France, eut également lieu ce type de "grande fête de toutes les classes sociales" qui s’achèvera avec les journées de juin où le prolétariat parisien s'affronta, les armes à la main, au Gouvernement Provisoire. Au cours de la Révolution russe de 1917 régna aussi entre février et avril cette même ambiance d’union générale sous l’égide de la "démocratie révolutionnaire".
14 À l’exception de l’extrême-droite qui, portée par sa haine irrépressible contre la classe ouvrière, exprimait à haute voix ce que les autres fractions de la bourgeoisie se limitaient à dire dans l’intimité de ses salons.
15 Possibilité pour les citoyens de recueillir un certain nombre de signatures afin de proposer et faire voter des lois et des réformes au Parlement.
16 La démocratie se base sur la passivité et l’atomisation de l’immense majorité réduite à une somme d’individus d’autant plus sans défense et vulnérables qu’ils pensent que leur Moi peut être souverain. Par contre, les assemblées partent du point de vue opposé : les individus sont forts parce qu’ils s’appuient sur la "richesse de leurs rapports sociaux" (Marx) en s’intégrant et étant partie prenante d’un vaste corps collectif.
17 Comme s’il pouvait exister une répression "proportionnée" !
18 DRY demande que les manifestants encerclent et critiquent publiquement le comportement de tout élément "violent", ou "suspect d’être violent" (sic).
19 Ses origines plus lointaines sont les réunions de districts pendant la Commune de Paris, mais c’est avec le mouvement révolutionnaire de Russie en 1905 qu’elles s’affirment et, depuis lors, tout grand mouvement de la classe les verra surgir sous différentes formes et appellations : Russie 1917, Allemagne 1918, Hongrie 1919 et 1956, Pologne 1980… Il y eut en 1972 à Vigo en Espagne une Assemblée générale de ville qui se répéta à Pampelune en 1973 et à Vitoria en 1976, puis de nouveau à Vigo en 2006. Nous avons écrit de nombreux articles sur l’origine de ces assemblées ouvrières. Voir en particulier la série "Que sont les conseils ouvriers", à partir de la Revue internationale no 140.
20 A Cadix, l’Assemblée générale organise un débat sur la précarité qui attire une forte assistance. A Caceres est dénoncée l’absence d’information sur le mouvement en Grèce et à Almeria est organisée le 15 juin une réunion sur "la situation du mouvement ouvrier".
21 Ce sont en fait des armes à double tranchant : elles contiennent des aspects positifs, par exemple l’extension du débat massif vers des couches plus profondes de la population travailleuse et la possibilité – comme ce fut le cas – d’impulser des assemblées contre le chômage et la précarité, brisant l’atomisation et le sentiment de honte qui accable beaucoup de travailleurs au chômage, rompant aussi la situation de totale vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs précaires des petits commerces. Le point négatif est qu’elles sont aussi utilisées pour disperser le mouvement, lui faire perdre ses préoccupations plus globales, pour l’enfermer dans des dynamiques "citoyennes" favorisées par le fait que le quartier – entité qui mélange les ouvriers avec la petite bourgeoisie, des patrons, etc. – se prête plus à ce genre de préoccupations.
22 Voir entre autres "un protocole anti-violence".
23 Dans la Coordination des Assemblées de quartiers et de banlieues du sud de Madrid, on trouve fondamentalement des Assemblées de travailleurs de différents secteurs même si y participent également des petits syndicats radicaux. Voir https://asambleaautonomazonasur.blogspot.com/ [66]
24 La privatisation des services publics et des Caisses d'épargne est une réponse du capitalisme à l'aggravation de la crise et, plus concrètement, au fait que l'État, de plus en plus endetté, est contraint de réduire ses dépenses, quitte pour cela à dégrader de façon insupportable la manière dont des services essentiels sont assumés. Cependant, il est important de comprendre que l'alternative aux privatisations n'est pas la lutte pour le maintien de ces services dans le giron de l'État. En premier lieu, parce que les services "privatisés" continuent souvent d'être contrôlés organiquement par des institutions étatiques qui sous-traitent le travail à des entreprises privées. Et en deuxième lieu, parce que l'État et la propriété étatique n'ont rien de "social" ni à voir avec un quelconque "bien-être citoyen". L'État est un organe exclusivement au service de la classe dominante et la propriété étatique est basée sur l'exploitation salariée. Cette problématique a commencé à être posée dans certains milieux ouvriers, notamment dans une assemblée à Valence contre le chômage et la précarité. www.kaosenlared.net/noticia/cronica-libre-reunion-contra-paro-precariedad [67].
25 Voir https://infopunt-vlc.blogspot.com/2011/06/19-j-bloc-autonom-i-anticapitalista.html [68]
26 Voir "Grève de la métallurgie à Vigo en Espagne : une avancée dans la lutte prolétarienne [69]" et aussi "A Vigo, en Espagne : les méthodes syndicales mènent tout droit à la défaite [70]".
27 Ce qui n’implique pas la sous-estimation des obstacles que la nature intrinsèque du capitalisme, basé sur la concurrence à mort et la méfiance des uns par rapport aux autres, oppose à ce processus d’unification. Celui-ci ne pourra se réaliser qu’au terme d’énormes et complexes efforts se basant sur la lutte unitaire et massive de la classe ouvrière, une classe qui produit collectivement et au moyen du travail associé les principales richesses sociales et qui, pour cela, contient en elle la reconstruction de l’être social de l’humanité.
28 Voir la série "Mai 68 et la perspective révolutionnaire", à partir de la Revue internationale no 133.
29 Voir la Revue internationale no 125, "Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [2]", et la Revue internationale no 136, "Les révoltes de la jeunesse en Grèce confirment le développement de la lutte de classe [71]".
30 La censure sur les événements en Grèce et les mouvements massifs qui s'y déroulent est totale, ce qui nous empêche de les intégrer dans notre analyse.
31 Repris de Kaosenlared.
32 Revue internationale no 20, "Sur l'intervention des révolutionnaires : réponse à nos censeurs [72]".
33 Voir les différents articles qui ponctuent chacun de ces moments dans notre presse.
34 Ce n’était pas une insistance spécifique du CCI, un mot d’ordre assez populaire disait : "Être réaliste, c’est être anticapitaliste !", une banderole proclamait : "Le système est inhumain, soyons antisystème".
A propos du 140e anniversaire de la Commune de Paris
- 1388 lectures
La Commune de Paris, qui s'est déroulée de mars à juin 1871, constitue le premier exemple dans l'histoire de prise du pouvoir politique par la classe ouvrière. La Commune a démantelé l'ancien État bourgeois et formé un pouvoir directement contrôlé d'en bas : les délégués de la Commune, élus par les assemblées populaires des quartiers de Paris, étaient révocables à tout moment et leur salaire ne dépassait pas la moyenne de celui des ouvriers. La Commune appela à suivre son exemple dans toute la France, détruisit la Colonne Vendôme, symbole du chauvinisme national français et déclara que son drapeau rouge était le drapeau de la République universelle. Évidemment, ce crime contre "l'ordre naturel" devait être puni sans merci. Le journal libéral britannique The Guardian publia à l'époque un rapport très critique de la revanche sanglante prise par la classe dominante française :
"Le gouvernement civil est temporairement suspendu à Paris. La ville est divisée en quatre districts militaires, sous le commandement des généraux Ladmirault, Cissky, Douay et Vinoy. Tout le pouvoir des autorités civiles dans le maintien de l'ordre est transféré aux militaires. Les exécutions sommaires se poursuivent, et les déserteurs de l'armée, les incendiaires et les membres de la Commune sont tués sans merci. On rapporte que le Marquis De Galliffet a suscité un léger mécontentement en faisant abattre des personnes innocentes près de l'Arc de triomphe. Il faut rappeler que le Marquis (qui était avec Bazaine au Mexique) a ordonné que 80 personnes, extraites d'un grand convoi de prisonniers, soient exécutées près de l'Arc. On dit maintenant que certaines d'entre elles étaient innocentes. Si on le lui demandait, le Marquis exprimerait probablement un regret poli qu'une telle circonstance fâcheuse se soit produite et qu'est-ce qu'un "véritable ami de l'ordre" demanderait de plus ?" (Manchester, jeudi 1er juin 1871. Résumé des nouvelles. Étranger.)
En à peine huit jours, 30 000 communards ont été massacrés. Et ceux qui ont infligé ce supplice ne sont pas seulement les Galliffet ni leurs supérieurs français. Les prussiens, dont la guerre avec la France a provoqué le soulèvement à Paris, ont mis de côté leurs intérêts divergents de ceux de la bourgeoisie française pour permettre à cette dernière d'écraser la Commune : c'est clairement la première indication du fait que, aussi féroces que soient les rivalités nationales qui opposent les unes aux autres les différentes fractions de la classe dominante, celles-ci se serrent les coudes quand elles sont confrontées à la menace prolétarienne.
La Commune fut totalement vaincue, mais elle a constitué une source inestimable de leçons politiques pour le mouvement ouvrier. Marx et Engels ont revu leur vision de la révolution prolétarienne à la suite de celle-ci et en ont déduit que la classe ouvrière ne pouvait pas prendre le contrôle de l'ancien appareil d'État bourgeois mais devait le détruire et le remplacer par une nouvelle forme de pouvoir politique. Les Bolcheviks et les Spartakistes des révolutions russe et allemande de 1917-19 se sont inspirés de la Commune et ont considéré que les conseils ouvriers, ou soviets, qui étaient nés de ces révolutions constituaient une continuation et un développement des principes de la Commune. La Gauche communiste des années 1930 et 1940, qui cherchait à comprendre les raisons de la défaite de la révolution en Russie, est revenue sur l'expérience de la Commune et a examiné ses apports concernant le problème de l'État dans la période de transition. Dans la lignée de cette tradition, notre Courant a publié un certain nombre d'articles sur la Commune. Le premier volume de notre série Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle, qui se penche sur l'évolution du programme communiste dans le mouvement ouvrier au XIXe siècle, consacre un chapitre à la Commune et examine comment cette expérience a clarifié l'attitude que la classe ouvrière doit adopter à la fois envers l'État bourgeois et l'État post-révolutionnaire, envers les autres couches non exploiteuses de la société, envers les mesures politiques et économiques nécessaires pour avancer dans la direction d'une société sans classe et sans État. On peut lire cet article ("1871 : la première révolution prolétarienne [27]") dans la Revue internationale n° 77 (1994, 8e partie).
Nous republions également dans notre presse territoriale un article [73] écrit pour le 120e anniversaire de la Commune, en 1991. Cet article dénonce les tentatives du moment de récupérer la mémoire de la Commune et de travestir son caractère essentiellement internationaliste et révolutionnaire en la présentant comme un moment de la lutte patriotique pour les libertés démocratiques.
Histoire du mouvement ouvrier:
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique (II) - la période 1914/1928 : premiers véritables affrontements entre les deux classes
- 2301 lectures
On a pu remarquer qu’entre 1855 et 1914, le prolétariat qui émergeait dans la colonie de l’AOF (Afrique Occidentale Française) faisait l’apprentissage de la lutte de classe en cherchant à se regrouper et à s’organiser en vue de se défendre face aux exploiteurs capitalistes. En effet, malgré son extrême faiblesse numérique, il a pu démontrer sa volonté de lutter et la prise de conscience de sa force en tant que classe exploitée. Par ailleurs, on a pu noter que, à la veille de la Première Guerre mondiale, le développement des forces productives dans la colonie était suffisant pour donner lieu à un choc frontal entre la bourgeoisie et la classe ouvrière.
Grève générale et émeute à Dakar en 1914
Au début de 1914, le mécontentement et l’inquiétude de la population qui s'accumulaient depuis l’année précédente ne s'exprimèrent pas tout de suite sous forme de grève ou de manifestation. Mais au mois de mai la colère explosa, entraînant celle de la classe ouvrière qui déclencha une grève générale insurrectionnelle.
Cette grève fut avant tout une réponse aux grossières provocations du pouvoir colonial envers la population de Dakar lors des élections législatives de mai cette année-là à l'occasion desquelles le gros commerce 1 et le maire de la commune menaçaient de couper les crédits, l’eau et l’électricité à tous ceux qui voulaient voter pour le candidat autochtone (un certain Blaise Diagne, nous y reviendrons plus loin). Le hasard fit qu’éclata à ce moment-là une épidémie de peste dans la ville et que, sous prétexte d’endiguer son éventuelle extension vers les quartiers résidentiels (où habitaient les européens), le maire de Dakar, Masson (un colon), ordonna purement et simplement la destruction par le feu de toutes les habitations (des populations locales) suspectées d’infection.
Cela mit un autre feu aux poudres : grève générale et émeute contre les procédés criminels des autorités coloniales. Et, pour passer à l‘action, un groupe de jeunes dit "Jeunes Sénégalais" appela au boycott économique et sillonna les rues pour placarder dans tout Dakar le slogan : "affamons les affameurs", en reprenant ainsi le mot d’ordre du candidat et futur député noir.
De son côté, tout en dissimulant mal son inquiétude, le gros commerce lança une violente campagne de dissuasion véhiculée par le journal L’AOF (à sa botte) contre les grévistes dans ces termes :
"Voilà nos arrimeurs, charretiers et manœuvres privés de leurs salaires (…) Avec quoi vont-ils manger ? (…) vos grèves, celles qui atteindraient la vie du port, ne feraient que rendre la gêne bien plus cruelle aux malheureux qu’à ceux qui ont de la fortune : elles paralyseraient le développement de Dakar en décourageant ceux qui peuvent venir s’y fixer". (cité par Iba Der Thiam.)2
Mais rien n’y fit, la grève ne put être empêchée. Au contraire, elle s’étendit en touchant l’ensemble des secteurs, notamment les poumons de l’économie de la colonie à savoir le port et le chemin de fer, ainsi que les services et le commerce, public et privé confondus. La suite nous est racontée dans les mémoires secrets du Gouverneur de la colonie William Ponty :
"La grève (ajoutait le Gouverneur général), par l’abstention fomentée en dessous, était parfaitement organisée et eut un plein succès. C’était (…) la première manifestation de ce genre qu’il m’ait été donné de voir aussi unanime dans ces régions". (Thiam, ibidem)
La grève dura 5 jours (entre le 20 et le 25 mai) et ses auteurs finirent par acculer les autorités coloniales à éteindre l’incendie qu’elles avaient, elles-mêmes, allumé. En effet quelle grève exemplaire ! Voilà une lutte qui marqua un tournant majeur dans la confrontation entre la bourgeoisie et la classe ouvrière de l’AOF. C’était la première fois qu’une grève se généralisait au-delà des catégories professionnelles en réunissant, ensemble, ouvriers et population de Dakar et sa région dans un même combat contre le pouvoir dominant. En clair, ce fut une lutte qui modifia brusquement le rapport de forces en faveur des opprimés, d’où d’ailleurs la décision de ce même Gouverneur (avec l’aval de Paris) de céder aux revendications de la population gréviste, exprimée en ces termes :
"La cessation des incinérations des cases, la restitution des cadavres, la reconstruction en matériaux durs des bâtiments et concessions détruites, la disparition complète dans la ville entière de toutes les baraques en mauvaises planches de caisses ou en paille et leur remplacement par des immeubles en ciment, un type d’habitation à bon marché". (Thiam, ibid.)
Cependant, le même Gouverneur ne dit rien sur le nombre des victimes, brûlées à l’intérieur de leur case ou tombées sous les balles des forces de l’ordre. Tout au plus, les autorités locales de la colonie évoquèrent seulement "la restitution des cadavres" mais, là aussi, sans un mot sur les conditions des tueries, ni sur leur étendue.
Mais, en dépit de la censure sur les actes et les paroles de la classe ouvrière de cette époque, on peut cependant penser que les ouvriers qui voyaient brûler leur propre maison et celles de leurs proches ne restèrent pas inertes et qu'ils durent livrer une bataille acharnée. En clair, bien que très minoritaire, la classe ouvrière fut sans doute un élément décisif dans les affrontements qui firent plier les forces du capital colonial. Mais, surtout, la grève avait un caractère très politique :
"Il s’agissait donc d’une grève économique, certes, mais aussi politique, d’une grève de protestation, d’une grève de sanction, d’une grève de représailles, décidée et appliquée par toute la population du Cap- Vert (…). Leur grève avait donc un caractère nettement politique, la réaction des autorités le fut tout autant (…) L’administration était à la fois surprise et désarmée. Surprise parce qu’elle n’avait jamais eu à faire face à une manifestation de cette nature, désarmée parce qu’elle ne se trouvait nullement en présence d’une organisation syndicale classique avec bureau, statuts, mais d’un mouvement général pris en main par toute une population dont la direction était invisible". (Thiam, ibid.)
En accord avec le point de vue cet auteur, on se doit de conclure qu’il s’était agi d’une grève éminemment politique exprimant un haut degré de conscience prolétarienne. Phénomène d’autant plus remarquable que le contexte était peu favorable à la lutte de classe car dominé, à l’extérieur, par le bruit de bottes et, au plan intérieur, par des luttes de pouvoir et des règlements de comptes au sein de la bourgeoisie à travers justement les élections législatives dont l’enjeu principal était l'élection, pour la première fois de l’histoire, d'un député du continent noir. Voilà le piège mortel que la classe ouvrière sut retourner contre la classe dominante en déclenchant avec la population la grève victorieuse.
1917/1918 : des mouvements de grève qui inquiétèrent sérieusement la bourgeoisie
Comme on le sait, la période de 1914/1916 fut marquée, dans le monde en général et en Afrique en particulier, par un sentiment de terreur et d’abattement consécutif à l'éclatement de la première boucherie mondiale. Certes, juste avant le début de l’embrasement, on avait pu assister au formidable combat de classe à Dakar en 1914, de même à une dure grève de mineurs en Guinée en 1916 3 mais, dans l’ensemble, ce qui dominait était un état général d’impuissance au sein de la classe ouvrière alors même que ses conditions de vie se dégradaient sur tous les plans. En effet, il fallut attendre 1917 (pur hasard ?) pour voir de nouvelles expressions de luttes conséquentes dans la colonie :
"Les effets cumulés de l’inflation galopante, du blocage des salaires et des tracasseries de tous ordres, en même temps qu’ils révèlent au grand jour la nature étroite du lien de dépendance existant entre la colonie et la Métropole et l’imbrication accentuée du Sénégal dans le système capitaliste mondial, avaient provoqué une rupture de l’équilibre social à la faveur de laquelle la conscience des travailleurs et leur volonté de lutte s’étaient nettement affirmées. Dès l’année 1917, les rapports politiques signalaient, que devant la situation de crise, le marasme des affaires, la fiscalité écrasante, la paupérisation accrue des masses, des travailleurs de plus en plus nombreux, incapables de joindre les deux bouts, revendiquaient des augmentations de salaires". (Thiam, ibid.)
Effectivement, des grèves éclatèrent entre décembre 1917 et février 1918 contre la misère et la dégradation des conditions de vie de la classe ouvrière, et ce malgré l’instauration de l’état de siège dans toute la colonie, accompagné d’une censure implacable. Néanmoins, même avec le peu de détail sur les tenants et aboutissants des grèves de cette époque, on peut y voir, à travers certaines notes confidentielles, l’existence de véritables affrontements de classes. Ainsi, à propos du mouvement de grève des charbonniers de la société italienne Le Sénégal, on peut lire, dans une note du Gouverneur William Ponty à son ministère, ceci :
"(…) Satisfaction leur ayant été donnée de suite, le travail fut repris le lendemain (…)".
Ou encore : "Une petite grève de deux jours s’est produite également au cours du trimestre dans le chantier des entreprises Bouquereau et Leblanc. La plupart des grévistes ont été remplacés par des Portugais". (Thiam, ibid.)
Mais, sans que l’on puisse savoir ce que fut la nature des réactions des ouvriers remplacés par des "jaunes", le Gouverneur général indiquait quand même que : "Les ouvriers de toutes les professions devaient faire grève générale le 1er janvier". Plus loin, il informa son ministre que des maçons répartis sur une dizaine de chantiers étaient partis en grève le 20 février en revendiquant une augmentation de salaire de 6 à 8 francs par jour, et que "la satisfaction [de la revendication] mit fin à la grève".
Comme on peut le voir clairement, entre 1917 et 1918, la combativité ouvrière fut telle que les affrontements entre la bourgeoisie et le prolétariat débouchèrent souvent sur des victoires de ce dernier, comme en attestent les citations des divers rapports ou propos secrets des autorités coloniales. De même les luttes ouvrières de cette époque ne pouvaient pas être sans rapport avec le contexte historique de la révolution en Russie en particulier et en Europe en général :
"La concentration de travailleurs salariés dans les ports, les chemins de fer, crée les conditions pour l’apparition des premières manifestations du mouvement ouvrier. (…) Enfin, les souffrances de la guerre - effort de guerre, épreuves subies par les combattants - créent le besoin d’une détente, l’espoir d’un changement. Or, les échos de la Révolution russe d’octobre sont parvenus en Afrique ; il y avait des troupes sénégalaises parmi les unités stationnées en Roumanie qui ont refusé de marcher contre les Soviets ; il y avait des marins noirs sur les unités navales mutinées de la Méditerranée ; certains ont assisté aux mutineries de 1917, ont vécu ou suivi l’essor révolutionnaire des années de la fin de la guerre et de l’immédiat après-guerre en France". ( Jean Suret-Canale. Ibid).
Effectivement, la révolution russe d’octobre 1917 eut des échos jusqu’en Afrique, en particulier auprès de la jeunesse dont une grande partie fut enrôlée et expédiée en Europe par l’impérialisme français en vue de la boucherie de 1914-18. Dans ce contexte, on comprend mieux le bien-fondé des inquiétudes d’alors de la bourgeoisie française, d’autant plus que la vague de luttes se poursuivait.
1919 : année de luttes et tentatives de constitution d’organisations ouvrières
1919, année d’intenses luttes ouvrières, fut aussi l’année de l’émergence de multiples structures associatives à caractère professionnel alors que l’autorité coloniale continuait d’interdire en AOF toute organisation syndicale et toute coalition de travailleurs supérieure à vingt personnes. Pourtant, nombreux furent les travailleurs qui prenaient l’initiative de créer des associations professionnelles (des "amicales") susceptibles de prendre en charge la défense de leurs intérêts. Mais l’interdiction étant destinée particulièrement aux travailleurs indigènes, il revint par conséquent à leurs camarades européens, en l’occurrence les cheminots, d'avoir pris l'initiative de créer la première "amicale professionnelle" en 1918, les cheminots ayant déjà été à l’origine de la première tentative (publique) en la matière, en 1907.
Ce sont ces amicales professionnelles qui furent les jalons des premières organisations syndicales reconnues dans la colonie :
"(…) Peu à peu, sortant du cadre étroit de l’entreprise, le processus de coalition des travailleurs était, de proche en proche, émancipé, assez vite d’ailleurs, passant d’abord à l’Union à l’échelon d’une ville comme Saint-Louis ou Dakar, puis au regroupement au niveau de la colonie, de tous ceux que leurs obligations professionnelles associaient aux mêmes servitudes professionnelles. Nous en trouvons des exemples chez les instituteurs, les agents des PTT, les dames dactylographes, les employés de commerce. (…) Par ce moyen, le mouvement syndical naissant renforçait ses positions de classe. Il élargissait le champ et le cadre de son action, et disposait d’une force de frappe dont la mise en œuvre pouvait se révéler particulièrement efficace face au patronat. Ainsi, l’esprit de solidarité entre travailleurs prenait corps peu à peu. Des indices probants prouvaient même que les éléments les plus avancés étaient en train de prendre conscience des limites du corporatisme et de jeter les bases d’une union interprofessionnelle des travailleurs d’un même secteur dans un cadre géographique beaucoup plus vaste". (Thiam, ibid.) 4
En effet, c’est dans ce contexte qu’on apprendra plus tard, dans un rapport de police tiré des archives, l’existence d’une fédération des associations des fonctionnaires coloniaux de l’AOF.
Mais dès qu’il prit connaissance de l’ampleur du danger que constituait à ses yeux le surgissement des groupes ouvriers fédérés, le Gouverneur ordonna une enquête sur les activités des syndicats émergents. Par la suite, il chargea son secrétaire général de briser les organisations et leurs responsables dans les termes suivants (selon Thiam) :
"1) voir s’il est possible de liquider tous les indigènes signalés ;
2) rechercher dans quelles conditions ils ont été engagés ;
3) ne pas donner la note jointe dans les services et la conserver dans votre tiroir, pour me la remettre personnellement avec ma note".
Quel vocabulaire, et quel cynique ce Monsieur le Gouverneur ! C’est donc en toute logique qu’il fit appliquer sa sale "mission" se traduisant effectivement par des révocations massives et par la "chasse à l’ouvrier" et à tout travailleur susceptible d’appartenir à une organisation syndicale ou autre. En clair, l’attitude du Gouverneur fut celle d’un chef d'État policier dans ses œuvres les plus criminelles et, en ce sens, il appliquait également la ségrégation entre ouvriers européens et ouvriers "indigènes", comme le montre ce document d’archive :
"Que les lois civiles métropolitaines soient étendues aux citoyens habitants les colonies, cela se conçoit puisqu’il s’agit de membres d’une société évoluée ou bien d’originaires habitués depuis longtemps à nos mœurs et à notre vie civique ; mais prétendre y assujettir des races sinon encore dans un état voisin de la barbarie, du moins tout à fait étrangères à notre civilisation, c’est souvent une impossibilité, quand ce n’est pas une erreur regrettable". (Thiam, ibid.)
Nous voilà devant un Gouverneur parfaitement méprisant en train de mener sa politique d’apartheid. En effet, non content d’avoir décidé de "liquider" les ouvriers indigènes, il se permit de surcroît de justifier ses actes par des théories ouvertement racistes.
Malgré cette politique criminelle anti-prolétarienne, la classe ouvrière de cette époque (ouvriers européens et africains) refusa de capituler en poursuivant la lutte de plus belle pour la défense de ses intérêts de classe.
Grève des cheminots en avril 1919
1919 fut une année de forte agitation sociale où plusieurs secteurs entrèrent en lutte pour diverses revendications, que ce soit d’ordre salarial ou concernant le droit de constituer des organisations de défense des intérêts des travailleurs.
Mais ce sont les cheminots les premiers qui entrèrent en grève cette année-là, entre le 13 et le 15 avril, en envoyant d’abord un avertissement à l’employeur :
"Le 8 avril 1919, soit sept mois à peine après la fin des hostilités, un mouvement de revendication éclata dans les services du chemin de fer Dakar - Saint-Louis (DSL) à l’initiative des travailleurs européens et indigènes sous la forme d’un télégramme anonyme ainsi libellé, adressé à l’Inspecteur général des travaux publics : "cheminots Dakar - Saint-Louis d’accord unanime présentent revendications suivantes : relèvement de soldes personnel européen et indigène, augmentation régulière et maintien indemnité, amélioration soldes et indemnités congés maladie… cesseront tout travail sous cent vingt heures, à partir ce jour, c'est-à-dire le douze avril, vingt quatre heures si pas réponse favorable sur tous points : signé Cheminots Dakar - Saint-Louis" ". (Thiam, ibid.)
Voilà le ton particulièrement ferme et combatif avec lequel les employés du chemin de fer annoncèrent leur intention de partir en grève, s’ils n'étaient pas entendus par leurs employeurs. De même, on doit noter le caractère unitaire des grévistes. Pour la première fois, de façon consciente, européens et africains décidèrent d’élaborer ensemble leur cahier de revendications. Là, nous sommes en face d’un geste d’internationalisme dont seule la classe ouvrière est authentiquement porteuse. C’est le pas de géant que purent franchir les cheminots en s’efforçant de dépasser sciemment les frontières ethniques que l’ennemi de classe établit régulièrement pour les diviser en vue de mieux les amener à la défaite.
Réaction des autorités face aux revendications des cheminots
À la réception du télégramme des ouvriers, le Gouverneur général convoqua les membres de son administration ainsi que les chefs de l’armée pour décider aussitôt la réquisition totale du personnel et de l’administration de la ligne du Dakar - Saint-Louis, placée sous les ordres de l’autorité militaire. En effet on peut lire ceci dans l’arrêté du Gouverneur :
"La troupe se servirait d’abord de la crosse de ses fusils. A une attaque à armes blanches, elle répondrait par l’usage de la baïonnette (…) Il serait indispensable à la troupe de faire usage des feux pour assurer la sécurité du personnel de l’administration qui serait en danger ainsi que la sienne propre (…)."
Et l’autorité française de conclure que les lois et les règlements régissant l’armée devenaient immédiatement applicables.
Pourtant, ni cette terrible décision à vocation décidément répressive, ni le tapage arrogant accompagnant sa mise en œuvre, ne réussirent à empêcher le déclenchement de la grève :
"A 18h 30, Lachère (chef civil du réseau) câblait au chef de la Fédération que "trains impairs pas partis aujourd’hui ; trains quatre et six partis, le deuxième arrêté à Rufisque (…)" et priait celui-ci de lui indiquer d’urgence la suite qu’il convient de donner aux revendications des travailleurs. En vérité le trafic avait été presque complètement paralysé. Il en était de même à Dakar, à Saint-Louis, à Rufisque. Tout le réseau était en grève, européens, comme africains (…) ; les arrestations opérées ici et là, les tentatives visant à opposer les travailleurs sur des bases raciales n’y firent rien. Ou bien le personnel se rendait dans les gares sans travailler, ou bien il faisait purement et simplement défection. Le 15 avril au matin, la grève fut totale à Rufisque. Aucun agent européen, ni africain n’était présent. En conséquence ordre fut donné de fermer la gare. C’était là que se trouvait le centre du mouvement de grève. Jamais le Sénégal n’avait connu un mouvement d’une telle ampleur. Pour la première fois une grève avait été conduite par des Européens et des Africains et réussie avec éclat, et à l’échelle territoriale. Les milieux économiques s’affolèrent. Giraud, président de la chambre de commerce, entra en contact avec les cheminots et tenta une action de conciliation. La Maison Maurel et Prom alerta sa direction à Bordeaux. La Maison Vieilles adressa à son siège marseillais ce télégramme alarmiste : "Situation intenable, agissez". Giraud revint à la charge, saisit directement le Président du Syndicat de défense des intérêts sénégalais (patronaux) à Bordeaux, stigmatisa la nonchalance des autorités". (Thiam, ibid.)
Panique et tremblement s'emparaient des dirigeants de l’administration coloniale face aux flammes de la lutte ouvrière. En effet, suite aux pressions du milieu économique de la colonie, à la fois sur ses dirigeants métropolitains et sur le gouvernement central, les autorités de Paris durent donner le feu vert en vue de négocier avec les grévistes. Dès lors, le Gouverneur général convoqua les représentants de ces derniers (au deuxième jour de la grève) avec des propositions allant dans le sens des revendications des grévistes. Et lorsque le Gouverneur signifia son désir de rencontrer les délégués des cheminots composés uniquement d’européens, les ouvriers répliquèrent en refusant de se rendre à la concertation sans la présence des délégués africains sur un même pied d’égalité de droits que leurs camarades blancs. En effet, les ouvriers grévistes se méfiaient de leurs interlocuteurs, non sans raison, car après avoir donné satisfaction aux cheminots sur les principaux points de leurs revendications, les autorités poursuivirent leurs manœuvres et tergiversèrent par rapport à certaines revendications des indigènes. Mais cela ne faisait qu’augmenter la combativité des cheminots, qui décidèrent aussitôt de repartir en grève, d’où à nouveau des pressions de la part des représentants de la bourgeoisie française à Dakar sur le gouvernement central de Paris. C'est ce que montrent les télégrammes suivants (Thiam, ibid.) :
"Il est urgent que satisfaction soit donnée de suite au personnel du DSL et décision soit notifiée sans tarder sinon nous risquons avoir nouvelle grève" (le représentant du gros commerce) ;
"Je vous demande instamment (…) donner approbation arbitrage Gouverneur Général transmis mon câble du 16…toute urgence avant le 1er mai, si allons (probablement si voulons) avoir nouvelle cessation de travail cette date" (le directeur du chemin de fer) ;
"Malgré mes conseils, grève va reprendre si compagnie donne pas satisfaction" (le Gouverneur général).
Visiblement, ce fut l’affolement général chez les autorités coloniales à tous les étages. Bref, au bout du compte, le gouvernement français donna son approbation à l’arbitrage de son Gouverneur en validant ainsi les accords négociés avec les grévistes, et le travail reprit le 16 avril. Une fois encore, la classe ouvrière arracha une belle victoire sur les forces du capital grâce notamment à son unité de classe exploitée par le même exploiteur, mais surtout au développement de sa conscience de classe.
Mais, en plus de la satisfaction des revendications des cheminots, ce mouvement eut d’autres retombées positives pour les autres travailleurs, en l’occurrence, la journée de 8 heures fut étendue à la colonie au lendemain de la grève. Cependant, face à la résistance du patronat pour l’accepter et face à la dynamique de lutte créée par les cheminots, des ouvriers d’autres branches durent eux aussi partir en lutte pour se faire entendre.
Grève des postiers
Ainsi, pour obtenir des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail, les agents des PTT de Saint-Louis partirent en grève le 1er mai 1919. Celle-ci dura 12 jours et se solda par une paralysie quasi-totale des services postaux. Devant l’ampleur du mouvement, l’autorité coloniale fit appel, par réquisition, à l’armée afin que celle-ci lui fournisse des forces spécialisées en matière postale pour assurer la continuité du service public. Mais ce corps militaire étant loin de pouvoir jouer efficacement les "jaunes", l’autorité administrative dut par conséquent se résoudre à négocier avec le comité de grève des postiers, auquel fut proposée une majoration des traitements de 100 %. En effet :
"La duplicité des autorités coloniales avait aussitôt relancé le mouvement de grève, qui avait repris avec vigueur renouvelée, tonifié sans aucun doute par les perspectives alléchantes qu’il avait un moment pu entrevoir. Il dura jusqu’au 12 mai et se termina par un succès total". (Thiam, ibid.)
Une fois de plus, voilà une victoire obtenue par les ouvriers des PTT, grâce à la pugnacité de leur combat. Décidément, les ouvriers se montraient de plus en plus conscients de leur force et de leur appartenance de classe.
En fait, toute la fonction publique avait été plus ou moins touchée par le mouvement. De même, de nombreuses catégories professionnelles purent bénéficier amplement des retombées du succès de la lutte déclenchée par les agents des PTT : après que ceux-ci eurent obtenu de fortes hausses de salaires, ce fut ensuite le cas pour des agents des travaux publics, des agents de la culture, des enseignants, des aide- médecins, etc. Mais le succès de ce mouvement ne s’arrêta pas là ; de nouveau les représentants du capital refusèrent d’abdiquer.
Menace d’une nouvelle grève des cheminots et manœuvres politiques de la bourgeoisie
Suite au mouvement des agents des PTT et six mois après la fin victorieuse de leur propre mouvement, les cheminots indigènes décidèrent de repartir en lutte sans leurs camarades européens en adressant aux autorités de nouvelles revendications :
"Dans cette lettre, nous demandons, notaient-ils, une amélioration de traitement et quelques modifications sur le règlement du Personnel indigène. (…) Nous nous permettons de vous dire que nous ne pouvons plus continuer à mener cette vie de galère et nous espérons que vous éviterez d’en arriver à des mesures dont seul vous serez responsable. (…) et nous voulons comme le personnel sédentaire (formé presque uniquement d’européens) être récompensés. Agissez à notre égard, comme vous agissez à leur égard, et tout ira pour le mieux". (Thiam, ibid.)
En fait, les cheminots indigènes voulaient bénéficier d'avantages matériels que certains fonctionnaires avaient acquis suite à la grève des agents PTT. Mais surtout ils réclamaient une égalité de traitement avec les cheminots européens, avec à la clé la menace d’une nouvelle grève.
"L’initiative des agents indigènes du D.S.L. avait, tout naturellement, suscité le plus vif intérêt du côté patronal. L’unité d’action grâce à laquelle le mouvement du 13 au 15 avril avait été couronné de succès ayant désormais vécu, il fallait tout faire, pour que le fossé nouveau qui venait se creuser entre travailleurs européens et africains ne soit jamais comblé. On aurait ainsi le meilleur moyen d’affaiblir le mouvement ouvrier, en le laissant s’épuiser dans des rivalités fratricides qui rendaient inefficace toute entreprise de coalition à venir.
L’administration du réseau s’employa, à partir de cette analyse, à accentuer les disparités pour augmenter la frustration des milieux indigènes dans l’espoir de rendre définitive la rupture amorcée". (Thiam, ibid.)
Par conséquent les responsables coloniaux passèrent cyniquement à l’acte en décidant, non pas d’ajuster les revenus des indigènes par rapport à ceux des européens, mais au contraire d’augmenter tapageusement les rémunérations de ces derniers, tout en tardant à satisfaire les revendications des cheminots autochtones, avec la volonté évidente de creuser l’écart entre les deux groupes pour mieux les dresser les uns contre les autres dans le but de les neutraliser.
Mais heureusement, sentant venir ce gros piège dans lequel les autorités coloniales voulaient les faire tomber, les cheminots indigènes surent éviter de partir en grève dans ces conditions, en décidant d’attendre des jours meilleurs. On constatera plus loin que, s’ils donnèrent l’impression d’avoir oublié l’importance de l’unité de classe dont ils avaient fait preuve précédemment en s’alliant avec leurs camarades européens, les cheminots indigènes purent cependant décider d’élargir leur mouvement à d’autres catégories ouvrières (employés de services publics et privés, européens comme africains). De toute façon, il convient de prendre en compte ici, chez les ouvriers, le caractère balbutiant de l’unité de classe doublé d’une conscience qui se développait lentement et en dents de scie. Rappelons aussi le fait que le pouvoir colonial institutionnalisa les divisions raciales et ethniques dès les premiers contacts entre les populations européennes et africaines. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il n’y aura plus d’autres tentatives d’unité entre ouvriers européens et africains.
La révolte des marins sénégalais à Santos (Brésil) en 1920 : grève et répression
On apprend dans les souvenirs d’un consul français l’existence d’un mouvement de lutte mené par des marins du Vapeur Provence (immatriculé à Marseille) à Santos courant mai 1920, l’épisode montrant une lutte de solidarité ouvrière suivie d’une féroce répression policière. Voici comment ce diplomate relata l’évènement :
"Des actes d’indiscipline s’étant produits à bord du Vapeur Provence…, je me suis rendu à Santos et, après enquête, j’ai puni les principaux coupables. (…) 4 jours de prison et je les ai fait conduire à la prison de la ville dans l’intérêt de la sécurité du navire. (…) Tous les chauffeurs sénégalais se sont solidarisés avec leurs camarades, ont pris une attitude menaçante et ont voulu quitter le bord malgré ma défense formelle. (…) Et les sénégalais ont essayé de dégager leurs camarades, ont suivi les agents de police en proférant des menaces et des injures et l’autorité locale a dû finalement procéder à leur arrestation". (Thiam, ibid.)
En fait, il s’agissait d’ouvriers marins (chauffeurs, graisseurs, matelots) dont les uns étaient inscrits à Dakar et les autres à Marseille, employés par le gros commerce français pour assurer le transport des marchandises entre les trois continents. Le problème ici est que les notes du diplomate restent muettes sur la cause de la révolte. Il semble cependant que ce mouvement ait pu avoir un lien avec un autre fait précédent s'étant produit en 1919 quand des marins sénégalais, suite à une lutte, furent débarqués et remplacés par des européens (selon des sources policières). Suite à cela, après la grève, beaucoup de syndiqués indigènes décidèrent de quitter la CGT qui avait approuvé cette décision pour adhérer à la CGTU (cette dernière étant dissidente de la première).
En tous cas, cet événement semble avoir inquiété sérieusement les autorités coloniales comme le montre le récit suivant qui en est fait :
"Le consul fulminait de plus belle, demandait avec véhémence que les coupables soient déférés, dès leur arrivée à Dakar, devant les tribunaux compétents et traduisait sa surprise et son indignation en ces termes : "L’attitude de ces individus est telle qu’elle constitue un réel danger pour les navires sur lesquels ils seraient embarqués à l’avenir, et pour la sécurité des états-majors et des équipages. Ils sont animés du plus mauvais esprit, ont perdu, ou n’ont jamais eu, le moindre respect pour la discipline et se croient le droit de donner des ordres au commandant".
Il découvrit, sans doute, pour la première fois, l’état d’esprit des sénégalais après la Première Guerre mondiale et avait manifestement été scandalisé par leur esprit de contestation et leur détermination à ne pas accepter sans réagir ce qu’ils considéraient comme attentatoire à leurs droits et libertés. La classe ouvrière était en train de mûrir politiquement et syndicalement". (Thiam, ibid.)
Effectivement on assiste là à un magnifique combat de classe de la part des ouvriers marins qui, malgré le rapport de force qui leur était très défavorable, purent montrer à l’ennemi leur détermination à se faire respecter en étant solidaires dans la lutte.
1920 : la relance de l’action des cheminots se conclut victorieusement
On a vu que, suite au mouvement victorieux des agents des PTT (en 1919), les cheminots indigènes voulaient s’engouffrer dans cette brèche pour repartir en grève avant de décider finalement d’annuler leur action faute de conditions favorables.
Six mois après cet épisode, ils décidèrent de relancer pour de bon leur action revendicative. Le mouvement d’action des cheminots fut motivé d’abord par la dégradation générale des conditions de vie due aux conséquences désastreuses de la Grande Guerre, ayant accentué le mécontentement prévisible des travailleurs et de la population en général. En effet, le coût de la vie connut dans les principales villes des hausses vertigineuses. Ainsi, le prix du kilo de mil qui était en décembre 1919 de 0,75 F avait été multiplié par trois en l’espace de quatre mois. Et le kilo de viande était passé de 5 à 7 F, de poulet de 6 à 10 F, etc.
Ce fut une note de l’Inspecteur général des Travaux publics le 13 avril, dans laquelle il demandait à ses supérieurs administratifs de ne pas appliquer la loi sur la journée de huit heures dans la colonie, qui fit déborder le vase en ravivant aussitôt le mécontentement latent qui couvait chez les cheminots depuis leur mouvement revendicatif de décembre 1919. Et de fait les ouvriers du rail passèrent à l’action le premier juin 1920 :
"C’était là le premier mouvement de grève mené à l’échelle ethnique par les ouvriers du chemin de fer, ce qui explique la rapidité et l’unanimité avec lesquelles les milieux économiques accueillirent l’événement et résolurent d’y porter remède. (…) Dès le premier juin, ils tenaient les États Généraux du commerce colonial au Sénégal, adressaient au chef de la Fédération leur préoccupation, et l’invitaient à ne pas assister en spectateur à la détérioration en cours du climat social". (Thiam, ibid.)
Les cheminots indigènes décidèrent ainsi de se lancer dans un nouveau bras de fer avec les autorités coloniales afin de faire aboutir les mêmes revendications. Mais, cette fois-ci, les cheminots africains semblèrent avoir tiré les leçons de l’action avortée, en élargissant la base sociale du mouvement, avec plusieurs délégués représentant chaque corps de métier, pleinement investis pour négocier collectivement avec les responsables politiques et économiques. Précisément, dès le deuxième jour de la grève, l’inquiétude grandit chez les principaux responsables coloniaux. Ainsi alerté par les décideurs économiques de Dakar, le ministre des colonies envoya un câble au Gouverneur dont les termes sont les suivants :
"On me signale que par suite grève 35 000 tonnes graines non abritées seraient en souffrance dans différentes stations du Dakar - Saint- Louis".
A partir de là, la pression fut renforcée sur le directeur du réseau ferré pour le pousser à répondre aux revendications des salariés. Et le "chef de gare" de répondre à ses supérieurs comme suit :
"Nous craignons que si une nouvelle augmentation de salaire aussi forte et aussi peu justifiée était accordée, il en résulte une répercussion générale sur les prétentions de tout le personnel et un encouragement à nous présenter de nouvelles demandes".
Dès lors, la Direction du réseau s’efforça d’emblée de briser la grève en jouant les blancs contre les noirs (ce qui lui avait réussi précédemment). Ainsi, au 3e jour du mouvement, elle parvenait même à composer un train de marchandises et de voyageurs grâce au concours d’un mécanicien européen et de chauffeurs de la Marine sous bonne escorte des forces de l’ordre. Mais, quand la Direction voulut jouer à nouveau ce scénario, elle ne trouva aucun salarié pour se prêter à son jeu car, cette fois-ci, les cheminots européens avaient décidé de rester "neutres", à la suite de fortes pressions exercées sur eux par les grévistes indigènes. Et la suite on l’entendra dans un compte-rendu du délégué du Gouverneur du Sénégal 5 : "Les agents de Dakar - Saint-Louis ont déclaré que, si au bout d’un mois, ils n’ont pas satisfaction, ils quitteront Dakar pour aller cultiver des lougans 6 dans l’intérieur de la colonie".
Dès cet instant, le Gouverneur du Sénégal convoqua aussitôt (au 6e jour de la grève) l’ensemble des partenaires sociaux pour leur notifier une série de mesures élaborées par ses propres services en vue de satisfaire les revendications des grévistes et, au bout du compte, les grévistes obtinrent ce qu'ils voulaient. En clair, les ouvriers remportèrent ainsi une nouvelle victoire grâce à leur combativité et à une meilleure organisation de la grève, et c’est bien cela qui leur permit d’imposer un rapport de force aux représentants de la bourgeoisie :
"Ce qui en revanche paraît sûr, c’est que la mentalité ouvrière au fil des épreuves s’affermissait et s’affinait de plus en plus et concevait au regard des enjeux en cause des formes de lutte plus étendues et des tentatives de coordination syndicale dans une sorte de large front de classe, face à un patronat de combat". (Thiam, ibid.)
Mais plus significatif encore dans cette montée du développement du front de classe, ce fut le 1er juin 1920, le jour où les cheminots venaient de déclencher la grève et le fait "que les équipages des remorqueurs cessaient le travail quelques heures plus tard, malgré la promesse qu’ils avaient donnée, notait le Délégué du Gouverneur, d’attendre le résultat des pourparlers qu’avait été chargé de conduire Martin, le chef du service de l’inspection maritime. Nous avons donc là, la première tentative délibérée de coordination volontaire de mouvements de grève simultanés déclenchés par (…) des cheminots et des ouvriers des équipages du port, c'est-à-dire, les personnels des deux secteurs qui constituaient les poumons de la colonie dont la paralysie concertée bloquait toute activité économique, commerciale, à l’entrée comme à la sortie (…). La situation paraissait plus préoccupante encore (pour l’Administration), puisque les boulangers de Dakar avaient eux aussi menacé de se mettre en grève, précisément le 1er juin et auraient sans nul doute tenu parole si des augmentations immédiates de salaires ne leur avaient pas été concédées." (Thiam, ibid.)
De même, au même moment, d’autres mouvements de grève éclatèrent simultanément aux chantiers Han/Thiaroye et aux chantiers de la route de Dakar à Rufisque. Les sources policières qui relatent cet événement ne disent rien sur l’origine de l’éclatement simultané de ces différents mouvements. Cependant, un recoupement de plusieurs éléments d’information de la même police coloniale permet de conclure que l’extension du mouvement de lutte n’était pas sans lien avec la tentative du Gouverneur de briser la grève des transports maritimes. En effet, sans le dire ouvertement, le représentant de l'État colonial fit d’abord appel à la Marine en compagnie de quelques équipages civils européens pour assurer les services de transport entre Dakar et Gorée 7. Et cela semble avoir provoqué des actions de solidarité chez les ouvriers d’autres secteurs :
"Cette intervention de l'État aux côtés du patronat avait-elle suscité la solidarité d’autres branches professionnelles ? Sans pouvoir l’affirmer de manière péremptoire, nous ne pouvons ne pas noter la grève qui éclata presque simultanément aux tentatives visant à briser le mouvement de revendication des équipages, dans les travaux publics". (Thiam, ibid.)
En effet, on sait qu’au bout du 5e jour, le mouvement s’effritait sous le double effet de la répression étatique et des rumeurs faisant état de la décision du patronat de remplacer les grévistes par des "jaunes".
"Les travailleurs, sentant que la durée de leur lutte et l’intervention des militaires pouvaient modifier le rapport des forces et compromettre l’heureux aboutissement de leur action, avaient, au septième jour de leur action de grève assoupli leurs exigences initiales en formulant leur plateforme sur les bases suivantes (…). L’Administration et le patronat firent front pour rejeter ces nouvelles propositions, obligeant ainsi les grévistes à poursuivre désespérément leur mouvement ou bien à l’arrêter aux conditions des autorités locales. Ils optèrent pour cette dernière solution". (Thiam, ibid.).
En clair, les grévistes durent effectivement reprendre le travail avec leur ancien salaire plus la "ration", en constatant la modification du rapport des forces nettement en faveur de la bourgeoisie et tout en mesurant les dangers encourus dans la poursuite de leur mouvement dans l’isolement. On peut dire qu’ici la classe ouvrière a bien subi une défaite mais le fait d'avoir su reculer en bon ordre a permis que celle-ci ne soit pas davantage profonde, ni à même d'effacer dans la conscience ouvrière les victoires plus nombreuses et plus importantes qu'elle avait remportées.
En résumé, cette période allant de 1914 à 1920 fut fortement marquée par d’intenses affrontements de classe entre la bourgeoisie coloniale et la classe ouvrière qui émergeait dans la colonie de l’AOF, cela dans un contexte révolutionnaire à l’échelle mondiale, ce dont le capital français prit pleinement conscience car se sentant fortement bousculé par le prolétariat en lutte exemplaire.
"Les activités du mouvement communiste mondial connurent pendant la même période, un développement ininterrompu marqué notamment par l’entrée en scène du premier africain de formation marxiste 8 ; rompant avec l’approche utopique que ses frères avaient des problèmes coloniaux, il tenta la première explication autochtone connue dans l’état actuel des sources, et la première critique sérieuse et approfondie du colonialisme, en tant que système organisé d’exploitation et de domination". (Thiam, ibid.)
Précisément, parmi les ouvriers qui se portèrent à la tête des mouvements de grève au Sénégal dans la période 1914/1920, certains purent côtoyer d’anciens "jeunes tirailleurs" immobilisés ou rescapés de la Première Guerre mondiale. Par exemple, les mêmes sources font part de l’existence, à l’époque, d’une petite poignée de syndicalistes sénégalais dont un certain Louis Ndiaye (jeune marin de 13 ans) qui fut militant de la CGT dès 1905 et le représentant de cette organisation dans les colonies entre 1914 et 1930. Par ailleurs, comme beaucoup d’autres jeunes "tirailleurs", il fut mobilisé en 1914/18, dans la Marine où il faillit périr. De même, avec un autre jeune sénégalais, en l’occurrence Lamine Senghor (proche du PCF dans les années 1920), ils furent, tous deux, sensiblement influencés par les idées de l’Internationale communiste. En ce sens, en compagnie d’autres figures des années 1920, on les considérait comme ayant joué un rôle majeur et dynamisant dans le processus de politisation et de développement de la conscience de classe dans les rangs ouvriers de la première colonie de l’AOF.
Lassou (à suivre)
1 Ce terme désignait à l'époque le commerce autre que local, essentiellement l'import / export contrôlé par quelques familles.
2 Iba Der Thiam, Histoire du Mouvement syndical africain 1790-1929, Éditions L’Harmattan, 1991.
3 Voir Afrique noire, l'Ère coloniale 1900- 1945. Jean Suret-Canale , Éditions Sociales, Paris 1961.
4 Il vaut ici la peine de rappeler ce que nous avons déjà signalé à l'occasion de la publication de la première partie de cet article dans la Revue Internationale n° 145. "Si nous reconnaissons largement le sérieux des chercheurs qui transmettent les sources de référence, en revanche nous ne partageons pas forcément certaines de leurs interprétations des évènements historiques. Il en est de même sur certaines notions, par exemple quand les mêmes parlent de "conscience syndicale" à la place de "conscience de classe" (ouvrière), ou encore "mouvement syndical" (au lieu de mouvement ouvrier). Reste que, jusqu’à nouvel ordre, nous avons confiance en leur rigueur scientifique tant que leurs thèses ne se heurtent pas aux faits historiques ou n’empêchent pas d’autres interprétations". De manière plus générale, nous soulignons à nouveau ici que si les syndicats ont, dans une première période de la vie du capitalisme, effectivement constitué de véritables organes de la lutte de la classe ouvrière en vue de la défense de ses intérêts immédiats au sein du capitalisme, ils ont par la suite été intégrés à l'Etat capitaliste et ont définitivement perdu toute possibilité d'être utilisés par la classe ouvrière dans son combat contre l'exploitation.
5 Le Gouverneur du Sénégal était le subalterne du Gouverneur général de l'AOF.
6 Champs créés sur brûlis.
7 Île sénégalaise située dans la baie de Dakar.
8 Il s'agissait de Lamine Senghor.
Géographique:
- Afrique [18]
Résolution sur la situation internationale du XIXe congrès du CCI
- 1559 lectures
Crise économique
1) La résolution adoptée par le précédent congrès du CCI mettait d'emblée en évidence le démenti cinglant infligé par la réalité aux prévisions optimistes des dirigeants de la classe bourgeoise au début de la dernière décennie du 20e siècle, particulièrement après l'effondrement de cet "Empire du mal" que constituait le bloc impérialiste dit "socialiste". Elle citait la déclaration désormais fameuse du président George Bush senior de mars 1991 annonçant la naissance d'un "Nouvel Ordre mondial" basé sur le "respect du droit international" et elle soulignait son caractère surréaliste face au chaos croissant dans lequel s'enfonce aujourd'hui la société capitaliste. Vingt ans après ce discours "prophétique", et particulièrement depuis le début de cette nouvelle décennie, jamais, depuis la fin de la seconde guerre mondiale le monde n'a donné une telle image de chaos. A quelques semaines d'intervalle on a assisté à une nouvelle guerre en Libye, venant s'ajouter à la liste de tous les conflits sanglants qui ont touché la planète au cours de la dernière période, à de nouveaux massacres en Côte d'Ivoire et aussi à la tragédie qui a frappé un des pays les plus puissants et modernes du monde, le Japon. Le tremblement de terre qui a ravagé une partie de ce pays a souligné une nouvelle fois qu'il n'existe pas des "catastrophes naturelles" mais des conséquences catastrophiques à des phénomènes naturels. Il a montré que la société dispose aujourd'hui de moyens pour construire des bâtiments qui résistent aux séismes et qui permettraient d'éviter des tragédies comme celle d'Haïti l'an dernier. Mais il a montré aussi toute l'imprévoyance dont même un État aussi avancé que le Japon peut faire preuve : le séisme en lui-même a fait peu de victimes mais le tsunami qui l'a suivi a tué près de 30 000 êtres humains en quelques minutes. Plus encore, en provoquant un nouveau Tchernobyl, il a mis en lumière, non seulement l'imprévoyance de la classe dominante, mais aussi sa démarche d'apprenti sorcier, incapable de maîtriser les forces qu'elle a mises en mouvement. Ce n'est pas l'entreprise Tepco, l'exploitant de la centrale atomique de Fukushima qui est le premier, encore moins l'unique responsable de la catastrophe. C'est le système capitaliste dans son ensemble, basé sur la recherche effrénée du profit ainsi que sur la compétition entre secteurs nationaux et non sur la satisfaction des besoins de l'humanité, qui porte la responsabilité fondamentale des catastrophes présentes et futures subies par l'espèce humaine. En fin de compte, le Tchernobyl japonais constitue une nouvelle illustration de la faillite ultime du mode de production capitaliste, un système dont la survie constitue une menace croissante pour la survie de l'humanité elle-même.
2) C'est évidemment la crise que subit actuellement le capitalisme mondial qui exprime le plus directement la faillite historique de ce mode de production. Il y a deux ans, la bourgeoisie de tous les pays était saisie d'une sainte panique devant la gravité de la situation économique. L'OCDE n'hésitait pas à écrire : "L’économie mondiale est en proie à sa récession la plus profonde et la plus synchronisée depuis des décennies" (Rapport intermédiaire de mars 2009). Quand on sait avec quelle modération cette vénérable institution s'exprime habituellement, on peut se faire une idée de l'effroi que ressentait la classe dominante face à la faillite potentielle du système financier international, la chute brutale du commerce mondial (plus de 13% en 2009), la brutalité de la récession des principales économies, la vague de faillites frappant ou menaçant des entreprises emblématiques de l'industrie telles General Motors ou Chrysler. Cet effroi de la bourgeoisie l'avait conduite à convoquer les sommets du G20 dont celui de mars 2009 à Londres décidant notamment le doublement des réserves du Fonds monétaire international et l'injection massive de liquidités dans l'économie par les États afin de sauver un système bancaire en perdition et de relancer la production. Le spectre de la "Grande Dépression des années 1930" hantait les esprits ce qui conduisait la même OCDE à conjurer de tels démons en écrivant : "Bien qu’on ait parfois qualifié cette sévère récession mondiale de ‘grande récession’, on reste loin d’une nouvelle ‘grande dépression’ comme celle des années 30, grâce à la qualité et à l’intensité des mesures que les gouvernements prennent actuellement" (Ibid.). Mais comme le disait la résolution du 18e congrès, "le propre des discours de la classe dominante aujourd'hui est d’oublier les discours de la veille" et le même rapport intermédiaire de l'OCDE du printemps 2011 exprime un véritable soulagement face à la restauration de la situation du système bancaire et à la reprise économique. La classe dominante ne peut faire autrement. Incapable de se donner une vision lucide, d'ensemble et historique des difficultés que rencontre son système, car une telle vision la conduirait à découvrir l'impasse définitive dans laquelle se trouve ce dernier, elle en est réduite à commenter au jour le jour les fluctuations de la situation immédiate en essayant de trouver dans celle-ci des motifs de consolation. Ce faisant, elle en est amenée à sous-estimer, même si, de temps en temps, les médias adoptent un ton alarmiste à son sujet, la signification du phénomène majeur qui s'est fait jour depuis deux ans : la crise de la dette souveraine d'un certain nombre d'États européens. En fait, cette faillite potentielle d'un nombre croissant d'États constitue une nouvelle étape dans l'enfoncement du capitalisme dans sa crise insurmontable. Elle met en relief les limites des politiques par lesquelles la bourgeoisie a réussi à freiner l'évolution de la crise capitaliste depuis plusieurs décennies.
3) Cela fait maintenant plus de 40 ans que le système capitaliste se confronte à la crise. Mai 68 en France et l'ensemble des luttes prolétariennes qui ont suivi internationalement n'ont connu cette ampleur que parce qu'ils étaient alimentés par une aggravation mondiale des conditions de vie de la classe ouvrière, une aggravation résultant des premières atteintes de la crise capitaliste, notamment la montée du chômage. Cette crise a connu une brutale accélération en 1973-75 avec la première grande récession internationale de l'après guerre. Depuis, de nouvelles récessions, chaque fois plus profondes et étendues, ont frappé l'économie mondiale jusqu'à culminer avec celle de 2008-2009 qui a ramené dans les consciences le spectre des années 1930. Les mesures adoptées par le G20 de mars 2009 pour éviter une nouvelle "Grande Dépression" sont significatives de la politique menée depuis plusieurs décennies par la classe dominante : elles se résument par l'injection dans les économies de masses considérables de crédits. De telles mesures ne sont pas nouvelles. En fait, depuis plus de 35 ans, elles constituent le cœur des politiques menées par la classe dominante pour tenter d'échapper à la contradiction majeure du mode de production capitaliste : son incapacité à trouver des marchés solvables en mesure d'absorber sa production. La récession de 1973-75 avait été surmontée par des crédits massifs aux pays du Tiers-Monde mais, dès le début des années 1980, avec la crise de la dette de ces pays, la bourgeoise des pays les plus développés avait dû renoncer à ce poumon pour son économie. Ce sont alors les États des pays les plus avancés, et au premier lieu celui des États-Unis, qui ont pris la relève en tant que "locomotive" de l'économie mondiale. Les "reaganomics" (politique néolibérale de l'Administration Reagan) du début des années 80, qui avaient permis une relance significative de l'économie de ce pays, étaient basées sur un creusement inédit et considérable des déficits budgétaires alors que Ronald Reagan déclarait au même moment que "L'État n'est pas la solution, c'est le problème". En même temps, les déficits commerciaux également considérables de cette puissance permettaient aux marchandises produites par les autres pays de trouver à s'y écouler. Au cours des années 1990, les "tigres" et les "dragons" asiatiques (Singapour, Taïwan, Corée du Sud, etc.) ont accompagné pour un temps les États-Unis dans ce rôle de "locomotive" : leurs taux de croissance spectaculaires en faisaient une destination importante pour les marchandises des pays les plus industrialisés. Mais cette "success story" s'est construite au prix d'un endettement considérable qui a conduit ces pays à des convulsions majeures en 1997 au même titre que la Russie "nouvelle" et "démocratique" qui s'est retrouvée en cessation de paiements ce qui a déçu cruellement ceux qui avaient misé sur la "fin du communisme" pour relancer durablement l’économie mondiale. Au début des années 2000 l’endettement a connu une nouvelle accélération, notamment grâce au développement faramineux des prêts hypothécaires à la construction dans plusieurs pays, en particulier aux États-Unis. Ce dernier pays a alors accentué son rôle de "locomotive de l’économie mondiale" mais au prix d’une croissance abyssale des dettes, -notamment au sein de la population américaine- basées sur toutes sortes de "produits financiers" censés prévenir les risques de cessation de paiement. En réalité, la dispersion des créances douteuses n’a nullement aboli leur caractère d’épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’économie américaine et mondiale. Bien au contraire, elle n’a fait qu’accumuler dans le capital des banques les "actifs toxiques" à l’origine de leur effondrement à partir de 2007 et de la brutale récession mondiale de 2008-2009.
4) Ainsi, comme le disait la résolution adoptée au précédent congrès, "ce n’est pas la crise financière qui est à l’origine de la récession actuelle. Bien au contraire, la crise financière ne fait qu’illustrer le fait que la fuite en avant dans l’endettement qui avait permis de surmonter la surproduction ne peut se poursuivre indéfiniment. Tôt ou tard, "l’économie réelle" se venge, c’est-à-dire que ce qui est à la base des contradictions du capitalisme, la surproduction, l’incapacité des marchés à absorber la totalité des marchandises produites, revient au devant de la scène." Et cette même résolution précisait, après le sommet du G20 de mars 2009, que "la fuite en avant dans l’endettement est un des ingrédients de la brutalité de la récession actuelle. La seule ‘solution’ que soit capable de mettre en œuvre la bourgeoisie est… une nouvelle fuite en avant dans l’endettement. Le G20 n’a pu inventer de solution à une crise pour la bonne raison qu’il n’existe pas de solution à celle-ci."
La crise des dettes souveraines qui se propage aujourd'hui, le fait que les États soient incapables d'honorer leurs dettes, constitue une illustration spectaculaire de cette réalité. La faillite potentielle du système bancaire et la récession ont obligé tous les États à injecter des sommes considérables dans leur économie alors même que les recettes étaient en chute libre du fait du recul de la production. De ce fait les déficits publics ont connu, dans la plupart des pays, une augmentation considérable. Pour les plus exposés d'entre eux, comme l'Irlande, la Grèce ou le Portugal, cela a signifié une situation de faillite potentielle, l'incapacité de payer leurs fonctionnaires et de rembourser leurs dettes. Les banques se refusent désormais à leur consentir de nouveaux prêts, sinon à des taux exorbitants, puisqu'elles n'ont aucune garantie de pouvoir être remboursées. Les "plans de sauvetage" dont ils ont bénéficié de la part de la Banque européenne et du Fonds monétaire international constituent de nouvelles dettes dont le remboursement s'ajoute à celui des dettes précédentes. C'est plus qu'un cercle vicieux, c'est une spirale infernale. La seule "efficacité" de ces plans consiste dans l'attaque sans précédent contre les travailleurs qu'ils représentent, contre les fonctionnaires dont les salaires et les effectifs sont réduits de façon drastique, mais aussi contre l'ensemble de la classe ouvrière à travers les coupes claires dans l'éducation, la santé et les pensions de retraite ainsi que par des augmentations majeures des impôts et taxes. Mais toutes ces attaques anti-ouvrières, en amputant massivement le pouvoir d'achat des travailleurs, ne pourront qu'apporter une contribution supplémentaire à une nouvelle récession.
5) La crise de la dette souveraine des PIIGS (Portugal, Italie, Irlande, Grèce, Espagne) ne constitue qu'une part infime du séisme qui menace l'économie mondiale. Ce n'est pas parce qu'elles bénéficient encore pour le moment de la note AAA dans l'indice de confiance des agences de notation (les mêmes agences qui, jusqu'à la veille de la débandade des banques en 2008, leur avaient accordé la note maximale) que les grandes puissances industrielles s'en tirent beaucoup mieux. Fin avril 2011, l'agence Standard and Poor's émettait une opinion négative face à la perspective d'un Quantitative Easing n° 3, c'est-à-dire un 3e plan de relance de l'État fédéral américain destiné à soutenir l'économie. En d'autres termes, la première puissance mondiale court le risque de se voir retirer la confiance "officielle" sur sa capacité à rembourser ses dettes, si ce n'est avec un dollar fortement dévalué. En fait, de façon officieuse, cette confiance commence à faire défaut avec la décision de la Chine et du Japon depuis l'automne dernier d'acheter massivement de l'or et des matières premières en lieu et place des bons du Trésor américain ce qui conduit la Banque fédérale américaine à en acheter maintenant de 70% à 90% à leur émission. Et cette perte de confiance se justifie parfaitement quand on constate l'incroyable niveau d'endettement de l'économie américaine : en janvier 2010, l'endettement public (État fédéral, États, municipalités, etc.) représentait déjà près de 100% du PIB ce qui ne constituait qu'une partie de l'endettement total du pays (qui comprend également les dettes des ménages et des entreprises non financières) se montant à 300% du PIB. Et la situation n'était pas meilleure pour les autres grands pays où la dette totale représentait à la même date des montants de 280% du PIB pour l’Allemagne, 320% pour la France, 470% pour le Royaume-Uni et le Japon. Dans ce dernier pays, la dette publique à elle seule atteignait 200% du PIB. Et depuis, pour tous les pays, la situation n'a fait que s'aggraver avec les divers plans de relance.
Ainsi, la faillite des PIIGS ne constitue que la pointe émergée de la faillite d'une économie mondiale qui n'a dû sa survie depuis des décennies qu'à la fuite en avant désespérée dans l'endettement. Les États qui disposent de leur propre monnaie comme le Royaume-Uni, le Japon et évidemment les États-Unis ont pu masquer cette faillite en faisant fonctionner à tout va la planche à billets (au contraire de ceux de la zone Euro, comme la Grèce, l'Irlande ou le Portugal, qui ne disposent pas de cette possibilité). Mais cette tricherie permanente des États qui sont devenus de véritables faux-monnayeurs, avec comme chef de gang l'État américain, ne pourra se poursuivre indéfiniment de la même façon que ne pouvaient pas se poursuivre les tricheries du système financier comme l'a démontré la crise de celui-ci en 2008 qui a failli le faire exploser. Un des signes visibles de cette réalité est l'accélération actuelle de l'inflation mondiale. En basculant de la sphère des banques à celles des États, la crise de l'endettement ne fait que marquer l'entrée du mode de production capitaliste dans une nouvelle phase de sa crise aiguë où vont s'aggraver encore de façon considérable la violence et l'étendue de ses convulsions. Il n'y a pas de "sortie du tunnel" pour le capitalisme. Ce système ne peut qu'entraîner la société dans une barbarie toujours croissante.
Tensions impérialistes
6) La guerre impérialiste constitue la manifestation majeure de la barbarie dans laquelle le capitalisme décadent précipite la société humaine. L'histoire tragique du 20e siècle en constitue la manifestation la plus évidente : face à l'impasse historique dans laquelle se trouve son mode de production, face à l'exacerbation des rivalités commerciales entre États, la classe dominante est conduite à une fuite en avant dans les politiques guerrières, dans les affrontements militaires. Pour la plupart des historiens, y compris ceux qui ne se réclament pas du marxisme, il est clair que la Seconde Guerre mondiale est fille de la Grande Dépression des années 1930. De même, l'aggravation des tensions impérialistes de la fin des années 1970 et du début des années 1980 entre les deux blocs d'alors, l'américain et le russe (invasion de l'Afghanistan par l'URSS en 1979, croisade contre "l'Empire du mal" de l'administration Reagan) découlaient pour une grande partie du retour de la crise ouverte de l'économie capitaliste à la fin des années 1960. Cependant, l'histoire a montré que ce lien entre aggravation des affrontements impérialistes et crise économique du capitalisme n'est pas direct ou immédiat. L'intensification de la "guerre froide" s'est finalement soldée par la victoire du bloc occidental et par l'implosion du bloc adverse, laquelle a conduit en retour à la désagrégation du premier. Mais s'il échappait à la menace d'une nouvelle guerre généralisée qui pouvait aboutir à la disparition de l'espèce humaine, le monde n'a pu s'épargner une explosion des tensions et des affrontements militaires : la fin des blocs rivaux a signifié la fin de la discipline qu'ils réussissaient à imposer dans leurs territoires respectifs. Depuis, l'arène impérialiste planétaire est dominée par la tentative de la première puissance mondiale de maintenir son leadership sur le monde, et en premier lieu sur ses anciens alliés. La 1e Guerre du Golfe, en 1991, avait déjà cet objectif mais l'histoire des années 1990, particulièrement la guerre en Yougoslavie, a montré la faillite de cette ambition. La "guerre contre le terrorisme mondial" déclarée par les États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre 2001 se voulait une nouvelle tentative pour réaffirmer leur leadership, mais leur enlisement en Afghanistan et en Irak a souligné une nouvelle fois l'incapacité de rétablir ce leadership.
7) Ces échecs des États-Unis n'ont pas découragé cette puissance à poursuivre la politique offensive qu'elle mène depuis le début des années 1990 et qui fait d'elle le principal facteur d'instabilité sur la scène mondiale. Comme le disait la résolution du précédent congrès : "Face à cette situation, Obama et son administration ne pourront pas faire autre chose que poursuivre la politique belliciste de leurs prédécesseurs" (…) "si Obama a prévu de retirer les forces américaines d'Irak, c'est pour pouvoir renforcer leur engagement en Afghanistan et au Pakistan". C'est ce qui s'est illustré récemment avec l'exécution de Ben Laden par un commando américain sur le territoire pakistanais. Cette opération "héroïque" avait évidemment une vocation électorale à un an et demi des élections américaines. Elle visait notamment à contrer les critiques des républicains qui reprochaient à Obama sa mollesse dans l'affirmation de la prééminence des États-Unis sur le plan militaire, des critiques qui s'étaient radicalisées lors de l'intervention en Libye où le leadership de l'opération avait été laissé au tandem franco-britannique. Elle signifiait aussi qu'après avoir fait jouer à Ben Laden le rôle du méchant de l'histoire pendant près de 10 ans, il était temps de s'en débarrasser sous peine d'apparaître comme impuissants. Ce faisant, la puissance américaine faisait la preuve qu'elle est la seule à avoir les moyens militaires, technologiques et logistiques de réussir ce genre d'opération, justement au moment où la France et le Royaume-Uni peinent à mener à bien leur opération anti-Kadhafi. Elle signifiait au monde qu'elle n'hésitait pas à violer la "souveraineté nationale" d'un "allié", qu'elle entendait fixer les règles du jeu partout où elle l'estimait nécessaire. Enfin, elle réussissait à obliger la plupart des gouvernements du monde à saluer, souvent à leur cœur défendant, la valeur de cet exploit.
8) Cela-dit, le coup d'éclat réussi par Obama au Pakistan ne saurait en aucune façon lui permettre de stabiliser la situation dans la région, notamment au Pakistan même où ce camouflet subi par sa "fierté nationale" risque d'attiser les conflits anciens entre divers secteurs de la bourgeoisie et de l'appareil d'État. De même, la mort de Ben Laden ne permettra pas aux États-Unis et aux autres pays engagés en Afghanistan de reprendre le contrôle du pays et d'asseoir l'autorité d'un gouvernement Karzaï complètement miné par la corruption et le tribalisme. Plus généralement, elle ne permettra nullement de mettre un frein aux tendances au "chacun pour soi" et à la contestation de l'autorité de la première puissance mondiale telle qu'elle continue à se manifester, comme on l'a vu récemment avec la constitution d'une série d’alliances ponctuelles surprenantes : rapprochement entre la Turquie et l’Iran, alliance entre l’Iran, le Brésil et le Venezuela, (stratégique et anti-USA), entre l’Inde et Israël (militaire et rupture d’isolement), entre la Chine et l’Arabie Saoudite (militaire et stratégique), etc. En particulier, elle ne saurait décourager la Chine de faire prévaloir les ambitions impérialistes que lui permet son statut récent de grande puissance industrielle. Il est clair que ce pays, malgré son importance démographique et économique, n'a absolument pas les moyens militaires ou technologiques, et n'est pas prêt de les avoir, de constituer une nouvelle tête de bloc. Cependant, il a les moyens de perturber encore plus les ambitions américaines – que ce soit en Afrique, en Iran, en Corée du Nord, en Birmanie, et d'apporter sa pierre à l'instabilité croissante qui caractérise les rapports impérialistes. Le "nouvel ordre mondial" prédit il y a 20 ans par George Bush père, et que celui-ci rêvait sous l'égide des États-Unis, ne peut que se présenter toujours plus comme un "chaos mondial", un chaos que les convulsions de l'économie capitaliste ne pourront qu'aggraver encore.
Lutte de classe
9) Face à ce chaos qui affecte la société bourgeoise sur tous les plans - économique, guerrier et aussi environnemental, comme on l'a vu encore récemment au Japon - seul le prolétariat peut apporter une solution, SA solution, la révolution communiste. La crise insoluble de l'économie capitaliste, les convulsions toujours croissantes qu'elle va connaître, constituent les conditions objectives pour celle-ci. D'une part en obligeant la classe ouvrière à développer de façon croissante ses luttes face aux attaques dramatiques qu'elle va subir de la part de la classe exploiteuse. D'autre part en lui permettant de comprendre que ces luttes prennent toute leur signification comme moments de préparation de son affrontement décisif avec un mode de production - le capitalisme - condamné par l'histoire, en vue de son renversement.
Cependant, comme le disait la résolution du précédent congrès international : "Le chemin est encore long et difficile qui conduit aux combats révolutionnaires et au renversement du capitalisme. (…) Pour que la conscience de la possibilité de la révolution communiste puisse gagner un terrain significatif au sein de la classe ouvrière, il est nécessaire que celle-ci puisse prendre confiance en ses propres forces et cela passe par le développement de ses luttes massives." De façon beaucoup plus immédiate, la résolution précisait que "la forme principale que prend aujourd’hui cette attaque, celle des licenciements massifs, ne favorise pas, dans un premier temps, l’émergence de tels mouvements. (…) C’est dans un second temps, lorsqu’elle sera en mesure de résister aux chantages de la bourgeoisie, lorsque s’imposera l’idée que seule la lutte unie et solidaire peut freiner la brutalité des attaques de la classe régnante, notamment lorsque celle-ci va tenter de faire payer à tous les travailleurs les énormes déficits budgétaires qui s’accumulent à l’heure actuelle avec les plans de sauvetage des banques et de 'relance' de l’économie, que des combats ouvriers de grande ampleur pourront se développer beaucoup plus."
10) Les deux années qui nous séparent du précédent congrès ont amplement confirmé cette prévision. Cette période n'a pas connu de luttes d'ampleur contre les licenciements massifs et la montée du chômage sans précédent subis par la classe ouvrière dans les pays les plus développés. En revanche, c'est à partir des attaques portées directement par les gouvernements en application des plans "d'assainissement des comptes publics" qu'ont commencé à se développer des luttes significatives. Cette réponse est encore très timide, notamment là où ces plans d'austérité ont pris les formes les plus violentes, dans des pays comme la Grèce ou l'Espagne par exemple où, pourtant, la classe ouvrière avait fait preuve dans un passé récent d'une combativité relativement importante. D'une certaine façon, il semble que la brutalité même des attaques provoque un sentiment d'impuissance dans les rangs ouvriers, d'autant plus qu'elles sont conduites par des gouvernements "de gauche". Paradoxalement, c'est là où ces attaques semblent les moins violentes, en France par exemple, que la combativité ouvrière s'est exprimée le plus massivement avec le mouvement contre la réforme des retraites de l'automne 2010.
11) En même temps, les mouvements les plus massifs qu'on ait connus au cours de la dernière période ne sont pas venus des pays les plus industrialisés mais des pays de la périphérie du capitalisme, notamment dans un certain nombre de pays du monde arabe, particulièrement la Tunisie et l'Égypte où, finalement, après avoir tenté de les museler par une répression féroce, la bourgeoisie a été conduite à licencier les dictateurs en place. Ces mouvements n'étaient pas des luttes ouvrières classiques comme ces pays en avaient déjà connues dans un passé récent (par exemple les luttes à Gafsa en Tunisie en 2008 ou les grèves massives dans l’industrie textile en Égypte, durant l’été 2007, rencontrant la solidarité active de la part de nombreux autres secteurs). Ils ont pris souvent la forme de révoltes sociales où se trouvaient associés toutes sortes de secteurs de la société : travailleurs du public et du privé, chômeurs, mais aussi des petits commerçants, des artisans, les professions libérales, la jeunesse scolarisée, etc. C'est pour cela que le prolétariat, la plupart du temps, n'y est pas apparu directement de façon distincte (comme il est apparu, par exemple, dans les grèves en Égypte vers la fin des révoltes), encore moins en assumant le rôle de force dirigeante. Cependant, à l'origine de ces mouvements (ce qui se reflétait dans beaucoup des revendications mises en avant) on trouve fondamentalement les mêmes causes à l'origine des luttes ouvrières dans les autres pays : l'aggravation considérable de la crise, la misère croissante qu'elle provoque au sein de l'ensemble de la population non exploiteuse. Et si en général le prolétariat n'est pas apparu directement comme classe dans ces mouvements, son empreinte y était présente dans les pays où il a un poids significatif, notamment par la profonde solidarité qui se manifestait dans les révoltes, leur capacité à éviter de se lancer dans des actes de violence aveugle et désespérée malgré la terrible répression qu'ils ont dû affronter. En fin de compte, si la bourgeoisie en Tunisie et en Égypte s'est finalement résolue, sur les bons conseils de la bourgeoisie américaine, à se débarrasser des vieux dictateurs, c'est en grande partie à cause de la présence de la classe ouvrière dans ces mouvements. Une des preuves, en négatif, de cette réalité, c'est l'issue qu'ont connue les mouvements en Libye : non pas le renversement du vieux dictateur Kadhafi mais l'affrontement militaire entre cliques bourgeoises où les exploités ont été enrôlés comme chair à canon. Dans ce pays, une grande partie de la classe ouvrière était constituée de travailleurs immigrés (égyptiens, tunisiens, chinois, subsahariens, bengalis) dont la réaction principale a été de fuir la répression qui s'est déchaînée avec férocité dès les premiers jours.
12) L'issue guerrière du mouvement en Libye, avec l'entrée en lice des pays de l'OTAN, a permis à la bourgeoise de promouvoir des campagnes de mystification en direction des ouvriers des pays avancés dont la réaction spontanée avait été de se sentir solidaires des manifestants de Tunis et du Caire et de saluer leur courage et leur détermination. En particulier, la présence massive des jeunes générations dans le mouvement, notamment de la jeunesse scolarisée dont l'avenir se présente sous les auspices sinistres du chômage et de la misère, faisait écho aux récents mouvements qui ont animé la jeunesse scolarisée dans de nombreux pays européens dans la dernière période : mouvement contre le CPE en France au printemps 2006, révoltes et grèves en Grèce fin 2008, manifestations et grèves des lycéens et étudiants en Grande-Bretagne fin 2010, mouvements étudiants en Italie en 2008 et aux États-Unis en 2010, etc.). Ces campagnes bourgeoises pour dénaturer, aux yeux des travailleurs des autres pays, la signification des révoltes en Tunisie et en Égypte ont évidemment été facilitées par les illusions qui pèsent fortement sur la classe ouvrière de ces pays : les illusions nationalistes, démocratiques et syndicalistes notamment, comme cela avait d'ailleurs été le cas en 1980-81 avec la lutte du prolétariat polonais.
13) Ce mouvement d'il y a 30 ans avait permis au CCI d’élaborer son analyse critique de la théorie des "maillons faibles" développée notamment par Lénine au moment de la révolution en Russie. Le CCI avait à ce moment-là mis en avant, en se basant sur les positions élaborées par Marx et Engels, que c'est des pays centraux du capitalisme, et particulièrement des vieux pays industriels d'Europe de l'Ouest, que viendrait le signal de la révolution prolétarienne mondiale, du fait de la concentration du prolétariat de ces pays, et plus encore de son expérience historique, et qui lui donnent les meilleures armes pour déjouer finalement les pièges idéologiques les plus sophistiqués mis en œuvre depuis longtemps par la bourgeoisie. Ainsi, une des étapes fondamentales du mouvement de la classe ouvrière mondiale dans l'avenir sera constituée non seulement par le développement des luttes massives dans les pays centraux d'Europe occidentale, mais aussi par leur capacité à déjouer les pièges démocratiques et syndicaux, notamment par une prise en main de ces luttes par les travailleurs eux-mêmes. Ces mouvements constitueront un phare pour la classe ouvrière mondiale, y compris pour celle de la principale puissance capitaliste, les États-Unis, dont la plongée dans une misère croissante, une misère qui touche déjà des dizaines de millions de travailleurs, va transformer le "rêve américain" en véritable cauchemar.
CCI (mai 2011)
Vie du CCI:
XIXe congrès du CCI : se préparer aux affrontements de classe
- 1977 lectures
Le CCI a tenu son 19e congrès en mai dernier. Le congrès constitue, en général, le moment le plus important de la vie des organisations révolutionnaires et, dans la mesure où celles-ci sont parties intégrantes de la classe ouvrière, il leur appartient de porter à la connaissance de cette dernière les principaux enseignements de leur congrès. C'est le but du présent article. Il faut d'emblée signaler que le congrès lui-même a mis en pratique cette volonté d'ouverture vers l'extérieur de l'organisation puisque, outre les délégations des sections du CCI, étaient présents non seulement des sympathisants de celui-ci ou des membres de cercles de discussion auxquels participent ses militants mais aussi des délégations d'autres groupes avec qui le CCI est en contact et en discussion ; deux groupes de Corée et Opop du Brésil1. D'autres groupes avaient été invités et avaient accepté l'invitation mais il n'ont pu venir du fait des barrages de plus en plus sévères que la bourgeoisie européenne oppose aux ressortissants des pays non européens.
Suivant les statuts de notre organisation :
"Le Congrès international est 1'organe souverain du CCI. Comme tel il a pour tâches :
- d'élaborer les analyses et orientations générales de l'organisation, notamment en ce qui concerne la situation internationale ;
- d'examiner et faire le bilan des activités de l'organisation depuis le précédent congrès ;
- de définir ses perspectives de travail pour le futur."
C'est sur la base de ces éléments qu'on peut tirer le bilan et les enseignements du 19e congrès.
La situation internationale
Le premier point qu'il importe d'aborder est celui de nos analyses et discussions sur la situation internationale. En effet, si l'organisation n'est pas en mesure d'élaborer une compréhension claire de celle-ci, elle se prive de sa capacité à y intervenir de façon appropriée. L'histoire nous a appris combien pouvait être catastrophique une évaluation erronée de la situation internationale de la part des organisations révolutionnaires. On peut citer les cas les plus dramatiques comme la sous-évaluation du danger de guerre par la majorité de la 2e Internationale à la veille de la première boucherie impérialiste mondiale, alors que dans la période précédente, sous l'impulsion de la Gauche de l'Internationale, ses congrès avaient correctement mis en garde et appelé à la mobilisation du prolétariat contre ce danger.
Un autre exemple est celui de l'analyse faite par Trotski au cours des années 1930 lorsqu'il voit dans les grèves ouvrières en France de 1936 ou dans la guerre civile en Espagne les prémices d'une nouvelle vague révolutionnaire internationale. Cette analyse le conduit à fonder en 1938 une "4e Internationale" qui doit, face à la "politique conservatrice des partis communistes et socialistes", prendre leur place à la tête "des masses de millions d'hommes [qui] s'engagent sans cesse sur la voie de la révolution". Cette erreur a fortement contribué au passage des sections de la 4e Internationale dans le camp bourgeois au cours de la Seconde Guerre mondiale : voulant à tout pris "coller aux masses", elles se sont engouffrées dans les politiques de la "Résistance" menées par les partis socialistes et "communistes", c'est-à-dire au soutien du camp impérialiste des Alliés.
Plus près de nous, on a pu voir comment certains groupes qui se réclamaient de la Gauche communiste étaient passés à côté de la grève généralisée de Mai 1968 en France et de l'ensemble du mouvement international de luttes ouvrières qui l'a suivi en considérant que c'était un "mouvement d'étudiants". On a pu aussi constater le cruel destin d'autres groupes qui, en considérant que Mai 68 était une "révolution", ont sombré dans le désespoir et ont finalement disparu lorsque que ce mouvement n'a pas tenu les promesses qu'ils y voyaient.
Aujourd'hui, il est de la plus haute importance pour les révolutionnaires d'élaborer une analyse correcte des enjeux de la situation internationale justement parce que ces enjeux ont acquis, au cours de la dernière période, une importance toute particulière.
Nous publions dans ce numéro de la Revue Internationale la résolution adoptée par le Congrès et il n'est donc pas nécessaire de revenir sur tous les points de celle-ci. Nous voulons seulement en souligner les aspects les plus importants.
Le premier aspect, le plus fondamental, est le pas décisif que vient de franchir la crise du capitalisme avec la crise de la dette souveraine de certains États européens comme la Grèce.
"En fait, cette faillite potentielle d'un nombre croissant d'États constitue une nouvelle étape dans l'enfoncement du capitalisme dans sa crise insurmontable. Elle met en relief les limites des politiques par lesquelles la bourgeoisie a réussi à freiner l'évolution de la crise capitaliste depuis plusieurs décennies. (…) Les mesures adoptées par le G20 de mars 2009 pour éviter une nouvelle 'Grande Dépression' sont significatives de la politique menée depuis plusieurs décennies par la classe dominante : elles se résument par l'injection dans les économies de masses considérables de crédits. De telles mesures ne sont pas nouvelles. En fait, depuis plus de 35 ans, elles constituent le cœur des politiques menées par la classe dominante pour tenter d'échapper à la contradiction majeure du mode de production capitaliste : son incapacité à trouver des marchés solvables en mesure d'absorber sa production. (…) La faillite potentielle du système bancaire et la récession ont obligé tous les États à injecter des sommes considérables dans leur économie alors même que les recettes étaient en chute libre du fait du recul de la production. De ce fait les déficits publics ont connu, dans la plupart des pays, une augmentation considérable. Pour les plus exposés d'entre eux, comme l'Irlande, la Grèce ou le Portugal, cela a signifié une situation de faillite potentielle, l'incapacité de payer leurs fonctionnaires et de rembourser leurs dettes. (…) Les 'plans de sauvetage' dont ils ont bénéficié de la part de la Banque européenne et du Fonds monétaire international constituent de nouvelles dettes dont le remboursement s'ajoute à celui des dettes précédentes. C'est plus qu'un cercle vicieux, c'est une spirale infernale. (…) La crise de la dette souveraine des PIIGS (Portugal, Italie, Irlande, Grèce, Espagne) ne constitue qu'une part infime du séisme qui menace l'économie mondiale. Ce n'est pas parce qu'elles bénéficient encore pour le moment de la note AAA dans l'indice de confiance des agences de notation… que les grandes puissances industrielles s'en tirent beaucoup mieux. (…) la première puissance mondiale court le risque de se voir retirer la confiance 'officielle' sur sa capacité à rembourser ses dettes, si ce n'est avec un dollar fortement dévalué. (…) pour tous les pays, la situation n'a fait que s'aggraver avec les divers plans de relance. Ainsi, la faillite des PIIGS ne constitue que la pointe émergée de la faillite d'une économie mondiale qui n'a dû sa survie depuis des décennies qu'à la fuite en avant désespérée dans l'endettement. (…) La crise de l'endettement ne fait que marquer l'entrée du mode de production capitaliste dans une nouvelle phase de sa crise aiguë où vont s'aggraver encore de façon considérable la violence et l'étendue de ses convulsions. Il n'y a pas de 'sortie du tunnel' pour le capitalisme. Ce système ne peut qu'entraîner la société dans une barbarie toujours croissante."
La période qui a suivi le congrès a confirmé cette analyse. D'une part, la crise des dettes souveraines des pays européens, dont il est clair maintenant qu'elle ne concerne pas que les "PIIGS" mais menace toute la zone Euro, est venue occuper l'actualité d'une façon de plus en plus insistante. Et ce n'est pas le prétendu "succès" du sommet européen du 22 juillet sur la Grèce qui y changera grand-chose. Tous les sommets précédents avaient vocation à résoudre durablement les difficultés rencontrées par ce pays et on voit avec quelle efficacité !
D'autre part, au même moment, avec les difficultés rencontrées par Obama pour faire adopter sa politique budgétaire, les médias "découvrent" que les États-Unis également sont confrontés à une dette souveraine colossale, dont le niveau (130% du PIB) n'a rien à envier à celui des PIIGS. Cette confirmation des analyses qui s'étaient dégagées du congrès ne découle d'aucun mérite particulier de notre organisation. Le seul "mérite" dont elle se revendique c'est d'être fidèle aux analyses classiques du mouvement ouvrier qui ont toujours, depuis le développement de la théorie marxiste, mis en avant le fait que le mode de production capitaliste, comme les précédents, n'était que transitoire et qu'il ne pourrait pas, à terme, surmonter ses contradictions économiques. Et c'est dans le cadre de l'analyse marxiste que s'est déroulée la discussion du congrès. Des points de vue différents s'y sont exprimés, notamment sur les causes ultimes des contradictions du capitalisme (qui recoupent en grande partie ceux exprimés dans notre débat sur les Trente Glorieuses 2) ou bien encore sur la possibilité que l'économie mondiale ne soit plongée dans l'hyperinflation du fait de l'utilisation effrénée de la planche à billets par les États, notamment celui des États-unis. Mais une réelle homogénéité s'est dégagée pour souligner toute la gravité de la situation actuelle comme le fait la résolution adoptée à l'unanimité.
Le congrès s'est également penché sur l'évolution des conflits impérialistes comme il apparaît dans la résolution. Sur ce plan, les deux années qui nous séparent du précédent congrès n'ont pas apporté d'élément fondamentalement nouveau sinon une confirmation du fait que, malgré tous ses efforts militaires, la première puissance mondiale se montre incapable de rétablir le "leadership" qui avait été le sien lors de la "Guerre froide" et que ses engagements en Irak et en Afghanistan n'ont pu établir une "Pax américana" sur le monde, bien au contraire :
"Le 'nouvel ordre mondial' prédit il y a 20 ans par George Bush père, et que celui-ci rêvait sous l'égide des États-Unis, ne peut que se présenter toujours plus comme un 'chaos mondial', un chaos que les convulsions de l'économie capitaliste ne pourront qu'aggraver encore." (point 8 de la résolution)
Il importait que le congrès se penche tout particulièrement sur l'évolution présente de la lutte de classe puisque, au-delà de l'importance toute particulière que revêt pour les révolutionnaires cette question, le prolétariat se trouve aujourd'hui confronté dans tous les pays à des attaques sans précédent de ses conditions d'existence. Ces attaques sont particulièrement brutales dans les pays mis sous perfusion par la Banque européenne et le Fonds monétaire international, comme c'est notamment le cas de la Grèce. Mais elles se déchaînent dans tous les pays du fait de l'explosion du chômage et surtout de la nécessité pour tous les gouvernements de réduire les déficits budgétaires.
La résolution adoptée par le précédent congrès avançait que : "la forme principale que prend aujourd’hui cette attaque, celle des licenciements massifs, ne favorise pas, dans un premier temps, l’émergence de tels mouvements [de luttes massives]. (…) C’est dans un second temps, lorsqu’elle sera en mesure de résister aux chantages de la bourgeoisie, lorsque s’imposera l’idée que seule la lutte unie et solidaire peut freiner la brutalité des attaques de la classe régnante, notamment lorsque celle-ci va tenter de faire payer à tous les travailleurs les énormes déficits budgétaires qui s’accumulent à l’heure actuelle avec les plans de sauvetage des banques et de 'relance' de l’économie, que des combats ouvriers de grande ampleur pourront se développer beaucoup plus."
Le 19e congrès a constaté que "Les deux années qui nous séparent du précédent congrès ont amplement confirmé cette prévision. Cette période n'a pas connu de luttes d'ampleur contre les licenciements massifs et la montée du chômage sans précédent subis par la classe ouvrière dans les pays les plus développés. En revanche, c'est à partir des attaques portées directement par les gouvernements en application des plans 'd'assainissement des comptes publics' qu'ont commencé à se développer des luttes significatives." Cependant, le congrès a relevé que : "Cette réponse est encore très timide, notamment là où ces plans d'austérité ont pris les formes les plus violentes, dans des pays comme la Grèce ou l'Espagne par exemple où, pourtant, la classe ouvrière avait fait preuve dans un passé récent d'une combativité relativement importante. D'une certaine façon, il semble que la brutalité même des attaques provoque un sentiment d'impuissance dans les rangs ouvriers, d'autant plus qu'elles sont conduites par des gouvernements 'de gauche'". Depuis, la classe ouvrière a fait la preuve dans ces mêmes pays qu'elle ne se résignait pas. C'est notamment le cas en Espagne où le mouvement des "Indignés" est devenu pour plusieurs mois une sorte de "phare" pour les autres pays d'Europe ou d'autres continents.
Ce mouvement a débuté au moment même où se tenait le congrès et ce dernier n'a pu, évidemment, en discuter. Cela dit, le congrès a été conduit à se pencher sur les mouvements sociaux qui avaient touché les pays arabes à partir de la fin de l'année dernière. Il n'y pas eu une totale homogénéité dans les discussions sur ce sujet, notamment du fait de leur caractère inédit, mais l'ensemble du congrès s'est rassemblé autour de l'analyse qui se trouve dans la résolution :
"… les mouvements les plus massifs qu'on ait connus au cours de la dernière période ne sont pas venus des pays les plus industrialisés mais des pays de la périphérie du capitalisme, notamment dans un certain nombre de pays du monde arabe, particulièrement la Tunisie et l'Égypte où, finalement, après avoir tenté de les museler par une répression féroce, la bourgeoisie a été conduite à licencier les dictateurs en place. Ces mouvements n'étaient pas des luttes ouvrières classiques comme ces pays en avaient déjà connues dans un passé récent (par exemple les luttes à Gafsa en Tunisie en 2008 ou les grèves massives dans l’industrie textile en Égypte, durant l’été 2007, rencontrant la solidarité active de la part de nombreux autres secteurs). Ils ont pris souvent la forme de révoltes sociales où se trouvaient associés toutes sortes de secteurs de la société : travailleurs du public et du privé, chômeurs, mais aussi des petits commerçants, des artisans, les professions libérales, la jeunesse scolarisée, etc. C'est pour cela que le prolétariat, la plupart du temps, n'y est pas apparu directement de façon distincte (comme il est apparu, par exemple, dans les grèves en Égypte vers la fin des révoltes), encore moins en assumant le rôle de force dirigeante. Cependant, à l'origine de ces mouvements (ce qui se reflétait dans beaucoup des revendications mises en avant) on trouve fondamentalement les mêmes causes à l'origine des luttes ouvrières dans les autres pays : l'aggravation considérable de la crise, la misère croissante qu'elle provoque au sein de l'ensemble de la population non exploiteuse. Et si en général le prolétariat n'est pas apparu directement comme classe dans ces mouvements, son empreinte y était présente dans les pays où il a un poids significatif, notamment par la profonde solidarité qui se manifestait dans les révoltes, leur capacité à éviter de se lancer dans des actes de violence aveugle et désespérée malgré la terrible répression qu'ils ont dû affronter. En fin de compte, si la bourgeoisie en Tunisie et en Égypte s'est finalement résolue, sur les bons conseils de la bourgeoisie américaine, à se débarrasser des vieux dictateurs, c'est en grande partie à cause de la présence de la classe ouvrière dans ces mouvements."
Ce surgissement de la classe ouvrière dans des pays de la périphérie du capitalisme a conduit le congrès à se pencher sur l'analyse élaborée par notre organisation à la suite des grèves de masse de 1980 en Pologne : "Le CCI avait à ce moment-là mis en avant, en se basant sur les positions élaborées par Marx et Engels, que c'est des pays centraux du capitalisme, et particulièrement des vieux pays industriels d'Europe de l'Ouest, que viendrait le signal de la révolution prolétarienne mondiale, du fait de la concentration du prolétariat de ces pays, et plus encore de son expérience historique, et qui lui donnent les meilleures armes pour déjouer finalement les pièges idéologiques les plus sophistiqués mis en œuvre depuis longtemps par la bourgeoisie. Ainsi, une des étapes fondamentales du mouvement de la classe ouvrière mondiale dans l'avenir sera constituée non seulement par le développement des luttes massives dans les pays centraux d'Europe occidentale, mais aussi par leur capacité à déjouer les pièges démocratiques et syndicaux, notamment par une prise en main de ces luttes par les travailleurs eux-mêmes. Ces mouvements constitueront un phare pour la classe ouvrière mondiale, y compris pour celle de la principale puissance capitaliste, les États-Unis, dont la plongée dans une misère croissante, une misère qui touche déjà des dizaines de millions de travailleurs, va transformer le "rêve américain" en véritable cauchemar."
Cette analyse a connu un début de vérification avec le récent mouvement des "Indignés". Alors que les manifestants de Tunis ou du Caire arboraient le drapeau national comme emblème de leur lutte, les drapeaux nationaux étaient absents dans la plupart des grandes villes européennes à la fin du printemps dernier (en Espagne en particulier). Certes le mouvement des "Indignés" est encore fortement imprégné d'illusions démocratiques mais il a le mérite de mettre en évidence que tout État, même le plus "démocratique" et y compris étiqueté "de Gauche", est un ennemi féroce des exploités.
L'intervention du CCI dans le développement des combats de classe
Comme on l'a vu plus haut, la capacité des organisations révolutionnaires à analyser correctement la situation historique dans laquelle elles se trouvent, de même que de savoir remettre en cause éventuellement des analyses qui ont été infirmées par la réalité des faits, conditionne la qualité, dans sa forme comme dans son contenu, de leur intervention au sein de la classe ouvrière, c'est-à-dire, en fin de compte, de leur capacité d'être à la hauteur de la responsabilité pour laquelle cette dernière les a fait surgir.
Le 19e congrès du CCI, sur la base de l'examen de la crise économique, des terribles attaques que celle-ci va entraîner contre la classe ouvrière et sur la base des premières réponses de celle-ci à ces attaques, a considéré que nous entrions dans une période de développement des luttes prolétariennes bien plus intenses et massives que dans la période qui va de 2003 à aujourd'hui. Dans ce domaine, encore plus peut-être que dans celui de l'évolution de la crise qui le détermine grandement, il est difficile de faire des prévisions à court terme. Il serait illusoire d'essayer de chercher où et quand les prochains combats de classe importants vont se déployer. Ce qu'il importe de faire, en revanche, c'est de dégager une tendance générale et d'être particulièrement vigilant face à l'évolution de la situation afin de pouvoir réagir rapidement et de façon appropriée quand celle-ci le requiert tant du point de vue des prises de position que de l'intervention directe dans les luttes.
Le 19e congrès a estimé que le bilan de l'intervention du CCI depuis le précédent congrès était indiscutablement positif. Chaque fois que c'était nécessaire, et souvent de façon très rapide, des prises de position ont été publiées en de nombreuses langues sur notre site Internet et dans notre presse papier territoriale. Dans la mesure de nos très faibles forces, celle-ci a été diffusée largement dans les manifestations qui ont accompagné les mouvements sociaux qu'on a connus dans la période passée, notamment lors du mouvement contre la réforme des retraites à l'automne 2010 en France ou lors des mobilisations de la jeunesse scolarisée contre les attaques ciblant particulièrement les étudiants issus de la classe ouvrière (comme l'augmentation considérable des droits d'inscription dans les universités britanniques à la fin 2010). Parallèlement, le CCI a tenu des réunions publiques dans de nombreux pays et sur plusieurs continents traitant des mouvements sociaux en cours. De même, les militants du CCI sont intervenus, chaque fois que c'était possible, dans les assemblées, comités de lutte, cercles de discussion, forums Internet pour soutenir les positions et analyses de l'organisation et participer au débat international que ces mouvements avaient suscité.
Ce bilan n'est nullement un affichage destiné à consoler les militants ou à bluffer ceux qui liront cet article. Il peut être vérifié, et contesté, par tous ceux qui ont suivi les activités de notre organisation puisqu'il concerne, par définition, des activités publiques.
De même, le congrès a tiré un bilan positif de notre intervention en direction des éléments et groupes qui défendent des positions communistes ou qui s'approchent de ces positions.
En effet, la perspective d'un développement significatif des luttes ouvrières porte avec elle celle du surgissement de minorités révolutionnaires. Avant même que le prolétariat mondial ne se soit engagé dans des luttes massives, on a pu constater (comme cela a déjà été relevé dans la résolution adoptée par le 17e congrès3) qu'un tel surgissement commençait à se dessiner, notamment du fait que, depuis 2003, la classe ouvrière avait commencé à surmonter le recul qu'elle avait subi suite à l'effondrement du bloc dit "socialiste" en 1989 et des formidables campagnes sur "la fin du communisme", voire "la fin de la lutte de classe". Depuis, même si de façon encore timide, cette tendance s'est confirmée ce qui a conduit à l'établissement de contacts et discussions avec des éléments et groupes dans un nombre significatif de pays. "Ce phénomène de développement des contacts concerne aussi bien des pays où le CCI n'a pas de section que d'autres où il est déjà présent. Cependant l'afflux des contacts n'est pas immédiatement palpable au niveau de chaque pays où existe le CCI, loin s'en faut. On peut même dire que ses manifestations les plus franches sont encore réservées à une minorité de sections du CCI." (Présentation au congrès du rapport sur les contacts)
En fait, bien souvent, les nouveaux contacts de notre organisation sont apparus dans des pays où il n'existe pas (ou pas encore) de section de celle-ci. C'est ce qu'on a pu constater par exemple lors de la conférence "panaméricaine" qui s'est tenue en novembre 2010 et où étaient présents, outre Opop et d'autres camarades du Brésil, des camarades du Pérou, de Saint-Domingue et d'Équateur.4 Du fait du développement du milieu de contacts, "notre intervention en direction [de ces derniers] a connu une accélération très importante, nécessitant un investissement militant et financier comme jamais notre organisation n'en avait effectué pour ce type d'activité, permettant ainsi que puissent avoir lieu les rencontres et discussions les plus nombreuses et riches de toute notre existence" (Rapport sur les contacts présenté au congrès).
Ce rapport "met l'accent sur des nouveautés de la situation concernant les contacts, en particulier notre collaboration avec des anarchistes. Nous avons réussi, en certaines occasions, à faire cause commune dans la lutte avec des éléments ou groupes qui se trouvent dans le même camp que nous, celui de l'internationalisme." (Présentation du rapport au congrès) Cette collaboration avec des éléments et groupes se réclamant de l'anarchisme a suscité au sein de notre organisation de nombreuses et riches discussions qui nous ont permis de mieux connaître les différentes facettes de ce courant et en particulier de mieux comprendre toute l'hétérogénéité existant en sont son sein (depuis de purs gauchistes prêts à soutenir toutes sortes de mouvements ou idéologies bourgeoises, tel le nationalisme jusqu'à des éléments clairement prolétarien et d'un internationalisme irréprochable).
"Une autre nouveauté, c'est notre collaboration, à Paris, avec des éléments se réclamant du trotskisme (…) Pour l'essentiel, ces éléments (…) étaient très actifs [lors de la mobilisation contre la réforme des retraites] dans le sens de favoriser la prise en charge par la classe ouvrière de ses propres luttes, en dehors du cadre syndical et que, également, ils favorisaient le développement de la discussion au sein de celle-ci, tout comme le CCI aurait pu le faire. Nous avions, de ce fait toutes les raisons de nous associer à leur effort. Que leur attitude entre en contradiction avec la pratique classique du trotskisme, c'est tant mieux." (Présentation du rapport))
Ainsi, le congrès a pu tirer également un bilan positif de la politique de notre organisation en direction des éléments qui défendent les positions révolutionnaires ou s'en approchent. C'est là une partie très importante de notre intervention en direction de la classe ouvrière, celle qui participe à la future constitution d'un parti révolutionnaire indispensable pour le triomphe de la révolution communiste.5
Les questions organisationnelles
Toute discussion sur les activités d'une organisation révolutionnaire doit se pencher sur le bilan de son fonctionnement. Et c'est dans ce domaine que le congrès, sur base de différents rapports, a constaté les plus grandes faiblesses dans notre organisation. Nous avons déjà traité publiquement, dans notre presse ou même dans des réunions publiques, des difficultés organisationnelles qu'a pu rencontrer le CCI par le passé. Ce n'est nullement de l'exhibitionnisme mais une pratique classique du mouvement ouvrier. Le congrès s'est longuement penché sur ces difficultés et en particulier sur l'état souvent dégradé du tissu organisationnel et du travail collectif qui pèse sur un certain nombre de sections. Nous ne pensons pas que le CCI connaisse aujourd'hui une crise comme cela a été le cas en 1981, 1993 ou 2001. En 1981, nous avions assisté à l'abandon par une partie significative de l'organisation des principes politiques et organisationnels sur lesquels elle avait été fondée, ce qui avait entraîné des convulsions très sérieuses et notamment la perte de la moitié de notre section en Grande-Bretagne. En 1993 et en 2001, le CCI avait dû affronter des difficultés de type clanique qui avaient entraîné le rejet de la loyauté organisationnelle et de nouveaux départs de militants (notamment des membres de la section de Paris en 1995 et des membres de l'organe central en 2001) 6. Parmi les causes de ces deux dernières crises, le CCI a identifié le poids des conséquences de l'effondrement du bloc "socialiste" qui a provoqué un recul très important de la conscience au sein du prolétariat mondial et, plus généralement, de la décomposition sociale qui affecte aujourd'hui le société capitaliste moribonde. Les causes des difficultés actuelles sont en partie du même ordre mais elles n'entraînent pas de phénomènes de perte de conviction ou de déloyauté. Tous les militants des sections où ces difficultés se manifestent sont fermement convaincus de la validité du combat mené par le CCI, sont totalement loyaux envers celle-ci et continuent à manifester leur dévouement à son égard. Alors que le CCI a dû faire face à la période la plus sombre connue par la classe ouvrière depuis la fin de la contre-révolution marquée avec éclat par le mouvement de Mai 1968 en France, celle d'un recul général de sa conscience et de sa combativité à partir du début des années 1990, ces militants sont restés "fidèles au poste". Bien souvent, ces camarades se connaissent et militent ensemble depuis plus de trente ans. Il existe souvent entre eux, de ce fait, des liens d'amitié et de confiance solides. Mais les petits défauts, les petites faiblesses, les différences de caractère que chacun doit pouvoir accepter chez les autres ont souvent conduit au développement de tensions ou d'une difficulté croissante à travailler ensemble pendant des dizaines d'années au sein de petites sections qui n'ont pas été irriguées par le "sang neuf" de nouveaux militants du fait, justement, du recul général subi par la classe ouvrière. Aujourd'hui, ce "sang neuf" commence à alimenter certaines sections du CCI mais il est clair que les nouveaux membres de celui-ci ne pourront être correctement intégrés en son sein que si son tissu organisationnel s'améliore. Le congrès a discuté avec beaucoup de franchise de ces difficultés ce qui a conduit certains des groupes invités à lui faire part également de leurs propres difficultés organisationnelles. Cependant, il n'a pas apporté de "solution miracle" à ces difficultés qui avaient déjà été constatées lors des précédents congrès. La résolution d'activités qu'il a adoptée rappelle la démarche déjà adoptée par l'organisation et appelle l'ensemble des militants et sections à la prendre en charge de façon plus systématique :
"Depuis 2001, le CCI s'est engagé dans un projet théorique ambitieux qui a été conçu, entre autres choses, pour expliquer et développer ce qu'est le militantisme communiste (et donc l'esprit de parti). Il a fallu faire preuve d'un effort de création pour comprendre au niveau le plus profond :
- les racines de la solidarité et de la confiance prolétariennes,
- la morale et la dimension éthique du marxisme,
- la démocratie et le démocratisme et leur hostilité à l'égard du militantisme communiste,
- la psychologie et l'anthropologie et leur rapport au projet communiste,
- le centralisme et le travail collectif,
- la culture du débat prolétarien,
- le marxisme et la science.
En bref, le CCI s'est engagé dans un effort pour rétablir une meilleure compréhension de la dimension humaine de l'objectif communiste et de l'organisation communiste, pour redécouvrir l'ampleur de la vision du militantisme qui a été presque perdue au cours de la contre-révolution et donc pour se prémunir contre la réapparition des cercles, des clans qui se développent dans une atmosphère d'ignorance ou de déni de ces questions plus générales d'organisation et de militantisme." (Point 10)
"La réalisation des principes unitaires de l'organisation – le travail collectif – requiert le développement de toutes les qualités humaines en lien avec l'effort théorique pour appréhender le militantisme communiste de façon positive auquel nous nous référons dans le point 10. Cela signifie que le respect mutuel, la solidarité, les réflexes de coopération, un esprit chaleureux de compréhension et de sympathie pour les autres, les liens sociaux et la générosité doivent se développer." (Point 15)
La discussion sur "Marxisme et science"
Une des insistances des discussions et de la résolution adoptée par le congrès porte sur la nécessité d'approfondir les aspects théoriques des questions auxquelles nous sommes confrontés. C'est pour cela que, comme pour les précédents congrès, celui-ci a consacré un point de son ordre du jour à une question théorique : "Marxisme et science" qui va donner lieu, comme nous l'avons fait pour la plupart des autres questions théoriques discutées en notre sein, à la publication d'un ou plusieurs documents. Nous n'allons pas de ce fait rapporter ici les éléments abordés dans la discussion, laquelle faisait suite à de nombreuses discussions qui s'étaient tenues auparavant au sein des sections. Ce qu'il nous faut signaler c'est la grande satisfaction qu'ont retiré les délégations de cette discussion, une satisfaction qui devait beaucoup aux contributions d'un scientifique, Chris Knight 7, que nous avons avions invité à participer à une partie du congrès. Ce n'était pas la première fois que le CCI invitait un scientifique à son congrès. Il y a deux ans, Jean-Louis Dessalles était venu nous présenter ses réflexions sur l'origine du langage, ce qui avait provoqué des discussions très animées et intéressantes. 8 Avant toute chose, nous voulons remercier Chris Knight d'avoir accepté notre invitation et nous tenons à saluer la qualité de ses interventions ainsi que leur caractère très vivant et accessible par des non spécialistes comme le sont la plupart des militants du CCI. Chris Knight est intervenu à trois reprises 9. Il a pris la parole dans le débat général et tous les participants ont été impressionnés non seulement par la qualité de ses arguments mais aussi par la remarquable discipline dont il a fait preuve, respectant strictement le temps de parole et le cadre du débat (discipline qu'on souvent du mal à respecter beaucoup de membres du CCI). Il a ensuite présenté, de façon très imagée, un résumé de sa théorie sur l'origine de la civilisation et du langage humain, évoquant la première des "révolutions" connues par l'humanité, dans laquelle les femmes ont joué un rôle moteur (idée qu'il reprend d'Engels), révolution qui a été suivie de plusieurs autres, permettant à chaque fois à la société de progresser. Il inscrit la révolution communiste comme point culminant de cette série de révolutions et estime que, comme les précédentes, l'humanité dispose des moyens pour la réussir.
La troisième intervention de Chris Knight a consisté en un salut très sympathique qu'il a dressé à notre congrès.
A la suite du congrès, l'ensemble des délégations a estimé que la discussion sur "Marxisme et Science", et la participation de Chris Knight au sein de celle-ci, avaient constitué un des moments les plus intéressants et satisfaisants du congrès, un moment qui encourage l'ensemble des sections à poursuivre et approfondir l'intérêt pour les questions théoriques.
Avant de passer à la conclusion de cet article, nous devons signaler que les participants au 19e congrès du CCI (délégations, groupes et camarades invités), qui s'est tenu 140 ans, presque jour pour jour, après la semaine sanglante qui a mis fin à la Commune de Paris, et à proximité de cet événement, a tenu à saluer la mémoire des combattants de cette première tentative révolutionnaire du prolétariat.10
Nous ne tirons pas un bilan triomphaliste du 19e congrès du CCI, notamment du fait que ce congrès a pu prendre la mesure des difficultés organisationnelles que rencontre notre organisation, des difficultés qu'elle devra surmonter si elle veut continuer à être présente aux rendez-vous que l'histoire donne aux organisations révolutionnaires. C'est donc un combat long et difficile qui attend notre organisation. Mais cette perspective n'est pas faite pour nous décourager. Après tout, le combat de l'ensemble de la classe ouvrière lui aussi est long et difficile, semé d'embûches et de défaites. Ce que cette perspective doit inspirer aux militants, c'est la ferme volonté de mener ce combat. Après tout, une des caractéristiques fondamentales de tout militant communiste c'est d'être un combattant.
CCI (31/07/2011)
1 Opop était déjà présent aux deux précédents congrès du CCI. Pour sa présentation voir les articles consacrés aux 17e et au 18e congrès du CCI dans les numéros 130 et 138 de la Revue Internationale.
2 Voire à ce sujet les Revues internationales n° 133, 135, 136, 138 et 141.
3 "Aujourd'hui, comme en 1968, la reprise des combats de classe s'accompagne d'une réflexion en profondeur dont l'apparition de nouveaux éléments se tournant vers les positions de la Gauche communiste constitue la pointe émergée de l'iceberg" (point 17)
4 Voir à ce sujet notre article "5ª Conferencia Panamericana de la Corriente Comunista Internacional - Un paso importante hacia la unidad de la clase obrera". https://es.internationalism.org/RM120-panamericana [76].
5 Le congrès a discuté et repris à son compte une critique contenue dans le rapport sur les contacts concernant la formulation suivante contenue dans la résolution sur la situation internationale du 16e congrès du CCI : "le CCI constitue déjà le squelette du futur parti". En effet, "Il n'est pas possible de définir dès à présent la forme que prendra la participation organisationnelle du CCI à la formation du futur parti puisque cela dépendra de l'état général et de la configuration du nouveau milieu mais aussi de notre propre organisation." Cela dit, le CCI a la responsabilité de maintenir vivant et d'enrichir le patrimoine qu'il a hérité de la Gauche communiste afin d'en faire bénéficier les générations actuelles et futures de révolutionnaires, et donc le futur parti. En d'autres termes, il a la responsabilité de participer à remplir la fonction de pont entre la vague révolutionnaire des années 1917-23 et la future vague révolutionnaire.
6 Ces éléments qui rejettent leur loyauté envers l'organisation sont souvent entraînées dans une démarche que nous avons qualifiée de "parasitaire" : tout en prétendant continuer à défendre les "véritables positions de l'organisation", ils consacrent l'essentiel de leurs efforts à la dénigrer et à essayer de la discréditer. Nous avons consacré un document au phénomène du parasitisme politique (Voir "Construction de l'organisation des révolutionnaires : thèses sur le parasitisme" dans la Revue Internationale 94). Il faut noter que certains camarades du CCI, tout en constatant ce type de comportements et en revendiquant la nécessité de défendre fermement l'organisation contre eux, ne partagent pas cette analyse du parasitisme, désaccord qui s'est exprimé au congrès.
7 Chris Knight est un universitaire britannique qui a enseigné l'anthropologie jusqu'en 2009 au London East College. Il est l'auteur, notamment, de Blood Relations, Menstruation and the Origins of Culture dont nous avons rendu compte sur notre site Internet en langue anglaise (https://en.internationalism.org/2008/10/Chris-Knight [77]) et qui s'appuie de façon très fidèle sur la théorie de l'évolution de Darwin ainsi que sur les travaux de Marx et surtout Engels (notamment, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État). Il se dit 100% "marxiste" en anthropologie. Par ailleurs, c'est un militant politique animant le groupe Radical Anthropology dont un des principaux modes d'intervention est l'organisation de représentations de théâtre de rue dénonçant et ridiculisant les institutions capitalistes Il a été exclu de l'Université pour avoir organisé des manifestations contre la tenue du G20 à Londres en mars 2009. Il était notamment accusé "d'appel au meurtre" pour avoir pendu en effigie des banquiers et avoir arboré une pancarte disant "Eat the banquers" ("Mangez les banquiers"). Nous ne partageons pas un certain nombre des positions politiques ni des modes d'action de Chris Knight mais, pour avoir discuté avec lui depuis un certain temps, nous tenons à affirmer notre conviction de sa totale sincérité, de son réel dévouement à la cause de l'émancipation du prolétariat et de sa farouche conviction que la science et la connaissance sont des armes fondamentales de celle-ci. Nous voulons, en ce sens, lui apporter notre chaleureuse solidarité face aux mesures de répression dont il a été l'objet (licenciement, arrestation).
8 Voir notre article sur le 18e congrès du CCI dans la Revue Internationale 138.
9 Nous publierons sur notre site Internet des extraits des interventions de Chris Knight.
10 Les participants au 19e congrès du CCI dédient ce congrès à la mémoire des combattants de la Commune de Paris qui sont tombés, il a exactement 140 ans, face à la bourgeoisie déchaînée qui leur a fait payer leur volonté de partir à "l'assaut du ciel".
En mai 1871, pour la première fois de l'Histoire, le prolétariat a fait trembler la classe dominante. C'est cette peur de la bourgeoisie face au fossoyeur du capitalisme qui explique la furie et la barbarie de la répression sanglante des insurgés de la Commune.
L'expérience de la Commune de Paris a apporté des leçons fondamentales aux générations suivantes de la classe ouvrière. Des leçons qui lui ont permis de s'engager dans la révolution russe en 1917.
Les combattants de la Commune de Paris, tombés sous la mitraille du Capital, n'auront pas donné leur sang pour rien si, dans ses combats futurs, la classe ouvrière est capable de s'inspirer de l'exemple de la Commune pour renverser le capitalisme.
"Le Paris ouvrier, avec sa Commune, sera célébré a jamais comme le glorieux fourrier d'une société nouvelle. Le souvenir de ses martyrs est conservé pieusement dans le grand cœur de la classe ouvrière. Ses exterminateurs, l'histoire les a déjà cloués au pilori éternel, et toutes les prières de leurs prêtres n'arriveront pas à les en libérer." (Karl Marx, La guerre civile en France)
Vie du CCI:
Décadence du capitalisme (X) : Pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme
- 2284 lectures
Il n'y a pas eu de réelle reprise du capitalisme mondial après la dévastation de la Première Guerre mondiale. La plupart des économies d'Europe stagnaient, incapables de résoudre les problèmes posés par la rupture opérée par la guerre et la révolution, par des usines obsolètes et le chômage massif. La situation difficile de l'économie britannique, qui avait été la plus puissante, est typique de la situation lorsqu'en 1926 elle recourt à des réductions de salaire pour tenter vainement de reconstituer son avantage concurrentiel sur le marché mondial. Il en résulte la grève de dix jours en solidarité avec les mineurs dont les salaires et les conditions de vie étaient la cible centrale de l'attaque. Le seul vrai boom eu lieu aux États-Unis, qui ont bénéficié à la fois des difficultés de leurs anciens rivaux et du développement accéléré de la production en série symbolisée par les chaînes de montage de Détroit qui produisaient la Ford T. Le couronnement de l'Amérique comme première puissance économique mondiale a également permis de sortir l'économie allemande du marasme grâce à l'injection de prêts massifs. Mais tout le vacarme des "rugissantes années 20" [1] aux États-Unis et dans quelques autres endroits ne pouvait cacher le fait que cette relance n'était fondée sur aucune extension substantielle du marché mondial, contrairement à la croissance massive qui avait eu lieu durant les dernières décennies du 19ème siècle. Le boom, déjà en grande partie alimenté par la spéculation et les créances irrécouvrables, préparait le terrain pour la crise de surproduction qui a éclaté en 1929 et rapidement englouti l'économie mondiale, l'ensevelissant dans la dépression la plus profonde jamais connue (voir le premier article de cette série, dans la Revue internationale n° 132).
Ce n'était pas un retour au cycle "expansion – récession" du 19ème siècle, mais une maladie entièrement nouvelle : la première crise économique majeure d'une nouvelle ère de la vie du capitalisme. C'était une confirmation de ce que la grande majorité des révolutionnaires avait conclu en réponse à la guerre de 1914 : le mode de production bourgeois était devenu obsolète, un système décadent. La Grande Dépression des années 1930 a été interprétée par presque toutes les expressions politiques de la classe ouvrière comme une nouvelle confirmation de ce diagnostic. A celle-ci contribua de façon non négligeable le fait que pendant les années précédentes, il était devenu de plus en plus évident qu'il n'y aurait aucune récupération économique spontanée et que la crise poussait de plus en plus le système vers un deuxième partage impérialiste du monde.
Mais cette nouvelle crise n'a pas provoqué une nouvelle vague de luttes révolutionnaires, malgré des mouvements de classe importants qui eurent lieu dans un certain nombre de pays. La classe ouvrière avait souffert une défaite historique suite à l'écrasement des tentatives révolutionnaires en Allemagne, Hongrie, Italie et ailleurs, et à la mort atroce de la révolution en Russie. Avec le triomphe du stalinisme dans les partis communistes, les courants révolutionnaires qui survécurent avaient été réduits à de petites minorités luttant pour clarifier les raisons de cette défaite et incapables d'exercer une influence significative quelconque dans la classe ouvrière. Néanmoins, la compréhension de la trajectoire historique de la crise du capitalisme était un élément crucial qui a guidé ces groupes au cours de cette période sombre.
Les réponses de la part du mouvement politique prolétarien : trotskisme et anarchisme
Le courant d'Opposition de gauche autour de Trotsky, regroupé au sein d'une nouvelle Quatrième Internationale, a édité son programme en 1938, avec le titre L'agonie du capitalisme et les tâches de la 4ème Internationale. En continuité avec la Troisième Internationale, il affirmait que le capitalisme était entré dans une décadence irrémédiable. "La prémisse économique de la révolution prolétarienne est arrivée depuis longtemps au point le plus élevé qui puisse être atteint sous le capitalisme. Les forces productives de l’humanité ont cessé de croître (…) Les bavardages de toutes sortes selon lesquels les conditions historiques ne seraient pas encore "mûres" pour le socialisme ne sont que le produit de l’ignorance ou d’une tromperie consciente. Les prémisses objectives de la révolution ne sont pas seulement mûre ; elles ont même commencé à pourrir". (Programme de transition. https://www.cps-presse.com/archives/prg-tr/prgtrans.htm [79]). Ce n'est pas le lieu ici d'une critique détaillée du Programme de transition, nom sous lequel ce texte s'est fait connaître. En dépit de son point de départ marxiste, il présente une vision des rapports entre les conditions objectives et subjectives qui tombe à la fois dans le matérialisme vulgaire et l'idéalisme : d'une part, il tend à présenter la décadence du système comme un arrêt absolu du développement des forces productives ; de l'autre, il considère qu'une fois cette impasse objective atteinte, il ne manque qu'une direction politique correcte au prolétariat pour transformer la crise en révolution,. L'introduction du document déclare ainsi que "La crise historique de l’humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire". D'où la tentative volontariste de former une nouvelle Internationale dans une période de contre-révolution. En effet, pour Trotsky, la défaite du prolétariat constitue précisément ce qui rend nécessaire la proclamation de la nouvelle Internationale : "Des sceptiques demandent : mais le moment est-il venu de créer une nouvelle Internationale ? Il est impossible, disent-ils, de créer une Internationale "artificiellement" ; seuls, de grands événements peuvent la faire surgir, etc. (…) La IVème Internationale est déjà surgie de grands événements : les plus grandes défaites du prolétariat dans l’Histoire". En ratiocinant de la sorte, le niveau réel de la conscience de classe du prolétariat et sa capacité à s'affirmer comme force indépendante sont plus ou moins relégués à un rôle marginal. Cette démarche n'est pas sans lien avec la teneur semi-réformiste et capitaliste d'État de beaucoup des revendications transitoires contenues dans le programme, puisqu'elles ne sont pas tant vues comme de réelles solutions à l'étranglement des forces productives mais, plutôt, comme des moyens sophistiqués pour arracher le prolétariat à la prison de sa direction corrompue du moment, et le guider vers la bonne direction politique. Le programme de transition est ainsi établi sur une séparation totale entre l'analyse de la décadence du capitalisme et ses conséquences programmatiques.
Les anarchistes ont souvent été en désaccord avec les marxistes sur l'insistance de ces derniers pour baser les perspectives de la révolution sur les conditions objectives atteintes par le développement capitaliste. Au 19ème siècle, l'époque du capitalisme ascendant, des anarchistes comme Bakounine défendaient l'idée que le soulèvement des masses était possible à tout moment et accusaient les marxistes de remettre la lutte révolutionnaire à un avenir lointain. En conséquence, pendant la période qui suivit la Première Guerre mondiale, il y eut peu de tentatives de la part des courants anarchistes pour tirer les conséquences de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence puisque, pour bon nombre d'entre eux, rien n'avait réellement changé. Néanmoins, l'ampleur de la crise économique des années 1930 a convaincu certains de ses meilleurs éléments que le capitalisme avait en effet atteint son époque de déclin. L'anarchiste russe exilé Maximoff, dans Mon credo social, édité en 1933, affirme que "ce processus de déclin a commencé immédiatement après la Première Guerre mondiale, et il a pris la forme de crises économiques de plus en plus importantes et aigües qui, durant ces dernières années, ont éclaté simultanément dans les pays vainqueurs et vaincus. Au moment d'écrire ce texte (1933-1934), une véritable crise mondiale du système capitaliste touche presque tous les pays. Sa nature prolongée et sa portée universelle ne peuvent nullement être expliquées par la théorie de crises politiques périodiques" [2]. Il poursuit en montrant comment les efforts du capitalisme pour sortir de la crise par des mesures protectionnistes, des réductions de salaire ou la planification étatique ne font qu'approfondir les contradictions du système : "le capitalisme, qui a donné naissance à un nouveau fléau social, ne peut se débarrasser de sa propre progéniture maléfique sans se tuer lui-même. Le développement logique de cette tendance doit inévitablement aboutir au dilemme suivant : soit une désintégration complète de la société, soit l'abolition du capitalisme et la création d'un nouveau système social plus progressiste. Il n'existe aucune autre alternative. La forme moderne d'organisation sociale a suivi son cours et prouve, aujourd'hui même, qu'elle constitue à la fois un obstacle au progrès de l'humanité et un facteur de délabrement social. Ce système dépassé doit donc être relégué au musée des reliques de l'évolution sociale" (Ibid). Il est vrai que Maximoff sonne très marxiste dans ce texte, de même lorsqu'il avance que l'incapacité du capitalisme à s'étendre empêchera que la crise puisse se résoudre de la même manière qu'autrefois : "Dans le passé, le capitalisme aurait évité la crise mortelle au moyen des marchés coloniaux et de ceux des nations agraires. De nos jours, la plupart des colonies elles-mêmes concurrencent les pays métropolitains sur le marché mondial, alors que les terres agraires sont en cours d'industrialisation intensive" (Ibid). On rencontre la même clarté concernant les caractéristiques de la nouvelle période dans les écrits du groupe britannique Fédération Communiste Anti-Parlementaire (APCF), chez qui l'influence des marxistes de la Gauche communiste germano-hollandaise a été beaucoup plus directe [3].
La Gauche italienne / belge
Ce n'était pas un hasard : c'est la Gauche communiste qui a été la plus rigoureuse dans l'analyse de la signification historique de la dépression économique en tant qu'expression de la décadence du capitalisme et dans les tentatives d'identifier les racines de la crise au moyen de la théorie marxiste de l'accumulation. Les fractions italienne et belge de la Gauche communiste en particulier ont toujours fondé leurs positions programmatiques sur la reconnaissance du fait que la crise du capitalisme était historique et pas seulement cyclique : par exemple le rejet des luttes nationales et des revendications démocratiques, qui a clairement distingué ce courant du trotskisme, se basait non sur un sectarisme abstrait mais sur le fait que le changement des conditions du capitalisme mondial avait rendu obsolètes ces aspects du programme du prolétariat. Cette recherche d'une cohérence a incité les camarades de la Gauche italienne et belge à se lancer dans une étude approfondie de la dynamique interne de la crise capitaliste. Inspirée également par la traduction récente en français de L'accumulation du capital de Rosa Luxemburg, cette étude a donné naissance aux articles signés Mitchell, "Crises et cycles dans l'économie du capitalisme agonisant", publiés en 1934 dans les numéros 10 et 11 de Bilan (republiés dans les numéros 102 et 103 de la Revue internationale).
Les articles de Mitchell retournent à Marx et examinent la nature de la valeur et de la marchandise, le processus de l'exploitation du travail et les contradictions fondamentales du système capitaliste qui résident dans la production de la plus-value elle-même. Pour Mitchell, il y avait une claire continuité entre Marx et Rosa Luxemburg à travers la reconnaissance de l'impossibilité que l'intégralité de la plus-value soit réalisée au moyen de la consommation des travailleurs et des capitalistes. Concernant les schémas de la reproduction de Marx, qui sont au cœur de la polémique qui éclate avec le livre de Rosa Luxemburg, Mitchell dit ceci :
" … si Marx, dans ses schémas de la reproduction élargie, a émis cette hypothèse d'une société entièrement capitaliste où ne s'opposeraient que des capitalistes et des prolétaires c'est, nous semble-t-il, afin de pouvoir précisément faire la démonstration de l'absurdité d'une production capitaliste s'équilibrant et s'harmonisant un jour avec les besoins de l'humanité. Cela signifierait que la plus-value accumulable, grâce à l'élargissement de la production, pourrait se réaliser directement d'une part par 1'achat de nouveaux moyens de production nécessaires, d'autre part par la demande des ouvriers supplémentaires (où les trouver d'ailleurs ?) et que les capitalistes, de loups se seraient transformés en pacifiques progressistes.
Marx, s'il avait pu poursuivre le développement de ses schémas, aurait abouti à cette conclusion opposée qu'un marché capitaliste qui ne serait plus extensible par l'incorporation de milieux non capitalistes, qu'une production entièrement capitaliste - ce qui historiquement est impossible - signifierait l'arrêt du processus de l'accumulation et la fin du capitalisme lui-même. Par conséquent, présenter les schémas (comme l'ont fait certains "marxistes") comme étant l'image d'une production capitaliste pouvant se dérouler sans déséquilibre, sans surproduction, sans crises, c'est falsifier sciemment la théorie marxiste". (Bilan n° 10)
Mais le texte de Mitchell ne reste pas au niveau abstrait. Il nous présente les phases principales de l'ascendance et du déclin de l'ensemble du système capitaliste, depuis les crises cycliques du 19ème siècle, où il essaye de mettre en évidence l'interaction entre le problème de la réalisation et la tendance à la baisse du taux de profit, le développement de l'impérialisme et du monopole et la fin du cycle des guerres nationales après les années 1870. Tout en mettant l'accent sur le rôle croissant du capital financier, il critique la tendance de Boukharine à voir l'impérialisme comme un produit du capital financier plutôt que comme une réponse du capital à ses contradictions internes. Il analyse la chasse aux colonies et la concurrence croissante entre les principales puissances impérialistes comme étant les facteurs immédiats de la Première Guerre mondiale, qui marque l'entrée du système dans sa crise de sénilité. Il identifie alors certaines des caractéristiques principales du mode de vie du capitalisme dans cette nouvelle période : le recours croissant à la dette et au capital fictif, l'interférence massive de l'État dans la vie économique, dont le fascisme est une expression typique mais qui est significative de la tendance plus générale au divorce croissant entre l'argent et la valeur réelle symbolisé par l'abandon de l'étalon or. La récupération de courte durée effectuée par le capitalisme après la Première Guerre mondiale est expliquée par certains facteurs : la destruction de capital surabondant ; la demande produite par la nécessité de reconstruire les économies ruinées ; la position unique des États-Unis comme nouvelle locomotive de l'économie mondiale ; mais, surtout, la "prospérité fictive" créée par le crédit : cette croissance d'après-guerre n'était pas basée sur une véritable expansion du marché global et était donc très différente des reprises du 19ème siècle. Du même coup, la crise mondiale qui a éclaté en 1929 était différente des crises cycliques du 19ème siècle : pas seulement en ce qui concerne son échelle mais en raison de sa nature insoluble, faisant qu'elle ne serait pas suivie automatiquement ou spontanément par un boom. Le capitalisme survivrait dorénavant en flouant de plus en plus ses propres lois : "En nous référant aux facteurs déterminants de la crise générale du capitalisme, nous pouvons comprendre pourquoi la crise mondiale ne peut être résorbée par 1'action "naturelle" des lois économiques capitalistes, pourquoi, au contraire, celles-ci sont vidées par le pouvoir conjugué du capital financier et de l'État capitaliste, comprimant toutes les manifestations d'intérêts capitalistes particuliers" (Bilan n° 11). Ainsi, si les manipulations de l'État permettaient un accroissement de la production, celui-ci a été consacré en grande partie au secteur militaire et aux préparatifs pour une nouvelle guerre. "De quelque côté qu'il se tourne, quelque moyen qu'il puisse utiliser pour se dégager de l'étreinte de la crise, le capitalisme est poussé irrésistiblement vers son destin, à la guerre. Où et comment elle surgira est impossible à déterminer aujourd'hui. Ce qu'il importe de savoir et d'affirmer, c'est qu'elle explosera en vue du partage de l'Asie et qu'elle sera mondiale" (ibid).
Sans entrer davantage dans l'analyse des forces et de certains points plus faibles de l'analyse de Mitchell [4], ce texte s'avère remarquable à tout point de vue, il constitue une première tentative de la part de la Gauche communiste de fournir une analyse cohérente, unifiée et historique du processus d'ascendance et de décadence du capitalisme.
La Gauche germano-hollandaise
Dans la tradition de la gauche germano-hollandaise, qui avait été sévèrement décimée par la répression contre-révolutionnaire en Allemagne même, l'analyse luxemburgiste constituait encore la référence pour un certain nombre de groupes. Mais il y existait également une tendance importante, orientée dans une autre direction, en particulier dans la Gauche hollandaise et dans le groupe autour de Paul Mattick aux États-Unis. En 1929, Henryk Grossman publiait un travail important sur la théorie des crises : La loi de l'accumulation et de l'effondrement du système capitaliste. Le Groep van Internationale Communisten (GIC) en Hollande avait qualifié ce travail de "remarquable" [5] et, en 1934, Paul Mattick publiait un résumé (et un développement) des idées de Grossman, intitulé "La crise permanente – l'interprétation par Henryk Grossman de la théorie de Marx de l'accumulation capitaliste", au sein du n° 2 du volume 1 de International Council Correspondence. Ce texte reconnaissait explicitement la valeur de la contribution de Grossman tout en la développant sur certains points. En dépit du fait que Grossman était sympathisant du KPD et d'autres partis staliniens, et malgré l'appréciation qu'il faisait de Mattick, le considérant comme politiquement sectaire [6], les deux hommes ont maintenu une correspondance pendant quelque temps, en grande partie autour des questions posées par le livre de Grossman.
Le livre de Grossman a donc été publié avant l'éclatement de la crise mondiale, mais il a certainement inspiré un certain nombre de révolutionnaires pour appliquer sa thèse à la réalité concrète de la Grande Dépression. Au cœur de son livre, Grossman insiste sur l'idée selon laquelle la théorie de l'effondrement du capitalisme est absolument centrale dans Le Capital de Marx, même si Marx ne pouvait pas en tirer les conséquences ultimes. Les révisionnistes du marxisme - Bernstein, Kautsky, Tugan Baranowski, Otto Bauer et d'autres - ont tous rejeté la notion d'effondrement du capitalisme, en toute cohérence avec leur politique réformiste. Pour Grossman, il était axiomatique que le socialisme ne surviendrait pas seulement parce que le capitalisme était un système immoral mais parce que son évolution historique elle-même devait le plonger dans des contradictions insurmontables, le transformant en entrave à la croissance des forces productives : "À un certain stade de son développement historique, le capitalisme ne parvient plus à susciter un nouveau développement des forces productives. À partir de ce moment, la chute du capitalisme devient économiquement inévitable. La véritable tâche que se fixait Marx dans Le Capital était de fournir une description précise de ce processus et d'en saisir les causes au moyen d'une analyse scientifique du capitalisme" (La loi de l'accumulation, édition abrégée en anglais - 1992, Pluto Press, p. 36. Notre traduction). D'autre part, "s'il n'existe pas une raison économique faisant que le capitalisme doit nécessairement échouer, alors le socialisme peut remplacer le capitalisme sur des bases qui n'ont rien d'économique mais qui sont purement politiques, psychologiques ou morales. Mais, dans ce cas, nous abandonnons le fondement matérialiste d'un argument scientifique en faveur de la nécessité du socialisme, nous abandonnons la déduction de cette nécessité à partir du mouvement économique" (ibid, p. 56).
Jusque-là, Grossman est en accord avec Luxemburg qui avait ouvert la voie en réaffirmant le rôle central de la notion d'effondrement et, sur ce point, il est à ses côtés contre les révisionnistes. Cependant, Grossman considérait que la théorie de Luxemburg sur la crise comportait de grandes faiblesses car elle était basée sur une mauvaise compréhension de la méthode que Marx avait cherché à développer dans son utilisation du schéma de la reproduction : "au lieu d'examiner le schéma de la reproduction de Marx dans le cadre de son système total et particulièrement de sa théorie de l'accumulation, au lieu de se demander quel rôle celui-ci joue méthodologiquement dans la structure de sa théorie, au lieu d'analyser le schéma de l'accumulation depuis son début jusqu'à sa conclusion finale, Luxemburg a été inconsciemment influencée par eux (les épigones révisionnistes). Elle en est arrivée à croire que les schémas de Marx permettent une accumulation illimitée" (ibid p125). En conséquence, argumentait-il, elle a déplacé le problème de la sphère principale de la production de la plus-value vers la sphère secondaire de la circulation. Grossman a réexaminé le schéma de la reproduction qu'Otto Bauer avait adapté de Marx dans sa critique de L'accumulation du capital [7]. Le but de Bauer était alors de réfuter la thèse de Luxemburg selon laquelle le capitalisme serait confronté à un problème insoluble dans la réalisation de la plus-value une fois qu'il aurait éliminé tous les marchés "extérieurs" à son mode de production. Pour Bauer, la croissance démographique du prolétariat était suffisante pour absorber toute la plus-value requise pour permettre l'accumulation. Il faut souligner que Grossman n'a pas commis l'erreur de considérer le schéma de Bauer comme une description réelle de l'accumulation capitaliste (contrairement à ce que dit Pannekoek, nous y reviendrons plus loin) : "Je montrerai que le schéma de Bauer reflète et ne peut refléter que le côté valeur du processus de reproduction. En ce sens, ce schéma ne peut pas décrire le processus réel de l'accumulation en termes de valeur et valeur d'usage. Deuxièmement, l'erreur de Bauer consiste en ceci qu'il suppose que le schéma de Marx est, d'une certaine manière, une illustration des processus réels dans le capitalisme, et oublie les simplifications qui l'accompagnent. Mais ces points faibles ne réduisent pas la valeur du schéma de Bauer" (ibid p. 69). L'intention de Grossman, lorsqu'il pousse le schéma de Bauer jusqu'à à sa conclusion "mathématique", est de montrer que, même sans problème de réalisation, le capitalisme se heurterait inévitablement à des barrières insurmontables. Prenant en considération l'augmentation de la composition organique du capital et la tendance à la baisse du taux de profit qui en résulte, l'élargissement global du capital aboutirait à un point où la masse absolue du profit serait insuffisante pour permettre davantage d'accumulation, et le système serait confronté à l'effondrement. Dans l'utilisation par Grossman, selon ses hypothèses, du schéma de Bauer, ce point est atteint au bout de 35 ans : à partir dece moment, "toute nouvelle accumulation de capital dans les conditions postulées serait tout à fait sans effet. Le capitaliste gaspillerait ses efforts à gérer un système productif dont les fruits sont entièrement absorbés par la part des travailleurs. Si cet état persistait, cela signifierait une destruction du mécanisme capitaliste, sa fin économique. Pour la classe des entrepreneurs, l'accumulation serait non seulement insignifiante, elle serait objectivement impossible parce que le capital sur-accumulé se trouverait inexploité, ne pourrait pas fonctionner, échouerait à rapporter du profit" (ibid, p. 76).
Ceci a amené certains critiques de Grossman à dire que celui-ci pensait pouvoir prévoir avec une certitude absolue le moment où le capitalisme deviendrait impossible. Cependant, cela n'a jamais été son but. Grossmann essayait simplement de se réapproprier la théorie de Marx de l'effondrement en expliquant pourquoi celui-ci avait considéré la tendance à la baisse du taux de profit comme la contradiction centrale dans le processus d'accumulation. "Cette baisse du taux de profit à l'étape de la suraccumulation est différente de la baisse de ce taux aux étapes précédentes de l'accumulation du capital. Un taux de profit en baisse est un symptôme permanent du progrès de l'accumulation au cours de ses différentes étapes mais, durant les premières étapes de l'accumulation, il va de pair avec une masse croissante de profit et une consommation capitaliste elle aussi en hausse. Au-delà de certaines limites cependant, la baisse du taux de profit s'accompagne d'une chute de la plus-value affectée à la consommation capitaliste et, bientôt, de la plus-value destinée à l'accumulation. "La baisse du taux de profit s'accompagnerait cette fois d'une diminution absolue de la masse du profit" [Marx, Le Capital, livre 3, 3e section, Conclusions, "Les contradictions internes de la loi", Bibliothèque de La Pléiade, tome 2, p. 1034]" (ibid pp. 76-77).
Pour Grossman, la crise ne survient pas, comme le soutenait Rosa Luxemburg, parce que le capitalisme est confronté à "trop" de plus-value, mais parce qu'au final trop peu de plus-value est extraite de l'exploitation des travailleurs pour réaliser davantage d'investissements rentables dans l'accumulation. Les crises de surproduction se produisent effectivement mais elles sont fondamentalement la conséquence de la suraccumulation du capital constant : "La surproduction des marchandises est une conséquence d'une valorisation insuffisante due à la suraccumulation. La crise n'est pas provoquée par une disproportion entre l'expansion de la production et l'insuffisance du pouvoir d'achat, c'est-à-dire par une pénurie de consommateurs. La crise intervient parce qu'aucune utilisation n'est faite du pouvoir d'achat qui existe. C'est parce que cela ne paie pas d'augmenter la production puisque l'échelle de la production ne modifie pas la quantité de plus-value disponible. Ainsi, d'une part, le pouvoir d'achat demeure inemployé, de l'autre, les marchandises produites demeurent invendues" (ibid p. 132).
Le livre de Grossman constitue un réel retour à Marx et il n'hésite pas à critiquer des marxistes éminents comme Lénine et Boukharine pour leur incapacité à analyser les crises ou les menées impérialistes du capitalisme comme des expressions de ses contradictions internes, se concentrant au lieu de cela sur des manifestations extérieures de ces dernières (dans le cas de Lénine, par exemple, l'existence des monopoles vue comme la cause de l'impérialisme). Dans l'introduction à son livre, Grossman explique la prémisse méthodologique qui sous-tend cette critique : "J'ai essayé de montrer comment les tendances empiriquement décelables de l'économie mondiale qui sont considérées comme définissant les caractéristiques de de la dernière étape du capitalisme (monopoles, exportation de capitaux, la lutte pour le partage des sources des matières premières, etc.) ne sont que des manifestations extérieures secondaires qui résultent de l'essence de l'accumulation capitaliste qui en constitue le fondement. A travers ce mécanisme interne, il est possible d'employer un seul principe, la loi marxiste de la valeur, pour expliquer clairement toutes les manifestations du capitalisme sans avoir besoin d'improviser une théorie spécifique, et également de faire la lumière sur son étape ultime - l'impérialisme. Je n'insiste pas sur le fait que c'est la seule manière de démontrer l'immense cohérence du système économique de Marx"
Poursuivant dans la même veine, Grossman se défend alors à l'avance de l'accusation "d'économisme pur" :
"Puisque, dans cette étude, je me limite délibérément à ne décrire que les fondements économiques de l'effondrement du capitalisme, laissez-moi dès à présent dissiper tout soupçon d'économisme. Il est inutile de gâcher du papier à propos du lien entre les sciences économiques et la politique ;il est évident que ce lien existe. Cependant, tandis que les marxistes ont énormément écrit sur la révolution politique, ils ont négligé de traiter théoriquement l'aspect économique de cette question et n'ont pas réussi à prendre en compte le contenu réel de la théorie de Marx de l'effondrement. Mon unique souci ici est de combler cette lacune de la tradition marxiste" (Ibid p. 32-33).
On doit garder cela à l'esprit quand on accuse Grossman de ne décrire la crise finale du système que par l'incapacité de l'appareil économique de continuer à fonctionner plus longtemps. Cependant, si on laisse de côté l'impression créée par plusieurs de ses formulations abstraites au sujet de l'effondrement capitaliste, il y a un problème plus fondamental dans la tentative de Grossman "de faire la lumière sur l'étape ultime (du capitalisme) - l'impérialisme"
À la différence de Mitchell, par exemple, il ne conçoit pas explicitement son travail comme étant destiné à clarifier les conclusions auxquelles la Troisième internationale avait abouti, à savoir que la Première Guerre mondiale avait ouvert l'époque de déclin du capitalisme, l'époque des guerres et des révolutions. Dans certains passages, par exemple, il reproche à Boukharine de considérer la guerre (mondiale) comme la preuve du fait que l'époque de l'effondrement est arrivée, il tend à réduire l'importance de la Guerre Mondiale comme expression indubitable de la sénilité du mode de production capitaliste. Il est vrai qu'il accepte que cela "pourrait très bien être le cas", et que son objection principale à l'argument de Boukharine est l'idée de ce dernier selon laquelle la guerre serait la cause du déclin et non son symptôme ; mais Grossman argumente également que "loin de constituer une menace pour le capitalisme, les guerres sont le moyen de prolonger son existence comme un tout. Les faits montrent précisément qu'après chaque guerre, le capitalisme connaît une nouvelle période de croissance" (ibid pp. 49-50). Ceci représente une sérieuse sous-estimation de la menace que la guerre capitaliste représente pour la survie de l'humanité et semble confirmer que, pour Grossman, la crise finale sera purement économique. En outre, bien que son travail témoigne d'un certain nombre d'efforts pour concrétiser son analyse – en mettant en évidence l'accroissement inévitable des tensions impérialistes provoquée par la tendance vers l'effondrement, son insistance sur l'inévitabilité d'une crise finale qui obligerait la classe ouvrière à renverser le système ne fait pas clairement apparaître si l'époque de la révolution prolétarienne est réellement déjà ouverte.
Mattick et l'époque de la crise permanente
Par rapport à cette question, le texte de Mattick est plus explicite que le livre de Grossman puisqu'il appréhende la crise du capitalisme dans le contexte général du matérialisme historique et, ce faisant, au moyen du concept d'ascendance et de décadence des différents modes de production. Ainsi, le point de départ du document est l'affirmation selon laquelle "le capitalisme en tant que système économique a eu la mission de développer les forces productives de la société à un degré qu'aucun système précédent n'aurait été capable d'atteindre. Le moteur du développement des forces productives dans le capitalisme est la course pour le profit. Et pour cette raison même, ce processus ne peut se poursuivre qu'aussi longtemps qu'il est rentable. De ce point de vue, le capital devient une entrave au développement continu des forces productives dès lors que ce développement entre en conflit avec la nécessité du profit" (notre traduction). Mattick n'a aucun doute sur le fait que l'époque de la décadence capitaliste est arrivée et que nous sommes maintenant dans la phase de la crise permanente comme l'exprime le titre de son texte, quoiqu'il puisse y avoir des booms temporaires provoqués par des mesures destinées à enrayer le déclin, telles que l'augmentation de l'exploitation absolue. Ces booms temporaires "au sein de la crise mortelle", ne sont pas "une expression du développement mais du délabrement".A nouveau, peut-être plus clairement que Grossman, Mattick ne plaide pas pour un effondrement automatique une fois que le taux de profit aura diminué en-deçà d'un certain niveau : il montre la réaction du capitalisme à son impasse historique, consistant à augmenter l'exploitation de la classe ouvrière pour extraire les dernières gouttes de plus-value requises pour l'accumulation, et marchant à la guerre mondiale pour s'approprier les matières premières à meilleur marché, conquérir des marchés et annexer de nouvelles sources de force de travail. En même temps, il considère les guerres, tout comme la crise économique elle-même, comme "de gigantesques dévalorisations du capital constant à travers la destruction violente de valeur et de valeurs d'usage qui forment sa base matérielle". Ces deux facteurs conduisent à une augmentation de l'exploitation et, selon la vision de Mattick, la guerre mondiale provoquera une réaction de la classe ouvrière qui ouvrira la perspective de la révolution prolétarienne. Déjà, la Grande Dépression constitue "la plus grande crise dans l'histoire capitaliste" mais "c'est de l'action des travailleurs que dépend qu'elle soit la dernière pour le capitalisme, aussi bien que pour ceux-ci".
Le travail de Mattick se situe ainsi clairement dans la continuité des tentatives antérieures de l'Internationale communiste et de la Gauche communiste pour comprendre la décadence du système. Et tandis que Grossman avait déjà examiné les limites des contre-tendances à la baisse du taux de profit, Mattick a permis de rendre celles-ci plus concrètes à travers l'analyse du développement réel de la crise capitaliste mondiale pendant la période ouverte par le krach de 1929.
De notre point de vue, en dépit des concrétisations apportées par Mattick à la théorie de Grossman, des aspects de cette démarche générale demeurent abstraits. Nous sommes perplexes face à la vision de Grossman selon laquelle il n'y a "aucune trace chez Marx" d'un problème d'insuffisance du marché (La loi de l'accumulation, p. 128). Le problème de la réalisation ou de la "circulation" ne réside pas en dehors du processus d'accumulation mais en constitue une partie indispensable.De même, Grossman semble écarter le problème de la surproduction comme étant un simple sous-produit de la baisse du taux de profit et ignore les passages de Marx qui l'enracinent clairement au sein des relations fondamentales entre travail salarié et capital [8]. Alors qu' en analysant ces éléments, Luxemburg fournit un cadre cohérent pour comprendre pourquoi le triomphe même du capitalisme en tant que système global devait le propulser dans son ère de déclin, il est plus difficile de saisir à quel moment l'augmentation de la composition organique du capital atteint un niveau tel que les contre-tendances deviennent inefficaces et que le déclin commence. En effet, en incluant le commerce extérieur dans l'ensemble de ces contre-tendances, Mattick lui-même se rapproche un peu de Luxemburg quand il argumente que la transformation des colonies en pays capitalistes enlève cette option essentielle : "En transformant les pays importateurs de capitaux en pays exportateurs de capitaux, en accélérant leur développement industriel par une forte croissance locale, le commerce extérieur cesse de devenir une contre-tendance [à la baisse du taux de profit]. Alors que l'effet des contre-tendances est annulé, la tendance à l'effondrement capitaliste reste dominante. Nous avons alors la crise permanente, ou la crise mortelle du capitalisme. Le seul moyen qu'il reste pour permettre au capitalisme de continuer à exister est alors la paupérisation permanente, absolue et générale du prolétariat". À notre avis, nous avons là une indication du fait que le problème de la réalisation - la nécessité de l'extension permanente du marché global afin de compenser les contradictions internes du capital - ne peut pas être retiré de l'équation aussi facilement [9].
Cependant, le but de ce chapitre n'est pas de fouiller à nouveau dans les arguments en faveur ou contre la théorie de Luxemburg, mais de prouver que l'explication alternative de la crise contenue dans la théorie de Grossman-Mattick s'insère également entièrement dans une compréhension de la décadence du capitalisme. Il n'en est pas de même concernant la principale critique portée à la thèse de Grossman-Mattick au sein de la Gauche communiste pendant les années 1930, "La théorie de l'écroulement du capitalisme" de Pannekoek, texte édité pour la première fois dans Rätekorrespondenz en juin 1934 [10].
La critique par Pannekoek de la théorie de l'effondrement
Pendant les années 1930, Pannekoek travaillait très étroitement avec le Groep van Internationale Communisten et son texte a, sans aucun doute, été écrit en réponse à la popularité croissante des théories de Grossman au sein du courant communiste de conseils : il mentionne le fait que cette théorie avait déjà été intégrée dans le manifeste du Parti Uni des Travailleurs de Mattick. Les paragraphes introductifs du texte expriment une préoccupation qui pouvait être parfaitement justifiée et avait en vue d'éviter les erreurs faites par un certain nombre de communistes allemands à l'heure de la vague révolutionnaire, quand l'idée de la "crise mortelle" était invoquée pour affirmer que le capitalisme avait déjà épuisé toutes les options et qu' une légère poussée seulement était nécessaire pour le renverser complètement, un point de vue qui s'associait souvent à des actions volontaristes et aventuristes. Cependant, comme nous l'avons écrit par ailleurs [11], la faille essentielle dans le raisonnement de ceux qui défendaient la notion de crise mortelle dans l'après-guerre ne résidait pas dans la notion même de crise catastrophique du capitalisme. Cette notion caractérise un processus qui peut durer des décennies et non un krach soudain qui viendrait de nulle part. Cette faille résidait dans l'amalgame de deux phénomènes distincts : la décadence historique du capitalisme comme mode de production et la crise économique conjoncturelle –quelle que soit sa profondeur- que le système peut connaître à un moment donné. Dans sa polémique contre l'idée d'un l'effondrement du capitalisme en tant que phénomène immédiat et ayant lieu à un niveau purement économique, Pannekoek est tombé dans le piège de rejeter complètement la notion de décadence du capitalisme, en cohérence avec d'autres positions auxquelles il adhérait à cette époque, comme la possibilité de révolutions bourgeoises dans les colonies et le "rôle bourgeois du bolchevisme" en Russie.
Pannekoek commence par critiquer la théorie de l'effondrement de Rosa Luxemburg. Il reprend des critiques classiques faites à ses théories selon lesquelles celles-ci sont basées sur un faux problème et que, mathématiquement parlant, les schémas de la reproduction de Marx ne présentent pas de problème de réalisation pour le capitalisme. Cependant, la cible principale du texte de Pannekoek est la théorie de Grossman.
Pannekoek reproche à Grossman deux aspects essentiels : le manque de concordance entre sa théorie des crises et celle de Marx ; la tendance à considérer la crise comme un facteur automatique de l'avènement du socialisme exigeant peu de la classe ouvrière en termes d'action consciente. Un certain nombre des critiques détaillées faites par Pannekoek à l'utilisation par Grossman des tables de Bauer souffre d'un point de départ défectueux, en ce sens qu'il accuse Grossman de prendre telles quelles les tables de Bauer. Nous avons montré que ceci est faux. Plus sérieuse est son accusation selon laquelle Grossman aurait mal compris, voire même consciemment réécrit Marx concernant la relation entre la baisse du taux de profit et l'augmentation de la masse du profit. Pannekoek insiste sur le fait que, puisqu'une augmentation de la masse du profit a toujours accompagné la baisse du taux de profit, Marx n'a jamais envisagé une situation où il y aurait une pénurie absolue de plus-value : "Marx parle d’une suraccumulation qui introduit la crise, d’un trop-plein de plus-value accumulée qui ne trouve pas où s’investir et pèse sur le profit ; l’écroulement de Grossmann provient d’une insuffisance de plus-value accumulée."
(https://www.marxists.org/francais/pannekoek/works/1934/00/pannekoek_19340001.htm [80])
Il est difficile de suivre ces critiques : il n'est pas contradictoire de parler, d'une part, de suraccumulation et, d'autre part, d'une pénurie de plus-value : la "suraccumulation" étant une autre manière de dire qu'il y a un excès de capital constant, ceci signifiera nécessairement que les marchandises produites contiendront moins de plus-value et ainsi moins de profit potentiel pour les capitalistes. Il est vrai que Marx a considéré qu'une baisse du taux de profit serait compensée par une augmentation de la masse du profit : ceci dépend en particulier de la possibilité de vendre une quantité de marchandises toujours plus grande et nous amène ainsi au problème de la réalisation de la plus-value, mais nous n'avons pas l'intention de l'examiner ici.
Le problème majeur que nous voulons aborder ici est la notion basique d'effondrement capitaliste et non pas les explications théoriques spécifiques à celle-ci. L'idée d'un effondrement purement économique (et il est vrai que Grosssman tend dans cette direction avec sa vision de la crise finale en tant que simple grippage des mécanismes économiques du capitalisme) trahit une approche très mécanique du matérialisme historique où l'action humaine ne joue qu'un rôle infime, voire ne joue pas de rôle ; et, pour Pannekoek, Marx a toujours vu la fin du capitalisme comme résultant de l'action consciente de la classe ouvrière. Cette question est centrale dans la critique portée par Pannekoek aux théories de l'effondrement, parce qu'il estimait que de telles théories tendaient à sous-estimer la nécessité pour la classe ouvrière de s'armer dans la lutte, de développer sa conscience et son organisation afin de réaliser l'immense tâche de renverser le capitalisme, qui ne tomberait certainement pas comme un fruit mûr dans les mains du prolétariat. Pannekoek accepte le fait que Grossman ait considéré que l'avènement de la crise finale provoquerait la lutte des classes, mais il critique la vision purement économiste de cette lutte. Pour Pannekoek, "Ce n’est pas parce que le capitalisme s’écroule économiquement et que les hommes –les ouvriers et les autres– sont poussés par la nécessité à créer une nouvelle organisation, que le socialisme apparaît. Au contraire : le capitalisme, tel qu’il vit et croît, devenant toujours plus insupportable pour les ouvriers, les pousse à la lutte, continuellement, jusqu’à ce que se soient formées en eux la volonté et la force de renverser la domination du capitalisme et de construire une nouvelle organisation, et alors le capitalisme s’écroule. Ce n’est pas parce que l’insupportabilité du capitalisme est démontrée de l’extérieur, c’est parce qu’elle est vécue spontanément comme telle, qu’elle pousse à l’action.".
(https://www.marxists.org/francais/pannekoek/works/1934/00/pannekoek_19340001.htm [80])
En fait, un passage de Grossman anticipe déjà plusieurs des critiques de Pannekoek : "L'idée de l'effondrement, nécessaire pour des raisons objectives, ne contredit évidemment pas la lutte des classes. En revanche, l'effondrement, en dépit de sa nécessité objectivement donnée, peut être influencé dans une large mesure par l'action vivante des classes en lutte et laisse une certaine place pour une intervention active de la classe. C'est alors seulement qu'il est possible de comprendre pourquoi, un haut niveau d'accumulation du capital étant atteint, chaque hausse sérieuse des salaires rencontre de plus en plus de difficultés, pourquoi chaque lutte économique majeure devient nécessairement une question d'existence pour le capitalisme, une question de pouvoir politique…. La lutte de la classe ouvrière sur des revendications quotidiennes est ainsi liée à sa lutte pour le but final. Le but final, pour lequel la classe ouvrière lutte, n'est pas un idéal introduit au sein du mouvement ouvrier depuis l'extérieur par des moyens spéculatifs, et dont la réalisation, indépendante des luttes du présent, est réservée à l'avenir lointain. C'est le contraire, comme le montre la loi de l'effondrement du capitalisme présentée ici : [le but final est] un résultat des luttes quotidiennes immédiates et il peut être atteint plus rapidement au moyen de ces luttes" (Kuhn, op. cit. pp. 135-6, citation issue de l'édition allemande complète de La loi de l'accumulation. Notre traduction),
Mais, pour Pannekoek, Grossman était "un économiste bourgeois qui n’a jamais eu d'expérience pratique de la lutte du prolétariat, et par conséquent est dans une situation qui lui interdit de comprendre l’essence du marxisme" (https://www.marxists.org/francais/pannekoek/works/1934/00/pannekoek_1934... [80]). Et bien que, il faut en convenir, Grossman ait critiqué des aspects du "vieux mouvement ouvrier" (social-démocratie et "communisme de parti"), il n'avait vraiment rien en commun avec ce que les communistes de conseils appelaient le "nouveau mouvement ouvrier", qui était véritablement indépendant du "vieux". Pannekoek insiste ainsi sur le fait que si, pour Grossman, il y a une dimension politique à la lutte des classes, celle-ci relève essentiellement de l'activité d'un parti de type bolchevique. Pour lui, Grossman est resté un avocat de l'économie planifiée, et la transition de la forme traditionnelle et anarchique du capital à la forme gérée par l’État pourrait facilement se passer de toute intervention du prolétariat auto-organisé ; tout ce dont elle a besoin, c'est de la main ferme d'une "avant-garde révolutionnaire" au moment de la crise finale.
Il n'est pas totalement juste d'accuser Grossman de n'être rien qu'un économiste bourgeois sans expérience pratique de la lutte des travailleurs : avant la guerre, il avait été très impliqué dans le mouvement des travailleurs juifs en Pologne et, bien qu'à la suite de la vague révolutionnaire il soit resté un sympathisant des partis staliniens (et des années plus tard, peu avant sa mort, il avait été employé par l'université de Leipzig en Allemagne de l'Est stalinienne), il a toujours maintenu une indépendance d'esprit, si bien que ses théories ne peuvent pas être écartées comme une simple apologie du stalinisme. Comme nous l'avons vu, il n'a pas hésité à critiquer Lénine ; il a maintenu une correspondance avec Mattick et, pendant une brève période au début des années 1930, il avait été attiré par l'opposition trotskiste. Il est clair que, contrairement à Rosa Luxemburg, Mattick, ou lénine, il n'a pas passé la plus grande partie de sa vie en tant que révolutionnaire communiste, mais il est réducteur de considérer la totalité de la théorie de Grossman comme étant le reflet direct de sa politique [12].
Pannekoek résume son argumentation dans "La théorie de l'écroulement du capitalisme" de la manière suivante : "Le mouvement ouvrier n’a pas à attendre une catastrophe finale, mais beaucoup de catastrophes, des catastrophes politiques – comme les guerres – et économiques – comme les crises qui se déclenchent périodiquement, tantôt régulièrement, tantôt irrégulièrement mais qui, dans l’ensemble, avec l’extension croissante du capitalisme, deviennent de plus en plus dévastatrices. Cela ne cessera de provoquer l’écroulement des illusions et des tendances du prolétariat à la tranquillité, et l’éclatement de luttes de classe de plus en plus dures et de plus en plus profondes. Cela apparaît comme une contradiction que la crise actuelle – plus profonde et plus dévastatrice qu’aucune auparavant – ne laisse rien entrevoir de l’éveil d’une révolution prolétarienne. Mais l’élimination des vieilles illusions est sa première grande tâche : en premier lieu de l’illusion de rendre le capitalisme supportable, grâce aux réformes qu’obtiendraient la politique parlementaire et l’action syndicale ; et d’autre part, l’illusion de pouvoir renverser le capitalisme dans un assaut guidé par un parti communiste se donnant des allures révolutionnaires. C’est la classe ouvrière elle-même, comme masse, qui doit mener le combat, et elle a encore à se reconnaître dans les nouvelles formes de lutte, tandis que la bourgeoisie façonne de plus en plus solidement son pouvoir. Des luttes sérieuses ne peuvent pas ne pas venir. La crise présente peut bien se résorber, de nouvelles crises viendront et de nouvelles luttes. Dans ces luttes la classe ouvrière développera sa force de combat, reconnaîtra ses objectifs, se formera, se rendra autonome et apprendra à prendre elle-même en main ses propres destinées, c’est-à-dire la production sociale. C’est dans ce processus que s’accomplit le trépas du capitalisme. L’auto-émancipation du prolétariat est l’écroulement du capitalisme". (https://www.marxists.org/francais/pannekoek/works/1934/00/pannekoek_1934... [80])
Il y a beaucoup de choses correctes dans cette vision, surtout la nécessité pour la classe dans son ensemble de développer son autonomie vis-à-vis de toutes les forces capitalistes qui se présentent comme son sauveur. Pannekoek, cependant, n'explique pas pourquoi les crises devraient devenir de plus en plus dévastatrices - il invoque seulement la taille du capitalisme comme facteur de cette caractéristique [13]. Mais également, il ne pose pas la question : combien de catastrophes dévastatrices le capitalisme peut-il traverser avant qu'il ne se détruise lui-même et, avec lui, la possibilité d'une nouvelle société ? En d'autres termes, ce qui est absent ici, c'est la compréhension que le capitalisme est un système limité historiquement par ses propres contradictions et qu'il a déjà mis l'humanité face à l'alternative socialisme ou barbarie. Pannekoek avait parfaitement raison d'insister sur le fait que l'effondrement économique ne mènerait nullement automatiquement au socialisme. Mais il a tendu à oublier qu'un système en déclin qui n'a pas été renversé par la classe ouvrière révolutionnaire pourrait se détruire et détruire avec lui toute possibilité pour le socialisme. Les lignes introductrices du Manifeste communiste laissent ouverte la possibilité que les contradictions croissantes du mode de production puissent aboutir simplement à la ruine mutuelle des classes en présence si la classe opprimée ne peut pas réaliser sa transformation de la société. Dans ce sens, le capitalisme est en effet condamné à se détériorer jusqu'à sa "crise finale", et il n'y a aucune garantie que le communisme puisse s'édifier sur le sol de cette débâcle. Cette prise de conscience ne saurait cependant en rien diminuer l'importance de l'action décidée de la classe ouvrière pour imposer sa propre solution à l'effondrement du capitalisme. Au contraire, elle rend d'autant plus urgente et indispensable la lutte consciente du prolétariat et l'activité des minorités révolutionnaires en son sein.
Gerrard
1. Terme anglophone faisant explicitement référence à la période de l'entre-deux-guerres, et plus précisément aux années 1920 comme son nom l'indique, période durant laquelle les activités économiques et culturelles battent leur plein. On désigne par là le plus souvent un phénomène qui s'est déroulé en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis. Cependant, ce phénomène trouve son pendant en France avec les "années folles". Source Wikipédia.
2. Notre traduction à partir de l'anglais. Il existe également une version en français.
3. Par exemple, Advance (Le Progrès), le journal de l'APCF, a édité en mai 1936 un article de Willie McDougall, intitulé "Le capitalisme doit continuer" qui explique la crise économique en termes de surproduction. L'article conclut de la sorte : "La mission historique [du capitalisme] - le remplacement du féodalisme - a été accomplie. Il a élevé le niveau de la production à des sommets auxquels ne songeaient même pas ses propres pionniers, mais son point le plus haut a été atteint et le déclin a commencé. A chaque fois qu'un système devient une entrave au développement ou au fonctionnement même des forces productives, une révolution est imminente et il est condamné à laisser la place à un successeur. Tout comme le féodalisme devait laisser la place au système plus productif qu'est le capitalisme, ce dernier doit être balayé du chemin du progrès pour laisser la place au socialisme." (Notre traduction à partir de l'anglais).
4. En particulier les paragraphes traitant la destruction de capital et du travail dans la guerre. Voir à ce sujet l'introduction à la discussion sur les facteurs à la base des "Trente glorieuses" [81] dans la Revue internationale n° 133 et, également, la note 2 [82] à la deuxième partie de l'article de Mitchell dans la Revue internationale n° 103.
5. PIC, Persdinst van de Groep van Internationale Communisten no.1, Janvier 1930 ‘Een marwaardog boek’, cité dans la brochure du CCI La Gauche Hollandaise, p 210.
6. Rick Kuhn, Henryk Grossman and the Recovery of Marxism, Chicago 2007, p 184
7. Otto Bauer, "L'accumulation du capital", Die Neue Zeit, 1913
8. Voir l'article précédent de cette série de la Revue internationale n° 139, "Les contradictions mortelles de la société bourgeoise [53]".
9. Dans un travail postérieur, Crises et théorie des crises (1974), Mattick revient sur ce problème et reconnaît qu'effectivement Marx ne conçoit pas le problème de la surproduction seulement comme une conséquence de la baisse du taux de profit, mais comme une contradiction réelle, résultant en particulier du "pouvoir de consommation limité" de la classe ouvrière. En fait, son honnêteté intellectuelle l'amène à poser une question inconfortable : "Une fois de plus, nous nous trouvons devant le point de savoir si Marx a élaboré deux théories des crises, l'une découlant de la théorie de la valeur, sous la forme de la baisse du taux de profit, l'autre relative à la faiblesse de la consommation ouvrière" (Crises et théorie des crises, chapitre "Les épigones", p. 140, Éditions Champ Libre). La réponse qu'il propose est que les formulations de Marx relatives à la "sous-consommation de la classe ouvrière" doivent être imputées "soit à une erreur de jugement soit à une faute de plume" (Idid., chapitre "La théorie des crises chez Marx", p. 100).
10. Traduction en français : "La théorie de l'écroulement du capitalisme [80]", sur www.marxists.org [83].
11. "L'âge des catastrophes [84]" dans la Revue internationale n° 143.
12. Ce serait là une erreur en quelque sorte similaire à celle que Pannekoek a faite dans Lénine philosophe où il défendait que les influences bourgeoises sur les écrits philosophiques de Lénine démontraient la nature de classe bourgeoise du bolchevisme et de la révolution d'Octobre
13. Voir notre livre sur la Gauche hollandaise, p 211, où une remarque semblable est faite au sujet de la position du GIC dans son ensemble : "tout en rejetant les conceptions quelque peu fatalistes de Grossman et de Mattick, le GIC abandonnait tout l'héritage théorique de la gauche allemande sur les crises. La crise de 1929 n'était pas une crise généralisée exprimant le déclin du système capitaliste mais une crise cyclique. Dans une brochure parue en 1933, le GIC affirmait que la Grande Crise avait un caractère chronique et non pas permanent, même depuis 1914. Le capitalisme était semblable au Phénix de la légende, sans cesse renaissant de ses cendres. Après chaque "régénération" par la crise, le capitalisme apparaît "plus grand et plus puissant que jadis". Mais cette régénération n'était pas éternelle ; puisque "l'incendie menace de mort toujours plus violemment l'ensemble de la vie sociale". Finalement, seul le prolétariat pouvait donner le "coup mortel" au Phénix capitaliste et transformer un cycle de crise en crise finale. Cette théorie était donc contradictoire, puisque, d'un côté, elle reprenait la vision des crises cycliques comme au XIXe siècle, élargissant sans cesse l'extension du capitalisme, en une ascension ininterrompue ; de l'autre, elle définissait un cycle de destructions et de reconstructions de plus en plus fatal à la société." La brochure évoquée dans la citation est De beweging van het kapitalistisch bedrijfsleven.
Questions théoriques:
- Décadence [54]
Rubrique:
Revue Internationale n° 147 - 4e trimestre 2011
- 2510 lectures
La catastrophe économique mondiale est inévitable
- 2742 lectures
Ces derniers mois sont intervenus, de façon très rapprochée, des évènements d'une grande portée et qui témoignent de la gravité de la situation économique mondiale : incapacité de la Grèce à faire face à ses dettes ; menaces analogues pour l'Espagne et l'Italie ; mise en garde de la France pour son extrême vulnérabilité face à une éventuelle cessation de paiement de la Grèce ou l'Italie ; blocage à la Chambre des Représentants des États-Unis sur le relèvement du plafond de la dette de l'État ; perte par ce pays de son "triple A" - note maximale qui, jusque-là, caractérisait la garantie de remboursement de sa dette ; rumeurs de plus en plus persistantes sur le risque de faillite de certaines banques, les démentis opposés ne trompant personne, étant donné les suppressions d'emplois massives auxquelles elles ont déjà procédé ; première confirmation de cette rumeur avec la faillite de la banque franco-belge Dexia. Chaque fois, les dirigeants de ce monde courent après les événements mais les brèches qu'ils semblaient avoir colmatées s'ouvrent à nouveau, quelques semaines ou même quelques jours plus tard. Leur impuissance à contenir l'escalade de la crise ne traduit pas tant leur incompétence et leur vue à court terme, que la dynamique actuelle du capitalisme vers des catastrophes qui ne peuvent être évitées : faillites d'établissements financiers, faillites d'États, plongée dans une profonde récession mondiale.
Des conséquences dramatiques pour la classe ouvrière
Les mesures d'austérité prises depuis 2010 sont implacables, plaçant de plus en plus la classe ouvrière - et une grande partie du reste de la population - dans l'incapacité de faire face à leurs besoins vitaux. Énumérer toutes les mesures d'austérité qui ont été mises en place dans la zone euro, ou qui sont en train de l'être, aboutirait à un très long catalogue. Il est malgré tout nécessaire d'en mentionner un certain nombre qui tendent à se généraliser et sont significatives du sort qui est fait à des millions d'exploités. En Grèce, alors qu'en 2010 les impôts sur les biens de consommation avaient été augmentés, l'âge de la retraite repoussé à 67 ans, et les salaires des fonctionnaires réduits brutalement, il a été décidé, au mois de septembre 2011, de mettre au chômage technique 30 000 employés de la fonction publique avec une diminution de 40% de leur salaire, de réduire de 20% le montant des retraites de plus de 1200 euros et d'imposer tous les revenus supérieurs à 5000 euros par an 1. Dans presque tous les pays les impôts augmentent, l'âge de la retraite est relevé et des emplois publics sont supprimés par dizaines de milliers. Il en résulte des dysfonctionnements importants des services publics, y compris ceux revêtant un caractère vital ; ainsi, dans une ville comme Barcelone, les blocs opératoires et les services d'urgence ont réduit leurs heures d'ouverture et des lits d'hôpitaux sont supprimés en masse 2 ; à Madrid, 5000 professeurs non-titulaires ont perdu leur poste 3 et cela a été compensé par l'augmentation de 2 heures de la durée hebdomadaire d'enseignement des professeurs titulaires.
Les chiffres du chômage sont de plus en plus alarmants : 7,9% au Royaume-Uni à la fin août, 10% en zone euro (20% en Espagne) à la fin septembre 4 et 9,1% aux États-Unis à la même période. Durant tout l'été, les plans de licenciements ou de suppression d'emplois se sont succédés : 6500 chez Cisco, 6000 chez Lockheed Martin, 10000 chez HSBC, 30000 chez Bank of America, et la liste n'est pas close. Les revenus des exploités chutent : selon les chiffres officiels, le salaire réel avait diminué de plus de 10% en rythme annuel en Grèce au début 2011, de plus de 4% en Espagne et, dans une moindre mesure, au Portugal et en Italie. Aux États-Unis, 45,7 millions de personnes, soit une augmentation de 12% en un an 5, ne survivent que grâce au système des bons d'alimentation de 30 dollars par semaine délivrés par l'Administration.
Et malgré cela, le pire est encore à venir.
Ainsi, c'est toujours avec plus d'acuité que se pose la nécessité du renversement du système capitaliste avant que, dans son effondrement, il n'entraîne la ruine de l'humanité. Les mouvements de protestation en réaction aux attaques et qui ont eu lieu depuis le printemps 2011 dans un certain nombre de pays, quelles que soient les insuffisances ou les faiblesses qu'ils peuvent exprimer, constituent néanmoins les premiers jalons d'une riposte prolétarienne d'ampleur à la crise du capitalisme (voir à ce sujet l'article "De l'indignation à la préparation des combats de classe" dans ce numéro de la Revue internationale).
Depuis 2008 la bourgeoisie n'est pas parvenue à endiguer la tendance à la récession
L'illusion pouvait exister, au début de l'années 2010, que les États étaient parvenus à mettre le capitalisme à l'abri d'une poursuite de la récession qui avait eu lieu en 2008 et début 2009 et s'était traduite par une chute vertigineuse de la production. A cette fin, toutes les grandes banques centrales du monde avaient procédé à des injections massives de monnaie dans l'économie. C'est à cette occasion que Ben Bernanke, le directeur de la FED (à l'origine du lancement de plans de relance considérables), fut surnommé "Helicopter Ben" tant il paraissait arroser les États-Unis de dollars depuis un hélicoptère. Entre 2009 et 2010, d'après les chiffres officiels que l'on sait toujours surévalués, le taux de croissance était passé aux États-Unis de 2,6% à +2,9% et, dans la zone euro, de 4,1% à +1,7%. Dans les pays émergents, les taux de croissance, qui avaient baissé, semblaient retrouver en 2010 les valeurs antérieures à la crise financière : 10,4% en Chine, 9% en Inde. Tous les États et leurs médias avaient alors entonné le couplet de la reprise alors qu'en réalité la production de l'ensemble des pays développés n'est jamais parvenue à retrouver ses niveaux de 2007. En d'autres termes, en fait de reprise, on peut tout juste parler d'un pallier au sein d'un mouvement de chute de la production. Et ce palier n'a duré que quelques trimestres :
- Dans les pays développés, les taux de croissance ont recommencé à chuter à partir de la mi-2010. La croissance prévue aux États-Unis pour l'année 2011 est de 0,8%. Ben Bernanke a annoncé que la reprise américaine était sur le point de "marquer le pas". Par ailleurs, la croissance des grands pays européens (Allemagne, France, Royaume-Uni) est voisine de 0 et si les gouvernements des pays du Sud de l'Europe (Espagne, 0,6% en 2011 après -0,1% en 2010 6 ; Italie, 0,7% en 2011) 7 sont en train de nous répéter sur tous les tons que leur pays "n'est pas en récession", en réalité, compte tenu des plans de rigueur qu'ils ont subi et vont encore subir, la perspective qui les attend n'est certainement n'est pas très éloignée de ce que connaît actuellement la Grèce, pays dont la chute de la production sera supérieure à 5 % en 2011.
- Pour les pays émergents, la situation est loin d'être brillante. S'ils ont connu des taux de croissance importants en 2010 avaient été, l'année 2011 se présente sous un jour beaucoup moins favorable. Le FMI avait prévu qu'ils connaîtraient une croissance de 8,4% l'an pour l'année 2011 8, mais certains indices montrent que l'activité en Chine est en train de ralentir 9. Il est prévu que la croissance du Brésil passe de 7,5% en 2010 à 3,7% en 2011 10 . Et enfin, les capitaux sont en train de fuir la Russie 11. En bref, contrairement à ce que nous ont rabâché les économistes et beaucoup d'hommes politiques depuis des années, les pays émergents ne seront pas la locomotive permettant un retour de la croissance mondiale. Tout au contraire, ceux-ci vont pâtir au premier chef de la dégradation de la situation des pays développés et connaître ainsi une chute de leurs exportations, lesquelles avaient jusqu'alors été le facteur de leur croissance.
Le FMI vient de revoir ses prévisions qui tablaient sur une croissance de 4% au niveau mondial pour les années 2011 et 2012, en signalant, après avoir précédemment constaté que la croissance s'était "considérablement affaiblie", "qu'il ne peut pas exclure" 12 une récession pour l'année 2012. En d'autres termes, la bourgeoisie est en train de prendre conscience à quel point l'activité économique va se contracter. Au vu d'une telle évolution, on ne peut que se poser la question : pourquoi les banques centrales n'ont-elles pas continué à arroser le monde de monnaie comme elles l'ont fait à la fin de l'année 2008 et en 2009, augmentant ainsi de manière considérable la masse monétaire (elle a été multipliée par 3 aux États-Unis et par 2 dans la zone euro) ? La raison en est que le déversement de "monnaie de singe" sur les économies ne résout pas les contradictions du capitalisme. Il en résulte moins une relance de la production que de l'inflation, cette dernière avoisinant 3% en zone euro, un peu plus aux États-Unis, 4,5% au Royaume-Uni, entre 6% et 9% dans les pays émergents.
L'émission de monnaie papier ou électronique permet que de nouveaux prêts soient consentis… et que l'endettement mondial soit augmenté. Le scénario n'est pas nouveau, c'est comme cela que de grands acteurs économiques du monde se sont endettés à un point tel qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui rembourser leur dette. En d'autres termes, ils sont aujourd'hui insolvables, et parmi eux on compte, rien de moins, que les États européens, l'État américain et l'ensemble du système bancaire.
Le cancer de la dette publique
La zone euro
Les États européens éprouvent de plus en plus de difficultés à honorer le paiement des intérêts de leur dette.
Si c'est dans la zone euro que se sont manifestés en premier des défauts de paiement de certains États, c'est parce que ceux-ci n'ayant pas, contrairement aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Japon, la maîtrise de l'émission de leur propre monnaie, ils n'ont pas eu la possibilité de faire marcher la planche à billets pour honorer, en monnaie de singe, les échéances de leur dette. L'émission d'Euros est du ressort de la Banque Centrale Européenne (BCE) qui est plutôt soumise à la volonté des grands États Européens et, en particulier, de l'Allemagne. Et, comme chacun le sait, multiplier la masse monétaire par deux ou par trois, alors que la production stagne, ne peut que se traduire par le développement de l'inflation. C'est pour éviter cela que la BCE a de plus en plus renâclé à assurer le financement des États qui le nécessitaient afin de ne pas se retrouver elle-même en défaut de paiement.
C'est une des raisons essentielles pour laquelle les pays de la zone euro vivent, depuis un an et demi, sous la menace d'un défaut de paiement de l'État grec. En fait, le problème qui se pose à la zone euro n'a pas de solution car son refus de financer la dette grecque provoquerait la cessation de paiement de la Grèce et sa sortie de la zone euro. Les créanciers de la Grèce, parmi lesquels figurent des États européens et des banques européennes importantes, rencontreraient à leur tour des difficultés pour faire face à leurs propres engagements, et seraient à leur tour menacés de faillite. C'est l'existence même de la zone Euro qui se trouve ainsi mise en question, alors que son existence est essentielle pour les pays exportateurs situés au nord de celle-ci, l'Allemagne en particulier.
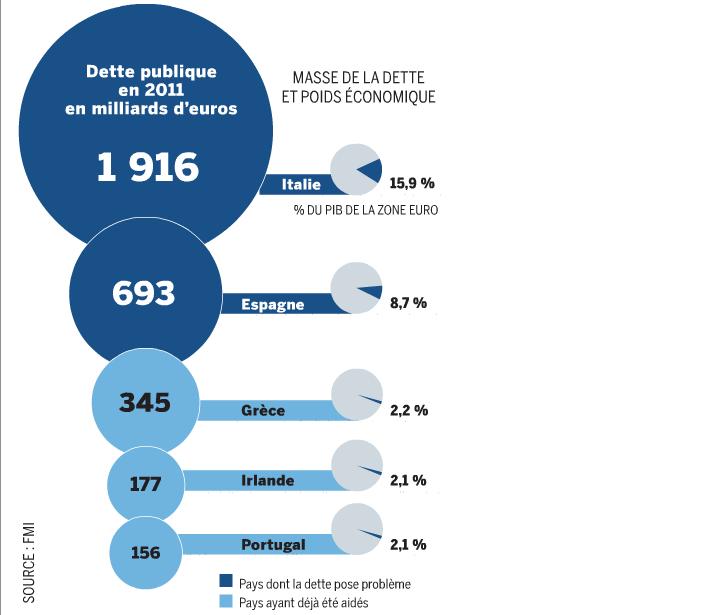
C'est essentiellement la Grèce qui, depuis un an et demi, a polarisé l'attention sur les questions de défaut de paiement. Mais des pays comme l'Espagne et l'Italie vont se trouver dans une situation semblable vu qu'ils n'arriveront jamais à dégager les recettes fiscales nécessaires à l'amortissement d'une partie de leur dette (Cf. Graphique) 13. Un simple regard sur l'ampleur de la dette de l'Italie, dont le défaut de paiement à court terme est très probable, montre que la zone euro ne pourra pas soutenir ce pays pour lui permettre d'assumer ses engagements. Déjà les investisseurs croient de moins en moins en ses capacités de remboursement, et c'est pour cela qu'ils ne consentent à lui prêter de l'argent qu'à des taux très élevés. La situation de l'Espagne est, pour sa part, assez voisine de celle de la Grèce.
Les prises de position des gouvernements et des instances de la zone euro, en particulier du gouvernement allemand, traduisent leur incapacité à faire face à la situation créée par la menace de faillite de certains pays. La majeure partie de la bourgeoisie de la zone euro est consciente du fait que le problème n'est plus de savoir si la Grèce est en défaut de paiement : l'annonce selon laquelle les banques allaient participer au sauvetage de la Grèce pour 21% de sa dette constituait déjà une reconnaissance de cette situation, qui a été confirmée lors du sommet Merkel-Sarkozy du 9 Octobre admettant qu'il y aura défaut de paiement de la Grèce pour 60% de sa dette. Dès lors, le problème qui se pose à la bourgeoisie est de trouver les moyens de faire en sorte que ce défaut de paiement provoque le moins de convulsions possibles au sein de la zone euro, ce qui constitue un exercice particulièrement délicat provocant hésitations et divisions en son sein. Ainsi, les partis politiques au pouvoir en Allemagne sont très divisés sur le fait de savoir s'il faut aider financièrement la Grèce, comment l'aider et s'il faut aussi aider les autres États qui vont à grands pas vers le même défaut de paiement qui touche aujourd'hui ce pays. A titre d'illustration, il est remarquable que le plan décidé le 21 juillet par les autorités de la zone euro pour "sauver" la Grèce et qui prévoit un renforcement de la capacité de prêt du Fonds Européen de Stabilité Financière de 220 à 440 milliards d'euros (avec pour corollaire évident une augmentation de la contribution des différents États), ait été, pendant des semaines, remis en cause par une partie importante des partis au pouvoir en Allemagne. Revirement de situation, il a finalement été massivement voté par le Bundestag le 29 septembre ! De même, jusqu'à début août, le gouvernement allemand refusait que la BCE rachète des titres de la dette souveraine de l'Italie et de l'Espagne. Compte tenu de la dégradation de la situation financière de ces pays, l'État allemand a finalement accepté qu'à partir du 7 août la BCE puisse racheter de telles obligations 14. Si bien que, entre le 7 août le 22 août, la BCE aura racheté pour 22 milliards de dette souveraine de ces deux pays 15 ! En fait, ces contradictions et atermoiements montrent qu'une bourgeoisie aussi importante internationalement que la bourgeoisie allemande ne sait pas quelle politique mener. De manière générale, l'Europe, poussée par l'Allemagne, a plutôt choisi l'austérité. Cela n'exclut pas de permettre de financer a minima les États et les banques par l'instauration du Fonds Européen de Solidarité Financière (ce qui suppose donc aussi l’augmentation des ressources financières de cet organisme), ni d'autoriser la BCE à créer suffisamment de monnaie pour venir en aide à un État ne pouvant plus payer ses dettes, afin que le défaut de paiement n'intervienne pas tout de suite.
Bien sûr le problème n'est pas celui de la bourgeoisie allemande, mais celui de toute la classe dominante car c'est elle dans son ensemble qui, depuis la fin des années 1960, s'est endettée pour éviter la surproduction, et cela à un point tel qu'il est aujourd'hui très difficile de non seulement de rembourser les échéances de la dette mais même d'honorer les intérêts de celle-ci. D'où les économies qu'elle essaie de faire actuellement au moyen de politiques d'austérité draconiennes qui ponctionnent tous les revenus mais, dans le même temps, ne peuvent qu'impliquer une diminution de la demande, accroître la surproduction et accélérer la plongée dans la dépression.
Les États-Unis
Ce pays a été confronté au même type de problème durant l'été 2011.
Le plafond de la dette, qui avait été fixé en 2008 à 14 294 milliards de dollars, a été atteint en mai 2011. Il devait être relevé pour que, de manière analogue aux pays de la zone euro, ils puissent faire face à leurs engagements, y compris intérieurs, c'est-à-dire assurer le fonctionnement de l'État. Même si l'invraisemblable archaïsme et la bêtise du Tea Party ont été un facteur d'aggravation de la crise, ils n'ont pas constitué le fond du problème qui s'est posé au Président et au Congrès des États-Unis. Le vrai problème était bien l'alternative suivante dont il fallait choisir l'un des termes :
- soit poursuivre la politique d'endettement de l'État fédéral, comme le demandaient les démocrates, c'est-à-dire fondamentalement demander à la FED de créer de la monnaie au risque de provoquer une chute incontrôlée de la valeur de cette dernière ;
- soit pratiquer une politique d'austérité drastique comme l'exigeaient les républicains, à travers en particulier la réduction, sur 10 ans, des dépenses publiques de 4000 à 8000 milliards de dollars. A titre de comparaison, le PIB des États-Unis en 2010 était de 14 624 milliards de dollars, ce qui donne une idée de l'ampleur des coupes budgétaires, et donc des suppressions d'emplois publics, impliquées par un tel plan.
En résumé, l'alternative posée cet été aux États-Unis était la suivante : soit prendre le risque d'ouvrir la porte à une inflation pouvant devenir galopante, soit pratiquer une politique d'austérité qui ne pouvait que réduire fortement la demande, provoquer la chute ou même la disparition des profits, avec au bout du compte la fermeture en chaine de toute une série d'entreprises et une chute vertigineuse de la production. Du point de vue des intérêts du capital national, tant le positionnement des Républicains que celui des Démocrates est légitime. Tiraillées par les contradictions qui assaillent l'économie nationale, les autorités américaines de ce pays en furent réduites à des demi-mesures… contradictoires et incohérentes. Le Congrès se trouvera donc à nouveau confronté à la nécessité de réaliser à la fois des milliers de milliards de dollars d'économies budgétaires et un nouveau plan de relance de l'emploi.
L'issue du conflit entre républicains et démocrates montre que, contrairement à l'Europe, les États-Unis ont plutôt choisi l'aggravation de la dette puisque le plafond de la dette fédérale a ainsi été rehaussé de 2100 milliards de dollars jusqu'en 2013 avec, comme contrepartie, des réductions de dépenses budgétaires d'environ 2500 milliards dans les dix ans à venir.
Mais, comme pour l'Europe, cette décision montre que l'État américain ne sait pas quelle politique mener face à l'impasse de son endettement.
L’abaissement de la note de la dette américaine par l'agence Standard and Poor's et les réactions qu'elle a provoquées sont une illustration du fait que la bourgeoisie sait parfaitement qu'elle est dans une impasse et qu'elle ne voit pas quels moyens se donner pour en sortir. Contrairement à bien d'autres décisions des agences de notation depuis le début de la crise des subprimes, la décision de Standard and Poor's de cet été apparaît cohérente : l'agence montre qu'il n'y pas de recettes suffisantes pour compenser l'augmentation de l'endettement accepté par le Congrès et que, en conséquence, la capacité des États-Unis de rembourser leurs dettes a perdu de sa crédibilité. En d'autres termes, pour cette institution, le compromis qui a évité une grave crise politique aux États-Unis en aggravant l'endettement de ce pays va accroître l'insolvabilité de l'État américain lui-même. La perte de confiance des financiers de la planète envers le dollar qui inévitablement résultera de la sentence de Standard and Poor's va tirer ainsi sa valeur à la baisse. Par ailleurs, si le vote de l'augmentation du plafond de la dette fédérale permet d'éviter la paralysie à l'Administration fédérale, les différents États fédérés et les municipalités en faillite le resteront. Depuis le 4 juillet, l'État du Minnesota est en défaut de paiement et il a dû demander à 22 000 fonctionnaires de rester chez eux 16. Un certain nombre de villes américaines (dont Central Falls et Harrisburg, capitale de la Pennsylvanie) sont dans la même situation ; situation que l'État de Californie – et il n'est pas le seul - semble ne pas pouvoir éviter dans un avenir proche.
Face à l'aggravation de la crise depuis 2007, aussi bien la politique économique de la zone euro que celle des États-Unis, n'ont pu éviter aux États de devoir prendre en charge les dettes qui avaient été, à l'origine, contractées par le secteur privé. Ces nouvelles dettes du secteur public n'ont fait qu'accroître la dette publique qui, de son côté, ne cessait de se développer depuis des décennies. Il en a résulté un échéancier de remboursements auxquels les États ne peuvent pas faire face. Aux États-Unis comme dans la zone euro, cela se traduit par des licenciements massifs dans le secteur public, par la baisse sans fin des salaires et l'augmentation, également sans fin, des impôts.
La menace d'une grave crise bancaire
En 2008-2009, après l'effondrement de certaines banques comme Bear Stearns et Northern Rock et la faillite pure et simple de Lehman Brothers, les États avaient volé au secours de beaucoup d'autres en les recapitalisant afin de leur éviter le même sort. Où en est-on à présent de la santé des établissements bancaires ? Elle est à nouveau très mauvaise. Tout d'abord, les livres des comptes bancaires sont loin d'avoir évacué toute une série de créances irrécouvrables. Ensuite, beaucoup de banques sont elles-mêmes détentrices d'une partie de la dette d'États aujourd'hui en difficulté de paiement. Le problème pour elles, c'est que la valeur de la dette ainsi achetée a depuis lors considérablement diminué.
La déclaration récente du FMI, se basant sur sa connaissance des difficultés actuelles des banques européennes et stipulant que celles-ci devaient augmenter leurs fonds propres de 200 milliards, a provoqué en retour des réactions agacées et des déclarations de la part de ces institutions selon lesquelles tout allait bien pour elles. Et cela, alors qu'au même moment, tout témoignait du contraire :
- les banques américaines ne veulent plus refinancer en dollars les filiales américaines des banques européennes et rapatrient les fonds qu'elles avaient placés en Europe ;
- les banques européennes se prêtent de moins en moins entre elles parce qu'elles sont de moins en moins sûres d'être remboursées et préfèrent placer, même à des taux très bas, leurs liquidités à la BCE ;
- conséquence de ce manque de confiance se généralisant, les taux des prêts entre banques ne cessent d'augmenter, même s'ils n'ont pas encore atteint les niveaux de fin 2008 17.
Le comble, c'est que quelques semaines après que les banques aient affirmé leur merveilleuse santé, on assistait à la faillite et à la liquidation de la banque franco-belge Dexia sans qu'aucune autre banque ne soit intéressée à se porter à son secours.
Ajoutons que les banques américaines sont bien mal placées pour "rouler des mécaniques" face à leurs consœurs européennes : du fait des difficultés qu'elles rencontrent, Bank of America vient de supprimer 10% de ses postes de travail et Goldman Sachs, la banque qui est devenue le symbole de la spéculation mondiale, vient de licencier 1000 personnes. Et, elles aussi, préfèrent déposer leurs liquidités à la FED plutôt que de prêter à d'autres banques américaines.
La santé des banques est essentielle pour le capitalisme car celui-ci ne peut pas fonctionner sans un système bancaire qui l'approvisionne en monnaie. Or, la tendance à laquelle nous assistons est celle qui mène au "Credit Crunch", à savoir une situation dans laquelle les banques ne veulent plus prêter dès qu'il y a le moindre risque de non-remboursement. Ce que cela contient, à terme, c'est un blocage de la circulation du capital, c'est-à-dire le blocage de l'économie. On comprend mieux, sous cet angle, pourquoi le problème du renforcement des fonds propres des banques est devenu le premier point à l'ordre du jour des multiples réunions au sommet qui ont lieu au niveau international, avant même la situation de la Grèce qui, pourtant, n'est toujours pas réglée. Au fond, le problème des banques montre l’extrême gravité de la situation économique et illustre à lui seul les difficultés inextricables auxquelles le capitalisme doit faire face.
Lors de la perte de la note AAA par les États-Unis, le quotidien économique français Les Echos titrait le 8 août 2011 en première page : "L'Amérique dégradée, le monde dans l'inconnu". Lorsque le principal média économique de la bourgeoisie française exprime une telle désorientation, une telle angoisse par rapport à l'avenir, il ne fait en cela qu'exprimer la désorientation de la bourgeoisie elle-même. Depuis 1945, le capitalisme occidental (et le capitalisme mondial après l'effondrement de l'URSS) est basé sur le fait que la force du capital américain constitue en dernière instance le gage ultime garantissant l'ensemble des dollars qui assurent, partout dans le monde, la circulation des marchandises, et donc du capital. Or, l'immense accumulation de dettes que la bourgeoisie américaine a contractées pour faire face, depuis la fin des années 1960, au retour de la crise ouverte du capitalisme, a fini par constituer un facteur accélérateur et aggravant de cette même crise. Tous ceux qui détiennent des parcelles de la dette américaine, à commencer par l'État américain lui-même, détiennent en réalité un avoir… qui vaut de moins en moins. La monnaie dans laquelle celle-ci est libellée, ne peut à son tour que s'affaiblir de même que… l'État américain.
La base de la pyramide sur laquelle le monde est construit depuis 1945 se désagrège. En 2007, lors de la crise financière, le système financier mondial a été sauvé par les banques centrales, c'est-à-dire par les États ; maintenant ceux-ci sont au bord de la faillite et il est hors de question que les banques puissent venir les secourir ; de quelque côté que les capitalistes se tournent, il n'existe rien qui puisse permettre une réelle reprise économique. En effet, une croissance même très faible suppose l'émission de nouvelles dettes pour créer une demande permettant d'écouler les marchandises ; or, même les intérêts des dettes déjà contractées ne sont plus remboursables et précipitent banques et États dans la banqueroute.
Comme on l'a vu, des décisions qui étaient affirmées irrévocables sont remises en cause au bout de quelques jours, des certitudes affirmées quant à la santé de l'économie ou des banques sont démenties tout aussi rapidement. Dans un tel contexte, les États sont de plus en plus amenés à naviguer au jour le jour. Il est probable, mais non certain, justement parce que la bourgeoisie est désorientée par une situation inédite, que pour faire face à l'immédiat, pour gagner un peu de temps, elle continue à arroser de monnaie le capital qu'il soit financier, commercial ou industriel, même si cela induit une inflation qui a déjà commencé, qui va s'accroître et qui va devenir de plus en plus incontrôlable. Cela n'empêchera pas la poursuite des licenciements, des baisses de salaires et des hausses d'impôts ; mais, en plus, l'inflation va aggraver la misère de la très grande majorité des exploités. Le jour même où Les Echos titraient "L'Amérique dégradée, le monde dans l'inconnu", un autre quotidien économique français, La tribune, titrait "Dépassés", à propos des grands décideurs de la planète dont la photo figurait également en "Une". Oui, ceux qui nous ont promis monts et merveille, puis qui nous ont consolés lorsqu'il était devenu évident qu'en fait de merveille c'était le cauchemar qui nous attendait, avouent maintenant qu'ils sont "dépassés". Et s'ils sont "dépassés", c'est parce que leur système, le capitalisme, est définitivement caduc et qu'il est en train d'entraîner la très grande majorité de la population mondiale dans la plus terrible des misères.
Vitaz (10-10-2011)
1 https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/09/22/04016-20110922ARTFIG00699-la-colere-gronde-de-plus-en-plus-fort-en-grece.php [86]
2 https://news.fr.msn.com/m6-actualite/monde/espagne-les-enseignants-manif... [87]
3 www.rfi.fr/fr/europe/20110921-manifestations-enseignants-lyceens-espagne [88]
4 Statistique Eurostat
5 Le Monde, 7-8 août 2011
6 finance-economie.com/blog/2011/10/10/chiffres-cles-espagne-taux-de-chomage-pib-2010-croissance-pib-et-dette-publique
7 globalix.fr/la-dynamique-de-la-dette-italiennela-dynamique-de-la-dette-italienne [89]
8 FMI, perspectives de l'économie mondiale, juillet 2010
9 Le Figaro, 3 octobre 2011
10Les Echos, 9 août 2011
11 www.lecourrierderussie.com/2011/10/12/poutine-la-crise-existe [90]
12https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/10/05/97002-20111005FILWWW00435-fmi-recession-mondiale-pas-exclue.php [91]
13Paru dans le journal Le Monde du 5 août 2011.
14Les Echos, août 2011
15Les Echos, 16 août 2011
16www.rfi.fr/fr/ameriques/20110702-faillite-le-gouvernement-minnesota-cesse-activites [92]
17https://www.gecodia.fr/Le-stress-interbancaire-en-Europe-s-approche-du-pic-post-Lehman_a2348.html [93]
Récent et en cours:
- Crise économique [7]
Rubrique:
Mouvement des indignés en Espagne, Grèce et Israël : de l’indignation à la préparation des combats de classe
- 5836 lectures
Dans le dernier éditorial de la Revue internationale no 146, nous rendions compte de la lutte qui se développait en Espagne [1]. Depuis, la contagion de son exemple s’est propagée jusqu’en Grèce et en Israël [2]. Dans le présent article, nous voulons tirer les leçons de ces mouvements et voir quelles perspectives s’en dégagent face à une situation de faillite du capitalisme et d’attaques féroces contre le prolétariat et la grande majorité de la population mondiale.
Il est indispensable pour les comprendre de rejeter catégoriquement la méthode immédiatiste et empiriste qui prédomine dans la société actuelle. Celle-ci analyse chaque événement en lui-même, hors de tout contexte historique et en l’isolant dans le pays où il apparaît. Cette méthode photographique est un reflet de la dégénérescence idéologique de la classe capitaliste, car "le seul projet que cette classe puisse proposer à l’ensemble de la société est celui de résister au jour le jour, au coup par coup, et sans espoir de réussite, à l’effondrement irrémédiable du mode de production capitaliste" [3].
Une photographie peut nous montrer un personnage heureux arborant un large sourire, mais cela peut occulter qu’il affichait quelques secondes avant ou après un rictus angoissé. Nous ne pouvons comprendre les mouvements sociaux de cette façon. On ne peut les voir qu’en les situant à la lumière du passé qui les a fait mûrir et du futur qu’ils annoncent ; il est nécessaire de les situer dans le cadre mondial et non dans le réduit national où ils apparaissent ; et, surtout, ils doivent être compris dans leur dynamique, non par ce qu’ils sont à un moment donné mais par ce qu’ils peuvent devenir du fait des tendances, forces et perspectives qu’ils contiennent et qui surgiront tôt ou tard à la surface.
Le prolétariat sera-t-il capable de répondre à la crise du capitalisme ?
Nous avons publié, au début du xxie siècle, une série de deux articles intitulés "A l'aube du xxie siècle, pourquoi le prolétariat n'a pas encore renversé le capitalisme ?" [4]. Nous y rappelions que la révolution communiste n’est pas une fatalité et que son avènement dépend de l'union de deux facteurs, l’objectif et le subjectif. Le facteur objectif est donné par la décadence du capitalisme [5] et par le développement d'une crise ouverte de la société bourgeoise faisant la preuve évidente que les rapports de production capitalistes doivent être remplacés par d'autres rapports de production [6] comme le dit l'article. Le facteur subjectif est lié à l’action collective et consciente du prolétariat.
L’article reconnaît que le prolétariat a raté ses rendez-vous avec l’histoire. Lors du premier – la Première Guerre mondiale –, la tentative de riposte par une vague révolutionnaire mondiale en 1917-23 fut défaite ; lors du deuxième – la Grande dépression de 1929 –, il fut absent comme classe autonome ; lors du troisième – la Seconde Guerre mondiale –, non seulement il fut absent mais il crut en outre que la démocratie et l’État-providence, ces mythes manipulés par les vainqueurs, constituaient réellement sa victoire. Par la suite, avec le retour de la crise à la fin des années 1960, il "n'avait pas manqué le rendez-vous (…) mais, en même temps, nous avons pu mesurer la quantité d'obstacles auxquels il s'est affronté depuis et qui ont ralenti d'autant son chemin vers la révolution prolétarienne" [7]. Ces freins se vérifièrent lors d’un nouvel événement de grande envergure – l’effondrement des régimes soi-disant "communistes" en 1989 –, dans lequel non seulement il ne fut pas facteur actif, mais où il fut victime d’une formidable campagne anti-communiste qui le fit reculer tant au niveau de sa conscience que de sa combativité.
Ce que nous pourrions appeler le "cinquième rendez-vous" de l’histoire s’ouvre à partir de 2007. La crise qui se manifeste plus ouvertement démontre l’échec pratiquement définitif des politiques que le capitalisme avait déployées pour accompagner l’émergence de sa crise économique insoluble. L’été 2011 a mis en évidence que les énormes sommes injectées ne peuvent arrêter l’hémorragie et que le capitalisme est entraîné sur la pente de la Grande dépression, d’une gravité bien supérieure à celle de 1929 [8].
Mais, dans un premier temps, et malgré les coups qui pleuvent sur lui, le prolétariat semble également absent. Nous avions envisagé une telle situation lors de notre XVIIIe Congrès international (2009) : "Mais ce seront probablement, dans un premier temps, des combats désespérés et relativement isolés, même s’ils bénéficient d’une sympathie réelle des autres secteurs de la classe ouvrière. C’est pour cela que si, dans la période qui vient, on n’assiste pas à une réponse d’envergure de la classe ouvrière face aux attaques, il ne faudra pas considérer que celle-ci a renoncé à lutter pour la défense de ses intérêts. C’est dans un second temps, lorsqu’elle sera en mesure de résister aux chantages de la bourgeoisie, lorsque s’imposera l’idée que seule la lutte unie et solidaire peut freiner la brutalité des attaques de la classe régnante, notamment lorsque celle-ci va tenter de faire payer à tous les travailleurs les énormes déficits budgétaires qui s’accumulent à l’heure actuelle avec les plans de sauvetage des banques et de "relance" de l’économie, que des combats ouvriers de grande ampleur pourront se développer beaucoup plus" [9].
Les mouvements actuels en Espagne, Israël et Grèce montrent que le prolétariat commence à assumer ce "cinquième rendez-vous de l’histoire", à se préparer pour y être présent, à se donner les moyens de vaincre [10].
Dans la série citée plus haut, nous disions que deux des piliers sur lesquels le capitalisme – tout au moins dans les pays centraux – s’est appuyé pour maintenir le prolétariat sous sa coupe étaient la démocratie et ce que l’on nomme "État-providence". Ce que révèlent les trois mouvements actuels c'est que ces piliers commencent à être contestés, bien que confusément encore, contestation qui va se nourrir de l’évolution catastrophique de la crise.
La contestation de la démocratie
La colère contre les politiciens et, en général, contre la démocratie s’est manifestée dans les trois mouvements, comme s’est aussi manifestée l’indignation vis-à-vis du fait que les riches et leur personnel politique soient toujours plus riches et corrompus, que la grande majorité de la population soit traitée comme une marchandise au service des bénéfices scandaleux de la minorité exploiteuse, marchandise jetée à la poubelle quand les "marchés ne vont pas bien" ; les programmes d’austérité drastiques aussi ont été dénoncés, programmes dont personne ne parle jamais lors des campagnes électorales et qui pourtant deviennent la principale occupation de ceux qui sont élus.
Il est évident que ces sentiments et ces attitudes ne sont pas nouveaux : dire du mal des politiciens par exemple a été monnaie courante au cours de ces trente dernières années. Il est clair aussi que ces sentiments peuvent être détournés vers des impasses comme ont tenté de le faire avec persévérance les forces de la bourgeoisie en action dans ces trois mouvements : "vers une démocratie participative", vers un "renouveau de la démocratie", etc.
Mais ce qui est nouveau et revêt une importance significative, c’est que ces thème qui, qu’on le veuille ou non, mettent en question la démocratie, l’État bourgeois et ses appareils de domination, sont l’objet de débats lors d’innombrables assemblées. On ne peut comparer des individus qui ruminent leur dégoût tout seuls, atomisés, passifs et résignés avec ces mêmes individus qui l’expriment collectivement dans des assemblées. Au-delà des erreurs, des confusions, des impasses qui s’y expriment inévitablement et qui doivent être débattues avec la plus grande patience et énergie, l’essentiel se trouve précisément dans le fait que les problèmes soient posés publiquement, ce qui contient en puissance une évidente politisation des grandes masses et, aussi, le principe d’une mise en question de cette démocratie qui a rendu tant de services au capitalisme tout au long du dernier siècle.
La fin du prétendu "État-providence"
Après la Seconde Guerre mondiale, le capitalisme instaura ce qui fut appelé "l’État-providence" [11]. Celui-ci a constitué un des principaux piliers de la domination capitaliste au cours des 70 dernières années. Il a créé l’illusion que le capitalisme aurait dépassé les aspects les plus brutaux de sa réalité : l’État-providence garantirait une sécurité face au chômage, pour la retraite, la gratuité des soins de santé et d’éducation, des logements sociaux, etc.
Cet "État social", complément de la démocratie politique, a subi des amputations significatives au cours des 25 dernières années et s’achemine à présent vers sa disparition pure et simple. En Grèce, en Espagne ou en Israël (où c'est surtout la pénurie de logements qui a polarisé les jeunes), l’inquiétude créée par cette suppression des minima sociaux était au centre des mobilisations. Il est bien évident que la bourgeoisie a tenté de les dévoyer vers des "réformes" de la Constitution, l'adoption de lois qui "garantissent" ces prestations, etc. Mais la vague d’inquiétude croissante va contribuer à remettre en cause ces digues qui ont vocation de contrôler les travailleurs.
Les mouvements des Indignés, point culminant de huit années de luttes
Le cancer du scepticisme domine l’idéologie actuelle et infecte également le prolétariat et ses minorités révolutionnaires. Comme on l'a dit plus haut, le prolétariat a raté tous les rendez-vous que l’histoire lui avait donnés durant presqu’un siècle de décadence capitaliste et il en résulte un doute angoissant dans ses rangs concernant sa propre identité et ses capacités, à tel point que même lors de manifestations de combativité, certains rejettent jusqu’au terme de "classe ouvrière" [12]. Ce scepticisme est d’autant plus fort qu’il est alimenté par la décomposition du capitalisme [13] : le désespoir, l’absence de projet concret concernant l’avenir favorisent l’incrédulité et la méfiance envers toute perspective d’action collective.
Les mouvements en Espagne, Israël et Grèce – malgré toutes les faiblesses qu’ils contiennent – commencent à fournir un remède efficace contre le cancer du scepticisme, de par leur existence même et par ce qu’ils signifient dans la continuité des luttes et des efforts de prise de conscience que réalise le prolétariat mondial depuis 2003 [14]. Ils ne sont pas un orage qui éclate soudain dans un ciel d’azur, ils sont le fait d’une lente condensation ces huit dernières années de petites nuées, de crachins, d’éclairs timides qui a progressé jusqu’à atteindre une qualité nouvelle.
Le prolétariat commence à récupérer depuis 2003 de la longue période de recul dans sa conscience et dans sa combativité qu’il a subi à partir des événements de 1989. Ce processus suit un rythme lent, contradictoire et très tortueux, se manifestant par :
– une succession de luttes assez isolées dans divers pays tant du centre que de la périphérie, caractérisées par des manifestations "chargées de futur" : recherche de solidarité, tentatives d’auto-organisation, présence des nouvelles générations, réflexions sur l’avenir ;
– un développement de minorités internationalistes qui recherchent une cohérence révolutionnaire, se posent de nombreuses questions et recherchent le contact entre elles, débattent, tracent des perspectives…
En 2006 éclatent deux mouvements – la lutte contre le CPE en France [15] et la grève massive des travailleurs de Vigo en Espagne – qui, malgré la distance, la différence de conditions ou d’âge, présentent des traits similaires : assemblées générales, extension à d’autres secteurs, massivité des manifestations… C’est comme un premier coup de semonce qui, apparemment, n’a pas de suite [16].
Un an plus tard un embryon de grève massive éclate en Égypte à partir d’une grande usine de textile. Début 2008 éclatent de nombreuses luttes isolées les unes des autres mais simultanées dans un grand nombre de pays, de la périphérie au centre du capitalisme. D’autres mouvements se distinguent, comme la prolifération de révoltes de la faim dans 33 pays durant le premier trimestre 2008. En Égypte, elles sont soutenues et en partie prises en charge par le prolétariat. Fin 2008 éclate la révolte de la jeunesse ouvrière en Grèce, appuyée par une partie du prolétariat. Nous remarquons aussi des germes de réactions internationalistes en 2009 à Lindsay (Grande-Bretagne) et une grève généralisée explosive dans le sud de la Chine (en juin).
Après le recul initial du prolétariat face au premier impact de la crise, comme nous l’avons signalé, celui-là commence à lutter de façon bien plus décidée et, en 2010, la France est secouée par des mouvements massifs de protestation contre la réforme des retraites, des mouvements au cours desquels apparaissent des tentatives d’assemblées interprofessionnelles ; la jeunesse britannique se révolte en décembre contre l’augmentation brutale des coûts de scolarité. L’année 2011 voit les grandes révoltes sociales en Égypte et en Tunisie. Le prolétariat semble prendre de l’élan pour un nouveau saut en avant : le mouvement des Indignés en Espagne, puis en Grèce et en Israël.
Ce mouvement appartient-il à la classe ouvrière ?
Ces trois derniers mouvements ne peuvent se comprendre hors du contexte que nous venons d’analyser. Ils sont comme un premier puzzle qui unit tous les éléments apportés tout au long des huit dernières années. Mais le scepticisme est très fort et beaucoup se demandent : peut-on parler de mouvements de la classe ouvrière puisque celle-ci ne se présente pas comme telle et qu’ils ne sont pas renforcés par des grèves ou des assemblées sur les lieux de travail ?
Le mouvement se nomme "Les Indignés", concept très valable pour la classe ouvrière [17] mais qui ne révèle pas immédiatement ce dont il est porteur puisqu'il ne s’identifie pas directement avec sa nature de classe. Deux facteurs lui confèrent essentiellement une apparence de révolte sociale :
La perte de l’identité de classe
Le prolétariat a traversé une longue période de recul qui lui a infligé des dommages significatifs en ce qui concerne sa confiance en lui-même et la conscience de sa propre identité : "Après l’effondrement du bloc de l’Est et des régimes soi-disant 'socialistes', les campagnes assourdissantes sur la 'fin du communisme', voire sur la 'fin de la lutte de classe', ont porté un coup sévère à la conscience au sein de la classe ouvrière de même qu’à sa combativité. Le prolétariat a subi alors un profond recul sur ces deux plans, un recul qui s’est prolongé pendant plus de dix ans (…) D’autre part, [la bourgeoisie] a réussi à créer au sein de la classe ouvrière un fort sentiment d’impuissance du fait de l’incapacité de celle-ci à mener des luttes massives" [18]. Ceci explique en partie pourquoi la participation du prolétariat comme classe n’a pas été dominante mais qu’il fut présent à travers la participation des individus ouvriers (salariés, chômeurs, étudiants, retraités…) qui tentent de se clarifier, de s'impliquer selon leur instinct mais à qui manquent la force, la cohésion et la clarté que donne le fait de s’assumer collectivement comme classe.
Il découle de cette perte d’identité que le programme, la théorie, les traditions, les méthodes du prolétariat ne sont pas reconnus somme siens par l’immense majorité des ouvriers. Le langage, les formes d’action, les symboles mêmes qui apparaissent dans le mouvement des Indignés s'abreuvent à d’autres sources. C’est une faiblesse dangereuse qui doit être patiemment combattue pour que se réalise une réappropriation critique de tout le patrimoine théorique, d’expérience, de traditions que le mouvement ouvrier a accumulé au long de ces deux derniers siècles.
La présence de couches sociales non prolétariennes
Parmi les Indignés il y a une forte présence de couches sociales non prolétariennes, en particulier une couche moyenne en voie de prolétarisation. En ce qui concerne Israël, notre article soulignait : "Une autre tactique pour minimiser [ces événements] est de les cataloguer comme représentatifs du mouvement des classes moyennes. Il est vrai que, comme pour tous les autres mouvements, nous assistons à une révolte sociale très large qui peut exprimer le mécontentement de beaucoup de couches différentes de la société, allant des petits entrepreneurs jusqu'aux ouvriers à la chaîne, qui sont toutes touchées par la crise économique mondiale, par l'écart grandissant entre les riches et les pauvres, et, dans un pays comme Israël par l'aggravation des conditions de vie à cause des exigences insatiables de l'économie de guerre. Mais le terme de 'classe moyenne' est devenu un synonyme de paresseux, un terme 'fourre-tout' pour parler de quelqu'un qui a reçu une certaine éducation ou bénéficie d'un travail et, en Israël comme en Afrique du Nord, en Espagne ou en Grèce, un nombre croissant de jeunes gens instruits sont poussés dans les rangs du prolétariat, travaillant dans des emplois précaires mal rémunérés et peu qualifiés où l'on peut embaucher n'importe qui" [19].
Bien que le mouvement semble vague et mal défini, cela ne peut remettre en cause son caractère de classe, surtout si nous considérons les choses dans leur dynamique, dans la perspective de l’avenir, comme le font les camarades du TPTG à propos des mouvements en Grèce : "Ce qui inquiète les politiciens de tous bords dans ce mouvement des assemblées, c’est que la colère et l’indignation prolétariennes (et de couches petite-bourgeoises) grandissantes ne s’exprime plus par le circuit médiatique des partis politiques et des syndicats. Il n’est donc pas aussi contrôlable et il est potentiellement dangereux pour le système représentatif du monde politique et syndical en général" [20].
La présence du prolétariat n’est pas visible en tant que force dirigeante du mouvement ni à travers une mobilisation à partir des centres de travail. Elle réside dans la dynamique de recherche, de clarification, de préparation du terrain social, de reconnaissance du combat qui se prépare. Là se trouve toute son importance, malgré le fait que ce ne soit qu’un petit pas en avant extrêmement fragile. Sur la Grèce, les camarades du TPTG disent que le mouvement "constitue une expression de la crise des rapports de classe et de la politique en général. Aucune autre lutte ne s’est exprimée de façon aussi ambivalente et explosive au cours des dernières décennies" [21] et sur Israël, un journaliste signale, avec ses mots : "ce n'a jamais été l'oppression qui a maintenu l'ordre social en Israël, concernant la communauté juive. C'est l'endoctrinement qui s'en est chargé – l'idéologie dominante, pour utiliser le terme préféré des théoriciens critiques. Et c'est cet ordre culturel qui a été ébranlé dans ce tourbillon de protestations. Pour la première fois, une grande partie de la classe moyenne juive – il est trop tôt pour évaluer l'importance que celle-ci représente – a reconnu que son problème n'était pas vis-à-vis d'autres Israéliens, ni avec les Arabes, ni avec tel ou tel politicien mais avec l'ordre social tout entier, avec le système dans son ensemble. En ce sens, c'est un événement inédit dans l'histoire d'Israël" [22].
Les caractéristiques des luttes futures
Dans cette optique, nous pouvons comprendre les traits de ces luttes comme des caractéristiques que les futures luttes pourront reprendre avec un esprit critique et développer à des niveaux supérieurs :
– l’entrée en lutte de nouvelles générations du prolétariat, avec cependant une différence importante avec les mouvements de 1968 : alors que la jeunesse d’alors tendait à repartir de zéro et considérait que les aînés étaient "vaincus et embourgeoisés", nous voyons aujourd’hui une lutte unie des différentes générations de la classe ouvrière ;
– l’action directe des masses : la lutte a gagné la rue, les places ont été occupées. Les exploités s’y sont retrouvés directement, ils ont pu vivre, discuter et agir ensemble ;
– le début de la politisation : au-delà des fausses réponses qui sont et seront données, il est important que les grandes masses commencent à s’impliquer directement et activement dans les grandes questions de la société, c’est le début de leur politisation comme classe ;
– les assemblées : elles sont liées à la tradition prolétarienne des conseils ouvriers de 1905 et 1917 en Russie, qui s’étendirent en Allemagne et à d'autres pays pendant la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23. Elles réapparurent en 1956 en Hongrie et en 1980 en Pologne. Elles sont l’arme de l’unité, du développement de la solidarité, de la capacité de compréhension et de décision des masses ouvrières. Le slogan "Tout le pouvoir aux assemblées !", très populaire en Espagne, exprime la naissance d’une réflexion-clé sur des questions telles que l’État, le double pouvoir, etc. ;
– la culture du débat : la clarté qui inspire la détermination et l’héroïsme des masses prolétariennes ne se décrète pas, pas plus qu’elle n’est le fruit d’un endoctrinement réalisé par une minorité détentrice de "la vérité" : elle est le produit conjugué de l’expérience, de la lutte et particulièrement du débat. La culture du débat a été très présente dans ces trois mouvements : tout a été soumis à la discussion, rien de ce qui est politique, social, économique, humain, n’a échappé à la critique de ces immenses agoras improvisées. Comme nous le disons dans l’introduction à l’article des camarades de Grèce, ce fait a une énorme importance : "l’effort déterminé pour contribuer à l’émergence de ce que les camarades de TPTG appellent 'une sphère prolétarienne publique' qui rendra possible à un nombre grandissant d’éléments de notre classe non seulement d’œuvrer pour la résistance aux attaques capitalistes contre nos conditions de vie mais aussi de développer les théories et les actions qui conduisent ensemble à une nouvelle façon de vivre" [23] ;
– la façon d'envisager la question de la violence : le prolétariat "a été confronté depuis le début à la violence extrême de la classe exploiteuse, la répression lorsqu'il essayait de défendre ses intérêts, la guerre impérialiste mais aussi à la violence quotidienne de l'exploitation. Contrairement aux classes exploiteuses, la classe porteuse du communisme ne porte pas avec elle la violence, et même si elle ne peut s'épargner l'utilisation de celle-ci, ce n'est jamais en s'identifiant avec elle. En particulier, la violence dont elle devra faire preuve pour renverser le capitalisme, et dont elle devra se servir avec détermination, est nécessairement une violence consciente et organisée et doit donc être précédée de tout un processus de développement de sa conscience et de son organisation à travers les différentes luttes contre l'exploitation" [24]. Comme lors du mouvement des étudiants en 2006, la bourgeoisie a tenté plusieurs fois d’entraîner le mouvement des Indignés (particulièrement en Espagne) dans le piège des affrontements violents contre la police dans un contexte de dispersion et de faiblesse, pour ainsi pouvoir discréditer le mouvement et faciliter son isolement. Ces pièges furent évités et une réflexion active sur la question de la violence a commencé à voir le jour [25].
Faiblesses et confusions à combattre
Nous ne voulons pas le moins du monde glorifier ces mouvements. Rien n’est plus étranger à la méthode marxiste que de faire d’une lutte déterminée, pour importante et riche qu’elle soit, un modèle définitif, achevé et monolithique qu’il faudrait suivre à la lettre. Nous comprenons parfaitement ses faiblesses et ses difficultés avec un regard lucide.
La présence d’une "aile démocrate"
Celle-ci pousse à la réalisation d’une "vraie démocratie". Cette démarche est représentée par plusieurs courants, y compris des courants de droite comme en Grèce. Il est évident que les medias et les politiciens s’appuient sur cette aile pour faire en sorte que l’ensemble du mouvement s’identifie à elle.
Les révolutionnaires doivent combattre énergiquement toutes les mystifications, les fausses mesures, les arguments fallacieux de cette tendance. Cependant, pourquoi existe-t-il encore une forte propension à se laisser séduire par les chants de sirène de la démocratie, après tant d’années de tromperies, de mensonges et de déceptions ? Nous pouvons en donner trois raisons. La première se trouve dans le poids des couches sociales non prolétariennes très réceptives aux mystifications démocratiques et à l’interclassisme. La deuxième réside dans la puissance des confusions et des illusions démocratiques très présentes encore dans la classe ouvrière, particulièrement chez les jeunes qui n’ont pas encore pu développer une expérience politique. La troisième, enfin, se trouve dans la pression de ce que nous nommons la décomposition sociale et idéologique du capitalisme qui favorise la tendance à chercher refuge dans une entité "au dessus des classes et des conflits", c’est-à-dire l’État, qui pourrait prétendument apporter un certain ordre, la justice et la médiation.
Mais il y a une cause plus profonde sur laquelle il est important d’attirer l’attention. Dans Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, Marx constate que "Les révolutions prolétariennes (…) reculent constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts" [26]. Aujourd’hui, les événements mettent en évidence la faillite du capitalisme, la nécessité de le détruire et de construire une nouvelle société. Pour un prolétariat qui doute de ses propres capacités, qui n’a pas récupéré son identité, cela crée et continuera encore à créer pendant un certain temps la tendance à se raccrocher à des branches pourries, à de fausses mesures "de réformes" et de "démocratisation", même en ayant des doutes. Tout ceci, indiscutablement, donne une marge de manœuvre à la bourgeoisie qui lui permet de semer la division et la démoralisation et, en conséquence, de rendre plus difficile encore pour le prolétariat la récupération de cette confiance en soi et de cette identité de classe.
Le poison de l’apolitisme
Il s’agit d’une vieille faiblesse que traîne le prolétariat depuis 1968 et qui trouve son origine dans l’énorme déception et le profond scepticisme provoqués par la contre-révolution stalinienne et social-démocrate, qui induit la tendance à croire que toute option politique, y compris celles qui se réclament du prolétariat, n’est qu’un vil mensonge, contiendrait en son sein le ver de la trahison et de l’oppression. C’est ce dont profitent largement les forces de la bourgeoisie qui, occultant leur propre identité et imposant la fiction d’une intervention "en tant que libres citoyens", opèrent dans le mouvement pour prendre le contrôle des assemblées et les saboter de l’intérieur. Les camarades du TPTG le mettent clairement en évidence : "Au début, il y avait un esprit communautaire dans l’effort d’auto-organiser l’occupation de la place et officiellement les partis politiques n’étaient pas tolérés. Cependant, les gauchistes et, en particulier, ceux qui venaient de SYRIZA (coalition de la Gauche radicale) furent rapidement impliqués dans l’assemblée de Syntagma et conquirent des postes importants dans le groupe qui avait été formé pour gérer l’occupation de la place Syntagma et, plus spécifiquement, dans le groupe pour le 'secrétariat de soutien' et celui responsable de la 'communication'. Ces deux groupes sont les plus importants parce qu’ils organisent les ordres du jour des assemblées aussi bien que la tenue des discussions. On doit remarquer que ces gens ne faisaient pas état de leur affiliation politique et qu’ils apparaissaient comme des 'individus'" [27].
Le danger du nationalisme
Celui-ci est plus présent en Grèce et en Israël. Comme le dénonçaient les camarades du TPTG, "le nationalisme (principalement sous sa forme populiste) est dominant, favorisé à la fois par les diverses cliques d’extrême droite et par les partis de gauche et les gauchistes. Même pour beaucoup de prolétaires et de petit-bourgeois frappés par la crise qui ne sont pas affiliés à des partis politiques, l’identité nationale apparaît comme un dernier refuge imaginaire quand tout le reste s’écroule rapidement. Derrière les mots d’ordre contre 'le gouvernement vendu à l’étranger' ou pour 'le salut du pays', 'la souveraineté nationale', la revendication d’une 'nouvelle constitution' apparaît comme une solution magique et unificatrice" [28].
La réflexion des camarades est aussi juste que profonde. La perte de l’identité et de confiance du prolétariat en sa propre force, le lent processus que traverse la lutte dans le reste du monde, favorise la tendance à "s’accrocher à la communauté nationale", refuge utopique face à un monde hostile et plein d’incertitudes.
Ainsi, par exemple, les conséquences des coupes dans la santé et l’éducation, le problème réel créé par l’affaiblissement de ces services, sont utilisés pour enfermer les luttes derrière les barreaux nationalistes de la revendication d’une "bonne éducation" (car celle-ci nous rendrait compétitifs sur le marché mondial), et d’une "santé au service de tous les citoyens".
La peur et la difficulté pour assumer la confrontation de classe
L’angoissante menace du chômage, la précarité massive, la fragmentation croissante des employés – divisés, sur un même lieu de travail, dans un réseau inextricable de sous-traitants et par une incroyable variété de modalités d’embauche - provoquent un puissant effet intimidateur et rendent plus difficile le regroupement des travailleurs pour la lutte. Cette situation ne peut être dépassée par des appels volontaristes à la mobilisation, pas plus qu’en morigénant les travailleurs pour leur supposée "lâcheté" ou "servilité".
De ce fait, le pas vers la mobilisation massive des chômeurs, des précaires, des centres de travail et d’étude, est rendu plus difficile que ce qu’il pourrait sembler à première vue, difficulté provoquant à son tour une hésitation, un doute et une tendance à s’accrocher à des "assemblées" qui deviennent tous les jours plus minoritaires et dont "l’unité" ne favorise que les forces bourgeoises qui agissent en leur sein. Ceci donne une marge de manœuvre à la bourgeoisie pour préparer ses coups tordus destinés à saboter les assemblées générales de l’intérieur. C’est ce que dénoncent justement les camarades du TPPG : "La manipulation de la principale assemblée sur la place Syntagma (il y en a plusieurs autres dans différents quartiers d’Athènes et dans d’autres villes) par des membres 'non déclarés' des partis et des organisations de gauche est évidente et c’est un obstacle réel à une direction de classe du mouvement. Cependant, à cause de la profonde crise de légitimité du système politique de représentation en général, eux aussi devaient cacher leur identité politique et garder un équilibre – pas toujours réussi – entre d’un côté un discours général et abstrait sur 'l’autodétermination', la 'démocratie directe', 'l’action collective', 'l’antiracisme', le 'changement social', etc., et de l’autre côté contenir le nationalisme extrême, le comportement de voyou de quelques individus d’extrême-droite qui participaient aux regroupements sur la place" [29].
Regarder le futur avec sérénité
S’il est évident que "pour que vive l’humanité, le capitalisme doit mourir" [30], le prolétariat est encore loin d’avoir atteint la capacité d’exécuter la sentence. Le mouvement des Indignés pose une première pierre.
Dans la série mentionnée plus haut, nous disions : "Une des raisons pour lesquelles les prévisions des révolutionnaires du passé sur l'échéance de la révolution ne se sont pas réalisées est qu'ils ont sous-estimé la force de la classe dirigeante, particulièrement son intelligence politique" [31]. Cette capacité de la bourgeoisie à utiliser son intelligence politique contre les luttes est aujourd’hui plus vive que jamais ! Ainsi, par exemple, les mouvements des Indignés dans les trois pays ont été complètement occultés ailleurs, sauf quand il s’en est donné une version light de "rénovation démocratique". Autre exemple, la bourgeoisie britannique a été capable de profiter du mécontentement pour le canaliser vers une révolte nihiliste qui lui a servi de prétexte pour renforcer la répression et intimider la moindre riposte de classe [32].
Les mouvements des Indignés ont posé une première pierre, dans le sens où ils ont fait les premiers pas pour que le prolétariat récupère sa confiance en lui-même et sa propre identité de classe, mais cet objectif reste encore très lointain car il nécessite le développement de luttes massives sur un terrain directement prolétarien qui mette en évidence que la classe ouvrière est capable d’offrir, face à la débâcle du capitalisme une alternative révolutionnaire aux couches sociales non exploiteuses.
Nous ignorons comment nous parviendrons à cette perspective et nous devons rester vigilants envers les capacités et les initiatives des masses, comme celle du 15 mai en Espagne. Ce dont nous sommes sûrs, c’est que l’extension internationale des luttes sera un facteur essentiel dans ce sens.
Les trois mouvements ont planté le germe d’une conscience internationaliste : lors du mouvement des Indignés en Espagne, il se disait que sa source d’inspiration était la place Tahrir en Égypte [33] ; il avait cherché une extension internationale de la lutte, malgré que cela se soit fait dans la plus grande confusion. De leur côté, les mouvements en Israël et en Grèce ont déclaré explicitement qu’ils suivaient l’exemple des Indignés d’Espagne. Les manifestants d’Israël exhibaient des pancartes qui disaient : "Moubarak, Assad, Netanyahou : tous pareils !", ce qui montre non seulement un début de conscience de qui est l’ennemi mais une compréhension au moins embryonnaire du fait que leur lutte se mène avec les exploités de ces pays et non contre eux dans le cadre de la défense nationale [34]. "A Jaffa, des dizaines de manifestants arabes comme juifs portaient des pancartes écrites à la fois en Hébreu et en Arabe où on pouvait lire "Les Arabes et les Juifs veulent un logement au prix abordable" et "Jaffa ne veut pas d'offres de logements réservées aux riches." (…) Il y a eu des manifestations de Juifs et d'Arabes pour protester contre l'expulsion de ces derniers, partant du quartier de Cheikh Jarrah. A Tel-Aviv, des contacts ont été établis avec les résidents de camps de réfugiés dans les territoires occupés, qui ont visité à leur tour les villages de tentes et ont engagé des discussions avec les manifestants" [35]. Les mouvements en Égypte et en Tunisie comme ceux en Israël changent la donne de la situation, dans une partie de la planète qui est probablement le centre principal de confrontation impérialiste du monde. Comme le dit notre article, "L'actuelle vague de révoltes contre l'austérité capitaliste ouvre la porte à une tout autre solution : la solidarité de tous les exploités face à toutes les divisions religieuses ou nationales ; la lutte de classes dans tous les pays dans le but de faire la révolution dans le monde entier qui sera la négation des frontières nationales et l'abolition des États. Il y a un an ou deux, une telle perspective aurait semblé totalement utopique à la plupart des gens. Aujourd'hui, un nombre croissant de personnes voit la révolution mondiale comme une alternative réaliste à l'ordre du monde capitaliste en train de s'effondrer" [36].
Les trois mouvements ont contribué à la cristallisation d’une aile prolétarienne : tant en Grèce qu'en Espagne, mais aussi en Israël [37], est en train d’émerger une "aile prolétarienne" à la recherche de l’auto-organisation, de la lutte intransigeante à partir de positions de classe et du combat pour la destruction du capitalisme. Les problèmes mais également les potentialités et les perspectives de cette large minorité ne peuvent être abordés dans le cadre de cet article. Ce qui est certain, c’est qu’elle constitue une arme vitale à qui le prolétariat a donné vie pour préparer ses combats futurs.
C. Mir, 23-9-2011
1. Cf. https://fr.internationalism.org/node/4752 [94]. Dans la mesure où cet article analysait en détail cette expérience, nous ne la répéterons pas ici.
2. Cf. les articles sur ces mouvements sur https://fr.internationalism.org/node/4776 [95].
3. Révolution communiste ou destruction de l’humanité, Manifeste du IXe Congrès du CCI, 1991.
4. Cf. Revue internationale nos 103 [96] et 104 [96].
5. Pour débattre de ce concept crucial de décadence du capitalisme, voir entre autres la Revue internationale no 146, "Pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme [97]".
6. Revue internationale no 103, "A [96] [96]l'aube [96] [96]du [96] [96]xxi [96]e [96] [96]siècle, [96] [96]pourquoi [96] [96]le [96] [96]prolétariat [96] [96]n'a [96] [96]pas [96] [96]encore [96] [96]renversé [96] [96]le [96] [96]capitalisme ? [96]" : "La deuxième condition de la révolution prolétarienne consiste dans le développement d'une crise ouverte de la société bourgeoise faisant la preuve évidente que les rapports de production capitalistes doivent être remplacés par d'autres rapports de production."
7. Revue internationale no 104, "A [98] [98]l'aube [98] [98]du [98] [98]xxi [98]e [98] [98]siècle, [98] [98]pourquoi [98] [98]le [98] [98]prolétariat [98] [98]n'a [98] [98]pas [98] [98]encore [98] [98]renversé [98] [98]le [98] [98]capitalisme ? II [98]".
8. Cf. "Crise [99] [99]économique [99] [99]mondiale : [99] [99]un [99] [99]été [99] [99]meurtrier [99]".
9. Cf. Revue internationale no 138, "Résolution [100] [100]sur [100] [100]la [100] [100]situation [100] [100]internationale [100]".
10. "Puisqu'il est privé de tout point d'appui économique au sein du capitalisme, sa seule véritable force, outre son nombre et son organisation, est sa capacité à prendre clairement conscience de la nature, des buts et des moyens de son combat", Revue internationale no 103, op. cit.
11. Les nationalisations, de même qu'un certain nombre de mesures 'sociales' (comme une plus grande prise en charge par l'État du système de santé) sont des mesures parfaitement capitalistes (…) Les capitalistes ont tout intérêt à disposer d'ouvriers en bonne santé (…) Cependant, ces mesures capitalistes sont présentées comme des 'victoires ouvrières'", Revue internationale no 104, op. cit.
12. Nous ne pouvons développer ici pourquoi la classe ouvrière est la classe révolutionnaire de la société non plus que pourquoi sa lutte représente l’avenir pour toutes les couches sociales non-exploiteuses, question brûlante comme nous le verrons plus loin lors du mouvement des Indignés. Le lecteur pourra trouver des éléments de réponse pour alimenter le débat sur cette question dans la série de deux articles publiés dans les nos 73 et 74 de la Revue internationale, "Qui [101] [101]peut [101] [101]changer [101] [101]le [101] [101]monde ? [101]".
13. Cf. "La [64] [64]décomposition, [64] [64]phase [64] [64]ultime [64] [64]de [64] [64]la [64] [64]décadence [64] [64]du [64] [64]capitalisme [64]", Revue internationale no 62.
14. Cf. les articles d’analyse de la lutte de classe dans notre Revue internationale.
15. Cf. Revue internationale no 125, "Thèses [2] [2]sur [2] [2]le [2] [2]mouvement [2] [2]des [2] [2]étudiants [2] [2]du [2] [2]printemps [2] [2]2006 [2] [2]en [2] [2]France [2]".
16. La bourgeoisie prend bien garde de cacher ces événements : les révoltes nihilistes des banlieues en novembre 2005 en France sont beaucoup plus connues, y compris dans les milieux politisés, que le mouvement conscient des étudiants cinq mois plus tard.
17. L’indignation n’est ni la résignation ni la haine. Contre la dynamique insupportable du capitalisme, la résignation exprime une passivité, une tendance à rejeter sans voir comment affronter. La haine, de son côté, exprime un sentiment actif puisque le rejet se transforme en lutte, mais il s’agit d’un combat aveugle, privé de perspectives et de réflexion pour élaborer un projet alternatif, elle est purement destructive, assemblant une somme de ripostes individuelles mais ne générant rien de collectif. L’indignation exprime la transformation active du rejet accompagnée par la tentative de lutter consciemment, recherchant l’élaboration concomitante d’une alternative, elle est donc collective et constructive. "… L’indignation amenant à la nécessité d’une régénération morale, d’un changement culturel, les propositions faites – même si elles peuvent parfois paraître naïves ou farfelues – expriment un désir, même timide ou confus, de vouloir "vivre autrement"", "De [102] [102]la [102] [102]Place [102] [102]Tahrir [102] [102]à [102] [102]la [102] [102]Puerta [102] [102]del [102] [102]Sol [102]", ICC on-line.
18. Cf. Revue internationale no 130, "Résolution [103] [103]sur [103] [103]la [103] [103]situation [103] [103]internationale [103]".
19. Cf. ICC on-line, "Révoltes [104] [104]sociales [104] [104]en [104] [104]Israël : [104] [104]Moubarak, [104] [104]Assad, [104] [104]Netanyahou : [104] [104]tous [104] [104]pareils ! [104]".
20. ICC on-line, "Une [95] [95]contribution [95] [95]du [95] [95]TPTG [95] [95]sur [95] [95]le [95] [95]mouvement [95] [95]des [95] [95]'Indignés' [95] [95]en [95] [95]Grèce [95]".
21. Idem.
22. "Révoltes sociales en Israël…", op.cit.
23. "Une contribution du TPTG", op. cit.
24. Revue internationale no 125, "Thèses [2] [2]sur [2] [2]le [2] [2]mouvement [2] [2]des [2] [2]étudiants [2] [2]du [2] [2]printemps [2] [2]2006 [2] [2]en [2] [2]France [2]".
25. Cf CCI-on line, “Qu [105]’ [105]y [105] [105]a-t-il [105] [105]derrière [105] [105]la [105] [105]campagne [105] [105]contre [105] [105]les [105] [105]"violents" [105] [105]autour [105] [105]des [105] [105]incidents [105] [105]de [105] [105]Barcelone ? [105]".
26. Karl Marx, Le [106] [106]18 [106] [106]Brumaire [106] [106]de [106] [106]Louis [106] [106]Bonaparte [106].
27. "Une contribution du TPTG…", op. cit. Cf. aussi ICC on-line, "'L'apolitisme' [107] [107]est [107] [107]une [107] [107]mystification [107] [107]dangereuse [107] [107]pour [107] [107]la [107] [107]classe [107] [107]ouvrière [107]".
28. Idem.
29. Idem.
30. Mot d’ordre de la Troisième Internationale.
31. Revue internationale no 104, op. cit.
32. Cf. "Les [108] [108]émeutes [108] [108]en [108] [108]Grande-Bretagne [108] [108]et [108] [108]la [108] [108]perspective [108] [108]sans [108] [108]avenir [108] [108]du [108] [108]capitalisme [108]".
33. La "Plaza de Cataluña" fut rebaptisée par l’Assemblée "Place Tahrir", ce qui non seulement affirme une volonté internationaliste mais en outre constitue un camouflet au nationalisme catalan qui considère que cette place est son plus beau fleuron.
34. Cité dans "Révoltes sociales en Israël", op. cit. : "Un animateur interrogé sur le réseau RT News a demandé si les manifestations avaient été inspirées par les événements dans les pays arabes. Il a répondu 'Ce qui s'est passé sur la place Tahrir a eu beaucoup d'influence. Cela garde beaucoup d'influence, bien sûr. C'est quand les gens comprennent qu'ils ont le pouvoir, qu'ils peuvent s'organiser eux-mêmes, ils n'ont plus besoin d'un gouvernement pour leur dire ce qu'ils doivent faire, ils peuvent commence à dire aux gouvernements ce qu'ils veulent'".
35. Idem.
36. Idem.
37. Dans ce mouvement, "certains ont ouvertement mis en garde contre le danger que le gouvernement pourrait provoquer des affrontements militaires ou même une nouvelle guerre pour restaurer 'l'union nationale' et diviser le mouvement", (idem), ce qui, même encore implicitement, révèle une prise de distance vis-à-vis de l’État israélien d’Union nationale au service de l’économie de guerre et de la guerre.
Récent et en cours:
- Indignés [109]
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique (III) : les années 1920
- 3546 lectures
Les années 1920 : Face au développement des luttes ouvrières la bourgeoisie française réorganise son dispositif répressif
1923 : "l’accord de Bordeaux" ou le pacte d’une "collaboration de classes"
C’est cette année-là que fut signé "l’accord de Bordeaux", un "pacte d’entente" conclu entre le milieu économique colonial 1 et Blaise Diagne, le premier député africain siégeant à l’Assemblée nationale française. En effet, ayant tiré les leçons de la magnifique grève insurrectionnelle de mai 1914 à Dakar et de ses prolongements les années suivantes 2, la bourgeoisie française se devait de réorganiser son dispositif politique face à la montée inexorable du jeune prolétariat de sa colonie africaine. Ce fut dans ce cadre qu’elle décida de jouer à fond la carte de Blaise Diagne en faisant de lui le "médiateur/pacificateur" des conflits entre les classes, en fait un vrai contre-révolutionnaire. En effet, au lendemain de son élection comme député et en tant que témoin majeur du mouvement insurrectionnel contre le pouvoir colonial dans lequel il avait lui-même été impliqué au départ, Diagne se trouva devant trois possibilités lui permettant de jouer un rôle historique à l’issue de cet événement : 1) profiter de l’affaiblissement politique de la bourgeoisie coloniale au lendemain de la grève générale, dont elle sortit défaite, pour déclencher une "lutte de libération nationale" ; 2) militer pour le programme communiste en portant le drapeau de la lutte prolétarienne dans la colonie, en profitant notamment du succès de la grève ; 3) jouer sa carte politique personnelle en s’alliant avec la bourgeoisie française qui lui tendait la main à ce moment-là.
Finalement Blaise Diagne décida de choisir cette dernière voie, à savoir l’alliance avec la puissance coloniale. En réalité derrière cet acte dit "accord de Bordeaux", la bourgeoisie française ne manifestait pas seulement sa crainte de la classe ouvrière en effervescence dans sa colonie africaine, mais elle était également préoccupée par le contexte révolutionnaire international.
"(…) Devant la tournure que prirent les choses, le gouvernement colonial entreprit de gagner le député noir à sa cause pour mettre sa puissance de persuasion et son courage téméraire au service des intérêts de la colonisation et des maisons de commerce. De cette façon il parviendrait à couper l’herbe sous les pieds à l’effervescence qui s’était emparée des esprits de l’élite africaine à un moment où la révolution d’octobre (1917), le mouvement pan-noir et les menaces du communisme mondial en direction des colonies pourraient exercer une dangereuse séduction sur les consciences des colonisés".
"(…) Tel fut le véritable sens de l’accord de Bordeaux signé le 12 juin 1923. Il marquait la fin du Diagnisme combatif et volontariste et ouvrait une nouvelle ère de collaboration entre colonisateurs et colonisés dont le député sortit dépouillé de tout charisme qui représentait jusque là son atout politique majeur. Un grand élan venait d’être brisé". (Iba Der Thiam) 3
Le premier député noir de la colonie africaine resta fidèle au capital français jusqu’à sa mort
Pour mieux comprendre le sens de cet accord entre la bourgeoisie coloniale et le jeune député, revenons sur la trajectoire de ce dernier. Blaise Diagne fut remarqué très tôt par l’appareil du capital français qui voyait en lui une future carte politique stratégique et le forma d’ailleurs dans ce sens. En effet, Diagne exerçait une forte influence sur la jeunesse urbaine à travers le Parti Jeunes Sénégalais acquis à sa cause. Justement, fort du soutien de la jeunesse, notamment des jeunes instruits et intellectuels, il se lança en avril 1914 dans l’arène électorale et arracha le seul poste de député à pourvoir pour l’ensemble de la colonie de l’AOF (Afrique Occidentale Française). Rappelons qu’on était à la veille des tueries impérialistes de masse et que ce fut dans ces circonstances qu’éclata la fameuse grève générale de mai 1914 où, après avoir mobilisé la jeunesse dakaroise en vue du déclenchement du formidable mouvement de révolte, Diagne essaya de l’arrêter sans succès en voulant éviter ainsi de mettre en péril ses intérêts de jeune député petit bourgeois.
En fait, une fois élu, le député fut chargé de veiller à la protection des intérêts des grands groupes commerciaux d’une part et de faire respecter les "lois de la République" d’autre part. Déjà bien avant la signature de l’accord de Bordeaux, Diagne s’illustra en bon agent recruteur de 72 000 "tirailleurs sénégalais" en vue de la boucherie mondiale de 1914/1918. C’est à cette fin qu’il avait été nommé, en janvier 1918, Commissaire de la République par Georges Clemenceau alors Président du Conseil. Effectivement, face aux réticences des jeunes et de leurs parents à se faire enrôler, il sillonna les villages africains de l’AOF pour convaincre les récalcitrants et, à coup de propagande et d'intimidation, parvint à envoyer au massacre des dizaines de milliers d’africains.
De même il fut un ardent défenseur de cet abominable "travail forcé" dans les colonies françaises, comme l’indique son discours à la XIVe session du Bureau International du Travail à Genève 4.
Tout compte fait, le premier député noir de la colonie africaine, ne fut jamais un véritable défenseur de la cause ouvrière, au contraire, il ne fut en définitive qu’un arriviste contre-révolutionnaire. D’ailleurs la classe ouvrière ne tarda pas à en prendre conscience :
"(…) comme si l’accord de Bordeaux avait convaincu les travailleurs que la classe ouvrière paraissait désormais seule en mesure de prendre le relais et de porter haut le flambeau du combat contre l’injustice pour l’égalité économique, sociale et politique, les luttes syndicales connurent, par une sorte de mouvement pendulaire, une exceptionnelle impulsion." (Thiam, ibid.) 5
En clair, Diagne ne put garder longtemps la confiance de la classe ouvrière et resta fidèle à ses parrains coloniaux jusqu’à sa mort en 1934.
1925 : année de forte combativité et de solidarité face à la répression policière
"Rien que dans le chemin de fer, en effet, l’année 1925 avait été secouée par trois grands mouvements sociaux, dont chacun avait eu des conséquences importantes. Il s'agit, d’une part, de la grève des cheminots indigènes et européens du Dakar - Saint-Louis, du 23 au 27 janvier, déclenchée pour des raisons économiques, d’autre part, de la menace de grève générale dans le Thiès-Kayes envisagée autour précisément de mots d’ordre dont le droit syndical, peu de temps après, enfin de la révolte des travailleurs Bambara en service dans les chantiers de construction du chemin de fer à Ginguinéo, révolte que des soldats appelés pour l’écraser refusèrent de mâter". (Thiam, ibid.)
Et pourtant, le moment n’était pas particulièrement propice à la mobilisation pour la lutte car, en prévention de la combativité ouvrière, l’autorité coloniale prenait une série de mesures extrêmement répressives.
"Au cours de l’année 1925, le département des colonies avait édicté, sur les recommandations des Gouverneurs Généraux, singulièrement celui de l’AOF, des mesures draconiennes touchant notamment la répression de la propagande révolutionnaire.
Au Sénégal, des nouvelles instructions, émanant de la Fédération (des 2 colonies françaises, AOF-AEF), avaient provoqué le renforcement des mesures de surveillance, sur l’ensemble du territoire. Et, dans chacune des colonies du groupe, un service spécial avait été institué, en liaison avec les services de la Sûreté Générale, chargé de centraliser à Dakar, et de recouper, tous les indices perçus aux postes d’écoute.
(…) Un nouveau projet fixant le régime de l’émigration, et de l’identification des indigènes, avait été dressé, au Département, dans le courant du mois de décembre 1925. Les étrangers et les suspects avaient désormais chacun leur casier ; la presse étrangère faisait l’objet d’un contrôle sévère, et les saisies de journaux étaient presque devenues la règle. (…) Le courrier était systématiquement violé, les envois de journaux ouverts et souvent détruits". (Thiam, ibid.)
Une fois encore, le pouvoir colonial trembla dès l’annonce d’un nouvel assaut de la classe ouvrière d’où sa décision d’instaurer un régime policier en vue de contrôler sévèrement toute la vie civile et les mouvements sociaux qui se développaient dans la colonie mais aussi et surtout en cherchant à éviter tout contact entre les ouvriers en lutte dans les colonies avec leurs frères de classe dans le monde, d’où les mesures draconiennes contre la "propagande révolutionnaire". Et pourtant, dans ce contexte, d’importantes luttes ouvrières purent éclater avec vigueur, ce malgré tout l’arsenal répressif brandi par l'État colonial.
Une grève des cheminots à caractère très politique
Le 24 janvier 1925, les cheminots européens et africains partirent ensemble en grève, en se dotant d’un comité de grève énonçant les revendications suivantes :
"Les agents du chemin de fer de Dakar - Saint-Louis ont arrêté le 24 janvier le trafic, à l’unanimité. Ce n’est pas sans réflexion, ni sans amertume qu’ils accomplissent ce geste. Depuis 1921, leurs salaires n’ont reçu aucun relèvement, malgré la hausse constante du coût de la vie à la colonie. Les Européens en majorité ne réalisent pas un salaire mensuel de 1000 francs et un indigène un salaire journalier de 5 francs. Ils demandent que leurs traitements soient relevés pour pouvoir vivre honnêtement". (Thiam, ibid.)
En effet, dès le lendemain, tous les agents des divers secteurs du chemin de fer abandonnèrent machines, chantiers et bureaux, bref une paralysie générale du rail. Mais surtout ce mouvement eut un caractère très politique dans la mesure où il intervint au milieu d’une campagne législative, en obligeant ainsi les partis et leurs candidats à se positionner clairement par rapport aux revendications des grévistes. De ce fait, dès cet instant, les notables politiques et les lobbies du commerce interpellèrent l’administration coloniale centrale en l’incitant à œuvrer immédiatement pour la satisfaction des revendications des salariés. Et, aussitôt après, au bout du deuxième jour de grève, les revendications des cheminots furent pleinement satisfaites. Ce fut d’ailleurs avec jubilation que les membres du comité de grève se permirent de retarder leur réponse dans l’attente du résultat de la consultation de leur base. De même que les grévistes avaient tenu à faire porter par leurs délégués l’ordre de reprise, par écrit, par un train spécial passant par toutes les gares.
"Les travailleurs avaient, une nouvelle fois, remporté une importante victoire, dans des conditions de lutte où ils avaient fait preuve d’une grande maturité, ainsi que d’une fermeté, non exempte de souplesse et de réalisme. (…) Ce succès est d’autant plus significatif qu’il était le fait de tous les travailleurs du réseau, européens comme indigènes, qui, après avoir été opposés par des problèmes de couleur et de relations de travail difficiles, avaient eu la sagesse de taire leurs divergences, dès que le danger d’une législation du travail draconienne se profila à l’horizon. (…) Le gouverneur lui-même n’avait pu s’empêcher de noter la maturité et l’esprit de suite et d’à propos, avec lesquels la grève avait été organisée. La préparation, écrit-il, en avait été fort adroitement menée. Le maire de Dakar, lui-même, connu et aimé des indigènes, n’avait pas été prévenu de leur participation. L’époque de la traite était choisie de façon à ce que le commerce, pour la sauvegarde de ses propres intérêts, soutienne les revendications. Les motifs invoqués, et pour certains justifiés, mettaient la campagne en mauvaise posture. En un mot, concluait-il, tout concordait pour lui faire rendre son maximum d’efficacité et lui donner l’appui de l’opinion publique". (Thiam, ibid.)
Voilà une éclatante illustration du haut niveau de combativité et de conscience de classe dont fit preuve la classe ouvrière de la colonie française, où travailleurs européens et africains prirent en main collectivement l’organisation de leur lutte victorieuse. On a là une belle leçon de solidarité de classe venant comme consolidation des acquis de toutes les expériences précédentes de confrontation avec la bourgeoisie. Et cela rend encore plus évident le caractère internationaliste des combats ouvriers de cette époque, et ce malgré l’effort permanent de la bourgeoisie de "diviser pour régner".
En février 1925, la grève des câblistes fit plier les autorités au bout de 24 heures
Le mouvement des cheminots venait à peine de se terminer que les câblistes partirent en grève, en formulant, eux aussi, de nombreuses revendications dont une forte augmentation de salaire et l’amélioration de leur statut. Et ce mouvement fut arrêté au bout de 24 heures et pour cause…
"Grâce au concours combiné des pouvoirs locaux et métropolitains, grâce à l’intervention heureuse des membres des corps élus, tout revint à l’ordre dans les 24 heures, car satisfaction fut donnée en partie aux câblistes, en ce qui rapportait à l’octroi de l’allocation d’attente à tout le personnel". (Thiam, ibid.)
Aussi, revigorés par ce premier succès, les câblistes (européens et indigènes ensemble) remettaient sur le tapis le reste de leurs revendications en menaçant de repartir immédiatement en grève. En fait, ils profitèrent de la place stratégique qu’ils occupaient dans le dispositif administratif et économique en tant qu’agents hautement qualifiés, donc possédant, de fait, une grande capacité de blocage du fonctionnement des réseaux de communication sur le territoire.
Pour leur part, face aux revendications des agents câblistes accompagnées d’une nouvelle menace de grève, les représentants de la bourgeoisie décidèrent de riposter en lançant une campagne d’intimidation et de culpabilisation à l’encontre des grévistes sur le thème :
"Comment les quelques fonctionnaires qui s’agitent pour exiger les augmentations de solde ne voient-ils pas qu’ils creusent eux-mêmes leur propre fosse ?" (Thiam, ibid.)
En fait, le pouvoir politique et du gros commerce mobilisa d’autres gros moyens de pression sur les grévistes allant jusqu’à les accuser de vouloir "détruire délibérément l’économie du pays" tout en s’efforçant par ailleurs de briser l’unité qui existait entre eux. La pression devenant de plus en plus forte, les ouvriers décidèrent alors de reprendre le travail sur la base des revendications satisfaites à l’issue de la grève précédente.
En fait, cet épisode fut aussi un des moments forts où l’unité entre ouvriers européens et africains se réalisa pleinement dans la lutte.
Rébellion sur les chantiers du chemin de fer Thiès-Kayes le 11 décembre 1925
Une rébellion éclata sur cette ligne où un contingent de travailleurs (une centaine) décida d’en découdre avec son chef, capitaine de l’armée coloniale, personnage cynique et autoritaire, accoutumé à être obéi "au doigt et à l’œil", et qui avait l’habitude de faire subir des sévices corporels aux travailleurs qu’il jugeait "paresseux".
"De l’enquête qui avait pourtant été menée par l’Administrateur Aujas, commandant de cercle de Kaolack, il ressortait qu’une rébellion avait éclaté le 11 décembre par suite de "mauvais traitements" infligés à ces travailleurs. Le commandant de cercle ajoutait, que, sans admettre entièrement ces déclarations, monsieur le capitaine Heurtematte a reconnu qu’il lui arrivait quelquefois de frapper d’un coup de cravache un manœuvre paresseux et récalcitrant. [L’incident] s’est envenimé dès le moment où le capitaine fit attacher à un pieu par des cordes, trois bambaras [terme ethnique], qu’il prit pour les meneurs de l’affaire". (Thiam, ibid.)
Et les choses se gâtèrent pour le capitaine quand il se mit à fouetter ces trois travailleurs car leurs camarades du chantier décidèrent d’en finir pour de bon avec leur tortionnaire et celui-ci ne put sauver sa tête que d’extrême justesse par l’arrivée sur place des tirailleurs appelés à son secours.
"Les tirailleurs dont il était question étaient formés de sujets français originaires du Sénégal oriental et de Thiès ; arrivés sur place et ayant appris ce qui s’était passé, ils refusèrent unanimement l’ordre de tirer sur les travailleurs noirs, ordre que le pauvre capitaine assailli de toutes parts, par une meute menaçante et féroce, leur avait intimé, craignant, disait-il, pour sa vie". (Thiam, ibid.)
Voilà un fait singulier car jusque là on était plutôt habitué à voir les "tirailleurs" comme forces aveugles, acceptant par exemple de jouer docilement le rôle de "jaunes" ou carrément de "liquidateurs" de grévistes. Du coup ce geste de fraternisation ne peut que nous rappeler quelques épisodes historiques où des conscrits refusèrent de briser des grèves ou des révolutions. L’exemple le plus célèbre reste évidemment l’épisode de la révolution russe où un grand nombre de militaires refusèrent de tirer sur leurs frères révolutionnaires en désobéissant aux ordres de leur hiérarchie, ce malgré les gros risques encourus.
L’attitude des "tirailleurs" face à leur capitaine fut d’autant plus réjouissante que le contexte était particulièrement alourdi par une forte tendance à la militarisation de la vie sociale et économique de la colonie. D’ailleurs l’affaire prenait une tournure hautement politique car l’administration civile et militaire se trouvait ainsi bien embarrassée de devoir choisir, soit de sanctionner l’attitude d’insoumission des soldats au risque de resserrer leur solidarité avec les travailleurs, soit d’étouffer l’incident. Et finalement l’autorité coloniale choisit cette dernière solution.
"Mais l’affaire ayant fortement défrayé la chronique et menaçant de compliquer les relations interraciales déjà plus que préoccupantes dans un service comme le chemin de fer, les autorités fédérales comme locales avaient finalement conclu à la nécessité d’étouffer l’incident et de le minimiser, maintenant qu’elles s’étaient rendu compte des conséquences désastreuses que la politique dite de collaboration des races inaugurée par Diagne depuis la signature du pacte de Bordeaux était en train de leur coûter cher". (Thiam, ibid.)
En effet, comme les précédents, ce mouvement de lutte illustra remarquablement les limites du "pacte de Bordeaux" par lequel le député Blaise Diagne pensait avoir garanti la "collaboration" entre exploiteurs et exploités. Mais hélas pour la bourgeoisie coloniale, la conscience de classe était passée par là.
La vigoureuse grève des inscrits maritimes en 1926
Comme l’année précédente, 1926 fut marquée par un épisode de lutte très vigoureuse et très riche en termes de combativité et de solidarité de classe, d’autant plus remarquable que le mouvement fut déclenché dans le même contexte de répression des luttes sociales dans lequel, depuis l’année précédente, nombre de chantiers et d'autres secteurs étaient encadrés en permanence par les forces de police et de gendarmerie, au nom de la "sécurisation" de l’environnement économique.
"Alors que les attentats sur la voie ferrée se poursuivaient inexorablement 6 et que l’agitation gagnait des milieux aussi attachés pourtant à l’ordre et à la discipline que les anciens combattants, les travailleurs des Messageries Africaines de Saint-Louis déclenchaient un ordre de grève, qui allait détenir le record de la durée parmi tous les mouvements sociaux jusque-là étudiés dans cette localité.
Tout avait commencé le 29 septembre lorsqu’un télégramme du Lieutenant-Gouverneur informa le Chef de la Fédération que les inscrits maritimes de la Compagnie des Messageries Africaines à Saint-Louis s’étaient mis en grève pour obtenir des améliorations de salaires. Par un bel esprit de solidarité presque spontané, leurs collègues de la Maison Peyrissac, employés sur le Vapeur Cadenel ayant alors jeté l’ancre à Saint-Louis, bien que non concernés par la revendication avancée, avaient cessé eux aussi le travail dès le premier octobre suivant". (Thiam, ibid.)
Sous la poussée de la hausse effrayante du coût de la vie, beaucoup de secteurs avancèrent des revendications salariales en menaçant de partir en lutte et de ce fait un grand nombre d’entreprises avaient accordé des hausses de salaire à leurs employés. Tel n’avait pas été le cas pour les travailleurs des Messageries, d’où le déclenchement de leur mouvement et le soutien reçu de leurs camarades du Vapeur. Cependant, malgré cela, le patronat resta de marbre et refusa toute négociation avec les grévistes jusqu’au cinquième jour de la grève, laissant le mouvement se poursuivre dans l’espoir de son épuisement à court terme.
"Mais le mouvement, ayant conservé sa cohésion et sa solidarité des premiers jours, le 6 octobre, la Direction des Messageries assaillie de toutes parts par les maisons de commerces et encouragée secrètement par l’Administration à faire preuve de plus de souplesse, vu la précarité de la conjoncture, baissa pavillon, subitement. Elle fit aux équipages les propositions suivantes : "augmentation mensuelle de 50 francs (sans distinction de catégorie) et des denrées pour la pitance (41 francs par mois environ)". (…) Mais les travailleurs concernés, voulant payer leurs collègues de la Maison Peyrissac de leur solidarité agissante, demandèrent et obtinrent que les mêmes avantages leur fussent accordés. La Direction de cette maison s’inclina. Le 6 octobre, la grève prit fin. Le mouvement avait duré huit jours pleins, sans que l’unité des travailleurs se soit émoussée un seul instant. C’était là, un événement d’une grande importance". (Thiam, ibid.)
Nous assistons, là encore, à un mouvement formidable, exemplaire et riche d’enseignements sur la vitalité des luttes de cette époque. En d’autres termes, cette séquence de la lutte fut l’occasion d’une véritable expression de "solidarité agissante" (comme le dit l’auteur cité) entre ouvriers de diverses entreprises. Quel meilleur exemple de solidarité de voir tel équipage exiger et obtenir que les mêmes avantages qu’il arracha à l’issue de sa lutte fussent accordés à ses camarades d’une autre entreprise en "remerciement" du soutien reçu de ces derniers !
Que dire aussi de la combativité et de la cohésion dont les ouvriers des messageries firent preuve en imposant un rapport de force sans faille aux forces du capital !
La longue et dure grève des marins de Saint-Louis en juillet/août 1928
L’annonce de cette grève préoccupait beaucoup les autorités coloniales car elle semblait faire écho aux revendications des marins en France qui s’apprêtaient à partir en lutte au même moment que leurs camarades africains.
Au congrès de la Fédération syndicale internationale (de tendance social-démocrate), tenu à Paris en août 1927, fut lancé un appel à la défense des prolétaires des colonies comme le relate (Thiam, ibid.) :
"Un délégué anglais au Congrès de la Fédération syndicale internationale (FSI) à Paris ; saisissant l’occasion, ce délégué nommé Purcell avait particulièrement insisté sur l’existence dans les colonies de millions d’hommes soumis à une exploitation effrénée, devenus des prolétaires au sens plein du terme, qu’il fallait, désormais, organiser et engager dans des actions revendicatives de type syndical, en recourant notamment à l’arme de la protestation et de la grève. Lui faisant écho, Koyaté (syndicaliste africain) lui-même déclarait que "le droit syndical est à arracher en Afrique noire française par des grèves de masse, dans l’illégalité" ". En France depuis le mois de juin 1928, une agitation se développait chez les ouvriers marins qui réclamaient des augmentations de salaire et on s’attendait donc à une grève le 14 juillet. Or, à la date fixée, ce furent les marins indigènes des compagnies maritimes de Saint-Louis qui entrèrent massivement en grève sur les mêmes revendications que leurs camarades en métropole. Dès lors la réaction des autorités coloniales fut de crier au "complot international" en désignant, entre autres, deux leaders syndicalistes indigènes comme "meneurs" du mouvement. Et pour y faire face, l’Administration de la colonie fit front avec le patronat en combinant manœuvres politiques et mesures répressives pour briser la grève.
"(…) Commencèrent alors d’âpres et longs marchandages. Alors que les marins acceptaient, tout au plus, de réduire leurs demandes de 25 francs seulement, le patronat déclara qu’il était impossible d’attribuer plus de 100 francs par mois aux grévistes. Les travailleurs (qui en réclamaient 250) ayant considéré cette offre insuffisante le mouvement de grève continua de plus belle". (Thiam, ibid.)
En effet, les grévistes de la région de Saint-Louis purent bénéficier spontanément du soutien actif d’autres ouvriers marins (Thiam, ibid) :
"(Archives d'État) Le chef du service de l’Inscription nous apprend, en effet, que le 19, dans l’après midi, le "Cayor" remorqueur venant de Dakar, est arrivé avec le Chaland "Forez". A peine le navire stoppé, l’équipage a fait cause commune avec les grévistes à l’exclusion d’un vieux maître d’équipage et d’un autre marin. Mais nous dit-il, dans la matinée du lendemain 20 juillet, les grévistes ont fait irruption à bord du "Cayor" et ont traîné à terre, de force les deux marins demeurés à leur poste. Une courte manifestation aux abords de la mairie a été dispersée par la police".
La grève se prolongea pendant plus d’un mois avant d’être brisée militairement par le Gouverneur colonial qui délogea de force les équipages indigènes et les remplaça par les troupes. En effet, épuisés par de longues semaines de lutte, privés de ressources financières nécessaires à l’entretien de leur famille, bref pour éviter de crever de faim, les marins durent reprendre le travail, d’où la jubilation gourmande du représentant du pouvoir colonial sur place que traduit son propre récit de l’événement :
"[A la fin de la grève] les marins ont demandé à rembarquer sur les navires de la Société des Messageries Africaines. Ils ont été repris aux anciennes conditions, le résultat de la grève s’est donc traduit, pour les marins, par la perte d’un mois de salaire, alors que s’ils avaient écouté les propositions du Chef du service de l’Inscription maritime, ils bénéficieraient d’un relèvement de solde de 50 à 100 F par mois". (Thiam, ibid.)
Ce repli des grévistes, somme toute réaliste, fut considéré par la bourgeoisie comme une "victoire" pour elle alors que s’annonçait la crise de 1929, dont les effets commençaient à se faire sentir au niveau local. Dès lors le pouvoir colonial ne tarda pas à profiter de sa "victoire" sur les marins grévistes et de la conjoncture pour renforcer davantage son arsenal répressif.
"Placé devant cette situation, le Gouverneur colonial, tirant les leçons des tensions politiques déjà décrétées, des déclarations de Ameth Sow Télémaquem 7 parlant de révolution à faire au Sénégal, de la succession des mouvements sociaux, de la dégradation de la situation budgétaire, et du mécontentement des populations, avait pris deux mesures relevant du domaine de maintien de l’ordre.
Dans la première il avait accéléré le processus, amorcé depuis 1927, en vue d’établir la direction des services de sécurité du Sénégal à Dakar d’où la surveillance de la colonie devait, selon lui, être accentuée. (…) La seconde mesure avait été la mise en application accélérée, elle aussi, de l’instruction règlementant le service de la gendarmerie chargé de la police du Thiès-Niger". (Thiam, ibid.).
En clair, la présence de gendarmes affectés au service d’escorte de trains pour "accompagner" les roulants avec des brigades d’intervention sur toutes les lignes, des mesures visant les individus ou groupes qui seraient arrêtés et mis en prison s’ils devaient braver les ordres de police, tandis que les auteurs de "troubles sociaux" (grèves et manifestations) seraient sévèrement punis. Signalons que tous ces moyens de répression, venant accentuer la militarisation du travail, visaient principalement les deux secteurs qui étaient des poumons sur lesquels reposait l’économie coloniale, à savoir le maritime et le ferroviaire.
Mais, en dépit de ce quadrillage militaire, la classe ouvrière ne cessa pas pour autant de constituer une menace pour les autorités coloniales.
"Pourtant lorsque l’agitation sociale reprit dans des sections du Railway à Thiès, où des menaces de grève furent proférées à la suite du non-paiement des rappels de solde dus au personnel, de la présentation de revendications visant des augmentations de salaires et de la dénonciation de l’incurie d’une administration qui se désintéressait complètement de leur sort, le Gouverneur prit très au sérieux lesdites menaces et en s’employant à constituer, au cours de 1929, une nouvelle police privée, composée cette fois d’anciens militaires, la plupart gradés, qui, sous la direction du Commissaire de la police spéciale, devaient veiller d’une façon permanente à la tranquillité au dépôt de Thiès". (Thiam, ibid.)
Donc, dans cette période de fortes et menaçantes tensions sociales, en lien avec la terrible crise économique mondiale, le régime colonial n’avait pas d’autre moyen que de s’appuyer plus que jamais sur ses forces armées pour venir à bout de la combativité ouvrière.
L’entrée dans la Grande Dépression et la militarisation du travail affaiblissent la combativité ouvrière
Comme on a pu le voir précédemment, le pouvoir colonial n’avait pas attendu l’arrivée de la crise de 1929 pour militariser le monde du travail, car il commença dès 1925 à recourir à l’armée pour faire face à la pugnacité de la classe ouvrière. Mais cette situation combinée de surgissement de la crise économique mondiale et de militarisation du travail dut peser lourdement sur la classe ouvrière de la colonie car, entre 1930 et 1935, il y eut peu de lutte. En fait le seul mouvement de classe conséquent connu fut celui des ouvriers du port de Kaolack 8 :
"(…) Une grève courte mais violente à Kaolack le 1er mai 1930 : 1500 à 2000 ouvriers de seccos d’arachides et du port ont arrêté le travail pendant le chargement des bateaux. Ils réclament le doublement de leurs salaires de 7,50 francs. La gendarmerie intervient ; un gréviste est légèrement blessé. Le travail reprend à 14 heures : les ouvriers ont obtenu un salaire journalier de 10 francs".
Cette grève courte et néanmoins vigoureuse vint clôturer la série de luttes fulgurantes entamées depuis 1914. En d’autres termes, 15 ans d’affrontements de classes au bout desquels le prolétariat de la colonie de l’AOF sut tenir tête à son ennemi et construire son identité de classe autonome.
Pour sa part, dans la même période, la bourgeoisie montra sa vraie nature de classe sanguinaire en utilisant tous les moyens à sa disposition, y compris les plus féroces, pour tenter de venir à bout de la combativité ouvrière. Mais au bout du compte elle dut cependant reculer régulièrement face aux assauts de la classe ouvrière en cédant souvent totalement aux revendications des grévistes.
1936/1938 : importantes luttes ouvrières sous le gouvernement de Front populaire
Dans la foulée de l’avènement du gouvernement de Front populaire de Léon Blum, on put assister au redémarrage fulgurant de la combativité ouvrière à travers l’éclatement de nombreuses grèves. Ainsi, on ne dénombra pas moins de 42 "grèves sauvages" au Sénégal entre 1936 et 1938, dont celle de septembre 1938 que nous verrons ci-après. Ce fait est d’autant plus significatif que les syndicats venaient d’être légalisés avec de "nouveaux droits" par le gouvernement de Front populaire, en bénéficiant donc d’une légitimité.
Ces mouvements de lutte furent souvent victorieux. Par exemple celui de 1937 où des marins d’origine européenne d’un navire français en escale en Côte d’Ivoire qui, sensibilisés par les conditions de vie misérables des marins indigènes (des Kroumen), incitèrent ces derniers à formuler des revendications visant à améliorer leurs conditions de travail. Mais les ouvriers indigènes furent chassés manu militari par l’administrateur colonial, ce qui mit aussitôt l’équipage français en grève en soutien à leurs camarades africains en obligeant ainsi les autorités à satisfaire pleinement les revendications des grévistes.
Voilà encore un énième acte de solidarité ouvrière qui vint s’ajouter aux nombreux épisodes cités précédemment où l’unité et la solidarité entre européens et africains fut à l’origine d’un bon nombre de luttes victorieuses, ce en dépit de leurs "différences raciales".
1938 : la grève des cheminots suscita la haine de toute la bourgeoisie contre les ouvriers
Un autre mouvement hautement significatif en termes d’affrontement de classes fut la grève des cheminots en 1938, menée par les ouvriers à contrats précaires dont les syndicats "négligeaient" les revendications. En l’occurrence des journaliers ou auxiliaires, plus nombreux et plus démunis chez les cheminots, payés à la journée en travaillant les dimanches et jours fériés, jours de maladie compris et en faisant 54 heures par semaine sans aucune des prérogatives accordées aux agents titulaires, le tout avec un emploi révocable chaque jour.
Ce sont donc ces cheminots-là qui déclenchèrent la célèbre grève de 1938 9 :
"(…) Le mouvement a d’ailleurs éclaté spontanément et en dehors de l’organisation syndicale. Le 27 septembre, les cheminots auxiliaires (non titulaires) du Dakar-Niger se mettent en grève à Thiès et à Dakar pour protester contre le déplacement arbitraire d’un de leurs camarades.
Le lendemain, au dépôt de Thiès, les grévistes organisent un barrage pour empêcher les "jaunes" de venir travailler. La police du Dakar-Niger tente d’intervenir, mais elle est vite débordée ; la direction du chemin de fer fait appel à l’administrateur qui envoie la troupe : les grévistes se défendent à coups de pierres ; l’armée fait feu. Il y a six morts et trente blessés. Le lendemain (le 29) la grève est générale sur tout le réseau. Le jeudi 30, un accord est signé entre les délégués ouvriers et le gouvernement général sur les bases suivantes :
1) Pas de sanctions ; 2) Pas d’entrave au droit d’association ;3) Indemnisation des familles de victimes nécessiteuses ; 4) Examen des revendications.
Le 1e octobre, le syndicat donne l’ordre de reprise du travail".
Nous voyons, là encore, une autre lutte spectaculaire et héroïque livrée par les cheminots, en dehors des consignes syndicales, qui firent plier la puissance coloniale, ce malgré le recours à son bras sanguinaire, en l’occurrence l’armée, comme l’indique le nombre de morts et de blessés sans compter les dizaines d’ouvriers jetés en prison. D’ailleurs, pour mieux mesurer le caractère barbare de la répression, voici le témoignage d’un ouvrier peintre, un des rescapés du carnage 10 :
"Lorsque nous apprîmes l’affectation à Gossas de Cheikh Diack, un violent mécontentement gagna les milieux des travailleurs, surtout les auxiliaires dont il était le porte-parole. Nous décidâmes de nous y opposer par la grève qui éclata le lendemain où notre dirigeant rejoignit son poste. En me réveillant ce jour-là, un mardi - je m’en souviendrai toujours - j’entendais des coups de feu. J’habitais à proximité de la Cité Ballabey. Quelques instants après, j’ai vu mon frère Domingo partir précipitamment vers le Dépôt. Je me jetai à sa poursuite, conscient du danger qu’il courait. Bientôt je le vis franchir la ligne du chemin de fer et tomber quelques mètres plus loin. Lorsque j’arrivai près de lui, je le crus victime d’un malaise, car je ne voyais aucune blessure, quand je le relevai, il poussa un gémissement rauque. Le sang coulait à flots d’une blessure qu’il portait près de l’épaule gauche. Il expira quelques instants après dans mes bras. Ivre de rage, je fonçai sur le soldat en face de moi. Il tira. J’avançai toujours sans savoir que j’étais blessé. Je crois que c’est la colère qui grondait en moi qui me donna la force de l’atteindre et de lui arracher son fusil, son ceinturon, son calot, après l’avoir assommé, avant de tomber évanoui".
Ce récit illustre la férocité des tirailleurs sénégalais envers les ouvriers "indigènes", ignorant l’exemple de leurs collègues qui avaient refusé de tirer sur les ouvriers lors de la rébellion sur le chantier de Thiès en 1925. Reste à saluer la combativité et le courage dont firent preuve les ouvriers grévistes dans la défense de leurs intérêts et de leur dignité de classe exploitée.
Il faut noter ici le fait qu’avant de partir en grève, les ouvriers furent harcelés par toutes les forces de la bourgeoisie, partis et divers notables, patronat et syndicats. Tous ces représentants de l’ordre du capital lancèrent injures et intimidations aux ouvriers qui osèrent partir en grève sans "bénédiction" de personne sauf d’eux-mêmes et, de fait, en rendant fous et hystériques les chefs religieux musulmans qui se déchaînèrent contre les grévistes, ce à la demande du Gouverneur, comme le rappelle Nicole Bernard-Duquenet (ibid.) :
"Il (le gouverneur) fait aussi appel aux chefs religieux et coutumiers ; Seydou Nourou Tall, qui a souvent joué un rôle d’émissaire du gouverneur général, parle à Thiès (devant les ouvriers grévistes) ; Cheikh Amadou Moustapha Mbacke parcourt le réseau en expliquant qu’un bon musulman ne doit pas faire grève car c’est une forme de rébellion".
Une fois n’est pas coutume, nous sommes tout à fait d’accord avec ce cynique marabout pour dire que faire grève est bien un acte de rébellion, pas seulement contre l’exploitation et l’oppression, mais aussi contre l’obscurantisme religieux.
Quant aux syndicats, qui ne furent pas à l’initiative de la lutte des cheminots, ils durent quand même prendre le "train en marche" pour ne pas perdre totalement le contrôle du mouvement. Et voici décrit leur état d’esprit par le délégué des grévistes 11
"(…) Nous demandions une augmentation de 1,50 francs par jour pour les débutants jusqu’à 5 ans d’ancienneté, 2,50 francs de 5 à 10 ans, et 3,50 francs au dessus de 10 ans ainsi qu’une indemnité de déplacement en faveur des chefs de train, convoyeurs, mécaniciens etc.(…) Si invraisemblable que cela puisse paraître, ces revendications accueillies favorablement par la Direction du réseau, furent au contraire battues en brèche par le Syndicat des Travailleurs Indigènes du Dakar-Niger qui groupait les agents cadres. En effet, celui-ci ne pouvait pas se résigner à nous voir emporter cette première manche. Ses dirigeants cultivaient et tentaient de monopoliser le droit exclusif à la revendication auprès des autorités du réseau. La conjoncture syndicale de l’époque faite de rivalités, de luttes obscures intestines et de surenchère sur la fidélité à l’égard du patronat, explique largement une telle prise de position. Le résultat est que je fus muté à Dakar. On eut, en haut lieu, la candeur de croire que cette mutation pouvait étouffer le mouvement revendicatif qui avait pris naissance chez les "gagne-petit" ".
Encore une terrible démonstration du rôle d’agent traître à la cause ouvrière et de "négociateur de paix sociale" qu’exerce le syndicalisme au bénéfice du capital et de l’Etat bourgeois. Bref comme le dit Nicole Bernard-Duquenet (ibid.) :
"Aussi est-il à peu près certain que les secrétaires des syndicats ont tout fait pour enrayer les menaces de grève qui auraient pu gêner les autorités.
Mais en plus des forces militaro-policières, syndicales, patronales et religieuses, ce fut surtout leur porte-parole, à savoir la presse aux ordres (de droite et de gauche) qui s’acharna comme un charognard affamé contre les grévistes :
Le "Courrier colonial" (du patronat) :
"Dans la métropole, on a eu trop longtemps à déplorer les désastreuses conséquences des grèves se produisant un peu partout, sur des mots d’ordre d’agitateurs le plus souvent étrangers, ou à la solde de l’étranger, pour que les gouvernements coloniaux se hâtent de refreiner énergiquement toute velléité de transformer nos colonies en champ d’actions de gréviculture" ;
"L’Action française" (droite) :
"Ainsi, alors que les responsables marxistes de l’émeute sont clairement établis, le ministre des Colonies envisage de prendre des sanctions contre les tirailleurs sénégalais (et non contre les grévistes). Et tout cela pour plaire aux socialistes et sauver leur créature, le Gouverneur général De Coppet, dont on verra la scandaleuse carrière". "
Voilà donc un aperçu de ce que fut l’attitude des vautours médiatiques de la droite. Pourtant en ce domaine la presse de gauche ne fut guère moins acharnée :
"Les journaux proches du Front populaire sont très amers. L’A.O.F. impute la grève à des agents provocateurs, une "grève absurde" (…).
Le Périscope Africain parle d’une grève "frisant la rébellion" alors qu’aucun gréviste ne faisait partie du syndicat indigène. Le Bulletin de la Fédération des fonctionnaires flétrit l’usage des balles pour disperser les grévistes, interprète la grève comme une émeute, les auxiliaires n’étant ni des cégétistes, ni des communistes. Ils ne sont même pas syndiqués. "Aux fascistes les responsabilités".
Le Populaire (SFIO) impute la responsabilité des incidents à un "parti local de droite violemment hostile à la CGT et aux menées fascistes de certains syndicalistes (allusion au porte-parole des grévistes)"." (Nicole Bernard-Duquenet, ibid.)
Et pour caractériser toutes ces ignobles réactions anti-ouvrières, écoutons les conclusions de l’historien Iba Der Thiam 12 quand il dit ceci :
"Comme on le voit, on ne vit à gauche, comme à droite, dans les événements survenus à Thiès, que le prolongement de la politique intérieure française, c'est-à-dire, une lutte opposant démocrates et fascistes, en l’absence de toute motivation sociale concrète et plausible.
C’est cette erreur d’appréciation, qui expliquerait dans une large mesure, pourquoi la grève des cheminots de Thiès n’a jamais été correctement appréhendée par les syndicats français, même les plus avancés.
(…) Les récriminations de l’AOF et du Périscope Africain, contre les grévistes, ressemblent sur bien des points aux articles du Populaire et de l’Humanité".
Autrement dit, une attitude similaire entre la presse de droite et de gauche face au mouvement des cheminots. Voilà, tout est dit dans ce dernier paragraphe ; en effet, on voit là l’unanimité des forces de la bourgeoisie, nationales et coloniales, contre la classe ouvrière qui lutta contre la misère et pour sa dignité. Manifestement, ces réactions haineuses de la presse de gauche envers les ouvriers grévistes confirmèrent avant tout l’encrage définitif du "PC" au sein du capital français, sachant que c’était déjà le cas du "PS" depuis 1914. Aussi, il faut se rappeler que ce comportement anti-ouvrier s’inscrivait dans le contexte d’alors des préparatifs militaires en vue de la seconde boucherie mondiale, pendant laquelle la gauche française joua un rôle actif d’embrigadement du prolétariat en France métropolitaine et dans les colonies africaines.
Lassou (à suivre)
1 Il s’agit du gros commerce dominé par les négociants bordelais comme Maurel & Prom, Peyrissac, Chavanel, Vézia, Devès, etc., groupe dont le monopole du crédit s’exerçait sur l’unique Banque de l’Afrique Occidentale.
2 Une grève générale et une émeute de 5 jours étendue à toute la région de Dakar, paralysant totalement la vie économique et politique et obligeant la bourgeoisie coloniale à céder aux revendications des grévistes (voir la Revue internationale n° 146).
3 Iba Der Thiam, Histoire du Mouvement syndical africain 1790-1929, Éditions L’Harmattan, 1991.
4 Voir Afrique noire, l'Ère coloniale 1900-1945, Jean Suret-Canale, Éditions Sociales, Paris 1961.
5 Il vaut ici la peine de rappeler ce que nous avons déjà signalé à l'occasion de la publication de la première partie de cet article dans la Revue Internationale n° 145. "Si nous reconnaissons largement le sérieux des chercheurs qui transmettent les sources de référence, en revanche nous ne partageons pas forcément certaines de leurs interprétations des évènements historiques. Il en est de même sur certaines notions, par exemple quand les mêmes parlent de "conscience syndicale" à la place de "conscience de classe" (ouvrière), ou encore "mouvement syndical" (au lieu de mouvement ouvrier). Reste que, jusqu’à nouvel ordre, nous avons confiance en leur rigueur scientifique tant que leurs thèses ne se heurtent pas aux faits historiques ou n’empêchent pas d’autres interprétations".
6 Les informations dont nous disposons ne donnent pas d’indication sur les auteurs de ces attentats.
7 Syndicaliste africain, membre de la Fédération syndicale internationale, de tendance social-démocrate.
8 Nicole Bernard-Duquenet, Le Sénégal et le Front populaire, L’Harmattan, 1985
9 Jean Suret-Canale, op. cit.
10 Antoine Mendy, cité par la publication Sénégal d’Aujourd’hui, n° 6, mars 1964.
11 Cheikh Diack, cité par le même journal Sénégal d’Aujourd’hui.
12 Iba Der Thiam, La grève des cheminots du Sénégal de septembre 1938, Mémoire de Maîtrise, Dakar 1972.
Géographique:
- Afrique [18]
Le syndicalisme-révolutionnaire en Allemagne (III) : la FVDG syndicaliste-révolutionnaire au cours de la Première Guerre mondiale
- 2802 lectures
L'épreuve de l'heure : Union sacrée ou internationalisme ?
Main dans la main avec la social-démocratie qui vote publiquement les crédits de guerre le 4 août 1914, les directions des grands syndicats sociaux-démocrates s’inclinent également devant les plans de guerre de la classe dominante. À la conférence des comités directeurs des syndicats sociaux-démocrates du 2 août 1914, où il fut décidé de suspendre toute grève et toute lutte revendicative pour ne pas troubler la mobilisation dans la guerre, Rudolf Wissell exprime le paroxysme du chauvinisme qui a envahi les syndicats sociaux-démocrates : "Si l'Allemagne est vaincue dans la lutte actuelle, ce qu'aucun de nous n'espère, alors toutes les luttes syndicales après la fin de la guerre sont vouées à l'échec et inutiles. Si l’Allemagne triomphe, alors une conjoncture ascendante s’inaugure et les moyens de l’organisation n’auront ensuite pas besoin de peser autant dans la balance." 1 La logique effrayante des syndicats consiste à lier directement le sort de la classe ouvrière à l’issue de la guerre : si "leur propre nation" et leur classe dominante tirent profit de la guerre, alors c’est aussi un bénéfice pour les ouvriers, parce qu'on peut compter ensuite sur des concessions de politique intérieure pour la classe ouvrière. Par conséquent, il faut soutenir tous les moyens en vue de la victoire militaire de l'Allemagne.
L'incapacité des syndicats sociaux-démocrates et du SPD à adopter une position internationaliste face à la guerre n’est pas surprenante. Quand on enchaîne la défense des intérêts de la classe ouvrière au cadre national, quand on encense le parlementarisme bourgeois comme panacée au lieu de prendre comme orientation politique l’antagonisme international entre la classe ouvrière et le capitalisme, cela conduit inévitablement dans le camp du capital.
Effectivement la classe dominante en Allemagne n’a pu faire la guerre que grâce à la conversion publique du SPD et de ses syndicats ! Les syndicats sociaux-démocrates n’ont pas seulement joué un rôle de suiveurs. Non, ils ont développé une véritable politique de guerre, de propagande chauvine et ont constitué le facteur crucial dans l'établissement d'une intensive production de guerre. Le "réformisme socialiste" s'était transformé en "social-impérialisme" comme l’a formulé Trotski en 1914.
Parmi les ouvriers qui, dans les premiers temps de la déclaration de guerre en Allemagne, ont tenté de nager contre le courant, nombre d’entre eux étaient influencés par le syndicalisme révolutionnaire. La grève sur le paquebot "Vaterland" 2 en mai-juin 1914, peu avant le début de la guerre, constitue un exemple de l’affrontement entre les fractions combatives de la classe ouvrière et la centrale syndicale social-démocrate qui défendait l’Union Sacrée. Le plus grand paquebot du monde de l'époque constituait l’orgueilleux emblème de l'impérialisme allemand. Une partie de l'équipage, comportant une forte présence d’ouvriers de la fédération industrielle syndicaliste révolutionnaire, s’était mise en grève pendant le voyage inaugural Hambourg-New York. La Fédération des Ouvriers Allemands des Transports social-démocrate s'est opposée avec agressivité à cette grève : "Par conséquent, tous ceux qui ont participé à ces assemblées de syndicalistes révolutionnaires ont commis un crime contre les marins. (…) Nous rejetons par principe les grèves sauvages. (…) Et dans la gravité des temps présents, où il s'agit de rassembler toutes les forces des travailleurs, les syndicalistes révolutionnaires mènent leurs tentatives de division parmi les ouvriers et se revendiquent par-dessus le marché du mot d’ordre de Marx : l’émancipation des travailleurs ne peut être que l’œuvre des travailleurs eux-mêmes." 3 Les appels à l’unité du mouvement ouvrier par les syndicats sociaux-démocrates n'étaient plus que des phrases pour s’assurer du contrôle des mouvements dans la classe ouvrière afin de la faire basculer dans "l'union pour la guerre" en août 1914.
On ne peut pas du tout faire le reproche aux syndicalistes-révolutionnaires en Allemagne d’avoir abandonné la lutte des classes dans les semaines avant la déclaration de la guerre. Au contraire, pendant un court temps, ils ont formé un centre de ralliement de prolétaires combatifs : "Là arrivèrent des ouvriers qui entendaient pour la première fois le terme de syndicalisme révolutionnaire et escomptaient ici du jour au lendemain assouvir leurs désirs révolutionnaires." 4 Toutes les organisations de la classe ouvrière, le courant syndicaliste révolutionnaire y compris, devaient cependant faire face à une autre tâche. Outre maintenir la lutte des classes, il était indispensable de démasquer le caractère impérialiste de la guerre qui se profilait.
Quelle a été l'attitude de la FVDG syndicaliste révolutionnaire par rapport à la guerre ? Le 1er août 1914, elle a clairement pris position dans son organe principal Die Einigkeit contre la guerre imminente, non en tant que pacifistes naïfs, mais en tant qu’ouvriers recherchant la solidarité avec ceux des autres pays : "Qui veut la guerre ? Pas le peuple laborieux, mais une camarilla militaire de vauriens, qui dans tous les États européens est avide de gloire martiale. Nous travailleurs ne voulons pas de guerre ! Nous l’exécrons, elle assassine la culture, elle viole l'humanité et augmente jusqu’à la monstruosité le nombre des estropiés de la guerre économique actuelle. Nous travailleurs voulons la paix, la paix intégrale ! Nous ne connaissons pas d’Autrichiens, de Serbes, de Russes, d’Italiens, de Français, etc. Frères du travail, voilà notre nom ! Nous tendons les mains aux travailleurs de tous les pays pour empêcher un crime atroce qui produira des torrents de larmes dans les yeux des mères et des enfants. Les barbares et les individus hostiles à toute civilisation peuvent bien voir dans la guerre une sublime et sainte expression - les hommes au cœur sensible, les socialistes, portés par une conception du monde faite de justice, d'humanité et d'amour des hommes, dédaignent la guerre ! Par conséquent, travailleurs et camarades, élevez partout la voix en protestation contre ce crime contre l'humanité qui se prépare ! Il coûte leurs biens et leur sang aux pauvres, mais il apporte le profit aux riches, gloire et honneur aux représentants du militarisme. A bas la guerre !"
Le 6 août 1914 se produisait l'attaque des troupes allemandes contre la Belgique. Franz Jung, un sympathisant syndicaliste révolutionnaire de la FVDG et ultérieurement membre du KAPD, dresse le tableau de ses expériences saisissantes dans le Berlin de ces jours-là, pris dans l’ivresse guerrière : "Pour le moins toute une foule fondit sur les quelques douzaines de manifestants pour la paix, auxquels je m'étais joint. Autant que je me le rappelle, cette manifestation avait été organisée par les syndicalistes révolutionnaires autour de Kater et de Rocker. Une banderole tendue entre deux perches a été brandie, un drapeau rouge déployé et la manifestation "A bas la guerre !" a commencé à s’ordonner en rangs. Nous ne sommes pas allés loin." 5
Laissons s’exprimer une autre révolutionnaire de l'époque, l'anarchiste internationaliste Emma Goldman : "En Allemagne Gustav Landauer, Erich Mühsam, Fritz Oerter, Fritz Kater, et beaucoup d'autres camarades restaient en liaison. Évidemment, nous n’étions qu’une poignée en comparaison des millions grisés par la guerre, cependant nous sommes parvenus à diffuser dans le monde entier un manifeste de notre Bureau International et nous dénoncions chez nous avec la dernière énergie la véritable nature de la guerre." 6 Oerter et Kater étaient les principaux membres expérimentés de la FVDG. La FVDG a solidement maintenu sa position contre la guerre pendant toute la durée du conflit. Cela constitue incontestablement la force la plus saillante de la FVDG - mais curieusement le chapitre de son histoire le moins documenté.
Dès le début de la guerre, la FVGD a été immédiatement interdite. Beaucoup de ses membres - elle en comptait en 1914 encore environ 6000 - ont été placés en détention ou envoyés de force au front. Dans la revue Der Pionier, un autre de ses organes, la FVDG écrit le 5 août 1914 dans l'éditorial "Le Prolétariat international et la guerre mondiale imminente" que "chacun sait que la guerre entre la Serbie et l'Autriche n'est qu’une expression visible de la fièvre guerrière chronique…". La FVDG décrit comment les gouvernements de Serbie, d'Autriche et d'Allemagne ont réussi à gagner la classe ouvrière à la "furie guerrière" et dénonce à ce propos le SPD et le mensonge de la prétendue "guerre défensive" : "L’Allemagne ne sera jamais l’agresseur, c’est cette conception que ces messieurs du gouvernement nous inculquent déjà, et c’est pour cette raison que les sociaux-démocrates allemands, comme leur presse et leurs orateurs, l’ont déjà mis en sûre perspective, se retrouveront comme un seul homme dans les rangs des armées allemandes." Le numéro 32 du 8 août 1914 de "Die Einigkeit" fut le dernier numéro distribué aux militants.
Un antimilitarisme internationaliste
Dans la partie introductive de cette série d'articles sur le syndicalisme révolutionnaire, nous avons fait une distinction entre l’antimilitarisme et l’internationalisme. "L'internationalisme se base sur la compréhension du fait que, si le capitalisme est un système mondial, il reste néanmoins incapable de dépasser le cadre national et la concurrence de plus en plus effrénée entre les nations. En tant que tel, il engendre un mouvement visant à renverser la société capitaliste au niveau international, par une classe ouvrière unie elle aussi au niveau international. (…) L'antimilitarisme, par contre, n'est pas forcément internationaliste puisqu'il tend à prendre comme ennemi principal, non pas le capitalisme en tant que tel, mais seulement un aspect de celui-ci." 7 Dans quel camp la FVDG s'est-elle rangée
Dans la presse de la FVDG de cette période, on trouve peu d’analyses politiques fouillées ou développées concernant les causes de la guerre ou les relations entre les différentes puissances impérialistes. Cette lacune provient de la vision syndicaliste de la FVDG. Celle-ci se concevait, à ce moment surtout, comme une organisation de lutte sur le plan économique, même si, plutôt qu'un syndicat, elle était en réalité beaucoup plus une coordination de groupes défendant des idées syndicalistes. Les dures confrontations avec le SPD qui prirent fin en 1908 avec son exclusion, avaient produit dans les rangs de la FVDG une aversion exacerbée de la "politique" et, conséquence supplémentaire, la perte de l'héritage des combats passés contre l'idéologie de la séparation entre économie et politique, véhiculée par les grands syndicats de la social-démocratie. Bien que la compréhension par la FVDG de la dynamique de l'impérialisme n'ait pas été réellement à la hauteur des nécessités, cette organisation était cependant inévitablement poussée par la guerre à adopter un positionnement fortement politique.
L'histoire du syndicalisme révolutionnaire en Allemagne montre, à l'exemple de la FVDG, que les analyses théoriques sur l'impérialisme ne suffisent pas à elles seules pour adopter une position vraiment internationaliste. Un sain instinct prolétarien, un profond sentiment de solidarité avec la classe ouvrière internationale, sont également indispensables - et c'est précisément cela qui formait l’épine dorsale de la FVDG en 1914.
La FVDG se qualifie généralement d’"antimilitariste" dans ses publications ; on y trouve à peine le terme d’internationalisme. Mais pour rendre pleine justice aux syndicalistes révolutionnaires de la FVDG, il est absolument nécessaire de prendre en considération la vraie nature de son travail d'opposition contre la guerre. Le point de vue de la FVDG sur la guerre ne faisait pas partie de ceux qui se bornaient aux frontières nationales ni de ceux bercés par les illusions répandues par le pacifisme quant à la possibilité d'un capitalisme pacifique. Contrairement à la grande majorité des pacifistes qui, pour la plupart, se sont trouvés immédiatement après la déclaration de guerre dans les rangs de la défense de la nation contre le militarisme étranger, prétendument le plus barbare, la FVDG a, le 8 août 1914, mis clairement la classe ouvrière en garde contre toute coopération avec la bourgeoisie nationale : "Les travailleurs ne doivent donc pas crédulement faire confiance en l'humanité du moment, celle des capitalistes et des patrons. La fureur guerrière actuelle ne doit pas brouiller la conscience des antagonismes de classe existant entre le Capital et le Travail." 8
Pour les camarades de la FVDG il ne s’agissait pas de combattre seulement un aspect du capitalisme, le militarisme, mais d’intégrer la lutte contre la guerre à la lutte générale de la classe ouvrière pour le dépassement du capitalisme à l’échelle mondiale, comme l’avait formulé Karl Liebknecht déjà en 1906 dans sa brochure "Militarisme et antimilitarisme". En 1915, dans l’article "Antimilitarisme !", celui-ci avait, à juste titre, critiqué les formes héroïques et radicales en apparence de l’antimilitarisme comme la désertion, qui livre encore plus l’armée aux mains des militaristes par l’élimination des meilleurs antimilitaristes, en conséquence de quoi "toutes les méthodes opérant uniquement individuellement ou exercées individuellement sont à rejeter par principe". Dans le mouvement syndicaliste révolutionnaire international, il y eut les points de vue les plus différents sur la lutte antimilitariste. Domela Nieuwenhuis, un représentant historique de l’idée de la grève générale, en a défini les moyens en 1901 dans sa brochure "Le Militarisme" comme un curieux mélange de réformes et d’objection individuelle. Il en va tout autrement pour la FVDG ; celle-ci partageait la préoccupation de Liebknecht selon laquelle c’est la lutte de classe de tous les travailleurs collectivement – et non pas l'action individuelle – qui constitue l’unique moyen contre la guerre.
La réalisation de la presse de la FVDG, assurée surtout par le secrétariat (Geschäftskommission) à Berlin se composant de 5 camarades autour de Fritz Kater, exprimait fortement les propres positions politiques de ces camarades du fait de la cohésion organisationnelle lâche du FVDG. L'internationalisme dans la FVDG ne se limite toutefois pas à une minorité de l'organisation comme dans la CGT syndicaliste révolutionnaire en France. Il ne s'est pas produit de scission en son sein sur la question de la guerre. Ce sont plutôt la répression contre l'organisation et les incorporations forcées sur le front qui ont eu pour conséquence que seule une minorité a pu maintenir une activité permanente. Des groupes syndicalistes révolutionnaires restaient encore actifs principalement à Berlin et dans environ 18 autres localités. Suite à l'interdiction de Die Einigkeit en août 1914, ils restèrent en liaison par le biais de la Mitteilungsblatt, puis après la suppression de celle-ci en juin 1915, à travers l'organe Rundschreiben, interdit à son tour en mai 1917. La forte répression contre les syndicalistes révolutionnaires internationalistes en Allemagne fait que leurs publications ont, dès le début de la guerre, plutôt pris le caractère de bulletins internes que de revues publiques : "Les comités directeurs, ou les personnes de confiance, doivent immédiatement n’éditer que le nombre nécessaire d’exemplaires pour leurs membres existants et ne distribuer le bulletin qu’à ceux-ci." 9
Les camarades de la FVDG ont aussi eu le courage de s'opposer à la mobilisation de la majorité de la CGT syndicaliste révolutionnaire en France pour la participation à la guerre : "Toute cette excitation à la guerre de la part de socialistes, de syndicalistes et d’antimilitaristes internationaux ne contribue pas le moins du monde à ébranler nos principes." 10, écrivirent-ils à propos de la capitulation de la majorité de la CGT. La question de la guerre était devenue la pierre de touche dans le mouvement syndicaliste révolutionnaire international. S’opposer à la grande sœur CGT syndicaliste révolutionnaire exigeait une solide fidélité à la classe ouvrière, alors que la CGT et ses théories avaient constitué durant des années un important point de repère dans l’évolution de la FVDG vers le syndicalisme révolutionnaire. Au cours de la guerre, les camarades de la FVDG soutiennent la minorité internationaliste, autour de Pierre Monatte, sortie de la CGT.
Pourquoi la FVDG est-elle restée internationaliste ?
Tous les syndicats en Allemagne en 1914 ont succombé à la fièvre nationaliste de la guerre. Pourquoi la FVDG fut-elle une exception ? Il est impossible de répondre à cette question en invoquant seulement la "chance" d’avoir possédé, comme ce fut le cas, un secrétariat (Geschäftskommission) ferme et internationaliste. De même qu’on ne peut pas expliquer la capitulation des syndicats sociaux-démocrates face à la question de la guerre par la "poisse" d’avoir eu à leur tête des directions traitres.
La FVDG a tout aussi peu acquis une solidité internationaliste du simple fait de sa claire évolution vers le syndicalisme révolutionnaire à partir de 1908. L'exemple de la CGT française montre que le syndicalisme révolutionnaire de l'époque n'a pas représenté en soi une garantie d'internationalisme. On peut dire en général que ni la profession de foi de marxisme, d'anarchisme ou bien de syndicalisme révolutionnaire n’offre en soi la garantie d’être internationaliste.
La FVDG a rejeté le mensonge patriotique de la classe dominante, avec dans ses rangs la social-démocratie, d'une pure "guerre défensive" (un piège dans lequel Kropotkine est tragiquement tombé). Elle a dénoncé dans sa presse la logique selon laquelle chaque nation se présente comme "l’agressée", l'Allemagne par le sombre tsarisme russe, la France par le militarisme prussien, etc. 11 Cette clarté ne pouvait se développer que sur la base de la conception de l’impossibilité de pouvoir désormais distinguer, au sein du capitalisme, des nations plus modernes ou des nations plus arriérées, et que le capitalisme dans son ensemble était devenu destructeur pour l'humanité. La position internationaliste s'est distinguée à l'époque de la Première Guerre mondiale surtout par la dénonciation politique de la "guerre défensive". Ce n’est pas par hasard si Trotski a consacré, à l’automne 1914, une brochure entière à cette question. 12 La FVDG argumentait aussi en recourant à des principes humains : "Le socialisme place les principes humains au-dessus des principes nationaux." (…) "Il est (…) difficile de se trouver du côté de l’humanité plongée dans l’affliction, mais si nous voulons être des socialistes, là est notre place." 13 La question de la solidarité et de la relation humaine aux autres travailleurs du monde entier constitue une base pour l’internationalisme. L'internationalisme de la FVDG exprimé en 1914 de façon prolétarienne contre la guerre étaitun signe de la force du mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne par rapport à la question décisive de la guerre.
Les racines fondamentales de l'internationalisme de la FVDG se trouvent toutefois surtout dans l’histoire de sa longue opposition au réformisme qui s'insinuait dans le SPD et les syndicats sociaux-démocrates. Son aversion pour la panacée universelle du parlementarisme du SPD a joué un rôle essentiel puisqu'elle empêcha justement, contrairement aux syndicats sociaux-démocrates, son intégration idéologique dans l'État capitaliste.
Dans les années immédiatement avant l`éclatement de la Guerre mondiale, il se manifesta une opposition entre trois tendances au sein de la FVDG : une exprimant l'identité syndicale, une autre la résistance contre "la politique" (du SPD) et une troisième la propre réalité de FVDG comme un ensemble de groupes de propagande (réalité qui, comme on l'a déjà expliqué, a aussi freiné la capacité à produire des analyses claires de l`impérialisme). Cette confrontation n'a pas produit que des faiblesses. Face à la politique ouvertement chauvine du SPD et des autres syndicats, le vieux réflexe de la résistance contre la dépolitisation des luttes ouvrières, assez fort jusqu'au débat sur la grève de masse en 1904, s'était trouvé ravivé.
Même si, comme le décrit notre précédent article, la résistance de la FVDG au réformisme portait en elle d’étranges faiblesses comme l’aversion envers "la politique", ce qui était déterminant en 1914, c'était l'attitude par rapport à la guerre. La contribution internationaliste de la FVDG était à ce moment beaucoup plus importante, pour la classe ouvrière, que ses faiblesses.
La saine réaction de ne pas se replier sur l’Allemagne, en dépit des conditions les plus difficiles, avait été décisive pour le maintien d'une fermeté internationaliste. La FVDG a recherché le contact non seulement avec la minorité internationaliste de Monatte dans la CGT, mais aussi avec d'autres syndicalistes révolutionnaires au Danemark, en Suède, en Espagne, en Hollande (Nationaal Arbeids Secretariaat) et en Italie (Unione Sindacale Italiana) qui tentaient de s'opposer à la guerre.
Une coopération insuffisante avec les autres internationalistes en Allemagne
Avec quelle force la voix internationaliste de la FVDG pouvait-elle se faire entendre dans la classe ouvrière pendant la guerre ? Elle s’est opposée vigoureusement aux perfides organes d’intégration à l’Union Sacrée. Comme formulé dans son organe interne, Rundschreiben, elle s'est opposée de façon très conséquente à la participation à des comités de guerre 14 : "Certainement pas ! De telles fonctions ne sont rien pour ceux de nos membres ou fonctionnaires (…) personne ne peut exiger cela d'eux." 15 Mais dans les années 1914-1917, elle s’adresse presque exclusivement à ses propres membres. Avec une estimation réaliste de l'impuissance présente et de l'impossibilité de pouvoir faire vraiment obstacle à la guerre, mais surtout avec une crainte légitime de la destruction de l’organisation, Fritz Kater au nom du secrétariat (Geschäftskommission) s’adressa le 15 août 1914 dans la Mitteilungsblatt aux camarades de la FVDG : "Nos points de vue sur le militarisme et la guerre, comme nous les avons défendus et propagés depuis des décennies, dont nous nous portons garants jusqu’à la fin de la vie, ne sont pas admissibles à une époque d'enthousiasme débridé en faveur de la guerre, on nous condamne au silence. C’était à prévoir et donc l'interdiction n’a absolument pas été pour nous une surprise. Nous devons ainsi nous résigner au silence, au même titre aussi que tous les autres camarades du syndicat."
Kater exprime d'une part l'espoir de maintenir les activités comme avant la guerre (ce qui cependant était impossible du fait de la répression) et d'autre part l'objectif minimal de sauver l'organisation : "Le secrétariat (Geschäftskommission) est toutefois d'avis qu’il agirait en oubliant ses devoirs s’il cessait maintenant, avec l’interdiction des journaux, toutes les autres activités. Cela, il ne le fera pas. (…) Il maintiendra les liaisons entre les différentes organisations et fera tout ce qui est nécessaire pour empêcher leur décomposition."
La FVDG a survécu en effet à la guerre. Cela non pas sur la base d'une stratégie de survie particulièrement habile ou d’appels insistants à ne pas quitter l'organisation. C'est clairement son internationalisme qui a constitué tout le temps de la guerre un point d’ancrage pour ses membres.
Lorsqu’en septembre 1915 l’appel international contre la guerre du Manifeste de Zimmerwald retentit avec un grand écho, celui-ci a été salué solidairement par la FVDG. Cela surtout en raison de sa proximité avec la minorité internationaliste de la CGT présente à Zimmerwald. Mais la FVDG nourrissait une méfiance envers une grande partie des groupements de la conférence de Zimmerwald, parce que ceux-ci étaient encore par trop reliés à la tradition du parlementarisme. Cela il est vrai n’était pas injustifié, six des présents, parmi eux Lénine, avaient déclaré : "Le manifeste accepté par la conférence ne nous satisfait pas complètement. (…) Le manifeste ne contient aucune caractéristique claire des moyens de combattre la guerre." 16. La FVDG n'avait pas non plus, contrairement à Lénine, la clarté nécessaire sur les moyens pour combattre la guerre. Sa méfiance exprimait plutôt un manque d'ouverture par rapport aux autres internationalistes comme le montrent clairement ses relations avec ceux d'Allemagne.
Pourquoi n'y a-t-il pas eu en Allemagne même de coopération entre l'opposition internationaliste du Spartakusbund et les syndicalistes révolutionnaires de la FVDG ? Pendant une longue période, il y a eu entre eux de profonds fossés qui n’avaient pu être comblés. Karl Liebknecht, 10 ans auparavant, dans le débat sur la grève de masse, avait durement généralisé à la FVDG les faiblesses individualistes de l’un de ses porte-paroles temporaires, Rafael Friedeberg. Pour autant que nous sachions, les révolutionnaires autour de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht n’ont pas non plus recherché le contact avec la FVDG pendant les premières années de la guerre, certainement à cause d'une sous-estimation des capacités internationalistes des syndicalistes révolutionnaires.
La FVDG elle-même a eu vis-à-vis de Liebknecht, la figure symbolique du mouvement contre la guerre en Allemagne, une attitude très fluctuante empêchant tout rapprochement. D’une part, elle ne put jamais pardonner à Liebknecht son approbation des crédits de guerre en août 1914, votés non par conviction mais exclusivement sur la base d’une conception fausse de la discipline de fraction qu’il a lui-même critiquée par la suite. Toutefois, dans sa presse, la FVDG a toujours pris sa défense quand il fut victime de la répression. La FVDG ne croyait pas l'opposition révolutionnaire au sein du SPD capable de se défaire du parlementarisme, une étape qu’elle-même n’avait accomplie que par sa séparation du SPD en 1908. Une profonde méfiance existait. Ce n'est que fin 1918, lorsque le mouvement révolutionnaire envahit complètement l'Allemagne, que la FVDG appelle ses membres à adhérer temporairement au Spartakusbund en double affiliation.
Rétrospectivement, ni la FVDG ni les Spartakistes n'ont suffisamment cherché le contact sur la base de leur position internationaliste pendant la guerre. C'est plutôt la bourgeoisie qui a mieux reconnu le point commun internationaliste de la FVDG et des Spartakistes que ces deux organisations elles-mêmes : la presse contrôlée par la direction du SPD a souvent essayé de dénigrer les Spartakistes comme étant les proches de la "tendance Kater." 17
Si, à l’aune de l'histoire de la FVDG pendant la Première Guerre mondiale, nous pouvons tirer un enseignement pour aujourd'hui et l'avenir, c'est bien le suivant : la nécessité de chercher le contact avec les autres internationalistes, même s’il existe des différences sur d'autres questions politiques. Cela n'a absolument rien à voir avec un "front unique" (qui en raison d’une faiblesse sur les principes recherche même la coopération avec des organisations du camp bourgeois) comme en a connu l'histoire du mouvement ouvrier dans les années 1920-30, mais au contraire avec la reconnaissance du point commun prolétarien le plus important.
Mario 5. 8. 2011
1 H.J. Bieber : Gewerkschaften in Krieg und Revolution, 1981, tome 1, p. 88, (notre traduction)
2 "Patrie" en allemand.
3 Voir Folkert Mohrhof, Der syndikalistische Streik auf dem Ozean-Dampfer "Vaterland“ 1914, 2008, (notre traduction)
4 Die Einigkeit, principal organe de la FVDG, 27 juin 1914, article de Karl Roche, "Ein Gewerkschaftsführer als Gehilfe des Staatsanwalts“, (notre traduction)
5 Franz Jung, Der Weg nach unten, Nautilus, p.89, (notre traduction)
6 Emma Goldman, Living My Life, p.656, (notre traduction). En février 1915, Emma Goldman s’est publiquement prononcée avec d’autres anarchistes internationalistes, tels Berkman et Malatesta, contre l’approbation de la guerre par la principale figure de l’anarchisme, Kropotkine, et d’autres. La FVDG salua dans la Mitteilungsblatt du 20 février 1915 cette défense de l’internationalisme vis-à-vis de Kropotkine par des anarchistes révolutionnaires.
7 "Ce qui distingue le mouvement syndicaliste révolutionnaire [110]", Revue internationale n° 118.
8 Die Einigkeit, n° 32, 8 août 1914
9 Mitteilungsblatt, 15 août 1914
10 Mitteilungsblatt, 10 octobre 1914. Cité d’après Wayne Thorpe, Keeping the faith: The German Syndicalists in the First World War. Cet ouvrage est, avec les documents originaux de la FVDG, la seule (et très précieuse) source sur le syndicalisme révolutionnaire allemand au cours de la Première Guerre mondiale.
11 Voir entre autres Mitteilungsblatt, novembre 1914 et Rundschreiben, août 1916.
12 La Guerre et l‘Internationale
13 Mitteilungsblatt, 21 novembre 1914
14 Ces comités de guerre (Kriegsausschüsse) ont été fondés après février 1915, d’abord dans l’industrie métallurgique de Berlin, entre représentants des associations patronales de la métallurgie et des grands syndicats. Le but poursuivi était de faire cesser la tendance croissante chez les ouvriers à trop souvent changer de lieu de travail à la recherche de salaires plus élevés, le début de la saignée de la société par les massacres ayant provoqué une pénurie des forces de travail. Cette fluctuation "incontrôlée" était, aux yeux du gouvernement et des syndicats, nuisible à l’efficacité de la production de guerre. La mise en place de ces comités s'était basée sur une tentative précédente lancée dès août 1914 par le leader syndical social-démocrate Theodor Leipart visant la formation de Kriegsarbeitsgemeinschaften (collectifs de guerre avec les employeurs) qui, sous couvert hypocrite d’agir en faveur de la classe ouvrière pour "combattre le chômage" et réguler le marché du travail, visaient en réalité à mettre tout en œuvre pour rendre plus efficace la production pour la guerre.
15 Cité d‘après W. Thorpe, Keeping the faith: The German Syndicalists in the First World War.
16 Déclaration de Lénine, Zinoviev, Radek, Nerman, Höglund, Berzin à la conférence de Zimmerwald, cité par J. Humbert-Droz, L’Origine de l’Internationale Communiste, p.144
17 Vorwärts, 9 janvier 1917
Géographique:
- Allemagne [111]
Courants politiques:
Décadence du capitalisme (XI) : le boom d'après-guerre n'a pas renversé le cours du déclin du capitalisme
- 3634 lectures
Dans les articles précédents de cette série, nous avons montré que les marxistes (et même certains anarchistes) partageaient en grande partie le même point de vue sur l'étape historique atteinte par le capitalisme au milieu du 20e siècle. La guerre impérialiste dévastatrice de 1914-18, la vague révolutionnaire internationale qui avait pris place dans son sillage et la dépression économique mondiale sans précédent qui avait marqué les années 1930, tous ces événements étaient considérés comme la preuve irréfutable du fait que le mode de production bourgeois était entré dans sa phase de déclin, l'époque de la révolution prolétarienne mondiale. L'expérience du deuxième massacre impérialiste ne remit pas en cause ce diagnostic ; au contraire, il constituait une preuve encore plus décisive du fait que le système avait fait son temps. Victor Serge avait déjà écrit à propos des années 1930 qu'il était "minuit dans le siècle" - une décennie qui avait vu la contre-révolution vaincre sur tous les fronts au moment même où les conditions objectives du renversement du système n'avaient jamais été si nettement développées. Mais les événements de 1939-45 ont montré que la nuit pouvait s'obscurcir encore plus.
Comme nous l'avons écrit dans le premier article de cette série 1 : "Le tableau de Picasso, Guernica, est célébré à juste raison comme une représentation sans précédent des horreurs de la guerre moderne. Le bombardement aveugle de la population civile de cette ville espagnole par l'aviation allemande qui soutenait l'armée de Franco, constitua un grand choc car c'était un phénomène encore relativement nouveau. Le bombardement aérien de cibles civiles avait été limité durant la Première Guerre mondiale et très inefficace. La grande majorité des tués pendant cette guerre étaient des soldats sur les champs de bataille. La Deuxième Guerre mondiale a montré à quel point la capacité de barbarie du capitalisme en déclin s'était accrue puisque, cette fois, la majorité des tués furent des civils : "L'estimation totale en pertes de vies humaines causées par la Deuxième Guerre mondiale, indépendamment du camp dont elles faisaient partie, est en gros de 72 millions. Le nombre de civils atteint 47 millions, y compris les morts de faim et de maladie à cause de la guerre. Les pertes militaires se montent à environ 25 millions, y compris 5 millions de prisonniers de guerre" 2. L'expression la plus terrifiante et la plus concentrée de cette horreur est le meurtre industrialisé de millions de Juifs et d'autres minorités par le régime nazi, fusillés, paquets par paquets, dans les ghettos et les forêts d'Europe de l'Est, affamés et exploités au travail comme des esclaves jusqu'à la mort, gazés par centaines de milliers dans les camps d'Auschwitz, Bergen-Belsen ou Treblinka. Mais le nombre de morts civils victimes du bombardement des villes par les protagonistes des deux côtés prouve que cet Holocauste, ce meurtre systématique d'innocents, était une caractéristique générale de cette guerre. En fait, à ce niveau, les démocraties ont certainement surpassé les puissances fascistes, et les tapis de bombes, notamment de bombes incendiaires, qui ont recouvert les villes allemandes et japonaises confèrent, en comparaison, un air plutôt "amateur" au Blitz allemand sur le Royaume-Uni. Le point culminant et symbolique de cette nouvelle méthode de massacre de masse a été le bombardement atomique des villes d'Hiroshima et de Nagasaki ; mais en termes de morts civils, le bombardement "conventionnel" de villes comme Tokyo, Hambourg et Dresde a été encore plus meurtrier."
Contrairement à la Première Guerre mondiale à laquelle avait mis fin l'éclatement des luttes révolutionnaires en Russie et en Allemagne, le prolétariat n'a pas secoué les chaînes de la défaite à la fin de la Deuxième. Non seulement il avait été écrasé physiquement, en particulier par l'assommoir du stalinisme et du fascisme, mais il avait également été embrigadé idéologiquement et physiquement derrière les drapeaux de la bourgeoisie, essentiellement à travers la mystification de l'antifascisme et de la défense de la démocratie. Il y eut des explosions de lutte de classe et des révoltes à la fin de la guerre, en particulier dans les grèves qui éclatèrent dans le nord de l'Italie et qui avaient clairement un esprit internationaliste. Mais la classe dominante s'était bien préparée à de telles explosions et elle les a traitées avec une cruauté impitoyable, en particulier en Italie où les forces alliées, guidées de main de maître par Churchill, ont permis aux forces nazies de réprimer la révolte ouvrière pendant qu'elles-mêmes bombardaient les villes du nord touchées par les grèves ; pendant ce temps, les staliniens faisaient de leur mieux pour recruter les ouvriers combatifs dans la résistance patriotique. En Allemagne, la terreur des bombardements des villes élimina toute possibilité que la défaite militaire du pays permette une répétition des luttes révolutionnaires de 1918. 3
Bref, l'espoir qui avait animé les petits groupes révolutionnaires ayant survécu au naufrage des années 1920 et 30 – qu'une nouvelle guerre donne lieu à un nouveau surgissement révolutionnaire – s'éteignit rapidement.
L'état du mouvement politique prolétarien après la Deuxième Guerre mondiale
Dans ces conditions, le petit mouvement révolutionnaire qui avait maintenu des positions internationalistes au cours de la guerre, après une brève période de revitalisation à la suite de l'effondrement des régimes fascistes en Europe, fut confronté aux conditions les plus difficiles quand il entreprit d'analyser la nouvelle phase de la vie du capitalisme après six ans de carnage et de destruction. La plupart des groupes trotskistes avaient signé leur sentence de mort en tant que courant prolétarien en soutenant au cours de la guerre le camp Allié, au nom de la défense de la "démocratie" contre le fascisme ; cette trahison se confirma avec leur soutien ouvert à l'impérialisme russe et à ses annexions en Europe de l'Est après la guerre. Il existait encore un certain nombre de groupes qui avaient rompu avec le trotskisme et maintenu une position internationaliste contre la guerre, comme les RKD d'Autriche, le groupe autour de Munis, et l'Union communiste internationaliste en Grèce animée par Aghis Stinas et Cornelius Castoriadis, qui forma le groupe Socialisme ou Barbarie par la suite. Les RKD, dans leur hâte d'analyser ce qui avait conduit le trotskisme à la mort, commencèrent par rejeter le bolchevisme et finirent par abandonner complètement le marxisme. Munis évolua vers des positions communistes de gauche et fut toute sa vie convaincu que la civilisation capitaliste était profondément décadente, appliquant cette vision avec une grande clarté à des questions clé telles que la question syndicale et la question nationale. Mais il semble qu'il ne parvint pas à comprendre comment cette décadence était liée à l'impasse économique du système : dans les années 1970, son organisation, le Ferment ouvrier révolutionnaire (FOR), quitta les Conférences de la Gauche communiste parce que les autres groupes participants pensaient tous qu'il y avait une crise économique ouverte du système, position qu'elle rejetait. Comme nous le verrons plus loin, Socialisme ou Barbarie fut abusé par le boom qui débuta dans les années 1950 et remit également en cause les fondements de la théorie marxiste. De ce fait, aucun des anciens groupes trotskistes ne semble avoir apporté de contribution durable à la compréhension marxiste des conditions historiques auxquelles était maintenant confronté le capitalisme mondial.
L'évolution de la Gauche communiste hollandaise après la guerre donne également des indications sur la trajectoire générale du mouvement. Il y eut un bref renouveau politique et organisationnel avec la formation du Spartacusbond en Hollande. Comme nous le montrons dans notre livre La Gauche communiste hollandaise, ce groupe retrouva momentanément la clarté du KAPD, non seulement en reconnaissant le déclin du système mais aussi en abandonnant la peur conseilliste du parti. Cette attitude fut facilitée par son ouverture à d'autres courants révolutionnaires, en particulier envers la Gauche communiste de France. Mais cela ne dura pas longtemps. La majorité de la Gauche hollandaise, en particulier le groupe autour de Cajo Brendel, fit vite marche arrière vers des conceptions anarchisantes de l'organisation et une démarche ouvriériste qui ne voyait que peu d'intérêt à situer les luttes ouvrières dans leur contexte historique général.
Les débats dans la Gauche communiste d'Italie
Le courant révolutionnaire qui avait été le plus clair sur la trajectoire suivie par le capitalisme dans les années 1930 – la Gauche communiste d'Italie – ne fut pas épargné par le désarroi qui avait affecté le mouvement révolutionnaire à la fin de la guerre. Au départ, la plus grande partie de ses membres a vu, dans l'éclatement d'une révolte prolétarienne significative en Italie du nord en 1943, l'expression d'un changement de cours historique, les frémissements de la révolution communiste qu'on attendait. Les camarades de la Fraction française de la Gauche communiste internationale, qui s'était formée au cours de la guerre dans la France de Vichy, partageaient initialement ce point de vue mais estimèrent rapidement que la bourgeoisie, profitant de toute l'expérience de 1917, était bien préparée à de telles explosions et avait utilisé tout son arsenal d'armes pour les écraser impitoyablement. En revanche, la majorité des camarades restés en Italie, rejointe par les membres de la Fraction italienne rentrée d'exil, avait déjà proclamé la constitution du Parti communiste internationaliste (qu'on désignera comme PCInt, pour le distinguer des "Parti communiste international" ultérieurs). La nouvelle organisation avait une claire position internationaliste contre les deux camps impérialistes, mais elle s'était constituée à la hâte et rassemblait toute une série d'éléments politiquement différents et en grande partie disparates ; et ceci allait donner lieu à de nombreuses difficultés dans les années suivantes. La majorité des camarades de la Fraction française s'opposa à la dissolution de la Fraction italienne et à l'entrée de ses membres dans le nouveau parti. Elle allait rapidement mettre ce dernier en garde contre l'adoption de positions qui marquaient une claire régression par rapport à celles de la Fraction italienne. Sur des questions aussi centrales que les rapports entre le parti et les syndicats, la volonté de participer aux élections et la pratique organisationnelle interne, la Fraction française décelait une manifestation claire d'un glissement vers l'opportunisme.4 Le résultat de ces critiques fut que la Fraction française fut exclue de la Gauche communiste internationale et se constitua en Gauche communiste de France (GCF).
L'une des composantes du PCInt était la "Fraction des Socialistes et des Communistes" à Naples autour d'Amadeo Bordiga ; et le projet de former le parti avec Bordiga, qui avait joué un rôle incomparable dans la formation du Parti communiste d'Italie au début des années 1920 et dans la lutte contre la dégénérescence de l'Internationale communiste par la suite, constituait un élément central dans la décision de proclamer le parti. Bordiga avait été le premier à critiquer ouvertement Staline dans les sessions de l'IC, le dénonçant en face comme fossoyeur de la révolution. Mais depuis le début des années 1930 et au cours des premières années de la guerre, Bordiga s'était retiré de la vie politique malgré les nombreux appels de ses camarades pour qu'il reprenne l'activité. En conséquence, les acquis politiques développés par la Fraction italienne – sur les rapports entre la fraction et le parti, les leçons qu'elle avait tirées de la révolution russe, sur le cours du déclin du capitalisme et son impact sur des problèmes comme la question syndicale et la question nationale - lui échappèrent en grande partie et il resta figé sur les positions des années 1920. En fait, dans sa détermination à combattre toutes les formes d'opportunisme et de révisionnisme incarnées par les constants "nouveaux tournants" des partis "communistes" officiels, Bordiga commença à développer la théorie de "l'invariance historique du marxisme" : selon cette vision, ce qui distingue le programme communiste, c'est sa nature fondamentalement immuable, et cela implique que les grands changements qui eurent lieu dans les positions de l'IC ou de la Gauche communiste, quand ils rompirent avec la social-démocratie, ne constituaient qu'une "restauration" du programme d'origine incarné par le Manifeste communiste de 1848.5 Cette démarche avait pour implication logique qu'il n'y avait pas eu de changement d'époque dans la vie du capitalisme au 20e siècle ; le principal argument de Bordiga contre la notion de décadence du capitalisme se trouve dans la polémique contre ce qu'il appelait "la théorie de la courbe descendante" : "La théorie de la courbe descendante compare le développement historique à une sinusoïde : tout régime (par exemple le régime bourgeois) commence par une phase ascendante, atteint un point maximum, après quoi un autre régime remonte. Cette vision est celle du réformisme gradualiste : il n’y a pas de bonds, de secousses, ni de sauts. [...] La vision marxiste peut être représentée schématiquement par un certain nombre de courbes toujours ascendantes jusqu’à des sommets (en géométrie «points singuliers» ou «points de rupture») suivis d’une chute, presque verticale, puis, tout en bas, d’une autre branche historique ascendante, c’est-à-dire un nouveau régime social [...] L’affirmation courante selon laquelle le capitalisme est dans sa phase descendante et ne peut plus remonter, contient deux erreurs: le fatalisme et le gradualisme." (Réunion de Rome, avril 1951 6).
Bordiga écrit aussi : "Pour Marx 1e capitalisme croît sans arrêt au-delà de toute limite…" 7. Le capitalisme serait constitué d'une série de cycles dans lesquels chaque crise, succédant à une période d'expansion "illimitée", est plus profonde que la précédente et pose la nécessité d'une rupture complète et soudaine avec le vieux système.
Nous avons répondu à ces arguments dans les Revue internationale n° 48 et 55 8, et rejeté l'accusation de Bordiga selon laquelle la notion de déclin du capitalisme ouvre la porte à une vision gradualiste et fataliste ; nous avons expliqué pourquoi de nouvelles sociétés ne naissent pas sans que les êtres humains aient fait une longue expérience de l'incompatibilité de l'ancien système avec leurs besoins. Mais dans le PCInt déjà, des voix s'élevaient contre la théorie de Bordiga. Tout le travail de la Fraction n'avait pas été perdu parmi les forces qui avaient constitué le PCInt. Face à la réalité de l'après-guerre – principalement marquée par un isolement croissant des révolutionnaires d'avec la classe et transformant inévitablement une organisation qui avait pu se prendre pour un parti en un petit groupe communiste – deux tendances principales surgirent, ce qui prépara le terrain de la scission de 1952. Le courant autour d'Onorato Damen, ancêtre de l'actuelle Tendance communiste internationaliste (TCI), conserva la notion de décadence du capitalisme – c'est ce courant qui constituait la cible principale de la polémique de Bordiga sur "la courbe descendante" – et cela lui permit de maintenir la clarté de la Fraction sur des questions clés telles que la caractérisation de la Russie comme une forme de capitalisme d'État, l'accord avec Rosa Luxemburg sur la question nationale et la compréhension de la nature capitaliste des syndicats (cette dernière position était défendue de façon particulièrement claire par Stefanini qui avait été l'un des premiers de la Fraction en exil à comprendre leur intégration dans l'État capitaliste).
Le numéro de l'été 2011 de Revolutionary Perspectives, journal de la Communist Workers' Organisation (groupe affilié à la TCI au Royaume-Uni), republie l'introduction de Damen à la correspondance que ce dernier avait échangée avec Bordiga à l'époque de la scission. Damen, se référant à la conception de Lénine d'un capitalisme moribond et au point de vue de Rosa Luxemburg sur l'impérialisme en tant que processus précipitant l'effondrement du capitalisme, rejette la polémique de Bordiga contre la théorie de la courbe descendante : "Il est vrai que l'impérialisme accroît énormément et fournit les moyens de prolonger la vie du capital mais, en même temps, il constitue le moyen le plus sûr de l'abréger. Ce schéma d'une courbe toujours ascendante non seulement ne montre pas cela mais, dans un certain sens, le nie." (Traduit de l'anglais par nous)
De plus, comme Damen le souligne, la vision d'un capitalisme en ascendance perpétuelle en quelque sorte permet à Bordiga de laisser des ambiguïtés sur la nature et le rôle de l'URSS : "Face à l'alternative de rester ce que nous avons toujours été, ou de pencher vers une attitude d'aversion platonique et intellectualiste vis-à-vis du capitalisme américain et de bienveillante neutralité envers le capitalisme russe simplement du fait qu'il n'est pas encore mûr du point de vue capitaliste, nous n'hésitons pas à réaffirmer la position classique que les communistes internationalistes ont défendue envers tous les protagonistes du second conflit impérialiste et qui n'est pas d'espérer la victoire de l'un ou l'autre des adversaires mais de chercher une solution révolutionnaire à la crise capitaliste."
A cela, nous pourrions ajouter que cette idée selon laquelle les parties les moins développées de l'économie mondiale pourraient contenir une forme de "jeunesse" du capitalisme et donc un caractère progressiste a amené le courant bordiguiste à une dilution encore plus explicite des principes internationalistes avec son soutien au mouvement des "peuples de couleur" dans les anciennes colonies.
C'est une marque du repliement de la Gauche italienne dans les confins de l'Italie après la guerre que la plus grande partie du débat entre les deux tendances au sein du PCInt soit longtemps restée inaccessible au monde qui ne parlait pas italien. Mais il nous semble que, tandis que le courant de Damen était de façon générale bien plus clair sur les positions de classe fondamentales, aucun des deux courants n'avait le monopole de la clarté. Bordiga, Maffi et d'autres avaient raison dans leur intuition que la période qui s'ouvrait, encore caractérisée par le triomphe de la contre-révolution, signifiait inévitablement que les tâches théoriques seraient prioritaires sur un travail de large agitation. La tendance de Damen, en revanche, comprenait encore moins qu'un véritable parti de classe, capable de développer une présence effective au sein de la classe ouvrière, n'était tout simplement pas à l'ordre du jour dans cette période. En ce sens, la tendance de Damen perdit complètement de vue les clarifications cruciales de la Fraction italienne, précisément sur la question de la Fraction en tant que pont entre l'ancien parti dégénéré et le nouveau parti rendu possible par le renouveau de la lutte de classe. En fait, sans véritable élaboration, Damen établit un lien injustifié entre le schéma de Bordiga d'une courbe toujours ascendante – schéma indiscutablement faux - et la théorie de "l'inutilité de créer un parti dans une période contre-révolutionnaire" qui, de notre point de vue, était essentiellement valide. Contre cette idée, Damen propose la suivante : "la naissance du parti ne dépend pas, et nous sommes d'accord là-dessus, ‘du génie ou de la valeur d'un leader ou d'une avant-garde’, mais c'est l'existence historique du prolétariat en tant que classe qui pose, non pas de façon simplement épisodique dans le temps et l'espace, la nécessité de l'existence de son parti."
On pourrait également dire que le prolétariat a en permanence "besoin" de la révolution communiste : à un niveau c'est vrai, mais cela ne nous amène nulle part pour comprendre si le rapport de forces entre les classes fait de la révolution quelque chose de tangible, à sa portée, ou si c'est une perspective pour un futur plus lointain. De plus, si nous mettons en relation ce problème général avec les spécificités de l'époque de déclin du capitalisme, la logique de Damen apparaît encore plus boiteuse : les conditions réelles de la classe ouvrière dans la période de décadence, en particulier l’absorption de ses organisations de masse permanentes dans les mâchoires du capitalisme d'État, ont clairement rendu non pas moins mais plus difficile pour le parti de classe de se maintenir en dehors des phases d'intenses surgissements prolétariens.
La contribution de la Gauche communiste de France
La GCF, bien que formellement exclue de la branche italienne de la Gauche communiste, fut bien plus fidèle à la conception développée par l'ancienne Fraction italienne sur le rôle de la minorité révolutionnaire dans une période de défaite et de contre-révolution. C'est aussi le groupe qui fit les avancées les plus importantes dans la compréhension des caractéristiques de la période de décadence. Il ne s'est pas contenté de répéter ce qui avait été compris dans les années 1930 mais avait pour but d'arriver à une synthèse plus profonde : ses débats avec la Gauche hollandaise lui permirent de surmonter certaines erreurs de la Gauche italienne sur le rôle du parti dans la révolution et affinèrent sa compréhension de la nature capitaliste des syndicats. Et ses réflexions sur l'organisation du capitalisme dans la période de décadence lui permirent de développer une vision plus claire des profonds changements dans le rôle de la guerre et dans l'organisation de la vie économique et sociale qui marquaient cette période. Ces avancées furent résumées avec une clarté particulière dans deux textes clés : le "Rapport sur la situation internationale" de la Conférence de juillet 1945 de la GCF 9 et "L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective" publié dans Internationalisme n°46 en 1952. 10
Le rapport de 1945 était centré sur la façon dont la fonction de la guerre capitaliste avait changé entre la période d'ascendance et celle de décadence. La guerre impérialiste constituait l'expression la plus concentrée du déclin du système :
"Il n'existe pas une opposition fondamentale en régime capitaliste entre guerre et paix, mais il existe une différence entre les deux phases ascendante et décadente de la société capitaliste et partant une différence de fonction de la guerre (dans le rapport de la guerre et de la paix), dans les deux phases respectives. Si dans la première phase, la guerre a pour fonction d'assurer un élargissement du marché, en vue d'une plus grande production de consommation, dans la seconde phase la production est essentiellement axée sur la production de moyens de destruction, c'est-à-dire en vue de la guerre. La décadence de la société capitaliste trouve son expression éclatante dans le fait que des guerres en vue du développement économique - période ascendante -, l'activité économique se restreint essentiellement en vue de la guerre - période de décadence.
Cela ne signifie pas que la guerre soit devenue le but de la production capitaliste, le but restant toujours pour le capitalisme la production de plus-value, mais cela signifie que la guerre prenant un caractère de permanence est devenue le mode de vie du capitalisme décadent." ("Rapport sur la situation internationale" de la Conférence de juillet 1945)
En réponse à ceux qui défendaient que le caractère destructeur de la guerre ne constituait qu'une continuation du cycle classique de l'accumulation capitaliste et était donc un phénomène totalement "rationnel", la GCF mettait en avant le caractère profondément irrationnel de la guerre impérialiste – pas seulement du point de vue de l'humanité mais même de celui du capital lui-même :
"La production de guerre n'a pas pour objectif la solution d'un problème économique. A l'origine, elle est le fruit d'une nécessité de l'État capitaliste de se défendre contre les classes dépossédées et de maintenir par la force leur exploitation, d'une part, et d'assurer par la force ses positions économiques et de les élargir, aux dépens des autres États impérialistes. (…) La crise permanente pose l'inéluctabilité, l'inévitabilité du règlement des différends impérialistes par la lutte armée. La guerre et la menace de guerre sont les aspects latents ou manifestes d'une situation de guerre permanente dans la société. La guerre moderne est essentiellement une guerre de matériel. En vue de la guerre une mobilisation monstrueuse de toutes les ressources techniques et économiques des pays est nécessaire. La production de guerre devient aussi l'axe de la production industrielle et le principal champ économique de la société.
Mais la masse des produits représente-t-elle un accroissement de la richesse sociale ? A cette question, il faut répondre catégoriquement par la négative, la production de guerre, toutes les valeurs qu'elle matérialise, est destinée à sortir de la production, à ne pas se retrouver dans la reprise du procès de la production et à être détruite. Après chaque cycle de production, la société n'enregistre pas un accroissement de son patrimoine social, mais un rétrécissement, un appauvrissement dans la totalité" (Idem)
Ainsi, la GCF considérait la guerre impérialiste comme une expression de la tendance du capitalisme sénile à s'autodétruire. On pourrait dire la même chose du mode d'organisation devenu dominant dans la nouvelle époque : le capitalisme d'État.
Dans "L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective", la GCF analysait le rôle de l'État dans la survie du système dans la période de décadence ; là encore, la distorsion de ses propres lois par le capitalisme est typique de l'agonie qui mène à son effondrement :
"Devant l'impossibilité de s'ouvrir de nouveaux marchés, chaque pays se ferme et tend désormais à vivre sur lui-même. L'universalisation de l'économie capitaliste, atteinte au travers du marché mondial, se rompt : c'est l'autarcie. Chaque pays tente de se suffire à lui-même ; on y crée un secteur non rentable de production, lequel a pour objet de pallier aux conséquences de la rupture du marché. Ce palliatif même aggrave encore la dislocation du marché mondial.
La rentabilité, par la médiation du marché, constituait avant 1914 l'étalon, mesure et stimulant, de la production capitaliste. La période actuelle enfreint cette loi de la rentabilité : celle-ci s'effectue désormais non plus au niveau de l'entreprise mais à celui, global, de l'État. La péréquation se fait sur un plan comptable, à l'échelle nationale ; non plus par l'entremise du marché mondial. Ou bien, l'État subventionne la partie déficitaire de l'économie, ou bien l'État prend en mains l'ensemble de l'économie.
De ce qui précède, on ne peut conclure à une "négation" de la loi de la valeur. Ce à quoi nous assistons tient en ce que la production d'une unité de la production semble détachée de la loi de la valeur cette production s'effectuant sans considération apparente de sa rentabilité.
Le surprofit monopolistique se réalisait au travers de prix "artificiels", cependant sur le plan global de la production, celle-ci demeurait liée à la loi de la valeur. La somme des prix, pour l'ensemble des produits, n'exprimait rien d'autre que la globale valeur des produits. Seule la répartition des profits entre divers groupes capitalistes se trouvait transformée : les monopoles s'arrogeaient un surprofit aux dépens des capitalistes moins bien armés. De même peut-on dire que la loi de la valeur joue au niveau de la production nationale. La loi de la valeur n'agit plus sur un produit pris individuellement, mais sur l'ensemble des produits. On assiste à une restriction du champ d'application de la loi de la valeur. La masse totale du profit tend à diminuer du fait de la charge que fait peser l'entretien des branches déficitaires sur les autres branches de l'économie."
Nous avons dit que personne ne détenait le monopole de la clarté dans les débats au sein du PCInt ; on peut dire la même chose de la GCF. Face à la sombre situation du mouvement ouvrier au lendemain de la guerre, elle allait jusqu'à conclure non seulement que les anciennes institutions du mouvement ouvrier, partis et syndicats, étaient irréversiblement intégrées dans le Léviathan de l'État capitaliste, mais aussi que la lutte défensive elle-même avait perdu son caractère de classe :
"Les luttes économiques des ouvriers ne peuvent plus amener que des échecs - au mieux le maintien habile de conditions de vie d'ores et déjà dégradées. Elles lient le prolétariat aux exploiteurs en l'amenant à se considérer solidaire du système en échange d'une assiette de soupe supplémentaire (et qu'il n'obtiendra, en fin de compte, qu'en améliorant sa "productivité")." (L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective)
Il est certainement juste que les luttes économiques ne pouvaient permettre aucun acquis durable dans la nouvelle période mais l'idée qu'elles ne servent qu'à attacher le prolétariat à ses exploiteurs n'était pas correcte : au contraire, elles continuaient de constituer une précondition indispensable pour briser cette "solidarité avec le système".
La GCF ne voyait pas non plus de possibilité que le capitalisme puisse connaître une reprise quelconque après la guerre. D'un côté, elle pensait qu'il y avait un manque absolu de marchés extra-capitalistes permettant un véritable cycle de reproduction élargie. Dans sa polémique légitime contre l'idée de Trotski qui voyait dans les mouvements nationalistes des colonies ou des anciennes colonies une possibilité de saper le système impérialiste mondial, elle défendait :
"En fait, les colonies ont cessé de représenter un marché extra-capitaliste pour la métropole, elles sont devenues de nouveaux pays capitalistes. Elles perdent donc leur caractère de débouchés, ce qui rend moins énergique la résistance des vieux impérialismes aux revendications des bourgeoisies coloniales. A ceci s'ajoute le fait que les difficultés propres à ces impérialismes ont favorisé l'expansion économique - au cours des deux guerres mondiales - des colonies. Le capital constant s'amenuisait en Europe, tandis que la capacité de production des colonies ou semi-colonies augmentait, amenant une explosion du nationalisme indigène (Afrique du Sud, Argentine, Inde, etc...). Il est significatif de constater que ces nouveaux pays capitalistes passent, dès leur création, en tant que nations indépendantes, au stade de capitalisme d'État présentant ces mêmes aspects d'une économie tournée vers la guerre que l'on décèle par ailleurs.
La théorie de Lénine et de Trotski s'effondre. Les colonies s'intègrent au monde capitaliste et, par là même, le renforcent d'autant. Il n'y a plus de "maillon le plus faible : la domination du capital est également répartie sur la surface entière du globe."
Il est vrai que la guerre avait permis à certaines colonies situées en dehors du terrain principal du conflit de se développer dans un sens capitaliste et que, globalement, les marchés extra-capitalistes étaient devenus de plus en plus inadéquats pour fournir un débouché à la production capitaliste. Mais il était prématuré d'annoncer leur disparition totale. En particulier, l'éviction des vieilles puissances comme la France et la Grande-Bretagne de leurs anciennes colonies, avec leurs rapports en grande partie parasitaires vis-à-vis de leurs empires, a permis au grand vainqueur de la guerre – les États-Unis - de trouver de nouveaux champs lucratifs d'expansion, en particulier en Extrême-Orient 11. A la même époque, il existe des marchés extra-capitalistes non encore épuisés dans certains pays européens (en France notamment) constitués en grande partie par ce secteur de la petite paysannerie qui n'a pas encore été intégré dans les rouages de l'économie capitaliste.
La survivance de certains marchés solvables extérieurs à l'économie capitaliste a constitué l'un des facteurs qui a permis au capitalisme de se ranimer après la guerre pendant une période d'une longueur inattendue. Mais c'était beaucoup lié à la réorganisation politique et économique plus générale du système capitaliste. Dans le rapport de 1945, la GCF avait reconnu que, bien que le bilan global de la guerre fût catastrophique, certaines puissances impérialistes pouvaient quand même se renforcer grâce à leur victoire dans la guerre. En fait, les États-Unis en étaient sortis dans une position de force sans précédent qui leur a permis de financer la reconstruction des puissances européennes et japonaise ravagées par la guerre, évidemment pour leurs propres intérêts impérialistes et économiques. Et les mécanismes utilisés pour revivifier et étendre la production au cours de cette phase furent précisément ceux que la GCF avait identifiés : le capitalisme d'État, en particulier sous sa forme keynésienne, qui a permis une certaine "harmonisation" forcée entre la production et la consommation, non seulement au niveau national mais, également, international, à travers la formation d'énormes blocs impérialistes ; et, allant de pair, une véritable déformation de la loi de la valeur, sous la forme de prêts massifs et même de "cadeaux" tout court de la part des États-Unis triomphants envers les puissances vaincues et ruinées, ce qui a permis à la production de reprendre et de croître non sans que commence à s’accroître, de façon irréversible, une dette qui ne pourra jamais être remboursée, à la différence du développement du capitalisme ascendant.
Ainsi en se rechapant à l'échelle globale, le capitalisme a connu, pour la première fois depuis la "Belle Époque" au début du 20e siècle, une période de boom. Ce n'était pas encore visible en 1952 quand dominait encore l'austérité d'après-guerre. Ayant analysé avec justesse qu'il n'y avait pas eu de revitalisation du prolétariat après la guerre, la GCF conclut de façon erronée qu'une troisième guerre mondiale était à l'ordre du jour pour bientôt. Cette erreur participa à accélérer la disparition du groupe qui se dissout en 1952 – l'année où avait lieu la scission dans le PCInt. Ces deux événements confirmaient que le mouvement ouvrier vivait encore dans l'ombre de la profonde réaction qui avait suivi la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23.
"Le grand boom keynésien"
Au milieu des années 1950, quand la phase d'austérité absolue tirait à sa fin dans les pays capitalistes centraux, il devenait clair que le capitalisme connaissait un boom sans précédent. En France, cette période est connue sous le nom des "Trente Glorieuses" ; d'autres l'appellent "le grand boom keynésien". La première expression est évidemment plutôt inexacte. On peut certainement douter du fait qu'elle ait duré trente ans 12, et elle fut moins que glorieuse pour une partie très importante de la population globale. Néanmoins, elle connut des taux de croissance très rapides dans les pays occidentaux, et même dans ceux de l'Est, bien plus léthargiques et économiquement arriérés, il y eut une poussée de développement technologique qui suscita des discussions sur la capacité de la Russie de "rattraper" l'Ouest comme le suggéraient de façon frappante les succès russes initiaux dans la course à l'espace. Le "développement" de l'URSS était toujours basé sur l'économie de guerre, comme dans les années 1930. Mais bien que le secteur d'armement continuât à peser lourdement à l'Ouest, les salaires réels des ouvriers des principaux pays industrialisés augmentèrent de façon importante (en particulier relativement aux conditions très dures qui avaient prévalu durant la période de reconstruction de l'économie) et le "consumérisme" de masse devint un élément de la vie de la classe ouvrière, combiné à des programmes sociaux importants (santé, vacances, paiement des congés maladie) et un taux de chômage très bas. C'est ce qui permit au Premier ministre conservateur britannique, Harold Macmillan, de proclamer de façon paternaliste que "la plus grande partie de notre population n'a jamais vécu aussi bien" (discours à Bedford, juillet 1957).
Un économiste universitaire résume ainsi le développement économique au cours de cette période :
"Rien qu'un bref coup d'œil aux chiffres et aux taux de croissance révèle que la croissance et la reprise après la Deuxième Guerre mondiale furent étonnamment rapides. Si l'on considère les trois plus importantes économies d'Europe occidentale – la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne – la Deuxième Guerre mondiale leur a infligé bien plus de dommages et de destructions que la Première. Et (sauf pour la France) les pertes humaines ont été également plus grandes pendant la Deuxième. A la fin de la guerre, 24% des Allemands nés en 1924 étaient morts ou disparus, 31% handicapés ; après la guerre, il y avait 26% de plus de femmes que d'hommes. En 1946, l'année qui suivit la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le PNB par tête dans les trois plus grandes économies européennes avait chuté d'un quart par rapport au niveau d'avant-guerre de 1938. C'était équivalent à la moitié de la chute de la production par tête en 1919 par rapport au niveau d'avant-guerre en 1913."
Pourtant le rythme de la reprise d'après la Deuxième Guerre surpassa rapidement celui d'après la Première. En 1949, le PNB moyen par tête dans les trois grands pays avait quasiment retrouvé son niveau d'avant-guerre et, comparativement, la reprise avait deux ans d'avance sur le rythme d'après la Première Guerre. En 1951, six ans après la guerre, le PNB par tête était supérieur de plus de 10% à celui d'avant-guerre, un niveau de reprise qui ne fut jamais atteint au cours des onze années d'après la Première Guerre, avant que ne commence la Grande Dépression. Ce qui fut accompli en six ans après la Deuxième Guerre, avait pris seize ans après la Première.
La restauration de la stabilité financière et le libre jeu des forces du marché permirent à l'économie européenne de connaître deux décennies d'une croissance rapide jamais vue. La croissance économique européenne entre 1953 et 1973 fut deux fois plus rapide que tout ce qu'on avait connu jusqu'alors et qu'on a connu depuis pour une telle période. Le taux de croissance du PNB était de 2% par an entre 1870 et 1913, de 2,5% par an entre 1922 et 1937. Comparativement, la croissance s'accéléra incroyablement jusqu'à 4,8% par an entre 1953 et 1973, avant de ralentir à la moitié de ce taux de 1973 à 1979." (Traduit de l'anglais par nous.13)
Socialisme ou Barbarie : théoriser le boom
Sous le poids de cette avalanche de faits, la vision marxiste du capitalisme comme système sujet aux crises et entré dans sa période de déclin depuis quasiment un demi-siècle s'est trouvé mise en cause sur tous les fronts. Et étant donné l'absence de mouvements de classe généralisés (avec quelques exceptions notables comme les luttes massives dans le bloc de l'Est en 1953 et en 1956), la sociologie officielle s'est mise à parler de "l'embourgeoisement" de la classe ouvrière, de la récupération du prolétariat par la "société de consommation" qui semblait avoir réglé les problèmes de gestion de l'économie. La mise en question des principes fondamentaux du marxisme affecta inévitablement des éléments qui se considéraient comme des révolutionnaires. Marcuse accepta l'idée que la classe ouvrière des pays avancés s'était plus ou moins intégrée au système et estima que le sujet révolutionnaire était désormais constitué par les minorités ethniques opprimées, les étudiants révoltés des pays avancés et les paysans du "Tiers-Monde". Mais l'élaboration la plus cohérente à l'encontre des catégories marxistes "traditionnelles" provint du groupe Socialisme ou Barbarie (S ou B) en France, un groupe dont les communistes de gauche de la GCF avaient salué la rupture avec le trotskisme officiel.
Dans Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne rédigé par le principal théoricien du groupe, Paul Cardan/Cornelius Castoriadis, celui-ci analyse les principaux pays capitalistes au milieu des années 1960 et conclut que le capitalisme "bureaucratique" "moderne" est parvenu à éliminer les crises économiques et peut donc poursuivre indéfiniment son expansion.
"Le capitalisme est parvenu à contrôler le niveau de l’activité économique à un degré tel que les fluctuations de la production et de la demande sont maintenues dans des limites étroites et que des dépressions de l’ordre de celles d’avant-guerre sont désormais exclues (…)
(…) il y a une intervention consciente continue de l'État en vue de maintenir l’expansion économique. Même si la politique de l'État capitaliste est incapable d’éviter à l’économie l’alternance de phases de récession et d’inflation, encore moins d’en assurer le développement rationnel optimum, elle a été obligée d’assumer la responsabilité du maintien d’un 'plein emploi' relatif et de l’élimination de dépressions majeures. La situation de 1933, qui correspondrait aujourd’hui aux États-Unis à un chômage de 30 millions, est absolument inconcevable, ou bien conduirait à l’explosion du système dans les vingt-quatre heures ; ni les ouvriers, ni les capitalistes ne la toléreraient plus longuement." 14
Ainsi, la vision du capitalisme de Marx comme un système sujet aux crises ne n'applique qu'au 19e siècle et non plus à notre époque. Il n'y a pas de contradictions économiques "objectives" et les crises économiques, si elles ont lieu, ne seront désormais essentiellement que des accidents (il existe une introduction datée de 1974 à ce livre qui décrit précisément la récession de cette période comme le produit de "l'accident" de l'augmentation des prix du pétrole 15). La tendance à l'effondrement comme résultat de contradictions économiques internes - en d'autres termes le déclin du système – ne constitue plus la base d'une révolution socialiste dont il faut chercher ailleurs les fondements. Cardan défend l'idée que, tandis que les convulsions économiques et la pauvreté matérielle peuvent être surmontées, ce dont le capitalisme bureaucratique ne peut se débarrasser, c'est l'augmentation de l'aliénation au travail et dans les loisirs, la privatisation croissante de la vie quotidienne 16 et, en particulier, la contradiction entre le besoin du système de traiter les ouvriers comme des objets stupides seulement capables d'obéir à des ordres et la nécessité d'un appareil technologique de plus en plus sophistiqué qui s'appuie sur l'initiative et l'intelligence des masses pour lui permettre de fonctionner.
Cette démarche reconnaissait que le système bureaucratique avait fondamentalement annexé les anciens partis ouvriers et les syndicats 17, augmentant le manque d'intérêt des masses pour la politique traditionnelle. Il critiquait férocement le vide de la vision du socialisme défendue par la "gauche traditionnelle" dont la défense d'une économie totalement nationalisée (additionnée d'un peu de contrôle ouvrier si l'on prend la version trotskiste) n'offrait tout simplement aux masses qu'un renforcement des conditions présentes. Contre ces institutions fossilisées et contre la bureaucratisation débilitante qui affectait toutes les habitudes et les organisations de la société capitaliste, S ou B défendait la nécessité de l'auto-activité des ouvriers à la fois dans la lutte quotidienne et comme seul moyen d'atteindre le socialisme. Comme ce dernier était présenté autour de la question essentielle de qui contrôle vraiment la production dans la société, il y avait là une base bien plus solide pour la création d'une société socialiste que la vision "objectiviste" des marxistes traditionnels qui attendaient la prochaine grande dégringolade pour entrer en scène et mener les ouvriers à la terre promise, non sur la base d'une véritable élévation de la conscience, mais simplement sur celle d'une sorte de réaction biologique à l'appauvrissement. Un tel schéma de la révolution, pour faire court, ne pourrait jamais mener à une véritable compréhension des rapports humains.
"Et quelle est l’origine des contradictions du capitalisme, de ses crises et de sa crise historique ? C’est l’"appropriation privée", autrement dit la propriété privée et le marché. C’est cela qui fait obstacle au "développement des forces productives", qui serait par ailleurs le seul, vrai et éternel objectif des sociétés humaines. La critique du capitalisme consiste finalement à dire qu’il ne développe pas assez vite les forces productives (ce qui revient à dire qu’il n’est pas assez capitaliste). Pour réaliser ce développement plus rapide, il faudrait et il suffirait que la propriété privée et le marché soient éliminés : nationalisation des moyens de production et planification offriraient alors la solution à la crise de la société contemporaine.
Cela d’ailleurs les ouvriers ne le savent pas et ne peuvent pas le savoir. Leur situation leur fait subir les conséquences des contradictions du capitalisme, elle ne les conduit nullement à en pénétrer les causes. La connaissance de celles-ci ne résulte pas de l’expérience de la production, mais du savoir théorique portant sur le fonctionnement de l’économie capitaliste, savoir accessible certes à des ouvriers individuels, mais non pas au prolétariat en tant que prolétariat. Poussé par sa révolte contre la misère, mais incapable de se diriger lui-même puisque son expérience ne lui donne aucun point de vue privilégié sur la réalité ; le prolétariat ne peut être, dans cette optique, que l’infanterie au service d’un état-major de spécialistes, qui eux, savent, à partir d’autres considérations auxquelles le prolétariat comme tel n’a pas accès, ce qui ne va pas avec la société actuelle et comment il faut la modifier. La conception traditionnelle sur l’économie et la perspective révolutionnaire ne peut fonder, et n’a fondé effectivement dans l’histoire, qu’une politique bureaucratique.
Certes Marx lui-même n’a pas tiré ces conséquences de sa théorie économique ; ses positions politiques sont allées, la plupart du temps, dans un sens diamétralement opposé. Mais ce sont ces conséquences qui en découlent objectivement, et ce sont elles qui ont été affirmées de façon de plus en plus nette dans le mouvement historique effectif, aboutissant finalement au stalinisme. La vue objectiviste de l’économie et de l’histoire ne peut être que la source d’une politique bureaucratique, c’est-à-dire d’une politique qui, sauvegardant l’essence du capitalisme, essaye d’en améliorer le fonctionnement." 18
Dans ce texte, il est clair que Cardan ne cherche pas à distinguer la "gauche traditionnelle" – c'est-à-dire l'aile gauche du capital – des authentiques courants marxistes qui survécurent à la récupération par le capitalisme des anciens partis et qui défendirent vigoureusement l'auto-activité de la classe ouvrière malgré leur adhésion à la critique par Marx de l'économie politique. Ces derniers (malgré les discussions d'après-guerre entre S ou B et la GCF) ne sont presque jamais mentionnés ; mais, plus centralement, malgré la continuation de l'attachement à Marx contenu dans ce passage, Cardan ne cherche pas à expliquer pourquoi Marx ne tira pas de conclusions "bureaucratiques" de son économie "objectiviste", pas plus qu'il ne cherche à mettre en lumière le gouffre qui sépare la conception du socialisme de Marx de celle des staliniens et des trotskistes. En fait, ailleurs, dans le même texte, il accuse la méthode de Marx d'objectivisme, d'ériger d'implacables lois économiques vis-à-vis desquelles les êtres humains ne peuvent rien, de tomber dans la même réification de la force de travail qu'il critiquait lui-même. Et malgré son approbation ici et là des Manuscrits économiques et philosophiques de 1844, Cardan n'accepte jamais le fait que la critique de l'aliénation est à la base de l'ensemble de l'œuvre de Marx qui n'est rien d'autre qu'une protestation contre la réduction de la puissance créatrice de l'homme à une marchandise mais qui, en même temps, reconnaît cette généralisation des rapports marchands comme la base "objective" du déclin ultime du système. De même, malgré une reconnaissance du fait que Marx a vu un aspect "subjectif" à la détermination de la valeur de la force de travail, cela n'empêche pas Cardan de tirer la conclusion que "Marx, qui a découvert la lutte des classes, écrit un ouvrage monumental analysant le développement du capitalisme, ouvrage d’où la lutte des classes est totalement absente." (Cardan, Ibid.)
De plus, les contradictions économiques que Cardan écarte sont présentées de façon très superficielle. Cardan s'aligne sur l'école néo-harmoniste (Otto Bauer, Tugan-Baranovski, etc.) qui tenta d'appliquer les schémas de Marx dans le 2e livre du Capital pour prouver que le capitalisme pouvait poursuivre l'accumulation sans crises : pour Cardan, le capitalisme régulé de la période d'après-guerre avait finalement apporté l'équilibre nécessaire entre la production et la consommation, éliminant le problème du "marché" pour toujours. C'est vraiment une simple resucée du keynésianisme, et les limites inhérentes à la réalisation d'un "équilibre" entre la production et le marché allaient se révéler très rapidement. Il expédie la baisse du taux de profit brièvement dans un appendice. L'aspect le plus parlant de cette partie est quand il écrit :
"L'argument dans son ensemble est de plus hors de propos : c'est une diversion. Nous ne l'avons discuté que parce que c'est devenu une obsession dans les esprits de beaucoup de révolutionnaires honnêtes, qui ne peuvent pas se défaire des chaînes de la théorie traditionnelle. Quelle différence cela fait-il pour le capitalisme dans son ensemble que les profits soient aujourd'hui disons de 12 % en moyenne, alors qu'ils étaient de 15 % il y a un siècle ? Cela ralentirait-il l'accumulation et ainsi l'expansion de production capitaliste comme parfois dit dans ces discussions ? Et même en supposant que ce soit le cas : ET ALORS ? Quand et de combien ? […] Et même si cette "loi" était juste, pourquoi cesserait-elle de l'être sous le socialisme ?
Le seul "fondement" de cette "loi" chez Marx est quelque chose qui n'a aucun rapport avec le capitalisme lui-même ; c'est le fait technique qu'il y a de plus en plus de machines et de moins en moins d'hommes [les actionnant, NDLR]. Sous le socialisme, les choses seraient "encore pires". Le progrès technique serait accéléré et, ce qui, dans le raisonnement de Marx, s'oppose à la baisse du taux de profit sous le capitalisme, à savoir l'augmentation du taux d'exploitation, n'aurait pas d'équivalent sous le socialisme. Une économie socialiste connaitrait-elle un blocage à cause d'une pénurie de capital à accumuler ?" 19
Ainsi, pour Cardan, une contradiction fondamentale enracinée dans la production de valeur elle-même n'a pas d'importance parce que le capitalisme traverse une période d'accumulation accélérée. Pire : il y aura toujours (pourquoi pas ?) production de valeur dans le socialisme puisque la production de marchandises en elle-même n'amène pas inéluctablement à la crise et à l'effondrement. En fait, l'utilisation des catégories capitalistes de base comme la valeur et la monnaie pourrait même s'avérer une façon rationnelle de distribuer le produit social, comme Cardan l'explique dans la brochure Sur le contenu du socialisme (publiée à l'été 1957 dans Socialisme ou Barbarie n° 22).
Cette superficialité a empêché Cardan de saisir la nature contingente et temporaire du boom d'après-guerre. 1973 n'était pas un accident et n'a pas eu pour première cause l'augmentation des prix du pétrole, c'était la réapparition manifeste des contradictions fondamentales du capitalisme que la bourgeoisie avait tant cherché à nier et qu'elle avait tenté de conjurer au cours des 40 dernières années, avec plus ou moins d'effet. Aujourd'hui plus que jamais, la prédiction de Cardan qu'une nouvelle dépression était impensable semble ridiculement obsolète. Ce n'est pas surprenant que S ou B et son successeur en Grande-Bretagne, Solidarity, aient disparu entre les années 1960 et 90, lorsque la réalité de la crise économique s'est révélée de plus en plus sévère à la classe ouvrière et à ses minorités politiques. Cependant, beaucoup des idées de Cardan – comme son rejet du "marxisme classique" comme étant "objectiviste" et niant la dimension subjective de la lutte révolutionnaire – se sont avérées remarquablement persistantes, comme nous le verrons dans un autre article.
Gerrard
1 "Décadence du capitalisme : la révolution est nécessaire et possible depuis un siècle [113]", Revue internationale n° 132,
2 https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties [114]
3 Voir "La lutte de classe contre la guerre impérialiste : les luttes ouvrières en Italie 1943 [115]", Revue internationale n° 75,
4 Voir notre livre La Gauche communiste d'Italie pour plus de détails sur la façon dont s'est formé le PCInt. Pour les critiques portées par la GCF à la plateforme du parti, lire "Le Deuxième Congrès du PCInt en Italie [116]" dans Internationalisme n° 36, juillet 1948, republié dans la Revue internationale n°36.
5 "L'invariance" bordiguiste, comme nous l'avons souvent montré, est en réalité très variable. Ainsi, tout en insistant sur la nature intégrale du programme communiste depuis 1848 et donc la possibilité du communisme depuis cette époque, Bordiga, par loyauté aux congrès de fondation de l'IC, était également obligé d'admettre que la guerre avait marqué l'ouverture d'une crise historique générale du système. Comme Bordiga l'a écrit lui-même dans les "Thèses caractéristiques du parti" en 1951 : "Les guerres impérialistes mondiales démontrent que la crise de désagrégation du capitalisme est inévitable du fait que celui-ci est entré définitivement dans la période où son expansion n'exalte plus historiquement l'accroissement des forces productives, mais lie leur accumulation à des destructions répétées et croissantes." https://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vami/vamimfebif.html [117]. Nous avons écrit plus longuement sur l'ambiguïté des bordiguistes concernant le problème du déclin du capitalisme dans la Revue internationale n° 77, 1994 :"Le rejet de la notion de décadence conduit à la démobilisation du prolétariat face à la guerre - Polémique avec Programme Communiste sur la guerre impérialiste ", https://fr.internationalism.org/rinte77/decad.htm [118]
6 https://www.pcint.org/15_Textes_Theses/07_01_fr/1951-theorie-action-dans-doctrine-marxiste.htm [119]
7 "Dialogue avec les morts", 1956.
8 "Comprendre la décadence du capitalisme" (1 et 5) , https://fr.internationalism.org/rinte48/decad.htm [120] et https://fr.internationalism.org/french/rinte55/decad.htm [121]
9 Republié en partie dans la Revue internationale n° 59, au sein de l'article "Il y a 50 ans : les véritables causes de la 2 [122]e [122] guerre mondiale [122]".
10 Republié [123] dans la Revue internationale n° 21.
11 Dans ses articles "Crises et cycles dans l'économie du capitalisme agonisant", publiés en 1934 dans les numéros 10 et 11 de Bilan (republiés dans les numéros 102 [124] et 103 [125] de la Revue internationale), que nous avons examinés dans le précédent article de cette série, Mitchell avait affirmé que les marchés asiatiques constitueraient l'un des enjeux de la guerre à venir. Il n'a pas développé cette affirmation, mais cela vaudrait la peine de se pencher sur cette question, étant donné que, dans les années 1930, l'Asie et l'Extrême-Orient en particulier constituaient une région du globe où subsistaient des vestiges considérables des civilisations pré-capitalistes, et étant donné l'importance de la capitalisation de cette région pour le développement du capitalisme au cours des dernières décennies.
12 La fin des années 1940 fut une période d'austérité et de privations dans la plupart des pays européens. Ce n'est pas avant le milieu des années 1950 que la "prospérité" commença à se faire sentir dans des parties de la classe ouvrière et les premiers signes d'une nouvelle phase de crise économique apparurent vers 1966-67, devenant évidente au niveau global au début des années 1970.
13 Slouching Towards Utopia? The Economic History of the Twentieth Century – chapitre XX "The Great Keynesian Boom : 'Thirty Glorious Years' ", J.Bradford DeLong, Université de Californie, Berkeley et NBER, février 1997
14 Cornelius Castoriadis. Brochure n°10. Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne [126]. Chap. I : "Quelques traits importants du capitalisme contemporain".
15 Cette introduction à la réédition anglaise de 1974 est disponible dans la brochure n° 9.
16 Les situationnistes, dont la vision de l' "économie" était très influencée par Cardan, sont allés bien plus loin dans la critique de la stérilité de la culture capitaliste moderne et de la vie quotidienne.
17 La critique des syndicats est cependant limitée : le groupe avait beaucoup d'illusions sur le système des shop-stewards britanniques qui en réalité avait fait depuis longtemps la paix avec la structure syndicale officielle.
18 Cornelius Castoriadis, op. cit., Chap. II : "La perspective révolutionnaire dans le marxisme traditionnel"
19 Ibid. Notre traduction à partir de la version anglaise de l'ouvrage mentionné de Castoriadis, Modern Capitalism and Revolution ; Appendix – The “Falling Rate of Profit” ; https://libcom.org/library/modern-capitalism-revolution-paul-cardan [127].



