Revue Int. 2009 - 136 à 139
- 3686 lectures
Revue Internationale n° 136 - 1er trimestre 2009
- 2670 lectures
Les révoltes de la jeunesse en Grèce confirment le développement de la lutte de classe
- 2909 lectures
A la fin de l'année 2008, plusieurs pays d'Europe ont été touchés simultanément par des mouvements massifs de la jeunesse scolarisée (étudiants et lycéens). En Grèce, les assemblées générales massives d'étudiants ont même évoqué un nouveau "Mai 68". En effet, ce ne sont pas seulement des jeunes qui se sont mobilisés contre les attaques du gouvernement et contre la répression de l'État policier, mais aussi plusieurs secteurs de la classe ouvrière en solidarité avec les jeunes générations. L'aggravation de la crise économique mondiale révèle de plus en plus la faillite d'un système qui n'a plus d'avenir à offrir aux enfants de la classe ouvrière. Mais ces mouvements sociaux ne sont pas seulement des mouvements de la jeunesse. Ils s'intègrent dans les luttes ouvrières qui se développent à l'échelle mondiale. La dynamique actuelle de la lutte de classe internationale, marquée par l'entrée des jeunes générations sur la scène sociale, confirme que l'avenir est bien entre les mains de la classe ouvrière. Face au chômage, à la précarité, à la misère et à l'exploitation, le vieux slogan du mouvement ouvrier "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous" est plus que jamais d'actualité.
L’explosion de colère et la révolte des jeunes générations prolétarisées en Grèce n’ont rien d’un phénomène isolé ou particulier. Elles plongent leurs racines dans la crise mondiale du capitalisme et leur confrontation à la répression violente met à nu la vraie nature de la bourgeoisie et de sa terreur d’État. Elles se situent dans la lignée directe de la mobilisation des jeunes générations sur un terrain de classe en France contre le CPE (Contrat Première Embauche) de 2006 et la LRU (Loi sur la Réforme de l’Université) de 2007 où les étudiants et les lycéens se reconnaissent avant tout comme des prolétaires révoltés contre leurs futures conditions d’exploitation. L’ensemble de la bourgeoisie des principaux pays européens l’a d’ailleurs bien compris en avouant ses craintes de contagion d’explosions sociales similaires face à l’aggravation de la crise. Ainsi, de façon significative, la bourgeoisie en France a fini par reculer en suspendant précipitamment son programme de réforme des lycées. D’ailleurs, le caractère international de la contestation et de la combativité étudiante et surtout lycéenne s’exprime déjà fortement.
En Italie, deux mois de mobilisation étudiante ont été ponctués par des manifestations massives qui se sont déroulées le 25 octobre et le 14 novembre derrière le slogan "Nous ne voulons pas payer pour la crise" contre le décret Gelmini contesté à cause des coupes budgétaires dans l’Éducation nationale et ses conséquences : notamment le non-renouvellement des contrats de 87 000 enseignants précaires et de 45 000 travailleurs de l’ABA (personnel technique employé par l’Éducation nationale) ainsi que face à la réduction des fonds publics pour l’université 1.
En Allemagne, le 12 novembre, 120 000 lycéens sont descendus dans les rues des principales villes du pays (avec des slogans tels que : "Le capitalisme, c’est la crise" comme à Berlin ou en assiégeant le parlement provincial comme à Hanovre).
En Espagne, le 13 novembre, des centaines de milliers d’étudiants ont manifesté dans plus de 70 villes du pays contre les nouvelles directives à l’échelle européenne (directives de Bologne) de la réforme de l’enseignement supérieur et universitaire généralisant la privatisation des facultés et multipliant les stages dans les entreprises.
La révolte notamment des jeunes générations de prolétaires face à la crise et à la détérioration de leur niveau de vie s’étend à d’autres pays : rien qu’en janvier 2009, Vilnius (Lituanie), Riga (Lettonie) et Sofia (Bulgarie) ont connu des mouvements d’émeutes durement réprimées par la police. Au Sénégal, en décembre 2008 des affrontements violents contre la misère croissante alors que les manifestants réclamaient une quote-part des fonds miniers exploités par Arcelor Mittal ont fait deux morts à Kégoudou, à 700 km au Sud-Est de Dakar. Au Maroc, 4000 étudiants de Marrakech s’étaient déjà révoltés début mai 2008 face à une intoxication alimentaire touchant 22 d’entre eux dans un restaurant universitaire. Suite à la répression violente du mouvement, arrestations, lourdes peines de prison et tortures se sont multipliées depuis lors.
Beaucoup d’entre eux se sont reconnus dans le combat des étudiants en Grèce.
L’ampleur de cette mobilisation face aux mêmes mesures de l’État n’a rien d’étonnant. La réforme du système éducatif entreprise à l’échelle européenne est à la base d’un conditionnement des jeunes générations ouvrières à un avenir bouché et à la généralisation de la précarité et du chômage.
Le refus et la révolte des nouvelles générations de prolétaires scolarisés face à ce mur du chômage et à cet océan de précarité que leur réserve le système capitaliste en crise suscitent également partout la sympathie des prolétaires, toutes générations confondues.
Violence minoritaire ou lutte massive contre l’exploitation et la terreur d’État ?
Les médias aux ordres de la propagande mensongère du capital n’ont pas cessé de chercher à déformer la réalité de ce qui s’est passé en Grèce depuis le meurtre par balle, le 6 décembre dernier, du jeune Alexis Andreas Grigoropoulos âgé de 15 ans. Ils ont présenté les affrontements avec la police comme le fait soit d’une poignée d’autonomes anarchistes et d’étudiants d'ultra-gauche issus de milieux aisés, soit de casseurs marginalisés. Ils n'ont cessé de diffuser en boucle à la télé des images d’affrontements violents avec la police et mettant surtout en scène des images d’émeutes de jeunes cagoulés faisant brûler des voitures, faisant voler en éclats des vitrines de boutiques ou de banques, voire des scènes de pillage de magasins.
C’est exactement la même méthode de falsification de la réalité que celle qu'on avait vue lors de la mobilisation anti-CPE de 2006 en France assimilée aux émeutes dans les banlieues de l’année précédente. C'est encore cette grossière méthode à laquelle on avait assisté lorsque les étudiants en lutte contre la LRU en 2007 en France avaient été assimilés à des "terroristes" et même à des "khmers rouges" !
Mais si le cœur des troubles a eu lieu dans le quartier universitaire grec, Exarchia, il est difficile aujourd'hui de faire avaler une telle pilule : comment ces mouvements de révolte seraient-ils seulement l’œuvre de bandes de casseurs ou d’activistes anarchistes alors qu’ils se sont étendus très rapidement comme une traînée de poudre à l’ensemble des principales villes du pays et jusque dans les îles (Chios, Samos) et les villes les plus touristiques comme Corfou ou en Crète comme à Héraklion ?
En fait, les révoltes se sont étendues à 42 préfectures de Grèce, même dans des villes où il n’y avait jamais eu de manifestation auparavant. Plus de 700 lycées et une centaine d’universités ont été occupés.
Les raisons de la colère
Toutes les conditions étaient réunies pour que le ras-le-bol d’une large partie des jeunes générations ouvrières prises d’angoisse et privées d’avenir éclate en Grèce qui est un concentré de l’impasse que le capitalisme réserve aux jeunes générations ouvrières : quand ceux qui sont appelés "la génération 600 euros" entrent dans la vie active, ils ont l’impression de se faire arnaquer. La plupart des étudiants doivent cumuler deux emplois par jour pour survivre et pouvoir poursuivre leurs études : ils en sont réduits à de petits boulots non déclarés et sous-payés, même en cas d’emplois davantage rémunérés ; une partie de leur salaire n’est pas déclarée, ce qui ampute ainsi leurs droits sociaux ; ils se retrouvent notamment privés de sécurité sociale ; leurs heures supplémentaires ne sont pas payées et ils sont incapables de quitter le domicile parental avant parfois l'âge de 35 ans faute de revenus suffisants pour pouvoir se payer un toit. 23 % des chômeurs en Grèce sont des jeunes (le taux de sans-emploi chez les 15-24 ans est officiellement de 25,2 %). Comme l’indique un article de presse en France 2: "Ces étudiants ne se sentent plus protégés par rien : la police les flingue, l’éducation les piège, l’emploi les lâche, le gouvernement leur ment". Le chômage des jeunes et leurs difficultés à entrer dans le monde du travail a ainsi créé et diffusé un climat d’inquiétude, de colère et d’insécurité généralisé. La crise mondiale est en train d’entraîner de nouvelles vagues de licenciements massifs. En 2009, est prévue une nouvelle perte de 100 000 emplois en Grèce, ce qui correspond à 5% de chômage supplémentaire. En même temps, 40% des travailleurs gagnent moins de 1100 euros brut et la Grèce connaît le taux le plus élevé de travailleurs pauvres des 27 États de l’UE : 14%.
Il n’y a d’ailleurs pas que les jeunes qui sont descendus dans la rue, mais aussi les enseignants mal payés et beaucoup de salariés, en proie aux mêmes problèmes, à la même misère et animés par le même sentiment de révolte. La brutale répression du mouvement, dont le meurtre de cet adolescent de 15 ans a été l’épisode le plus dramatique, n’a fait qu’amplifier cette solidarité où se mêle un mécontentement social généralisé. Comme le rapporte un étudiant, beaucoup de parents d’élèves ont été également profondément choqués et révoltés : "Nos parents ont découvert que leurs enfants peuvent mourir comme ça dans la rue, sous les balles d’un flic" 3 et ont pris conscience du pourrissement d’une société où leurs enfants n’auront pas le même niveau de vie qu’eux. Lors de maintes manifestations, ils ont été témoins des tabassages violents, des arrestations musclées, des tirs à balle réelle et à bras tendu des policiers antiémeutes (les MAT) avec leur arme de service.
Si les occupants de l’École Polytechnique, haut lieu de la contestation étudiante, ont dénoncé la terreur d’État, on retrouve cette colère contre la brutalité de la répression dans toutes les manifestations avec des slogans tels que : "Des balles pour les jeunes, de l’argent pour les banques." Plus clairement encore, un participant du mouvement a déclaré : "On n’a pas de job, pas d’argent, un État en faillite avec la crise, et tout ce qu’il y a comme réponse, c’est de donner des armes aux policiers." 4
Cette colère n’est pas nouvelle : les étudiants grecs s’étaient déjà largement mobilisés en juin 2006 contre la réforme des universités dont la privatisation entraînait l’exclusion des étudiants des milieux les plus modestes. La population avait aussi manifesté sa colère contre l’incurie du gouvernement lors des incendies de l’été 2007 qui avaient fait 67 morts, gouvernement qui n’a toujours pas indemnisé les nombreuses victimes qui avaient perdu leurs maisons ou leurs biens. Mais ce sont surtout les salariés qui s’étaient massivement mobilisés contre la réforme du régime des retraites début 2008 avec deux journées de grève générale très suivies en deux mois, avec des manifestations rassemblant chaque fois plus d’un million de personnes contre la suppression de la retraite anticipée pour les professions les plus pénibles et la remise en cause du droit des ouvrières de prétendre à la retraite dès 50 ans.
Face à la colère des travailleurs, la grève générale du 10 décembre encadrée par les syndicats a servi de son côté de contre-feu pour chercher à dévoyer le mouvement, PS et PC en tête, réclamant la démission du gouvernement actuel et des élections législatives anticipées. Cela n’est pas parvenu à canaliser la colère et à faire cesser le mouvement, malgré les multiples manœuvres des partis de gauche et des syndicats pour tenter d’enrayer la dynamique d’extension de la lutte et les efforts de toute la bourgeoisie et de ses médias pour isoler les jeunes des autres générations et de l’ensemble de la classe ouvrière en les poussant dans des affrontements stériles avec la police. Tout au long de ces journées et de ces nuits, les affrontements ont été incessants : les violentes charges policières à coups de matraques et de grenades lacrymogènes se sont traduites par des arrestations et des tabassages par dizaines.
Les jeunes générations d’ouvriers sont celles qui expriment le plus clairement le sentiment de désillusion et d’écœurement par rapport à un appareil politique ultra-corrompu. Depuis l’après-guerre, trois familles se partagent le pouvoir et depuis plus de trente ans, les dynasties des Caramanlis (à droite) et des Papandreou (à gauche) règnent sans partage en alternance sur le pays avec force pots-de-vin et scandales. Les conservateurs sont arrivés au pouvoir en 2004 après une période d’hyper-magouilles des socialistes dans les années 2000. Beaucoup rejettent l’encadrement d’un appareil politique et syndical totalement discrédité : "Le fétichisme de l’argent s’est emparé de la société. Alors les jeunes veulent une rupture avec cette société sans âme et sans vision." 5 Aujourd’hui, avec le développement de la crise, cette génération de prolétaires n’a pas seulement développé sa conscience d’une exploitation capitaliste qu’elle vit dans sa chair, elle exprime aussi sa conscience de la nécessité d’un combat collectif en mettant spontanément en avant des méthodes et une solidarité DE CLASSE. Au lieu de sombrer dans le désespoir, elle tire sa confiance en elle de son assurance d’être porteuse d’un autre avenir et déploie toute son énergie à s'insurger contre la pourriture de la société qui les entoure. Les manifestants revendiquent ainsi fièrement leur mouvement : "Nous sommes une image du futur face à une image très sombre du passé."
Si la situation n’est pas sans rappeler mai 68, la conscience des enjeux va bien au-delà.
La radicalisation du mouvement
Le 16 décembre, les étudiants investissent pendant quelques minutes la station de télévision gouvernementale NET et déploient sous les écrans une banderole proclamant : "Arrêtez de regarder la télé. Tout le monde dans les rues !" et lancent cet appel : "L’État tue. Votre silence les arme. Occupation de tous les édifices publics !". Le siège de la police antiémeutes d’Athènes est attaqué et un fourgon de cette police est incendié. Ces actions sont aussitôt dénoncées par le gouvernement comme une "tentative de renversement de la démocratie", et également condamnées par le PC grec (KKE). A Thessalonique, les branches locales du syndicat GSEE et de l’ADEDY, la Fédération des fonctionnaires, tentèrent de confiner les grévistes dans un rassemblement en face de la Bourse du travail. Les lycéens et les étudiants se montrèrent alors déterminés à emmener les grévistes en manifestation et ils y réussirent. 4000 étudiants et travailleurs défilèrent dans les rues de la ville. Déjà le 11 décembre, des militants de l’organisation étudiante du Parti communiste (PKS) tentèrent de bloquer les assemblées afin d’empêcher les occupations (Université du Panthéon, École de philosophie de l’Université d’Athènes). Leurs tentatives échouèrent alors que les occupations se développaient dans Athènes et le reste de la Grèce. Dans le quartier d’Ayios Dimitrios, la mairie est occupée avec une assemblée générale à laquelle ont participé plus de 300 personnes de toutes générations. Le 17, l’immeuble qui est le siège du principal syndicat du pays, la Confédération Générale des Travailleurs en Grèce (GSEE) à Athènes, est occupé par des travailleurs qui se proclament insurgés et invitent tous les prolétaires à venir faire de ce site un lieu d’assemblées générales ouvert à tous les salariés, aux étudiants et aux chômeurs.
Un scénario identique, avec occupation et AG ouvertes à tous, a également eu lieu à l’Université d’Économie d’Athènes et à l’École Polytechnique.
Nous publions la déclaration de ces travailleurs en lutte pour contribuer à rompre le "cordon sanitaire" médiatique mensonger qui encercle ces luttes et qui les présente comme de simples émeutes violentes animées par quelques jeunes casseurs anarchistes qui terroriseraient la population. Ce texte montre au contraire clairement la force du sentiment de solidarité ouvrière qui anime ce mouvement et fait le lien entre les différentes générations de prolétaires !
"Nous déterminerons notre histoire nous mêmes ou nous la laisserons être déterminée sans nous. Nous, travailleurs manuels, employés, chômeurs, intérimaires et précaires, locaux ou migrants, ne sommes pas des téléspectateurs passifs. Depuis le meurtre d’Alexandros Grigoropoulos le samedi 6 au soir, nous participons aux manifestations, aux affrontements avec la police, aux occupations du centre ville comme des alentours. Nous avons dû maintes et maintes fois quitter le travail et nos obligations quotidiennes pour descendre dans la rue avec les lycéens, les étudiants et les autres prolétaires en lutte.
NOUS AVONS DÉCIDÉ D’OCCUPER LE BÂTIMENT DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS EN GRÈCE (GSEE)
Pour le transformer en un espace de libre expression et un point de rendez-vous pour les travailleurs.
Pour dissiper les mythes encouragés par les médias sur l’absence des travailleurs dans les affrontements, sur la rage de ces derniers jours qui ne serait l’œuvre que de quelques 500 “cagoulés”, “hooligans”, ou autres histoires farfelues, sur la présentation des travailleurs par les journaux télévisés comme des victimes de ces affrontements, et alors que la crise capitaliste en Grèce et dans le monde mène à des licenciements innombrables que les médias et leurs dirigeants considèrent comme un “phénomène naturel”.
Pour démasquer le rôle honteux de la bureaucratie syndicale dans le travail de sape contre l’insurrection, mais aussi d’une manière générale. La Confédération générale des travailleurs en Grèce (GSEE), et toute l’intégralité de la machinerie syndicale qui le soutient depuis des dizaines et des dizaines d’années, sape les luttes, négocie notre force de travail contre des miettes, perpétue le système d’exploitation et d’esclavage salarié. L’attitude de la GSEE mercredi dernier parle d’elle-même : la GSEE a annulé la manifestation des grévistes pourtant programmée, se rabattant précipitamment sur un bref rassemblement sur la place Syntagma, tout en s’assurant simultanément que les participants se disperseraient très vite, de peur qu’ils ne soient infectés par le virus de l’insurrection.
Pour ouvrir cet espace pour la première fois, comme une continuation de l’ouverture sociale créée par l’insurrection elle-même, espace qui a été construit avec notre contribution mais dont nous avons été jusqu’ici exclus. Pendant toutes ces années, nous avons confié notre destin à des sauveurs de toute nature, et nous avons fini par perdre notre dignité. Comme travailleurs, nous devons commencer à assumer nos responsabilités, et cesser de faire reposer nos espoirs dans des leaders “sages” ou des représentants “compétents”. Nous devons commencer à parler de notre propre voix, nous rencontrer, discuter, décider et agir par nous-mêmes. Contre les attaques généralisées que nous endurons. La création de collectifs de résistance "de base" est la seule solution.
Pour propager l’idée de l’auto-organisation et de la solidarité sur les lieux de travail, de la méthode des comités de luttes et des collectifs de base, abolir les bureaucraties syndicales.
Pendant toutes ces années, nous avons gobé la misère, la résignation, la violence au travail. Nous nous sommes habitués à compter nos blessés et nos morts - les soi-disant “accidents du travail”. Nous nous sommes habitués à ignorer que les immigrants, nos frères de classe, étaient tués. Nous sommes fatigués de vivre avec l’anxiété de devoir assurer notre salaire, de pouvoir payer nos impôts et de se garantir une retraite qui maintenant ressemble à un rêve lointain.
De même que nous luttons pour ne pas abandonner nos vies dans les mains des patrons et des représentants syndicaux, de même nous n’abandonnerons pas les insurgés arrêtés dans les mains de l’Etat et des mécanismes juridiques !
LIBÉRATION IMMÉDIATE DES DÉTENUS !
RETRAIT DES CHARGES CONTRE LES INTERPELLÉS !
AUTO-ORGANISATION DES TRAVAILLEURS !
GRÈVE GÉNÉRALE !
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DANS LES BATIMENTS LIBÉRÉS DE LA GSEE" 6
Dans la soirée du 17 décembre, une cinquantaine de bonzes et de gros bras syndicaux tentent de réinvestir les locaux mais ils s’enfuient devant les renforts d’étudiants, en majorité anarchistes, de l’Université d’Économie, elle aussi occupée et transformée en lieu de réunion et de discussion ouverte à tous les ouvriers venant à la rescousse des occupants en chantant à tue-tête "Solidarité !".
L’association des immigrés albanais diffuse, entre autres, pour proclamer sa solidarité avec le mouvement, un texte intitulé "Ces jours-là sont les nôtres, aussi !"
De façon significative, une petite minorité de ces occupants diffusait le message suivant : "Panagopoulos, le secrétaire général de la GSEE, a déclaré que nous ne sommes pas des travailleurs, car les travailleurs sont au travail. Ceci, parmi d’autres choses, révèle bien ce qu’est en réalité le “job” de Panagopoulos. Son “job” est de s’assurer que les travailleurs sont bien au travail, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que les travailleurs vont au travail.
Mais depuis une dizaine de jours, les travailleurs ne sont pas seulement au travail, ils sont aussi dehors, dans les rues. Et ceci est une réalité que aucun Panagopoulos du monde ne peut cacher (…) Nous sommes des gens qui travaillons, nous sommes aussi des chômeurs (payant par des licenciement nos participations dans des grèves appelées par la GSEE quand eux, les syndicalistes, sont récompensés par des promotions, nous travaillons sous contrat précaire de petit boulot en petit boulot, nous travaillons sans sécurité de façon formelle ou informelle dans des programmes de stages ou dans des emplois subventionnés pour diminuer le taux de chômage. Nous sommes une partie de ce monde et nous sommes ici.
Nous sommes des travailleurs insurgés, point barre.
Chacune de nos fiches de paye est payée avec notre sang, notre sueur, la violence au travail, les têtes, genoux, poignets, mains, pieds cassés [par les accidents du travail]
Le monde entier est fabriqué par nous, les travailleurs. (…)
Des prolétaires du bâtiment libéré de la GSEE"
Des appels à une grève générale à durée indéterminée à partir du 18 se multiplient. Les syndicats sont contraints d’appeler à une grève de trois heures dans les services publics pour ce jour-là.
Dans la matinée du 18, un autre lycéen de 16 ans participant à un sit-in près de son école dans une banlieue d’Athènes est blessé par balle. Le même jour, plusieurs sièges de radio ou de télévision sont occupés par des manifestants, notamment à Tripoli, Chania et Thessalonique. L’immeuble de la chambre de commerce a été occupé à Patras où de nouveaux affrontements avec la police se produisent. La gigantesque manifestation à Athènes a été très violemment réprimée : pour la première fois, de nouveaux types d’armes sont utilisés par les forces antiémeutes : des gaz paralysants et des grenades assourdissantes. Un tract dirigé contre la "terreur de l’État" est signé "des filles en révolte" et circule à partir de l’Université d’Économie.
Le mouvement perçoit confusément ses propres limites géographiques : c’est pourquoi il accueille avec enthousiasme les manifestations de solidarité internationale, notamment à Berlin, à Rome, à Moscou, à Montréal ou à New York et s’en fait l’écho : "ce soutien est très important pour nous". Les occupants de l’École Polytechnique appellent à "une journée internationale de mobilisation contre les meurtres d’État" pour le 20 décembre mais pour vaincre l’isolement de ce mouvement prolétarien en Grèce, la seule voie, la seule perspective est le développement de la solidarité et de la lutte de classe à l’échelle internationale qui s’exprime de plus en plus clairement face à la crise mondiale.
Une maturation porteuse d’avenir
A partir du 20 décembre, des combats de rue violents ont lieu et l’étau se resserre, en particulier autour de l’École Polytechnique assiégée par les forces de police qui menacent d’y donner l’assaut. Le bâtiment occupé du syndicat GSEE a été remis au GSEE le 21/12, à la suite d’une décision du comité d’occupation et votée en Assemblée Générale. Le comité d’occupation de l’École Polytechnique d’Athènes publiait le 22 décembre un communiqué déclarant notamment : "Nous sommes pour l’émancipation, la dignité humaine et la liberté. Pas besoin de nous envoyer vos gaz lacrymogènes, nous pleurons suffisamment par nous-mêmes."
Avec beaucoup de maturité, conformément à la décision prise lors de l’assemblée générale à l’université des Sciences économiques, les occupants de cette université utilisent l’appel à la manifestation du 24 contre la répression policière et en solidarité avec les emprisonnés comme moment propice pour évacuer l’immeuble en masse et en sécurité : "il semble y avoir un consensus sur la nécessité de quitter les universités et de semer l’esprit de la révolte dans la société en général." Cet exemple sera suivi dans les heures suivantes par les AG des autres universités occupées, en déjouant le piège de l’enfermement et d’un affrontement direct avec la police. Le bain de sang et une répression plus violente sont évités. De même, les AG ont clairement dénoncé des coups de feu dirigés contre un car de police et revendiqué par une soi-disant "Action populaire", comme un acte de provocation policière.
Le comité d’occupation de Polytechnique évacuait le dernier bastion d’Athènes symboliquement le 24 décembre à minuit. "L’assemblée générale et l’assemblée seule décidera si (et quand) nous quitterons l’université (…) La décision de l’occupation de l’Assemblée est politiquement sur place : le point crucial est ici que c’est aux personnes occupant l’immeuble, et non pas à la police, de décider du moment de quitter les lieux."
Auparavant, le comité d’occupation publiait une déclaration : "En mettant fin à l’occupation de l’École Polytechnique après 18 jours, nous envoyons notre plus chaleureuse solidarité à toutes les personnes qui ont fait partie de cette révolte de différentes manières, non seulement en Grèce mais aussi dans de nombreux pays d’Europe, des Amériques, en Asie et en Océanie. Pour tous ceux que nous avons rencontrés et avec qui nous allons rester, combattant pour la libération des prisonniers de cette révolte, mais aussi son prolongement jusqu’à la libération sociale mondiale."
Dans certains quartiers, les habitants se sont emparés de la sono installée par la municipalité pour jouer des chants de Noël, pour lire au micro des communiqués demandant, entre autres, la mise en liberté immédiate des détenus, le désarmement de la police, la dissolution des brigades antiémeutes et l’abolition des lois antiterroristes. A Volos, la station de radio municipale et les bureaux du journal local ont été occupés pour parler des événements et de leurs exigences. A Lesvos, des manifestants ont installé une sono dans le centre de la ville et ont transmis des messages. A Ptolemaida ou à Ioannina, un arbre de Noël a été décoré avec des photos du jeune lycéen tué et des manifestations, et avec les revendications du mouvement.
Le sentiment de solidarité s’est exprimé à nouveau spontanément et avec force le 23 décembre, après l’agression d’une employée par une entreprise de nettoyage Oikomet, sous-traitante de la compagnie de métro d’Athènes (Athens Piraeus Electric Railway –ISAP-), qui a reçu de l’acide sulfurique au visage alors qu’elle revenait du travail. Des manifestations de solidarité se sont déroulées et le siège du métro d’Athènes a été occupé le 27 décembre 2008 alors qu’à Thessalonique, c’est le siège de la GSEE qui était occupé à son tour. Les deux occupations ont organisé une série de manifestations, de concerts de solidarité et d’actions de "contre-information" (en occupant, par exemple, le système des haut-parleurs de la station de métro pour lire des communiqués).
L’assemblée à Athènes déclarait dans son texte :
"Quand ils attaquent l’une d’entre nous, c’est nous tous qu’ils attaquent !
Aujourd’hui, nous occupons les bureaux centraux de ISAP (métro d’Athènes) comme une première réponse à l’attaque meurtrière au vitriol sur le visage de Constantina Kouneva le 23 décembre, quand elle revenait du travail. Constantina est aux soins intensifs à l’hôpital. La semaine dernière, elle s’est disputée avec la compagnie revendiquant toute la prime de Noël pour elle et ses collègues, en dénonçant les actes illégaux des patrons. Avant cela, sa mère a été virée par la même compagnie. Elle-même a été déplacée loin de son premier poste de travail. Ce sont des pratiques très répandues dans le secteur des compagnies de nettoyage qui embauchent des travailleurs précaires. (...) Oikomet (…) a pour propriétaire un membre du PASOK (le parti socialiste grec). Elle emploie officiellement 800 travailleurs (les travailleurs parlent du double, tandis que les trois dernières années plus de 3000 y ont travaillé), où le comportement mafieux illégal des patrons est un phénomène quotidien. Par exemple, les travailleurs y sont obligés de signer des contrats blancs (les conditions sont écrites par les patrons ultérieurement) qu’ils n’ont jamais l’occasion de revoir. Ils travaillent 6 heures et ne sont payés que pour 4,5 (salaire brut) pour ne pas dépasser les 30 heures (sinon ils devaient être inscrits dans la catégorie de travailleurs à haut risque). Les patrons les terrorisent, les déplacent, les licencient et les menacent avec des démissions forcées. Constantina est l’une d’entre nous. La lutte pour la DIGNITÉ et la SOLIDARITÉ est NOTRE lutte."
Parallèlement, l’assemblée d’occupation du GSEE de Thessalonique publiait un texte dont nous reproduisons des extraits : "Nous occupons aujourd’hui le siège des Syndicats de Thessalonique pour nous opposer à l’oppression qui se manifeste par des meurtres et le terrorisme contre les travailleurs ; (…) nous faisons appel à tous les travailleurs pour rejoindre cette lutte commune. (…) L’assemblée ouverte de ceux qui occupent la centrale syndicale qui sont de milieux politiques différents, des syndicalistes, étudiants, immigrés et des camarades de l’étranger ont adopté cette décision commune :
- Continuer l’occupation ;
- Organiser un rassemblement en solidarité avec K. Kuneva ; (…)
- Organiser des actions d’informations et de prise de conscience dans les environs de la ville ;
- Organiser un concert dans le Centre pour récolter de l’argent pour Konstantina."
Par ailleurs, cette assemblée déclarait :
"Nulle part dans la plate-forme [des syndicats], il n’est fait référence aux causes de l’inégalité et de la misère et des structures de hiérarchie dans la société. (…) Les Confédérations Générales et les Centres de Syndicats en Grèce sont intrinsèquement partie prenante dans le régime au pouvoir ; leurs membres de base et les ouvriers doivent leur tourner le dos, et (…) choisir la création d’un pôle autonome de lutte dirigée par eux (…) Si les travailleurs prennent en charge leurs luttes et cassent la logique de leur représentation par les complices des patrons, ils retrouveront leur confiance et des milliers d’entre eux rempliront les rues dans les prochaines grèves. L’État et ses gros bras assassinent des gens.
Auto-organisation ! Luttes d’auto-défense sociale ! Solidarité avec les travailleurs immigrés et Konstantina Kuneva !"
Début janvier 2009, des manifestations ont encore lieu à travers tout le pays en solidarité avec les prisonniers. 246 personnes ont été arrêtés dont 66 sont toujours en prison préventive. A Athènes, 50 immigrants ont été arrêtés dans les trois premiers jours du mouvement de révolte, avec des peines allant jusqu’à 18 mois de prison dans des jugements sans interprètes, et se retrouvent menacés d’expulsion.
Le 9 janvier, jeunes et policiers se sont à nouveau affrontés à Athènes, à l’issue d’un défilé dans le centre ville de près de 3000 enseignants, étudiants et élèves. Sur leurs banderoles, figuraient des slogans tels que : "L’argent pour l’éducation et pas pour les banquiers“, “A bas le gouvernement des assassins et de la pauvreté". D’importantes forces antiémeutes ont chargé à plusieurs reprises pour les disperser, effectuant de nombreuses nouvelles interpellations.
Partout, comme en Grèce, avec la précarité, les licenciements, le chômage, les salaires de misère qu’impose sa crise mondiale, l’État capitaliste ne peut apporter que davantage de police et de répression. Seul, le développement international de la lutte et de la solidarité de classe entre ouvriers, employés, lycéens, étudiants, chômeurs, travailleurs précaires, retraités, toutes générations confondues, peut ouvrir la voie à une perspective d’avenir pour abolir ce système d’exploitation.
W. (18 janvier)
1. Voir notre article [1] sur la mobilisation massive contre la réforme de l'enseignement en Italie ;
2. Marianne n° 608 daté du 13 décembre : "Grèce : les leçons d’une émeute "
3. Libération du 12/12/2008
4. Le Monde du 10/12/2008
5. Marianne du 13 décembre
6. La plupart des textes reproduits ou les informations de presse locale ont été traduits par des sites anarchistes : tels que indymedia, cnt-ait.info, dndf.org, emeutes.wordpress.com en français ou sur libcom.org en anglais
Géographique:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [4]
La plus grave crise économique de l'histoire du capitalisme
- 6404 lectures
La bourgeoisie s'est payé une belle frayeur. D'août à octobre, un véritable vent de panique a soufflé sur l'économie mondiale. Les déclarations fracassantes des politiciens et économistes en attestent : "Au bord du gouffre", "Un Pearl Harbor économique", "Un tsunami qui approche", "Un 11-Septembre de la finance" 1,... seule l'allusion au Titanic manqua à l'appel !
Il faut dire que les plus grandes banques de la planète étaient en train de faire faillite les unes après les autres et que les Bourses plongeaient, perdant 32 000 milliards de dollars depuis janvier 2008, soit l'équivalent de deux années de la production totale des États-Unis. La Bourse islandaise s'est effondrée de 94 % et celle de Moscou de 71 % !
Finalement, la bourgeoisie, de plan de "sauvetage" en plan de "relance", est parvenue à éviter la paralysie totale de l’économie. Est-ce à dire que le pire est derrière nous ? Certainement pas ! La récession dans laquelle nous venons tout juste d'entrer s’annonce comme la plus dévastatrice depuis la Grande Dépression de 1929.
Les économistes l’avouent clairement : la "conjoncture" actuelle est "la plus difficile depuis plusieurs décennies" a annoncé HSBC, la "plus grande banque du monde", le 4 août 2. "Nous sommes confrontés à l'un des environnements économiques et de politique monétaire les plus difficiles jamais vus" a surenchéri le président de la Réserve fédérale américaine (la FED), le 22 août 3.
La presse internationale ne s’y est d’ailleurs pas trompée, elle qui n’a cessé de comparer la période actuelle au marasme économique des années 1930, telle cette Une de Time annonçant "The New Hard Times" sur une photo d’ouvriers allant à la "free soup" (la soupe populaire) en 1929. Et effectivement, de telles scènes se reproduisent bel et bien à nouveau : les associations caritatives distribuant des repas sont toutes débordées alors qu'en de nombreux pays, des files d’attente de plusieurs centaines de travailleurs désœuvrés se forment chaque jour devant les bureaux d’embauche.
Et que dire de l’allocution télévisée du 24 septembre 2008 de George W. Bush, Président des États-Unis : "Nous sommes au milieu d'une crise financière grave (...) toute notre économie est en danger. (...) Des secteurs clés du système financier des États-Unis risquent de s'effondrer. (...) l'Amérique pourrait sombrer dans la panique financière, et nous assisterions à un scénario désolant. De nouvelles banques feraient faillite (…) Le marché boursier s'effondrerait encore plus, ce qui réduirait la valeur de votre compte de retraite. La valeur de votre maison chuterait. Les saisies se multiplieraient. (...) De nombreuses entreprises devraient mettre la clé sous la porte, et des millions d'Américains perdraient leur emploi. (…) Au bout du compte, notre pays pourrait sombrer dans une longue et douloureuse récession".
Eh bien, ce "scénario désolant" d’une "longue et douloureuse récession" est en train de se réaliser, touchant non pas seulement "le peuple américain" mais les ouvriers du monde entier !
Une récession brutale…
Depuis la désormais célèbre "crise des subprimes" de l’été 2007, les mauvaises nouvelles économiques ne cessent de tomber, jour après jour.
L’hécatombe du secteur bancaire pour la seule année 2008 est impressionnante. Ont dû être rachetés par un concurrent, renfloués par une banque centrale ou tout simplement nationalisés : Northern Rock (la huitième banque anglaise), Bear Stearns (la cinquième banque de Wall Street), Freddie Mac et Fannie Mae (deux organismes de refinancement hypothécaire américains pesant près de 850 milliards de dollars), Merrill Lynch (autre fleuron américain), HBOS (deuxième banque d'Écosse), AIG (American International Group, l'un des plus grands assureurs mondiaux) et Dexia (organisme financier luxembourgeois, belge et français). Des faillites retentissantes et historiques ont aussi marqué cette année de crise. En juillet, Indymac, l'un des plus gros prêteurs hypothécaires américains, était placé sous tutelle des autorités fédérales. Il était alors le plus important établissement bancaire à faire faillite aux États-Unis depuis vingt-quatre ans ! Mais son record ne tiendra pas longtemps. Quelques jours plus tard, Lehman Brothers, la quatrième banque américaine, se déclare elle aussi en faillite. Le total de ses dettes s'élève alors à 613 milliards de dollars. Record battu ! La plus grosse faillite d'une banque américaine à ce jour, celle de Continental Illinois en 1984, mettait en jeu une somme seize fois plus modeste (soit 40 milliards de dollars). Deux semaines après seulement, nouveau record ! C'est au tour de Washington Mutual (WaMu), la plus importante caisse d'épargne aux États-Unis, de mettre la clef sous la porte.
Après cette sorte d’infarctus de ce qui constitue le cœur même du capitalisme, le secteur bancaire, c’est aujourd’hui la santé de l’ensemble du corps qui vacille et décline ; "l’économie réelle" est à son tour brutalement touchée. D’après le Bureau national de la recherche économique (NBER), les États-Unis sont officiellement en récession depuis décembre 2007. Nouriel Roubini, l'économiste le plus respecté aujourd'hui à Wall Street, pense même qu’une contraction de l'activité de l’économie américaine de l'ordre de 5 % en 2009 et de 5 % de nouveau en 2010 est probable 4 ! Nous ne pouvons savoir si tel sera le cas, mais le simple fait que l'un des économistes les plus réputés de la planète puisse envisager un tel scénario catastrophe révèle l'inquiétude réelle de la bourgeoisie. L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) s'attend à ce que toute l'Union Européenne soit en récession en 2009. Pour l’Allemagne, la Deutsche Bank prévoit un recul du PIB pouvant aller jusqu'à 4 % 5 ! Pour avoir un ordre d’idée de l’ampleur d’une telle récession, il faut savoir que la pire année depuis la Seconde Guerre mondiale avait été jusqu'ici 1975, quand le PIB allemand avait diminué de "seulement" 0,9 %. Aucun continent n’est épargné. Le Japon est déjà en récession et même la Chine, cet "Eldorado capitaliste", n'échappe pas à ce ralentissement brutal. Résultat : la demande s'est effondrée à un tel point que tous les prix, y compris le pétrole, sont à la baisse. Bref, l’économie mondiale va très mal.
… et une vague de paupérisation sans précédent depuis les années 1930
La première victime de cette crise est évidemment le prolétariat. Aux États-Unis, la dégradation des conditions de vie est ainsi particulièrement spectaculaire. 2,8 millions de travailleurs, incapables de faire face aux remboursements de leurs crédits, se sont retrouvés à la rue depuis l'été 2007. D’après l'Association des banquiers hypothécaires MBA, près d’un emprunteur immobilier américain sur dix est aujourd’hui potentiellement menacé d'expulsion. Et ce phénomène commence à toucher l'Europe, en particulier l'Espagne et la Grande-Bretagne.
Les licenciements aussi se multiplient. Au Japon, Sony a annoncé un plan sans précédent de 16 000 suppressions de postes, dont 8 000 salariés en contrat à durée indéterminée (CDI). Ce groupe emblématique de l'industrie nippone n’avait jamais licencié d’employés en CDI. Le secteur du bâtiment, avec la crise de l’immobilier, tourne au ralenti. Le BTP espagnol s’attend à perdre 900 000 emplois d'ici à 2010 ! Pour les banques, c’est un véritable jeu de massacre. Citigroup, l'une des plus grandes banques du monde, va supprimer 50 000 emplois alors qu'elle en a déjà détruit 23 000 depuis début 2008 ! En 2008, pour ce seul secteur, 260 000 emplois ont été supprimés aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Or, un emploi dans la finance génère en moyenne quatre emplois directs. L'effondrement des organismes financiers signifie donc le chômage pour des centaines de milliers de familles ouvrières. Autre secteur particulièrement touché, celui de l'automobile. Les ventes de véhicules se sont effondrées partout cet automne de plus de 30%. Renault, premier constructeur français, a pratiquement arrêté sa production depuis la mi-novembre ; plus aucune voiture ne sort de ses ateliers et cela alors que ses chaînes tournent déjà depuis des mois à 54 % de leurs capacités. Toyota va supprimer 3000 emplois temporaires sur 6000 (soit 50 % !) dans ses usines au Japon. Mais, c'est une nouvelle fois des États-Unis que parviennent les nouvelles les plus alarmantes : les fameux Big Three de Detroit (General Motors, Ford et Chrysler) sont au bord de la faillite. L’enveloppe de 15 milliards de dollars versée par l’État américain ne suffira pas à les sortir durablement d’affaire 6 (les Big Three demandaient d’ailleurs au minimum 34 milliards). Des restructurations massives vont avoir nécessairement lieu dans les mois à venir. Entre 2,3 et 3 millions d'emplois sont menacés. Et ici, les ouvriers licenciés vont aussi perdre, avec leur emploi, leur assurance maladie et leur retraite !
La conséquence inexorable de cette destruction massive d’emplois est évidemment l’explosion du chômage. En Irlande, le "modèle économique de la dernière décennie", le nombre de chômeurs a plus que doublé en un an, ce qui représente la plus forte hausse jamais enregistrée ! L'Espagne termine l'année avec 3,13 millions de chômeurs, soit près d'1 million de plus qu'en 2007 7. Aux États-Unis, 2,6 millions d’emplois ont été détruits en 2008, du jamais vu depuis 1945 8. La fin d’année a été particulièrement désastreuse avec plus de 1,1 millions de postes perdus sur novembre et décembre. A ce rythme, il pourrait y avoir encore 3 ou 4 millions de chômeurs supplémentaires d’ici le début de l’été 2009.
Et pour les rescapés, ceux qui voient leurs collègues être licenciés, l’avenir est au "travailler beaucoup plus pour gagner beaucoup moins" 9. Ainsi, selon le dernier rapport du Bureau international du Travail (BIT) intitulé "Rapport mondial sur les salaires 2008/09", "Pour les 1,5 milliard de salariés dans le monde, des temps difficiles sont à venir", "la crise économique mondiale devrait déboucher sur de douloureuses coupes dans les salaires".
Inévitablement, le résultat attendu de toutes ces attaques est une hausse considérable de la misère. De l'Europe aux États-Unis, toutes les associations caritatives ont constaté ces derniers mois une augmentation d'au moins 10 % de l’affluence à la soupe populaire. Cette vague de paupérisation signifie que se loger, se soigner et se nourrir va devenir de plus en plus difficile. Cela signifie aussi pour les jeunes d'aujourd'hui que ce monde capitaliste n'a plus d'avenir à leur offrir !
Comment la bourgeoisie explique cette crise
Les mécanismes économiques qui ont engendré la récession actuelle commencent à être relativement connus. La télévision nous a abreuvé de reportages nous révélant, soi-disant, tous les dessous de l’affaire. Pour faire simple, durant des années, la consommation des "ménages américains" (autrement dit, des familles ouvrières) a été soutenue artificiellement par toutes sortes de crédits, en particulier, un crédit au succès foudroyant : les prêts hypothécaires à risque ou "subprimes". Les banques, les institutions financières, les fonds de pension… tous prêtaient sans se soucier de la capacité réelle de ces ouvriers à rembourser (d’où "à risque") pourvu qu’ils aient un bien immobilier (d’où "hypothécaire"). Au pire, croyaient-ils, ils seraient dédommagés par la vente des maisons gagées des débiteurs ne parvenant pas à rembourser leur dette. Il y eut alors un effet boule de neige : plus les ouvriers empruntaient – notamment pour acheter leur maison – et plus l’immobilier montait ; plus l’immobilier montait et plus les ouvriers pouvaient emprunter. Tous les spéculateurs de la planète sont alors entrés dans la danse : ils se sont mis à acheter eux aussi des maisons pour les revendre ensuite plus chers et, surtout, ils se sont vendus les uns les autres ces fameux subprimes par le biais de la "titrisation" (c'est-à-dire de la transformation des créances en valeurs mobilières échangeables sur le marché mondial comme les autres actions et obligations). En une décennie, la bulle spéculative est devenue énorme ; toutes les institutions financières de la planète ont réalisé ce type d’opération à hauteur de milliers de milliards de dollars. Autrement dit, des ménages que l’on savait insolvables sont devenus la poule aux œufs d’or de l’économie mondiale.
Evidemment, l’économie réelle a fini par rappeler tout ce beau monde à sa dure réalité. Dans la "vraie vie", tous ces ouvriers surendettés ont connu aussi la hausse du coût de la vie et le gel des salaires, les licenciements, la baisse des allocations chômage… En un mot, ils se sont appauvris considérablement si bien qu’une part de plus en plus grande d’entre eux fut effectivement incapable de faire face aux échéances de leur emprunt. Les capitalistes ont alors expulsé manu militari les mauvais payeurs pour revendre les biens immobiliers… mais les maisons mises ainsi en vente furent tellement nombreuses 10 que les prix ont commencé à baisser et… patatras… sous le soleil de l'été 2007, la belle grosse boule de neige a fondu d’un coup ! Les banques se sont retrouvées avec des centaines de milliers de débiteurs insolvables et autant de maisons ne valant plus rien sur les bras. Ce fut la faillite, le krach.
Résumé ainsi, tout cela peut sembler absurde. Prêter à des gens qui n’ont pas les moyens de rembourser va à l’encontre du bon sens capitaliste. Et pourtant, l’économie mondiale a basé l’essentiel de sa croissance de la dernière décennie sur une telle fumisterie. La question est donc pourquoi ? Pourquoi une telle folie ? La réponse apportée par les journalistes, les politiciens, les économistes est simple et unanime : C'est la faute aux spéculateurs ! C'est la faute à la cupidité des "patrons voyous" ! C'est la faute aux "banquiers irresponsables" ! Aujourd’hui, tous reprennent en chœur la ritournelle traditionnelle de la gauche et de l’extrême-gauche sur les méfaits de la "dérégulation" et du "néo-libéralisme" (sorte de libéralisme débridé), et appellent de leurs vœux un retour de l’État… ce qui révèle d’ailleurs la vraie nature des propositions "anti-capitalistes" de la gauche et de l’extrême-gauche. Ainsi, Sarkozy proclame que "le capitalisme doit se refondre sur des bases éthiques". Madame Merkel insulte les spéculateurs. Zapatero pointe un doigt accusateur sur les "fondamentalistes du marché". Et Chavez, l'illustre paladin du "socialisme du 21e siècle", commente les mesures de nationalisations d’urgence prises par Bush en lançant : "Le camarade Bush est en train de prendre certaines mesures propres au camarade Lénine" 11. Tous nous disent que l'espoir se tourne aujourd'hui vers un "autre capitalisme", plus humain, plus moral,… plus étatique !
Mensonges ! Dans la bouche de tous ces politiciens, tout est faux, à commencer par leur prétendue explication de la récession.
La catastrophe économique actuelle est le fruit de cent ans de décadence
En réalité, c’est l’État lui-même qui, le premier, a organisé cet endettement généralisé des ménages. Pour soutenir artificiellement l’économie, les État ont ouvert toutes grandes les vannes du crédit en diminuant les taux directeurs des banques centrales. Ces banques d’État en prêtant à bas-coût, à moins de 1% parfois, ont permis à l’argent de couler à flots. L’endettement mondial fut donc le résultat d’un choix délibéré de la bourgeoisie et non d’une quelconque "dérégulation". Comment comprendre autrement la déclaration de Bush au lendemain du 11 septembre 2001 qui, face à un début de récession, a lancé aux ouvriers : "Soyez de bons patriotes, consommez !". Le Président américain donnait ici un message clair à toute la sphère financière : multipliez les crédits à la consommation sinon l’économie nationale s’écroulera ! 12
En vérité, cela fait des décennies que le capitalisme survit ainsi, à crédit. Le graphique de la figure 1 13, qui présente l’évolution de la dette totale américaine (c’est-à-dire la dette de l’État, des entreprises et des ménages) depuis 1920, parle de lui-même. Pour comprendre l'origine de ce phénomène et aller au-delà de l'explication aussi simpliste que frauduleuse de la "folie des banquiers, des spéculateurs et des patrons", il faut percer "le grand secret de la société moderne": "la fabrication de plus-value" 14, selon les propres termes de Marx.
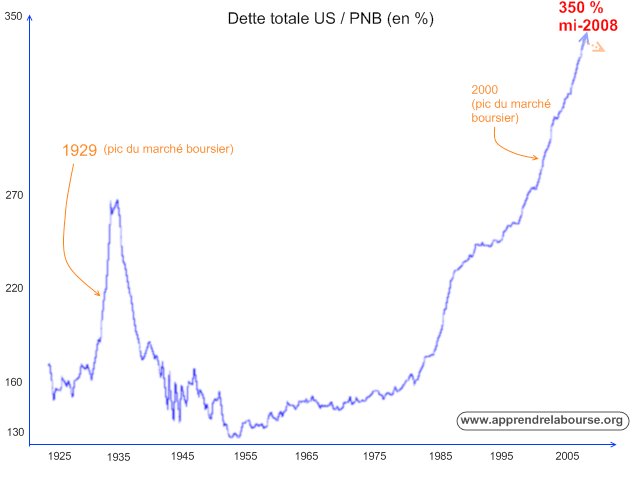
Figure 1 : Evolution de la dette totale américaine depuis 1920
Le capitalisme porte en lui, depuis toujours, une sorte de maladie congénitale : il produit une toxine en abondance que son organisme n’arrive pas à éliminer, la "surproduction". En effet, il fabrique plus de marchandises que son marché ne peut en assimiler. Pourquoi ? Prenons un exemple totalement théorique : un ouvrier travaillant sur une chaîne de montage ou derrière un micro-ordinateur et qui, à la fin du mois, est payé 800 euros. En fait, il a produit non pas pour l'équivalent de 800 euros, ce qu'il reçoit, mais pour la valeur de 1200 euros. Il a effectué un travail non payé ou, autrement dit, une plus-value. Que fait le capitaliste des 400 euros qu'il a volés à l'ouvrier (à condition qu'il soit parvenu à vendre la marchandise) ? Il en met une partie dans sa poche, admettons 150 euros, et les 250 euros restant, il les réinvestit dans le capital de son entreprise, le plus souvent sous forme de l'achat de machines plus modernes, etc. Mais pourquoi le capitaliste procède-t-il ainsi ? Parce qu'il n'a pas le choix. Le capitalisme est un système concurrentiel, il faut vendre les produits moins cher que le voisin qui fabrique le même type de produits. En conséquence, le patron est contraint non seulement de baisser ses coûts de production, c'est-à-dire les salaires 15, mais encore d'utiliser une part croissante du travail non payé dégagé pour le réinvestir prioritairement dans des machines plus performantes 16, afin d'augmenter la productivité. S'il ne le fait pas, il ne peut pas se moderniser, et, tôt ou tard, son concurrent, qui, lui, le fera, vendra moins cher et remportera le marché. Le système capitaliste est ainsi affecté par un phénomène contradictoire : en ne rétribuant pas les ouvriers par l'équivalent de ce qu'ils ont effectivement fourni comme travail et en contraignant les patrons à renoncer à consommer une grande part du profit ainsi extorqué, le système produit plus de valeur qu'il n'en distribue. Jamais ni les ouvriers ni les capitalistes réunis ne pourront donc à eux seuls absorber toutes les marchandises produites. Ce surplus de marchandises, qui va le consommer ? Pour ce faire, ce système doit forcément trouver de nouveaux débouchés en dehors du cadre de la production capitaliste ; c'est ce qu'on appelle les marchés extra-capitalistes (au sens d'en dehors du capitalisme, qui ne fonctionne pas de manière capitaliste).
C’est pourquoi au 18e siècle et surtout au 19e siècle, le capitalisme partit à la conquête du monde : il devait trouver en permanence de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, pour faire du profit en vendant ses marchandises en surplus, sous peine de voir son économie être paralysée. Et régulièrement d’ailleurs, c’est ce qui advenait quand il ne parvenait pas assez rapidement à obtenir de nouvelles conquêtes. Le Manifeste communiste de 1848 fait une description magistrale de ce type de crise : "Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société, l'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentanée ; on dirait qu'une famine, une guerre d'extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance ; l'industrie et le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce". A cette époque néanmoins, parce que le capitalisme était en pleine croissance, qu’il pouvait justement conquérir de nouveaux territoires, chaque crise laissait ensuite la place à une nouvelle période de prospérité. "Poussée par le besoin de débouchés toujours plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe. Partout elle doit s'incruster, partout il lui faut bâtir, partout elle établit des relations... Le bas prix de ses marchandises est la grosse artillerie avec laquelle elle démolit toutes les murailles de Chine et obtient la capitulation des barbares les plus opiniâtrement xénophobes. Elle contraint toutes les nations, sous peine de courir à leur perte, d'adopter le mode de production bourgeois ; elle les contraint dimporter chez elles ce qui s'appelle la civilisation, autrement dit : elle fait des nations de bourgeois. En un mot, elle crée un monde à son image..." (Le Manifeste). Mais déjà à ce moment-là, Marx percevait dans ces crises périodiques quelque chose de plus qu'un simple cycle éternel qui déboucherait toujours sur la prospérité. Il y voyait l'expression des contradictions profondes qui minent le capitalisme. En "s'emparant de marchés nouveaux", la bourgeoisie "prépare des crises plus générales et plus profondes, tout en réduisant les moyens de les prévenir." (idem) ou encore, dans Travail Salarié et Capital, "C'est que la masse des produits et donc le besoin de débouchés s'accroît, alors que le marché mondial se rétrécit ; c'est que chaque crise soumet au monde commercial un marché non encore conquis ou peu exploité et restreint ainsi les débouchés.".
Tout au long du 18e et du 19e siècle, les principales puissances capitalistes se livrent à une véritable course à la conquête du monde ; elles se partagent progressivement la planète en colonies et forment de véritables empires. De temps à autre, elles se retrouvent face à face à lorgner sur un même territoire, une guerre courte éclate alors, et le vaincu part vite trouver un autre coin de terre à conquérir. Mais au début du 20e siècle, les grandes puissances s'étant partagées la domination du monde, il ne s’agit plus pour elles de faire la course en Afrique, en Asie ou en Amérique, mais de se livrer une guerre impitoyable pour défendre leurs aires d’influence et s’emparer, à la force des canons, de celles de leurs concurrents impérialistes. Il s’agit ici d’une véritable question de survie pour les nations capitalistes, il leur faut impérativement pouvoir déverser suffisamment leur surproduction sur les marchés non-capitalistes. Ce n’est donc pas un hasard si c’est l’Allemagne qui, n’ayant que très peu de colonies et étant dépendante du bon vouloir de l’Empire britannique pour commercer sur ses terres (dépendance insoutenable pour une bourgeoisie nationale), se montre la plus agressive et déclenche, en 1914, la Première Guerre mondiale. Cette boucherie fit plus de 11 millions de morts, causa des souffrances horribles et provoqua un traumatisme moral et psychologique à des générations entières. Cette horreur annonce l’entrée dans une nouvelle époque, l’époque la plus barbare de l’Histoire. Dès lors, le capitalisme a atteint son apogée, il entre dans sa période de décadence. Le krach de 1929 en sera une confirmation éclatante.
Et pourtant, après plus de cent années de lente agonie, ce système est toujours debout, titubant, mal en point, mais debout. Comment fait-il pour survivre ? Pourquoi son organisme n’est-il pas encore totalement paralysé par la toxine de la surproduction ? C’est ici que le recours à l’endettement entre en jeu. L'économie mondiale est parvenue à éviter un effondrement fracassant en y recourant de plus en plus massivement.
Comme le montre la figure 1, dès le début du 20e siècle, la dette totale américaine s'affole pour littéralement exploser dans les années 1920. Les ménages, les entreprises et les banques croulent sous les dettes. Et la chute brutale de la courbe de l’endettement dans les années 1930 et 1940 est en réalité trompeuse. En effet, la Grande Dépression des années 1930 représente la première grande crise économique de la décadence. La bourgeoisie n’était pas encore préparée à un tel choc. Tout d’abord, elle ne réagit pas ou mal. En fermant ses frontières (le protectionnisme), elle accentua la surproduction, la toxine fit des ravages. Entre 1929 et 1933, la production industrielle américaine s’effondra de moitié 17 ; le chômage frappa 13 millions d’ouvriers et une misère sans nom se développa, deux millions d’Américains se retrouvèrent sans-abri 18. Dans un premier temps, le gouvernement ne vint pas au secours du secteur financier : des 29 000 banques recensées en 1921, il n’en restera plus que 12 000 à la fin du mois de mars 1933 ; et cette hécatombe se poursuivra encore jusqu’en 1939 19. Toutes ces faillites sont synonymes d’une disparition pure et simple de montagnes de dettes 20. Par contre, ce qui n’apparaît pas sur ce graphique, c’est la croissance de l’endettement public. Après quatre années d’attentisme, l’État américain prit enfin des mesures : ce fut le New Deal de Roosevelt. Et en quoi consista ce plan dont on reparle tant aujourd’hui ? Il s’agit d’une politique de grands travaux basée sur… un recours massif et inédit à l’endettement étatique (de 17 milliards en 1929, la dette publique passa à 40 milliards en 1939 21).
Par la suite, la bourgeoise a tiré les leçons de cette mésaventure. A la sortie de la Seconde Guerre mondiale, elle organisa au niveau international des instances monétaires et financières (via la conférence Bretton Woods) et, surtout, elle systématisa le recours au crédit. Ainsi, après avoir touché un plancher en 1953-1954 et malgré la courte accalmie des années 1950 et 1960 22, la dette totale américaine recommence lentement mais sûrement à augmenter dès le milieu des années 1950. Et quand la crise fit son grand retour en 1967, la classe dominante n’attendit pas cette fois-ci quatre années pour réagir. Immédiatement, elle recourut aux crédits. Ces quarante dernières années peuvent en effet se résumer en une succession de crises et une montée exponentielle de la dette mondiale. Aux États-Unis, il y a eu officiellement des récessions en 1969, 1973, 1980, 1981, 1990 et 2001 23. La solution utilisée par la bourgeoisie américaine pour faire face chaque fois à ces difficultés est là aussi visible sur le graphique : la pente de l’endettement s’incline fortement à partir de 1973 et démesurément à partir des années 1990. Toutes les bourgeoisies du monde ont agit de la même façon.
Mais l'endettement n'est pas une solution magique. La Figure 2 24 montre que, depuis 1966, l’endettement est de moins en moins efficace pour engendrer de la croissance 25. Il s’agit là d’un cercle vicieux : les capitalistes produisent plus de marchandises que le marché ne peut normalement en absorber ; puis, le crédit crée un marché artificiel ; les capitalistes vendent donc leurs marchandises et réinvestissent ainsi leur profit dans la production et donc… re-belote, il faut de nouveaux crédits pour vendre les nouvelles marchandises. Non seulement ici les dettes s’accumulent mais, à chaque nouveau cycle, les nouvelles dettes doivent être de plus en plus importantes pour maintenir un taux de croissance identique (puisque la production s’est élargie). De plus, une part de plus en plus grande des crédits n’est jamais injectée dans le circuit de la production mais disparaît aussitôt, engloutie dans le gouffre des déficits. En effet, les ménages surendettés contractent souvent un nouvel emprunt afin de rembourser leurs dettes les plus anciennes. Les Etats, les entreprises et les banques fonctionnent de la même façon. Enfin, lors de ces vingt dernières années, l’"économie réelle" étant perpétuellement en crise, une partie croissante de l’argent créé est allé alimenter les bulles spéculatives (la bulle Internet, celles des Télécoms, de l’immobilier…) 26. Il était en effet plus rentable et finalement moins risqué de spéculer en Bourse que d'investir dans la production de marchandises qui ont toutes les peines du monde à être vendues. Il y a aujourd'hui cinquante fois plus d'argent qui circule dans les Bourses que dans la production 27.
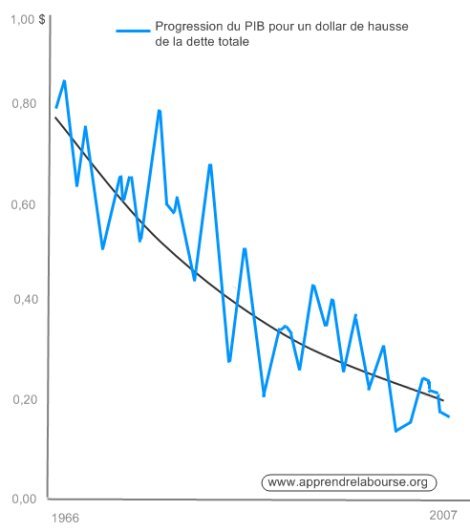
Figure 2 : Répercussion toujours plus faible de l'augmentation de la dette sur celle du PIB
Mais cette fuite en avant dans l’endettement n’est pas simplement de moins en moins efficace, elle débouche surtout inexorablement et systématiquement sur une crise économique dévastatrice. Le capital ne peut pas indéfiniment sortir de l'argent de son chapeau. C'est le b-a-ba du commerce : toute dette doit un jour être remboursée sous peine d'engendrer, pour le prêteur, de sérieuses difficultés pouvant aller jusqu'à la faillite. Nous revenons donc en quelque sorte à la case départ, le capital n'a fait que gagner du temps face à sa crise historique. Pire ! En reportant ainsi les effets de sa crise au lendemain, il a préparé en réalité chaque fois des convulsions économiques plus violentes encore. Voilà exactement ce qui arrive au capitalisme aujourd’hui !
L'État peut-il sauver l'économie capitaliste ?
Quand un particulier fait faillite, il perd tout et il est jeté à la rue. L'entreprise, elle, met la clef sous la porte. Mais un État ? Un État peut-il faire faillite ? Après tout, nous n'avons jamais vu d'État "fermer boutique". Pas exactement en effet. Mais être en cessation de paiement, oui !
En 1982, quatorze pays africains surendettés ont été contraints de se déclarer officiellement en cessation de paiement. Dans les années 1990, des pays d'Amérique du Sud et la Russie ont fait eux aussi défaut. Plus récemment, en 2001, l'Argentine s'est à son tour écroulée. Concrètement, ces États n'ont pas cessé d'exister, l'économie nationale ne s'est pas arrêtée non plus. Par contre, chaque fois, il y eut une sorte de séisme économique : la valeur de la monnaie nationale a chuté, les préteurs (en général d'autres États) ont perdu tout ou partie de leur investissement et, surtout, l'État a réduit drastiquement ses dépenses en licenciant une bonne partie des fonctionnaires et en cessant de payer pour un temps ceux qui restaient.
Aujourd'hui, de nombreux pays sont au bord d'un tel gouffre : l'Equateur, l'Islande, l'Ukraine, la Serbie, l'Estonie… Mais qu'en est-il des grandes puissances ? Le gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a déclaré fin décembre que son État se trouvait en "état d'urgence fiscale". Ainsi, le plus riche des Etats américains, le "Golden State", s'apprête à licencier une bonne partie de ses 235 000 fonctionnaires (ceux qui resteront vont devoir prendre deux jours de congé non payés par mois à partir du 1er février 2009) ! En présentant ce nouveau budget, l'ex-star d'Hollywood a averti que "chacun devra consentir des sacrifices". C'est ici un symbole fort des difficultés économiques profondes de la première puissance mondiale. Nous sommes encore loin d'une cessation de paiement de l'État américain mais cet exemple montre clairement que les marges de manœuvres financières sont actuellement très limitées pour l'ensemble des grandes puissances. L'endettement mondial semble arriver à saturation (il était de 60 000 milliards de dollars en 2007 et a encore gonflé de plusieurs milliers de milliards depuis) ; contrainte de poursuivre dans cette voie, la bourgeoisie va donc provoquer des secousses économiques dévastatrices. La FED a abaissé ses taux directeurs pour l’année 2009 à 0,25% pour la première fois depuis sa création en 1913 ! L’État américain prête donc de l’argent presque gratuitement (et même en y perdant si l’on prend en compte l’inflation). Tous les économistes de la planète en appellent à un "new New Deal", rêvant de voir en Obama le nouveau Roosevelt, capable de relancer l'économie, comme en 1933, par un immense plan de grands travaux publics financé… à crédit 28. Des plans d’endettement étatique équivalents au New Deal, la bourgeoisie en lance régulièrement depuis 1967, sans véritable succès. Et le problème est qu'une telle politique de fuite en avant peut entraîner l’effondrement du dollar. Nombreux sont les pays aujourd'hui à effectivement douter des capacités des États-Unis à rembourser un jour leurs emprunts et à être tentés de retirer tous leurs investissements. Il en va ainsi de la Chine qui, fin 2008, a menacé, en langage diplomatique, l'Oncle Sam d'arrêter de soutenir l'économie américaine à travers l'achat de ses bons du Trésor : "Toute erreur sur la gravité de la crise causerait des difficultés aux emprunteurs comme aux créditeurs. L’appétit apparemment grandissant du pays pour les bons du Trésor américain n’implique pas qu’ils resteront un investissement rentable sur le long terme ou que le gouvernement américain continuera de dépendre des capitaux étrangers". Et voilà comment, en une phrase, la Chine menace l'État américain de couper la pompe à dollars chinoise qui alimente l’économie états-unienne depuis plusieurs années ! Si La Chine mettait sa menace à exécution 29, le désordre monétaire international qui s’ensuivrait serait alors apocalyptique et les ravages sur les conditions de vie de la classe ouvrière seraient gigantesques. Mais il n'y a pas que l'Empire du Milieu qui commence à douter : le mercredi 10 décembre, pour la première fois de son histoire, l'État américain a eu toutes les peines du monde à trouver des acquéreurs pour un emprunt de 28 milliards de dollars. Et, comme quoi toutes les grandes puissances ont les caisses vides, des ardoises de dettes interminables et une économie en piètre santé, le même jour, la même mésaventure a frappé l'État allemand : lui aussi, pour la première fois depuis les années 1920, a eu les pires difficultés à trouver des acheteurs pour un emprunt de 7 milliards d'euros.
Décidément, l'endettement, qu'il soit des ménages, des entreprises ou des États, n'est bien qu'un palliatif, il ne guérit pas le capitalisme de la maladie de la surproduction ; il permet tout au plus de sortir momentanément l'économie de l’ornière mais en préparant toujours des crises à venir plus violentes. Et pourtant, la bourgeoisie va poursuivre cette politique désespérée car elle n'a pas d'autre choix comme le montre, une énième fois, la déclaration du 8 novembre 2008 d’Angela Merkel à la Conférence Internationale de Paris : "Il n’existe aucune autre possibilité de lutter contre la crise que d’accumuler des montagnes de dettes" ou encore la dernière intervention du chef économiste du FMI, Olivier Blanchard : "Nous sommes en présence d’une crise d’une amplitude exceptionnelle, dont la principale composante est un effondrement de la demande […] Il est impératif de relancer […] la demande privée, si l’on veut éviter que la récession ne se transforme en Grande Dépression". Comment ? "par l’augmentation des dépenses publiques".
Mais, si ce n’est à travers ses plans de relance, l’État peut-il tout de même être LE sauveur en nationalisant une grande partie de l’économie, en particulier les banques et le secteur automobile ? Eh bien non, encore raté ! D’abord, et contrairement aux mensonges traditionnels de la gauche et de l’extrême gauche, les nationalisations n’ont jamais été une bonne nouvelle pour la classe ouvrière. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’importante vague de nationalisations avait pour objectif de remettre sur pied l'appareil productif détruit en augmentant les cadences de travail. Il ne faut pas oublier les paroles de Thorez, secrétaire général du Parti Communiste Français et alors vice-président du gouvernement dirigé par De Gaulle, qui lança à la face de la classe ouvrière en France, et tout particulièrement aux ouvriers des entreprises publiques : "Si des mineurs doivent mourir à la tâche, leurs femmes les remplaceront.", ou "Retroussez vos manches pour la reconstruction nationale !" ou encore "la grève est l’arme des trusts". Bienvenu dans le monde merveilleux des entreprises nationalisées ! Il n’y a ici rien d’étonnant. Les révolutionnaires communistes ont toujours mis en évidence, depuis l’expérience de la Commune de Paris de 1871, le rôle viscéralement anti-prolétarien de l’État. "L'État moderne, quelle qu'en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l'État des capitalistes, le capitaliste collectif idéal. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble." (F. Engels en 1878) 30
La nouvelle vague de nationalisations n’apportera donc rien de bon à la classe ouvrière. Et elle ne permettra pas non plus à la bourgeoisie de renouer avec une véritable croissance durable. Au contraire ! Ces nationalisations annoncent des bourrasques économiques à venir encore plus violentes. En effet, en 1929, les banques américaines qui ont fait faillite ont sombré avec les dépôts d'une grande partie de la population américaine, plongeant dans la misère des millions d'ouvriers. Dès lors, pour éviter qu'une telle débâcle ne se reproduise, le système bancaire avait été séparé en deux : d'un coté les banques d'affaires qui financent les entreprises et qui travaillent sur les opérations financières en tout genre, d'un autre coté les banques de dépôt qui reçoivent l'argent des déposants et qui s'en servent pour des placements relativement sécurisés. Or, emportées par la vague de faillites de l’année 2008, ces banques d'affaires américaines n'existent plus. Le système financier américain s'est recomposé tel qu'il était avant le 24 octobre 1929 ! A la prochaine bourrasque, toutes les banques "rescapées" grâce aux nationalisations partielles ou totales, risquent à leur tour de disparaître mais en emportant cette fois-ci les maigres économies et les salaires des familles ouvrières. Aujourd’hui, si la bourgeoise nationalise, ce n’est donc pas pour suivre un quelconque nouveau plan de relance économique mais pour éviter l'insolvabilité immédiate des mastodontes de la finance ou de l'industrie. Il s’agit d’éviter le pire, de sauver les meubles 31.
La montagne de dettes accumulées durant quatre décennies s'est transformée en véritable Everest et rien ne peut aujourd’hui empêcher le capital d’en dévaler la pente. L'état de l'économie est réellement désastreux. Cela dit, il ne faut pas croire que le capitalisme va sombrer d’un coup. La bourgeoisie ne laissera pas SON monde disparaître sans réagir ; elle tentera désespérément et par tous les moyens de prolonger l'agonie de son système, sans se soucier des maux infligés à l'humanité. Sa folle fuite en avant vers toujours plus d'endettement va se poursuivre et il y aura probablement à l’avenir, de-ci de-là, des courts moments de retour à la croissance. Mais ce qui est certain, c’est que la crise historique du capitalisme vient de changer de rythme. Après quarante années d'une lente descente aux enfers, l’avenir est aux soubresauts violents, aux spasmes économiques récurrents balayant non plus les seuls pays du Tiers-monde mais aussi les États-Unis, l’Europe, l’Asie… 32
La devise de l'Internationale communiste de 1919 "Pour que l'humanité puisse survivre, le capitalisme doit périr !" est plus que jamais d'actualité.
Mehdi (10 janvier 2009)
1. Respectivement : Paul Krugman (dernier prix Nobel d'économie), Warren Buffet (investisseur américain, surnommé "l'oracle d'Omaha" tant l'opinion du milliardaire de la petite ville américaine du Nebraska est respectée par le monde financier), Jacques Attali (économiste et conseiller des présidents français Mitterrand et Sarkozy) et Laurence Parisot (présidente de l'association des patrons français).
2. Libération du 4.08.08
3. Le Monde du 22.08.08.
4. Source : www.contreinfo.info [6]
5. Les Echos du 05.12.08
6. Cet argent a été trouvé dans les caisses du plan Paulson, pourtant déjà insuffisant pour le secteur bancaire. La bourgeoisie américaine est obligée "de déshabiller Paul pour habiller Jack", ce qui révèle là aussi l’état désastreux des finances de la première puissance mondiale.
7. Les Echos du 08.01.09
8. D’après le rapport publié le 9 janvier par le département du Travail américain (Les Echos du 09.01.09)
9. En France, le président Nicolas Sarkozy avait mené campagne en 2007 avec pour slogan principal "Travailler plus pour gagner plus" (sic !).
10. En 2007, près de trois millions de foyers américains sont en situation de défaut de paiement (in Subprime Mortgage Foreclosures by the Numbers - https://www.americanprogress.org/issues/2007/03/foreclosures_numbers.html [7]).
11. Pour une fois, nous sommes d'accord avec Chavez. Bush est effectivement son camarade. Même s'ils sont opposés par la lutte acharnée de leurs deux nations impérialistes respectives, ils n'en sont pas moins camarades dans la défense du capitalisme et des privilèges de leur classe… la bourgeoisie.
12. Aujourd’hui, Alan Greenspan, l’ex-président de la FED et le chef d’orchestre de cette économie à crédit, est lynché par tous les économistes et autres docteurs es-science. Tout ce beau monde a la mémoire bien courte et oublie un peu vite qu’il y a peu encore, il le portait aux nues, le surnommant même le "gourou de la finance" !
13. Source : eco.rue89.com/explicateur/2008/10/09/lendettement-peut-il-financer-leconomie-americaine
14. Le Capital, Livre 1, p725, La Pléiade.
15. ou, autrement dit, le capital variable.
16. Le capital fixe.
17. A. Kaspi, Franklin Roosevelt, Paris, Fayard, 1988, p.20
18. Ces chiffres sont d’autant plus importants que la population américaine n’est à l’époque que de 120 millions. Source : Lester V. Chandler, America’s Greatest Depression 1929-1941, New York, Harper and Row, 1970, p.24. et sq.
19. D’après Frédéric Valloire, in Valeurs Actuelles du 15.02.2008.
20. Pour être complet, cette chute de la dette totale s’explique aussi par un mécanisme économique complexe : la création monétaire. En effet, le New Deal n'a pas été financé intégralement par la dette mais aussi par de la pure création monétaire. Ainsi le 12 mai 1933, on autorise le Président à faire augmenter les crédits des banques fédérales de 3 milliards de $ et la création de billets sans contrepartie or également de 3 milliards de $. Le 22 octobre de la même année, il y a dévaluation de 50 % du $ par rapport à l'or. Tout ceci explique la relative modération des ratios d'endettement.
22. De 1950 à 1967, le capitalisme connaît une phase de croissance importante, appelée "Trente Glorieuses" ou "Age d'or". Le but de cet article n'est pas d'analyser les causes de cette sorte de parenthèse dans le marasme économique du 20e siècle. Un débat se déroule aujourd’hui dans le CCI pour mieux comprendre les ressorts de cette période faste, débat que nous avons commencé à publier dans notre presse (lire "Débat interne au CCI : Les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale" [9] in Revue internationale n° 133, 2e trimestre 2008). Nous encourageons vivement tous nos lecteurs à participer à cette discussion lors de nos réunions (permanences, réunions publiques) par courrier [10]ou par mail [11] .
23. Source : www.nber.org/research/business-cycle-dating [12].
24. Source : eco.rue89.com/explicateur/2008/10/09/lendettement-peut-il-financer-leconomie-americaine
25. En 1966, un dollar d'endettement supplémentaire produisait 0,80 dollar de production de richesse en plus alors qu’en 2007, ce même dollar n’engendre plus que 0,20 dollar de PIB en plus.
26. Les actifs et l’immobilier ne sont pas comptabilisés dans le PIB.
27. Ainsi, contrairement à tous ce que nous disent les économistes, journalistes et autres bonimenteurs, cette "folie spéculative" est donc le produit de la crise et non l'inverse !
28. Alors que la rédaction de cet article est terminée, Obama vient d’annoncer son plan de relance tant attendu qui est, aux dires mêmes des économistes, "bien décevant" : 775 milliards vont être débloqués pour à la fois permettre un "cadeau fiscal" de 1000 dollars aux foyers américains (95% de ces foyers sont concernés) afin de les inciter à "se remettre à dépenser" et lancer un programme de grands travaux dans le domaine de l’énergie, des infrastructures et de l’école. Ce plan devrait, promet Obama, créer trois millions d’emplois "au cours des prochaines années". L’économie américaine détruisant en ce moment plus de 500 000 emplois par mois, ce nouveau New Deal (même s’il fonctionne au mieux des prévisions ce qui est très peu probable) est donc encore vraiment loin du compte.
29. Cette menace révèle, en elle-même, l'impasse et les contradictions dans lesquelles est l'économie mondiale. En effet, vendre massivement ses dollars reviendrait pour la Chine à scier la branche sur laquelle elle est assise puisque les Etats-Unis constituent le principal débouché de ses marchandises. C'est pourquoi elle a jusqu'à présent continué de soutenir en grande partie l'économie américaine. Mais d'un autre côté, elle a conscience que cette branche est pourrie, totalement vermoulue, et elle n'a aucune envie d'être encore assise dessus quand elle va craquer.
30. In L'Anti-Duhring, Ed.Sociales 1963, p.318.
31. Ce faisant, elle crée un terrain plus propice au développement des luttes. En effet, en devenant leur patron officiel, les ouvriers auront tous face à eux dans leur lutte directement l’Etat. Dans les années 1980, la vague importante de privatisation des grandes entreprises (sous Thatcher en Angleterre, par exemple) avait constitué une difficulté supplémentaire pour dévoyer la lutte de classe. Non seulement les ouvriers étaient appelés par les syndicats à se battre pour sauver les entreprises publiques ou, autrement dit, pour être exploités par un patron (l'Etat) plutôt qu'un autre (privé), mais en plus ils se confrontaient non plus au même patron (l'Etat) mais à une série de patrons privés différents. Leurs luttes étaient souvent éparpillées et donc impuissantes. A l'avenir, au contraire, le terreau sera plus fertile aux luttes d’ouvriers unis contre l’Etat.
32. Le terrain économique est particulièrement miné, il est donc difficile de savoir quelle sera la prochaine bombe à éclater. Mais dans les pages des revues économiques, un nom revient souvent sous la plume angoissée des spécialistes et autres docteurs es-science : les CDS. Un CDS (credit default swap) est une sorte d’assurance par laquelle un établissement financier se protège du risque de défaut de paiement d’un crédit en payant une prime. Le total du marché des CDS était estimé à 60 000 milliards de dollars en 2008. C’est dire si une crise des CDS sur le modèle de la crise des subprimes serait terriblement ravageuse. Elle emporterait en particulier tous les fonds de pensions américains et donc les retraites ouvrières.
Récent et en cours:
- Crise économique [13]
Questions théoriques:
- L'économie [14]
Il y a 90 ans, la révolution allemande : la guerre civile en Allemagne (1918-1919)
- 5951 lectures
Dans les trois premières parties de cette série sur la révolution allemande de 1918-1919 1, nous avons montré comment, après l’effondrement de l’Internationale socialiste face à la Première Guerre mondiale, le cours s’est inversé en faveur du prolétariat et a culminé dans la révolution de novembre 1918. Tout comme la révolution d’Octobre en Russie l’année précédente, novembre 1918 en Allemagne constituait l'aboutissement d'un processus de lutte et de révolte contre la guerre impérialiste. Alors qu’Octobre avait représenté le premier coup puissant porté par la classe ouvrière contre la "Grande Guerre", ce fut l’action du prolétariat allemand qui parvint, finalement, à y mettre fin.
Selon les livres d’histoire de la classe dominante, le parallèle entre les mouvements en Russie et en Allemagne s’arrête là. Pour ces livres, le mouvement révolutionnaire en Allemagne se limite aux événements de 1918, contre la guerre. Et, contrairement à la Russie, il n’y eut jamais en Allemagne de mouvement socialiste de masse contre le système capitaliste lui-même. D’après eux, les "extrémistes" qui se battaient pour qu’une révolution "bolchevique" ait lieu en Allemagne, allaient payer de leur vie le fait de ne pas l’avoir compris. C’est ce qu’on proclame.
Pourtant, la classe dominante de l’époque ne partageait pas la légèreté des historiens d’aujourd’hui sur le caractère indestructible de la domination capitaliste. Son programme du moment, c’était la Guerre civile !
Le "double pouvoir" et le système des conseils
L’existence d’une situation de double pouvoir, qui résultait de la révolution de novembre, motivait cet ordre du jour. Le résultat principal de la révolution de novembre fut la fin de la guerre impérialiste ; son principal produit fut la création d’un système de conseils d’ouvriers et de soldats qui, comme en Russie et en Autriche-Hongrie, s’étendait à tout le pays.
La bourgeoisie allemande, en particulier la social-démocratie, tirant rapidement les leçons de ce qui s’était passé en Russie, intervint immédiatement pour faire de ces organes des coquilles vides. Dans bien des cas, elle imposa l’élection de délégués sur la base de listes de partis, à savoir le parti social-démocrate (le SPD) et l’USPD hésitant et conciliateur, excluant ainsi de fait les révolutionnaires de ces organes. Lors du Premier Congrès des Conseils d’ouvriers et de soldats à Berlin, l’aile gauche du capital empêcha Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg d’intervenir. Et, surtout, elle fit adopter une motion déclarant que tout le pouvoir serait remis aux mains du futur gouvernement parlementaire.
Ces succès de la bourgeoisie sont toujours aujourd’hui à la base du mythe selon lequel les conseils en Allemagne, contrairement à ceux de Russie, n’étaient pas révolutionnaires. Mais cela ignore le fait qu’en Russie aussi, au début de la révolution, les conseils ne suivaient pas une orientation révolutionnaire, que la plupart des délégués élus au départ n’étaient pas révolutionnaires et que, là aussi, on avait poussé les "soviets" à abandonner le pouvoir rapidement.
Après la révolution de novembre, la bourgeoisie allemande ne se faisait aucune illusion sur le caractère prétendument inoffensif du système des conseils. Tout en revendiquant le pouvoir pour eux-mêmes, ces conseils continuaient à permettre à l’appareil d’Etat bourgeois de coexister à côté d’eux. Mais, d’un autre côté, le système des conseils, par sa nature dynamique et flexible, par sa composition, par son attitude, par son mode d’action, était capable de s’adapter à tous les tournants et de se radicaliser. Les Spartakistes, qui l’avaient immédiatement compris, avaient commencé une agitation incessante pour que les délégués soient réélus, ce qui se concrétiserait par un fort tournant à gauche de l’ensemble du mouvement.
Personne ne comprenait mieux le danger de cette situation de "double pouvoir" que la direction militaire allemande. Le général Groener, désigné pour mener les opérations de riposte, activa immédiatement la connexion téléphonique secrète 998 avec le nouveau chancelier, le social-démocrate Ebert. Et tout comme le légendaire sénateur Caton, deux mille ans plus tôt, avait conclu tous ses discours par les mots "Carthage (l’ennemi mortel de Rome) doit être détruit", Groener ne pensait qu’à détruire les conseils ouvriers et surtout de soldats Bien que pendant et après la révolution de novembre, les conseils de soldats aient en partie incarné un poids mort conservateur qui tirait les ouvriers en arrière, Groener savait que la radicalisation de la révolution renverserait cette tendance et que les ouvriers commenceraient à entraîner les soldats derrière eux. Et, par dessus tout, l’ambition des conseils de soldats était d’imposer leur commandement propre et de briser la domination des officiers sur les forces armées. Cela équivalait, rien de moins, qu’à armer la révolution. Aucune classe dominante n’a jamais accepté volontairement la contestation de son monopole sur les forces armées. En ce sens, l’existence même du système de conseils mettait la guerre civile à l’ordre du jour.
Plus encore, la bourgeoisie comprit qu’à la suite de la révolution de novembre, le temps ne jouait plus en sa faveur. La tendance spontanée contenue dans l'ensemble de la situation était à la radicalisation de la classe ouvrière, à la perte de ses illusions sur la social-démocratie et la "démocratie" et au développement de sa confiance en elle-même. C’est sans la moindre hésitation que la bourgeoisie allemande se lança dans la politique consistant à provoquer systématiquement des affrontements militaires. Elle voulait imposer des confrontations décisives à son ennemi de classe avant qu’une situation révolutionnaire ne puisse mûrir ; concrètement, "décapiter" le prolétariat au moyen d’une défaite sanglante des ouvriers dans la capitale, Berlin, centre politique du mouvement ouvrier allemand, avant que les luttes dans les provinces ne puissent atteindre une phase "critique ".
Une situation de lutte ouverte entre deux classes, chacune déterminée à imposer son propre pouvoir, chacune ayant ses propres organisations de domination de classe, ne peut qu’être temporaire, instable. Une telle situation de "double pouvoir" débouche nécessairement dans la guerre civile.
Les forces de la contre-révolution
Contrairement à la situation en Russie de 1917, la révolution allemande faisait face aux forces hostiles de l’ensemble de la bourgeoisie mondiale. La classe dominante n’était plus divisée par la guerre impérialiste en deux camps rivaux. De ce fait, la révolution devait affronter non seulement la bourgeoisie allemande mais aussi les forces de l’Entente qui étaient rassemblées sur la rive occidentale du Rhin, prêtes à intervenir si le gouvernement allemand perdait le contrôle de la situation sociale. Les États-Unis, qui étaient dans une certaine mesure un nouveau venu sur la scène politique mondiale, jouaient la carte de la "démocratie" et du "droit des peuples à disposer d’eux-mêmes", se présentant comme la seule garantie de paix et de prospérité. Comme tels, ils cherchaient à formuler une alternative politique à la Russie révolutionnaire. La bourgeoisie française, pour sa part, obsédée par sa soif de revanche chauvine, brûlait de pénétrer plus avant dans le territoire allemand et, en cours de route, de noyer la révolution dans le sang. Ce fut la Grande-Bretagne, puissance dominante de l’époque, qui assuma la direction de l’alliance contre-révolutionnaire. Au lieu de lever l’embargo imposé à l’Allemagne au cours de la guerre, elle le maintint et même le renforça partiellement. Londres était déterminée à affamer la population allemande tant que ne serait pas installé dans le pays un régime politique approuvé par le gouvernement de sa majesté.
En Allemagne même, l’axe central de la contre-révolution était l’alliance de deux forces majeures : la social-démocratie et l’armée. La social-démocratie était le cheval de Troie de la terreur blanche ; elle opérait derrière les lignes de la classe ennemie, sabotant la révolution de l’intérieur, usant de l'autorité qui lui restait en tant qu’ancien parti ouvrier (avec les syndicats) pour créer un maximum de confusion et de démoralisation. Les militaires fournissaient les forces armées, mais aussi la cruauté, l’audace et la capacité stratégique qui les caractérisent.
Que représentait le groupe de socialistes russes, hésitants et peu enthousiastes, regroupés autour de Kerensky en 1917, en comparaison du sang-froid des contre-révolutionnaires du SPD allemand ! Qu’était la foule inorganisée des officiers russes comparée à l’efficacité sinistre de l’élite militaire prussienne ! 2
Au cours des jours et des semaines qui suivirent la révolution de novembre, cette alliance sinistre se prépara à résoudre deux problèmes majeurs. Face à la dissolution des armées impériales, elle devait souder en un noyau dur une nouvelle force, une armée blanche de la terreur. Elle en tira la matière brute à deux sources : de l’ancien corps des officiers et des sycophantes déracinés, rendus fous par la guerre et qui ne pouvaient plus être réintégrés dans la vie "civile ". Eux-mêmes victimes de l’impérialisme mais des victimes brisées, ces anciens soldats étaient à la recherche d’un exutoire à leur haine aveugle et d’un paiement pour ce service. C’est parmi ces desperados que les officiers de l’aristocratie – soutenus politiquement et couverts par le SPD – recrutèrent et entraînèrent ce qui allait devenir les Freikorps (les Corps francs), les mercenaires de la contre-révolution, le noyau de ce qui devint le mouvement nazi.
Ces forces armées étaient complétées par toute une série de réseaux d’espions et d’agents provocateurs coordonnés par le SPD et l’état-major de l’armée.
Le second problème était comment justifier aux yeux des ouvriers l’emploi de la terreur blanche. C’est la social-démocratie qui le résolut. Pendant quatre ans, elle avait défendu la guerre impérialiste au nom de la paix. Maintenant, elle prêchait la guerre civile pour… empêcher la guerre civile. Il n’y a personne qui veuille un bain de sang, déclarait-elle – sauf Spartakus ! La Grande Guerre a répandu bien trop de sang des ouvriers – mais Spartakus en veut plus !
Les médias de l’époque répandirent ces mensonges infâmes : Spartakus assassine, pille, recrute les soldats pour la contre-révolution et collabore avec l’Entente, reçoit de l’argent des capitalistes et prépare une dictature. Le SPD accusait Spartakus de ce qu’il était en train de faire lui-même !
La première grande chasse à l’homme du 20e siècle dans l’une des nations industrielles hautement "civilisées" d’Europe occidentale fut dirigée contre Spartakus. Et tandis que les capitalistes et les militaires de haut rang, offrant d’énormes récompenses pour la liquidation des chefs de Spartakus, préféraient garder l’anonymat, le SPD appela ouvertement à l’assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg dans la presse du parti. Contrairement à leurs nouveaux amis bourgeois, dans cette campagne, le SPD était animé non seulement par l’instinct de classe (bourgeois) et par des considérations stratégiques, mais également par une haine aussi éperdue que celle des Corps francs.
La bourgeoisie ne se laissa pas tromper par l’impression superficielle et fugitive du moment : Spartakus apparaissait comme un petit groupe, marginal. Elle savait que là battait le cœur du prolétariat et elle se prépara à porter son coup mortel.
Décembre 1918 : les premières victoires du prolétariat
L’offensive contre-révolutionnaire commença le 6 décembre à Berlin : une attaque dans trois directions. Un raid eut lieu sur le quartier général de la Rote Fahne ("Le drapeau rouge ") , le journal du Spartakusbund. Un autre groupe de soldats tenta d’arrêter les chefs de l’organe exécutif des conseils ouvriers qui étaient réunis en session. L’intention d’éliminer les conseils en tant que tels était claire. Au coin de la rue, un autre groupe de soldats appelait complaisamment Ebert à interdire le Conseil exécutif. Et une embuscade fut tendue à une manifestation de Spartakus près du centre ville, à Chausseestrasse : 18 morts, 30 blessés. Le courage et l’ingéniosité du prolétariat permit d’éviter le pire. Tandis que les chefs de l’exécutif des conseils parvinrent à discuter longuement avec les soldats impliqués dans cette action, un groupe de prisonniers de guerre russes, arrivant par derrière le long de Friedrichstrasse, surprit et maîtrisa les mitrailleurs à mains nues. 3
Le jour suivant, Karl Liebknecht échappa à une tentative de kidnapping et d’assassinat dans les locaux de la Rote Fahne. C’est son sang-froid qui lui permit de sauver sa vie à cette occasion.
Ces actes provoquèrent les premières gigantesques manifestations du prolétariat berlinois de solidarité avec Spartakus. A partir de ce moment là, toutes les manifestations du Spartakusbund étaient armées, menées par des camions portant des batteries de mitrailleuses. Au même moment, la gigantesque vague de grèves qui avait éclaté fin novembre dans les régions d’industrie lourde de Haute Silésie et de la Ruhr, s’intensifia face à ces provocations.
La cible suivante de la contre-révolution était la Volksmarinedivision (Division de la Marine du peuple) composée de marins armés qui avait marché depuis les ports de la côte sur la capitale pour répandre la révolution. Pour les autorités, sa présence même était une provocation, d’autant plus que, depuis lors, elle occupait le Palais des vénérés rois de Prusse. 4
Cette fois-ci, le SPD prépara le terrain plus soigneusement. Il attendit les résultats du Congrès national des conseils qui se prononça pour remettre le pouvoir au gouvernement social-démocrate et pour la convocation d’une assemblée nationale. Une campagne médiatique accusa les marins de maraude et de pillage. C’étaient des criminels, des spartakistes !
Au matin du 24 décembre, à la veille de Noël, le gouvernement présenta un ultimatum aux 28 marins qui tenaient le palais et aux 80 autres qui se trouvaient dans le Marstall (l’arsenal) 5 : reddition sans condition. La garnison mal armée jura de se battre jusqu’au dernier. Dix minutes plus tard exactement (il n’y eut même pas le temps d’évacuer des bâtiments les femmes et les enfants), le grondement de l’artillerie commença, réveillant la ville.
"Malgré toute la ténacité des marins, ce ne pouvait être qu’une bataille perdue puisqu’ils étaient très mal armés – où que la bataille ait pris place. Mais elle eut lieu au centre de Berlin. Il est bien connu que, dans les batailles, les rivières, les collines, les difficultés topographiques jouent un rôle important. A Berlin, les difficultés topographiques étaient les êtres humains.
Quand les canons se mirent à gronder, fièrement et très fort, les civils sortirent de leur sommeil et ils comprirent immédiatement ce que les canons disaient." 6
Contrairement à la Grande-Bretagne ou à la France, l’Allemagne n’était pas une monarchie depuis longtemps centralisée. Contrairement à Londres ou à Paris, Berlin n’était pas devenue une métropole mondiale développée sous la conduite d’un plan gouvernemental. Comme la vallée de la Ruhr, Berlin avait poussé comme un cancer. Il en résultait que les quartiers gouvernementaux finirent par être encerclés sur trois côtés par une "ceinture rouge ", de gigantesques quartiers ouvriers. 7 Les ouvriers armés se précipitèrent sur les lieux pour défendre les marins. Les femmes et les enfants de la classe ouvrière se mirent entre les mitrailleuses et leurs cibles, uniquement armés de leur courage, de leur humour et de leur capacité de persuasion. Les soldats jetèrent leurs armes et désarmèrent les officiers.
Le jour suivant, la manifestation la plus massive dans la capitale depuis le 9 novembre prit possession du centre ville – cette fois-ci contre le SPD pour défendre la révolution. Le même jour, des groupes d’ouvriers occupèrent les bureaux du Vorwärts, le quotidien du SPD. Il ne fait pas de doute que cette action fût le résultat spontané de la profonde indignation du prolétariat. Pendant des décennies, le Vorwärts avait été le porte-parole de la classe ouvrière – jusqu’a ce que la direction du SPD l’en dépossède pendant la guerre mondiale. Il était maintenant devenu l’organe le plus honteux et le plus malhonnête de la contre-révolution.
Le SPD vit immédiatement la possibilité d’exploiter cette situation par une nouvelle provocation, en commençant par une campagne contre une prétendue "attaque contre la liberté de la presse ". Mais les délégués révolutionnaires, les Öbleute, se ruèrent au quartier général du Vorwärts pour persuader ceux qui l’occupaient qu’il était tactiquement plus sage de se retirer temporairement afin d’éviter une confrontation prématurée. (voir note 26)
L’année se termina donc par une autre manifestation de détermination révolutionnaire : l’enterrement des 11 marins tués dans la bataille du Marstall. Le même jour, la gauche de l’USPD quitta la coalition gouvernementale avec le SPD. Et, tandis que le gouvernement de Ebert envisageait de fuir la capitale, le Congrès de fondation du KPD commençait.
L’affaire Eichhorn et la deuxième occupation du Vorwärts
Les événements de décembre 1918 révélaient que la révolution commençait à s’affermir en profondeur. La classe ouvrière gagna les premières confrontations de la nouvelle phase tant par l’audace de ses réactions que par la sagesse de ses retraits tactiques. Le SPD avait finalement commencé à dévoiler sa nature contre-révolutionnaire aux yeux de l’ensemble de la classe. Il s’avéra vite que la stratégie bourgeoise de provocation était difficile à réaliser et même dangereuse.
Le dos au mur, la classe dominante tira les leçons de ces premières escarmouches avec une lucidité remarquable. Elle prit conscience que cibler directement et massivement les symboles et les figures auxquels s’identifiait la révolution – Spartakus, la direction des conseils ouvriers ou la division des marins – pouvait s’avérer contre-productif en provoquant la solidarité de l’ensemble de la classe ouvrière. Il valait mieux s’en prendre à des figures de second ordre qui susciteraient le soutien d’une partie de la classe seulement, ce qui permettrait ainsi de diviser les ouvriers de la capitale et de les isoler du reste du pays. Emil Eichhorn constituait une telle figure ; il appartenait à l’aile gauche de l’USPD. Un caprice du destin, paradoxe tel qu’en produit toute grande révolution, avait fait de lui le président de la police de Berlin. Dans cette fonction, il avait commencé à distribuer des armes aux milices ouvrières. C’était une provocation pour la classe dominante. Cibler cet homme aiderait à galvaniser les forces de la contre-révolution qui titubaient encore de ces premiers revers. En même temps, la défense d’un chef de la police constituait une cause ambiguë pour mobiliser les forces révolutionnaires ! Mais la contre-révolution avait une deuxième provocation dans sa manche, non moins ambiguë et comportant tout autant de potentiel pour diviser la classe ouvrière et la faire hésiter. La direction du SPD avait bien vu que la brève occupation des bureaux du Vorwärts avait choqué les ouvriers sociaux-démocrates. La plupart de ces ouvriers étaient honteux du contenu de ce journal mais ils étaient préoccupés par autre chose : le spectre d’un conflit militaire entre ouvriers sociaux-démocrates et ouvriers communistes – menace agitée en couleurs criardes par le SPD – qui pourrait résulter de ce genre d’actions d’occupation. Cette inquiétude pesait d’autant plus lourd – la direction du SPD le savait – qu’elle avait pour motif une réelle préoccupation prolétarienne de défendre l’unité de la classe.
Toute la machine de la provocation se mit à nouveau en marche.
Un torrent de mensonges : Eichhorn est corrompu, c’est un criminel payé par les Russes qui prépare un putsch contre-révolutionnaire !
Un ultimatum : Eichhorn doit démissionner immédiatement ou être forcé à le faire !
L’étalage de la force brute : Cette fois-ci, 10 000 hommes de troupe furent postées au centre de la ville, 80 000 autres rassemblés dans le voisinage. Ce dispositif militaire comprenait les divisions d’élite hautement disciplinées du général Maercker, des troupes d’infanterie, une "brigade de fer" postée sur la côte, des milices des quartiers bourgeois et les premiers Corps francs. Mais elles comprenaient aussi la "Garde républicaine ", milice armée du SPD, et d’importantes troupes du contingent qui sympathisaient avec la social-démocratie.
Le piège était prêt à se refermer.
Le piège fatal de janvier 1919
Comme la bourgeoisie s’y attendait, l’attaque contre Eichhorn ne mobilisa pas les troupes de la capitale qui sympathisaient avec la révolution. Elle ne mobilisa pas non plus les ouvriers des provinces où le nom de Eichhorn n’était pas connu. 8
Mais, dans la nouvelle situation, il existait une composante qui prit tout le monde par surprise. Ce fut la massivité et l’intensité de la réaction du prolétariat de Berlin. Le dimanche 5 janvier, 150 000 personnes répondirent à l’appel des Öbleute à manifester face à la police sur Alexanderplatz. Le lendemain, plus d’un demi million d’ouvriers posèrent leurs outils et prirent possession du centre ville. Ils étaient prêts à se battre et à mourir. Ils avaient immédiatement compris que la vraie question n’était pas Eichhorn mais la défense de la révolution.
Bien que déconcertée par la puissance de cette réponse, la contre-révolution eut assez de sang-froid pour poursuivre ses plans. Les locaux du Vorwärts furent de nouveau occupés mais aussi d’autres bureaux de presse de la ville. Cette fois, c’étaient les agents provocateurs de la police qui en avaient pris l’initiative. 9
Le jeune KPD lança immédiatement un avertissement à la jeune classe ouvrière. Dans un tract et dans les articles de première page de la Rote Fahne, il appelait le prolétariat à élire de nouveaux délégués à ses conseils et à s’armer mais, aussi, à prendre conscience que le moment de l’insurrection armée n’était pas encore venu. Une telle insurrection requérait une direction centralisée au niveau de tout le pays. Seuls des conseils ouvriers où les révolutionnaires domineraient, pourraient la fournir.
Le matin du 5 janvier, les chefs révolutionnaires se réunirent dans le quartier général de Eichhorn pour se consulter. Environ 70 Öbleute étaient présents dont, en gros, 80% soutenaient la gauche de l’USPD, les autres le KPD. Les membres du comité central de l’organisation berlinoise de l’USPD étaient venus ainsi que deux membres du comité central du KPD : Karl Liebknecht et Wilhelm Pieck.
Au départ, les délégués des organisations ouvrières n’étaient pas sûrs de la façon dont il fallait riposter. Puis l’atmosphère changea, électrisée par les rapports qui arrivaient. Ceux-ci concernaient les occupations armées dans le quartier de la presse et la prétendue préparation des différentes garnisons à se joindre à l’insurrection armée. Liebknecht déclara alors que, dans ces circonstances, il était nécessaire non seulement de repousser l’attaque contre Eichhorn mais de lancer l’insurrection armée.
Les témoins oculaires de cette réunion dramatique indiquent que l’intervention de Liebknecht constitua le tournant fatal. Durant toute la guerre, il avait représenté la boussole et la conscience morale du prolétariat allemand et même mondial. Maintenant, à ce moment crucial de la révolution, il perdit la tête et ses repères. Par dessus tout, il prépara la voie aux Unabhängigen, les indépendants, qui étaient toujours la principale force à ce moment. Manquant de principes politiques clairement définis, d’une perspective claire et à long terme et d’une confiance profonde dans la cause du prolétariat, ce courant "indépendant" était condamné à vaciller constamment sous la pression de la situation immédiate et donc à concilier avec la classe dominante. Mais le revers de ce "centrisme" était le besoin fortement ressenti de participer à n’importe quelle "action" peu claire à l’ordre du jour, ne serait-ce que pour montrer sa propre détermination révolutionnaire.
"Le parti indépendant n’avait pas de programme politique clair ; mais il n‘avait aucune intention de renverser le gouvernement Ebert-Scheidemann. A cette conférence, les décisions étaient aux mains des indépendants. Et à ce moment-là il apparut clairement que les figures hésitantes qui siégeaient au comité du parti de Berlin et n’aimaient pas en temps normal prendre des risques mais voulaient en même temps participer à tout, s’avérèrent les plus grands brailleurs, se présentant de la façon la plus "révolutionnaire" possible". 10
Selon Richard Müller, il y eut une sorte de surenchère entre les chefs de l’USPD et la délégation du KPD. "A présent les indépendants voulaient montrer leur courage et leur sérieux en surenchérissant sur les objectifs proposés par Liebknecht. Liebknecht pouvait-il se retenir, face au "feu révolutionnaire" de ces "éléments vacillants et hésitants" ? Ce n’était pas dans sa nature." (Ibid.)
On n’écouta pas les avertissements des délégués de soldats qui exprimèrent des doutes sur la préparation des troupes à la lutte.
"Richard Müller s’exprima de la façon la plus tranchante contre l’objectif proposé, le renversement du gouvernement. Il souligna qu’il n’existait ni les conditions politiques ni les conditions militaires. Le mouvement grandissait jour après jour dans le pays, aussi très rapidement les conditions politiques, militaires et psychologiques seraient atteintes. Une action prématurée et isolée à Berlin pourrait remettre en cause cette évolution ultérieure. Ce n’est qu’avec difficulté qu’il put exprimer ce rejet face à des objections venant de toutes parts.
Pieck, en tant que représentant du comité central du KPD, s’exprima fortement contre Richard Müller et demanda, en termes très précis, un vote immédiat et que la lutte soit engagée." 11
Trois décisions majeures furent mises au vote et adoptées. L’appel à la grève générale fut adopté à l’unanimité. Les deux autres décisions, l’appel à renverser le gouvernement et à poursuivre l’occupation des bureaux de presse, furent adoptées par une large majorité mais avec six voix contre. 12
Un "comité provisoire d’action révolutionnaire" fut alors constitué comportant 53 membres et trois présidents : Liebknecht, Ledebour et Scholze.
Maintenant, le prolétariat était pris au piège.
La semaine dite de Spartakus
Il allait s’ensuivre ce qui devait devenir "la semaine sanglante" à Berlin. La bourgeoisie l’appela "la semaine Spartakus" : un "putsch communiste" a été déjoué par les "héros de la liberté et de la démocratie ". Le destin de la révolution mondiale se joua en bonne partie cette semaine là, du 5 au 12 janvier 1919.
Le matin qui suivit la constitution du comité révolutionnaire, la grève était quasiment totale dans la ville. Un nombre d’ouvriers encore plus grand que la veille se répandit au centre ville, beaucoup d’entre eux étaient armés. Mais à midi, tous les espoirs d’un soutien actif des garnisons s’étaient évaporés. Même la division des marins, légende vivante, se déclara neutre et alla même jusqu’à arrêter son propre délégué, Dorrenbach, pour ce qu’elle considérait être sa participation irresponsable à l’appel à l’insurrection. Le même après-midi, la même Volksmarinedivision fit sortir le comité révolutionnaire du Marstall où il avait cherché refuge. De même, les mesures concrètes pour déloger le gouvernement furent contrecarrées ou même ignorées, puisque visiblement aucune puissance armée ne les soutenait ! 13
Toute la journée, les masses furent dans la rue, attendant des instructions de leurs dirigeants. Mais celles-ci ne venaient pas. L’art de réussir des actions de masse consiste dans la concentration et l’orientation de l’énergie vers un but qui dépasse le point de départ, qui fait avancer le mouvement général, qui donne à ses participants le sentiment d’un succès et d’une force collectifs. Dans la situation d'alors, la simple répétition de la grève et des manifestations de masse des jours précédents ne suffisait pas. Un pas en avant aurait été, par exemple, l’encerclement des casernes et l’agitation envers elles afin de gagner les soldats à la nouvelle étape de la révolution, à désarmer les officiers, à commencer un armement plus large des ouvriers eux-mêmes. 14 Mais le comité révolutionnaire auto-proclamé ne proposa pas ces mesures, entre autres du fait qu’il avait déjà mis en avant un ensemble d’actions plus radicales mais malheureusement irréalistes. Après avoir appelé à rien moins que l’insurrection armée, des mesures plus concrètes mais bien moins spectaculaires seraient apparues comme une déconvenue, une attente déçue, un recul. Le comité, et le prolétariat avec lui, étaient prisonniers d’un radicalisme erroné et vide.
La direction du KPD fut horrifiée quand elle reçut les nouvelles de la proposition d’insurrection. Rosa Luxemburg et Leo Jogiches en particulier accusèrent Liebknecht et Pieck d’avoir abandonné non seulement les décisions du Congrès du parti mais le programme du parti lui-même. 15
Mais on ne pouvait défaire ces erreurs et, comme telles, elles n’étaient pas (encore) la question de l’heure. Le cours des événements plaça le parti face à un terrible dilemme : comment sortir le prolétariat du piège où il était déjà pris ?
Cette tâche était bien plus difficile que celle qu’avaient accomplie les Bolcheviks au cours des célèbres "journées de juillet" de 1917 en Russie, quand le parti était parvenu à aider la classe ouvrière à éviter le piège d’une confrontation militaire prématurée.
La réponse étonnante, paradoxale que trouva le parti, sous l’impulsion de Rosa Luxemburg, fut la suivante. Le KPD, opposant le plus déterminé à une révolution armée jusqu’ici, devait devenir son protagoniste le plus fervent. Pour une simple raison. Prendre le pouvoir à Berlin était le seul moyen d’empêcher le massacre sanglant devenu maintenant imminent, d’empêcher la décapitation du prolétariat allemand. Une fois ce problème réglé, le prolétariat de Berlin pourrait s’attaquer à celui de tenir ou de reculer en bon ordre jusqu’à ce que la révolution soit mûre dans l’ensemble du pays.
Karl Radek, émissaire du parti russe, caché à Berlin, proposa une orientation alternative : retrait immédiat tout en gardant les armes mais, si nécessaire, en les rendant. Mais la classe dans son ensemble n’avait pas encore d’armes. Le problème était que l’apparition d’un "putsch" communiste "non démocratique" fournissait au gouvernement le prétexte dont il avait besoin pour imposer un bain de sang. Aucun recul des combattants ne pouvait défaire cela.
Le cours de l’action qu’avait proposé Rosa Luxemburg, était basé sur l’analyse que le rapport de forces militaire dans la capitale n’était pas défavorable au prolétariat. Et, en réalité, si le 6 janvier détruisit les espoirs que mettait le comité révolutionnaire dans "ses" troupes, il fut rapidement clair que la contre-révolution aussi avait mal calculé. La Garde républicaine et les troupes qui sympathisaient avec le SPD refusaient maintenant d’utiliser la force contre les ouvriers révolutionnaires. Dans leurs comptes-rendus des événements, le révolutionnaire Richard Müller et le contre-révolutionnaire Gustav Noske confirmèrent tous deux ultérieurement la justesse de l’analyse de Rosa Luxemburg : du point de vue militaire, le rapport de force au début de la semaine était en faveur du prolétariat.
Mais la question décisive n’était pas le rapport de force militaire mais le rapport de force politique. Et celui-ci pesait contre le prolétariat pour la simple raison que la direction du mouvement était toujours aux mains des "centristes ", des éléments hésitants et pas encore à celles des révolutionnaires conséquents. Selon "l’art de l’insurrection" marxiste, l’insurrection armée est la dernière étape du processus de renforcement de la révolution et elle balaie simplement les derniers postes de résistance.
Prenant conscience du piège dans lequel il s’était mis lui-même, le comité provisoire, au lieu d’armer le prolétariat, commença à négocier avec le gouvernement qu’il venait de déclarer déchu et sans même savoir ce qu’il voulait négocier. Face à cette attitude du comité, le KPD obligea Liebknecht et Pieck d’en démissionner le 10 janvier. Mais le mal était fait. La politique de conciliation paralysa le prolétariat, faisant remonter à la surface tous ses doutes et ses hésitations. Les ouvriers de toute une série d’usines importantes sortirent avec des déclarations qui condamnaient le SPD mais également Liebknecht et les "Spartakistes ", appelant à la réconciliation des "partis socialistes ".
A ce moment où la contre-révolution titubait, le social-démocrate Noske vint à la rescousse. "Il faut que quelqu’un joue le rôle du chien sanglant. Je n’ai pas peur de la responsabilité ", déclara-t-il. Tout en prétendant "négocier" pour gagner du temps, le SPD convoqua ouvertement les officiers, les étudiants, les milices bourgeoises pour noyer la résistance ouvrière dans le sang. Avec le prolétariat divisé et démoralisé, la voie était maintenant ouverte à la terreur blanche la plus sauvage. Les atrocités comportèrent le bombardement des bâtiments par l’artillerie, le meurtre des prisonniers et même des délégués venus négocier, le lynchage des ouvriers mais aussi des soldats ayant serré la main aux révolutionnaires, la persécution des femmes et des enfants dans les quartiers ouvriers, la profanation des cadavres mais aussi la chasse systématique et le meurtre de révolutionnaires comme Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht. Nous reviendrons sur la nature et la signification de cette terreur dans le dernier article de cette série.
La grève de masse révolutionnaire, janvier - mars 1919
Dans un célèbre article publié dans la Rote Fahne le 27 novembre 1918, "L’Achéron s’est mis en mouvement ", Rosa Luxemburg annonçait le début d’une nouvelle phase de la révolution : celle de la grève de masse. Cela allait se confirmer rapidement de façon éclatante. La situation matérielle de la population ne s’était pas améliorée avec la fin de la guerre, au contraire. L’inflation, les licenciements, le chômage massif, le travail précaire et la chute des salaires réels créèrent une nouvelle misère pour des millions d’ouvriers, de fonctionnaires mais aussi pour de larges couches des classes moyennes. De plus en plus, la misère matérielle mais aussi la déception amère vis-à-vis des résultats de la révolution de novembre poussaient les masses à se défendre. Les estomacs vides constituaient un puissant argument contre les prétendus bénéfices de la nouvelle démocratie bourgeoise. Des vagues de grèves successives parcoururent le pays, surtout pendant le premier trimestre 1919. Bien loin des centres traditionnels du mouvement socialiste organisé comme Berlin, les ports côtiers ou les secteurs du génie civil et de la haute technologie 16, des parties du prolétariat politiquement moins expérimentées furent entraînées dans le processus révolutionnaire. Elles comprenaient ceux que Rosa Luxemburg, dans sa brochure sur la grève de masse, appelait "la masse des Ilotes". C’étaient des secteurs particulièrement opprimés de la classe ouvrière qui n’avaient bénéficié d’aucune éducation socialiste et qui, de ce fait, étaient souvent regardés de haut par les fonctionnaires de la social-démocratie et des syndicats avant la guerre. Rosa Luxemburg avait prédit qu’ils joueraient un rôle majeur dans la lutte future pour le socialisme.
Et maintenant, ils étaient là. Par exemple, des millions de mineurs, de sidérurgistes, d’ouvriers du textile des régions industrielles du Bas-Rhin et de Westphalie. 17 Là, les luttes ouvrières défensives s’affrontèrent immédiatement à l’alliance brutale des patrons et des gardes armés de leurs usines, des syndicats et des Corps francs. A partir de ces premières confrontations se cristallisèrent deux principales revendications du mouvement de grève, formulées à la conférence des délégués de toute la région début février à Essen : tout le pouvoir aux conseils d’ouvriers et de soldats ! Socialisation des usines et des mines ! La situation s’exacerba lorsque les militaires tentèrent de désarmer et de démanteler les conseils de soldats et envoyèrent 30 000 membres des Corps francs occuper la Ruhr. Le 14 février, les conseils d’ouvriers et de soldats appelèrent à la grève générale et à la résistance armée. La détermination et la mobilisation des ouvriers étaient si grandes que l’armée blanche mercenaire n’osa même pas attaquer. L’indignation contre le SPD qui soutenait ouvertement les militaires et dénonçait la grève, fut indescriptible. A tel point que le 25 février, les conseils - soutenus par les délégués communistes – décidèrent de mettre fin à la grève. Les dirigeants avaient peur que les ouvriers inondent les mines ou attaquent les ouvriers sociaux-démocrates. 18 En fait, les ouvriers montrèrent un haut degré de discipline et une large minorité respecta l’appel à la reprise du travail – même si elle n’était pas d’accord avec cette décision. Malheureusement c’était le moment où la grève commençait en Allemagne centrale !
Une deuxième grève de masse gigantesque éclata vers la fin mars et dura plusieurs semaines malgré la répression des Corps francs.
"Très vite il apparut clairement que le Parti social-démocrate et les dirigeants syndicaux avaient perdu de leur influence sur les masses. La puissance du mouvement révolutionnaire des mois de février et mars ne résidait pas dans la possession ni dans l’utilisation des armes, mais dans la possibilité de retirer au gouvernement socialiste bourgeois son fondement économique en paralysant les aires de production les plus importantes. (…) L’énorme mobilisation militaire, l’armement de la bourgeoisie, la brutalité de la soldatesque ne purent briser cette puissance, ne purent forcer les ouvriers en grève à rentrer au travail." 19
Le second grand centre de la grève de masse était la région connue sous le nom d’Allemagne centrale (Mitteldeutschland). 20 Là le mouvement de grève explosa à la mi-février, pas seulement en réponse à la paupérisation et à la répression, mais aussi en solidarité avec les victimes de la répression à Berlin et avec les grèves du Rhin et de la Ruhr. Comme dans la région précédente, le mouvement tira sa force de sa direction par les conseils d’ouvriers et de soldats au sein desquels les sociaux-démocrates perdaient rapidement leur influence.
Mais, alors que dans la région de la Ruhr, les ouvriers de l’industrie lourde formaient l'essentiel des troupes, ici le mouvement incorpora non seulement les mineurs, mais quasiment toutes les professions et les branches d’industrie. Pour la première fois depuis le début de la révolution, les cheminots se joignirent au mouvement. Cela revêtait une importance particulière. L’une des premières mesures du gouvernement Ebert à la fin de la guerre avait été d’augmenter les salaires des cheminots de façon substantielle. La bourgeoisie avait besoin de "neutraliser" ce secteur pour pouvoir transporter ses brigades contre-révolutionnaires d’un bout à l’autre de l’Allemagne. Maintenant, pour la première fois, cette possibilité était mise en question.
Tout aussi significatif était le fait que les soldats des garnisons sortirent pour soutenir les grévistes. L’Assemblée nationale qui avait fui les ouvriers de Berlin, se déplaça à Weimar pour y tenir sa session parlementaire constitutive. Elle arriva en plein milieu d’une lutte de classe aiguë et de soldats hostiles, et dut se réunir derrière un rempart protecteur de pièces d’artillerie et de mitrailleuses. 21
L’occupation sélective des villes par les Corps francs provoqua des batailles de rue à Halle, Merseburg et Zeitz, des explosions des masses "enragées jusqu’à la folie" comme l’écrit Richard Müller. Comme dans la Ruhr, ces actions militaires ne parvinrent pas à briser le mouvement de grèves.
L’appel des délégués d’usines à la grève générale le 24 février devait révéler un autre développement extrêmement significatif. Les délégués soutinrent cet appel à l’unanimité, y compris ceux du SPD. En d’autres termes, la social-démocratie perdait de son contrôle même parmi ses membres.
"Dès le départ, la grève s’étendit au maximum. Il n’y avait pas d’intensification possible sinon par l’insurrection armée que les grévistes rejetaient et qui semblait injustifiée. Le seul moyen de rendre la grève plus efficace passait par les ouvriers de Berlin." 22
C’est ainsi que les ouvriers appelèrent le prolétariat de Berlin à rejoindre, à diriger en fait, le mouvement qui embrasait le centre de l’Allemagne, le Rhin et la Ruhr.
Et les ouvriers de Berlin répondirent du mieux qu’ils purent malgré la défaite qu’ils venaient de subir. Là, le centre de gravité était passé de la rue aux assemblées massives. Les débats qui eurent lieu dans les usines, les bureaux et les casernes avaient pour effet d’affaiblir continuellement l’influence du SPD et le nombre de ses délégués dans les conseils ouvriers. Les tentatives du parti de Noske de désarmer les soldats et de liquider leurs organisations ne firent qu’accélérer ce processus. Une assemblée générale des conseils ouvriers à Berlin le 28 février appela tout le prolétariat à défendre ses organisations et à se préparer à la lutte. La tentative du SPD d’empêcher cette résolution fut déjouée par ses propres délégués.
L’assemblée réélut son comité d’action. Le SPD perdit sa majorité. Lors de l’élection suivante du comité, le KPD avait presque autant de délégués que le SPD ; dans les conseils à Berlin, le cours s’orientait en faveur de la révolution. 23
Prenant conscience que le prolétariat ne pourrait vaincre que s’il était dirigé par une organisation unie et centralisée, l’agitation de masse pour la réélection des conseils d’ouvriers et de soldats dans tout le pays et pour la tenue d’un nouveau congrès national des conseils commença. Malgré l’opposition hystérique du gouvernement et du SPD à cette proposition, les conseils de soldats commencèrent à se déclarer en faveur de cette dernière. Les sociaux-démocrates misèrent sur le temps, pleinement conscients des difficultés pratiques pour mettre en œuvre ces projets.
Mais le mouvement à Berlin était confronté à une autre question très pressante : l’appel à soutenir les ouvriers d’Allemagne centrale. L’assemblée générale des conseils ouvriers de Berlin se réunit le 3 mars pour décider de cette question. Le SPD, sachant que le cauchemar de la semaine sanglante de janvier hantait toujours le prolétariat de la capitale, était déterminé à empêcher une grève générale. Et en fait, au départ, les ouvriers hésitèrent. Par leur agitation pour apporter la solidarité à l’Allemagne centrale, les révolutionnaires renversèrent peu à peu le cours. Des délégations de toutes les principales usines de la ville furent envoyées à l’assemblée des conseils pour l’informer que les assemblées sur les lieux de travail avaient déjà décidé d’arrêter le travail. Il devint clair que les communistes et les indépendants de gauche avaient la majorité des ouvriers derrière eux.
A Berlin aussi, la grève était quasiment totale. Le travail ne continua que dans les usines désignées par les conseils ouvriers pour le faire (les pompiers, les fournisseurs d’eau, d’électricité et de gaz, la santé, la production alimentaire). Le SPD - et son porte-parole le Vorwärts - dénonça immédiatement la grève, appelant les délégués membres du parti à faire de même. Ces délégués prirent alors position contre celle de leur propre parti. De plus, les imprimeurs qui étaient sous forte influence social-démocrate, avaient été parmi les rares professions à ne pas rejoindre le front des grévistes ; maintenant ils le faisaient pour protester contre l’attitude du SPD. De cette façon, la campagne de haine fut en grande partie réduite au silence.
Malgré tous ces signes de maturation, le traumatisme de janvier s’avéra fatal. La grève générale à Berlin arriva trop tard, au moment même où elle prenait fin en Allemagne centrale. Pire même. Les communistes, traumatisés en fait par la défaite de janvier, refusèrent de participer à la direction de la grève aux côtés des sociaux-démocrates. L’unité du front de la grève commença à s’effriter. La division et la démoralisation se répandirent.
C’était le moment pour les Corps francs d’envahir Berlin. Tirant les leçons des événements de janvier, les ouvriers se réunirent dans les usines et pas dans la rue. Mais au lieu d’attaquer immédiatement les ouvriers, les Corps francs marchèrent d’abord sur les garnisons et les conseils de soldats, d’abord contre les régiments qui avaient participé à réprimer les ouvriers en janvier ; ceux qui jouissaient le moins de la sympathie des travailleurs. Ce n’est qu’après qu’ils se tournèrent contre le prolétariat. Comme en janvier, il y eut des exécutions sommaires dans les rues, des révolutionnaires furent assassinés (parmi lesquels Leo Jogiches) ; les cadavres étaient jetés dans la Spree. Cette fois, la terreur blanche fut encore plus féroce qu’en janvier et monta à bien plus que 1000 morts. Le quartier ouvrier de Lichtenberg, à l’Est du centre ville, fut bombardé par l’aviation.
Sur les luttes de janvier - mars, Richard Müller écrit : "Ce fut le soulèvement le plus gigantesque du prolétariat allemand, des ouvriers, des employés, des fonctionnaires et même des parties des classes moyennes petites bourgeoises, à une échelle jamais vue auparavant et atteinte une seule fois par la suite pendant le putsch de Kapp. Les masses populaires étaient en grève générale non seulement dans les régions d’Allemagne sur lesquelles on s’est centré, mais en Saxe, en Bade, en Bavière ; partout les vagues de la révolution socialiste battaient les murs de la production capitaliste et de la propriété. Les masses ouvrières avançaient à grands pas sur la route poursuivant la transformation politique de novembre 1918." 24
Cependant, "le cours pris par les événements de janvier pesait toujours sur le mouvement révolutionnaire. Son début absurde et ses conséquences tragiques avaient brisé les ouvriers de Berlin et il fallut des semaines de travail opiniâtre pour les rendre capables d’entrer à nouveau en lutte. Si le putsch de janvier n’avait pas eu lieu, le prolétariat de Berlin aurait pu porter assistance à temps aux combattants du Rhin, de Westphalie et d’Allemagne centrale. La révolution se serait poursuivie et la nouvelle Allemagne aurait montré une face économique et politique tout à fait différente." 25
La révolution aurait-elle pu triompher ?
L’incapacité du prolétariat mondial à empêcher la Première Guerre mondiale créa des conditions difficiles pour la victoire de la révolution. En comparaison avec une révolution répondant avant tout à une crise économique, une révolution contre la guerre mondiale comporte des inconvénients considérables. D’abord, la guerre avait tué ou blessé des millions de travailleurs ; beaucoup d’entre eux étaient des socialistes expérimentés ayant une conscience de classe. Deuxièmement, contrairement à la crise économique, la bourgeoisie peut mettre fin à la guerre si elle voit que sa poursuite menace son système. C’est ce qui est arrivé en 1918. Cela a créé des divisions entre les ouvriers de chaque pays, entre ceux qui se contentaient de la fin des hostilités et ceux pour qui seul le socialisme pouvait résoudre le problème. Troisièmement, le prolétariat international était divisé, d’abord par la guerre elle-même, ensuite entre les ouvriers des pays "vaincus" et ceux des pays "vainqueurs ". Ce n’est pas par hasard si une situation révolutionnaire s’est développée dans les pays où la guerre était perdue (la Russie, l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne) et non dans les pays de l’Entente (la Grande-Bretagne, la France, les Etats-Unis).
Mais cela veut-il dire qu’une révolution prolétarienne victorieuse, dans ces circonstances, était impossible dès le départ ? Rappelons que c’était l’un des principaux arguments avancés par la social-démocratie pour justifier son rôle contre-révolutionnaire. Mais en réalité, c’était loin d’être le cas.
D’abord, bien que la "Grande Guerre" ait décimé physiquement et affaibli psychologiquement le prolétariat, cela n’empêcha pas la classe ouvrière de lancer un assaut puissant contre le capitalisme. Le carnage imposé était immense, mais moins que celui infligé par la suite par la Seconde Guerre mondiale ; et il n’y a pas de comparaison possible avec ce qu’une troisième guerre mondiale avec des armes thermonucléaires signifierait.
Deuxièmement, bien que la bourgeoisie ait pu mettre fin à la guerre, cela ne veut pas dire qu’elle pouvait en éliminer les conséquences matérielles et politiques. Parmi ces conséquences, il y avait l’épuisement de l’appareil productif, la désorganisation de l’économie et la surexploitation de la classe ouvrière en Europe. Dans les pays vaincus en particulier, la fin de la guerre ne mena pas à une restauration rapide du niveau de vie d’avant-guerre pour les masses de la population. Au contraire. Bien que la revendication de la "socialisation de l’industrie" ait contenu le danger de dévoyer la classe ouvrière de la lutte pour le pouvoir vers une sorte de projet autogestionnaire ayant la faveur de l’anarchisme et de l’anarcho-syndicalisme, en 1919 en Allemagne, la force principale derrière cette revendication était la préoccupation de la survie physique du prolétariat. Les ouvriers, de plus en plus convaincus de l’incapacité du capitalisme à produire assez de biens alimentaires, de charbon, etc. à des prix abordables pour que la population puisse passer l’hiver, commencèrent à se rendre compte qu’une force de travail sous-alimentée et épuisée, menacée d’épidémies et d’infection, devait prendre cette question en main, avant qu’il ne soit trop tard.
En ce sens, les luttes qui s'étaient développées contre la guerre ne se terminèrent pas avec la guerre elle-même. De plus, l’impact de la guerre sur la conscience de classe était profond. Il ôtait à la guerre moderne son image d’héroïsme.
Troisièmement, la brèche entre les ouvriers des pays "vainqueurs" et "vaincus" n’était pas insurmontable. En Grande-Bretagne en particulier, il y eut de puissants mouvements de classe à la fois pendant et à la fin de la guerre. L’aspect le plus frappant de 1919, "année de la révolution" en Europe centrale, était l’absence relative de la scène du prolétariat français. Où était cette partie de la classe qui, de 1848 à la Commune de Paris de 1871, avait été l’avant-garde de l’insurrection prolétarienne ? Dans une certaine mesure, il avait été contaminé par la frénésie chauvine de la bourgeoisie qui promettait à "ses" ouvriers une nouvelle ère de prospérité sur la base des réparations qu’elle allait imposer à l’Allemagne. N’y avait-il pas d’antidote à ce poison nationaliste ? Oui, il y en avait un. La victoire du prolétariat allemand aurait constitué cet antidote.
En 1919, l’Allemagne constituait la charnière indispensable entre la révolution à l’Est et la conscience de classe en sommeil à l’Ouest. La classe ouvrière européenne de 1919 avait été éduquée dans le socialisme. Sa conviction sur la nécessité et la possibilité du socialisme n’avait pas encore été minée par la contre-révolution stalinienne. La victoire de la révolution en Allemagne aurait sapé les illusions sur la possibilité d’un retour à la "stabilité" apparente du monde d’avant-guerre. La reprise par le prolétariat allemand de son rôle dirigeant dans la lutte de classe aurait énormément renforcé la confiance dans l’avenir du socialisme.
Mais la victoire de la révolution en Allemagne même était-elle une possibilité réaliste ? La révolution de novembre révéla la puissance et l’héroïsme de la classe mais, aussi, ses énormes illusions, ses confusions et ses hésitations. Pourtant, c’était tout autant le cas en février 1917 en Russie. Dans les mois qui suivirent février, le cours de la révolution russe a révélé la maturation progressive d’un immense potentiel qui a mené à la victoire d’Octobre. En Allemagne, à partir de novembre 1918 – malgré la fin de la guerre – on voit une maturation très similaire. Au cours du premier trimestre de 1919, nous avons vu le développement de la grève de masse, l’entrée de toute la classe ouvrière dans la lutte, le rôle croissant des conseils ouvriers et des révolutionnaires en leur sein, le début des efforts pour créer une organisation et une direction centralisées du mouvement, la mise à jour progressive du rôle contre-révolutionnaire du SPD et des syndicats ainsi que les limites de l’efficacité de la répression étatique.
Au cours de 1919, des soulèvements locaux et des "républiques des conseils" dans des villes côtières, en Bavière et ailleurs furent liquidés. Ces épisodes sont remplis d’exemples de l’héroïsme du prolétariat et d’amères leçons pour l’avenir. Pour l’issue de la révolution en Allemagne, ils ne furent pas décisifs. Les centres déterminants se trouvaient ailleurs. D’abord, dans l’énorme concentration industrielle de ce qui est, aujourd’hui, la province du Rhin-Westphalie. Aux yeux de la bourgeoisie, cette région était peuplée par une espèce sinistre vivant dans une sorte de sous-monde, qui ne voyait jamais la lumière du jour, qui vivait au-delà des frontières de la civilisation. La bourgeoisie fut horrifiée lorsqu’elle vit cette immense armée grise de villes tentaculaires, où le soleil ne brillait quasiment jamais et où la neige tombait noire, sortir des mines et des hauts fourneaux. Horrifiée, encore plus horrifiée même quand elle connut l’intelligence, la chaleur humaine, le sens de la discipline et de la solidarité de cette armée qui n’était plus, désormais, la chair à canon des guerres impérialistes mais le protagoniste de sa propre guerre de classe.
Ni en 1919, ni en 1920, la brutalité combinée des militaires et des Corps francs ne fut capable d’écraser cet ennemi sur son propre terrain. Il ne fut vaincu que lorsque, après avoir repoussé le putsch de Kapp en 1920, ces ouvriers commirent l’erreur d’envoyer leur "armée rouge de la Ruhr" hors des villes et des terrils mener une bataille conventionnelle. Ensuite, en Allemagne centrale avec sa classe ouvrière très ancienne et hautement qualifiée, baignée par la tradition socialiste. 26 Avant et pendant la guerre, des industries extrêmement modernes comme la chimie, l’aviation, y furent établies, attirant des dizaines de milliers de jeunes ouvriers inexpérimentés mais radicaux, combatifs, ayant un grand sens de la solidarité. Ce secteur aussi allait s’engager dans des luttes massives en 1920 (Kapp) et 1921 (l’Action de mars).
Mais si le Rhin, la Ruhr et l’Allemagne centrale étaient les poumons, le cœur et le tube digestif de la révolution, Berlin en était le cerveau. Troisième ville du monde par sa taille (après New York et Londres), Berlin était la "Silicon Valley" de l’Europe à l’époque. La base de son développement économique était l’ingéniosité de la force de travail, hautement qualifiée. Celle-ci avait une éducation socialiste de longue date et se trouvait au cœur du processus de formation du parti de classe.
La prise du pouvoir n’était pas encore à l’ordre du jour le premier trimestre 1919. La tâche de l’heure était de gagner du temps pour que la révolution mûrisse dans l’ensemble de la classe tout en évitant une défaite décisive. Le temps, à ce moment crucial, jouait en faveur du prolétariat. La conscience de classe s’approfondissait. Le prolétariat luttait pour constituer les organes nécessaires à sa victoire – le parti, les conseils. Les principaux bataillons de la classe rejoignaient la lutte.
Mais avec la défaite de janvier 1919 à Berlin, le facteur temps changea de camp, passant du côté de la bourgeoisie. La défaite de Berlin vint en deux temps : janvier et mars-avril 1919. Mais janvier fut déterminant car ce n’était pas seulement une défaite physique mais une défaite morale. L’unification des secteurs décisifs de la classe dans la grève de masse constituait la force capable de déjouer la stratégie de la contre-révolution et d’ouvrir la voie vers l’insurrection. Mais ce processus d’unification – similaire à ce qui eut lieu en Russie à la fin de l’été 1917 face au putsch de Kornilov – dépendait avant tout de deux facteurs : le parti de classe et les ouvriers de la capitale. La stratégie de la bourgeoisie consistant à infliger préventivement des blessures sérieuses à ces éléments décisifs, réussit. L’échec de la révolution en Allemagne face à ses propres "journées de Kornilov" fut avant tout le résultat de son échec face à la version allemande des "journées de juillet" 27.
La différence la plus frappante avec la Russie est l’absence d’un parti révolutionnaire capable de formuler et de défendre une politique lucide et cohérente face aux tempêtes inévitables de la révolution et aux divergences dans ses rangs. Comme nous l’avons écrit dans l’article précédent, la révolution pouvait triompher en Russie sans la constitution d’un parti de classe mondial, mais pas en Allemagne.
C’est pourquoi nous avons consacré un article entier de cette série au Congrès de fondation du KPD. Ce Congrès comprit beaucoup de questions, mais pas les questions brûlantes de l’heure. Bien qu'il ait formellement adopté l’analyse de la situation présentée par Rosa Luxemburg, en réalité trop de délégués sous-estimaient l’ennemi de classe. Tout en insistant énormément sur le rôle des masses, leur vision de la révolution était toujours influencée par les exemples des révolutions bourgeoises passées. Pour la bourgeoisie, la prise du pouvoir constituait le dernier acte de sa montée au pouvoir, préparée depuis longtemps par la montée de sa puissance économique. Comme le prolétariat en tant que classe exploitée, sans propriété, ne peut accumuler aucune richesse, il doit préparer sa victoire par d’autres moyens. Il doit accumuler la conscience, l’expérience, l’organisation. Il doit devenir actif et apprendre à prendre son destin en main. 28.
Le déroulement d’une révolution
Le mode de production capitaliste détermine la nature de la révolution prolétarienne. La révolution prolétarienne révèle le secret du mode de production capitaliste. Etant passé par les étapes de la coopération, de la manufacture et de l’industrialisation, le capitalisme développe les forces productives qui sont la condition nécessaire à l’instauration d’une société sans classe. Elle le fait par l’établissement du travail associé. Le “travailleur collectif”, créateur de la richesse, est asservi aux rapports de propriété capitalistes par l’appropriation privée, compétitive et anarchique des fruits du travail associé. La révolution prolétarienne abolit la propriété privée, permettant au nouveau mode d’appropriation d’être conforme au caractère associé de la production. Sous la domination du capital, le prolétariat a depuis son origine créé les conditions de sa propre libération. Mais les fossoyeurs de la société capitaliste ne peuvent remplir leur mission historique que si la révolution prolétarienne est elle-même le produit du "travailleur collectif ", des ouvriers du monde agissant pour ainsi dire comme une seule personne. Le caractère collectif du travail salarié doit devenir l’association collective consciente de lutte.
Réunir dans la lutte à la fois l’ensemble de la classe et ses minorités révolutionnaires prend du temps. En Russie, cela prit une douzaine d’années, depuis la lutte pour "un nouveau type de parti de classe" en 1903, en passant par la grève de masse de 1905-1906 et la veille de la Première Guerre mondiale jusqu’aux exaltantes journées de 1917. En Allemagne et dans l’ensemble des pays occidentaux, le contexte de la guerre mondiale et de la brutale accélération de l’histoire qu’elle incarne, a accordé peu de temps à cette nécessaire maturation. L’intelligence et la détermination de la bourgeoisie après l’armistice de 1918 ont encore réduit le temps disponible pour celle-ci.
Nous avons plusieurs fois parlé, dans cette série d’articles, de l’ébranlement de la confiance en soi de la classe ouvrière et de son avant-garde révolutionnaire avec l’effondrement de l’Internationale socialiste face à l’éclatement de la guerre. Que voulions-nous dire ?
La société bourgeoise conçoit la question de la confiance en soi du point de vue de l’individu et de ses capacités. Cette conception oublie que l’humanité, plus que tout autre espèce connue, dépend de la société pour survivre et se développer. C’est encore plus vrai pour le prolétariat, le travail associé, qui produit et lutte non pas individuellement mais collectivement, qui produit non des individus révolutionnaires mais des organisations révolutionnaires. L’impuissance de l’ouvrier individuel – qui est bien plus extrême que celle du capitaliste ou même du petit propriétaire individuel – se révèle dans la lutte comme la force cachée de cette classe. Sa dépendance vis-à-vis du collectif préfigure la nature de la future société communiste dans laquelle l’affirmation conscience de la communauté permettra pour la première fois le plein développement de l’individualité. La confiance en soi de l’individu présuppose la confiance des parties dans le tout, la confiance mutuelle des membres de la communauté de lutte.
En d’autres termes, ce n’est qu’en forgeant une unité dans la lutte que la classe peut développer le courage et la confiance nécessaires à sa victoire. Ses outils théoriques et d’analyse ne peuvent être suffisamment aiguisés que de façon collective. Les erreurs des délégués du KPD au moment décisif à Berlin étaient en réalité le produit d’une maturité encore insuffisante de cette force collective du jeune parti de classe dans son ensemble.
Notre insistance sur la nature collective de la lutte prolétarienne ne dénie en aucune façon un rôle à l’individu dans l’histoire. Trotsky dans l’Histoire de la révolution russe, a écrit que sans Lénine, les Bolcheviks, en octobre 1917, auraient pu reconnaître trop tard que le moment de l’insurrection était venu. Le parti a failli rater "le rendez-vous de l’histoire ". Si le KPD avait envoyé Rosa Luxemburg et Leo Jogishes – ces analystes à la vision claire - au lieu de Karl Liebknecht et Wilhelm Pieck à la réunion dans le quartier général d’Emil Eichhorn le soir du 5 janvier, l’issue historique aurait pu être différente.
Nous ne nions pas l’importance de Lénine ou de Rosa Luxemburg dans les luttes révolutionnaires de l’époque. Ce que nous rejetons, c’est l’idée que leur rôle ait été avant tout le fait de leur génie personnel. Leur importance venait par dessus tout de leur capacité à être collectifs, à concentrer et renvoyer comme un prisme toute la lumière irradiée par la classe et le parti dans leur ensemble. Le rôle tragique de Rosa Luxemburg dans la révolution allemande, l’insuffisance de son influence sur le parti au moment décisif vient du fait qu’elle incarnait l’expérience vivante du mouvement international à un moment où le mouvement en Allemagne souffrait toujours de son isolement du reste du prolétariat mondial.
Nous voulons insister sur le fait que l’histoire est un processus ouvert et que la défaite de la première vague révolutionnaire n’était pas une conclusion inévitable. Nous n’avons pas l’intention de raconter l’histoire de "ce qui aurait pu être ". Il n’y a pas de retour en arrière dans l’histoire, seulement une marche en avant. Avec le recul, le cours suivi par l’histoire est toujours "inévitable ". Mais là nous oublions que la détermination – ou le manque de détermination – du prolétariat, sa capacité à tirer les leçons – ou l’absence de cette capacité – font partie de l’équation. En d’autres termes, ce qui devient "inévitable" dépend également de nous. Nos efforts actifs vers un but conscient constituent une composante active de l’équation de l’histoire.
Dans le prochain et dernier article de cette série, nous examinerons les immenses conséquences de la défaite de la révolution allemande et la validité de ces événements pour aujourd’hui et pour demain.
Steinklopfer
1 Pour lire ces articles, suivre ces liens : première partie [15], deuxième partie [16] et troisième partie [17].
2. Cette alliance entre les forces armées et le SPD qui s’avéra décisive pour la victoire de la contre-révolution, n’aurait pas été possible sans le soutien de la bourgeoisie britannique. Anéantir la puissance de la caste militaire prussienne était l’un des buts de guerre de Londres. Cet objectif fut abandonné afin de ne pas affaiblir les forces de la réaction. En ce sens, il n’est pas exagéré de parler de l’alliance entre la bourgeoisie allemande et la bourgeoisie britannique comme du pilier de la contre-révolution internationale de l’époque. Nous reviendrons sur cette question dans la dernière partie de la série.
3. Des milliers de prisonniers, russes et autres, étaient toujours détenus par la bourgeoisie allemande et condamnés au travail forcé, malgré la fin de la guerre. Ils participèrent activement à la révolution aux côtés de leurs frères de classe allemands.
4. Cet édifice baroque monumental, qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale, fut détruit par la République démocratique allemande et remplacé par le "Palais de la République " stalinien. Auparavant, le portail devant lequel Karl Liebknecht avait proclamé la République socialiste le jour de la révolution de novembre, fut retiré et intégré à la façade adjacente du "Conseil d’Etat de la RDA ". Ainsi, le lieu d’où Liebknecht appela à la révolution mondiale fut transformé en symbole nationaliste du "socialisme en un seul pays ".
5. Ce bâtiment situé derrière le palais, existe toujours.
6. C’est ainsi que l’auteur Alfred Döblin le formule dans son livre Karl & Rosa, dans la dernière partie de son roman en 4 volumes : Novembre 1918. En tant que sympathisant de l’aile gauche de l’USPD, il fut le témoin oculaire de la révolution à Berlin. Son récit monumental fut écrit dans les années 1930 et est marqué par la confusion et le désespoir engendré par la contre-révolution triomphante.
7. Au cours de la reconstruction du centre ville après la chute du mur de Berlin, des tunnels d’évasion réalisés par les différents gouvernements du 20e siècle ont été mis à jour, qui n’étaient indiqués sur aucune carte officielle, monuments à la peur de la classe dominante. On ne sait pas si de nouveaux tunnels ont été construits.
8. Il y eut des grèves de sympathie et des occupations dans un certain nombre de villes dont Stuttgart, Hambourg et Düsseldorf.
9. Cette question, largement documentée par Richard Müller dans son histoire de la révolution allemande écrite dans les années 1920, est aujourd’hui un fait accepté par les historiens.
10. Volume III de l’Histoire de la révolution allemande : la guerre civile en Allemagne.
11. Müller, ibid. Richard Müller était l’un des chefs les plus talentueux et les plus expérimentés du mouvement. On peut faire un certain parallèle entre le rôle joué par Müller en Allemagne et celui de Trotsky en Russie en 1917. Tous deux furent présidents du comité d’action des conseils ouvriers dans une ville centrale. Tous deux allaient devenir historiens de la révolution à laquelle ils avaient directement participé. Il est pénible de voir la façon sommaire avec laquelle Wilhelm Pieck écarta les avertissements d’un dirigeant aussi responsable et expérimenté.
12. Les six opposants étaient Müller, Däuming, Eckert, Malzahn, Neuendorf et Rusch.
13. Le cas de Lemmgen, un marin révolutionnaire, fait partie de la légende mais est malheureusement vrai. Après l’échec de ses tentatives répétées de confisquer la banque d’Etat (un fonctionnaire appelé Hamburger contesta la validité des signatures de cet ordre), le pauvre Lemmgen était si démoralisé qu’il rentra chez lui et alla furtivement se coucher.
14. C’est précisément cette proposition d’action qui fut présentée publiquement par le KPD dans son organe de presse la Rote Fahne.
15. En particulier le passage du programme qui déclare que le parti assumerait le pouvoir uniquement avec le soutien des grandes masses du prolétariat.
16. Comme la Thuringe, la région de Stuttgart ou la vallée du Rhin, bastions du mouvement marxiste de longue date.
17. Centrés autour des rivières Ruhr et Wupper .
18. Le 22 février, les ouvriers communistes de Mülheim dans la Ruhr attaquèrent une réunion publique du SPD avec des pistolets.
19. R. Müller, Op.cit., Vol. III
20. Les provinces de Saxe, de Thuringe et de Saxe-Anhalt. Le centre de gravité était la ville de Halle et, à proximité, la ceinture d’industries chimiques autour de l’usine géante de Leuna.
21. Le terme "République de Weimar " qui couvre la période de l’histoire allemande qui va de 1919 à 1933 , a pour origine cet épisode.
22. Müller, ibid.
23. Durant les premiers jours de la révolution, l’USPD et Spartakus ensemble n’avaient qu’un quart de tous les délégués derrière eux. Le SPD dominait massivement. Les délégués membres des partis début 1919 se répartissaient ainsi :
le 28 février : 305 USPD, 271 SPD, 99 KPD, 95 Démocrates.
Le 19 avril : 312 USPD, 164 SPD, 103 KPD, 73 Démocrates.
Il faut noter que, durant cette période, le KPD ne pouvait agir que dans la clandestinité et qu’un nombre considérable de délégués nommés comme membres de l’USPD sympathisaient, en réalité, avec les communistes et allaient rapidement rejoindre leurs rangs.
24. Müller, ibid.
25. Müller, ibid.
26. Ce n’est pas par hasard si l’enfance du mouvement marxiste en Allemagne est associée aux noms de villes de Thuringe : Eisenach, Gotha, Erfurt.
27. Les journées de juillet 1917 constituent un des moments les plus importants non seulement de la révolution russe mais de toute l'histoire du mouvement ouvrier. Le 4 juillet, une manifestation armée d'un demi million de participants fait le siège de la direction du soviet de Petrograd, l'appelant à prendre le pouvoir, mais se disperse pacifiquement dans la soirée répondant en cela à l'appel des Bolcheviks. Le 5 juillet, les troupes contre-révolutionnaires reprennent la capitale de la Russie, lancent une chasse aux Bolcheviks et répriment les ouvriers les plus combatifs. Cependant, en évitant une lutte prématurée pour le pouvoir alors que l'ensemble de la classe ouvrière n'est pas encore prête, celle-ci va maintenir ses forces révolutionnaires intactes. C'est ce qui permettra à la classe ouvrière de tirer des leçons essentielles de ces événements, en particulier la compréhension du caractère contre-révolutionnaire de la démocratie bourgeoise et de la nouvelle gauche du capital : les Mencheviks et les Socialistes-révolutionnaires qui ont trahi la cause des travailleurs et des paysans pauvres et sont passés dans le camp ennemi. A aucun autre moment de la révolution russe, le danger d'une défaite décisive du prolétariat et de la liquidation du parti bolchevique n'a été aussi aigu que pendant ces 72 heures dramatiques. A aucun autre moment la confiance profonde des bataillons les plus avancés du prolétariat dans leur parti de classe, dans l'avant-garde communiste, n'a eu une aussi grande importance.
Avec la défaite de juillet, la bourgeoisie croit pouvoir en finir avec ce cauchemar. Pour cela, partageant la besogne entre le bloc "démocratique" de Kerenski et le bloc ouvertement réactionnaire de Kornilov, chef des armées, elle prépare le coup d'Etat de ce dernier pour la fin août et rassemble des régiments de Cosaques, de Caucasiens, etc., qui semblent encore fidèles au pouvoir bourgeois, et tente de les lancer contre les soviets. Mais la tentative échoue lamentablement. La réaction massive des ouvriers et des soldats, leur ferme organisation dans le Comité de défense de la révolution - qui, sous le contrôle du soviet de Pétrograd, se transformera plus tard en Comité militaire révolutionnaire, organe de l'insurrection d'Octobre - font que les troupes de Kornilov, ou bien restent immobilisées et se rendent, ou bien désertent pour rejoindre les ouvriers et les soldats - ce qui arrive dans la plupart des cas.
28. Contrairement à Luxemburg, Jogiches et Marchlewski qui étaient en Pologne (qui faisait partie de l’empire russe à l'époque) pendant la révolution de 1905-06, la majorité des fondateurs du KPD n’avaient pas d’expérience directe de la grève de masse et avaient du mal à comprendre qu’elle était indispensable à la victoire de la révolution.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [18]
Débat interne au CCI : les causes de la prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (III)
- 4069 lectures
Nous poursuivons dans ce numéro de la Revue Internationale la publication de notre débat interne relatif à l'explication de la période de prospérité des années 1950 et 60. Pour mémoire, ce débat avait initialement été motivé par des critiques à notre brochure La décadence du capitalisme concernant son analyse des destructions opérées durant la Seconde Guerre mondiale. Ces dernières étaient en effet considérées comme étant à l'origine du marché de la reconstruction constituant un débouché à la production capitaliste. Une position (dénommée L’économie de guerre et le capitalisme d’État) s'était exprimée dès le début "en défense du point de vue défendu par notre brochure", selon lequel "le dynamisme économique en question avait été fondamentalement déterminé par les suites de la Guerre marquées par un renforcement extraordinaire des États-Unis sur le plan économique et impérialiste, et par l’économie de guerre permanente caractéristique du capitalisme décadent". Deux autres positions, qui partageaient alors la critique à l'analyse de la reconstruction exprimée dans La décadence du capitalisme, s'opposaient cependant par ailleurs sur l'analyse des mécanismes à l'œuvre permettant d'expliquer la prospérité des années 1950 et 60 : mécanismes keynésiens pour l'une (dénommée Le Capitalisme d'État keynésiano-fordiste) ; exploitation des derniers marchés extra-capitalistes et début de fuite en avant dans l'endettement pour l'autre (dénommée Les marchés extra-capitalistes et l'endettement).
Dans la Revue Internationale n° 133 [9] ont été publiées la présentation du cadre du débat ainsi que trois contributions exposant de façon synthétique les trois principales positions en présence. Dans le numéro 135 [19] de notre Revue, a été publié un article, Origine, dynamique et limites du capitalisme d’État keynésiano-fordiste, développant de façon plus exhaustive la thèse du Capitalisme d'État keynésiano-fordiste.
Dans ce numéro, nous laissons la parole aux deux autres positions avec les textes suivants "Les bases de l’accumulation capitaliste" et "Économie de guerre et capitalisme d’État" (en défense respectivement des positions Les marchés extra-capitalistes et l'endettement et L’économie de guerre et le capitalisme d’État). Nous tenons toutefois à faire précéder cette exposition de considérations relatives, d'une part à l'évolution des positions en présence et, d'autre part, à la rigueur du débat.
L'évolution des positions en présence
Pendant toute une période du débat, les différents points de vue exprimés se revendiquaient tous du cadre d'analyse du CCI1, celui-ci servant d'ailleurs souvent de référence aux critiques faites par telle ou telle position à telle ou telle autre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et depuis un certain temps déjà. Une telle évolution fait partie des possibilités inhérentes à tout débat : des différences qui apparaissent comme mineures au départ peuvent s'avérer, après discussion, plus profondes qu'il n'y paraissait, jusqu'à remettre en cause le cadre théorique initial de la discussion. C'est ce qui s'est passé au sein de notre débat, notamment avec la thèse appelée Le Capitalisme d'État keynésiano-fordiste. Ainsi que cela ressort de la lecture de l'article Origine, dynamique et limites du capitalisme d’État keynésiano-fordiste.(Revue internationale n° 135), cette thèse assume à présent ouvertement la remise en cause de différentes positions du CCI. Dans la mesure où des telles remises en question devront être prises en charge par le débat lui-même, nous nous limiterons ici à en signaler l'existence, laissant le soin à des contributions ultérieures de revenir dessus. Ainsi, pour cette thèse :
"Le capitalisme génère en permanence la demande sociale qui est à la base du développement de son propre marché" alors que, pour le CCI, "contrairement à ce que prétendent les adorateurs du capital, la production capitaliste ne crée pas automatiquement et à volonté les marchés nécessaires à sa croissance" (Plate-forme du CCI [20] )
L'apogée du capitalisme correspond à un certain stade de "l’extension du salariat et sa domination par le biais de la constitution du marché mondial". Pour le CCI, par contre, cette apogée intervient lorsque les principales puissances économiques se sont partagé le monde et que le marché atteint "un degré critique de saturation des mêmes débouchés qui lui avaient permis sa formidable expansion du 19ème siècle." (Plate-forme du CCI [20] )
L’évolution du taux de profit et la grandeur des marchés sont totalement indépendantes, alors que, pour le CCI, "la difficulté croissante pour le capital de trouver des marchés où réaliser sa plus-value, accentue la pression à la baisse qu’exerce, sur son taux de profit, l’accroissement constant de la proportion entre la valeur des moyens de production et celle de la force de travail qui les met en œuvre." (ibid. [20] )
Pousser la clarification systématique et méthodique des divergences jusqu'à leur racine, sans craindre les remises en cause qui pourraient en résulter, est le propre d'un débat prolétarien apte à réellement renforcer les bases théoriques des organisations qui se réclament du prolétariat. Les exigences de clarté d'un tel débat imposent, de ce fait, la plus grande rigueur militante et scientifique notamment dans la référence aux textes du mouvement ouvriers, dans leur utilisation en vue de telle ou telle démonstration ou polémique. Or justement l'article Origine, dynamique et limites du capitalisme d’État keynésiano-fordiste, de la Revue n° 135, n'est pas sans poser des problèmes sur ce plan.
Des exigences de rigueur du débat parfois mal assumées
L'article en question débute par une citation empruntée au n° 46 d'Internationalisme (Organe de la Gauche communiste de France): "En 1952, nos ancêtres de la Gauche communiste de France décidaient d'arrêter leur activité de groupe parce que : "La disparition des marchés extra-capitalistes entraîne une crise permanente du capitalisme (...) il ne peut plus élargir sa production. On verra là l'éclatante confirmation de la théorie de Rosa Luxemburg : le rétrécissement des marchés extra-capitalistes entraîne une saturation du marché proprement capitaliste. (...) En fait, les colonies ont cessé de représenter un marché extra-capitaliste pour la métropole, elles sont devenues de nouveaux pays capitalistes. Elles perdent donc leur caractère de débouchés. (...) la perspective de guerre... tombe à échéance. Nous vivons dans un état de guerre imminente...". Le paradoxe veut que cette erreur de perspective ait été énoncée à la veille des Trente glorieuses !"
De la lecture du passage cité, il ressort les deux idées suivantes :
En 1952 (date à laquelle l'article d'Internationalisme a été écrit), les marchés extra-capitalistes ont disparu, d'où la situation de "crise permanente du capitalisme".
La prévision par le groupe Internationalisme de l'échéance inéluctable de la guerre imminente découle de son analyse de l'épuisement des marchés extra-capitalistes.
Or, ceci n'est pas la réalité de la pensée d'Internationalisme mais sa transcription déformée à travers une citation (celle reproduite ci-dessus) empruntant respectivement et successivement au texte original des passages des pages 9, 11, 17 et 1 de la revue Internationalisme.
Le premier passage cité, "La disparition des marchés extra-capitalistes entraîne une crise permanente du capitalisme", est immédiatement suivi, dans Internationalisme, de la phrase suivante, non citée : "Rosa Luxemburg démontre par ailleurs que le point d’ouverture de cette crise s’amorce bien avant que cette disparition soit devenue absolue". En d'autres termes, pour Rosa Luxemburg comme pour Internationalisme, la situation de crise qui prévaut au moment de l'écriture de cet article n'implique en rien l'épuisement des marchés extra-capitalistes, "la crise s'amorçant bien avant cette échéance". Cette première altération de la pensée d'Internationalisme n'est pas sans conséquence sur le débat puisqu'elle alimente l'idée (défendue par la thèse du Capitalisme d'État keynésiano-fordiste) que les marché extra-capitalistes interviennent pour quantité négligeable dans la prospérité des années 1950 et 60.
La seconde idée attribuée à Internationalisme, "l'échéance de l'inéluctabilité de la guerre imminente qui découlerait de l'épuisement des marchés extra-capitalistes", n'est en fait pas une idée du groupe Internationalisme en tant que tel mais de certains camarades en son sein vis-à-vis desquels la discussion est engagée. C'est ce que montre le passage suivant d'Internationalisme, utilisé également dans la citation mais avec des amputations importantes et significatives (amputations en gras dans le texte qui suit) : "Pour certains de nos camarades, en effet, la perspective de guerre, qu’ils ne cessèrent jamais de considérer comme imminente, tombe à échéance. Nous vivons dans un état de guerre imminente et la question qui se pose à l’analyse n’est pas d’étudier les facteurs qui pousseraient à la conflagration mondiale –ces facteurs sont donnés et agissent déjà- mais, bien au contraire, d’examiner pourquoi la guerre mondiale n’a pas encore éclaté à l’échelle mondiale". Cette seconde altération de la pensée d'Internationalisme tend à discréditer la position défendue par Rosa Luxemburg et Internationalisme, puisque la Troisième Guerre mondiale, qui aurait dû être la conséquence de la saturation du marché mondial, n'a comme on le sait jamais eu lieu.
Le but de cette mise au point n'est pas la discussion de l'analyse d'Internationalisme, laquelle contient effectivement des erreurs, mais de relever une interprétation tendancieuse qui en a été faite, dans les colonnes de notre Revue Internationale. Il n'est pas davantage de porter préjudice au fond de l'analyse de l'article Origine, dynamique et limites du capitalisme d’État keynésiano-fordiste, qui doit absolument être différencié des arguments litigieux qui viennent d'être critiqués. Ces clarifications nécessaires étant à présent réalisées, il reste à poursuivre sereinement la discussion des questions en divergence au sein de notre organisation.
1. Comme nous le mettons en évidence dans la présentation [9] du cadre du débat (Revue Internationale n ° 133)
Questions théoriques:
- L'économie [14]
- Décadence [21]
Heritage de la Gauche Communiste:
Les bases de l'accumulation capitaliste
- 3670 lectures
La thèse dite des marchés extra-capitalistes et de l'endettement, comme son nom l'indique, considère que c'est la vente aux marchés extra-capitalistes et la vente à crédit qui ont constitué les débouchés permettant la réalisation de la plus-value nécessaire à l'accumulation du capitalisme durant les années 1950 et 60. Pendant cette période, l'endettement prend progressivement le relais des marchés extra-capitalistes subsistant encore dans le monde lorsque ces derniers deviennent insuffisants pour écouler les marchandises produites.
Deux questions se posent à propos de cette thèse :
- Sa validité peut-elle être vérifiée par l'analyse des échanges entre différentes zones économiques, présentant des niveaux différents d'intégration aux rapports de production capitalistes ? Peut-elle l'être également par l'analyse de l'endettement à cette époque ? Une prochaine contribution se penchera sur ce problème.
- En quoi se différencie-t-elle des deux autres thèses principales en présence ? En quoi est-elle compatible ou non avec celles-ci ? L'objet de la présente contribution est justement d'effectuer une analyse critique de la thèse dite du capitalisme d’État keynésiano-fordiste. Une autre viendra ultérieurement en commentaire de la thèse de L'économie de guerre et le capitalisme d'État.
Comme nous l'avons avancé dans le texte de présentation de la thèse des marchés extra-capitalistes et de l'endettement paru dans la Revue Internationale n° 133 [9] , pas plus l'augmentation du pouvoir d'achat de la classe ouvrière que celle des commandes étatiques - dont une grande partie est improductive, comme l'illustre le cas de l'industrie d'armement - ne peuvent en rien participer à l'enrichissement du capital global. Nous dédions l'essentiel du présent article à cette question qui, selon nous, fait l'objet d'une ambiguïté importante au sein de la thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste, en particulier du fait des vertus qu'elle attribue, pour l'économie capitaliste, à l'augmentation du pouvoir d'achat de la classe ouvrière.
Pour cette dernière, "Ce système a donc momentanément pu garantir la quadrature du cercle consistant à faire croître la production de profit et les marchés en parallèle dans un monde désormais largement dominé par la demande salariale" 1. Que signifie faire croître la production de profit ? Produire des marchandises et les vendre, mais alors pour satisfaire quelle demande ? Celle émanant des ouvriers ? La phrase suivante de l'article en question est tout aussi ambiguë et ne nous renseigne pas davantage : "L’accroissement assuré des profits, des dépenses de l’État et l’augmentation des salaires réels, ont pu garantir la demande finale si indispensable au succès du bouclage de l’accumulation capitaliste" 2. Si l'accroissement des profits est assuré, l'accumulation capitaliste l'est aussi et, dans ce cas, il devient tout à fait inutile d'invoquer l'augmentation des salaires et des dépenses de l'État pour expliquer "le bouclage" de l'accumulation !
Ce flou dans la formulation du cœur du problème ne nous laisse pas d'autre possibilité que d'interpréter, au risque de nous tromper. Veut-on dire que les dépenses de l’État et l’augmentation des salaires réels garantissent la demande finale, permettant ainsi l'accroissement des profits, à la base de l'accumulation capitaliste ? Est-ce bien cela la bonne interprétation, comme pourrait le suggérer l'ensemble du texte. Si oui, alors il y a réellement un problème avec cette thèse qui, selon nous, remet en cause les fondements mêmes de l'analyse marxiste de l'accumulation capitaliste, comme nous allons le voir. Si, par contre, ce n'est pas la bonne interprétation, il faut nous dire quelle demande garantit la réalisation de profit à travers la vente des marchandises produites.
Ce qui est accumulé par les capitalistes, c'est ce qui reste de la plus-value extraite de l'exploitation des ouvriers, une fois payées toutes les dépenses improductives. Une augmentation des salaires réels ne pouvant se faire qu'au détriment de la plus-value totale, elle se fait donc nécessairement aussi au détriment de cette partie de la plus-value destinée à l'accumulation. En fait, une augmentation de salaire revient, dans la pratique, à reverser aux ouvriers une partie de la plus-value résultant de leur exploitation. Le problème avec cette partie de la plus-value reversée aux ouvriers est que, n'étant pas destinée à la reproduction de la force de travail (laquelle est déjà assurée par le salaire "non augmenté"), elle ne peut pas non plus participer à la reproduction élargie. En effet, qu'elle serve à l'alimentation, au logement ou aux loisirs des ouvriers, elle ne pourra plus jamais être utilisée pour participer à augmenter les moyens de production (machines, salaires pour de nouveaux ouvriers, etc.). C'est pourquoi, augmenter les salaires au-delà de ce qui est nécessaire à la reproduction de la force de travail constitue purement et simplement, du point de vue capitaliste, un gaspillage de plus-value qui n'est en aucune manière capable de participer au processus de l'accumulation.
Il est vrai que les statistiques de la bourgeoisie occultent cette réalité. En effet, le calcul du PIB (Produit Intérieur Brut) intègre allègrement tout ce qui est relatif à l'activité économique improductive, qu'il s'agisse des dépenses militaires ou publicitaires, du revenu des curés ou des policiers, de la consommation de la classe exploiteuse ou des augmentations de salaires versées à la classe ouvrière. Tout comme les statistiques bourgeoises, la thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste confond "accroissement de la production", mesurée par l'accroissement du PIB et "enrichissement du capitalisme", ces deux termes étant loin d'être équivalents puisque "l'enrichissement du capitalisme" a pour base l'augmentation de la plus-value réellement accumulée, à l'exclusion de la plus-value stérilisée dans les dépenses improductives. Or cette différence n'est pas minime en particulier dans la période considérée qui se caractérise par l'envol des dépenses improductives : "La création par le keynésianisme d'un marché intérieur capable de donner une solution immédiate à l'écoulement d'une production industrielle massive a pu donner l'illusion d'un retour durable à la prospérité de la phase d'ascendance du capitalisme. Mais, ce marché étant totalement déconnecté des besoins de valorisation du capital, il a eu pour corollaire la stérilisation d'une portion significative de capital." 3
L'idée selon laquelle l'augmentation des salaires de la classe ouvrière pourrait constituer, en certaines circonstances, un facteur favorable à l'accumulation capitaliste est totalement contradictoire avec cette position de base du marxisme (et pas seulement d'ailleurs !) pour qui "le caractère essentiel de la production capitaliste (…) est la mise en valeur du capital et non la consommation" 4.
Pourtant, rétorqueront les camarades qui défendent la thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste, celle-ci s'appuie elle-même sur Marx. L'explication que fournit cette thèse concernant le succès des mesures de capitalisme d'État visant à éviter la surproduction se base en effet sur cette idée de Marx selon laquelle "la masse du peuple ne peut jamais consommer davantage que la quantité moyenne des biens de première nécessité, (…) sa consommation n’augmente donc pas au rythme de l’augmentation de la productivité du travail" (Marx, Théories sur la plus-value, livre IV, Éditions sociales, tome 2 : 559-560). A travers cette formulation de Marx, la thèse en question entrevoit la solution au dépassement d'une contradiction de l'économie capitaliste : pourvu qu'il existe des gains de productivité suffisamment élevés permettant que la consommation augmente au rythme de l’augmentation de la productivité du travail, le problème de la surproduction est réglé sans empêcher l'accumulation puisque, par ailleurs, les profits, également en augmentation, sont suffisants pour assurer l'accumulation. Marx, de son vivant, n'avait jamais constaté une augmentation des salaires au rythme de la productivité du travail, et pensait même que cela ne pouvait pas se produire. Cela s'est pourtant produit à certains moments de la vie même du capitalisme, mais ce fait ne saurait en rien autoriser à en déduire que le problème fondamental de la surproduction, tel que Marx le met en évidence, s'en serait pour autant trouvé résolu, même momentanément. En effet, le marxisme ne réduit pas cette contradiction que constitue la surproduction à une question de proportion entre augmentation des salaires et celle de la productivité. Que le keynésianisme ait vu à travers un tel mécanisme de répartition de la richesse le moyen de maintenir momentanément un certain niveau d'activité économique dans un contexte de forte augmentation de la productivité du travail, est une chose. Que les "débouchés" ainsi créés aient effectivement permis un développement du capitalisme est une autre chose, illusoire celle-là. Il nous faut ici examiner de plus près comment une telle manière de "régler" la question de la surproduction par la consommation ouvrière se répercute sur les rouages de l'économie capitaliste. Il est vrai que la consommation ouvrière et les dépenses de l'État permettent d'écouler une production accrue mais avec pour conséquence, nous l'avons vu, une stérilisation de la richesse produite qui ne trouve pas à s'employer utilement pour valoriser le capital. La bourgeoise a d'ailleurs expérimenté d'autres expédients du même type visant à contenir la surproduction : la destruction des excédents agricoles, en particulier dans les années 1970 (alors que la famine sévissait déjà dans le monde), le contingentement à l'échelle européenne voire mondiale de la production d'acier, de pétrole, etc. En fait, quels que soient les moyens utilisés par la bourgeoisie afin d'absorber ou de faire disparaître la surproduction, ceux-ci se résument en bout de course à une stérilisation de capital.
Paul Mattick5, qui est cité par la thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste 6, fait lui aussi le constat, concernant la période qui nous intéresse, d'une augmentation des salaires au rythme des gains de productivité : "Il est indéniable qu’à l’époque moderne les salaires réels ont augmenté. Mais seulement dans le cadre de l’expansion du capital, laquelle suppose que le rapport des salaires aux profits demeure constant en général. La productivité du travail devait alors s’élever avec une rapidité permettant à la fois d’accumuler du capital et d’accroître le niveau de vie des ouvriers" (7).
Mais il est dommage que la thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste ne soit pas allée plus avant dans l'utilisation des travaux de Mattick. En effet, pour ce dernier comme pour nous, "la prospérité a pour base l'élargissement de plus-value destinée à l'expansion du capital." 8 En d'autres termes, elle ne s'accroît pas par des ventes à des marchés résultant d'augmentations des salaires ou des dépenses improductives de l'État : "Tout le problème se réduit en fin de compte à ce fait d'évidence qu'on ne peut accumuler ce qui est consommé, de sorte que la "consommation publique" ne saurait inverser le mouvement qui conduit le taux d'accumulation à stagner, voire à se contracter" 9. Or, cette particularité de la prospérité des années 1950 et 60 est demeurée inaperçue de l'économie bourgeoisie officielle et de la thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste : "Les économistes ne font pas la distinction entre économie tout court et économie capitaliste, ils n'arrivent pas à voir que la productivité et ce qui est "productif pour le capital" sont deux choses différentes, que les dépenses, et publiques et privées, ne sont productives que dans la mesure où elles sont génératrices de plus-value, et non simplement de biens matériels et autres agréments de la vie" 10. Si bien que "Le surcroît de production que le déficit budgétaire a permis de financer se présente comme une demande additionnelle, mais d'une espèce particulière ; certes, elle prend son origine dans une production accrue, mais il s'agit d'un produit total accru sans augmentation corrélative du profit global." 11
De ce qui précède, il découle que la prospérité réelle des décennies 1950 et 60 n'a pas été aussi importante que veut bien le présenter la bourgeoisie, lorsqu'elle exhibe fièrement les PIB des principaux pays industrialisés de cette époque. Le constat que fait Mattick à ce propos est totalement valide : "En Amérique toutefois, il fallut maintenir la stabilité du niveau de production au moyen de la dépense publique, ce qui eut pour effet de gonfler, lentement mais sûrement, la dette publique. En outre, à la base de tout cela, on trouvait aussi la politique impérialiste des États-Unis — notamment, plus tard, la guerre du Vietnam. Or, comme le chômage ne tomba pas au-dessous de 4 % de la population active et que les capacités de production ne furent pas utilisées à plein, il est plus que vraisemblable que, sans la "consommation publique" d'armements et de vies humaines, le nombre de chômeurs aurait été infiniment supérieur à ce qu'il fut en réalité. Et comme à peu près la moitié de la production mondiale était d'origine américaine, on ne pouvait parler sérieusement, malgré l'essor du Japon et de l'Europe de l'Ouest, d'élimination complète de la crise mondiale, et bien moins encore si l'on faisait entrer les pays sous-développés en ligne de compte. Pour animée que fût la conjoncture, elle ne concernait que certaines fractions du capital mondial sans parvenir à créer un essor économique généralisé à la terre entière" 12. La thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste sous-estime cette réalité.
Pour nous, la source réelle de l'accumulation ne se trouve nullement dans les mesures keynésiennes mises en oeuvre à cette époque 13, mais dans la réalisation de la plus-value à travers la vente aux marchés extra-capitalistes et dans la vente à crédit. La thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste, si nous l'avons bien interprétée, commet une erreur théorique sur ce plan qui ouvre la voie à l'idée de la possibilité, pour le capitalisme, de surmonter sa crise pourvu que celui-ci parvienne de façon continue à augmenter la productivité du travail et à augmenter dans la même proportion les salaires des ouvriers.
Alors que la thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste se revendiquait, au début de notre débat, de la continuité avec le cadre théorique développé par Marx et enrichi par Rosa Luxemburg sur les contradictions économiques du mode de production capitaliste, cela n'est plus aujourd'hui le cas concernant Rosa Luxemburg. Cependant, de notre point de vue, que cette thèse reprenne à son compte la théorie de Rosa Luxemburg ou la rejette, ne change strictement rien à son incapacité à rendre compte des contradictions qui minaient la société capitaliste pendant la période dite des Trente Glorieuses. En effet, comme on l'a vu à travers les différentes citations de Paul Mattick sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour critiquer la thèse en question, le débat avec cette dernière thèse ne renvoie en rien à celui, plus classique, opposant la nécessité de marchés extra-capitalistes pour le développement du capitalisme (comme la défend Rosa Luxemburg) et l'analyse des défenseurs de la baisse du taux de profit comme explication exclusive de la crise du capitalisme (comme la défend Paul Mattick).
Quant à cette autre question de savoir si la vente à crédit peut constituer de façon durable le moyen d'une réelle accumulation, elle renvoie bien au débat entre baisse du taux de profit et saturation des marchés extra-capitalistes. La réponse à cette question se trouve dans la capacité qu'a, ou n'a pas, le capitalisme de rembourser ses dettes. Or, l'accroissement continu de la dette, y inclus depuis fin des années 1950, est un signe que la crise ouverte actuelle de l'endettement plonge ses racines jusques et y compris dans la période de "prospérité" des années 1950 et 60. Mais ceci est un autre débat sur lequel nous reviendrons au moment de la vérification dans la réalité de la thèse des marchés extra-capitalistes et de l'endettement.
Silvio
1. In "Origine, dynamique et limites du capitalisme d’État keynésiano-fordiste", Revue Internationale n° 135 [19].
2. Ibid
3. "Les causes de la prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (I) ; "Les marchés extra-capitalistes et l'endettement" ", Revue Internationale n° 133 [9].
4. Le Capital, Livre III, section III : "La loi tendancielle de la baisse du taux de profit", Chapitre X : "Le développement des contradictions immanentes de la loi, Pléthore de capital et surpopulation"
5. Membre de la Gauche communiste ayant milité dans le KAPD au moment de la révolution allemande. Emigré aux États-Unis en 1926, il militera dans les IWW et produira de nombreux écrits politiques y compris sur les questions économiques. A ce sujet, signalons deux ouvrages connus Marx et Keynes – Les limites de l'économie mixte, paru en 1969, et Crise et théorie des crises paru en 1974. Paul Mattick fait fondamentalement découler la crise du capitalisme de la contradiction mise en évidence par Marx, la baisse tendancielle du taux de profit. En ce sens, il diverge de l'interprétation luxemburgiste des crises qui, sans nier la baisse du taux de profit, met essentiellement l'accent sur la nécessité de débouchés extérieurs aux rapports de production capitalistes pour permettre au capitalisme de se développer. Il faut signaler la capacité de Mattick à résumer magistralement dans Crise et théorie des crises les contributions à la théorie des crises des épigones de Marx, de Rosa Luxemburg à Grossmann en passant par Tougan Baranowsky, sans oublier Pannekoek. Ses désaccords avec Rosa Luxemburg ne l'empêchent nullement de rendre compte de façon tout à fait objective et intelligible des travaux économique de la grande révolutionnaire.
6. Cette citation n'est pas présente dans la version de cet article publiée sur notre site. Elle l'est seulement dans la version imprimée de la Revue Internationale n° 135.
7. Paul Mattick, Intégration capitaliste et rupture ouvrière, EDI : 151. Cité dans l'article de la Revue n° 135 [19], "Origine, dynamique et limites du capitalisme d’État keynésiano-fordiste".
8. In Crise et théorie des crises, Paul Mattick. Souligné par nous.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. Ibid.
12. Ibid
13. Comme le note encore Mattick, conçu à l'origine comme moyen de s'affranchir de la crise, le keynésianisme ne constitue dans le fond qu'un facteur de son aggravation : "Ainsi la production compensatrice induite par l'État, à l'origine moyen d'atténuer la crise, contribue maintenant à l'aggraver, étant donné qu'elle fait perdre à une fraction toujours plus large de la production sociale son caractère capitaliste, autrement dit, sa faculté de créer du capital additionnel." (Ibid).
Questions théoriques:
- L'économie [14]
- Décadence [21]
Heritage de la Gauche Communiste:
Économie de guerre et capitalisme d'État
- 4849 lectures
Le but principal de cet article est de développer quelques bases pour l’analyse de la période du boom économique d’après-guerre, qui ont été esquissées dans la Revue internationale n° 133 [9] sous le titre Capitalisme d’Etat et économie de guerre. 1 Ce faisant, il semble également utile d’examiner brièvement certaines des objections à cette analyse soulevées par d’autres participants au débat.
Comme le soulignent très justement les remarques introductives dans la Revue internationale n°133, l’importance de ce débat va bien au-delà de l’analyse du boom d’après-guerre lui-même, mais touche des aspects plus fondamentaux de la critique marxiste de l’économie politique. Il doit en particulier contribuer à une meilleure compréhension des principales forces qui gouvernent la société capitaliste. Ces forces déterminent à la fois le dynamisme extraordinaire de la période d’ascendance du capitalisme qui l’ont fait progresser, depuis ses débuts dans les cités-États d’Italie et de Flandres jusqu’à la création de la première société planétaire, et le caractère immensément destructeur de la période décadente du capitalisme au cours de laquelle l’humanité a subi deux guerres mondiales dont la barbarie aurait fait pâlir Gengis Khan et qui menace aujourd’hui l’existence même de notre espèce.
Qu’est-ce qui sous-tend l’expansionnisme dynamique de l’économie capitaliste ?
La clé du dynamisme du capitalisme réside au cœur même des rapports sociaux capitalistes :
- l’exploitation de la classe productrice par la classe dominante prend la forme de l’achat de la force de travail comme marchandise ;
- le produit du travail de la classe exploitée doit nécessairement prendre la forme de marchandises ce qui, à son tour, signifie que l’expropriation du surtravail par la classe dominante implique nécessairement la vente de ces marchandises sur le marché. 2
Pour exprimer cela plus simplement à travers un exemple : le seigneur féodal s’emparait du surplus produit par ses serfs et l’utilisait directement pour entretenir son train de vie. Le capitaliste extrait la plus-value des ouvriers sous la forme de marchandises qui ne lui sont pas utiles comme telles, mais qui doivent être vendues sur le marché afin d’être transformées en capital monétaire.
Ceci crée inévitablement un problème pour le capitaliste : qui va acheter les marchandises qui représentent la plus-value créée par le travail des ouvriers ? Très schématiquement, historiquement deux réponses ont été apportées à cette question dans le mouvement ouvrier :
- selon certaines théories, le problème n’existe pas : le processus d’accumulation du capital et les opérations normales de crédit permettent aux capitalistes d’investir dans un nouveau cycle de production qui, se déroulant à une échelle plus large, absorbe la plus-value produite au cours du cycle précédent et l’ensemble du processus ne fait que recommencer. 3
- pour le CCI dans sa majorité, cette explication est inadéquate. 4 Après tout, si le capitalisme peut s’étendre à l’infini sur ses propres bases sans aucun problème, pourquoi la classe capitaliste a-t-elle la manie de la conquête extérieure ? Pourquoi la bourgeoisie ne reste-t-elle pas tranquillement chez elle et ne continue-t-elle pas à étendre son capital sans se lancer dans l’entreprise risquée, coûteuse et violente d’étendre constamment son accession à de nouveaux marchés ? Luxemburg répond ainsi à cette question dans l’Anti-critique : "Il doit s'agir d'acheteurs qui se procurent des moyens de paiement grâce à un système d'échange de marchandises, donc sur la base d'une production de marchandises, et cette production doit nécessairement se trouver à l'extérieur du système capitaliste de production ; les moyens de production de ces producteurs ne doivent pas entrer en ligne de compte comme capital, eux-mêmes n'entreront pas dans l'une des deux catégories de capitalistes ou d'ouvriers, et cependant ils ont besoin de marchandises capitalistes." 5
Jusqu’à la publication de son article dans la dernière Revue internationale n°135, il semblait raisonnable de penser que le camarade C.Mcl partageait cette vision de l’expansion du capitalisme dans sa phase ascendante.6 Dans cet article intitulé "Origine, dynamique, et limites du capitalisme d'État keynésiano-fordiste", le camarade semble avoir changé d'avis à ce sujet. Cela montre à tout le moins que les idées changent au cours des débats ; cependant, il nous semble nécessaire de nous arrêter un moment pour examiner certaines des idées nouvelles qu'il met en avant.
Il faut dire que ces idées ne sont pas très claires à première vue. D'une part, C.Mcl nous dit, et nous sommes d'accord, que l'environnement extra-capitaliste a "fourni [au capitalisme] toute une série d'opportunités" pour, entre autres, vendre les marchandises en excès. 7 Cependant C.Mcl nous dit, d’autre part, que non seulement ces "opportunités externes" n’étaient pas nécessaires puisque le capitalisme est parfaitement capable de développer sa propre "régulation interne", mais que l’expansion extérieure du capitalisme freine en fait son développement ; si nous comprenons bien le camarade C.Mcl, c’est parce que les marchandises vendues sur les marchés extra-capitalistes cessent de fonctionner comme capital et ne contribuent donc pas à l’accumulation, tandis que les marchandises vendues au sein du capitalisme permettent à la fois la réalisation de la plus-value (par la conversion du capital sous forme de marchandises en capital sous forme d’argent) et fonctionnent également comme éléments de l’accumulation, que ce soit sous forme de machines (moyens de production, capital constant) ou de biens de consommation (moyens de consommation pour la classe ouvrière, capital variable). Pour valider cette idée, le camarade C.Mcl nous apprend que les pays capitalistes qui n’avaient pas de colonies, ont connu au 19e siècle des taux de croissance supérieurs à ceux des puissances coloniales. 8 Ce point de vue nous semble tout à fait erroné tant d’un point de vue empirique que théorique. Il exprime une vision fondamentalement statique dans laquelle le marché extra-capitaliste ne constitue rien d’autre qu’une sorte de trop-plein pour le marché capitaliste lorsque celui-ci déborde.
Les capitalistes ne font pas que vendre sur le marché extra-capitaliste, ils y achètent également. Les navires qui transportaient des marchandises bon marché sur les marchés de l’Inde et de la Chine 9, ne rentraient pas à vide : ils revenaient chargés de thé, d’épices, de coton et d’autres matières premières. Jusqu’aux années 1860, le principal fournisseur de coton pour l’industrie textile anglaise était l’économie esclavagiste des États du Sud des Etats-Unis. Pendant la "crise du coton" causée par la Guerre civile, l’Inde et l’Égypte devinrent les nouveaux fournisseurs.
En réalité, "... dans le processus de circulation où le capital industriel fonctionne soit comme argent, soit comme marchandise, son circuit s'entrecroise – comme capital-argent ou comme capital-marchandise – avec la circulation marchande des modes sociaux de production les plus divers, dans la mesure où celle-ci est en même temps production marchande. Il importe peu que les marchandises soient le fruit d'une production fondée sur l'esclavage, ou le produits de paysans (Chinois, ryots des Indes), de communes rurales (Indes hollandaises), d'entreprises d'État (comme on les rencontre aux époques anciennes de l'histoire russe, sur la base du servage) ou de peuples chasseurs demi-sauvages, etc. : comme marchandises et argent, elles affrontent l'argent et les marchandises qui représentent le capital industriel ; elles entrent dans le circuit du capital industriel tout autant que dans le circuit de la plus-value véhiculée par le capital-marchandise et dépensée comme revenu (...). Le caractère du processus de production dont elles émanent est immatériel. Elles fonctionnent comme marchandises sur le marché et, en tant que marchandises, elles entrent dans le circuit du capital industriel comme dans le circuit de la plus-value qui y est incorporé." 10
Qu’en est-il de l’argument selon lequel l’expansion coloniale freine le développement du capitalisme ? A notre avis, on commet deux erreurs ici :
- comme le CCI (à la suite de Marx et de Luxemburg) l’a souligné à de nombreuses reprises, le problème du marché extra-capitaliste se pose à un niveau global et non au niveau du capital individuel ni même national 11 ;
- la colonisation ne constitue pas la seule forme que prend l’expansion capitaliste sur les marchés extra-capitalistes.
L’histoire des États-Unis fournit une illustration particulièrement claire – et d’autant plus importante du fait du rôle croissant de l’économie américaine au cours du 19e siècle – de ce point.
D’abord, l’inexistence d’un empire colonial américain au cours du 19e siècle n’était pas due à une "indépendance" quelconque de l’économie des États-Unis vis-à-vis d’un environnement extra-capitaliste mais au fait qu'elle trouvait ce dernier au sein des frontières américaines elles-mêmes. 12 Nous avons déjà mentionné l’économie esclavagiste des États du Sud. Après la destruction de celle-ci par la Guerre civile (1861-1865), le capitalisme s’est étendu au cours des 30 années suivantes vers l’Ouest américain selon un processus continu qu’on peut décrire ainsi : massacre et nettoyage ethnique de la population indigène ; établissement d’une économie extra-capitaliste à travers la vente et la concession de territoires nouvellement annexés par le gouvernement à des colons et de petits éleveurs 13 ; extermination de cette économie extra-capitaliste par la dette, la fraude et la violence, et extension de l’économie capitaliste. 14 En 1890, le Bureau américain du Recensement déclara "la Frontière" interne fermée. 15 En 1893, les États-Unis connurent une dépression sévère et au cours des années 1890, la bourgeoisie américaine était de plus en plus préoccupée par la nécessité d’étendre ses frontières nationales. 16 En 1898, un document du Département d’Etat américain expliquait : "Il semble y avoir un accord général sur le fait que nous allons chaque année nous trouver avec un surplus grandissant de produits manufacturés destinés aux marchés étrangers si l'on veut maintenir l'emploi des ouvriers et des artisans américains. L'élargissement de la consommation à l'étranger des produits de nos usines et de nos ateliers devient ainsi un problème sérieux non seulement commercial mais politique." 17. Suivit alors une rapide expansion impérialiste : Cuba (1898), Hawaï (1898 également), Philippines (1899) 18, la zone du canal de Panama (1903). En 1900, Albert Beveridge (un des principaux partisans de la politique impérialiste américaine) déclarait au Sénat : "Les Philippines sont à nous pour toujours (...). Et derrière les Philippines, il y a les marchés illimités de Chine (...). Le Pacifique est notre océan (...) Où trouver des consommateurs pour nos surplus ? La géographie apporte la réponse. La Chine est notre client naturel." 19
La décadence et la guerre
Les Européens pensent souvent à la frénésie impérialiste de la fin du 19e siècle comme une "Ruée vers l’Afrique". Sous beaucoup de rapports cependant, la conquête américaine des Philippines était d’une importance plus grande dans la mesure où elle symbolisait le moment où l’expansion impérialiste européenne vers l’Est s’affrontait à l’expansion américaine vers l’Ouest. La première guerre de cette nouvelle époque impérialiste fut menée par des puissances asiatiques, la Russie et le Japon, pour le contrôle de la Corée et l’accès aux marchés chinois. Cette guerre fut un facteur clé dans le premier soulèvement révolutionnaire du 20e siècle, en Russie, en 1905.
Qu’est-ce que cette nouvelle «époque de guerres et de révolutions" (comme l’Internationale communiste l’a décrite) impliquait pour l’organisation de l’économie capitaliste ?
De façon très schématique, elle implique l’inversion du rapport entre l’économie et la guerre : alors que dans la période ascendante du capitalisme, la guerre est une fonction de l’expansion économique, dans la décadence au contraire, l’économie est au service de la guerre impérialiste. L’économie capitaliste dans la décadence est une économie de guerre permanente. 20 C’est le problème fondamental qui sous-tend l’ensemble du développement de l’économie capitaliste depuis 1914 et en particulier de l’économie du boom d’après-guerre qui a suivi 1945.
Avant de poursuivre par l’examen du boom d’après-guerre de ce point de vue, il semble nécessaire de revenir brièvement sur certaines des autres positions présentes dans le débat.
1) Le rôle des marchés extra-capitalistes après 1945
Cela vaut la peine de rappeler que la brochure du CCI, La décadence du capitalisme, attribue déjà un rôle à la destruction continue des marchés extra-capitalistes au cours de cette période 21 et il est possible que nous ayons sous-estimé leur rôle dans le boom d'après-guerre ; en fait la destruction de ces marchés (dans le sens classique décrit par Luxemburg) continue encore aujourd'hui sous des formes les plus dramatiques, comme on peut le voir avec les dizaines de milliers de suicides chez les paysans indiens incapables de rembourser les dettes qu'ils ont contractées pour acheter des semences et des engrais à Monsanto et à d'autres. 22
Néanmoins, il est difficile de voir comment ces marchés auraient pu contribuer de façon décisive au boom d'après-guerre si l'on prend en compte :
- l'énorme destruction qu'a connue la petite économie paysanne dans beaucoup de pays entre 1914 et 1945 comme résultat de la guerre et de la catastrophe économique ; 23
- le fait que toutes les économies européennes subventionnaient massivement l'agriculture pendant la période d'après-guerre : l'économie paysanne constituait un coût pour ces économies plutôt qu'un marché.
2) La montée de la dette
Sur le plan des données, cet argument est beaucoup plus solide. Il est vrai que par rapport aux niveaux astronomiques atteints aujourd'hui, après plus de trente années de crise, l'accroissement de la dette pendant le boom d'après-guerre peut sembler à première vue trivial. Cependant comparé à ce qui se passait auparavant, sa montée fut spectaculaire. Aux États-Unis, la dette fédérale brute à elle seule passa de 48,2 milliards de dollars en 1938 à 483,9 milliards de dollars en 1973, c'est à dire dix fois plus. 24
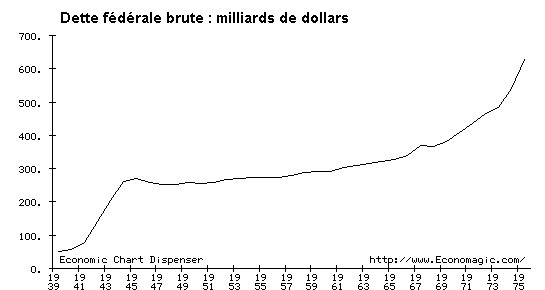
Le crédit à la consommation aux Etats-Unis passa de 4% du PIB en 1948 à plus de 12% au début des années 1970.
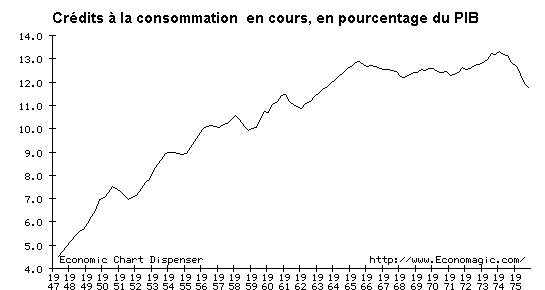
Les prêts immobiliers passèrent également de 7 milliards de dollars en 1947 à 70,5 milliards en 1970 – c'est-à-dire dix fois plus à cause du niveau important de crédits accordés, à bas taux et d'accès facile, par le gouvernement : en 1955, la Federal Housing Administration et la Veterans Administration détenaient à eux deux 41% de toutes les hypothèques. 25

3) L'augmentation des salaires
Pour le camarade C.Mcl, la prospérité du boom d'après-guerre était en grande partie due au fait que les salaires ont augmenté en même temps que la productivité grâce à une politique keynésienne délibérée ayant pour but d'absorber la production excédentaire et de permettre la poursuite de l'expansion du marché.
Il est vrai, comme Marx l'a souligné dans Le Capital, que les salaires peuvent augmenter sans menacer les profits tant que la productivité augmente aussi. Il est également vrai que la production de masse de biens de consommation est impossible sans la consommation massive de la classe ouvrière. Et il est tout aussi vrai qu'il y a eu une politique délibérée d'augmenter les salaires et le niveau de vie des ouvriers après la Seconde Guerre mondiale afin de se prémunir contre les révoltes sociales. Cependant, rien de tout cela ne résout le problème de base, identifié par Marx et Luxemburg, selon lequel la classe ouvrière ne peut absorber toute la valeur de ce qu'elle produit.
De plus, l'hypothèse de C.Mcl se fonde sur deux suppositions majeures qui ne sont pas justifiées empiriquement à notre avis :
- La première est que l'augmentation des salaires était garantie par l'indexation de ceux-ci à la productivité ; mais nous ne trouvons pas que cette politique soit attestée comme politique générale, sauf dans des cas mineurs comme en Belgique. 26 Pour prendre deux contre-exemples, l'échelle mobile introduite en Italie en 1945 liait les salaires à l'inflation (ce qui est évidemment une autre chose) et le "Contrat social" introduit par le gouvernement travailliste de Wilson en Grande-Bretagne à la fin du boom constituait une tentative désespérée de réduire les salaires dans une période de forte inflation en les indexant à la productivité.
-
La seconde est que le capital occidental n'aurait pas cherché une main d'œuvre bon marché jusqu'au début de la période de "mondialisation" dans les années 1980.C'est tout simplement faux : aux États-Unis, la migration des campagnes vers les villes a réduit la population rurale de 24,4 millions en 1945 à 9,7 millions en 1970. 27 En Europe, le même phénomène fut encore plus spectaculaire : environ 40 millions de personnes émigrèrent des campagnes et de pays hors d'Europe vers les grandes zones industrielles. 28
Les fruits de la guerre
La Seconde Guerre mondiale - encore plus que la Première – a démontré l'irrationalité fondamentale de la guerre impérialiste dans la décadence. Loin d'être payante par la conquête de nouveaux marchés, la guerre ruina les pays vainqueurs comme les pays vaincus. A une seule exception : les États-Unis, seul pays belligérant qui n'a subi aucune destruction sur son territoire. Cette exception jeta les bases d'un boom après guerre tout aussi exceptionnel et ne pouvant, de ce fait, se répéter.
L'un des principaux défauts des autres positions dans ce débat est que a) elles tendent à poser le problème en termes purement économiques, et b) elles ne considèrent que le boom d'après-guerre en lui-même et ne parviennent pas, de ce fait, à comprendre que ce boom a été déterminé par la situation créée par la guerre.
Quelle était donc cette situation ?
Entre 1939 et 1945, la taille de l'économie américaine doubla 29. Les industries existantes (comme la construction navale) appliquèrent les techniques de production de masse. De nouvelles industries entières furent créées : production à la chaîne d'avions, électronique, informatique (les premiers ordinateurs ont été utilisés pour calculer les trajectoires balistiques), produits pharmaceutiques (avec la découverte de la pénicilline), plastiques – la liste est sans fin. Et bien que la dette gouvernementale ait atteint un pic pendant la guerre, pour les Etats-unis, la plus grande partie de ce développement constituait de la pure accumulation de capital puisqu'ils saignaient à blanc les empires britannique et français en s'emparant de leur richesse accumulée contre des commandes d'armements.
Malgré cette supériorité écrasante, les États-Unis connurent, pour le moins, des problèmes à la fin de la guerre. Nous pouvons les résumer comme suit :
- Où trouver des débouchés pour la production industrielle américaine qui avait doublé pendant la guerre ? 30
- Comment défendre les intérêts nationaux américains – situés pour la première fois à une échelle vraiment mondiale – contre la menace d'expansion soviétique ?
- Comment éviter des soulèvements importants et la menace potentielle constituée par la classe ouvrière – aucune fraction de la bourgeoisie mondiale n'avait oublié Octobre 1917 – en Europe en particulier ?
Comprendre comment les Etats-Unis ont cherché à résoudre ces problèmes constitue la clé de la compréhension du boom d'après-guerre – et de sa fin dans les années 1970. Nous y reviendrons dans un prochain article ; cependant cela vaut la peine de souligner que Rosa Luxemburg écrivant avant le plein développement de l'économie capitaliste d'État pendant la Première et, surtout, la Seconde Guerre mondiale, avait déjà donné quelques indications sur les effets économiques de la militarisation de l'économie : "La multiplicité et l'éparpillement des demandes minimes de diverses catégories de marchandises, qui ne coïncident pas dans le temps et peuvent être satisfaites par la production marchande simple, qui n'intéressent donc pas l'accumulation capitaliste, font place à une demande concentrée et homogène de l'État. La satisfaction d'une telle demande implique l'existence d'une grande industrie développée à un très haut niveau, donc des conditions très favorables à la production de la plus-value et à l'accumulation. De plus, le pouvoir d'achat des énormes masses de consommateurs, concentré sous la forme de commandes de matériel de guerre faites par l'État, sera soustrait à l'arbitraire, aux oscillations subjectives de la consommation individuelle ; l'industrie des armements sera douée d'une régularité presque automatique, d'une croissance rythmique. C'est le capital lui-même qui contrôle ce mouvement automatique et rythmique de la production pour le militarisme, grâce à l'appareil de la législation parlementaire et à la presse, qui a pour tâche de faire l'opinion publique. C'est pourquoi ce champ spécifique de l'accumulation capitaliste semble au premier abord être doué d'une capacité d'expansion illimitée. Tandis que toute extension des débouchés et des bases d'opération du capital est liée dans une large mesure à des facteurs historiques, sociaux et politiques indépendants de la volonté du capital, la production pour le militarisme constitue un domaine dont l'élargissement régulier et par bonds paraît dépendre en première ligne de la volonté du capital lui-même." 31
Moins de 50 ans après la rédaction de ce livre, la réalité du militarisme impérialiste était décrite ainsi : "La conjonction d'un immense appareil militaire et d'une grande industrie d'armements est une expérience nouvelle pour les États-Unis. Chaque ville, chaque gouvernement d'État, chaque bureau du gouvernement fédéral ressent toute son influence –économique, politique et même spirituelle (...) nous devons en comprendre les graves implications. Notre travail, nos ressources, nos moyens d'existence, tout est impliqué ; de même la structure même de notre société.
Dans les conseils gouvernementaux, nous devons mettre en garde contre l'acquisition d'une influence injustifiée – recherchée ou non – du complexe militaro-industriel. Il existe et il persistera la possibilité d'une montée désastreuse de puissance incontrôlée.
(...) Dans le même ordre de choses et en grande partie responsable du changement radical de notre position militaro-industrielle, il y a la révolution technologique des dernières décennies.
Dans cette révolution, la recherche est devenue centrale ; elle est aussi devenue plus officielle, plus complexe et plus coûteuse. Une part qui s'accroît de façon régulière a lieu pour le gouvernement fédéral, par celui-ci et sous sa direction." Ces mots ont été prononcée en 1961, non pas par un quelconque intellectuel de gauche mais par le président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower.
Jens, 10 décembre 2008.
1.. Pour des raisons de place, il est impossible de rendre compte de toute la période de 1945 à 1970. Nous nous proposons donc de n’aller pas plus loin qu’introduire une analyse des fondements du boom d’après-guerre que nous espérons traiter plus en détails plus tard.
2.. Ce n’est pas par hasard si le premier chapitre du Capital s’intitule "La marchandise ".
3.. Nous laissons de côté pour le moment la question des crises cycliques à travers lesquelles ce processus évolue historiquement.
4.. Nous ne répétons pas ici ce que le CCI a déjà écrit à maintes occasions pour défendre la vision que pour Marx et Engels - et pour Rosa Luxemburg en particulier parmi les marxistes de la génération suivante - le problème de l’inadéquation du marché capitaliste constitue une difficulté fondamentale sur la voie du processus d’accumulation élargie du capital.
6.. Voir en particulier l’article écrit par le camarade dans la Revue internationale n°127 [24] dans lequel, sous l’intertitre "Marx et Rosa Luxemburg : une analyse identique des contradictions économiques du capitalisme", il démontre de façon claire et très documentée la continuité entre l’analyse de Marx et celle de Luxemburg.
7.. "Cet environnement lui a cependant encore fourni toute une série d'opportunités tout au long de sa phase ascendante (1825-1914) comme source de profits, exutoire pour la vente de ses marchandises et appoint complémentaire de main d'œuvre."
8.. "Au 19e siècle, là où les marchés coloniaux interviennent le plus, TOUS les pays capitalistes NON coloniaux ont connu des croissances nettement plus rapides que les puissances coloniales (71% plus rapide en moyenne). Ce constat est valable pour toute l'histoire du capitalisme. En effet, la vente à l'extérieur du capitalisme pur permet bien aux capitalistes individuels de réaliser leurs marchandises, mais elle freine l'accumulation globale du capitalisme car, tout comme pour l'armement, elle correspond à une sortie de moyens matériels du circuit de l'accumulation".
9.. Notamment en ce qui concerne l’opium dans le cas de la Chine, la très "vertueuse" bourgeoisie britannique a mené deux guerres afin de forcer le gouvernement chinois à continuer de permettre à la population de s’empoisonner avec l’opium britannique.
10.. Le Capital, Livre II, première partie, chapitre II en français, Ed. La Pléiade. Les dernières phrases sont traduites de la version anglaise du Capital par nous.
11.. Schématiquement si l’industrie d’Allemagne (qui ne comportait pas de colonies) a pris le pas sur le marché mondial sur celle de Grande Bretagne (qui avait des colonies) et a connu un taux de profit supérieur, elle profitait aussi des marchés extra-capitalistes conquis par l’impérialisme britannique.
12.. Lorsque les Etats-Unis ont, par la force et la tromperie, dépouillé le Mexique du Texas (1836-1845) et de la Californie (1845-1847), ces nouveaux états ne furent pas intégrés à un "empire" mais au territoire national des Etats-Unis.
13.. Par exemple, le "Oklahoma Land Rush" (la "ruée vers le territoire de l’Oklahoma") en 1889. La ruée commença le 22 avril 1889 à midi avec environ 50 000 personnes sur la ligne de départ pour acquérir une part des 2 millions d’acres (8 000km2) disponibles.
14.. L’histoire du développement capitaliste aux États-Unis mériterait une série d’articles à elle seule et nous n’avons pas la place ici pour développer cette question. Par ailleurs, cela vaut la peine de souligner que ces mécanismes de l’expansion capitaliste ne se limitaient pas aux États-Unis mais qu’on les rencontre également –comme on peut le lire dans l’Introduction à l’économie politique de Rosa Luxemburg – dans l’expansion de la Russie vers l’Est et dans l’incorporation à l’économie capitaliste de la Chine, de l’Égypte et de la Turquie – pays qui n’ont jamais été des colonies.
15. Dans la société américaine, l'expression la Frontière (the Frontier) a un sens spécifique qui se réfère à son histoire. Il s'agit, tout au long du 19e siècle, un des aspects les plus importants du développement des États-Unis par l’extension du capitalisme industriel vers l’Ouest, qui s'est traduite par le peuplement de ces régions par des populations essentiellement composées de gens de souche européenne ou africaine.
16.. Cette préoccupation avait déjà trouvé une expression dans la "Doctrine Monroe" adoptée en 1823 qui établissait clairement que les États-Unis considéraient tout le continent américain, du Nord et du Sud, comme sa sphère d’intérêts exclusive – et la Doctrine Monroe fut imposée au moyen d’interventions militaires américaines répétées en Amérique latine.
17.. Cité dans Howard Zinn, History of American People. Traduit par nous
18.. La conquête des Philippines où les États-Unis commencèrent par évincer la puissance coloniale espagnole, puis menèrent une guerre féroce contre les insurrectos philippins, constitue un exemple particulièrement révoltant de l’hypocrisie et de la barbarie capitalistes.
19.. Howard Zinn, op.cit.
20.. Nous illustrerons cela par un exemple. En 1805, la révolution industrielle était déjà bien avancée en Grande-Bretagne : l'utilisation de la machine à vapeur et la production mécanisée des textiles s'étaient rapidement développées depuis les années 1770. Pourtant, lorsque cette année-là, les Britanniques détruisirent les flottes française et espagnole à la bataille de Trafalgar, le navire amiral de Nelson, HMS Victory, avait déjà près de 50 ans (ses plans en avaient été établis en 1756 et le navire finalement lancé en 1765). Il suffit de comparer cela à la situation actuelle où les technologies les plus avancées dépendent de l'industrie d'armement.
21.. La brochure La décadence du capitalisme – de façon juste à notre avis – associe ce phénomène au militarisme croissant des économies du "Tiers-Monde".
22.. On pourrait aussi parler de l'élimination des petits commerçants dans les pays développés avec l'expansion des supermarchés et de la commercialisation de masse des produits ménagers les plus ordinaires (y compris la nourriture évidemment), phénomènes qui ont clairement commencé dans les années 1950 et 1960.
23.. Le programme de collectivisation forcée de Staline en URSS pendant les années 1930, les guerres entre seigneurs et la guerre civile en Chine dans l'entre-deux guerres, la conversion de l'économie paysanne en économie de marché de pays comme la Roumanie, la Norvège ou la Corée pour répondre au besoin de l'impérialisme allemand et japonais d'être autonome pour leur approvisionnement alimentaire, les effets désastreux de la Grande Dépression sur les petits fermiers américains (Oklahoma Dust Bowl, - tempêtes de poussière en Oklahoma -), etc.
24.. Sauf mention contraire, les chiffres et les graphiques sont tirés des statistiques gouvernementales américaines disponibles sur https://www.economagic.com [25]. Nous nous concentrons, dans cet article, sur l'économie américaine en partie parce que les statistiques du gouvernement sont plus facilement disponibles mais, surtout, à cause du poids écrasant de l'économie américaine sur l'économie mondiale durant cette période.
25.. James T. Patterson, Grand expectations.
26.. En fait, selon une étude (cedar.barnard.columbia.edu/-econhist/papers/Hanes_sscaled4.pdf), des accords d'échelle mobile des salaires avaient déjà existé dans certaines industries américaines et britanniques dès le milieu du 19e siècle jusqu'aux années 1930 pour n'être abandonnés qu'après la guerre.
27.. Patterson (op. cit). Ce fut "l'un des changements les plus dramatiques de l'histoire américaine moderne".
28.. "En Italie, entre 1955 et 1971, environ 9 millions de personnes changèrent de régions. (...) 7 millions d'Italiens quittèrent le pays entre 1945 et 1970. Dans les années 1950-70, un quart de la force de travail grecque partit chercher du travail à l'étranger. (...) On estime qu'entre 1961 et 1974, un million et demi d'ouvriers portugais trouvèrent du travail à l'étranger – mouvement de population le plus important de toute l'histoire du Portugal, et qui laissa derrière lui une force de travail de 3,1 millions de personnes seulement. (...) En 1973, rien qu'en Allemagne de l'Ouest, il y avait près d'un demi-million d'Italiens, 535 000 Yougoslaves et 605 000 Turcs." (Tony Judt, Postwar: A History of Europe since 1945).
29.. Les Etats-Unis représentaient environ 40% de la production industrielle mondiale ; à eux seuls, ils produisaient en 1945 la moitié de la production mondiale de charbon, deux-tiers du pétrole, et la moitié de l'électricité. De plus, ils détenaient plus de 80% des réserves mondiales d'or.
30.. Howard Zinn (op.cit.) cite un membre du Département d'État en 1944 : "Comme vous le savez, nous devons prévoir une énorme augmentation de la production dans ce pays après la guerre, et le marché intérieur américain ne peut absorber indéfiniment toute cette production. La nécessité d'augmenter énormément les marchés étrangers ne fait aucun doute."
31.. L'accumulation du capital, écrit en 1913, chapitre : "Le militarisme, champ d'action du capital" (souligné par nous).
Questions théoriques:
- Décadence [21]
- L'économie [14]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale n° 137 - 2e trimestre 2009
- 3359 lectures
Sommet du G20 à Londres : un nouveau monde capitaliste n'est pas possible
- 3286 lectures
"La première crise globale de l’humanité" (OMC, avril 2009) 1. La récession "la plus profonde et la plus synchronisée de mémoire d’homme" (OCDE, mars 2009) 2 ! De l’aveu même des grandes institutions internationales, la crise économique actuelle est d’une gravité sans précédent. Pour y faire face, toutes les forces de la bourgeoisie sont mobilisées depuis des mois. La classe dominante tente de juguler par tous les moyens cette descente aux enfers de l’économie mondiale. Le G20 est sans nul doute le symbole le plus fort de cette réaction internationale 3.
Début avril, tous les espoirs capitalistes étaient tournés vers Londres, ville où se tenait le sommet salvateur qui devait "relancer l’économie et moraliser le capitalisme". Et à en croire les déclarations des différents dirigeants de la planète, ce G20 fut un véritable succès. "C'est le jour où le monde s'est rassemblé pour combattre la récession" a lancé le Premier ministre britannique, Gordon Brown. "C'est au-delà de ce que nous pouvions imaginer", s’est ému le président français Nicolas Sarkozy. "Il s'agit d'un compromis historique pour une crise exceptionnelle", a estimé quant à elle la chancelière allemande Angela Merkel. Et pour Barack Obama, ce sommet est un "tournant".
Évidemment, la vérité est tout autre.
La seule réussite du G20 : s’être tenu !
Ces derniers mois, la crise économique a attisé fortement les tensions internationales. D’abord, la tentation du protectionnisme s’est développée. Chaque État tente de plus en plus de sauver une partie de son économie en la subventionnant et en lui octroyant des privilèges nationaux contre la concurrence étrangère. Ce fut par exemple le cas du plan de soutien à l’automobile décidé par Nicolas Sarkozy en France, plan vertement critiqué par ses "amis" européens. Ensuite, il y a une tendance croissante à mener les plans de relance en ordre dispersé, en particulier en ce qui concerne le sauvetage du secteur financier. Enfin, les États-Unis, épicentre du séisme financier, étant touchés de plein fouet par la bourrasque économique, de nombreux concurrents tentent de profiter de la situation pour affaiblir encore un peu plus le leadership économique américain. Tel est le sens des appels au "multilatéralisme" de la France, de l’Allemagne, de la Chine, des pays sud-américains…
Ce G20 de Londres s’annonçait donc tendu et, dans les coulisses, les débats ont dû effectivement être houleux. Mais les apparences sont restées sauves, la catastrophe pour la bourgeoisie d’un G20 chaotique a été évitée. La bourgeoisie n’a pas oublié combien l’absence de coordination internationale et le chacun pour soi forcené avaient contribué au désastre en 1929. A l’époque, le capitalisme est confronté à la première grande crise de sa période de décadence 4, la classe dominante ne sait pas encore y faire face. Dans un premier temps, les États vont rester sans réagir. De 1929 à 1933, presque aucune mesure n’est prise alors que les banques font faillite les unes après les autres, par milliers. Le commerce mondial s’effondre littéralement. En 1933, une première réaction s’ébauche : il s’agit du premier New Deal 5 de Roosevelt. Ce plan de relance contient une politique de grands travaux et d’endettement étatique mais aussi une loi protectionniste, le "Buy American Act" ("loi Achetez américain") 6. Dès lors, tous les pays se lancent dans la course au protectionnisme. Le commerce mondial, pourtant déjà mal en point, subit encore un choc. Par leurs mesures, les bourgeoisies ont finalement aggravé la crise mondiale dans les années 1930.
Aujourd’hui, toutes les bourgeoisies veulent donc éviter que ne se répète ce cercle vicieux crise-protectionnisme-crise… Elles ont conscience de devoir tout faire pour ne pas répéter les erreurs du passé. Il fallait impérativement que ce G20 affiche l’unité des grandes puissances contre la crise, en particulier pour soutenir le système financier international. Le FMI a même consacré un point spécifique de son "Document de travail" préparatoire au G20 pour mettre en garde contre ce danger du chacun pour soi 7. Il s’agit du point 13 intitulé "Le spectre du protectionnisme commercial et financier est une préoccupation croissante" : "Nonobstant les engagements pris par les pays du G20 [celui de novembres 2008] de ne pas recourir à des mesures protectionnistes, d’inquiétants dérapages ont eu lieu. Les lignes sont floues entre l’intervention publique visant à contenir l’impact de la crise financière sur les secteurs en difficulté et les subventions inappropriées aux industries dont la viabilité à long terme est discutable. Certaines politiques de soutien à la finance conduisent également les banques à orienter le crédit vers leur pays. Dans le même temps, il y a des risques croissants que certains pays émergents confrontés à des pressions extérieures sur leurs comptes cherchent à imposer des contrôles de capitaux." Et le FMI n’a pas été le seul à lancer de tels avertissements : "Je crains [qu’un] retour généralisé au protectionnisme soit probable, les pays déficitaires, comme les États-Unis, trouvant là le moyen de renforcer la demande de la production intérieure et le niveau d’emploi. […] Il s’agit d’un moment décisif. Des choix doivent être faits entre se tourner vers l’extérieur ou se replier vers des solutions internes. Nous avons tenté cette deuxième option dans les années 1930. Cette fois, nous devons tenter la première." (Martin Wolf, devant la Commission des Affaires Étrangères du Sénat des États-Unis, le 25 mars 2009 8).
Le G20 a entendu le message : les dirigeants du monde ont su présenter une apparence d’unité et inscrire dans leur communiqué final : "Nous ne répéterons pas les erreurs du passé". Il s’en est suivi un véritable "ouf" international de soulagement. Comme l’écrit le journal économique français Les Échos du 3 avril, "la première conclusion qui s'impose à propos du G20 qui s'est tenu hier dans la capitale britannique, c'est qu'il n'a pas échoué, et que c'est déjà beaucoup. Après les tensions de ces dernières semaines, les vingt grandes économies de la planète ont affiché leur unité" face à la crise.
Concrètement, les pays se sont engagés à ne pas mettre en place de barrières, y compris sur les flux financiers, et ont mandaté l'OMC pour qu'elle vérifie scrupuleusement que cet engagement soit respecté. Par ailleurs, 250 milliards de dollars vont être mis à disposition d'agences de soutien à l'export ou d'agences d'investissement afin d'aider à la reprise du commerce international. Mais surtout, la montée des tensions n’a pas pourri ce sommet au point de le transformer ostensiblement en pugilat. L’apparence est restée sauve. Voilà le seul succès du G20. Et encore, un succès certainement temporaire tant l’aiguillon de la crise va continuer d’attiser inexorablement la désunion internationale.
L’endettement d’aujourd’hui prépare les crises de demain
Depuis l’été 2007, et la fameuse crise des "subprimes", les plans de relance se succèdent à un rythme effréné. Les premières fois que furent annoncées des injections massives de milliards de dollars, un vent d’optimisme souffla momentanément. Mais aujourd’hui, la crise ayant continué de s’aggraver inexorablement, chaque nouveau plan est accueilli avec de plus en plus de scepticisme. Paul Jorion, sociologue spécialisé en économie (et qui est l’un des premiers à avoir annoncé la catastrophe économique), raille ainsi cette répétition d’échecs : "On est passé insensiblement des petits coups de pouce de 2007 d’un montant chiffré en milliards d’euros ou de dollars aux gros coups de pouce du début 2008, puis aux coups de pouce énormes de la fin de l’année se chiffrant désormais en centaines de milliards. Quant à 2009, c’est l’année des "kolossal" coups de pouce, aux montants exprimés cette fois en "trillions" d’euros ou de dollars. Et malgré l’ambition de plus en plus pharaonique, toujours pas la moindre lueur au bout du tunnel !" 9.
Et que propose le G20 ? Une nouvelle surenchère tout aussi inefficace ! 5 000 milliards de dollars vont être injectés dans l'économie mondiale d'ici la fin 2010 10. La bourgeoise n’a aucune autre "solution" à avancer et révèle par là-même son impuissance 11. La presse internationale ne s’y est d’ailleurs pas trompée : "La crise est en effet loin d'être finie et il faudrait être naïf pour croire que les décisions du G20 vont tout changer" (La Libre Belgique), "Ils ont failli à un moment où l’économie mondiale est en train d’imploser " (New York Times), "La relance les a laissés de marbre au sommet du G20 " (Los Angeles Times)
Les estimations de l’OCDE pour 2009, pourtant si optimistes d’habitude, ne laissent d’ailleurs guère de doute à propos de ce qui va venir frapper l’humanité dans les mois à venir, avec ou sans G20. D’après elle, les États-Unis devraient connaître une récession de 4%, la Zone euro de 4,1% et le Japon de 6,6 ! La Banque mondiale, de son côté, a affirmé, lundi 30 mars, attendre pour 2009 "une contraction de 1,7% du PIB mondial, ce qui constituerait le plus fort recul jamais enregistré de la production globale". La situation va donc certainement encore s'aggraver dans les mois à venir alors que la crise actuelle est déjà pire que celle de 1929. Les économistes Barry Eichengreen et Kevin O'Rourke ont ainsi calculé que la chute de la production industrielle mondiale était, depuis neuf mois, aussi violente qu'en 1929, que la chute des cours de Bourse était deux fois plus rapide, de même que le recul du commerce mondial 12.
Tous ces chiffres ont une réalité bien concrète et dramatique pour des millions d’ouvriers de par le monde. Aux États-Unis, première puissance mondiale, 663 000 emplois ont encore été détruits au mois de mars ce qui porte le total à 5,1 millions d’emplois détruits en 2 ans. Tous les pays sont aujourd’hui durement touchés par la crise. En Espagne, par exemple, le chômage devrait dépasser les 17% en 2009 !
Mais cette politique n’est pas simplement inefficace aujourd’hui, elle prépare aussi des crises plus violentes encore pour l’avenir. En effet, tous ces milliards sont créés en recourant massivement à l’endettement. Or, ces dettes, il faudra bien un jour (pas si lointain) essayer de les rembourser. Même les bourgeois le disent : "Il est clair que les conséquences de cette crise c'est qu'il va falloir payer une facture : il va y avoir des pertes de richesse, des pertes de patrimoine, des pertes de revenus, des pertes d'emplois, il n'est pas pensable, ce serait démagogiqu,e de dire que personne au monde ne va payer tout ou partie de cette facture" (Henri Guaino, conseiller spécial du Président de la République en France, le 03 avril dernier) 13. En accumulant les dettes, c’est finalement l’avenir économique que le capitalisme met en hypothèque.
Et que dire de tous ces journalistes qui se sont félicités de l’importance retrouvée du FMI ? Ses moyens financiers ont été triplés par le G20, en étant portés à 750 milliards de dollars avec, de plus, l'autorisation d’émission de Droits de Tirages Spéciaux (DTS) 14 pour 250 milliards de dollars. On comprend pourquoi son président, Dominique Strauss-Kahn, a déclaré qu’il s’agissait là du "plus grand plan de relance coordonné jamais décidé" dans l'histoire. Mission lui a été donnée "d’aider les plus faibles", en particuliers les pays de l’Est qui sont au bord de la faillite. Mais le FMI est une drôle de planche de salut. La réputation – justifiée – de cette organisation est d'imposer une austérité draconienne en contrepartie de son "aide". Restructurations, licenciements, chômage, suppression des allocations santé, retraite… telle est "l’effet FMI". Cette organisation s’est portée, par exemple, au chevet de l’Argentine dans les années 1990 jusqu’à… l’effondrement de cette économie en 2001 !
Non seulement, ce G20 n’a donc pas éclairci le ciel capitaliste mais il a laissé entrevoir des lendemains encore plus sombres.
Le grand bluff de la moralisation du capitalisme
Compte tenu de l’incapacité patente de ce G20 à proposer de réelles solutions pour l’avenir, il était bien difficile pour la bourgeoisie de promettre un retour rapide à la croissance et des lendemains radieux. Or, il y a dans les rangs ouvriers un profond dégoût pour ce capitalisme et une réflexion croissante sur l’avenir. La classe dominante s’est donc empressée de répondre, à sa façon, à ce questionnement. Avec tambours et trompettes, ce G20 a promis un nouveau capitalisme, mieux régulé, plus moral, plus écologique…
La manœuvre est tellement grosse qu’elle en est ridicule. En guise de moralisation du capitalisme, le G20 a fait les gros yeux à quelque "paradis fiscaux", en menaçant d’éventuelles sanctions, auxquelles il allait réfléchir d’ici la fin de l’année (sic !), les pays ne faisant pas d’effort de "transparence". Ont été pointés du doigt quatre territoires constituant la désormais célèbre "liste noire" : le Costa Rica, la Malaisie, les Philippines et l'Uruguay. D’autres nations ont été sermonnées et classées en "liste grise". Y figurent, par exemples, l'Autriche, la Belgique, le Chili, le Luxembourg, Singapour et la Suisse.
Autrement dit, les principaux "paradis fiscaux" manquent à l’appel ! Les îles Caïmans et ses hedge funds, les territoires dépendants de la couronne britannique (Guernesey, Jersey, île de Man), la City de Londres, les États fédérés américains comme le Delaware, le Nevada ou le Wyoming… tous ceux-là sont officiellement blancs comme neige (et figurent donc dans la liste blanche). Avec ce classement des paradis fiscaux par le G20, c’est un peu comme si l’hôpital se moquait de la charité.
Comble de l’hypocrisie, quelques jours seulement après le sommet de Londres, l'OCDE – responsable de cette classification – a annoncé le retrait des quatre pays de la liste noire, en échange de promesses d’effort de transparence !
Il n’y a dans toute cette histoire rien d’étonnant. Comment tous ces grands responsables capitalistes, véritables gangsters sans foi ni loi, pourraient-ils "moraliser" quoi que ce soit 15 ? Et comment un système basé sur l’exploitation et la recherche du profit pour le profit pourrait-il être plus "moral" ? Personne ne s'attendait d’ailleurs sérieusement à voir sortir de ce G20 un "capitalisme plus humain". Cela n'existe pas et les dirigeants politiques en parlent comme les parents parlent du Père Noël à leurs enfants. Ces temps de crise révèlent au contraire, encore plus crûment, le visage inhumain de ce système. Il y a presque 130 ans, Paul Lafargue écrivait "la morale capitaliste […] frappe d'anathème la chair du travailleur ; elle prend pour idéal de réduire le producteur au plus petit minimum de besoins, de supprimer ses joies et ses passions et de le condamner au rôle de machine délivrant du travail sans trêve ni merci" (in Le droit à la paresse) ou plutôt, pourrions nous rajouter, la seule « trêve » possible est celle du chômage et de la misère. Quand la crise économique frappe, les travailleurs sont licenciés et jetés à la rue comme des objets devenus inutiles. Le capitalisme est et sera toujours un système d'exploitation brutal et barbare.
Mais la grossièreté de la manœuvre est en elle-même révélatrice. Cela démontre qu’ils n’ont vraiment plus rien à proposer, que le capitalisme n’apportera plus rien de bon à l’humanité, juste plus de misère et de souffrance. Et il n’y a pas plus de chance de voir naître un "capitalisme écologique" ou "un capitalisme moral" que de voir les alchimistes transformer le plomb en or.
Si ce G20 montre bien une chose c’est qu’un autre monde capitaliste n’est pas possible. Il est probable que la crise va connaître des hauts et des bas, avec parfois des moments ponctuels de retour à la croissance. Mais, fondamentalement, le capitalisme va continuer à sombrer économiquement, en semant la misère et en engendrant des guerres.
Il n’y a rien à attendre de ce système. La bourgeoisie, avec ses sommets internationaux et ses plans de relance, ne fait pas partie de la solution mais du problème. Seule la classe ouvrière peut changer le monde, mais il lui faut pour cela reprendre confiance en la société qu’elle peut faire naître : le communisme !
Mehdi (16 avril 2009)
1. Déclaration de Pascal Lamy, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce.
2. Rapport intermédiaire de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques.
3. Le G20 est composé des membres du G8 (Allemagne, France, ÉtatÉtats-Unis, Japon, Canada, Italie, Royaume-Uni, Russie) auxquels s’ajoutent l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, la Turquie et enfin l’Union Européenne. Un premier sommet s’était tenu en novembre 2008, en pleine tourmente financière.
4. Lire notre série d’articles "Comprendre la décadence du capitalisme [27]".
5. Un mythe est aujourd’hui largement répandu, celui selon lequel le New Deal de 1933 aurait permis à l’économie mondiale de sortir du marasme économique. Et, conclusion logique, d’en appeler aujourd’hui à un "New New Deal". Mais en réalité, l’économie américaine, de 1933 à 1938, va rester particulièrement atone ; c’est le second New Deal, celui de 1938, qui va permettre véritablement de relancer la machine. Or, ce second New Deal ne fut rien d’autre que le début de l’économie de guerre (qui prépara la Seconde guerre mondiale). On comprend pourquoi ce fait est passé très largement sous silence !
6. Cette loi impose l'achat de biens produits sur le territoire américain pour les achats directs effectués par le gouvernement américain.
7. Source : contreinfo.info/prnart.php3?id_article=2612
8. Martin Wolf est un journaliste économique britannique. Il est rédacteur associé et commentateur économique en chef au Financial Times.
9. "L’ère des ‘Kolossal’ coups de pouce", publié le 7 avril.
10. En réalité, pour 4 000 milliards, il s’agit des dollars des plans de relance déjà annoncés ces derniers mois.
11. Au Japon, un nouveau plan de relance de 15.400 milliards de yens (116 milliards d'euros) vient d’être décidé. C'est le quatrième programme de relance élaboré par Tokyo en l'espace d'un an !
13. Sur le rôle de l’endettement dans le capitalisme et ses crises, lire l’article de notre Revue précédente "La plus grave crise économique de l’histoire du capitalisme [29]".
14. Les DTS sont un panier monétaire constitué de dollars, d’euros, de yen et de livres sterling.
C’est la Chine qui, tout particulièrement, a insisté pour que soient tirés ces DTS. Ces dernières semaines, l’Empire du milieu a multiplié les déclarations officielles en appelant à la création d’une monnaie internationale pouvant remplacer le dollar. Et de nombreux économistes à travers le monde ont relayé cet appel, en avertissant de la chute inexorable de la monnaie américaine et des secousses économiques qui vont s’en suivre.
Il est vrai que l’affaiblissement du dollar, au fur et à mesure que l’économie américaine s’enfonce dans la récession, est un vrai danger pour l’économie mondiale. En tant que référence internationale, elle est l’un des piliers de la stabilité capitaliste depuis l’après-guerre. Par contre, l’émergence d’une nouvelle monnaie de référence (que ce soit l’Euro, le Yen, la Livre sterling ou les DTS du FMI) est totalement illusoire. Aucune puissance ne va venir remplacer les États-Unis, aucune ne va jouer son rôle de stabilisateur économique international. L’affaiblissement de l’économie américaine et de sa monnaie signifie donc un désordre monétaire croissant.
15 Lénine qualifiait la Société Des Nations, autre institution internationale, de "repaire de brigands".
Récent et en cours:
- Crise économique [13]
Darwinisme et marxisme I (Anton Pannekoek)
- 6206 lectures
L'année 2009 a été décrétée partout dans le monde, tant par les institutions scientifiques que par les maisons d'édition et les médias, "Année Darwin". En effet, elle correspond au bicentenaire de la naissance de Charles Darwin (12 février 1809) et au cent-cinquantenaire de la publication du premier de ses ouvrages fondamentaux, "Sur l'Origine des Espèces au moyen de la Sélection Naturelle", paru le 24 novembre 1859. À l'heure actuelle, nous sommes donc face à une multitude de conférences, de livres, de revues et d'émissions de télévision traitant de Darwin et de sa théorie qui, s'ils permettent quelquefois de se faire une idée plus précise de cette dernière, aboutissent bien souvent à l'entourer d'un brouillard épais dans lequel il est difficile de s'orienter. Cela tient en partie au fait que beaucoup d'auteurs, de conférenciers et de journalistes, qui sont présentés comme "spécialistes de Darwin", n'en connaissaient rien il y a un an et que, pour eux et leurs employeurs, l'Année Darwin est surtout une bonne occasion, grâce à une lecture rapide de quelques articles de Wikipédia, d'accroître leur notoriété ou leurs revenus. Mais il existe une autre cause à ce phénomène de brouillage des conceptions de Darwin. En effet, dès leur exposition dans "L'Origine des espèces", celles-ci ont constitué un enjeu idéologique et politique de premier ordre, notamment parce qu'elles portaient un coup sévère aux dogmes religieux de l'époque mais aussi parce qu'elles ont été immédiatement instrumentalisées par différents idéologues de la bourgeoisie. Et ces enjeux sont présents, aujourd'hui encore, dans les interprétations et falsifications multiples dont la théorie de Darwin continue de faire l'objet. Afin de permettre à nos lecteurs d'y voir un peu plus clair, nous republions en deux parties la brochure d'Anton Pannekoek, "Darwinisme et Marxisme", écrite en 1909 à l'occasion du centenaire de la naissance de Darwin et qui reste, pour l'essentiel, toujours d'actualité. Le marxisme s'est toujours intéressé à l'évolution des sciences comme faisant partie intégrante du développement des forces productives de la société et aussi parce qu'il considérait que la perspective du communisme ne pouvait se baser simplement sur une exigence morale de justice, comme c'était le cas pour nombre de "socialistes utopiques" du passé, mais sur une connaissance scientifique de la société humaine et de la nature à laquelle elle appartient. C'est pour cela que, bien avant la publication de la brochure de Pannekoek, Marx lui-même avait dédicacé, en juin 1873, un exemplaire de son œuvre principale, Le Capital, à Charles Darwin. En effet, Marx et Engels avaient reconnu dans sa théorie de l'évolution dans le domaine de l'étude des organismes vivants, une démarche analogue à celle du matérialisme historique comme l'attestent ces deux extraits de leur correspondance :
"Ce Darwin, que je suis en train d'étudier, est tout à fait sensationnel. On n'avait jamais fait une tentative d'une telle envergure pour démontrer qu'il y a un développement historique dans la nature." (Engels à Marx, 11 décembre 1859)
"Voilà le livre qui contient la base, en histoire naturelle, pour nos idées." (Marx à Engels, 19 décembre 1860) 1
Le texte de Pannekoek, rédigé avec une très grande simplicité, nous fournit un excellent résumé de la théorie de l'évolution des espèces. Mais Pannekoek n'était pas seulement un homme de science érudit (il était un astronome réputé). Il était avant tout un marxiste et un militant du mouvement ouvrier. C'est pour cela que sa brochure "Darwinisme et Marxisme" s'efforce de critiquer toute tentative d'appliquer schématiquement et mécaniquement la théorie de Darwin de la sélection naturelle à l'espèce humaine. Pannekoek met clairement en évidence les analogies entre marxisme et darwinisme et il rend compte de l'utilisation de la théorie de la sélection naturelle par les secteurs les plus progressistes de la bourgeoisie contre les vestiges réactionnaires de la féodalité. Mais il critique également l'exploitation frauduleuse par la bourgeoisie de la théorie de Darwin contre le marxisme, notamment les dérives du "darwinisme social", idéologie développée en particulier par le philosophe britannique Herbert Spencer (et reprise aujourd'hui par les idéologues du libéralisme pour justifier la concurrence capitaliste, la loi de la jungle, le chacun pour soi et l'élimination des plus faibles).
Face au retour des croyances obscurantistes issues de la nuit des temps, et notamment du "créationnisme" avec son avatar du "dessein intelligent" selon lequel l'évolution des organismes vivants (et l'apparition de l'homme lui-même) correspondrait à un "plan" préétabli par une "intelligence supérieure" d'essence divine, il appartient aux marxistes de réaffirmer le caractère scientifique et matérialiste de la théorie de Darwin et de souligner le pas considérable qu'elle a fait accomplir aux sciences de la nature.
Bien évidemment, la brochure de Pannekoek doit être resituée dans le contexte des connaissances scientifiques de son époque et certaines de ses vues, développées dans sa seconde partie (que nous publierons dans le prochain numéro de la Revue Internationale), sont aujourd'hui quelque peu dépassées par un siècle de recherches et de découvertes scientifiques (notamment celles de la paléoanthropologie et de la génétique). Mais pour l'essentiel, sa contribution2 (rédigée en néerlandais, et qui n'a pas, jusqu'à ce jour, été traduite en français) reste un apport inestimable à l'histoire du mouvement ouvrier.
CCI (19 avril 2009)
Brochure d'Anton Pannekoek
I Le darwinisme
Peu de scientifiques ont autant marqué la pensée de la deuxième moitié du 19e siècle que Darwin et Marx. Leurs apports ont révolutionné la conception que les masses se faisaient du monde. Pendant des décennies, leurs noms ont été sur toutes les bouches et leurs travaux sont au centre des luttes intellectuelles qui accompagnent les luttes sociales d'aujourd'hui. La raison en réside dans le contenu hautement scientifique de ces travaux.
L'importance scientifique du marxisme de même que du darwinisme réside dans leur fidélité rigoureuse à la théorie de l'évolution, portant, pour l'un, sur le domaine du monde organique, celui des objets animés, pour l'autre, sur le domaine de la société. Cette théorie de l'évolution n’était cependant nullement nouvelle : elle avait eu ses avocats avant Darwin et Marx ; le philosophe Hegel en avait même fait le point central de sa philosophie. Il est donc nécessaire d'examiner de près les apports de Darwin et de Marx dans ce domaine.
La théorie suivant laquelle les plantes et les animaux se sont développés les uns à partir des autres se rencontre pour la première fois au 19e siècle. Auparavant, à la question : "D'où viennent les milliers et les centaines de milliers de différentes sortes de plantes et d'animaux que nous connaissons ?", on répondait : "Aux temps de la création, Dieu les a tous créés, chacun selon son espèce". Cette théorie primitive était conforme à l'expérience acquise et aux meilleures données qui étaient disponibles sur le passé. Selon ces données, toutes les plantes et tous les animaux connus avaient toujours été identiques. Sur le plan scientifique, l’expérience était exprimée de la façon suivante : "Toutes les espèces sont invariables parce que les parents transmettent leurs caractéristiques à leurs enfants".
Cependant, du fait de certaines particularités parmi les plantes et les animaux, il devint nécessaire d'envisager une autre conception. Aussi ces particularités ont-elles été joliment organisées selon un système qui fut d'abord établi par le scientifique suédois Linné. Selon ce système, les animaux sont divisés en règnes (phylum), eux-mêmes divisés en classes, les classes en ordres, les ordres en familles, les familles en genres, chaque genre contenant des espèces. Plus les caractéristiques des êtres vivants sont semblables, plus, dans ce système, ils sont proches les uns des autres, et plus le groupe auquel ils appartiennent est petit. Tous les animaux classés comme mammifères présentent les mêmes caractéristiques générales dans leur forme corporelle. Les animaux herbivores, les carnivores et les singes qui appartiennent à des ordres différents, sont à nouveau différenciés. Les ours, les chiens et les chats, qui sont des animaux carnivores, ont beaucoup plus de points communs dans leur forme corporelle qu'ils n’en ont avec les chevaux ou les singes. Cette similarité augmente de façon évidente quand on examine des variétés de même espèce ; le chat, le tigre et le lion se ressemblent à bien des égards et diffèrent des chiens et des ours. Si nous quittons la classe des mammifères pour nous tourner vers d'autres classes, comme celles des oiseaux ou des poissons, nous trouvons de plus grandes différences entre les classes qu'au sein d’une classe. Il persiste cependant toujours une ressemblance dans la formation du corps, du squelette et du système nerveux. Ces caractéristiques disparaissent quand nous quittons cette division principale qui embrasse tous les vertébrés, pour nous tourner vers les mollusques (animaux à corps mou) ou les polypes.
L’ensemble du monde animal peut donc être organisé en divisions et subdivisions. Si chaque espèce différente d'animal avait été créée totalement indépendamment des autres, il n’y aurait aucune raison pour que de telles catégories existent. Il n'y aurait aucune raison pour qu'il n'y ait pas de mammifères à six pattes. Il faudrait donc supposer qu'au moment de la création, Dieu aurait suivi le plan du système de Linné et aurait tout créé selon ce plan. Heureusement, nous disposons d’une autre explication. La similarité dans la construction du corps peut être due à un vrai rapport de parenté. Selon cette conception, la similarité des particularités indique dans quelle mesure le rapport est proche ou éloigné, tout comme la ressemblance entre frères et sœurs est plus grande qu'entre parents plus éloignés. Les espèces animales n'ont donc pas été créées de façon individuelle, mais sont descendues les unes des autres. Elles forment un tronc qui a commencé sur des bases simples et qui s'est continuellement développé ; les dernières branches, les plus minces, sont constituées par les espèces existant aujourd'hui. Toutes les espèces de chats descendent d'un chat primitif qui, comme le chien primitif et l'ours primitif, est le descendant d'un certain type primitif d'animal carnivore. L'animal carnivore primitif, l'animal à sabots primitif et le singe primitif sont descendus d'un mammifère primitif, etc.
Cette théorie de la filiation a été défendue par Lamarck et par Geoffroy St. Hilaire. Cependant, elle n'a pas rencontré l'approbation générale. Ces naturalistes n’ont pas pu prouver la justesse de cette théorie et, par conséquent, elle est restée à l'état d'hypothèse, de simple supposition. Mais lorsque Darwin est arrivé, avec son oeuvre principale, L’Origine des Espèces, celle-ci a frappé les esprits comme un coup de tonnerre ; sa théorie de l'évolution a été immédiatement acceptée comme une vérité hautement démontrée. Depuis lors, la théorie de l'évolution est devenue inséparable du nom de Darwin. Pourquoi en est-il ainsi ?
C'est en partie dû au fait qu'avec l'expérience, on a accumulé de plus en plus de matériel à l’appui de cette théorie. On a trouvé des animaux qu'on ne pouvait pas situer clairement dans la classification, comme les mammifères ovipares, des poissons ayant des poumons, et des animaux vertébrés sans vertèbres. La théorie de la filiation affirmait que c'étaient simplement des vestiges de la transition entre les groupes principaux. Les fouilles ont révélé des restes fossilisés qui semblaient différents des animaux vivant de nos jours. Ces restes se sont en partie avérés être les formes primitives des animaux de notre époque et ont montré que les animaux primitifs ont graduellement évolué pour devenir les animaux d'aujourd’hui. Puis la théorie cellulaire s'est développée ; chaque plante, chaque animal se compose de millions de cellules et s'est développé par division et différentiation incessantes à partir de cellules uniques. Une fois arrivé aussi loin, penser que les organismes les plus développés sont descendus d’êtres primitifs constitués d’une seule cellule, n'apparaissait plus comme aussi étrange.
Toutes ces nouvelles expériences, cependant, ne pouvaient pas élever la théorie à un niveau de vérité démontrée. La meilleure preuve de l'exactitude de cette théorie aurait été de pouvoir observer de nos yeux une véritable transformation d'une espèce animale en une autre. Mais c'est impossible. Comment donc démontrer qu'une espèce animale se transforme en d'autres ? On peut le faire en montrant la cause, la force qui propulse un tel développement. Cela, Darwin l’a fait. Darwin a découvert le mécanisme du développement animal et, ce faisant, il a prouvé que, dans certaines conditions, certaines espèces animales se transformaient nécessairement en d'autres espèces animales. Nous allons maintenant clarifier ce mécanisme.
Son principal fondement est la nature de la transmission, le fait que les parents transmettent leurs particularités à leurs enfants mais, qu'en même temps, les enfants divergent de leurs parents à certains égards et diffèrent également entre eux. C'est pour cette raison que les animaux de la même espèce ne sont pas tous semblables, mais diffèrent dans toutes les directions à partir d'un type moyen. Sans cette variation, il serait totalement impossible qu’une espèce animale se transforme en une autre. Ce qui est nécessaire à la formation d’une nouvelle espèce, c'est que la divergence à partir du type central grandisse et qu'elle se poursuive dans la même direction jusqu'à devenir si importante que le nouvel animal ne ressemble plus à celui dont il est descendu. Mais quelle est cette force qui susciterait une variation croissante toujours dans la même direction ?
Lamarck a déclaré que le changement était dû à l'usage et à l'utilisation intense de certains organes ; qu’à cause de l’exercice continu de certains organes, ceux-ci se perfectionnaient de plus en plus. Tout comme les muscles des jambes des hommes se renforcent à courir beaucoup, de la même manière le lion a acquis des pattes puissantes et le lièvre des pattes véloces. De la même manière, les girafes ont développé leur long cou pour atteindre et manger les feuilles des arbres ; à force d’étendre leur cou, certains animaux à cou court ont développé un long cou de girafe. Pour beaucoup, cette explication n'était pas crédible et elle ne rendait pas compte du fait que la grenouille devait être verte pour assurer sa protection.
Pour résoudre cette question, Darwin s'est tourné vers un autre champ d'expérience. L'éleveur et l'horticulteur sont capables de développer de façon artificielle de nouvelles races et de nouvelles variétés. Quand un horticulteur veut développer, à partir d'une certaine plante, une variété ayant de grandes fleurs, tout ce qu'il doit faire est de supprimer, avant maturité, toutes les plantes ayant de petites fleurs et préserver celles qui en ont des grandes. S'il répète ceci pendant quelques années d'affilée, les fleurs seront toujours plus grandes, parce que chaque nouvelle génération ressemble à la précédente, et notre horticulteur, ayant toujours sélectionné les plus grandes d’entre les grandes, dans un but de propagation, réussit à développer une plante ayant des fleurs très grandes. Par une telle action, parfois délibérée et parfois accidentelle, les hommes ont développé un grand nombre de races de nos animaux domestiques qui diffèrent de leur forme d'origine bien davantage que les espèces sauvages ne diffèrent entre elles.
Si nous demandions à un éleveur de développer un animal à cou long à partir d’un animal à cou court, cela ne lui semblerait pas impossible. Tout ce qu'il devrait faire, ce serait de sélectionner ceux ayant des cous relativement plus longs, de les croiser, de supprimer les jeunes aux cous rétrécis et de croiser à nouveau ceux qui ont un long cou. S'il répétait ceci à chaque nouvelle génération, le résultat serait que le cou deviendrait toujours plus long et qu’il obtiendrait un animal ressemblant à la girafe.
Ce résultat est atteint parce qu'il y a une volonté définie avec un objectif défini, qui, dans le but d'élever une certaine variété, choisit certains animaux. Dans la nature, il n'existe pas une telle volonté et toutes les variations vont être atténuées par le croisement ; il est donc impossible qu’un animal continue à s’écarter du tronc commun original et poursuive dans la même direction jusqu'à devenir une espèce entièrement différente. Quelle est donc la force, dans la nature, qui sélectionne les animaux comme le fait un éleveur ?
Darwin a médité longtemps sur ce problème avant de trouver sa solution dans la "lutte pour l'existence". Dans cette théorie, nous avons un reflet du système productif de l’époque où Darwin a vécu, parce que c’est le combat de la concurrence capitaliste qui lui a servi de modèle pour la lutte pour l'existence qui prévalait dans la nature. Ce n’est pas grâce à ses propres observations que cette solution s’est présentée à lui. Elle lui est venue de sa lecture des travaux de l'économiste Malthus. Malthus a essayé d'expliquer que c'est parce que la population augmente beaucoup plus rapidement que les moyens de subsistance existants qu'il y a tant de misère, de famine et de privations dans notre monde bourgeois. Il n'y a pas assez de nourriture pour tous : les individus doivent donc lutter les uns contre les autres pour leur existence, et beaucoup d’entre eux succombent dans cette lutte. Avec cette théorie, la concurrence capitaliste comme la misère existante étaient déclarées loi naturelle inévitable. Dans son autobiographie, Darwin déclare que c'est le livre de Malthus qui l'a incité à penser à la lutte pour l'existence.
"En octobre 1838, c'est-à-dire quinze mois après que j’eus commencé mon enquête systématique, il m’arriva de lire, pour me distraire, l’essai de Malthus sur la Population ; et comme j’étais bien préparé, du fait de mes observations prolongées sur les habitudes des animaux et des plantes, à apprécier la présence universelle de la lutte pour l’existence, je fus soudain frappé par l’idée que dans ces circonstances, les variations favorables auraient tendance à être préservées, et les défavorables à être anéanties. Le résultat de cela serait la formation de nouvelles espèces. J’avais donc trouvé là, enfin, une théorie pour travailler."
C'est un fait que l'augmentation des naissances chez les animaux excède celle de la quantité de nourriture nécessaire à leur subsistance. Il n'y a aucune exception à la règle suivant laquelle le nombre des êtres organiques tend à croître à une telle vitesse que notre terre serait rapidement débordée par la descendance d'un seul couple, si une partie de celle-ci n’était pas détruite. C'est pour cette raison qu'une lutte pour l'existence doit survenir. Chaque animal tente de vivre, fait de son mieux pour manger et cherche à éviter d'être mangé par d'autres. Avec ses particularités et ses armes spécifiques, il lutte contre tout le monde antagonique, contre les animaux, contre le froid, la chaleur, la sécheresse, les inondations, et d'autres circonstances naturelles qui peuvent menacer de le détruire. Par-dessus tout, il lutte contre les animaux de sa propre espèce, qui vivent de la même manière, possèdent les mêmes caractéristiques, utilisent les mêmes armes et vivent de la même alimentation. Cette lutte n'est pas directe ; le lièvre ne lutte pas directement contre le lièvre, ni le lion contre le lion à moins que ce soit une lutte pour la femelle - mais c'est une lutte pour l'existence, une course, une lutte compétitive. Tous ne peuvent atteindre l’âge adulte ; la plupart sont détruits, et seuls ceux qui remportent la course survivent. Mais quels sont ceux qui l'emportent ? Ceux qui, par leurs caractéristiques, par leur structure corporelle sont plus aptes à trouver de la nourriture ou échapper à l'ennemi ; en d'autres termes, ceux qui sont les mieux adaptés aux conditions existantes survivront. "Puisqu'il y a toujours plus d'individus qui naissent que de survivants, le combat pour la survie doit sans cesse recommencer et la créature qui possède un certain avantage par rapport aux autres survivra mais, comme ses caractéristiques particulières sont transmises aux nouvelles générations, c'est la nature elle-même qui choisit, et la nouvelle génération surgira avec des caractéristiques différentes de la précédente."
Ici nous avons un autre schéma pour comprendre l'origine de la girafe. Quand l'herbe ne pousse pas dans certains endroits, les animaux doivent se nourrir des feuilles des arbres, et tous ceux dont le cou est trop court pour atteindre ces feuilles vont périr. C'est la nature elle-même qui fait la sélection et la nature sélectionne seulement ceux qui ont de longs cous. Par référence à la sélection réalisée par l'éleveur, Darwin a appelé ce processus "la sélection naturelle".
Ce processus produit nécessairement de nouvelles espèces. Puisqu'il naît trop d'individus d’une même espèce, plus que les réserves de nourriture n'en permettent la subsistance, ils tentent en permanence de s’étendre sur une superficie plus vaste. Afin de se procurer leur nourriture, ceux qui vivent dans les bois vont vers les prairies, ceux qui vivent sur le sol vont dans l'eau, et ceux qui vivent sur la terre grimpent dans les arbres. Dans ces nouvelles conditions, une aptitude ou une variation est souvent appropriée alors qu’elle ne l’était pas avant, et elle se développe. Les organes changent avec le mode de vie. Ils s’adaptent aux nouvelles conditions et, à partir de l'ancienne espèce, une nouvelle se développe. Ce mouvement continu des espèces existantes se ramifiant en de nouvelles branches aboutit à l'existence de ces milliers d’animaux différents qui vont se différencier toujours plus.
De même que la théorie darwinienne explique ainsi la filiation générale des animaux, leur transmutation et leur formation à partir des êtres primitifs, elle explique, en même temps, l'adaptation merveilleuse qui existe dans toute la nature. Auparavant, cette merveilleuse adaptation ne pouvait s'expliquer que par la sage intervention de Dieu. Maintenant, cette filiation naturelle est clairement comprise. Car cette adaptation n’est rien d'autre que l'adaptation aux moyens d'existence. Chaque animal et chaque plante sont exactement adaptés aux circonstances existantes, car tous ceux qui y sont moins conformes, sont moins adaptés et sont exterminés dans la lutte pour l'existence. Les grenouilles vertes, qui proviennent des grenouilles brunes, doivent préserver leur couleur protectrice, car toutes celles qui dévient de cette couleur sont plus vite découvertes par leurs ennemis et sont détruites, ou elles éprouvent des difficultés plus grandes pour se nourrir et périssent.
C'est de cette façon que Darwin nous a montré, pour la première fois, que les nouvelles espèces se sont toujours formées à partir des anciennes. La théorie transformiste, qui n'était jusque là qu'une simple présomption induite à partir de nombreux phénomènes qu'on ne pouvait bien expliquer d'aucune autre façon, a gagné ainsi la certitude d'un fonctionnement nécessaire de forces spécifiques et que l'on pouvait prouver. C’est une des raisons principales pour laquelle cette théorie s'est imposée aussi rapidement dans les discussions scientifiques et a attiré l'attention du public.
II Le marxisme
Lorsqu'on se penche sur le marxisme, nous voyons immédiatement une grande ressemblance avec le darwinisme. Comme avec Darwin, l'importance scientifique du travail de Marx consiste en ceci qu'il a découvert la force motrice, la cause du développement social. Il n'a pas eu à démontrer qu'un tel développement avait lieu ; chacun savait que, depuis les temps les plus primitifs, de nouvelles formes sociales avaient toujours supplanté les anciennes ; mais les causes et les buts de ce développement restaient inconnus.
Dans sa théorie, Marx est parti des connaissances dont il disposait à son époque. La grande révolution politique qui a conféré à l'Europe l'aspect qu'elle a, la révolution française, était connue de chacun pour avoir été une lutte pour la suprématie, menée par la bourgeoisie contre la noblesse et la royauté. Après cette lutte, de nouvelles luttes de classes ont vu le jour. La lutte menée en Angleterre par les capitalistes industriels contre les propriétaires fonciers dominait la politique ; en même temps, la classe ouvrière se révoltait contre la bourgeoisie. Quelles étaient ces classes ? En quoi différaient-elles les unes des autres ? Marx a montré que ces distinctions de classe étaient dues aux différentes fonctions que chacune jouait dans le processus productif. C'est dans le processus de production que les classes ont leur origine, et c'est ce processus qui détermine à quelle classe on appartient. La production n'est rien d'autre que le processus de travail social par lequel les hommes obtiennent leurs moyens de subsistance à partir de la nature. C'est cette production des biens matériels nécessaire à la vie qui constitue le fondement de la société et qui détermine les relations politiques, les luttes sociales et les formes de la vie intellectuelle.
Les méthodes de production n'ont cessé de changer au cours du temps. D'où sont venus ces changements ? La façon de travailler et les rapports de production dépendent des outils avec lesquels les gens travaillent, du développement de la technique et des moyens de production en général. C'est parce qu'au Moyen-Âge on travaillait avec des outils rudimentaires, alors qu'aujourd'hui on travaille avec des machines gigantesques, qu'on avait à cette époque le petit commerce et le féodalisme, alors que maintenant on a le capitalisme. C'est également pour cette raison que, au Moyen-Âge, la noblesse féodale et la petite bourgeoisie étaient les classes les plus importantes, alors que maintenant la bourgeoisie et le prolétariat constituent les classes principales.
C'est le développement des outils, de ce matériel technique que les hommes mettent en oeuvre, qui est la cause principale, la force motrice de tout le développement social. Il va de soi que les hommes essayent toujours d'améliorer ces outils de sorte que leur travail soit plus facile et plus productif, et la pratique qu'ils acquièrent en utilisant ces outils, les amène à son tour à développer et perfectionner leur pensée. En raison de ce développement, un progrès, lent ou rapide, de la technique a lieu, qui transforme en même temps les formes sociales du travail. Ceci conduit à de nouveaux rapports de classe, à des institutions sociales nouvelles et à de nouvelles classes. En même temps, des luttes sociales, c'est-à-dire politiques, surgissent. Les classes qui dominaient dans l'ancien procès de production, tentent de préserver artificiellement leurs institutions, alors que les classes montantes cherchent à promouvoir le nouveau procès de production ; et en menant des luttes de classe contre la classe dirigeante et en conquérant le pouvoir, elles préparent le terrain pour un nouveau développement sans entrave de la technique.
Ainsi la théorie de Marx a révélé la force motrice et le mécanisme du développement social. Ce faisant, elle a montré que l'histoire n'est pas quelque chose erratique, et que les divers systèmes sociaux ne sont pas le résultat du hasard ou d'événements aléatoires, mais qu'il existe un développement régulier dans une direction définie. Il a aussi prouvé que le développement social ne cesse pas avec notre système, parce que la technique se développe continuellement.
Ainsi, les deux enseignements, celui de Darwin et celui de Marx, l'un dans le domaine du monde organique et l'autre dans le champ de la société humaine, ont élevé la théorie de l'évolution au niveau d'une science positive.
De ce fait, ils ont rendu la théorie de l'évolution acceptable pour les masses en tant que conception de base du développement social et biologique.
III. Le marxisme et la lutte de classe
Bien qu'il soit vrai que, pour qu'une théorie ait une influence durable sur l'esprit humain, elle doive avoir une valeur hautement scientifique, cela n'est cependant pas suffisant. Il est très souvent arrivé qu'une théorie scientifique de la plus grande importance pour la science, ne suscite aucun intérêt, sinon pour quelques hommes instruits. Tel fut le cas, par exemple, de la théorie de l’attraction universelle de Newton. Cette théorie est la base de l'astronomie, et c'est grâce à cette théorie que nous connaissons les astres et pouvons prévoir l'arrivée de certaines planètes et des éclipses. Cependant, lorsque la théorie de Newton sur l’attraction universelle est apparue, seuls quelques scientifiques anglais y ont adhéré. Les grandes masses n'ont prêté aucune attention à cette théorie. Elle n’a été connue des masses qu’avec un livre populaire de Voltaire, écrit un demi-siècle plus tard.
Il n'y a rien étonnant à cela. La science est devenue une spécialité pour un certain groupe d'hommes instruits, et ses progrès ne concernent que ces derniers, tout comme la fonderie est la spécialité du forgeron, et toute amélioration dans la fonderie du fer ne concerne que lui. Seule une connaissance dont tout le monde peut se servir et qui s'avère être une nécessité vitale pour tous peut gagner l’adhésion des grandes masses. Donc quand nous voyons qu'une théorie scientifique suscite enthousiasme et passion dans les grandes masses, ceci peut être attribué au fait que cette théorie leur sert d'arme dans la lutte de classe. Car c’est la lutte de classe qui mobilise la grande majorité de la société.
On peut constater cela de la façon la plus claire avec le marxisme. Si les enseignements économiques de Marx étaient sans importance pour la lutte de classe moderne, seuls quelques économistes professionnels y consacreraient du temps. Mais du fait que le marxisme sert d'arme aux prolétaires dans leur lutte contre le capitalisme, les luttes scientifiques se concentrent sur cette théorie. C'est grâce au service que cette dernière leur a rendu que des millions de personnes honorent le nom de Marx alors qu'elles connaissent pourtant très peu ses travaux, et que ce nom est méprisé par des milliers d’autres qui ne comprennent rien à sa théorie. C’est grâce au grand rôle que la théorie marxiste joue dans la lutte de classe que celle-ci est assidûment étudiée par les grandes masses et qu'elle domine l'esprit humain.
La lutte de classe prolétarienne existait avant Marx, car elle est le fruit de l'exploitation capitaliste. Il était tout à fait naturel que les ouvriers, étant exploités, pensent à un autre système de société où l'exploitation serait abolie et le revendiquent. Mais tout ce qu'ils pouvaient faire était de l'espérer et d'en rêver. Ils n'étaient pas certains qu'il puisse advenir. Marx a donné au mouvement ouvrier et au socialisme une fondation théorique. Sa théorie sociale a montré que les systèmes sociaux se développaient en un mouvement continu au sein duquel le capitalisme ne constituait qu'une forme temporaire. Son étude du capitalisme a montré que, du fait du perfectionnement constant de la technique, le capitalisme doit nécessairement céder la place au socialisme. Ce nouveau système de production ne peut être établi que par les prolétaires dans leur lutte contre les capitalistes dont l'intérêt est de maintenir l'ancien système de production. Le socialisme est donc le fruit et le but de la lutte de classe prolétarienne.
Grâce à Marx, la lutte de classe prolétarienne a pris une forme entièrement différente. Le marxisme est devenu une arme entre les mains des prolétaires ; à la place de vagues espoirs, il leur a donné un but positif et, en mettant clairement en évidence le développement social, il a donné de la force au prolétariat et, en même temps, il a créé la base pour la mise en oeuvre d'une tactique correcte. C'est à partir du marxisme que les ouvriers peuvent prouver le caractère transitoire du capitalisme ainsi que la nécessité et la certitude de leur victoire. En même temps, le marxisme a balayé les anciennes visions utopiques selon lesquelles le socialisme serait instauré grâce à l'intelligence et à la bonne volonté de l’ensemble des hommes sages, qui considéraient le socialisme comme une revendication de justice et de morale ; comme si l'objectif était d'établir une société infaillible et parfaite. La justice et la morale changent avec le système de production, et chaque classe s’en fait une conception différente. Le socialisme ne peut être obtenu que par la classe qui a intérêt au socialisme et ce n'est pas question de l'établissement d'un système social parfait, mais d’un changement dans les méthodes de production, menant à une étape supérieure, c’est-à-dire à la production sociale.
Puisque la théorie marxiste du développement social est indispensable aux prolétaires dans leurs luttes, les prolétaires cherchent à l'intégrer dans leur être ; elle domine leur pensée, leurs sentiments, toute leur conception du monde. Puisque le marxisme est la théorie du développement social, au sein duquel nous nous trouvons, le marxisme se tient donc à l’épicentre des grands combats intellectuels qui accompagnent notre révolution économique.
IV. Le darwinisme et la lutte de classe
Le fait que le marxisme a acquis son importance et sa position uniquement grâce au rôle qu’il occupe dans la lutte de classe prolétarienne est connu de tous. Avec le darwinisme, en revanche, les choses semblent différentes à un observateur superficiel, parce que le darwinisme traite d’une nouvelle vérité scientifique qui doit faire face à l'ignorance et aux préjugés religieux. Pourtant il n'est pas difficile de voir qu'en réalité, le darwinisme a dû subir les mêmes vicissitudes que le marxisme. Le darwinisme n'est pas une simple théorie abstraite qui aurait été adoptée par le monde scientifique après en avoir discuté et l'avoir mise à l'épreuve d'une façon purement objective. Non, immédiatement après son apparition, le darwinisme a eu ses avocats enthousiastes et ses adversaires passionnés ; le nom de Darwin aussi a été, soit honoré par les personnes qui avaient compris quelque chose à sa théorie, soit décrié par d'autres qui ne connaissaient rien de sa théorie sinon que «l’homme descend du singe» et qui étaient incontestablement incompétents pour juger d'un point de vue scientifique l'exactitude ou la fausseté de la théorie de Darwin. Le darwinisme aussi a joué un rôle dans la lutte de classe, et c’est à cause de ce rôle qu'il s’est répandu aussi rapidement et a eu des partisans enthousiastes et des adversaires acharnés.
Le darwinisme a servi d'instrument à la bourgeoisie dans son combat contre la classe féodale, contre la noblesse, les droits du clergé et les seigneurs féodaux. C'était une lutte entièrement différente de la lutte que mènent les prolétaires aujourd'hui. La bourgeoisie n'était pas une classe exploitée luttant pour supprimer l'exploitation. Oh non ! Ce que la bourgeoisie voulait, c’était se débarrasser des vieilles puissances dominantes qui se trouvaient en travers de sa route. La bourgeoisie voulait gouverner elle-même, et elle basait ses exigences sur le fait qu'elle était la classe la plus importante qui dirigeait l'industrie. Quels arguments pouvait lui opposer l'ancienne classe, la classe qui n'était devenue qu'un parasite inutile ? Cette dernière s’appuyait sur la tradition, sur ses anciens droits «divins». C'étaient là ses piliers. Grâce à la religion, les prêtres maintenaient la grande masse dans la soumission et la préparaient à s'opposer aux exigences de la bourgeoisie.
C’était donc pour défendre ses propres intérêts que la bourgeoisie se trouvait contrainte de saper le droit «divin» des gouvernants. Les sciences naturelles sont devenues une arme pour s'opposer à la croyance et à la tradition ; la science et les lois de la nature nouvellement découvertes ont été mises en avant ; c’est avec ces armes que la bourgeoisie a mené le combat. Si les nouvelles découvertes pouvaient montrer que ce que les prêtres enseignaient était faux, l'autorité «divine» de ces prêtres s'effriterait et les «droits divins» dont jouissait la classe féodale seraient détruits. Évidemment, la classe féodale n'a pas été vaincue seulement de cette façon ; le pouvoir matériel ne peut être renversé que par le pouvoir matériel ; mais les armes intellectuelles deviennent des armes matérielles. C'est pour cette raison que la bourgeoisie ascendante a accordé une telle importance à la science de la nature.
Le darwinisme est arrivé au bon moment. La théorie de Darwin, selon laquelle l'homme est le descendant d'un animal inférieur, détruisait tout le fondement du dogme chrétien. C'est pour cette raison que, dès que le darwinisme a fait son apparition, la bourgeoisie s’en est emparée avec beaucoup de zèle.
Ce ne fut pas le cas en Angleterre. Ici, nous voyons à nouveau à quel point la lutte de classe était importante pour la propagation de la théorie de Darwin. En Angleterre, la bourgeoisie dominait déjà depuis plusieurs siècles et, dans l’ensemble, elle n’avait aucun intérêt à attaquer ou à détruire la religion. C'est pour cette raison que, bien que cette théorie ait été largement lue en Angleterre, elle n'y a passionné personne ; elle a simplement été considérée comme une théorie scientifique sans grande importance pratique. Darwin lui-même la considérait comme telle et, de peur que sa théorie ne choque les préjugés religieux régnants, il a volontairement évité de l'appliquer immédiatement aux hommes. C’est seulement après de nombreux ajournements et après que d'autres l'aient fait avant lui, qu'il a décidé de franchir ce pas. Dans une lettre à Haeckel, il déplorait le fait que sa théorie doive heurter tant de préjugés et rencontre tant d’indifférence de sorte qu'il ne s’attendait pas à vivre assez longtemps pour la voir surmonter ces obstacles.
Mais en Allemagne, les choses étaient totalement différentes ; et Haeckel a répondu avec raison à Darwin qu'en Allemagne, la théorie darwinienne avait rencontré un accueil enthousiaste. En fait, lorsque la théorie de Darwin parut, la bourgeoisie s’apprêtait à mener une nouvelle attaque contre l'absolutisme et les junkers. La bourgeoisie libérale était dirigée par les intellectuels. Ernest Haeckel, un grand scientifique et, en outre, des plus audacieux, a immédiatement tiré dans son livre, Natürliche Schöpfungsgeschichte, les conclusions les plus audacieuses contre la religion. Ainsi, alors que le darwinisme rencontrait l’accueil le plus enthousiaste de la part de la bourgeoisie progressiste, il était aussi âprement combattu par les réactionnaires.
La même lutte eut lieu également dans d'autres pays européens. Partout, la bourgeoisie libérale progressiste devait lutter contre des forces réactionnaires. Les réactionnaires détenaient ou tentaient d'obtenir, avec l’aide de leurs soutiens religieux, le pouvoir disputé. Dans ces circonstances, même les discussions scientifiques se menaient avec l'ardeur et la passion d'une lutte de classe. Les écrits qui parurent, pour ou contre Darwin, avaient donc un caractère de polémique sociale, malgré le fait qu’ils portaient les noms d’auteurs scientifiques. Beaucoup d’écrits populaires de Haeckel, si on les considère d'un point de vue scientifique, sont très superficiels, tandis que les arguments et les protestations de ses adversaires font preuve d’une sottise incroyable dont on ne peut trouver d'équivalent que dans les arguments utilisés contre Marx.
La lutte menée par la bourgeoisie libérale contre le féodalisme n'avait pas pour objectif d’être conduite à son terme. C'était en partie dû au fait que partout, des prolétaires socialistes apparaissaient, menaçant tous les pouvoirs dominants, y compris celui de la bourgeoisie. La bourgeoisie libérale se calma et les tendances réactionnaires prirent le dessus. L'ancienne ardeur pour combattre la religion s'éteignit complètement et, même si les libéraux et les réactionnaires se combattaient toujours les uns les autres, en réalité, ils se rapprochaient. L'intérêt pour la science comme arme révolutionnaire dans la lutte de classe manifesté auparavant, avait entièrement disparu, tandis que la tendance réactionnaire chrétienne, qui voulait que le peuple conserve sa religion, se manifestait de manière toujours plus puissante et brutale.
L'estime pour la science a également subi un changement allant de pair avec le besoin de celle-ci. Auparavant, la bourgeoisie instruite avait fondé sur la science une conception matérialiste de l'univers, dans laquelle elle voyait la solution à l'énigme de celui-ci. Maintenant le mysticisme prenait de plus en plus le dessus ; tout ce qui avait été résolu par la science apparut comme très insignifiant, alors que tout ce qui ne l’avait pas été, prenait une très grande importance, embrassant les plus importantes questions de la vie. Un état d’esprit fait de scepticisme, de critique et de doute prenait de plus en plus le pas sur l'ancien esprit jubilatoire en faveur de la science.
Ceci se perçut également dans la position prise contre Darwin. "Que montre sa théorie? Elle laisse l'énigme de l'univers sans solution ! D'où vient cette nature merveilleuse de la transmission, d'où vient cette capacité des êtres animés à changer de façon si appropriée ?" C’est là que réside l'énigme mystérieuse de la vie qui ne peut pas être résolue avec des principes mécaniques. Que reste-t-il donc du darwinisme à la lumière de cette dernière critique ?
Naturellement, les avancées de la science ont permis de rapides progrès. La solution à un problème fait toujours apparaître de nouveaux problèmes à résoudre, qui étaient cachés sous la théorie de la transmission. Cette théorie, que Darwin avait dû accepter comme base de recherche, continuait à être étudiée, et une âpre discussion surgit au sujet des facteurs individuels du développement et de la lutte pour l'existence. Alors que quelques scientifiques portaient leur attention sur la variation qu'ils considéraient comme étant due à l'exercice et à l'adaptation à la vie (selon le principe établi par Lamarck), cette idée était expressément rejetée par des scientifiques comme Weissman et d'autres. Tandis que Darwin n'admettait que des changements progressifs et lents, de Vries découvrait des cas de variations soudaines et des sauts ayant pour résultat l'apparition soudaine de nouvelles espèces. Tout ceci, alors que se renforçait et se développait la théorie de la filiation, donnait, dans certains cas, l'impression que les nouvelles découvertes mettaient en pièces la théorie de Darwin, et chacune des nouvelles découvertes qui apparaissaient, était donc saluée par les réactionnaires comme preuve de la faillite du darwinisme. En même temps, la conception sociale rétroagissait sur la science. Les scientifiques réactionnaires proclamaient qu'un élément spirituel était nécessaire. Le surnaturel et le mystérieux, que le darwinisme avait balayés, devaient être réintroduits par la porte de derrière. C’était l’expression d’une tendance réactionnaire croissante au sein de cette classe qui, au début, s'était fait le porte-drapeau du darwinisme.
V Le darwinisme contre le socialisme
Le darwinisme a été d’une utilité inestimable à la bourgeoisie dans sa lutte contre les puissances du passé. Il était donc tout à fait naturel que la bourgeoisie l’utilisât contre son nouvel ennemi, le prolétariat; non pas parce que les prolétaires étaient opposés au darwinisme, mais pour la raison inverse. Dès que le darwinisme fit son apparition, l'avant-garde prolétarienne, les socialistes, salua la théorie darwinienne, parce qu'elle voyait dans le darwinisme une confirmation et un accomplissement de sa propre théorie ; non pas, comme quelques adversaires superficiels le croyaient, parce qu'elle voulait fonder le socialisme sur le darwinisme, mais dans le sens où la découverte darwinienne - qui montre que, même dans le monde organique apparemment stationnaire, il existe un développement continu – constitue une confirmation et un accomplissement magnifiques de la théorie marxiste du développement social.
Il était cependant normal que la bourgeoisie se serve du darwinisme contre les prolétaires. La bourgeoisie devait faire face à deux armées, et les classes réactionnaires le savaient très bien. Quand la bourgeoisie s’attaque à leur autorité, celles-ci montrent du doigt les prolétaires et mettent en garde la bourgeoisie contre tout morcellement de l’autorité. En agissant ainsi, les réactionnaires cherchent à effrayer la bourgeoisie afin qu’elle renonce à toute activité révolutionnaire. Naturellement, les représentants bourgeois répondent qu'il n'y a rien à craindre ; que leur science ne réfute que l'autorité sans fondement de la noblesse et les soutient dans leur lutte contre les ennemis de l’ordre.
Lors d’un congrès de naturalistes, le politicien et scientifique réactionnaire Virchow accusa la théorie darwinienne de soutenir le socialisme. "Faites attention à cette théorie, dit-il aux Darwiniens, car cette théorie est très étroitement liée à celle qui a causé tellement d’effroi dans le pays voisin." Cette allusion à la Commune de Paris, faite durant l’année célèbre pour sa chasse aux socialistes, dut avoir beaucoup d'effet. Que dire, cependant, de la science d'un professeur qui attaque le darwinisme avec l'argument selon lequel il n'est pas correct parce qu'il est dangereux ! Ce reproche, d'être allié aux révolutionnaires rouges, a beaucoup contrarié Haeckel, défenseur de cette théorie. Il ne put le supporter. Immédiatement après, il tenta de démontrer que c’était précisément la théorie darwinienne qui montrait le caractère indéfendable des revendications socialistes, et que darwinisme et socialisme "se soutiennent mutuellement comme le feu et l'eau".
Suivons les controverses de Haeckel, dont on retrouve les idées principales chez la plupart des auteurs qui basent sur le darwinisme leurs arguments contre le socialisme.
Le socialisme est une théorie qui présuppose l'égalité naturelle entre les personnes et qui s’efforce de promouvoir l'égalité sociale ; égalité des droits, des devoirs, égalité de propriété et de sa jouissance. Le darwinisme, au contraire, est la preuve scientifique de l'inégalité. La théorie de la filiation établit le fait que le développement animal va dans le sens d'une différentiation ou d’une division du travail toujours plus grande ; plus l'animal est supérieur et se rapproche de la perfection, plus l’inégalité est importante. Ceci tient tout autant pour la société. Ici aussi, nous voyons la grande division du travail entre les métiers, entre les classes, etc., et plus la société est développée, plus s’accroissent les inégalités dans la force, l’habileté, le talent. Il faut donc recommander la théorie de la filiation comme "le meilleur antidote à la revendication socialiste d’égalitarisme total".
Cela s"applique également, mais dans mesure encore plus grande, pour la théorie darwinienne de la survie. Le socialisme veut abolir la concurrence et la lutte pour l'existence. Mais le darwinisme nous enseigne que cette lutte est inévitable et qu'elle est une loi naturelle pour l’ensemble du monde organique. Non seulement cette lutte est naturelle, mais elle est également utile et salutaire. Cette lutte apporte une perfection grandissante, et cette perfection consiste dans l'élimination toujours plus grande de ce qui est inadapté. Seule la minorité sélectionnée, ceux qui sont qualifiés pour résister à la concurrence, peut survivre ; la grande majorité doit disparaître. Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. En même temps, la lutte pour l'existence a pour résultat la victoire des meilleurs, alors que les moins bons et les inadaptés doivent être éliminés. On peut s’en lamenter, tout comme on se lamente que tous doivent mourir, mais le fait ne peut être ni nié ni changé.
Nous voulons remarquer ici comment un petit changement de mots presque semblables sert à la défense du capitalisme. Darwin a parlé, à propos de la survie des plus aptes, de ceux qui sont mieux adaptés aux conditions. Voyant que, dans cette lutte, ceux qui sont les mieux organisés l'emportent sur les autres, les vainqueurs furent appelés les vigilants et, par la suite, les "meilleurs". Cette expression a été introduite par Herbert Spencer. Étant les gagnants dans leur domaine, les vainqueurs de la lutte sociale, les grands capitalistes, se sont proclamés les meilleurs.
Haeckel a maintenu cette conception et la confirme toujours. En 1892, il dit :
"Le darwinisme, ou la théorie de la sélection, est entièrement aristocratique ; elle est basée sur la survie des meilleurs. La division du travail apportée par le développement est responsable d’une variation toujours plus grande dans le caractère, d'une inégalité toujours plus grande entre les individus, dans leur activité, leur éducation et leur condition. Plus la culture humaine est avancée, plus grandes sont la différence et le fossé entre les différentes classes existantes. Le communisme et les revendications d’égalité de condition et d'activité mis en avant par les socialistes sont synonymes de retour aux stades primitifs de la barbarie."
Le philosophe anglais Herbert Spencer avait déjà, avant Darwin, une théorie sur le développement social. C'était la théorie bourgeoise de l’individualisme, basée sur la lutte pour l'existence. Plus tard il a mis cette théorie en relation étroite avec le darwinisme. "Dans le monde animal, disait-il, les vieux, les faibles et les malade sont toujours anéantis et seuls les éléments forts et en bonne santé survivent. La lutte pour l'existence sert donc à la purification de la race, la protégeant de la dégénérescence. C'est l'effet bienfaiteur de cette lutte car, si cette lutte cessait et que chacun soit certain de subvenir à son existence sans la moindre lutte, la race dégénèrerait nécessairement. Le soutien apporté aux malades, aux faibles et aux inadaptés amène une dégénérescence générale de la race. Si la sympathie, qui trouve son expression dans la charité, dépasse des limites raisonnables, elle manque son objectif ; au lieu de diminuer la souffrance, elle l’augmente pour les nouvelles générations. L’effet bénéfique de la lutte pour l'existence se perçoit le mieux chez les animaux sauvages. Ils sont tous forts et en bonne santé parce qu'ils ont dû endurer des milliers de dangers qui ont nécessairement éliminé tous ceux qui n'étaient pas adaptés. Chez les hommes et les animaux domestiques, la faiblesse et la maladie sont généralisées parce que les malades et les faibles sont préservés. Le socialisme, ayant pour objectif de supprimer la lutte pour l'existence dans le monde humain, apportera nécessairement une dégénérescence mentale et physique toujours croissante."
Ce sont les principaux arguments de ceux qui utilisent le darwinisme pour défendre le système bourgeois. Aussi puissants que pouvaient paraître, à première vue, ces arguments, il ne fut pas difficile cependant aux socialistes d’en triompher. Ce ne sont, pour l’essentiel, que les vieux arguments utilisés contre le socialisme, mais revêtus de neuf avec la terminologie darwinienne, et ils manifestent une ignorance totale du socialisme comme du capitalisme.
Ceux qui comparent l'organisation sociale au corps de l’animal laissent de côté le fait que les hommes ne diffèrent pas entre eux comme diffèrent des cellules ou des organes, mais seulement dans le degré de leurs capacités. Dans la société, la division du travail ne peut aller jusqu'à un point où toutes les capacités devraient disparaître au profit d'une seule. De plus, quiconque comprend quelque chose au socialisme sait que la division efficace du travail ne cesse pas avec le socialisme, que, pour la première fois avec le socialisme, une véritable division sera possible. La différence entre les ouvriers, entre leurs capacités, leurs emplois ne disparaîtra pas ; ce qui cessera sera la différence entre les ouvriers et les exploiteurs.
Alors qu'il est tout à fait vrai que, dans la lutte pour l'existence, les animaux physiquement les plus forts, sains et bien adaptés survivent, cela ne se produit pas avec la concurrence capitaliste. Ici, la victoire ne dépend pas de la perfection de ceux qui sont engagés dans la lutte. Tandis que le talent pour les affaires et l’énergie peuvent jouer un rôle dans le monde petit bourgeois, dans le développement ultérieur de la société, le succès dépend de plus en plus de la possession du capital. Le plus grand capital l'emporte sur le plus petit, même si ce dernier se trouve en des mains plus qualifiées. Ce ne sont pas les qualités personnelles, mais la possession de l'argent qui décide qui sera le vainqueur de la lutte pour la survie. Quand les propriétaires de petits capitaux disparaissent, ils ne périssent pas en tant qu’hommes mais en tant que capitalistes ; ils ne sont pas éliminés de la vie, mais de la bourgeoisie. La concurrence qui existe dans le système capitaliste est donc quelque chose de différent, dans ses exigences et ses résultats, de la lutte animale pour l'existence.
Les gens qui périssent en tant que personnes sont des membres d'une classe entièrement différente, une classe qui ne participe pas au combat de la concurrence. Les ouvriers ne concurrencent pas les capitalistes, ils leur vendent seulement leur force de travail. Parce qu’ils n’ont aucune propriété, ils n'ont même pas l'occasion de mesurer leurs grandes qualités, ni d’entrer dans la course avec les capitalistes. Leur pauvreté et leur misère ne peuvent pas être attribuées au fait qu'ils échouent dans une lutte concurrentielle à cause de leur faiblesse ; mais, parce qu'ils sont très mal payés pour leur force de travail, c’est pour cette raison que, même si leurs enfants sont nés forts et en bonne santé, ils meurent de façon massive ; alors que les enfants nés de parents riches, même s’ils sont nés malades, survivent grâce à l'alimentation et aux nombreux soins qui leur sont apportés. Les enfants des pauvres ne meurent pas parce qu'ils sont malades ou faibles, mais pour des raisons extérieures. C'est le capitalisme qui crée toutes ces conditions défavorables avec l'exploitation, la réduction des salaires, les crises de chômage, les mauvais logements et les longues heures de travail. C'est le système capitaliste qui fait succomber tant d’êtres forts et sains.
Ainsi les socialistes montrent que, à la différence du monde animal, la lutte concurrentielle qui existe entre les hommes ne favorise pas ceux qui sont les meilleurs et les plus qualifiés, mais anéantit beaucoup d’individus forts et sains en raison de leur pauvreté, alors que ceux qui sont riches, même faibles et malades, survivent. Les socialistes montrent que la force personnelle n'est pas le facteur déterminant, mais que celui-ci est quelque chose d’extérieur à l'homme ; c'est la possession de l'argent qui détermine qui survivra et qui mourra.
Anton Pannekoek
1 Il faut relever que, quelque temps après, dans une autre lettre à Engels datée du 18 juin 1862, Marx reviendra sur son jugement en faisant cette critique à Darwin : "Il est remarquable de voir comment Darwin reconnaît chez les animaux et les plantes sa propre société anglaise, avec sa division du travail, sa concurrence, ses ouvertures de nouveaux marchés, ses 'inventions' et sa 'malthusienne' 'lutte pour la vie'. C'est le bellum omnium contra omnes (la guerre de tous contre tous) de Hobbes, et cela rappelle Hegel dans la Phénoménologie, où la société civile intervient en tant que 'règne animal' de l'esprit, tandis que chez Darwin, c'est le règne animal qui intervient en tant que société civile." (Marx-Engels, Correspondance, Éditions sociales, Paris, 1979). Par la suite, Engels reprendra, en partie, à son compte cette critique de Marx dans L'Anti-Dühring (Engels fera allusion à la "bévue malthusienne" de Darwin) et dans la Dialectique de la nature. Dans le prochain numéro de la Revue Internationale, nous reviendrons sur ce qu'il faut bien considérer comme une interprétation erronée de l'œuvre de Darwin par Marx et Engels.
2 La traduction a été effectuée à partir de la version anglaise (1912, Nathan Weiser ) et ensuite améliorée sur la base de l'original en hollandais.
Conscience et organisation:
Personnages:
- Darwin [31]
Il y a 90 ans, la révolution allemande (V) : La terreur orchestrée par la social-démocratie fait le lit du fascisme
- 3789 lectures
La défaite de la révolution prolétarienne en Allemagne constitua le tournant décisif du 20e siècle puisqu'elle signifiait aussi, par conséquence, la défaite de la révolution mondiale. En Allemagne, l'instauration du régime national-socialiste édifié sur l'écrasement du prolétariat révolutionnaire ouvrait la marche accélérée de ce pays vers la Seconde Guerre mondiale. La barbarie particulière du régime national-socialiste devait très tôt servir de faire-valoir aux campagnes antifascistes destinées, quant à elles, à embrigader dans la guerre le prolétariat du camp impérialiste "démocratique". Selon l'idéologie antifasciste, le capitalisme démocratique serait un "moindre mal" qui pourrait, dans une certaine mesure, protéger les populations contre ce qu'il y a de pire dans la société bourgeoise. Une telle mystification, qui a encore aujourd'hui un pouvoir de nuisance sur la conscience de la classe ouvrière, est totalement démentie par les luttes révolutionnaires en Allemagne défaites par la social-démocratie qui déchaîna pour cela une terreur préfigurant celle du fascisme. C'est une des raisons pour lesquelles la classe dominante préfère couvrir ces événements d'un épais silence.
L'ordre règne à Berlin
Le soir du 15 janvier 1919, cinq membres du comité armé de vigilance bourgeois du quartier cossu de Wilmersdorf à Berlin, dont deux hommes d'affaires et un bouilleur de cru, s'introduisirent dans l'appartement de la famille Marcusson où ils trouvèrent trois membres du comité central du jeune Parti communiste d'Allemagne (KPD) : Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg et Wilhelm Pieck. Les livres d'histoire "officiels" racontent encore aujourd'hui que les chefs du KPD furent "arrêtés". En réalité, Liebknecht, Luxemburg et Pieck furent kidnappés. Bien que les membres de "la milice citoyenne" fussent convaincus que leurs prisonniers étaient des criminels, ils ne les livrèrent pas à la police. Ils les emmenèrent, au lieu de cela, au luxueux hôtel Eden où, le matin même seulement, la Garde-Kavallerie-Schützen-Division ("Division de fusiliers de cavalerie de la garde", GKSD) venait d'établir ses nouveaux quartiers généraux.
La GKSD avait été une unité d'élite de l'armée impériale - à l'origine les gardes du corps de l'empereur lui-même. Comme les SS qui allaient prendre sa succession dans la Seconde Guerre mondiale, elle envoyait au front des unités de choc mais disposait aussi de son propre système de sécurité et d'espionnage. Dès que la nouvelle de la révolution arriva au front occidental, la GSKD rentra pour prendre la direction de la contre-révolution ; elle arriva dans la région de Berlin le 30 novembre. Là, elle mena l'attaque de la "veille de Noël" contre les marins révolutionnaires dans le palais impérial en employant, en plein milieu de la ville, l'artillerie, les gaz et les grenades.1
Dans ses mémoires, le commandant en chef du GSKD, Waldemar Pabst, raconte comment un de ses officiers, un aristocrate catholique, après avoir entendu un discours de Rosa Luxemburg, avait déclaré qu'elle était une "sainte" et lui avait demandé de permettre à Rosa Luxemburg de s'adresser à leur unité. Pabst écrit : "J'ai pris conscience du danger que représentait Madame Luxemburg. Elle était plus dangereuse que tout, même que ceux qui étaient armés."2
A leur arrivée avec leur butin au "paradis" de l'hôtel Eden, les cinq défenseurs intrépides de la loi et de l'ordre de Wilmersdorf furent grassement récompensés pour leurs services. Le GKSD était l'une des trois organisations de la capitale qui offrait une récompense financière considérable pour la capture de Liebknecht et de Luxemburg.3
Pabst nous fait un bref compte-rendu de l'interrogatoire de Rosa Luxemburg ce soir là. "Êtes-vous Madame Rosa Luxemburg ?" demanda-t-il. "Décidez-en vous-même s'il vous plaît", répondit-elle. "D'après les photos, ce doit être le cas." "Si vous le dites." Puis elle prit une aiguille et se mit à recoudre sa jupe dont le bord avait été déchiré lors de son arrestation. Puis elle se mit à lire l'un de ses livres préférés, Faust de Goethe, et ignora la présence de son interrogateur.
Dès que la nouvelle de la capture des "Spartakistes" se répandit, une atmosphère de pogrom éclata chez les hôtes de l'élégant hôtel. Cependant Pabst avait ses propres plans. Il fit venir des lieutenants et des officiers de la marine, des hommes d'honneur très respectés ; des hommes dont "l'honneur" avait été tout particulièrement blessé puisque leurs propres subordonnés, les marins de la flotte impériale, désertaient et s'engageaient dans la révolution. Ces gentlemen prêtèrent serment de garder le silence pour le reste de leur vie sur ce qui allait suivre.
Ils voulaient éviter un procès, une "exécution selon la loi martiale" ou tout autre procédé qui feraient apparaître les victimes comme des héros ou des martyrs. Les "Spartakistes" devaient mourir d'une mort honteuse. On se mit d'accord pour prétendre que Liebknecht était emmené en prison, simuler une panne de voiture dans le parc du centre ville, le Tiergarten, et l'abattre alors qu'il "était en fuite". Puisque cette "solution" avait peu de chance d'être crédible pour Rosa Luxemburg dont le handicap de la hanche qui la faisait boiter, était connu de tous, on décida qu'elle devait apparaître comme la victime d'un lynchage par la foule. Le rôle de la foule fut assigné au lieutenant de la marine, Herman Souchon, dont le père, l'amiral Souchon, avait en novembre 1918, en tant que gouverneur de Kiel, subi la déshonneur de devoir négocier avec les ouvriers et les marins révolutionnaires. Il devait attendre en dehors de l'hôtel, se ruer sur la voiture qui emmenait Rosa Luxemburg et lui tirer dans la tête.
Au cours de l'exécution de ce plan, un élément imprévu apparut en la personne d'un soldat appelé Runge qui s'était arrangé avec son capitaine, appelé Petri, pour rester à son poste après la fin de son service à 11 heures du soir. Ils voulaient recevoir pour eux la principale récompense pour la liquidation de ces révolutionnaires. Alors qu'on emmenait Liebknecht à une voiture en dehors de l'hôtel, Runge lui porta un terrible coup sur la tête avec la crosse de son fusil. Cette action allait considérablement discréditer la fable selon laquelle Liebknecht avait été abattu "en fuite". Dans la consternation qui suivit cet acte, personne ne pensa à écarter Runge de la scène. Et quand Rosa Luxemburg fut emmenée hors de l'hôtel à son tour, Runge en uniforme l'assomma de la même manière. Alors qu'elle gisait par terre, il lui asséna un second coup. Une fois qu'elle fut jetée à demi-morte dans la voiture qui attendait, un autre soldat en service, von Rzewuski, lui infligea un autre coup. C'est seulement à ce moment là que Souchon accourut pour l'exécuter. Ce qui suivit est bien connu. Liebknecht fut abattu dans le Tiergarten. Le corps de Rosa Luxemburg fut jeté dans le Landwehr canal proche.4 Le lendemain, les meurtriers furent photographiés à leur fête de célébration des événements.
Après avoir exprimé combien il était choqué par ces "atrocités" et les avoir condamnées, le gouvernement social-démocrate promit une "enquête la plus rigoureuse" qu'il mit entre les mains de la GKSD. Le responsable de l'enquête, Jorns, qui avait acquis sa réputation du fait de la dissimulation d'un génocide colonial par l'armée allemande en "Afrique du Sud-Ouest allemande" avant la guerre, installa son bureau à l'hôtel Eden où il était aidé dans son "enquête" par Pabst et par l'un des accusés du meurtre, von Pflugk-Hartnung. Cependant, le projet de jouer sur le temps et d'enterrer ensuite l'idée d'un procès, fut contrecarré par un article paru le 12 février dans la Rote Fahne, journal du KPD. Cet article, qui rendait compte de façon remarquable de ce qui a été établi comme vérité historique sur ces meurtres, déclencha un tollé général.5
Le procès commença donc le 8 mai 1919. Le palais de justice fut placé sous la protection des forces armées du GSKD. Le juge désigné était un autre représentant de la flotte impériale, Wilhelm Canaris, ami personnel de Pabst et de von Pflugk-Hartnung. Il devait devenir commandant en chef des services d'espionnage en Allemagne nazie. Encore une fois, presque tout se déroula selon un plan préétabli -sauf que des membres du personnel de l'hôtel Eden, malgré la peur de perdre leur emploi et d'être mis sur la liste des personnes à assassiner par les brigades militaires de tueurs, témoignèrent de la vérité de ce qu'ils avaient vu. La femme de ménage, Anna Belger, raconta qu'elle avait entendu les officiers parler de la "réception" qu'ils préparaient pour Liebknecht dans le Tiergarten. Les serveurs, Mistelski et Krupp, 17 ans tous les deux, identifièrent Runge et révélèrent ses relations avec Petri. Malgré tout cela, la cour accepta sans problème la version selon laquelle Liebknecht avait été abattu "en cours de fuite", et acquitta les officiers qui avaient tiré. Dans le cas de Rosa Luxemburg, il fut décrété que deux soldats avaient tenté de la tuer, mais qu'on ne connaissait pas le meurtrier. On ne connaissait pas non plus la cause de sa mort puisqu'on n'avait pas retrouvé son corps.
Le 31 mai 1919, des ouvriers trouvèrent le cadavre de Rosa Luxemburg à l'écluse du canal. Dès qu'il apprit qu' "elle" était réapparue, le ministre de l'intérieur SPD, Gustav Noske, ordonna un black-out des informations à ce sujet. Ce n'est que trois jours plus tard qu'une annonce officielle fut publiée, disant que les restes de Rosa Luxemburg avaient été trouvés par une patrouille militaire, et non par des ouvriers.
Au défi de toutes les règles, Noske remit le corps à ses amis militaires, aux mains des meurtriers eux-mêmes. Les autorités responsables ne purent s'empêcher de souligner que Noske avait en fait volé le corps. Il est évident que les sociaux-démocrates étaient terrifiés par Rosa Luxemburg, même par son cadavre. Le serment de silence fait à l'hôtel Eden tint pendant plusieurs décennies. Mais c'est Pabst lui-même qui le brisa finalement. Il ne pouvait supporter plus longtemps de ne pas se voir attribuer publiquement le mérite de son exploit. Après la Seconde Guerre mondiale, il se mit à y faire de lourdes allusions dans des interviews données à des journaux d'information (Spiegel, Stern) et à être plus explicite dans des discussions avec des historiens et dans ses mémoires. Dans la République fédérale d'Allemagne de l'Ouest, "l'anticommunisme" de la période d'après-guerre offrait des circonstances favorables. Pabst rapporta qu'il avait téléphoné au ministre de l'intérieur social-démocrate Noske, le soir du 15 janvier 1919, pour le consulter sur la procédure à suivre vis-à-vis de ses illustres prisonniers. Ils se mirent d'accord sur la nécessité de "mettre fin à la guerre civile". Sur la façon de le faire, Noske déclara : "Votre général6 doit prendre la décision, ce sont vos prisonniers". Dans une lettre au Dr Franz, datée de 1969, Pabst écrit : "Noske et moi étions en total accord. Naturellement, Noske ne pouvait donner l'ordre lui-même". Et dans une autre lettre, il écrit : "... ces idiots d'allemands devraient tomber à genoux et me remercier ainsi que Noske ; des rues et des squares devraient porter nos noms7 ! Noske fut exemplaire à l'époque et le Parti (sauf son aile gauche à demi-communiste) sans reproche. Il est clair que je n'aurais jamais pu décider cette action sans l'accord de Noske (ni de Ebert derrière-lui) et que je devais protéger mes officiers."8
Le système de l'assassinat politique
La situation de l'Allemagne de 1918 à 1920, où l'on répondit à une tentative de révolution prolétarienne par un horrible massacre qui coûta la vie à près de 20 000 prolétaires, ne constituait pas une première dans l'histoire. Des scènes similaires avaient eu lieu à Paris, à l'époque de la révolution de juillet, en 1848, et de la Commune de Paris en 1871. Et, alors que la révolution d'octobre en 1917 en Russie ne répandit quasiment pas de sang, la guerre civile que le capital international déchaîna pour y répondre coûta des millions de vies. Ce qui était nouveau en Allemagne, c'était l'utilisation du système de l'assassinat politique, pas seulement à la fin du processus révolutionnaire, mais dès le tout début.9
Sur ce sujet, après avoir cité Klaus Gietinger, nous nous reportons à un autre témoin, Emil Julius Gumbel, qui publia, en 1924, un livre célèbre intitulé "Quatre années d'assassinats politiques"10 Comme Klaus Gietinger aujourd'hui, Gumbel n'était pas un communiste révolutionnaire. Il était, en fait, un défenseur de la république bourgeoise établie à Weimar. Mais il était avant tout un homme à la recherche de la vérité et prêt à risquer sa vie dans cette quête.
Pour Gumbel, ce qui caractérisait l'évolution en Allemagne, c'était la transition de "l'assassinat artisanal" à ce qu'il appelle "une méthode plus industrielle".11 Elle se basait sur des listes de gens à assassiner, établies par des organisations secrètes, et était mise en œuvre systématiquement par des escadrons de la mort composés d'officiers et de soldats. Ces escadrons non seulement coexistaient pacifiquement avec les organismes officiels de l'État démocratique mais, de plus, ils coopéraient activement avec lui. Les médias jouaient un rôle-clé dans cette stratégie ; ils préparaient et justifiaient les assassinats à l'avance et, par la suite, dérobaient aux morts tout ce qu'il leur restait : leur réputation sans tache.
Comparant le terrorisme, principalement individuel, de l'aile gauche avant la guerre12 à la nouvelle terreur de droite, Gumbel écrivait : "L'incroyable clémence des tribunaux envers les auteurs est bien connue. C'est ainsi que les assassinats politiques actuels en Allemagne se distinguent de ceux du passé, communs à d'autres pays, par deux aspects : leur massivité et à quel point ils ne sont pas punis. Auparavant, l'assassinat politique requérait après tout une force de décision certaine. On ne peut lui dénier un certain héroïsme. L'auteur risquait sa vie. Il était extraordinairement difficile de s'enfuir. Aujourd'hui, le coupable ne risque rien. Des organisations puissantes ayant des représentants dans tout le pays lui offrent un abri, une protection et un soutien matériel. Des fonctionnaires "bienveillants", chefs de police, procurent les papiers nécessaires pour partir à l'étranger si nécessaire... On vous loge dans les meilleurs hôtels où on peut mener la belle vie. En un mot, l'assassinat politique est passé d'un acte héroïque à un acte du quotidien, pratiquement à une source de revenu facile."13
Ce qui était valable pour l'assassinat de personnes l'était tout autant pour un putsch de droite, utilisé en vue de tuer à grande échelle – ce que Gumbel appelle "l'assassinat semi-organisé". "Si le putsch réussit, tant mieux. S'il échoue, les tribunaux font en sorte que rien n'arrive aux meurtriers. Et ils l'ont fait. Pas un seul assassinat de la droite n'a jamais été vraiment puni. Même les meurtriers qui ont avoué leurs crimes ont été libérés sur la base de l'amnistie de Kapp."
En réponse à l'éclatement de la révolution prolétarienne, de nombreuses organisations contre-révolutionnaires de ce type furent constituées en Allemagne.14 Et lorsqu'elles furent bannies du pays, que la loi martiale et le système des tribunaux extraordinaires furent abolis, tout cela fut maintenu en Bavière, faisant de Munich le "nid" de l'extrême droite allemande et des exilés russes. Ce qui a été présenté comme une "particularité bavaroise" était, en réalité, une division du travail. Les principaux leaders de cette "fronde bavaroise" étaient Ludendorff et ses adeptes des anciens quartiers généraux militaires qui n'étaient absolument pas bavarois.15
La social-démocratie, les militaires et le système de la terreur
Comme nous l'avons rappelé dans la deuxième partie de cette série, la Dolchstosslegende, "la légende du coup de poignard dans le dos", fut inventée en septembre 1918 par le général Ludendorff. Dès qu'il réalisa que la guerre était perdue, il appela à la formation d'un gouvernement civil chargé de réclamer la paix. Son idée de départ était de faire porter la faute sur les civils et de sauver la réputation des forces armées. La révolution n'avait pas encore éclaté. Après son éclatement, la Dolchstosslegende prit une importance nouvelle. La propagande selon laquelle une force armée glorieuse, jamais vaincue sur les champs de bataille, se voyait dérober la victoire au dernier moment par la révolution, avait pour but de provoquer dans la société, et parmi les soldats en particulier, une haine ardente contre la révolution.
Au départ, quand les sociaux-démocrates se virent offrir une place dans ce gouvernement civil "du déshonneur", l'intelligent Scheidemann de la direction du SPD reconnut le piège et voulut décliner l'offre.16 Son point de vue fut vivement écarté par Ebert qui plaida pour la nécessité de mettre le bien de la patrie "au dessus de la politique de parti".17
Quand, le 10 décembre 1918, le gouvernement SPD et le haut commandement militaire firent défiler en masse dans les rues de Berlin des troupes revenant du front, leur intention était de les utiliser pour écraser la révolution. Dans ce but, Ebert s'adressa aux troupes à la Porte de Brandebourg en saluant l'armée "jamais battue sur les champs de bataille". C'est à ce moment-là qu'Ebert fit de la Dolchstosslegende une doctrine officielle du SPD et de son gouvernement.18
Évidemment, la propagande du "coup de poignard dans le dos" n'accusait pas explicitement la classe ouvrière d'être responsable de la défaite de l'Allemagne. Cela n'aurait pas été habile au moment où la guerre civile commençait, c'est-à-dire quand il était nécessaire pour la bourgeoisie d'estomper les divisions de classe. Il fallait trouver des minorités présentées comme ayant manipulé et dupé les masses et qu'on puisse désigner comme les véritables coupables.
Parmi ces coupables, figuraient les Russes et leur agent, le bolchevisme allemand, représentant une forme sauvage, asiatique de socialisme, le socialisme de la famine, virus qui menaçait la "civilisation européenne". Avec des mots différents, ces thèmes étaient en continuité directe avec la propagande antirusse des années de guerre. Le SPD était le principal et le plus ignoble agent de la propagation de ce poison. Là-dessus, les militaires étaient en fait plus hésitants, puisque certains de leurs représentants les plus audacieux misaient sur l'idée de ce qu'ils appelaient le "national-bolchevisme" (l'idée qu'une alliance militaire du militarisme prussien avec la Russie prolétarienne contre les "puissances de Versailles" pourrait aussi constituer un bon moyen de détruire moralement la révolution en Allemagne comme en Russie).
L'autre coupable ? Les Juifs. Ludendorff pensait à eux dès le départ. A première vue, il semblerait que le SPD n'ait pas suivi cette orientation. En réalité, sa propagande ne faisait que reprendre les ignominies répandues par les officiers – à part qu'il remplaçait le mot "Juif" par "étranger", "éléments sans racines nationales" ou par "intellectuels", des termes qui, dans le contexte du moment, signifiaient la même chose. Cette haine anti-intellectuelle envers les "rats de bibliothèque" est une caractéristique bien connue de l'antisémitisme. Deux jours avant l'assassinat de Luxemburg et Liebknecht, le Vorwärts, quotidien du SPD, publia un "poème" – en réalité un appel au pogrom – "La Morgue", qui regrettait qu'il n'y ait que des prolétaires parmi les morts tandis que les gens "du genre" de "Karl, Rosa, Radek" s'en étaient sortis.
La social-démocratie a saboté les luttes de l'intérieur. Elle a dirigé l'armement de la contre-révolution et ses campagnes militaires contre le prolétariat. En écrasant la révolution, elle a créé les conditions de la victoire ultérieure du national-socialisme et préparé involontairement son chemin. Le SPD a même fait plus que son devoir dans la défense du capitalisme. En aidant à créer les armées mercenaires non officielles des Corps-francs, en protégeant les organisations de tueurs des officiers, en répandant les idéologies de la réaction et de la haine qui allaient dominer la vie politique allemande pendant le quart de siècle suivant, il a participé activement à cultiver le milieu qui a permis de produire le régime d'Hitler.
"Je hais la révolution comme le péché", déclarait pieusement Ebert. Ce n'était pas la haine des industriels ou des militaires qui avaient peur de perdre leur propriété et pour qui l'ordre existant semblait si naturel qu'ils ne pouvaient que combattre tout ce qui se présentait de différent. Les péchés que la social-démocratie haïssait, c'étaient ceux de son propre passé, son engagement dans un mouvement aux côtés de révolutionnaires convaincus et de prolétaires internationalistes – même si beaucoup de membres de la social-démocratie n'avaient jamais partagé ces convictions ; la haine du renégat envers la cause trahie. Les chefs du SPD et les syndicats pensaient que le mouvement ouvrier était leur propriété. Lorsqu'ils se liguèrent avec la bourgeoisie impérialiste au moment de l'éclatement de la guerre, ils pensaient que c'était la fin du socialisme, ce chapitre illusoire qu'ils étaient maintenant décidés à fermer. Lorsque quatre années plus tard seulement, la révolution releva la tête, c'était comme la réapparition d'un fantôme effrayant du passé. Leur haine de la révolution venait aussi de la peur qu'ils en avaient. Projetant leurs propres émotions sur leurs ennemis, ils avaient peur d'être lynchés par les "Spartakistes" (une peur que partageaient les officiers des escadrons de la mort).19
Ebert était sur le point de fuir la capitale entre Noël et le Jour de l'An 1918. Tout cela se cristallisa autour de la principale cible de leur haine : Rosa Luxemburg. Le SPD était devenu un concentré de tout ce qui était réactionnaire dans le capitalisme en putréfaction. Aussi, l'existence même de Rosa Luxemburg était une provocation pour lui : sa loyauté envers les principes, son courage, sa brillance intellectuelle, le fait qu'elle était étrangère, d'origine juive, et une femme. Ils l'appelèrent "Rosa la rouge", assoiffée de sang et de revanche, une femme avec un fusil.
Quand on examine la révolution en Allemagne, il faut garder à l'esprit l'un de ses phénomènes frappants : le degré de servilité de la social-démocratie envers les militaires que même la caste des officiers prussiens trouvait répugnante et ridicule. Au cours de toute la période de collaboration entre le corps des officiers et le SPD, le premier ne cessa jamais de déclarer en public qu'il enverrait ce dernier "en enfer" dès qu'il n'en aurait plus besoin. Rien de tout cela ne pouvait plus stopper la servilité du SPD. Cette servilité n'était évidemment pas nouvelle. Elle avait caractérisé l'attitude des syndicats et des politiciens réformistes bien avant 1914.20 Mais elle s'ajoutait maintenant à la conviction que seuls les militaires pourraient sauver le capitalisme et, donc, le SPD lui-même.
En mars 1920, des officiers de droite se révoltèrent contre le gouvernement SPD (le putsch de Kapp). Du côté des putschistes, on trouve tous les collaborateurs d'Ebert et Noske dans le double assassinat du 15 janvier 1919 : Pabst et son général von Lüttwitz, le GSKD, les lieutenants de la Marine déjà mentionnés. Kapp et Lüttwitz avaient promis à leurs troupes une belle récompense financière pour le renversement d'Ebert. Le coup fut déjoué, non par le gouvernement (qui s'enfuit à Stuttgart), ni par le commandement militaire officiel (qui déclara sa "neutralité"), mais par le prolétariat. Les trois partis en conflit de la classe dominante – le SPD, les "kappistes" et le commandement militaire (ayant abandonné sa "neutralité") - s'unirent à nouveau pour vaincre les ouvriers. Tout est bien qui finit bien ! A l'exception d'une chose : qu'en était-il des infortunés mutinés qui espéraient une récompense pour le renversement d'Ebert ? Pas de problème ! Le gouvernement Ebert, de retour au travail, paya lui-même la récompense.
Voilà ce qu'il en est de l'argument (mis en avant par Trotsky, par exemple, avant 1933) selon lequel la social-démocratie, tout en étant intégrée au capitalisme, pourrait quand même se dresser contre les autorités et empêcher le fascisme – pour sauver sa peau.
La dictature du capital et la social-démocratie
En réalité, les militaires n'étaient pas tant opposés à la social-démocratie et aux syndicats qu'à l'ensemble du système des partis politiques existant.21 Déjà avant la guerre, l'Allemagne n'était pas gouvernée par les partis politiques mais par la caste militaire, système que symbolisait la monarchie. La bourgeoisie industrielle et financière de plus en plus puissante s'intégra peu à peu à ce système mais dans des structures non officielles, avant tout le Alldeutscher Verein ("Association panallemande") qui a en fait dirigé le pays avant et pendant la Première Guerre mondiale.22
En revanche, dans l'Allemagne impériale, le Parlement (le Reichstag) n'avait quasiment aucun pouvoir. Les partis politiques n'avaient pas de véritable expérience gouvernementale. C'étaient plus des groupes d'influence de différentes fractions économiques ou régionales qu'autre chose.
Ce qui était, à l'origine, le produit de l'arriération politique de l'Allemagne s'avéra un énorme avantage une fois que la guerre mondiale eut éclaté. Pour y faire face et pour affronter la révolution qui allait suivre, un contrôle dictatorial de l'État sur l'ensemble de la société était d'une nécessité impérieuse. Dans les vieilles "démocraties" occidentales, en particulier dans les pays anglo-saxons avec leur système sophistiqué à deux partis, ce capitalisme d'État évolua à travers la fusion graduelle des partis politiques et des différentes fractions économiques de la bourgeoisie avec l'État. Cette forme de capitalisme d'État, au moins en Grande-Bretagne et aux États-Unis, s'avéra très efficace. Mais cela prit un temps relativement long pour qu'elle se mette en place.
En Allemagne, la structure d'une telle intervention d'un État dictatorial existait déjà. L'un des principaux "secrets" de la capacité de l'Allemagne à tenir pendant la guerre pendant plus de quatre ans contre presque toutes les anciennes puissances majeures du monde – qui disposaient en outre des ressources de leurs empires coloniaux – réside dans l'efficacité de ce système. C'est pourquoi les alliés occidentaux ne faisaient pas que "jouer pour la galerie" lorsqu'ils demandèrent la liquidation du "militarisme prussien" à la fin de la guerre.
Comme nous l'avons déjà vu au cours de cette série d'articles, non seulement les militaires mais également Ebert lui-même voulaient sauver la monarchie à la fin de la guerre et garder un Reichstag semblable à celui qui existait avant 1914. En d'autres termes, ils voulaient maintenir ces structures capitalistes d'État qui avaient fait leurs preuves durant la guerre. Il fallut abandonner ce projet face au danger de la révolution. Tout l'arsenal et le spectacle de la démocratie politique des partis étaient nécessaires pour dévoyer les ouvriers.
C'est ce qui produisit le phénomène de la république de Weimar : un tas de partis inexpérimentés et inefficaces, tout à fait incapables de coopérer et de s'intégrer de façon disciplinée dans le régime capitaliste d'État. Il n'est pas surprenant que les militaires aient voulu s'en débarrasser ! Le seul véritable parti politique bourgeois existant en Allemagne était le SPD.
Mais si la révolution avait rendu impossible le maintien du régime de guerre capitaliste d'État23, elle rendait également impossible la réalisation du plan de la Grande-Bretagne et en particulier des États-Unis, de liquider sa base sociale militaire. Les "démocraties" occidentales durent conserver intact le noyau de la caste militaire et son pouvoir, afin d'écraser le prolétariat. Cela ne fut pas sans conséquence. Lorsqu'en 1933, les dirigeants traditionnels de l'Allemagne, les forces armées et la grande industrie, abandonnèrent le système de Weimar, ils retrouvèrent leur supériorité organisationnelle sur leurs rivaux impérialistes occidentaux dans la préparation de la Seconde Guerre mondiale. Sur le plan de sa composition, la principale différence entre l'ancien et le nouveau système était que le SPD était remplacé par le NSDAP, le parti nazi. Le SPD avait si bien réussi à vaincre le prolétariat que ses services n'étaient plus nécessaires.
La Russie et l’Allemagne : pôles dialectiques de la révolution mondiale
En octobre 1917, Lénine appela les soviets et le parti à l’insurrection en Russie. Dans une résolution pour le comité central du Parti bolchevique, "rédigée en hâte par Lénine, avec un petit bout de crayon sur une feuille de papier quadrillé d'écolier"24, il écrivait : "Le Comité central reconnaît que la situation internationale de la révolution russe (la mutinerie de la flotte en Allemagne, manifestation extrême de la croissance de la révolution socialiste mondiale dans toute l'Europe ; et, par ailleurs, la menace de voir la paix impérialiste étouffer la révolution en Russie), - de même que la situation militaire (décision indubitable de la bourgeoisie russe et de Kerenski et consorts, de livrer Petrograd aux Allemands), - de même que l'obtention par le parti prolétarien de la majorité aux Soviets, - tout cela, lié au soulèvement paysan et au changement d'attitude du peuple qui fait confiance à notre parti (élections de Moscou) et enfin la préparation manifeste d'une nouvelle aventure Kornilov (retrait des troupes de Petrograd, transfert des cosaques à Petrograd, encerclement de Minsk par les cosaques, etc.) - tout cela met l'insurrection armée à l'ordre du jour."25
Dans cette formulation se trouve toute la vision marxiste de la révolution mondiale du moment, et du rôle central de l’Allemagne dans ce processus. D’une part, l’insurrection doit avoir lieu en Russie en réponse au début de la révolution en Allemagne qui constitue un signal pour toute l’Europe. D’autre part, incapable d’écraser la révolution sur son territoire, la bourgeoisie russe a l’intention de confier cette tâche au gouvernement allemand, gendarme de la contre-révolution sur le continent européen (en livrant Petrograd). Lénine tonna contre ceux qui, dans le parti, s’opposaient à l’insurrection, qui déclaraient leur solidarité avec la révolution en Allemagne et, de ce fait, appelaient les ouvriers russes à attendre que le prolétariat allemand prenne la direction de la révolution. "Réfléchissez donc : dans des conditions pénibles, infernales, avec le seul Liebknecht [33] (enfermé au bagne, par surcroît), sans journaux, sans liberté de réunions, sans Soviets, au milieu de l'hostilité incroyable de toutes les classes de la population - jusqu'au dernier paysan aisé - à l'égard de l'idée de l'internationalisme, malgré l'organisation supérieure de la grande, de la moyenne et de la petite bourgeoisie impérialiste, les Allemands, c'est-à-dire les révolutionnaires internationalistes allemands, les ouvriers portant la vareuse de matelot, ont déclenché une mutinerie de la flotte, alors qu'ils n'avaient peut-être qu'une chance sur cent.
Et nous qui avons des dizaines de journaux, la liberté de réunion, qui avons la majorité dans les Soviets, nous qui sommes des internationalistes prolétariens possédant les positions les plus solides du monde entier, nous refuserions de soutenir par notre insurrection les révolutionnaires allemands. Nous raisonnerions comme les Scheidemann et les Renaudel : le plus sage est de ne pas nous soulever, car si on nous fusille tous tant que nous sommes, le monde perdra des internationalistes d'une si belle trempe, si sensés, si parfaits !!"26
Comme il l‘écrivit dans son texte célèbre "La crise est mûre" (29 septembre 1917), ceux qui voulaient retarder l’insurrection en Russie seraient des "traîtres à cette cause car par leur conduite, ils trahiraient les ouvriers révolutionnaires allemands qui ont commencé à se soulever dans la flotte."
Un débat similaire eut lieu au sein du parti bolchevique à l’occasion de la première crise politique qui suivit la prise du pouvoir : fallait-il ou non signer le Traité de Brest-Litovsk avec l’impérialisme allemand. A première vue, il semblait que les camps s’étaient renversés. C’était Lénine qui défendait la prudence maintenant : il fallait accepter l’humiliation de ce traité. Mais en réalité, il y a une continuité. Dans les deux cas où le destin de la révolution russe était en jeu, c’est la perspective de la révolution en Allemagne qui était au cœur du débat. Dans les deux cas, Lénine insiste sur le fait que tout dépend de ce qui se passe en Allemagne mais, également, sur le fait que, dans ce pays, la révolution prendra plus de temps et sera infiniment plus difficile qu’en Russie. C’est pourquoi la révolution russe devait prendre la tête en octobre 1917. C’est pourquoi, à Brest-Litovsk, le bastion russe devait se préparer au compromis. Il avait la responsabilité de "tenir" pour pouvoir soutenir la révolution allemande et mondiale.
Dès ses débuts, la révolution en Allemagne était imprégnée du sens des responsabilités vis-à-vis de la révolution russe. C’était aux prolétaires allemands qu’incombait la tâche de libérer les ouvriers russes de leur isolement international. Comme Rosa Luxemburg l’écrivait de sa prison dans ses notes sur la révolution russe, publiées de façon posthume, en 1922 ; "Tout ce qui se passe en Russie s'explique parfaitement : c'est une chaîne inévitable de causes et d'effets dont les points de départ et d'arrivée sont la carence du prolétariat allemand et l'occupation de la Russie par l'impérialisme allemand."27
La gloire des événements en Russie c’est d’avoir commencé la révolution mondiale.
"C'est là ce qui est essentiel, ce qui est durable dans la politique des Bolcheviks. En ce sens, il leur reste le mérite impérissable d'avoir, en conquérant le pouvoir et en posant pratiquement le problème de la réalisation du socialisme, montré l'exemple au prolétariat international, et fait faire un pas énorme dans la voie du règlement de comptes final entre le Capital et le Travail dans le monde entier. En Russie, le problème ne pouvait être que posé. Et c'est dans ce sens que l'avenir appartient partout au bolchevisme." (Ibid.)
Ainsi, la solidarité pratique du prolétariat allemand avec le prolétariat russe est la conquête révolutionnaire du pouvoir, l’élimination du principal bastion de la contre-révolution militaire et sociale-démocrate en Europe continentale. Seul ce pas pouvait élargir la brèche initiée en Russie et permettre que s'y engouffre le flot révolutionnaire mondial.
Dans une autre contribution depuis sa cellule, La tragédie russe, Rosa Luxemburg a montré les deux dangers mortels qui guettaient l’isolement de la révolution en Russie. Le premier était celui d’un terrible massacre par le capitalisme mondial, représenté, à ce moment-là, par le militarisme allemand. Le deuxième était celui d’une dégénérescence politique et de la banqueroute morale du bastion russe lui-même, son intégration dans le système impérialiste mondial. Au moment où elle écrivait (après Brest-Litovsk), elle voyait le danger du côté de ce qui allait devenir la ligne de pensée soi-disant nationale bolchevique dans l’ordre militaire allemand. Celle-ci se centrait sur l’idée d’offrir à la "Russie bolchevique" une alliance militaire comme moyen, non seulement d’aider l’impérialisme allemand à établir son hégémonie mondiale sur ses rivaux européens, mais en même temps de corrompre moralement la révolution russe – avant tout par la destruction de son principe fondamental, l’internationalisme prolétarien.
En fait, Rosa Luxemburg surestimait largement l’empressement de la bourgeoisie allemande à ce moment-là à vouloir se lancer dans une telle aventure. Mais elle avait fondamentalement raison d'identifier le deuxième danger et de reconnaître que si cela se passait, ce serait le résultat direct de la défaite de la révolution allemande et mondiale. Elle concluait : "N'importe quelle défaite politique des Bolcheviks dans un combat loyal contre des forces trop puissantes et la défaveur de la situation historique, serait préférable à cette débâcle morale."28
On ne peut comprendre la révolution russe et la révolution allemande qu’ensemble. Elles constituent deux moments d’un seul et même processus historique. La révolution mondiale commença à la périphérie de l’Europe. La Russie était le maillon faible de la chaîne de l’impérialisme, parce que la bourgeoisie mondiale était divisée par la guerre impérialiste. Mais il fallait porter un second coup, au cœur du système, pour pouvoir renverser le capitalisme mondial. Ce deuxième coup eut lieu en Allemagne et commença par la révolution de novembre 1918. Mais la bourgeoisie fut capable de dévier de son cœur le coup mortel. Cela scella le destin de la révolution en Russie. Ce qui se passa ne correspond pas à la première mais à la deuxième hypothèse de Rosa Luxemburg, celle qui l’effrayait le plus. Contre toute attente, la Russie rouge vainquit les forces d’invasion blanches contre-révolutionnaires. Ce fut possible grâce à la combinaison de trois facteurs principaux : d’abord la direction politique et organisationnelle du prolétariat russe qui était passée par l’école du marxisme et de la révolution ; deuxièmement, l’immensité du pays qui avait déjà permis de vaincre Napoléon et allait contribuer à la défaite d’Hitler et qui, cette fois également, devait désavantager les envahisseurs contre-révolutionnaires ; troisièmement, la confiance des paysans, la vaste majorité de la population russe, dans la direction révolutionnaire prolétarienne. Ce furent les paysans qui fournirent la grande masse des troupes de l’Armée rouge commandée par Trotsky.
Ce qui suivit, ce fut la dégénérescence capitaliste de l’intérieur de la révolution isolée : une contre-révolution au nom de la révolution. Ainsi, la bourgeoisie a pu enterrer le secret de la défaite de la révolution russe. Tout cela se base sur la capacité de la bourgeoisie à jeter un voile sur le fait qu’il y eut un soulèvement révolutionnaire en Allemagne. Le secret, c’est que la révolution n’a pas été vaincue à Moscou ou à St Petersburg, mais à Berlin et dans la Ruhr. La défaite de la révolution en Allemagne constitue la clé pour comprendre celle de la révolution en Russie. La bourgeoisie a caché cette clé, grand tabou historique auquel tous les cercles responsables se conforment. On ne parle pas de corde dans la maison du pendu.
En un sens, l‘existence de luttes révolutionnaires en Allemagne est plus problématique que les luttes en Russie, précisément parce que la révolution allemande a été vaincue par la bourgeoisie dans une lutte ouverte. Non seulement le mensonge selon lequel le stalinisme serait le communisme, mais le mensonge selon lequel la démocratie bourgeoise, la social-démocratie serait antagonique au fascisme, dépend, dans une large mesure, de la dissimulation des combats en Allemagne.
Ce qui en est resté est embarrassant, se concrétise par un malaise, avant tout par rapport aux meurtres de Luxemburg et Liebknecht, des assassinats devenus le symbole de la victoire de la contre-révolution.29 En fait ce crime qui incarne celui de dizaines de millions d’autres, est un abrégé de la cruauté, de la volonté de vaincre de la bourgeoisie pour défendre son système. Mais ce crime n’a-t-il pas été commis sous la direction de la démocratie bourgeoise ? N’était-il pas le produit conjoint de la social-démocratie et de l’extrême droite ? Ses victimes, et non ses bourreaux, n’étaient-elles pas l'essence de ce qu’il y a de meilleur, de plus humain, les meilleurs représentants de ce que pourrait être l’avenir pour l’espèce humaine ? Et pourquoi, déjà à l’époque, et à nouveau aujourd’hui, ceux qui se sentent une responsabilité envers l’avenir de la société, sont-ils si profondément troublés par ces crimes, si attirés par ceux qui en furent les victimes ? Ces crimes revendiqués et qui ont permis de sauver le système il y a 90 ans, peuvent encore se transformer en boomerang.
Dans son étude sur l’assassinat politique en Allemagne, menée dans les années 1920, Emil Gumbel établit un lien entre cette pratique et la vision "héroïque" des défenseurs de l’ordre social actuel qui voient l’histoire comme le produit des individus : "La droite est encline à penser qu’elle peut éliminer l’opposition de gauche qui est animée par l’espoir d’un ordre économique radicalement différent, en liquidant ses chefs."30 Mais l’histoire est un processus collectif, conduit et mis en œuvre par les millions de personnes, pas seulement par la classe dominante qui veut en monopoliser les leçons.
Dans son étude de la révolution allemande, écrite dans les années 1970, l’historien "libéral" Sebastian Haffner concluait que ces crimes étaient toujours une blessure ouverte et que leurs résultats à long terme était toujours une question ouverte.
"Aujourd'hui on réalise avec horreur que cet épisode fut vraiment l'événement historiquement déterminant du drame de la révolution allemande. En regardant ces événements avec un demi-siècle de distance, leur impact historique a pris l'imprédictibilité étrange des événements de Golgotha – qui, au moment où ils eurent lieu, semblaient aussi n'avoir rien changé." Et : "Le meurtre du 15 janvier 1919 était le début – le début des milliers de meurtres sous Noske dans les mois qui suivirent, jusqu'aux millions de meurtres dans les décennies suivantes sous Hitler. C'était le signal de tout ce qui allait suivre."31
Les générations présentes et futures de la classe ouvrière peuvent-elles se réapproprier cette réalité historique ? Est-il possible, à long terme, de liquider les idées révolutionnaires en tuant ceux qui les défendent ? Les derniers mots du dernier article de Rosa Luxemburg avant sa mort étaient écrits au nom de la révolution : "J'étais, je suis, je serai".
Steinklopfer
1. Cette attaque fut déjouée par la mobilisation spontanée des ouvriers. Voir le précédent article [34] dans la Revue n°136.
2 Cité par Klaus Gietinger : Eine Leiche im Landwehrkanal. Die Ermordung Rosa Luxemburgs ("Un cadavre dans le Landwehr canal. Le meurtre de Rosa Luxemburg"), page 17, Hambourg 2008. Gietinger, sociologue, auteur et cinéaste, a dédié une grande partie de sa vie à faire des recherches sur les circonstances du meurtre de Luxemburg et Liebknecht. Son dernier livre – Waldemar Pabst : der Konterrevolutionär – bénéficie du point de vue de documents historiques obtenus à Moscou et à Berlin-Est et qui complètent les preuves de l'implication du SPD.
3. Les autres étaient le "Régiment Reichstag" monarchiste et l'organisation d'espionnage du SPD sous le commandement d'Anton Fischer.
4. Wilhelm Pieck fut le seul des trois à avoir la vie sauve. A ce jour, on ne sait toujours pas clairement s'il a réussi à s'échapper de lui-même ou si on lui permit de le faire après qu'il eut trahi ses camarades. Pieck devait devenir, après la seconde guerre mondiale, président de la République démocratique allemande (RDA).
5. L'auteur de l'article, Leo Jogiches, fut abattu un mois plus tard lui aussi "en fuite"… dans la cellule de sa prison.
6. Le général von Lüttwitz
7. A l'occasion du 90e anniversaire de ces atrocités, le parti libéral d'Allemagne (FPD) a proposé d'ériger un monument en l'honneur de Noske à Berlin. Pofalla, le secrétaire général de la CDU, parti de la chancelière Angela Merkel, a décrit les agissements de Noske comme "une défense courageuse de la république" (cité dans le journal berlinois Tagesspiegel, 11 janvier 2009).
8. Gietinger, Die Ermordung der Rosa Luxemburg ("L'assassinat de Rosa Luxemburg"). Voir le chapitre "74 Jahre danach" ("74 ans plus tard").
9. L'importance de ce pas fait en Allemagne est soulignée par l'écrivain Peter Weiss, un artiste allemand d'origine juive qui a fui en Suède la persécution nazie. Son roman monumental Die Ästhetik des Widerstands ("L'esthétique de la résistance") raconte l'histoire du ministre suédois de l'intérieur, Palmstierna qui, au cours de l'été 1917, envoya un émissaire à Petrograd, appelant – en vain - Kerensky, premier ministre du gouvernement russe pro-Entente, à assassiner Lénine. Kerensky refusa et nia que Lénine représentât un vrai danger.
10. Gumbel, Vier Jahre politischer Mord (Malik-Verlag Berlin, republié en 1980 par Wuderhorn, Heidelberg)
11. Qui peut lire ces lignes aujourd'hui sans penser à Auschwitz ?
12. Par exemple, le terrorisme des anarchistes d'Europe occidentale ou les Narodniki russes et les socialistes-révolutionnaires.
13. Gumbel, ibid.
14. Gumbel en établit la liste dans son livre. Nous la reproduisons ici – sans chercher à en traduire le nom – pour donner une impression de l'échelle du phénomène : Verband nationalgesinnter Soldaten, Bund der Aufrechten, Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund, Stahlhelm, Organisation “C”, Freikorps and Reichsfahne Oberland, Bund der Getreuen, Kleinkaliberschützen, Deutschnationaler Jugendverband, Notwehrverband, Jungsturm, Nationalverband Deutscher Offiziere, Orgesch, Rossbach, Bund der Kaisertreuen, Reichsbund Schwarz-Weiß-Rot, Deutschsoziale Partei, Deutscher Orden, Eos, Verein ehemaliger Baltikumer, Turnverein Theodor Körner, Allgemeiner deutschvölkischer Turnvereine, Heimatssucher, Alte Kameraden, Unverzagt, Deutscher Eiche, Jungdeutscher Orden, Hermansorden, Nationalverband deutscher Soldaten, Militärorganisation der Deutschsozialen und Nationalsozialisten, Olympia (Bund für Leibesübungen), Deutscher Orden, Bund für Freiheit und Ordnung, Jungsturm, Jungdeutschlandbund, Jung-Bismarckbund, Frontbund, Deutscher Waffenring (Studentenkorps), Andreas-Hofer-Bund, Orka, Orzentz, Heimatbund der Königstreuen, Knappenschaft, Hochschulring deutscher Art, Deutschvölkische Jugend, Alldeutscher Verband, Christliche Pfadfinder, Deutschnationaler Beamtenbund, Bund der Niederdeutschen, Teja-Bund, Jungsturm, Deutschbund, Hermannsbund, Adlerund Falke, Deutschland-Bund, Junglehrer-Bund, Jugendwanderriegen-Verband, Wandervögel völkischer Art, Reichsbund ehemaliger Kadetten.
15. C'est le général Ludendorff, quasiment dictateur de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, qui organisa le "putsch de la brasserie" à Munich en 1923 avec Adolf Hitler.
16. Scheidemann lui-même devait devenir la cible d'une tentative (manquée) d'assassinat par l'extrême droite qui lui reprochait d'avoir accepté le Traité de Versailles dicté par les puissances occidentales.
17. L'admiration de l'ancien chancelier d'Allemagne de l'Ouest, Helmut Schmidt, pour "l'homme d'État" Ebert est bien connue.
18. Mais, contaminées par l'état d'esprit révolutionnaire qui régnait dans la capitale, la plupart des troupes fraternisèrent avec la population ou se dispersèrent.
19. Après le meurtre de Karl et de Rosa, les membres du GKSD exprimèrent leur peur d'être lynchés si on les mettait en prison.
20. Durant les grèves de masse à Berlin en janvier 1918, Scheidemann du SPD participa à une délégation des ouvriers envoyée négocier au siège du gouvernement. Là, elle fut ignorée. Les ouvriers décidèrent de repartir. Scheidemann quémanda auprès des officiels qu'ils reçoivent la délégation. Son visage "s'illumina de plaisir" lorsque l'un d'eux fit de vagues promesses. La délégation ne fut pas reçue. (Rapporté par Richard Müller, "De l'Empire à la République")
21. Au fond, les militaires appréciaient tout à fait Ebert et Noske en particulier. Stinnes, l'homme le plus riche d'Allemagne après la Première Guerre mondiale, a appelé son yacht Legien, du nom du chef social-démocrate de la fédération syndicale.
22. Selon Gumbel, ce fut également le principal organisateur du putsch de Kapp.
23. Ou "socialiste d'État" comme l'appelait, avec enthousiasme, Walter Rathenow, président du gigantesque complexe électrique AEG.
24 Léon Trotsky, Histoire de la révolution russe, chapitre "Lénine appelle à l’insurrection"
25 Séance du Comité Central du P.O.S.D. (b) R. du 10 (23) octobre 1917 (Lénine, Œuvres complètes)
26 Lénine, "Lettre aux camarades", écrit le 17 (30) octobre 1917
27 Rosa Luxemburg, La révolution russe, "La dissolution de l'Assemblée constituante"
28 Rosa Luxemburg, "La tragédie russe"
29 Les libéraux indécrottables du FDP à Berlin ont suggéré de donner à une place publique de la ville le nom de Noske, comme nous l’avons mentionné plus haut. Le SPD, le parti de Noske, déclina la proposition. Aucune explication plausible ne fut apportée à cette modestie atypique.
30 Gumbel, ibid.
31 Haffner, 1918/1919 - eine deutsche Revolution
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [18]
Décadence du capitalisme (IV) : du capitalisme à la fin de la préhistoire
- 4091 lectures
Dans les précédents articles de cette série, nous avons examiné en détail le résumé de la méthode du matérialisme historique fait par Marx dans la Préface à l’Introduction à la critique de l’économie politique. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de ce résumé : "Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme antagonique du processus social de la production. Il n'est pas question ici d'un antagonisme individuel ; nous l'entendons bien plutôt comme le produit des conditions sociales de l'existence des individus ; mais les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent dans le même temps les conditions matérielles propres à résoudre cet antagonisme. Avec ce système social c'est donc la préhistoire de la société humaine qui se clôt."
L’universalité de la méthode de Marx
Nous reviendrons plus tard sur les antagonismes spécifiques que Marx considérait comme propres à la société capitaliste et sur la base desquels il fonde son verdict selon lequel le capitalisme, à l'instar de toutes les formes précédentes d’exploitation de classe, ne peut être considéré que comme une formation sociale transitoire. Mais auparavant, nous voulons répondre à une accusation portée contre les marxistes lorsqu'ils situent l’ascendance et le déclin de la société capitaliste dans le contexte de la succession des modes de production précédents – en d’autres termes, qui utilisent la méthode marxiste pour examiner le capitalisme comme un moment du déroulement de l'histoire humaine. Au cours des discussions avec des éléments de la nouvelle génération qui arrive à des positions révolutionnaires (par exemple sur le forum de discussion Internet libcom.org), cette démarche a été critiquée pour n'offrir qu'une "narration métaphysique" menant à des conclusions messianiques ; ailleurs sur le même forum 1, les tentatives de tirer des conclusions sur l'ascendance et le déclin du capitalisme à partir d'une perspective historique plus générale sont considérées comme une entreprise que Marx lui-même aurait rejetée en tant que recherche d'"une théorie historico-philosophique dont la suprême vertu consiste à être supra-historique." 2
Cette citation de Marx est souvent utilisée hors de son contexte afin de défendre l'idée que Marx n'aurait jamais cherché à élaborer une théorie générale de l'histoire mais avait uniquement pour but l'analyse des lois du capitalisme. Quel est donc le contexte de cette citation ?
Elle provient d'une lettre de Marx à l'éditeur de la revue russe Otyecestvenniye Zapisky (novembre 1877) répondant à "un critique russe" qui essayait de décrire la théorie de l'histoire de Marx comme un schéma dogmatique et mécaniste selon lequel chaque nation était destinée à suivre exactement le même modèle de développement que celui que Marx avait analysé à propos de la montée du capitalisme en Europe. Ce critique se voit obligé "de métamorphoser mon esquisse de la genèse du capitalisme dans l’Europe occidentale en une théorie historico-philosophique de la marche générale fatalement imposée à tous les peuples, quelles que soient les circonstances historiques où ils se trouvent placés" 3. En fait, cette tendance était très forte parmi les premiers marxistes russes qui avaient souvent tendance à présenter le marxisme comme une simple apologie du développement capitaliste et considéraient que la Russie devait nécessairement accomplir sa propre révolution bourgeoise avant de pouvoir atteindre l'étape de la révolution socialiste. C'est la même tendance qui refit plus tard surface sous la forme du menchevisme.
Dans la lettre en question, Marx aboutit en fait à une conclusion très différente :
"Pour pouvoir juger en connaissance de cause du développement économique de la Russie contemporaine, j'ai appris le russe et puis étudié, pendant de longues années, les publications officielles et autres ayant rapport à ce sujet. Je suis arrivé à ce résultat : si la Russie continue à marcher dans le sentier suivi depuis 1861, elle perdra la plus belle chance que l’histoire ait jamais offerte à un peuple, pour subir toutes les péripéties fatales du régime capitaliste." 4 (Ibid., p. 1553)
En somme, Marx ne considérait absolument pas que sa méthode pour analyser l'histoire en général pouvait s'appliquer de façon schématique à chaque pays pris séparément, ni que sa théorie de l'histoire était un système rigide du "progrès universel", qui suivrait un processus linéaire et mécanique se développant toujours dans une même direction progressive (même si c'est ce qu'est effectivement devenu entre les mains des mencheviks et plus tard des staliniens ce qui était appelé le marxisme). Marx avait raison de considérer que la Russie pouvait être épargnée des horreurs d'une transformation capitaliste par la conjonction d’une révolution prolétarienne dans les pays occidentaux avancés et des formes communales traditionnelles à la base de l'agriculture russe. Le fait que les choses ne se produisirent pas ainsi n'invalide pas la démarche ouverte de Marx. De plus, sa méthode est concrète et prend en considération les circonstances historiques réelles dans lesquelles une forme sociale donnée apparaît. Toujours dans la même lettre, Marx donne un exemple de la façon dont il travaille : "En différents endroits du Capital, j’ai fait allusion au destin qui atteignit les plébéiens de l’ancienne Rome. C'étaient originairement des paysans libres cultivant, chacun pour son compte, leurs propres parcelles. Dans le cours de l'histoire romaine, ils furent expropriés. Le même mouvement qui les sépara d’avec leurs moyens de production et de subsistance impliqua non seulement la formation des grandes propriétés foncières mais encore celle de grands capitaux monétaires. Ainsi, un beau matin, il y avait, d'un côté, des hommes libres, dénués de tout, sauf de leur force de travail et, de l'autre, pour exploiter ce travail, les détenteurs de toutes les richesses acquise. Qu'est-ce qui arriva ? Les prolétaires romains devinrent non des travailleurs salariés mais un mob fainéant, plus abject que les ci-devant poor whites des pays méridionaux des États-Unis ; et à leur côté, se déploya un mode de production non capitaliste mais esclavagiste. Donc, des événements d'une analogie frappante, mais se passant dans des milieux historiques différents, amenèrent des résultats tout à fait disparates. En étudiant chacune de ces évolutions à part, et en les comparant ensuite, l’on trouvera facilement la clef de ces phénomènes, mais on n'y arrivera jamais avec le passe-partout d'une théorie historico-philosophique générale, dont la vertu suprême consiste à être supra-historique." (Ibid., p.1555)
Mais ce que cet exemple ne montre absolument pas, c'est l'idée selon laquelle la théorie de Marx aurait exclu la possibilité de tracer une dynamique générale des formes sociales précapitalistes ni que, par conséquent, toute discussion sur l'ascension et le déclin des systèmes sociaux serait une entreprise futile et dépourvue de sens. L'énorme quantité d'énergie que Marx a dédiée à l'étude de la "commune" russe et à la question du communisme primitif en général au cours de ses dernières années, et le nombre de pages qu'il a consacrées à l'analyse des formes de société précapitalistes, dans les Grundrisse et ailleurs, contredit clairement ce point de vue. La lettre qui est prise pour exemple montre que Marx insistait sur la nécessité d'étudier une formation sociale de façon séparée, avant d'établir des comparaisons et, de cette façon, de "trouver la clef" du phénomène en question, mais elle ne montre pas que Marx refusait d'aller du particulier au général pour comprendre le mouvement de l'histoire.
Et, par dessus tout, l'accusation selon laquelle toute tentative de situer le capitalisme dans le contexte de la succession des modes de production serait un projet "supra-historique" est réfutée par la démarche présentée dans la Préface à la Critique de l'économie politique dans laquelle Marx expose comment il envisage de façon générale l'évolution historique et où il annonce très clairement le but de son investigation. Dans le précédent article, nous avons examiné le passage qui traite des formations sociales passées (communisme primitif, despotisme asiatique, esclavage, féodalisme, etc.) et montré comment on peut tirer certaines conclusions générales sur les raisons de leur ascension et de leur déclin – pour être précis, sur l'instauration de rapports sociaux de production agissant, à un moment donné, comme aiguillon, à un autre, comme entrave au développement des forces productives. Dans le passage de la Préface que nous examinons ici, Marx utilise une simple expression – mais pleine de signification – pour souligner le fait que le but de son investigation est l'ensemble de l'histoire de l'humanité : "Avec ce système social, s'achève donc la préhistoire de la société humaine." Qu' entendait exactement Marx par cette expression ?
Fin de l'histoire ou fin de la préhistoire ?
Lorsque le bloc de l'Est s'est effondré en 1989, la classe dominante à l'Ouest a lancé une énorme campagne de propagande autour du slogan "le communisme est mort" et elle exultait en concluant que Marx, le "prophète" du communisme, était enfin disqualifié. C'est Francis Fukuyama qui a apporté à cette campagne son vernis "philosophique" en annonçant sans hésitation "la fin de l'histoire" – le triomphe définitif du capitalisme libéral et démocratique qui allait apporter, à sa façon certes imparfaite mais fondamentalement humaine, la fin de la guerre et de la pauvreté et libérer le genre humain du fardeau des crises cataclysmiques : "Ce à quoi nous assistons peut-être n'est pas seulement à la fin de la Guerre froide, ni à la fin d'une période particulière de l'histoire d'après-guerre, mais à la fin de l'histoire en tant que telle... C'est-à-dire le point final de l'évolution idéologique de l'humanité et l'universalisation de la démocratie libérale occidentale en tant que forme ultime du gouvernement humain". (La fin de l'histoire et le dernier homme, Fukuyama, 1992, traduit de l'anglais par nous).
Les deux décennies qui ont suivi cet événement et leur cortège de barbarie et de génocides militaires, le fossé croissant entre les riches et les pauvres au niveau mondial, l'évidence grandissante d'une catastrophe environnementale aux proportions planétaires ont rapidement ébranlé la thèse complaisante de Fukuyama qu'il allait lui-même nuancer, en même temps qu'il apportait un soutien acritique à la fraction dominante des Néoconservateurs américains aux États-Unis. Et aujourd'hui, avec l'éclatement d'une crise économique profonde au cœur même du capitalisme démocratique libéral triomphant, de telles idées ne peuvent qu'être objets de ridicule – et, entre-temps, Marx et sa vision du capitalisme comme système ravagé par la crise ne peuvent plus être écartés comme le vestige d'une ancienne période jurassique depuis longtemps révolue.
Marx lui-même avait très tôt remarqué que la bourgeoisie était déjà parvenue à la conclusion que son système constituait la fin de l'histoire, le summum et le but final de l'entreprise humaine et l'expression la plus logique de la nature humaine. Même un penseur révolutionnaire comme Hegel dont la méthode dialectique se basait sur la reconnaissance du caractère transitoire de toutes les phases et expressions historiques, était tombé dans ce piège en considérant le régime prussien existant comme l'aboutissement de l'Esprit absolu.
Comme on l'a vu dans les articles précédents, Marx rejetait l'idée que le capitalisme, basé sur la propriété privée et l'exploitation du travail humain, fût l'expression parfaite de la nature humaine ; il mettait en avant que l'organisation sociale humaine avait été au début une forme de communisme ; il considérait le capitalisme comme une forme parmi d'autres au sein d'une série de sociétés divisées en classe qui ont fait suite à la dissolution du communisme primitif, lui-même condamné à disparaître du fait de ses propres contradictions internes.
Le capitalisme, épisode final de la série
Mais le capitalisme constitue vraiment l'épisode final de cette série, "la dernière forme antagoniste du processus social de la production, antagoniste non pas dans le sens d'un antagonisme individuel, mais d'un antagonisme qui naît des conditions sociales d'existence des individus".
Pourquoi ? Parce que "les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles propres à résoudre cet antagonisme". (Préface)
Le terme de "forces productives" a été considéré avec méfiance depuis que Marx l'a utilisé. Et de façon compréhensible car (comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent) la perversion du marxisme par la contre-révolution stalinienne a conféré à la notion de développement des forces productives une signification sinistre qui évoque l'image de l'exploitation stakhanoviste et de la construction d'une économie de guerre monstrueusement déséquilibrée. Et au cours des dernières décennies, l'évolution rapide de la crise écologique a mis en relief le prix terrible que l'humanité paie pour la poursuite du "développement" frénétique du capitalisme.
Pour Marx, les forces productives ne sont pas une sorte de puissance autonome déterminant l'histoire de l'humanité – ce n'est vrai que dans la mesure où elles sont le produit du travail aliéné et ont échappé des mains de l'espèce qui les a développées au départ. De même, ces forces, mues par des formes particulières d'organisation sociale, ne sont pas, de façon inhérente, hostiles au genre humain comme dans les cauchemars anti-technologiques des primitivistes et autres anarchistes. Au contraire, à un certain stade de leur développement coûteux et contradictoire, elles constituent la clé pour libérer l'espèce humaine de millénaires de labeur et d'exploitation, à condition que l'humanité soit capable de réorganiser ses rapports sociaux de sorte que l'immense puissance productrice qui s'est développée sous le capitalisme, soit utilisée pour satisfaire les véritables besoins humains.
En fait, une telle réorganisation est possible du fait de l'existence, au sein du capitalisme, d'une "force productive", le prolétariat, qui, pour la première fois, est à la fois classe exploitée et classe révolutionnaire, contrairement par exemple à la bourgeoisie qui, tout en étant révolutionnaire face à l'ancienne classe féodale, était à son tour porteuse d'une nouvelle forme d'exploitation de classe. La classe ouvrière, elle, n'a aucun intérêt à l'instauration d'un nouveau système d'exploitation car elle ne peut se libérer qu'en libérant toute l'humanité. Comme l'écrit Marx dans L'Idéologie allemande :
"Dans toutes les révolutions antérieures, le mode d'activité restait inchangé et il s'agissait seulement d'une autre distribution de cette activité, d'une nouvelle répartition du travail entre d'autres personnes ; la révolution communiste par contre est dirigée contre le mode d'activité antérieur, elle supprime le travail, et abolit la domination de toutes les classes en abolissant les classes elles-mêmes, parce qu'elle est effectuée par la classe qui n'est plus considérée comme une classe dans la société, qui n'est plus reconnue comme telle et qui est déjà l'expression de la dissolution de toutes les classes, de toutes les nationalités, etc., dans le cadre de la société actuelle". 5
Mais cela signifie aussi émanciper l'humanité de toutes les cicatrices laissées par des milliers d'années de domination de classe et, au delà de ça, de centaines de milliers d'années durant lesquelles l'humanité a été dominée par la pénurie matérielle et la lutte pour la survie.
L'humanité arrive donc à un point de rupture net avec toutes les époques historiques antérieures. C'est pourquoi Marx parle de la fin de la "préhistoire". Si le prolétariat parvient à renverser la domination du capital et, après une période de transition plus ou moins longue, à créer une société mondiale pleinement communiste, il sera possible pour la prochaine génération d'êtres humains de faire leur propre histoire en pleine conscience. Engels présente cela dans un passage de l'Anti-Dühring de façon très éloquente :
"Avec la prise de possession des moyens de production par la société, la production marchande est éliminée et, par suite, la domination du produit sur le producteur. L'anarchie à l'intérieur de la production sociale est remplacée par l'organisation planifiée consciente. La lutte pour l'existence individuelle cesse. Par là, pour la première fois, l'homme se sépare, dans un certain sens, définitivement du règne animal, passe de conditions animales d'existence à des conditions réellement humaines. Le cercle des conditions de vie entourant l'homme, qui jusqu'ici dominait l'homme, passe maintenant sous la domination et le contrôle des hommes qui, pour la première fois, deviennent des maîtres réels et conscients de la nature, parce que et en tant que maîtres de leur propre vie en société. Les lois de leur propre pratique sociale qui, jusqu'ici, se dressaient devant eux comme des lois naturelles, étrangères et dominatrices, sont dès lors appliquées par les hommes en pleine connaissance de cause, et par là dominées. La vie en société propre aux hommes qui, jusqu'ici, se dressait devant eux comme octroyée par la nature et l'histoire, devient maintenant leur acte propre et libre. Les puissances étrangères, objectives qui, jusqu'ici, dominaient l'histoire, passent sous le contrôle des hommes eux-mêmes. Ce n'est qu'à partir de ce moment que les hommes feront eux-mêmes leur histoire en pleine conscience ; ce n'est qu'à partir de ce moment que les causes sociales mises par eux en mouvement auront aussi d'une façon prépondérante, et dans une mesure toujours croissante, les effets voulus par eux. C'est le bond de l'humanité du règne de la nécessité dans le règne de la liberté." 6
Dans ce passage, Marx et Engels réaffirment la vaste étendue de leur vision de l'histoire, montrant l'unité sous-jacente de toutes les époques de l'histoire de l'humanité qui ont existé jusqu'ici et montrant comment le processus historique, bien qu'il ait eu lieu plus ou moins inconsciemment, de façon aveugle, crée néanmoins les conditions d'un saut qualitatif non moins fondamental que celui de la première émergence de l'homme du règne animal.
Cette vision grandiose fut reprise par Trotsky plus de cinquante années plus tard, dans une présentation à des étudiants danois le 27 novembre 1932, peu de temps après son exil de Russie. Trotsky se réfère au matériel apporté par les sciences humaines et les sciences naturelles, en particulier aux découvertes de la psychanalyse, afin d'indiquer plus précisément ce que cette étape implique pour la vie intérieure des hommes. "L'anthropologie, la biologie, la physiologie, la psychologie ont rassemblé des montagnes de matériaux pour ériger devant l'homme dans toute leur ampleur les tâches de son propre perfectionnement corporel et spirituel et de son développement ultérieur. Par la main géniale de Sigmund Freud, la psychanalyse souleva le couvercle du puits nommé poétiquement "l'âme" de l'homme. Et qu'est-il apparu ? Notre pensée consciente ne constitue qu'une petite partie dans le travail des obscures forces psychiques. De savants plongeurs descendent au fond de l'Océan et y photographient de mystérieux poissons. Pour que la pensée humaine descende au fond de son propre puits psychique, elle doit éclairer les forces motrices mystérieuses de l'âme et les soumettre à la raison et à la volonté. Quand il aura terminé avec les forces anarchiques de sa propre société, l'homme travaillera sur lui-même dans les mortiers, dans les cornues du chimiste. Pour la première, fois, l'humanité se considérera elle-même comme une matière première, et dans le meilleur des cas comme un produit semi-achevé physique et psychique." 7
Dans ces deux passages est clairement établie une unité entre toutes les époques historiques jusqu'ici : durant cette immense période de temps, l'homme est "un produit semi-achevé physique et psychique" – en un sens, une espèce toujours en transition du règne animal vers une existence pleinement humaine.
De toutes les sociétés de classe jusqu'à ce jour, seul le capitalisme pouvait être le prélude à un tel saut qualitatif, car il a développé les forces productives au point où les problèmes fondamentaux de l'existence matérielle de l'humanité – la fourniture des besoins vitaux pour tous les hommes de la planète – peuvent enfin être résolus, permettant aux êtres humains la liberté de développer leurs capacités créatrices sans limites et de réaliser leur potentiel véritable et caché. Ici la véritable signification des "forces productives" devient claire : les forces productives sont fondamentalement la puissance créatrice de l'humanité elle-même qui ne se sont jusqu'à présent exprimées que de façon limitée et altérée, mais qui prendront leur véritable essor une fois que les limites de la société de classe auront été transcendées.
Plus encore, le communisme, société sans propriété privée ni exploitation, est devenu la seule base possible pour le développement de l'humanité puisque les contradictions inhérentes au travail salarié généralisé et à la production de marchandises menacent de désintégrer tous les liens sociaux de l'humanité et même de détruire les fondements mêmes de la vie humaine. L'humanité vivra en harmonie avec elle-même et avec la nature, ou elle ne vivra pas. L'affirmation de Marx dans L'Idéologie allemande, rédigé durant la jeunesse du capitalisme, devient bien plus urgente et inévitable au fur et à mesure que le capitalisme s'enfonce dans son déclin. "Nous en sommes arrivés aujourd'hui au point que les individus sont obligés de s'approprier la totalité des forces productives existantes, non seulement pour parvenir à une manifestation de soi, mais avant tout pour assurer leur existence". 8
Le communisme résout donc l'énigme de l'histoire de l'humanité – comment assurer les besoins vitaux afin de jouir pleinement de la vie. Mais, contrairement à l'idéologie capitaliste, les communistes ne considèrent pas le communisme comme un point final et statique. Dans les Manuscrits économiques et philosophiques, de 1844, il est vrai que Marx présente le communisme comme "la solution à l'énigme de l'histoire", mais il le considère également comme un point de départ à partir duquel la véritable histoire de l'homme pourra commencer. "Le communisme pose le positif comme négation de la négation, il est donc le moment réel de l'émancipation et de la reprise de soi de l'homme, le moment nécessaire pour le développement à venir de l'histoire. Le communisme est la forme nécessaire et le principe énergétique du futur prochain, mais le communisme n'est pas en tant que tel le but du développement humain, la forme de la société humaine". 9
Le point de vue du futur
De façon caractéristique, le résumé que fait Marx de la façon dont il considère nécessaire d'envisager le passé, s'achève en se tournant vers un avenir très lointain. Et cela aussi fait totalement partie de sa méthode, au scandale de ceux qui pensent que poser les questions à une telle échelle aboutit inévitablement dans la "métaphysique". En fait, on pourrait dire que le futur est toujours le point de départ de Marx. Comme il l'explique dans les Thèses sur Feuerbach, le point de vue du nouveau matérialisme, la base de la connaissance de la réalité par le mouvement prolétarien, ne partait pas de l'addition des individus atomisés qui constituent la société bourgeoise, mais de "l'humanité socialisée" ou l'homme tel qu'il pourrait être dans une société vraiment humaine ; en d'autres termes, l'ensemble du mouvement de l'histoire jusqu'à aujourd'hui doit être évalué en partant du communisme du futur. Il est essentiel de garder cela à l'esprit quand on cherche à analyser si une forme sociale est un facteur de "progrès" ou un système qui fait reculer l'humanité. Le point de vue qui considère toutes les époques de l'humanité jusqu'à aujourd'hui comme appartenant à sa "préhistoire" ne se base pas sur un idéal de perfection pour laquelle l'humanité serait inévitablement programmée, mais sur la possibilité matérielle inhérente à la nature de l'homme et à son interaction avec la nature – une possibilité qui peut échouer précisément parce que cette réalisation est en fin de compte dépendante de l'action humaine consciente. Mais le fait qu'il n'existe pas de garantie de succès du projet communiste ne change pas le jugement que les révolutionnaires, qui "représentent le futur dans le monde présent", doivent porter sur la société capitaliste une fois qu'elle a atteint le point où elle a rendu possible le saut dans le règne de la liberté à l'échelle globale : le fait qu'elle est devenue superflue, obsolète et décadente en tant que système de reproduction sociale.
Gerrard.
1. Par exemple sur https://libcom.org/forums/thought/general-discussion-decadence-theory-17092007 [35]
2 "Réponse à Mikhaïlovski", Œuvres II, Éditions La Pléiade, p. 1555.
3. Ibid.
4 Ibid., p. 1553.
5. L'idéologie allemande [36], "B. La base réelle de l'idéologie".
6. Anti-Dühring [37], partie "Socialisme, II Notions théoriques"
8. L'idéologie allemande [36], "B. La base réelle de l'idéologie"
9. Troisième Manuscrit [39], "Propriété privée et communisme"
La naissance du syndicalisme révolutionnaire dans le mouvement ouvrier allemand
- 4480 lectures
La caractéristique majeure du syndicalisme révolutionnaire est, pour résumer, la conception selon laquelle, les syndicats constituent, d'une part, l'organisation de lutte la plus adaptée de la classe ouvrière au sein du capitalisme et, d'autre part, après la révolution par la grève générale victorieuse, la base d'une nouvelle structure de la société.
L'opposition syndicale des "Localistes" puis, à partir de 1897, la fondation de la Freie Vereinigung Deutscher Gewerschaften (FVDG, Union Libre des syndicats allemands) ont constitué des jalons dans la naissance du syndicalisme révolutionnaire organisé dans le mouvement ouvrier allemand. De façon comparable aux tendances syndicalistes révolutionnaires plus importantes en France, en Espagne et aux États-Unis, ce courant a représenté, à son origine, une réaction prolétarienne saine au sein mouvement ouvrier allemand contre la politique de plus en plus alignée sur le réformisme de la direction de la puissante social-démocratie et de ses syndicats.
Après la Première Guerre mondiale, en septembre 1919, a été fondée la Freie Arbeiter Union Deutschlands (FAUD, Union des Travailleurs Libres d'Allemagne). Désormais, en tant qu'organisation "anarcho-syndicaliste" déclarée, la FAUD se concevait comme l'héritière directe d'un mouvement syndicaliste révolutionnaire antérieur à la Première Guerre mondiale.
Il existe encore aujourd'hui de multiples groupements anarcho-syndicalistes qui se réclament de la tradition de la FVDG et de l'anarcho-syndicalisme ultérieur de la FAUD des années 1920. Rudolf Rocker, en tant que "théoricien" le plus connu de l'anarcho-syndicalisme allemand à partir de 1919, sert souvent de point de référence politique.
Le syndicalisme révolutionnaire en Allemagne a toutefois connu, sans aucun doute, une grande transformation depuis sa naissance. Pour nous, la question centrale est d'examiner si le mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne a été capable de défendre les intérêts de sa classe, d'apporter des réponses politiques aux questions brûlantes et de rester fidèle à l'internationalisme du prolétariat.
Il vaut la peine d'examiner préalablement le défi le plus sérieux auquel la classe ouvrière a été confrontée au cours des dernières décennies du 19e siècle en Allemagne : le réformisme. A défaut de quoi, le danger est grand de considérer le syndicalisme révolutionnaire en Allemagne simplement comme une "stratégie syndicale particulièrement radicale" ou de le voir seulement comme une "importation d'idées" en provenance de pays latins tels que l'Espagne ou la France, où le syndicalisme révolutionnaire a toujours joué un rôle de loin plus important qu'en Allemagne.
L’amorce de la dégénérescence de la social-démocratie : ressort de l’apparition des "ancêtres" du syndicalisme révolutionnaire
Le parti social-démocrate allemand (SPD) a constitué, au sein de la 2e Internationale (1889-1914), l'organisation prolétarienne la plus puissante et a servi, pendant des années, de boussole politique pour le mouvement ouvrier international. Mais le SPD constitue tout autant le symbole d’une expérience tragique : il est l’exemple typique d'une organisation qui, après des années passées sur le terrain de la classe ouvrière, a subi un processus de dégénérescence insidieux pour finalement, dans les années de la première guerre mondiale 1914-18, passer irrémédiablement dans le camp de la classe dominante. La direction du SPD a poussé la classe ouvrière en 1914 dans la boucherie de la guerre et s'est chargée d'un rôle central dans la défense des intérêts de l'impérialisme allemand.
Bismarck avait imposé en 1878 la "loi antisocialiste" qui devait rester en vigueur durant 12 ans - jusqu'en 1890. Cette loi, qui réprimait les activités et les réunions d'organisations prolétariennes, visait toutefois et surtout toute liaison organisationnelle entre organisations prolétariennes. Mais la "loi antisocialiste" ne consistait aucunement, uniquement, en une répression dure et aveugle contre la classe ouvrière. La classe dominante a, avec ses mesures, essayé de rendre attrayante, aux yeux de la direction du SPD, la participation au parlement bourgeois comme activité centrale. Habilement, elle a ainsi facilité la voie à la tendance réformiste en germe dans la social-démocratie.
Les conceptions réformistes dans la social-démocratie s'exprimèrent précocement dans le Manifeste des Zurichois de 1879 et se cristallisèrent autour de la personne d’Eduard Bernstein. Elles revendiquaient de placer le travail parlementaire au centre de l'activité du parti afin de conquérir progressivement le pouvoir au sein de l’État bourgeois. C'était donc un rejet de la perspective de la révolution prolétarienne - qui doit détruire l'État bourgeois - en faveur de la réforme du capitalisme. Bernstein et ses partisans revendiquaient une transformation du SPD, de parti ouvrier en une organisation dont la fonction était de gagner la classe dominante à la conversion du capital privé en capital commun. Ainsi, la classe dominante devait devenir elle-même le ressort du dépassement de son propre système, le capitalisme : une absurdité ! Ces conceptions représentaient une attaque frontale contre la nature encore prolétarienne du SPD. Mais plus encore : le courant de Bernstein faisait ouvertement de la propagande en faveur du soutien à l'impérialisme allemand dans sa politique coloniale en approuvant la construction de puissants navires transocéaniques. Les idées réformistes de Bernstein ont, à l’époque du Manifeste des Zurichois, clairement été combattues par la majorité de la direction social-démocrate et n'ont pas trouvé non plus grand écho à la base du parti. L'histoire a toutefois montré tragiquement, dans les décennies suivantes, que cela avait été la première expression d'un cancer qui devait envahir peu à peu, inexorablement, de grandes parties du SPD. Il n'est donc pas étonnant que cette capitulation ouverte face au capitalisme, que Bernstein a d’abord symbolisée isolément mais qui obtint une influence toujours plus grande dans la social-démocratie allemande, ait déclenché un réflexe d’indignation au sein de la classe ouvrière. Il n’est pas étonnant que, dans cette situation, une réaction spécifique se soit fait jour justement parmi les ouvriers combatifs organisés dans les syndicats.
La théorie des syndicats de Carl Hillmann
Il y avait toutefois déjà eu dans le mouvement ouvrier allemand, avant le Manifeste des Zurichois et dès le début des années 1870, une première tentative autour de Carl Hillmann en vue de développer une "théorie des syndicats" indépendante. Le mouvement syndicaliste, peu avant la première guerre mondiale, et surtout l’anarcho-syndicalisme par la suite, n’ont cessé de s’en réclamer. À partir de mai 1873, parut une série d'articles sous le titre Indications pratiques d’émancipation dans la revue Der Volkstaat’1, où Hillmann écrivait :
"(…) la grande masse des travailleurs éprouve une méfiance à l'égard de tous les partis purement politiques parce que, d'une part, ils sont souvent trahis et abusés par ces derniers et parce que, d'autre part, l'ignorance par ces partis des mouvements sociaux conduit à masquer l'importance de leur côté politique ; en outre, les travailleurs montrent une plus grande compréhension et un sens pratique pour des questions qui leur sont plus proches : réduction du temps de travail, élimination des règlements d'usine répugnants, etc.
L'organisation purement syndicale exerce une pression durable sur la législation et les gouvernements. Par conséquent, cette expression du mouvement ouvrier est, elle aussi, politique, même si seulement en second lieu ;
(…) les efforts effectifs d'organisation syndicale font mûrir la pensée de la classe ouvrière vers son émancipation, et c'est pourquoi ces organisations naturelles doivent être mises au même rang que l'agitation purement politique et ne peuvent être considérées ni comme une formation réactionnaire, ni comme la queue du mouvement politique."
Derrière le désir de Hillmann, dans les années 1870, de défendre le rôle des syndicats en tant qu'organisations centrales pour la lutte de la classe ouvrière, il n’y avait aucune intention d’introduire une ligne de séparation entre la lutte économique et la lutte politique ou même de rejeter la lutte politique. La "théorie des syndicats" de Hillmann était plutôt principalement une réaction significative face aux tendances émergeant au sein de la direction de la social-démocratie, consistant à subordonner le rôle des syndicats, et en général la lutte de classe, aux activités parlementaires.
Engels, déjà à l’époque de Hillmann, en mars 1875, critiqua exactement sur la même question le projet de programme pour le congrès d'union des deux partis socialistes d'Allemagne à Gotha, qu’il jugeait "sans sève ni vigueur" : "En cinquième lieu, il n'est même pas question de l'organisation de la classe ouvrière, en tant que classe, par le moyen des syndicats. Et c'est là un point tout à fait essentiel, car il s'agit, à proprement parler, de l'organisation de classe du prolétariat, au sein de laquelle celui-ci mène ses luttes quotidiennes contre le capital, et se forme à la discipline, organisation qui aujourd'hui, même au milieu de la plus redoutable des réactions (comme c'est le cas en ce moment à Paris), ne peut absolument plus être détruite. Étant donnée l'importance prise par cette organisation aussi en Allemagne, il serait, à notre avis, absolument nécessaire de la prendre en considération dans le programme et de lui donner si possible une place dans l'organisation du Parti."2
Effectivement, les syndicats, à l'époque d'un capitalisme en plein développement, étaient un instrument important pour le dépassement de l'isolement des travailleurs et pour le développement de leur conscience de soi en tant que classe : une école de la lutte de classe. La voie était encore ouverte pour l'obtention par la classe ouvrière, de la part du capitalisme en plein développement, des réformes durables en sa faveur.3
Contrairement à l'historiographie de certaines parties du milieu anarcho-syndicaliste, ce n'était pas l'intention de Hillmann de faire de la résistance aux marxistes qui auraient prétendument toujours sous-estimé les syndicats. C'est là une affirmation à laquelle on se heurte constamment de façon caractéristique, mais qui ne correspond toutefois pas à la réalité. Hillmann se considérait clairement, du point de vue de ses conceptions générales, comme faisant partie de l’Association Internationale des Travailleurs (A.I.T.), au sein de laquelle Marx et Engels militaient aussi. Le fond de ses critiques était dirigé contre ceux qui, dans la social-démocratie, introduisaient la sujétion à la lutte parlementaire, les mêmes auxquels Marx et Engels s’étaient opposés dans leurs critiques au programme de Gotha. Par conséquent, parler de l'existence, déjà dans les années 1870, d’un "syndicalisme indépendant" dans le mouvement ouvrier allemand serait sûrement faux. Comme mouvement effectif au sein de la classe ouvrière en Allemagne, il ne se forma peu à peu qu’une vingtaine d’années plus tard.
Alors que Hillmann, avec un sain instinct prolétarien, perçut précocement la lente introduction du crétinisme parlementaire dans le mouvement ouvrier allemand, et réagit à cette situation, il y a toutefois une différence essentielle dans sa démarche par rapport à la lutte de Marx et Engels : Hillmann revendiquait en premier lieu l’autonomie des syndicats et "l'importance des questions d'intérêt immédiat". Marx, en revanche, avait pour sa part déjà mis en garde, dans la fin des années 1860, contre une réduction de la lutte pour les salaires à une lutte pour le salaire : "Jusqu’ici, les syndicats ont envisagé trop exclusivement les luttes sociales et immédiates contre le capital. Ils n’ont pas encore compris parfaitement leur force d’offensive contre le système d’esclavage du salariat et contre le mode de production actuel. C’est pourquoi ils se sont tenus trop à l’écart des mouvements sociaux et politiques généraux."4
Comme nous le voyons déjà à cette époque, Marx et Engels insistaient sur l'unité générale de la lutte économique et de la lutte politique de la classe ouvrière, même si elles devaient être conduites au moyen d’organisations différentes. Les idées de Hillmann recelaient, par rapport à cela, la grande faiblesse de ne pas engager de façon conséquente et active la lutte politique contre l’aile du SPD exclusivement orientée vers le parlement, et de se retirer dans l'activité syndicale, cédant ainsi le terrain presque sans combat au réformisme. Cela a fait le jeu de ses adversaires car le cantonnement des travailleurs à la lutte purement économique est exactement ce qui a caractérisé le développement du réformisme dans le mouvement syndical.
Le syndicalisme révolutionnaire en Allemagne provient-il du camp anarchiste ?
Durant l’été 1890, se constitua dans le SPD une petite opposition, celle des "Jeunes". Ce qui caractérisait ses représentants les plus connus Wille, Wildberger, Kapfmeyer, Werner et Baginski, c’était leur appel à "plus de liberté" dans le parti et leur attitude antiparlementaire. Ils rejetaient en outre, dans une démarche très localiste, la nécessité d'un organe central pour le SPD.
"Les Jeunes" ont représenté une opposition de parti très hétérogène – qu’il est probablement plus approprié de désigner comme un rassemblement de membres du SPD mécontents. Toutefois, le mécontentement des "Jeunes" était en réalité tout à fait justifié, car la tendance réformiste dans la social-démocratie n'avait nullement disparu après l’abolition de la loi antisocialiste en 1890. Peu à peu, le réformisme gagnait davantage de poids. Mais la critique des "Jeunes" n'a pas été en mesure d’identifier les vrais problèmes et les racines idéologiques du réformisme. Au lieu d'une lutte politiquement fondée contre l'idée réformiste de la "transformation pacifique" du capitalisme en une société socialiste sans classes, les "Jeunes" ont uniquement mené une violente campagne contre différents chefs du SPD et sur le terrain d'attaques très personnelles. Leur explication du réformisme a trouvé son expression dans une argumentation immature et réductrice qui plaçait au centre "la recherche d’un profit personnel et de la célébrité" et "la psychologie des dirigeants du SPD". Ce conflit s’est terminé par le départ, et l'exclusion simultanée, des "Jeunes" du SPD au congrès d'Erfurt de 1891. Ceci ouvrait les portes, en novembre 1891, à la fondation de l’Union Anarchiste des Socialistes Indépendants (VUS). L’éphémère VUS, regroupement complètement hétérogène formé principalement d’anciens membres du SPD mécontents, est rapidement tombé, après de lourdes tensions personnelles, sous le contrôle de l’anarchiste Gustav Landauer et disparut trois ans plus tard, en 1894.
A la lecture des représentations anarcho-syndicalistes actuelles et des livres les plus connus sur la naissance du syndicalisme révolutionnaire en Allemagne, il apparaît clairement l'existence d'une tentative, souvent convulsive, de tricoter un fil rouge remontant vers le passé, pour y rattacher l'anarcho-syndicalisme de la FAUD fondée en 1919. La plupart du temps, ces représentations consistent en une simple juxtaposition de différents mouvements d'opposition dans les organisations ouvrières allemandes : depuis Hillmann en passant par Johann Most, les "Jeunes" et les "Localistes", puis la FVDG, l’Union Libre des syndicats allemands et, finalement, la FAUD. La simple existence d'un conflit avec les tendances dirigeantes respectives au sein de la social-démocratie et des syndicats y est considérée comme le point commun déterminant. Mais l'existence d'un conflit avec la direction des syndicats ou bien du parti ne constitue pas en soi une continuité politique, laquelle, à y regarder de plus près, n’existe pas non plus entre toutes ces organisations ! Chez Hillmann, Most et les "Jeunes", on peut discerner une aversion possible et commune face aux illusions vis-à-vis du parlementarisme qui gagnent du terrain autour d’eux. Alors que Hillmann est toutefois toujours resté partie prenante de la Première Internationale et de la lutte vivante de la classe ouvrière, Most de concert avec Hasselmann, glissa rapidement, au début des années 1880, dans la "propagande par le fait" petite bourgeoise, isolée et désespérée – des actes terroristes. Les "Jeunes" n'ont pas pu, avec leurs attaques personnelles, égaler la qualité politique de Hillmann qui avait constitué une tentative sérieuse d’impulser la lutte de classe. Ensuite, les "Localistes" et la FVDG qu'ils ont formée, ont en revanche représenté, durant des années, un mouvement vivant au sein de la classe ouvrière. Dans l'opposition syndicale, qui donna plus tard le jour au syndicalisme révolutionnaire en Allemagne, les idées anarchistes n'avaient toujours eu, jusqu'en 1908, qu'une faible influence. On peut toutefois parler d’une véritable "empreinte anarchiste" sur le syndicalisme révolutionnaire allemand, mais qui ne s'est développée, au plus profond du giron des syndicats sociaux-démocrates, qu’après la Première Guerre mondiale.
Les "Localistes": une réaction prolétarienne contre l’émasculation politique de la classe ouvrière
Une opposition organisée dans les rangs des syndicats sociaux-démocrates en Allemagne se forma en mars 1892, à Halberstadt, au moment du premier congrès syndical après l'abolition de la loi antisocialiste. La Commission Générale de la centrale syndicale, sous la direction de Karl Legien, décréta à ce congrès une séparation absolue entre la lutte politique et la lutte économique. La classe ouvrière organisée dans les syndicats, selon ce point de vue, devait se limiter exclusivement à des luttes économiques tandis que seule la social-démocratie - et surtout ses députés au parlement (!) – devaient être compétente pour les questions politiques.
Mais, du fait des conditions imposées par les 12 années de la loi antisocialiste, les travailleurs organisés dans les unions professionnelles étaient habitués à la réunion, au sein de la même organisation, des aspirations et des discussions politiques et économiques, une réunion qui s'était aussi développée sous la contrainte des nécessités de l’illégalité.
Les relations entre la lutte économique et la lutte politique devinrent déjà, alors, l’objet de l’un des débats centraux au sein de la classe ouvrière internationale - et elles le sont restées sans aucun doute jusqu'à aujourd'hui ! À une époque du mûrissement des conditions pour la révolution mondiale, avec l'amorce de l’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, il a tendu à s'imposer de plus en plus clairement que le prolétariat, en tant que classe, pouvait et devait apporter sa réponse à des questions politiques comme justement celle de la guerre !
En 1892, la direction du mouvement syndical allemand, malgré l’éparpillement de plusieurs années en unions professionnelles isolées à cause de l’illégalité, installe sa confédération centrale syndicale – mais justement au prix tragique du cantonnement des syndicats à la lutte économique. Ceci, non plus parce que, comme au cours des années précédentes et sous la pression de la répression de la loi antisocialiste, il fallait renoncer à la liberté de parole et de réunion sur des questions politiques, mais sur la base des visions réformistes et des illusions énormes sur le parlementarisme qui se développaient de plus en plus. En tant que saine réaction prolétarienne à cette politique de la direction des syndicats autour de Legien, il se forma dans les syndicats l'opposition des "Localistes". Gustav Kessler y joua un rôle essentiel. Il avait travaillé dans les années 1880 à la coordination des unions professionnelles au moyen d’un système d’hommes de confiance et avait participé de façon prépondérante à la publication de l’organe syndical Der Bauhandwerker.
Pour apprécier les "Localistes" à leur juste valeur, il s'agit d'abord de procéder à la rectification d'une erreur répandue : le nom de "Localistes" renvoie, au premier abord, à une opposition dont le but principal serait de s'occuper exclusivement des affaires de la région ou dont le principe serait de refuser toute relation organisationnelle avec la classe ouvrière d'autres secteurs ou régions. Cette impression ressort souvent de la lecture de la littérature d'aujourd'hui, précisément celle de l’anarcho-syndicalisme actuel.
Il est souvent difficile de juger si une telle interprétation résulte uniquement d’une pure ignorance de l’histoire ou bien de la volonté de faire, rétrospectivement, des "Localistes" et de la FVDG, des organisations de type anarcho-syndicaliste - comme il en existe actuellement - avec une idéologie localiste.
La même critique vaut aussi concernant l’utilisation trop schématique de descriptions très précieuses sur les débuts du syndicalisme révolutionnaire en Allemagne, issues des rangs du marxisme, comme celle d'Anton Pannekoek. Lorsque celui-ci écrit en 1913 : "(…) d’après leur pratique, ils se qualifient de "Localistes" et expriment ainsi à l’encontre de la centralisation des grandes fédérations leur principe plus important d'agitation."5, il s'agit là, en réalité, d'un développement au sein du mouvement ouvrier allemand qui ne débute qu'à partir de 1904, à travers le rapprochement ultérieur avec l’idée des Bourses du travail de la Charte d’Amiens française (1906), mais qui ne concerne pas la période des années 1890.
Ce ne sont pas les principes fédéralistes de la lutte de classe qui ont poussé fondamentalement les "Localistes" à former leur opposition syndicale à la politique de Legien. En fait, les forces dirigeantes dans les syndicats se paraient de formules sonores se référant au concept d'une "centralisation stricte" de la lutte de la classe ouvrière pour mieux imposer une stricte abstention politique aux travailleurs organisés syndicalement. Ce qu'il faut constater, c'est l’apparition d’une dynamique oppositionnelle née de cette situation et qui a commencé à pousser progressivement des parties des "Localistes" vers des conceptions fédéralistes et anticentralisatrices. C'est une tout autre réalité.
Une centralisation permettant la lutte commune de la classe ouvrière et l'expression de la solidarité par delà les métiers, les secteurs et les nations était absolument nécessaire. Cependant, la centralisation des centrales syndicales, évoquait avec raison l'idée, pour certains travailleurs, "d’organes de contrôle" aux mains des leaders syndicaux réformistes. Au cœur de la formation de l'opposition Localiste, au milieu des années 1890, se trouvait en fait clairement l'indignation par rapport à l'abstention politique décrétée pour les travailleurs !
Il nous semble important, à propos de la naissance du syndicalisme révolutionnaire en Allemagne, de faire une mise au point concernant la focalisation fausse, et souvent exclusive, sur la question "fédéralisme contre centralisme" au moyen des termes mêmes employés par Fritz Kater (l’un des membres les plus marquants durant des années de la FVDG et de la FAUD) : "L’effort pour organiser les syndicats en Allemagne en confédérations centrales allait de pair avec l’abandon de tout éclaircissement dans les réunions sur les affaires publiques et politiques, et tout particulièrement de toute influence du syndicat sur celles-ci, pour s’engager exclusivement dans la lutte au jour le jour pour de meilleures conditions de travail et de salaire. C’est ce dernier point justement qui constituait alors la raison principale pour ceux qu’on a appelés les "Localistes" de rejeter et de combattre le centralisme de la confédération. Ils étaient quand même alors, en tant que révolutionnaires sociaux-démocrates et membres du parti, de l'avis très juste que la lutte dénommée syndicale pour l'amélioration de la situation des travailleurs sur le terrain de l'ordre existant ne peut pas être conduite sans toucher de façon incisive et déterminante aux rapports des ouvriers à l’État actuel et à ses organes de législation et d’administration…"6 (C’est nous qui soulignons)
Par cette fausse représentation des "Localistes" comme symbole du fédéralisme absolu, les historiographies stalinienne et trotskiste outrées donnent étrangement la main à certains écrits néo-syndicalistes, qui encensent le fédéralisme comme "nec plus ultra".
Même Rudolf Rocker, qui n'a pas vécu en Allemagne entre 1893 et 1919, et qui, au sein de la FAUD dans les années 1920, érigea ensuite effectivement le fédéralisme en principe théorique singulier, décrit honnêtement et pertinemment "le fédéralisme" des "Localistes" de 1892 de la façon suivante : "Cependant ce fédéralisme n’était absolument pas le produit d'une notion politique et sociale comme chez Pisacane en Italie, Proudhon en France et Pi y Margall en Espagne, qui a été repris plus tard par le mouvement anarchiste de ces pays ; il a résulté surtout de la tentative de contourner les dispositions de la loi prussienne de l'époque en matière d’association qui certes accordaient aux syndicats purement locaux le droit de discuter de questions politiques dans leurs réunions, mais refusait ce droit aux membres des confédérations centrales."7
Dans les conditions de la loi antisocialiste, habitués à un mode de coordination (qu’on peut aussi appeler centralisation !) par un réseau "d'hommes de confiance", il était effectivement difficile pour les "Localistes" de s'approprier une autre forme de coordination correspondant à la modification des conditions à partir de 1890. Une tendance fédéraliste apparaît déjà en germe sans doute dès 1892. Mais le fédéralisme des "Localistes" de cette période peut être décrit, sans doute de façon plus pertinente, comme tentative de faire une vertu du système des "hommes de confiance" !
Les "Localistes" restèrent toutefois encore presque cinq années dans les grandes confédérations syndicales centrales avec la volonté d’y représenter une avant-garde combative au sein des syndicats sociaux-démocrates et se concevaient clairement comme une partie de la social-démocratie.
La fondation de la FVDG
Dans la deuxième moitié des années 1890, et surtout lors des grèves, de plus en plus de conflits ouverts éclataient entre les adhérents des unions professionnelles "localistes" et les confédérations centrales. De façon latente mais aussi violemment parmi les ouvriers du bâtiment à Berlin et lors de la grève des ouvriers portuaires en 1896-97 à Hambourg. Lors de ces confrontations, la question centrale était généralement celle de l’entrée en grève : les unions professionnelles pouvaient-elles prendre elles-mêmes cette décision de leur propre chef ou celle-ci était-elle liée au consentement de la direction de la confédération centrale ? A ce propos, il saute aux yeux que les "Localistes" recrutaient leurs adhérents dans les métiers artisanaux du bâtiment (les maçons, les carreleurs, les charpentiers, chez lesquels existait une forte "fierté professionnelle") et proportionnellement beaucoup moins parmi les ouvriers industriels.
Parallèlement, la direction de la social-démocratie inclinait de plus en plus, à partir de la fin des années 1890, à accepter le modèle apolitique de la "neutralité" des syndicats de la Commission générale autour de Legien. Face à ce problème de conflits dans les syndicats, le SPD, pour différentes raisons, avait longtemps louvoyé et s’était exprimé avec réserve. Même si les "Localistes", à l'époque du congrès d’Halberstadt en 1892, ne représentaient qu’une minorité comparativement petite d'environ 10.000 membres (seulement environ 3% de l’ensemble des travailleurs organisés syndicalement en Allemagne), parmi eux se trouvaient de nombreux vieux syndicalistes combatifs étroitement liés au SPD. Par crainte de contrarier ces camarades en prenant parti de façon unilatérale dans les débats syndicaux, mais surtout à cause de son propre manque de clarté sur les relations entre la lutte économique et la lutte politique de la classe ouvrière, la direction de la social-démocratie est restée longtemps sur la réserve. C’est seulement en 1908 que les membres de la FVDG ont définitivement été abandonnés par la direction du SPD.
En mai 1897, avec un nombre de 6800 membres8, naissait le premier précurseur déclaré, et organisé de façon indépendante, du futur syndicalisme révolutionnaire en Allemagne. Ou dit plus précisément : l'organisation qui devait, dans les années suivantes, prendre en Allemagne la voie du syndicalisme révolutionnaire. Avec cette fondation d’une union syndicale nationale s’effectuait une scission historique du mouvement syndical social-démocrate. Au "premier congrès des syndicats d'Allemagne organisés localement" à Halle, les "Localistes" proclamèrent leur indépendance organisationnelle. Le nom d’"Union Libre des Syndicats Allemands"9 (FVDG) ne fut adopté qu’en septembre 1901. Son organe de presse nouvellement fondé Die Einigkeit devait paraître jusqu'à l'interdiction de la FVDG au commencement de la guerre en 1914.
Encore main dans la main avec la social-démocratie ?
La célèbre résolution du congrès de 1897 élaborée par Gustav Kessler exprime le plus clairement sur quelle compréhension de la lutte politique de la classe ouvrière et des relations à la social-démocratie se basait la FVDG :
"1. Toute séparation du mouvement syndical de la politique social-démocrate consciente est impossible, au risque de paralyser et de vouer à l'échec la lutte pour l'amélioration de la situation des travailleurs sur le terrain de l'ordre actuel ;
2. que les efforts, d’où qu’ils proviennent, pour distendre ou briser la relation à la social-démocratie, doivent être considérés comme hostiles à la classe ouvrière ;
3. que les formes d'organisation du mouvement syndical qui l’entravent dans la lutte pour des objectifs politiques doivent être considérées comme erronées et condamnables. Le congrès voit dans la forme d'organisation que s'est donnée le parti social-démocrate d'Allemagne au Congrès de Halle en 1890, compte tenu de l’existence de la loi en matière d'association, aussi pour l'organisation syndicale le meilleur dispositif et le plus approprié pour la poursuite de tous les objectifs du mouvement syndical."10
Dans ces lignes s’exprime la défense des exigences politiques de la classe ouvrière et les fortes attaches à la social-démocratie en tant "qu’organisation sœur". La relation à la social-démocratie était comprise comme un pont avec la politique. La fondation de la FVDG, par conséquent, ne constituait pas, au niveau programmatique, un refus de l'esprit de la lutte de classe défendu par Marx, ou un refus du marxisme en général, mais au contraire une tentative de maintenir cet esprit. Le désir formulé par la FVDG de ne pas laisser échapper des mains des travailleurs "la lutte pour des objectifs politiques" constituait encore la force essentielle de ses années de fondation.
Les débats au "4e Congrès de la centralisation par les hommes de confiance" en mai 1900 montrent la fermeté de l’attachement politique à la social-démocratie. La FVDG compte alors environ 20.000 membres. Kessler défend même la revendication d’une fusion possible des syndicats et du parti, qui a été acceptée dans une résolution : "L'organisation politique et syndicale doivent donc se réunifier. Cela ne peut pas arriver immédiatement, car les circonstances, qui se sont développées historiquement, ont le droit d’exister ; mais nous avons probablement le devoir de préparer cette unification, en rendant les syndicats propres à rester les porteurs de la pensée socialiste. (…) Quiconque est convaincu que la lutte syndicale et politique est la lutte des classes, qu’elle ne peut au fond qu’être menée par le prolétariat lui-même, celui-ci est notre camarade et est avec nous dans le même bateau."11
Derrière ce point de vue refusant de se cantonner exclusivement à la lutte économique d'une part et, d'autre part, aspirant à se lier à la plus grande organisation politique de la classe ouvrière allemande, le SPD, se trouve une saine exigence. Mais il y aussi clairement, en germe, la confusion ultérieure du syndicalisme révolutionnaire à propos de "l’organisation unitaire". Une idée qui devait se manifester en Allemagne des années plus tard à partir de 1919, non seulement dans le syndicalisme révolutionnaire, mais surtout dans les "unions ouvrières". La vision de la FVDG aspirant à la lutte commune avec la social-démocratie qui figure dans la résolution de 1900 devait toutefois, la même année, être durement mise à l’épreuve.
Le "conflit syndical de Hambourg"
Lorsqu’en 1900 à Hambourg, la confédération centrale des syndicats a conclu un accord avec les employeurs visant à l'abolition du travail aux pièces, une partie des maçons à la tâche s'y opposa. Ils reprirent le travail, furent accusés de briseurs de grève et exclus de la confédération centrale des syndicats. Ensuite les maçons à la tâche adhérèrent à la FVDG. L'exclusion de ces travailleurs du parti fut exigée immédiatement par le SPD de Hambourg, décision toutefois rejetée par un jury d'arbitrage du SPD.
Non pas à cause d'une proximité politique avec la FVDG, mais dans sa lutte contre le réformisme et, dans ce cadre, surtout dans l’effort de clarifier les relations entre la lutte économique et la lutte politique pour la classe ouvrière, Rosa Luxemburg défendit la décision du jury d'arbitrage de ne pas exclure du SPD les maçons FVDG de Hambourg. Elle exigea certes "d’infliger un sévère blâme aux maçons à la tâche"12 pour avoir rompu la grève, mais rejetait vigoureusement le point de vue bureaucratique et formel de faire admettre une rupture de la grève comme motif d'exclusion immédiate des travailleurs du parti. La confédération centrale des syndicats sociaux-démocrates avait elle-même plusieurs fois eu recours, dans les confrontations avec la FVDG, au moyen de la rupture de la grève ! Le SPD ne devait pas, selon le point de vue de Rosa Luxemburg, devenir le "terrain d’affrontement" des syndicats. Le parti ne se fait pas le juge de la classe ouvrière.
Rosa Luxemburg avait compris que, derrière cette violente affaire syndicale des maçons à la tâche de Hambourg, se dissimulaient des questions beaucoup plus centrales. Les mêmes questions qui se trouvaient au cœur des rapports présentés dans la FVDG à propos de "l’unification" du parti et de l'organisation de masse syndicale : la distinction entre une organisation politique révolutionnaire d'une part et la forme organisationnelle dont doit se doter la classe ouvrière dans les moments de lutte des classes ouverte : "En pratique cela conduirait en dernière instance à l’amalgame entre l’organisation politique et l'organisation économique de la classe ouvrière, confusion dans laquelle les deux formes de combat y perdraient. Leur séparation externe et leur division du travail engendrées et conditionnées historiquement ne feraient que régresser."13
Si Rosa Luxemburg en 1900, comme le mouvement ouvrier dans son ensemble, ne pouvait pas alors encore dépasser l'horizon de la forme d'organisation syndicale traditionnelle de la classe ouvrière et considérait les syndicats comme les grandes organisations de la lutte de classe économique, c’est parce que c’est seulement dans les années suivantes que la classe ouvrière va se trouver confrontée à la tâche de faire surgir la grève de masse et les conseils ouvriers - les creusets révolutionnaires unissant la lutte économique et la lutte politique.
L’unification de la lutte de la classe ouvrière, qui se trouvait en Allemagne dispersée dans des syndicats les plus divers, était en effet historiquement nécessaire. Mais ce but ne pouvait pas être atteint par l’instrumentalisation formelle de l'autorité du parti en vue de discipliner les travailleurs, comme les confédérations centrales le voulaient. Il ne pouvait pas l’être à l’aide de la conception des "organisations unitaires" qui sous-estimait la nécessité d'un parti politique, une idée qui a commencé à se développer dans les rangs de la FVDG. Le problème ne pouvait pas non plus être résolu par un "grand syndicat", mais seulement par l’unification de la classe ouvrière dans la lutte de classe elle-même. Le congrès du parti du SPD à Lübeck en 1901 refusa, certes sur la pression de Rosa Luxemburg, et probablement de façon formelle, de devoir jouer le rôle de tribunal d'arbitrage entre la confédération syndicale centrale et la FVDG. Il a toutefois adopté en même temps "la résolution Sonderbund" de Bernstein qui menaçait à l'avenir toute scission syndicale d’exclusion du parti. Le SPD commençait ainsi clairement à prendre ses distances avec la FVDG.
Dans les années 1900-01, la FVDG souffrit de tensions internes croissantes tournant principalement autour de la question du soutien financier mutuel par une caisse de grève unitaire. Il se manifesta de fortes tendances particularistes et un manque d'esprit de solidarité dans ses propres rangs. L'exemple du syndicat des couteliers et des emboutisseurs de Solingen en est typique : il avait reçu de la Commission administrative de la FVDG un soutien financier pendant une longue durée, mais il menaça de partir immédiatement quand il fut lui-même sollicité financièrement pour fournir son aide à d'autres grèves.
De janvier 1903 à mars 1904, face à l'initiative et à la pression du SPD, de furtives négociations se déroulèrent entre la FVDG et la confédération syndicale centrale, dans l'objectif de réintégrer la FVDG dans la confédération centrale. Les négociations échouèrent. Au sein de la FVDG même, ces négociations d’unification déclenchèrent de violentes tensions entre Fritz Kater, qui représentait la tendance clairement syndicaliste révolutionnaire qui se développera plus tard, et Hinrichsen qui cédait simplement à la pression des confédérations centrales. Une énorme déstabilisation se produit parmi les travailleurs organisés. Environ 4400 membres de la FVDG (plus de 25%) passèrent en 1903/04 à la confédération centrale ! Les négociations d'unification manquées dans une ambiance de grande méfiance mutuelle conduisirent, d'une part, à un affaiblissement sensible de la FVDG et représentèrent le premier chapitre de sa rupture historique avec le SPD.
Conclusion
Jusqu'en 1903, il revient aux "Localistes" et à la FVDG en Allemagne, le mérite d’avoir exprimé la nécessité vitale des travailleurs de ne pas concevoir les questions politiques comme une "affaire réservée au parti". Ils se sont ainsi opposés clairement au réformisme et à sa "délégation de la politique aux parlementaires". La FVDG était un mouvement prolétarien politiquement très motivé et très combatif, mais hétérogène et complètement enfermé sur le terrain syndical. En tant qu’assemblage lâche de petites unions professionnelles syndicales, il lui était évidemment impossible de jouer le rôle d'une organisation politique de la classe ouvrière. Pour satisfaire sa "poussée vers la politique", elle aurait dû s'approcher plus fortement de l'aile gauche révolutionnaire au sein du SPD.
En outre, l'histoire des "Localistes" et de la FVDG montre qu'il est vain de chercher "l'heure exacte" de la naissance du syndicalisme révolutionnaire allemand. Celui-ci a plutôt résulté d'un processus, s'étendant sur plusieurs années, de détachement d'une minorité prolétarienne du giron de la social-démocratie et des syndicats sociaux-démocrates.
Le défi de la question de la grève de masse, directement posé au syndicalisme révolutionnaire, devait devenir un autre jalon dans le développement de celui-ci en Allemagne. Le prochain article abordera les débats autour de la grève de masse et l'histoire de la FVDG, de la rupture définitive avec le SPD en 1908, jusqu'à l’éclatement de la première guerre mondiale.
Mario (27 octobre 2008)
1. Le Volkstaat était l’organe du Parti Socialiste Ouvrier d’Allemagne, de la tendance dite d’Eisenach sous la direction de Wilhelm Liebknecht et d’August Bebel.
2. Lettre d’Engels à A. Bebel, 18/28 mars 1875, in Marx, Engels, Critique des Programmes de Gotha et d’Erfurt, Editions Sociales, 1950, p.47.
3. Voir notre brochure Les Syndicats contre la classe ouvrière [40].
4. Résolution (rédigée par Marx) du 1er Congrès de l’Association Internationale des Travailleurs, Genève 1866 in Marx Textes 2, Editions sociales, classiques du marxisme, p.237.
5. Anton Pannekoek : Le Syndicalisme allemand, 1913, notre traduction
6. Fritz Kater, Fünfundzwanzig Jahre Freie Arbeiter-Union Deutsclands (Synkalisten), Der Syndikalist n°20, 1922 (notre traduction.)
7. Rudolf Rocker, Aus den Memoiren eines deutschen Anarchisten, Ed. Suhrkamp, p.288 (notre traduction)
8. Voir aussi : www.syndikalismusforschung.info/museum.htm [41]
9. La grande confédération centrale des syndicats se dénommait officiellement "Syndicats Libres". La proximité langagière avec le nom de l’"Union Libre" conduit fréquemment à des confusions.
10. Cité par W. Kulemann, Die Berufvereine, tome 2, Iéna, 1908, p.46 (notre traduction).
11. Procès-verbal de la FVDG, cité par D. H. Müller, Gewerkschaftliche Versammlungsdemokratie und Arbeiterdelegierte, 1985, p.159 (notre traduction)
12. Rosa Luxemburg, Der Parteitag und des hamburger Gewerkschaftsstreit, Gesammelte Werke, tome 1 / 2, p.117 (notre traduction)
13. Ibidem, p.116
Courants politiques:
Approfondir:
Revue Internationale n° 138 - 3e trimestre 2009
- 2737 lectures
.
Le mythe de la "Green Economy"
- 2971 lectures
Aujourd'hui, le capitalisme a besoin de tout un arsenal de mystifications idéologiques pour survivre. Système économique et social ayant historiquement fait faillite, le capitalisme n'a plus rien d'autre à offrir à l'humanité que la misère, le déclin et la guerre. Pour la classe dominante, il est nécessaire de dissimuler cette réalité et d'empêcher la classe ouvrière de reconnaître ses responsabilités révolutionnaires historiques et de les mettre en acte. La dernière mystification en date sortie de l'arsenal de la bourgeoisie mondiale, c'est la green economy (l'économie verte). De plus en plus, les experts des médias, les politiciens, les économistes et les hommes d'affaires conçoivent l'expansion de l'économie verte comme une composante significative de la reprise économique. Certains comparent la green economy aux technologies hi tec et informatique du point de vue de ses potentialités de transformation de l'économie américaine. C'est presque comique de voir toutes les grandes entreprises sauter dans le wagon "vert", maintenant que l'écologie est "dans le vent". Même les pires pollueurs prêchent l'écologie maintenant, comme on le voit dans la publicité télévisée aux Etats-Unis qui prétend que le chauffage au fuel consomme peu d'énergie et est bon pour l'environnement !
Comme toutes les escroqueries idéologiques, l'économie verte a un certain rapport avec la réalité. Il existe une préoccupation véritable et largement partagée face au pillage de l'environnement et à la menace très réelle de changements climatiques et de leurs effets potentiellement catastrophiques sur le plan social. Par ailleurs, c'est un fait indéniable que le ralentissement économique détruit des emplois par millions dans le monde entier, aggrave la pauvreté et les privations. Ce lien avec la réalité rend le mythe de la green economy plus pernicieux qu'une banale campagne de propagande forgée de toute pièce.
La bourgeoisie mondiale a la prétention absurde de disposer d'une alternative politique pour sauver la situation, afin de court-circuiter le développement de la conscience de classe et la reconnaissance du fait que le désastre écologique et la crise économique mettent à nu le caractère anachronique du capitalisme et posent, en termes on ne peut plus clairs,la nécessité de son renversement. Ainsi, la bourgeoisie dénie le fait que la crise actuelle soit une crise du système et soutient l'idée que c'est un problème qui peut être traité par une autre politique. L'économie verte, nous dit-on, va révolutionner l'économie et ramener la prospérité.
Les réalités écologiques et économiques
Les preuves scientifiques du sérieux de la crise écologique sont abondantes. Selon un rapport réalisé par les conseillers scientifiques de la Maison blanche de Barack Obama, le réchauffement climatique a déjà causé des changements significatifs dans les tendances climatiques aux Etats-Unis, comportant des précipitations plus fortes, l'augmentation de la température et du niveau de la mer, le recul rapide des glaciers, l'allongement des saisons de culture, la modification des débits des rivières.1 Ce rapport prévoit que les températures aux Etats-Unis pourraient augmenter en moyenne de 11° Fahrenheit - ou environ 6° C - d'ici la fin du siècle. La Conférence internationale sur le changement climatique qui s'est tenue à Copenhague en mars 2009, a rapporté que "les sociétés contemporaines auraient beaucoup de difficultés à faire face à une augmentation de température de plus de 2°C et que cette dernière accroîtrait les bouleversements climatiques pendant le reste du siècle". Et aux dernières nouvelles, 6°, c'est trois fois plus que 2° !
L'une des principales conclusions de la Conférence de Copenhague était la suivante :
"Les dernières observations confirment que le pire des scénarios du GIEC est en train de se réaliser. Les émissions ont continué d’augmenter fortement et le système climatique évolue d’ores et déjà en dehors des variations naturelles à l’intérieur desquelles nos sociétés et nos économies se sont construites : la température moyenne à la surface de la planète, l'augmentation du niveau des mers, la dynamique des océans et des glaces, l'acidification de l'océan et des événements climatiques extrêmes. Il y a un risque significatif que beaucoup de tendances s'accélèrent, aboutissant à des changements climatiques abrupts ou irréversibles."2
En ce qui concerne la crise économique, il n'est pas nécessaire de présenter ici des preuves du sérieux de la récession actuelle. Les médias bourgeois eux-mêmes la considèrent comme la pire crise économique depuis la Grande Dépression. Comme la récession actuelle a lieu malgré la myriade de mesures de sauvegarde et de palliatifs capitalistes d'Etat mis en place après la Grande Dépression dans les années 1930, et qui étaient supposés empêcher qu'un tel désastre économique ne se reproduise, on peut dire que cette récession est même pire que celle de 1929. Elle a mis à genoux l'économie mondiale la plus grande et la plus puissante, les Etats-Unis ; elle a requis la quasi-nationalisation de l'industrie bancaire, le soutien de toute l'industrie financière et a vu la banqueroute de General Motors, entreprise la plus importante du monde. Il était d'usage de dire : "ce qui est bon pour General Motors est bon pour les Etats-Unis".
L'administration Obama a d'abord annoncé qu'aux Etats-Unis, le chômage allait augmenter jusqu'à 8% avant de se stabiliser. La réalité a déjà dépassé cette prédiction excessivement optimiste. Officiellement, le chômage a déjà atteint 9,4% et Obama lui-même reconnaît ouvertement maintenant que le taux de chômage doublera avant que les choses ne commencent à s'améliorer. Et même ces sinistres chiffres sont en dessous de la réalité. Aux Etats-Unis, on considère que quelqu'un est au chômage seulement s'il n'a pas de travail et en a cherché depuis 30 jours. Les chômeurs qui n'ont pas cherché de travail pendant cette période, ou qui sont trop démoralisés pour se mettre à la recherche d'emplois qui n'existent pas et ont renoncé à s'inscrire, sont considérés comme en dehors de la force de travail. Selon l'Etat américain, ces "travailleurs découragés" ne sont plus des travailleurs et ne sont donc pas des chômeurs !
Les travailleurs qui ont perdu leur emploi et ne peuvent en retrouver un à temps plein mais se bousculent pour accéder à un emploi subalterne à temps partiel rien que pour survivre – appelés "ouvriers à temps partiel involontaires" – ne sont pas considérés comme chômeurs ni même sous-employés. S'ils ont un travail à temps partiel d'au moins 10 heures par semaine, ils sont considérés comme "ayant du travail" et, mieux encore, chacun de leur emploi à temps partiel compte comme un "emploi" dans les statistiques qui comptabilisent le nombre d'empois dans l'économie. Ainsi par exemple, une assistante d'éducation spécialisée de 59 ans qui a été licenciée et a perdu son emploi il y a neuf mois, et qui en a maintenant quatre à temps partiels : pour le gouvernement, non seulement elle n'est pas chômeuse mais, à elle seule, elle comptabilise quatre emplois nouveaux dans l'économie. Travaillant comme professeur de gymnastique dans cinq classes par semaine, comme aide-soignante, comme infirmière à domicile pour un trisomique et comme professeur de gymnastique pour des clients privés, elle parvient à récolter la somme de 750 $ par mois, ce qui ne l'aide pas beaucoup puisque son remboursement immobilier mensuel est de 1000 $.3
Le Labor Departement américain (ministère du travail) reconnaît qu'il y avait 9,1 millions d'"ouvriers à temps partiel involontaires" en mai et que si les ouvriers découragés et les temps partiels involontaires étaient compris dans le calcul du chômage, ce n'est pas à 9,4% mais à 16,4% que ce dernier s'élèverait. Même les pronostiqueurs les plus optimistes prévoient que le "plein" emploi (défini à 6% de chômage) ne sera peut-être pas de retour aux Etats-Unis avant 2013 ou 2014.
La Green Economy
La mystification de la green economy a été un élément central dans la campagne présidentielle d'Obama. Au cours du second débat présidentiel, en octobre 2008, Obama a dit : "si nous créons une économie d'énergies nouvelles, nous pouvons créer facilement cinq millions de nouveaux emplois". Plus précisément, son site web de campagne promettait de "créer cinq millions d'emplois nouveaux en investissant de façon stratégique 150 milliards de dollars au cours des dix prochaines années afin de catalyser les efforts de chacun pour construire l'énergie propre du futur".4 Dans son programme, l'économie verte proposée par Obama/Biden comprend les points suivants :
- d'ici dix ans, économiser plus de pétrole qu'il n'en est importé actuellement du Moyen-Orient et du Venezuela ;
- d'ici 2015, avoir plus d'un million de voitures à moteur hybride sur les routes ;
- assurer que 10% de l'électricité provienne de sources renouvelables d'ici 2012, 25% en 2025 ;
- mettre en place dans toute l'économie un programme cap-and-trade (de limitation et taxation de la pollution) afin de réduire l'émission de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2050.5
En février 2009, le Congrès a adopté le plan de reprise économique d'Obama qui se distinguait par un budget de 80 millions pour stimuler les dépenses dans le développement de sources d'énergie alternatives et d'autres initiatives écologiques ; cela a été largement "revendu" aux groupes écologistes comme un acompte sur la green economy. Cependant, malgré le triomphalisme de ces groupes, ces piètres 80 millions signifient mathématiquement qu'Obama doit encore dépenser "de façon stratégique" 149,92 milliards6 dans les 9 ans à venir pour remplir sa promesse d'économie verte.
La mystification de l'économie verte n'est pas un phénomène simplement américain. Selon un militant écologiste européen, "l'économie propre est sur le point de s'envoler".7 L'Union européenne encourage activement l'investissement dans l'industrie verte. Les pays européens ont introduit leurs propres programmes cap-and-trade sur le dioxyde de carbone en 2005. L'Allemagne a promulgué la loi sur l'énergie renouvelable allemande et introduit un programme de feed-in tariffs (FITs)8 incitant à des investissements en énergie propre. Au Canada, la province de l'Ontario a adopté une mesure sur le modèle du FIT allemand. En Grande-Bretagne, les efforts pour promouvoir des investissements bons pour l'environnement sont au cœur des plans de reprise économique. L'Australie veut augmenter les emplois verts de 3000% dans les décennies à venir. L'Allemagne, l'Espagne et le Danemark ont favorisé des programmes d'énergie éolienne. L'Allemagne et l'Espagne ont aussi soutenu des entreprises d'énergie solaire.
La Green Economy est-elle une potion magique ?
La Green Economy n'est pas la potion magique qui sauvera le capitalisme de lui-même. Les comparaisons entre l'économie verte et ce qui était appelé "la révolution technologique" sont fausses. Ce n'est pas une révolution technologique qui transformera la société comme la révolution industrielle le fit en permettant de transcender la production naturelle et de développer l'industrie moderne, de baisser les coûts et d'augmenter la production, d'élever le niveau de vie. Quand le capitalisme était un système historiquement progressif, capable de développer les forces productives, quand de nouvelles technologies et de nouvelles industries naissaient, cela produisait des millions d'emplois nouveaux, même si les anciens emplois et les vieilles industries étaient détruits. Mais aujourd'hui, dans une crise globale de surproduction, la technologie informatique, pour autant qu'elle a été capable de réduire les coûts de production et d'augmenter la productivité, n'a pas révolutionné l'économie, n'a pas permis au système de surmonter sa crise économique mais a, au contraire, aggravé la crise de surproduction.
L'idée que réparer le gâchis que le capitalisme a créé au cours du siècle dernier, est la base du progrès économique, est une erreur totale. C'est comme si on disait que l'ouragan Katrina qui a dévasté La Nouvelle Orléans en 2004, était bon pour l'économie parce qu'il a créé des millions de nouveaux emplois dans la construction et rendu possible la croissance économique. Ce genre de tour de passe-passe idéologique ne marche que si on sort de l'équation toute la souffrance humaine (les morts, la pauvreté) et la destruction des forces productives, des habitations, des écoles, des hôpitaux, etc. que Katrina a provoquées. Réparer quelque chose de cassé ne constitue en rien une "révolution" de l'économie.
De toutes façons, tout le battage sur l'économie verte qui va créer de nouveaux emplois est un non sens. Une étude commandée par la Conférence américaine des Maires prévoit une augmentation des emplois verts d'environ 750 000 qu'ils sont aujourd'hui, à 2,5 millions en 2018, soit un accroissement de 1 750 000 emplois – bien plus modeste que les 5 millions prévus par Obama. Cependant, des chercheurs d'universités, comme le York College en Pennsylvanie, les universités d'Illinois et de Arlington Texas, ont contesté les prédictions des maires pour être largement surestimées, car elles ont gonflé le nombre d'emplois avec des postes de soutien administratif n'ayant aucun rapport direct avec la production d'énergie propre. Et même si les prétentions exagérées d'Obama étaient exactes, 5 millions de nouveaux emplois verts dans les dix années à venir sont loin de permettre de compenser le effets passés et à venir de la récession aux Etats-Unis. Depuis que la récession a commencé en décembre 2007, l'économie américaine a perdu presque 6 millions d'emplois pour cause de licenciements et elle a besoin de 125 000 à 150 000 nouveaux emplois par mois - soit 1 500 000 à 1 800 000 par an – rien que pour absorber les nouveaux travailleurs en âge d'entrer dans le monde du travail et maintenir un niveau stable de chômage. Ainsi les prétendus cinq millions de nouveaux emplois qui seront "facilement" créés dans les dix années à venir, ne compenseront même pas tous les emplois détruits au cours des 18 derniers mois de récession !
Les nouveaux emplois verts ne compenseraient pas non plus ceux qui seraient perdus dans les industries du pétrole, de l'essence, du charbon, du nucléaire et de l'automobile du fait de l'abandon à grande échelle des énergies fossiles. Le programme cap-and-trade tant vanté qui permet aux entreprises pollueuses de faire du commerce avec les autorisations de polluer, et qui est applicable en Europe depuis quatre ans, doit encore démontrer ses effets bénéfiques puisque les niveaux d'émissions ont augmenté dans ces pays.
Les entreprises capitalistes ne se convertiront à des pratiques et des investissements bons pour l'environnement que s'il y a des profits à faire. Ces nouvelles technologies comportant d'énormes investissements préliminaires, de recherche et de développement, elles doivent pouvoir rapporter beaucoup de profit. La seule façon dont les gouvernements peuvent promouvoir la green economy est d'introduire des mesures de dissuasion vis-à-vis de la poursuite de l'utilisation des énergies fossiles, et d'incitation des entreprises à investir dans l'économie verte. Les forces dites du "libre marché" ne permettront jamais que cela arrive, seule peut le permettre une politique d'intervention capitaliste d'Etat, laquelle signifie une augmentation des taxes sur l'utilisation des technologies d'énergie fossile, l'augmentation des coûts de production des marchandises selon les processus industriels classiques, et l'augmentation des prix pour les consommateurs. Cela suppose également des subventions des gouvernements et des baisses d'impôts pour les entreprises à technologie verte. Tout cela sera bien sûr financé sur le dos de la classe ouvrière qui devra payer plus cher les biens de consommation "propres" et plus d'impôts pour financer les subventions et compenser les revenus perdus du fait des baisses de taxes. En fin de compte, l'économie verte qui est supposée "révolutionner" l'économie et sauver le monde du désastre écologique n'est qu'une autre façon de faire porter le fardeau de l'austérité sur la classe ouvrière et de baisser encore plus son niveau de vie.
Le capitalisme mondial est totalement incapable de coopérer pour faire face à la menace écologique. En particulier dans la période de décomposition sociale, avec la tendance croissante de chaque nation à jouer sa propre carte sur l'arène internationale, dans la concurrence de tous contre tous, une telle coopération est impossible. Si les Etats-Unis ont été attaqués pour leur refus de participer au Protocole de Kyoto qui visait à réduire les émissions de carbone, pour leur part les nations qui ont participé avec enthousiasme au traité n'ont rien fait pour réduire les gaz à effet de serre dans la décennie passée. Même lorsque le capitalisme "essaie" de mettre en oeuvre des solutions à la crise environnementale, le motif du profit joue irrationnellement pour saper le bien-être social. L'exemple désastreux de ce qui est arrivé avec le passage, motivé par le profit, à la production d'éthanol comme énergie alternative à partir du maïs est édifiant : une grande partie de l'agroalimentaire a été poussé à produire du maïs pour l'éthanol et non plus pour l'alimentation, contribuant ainsi à la pénurie globale de nourriture. Face à cela, des émeutes de la faim éclatèrent aux quatre coins du monde. Nous avons là un avant-goût de ce que la green economy capitaliste réserve à l'humanité.
La Green Economy est un rideau de fumée
La green economy n'est qu'un rideau de fumée, une campagne idéologique pour donner un visage humain au capitalisme. Dans sa course au profit, le capitalisme a dénaturé l'environnement. La calamité écologique que le capitalisme a créée est une nouvelle preuve du fait qu'il est allé au-delà de son utilité, qu'il faut le mettre au rancart. Mais l'économie verte est une réponse cynique de la classe dominante qui prétend pouvoir régler un problème alors que celui-ci est l'émanation directe de la nature de son système. La distance qui sépare la promesse de la green economy de la réalité est si grande que c'en est risible. Et pas seulement sur le plan des emplois. Elle va mettre sur le marché des denrées alimentaires écologiques qui sont supposées être plus naturelles, plus biologiques, mais dont le prix est le plus souvent au-delà de ce que peut acheter un ouvrier moyen. Autre exemple : pour économiser l'énergie, il est édicté de remplacer les ampoules à incandescence par des lampes fluorescentes, mais celles-ci contiennent du mercure qui est désastreux pour l'environnement si on ne n'en sert pas de façon contrôlée.
Quel que soit l'emballage idéologique, le capitalisme est fait pour générer du profit, pas pour répondre aux besoins des hommes.
Le capitalisme n'a aucune porte de sortie pour échapper à la crise économique et à celle de l'environnement. Seul le prolétariat a la capacité de sauver l'avenir de l'humanité – de détruire ce système rapace d'exploitation capitaliste de l'homme par l'homme basé sur une course incessante au profit et de le remplacer par une société dans laquelle répondre au besoin social constituera le principe prépondérant de la vie économique et sociale. Tout ce bavardage sur l'économie verte ou noire est un non sens. Seule une économie rouge offrira un avenir à l'humanité.
J. Grevin
1. Selon la loi, la Maison blanche doit produire un rapport sur l'impact du réchauffement climatique, mais aucun rapport n'a été produit depuis 2000, quand l'administration Clinton/Gore était encore au pouvoir. L'administration Bush – avec ses liens étroits avec l'industrie de l'énergie et ses petits copains de droite anti-réglementation – a refusé de produire un tel rapport tout au long de ses huit ans en fonction. Jusqu'à ce que l'International Panel on Climate Change (IPCC) - Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) - ait remis son rapport affirmant le réchauffement climatique en tant que fait incontournable, l'administration Bush considérait la question comme un problème scientifique "ouvert", à la consternation des scientifiques professionnels de l'Environmental Protection Agency et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dont les rapports furent censurés ou supprimés durant les années Bush.
2. "Key messages from the Congress".
3. De Pass Dee, "More Workers Fall Back on Part-Time 'Survival' Jobs", Star Tribune, Minneapolis, MN), 21 juin 2009.
4. barackobama.com [44]
5. Ibid.
6. Les 150 milliards promis lors du débat électoral auxquels sont soustraits les 80 millions déjà alloués en février 2009
7. WWF : "Green Economy Creates Jobs".
8. Tarifs imposés aux compagnies pour l'achat d'électricité de source renouvelable
Récent et en cours:
- Ecologie [45]
Au Bangladesh, en Chine, en Espagne, en Angleterre… la classe ouvrière refuse la fatalité de la crise
- 2156 lectures
Depuis 1929, jamais une crise économique n’avait frappé avec une telle violence le prolétariat mondial. Partout, le chômage et la misère explosent. Cette situation dramatique ne peut que provoquer un fort sentiment de colère chez les ouvriers. Mais transformer cette colère en combativité est aujourd’hui très difficile. Que faire quand son usine ferme ? Comment lutter ? Quels types de grèves et d’actions mener ? Et pour tous ceux qui ont encore un travail, comment résister aux baisses de salaires, aux heures supplémentaires gratuites et à l’augmentation des cadences quand le patron exerce ce chantage odieux "c’est ça ou la porte, il y en a des milliers dehors qui attendent ta place" ? La brutalité de cette récession est une source d’angoisse terrible, voire paralysante, pour les familles ouvrières.
Et pourtant, ces derniers mois, d’importantes grèves ont éclaté :
Au Bangladesh, à Narayanganj, en mai dernier, 20 000 travailleurs impayés depuis des mois ont laissé exploser leur colère en saccageant des dizaines d’usines de textile et en allant s’affronter à l’armée au péril de leur vie.
En Chine, dans les villes de Daqing et de Liaoyang, au cœur du bassin industriel de Mandchourie, des dizaines de milliers d’ouvriers récemment licenciés descendent tous les jours dans les rues depuis le premier mars pour réclamer le versement de leurs allocations chômage et le maintien de leur sécurité sociale. Cette vague de luttes est représentative de la montée générale de la combativité du prolétariat de cette région du monde. D’après les agences de surveillance de la stabilité politique situées à Hong Kong, la Chine a connu 58 000 "incidents de masse" (grèves, manifestations,…) au cours des trois premiers mois de cette année. "Si cette tendance continue toute l’année, 2009 battrait tous les records précédents avec plus de 230 000 de ces dits "incidents de masse", comparés aux 120 000 en 2008 et aux 90 000 de 2006 " 1.
En Espagne, à la fin avril, les métallurgistes de Vigo sont à nouveau entrés en lutte. Après avoir mené une grève exemplaire en 2006 en organisant des assemblées générales dans la rue afin d’entraîner toute la population ouvrière de la ville, ces ouvriers ont dû faire face cette fois-ci à des syndicats préparés et aux armes aiguisées : assemblées générales bidons et sans débat, actions coups de poings stériles telles que le blocage des bateaux de croisière… Si les grévistes n’ont pas su cette fois-ci déjouer tous ces pièges, la prise de conscience de la nécessité de la lutte a franchi un nouveau cap comme en témoigne cette phrase d'un ouvrier en lutte : "Ça va très très mal. Ou on lutte ou on meurt" 2.
Mais c’est en Angleterre que des luttes expriment le plus nettement une avancée de la conscience au sein de la classe ouvrière. Au début de l’année, les ouvriers de la raffinerie de Lindsey avaient été au cœur d’une vague de grèves sauvages. Cette lutte, à ses débuts, avait été freinée par le poids du nationalisme, symbolisé par le slogan "des emplois anglais pour les ouvriers anglais". La classe dominante avait alors utilisé ces idées nationalistes à plein en présentant cette grève comme étant contre les ouvriers italiens et polonais employés sur le site. Cependant, la bourgeoisie a mis soudainement fin à cette grève quand ont commencé à apparaître des banderoles appelant les ouvriers portugais et italiens à rejoindre la lutte, affirmant "Ouvriers du monde entier, unissez-vous" et que les ouvriers polonais du bâtiment ont effectivement rejoint les grèves sauvages à Plymouth. Au lieu d’une défaite ouvrière, avec des tensions croissantes entre ouvriers de différents pays, les ouvriers de Lindsey ont obtenu la création de 101 emplois supplémentaires (les ouvriers portugais et italiens gardant le leur), gagné l’assurance qu’aucun ouvrier ne serait licencié et, surtout, sont rentrés unis au travail ! Quand, en juin, Total a annoncé le licenciement de 51 puis de 640 employés, les ouvriers ont ainsi pu s’appuyer sur cette récente expérience. La nouvelle vague de luttes a en effet éclaté d’emblée sur une base beaucoup plus claire : solidarité avec tous les ouvriers licenciés. Et rapidement, des grèves sauvages ont éclaté dans tout le pays. "Des ouvriers des centrales électriques, des raffineries, des usines dans le Cheshire, le Yorkshire, le Nottinghamshire, l’Oxfordshire, en Galles du Sud et à Teesside arrêtaient le travail pour montrer leur solidarité". (The Independent du 20 juin). "Il y avait aussi des signes que la grève s’étendait à l’industrie nucléaire, puisque EDF Energy disait que les ouvriers contractuels du réacteur de Hickley Point, dans le Somerset, avaient arrêté le travail." (Le Times). La fraction la plus ancienne du prolétariat mondial a montré à cette occasion que la force de la classe ouvrière réside avant tout dans sa capacité à être unie et solidaire.
Toutes ces luttes peuvent sembler peu de chose en comparaison de la gravité de la situation. Et, effectivement, l’avenir de l’humanité passe nécessairement par des combats prolétariens d’une tout autre ampleur et massivité. Mais si la crise économique actuelle a agi jusqu’à présent comme un coup de massue laissant le prolétariat quelque peu hébété, elle reste néanmoins le terreau le plus fertile au développement futur de la combativité et de la conscience ouvrières. En ce sens, ces exemples de luttes qui portent en eux le germe de l’unité, de la solidarité et de la dignité humaine, sont autant de promesses d’avenir.
Mehdi (8 juillet 2009)
1. Source : « Des nouvelles du front [46] ».
2. Pour de plus amples informations sur cette lutte, lire notre article en espagnol « Vigo : Los metodos sindicales conducen a la derrota [47] ».
Récent et en cours:
- Luttes de classe [4]
Darwinisme et marxisme II (Anton Pannekoek)
- 2917 lectures
L'article que nous publions ci-dessous est la seconde partie de la brochure d'Anton Pannekoek, "Marxisme et Darwinisme" dont nous avons publié les premiers chapitres dans le numéro précédent de la Revue Internationale. Ce texte explique ici l'évolution de l'Homme en tant qu'espèce sociale. Pannekoek se réfère à juste raison au second grand ouvrage de Darwin, La filiation de l'Homme (1871) et met clairement en évidence que le mécanisme de la lutte pour l'existence par la sélection naturelle, développée dans "L'origine des espèces", ne peut s'appliquer schématiquement à l'espèce humaine comme l'avait démontré Darwin lui-même. Chez tous les animaux sociaux, et plus encore chez l'Homme, la coopération et l'entraide sont la condition de la survie collective du groupe au sein duquel les plus faibles ne sont pas éliminés, mais au contraire protégés. Le moteur de l'évolution de l'espèce humaine n'est donc pas la lutte compétitive pour l'existence et l'avantage conféré aux êtres vivants les plus adaptés aux conditions de l'environnement, mais le développement de leurs instincts sociaux.
La brochure de Pannekoek montre que le livre de Darwin, La filiation de l'Homme, constitue un démenti cinglant à l'idéologie réactionnaire du "darwinisme social" préconisé notamment par Herbert Spencer (comme il tord le cou à l'eugénisme de Francis Galton), qui s'est appuyée sur le mécanisme de la sélection naturelle, décrit dans L'origine des espèces, pour donner une caution pseudo scientifique à la logique du capitalisme basée sur la concurrence, la loi du plus fort et l'élimination des "moins aptes". A tous les "darwinistes sociaux" d'hier et d'aujourd'hui (qu'il désigne sous le terme de "darwinistes bourgeois"), Pannekoek répond très clairement, en se basant sur Darwin, que : "Ceci jette un éclairage entièrement nouveau sur le point de vue des darwinistes bourgeois. Ces derniers proclament que seule l'élimination des faibles est naturelle et qu'elle est nécessaire afin d'empêcher la corruption de la race. D’autre part, la protection apportée aux faibles est contre la nature et contribue à la déchéance de la race. Mais que voyons-nous ? Dans la nature elle-même, dans le monde animal, nous constatons que les faibles sont protégés, qu'ils ne se maintiennent pas grâce à leur propre force personnelle, et qu'ils ne sont pas écartés du fait de leur faiblesse individuelle. Ces dispositions n'affaiblissent pas le groupe, mais lui confèrent une force nouvelle. Le groupe animal dans lequel l'aide mutuelle est la mieux développée, est mieux adapté pour se préserver dans les conflits. Ce qui, selon la conception étroite de ces darwinistes, apparaissait comme facteur de faiblesse, devient exactement l'inverse, un facteur de force, contre lequel les individus forts qui mènent la lutte individuellement ne font pas le poids."
Dans cette deuxième partie de sa brochure, Pannekoek examine également, avec une très grande rigueur dialectique, comment l'évolution de l'Homme a permis à ce dernier de se dégager de son animalité et de certaines contingences de la nature, grâce au développement conjoint du langage, de la pensée et des outils. Néanmoins, en reprenant l'analyse développée par Engels dans son article inachevé "Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme" (publié dans La dialectique de la nature), il tend à sous-estimer le rôle fondamental du langage dans le développement de la vie sociale de notre espèce.
Cet article de Pannekoek a été rédigé il y a un siècle et il ne pouvait donc intégrer les dernières découvertes scientifiques, notamment en primatologie. Les études récentes sur le comportement social des singes anthropoïdes nous permettent d'affirmer que le langage humain n'a pas été sélectionné en premier lieu pour la fabrication des outils (comme semblait le penser Pannekoek, à la suite d'Engels) mais d'abord pour la consolidation des liens sociaux (sans lesquels les premiers humains n'auraient pu communiquer notamment pour construire des abris, se protéger des prédateurs et des forces hostiles de la nature, puis transmettre leurs connaissances d'une génération à l'autre).
Bien que le texte de Pannekoek donne un tableau très bien argumenté du processus de développement des forces productives depuis la fabrication des premiers outils, il tend cependant à réduire ces dernières à la seule satisfaction des besoins biologiques de l'Homme (notamment la satisfaction de la faim) et à perdre ainsi de vue que l'émergence de l'art (qui a fait son apparition très tôt dans l'histoire de l'humanité) a constitué également une étape fondamentale dans le dégagement de l'espèce humaine du règne animal.
Par ailleurs, si comme on l'a vu, Pannekoek explique, de façon très synthétique mais avec une remarquable clarté et simplicité, la théorie darwinienne de l'évolution de l'Homme, il ne va pas suffisamment loin, à notre avis, dans la compréhension de l'anthropologie de Darwin. En particulier, il ne met pas en évidence qu'avec la sélection naturelle des instincts sociaux, la lutte pour l'existence a sélectionné des comportements anti-éliminatoires qui ont donné naissance à la morale1. En opérant une rupture entre morale naturelle et morale sociale, entre nature et culture, Pannekoek n'avait pas suffisamment compris la continuité évolutive existant entre la sélection des instincts sociaux, la protection des faibles par l'entraide, et ce qui a permis à l'Homme de s'engager dans la voie de la civilisation. C'est justement cet élargissement de la solidarité et de la conscience d'appartenir à la même espèce qui a permis à l'Humanité, à un certain stade de son développement, d'énoncer, sous l'Empire romain (comme le souligne d'ailleurs le texte de Pannekoek) cette formule du christianisme : "Tous les hommes sont frères".
Brochure d’Anton Pannekoek (suite)
VI Loi naturelle et théorie sociale
Les conclusions fausses tirées par Haeckel et Spencer sur le socialisme ne sont nullement surprenantes. Le darwinisme et le marxisme sont deux théories distinctes, l’une s'appliquant au monde animal, l'autre à la société. Elles se complètent dans le sens où le monde animal se développe selon les lois de la théorie darwinienne jusqu'à l'étape de l'homme et, à partir du moment où celui-ci s’est extrait du monde animal, c'est le marxisme qui rend compte de la loi du développement. Quand on veut faire passer une théorie d'un domaine à l'autre, au sein desquels s'appliquent des lois différentes, on ne peut qu’en tirer des déductions erronées.
Tel est le cas quand nous voulons découvrir, à partir de la loi de la nature, quelle forme sociale est naturelle et la plus en conformité avec la nature, et c’est exactement ce que les darwinistes bourgeois ont fait. Ils ont déduit des lois qui gouvernent le monde animal, où la théorie darwinienne s'applique, que l’ordre social capitaliste, qui est en conformité avec cette théorie, est dès lors l’ordre naturel qui doit durer toujours. D'un autre côté, il y avait aussi des socialistes qui voulaient prouver de la même manière que le système socialiste est le système naturel. Ces socialistes disaient :
"Sous le capitalisme, les hommes ne mènent pas la lutte pour l'existence avec des armes identiques, mais avec des armes artificiellement inégales. La supériorité naturelle de ceux qui sont plus sains, plus forts, plus intelligents ou moralement meilleurs, ne peut aucunement prédominer tant que la naissance, la classe sociale ou surtout la possession de l'argent déterminent cette lutte. Le socialisme, en supprimant toutes ces inégalités artificielles, rend les conditions aussi favorables pour tous, et c'est alors seulement que la vraie lutte pour l'existence prévaudra dans laquelle l’excellence personnelle constituera le facteur décisif. D’après les principes darwiniens, le mode de production socialiste constituerait donc celui qui serait véritablement naturel et logique".
En tant que pendant critique des conceptions des darwinistes bourgeois, cette argumentation n’est pas mauvaise, mais elle est tout aussi erronée que cette dernière. Les deux démonstrations opposées sont également fausses car elles partent toutes les deux de la prémisse, depuis longtemps dépassée, selon laquelle il existerait un seul système social naturel ou logique.
Le marxisme nous a enseigné qu'il n'existe pas de système social naturel et qu'il ne peut y en avoir ou, pour le dire d’une autre manière, que tout système social est naturel, parce que chaque système social est nécessaire et naturel dans des conditions données. Il n'y a pas un seul système social défini qui puisse se revendiquer d’être naturel ; les différents systèmes sociaux se succèdent les uns aux autres en raison du développement des forces productives. Chaque système est donc le système naturel pour son époque particulière, comme le suivant le sera à une époque ultérieure. Le capitalisme n'est pas le seul ordre naturel, comme le croit la bourgeoisie, et aucun système socialiste mondial n'est le seul ordre naturel, comme certains socialistes essayent de le prouver. Le capitalisme était naturel dans les conditions du 19e siècle, tout comme le féodalisme l’était au Moyen-âge, et comme le sera le socialisme au stade de développement futur des forces productives. La tentative de promouvoir un système donné comme le seul système naturel est tout aussi futile que vouloir désigner un animal et dire que cet animal est le plus parfait de tous les animaux. Le darwinisme nous enseigne que chaque animal est également adapté et également parfait dans sa forme pour s’adapter à son environnement particulier. De la même manière, le marxisme nous enseigne que chaque système social est particulièrement adapté à ses conditions et que, dans ce sens, on peut le qualifier de bon et parfait.
C’est ici que réside la raison principale pour laquelle les tentatives des darwinistes bourgeois pour défendre le système capitaliste décadent sont vouées à l’échec. Les arguments basés sur la science de la nature, quand ils sont appliqués aux questions sociales, conduisent presque toujours à des conclusions erronées. En effet, alors que la nature ne change pas dans ses grandes lignes au cours de l'histoire de l’humanité, la société humaine, en revanche, subit des changements rapides et continus. Pour comprendre la force motrice et la cause du développement social, nous devons étudier la société comme telle. Le marxisme et le darwinisme doivent chacun s'en tenir à leur domaine propre ; ils sont indépendants l'un de l'autre et il n'existe aucun lien direct entre eux.
Ici surgit une question très importante. Pouvons-nous nous arrêter à la conclusion selon laquelle le marxisme s'applique uniquement à la société et le darwinisme uniquement au monde organique, et que ni l'une ni l'autre de ces théories n'est applicable à l'autre domaine ? D’un point de vue pratique, c’est très commode d'avoir un principe pour le monde humain et un autre pour le monde animal. En adoptant ce point de vue cependant, nous oublions que l'homme est aussi un animal. L'homme s'est développé à partir de l’animal, et les lois qui s'appliquent au monde animal ne peuvent pas, soudainement, perdre leur applicabilité à l’être humain. Il est vrai que l'homme est un animal très particulier, mais si c'est le cas il est nécessaire de trouver, à partir de ces particularités mêmes, pourquoi les principes applicables à tous les animaux ne s'appliquent pas aux hommes, ou pourquoi ils prennent une forme différente.
Ici, nous touchons à un autre problème. Les darwinistes bourgeois n'ont pas ce problème ; ils déclarent simplement que l'homme est un animal et ils se lancent sans réserve dans l'application des principes darwiniens aux hommes. Nous avons vu à quelles conclusions erronées ils arrivent. Pour nous, cette question n'est pas aussi simple ; nous devons d'abord avoir une vision claire des différences qui existent entre les hommes et les animaux, puis, à partir de ces différences, il doit découler la raison pour laquelle, dans le monde humain, les principes darwiniens se transforment en des principes totalement différents, à savoir en ceux du marxisme.
VII La sociabilité de l'homme
La première particularité que nous observons chez l’homme est qu’il est un être social. En cela, il ne diffère pas de tous les animaux car même parmi ces derniers, il y a beaucoup d'espèces qui vivent de façon sociale. Mais l'homme diffère de tous les animaux que nous avons observés jusqu'ici en parlant de la théorie darwinienne, de ces animaux qui vivent séparément, chacun pour soi et qui luttent contre tous les autres pour subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas aux prédateurs, qui vivent de façon séparée et qui sont les animaux modèles des Darwiniens bourgeois, que l'homme doit être comparé, mais à ceux qui vivent socialement. La sociabilité est une force nouvelle, dont nous n'avons pas encore tenu compte jusqu’à présent ; une force qui fait appel à de nouveaux rapports et à de nouvelles qualités chez les animaux.
C'est une erreur de considérer la lutte pour l'existence comme la force unique et omnipotente donnant forme au monde organique. La lutte pour l'existence est la principale force qui est à l'origine de nouvelles espèces, mais Darwin lui-même savait très bien que d'autres forces coopèrent, qui façonnent les formes, les habitudes et les particularités du monde organique. Dans son livre plus tardif, La Filiation de l’homme, Darwin a minutieusement traité de la sélection sexuelle et a montré que la concurrence des mâles pour les femelles a donné naissance aux couleurs bariolées des oiseaux et des papillons et, également, aux chants mélodieux des oiseaux. Il a également consacré tout un chapitre à la vie sociale. On peut aussi trouver beaucoup d’exemples sur cette question dans le livre de Kropotkine, L'Entraide, un facteur d'évolution. Le meilleur exposé des effets de la sociabilité se trouve dans L'Éthique et la conception matérialiste de l'histoire de Kautsky.
Quand un certain nombre d'animaux vivent en groupe, en troupeau ou en bande, ils mènent en commun la lutte pour l'existence contre le monde extérieur ; à l’intérieur d’un tel groupe la lutte pour l'existence cesse. Les animaux qui vivent socialement n’engagent plus les uns contre les autres de combats où les faibles succombent ; c’est exactement l'inverse, les faibles jouissent des mêmes avantages que les forts. Quand quelques animaux ont l'avantage d’un odorat plus aiguisé, d’une plus grande force, ou de l’expérience qui leur permet de trouver le meilleur pâturage ou d’éviter l'ennemi, cet avantage ne bénéficie pas seulement à eux-mêmes, mais également au groupe entier, y compris aux individus les moins pourvus. Le fait pour les individus les moins pourvus de se joindre aux plus avantagés permet aux premiers de surmonter, jusqu’à un certain point, les conséquences de leurs propriétés moins favorables.
Cette mise en commun des différentes forces profite à l’ensemble des membres. Elle donne au groupe une puissance nouvelle et beaucoup plus importante que celle d'un seul individu, même le plus fort. C’est grâce à cette force unie que les herbivores sans défense peuvent contrer les prédateurs. C'est seulement au moyen de cette unité que certains animaux sont capables de protéger leurs petits. La vie sociale profite donc énormément à l’ensemble des membres du groupe.
Un deuxième avantage de la sociabilité vient du fait que, lorsque les animaux vivent socialement, il y a une possibilité de division du travail. Ces animaux envoient des éclaireurs ou placent des sentinelles dont la tâche est de s'assurer de la sécurité de tous, pendant que les autres sont tranquillement en train de manger ou de cueillir, en comptant sur leurs gardes pour les avertir du danger.
Une telle société animale devient, à certains égards, une unité, un seul organisme. Naturellement, les rapports restent beaucoup plus lâches que dans les rapports qui règnent entre les cellules d'un seul corps animal ; en effet les membres restent égaux entre eux – ce n’est que chez les fourmis, les abeilles et quelques autres insectes qu’une distinction organique se développe – et ils sont capables, dans des conditions certes plus défavorables, de vivre isolément. Néanmoins, le groupe devient un corps cohérent, et il doit y avoir une certaine force qui lie les différents membres entre eux.
Cette force n'est autre que les motifs sociaux, l'instinct qui maintiennent les animaux réunis et qui permettent ainsi la perpétuation du groupe. Chaque animal doit placer l'intérêt de l'ensemble du groupe au-dessus de ses intérêts propres ; il doit toujours agir instinctivement pour le bénéfice du groupe sans considération pour lui-même. Si chacun des faibles herbivores ne pense qu’à lui-même et s’enfuit quand il est attaqué par un fauve, le troupeau réuni s’éparpille à nouveau. C’est seulement quand le motif fort de l'instinct de conservation est contré par un motif encore plus fort d'union, et que chaque animal risque sa vie pour la protection de tous, c’est seulement alors que le troupeau se maintient et profite des avantages de rester groupé. Le sacrifice de soi, le courage, le dévouement, la discipline et la fidélité doivent surgir de cette façon, parce que là où ces qualités n'existent pas, la cohésion se dissout ; la société ne peut exister que là où ces qualités existent.
Ces instincts, tout en ayant leur origine dans l'habitude et la nécessité, sont renforcés par la lutte pour l'existence. Chaque troupeau animal se trouve toujours dans une lutte de concurrence avec les mêmes animaux d'un troupeau différent ; les troupeaux qui sont les mieux adaptés pour résister à l'ennemi survivront, alors que ceux qui sont plus pauvrement équipés disparaîtront. Les groupes dans lesquels l'instinct social est le mieux développé pourront le mieux se maintenir, alors que le groupe dans lequel l'instinct social est peu développé, soit va devenir une proie facile pour ses ennemis, soit ne sera pas en mesure de trouver les pâturages les plus favorables à son existence. Ces instincts sociaux deviennent donc les facteurs les plus importants et les plus décisifs qui déterminent qui survivra dans la lutte pour l'existence. C'est à cause de cela que les instincts sociaux ont été élevés à la position de facteurs prédominants dans la lutte pour la survie.
Ceci jette un éclairage entièrement nouveau sur le point de vue des darwinistes bourgeois. Ces derniers proclament que seule l'élimination des faibles est naturelle et qu'elle est nécessaire afin d'empêcher la corruption de la race. D’autre part, la protection apportée aux faibles est contre la nature et contribue à la déchéance de la race. Mais que voyons-nous ? Dans la nature elle-même, dans le monde animal, nous constatons que les faibles sont protégés, qu'ils ne se maintiennent pas grâce à leur propre force personnelle, et qu'ils ne sont pas écartés du fait de leur faiblesse individuelle. Ces dispositions n'affaiblissent pas le groupe, mais lui confèrent une force nouvelle. Le groupe animal dans lequel l'aide mutuelle est la mieux développée, est mieux adapté pour se préserver dans les conflits. Ce qui, selon la conception étroite de ces Darwinistes, apparaissait comme facteur de faiblesse, devient exactement l'inverse, un facteur de force, contre lequel les individus forts qui mènent la lutte individuellement ne font pas le poids. La race, prétendument dégénérescente et corrompue, remporte la victoire et s'avère dans la pratique la plus habile et la meilleure.
Ici nous voyons d'abord pleinement à quel point les affirmations des darwinistes bourgeois sont à courte vue, révèlent une étroitesse d’esprit et une absence d’esprit scientifique. Ils font dériver leurs lois naturelles et leurs conceptions de ce qui est naturel concernant une partie du monde animal à laquelle l'homme ressemble le moins, les animaux solitaires, alors qu'ils laissent de côté l'observation des animaux qui vivent pratiquement dans les mêmes circonstances que l'homme. On peut en trouver la raison dans leurs propres conditions de vie ; ils appartiennent à une classe où chacun est en concurrence individuelle avec l'autre. Par conséquent, ils ne voient chez les animaux que la forme de la lutte pour l'existence qui correspond à la lutte de concurrence bourgeoise. C'est pour cette raison qu'ils négligent les formes de lutte qui sont de la plus grande importance pour les hommes.
Il est vrai que les darwinistes bourgeois sont conscients du fait que tout, dans le monde animal comme dans l’humain, ne se réduit pas à l’égoïsme pur. Les scientifiques bourgeois disent très souvent que tout homme est habité par deux sentiments : le sentiment égoïste ou amour de soi, et le sentiment altruiste, ou amour des autres. Mais comme ils ne connaissent pas l'origine sociale de cet altruisme, ils ne peuvent comprendre ni ses limites ni ses conditions. L'altruisme, dans leur bouche, devient une idée très vague qu'ils ne savent pas manier.
Tout ce qui s'applique aux animaux sociaux s'applique également à l'homme. Nos ancêtres ressemblant à des singes et les hommes primitifs qui se sont développés à partir d’eux étaient tous des animaux faibles, sans défense qui, comme presque tous les singes, vivaient en tribus. Chez eux, ont dû apparaître les mêmes motifs et les mêmes instincts sociaux qui, plus tard, chez l’homme, se sont développés sous la forme de sentiments moraux. Le fait que nos coutumes et nos morales ne soient rien d’autre que des sentiments sociaux, des sentiments que nous rencontrons chez des animaux, est connu de tous ; Darwin aussi a déjà parlé des "habitudes des animaux en rapport avec leur attitudes sociales qui s'appelleraient morale chez les hommes". La différence réside seulement dans le degré de conscience ; dès que ces sentiments sociaux deviennent clairement conscients pour les hommes, ils prennent le caractère de sentiments moraux. Ici nous voyons que la conception morale - que les auteurs bourgeois considéraient comme la différence principale entre les hommes et les animaux - n'est pas propre aux hommes, mais est un produit direct des conditions existant dans le monde animal.
Le fait que les sentiments moraux ne s’étendent pas au-delà du groupe social auquel l'animal ou l'homme appartient, réside dans la nature de leur origine. Ces sentiments servent le but pratique de préserver la cohésion du groupe ; au delà, ils sont inutiles. Dans le monde animal, l’étendue et la nature du groupe social sont déterminées par les circonstances de la vie, et donc le groupe demeure presque toujours le même. Chez les hommes, en revanche, les groupes, ces unités sociales, sont toujours changeantes en fonction du développement économique, et ceci change également le domaine de validité des instincts sociaux.
Les anciens groupes, à l’origine des peuplades sauvages et barbares, étaient plus fortement unis que les groupes animaux non seulement parce qu’ils étaient en concurrence mais aussi parce qu’ils se faisaient directement la guerre. Les rapports familiaux et un langage commun ont renforcé plus tard cette unité. Chaque individu dépendait entièrement du soutien de sa tribu. Dans ces conditions, les instincts sociaux, les sentiments moraux, la subordination de l'individu au tout, ont dû se développer à l'extrême. Avec le développement ultérieur de la société, les tribus se sont dissoutes en des entités économiques plus larges et se sont réunies dans des villes et des peuples.
De nouvelles sociétés prennent la place des anciennes, et les membres de ces entités poursuivent la lutte pour l'existence en commun contre d'autres peuples. Dans une proportion égale au développement économique, la taille de ces entités augmente, au sein desquelles la lutte de chacun contre les autres faiblit et les sentiments sociaux s'étendent. À la fin de l'antiquité, nous constatons que tous les peuples connus autour de la Méditerranée forment alors une unité, l'Empire romain. A cette époque, surgit aussi la doctrine qui étend les sentiments moraux à l’humanité entière et formule le dogme que tous les hommes sont frères.
Quand nous considérons notre propre époque, nous voyons qu'économiquement tous les peuples forment de plus en plus une unité, même si c'est une unité faible. En conséquence, il règne un sentiment – il est vrai relativement abstrait – d’une fraternité qui englobe l’ensemble des peuples civilisés. Bien plus fort est le sentiment national, surtout chez la bourgeoisie, parce que les nations constituent les entités en lutte constante de la bourgeoisie. Les sentiments sociaux sont les plus forts envers les membres de la même classe, parce que les classes constituent les unités sociales essentielles, incarnant les intérêts convergents de ses membres Ainsi nous voyons que les entités sociales et les sentiments sociaux changent dans la société humaine, selon le progrès du développement économique. 2
VIII. Outils, pensée et langage
La sociabilité, avec ses conséquences, les instincts moraux, constitue une particularité qui distingue l'homme de certains animaux, mais pas de tous. Il existe, cependant, des particularités qui n'appartiennent qu'à l’homme et qui le séparent de l’ensemble du monde animal. C’est, en premier lieu, le langage, ensuite, la raison. L'homme est également le seul animal qui se sert d’outils fabriqués par lui-même.
Les animaux présentent ces propriétés en germes, tandis que chez les hommes, elles se sont développées à travers de nouvelles caractéristiques spécifiques. Beaucoup d'animaux ont une sorte de voix et peuvent, au moyen de sons, communiquer leurs intentions, mais c’est seulement l'homme qui émet des sons tels que des noms qui lui servent de moyen pour nommer des choses et des actions. Les animaux ont également un cerveau avec lequel ils pensent, mais l’intelligence humaine révèle, comme nous le verrons plus tard, une orientation entièrement nouvelle, que nous désignons comme une pensée rationnelle ou abstraite. Les animaux, aussi, se servent d'objets inanimés qu'ils utilisent dans certains buts ; par exemple, la construction des nids. Les singes utilisent parfois des bâtons ou des pierres, mais seul l'homme utilise les outils qu'il fabrique lui-même délibérément dans des buts particuliers. Ces tendances primitives chez les animaux nous convainquent que les particularités que l'homme possède lui sont venues, non pas grâce au miracle de la création, mais par un lent développement. Comprendre comment ces premières traces de langage, de pensée et d’utilisation d’outils se sont développées en de telles propriétés nouvelles et de première importance chez l’homme implique la problématique de l’humanisation de l’animal.
Seul l’être humain en tant qu’animal social a été capable de cette évolution. Les animaux qui vivent en solitaires ne peuvent pas parvenir à un tel niveau de développement. En dehors de la société, le langage est aussi inutile que l'œil dans l'obscurité, et il est voué à s’éteindre. Le langage n'est possible que dans la société, et c'est seulement là qu'il est nécessaire comme moyen de délibération entre ses membres. Tous les animaux sociaux possèdent certains moyens pour exprimer leurs intentions, autrement ils ne pourraient pas agir selon un plan collectif. Les sons qui étaient nécessaires comme moyen de se comprendre lors du travail collectif pour l'homme primitif, ont dû se développer lentement jusqu’à des noms d’activités et ensuite de choses.
L'utilisation des outils aussi présuppose une société, parce que c'est seulement à travers la société que les acquis peuvent être préservés. Dans un état de vie solitaire, chacun aurait dû découvrir cet emploi pour lui seul et, avec la mort de l’inventeur, la découverte aurait disparu également, et chacun aurait dû tout recommencer depuis le début. Ce n'est qu'avec la société que l'expérience et la connaissance des anciennes générations peuvent être préservées, perpétuées et développées. Dans un groupe ou une tribu, quelques-uns peuvent mourir, mais le groupe, lui, est en quelque sorte immortel. Il subsiste. La connaissance de l'utilisation des outils n'est pas innée, elle est acquise plus tard. C'est pourquoi une tradition intellectuelle est indispensable, qui n’est possible que dans la société.
Alors que ces caractéristiques spécifiques à l'homme sont inséparables de sa vie sociale, elles sont également fortement reliées entre elles. Ces caractéristiques ne se sont pas développées séparément, mais ont toutes progressé en commun. Que la pensée et le langage peuvent exister et se développer seulement en commun est connu de tous ceux qui ont essayé de se représenter la nature de leur propre pensée. Lorsque nous pensons ou réfléchissons, en fait, nous nous parlons à nous-mêmes et nous observons alors qu'il nous est impossible de penser clairement sans employer des mots. Lorsque nous ne pensons pas avec des mots, nos pensées demeurent imprécises et nous n’arrivons pas à saisir les pensées spécifiques. Chacun d’entre nous peut comprendre cela par sa propre expérience. C'est parce que le raisonnement dit abstrait est une pensée perceptive et ne peut avoir lieu qu’au moyen de concepts. Or nous ne pouvons désigner et maîtriser ces concepts qu’au moyen de mots. Chaque tentative pour élargir notre pensée, chaque tentative pour faire avancer notre connaissance doit commencer par la distinction et la classification au moyen de noms ou en donnant aux anciennes appellations une signification plus précise. Le langage est le corps de la pensée, le seul matériel avec lequel toute science humaine est construite.
La différence entre l'esprit humain et l'esprit animal a été très pertinemment montrée par Schopenhauer dans une citation qui est aussi relevée par Kautsky dans L'Éthique et la Conception Matérialiste de l'Histoire (pages 139-40 de la traduction en anglais). Les actes de l'animal dépendent de motifs visuels, de ce qu'il voit, entend, sent ou observe. Nous pouvons presque toujours voir et dire ce qui pousse un animal à faire ceci ou cela car, nous aussi, nous pouvons le voir si nous faisons attention. Avec l'homme cependant, c’est totalement différent. Nous ne pouvons pas prévoir ce qu'il fera, parce que nous ne connaissons pas les motifs qui l'incitent à agir ; ce sont les pensées dans sa tête. L'homme réfléchit et, ce faisant, il fait entrer en jeu toute sa connaissance, résultat de ses anciennes expériences, et c'est alors qu'il décide comment agir. Les actes d'un animal dépendent d’une impression immédiate, alors que ceux de l'homme dépendent de conceptions abstraites, de pensées et de concepts. L'homme "est en quelque sorte mû par des fils invisibles et subtils. Ainsi tous ses mouvements donnent l'impression d’être guidés par des principes et des intentions qui leur donnent l'aspect de l'indépendance et les distinguent évidemment de ceux des animaux".
Parce qu’ils ont des exigences corporelles, les hommes et les animaux sont forcés de chercher à les satisfaire dans la nature environnante. La perception sensorielle constitue l'impulsion et le motif immédiat ; la satisfaction des besoins est l’objectif et le but de l'action appropriée. Chez l'animal, l'action intervient immédiatement après l'impression. Il voit sa proie ou sa nourriture et, immédiatement, il saute, saisit, mange, ou fait ce qui est nécessaire pour la saisir, et ceci est l’héritage de son instinct. L'animal entend un bruit hostile et, immédiatement, il s’enfuit si ses pattes sont suffisamment développées pour courir rapidement, ou bien il s’allonge et fait le mort pour ne pas être vu si sa couleur lui sert de protection. Chez l'homme, en revanche, entre ses perceptions et ses actes, passe dans sa tête une longue chaîne de pensées et de réflexions. Ses actes dépendront du résultat de ces réflexions.
D'où vient cette différence ? Il n'est pas difficile de voir qu'elle est étroitement associée à l'utilisation des outils. De la même manière que la pensée s’insère entre les perceptions de l'homme et ses actes, l'outil s’insère entre l'homme et l’objet qu'il cherche à saisir. En outre, puisque l'outil se glisse entre l'homme et les objets extérieurs, c’est aussi pour cela que la pensée doit surgir entre la perception et l'exécution. L'homme ne se jette pas les mains nues sur son objectif, que ce soit son ennemi ou le fruit à cueillir, mais il procède de façon indirecte, il prend un outil, une arme (les armes sont également des outils) qu'il utilise envers le fruit ou contre l'animal hostile. C’est pourquoi, dans sa tête, la perception sensorielle ne peut pas être suivie immédiatement de l’acte, mais l’esprit doit prendre un détour : il doit d’abord penser aux outils et ensuite poursuivre son objectif. Le détour matériel crée le détour mental ; la pensée supplémentaire est le résultat de l’outil supplémentaire.
Ici nous avons envisagé un cas extrêmement simple d'outils primitifs et les premières phases du développement mental. Plus la technique se complique, plus le détour matériel est grand et, par conséquent, l'esprit doit accomplir de plus grands détours. Quand chacun fabriquait ses propres outils, le souvenir de la faim et de la lutte devait orienter l'esprit humain vers l’outil et vers sa fabrication pour qu’il soit prêt à être utilisé. Ici nous avons une chaîne de pensées plus longue entre les perceptions et la satisfaction finale des besoins humains. Quand nous arrivons à notre époque, nous constatons que cette chaîne est très longue et très compliquée. L'ouvrier qui est licencié prévoit la faim qui l’attend ; il achète un journal pour voir s'il n’y a pas quelques offres d'emploi ; il va à la recherche d’offres, se présente et ne touchera que bien plus tard un salaire, avec lequel il pourra acheter de la nourriture et se protéger contre la famine. Tout cela sera d’abord délibéré dans sa tête avant que d'être mis en pratique. Quel long et tortueux chemin l'esprit doit suivre avant d'atteindre son but ! Mais celui-ci est conforme à l’élaboration complexe de notre société actuelle, au sein de laquelle l'homme ne peut satisfaire ses besoins qu’à travers une technique hautement développée.
C’est bien là-dessus que Schopenhauer attirait notre attention, le déroulement dans le cerveau du fil de la réflexion, qui anticipe l’action et qui doit être compris comme le produit nécessaire de l’emploi d’outils. Mais nous n’avons toujours pas accédé à l’essentiel. L’homme n’est pas le maître d'un seul outil, il en a de nombreux, qu'il utilise pour des objectifs différents et entre lesquels il peut choisir. L’homme, à cause de ces outils, n'est pas comme l'animal. L'animal ne va jamais au-delà des outils et des armes que la nature lui a offerts, alors que l'homme peut changer d’outils artificiels. C’est ici que se situe la différence fondamentale entre l’homme et l’animal. L’homme est en quelque sorte un animal aux organes modifiables et c’est pourquoi il doit avoir la capacité de choisir entre ses outils. Dans sa tête vont et viennent diverses pensées, son esprit examine tous les outils et les conséquences de leur application, et ses actes dépendent de cette réflexion. Il combine également une pensé avec une autre, et il retient rapidement l'idée qui convient à son but. Cette délibération, cette libre comparaison d’une série de séquences de réflexions individuellement choisies, cette propriété qui différencie fondamentalement la pensée humaine de la pensée animale doit directement être rattachée à l’utilisation d’outils choisis à volonté.
Les animaux n'ont pas cette capacité ; celle-ci leur serait inutile car ils ne sauraient pas quoi en faire. À cause de leur forme corporelle, leurs actions sont étroitement contraintes. Le lion peut seulement bondir sur sa proie, mais il ne peut pas penser l'attraper en lui courant après. Le lièvre est constitué de telle sorte qu’il peut fuir; il n'a aucun autre moyen de défense, même s’il aimerait en avoir. Ces animaux n'ont rien à prendre en considération, excepté le moment où il faut sauter ou courir, le moment où les impressions atteignent une force suffisante pour le déclenchement de l’action. Chaque animal est constitué de telle sorte qu’il s’adapte à un mode de vie défini. Leurs actions deviennent et sont transmises comme des habitudes, des instincts. Ces habitudes ne sont évidemment pas immuables. Les animaux ne sont pas des machines, quand ils sont soumis à des circonstances différentes, ils peuvent acquérir des habitudes différentes. Physiologiquement et en ce qui concerne les aptitudes, le fonctionnement de leur cerveau n’est pas différent du nôtre. Il l’est uniquement pratiquement au niveau du résultat. Ce n’est pas dans la qualité de leur cerveau, mais dans la formation de leur corps que résident les restrictions animales. L'acte de l'animal est limité par sa forme corporelle et par son milieu, ce qui lui laisse peu de latitude pour réfléchir. La raison humaine serait donc pour l’animal une faculté totalement inutile et sans objet, qu’il ne pourrait pas appliquer et qui lui ferait plus de mal que de bien.
D'un autre côté, l'homme doit posséder cette capacité parce qu'il exerce son discernement dans l'utilisation des outils et des armes, qu'il choisit en fonction des conditions particulières. S'il veut tuer le cerf agile, il prend l'arc et la flèche ; s'il rencontre l'ours, il utilise la hache, et s'il veut ouvrir un certain fruit en le cassant, il prend un marteau. Quand le danger le menace, l’homme doit décider s'il va s’enfuir ou s’il va se défendre en combattant avec des armes. Cette capacité de penser et de réfléchir lui est indispensable dans son utilisation d'outils artificiels, tout comme l’éveil de l’esprit en général appartient à la libre mobilité du monde animal.
Cette puissante connexion entre les pensées, le langage et les outils, chacun étant impossible sans les deux autres, montre qu'ils ont dû se développer en même temps. Comment ce développement a eu lieu, nous pouvons seulement le supposer. Ce fut, sans doute, un changement dans les circonstances de la vie qui a fait d’un animal simiesque l’ancêtre de l’homme. Après avoir émigré des bois, l'habitat original des singes, vers les plaines, l'homme a dû subir un total changement de vie. La différence entre les mains pour saisir et les pieds pour courir doit s'être développée alors. Cet être a apporté de ses origines les deux conditions fondamentales pour un développement vers un niveau supérieur : la sociabilité et la main simiesque, bien adaptée pour saisir des objets. Les premiers objets bruts, tels que les pierres ou les bâtons, utilisés épisodiquement dans le travail collectif, leurs arrivaient involontairement dans les mains et étaient ensuite jetés. Ceci a dû se répéter instinctivement et inconsciemment si souvent que cela doit avoir laissé une empreinte dans l'esprit de ces hommes primitifs.
Pour l'animal, la nature environnante est un tout indifférencié, dont il n’est pas conscient des détails. Il ne peut pas faire la distinction entre divers objets car il lui manque le nom des parties distinctes et des objets, qui nous permettent de différencier. Certes, cet environnement n’est pas immuable. Aux changements qui signifient ‘nourriture’ ou ‘danger’, l’animal réagit de manière appropriée, par des actions spécifiques. Globalement, néanmoins, la nature reste indifférenciée et notre homme primitif, à son niveau le plus bas, a dû être au même niveau de conscience. A partir de cette globalité, s’imposent par le travail lui-même, le contenu principal de l’existence humaine, progressivement ces choses qui sont utilisées pour le travail. L’outil, qui est parfois un élément mort quelconque du monde extérieur et qui parfois agit comme un organe de notre propre corps, qui est inspiré par notre volonté, se situe à la fois hors du monde extérieur et hors de notre corps, ces dimensions évidentes pour l’homme primitif qu’il ne remarque pas. Ces outils, qui sont des aides importantes, se sont vus attribuer une certaine désignation, ont été désignés par un son qui en même temps nommait l'activité particulière. Avec cette désignation, l'outil se dégage comme chose particulière du reste de l’environnement. L'homme commence ainsi à analyser le monde au moyen de concepts et de noms, la conscience de soi fait son apparition, des objets artificiels sont recherchés à dessein et utilisés en connaissance de cause pour travailler.
Ce processus – car c'est un processus très lent - marque le commencement de notre transformation en hommes. Dès que les hommes ont délibérément cherché et utilisé certains outils, nous pouvons dire que ceux-ci ont été ‘produits’; de cette étape à celle de la fabrication d'outils, il n’y a qu’un pas. Avec le premier nom et la première pensée abstraite, l’homme est fondamentalement né. Un long chemin reste alors à accomplir : les premiers outils bruts diffèrent déjà selon leur utilisation ; à partir de la pierre pointue nous obtenons le couteau, le coin, le foret, et la lance ; à partir du bâton nous obtenons la cognée. Ainsi, l’homme primitif est apte à affronter le fauve et la forêt et se présente déjà comme le futur roi de la terre. Avec une plus grande différentiation des outils, qui vont plus tard servir à la division du travail, le langage et la pensée prennent des formes plus riches et nouvelles et, réciproquement, la pensée conduit l'homme à mieux utiliser les outils, à améliorer les anciens et à en inventer de nouveaux.
Ainsi nous voyons qu'une chose en amène une autre. La pratique des relations sociales et du travail sont la source où la technique, la pensée, les outils et la science prennent leur origine et se développent continuellement. Par son travail, l'homme primitif simiesque s'est élevé à la vraie humanité. L'utilisation des outils marque la grande rupture qui va s'agrandir de façon croissante entre les hommes et les animaux.
IX. Organes animaux et outils humains
C’est sur ce point que nous avons la différence principale entre les hommes et les animaux. L'animal obtient sa nourriture et vainc ses ennemis avec ses propres organes corporels ; l'homme fait la même chose à l'aide d’outils artificiels. Organe (organon) est un mot grec qui signifie également outil. Les organes sont les outils naturels de l'animal, rattachés à son corps. Les outils sont les organes artificiels des hommes. Mieux encore : ce que l'organe est à l'animal, la main et l'outil le sont à l’homme. Les mains et les outils remplissent les fonctions que l’organe animal doit remplir seul. De par sa structure, la main, spécialisée pour tenir et diriger divers outils, devient un organe général adapté à toutes sortes de travaux ; les outils sont les choses inanimées qui sont prises en main à tour de rôle et qui font de la main un organe variable qui peut remplir une diversité de fonctions.
Avec la division de ces fonctions, s'ouvre aux hommes un large champ de développement que les animaux ne connaissent pas. Puisque la main humaine peut utiliser divers outils, elle peut combiner les fonctions de tous les organes possibles que les animaux possèdent. Chaque animal est construit et adapté à un entourage et un mode de vie définis. L’homme, avec ses outils, s'adapte à toutes les circonstances et est équipé pour tous les environnements. Le cheval est bâti pour la prairie, et le singe pour la forêt. Dans la forêt, le cheval serait aussi désemparé que le singe qu'on amènerait dans la prairie. L'homme, pour sa part, utilise la hache dans la forêt et la bêche dans la prairie. Avec ses outils, l’homme peut se frayer un chemin dans toutes les régions du monde et s'établir partout. Alors que presque tous les animaux ne peuvent vivre que dans des régions particulières, là où ils peuvent subvenir à leurs besoins, et ne peuvent pas vivre ailleurs, l'homme a conquis le monde entier. Comme l’a exprimé une fois un zoologiste, chaque animal possède ses points forts grâce auxquels il se maintient dans la lutte pour l'existence, et des faiblesses propres qui font de lui une proie pour d'autres et l'empêchent de se multiplier. Dans ce sens, l'homme n'a que de la force et pas de faiblesse. Grâce à ses outils, l'homme est l'égal de tous les animaux. Comme ses outils ne sont pas figés mais s'améliorent continuellement, l'homme se développe au-dessus de tous les animaux. Avec ses outils, il devient le maître de toute la création, le Roi de la terre.
Dans le monde animal, il y a aussi un développement et un perfectionnement continus des organes. Mais ce développement est lié aux changements du corps de l'animal, qui rend le développement des organes infiniment lent, dicté par des lois biologiques. Dans le développement du monde organique, des milliers d'années comptent peu. L'homme, en revanche, en transférant son développement organique sur des objets extérieurs a pu se libérer de l’asservissement à la loi biologique. Les outils peuvent être transformés rapidement, et la technique fait des avancées si rapides par rapport au développement des organes animaux, qu’on ne peut que s’en émerveiller. Grâce à cette nouvelle voie, l'homme a pu, au cours de la courte période de quelques milliers d’années, s’élever au-dessus des plus évolués des animaux autant que ces derniers dépassent les moins évolués. Avec l'invention des outils artificiels, est mis fin en quelque sorte à l’évolution animale. L’enfant de singe s’est développé à une vitesse phénoménale jusqu’à une puissance divine, et il a pris possession de la terre en la soumettant à son autorité exclusive. L’évolution, jusqu’ici paisible et sans encombre, du monde organique, cesse de se développer selon les lois de la théorie darwinienne. C'est l'homme qui agit dans le monde des plantes et des animaux en tant que sélectionneur, dompteur, cultivateur ; et c'est l'homme qui défriche. Il transforme tout l'environnement, créant de nouvelles formes de plantes et d’animaux adaptées qui correspondent à ses objectifs et à sa volonté.
Ceci explique aussi pourquoi, avec l'apparition des outils, le corps humain ne change plus. Les organes humains demeurent ce qu’ils étaient, à l’exception notoire toutefois du cerveau. Le cerveau humain a dû se développer parallèlement aux outils ; et, en fait, nous voyons que la différence entre les races les plus évoluées de l’humanité et les plus inférieures réside principalement dans le contenu de leur cerveau. Mais même le développement de cet organe a dû s'arrêter à une certaine étape. Depuis le début de la civilisation, certaines fonctions sont continuellement retirées au cerveau par des moyens artificiels ; la science est précieusement conservée dans ces granges que sont les livres. Notre faculté de raisonnement d'aujourd'hui n'est pas tellement supérieure à celle qu'avaient les Grecs, les Romains ou même les Germains, mais notre connaissance s'est immensément développée, et c'est dû, en grande partie, au fait que le cerveau a été déchargé sur ses substituts, les livres.
Maintenant que nous avons établi la différence entre les hommes et les animaux, tournons à nouveau le regard sur la façon dont les deux groupes sont affectés par la lutte pour l'existence. Que cette lutte soit à l’origine de la perfection dans la mesure où ce qui est imparfait est éliminé, ne peut pas être nié. Dans ce combat, les animaux se rapprochent toujours plus de la perfection. Il est cependant nécessaire d'être plus précis dans l'expression et dans l'observation de ce en quoi consiste cette perfection. Ce faisant, nous ne pouvons plus dire que se sont les animaux dans leur totalité qui luttent et se perfectionnent. Les animaux luttent et se concurrencent au moyen d’organes particuliers, ceux qui sont déterminants dans la lutte pour la survie. Les lions ne combattent pas avec leur queue ; les lièvres ne se fient pas à leur vue ; et le succès des faucons ne vient pas de leur bec. Les lions mènent le combat à l'aide de leurs muscles (pour bondir) et de leurs dents ; les lièvres comptent sur leurs pattes et leurs oreilles, et les faucons réussissent grâce à leurs yeux et à leurs ailes. Si maintenant nous nous demandons qu'est-ce qui lutte et entre en compétition, la réponse est : les organes luttent et ce faisant, ils deviennent de plus en plus parfait. Les muscles et les dents pour le lion, les pattes et les oreilles pour le lièvre et les yeux et les ailes pour le faucon mènent la lutte. C'est dans cette lutte que les organes se perfectionnent. L'animal dans son ensemble dépend de ces organes et partage leur sort, celui des forts qui seront victorieux ou des faibles qui seront vaincus.
Maintenant, posons la même question à propos du monde humain. Les hommes ne luttent pas au moyen de leurs organes naturels, mais au moyen d'organes artificiels, à l'aide des outils (et des armes que nous devons considérer comme des outils). Ici, aussi, le principe de la perfection et de l’élimination par la lutte de ce qui est imparfait, s’avère vrai. Les outils entrent en lutte, et ceci conduit au perfectionnement toujours plus important de ces derniers. Les communautés tribales qui utilisent de meilleurs outils et de meilleures armes peuvent le mieux assurer leur subsistance et, quand elles entrent en lutte directe avec une autre race, la race qui est la mieux pourvue d’outils artificiels gagnera et exterminera les plus faibles. Les grandes améliorations de la technique et des méthodes de travail aux origines de l’humanité, comme l’introduction de l’agriculture et de l’élevage, font de l’homme une race physiquement plus solide qui souffre moins de la rudesse des éléments naturels. Les races dont le matériel technique est le mieux développé, peuvent chasser ou soumettre celles dont le matériel artificiel n’est pas développé, peuvent s’assurer des meilleures terres et développer leur civilisation. La domination de la race 3 européenne est basée sur sa suprématie technique.
Ici nous voyons que le principe de la lutte pour l'existence, formulé par Darwin et souligné par Spencer, exerce un effet différent sur les hommes et sur les animaux. Le principe selon lequel la lutte amène le perfectionnement des armes utilisées dans les conflits, conduit à des résultats différents chez les hommes et chez les animaux. Chez l'animal, il mène à un développement continu des organes naturels ; c'est la base de la théorie de la filiation, l'essence du darwinisme. Chez les hommes, il mène à un développement continu des outils, des techniques des moyens de production. Et ceci est le fondement du marxisme.
Il apparaît donc ici que le marxisme et le darwinisme ne sont pas deux théories indépendantes qui s'appliqueraient chacune à leur domaine spécifique, sans aucun point commun entre elles. En réalité, le même principe sous-tend les deux théories. Elles forment une unité. La nouvelle direction prise lors de l’apparition de l’homme, la substitution des outils aux organes naturels, fait se manifester ce principe fondamental de façon différente dans les deux domaines ; celui du monde animal se développe selon le principe darwinien alors que, pour l'humanité, c’est le marxisme qui détermine la loi de développement. Quand les hommes se sont libérés du monde animal, le développement des outils, des méthodes productives, de la division du travail et de la connaissance sont devenus la force propulsive du développement social. C’est cette force qui a fait naître les différents systèmes économiques, comme le communisme primitif, le système rural, les débuts de la production marchande, le féodalisme et, maintenant, le capitalisme moderne. Il nous reste à présent à situer le mode de production actuel et son dépassement dans la cohérence proposée et à appliquer sur eux de manière correcte la position de base du darwinisme.
X. Capitalisme et socialisme
La forme particulière que prend la lutte darwinienne pour l'existence comme force motrice pour le développement dans le monde humain, est déterminée par la sociabilité des hommes et leur utilisation des outils. Les hommes mènent la lutte collectivement, en groupes. La lutte pour l'existence, alors qu'elle se poursuit encore entre des membres de groupes différents, cesse néanmoins chez les membres du même groupe, et elle est remplacée par l’entraide et par les sentiments sociaux. Dans la lutte entre les groupes, l’équipement technique décide qui sera le vainqueur ; ceci a comme conséquence le progrès de la technique. Ces deux circonstances conduisent à des effets différents sous des systèmes sociaux différents. Voyons de quelle façon ils se manifestent sous le capitalisme.
Lorsque la bourgeoisie prit le pouvoir politique et fit du mode de production capitaliste le mode dominant, elle commença par briser les barrières féodales et à rendre les gens libres. Pour le capitalisme, il était essentiel que chaque producteur puisse participer librement à la lutte concurrentielle, sans qu'aucun lien n’entrave sa liberté de mouvement, qu’aucune activité ne soit paralysée ou freinée par des devoirs de corporation ou entravée par des statuts juridiques, car ce n’était qu’à cette condition que la production pourrait développer sa pleine capacité. Les ouvriers doivent être libres et ne pas être soumis à des contraintes féodales ou de corporation, parce que c’est seulement en tant qu’ouvriers libres qu’ils peuvent vendre leur force de travail comme marchandise aux capitalistes, et c’est seulement s’ils sont des travailleurs libres que les capitalistes peuvent les employer pleinement. C'est pour cette raison que la bourgeoisie a éliminé tous les liens et les devoirs du passé. Elle a complètement libéré les gens mais, en même temps, ceux-ci se sont trouvés totalement isolés et sans protection. Autrefois les gens n’étaient pas isolés ; ils appartenaient à une corporation ; ils étaient sous la protection d'un seigneur ou d’une commune et ils y trouvaient de la force. Ils faisaient partie d'un groupe social envers lequel ils avaient des devoirs et dont ils recevaient protection. Ces devoirs, la bourgeoisie les a supprimés ; elle a détruit les corporations et aboli les rapports féodaux. La libération du travail voulait aussi dire que l’homme ne pouvait plus trouver refuge nulle part et ne pouvait plus compter sur les autres. Chacun ne pouvait compter que sur lui-même. Seul contre tous, il devait lutter, libre de tout lien mais aussi de toute protection.
C'est pour cette raison que, sous le capitalisme, le monde humain ressemble le plus au monde des prédateurs et c'est pour cette raison même que les darwinistes bourgeois ont recherché le prototype de la société humaine chez les animaux solitaires. C’est leur propre expérience qui les guidait. Cependant leur erreur consistait dans le fait qu’ils considéraient les conditions capitalistes comme les conditions humaines éternelles. Le rapport qui existe entre notre système capitaliste concurrentiel et les animaux solitaires a été exprimé par Engels dans son livre, L'Anti-Dühring (Chapitre II : Notions théoriques) comme suit :
"La grande industrie, enfin, et l'établissement du marché mondial ont universalisé la lutte et lui ont donné en même temps une violence inouïe. Entre capitalistes isolés, de même qu'entre industries entières et pays entiers, ce sont les conditions naturelles ou artificielles de la production qui, selon qu'elles sont plus ou moins favorables, décident de l'existence. Le vaincu est éliminé sans ménagement. C'est la lutte darwinienne pour l'existence de l'individu transposée de la nature dans la société avec une rage décuplée. La condition de l'animal dans la nature apparaît comme l'apogée du développement humain." (marxists.org)
Qu'est-ce qui est en lutte dans la concurrence capitaliste, quelle chose, dont la perfection décidera de la victoire ?
Ce sont d'abord les outils techniques, les machines. Ici à nouveau s’applique la loi selon laquelle la lutte mène à la perfection. La machine qui est la plus perfectionnée surpasse celle qui l’est moins, les machines de mauvaise qualité et le petit outillage sont éliminés, et la technique industrielle fait des avancées colossales vers une productivité toujours plus grande. C'est la véritable application du darwinisme à la société humaine. La chose qui lui est particulière, c'est que, sous le capitalisme, il y a la propriété privée et que, derrière chaque machine, il y a un homme. Derrière la machine gigantesque, il y a un grand capitaliste et derrière la petite machine, il y a un petit-bourgeois. Avec la défaite de la petite machine, le petit-bourgeois périt, avec toutes ses illusions et espérances. En même temps la lutte est une course entre capitaux. Le grand capital est le mieux armé ; le grand capital vainc le petit et ainsi, il s'agrandit encore. Cette concentration de capital sape le capital lui-même, parce qu’elle réduit la bourgeoisie dont l'intérêt est de maintenir le capitalisme, et elle accroît la masse qui cherche à le supprimer. Dans ce développement, l'une des caractéristiques du capitalisme est graduellement supprimée. Dans ce monde où chacun lutte contre tous et tous contre chacun, la classe ouvrière développe une nouvelle association, l'organisation de classe. Les organisations de la classe ouvrière commencent par en finir avec la concurrence existant entre les ouvriers et unissent leurs forces séparées en une grande force pour leur lutte contre le monde extérieur. Tout ce qui s'applique aux groupes sociaux s'applique également à cette nouvelle organisation de classe, née de circonstances externes. Dans les rangs de cette organisation de classe, se développent de la façon la plus remarquable les motivations sociales, les sentiments moraux, le sacrifice de soi et le dévouement à l’ensemble du groupe. Cette organisation solide donne à la classe ouvrière la grande force dont elle a besoin pour vaincre la classe capitaliste. La lutte de classe qui n'est pas une lutte avec des outils mais pour la possession des outils, une lutte pour la possession de l’équipement technique de l’humanité, sera déterminée par la force de l’action organisée, par la force de la nouvelle organisation de classe qui surgit. A travers la classe ouvrière organisée transparaît déjà un élément de la société socialiste.
Considérons maintenant le système de production futur, tel qu’il existera dans le socialisme. La lutte pour le perfectionnement des outils, qui a marqué toute l’histoire de l’humanité, ne s’arrête pas. Comme précédemment sous le capitalisme, les machines inférieures seront dépassées et écartées par des machines supérieures. Comme auparavant, ce processus conduira à une plus grande productivité du travail. Mais, la propriété privée des moyens de production ayant été abolie, on ne trouvera plus un homme derrière chaque machine dont il revendique la propriété et dont il partage le sort. Leur concurrence ne sera plus qu’un processus innocent, mené consciemment à terme par l’homme qui après concertation rationnelle, remplacera simplement les mauvaises machines par de meilleures. C’est dans un sens métaphorique qu’on appellera lutte ce progrès. En même temps, la lutte réciproque des hommes contre les hommes cesse. Avec l’abolition des classes, l’ensemble du monde civilisé deviendra une grande communauté productive. Pour elle vaut ce qui vaut pour toute communauté collective. Au sein de cette communauté, la lutte qui opposait ses propres membres cesse et elle se fera uniquement en direction du monde extérieur. Mais à la place de petites communautés, nous aurons à présent une communauté mondiale. Cela signifie que la lutte pour l’existence dans le monde humain s’arrête. Le combat vers l’extérieur ne sera plus une lutte contre notre propre espèce, mais une lutte pour la subsistance, une lutte contre la nature 4. Mais, grâce au développement de la technique et de la science, on ne pourra pas appeler cela une lutte. La nature est subordonnée à l’homme et, avec très peu d’efforts de la part de celui-ci, elle le pourvoit en abondance. Ici, une nouvelle vie s’ouvre à l’humanité : la sortie de l’homme du monde animal et son combat pour l’existence au moyen d’outils atteignent leur terme. La forme humaine de la lutte pour l’existence prend fin et un nouveau chapitre de l’histoire de l’humanité commence.
Anton Pannekoek
1 Cette idée est présente, en revanche, dans l'ouvrage de Kautsky, évoqué et salué par Pannekoek, L'Éthique et la conception matérialiste de l'histoire, comme l'illustre la citation suivante : "La loi morale est une impulsion animale et rien d'autre. De là vient son caractère mystérieux, cette voix intérieure qui n'a de lien avec aucune impulsion extérieure, ni aucun intérêt apparent ; (…) La loi morale est un instinct universel, aussi puissant que l'instinct de conservation et de reproduction ; de là vient sa force, son pouvoir auquel nous obéissons sans réfléchir ; de là notre capacité de décider rapidement, dans certains cas, si une action est bonne ou mauvaise, vertueuse ou nuisible ; de là aussi la force de décision de notre jugement moral et la difficulté d’en démontrer le fondement rationnel lorsqu’on essaie de l’analyser." Par ailleurs, l'anthropologie de Darwin est très clairement expliquée dans la théorie de "l'effet réversif de l'évolution" que développe Patrick Tort, notamment dans son livre L'effet Darwin : sélection naturelle et naissance de la civilisation (Éditions du Seuil). Nos lecteurs pourront trouver une présentation de cet ouvrage dans l'article "A propos du livre de Patrick Tort, L'effet Darwin : Une conception matérialiste des origines de la morale et de la civilisation [48]".
2 Il faut noter que cette échelle croissante des sentiments de solidarité au sein de l'espèce humaine n'échappe pas à Darwin lorsqu'il écrit : "À mesure que l'homme avance en civilisation, et que les petites tribus se réunissent en communautés plus larges, la plus simple raison devrait aviser chaque individu qu'il doit étendre ses instincts sociaux et ses sympathies à tous les membres d'une même nation, même s'ils lui sont personnellement inconnus. Une fois ce point atteint, il n'y a plus qu'une barrière artificielle pour empêcher ses sympathies de s'étendre aux hommes de toutes les nations et de toutes les races. Il est vrai que si ces hommes sont séparés de lui par de grandes différences d'apparences extérieures ou d'habitudes, l'expérience malheureusement nous montre combien le temps est long avant que nous les regardions comme nos semblables." (La Filiation de l'Homme, chapitre IV.) (Note du CCI)
3 Scientifiquement parlant, il n'existe pas de race européenne. Cela étant dit, le fait que Pannekoek utilise le terme race pour distinguer tel sous-ensemble des êtres humains de tel autre ne constitue en rien une concession à un quelconque racisme de sa part. Sur ce plan également, il s'inscrit dans la continuité de Darwin qui se démarquait clairement des théories racistes de scientifiques de son temps tels qu'Eugène Dally. Par ailleurs, il faut rappeler que, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, le terme race n'était pas connoté comme il l'est aujourd'hui comme en témoigne le fait que certains écrits du mouvement ouvrier parlent même (improprement il est vrai) de la race des ouvriers. (Note du CCI)
4 L'expression "lutte contre la nature" est inappropriée, il s'agit de lutte pour la maîtrise de la nature, l'établissement de la communauté humaine mondiale supposant que celle-ci soit capable de vivre en totale harmonie avec la nature. (Note du CCI)
Personnages:
- Darwin [31]
Heritage de la Gauche Communiste:
18e congrès du CCI : vers le regroupement des forces internationalistes
- 2910 lectures
A la fin du mois de mai, le CCI a tenu son 18e congrès international. Comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent, et comme il est de tradition dans le mouvement ouvrier, nous livrons aux lecteurs de notre presse les principaux enseignements de ce congrès dans la mesure où ces enseignements ne sont pas une affaire interne à notre organisation mais concernent l'ensemble de la classe ouvrière dont le CCI fait partie intégrante.
Dans la résolution sur les activités du CCI adoptée par le congrès il est dit :
"L’accélération de la situation historique, inédite dans l’histoire du mouvement ouvrier, est caractérisée par la conjonction des deux dimensions suivantes :
- l’extension de la plus grave crise économique ouverte dans l’existence du capitalisme, combinée avec l’exacerbation des tensions inter-impérialistes et d’une avancée lente mais progressive en profondeur et en extension de la maturation au sein de la classe ouvrière, engagée depuis 2003 ;
- et le développement d’un milieu internationaliste, qui est particulièrement perceptible dans les pays de la périphérie du capitalisme,
Cette accélération rehausse encore la responsabilité politique du CCI, lui pose des exigences plus élevées en termes d’analyse théorique/ politique et d’intervention dans la lutte de classe, et envers les éléments en recherche (…)"
Le bilan que l'on peut tirer du 18e congrès international de notre organisation doit donc se baser sur la capacité de celle-ci à faire face à ces responsabilités.
Pour une organisation communiste véritable et sérieuse, il est toujours délicat de proclamer haut et fort que telle ou telle de ses actions a été un succès. Et cela pour plusieurs raisons.
En premier lieu, parce que la capacité d'une organisation qui lutte pour la révolution communiste à être à la hauteur de ses responsabilités ne se juge pas à court terme mais à long terme puisque son rôle, s'il est en permanence ancré dans la réalité historique de son époque, consiste, la plupart du temps, non pas à influencer cette réalité immédiate, tout au moins à grande échelle, mais à préparer les événements futurs.
En second lieu, parce que, pour les membres d'une organisation, il existe toujours le danger "d'enjoliver les choses", de faire preuve d'une indulgence excessive vis-à-vis des faiblesses d'un collectif à la vie duquel ils consacrent leur dévouement et leurs efforts et qu'ils ont en permanence le devoir de défendre contre les attaques que lui portent tous les défenseurs de la société capitaliste, avoués ou cachés. L'histoire n'est pas avare d'exemples de militants convaincus et dévoués à la cause du communisme, qui par "patriotisme de parti" n'ont pas été capables d'identifier les faiblesses, les dérives, voire la trahison de leur organisation. Aujourd'hui encore, parmi les éléments qui défendent une perspective communiste, on en trouve qui considèrent que leur groupe, dont les effectifs peuvent souvent se compter sur les doigts d'une main, est le seul "Parti communiste international" auquel vont se rallier les masses prolétariennes un jour dans le futur et qui, réfractaires à toute critique ou a tout débat, considèrent les autres groupes du milieu prolétarien comme des faussaires.
C'est conscients de ce danger de se faire des illusions et avec la prudence nécessaire qui en découle, que nous n'avons pas peur d'affirmer que le 18e congrès du CCI s'est porté à la hauteur des exigences énoncées plus haut et a créé les conditions pour que nous puissions poursuivre dans cette direction.
Nous ne pouvons ici rendre compte de tous les éléments qui peuvent appuyer cette affirmation. Nous n'en soulignerons que les plus importants :
-
le fait que le congrès ait débuté ses travaux par la ratification de l'intégration de deux nouvelles sections territoriales, aux Philippines et en Turquie ;
-
la présence à celui-ci de quatre groupes du milieu prolétarien ;
-
la démarche d'ouverture de notre organisation envers l'extérieur illustrée notamment par cette présence ;
-
sa volonté de se pencher avec lucidité sur les difficultés et les faiblesses que doit surmonter notre organisation ;
-
l'ambiance fraternelle et enthousiaste qui a présidé aux travaux du congrès.
L'intégration de deux nouvelles sections territoriales
Notre presse a déjà rendu compte de l'intégration des nouvelles sections du CCI aux Philippines et en Turquie (la responsabilité du Congrès était de valider la décision d'intégration qui avait été adoptée par l'organe central de notre organisation au début 2009) 1.Comme nous l'écrivions à cette occasion : "L'intégration de ces deux nouvelles sections au sein de notre organisation élargit de façon importante l'extension géographique de celle-ci." Nous précisions aussi les deux faits suivants concernant ces intégrations :
-
elles ne relevaient pas d'un "recrutement" à la va-vite (comme c'est la mode chez les trotskystes et même, malheureusement, parmi certains groupes du camp prolétarien) mais résultaient, comme c'est la pratique du CCI, de tout un travail de discussions approfondies durant plusieurs années avec les camarades d'EKS en Turquie et d'Internasyonalismo aux Philippines dont nous avions rendu compte du travail dans notre presse ;
-
elles apportaient un démenti aux accusations "d'européocentrisme" qui ont souvent été portées contre notre organisation.
L'intégration de deux nouvelles sections n'est pas un fait fréquent pour notre organisation. La dernière intégration remontait à 1995 avec la section en Suisse. C'est dire si l'arrivée de ces deux sections (qui faisait suite à la constitution d'un noyau au Brésil en 2007) a été ressentie par l'ensemble des militants du CCI comme un événement très important et très positif. Elle vient confirmer à la fois l'analyse que notre organisation avait faite depuis plusieurs années sur les nouvelles potentialités de développement de la conscience de classe contenues dans la situation historique actuelle et la validité de la politique menée envers les groupes et éléments qui se tournent vers les positions révolutionnaires. Et cela d'autant plus qu'étaient présentes au congrès des délégations de quatre groupes du milieu internationaliste.
La présence des groupes internationalistes
Dans le bilan que nous avons tiré du précédent congrès du CCI, nous avons souligné toute l'importance qu'avait donnée à ce congrès la présence, pour la première fois depuis des décennies, de quatre groupes du milieu internationaliste venant respectivement du Brésil, de Corée, des Philippines et de Turquie. Cette fois-ci étaient également présents quatre groupes de ce milieu. Mais ce n'était nullement une sorte de "sur-place" puisque deux des groupes présents lors du dernier congrès sont depuis devenus des sections du CCI et que nous avons eu la satisfaction d'accueillir deux nouveaux groupes : un deuxième groupe venu de Corée et un groupe basé en Amérique centrale (Nicaragua et Costa-Rica), la LECO (Liga por la Emancipación de la Clase Obrera) qui avait participé à la "Rencontre de communistes internationalistes" 2 tenue en Amérique latine au printemps dernier sur l'initiative du CCI et de OPOP, le groupe internationaliste du Brésil avec lequel notre organisation entretient des relations fraternelles et très positives depuis plusieurs années. Ce groupe était de nouveau présent à notre congrès. D'autres groupes ayant participé à cette rencontre avaient également été invités mais ils n'ont pu envoyer de délégation du fait que l'Europe se transforme de plus en plus en forteresse vis-à-vis des personnes qui ne sont pas nées dans le cercle très fermé des "pays riches".
La présence des groupes du milieu internationaliste a constitué un élément très important dans le succès du congrès et notamment dans l'ambiance des discussions de celui-ci. Ces camarades se sont tous montrés très chaleureux envers les militants de notre organisation, ont soulevé des questions, notamment à propos de la crise économique et la lutte ce classe, dans des termes auxquels nous ne sommes pas habitués dans nos débats internes ce qui ne pouvait que stimuler la réflexion de l'ensemble de notre organisation.
Enfin, la présence de ces camarades constituait un élément supplémentaire de la démarche d'ouverture que le CCI s'est fixé comme objectif depuis plusieurs années, une ouverture envers les autres groupes prolétariens mais aussi envers les éléments qui s'approchent des positions communistes. En particulier, face à des personnes extérieures à notre organisation, il devient très difficile de tomber dans le travers, évoqué plus haut, de "se raconter des histoires" ou d'en raconter aux autres. Une ouverture également dans nos préoccupations et réflexions, notamment en direction des recherches et découvertes du domaine scientifique 3 et qui s'est concrétisée par l'invitation d'un membre de la communauté scientifique à une séance du congrès.
L'invitation d'un scientifique
Pour célébrer à notre façon "l'année Darwin" et manifester le développement au sein de notre organisation de l'intérêt pour les questions scientifiques, nous avons demandé à un chercheur spécialisé dans la question de l'évolution du langage (auteur notamment d'un ouvrage intitulé "Aux origines du langage") de faire une présentation devant le congrès de ses travaux, lesquels sont basés, évidemment, sur l'approche darwinienne. Les réflexions originales de Jean-Louis Dessalles 4 sur le langage, le rôle de celui-ci dans le développement des liens sociaux et de la solidarité dans l'espèce humaine ont un lien avec les réflexions et discussions qui se sont menées, et qui se poursuivent, dans notre organisation à propos de l'éthique et de la culture du débat. La présentation de ce chercheur a été suivie d'un débat que nous avons été obligés de limiter dans le temps du fait des contraintes de l'ordre du jour, mais qui aurait pu se poursuivre pendant des heures tant les questions abordées ont passionné la plupart des participants au congrès.
Nous tenons ici à remercier Jean-Louis Dessalles qui, bien que ne partageant pas nos idées politiques, a accepté de façon très cordiale de consacrer une partie de son temps pour enrichir la réflexion au sein de notre organisation. Nous tenons à saluer aussi le caractère très chaleureux et convivial des réponses qu'il a apportées aux questions et objections des militants du CCI.
La discussion sur la situation internationale
Les travaux du congrès ont abordé les points classiques qui relèvent d'un congrès international :
-
l'analyse de la situation internationale ;
-
les activités et la vie de notre organisation.
La résolution sur la situation internationale, que nous publions dans ce même numéro de la Revue, constitue une sorte de synthèse des discussions du congrès concernant l'examen du monde actuel. Évidemment, elle ne peut rendre compte de tous les aspects abordés dans ces discussions (ni dans les rapports préparatoires). Elle se donne trois objectifs principaux :
-
comprendre les véritables causes et enjeux de l'aggravation actuelle et sans précédent de la crise économique du système capitaliste face à toutes les mystifications que les défenseurs de ce système ne manquent pas de colporter ;
-
comprendre l'impact que pourra avoir sur les conflits impérialistes l'accession au pouvoir de la première puissance mondiale du démocrate Barack Obama, lequel a été présenté comme apportant une nouvelle donne dans ces conflits et un espoir de leur atténuation ;
-
dégager les perspectives pour la lutte de classe, notamment dans les conditions créées par les brutales attaques qu'a commencé à subir le prolétariat du fait de la violence de la crise économique.
Sur le premier aspect, la compréhension des enjeux de la crise actuelle du capitalisme, il importe de souligner les aspects suivants :
"… la crise actuelle est la plus grave qu’ait connue ce système depuis la grande dépression qui a débuté en 1929. (…) … ce n’est pas la crise financière qui est à l’origine de la récession actuelle. Bien au contraire, la crise financière ne fait qu’illustrer le fait que la fuite en avant dans l’endettement qui avait permis de surmonter la surproduction ne peut se poursuivre indéfiniment. (…) En fait, même si le système capitaliste ne va pas s’effondrer comme un château de cartes… sa perspective est celle d’un enfoncement croissant dans son impasse historique, celle du retour à une échelle toujours plus vaste des convulsions qui l’affectent aujourd’hui."
Évidemment, le congrès n'a pu apporter de réponses définitives à toutes les questions que soulève la crise actuelle du capitalisme. D'une part, parce que chaque jour qui passe apporte de nouveaux rebondissements de celle-ci obligeant les révolutionnaires à apporter une attention soutenue et permanente à l'évolution de la situation et à poursuivre la discussion à partir de ces nouveaux éléments. D'autre part, parce que notre organisation n'est pas homogène sur un certain nombre d'aspects de l'analyse de la crise du capitalisme. Ce n'est nullement, à notre avis, une preuve de faiblesse du CCI. En fait, dans toute l'histoire du mouvement ouvrier, les débats se sont poursuivis, dans le cadre du marxisme, sur la question des crises du système capitaliste. Dès à présent, le CCI a commencé à publier certains aspects de ses débats internes sur cette question 5 dans la mesure où ces débats ne sont pas une "propriété privée" de notre organisation mais appartiennent à l'ensemble de la classe ouvrière. Et il est déterminé à poursuivre dans cette direction. Par ailleurs, la résolution sur les perspectives d'activité de notre organisation adoptée par le congrès demande explicitement que se développent les débats sur d'autres aspects de l'analyse de la crise actuelle afin que le CCI soit le mieux armé possible pour apporter des réponses claires aux questions que celle-ci pose à la classe ouvrière et aux éléments qui sont déterminés à s'engager dans son combat pour le renversement du capitalisme.
Concernant la "nouvelle donne" que constitue l'élection d'Obama, la résolution répond très clairement que :
" … la perspective qui se présente à la planète après l’élection d’Obama à la tête de la première puissance mondiale n’est pas fondamentalement différente de la situation qui a prévalu jusqu’à présent : poursuite des affrontements entre puissances de premier ou second plan, continuation de la barbarie guerrière avec des conséquences toujours plus tragiques (famines, épidémies, déplacements massifs) pour les populations habitant dans les zones en dispute."
Enfin, pour ce qui concerne la perspective de la lutte de classe, la résolution, tout comme les débats au congrès, essaie d'évaluer l'impact sur celle-ci de l'aggravation brutale de la crise capitaliste :
"L’aggravation considérable que connaît actuellement la crise du capitalisme constitue évidemment un élément de premier ordre dans le développement des luttes ouvrières. (…) Ainsi les conditions mûrissent pour que l’idée de la nécessité de renverser ce système puisse se développer de façon significative au sein du prolétariat. Cependant, il ne suffit pas à la classe ouvrière de percevoir que le système capitaliste est dans une impasse, qu’il devrait céder la place à une autre société, pour qu’elle soit en mesure de se tourner vers une perspective révolutionnaire. Il faut encore qu’elle ait la conviction qu’une telle perspective est possible et aussi qu’elle a la force de la réaliser. (…) Pour que la conscience de la possibilité de la révolution communiste puisse gagner un terrain significatif au sein de la classe ouvrière, il est nécessaire que celle-ci puisse prendre confiance en ses propres forces et cela passe par le développement de ses luttes massives. L’énorme attaque qu’elle subit dès à présent à l’échelle internationale devrait constituer la base objective pour de telles luttes. Cependant, la forme principale que prend aujourd’hui cette attaque, celle des licenciements massifs, ne favorise pas, dans un premier temps, l’émergence de tels mouvements. (…) C’est pour cela que si, dans la période qui vient, on n’assiste pas à une réponse d’envergure de la classe ouvrière face aux attaques, il ne faudra pas considérer que celle-ci a renoncé à lutter pour la défense de ses intérêts. C’est dans un second temps (…) que des combats ouvriers de grande ampleur pourront se développer beaucoup plus."
Les discussions sur les activités et la vie du CCI
Un rapport a été présenté destiné à faire le point sur les principales positions en présence dans les discussions de fond en cours au sein du CCI. Un volet important de ces discussions a été consacré, au cours des deux dernières années, à la question économique, dont nous avons évoqué déjà au sein de cet article des divergences auxquelles elle a donné lieu.
Un autre volet de nos discussions a concerné la question de la nature humaine, donnant lieu à un débat animé, alimenté par des contributions nombreuses et riches. Ce débat, qui est loin d'être achevé, fait apparaître une convergence globale avec les textes d'orientations publiés dans la Revue internationale, La confiance et solidarité dans la lutte du prolétariat (n° 111), Marxisme et éthique (n° 127) ou La culture du débat, une arme de la lutte de classe (n° 131), avec encore de nombreuses interrogations ou réserves posées sur tel ou tel aspect. Dès que celles-ci seront suffisamment élaborées pour donner lieu à publication vers l'extérieur, le CCI, conformément à la tradition du mouvement ouvrier, ne manquera pas d'y procéder. Signalons enfin l'expression récente d'un désaccord profond avec les trois textes cités précédemment ("récente" relativement à la publication déjà ancienne de certains de ces textes), considérant ceux-ci comme non marxistes, de la part d'un camarade de la section de Belgique-Hollande ayant récemment quitté l'organisation (cf. ci-après).
Concernant les activités et la vie du CCI, le congrès a tiré un bilan positif de celles-ci pour la précédente période même s'il subsiste des faiblesses à surmonter :
"Le bilan des activités des deux dernières années montre la vitalité politique du CCI, sa capacité à être en phase avec la situation historique, à s'ouvrir, à être facteur actif dans le développement de la conscience de classe, sa volonté de s’investir dans des initiatives de travail commun avec d’autres forces révolutionnaires. (…) Sur le plan de la vie interne de l’organisation, le bilan des activités est également positif, malgré des difficultés réelles subsistant au premier chef au niveau du tissu organisationnel et, dans une moindre mesure, sur le plan de la centralisation." (Résolution sur les activités du CCI)
Effectivement, le congrès a consacré une partie de ses débats à examiner les faiblesses organisationnelles qui subsistent au sein du CCI. En fait, ces dernières ne relèvent aucunement d'une "spécificité" de celui-ci mais sont le lot de toutes les organisations du mouvement ouvrier qui sont en permanence soumises au poids de l'idéologie bourgeoise ambiante. La véritable force de ces organisations a toujours consisté à être en mesure, comme ce fut notamment le cas du parti bolchevique, de les affronter avec lucidité afin de pouvoir les combattre. C'est le même esprit qui a animé les débats du congrès sur cette question.
Un des points qui a été discuté est notamment celui des faiblesses qui ont affecté notre section en Belgique-Hollande dont un petit nombre de militants ont démissionné récemment, notamment suite aux accusations développées par le camarade M. Depuis un certain temps, celui-ci avait accusé notre organisation, et particulièrement la commission permanente de son organe central, de tourner le dos à la culture du débat dont le précédent congrès avait largement discuté 6 et qu'il avait considéré comme une nécessité pour la capacité des organisations révolutionnaires à se porter à la hauteur de leurs responsabilités. Le camarade M., qui défendait une position minoritaire sur l'analyse de la crise capitaliste, s'estimait victime "d'ostracisme" et considérait que ses positions étaient "discréditées" de façon délibérée afin que le CCI ne puisse pas en discuter. Face à ces accusations, l'organe central du CCI a décidé de constituer une commission spéciale dont les trois membres ont été désignés par le camarade M. lui-même et qui, après de nombreux mois de travail, d'entretiens et d'examen de centaines de pages de documents, est arrivée à la conclusion qu'elles n'étaient pas fondées. Le congrès n'a pu que regretter que le camarade M. de même qu'une partie des autres camarades qui l'ont suivi, n'aient pas attendu que cette commission livre ses conclusions pour décider de quitter le CCI.
En fait, le congrès a pu constater, notamment dans la discussion qu'il a menée au sujet de ses débats internes, qu'il existait aujourd'hui au sein de notre organisation une véritable préoccupation pour faire progresser sa culture du débat. Et là, ce ne sont pas seulement les militants du CCI qui ont pu le constater : les délégués des organisations invitées ont tiré les mêmes conclusions des travaux du congrès :
"La culture du débat du CCI, des camarades du CCI est très impressionnante. Quand je reviendrai en Corée, je vais partager mon expérience avec mes camarades." (un des groupes venus de Corée)
"C’est [le congrès] une bonne occasion de clarifier mes positions ; dans beaucoup de discussions, j’ai rencontré une véritable culture du débat. Je pense que je dois beaucoup faire pour développer les rapports entre [mon groupe] et le CCI et j’ai l’intention de le faire. J’espère que nous allons pouvoir travailler ensemble pour une société communiste un jour." (l'autre groupe de Corée) 7
Le CCI ne pratique pas la culture du débat une fois tous les deux ans à l'occasion de son congrès international mais, comme en témoigne l'intervention de la délégation de OPOP dans la discussion sur la crise économique, elle fait partie de la relation continue entre nos deux organisations. Cette relation est capable de se renforcer malgré des divergences sur différentes questions, dont l'analyse de la crie économique : "Je veux, au nom de OPOP, saluer l'importance de ce congrès. Pour OPOP, le CCI est une organisation-sœur, comme étaient frères le parti de Lénine et celui de Rosa Luxemburg. C'est-à-dire qu'il y avait entre eux, en divergence, toute une série de points de vue, d'opinions et aussi de conceptions théoriques, mais il y avait surtout une unité programmatique en ce qui concerne la nécessité du renversement révolutionnaire de la bourgeoisie et de l'instauration de la dictature du prolétariat, de l'expropriation immédiate de la bourgeoisie et du capital".
L'autre difficulté relevée dans la résolution d'activités concerne la question de la centralisation. C'est en vue de surmonter ces difficultés que le congrès avait également mis à son ordre du jour la discussion d'un texte plus général concernant la question de la centralisation. Cette discussion, si elle a été utile pour réaffirmer et préciser les conceptions communistes sur cette question auprès de la "vieille garde" de notre organisation, s'est révélée particulièrement importante pour les nouveaux camarades et les nouvelles sections qui ont récemment intégré le CCI.
En effet, un des traits significatifs du 18e congrès du CCI était la présence, que tous les "anciens" ont constatée avec une certaine surprise, d'un nombre élevé de "nouvelles têtes" parmi lesquelles la jeune génération était particulièrement représentée.
L'enthousiasme pour le futur
Cette présence importante de jeunes participants au congrès a été un facteur important du dynamisme et de l'enthousiasme qui a imprégné ses travaux. Contrairement aux médias bourgeois, le CCI ne cultive pas le "jeunisme" mais l'arrivée d'une nouvelle génération de militants au sein de notre organisation -et qui est le fait aussi des autres groupes participants si on en juge par la jeunesse de la plupart des délégués de ces derniers- est de la plus haute importance pour la perspective de la révolution prolétarienne. D'une part, comme pour les icebergs, elle constitue la "pointe émergée" d'un processus de prise de conscience en profondeur au sein de la classe ouvrière mondiale. D'autre part, elle crée les conditions d'une relève des forces communistes. Comme le dit la résolution sur la situation internationale adoptée par le congrès, "le chemin est encore long et difficile qui conduit aux combats révolutionnaires et au renversement du capitalisme (…) mais cela ne saurait en aucune façon être un facteur de découragement pour les révolutionnaires, de paralysie de leur engagement dans le combat prolétarien. Bien au contraire !". Même si les "vieux" militants du CCI conservent toute leur conviction et leur engagement, c'est à cette nouvelle génération qu'il appartiendra d'apporter une contribution décisive aux futurs combats révolutionnaires du prolétariat. Et, dès à présent, l'esprit fraternel, la volonté de rassemblement, de même que celle d'en découdre avec les pièges tendus par la bourgeoisie, le sens des responsabilités, toutes ces qualités amplement partagées par les éléments de cette nouvelle génération présents au congrès – militants du CCI ou des groupes invités – augurent positivement de la capacité de cette dernière à se porter à la hauteur de sa responsabilité. C'est bien cela qu'exprimait, entre autres, l'intervention du jeune délégué de la LECO à propos de la rencontre internationaliste qui s'est tenue en Amérique latine au printemps dernier : "Le débat que nous commençons à développer rassemble des groupes, des individus qui cherchent une unité sur des bases prolétariennes et nécessite des espaces de débat internationaliste, nécessite ce contact avec les délégués de la Gauche communiste. La radicalisation de la jeunesse et des minorités en Amérique latine, en Asie, permettront que ce pôle de référence soit identifié par plus de groupes encore qui grandissent numériquement et politiquement. Ceci nous donne des armes pour intervenir, pour affronter les issues que proposent le gauchisme, le "socialisme du XXIe siècle", le sandinisme, etc. …. La position atteinte dans la Rencontre latine est déjà une arme prolétarienne. Je salue les interventions des camarades qui expriment un véritable internationalisme, une préoccupation pour cette avancée politique et numérique de la Gauche communiste au niveau mondial"
CCI (12 juillet 09)
2 A propos de cette rencontre, voir notre article "Une rencontre de communistes internationalistes en Amérique latine [51]".
3 Comme nous l'avons déjà illustré dans les différents articles que nous avons publiés récemment sur Darwin et le darwinisme.
4 Le lecteur qui voudrait se faire une idée de ces réflexions peut se reporter au site [52] de J-L Dessales.
5 Voir notamment dans cette Revue l'article de discussion : En défense de la thèse 'Le Capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste' [53].
6 Voir à ce sujet "17e congrès du CCI : un renforcement international du camp prolétarien [54]" et notre texte d'orientation "La culture du débat : une arme de la lutte de classe [55]".
7 Cette impression sur la qualité de la culture du débat qui s'est manifestée dans le congrès a été relevée également par le scientifique que nous avions invité. Il nous a adressé le message suivant : "Merci encore pour l'excellente interaction que j'ai eue avec la Marx communauté. J'ai passé vraiment un très bon moment."
Vie du CCI:
Résolution sur la situation internationale 2009
- 2926 lectures
1) Le 6 mars 1991, suite à l'effondrement du bloc de l'Est et de la victoire de la coalition en Irak, le Président George Bush père annonçait devant le Congrès des États-Unis la naissance d'un "Nouvel Ordre mondial" basé sur le "respect du droit international". Ce nouvel ordre devait apporter à la planète paix et prospérité. La "fin du communisme" signifiait le "triomphe définitif du capitalisme libéral". Certains, tel le "philosophe" Francis Fukuyama, prédisaient même la "fin de l'histoire". Mais l'histoire, la vraie et non celle des discours de propagande, s'est dépêchée de ridiculiser ces boniments de charlatan. En fait de paix, l'année 1991 allait connaître le début de la guerre dans l'ex Yougoslavie provoquant des centaines de milliers de morts au cœur même de l'Europe, un continent qui avait été épargné par ce fléau depuis presque un demi-siècle. De même, la récession de 1993, puis l'effondrement des "tigres" et des "dragons" asiatiques de 1997, puis la nouvelle récession de 2002 qui mit fin à l'euphorie provoquée par la "bulle Internet" ont égratigné sensiblement les illusions sur la "prospérité" annoncée par Bush senior. Mais, le propre des discours de la classe dominante aujourd'hui est d’oublier les discours de la veille. Entre 2003 et 2007, la tonalité des discours officiels des secteurs dominants de la bourgeoisie a été à l’euphorie, célébrant le succès du « modèle anglo-saxon » qui permettait des profits exemplaires, des taux de croissance vigoureux du PIB et même une baisse significative du chômage. Il n’existait pas de mots assez élogieux pour célébrer le triomphe de « l’économie libérale » et les bienfaits de la « dérégulation ». Mais depuis l’été 2007 et surtout l’été 2008, ce bel optimisme a fondu comme neige au soleil. Désormais, au centre des discours bourgeois, les mots « prospérité », « croissance », « triomphe du libéralisme » se sont éclipsés discrètement. A la table du grand banquet de l’économie capitaliste s’est installé un convive qu’on croyait avoir expulsé pour toujours : la crise, le spectre d’une « nouvelle grande dépression » semblable à celle des années 30.
2) Aux dires même de tous les responsables bourgeois, de tous les « spécialistes » de l’économie, y compris des thuriféraires les plus inconditionnels du capitalisme, la crise actuelle est la plus grave qu’ait connue ce système depuis la grande dépression qui a débuté en 1929. D’après l’OCDE : « L’économie mondiale est en proie à sa récession la plus profonde et la plus synchronisée depuis des décennies » (rapport intermédiaire de mars 2009). Certains même n’hésitent pas à considérer qu’elle est encore plus grave et que la raison pour laquelle ses effets ne sont pas aussi catastrophiques que lors des années 30 consiste dans le fait que, depuis cette époque, les dirigeants du monde, forts de leur expérience, ont appris à faire face à ce genre de situation, notamment en évitant un chacun pour soi généralisé : « Bien qu’on ait parfois qualifié cette sévère récession mondiale de ‘grande récession’, on reste loin d’une nouvelle ‘grande dépression’ comme celle des années 30, grâce à la qualité et à l’intensité des mesures que les gouvernements prennent actuellement. La ‘grande dépression’ avait été aggravée par de terribles erreurs de politique économique, depuis les mesures monétaires restrictives jusqu’à la politique du ‘chacun pour soi ‘, prenant la forme de protections commerciales et de dévaluations compétitives. En revanche, l’actuelle récession a généralement suscité les bonnes réponses. » (Ibid.).
Cependant, même si tous les secteurs de la bourgeoisie constatent la gravité des convulsions actuelles de l’économie capitaliste, les explications qu’ils donnent, bien que souvent divergentes entre elles, sont évidemment incapables de saisir la véritable signification de ces convulsions et la perspective qu’elles annoncent pour l’ensemble de la société. Pour certains, la responsable des difficultés aiguës du capitalisme est la « finance folle », le fait que se soient développée depuis le début des années 2000 toute une série de « produits financiers toxiques » permettant une explosion des crédits sans garantie suffisante de leur remboursement. D’autres affirment que le capitalisme souffre d’un excès de « dérégulation » à l’échelle internationale, orientation qui se trouvait au cœur des « reaganomics » mises en œuvre depuis le début des années 1980. D’autres enfin, les représentants de la Gauche du capital en particulier, considèrent que la cause profonde réside dans une insuffisance des revenus des salariés, obligeant ces derniers, notamment dans les pays les plus développés, à une fuite en avant dans des emprunts pour être en mesure de satisfaire leurs besoins élémentaires. Mais quelles que soient leurs différences, ce qui caractérise toutes ces interprétations, c’est qu’elles considèrent que ce n’est pas le capitalisme, comme mode de production, qui est en cause mais telle ou telle forme de ce système. Et justement, c’est bien ce postulat de départ qui empêche toutes ces interprétations d’aller au fond de la compréhension des causes véritables de la crise actuelle et de ses enjeux.
3) En fait, seule une vision globale et historique du mode de production capitaliste permet de comprendre, de prendre la mesure et de dégager les perspectives de la crise actuelle. Aujourd’hui, et c’est ce qui est occulté par l’ensemble des « spécialistes » de l’économie, se révèle ouvertement la réalité des contradictions qui assaillent le capitalisme : la crise de surproduction de ce système, son incapacité à vendre la masse des marchandises qu’il produit. Il n’y a pas surproduction par rapport aux besoins réels de l’humanité, lesquels sont encore très loin d’être satisfaits, mais surproduction par rapport aux marchés solvables, en moyens de paiement pour cette production. Les discours officiels, de même que les mesures qui sont adoptées par la plupart des gouvernements, se focalisent sur la crise financière, sur la faillite des banques, mais en réalité, ce que les commentateurs appellent « l’économie réelle » (par opposition à « l’économie fictive ») est en train d’illustrer ce fait : pas un jour ne se passe sans qu’on n’annonce des fermetures d’usines, des licenciements massifs, des faillites d’entreprises industrielles. Le fait que General Motors, qui pendant des décennies fut la première entreprise du monde, ne doive sa survie qu’à un soutien massif de l’État américain, alors que Chrysler est officiellement déclarée en faillite et est passée sous le contrôle de la FIAT italienne, est significatif des problèmes de fond qui affectent l’économie capitaliste. De même, la chute du commerce mondial, la première depuis la seconde guerre mondiale et qui est évaluée par l’OCDE à -13.2% pour 2009, signe l’incapacité pour les entreprises de trouver des acheteurs pour leur production.
Cette crise de surproduction, évidente aujourd’hui, n’est pas une simple conséquence de la crise financière comme essaient de le faire croire la plupart des « spécialistes ». C’est dans les rouages mêmes de l’économie capitaliste qu’elle réside comme l’a mis en évidence le marxisme depuis un siècle et demi. Tant que se poursuivait la conquête du monde par les métropoles capitalistes, les nouveaux marchés permettaient de surmonter les crises momentanées de surproduction. Avec la fin de cette conquête, au début du 20e siècle, ces métropoles, et particulièrement celle qui était arrivée en retard dans le concert de la colonisation, l’Allemagne, n’ont eu d’autre recours que de s’attaquer aux zones d’influence des autres provoquant la première guerre mondiale avant même que ne s’exprime pleinement la crise de surproduction. Celle-ci, en revanche, s’est manifestée clairement avec le krach de 1929 et la grande dépression des années 1930 poussant les principaux pays capitalistes dans la fuite en avant guerrière et dans une seconde guerre mondiale qui a dépassé de très loin la première en termes de massacres et de barbarie. L’ensemble des dispositions adoptées par les grandes puissances au lendemain de celle-ci, notamment l’organisation sous la tutelle américaine des grandes composantes de l’économie capitaliste comme celle de la monnaie (Bretton Woods) et la mise en place par les États de politiques néokeynésiennes, de même que les retombées positives de la décolonisation en termes de marchés ont permis pendant près de trois décennies au capitalisme mondial de donner l’illusion qu’il avait enfin surmonté ses contradictions. Mais cette illusion a subi un coup majeur en 1974 avec la survenue d’une récession violente, notamment dans la première économie mondiale. Cette récession ne constituait pas le début des difficultés majeures du capitalisme puisqu’elle faisait suite à celle de 1967 et aux crises successives de la livre et du dollar, deux monnaies fondamentales dans le système de Bretton Woods. En fait, c’est dès la fin des années 1960 que le néo keynésianisme avait fait la preuve de son échec historique comme l’avaient souligné à l’époque les groupes qui allaient constituer le CCI. Cela dit, pour l’ensemble des commentateurs bourgeois et pour la majorité de la classe ouvrière, c’est l’année 1974 qui marque le début d’une période nouvelle dans la vie du capitalisme d’après guerre, notamment avec la réapparition d’un phénomène qu’on croyait définitivement révolu dans les pays développés, le chômage de masse. C’est à ce moment-là aussi que le phénomène de la fuite en avant dans l’endettement s’est accéléré très sensiblement : à cette époque ce sont les pays du Tiers-Monde qui se sont trouvés aux avants postes de ce celui-ci et ont constitué, pour un temps, la « locomotive » de la relance. Cette situation a pris fin au début des années 1980 avec la crise de la dette, l’incapacité des pays du tiers-monde à rembourser les emprunts qui leur avaient permis pour un temps de constituer un débouché pour la production des grands pays industriels. Mais la fuite dans l’endettement n’a pas pris fin pour autant. Les États-Unis ont commencé à prendre le relais comme « locomotive » mais au prix d’un creusement considérable de leur déficit commercial et surtout budgétaire, politique qui leur était permise par le rôle privilégié de leur monnaie nationale comme monnaie mondiale. Si le slogan de Reagan était alors « l’État n’est pas la solution, c’est le problème » pour justifier la liquidation du néo keynésianisme, l’État fédéral américain, par ses énormes déficits budgétaires a continué de constituer l’agent essentiel dans la vie économique nationale et internationale. Cependant, les « reaganomics », dont la première inspiratrice avait été Margareth Thatcher en Grande-Bretagne, représentaient fondamentalement un démantèlement de « l’État providence », c’est-à-dire des attaques sans précédents contre la classe ouvrière qui ont contribué à surmonter l’inflation galopante qui avait affecté le capitalisme à la fin des années 1970.
Au cours des années 1990, une des « locomotives » de l’économie mondiale a été constituée par les « tigres » et les « dragons » asiatiques qui ont connu des taux de croissance spectaculaires mais au prix d’un endettement considérable qui les a conduits à des convulsions majeures en 1997. Au même moment, la Russie « nouvelle » et « démocratique », qui elle aussi s’est retrouvée en situation de cessation des paiements, a déçu cruellement ceux qui avaient misé sur la « fin du communisme » pour relancer durablement l’économie mondiale. A son tour, la « bulle Internet » de la fin des années 1990, en fait une spéculation effrénée sur les entreprises « high tech », a éclaté en 2001-2002 mettant fin au rêve d’une relance de l’économie mondiale par le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication. C’est alors que l’endettement a connu une nouvelle accélération, notamment grâce au développement faramineux des prêts hypothécaires à la construction dans plusieurs pays et notamment aux États-Unis. Ce dernier pays a alors accentué son rôle de « locomotive de l’économie mondiale » mais au prix d’une croissance abyssale des dettes, -notamment au sein de la population américaine- basées sur toutes sortes de « produits financiers » censés prévenir les risques de cessation de paiement. En réalité, la dispersion des créances douteuses n’a nullement aboli leur caractère d’épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’économie américaine et mondiale. Bien au contraire, elle n’a fait qu’accumuler dans le capital des banques les « actifs toxiques » à l’origine de leur effondrement à partir de 2007.
4) Ainsi, ce n’est pas la crise financière qui est à l’origine de la récession actuelle. Bien au contraire, la crise financière ne fait qu’illustrer le fait que la fuite en avant dans l’endettement qui avait permis de surmonter la surproduction ne peut se poursuivre indéfiniment. Tôt ou tard, « l’économie réelle » se venge, c’est-à-dire que ce qui est à la base des contradictions du capitalisme, la surproduction, l’incapacité des marchés à absorber la totalité des marchandises produites, revient au devant de la scène.
En ce sens, les mesures qui ont été décidées en mars 2009 lors du G20 de Londres, un doublement des réserves du Fond monétaire international, un soutien massif des États au système bancaire en perdition, un encouragement à ces derniers à mettre en œuvre des politiques actives de relance de l’économie au prix d’un bond spectaculaire des déficits budgétaires, ne sauraient en aucune façon résoudre la question de fond. La fuite en avant dans l’endettement est un des ingrédients de la brutalité de la récession actuelle. La seule « solution » que soit capable de mettre en œuvre la bourgeoisie est… une nouvelle fuite en avant dans l’endettement. Le G20 n’a pu inventer de solution à une crise pour la bonne raison qu’il n’existe pas de solution à celle-ci. Il avait pour vocation d’éviter le chacun pour soi qui avait caractérisé les années 1930. Il se proposait aussi de tenter de rétablir un peu de confiance parmi les agents économiques, sachant que celle-ci, dans le capitalisme, constitue un facteur essentiel dans ce qui se trouve au cœur de son fonctionnement, le crédit. Cela dit, ce dernier fait, l’insistance sur l’importance de la « psychologie » dans les convulsions économiques, la mise en scène du verbe face aux réalités matérielles, signe le caractère fondamentalement illusoire des mesures que pourra prendre le capitalisme face à la crise historique de son économie. En fait, même si le système capitaliste ne va pas s’effondrer comme un château de cartes, même si la chute de la production ne va pas se poursuivre indéfiniment, sa perspective est celle d’un enfoncement croissant dans son impasse historique, celle du retour à une échelle toujours plus vaste des convulsions qui l’affectent aujourd’hui. Depuis plus de quatre décennies, la bourgeoisie n'a pas pu empêcher l’aggravation continue de la crise. Elle part aujourd'hui d'une situation bien plus dégradée que celle des années 60. Malgré toute l’expérience qu’elle a acquise au cours de ces décennies, elle ne pourra pas faire mieux mais pire encore. En particulier, les mesures d’inspiration néokeynésiennes qui ont été promues par le G20 de Londres (allant même jusqu’à la nationalisation des banques en difficulté) n’ont aucune chance de rétablir une quelconque « santé » du capitalisme puisque le début de ses difficultés majeures, à la fin des années 1960, résultait justement de la faillite définitive des mesures néokeynésiennes adoptées au lendemain de la seconde mondiale.
5) Si elle a grandement surpris la classe dominante, l’aggravation brutale de la crise capitaliste n’a pas surpris les révolutionnaires. Comme le mettait en avant la résolution adoptée par le précédent congrès international avant même le début de la panique de l’été 2007 : « Dès à présent (…) les menaces qui s'amoncellent sur le secteur des logements aux États-Unis, un des moteurs de l'économie américaine, et qui portent avec elles le danger de faillites bancaires catastrophiques, sème le trouble et l'inquiétude dans les milieux économiques. » (Point 4).
Cette même résolution tordait également le cou aux grandes expectatives suscitées par le « miracle chinois » : « … loin de représenter un "nouveau souffle" de l'économie capitaliste, le "miracle chinois" et d'un certain nombre d'autres économies du Tiers-monde n'est pas autre chose qu'un avatar de la décadence du capitalisme. En outre, l'extrême dépendance de l'économie chinoise à l'égard de ses exportations constitue un facteur certain de fragilité face à une rétractation de la demande de ses clients actuels, rétractation qui ne saurait manquer d'arriver, notamment lorsque l'économie américaine sera contrainte de remettre de l'ordre dans l'endettement abyssal qui lui permet à l'heure actuelle de jouer le rôle de "locomotive" de la demande mondiale. Ainsi, tout comme le "miracle" représenté par les taux de croissance à deux chiffres des "tigres" et "dragons" asiatiques avait connu une fin douloureuse en 1997, le "miracle" chinois d'aujourd'hui, même s'il n'a pas des origines identiques et s'il dispose d'atouts bien plus sérieux, sera amené, tôt ou tard, à se heurter aux dures réalités de l'impasse historique du mode de production capitaliste." (Point 6). La chute du taux de croissance de l’économie chinoise, l’explosion du chômage qu’elle provoque, notamment avec le retour forcé dans leur village de dizaines de millions de paysans qui s’étaient enrôlés dans les bagnes industriels pour tenter d’échapper à une misère intenable, viennent pleinement confirmer cette prévision.
En fait, la capacité du CCI à prévoir ce qui allait se passer ne s’appuie sur aucun « mérite particulier » de notre organisation. Son seul « mérite » consiste en sa fidélité à la méthode marxiste, en la volonté de la mettre en œuvre de façon permanente dans l’analyse de la réalité mondiale, en sa capacité de résister fermement aux sirènes proclamant la « faillite définitive du marxisme ».
6) La confirmation de la validité du marxisme ne concerne pas seulement la question de la vie économique de la société. Au cœur des mystifications qui s’étaient répandues au début des années 1990 résidait celle de l’ouverture d’une période de paix pour le monde entier. La fin de la « guerre froide », la disparition du bloc de l’Est, présenté en son temps par Reagan comme « l’Empire du mal », étaient censé mettre un terme aux différents conflits militaires à travers lesquels s’était mené l’affrontement entre les deux blocs impérialistes depuis 1947. Face à ce type de mystifications sur la possibilité de paix au sein du capitalisme, le marxisme a toujours souligné l’impossibilité pour les États bourgeois de dépasser leurs rivalités économiques et militaires, particulièrement dans la période de décadence. C’est pour cela que, dès janvier 1990, nous pouvions écrire :
« La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux ‘partenaires’ d’hier, ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l’heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial (…). En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d’être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible. » (Revue Internationale n° 61, « Après l’effondrement du bloc de l’Est, stabilisation et chaos ») La scène mondiale n’allait pas tarder à confirmer cette analyse, notamment avec la première Guerre du Golfe en janvier 1991 et la guerre dans l’ex Yougoslavie à partir de l’automne de la même année. Depuis, les affrontements sanglants et barbares n’ont pas cessé. On ne peut tous les énumérer mais on peut souligner notamment :
-
la poursuite de la guerre dans l’ex Yougoslavie qui a vu un engagement direct, sous l’égide de l’OTAN, des États-Unis et des principales puissances européennes en 1999 ;
-
les deux guerres en Tchétchénie ;
-
les nombreuses guerres qui n’ont cessé de ravager le continent africain (Rwanda, Somalie, Congo, Soudan, etc.) ;
-
les opérations militaires d’Israël contre le Liban et, tout récemment, contre la bande de Gaza ;
-
la guerre en Afghanistan de 2001 qui se poursuit encore ;
-
la guerre en Irak de 2003 dont les conséquences continuent de peser de façon dramatique sur ce pays, mais aussi sur l’initiateur de cette guerre, la puissance américaine.
Le sens et les implications de la politique de cette puissance ont depuis longtemps été analysés par le CCI :
« … le spectre de la guerre mondiale a cessé de menacer la planète mais, en même temps, on a assisté à un déchaînement des antagonismes impérialistes et des guerres locales avec une implication directe des grandes puissances, à commencer par la première d'entre elles, les États-Unis. Il revenait à ce pays, qui s'est investi depuis des décennies du rôle de ‘gendarme du monde’, de poursuivre et renforcer ce rôle face au nouveau ‘désordre mondial’ issu de la fin de la guerre froide. En réalité, s'il a pris à cœur ce rôle, ce n'est nullement pour contribuer à la stabilité de la planète mais fondamentalement pour tenter de rétablir son leadership sur celle-ci, un leadership sans cesse remis en cause, y compris et notamment par ses anciens alliés, du fait qu'il n'existe plus le ciment fondamental de chacun des blocs impérialistes, la menace d'un bloc adverse. En l'absence définitive de la ‘menace soviétique’, le seul moyen pour la puissance américaine d'imposer sa discipline est de faire étalage de ce qui constitue sa force principale, l'énorme supériorité de sa puissance militaire. Ce faisant, la politique impérialiste des États-Unis est devenue un des principaux facteurs de l'instabilité du monde. » (Résolution sur la situation internationale, 17e congrès du CCI, point 7)
7) L’arrivée du démocrate Barak Obama à la tête de la première puissance mondiale a suscité beaucoup d’illusions sur un possible changement d’orientation de la stratégie de celle-ci, un changement permettant l’ouverture d’une « ère de paix ». Une des bases de ces illusions provient du fait qu’Obama fut l’un des rares sénateurs américains à voter contre l’intervention militaire en Irak en 2003 et qui, contrairement à son concurrent républicain McCain, s’est engagé pour un retrait de ce pays des forces armées américaines. Cependant, ces illusions ont été rapidement confrontées à la réalité des faits. En particulier, si Obama a prévu de retirer les forces américaines d’Irak, c’est pour pouvoir renforcer leur engagement en Afghanistan et au Pakistan. D’ailleurs, la continuité de la politique militaire des États-Unis est bien illustrée par le fait que la nouvelle administration a reconduit dans ses fonctions le Secrétaire à la Défense, Gates, nommé par Bush.
En réalité, la nouvelle orientation de la diplomatie américaine ne remet nullement en question le cadre rappelé plus haut. Elle continue d’avoir pour objectif la reconquête du leadership des États-Unis sur la planète au moyen de leur supériorité militaire. Ainsi, l’orientation d’Obama en faveur de l’accroissement du rôle de la diplomatie a en grande partie pour but de gagner du temps et donc de reculer le moment d’inévitables interventions impérialistes des forces militaires américaines qui sont, actuellement, trop dispersées et trop épuisées pour mener simultanément des guerres en Irak et en Afghanistan
Cependant, comme le CCI l’a souvent souligné, il existe au sein de la bourgeoisie américaine deux options pour parvenir à ces fins :
-
l’option représentée par le Parti Démocrate qui essaie d’associer autant que possible d’autres puissances à cette entreprise ;
-
l’option majoritaire parmi les républicains consistant à prendre l’initiative des offensives militaires et à l’imposer coûte que coûte aux autres puissances.
La première option fut notamment mise en œuvre à la fin des années 1990 par l’administration Clinton dans l’ex Yougoslavie où cette administration avait réussi à obtenir des principales puissances d’Europe occidentale, notamment l’Allemagne et la France de coopérer et participer aux bombardements de l’OTAN en Serbie pour contraindre ce pays à abandonner le Kosovo.
La seconde option est typiquement celle du déclenchement de la guerre contre l’Irak en 2003 qui s’est faite contre l’opposition très déterminée de l’Allemagne et de la France associées en cette circonstance à la Russie au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU.
Cependant, aucune de ces deux options n’a été en mesure, jusqu’à présent, de renverser le cours de la perte du leadership américain. La politique du « passage en force », qui s’est particulièrement illustrée durant les deux mandats de George Bush fils, a conduit non seulement au chaos irakien, un chaos qui n’est pas près d’être surmonté, mais aussi à un isolement croissant de la diplomatie américaine illustré notamment par le fait que certains pays qui l’avaient soutenue en 2003, tels l’Espagne et l’Italie, ont quitté le navire de l’aventure irakienne en cours de route (sans compter la prise de distance plus discrète du gouvernement de Gordon Brown par rapport au soutien inconditionnel apporté par Tony Blair à cette aventure). De son côté, la politique de « coopération », qui a la faveur des démocrates, ne permet pas réellement de s’assurer une « fidélité » des puissances qu’on essaie d’associer aux entreprises militaires, notamment du fait qu’elle laisse une marge de manœuvre plus importante à ces puissances pour faire valoir leurs propres intérêts.
Aujourd’hui, par exemple, l’administration Obama a décidé d’adopter une politique plus conciliante à l’égard de l’Iran et plus ferme à l’égard d’Israël, deux orientations qui vont dans le sens de la plupart des États de l’Union Européenne, notamment l’Allemagne et la France, deux pays qui souhaitent récupérer une partie de l’influence qu’ils ont eue par le passé en Iran et en Irak. Cela dit, cette orientation ne permettra pas d’empêcher que se maintiennent des conflits d’intérêt majeurs entre ces deux pays et les États-Unis notamment dans la sphère Est-européenne (où l’Allemagne essaie de préserver des rapports « privilégiés » avec la Russie) ou africaine (où les deux factions qui mettent à feu et à sang le Congo ont le soutien respectif de la France et des États-Unis).
Plus généralement, la disparition de la division du monde en deux grands blocs impérialistes rivaux a ouvert la porte à l’émergence des ambitions d’impérialismes de second plan qui constituent de nouveaux protagonistes de la déstabilisation de la situation internationale. Il en est ainsi, par exemple de l’Iran qui vise à conquérir une position dominante au Moyen-Orient sous le drapeau de la « résistance » au « Grand Satan » américain et du combat contre Israël. Avec des moyens bien plus considérables, la Chine vise à étendre son influence sur d’autres continents, particulièrement en Afrique où sa présence économique croissante vise à asseoir dans cette région du monde une présence diplomatique et militaire comme c’est déjà le cas dans la guerre au Soudan.
Ainsi, la perspective qui se présente à la planète après l’élection d’Obama à la tête de la première puissance mondiale n’est pas fondamentalement différente de la situation qui a prévalu jusqu’à présent : poursuite des affrontements entre puissances de premier ou second plan, continuation de la barbarie guerrière avec des conséquences toujours plus tragiques (famines, épidémies, déplacements massifs) pour les populations habitant dans les zones en dispute. Il faut même s’attendre à ce que l’instabilité que va provoquer l’aggravation considérable de la crise dans toute une série de pays de la périphérie ne vienne alimenter une intensification des affrontements entre cliques militaires au sein de ces pays avec, comme toujours, une participation des différentes puissances impérialistes. Face à cette situation, Obama et son administration ne pourront pas faire autre chose que poursuivre la politique belliciste de leurs prédécesseurs, comme on le voit par exemple en Afghanistan, une politique synonyme de barbarie guerrière croissante.
8) De même que les « bonnes dispositions » affichées par Obama sur le plan diplomatique n’empêcheront pas le chaos militaire de se poursuivre et de s’aggraver dans le monde ni la nation qu’il dirige d’être un facteur actif dans ce chaos, la réorientation américaine qu’il annonce aujourd’hui dans le domaine de la protection de l’environnement ne pourra empêcher la dégradation de celui-ci de se poursuivre. Cette dégradation n’est pas une question de bonne ou mauvaise volonté des gouvernements, aussi puissants soient-ils. Chaque jour qui passe met un peu plus en évidence la véritable catastrophe environnementale qui menace la planète : tempêtes de plus en plus violentes dans des pays qui en étaient épargnés jusqu’à présent, sécheresse, canicules, inondations, fonte de la banquise, pays menacés d’être recouverts par la mer… les perspectives sont de plus en plus sombres. Cette dégradation de l’environnement porte avec elle également une menace d’aggravation des affrontements militaires, particulièrement avec l’épuisement des réserves d'eau potable qui vont constituer un enjeu pour de nouveaux conflits.
Comme le soulignait la résolution adoptée par le précédent congrès international :
« Ainsi, comme le CCI l'avait mis en évidence il y a plus de 15 ans, le capitalisme en décomposition porte avec lui des menaces considérables pour la survie de l'espèce humaine. L'alternative annoncée par Engels à la fin du 19e siècle, socialisme ou barbarie, est devenue tout au long du 20e siècle une sinistre réalité. Ce que le 21e siècle nous offre comme perspective, c'est tout simplement socialisme ou destruction de l'humanité. Voila l'enjeu véritable auquel se confronte la seule force de la société en mesure de renverser le capitalisme, la classe ouvrière mondiale. » (Point 10)
9) Cette capacité de la classe ouvrière à mettre fin à la barbarie engendrée par le capitalisme en décomposition, à sortir l’humanité de sa préhistoire pour lui ouvrir les portes du « règne de la liberté », suivant l’expression d’Engels, c’est dès à présent, dans les combats quotidiens contre l’exploitation capitaliste, qu’elle se forge. Après l’effondrement du bloc de l’Est et des régimes soi-disant « socialistes », les campagnes assourdissantes sur la « fin du communisme », voire sur la « fin de la lutte de classe », ont porté un coup sévère à la conscience au sein de la classe ouvrière de même qu’à sa combativité. Le prolétariat a subi alors un profond recul sur ces deux plans, un recul qui s’est prolongé pendant plus de dix ans. Ce n’est qu’à partir de 2003, comme le CCI l’a mis en évidence en de nombreuses reprises, que la classe ouvrière mondiale a fait la preuve qu’elle avait surmonté ce recul, qu’elle avait repris le chemin des luttes contre les attaques capitalistes. Depuis, cette tendance ne s’est pas démentie et les deux années qui nous séparent du précédent congrès ont vu la poursuite de luttes significatives dans toutes les parties du monde. On a pu voir même, à certaines périodes, une simultanéité remarquable des combats ouvriers à l’échelle mondiale. C’est ainsi qu’au début de l’année 2008, ce sont les pays suivants qui ont été affectés en même temps par des luttes ouvrières : la Russie, l’Irlande, la Belgique, la Suisse, l’Italie, la Grèce, la Roumanie, la Turquie, Israël, l’Iran, l’Émirat de Bahrein, la Tunisie, l’Algérie, le Cameroun, le Swaziland, le Venezuela, le Mexique, les États-Unis, le Canada et la Chine.
De même, on a pu assister à des luttes ouvrières très significatives au cours des deux années passées. Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut citer les exemples suivants :
-
en Égypte, durant l’été 2007, où des grèves massives dans l’industrie textiles rencontrent la solidarité active de la part de nombreux autres secteurs (dockers, transports, hôpitaux…) ;
-
à Dubaï, en novembre 2007, où les ouvriers du bâtiment (essentiellement des immigrés) se mobilisent massivement ;
-
en France, en novembre 2007, où les attaques contre les régimes de retraite provoquent un grève très combative dans les chemins de fer, avec des exemples d’établissement de liens de solidarité avec les étudiants mobilisés au même moment contre les tentatives du gouvernement d’accentuer la ségrégation sociale à l’Université, une grève qui a dévoilé ouvertement le rôle de saboteurs des grandes centrales syndicales, notamment la CGT et la CFDT, obligeant la bourgeoisie de redorer le blason de son appareil d’encadrement des luttes ouvrières ;
-
en Turquie, fin 2007, où la grève de plus d’un mois des 26000 travailleurs de Türk Telecom constitue la mobilisation la plus importante du prolétariat dans ce pays depuis 1991, et cela au moment même où le gouvernement de celui-ci est engagé dans une opération militaire dans le Nord de l’Irak ;
-
en Russie, en novembre 2008, où des grèves importantes à Saint-Pétersbourg (notamment à l’usine Ford) témoignent de la capacité des travailleurs à surmonter une intimidation policière très présente, notamment de la part du FSB (ancien KGB) ;
-
en Grèce, à la fin de l’année 2008 où, dans un climat d’un énorme mécontentement qui s’était déjà exprimé auparavant, la mobilisation des étudiants contre la répression bénéficie d’une profonde solidarité de la part de la classe ouvrière dont certains secteurs débordent le syndicalisme officiel ; une solidarité qui ne reste pas à l’intérieur des frontières du pays puisque ce mouvement rencontre un écho de sympathie très significatif dans de nombreux pays européens ;
-
en Grande-Bretagne, où la grève sauvage dans la raffinerie Linsay, au début de 2009, a constitué un des mouvements les plus significatifs de la classe ouvrière de ce pays depuis deux décennies, une classe ouvrière qui avait subi de cruelles défaites au cours des années 1980 ; ce mouvement a fait la preuve de la capacité de la classe ouvrière d’étendre les luttes et, en particulier, a vu le début d’une confrontation contre le poids du nationalisme avec des manifestations de solidarité entre ouvriers britanniques et ouvriers immigrés, polonais et italiens.
10) L’aggravation considérable que connaît actuellement la crise du capitalisme constitue évidemment un élément de premier ordre dans le développement des luttes ouvrières. Dès à présent, dans tous les pays du monde, les ouvriers sont confrontés à des licenciements massifs, à une montée irrésistible du chômage. De façon extrêmement concrète, dans sa chair, le prolétariat fait l’expérience de l’incapacité du système capitaliste à assurer un minimum de vie décente aux travailleurs qu’il exploite. Plus encore, il est de plus en plus incapable d’offrir le moindre avenir aux nouvelles générations de la classe ouvrière, ce qui constitue un facteur d’angoisse et de désespoir non seulement pour celles-ci mais aussi pour celles de leurs parents. Ainsi les conditions mûrissent pour que l’idée de la nécessité de renverser ce système puisse se développer de façon significative au sein du prolétariat. Cependant, il ne suffit pas à la classe ouvrière de percevoir que le système capitaliste est dans une impasse, qu’il devrait céder la place à une autre société, pour qu’elle soit en mesure de se tourner vers une perspective révolutionnaire. Il faut encore qu’elle ait la conviction qu’une telle perspective est possible et aussi qu’elle a la force de la réaliser. Et c’est justement sur ce terrain que la bourgeoisie a réussi à marquer des points très importants contre la classe ouvrière à la suite de l’effondrement du prétendu « socialisme réel ». D’une part, il a réussi à enfoncer l’idée que la perspective du communisme est un songe creux : « le communisme, ça ne marche pas ; la preuve, c’est qu’il a été abandonné au bénéfice du capitalisme par les populations qui vivaient dans un tel système ». D’autre part, il a réussi à créer au sein de la classe ouvrière un fort sentiment d’impuissance du fait de l’incapacité de celle-ci à mener des luttes massives. En ce sens, la situation d’aujourd’hui est très différente de celle qui prévalait lors du surgissement historique de la classe à la fin des années 1960. A cette époque, le caractère massif des combats ouvriers, notamment avec l’immense grève de mai 1968 en France et l’automne chaud italien de 1969, avait mis en évidence que la classe ouvrière peut constituer une force de premier plan dans la vie de la société et que l’idée qu’elle pourrait un jour renverser le capitalisme n’appartenait pas au domaine des rêves irréalisables. Cependant, dans la mesure où la crise du capitalisme n’en était qu’à ses tous débuts, la conscience de la nécessité impérieuse de renverser ce système ne disposait pas encore des bases matérielles pour pouvoir s’étendre parmi les ouvriers. On peut résumer cette situation de la façon suivante : à la fin des années 1960, l’idée que la révolution était possible pouvait être relativement répandue mais celle qu’elle était indispensable ne pouvait pas s’imposer. Aujourd’hui, au contraire, l’idée que la révolution soit nécessaire peut trouver un écho non négligeable mais celle qu’elle soit possible est extrêmement peu répandue.
11) Pour que la conscience de la possibilité de la révolution communiste puisse gagner un terrain significatif au sein de la classe ouvrière, il est nécessaire que celle-ci puisse prendre confiance en ses propres forces et cela passe par le développement de ses luttes massives. L’énorme attaque qu’elle subit dès à présent à l’échelle internationale devrait constituer la base objective pour de telles luttes. Cependant, la forme principale que prend aujourd’hui cette attaque, celle des licenciements massifs, ne favorise pas, dans un premier temps, l’émergence de tels mouvements. En général, et cela s’est vérifié fréquemment au cours des quarante dernières années, les moments de forte montée du chômage ne sont pas le théâtre des luttes les plus importantes. Le chômage, les licenciements massifs, ont tendance à provoquer une certaine paralysie momentanée de la classe. Celle-ci est soumise à un chantage de la part des patrons : « si vous n’êtes pas contents, beaucoup d’autres ouvriers sont prêts à vous remplacer ». La bourgeoise peut utiliser cette situation pour provoquer une division, voire une opposition entre ceux qui perdent leur travail et ceux qui ont le « privilège » de le conserver. De plus, les patrons et les gouvernements se replient derrière un argument « décisif » : « Nous n’y sommes pour rien si le chômage augmente ou si vous êtes licenciés : c’est la faute de la crise ». Enfin, face aux fermetures d’entreprises, l’arme de la grève devient inopérante accentuant le sentiment d’impuissance des travailleurs. Dans une situation historique où le prolétariat n’a pas subi de défaite décisive, contrairement aux années 1930, les licenciements massifs, qui ont d’ores et déjà commencé, pourront provoquer des combats très durs, voire des explosions de violence. Mais ce seront probablement, dans un premier temps, des combats désespérés et relativement isolés, même s’ils bénéficient d’une sympathie réelle des autres secteurs de la classe ouvrière. C’est pour cela que si, dans la période qui vient, on n’assiste pas à une réponse d’envergure de la classe ouvrière face aux attaques, il ne faudra pas considérer que celle-ci a renoncé à lutter pour la défense de ses intérêts. C’est dans un second temps, lorsqu’elle sera en mesure de résister aux chantages de la bourgeoisie, lorsque s’imposera l’idée que seule la lutte unie et solidaire peut freiner la brutalité des attaques de la classe régnante, notamment lorsque celle-ci va tenter de faire payer à tous les travailleurs les énormes déficits budgétaires qui s’accumulent à l’heure actuelle avec les plans de sauvetage des banques et de « relance » de l’économie, que des combats ouvriers de grande ampleur pourront se développer beaucoup plus. Cela ne veut pas dire que les révolutionnaires doivent rester absents des luttes actuelles. Celles-ci font partie des expériences que doit traverser le prolétariat pour être en mesure de franchir une nouvelle étape dans son combat contre le capitalisme. Et il appartient aux organisations communistes de mettre en avant, au sein de ces luttes, la perspective générale du combat prolétarien et des pas supplémentaires qu’il doit accomplir dans cette direction.
12) Le chemin est encore long et difficile qui conduit aux combats révolutionnaires et au renversement du capitalisme. Ce renversement fait tous les jours plus la preuve de sa nécessité mais la classe ouvrière devra encore franchir des étapes essentielles avant qu’elle ne soit en mesure d’accomplir cette tache :
-
la reconquête de sa capacité à prendre en main ses luttes puisque, à l’heure actuelle, la plupart d’entre elles, notamment dans les pays développés, sont encore fortement sous l’emprise des syndicats (contrairement à ce qu’on avait pu constater aux cours des années 1980) ;
-
le développement de son aptitude à déjouer les mystifications et les pièges bourgeois qui obstruent le chemin vers les luttes massives et le rétablissement de sa confiance en soi puisque, si le caractère massif des luttes de la fin des années 1960 peut s’expliquer en bonne partie par le fait que la bourgeoisie avait été surprise après des décennies de contre-révolution, ce n’est évidemment plus le cas aujourd’hui ;
-
la politisation de ses combats, c’est-à-dire sa capacité à les inscrire dans leur dimension historique, à les concevoir comme un moment du long combat historique du prolétariat contre l’exploitation et pour l’abolition de celle-ci.
Cette étape est évidemment la plus difficile à franchir, notamment du fait :
-
de la rupture provoquée au sein de l’ensemble la classe par la contre-révolution entre ses combats du passé et ses combats actuels ;
-
de la rupture organique au sein des organisations révolutionnaires résultant de cette situation ;
-
du recul de la conscience dans l’ensemble de la classe à la suite de l’effondrement du stalinisme ;
-
du poids délétère de la décomposition du capitalisme sur la conscience du prolétariat ;
-
de l’aptitude de la classe dominante à faire surgir des organisations (tel le Nouveau Parti Anticapitaliste en France et Die Linke en Allemagne) qui ont pour vocation de prendre la place des partis staliniens aujourd’hui disparus ou moribonds ou de la Social-démocratie déconsidérée par plusieurs décennies de gestion de la crise capitaliste mais qui, du fait de leur nouveauté, sont en mesure d’entretenir des mystifications importantes au sein de la classe ouvrière.
En fait, la politisation des combats du prolétariat est en lien avec le développement de la présence en leur sein de la minorité communiste. Le constat des faibles forces actuelles du milieu internationaliste est un des indices de la longueur du chemin qui reste encore à parcourir avant que la classe ouvrière puisse s’engager dans ses combats révolutionnaires et qu’elle fasse surgir son parti de classe mondial, organe essentiel sans lequel la victoire de la révolution est impossible.
Le chemin est long et difficile, mais cela ne saurait en aucune façon être un facteur de découragement pour les révolutionnaires, de paralysie de leur engagement dans le combat prolétarien. Bien au contraire !
Vie du CCI:
Débat interne au CCI : Les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (IV)
- 5850 lectures
Pour la quatrième fois depuis la sortie de la Revue Internationale n° 133, nous publions des éléments du débat interne au CCI concernant l'explication de la période de prospérité ayant succédé à la Seconde Guerre mondiale.
Nous invitons le lecteur désirant connaître l'historique du débat et des articles publiés sur ce sujet à se reporter respectivement aux numéros 133, 135 et 136 de la Revue Internationale. L'article que nous publions aujourd'hui se revendique de la thèse dénommée Le Capitalisme d'État keynésiano-fordiste défendant l'idée que la prospérité des années 1950-60 a reposé sur la mise en œuvre de mécanismes keynésiens par la bourgeoisie. Il répond à deux articles publiés dans la Revue n° 136 qui, eux, défendaient respectivement pour l'un[1], l'idée que cette prospérité a fondamentalement été la conséquence de l'exploitation des derniers marchés extra capitalistes encore importants et d'un début de fuite en avant dans l'endettement (thèse Les marchés extra-capitalistes et l'endettement) et, pour l'autre[2], l'idée qu'elle avait été fondamentalement permise par le poids pris par l'économie de guerre et le capitalisme d'Etat dans la société.
Dans l'introduction à la publication de ces deux articles, nous dressions un panorama de l'évolution des discussions en présence en notant le fait que la thèse Le Capitalisme d'État keynésiano-fordiste "assume à présent ouvertement la remise en cause de différentes positions du CCI". Les camarades qui signent l'article publié ci-après ne sont pas d'accord avec une telle caractérisation et s'en expliquent [3].
Enfin, dans cette même introduction, nous signalions le fait que l'article Origine, dynamique et limites du capitalisme d'État keynésiano-fordiste, de la Revue n° 135 (en défense également de la thèse du Capitalisme d'État keynésiano-fordiste), n'était pas sans poser des problèmes concernant des manques évidents "de rigueur militante et scientifique notamment dans la référence aux textes du mouvement ouvriers, dans leur utilisation en vue de telle ou telle démonstration ou polémique", notamment à travers le l'altération du sens de certaines citations utilisées. Un tel problème ne découlait évidemment en rien de la nature de cette position comme en témoigne ce nouvel article, absolument irréprochable sur ce plan.
En défense de la thèse Le Capitalisme d'État keynésiano-fordiste (Réponse à Silvio et à Jens)
Nous continuons ici le débat entamé dans la Revue internationale nº 133 sur "... l'explication de la période de prospérité pendant les années 1950-60, qui a été une exception dans la vie du capitalisme depuis la Première Guerre mondiale...". Nous voulons répondre aux arguments des contributions des camarades Silvio et Jens, publiées dans le nº 136 de la Revue, ainsi qu'à la présentation de ces mêmes contributions qui nous semble contenir quelques malentendus.
Les divergences qui se discutent actuellement au sein de notre organisation se situent dans le cadre des positions défendues par les révolutionnaires dans la Deuxième et Troisième Internationales et au sein des Gauches communistes. Ce sont les contributions de Luxemburg, Boukharine, Trotski, Pannekoek, Bilan, Mattick entre autres. Nous savons qu'on ne peut concilier ces contributions car elles se contredisent sur divers aspects. Mais aucune de ces contributions n'explique complètement, à elle seule, le développement des Trente Glorieuses, pour la simple raison que leurs auteurs n'ont pas connu cette période (à l'exception de P. Mattick). Nous pensons cependant que tous ont contribué à la discussion que nous poursuivons en ce moment. Il est de la responsabilité des révolutionnaires aujourd'hui de continuer la discussion ouverte au sein du mouvement révolutionnaire afin de mieux comprendre les mécanismes qui facilitent ou freinent le développement du capitalisme, surtout pendant sa décadence.
Les auteurs de cet article défendent la thèse dite du "capitalisme d'État keynesiano-fordiste". Cette thèse a déjà été présentée, avec plus de détails, dans la Revue internationale no 135, par C.Mcl, auteur de la contribution. Celui-ci a décidé d'abandonner le débat et a rompu le contact avec nous. C'est pourquoi nous ne savons pas si la position que nous défendons ici est absolument identique à la sienne.
De quels faits parlons-nous ?
Pour poursuivre ce débat, nous voulons en premier lieu indiquer quelques faits historiques sur lesquels il n'a pas semblé jusqu'à présent y avoir de divergences parmi les trois positions exposées dans ce débat. Ce sont les suivants :
1) Entre les années 1945 et 1975, au moins dans la sphère des pays industrialisés du bloc dominé par les Etats-Unis, non seulement le PIB par habitant a crû comme jamais dans toute l'histoire du capitalisme[4], mais il y a aussi eu une augmentation des salaires réels de la classe ouvrière[5].
2) Dans la même période et dans la même sphère il y eut également une croissance constante de la productivité du travail, "les gains de productivité les plus importants de l'histoire du capitalisme, dus en particulier au perfectionnement du travail à la chaîne (fordisme), à l'automatisation de la production et leur généralisation partout où c'était possible"[6]. Pour le dire simplement : la technique et l'organisation de la production permettaient qu'un travailleur produise beaucoup plus qu'auparavant pendant une heure de travail.
3) Le taux de profit (c'est-à-dire le profit réalisé comparé au capital total investi) fut très élevé au cours de cette période, mais montra une fois de plus une tendance à la baisse à partir de 1969. Tous les camarades impliqués dans ce débat se référent sur ce thème aux mêmes statistiques[7].
4) Il y eut, au moins jusqu'en 1971, une concertation particulière, inconnue jusqu'alors dans l'histoire du capitalisme, entre tous les États du bloc dominé par les Etats-Unis (discipline de bloc, système de Bretton Woods[8]).
En ce qui concerne les trois premiers aspects, il faut être cohérent dans l'argumentation. Si nous sommes tous d'accord avec ces faits, nous ne pouvons pas faire un pas en arrière en insistant sur le fait que : "(...) la prospérité réelle des décennies 1950 et 60 n'a pas été aussi importante que veut bien le présenter la bourgeoisie, lorsqu'elle exhibe fièrement les PIB des principaux pays industrialisés de cette époque"[9]. Ce que nous présente la bourgeoisie sur cette période est une chose, mais nous ne pouvons pas résoudre le problème en disant que le problème n'existe pas, parce qu'il n'y a pas eu dans la réalité une telle croissance. Ce qui doit nous guider pour poursuivre ce débat, ce que nous devons clarifier pour nous et pour le reste des prolétaires qui n'ont pas le moindre intérêt à se masquer la réalité, c'est d'expliquer les mécanismes qui ont permis simultanément :
-
une accumulation sans interruption majeure (indépendamment des crises cycliques normales) ;
-
un taux de profit élevé ;
-
une croissance des salaires réels.
Si nous exagérons un aspect, ou si nous sous-estimons certaines difficultés, ce ne sont que des arguments relatifs (plus ou moins de quantité), alors que ce qui préoccupe est une question qualitative : comme est-il possible que le capitalisme décadent passe par une phase de prospérité d'une vingtaine d'années pendant laquelle les salaires augmentent et les profits sont élevés ?
Là est la question à laquelle nous devons répondre.
Jusqu'à quel point la thèse du capitalisme d'État keynesiano-fordiste reste-t-elle en accord avec Rosa Luxemburg ?
La thèse du "capitalisme d'État keynesiano-fordiste" est surtout critiquée parce qu'elle rejette une partie de l'argumentation de Rosa Luxemburg, comme on peut le lire dans l'article qui présente cette thèse plus en détail dans la Revue internationale no 135. Il semblerait qu'il y ait une confusion sur la question de savoir jusqu'à quel point nous sommes d'accord avec Luxemburg. Ainsi, le camarade Jens, dans son article de la Revue internationale no 136, pense que C. Mcl a changé d'avis depuis l'article qu'il écrivit dans la Revue internationale no 127. Dans cet article, on expliquait déjà (au nom du CCI dans une polémique avec la CWO) que la réduction du marché solvable comparée avec les nécessités du capital "n'est évidemment pas (...) le seul facteur qui participe à l'origine des crises", indiquant en outre qu'il fallait aussi prendre en compte la loi de la tendance à la baisse du taux de profit et le déséquilibre dans le rythme d'accumulation entre les grands secteurs de la production.
Pour nous, la réalisation de la plus-value produite est effectivement un problème fondamental du capitalisme. Il n'y a pas seulement une explication de la crise capitaliste, mais de deux de ses causes essentielles (nous ne parlons pas ici pour l'instant du problème de la proportionnalité). Non seulement il existe le problème de la tendance à la baisse du taux de profit, conséquence de l'augmentation de la composition organique du capital, mais également (après l'acte de production et d'appropriation de la plus-value) il subsiste le problème de vendre le produit en réalisant une plus-value. C'est un des mérites de R. Luxemburg que d'avoir localisé la difficulté de la réalisation du produit par l'insuffisance de marchés solvables.
Le capitalisme est un système qui est contraint de se développer. L'accumulation n'est pas basée sur la reproduction simple mais sur la reproduction élargie. Dans chaque cycle, le capital doit élargir sa base, c'est-à-dire le capital constant et le capital variable. Le capitalisme s'est développé dans un environnement féodal, dans un milieu extra-capitaliste avec lequel s'établirent des relations pour obtenir les moyens matériels de son accumulation : matières premières, force de travail, etc.
Un autre des mérites de R. Luxemburg fut d'analyser les rapports entre la sphère capitaliste et le milieu extra-capitaliste. Nous ne sommes pas d'accord avec tous les arguments économiques de cette analyse (comme nous l'expliquerons dans la partie suivante), mais partageons ses idées centrales : le capitalisme détruit continuellement les autres modes de production se trouvant dans son environnement, la contradiction interne cherche une solution dans l'extension du domaine extérieur, il y a un changement qualitatif dans le développement du capitalisme à partir du moment où toute la planète est conquise par le capitalisme, c'est-à-dire une fois que s'est constitué le marché mondial. Le capitalisme a alors accompli sa fonction progressiste et entre dans sa phase de décadence. Comme le dit C.Mcl. dans la Revue internationale no 127 : Luxemburg précise "plus amplement la raison et le moment de l'entrée en décadence du système capitaliste. En effet, outre son analyse du lien historiquement indissoluble entre les rapports sociaux de production capitalistes et l'impérialisme, qui montre que le système ne peut vivre sans s'étendre, sans être impérialiste par essence, ce que Rosa Luxemburg précise davantage c'est le moment et la manière dont le système capitaliste entre dans sa phase de décadence. (...) L'entrée en décadence du système s'est donc caractérisée non par la disparition des marchés extra capitalistes mais par leur insuffisance eu égard aux besoins de l'accumulation élargie atteinte par le capitalisme."[10].
Chaque cycle de l'accumulation capitaliste exige-t-il des marchés extra-capitalistes ?
Dans le capitalisme ascendant, il est vrai que les marchés situés en dehors de la sphère capitaliste ont constitué pour celui-ci une issue pour la vente de ses marchandises à une époque de surproduction. Déjà dans sa phase ascendante, le capitalisme avait souffert de ses contradictions internes et les avait dépassées, momentanément, d'une part à travers les crises périodiques et d'autre part grâce à la vente de produits (invendables dans la sphère capitaliste pure) à des marchés extra-capitalistes. Dans les crises cycliques provoquées par la baisse du taux de profit, plusieurs parties du capital sont dévalorisées permettant que se rétablisse une composition organique suffisamment utilisable pour que s'entame un autre cycle d'accumulation. Et, par ailleurs, dans la phase ascendante, l'environnement extra-capitaliste fournit au capitalisme "un exutoire pour la vente de ses marchandises en surproduction"[11], atténuant ainsi le problème de l'insuffisance de marchés solvables.
L'erreur de R. Luxembourg, c'est qu'elle fait de ces marchés extra-capitalistes et de la plus-value réalisée dans la vente à ceux-ci, l'élément indispensable de la reproduction élargie du capital. Le capitaliste produit pour vendre et non pas simplement pour produire. La marchandise doit trouver un acheteur. Et chaque capitaliste est avant tout un vendeur ; il n'achète que pour investir à nouveau, après avoir vendu son produit avec profit. En somme, le capital doit passer par une phase argent et, tant individuellement que pour être réalisées, les marchandises doivent être converties en argent, mais ni en totalité, ni au moment-même, ni annuellement comme l'envisage Luxemburg : une partie peut se maintenir sous sa forme matérielle, tandis que l'autre évolue à travers de multiples transactions commerciales pendant lesquelles une même quantité d'argent peut servir plusieurs fois pour la conversion de marchandises en argent, et d'argent en marchandises.
S'il n'y avait pas de crédit et s'il était nécessaire de réaliser en argent toute la production annuelle d'un seul coup sur le marché, alors, oui, il devrait exister un acheteur externe à la production capitaliste.
Mais ce n'est pas le cas. Il est évident que des obstacles peuvent survenir dans ce cycle (achat è production/extraction de plus-value è vente è nouvel achat). Il y a plusieurs difficultés. Mais la vente à un acheteur extra-capitaliste n'est pas une condition sine qua non de l'accumulation dans des conditions "normales", c'est seulement une issue possible s'il y a surproduction ou disproportion entre la production de moyens de production et celle des moyens de consommation, problèmes qui ne se manifestent pas à chaque moment.
Ce point faible de l'argumentation de R. Luxemburg a aussi été critiqué par des "luxemburgistes", comme Fritz Sternberg, qui parle à ce sujet "d'erreurs fondamentales, difficilement compréhensibles"[12]. Si ces erreurs de Rosa Luxemburg sont "difficilement compréhensibles" par les partisans du "luxemburgisme pur", c'est justement parce que ceux-ci ne prennent pas en considération ce point de la critique de Sternberg. Depuis le début des débats dans le CCI sur la décadence (années 1970), F. Sternberg est considéré comme une référence très importante, précisément parce qu'il est aussi considéré être luxemburgiste.
Le camarade Jens n'est pas d'accord avec l'idée de la thèse du "capitalisme d'État keynesiano-fordiste" qui affirme, selon lui, que "le marché extra-capitaliste ne constitue rien d'autre qu'une sorte de trop-plein pour le marché capitaliste lorsque celui-ci déborde."[13]. Pour éviter des malentendus : nous pensons que c'est précisément sur ce point que le luxemburgisme de Sternberg se différencie d'avec "le luxemburgisme pur" de Jens (et Silvio). Sur ce point, nous sommes d'accord avec Sternberg.
Pour nous, le mystère des Trente Glorieuses ne peut s'expliquer par des restes de marchés extra-capitalistes, alors que ceux-ci sont insuffisants depuis la Première Guerre mondiale en regard des nécessités de l'accumulation élargie atteinte par le capitalisme.
Comment fonctionne l'accumulation en présence d'une forte augmentation de la productivité ?
Pour la thèse du capitalisme d'État keynesiano-fordiste, la prospérité d'après la Seconde Guerre mondiale est la combinaison d'au moins trois facteurs essentiels :
-
des gains importants de productivité pendant une période de plus de deux décennies ;
-
une élévation importante des salaires réels pendant la même période ;
-
l'existence d'un capitalisme d'État développé (et coordonné au niveau supranational) pratiquant des politiques keynésiennes à d'autres niveaux également (et pas seulement sur le plan salarial).
Dans la Revue internationale no 136, le camarade Silvio se demande, perplexe : "Que signifie faire croître la production de profits ? Produire des marchandises et les vendre, mais alors pour satisfaire quelle demande ? Celle émanant des ouvriers ?"
Nous voulons répondre aux inquiétudes du camarade : si la productivité du travail augmente dans l'ensemble des industries, alors les moyens de consommation du travailleur sont diminués. Le capitaliste paye à ses travailleurs moins d'argent pour un même temps de travail. Le temps non payé au travailleur augmente, c'est-à-dire que la plus-value augmente. C'est-à-dire qu'augmente le taux de plus-value (qui n'est autre que le taux d'exploitation). Ce processus, Marx l'appela production de la plus-value relative. Si les autres facteurs se maintiennent (ou si le capital constant lui-même est en baisse), un accroissement de plus-value signifie aussi un accroissement du taux de profit. Si ce profit est suffisamment élevé, les capitalistes peuvent augmenter les salaires sans perdre tout l'accroissement de la plus-value extraite.
Or, la seconde question est celle du marché. Si on augmente le salaire du travailleur, il peut consommer plus. La force de travail, comme Marx l'indique, doit se reproduire. C'est la reproduction du capital variable (v), également nécessaire comme l'est la rénovation du capital constant (c). Par conséquent, le capital variable fait partie du marché capitaliste. Une augmentation générale des salaires signifie également un accroissement de ces marchés.
Il peut être répondu à ceci qu'un tel accroissement du marché est insuffisant pour réaliser toute la partie de la plus-value nécessaire à l'accumulation. Cela est vrai d'un point de vue général et à long terme. Nous, défenseurs de la thèse du capitalisme d'État keynesiano-fordiste, ne pensons pas avoir trouvé une solution aux contradictions inhérentes du capitalisme, une solution qui puisse se répéter à volonté. Notre analyse n'est pas une nouvelle théorie, mais une prolongation de la critique de l'économie capitaliste, une critique qu'a commencée Marx et qu'ont poursuivie d'autres révolutionnaires déjà cités.
Mais on ne peut nier qu'un tel accroissement du marché atténue le problème de l'insuffisance de la demande dans les conditions créées après la Seconde Guerre mondiale. Peut-être le camarade Silvio se demande-t-il encore d'où vient cette demande ? Une demande dans le capitalisme présuppose deux facteurs : une nécessité (désir de consommer) et la solvabilité (possession d'argent). Le premier facteur n'est presque jamais un problème, il y a toujours un manque de moyens de consommation. Le second facteur, au contraire, est un problème permanent pour le capitalisme - un problème qu'il parvient à atténuer précisément par la croissance des salaires pendant les Trente Glorieuses.
Mais l'extension du marché formé par les salariés n'est pas le seul facteur atténuant la pénurie de marchés au cours de cette période, il y a aussi eu l'augmentation des frais de l'État keynésien (par exemple les investissements dans des projets d'infrastructure, l'armement, etc.). Il s'agit d'une tripartition des accroissements du profit, d'une distribution des bénéfices obtenus grâce à l'augmentation de la productivité entre les capitalistes (profit), les ouvriers (salaires) et l'État (impôts). Il semble que le camarade Silvio soit d'accord avec nous là-dessus quand il affirme : "Il est vrai que la consommation ouvrière et les dépenses de l'État permettent d'écouler une production accrue". Il y voit toutefois un autre problème, la "conséquence, comme nous avons vu, une stérilisation de la richesse produite qui ne trouve pas à s'employer utilement pour valoriser le capital". Il se réfère ici à l'idée selon laquelle "augmenter les salaires au-delà de ce qui est nécessaire à la reproduction de la force de travail constitue purement et simplement, du point de vue capitaliste, un gaspillage de plus-value qui n'est en aucune manière capable de participer au processus de l'accumulation".
Ici le camarade confond deux sphères qu'il faut distinguer avant d'analyser la dynamique du processus général qui les unit :
-
un problème (dans la sphère de la circulation, des marchés) est la réalisation du produit obtenu. Il semble à ce niveau que Silvio nous donne raison s'il dit que la consommation ouvrière (comme les frais de l'État) permet de donner un débouché à une production croissante.
-
un autre problème est (dans la sphère de la production) la valorisation du capital de telle sorte que l'accumulation soit possible non seulement avec profit, mais avec toujours plus de profit.
Évidemment, l'objection du camarade sur le "gaspillage de plus-value" se situe au second niveau, celui de la production. Alors suivons-le (après avoir remarqué qu'il nous donne au moins partiellement raison au niveau des marchés), à l'usine, où le travailleur est exploité avec un salaire croissant. Que se passe-t-il si la plus-value augmente grâce à l'accroissement important de la productivité du travail ? (Nous faisons ici abstraction de la tripartition des profits, c'est à dire des impôts qui se transforment en frais de l'État. La bipartition entre capitaliste et travailleur est suffisante pour expliquer le mécanisme fondamental.) Le produit total d'une entité capitaliste (une entreprise, un pays, la sphère capitaliste dans sa totalité) pendant un certain temps, par exemple une année, peut être divisé en trois parties : le capital constant c, le capital variable v, et la plus-value pv. Si nous parlons d'accumulation, la plus-value n'est pas consommée dans sa totalité par le capitaliste, il doit en investir une partie dans l'extension de la production. La plus-value est alors divisée entre la partie consommée par le capitaliste (l'intérêt de son investissement : i) et la partie consacrée à l'accumulation (a) : pv = r + a. Cette seconde partie (a), nous pouvons la diviser à son tour entre la partie qui est investie dans le capital constant (ac) et la partie qui enrichit le capital variable (av) dans le prochain cycle de production : a = ac + av. Le produit total de cette entité capitaliste se présente alors ainsi :
c + v + pv, ou :
c + v + (i + a), ou :
c + v + (i + ac + av).
Si le capitaliste obtient grâce à l'augmentation importante de la productivité une plus-value suffisamment grande, la partie ac peut grandir chaque fois davantage, même si la partie av croît "au-delà ce qui est nécessaire". Si, par exemple, les moyens de consommation baissent de 50 % et les heures non payées au travailleur augmentent de 3 à 5 heures (d'une journée de travail de 8 heures) grâce à l'effet de la production de plus-value relative, le taux de plus-value croît de 3/8 à 5/8, par exemple de 375 € à 625 €, bien que le travailleur ait une augmentation de 20 % de son salaire réel (son salaire représente d'abord le produit de 5 heures, ensuite avec une productivité double, le salaire représente le produit de 3 heures = 6 heures auparavant). La même chose survient avec une consommation accrue du capitaliste (parce que ses produits de consommation baissent aussi de 50 %) et la partie de la plus-value consacrée à l'accumulation peut croître. Et la partie ac peut aussi croître année après année même si la partie av croît "au-delà du nécessaire", sous réserve que la productivité du travail continue à augmenter au même rythme. Le seul effet "nuisible" de ce "gaspillage de plus-value" réside dans le fait que l'augmentation de la composition organique du capital est plus lente que le rythme frénétique qu'elle aurait sinon : la croissance de la composition organique implique que la partie ac croisse plus rapidement que la partie av ; si la partie av grandit "au-delà du nécessaire", cette tendance est freinée (elle peut même être annulée ou inversée), mais on ne peut pas affirmer que ce "gaspillage de plus-value" ne prenne en aucune manière part au processus d'accumulation. Au contraire, cette distribution des profits obtenus par l'augmentation de la productivité participe pleinement de l'accumulation. Et non seulement cela, elle atténue précisément le problème identifié par R. Luxemburg dans le chapitre 25 del'Accumulation du capital, où elle fait valoir fermement qu'avec la tendance vers une composition organique du capital toujours plus grande, un échange entre les deux secteurs principaux de la production capitaliste (production de moyens de production d'une part, de moyens de consommation de l'autre) est impossible à long terme[14]. Après peu de cycles, il reste déjà un reliquat invendable dans le second secteur de l'économie capitaliste, celui de la production de moyens de consommation. La combinaison du fordisme (augmentation de la productivité) avec le keynesianisme (augmentation des salaires et augmentation des frais de l'État) aide à freiner cette tendance, atténue le problème de la surproduction dans ce secteur II et le problème des proportionnalités entre les deux branches principales de la production. Les leaders de l'économie occidentale ne pouvaient pas éviter l'arrivée de la crise à la fin des années 60, mais pouvaient ainsi la retarder.
Nous ne pouvons abandonner ce sujet sans mentionner que le camarade Silvio nous a laissés perplexes. Il semblerait qu'il ait compris au niveau théorique ce que nous venons d'expliquer, c'est-à-dire le mécanisme de la production de plus-value relative comme base idéale pour une accumulation la plus interne possible et la moins externe possible, quand il dit : "pourvu qu'il existe des gains de productivité suffisamment élevés permettant que la consommation augmente au rythme de l'augmentation de la productivité du travail, le problème de la surproduction est réglé sans empêcher l'accumulation puisque, par ailleurs, les profits, également en augmentation, sont suffisants pour assurer l'accumulation"[15]. Nous supposons que Silvio sait ce qu'il dit ou, du moins, qu'il comprend ce qu'il vient de dire, car c'est là sa propre formulation, conclusion de la citation de Marx sur les "Théories sur la plus-value", volume 2 (une citation qui bien sûr ne prouve rien par elle-même). Mais Silvio ne répond pas à ce niveau théorique ou, du moins, ne se prête pas à suivre la logique même de l'argument, il préfère changer de sujet et porte l'objection : "Marx, de son vivant, n'avait jamais constaté une augmentation des salaires au rythme de la productivité du travail, et pensait même que cela ne pouvait pas se produire. Cela s'est pourtant produit à certains moments de la vie même du capitalisme, mais ce fait ne saurait en rien autoriser d'en déduire que le problème fondamental de la surproduction, tel que Marx le met en évidence, s'en serait pour autant trouvé résolu, même momentanément". Quelle réponse ! Nous sommes sur le point de tirer la conclusion d'un raisonnement - mais, au lieu de vérifier ou de contredire la conclusion d'une série de faits, nous continuons à parler sur sa probabilité ou son improbabilité empirique. Comme s'il avait senti que cela n'était pas satisfaisant, le camarade riposte par anticipation : "En effet, le marxisme ne réduit pas cette contradiction que constitue la surproduction à une question de proportion entre augmentation des salaires et celle de la productivité" L'autorité de Marx ne suffisant pas, il faut celle du "marxisme". Un appel à l'orthodoxie ! Laquelle ?
Soyons plus conséquents dans le raisonnement, plus ouverts et osés dans les conclusions !
La valeur des schémas de l'accumulation capitaliste
Dans le second volume du Capital, Marx présente le problème de la reproduction élargie (c'est à dire de l'accumulation) en termes de schémas, par exemple :
Secteur I : 4000c + 1000v + 1000pv = 6000
Secteur II : 1500c + 750v + 750pv = 3000.
Nous sollicitons l'indulgence et la patience du lecteur pour la lourdeur que suppose la lecture et la compréhension de ces schémas. Mais nous pensons qu'ils ne doivent pas faire peur.
Le secteur I est la branche de l'économie qui produit les moyens de production, le secteur II celui où se produisent les moyens de consommation. 4000c est la quantité de valeur produite dans le secteur I pour la reproduction du capital constant (c) ; 1000v est la somme des salaires payés dans le secteur I ; 1000pv est la plus-value extraite des ouvriers dans le secteur I - de même pour l'autre secteur. Pour la reproduction élargie, il est essentiel de respecter la proportionnalité entre les différentes parties des deux secteurs. Les travailleurs du secteur I produisent, par exemple, des machines, mais ont besoin, pour leur propre reproduction, de moyens de consommation qui sont produits dans l'autre branche. Il y a un échange entre les deux entités, selon certaines règles. Si, par exemple, la moitié de la plus-value du secteur I (1000pv) est utilisée pour l'extension de la production et la composition organique reste inchangée, il est déjà alors défini que des 500pv réinvestis, 400 sont consacrés à l'amplification du capital constant et 100 seulement à l'augmentation de la masse salariale dans ce secteur. Ainsi Marx a donné comme exemple du second cycle :
I : 4400c + 1100v + 1100pv = 6600
II : 1600c + 800v + 800pv = 3200
Et il a poursuivi avec des schémas possibles de divers cycles d'accumulation. Ces schémas ont été élargis, critiqués et affinés par Luxemburg, Bauer, Boukharine, Sternberg, Grossmann et d'autres encore. Ce que nous pouvons en tirer est une certaine loi qui peut se résumer par la formule :
Si nous avons
Un secteur I avec : c1 + v1 + i1 + ac1 + av1
Un secteur II avec : c2 + v2 + i2 + ac2 + av2, la reproduction élargie exige que :
c2 + ac2 = v1 + i1 + av1. [16]
Où : la valeur du capital constant dans le secteur II (c2) plus la partie de plus-value dans ce même secteur consacrée à l'élargissement du capital constant (ac2)[17] doit être échangé avec la valeur du capital variable du secteur I (la masse salariale, v1) plus la production des capitalistes du même secteur (i1) plus la partie de la plus-value de ce secteur consacrée à l'emploi de nouveaux travailleurs (av1) [18].
Ces schémas ne tiennent pas compte de certains facteurs, par exemple :
1) Le fait que cette économie ait besoin de conditions pour son expansion "permanente" ; elle exige toujours plus de travailleurs et de matières premières.
2) Le fait qui il n'y ait pas d'échange direct entre les diverses entités mais échange de transactions par l'intermédiaire de l'argent, la marchandise universelle. Par exemple, l'entité de produits matérialisés dans la valeur ac1 doit être échangée avec elle-même : ce sont des moyens de production qui sont nécessaires dans le même secteur, il faut les vendre puis les acheter avant de pouvoir les utiliser.
En même temps les schémas ont certaines conséquences relativement gênantes, comme par exemple le fait que le secteur II n'a aucune autonomie face au secteur I. Le rythme de croissance du secteur de la production de moyens de consommation, ainsi que sa composition organique, dépendent totalement des proportions dans l'accumulation du secteur I[19].
Nous ne pouvons pas obliger les partisans de la nécessité des marchés capitalistes à voir un certain problème, c'est-à-dire à voir ce que Marx a recherché avec les schémas de l'accumulation capitaliste. Au lieu de regarder les différents problèmes, en les replaçant chacun dans leur lieu spécifique, ils préfèrent mélanger les différentes contradictions en insistant de façon permanente sur un aspect du problème : qui achète en fin de comptes la marchandise nécessaire à l'extension de la production ? C'est une fixation qui les aveugle. Mais si on veut suivre la logique même des schémas tels que Marx les a présentés, on ne peut alors s'opposer à la conclusion suivante :
Si les conditions sont celles que les schémas présupposent et si nous en acceptons les conséquences (conditions et conséquences qui peuvent être analysées séparément), par exemple un gouvernement qui contrôle toute l'économie peut théoriquement l'organiser de telle sorte que l'accumulation fonctionne selon le schéma : c2 + ac2 = v1 + i1 + av1. À ce niveau, il n'y a aucune nécessité de marchés extra-capitalistes. Si nous acceptons cette conclusion, nous pouvons analyser séparément (c'est-à-dire les distinguer) les autres problèmes, par exemple :
1) Comment une économie dans un monde nécessairement limité peut-elle croître en permanence ?
2) Quelles sont les conditions de l'utilisation de l'argent ? Comme l'argent peut-il interférer efficacement dans les différents actes de transformation d'un élément du capital global en un autre ?
3) Quels sont les effets d'une composition organique croissante (quand le capital constant croît plus rapidement que le capital variable) ?
4) Quels sont les effets de salaires qui croissent "au-delà du nécessaire" ?
Il est clair, comme l'a dit Rosa Luxemburg, que les schémas mathématiques ne prouvent rien en soi, pas plus la possibilité que l'impossibilité de l'accumulation. Mais si nous savons précisément ce qu'ils disent (et de quoi ils sont l'abstraction), nous pouvons distinguer les différents problèmes. Luxemburg a étudié aussi les trois premiers problèmes énumérés ici. Elle a surtout contribué à analyser les questions 1) et 3). Mais en ce qui concerne le problème 2), elle a confondu différentes contradictions et les a résumées en une seule difficulté, celle de la réalisation de la partie de la plus-value consacrée à l'extension de la reproduction : la transformation en argent non seulement est un problème pour cette partie du produit global (ac1, av1,ac2 et av2), mais pour tous les éléments de la production (aussi c1, v1, c2, v2 et même de la production : le propriétaire de l'usine de chocolat ne peut manger uniquement du chocolat). Cette transformation des marchandises en argent, et ensuite d'argent en nouveaux éléments matériels de la production peuvent échouer. Chaque vendeur doit trouver son acheteur, chaque vente est un défi - ceci est un problème distinct qui peut théoriquement être séparé de l'autre problème (numéro 1) : la nécessité de la croissance de la sphère du mode de production capitaliste, qui contient aussi la nécessité de la croissance du marché. Une telle croissance doit obligatoirement se réaliser au détriment des sphères[20] extra-capitalistes. Mais cette croissance présuppose seulement que le capitalisme dispose de tous les éléments matériels pour sa production élargie (force de travail, matières premières, etc.) ; ce problème n'a rien voir avec la vente d'une partie de la production capitaliste à des producteurs de marchandises non capitalistes. Comme nous l'avons dit précédemment : la vente à des marchés extra-capitalistes peut atténuer les problèmes de la surproduction, mais n'est pas constitutive pour l'accumulation.
Quelle est notre attitude face à la plate-forme du CCI ?
Dans la présentation de la discussion dans la Revue internationale no 136, la Rédaction a tenté d'opposer certaines positions de la Thèse "capitalisme d'État keynesiano-fordiste" aux positions du CCI, particulièrement avec notre plate-forme. Cette tentative est peut être motivée par certaines notes de C.Mcl dans la version complète de son article pour la Revue internationale no 135, version qui existe seulement sur notre site en français[21]. C.Mcl critique certaines formulations du point 3 de la plate-forme. Il les critique d'un point de vue théorique sans proposer de formulations alternatives. Nous ne connaissons pas l'attitude actuelle de C.Mcl par rapport à la Plate-forme, puisqu'il a abandonné la discussion. Nous ne pouvons pas parler pour lui. Mais nous sommes d'accord avec notre Plate-forme qui a été conçue, dès son origine, pour intégrer tous ceux qui sont d'accord avec l'analyse selon laquelle le capitalisme est entré dans sa phase de décadence avec la Première Guerre mondiale. Le point 3 de la Plate-forme ne prétendait en aucun cas exclure les révolutionnaires qui expliquent la décadence par la baisse tendancielle du taux de profit, bien que la formulation de ce point ait des accents "luxemburgistes". Si le point 3 de notre Plate-forme est quelque chose comme le dénominateur commun entre les marxistes révolutionnaires qui expliquent la décadence par l'insuffisance de marchés extra-capitalistes et ceux qui l'expliquent par la baisse tendancielle du taux de profit, nous ne voyons aucune raison de sortir de ce cadre parce que nous défendons non seulement une mais les deux idées, chacune dans leur dynamique propre. En ce sens nous n'avons aucun intérêt à avoir une Plate-forme qui exclut l'une ou l'autre des positions qui donnent une explication à l'entrée du capitalisme dans sa décadence. Une formulation comme l'actuelle est préférable, bien qu'avec l'avancée de la discussion sur les Trente Glorieuses, on puisse trouver une formulation qui reflète de façon plus consciente les différentes analyses de la décadence du capitalisme.
Dans ce même sens, nous voulons clarifier notre position relative à la présentation dans la Revue internationale no 136 de "la remise en question de différentes positions du CCI" par la thèse du "capitalisme d'État keynesiano-fordiste". Sous le titre "L'évolution des positions en présence" sont signalées trois prétendues contradictions entre les arguments de la plate-forme et la Thèse du "capitalisme d'État keynésiano-fordiste", contradictions que nous voulons clarifier. Nous citons les paragraphes critiques de la présentation :
1) "Ainsi, pour cette thèse : (celle du capitalisme d'État keynésiano-fordiste)
- "Le capitalisme produit en permanence la demande sociale qui est la base du développement de son propre marché", alors que, pour le CCI,"contrairement à ce que prétendent les adorateurs du capital, la production capitaliste ne crée pas automatiquement et à volonté les marchés nécessaires à sa croissance" (Plate-forme du CCI)."
Bien qu'on trouve la citation :" Le capitalisme produit en permanence la demande sociale qui est la base du développement de son marché propre" dans la Revue internationale nº 135, on ne peut isoler cette idée de son contexte. Comme on l'a vu dans la précédente partie du présent texte, le capitalisme (pour nous, mais aussi pour ceux qui expliquent la décadence uniquement par la baisse tendancielle du taux de profit) a une dynamique propre d'extension de son marché. Mais aucun des défenseurs de la thèse du "capitalisme d'État keynésiano-fordiste" n'a affirmé que ces marchés sont suffisants. Ils peuvent offrir une issue momentanée, mais il n'y a pas dépassement de la contradiction élémentaire : le marché croît moins rapidement que la production.
2) "L'apogée du capitalisme correspond à un certain stade de "l'extension du salariat et sa domination par le biais de la constitution du marché mondial". Pour le CCI, par contre, cette apogée intervient lorsque les principales puissances économiques se sont partagé le monde et que le marché atteint "un degré critique de saturation des mêmes débouchés qui lui avaient permis sa formidable expansion du 19ème siècle." (Plate-forme du CCI)"
Le second point des prétendues divergences de notre position avec celles du CCI se réfère à l'entrée du capitalisme dans sa phase décadente. La thèse du "capitalisme d'État keynésiano-fordiste" est totalement d'accord sur le fait que l'apogée est atteinte quand les principales puissances économiques se sont partagé le monde. La seule différence entre le "luxemburgisme" de la plate-forme et nous se trouve dans le rôle des marchés extra-capitalistes. Mais évidemment, cette divergence est bien moindre que celle des défenseurs de l'analyse de la baisse tendancielle du taux de profit comme unique facteur de l'entrée en décadence (Grossmann, Mattick).
3) "L'évolution du taux de profit et la grandeur des marchés sont totalement indépendantes, alors que, pour le CCI, "la difficulté croissante pour le capital de trouver des marchés où réaliser sa plus-value, accentue la pression à la baisse qu'exerce, sur son taux de profit, l'accroissement constant de la proportion entre la valeur des moyens de production et celle de la force de travail qui les met en œuvre." (idem)."
Par rapport à ce dernier point, nous pouvons dire que nous sommes globalement d'accord avec la présentation bien que nous ne parlions pas d'indépendance "totale" mais "théorique". Nous avons toujours dit que le taux de profit influence les marchés et réciproquement, mais ce sont deux facteurs "non liés théoriquement".
Les conséquences des divergences
Quelles sont les conséquences des divergences ? À première vue, aucune.
Nous avons évidemment une interprétation différente de certaines dynamiques dans l'économie capitaliste. Ces différences peuvent aussi nous amener à des divergences sur d'autres aspects, par exemple dans l'analyse de la crise actuelle et des perspectives immédiates du capitalisme. L'appréciation du rôle du crédit dans la crise actuelle, l'explication de l'inflation et le rôle de la lutte de classes nous paraissent être des sujets qui peuvent être analysés différemment selon les positions diverses de ce débat sur les Trente Glorieuses.
Malgré les divergences exposées dans ce débat, tant dans au cours du XVIIe Congrès qu'au cours du XVIIIe, nous discutons de la crise économique actuelle et votons ensemble pour les mêmes Résolutions sur la Situation internationale. Même si différentes analyses sur les mécanismes fondamentaux de l'économie capitaliste coexistent dans l'organisation, nous pouvons parvenir à des conclusions très semblables quant aux perspectives immédiates et aux tâches des révolutionnaires. Cela ne veut pas dire que le débat n'est pas nécessaire, mais au contraire qu'il exige de nous patience et capacité de nous écouter mutuellement avec un esprit ouvert.
Salome et Ferdinand (04/06/09)
[1] Les bases de l'accumulation capitaliste
[2] Économie de guerre et capitalisme d'État
[3] L'article ci-après (Réponse à Silvio et à Jens, cosigné Salome et Ferdinand) signale le fait que certaines notes à l'article de C. Mcl, Origine, dynamique, et limites du capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste [19], présentes dans sa version française, n'ont pas été transcrites en anglais ni en espagnol. Nous remédierons à ces défauts sur notre site dans ces langues, de manière à rendre le plus limpide possible les termes de ce débat et du fait en particulier que, comme le signalent Salome et Ferdinand, C.Mcl "critique certaines formulations du point 3 de la plate-forme", "d'un point de vue théorique sans proposer de formulations alternatives".
[4] Revue internationale no 133, "Débat interne dans le CCI [9]" (voir note 1).
[5] Revue internationale no 136, "Débat interne au CCI : les causes de la prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (III) [58] ; les bases de l'accumulation capitaliste [59]" (de Silvio), citant P. Mattick.
[6] Revue internationale no 133, "Débat.. [9].", partie Les marchés extra-capitalistes et l'endettement.
[7] Revue internationale n°121, Crise économique : la descente aux enfers [60].
[8] Pour davantage d'informations sur les Accords de Bretton Woods, consulter par exemple la contribution [61] de "papamarx".
[9] Silvio [59], Revue internationale no 136.
[10] Revue internationale no 127, "Réponse à la CWO - la guerre dans la phase de décadence du capitalisme [62]".
[11] Revue internationale no 135, "Débat interne dans le CCI - les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale [19]" (II).
[12] Fritz Sternberg, El imperialismo; Siglo XXI editores, p. 75.
[13] Revue internationale no 136. "Débat interne dans le CCI - les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale" (III), Economie de guerre et capitalisme d'Etat [63]
[14] F. Sternberg considère ce point de réflexion de R. Luxemburg comme le plus important de "tous ceux qui ont soigneusement été évités par ceux qui critiquent Rosa Luxemburg" (Fritz Sternberg, El imperialismo ; Siglo XXI editores, p 70).
[15] Revue internationale n° 136 [58].
[16] Par exemple Nicolas Boukharine, L'Impérialisme et l'accumulation du capital, réponse à Rosa Luxemburg, chapitre III.
[17] Ces deux éléments étaient produits dans le secteur II, c'est à dire se retrouvent sous forme de moyens de consommation.
[18] Ces trois éléments sont trouvés sous forme de moyens de production, et doivent être achetés finalement dans l'une ou l'autre manière par les capitalistes du secteur II ("changé" par c2 + a2c).
[19] Nous pensons que là se trouve la raison économique de la souffrance des travailleurs exploités sous le stalinisme (ou le maoïsme) : ce capitalisme d'État très rigide a forcé au maximum l'industrialisation en privilégiant le secteur I, ce qui a laissé le secteur de la production des moyens de consommation à un niveau réduit au minimum.
[20] Une sphère n'est pas nécessairement un marché : laver et repasser des vêtements à la maison sont des activités dans une sphère extra-capitaliste. Cette sphère peut être conquise par le capitalisme si le salaire est suffisamment haut pour permettre au travailleur de porter le vêtement sale à la blanchisserie. Mais il n'y a aucun marché extra-capitaliste dans cet exemple.
[21] /content/3514/debat-interne-au-cci-causes-prosperite-consecutive-a-seconde-guerre-mondiale-ii [19], notes 16, 22, 39, 41.
Questions théoriques:
- L'économie [14]
Revue Internationale n° 139 - 4e trimestre 2009
- 2265 lectures
Apollo 11 et la conquête de l'espace: une aventure sans lendemain
- 4214 lectures
Le 20 juillet 1969, il y a tout juste quarante ans, un vaisseau spatial s'est posé sur la surface de la lune. Apollo 11 était le premier de six alunissages qui allaient se suivre jusqu'à la mission Apollo 17 en décembre 1972. Les trois dernières missions prévues furent annulées par manque de fonds, et Apollo 17 reste aujourd'hui le dernier vol habité en dehors de l'orbite terrestre basse.
Pour les millions de gens qui ont regardé l'alunissage à la télévision, ce fut indéniablement un moment de grande émotion. Qui ,en effet, pouvait ne pas être touché par les images de la Terre vue depuis la lune, de ce berceau commun de l'espèce humaine, si beau et en même temps si fragile, dans le vaste espace intersidéral ? Qui ne pouvait admirer le courage des astronautes qui avaient réussi pareil exploit ? Pour la première fois, l'humanité avait mis pied sur un astre autre que la terre. Et d'autres planètes, d'autres systèmes solaires même, au-delà, apparaissaient du coup presque accessibles. L'expédition Apollo avait transformé les paroles de John Kennedy en réalité. Sept ans auparavant, à la Rice University de Houston, il avait prononcé une allocution qui semblait ouvrir une nouvelle époque de confiance et d'expansion humaine - menée bien sûr par les Etats-Unis avec à leur tête un président jeune, confiant et dynamique : "...l'homme, dans sa quête de connaissance et de progrès est résolu, et ne peut être découragé. L'exploration de l'espace ira de l'avant, que nous y participions ou non ; elle est une des grandes aventures de l'époque, et aucune nation qui s'attend être à la tête des autres nations ne peut se permettre de rester en arrière dans cette course vers l'espace (...) Nous avons l'intention de participer [à la nouvelle ère spatiale], nous avons l'intention d'y être à la tête. Car le regard du monde est aujourd'hui tourné vers l'espace, vers la lune, et vers les planètes au-delà, et nous avons juré de ne pas la laisser gouverner par un drapeau hostile et conquérant, mais par le drapeau de la liberté et de la paix. Nous avons juré de voir l'espace rempli, non pas par des armes de destruction massive mais par les instruments de la connaissance (...) L'espace est là (...) la lune et les planètes sont là, de nouveaux espoirs pour la connaissance et la paix sont là. Alors nous demandons, au moment de hisser les voiles, la bénédiction de Dieu sur la plus hasardeuse, la plus dangereuse, et la plus grande aventure dans laquelle l'homme s'est jamais embarqué".
La réalité était bien différente.
Le 20 novembre 1962, dans une conversation privée avec l'administrateur de NASA James E Webb, Kennedy déclare : "Tout ce que nous faisons doit être fait pour que nous arrivions sur la lune avant les russes (...) sinon on ne devrait pas dépenser tout cet argent, parce que l'espace ne m'intéresse pas plus que ça (...) la seule justification de ces dépenses (...) est que nous espérons battre [l'Union soviétique] et démontrer que, bien qu'elle nous ait devancé de quelques années, bon Dieu, nous l'avons doublée".
Loin de refuser les "armes de destruction massive" dans l'espace, les Etats-Unis s'efforçaient de les développer depuis la Deuxième Guerre mondiale, en particulier grâce à l'aide de scientifiques et de techniciens, comme Werner von Braun, qui avaient participé à l'effort de guerre allemand. Les années 1950 ont vu le développement, par le RAND Corporation et autres, de toute une panoplie de théories sur la dissuasion nucléaire et les moyens d'éviter la destruction par l'ennemi de la capacité de riposter à une attaque nucléaire (une étude plutôt farfelue présenté par Boeing en 1959 a même proposé la construction de bases lance-missiles sur la lune !). Les paroles "pacifiques" de Kennedy à ce propos sont donc parfaitement hypocrites et cachent mal l'effroi causé à la bourgeoisie américaine - et largement relayé par sa propagande envers la population en général - par le lancement du premier Spoutnik en 1957 et l'incapacité de l'armée américaine de rivaliser avec cette réussite, d'une part et, d'autre part, par le succès du premier vol spatial habité du cosmonaute russe Yuri Gagarin. Le choc causé par Spoutnik était donc d'autant plus grand que les Etats-Unis se croyaient en avance dans le développement des missiles et des armements spatiaux. En fait, l'URSS semblait devancer les Etats-Unis dans la nouvelle technologie des missiles et, surtout, en missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) capables de frapper les Etats-Unis sur leur propre territoire. Dans un document publié en janvier 1958, Hugh Dryden, directeur du NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) publia un rapport sur Un programme national pour la technologie spatiale qui déclarait : "Il est de la plus grande urgence et importance pour notre pays, à la fois pour son prestige et de par des considérations militaires, que ce défi [c'est à dire le Spoutnik] soit contré par un programme énergique de recherche et de développement pour la conquête spatiale". Le résultat en fut la transformation en 1958 du NACA, une commission établie pendant la Première Guerre mondiale, essentiellement pour veiller au développement de l'aviation militaire, en NASA dont le budget allait exploser : partant d'un budget de seulement $100 millions pour le NACA en 1957, la NASA allait engloutir plus de $25 milliards rien que dans le programme Apollo.
Cependant, la raison fondamentale derrière le programme Apollo n'était pas directement militaire : les énormes lanceurs Saturn V n'étaient pas aptes à porter des missiles balistiques, et les bases de lancement était bien trop vastes et trop exposées pour servir en temps de guerre. En réalité, le programme Apollo a sciemment détourné des fonds importants des programmes ICBM, plus explicitement militaires. Déjà, en janvier 1961, le rapport Weisner, préparé pour le nouveau président avant son entrée en fonction, signalait que la raison principale de l'effort spatial devait être "...le facteur de prestige national. L'exploration de l'espace et les exploits dans l'espace ont saisi l'imagination des peuples du monde. Pendant les années à venir, le prestige des Etats-Unis sera déterminé en partie par notre leadership dans l'espace". Pour Kennedy ce facteur de prestige est primordial. Lorsque, le 25 mai 1961, Kennedy présente le programme de son gouvernement à une séance réunissant les deux chambres du Congrès, le programme spatial est très clairement présenté à la lumière de la rivalité impérialiste entre les Etats Unis et l'URSS dans un contexte de décolonisation des vieux empires européens : "Le grand champ de bataille pour la défense et l'expansion de la liberté occupe aujourd'hui la moitié sud de la planète - l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique et le Moyen Orient - les pays des peuples montants. Leur révolution est la plus grande de l'histoire humaine. Ils cherchent une fin à l'injustice, à la tyrannie et à l'exploitation (...) nous devrions soutenir leur révolution (...) quel que soit le chemin qu'ils choisissent pour aller vers la liberté. Car les adversaires de la liberté [sous-entendu, l'URSS] n'ont pas créé la révolution, ni les conditions qui l'impulsent. Mais ils essaient de la monter, et de la capturer à leur profit. Pourtant leur agression est plus souvent cachée qu'ouverte...".
En d'autres termes, les anciens empires (surtout les empires anglais et français) ont créé une situation catastrophique dans laquelle des "révolutions" nationales risquent de basculer dans le camp russe, et ce, non pas à cause de leurs faits d'armes, mais parce que l'URSS représente une option plus attrayante pour les nouvelles cliques de la bourgeoisie locale qui sortent de la décolonisation. Dans ce contexte, Kennedy présente une série de mesures de renforcement militaire américain, d'aide militaire et civile aux gouvernements amis, etc. A la fin du discours le programme Apollo est annnoncé : "Si nous voulons gagner la bataille qui se déroule dans le monde entre la liberté et la tyrannie, les exploits spatiaux spectaculaires de ces dernières semaines doivent montrer clairement, comme Spoutnik en 1957, l'impact de cette aventure sur les esprits de tous ceux qui essaient de déterminer quel chemin ils doivent prendre (...) Aucun autre projet ne sera plus impressionnant pour l'humanité [que l'envoi d'un homme sur la lune]" (ibid).
De même que la "mission civilisatrice" des puissances coloniales européennes au 19e siècle, l'engagement des Etats Unis dans cette grande "aventure pour la liberté" comportait une grande part d'hypocrisie : il a indubitablement servi de masque pour cacher les réelles visées impérialistes américaines dans la bataille que livraient les Etats-Unis contre le bloc russe adverse pour la domination de la planète. Dans ce sens, la véritable cible de l'expédition Apollo 11 se trouvait non sur la lune mais bien sur la Terre.
Et pourtant, ce serait réducteur de ne voir que l'aspect hypocrite. L'expédition lunaire comportait aussi d'énormes risques : c'était un projet d'un coût, d'une complexité, et d'une nouveauté jamais égalés. Le fait d'entreprendre ce projet était également une expression d'une confiance remarquable de la bourgeoisie américaine dans ses propres capacités - une confiance que les vieilles puissances avaient totalement perdue, restées exsangues après deux guerres mondiales et en perte de vitesse économique et militaire. Les Etats-Unis au contraire semblaient au sommet de leur puissance : n'ayant subi aucune occupation ni bombardement sur leur propre territoire, seuls vainqueurs indiscutable de la Deuxième Guerre dont ils étaient sortis avec une puissance militaire inégalée, et apparemment en plein boom économique avec une prospérité qui restait un objet d'admiration et d'envie pour les autres pays. L'idéologie dominante américaine avait, en quelque sorte, pris du retard sur la réalité et continuait d'exprimer la confiance en soi d'une bourgeoisie triomphante qui aurait été plus appropriée au 19e siècle, avant que la boucherie de 1914-18 ne vienne démontrer que la classe capitaliste était devenu un obstacle au progrès futur de l'espèce humaine.
En 1962 Kennedy avait projeté d'envoyer des astronautes sur la lune dans les dix ans. En l'occurrence, c'est seulement sept ans plus tard que Apollo 11 se pose sur la lune. Mais loin d'être le début d'une nouvelle ère triomphante d'expansion spatiale à l'image de l'expansion vers l'ouest des Etats-Unis pendant le 19e siècle, la réussite du programme lunaire marque aussi le moment où la réalité de la période de la décadence du capitalisme a rattrapé le rêve américain. Le pays est empêtré dans la guerre du Vietnam, Kennedy est assassiné, et les débuts de la crise économique commencent à se faire sentir - les Etats-Unis allaient abandonner l'étalon-or en 1971, ce qui signifia la fin du système de Bretton Woods qui avait assuré la stabilité du système financier international depuis la Deuxième guerre.
Le sort du programme spatial américain est à l'image de cette perte de vitesse économique, perte d'invincibilité militaire et perte de confiance idéologique. L'objectif fixé par Reagan dans les années 1980 n'est plus l'exploration mais la militarisation à outrance de l'espace orbital avec le programme dit de "Guerre des étoiles". Les ambitions déclarées de développer des moyens plus économiques et efficace pour envoyer des hommes et du matériel dans l'espace, avec la navette spatiale, n'ont rien donné : la navette date aujourd'hui de trente ans et les Etats Unis seront bientôt dépendants des fusées russes tout aussi vieillissantes pour approvisionner la station spatiale internationale (ISS). In 2004, George W Bush annonça une nouvelle "vision" pour l'exploration spatiale, avec l'achèvement de l'ISS et l'envoi d'une nouvelle mission vers la lune pour 2020 afin de préparer des voyages ultérieurs vers Mars. Cependant, dès qu'on regarde de près, il est évident que ce n'est que du barouf. L'expédition vers Mars serait d'une complexité et d'un coût proprement astronomiques et, alors que le gouvernement américain dépense des milliards pour les guerres en Irak et en Afghanistan, il n'y a aucune indication de comment il fera pour allouer des fonds adéquats à la NASA. Alors qu'on présente le président Obama comme un nouveau Kennedy - jeune, dynamique, porteur d'espoir - il est évident qu'il n'a pas, et ne peut pas se permettre, les ambitions d'un Kennedy. Les Etats-Unis ne sont plus la puissance triomphante d'il y a 40 ans mais un géant aux pieds d'argile, de plus en plus contesté par des puissances de deuxième et de troisième ordre. D'ailleurs, la mise en oeuvre effective d'un programme coûteux de nouveaux vols habités vers la lune est de plus en plus contestée dans l'administration Obama, et ne parlons même pas d'aller sur Mars. Il n'y aura pas de "nouvelle ère spatiale" : les grandes puissances au contraire sont en train de militariser à outrance l'espace proche avec des satellites espions et sans doute bientôt, des satellites armés au laser pour la destruction de missiles ; le LEO (Low Earth Orbit) est en cours de devenir une énorme poubelle de satellites et étages de fusée abandonnées. Le capitalisme mondial est une société moribonde qui a perdu son ambition et sa confiance en elle-même, et les puissances ne pensent à l'espace que pour protéger leurs propres intérêts mesquins sur Terre.
Peut-on atteindre les étoiles ?
De tous les exploits réalisés par l'espèce humaine, sans doute le plus grand est celui lancé par nos ancêtres lointains, il y a environ 100.000 ans lorsqu'ils ont quitté la vallée du Rift, berceau de l'humanité, pour peupler d'abord le continent africain et ensuite le reste du monde. Nous ne saurons jamais à quelles qualités de courage, de curiosité, de connaissance et d'ouverture vers l'extérieur nos prédécesseurs ont dû faire appel en partant à la découverte d'un monde inconnu. Cette grande aventure était celle d'une société (ou plutôt d'un foisonnement de sociétés) communiste primitive. Nous ne pouvons pas dire si l'humanité sera un jour capable de quitter la Terre et s'aventurer sur d'autres planètes, ou même d'explorer d'autres étoiles. Mais une chose est certaine : cet exploit ne pourrait être réalisé que par une société communiste qui aura fini d'engloutir des ressources énormes dans la guerre, qui aura réparé la destruction planétaire dont l'anarchie capitaliste est responsable, qui ne gaspillera plus l'énergie physique et mentale de sa jeunesse dans la misère et le chômage, qui entreprendra l'exploration et la recherche scientifique pour le bien des hommes et pour le plaisir d'apprendre, et qui pourra regarder vers l'avenir avec confiance et enthousiasme.
Jens (2009)
"Low Earth Orbit", c'est à dire entre 160 et 2.000km au-dessus de la Terre.
12 septembre 1962, https://en.wikisource.org/wiki/We_choose_to_go_to_the_moon [65] (les traductions de l'anglais sont de nous).
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Race [66].
Werner von Braun, responsable du développement des fusées V2 allemandes qui ont bombardé Londres à la fin de la guerre, a travaillé après la guerre sur le programme ICBM (Inter-Continental Ballistic Missile) américain, avant de devenir l'architecte du lanceur Saturn V utilisé pour les missions Apollo, et le responsable du Marshall Space Flight Centre.
Voir "Take off and nuke the site from orbit" dans un numéro du Space Review de 2007 [67].
En décembre 1957, la tentative de lancer une fusée Vanguard par l'armée américaine échoue lamentablement devant les caméras de télévision. La nécessité de mettre fin à la rivalité entre les armées de terre et de mer en matière de recherche aéronautique et spatiale était une des motivations sous-jacente à la création de la NASA.
Cité dans Mark Erickson, Into the unknown together - the DOD, NASA, and early spaceflight.
https://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/report61.html [68]
Disponible dans la bibliothèque Kennedy.
Selon un rapport qui vient d'être présenté à la Maison Blanche, la NASA aura besoin de $3 milliards de plus par an à partir de 2014 pour entreprendre des expéditions au delà de l'orbite terrestre, ses budgets ayant été grevés par des transferts imprévus vers d'autres postes.
Personnages:
- JF Kennedy [69]
Evènements historiques:
- Apollo 11 [70]
Rubrique:
Anniversaire de l'effondrement du stalinisme : vingt ans après l'euphorie, la bourgeoisie fait profil bas
- 2530 lectures
Il y a vingt ans se produisait un des événements les plus considérables de la seconde partie du vingtième siècle : l'effondrement du bloc impérialiste de l'Est et des régimes staliniens d'Europe, dont le principal d'entre eux, celui de l'URSS.
Cet événement fut utilisé par la classe dominante pour déchaîner une des campagnes idéologiques les plus massives et pernicieuses qui ait jamais été dirigée contre la classe ouvrière. En identifiant frauduleusement, une nouvelle fois, le stalinisme qui s'effondrait avec le communisme, en faisant de la faillite économique et de la barbarie des régimes staliniens la conséquence inévitable de la révolution prolétarienne, la bourgeoisie visait à détourner les prolétaires de toute perspective révolutionnaire et à porter un coup décisif aux combats de la classe ouvrière.
Dans la foulée, la bourgeoisie en profitait également pour faire passer un second gros mensonge : avec la disparition du stalinisme, le capitalisme entrait dans une ère de paix et de prospérité et allait enfin pouvoir s’épanouir vraiment. L’avenir, promettait-elle, s’annonçait radieux.
Le 6 mars 1991, George Bush père, président des États-Unis d'Amérique, fort de sa toute récente victoire sur l’armée irakienne de Saddam Hussein, annonçait la venue d'un "nouvel ordre mondial" et l'avènement d'un "monde où les Nations unies, libérées de l'impasse de la guerre froide, sont en mesure de réaliser la vision historique de leurs fondateurs. Un monde dans lequel la liberté et les droits de l'homme sont respectés par toutes les nations".
Vingt ans après, on pourrait presque en rire, si le désordre mondial et la prolifération des conflits aux quatre coins de la planète, qui ont caractérisé le monde depuis ce célèbre discours, n'avaient répandu autant de mort et de misère. Sur ce plan, le bilan ne fait que s'alourdir année après année.
Quant à la prospérité, il est hors de propos d'en parler. En effet, depuis l’été 2007 et surtout l’été 2008, "au centre des discours bourgeois, les mots "prospérité", "croissance", "triomphe du libéralisme" se sont éclipsés discrètement. A la table du grand banquet de l’économie capitaliste s’est installé un convive qu’on croyait avoir expulsé pour toujours : la crise, le spectre d’une "nouvelle grande dépression" semblable à celle des années 30." 1 Hier, l'effondrement du stalinisme signifiait le triomphe du capitalisme libéral. Aujourd'hui, c'est ce même libéralisme qui est accusé de tous les maux par l'ensemble des spécialistes et politiques, même parmi ceux qui s'en étaient fait les plus acharnés défenseurs, comme le président français Sarkozy !
On ne choisit évidemment pas les dates des anniversaires et, le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci tombe au plus mal pour la bourgeoisie. Si, à cette occasion, elle s'est délibérément privée d'en remettre une couche sur "la mort du communisme" et "la fin de la lutte de classe", ce n'est pas l'envie qui lui en manquait mais, la situation du capitalisme étant calamiteuse, cela risquait de dévoiler plus complètement encore l'imposture de ces thèmes idéologiques. C'est pourquoi la bourgeoisie nous a épargné de grandes célébrations de l'effondrement de la "dernière tyrannie mondiale", de la grande victoire de la "liberté". Au lieu de cela, mis à part les quelques évocations historiques de rigueur, il n'y eut point d'euphorie ni d'exaltation.
Si l'histoire a tranché quant à la réalité de la paix et de la prospérité que le capitalisme devait nous offrir, ce n'est pas pour autant que la barbarie et la misère actuelles apparaissent clairement aux yeux de tous les exploités comme la conséquence inéluctable des contradictions insurmontables du capitalisme. En effet, la propagande de la bourgeoisie, aujourd'hui plutôt orientée sur la nécessité "d'humaniser" et de "réformer" le capitalisme, a pour mission de différer le plus possible la prise de conscience de cette réalité par les exploités. Plus encore, la réalité n'a dévoilé qu'une partie du mensonge, l'autre partie, l'identification du stalinisme avec le communisme continue encore aujourd'hui de peser sur le cerveau des vivants, même si c'est évidemment de façon moins massive et abrutissante que durant les années 1990. Face à cela, il est nécessaire de rappeler quelques éléments d'histoire.
La même crise du capitalisme à l'origine de l'effondrement du stalinisme et de l'actuelle récession
"La crise mondiale du capitalisme se répercute avec une brutalité toute particulière sur leur économie [celle des pays de l'Est] qui est, non seulement arriérée, mais aussi incapable de s'adapter d'une quelconque façon à l'exacerbation de la concurrence entre capitaux. La tentative d'introduire des normes "classiques" de gestion capitaliste, afin d'améliorer sa compétitivité, ne réussit qu'à provoquer une pagaille plus grande encore, comme le démontre en URSS l'échec complet et cuisant de la "Perestroïka". (...) La perspective pour l'ensemble des régimes staliniens n'est nullement celle d'une "démocratisation pacifique" ni d'un redressement de l'économie. Avec l'aggravation de la crise mondiale du capitalisme, ces pays sont entrés dans une période de convulsions d'une ampleur inconnue dans leur passé pourtant déjà "riche" de soubresauts violents." ("Convulsions capitalistes et luttes ouvrières", 7/09/89, Revue Internationale n°59).
Cette situation catastrophique des pays de l'Est n'empêchera pas la bourgeoisie de les présenter comme recélant de nouveaux marchés immenses à exploiter, dès lors qu'ils auront été complètement libérés du joug du "communisme". Pour cela, il fallait y développer une économie moderne qui, de plus, aurait cette vertu de remplir les carnets de commande des entreprises occidentales pendant des décennies. La réalité fut tout autre : il y avait certes beaucoup de choses à construire, mais personne pour payer.
Le boom attendu de l'Est ne viendra donc pas. Bien au contraire, les difficultés économiques qui apparaissent à l'Ouest sont, sans le moindre scrupule, mises sur le compte de la nécessaire assimilation des pays arriérés de l'ancien bloc de l'Est. Il en est ainsi de l'inflation qui devient difficilement maîtrisable en Europe. La situation ne tarde pas à déboucher, dès 1993, sur une récession ouverte sur le vieux continent 2. Ainsi, la nouvelle configuration du marché mondial, avec l'intégration complète en son sein des pays de l'Est, ne changea absolument rien aux lois fondamentales qui régissent le capitalisme. En particulier, l'endettement a continué à occuper une place toujours plus importante dans le financement de l'économie, la rendant toujours plus fragile face à la moindre déstabilisation. Les illusions de la bourgeoisie durent rapidement s'envoler face à la dure réalité économique de son système. Ainsi, en décembre 1994, le Mexique craque face à l'afflux des spéculateurs que l'Europe en crise avait fait fuir : le Peso s'effondre et risque d'entraîner avec lui une bonne partie des économies du continent américain. La menace est réelle et bien comprise. Une semaine après le début de la crise, les États-Unis mobilisent 50 milliards de dollars pour secourir la monnaie mexicaine. A l'époque, la somme paraît faramineuse... Vingt ans plus tard, c'est quatorze fois plus que les États-Unis mobiliseront, pour leur seule économie !
Dès 1997, rebelote, en Asie. Cette fois, ce sont les monnaies des pays du Sud-est asiatique qui s'effondrent brutalement. Ces fameux Tigres et Dragons, pays modèles du développement économique, vitrine de ce "nouvel ordre mondial" où la prospérité est accessible même aux plus petits pays, subissent eux aussi la dure loi capitaliste.
L'attrait pour ces économies avait nourri une bulle spéculative qui éclatera début 1997. En moins d'un an, tous les pays de la région seront touchés. 24 millions de personnes se retrouvent au chômage en un an. Les émeutes et pillages se multiplient, causant la mort de 1200 personnes. Le nombre de suicides explose. Dès l'année suivante, le risque de contagion internationale est constaté, avec l'apparition de graves difficultés en Russie.
Le modèle asiatique, fameuse "troisième voie", était enterré aux côtés du modèle "communiste". Il allait falloir trouver autre chose pour prouver que le capitalisme est le seul créateur de richesse sur terre. Cette autre chose, c'est le miracle économique de l'Internet. Puisque tout s'effondre dans le monde réel, investissons dans le virtuel ! Puisque prêter aux riches ne suffit plus, prêtons à ceux qui nous promettent de devenir riches ! Le capitalisme a horreur du vide, surtout dans son portefeuille, et quand l'économie mondiale semble bien incapable d'offrir les profits toujours plus grands pour répondre aux besoins insatiables du capital, quand plus rien n'existe de rentable, on invente un nouveau marché de toutes pièces. Le système va fonctionner un temps, les paris se multipliant sur le cours d'actions qui n'ont plus aucun lien raisonnable avec le réel. Des sociétés qui dégagent des millions de pertes valent plusieurs milliards de dollars sur le marché. La bulle est constituée, et elle gonfle. La folie s'empare d'une bourgeoisie qui s'illusionne totalement sur la pérennité à long terme de la "nouvelle économie", au point d'y mouiller aussi "l'ancienne". Les secteurs traditionnels de l'économie s'y mettent aussi, espérant trouver là leur rentabilité perdue dans leur activité historique. La "nouvelle économie" envahit l'ancienne 3, et elle l'entraînera de ce fait dans sa chute.
La chute fait mal. L'effondrement d'un tel dispositif fondé sur rien d'autre que la confiance mutuelle entre les acteurs pour qu'aucun ne flanche, ne peut qu'être brutal. L'éclatement de la bulle provoque des pertes de 148 milliards de dollars dans les sociétés du secteur. Les faillites se multiplient, les survivants déprécient leurs actifs à coup de centaines de milliards de dollars. Au moins 500 000 emplois sont supprimés dans le secteur des télécommunications. La "nouvelle économie" ne s'est pas montrée finalement plus fructueuse que l'ancienne et les fonds qui échappent à temps du marasme vont devoir trouver un autre secteur où se placer.
Et c'est dans l'immobilier qu'ils trouvent. Finalement, après avoir prêté à des pays vivant au-dessus de leurs moyens, après avoir prêté à des sociétés construites sur du vent, à qui peut-on encore prêter ? La bourgeoisie n'a aucune limite à sa soif de profit. Désormais, le vieil adage "on ne prête qu'aux riches" est définitivement remisé dans les placards, puisque de riches, il n'en est plus assez. La bourgeoisie va donc s'attaquer à un nouveau marché... celui des pauvres. Au-delà du cynisme évident de la démarche, il y a aussi le mépris total pour la vie des personnes qui vont devenir les proies de ces vautours. Les prêts octroyés sont garantis par la valeur du bien acquis par son intermédiaire. Mais en plus, quand ce bien prend de la valeur avec la hausse du marché, il donne l'occasion pour augmenter encore les dettes des familles, les plaçant dans une situation potentielle désastreuse. Car quand le modèle s'effondre, ce qui s'est passé en 2008, la bourgeoisie pleure ses propres morts, les banques d'affaires et autres sociétés de refinancement, mais elle oublie les millions de familles à qui tout ce qu'elles possédaient, bien que ça ne vaille plus rien du tout, leur a été enlevé, les jetant à la rue ou dans des bidonvilles improvisés.
La suite est suffisamment connue pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir, si ce n'est à travers ces quelques mots qui la résument parfaitement : une récession ouverte mondiale, la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, jetant à la rue des millions d'ouvriers dans tous les pays, une augmentation considérable de la misère.
Les guerres, avant et après 1990, sont le produit des mêmes contradictions du capitalisme
La configuration impérialiste se trouve évidemment bouleversée par l'effondrement du bloc de l'Est. Avant cet évènement, le monde était divisé en deux blocs adverses constitués chacun autour d'une puissance dirigeante. Toute la période d'après Seconde Guerre mondiale, jusqu'à l'effondrement du bloc de l'Est, est marquée par les très fortes tensions entre les blocs prenant la forme de conflits ouverts à travers des pays du tiers monde interposés. Pour n'en citer que quelques uns : guerre de Corée au début des années 50, guerre du Vietnam tout au long des années 60 et jusqu'au milieu des années 70, guerre en en Afghanistan à partir de 1979, etc. L'effondrement de l'édifice stalinien en 1989 est en fait le produit de son infériorité économique et militaire face au bloc adverse.
Néanmoins la disparition de "l'empire du mal", le bloc russe tenu pour unique responsable par la propagande occidentale des tensions guerrières, ne pouvait mettre fin aux guerres. Telle était l'analyse que le CCI défendait en janvier 1990 : "La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux ‘partenaires’ d’hier, ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l’heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial (…). En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d’être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible." (Revue Internationale n° 61, "Après l’effondrement du bloc de l’Est, stabilisation et chaos"). La scène mondiale n’allait pas tarder à confirmer cette analyse, notamment avec la première Guerre du Golfe en janvier 1991 et la guerre dans l’ex Yougoslavie à partir de l’automne de la même année. Depuis, les affrontements sanglants et barbares n’ont pas cessé. On ne peut tous les énumérer mais on peut souligner notamment : la poursuite de la guerre dans l’ex Yougoslavie qui a vu un engagement direct, sous l’égide de l’OTAN, des États-Unis et des principales puissances européennes en 1999 ; les deux guerres en Tchétchénie ; les nombreuses guerres qui n’ont cessé de ravager le continent africain (Rwanda, Somalie, Congo, Soudan, etc.) ; les opérations militaires d’Israël contre le Liban et, tout récemment, contre la bande de Gaza ; la guerre en Afghanistan de 2001 qui se poursuit encore ; la guerre en Irak de 2003 dont les conséquences continuent de peser de façon dramatique sur ce pays, mais aussi sur l’initiateur de cette guerre, la puissance américaine.
Le stalinisme, une forme particulièrement brutale du capitalisme d’Etat
Toute la partie qui suit, relative à la dénonciation du stalinisme, fait partie d'un supplément à notre un intervention qui a été diffusé massivement en janvier 1990 (Le supplément en question est publié intégralement dans l'article "1989-1999 - Le prolétariat mondial face à l'effondrement du bloc de l'Est et à la faillite du stalinisme"de la Revue internationale n° 99). Considérant que, 20 ans après, cette dénonciation demeure parfaitement valable, nous la reproduisons sans aucune modification.
"C'est sur les décombres de la révolution d'Octobre 1917 que le stalinisme a assis sa domination. C'est grâce à cette négation du communisme constituée par la théorie du "socialisme en un seul pays" que l'URSS est redevenue un État capitaliste à part entière. Un État où le prolétariat sera soumis, le fusil dans le dos, aux intérêts du capital national, au nom de la défense de la "patrie socialiste".
"Ainsi, autant l'Octobre prolétarien, grâce au pouvoir des conseils ouvriers, avait donné le coup d'arrêt à la Première Guerre mondiale, autant la contre-révolution stalinienne, en détruisant toute pensée révolutionnaire, en muselant toute velléité de lutte de classe, en instaurant la terreur et la militarisation de toute la vie sociale, annonçait la participation de l'URSS à la deuxième boucherie mondiale.
Toute l'évolution du stalinisme sur la scène internationale dans les années 30 a, en effet, été marquée par ses marchandages impérialistes avec les principales puissances capitalistes qui, de nouveau, se préparaient à mettre l'Europe à feu et à sang. Après avoir misé sur une alliance avec l'impérialisme allemand afin de contrecarrer toute tentative d'expansion de l'Allemagne vers l'Est, Staline tournera casaque au milieu des années 30 pour s'allier avec le bloc "démocratique" (adhésion de l'URSS en 1934 à ce "repaire de brigands" qu'était la SDN, pacte Laval-Staline en 1935, participation des PC aux "fronts populaires" et à la guerre d'Espagne au cours de laquelle les staliniens n'hésiteront pas à user des mêmes méthodes sanguinaires en massacrant les ouvriers et les révolutionnaires qui contestaient leur politique). A la veille de la guerre, Staline retournera de nouveau sa veste et vendra la neutralité de l'URSS à Hitler en échange d'un certain nombre de territoires, avant de rejoindre enfin le camp des "Alliés" en s'engageant à son tour dans la boucherie impérialiste où l'État stalinien sacrifiera, à lui seul, 20 millions de vies humaines. Tel fut le résultat des tractations sordides du stalinisme avec les différents requins impérialistes d'Europe occidentale. C'est sur ces monceaux de cadavres que l'URSS stalinienne a pu se constituer son empire, imposer sa terreur dans tous les États qui vont tomber, avec le traité de Yalta, sous sa domination exclusive. C'est grâce à sa participation à l'holocauste généralisé aux côtés des puissances impérialistes victorieuses que, pour le prix du sang de ses 20 millions de victimes, l'URSS a pu accéder au rang de superpuissance mondiale.
Mais si Staline fut "l'homme providentiel" grâce à qui le capitalisme mondial a pu venir à bout du bolchevisme, ce n'est pas la tyrannie d'un seul individu, aussi paranoïaque fût-il, qui a été le maître d’œuvre de cette effroyable contre-révolution. L'État stalinien, comme tout État capitaliste, est dirigé par la même classe dominante que partout ailleurs, la bourgeoisie nationale. Une bourgeoisie qui s'est reconstituée, avec la dégénérescence interne de la révolution, non pas à partir de l'ancienne bourgeoisie tsariste éliminée par le prolétariat en 1917, mais à partir de la bureaucratie parasitaire de l'appareil d'État avec lequel s'est confondu de plus en plus, sous la direction de Staline, le Parti bolchevique. C'est cette bureaucratie du Parti-État qui, en éliminant à la fin des années 20, tous les secteurs susceptibles de reconstituer une bourgeoisie privée, et auxquels elle s'était alliée pour assurer la gestion de l'économie nationale (propriétaires terriens et spéculateurs de la NEP), a pris le contrôle de cette économie. Telles sont les conditions historiques qui expliquent que, contrairement aux autres pays, le capitalisme d'État en URSS ait pris cette forme totalitaire, caricaturale. Le capitalisme d'État est le mode de domination universel du capitalisme dans sa période de décadence où l'État assure sa mainmise sur toute la vie sociale, et engendre partout des couches parasitaires. Mais dans les autres pays du monde capitaliste, ce contrôle étatique sur l'ensemble de la société n'est pas antagonique avec l'existence de secteurs privés et concurrentiels qui empêchent une hégémonie totale de ces secteurs parasitaires. En URSS, par contre, la forme particulière que prend le capitalisme d'État se caractérise par un développement extrême de ces couches parasitaires issues de la bureaucratie étatique et dont la seule préoccupation n'était pas de faire fructifier le capital en tenant compte des lois du marché, mais de se remplir les poches individuellement au détriment des intérêts de l'économie nationale. Du point de vue du fonctionnement du capitalisme, cette forme de capitalisme d'État était donc une aberration qui devait nécessairement s'effondrer avec l'accélération de la crise économique mondiale. Et c'est bien cet effondrement du capitalisme d'État russe issu de la contre-révolution qui a signé la faillite irrémédiable de toute l'idéologie bestiale qui, pendant plus d'un demi-siècle, avait cimenté le régime stalinien et fait peser sa chape de plomb sur des millions d'êtres humains.
En aucune façon, et quoi qu'en disent la bourgeoisie et ses médias aux ordres, l'hydre monstrueuse du stalinisme ne s'apparente ni au contenu ni à la forme de la révolution d'Octobre 17. Il fallait que celle-ci s'effondre pour que celle-là puisse s'imposer. Cette rupture radicale, cette antinomie entre Octobre et le stalinisme, le prolétariat doit en prendre pleinement conscience."
Destruction du capitalisme ou destruction de l'humanité
Le monde ressemble de plus en plus à un désert jonché de cadavres et des milliards d'êtres humains sont en situation de survie. Chaque jour, près de 20 000 enfants meurent de faim dans le monde, plusieurs milliers d'emplois sont supprimés, laissant des familles dans la détresse ; les baisses de salaires se multiplient pour ceux qui ont encore un travail.
Voilà le "nouvel ordre mondial" promis il y a presque vingt ans par George Bush senior. Il ressemble davantage à un désordre absolu ! Ce terrifiant spectacle invalide totalement cette idée que l'effondrement du bloc de l'Est marquait "la fin de l'histoire" (sous-entendu, le début de l'histoire éternelle du capitalisme) comme le "philosophe" Francis Fukuyama le clamait à l'époque. Il marquait plutôt une étape importante dans la décadence du capitalisme, en signifiant que, confronté de plus en plus durement à ses limites historiques, le système voyait ses parties les plus fragiles s'écrouler définitivement. Mais pour autant, la disparition du bloc de l'Est n'a en rien assaini le système. Les limites sont toujours là et elles menacent toujours plus le cœur même du capitalisme. Chaque nouvelle crise est plus grave que la précédente.
C'est pourquoi la seule leçon qui vaille concernant ces vingt dernières années, c'est bien qu'il ne peut y avoir aucun espoir de paix et de prospérité dans le capitalisme. L'enjeu est, et restera, destruction du capitalisme ou destruction de l'humanité.
Si les campagnes sur "la mort du communisme" ont effectivement porté un coup sévère à la conscience de la classe ouvrière, cette dernière n'étant pas vaincue, il existait la possibilité de récupérer le terrain perdu et de s'engager à nouveau dans un processus de développement de la lutte de classe à l'échelle internationale. Et effectivement, depuis le début des années 2000, face à l'usure des campagnes sur la mort du communisme et de la lutte de classe, et confrontée à des attaques considérables de ses conditions de vie, la classe ouvrière a repris le chemin de la lutte. Cette reprise, qui, d'ores et déjà manifeste un effort minoritaire de politisation à l'échelle internationale, constitue la préparation à des luttes massives qui, dans le futur, dégageront à nouveau la seule perspective pour le prolétariat et l'humanité, le renversement du capitalisme et l'instauration du communisme.
GDS
1. Résolution sur la situation internationale du 18e congrès du CCI [71] publiée dans la Revue internationale n° 138.
2. Voir, entre autres, "la récession de 1993 réexaminée", Persée, revue de l'OCDE, 1994, volume 49, n°1.
3. Elle l'achète même : l'opération d'achat de la société Time Warner par AOL, fournisseur Internet, reste un symbole de l'irrationalité qui s'empare à ce moment de la bourgeoisie.
Récent et en cours:
- Crise économique [13]
- Tensions impérialistes [72]
Courants politiques:
- Stalinisme [73]
Le monde à la veille d'une catastrophe environnementale (II) - Qui est responsable ?
- 4805 lectures
Dans le premier article [74] de cette série sur la question de l’environnement, publié dans la Revue Internationale n° 135, nous avons fait un état des lieux et cherché à montrer la nature du risque auquel est confrontée l’humanité toute entière à travers la mise en évidence des phénomènes les plus menaçants au niveau planétaire que sont :
- l’accroissement de l’effet de serre ;
- la production massive de déchets et les problèmes qui en découlent pour leur gestion ;
- la diffusion sans cesse accrue de produits toxiques et le processus de bioconcentration croissante de ces derniers dans la chaîne alimentaire ;
- l’épuisement des ressources naturelles et/ou le fait qu’elles soient menacées par la pollution.
Nous poursuivons cette série avec ce deuxième article dans lequel nous chercherons à démontrer comment les problèmes d’environnement ne sont pas du ressort de quelques individus ni de quelques entreprises en particulier qui ne respecteraient pas les lois – bien qu’il existe aussi, bien sûr, des responsabilités individuelles ou de certaines entreprises – mais que c’est le capitalisme qui en est le vrai responsable avec sa logique du profit maximum.
Nous chercherons ainsi à illustrer, à travers une série d’exemples, en quoi ce sont les mécanismes spécifiques du capitalisme qui génèrent les problèmes écologiques déterminants, indépendamment de la volonté même de quelque capitaliste que ce soit. Par ailleurs, l’idée couramment répandue selon laquelle le développement scientifique atteint aujourd’hui nous mettrait davantage à l’abri des catastrophes naturelles et concourrait de manière décisive à éviter des problèmes au niveau environnemental, sera fermement combattue. Dans cet article, nous montrerons, en citant largement Bordiga, comment la technologie capitaliste moderne n’est vraiment pas synonyme de sécurité et comment le développement des sciences et de la recherche, n’étant pas déterminé par la satisfaction des besoins humains, mais subordonné aux impératifs capitalistes de la réalisation du maximum de profit, est en fait assujetti aux exigences du capitalisme et de la concurrence sur le marché et, quand c’est nécessaire, de la guerre. Il reviendra au troisième et dernier article d’analyser les réponses données par les différents mouvements des Verts, des écologistes, etc. pour montrer leur inefficacité totale, en dépit de toute la bonne volonté de la plupart de ceux qui s'en revendiquent et militent en leur sein,. la seule solution possible étant, de notre point de vue, la révolution communiste mondiale.
L'identification du problème et de ses causes
Qui est responsable des différents désastres environnementaux ? La réponse à cette question est de la plus haute importance, pas seulement d’un point de vue éthique et moral, mais aussi et surtout parce que l’identification correcte ou erronée de l'origine du problème peut conduire soit à sa résolution correcte soit au contraire à une impasse. Nous allons d’abord commenter une série de lieux communs, de réponses fausses ou partiellement vraies, dont aucune ne réussit vraiment à identifier l’origine et le responsable de la dégradation croissante de l’environnement à laquelle nous assistons jour après jour, pour montrer au contraire comment cette dynamique est elle-même la conséquence, ni volontaire ni consciente mais objective, du système capitaliste.
Le problème ne serait pas aussi grave que ce qu’on veut nous faire croire
Aujourd'hui que les gouvernements se veulent tous plus "verts" les uns que les autres, ce discours – qui a été dominant pendant des décennies - n'est généralement plus celui qu'on entend dans la bouche des hommes politiques. Il demeure néanmoins une position classique dans le monde de l’entreprise qui, face à un danger – menaçant les travailleurs, la population ou l’environnement - lié à une activité donnée, tend à minimiser la gravité du problème tout simplement parce qu'assurer la sécurité au travail signifie dépenser davantage et extorquer moins de profit aux ouvriers. C’est ce qui se vit au quotidien avec des centaines de morts au travail par jour dans le monde, simple coup de la fatalité d’après les employeurs, alors qu'il s'agit d'un authentique produit de l’exploitation capitaliste de la force de travail.
Le problème existe,mais son origine est controversée
La grande quantité de déchets produits par la société actuelle serait, pour certains, le fruit de "notre" frénésie de consommation. Ce qui est en cause, en réalité, c'est une politique économique qui, afin de favoriser une commercialisation plus compétitive des marchandises, tend, depuis des décennies, à minimiser les coûts par un usage massif des emballages non dégradables 1.
Pour certains, la pollution de la planète résulterait d'une carence d’esprit civique face à laquelle il faudrait promouvoir des campagnes de nettoyage des plages, des parcs, etc., en éduquant ainsi la population. Dans le même sens, on invective une partie des gouvernements pour leur incapacité à faire respecter les lois sur le transport maritime, etc. Ou bien encore c'est la mafia et ses trafics de déchets dangereux qu'on incrimine, comme si c’était la mafia qui les produisait et non pas le monde industriel qui, afin de réduire les coûts de production, recourt à la mafia comme simple exécuteur de ses sales affaires. La responsabilité incomberait bien aux industriels, mais seulement aux mauvais, aux cupides…
Quand, finalement, on en arrive à un épisode comme celui de l’incendie à la Thyssen Krupp à Turin en décembre 2007, qui coûta la vie à 7 ouvriers en raison de la totale inobservance des normes de sécurité et de prévention anti-incendie, alors un courant de solidarité se lève, jusqu’au monde de l’industrie, mais uniquement pour avancer l’idée trompeuse selon laquelle, si des catastrophes arrivent, c’est seulement parce qu’il y a des secteurs d'affaires sans scrupules qui s'enrichissent au détriment des autres.
Mais est-ce vraiment le cas ? Y a-t-il, d’un côté, des capitalistes cupides et, de l'autre, ceux qui seraient responsables et de bons gestionnaires de leurs entreprises ?
Le système de production capitaliste, seul responsable de la catastrophe environnementale
Toutes les sociétés d'exploitation ayant précédé le capitalisme ont apporté leur contribution à la pollution de la planète engendrée en particulier par le processus productif. De même, certaines sociétés s'étant livrées à l'exploitation excessive des ressources à leur disposition, comme ce fut probablement le cas des habitants de l'Ile de Pâques 2, ont disparu du fait de l'épuisement de celles-ci. Néanmoins, les nuisances ainsi causées ne constituaient pas, dans ces sociétés, un danger significatif, susceptible de mettre en jeu la survie même de la planète, comme c'est le cas aujourd'hui pour le capitalisme. Une raison en est que, en faisant connaître un bond prodigieux aux forces productives, le capitalisme a également provoqué un bond de même échelle aux nuisances qui en résultent et qui affectent maintenant l'ensemble du globe terrestre, le capital ayant conquis ce dernier dans sa totalité. Mais là n'est pas l'explication la plus fondamentale puisque le développement des forces productives n'est pas en soi nécessairement significatif de l'absence de maîtrise de celles-ci. Ce qui, en effet, est essentiellement en cause, c'est la manière dont ces forces productives sont utilisées et gérées par la société. Or justement, le capitalisme se présente comme l'aboutissement d'un processus historique qui consacre le règne de la marchandise, un système de production universelle de marchandises où tout est à vendre. Si la société est plongée dans le chaos par la domination des rapports marchands, qui n'implique pas seulement le strict phénomène de la pollution mais également l'appauvrissement accéléré des ressources de la planète, la vulnérabilité croissante aux calamités dites "naturelles", etc. c'est pour un ensemble de raisons qui peuvent être résumées de la sorte :
- la division du travail et, plus encore, la production sous le règne de l'argent et du capital divisent l'humanité en une infinité d'unités en concurrence ;
- la finalité n'est pas la production de valeurs d'usage, mais, à travers celles-ci, la production de valeurs d'échange qu'il faut vendre à tout prix, quelles qu'en soient les conséquences pour l'humanité et la planète, de manière à pouvoir faire du profit.
C'est cette nécessité qui, au-delà de la plus ou moins grande moralité de chaque capitaliste, contraint ceux-ci à adapter leur entreprise à la logique de l’exploitation maximale de la classe ouvrière.
Cela conduit à un gaspillage et à une spoliation énormes de la force de travail humaine et des ressources de la planète comme Marx le mettait déjà en évidence dans Le Capital : "Dans l'agriculture moderne, de même que dans l'industrie des villes, l'accroissement de productivité et le rendement supérieur du travail s'achètent au prix de la destruction et du tarissement de la force de travail. En outre, chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol ; chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps, [est] un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité (…). La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur. (Marx, Le Capital, Volume 1, Chap. 15, "Machinisme et grande industrie", par. 10 "Grande industrie et agriculture", www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-15-10.htm [75])
Comble de l'irrationalité et de l'absurdité de la production sous le capitalisme, il n'est pas rare de trouver des entreprises qui fabriquent des produits chimiques fortement polluants et, en même temps, des systèmes de purification des terrains et des eaux contre les mêmes polluants ; d'autres qui fabriquent des cigarettes et des produits pour empêcher de fumer et, enfin, certaines encore qui contrôlent des secteurs de production d’armes mais qui s’occupent aussi de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales.
On atteint ici des sommets qui n'existaient pas dans les sociétés antérieures où les biens étaient essentiellement produits pour leur valeur d’usage (ou bien ils étaient utiles à leurs producteurs, les exploités, ou bien ils servaient la splendeur de la classe dominante).
La nature réelle de la production de marchandises interdit au capitaliste de pouvoir s’intéresser à l’utilité, au genre ou à la composition des marchandises produites. La seule chose qui doit l’intéresser est de savoir comment gagner de l’argent. Ce mécanisme explique pourquoi nombre de marchandises n’ont qu’une utilité limitée, quand elles ne sont pas carrément totalement inutiles.
La société capitaliste étant essentiellement basée sur la concurrence, même lorsque les capitalistes trouvent des accords circonstanciels, ils demeurent fondamentalement et férocement concurrents : la logique du marché veut en fait que la fortune de l’un corresponde à l’infortune des autres. Ceci signifie que chaque capitaliste produit pour lui-même, que chacun d’entre eux est rival de tous les autres et qu’il ne peut y avoir de planification réelle décidée par tous les capitalistes, localement ou internationalement, mais seulement une compétition permanente avec des gagnants et des perdants. Et dans cette guerre, un des perdants est précisément la nature.
En fait, dans le choix d’un site pour implanter une nouvelle installation industrielle ou d'un terrain et des modalités d’une culture agricole, l’entrepreneur ne tient compte que de ses intérêts immédiats et aucune place n’est laissée aux considérations d’ordre écologique. Il n'existe aucun organe centralisé au niveau international qui ait l’autorité de donner une orientation ou d’imposer des limites ou des critères à respecter. Dans le capitalisme, les décisions sont uniquement prises en fonction de la réalisation du profit maximum de façon que, par exemple, un capitaliste particulier puisse produire et vendre de la manière la plus profitable ou en plus grande quantité, ou que l’État puisse imposer au mieux ce qui va dans le sens des intérêts du capital national et donc, globalement, des capitalistes nationaux.
Des législations existent cependant au niveau de chaque pays où elles sont plus ou moins contraignantes. Lorsqu'elles le sont trop, il n'est pas rare que, pour augmenter sa rentabilité, telle entreprise expatrie une partie de sa production là où les normes sont moins sévères. Ainsi, Union Carbide, multinationale chimique américaine avait implanté une de ses usines à Bhopal, en Inde, sans la doter d'un système de réfrigération. En 1984, cette usine laissait échapper un nuage chimique toxique de 40 tonnes de pesticides qui a tué, immédiatement et dans les années suivantes, au moins 16 000 personnes, causant des dommages corporels irrémédiables à un million d'autres 3. Quant aux régions et aux mers du tiers-monde, elles constituent souvent un dépotoir bon marché où, légalement ou non, des compagnies établies dans des pays développés expédient leurs déchets dangereux ou toxiques, alors qu'il leur en coûterait beaucoup plus cher de s'en débarrasser dans leur pays d'origine.
Tant qu’il n'existera pas de planification agricole et industrielle coordonnée et centralisée au niveau international, qui prenne en compte l’harmonisation nécessaire des exigences d’aujourd’hui et la sauvegarde de l’environnement de demain, alors les mécanismes du capitalisme continueront à détruire la nature avec toutes les conséquences dramatiques que nous avons vues.
Il est courant que la responsabilité de cet état de fait soit imputée aux multinationales ou à un secteur particulier de l’industrie, du fait que les origines du problème se trouvent dans les mécanismes "anonymes" du marché.
Mais, l’état pourrait-il mettre fin à cette folie au moyen d’un interventionnisme accru ? En fait, non, parce que l’état ne peut que "réguler" cette anarchie. Ainsi, en défendant les intérêts nationaux, l’état contribue à renforcer la concurrence. Contrairement aux revendications des ONG (Organisations non gouvernementales) et du mouvement altermondialiste, une intervention accrue de l’état - laquelle d'ailleurs ne s'est jamais démentie malgré certaines apparences passées du "libéralisme" et comme le révèle, de façon évidente, l'interventionnisme étatique face à l'accélération présente de la crise économique - n'est pas en mesure de résoudre les problèmes de l'anarchie capitaliste.
Quantité contre qualité
L’unique préoccupation des capitalistes est, comme on l'a vu, de vendre avec un profit maximum. Mais ce qui est en question, ce n’est pas l’égoïsme des uns ou des autres, mais bien une loi du système à laquelle aucune entreprise, petite ou grande, ne peut se soustraire. Le poids croissant des coûts d’équipement sur la production industrielle implique que les investissements énormes ne peuvent être amortis que par des ventes très importantes.
Par exemple, l’entreprise Airbus, fabriquant d’avions, doit vendre au moins 600 de ses gigantesques A 380 avant de réaliser des profits. De la même façon, les entreprises productrices d'automobiles doivent vendre des centaines de milliers de voitures avant de compenser la dépense affectée aux équipements qui en permettent la construction. Bref, chaque capitaliste doit vendre le plus possible et être constamment à la recherche de nouveaux marchés. Mais pour cela, il doit pouvoir s'imposer face à ses concurrents dans un marché saturé, ce qu'il fait à travers une débauche des moyens publicitaires qui sont la source d'un gaspillage énorme de travail humain et de ressources naturelles comme, par exemple, la pâte à bois engloutie dans la production de milliers de tonnes de prospectus.
Ces lois de l’économie (qui contraignent à la réduction des coûts, impliquant une diminution conséquente de la qualité de la production et de la fabrication en série) impliquent que le capitaliste est bien loin de se préoccuper de la composition de ses produits et de se demander si celle-ci peut être dangereuse. Ainsi, bien que les risques des carburants fossiles pour la santé (cause de cancer) soient connus depuis longtemps, l’industrie ne prend aucune mesure pour y remédier. Les risques sanitaires liés à l’amiante ont été reconnus depuis des années. Mais seule l’agonie et la mort de milliers d’ouvriers ont contraint l’industrie à réagir longtemps après. Beaucoup d’aliments sont enrichis en sucre et en sel, en glutamate monosodique, afin d’en augmenter la vente, aux dépens des conséquences sur la santé. Une incroyable quantité d'additifs alimentaires sont introduits dans les aliments sans que soient vraiment connus les risques qui en résultent pour les consommateurs alors qu'il est notoire que beaucoup de cancers sont imputables à la nutrition.
Quelques irrationalités notoires de la production et de la commercialisation
Un des aspects les plus irrationnels du système actuel de production est le fait que les marchandises voyagent tout autour de la planète avant d’arriver sur le marché sous forme de produit fini. Ceci n’est pas lié à la nature des marchandises ou à une exigence de production, mais exclusivement au fait que la sous-traitance est plus avantageuse dans tel ou tel pays. Un exemple célèbre est celui de la fabrication des yoghourts : le lait est transporté à travers les Alpes, de l’Allemagne vers l’Italie, où il est transformé en yoghourt pour être re-transporté sous cette forme, de l’Italie vers l’Allemagne. Un autre exemple concerne les automobiles dont chaque composant provient de différents pays du monde avant d’être assemblé sur une chaîne de montage. En général, avant qu’un bien soit disponible sur le marché, ses composants ont déjà parcouru des milliers de kilomètres par les moyens les plus divers. Ainsi, par exemple, les appareils électroniques ou ceux d’usage domestique sont produits en Chine en raison des très bas salaires pratiqués dans ce pays et de l’absence quasi-totale de mesures de protection de l’environnement, même si, d’un point de vue technologique, il aurait été facile de les produire dans les pays où ils sont commercialisés. Souvent, le lancement de leur production a eu lieu, au début, dans le pays consommateur pour être ensuite délocalisée dans un autre pays où les coûts de production, et surtout les salaires, sont plus bas.
Nous avons aussi l’exemple des vins, produits au Chili, en Australie ou en Californie et vendus sur les marchés européens tandis que le raisin produit en Europe pourrit en raison de la surproduction, ou encore l’exemple des pommes importées d’Afrique tandis que les cultivateurs européens ne savent plus que faire de leur excédent de production de pommes.
Ainsi, à cause de la logique du profit maximum au détriment de celle de la rationalité et du recours minimum aux dépenses humaines, énergétiques et naturelles, les marchandises sont produites quelque part sur la planète pour être ensuite transportées dans une autre partie du monde afin d’y être vendues. Il n’y a plus à s’étonner, dès lors, que des marchandises de même valeur technologique, comme les automobiles, produites par différents fabricants dans le monde, soient construites en Europe pour être ensuite exportées au Japon ou aux États-Unis, tandis que, simultanément, d’autres automobiles, construites au Japon ou en Corée, sont vendues sur le marché européen. Ce réseau de transport de marchandises – quelquefois très semblables entre elles – qui changent de pays uniquement afin d’obéir à la logique du profit, de la concurrence et du jeu du marché, est totalement aberrant et à l’origine de conséquences désastreuses sur l’environnement.
Une planification rationnelle de la production et de la distribution pourrait rendre ces biens disponibles sans qu’ils aient à subir ces transports totalement irrationnels, expression de la folie du système de production capitaliste.
L’antagonisme de fond entre ville et campagne
La destruction de l’environnement résultant de la pollution due à l'hypertrophie des transports n'est pas un simple phénomène contingent puisqu'il puise ses racines les plus profondes dans l’antagonisme entre ville et campagne. A l'origine, la division du travail à l’intérieur des nations a séparé l’industrie et le commerce du travail agricole. De là est née l’opposition entre ville et campagne avec les antagonismes d’intérêts qui en résultent. C'est sous le capitalisme que cette opposition atteint le paroxysme de ses aberrations 4.
A l’époque des exploitations agricoles du Moyen Age, dévolues à la seule production de subsistance, on voyait difficilement la nécessité de transporter des marchandises. Au début du 19e siècle, lorsque les ouvriers vivaient le plus souvent près de l’usine ou de la mine, il était possible de s'y rendre à pied. Depuis, cependant, la distance entre les lieux de travail et d’habitation a augmenté. De plus, la concentration des capitaux dans certaines localités (comme dans le cas d’entreprises implantées dans certaines zones industrielles ou autres zones inhabitées, afin de profiter de dégrèvements fiscaux ou du prix particulièrement bas des terrains), la désindustrialisation et l’explosion du chômage liée à la perte de nombreux postes de travail, ont profondément modifié la physionomie des transports.
Ainsi, chaque jour, des centaines de millions de travailleurs doivent se déplacer sur des distances très longues pour aller au travail. Beaucoup d’entre eux doivent utiliser une automobile parce que, souvent, les transports publics ne leur permettent pas de se rendre sur leur lieu de travail.
Mais il y a pire encore : la concentration d’une grande masse d’individus au même endroit a pour conséquence une série de problèmes qui agissent encore une fois sur l’état sanitaire de l’environnement de certaines zones. Le fonctionnement d’une concentration de personnes qui peut atteindre jusqu’à 10-20 millions d’individus suppose une accumulation de déchets (matières fécales, ordures ménagères, gaz d’échappement des véhicules, de l’industrie et du chauffage…) dans un espace qui, aussi vaste soit-il, reste toutefois trop étroit pour en détruire et digérer la charge.
Le cauchemar de la pénurie alimentaire et en eau
Avec le développement du capitalisme, l’agriculture a subi les plus profonds changements de son histoire, vieille de 10 000 ans. Ceci est advenu parce que, dans le capitalisme, contrairement aux modes de production précédents où l'agriculture répondait directement à des besoins directs, les agriculteurs doivent se soumettre aux lois du marché mondial, ce qui signifie produire à moindre frais. La nécessité d’augmenter la rentabilité a eu des conséquences catastrophiques sur la qualité des sols.
Ces conséquences, qui sont inséparablement liées à l’apparition d’un fort antagonisme entre ville et campagne, ont déjà été dénoncées par le mouvement ouvrier du 19e siècle. On peut voir, dans les citations suivantes, comment Marx a pointé le lien inséparable entre l’exploitation de la classe ouvrière et le saccage du sol : "La grande propriété foncière décime de plus en plus la population agricole et lui oppose une population industrielle de plus en plus dense, concentrée dans les grandes villes. Elle engendre ainsi des conditions qui provoquent une rupture immédiate de l'équilibre de l'échange social des matières tel qu'il est commandé par les lois naturelles de la vie, et qui aboutissent au gaspillage des forces productives de la terre, gaspillage que le commerce étend bien au delà des frontières d'un pays." (Marx, Le Capital, Volume 3, Chap. 47. "Genèse de la rente foncière capitaliste", "Introduction" - www.marxists.org [76])
L’agriculture a dû constamment accroître l'utilisation des produits chimiques pour intensifier l’exploitation des sols et étendre les aires de culture. Ainsi, dans la majeure partie de la planète, les paysans pratiquent des cultures qui seraient impossibles sans l'apport de grandes quantités de pesticides et engrais, ni sans irrigation, alors qu’en plantant ailleurs, on pourrait se passer de ces moyens ou, du moins, en faire un usage réduit. Planter des herbes médicinales en Californie, des agrumes en Israël, du coton autour de la Mer d’Aral en ex-Union Soviétique, du froment en Arabie Saoudite ou au Yémen, c'est-à-dire planter des cultures dans des régions qui n’offrent pas les conditions naturelles à leur croissance, se traduit par un énorme gaspillage d’eau. La liste des exemples est vraiment sans fin puisque, actuellement, environ 40% des produits agricoles dépendent de l’irrigation, avec la conséquence que 75% de l’eau potable disponible sur la terre est utilisée par l’agriculture.
Par exemple, l'Arabie Saoudite a dépensé une fortune pour pomper l’eau d’une nappe souterraine et viabiliser un million d’hectares de terre dans le désert pour cultiver du froment. Pour chaque tonne de froment cultivé, le gouvernement fournit 3000 m3 d’eau, soit plus de trois fois plus que ce que nécessite la culture de cette céréale. Et cette eau provient de puits qui ne sont pas alimentés par l’eau de pluie. Un tiers de toutes les entreprises d’irrigation du monde utilise l’eau des nappes. Et, bien que ces ressources non renouvelables soient en voie d'assèchement, les cultivateurs de la région indienne de Gujarat, assoiffée de pluie, persistent dans l’élevage de vaches laitières, qui nécessite 2000 litres d’eau pour produire un seul litre de lait ! Dans certaines régions de la terre, la production d’un kilo de riz requiert jusqu’à 3000 litres d’eau. Les conséquences de l’irrigation et de l’usage généralisé de produits chimiques sont désastreuses : salinisation, overdose d’engrais, désertification, érosion des sols, forte baisse du niveau d’eau dans les nappes et, par conséquent, épuisement des réserves d’eau potable.
Le gaspillage, l’urbanisation, la sécheresse et la pollution aiguisent la crise mondiale de l’eau. Des millions et des millions de litres d’eau s’évaporent en transitant par des canaux d’irrigation ouverts. Les zones autour des mégapoles, surtout, mais aussi des étendues entières de terre voient leurs réserves en eau baisser rapidement et de façon irréversible.
Dans le passé, la Chine était le pays de l’hydrologie. Son économie et sa civilisation se sont développées grâce à sa capacité à irriguer les terres arides et à construire les barrages pour protéger le pays des inondations. Mais, dans la Chine d’aujourd’hui, les eaux du puissant Fleuve Jaune, la grande artère du Nord, n'atteignent pas la mer durant plusieurs mois de l’année. 400 des 660 villes de la Chine manquent d’eau. Un tiers des puits de la Chine sont à sec. En Inde, 30% des terres cultivables sont menacées de salinisation. Dans le monde entier, environ 25% des terres agricoles sont menacées par ce fléau.
Mais la culture de produits agricoles dans des régions qui, à cause de leur climat ou de la nature de leur sol, n'y sont pas adaptées, n’est pas l’unique absurdité de l’agriculture actuelle. En particulier, à cause de la pénurie d’eau, le contrôle des fleuves et des digues est devenu une question stratégique fondamentale vis-à-vis de laquelle les États nationaux interviennent inconsidérément aux dépens de la nature.
Plus de 80 pays ont déjà signalé une raréfaction de l’eau les concernant. Selon une prévision de l’ONU, le nombre de personnes qui devront vivre dans des conditions de pénurie d’eau atteindra 5,4 milliards au cours des 25 prochaines années. Malgré la disponibilité importante de terres agricoles, les terres réellement cultivables du monde diminuent constamment à cause de la salinisation et d’autres facteurs. Dans les sociétés antiques, les tribus nomades devaient se déplacer quand l’eau devenait rare. Dans le capitalisme, ce sont les denrées alimentaires de première nécessité qui manquent, bien que ce système soit soumis à la surproduction. Ainsi, à cause des multiples dégâts causés à l’agriculture, la pénurie alimentaire est inévitable. A partir de 1984 par exemple, la production mondiale de céréales n’a pas suivi la croissance de la population mondiale. En l’espace de 20 ans, cette production s’est effondrée, passant de 343 kg par an et par personne à 303.
Ainsi, le spectre qui a toujours accompagné l’humanité, depuis son origine, le cauchemar de la pénurie alimentaire, semble revenir à la charge, non par manque de terres cultivables ou par manque de moyens et d'outils à mettre au service de l'agriculture, mais à cause de l’irrationalité absolue dans l’utilisation des ressources terrestres.
Une technologie plus avancée ne garantit pas plus de sécurité
S’il est vrai que le développement des sciences et de la technologie met à la disposition de l'humanité des instruments dont on ne pouvait même pas imaginer l'existence dans le passé et qui permettent de prévenir les accidents et les catastrophes naturelles, il est aussi vrai que l’utilisation de ces technologies est coûteuse et n’est mise en œuvre que s’il y a une retombée économique. Nous voulons souligner une fois encore que ce n'est pas ici une attitude égoïste et cupide de telle ou telle entreprise qui est en cause, mais bien la nécessité imposée à n’importe quelle entreprise ou pays de réduire au minimum les coûts de production des marchandises ou des services pour pouvoir soutenir la concurrence mondiale.
Dans notre presse, nous avons souvent abordé ce problème, en montrant comment les prétendues catastrophes naturelles ne sont pas dues au hasard ou à la fatalité, mais sont le résultat logique de la réduction des mesures de prévention et de sécurité, en vue de faire des économies. Voila ce que nous écrivions par exemple à propos des catastrophes engendrées par l’ouragan Katrina à la Nouvelle Orléans en 2005 :
"L'argument selon lequel cette catastrophe n'était pas prévue est aussi un non-sens. Depuis presque 100 ans, scientifiques, ingénieurs et politiciens ont discuté de la façon de faire face à la vulnérabilité de la Nouvelle Orléans vis-à-vis des cyclones et des inondations. Au milieu des années 1980, plusieurs projets ont été développés par différents groupes de scientifiques et d'ingénieurs, ce qui a finalement mené à une proposition, en 1998 (sous l'administration Clinton), appelée Coast 2050. Ce projet comprenait le renforcement et le réaménagement des digues existantes, la construction d'un système d'écluses et la création de nouveaux canaux qui amèneraient des eaux remplies de sédiments afin de restaurer les zones marécageuses tampon du delta ; ce projet requérait un investissement de 14 milliards de dollars sur une période de 10 ans. Il ne reçut pas l'approbation de Washington, non pas sous Bush mais sous Clinton.
L'an dernier, l'armée a demandé 105 millions de dollars pour des programmes de lutte contre les cyclones et les inondations à la Nouvelle Orléans, mais le gouvernement ne lui a accordé que 42 millions. Au même moment, le Congrès approuvait un budget de 231 millions de dollars pour la construction d'un pont vers une petite île inhabitée d'Alaska" 5.
Nous avons aussi dénoncé le cynisme et la responsabilité de la bourgeoisie à propos de la mort de 160 000 personnes lors du tsunami qui s’est produit le 26 décembre 2004.
En fait, il est clairement reconnu aujourd’hui, de façon officielle, que l’alerte n’a pas été lancée de crainte de… porter atteinte au secteur du tourisme ! Autrement dit, c’est pour défendre de sordides intérêts économiques et financiers que des dizaines de milliers d'êtres humains ont été sacrifiés.
Cette irresponsabilité des gouvernements est une nouvelle illustration du mode de vie de cette classe de requins qui gère la vie et l'activité productive de la société. Les États bourgeois sont prêts à sacrifier autant de vies humaines, si cela est nécessaire, pour préserver l’exploitation et les profits capitalistes.
Ce sont toujours les intérêts capitalistes qui dictent la politique de la classe dominante, et dans le capitalisme, la prévention n’est pas une activité rentable comme le reconnaissent aujourd'hui tous les médias : "Des pays de la région auraient jusqu’ici fait la sourde oreille pour mettre sur pied un système d’alerte en raison des énormes coûts financiers. Selon les experts, un dispositif d’alerte coûterait des dizaines de millions de dollars, mais il permettrait de sauver des dizaines de milliers de vies humaines." (Les Échos du 30/12) 6
On peut encore prendre l’exemple du pétrole qui se déverse chaque année en mer (déversements intentionnels et accidentels, sources endogènes, apports des fleuves, etc.) : on parle de 3 à 4 millions de tonnes de pétrole par an. Selon un rapport de Legambiente : "En analysant les causes de ces incidents, il est possible d’évaluer à 64% des cas ceux qui sont imputables à une erreur humaine, 16% à des pannes mécaniques et 10% à des problèmes de structure des bateaux, tandis que les 10 % restant ne sont pas attribuables à des causes bien déterminées" 7.
On comprend facilement que, lorsqu'on parle d’erreur humaine – comme par exemple dans le cas des accidents de chemin de fer attribués aux cheminots – on parle d’erreurs commises par le machiniste parce qu’il travaille dans des conditions d’épuisement prononcé et de fort stress. Par ailleurs, les compagnies pétrolières ont l’habitude de faire naviguer des pétroliers, même vieux et décrépis, pour transporter l’or noir puisque, en cas de naufrage, ils perdent au maximum la valeur d'un chargement, alors qu’acquérir un nouveau bateau coûterait énormément plus. C’est pourquoi le spectacle de pétroliers qui se brisent à moitié au voisinage des côtes en déversant tout leur chargement est devenu quelque chose de courant. On peut affirmer, en prenant tout en compte, qu’au moins 90% des marées noires sont la conséquence d'un manque absolu de vigilance des compagnies pétrolières, ce qui, une fois de plus, est la conséquence de l’intérêt qu'elles ont à réduire au minimum les dépenses et augmenter au maximum les marges de profit.
On doit à Amadeo Bordiga 8, dans la période suivant la Seconde Guerre mondiale, une condamnation systématique, incisive, profonde et argumentée des désastres causés par le capitalisme. Dans la préface au livre Drammi gialli e sinistri della moderna decadenza sociale, qui est un recueil d’articles d’Amadeo Bordiga, on peut lire: "...à mesure que le capitalisme se développe puis pourrit sur pied, il prostitue de plus en plus cette technique qui pourrait être libératrice, à ses besoins d'exploitation, de domination et de pillage impérialiste, au point d'en arriver à lui transmettre sa propre pourriture et à la retourner contre l'espèce. (...) C'est dans tous les domaines de la vie quotidienne des phases "pacifiques" qu'il veut bien nous consentir entre deux massacres impérialistes ou deux opérations de répression que le capital, aiguillonné sans trêve par la recherche d'un meilleur taux de profit, entasse, empoisonne, asphyxie, mutile, massacre les individus humains par l'intermédiaire de la technique prostituée. (...) Le capitalisme n'est pas innocent non plus des catastrophes dites "naturelles". Sans ignorer l'existence de forces de la nature qui échappent à l'action humaine, le marxisme montre que bien des cataclysmes ont été indirectement provoqués ou aggravés par des causes sociales. (...) Non seulement la civilisation bourgeoise peut provoquer directement ces catastrophes par sa soif de profit et par l'influence prédominante de l'affairisme sur la machine administrative (...), mais elle se révèle incapable d'organiser une protection efficace dans la mesure où la prévention n'est pas une activité rentable.". 9
Bordiga démystifie la légende selon laquelle : "la société capitaliste contemporaine, avec le développement conjoint des sciences, de la technique et de la production mettrait l’espèce humaine en excellente condition pour lutter contre les difficultés du milieu naturel" 10. En fait, ajoute Bordiga, "s’il est vrai que le potentiel industriel et économique du monde capitaliste s’accroît et ne s’infléchit pas, il est tout aussi vrai que plus grande est sa force, pires sont les conditions de vie des masses humaines face aux cataclysmes naturels et historiques." 11 Pour démontrer ce qu’il avance, Bordiga analyse toute une série de désastres qui se sont produits de par le monde en mettant en évidence à chaque fois qu’ils n’étaient pas dus au hasard ou à la fatalité, mais à la tendance intrinsèque du capitalisme à tirer le maximum de profit en investissant le moins possible comme, par exemple, dans le cas du naufrage du Flying Enterprise.
"Le tout nouveau bateau luxueux que Carlsen faisait briquer de façon à ce qu’il brille comme un miroir et qui devait faire une traversée archi-sûre, était à quille plate. (…) Comment se fait-il que les chantiers très modernes de Flying aient adopté la quille plate, celle des barques lacustres ? Un journal le dit en toutes lettres : pour réduire le coût unitaire de production. (…) On a ici la clef de toute la science appliquée moderne. Ses études, ses recherches, ses calculs, ses innovations ont cela pour but : réduire les coûts, augmenter les frais d’affrètement. De là, le faste des salons à miroirs et tentures pour attirer le client fortuné, radinerie de pouilleux en ce qui concerne les structures à la limite de la cohésion mécanique, de l’exiguïté des dimensions et du poids. Cette tendance caractérise toute l’ingénierie moderne, du bâtiment à la mécanique, c'est-à-dire soigner une présentation qui fait riche, pour "épater le bourgeois", des compléments et des finitions que n’importe quel idiot puisse admirer (ayant de plus justement une culture de pacotille acquise au cinéma et dans les périodiques illustrés) et lésiner de façon indécente sur la solidité des structures portantes, invisibles et incompréhensibles pour le profane". 12
Que les désastres analysés par Bordiga n'aient pas de conséquences écologiques ne change rien à l'affaire. En effet, à travers ceux-ci, et à travers également ceux qui sont exposés dans la préface de ses articles dans Espèce humaine et croûte terrestre dont nous citons quelques exemples, on peut imaginer sans peine les effets de la même logique capitaliste lorsqu'elle est à l'œuvre dans des domaines ayant un impact direct et décisif sur l'environnement, comme par exemple la conception et la maintenance des centrales nucléaires : "Dans les années 60, plusieurs avions "Comet" britanniques, dernier cri de la technique la plus sophistiquée, explosent en plein vol, tuant tous les passagers : la longue enquête révèle finalement que les explosions étaient dues à la fatigue du métal de la cellule, qui était trop mince car il fallait économiser sur le métal, la puissance des réacteurs, l’ensemble des coûts de production, pour augmenter le profit. En 1974, l’explosion d’un DC10 au dessus d’Ermenonville fait plus de 300 morts : on savait que le système de fermeture de la soute à bagages était défectueux mais le refaire aurait coûté de l'argent… Mais le plus hallucinant est rapporté par la revue anglaise The Economist (24-9-1977) après la découverte de craquelures dans le métal sur dix avions Trident et l’explosion inexplicable d’un Boeing : selon la "nouvelle conception" qui préside à la construction des avions de transport, ceux-ci ne sont plus arrêtés pour révision complète après un certain nombre d’heures de vol, mais sont censés "sûrs" … jusqu’à l’apparition des premières craquelures dues à la "fatigue" du métal : on peut donc les user "jusqu'au bout" de ce qu'ils peuvent donner, alors qu'en les arrêtant trop tôt pour révision, les compagnies perdaient de l' argent !" 13 Nous avons déjà évoqué, dans l'article précédent de cette série, le cas de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Dans le fond, c'est le même problème qui est en cause, et qui l'était également en 1979 lors de la fusion d'un réacteur nucléaire sur l'île de Three Mile Island, en Pennsylvanie aux États-Unis.
La science au service du développement de la société capitaliste
En fait, la compréhension de la place de la technique et de la science au sein de la société capitaliste est de la plus haute importance quant à la question de savoir si, oui ou non, celles-ci peuvent constituer un point d'appui pour prévenir l'avancée du désastre écologique en marche et lutter efficacement dès à présent contre certaines de ses manifestations.
Si la technique est, comme on vient de le voir, prostituée aux exigences du marché, en est-il de même concernant le développement des sciences et de la recherche scientifique ? Est-il possible de faire en sorte que celui-ci reste en dehors de tout intérêt partisan ?
Pour répondre à cette question, nous devons partir de la reconnaissance du fait que la science est une force productive, que son développement permet à une société de se développer plus rapidement, d’augmenter ses ressources. Le contrôle du développement des sciences n’est, en conséquence, pas indifférent - et ne peut l'être - aux gestionnaires de l’économie, au niveau étatique comme au niveau des entreprises. C’est la raison pour laquelle la recherche scientifique, et certains de ses secteurs en particulier, bénéficient de financements importants. La science n’est donc pas – et elle ne pourrait l’être au sein d’une société de classe comme le capitalisme – un secteur neutre dans lequel il existerait une liberté pour la recherche et qui serait épargné par les intérêts économiques, pour la simple raison que la classe dominante a tout à gagner à assujettir la science et le monde scientifique à ses propres intérêts. On peut vraiment affirmer que le développement des sciences et de la connaissance – à l’époque capitaliste – n'est pas mû par une dynamique autonome et indépendante mais est subordonné à l'objectif de réaliser le maximum de profit.
Cela a des conséquences très importantes dont on ne s’aperçoit que rarement. Prenons par exemple le développement de la médecine moderne. L’étude et le traitement médical de l’être humain ont été fractionnés en dizaines de spécialités différentes, auxquelles il manque en dernière analyse une vision d’ensemble du fonctionnement de l’organisme humain. Pourquoi en est-on arrivé là ? Parce que le but principal de la médecine, dans le monde capitaliste, n’est pas que chaque personne vive bien, mais de "réparer" la "machine humaine" quand elle tombe en panne et la remettre d’aplomb le plus rapidement possible pour qu’elle retourne au travail. Dans ce cadre, on comprend bien le recours massif aux antibiotiques, les diagnostics qui cherchent toujours les causes des maladies parmi des facteurs spécifiques plutôt que dans les conditions générales de vie des personnes examinées.
Une autre conséquence de la dépendance du développement scientifique vis-à-vis de la logique du monde capitaliste est que la recherche est constamment tournée vers la production de nouveaux matériaux (plus résistants, moins chers) dont l’impact du point de vue toxicologique n’a jamais représenté un gros problème … dans l'immédiat, permettant qu’on ne dépense que très peu ou rien au niveau scientifique pour chercher à éliminer ou rendre inoffensif ce qui menace la sécurité dans les produits. Mais des décennies plus tard, il faut payer l'addition, le plus souvent en termes de dommages aux êtres humains.
Le lien le plus fort est celui qui existe entre la recherche scientifique et les besoins du secteur militaire et de la guerre en particulier. Nous pouvons examiner à ce niveau quelques exemples concrets qui concernent les différents domaines de la science, en particulier celui qui pourrait paraître "le plus pur" scientifiquement parlant, celui des mathématiques !
Dans les citations qui suivent, on peut voir jusqu’où le développement scientifique est soumis au contrôle de l’État et aux exigences militaires, au point que, dans l’après-guerre, ont fleuri un peu partout "les commissions" de scientifiques qui travaillaient secrètement pour le pouvoir militaire en y consacrant une partie importante de leur temps, les autres scientifiques ignorant le but final des recherches ainsi menées de façon occulte :
"L’importance des mathématiques pour les officiers de la marine de guerre et de l’artillerie requérait une éducation spécifique en mathématique ; ainsi au 17e siècle, le groupe le plus important pouvant se réclamer d’un savoir en mathématiques, au moins de base, était celui des officiers de l’armée. (...) (Dans la Grande Guerre) de nombreuses nouvelles armes ont été créées et perfectionnées au cours de la guerre – avions, sous-marins, sonars pour combattre ces derniers, armes chimiques. Après quelques hésitations de la part des appareils militaires, de nombreux scientifiques furent employés pour essayer de développer le militaire, même si ce n’était pas pour faire de la recherche, mais comme ingénieurs créatifs au plus haut niveau. (…) En 1944, trop tard pour devenir efficace pendant la Deuxième Guerre, le "Matematisches Forschunginstitut Oberwolfach" fut créé en Allemagne. Cela ne fait pas tellement plaisir aux mathématiciens allemands mais c’était une structure très bien conçue, qui avait pour but de faire de tout le secteur des mathématiques un secteur "utile" : le noyau était constitué d’un petit groupe de mathématiciens qui étaient tout à fait au courant des problèmes posés aux militaires, et donc en mesure de détecter les problèmes qui pouvaient se résoudre mathématiquement. Autour de ce noyau, d’autres mathématiciens, très compétents et qui connaissaient bien tout le milieu des mathématiques, devaient traduire ces problèmes en problèmes mathématiques et les donner à traiter sous cette forme à des mathématiciens spécialisés (qui n’avaient pas besoin de comprendre le problème militaire qui était à l’origine, ni même de le connaître). Ensuite, le résultat obtenu, on faisait fonctionner le réseau à l’envers.
Aux États-Unis, une structure semblable, même si elle était un peu improvisée, fonctionnait déjà autour de Marston Morse pendant la guerre. Dans l’après-guerre, une structure tout à fait analogue et qui cette fois n'était pas improvisée, se trouvait dans le "Wisconsin Army Mathematics Research Center" (…).
L’avantage de telles structures est de permettre à la machine militaire d’exploiter les compétences de beaucoup de mathématiciens sans avoir besoin de "les avoir à la maison" avec tout ce que cela comporte : contrat, nécessité de consensus et de soumission, etc." 14
En 1943, ont été institués aux États-Unis des groupes de recherche opérationnelle spécifiquement dédiés à la guerre anti-submersible, au dimensionnement des convois navals, au choix des cibles des incursions aériennes, au repérage et à l’interception des avions ennemis. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, plus de 700 mathématiciens en tout ont été employés au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis.
"Comparée à la recherche britannique, la recherche américaine est caractérisée depuis le début par un usage plus sophistiqué des mathématiques et, en particulier, du calcul des probabilités et par un recours plus fréquent à la modélisation (…). La recherche opérationnelle (qui deviendra dans les années 50 une branche autonome des mathématiques appliquées) a donc fait ses premiers pas au travers de difficultés stratégiques et d’optimisation des ressources guerrières. Quelle est la meilleure tactique de combat aérien ? Quelle est la meilleure disposition d’un certain nombre de soldats à certains points d’attaque ? Comment peut-on distribuer les rations aux soldats en en gaspillant le moins possible et en les rassasiant au mieux ?" 15 "(…) Le projet Manhattan a été le signal d’un grand tournant, non seulement parce qu’il concentrait le travail de milliers de scientifiques et de techniciens de multiples domaines sur un projet unique, dirigé et contrôlé par les militaires, mais parce qu’il représentait aussi un bond énorme pour la recherche fondamentale, inaugurant ce qu’on appelé par la suite la big science. (…) L’enrôlement de la communauté scientifique pour un travail sur un projet précis, sous le contrôle direct des militaires, avait été une mesure d’urgence, mais ne pouvait durer éternellement, pour de nombreuses raisons (dont la dernière n’était pas la "liberté de la recherche" réclamée par les scientifiques). Mais par ailleurs, le Pentagone ne pouvait se permettre de renoncer à la coopération précieuse et indispensable de la communauté scientifique, ni à une forme de contrôle de son activité : il fallait, par la force des choses, mettre au point une stratégie différente et changer les termes du problème. (…) En 1959, à l’initiative d’un ensemble de scientifiques reconnus, consultants auprès du gouvernement des États-Unis, un groupe semi permanent d’experts était créé, groupe qui tenait des réunions d’étude régulières. Ce groupe reçut le nom de "Division Jason", du nom du héros grec mythique parti à la recherche aventureuse de la toison d’or avec les Argonautes, Jason. Il s’agit d’un groupe d’élite d’une cinquantaine d’éminents scientifiques, parmi lesquels plusieurs prix Nobel, qui se rencontrent chaque été pendant quelques semaines pour examiner en toute liberté les problèmes liés à la sécurité, à la défense et au contrôle des armements mis en place par le Pentagone, le Département de l’Énergie et d’autres agences fédérales ; ils fournissent des rapports détaillés qui restent en grande partie "secrets" et influencent directement la politique nationale. La Division Jason a joué un rôle de premier plan, avec le Secrétaire à la Défense Robert McNamara, pendant la guerre du Vietnam, en fournissant trois études particulièrement importantes qui ont eu un impact sur les conceptions et la stratégie états-unienne : sur l’efficacité des bombardements stratégiques pour couper les voies d’approvisionnement des Viêt-Cong, sur la construction d’une barrière électronique à travers le Vietnam et sur les armes nucléaires tactiques." 16
Les éléments de ces longues citations nous font comprendre que la science aujourd’hui est une des pierres angulaires du maintien du statu quo du système capitaliste et de la définition des rapports de force en son sein. Le rôle important qu'elle a joué pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, comme on vient de le voir, ne peut naturellement que s’accroître avec le temps, même si la bourgeoisie tend systématiquement à le camoufler.
En conclusion, ce que nous avons cherché à montrer, c’est comment les catastrophes écologiques et environnementales, même si elles peuvent être déclenchées par des phénomènes naturels, s’abattent avec férocité sur les populations, en particulier les plus démunies, et cela du fait d’un choix conscient de la classe dominante quant à la répartition des ressources et l'utilisation de la recherche scientifique elle-même. L’idée que la modernisation, le développement des sciences et de la technologie sont associées automatiquement à la dégradation de l’environnement et à une plus grande exploitation de l’homme, est donc à rejeter catégoriquement. Il existe au contraire de grandes potentialités de développement des ressources humaines, non seulement sur le plan de la production de biens mais, ce qui compte le plus, concernant la possibilité de produire d’une autre façon, en harmonie avec le milieu et le bien-être de l’écosystème dont l’homme fait partie. La perspective n’est donc pas le retour en arrière, en invoquant un futile et impossible retour aux origines, quand l’environnement était beaucoup plus épargné. Elle est au contraire d’aller de l’avant sur une voie différente, celle d’un développement qui soit vraiment en harmonie avec la planète Terre.
Ezechiele 5 avril 2009.
1. Voir la première partie de cet article "Le monde à la veille d'une catastrophe environnementale [74]" publié dans le numéro 135 de la Revue internationale.
2. Lire le premier article [74] de cette série dans la Revue Internationale n °135.
3. Idem
4. Le 20e siècle a vu une explosion des mégapoles. Au début du 20e siècle, il n’y avait que 6 villes de plus d’un million d’habitants ; au milieu du même siècle, il n’y avait que 4 villes qui dépassaient 5 millions d’habitants. Avant la Seconde Guerre mondiale, les mégapoles étaient un phénomène observé uniquement dans les pays industrialisés. Aujourd’hui, la majeure partie de ces "méga" villes est concentrée dans les pays de la périphérie. Dans quelques-unes, la population a été multipliée par 10 en quelques dizaines d’années. Actuellement, la moitié de la population mondiale vit dans les villes, en 2020, ce sera les deux tiers. Mais aucune de ces grandes villes qui connaissent un afflux d’immigrés supérieur à 5000 par jour, n’est réellement en mesure de faire face à cette augmentation de population contre nature, ce qui fait que les immigrés, ne pouvant être intégrés dans le tissu social de la ville, vont grossir démesurément les bidonvilles des banlieues où, presque toujours, il y un manque total de services et d’infrastructures adéquates.
5. "Cyclone Katrina, le capitalisme est responsable de la catastrophe sociale [77]", Revue Internationale n° 123
6. "Raz-de-marée meurtriers en Asie du Sud-est : La vraie catastrophe sociale, c'est le capitalisme ! [78]", Révolution internationale n° 353
8. Bordiga, leader du courant de gauche du Parti Communiste d’Italie à la fondation duquel il avait grandement contribué en 1921 et dont il a été expulsé en 1930 après le processus de stalinisation, a activement participé à la fondation du Parti Communiste International en 1945.
9. Préface (anonyme) à Drammi gialli e sinistri della moderna decadenza sociale de Amadeo Bordiga, edition Iskra, pages. 6, 7, 8 et 9. En français, préface à Espèce humaine et Croûte terrestre ; Petite Bibliothèque Payot 1978, Préface, pages 7,9 et 10)
10. Publié in Battaglia Comunista n°23 1951 et encore in Drammi gialli e sinistri della decadenza sociale, édition Iskra, page 19.
11. Idem
12. A. Bordiga, Politica e “costruzione”, publié in Prometeo, serie II, n°3-4, 1952 et encore in Drammi gialli e sinistri della decadenza sociale, edition Iskra, page 62-63.
13. Préface à la publication de Espèce Humaine et Croûte terrestre, op.cit.
14. Jens Hoyrup, Université de Roskilde, Danemark. "Mathématique et guerre", Conférence Palerme, 15 mai 2003. Cahiers de la recherche en didactique, n°13, GRIM (Départment of mathematics, University of Palermo, Italy) math.unips.it/-grim/Horyup_mat_guerra_quad13.pdf..
15. Annaratone, www.scienzaesperienza.it/news.php?/id=0057 [80].
16. Angelo Baracca, "Fisica fondamentale, ricerca e realizzazione di nuove armi nucleari".
Récent et en cours:
- Ecologie [45]
1914 - 23 : dix années qui ébranlèrent le monde (I) - la révolution hongroise de 1919
- 3897 lectures
La décennie entre 1914 et 1923 est l’une des plus intenses de l’histoire de l’humanité. Ce court laps de temps a vu une guerre terrible, la Première Guerre mondiale, qui mit fin à trente années de prospérité et de progrès ininterrompus de l’économie capitaliste et de la vie sociale dans son ensemble. Face à cette hécatombe, le prolétariat international se souleva avec, à sa tête, les ouvriers russes en 1917, et c'est vers 1923 que les échos de cette vague révolutionnaire commencèrent à s’éteindre, écrasés par la réaction bourgeoise. Ces dix années connurent la guerre mondiale qui ouvrait la période de décadence du capitalisme, la révolution en Russie et les tentatives révolutionnaires à l’échelle mondiale et, enfin, le début d’une barbare contre-révolution bourgeoise. Décadence du capitalisme, guerre mondiale, révolution et contre-révolution, furent des événements qui ont marqué la vie économique, sociale, culturelle, psychologique de l’humanité pendant presque un siècle et qui se concentrèrent intensivement en une seule décennie.
Il est vital pour les générations actuelles de connaître cette décennie, de la comprendre, de réfléchir sur ce qu’elle représente, d'en tirer les leçons qu’elle apporte. C’est vital à cause de l’immense méconnaissance de sa signification réelle qui a cours aujourd’hui, résultat du monceau de mensonges avec lesquels l’idéologie dominante a tenté de l’occulter ainsi que de l’attitude qu’elle favorise, délibérément ou inconsciemment, consistant à vivre attaché à l’immédiat et au moment présent, en oubliant le passé et les perspectives du futur 1.
Cette limitation à l’immédiat et au circonstanciel, ce "vivre le moment présent" sans réflexion ni compréhension de son enracinement, sans son inscription dans une perspective de futur, rendent difficile la connaissance du véritable visage de ces dix années incroyables dont l’étude critique nous apporterait de nombreux éclairages sur la situation actuelle.
Aujourd'hui, on connaît et réfléchit à peine sur le gigantesque choc que reçurent les contemporains quand éclata la Première Guerre mondiale et sur le saut qualitatif dans la barbarie qu’elle constitua 2. De nos jours, après avoir vécu presque un siècle de guerres impérialistes avec leur lot de terreur, de destruction et surtout de la pire barbarie idéologique et psychologique, tout cela parait être "la chose la plus normale au monde", comme si cette situation ne nous secouait ni ne nous indignait et révoltait. Mais ce n’était pas du tout l’attitude des contemporains de ces événements qui furent profondément ébranlés par une guerre dont la sauvagerie marqua un pas jamais franchi jusqu’alors.
On ignore plus encore que cette terrible boucherie s’acheva grâce à la rébellion généralisée du prolétariat international avec, à sa tête, ses frères de Russie. 3 A peine sait-on quelle énorme sympathie la révolution russe suscita parmi les exploités du monde entier. 4 Concernant les nombreux épisodes de solidarité avec les travailleurs russes et les nombreuses tentatives de suivre leur exemple et d’étendre la révolution au niveau international, on constate une lourde chape de silence et de désinformation. Les atrocités commises par divers gouvernements démocratiques et, en particulier, par le gouvernement allemand, dans le but d’écraser l’impulsion révolutionnaire des masses ne sont pas encore connues du grand public.
La principale et pire déformation concerne la révolution d’octobre 1917. Celle-ci est systématiquement présentée comme un phénomène russe, totalement isolé du contexte historique que nous venons d’évoquer et, en partant de ces prémisses, on donne libre cours aux pires mensonges et aux plus absurdes spéculations : ce fut l'œuvre - géniale selon les staliniens, diabolique selon ses détracteurs - de Lénine et des bolcheviks ; ce fut une révolution bourgeoise en réponse à l’arriération tsariste ; dans ce pays, la révolution socialiste était impossible et seul l’acharnement fanatique des bolcheviks la conduisit dans une voie qui ne pouvait aboutir que là où elle est arrivée.
A partir de cette prémisse, on est réduit à considérer la répercussion internationale de la révolution d’octobre 1917 comme un modèle qui pourrait s’exporter aux autres pays ; c’est la déformation la plus constante opérée par le stalinisme. Cette méthode du "modèle" est doublement erronée et pernicieuse. D'une part, la révolution russe est considérée comme un phénomène national et, d’autre part, elle est conçue comme une "expérience sociale" qui peut être activée à volonté par un groupe suffisamment motivé et expérimenté.
Ce procédé dénature scandaleusement la réalité de cette période historique. La révolution russe ne fut pas une expérience de laboratoire effectuée entre les quatre murs de son immense territoire. Elle fut une partie vivante et active d’un processus mondial de réponse prolétarienne provoqué par l’entrée en guerre du capitalisme et les terribles souffrances que celle-ci provoqua. Les bolcheviks n’avaient pas la moindre intention d’imposer un modèle fanatique dont le peuple russe aurait été le cobaye. Une résolution adoptée par le parti en avril 1917 affirme que : "Les conditions objectives de la révolution socialiste, qui existaient incontestablement dans les pays les plus avancés avant la guerre, ont encore mûri et continuent à mûrir avec une très grande rapidité comme conséquence de la guerre. La révolution russe est seulement la première étape de la première des révolutions qui éclateront comme conséquence de la guerre ; l’action commune des ouvriers des différents pays est la seule voie qui garantisse le développement le plus régulier et le succès le plus certain de la révolution socialiste mondiale."5
Il est important de comprendre que l’historiographie bourgeoise sous-estime - quand elle ne la déforme pas complètement - la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23. Et le stalinisme participe également à cette déformation. Par exemple, lors de la réunion élargie du Comité Exécutif de l’IC en 1925, c'est-à-dire au début de la stalinisation, la révolution allemande fut qualifiée de "révolution bourgeoise", en jetant à la poubelle tout ce que les bolcheviks avaient défendu entre 1917 et 1923.6
Cette "opinion" que diffusent aujourd’hui massivement tant les historiens que les hommes politiques au sujet de cette époque n’était pas le moins du monde partagée par leurs collègues d’alors. Lloyd George, politicien britannique, disait en 1919 : "L’Europe tout entière déborde d’esprit révolutionnaire. Il existe un profond sentiment non seulement de mécontentement, mais aussi de colère et de révolte des travailleurs contre leurs conditions de vie d'après la guerre. L’ensemble de l’ordre social existant, dans ses aspects politiques, sociaux et économiques, est remis en question par les masses populaires d’un bout à l’autre de l’Europe." 7
On ne peut comprendre la révolution russe qu'en tant que partie d’une tentative révolutionnaire mondiale de l’ensemble du prolétariat international, mais cela exige, en même temps, de prendre en considération l’époque historique où elle se produisit : celle où éclata la Première Guerre mondiale, et comprendre la signification profonde de celle-ci, c'est-à-dire celle de l’entrée du capitalisme dans son déclin historique, sa phase de décadence. Sinon, les bases d’une réelle compréhension s’écroulent et tout perd son sens. Dès lors, la guerre mondiale et tous les événements qui lui ont succédé perdent toute signification puisqu'ils apparaissent soit comme des exceptions sans répercussions ultérieures, soit comme le résultat d’une conjoncture malheureuse qui serait aujourd’hui dépassée, de sorte que les événements actuels n’auraient aucun rapport avec ce qui se passa alors.
Nos articles ont amplement polémiqué contre ces conceptions. Ils se sont positionnés du point de vue historique et mondial, ce qui est le propre du marxisme. Nous pensons ainsi pouvoir apporter une explication cohérente de cette époque historique, une explication permettant d’orienter et d’être matière à réflexion afin de comprendre l’époque actuelle et de contribuer à libérer l’humanité du joug du capitalisme. Sans cela, la situation d’alors et celle de maintenant sont privées de sens et de perspective et l’activité de tous ceux qui veulent contribuer à une révolution mondiale se condamne à l’empirisme le plus absolu et à s’exténuer à donner des coups à l’aveuglette.
Cette rubrique thématique se propose d’apporter, en continuité avec les nombreuses contributions que nous avons déjà faites, un essai de reconstitution de cette époque selon les témoignages et les récits des protagonistes eux-mêmes. 8
Nous avons consacré de nombreuses pages à la révolution en Russie et en Allemagne 9. De ce fait, nous publierons des travaux sur des expériences moins connues en divers pays avec, pour objectif, de donner une perspective mondiale. Quand on se penche un peu sur cette époque, on est étonné par le nombre de luttes qui l'ont traversée, par l'ampleur de l'écho de la révolution de 1917 10. Nous considérons le cadre de cette série d'articles comme ouvert et donc comme une invitation au débat et aux apports des camarades et des groupes révolutionnaires.
La révolution hongroise de 1919
L’exemple de la Russie 1917 inspire les ouvriers hongrois (I)
La tentative révolutionnaire du prolétariat hongrois eut une forte motivation internationale. Elle fut le fruit de deux facteurs : la situation insoutenable provoquée par la guerre et l’exemple de la révolution d’octobre 1917.
Comme nous l’avons dit dans l’introduction de cette rubrique, la Première Guerre mondiale fut une explosion de barbarie. Par certains côtés, la "paix" fut encore pire, une paix signée dans la précipitation par les grandes puissances capitalistes en novembre 1918 quand éclata la révolution en Allemagne 11. Elle n’apporta pas le moindre soulagement aux souffrances des masses, ni une diminution du chaos et de la désorganisation de la vie sociale que la guerre avait provoqués. L’hiver 1918 et le printemps 1919 furent un cauchemar : famine, paralysie des transports, conflits démentiels entre politiciens, occupation des pays vaincus par l’armée, guerre contre la Russie soviétique, désordre extrême à tous les niveaux de la vie sociale, survenue et propagation fulgurante d’une épidémie, nommée grippe espagnole, qui causa autant de morts, sinon plus, que la guerre… Aux yeux de la population, la "paix" fut encore pire que la guerre.
L'appareil économique avait été exploité jusqu’à son extrême limite, ce qui généra un phénomène insolite de sous-production comme le souligne Béla Szantò 12 pour la Hongrie : "Comme conséquence de l’effort de production des industries de guerre, stimulé par la recherche de superprofits, les moyens de production se retrouvèrent complètement épuisés et les machines hors d’état. Leur reconversion aurait exigé d’énormes investissements, alors qu’il n’y avait pas la moindre possibilité d’amortissement. Il n’y avait pas de matières premières. Les usines étaient arrêtées. Suite à la démobilisation mais aussi à la fermeture des usines, il y avait un chômage énorme." 13
Le Times de Londres affirmait (19-07-19) : "L’esprit du désordre règne sur le monde entier, de l’Amérique occidentale à la Chine, de la Mer noire à la Baltique ; aucune société, aucune civilisation, aussi solide soit-elle, aucune constitution aussi démocratique soit-elle, ne peut échapper à cette influence maligne. Partout apparaissent les indices de l’effondrement des liens sociaux les plus élémentaires, provoqué par cette tension prolongée." 14 Dans ce contexte, l’exemple russe suscita une vague d’enthousiasme et d’espoir au sein de tout le prolétariat mondial. Les ouvriers possédaient un antidote contre le virus mortel du capitalisme submergé par le chaos : la lutte révolutionnaire mondiale prenant exemple sur Octobre 1917.
La République démocratique d’octobre 1918
La Hongrie, qui appartenait encore à l’Empire austro-hongrois et figurait parmi les perdants de la guerre, souffrait au plus haut point de cette situation, mais le prolétariat - fortement concentré à Budapest qui comptait le septième de la population du pays et presque 80% de son industrie - se révéla fortement combatif.
Une période d’apathie avait fait suite aux mutineries de 1915, écrasées avec l’aide scandaleuse du parti social-démocrate avec, toutefois, de timides mouvements en 1916 et 1917. Mais en janvier 1918, l’agitation sociale mena à ce qui fut probablement la première grève de masse internationale de toute l’histoire, qui s’étendit à de nombreux pays d’Europe centrale depuis l’épicentre de Vienne et Budapest. Elle débuta le 14 janvier à Budapest ; le 16, elle gagna la Basse-Autriche et la Styrie, le 17 Vienne et le 23 les grandes usines d’armement de Berlin, avec de nombreux échos en Slovénie, Tchécoslovaquie, Pologne et Croatie 15. La lutte se concentra autour de trois objectifs : contre la guerre, contre la pénurie, et en solidarité avec la révolution russe. Deux slogans furent mis en avant en de nombreuses langues : "A bas la guerre" et "Vive le prolétariat russe".
A Budapest, la grève éclata en dehors du contrôle des dirigeants sociaux-démocrates et des syndicats, et dans de nombreuses usines enthousiasmées par l’exemple russe, on vota des résolutions en faveur des conseils ouvriers… sans réussir à les constituer effectivement. Le mouvement ne se donna aucune organisation, ce dont les syndicats profitèrent pour en prendre la tête et imposer des revendications sans rapport avec les préoccupations des masses, en particulier en faveur du suffrage universel. Le gouvernement tenta d’écraser la grève en faisant une exhibition de troupes armées de canons et de mitrailleuses. Le peu de succès de cette démonstration et les doutes croissants des soldats qui ne voulaient pas combattre au Front et encore moins contre les ouvriers, dissuada le gouvernement qui, en 24 heures, changea d’attitude et "céda" à la revendication - qui était seulement celle des syndicats et des sociaux-démocrates - du suffrage universel.
Forts de cela, les syndicats se rendirent dans les usines pour maîtriser la grève. Ils furent froidement accueillis. Cependant, la fatigue, le manque de nouvelles d’Autriche et d’Allemagne et la reprise progressive du travail dans les secteurs les plus vulnérables finirent par plomber le moral des travailleurs des grandes entreprises métallurgiques qui décidèrent finalement de reprendre le travail.
Renforcée par ce triomphe, la social-démocratie "mena une campagne de représailles contre tous ceux qui s’efforçaient de réveiller la lutte de classe révolutionnaire parmi les masses. Dans Népszava -organe central du parti- parurent des articles diffamatoires et même de délation qui donnèrent une abondante matière aux persécutions politiques menées par le gouvernement réactionnaire de Wkerle-Vaszonyi" 16.
L’agitation se poursuivit malgré la répression. En mai, les soldats du régiment d’Ojvideck se mutinèrent contre leur envoi au Front. Ils se rendirent maîtres du central téléphonique et de la gare ferroviaire. Les ouvriers de la ville les soutinrent. Le gouvernement envoya deux régiments spéciaux qui bombardèrent sauvagement la cité pendant trois jours avant de s’en emparer. La répression fut sans pitié : un soldat sur dix – participant ou non à la mutinerie - fut fusillé, des milliers de personnes furent emprisonnées.
En juin, les gendarmes tirèrent sur les ouvriers grévistes d’une usine métallurgique de la capitale, faisant de nombreux morts et blessés. Les ouvriers se rendirent rapidement aux usines voisines qui cessèrent immédiatement la production et sortirent dans la rue. Tout Budapest fut paralysée en quelques heures. Le jour suivant, la grève s’étendit au pays tout entier. Des assemblées improvisées, dans une ambiance révolutionnaire, décidaient des mesures à prendre. Le gouvernement arrêta les délégués, envoya au Front les ouvriers les plus impliqués, les tramways furent remis en circulation par des briseurs de grève escortés chacun par quatre soldats baïonnette au clair. Après huit jours de lutte, la grève se termina par une défaite.
Cependant, une prise de conscience se développait dans la classe : "Peu à peu, parmi de nombreux cercles ouvriers, émergeait la conviction que la politique du parti social-démocrate et le comportement des dirigeants du parti ne permettaient pas de soutenir, d’assumer une orientation révolutionnaire (...). Les forces révolutionnaires avaient commencé à trouver leur cohésion, les ouvriers des grandes usines établirent des contacts directs entre eux. Les réunions et les délibérations secrètes se tenaient de façon quasi-permanente et les contours d’une politique prolétarienne indépendante commencèrent à se dessiner." 17 Ces cercles ouvriers commençaient à être connus en tant que Groupe Révolutionnaire.
Les mutineries de soldats étaient de plus en plus fréquentes malgré la répression. Les grèves devenaient quotidiennes. Le gouvernement – incapable de mener une guerre perdue, avec une armée de plus en plus en débandade, désorganisée, une économie paralysée et une pénurie totale en approvisionnements - s’effondrait. Pour éviter une si dangereuse carence de pouvoir, le Parti social-démocrate, montrant une fois encore de quel côté il se rangeait, décida de rassembler les partis bourgeois dans un Conseil national.
Le 28 octobre, le Conseil des Soldats se coordonna avec le Groupe Révolutionnaire ; les deux convoquèrent une grande manifestation à Budapest dont le but était de se rendre à la Citadelle pour remettre une lettre au délégué royal. Il y avait là un énorme cordon de soldats et de policiers. Les premiers se rangèrent pour laisser le passage à la foule mais la police fit feu, tuant de nombreuses personnes. "L’indignation de la population à l’égard de la police fut indescriptible. Le jour suivant les ouvriers de l’usine d’armement forcèrent les dépôts et s’armèrent." 18
Le gouvernement tenta d’envoyer hors de Budapest les bataillons militaires qui avaient été à l’avant-garde du Conseil des Soldats, ce qui provoqua l’indignation générale : des milliers de travailleurs et de soldats se rassemblèrent dans la rue Rakóczi - la principale artère de la ville - afin d’empêcher leur sortie. Une compagnie de soldats ayant reçu l’ordre de départ refusa et s’unit à la foule au niveau de l’Hôtel Astoria. Vers minuit, les deux centraux téléphoniques furent pris.
Au matin et pendant la journée suivante, des bâtiments publics, des casernes, la gare centrale, les magasins d’alimentation furent occupés par des bataillons de soldats et d’ouvriers en armes. Des manifestations massives se rendirent aux prisons et libérèrent les prisonniers politiques. Les syndicats, se présentant comme les porte-parole du mouvement, réclamèrent le pouvoir pour le Conseil national. Le 31 octobre, en milieu de matinée, le comte Hadik - chef du gouvernement - remit le pouvoir à un autre comte, Károlyi, chef du parti de l’Indépendance et président du Conseil national.
Celui-ci se retrouvait avec la totalité du pouvoir sans avoir bougé le petit doigt. Ce pouvoir ne lui appartenait pas puisque résultant de l’impulsion encore inorganisée et inconsciente des masses ouvrières. C’est pourquoi le gouvernement rejeta toute légitimation révolutionnaire et alla chercher une légitimité auprès de la monarchie hongroise qui faisait partie du fantomatique "Empire austro-hongrois". En l’absence du roi, les membres du Conseil national, avec à leur tête les sociaux-démocrates, allèrent trouver le plénipotentiaire de l’empereur, l’archiduc Joseph, qui autorisa le nouveau gouvernement.
La nouvelle indigna de nombreux travailleurs. Un rassemblement fut organisé au Tisza Calman-Tér. Malgré une pluie torrentielle, une foule imposante se réunit et décida de se rendre au siège du parti social-démocrate pour exiger la proclamation de la République.
La revendication de la République avait été au cours du XIXe siècle un mot d'ordre du mouvement ouvrier qui considérait que cette forme de gouvernement était plus ouverte et favorable à ses intérêts que la monarchie constitutionnelle. Cependant, face à cette nouvelle situation où il n’y avait pas d’autre alternative que pouvoir bourgeois ou pouvoir prolétarien, la République se présentait comme l'ultime recours du Capital. De fait, la République est née avec la bénédiction de la monarchie et du haut clergé, dont le chef - le prince archevêque de Hongrie, reçut la visite du Conseil national à son grand complet. Le social-démocrate Kunfi prononça un discours célèbre : "Il m’échoit l’obligation accablante de dire, moi, social-démocrate convaincu, que nous ne voulons pas agir selon les méthodes de la haine de classe ni de la lutte de classe. Et nous lançons un appel pour que tous, éliminant les intérêts de classe, et laissant de côté les points de vue partisans, nous aident dans les lourdes tâches qui nous incombent." (cité par Szantò, page 35). Toute la Hongrie bourgeoise s’était regroupée autour de son nouveau sauveur, le Conseil national dont le moteur était le parti social-démocrate. Le 16 novembre, la nouvelle république fut solennellement proclamée.
La constitution du Parti communiste
La classe ouvrière ne peut mener à bien sa tentative révolutionnaire si elle ne crée pas en son sein l’outil vital qu’est le Parti communiste. Mais il ne suffit pas que celui-ci ait des positions programmatiques internationalistes, il doit aussi les faire vivre à travers des propositions concrètes au prolétariat, dans sa capacité d’analyse consciencieuse et avec une large vision des événements et des orientations à suivre. Pour ce faire, il est décisif que le parti soit international et non pas une simple somme de partis nationaux afin de pouvoir combattre le poids asphyxiant et déroutant de l’immédiat et du local, des particularismes nationaux, mais aussi pour impulser la solidarité, le débat commun et une vision globale ouvrant des perspectives.
Le drame des tentatives révolutionnaires en Allemagne et en Hongrie fut l’absence de l’Internationale. Celle-ci se constitua trop tard, en mars 1919, alors que l’insurrection de Berlin avait été écrasée et que la tentative révolutionnaire hongroise avait déjà commencé. 19
Le Parti communiste hongrois souffrit très cruellement de cette difficulté. L’un de ses fondateurs fut le Groupe Révolutionnaire qui était formé de délégués et d’éléments actifs des ouvriers des grandes usines de Budapest 20. Il fut rejoint par des éléments venant de Russie - en novembre 1918 - qui avaient fondé le Groupe Communiste, menés par Béla Kun, par l’Union Socialiste Révolutionnaire de tendance anarchiste et par les membres de l’Opposition Socialiste, noyau formé à l’intérieur du Parti social-démocrate hongrois depuis l’éclatement de la Première Guerre mondiale.
Avant l’arrivée de Béla Kun et de ses camarades, les membres du GR avaient considéré la possibilité de former un Parti communiste. Le débat sur cette question mena à une impasse car il y avait deux tendances qui ne parvenaient pas à se mettre d’accord : d’un côté les partisans d’une Fraction internationaliste à l’intérieur du Parti social-démocrate et, de l’autre, ceux qui considéraient que la formation d’un nouveau parti était urgente. La décision fut finalement prise de constituer une Union qui prit le nom de Ervin Szabo 21, laquelle décida de poursuivre la discussion. L’arrivée des militants venant de Russie changea radicalement la situation. Le prestige de la Révolution russe et la force de persuasion de Béla Kun firent pencher vers la formation immédiate du Parti communiste, qui fut fondé le 24 novembre. Le document programmatique adopté comportait des points très valables 22 :
- "alors que le Parti Social-démocrate visait à mettre la classe ouvrière au service de la reconstruction du capitalisme, le nouveau parti a pour tâche de montrer aux travailleurs comment le capitalisme a déjà subi une secousse mortelle et est parvenu à un stade de développement, sur le plan moral mais aussi économique, qui le met au bord de la ruine"
- "grève de masse et insurrection armée : ce sont les moyens souhaités par les communistes pour prendre le pouvoir. Ils n’aspirent pas à une république bourgeoise (...) mais à la dictature du prolétariat organisé en conseils"
- les moyens qu’il se donnait : "maintenir vivante la conscience du prolétariat hongrois, l’écarter de son ancienne liaison avec la classe dominante hongroise malhonnête, ignorante et corrompue (...) réveiller en lui le sentiment de la solidarité internationale, auparavant systématiquement étouffé", lier le prolétariat hongrois à "la dictature russe des conseils et potentiellement avec n’importe quel autre pays où pourrait éclater une révolution semblable".
Un journal fut fondé - Voro Ujsàg ("La Gazette Rouge")- et le parti se lança dans une agitation fébrile, qui d'ailleurs était nécessaire étant donné le caractère décisif du moment que l’on vivait alors 23. Cependant cette agitation ne fut pas étayée par un débat programmatique en profondeur, par une analyse collective méthodique des événements. Le Parti était en réalité trop jeune et inexpérimenté ; de plus, il avait peu de cohésion. Tout ceci l’amena, comme nous le verrons dans le prochain article, à commettre de graves erreurs.
Syndicats ou Conseils ouvriers ?
Pendant l’époque historique 1914-23, une question très complexe se posait au prolétariat. Les syndicats s’étaient comportés comme des sergents recruteurs du capital pendant la guerre impérialiste et le surgissement des ripostes ouvrières se fit en dehors de leur initiative. Mais par ailleurs, les temps héroïques où les luttes ouvrières avaient été organisées à travers les syndicats, étaient très proches ; ceux-ci avaient coûté beaucoup d’efforts économiques, beaucoup d’heures de réunions collectives, subi beaucoup de répression. Les ouvriers les considéraient encore comme appropriés et espéraient pouvoir les récupérer.
Simultanément, il y avait un immense enthousiasme pour l’exemple russe des conseils ouvriers qui avaient pris le pouvoir en 1917. En Hongrie, en Autriche et en Allemagne, les luttes tendaient à la formation de conseils ouvriers. Mais alors qu'en Russie, les ouvriers accumulèrent une grande expérience sur ce qu’ils étaient, sur leur fonctionnement, quelles étaient leurs faiblesses, sur la façon dont la classe ennemie tentait de les saboter, aussi bien en Autriche qu’en Hongrie cette expérience était très limitée.
Cet ensemble de facteurs historiques produisit une situation hybride qui fut habilement mise à profit par le Parti social-démocrate et les syndicats pour constituer, le 2 novembre, le Conseil ouvrier de Budapest constitué d'un étrange mélange de chefs syndicaux, de leaders sociaux-démocrates et de délégués élus dans quelques grandes usines. Les jours suivants se multiplièrent toutes sortes de "conseils" qui n’étaient que des organisations syndicales et corporatistes qui s’étaient parées de l'étiquette à la mode : Conseil des policiers (fondé le 2 novembre et complètement contrôlés par la social-démocratie), Conseil des fonctionnaires, Conseil des étudiants. Il y eut même un Conseil des prêtres le 8 novembre ! Cette prolifération de conseils avait pour but de court-circuiter leur formation par les ouvriers.
L’économie était paralysée. L’État n’avait aucune ressource et comme tout le monde lui demandait une aide, sa seule réponse fut d’imprimer du papier monnaie pour des subventions, le versement des salaires des employés d’État, et les dépenses courantes... En décembre 1918, le ministre des finances réunit les syndicats pour leur demander de mettre fin aux revendications de salaires, de coopérer avec le gouvernement pour relancer l’économie et prendre au besoin les rênes de la gestion des entreprises. Les syndicats se montrèrent très réceptifs.
Mais cela provoqua l’indignation des travailleurs. Il y eut à nouveau des assemblées massives. Le Parti communiste récemment constitué prit la tête de la contestation. Il avait décidé de participer dans les syndicats et il obtint rapidement la majorité dans plusieurs organisations des grandes usines. La création de conseils ouvriers était à leur programme, mais ils étaient considérés comme compatibles avec les syndicats 24. Cette situation produisait un continuel va et vient. Le Conseil ouvrier de Budapest, créé préventivement par les sociaux-démocrates, était devenu un organe sans vie. A ce moment, des efforts d'organisation et de prise de conscience avaient lieu sur le terrain de plus en plus inutilisable des syndicats comme par exemple l’assemblée massive du Syndicat de la métallurgie en réponse aux plans du ministre qui adopta, après deux jours de débats, des positions très profondes : "Du point de vue de la classe ouvrière, le contrôle de l’état sur la production ne peut avoir aucun effet, étant donné que la République populaire n’est qu’une forme modifiée de la domination capitaliste, où l’État continue à être ce qu’il était auparavant : l’organe collectif de la classe qui détient la propriété des moyens de production et opprime la classe ouvrière." 25
La radicalisation des luttes ouvrières
La désorganisation et la paralysie de l’économie plongeaient les ouvriers et la majeure partie de la population au bord de la famine. Dans de telles conditions, l’Assemblée décida que "dans toutes les grandes entreprises doivent s’organiser des Conseils de Contrôle d’Usine qui, en tant qu’organes du pouvoir ouvrier, contrôlent la production des usines, l’approvisionnement en matières premières et également le fonctionnement et la bonne marche des affaires" (idem). Toutefois, ils ne se considéraient pas comme des organisations paritaires de coopération avec l’État, ni comme des organes "d’autogestion", mais comme des leviers et des compléments de la lutte pour le pouvoir politique : "le contrôle ouvrier est uniquement une phase de transition vers le système de gestion ouvrière pour laquelle la prise au préalable du pouvoir politique est une condition nécessaire (...) En prenant tout cela en considération, l’assemblée des délégués et des membres de l’organisation condamne toute suspension, même provisoire, de la lutte de classe, toute adhésion aux principes constitutionnels, et considère que la tâche immédiate est l’organisation des Conseils Ouvriers, Soldats et Paysans en tant qu’agents de la dictature du prolétariat." (Idem)
Le 17 décembre, le Conseil ouvrier de Szeged - deuxième ville du pays - décida de dissoudre la municipalité et de "prendre le pouvoir". Ce fut un acte isolé qui exprimait la tension devant la détérioration de la situation. Le gouvernement réagit avec prudence et entama des négociations qui aboutirent au rétablissement de la municipalité avec une "majorité social-démocrate". A Noël 1918, les ouvriers d’une usine de Budapest réclamèrent une augmentation de salaire. En deux jours tout Budapest reprenait cette revendication qui commença à s’étendre à la province. Les industriels n’eurent d’autre choix que de céder. 26
Début janvier, les mineurs de Salgótarján formèrent un Conseil ouvrier qui décida la prise de pouvoir et l’organisation d’une milice. Le gouvernement central prit peur et envoya aussitôt des troupes d’élite qui occupèrent le district et firent 18 morts et 30 blessés. Deux jours plus tard, les ouvriers de la région de Satoralja–Llihely prenaient la même décision et reçurent la même réponse du gouvernement qui provoqua un nouveau bain de sang. A Kiskunfélegyháza, les femmes organisèrent une manifestation contre la pénurie de nourriture et les prix trop élevés, la police tira sur la foule tuant dix personnes et en blessant trente. Le surlendemain, ce fut le tour des ouvriers de Poszony dont le Conseil ouvrier proclama la dictature du prolétariat. Le gouvernement, manquant de forces, demanda au gouvernement tchèque d’occuper militairement la ville qui était dans une zone frontalière. 27
Le problème paysan s'aiguisait. Les soldats démobilisés rentraient dans leurs villages et répandaient l’agitation. Des réunions se tenaient qui réclamaient le partage des terres. Le Conseil ouvrier de Budapest 28 manifesta une grande solidarité qui déboucha sur la proposition de tenir une réunion "afin d’imposer au gouvernement une solution au problème agraire". La première réunion ne parvint à aucun accord et il fallut en tenir une seconde qui se termina par l'acceptation de la proposition social-démocrate qui prévoyait la formation "d'exploitations agricoles individuelles avec indemnisation des anciens propriétaires." Cette mesure calma momentanément la situation, durant à peine quelques semaines, comme nous le verrons dans le prochain article. De fait, en Arad - près de la Roumanie - les paysans occupèrent les terres fin janvier et le Gouvernement dut les arrêter avec d’importants dispositifs de troupes qui provoquèrent une énième tuerie.
Février 1919 : l’offensive répressive contre les communistes
En février l’Union des Journalistes se constitua en Conseil et demanda la censure de tous les articles hostiles à la Révolution. Les assemblées de typographes et d’autres secteurs rattachés se multipliaient et apportaient leur soutien à cette mesure. Les travailleurs de la métallurgie participèrent à cette activité qui déboucha sur la prise de contrôle de la plupart des journaux par les ouvriers. A partir de ce moment-là, la publication des nouvelles et des articles était soumise à la décision collective des ouvriers.
Budapest s’était transformée en une gigantesque école de débat 29. Chaque jour, à toute heure, se déroulaient des discussions sur les thèmes les plus divers. Partout on occupait des locaux. Seuls les généraux et les grands patrons étaient privés du droit de réunion puisqu'à chacune de leur tentative, ils étaient dispersés par des groupes d’ouvriers de la métallurgie et de soldats qui finirent par s’emparer de leurs luxueux locaux.
Parallèlement au développement des conseils ouvriers et face au problème posé par le chaos et la désorganisation de la production, un second type d’organisation se développa dans les entreprises, les conseils d’usine, qui assuraient le contrôle de l’approvisionnement et la production de biens et services essentiels afin d’éviter la pénurie des biens les plus élémentaires. Fin janvier, le Conseil ouvrier de Budapest prit une audacieuse initiative centralisatrice : prendre le contrôle de la production de gaz, des usines d’armement, des principaux chantiers de construction, du journal Deli Hirlap et de l’hôtel Hungaria.
Cette décision était un défi au gouvernement à laquelle répondit le socialiste Garami en proposant un projet de loi qui réduisait les conseils d’usine à de simples collaborateurs des patrons à qui on réattribuait l’entière responsabilité de la production, l’organisation de l’entreprise, etc. Les assemblées massives de protestation contre cette mesure se multiplièrent. Au Conseil ouvrier de Budapest la discussion fut très vive. Le 20 février, lors de la troisième session concernant ce projet de loi, les sociaux-démocrates firent un spectaculaire coup d’éclat, leurs délégués interrompirent la séance avec une nouvelle sensationnelle : "Les communistes ont lancé une attaque contre le Népszava. La rédaction a été prise d’assaut avec des rafales de mitrailleuses ! Plusieurs rédacteurs ont déjà péri ! La rue est jonchée de cadavres et de blessés !" 30
Cela permit de faire adopter à une courte majorité la disposition contre les conseils d’usine mais ouvrit aussi la porte à une étape cruciale : la tentative d'écraser par la force le Parti communiste.
La prise d’assaut du Népszava se révéla rapidement avoir été une provocation montée par le Parti social-démocrate. Cette opération menée à un moment particulièrement délicat – les conseils ouvriers se multipliant partout dans le pays et de plus en plus remontés contre le gouvernement - venait couronner une campagne, menée par le Parti social-démocrate, contre le Parti communiste et qui était organisée depuis des mois.
Déjà, en décembre 1918, le gouvernement, sur proposition du Parti social-démocrate, avait interdit l’utilisation de tous les types de papier d'imprimerie dans le but d’empêcher l’édition et la diffusion de Vörös Ujsàg. En février 1919, le gouvernement eut recours à la force : "Un matin, un détachement de 160 policiers armés de grenades et de mitrailleuses, encercle le Secrétariat. Prétextant un contrôle, les policiers envahissent le local, dévastent le mobilier et l’équipement et emportent tout en remplissant huit grandes voitures." 31
Szanto signale que "l’assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg par la contre-révolution blanche en Allemagne fut considéré par les contre-révolutionnaires hongrois comme le signal de la lutte contre le bolchevisme". (page 51). Un journaliste bourgeois très influent, Ladislas Fényes, lança une campagne insistante contre les communistes. Il disait qu’"il fallait les écarter les armes à la main".
Le Parti social-démocrate répétait avec insistance que Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg "avaient payé de leur vie pour avoir défié l’unité du mouvement ouvrier". Alexandre Garbai - qui sera ultérieurement président des conseils ouvriers hongrois, déclara que "les communistes doivent être placés devant les canons des fusils car nul ne peut diviser le parti social-démocrate sans le payer de sa vie" 32. L’unité ouvrière, qui est le bien fondamental du prolétariat, était utilisée frauduleusement pour appuyer et amplifier l’offensive de la bourgeoisie. 33
La question de "l’unité ouvrière menacée" fut portée devant le Conseil ouvrier par le Parti social-démocrate. Les conseils ouvriers qui commençaient tout juste à fonctionner se virent confrontés à une question épineuse qui finit par les paralyser : à plusieurs reprises les sociaux-démocrates présentèrent des motions demandant l’exclusion des communistes des réunions pour "avoir brisé l’unité ouvrière". Ils ne faisaient que reproduire la féroce campagne de leurs acolytes allemands qui, depuis novembre 1918, avaient fait de l’unité leur principal point d'appui pour écarter les Spartakistes, favorisant une atmosphère de pogrom contre eux.
L’assaut contre le Népszava se situe dans ce contexte. Sept policiers y trouvent la mort. Au cours de cette même nuit du 20 février il y a une vague d’arrestations de militants communistes. Les policiers, révoltés par la mort de leurs sept collègues, torturent les prisonniers. Le 21 février, le Népszava diffuse une déclaration qui traite les communistes de "contre-révolutionnaires mercenaires à la solde des capitalistes" et appelle à la grève générale en protestation. Une manifestation devant le Parlement est proposée l’après-midi même.
La manifestation est gigantesque. Beaucoup de travailleurs, indignés par l’assaut attribué aux communistes, s'y rendent mais surtout le Parti social-démocrate mobilise des fonctionnaires, des petits bourgeois, des officiers de l’armée, des commerçants, etc. qui réclament la sévérité de la justice bourgeoise contre les communistes.
Le 22 février, la presse rend compte des tortures infligées aux prisonniers. Le Népszava défend les policiers : "Nous comprenons la rancœur de la police et compatissons vivement à sa douleur pour les collègues tombés en défendant la presse ouvrière. Nous pouvons nous féliciter que les policiers aient donné leur adhésion à notre parti, qu’ils se soient organisés et qu’ils aient des sentiments de solidarité envers le prolétariat" 34.
Ces paroles répugnantes sont l'alpha et l'oméga d’une offensive en règle en deux étapes, dirigée par le Parti social-démocrate contre le prolétariat : d’abord, écraser les communistes en tant qu’avant-garde révolutionnaire et ensuite défaire la masse prolétarienne, de plus en plus radicale.
Le 22 même, la motion d’expulsion des communistes du Conseil ouvrier est approuvée. Les communistes sont-ils complètement décapités ? En apparence, la contre-révolution est en train de triompher.
Dans le prochain article, nous verrons comment cette offensive sera défaite par une riposte vigoureuse du prolétariat.
C Mir 3-3-09
1. Un historien qui, sous plusieurs aspects, est raisonnablement sérieux et pénétrant, Eric Hobsbawm, reconnaît dans son Histoire du 20e siècle que "la destruction du passé, ou plutôt des mécanismes sociaux qui rattachent les contemporains aux générations antérieures, est l’un des phénomènes les plus caractéristiques et mystérieux de la fin du XXe siècle. De nos jours, la plupart des jeunes grandissent dans une sorte de présent permanent, sans aucun lien organique avec le passé public des temps dans lesquels ils vivent." (L'Âge des extrêmes, Éditions Complexe, 2003, p. 21)
2. On trouve un témoignage de la façon dont la guerre mondiale a bouleversé ses contemporains dans l'article de Sigmund Freud publié en 1915 et intitulé "Considérations actuelles sur la guerre et la mort" dans lequel il signale ce qui suit : "Entraînés dans le tourbillon de ce temps de guerre, insuffisamment renseignés, sans un recul suffisant pour porter un jugement sur les grands changements qui se sont déjà accomplis ou sont en voie de s'accomplir, sans échappée sur l'avenir qui se prépare, nous sommes incapables de comprendre la signification exacte des impressions qui nous assaillent, de nous rendre compte de la valeur des jugements que nous formulons. Il nous semble que jamais un événement n'a détruit autant de patrimoine précieux, commun à l'humanité, n'a porté un tel trouble dans les intelligences les plus claires, n'a aussi profondément abaissé ce qui était élevé. La science elle-même a perdu sa sereine impartialité ; ses serviteurs, exaspérés au plus haut degré, lui empruntent des armes, afin de pouvoir contribuer, à leur tour, à terrasser l'ennemi. L'anthropologiste cherche à prouver que l'adversaire appartient à une race inférieure et dégénérée ; le psychiatre diagnostique chez lui des troubles intellectuels et psychiques."
3. Les manuels d'histoire font une étude militaire de l'évolution de la guerre et, lorsqu'ils arrivent à 1917 et 1918, ils intercalent soudainement, comme s'il s'agissait d'événements advenus sur une autre planète, la révolution russe et le mouvement insurrectionnel en Allemagne de 1918. On peut se reporter, pour prendre un exemple, à l'article sur la Première Guerre mondiale [81] de Wikipedia qui pourtant a la réputation d'être une encyclopédie alternative.
4. Aujourd'hui, l'immense majorité des idéologues de l'anarchisme dénigre la révolution de 1917 et couvre des pires insultes les bolcheviks. Pourtant ce ne fut pas le cas en 1917-21. Dans l'article "La CNT face à la guerre et à la révolution [82]" (Revue Internationale n° 129) nous montrons comment beaucoup d'anarchistes espagnols – tout en maintenant leurs propres critères et avec un esprit critique - ont appuyé avec beaucoup d'enthousiasme la révolution russe et, dans un éditorial de Solidaritad, le journal de la CNT, on pouvait lire : "Les Russes nous montrent le chemin à suivre. Le peuple russe triomphe : nous apprenons de ses actes pour triompher à notre tour, en arrachant par la force ce qu'on nous refuse". Par ailleurs, Manuel Bonacasa, anarchiste très réputé, affirme dans ses mémoires : "Qui en Espagne –en tant qu'anarchiste- a dédaigné de se désigner lui-même comme Bolchevik ?". Emma Goldman, une anarchiste américaine, signale dans son livre Living my life : "La presse américaine, toujours incapable d'analyse en profondeur, dénonça violemment Octobre comme complot allemand : Lénine, Trotski et les autres dirigeants étaient réduits à l'état de mercenaires à la solde du Kaiser. [Durant des mois, les écrivassiers fabriquèrent des inventions fantastiques sur la Russie bolchevique. Leur ignorance des forces qui avaient conduit à la révolution d'Octobre était aussi épouvantable que leurs tentatives puériles d'interpréter le mouvement conduit par Lénine. C'est à peine si il y eut le moindre périodique donnant la plus petite preuve qu'il avait compris que le bolchevisme était une conception sociale portée par l'esprit brillant d'hommes animés par l'ardeur et le courage des martyrs. (…) Il était de la plus grande urgence que les anarchistes et les autres véritables révolutionnaires s'engagent résolument en défense de ces hommes diffamés et de leur cause dans les événements qui se précipitaient en Russie.]" (La première partie de cette citation est extraite du livre L'épopée d'une anarchiste publié par Hachette en 1979 et republié par les Éditions Complexe en 1984 et 2002. Il s'agit d'une traduction-adaptation commise par Cathy Bernheim et Annette Lévy-Willard qui sont bien conscientes de leur trahison lorsqu'elles écrivent : "Si nous la rencontrions aujourd'hui, elle jetterait probablement un regard de mépris sur notre 'adaptation' (…) Telle aurait sans doute été son appréciation sur notre travail. Mais la seule chose qu'Emma Goldman, fanatique de la liberté, n'aurait pu nous reprocher, c'est d'avoir fait de ses mémoires une adaptation libre." Pour preuve de cette "trahison libre", on peut signaler que le passage entre crochets ne figure pas dans le livre de ces dames, sinon sous une forme édulcorée, et qu'il a été traduit par nos soins à partir de l'original.
5. Cité par E.H. Carr dans La révolution bolchevique tome I, page 100 de l'édition espagnole.
6. Dans le livre Le mouvement ouvrier international Tome IV, publié par les Éditions du Progrès de Moscou, il est indiqué dans une note que : "à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, comme résultat de larges discussions dans l'historiographie marxiste, il a été affirmé la nature des révolutions de 1918-19 dans les pays d'Europe centrale comme étant complètement des révolutions démocratiques bourgeoises (ou démocratiques nationales)". (page 277 de l'Edition espagnole)
7. Cité par E.H. Carr, op. cité, Tome III, page 128.
8 Dans le prologue de l'ouvrage déjà cité de Trotsky, Histoire de la révolution russe, l'auteur réfléchit sur la méthode avec laquelle il convient d'analyser les faits historiques. Critiquant la supposée approche "neutre et objective" préconisée par un historien français qui affirme que "un historien doit monter sur le rempart de la cité menacée et, de là, considérer les assiégeants comme les assiégés", Trotsky répond que : "Le lecteur sérieux et doué de sens critique n'a pas besoin d'une impartialité fallacieuse qui lui tendrait la coupe de l'esprit conciliateur, saturée d'une bonne dose de poison, d'un dépôt de haine réactionnaire, mais il lui faut la bonne foi scientifique qui, pour exprimer ses sympathies, ses antipathies, franches et non masquées, cherche à s'appuyer sur une honnête étude des faits, sur la démonstration des rapports réels entre les faits, sur la manifestation de ce qu'il y a de rationnel dans le déroulement des faits. Là seulement est possible l'objectivité historique, et elle est alors tout à fait suffisante, car elle est vérifiée et certifiée autrement que par les bonnes intentions de l'historien - dont celui-ci donne, d'ailleurs, la garantie - mais par la révélation de la loi intime du processus historique."
9. Pour connaître la révolution russe, il existe deux livres qui sont des classiques dans le mouvement ouvrier : L'Histoire de la révolution russe de Trotsky et le livre célèbre de John Reed Dix jours qui ébranlèrent le Monde.
10. Le livre déjà mentionné de E.H. Carr cite une autre déclaration de Lloyd George en 1919 : "Si une action militaire était entreprise contre les bolcheviques, alors l'Angleterre deviendrait bolchevique et il y aurait un soviet à Londres", ce à quoi l'auteur ajoute : "Lloyd George s'exprimait comme à son habitude pour causer un effet mais son esprit perspicace avait correctement diagnostiqué les symptômes".
11. L'armistice généralisé a été signé le 11 novembre 1918 quelques jours à peine après le surgissement de la révolution à Kiel (dans le nord de l'Allemagne) et l'abdication du Kaiser Guillaume, l'Empereur allemand. Voir à ce sujet la série d'articles que nous avons publiée à partir de la Revue Internationale n° 133.
12. Voir le livre de cet auteur La République hongroise des conseils, page 40 de l'édition espagnole.
13. Ce phénomène de sous-production généré par la mobilisation totale et extrême de toutes les ressources pour les armements et la guerre est également constaté par Gers Hardach dans son livre La Première Guerre mondiale (page 86 de l'édition espagnole) à propos de l'Allemagne qui, à partir de 1917, donne des signes d'effondrement de tout son appareil économique, provoquant rupture des approvisionnements et chaos, ce qui finit à son tour par bloquer la production de guerre.
14. Cité par Karl Radek dans le livre signalé plus haut (page 10 de l'édition espagnole).
15. Dans son livre (en anglais) Le Communisme mondial, l'autrichien Franz Borkenau, ancien militant communiste, dit que : "En beaucoup d'aspects, cette grève a été le plus grand mouvement révolutionnaire d'origine réellement prolétarienne que le monde entier ait jamais vécu (…) La coordination internationale que le Comintern a tenté à plusieurs reprises de réaliser s'est produite ici automatiquement, à l'intérieur des frontières des puissances centrales, par la communauté des intérêts dans les pays concernés et par la prééminence dans les différents lieux de deux problèmes principaux, le pain et les négociations de Brest [il s'agit des négociations de paix entre le gouvernement soviétique et l'Empire allemand en janvier-mars 1918]. De tous les côtés, les mots d'ordre revendiquaient la paix en Russie sans annexions ni compensations, des rations plus importantes et la démocratie politique." (page 92 de l'édition anglaise, traduit par nous)
16. Béla Szantò, La Révolution Hongroise de 1919, édition espagnole, page 21.
17. Szantò, op. cité, page 24.
18. Szantò, op. cité, page 28.
19. Voir "La formation du parti, l'absence de l'Internationale [17]" dans la Revue Internationale n° 135.
20. Très semblables aux délégués révolutionnaires en Allemagne. En fait, il existe une coïncidence significative dans les composants qui ont convergé vers la formation du parti bolchevique en Russie, du KPD en Allemagne et du PC hongrois : "Le fait que les trois forces que nous avons mentionnées aient joué un rôle crucial dans le drame de la formation du parti de classe n'est pas une particularité de la situation allemande. L'une des caractéristiques du bolchevisme pendant la révolution en Russie est la façon dont il unifia fondamentalement les même forces qui existaient au sein de la classe ouvrière : le parti d'avant-guerre qui représentait le programme et l'expérience organisationnelle ; les ouvriers avancés, ayant une conscience de classe, des usines et sur les lieux de travail, qui ancraient le parti dans la classe et jouèrent un rôle positif décisif en résolvant les différentes crises dans l'organisation ; et la jeunesse révolutionnaire politisée par la lutte contre la guerre." (Op. cité, Revue Internationale n° 135)
21. Militant de la gauche de la Social-démocratie qui quitta le parti en 1910 et évolua vers des positions anarchistes. Il est mort en 1918 après avoir combattu énergiquement la guerre sur une position internationaliste.
22. Nous citons le résumé de ses principes réalisé par Béla Szantó dans le livre évoqué plus haut.
23. Le parti fit preuve d'une grande efficacité dans l'agitation et le recrutement des militants. En quatre mois, il est passé de 4000 à 70 000 militants.
24. Cette même position a prévalu dans le prolétariat russe et parmi les Bolcheviks. Toutefois, alors qu'en Russie les syndicats étaient très faibles, en Hongrie et dans d'autres pays, leur force était bien supérieure.
25. Szantò, op. cité, page 43.
26. En compensation, le ministre social-démocrate Garami proposa d'accorder aux industriels un crédit de 15 millions de couronnes. C'est-à-dire que les augmentations obtenues par les travailleurs allaient s'évaporer en quelques jours du fait de l'inflation qu'un tel prêt allait provoquer. La subvention fut approuvée alors que même les ministres officiellement bourgeois du cabinet y étaient opposés.
27. Cette zone se maintiendra sous la domination tchèque jusqu'à l'écrasement de la révolution en août 1919.
28. Depuis janvier, celui-ci avait repris vie avec le va et vient que nous avons évoqué plus haut. Les grandes usines avaient envoyé des délégués – dont beaucoup étaient communistes - lesquels avaient exigé la reprise de ses réunions.
29. Ce fut aussi une des caractéristiques remarquables de la Révolution russe que souligne, par exemple, John Reed dans son livre Dix jours qui ébranlèrent le monde.
30. Szantò, page 60.
31. Szantò, page 51.
32. Szantò, page 52.
33. Nous verrons dans un prochain article comment l'unité fut le cheval de Troie utilisé par les sociaux-démocrates pour conserver le contrôle des conseils ouvriers quand ces derniers prirent le pouvoir.
34. Szantò, page 63.
Heritage de la Gauche Communiste:
Décadence du capitalisme (V) : les contradictions mortelles de la société bourgeoise
- 3530 lectures
Bordiga, communiste de gauche d'Italie, qualifia un jour l'ensemble de l'œuvre de Marx de "nécrologie du capital" – en d'autres termes, l'étude des contradictions internes auxquelles la société bourgeoise ne pourrait échapper et qui la mèneraient à sa fin.
Décréter la mort avec certitude est un problème pour les êtres humains de façon générale – l'humanité est la seule espèce du règne animal à porter le poids de la conscience de l'inévitabilité de la mort, et ce fardeau se manifeste, entre autres, par l'omniprésence des mythes de la vie après la mort dans toutes les époques de l'histoire et dans toutes les formations sociales.
De même, les classes dominantes, exploiteuses, et les individus qui la représentent sont heureux d'échapper à la mort en se consolant par des rêves sur le caractère éternel des fondements et de la destinée de leur règne. Le régime des pharaons et des empereurs divins est ainsi justifié par les histoires sacrées qui embrassent les origines primordiales jusqu'au futur lointain.
Bien qu'elle s'enorgueillisse de sa vision rationnelle et scientifique, la bourgeoisie n'en est pas moins sujette aux projections mythologiques. Comme Marx l'a observé, on discerne aisément cela dans l'attitude de cette classe envers l'histoire où elle projette ses "Robinsonnades" sur la propriété privée comme fondement de l'existence humaine. Et elle n'est pas plus encline que les anciens despotes à envisager la fin de son système d'exploitation. Même dans son époque révolutionnaire, même dans la pensée du philosophe par excellence du mouvement dialectique, Hegel, on trouve la même tendance à proclamer que la domination de la société bourgeoise constitue "la fin de l'histoire". Marx fit la remarque que pour Hegel, l'avancée permanente de l'Esprit du Monde avait fini par trouver paix et repos sous la forme de l'Etat bureaucratique prussien (qui, d'ailleurs, était toujours bien embourbé dans le passé féodal).
Nous considérons donc comme un axiome de base de la vision du monde de la bourgeoisie, distordue par son idéologie, le fait qu'elle ne peut tolérer aucune théorie qui mette en avant la nature purement transitoire de sa domination de classe. Le marxisme lui, qui exprime le point de vue théorique de la première classe exploitée de l'histoire à contenir les germes d'un nouvel ordre social, ne connaît pas un tel blocage de sa vision.
Ainsi, Le Manifeste communiste de 1848 commence par le passage célèbre sur l'histoire comme étant celle de la lutte de classe qui, dans tous les modes de production jusqu'ici, avait fait éclater le tissu social de l'intérieur, et fini "soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte" (chapitre "Bourgeois et prolétaires") 1. La société bourgeoise a simplifié les oppositions de classe au point de les avoir réduits socialement à deux grands camps – capitaliste d'une part, prolétarien de l'autre. Et le destin du prolétariat est d'être le fossoyeur de l'ordre bourgeois.
Mais Le Manifeste ne s'attendait pas à ce que la confrontation décisive entre les classes résulte simplement de la simplification des différences dans le capitalisme, ni de l'injustice évidente représentée par le monopole des privilèges et de la richesse par la bourgeoisie. Il était d'abord nécessaire que le système bourgeois ne soit plus capable de fonctionner "normalement", qu'il ait atteint le point où "... la bourgeoisie est incapable de remplir plus longtemps son rôle de classe dirigeante et d'imposer à la société, comme loi régulatrice, les conditions d'existence de sa classe. Elle ne peut plus régner, parce qu'elle est incapable d'assurer l'existence de son esclave dans le cadre de son esclavage, parce qu'elle est obligée de le laisser déchoir au point de devoir le nourrir au lieu de se faire nourrir par lui. La société ne peut plus vivre sous sa domination, ce qui revient à dire que l'existence de la bourgeoisie n'est plus compatible avec celle de la société." (Ibid.) En somme, le renversement de la société bourgeoise devient une nécessité vitale pour la survie même de la classe exploitée et de la vie sociale dans son ensemble.
Le Manifeste voyait dans les crises économiques qui ravageaient périodiquement la société capitaliste à cette époque les signes avant-coureurs de ce moment qui approchait.
"Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société, - l'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentanée ; on dirait qu'une famine, une guerre d'extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance ; l'industrie et le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. Les forces productives dont elle dispose ne favorisent plus le régime de la propriété bourgeoise ; au contraire, elles sont devenues trop puissantes pour ce régime qui alors leur fait obstacle ; et toutes les fois que les forces productives sociales triomphent de cet obstacle, elles précipitent dans le désordre la société bourgeoise tout entière et menacent l'existence de la propriété bourgeoise. Le système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir les richesses créées dans son sein - Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'un côté, en détruisant par la violence une masse de forces productives ; de l'autre, en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciens. A quoi cela aboutit-il ? A préparer des crises plus générales et plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir." (Ibid.)
Il y a plusieurs points à souligner à propos de ce passage souvent cité :
- il établit que les crises économiques sont le résultat de la surproduction de marchandises, du fait que les vastes forces productives mises en oeuvre par le capitalisme se heurtent aux limites de la forme capitaliste d'appropriation et de distribution. Comme Marx allait l'expliquer plus tard, il ne s'agissait pas de surproduction par rapport aux besoins. Au contraire, elle résultait du fait que les besoins de la grande majorité étaient nécessairement restreints par l'existence de rapports de production antagoniques. C'était la surproduction par rapport à la demande effective – une demande soutenue par la capacité de payer ;
- il considère que les rapports de production capitalistes sont déjà devenus une entrave définitive au développement de ces forces productives, un carcan qui les entravait ;
- en même temps, le capitalisme a à sa disposition différents mécanismes pour surmonter ses crises : d'une part, la destruction de capital, ce par quoi Marx voulait essentiellement dire non la destruction physique d'usines et de machines non rentables, mais leur destruction comme valeur parce que la crise les rendait inutiles. Ceci, comme Marx allait l'expliquer dans des travaux ultérieurs, permettait à la fois de débarrasser le marché de concurrents improductifs et avait un effet "bénéfique" sur le taux de profit ; d'autre part, "la conquête de nouveaux marchés et la meilleure exploitation des anciens", permettait d'échapper temporairement à l'engorgement du marché dans les zones déjà conquises par le capitalisme ;
- ces mécanismes échappatoires eux-mêmes ne faisaient en réalité que préparer la voie à des crises de plus en plus destructrices et tendaient à se neutraliser comme moyens de surmonter la crise. Bref, le capitalisme avançait nécessairement vers une impasse historique.
Le Manifeste a été écrit à la veille de la grande vague de soulèvements qui a balayé l'Europe au cours de l'année 1848. Mais bien que ces soulèvements eussent des racines très matérielles – en particulier, l'éclatement de famines dans toute une série de pays – et que se fussent exprimées alors les premières manifestations massives de l'autonomie politique du prolétariat (le mouvement chartiste en Grande-Bretagne, le soulèvement de juin de la classe ouvrière parisienne), ils constituaient essentiellement les derniers feux de la révolution bourgeoise contre l'absolutisme féodal. Dans son effort pour comprendre l'échec de ces soulèvements du point de vue du prolétariat – même les buts bourgeois que se donnait la révolution ont rarement été atteints et la bourgeoisie française n'hésita pas à écraser les ouvriers insurgés de Paris – Marx reconnut que la perspective d'une révolution prolétarienne imminente était prématurée. Non seulement la classe ouvrière avait reçu un coup et avait reculé politiquement avec la défaite des soulèvements de 1848, mais le capitalisme était très loin d'avoir achevé sa mission historique, il s'étendait à travers la planète et continuait à "créer un monde à son image" comme l'exprime Le Manifeste. Le dynamisme de la bourgeoisie, comme Le Manifeste le reconnaissait, était encore une forte réalité. Contre les militants impatients de son propre "parti" qui pensaient que les masses pouvaient être poussées à l'action par la simple volonté, Marx mit en avant que le prolétariat aurait sans doute à mener des luttes pendant des décennies avant de parvenir à la confrontation décisive avec son ennemi de classe. Il défendit aussi avec force l'idée que "Une nouvelle révolution ne sera possible qu'à la suite d'une nouvelle crise, mais l'une est aussi certaine que l'autre." (Les luttes de classe en France, chapitre : "L'abolition du suffrage universel en 1850") 2
Marx répond aux apologistes
C'est cette conviction qui amena Marx à se dédier à l'étude – ou, plutôt, à la critique – de l'économie politique, une recherche profonde et vaste qui allait prendre la forme écrite des Grundrisse et des quatre volumes du Capital. Pour comprendre les conditions matérielles de la révolution prolétarienne, il était nécessaire de comprendre plus en profondeur les contradictions inhérentes au mode de production capitaliste, les faiblesses fatales qui finiraient pas le condamner à mort.
Dans ces travaux, Marx reconnaît sa dette envers des économistes bourgeois tels que Adam Smith et Ricardo qui avaient largement contribué à la compréhension du système économique bourgeois, en particulier parce que, dans leurs polémiques contre les apologistes des formes de production semi-féodales dépassées, ils avaient défendu le point de vue selon lequel la "valeur" des marchandises n'était pas quelque chose d'inhérent à la qualité du sol, ni un chiffre déterminé par les caprices de l'offre et de la demande, mais qu'elle se basait sur le travail réel des hommes. Mais Marx montra également que ces polémistes de la bourgeoisie étaient aussi ses apologistes dans la mesure où dans leurs écrits :
- ils reflétaient la vision du "sens commun" de l'idéologie bourgeoise qui, tout en condamnant les modes de production précédents, l'esclavage et le féodalisme, en tant que systèmes de privilèges de classe, niait que le capitalisme fût à son tour fondé sur l'exploitation du travail puisque pour eux, la transaction fondamentale au cœur de la production capitaliste était un échange équitable entre la capacité de travail de l'ouvrier et le salaire qui lui était offert par le capitaliste. Marx montra qu'au même titre que les modes de production précédents, le capitalisme était fondé sur l'extraction du surtravail de la classe exploitée – mais que ceci prenait la forme de l'extraction de la plus-value, le temps de travail "libre" extorqué à l'ouvrier mais dissimulé dans le contrat salarial ;
- ils avaient tendance à considérer que, malgré le problème des crises économiques périodiques du capitalisme, il n'existait pas de barrières inhérentes au développement de celui-ci et que l'on n'atteindrait donc jamais le point où il serait nécessaire de le dépasser dans une forme de société supérieure. S'il y avait des crises, elles étaient dues à l'action des spéculateurs ou à une disproportionnalité temporaire entre les différentes branches de l'industrie, ou à d'autres facteurs contingents et, puisque chaque produit était, en fin de compte, destiné à trouver acheteur, l'opération même du marché finirait par surmonter les problèmes et fournirait les bases pour de nouvelles phases de croissance.
Ce qui est fondamental dans toutes les théories économiques bourgeoises, c'est le déni du fait que les crises du capitalisme prouvent qu'il existe des contradictions fondamentales et insurmontables dans le mode de production capitaliste – oiseaux de mauvais augure, corbeaux annonciateurs de catastrophes dont les rauques croassements prophétisent le Ragnarök 3 de la société bourgeoise.
"La phraséologie apologétique visant à nier les crises a son importance parce qu'elle prouve le contraire de ce qu'elle veut prouver. Pour nier la crise, elle affirme l'unité là où il y a contradiction et opposition. A la vérité, on pourrait dire que, si les contradictions arbitrairement niées par les apologistes n'existaient pas, il n'y aurait pas de crise. Mais en réalité la crise existe parce que ces contradictions existent. Toute raison qu'ils allèguent contre la crise vise à nier arbitrairement les contradictions réelles qui sont cause de la crise. Ce désir fantaisiste de nier les contradictions ne fait que confirmer les contradictions réelles dont on souhaite précisément l'inexistence." (Théories de la plus-value). 4
Premier oiseau de mauvais augure : "la surproduction, contradiction fondamentale du capital développé..."
L'apologie du capital par les économistes se fonde dans une large mesure sur le déni du fait que les crises de surproduction qui font leur apparition au cours de la deuxième ou de la troisième décennie du 19e siècle, soient un indicateur de l'existence de barrières insurmontables pour le mode de production bourgeois.
Face à la réalité concrète de la crise, le déni des apologistes prit diverses formes que les experts économiques ont pour la plupart reprises au cours des dernières décennies. Marx souligne, par exemple, que Ricardo cherchait à expliquer les premières crises du marché mondial par différents facteurs contingents, tels que les mauvaises récoltes, la dévaluation du papier monnaie, la chute des prix ou les difficultés du passage de périodes de paix à des périodes de guerre, ou de guerre à des phases de paix dans les premières années du 19e siècle. Il est évident que ces facteurs ont pu jouer un rôle dans l'exacerbation des crises, et même provoquer leur éclatement, mais ils ne touchaient pas le cœur du problème. Ces échappatoires nous rappellent les prises de position récentes des "experts" économiques, qui situaient la "cause" de la crise dans les années 1970 dans l'augmentation du prix du pétrole ou, aujourd'hui, dans l'avidité des banquiers. Lorsque vers le milieu du 19e siècle, il devint plus difficile d'ignorer le cycle des crises commerciales, les économistes furent contraints de développer des arguments plus sophistiqués, d'accepter par exemple l'idée qu'il y avait trop de capital tout en niant que cela signifiait aussi trop de marchandises invendables.
Et quand le problème de la surproduction était accepté, il était relativisé. Pour les apologistes, à la base, "on ne vend jamais que pour acheter quelque autre produit qui puisse être d'une utilité immédiate ou qui puisse contribuer à la production à venir." (Ibid., page 479) En d'autres termes, il existait une profonde harmonie entre la production et la vente et, dans le meilleur des mondes au moins, toute marchandise devait trouver un acheteur. S'il existe des crises, elles ne sont rien d'autre que les possibilités contenues dans la métamorphose des marchandises en argent, comme le défendait John Stuart Mill, ou bien elles résultent d'une simple disproportionnalité entre un secteur de la production et un autre.
Marx ne nie absolument pas qu'il puisse exister des disproportions entre les différentes branches de la production – il insiste même sur le fait que c'est toujours une tendance dans une économie non planifiée dans laquelle il est impossible de produire les marchandises en fonction de la demande immédiate. Ce à quoi il s'oppose, c'est à la tentative d'utiliser la question de la "disproportionnalité" comme prétexte pour se débarrasser des contradictions plus fondamentales qui existent dans les rapports sociaux capitalistes :
"Dire qu'il n'y a pas surproduction générale, mais disproportion au sein des différentes industries, c'est simplement dire que, dans la production capitaliste, la proportionnalité des diverses industries est un processus permanent de la disproportionnalité, en ce sens que la cohérence de la production totale s'impose ici aux agents de la production comme une loi aveugle, et non comme une loi comprise et dominée par leur raison d'individus associés qui soumettent le processus de production à leur contrôle commun." (Le Capital, Livre III) 5
De même, Marx rejette l'argument selon lequel il peut exister une surproduction partielle mais pas une surproduction générale:
"C'est pourquoi Ricardo admet pour certaines marchandises l'encombrement du marché. C'est l'encombrement général et simultané du marché qui serait impossible. La possibilité de surproduction dans une sphère particulière de la production n'est pas niée ; mais le phénomène ne pouvant exister dans toutes les sphères à la fois, il ne pourrait y avoir ni surproduction, ni encombrement général du marché." (Théories sur la plus-value). 6
La spécificité historique du capitalisme
Ce qu'ont en commun tous ces arguments, c'est de nier la spécificité historique du mode de production capitaliste. Le capitalisme est la première forme économique à avoir généralisé la production de marchandises, la production pour la vente et le profit, à l'ensemble du processus de production et de distribution ; et c'est dans cette spécificité qu'on devait trouver la tendance à la surproduction. Non pas, comme Marx prend le soin de le souligner, la surproduction par rapport aux besoins :
"Le mot même de "surproduction" peut nous induire en erreur. Tant que les besoins les plus urgents d'une grande partie de la société ne sont pas satisfaits ou que seuls le sont les besoins les plus immédiats, il ne peut naturellement pas être question de surproduction au sens d'une surabondance de produits par rapport aux besoins. Il faudrait dire au contraire que, la production étant capitaliste, il y a toujours une sous-production au sens où nous l'entendons. C'est le profit des capitalistes qui limite la production, non le besoin des producteurs. Mais surproduction de produits et surproduction de marchandises sont deux choses absolument différentes. Quand Ricardo affirme que la forme marchandise n'affecte pas le produit, ensuite qu'entre la circulation des marchandises et le troc il n'y a qu'une différence de forme, que la valeur d'échange n'est ici qu'une forme passagère des échanges matériels, donc que l'argent n'est qu'un moyen formel de circulation, il ne fait qu'exprimer la thèse suivant laquelle le mode de production bourgeois est le mode absolu, dépourvu de toute détermination spécifique, et que son caractère est, par conséquent purement formel. Aussi ne saurait-il admettre que la production bourgeoise implique une limite au libre développement des forces productives, limite qui se manifeste dans les crises, dont la surproduction est le phénomène fondamental." (Théories sur la plus-value). (Ibid., page 490)
Ensuite Marx montre la différence entre le mode de production capitaliste et les modes de production précédents qui ne cherchaient pas à accumuler des richesses mais à les consommer et qui furent confrontés au problème de la sous-production plutôt que de la surproduction :
"... les Anciens ne songeaient même pas à transformer le surproduit en capital, ou du moins ils ne le firent qu'à une échelle très réduite. (L'ampleur qu'ils donnaient à la thésaurisation proprement dite montre bien que leur surproduit restait sans emploi.) Ils en transformaient une grande partie en dépenses improductives pour des oeuvres d'art, des monuments religieux, des travaux publics. Encore moins leur industrie visait-elle à libérer et à développer les forces productives matérielles : division du travail, machinisme, application des forces naturelles et de la science à la production privée. Dans l'ensemble, ils ne dépassèrent pas les limites du travail artisanal. C'est pourquoi la richesse qu'ils créèrent pour la consommation privée était relativement restreinte ; elle ne paraît grande que parce qu'elle s'accumulait entre les mains d'un petit nombre d'individus, qui ne savaient du reste qu'en faire. S'il n'y avait donc pas surproduction chez les Anciens, il y avait surconsommation par les riches, qui dégénéra dans la dernière période de Rome et de la Grèce en une folle dissipation. Les rares peuples commerçants parmi eux vivaient en partie aux dépens de ces nations essentiellement pauvres. La surproduction moderne a pour base, d'une part, le développement absolu des forces productives, donc la production en masse par les producteurs enfermés dans le cercle du strict nécessaire, et, d'autre part, la limite imposée par le profit des capitalistes." (Ibid., page 491)
Le problème posé par les économistes, c'est qu'ils considèrent le capitalisme comme s'il était déjà un système social harmonieux – une sorte de socialisme dans lequel la production est fondamentalement déterminée par les besoins :
"Toutes les difficultés soulevées par Ricardo et d'autres à propos du problème de la surproduction viennent ou bien de ce qu'ils regardent la production bourgeoise comme un mode de production où il n'y a pas de distinction entre l'achat et la vente – troc direct – ou bien de ce qu'ils voient une production sociale : comme si la société répartissait d'après un plan ses moyens de production et ses forces productives, afin qu'ils servent à satisfaire ses divers besoins, et ce en sorte que chaque secteur de la production reçoive les quantités nécessaires qui lui correspondent. Cette fiction a sa source dans l'incapacité de comprendre la forme spécifique de la production bourgeoise, incapacité qui provient de ce qu'on la regarde et la prend pour la production tout court. Ainsi le croyant considère sa propre religion comme la religion tout court et ne voit ailleurs que 'fausses' religions." (Ibid., page 491-92)
A la racine, la surproduction réside dans les rapports sociaux capitalistes
A l'encontre de ces distorsions, Marx situait les crises de surproduction dans les rapports sociaux mêmes qui définissent le capital comme mode de production spécifique : le rapport du travail salarié
"... à tout ramener au simple rapport consommateur-producteur, on oublie que le salarié et le capitaliste constituent deux types de producteurs totalement différents, sans mentionner les consommateurs qui ne produisent rien. C'est se débarrasser une fois de plus, en en faisant abstraction, des contradictions antagoniques réelles de la production. Le simple rapport salarié-capitaliste implique que :
1° la majorité des producteurs (les ouvriers) ne sont pas consommateurs (acheteurs) du plus gros de leur production, à savoir les matières premières et les instruments de travail ;
et que 2° la majorité des producteurs (les ouvriers) ne consomment jamais l'équivalent de leur production puisque, au-delà de cet équivalent, ils doivent fournir de la plus-value ou du surproduit. Pour pouvoir consommer ou acheter dans les limites de leurs besoins, ils doivent toujours être surproducteurs, toujours produire au-delà de leurs besoins." (Ibid., page 484)
Evidemment, le capitalisme ne commence pas chaque phase du processus d'accumulation avec un problème immédiat de surproduction : il est né et se développe comme un système dynamique en expansion constante vers de nouveaux domaines d'échange productif, à la fois dans l'économie intérieure et à l'échelle mondiale. Mais du fait de la nature inévitable de la contradiction que Marx vient de décrire, cette expansion constante est une nécessité pour le capital s'il veut repousser ou dépasser la crise de surproduction et ici, de nouveau, Marx devait soutenir ce point de vue contre les apologistes qui considéraient plus l'extension du marché comme quelque chose de commode que comme une question de vie ou de mort, du fait de leur tendance à considérer le capital comme un système indépendant et harmonieux :
"Cependant, si l'on admet que le marché doit s'étendre avec la production, on admet également la possibilité d'une surproduction. Du point de vue géographique, le marché est limité : le marché intérieur est restreint par rapport à un marché intérieur et extérieur, qui l'est pas rapport au marché mondial, lequel – bien que susceptible d'extension – est lui-même limité dans le temps. En admettant donc que le marché doive s'étendre pour éviter la surproduction, on admet la possibilité de la surproduction." (Ibid., page 489)
Dans le même passage, Marx poursuit en montrant que, tandis que l'extension du marché mondial permet au capitalisme de surmonter ses crises et de poursuivre le développement des forces productives, l'extension précédente du marché devient rapidement inapte à absorber le nouveau développement de la production. Il ne voyait pas cela comme un processus éternel : il existe des limites inhérentes à la capacité du capital de devenir un système véritablement universel et une fois qu'il aura atteint ces limites, elles entraîneront le capitalisme vers l'abîme :
"Cependant, si le capital pose en idée toute limitation comme un obstacle à surmonter, il n'en résulte pas qu'en réalité il les surmonte tous. Toute barrière étant contraire à sa vocation, la production capitaliste se développe dans des contradictions qui sont constamment surmontées, mais aussi continuellement posées. Plus : l'universalité vers quoi tend sans cesse le capital rencontre des limites immanentes à sa nature, lesquelles, à un certain stade de son développement, le font apparaître comme le plus grand obstacle à cette tendance et le poussent à son autodestruction." (Grundrisse) 7
Et ainsi nous arrivons à la conclusion que la surproduction est le premier oiseau de mauvais augure annonçant la faillite du capitalisme, l'illustration concrète, dans le capitalisme, de la formule fondamentale de Marx expliquant la montée et le déclin de tous les modes de production ayant existé jusqu'ici : hier forme de développement (dans ce cas, l'extension générale de la production de marchandises), elle devient aujourd'hui une entrave à la poursuite du développement des forces productives de l'humanité :
"Pour mieux cerner la question : en premier lieu, il existe une limite inhérente non pas à la production en général, mais à la production fondée sur le capital. Cette limite est double - ou plutôt unique, mais elle se présente sous deux angles. Pour révéler le fondement de la surproduction – contradiction fondamentale du capital développé, il suffit de démontrer que le capital renferme une limitation particulière de la production, contrastant avec sa tendance générale à en dépasser toutes les barrières ; il suffit de démontrer que, contrairement à l'opinion des économistes, le capital n'est pas la forme absolue du développement des forces productives et que la richesse n'y coïncide pas absolument. Du point de vue du capital, les étapes de la production qui le précèdent apparaissent comme autant d'entraves aux forces productives. Correctement compris le capital lui-même apparaît comme condition du développement des forces productives tant que celles-ci réclament un stimulant extérieur, qui en est en même temps le frein. Le capital discipline ses forces, mais à un certain niveau de leur accroissement – tout comme autrefois les corporations, etc. – cette discipline se révèle superflue et gênante." (Ibid., page 266) 8
Deuxième oiseau de mauvais augure : la baisse tendancielle du taux de profit
Une autre critique que fait Marx aux économistes politiques porte sur leur incohérence dans le fait qu'ils nient la surproduction de marchandises tout en admettant la surproduction de capital :
"Dans le cadre de ses propres prémisses, Ricardo reste conséquent avec lui-même : affirmer l'impossibilité d'une surproduction de marchandises, c'est pour lui, affirmer qu'il ne peut y avoir pléthore ou surabondance de capital.
Qu'aurait dit alors Ricardo devant la stupidité de ses successeurs qui, niant la surproduction sous une de ses formes (engorgement général du marché), l'acceptent sous celle de la pléthore, de la surabondance du capital et en font même un point essentiel de leurs doctrines ?" (Théories de la plus-value) 9
Cependant Marx, en particulier dans le troisième volume du Capital, montre que le fait que le capital ait tendance à devenir "surabondant", surtout sous sa forme de moyens de production, n'a rien de consolant. Parce que cette surabondance ne fait que développer une autre contradiction mortelle, la tendance à la baisse du taux de profit que Marx qualifie ainsi : "C'est, de toutes les lois de l'économie politique moderne, la plus importante qui soit." (Grundrisse) 10. Cette contradiction n'est pas moins inscrite dans les rapports sociaux fondamentaux du capitalisme : puisque seul le travail vivant peut ajouter de la valeur – et c'est le "secret" du profit capitaliste – et, qu'en même temps, les capitalistes sont contraints sous le fouet de la concurrence de constamment "révolutionner les moyens de production", c'est-à-dire d'augmenter la proportion entre le travail mort des machines et le travail vivant des hommes, il est confronté à la tendance intrinsèque à ce que la proportion de valeur nouvelle contenue dans chaque marchandise s'amenuise et donc à ce que le taux de profit baisse.
A nouveau, les apologistes bourgeois fuient avec terreur les implications de cela puisque la loi de la baisse du taux de profit montre aussi le caractère transitoire du capital :
"En outre, dans la mesure où le taux d'expansion du capital total, le taux de profit, est le moteur de la production capitaliste (comme la mise en valeur du capital en est le but unique), sa baisse ralentit la formation de nouveaux capitaux indépendants et apparaît ainsi comme une menace pour le développement du processus de production capitaliste. Elle favorise la surproduction, la spéculation, les crises, le capital excédentaire à côté de la population excédentaire. Les économistes qui, à l'exemple de Ricardo, considèrent le mode de production capitaliste comme un absolu, ont alors la sensation que ce mode de production se crée lui-même une barrière, et ils en rendent responsables non pas la production, mais la nature (dans leur théorie de la rente). L'important, dans l'horreur qu'ils éprouvent devant le taux de profit décroissant, c'est qu'ils s'aperçoivent que le mode de production capitaliste rencontre, dans le développement des forces productives, une limite qui n'a rien à voir avec la production de la richesse comme telle. Et cette limite particulière démontre le caractère étroit, simplement historique et transitoire, du mode de production capitaliste ; elle démontre que ce n'est pas un mode de production absolu pour la production de la richesse, mais qu'à un certain stade il entre en conflit avec son développement ultérieur." (Le Capital, Livre III) 11
Et ici, dans les Grundrisse, les réflexions de Marx sur la baisse du taux de profit font ressortir ce qui est peut-être son annonce la plus explicite de la perspective du capitalisme qui, comme les formes antérieures de servitude, ne peut éviter d'entrer dans une phase d'obsolescence ou de sénilité dans laquelle une tendance croissante à l'autodestruction posera à l'humanité la nécessité de développer une forme supérieure de vie sociale :
"Cela étant : la force productive matérielle déjà existante et acquise sous la forme de capital fixe, les conquêtes de la science, l'essor des populations, etc., bref, les immenses richesses et les conditions de leur reproduction dont dépend le plus haut développement de l'individu social et que le capital a créées dans le cours de son évolution historique – cela étant, on voit qu'à partir d'un certain point de son expansion le capital lui-même supprime ses propres possibilités. Au-delà d'un certain point, le développement des forces productives devient un obstacle pour l'expansion des forces productives du travail. Arrivé à ce point, le capital, ou plus exactement le travail salarié, entre dans le même rapport avec le développement de la richesse sociale et des forces productives que le système des corporations, le servage, l'esclavage, et il est nécessairement rejeté comme une entrave. La dernière forme de la servitude que prend l'activité humaine – travail salarié d'un côté et capital de l'autre – est alors dépouillée, et ce dépouillement lui-même est le résultat du mode de production qui correspond au capital. Eux-mêmes négation des formes antérieures de la production sociale asservie, le travail salarié et le capital sont à leur tour niés par les conditions matérielles et spirituelles issues de leur propre processus de production. C'est par des conflits aigus, des crises, des convulsions que se traduit l'incompatibilité croissante entre le développement créateur de la société et les rapports de production établis. L'anéantissement violent du capital par des forces venues non pas de l'extérieur, mais jaillies du dedans, de sa propre volonté d'autoconservation, voilà de quelle manière frappante avis lui sera donné de déguerpir pour faire place nette à une phase supérieure de la production sociale." 12
Le cercle vicieux des contradictions capitalistes
Il est certain que Marx discernait le futur dans des passages comme celui-ci : il reconnaissait qu'il existait des contre-tendances qui faisaient de la chute du taux de profit une entrave sur le long terme et non dans l'immédiat à la production capitaliste. Ceci comprend : l'augmentation de l'intensité de l'exploitation ; la baisse des salaires au dessous de la valeur de la force de travail ; la baisse du prix d'éléments du capital constant et le commerce extérieur. La façon dont Marx traite de ce dernier en particulier montre comment les deux contradictions au cœur du système sont étroitement liées. Le commerce extérieur implique en partie l'investissement (comme on le voit aujourd'hui dans le phénomène de l'outsourcing) dans des sources de force de travail meilleur marché et dans la vente des produits du marché intérieur "au-dessus de leur valeur, bien que meilleur marché que les pays concurrents" (Le Capital, Livre III) 13. Mais la même section parle aussi des "nécessités qui lui sont inhérentes, en particulier du besoin d'un marché de plus en plus étendu." (Ibid.). Ceci est également lié à la tentative de compenser la chute du taux de profit puisque, même si chaque marchandise comprend moins de profit, tant que le capitalisme peut vendre plus de marchandises, il peut réaliser une plus grande masse de profit. Mais ici de nouveau le capitalisme se heurte à ses limites inhérentes :
"Le même commerce extérieur développe à l'intérieur le mode de production capitaliste, par suite la diminution du capital variable par rapport au capital constant, et engendre, d'autre part, la surproduction par rapport aux marchés extérieurs ; il produit donc, de nouveau, à long terme, un effet contraire." (Ibid. p.1022)
ou encore
"La compensation de la baisse du taux de profit par la masse de profit accrue ne vaut que pour le capital total de la société et pour les gros capitalistes complètement installés. Le nouveau capital additionnel, opérant en toute indépendance, ne rencontre pas ces conditions compensatrices ; il est obligé de les conquérir de haute lutte, et c'est ainsi que la baisse du taux de profit provoque la concurrence entre capitalistes, et non inversement celle-ci celle-là. Cette concurrence s'accompagne, certes, d'une hausse temporaire du salaire et d'une baisse correspondante temporaire du taux de profit, le même phénomène se manifeste dans la surproduction de marchandises, l'encombrement des marchés. Le but du capital n'est pas de satisfaire des besoins, mais de produire du profit ; ce but, il ne peut l'atteindre que par des méthodes qui visent à régler la quantité des produits en fonction de l'échelle de la production, et non pas inversement. Dès lors, une discordance ne peut manquer de s'établir entre les dimensions restreintes de la consommation sur une base capitaliste et une production qui tend toujours à dépasser cette limite immanente. D'ailleurs le capital se compose de marchandises ; donc, la surproduction de capital implique celle de marchandises." (Le Capital, Livre III) 14
En cherchant à échapper à l'une de ses contradictions, le capitalisme n'a fait que se confronter aux limites de l'autre. Ainsi Marx voyait l'inévitabilité "des conflits aigus, des crises, des convulsions..." dont il avait déjà parlé dans Le Manifeste. L'approfondissement de ses études de l'économie politique capitaliste l'avait confirmé dans son point de vue selon lequel le capitalisme atteindrait un point où il aurait épuisé sa mission progressive et commencerait à menacer la capacité même de la société humaine à se reproduire. Marx n'a pas spéculé sur la forme précise que prendrait cette chute. Il n'avait même pas encore vu émerger les guerres impérialistes mondiales qui, tout en cherchant à "résoudre" la crise économique pour des capitaux particuliers, allaient tendre à devenir de plus en plus ruineuses pour le capital dans son ensemble et constituer une menace croissante pour la survie de l'humanité. De même, il n'avait fait qu'entrevoir la propension du capitalisme à détruire l'environnement naturel sur lequel, en dernière instance, se base toute reproduction sociale. D'un autre côté, il a posé la question de la fin de l'époque ascendante du capitalisme en des termes très concrets : comme nous l'avons noté dans un précédent article de cette série, dès 1858, Marx considérait que l'ouverture de vastes régions telles que la Chine, l'Australie et la Californie indiquait que la tâche du capitalisme de créer un marché mondial et une production mondiale basée sur ces marchés touchait à sa fin ; en 1881, il parlait du capitalisme dans les pays avancés comme étant devenu un système "régressif", bien que dans les deux cas, il ait pensé que le capitalisme avait encore du chemin à faire (surtout dans les pays périphériques) avant qu'il ne cesse d'être un système ascendant au niveau global.
Au départ, Marx concevait ses études du capital comme une partie d'un travail plus vaste qui embrasserait d'autres domaines de recherche comme l'Etat et l'histoire de la pensée socialiste. De fait, sa vie fut trop courte pour qu'il finisse même la partie "économique", ce qui fait que Le Capital est resté une oeuvre inachevée. En même temps, prétendre élaborer une théorie finale décisive de l'évolution capitaliste aurait été étranger aux prémisses fondamentales de la méthode de Marx, qui considérait l'histoire comme un mouvement sans fin et la dialectique de la "Ruse de la Raison" comme nécessairement pleine de surprises. Par conséquent, dans la sphère de l'économie, Marx n'a pas apporté de réponse définitive sur quel "oiseau de mauvais augure" (le problème du marché ou celui de la baisse du taux de profit) allait jouer le rôle le plus décisif dans l'ouverture des crises qui finiraient par amener le prolétariat à se révolter contre le système. Mais une chose est claire : la surproduction de marchandises comme la surproduction de capital sont la preuve que l'humanité a finalement atteint l'étape où il est devenu possible de subvenir aux besoins de la vie de tous et donc de créer la base matérielle pour l'élimination de toutes les divisions de classe. Que des populations meurent de faim tandis que les marchandises invendues s'accumulent dans les entrepôts ou que les usines qui produisent les biens nécessaires à la vie ferment parce que leur production n'apporte pas de profit, le fossé entre l'immense potentialité contenue dans les forces productives et leur compression dans l'enveloppe de la valeur, tout cela fournit les fondements de l'émergence d'une conscience communiste chez ceux qui sont les plus directement confrontés aux conséquences des absurdités du capitalisme.
Gerrard.
1. Le manifeste du Parti communiste, I. Bourgeois et prolétaires [84].
3. Dans la mythologie nordique, le Ragnarök (vieux norrois signifiant Consommation du Destin des Puissances) désigne une prophétique fin du monde où les éléments naturels se déchaîneront et une grande bataille aura lieu conduisant à la mort de la majorité des divinités, géants et hommes, avant une renaissance. (source Wikipédia).
4. Edition La Pléiade, Oeuvres, Tome 2, publiées sous le nom Matériaux pour l' "économie" , partie IV : "Les crises", page 484. (En anglais, Theories of SurplusValue, 2e partie, chapitre XVII)
5. Edition La Pléiade, Oeuvres Tome 2, Troisième Section, "Conclusions : Les contradictions internes de la loi", p. 1039. (En anglais, chapitre XV, 3e partie).
6. Edition La Pléiade, Oeuvres, Tome2, publié sous le nom Matériaux pour l' "économie" , partie IV : "Les crises".
7. Edition La Pléiade, Oeuvres, Tome2, publié sous le nom Principes d'une critique de l'économie politique, partie II : "Le capital", "Marché mondial et système de besoins", page260-61.
8. Principes d'une critique de l'économie politique, op. cit., partie II : "Le capital", "Surproduction et crises modernes".
9. Matériaux pour l' "économie" , op. cit., partie IV : "Les crises", page 464.
10. Principes d'une critique de l'économie politique, op. cit., partie II : "Le capital", "Baisse du taux de profit", page 271.
11. Edition La Pléiade, Oeuvres Tome 2, Troisième Section, "Conclusions : Les contradictions internes de la loi", p. 1024-25. (En anglais, chapitre XV, 1ère partie).
12. Principes d'une critique de l'économie politique, op. cit., partie II : "Le capital", "Baisse du taux de profit", page 272-73.
13. Edition La Pléiade, Oeuvres Tome 2, Troisième Section, "Le commerce extérieur", p.1021. (En anglais, chapitre XIV, 5e partie).
14. Edition La Pléiade, Oeuvres Tome 2, p. 1038-39, Troisième Section, "Conclusions : Les contradictions internes de la loi", p. 1038-39. (En anglais, chapitre XV, 3e partie).
Questions théoriques:
- Décadence [21]
Ce qui distingue les révolutionnaires du trotskisme (Internationalisme 1947)
- 4358 lectures
Nous publions ci-dessous deux articles de la revue Internationalisme, organe de la Gauche communiste de France dédiés à la question du trotskisme et écrits en 1947. A cette époque, le trotskisme s'était déjà illustré par son abandon de l'internationalisme prolétarien en participant à la Deuxième Guerre mondiale, au contraire des groupes de la Gauche communiste qui, dans les années 1930, avaient résisté à la vague déferlante de l'opportunisme à laquelle avait donné naissance la défaite de la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23. Parmi ces groupes, la gauche italienne autour de la revue Bilan (fondée en 1933) définissait correctement les tâches de l’heure : face à la marche à la guerre, ne pas trahir les principes élémentaires de l’internationalisme ; établir le "bilan" de l’échec de la vague révolutionnaire et de la révolution russe en particulier. La Gauche communiste combattait les positions opportunistes adoptées par la Troisième Internationale dégénérescente, en particulier la politique défendue par Trotsky de Front unique avec les partis socialistes qui jetait par dessus bord toute la clarté si chèrement acquise sur la nature désormais capitaliste de ces derniers. Elle eut même, à plusieurs reprises, l'occasion de confronter son approche politique avec celle, différente, du courant - encore prolétarien à l'époque - constitué autour des positions de Trotsky, notamment lors des tentatives pour réunifier les différents groupes opposés à la politique de l'Internationale Communiste et des PC stalinisés .
C'est avec la même méthode que celle de Bilan que la Gauche communiste de France analyse le fond de la politique du trotskisme qui n'est pas tant "la défense de l'URSS", même si cette question manifeste le plus nettement son fourvoiement, que l’attitude à prendre face à la guerre impérialiste. En effet, comme le met en évidence le premier article, La fonction du trotskisme, l'engagement de ce courant dans la guerre n'est pas en premier lieu déterminé par la défense de l'URSS, comme le prouve le fait que certaines de ses tendances qui rejetaient la thèse de l'État ouvrier dégénéré ont-elles aussi participé à la curée impérialiste. Elle est en fait celle du "moindre mal", le choix de la lutte contre "l'occupation étrangère" et de "l'antifascisme", etc. Cette caractéristique du trotskisme est particulièrement mise en évidence dans le second article publié, "Bravo Abd-El-Krim" ou la petite histoire du trotskisme, qui constate que "toute l’histoire du trotskisme tourne autour de la "défense" de quelque chose" au nom du moindre mal ; ce quelque chose étant tout sauf prolétarien. Cette marque de fabrique du trotskisme n'a en rien été altérée par le temps comme en témoignent les diverses manifestations de l'activisme du trotskisme contemporain, de même que son empressement à choisir un camp contre un autre dans les multiples conflits qui ensanglantent la planète, y compris depuis la disparition de l'URSS.
A la racine de cette errance du trotskisme on trouve, comme le dit le premier article, l'attribution d'un rôle progressiste "à certaines fractions du capitalisme, à certains pays capitalistes (et comme le dit expressément le programme transitoire, à la majorité des pays)". Dans cette conception, selon la caractérisation qu'en fait l'article, "l'émancipation du prolétariat n'est pas le fait de la lutte plaçant le prolétariat en tant que classe face à l'ensemble du capitalisme, mais sera le résultat d'une série de luttes politiques, dans le sens étroit du terme et dans lesquelles, allié successivement à diverses fractions politiques de la bourgeoisie, celui-ci éliminera certaines autres fractions et parviendra ainsi, par degrés, par étapes, graduellement, à affaiblir la bourgeoisie, à triompher d’elle en la divisant et en la battant par morceaux." Il ne reste plus rien de marxiste révolutionnaire dans tout cela.
La fonction du trotskisme
(Internationalisme n° 26 – Septembre 1947)
C'est une grosse erreur, et très répandue, de considérer que ce qui distingue les révolutionnaires du trotskisme, soit la question de la "défense de l'URSS".
Il va de soi que les groupes révolutionnaires, que les trotskistes se plaisent à appeler, avec quelque mépris : "ultragauches" (terme péjoratif des trotskistes à l'égard des révolutionnaires, dans le même esprit que celui de "hitléro-trotskistes" que leur donnent les staliniens), il va de soit que les révolutionnaires rejettent tout naturellement toute espèce de défense de l'État capitaliste (capitalisme d'État) russe. Mais la non défense de l'État russe ne constitue nullement le fondement théorique et programmatique des groupes révolutionnaires, ce n'en est qu'une conséquence politique, contenue et découlant normalement de leurs conceptions générales, de leur plate-forme révolutionnaire de classe. Inversement, la "défense de l'URSS" ne constitue pas davantage le propre du trotskisme.
Si, de toutes les positions politiques qui constituent son programme, "la défense de l'URSS" est celle qui manifeste le mieux, le plus nettement son fourvoiement et son aveuglement, on commettra toutefois une grave erreur en ne voulant voir le trotskisme uniquement qu'à travers cette manifestation. Tout au plus doit-on voir dans cette défense l'expression la plus achevée, la plus typique, l’abcès de fixation du trotskisme. Cet abcès est si monstrueusement apparent que sa vue écœure un nombre chaque jour plus grand d'adhérents de cette quatrième internationale et, fort probablement, il est une des causes, et non des moindres, qui fait hésiter un certain nombre de sympathisants à prendre place dans les rangs de cette organisation. Cependant l'abcès n'est pas la maladie, mais seulement sa localisation et son extériorisation.
Si nous insistons tant sur ce point, c'est parce que trop de gens qui s'effrayent à la vue des marques extérieures de la maladie, ont trop tendance à se tranquilliser facilement dès que ces témoignages disparaissent apparemment. Ils oublient qu'une maladie "blanchie" n'est pas une maladie guérie. Cette espèce de gens est certainement aussi dangereuse, aussi propagatrice de germes de la corruption que l'autre, et peut-être davantage encore, croyant sincèrement en être guérie.
Le "Workers’ Party" aux États-Unis (organisation trotskiste dissidente, connue sous le nom de son leader, Shachtman), la tendance de G. Munis au Mexique , les minorités de Gallien et de Chaulieu, en France, toutes les tendances minoritaires de la "IVe internationale" qui, du fait qu'elles rejettent la position traditionnelle de la défense de la Russie, croient être guéries de "l'opportunisme" (comme elles disent) du mouvement trotskiste. En réalité elles ne sont que "blanchies" restant, quant au fond imprégnées et totalement prisonnières de cette idéologie.
Ceci est tellement vrai qu'il suffit de prendre pour preuve la question la plus brûlante, celle qui offre le moins d'échappatoires, qui se pose et oppose le plus irréductiblement les positions de classe du prolétariat, de la bourgeoisie, la question de l’attitude à prendre face à la guerre impérialiste. Que voyons-nous ?
Les uns et les autres, majoritaires et minoritaires, avec des slogans différents, tous participent à la guerre impérialiste.
Qu'on ne se donne pas la peine de nous citer, pour nous démentir, les déclarations verbales des trotskistes contre la guerre. Nous les connaissons fort bien. Ce qui importe, ce ne sont pas les déclamations mais la pratique politique réelle qui découle de toutes les positions théoriques et qui s'est concrétisée dans le soutien idéologique et pratique des forces de guerre. Peu importe ici de savoir par quels arguments cette participation fut justifiée. La défense de l'URSS est certes un des nœuds les plus importants, qui rattache et entraîne le prolétariat dans la guerre impérialiste. Toutefois il n’est pas le seul nœud. Les minoritaires trotskistes qui rejetaient la défense de l'URSS ont trouvé, tout comme les socialistes de gauche et les anarchistes, d'autres raisons, non moins valables et non moins inspirées d'une idéologie bourgeoise, pour justifier leur participation à la guerre impérialiste. Ce furent, pour les uns, la défense de la "démocratie", pour les autres "la lutte contre le fascisme" ou la "libération nationale" ou encore "le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes".
Pour tous, ce fut une question de "moindre mal", qui les avait fait participer dans la guerre ou dans la Résistance du côté d'un bloc impérialiste contre l'autre.
Le parti de Shachtman a parfaitement raison de reprocher aux trotskistes officiels de soutenir l'impérialisme russe qui, pour lui, n'est plus un "État Ouvrier", mais cela ne fait pas de Shachtman un révolutionnaire car ce reproche, il ne le fait pas en vertu d'une position de classe du prolétariat, contre la guerre impérialiste, mais en vertu du fait que la Russie est un pays totalitaire et où il y a moins de "démocratie" que partout ailleurs et que, en conséquence, il fallait selon lui soutenir la Finlande, qui était moins "totalitaire" et plus démocratique, contre l'agression russe .
Pour manifester la nature de son idéologie, notamment dans la question primordiale de la guerre impérialiste, le trotskisme n'a nullement besoin, comme nous venons de le voir, de la position de défense de l'URSS. Cette défense de l'URSS facilite, évidemment énormément sa position de participation à la guerre lui permettant de la camoufler sous une phraséologie pseudo-révolutionnaire, mais par là-même, elle obscurcit sa nature profonde et empêche de poser la question de la nature de l’idéologie trotskiste en pleine lumière.
Faisons donc, pour plus de clarté, abstraction, pour un moment, de l'existence de la Russie ou si l'on préfère, de toute cette sophistique sur la nature socialiste de l'État russe, par laquelle les trotskistes parviennent à obscurcir le problème central de la guerre impérialiste et de l'attitude du prolétariat. Posons brutalement la question de l'attitude des trotskistes dans la guerre. Les trotskistes répondront évidemment par une déclaration générale contre la guerre.
Mais aussitôt la litanie sur le "défaitisme révolutionnaire" dans l’abstrait correctement citée, ils commenceront immédiatement, dans le concret, par établir des restrictifs, par des "distinctions" savantes, des "mais..." et des "si..." qui les amèneront, dans la pratique à prendre parti pour un des partenaires en présence, et à inviter les ouvriers à participer à la boucherie impérialiste.
Quiconque a eu des rapports avec les milieux trotskistes en France pendant les années 39-45, peut témoigner que les sentiments prédominants chez eux n'étaient pas tant dictés par la position de la défense de la Russie que par le choix du "moindre mal", le choix de la lutte contre "l'occupation étrangère" et de "l'antifascisme".
C'est ce qui explique leur participation à la "résistance" , aux F.F.I. et dans la "libération". Et quand le PCI de France se voit félicité par des sections d'autres pays pour la part qu'il a prise dans ce qu'elles appellent "le soulèvement populaire" de la Libération, nous leur laissons la satisfaction que peut leur donner le bluff sur l'importance de cette part (voyez l’importance de quelques dizaines de trotskistes dans "LE GRAND soulèvement populaire" !). Retenons pour témoignage surtout le contenu politique d'une telle félicitation.
Quel est le critère de l'attitude révolutionnaire dans la guerre impérialiste ?
Le révolutionnaire part de la constatation du stade impérialiste atteint par l'économie mondiale. L'impérialisme n'est pas un phénomène national. La violence de la contradiction capitaliste entre le degré de développement des forces productives - du capital social total - et le développement du marché détermine la violence des contradictions inter impérialistes. Dans ce stade, il ne saurait y avoir de guerres nationales. La structure impérialiste mondiale détermine la structure de toute guerre ; dans cette époque impérialiste il n'y a pas de guerre "progressiste". L'unique progrès n'existant que dans la révolution sociale. L'alternative historique qui est posée à l'humanité étant la révolution socialiste, ou la décadence, la chute dans la barbarie par l'anéantissement des richesses accumulées par l'humanité, la destruction des forces productives et le massacre continu du prolétariat dans une suite interminable de guerres localisées et généralisées. C'est donc un critère de classe en rapport avec l'analyse de l'évolution historique de la société que pose le révolutionnaire.
Voyons comment le pose théoriquement le trotskisme :
"... Mais tous les pays du monde ne sont pas impérialistes. Au contraire, la majorité des pays sont les victimes de l’impérialisme. Certains pays coloniaux ou semi-coloniaux tenteront, sans aucun doute, d'utiliser la guerre pour rejeter le joug de l'esclavage. De leur part, la guerre ne sera pas impérialiste mais émancipatrice. Le devoir du prolétariat international sera d'aider les pays opprimés en guerre contre les oppresseurs..." (Le Programme Transitoire - Chapitre : La Lutte Contre l’Impérialisme et la Guerre)
Ainsi, le critère trotskiste ne se rattache pas à la période historique que nous vivons mais crée, se réfère, à une notion abstraite et partant fausse de l'impérialisme. Est impérialiste uniquement la bourgeoisie d'un pays dominant. L'impérialisme n'est pas un stade politico-économique du capitalisme mondial mais strictement du capitalisme de certains pays, tandis que les autres pays capitalistes qui sont la "majorité", ne sont pas impérialistes. A moins de recourir à une distinction formelle, vide de sens, tous les pays du monde sont actuellement dominés en fait, économiquement, par deux pays : les États-Unis et la Russie. Faut-il conclure que seule la bourgeoisie de ces deux pays uniquement est impérialiste et que l'hostilité du prolétariat à la guerre ne doit s'exercer qu'uniquement dans ces deux pays ?
Bien mieux, si sur les traces des trotskistes l'on retranche encore la Russie qui, par définition, "n'est pas impérialiste", l'on arrive à cette absurdité monstrueuse qu'il n'y a qu'un seul pays impérialiste au monde : les États-Unis. Cela nous conduit à la réconfortante conclusion que tous les autres pays du monde - étant tous "non impérialistes" et "opprimés" - le prolétariat a pour devoir de les aider.
Voyons concrètement, comment cette distinction trotskiste se traduit dans les faits, dans la pratique.
En 1939, la France est un pays impérialiste : défaitisme révolutionnaire.
En 1940-45, la France est occupée : d’un pays impérialiste elle devient un pays opprimé ; sa guerre est "émancipatrice" ; "le devoir du prolétariat est de soutenir sa lutte". Parfait. Mais, du coup, c'est l'Allemagne qui devient, en 1945, un pays occupé et "opprimé" : devoir du prolétariat de soutenir une éventuelle émancipation de l'Allemagne contre la France. Ce qui est vrai pour la France, l'Allemagne, est également vrai pour n'importe quel autre pays : le Japon, l'Italie, la Belgique, etc. Qu'on ne vienne pas parler des pays coloniaux et semi coloniaux. Tout pays, à l'époque impérialiste, qui, dans la compétition féroce entre les impérialismes, n'a pas la chance ou la force d'être le vainqueur devient, en fait, un pays "opprimé". Exemple : l'Allemagne et le Japon et, dans le sens contraire, la Chine.
Le prolétariat n'aura donc pour devoir que de passer son temps à danser d'un plateau de la balance impérialiste sur l'autre, au rythme des commandements trotskistes, et à se faire massacrer pour ce que les trotskistes appellent "Aider une guerre juste et progressiste..." (Voir le Programme Transitoire : même chapitre).
C'est le caractère fondamental du trotskisme que, dans toutes les situations et dans toutes ses positions courantes, il offre au prolétariat une alternative, non d'opposition et de solution de classe du prolétariat contre la bourgeoisie, mais le CHOIX entre deux formations, deux forces également capitalistes "opprimées ..." : entre bourgeoisie fasciste et antifasciste ; entre "réaction" et "démocratie" ; entre monarchie et république ; entre guerre impérialiste et guerres "justes et progressistes".
C'est en partant de ce choix éternel du "moindre mal", que les trotskistes ont participé à la guerre impérialiste, et nullement en fonction de la nécessité de la défense de l'URSS. Avant de défendre cette dernière, ils avaient participé à la guerre d'Espagne (1936-38) pour la défense de l'Espagne républicaine contre Franco. Ce fut ensuite la défense de la Chine de Tchang Kaï-Chek contre le Japon.
La défense de l'URSS apparaît donc, non comme point de départ de leurs positions, mais comme un aboutissement, manifestation entre autres de leur plate-forme fondamentale, plate-forme pour laquelle le prolétariat n'a pas une position de classe propre dans une guerre impérialiste mais qu'il peut et doit faire une distinction entre les diverses formations capitalistes nationales, momentanément antagoniques, qu'il doit proclamer "progressistes" et accorder son aide, en règle générale à celle des formations la plus faible, la plus retardataire, la bourgeoisie "opprimée".
Cette position, dans la question aussi cruciale (centrale) qu'est la guerre, place d'emblée le trotskisme en tant que courant politique hors du camp du prolétariat et justifie à elle seule la nécessité de rupture totale avec lui de la part de tout élément révolutionnaire prolétarien.
Les trotskistes mettent le prolétariat à la remorque de la bourgeoisie proclamée "progressiste".
Cependant, nous n’avons mis en lumière qu'une des racines du trotskisme. D'une façon plus générale, la conception trotskiste est basée sur l’idée que l'émancipation du prolétariat n'est pas le fait de la lutte d'une façon absolue, plaçant le prolétariat en tant que classe face à l'ensemble du capitalisme, mais sera le résultat d'une série de luttes politiques, dans le sens étroit du terme et dans lesquelles, allié successivement à diverses fractions politiques de la bourgeoisie, il éliminera certaines autres fractions et parviendra ainsi, par degrés, par étapes, graduellement, à affaiblir la bourgeoisie, à triompher d’elle en la divisant et en la battant par morceaux.
Que ce soit là, non seulement une très haute vue stratégique, extrêmement subtile et malicieuse, qui a trouvé sa formulation dans le slogan ... "marcher séparément et frapper ensemble...", mais que ce soit encore une des bases de la conception trotskiste, nous en trouvons la confirmation dans la théorie de la "révolution permanente" (nouvelle manière), qui veut que la permanence de la révolution considère la révolution elle-même comme un déroulement permanent d'événements politiques se succédant, et dans lequel la prise du pouvoir par le prolétariat est un événement parmi tant d'autres événements intermédiaires, mais qui ne pense pas que la révolution soit un processus de liquidation économique et politique d'une société divisée en classe et, enfin et surtout, que l’édification socialiste soit seulement possible, qu'elle ne peut commencer qu'après la prise du pouvoir par le prolétariat.
Il est exact que cette conception de la révolution reste, en partie, "fidèle" au schéma de Marx. Mais ce n’est qu'une fidélité à la lettre. Marx a connu ce schéma en 1848, à l'époque où la bourgeoisie constituait encore une classe historiquement révolutionnaire, et c'est dans le feu de révolutions bourgeoises, qui déferlaient dans toute une série de pays d'Europe, que Marx espérait ne pas être arrêtées au stade bourgeois, mais débordées par le prolétariat poursuivant la marche en avant jusqu'à la révolution socialiste.
Si la réalité a infirmé l'espoir de Marx, ce fut en tout cas chez lui une vision révolutionnaire osée, en avance des possibilités historiques. Toute autre apparaît la révolution permanente trotskiste. Fidèle à la lettre, mais infidèle à l'esprit, le trotskisme attribue, UN siècle après la fin des révolutions bourgeoises, à l'époque de l'impérialisme mondial, alors que la société capitaliste est entrée dans son ensemble dans la phase décadente, il attribue à certaines fractions du capitalisme, à certains pays capitalistes (et comme le dit expressément le Programme transitoire, à la majorité des pays) un rôle progressiste.
Marx entendait mettre le prolétariat, en 1848, en avant, à la tête de la société, les trotskistes, eux, en 1947, mettent le prolétariat à la remorque de la bourgeoisie proclamée "progressiste". On peut difficilement imaginer une caricature plus grotesque ; une déformation plus étroite que celle donnée par les trotskistes, du schéma de la révolution permanente de Marx.
Telle que Trotsky l’avait reprise et formulée en 1905, la théorie de la révolution permanente gardait alors toute sa signification révolutionnaire. En 1905, au début de l'ère impérialiste, alors que le capitalisme semblait avoir devant lui de belles années de prospérité, dans un pays des plus retardataires de l'Europe, où subsistait encore toute une superstructure politique féodale, où le mouvement ouvrier faisait ses premiers pas, face à toutes les fractions de la social-démocratie russe qui annonçaient l'avènement de la révolution bourgeoise, face à Lénine qui, plein de restrictions, n’osait aller plus loin que d'assigner à la future révolution la tache de réformes bourgeoises sous une direction révolutionnaire démocratique des ouvriers et de la paysannerie, Trotsky avait le mérite incontestable de proclamer que la révolution serait, ou bien socialiste - la dictature du prolétariat - ou ne serait pas.
L'accent de la théorie de la révolution permanente portait sur le rôle du prolétariat, désormais unique classe révolutionnaire. Ce fut une proclamation révolutionnaire audacieuse, entièrement dirigée contre les théoriciens socialistes petit-bourgeois, effrayés et sceptiques, et contre les révolutionnaires hésitants, manquant de confiance dans le prolétariat.
Aujourd'hui, alors que l'expérience des quarante dernières années a pleinement confirmé ces données théoriques, dans un monde capitaliste achevé et déjà décadent, la théorie de la révolution permanente "nouvelle manière" est uniquement dirigée contre les "illusions" révolutionnaires de ces hurluberlus ultragauches, la bête noire du trotskisme.
Aujourd'hui, l'accent est mis sur les illusions retardataires des prolétaires, sur l’inévitabilité des étapes intermédiaires, sur la nécessité d'une politique réaliste et positive, sur des gouvernements ouvriers et paysans, sur des guerres justes et des révolutions d’émancipation nationales progressistes.
Tel est désormais le sort de la théorie de la révolution permanente, entre les mains de disciples qui n’ont su retenir et assimiler que les faiblesses, et rien de ce qui fut la grandeur, la force et la valeur révolutionnaire du maître.
Soutenir les tendances et les fractions "progressistes" de la bourgeoisie et renforcer la marche révolutionnaire du prolétariat, en l’asseyant sur l'exploitation de la division et l’antagonisme inter capitalistes, sont les deux mamelles de la théorie trotskiste. Nous avons vu ce qui était de la première, voyons le contenu de la seconde.
En quoi résident les divergences dans le camp capitaliste ?
Premièrement dans la manière de mieux assurer l’ordre capitaliste. C'est-à-dire de mieux assurer l'exploitation du prolétariat.
Secondement, sur les divergences d'intérêts économiques de divers groupes composant la classe capitaliste. Trotsky, qui s'est laissé souvent emporter par son style imagé et ses métaphores, au point de perdre de vue leur contenu social réel, a beaucoup insisté sur ce deuxième aspect. "On a tort de considérer le capitalisme comme un tout unifié", enseignait-il. "La musique aussi est un tout, mais serait un bien piètre musicien celui qui ne distinguerait les notes les unes des autres". Et cette métaphore, il l'appliquait aux mouvements et luttes sociales. Il ne peut venir à personne l’idée de nier ou de méconnaître l'existence d'oppositions d’intérêts, au sein même de la classe capitaliste, et des luttes qui en résultent. La question est de savoir la place qu’occupent, dans la société, les diverses luttes. Serait un très médiocre marxiste révolutionnaire celui qui mettrait sur le même pied, la lutte entre les classes et la lutte entre groupes au sein de la même classe.
"L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, n'a été que l'histoire des luttes de classe". Cette thèse fondamentale du Manifeste Communiste, ne méconnaît évidemment pas l'existence des luttes secondaires des divers groupes et individualités économiques à l'intérieur des classes, et leur importance relative. Mais le moteur de l’histoire n'est pas ces facteurs secondaires, mais bien celui de la lutte entre la classe dominante et la classe dominée. Quand une nouvelle classe est appelée, dans l'histoire, à se substituer à l'ancienne, devenue inapte à assurer la direction de la société, c'est-à-dire dans une période historique de transformation et de révolution sociale, la lutte entre ces deux classes détermine et domine absolument, d'une façon catégorique, tous les événements sociaux et tous les conflits secondaires. Dans de telles périodes historiques, comme la nôtre, insister sur les conflits secondaires, au travers desquels on veut déterminer et conditionner la marche du mouvement de la lutte de classe, sa direction et son ampleur, montre avec une clarté éblouissante qu'on n'a rien compris aux questions les plus élémentaires de la sociologie marxiste. On ne fait que jongler avec des abstractions sur des notes de musique, et on subordonne, dans le concret, la lutte sociale historique du prolétariat, aux contingences des conflits politiques inter-capitalistes.
Toute cette politique repose, quant au fond, sur un singulier manque de confiance dans les forces propres du prolétariat. Assurément les trois dernières décennies de défaites ininterrompues ont tragiquement illustré l’immaturité et la faiblesse du prolétariat. Mais on aurait tort de chercher la source de cette faiblesse dans l'auto-isolement du prolétariat, dans l'absence d'une ligne suffisamment souple de conduite envers les autres classes, couches et formations politiques anti-prolétariennes. C'est tout le contraire. Depuis la fondation de l’I.C., on ne faisait que décrier la maladie infantile de la gauche, on élaborait la stratégie irréaliste de la conquête de larges masses, de la conquête des syndicats, l'utilisation révolutionnaire de la tribune parlementaire, du front unique politique avec "le diable et sa grand-mère" (Trotsky), de la participation au gouvernement ouvrier de Saxe....
Quel fut le résultat ?
Désastreux. A chaque nouvelle conquête de la stratégie en souplesse, en suivait une défaite plus grande, plus profonde. Pour pallier à cette faiblesse qu'on attribue au prolétariat, pour le "renforcer", on allait s'appuyer non seulement sur des forces politiques extra-prolétariennes (social-démocratie) mais aussi sur des forces sociales ultra réactionnaires : Partis paysans "révolutionnaires" ; - Conférence internationale de la paysannerie ; Conférence internationale des peuples coloniaux. Plus les catastrophes s’accumulaient sur la tête du prolétariat, plus la rage des alliances et la politique d’exploitation triomphaient dans l‘I.C. Certainement doit-on chercher l'origine de toute cette politique dans l'existence de l'État russe, trouvant sa raison d'être en lui-même, n'ayant par nature rien de commun avec la révolution socialiste, opposé et étranger qu'il [l'État] est et reste au prolétariat et à sa finalité en tant que classe.
L'État, pour sa conservation et son renforcement, doit chercher et peut trouver des alliés dans les bourgeoisies "opprimées", dans les "peuples" et pays coloniaux et "progressistes", parce que ces catégories sociales sont naturellement appelées à construire, elles aussi l’État. Il peut spéculer sur la division et les conflits entre autres États et groupes capitalistes, parce qu'il est de la même nature sociale et classe qu’eux.
Dans ces conflits, l'affaiblissement d'un des antagonistes peut devenir la condition de son renforcement à lui. Il n'en est pas de même du prolétariat et de sa révolution. Il ne peut compter sur aucun de ces alliés, il ne peut s'appuyer sur aucune de ces forces. Il est seul et, qui plus est, en opposition de tout instant, en opposition historique irréductible avec l'ensemble de ces forces et éléments qui, face à lui, présentent une unité indivisible.
Rendre conscient le prolétariat de sa position, de sa mission historique, ne rien lui cacher sur les difficultés extrêmes de sa lutte, mais également lui enseigner qu'il n'a pas de choix, qu’au prix de son existence humaine et physique, il doit et peut vaincre malgré les difficultés, c’est l’unique façon d'armer le prolétariat pour la victoire.
Mais chercher à contourner la difficulté en cherchant au prolétariat des alliés (même temporaires) possibles, en lui présentant des forces "progressistes" dans les autres classes, sur lesquelles il puisse appuyer sa lutte, c'est le tromper pour le consoler, c’est le désarmer, c'est le fourvoyer.
C'est effectivement en ceci que consiste la fonction du mouvement trotskiste à l’heure présente.
Marc
"Bravo Abd-El-Krim" ou la petite histoire du trotskisme
(Internationalisme n° 24 – Juillet 1947)
Certaines gens souffrent d’un sentiment d’infériorité, d’autres d’un sentiment de culpabilité, d’autres encore de la manie de la persécution. Le trotskisme, lui, est affligé d’une maladie qu'on pourrait, faute de mieux, appeler le "défensisme". Toute l’histoire du trotskisme tourne autour de la "défense" de quelque chose. Et quand par malheur il arrive aux trotskistes des semaines creuses où ils ne trouvent rien ni personne à défendre, ils sont littéralement malades. On les reconnaît alors à leurs mines tristes, défaites, à leurs yeux hagards, cherchant partout comme le toxicomane sa ration quotidienne de poison : une cause ou une victime dont ils pourraient bien prendre la défense.
Dieu merci qu’il existe une Russie qui avait connu autrefois la révolution. Elle servira aux trotskistes à alimenter jusqu’à la fin des jours leur besoin de défense. Quoiqu’il advienne de la Russie, les trotskistes resteront inébranlablement pour la "défense de l’URSS" car ils ont trouvé en la Russie une source inépuisable pouvant satisfaire leur vice "défensiste".
Mais il n’y a pas que les grandes défenses qui comptent. Pour remplir la vie du trotskisme, il lui faut en plus de la grande, l’immortelle, l’inconditionnelle "défense de l’URSS" - qui est le fondement et la raison d’être du trotskisme - il lui faut encore les menues "défenses… quotidiennes", la petite "défense journalière".
Le capitalisme, dans sa phase de décadence, déchaîne une destruction générale telle qu’en plus du prolétariat, victime de toujours du régime, la répression et le massacre se répercutent en se multipliant au sein même de la classe capitaliste. Hitler massacre les bourgeois républicains, Churchill et Truman pendent et fusillent les Goering et Cie, Staline met tout le monde d’accord en massacrant les uns et les autres. Le chaos sanglant généralisé, le déchaînement d’une bestialité perfectionnée et d’un sadisme raffiné inconnus jusque là sont la rançon immanquable de l’impossibilité du capitalisme à surmonter ses contradictions, et de l’absence d’une volonté consciente du prolétariat pour le faire dépérir. Que Dieu soit loué ! Quelle aubaine pour nos chercheurs de causes à défendre ! Nos trotskistes sont à l’aise. Chaque jour se présentent des occasions nouvelles pour nos chevaliers modernes, leur permettant de manifester au grand jour leur généreuse nature de redresseurs de torts et de vengeurs d’offensés.
Qu’on jette donc un coup d’œil sur ce calendrier suggestif de l’histoire du trotskisme
A l'automne 1935, l’Italie commence une campagne militaire contre l’Éthiopie. C’est incontestablement une guerre impérialiste de conquête coloniale opposant d’un côté un pays capitaliste avancé : l’Italie, à un pays arriéré : l’Éthiopie, économiquement et politiquement encore semi-féodal de l’autre côté. L’Italie, c’est le régime de Mussolini, l’Éthiopie, c’est le régime du Négus, le "roi des rois". Mais la guerre italo-éthiopienne est encore plus qu’une simple guerre coloniale du type classique. C’est la préparation, le prélude à la guerre mondiale qui s’annonce. Mais les trotskistes n’ont pas besoin de voir si loin. Il leur suffit de savoir que Mussolini est le "méchant agresseur" contre le "royaume pauvre" du Négus, pour prendre immédiatement la défense "inconditionnelle" de l’indépendance nationale de l’Éthiopie. Ah, mais comment ! Ils joindront leurs voix au chœur général (surtout chœur du bloc "démocratique" anglo-saxon qui est en formation et qui se cherche encore) pour réclamer des sanctions internationales contre "l’agression fasciste". Plus défenseurs que quiconque n’ayant sur ce point de leçons à recevoir de personne, ils blâmeront et dénonceront la défense insuffisante, à leur avis, de la part de la SDN , et appelleront les ouvriers du monde à assurer la défense de l’Éthiopie et du Négus. Il est vrai que la défense trotskiste n’a pas porté beaucoup de chance au roi Négus, qui malgré cette défense, a été battu. Mais on ne saurait en toute justice faire porter le poids de cette défaite à leur compte, car quand il s’agit de défense, et même celle d’un Négus, les trotskistes ne chicanent pas. Ils sont là et bien là !
En 1936, la guerre se déchaîne en Espagne. Sous forme de "guerre civile" interne, divisant la bourgeoisie espagnole en clan franquiste et clan républicain, se fait avec la vie et le sang des ouvriers, la répétition générale en vue de la guerre mondiale imminente. Le gouvernement républicain-stalinien-anarchiste est dans une position d’infériorité militaire manifeste. Les trotskistes naturellement volent au secours de la République "en danger contre le fascisme". Une guerre ne peut évidemment se poursuivre avec l’absence de combattants et sans matériel. Elle risque de s’arrêter. Effrayés par une telle perspective, où il n’y aura plus de question de défense, les trotskistes s’emploient de toutes leurs forces à recruter des combattants pour les brigades internationales et se dépensent tant et tant pour l’envoi "des canons à l’Espagne". Mais le gouvernement républicain, ce sont les Azaña, les Negrin, les amis d’hier et de demain de Franco contre la classe ouvrière. Les trotskistes ne regardent pas de si près ! Ils ne marchandent pas leur aide. On est pour ou contre la Défense. Nous trotskistes, nous sommes néo-défenseurs. Un point c’est tout.
En 1938, la guerre fait rage en Extrême-Orient. Le Japon attaque la Chine de Tchang Kaï-Chek. Ah ! Alors, pas d’hésitation possible : "Tous comme un seul homme pour la défense de la Chine". Trotsky lui-même expliquera que ce n’est pas le moment de se rappeler le sanglant massacre de milliers et de milliers d’ouvriers de Shanghai et de Canton par les armées de ce même Tchang Kaï-Chek lors de la révolution de 1927. Le gouvernement de Tchang Kaï-Chek a beau être un gouvernement capitaliste à la solde de l’impérialisme américain et qui, dans l’exploitation et la répression des ouvriers, ne le cède en rien au régime japonais, cela importe peu, devant le principe supérieur de l’indépendance nationale. Le prolétariat international mobilisé pour l’indépendance du capitalisme chinois reste toujours dépendant… de l’impérialisme yankee, mais le Japon a effectivement perdu la Chine et a été battu. Les trotskistes peuvent être contents. Au moins ont-ils réalisé la moitié de leur but. Il est vrai que cette victoire antijaponaise a coûté quelques dizaines de millions d’ouvriers massacrés pendant 7 ans sur tous les fronts du monde pendant la dernière guerre mondiale. Il est vrai que les ouvriers en Chine comme partout ailleurs continuent à être exploités et massacrés chaque jour. Mais est-ce que cela compte à côté de l’indépendance assurée (toute relative) de la Chine ?
1939 – L’Allemagne d’Hitler attaque la Pologne. En avant pour la défense de la Pologne ! Mais voilà que l’"État ouvrier" russe attaque aussi la Pologne, de plus, fait la guerre à la Finlande et arrache de force des territoires à la Roumanie. Cela embrouille un peu les cerveaux trotskistes qui, comme les staliniens, ne retrouvent complètement leurs sens qu’après l’ouverture des hostilités entre la Russie et l’Allemagne. Alors tout devient simple, trop simple, tragiquement simple. Pendant 5 ans, les trotskistes appelleront les prolétaires de tous les pays à se faire massacrer pour la "défense de l’URSS" et par ricochet tout ce qui est allié de l’URSS. Ils combattront le gouvernement de Vichy qui veut mettre au service de l’Allemagne l’empire colonial français et risque ainsi "son unité". Ils combattront Pétain et autres Quisling. Aux États-Unis, ils réclameront le contrôle de l’armée par les syndicats afin de mieux assurer la défense des États-Unis contre la menace du fascisme allemand. Ils seront de tous les maquis et de toutes les résistances, dans tous les pays. Ce sera la période de l’apogée de la "défense".
La guerre peut bien finir, le profond besoin de "défense" chez les trotskistes, lui, est infini. Le chaos mondial qui a suivi la cessation officielle de la guerre, les divers mouvements de nationalisme exaspéré, les soulèvements nationalistes bourgeois dans les colonies, autant d’expressions du chaos mondial qui a suivi la cessation officielle de la guerre, et qui sont utilisés et fomentés un peu partout par les grandes puissances pour leurs intérêts impérialistes, continueront à fournir amplement matière à défendre pour les trotskistes. Ce sont surtout les mouvements bourgeois coloniaux où, sous les drapeaux de "libération nationale" et de "lutte contre l’impérialisme" (toute verbale), on continue à massacrer des dizaines de milliers de travailleurs, qui mettront le comble à l’exaltation de défense des trotskistes.
En Grèce, les deux blocs russe et anglo-américain s’affrontent pour la domination des Balkans, sous couleur locale d’une guerre de partisans contre le gouvernement officiel, les trotskistes sont de la danse. "Bas les pattes devant la Grèce !" hurlaient-ils, et ils annoncent la bonne nouvelle aux prolétaires, de la constitution de brigades internationales sur le territoire yougoslave du "libérateur" Tito dans lesquelles ils invitent les ouvriers à s’embrigader pour libérer la Grèce.
Avec non moins d’enthousiasme, ils relatent leurs faits d’armes héroïques en Chine dans les rangs de l’armée dite communiste et qui a de communiste tout juste autant que le gouvernement russe de Staline dont elle est l’émanation. L’Indochine, où les massacres y sont également bien organisés, sera une autre terre d’élection pour la défense trotskiste de "l’indépendance nationale du Vietnam". Avec le même élan généreux, les trotskistes soutiendront et défendront le parti national bourgeois du Destour, en Tunisie, du parti national bourgeois (PPA) d’Algérie. Ils découvriront des vertus libératrices au MDRM, mouvement bourgeois nationaliste de Madagascar. L’arrestation, par leurs compères du gouvernement capitaliste français, des conseillers de la République et députés de Madagascar, met le comble à l’indignation des trotskistes. Chaque semaine La Vérité sera remplie avec ses appels pour la défense des "pauvres" députés malgaches. "Libérez Ravoahanguy, libérez Raharivelo, libérez Roseta !" Les colonnes du journal seront insuffisantes pour contenir toutes les "défenses" qu’ont à soutenir les trotskistes. Défense du parti stalinien menacé aux États-Unis ! Défense du mouvement pan-arabe contre le sionisme colonisateur juif en Palestine, et défense des enragés de la colonisation chauvine juive, les leaders terroristes de l’Irgoun, contre l’Angleterre ! Défense des Jeunesses Socialistes contre le Comité Directeur de la SFIO.
Défense de la SFIO contre le néo-socialiste Ramadier.
Défense de la CGT contre ses chefs.
Défense des "libertés…" contre les menaces "fascistes de de Gaulle".
Défense de la Constitution contre la Réaction.
Défense du gouvernement PS-PC-CGT contre le MRP.
Et dominant le tout, défense de la "pauvre" Russie de Staline, MENACÉE D’ENCERCLEMENT ! par les États-Unis.
Pauvres, pauvres trotskistes, sur les frêles épaules de qui pèse la lourde charge de tant de "défenses" !
Le 31 mai dernier s’est produit un événement quelque peu sensationnel : Abd-El-Krim, le vieux chef du Rif , brûlait la politesse au gouvernement français, en s’évadant au cours de son transfert en France. Cette évasion fut préparée et exécutée avec la complicité du roi Farouk d’Égypte, qui lui a donné un asile, on peut le dire, royal et aussi avec l’indifférence bienveillante des États-Unis. La presse et le gouvernement français sont consternés. La situation de la France dans ses colonies est rien moins que sûre, pour y ajouter de nouvelles causes de troubles. Mais plus qu’un danger réel, l’évasion d’Abd-El-Krim est surtout un événement ridiculisant un peu plus la France dont le prestige dans le monde est déjà suffisamment ébranlé. Aussi comprend-t-on parfaitement les récriminations de toute la presse se plaignant de l’abus de confiance d’Abd-El-Krim envers le gouvernement démocratique français et s’évadant en dépit de sa parole d’honneur donnée.
Évènement "formidable" pour nos trotskistes trépignant de joie et d’enthousiasme. La Vérité du 6 juin, sous le titre "Bravo Abd-El-Krim" s’attendrit sur celui qui "… conduisait la lutte héroïque du peuple marocain…" et d’expliquer la grandeur révolutionnaire de son geste. "Si vous avez, écrit La Vérité, trompé ces messieurs de l’État-major et du Ministère des Colonies, vous avez bien fait. Il faut savoir tromper la bourgeoisie, lui mentir, ruser avec elle, enseignait Lénine…". Voilà Abd-El-Krim transformé en élève de Lénine, en attendant de devenir un membre d’honneur du Comité Exécutif de la 4ème Internationale !
Les trotskistes assurent au "vieux lutteur rifain, qui comme par le passé veut l’indépendance de son pays" que "Aussi longtemps qu’Abd-El-Krim se battra, tous les communistes du monde lui prêteront aide et assistance." Et de conclure : "Ce qu’hier disaient les staliniens, nous autres trotskistes le répétons aujourd’hui."
En effet, en effet, on ne pouvait mieux le dire !
Nous ne reprochons pas aux trotskistes de "répéter aujourd’hui ce que les staliniens disaient hier" et faire ce que les staliniens ont toujours fait. Nous ne disputerons pas davantage aux trotskistes de "défendre" ceux qu’ils veulent. Ils sont tout à fait dans leur rôle.
Mais qu’il nous soit permis d’exprimer un souhait, un unique souhait. Mon dieu ! Pourvu que le besoin de défense des trotskistes ne se porte pas un jour sur le prolétariat. Car avec cette sorte de défense, le prolétariat ne se relèvera jamais.
L’expérience du stalinisme lui suffit amplement !
Marc
. Lire notre brochure La Gauche Communiste de France [86].
. Lire notre article, La Gauche Communiste et la continuité du marxisme [87].
. Lire à ce propos le premier chapitre de La Gauche Communiste de France : Les tentatives avortées de création d’une Gauche communiste de France.
. [Note de la rédaction] Une référence particulière doit être faite à Munis qui rompra avec le trotskisme sur la base de la défense de l'internationalisme prolétarien. Voir à ce sujet notre article de la Revue internationale n° 58, A la mémoire de Munis, un militant de la classe ouvrière [88].
. [Note de la rédaction] Il s'agit de l'offensive russe en 1939 qui, en plus de la Finlande, a concerné également la Pologne (en cours d'invasion par Hitler) les Pays Baltes et la Roumanie.
. Il est tout à fait caractéristique que le groupe Johnson-Forest qui vient de scissionner d’avec le parti de Schachtman et qui se considère "très à gauche", du fait qu’il rejette à la fois la défense de l’URSS et les positions antirusses de Schachtman. Ce même groupe critique sévèrement les trotskistes français qui, d’après lui, n’avaient pas participé assez activement à la "Résistance". Voilà un échantillon typique du trotskisme.
. [Note de la rédaction] Forces Françaises de l'Intérieur, l'ensemble des groupements militaires de la Résistance intérieure française qui s'étaient constitués dans la France occupée et placés, en mars 1944, sous le commandement du général Kœnig et l'autorité politique du général de Gaulle.
. [Note de la rédaction] Parti Communiste Internationaliste, résultat du regroupement en 1944 du Parti Ouvrier Internationaliste et du Comité Communiste Internationaliste.
. [Note de la Rédaction] Société des Nations, précurseur d’avant-guerre des Nations Unies.
. Lire, par exemple, dans La Vérité du 20/06/47, dans "La lutte héroïque des trotskistes chinois" : "Dans la province de Chantoung, nos camarades devinrent les meilleurs combattants de guérillas… Dans la province de Kiang-Si, … les trotskistes sont salués par les staliniens comme ‘les plus loyaux combattants antijaponais’… etc."
. [Note de la Rédaction] Vidkun Quisling fut le dirigeant du Nasjonal Samling (parti nazi) norvégien et dirigeant du gouvernement fantoche mis en place par les Allemands après l’invasion de la Norvège.
. [Note de la Rédaction] Josip Broz Tito, fut un des principaux responsables de la résistance yougoslave, et prit le pouvoir en Yougoslavie à la fin de la guerre.
. [Note de la rédaction] Abd-el-Krim El Khattabi, (né vers 1882 à Ajdir au Maroc, mort le 6 février 1963 au Caire en Égypte) mena une longue résistance contre l’occupation coloniale du Rif – région montagneuse du nord du Maroc – d’abord par les Espagnols, ensuite par les Français et réussit à constituer une "République confédérée des tribus du Rif" en 1922. La guerre pour écraser cette nouvelle république fut menée par une armée de 450 000 hommes réunie par les gouvernements français et espagnol. En voyant sa cause perdue, Abd-el-Krim s’est constitué prisonnier de guerre afin d’épargner les vies des civils, ce qui n’a pas empêché les Français de bombarder les villages avec du gaz moutarde provoquant ainsi 150 000 morts civils. Abd-el-Krim est exilé à la Réunion à partir de 1926 où il vit en résidence surveillée, mais reçoit la permission de revenir vivre en France en 1947. Lorsque son navire fait escale en Égypte, il réussit à fausser compagnie à ses gardiens, et finit sa vie au Caire (voir Wikipedia [89]).
Courants politiques:
- Trotskysme [90]



