Révolution Internationale - 1973
- 890 lectures
Révolution Internationale (nouvelle série) N°2 - février
- 36 lectures
Rubrique:
Les barricades de la bourgeoisie
- 59 lectures
La célébration du suffrage universel
Ces derniers mois, le monde a vécu à l’heure dos élections, Tour à tour, ce sont les populations du Canada, des Etats-Unis, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Australie, do Nouvelle Zélande et di Japon qui ont été conviées à se rendre massivement aux urnes.
Au-delà de la simple coïncidence de dates, ce qui a frappé, au sujet de ces consultations électorales, c'est la débauche de moyens mis en œuvre par les gouvernements et les partis politiques pour faire voter. Chacun a encore en mémoire l'énorme battage publicitaire qui a entouré les élections américaines et leur préparation (élections primaires, ascension de Mac Govern etc.). On se souvient aussi qu'à cette occasion, le très réactionnaire Nixon a pris une mesure que notre PCP réclame à cor et à cris depuis longtemps : le droit de vote à 18 ans. Et il n'a pas été seul dans ce cas puisque les gouvernements allemand et néerlandais l’ont imité peu après.
En France, la radio, la télévision, la grande presse et les sondages d’opinion sont mobilisés dans la préparation des élections. Rien ne manque pour rehausser l’importance de l’évènement. La télévision à elle seule, avec ses "armes égales” et "Portraits de candidats" a commencé à "chauffer ll’ambiance" avant même l’ouverture officielle de la campagne électorale. Tous les partis mènent campagne tambour battant îles uns activement autour de leur "Programme Commun", les autres bruyamment contre. Et à côté des "grands partis sérieux" on a vu resurgir les adeptes d'un "parlementarisme révolutionnaire" : les trots kystes, qui ne sont pas les derniers à engager les électeurs à accomplir leur devoir.
Bref, tout est mis en œuvre pour que les élections législatives du 4 et du ll mars soient l'évènement de l'année 1973 ...A tel point que même l'ouverture do la pêche a été déplacée pour ne pas qu'elle porte ombrage à cette célébration.
En a-t-il toujours été ainsi ?
Aujourd'hui, tout ce tapage est entré dans les mœurs et parait presque normal. Et chacun semble avoir oublié qu’avant qui on ne parle de "devoir électoral"; les travailleurs du siècle dernier se sont battus pendant des dizaines d'années peur le "droit électoral”, pour le suffrage universel.
En Angleterre, maintenant considérée comme le pays démocratique par excellence, le suffrage universel faisait partie des revendications du mouvement chartiste, première manifestation massive du prolétariat mondial et qui mena pendant la première moitié du 19e siècle des luttes souvent sanglantes. En 1848, cette même revendication se trouvait dans le Manifeste Communiste.
En Allemagne, où tout le monde s’est félicité récemment du pourcentage élevé de participation électorale, ce n'est qu'en 1866 que les travailleurs ont obtenu ce que les luttes de 1848-49 n'avaient pu leur donner : le suffrage universel.
En Italie, où la loi accorde aujourd’hui une journée chômée pour les élections, tout le 19e siècle est fait de luttes pour l'obtention, entre autres, de ce droit.
En Belgique, où aujourd'hui le vote est obligatoire, le suffrage universel nia été arraché qu'après des mouvements successifs de grève générale de 1893, 1902 et 1913.
En France, enfin, où lion parle tant du "devoir électoral”, c'est le suffrage censitaire qui, malgré l789, a cours durant la majeure partie du 19e siècle. Ce n'est qu'après le bain de sang de la Commune que les travailleurs obtiennent définitivement le suffrage universel.
La question se pose donc pourquoi cette même bourgeoisie qui, au siècle dernier réprimait violemment les ouvriers qui demandaient le suffrage universel, fait tant d'efforts aujourd'hui pour que le maximum d'entre eux aille voter? Pourquoi est-elle devenue si démocratique?
Pour répondre à cette question, il faut faire ressortir ce qui distingue ces deux époques du capitalisme.
Deux époques du Parlement
Au siècle dernier, le capitalisme cornait sa phase d'apogée. Alimentée en débouchés par les sabres et les goupillons des "civilisateurs”, la production capitaliste se développe à pas de géant. Les crises cycliques qui secouent l'économie et éliminent les entreprises les plus faibles trouvent une solution dans l'élargissement du marché: elles constituent les battements de cœur du système.
C'est dans cette période de prospérité que la bourgeoisie assoit sa domination politique sur l'ensemble de la société et élimine brutalement ou progressivement le pouvoir de l'ancienne classe régnante : la noblesse. Le suffrage universel et le parlement constituent un des moyens les plus importants de lutte de la fraction radicale de la bourgeoisie contre la noblesse et contre les fractions rétrogrades de celle-là.
La lutte que mène le prolétariat, durant cette période est directement conditionnée par la situation du capitalisme. En l'absence de crise mortelle de celui-ci, la révolution socialiste n’est pas à l'ordre du jour. Pour le prolétariat il est seulement question de s'aménager la meilleure place possible dans le système, donc de lutter pour des réformes.
Les syndicats et les partis parlementaires lui permettant de se regrouper indépendamment des partis bourgeois et démocratiques et de faire pression sur l'ordre existant, au besoin en faisant alliance avec les fractions radicales de la bourgeoisie, sont les moyens qu'il se donne pour l'obtention des réformes.
Le parlement étant le lieu où les différentes fractions de la bourgeoisie s'unissent ou s'affrontent pour gouverner la société, le prolétariat se doit d'y participer pour tenter d'infléchir son action dans le sens de la défense de ses intérêts et ceci malgré les dangers de mystification qu'une telle politique peut lui faire encourir.
Parallèlement, les élections constituent une tribune pour la propagande ouvrière, c’est pour cela que Marx écrit en 1850 :
- "même là où il n'y a pas la moindre perspective de succès, les ouvriers doivent présenter leurs propres candidats, afin de conserver leur indépendance, de compter leurs forces et de faire connaître leur position révolutionnaire et les points de vue de leur parti"[1]. (1)
Avec le 20e siècle, le capitalisme entre dans une nouvelle phase: celle de son déclin. Le partage du monde est terminé entre les grandes puissances. Chacune d'entre elles ne peut s’approprier de nouveaux marchés qu'au détriment des autres : le nouveau cycle de l”économie est désormais: crise -guerre impérialiste- reconstruction... Avec l'agonie du capitalisme s'ouvre, comme dit l'internationale Communiste", l'ère des guerres et des révolutions" En Russie (1905 et 1917), Allemagne (1918- 23) Hongrie (1919), Italie (1920) le prolétariat fait, trembler le vieux monde et pose sa candidature à sa succession.
Pour faire face à ses difficultés croissantes le capital est- contraint de renforcer constamment le pouvoir de son Etat.
- De plus en plus, l'Etat tend à se rendre maître de l'ensemble de la vie sociale en premier lieu dans le domaine économique. Cette évolution du rôle de l'état s'accompagne d'un affaiblissement du rôle du législatif en faveur de l'exécutif. Comme le dit le deuxième congrès de l'Internationale Communiste: "Le centre de gravité de la vie politique actuelle est complètement définitivement sorti du Parlement".
Aujourd'hui, en France, il est patent que l'Assemblée nationale n'a plus aucun pouvoir, c'est tout au plus une chambre d'enregistrement: la grande majorité (80%) des lois qu'elle vote est présentée par le gouvernement et une fois votées cette loi doit être promulguée par le président de la république et pour prendre effet elle doit encore attendre que soit signé le décret d'application par ce même président. Ce dernier peut d'ailleurs se passer carrément du parlement pour légiférer en ayant recours aux ordonnances ou encore à l'aide de l'article 16 de la constitution qui lui donne les pleins pouvoirs.
Ce rôle insignifiant du parlement se traduit par une participation ridicule des députés à ses séances : la plupart du temps ils ne sont pas plus d'une vingtaine à suivre ses débats.
Dans d'autres pays où subsiste une constitution plus "démocratique", l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas par exemple, les crises gouvernementales se suivent ce qui indique une inadaptation des institutions aux nécessités actuelles du capital.
Le déclin du parlement comme organe de pouvoir est un fait objectif, lié à l'évolution de la société capitaliste et absolument indépendant, de la volonté des hommes et des partis politiques. En ce sens, la promesse de certains partis et en particulier de la gauche, de redonner vie au parlement est parfaitement mystificatrice : autant vouloir ressusciter un cadavre.
La question se pose donc : si les parlements et par suite les élections ont perdu l'essentiel du rôle politique qu'ils avaient au siècle dernier, pourquoi la bourgeoisie et ses différents partis font-ils un tel tapage et de telles dépenses pour pousser les citoyens vers les urnes ?
A quoi servent aujourd'hui parlements et élections ?
La théorie marxiste attribue à toute superstructure de la société de classes une double fonction: permettre que s’exercent du mieux possible les lois économiques au bénéfice de la classe dominante et entretenir auprès des classes dominées la mystification nécessaire pour qu'elles ne rejettent pas leur oppression. Le droit n'échappe pas à cette 'réglé et c’est justement avec cette forme idéologique qu'on voit le mieux, au cours de l'histoire, se manifester cette double fonction,
A l'origine de la civilisation, le droit remplit essentiellement la première de ces fonctions et ceci avec une franchise quelquefois brutale : ainsi les juristes romains ne se gênent-ils pas pour affirmer que les esclaves sont des "choses” et non des personnes. Mais plus le développement de l'économie et de la civilisation font entrer l'ensemble de la société dans la vie sociale active, plus la fonction essentielle du droit devient, non pas de refléter, mais précisément de masquer la réalité économique et sociale. Ainsi, le droit féodal qui reconnaît l'existence de privilèges et déclare "sujets" la majorité des hommes, est-il incomparablement plus sincère que le droit bourgeois avec son "peuple souverain" et ses " citoyens " "égaux en droit". De même; l'exploitation de l'ouvrier dans la société capitaliste est autrement plus insidieuse et voilée que celle du serf dans la société féodale pour qui le temps de travail qu'il consacre à lui-même est matériellement distinct de celui qu'il donne au seigneur.
Comme forme juridique et politique l'institution parlementaire et électorale exerce donc cette double fonction et c'est justement la reconnaissance de cette dualité et de son évolution historique qui permet d'élucider le changement d'attitude de la bourgeoisie à l'égard du phénomène électoral.
Il est certain, qu'au siècle dernier, la fonction mystificatrice du parlement et des élections existaient déjà comme était déjà mystificateur l'ensemble des superstructures mises en place par la bourgeoisie au cours de sa révolution et en premier lieu ses constitutions qui toutes sont fondées sur la "souveraineté du peuple". Dès 1879, Marx et Engels, dans une lettre circulaire [2](1), mettaient en garde la Social-Démocratie contre les dangers de la mystification électoraliste, mystification à laquelle Engels lui-même n'échappait pas quand il écrivait en 1895:
- "Cette bonne utilisation du suffrage universel entraîna un tout nouveau mode de lutte du prolétariat, mode qui se développa rapidement. On s'aperçut que les institutions dans lesquelles s'organise le pouvoir de la bourgeoisie, offre, à la classe ouvrière de larges moyens de combat...
Et ainsi la bourgeoisie et le gouvernement en vinrent à craindre; bien plus l'action légale du parti ouvrier, bien plus les résultats de l'élection que ceux de la révolte."[3](2)
Mais pendant toute cette période, la fonction mystificatrice de l'institution parlementaire passe au second rang derrière la fonction politique, et ce n'est pas par hasard que la bourgeoisie fait tout son possible pour en interdire l'accès au prolétariat. En même temps que s'amenuise la fonction politique effective du parlement, sa fonction mystificatrice grandit et la bourgeoisie ne s'y trompe pas qui, dès 1917 en Russie, et 1919 en Allemagne brandit l'assemblée constituante contre la révolution prolétarienne, d'une façon désespérée dans le premier cas mais avec succès dans le second.
Désormais, la démocratie parlementaire sera le meilleur moyen dont disposera la bourgeoisie pour domestiquer le prolétariat. Et la défense de cette démocratie sera le thème qui permettra de mobiliser les travailleurs pour la seconde boucherie inter-impérialiste là où les mots d’ordre nationalistes sont restés sans effet.
Rôle des élections dans la crise actuelle
Depuis des décennies les différentes bourgeoisies avec leurs partis et leurs coalitions interchangeables, démocrates et républicains, conservateurs et travaillistes, socio-démocrates et démocrates-chrétiens, centre droit et centre gauche ont amusé la galerie en faisant croire que leurs élections permettaient un choix véritable, mais cette alternance même fait partie de la mystification puisqu'elle ne représente aucun changement véritable, ni souvent même minime, dans la façon dont ces bourgeoisies gèrent leur capital national.
Dans toute la période de reconstruction qui suit la seconde guerre mondiale et pendant laquelle le capital, mondial semble avoir résolu de façon définitive ses contradictions, le petit train-train électoral suffit, sans efforts particuliers de la bourgeoisie, à produire une dose suffisante d'illusions pour maintenir le prolétariat en place.
Depuis quelques années, le capitalisme est entré dans une nouvelle période de difficultés et de soubresauts. "Révolution Internationale" en a suffisamment traité depuis 1968 pour qu'on n'y revienne pas ici[4] (1).
A ces difficultés le prolétariat mondial a opposé une réaction inconnue depuis 50 ans et est revenu hanter, à l'Est comme à l'Ouest, l'ensemble de la classe capitaliste. Celle-ci a dû réagir à son tour, en même temps qu'elle a commencé à prendre une série de mesures de sauvegarde de ses économies nationales: dévaluation plans d'austérité, blocage des prix et salaires, elle s'est remise à brandir frénétiquement et avec des moyens exceptionnels son suffrage universel et ses élections.
En France, la manœuvre est plus qu'évidente. Certes, la venue au pouvoir de la gauche a de quoi effrayer un certain nombre de professionnels de la politique qui depuis l5 ans tètent au pis du gaullisme et qui se retrouveraient sans emploi. Elle peut inquiéter un certain nombre de capitalistes qui se verraient obligés de vendre leurs usines à l'état, mais avec les dédommagements qu'on leur donnerait, ils pourraient toujours réinvestir dans les 85% de l'économie non touchée par les nationalisations. Mais Marchais, Mitterrand et compagnie font tous leurs efforts pour rassurer la bourgeoisie : Pompidou pourra rester en place s’il veut, il n'est pas question d'étendre les nationalisations au-delà de celles prévues dans le programme et Marchais n’a pas peur de dire "Les ouvriers travailleraient davantage s'ils avaient un gouvernement dans lequel ils ont confiance"[5](1)
Bref, si Mitterrand et Marchais venaient au pouvoir, cela ne changerait pas grand-chose à la situation du capital national, plutôt moins que les mesures de 1945 avec De Gaulle. Quant aux travailleurs, ils sont déjà prévenus : en échange de quelques broutilles accordées depuis déjà longtemps dans d'autres pays européens, ils seraient conviés à être encore plus exploités... et dans l'enthousiasme
En fait, pour la bourgeoisie, l'enjeu principal des élections n'est pas dans l'équipe qui sera au pouvoir au lendemain du ll mars : quelle que soit la coloration de celle-ci, sa politique lui sera dictée par des nécessités qui dépassent les convictions et les intérêts particuliers des hommes et des partis, les nécessités de la défense du capital national, privé et étatique contre les travailleurs, et contre les autres capitaux nationaux[6](2).
Le véritable enjeu des élections est ailleurs. Pour tous les partis du capital, ce qui compte aujourd'hui par-dessus tout, c'est bien de briser l'offensive que la classe ouvrière a réengagée depuis plusieurs années contre l'exploitation et les élections sont un excellent moyen de détourner son mécontentement vers un terrain qui n'est pas le sien, où elle ne peut être que vaincue. Tous les grands partis du capital tiennent aux travailleurs le même langage : "laissez là vos luttes et allez voter". C'est ainsi que Messmer exhorte les travailleurs à la "modération" et fait appel à leur "solidarité nationale", alors que Séguy déclare sans ciller ; "Il n'est pas exclu qu’on suppute une aggravation de la tension sociale susceptible de dégénérer en épreuve de force propice à toutes sortes de provocations, qui pourraient être bénéfiques aux intérêts politiques de la majorité à la veille des élections politiques. Nous sommes tout à fait conscients de ce danger On aurait tort de croire, en haut lieu, que nous sommes prêts à tomber dans le panneau... Nous réaffirmons que nous ne ferons rien qui soit de nature à perturber les élections et le déroulement de la campagne électorale"[7](3). C'est donc clair: la CGT ne tombera pas dans le panneau... de la lutte de classes. Et elle joint l'acte à la parole: la combativité qu'ont manifestée les travailleurs français jusqu'à la fin a partout rencontré une solide détermination des syndicats pour l'étouffer. On se souvient de la façon dont la grève dans la banque a été brisée début décembre. On se souvient également de la "journée d'action" du 26 Octobre, des mots d'ordre de grève tournante dans la SNCF, de la manifestation platonique du 9 décembre sur l'Education Nationale.
Toutes ces manœuvres, loin d'inciter à l'action, sont destinées à convaincre par leur échec, les travailleurs de l’inefficacité de toute action, à les démoraliser et à leur présenter ainsi le bulletin de vote comme le seul moyen d'exprimer leur mécontentement et de changer quelque chose.
Il est évident que les partis de gauche n'ont pas pour seul objectif de briser la combativité ouvrière; ce qui est au centre de leurs préoccupations c'est bien sur la conquête du pouvoir, mais celle-ci signifie la lutte contre tout mouvement prolétarien. S'ils remportent la victoire en mars, ils affronteront directement les travailleurs avec tous les instruments de coercition de l'Etat, tout en leur disant qu'ils doivent faire des sacrifices pour ne pas "faire le jeu de la réaction" ou bien "de l'étranger". S'ils échouent à ces élections ils continueront, par l'intermédiaire des syndicats qui leur sont inféodés, à saboter les luttes afin de ne pas "compromettre le résultat des suivantes". Dans un cas comme dans l'autre, les élections seront toujours utilisées par la gauche pour défendre le capital contre les travailleurs.
En résumé, on peut donc dire que, face à une situation économique qui s'ag- grave de mois en mois et face à une montée des luttes prolétariennes de plus en plus menaçantes, le capital déploie tous ses moyens de mystification pour maintenir ses positions. Comme les “luttes de libération nationale", les élections font partie de son arsenal et la frénésie qui entoure celles-ci aujourd'hui est à la mesure de la crise dans laquelle il s'enfonce.
Le jeu et les arguments des trotskystes
A la gauche de la gauche, on revoit s'agiter les trotskystes. Jusqu’à présent, l'essentiel de leur propagande a tourné autour de la lutte "anti-impérialiste". A grand renfort de campagnes, de meetings et de cortèges, ils ont essayé de battre le P.C.F sur son terrain : celui de la défense du "camp socialiste". Dans les conflits inter-impérialistes, qui sous couvert de libération nationale, font chaque année des centaines de milliers de : morts, .ils ont joué et continuent de jouer le rôle ignoble des véritables jusqu’au-boutistes.
Maintenant, à l’approche des élections, leur rôle de chien de garde du capital a trouvé une nouvelle occasion de s’exercer. S’engageant à fond dans la campagne électorale, présentant plus de 300 candidats, ils demandent aux travailleurs un "vote de classe" et se font les rabatteurs, au second tour, pour les partis de gauche.
Leur participation aux élections revêt donc un double caractère : présentation d’un certain nombre de candidats (et même d’un nombre certain pour certaines organisations) au premier tour et campagne en faveur du candidat de la gauche au second tour (et même au premier pour l’OCT- AJS).
En faveur du vote pour les partis de gauche ils avancent les arguments suivants :
- ce vote leur permet de ne pas se couper des masses ouvrières.
- le vote pour "l’union de la gauche" est un vote de classe.
- il va dans le sens du "front unique ouvrier" qui doit mettre les "partis ouvriers" au pied du mur”.
Quant à la présentation de candidats trotskystes elle est justifiée de la façon suivante:
- elle doit permettre d’envoyer Marchais et Mitterrand au gouvernement sans leur donner carte blanche.
- elle permet d’utiliser la campagne électorale comme d’une tribune en faveur de la propagande révolutionnaire à un moment où l’intérêt des masses est polarisé sur les élections.
- en cas d'élection de candidats révolutionnaires, ceux-ci peuvent utiliser le parlement comme une tribune pour leur propagande :
- le résultat des élections permet de "tâter le pouls" de la classe ouvrière, de sa combativité et de l’influence que les révolutionnaires ont sur elle.
Etudions chacun de ces arguments.
Ne pas se couper des masses…
Sous des formes différentes, cet argument est repris par chacune des trois organisations trotskystes les plus importantes.
Comme souvent, la palme de l’opportunisme revient à l’OCI-AJS qui écrit dans son appel aux travailleuses, travailleurs, militants et jeunes :
"Elles (les revendications et aspirations exprimées dans la campagne électorale;) ouvrent la perspective d’un GOUVERNEMENT PS-PCF SANS^MINISTRE CAPITALISTE. Le prolétariat est prêt à s’engager dans l’enthousiasme dans cette bataille politique. Sans conditions[8](1),
l’OCL et l’AJS luttent pour un tel gouvernement.
La position de la Ligue Communiste ne vaut guère mieux bien que plus nuancée :
- "Au deuxième tour, nous appellerons à voter nationalement pour l’Union de la Gauche. Nous ne présenterons pas pour autant un éventuel gouvernement PS-PC comme un gouvernement des travailleurs, nous expliquons seulement aux masses qui croient encore en cette voie électorale que notre défection ne pourra être utilisée par les traîtres réformistes pour expliquer leur échec de demain.”[9]
- Quant à Lutte Ouvrière elle considère qu’elle a:
- "pour devoir de combler le fossé existant entre (elle) et les travailleurs influencés par le PCF, c’est à dire sinon la majorité de la classe ouvrière, du moins la majorité écrasante de son avant- garde.”[10]
Cet argument qui consiste à dire: "pour ne pas se couper des masses il faut faire ce que font les ouvriers, être là où ils se trouvent" relève d’une forme aigue d’opportunisme.
C’est l’argument qu’ont utilisé tous les socio-patriotes en 19l4pour justifier leur soutien à la guerre impérialiste et leur participation aux gouvernements d ‘union nationale et contre lequel les révolutionnaires se sont violemment élevés à cette époque, en particulier Lénine dans "Contre le Courant". C’est l’argument de toutes les capitulations devant la bourgeoisie. Rappelons (un exemple parmi beaucoup d’autres) que c’est en l’utilisant que les trotskystes d’Argentine ont, à une époque, soutenu ce fasciste au petit pied qu’était Juan Perón.
Un vote de classe…
Dans cette argumentation l’OCI-AJS encore une fois bat des records :
- "Contre le capital, ses partis, ses gouvernements. Pour le Front unique des organisations ouvrières VOTEZ CLASSE CONTRE CLASSE."
- "A la question : quel gouvernement peut satisfaire les revendications (du prolétariat, de la jeunesse, des masses exploitées des villes et des campagnes), il n’existe qu’une réponse : SEULEMENT UN GOUVERNEMENT DES GRANDS PARTIS OUVRIERS, UN GOUVERNEMENT FORME PAR LE PS ET LE PCF, UN GOUVERNEMENT SANS REPRESENTANTS DES PARTIS BOURGEOIS."[11]
La ligue Communiste, comme d’habitude est plus nuancée:
- "Le PS ne peut être défini aujourd’hui ni comme un parti bourgeois, ni comme un parti ouvrier bourgeois du fait de la faiblesse de l’implantation ouvrière."[12] "Dans l’union de la gauche, c’est le PCF, parti ouvrier réformiste qui est aujourd’hui hégémonique. c’est lui qui a imposé ses conditions. c’est cette hégémonie du PC qui donne à l‘ensemble de l’alliance sa nature de classe, et non la présence de tel ou tel politicien bourgeois."
De la même façon que sur le nombre "d’Etats ouvriers" existants à l’heure actuelle, les différents groupes trotskystes sont divisés sur le nombre de "partis ouvriers" qu’on peut compter en France. Si pour l’OCI-AJS, le PCF et le PS sont tous les deux des "partis ouvriers", pour la ligue Communiste et "Lutte ouvrière" seul le PCF est digne du Label.
Les arguments donnés pour caractériser comme ouvrier tel ou tel parti peuvent se résumer ainsi:
- 1° Ses origines historiques : le Ps est le descendant de la SFIO qui était une des sections de la 2e Internationale qui, à une époque, était une organisation défendant réellement les travailleurs. Le PC lui, fut une section de la 3e Internationale qui en 1919 constituait ltavant-garde révolutionnaire du prolétariat mondial. Leur caractère prolétarien se serait donc perpétué jusqu’à nos jours.
- 2° Sa composition sociologique et la confiance que lui témoignent les travailleurs: le caractère ouvrier du PC tiendrait, d’après la Ligue et “Lutte ouvrière”, à son "implantation" dans la classe ouvrière et dans les syndicats.
- 3° Le lien organique qui le rattache aux "états ouvriers dégénérés": c’est le grand dada de la ligue Communiste et en particulier de Weber qui font découler le caractère ouvrier du PCF de son allégeance à Moscou.
- 4° Les références au socialisme faites dans ses statuts.
Voyons ce que valent ces différents arguments.
-
Les origines historiques
La société capitaliste a deux moyens de lutter contre les organisations qui défendent les intérêts de la classe ouvrière: soit de les détruire physiquement par la répression, soit de les corrompre et de les transformer en rouages du système. Aucune organisation de la classe n’échappe à cette pression corruptrice du capital et en particulier les organisations permanentes qui ont un caractère de masse, c’est à dire qui sont composées d’individus qui bien que travailleurs, sont, en "temps normal", pour le plus grand nombre, soumis à l’idéologie bourgeoise.
Les partis social-démocrates et communistes étaient, à l’origine, des organes de la classe ouvrière. Mais la longue période de prospérité et de luttes réformistes qui va de la Commune à 19l4 pour l£S premiers et la terrible contre-révolution qui s test abattue en Russie et dans le monde entier après la vague révolutionnaire de 1917 à 23 pour les seconds ont eu raison de leur nature ouvrière et les ont transformés en principaux artisans de la contre-révolution. La nature de classe d’une organisation ouvrière ne lui est pas donnée d’une façon éternelle. Si l’on peut affirmer avec certitude qu’un parti bourgeois ne deviendra" jamais un parti prolétarien on peut par contre dire que tout parti ^prolétarien est constamment menace de devenir un instrument du capital: les exemples historiques ne manquent pas, et ce mouvement à sens unique si explique par le poids énorme qu’exerce l’idéologie bourgeoise sur les esprits : "les idées dominantes d’une époque sont les idées de la classe dominante". (Marx)
1 L’implantation dans la classe ouvrière.
Pour les mêmes raisons qu’on vient de voir, cet argument ne tient pas non plus. Dans une période où la bourgeoisie règne en maître incontesté, la majorité des travailleurs a une mentalité dominée par l’idéologie bourgeoise (ce qui ne veut pas dire que ceux-ci pensent exactement de la même façon que leurs exploiteurs). Dans ces conditions, tout parti qui a la confiance de la majorité des travailleurs ne peut l’obtenir qu’en abandonnant ses positions (en ce sens, seule une organisation ultra-minoritaire peut, dans une telle période, être le porteur des intérêts historiques du prolétariat).
La nature ouvrière d’une organisation n’est pas une question de statistique sociologique mais de fonction qu’elle exerce au sein de la société et de la lutte de classe. Si on retenait un tel critère statistique il faudrait dire que le parti nazi était bien plus ouvrier qu’un certain nombre de partis "communistes" actuels.
2 Le lien existant entre les partis "communistes" et l’URSS
Il n’est pas question d’entrer ici dans une analyse économique de l’URSS et des pays dits ”socialistes”[13] (1). Nous nous contenterons de rappeler l’ exploitation aigue subie par les travailleurs d’ URSS sous couvert de "stakhanovisme" et " d’émulation socialiste ", la déportation et l’extermination de millions d’entre eux qui tentaient de résister à cette exploitation inhumaine, la répression qu’ils continuent de subir aujourd’hui où la grève est considérée comme un crime et où depuis 53 en Allemagne de l’Est, 56 en Hongrie, 70 en Pologne ces régimes "socialistes" ont la palme quant à l’écrasement de mouvements prolétariens et au nombre d’ouvriers tués.
Tous ces faits attestent la nature profondément anti-ouvrière et contre- révolutionnaire de ces "états ouvriers" et l’argument de la Ligue se retourne contre elle: le seul fait pour les partis "communistes" de les appuyer suffit derechef à conférer à ces partis (ainsi qu’aux trotskystes qui également défendent l’URSS) une nature profondément anti-ouvrière et donc capitaliste.
3 Les références au socialisme faites dans les statuts.
L’OCI-AJS est spécialiste de ce genre d’arguties elle, qui a considéré que la social-démocratie allemande avait perdu son caractère ouvrier le jour où elle a abandonné toute référence au marxisme. Ainsi, l’écrasement de la révolution allemande en 1919’ l’assassinat de Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht et de milliers d’ouvriers, toutes œuvres de la social-démocratie, n’auraient pu faire ce que la simple modification d’une phrase dans ses statuts a suffi à réaliser : la modification de la nature de classe d’une organisation politique! Pouvoir des mots!
Il est à noter que l’OCI-AJS a l’air de revenir sur cette analyse puisqu’il semble qu’elle accorde à nouveau le label ouvrier à la social-démocratie quand elle écrit à propos des élections en Allemagne: "C’est contre l’ennemi de classe que les travailleurs et les jeunes ont utilisé le terrain électoral en votant SPD"[14]
Il est vrai que l’ OCI-AJS nous a habitués à ces voltes faces : n’a-t-elle pas crié sur tous les toits que l‘entrée de Mitterrand et de la Convention dans la SEEO allait enlever à celle-ci son caractère ouvrier.
Aujourd’hui, Mitterrand dirige le PS issu de cette fusion et celui-ci est toujours, pour l’OCI-AJS, un "parti ouvrier".
Pour les révolutionnaires, les statuts d’une organisation ne prouvent rien sur sa nature "ouvrière". Pas plus qu’un individu on ne juge un parti sur l’idée qu’il a de lui-même. Pour nous il n’existe pas une "essence" prolétarienne historique ou statistique des partis socio-démocrates et communistes. Ces partis sont qu’ils font. Leur nature leur est conférée par la fonction qu’ils assument dans la société bourgeoise.
Le rôle joué par les partis socio-démocrates depuis 1914 d’abord comme sergents recruteurs pour la boucherie inter-impérialiste, ensuite comme bourreaux de la classe ouvrière, enfin comme gérants fidèles du capital suffit amplement à les caractériser comme des partis bourgeois.
De même, la défense des intérêts impérialistes de l’URSS depuis les années 30, le coup de poignard dans le dos du prolétariat espagnol en 1936, la mobilisation des travailleurs sous couvert de "résistance anti-fasciste " pour le second conflit inter-impérialiste, la défense jalouse des intérêts du capital exercée par les ministres communistes dans neuf pays occidentaux après la "libération"[15]sans oublier l‘exploitation et la terreur policière appliquée aux travailleurs des pays de l’Est, rangent définitivement les partis "communistes" dans le camp du capital
Le front unique et la mise au pied du mur
Cette tactique adoptée aux 3è et 4è congrès de l’Internationale Communiste consiste pour les communistes à apporter leur appui aux partis (à l’époque les socio-démocrates) qui se réclament de la classe ouvrière sans défendre ses intérêts, afin de faire faire à celle-ci son expérience.
Devant les reniements et les trahisons de ces partis une fois au pouvoir les travailleurs prendraient conscience de leur véritable nature et ce tourneraient vers les révolutionnaires. Aujourd’hui il s’agirait donc de soutenir la gauche afin que celle-ci, une fois au pouvoir, se démasque aux yeux des travailleurs qui se tourneraient alors vers les trotskystes.
Depuis qu’elle est appliquée cette tactique a toujours échoué. Jamais, depuis 1922, les travailleurs ne se sont lancés dans des luttes révolutionnaires après qu’ils aient mis au pouvoir les partis de gauche. En fait, en 1923, cette tactique mise en application dans certains états allemands à la tête desquels se trouvait une coalition communiste socio-démocrate fut un coup de poignard dans le dos du soulèvement révolutionnaire des ouvriers allemands. Par cette alliance avec la social-démocratie, le parti communiste servit de caution à celle-ci et lui laissa les mains libres pour massacrer les travailleurs.
La tactique qui consiste à "faire faire sa propre expérience" à la classe se résume à la pousser à l’échec afin qu’elle comprenne après coup les dangers qui la menaçaient. Que penserait-on de l’attitude qui consisterait à pousser un enfant dans un escalier au lieu de le mettre en garde par avance, afin qu’il se rende compte que c’est là un endroit dangereux où il faut faire attention? Une telle attitude serait évidemment absurde, c’est pourtant la même que celle du "Front Unique".
Il est clair que c’est avant tout à partir de sa propre expérience que la classe ouvrière élève son niveau de conscience. Mais, contrairement à ce que pensent les trotskystes, les révolutionnaires ne peuvent réellement contribuer à cette prise de conscience qu’en luttant contre toutes les mystifications qui pèsent encore sur les travailleurs et non en les reprenant à leur compte. Une telle attitude est évidemment impopulaire et ne leur permet pas de gagner immédiatement la "confiance des masses" et c’est bien cela qui préoccupe les trotskystes d’aujourd'hui.
Ce que recouvre en fait la tactique du "Front Urique" c’est un opportunisme sans scrupule à l’adresse des partis socio-démocrates et staliniens de qui les trotskystes essayent de se faire reconnaître comme organisation "sérieuse" et "responsable". D’une façon inavouée, ce que recherchent et réclament en pleurnichant ces individus c’est un strapontin dans un futur "Gouvernement Ouvrier" PS-PCF, comme dit l’OCI-AJS, ou le droit d’y jouer le rôle de la mouche du coche.
Le "Front Unique" entre le PS, le PCF et les trotskystes sera peut-être un jour une réalité, mais il s’exercera alors non pas en faveur des travailleurs mais assurément contre.
Mais dès aujourd’hui, appeler les travailleurs à voter pour les partis de gauche, rebaptisés pour la circonstance "partis ouvriers", afin de les "mettre au pied du mur", revient en fait à jouer le triste rôle de larbins de ces partis: d’abord en perpétuant le mythe de leur caractère ouvrier qui a bien besoin d’être rafraîchi, ensuite en n'étant rien d ‘autre que des colleurs d’affiche bénévoles au service de "l’Union de la Gauche" tentant de racler à son profit les quelques voix des travailleurs que n’auraient pu séduire les chants de sirène des grands camps en présence.
"PRESENTER LES CANDIDATS POUR NE PAS DONNER CARTE BLANCHE A UN GOUVERNEMENT DE GAUCHE"
C’est exactement en ces termes que "Lutte Ouvrière" défend sa politique en titrant :
- "Pourquoi des candidats de Lutte Ouvrière aux élections législatives? Pour que les travailleurs puissent envoyer Marchais et Mitterrand au gouvernement sans leur donner carte blanche".
L’OCI-AJS, de son coté, utilise un argument semblable quand elle écrit:
- "Voter OCI-AJS, c’est affirmer la nécessité de rassembler, d’organiser les militants, les travailleurs, les jeunes, qui veulent agir pour que le PS et le PCF rompent avec les partis bourgeois réalisent le Front Unique Ouvrier se battent pour former un gouvernement sans ministre capitaliste".
Disons tout de suite que la perspective de l’OCI-AJS est plutôt mal engagée puisque Marchais, à la tribune du 20e Congrès du PCF, tendait sa main à "ceux qui ont suivi De Gaulle par patriotisme" et se déclarait prêt, dans une interview à un journal anglais, à accueillir dans le futur gouvernement de gauche des centristes rebaptisés pour la circonstance "républicains de progrès".
Il est probable que les trotskystes recueilleront quelques centaines de milliers de voix, aux élections législatives mais cela ne représentera de toute façon pas grand-chose à côté de la douzaine de millions de voix nécessaires à la gauche pour l’emporté. Et même si la proportion leur était plus favorable, cela ne changerait rien à l’affaire : la bourgeoisie et ses partis se moquent bien de la pression morale et platonique de petits morceaux de papier dans les urnes.
Le seul moyen dont disposent les travailleurs pour ne pas donner carte blanche à un gouvernement quel qu’il soit demeure la lutte de classe et c’est justement cette lutte de classe que la politique électoraliste des trotskystes contribue à endormir,
La campagne électorale comme tribune
On lit dans "Lutte de Classe"n°2 (Revue théorique de Lutte Ouvrière) :
- "D’une manière générale les révolutionnaires, tout en ne se faisant aucune illusion sur le parlementarisme et en dénonçant publiquement ces illusions auprès des travailleurs, ont trois raisons fondamentales de participer à des élections au parlement bourgeois.
"Tout d’abord, se servir de la campagne, aussi bien de l’intérêt qu’elle sus cite auprès des électeurs et notamment des électeurs populaires que des moyens d’information qui sont mis à la disposition des candidats par l’État à cette occasion, pour développer une large propagande en faveur du programme et des idées révolutionnaires.
"Ensuite, compter leurs partisans. Cela peut se faire suivant les moments soit sur le programme socialiste, soit sur un programme plus limité mais correspondant aux- questions de l’heure et y apportant la réponse des travailleurs révolutionnaires... Les résultats électoraux ne constituent jamais qu’un reflet déformé de l’état d’esprit du pays et des travailleurs. Ce reflet, tel qu’il est, est tout de même un moyen irremplaçable[16] de connaître et de vérifier cet état d’esprit et l’influence des idées et des organisations révolutionnaires.
"Enfin, éventuellement, envoyer des militants révolutionnaires au parlement pour se servir de la tribune qu’elle offre à ceux-ci. Il est vrai que, en France tout au moins, cette tribune est de moins en moins écoutée. Il est vrai aussi que dans l’état actuel des choses il y a très peu de chances pour qu’un militant révolutionnaire soit élu".
Le premier de ces arguments est repris par la Ligue Communiste :
- ”La présentation de candidats partout où la Ligue est implantée doit nous permettre de bénéficier de toutes les tribunes qu’offrent les institutions bourgeoises en période électorale (radio et presse régionale, etc.) afin de capter l’attention des travailleurs.”
"L’expérience a montré qu’il n’y a pas de campagne politique, en période électorale, sans participation directe à la compétition. Ne pas présenter de candidats, c’est passer sous la table.”[17] (1)
Commençons par répondre à ce premier argument:
Classe minoritaire dans la société, la bourgeoisie exerce le pouvoir non dans son ensemble mais en le délégant à une fraction minoritaire d ‘elle-même regroupée dans les partis politiques. Cela est valable aussi bien dans les "démocraties” (concurrence entre plusieurs partis) que dans les régimes totalitaires fascistes ou staliniens (parti unique).
Ce pouvoir d’une minorité de spécialistes de la politique n’est pas seulement le reflet de la position minoritaire de la bourgeoisie au sein de la société; il est également nécessaire pour préserver les intérêts généraux du capital national face aux intérêts divergents et concurrents des différentes fractions de cette bourgeoisie. Ce mode de pouvoir par délégation est donc inhérent à la société bourgeoise et se reflète dans chacune de ses institutions et principalement dans le suffrage universel. Celui-ci est même le moyen privilégié par lequel "la population", en fait la bourgeoisie, "confie" le pouvoir à un ou plusieurs partis politiques.
L’action révolutionnaire du prolétariat ne s’accommode pas de tels schémas. Dans ce cas, ce n’est pas à une délégation minoritaire de la classe que revient le rôle d’agir et de prendre le pouvoir mais à l’ensemble de la classe. C’est là la condition indispensable du succès de tout mouvement prolétarien. Le suffrage universel ne peut donc, de quelque façon que ce soit, servir de cadre pour l’engagement révolutionnaire du prolétariat contre l’ordre existant. Loin de favoriser la mobilisation et l’initiative des plus larges masses, il tend au contraire à maintenir leurs illusions et leur passivité.
En ce sens, les révolutionnaires dont le rôle n’est pas de constituer la minorité à qui la classe confie son pouvoir, mais au contraire à contribuer à la prise de conscience et à l’auto-organisation de celle-ci, ne peuvent en aucune manière utiliser les campagnes électorales comme tribunes. Tous les moyens ne sont pas bons pour faire de la propagande révolutionnaire et en particulier, la participation aux élections s’oppose au but que se proposent d’atteindre les révolutionnaires : la nécessité pour la classe d’agir par elle-même.
Le parlement comme tribune révolutionnaire
"Lutte Ouvrière" le constate plus haut elle-même : " dans l’état actuel des choses, il y a très peu de chances pour qu’un militant révolutionnaire soit élu." Gageons que les trotskystes reprendront un jour à leur compte la revendication du PCF depuis 1958 : le retour à la représentation proportionnelle qui leur permettrait d’avoir un certain nombre d’élus et donc de tribuns parlementaires.
Même si cette éventualité d'élections de candidats trotskystes n’est pas actuellement à l’ordre du jour, il faut répondre à cette conception du parlement comme tribune révolutionnaire qui se retrouve de façon constante dans tous les courants se revendiquant de la 3e Internationale.
L’argumentation développée contre l’utilisation de la campagne électorale s’applique à plus forte raison contre l’utilisation du parlement par les révolutionnaires.
Mais ce n’est pas tout. La participation au parlement est en plus pour les partis révolutionnaires un facteur puissant de dégénérescence opportuniste. Déjà, dans les partis de la 2e Internationale, les fractions parlementaires constituaient toujours les ailes droites. Rien de plus normal à cela : plus le programme et la propagande d’un candidat sont modérés, plus celui-ci a de chances d’être élu par un électorat imprégné de l’idéologie de la classe dominante. Pour conserver leur siège, les députés sociaux-démocrates faisaient pression pour orienter la politique de leur parti toujours plus à droite.
Lénine et la 3e Internationale sont parfaitement conscients de ce fait. Mais ils considèrent que le seul exemple de Liebknecht, utilisant la tribune parlementaire de façon révolutionnaire pendant la guerre, suffit- à justifier une telle tactique. Ils pensent aussi que le danger d’opportunisme peut être conjuré par une discipline très stricte dans le parti et par un contrôle rigoureux de ses instances suprêmes sur la fraction parlementaire.
Mais en fait, depuis cinquante ans qu’existe cette tactique, il ne s’est plus trouvé un seul Liebknecht pour détruire l’institution parlementaire "de l’intérieur" et la dégénérescence opportuniste s’est accomplie encore plus vite.
Cela n’a rien de mystérieux et s’explique simplement par le fait que les parlements s’étant vidés de toute vie politique réelle sont devenus uniquement les lieux de prédilection, de l’intrigue et de la corruption, et n’offrent aucune place pour une manifestation révolutionnaire.
Prendre le pouls de la classe et "compter ses partisans”
Le maître à penser de la Ligue, Lutte Ouvrière, OCI-AJS e.t autres, Trotsky lui-même écrit, à propos des "journées d’Avril" 19l7 où les ouvriers de Petrograd s’étant soulevés -avec les Bolcheviks en tête- contre une décision des partis conciliateurs n’avaient pas modifié leur représentation dans les Soviets :
- "La contradiction éclatante entre la hardiesse de l’offensive des masses et les tergiversations de sa représentation politique n’est pas accidentelle. les masses opprimées, à une époque révolutionnaire, sont entraînées à l’action directe plus aisément et rapidement qu’elles n’apprennent à donner à leurs désirs et à leurs revendications une expression en bonne et due forme par leur propre représentation. Plus est abstrait le système de la représentation, plus celui-ci retarde sur le rythme des évènements déterminés par les actions de masses. [18]"
Ce décalage entre la combativité des masses et la représentation qu’elles se donnent est plus qu’évident dans le cas des élections législatives et les exemples historiques ne manquent pas. Citons seulement le plus récent : Mai 68 ; la plus grande grève depuis la guerre débouche un mois après sur la plus grande victoire électorale que la droite ait connue en France.
La raison de ce décalage réside dans le fait que l’élection d’un député se trouve dans une sphère totalement différente de celle de la lutte de classe. Cette dernière est une action collective, solidaire, où l’ouvrier est accompagné d’autres ouvriers où les hésitations des uns sont emportées par la résolution des autres, où les intérêts en cause ne sont pas particuliers mais ceux d’une classe. Par contre, le vote fait appel à quelqu’un de déclassé : le citoyen, qui se retrouve seul dans l’isoloir face à un choix pour quelque chose d’abstrait, d’extérieur à sa vie quotidienne. C’est le terrain idéal pour la bourgeoisie, celui où la combativité ouvrière n’a aucune possibilité de se manifester réellement. Ce n’est pas par hasard que celle-là fait tant d’efforts pour faire voter.
Par conséquent, le résultat des élections du ll mars ne donnera aucune indication réelle sur l’état d’esprit et la combativité des masses ni d’ailleurs sur l’influence véritable des trotskystes auprès des travailleurs. La poussée prévue de la gauche ne signifiera pas une montée de la combativité ouvrière comme le pensent les trotskystes ni d’ailleurs le contraire. Elle exprimera essentiellement l’usure du pouvoir actuel auprès d’un grand nombre de catégories sociales, la "dynamique unitaire" du Programme Commun qui rend "crédible" un gouvernement de gauche et le ralliement de certaines couches petites-bourgeoises effrayées de voir le grand capital les faire disparaître progressivement et que la modération de ce programme n’effraie plus guère.
Loin d’être "un moyen irremplaçable de connaître et vérifier" l’état d’esprit des travailleurs, comme le dit stupidement Lutte Ouvrière dans son "Organe théorique" LUTTE de CLASSE, les résultats électoraux sont justement le terrain où ne s’exprime pas du tout la combativité des masses. Le seul moyen pour les révolutionnaires de savoir où en est la classe, est d’observer le niveau de ses luttes contre le Capital (grèves, occupations, affrontement des forces de répression).
La fonction des trotskystes
Tous les arguments des trotskystes pour justifier leur participation aux élections et leur soutien aux partis de gauche se retournent contre eux. Ce qui il reste essentiellement de toute leur action c’est que loin de démasquer la véritable fonction mystificatrice des élections dans la société bourgeoise actuelle, ils participent pleinement à cette mystification. De la même façon, au lieu de dénoncer impitoyablement les partis de gauche comme des partis du Capital, ils contribuent pleinement à préserver auprès des travailleurs le mythe de leur nature ouvrière.
Au même titre que leur propagande en faveur des "luttes de libération nationale, leur propagande autour des élections tend, non pas à élever le niveau de conscience politique des travailleurs, mais à maintenir en place les mystifications qui pèsent sur eux.
Sur bien des points la 3e Internationale a rompu avec le cours opportuniste et bourgeois de la 2e, particulièrement sur la caractérisation de la période ("ère des guerres et des révolutions") qui s’ouvre avec la guerre de 1914, et également sur la nécessité pour le prolétariat de détruire l’Etat Bourgeois et de le remplacer par le pouvoir des Conseils Ouvriers. Mais cette rupture n’est pas complète et ne va pas jusqu’au bout de ses implications ; ainsi, elle ne porte pas sur les tactiques frontistes, syndicales et parlementaires.
En 1920, les désaccords qui ont surgi autour de ces questions se situaient encore à l’intérieur d’un même de terrain classe. Mais les faillites successives auxquelles ont conduit ces "tactiques" ont fait de leur, rejet une question de principe, une frontière de classe au-delà de laquelle ne peut s’exercer, pour une organisation politique, aucune activité révolutionnaire.
En 1919, l’internationale Communiste luttait principalement contre les partis socio-démocrates et "centristes" dont l’opportunisme avait servi de dernier rempart à la bourgeoisie face au mouvement révolutionnaire des masses en divisant et démoralisant celles-ci.
Face à une nouvelle montée révolutionnaire de la classe ouvrière, le capital suscitera nécessairement l’apparition de tels partis conciliateurs jouissant d’une certaine audience parmi les travailleurs, mais en fait, entièrement à son service. Les partis sociaux-démocrates et "communistes", aujourd’hui partis de gouvernement, seront certainement trop déconsidérés à ce moment-là. La place sera donc libre. Par les services qu’ils rendent déjà à la bourgeoisie avec leur politique ouvertement opportuniste -mais soigneusement enrobée de phraséologie révolutionnaire- les trotskystes, posent dès aujourd’hui bien qu’ils sien défendent, leur candidature à cette place.
Perspectives
Dans les années d’après-guerre l’économie de reconstruction a permis à certains de penser que le capital avait enfin résolu ses contradictions de façon définitive. La crise revient maintenant hanter la société bourgeoise provoquant dès ses premières manifestations une réaction de la part de la classe ouvrière, d’une ampleur que l’on n’avait plus vue depuis cinquante ans.
Il s’agit pour la bourgeoisie de faire face à ces difficultés et en premier lieu de tenter de museler le prolétariat. Aidée par tous les partis du vieux monde -même les plus extrémistes comme les trotskistes-, elle se raccroche à toutes les planches de salut, c’est à dire, à toutes les diversions qui peuvent encore mystifieras travailleurs. Parmi celles-ci, les élections sont encore une des meilleures - et il faut croire qu’en France elles ont fait un certain effet, puisqu’ à l’approche des élections la combativité ouvrière qui s’était manifestée depuis la rentrée de Septembre 72, s‘est maintenant presque assoupie.
Certes, les travailleurs français sont pour l’instant mystifiés et il y a certainement un nombre important qui a confiance dans le Programme Commun. Mais ils ne le sont pas autant que la bourgeoisie elle-même qui s’imagine qu’elle a remporté là une victoire décisive : au lendemain du ll Mars, les travailleurs se retrouveront avec les mêmes problèmes qu’avant : hausse des prix, austérité (comme pourries travailleurs américains déjà), montée du chômage. La bourgeoisie aura beau multiplier les consultations électorales : à trop servir cette arme s’usera et la crise qui ne manquera pas de s’avancer (ne parle-t-on pas de nouvelles difficultés pour le dollar ?) contraindra les travailleurs des pays industrialisés à renouer avec une combativité croissante qui, malgré un cours en "dents de scie" au niveau de chaque nation, ne s’est globalement pas démentie depuis plus de quatre ans.
C. Giné
[1] (1) Adresse du Conseil Central de la Ligue
[2] (1) Lettre circulaire 1879, citée par Rubel dans "pages de Karl Marx pour une éthique socialiste".
[3] (2) Engels, préface de 1895 aux "luttes de classes en France" de K. Marx.
[4] (1) R.I. n°2 : ” La crise monétaire” et "Comprendre Mai" R.I. n° 6 et 7 "La Crise” ; (1) conférence de presse du 22 janvier 73.
[5] (1) conférence de presse du 22 janvier 73.
[6] (2) Georges Marchais (encore lui) est particulièrement clair là-dessus, lui qui s'insurge, dans la préface du "programme commun", de ce "que l'intérêt national n'est pas ce qui guide la politique de l'UDR", et qui se propose de rassembler "des patriotes... qui s'alarment avec raison de voir le pouvoir faire bon marché de la grandeur et de l'indépendance françaises" page 42). Comme pour les communistes, il est irrécusablement admis, depuis le manifeste de 1848, que "les prolétaires n'ont pas de patrie", cet "intérêt national" ne peut évidemment signifier autre chose que l'intérêt du capital national.
[7] (3) : "le Monde", 25/11/72
[8] (1) souligné par nous.
[9] Résolution politique du 3è congrès de la Ligue Communiste
[10] "Lutte de classe", revue théorique de Lutte Ouvrière.
[11] Notons que cette formulation de l’appel signifie que le pouvoir direct des travailleurs, la dictature du prolétariat organisé en conseils ne pourrait pas satisfaire ces revendications puisqu’à la question posée, "il n’existe qu’une réponse"-
[12] Rouge n° 184, page 10 "qu’est-ce-qu’un vote de classe ?"
[13] Pour cela voir l’article sur ”La loi de la valeur et le capitalisme d’Etat" qui paraîtra dans le numéro-3, et la résolution sur ” Le capitalisme d’Etat ” dans RI n°l nouvelle série.
[14] Informations Ouvrières n° 593.
[15] On se souvient du vice-président du Conseil Maurice Thorez exhortant les travailleurs au travail avec des phrases du genre: "retroussez vos manches", "travaillez d’abord, revendiquez ensuite", "la grève est l’arme des trusts". On se souvient aussi des bombardements de Sétif (20.000 à 40.000 morts) dirigés par le ministre de l’aviation Charles Tillon, aujourd’hui "récupéré" par la ligue Communiste (on a les amis qu’on mérite).
[16] souligné par nous.
[17] ROUGE n°184 page l0
[18] Histoire de la Révolution Russe Tome-1 "Février" p. 397 Ed. du Seuil.
Questions théoriques:
- Démocratie [1]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Révolution Internationale (nouvelle série) N°3 - avril
- 578 lectures
LE CAPITALISME D’ÉTAT ET LA LOI DE LA VALEUR
- 1235 lectures
LA TENDANCE GENERALE AU CAPITALISME D'ETAT
La nature capitaliste des ‘états ouvriers’.
L’analyse théorique qui reconnaît que le stade de développement du capitalisme décrit par Lénine dans l’"Impérialisme" (stade des trusts et des cartels, du capitalisme monopoliste) n’est pas le stade suprême de ce mode de production, se situe parmi les contributions théoriques les plus importantes des groupes ultra-gauche.
- "Depuis 1917, le capitalisme est entré dans une nouvelle phase, sa phase de décadence. De profonds changements de structure, politiques et économiques ont eu lieu, et de ce fait, le prolétariat se heurte à de nouveaux problèmes et de nouvelles conditions dans sa lutte révolutionnaire.
Ces problèmes historiques nouveaux étaient nécessairement inconnus de Marx et des théoriciens marxistes du passé.
C’est en essayant de comprendre les conditions de cette nouvelle période que les révolutionnaires peuvent intervenir de façon efficace en aidant le prolétariat à prendre • conscience de sa tâche historique : l’ émancipation de l’ humanité."
(Marc- "Salut à Socialisme et Barbarie’ Internationalisme –page 43- Juillet 49)
Ces changements économiques et politiques structurels du système capitaliste (qui déterminent la période de crise permanente et de guerres mondiales impérialistes) constituent la transition du capitalisme monopoliste vers le capitalisme d’Etat; les nationalisations des moyens de production, la planification étatique centralisée, l’absorption progressive de la société civile par l’Etat, le stalinisme etc... doivent être situés dans la trajectoire historique du développement capitaliste.
Les léninistes ont chanté les louanges de la Russie stalinienne en la qualifiant de "patrie du socialisme"; la IVe Internationale voyait dans l’URSS un "état ouvrier dégénéré", avec "un appareil d’Etat fascisant, un système de distribution bourgeois, et un système de production 'socialiste" (sic). A l’opposé de ces conceptions, qui défendaient inconditionnellement l’URSS, les groupes d’ultra-gauche mettaient en avant la nature capitaliste de la formation économique russe.
- "Le mode de production capitaliste s’est historiquement développé sur la base de la propriété individuelle des moyens de production. La Révolution Russe a démontré que sous certaines conditions, le mode de production capitaliste peut continuer a exister, bien que les propriétaires individuels soient éliminés et remplacés par un appareil collectif d’exploitation, dans lequel personne ne peut dire: ce moyen de production particulier est ma propriété individuelle.
Nier que la Russie soit un capitalisme d’Etat, c’est nier que le développement historique ait donné naissance à une nouvelle réalité. Il n’existe pas de terme exprimant plus clairement l’ordre économique établi en URSS, que celui de capitalisme d’Etat.
Le mode de production est capitaliste, c’est à dire qu’à travers le salariat, il y a appropriation de plus-value, de profit. Cette appropriation est faite par l’appareil d’Etat qui contrôle les moyens de production et distribue la plus-value suivant les besoins du système; à savoir les nécessités d ‘une accumulation aussi rapide que possible, et la sauvegarde de l’appareil par l’accroissement de son pouvoir et de son "prestige".
(International Council Correspondance Volume III -n°3 et 6- Juin 1937)
Au moment où des Léninistes de toute sorte aidaient à mobiliser la classe ouvrière pour la boucherie de la 2ème guerre mondiale, sous les mots d’ordre de l’anti-fascisme, de résistance nationale, des quatre libertés, etc. l’aile radicale du mouvement ouvrier ne voyait pas de différence entre le ‘fascisme rouge’ et le ‘fascisme brun’ (Otto Rühle), entre les deux blocs rivaux impérialistes :
- "En ce qui concerne le capitalisme, il n’existe pas de différence entre sa forme monopoliste-démocratique et sa forme étatique. En ce qui concerne les capitalistes, les Russes sont différents des Allemands, et ceux-ci des Américains. Un commissaire Russe parvient à sa position et la défend d’une façon différente de celle d’un propriétaire anglais. Les travaux Goering ont une histoire bien différente de celle de United Steel Trust. Cependant, quelles que soient les différences entre les divers propriétaires et contrôleurs du Capital, ils se comportent tous de la même manière."
(Mattick -"Competition and Monopoly”-.New essays -Vol. VI n°3- 1943)
L’apparition du capitalisme d’Etat en URSS, ou les tendances explicites en cette direction en Allemagne Nazie, en Italie; en Turquie sous Kemal, au Japon sous Tojos... n’étaient pas pour l’ultra-gauche une aberration historique; le capitalisme d’Etat représentait une nouvelle phase du développement du Capital international.
Selon Paul Mattick, un des militants les plus cohérents du mouvement du Communisme des Conseils, le développement du Capitalisme d’Etat dans les sociétés capitalistes plus faibles et moins avancées donne un aperçu de l’avenir des métropoles capitalistes les plus avancées.
En l’absence de révolution prolétarienne, quel que soit le vainqueur de la 2ème guerre mondiale, la tendance vers le capitalisme d’Etat intégral continuerait à se manifester: "quel que soit le vainqueur sur le plan militaire, le monde continuera à aller du monopolisme vers le totalitarisme (capitalisme d’Etat), de la même façon qu’il est venu de la concurrence aux monopoles" (Mattick -Competition and Monopoly)
Les groupes d‘ultra-gauche avaient correctement saisi les tendances inhérentes au développement capitaliste. L’après-guerre a vu l’extension du capitalisme d’Etat (sur le modèle russe) à travers l’Europe de l’Est et les secteurs d’Extrême Orient (Mongolie, Corée du Nord). En 1949, le triomphe de Mao en Chine et la victoire de Ho Chi Minh en 54 au Nord-Viet ’Nam ont mené à une plus grande extension de ce système.
Secteur étatisé et secteur privé dans le capitalisme traditionnel.
En Europe Occidentale, dans les sociétés capitalistes fatiguées et affaiblies par la guerre, le secteur d’Etat s’est élargi: En Grande Bretagne, la Banque d’Angleterre, le charbon, le gaz naturel, l’électricité, le fer et l’acier, et les transports routiers ont été nationalisés[1]. En France, la Banque de France, les quatre banques commerciales les plus importantes, de grandes compagnies d’assurance, le charbon, le gaz naturel, l’électricité, de larges secteurs de l’industrie aéronautique, ainsi que la plus grande usine de voitures et de camions (Renault) ont subi le même sort. En France, une planification centrale fut inaugurée et dans les autres pays européens, le réseau contrôlé par l’Etat se développe considérablement.
En Italie, l’énorme secteur étatique né sous Mussolini (banque, crédit, fer, acier, armement, secteur mécano-électrique, production de wagons de chemins de fer et de locomotives, construction navale et industrie maritime) est demeuré intact, et a même été élargi dans les années suivantes: les téléphones et l’électricité ont été nationalisés, et des secteurs dynamiques tels que le pétrole, le gaz et la pétrochimie ont été développés sous contrôle étatique(ENI)
Au cours de la période même de prospérité relative qu’a connu le capitalisme occidental dans les années de 1’après-guerre, de nombreux projets nécessitant des investissements considérables n’ont pu être entrepris que par l’Etat.
En France par exemple, parallèlement à une participation étatique dans la plus grande compagnie pétrolière (CFP) une nouvelle compagnie appartenant exclusivement à l’Etat a été créée pour l’exploitation, le raffinage et la distribution de gaz et de pétrole, et pour le développement des secteurs pétrochimiques (ELF ERAP) ; l’expansion et la réorganisation du secteur étatique de l’industrie aérospatiale ont aussi été réalisées. (Sud-Aviation).
En Italie, des industries de pointe telles que les télécommunications, les ordinateurs et les systèmes automatiques sont développés par le capital d’Etat (STET) ; l’industrie aérospatiale se développe sur une base égalitaire ( 50$-50$ ) par le capital d’État (IRI) et le capital privé ( FIAT ) à travers la nouvelle compagnie Aeritalia; on peut ajouter' que dans son effort de nationalisation et réorganisation du secteur chimique, l’Etat (à travers IRI et ENI) est devenu 1’actionnaire le plus important de la deuxième compagnie italienne Montecatini-Edison.
Pour empêcher les secteurs-clés de leur économie nationale (électronique, secteur nucléaire, ordinateurs, pétrole, pétrochimie) de tomber sous le contrôle américain, les gouvernements français, italiens, britannique, et Ouest-Allemand ont imposé aux trusts privés une série de réorganisations et fusions en vue de créer des compagnies nationales viables et compétitives[2].
Il devient de plus en plus clair que la seule mesure efficace pour résister à la menace de domination américaine, est la fusion des capitaux privés et étatiques au sein d’un cadre de planification et de contrôle étatique.
La crise économique actuelle produit déjà une expansion plus étendue du secteur étatique en Europe occidentale: nationalisation de Rolls Royce et réorganisation de la construction navale en Grande Bretagne; la récente participation du capital d’Etat italien dans l’entreprise de très gros appareillages électrique (la plus grande d’Europe) Zanussi.
Les USA paraissent être la seule exception à cette tendance générale vers le capitalisme d’Etat. En effet, les secteurs étatiques développés pendant la deuxième guerre mondiale (et qui englobaient 20$ de la capacité productive nationale) ont été démantelés à la fin de celle- ci et ‘vendus’ aux entreprises privées. Cependant, la stabilisation de l’économie américaine et le niveau de Keynésianisme (Interventionnisme économique de l’Etat) institutionnalisé n’ont été qu’une interruption de cette tendance; interruption résultant de la domination quasi totale du marché mondial par les USA à travers la défaite et l’épuisement temporaire de ses rivaux impérialistes.
Avec la stagnation du capitalisme américain et la perspective de crise économique mondiale, il devient clair que la tendance irréversible (que le capitalisme américain lui-même ne pourra pas contrecarrer) est celle qui mène à une économie contrôlée et à une fusion entre capital privé et capital étatique.
Un indice de nationalisation au moins partielle du crédit, nous est fourni par la récente ‘garantie fédérale de prêt concédée à Lockheed au bord de la faillite. Au moment de l’affaire Lockheed, l’été dernier, le président de la Bank of America, Chauncy J. Medberry déclarait que aucun "programme de l’ampleur du L-1011 (avion) de Lockheed, qu’il soit commercial ou de défense, ne serait plus financé exclusivement par du capital prive." Il énonçait ainsi les besoins de participation directe du capital d’Etat dans les futures gros investissements.
Le système récent de contrôle des prix et des salaires a accéléré ce mouvement vers une économie contrôlée -stade préparatoire du capitalisme d’Etat- et nous pouvons nous attendre dans les mois prochains à d’autres mesures dans ce sens.
Mais, c’est surtout dans le tiers monde sous l’impact de dizaines d’années de stagnation et de crises, que la transition vers le capitalisme d’Etat se développe plus rapidement.
Selon la résolution sur la politique industrielle adoptée en Inde en 1956 les industries suivantes devaient passer sous "la responsabilité exclusive de l’État": munitions, énergie atomique, fer et acier, équipement électrique lourd, charbon, pétrole, chemin de fer, mines, aéronautique, transports, construction navale, électricité. Parallèlement, l’aluminium, les machines-outils, les alliages ferreux, la chimie lourde, les fertilisateurs, le caoutchouc synthétique, les transports routiers et maritimes devaient: "progressivement devenir propriété étatique" et la responsabilité de nouvelles initiatives dans ce secteur serait prioritairement étatique. Le gouvernement permettait à d’importants trusts d’opérer dans ces secteurs mais sous son contrôle et sa réglementation. En outre, les banques, le crédit et les assurances ont été nationalisés.
La junte militaire qui gouverne le Pérou depuis octobre 68 a entrepris -une réorganisation complète des bases du capitalisme péruvien. L’Etat a déjà acquis le contrôle de 50% du capital bancaire; il a créé un holding (COFIDE, corporation de développement financier) destiné à fournir des crédits à long terme aux entreprises publiques et privées s’engageant dans des projets à échelle importante. Les secteurs pétroliers et minéraux sont contrôlés par des entreprises d’Etat (PETROPEROU et MINEPEROU). L’exploitation directe des gisements de pétrole et des mines, l’établissement des raffineries, la commercialisation des produits finis ainsi que les accords -quand nécessaire- en vue participation du capital étranger dans ces secteurs, toutes ces attributions tombent sous la responsabilité des entreprises d’Etat. Celui-ci a en outre l’intention de devenir propriétaire et -de contrôler les "industries de base", fer et acier, chimie lourde et pétrochimie.
Les modalités de développement du capitalisme d’Etat sont aussi diverses que les idéologies qui masquent cette réorganisation du capital: socialisme démocratique (Inde), marxisme-léninisme (Cuba), communautarisme (Pérou), socialisme arabe (Egypte) Unité populaire (Chili).
Aussi différents soient-ils, ces systèmes représentent des étapes dans le mouvement vers un capitalisme d‘Etat intégral.
CRITIQUE DES THESES DE PAUL MATTICK
Le capitalisme d'Etat, un nouveau système ?
Les groupes d’ultra-gauche ont compris depuis longtemps que la survie du capitalisme dans la période de crise permanente, requiert l’expropriation progressive du capitalisme monopoliste, la destruction des trusts privés et des cartels, et une réorganisation économique sous contrôle étatique. Derrière les façades des idéologies "marxistes-léninistes" et populistes, ils ont vu une exploitation plus intensive du travail salarié, menée à bien par la militarisation, le stakhanovisme, les salaires basés sur la productivité, l’intégration totale des syndicats dans l’appareil d’Etat etc.
Pour comprendre ces développements historiques nouveaux, il est néanmoins nécessaire de posséder une analyse scientifique des lois fondamentales de développement de société de capitalisme d’Etat.
Il est clair que des différences importantes entre le capitalisme d’Etat et le capitalisme privé existent tant au niveau des structures qu’au niveau de l’organisation, mais:
- "Ces différences sont-elles suffisamment importantes pour justifier la thèse qui veut que le vieux système socio-économique a été remplacé par un système nouveau FONDAMENTALEMENT DIFFERENT? Ce nouveau système se trouve-t-il alors soumis aux mêmes lois de développement et aux contradictions du capitalisme? "
("How new is the ‘NEW ORDER’ of Fascism?” Mattick, Partisan Review 1941)
En 1941, dans le contexte de son analyse de l’économie nazie allemande, Mattick arrivait à la conclusion que les systèmes basés sur la propriété d’Etat et contrôlés par celui-ci étaient soumis aux mêmes lois et en proie aux mêmes contradictions fondamentales que les formes antérieures du capitalisme.
- "L’ensemble du marché capitaliste -à 1’exception des relations de marché entre capital et travail- peut disparaître sans affecter la forme de production capitaliste. La relation de marché entre capital et travail est l’unique relation capitaliste EN SOI. Sans son abolition le mode de production historiquement développé et qui est appelé capitalisme, ne peut pas disparaître."
(Mattick "How new..." page 300)
Le capitalisme d'Etat échappe-t-il à la loi de la valeur ?
Dans ses articles plus récents et plus particulièrement dans son livre "MARX ET KEINES"[3] dont les trois derniers chapitres traitent DU CAPITALISME d’Etat) Mattick nous fournit une analyse bien différente quant à la structure et à l’organisation des sociétés de capitalisme d’Etat.
Mattick fonde son analyse sur deux prémisses de base (qui ont notre accord) :
- -Alors que la distribution du travail est déterminée, dans tout type de société par les "économies de temps", "le type de régulation de la production amenée par la loi de la valeur... est spécifiquement capitaliste".
- -Le capitalisme d’Etat est un système basé sur l’exploitation de la classe ouvrière, sur la séparation des travailleurs d’avec leurs moyens de production.
Il subsiste toutefois une question fondamentale: ces systèmes d’exploitation basés sur la propriété d’Etat sont-ils ‘régulés’ par la loi de la valeur, c’est à dire sont-ils des systèmes de production capitalistes ?
Mattick commence son analyse en mettant en avant les similitudes entre capitalisme privé et capitalisme d’Etat.
- "Tous les systèmes capitalistes d’Etat s’apparentent à l’économie de marché du fait que les rapports capital-travail s’y trouvent perpétués... Formellement, il n’y a pas grande différence de l’un à l’autre système, si ce n’est, dans le cas de l’étatisation, un contrôle plus centralisé du surproduit."
(‘Marx et Keynes’, p. 347 et 348)
En effet, "le capitalisme d’Etat continue d’être un système générateur de plus-value" (ibid. page 348). Toutefois, par la suite, Mattick affirme que la société capitaliste d’Etat n’est pas "régie" par la loi de la valeur, pas plus que ses relations économiques ne sont mises en ordre sur la base de cette loi". (Ibid., page 387)
Pour Mattick, là où il n ‘y a pas de propriété privée du capital, là où la production est planifiée centralement, là où les salaires et les prix sont contrôlés directement par l’Etat et même fixés par lui, là où capital et travail sont alloués en dehors des relations de marché, la loi de la valeur cesse de fonctionner.
Cependant, les caractéristiques propres au mode de production capitaliste - Double caractère du travail (travail concret et travail abstrait);double caractère de la marchandise (valeur d’usage et valeur d’échange); force de travail considérée comme marchandise; plus-value, travail non payé -ces caractéristiques qui déterminent les lois de développement du capitalisme, n’existent que dans une formation socio-économique dont le mécanisme régulateur est la loi de la valeur.
En plus du fait qu’on ne peut pas parler de plus-value là où la production de valeurs a cessé d’exister, les contradictions fondamentales et insolubles de la société capitaliste doivent disparaître avec la disparition de la production basée sur la loi de la valeur, puisque c’est cette dernière qui les a engendrées.
Si la production est "réglée consciemment, alors les crises de surproduction n’existent plus; si les biens ne sont plus des marchandises destinées à être échangées à travers le marché, alors, le problème de la réalisation cesse de se poser.
En ce qui concerne la baisse tendancielle du taux de profit,-considérée par Mattick comme la contradiction fondamentale du capitalisme et la source de ses crises- elle aussi cesse d’être un facteur opératoire:
- "Le capitalisme d’Etat ignore la contradiction entre production rentable et production non rentable dont souffre le système rival ... Le capitalisme d’Etat peut produire de manière rentable ou non sans tomber dans la stagnation."
("Marx et Keynes" page 350)
En raisonnant de la sorte, Mattick a rejeté la base matérielle de la révolution prolétarienne. Le communisme est le résultat de l’impossibilité économique de poursuivre l’accumulation du capital sur une échelle élargie; les crises économiques sont la principale manifestation de cet essoufflement du processus d’accumulation. Ceci n’est pas dire que les crises engendrent automatiquement une révolution socialiste, car le prolétariat doit prendre conscience de sa tache historique, il doit agir consciemment et se débarrasser du poids de l’idéologie bourgeoise.
Si ce processus n’a pas lieu, le monde sera condamné à une nouvelle orgie de guerres et de destruction. Cependant, la paupérisation croissante de la classe ouvrière, la crise permanente du capitalisme sont la base matérielle sur laquelle se développe la conscience de classe.
Là où il n’existe pas de crise économique, là où le système peut produire "sans être mené à la stagnation", le socialisme perd sa base de nécessité objective et devient simplement un espoir ou un rêve. La révolution prolétarienne en viendrait alors à dépendre de la puissance de persuasion de "l’idée", ou du programme que des intellectuels amèneraient à la classe. En ce sens, Mattick va du marxisme au socialisme utopique, du matérialisme à l’idéalisme.
Le capitalisme d ' Etat échappe-t-il à l'impérialisme ?
Selon Mattick, ce ne sont pas uniquement la loi de la valeur et les contradictions qui en découlent qui disparaissent dans le capitalisme d’Etat; "bases de l’impérialisme sont également absentes. Mattick a toujours soutenu que l’impérialisme est un produit inévitable" du mode de production capitaliste; sa base étant la recherche d’un taux de profit plus élevé dans les colonies (à travers l’exploitation des capitaux) pour contrecarrer la tendance à la baisse dans la métropole. Toutefois, il est clair que cette inévitabilité de l’impérialisme est spécifique seulement aux sociétés où la loi de la valeur joue, et ainsi elle est exclue dans la conception du capitalisme d’Etat chez Mattick.
Celui-ci évoque pour l’époque actuelle, une seconde cause de l’inévitabilité de l’impérialisme :
- "Il a pour objet non seulement de faire triompher les intérêts de groupes capitalistes organisés sur le plan national, mais encore de défendre ici et d’anéantir là- bas des structures sociales différentes."
("Marx et Keynes", page 324)
Pour Mattick, le capitalisme privé doit lutter contre la montée du capitalisme d’Etat, celui-ci constituant, un système différent et rival. Le capital privé "ne saurait tolérer l’expansion d’un système social différent du sien... Il lit dans la disparition du capital privé à l’étranger l’annonce de son éventuelle atrophie en Amérique". (Ibid, page 323)
Capitalisme d’Etat ou "Socialisme d'Etat" ?
Pour Mattick, cette explication aussi n’a d’application que pour le capital privé. Il argumente qu’à "côté du marché mondial dominé par les U.S.A" (cette partie du globe où domine l’impérialisme, et le colonialisme delà sphère du capitalisme privé) "il existe une espèce de second marché mondial dans lequel l’exploitation des pays sous-développés par les pays plus avancés est restreinte ou absente". ("The United States in South East Asia”, International Socialist Journal, Parag 14, page 134, Paul Mattick.)
Ce second marché mondial est composé du bloc de l’est, des sociétés de capitalisme d’Etat. Il semble que pour Mattick, le capitalisme d’Etat n’a besoin ni d’expansion ni d’impérialisme pour survivre. Ces sociétés n’auraient apparemment pas à exploiter ou piller les pays sous-développés.
A travers sa tentative pour distinguer le capitalisme d’Etat du capitalisme à ses débuts, il apparaît que pour Mattick. Les lois de développement, les mécanismes régulateurs ainsi que les tendances de développement ne sont pas les mêmes dans le capitalisme privé et le capitalisme d’Etat. Pour lui, ce dernier est un mode de production complètement différent, de celui que Marx analysait dans le ‘Capital’. Il le reconnaît quand il dit:
- "Le capitalisme d’État n’est ni capitaliste au sens traditionnel, ni socialiste au sens de Marx.
Du point de vue du capitalisme privé on peut le définir comme un socialisme d’Etat, du seul fait que le capital y est centralisé par l’État, mais du point de vue du socialisme prolétarien, il faut le définir comme un capitalisme d’Etat, puisqu’il perpétue la répartition capitaliste des conditions de production entre travailleurs et non-travailleurs. S’appliquant à des conditions identiques, les deux termes sont interchangeables."
(‘Marx et Keynes’, page 383)
Si la division entre travailleurs et non travailleurs est la seule caractéristique capitaliste de ce système, nous faisons remarquer que cette caractéristique n’est PAS spécifique au mode de production capitaliste.
La propriété et le contrôle des moyens de production par les non-travailleurs, l’extraction d’un surplus caractérisent des sociétés aussi différentes que la Rome Antique, l’Europe Féodale, et l’Empire INCA. L’exploitation des masses travailleuses commence avec la dissolution du communisme primitif et non pas avec le mode de production instauré par la bourgeoisie.
Le caractère spécifique de l’exploitation capitaliste se manifeste lorsque le surplus devient plus-value, sous forme de marchandises.
Ainsi le terme de capitalisme d’Etat employé par Mattick est faux. Le capitalisme d’Etat ou socialisme d’Etat tels qu’ils sont décrits par Mattick sont des sociétés d’exploitation qui ressemblent étrangement à la description que faisaient Bruno Rizzi et Max Scatman du "collectivisme bureaucratique", théorie apparue à la veille de la seconde guerre mondiale.
La crise du capitalisme, la crise du mode de production capitaliste basé sur la loi de la valeur n’engendre plus l’alternative historique: socialisme ou barbarie mais plutôt l’alternative: Socialisme barbarie ou capitalisme d’Etat. Le prolétariat n’est plus le seul à pouvoir résoudre les contradictions du capitalisme à travers la destruction de l’Etat bourgeois et du mode de production capitaliste; pour Mattick, le capitalisme d’Etat représente aussi une résolution historique des contradictions du système.
Peut-être trouve-t-on ici la raison du pessimisme de cet auteur en ce qui concerne la révolution prolétarienne. Il a dit par exemple que "l’époque des révolutions est peut-être révolue", bien qu’il dise aussi "tout est possible, même une révolution prolétarienne".
En l’absence d’une analyse plus détaillée et complète, il nous est impossible de savoir si Mattick prévoit une époque de socialisme d’Etat universel à la suite de l’essoufflement du capitalisme; pour le moment, nous tirons comme conclusion que, poux lui, une intervention consciente du prolétariat sur la scène historique demeure seulement une possibilité. Nous sommes loin de la conclusion qu’il donne à une brochure de 1935,"L’inévitabilité du communisme."
"Mais prématurée ou trop mûre, la révolution -locomotive de l’histoire- et avec elle la société communiste, s’affirme nécessairement et est menée à bien par les travailleurs eux-mêmes. La marche antérieure de l’histoire a créé des conditions ne permettant pas d’autre issue, la solution est identique aux nécessités vitales de la majorité de l’humanité."
Un libre développement des forces productives ...
Les contradictions spécifiques auxquelles le système capitaliste est en proie et qui mènent à son effondrement, à la paupérisation absolue de la classe ouvrière sont les manifestations particulières de cette contradiction fondamentale qui crée la nécessité objective de révolution sociale dans n’importe quelle formation socio-économique.
- "A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s tétaient mues jusqu’alors et qui n’en sont que l’expression juridique. Hier encore formes de développement des forces productives, ces conditions se changent en lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale.’
(K. Marx, Avant-propos à la ‘Critique de l’Economie politique’ Ed La Pléiade -Tome1- page 272)
Selon Marx, le ‘moteur’ du développement historique est le développement des forces productives de la société: c’est seulement lorsque ces forces ne peuvent plus se développer dans le cadre des rapports de production existants que la révolution est à l’ordre du jour.
Cependant, cette impossibilité d’un développement plus étendu des forces productives n’est pas le fait d’une mauvaise gestion de la société par la classe exploiteuse, mais est inhérente à l’organisation et à la structure du mode de production lui-même dans ses lois régulatrices.
Mattick argumente que le capitalisme d’Etat ou socialisme d’Etat n’est pas sujet aux contradictions des sociétés basées sur la loi de la valeur; il affirme que ce nouveau mode de production permet un plus grand développement des forces productives que sous le capitalisme privé.
- "A la différence des économies occidentales de concurrence, les économies centralisées telles la Russie et ses satellites ne semblent pas craindre les conséquences de la cybernétique... En principe, ...la nature centralisée du capital russe permet une application plus large de la cybernétique aux processus économiques et sociaux que celle permise à l’Ouest. Et ceci à son tour permet une automation plus rapide parallèle à 1’augmentation générale de la productivité"
(‘The Economies of Cybernation’, Mattick, New politics)
Sous le capitalisme d’Etat, "le rythme et l’extension de l’automation industrielle sont déterminés par le fond d’accumulation disponible et le besoin de remplacement de l’appareil productif existant" (ibid)
En d’autres termes, le développement des forces productives n’est pas freiné par les questions de profit, ni par les difficultés de la réalisation de la plus-value ; seule la question technique concernant la quantité disponible de moyens de production -qui ne sont plus du capital constant- paraît affecter le taux et l’extension de ce processus.
Cependant, ce qui nous intéresse, c’est de savoir si Mattick prévoit un moment où le socialisme d’Etat lui-aussi deviendra une barrière au développement des forces productives; moment où la poursuite du développement de celles-ci exigera la destruction des rapports de production caractérisant ce nouveau système.
Mattick écrit :
- "Théoriquement et à l’exclusion de catastrophes naturelles ou politiques, l’introduction et l’extension de la cybernétique pourrait être un processus ordonné. La production pourrait être augmentée jusqu’à l’abondance, le temps de travail réduit, et même les deux processus pourraient être simultanément réalisés, bien que plus lentement. En pratique, ceci n’est pas possible étant donné que la Russie fait partie de l’économie mondiale et concurrence les autres nations en vue d’une suprématie économique et politique."
(‘The Economies of Cybernation’, New politics)
Il semblerait alors que ce ne sont pas les "lois" économiques de ce système, mais bien la menace d’un capitalisme privé encore puissant qui empêcherait le plein développement des forces productives à l’Est; c’est la nécessité de se défendre contre l’occident qui empêche dans la pratique ce qui est possible en théorie.
Peut-être que pour Mattick, l’extension du capitalisme d'Etat à travers le globe et le triomphe du système qui "élimine l’exploitation des pays sous-développés par les pays développés" permettra finalement le plein développement de la technologie.
Toutefois, Mattick invoque encore un autre facteur, cette fois-ci un facteur interne qui limite le développement des forces productives dans le système capitaliste d'Etat.
- "Dans le cadre d'une société où l’on pourrait réduire à un minimum le travail nécessaire, toutes les causes objectives des antagonismes sociaux disparaitraient. En revanche, dans toutes les sociétés de classes, et cela concerne les sociétés actuelles fondées sur la production de capital, le développement des forces sociales de production se voit entravé dés au’ il risque de nuire au bien-être et à la survie de la classe socialement dirigeante."
(‘Marx et Keynes’, page 359)
C’est apparemment la classe dirigeante qui délibérément et consciemment retarde le développement des forces productives de façon à empêcher la disparition de ses privilèges et l’effondrement, des rapports sociaux dont ils dépendent. Privilèges et rapports sociaux qu’un état d'abondance mettrait en péril.
Mais une classe dirigeante régie-t-elle consciemment le développement des forces productives de façon à empêcher la disparition ou bien ce processus est-il déterminé en dernière analyse par les lois de cette formation particulière, indépendamment de la volonté subjective de la classe dirigeante?
Dans toutes les sociétés antérieures, ce ne fut pas la capacité des forces productives à se développer, mais bien leur incapacité à se développer au-delà d'un certain point qui menaça la domination de la classe dominante. En effet, aussi longtemps que les forces productives pouvaient se développer dans le cadre des rapports existants, il n’y avait pas de possibilité de révolution sociale, et aucune menace ne se faisait jour contre la loi des exploiteurs. Le développement des forces productives prend fin lorsque les rapports de production existants ne permettent plus leur développement; c'est cette situation qui crée la nécessité objective de renversement des rapports de production.
Ce ne sont pas les capitalistes qui empêchent un développement plus grand des forces productives; ce sont les rapports de production capitalistes qui ne sont plus un cadre adéquat à un tel développement.
Mattick renverse cette relation causale, -base du matérialisme historique- lorsqu’il traite du socialisme d'Etat : pour lui, ce serait dans ce cas, la volonté subjective de la classe dominante qui empêcherait le développement des forces productives, bien que les rapports sociaux permettent un tel développement.
(A SUIVRE)
MAC INTOSH
(Reproduit du n° 2 d’Internationalism New York - sept 72)
[1] Le fer et l’acier ont été dénationalisés en 1951; et ensuite nationalisés de nouveau et réorganisés sous le nom de British Steel Corporation, sous le gouvernement de Wilson.
[2] Voir le refus opposé par le gouvernement- français à la vente du trust électronique Jeumont-Schneider par’ le groupe bancaire Empain, à Westinghouse et 1 ‘imposition gouvernementale de réorganisation et rationalisation du secteur électronique. Voir aussi les efforts du gouvernement italien pour empêcher la vente de Ercole Marelli et Franco Tosi, à Westinghouse conjointement aux négociations récentes en vue de la création d’un trust électronique national avec capital privé (Fiat, Marelli, Franco Tosi) et capital étatique (Finmeccanica) ; nous citons ces 2 exemples parmi les nombreux cas existants.
[3] (1) Edition française chez Gallimard Fév. 1972 -
Questions théoriques:
- L'économie [4]
Révolution Internationale (nouvelle série) N°4 - juin
- 25 lectures
Rubrique:
CONFERENCE INTERNATIONALE
- 25 lectures
Au mois de Mai s'est tenue en Angleterre une conférence regroupant un certain nombre de groupes révolutionnaires. Cette rencontre n'avait nullement des objectifs immédiatement pratiques, mais constituait bien plutôt une tentative de connaître les positions d'autres fractions d’un mouvement renaissant à 1'échelle mondiale. Malgré toutes leurs limitations, de telles réunions sont pour nous d’une importance vitale. Les révolutionnaires se situent d'emblée, même lorsqu'ils sont peu nombreux, dans une perspective internationaliste. Ils ne se considèrent nullement comme une organisation nationale mais comme une fraction d’une classe mondiale. Il n'y a pas de principes qui soient "variables" selon les pays et les latitudes. Il n'y a pas non plus de domaines réservés, d'"indépendance nationale" des groupes. Tout révolutionnaire a le droit et le devoir d'intervenir activement là où il peut et les problèmes qui affrontent les ouvriers de tel ou tel pays sont ceux des prolétaires de tous les autres. Pour nous, les positions de classe ne sont pas le fruit de "cas particuliers" mais d'une expérience historique mondiale.
Si ce n'est que par une confrontation serrée, une autocritique impitoyable que le prolétariat pourra s'émanciper, les taches commencent dès aujourd'hui et par-delà les frontières.
Les groupes qui ont participé à ces discussions sont les suivants :
WORKERS’ VOICE : Ce groupe d'ouvriers est apparu au cours de la remontée des luttes en 1971-72 en Angleterre dans les usines de la région industrielle de Liverpool-Birkenhead. Ses positions essentielles sont 1'anti-parlementarisme, l'anti-syndicalisme, opposition aux luttes de libération nationale. C'est à dire qu'ils se situent sans ambiguïté dans la tradition de la Gauche Communiste européenne des années 20 : sur le terrain du prolétariat. Violemment hostiles aux trotskystes, maoïstes et autres opportunistes, la plupart de ces camarades nous semble cependant avoir développé, par réaction au substitutionisme léniniste des tendances conseillistes.
LE GROUPE DE LONDRES : est une tendance qui vient de scissionner du groupe "Solidarity". Ce dernier groupe se réclame des idées de "Socialisme ou Barbarie". Après avoir formé une fraction marxiste, ils ont rompu essentiellement sur la défense du matérialisme dialectique contre les aberrations cardanistes de "Solidarity" (idéalisme, pas de contradictions objectives dans le capitalisme, "dirigeants-dirigés "etc... ) et leur bouillie opportuniste (soutien au MLF, aux luttes de libération nationale etc.). Les camarades de Londres se rapprochent des idées de R.I.-Internationalism mais il y a encore discussion sur deux points de taille : la révolution russe et la question de 1'organisation.
L’ex-groupe de SOLIDARITY-ABERDEEN : qui a scissionné de "Solidarity" sur la question nationale et des questions d'organisation se réclame du marxisme et semble fortement influence par les idées du GLAT particulièrement sur la question de la crise.
Outre ces trois tendances d'apparition récente, en pleine évolution et qui en sont encore à se définir, deux tendances françaises R.I. et le GLAT étaient représentées (la camarade du GLAT a spécifié qu'elle était venue à titre individuel). Le Manifest Gruppen (Suède) et le Mouvement Communiste (France) ont envoyé des textes à la conférence.
LES DISCUSSIONS
Quatre sujets de discussion ont eu lieu :
1: LA CRISE. Ce débat ne pouvait de toute évidence être approfondi oralement et s'est résumé le plus souvent à une confrontation d'affirmations. Une opposition nette est apparue entre Aberdeen et R.I. sur la question de savoir si le capitalisme avait réussi, pour un temps, à éloigner la crise. Derrière cette polémique se cache en fait une différence radicale de méthode. Aberdeen se réclame des analyses du GLAT sur la baisse du taux de profit et de la lutte de classe comme auteur de la crise. Il se fonde sur la baisse d'intensité de la lutte de classe en Angleterre et une petite reprise temporaire pour affirmer que le spectre de la crise s'est pour quelque temps éloigné. (Pour une critique des thèses d'Aberdeen, voir R.I., bulletin de discussion n° 2) Quant à Workers' Voice, il y a reconnaissance générale de la crise, mais il ne semble pas y avoir de position développée et homogène sur cette question.
Londres et R.I., d'accord sur ce point, ont insisté sur le fait qu’on ne pouvait poser cette question de façon pragmatiste, étroitement nationale et purement conjoncturelle. Une conception générale de la période historique est le fondement même de toute analyse. 2 *
2 : LES SYNDICATS. En apparence, la position de tous les groupes présents semblait homogène. Tous considèrent les syndicats comme des organes contre-révolutionnaires et affirment que le prolétariat devra les détruire. Mais en fait la discussion a mis en lumière des clivages sérieux qui révèlent que derrière l’accord sur ce point se cachent de profondes différences. Le GLAT, et si nos souvenirs sont exacts, Aberdeen, estiment que les syndicats ont dès leur naissance au XIXo siècle été des gardiens de 1'ordre capitaliste, alors que R.I. et la plupart des camarades de Londres considèrent que c'est là une position qui ne tient pas compte de la différence des périodes historiques, (voir l'article de J.A. dans ce numéro, sur le GLAT.).
Sur la question des shop stewards tous les camarades présents se sont accordés à les définir comme des institutions bourgeoises et complètement intégrées, sauf les camarades d'Aberdeen qui défendent la conception d'une double nature de ces organisations, en s'appuyant sur le fait que les shop stewards sont élus et révocables à la base. Cette conception formaliste ne tient aucunement compte du problème de la fonction que doit remplir toute organisation permanente dans la société actuelle.
Les camarades de Workers' Voice ne partageaient nullement cette conception et ont montré de façon très convaincante l'intégration totale des shop stewards. Mais ils étaient par contre extrêmement hésitants sur la question de savoir si des militants pouvaient être shop stewards. Notre position à ce sujet était que ce n'était pas une question de tabou mais de savoir que l'on ne peut pas défendre clairement une perspective de rupture avec les syndicats tout en "organisant” les ouvriers à partir d'un poste syndical. Une fois dans une telle position, toutes les "critiques" à l' égard des syndicats deviennent une caution indirecte.
3 : L'ORGANISATION. Si tous étaient d'accord sur de très vagues généralités (rejet du substitutionisme mais affirmation de la nécessité d'une organisation des révolutionnaires au sein de la classe), la discussion n'a pas permis de véritablement faire ressortir de manière claire les divergences assez sérieuses que les participants ressentaient sur cette question. Quant à nous, très schématiquement, il nous a semblé que le rejet simple du substitutionisme menait la plupart des camarades présents à une tendance à sous-estimer le rôle politique de l'organisation et la nécessite d'un processus de centralisation à l'échelle nationale et internationale. Ceci conduit certains d'entre eux, notamment certains camarades de Workers' Voice à tendre à transformer les formes démocratiques nécessaires en fétiches administratifs.
4 : LE COMMUNISME. Bien que la discussion fût assez brève et ne permît pas d'aborder tous les problèmes complexes et non résolus sur la période de transition, il a semblé se dégager un accord général sur le contenu du communisme, comme destruction du salariat et de la production marchande, contre les idées de nationalisation et d'autogestion.
Les groupes participants ont décidé de maintenir un contact étroit pour approfondir la discussion.
Courants politiques:
Rubrique:
Révolution Internationale (nouvelle série) N°6 - novembre-décembre
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.6 Mo | |
| 1.86 Mo |
- 39 lectures
Crise du pétrole et récession
- 18 lectures
Au moment où nous sortons le n°6 de R.I., un vent de panique s’est mis à souffler sur le monde entier : depuis quelques jours, il n’est plus question que de la "crise du pétrole" et de ses effets désastreux sur l’économie mondiale. Les milieux officiels n’hésitent pas à parler de "croissance zér0 tt et de doublement du chômage pour 1974.
L’article qui suit,(Surproduction et Inflation, écrit avant la panique actuelle peut presque sembler démodé. Ainsi la question qu’il commence par poser : "La crise existe-t-elle ?", fait aujourd’hui sourire. Mais il n’en demeure pas moins d’actualité dans la mesure où il tente de montrer les causes profondes de l’inflation qui continue à sévir, ainsi que de la récession que tout le monde prévoit maintenant pour 1974. Et en cela, il permet de répondre par avance à la campagne de mystification qui se développe sur "la crise du pétrole". En effet la situation présente appelle les remarques suivantes :
1. : Il est indiscutable que le ralentissement des livraisons de pétrole entraîne déjà d’importantes difficultés pour les économies des plus développés, qui en ont fait une matière première extrêmement importante. Il est hors de doute également que les hausses sur ce produit contribueront à aggraver encore l’inflation. Ceci dit, il faut préciser que la situation politique qui est à l’origine de ces mesures est elle-même provoquée par une guerre qui tire ses causes profondes de l’aggravation les tensions inter-impérialistes conséquentes de la crise du capital mondial. En ce sens on peut dire que, bien que facteur aggravant, la crise du pétrole n’est elle-même en dernier ressort qu’un produit de la crise économique générale.
2. : La récession annoncée maintenant à grands cris pour 1974 a été prévue AVANT les derniers évènements du Proche-Orient (en particulier par l’OCDE). L’actuelle crise du pétrole et le freinage de la croissance qu’elle provoque dans les pays affectés, ne pourra qu’aggraver cette récession. Mais elle n’en sera pas la cause. Même si la, crise pétrolière se poursuit, elle ne sera que l’amplificateur d’un phénomène dont les racines sont ailleurs.
3° : L’extraordinaire battage qui est actuellement fait, dans le monde entier, autour des restrictions pétrolières n’est pas le seul résultat de l’affolement momentané, ni du goût du sensationnel des journalistes.
La-bourgeoisie mondiale trouve dans cette crise un bouc-émissaire inattendu, mais particulièrement opportun pour précipiter une série de mesures "impopulaires" qu’elle devra prendre. Les classes dominantes savent que la "récession" prévue exigera des licenciements, du chômage, c’est-à-dire d’attenter à un des seuls avantages réels que le capital ait été capable d’offrir au prolétariat depuis la deuxième guerre : la sécurité de l’emploi.
Celle-ci lui permettrai de supporter une deshumanisation accélérée de sa vie et de son exploitation. Les classes dominantes savent qu’elles devront s’attaquer de plus en plus violemment aux salaires réels de la classe ouvrière.
Elles savent aussi que depuis quelques années, il n’est pas aisé de s’attaquer trop brusquement au niveau de vie des travailleurs. La conscience des capitalistes du monde entier est aujourd’hui pleine d’avertissements qu’importent des noms comme Mai 68, Mai rampant italien, ou Gdansk 70.
La politique des pays producteurs de pétrole du Proche-Orient fournit dans ces conditions une occasion trop tentante de rendre effective une part de ces mesures; tout en en faisant porter la responsabilité sur cet homme à tout faire des moments difficiles de la bourgeoisie : "l’étranger" (en l’occurrence les arabes). Si les choses sont bien faites, on peut même se payer le luxe d’une petite "union sacrée de toutes les classes" face à la difficulté. La manœuvre est trop intéressante pour ne pas la deviner derrière toutes les campagnes de propagande actuelles qui accompagnent un raz de marée totalement disproportionné de fermetures d’usines et d’élévation des prix (l’essence en particulier). La force mystificatrice de cette manœuvre doit être dénoncée.
Dans l’ambiance de panique que la bourgeoisie développe une intervention militaire américaine au Proche-Orient, afin de rétablir "l’ordre pétrolier", apparaîtrait aux yeux des populations occidentales plus justifiée que lors des précédents conflits. La bourgeoisie aux abois aura de plus en plus à utiliser ce genre de mystifications. Dans cette tâche elle pourra compter sur les partis de gauche et sur les rabatteurs de ceux-ci : les gauchistes.
C’est pour cela que dans la période qui vient les révolutionnaires devront redoubler d’efforts pour mettre en lumière les véritables causes de la crise actuelle. Ils devront dénoncer toutes les mystifications véhiculées par les partis du capital pour tenter de préparer le prolétariat à la guerre impérialiste; seule réponse possible du capital a la crise.
Les deux articles "Surproduction et Inflation" et "la 4ème guerre du Proche-Orient" s’inscrivent dans cet effort.
Evènements historiques:
Questions théoriques:
- L'économie [4]
Rubrique:
La grève des petits commerçants et le prolétariat
- 10 lectures
Lorsque face à la taxation, les petits commerçants ont fermé boutique, toute la "gauche" et l’"extrême gauche" ont brandi le drapeau de l‘alliance de toutes les "couches populaires" contre le capital. Soutien critique, soutien tactique, soutien conditionnel : chacun se démarque des affreux "opportunistes" d’à coté. Mais tous, sans exception, préconisent, l ‘union des couches inférieures du commerce avec le prolétariat.
Quant à nous, nous nous opposons absolument à tout front, fût-il temporaire, spécifique et "conditionnel", entre la classe ouvrière et d’autres couches sociales. Nous voulons ici essayer d’indiquer quelques-unes des raisons qui fondent notre position et montrer le sens des propositions d’alliance inter-classiste’ Nous traiterons uniquement du problème du petit commerce et non de celui de l’agriculture, qui est plus complexe (R.I. N° 5, ancienne série)
Quelle est la place des petits commerçants dans le système ?
Si la bourgeoisie et le prolétariat sont les deux classes fondamentales de la société capitaliste, elles ne sont pas seules. Il subsiste des catégories extérieures au schéma de la production capitaliste et qui sont des survivances de modes de production antérieurs.
Les petits commerçants en particulier sont des représentants de la période pré-industrielle. Mais ils n’en échappent nullement pour autant aux lois du capital qui domine l‘ensemble de la société. Ils dépendent étroitement des circuits de distribution et du marché dominé par le capital. Il est vrai que le capital leur abandonne les secteurs non rentables (ou pas encore). Il est vrai que, tirant profit de l’anarchie de la distribution, il arrive encore que, dans certains secteurs nouveaux ou de luxe, se développent des entreprises indépendantes. Mais il est clair que cela n’infirme pas la tendance à leur dépendance accrue et à leur disparition progressive, ni leur confère un rôle "indépendant" nouveau. Le petit commerçant n’est plus aujourd’hui le légendaire et fier entrepreneur qui défend sa "liberté" face au capital. Il reçoit ses marchandises soit directement d’entreprises capitalistes, soit de réseaux de distributions capitalistes. Le plus souvent, il dépend, pour se moderniser un tant soit peu, de la "générosité" du capital bancaire. Gueulard dans les meetings contre "les riches" en général, il est tout obséquieux devant ses fournisseurs et ses créditeurs. Avec ses airs de sans culotte, il trompe les journalistes et les gauchistes -mais pas les bourgeois !
Contrairement au prolétariat, les couches moyennes ne sont pas une classe porteuse d’une solution historique. Eh effet, ce qui fait l’unité d’une classe, c’est sa finalité historique, c’est la société qu’elle représente et non sa simple qualité de catégorie socio-économique. La finalité des classes moyennes n’existe pas; la forme de société à laquelle elles aspirent est une forme irréelle et irréalisable. Autrement dit, ces classes ne représentent pas un mode historique de production, elles ne sont porteuses d’aucune forme sociale.
Cette absence d’une forme sociale propre aux classes moyennes provient du fait que le capitalisme a poussé la socialisation de la production à un point où elle entre en contradiction avec toute forme d'échange, toute forme d'appropriation privée. Sauf si l'on suppose que l'humanité puisse retomber à un stade primitif ou dégénérer, sa survie exige désormais l’instauration du communisme : il n’y a plus d’autre rapport de production possible.
N’étant pas homogènes, les couches moyennes n’ont aucun intérêt commun :
- en tant que propriétaires de moyens de production, elles ne peuvent se hausser à la vision socialiste du monde, c’est à dire la fin de l’appropriation des richesses ;
- en tant que travailleurs indépendants et individuels, elles ne peuvent acquérir ni une vision collectiviste ni globale du monde ;
- en tant que travailleurs isolés elles ne peuvent acquérir un esprit de classe, chacun défend ses propres intérêts, qui ne sont pas les mêmes que ceux de son propre concurrent ;
- en tant que couches liées par toutes leurs fonctions à la marchandise, elles sont soumises à la forme actuelle (et la seule possible) de la société marchande : elles vivent en parasites du système. Elles "revendiquent” en son sein, mais tant qu’elles ne sont pas précipitées dans le prolétariat, tant qu’elles ne sont pas dépossédées, elles dépendent des conditions de leur survie sociale, même si cette survie n’est qu’une misérable agonie.
L’absence de vision historique des classes moyennes a une double conséquence : dans les luttes sociales, elles tentent bien de défendre leurs intérêts particuliers, mais sont réduites, quand les choses deviennent sérieuses, à l’impuissance; il ne leur reste plus qu’à se réfugier dans les bras du capital, sauf si le prolétariat, par sa force, leur inspire la prudence de rester neutres.
Pourquoi la démagogie de la "gauche" ?
La "gauche" s'apitoie naturellement sur le sort des petits commerçants. La CGT et le PC en tête, elle multiplie les oppositions de collaboration de classe entre toutes "les victimes de la politique (?) du gouvernement en matière (?) d'inflation." (L’Humanité)
Chaque jour nous amène son lot de perles. L‘hebdomadaire du PCF, "France Nouvelle", déclare : "Peut-on être révolutionnaire, peut-on vouloir le socialisme et considérer la démocratie avancée comme l’ouverture à ce dernier et, en même temps, défendre les intérêts des petites et moyennes entreprises, c’est à dire, de propriétaires de moyens de production et d’échange, dont un certain nombre exploite la force de travail?" Sa réponse est affirmative. Et il conclut ; "En fin de comptes, et pour en revenir à l’alliance, sa base n’est donc en aucune manière conjoncturelle." La CFDT paraît avoir un langage plus gauchiste. Après la réunion tenue avec le bureau de la Fédération Nationale des syndicats des Commerçants non sédentaires, la CFDT déclare..."Comprendre le mécontentement des détaillants". Elle (la CFDT) leur a soumis en vue d’actions communes le texte de la déclaration des syndicats et des partis de gauche du 8 Novembre en insistant sur le caractère anti-capitaliste des objectifs poursuivis, qui mettent en cause tant le gouvernement que le patronat. Cela devient plus absurde encore que la CGT. Cette dernière en effet proposé aux commerçants une lutte contre les "monopoles" et le gouvernement, ce qui a au moins l’avantage d’être formellement logique. Mais la CFDT propose à des marchands de lutter contre le capital qu’il parasite. Autant demander du lait à un bouc.
Les fascistes ou le programme commun pourraient à la rigueur entraîner les commerçants dans l’attrape-nigaud de la lutte contre les "gros”. Mais quand M. Maire leur demande de devenir "anti-capitalistes", il leur demande de signer leur arrêt de mort. En fait, la CFDT ne croit pas à son propre baratin. Elle cherche simplement à paraître un peu plus à gauche que la CGT avec son "anticapitalisme" de pacotille, de façon à grignoter quelques ouvriers crédules.
Mais le but de toute cette démagogie effrénée est essentiellement de noyer toute réaction ouvrière dans le flot larmoyant des jérémiades démocratiques et inter-classistes. Un grand mouvement populaire sur un objectif concret et précis : La vie chère, dans lequel toute tentative par la classe ouvrière de -s ‘attaquer au capital puisse être traitée de "division" -voilà le rêve de M. Séguy; tant que les ouvriers sont noyés parmi la masse des "victimes" du gouvernement, la gauche peut manœuvrer, contrôler la classe, rassembler les "voix" des mécontents. Il faut à la gauche dans les conditions actuelles, pour parvenir au pouvoir, une classe docile, disciplinée, qui répond aux consignes syndicales et un glissement des voix de la petite bourgeoisie.
La gauche sait très bien que le seul dénominateur commun des prolétaires et des petits commerçants, c’est un antigouvernementalisme superficiel qui ne peut trouver son expression que sur le terrain "politique" des élections. Ce terrain est son terrain en tant que fraction du capital, et de plus, il est le terrain où les travailleurs atomisés et passifs ne lui poseront aucun problème.
Et dans cette opération, les gauchistes tiennent leur place habituelle, comme on va le voir.
Comment les gauchistes s'associent à cette opération
L’hebdomadaire "Rouge" du 16 novembre 1973 se permet de critiquer le PC qui soutient "inconditionnellement les petits commerçants". "Rouge" une fois de plus a le cul entre deux chaises et dit calmement sans rire, "le mouvement actuel des commerçants ne peut être soutenu inconditionnellement" (Nous soulignons). "Rouge" sera sans doute obligé de poser aux commerçants ses "conditions"! Le ridicule ne tue plus . Dans un accès de démagogie, "Rouge" abandonne toutes ses réserves et il se permet de dire que "les petits commerçants auraient tout à gagner à un système socialiste de distribution où ils ne seraient plus à la merci du grand capital, où ils n’auraient plus à payer les conséquences des aléas de la vente". Belle découverte ! Dans un "système socialiste", les commerçants, le marché et la vente existeront-ils toujours ? Évidemment, il n’y aurait plus d’aléas ! Le capital s’accumulerait en toute tranquillité ! Nous n’avons pas eu connaissance de ce socialisme-là. Il faut se rendre à l’évidence : soit nous ne connaissons pas la B-A-BA du marxisme, soit ces théoriciens sont en train de "révolutionner" le socialisme.
"Lutte Ouvrière", elle, ne s’embarrasse pas de toutes ces nuances et reproduit le mot d’ordre du PC (inadmissible d’après "Rouge") "Halte à la vie chère" parce qu’il rassemble tous les mécontents". LO se jette sans scrupules dans les bras des petits commerçants. "Le petit commerce a lui, face au pouvoir, les mêmes intérêts (sic !) que les travailleurs, victimes de la même inflation. C’est là qu’ils doivent chercher leurs alliés, s’ils veulent réellement voir leur sort changer." (LO, 26/11/73 page 12). La logique du frontisme amène ce groupe dans le populisme le plus abject. Ces populistes fustigent la CFDT qui est trop intransigeante et qui "dressera ouvriers et petits boutiquiers les uns contre les autres ... quitte à ne pas toucher les intérêts des grandes surfaces, des grands industriels des grandes banques. Tout comme ce fut la politique de la gauche au Chili, celle qui mena directement à la catastrophe actuelle ". (op cit.) Ce raisonnement nous laisse pantois : la "gauche" a réalisé l’Unité Populaire avec plusieurs couches de la population et c’est cette politique qui a fait faillite au Chili, comme en Espagne et en France en 1936. C’est cette politique qui a toujours fait faillite, qui a amené les prolétaires à la boucherie. Lutte Ouvrière feint d’oublier ces circonstances et affirme que si cette politique de vaste alliance avait été réalisée il n’y aurait pas eu de massacre au Chili.
Nous réaffirmons que les prolétaires n’ont pas à prendre parti dans la lutte sans merci que se livrent les différentes fractions du capital, ils ont encore moins à prendre parti pour la lutte des commerçants, ils ne défendent pas les petits capitalistes contre les gros et encore moins des fractions arriérées. Si au 19è siècle, les révolutionnaires prenaient parti pour certaines fractions de la bourgeoisie, c’était en vue de permettre le développement du capitalisme qui était encore un système progressiste. Aujourd’hui, il est définitivement entré dans sa phase de décadence, les révolutionnaires n’ont plus à soutenir des luttes bourgeoises, ils ont encore moins à prendre parti pour des couches condamnées par les secteurs encore dynamiques du capital.
L’attitude du prolétariat
"Toutes les autres classes se placent sur le terrain de la propriété privée des moyens de production et ont comme but commun la conservation de la société actuelle". Cette phrase d’Engels est aujourd’hui encore le fondement de la position du prolétariat sur la question. Le prolétariat, classe en lutte contre l’économie marchande n’a aucun intérêt commun avec les couches qui en vivent. Il ne peut former sa conscience politique et son organisation de classe que par la lutte contre les positions des classes moyennes. Cette lutte est le seul moyen de précipiter le passage de ces couches au prolétariat.
En effet, ce n’est qu’en montrant le maximum de détermination dans la défense de son programme et en s’affirmant comme porteur de la seule solution à la crise, la destruction de la société marchande, que le prolétariat peut forcer la neutralité des couches moyennes.
Les fractions petites bourgeoises ne sont révolutionnaires que dans l‘imminence de leur passage social au prolétariat.
En attendant, "les ouvriers devront porter tout seul le poids de la révolution" Gorter (Réponse à Lénine sur "la maladie infantile du communisme"-1920). Il nous faut tirer la leçon de cinquante ans de contrerévolution et d’alliances avec les couches petites-bourgeoises. Le prolétariat a été sans cesse massacré sous le drapeau de l’Unité Populaire. Il faut d’une part démystifier la fraction de "gauche" de la bourgeoisie qui pour arriver au pouvoir réclame une large alliance avec les couches moyennes. D’autre part, lutter pour que le prolétariat conquière son autonomie face à toutes les couches bourgeoises et qui en unifiant ses luttes, il impose son programme. Il faut réaffirmer qu’un petit nombre de petits-bourgeois rejoindront le programme prolétarien seulement si cette autonomie se dégage clairement.
En conclusion, nous disons que chaque fois que le prolétariat a perdu son autonomie de classe et accepté de se battre pour les buts des classes moyennes, sa défaite était acquise d’avance et celle des classes moyennes avec elle. Les couches moyennes devront accepter, de gré ou de force, la solution prolétarienne à la crise : leur propre disparition en tant que producteurs indépendants et leur intégration dans une économie socialisée et associée c’est à dire la dissolution de la production marchande.
Roux
Heritage de la Gauche Communiste:
La « Gauche Allemande » : apports et limites.
- 44 lectures
À PROPOS DE LA PARUTION DES TEXTES DU K.A.P.D. ET DES A.A.U.
La parution des textes du KAPD et des AAU (1920-1922) dans le recueil LA GAUCHE ALLEMANDE[1] vient à point et satisfait un des besoins les plus pressants du mouvement prolétarien renaissant : connaître son propre passé pour mieux en faire la critique[2]. Les dilettantes "modernistes" peuvent ignorer les tâtonnements de la classe ouvrière au cours de son histoire, mais les combattants de la future révolution se précipitent au contraire sur tout ce que le passé peut leur offrir. Et dans le cas de la gauche communiste d’Allemagne, ce dont il s’agit c’est bien de leur propre passé, des efforts d’un courant créé par la révolution, agissant dans la révolution et s’efforçant d’exprimer les moyens propres de la révolution à notre époque.
Beaucoup ne savaient de la révolution allemande que ce qu’avait bien voulu leur en dire l’historiographie combinée du stalinisme et du trotskysme. On connaît, par exemple la pauvre légende du professeur Broué : si la révolution allemande a échoué entre 1919 et 1923, c’est parce qu’il manquait au KPD des tacticiens capables de bien appliquer le "front unique". Quand on a une histoire si simple à se transmettre complaisamment, pourquoi se casser la tête sur les huluberlus de la "gauche", ces "gauchistes" puérils et aventuristes ?
La contrerévolution tente toujours de masquer sa propre nature, en forgeant un passé mythique sans révolution et sans révolutionnaire. Thermidor dépeignait Hébert comme un brigand braillard. Les bolcheviks eurent droit à un tel honneur tant qu’ils étaient un moment de la révolution et même un peu au-delà. Mais dès qu’ils furent devenus, consciemment ou non, des rouages de la réaction, ils participèrent à leur tour au refoulement du souvenir de l’irruption prolétarienne. Quant à ceux qui avaient exprimé de leur mieux ce mouvement, ils ont sombré à un tel point dans l’oubli que ce n’est qu’un demi-siècle plus tard que les fractions communistes renaissantes commencent à mesurer toute l’ampleur des questions qu’ils ont soulevées.
La coagulation dans les années 30[3] en un courant figé et porteur d’une idéologie appauvrie (le Conseillisme") ne facilitait pas, il est vrai, la recherche de ce qu’avait représenté le KAPD à ses origines. Mais même dans les erreurs les plus désastreuses des Pannekoek, Mattick ou Meier, englués dans la défaite, il y avait encore un faible écho de l’orage prolétarien — alors que dans le marxisme des épigones de Lénine, il n’y avait plus que l’arrogance bornée de la réaction.
Quoi qu’il en soit, l‘ignorance a de moins en moins d’excuses. Il n’est plus possible, après une lecture attentive de ces textes d’amalgamer le KAPD aux anarchosyndicalistes ou de réduire la richesse de ce courant au conseillisme. Les temps changent et ce n’est pas trop tôt !
Mythe et réalité
La présentation et les notes du recueil permettent de tirer de l’enchevêtrement des évènements qui marquent la période 1914-1922 deux fils précieux. 1° : Les spartakistes ne sont qu’un des courants -et certainement pas le plus clair sur les problèmes décisifs- qui confluent en décembre 1918 dans le KPD ; mais à bien des égards, certains de ces groupes "radicaux de gauche" préfigurent le rejet du syndicalisme et du parlementarisme qui dominera dans le PC à ses débuts[4].
2° : Les gauchistes" qui formeront le KAPD représentent 80% du parti communiste et ce dernier, menacé de dépérissement, ne suivit qu’en se fondant dans l’USPD (socialiste-indépendants, six à sept fois plus nombreuse). On a ainsi la continuité suivante :
"Centrisme" social-démocrate---à USPD ----à VKPD (section officielle de la 3è I.C.)
Spartakus-IKD (groupes radicaux de gauche) ------------------à KPD ------à KAPD
Il faut se graver dans la mémoire ces faits si l’on veut comprendre quoi que ce soit. Le KAPD n’est pas une secte marginale. Elle constitue un moment et un résultat d’un processus de radicalisation prolétarienne. Nous reviendrons sur la question, de savoir pourquoi elle est devenue isolée. Mais ce qui est certain, c’est qu’elle représente de par les conditions de sa formation, le courant le plus significatif de la montée révolutionnaire des années 20. Cela suffit à juger tous ceux qui ont traité par le mépris ou le silence son existence.
Autre fable répandue, et dont la lecture de ces textes ne laisse pas pierre sur pierre : celle qui prétend que c’est au nom d’un purisme "moral" que les communistes de "gauche" rejettent les tactiques préconisées par l’I.C. Ceux qui connaissaient les "gauchistes" à travers de vagues souvenirs de "La Maladie Infantile" de Lénine, seront certainement étonnés de voir qu’ils appréciaient de façon solidement réaliste les tâches objectives de l’"ancien mouvement ouvrier" : "s‘installer au sein de l’ordre capitaliste... envoyer des délégués au parlement et dans les institutions que la bourgeoisie et la bureaucratie avaient laissées ouvertes à la représentation ouvrière... Améliorer la situation du prolétariat au sein du capitalisme, etc. Tout cela fut mis à profit et à l’époque, c’était juste." (Jan Appel, page 33)
Quant à ceux qui s‘obstinent, comme les sous-produits dégénérés de la gauche italienne, à présenter les révolutionnaires allemands comme des "fédéralistes", ils devront expliquer comment Otto Rühle, l’un des plus "spontanéistes", puisqu’il trouvait le KAPD trop proche de la conception classique de l’avant-garde, pouvait écrire : "Le fédéralisme conduit à une caricature d’autonomie (droit d’autodétermination). On croit agir de façon sociale et prolétarienne quand on attribue à chaque région, chaque lieu (on devrait même le faire pour chaque personne) l‘autonomie dans tous les domaines. En fait, on ne fait qu’abolir l’empire pour le remplacer par une quantité de petites principautés. De partout surgissent des roitelets qui régissent... de façon "centralisée” une fraction des adhérents comme si c’était leur propriété."
On ne sait ce qui est le plus ridicule chez les bordiguistes, de leur apologie concassée de Lénine ou de leur rage à l’égard du KAPD. Quoiqu’il en soit, au lieu de ricaner bêtement sur le "formalisme conseilliste" de la gauche -ils feraient mieux de nous expliquer pourquoi, si c’est cela qui le caractérise fondamentalement, le KAPD refusait de participer aux formes vides des conseils d’entreprise légaux, méprisant en cela toutes les majorités statiques et électorales- alors que les léninistes s‘y accrochaient désespérément pour y trouver les masses et remplir la "forme" d’un contenu "révolutionnaire" :
- "Il arrive qu’en évoluant, d’authentiques conseils se corrompent et se figent en une nouvelle bureaucratie. Il faudra les combattre aussi vigoureusement que les organisations capitalistes..."
Mais la déformation la plus éhontée est celle qui a réussi à présenter la gauche communiste comme un courant spontanéiste, niant la fonction de l’avant-garde ou du parti. Que certains éléments en soient arrivés là ne permet pas de falsifier la pensée du courant dans son ensemble sur ce sujet. En tout cas, on peut affirmer sans crainte que le KAPD prenait mille fois plus au sérieux le concept d’avant-garde et la nécessité de ne pas noyer le parti dans les masses, que l’Internationale communiste ! Que ceux qui en doutent lisent soigneusement ces paroles de Jan Appel, en gardant à l’esprit la dissolution du KPD "léniniste" dans l’amas incohérent de la piétaille centriste en 1921 : "Le prolétariat a besoin d’un parti-noyau ultra formé. Chaque communiste doit être un communiste irrécusable... et il doit être un dirigeant sur place. Dans ses rapports dans les luttes où il est plongé, il doit tenir bon, et, ce qui le tient, c’est son programme. Ce qui le contraint à agir, ce sont les décisions que les communistes ont prises. Et là, règne la plus stricte discipline. Là, on ne peut rien changer, ou bien on sera exclu ou sanctionné..." (Jan Appel)[5]
Ces quelques rapides indications permettront de dépasser tous les faux procès faits à la Gauche Communiste et d’aller à l’essentiel : qu’y a-t-il de nouveau, d’original et de durable dans sa pratique et ses conceptions ?
Le KAPD, expression d’une nouvelle période
Le soubassement théorique des positions du KAPD, c’est d’abord la reconnaissance du caractère nouveau de la période ouverte par la première guerre mondiale : période de guerres, de crises et de révolutions. La décadence du capitalisme n’est pas définie, comme on le croit trop souvent, comme simple stagnation, mais comme une ère où "le caractère de lutte de classe de l’économie elle-même se réaffirme de manière dix fois plus accentuée qu’à l’époque de la floraison". La vision qui ressort de ces textes est la suivante s déclin du système ne signifie pas fin des oscillations cycliques et impossibilité pour le capital de se redresser. De fait, "le capital se reconstruit lui-même, sauve son profit, mais aux dépens de la productivité. Le capital reconstruit son pouvoir en détruisant l’économie". On a là une intuition imprécise mais profonde du caractère essentiel de la crise historique. Tentons de la préciser : la sauvegarde du capital exige, face à la saturation des marchés et à l’intensification de la concurrence qui en découle, des frais improductifs gigantesques et croissants. De ce fait, les progrès de productivité sont annulés par l’augmentation cancérique du temps de travail socialement nécessaire au maintien des conditions de reproduction du capital (armement, guerres, bureaucratie, secteur tertiaire, etc.)
Mais l’apport de la "gauche", ce n’est pas son analyse de la décadence, qui reste floue comme celle de l’IC dans son ensemble. C’est sa volonté acharnée de tirer toutes les conséquences du changement du cours historique. Les prolétaires qui se groupent dans la gauche du KPD, puis dans le KAPD, sont eux-mêmes un produit de la rupture brutale de 1914. Le réformisme n’est plus, pour eux, en discussion, il est mort. La pratique sociale-démocrate n’est donc pas un choix "tactique" possible parmi d’autres, mais une expérience déjà faite, nécessaire en son temps, mais qui a démontré clairement, à l’heure de la guerre impérialiste et de la révolution, son incompatibilité complétée avec les conditions et les tâches nouvelles.
Les fractions ouvrières qui commencent, dès la reprise de l’effervescence dans la classe en 1916, à avancer le mot d’ordre : "Sortez des syndicats !", S’attaquent sans crainte à des organes consacrés, forgés au cours de décennies de lutte. Ce qui leur donne cette audace inouïe, c’est que ces groupes ne considèrent nullement les institutions héritées du passé en fonction de ce qu’elles représentent dans la conscience mystifiée de l’ensemble des travailleurs -pas plus qu’ils ne déterminent la nature de celles-ci en les contemplant dans le miroir aux alouettes des possibilités "tactiques" qu’elles offrent. C’est là le subjectivisme "réaliste" de gangs qui veulent concurrencer la social-démocratie sur son terrain et non la méthode matérialiste du prolétariat révolutionnaire. Les délégués qui, au 1er congrès du KPD, préconisent unanimement la destruction des syndicats et à une très forte majorité le refus de participer aux élections (sur ce dernier point malgré l’opposition de Rosa Luxembourg), le font parce qu’ils ont vécu directement la fonction contre-révolutionnaire de ces organes. Poussés par une profonde conscience de classe, mille fois plus profonde que les arguties "léninistes" sur la question, ils parviennent d’emblée au nœud du problème syndical. DES ORGANES CONSTITUÉS POUR S’AMENAGER UNE PLACE DANS LE SYSTEME SONT INUTILISABLES POUR LE DÉTRUIRE, LA CLASSE REVOLUTIONNAIRE NE PEUT REPRENDRE LES OUTILS DE LA CLASSE-EN-SOI[6]. "LE PROLETARIAT NE DOIT S’ORGANISER QU’EN VUE DE LA REVOLUTION" (‘Jan Appel).
"On se construit des syndicats pour un but bien déterminé : s’installer à l’intérieur de l’ordre capitaliste. Alors, quand les communistes croient (qu’on peut utiliser) ces organes qui sont incapables de conduire des luttes révolutionnaires... ils sont dans l’erreur." (Jan Appel)
On a coutume de citer ironiquement les attaques du KAPD contre les "chefs" pour démontrer son prétendu "infantilisme ". Au lieu d’aller au-delà de ce qu’il y a de confus dans les formulations pour découvrir ce qu»il y a de profond dans le noyau de leur pensée, on ironise sur des phrases maladroites. Seules les mauvaises causes procèdent de la sorte. En fait, contrairement à ceux qui ne projettent que leur propre superficialité sur les textes, la Gauche Allemande parvient à une compréhension de phénomène de la bureaucratie qui échappera complètement à l’IC (sauf très partiellement à la gauche italienne). Alors que les léninistes usent leur lance déclamatoire contre la "bureaucratie”, les directions réformistes qui "trahissent", "ne tiennent pas leurs engagements", on trouve chez la gauche communiste l’idée que les bureaucrates ne sont pas la cause de la pourriture des syndicats, mais le produit. Ce ne sont pas les chefs "réformistes” qu’il faut détruire, mais les organes qui les sécrètent et les sélectionnent inévitablement.
"Le vieux mouvement ouvrier avait besoin d’une union des travailleurs. On choisissait des hommes de confiance, des travailleurs capables de négocier avec les patrons... C’EST À DE TELLES ORGANISATIONS QUE TIENNENT LES CHEFS. IIS EXISTENT GRACE A ELLES." (Jan APPEL)
Période historique, tâches objectives, fonction, organes, "chefs". Voilà la suite organique que reconnaît implicitement dans tous ses textes la "Gauche". Derrière la question des "chefs", se profile, à chacune de ces pages brûlantes, la question des tâches du prolétariat et non une question "morale", comme l’ont raconté tant de falsificateurs, eux-mêmes décidément bien obsédés par ce faux problème.
C’est la même vision historique matérialiste qui éclaire l’antiparlementarisme du KAPD. L’opposition à l’égard de la démocratie électorale n’est en aucune façon un principe abstrait mais une nécessité pratique liée à la période. "Exhorter dans la période de décadence du capitalisme le prolétariat à participer aux élections, cela signifie nourrir chez lui l’illusion que la crise pourrait être dépassée par des moyens parlementaires." Voilà qui devrait suffire à faire taire les nombreux faussaires qui ont amalgamé la position antiparlementaire du KAPD à l‘abstentionnisme principiel de l‘anarchisme.
Mais si le rejet des tactiques réformistes à l’heure de la révolution est le trait le plus saillant des textes de la gauche, il ne représente que la partie la plus visible d’un ensemble de conceptions qui tendent vers une cohérence . Il est clair, en particulier pour le KAPD, que le changement général des taches prolétariennes implique également une remise en question des notions traditionnelles concernant la fonction et la nature du parti[7].
Avec la tâche de "s’installer au sein de l’ordre bourgeois", disparaît également le type de parti qui lui était adapté : le parti "politique" classique, dont la fonction était de gagner une représentation parlementaire et de gagner les masses. Les notions de parti réformiste et de parti "de masse" se complètent. Pour imposer à la bourgeoisie une place au mouvement ouvrier, à l’époque du capitalisme ascendant, il fallait recruter des "électeurs" et des "adhérents". Car c’est ainsi que se présente la classe lorsqu’elle ne peut être révolutionnaire. Pour recruter électeurs et adhérents, il fallait disposer d’une tribune, d’une crédibilité politique nationale. Tout se tient et la gauche, qui le comprend bien, rejette le "parti de masse"[8] : "Nous disons : un parti de masse, créé selon le principe ‘faisons entrer le plus de monde possible, après ça nous taperons sur tout cela pour que cela fasse un parti en règle d’un point de vue révolutionnaire sous la pression des rossées de la direction’, nous disons qu’un tel parti ... porte en lui, dans toute sa structure, la plus grande chance de faillir." (Schwab)
Ce n’est plus d’un centre de manœuvre dans la sphère des alliances et des pratiques interclassistes, appuyé sur une masse de socialistes du dimanche dont a besoin le prolétariat. Parce qu’ils sont le fruit d’un mûrissement révolutionnaire au sein de la classe, et non un rassemblement de petits stratèges à l’échine souple, les communistes de gauche répliquent hautement au frontisme de l’IC ces fortes paroles brûlantes de réalité et d’actualité :
"La méthode de la lettre ouverte est impossible et non dialectique. C’est-une méthode par laquelle on veut attirer à soi les masses telles qu’elles sont ... en transigeant avec les pensées qu’elles se font. On dit, il est vrai, dans une phrase- conclusive : ‘Nous savons bien que cela ne colle pas, mais nous exigeons’, etc. Les masses ne comprennent pas cette contradiction, mais elles savent que cela ne va pas. Ou bien, si elles sont encore aveugles, elles se disent : ‘Bon, si les communistes eux-mêmes disent qu’on doit demander cela, c’est que ça ira’..." (jan Appel)
Fronts uniques, lettres ouvertes, mises au pied du mur, négociations pour des pseudo-gouvernements ouvriers sont des manigances extérieures à la classe. Ces combines sont l’aliment de véritables rackets, pour reprendre l’expression d’"Invariance", cliques dont l’objectif est de "compter leurs membres comme des idiots ou des nombres morts" (Rühle). Le KAPD, lui, est une partie de la classe qui agit au sein de la classe. C’est pourquoi il repousse par toutes les fibres de son corps l’escroquerie qui consiste à encourager les illusions des ouvriers pour mieux les appâter. La logique du frontisme, c’est un parti de thésaurisateurs qui accumulent les ouvriers comme des "chiffres inertes". La classe ne se livre pas à de tels petits jeux "pédagogiques" avec elle-même.
Pour le KAPD, le parti n’est pas un état-major qui se distingue par sa finesse tactique. Il est avant tout l’organisation de ceux qui défendent le but communiste au sein du mouvement : "Nous avons la tâche non de lancer les mots d’ordre de la lutte quotidienne ... ces mots d’ordre doivent être posés par les masses ouvrières dans les entreprises... Nous ne repoussons pas le combat quotidien, mais dans ce combat, nous nous mettons en avant des masses, nous leur montrons toujours le chemin, le grand but du communisme." (Meyer)
Le KAPD, cela va de soi, n’excluait pas de prendre en tant que parti les initiatives nécessaires (soutien direct à la Russie soviétique par le sabotage, par exemple) . Mais tout en refusant une conception purement propagandiste de l’avant-garde, il considérait que la fonction principale pour laquelle il existait était la défense du communisme et non celle de telle particularité circonstancielle du développement du mouvement. "Le parti communiste ne peut pas déclencher les luttes; il ne peut pas, non plus, refuser le combat. Il ne peut obtenir, à la longue, la direction des luttes que s’il oppose à toutes les illusions des masses la pleine clarté du but et des méthodes de lutte."
Contrairement aux racoleurs du VKPD, les communistes de gauche rejoignent les bolcheviks de la meilleure période dans la conviction que le rôle du parti est de s‘opposer aux illusions des "masses", quitte à s‘isoler temporairement. Au-delà de ses aspects indéniablement volontaristes, voilà ce qu’il y a de profond dans l‘attitude du KAPD. "Le prolétariat aujourd’hui encore nous insulte. Mais si la situation se développe et mûrit, alors le prolétariat ... reconnaît la voie."
On le voit, c’est véritablement vers une conception d’ensemble des moyens propres à la révolution prolétarienne que s‘oriente la gauche. On nous opposera que nous avons choisi nos citations et les avons reliées nous-mêmes, alors que tout cela apparaît de façon éparse dans les textes. Mais précisément, nous avons tenu à dégager la cohérence sous-jacente. C’est elle qui est essentielle, car elle préfiguré, dans ses balbutiements, l’avenir du mouvement.
C’est justement parce que nous reconnaissons toute son importance et sa richesse, que nous pouvons tenter d’en faire une critique féconde. Contrairement à ceux qui s’attardent complaisamment sur la confusion, inévitable à l’époque, ou sur les erreurs superficielles, les maladresses, nous voulons à la fois apprécier ce moment de la résurgence du mouvement prolétarien et en tracer toutes les limites, toutes les tendances inachevées. C’est ainsi que la révolution procède à l’égard de son passé. Toute autre attitude est scolastique.
Éléments pour une critique de la Gauche
”Si la destruction des syndicats ... ne s’est pas montrée jusqu’ici assez violente, c’est parce que le début de la révolution prit un caractère plus politique qu’économique." (Meyer)
Ce diagnostic cerne peut-être l’aspect fondamental de la révolution allemande. La maturation du mouvement élémentaire de la classe ouvrière, qui donne déjà des signes de révolte contre le réformisme au moment où son apogée tire à sa fin -cette maturation est brutalement interrompue avec la guerre mondiale. La révolution russe de 1905, les premières grèves sauvages, la lente et confuse cristallisation d’une gauche dans la IIe Internationale ne sont que les tout premiers signes d’une remise à l’ordre du jour de la révolution, qui n’aura pas le temps de bouleverser en profondeur l’être de la classe. Le prolétariat se trouve brutalement projeté, en 1914, dans une nouvelle période historique, avant même que sa propre expérience put dégager les nécessités nouvelles qui s’imposent.
Ce n’est pas tout. Bien qu’elle constitue, dans son essence, une continuation de l’économie, la guerre se présente, en grande partie, aux yeux des ouvriers, comme une question politique, au sens étroit du terme. Avant même que. le prolétariat allemand ait pu tirer à fond les conséquences de la crise sociale du système, il est contraint de réagir de façon politique aux problèmes de la guerre, de la paix, de l’empire, etc.
Cette conjonction d’une entrée soudaine dans la nouvelle période et d’une rupture conjoncturelle entre mouvement politique et social a pour effet de briser le procès d’unification de la classe. L’éclosion de la révolte matérielle n’a pas eu le temps de prendre forme. D’une part, le ciment social qui permet de souder en une unité les différentes fractions de la classe fait défaut. D'autre part, le passage à la classe révolutionnaire est brisé, parce que manque le ferment décisif qui réveille les couches les plus arriérées de leur torpeur, défait les habitudes corporatistes et localistes. La misère de l’hiver "rutabaga" de 1917, le rôle policier des syndicats, et même la faillite de la social-démocratie sont perçus par l’immense arrière-garde de la classe comme des conséquences temporaires d’un phénomène précis : la guerre. Le désir le plus profond, c’est la paix et le retour aux conditions de l’ère précédente. D’où l’écrasante inertie qui frappe tous ceux qui étudient la révolution avortée de 1918[9]. On ne fait plus confiance aux sociaux-démocrates pour finir la guerre, mais on pense qu’une fois rétablie la stabilité sociale, ils pourront rejouer leur rôle. D’où le slogan ; "Liebknecht ministre de la guerre ; Scheidemann, ministre des affaires sociales".
De là provient la profonde scission qui lézarde la classe. D’un côté, les éléments radicalisés (nouvelle génération n’ayant pas connu la prospérité, chômeurs, etc.) ; de l’autre, une lourde masse retenue par un conservatisme nostalgique dont l‘expérience n’a pas eu le temps de saper les bases. L’ensemble de la classe trouve l‘expression de ses aspirations dans le socialisme "indépendant" (USPD, puis VKPD). Comme l’a bien vu Invariance dans son étude sur le KAPD, "les communistes de gauche se retrouvent en 1919 en dehors du parti qu’ ils avaient créé. Cela voulait dire qu’ils n’étaient pas l’élément déterminant, dirigeant. Ils n’avaient plus l’avantage..."
La tragédie de la gauche est celle du mouvement de la classe dont elle est l’avant-garde sécrétée par la lutte révolutionnaire, mouvement qui s‘est trouvé incapable pratiquement et théoriquement de poursuivre sa radicalisation au-delà du cadre des phénomènes politiques qui avaient déclenché la révolution, et donc de se hisser à la hauteur de ses taches historiques. Le KAPD tend vers une définition théorique globale de la révolution à notre époque, mais il succombe parce que la classe dans son ensemble ne parvient pas à se dégager de l’époque précédente. Le prolétariat n’est pas mûr pour, en unifiant lutte économique et politique, s‘unifier lui-même et s ‘affirmer comme classe révolutionnaire, destructrice du capital.
Lorsqu’en 1922-23, s‘approfondit la crise sociale qui frappe l’Allemagne et lorsqu’enfin apparaît dans toute sa nudité la putréfaction du capitalisme lui-même (les ouvriers désertent les syndicats), il est trop tard. Le cours s‘est inversé à l‘échelle mondiale et en Allemagne, la contre-révolution a écrasé les fractions les plus avancées, pénétré la classe par le VKPD, isolé la gauche qui se décompose sous des pressions volontaristes et désespérées. Le prolétariat est définitivement cloué sur le terrain du capital. La combativité ouvrière n’y changera rien. La suite du mouvement ouvrier allemand ne sera plus pour des décennies, qu’une nuit sans fin.
On peut donc situer la gauche comme un moment inachevé d’un surgissement de la classe qui tente, avant d’être résorbée par l’involution du mouvement de définir les moyens de la révolution prolétarienne, a l‘époque de la crise historique du capitalisme. Dès que le mouvement ouvrier est définitivement ramené sur une orbite bourgeoise, les communistes de gauche se présentent comme les rescapés d’une révolution avortée en période de contre-révolution. Sectarisme, dissolution et pétrification idéologique deviennent alors inévitables.
Les erreurs fondamentales du courant expriment l‘impasse ou il se trouve. Volontarisme, conseillisme, unionisme ne sont trop souvent considérés que comme une simple addition de déviations idéalistes. En fait, nous pensons qu’ils recouvrent surtout un dénominateur commun qui est la recherche désespérée d’un moyen de renverser le cours contre-révolutionnaire.
Le KAPD parvient à une profonde intuition de la nature de ce cours et de la barbarie de la période qui s‘ouvre. Le capital peut se relever "pour des années, sinon des dizaines d’années sur les cadavres des prolétaires". Une défaite irrémédiable du prolétariat signifierait la possibilité pour le système de prolonger son agonie. Il faut donc "rendre impossible le relèvement du capitalisme".
Ce volontarisme à contre-courant conduit la gauche à affirmer unilatéralement le prolétariat tel qu’il se présente en période de reflux : ENFERME DANS L’USINE. La tâche de l’AAU est définie comme "la révolution dans l’entreprise". Au lieu de considérer LES USINES comme autant de points de départ d’un processus d’unification qui tend à briser ces cadres capitalistes, L’USINE ISOLEE devient le lieu institutionnalisé de l’unification. Le passage à la classe révolutionnaire apparaît ainsi comme le résultat d’une simple addition de formes "purement prolétariennes" que sont les organisations d’entreprise. Tout le mouvement qui va des usines à la société est nié[10].
La théorisation de la division de la classe en entreprises braque la pensée des communistes de gauche sur la question de la forme d’organisation qui y correspond (d’où le caractère superficiel de certaines de leurs critiques contre les syndicats, accusés d’être structurés par métiers et non par entreprises). Elle les entraîne, de plus, à des positions volontaristes, selon lesquelles ce serait à l’avant-garde de "créer les formes” "créer un cadre qui puisse accueillir le prolétariat" , etc.
On a là l ‘embryon de ce qui distinguera les sectes conseillistes. Alors que pour les léninistes, la tâche est d ‘organiser les ouvriers à travers le parti, pour les conseillistes elle deviendra de montrer aux ouvriers quelles formes il faut, pour éviter de tomber entre les mains des léninistes. Dans les deux cas, les communistes sont les "organisateurs" de la classe.
"L’organisation d’entreprise est la garantie (!) que la victoire aboutisse à la dictature du prolétariat et non pas à la dictature de quelques chefs de parti et de leurs cliques."
L’organe devient le but -et le but communiste disparaît parce que toute apologie de l’institutionnalisation d’un organe quelconque gèle le développement du contenu du mouvement. Fétichisme du parti ou fétichisme du conseil ne reviennent qu’à transformer des moments de la révolution en son point final. Poussés à leurs conséquences ultimes, ils sont contre-révolutionnaires. La lutte de classe crée les organes nécessaires et il serait absurde pour les révolutionnaires de ne pas en reconnaître la nécessité. Mais la forme n’est qu’un moment d’un contenu qui la dépasse. Les révolutionnaires ont pour tâche spécifique de défendre le contenu.
Affirmation désespérée d’organes destinés, de par leur "structure" même, à offrir au prolétariat de renverser le cours contre-révolutionnaire. Repli sur l’entreprise pour tenter d’y trouver l’être de la classe révolutionnaire face au capital qui domine sur la scène politique ; au moment même où la gauche parvient à exprimer la révolution, elle est déjà en train d’être happée par la contre-révolution.
Plus grave encore, le conseillisme mène déjà à la théorisation de l’autogestion comme force du communisme : "l’organisation d’entreprise est le début de la forme communiste et devient le fondement de la société communiste à venir".
Comme l’a bien vu Invariance, c’est par réaction à la mystification démocratique inter-classiste à l‘extérieur de l‘usine, que le KAPD s‘obnubile sur la recherche de garanties dans la démocratie au sein de l‘usine. Ainsi, alors que le communisme signifie destruction du cadre de l’entreprise, dans la pensée conseilliste, ce cadre juridique qui est le lieu de la logique intime du capital devient la forme de la société future. Au lieu de considérer les conseils et les usines comme des formes transitoires de regroupement de la classe, dont la classe tend immédiatement à faire éclater les limites, au fur et à mesure qu’elle se nie -les conseillistes en font l’essence de la révolution. L’identification, par Meier, par exemple des "organes de destruction du capitalisme" avec les "organes du communisme" revient à identifier prolétariat et communisme, c’est à dire à perpétuer le prolétariat. C’est de cette grossière erreur que procèdent les théories de la "gestion ouvrière", des "bons de travail" et toutes les idéologies ouvriéristes, proudhoniennes qui ont refleuri depuis.
Hembe
[1] Édité par la "Vieille Taupe", "Invariance" et "La vecchia Talpa". Écrire au "Mouvement Communiste", G. Dauvé, BP 95 — 94600 Choisy-Le-Roi.
[2] USPD : Parti social-démocrate indépendant ; KPD : Parti communiste allemand fondé en 1918 (décembre) ; KAPD : Parti ouvrier communiste d’Allemagne fondé en avril 1920 par la gauche du KPD ; VKPD : Parti communiste unifié d’Allemagne : fusion en décembre 1920 de la droite du KPD et de la gauche de l’USPD ; AAU : Union générale des travailleurs (organisations d’entreprise)
[3] Voir en particulier les textes parus dans "La contre-révolution bureaucratique" (10/18).
[4] Ceci dit, nous ne partageons pas l’appréciation des présentateurs sur les "chefs spartakistes". Il est facile de mettre en évidence leur confusion, mais ce serait également aisé pour 1«IKD. Tous les courants sont mal définis. Les jeux superficiels qui consistent à isoler à tel moment les positions de courants instables, mouvants et qui s’interpénètrent sont, à notre avis académiques.
[5] Un grand nombre de ces citations sont extraites de discours prononcés à la tribune du 3e congrès de l’IC. Les orateurs disposaient de très peu de temps ce qui explique le caractère elliptique de leur style.
[6] La constitution des AAU (organes dans les faits mi-syndicaux) est à notre avis, une régression par rapport à la clarté atteinte dans ces textes.
[7]Nous ne traitons ici que de la position du KAPD et non, par exemple de celle d’Otto Rühle, plus tard.
[8] La question du parti de masse ne se pose pas en termes de nombre : le KAPD comprenait 40 000 à 50 000 membres et il n’est pas impossible d’imaginer un parti mondial qui en regrouperait des millions. Ce qui est en cause, c’est la vision du parti S’appuyant sur le maximum d’"adhérents" possibles, recrutant de façon souple. Et derrière cela, se profile le refus de l’ancienne conception de la classe organisée dans et par le parti. Si toute la classe est communiste, il n’y a plus besoin de parti (il n’y a d’ailleurs plus de classe) .Si la classe n’est pas communiste, alors le parti est une minorité et non l’être de la classe. La conception du parti avant-garde n’est nullement élitiste. Il ne s’agit pas d’un groupe d’élus qui "sélectionnent" ses membres artificiellement. Ce qui le rend minoritaire, c’est le contenu des positions qu’il défend, et non un quelconque sectarisme auto-conservateur.
[9] Voir en particulier l’absence effarante d’initiatives du prolétariat berlinois au cours des journées de janvier 1919. On ne voit souvent que la confusion des chefs (Liebknecht, homme de confiance etc.). Mais les chefs sont bel et bien un produit de cette foule passive, ou pas une voix ne s’élève pour les critiquer
[10] Dans sa présentation des textes, la tendance Mouvement Communiste-Invariance-met bien en relief l’inadéquation de l’idéologie "conseilliste". Mais elle tombe du même coup dans une autre vision unilatérale qui rejette les conseils comme "forme dépassée". Outre que ce ne sont jamais les revues théoriques mais le prolétariat lui-même qui dépasse ses formes antérieures, et qu’en attendant, la plus grande prudence est de rigueur — on peut faire remarquer que si l’entreprise isolée est le lieu de parcellisation de la classe, la production (les usines) reste la base sociale à partir de laquelle s’affirme la spécificité du prolétariat. Pour se nier, la classe doit s’affirmer. En refusant fort justement le fétichisme des conseils, on tombe dans un fétichisme anti-conseils qui, sous le prétexte valable de relativiser les forces, finit par les nier, même comme moments nécessaires . On transforme la négation du prolétariat en un concept métaphysique abstrait (dissolution immédiate). Cette conception est 1«aboutissement logique des aberrations sur la "classe universelle". Nous y reviendrons.
Conscience et organisation:
Personnages:
Courants politiques:
- Le Communisme de Conseil [15]
- Bordiguisme [16]
- Trotskysme [17]
Approfondir:
- Révolution Allemande [18]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [19]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Conscience de classe [10]
Surproduction et inflation
- 122 lectures
Cet article ne prétend pas traiter à fond des causes de la crise qui touche aujourd'hui l'ensemble de l'économie capitaliste[1]. Il se propose seulement de tenter d'éclairer sous l'angle de la pensée révolutionnaire quelques-unes des manifestations de celle-ci et principalement celle qui aujourd'hui touche le plus directement les travailleurs : L'INFLATION.
La crise existe-t-elle ?
Aujourd'hui, cette question peut sembler farfelue. Inflation, crise du Système Monétaire International, plans de stabilisation, mesures d'austérité, conférences internationales : ces préoccupations sont devenues quotidiennes et à côté des retombées pétrolières de la guerre du Proche-Orient qui ne font que les aggraver, elles font la une de tous les journaux.
Dans les rangs de la bourgeoisie, le clan des ‘pessimistes’ croît en nombre, et certains de ses ‘experts’ n'hésitent pas à écrire :
- ‘Aujourd'hui, le pire est devant nous. Nous allons vers le suicide ‘collectif par les excès de toute sorte, comme dans le film ‘La ‘Grande Bouffe’. Il faut avoir le courage de le dire parce que ‘tout le monde veut l'ignorer’[2].
Si toutefois, nous posons la question ‘la crise existe-t-elle ?’, c'est parce que l'évolution de l'économie capitaliste en 1972 et 1973 semble infirmer les craintes qui se manifestaient parmi les plumitifs du capital après la récession de 1971 ainsi que les perspectives que nous tracions dans notre article ‘La crise’ (R. I. n° 6 et 7) :
- ‘Ralentissement massif des échanges internationaux
- guerres commerciales entre les différents pays
- mise en place de mesures protectionnistes et éclatement des unions douanières
- retour à l'autarcie
- chute de la production
- augmentation massive du chômage
- baisse des salaires réels des travailleurs.
De ces prévisions, 1972 et 1973 n'ont confirmé que l'intensification de la guerre commerciale (par le biais des fluctuations des monnaies) et la dislocation des unions douanières (difficultés accrues du marché commun). Par contre les salaires ont réussi pour le moment à suivre l'inflation (particulièrement en France) ; après une pointe début 1972 le chômage a régressé, les échanges internationaux ne se sont jamais aussi bien portés (augmentations annuelles de 10 à 20 % suivant les pays) et 1972 marque une très nette reprise par rapport aux années précédentes, en particulier pour les Etats-Unis qui connaissent leur plus forte croissance depuis la dernière guerre mondiale.
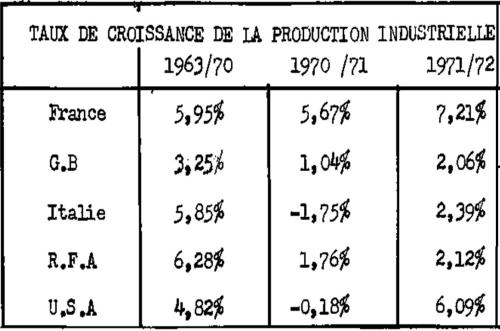
Ces résultats ont conduit certains à conclure que l'économie mondiale avait surmonté sa mauvaise passe et était repartie pour un nouveau boom (il faut d'ailleurs remarquer que ces ‘optimistes’ se recrutent plutôt parmi certains gauchistes[3] que parmi les ‘spécialistes’ officiels qui eux ne se font pas trop d'illusions et, déjà avant la guerre du Proche-Orient, prévoyaient, tels l'OCDE et Giscard, une récession pour 1974). On a en particulier spéculé sur la possibilité pour 1’inflation, telle qu'elle s'est développée en 1972-73, d'assurer une croissance continue.
Il s’agira pour nous d’expliquer pourquoi cette inflation et cette ‘mini-reprise’ annonceront en fait des difficultés accrues pour l'économie capitaliste.
Un autre phénomène fait dire à certains que les difficultés actuelles n’ont rien à voir avec une crise de surproduction modèle 1929. Alors qui en 1929 la crise s'était déclarée brutalement, en pleine période d'euphorie et qu'elle s'était traduite par un effondrement de la Bourse, on n'a pas vu dans la période actuelle de tel effondrement ni de la Bourse[4] ni de la production, mais essentiellement des difficultés sur le plan monétaire. Il s’agit donc de voir ce qui distingue les deux périodes et ce qui les identifie et s'expliquer comment la crise monétaire n'est qu’un reflet d'une crise des débouches. C'est ce que nous ferons d'abord.
Surproduction et crise monétaire
Depuis quelques années, la ‘crise Monétaire Internationale’ est devenue une vedette des journaux. Les dévaluations du dollar succèdent aux réévaluations du mark, les flottements de la livre aux spéculations sur l'or et les conférences internationales de gouverneurs de banques centrales aux réunions a trois, a cinq ou a quarante-sept des ministres des finances. Sur le plan monétaire, tout le monde est d'accord pour répondre : ‘Oui, la crise existe’. Et depuis quatre ou cinq ans, on convient aussi du fait que le ‘Système Monétaire International’ issu des accords de Bretton Woods de 1944 n'est plus adapte aux besoins actuels de l'économie mondiale et que, par conséquent, il faut le réorganiser au plus vite. Mais forts pourtant de ces constatations, les bourgeois n'ont pas réussi encore à résoudre cette crise qui loin de s'atténuer va en s'amplifiant : 1973 a connu une seconde dévaluation du dollar encore plus forte que la précédente (décembre 71 : 8,57 $ et mars 73 : 10 $) suivie d'une autre chute brutale en juillet, ainsi qu'une ascension vertigineuse du prix de l'or qui a triplé son prix officiel.
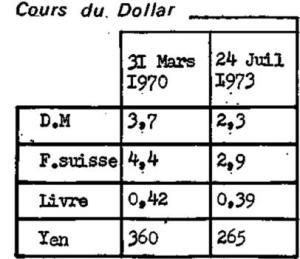
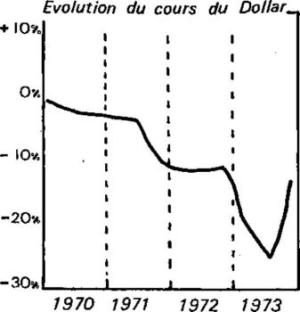
Pourquoi donc cette incapacité des bourgeois à résoudre leurs problèmes monétaires et à se mettre d'accord sur un nouveau S.M.I. ?
Est-ce parce qu’ils sont incompétents et ne savent pas par quel bout entreprendre cette tâche ? La compétence ne manque certainement pas au service de la bourgeoisie : depuis de nombreuses années, toutes les sommités économiques, des académiciens aux prix Nobel, se penchent sur le chevet du S.M.I. malade et lui concoctent toutes sortes de potions magiques. Leur échec ne signifie pas que ce sont des imbéciles mais tout simplement qu'ils se sont attaqués à un problème insoluble : remettre sur pied le Système Monétaire International alors que c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui est malade, malade d'un mal dont l'issue fatale s'appelle guerre ou révolution.
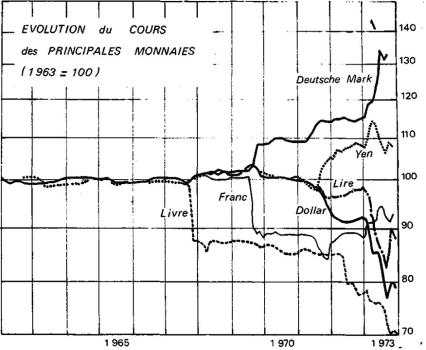
En effet, la monnaie n'a pas une existence indépendante par rapport à l'ensemble de l'économie. Il y a monnaie parce qu'il y a marchandise et c'est parce que celle-ci a besoin pour exister, qu'une marchandise spécifique s'autonomise par rapport aux autres que la monnaie revêt un certain aspect d'indépendance. Et c'est parce que la marchandise se trouve au cœur du mode de production capitaliste que les problèmes monétaires ont aujourd'hui une telle importance.
Le comportement de la monnaie au niveau international, sa stabilité aussi bien que ses fluctuations sont le reflet des conditions dans lesquelles se poursuit le mécanisme essentiel du mode de production capitaliste : la valorisation du capital. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui où la seule base sur laquelle repose la valeur de la monnaie d'un pays est la capacité de celui-ci à produire de façon rentable et à affronter la concurrence internationale.
Dans le passé, la monnaie papier émise par les banques centrales avait une contrepartie systématique, en or ou en argent ; convertibles avec des métaux précieux auxquels l'utilité sociale et le travail de production avaient conféré une réelle valeur d'échange, les billets de banque avaient cette même valeur.
Avec la diminution massive du taux de couverture des billets émis[5] c’est à dire l'impossibilité théorique de reconvertir en or une part importante de la monnaie en circulation, le problème change de données : désormais, ce qui garantit la valeur d'une monnaie, c'est la possibilité qu'elle a d'ache- ter des marchandises du pays où elle est produite. Tant que celui-ci est capable de fabriquer des marchandises échangeables sur le marché mondial (qualité et prix) le Monde a confiance dans sa monnaie. Par contre, si les marchandises produites par ce pays (pays A) n'arrivent plus à se vendre parce qu'elles sont plus chères que celles des autres, les détenteurs de la monnaie du premier s'en débarrassent au bénéfice de la monnaie des pays dont les marchandises se vendent bien. La monnaie du pays A n'étant la contrepartie d'aucune valeur réelle perdra alors la confiance de ses détenteurs et son cours s’effondrera[6]. Cet avatar arrive communément aux monnaies des pays sous-développés depuis de nombreuses années : leur chute presque incessante exprime les difficultés chroniques de l'économie de ces pays.
Mais le phénomène auquel nous assistons a une autre signification que 1'effondrement du Peso argentin, du Quetzal guatémaltèque ou du Kwacha du Malawi. La monnaie qui sombre aujourd'hui, qui, en trois ans,(Mars 70, Juillet 73) a perdu 37% de sa valeur par rapport au Mark, 34% par rapport au Franc suisse, 26% par rapport au Yen et même par rapport à la livre Sterling, cette monnaie donc n'est autre que le dollar ; devise de la nation qui produit 40% de la richesse mondiale, fait 20% du commerce international, devise qui pour cette raison, s'était imposée comme la monnaie universelle.
L'effondrement récent du dollar a exprimé le recul de la compétitivité des marchandises américaines sur le marché international, ainsi que sur son marché intérieur, face à celles de 1'Europe et du Japon. Et ceci est illustré par le fait qu'il a suffi, fin juillet, qu'on annonce que la balance commerciale américaine redevenait positive pour que le dollar accuse aussitôt un redressement spectaculaire.
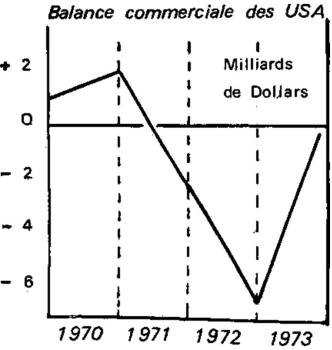 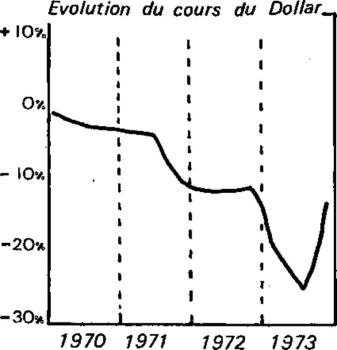 |
|||
|
|
Mais ce phénomène dépasse de loin le cadre de 1'économie américaine, compte tenu justement de sa place à part dans l'économie mondiale : dans la mesure où le dollar reste la monnaie universelle, sa crise est celle du Système Monétaire International. Dans la mesure où les U.S.A. sont encore la plus grande puissance commerciale du monde, leur difficulté à écouler leurs marchandises est le signe d'une saturation mondiale des marchés, l'un et l'autre phénomène étant évidemment lies de façon intime.
Comme nous l’expliquions dans notre précédent article[7], les causes profondes de la crise actuelle résident dans 1'impasse historique dans laquelle se trouve le mode de production capitaliste depuis la première guerre mondiale : les grandes puissances capitalistes se sont partagé entièrement le Monde et il n'existe plus de marchés en nombre suffisant, pour permettre l'expansion du capital; désormais, en 1'absence de révolution prolétarienne victorieuse, seule capable d'en finir avec lui, le système se survit grâce au mécanisme : crise, guerre, reconstruction, nouvelle crise, etc. Parvenant maintenant (en gros à partir du milieu des années soixante) à la fin de la période de reconstruction, le capitalisme est de nouveau hanté par le spectre de la surproduction généralisée.
La bataille que se livrent les grands pays à coups de dévaluations, flottaisons de monnaies, etc. et qui a disloqué l'ancien S.M.I n'exprime rien d'autre que les tentatives de chaque pays, et en particulier des plus atteints, de faire porter aux: autres le fardeau des difficultés croissantes de l'économie mondiale. Dans cette guérilla, un pays encore une fois, est mieux armé que ses rivaux : les États-Unis. Ceux-ci restent forts du poids présent de leur production et de leur commerce, comme de leur poids politique et militaire (régulièrement, pour inciter les pays européens à plus de docilité, ils agitent le martinet du retrait de leurs troupes et de leur parapluie atomique). Mais, ce qui est plus paradoxal, ils restent forts de leur faiblesse, c'est à dire de leurs dettes : les centaines de milliards de dollars actuellement en circulation dans le monde entier sont autant de dettes contractées par l'économie américaine et les détenteurs de cette monnaie ont tout intérêt à ce que leurs débiteurs soient épargnés par toute catastrophe qui les empocherait de les honorer. C'est pour cela que les autres pays sont contraints d'accepter les diktats américains, que cela leur plaise ou non[8] ;
-
réévaluation de leur monnaie (Yen, Mark, Florin, Franc Belge, etc.)
-
dévaluations brutales et répétées du dollar, suivies par la flottaison en baisse de cette monnaie, encouragée en partie par le gouvernement américain (cf. son attitude en juillet 73)
autant de mesures qui ont le double avantage :
- d'amputer d'autant la valeur des dettes américaines
- de baisser les prix des produits américains sur le marché mondial, et partant, de les rendre plus compétitifs (1'achat récent par la Belgique d'avions américains au lieu des ‘Mercure’ français prévus, en est une des illustrations les plus spectaculaires, parce qu'elle montre la futilité des C.E.E., etc. devant la crise...)
Pour des raisons que nous avons vues dans notre précédent article, la crise de surproduction s'est d'abord attaquée au plus puissant des pays capitalistes, mais parce qu'il est le plus puissant, ce pays s'arrangera pour reporter sur les épaules des autres le fardeau de ses difficultés.
Actuellement, c'est à cela qu'on assiste : la dévalorisation massive du dollar a permis un regain de compétitivité des marchandises américaines, qui reviennent concurrencer celles d'Europe et du Japon et permettent à la balance commerciale américaine de se rééquilibrer. Mais c'est là un répit de courte durée pour les Etats-Unis : 1'invasion des autres pays par leurs marchandises conduira ceux-ci à réduire leur production, ainsi que leur main d'œuvre, ce qui diminuera d'autant leur demande et se répercutera donc à terme sur les exportations américaines. En résumé, ce qu'exprime la crise monétaire, c'est que le marché mondial est aujourd'hui trop étroit pour la production capitaliste, et cela même, les économistes bourgeois l'ont compris bien que chez eux, l'empirisme continue à être de règle et que la volonté se maintienne comme facteur économique :
- ‘La cause fondamentale de la crise monétaire peut se résumer en une phrase : chaque pays capitaliste, pour maintenir chez lui le plein emploi, veut réduire le déficit de sa balance commerciale (différence entre les exportations et les importations) ou en maintenir, voire accroître l'excédent. Ces différents ‘projets’ nationaux sont incompatibles entre eux, dans la mesure où l'excédent global qui résulte de l'addition de ces projets ne peut être absorbé par le reste du monde non capitaliste[9].’
Marx constate quelque part que ce n'est que dans les moments de crise que la bourgeoisie devient intelligente, qu'elle comprend la réalité de son système et se persuade des contradictions de celui-ci. Il faut que la crise actuelle soit bien avancée pour qu'elle commence à faire ce que la plupart des ‘marxistes’ de ce siècle ont refusé ; reconnaître la validité de la thèse de Rosa Luxemburg sur la nécessité de l'existence de marchés extra-capita- listes pour que se poursuive le développement du capital[10].
Avec 1929 quelles différences ?
Depuis la 1ère guerre mondiale, le capitalisme est entré dans sa phase de décadence. Les crises de cette période se distinguent de celles du siècle dernier par le fait qu’elles ne peuvent se résoudre que par la guerre impérialiste. En ce sens on ne peut plus les considérer comme des crises cycliques de la croissance mais comme des râles de 1 ‘agonie. La crise actuelle fait évidemment partie de cette deuxième catégorie mais elle se distingue de la plus grande crise passée, celle de 1929 par le fait qu’elle commence par une crise monétaire et non par une catastrophe boursière comme celle du ‘jeudi noir’. Comment expliquer ces différences ?
La reconstruction suivant la première guerre mondiale a les caractéristiques suivantes :
- les productions d’armement sont réduites de façon considérable -applaudi par les économistes de l’époque qui y voient le remède enfin trouve à tous les maux du capitalisme, le crédit et particulièrement celui des banques privées se développe à une allure vertigineuse ;
- après l'intervention omniprésente de l'Etat dans l'économie de la période de guerre, on assiste à un certain retour au ‘laissez- faire’.
La reconstruction suivant la deuxième guerre mondiale se distingue par contre :
- par le maintien d'une économie d'armement (guerre froide)
- par une présence systématique de l'Etat dans la vie économique (achat d'armes, nationalisations, politiques budgétaires) qui se traduit sur le plan idéologique par le succès des conceptions néo-keynésiennes.
- un affaiblissement progressif du rôle de la bourse : des transactions importantes de capital se font maintenant directement entre grandes entreprises et souvent sous contrôle gouvernemental.
En résume on peut dire que si la première reconstruction se fait sous le signe du développement du crédit, la seconde se fait sous le signe de l'économie d'armement et de l'intervention de l'État.
Pour ces raisons c'est l'effondrement brutal (puisque l’État n'intervient pas pour ralentir le processus) du crédit et par suite de son instrument, la bourse, qui inaugure la crise de 1929.
De même, c'est parce que l'État contrôle maintenant l'ensemble de la vie économique et que les gouvernements ont tiré parti de l'expérience du passé que la crise actuelle n'a pas revêtu d'emblée un caractère brutal, que ses effets sont progressifs et qu'elle commence par se manifester sur le terrain par excellence des manipulations gouvernementales : la monnaie.
Les Conférences Internationales à répétition d'aujourd'hui où les gouvernements essaient constamment de faire front tout en ne pouvant cesser de tirer la couverture chacun à soi, sont à la crise actuelle ce que le ‘jeudi noir’ fut à la crise de 1929.
Ces différences entre les deux périodes de reconstruction expliquent également l’existence d'un phénomène relativement nouveau dans le capitalisme et qui aujourd'hui s'abat avec violence dans le monde entier : l'inflation.
Dans la partie qui suit, nous essaierons de dégager les causes de ce phénomène.
Les interprétations de l’inflation
L'inflation est un phénomène qui se manifeste depuis le début du siècle mais qui a connu son âge d'or depuis la deuxième guerre mondiale. Mais même les taux de l'après-guerre longtemps considérés comme inquiétants sont, depuis quelques années, amplement surpassés.
Hausse annuelle des prix à la consommation (en pourcentage)
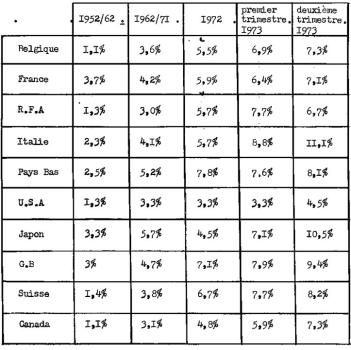
Et ce qu'il est frappant de constater, c'est que la ‘flambée’ des prix la plus importante correspond justement à la ‘mini-reprise’ de 1972. Ce n'est pas là un phénomène fortuit, c'est au contraire une manifestation de l'interpénétration des différents aspects de la crise actuelle. Pour comprendre l'inflation galopante actuelle, il nous faut d'abord expliquer le phénomène plus général de l'inflation telle qu'elle se manifeste depuis la deuxième guerre mondiale, particulièrement sous sa forme ‘rampante’.
Il existe autant d'interprétations de l'inflation qu'il y a d'écoles économiques. Pour certains c'est 1'excédent de la demande sur l'offre qui détermine une hausse constante des prix (inflation par la demande) : on comprend mal alors que le capitalisme mondial n'ait pu depuis de nombreuses années ajuster son offre à cette demande excédentaire alors que depuis longtemps il apparaît très nettement que ce qui limite la croissance ce ne sont pas des problèmes techniques d'élargissement de la production, mais un problème d'élargissement des marchés (existence de chômage et de capital sous utilisés), On comprend encore plus difficilement que la plus grande ‘flambée’ de l'après-guerre survienne à l'issue de sa récession la plus sérieuse : celle de 1971. Face à cette situation inexplicable pour eux, les économistes n'ont pu faire mieux que d'inventer un mot nouveau pour la désigner : la ‘stagflation’.
Tableau : capital et force de travail inutilisés aux USA.
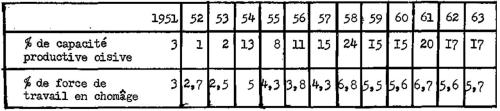
Suivant la première interprétation on explique donc la hausse brutale actuelle des prix par une demande exceptionnelle sur l'ensemble des biens et en premier lieu sur les matières premières et les produits agricoles pour lesquels les augmentations ont atteint leurs plus hauts sommets (doublement en six mois du prix de certaines matières premières et du blé, augmentation de 20 à 30% du prix de la viande, etc.). Ces hausses se répercuteraient ensuite sur l'ensemble des marchandises qui utilisent ces biens de base (deuxième interprétation) et, entre autres, sur les produits alimentaires, ce qui d'autant le prix de la force de travail, grande consommatrice de ces produits.
Tout mensonge, pour être crédible, doit receler une part de vérité ; en ce sens, cette interprétation de l'emballement actuel des prix est partiellement juste. En effet, c'est bien parce qu'il y a eu dernièrement des mauvaises récoltes de produits de base comme le blé et, par suite, une demande massive (achats considérables de l'URSS) que les prix de celui-ci et de l'ensemble des produits agricoles ont décollé[12]. Et les hausses record du prix du pétrole sont évidemment pour quelque chose dans 1'affolement actuel des prix.
De même, la poussée de la demande des acheteurs voulant devancer les hausses a été un des éléments contribuant à cet affolement, et ceci d'autant plus que la pratique d'anticipation des augmentations de tarifs, utilisée de façon courante par les fournisseurs, s'est généralisée avec les premiers assauts de l'inflation galopante.
Nous avons donc là une série de phénomènes : inflation par la demande, par les coûts, par l’anticipation des achats et des augmentations de tarifs, qui ont été longuement décrits et analysés ces derniers temps et qui, sans doute, contribuent partiellement à la panique actuelle. Mais toutes ces interprétations postulent :
- soit que la demande a, depuis la dernière guerre, dépassé l'offre, et principalement ces dernières années,
- soit que l'inflation existait parce qu'il y avait déjà inflation.
Nous avons vu plus haut ce qu'on peut penser de la première hypothèse; quant à la seconde, il suffit de la formuler pour qu'elle apparaisse comme une plate tautologie.
Ce qu'il s'agit de déterminer, c'est pourquoi, depuis plusieurs décennies, 1'ensemble des couts de production n'a cessé de monter alors que Hans la même période la productivité du travail a connu des taux d'augmentation inconnus jusqu'alors.
Certains bourgeois (parmi les plus réactionnaires) ainsi que certains ‘marxistes” ont une réponse toute trouvée, bien que formulée différemment :
- pour les premiers, c'est l'augmentation des ‘coûts salariaux’ imposée par l'action des syndicats qui est responsable de la hausse des coûts de production et donc des prix. Pour vaincre l'inflation, il faut donc briser l'échine des syndicats;
- pour les seconds, la lutte de classe, moteur de l'ensemble de la vie sociale, est à l'origine de la pression à la hausse sur les coûts de production, dans la mesure où elle contraint la bourgeoisie à accorder des augmentations de salaire aux ouvriers.[13],
Si l'on peut admettre effectivement que l'intensification des luttes ouvrières est un des éléments qui contribuent à faire évoluer l'inflation rampante (1945-1969) vers l'inflation galopante (après 1969)[1], cette hypothèse est cependant incapable de donner une réponse aux questions suivantes :
- pourquoi l'inflation s'est-elle poursuivie même pendant les années où la lutte de classe était particulièrement faible (années 50 et début des années 60), alors qu'au siècle dernier des luttes bien plus puissantes ne remettaient pas en cause la tendance à la baisse de 1'ensemble des prix ?
- pour quelle mystérieuse raison la lutte de classe s'est-elle intensifiée vers la fin des années 60 ?
L'incapacité de l'hypothèse des ‘coûts salariaux’ à rendre compte de ces phénomènes montre donc que ce ne sont pas, en dernier ressort, les prix qui courent après les salaires mais bien les salaires après les prix.
Une autre explication, dont le PCF s'est fait le spécialiste, consiste à dire que ce sont les sur-profits des monopoles qui sont responsables de la hausse des prix à la production. Il suffirait donc que la gauche vienne au pouvoir pour mettre au pas ces monopoles (éventuellement en les nationalisant) et briser net l'inflation. Il fallait y penser !
Nous ne nous attarderons pas sur le côté démagogique de cette explication (les monopoles sont-ils autre chose que la tendance générale du capitalisme vers la concentration du capital, et depuis quand l'État bourgeois est-il autre chose que le représentant du capital national ?). Nous nous contenterons de voir ce que contient cette notion de sur-profit monopoliste.
D'abord, supposons qu'une entreprise donnée soit seule sur 1e marché d'un produit. Dans une telle hypothèse, il est évident que cette entreprise ne serait plus obligée de fixer le prix de ses produits en fonction de leur valeur véritable. La loi de l'offre et de la demande ne jouant plus, puisque les clients ne pourraient s'adresser à aucun autre fournisseur, cette entreprise pourrait, théoriquement, établir ses prix aussi haut qu'elle le voudrait. Une telle situation ne peut exister dans les faits, puisqu'on verrait alors apparaître d'autres entreprises qui, même avec une productivité moindre, seraient en mesure de pratiquer des prix plus bas et donc de prendre les marchés de la première.
Et dans les faits, il n'existe aucun véritable monopole. Aucun marché dans le monde (excepté peut-être pour certains produits très particuliers et sur des volumes non significatifs) n'est la propriété exclusive d'une seule entreprise. Ce qui existe, par contre, ce sont des cartels, c'est-à-dire des ententes plus ou moins temporaires entre grandes compagnies, ayant pour but de limiter leur concurrence et de se répartir le marché. Ces ententes sont d'ailleurs toujours à la merci des fluctuations du marché mondial et ne sont, en fait, que de petites trêves dans la guerre continuelle que se livrent entre elles les différentes fractions du capital mondial[14]. Pour cette raison, même les ‘monopoles’ tant décriés ne sont pas en mesure de fixer librement leurs prix et provoquer 1'inflation, même s'ils peuvent, grâce aux cartels, s'opposer, dans certaines limites, aux tendances à la baisse et être les instruments de la transmission internationale de cette inflation.En fait, ces ‘monopoles’ et ces ‘cartels’ existent depuis fort longtemps déjà et ils alimentaient déjà les préoccupations des économistes à une époque où l'inflation était inconnue. Ils ne sont donc d'aucune utilité pour expliquer les causes fondamentales d'un phénomène qui est apparu bien après eux. Cet argument vaut également pour la thèse suivant laquelle c'est la baisse tendancielle du taux de profit qui serait responsable de l'inflation : pour lutter contre cette baisse, les monopoles auraient tendance à fixer leurs profits au- dessus du taux permis par la composition organique du capital, provoquant ainsi un déséquilibre général vers la hausse des prix. En fait, la tendance à la baisse du taux de profit s'exerce depuis que le capitalisme existe et n'a pas empêché pendant, toute une époque les prix de baisser. Si on peut donc admettre que c'est en partie à travers la baisse du taux de profit que les ‘monopoles’ ressentent aujourd'hui les contradictions du système et qu'ils sont obligés d'augmenter leurs prix, cette explication ne permet pas non plus de coup rendre l'essence de l'inflation. Là encore, on peut dire que les monopoles et les cartels en sont l'instrument, mais non la cause.
Les causes réelles de l’inflation
Les causes fondamentales de l’inflation sont à rechercher dans les conditions spécifiques du fonctionnement du mode de production capitaliste dans sa phase de décadence. En effet, l'observation empirique nous permet de noter que l'inflation est fondamentalement un phénomène de cette époque du capitalisme ainsi que de relever qu'elle se manifeste avec le plus d'acuité dans les périodes de guerre (1914-18, 1939-45, guerre de Corée, 1957-58 en France pendant la guerre d'Algérie...) c'est-à-dire celles où les dépenses improductives sont les plus élevées. Il est donc logique de considérer que c'est à partir de cette caractéristique spécifique de la décadence, la part considérable des armements et plus généralement des dépenses improductives dans l'économie[15], qu'on doit tenter d'expliquer le phénomène de l'inflation.
Comme nous l'avons vu plus haut, la décadence du capitalisme est causée par les difficultés croissantes et de plus en plus insurmontables que rencontre le système à écouler ses marchandises. Ces difficultés provoquent au niveau de chaque État l'augmentation constante des dépenses improductives destinées à maintenir en vie un système historiquement condamné :
- frais d'armement permettant à chaque État de défendre poings et ongles les positions de son capital national face à celles des autres capitaux concurrents.
- frais de fonctionnement de l'État qui, face à une société qui tend à se disloquer de plus en plus, se rend, véritable Moloch, maître de toute la vie sociale (police, administration, justice).
- frais de marketing, publicité, de recherches destinées à rendre les produits de plus en plus éphémères, frais qui sont tous consacrés à l'écoulement des marchandises et non à leur production.
Inexistence de frais improductifs dans la société capitaliste n'est pas en soi une nouveauté. Elle est le fait de toutes les sociétés et particulièrement des sociétés d'exploitation. Elle est la règle dans la féodalité, par exemple, où les nobles consomment la plus grosse part du surproduit social en biens de luxe. Elle se manifeste dans le capitalisme depuis ses débuts sous la forme de l'État, des porteurs de sabre et de goupillon et de la consommation de la classe capitaliste. Mais ce qui est fondamentalement nouveau dans la période de déclin du capitalisme, comme des autres systèmes d'ailleurs, c'est 1'ampleur que prennent ces dépenses par rapport à l'ensemble des activités productives : a ce stade, la quantité se transforme en qualité.
Aujourd'hui, dans le prix de chaque marchandise, à côté du profit et des coûts de la force de travail et du capital constant consommés dans sa production interviennent, de façon de plus en plus massive, tous les frais indispensables à sa vente sur un marché chaque jour plus encombré (depuis la rétribution des personnels des services de marketing jusqu’aux impôts destinés à payer la police, les fonctionnaires et les armes du pays producteur). Dans la valeur de chaque objet, la part revenant au travail nécessaire à sa- production devient chaque jour plus faible par rapport à la part revenant au travail humain imposé par les nécessités de la survie du système. La tendance du poids de ces dépenses improductives à annihiler les gains de productivité du travail se traduit par le constant dérapage vers le haut du prix des marchandises.
En d'autres termes, l'inflation exprime l'immense gaspillage de forces productives que le système en décadence est obligé de faire pour se maintenir en vie. Et dans la mesure où nous sommes dans une société d'exploitation l'inflation apparaît comme le moyen à travers lequel ce système fait porter aux travailleurs, par une agression continuelle contre leur niveau de vie, le fardeau de ses contradictions insolubles.
Que l'on considère l'histoire du XXe siècle sur de courtes ou de longues périodes, on peut constater que 1'augmentation des dépenses militaires (et en général les dépenses improductives) est toujours un facteur d'inflation. Sur de courtes périodes, on a déjà remarqué que les guerres provoquaient un taux record d'inflation. Sur de longues périodes, on peut faire apparaître que l'inflation rampante ininterrompue depuis la seconde guerre mondiale est le corollaire de la production massive d'armements depuis la guerre froide jusqu'à maintenant, alors que pendant l'entre-deux-guerres la période de désarmement était marquée par un ralentissement ou une disparition de l'inflation.
L’inflation galopante
En ce qui concerne la flambée actuelle des prix à l'échelle internationale, l'ensemble des éléments cités plus haut interviennent effectivement dans une certaine mesure.
Par exemple, la hausse des produits agricoles est liée à une pénurie réelle, mais il semble absurde qu'en 1973 l'humanité soit encore soumise aux caprices de la nature comme elle l'était au Moyen Age ou dans l'antiquité. En fait, cette brusque pénurie a pour cause véritable toute la politique de restriction de la production agricole (primes à l'arrachage, à la mise en jachère, destruction de stocks, etc. menée par les grandes puissances depuis la Seconde Guerre Mondiale. Soucieux de soutenir l'écoulement des produits agricoles dans un marché mondial saturé, le capitalisme, en en limitant la production au plus juste des besoins solvables, s'est mis à la merci de la première mauvaise récolte venue. Paradoxalement, c'est donc la surproduction qui est encore à l'origine de la pénurie actuelle des produits agricoles et donc des hausses qui les frappent.
On peut également dire que la montée mondiale de la lutte de classe depuis 1968 n'est pas absolument étrangère au processus d'emballement de l'inflation, mais là encore il faut préciser que cette montée était elle- même la conséquence d'une aggravation des conditions de vie des travailleurs, ressentie, entre autres choses, à travers la hausse des prix, aggravation due à l'exacerbation des contradictions du système capitaliste. Même si partiellement elle peut l'amplifier, la lutte de classe n'est pas la cause de l'inflation mais la conséquence.
De la même façon, nous avons vu que les explications bourgeoises sur le rôle des anticipations (à l'achat et à la hausse) sur la flambée des prix ne sont pas dénuées de tout fondement.
Nous avons donc là une série d'éléments qui permettent d'expliquer partiellement le passage de l'inflation rampante a l'inflation galopante. Il faut y ajouter un autre élément qui permet de comprendre comment la récession de 71 a contribué à renforcer le tourbillon inflationniste de 72-73. Depuis de nombreuses années, le système capitaliste se caractérise, outre l'existence séculaire d'une ‘armée industrielle de réserve’, par une sous-utilisation chronique du capital. Ce phénomène signifie que, outre les frais improductifs déjà signalés, le système doit supporter l'amortissement de la proportion importante du capital constant qui, bien que créée, n'est pas engagée dans la production et qui intervient donc comme frais improductif. En d'autres tenues, le coût de production d'une marchandise créée dans ces conditions. Incorporera, à côté du capital fixe réellement consommé, la part inemployée mais néanmoins payée de ce capital fixe.
Quand on sait que les taux d'utilisation des capacités productives sont respectivement (d'après l'I.N.S.E.E.) on peut prendre conscience de l'influence que le ralentissement de 1971 a eue sur la flambée des prix de 1972-73.
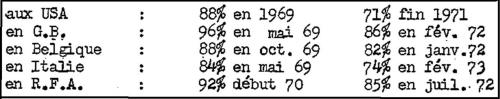
À l'influence de la sous-utilisation du capital constant vient s'ajouter, pendant la même période, celle de l'augmentation du chômage. En effet, même si les secours versés aux chômeurs sont souvent dérisoires, ils n'en représentent pas moins une dépense improductive que supporte l'ensemble de la société et qui se répercute donc sur les coûts, de production des marchandises.
Chômage et sous-utilisation des capacités productives sont donc deux éléments de la récession de 1971 qui contribuent encore à accentuer 1'explosion inflationniste de 1972-73.
Face à cette inflation galopante, quelles mesures peut prendre la bourgeoisie ?
L’échec de la lutte contre l’inflation
Comme nous l'avons vu, les causes fondamentales de l'inflation résident dans le mode d'existence actuel du système capitaliste, qui se traduit par un développement démesuré des dépenses improductives. En ce sens, il ne saurait y avoir de lutte efficace contre l'inflation sans réduction massive de ces dépenses improductives. Mais, comme nous l'avons vu également, ces dépenses sent absolument indispensables à la survie du système, ce qui revient à dire que le problème de la lutte contre l'inflation est aussi insoluble que celui de la quadrature du cercle.
Ne pouvant s'attaquer aux causes fondamentales du mal, la bourgeoisie est obligée de s'attaquer aux conséquences. C'est ainsi qu'elle a tenté de mettre en place une série de mesures :
- économies budgétaires
- freinage de la demande par la limitation du crédit
- blocage des prix
- blocage des salaires
Les économies budgétaires tentant de s'inscrire dans le sens d'une attaque contre les causes fondamentales de l'inflation. En fait, dans la mesure où une telle attaque est impossible sans toucher aux fondements mêmes du système, les politiques de ‘rigueur budgétaire’ ne signifient pas autre chose qu'austérité et restriction des ‘dépenses sociales’.
C'est ainsi qu'on a vu Nixon liquider la politique de ‘Grande Société’ mise en place par Johnson, Cette mesure n'a d'ailleurs pas été suffisante pour empêcher des déficits de plusieurs dizaines de milliards de dollars des deux derniers budgets américains, déficits qui, dans la mesure où ils sont couverts par la planche à billets, c'est-à-dire l'injection dans l'économie d'une masse de monnaie ne correspondant à aucune création de valeur en contre-partie, se traduisent par une baisse de la valeur de la monnaie et donc par l'inflation.
Par ailleurs, dans la mesure où les achats de l'État ont été pendant toute la période de la reconstruction un des débouchés de la production capitaliste, ces restrictions ont pour effet d'accentuer la récession actuelle. Les gouvernements doivent donc faire face au dilemme : inflation ou récession sans qu'ils puissent d'ailleurs réellement empêcher l'une par l'autre.
Les politiques de limitation du crédit, dans la mesure où elles se proposent de freiner la demande et, par suite, de réduire les débouchés, se trouvent elles aussi confrontées au même dilemme ; inflation ou récession. De plus, ces politiques de ‘crédit cher’ ont pour conséquence d'augmenter les frais d'amortissement du capital investi, frais qui se répercutent sur le prix des marchandises d'où à nouveau inflation.
Les blocages des prix, quant à eux, sont devenus maintenant l'occasion d'un scénario bien réglé : les prix ne bougent pas tant qu'ils sont soumis à la réglementation gouvernementale, mais dès que celle-ci cesse de s'appliquer on assiste à des bons spectaculaires, bons qui sont simplifiés par le fait que beaucoup de fournisseurs ayant attendu la fin du blocage pour effectuer leurs livraisons ont créé un déséquilibre entre l'offre et la demande au bénéfice de cette dernière. Loin d'empêcher l'inflation les politiques de blocage, des prix substituent une inflation par saccades a une inflation continue. Ces blocages n'auraient donc d'efficacité que s'ils étaient définitifs mais, dans la mesure où le système ne peut tricher avec ses propres lois et que celles-ci lui imposent une hausse continue des prix, il s'ensuivrait, dans ce cas un déséquilibre majeur qui se traduirait nécessairement par la récession : là encore la bourgeoisie est placée devant le même dilemme
Le blocage des salaires est la seule mesure qui ne fasse pas seulement intervenir des critères économiques mais également un rapport de force entre les classes. En ce sens l'échec ou la réussite (momentanée) d'une telle politique est conditionnée par le niveau de la combativité ouvrière. Dans la période actuelle, où la classe ouvrière s'est relevée de son écrasement de 50 années, toute agression majeure contre son niveau de vie se traduit par des réactions violentes (mai68, Gdansk70, grève des mineurs anglais en 71 qui ont obtenu 30% d'augmentation en période de blocage, grèves récentes des métallurgistes allemands). Par suite, la bourgeoisie, malgré quelques tentatives, continue à hésiter à imposer à la classe ouvrière la politique draconienne d'austérité que la situation réclame de plus en plus : les réactions de celle-ci lui font trop peur pour qu'elle ose l'affronter.
Si l'atteinte au niveau de vie des travailleurs est la seule politique qui reste à la bourgeoisie pour tenter de juguler l'inflation, c'est encore une politique qu'elle est obligée de manier aujourd'hui avec la plus grande circonspection.
En fait, depuis plusieurs années, le capitalisme mondial marche sur une corde raide: d'un coté la chute dans l'inflation galopante, de l'autre celle dans la récession. La récession de 1971 et le tourbillon inflationniste de 1972-73 sont l'illustration flagrante de cette situation. Ce que recouvre en fait la mini-reprise de 1972-73, c'est une certaine démission des gouvernements devant l'inflation qui a permis à celle-ci de se hisser à des taux spectaculaires. La libération temporaire du crédit, les anticipations des acheteurs sur les hausses, ainsi que le ‘rattrapage’ par rapport à l'année 71 (la reprise est d'autant plus spectaculaire qu'elle suit une année de stagnation) ayant permis cette reprise de 1972, certains ont voulu voir dans l'inflation un remède à la surproduction : du moment qu'elle reste plus ou moins uniforme dans chaque pays (il suffit de ne pas faire plus mal que son voisin), l'inflation galopante serait le ‘dopant’ qui manque aux économies actuelles. Qu'importerait, après tout, si les prix montaient de 10 ou 20% par an si, en même temps, pouvait se poursuivre le commerce international ?
Une telle possibilité, indépendamment de toutes les raisons qui nous ont permis d'expliquer le phénomène de l'inflation, est en soi absurde. En effet, une des fonctions fondamentales de la monnaie est d'être mesure de la valeur, fonction qui lui permet d'assurer toutes les autres (moyen de circulation des marchandises, de thésaurisation, de paiement, etc.). À partir d'un certain taux de dépréciation, une monnaie ne sera plus en mesure de remplir cette fonction : on ne peut pas passer de marché avec une monnaie dont la valeur change d'un jour sur l'autre ; en ce sens, la continuation du tourbillon inflationniste n'a d'autre issue que la paralysie a du marché mondial.
Par ailleurs, dans la mesure ou ce sont les anticipations qui, sont en grande partie responsables de la reprise de 1972-73, on se retrouve maintenant dans une situation:
- où les achats que devaient faire les entreprises pour la période actuelle sont déjà faits,
- où ceux-ci se sont traduits par un renforcement des capacités productives.
Cela signifie que la flambée inflationniste et la mini-reprise de 72-73 ne peuvent que déboucher sur une nouvelle récession à côté de laquelle celle de 1971 apparaîtra comme une aimable plaisanterie.
Plus que jamais, donc, les perspectives sont celles que nous tracions dans notre article précèdent :
- ralentissement massif des échanges internationaux
- guerres commerciales entre les différents pays
- mise en place de mesures protectionnistes et éclatement des unions douanières
- retour à l'autarcie
- chute de la production
- augmentation massive du chômage
- baisse des salaires réels des travailleurs
La crise et les tâches du prolétariat
Cette étude sur la situation économique actuelle ne correspond de notre part, à aucune préoccupation a caractère académique, mais uniquement militant. Les arguments du type : "il est inutile de se préoccuper de la situation économique puisque, de toute façon, nous n'y pouvons rien" ou "ce qui est important, c'est l'action des révolutionnaires" sont le fait d'irresponsables.
L’économie est le squelette de la société, c'est elle la base sur laquelle sont fondes l'ensemble des rapports sociaux. En ce sens, pour les révolutionnaires, connaître la société qu'ils combattent et se proposent de renverser, c'est connaître en premier lieu son économie. C'est à cause de sa place spécifique dans l'économie que le prolétariat est la classe révolution- maire et c'est a partir de conditions économiques précises de crise qu'il est en mesure d’accomplir sa tâche historique . C'est toujours à partir de la connaissance des conditions économiques dans lesquelles se déroule le combat de leur classe que les révolutionnaires ont tenté d'en préciser les objectifs et les perspectives.
En ce sens, les deux sujets traités dans cet article : l'inflation et la crise de surproduction permettent de situer les tâches actuelles du prolétariat.
L'inflation est l'expression de la crise historique du mode de production capitaliste, crise qui remet en cause le fonctionnement des rouages mêmes du système et de l'ensemble de la société. Par suite, son existence même comme maladie chronique de notre époque signifie que ce qui est historiquement, à l'ordre du jour pour le prolétariat ce n'est plus l'aménagement de sa place dans le système mais bien le renversement de celui-ci.
La récession qui s'annonce, quant à elle, dans la mesure où elle plonge le système dans des contradictions accrues et, partant, dans une situation de faiblesse, indique que c'est dans la période présente que ce renversement devient possible.
Dans les années qui viennent, la crise économique contraindra les travailleurs à mener des luttes de plus en plus dures. Face à celles-ci, le capital emploiera toute la panoplie de ses mystifications et, en particulier, tentera d'expliquer que ‘ce sont les anciennes directions qui portent la responsabilité de la crise’, ‘qu'avec une meilleure gestion, la situation pourra s'améliorer’... Déjà les forces de rechange du capital préparent le terrain : en France, la gauche se lance dans de grandes campagnes ‘contre la vie chère’, épaulée en cela par les gauchistes qui n'hésitent pas à écrire: "gouvernement et patrons organisent la vie chère"[16].
Contre ce type de phrases démagogiques, ce que doivent affirmer les révolutionnaires c'est, au contraire, que la bourgeoisie ne contrôle pratiquement plus rien, qu'elle est placée devant une situation contre laquelle elle peut de moins en moins, si ce n'est de tenter de mystifier les travailleurs pour mieux les massacrer ensuite.
Si les révolutionnaires ont une tâche fondamentale aujourd'hui, c'est d'expliquer que la crise actuelle est sans issue, qu'elle ne peut être résolue par aucune réforme du capital et que, par conséquent, il n'existe qu’une seule voie possible : celle de la révolution communiste, de la destruction du capital, de la marchandise et du salariat.
C.G.
[1] Pour une étude plus approfondie, voir ‘La Crise’ dans RI N°6 et 7 ancienne série.
[2] Article du professeur Christian Goux dans ‘Les Informations’, journal patronal
[3] Tels ceux qui considèrent que ‘les révolutionnaires qui n'avaient que trop souvent fondé leurs espoirs sur la perspective -présentée comme pierre de touche du marxisme- d'une catastrophe inévitable de l'économie capitaliste, ne semblaient plus que des esprits chimériques enfermés dans des rêves anachroniques’ (‘Organiser le courant marxiste révolutionnaire’, brochure éditée par les ancêtres de l'actuelle Gauche marxiste’).
[4] Les baisses brutales de Wall Street en Août 71, Juillet 73 et Novembre 73 ne peuvent quand même pas être comparées à la catastrophe qui débute le ‘jeudi noir’ de 1929’
[5] Aujourd'hui, les dollars en circulation dans le monde sont couverts à peine à quelques % par de l'or ou des devises étrangères.
[6] Ce n'est pas nécessairement vrai si la parité de la monnaie A est fixe par rapport aux autres (comme ce fut le cas jusqu'à ces dernières années entre les grandes monnaies) mais, sinon, le maintien d'une monnaie à un taux surévalué conduit à une spéculation effrénée contre elle. Ce qui veut dire que la banque centrale du pays A se vide de toutes ses réserves en devises fortes ou en or et reste uniquement en possession d'un papier qu'elle a elle-même fabriqué, qui ne peut pas acheter grand- chose et dont personne ne veut. Une telle situation ne peut prendre fin qu'avec un contrôle draconien des changes pratiquement impossible à mettre en œuvre ou avec une dévaluation qui a une double fonction : abaisser le prix des marchandises de ce pays sur le marché mondial et décourager les spéculateurs qui désormais vendront leur monnaie à un prix moindre.
[7] ‘La Crise’ R I. N°6 et 7, ancienne série.
[8] L’alignement de Giscard sur les positions américaines lors de la conférence de Tokyo ouvrant le Nixon Round et lors de la réunion du F. M. I. Nairobi, après qu'il a crié sur tous les toits qu'il n'était pas question de se soumettre à ces conditions, est particulièrement significatif à cet égard.
[9] Philippe Simonot, ‘Le Monde’, 13 février 73 p.2.
[10] Cette bourgeoisie est certainement plus lucide que certains ‘marxistes'’ actuels, grands pourfendeurs de ‘piètres lecteurs de Marx’, qui prétendent que ‘la source des difficultés de fonctionnement du capitalisme se situe au niveau de la production et non sur le marché’ (Lutte de Classe, organe du GLA.T, Sept.-Oct. 73). Comme si on pouvait séparer les deux et comme si la production capitaliste n'était pas une production de marchandises ! Marx était certainement un bien ‘piètre lecteur de Marx’ lorsqu'il écrivait : ‘Toutes les contradictions de la production bourgeoise éclatent collectivement dans les crises générales du marché mondial... La surproduction est une conséquence particulière de la loi de la production générale du capital : produire en proportion des forces productives (...) sans tenir compte des limites de marché ni des besoins solvables...’(Marx, La Pléiade T.2 p 496.)
[11] Notons que ces deux interprétations ne sont pas contradictoires et que la plupart des économistes les utilisent simultanément : leur seul défaut est de ne rien expliquer.
[12] Nous verrons ailleurs que cette pénurie elle-même ne se comprend qu'en la replaçant dans le cadre de la surproduction actuelle.
[13] Il est évident que 1'augmentation de 10% accordée aux ouvriers français en mai 1968 est en partie responsable des hausses qui ont suivi.
[14] On se souvient de la guerre sans merci que se sont livrées les compagnies aériennes sur les tarifs des traversées de l'Atlantique Nord, guerre qui suivait une période de paix et qui a abouti à un nouveau statu quo? quand ces compagnies se sont retrouvées au bord de la faillite.
[15] Voir articles sur ‘la décadence du capitalisme’ dans RI N°2,4,5 ancienne série.
[16] ‘Lutte Ouvrière’ N°272.
Questions théoriques:
- L'économie [4]