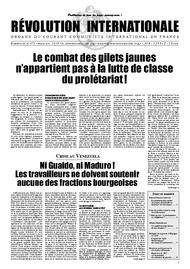Révolution internationale 2019 - n° 474 à 479
- 422 reads
Révolution internationale n° 474 - janvier février 2019
- 151 reads
Le capitalisme mène l’humanité à la mort, le prolétariat a la force de le renverser !
- 148 reads
Pour la quatrième année consécutive, l’espérance de vie aux États-Unis est en baisse. “C’est la première fois que l’on voit une tendance à la baisse depuis la grande épidémie de grippe de 1918”, selon Robert Anderson, chef des statistiques de la mortalité au Centre national des statistiques de santé. En cause, le fléau des overdoses de drogues qui a tué environ 70 000 américains en 2017, signe d’un suicide collectif face à une société sans avenir, mais aussi une pauvreté dévastatrice, une pollution entraînant l’explosion des maladies respiratoires et du système nerveux central, une alimentation industrielle proche de l’empoisonnement de masse, un système de soin en déliquescence… Les États-Unis ne sont pas une exception, une grande partie des pays développés sont concernés. Toutes les études récentes soulignent “une baisse importante de l’espérance de vie dans douze pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)”.
Il s’agit d’un symbole de la dynamique mortifère du capitalisme. Alors que les connaissances scientifiques continuent de se développer, que les moyens techniques et technologiques croissent sans interruption, le capitalisme impose à l’humanité une division du monde en nations et en classes, des rapports sociaux de production basés sur l’exploitation, un enfermement de l’activité humaine dans la recherche du profit et la concurrence de tous contre tous. Ce système est aujourd’hui obsolète. Mais pour perdurer, il fait agoniser toute l’humanité.
En Amérique centrale et du sud, la misère et la violence sont telles que des milliers de personnes fuient, en se regroupant pour se protéger les uns les autres. Solidaires, ils forment des caravanes pour marcher sur des milliers de kilomètres depuis le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica… traversant tout le Mexique vers les États-Unis, affrontant mille dangers. Ceux qui parviennent à la frontière américaine se heurtent à un mur, des barbelés, une armée autorisée à tirer, des miliciens fanatiques et assassins, puis… aux camps de rétention ! (1) En décembre, deux enfants de 7 et 8 ans sont morts de déshydratation au cœur des camps américains, dans les bras de leur père !
“On compte aujourd’hui soixante-dix à soixante-quinze murs construits ou annoncés dans le monde, les murs existants s’étalant sur environ 40 000 kilomètres”, affirme Élisabeth Vallet, une politologue canadienne de l’université du Québec à Montréal. Un monde fait de murs et de barbelés, voilà vers quoi mène cette société en putréfaction.
En France, face au développement de la pauvreté, une partie de la population a réagi pour crier sa colère. Le mouvement des “gilets jaunes” a rassemblé derrière une petite-bourgeoisie écrasée et excédée, quelques centaines de milliers de travailleurs précaires, chômeurs, retraités, mais aussi des artisans et des agriculteurs. Se rassemblant sur les ronds-points, aux péages des autoroutes, sur certains parkings, ils ont monté des tentes, fait des barbecues, etc. Ces derniers jours, entre Noël et le Nouvel An, était palpable, au sein de ces groupes éparpillés par poignées de quelques dizaines d’individus, le besoin d’être ensemble, de se réchauffer, de se serrer les coudes. Il y a là un point commun avec les caravanes de migrants d’Amérique centrale : la nécessité de s’agréger face à un monde en déliquescence. Seulement, sur ces ronds-points, il y avait aussi partout des drapeaux tricolores, des Marseillaises entonnées, des discussions enfermées dans la revendication du “référendum d’initiative citoyenne”, une peur voire un rejet des “migrants”. L’abrogation de la loi du “mariage pour tous”, permettant aux homosexuels de se marier depuis 2013, est même l’une des revendications les plus populaires parmi les “gilets jaunes”. En fait, ce mouvement souligne une nouvelle fois l’impasse de l’interclassisme. (2) Si le prolétariat ne développe pas son combat de façon autonome, avec ses méthodes de lutte (assemblées générales souveraines tout particulièrement), ses propres revendications sur le terrain économique face à la dégradation de ses conditions de vie et de travail et, in fine, sa perspective politique (le renversement du capitalisme et de ses États), toute la colère de la population sera vouée à se perdre dans des protestations au mieux stériles, au pire porteuses des stigmates les plus nauséabonds de cette société (le nationalisme, le racisme, l’homophobie, la violence aveugle…).
Le prolétariat mondial, et plus particulièrement celui d’Europe, porte donc sur ses épaules une lourde responsabilité. Car l’aggravation inexorable de la crise économique mondiale, les soubresauts à venir, (3) vont engendrer toujours plus de misère et de colère.
C’est au prolétariat que revient la tâche historique d’organiser et d’orienter la lutte des masses, c’est au prolétariat de renverser le capitalisme et d’ouvrir à toute l’humanité une autre perspective que celle du capitalisme décadent et barbare : une société sans classe ni nation, sans exploitation ni guerre. Pour cela, le prolétariat doit recouvrer la confiance en ses propres forces. Son histoire prouve qu’il en est capable. Il a déjà fait trembler la bourgeoisie maintes fois. (4) La mémoire de toute cette expérience est absolument vitale pour l’avenir. Car l’avenir appartient bel et bien à la lutte de classe !
Jacques, 4 janvier 2019
1) Lire dans ce journal notre article : “Migrations en Amérique Latine : Seul le prolétariat peut arrêter la barbarie du capitalisme en décomposition” [2]
2) Lire dans ce journal notre article sur le mouvement des “gilets jaunes” [3] ainsi que notre supplément [4] disponible sur le site Internet du CCI.
3) Lire dans ce journal notre article sur la crise économique [5].
4) Lire dans ce journal notre article sur l’héritage de Lénine, Luxemburg et Liebknecht [6].
Derrière les lobbies, la main bien visible du capitalisme d’État
- 277 reads
Pas une semaine sans que les médias ne nous rapportent un scandale financier, industriel ou social, causé selon eux par l’influence des lobbies ; que l’on nous parle de Monsanto et de son glyphosate, de la réforme du copyright dans l’Union européenne (UE) sous la pression des GAFAM, (1) des implants médicaux prescrits sans normes ni contrôles, le problème posé est toujours le même : les États et les instances étatiques comme l’UE sont à la merci des lobbies, de puissants intérêts privés qui exercent une pression sur les démocraties. Non-élus, ne représentant qu’eux-mêmes, ces lobbies seraient donc “un problème de démocratie : qui a le pouvoir, qui gouverne ?”, comme le demandait hypocritement Nicolas Hulot.
Lobbies et État, une identité commune
Les lobbies ne sont pourtant qu’un signe extérieur de la concurrence généralisée qui est le principal moteur de la société capitaliste : “Là où la bourgeoisie est chez elle, la seule loi qui préside aux rapports économiques est celle de la libre concurrence”. (2) Cette dernière est l’élément qui a toujours fait du capitalisme un système social particulièrement dynamique. L’existence de différents groupes de pression, représentant des secteurs économiques ou directement des grandes entreprises, cherchant à influer sur des décisions qui représentent potentiellement d’énormes profits et la garantie d’exploiter des marchés lucratifs n’a rien de surprenant. Si, pour de ridicules considérations morales ou par incapacité, certains refusaient de se plier à cette règle, cela signifierait “pour le capitaliste individuel, (…) l’élimination de la lutte pour la concurrence, la mort économique”. (3) À tous les étages de la société capitaliste le lobbying est donc la règle, y compris au niveau des États.
Il est à ce titre tout à fait mensonger de présenter les États comme des entités neutres, qui seraient en fait harcelées par des lobbies défendant uniquement des intérêts particuliers. Présents à tous les niveaux de la sphère politique, les lobbies font partie de la défense de chaque Capital national, dont l’État est le garant. De fait, chaque État défend bec et ongles les principaux “champions” de son économie nationale. Lorsque Macron est allé en Inde au printemps dernier, c’est évidemment en y emmenant plusieurs chefs d’entreprise dont l’État défend les intérêts sur place. Selon Paris Match du 15 mars 2018 : “Tout au long de ces trois jours, le président français a multiplié les gestes et les déclarations d’amitié envers l’Inde. Son ambition ? Faire de la France la “porte d’entrée” du géant de l’Asie du Sud en Europe. Dans ce but, Emmanuel Macron compte bien profiter du Brexit pour chiper aux Anglais leur position historique de “partenaire privilégié”. La partie est loin d’être gagnée : pour l’instant, l’Hexagone est seulement le 18e client des Indiens, loin derrière les Allemands, les Britanniques et même les Belges. Qu’importe ! Emmanuel Macron y croit : “C’est le moment de la France.” Alors le chef de l’État a fait le forcing et abattu ses cartes. Lundi, avec Narendra Modi, il a inauguré à Mirzapur la plus grande centrale solaire d’Inde, construite par Engie”. Si Macron n’a pas réussi le même coup que Hollande en 2016, à savoir vendre 36 avions de combat Rafale à l’Inde, les sociétés Safran et General Electrics ont quand même, à l’occasion de cette visite d’État, conclu avec ce pays un contrat de vente de moteurs d’avion de 12 milliards de dollars. Cette visite du chef de l’État français ressemble donc furieusement à l’activité de n’importe quel lobby privé. Lorsqu’on voit de quelle façon chaque État est capable de défendre ses intérêts et ceux de ses entreprises nationales, on sait qu’à l’échelle du commerce international les lobbyistes les plus puissants et efficaces sont bien les États nationaux eux-mêmes.
Le lobby, outil du capitalisme d’État
Contrairement à l’idéologie bourgeoise présentant l’État comme un acteur neutre de la société, “au-dessus” des classes sociales, il demeure en réalité le principal administrateur du Capital national. Que ce soit par ses participations directes dans des entreprises importantes, son encadrement législatif, sa capacité à infléchir la politique financière, sa gestion de la main-d’œuvre à travers le niveau des salaires et des prestations sociales, sa capacité à contraindre les capitalistes individuels à accepter ses décisions prises dans le sens de la défense des intérêts nationaux, l’État demeure le principal administrateur de l’économie nationale.
Ce que les marxistes appellent le capitalisme d’État implique que la défense des intérêts nationaux passe aux mains de l’État. Avec l’entrée du système capitaliste dans sa phase de déclin historique, depuis la Première Guerre mondiale, cette tendance universelle s’est nettement renforcée. Non seulement l’État occupe “une place prépondérante au sein de l’économie nationale, en tant que principal client et employeur de celle-ci, mais il détient entre ses mains un ensemble de prérogatives qui lui en permettent le contrôle absolu : il est le principal pourvoyeur de crédit et c’est lui qui fixe le coût de tous les emprunts ; il édicte les règles de la concurrence entre les différents agents économiques au sein du pays et lui seul est en mesure de négocier de telles règles vis-à-vis des autres pays ; il est le vecteur obligé de l’obtention de gros contrats à l’export ; il détient les moyens de faire ou défaire des montages et rachats industriels et financiers ; il décide des nationalisations ou privatisations ; il fixe les impôts, gère le budget et édicte le code du travail, instrument au service du capital pour organiser l’exploitation et dont dépend la compétitivité du capital national”. (4) De fait, l’État gère les intérêts généraux du Capital national et épouse totalement ceux des fractions les plus fiables de la bourgeoisie. C’est donc lui qui établit le cadre dans lequel les lobbies agissent et dont ils ne sauraient s’affranchir.
Cette tendance totalitaire des États modernes est générale ; plus l’économie nationale connaît de difficultés, plus l’État capitaliste doit s’impliquer dans sa défense et sa gestion. Engels, au XIXe siècle, définissait l’État comme “le capitaliste collectif en idée”, (5) ce qui résume très clairement ce qu’il est en effet aujourd’hui. Que l’État soit un lobbyiste particulièrement puissant n’a donc rien d’étonnant : lui aussi, pour défendre ses intérêts et ceux de l’économie nationale, doit agir en coulisses et défendre ses intérêts de façon inavouable. Les multinationales ne sont absolument pas indépendantes des États qui les défendent, elles agissent aussi pour le compte du Capital national : quand Boeing ou Airbus rivalisent pour un marché, ils ont chacun leur État pour les soutenir. Toutes les ventes d’armes, de matériels dits “sensibles” parce que technologiquement évolués, tous les appels d’offres internationaux fonctionnent ainsi ; lorsque les industries anglaises de l’armement se trouvent prises en flagrant délit de ventes d’armes à l’Arabie Saoudite, alors que ces armes servent en ce moment même à assassiner des civils dans la sale guerre du Yémen, il se trouve évidemment un tribunal britannique pour expliquer que ce massacre n’étant pas “une stratégie délibérée (…), la vente d’armes britanniques à l’Arabie Saoudite est donc légale et peut continuer”. (6) Macron a lui aussi refusé d’arrêter les ventes d’armes françaises à l’Arabie, pour lesquelles la France est en concurrence non seulement avec Londres, mais aussi avec Berlin.
Ce sont bien les États qui décident des transactions les plus importantes entre nations, depuis les ventes d’armes jusqu’à l’attribution des jeux olympiques ou de la Coupe du monde de football !
Lobbies contre démocratie, un mensonge contre la conscience de classe !
La question n’est cependant pas qu’économique, car si la bourgeoisie accepte très bien de fonctionner en groupes concurrents, ce n’est pas le cas de la classe ouvrière, et sur ce point, comme sur d’autres, la bourgeoisie utilise ses propres turpitudes pour brouiller la conscience de la classe ouvrière ; “la bourgeoisie essaie de nous rejouer le même air qu’au début des années 1990 où, en pleine récession, elle rejetait la responsabilité de celle-ci sur les fractions libérales jusque-là au pouvoir dans les plus grands pays industrialisés. Elle doit absolument trouver des thèmes de mystification présentant aux exploités une prétendue alternative, au sein du système, afin de limiter les possibilités de remise en question de celui-ci. Ainsi, afin d’éviter que l’aggravation de la crise et des attaques ne favorisent au sein de la classe ouvrière une remise en cause en profondeur du système, les fractions de gauche et d’extrême gauche de la bourgeoisie cherchent à intoxiquer la conscience des prolétaires en proclamant que des solutions sont possibles en redonnant notamment à l’État un rôle plus central que le libéralisme lui aurait prétendument confisqué. Or, c’est justement l’État lui-même, qu’il soit géré par des partis de droite ou de gauche, qui orchestre les attaques les plus massives depuis la fin des années soixante. C’est dans le but de masquer cette réalité qu’on tente aujourd’hui de raviver l’illusion que plus d’État, c’est, malgré tout, plus de justice et de social”. (7)
En se faisant passer pour une entité politiquement neutre dans la société, garante de la stabilité politique et du respect impartial des règles et des lois qui régissent l’ordre social, l’État cherche donc à se défausser de ses décisions les plus impopulaires auprès de la classe ouvrière. Pour cela les lobbies sont un bouc-émissaire rêvé : agissant dans l’ombre auprès des “représentants du peuple” élus démocratiquement, utilisant toutes les ressources de la persuasion, de la corruption et de la menace pour parvenir à leurs fins, les lobbies représentent en apparence une antithèse de l’ordre démocratique sous lequel la bourgeoisie nous présente son ordre social, ouvert, transparent et fruit de la “volonté populaire”. La classe dominante ne cesse de nous faire croire que l’État serait sous la coupe des lobbies, lesquels pourraient représenter une “menace pour l’ordre démocratique tout entier”. C’est le sens de la publicité constante que leur fait l’État à travers ses médias (d’Élise Lucet, avec son émission “Cash Investigation”, au journal satirique Le Canard enchaîné) : il faudrait aider nos élus à défendre la démocratie contre les lobbies ! De fait, il s’agit de pousser les “citoyens consommateurs” à défendre la démocratie, donc l’État bourgeois, face aux lobbies “anti-démocratiques”, de soutenir les élus du peuple contre les groupes de pression défendant des intérêts privés.
C’est d’ailleurs tout le sens du soutien des médias aux ONG, considérées comme de “bons” lobbies, face aux intérêts commerciaux et d’entreprises, qui seraient les “méchants”. ATTAC, par la plume de l’économiste Maxime Combes, nous en donne un exemple : “Dénoncer leurs poids [des lobbies] revient à dire que notre processus démocratique est pollué par des agents pathogènes qu’il faudrait a minima encadrer et contrôler pour éviter les abus”. (8)
Mais quand un acteur quelconque dénonce un scandale (par exemple celui, connu de longue date, d’importation dans l’UE de faux miel chinois), (9) c’est régulièrement l’État lui-même qui l’étouffe ou empêche qu’on y mette fin, tout simplement parce que l’État défend… le Capital national et pas les intérêts des consommateurs, qui sont majoritairement des ouvriers : “Donc l’industrie fait du lobby, paie des experts, et, au final, des lois sont faites sur mesure pour l’industrie. C’est un système de corruption organisé, qui est accepté par les politiques, voire encouragé, parce qu’il y a beaucoup de retombées financières”. (10)
Les lobbies sont les enfants naturels du capitalisme et de la concurrence
L’idée que les lobbies seraient une anomalie, un “agent pathogène” pour reprendre l’expression de M. Combes, est absolument mensongère : produit de la concurrence, les lobbies sont un élément parfaitement normal du capitalisme et de son fonctionnement. Ils existent d’ailleurs depuis que le capitalisme est devenu dominant, il suffit de se souvenir de l’affaire Raffalovitch (11) autour des emprunts russes, des chèques du Canal de Panama ou du “lobby colonial” de l’Assemblée nationale pour s’en convaincre.
Lorsque la bourgeoisie incrimine les pressions de groupes privés sur la direction des affaires politiques et économiques, notamment le sacrifice des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière dont les lobbies feraient peu de cas, il s’agit de dédouaner l’État, mais aussi le capitalisme tout entier, de leur responsabilité dans la politique anti-ouvrière qui est menée dans tous les pays.
Cette responsabilité est totale : il est tout aussi impossible d’éradiquer les lobbies qui sont un produit du fonctionnement du capitalisme que de faire disparaître la concurrence du système capitaliste. Les lobbies, comme les “patrons-voyous” ou les politiciens corrompus, ne sont rien d’autre que le produit de la concurrence capitaliste. Du reste, les politiciens admettent sans trop de difficultés que les lobbies ont leur utilité : “Il ne faut pas non plus fantasmer sur des lobbies. Je considère qu’il est normal qu’il y ait des groupes de pression qui fassent entendre les intérêts privés (…), après, c’est le Parlement qui tranche en toute transparence”. (12)
Aussi, quand les directeurs de Greenpeace en France et en Allemagne nous expliquent dans l’article : “La France et l’Allemagne doivent montrer l’exemple et se libérer de l’emprise du lobby des multinationales” (13) que “c’est bien de cela dont il s’agit, créer une nouvelle Union européenne soucieuse avant tout de l’intérêt général des populations, plus solidaire envers toutes et tous et respectueuse de l’environnement. Une Europe plus accueillante et juste, moins au service des multinationales et du monde de la finance”, c’est pour nous faire oublier que les multinationales autant que les États sont d’abord et avant tout au service du capitalisme et qu’ils en observent les règles. Ce ne sont pas les multinationales qui créent l’exploitation ni même les États, mais ce sont eux qui en vivent.
Loin d’être une anomalie dans le capitalisme décadent, les lobbies en dévoilent au contraire et de la façon la plus crue tout le fonctionnement : engagés dans une compétition à mort du fait d’un marché mondial saturé, les États soutiennent des groupes d’influence qui leur sont favorables, ce qui leur permet aussi de masquer qu’ils sont les donneurs d’ordre et les principaux acteurs du lobbyisme.
Ce ne sont donc pas tels ou tels bourgeois qui détourneraient la démocratie à leurs propres fins en défendant leurs intérêts à travers les lobbies, c’est le système capitaliste comme un tout et la concurrence qu’il génère qui fabriquent les lobbies. Cela se retrouve à tous les niveaux des relations internationales et même au sein d’un État national où les bourgeois se livrent une concurrence féroce.
En définitive, les lobbies ne sont pas un phénomène dont on peut se débarrasser sans détruire le capitalisme ; il revient à la seule classe qui ne vit pas de la concurrence, mais qui la subit tous les jours et a donc intérêt à la détruire, d’en finir avec le capitalisme décadent qui ne génère que la misère, la destruction et la corruption.
Sven, 2 janvier 2019
1) Acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les principales entreprises de taille mondiale, toutes américaines, développant leur activité à travers Internet.
2) Rosa Luxemburg, “Introduction à l’économie politique” (1907).
3) Rosa Luxemburg, “L’accumulation du capital” (1913).
4) “L’État, dernier rempart du capitalisme” [7], Révolution Internationale n° 339 (octobre 2003).
5) Friedrich Engels, “Anti-Dühring” (1878).
6) The Guardian, repris par le Courrier International (11 juillet 2017).
7) “L’État, dernier rempart du capitalisme” [7], Révolution internationale n° 339 (octobre 2003).
8) “Faire en sorte que les lobbies ne gagnent pas toujours à la fin”, Le Monde (30 mai 2018).
9) “Les grands industriels fabriquent des produits pollués, nocifs et le cachent”, Le Monde (2 janvier 2019).
10) Idem.
11) Arthur Raffalovitch est un économiste et diplomate russe qui a soudoyé des journalistes et des directeurs de médias français afin qu’ils publient des articles favorables au placement en France d’emprunts russes entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.
12) “Glyphosate : Stéphane Travert dément tout lien avec les lobbies après la fuite d’un amendement”, Le Monde (25 mai 2018). Travert est ancien Ministre de l’Agriculture et actuel député français.
13) Le Monde (13 juillet 2017).
Rubrique:
Anniversaire de Mickey: une souris exploitée depuis 90 ans par le capitalisme
- 390 reads
 Icône du cinéma et de la bande dessinée, Mickey, la petite souris créée par Walt Disney en 1928, fête ses 90 ans. C’est pendant la Grande Dépression que le personnage devient populaire aux États-Unis et dans le monde entier. Alors que la crise économique et le chômage de masse frappent la planète, Mickey, avec son optimisme à toute épreuve et ses traits attachants, divertit l’Amérique.
Icône du cinéma et de la bande dessinée, Mickey, la petite souris créée par Walt Disney en 1928, fête ses 90 ans. C’est pendant la Grande Dépression que le personnage devient populaire aux États-Unis et dans le monde entier. Alors que la crise économique et le chômage de masse frappent la planète, Mickey, avec son optimisme à toute épreuve et ses traits attachants, divertit l’Amérique.
Dès son plus jeune âge, Mickey est exploité par l’industrie cinématographique : il n’a que 2 ans lorsque Walt Disney l’envoie sur les routes comme représentant commercial, contraint de vendre toute sorte de jouets, de livres, de tasses... Car la souris doit aussi son succès à la création du Mickey Mouse Club où se côtoient événements commerciaux et scoutisme. En 1932, plus d’un million d’enfants reçoivent leur carte de membres leur permettant d’obtenir “réductions” et “avantages” pour l’achat de produits dérivés.
Dès 1929, Disney cherche à faire de Mickey un soldat. Dans The Barnyard Battle, la souris interprète une jeune recrue de la guerre entre les souris et les chats coiffés d’un casque à pointe allemand. Heureusement, contrairement à d’autres personnages du studio, Mickey, trop gentil, ne s’engage pas dans la Seconde Guerre mondiale. Walt Disney lui préfère d’autres personnages plus brutaux pour ses films de propagande, notamment Donald Duck (qu’il ne faut pas confondre avec un autre Donald, bien que la ressemblance est frappante). Donald reçoit son avis d’incorporation en 1942 dans Donald Gets Drafted et devient soldat dans pas moins de neuf films ! La production des Mickey est stoppée la même année ; la petite souris est au chômage. C’est Minnie, sa fiancée, qui rapporte de quoi manger à la maison. Walt Disney l’oblige, en effet, à contribuer à l’effort de guerre dans Out of the Frying Pan Into the Firing Line, un film de propagande dans lequel elle apprend aux enfants à faire des munitions pour le front à partir d’huile de friture.
Après la Guerre, Mickey retrouve son emploi de VRP et devient, avec d’autres marques emblématiques, un symbole de la puissance économique et culturelle des États-Unis. Emblème de la Walt Disney Company, il est si efficace que le petit studio se métamorphose en colosse international du divertissement assis sur un chiffre d’affaires annuel de près de 60 milliards ! Dessins animés, films, livres, bandes dessinées, parcs d’attraction, vêtements, dentifrices... Mickey est partout, omniprésent jusque dans l’éducation des enfants.
Naturellement, les enfants, bercés dès le plus jeune âge par la souris aux grandes oreilles, rêvent tous de partager un peu de la féerie de l’univers de Mickey. Quoi de mieux alors que de visiter son “royaume enchanté”, celui de Disneyland, particulièrement pendant cette période de fêtes de fin d’année où le parc d’attraction se revêt d’un manteau blanc et chatoyant ? D’après le slogan, Disneyland est l’endroit “où la magie prend vie”... la magie du capitalisme surtout ! La direction du parc n’hésite pas à déguiser ses employés, embauchés avec des contrats ultra-précaires, en les faisant passer pour Mickey et ses amis. Derrière le déguisement, de vrais danseurs de 25 ou 30 ans, ayant rêvé de monter sur les planches, se retrouvent, contre un SMIC, sur le trottoir pour la parade.
La pauvre souris est, par ailleurs, mise à contribution pour soutirer le maximum de fric aux visiteurs. Entre le billet d’entrée, la nuit d’hôtel, les repas (il est interdit d’apporter sa nourriture et ses boissons) et les boutiques de souvenirs, la plupart des familles ouvrières sont contraintes d’économiser une année entière pour arpenter le “royaume enchanté” du Capital où tout est prétexte à amasser de l’argent. Quant aux enfants des familles les plus pauvres, la “magie de Noël” restera bien sûr inaccessible, à moins que “papy” et “mamie” profitent de la diminution de la CSG sur leur pension de retraite pour leur offrir un ticket.
Mickey, lui, malgré ses 90 ans, n’a pas encore droit à la retraite. Il paraît qu’avec sa période de chômage de longue durée dans les années 1940, il n’a pas encore suffisamment cotisé.
DL, 23 décembre 2018
Rubrique:
À propos des prochaines élections en Israël: une voix de classe au Moyen-Orient
- 79 reads
Fin décembre 2018, le romancier israélien, Amos Oz, décédait à l’âge de 79 ans. En plus d’être un écrivain reconnu de romans relatant l’histoire troublée du nouvel État israélien, il était également un critique acerbe de la montée de sa politique militariste. En 1967, au milieu de l’euphorie qui a fait suite à la Guerre des Six Jours, Oz fut l’un des rares à avoir mis en garde contre l’influence de la corruption morale qu’entraînerait sur la société israélienne l’occupation de territoires en Palestine. Il a plaidé pour la fin immédiate de l’occupation et la création d’un État palestinien aux côtés d’Israël. Ce point de vue a pu sembler radical pour la bourgeoisie de l’époque, mais il a été rapidement intégré dans l’opinion publique et a été au cœur des Accords de Camp David en 2000.
À l’ère du populisme débridé, cependant, même cette proposition qui apparait désormais “modérée” au yeux de la bourgeoisie semble totalement “utopique”. L’aile droite du gouvernement Netanyahou, qui a tout mis en œuvre pour empêcher tout pourparlers en vue de la formation d’un État palestinien, fait face à une pression croissante des personnes les plus à droite qui revendiquent ouvertement un “Grand Israël” (une solution à un État, qui entraînerait certainement la déportation en masse de la population palestinienne arabe). Cependant, le mouvement nationaliste palestinien est de plus en plus dominé par des factions islamistes qui ne veulent rien de moins que la destruction militaire de l’État sioniste, une solution qui entraînerait immanquablement la déportation massive d’une autre population : celle des Juifs israéliens.
Dans cette atmosphère de plus en plus toxique, nous ne pouvons que nous réjouir de la parution d’un article qui est l’une des rares expressions d’un point de vue véritablement internationaliste dans une zone du monde où le poids du nationalisme est extrêmement lourd. L’auteur de l’article épouse la position marxiste selon laquelle tous les conflits nationaux et les campagnes idéologiques, à l’époque du capitalisme en déclin, sont devenus réactionnaires, et n’hésite pas à soutenir que la seule façon de sortir du piège créé par l’impérialisme en Israël-Palestine est l’unification des ouvriers palestiniens et israéliens sur une base de classe, conduisant à une révolution prolétarienne contre tous les États bourgeois. Le camarade appelle à juste titre à la formation d’un Parti révolutionnaire qui défendrait cette perspective. Nous défendons que cela sera possible seulement dans le cadre d’un développement international de la lutte, dans lequel la classe ouvrière, surtout dans les principaux centres du capitalisme mondial, sera capable de se réapproprier son projet historique : l’instauration de la société communiste. De la même manière, il est plus que probable que toute unité durable entre les ouvriers israéliens et palestiniens ne sera possible que dans le contexte d’une reprise de la lutte de classe à l’échelle internationale, dans un mouvement qui sera capable de repousser les vagues de nationalisme et de xénophobie. Ces dernières années, ces vagues ont connu une montée en puissance, et particulièrement en Israël-Palestine, du fait de l’histoire particulière de cette région.
Cependant, l’apparition d’une minorité, même infime, proposant une alternative prolétarienne au Moyen-Orient constitue un lien extrêmement important pour l’avenir révolutionnaire, qui est toujours possible et plus que jamais nécessaire.
CCI
Les prochaines élections législatives en Israël, qui auront lieu en avril 2019, seront marquées par l’instabilité de l’État sioniste. La décision du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, d’appeler à des élections anticipées montre l’impasse dans laquelle se trouve le gouvernement de Tel Aviv. Outre la décision attendue du procureur général israélien d’inculper Netanyahou pour corruption et fraude, le régime sioniste est aussi confronté à une terrible crise économique et politique.
Au niveau économique, la classe ouvrière subit une grave détérioration de ses conditions de vie et de sa capacité à supporter le coût de décennies d’occupation militaire. Le système de santé et d’éducation est sous-financé, le coût des produits de première nécessité et des services augmente sans arrêt et de nombreuses catégories parmi les travailleurs pauvres du pays sont incapables de faire face à leur situation économique précaire. De plus, 20 % des israéliens vivent dans la pauvreté et cette société est l’une des plus inégalitaires en Occident.
Sur le plan politique, Israël est mis au défi par les factions palestiniennes armées en Cisjordanie et à Gaza, qui résistent aux forces d’occupation israéliennes. La frontière sud est instable, suite aux incursions continuelles des militants islamiques du Hamas qui tentent de faire progresser la résistance armée près de la barrière de séparation ; les militants islamiques lancent des missiles contre la population israélienne dans le sud et creusent des tunnels afin d’attaquer l’armée. Sur la frontière nord, Israël mène des attaques contre les bases iraniennes des “Gardiens de la Révolution” en Syrie. De plus, une nouvelle guerre entre les forces israéliennes et le Hezbollah est plus que jamais imminente. Soutenu par l’administration américaine, Israël mène une politique agressive sur ses frontières pour faire tomber les islamistes à Gaza (l’enclave fait face à une situation humanitaire terrible, suite au blocus israélien) et chasse les miliciens iraniens hors de Syrie (de peur que ceux-ci n’aident le Hezbollah lors d’une future guerre).
La situation du régime israélien témoigne de son instabilité et de la crise en cours. En tant qu’État ségrégationniste, Israël cherche à maintenir les conditions dans lesquelles la classe ouvrière continuera à payer le prix pour l’occupation et l’agressivité militaire du pays, tout en acceptant la gestion capitaliste de l’économie par le gouvernement. La classe dominante israélienne, qui combat le mouvement nationaliste Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), est aidée pour cela par les populistes de droite et les dirigeants fascistes de l’étranger ; elle opprime les masses afin de préserver le projet de colonisation sioniste. Il y a beaucoup de travailleurs et de jeunes israéliens qui ne veulent pas accepter plus longtemps les conditions israéliennes d’oppression nationale et la cruelle exploitation capitaliste. Quelques-uns sont déjà mobilisés dans les partis d’opposition israéliens au gouvernement, même si ces partis sont au service des élites israéliennes.
L’absence d’alternative politique
Le système politique israélien est fragmenté et fragile. Les partis politiques de droite sont traditionnellement organisés autour du Likoud, dirigé par le Premier ministre, Netanyahou. Cependant, même au sein des partis de droite qui dirigent le pays, il y a des scissions et des crises. Alors que la plus importante faction politique à la Knesset est le Likoud, une formation ultra chauvine et néo-libérale qui s’est créée en 1973, il existe d’autres partis, plus petits que le Likoud, dont la politique est encore plus nationaliste et chauvine. Ces partis poursuivent des politiques dont le but est la constitution du “Grand Israël”, duquel les palestiniens seront chassés. La seule faction politique “centriste” qui ait rejoint la coalition de Netanyahou a été formée par d’anciens membres du Likoud. Cependant, cette faction a collaboré avec Netanyahou et la droite politique en poussant l’économie du pays dans un capitalisme extrême.
Les partis qui constituent l’opposition à Netanyahou ne sont pas homogènes en termes de politique et d’idéologie. Parmi eux, on trouve le Parti travailliste, auquel la plupart des israéliens ne font pas confiance, à cause de sa politique opportuniste et social-chauvine ; on trouve aussi le petit parti social-démocrate et sioniste Meretz, dont la base électorale politique est étroite. Les Palestiniens d’Israël sont représentés sur une liste commune de partis politiques nationaux dans laquelle le Parti Communiste stalinien joue un rôle central. Le problème de ce bloc de centre-gauchisant n’est pas juste son hétérogénéité sur le plan politique, mais réside dans le fait qu’aucun d’eux ne propose de perspective à la classe ouvrière israélienne ou palestinienne. Ni les factions pseudo-gauchistes sionistes, ni les partis arabes et communistes antisionistes ne proposent un moyen pour sortir des décennies d’occupation, de capitalisme brutal et de crise sociale permanente.
Cette situation est regrettable, mais compréhensible, dans la mesure où Israël, en tant qu’État conquérant, continue à coloniser les masses palestiniennes. Le problème de l’occupation israélienne joue un rôle central dans la politique du pays. Alors que la droite politique souhaite intensifier l’occupation et la colonisation, la pseudo-gauche politique met en avant la solution à deux États mort-nés dans laquelle une sorte de Bantoustan palestinien serait établi le long d’Israël. Alors qu’il existe un fort désir au sein des masses, de voir la fin de ce conflit sanglant, la droite prospère et répand son chauvinisme radical et son nationalisme empoisonné afin de diviser la classe ouvrière selon les frontières nationales. La pseudo-gauche ne suggère rien d’autre qu’une solution basée sur l’ordre impérialiste dans lequel le système capitaliste continuera à opprimer les masses et à les exploiter. En l’absence d’alternative à plus de cent ans de conflit sanglant, le nationalisme s’épanouit et le chauvinisme continue d’empêcher tout changement vers une réelle réconci liation entre les travailleurs israéliens et leurs homologues palestiniens.
La solution à un État
La nouvelle tendance au sein de quelques cercles gauchistes est l’idée d’un État bi-national Israël/Palestine, État qui attribuerait l’ “auto-détermination” aux deux nations. Cette idée est en train de devenir populaire dans le milieu radical, car elle exprime son désespoir quant à la possibilité de construire deux États-nations indépendants en Palestine. Cependant, le slogan de l’ “auto-détermination” n’est pas satisfaisant : à l’époque de l’impérialisme et de la décadence du capitalisme, la revendication de l’auto-détermination implique l’établissement d’un régime bourgeois. Du point de vue de la classe ouvrière, l’idée de construire un État bourgeois est une impasse en termes de lutte de classe. Outre le fait qu’appeler à l’ “auto-détermination” à l’intérieur du capitalisme constitue une illusion risquée pour l’ordre bourgeois, il en résulte aussi une situation dans laquelle la classe ouvrière n’est pas différenciée de la bourgeoisie nationale. Dans cette situation, il y a un clivage dans la classe ouvrière, selon les frontières nationales. Les révolutionnaires, dans les pays où le prolétariat existe et est capable d’une action révolutionnaire, ne peuvent pas se satisfaire d’un appel à l’ “auto-détermination”.
De plus, défendre le “droit à l’auto-détermination” revient à proclamer que ce seul droit est opposé aux intérêts de la bourgeoisie nationale. Cette position contredit la réalité en Palestine, dans la mesure où les bourgeoisies ne peuvent bénéficier que d’une situation d’économie capitaliste unifiée dans un État. L’intérêt des prolétariats palestinien et israélien est de s’unifier selon une frontière de classe ; le nationalisme et l’appel réactionnaire à l’ “auto-détermination” constituent une arme dans les mains de la bourgeoisie nationale qui aspire à empêcher la classe ouvrière de réaliser le socialisme. À cela, il faut ajouter le fait que, à l’époque de l’impérialisme, la lutte pour l’indépendance nationale ne peut pas aboutir, dans la mesure où le capitalisme essaie de détruire les États-nations ainsi que leurs économies et de construire un marché mondial à travers le processus de colonisation. La démarche radicale consistant à vouloir retourner à une période où il était possible de construire des États-nations véritablement indépendants est utopique, voire réactionnaire.
Ainsi, l’appel à l’établissement d’un État palestinien au sein de l’ordre capitaliste est en fait un appel pour que la bourgeoisie construise un autre pays capitaliste dans lequel la classe ouvrière sera opprimée et incapable de défendre ses droits contre la classe dirigeante capitaliste. Il existe cependant une infime minorité, essentiellement des groupes trotskistes, qui appellent à la création d’un État socialiste en Palestine, un État-nation aux caractéristiques socialistes, fondé sur le droit des peuples “opprimés” à l’ “auto-détermination”, à savoir les palestiniens. Cette distinction entre “opprimés” et “oppresseurs” contredit le projet révolutionnaire qui vise à renforcer le pouvoir de la classe ouvrière. Cela brouille les différences de classe entre le prolétariat et la bourgeoisie. L’unité des masses ne sera réalisée que sur la base de la révolution prolétarienne.
Quelle voie suivre ?
Il y a des appels parmi les gauchistes de telle ou telle chapelle à voter pour tel ou tel parti (les libéraux, les réformistes, les staliniens ou les trotskistes) afin d’empêcher la démocratie bourgeoise israélienne d’être écrasée par le fascisme. Cependant, cet appel reflète la croyance selon laquelle, à l’époque de l’impérialisme, la démocratie bourgeoise serait un véritable régime démocratique et non une pure illusion. Les masses souhaitent voir une démocratie et les fascistes veulent détruire les vestiges de la démocratie bourgeoise. Cependant, l’idée que le fascisme ne triomphera pas si les partis démocrates-libéraux bourgeois gagnent les élections législatives n’est pas seulement une illusion : c’est aussi une stratégie politique afin de réduire le pouvoir de la classe ouvrière en tant qu’agent révolutionnaire. Le fascisme doit être vaincu par les masses par une action révolutionnaire directe et indépendante, et non par ceux qui soutiennent le capitalisme ou le défendent.
Les partis de “gauche” actuels sur l’échiquier israélien ne sont pas différents des autres partis en Europe ou aux États-Unis, dans la mesure où ils défendent l’ordre capitaliste et diffusent des illusions concernant la possibilité de résoudre la question nationale au sein de l’ordre capitaliste. Ils défendent un ordre en décomposition, un ordre qui est en train d’agoniser. Ces partis ne peuvent pas rassembler les masses autour d’eux, car le prolétariat les méprise et ne fait pas confiance à leurs dirigeants et à leur programme. Le prolétariat a besoin de son propre Parti révolutionnaire, qui mettra en avant le programme communiste ; cependant, le jeu suggéré par certains réformistes et staliniens, à savoir la participation au parlement bourgeois et ainsi attendre que la révolution surgisse de nulle part, est faux et trompeur. La mystification de la démocratie bourgeoise découle d’une fausse analyse faite par ceux qui croient fermement dans des notions telles que la “citoyenneté”. En fait, dans une société de classes, la seule vraie démocratie, c’est-à-dire la loi du prolétariat, ne sera réalisée que par la révolution prolétarienne. Cette affirmation ne préjuge pas de la proximité (ou pas) de la révolution. Cependant les illusions dans le fait de travailler dans le parlement bourgeois ne permettront pas aux ouvriers de s’émanciper.
Le but de cette analyse n’est pas d’appeler les ouvriers en Israël/Palestine à gâcher leurs votes (1) mais plutôt à s’organiser en un Parti révolutionnaire unifié, basé sur un programme communiste. Le seul moyen de se débarrasser du capitalisme, du nationalisme et des guerres passe par la révolution. Les ouvriers n’ont pas de patrie et doivent donc s’unir pour construire une société communiste.”
DS, décembre 2018
1) Il s’agit ici d’une allusion au fait de vouloir rendre le bulletin de vote nul. Par exemple, en écrivant quelque chose dessus pour l’invalider (NdT).
Géographique:
- Israel [8]
Rubrique:
La “Transition écologique”, un alibi pour attaquer les ouvriers en continuant de détruire la planète
- 89 reads
La mesure phare de la “transition écologique” du gouvernement Macron, qui prévoyait l’augmentation des taxes sur le diesel, prétendument pour lutter contre la pollution aux particules fines, a déclenché un vent de colère dans toute la population. Avec cette énième attaque, la population a vu “jaune” et a exprimé son ras-le-bol de la précarité et de la pauvreté croissante en bloquant les ronds-points et les péages. Face à cela, quelle fut la première réponse de Macron ? Rien de moins que la culpabilisation cynique : “Les mêmes qui râlent sur la hausse du carburant, réclament aussi qu’on lutte contre la pollution de l’air parce que leurs enfants souffrent de maladies” ; “Vouloir traiter l’urgence sociale en renonçant à l’ambition écologique, c’est maintenir les Français dans une mauvaise situation”. Autrement dit, si les petites-gens préfèrent “regarder leur nombril” et leurs “fins de mois”, le gouvernement, lui, s’occupe avec son “grand cœur” de l’avenir de la planète et de l’humanité. Quelle ignoble hypocrisie !
La vérité, c’est que le capitalisme, les ravages du profit et le pillage industriel génèrent les catastrophes et la destruction de la planète. C’est ce système économique barbare qui fait que sept millions de personnes meurent tous les ans à cause de la pollution de l’air, notamment les particules fines (selon une étude de l’OMS publiée en 2018). Les émissions de CO2 contribuent au réchauffement climatique et entraîneront dans leur sillage une montée des eaux d’un mètre d’ici 100 ou 200 ans selon la NASA, des inondations de terres habitées ou agricoles (comme au Bangladesh ou au Pays-Bas), des phénomènes climatiques dévastateurs. Tout cela conduit à de véritables drames humains comme des déplacements de population, le développement des famines, l’éclosion des maladies, la disparition des forêts telles que l’Amazonie d’ici 2150 ou les forêts primaires brésiliennes d’ici 2070 ! Ces quelques exemples montrent bien que la bourgeoisie continue de régner en maître absolu, d’exploiter les hommes et la nature pour son seul profit. Si la classe ouvrière est incapable d’offrir une autre perspective, l’état de la planète va empirer au point de devenir invivable pour tous les grands mammifères, l’espèce humaine comprise.
La bourgeoisie a bien conscience qu’elle doit faire un minimum pour préserver notre environnement. Elle sait que le changement climatique est à terme une entrave à la production, que les dégâts provoqués coûtent chers, que les déplacements de population à venir vont être sources de conflits et de dépenses.
Incapable de limiter “la casse”, elle se console au mieux en tentant d’amuser la galerie avec ses COP 21, 22, 23 et COP 24. Mais justement, lors de ces réunions internationales au sommet, toute la nature destructrice du capitalisme ressort : chaque État y lutte âprement pour défendre l’intérêt de sa nation, les règlements écologiques deviennent des armes de guerres commerciales pour favoriser le développement de tel pays ou entraver celui de tel autre. Les États-Unis veulent limiter la pollution… chinoise. L’Europe… la pollution américaine, etc. À bas le diesel ! À bas le charbon ! À bas la déforestation ! À bas le nucléaire ! Selon que le principal concurrent exploite le pétrole, le charbon, le bois ou l’atome fissuré. Très loin d’une quelconque préoccupation écologique, ces négociations sont un autre moyen de maintenir les tensions impérialistes pour chaque grande puissance. L’avenir de la planète et de l’humanité n’a pas sa place ici. Hors des caméras ne reste que la défense des sordides intérêts nationaux. Un seul exemple : tous les gouvernements s’inquiètent du réchauffement climatique et de la fonte des pôles, et tous ces mêmes gouvernements en même temps fourbissent leurs armes, affûtent leurs arguments légaux et diplomatiques, appareillent leurs bateaux pour participer à la course à l’exploitation des nouvelles voies maritimes et aux nouvelles ressources “enfin” libérées des glaces.
La bourgeoisie française et son État ne font pas exception. Aujourd’hui, Macron se drape de vert pour justifier ses taxes. Il pointe du doigt les “gaulois réfractaires” et insensibles à l’avenir de la planète. Pendant ce temps, pour maintenir la compétitivité de l’agriculture française, des tonnes de glyphosate et autres désherbants, pesticides sont déversés partout. Et la “population égoïste” de développer cancer, troubles endocriniens et autres joyeusetés. Quid des grandes entreprises françaises : Total, L’Oréal, Danone pourtant parmi les plus grands pollueurs et empoisonneurs de la planète ? Sans parler de l’un des secteurs de pointe de la nation française : l’armement. Quoi de mieux pour l’humanité et la nature que de vendre à travers le monde mines, bombes, avions de guerre, quand ce n’est pas directement l’armée française qui déverse ses tapis de bombes au nom de la défense des valeurs démocratiques et du drapeau tricolore dans ses “missions de paix”.
Mais la bourgeoisie française pousse le vice encore plus loin. Même ses actes dits écologiques, officiellement pour financer la “transition” ne sont que pure escroquerie. Les recettes de la principale taxe écologique (TICPE ou taxe carbone) sont en réalité versées pour moitié dans le budget de l’État et il est impossible d’identifier ce qu’elles financent. Comme le rappelait le rapporteur de la commission des Finances du Sénat, le 7 novembre : “il n’est pas honnête de dire que la TICPE aidera les Français en matière de conversion énergétique”. Ainsi donc, même les euros volés sur le dos des plus pauvres au nom de la transition écologique n’iront pas… à la transition écologique ! Pire, dès la création de cette taxe, il était prévu qu’elle serve à financer le CICE, crédit d’impôts pour la compétitivité et l’emploi, à l’attention… des entreprises, y compris les plus polluantes. Décidément, oui, comme l’affirmait une banderole de la marche pour le climat du 8 décembre à Paris : “Fins du monde, fins de mois. Mêmes coupables, même combat”. Mais cela, à condition de bien comprendre que le vrai coupable est le capitalisme.
Près de trente ans après la signature du protocole de Kyoto, après vingt-quatre conférences des parties (COP), tous les indicateurs environnementaux sont au rouge. Les exploités ne doivent pas se faire berner : le sort de l’humanité et de son environnement est uniquement dans les mains de la classe ouvrière.
Elise, 6 janvier 2019
Récent et en cours:
- Ecologie [9]
Rubrique:
Migrations en Amérique Latine: seul le prolétariat peut arrêter la barbarie du capitalisme en décomposition
- 69 reads
Les phénomènes migratoires qui se produisent actuellement dans différents pays d’Amérique latine, ainsi que dans d’autres parties du globe, sont le résultat direct de l’incapacité de la bourgeoisie, en tant que classe dominante, à garantir les conditions de vie de millions d’êtres humains sur la planète. Enfoncée jusqu’au cou dans le bourbier de la crise économique mondiale, elle ne peut rien faire d’autre que ce qui est dans sa nature de classe exploiteuse : plonger le prolétariat et les autres couches non exploiteuses de la société dans la souffrance et la misère, afin de maintenir à flot son système pourri.
En ce moment-même, des groupes de migrants du Honduras marchent en direction de Veracruz (au Mexique) et de la frontière des États-Unis, où ils seront accueillis par l’armée aux abords des dites frontières, cadeau de bienvenue de Trump. Les milliers de personnes qui viennent du Honduras et des autres pays d’Amérique centrale continuent leur traversée, fuyant la misère et la violence de leur pays natal, pour affronter de nouvelles formes de violence et de misère dans leur prochaine destination. Parce que personne n’échappe à la misère et à la violence que le capitalisme offre dans la phase la plus sévère de sa décadence, ce que nous appelons la décomposition.
Il en va de même pour les ouvriers du Nicaragua, du Venezuela, du Maroc, de la Syrie, de la Birmanie et d’autres pays du monde, qui se déplacent en masses désespérées et qui, plus qu’une émigration, est un exode à proprement parler, un phénomène social qui démontre l’aggravation de la décomposition dans divers endroits de la planète. (1)
Les migrations expriment l’absence de perspective qu’offre le capitalisme à l’humanité
Rien qu’en 2017, 68 millions de personnes dans le monde ont été forcées de fuir leur foyer, à cause des guerres et des conflits politiques, un phénomène qui s’était déjà produit lors de la Seconde Guerre mondiale. D’après des données du pacte de Marrakech” de l’ONU sur les migrations, le nombre de personnes en exode forcé au cours des dix dernières années s’élève désormais à 260 millions, ce qui représente 3,4 % de la population mondiale. Des pays comme la Syrie et l’Afghanistan comptent déjà plus de six millions de migrants, le Soudan du Sud et la Birmanie les comptent également par millions, et la guerre civile au Yémen a, quant à elle, déraciné plus de trois millions de personnes et fait quelque 10 000 morts. (2) Ce qui est à l’origine de cette diaspora qui cherche à fuir la misère, le chaos et la mort, c’est la barbarie sans fin que produit le système capitaliste.
Ces phénomènes migratoires sont l’expression de la déstabilisation de la bourgeoisie dans tous ces pays, où une grande partie de la population active tente d’échapper à la misère et au drame qu’elle affronte chaque jour. La violence et l’hyperinflation au Venezuela, la violence des Maras (3) et la pauvreté qui touche les travailleurs Honduriens sont des exemples de ce qui se passe au niveau social et politique dans ces pays. Leur bourgeoisie, ne pouvant pas imposer à l’ensemble de la société son dessein et ses intérêts sans rencontrer de difficultés, se retrouve ébranlée et agitée à tous les niveaux, dans un chaos politique qui se traduit souvent par des conflits d’intérêts entre les différentes factions de la bourgeoisie locale, la corruption généralisée et la violence.
Les États capitalistes, dans ces pays frappés par les crises et les dictatures politiques depuis plusieurs années, cherchent constamment à appauvrir les conditions de vie des ouvriers, attaquant les salaires et le niveau de vie. Ajouté à des politiques gouvernementales populistes de gauche et de droite ou bien à des dictatures militaires extrêmes, tout cela engendre un terrain propice à la bombe à retardement dont les exodes d’ouvriers, dont nous sommes témoins aujourd’hui, sont une des nombreuses manifestations. (4)
Bien que l’arrivée de Bolsonaro au pouvoir au Brésil, après plusieurs gouvernements de gauche, se manifeste sur un autre plan (le gouvernement et l’appareil politique de la bourgeoisie), ce populiste de droite a réussi à combler le vide laissé par la corruption et l’échec des gouvernements précédents. La situation au Pérou montre également des niveaux de corruption sans précédents, ce qui a déstabilisé la bourgeoisie de ce pays.
Cette situation a immédiatement engendré des attaques envers la classe ouvrière, rendant les conditions de travail d’une grande partie de la population de plus en plus précaires, et aggravant la violence sous toutes ses formes. De même, en Équateur, la confrontation violente entre les autorités, les autochtones et les migrants vénézuéliens, a montré que la bourgeoisie équatorienne était incapable d’apporter une solution à ce problème. Dans la même veine, au Venezuela, continue de se développer une hyperinflation titanesque qui a déjà poussé 4 millions de personnes désespérées à fuir la faim et la violence de ce pays. Face à cela, les États n’ont pas d’autre choix que d’augmenter les restrictions d’accès à leur sol, qu’ils appellent “le contrôle aux frontières”.
À cela s’ajoute l’idéologie de la xénophobie qui commence à se développer, comme en Équateur et au Pérou. Cette idéologie, a plus ou moins été alimentée par les opinions populistes et de droite, provenant de groupes de citoyens et des fronts politiques. (5) Mais la xénophobie n’est pas associée à certains partis ou tendances politiques (elle n’est pas apparue avec Trump ou Bolsonaro par exemple), elle émane d’une forme d’aliénation produite par une société qui vit de l’exploitation du travail humain.
D’ailleurs, le Nicaragua, le Honduras et l’Amérique centrale connaissent le même sort. Des centaines de travailleurs et leurs familles fuient leur lieu d’origine, motivés par la peur et la faim imposées par les États de ces pays et par la violence de leurs pairs, les “Maras”, notamment la Mara Salvatrucha, (6) gangs criminels qui contrôlent les villes et rues de ces pays (et des autres pays) d’Amérique centrale. Dans certains cas, cette violence sans limites, qui se développe sur deux fronts, sert très bien les intérêts des factions les plus stables des bourgeoisies locales, tandis que dans d’autres, elle leur échappe totalement, accélérant l’effondrement de la société et forçant la classe ouvrière à s’échapper de ce cercle vicieux de la misère.
Le capitalisme, dans sa phase aggravée de décomposition, plonge les migrants dans la barbarie
Alors que la décomposition sociale du capitalisme s’accélère, la classe ouvrière doit faire face à la peur, la faim et au désespoir. Les conditions de pauvreté qui ont touché, de manière historique, certaines couches de la classe ouvrière dans diverses régions du globe, comme en Amérique centrale, peuvent pousser une partie du prolétariat dans le désarroi à réagir de façon désespérée. Cependant, ce scénario ne doit pas nous tromper ; le prolétariat, même face à ces difficultés, n’a perdu ni sa combativité, ni sa capacité à développer sa conscience de classe révolutionnaire. Il est vrai que toute cette situation ceinturée par la décomposition engendre une tendance à l’effondrement de toutes les sociétés de la planète, menaçant d’entraîner la classe ouvrière et l’humanité toute entière dans un chaos total, de mort et de destruction. Dans ce contexte, seul le prolétariat est capable de devenir un référent politique pour le restant des couches non exploiteuses de la société, en proposant, sur une base autonome, solidaire et internationale, le dépassement des rapports de production capitalistes. Pour mener à bien cette mission historique, le prolétariat a besoin de son avant-garde, une organisation politique prolétarienne mondiale, composante de l’effort du prolétariat pour développer sa conscience politique, défendant constamment les intérêts de la classe ouvrière, et qui soit également capable de mettre en garde le prolétariat contre les dangers et les difficultés qu’il rencontre dans sa lutte pour se réaffirmer comme seule classe révolutionnaire et internationale. Cela afin d’agir de manière organisée et unie contre le bombardement idéologique permanent des serviteurs du capital, contre le terrorisme et la terreur que certaines factions de la bourgeoisie utilisent pour faire taire les tentatives de révolte des ouvriers.
En ce sens, le prolétariat ne doit pas succomber au chant des sirènes populiste de gauche ou de droite, ni tomber dans le défaitisme des classes moyennes démoralisées, ni dans la confusion et le piège tendu par certaines factions des bourgeoisies régionales, principalement vénézuéliennes, qui consiste à présenter l’origine de ces migrations ainsi que l’accentuation de la faim et de la pauvreté à laquelle il fait face, comme le résultat “de l’application du modèle communiste”. En réalité, c’est le capitalisme qui entraîne l’humanité dans sa chute, et face à lui, seul le prolétariat a la capacité, en tant que classe révolutionnaire, unie et internationale, de proposer une perspective concrète afin de s’extirper de ce bourbier en détruisant ce système de misère, d’exploitation et de mort.
Native ou étrangère, la même classe ouvrière
Ce qu’il faut comprendre, c’est que la classe ouvrière immigrée, contrainte à un exode désespéré, est victime de la barbarie capitaliste, et que cette même barbarie attaque non seulement les migrants, mais aussi l’ensemble du prolétariat mondial ; en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, etc. Ces exodes dont nous avons été témoins, du Maroc au Nicaragua, du Honduras au Venezuela, ne font que confirmer la barbarie dans laquelle le capitalisme nous entraîne, et témoignent ouvertement des coups portés aux conditions de vie des ouvriers autochtones et étrangers du monde entier. (7)
Dans d’autres pays d’Amérique latine comme au Brésil, en Colombie, en Équateur ou au Pérou, le rejet des migrants s’observe également, en raison d’une situation de crise économique et sociale qui, au milieu d’une compétition féroce pour la survie, provoque des réactions humaines instinctives telles que la peur de perdre son emploi, le nationalisme, donnant elles-mêmes naissance à des idéologies irrationnelles comme la xénophobie, dont les racines se trouvent dans la division de la société en classes, en nations, en cultures, et dans le fait que la force de travail est la seule et unique marchandise que l’ouvrier peut vendre au capital pour gagner sa vie.
Dans le même ordre d’idées, la bourgeoisie dite populiste des Trump, Salvini, Orban, Le Pen ou du petit nouveau Bolsonaro au Brésil, ainsi que la bourgeoisie dite démocratique, des Merkel, Sánchez, Macron, López, Vizcarra, Moreno, sont en réalité les faces d’une même pièce et représentent le même ennemi pour le prolétariat : la bourgeoisie. Les deux camps capitalistes se font appeler populistes, droite “civilisée” ou encore gauche “humaniste”, alors qu’ils sont le même ennemi de la classe ouvrière.
C’est pourquoi la crise migratoire massive est un symptôme de la décomposition sociale du capitalisme, tout comme l’effondrement systématique des sociétés de la planète et la barbarie sans fin sont des manifestations constantes de ce système pourri. Malgré le fait que beaucoup ont dû émigrer pour survivre, le prolétariat n’est pas vaincu. Il continue de résister aux attaques menées contre ses conditions de vie (au Venezuela, il y a eu près de 11 000 manifestations cette année), comme le font d’autres couches de la population, montrant ainsi son indignation sociale.
En ce sens, nous devons donc continuer à penser que l’unique manière d’échapper à cette terrible situation est la lutte déterminée, unie et internationale du prolétariat. Lui seul pourra guider les autres couches sociales et, de par sa nature de classe et de force sociale internationale, affirmer avant tout que la classe ouvrière, d’ici ou d’ailleurs, reste la même, soulignant ainsi la perspective réelle de surmonter la misère à l’échelle planétaire.
Internacionalismo, section du CCI au Pérou, 13 décembre 2018
1) Voir notre article en espagnol : “Marruecos : protesta contra la barbarie capitalista a los emigrantes” [10].
2) El Comercio (26 août 2018).
3) Les Maras sont des gangs mafieux principalement impliqués dans des affaires de stupéfiants et dans toute sorte d’activités illicites. Beaucoup sont essentiellement composées d’adolescents. Le meurtre d’innocents fait partie des différentes épreuves d’initiation de certaines Maras, notamment la MS13 (Mara Salvatrucha). (NdT)
4) Voir notre article : "La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste [11]".
5) Voir notre article en espagnol : “Para luchar contra el racismo hay que luchar contra el capitalismo” [12].
6) La Mara Salvatrucha, ou MS, ou encore MS13, est originaire de Los Angeles. Elle est présente dans certaines régions des États-Unis, du Canada, du Mexique, le nord de l’Amérique Centrale (le Guatemala, le Salvador, le Honduras), ainsi que dans le sud de l’Europe (en Italie et en Espagne)
7) Voir notre article : “Crise de l’émigration à la frontière hispano-marocaine : l’hypocrisie de la bourgeoisie démocratique” [13].
Géographique:
Récent et en cours:
- Immigration [15]
Rubrique:
Crise économique mondiale: le pire est encore devant nous !
- 144 reads
De nouveau, à la Une des journaux s’étale la crainte de nouvelles secousses économiques mondiales. “Bourse : les banques européennes signent leur pire performance depuis 2011”, “Le moteur cassé du commerce mondial”, “Les banques centrales peu armées en cas de nouveau choc”, “Crack boursier et crise économique seront-ils au menu de 2019 ?”, etc.
En clair, les conditions de vie et de travail de millions d’êtres humains aux quatre coins du monde vont encore empirer. Vagues de licenciements, réduction du nombre de fonctionnaires, diminution des aides sociales et allocations chômage, détérioration des soins médicaux, appauvrissement des retraités, explosion de la précarité, de la flexibilité et des cadences de travail… tel est le programme de la classe dominante pour les années à venir. En définitive, un scénario similaire à celui de la décennie passée, voire pire.
La seule vraie question est : quels nouveaux mensonges vont encore inventer la bourgeoise et les médias à sa botte pour cacher la réalité de la faillite de son système ?
En 2008, ils ont pointé du doigt l’irresponsabilité des banques et la cupidité des traders dont les plus grassement enrichis servirent de bouc-émissaires (certains furent même jetés en prison).
En 2008, ils ont usé et abusé des allégories pour présenter la crise économique comme un cataclysme naturel, hors de contrôle de l’activité humaine : tempête financière, tsunami bancaire… induisant l’idée d’impuissance face à la fatalité.
En 2008, ils ont poussé des cris d’orfraie face à la mondialisation dérégulée et aux paradis fiscaux. Ils ont juré la main sur le cœur que les États allaient reprendre sérieusement le contrôle de cette “économie de casino”.
En 2008, ils ont asséné que “nous vivions au-dessus de nos moyens”, que depuis 60 ans “nous” avons égoïstement accru la dette des États, en hypothéquant ainsi la vie de nos enfants et des nouvelles générations. Ils ont ainsi culpabilisé sans vergogne les salariés, les retraités, les chômeurs qui ont pourtant vu, décennie après décennie, leurs conditions de vie se dégrader.
En 2008, ils ont promis qu’en se serrant la ceinture aujourd’hui et en acceptant les “sacrifices nécessaires”, les lendemains seraient meilleurs. Ils ont justifié ainsi toutes les pires attaques.
Des mensonges et encore des mensonges !
Le capitalisme est basé sur un rapport social de production. Les lois économiques ne tombent pas du ciel. Les investissements, les flux de capitaux, les achats et ventes en bourses, les règles de concurrence, toute la vie économique est une activé humaine.
Le capitalisme est un système basé sur l’exploitation de la force de travail des prolétaires. C’est la bourgeoisie qui dicte ses lois et ses règles, à travers ses États, à son profit, dans le seul but d’accumuler du capital. C’est le prolétariat, en tant que classe, qui travaille pour produire les richesses et sur lequel la classe capitaliste extrait la plus-value, c’est-à-dire un sur-travail volé légalement par la bourgeoisie.
Le capitalisme est un système décadent. La Première Guerre mondiale en 1914 a signé la fin de sa période historique de prospérité. En effet, ce système a besoin d’être en expansion permanente pour vendre toujours plus de marchandises et éviter la surproduction sur le marché mondial. Or, la planète a des limites objectives. En deux siècles, le XVIIIe et le XIXe, le capitalisme a conquis, par la colonisation, tous les continents. Au début du XXe siècle, les principales grandes puissances du capitalisme, au cœur de la vieille Europe, finissaient de se partager le monde. Il n’y avait nulle part de nouvelles régions du monde à conquérir. La planète est aussitôt devenue un terrain d’affrontements entre les grandes puissances pour se disputer les parts de marché. Parce qu’elle était dépourvue de colonies, l’Allemagne a dû se lancer la première dans l’offensive guerrière, justement pour s’approprier les marchés des autres par la force des armes. Pour l’Allemagne, comme pour les autres puissances impérialistes, il s’agissait d’ “exporter ou périr” (selon le cri de guerre d’Hitler). Les deux guerres mondiales qu’a connu l’humanité étaient la conséquence de l’exacerbation de ces tensions commerciales et impérialistes.
Depuis, avec l’approfondissement de la crise historique du capitalisme, la guerre ravage la planète quotidiennement. Tous les États ont concentré dans leurs mains l’ensemble de la vie sociale et économique afin de se livrer la concurrence économique et militaire la plus effroyable sur l’arène mondiale. Cela, au nom de la “compétitivité” des marchandises. L’un des moyens utilisés est l’endettement. Pour soutenir leurs économies nationales, tous les États injectent donc des quantités d’argent de plus en plus astronomiques à coups de crédits, de taux d’intérêt bas, de dérégulations et autres montages financiers.
Voilà pourquoi, depuis 2008, la dette mondiale a encore gonflé démesurément. Selon le FMI, fin 2007, elle était de 184 000 milliards de dollars, soit 225 % du PIB mondial ! Sans compter toutes les dettes liées aux actifs pourris, aux shadow banking (1) et à toute l’économie souterraine qui, malgré les discours de renforcement des contrôles, ne cessent de se développer.
En fait, l’expansion de cette “finance de l’ombre” est particulièrement révélatrice de l’impasse dans laquelle s’enfonce inexorablement le capitalisme. Tous les G7, G8, G20 successifs se sont déclarés en guerre contre ces pratiques douteuses. L’absence de maîtrise des États sur cette partie de l’économie mondiale inquiète, en effet, toute la bourgeoisie. Mais en même temps, elle est le produit inévitable de la politique et de la concurrence entre les États : ils déversent de l’argent à coups de taux de crédits ultra-bas afin de soutenir artificiellement leurs économies nationales. À côté de cela, l’économie réelle est saturée de marchandises invendables, la surproduction est partout. Les investisseurs utilisent donc tous les moyens pour faire fructifier leur capital, y compris les plus spéculatifs : bourses officielles et paradis fiscaux. Les États eux-mêmes, pris dans une guerre commerciale implacable, sont au cœur de telles pratiques. Les plus grandes entreprises nationales s’y déploient avec leur bénédiction. Les États ferment en grande partie les yeux sur le blanchiment de l’argent issu de tous les marchés noirs (la prostitution, la drogue, mais aussi, par exemple en France, le travail au noir qui est le pilier de la compétitivité du secteur textile), quand ils n’y investissent pas directement.
La bourgeoisie n’a pas de solution à la crise insoluble de son système. Son marché artificiel de la dette ne résout rien. Au contraire, il prépare des explosions toujours plus violentes.
Aujourd’hui, la croissance de l’économie réelle mondiale et les échanges mondiaux ralentissent. La situation dans laquelle se trouve la Chine est particulièrement inquiétante : la consommation et la production industrielle sont en berne, le pays connaît la plus grosse bulle immobilière de son histoire, les conflits commerciaux avec les États-Unis s’exacerbent.
L’économie mondiale est truffée de ce type de champs de mines, tels, par exemple, les prêts accordés aux étudiants aux États-Unis que ces futurs travailleurs précaires seront incapables de rembourser, la dette privée (entreprises et ménages) américaine pharaonique (150 % du PIB), la menace d’un retour de l’inflation et donc le risque de resserrement monétaire des banques centrales ou les conséquences du Brexit, de la politique de plus en plus protectionniste de Trump, etc.
Le capitalisme va donc continuer de s’enfoncer inexorablement dans sa crise historique, avec des soubresauts toujours plus violents et dévastateurs pour l’humanité. La bourgeoisie va continuer de mentir pour cacher que c’est son système comme un tout qui est en faillite et non uniquement telle ou telle branche plus pourrie que les autres.
L’avenir économique et social que nous promet la bourgeoisie est donc sombre. Il ne faut pourtant pas voir dans la misère que la misère. Le capitalisme est un système obsolète, divisé en classes et en nations. Mais il a aussi engendré en son sein une classe exploitée mondiale et un marché mondial. Aujourd’hui, les prolétaires, grâce au travail associé, coopèrent à l’échelle mondiale pour produire la moindre marchandise, même un simple stylo. Ils forment une classe porteuse de solidarité et d’unité internationale face à une classe bourgeoise qui les exploite dans tous les pays du monde. La classe exploitée porte en elle la capacité de s’organiser mondialement pour abattre le capitalisme et briser les chaînes de son exploitation et les barbelés des frontières qui divisent toute l’humanité en nations.
À terme, l’aggravation de la crise économique et de la misère ne peut que pousser des millions de prolétaires à se battre pour défendre leurs conditions d’existence. C’est seulement quand la classe exploitée se mobilisera massivement sur son propre terrain, contre les empiétements du Capital, que les prolétaires pourront prendre conscience de leur identité de classe et d’être la seule force sociale capable d’en finir avec ce système d’exploitation basé sur la production de marchandises et sur le profit.
Pawel, 5 janvier 2019
1) Le shadow-banking ou finance de l’ombre est “la migration des activités vers le secteur non régulé” (Jean Tirole).
Récent et en cours:
- Crise économique [16]
Rubrique:
Courrier des lecteurs: le mouvement des “gilets jaunes” peut-il ouvrir la voie à la lutte de classe ?
- 325 reads
Nous publions ci-dessous de larges extraits du courrier d’un lecteur qui, tout en saluant la ligne directrice de notre tract sur le mouvement des “gilets jaunes”, critique également certaines de nos positions, en particulier l’idée selon laquelle rien de bon ne pouvait sortir de ce mouvement interclassiste pour le prolétariat. Ces questionnements touchent à des aspects extrêmement importants de la lutte du prolétariat : ce qu’est la classe ouvrière, son combat, sa perspective.
Ce n’est que par un débat large, ouvert et animé, que nous parviendrons à élaborer les réponses les plus profondes, à participer au développement de la conscience de classe du prolétariat, à nous emparer de l’arme de la théorie. Nous encourageons donc tous nos lecteurs à nous écrire, à formuler leurs critiques, leurs accords ou leurs questions, afin de nourrir un débat vital pour le prolétariat. C’est avec cet état d’esprit que nous accompagnons ce courrier de notre réponse.
Courrier de notre lecteur
“(…) J’ai parcouru différentes prises de position dont celles des différents groupes gauchistes qui voient ce mouvement comme une réédition de 68. Or la différence saute aux yeux, mais une telle comparaison justifie leur soutien débridé.
On peut reconnaître comme le fait votre tract que l’éclosion spontanée de ces blocages traduit des colères sociales très profondes. Colères très diverses sinon contradictoires, exprimant le caractère interclassiste et son expression citoyenne voire nationaliste. D’accord avec votre critique sur le fond.
Sur trois points il pourrait y avoir discussion :
– L’idée d’un piège tendu aux ouvriers. Quel sens donner à ce “piège” ? Un piège suppose une organisation qui le prépare, l’organise, etc. Or on ne voit rien de tout cela ici.
Il y a aussi dans le tract l’idée que la classe ouvrière est empêchée de lutter : “Tout ce joli monde, chacun avec son credo, occupe et quadrille le terrain social pour empêcher les ouvriers de se mobiliser massivement, de développer une lutte autonome, solidaire et unie contre les attaques de la bourgeoisie”. Les ouvriers sont-ils seulement “empêchés”, sans quoi ils lutteraient ouvertement sur leur terrain classiste ? Non, évidemment.
Il y a bien un mouvement social mélangé, dans lequel le rapport n’est pas à l’avantage de la classe ouvrière et laisse libre cours à d’autres couches pour soutenir leurs propres intérêts, ce qui n’est pas étonnant aujourd’hui. D’accord, dans ce sens, avec le passage : “les prolétaires veulent exprimer leur profonde colère mais ils ne savent pas comment lutter efficacement pour défendre leurs conditions d’existence face aux attaques croissantes de la bourgeoisie et son gouvernement”.
– Là encore, est-il possible de concevoir une lutte de classe autonome comme préalable à un mouvement conséquent ? La lutte de classe ne devient-elle pas autonome en se dégageant comme telle au cours du mouvement lui-même ?
– Même si je partage la critique du contenu et des méthodes, je resterais davantage ouvert sur la possibilité de leur évolution. [Vous avez] remarqué le caractère spontané dans le déclenchement de ces blocages, or certains affichent le souci de s’auto-organiser, de fonctionner par de vraies AG, etc. (…)”
Notre réponse
À partir d’un constat commun sur le mouvement des “gilets jaunes” (1) caractérisé par des “colères très diverses sinon contradictoires, exprimant le caractère interclassiste et son expression citoyenne voire nationaliste”, ce courrier pose trois questions importantes.
Un piège pour les prolétaires ?
Notre tract affirme que ce mouvement est un véritable piège pour les prolétaires. Mais pour le camarade “quel sens donner à ce “piège” ? Un piège suppose une organisation qui le prépare, l’organise, etc. Or, on ne voit rien de tout cela ici”. En effet, ce mouvement a été spontané. Une jeune auto-entrepreneuse de Seine-et-Marne a lancé sur les réseaux sociaux une pétition contre l’augmentation des taxes sur le gazole. Puis un chauffeur-routier du même département a appelé à bloquer les routes, affublé d’un gilet jaune. De clic en clic, ces deux cris de colère se sont propagés à très haut débit, témoignant d’un ras-le-bol généralisé dans la population.
Il ne s’agit donc pas d’un piège tendu par la bourgeoisie, son État, ses partis, ses syndicats ou ses médias, mais d’un mouvement qui, de par sa nature interclassiste, est en lui-même un piège pour les ouvriers. Car dans un mouvement interclassiste où les prolétaires (employés, étudiants, retraités, chômeurs…) sont dilués comme individus-citoyens au milieu de toutes les autres couches de la société (petite-bourgeoisie, paysannerie, artisanat…), dominent les aspirations sociales et les méthodes de lutte de toutes ces couches intermédiaires.
C’est pourquoi le point de départ du mouvement fut l’explosion de colère des chauffeurs routiers, des taxis et des patrons de PME face à l’augmentation des taxes sur le gazole venant pénaliser encore un peu plus leur entreprise. C’est pourquoi le moyen d’action privilégié fut l’occupation des ronds-points et des péages, puis de “la plus belle avenue du monde”, les Champs-Élysées, un gilet jaune fluo sur le dos, pour “se faire voir”, “se faire entendre” et surtout se faire “reconnaître”. C’est pourquoi le drapeau tricolore, La Marseillaise et les références à la Révolution française de 1789, ont été aussi omniprésents au milieu de ce cri du “Peuple de France”. Autant de méthodes qui n’expriment en rien une mobilisation de la classe ouvrière sur son propre terrain, remettant en cause l’exploitation du capitalisme à travers des revendications telles que la hausse des salaires, contre les licenciements, etc.
Par ailleurs, les méthodes de lutte de la classe ouvrière ne s’y sont jamais exprimées. L’absence de grèves dans différents secteurs de la classe ou bien d’assemblées générales, au sein desquelles les exploités débattent et réfléchissent sur leur lutte et les objectifs à lui donner, le confirme aisément.
Pire encore, le terrain pourri du populisme et de la xénophobie gangrène une large partie du mouvement. Ce sont ainsi exprimés certains aspects les plus nauséabonds de la période historique actuelle, comme les appels officiels à renforcer les lois anti-immigrés ou des exactions xénophobes. (2) Plus de 90 % des sympathisants du Rassemblement national de Marine Le Pen soutiennent les “gilets jaunes” et plus de 40 % affirment participer eux-mêmes au mouvement.
Voilà dans quelle nasse ont été pris tous ces prolétaires en gilet jaune. Oui, ce mouvement a été pour eux un véritable piège idéologique.
Quelles sont les causes des difficultés politiques de la classe ouvrière ?
En quelques lignes ce courrier pose une question centrale : “Il y a aussi dans le tract l’idée que la classe ouvrière est empêchée de lutter (…). Les ouvriers sont-ils seulement “empêchés”, sans quoi ils lutteraient ouvertement sur leur terrain classiste ? Non, évidemment”. Quelles sont les causes des difficultés politiques actuelles de la classe ouvrière ? La réponse n’est pas dans une vision photographique du prolétariat d’aujourd’hui mais dans le film de son histoire. Nous ne pouvons donc répondre complètement ici, dans le cadre de cet article, à cette question complexe. (3) Nous voulons simplement marquer une insistance. Il ne faut pas sous-estimer le travail de sape permanent des syndicats dont le rôle spécifique depuis plus d’un siècle est justement le sabotage, sur les lieux de travail, des luttes et de la conscience.
Un seul exemple : quelques mois seulement avant le mouvement des “gilets jaunes”, les syndicats ont organisé la “grève perlée des cheminots”. Des milliers de travailleurs, particulièrement combatifs, ont enchaîné de nombreux jours de grève, complètement isolés, coupés des autres secteurs du prolétariat. Pourtant, au même moment, dans les EHPAD, à La Poste, dans les crèches, les hôpitaux, certaines usines, etc., des luttes se déroulaient également, chacune dans leur coin. Puis la CGT a lancé son appel à la “convergence des luttes”, simulacre d’unité consistant à défiler dans la rue, les uns derrière les autres, sous “son” mot d’ordre, “sa” corporation, “sa” boîte... et à repartir chacun chez soi sans assemblée générale commune, sans discussion, sans solidarité dans la lutte.
Ces mouvements syndicaux qui se répètent année après année, ont pour seule fonction de répandre le poison de la division, du désespoir, de l’impuissance. Alors, oui, le sabotage systématique de l’unité ouvrière par les syndicats est l’un des ingrédients majeurs de la faiblesse actuelle du prolétariat, faiblesse qui crée un terrain favorable à l’explosion de colères interclassistes et, donc, sans perspective.
En fait, la bourgeoisie exploite les faiblesses du prolétariat pour tenter de l’assommer davantage. En effet, la classe ouvrière traverse une période difficile. Depuis 1989 avec les campagnes sur l’effondrement du stalinisme identifié à la prétendue “faillite du communisme”, le prolétariat n’a pas été en mesure de retrouver son identité de classe et de se reconnaître en tant que classe révolutionnaire. Incapable d’esquisser les contours d’une société sans exploitation, la classe exploitée demeure très vulnérable mais surtout très passive sur le terrain de la lutte.
Si, à juste titre, de larges secteurs du prolétariat ne se sont pas reconnus dans la révolte populaire des “gilets jaunes”, ces secteurs centraux n’ont pour autant pas été en mesure de se mobiliser massivement et de façon solidaire et unie, pour riposter aux attaques du gouvernement sur leur propre terrain de classe et avec leurs propres méthodes de lutte.
Cependant, malgré ces difficultés, le prolétariat n’est pas battu. Compte tenu du mécontentement général et des attaques qui se profilent, les grandes masses prolétariennes peuvent très bien sortir de cette léthargie dans la période à venir. L’avenir appartient donc toujours à la lutte de classe.
Les “gilets jaunes”, un tremplin pour la lutte ouvrière ?
“La lutte de classe ne devient-elle pas autonome en se dégageant comme telle au cours du mouvement lui-même ? Même si je partage la critique du contenu et des méthodes, je resterais davantage ouvert sur la possibilité de leur évolution. [Vous avez] remarqué le caractère spontané dans le déclenchement de ces blocages, or certains affichent le souci de s’auto-organiser, de fonctionner par de vraies AG, etc”.
Le mouvement des “gilets jaunes”, même parti sur de mauvaises bases, pouvait-il se transformer, devenir autre chose, une authentique lutte de la classe ouvrière ?
En faveur de cette thèse, il y a l’élargissement progressif des revendications, puisque le rejet de l’augmentation de la taxe sur le gazole est passé au second plan derrière une plus large protestation contre la pauvreté et pour le pouvoir d’achat. De plus, la sympathie de la population pour ce mouvement ne se dément pas. Si le mouvement n’a jamais été massif (environ 300 000 “gilets jaunes” au plus fort de la mobilisation) et que la majorité des prolétaires des grandes entreprises et de la fonction publique sont restés spectateurs, il n’en reste pas moins vrai qu’il jouit d’une belle cote de popularité.
Toujours à l’appui de cette thèse, il existe des précédents historiques. En voici seulement trois, mais pas des moindres : la Commune de Paris de 1871 a eu comme prémisse une explosion de colère en apparence nationaliste et anti-prussienne ; la grève de masse en Russie en 1905 a débuté sous des bannières religieuses, un pope (Gapone) à sa tête ; Mai 1968 en France a été initié par un mouvement d’étudiants qui étaient, à l’époque, souvent issus de la petite bourgeoisie. À chaque fois, la classe ouvrière s’est finalement portée à la tête de la lutte, avec ses propres méthodes, son organisation, sa force. Pour paraphraser notre lecteur, à chaque fois “la lutte de classe est devenue autonome en se dégageant comme telle au cours du mouvement lui-même”.
Alors, le mouvement des “gilets jaunes” aurait-il pu se transformer lui-aussi en autre chose, en une véritable lutte ouvrière ? En fait, le camarade apporte lui-même la réponse dans son courrier : “Il y a bien un mouvement social mélangé, dans lequel le rapport n’est pas à l’avantage de la classe ouvrière et laisse libre cours à d’autres couches pour soutenir leurs propres intérêts, ce qui n’est pas étonnant aujourd’hui”.
Mais pourquoi cela ? Parce que nous ne sommes pas en 1871, en 1905, ni même en 1968. En 1871, la Commune de Paris n’est pas une exception. Dans de très nombreuses régions d’Europe, particulièrement en France, la classe ouvrière est en lutte et plusieurs “Communes” éclatent. La grève de masse en Russie en 1905 est précédée de tout un processus profond de montée du combat prolétarien (de sa conscience et de son organisation), là aussi à l’échelle internationale, depuis les années 1890 (Rosa Luxemburg décrit magistralement ce processus dans son livre “Grève de masse, partis et syndicat”). Mai 68 survient après une année 1967 marquée par des grèves ouvrières très importantes, particulièrement dans les grandes villes de l’ouest de la France.
Aujourd’hui, nous ne voyons rien de tout cela. Comme nous l’avons dit plus haut, la classe ouvrière est empêtrée dans de grandes difficultés. Elle n’est même pas consciente de son existence en tant que classe antagonique à la classe bourgeoise et distincte des couches sociales intermédiaires (notamment la petite bourgeoisie). Elle a perdu la mémoire de son propre passé, et ne peut se référer à son immense expérience historique, dont elle a même honte puisque sans cesse la bourgeoisie assimile le mot “ouvrier” à une espèce “disparue” et le mot “communisme” à la barbarie du stalinisme.
Dans cette situation, le mouvement des “gilets jaunes” ne pouvait en aucune façon être une sorte de tremplin ou d’étincelle pour une authentique lutte de la classe ouvrière. Au contraire, les prolétaires embarqués derrière les mots d’ordre et les méthodes de la petite-bourgeoisie, noyés dans l’idéologie interclassiste de la citoyenneté, dilués dans toutes les autres couches sociales, ne pouvaient que subir de façon négative la pression du “démocratisme” bourgeois et du nationalisme.
Par conséquent, heureusement que la majorité de la classe ouvrière s’est contentée d’un soutien platonique et que les prolétaires n’ont pas participé en masse à ce mouvement sans perspective. Cette réticence révèle que, au-delà de sa sympathie pour une partie des revendications contre la pauvreté, la classe ouvrière a surtout été distante, circonspecte, dès le début, devant la focalisation contre les taxes et les méthodes utilisées (l’occupation de ronds-points), alertée et dégoûtée par le soutien immédiat de toute la droite et de l’extrême-droite.
Cette méfiance montre que, malgré ses difficultés à engager la lutte sur son propre terrain de classe, le prolétariat n’est pas écrasé, défait, ni embrigadé massivement dans les idées pourries de la petite bourgeoisie et du populisme xénophobe et anti-immigrés.
Il y a même eu ces dernières semaines, au milieu de ce marasme, de petites lueurs : les lycéens sont rentrés en lutte contre la réforme du bac (sans Marseillaise ni drapeaux tricolores), non pour eux-mêmes directement, mais en solidarité avec les futurs élèves qui vont connaître un enseignement au rabais. De même, les étudiants se sont mobilisés pour refuser la hausse des frais d’inscription dans les facs pour les étrangers en brandissant le slogan “Solidarité avec les immigrés”. La colère des jeunes générations scolarisées (et futurs prolétaires) est une réponse cinglante tant aux mesures gouvernementales iniques qu’aux revendications anti-immigrés des “gilets jaunes”. La solidarité est en effet le ciment et la force de la classe ouvrière.
Le prolétariat a perdu momentanément son identité de classe, il est coupé de son histoire et de son expérience. Mais il est toujours là, bien vivant. Au plus profond de lui-même, la réflexion sur l’absence de perspective de la société capitaliste se poursuit, notamment parmi les éléments les plus conscients et combatifs. Poussé par l’aggravation de la crise économique, au début sans avoir conscience de sa force, sans croire en sa possible unité et son auto-organisation, le prolétariat sera contraint d’engager le combat pour la défense de ses conditions d’existence. Le mouvement des “gilets jaunes” est un signe révélateur de la profondeur du mécontentement qui existe dans toute la classe exploitée et des potentialités de la lutte de classe à venir.
Face à la paralysie momentanée de la lutte de classe, les révolutionnaires doivent s’armer de patience, ne pas craindre l’isolement, les pluies de critiques et d’incompréhensions ; ils doivent démasquer tous les ennemis du prolétariat, tous les pièges idéologiques, toutes les impasses, afin de participer, à la hauteur de leurs faibles forces, au développement de la conscience au sein de la classe ouvrière. Ceci avec la conviction que seule la lutte de classe est capable d’ouvrir une perspective d’avenir pour l’humanité.
RI, 24 décembre 2018
1) “Face à la misère et à la dégradation de nos conditions de vie : Comment lutter pour faire reculer le gouvernement et le patronat ?” [17] (tract disponible sur notre site Internet).
2) “Thèses sur la période de décomposition” [11], Revue internationale n° 107 (2001).
3) “Quand la bourgeoisie fait croire au prolétariat qu’il n’existe pas” [18], Révolution Internationale n° 447 (2014) et “Pourquoi le prolétariat n’a pas encore renversé le capitalisme ?” [19], Revue Internationale n° 104 (2001).
Vie du CCI:
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Gilets jaunes [22]
Rubrique:
Révolution internationale n° 475 - mars avril 2019
- 165 reads
Le combat des Gilets Jaunes n’appartient pas à la lutte de classe du prolétariat !
- 322 reads
En apparence, la situation sociale semble agitée. Les “gilets jaunes” ne désarment pas après plus de quatre mois de mobilisation. Les syndicats multiplient les grèves locales et les journées d’action. Certains appellent même à une “convergence des luttes”.
Indéniablement, la colère est immense au sein de la population. L’aggravation de la pauvreté et le chômage, la morgue et l’opulence des dirigeants, la violence étatique qui réprime les contestataires, les menaces incessantes d’une crise économique mondiale qui devrait encore s’aggraver ne peuvent que provoquer encore plus de grogne dans la population.
Pourtant, les expressions actuelles de cette colère légitime, notamment celle des “gilets jaunes”, n’inquiètent nullement la bourgeoisie. Bien au contraire, elle est parfaitement capable de les utiliser pour empêcher que resurgisse la lutte de classe du prolétariat
La bourgeoisie utilise le mouvement des gilets jaunes contre la classe ouvrière
Le mouvement des “gilets jaunes” est d’une incroyable longévité. Certains ronds-points sont occupés en continu depuis fin novembre ! C’est dire la détermination qui anime ces quelques milliers “d’irréductibles”. Pourtant, ce jusqu’au-boutisme désespéré ne fait pas trembler la bourgeoisie française. Au contraire, la classe dominante exploite ce mouvement interclassiste sans perspective pour à la fois entretenir les illusions sur la possibilité d’un capitalisme plus juste et plus humain, car prétendument plus démocratique, et renforcer l’arsenal répressif de son “État de droit”.
La bourgeoisie a exploité au mieux LA revendication centrale des “gilets jaunes”, celle du Référendum d’initiative citoyenne (RIC), en lançant son “Grand débat national”. Elle entretient ainsi les illusions sur son système et sa démocratie en mettant dans toutes les têtes une fausse alternative : participer au “Grand débat” ou organiser ses propres discussions entre “gilets jaunes”. “Nous, on a organisé un vrai grand débat des “gilets jaunes” dans la salle municipale qu’on nous a prêtée” se félicite, par exemple, l’un des “gilets jaunes” des ronds-points de l’Yonne. En réalité, ces discussions organisées par le gouvernement ou par les “gilets jaunes” (dans des salles municipales prêtées… par les maires), sont les deux faces de la même médaille : opposées en apparence, elles forment un tout. Tous ces “Grands débats”, quels qu’ils soient, se fondent sur le souhait d’une “véritable démocratie”, c’est-à-dire d’une plus grande écoute, d’une meilleure prise en compte de la parole du “peuple” par les institutions démocratiques. Or, ce système “démocratique” n’est qu’une mystification masquant que tous les gouvernements sont les gestionnaires du capital national, où une classe minoritaire exploite les prolétaires.
Une partie des “gilets jaunes” a conscience de la vacuité de ces palabres ; eux veulent imposer leurs revendications par la force. Les images du prestigieux restaurant Le Fouquet’s incendié lors de l’ “acte XVIII” ont ainsi fait le tour du monde. Le samedi 16 mars, quelques centaines de “black blocs” et “gilets jaunes” émeutiers ont d’abord tenté, sans succès, de prendre d’assaut l’Arc de triomphe, comme le 1er décembre, puis ont saccagé l’avenue des Champs-Élysées et les rues avoisinantes, principalement en brûlant des kiosques et en brisant des vitrines pour attaquer les symboles du capitalisme. “C’est pire que le 1er décembre. Mais Macron ne veut rien entendre ! Jusqu’où va-t-il falloir aller pour qu’on nous écoute ?” témoigne une manifestante, qui vient d’être gazée, à un journaliste de Libération. En une phrase, cette dame a résumé à la perfection la situation. Ces “gilets jaunes” veulent être “écoutés”. Mais ils ne savent pas comment être “reconnus” et “entendus” autrement qu’en détruisant et en saccageant : “Écoutez-nous, sinon on brûle tout !” pourrait être leur devise.
Ce mouvement est un mélange d’illusions démocratiques, de désespoir absolu et de violence aveugle. Cette révolte du désespoir est donc également infestée par le nihilisme des “black blocs” qui prônent partout : “La France est une vitrine, moi un pavé”. À chaque manifestation, un tag revient d’ailleurs sur les murs : “Le peuple applaudit les casseurs”. Le “peuple” peut bien applaudir, ces actes de destruction ne sapent en rien les fondements du système, ils sont comme des piqûres d’insectes sur la peau d’un éléphant. Pire, ils permettent à la bourgeoisie et son gouvernement de légitimer le renforcement juridique et policier de son arsenal répressif à l’image de la “loi anti-casseurs” adoptée par le parlement.
Il est vrai que le 1er décembre, le chaos qui s’est répandu dans les rues de Paris a contraint Macron à distribuer quelques miettes (primes de fin d’année, etc.) pour faire croire qu’il avait entendu le “petit peuple” qui n’arrive plus à joindre les deux bouts, tout en restant déterminé à ne pas reculer sur une des proncipales revendications des “gilets jaunes” : le retour de l’Impôt sur la fortune (supprimé par le “Président des riches”).
Est-ce la preuve que seule la menace d’un Paris en flammes avec le slogan “On ne lâchera rien !” serait efficace ? Aucunement ! Début décembre, les images des forces de l’ordre incapables de neutraliser des centaines de casseurs dans les lieux les plus touristiques de la capitale ont fait le tour du monde. En réalité, il est apparu de plus en plus évident que le gouvernement Macron avait laissé faire les “black blocs”, quitte à laisser saccager les commerces de l’avenue des Champs-Élysées (ce sont les assurances qui payeront les réparations !).
Tout le monde s’attendait à ce que les “gilets jaunes” fassent un nouveau coup d’éclat lors de leur “Acte XVI” (à la date à laquelle devait prendre fin le “Grand débat”). Le mot d’ordre des leaders “radicaux” des “gilets jaunes” : “Marchons sur l’Élysée !”, avait en effet circulé sur tous les réseaux sociaux (Prescilla Ludovsky avait même réussi à passer à travers les mailles du filet pour se rendre devant le Ministère de l’Intérieur, place Beauvau !). C’est donc ce qui s’est passé, le samedi 16 mars, où les Champs-Élysées ont servi de champs de bataille entre les CRS et les “gilets jaunes”, et de terrain de jeu aux bandes de casseurs professionnels, sans que les forces de répression aient complètement perdu la maîtrise de la situation (contrairement au 1er décembre). Si le gouvernement et son Ministre de l’Intérieur avaient voulu protéger la plus belle avenue du monde, ils auraient parfaitement pu déployer leurs cars de flics, leurs cordons de CRS et même les blindés de la gendarmerie pour bloquer tous les accès. Il faut être particulièrement naïf pour imaginer que le gouvernement a été complètement dépassé par une situation “inattendue” !
Si Macron et sa clique du gouvernement ont laissé faire, c’est d’abord pour obliger les autres partis électoraux concurrents et “l’opinion publique” à resserrer les rangs autour de la défense de l’État républicain “menacé par le chaos” et les actes de destruction des casseurs déguisés en gilets jaunes ou en costume noir : la loi anti-casseurs ne devait plus être contestée. On a pu entendre Macron déclarer que “personne ne peut tolérer que la République soit attaquée au nom du droit de manifester”. Il fallait donc faire l’union nationale, contre le vandalisme avec “la plus grande fermeté”, et donc faire accepter à tout le “peuple” de France les mesures de renforcement de l’État policier contre tous ceux qui manifestent “illégalement” et veulent mettre “la République en danger”.
Face à la critique de l’incurie du gouvernement Macron à empêcher les émeutes et les pillages dans les beaux quartiers de Paris, la stratégie du gouvernement a été de trouver un bouc émissaire : le Préfet de Paris a servi de fusible !
L’hyper-médiatisation du mouvement des “gilets jaunes” depuis le mois de novembre a occupé tous les esprits. Depuis le début, ce mouvement fait la Une de l’actualité avec toutes sortes de débats politiques et autres polémiques entre les différentes cliques bourgeoises ; toutes sortes d’experts et autres spécialistes en “sociologie des mouvements sociaux” sont régulièrement invités sur les plateaux de télévision pour nous tenir en haleine sur l’issue de ce mouvement “inédit” et “original”. Une telle publicité pour les “gilets jaunes” permet d’amuser la galerie en faisant croire qu’il s’agit d’une forme moderne de la lutte de classe (alors qu’il s’agit d’une révolte désespérée et sans perspective de citoyens français en colère contre la politique de Macron !).
La bourgeoisie et son gouvernement tirent profit de la médiatisation à outrance de ce mouvement social pour semer la confusion au sein la classe ouvrière. En polarisant toute l’attention sur les actions spectaculaires des “gilets jaunes”, la classe dominante vise aussi à empêcher le prolétariat des grandes concentrations urbaines de se mobiliser sur son propre terrain de classe, de défendre ses propres intérêts de classe exploitée, et non pas d’être au coude à coude avec les petits patrons et les petits commerçants paupérisés par l’augmentation des taxes et qui réclament une plus grande “justice fiscale” en usant de méthodes qui ne sont absolument pas celles de la classe ouvrière.
Syndicats et gauchistes appellent à “l’unité populaire” avec les “gilets jaunes”
Les salariés, les chômeurs, les précaires, les retraités n’ont plus conscience d’appartenir à une classe sociale totalement distincte de la petite-bourgeoisie, une classe exploitée qui est la seule force de la société capable de remettre en question de fond en comble le système capitaliste. Aujourd’hui, le prolétariat a perdu son identité de classe et la mémoire de ses grandes luttes révolutionnaires du passé que les campagnes de la bourgeoisie ont cherché à gommer ou à dénaturer. Les mouvements sociaux actuels sont l’expression de cette très grande difficulté du prolétariat à s’affirmer sur la scène sociale : malgré la colère profonde et générale face aux attaques incessantes de la bourgeoisie contre toutes les conditions de vie des travailleurs exploités, de nombreux prolétaires se sont mis à la remorque du mouvement citoyen, nationaliste et interclassiste des “gilets jaunes”, revendiquant maintenant “la nécessaire amélioration des institutions” et “la probité des dirigeants”.
Dans ce contexte, les syndicats en profitent pour se remettre en selle en occupant, eux aussi, le terrain social et en entrainant un maximum de prolétaires derrière leurs banderoles.
Ainsi, depuis plusieurs mois, ces organes de l’État bourgeois, spécialistes du sabotage des luttes, tentent de mobiliser la classe dans des journées de grèves sans lendemain et des manifestations bien encadrées où chaque secteur et chaque corporation sont scrupuleusement séparés les uns des autres. Le 28 mars, à Paris, les syndicats appelaient à pas moins de cinq rassemblements et mobilisations différentes, à des endroits et à des horaires différents. Dans les entreprises, là où les exploités n’en peuvent plus de la dégradation continuelle de leurs conditions de travail, là où le ras-le-bol est trop grand, les syndicats orchestrent des grèves isolées (donc impuissantes) et interminables afin d’épuiser la combativité des grévistes, les démoraliser et les amener à se dire que lutter ne sert à rien. Ce morcellement des luttes par entreprise et par corporation vise à saper toute unité de la classe ouvrière et ne fait qu’accroître le sentiment d’impuissance. Ainsi, par exemple, 150 postiers des Hauts-de-Seine, encadrés par Sud et la CGT, sont en grève depuis un an ! Tous seuls, dans leur coin, avec des revendications spécifiques à leur corporation.
Dans ce contexte, l’appel à la “convergence” entre le mouvement des “gilets jaunes” et les mobilisations syndicales ont pour but de noyer encore un peu plus la lutte de la classe ouvrière dans la révolte du “peuple”. Partout, on voit se multiplier des gilets de couleurs différentes, spécifique à chaque secteur ou corporation. Aux assisantes maternelles : le “gilet rose”, aux cégétistes : le “gilet rouge”, aux travailleurs indépendants des travaux publics : le “gilet orange”, aux enseignants (plus originaux) : le “stylo rouge” ! Non seulement, les syndicats divisent par secteur et par boîte, comme ils le font systématiquement depuis un siècle, mais, en plus, les ouvriers atomisés doivent maintenant se diluer dans le “peuple” et disparaître en tant que classe.
Les syndicats, CGT en tête, ont ainsi organisé un grand carnaval multicolore le 5 février dernier en appelant à une journée de “grève générale” contre la politique d’austérité de Macron et en appelant les “gilets jaunes” à faire converger leur lutte avec celle de tous les travailleurs et de tous les pauvres. Tous les cortèges de prolétaires en colère : ouvriers du secteur privé, de la fonction publique, retraites, chômeurs, étudiants, travailleurs immigrés… tous étaient bien encadrés pour défiler derrière les ballons et la sono de la CGT ! Cette manifestation balade a donné lieu, à Paris, à une véritable cacophonie où La Marseillaise et le drapeau tricolore des petits groupes de “gilets jaunes” faisaient écho à L’Internationale et aux drapeaux rouges ou noirs des trotskistes (du NPA et de LO) et des anarchistes (de la CNT) ! Pour couronner le tout, on a eu droit aux provocations policières des CRS matraquant sans vergogne des femmes et des retraités qui défilaient tranquillement vers la place de la Concorde où la manifestation a été rapidement dispersée par des jets de grenades lacrymogènes, sans que les dirigeants de la CGT n’émettent la moindre protestation ni pendant ni après cette journée de “grève générale” ! Faut-il croire que le parcours et la dispersion violente de cette manifestation ont été négociés entre la CGT et la Préfecture de police ?
Le spectre de la lutte de classe n’a pas disparu
“L’autonomie du prolétariat face à toutes les autres classes de la société est la condition première de l’épanouissement de sa lutte vers le but révolutionnaire. Toutes les alliances, et particulièrement celles avec des fractions de la bourgeoisie, ne peuvent aboutir qu’à son désarmement devant son ennemi en lui faisant abandonner le seul terrain où il puisse tremper ses forces : son terrain de classe” (Point 9 de la Plateforme du CCI).
La classe ouvrière est la classe révolutionnaire, elle seule porte une perspective pour toute l’humanité. Alors qu’aujourd’hui, elle éprouve de très grandes difficultés à imposer sa lutte en tant que classe autonome ayant des intérêts propres à défendre, plus que jamais il faut rappeler ce qu’écrivait Marx : “Il ne s’agit pas de savoir quel but tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier, se représente momentanément. Il s’agit de savoir ce que le prolétariat est et ce qu’il sera obligé historiquement de faire, conformément à cet être” (La Sainte Famille). Les journées insurrectionnelles de juin 1848 et la Commune de Paris en 1871, les luttes des années 1890 en Belgique, les combats révolutionnaires en Russie de 1905 et 1917 en Europe orientale, la révolution allemande de 1918, le mouvement prolétarien de Mai 1968 en France, de Pologne en 1980, etc., n’ont rien de commun avec le mouvement populaire, “radical” et jusqu’au-boutiste des “gilets jaunes”.
Si la classe ouvrière a momentanément perdu confiance dans ses potentialités révolutionnaires, à agir en tant que classe autonome, la bourgeoisie, elle, a parfaitement conscience que le prolétariat est le fossoyeur du capitalisme et qu’il n’a pas disparu. C’est pour cela que la classe dominante a tout intérêt à exploiter au maximum le mouvement interclassiste des “gilets jaunes” contre la conscience du prolétariat. C’est pourquoi, depuis des mois, elle entretient la colère des “gilets jaunes” par des provocations policières et une répression destinée à mettre de l’huile sur le feu dans l’engrenage de la violence, tout en utilisant l’arme des syndicats pour saboter toute tentative des ouvriers de se mobiliser sur leur propre terrain de classe, avec leurs propres méthodes de lutte. La bourgeoisie fait tout pour que le prolétariat continue d’être amnésique. Elle fait tout pour gommer les antagonismes de classe en cherchant à diluer la classe ouvrière dans le “peuple”. Car elle sait que les attaques économiques toujours plus violentes contre les conditions de vie de la classe ouvrière risquent de faire resurgir la vraie lutte de classe !
Lio, 31 mars 2019
Géographique:
- France [24]
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Gilets jaunes [22]
Rubrique:
Crise au Venezuela: ni Guaido, ni Maduro ! Les travailleurs ne doivent soutenir aucune des fractions de la bourgeoisie dans leur lutte pour le pouvoir !
- 110 reads
L’affrontement qui, depuis des années, oppose les fractions bourgeoises rivales de l’opposition et du chavisme au Venezuela a franchi un palier supplémentaire dès les premiers jours de 2019. Ceci dans le contexte d’un approfondissement sans précédent de la crise économique et sociale, dont le signe le plus évident est l’augmentation de la misère que vit une grande partie de la population, mais aussi dans le cadre d’un scénario où s’aiguise la rivalité entre les grandes puissances, rivalité dans laquelle la soi-disant “communauté internationale” joue également un rôle important, les uns en accordant ouvertement leur aide au régime de Nicolas Maduro, les autres en soutien à la proclamation de Juan Guaido comme président. Ce sont les États-Unis qui ont donné le ton, à travers leur reconnaissance de Guaido comme président du Venezuela, en déchaînant une stratégie plus appuyée et de grande ampleur pour écarter définitivement Nicolas Maduro du pouvoir. Cette menace n’exclue pas, comme l’ont avancé de hauts fonctionnaires et Donald Trump lui-même, une intervention militaire des États-Unis, utilisant comme alibi “l’aide humanitaire” à la population. Les réactions en soutien à Nicolas Maduro sont venues surtout de pays comme la Russie et la Chine, principaux alliés du chavisme. Nous ne pouvons pas exclure que les tensions impérialistes actuelles débouchent sur une guerre entre grandes puissances, chacune utilisant ses pions locaux (Maduro et Guaido) ; cependant, plus qu’une confrontation militaire directe entre les grandes puissances, le danger potentiel le plus important réside dans l’impasse que constituerait l’utilisation de la population en général et des travailleurs en particulier comme chair à canon dans une guerre entre gangs et au prix d’une encore plus grande effusion de sang. Les plus de 40 morts et la répression brutale (plus de 900 emprisonnements au cours des seules dernières semaines de janvier) ne représentent qu’un petit échantillon de cette réalité.
Avant cette escalade de la confrontation entre les fractions bourgeoises de droite et de gauche au Venezuela, qui va bien au-delà des frontières de ce pays, il est important et urgent d’appeler le prolétariat vénézuélien et mondial à comprendre le danger imminent d’un massacre dans ses rangs, à ne s’affilier à aucune des fractions du capital en présence, qu’elle vienne de l’intérieur comme de l’extérieur du pays, de se maintenir sur son terrain de classe et de rejeter cet engrenage infernal de chaos et de barbarie dans lequel s’enfonce la région, expression de la décomposition dans laquelle nous plonge le capitalisme. (1)
La carte Guaido : une stratégie “made in USA”
La mise sur le devant de la scène de Guaido ne surgit pas du néant ; sa propulsion soudaine dans l’arène politique a été minutieusement préparée par les États-Unis, avec l’appui des membres de l’opposition vénézuélienne dans le pays comme celui des membres de la prétendue communauté internationale (le Groupe de Lima en Amérique latine, à l’exception du Mexique) qui soutiennent la stratégie des États-Unis contre le régime de Maduro. L’attitude agressive et déterminée des États-Unis contre Maduro s’appuie et s’est notablement renforcée avec le triomphe électoral de Jair Bolsonaro au Brésil (dans lequel les États-Unis eux-mêmes ont pris une grande part). Ce n’est pas par hasard si la première déclaration commune avec Mike Pompeo (secrétaire d’État américain) lors de la cérémonie d’investiture de Bolsonaro concernait “la lutte contre le socialisme” et le rétablissement de la “démocratie” au Venezuela. De cette manière, le Venezuela s’est retrouvé encerclé sur ses frontières les plus importantes, à l’Ouest par la Colombie (principale alliée des États-Unis en Amérique du Sud) et au Sud par le Brésil. Plusieurs pays de l’Union européenne ont fini aussi par reconnaître la légitimité de Guaido, tout en essayant de développer leur propre intervention impérialiste à travers le soi-disant “Groupe de Contact” qui tente d’affaiblir l’action américaine.
Cette réaction énergique des États-Unis et de ses alliés dans la région profite en toile de fond de la situation créée par l’émigration de nombreux Vénézuéliens fuyant la misère et la barbarie imposées par le régime bourgeois de gauche du chavisme et qui s’est poursuivie sous Maduro (qui, selon les chiffres de l’ONU, s’est traduite par la migration de plus de quatre millions de personnes). L’opposition vénézuélienne s’est lancée dans cette offensive contre Maduro (la même opposition qui, à cause des conflits d’intérêts et du poids de la décomposition dans ses rangs, avait ouvert la voie de l’accession au pouvoir de l’aventurier Chavez en 1999) en utilisant les manifestations de colère que cela a suscité dans les rangs des ouvriers et de la population en général qui n’ont pas la force d’affronter de manière cohérente à la fois le régime chaviste et les secteurs bourgeois d’opposition à cause de la division créée par l’affrontement politique entre les fractions du capitalisme. (2)
Les secteurs de l’opposition, affaiblis par les conflits d’intérêts en leur sein, prétendent maintenant se rassembler derrière la personne de Guaido dans une autre aventure qui obtient un appui dans la population à cause du désespoir occasionné par la faim et la misère. L’action de la majorité de la bourgeoisie régionale et mondiale qui se positionne aujourd’hui contre Maduro met en évidence l’hypocrisie des classes exploiteuses parlant maintenant de respect des droits de l’homme, après avoir chanté les louanges d’un Chavez “défenseur des pauvres” qui aurait réussi à sortir “de la misère et de leur invisibilité” des millions de pauvres au Venezuela et aurait réparti les bénéfices dans la population grâce au prix élevé du pétrole alors qu’en fait il consolidait les fondations de la barbarie qui sévit aujourd’hui, enrichissant la classe des dirigeants militaires et civils qui défendent actuellement leurs privilèges en mettant le pays à feu et à sang. (3)
De son côté, le régime chaviste s’est proclamé “socialiste” et “révolutionnaire” alors qu’il a, en réalité, imposé au Venezuela un brutal régime de capitalisme d’État à outrance, du même style que les régimes dictatoriaux à Cuba, en Chine, en Corée du Nord ou les prétendus représentants du “socialisme arabe”. (4) Ce régime s’est proclamé en lutte contre le “néolibéralisme sauvage”, mais les effets de ce “socialisme” se sont révélés tout aussi dévastateurs pour la population : l’état d’extrême pauvreté touche 61,2 % de la population et 87 % des familles vivent avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté, plus de 10 % des enfants souffrent de dénutrition grave, entre cinq et six enfants sont morts, en moyenne, chaque semaine en 2017 pour cause de malnutrition ou de maladie, et, en 2017 et 2018, l’hyperinflation a dépassé 1 000 000 %, ce qui a pulvérisé les salaires. Non seulement la politique chaviste a éliminé pratiquement les conventions collectives mais en plus a instauré un régime de répression à l’intérieur des lieux de travail et des entreprises.
Ces modèles de gestion du capital comme celui du régime chaviste sont des régimes qui n’ont rien à voir avec le communisme pour lequel ont combattu Marx, Engels, Lénine, Rosa Luxemburg et tous ceux qui ont posé la nécessité d’en finir avec l’État bourgeois (que ce soit sous des gouvernements de droite ou de gauche) et avec les lois aveugles du mode de production capitaliste. Nous devons avoir présent à l’esprit que ni la gauche du capital ni les fractions de droite de la bourgeoisie ne peuvent trouver une issue à la crise du capitalisme dans cette phase de décomposition ; nous pouvons voir par exemple comment la droite en Argentine, après avoir supplanté les gouvernements de gauche des Kirchner, est désormais plongée dans une crise bien pire dont elle se décharge sur le dos des ouvriers. Il est en train de se passer la même chose avec le gouvernement de Bolsonaro au Brésil.
Le chavisme, et ses adorateurs gauchistes du monde entier, tout comme les différentes oppositions de centre ou de droite, ont hardiment essayé, en diffusant toutes sortes de mensonges et de confusions, de déformer l’héritage historique du marxisme et les leçons qu’ont laissées les luttes du mouvement ouvrier, quand ils ne cherchaient pas à l’effacer complètement, et cela aussi bien quand ils s’auto-proclament “marxistes” que quand ils identifient le “socialisme du XXIe siècle” au “communisme”. Tous ont essayé de maintenir leur domination de classe ; maintenant, c’est au tour de la droite ou du centre droit, en disant qu’il faut éradiquer le “communisme” en Amérique latine en l’identifiant au chavisme ou au castrisme.
Les grandes puissances attisent le chaos dans la région
Comme cela a déjà été évoqué, Guaido a été promu par les États-Unis qui cherchent à rétablir le contrôle le plus étroit sur son arrière-cour. La Chine, avec l’accroissement de son influence en Amérique latine et dans d’autres pays du monde au moyen notamment de son ambitieux programme appelé la “route de la soie”, prétend non seulement se tailler une part plus grande du marché mondial à sa portée mais encore aspire à une implantation stratégique impérialiste à l’échelle mondiale. À travers son extension sur le terrain économique, la Chine tente de tisser une toile impérialiste de dimension mondiale pour défaire le cordon sanitaire qui l’entoure depuis la période d’Obama aux États-Unis (Japon, Corée du Sud, Philippines, Inde, etc.). En ce sens, les alliances avec le Venezuela, l’Équateur, le Nicaragua, etc. revêtent beaucoup d’importance aux regard des ambitions impérialistes de la Chine. “L’opération Guaido” est une contre-attaque des États-Unis qui s’ajoute aux positions gagnées en Argentine et au Brésil et à la fidélité traditionnelle de l’alliance avec la Colombie.
Le premier pas de l’opération impérialiste des États-Unis est le déploiement d’une prétendue “aide humanitaire”. C’est le comble du cynisme et de l’hypocrisie que d’utiliser la faim, le manque de médicaments, la situation désespérée de millions de travailleurs et d’exploités au Venezuela pour mener la première phase de sa stratégie contre le régime de Maduro. Les camions qui apportent des aliments et des médicaments et qui sont stationnés sur le fameux pont aux petites boutiques dans la ville colombienne de Cucuta sont l’équivalent d’envois de missiles et d’avions porteurs de bombes. Avec eux, l’impérialisme américain tente de mettre dans une situation inconfortable son rival impérialiste chaviste : celle de rejeter la nourriture et les médicaments destinés à une population mourant de faim. Les deux protagonistes, américains comme chavistes, les partisans de Guaido comme ceux de Maduro, démontrent ainsi leur cynisme répugnant. Les premiers exploitent la faim parmi la population comme une arme de guerre, répétant la même opération déjà réalisée par Clinton en 1998-99 en Serbie où des tonnes d’aliments ont été balancées par des avions-porteurs pour affaiblir le régime adverse de Milosevic ou de la manœuvre similaire effectuée en Haïti en 2004. (5) Les seconds, avec Maduro à leur tête, rejetant l’aide démontrant ainsi ce qui est une évidence : ils se fichent complètement de la faim, du sort et des souffrances indicibles des populations.
Maduro va se cramponner le plus possible au pouvoir et, sans doute, la Chine et la Russie feront tout leur possible pour le soutenir. Jusqu’ici, l’armée et les forces de répression ont suivi en rangs serrés le chavisme. Ce qui est maintenant prévu, c’est d’affaiblir cette fidélité “inébranlable” de l’appareil militaro-policier envers Maduro. Pour mener à bien cette opération de déstabilisation, le danger d’affrontements armés se dessine à l’horizon. Étant donné la gravité des enjeux impérialistes et le degré élevé de décomposition idéologique, politique, économique et social qui s’est développé au Venezuela, il existe une réelle possibilité pour que la situation débouche même sur le déchaînement d’une guerre civile ou, du moins, dégénère en séries d’affrontements avec des bains de sang à répétition, ce qui provoquerait une spirale croissante de chaos et une multiplication de règlements de comptes en tout genre dans lesquels le pays comme toute la région peuvent finir par s’effondrer. La crainte de cette perspective est, par ailleurs, alimentée par les analyses de l’Observatoire vénézuélien de la Violence qui estime qu’il existe dans le pays huit millions d’armes à feu circulant illégalement. Il n’y a, en outre, pas de données précises sur le nombre d’armes entre les mains du crime organisé auquel il faut ajouter la menace du gouvernement chaviste de livrer 500 000 fusils à ses milices paramilitaires.
L’exode massif de la population vénézuélienne vers des pays de la région comme la Colombie, le Brésil, l’Argentine, le Chili, l’Équateur et le Pérou (avec des caravanes de marcheurs similaires à celles qui sillonnent les routes depuis le Honduras jusqu’aux États-Unis) constitue aussi un facteur de propagation du chaos. C’est un problème qu’il ne faut pas sous-estimer et auquel les bourgeoisies des pays les plus concernés répondent en lançant des campagnes racistes et xénophobes conçues comme des barrières contre la propagation du chaos. (6)
Seul le prolétariat offre la perspective d’un futur pour l’humanité
La crise du capitalisme est imparable, elle se nourrit jour après jour des propres contradictions du système. Pour cette raison, la sortie de la crise que subissent les exploités jusque dans leur chair sera seulement possible par l’union des prolétaires du Venezuela, de toute la région et du monde entier. Dans la phase actuelle de décomposition du capitalisme, il n’y a aucun pays du monde qui ne soit pas menacé de souffrir de la barbarie qui affecte aujourd’hui la vie quotidienne au Venezuela. Ni les populistes de gauche et de droite, ni les défenseurs du néo-libéralisme ne représentent une issue.
Les ouvriers au Venezuela doivent rejeter tout enrôlement dans les rangs des fractions en lutte pour le pouvoir, en rejetant les chants de sirène de la bourgeoisie d’opposition appelant les masses exploitées à rejoindre sa lutte ; de la même façon, ils ne doivent pas tomber dans les filets des partis, groupes ou syndicats de gauche ni dans ceux des gauchistes qui s’opposent au régime, comme ceux qui se réclament d’un soi-disant “chavisme sans Chavez” qui prétendent implanter leur propre interprétation bourgeoise de gauche d’un régime d’exploitation tout à fait semblable à celui de Maduro.
Nous avons vu qu’au Venezuela, il y a eu un grand nombre de protestations sous le régime chaviste. Pour la seule année 2018, 5 000 manifestations ont été comptabilisées (c’est-à-dire une moyenne de trente manifestations par jour), la majorité d’entre elles pour exiger des droits sociaux élémentaires comme de la nourriture, de l’eau, des services sociaux et de meilleurs salaires. Il faut signaler en particulier au cours de ces dernières années, les luttes des médecins et des infirmières qui ont non seulement osé défier les forces de répression de l’État, mais ont aussi montré une solidarité très typique d’une réaction de classe, en identifiant leurs intérêts avec ceux de leurs patients qui n’ont ni médicaments ni possibilité de soins et appelant à l’unité de leur lutte avec d’autres secteurs comme les enseignants et l’éducation. Cependant, ces luttes n’ont pas été épargnées par la pénétration des organisations syndicales et corporatistes afin de les contrôler et de les saboter, même s’il faut souligner le fait qu’il y avait une tendance à rejeter aussi bien le chavisme que les forces d’opposition pour tenter d’être plus autonomes dans leurs luttes. Les ouvriers doivent poursuivre leurs luttes contre le régime d’exploitation de la bourgeoisie sur leur propre terrain de classe. Dans ce combat, les ouvriers doivent essayer d’entraîner derrière eux les autres couches non exploiteuses de la société ; le prolétariat est la seule classe qui a la capacité de transformer l’indignation sociale en vrai programme politique de transformation sociale.
Les organisations révolutionnaires qui se réclament de la Gauche communiste, comme les minorités les plus politisées du Venezuela, de la région comme du monde entier doivent appeler au développement d’un mouvement sur les bases prolétariennes de la solidarité et de la lutte avec les masses exploitées comme celle du Venezuela dans n’importe quelle partie du globe. Le prolétariat mondial a une réponse à apporter face à cette perspective d’enfoncement dans la barbarie ; pour cela, il doit défendre bec et ongles son autonomie de classe, ce qui suppose le rejet de toutes les bandes bourgeoises rivales et l’affirmation de ses propres revendications en tant que classe ; la lutte pour l’unité de tous les ouvriers doit se construire autour du cri de ralliement : “D’ici ou d’ailleurs, partout, la même classe ouvrière !”
CCI, 12 février 2019
1) Pour comprendre, en profondeur et dans sa dimension historique, la notion de “décomposition du capitalisme”, lire nos “Thèses : La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste”, Revue internationale n° 107 (4e trimestre 2001),
2) Voir notre article “Crise au Venezuela : Le prolétariat exposé à la misère, au chaos et à la répression capitaliste”
3) Voir notre article lors de la mort de Chavez en mars 2013 : “Le legs de Chavez à la bourgeoisie : un programme de défense du capital, une grande mystification pour les masses appauvries”.
4) Nous avons dénoncé à de nombreuses reprises le “grand mensonge” du XXe siècle, à savoir le prétendu “communisme” des pays comme l’URSS, la Chine, Cuba, la Corée du Nord, etc. Voir en particulier notre article repris d’Internationalisme, organe de la Gauche communiste de France (1946) et publié dans la Revue Internationale n° 131 (4e trimestre 2007) : “L’expérience russe : propriété privée et propriété collective”. On peut aussi renvoyer à notre article en espagnol : “Cinq questions sur le communisme”, et aussi en espagnol : “20 ans après la chute du stalinisme, l’URSS était-elle un capitalisme d’État ou un “État ouvrier dégénéré” ?”.
5) Voir notamment l’article : “Derrière les opérations “humanitaires”, les grandes puissances font la guerre”, Revue internationale n° 71, (4e trimestre 1992), et l’article en espagnol : “Haïti : Derrière l’aide humanitaire, l’hypocrisie bourgeoise et l’affrontement impérialiste”.
6) Lire notre article : “Migrations en Amérique latine : seul le prolétariat peut arrêter la barbarie du capitalisme en décomposition”, Révolution Internationale n° 474, (janvier-février 2019).
Géographique:
- Vénézuela [25]
Rubrique:
Rassemblement National: le prolétariat doit rejeter les propos xénophobes et dénoncer les mensonges
- 97 reads
Dans son meeting du 24 février 2019, dans le nord de la France, la dirigeante du Rassemblement National a tenu des propos ignobles et mensongers sur le sort des migrants en France. Avec un aplomb sidérant, Marine Le Pen a prétendu qu’ “un migrant fraîchement débarqué peut toucher plus qu’un retraité ayant travaillé toute sa vie” ! Cette répugnante contrevérité accompagne l’idée que les migrants qui demandent aujourd’hui l’asile bénéficient non seulement d’une couverture de santé, comme la PUMA (Protection Universelle Maladie qui remplace depuis 2016 l’ancienne CMU de base), mais ont en plus des logements et transports gratuits. Ils cumuleraient, de surcroît, une “scandaleuse” et “gracieuse” allocation de survie.
Ces propos outranciers et nauséabonds, dont Jean-Marie Le Pen père n’aurait pas à rougir, ont été soigneusement démentis, chiffres à l’appui, par bon nombre de quotidiens qui ont aussi profité de cette “fake news” pour redorer l’image fortement ternie des médias. Il est évidemment complètement faux de prétendre que les migrants peuvent bénéficier de minima sociaux supérieurs à ceux des retraités les plus modestes. Comme le soulignent les “décodeurs” du journal Le Monde, les migrants ne constituent nullement une caste de “privilégiés” aux nombreux “avantages” (dont celui prétendu de l’Allocation de demandeurs d’Asile ou ADA). (1) Les montants des retraites les plus misérables représentent au moins le double de ce que peuvent espérer les migrants les mieux lotis.
Nul besoin de ces chiffres ou de “décodeurs” pour se rendre compte de la réalité misérable des migrants ! Madame Le Pen et sa clique de politiciens devraient se rendre une fois dans leur vie dans les quartiers pauvres de Paris ou à proximité de Calais pour mesurer l’absurdité insondable de propos dont le contenu ne va pas plus loin que le bout du nez de la pré-campagne électorale. Ils feraient bien de se rendre, par exemple, Porte de la Chapelle pour contempler le luxe des nombreuses tentes-igloos installées sous l’autoroute A1, ou Porte de Clignancourt, où, l’hiver, les migrants dormaient à même le sol en grelottant ! Les hébergements étant saturés, de nombreuses familles dorment dans la rue, parquées dans des conditions moins dignes que celles du bétail entassé en batterie. Mais elles doivent en plus endurer une répression policière quasi-quotidienne. Car, afin de “dissuader les installations” de fortunes, les flics s’appliquent à “déloger” ces pauvres gens, épuisés et sans ressources, en détruisant le peu qu’ils possèdent. Quel privilège pour ces misérables !
La réalité “décomplexée” de la politique migratoire des États démocratiques consiste, en effet, à utiliser ouvertement la maltraitance à des fins de “dissuasion”. À Calais déjà, du temps de la “jungle”, au nom du “ras-le-bol des riverains”, les politiciens applaudissaient des deux mains les brutalités des forces de l’ordre pour détruire les campements et chasser violemment les migrants. Plusieurs témoignages d’ONG et de migrants dénonçaient l’usage répété de “sprays au poivre” par les policiers, les gazages de nuit et le vol organisé des couvertures, des sacs de couchage, de chaussures, etc. Comme le souligne Démika N. (15 ans) à propos des gazages de nuit par les flics : “Vous ne voyez plus rien, vous ne vous rappelez plus de rien. Vous avez le sentiment qu’il vaudrait peut-être mieux vous tuer” (Témoignage recueilli par France Terre d’Asile).
Outre que l’attaque répugnante du Rassemblement National s’en prend ouvertement au “droit” d’asile (déjà ultra sélectif), les propos de Marine Le Pen constituent une sorte de clin d’œil à la composante populiste franchouillarde des “gilets jaunes”, pour les attirer vers les urnes et les encourager à voter aux élections européennes pour son parti politique au patronyme relooké. Profitant des relents xénophobes qui ont droit de cité dans le mouvement des “gilets jaunes”, le Rassemblement National espère au moins être au diapason de ceux qui avaient dénoncé aux autorités les migrants clandestins cachés dans un camion-citerne. (2)
En fin de compte, tout le discours nauséabond de Marine Le Pen s’inscrit dans les pratiques abjectes de l’État démocratique face aux migrants fuyant, toujours plus nombreux, la misère et la guerre : diviser la population, construire des murs, dresser des barbelés et réprimer brutalement. En multipliant les opérations de police et en bunkérisant les frontières, les migrants n’ont plus d’autre choix que de prendre de grands risques, notamment celui de couler à pic dans les eaux de la Méditerranée, pour rejoindre un illusoire Eldorado où ils seront parqués dans de nouveaux “camps de la honte”, réduits à la misère extrême et à l’exclusion.
Face aux calomnies que la bourgeoisie déverse sur tous ceux qui fuient la barbarie du capitalisme vers les supposées contrées dorées d’Occident, les ouvriers du monde entier doivent riposter et appeler à la solidarité de tous les exploités.
WH, 1er mars 2019
1) Pour prendre ce seul exemple, la majorité des migrants ne touche pas l’ADA, bon nombre en sont exclus. Même lorsqu’elle est versée, c’est-à-dire au compte goutte, cette aide est, selon Le Monde, “de 6,80 € par jour pour une personne seule, auxquels peuvent s’ajouter 7,40 € si aucune place d’hébergement ne lui a été proposée. Soit 440 € maximum par mois. En 2016, on dénombrait 76 100 bénéficiaires de cette aide, pour un coût total de 307,9 millions d’euros pour les finances publiques. À titre de comparaison, les huit principaux minima sociaux français représentaient environ 25 milliards d’euros la même année”.
2) Voir le supplément à Révolution Internationale n° 473 sur le mouvement des “gilets jaunes”.
Géographique:
- France [24]
Situations territoriales:
Rubrique:
Prise de position dans le camp révolutionnaire : Gilets jaunes : La nécessité de “réarmer le prolétariat”
- 236 reads
Nous publions ci-dessous un tract (signé “Fil Rouge”) sur le mouvement des “gilets jaunes”. Rédigé par des camarades issus de la tradition dite “bordiguiste”, ce tract représente une des rares voix de classe qui s’est manifestée au sujet des “gilets jaunes”. Ce mouvement, en dépit de la sympathie qu’il a pu susciter dans la population, reste extrêmement dangereux pour la conscience de classe du prolétariat. Sans lien avec la pratique héritée du mouvement ouvrier, exprimant des idéologies étrangères au prolétariat, nous l’avions dès le départ qualifié de mouvement “interclassiste”. Un certain nombre de prolétaires, parmi les plus fragilisés et marginalisés, ont en effet été entraînés dans le sillage de la révolte de petits patrons indépendants et autres couches petites bourgeoises. Le contenu du tract, à juste titre, fait mention de cette réalité. Bien que nous ne partagions pas tous les points d’analyse du tract (par exemples les notions d’indifferentisme et de classe moyenne, idées que nous critiquons et dont nous sommes prêts à débattre ultérieurement), nous le soutenons pleinement pour le diagnostic politique qu’il établit sur la nature de ce mouvement et pour l’orientation qu’il est capable de donner, celle de la nécessaire autonomie du prolétariat. Comme le disent les camarades, “la tâche des marxistes est donc de réarmer le prolétariat de sa doctrine et préparer la mort historique du capitalisme, réfutant dans le même temps toute l’idéologie des classes moyennes”. Le tract souligne que “notre bataille est celle d’une classe qui s’affronte au capitalisme mondial, à un complexe industriel qui parcourt la planète et met en relation les salariés du monde entier. Ce défi ne peut être affronté que par l’internationalisme et certainement pas par le localisme”. Ceci s’inscrit dans une démarche qui est celle de la tradition de la Gauche communiste, tant par le rejet de l’interclassisme que par la défense de l’autonomie de classe.
RI, 15 février 2018
Gilets jaunes : ni participation, ni indifférence
Les récentes mobilisations des gilets jaunes rendent visibles à la fois un processus de crise et une modification de l’équilibre social et constituent un exemple de l’érosion des “classes moyennes”. C’est un processus international produit de l’impérialisme et de la crise qui traverse le système capitaliste, basé sur les monopoles et la concurrence, et qui présente en France des caractéristiques particulières dues au “retard” historique du capitalisme français.
Dans les nations où la “révolution industrielle” s’est effectuée plus rapidement, comme l’Angleterre et l’Allemagne, le poids politique des classes moyennes a été bien plus marginal. En France, au contraire, ce sont la paysannerie, les artisans et la petite bourgeoisie qui furent les représentants sociaux des classes dirigeantes. De Napoléon jusqu’à nos jours, le pouvoir s’est appuyé sur ces couches sociales pour garantir sa stabilité basée sur le monde agricole et sur un réseau dense de villes de petite et moyenne dimension. Cette situation, ainsi que certaines conditions particulières du colonialisme français, expliquent pourquoi les principales métropoles se sont développées à la périphérie du pays. Le développement de métropoles à l’intérieur aurait détruit les équilibres de cette “France profonde”.
Sous la pression énorme de l’internationalisation de l’industrie et des flux financiers, ce bloc de classes se lézarde et finira par sauter. Les attaques du gouvernement Macron contre ces classes moyennes (en terme électoral, il se tire une balle dans le pied et avantage indirectement le Rassemblement National) est révélateur du processus de prolétarisation des classes moyennes pendant les périodes de turbulence économique du capitalisme.
D’un côté, le prolétariat, à travers l’automatisation de la production, le poids toujours plus grand de la finance, et par conséquent, l’augmentation du chômage, les coupes dans les budgets de la santé, de l’école et des services en général, se voit de plus en plus coupé du capital et de son État, d’un autre côté les classes moyennes doivent absorber le plat indigeste qui a suivi le banquet des soi-disant “Trente Glorieuses”. Et ce n’est pas un hasard si en Europe plusieurs gouvernements pensent réintroduire la conscription pour rétablir un lien entre eux et les citoyens en général et pour affronter les conflits internes et externes qui ne peuvent que se multiplier avec la crise.
Face à cette situation, les classes moyennes qui ont d’abord manifesté contre l’augmentation du prix des carburants en sont venues à la bataille contre la fiscalité et les taxes en général, tout en demandant à l’État français un renforcement du protectionnisme (contre les marchés internationaux). Un programme qui en France est réclamé aussi bien dans l’extrême-droite que dans l’extrême-gauche parlementaire.
La radicalité et la violence des manifestations (même si elles sont exagérées par les médias dans ce cas, notamment quand on fait la comparaison avec le nombre de manifestants comptabilisés lors du mouvement contre la Loi travail) sont des phénomènes endémiques des classes moyennes qui, lorsqu’elles sont attaquées, réagissent de manière schizophrénique, ne pouvant adopter un programme historique propre, et oscillant entre le parti de la bourgeoisie et celui du prolétariat.
Ce n’est pas un hasard si les mots d’ordre avancés sont anti-partis et anti-syndicats. Les bourgeois conséquents se servent eux de la politique (les partis) et utilisent les syndicats comme structure d’intégration de la classe salariée.
Il y a, inévitablement, au sein de ces mouvements “populaires”, des fractions du prolétariat, qui ne sont pas toutes liées à l’aristocratie ouvrière, poussées par les événements à participer à ces manifestations. La question des taxes sur les carburants, du coût des déplacements, sont des questions sociales qui se posent de manière transversale. Le poids politique du prolétariat dans ces mouvements est cependant dérisoire car la demande de défense des “privilèges” du passé est antagoniste avec sa nature qui, en tant que dernière des classes exploitées, a un programme historique d’abolition du système lui-même.
L’accusation récurrente faite aux révolutionnaires, à ceux qui défendent le programme communiste, est celle d’être des doctrinaires schématiques et donc d’être incapables de voir la diversité de la réalité, s’obstinant à séparer en deux, à la serpe, la société : d’un côté la bourgeoisie, de l’autre le prolétariat. A l’inverse, les démocrates rejettent les schémas dogmatiques de l’ “archéo-marxisme”, prétendant analyser la société suivant ses expressions multiformes et leur attribuer une valeur démocratique sinon de… progrès. Au sommet, se situeraient les grands propriétaires fonciers et les industriels les plus réactionnaires, partisans d’une réaction pré-bourgeoise. En dessous, la grande bourgeoisie industrielle et financière, conservatrice mais pas réactionnaire. En continuant à descendre l’échelle, on arrive aux classes moyennes qui, écrasées par les classes mentionnées précédemment, réclament la démocratie la plus large. Enfin, au plus bas étage, on trouve le prolétariat qui devrait s’allier, soit à la bourgeoisie en cas de danger ’d’involution autoritaire’, soit avec les classes moyennes lorsque des conquêtes démocratiques sont à réaliser, mais en ne lui reconnaissant jamais des buts propres en opposition à ceux de tout le corps social. Nous nous gardons bien de repousser l’accusation de schématisme doctrinaire, bien au contraire nous le revendiquons. Nous sommes schématiques en tant que nous nions aussi bien aux résidus de la classe des propriétaires fonciers ayant survécu à la révolution bourgeoise, qu’aux classes moyennes, la possibilité d’élaboration de buts historiques et d’un programme propre. Et nous le sommes en affirmant que le développement de la lutte de classe, et donc son issue historique seront déterminés par l’issue du choc entre bourgeoisie et prolétariat. Mais ceci n’empêche pas le parti prolétarien de reconnaître et d’analyser, à la lumière de la doctrine marxiste, l’existence d’autres classes que la bourgeoisie et le prolétariat, en particulier les classes moyennes, et d’élaborer un type d’actions tactiques à leur égard pour les attirer dans le camp de la lutte prolétarienne, sans pour autant concéder quoi que ce soit à leurs “exigences spécifiques” petites-bourgeoises. Et en se gardant tout au contraire du danger que leur idéologie hétéroclite ne s’instille au sein du parti prolétarien au risque de perdre sa physionomie de classe et l’empêcher de développer son rôle autonome. Car ce serait alors transférer ce rôle au grand capital qui est le représentant politique de ces classes moyennes.
La tâche des marxistes est donc de réarmer le prolétariat de sa doctrine et préparer la mort historique du capitalisme, réfutant dans le même temps toute l’idéologie des classes moyennes. La lutte ouverte et déclarée contre la mentalité et les préjugés petits-bourgeois ne veut absolument pas dire que nous donnons pour établi le fait que la petite bourgeoisie dans son ensemble se portera du côté du prolétariat, l’expérience historique nous ayant rendu plutôt pessimistes quant au choix que celle-ci effectuera lors du processus révolutionnaire. L’unique moyen pour attirer les classes moyennes petites bourgeoises du côté de la classe ouvrière est de combattre vaillamment leur idéologie et, sans attendre que notre propagande puisse avoir un large succès, expliquer que le capitalisme, inévitablement, les prolétarisera et qu’en conséquence, leur seule voie de salut est (non comme petits-bourgeois mais comme prolétaires de demain) d’appuyer la lutte pour l’émancipation du prolétariat, laquelle est aussi celle de l’espèce humaine. Ce qui caractérise principalement les classes moyennes, c’est leur indétermination, leur capacité à passer avec la plus grande facilité d’une position à son opposé. La très grande hétérogénéité de ces couches sociales les divise en trois parties du point de vue de leur destinée future : une partie disparaîtra sous le régime de production capitaliste lui-même ; une autre partie, du fait du caractère non homogène du développement capitaliste, survivra, au moins pour une certaine période, au sein du régime bourgeois ; une dernière se fondra dans la nouvelle organisation économique socialisée.
La défense du programme communiste se manifeste également dans le fait de refuser tout localisme, tout protectionnisme archaïque, de céder aux requêtes des classes moyennes et de l’aristocratie ouvrière qui, au nom de la défense des droits des travailleurs, face à la menace de la misère représentée par les travailleurs immigrés, demandent de manière plus ou moins voilée de nouvelles barrières. Notre bataille est celle d’une classe qui s’affronte au capitalisme mondial, à un complexe industriel qui parcourt la planète et met en relation les salariés du monde entier. Ce défi ne peut être affronté que par l’internationalisme et certainement pas par le localisme.
Face au mouvement actuel des gilets jaunes, nous ne sommes ni participants ni indifférents. La prolétarisation de nouvelles couches sociales est une loi du système capitaliste.
Cette prolétarisation ne doit pas pousser les communistes à défendre le “vieux monde” mais signifie au contraire saluer l’augmentation de l’armée prolétarienne dans sa lutte titanesque, bien qu’encore souterraine aujourd’hui, contre le monstre Capital. Ne pas accepter cette position, c’est succomber face à notre ennemi historique, le parti de la bourgeoisie, en donnant de la force, inconsciemment ou non, à de nouveaux mouvements réactionnaires de masse.
POUR L’AUTONOMIE PROLETARIENNE !
POUR LE PARTI DE CLASSE !
Le Fil Rouge
Vie du CCI:
Situations territoriales:
Rubrique:
Affaire Finkielkraut: un académicien au-dessus de tout soupçon ?
- 172 reads
L’agression verbale contre le “philosophe” Alain Finkielkraut par un groupe de “gilets jaunes” lors de la manifestation du 16 février à Paris a donné lieu à une levée de boucliers générale de toute la classe politique et à une gigantesque campagne d’union nationale contre l’ignominie de l’antisémitisme.
Même Marine Le Pen (dont le père, fondateur du FN, avait affirmé que les chambres à gaz de la Shoah n’étaient qu’un “détail” de l’histoire !) a tenu à exprimer son soutien à Finkielkraut : “L’agression d’Alain Finkielkraut aujourd’hui est un acte détestable et choquant, qui illustre la tentative d’infiltration du mouvement des “gilets jaunes” par l’extrême-gauche (pourquoi pas l’extrême-droite alors, NDLR ?) antisémite”.
Alors que Finkielkraut lui-même déclarait sur LCI : “on ne m’a pas traité de sale juif. Et on ne m’a jamais traité de sale juif”, toute la classe politique, du RN au PCF, a néanmoins sauté sur l’événement pour surjouer l’indignation, exploiter l’incident en s’affichant en hérauts de la lutte contre l’antisémitisme et pour ériger Finkielkraut en martyr de la nouvelle “peste brune”.
Bien évidemment, personne ne peut ni soutenir ni “excuser” les propos répugnants de ces “gilets jaunes” pro-salafistes, qui ont permis de monter en épingle ce fait divers. “Barre-toi, sale sioniste de merde”, “Nous sommes le peuple”, “La France, elle est à nous”, “Rentre chez toi en Israël”, “Tu vas mourir”. Ces insultes ou menaces sont d’ailleurs de la même veine que les propos xénophobes proférés, au début du mouvement, par d’autres “gilets jaunes” qui avaient dénoncé à la gendarmerie des migrants clandestins cachés dans un camion-citerne : “c’est encore avec nos impôts qu’on va payer pour ces enculés !”.
Finkielkraut étant devenu une star nationale, il n’est pas inutile de rappeler son curriculum vitae politique. “Finkie” fait partie de ces anciens gauchistes soixante-huitards (principalement des maoïstes) qui ont retourné leur veste pour s’intégrer dans la société capitaliste comme idéologues patentés au service de la classe dominante. Au palmarès de cette intelligentsia qui a fait ses choux gras des décombres du mouvement de Mai 68, on trouve Daniel Cohn-Bendit (devenu président des “Verts” au Parlement européen), Bernard Kouchner (ex-ministre “socialiste”, puis du gouvernement Fillon), Serge July (grand patron de la médiasphère, dont le journal Libération était financé par le banquier Édouard de Rothschild) et la brochette des “nouveaux philosophes” : André Glucksmann (devenu un “fan” de Nicolas Sarkozy), BHL (dandy en chemise blanche des plateaux TV), Alain Finkielkraut (pédant candidat à l’Académie française)… Ces arrivistes, anciens adeptes du Petit Livre rouge de Mao, se sont reconvertis en défenseurs zélés de l’ordre capitaliste, d’abord en faisant leurs classes comme supporters du PS et de Mitterrand, puis en penchant vers la droite néolibérale avant d’apporter leurs voix à Émmanuel Macron aux dernières présidentielles. Dans une interview en juillet-août 1988, Finkielkraut expliquait dans Passages :
“J’avais l’impression que le fait d’être juif faisait de moi le porte-parole naturel des opprimés : les Black Panthers aux États-Unis, les peuples colonisés. Je croyais qu’il y avait a priori une sorte de fraternité des victimes de l’histoire.
– Je suppose que vous vous sentiez solidaire des Palestiniens ?
– Non, jamais”... No comment !
Parmi les ex-gauchistes de Mai 68, seul Guy Hocquenghem avait pu garder un minimum de dignité, comme en témoigne son pamphlet : Lettre ouverte à ceux qui sont passé du col Mao au Rotary. C’est en ces termes cinglants que Hocquenghem s’adressait en 1986, deux ans avant sa mort, à ses anciens camarades renégats : “Cher ex-contestataires, le retour de la droite ne vous rendra pas votre jeunesse. Mais c’est bien la gauche au pouvoir qui vous l’a fait perdre. Définitivement. Ce fut sous Mitterrand que vous vous êtes “normalisés” ; et sous Fabius que vous avez viré votre cuti. Pour devenir les néo-bourgeois des années 1980, les maos-gauchos-contestos crachant sur leur passé ont profité de l’hypocrisie nationale que fut le pouvoir socialiste. Sous lui, ils s’installèrent dans tous les fromages. Plus que personne, ils s’en goinfrèrent. Deux reniements ainsi se sont alliés : celui des “ex” de Mai 68 devenus conseillers ministériels, patrons de choc ou nouveaux guerriers en chambre, et celui du socialisme passé plus à droite que la droite. Votre apostasie servit d’aiguillon à celle de la gauche officielle”.
Toute cette clique d’anciens soixante-huitards repentis (dont le fonds de commerce a consisté d’abord à dénoncer le marxisme comme étant l’idéologie totalitaire du stalinisme et à faire un parallèle plus que douteux entre le nazisme et le marxisme) se sont particulièrement distingués par leur soutien à toutes les croisades impérialistes du camp “démocratique” pro-américain.
Les “nouveaux philosophes” BHL, Glucksmann et Finkielkraut, après avoir fustigé dans leurs jeunes années l’ “impérialisme yankee” pendant la guerre du Vietnam, n’ont eu aucun scrupule à soutenir ce même impérialisme dans la guerre du Golfe en 1991, au nom d’un combat “humanitaire” contre le dictateur Saddam Hussein. Ainsi, Alain Finkielkraut avait-il affirmé être “exaspéré par le pacifisme” et qualifié l’intervention militaire de la coalition pro-américaine contre l’Irak de “guerre moralement juste”. Une guerre “moralement juste” avec ses frappes aériennes intensives, expérimentant les bombes à effets de souffle qui retournaient les soldats irakiens comme des gants ? Une guerre “moralement juste” qui a provoqué plus de 100 000 morts parmi les soldats irakiens et autant dans la population civile victime des “dommages collatéraux” de l’opération “Tempête du désert” commanditée par Georges Bush ? Les discours bellicistes de Finkielkraut en disent long sur la “morale” nauséabonde de ce “nouveau philosophe”, tout comme son engagement, aux côtés de son ami BHL dans le soutien sans faille à l’intervention militaire occidentale en ex-Yougoslavie (toujours au nom de la même “juste” cause : l’hypocrite croisade “humanitaire” contre les dictateurs sanguinaires). Déjà, lors de la guerre du Kippour en 1973, le va-t’en guerre Finkielkraut avait été l’un des premiers “intellectuels” à soutenir l’État impérialiste d’Israël.
Finkielkraut s’offusque d’avoir été traité de “raciste” par les “gilets jaunes” qui l’ont agressé. Faut-il rappeler cette déclaration qu’il avait faite, au lendemain des émeutes des banlieues de l’automne 2005 : “Le problème est que la plupart de ces jeunes sont des Noirs ou des Arabes avec une identité musulmane. Regardez ! En France il y a aussi des immigrés dont la situation est difficile (des Chinois, des Vietnamiens, des Portugais) et ils ne prennent pas part aux émeutes. C’est pourquoi il est clair que cette révolte a un caractère ethnique et religieux” (Interview au quotidien israélien Haaretz, retranscrite par le journal Le Monde).
Cette sortie de Finkielkraut se situe, en réalité, dans la droite ligne des discours “sécuritaires” (de sinistre mémoire) de l’ex-Premier flic de France, Nicolas Sarkozy :
“Dès demain, on va nettoyer au Karcher la cité. On y mettra les effectifs nécessaires et le temps qu’il faudra, mais ça sera nettoyé !” (19 juin 2005, dans la “cité des 4 000” à La Courneuve, après la mort d’un enfant de 11 ans tué lors d’une rixe entre deux bandes rivales) ;
“Vous en avez assez de cette bande de racaille ? Eh bien, on va vous en débarrasser !” (25 octobre 2005, lors d’une visite de Sarkozy dans le quartier de la dalle d’Argenteuil).
Ce sont ces propos musclés de Sarkozy (dont la candidature à la Présidentielle de 2007 a été soutenue par André Glucksmann, un des meilleurs “potes” de Finkielkraut) qui avaient contribué à déclencher les émeutes des banlieues, en novembre 2005 (après la mort à Clichy-sous-Bois [28] de deux adolescents, électrocutés dans l’enceinte d’un poste électrique alors qu’ils cherchaient à échapper à un contrôle de police [29]).
Il n’est guère surprenant que Finkielkraut ait bénéficié du plein soutien de Nicolas Sarkozy face à l’opposition farouche de certains “Immortels” qui voulaient le virer de l’Académie française, estimant que cet homme de lettres était décidément un peu trop “réac” pour briguer un siège à la Coupole : “Que l’on ait pu si violemment s’opposer à la candidature à l’Académie française d’un de nos plus brillants intellectuels (…) est à pleurer de bêtise”. (Sarkozy, cité dans l’hebdomadaire Le Point).
Parmi les autres bavures verbales de ce “brillant intellectuel” et éminent tribun de la droite, on peut encore signaler ce persiflage à propos de l’équipe de France de football : “Les gens disent que l’équipe nationale française est admirée par tous parce qu’elle est black-blanc-beur. En fait, l’équipe de France est aujourd’hui black-black-black, ce qui provoque des ricanements dans toute l’Europe”.
Finkielkraut est aujourd’hui la figure emblématique de la mobilisation contre l’antisémitisme. Ses protestations indignées face aux injures le qualifiant de “raciste” ne sont que la feuille de vigne derrière laquelle se cache l’islamophobie (à peine voilée) de ce “brillant intellectuel” érigé en héros national depuis son agression du 16 février. C’est bien pour cela que Marine Le Pen lui a témoigné également sa “solidarité”.
Pour paraphraser Marx (qui avait stigmatisé la Misère de la philosophie du socialiste bourgeois Proudhon), on est en droit de s’écrier : misère de la “nouvelle philosophie” !
Ces nouveaux “philosophes”, arrivistes et anciens maos défroqués, ne sont que les dignes maîtres à penser de la bourgeoisie décadente. Leur idéologie nationaliste, sioniste et militariste n’a pas grand-chose à envier ni au fanatisme réactionnaire des islamistes, ni à l’islamophobie des troupes de choc du Rassemblement National.
Marianne, 1er mars 2019
Géographique:
- France [24]
Situations territoriales:
Rubrique:
Réfugiés de la guerre d’Espagne en 1939: l’hypocrite “asile démocratique” des camps d’internement
- 288 reads
Fin janvier 1939 avait lieu le premier grand exode de population en Europe occidentale, la retirada (la retraite) espagnole.
Un effroyable exode
Près d’un demi-million d’espagnols, en grande partie des civils (dont des femmes, des enfants et des vieillards) fuyaient vers la frontière des Pyrénées. Une véritable tragédie pour une population déjà martyrisée par la guerre civile. Dès 1936, une première vague de 15 000 réfugiés s’était dirigée vers Hendaye suite à la prise du Pays basque et des Asturies par les troupes franquistes insurgées. Au cours de l’année 1937, une deuxième vague de 120 000 civils quittait le territoire espagnol à la fin de la campagne du Nord pour échapper aux massacres et à la misère. Mais l’ultime épisode de l’hiver 1939, avec la prise de la Catalogne et la chute de Barcelone, a provoqué un départ forcé et massif vers un nouvel enfer. Nombreux sont les témoignages de souffrances et d’angoisses liées à l’exode : “On était tous des réfugiés”, raconte Henri Melich, évoquant les bombardements, la longue attente à la frontière, les fouilles. “Jusqu’à ce qu’on arrive, on ne savait pas où on allait”. “On est venus avec une charrette, il y avait trois familles dedans, moi j’avais 13 ans, je marchais à côté de mon père”.
Comme pour Henri Melich, “les réfugiés se pressent à la frontière pour échapper à la vindicte des vainqueurs. Ils arrivent souvent à pied, à travers la montagne, malgré les rigueurs de l’hiver. Après avoir patienté plusieurs jours avant d’être autorisés à entrer sur le territoire, les femmes et les enfants sont dirigés vers des régions éloignées des Pyrénées et les hommes de moins de 50 ans sont conduits vers des camps improvisés à la hâte sur les plages du Roussillon. Les familles sont dispersées sur tout le territoire. Une dernière vague de réfugiés quitte le sud-est de l’Espagne fin mars et gagne l’Algérie par bateaux”. (1)
Les autorités françaises contrôlaient militairement, avec une brutalité inouïe, les différents points de passage. Un travail systématique d’identification et de fichage policier était effectué au préalable ; les soldats espagnols de l’armée “républicaine” étaient désarmés. Le long de la frontière s’est effectué, de manière expéditive, un semblant de ravitaillement et de vaccinations. La fatigue, la faim, le froid… Les réfugiés n’étaient pourtant qu’au début de leur calvaire ! Ils allaient découvrir l’abomination des camps, l’ignoble réalité de l’État “démocratique” français, sous le gouvernement du “républicain” Daladier.
L’ “asile” des camps de concentration
Des camps de “recueils” comme à Amélie-les-Bains, Le Boulou, etc., ont reçu les premiers réfugiés hagards, épuisés, affamés et crevant de froid. Ils étaient également internés dans d’autres lieux “d’hébergement”, comme Rieucros (ouvert le 21 janvier 1939), officiellement qualifiés de “camps de concentration”. Le ministre Albert Sarraut affirmait ainsi à propos de ces camps d’ “accueil” : “le camp d’Argelès-sur-Mer ne sera pas un lieu pénitentiaire, mais un camp de concentration. Ce n’est pas la même chose”. (2)
Ces camps en France préfigurent l’univers concentrationnaire qui va se développer un peu partout en Europe durant et après la Seconde Guerre mondiale. En mars 1939 on comptait ainsi 90 000 réfugiés à Saint-Cyprien, 50 000 à Barcarès, 77 000 à Argelès, etc. Les nombreux camps de “concentration” du Roussillon s’organisaient ainsi : “trois côtés hérissés de barbelés, le quatrième ouvert sur la mer. Dans chaque camp, un endroit disciplinaire, avec un poteau auquel on attache les récalcitrants ; les motifs de châtiment sont variables : de l’accusation de faire de la politique au refus de saluer un gardien. Les conditions de vie sont déplorables : absence d’hygiène, malnutrition, promiscuité”. (3)
Les réfugiés étaient traités comme des “indésirables” et des “pestiférés”, particulièrement ceux suspectés de “troubler l’ordre public”, surtout les “révolutionnaires”. Des camps étaient spécialement aménagés pour les réfugiés politiques, comme celui de Septfonds, où ont été parqués de nombreux exilés se revendiquant communistes. Dans le camp du Vernet, ont été incarcérés des anarchistes (parmi lesquels les combattants de la colonne Durruti). Ces camps disciplinaires étaient de véritables horreurs. Arthur Koestler, par certains points, comparait le camp du Vernet à celui de Dachau en Allemagne. Il allait même jusqu’à affirmer que : “au point de vue de la nourriture, de l’installation et de l’hygiène, Le Vernet était en dessous d’un camp de concentration nazi”. (4)
Les premières semaines, après avoir franchi la frontière, tous les réfugiés étaient parqués derrière des barbelés qu’ils étaient forcés de dresser souvent eux-mêmes. On leur lançait du pain, il n’y avait pas de cantine. Ils n’avaient souvent rien à boire, excepté l’eau de mer. Sans abris, ils ont été obligés, comme à Argelès, de creuser des trous dans le sable dès le premier soir de leur arrivée sur le territoire français, pour pouvoir dormir et se protéger du froid. Parfois, leur lit de fortune devenait leur propre tombe. Très rapidement, leurs corps affaiblis étaient infestés de parasites et de maladies : aux punaises et à la gale, s’ajoutaient la tuberculose, la pneumonie, la dysenterie, la typhoïde, le paludisme, etc. Les secours sanitaires de la Croix-Rouge ont tardé à arriver. Selon l’historien B. Bennassar, entre 5 000 et 14 600 réfugiés espagnols seraient morts dans ces camps uniquement au cours des six premiers mois de l’exode ! La promiscuité, l’absence d’intimité et les humiliations étaient quotidiennes, tout comme les brimades et les punitions des gardes chiourmes de l’État français. La moindre révolte entraînait des représailles ignobles infligées par les militaires, les tirailleurs sénégalais ou les gendarmes. À Argelès, par exemple, les réfugiés récalcitrants étaient enfermés nus et on les empêchait de dormir la nuit. (5) Dans les camps à vocation disciplinaire, l’humiliation et les exactions étaient accompagnées d’une répression féroce contre les réfugiés suspectés d’être des militants de la classe ouvrière. Certains ont été enfermés dans des cellules insalubres et humides, comme au château de Collioure. Il n’était pas rare que des réfugiés politiques finissent par mourir sous les coups des sévices corporels et de la torture. Un rapporteur de la commission internationale d’aide aux enfants réfugiés décrivait le camp de Bois-Brûlé (dans le Loir-et-Cher) comme “l’un des pires” qu’il ait visités : “Environ 250 réfugiés étaient installés dans des baraques sales, dans lesquelles la température était proche de zéro (…) Le sol était maculé d’urine gelée”.
Carmen Martin, née Lazaro, venant de Saragosse, témoigne ainsi de son internement dans ce camp : “J’ai le souvenir qu’avec d’autres de nos compatriotes, nous avons été poussés dans des wagons à bestiaux. On a dit aux mères que nous allions nous diriger vers le camp de concentration du Bois-Brûlé. Dans ce train on nous vaccinait (avec des produits périmés !) et j’en ai été très malade. Nous avons donc attendu dans ce camp jusqu’en février 1940. Nous y avons souffert de froid car l’hiver fut très rude, et de malnutrition (un pain qui gelait dans la journée, pour sept personnes et une boîte de conserve contenant un bouillon chaud)”. Par ailleurs, bon nombre de réfugiés allaient être utilisés un peu partout comme main d’œuvre corvéable à merci, surexploitées, pour les besoins de l’économie de guerre de l’impérialisme français. Ce fut le cas, par exemple, dans les travaux agricoles au sud de la France ou dans les mines de charbon (notamment celles de Decazeville). Bon nombre furent par la suite enrôlés comme chair à canon dans la Résistance et dans l’armée française (notamment dans la Légion étrangère). (6) Les “échappés de l’enfer espagnol étaient transformés en soldats de l’impérialisme français”. (7) Tous ceux qui tentaient de revenir en Espagne ou étaient refoulés par les autorités françaises, risquaient de passer devant les pelotons d’exécution franquistes ! Parmi ceux qui sont restés en France, beaucoup ont été finalement déportés dans les camps nazis.
La mystification de l’Eldorado démocratique
La sinistre réalité des camps de réfugiés espagnols en France, longtemps passée sous silence et méconnue, a donné lieu à un discours officiel mensonger tendant à opposer “l’humanité” du Front populaire, sa “générosité” à celle de la “dureté” d’une “droite conservatrice” sous le gouvernement de Daladier (qui était pour sa part “radical-socialiste”). Ainsi, la tradition française du prétendu “droit d’asile” et les “valeurs républicaines” n’auraient été bafouées que par quelques “années noires”. Pur mensonge ! La réalité des conditions abominables de survie de ces masses de réfugiés vient contredire cette sinistre fable. Elle dévoile la parfaite continuité entre les mesures de répression policières et les discours xénophobes. Cela, bien avant le Front populaire ! La méfiance et les préjugés obscurantistes envers ces “étrangers” considérés comme du bétail, était bien ancrée dans la population de leur “terre d’accueil”. Mais surtout, il fallait faire la chasse aux “indésirables” soupçonnés d’être venus sur le territoire français comme “fauteurs de troubles”. Les militants ouvriers étaient considérés et traités comme de véritables criminels. En témoignent ces propos du ministre de l’Intérieur Roger Salengro, déjà en 1936 : “il m’est signalé que des réfugiés espagnols sur notre territoire se livreraient à une active propagande anarchiste. J’ai l’honneur de vous prier de vouloir suivre très attentivement ces menées dont les auteurs devront faire l’objet d’une surveillance étroite à l’égard desquels vous voudrez bien prendre ou me proposer telle mesure d’éloignement que vous jugerez utile (…) Je précise à ce sujet que tout refoulement de ressortissant espagnol jugé indésirable en France en raison de ses agissements révolutionnaires ne pourra s’effectuer que par le poste frontière de Cerbère”. (8) C’est dans la même veine que son successeur Albert Sarraut (ministre du second gouvernement de Léon Blum avant que ce dernier ne démissionne en avril 1938), s’est distingué par ses discours musclés et ses diatribes xénophobes. C’est en ces termes que ce ministre radical-socialiste, inspiré par la paranoïa d’État et la haine des “communistes” et des anarchistes, qualifiait les réfugiés politiques espagnols : “l’élément trouble et louche de l’exode espagnol”, les “hors la loi”, “ces déchets d’humanité qui ont perdu tout sens moral et qui constitueraient un très grave danger pour nous si nous les conservions sur notre sol”. Ce sont des “détritus”. “Les instructions les plus sévères ont été données aux préfets, à tous les services de police sur le territoire pour fouiller tous les milieux et resserrer aussi étroitement que possible les mailles de la surveillance sur tous les cénacles étrangers. Tous les jours nous cherchons, nous raflons, nous épurons ; nos prisons en savent quelque chose”. (9)
Un tel zèle montre qu’avant la mise en place des camps et la chasse aux militants réfugiés de 1939, il était déjà difficile de passer entre les mailles de la répression. La propagande bourgeoise a pu s’appuyer sur les horreurs bien réelles du franquisme pour tenter de minimiser et d’occulter la propre responsabilité et les propres crimes du “camp démocratique” avant et pendant la Guerre. C’est pour cela, entre autres, que le sort des réfugiés espagnols est longtemps passé sous silence au profit de l’hyper médiatisation des camps nazis. En réalité, il n’y a pas de différence de nature entre ces deux régimes politiques, entre la barbarie fasciste, nazie ou franquiste et celle des États démocratiques. Ils sont tous un produit du même système capitaliste et expriment la même réalité de la société capitaliste décadente. Dans tous les cas, la démocratie reste le plus subtil des moyens de domination et de justification de la guerre et le meilleur moyen de masquer ses propres crimes.
Face aux traitements infligés à tous les réfugiés espagnols, à la répression et de la barbarie contre les civils, nous ne pouvons que rappeler la célèbre dénonciation de la guerre impérialiste par Rosa Luxemburg : “Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu’elle est. Ce n’est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l’ordre, de la paix et du droit, c’est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l’anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l’humanité qu’elle se montre toute nue, telle qu’elle est vraiment”. (10)
WH, 28 janvier 2019
1) “Réfugiés espagnols : quand la France choisissait l’infamie”, Libération (9 septembre 2015).
2) Geneviève Dreyfus-Armand, Émile Témime, Les Camps sur la plage, un exil espagnol. (Le “camp de concentration” est une appellation administrative des autorités françaises).
3) P.-J. Deschod, F. Huguenin, La République xénophobe (2001).
4) Cité et repris de Arthur Koestler, La lie de la terre (1947).
5) Selon le témoignage de la mère d’un militant du CCI, qui a été internée pendant onze mois à Argelès, la décision par le médecin du camp d’hospitaliser un enfant en bas âge équivalait à une condamnation à mort : les religieuses qui exerçaient le métier d’infirmière à l’hôpital de Perpignan n’apportaient aucun soin à ces “enfants de rouges” dont les parents étaient tous considérés comme des persécuteurs des membres de l’Église au cours de la guerre d’Espagne. Cette réalité a été confirmée par la propre mère de cette réfugiée qui a séjourné dans cet hôpital avec son bébé au début 1940. C’est pour cela qu’on pouvait assister près des barbelés à ces scènes insupportables de mères en pleurs essayant d’empêcher qu’on enlève leur enfant et qui étaient repoussées à coups de crosse par les gendarmes.
6) Les premiers chars alliés qui sont entrés dans Paris le 24 août 1944, ceux de la 9e Compagnie de la 2e DB de Leclerc, “la Nueve”, sont conduits par des réfugiés espagnols.
7) “Semailles d’un carnage impérialiste”, Communisme n° 23 (15 février 1939).
8) Circulaire du 3 novembre 1936 du ministre de l’Intérieur, Roger Salengro.
9) Séances du 10 et 14 mars 1939 à la Chambre des députés in La République xénophobe.
10) Rosa Luxemburg, Brochure de Junius (1915).
Evènements historiques:
- Guerre d'Espagne [30]
Rubrique:
Réunions publiques sur la révolution allemande: réponse à la CWO sur la question des fractions de gauche
- 137 reads
En novembre 2018, les deux principales organisations de la Gauche Communiste en Grande-Bretagne, le CCI et la Communist Workers Organisation (1), ont organisé des réunions publiques à Londres sur le centenaire de la révolution allemande. Il ressort nettement de ces deux réunions qu’il y a un consensus fondamental sur un certain nombre de points-clés de cette expérience :
— L’importance historique immense de la révolution allemande comme tournant dans la révolution mondiale, débutée en Russie, et les conséquences tragiques de sa défaite : l’isolement et la dégénérescence de la Révolution russe, puis le triomphe général de la contre-révolution sous des formes fascistes, staliniennes et démocratiques qui ont préparé le terrain de la Seconde Guerre mondiale ;
— La trahison irréversible des parties de la social-démocratie qui se sont ralliées à l’effort de guerre de la classe dominante, puis ont joué un rôle central dans le sabotage et la répression de la révolution qui a surgi en réaction au carnage. Dans tout futur assaut révolutionnaire, ce seront les factions de gauche de la bourgeoisie, les véritables héritiers de Noske, Scheidemann et des autres agents de la contre-révolution, qui seront utilisées par le capital comme dernier rempart contre le prolétariat.
— L’importance cruciale de la lutte pour un parti communiste afin de combattre les mensonges des sbires de la bourgeoisie et de proposer une alternative révolutionnaire claire et cohérente. Un tel parti ne peut être centralisé qu’à l’échelle mondiale puisque la révolution elle-même ne peut réussir que sur la scène mondiale. Comme l’a dit la CWO dans son article : L’importance de la révolution allemande : Réflexions sur la réunion publique CWO/TCI à Londres, le 17 novembre 2018 [31], “sans un noyau révolutionnaire de la classe ouvrière autour duquel un parti peut se construire, il n’y a pas la moindre chance que nous ressortions victorieux de cette lutte”.
Pourtant, il y a aussi des désaccords nets et précis entre nos deux organisations, qui sont apparus lors de la réunion publique de la CWO et qui ont été débattus la semaine suivante lors de la réunion du CCI, à laquelle a participé un membre de la CWO (2). Ces désaccords sont soulevés dans l’article de la CWO mentionné ci-dessus :
“Compte tenu de ce scénario, il était donc surprenant qu’un membre du Courant Communiste International (la seule autre organisation présente à la réunion) et dont les autres camarades avaient apporté des contributions positives à la discussion, avance qu’il aurait été prématuré pour le groupe internationaliste de quitter la Social-démocratie allemande en août 1914. Il a étonnamment soutenu qu’août 1914 n’était pas une trahison définitive du mouvement ouvrier international.
Il a ajouté que, le CCI et la TCI étant toutes deux issues de la tradition de la gauche communiste italienne, nous devrions reconnaître que c’était exactement comme les membres du Parti communiste italien (PCd'I) qui sont partis en exil dans les années 1920. Ils avaient vu le parti qu’ils avaient fondé être repris par les “centristes” comme Gramsci et Togliatti, avec le soutien de l’Internationale Communiste (même si la Gauche avait toujours le soutien de la majorité du PCd'I). Cependant, comme ils n’avaient aucune preuve évidente que cela signifiait que la Troisième Internationale avait définitivement et irrévocablement rompu avec la révolution internationale (étant donné les brusques changements de politique du Komintern, c’était une période de grande confusion), ils décidèrent de se former en une “fraction”. Le but de la Fraction était soit de persuader le Komintern de s’en tenir à l’internationalisme révolutionnaire, soit, si cela échouait et que l’Internationale faisait quelque chose qui montrait clairement qu’elle avait trahi la classe ouvrière, alors la fraction devrait former le noyau du nouveau parti. En fait, la Fraction décida en 1935 que le Komintern était passé de l’autre côté des barrières de classe (avec l’adoption du Front Populaire). Cependant, elle était alors divisée entre les partisans de Vercesi, qui soutenaient désormais que le parti ne pouvait être formé que dans des conditions où il pouvait gagner une masse de partisans (comme Luxemburg), et ceux qui voulaient commencer à le construire dans les années 1930. Le problème n’a jamais été résolu et la Fraction s’est effondrée en 1939.
Nous avons répondu que les cas de l’Allemagne en 1914 et des camarades italiens dans les années 1920 étaient tous deux différents. Comme le montre l’analyse précédente, le vote du SPD en faveur des crédits de guerre était une trahison claire et évidente de la cause de la classe ouvrière. Et ce jugement n’est pas le fruit d’un examen rétrospectif. Il y avait d’autres socialistes à l’époque (comme Lénine, mais pas seulement) qui le clamaient haut et fort. Il fallait une nouvelle bannière autour de laquelle la classe ouvrière révolutionnaire pourrait se rallier. Plus vite cette bannière serait levée, plus vite les révolutionnaires pourraient se mettre au travail afin de construire le mouvement qui, tôt ou tard, se sortirait de la guerre. Et le fait que l’Allemagne était un État fédéral imbibé de nationalisme rendit cette tâche d’autant plus urgente”.
Les réelles tâches d’une fraction révolutionnaire
Nous avons abondamment cité la CWO car nous voulions nous assurer que notre réponse tenait compte fidèlement de leurs points de vue. Mais, ce faisant, nous devrons faire ressortir certaines inexactitudes importantes dans le compte-rendu de la CWO, tant en ce qui concerne certains éléments historiques que dans notre propre compréhension de ceux-ci.
Tout d’abord, il est trompeur de dire que, pour le CCI, “Août 1914 ne signifiait pas la trahison définitive du mouvement ouvrier international”. Bien au contraire : la capitulation de la majorité des sociaux-démocrates, à l’intérieur comme à l’extérieur du Parlement, était en effet une trahison incontestable de tout ce que la social-démocratie internationale avait défendu et voté lors des grands congrès internationaux. Cela a confirmé que la droite opportuniste de la social-démocratie contre laquelle des militants, comme Luxemburg, luttaient avec détermination bien avant la fin du XIXe siècle, avait franchi la frontière du camp ennemi, frontière pour laquelle il ne pouvait y avoir retour en arrière.
Ce que nous voulions souligner, cependant, c’est que la trahison d’une grande partie de l’organisation ne signifiait pas encore que l’ensemble du parti avait été intégré à l’État capitaliste, précisément parce que, contrairement à ce que disent certains anarchistes, la social-démocratie n’a pas toujours été bourgeoise. La trahison d’août 1914 a donné lieu à une énorme lutte au sein du parti, à un flot de réactions contre la trahison, souvent confuses et inadéquates, limitées par des conceptions centristes et pacifistes, mais exprimant toujours fondamentalement une réaction prolétarienne internationaliste contre la guerre. Les plus clairs, les plus déterminés et les plus célèbres d’entre eux étaient les spartakistes. Tant que cette lutte se poursuivait, tant que les différentes oppositions à la nouvelle ligne officielle pouvaient encore opérer au sein du parti, la question de la fraction, d’une lutte interne organisée pour “l’âme” du parti, jusqu’à la disparition des traîtres ou l’expulsion des internationalistes, était toujours pertinente (3).
Dans un texte de discussion interne sur la nature du centrisme, que nous avons publié en 2015, notre camarade Marc Chirik a donné un grand nombre d’exemples du mouvement d’opposition au sein du SPD après août 1914, tant au parlement que dans le parti dans son ensemble. L’expression la plus ferme de cette réaction a été donnée par le groupe autour de Luxemburg et Liebknecht, qui n’a pas attendu que la classe se mobilise massivement, mais qui, dès le premier jour de la guerre, a organisé sa résistance dans ce qui deviendra par la suite le Spartakusbund et a essayé de réunir les forces internationales autour du slogan “Ne laissez pas le Parti aux mains de traîtres”. Peu de temps après, il y eut la décision de nombreux députés de ne pas voter en faveur de crédits de guerre supplémentaires ; les résolutions de nombreuses branches locales du SPD pour que les dirigeants abandonnent la politique de l’Union sacrée ; la formation du “collectif de travail social-démocrate” qui constituerait plus tard le noyau du Parti social-démocrate indépendant d’Allemagne, l’USPD ; la publication de tracts et de programmes, l’appel aux manifestations contre la guerre et en solidarité avec Karl Liebknecht pour son opposition intransigeante au militarisme de la classe dominante. Pour Marc, tout cela venait confirmer que : “ce qui n’est déjà pas valable pour une vie d’homme est une totale absurdité au niveau d’un mouvement historique, comme celui du prolétariat. Ici le passage de la vie à la mort ne se mesure pas en secondes, ni en minutes, mais en années. Ce n’est pas la même chose le moment où un parti ouvrier signe son arrêt de mort et sa mort effective, définitive. Cela est peut être difficile à comprendre pour un phraséologue radical, mais est tout à fait compréhensible pour un marxiste qui n’a pas l’habitude de quitter le bateau comme les rats dès que celui-ci commence à prendre l’eau. Les révolutionnaires savent ce que représente historiquement une organisation à qui la classe a donné le jour et, tant qu’il reste un souffle de vie, ils luttent pour la sauver, pour la garder à la classe.” (4)
Il est faux de dire que la situation des révolutionnaires allemands en 1914 était fondamentalement différente de celle des camarades de la Gauche italienne qui décidèrent de former une fraction afin de lutter contre la dégénérescence du Parti communiste italien durant les années 1920. Bien au contraire : dans les deux cas, il y avait un parti de plus en plus dominé par une faction ouvertement bourgeoise (les sociaux-chauvins au sein du SPD, les staliniens au sein du PC) et une opposition partagée entre un centre indécis et une gauche révolutionnaire qui a justement décidé, même si la situation tourne en défaveur de la classe, que c’est un devoir primordial de se battre aussi longtemps que possible pour les valeurs et le programme concret du parti tant que subsistera en lui une vie prolétarienne. En revanche, la façon dont la CWO a décrit la situation du SPD en 1914 ressemble étrangement à l’ancienne prise de position (essentiellement conseilliste) de cette dernière sur les bolcheviks et les partis communistes : qu’ils étaient déjà totalement bourgeois en 1921 et que quiconque pensait autrement était en quelque sorte complice de leurs futurs crimes.
Nous pourrions également reprendre la présentation extrêmement simpliste relatant l’histoire des débats au sein de la Fraction italienne jusqu’en 1939, mais il serait plus judicieux d’y revenir dans un article distinct étant donné que la CWO a récemment republié un article de Battaglia Comunista (5) sur la question des fractions et du parti, avec une longue introduction de la CWO exprimant de nombreuses critiques envers le CCI, pas seulement sur la question de la fraction et du parti, mais aussi sur notre analyse de la situation internationale.(6) Mais, l’un des points clés qui ressort à la fois de l’article de Battaglia Comunista et de sa nouvelle introduction est l’idée qu’une Fraction n’est pour ainsi dire qu’une sorte de cercle de discussions, ce qui montrerait son peu d’intérêt à intervenir dans la lutte des classes, comme la CWO le souligne à la fin de leur article sur la réunion publique : “Le moment n’est pas aux cercles de discussions ou aux fractions. Il est en revanche temps de constituer partout des noyaux de révolutionnaires et de converger vers la création d’un parti révolutionnaire, international et internationaliste en vue des inévitables conflits de classe à venir”.
Si, malgré ses nombreuses faiblesses, le groupe spartakiste jouait foncièrement le rôle d’une Fraction au sein du SPD, dont la longue dynamique de dégénérescence, suite au tournant décisif d’août 1914, allait s’accélérer de façon dramatique jusqu’à un point de rupture définitif, alors, le travail de fraction n’est clairement pas synonyme d’un enfermement au sein d’un débat purement théorique, loin de la réalité quotidienne de la lutte de classe et de la guerre. Au contraire, il ne fait aucun doute que les Spartakistes ont “hissé la bannière” de la lutte de classe contre la guerre. Au sein du SPD, le Spartakusbund avait sa propre structure organisationnelle, publiait son propre journal, diffusait de nombreux tracts et avait la capacité, avec certains des éléments les plus radicaux de la classe (notamment les “délégués révolutionnaires” ou “Obleute” des centres industriels), d’organiser des manifestations regroupant des milliers d’ouvriers. Cette structure organisationnelle distincte était une condition préalable à l’entrée des spartakistes au sein de l’USPD en avril 1917, presque trois ans après le début de la guerre, après l’expulsion massive de l’opposition au sein du SPD. La décision d’adhérer à l’USPD a été prise, comme l’a dit Liebknecht, “pour le pousser en avant, l’avoir à portée de notre fouet, en arracher les meilleurs éléments”. Comme Marc le souligne dans son texte : “Que cette stratégie fut valable à ce moment-là, c’est plus que douteux, mais une chose est claire : une telle question pouvait se poser pour Luxemburg et Liebknecht parce qu’ils considéraient, avec raison, l’USPD comme un mouvement centriste dans le prolétariat et non comme un parti de la bourgeoisie”. En somme, le travail de fraction des spartakistes se poursuivit, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un parti plus large, comme force indépendante cherchant à créer les conditions pour qu’émerge un nouveau parti, débarrassé de ses éléments tant bourgeois que centristes, comme il se poursuivit au sein de la Gauche italienne après leur expulsion du parti, entre les années 1920 et les années 1930, même après le constat du passage à l’ennemi du PC.
Par conséquent, une partie de la critique de la CWO à l’égard des spartakistes, qui seraient restés trop longtemps dans l’ancien parti, est donc basée sur une idée fausse du rôle d’une fraction, comme étant un simple cercle de discussion et dont les activités sont, en un sens, opposées à la formation de groupes révolutionnaires préparant les bases du futur parti mondial. Au contraire : c’était précisément le concept de la Fraction tel qu’il a été élaboré par la Gauche italienne. La différence réside ailleurs : dans la reconnaissance (partagée par Luxemburg et la Gauche italienne) que la constitution d’un nouveau parti international n’était pas le produit de la seule volonté des révolutionnaires, mais dépendait d’un processus de maturation beaucoup plus large et profond au sein de la classe.
Bolcheviks et Spartakistes
La présentation de la CWO à la réunion et l’article qui suit soulignent le contraste entre les spartakistes et les bolcheviks :
“Au début de l’année 1917, le nombre de bolcheviks en Russie n’était estimé qu’autour de 8 000 ou 10 000, mais ils étaient présents dans presque chaque ville ou village et, plus important encore, faisaient partie intégrante de la classe ouvrière. Ainsi, lorsque le mouvement révolutionnaire apparut, ils furent non seulement capables de prendre les devants, mais ils purent grandir en son sein. En février 1917, les ouvriers ont spontanément appelé au “pouvoir du soviet” (en mémoire de 1905), mais à l’été 1917, il était clair qu’un seul parti soutenait “tout le pouvoir aux soviets”, et ce parti comptait désormais 300 000 membres, selon la plupart des estimations”.
Il est certainement vrai que les bolcheviks étaient à l’avant-garde du mouvement révolutionnaire dans les années 1914-1919. Sur la question de la guerre, la délégation bolchevique à Zimmerwald a défendu une position bien plus rigoureuse que celle des spartakistes : elle a, avec les “radicaux de gauche” allemands, revendiqué le slogan “Transformer la guerre impérialiste en guerre civile”, alors que la délégation spartakiste montrait quant à elle une tendance à faire des concessions au pacifisme. Dans leur pratique concrète d’une situation révolutionnaire, les bolcheviks ont été capables d’analyser l’équilibre des forces entre les classes avec une grande lucidité, jouant ainsi un rôle clé aux moments décisifs : en juillet, lorsqu’il était nécessaire de faire abstraction des provocations de la bourgeoisie, qui cherchait à entraîner les ouvriers révolutionnaires dans un affrontement militaire prématuré ; en octobre, lorsque Lénine affirmait que les conditions pour une insurrection étaient mûres et qu’il était désormais vital d’attaquer avant qu’il ne soit trop tard. Tout cela contraste tragiquement avec le jeune Parti communiste allemand qui a commis l’erreur monumentale d’avoir mordu à l’hameçon de la bourgeoisie en janvier 1919 à Berlin, en grande partie parce que le leader spartakiste Liebknecht avait transgressé la discipline du parti en appelant à un soulèvement armé immédiat.
Cependant, la capacité des bolcheviks à jouer ce rôle ne peut se réduire à la seule notion d’être “ancrés” dans la classe. C’est surtout le fruit d’une longue lutte pour la clarté politique et organisationnelle au sein du Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie, qui a permis aux bolcheviks d’appréhender les enjeux réels du soulèvement de février, même si cela a entraîné au sein du parti de fermes luttes visant à éliminer une forte tendance à soutenir la démocratie bourgeoise et la position “défensive” dans la guerre, tout cela était le but des débats autour des Thèses d’avril de Lénine (7). Le fait que les bolcheviks soient sortis de ce débat renforcés et plus déterminés que jamais à se battre en faveur du pouvoir aux soviets était le résultat de deux facteurs essentiels : d’une part, leur solidité organisationnelle, qui permit de maintenir l’unité du parti malgré les divergences très nettes qui apparurent en son sein tout au long du processus révolutionnaire ; d’autre part, le fait que, dès le début, leur programme politique, et cela même s’il n’était pas aussi clair qu’il le deviendrait après 1917, était toujours fondé sur le principe d’indépendance de la classe vis-à-vis de la bourgeoisie, par opposition à l’autre courant majoritaire de la social-démocratie russe, les mencheviks. Mais ce que tout cela souligne vraiment, c’est que dans les années qui s’écoulèrent entre la naissance du bolchevisme et l’éclatement de la révolution, les bolcheviks avaient eux-mêmes accompli les tâches les plus fondamentales d’une fraction révolutionnaire au sein du Parti russe et de la Deuxième Internationale.
La rigueur des bolcheviks sur les problèmes organisationnels et programmatiques était l’un des aspects de cette capacité à faire la transition de fraction jusqu’à parti ; l’autre étant la maturation rapide au sein du prolétariat russe dans son ensemble. C’était un prolétariat bien moins vulnérable aux illusions réformistes que ses frères et sœurs de classe d’Allemagne : tant au niveau de leurs conditions de vie que des conditions politiques imposées par le régime tsariste, leur lutte prit nécessairement un caractère explosif et révolutionnaire qui, dans un sens, révélait déjà les circonstances auxquelles la classe ouvrière serait confrontée dans les pays les plus avancés dans la période de décadence qui allait s’ouvrir. C’était un prolétariat qui, en grande partie privé de la possibilité de construire des organisations défensives de masse à l’intérieur de l’ancien système, donna naissance en 1905 à la forme organisationnelle des soviets et qui acquit un avant-goût d’une valeur inestimable de ce que faire une révolution signifie. Aussi, il ne faut pas oublier que le prolétariat russe avait face à lui une bourgeoisie affaiblie, alors que les ouvriers allemands seraient catapultés dans des luttes révolutionnaires contre une classe dominante toute-puissante, qui savait pouvoir compter sur le soutien du SPD, des syndicats, ainsi que des bourgeoisies de tous les pays. De ce point de vue, nous pouvons plus facilement comprendre pourquoi ce problème ne se réduit pas seulement à la présence physique de révolutionnaires au sein de la classe ouvrière, bien que cela soit important. Les sociaux-démocrates allemands étaient certainement très présents au sein de la classe ouvrière et dans tous les aspects de sa vie : économique, politique, et culturelle. Le problème était que cette influence au sein de la classe était de plus en plus orientée vers l’institutionnalisation et donc la neutralisation de la lutte des classes. La différence clé entre le SPD et les bolcheviks résida dans la capacité de ces derniers à maintenir et à développer l’autonomie de classe du prolétariat.
En fin de compte, pour vraiment saisir le contraste entre les bolcheviks et les spartakistes, pour aller au plus profond des problèmes rencontrés par la minorité communiste durant la vague révolutionnaire qui suivit 1917, nous devons prendre en compte les situations particulières relatives à chaque pays et les réintégrer dans une vision internationale plus globale. La Deuxième Internationale s’est en effet écroulée en 1914 : face à la trahison de la plus grande partie de ses composants nationaux, elle a tout simplement cessé d’exister. Cela a immédiatement posé la nécessité d’une nouvelle Internationale, même si les conditions de sa formation n’étaient pas encore réunies. La formation tardive de l’Internationale communiste (et les faiblesses programmatiques qui l’accompagnaient) devait être un handicap majeur non seulement pour la révolution allemande, mais aussi pour le pouvoir des soviets russes et toute la vague révolutionnaire. Nous y reviendrons dans d’autres articles. Nous avons fait valoir que le travail préalable des fractions de Gauche est indispensable à la formation du parti sur une base solide. Mais nous devons également reconnaître qu’au début du XXe siècle, alors que le danger de l’opportunisme au sein des partis sociaux-démocrates devenait de plus en plus évident, les fractions de Gauche s’opposant à la dérive de l’intégration au sein de la politique bourgeoise étaient entravées par la structure fédérale de la Deuxième Internationale. C’était une Internationale qui fonctionnait en grande partie comme une sorte de centre de coordination pour un ensemble de partis nationaux. Il y avait solidarité et coopération entre les différents courants de gauche (par exemple, lorsque Lénine et Luxemburg ont travaillé ensemble pour rédiger la résolution de Bâle contre la guerre au Congrès international de 1912), mais il n’y a jamais eu une fraction centralisée au niveau international qui puisse développer une politique cohérente dans tous les pays, une réponse unifiée à tous les changements dramatiques qui étaient provoqués par le passage du capitalisme à une époque de guerres et de révolutions.
Les groupes révolutionnaires d’aujourd’hui ne sont pas vraiment des fractions, au sens d’être des parties intégrantes d’un ancien parti ouvrier, mais ils ne seront pas capables de préparer le terrain du parti de demain s’ils échouent à comprendre ce que l’apport historique des fractions de gauche peut nous apporter.
Amos, 23 janvier 2019
(1) La CWO est l’affiliée anglaise de la Tendance communiste internationaliste ; un camarade de leur groupe allemand, le GIS, a également pris part à la réunion. Bien qu’il soit positif que les deux organisations reconnaissent l’importance historique de la révolution allemande, qui a tout de même mis fin à la Première Guerre mondiale et menacé pour un court instant d’étendre le pouvoir politique du prolétariat de la Russie à toute l’Europe de l’Ouest, c’était une marque de désunion de la part des mouvements révolutionnaires actuels d’organiser deux réunions distinctes sur le même thème, dans la même ville, et à moins d’une semaine d’intervalle. Le CCI a proposé la tenue d’une réunion commune afin d’éviter ce télescopage, mais notre demande a été refusée par la CWO pour des motifs qui nous paraissent obscurs. Cela contraste avec les réunions sur la Révolution russe tenues en 2017, où la CWO avait accepté de faire une présentation lors de notre journée de discussion à Londres [32]. Pour nous, le fait que les groupes de la Gauche Communiste soient plus ou moins seuls à préserver et à élaborer les leçons essentielles de la révolution en Allemagne est une raison suffisante pour qu’ils répondent de manière coordonnée aux distorsions idéologiques de cet événement mises en avant par l’ensemble des factions de la classe dominante (y compris son effacement virtuel dans les livres d’histoire) ;
(2) Ce désaccord a été l’objet principal de la discussion lors de la réunion publique organisée par la CWO. Ce point a de nouveau été central lors de la réunion du CCI, bien qu’il y ait également eu débat autour des questions posées par un camarade anarchiste internationaliste sur la nécessité d’un parti et sur la question de savoir si la centralisation correspondait aux besoins organisationnels de la classe ouvrière. Sur cette question de la nécessité de la centralisation comme expression de la tendance à l’unité, le camarade a dit plus tard qu’il trouvait nos arguments clairs et convaincants.
(3) Voir en particulier les articles sur la révolution allemande dans la Revue Internationale n° 81, 82 et 85.
(4) Voir notre article : “Conférence de Zimmerwald : les courants centristes dans les organisations politiques du prolétariat [33]”, Revue internationale n° 155.
(5) Publication du Parti communiste internationaliste, l’affilié italien à la Tendance communiste internationaliste.
(6) En attendant, les camarades peuvent se référer à une série d’articles que nous avons publié critiquant les visions de Battaglia Communista et de la CWO autour de la fraction dans les Revue internationale n° 59, 61,64, 65.
(7) Voir notre article “1917 : la révolution russe : les “Thèses d’avril”, phare de la révolution prolétarienne [34]”, Revue Internationale n° 89.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [35]
Courants politiques:
Rubrique:
Révolution internationale n° 476 - mai juin 2019
- 215 reads
Face à la destruction de l’environnement: l’idéologie “verte” au service du capitalisme!
- 305 reads
Multiplication des catastrophes climatiques, zones contaminées, destruction des forêts, coulées de boue rouge, pollution de l’atmosphère, disparition massive des espèces… Chaque jour, les catastrophes environnementales font les gros titres de l’actualité. Chacun de ces articles se conclut invariablement par un appel à la “détermination” des gouvernements pour sauver la planète ou à la responsabilité individuelle des “citoyens du monde” qui devraient correctement utiliser leur bulletin de vote. En bref : sauvez la planète avec l’État bourgeois ! Les récentes Marches pour le climat et les nombreuses mobilisations des jeunes n’ont pas dérogé à cette règle : si l’indignation des jeunes est palpable, l’absence totale de solution réelle aux problèmes environnementaux l’est également.
Le capitalisme détruit la planète
Il y a 170 ans, Friedrich Engels constatait déjà que l’industrie anglaise rendait l’environnement insalubre pour les ouvriers : “La mortalité élevée qui sévit parmi les enfants des ouvriers, et particulièrement des ouvriers d’usine, est une preuve suffisante de l’insalubrité à laquelle ils sont exposés durant leurs premières années. Ces causes agissent également sur les enfants qui survivent mais évidemment leurs effets sont alors un peu plus atténués que sur ceux qui en sont les victimes. Dans le cas le plus bénin, ils entraînent une prédisposition à la maladie ou un retard dans le développement et, par conséquent, une vigueur physique inférieure à la normale”. (1)
En même temps qu’elle permettait un développement des forces productives, l’industrie a généralisé, partout où elle est apparue, une pollution toujours plus toxique et dangereuse pour la santé : “Dans ces bassins industriels, les fumées charbonneuses deviennent une source majeure de pollution. (…) De nombreux voyageurs, enquêteurs sociaux et romanciers décrivent l’ampleur des pollutions occasionnées par les cheminées des usines. Parmi eux, dans son célèbre roman “Hard Times”, Charles Dickens évoque en 1854 le ciel de suie de Coketown, ville fictive miroir de Manchester, où l’on ne voit que “les monstrueux serpents de fumée” qui se traînent au-dessus de la ville”. (2)
Le principal responsable d’une pollution qui ne date pas d’hier est un système social qui produit pour accumuler du capital sans se préoccuper des conséquences sur l’environnement et les hommes : le capitalisme.
L’épisode du smog de Londres en 1952 (3) a montré jusqu’où pouvait aller la pollution atmosphérique causée par l’industrie et le chauffage domestique, mais aujourd’hui, ce sont toutes les grandes métropoles du monde qui sont menacées par ces phénomènes de plus en plus permanents, au premier rang desquelles se trouvent New Delhi et Pékin. (4) L’un des secteurs les plus pollueurs est le transport maritime, dont l’activité et les coûts dérisoires sont deux conditions vitales du fonctionnement de toute l’économie mondiale. La destruction de l’environnement, des forêts aux fonds marins, tout comme les catastrophes industrielles répondent à cette même logique de rentabilité et de surexploitation à bas coût.
Ce n’est pas un secteur particulier de l’activité humaine, mais la société capitaliste comme un tout qui pollue sans se soucier des conséquences pour le futur.
Une réalité très inquiétante
Aux ravages causés, depuis deux siècles, par l’exploitation irresponsable des ressources naturelles engendrant la souillure des milieux naturels et la disparition croissante d’espèces et d’écosystèmes, les diktats de l’économie capitaliste et la loi du marché rendent la planète exsangue et l’air, saturé de particules nocives, irrespirable.
La pollution atmosphérique, par ses effets cumulatifs, de l’aveu des scientifiques, est aujourd’hui apocalyptique. N’en déplaise aux milieux “climato-sceptiques”, soutenus par toute l’industrie chimique et pétrolière de la planète, les mesures scientifiques du recul des glaciers et banquises, de la hausse du niveau des océans vont toutes dans le même sens et ne laissent aucun doute sur la réalité du phénomène : du fait de l’augmentation du taux de CO2 dans l’atmosphère, la température moyenne de la Terre monte inexorablement, entraînant une série de phénomènes climatiques imprévisibles dont les conséquences sur les populations humaines sont d’ores et déjà dramatiques dans certaines régions.
Autrement dit : l’ère industrielle du système capitaliste est aujourd’hui en train de menacer la civilisation d’une lente mais inéluctable chute dans la destruction et le chaos. D’ores et déjà, certaines régions du monde sont invivables pour des communautés humaines du fait des effets du réchauffement climatique et de la destruction de l’environnement. D’après une étude de la Banque mondiale, l’aggravation des effets du changement climatique pourrait pousser plus de 140 millions de personnes à migrer à l’intérieur de leur propre pays d’ici 2050.
Cette sinistre réalité, masquée en grande partie par le fait que le problème serait lié à un simple “manque de volonté politique” et à “l’égoïsme des consommateurs” insuffisamment “éclairés”, engendre une inquiétude diffuse parfaitement compréhensible. À la question : “quel monde laisserons-nous à nos enfants ?”, il n’y a pas de réponse bien optimiste. Il est donc tout à fait logique que les principaux intéressés (les enfants et les jeunes) soient les premiers à s’inquiéter d’avoir à passer toute leur vie dans un environnement de plus en plus dégradé, avec des conséquences climatiques qui s’annoncent terrifiantes.
Dans ce cadre, les “marches pour le climat”, organisées avec force publicité et une grande couverture médiatique, ont cherché à répondre à cette inquiétude. Lorsqu’une jeune lycéenne suédoise a quitté son école pour manifester devant le parlement de Stockholm, elle a montré toute l’absence de futur qu’elle ressentait. Invitée à la COP 24, à l’ONU, pour défendre son action, Greta Thunberg fait désormais figure de porte-étendard d’une génération qui prendrait conscience que son avenir est singulièrement mis à mal par la pollution et les dérèglements climatiques qui en résultent.
Une tentative de division entre “jeunes” et “aînés”
En apparence, on aurait pu se réjouir d’une mobilisation internationale qui poserait des questions sur le futur que la société nous réserve. En réalité, c’est tout l’opposé. On constate en effet que cette mobilisation est encadrée et fortement encouragée par une large partie de la classe dominante : des ex-ministres écologistes français Cécile Duflot et Nicolas Hulot à L’Humanité et Lutte Ouvrière, de Greenpeace au Secours catholique, etc. En définitive, partout en Europe, toute la bourgeoisie de la droite à l’extrême-gauche a soit soutenu, soit appelé à participer à la “Marche du siècle”, comme ce fut le cas le 16 mars à Paris et un peu partout dans d’autres capitales ou grandes métropoles. En France, le syndicat SUD avait déjà appelé à la Marche du 8 décembre 2018, faisant en sus le lien entre climat et emploi : “agir pour le climat, c’est agir pour l’emploi !”, mettant en relation deux inquiétudes bien réelles de la jeunesse et appelant à la “grève scolaire” (à l’instar de Greta Thunberg) pour “l’urgence climatique”.
Là où ce syndicat dévoile son jeu habituel de division, c’est quand, dans son communiqué (“Pour un printemps climatique et social”), il nous explique que “face à l’inaction de leurs aîné(e)s, les collégien/(ne)s, lycéen/(ne)s et étudiant(e)s ont lancé un appel à la grève internationale pour le climat vendredi 15 mars”. Autrement dit, il entérine, comme le font la plupart des organisations bourgeoises, l’idée que si la Terre se réchauffe, c’est parce que les “aînés” n’ont “rien fait” pour l’empêcher. La jeune génération serait, elle, bien plus “responsable”, parce qu’elle “agit” : elle fait grève pour le climat !
En réalité, ce n’est ni une responsabilité particulière des “générations précédentes”, ni les comportements individuels “irresponsables” en matière d’environnement ni la “mauvaise volonté” des élus ou le “poids des lobbies” qui génèrent la catastrophe environnementale que nous voyons poindre. Elle est le produit du capitalisme miné par ses propres contradictions internes. Le fait que ce système soit basé sur la concurrence brutale, le chacun pour soi et le profit, obsédé par le moindre coût, sans que cette logique soit ouvertement remise en cause, pousse autant la vieille génération que la nouvelle à subir les lois implacables de ce même système barbare. Autrement dit, la classe dominante, toutes générations confondues, dédouane le système capitaliste en putréfaction en créant un rideau de fumée pour masquer sa responsabilité directe.
L’objectif est donc de pousser la population dans les bras du gardien de l’ordre dominant, l’État capitaliste, qui devrait être à l’écoute des citoyens et s’orienter vers une politique écologique, “responsable”, voire “anti-capitaliste”.
En fin de compte, cette attaque idéologique, bien que globale, se porte particulièrement sur la jeune génération elle-même, puisque le but est d’empêcher toute solidarité entre générations, et plus encore, de cacher à ses yeux le vrai responsable des désastres. En opposant ainsi les “aînés” à la “jeunesse”, derrière le slogan “on nous vole notre futur”, la propagande capitaliste officie en arrière-plan afin de “diviser pour mieux régner”.
Mais le syndicat SUD ne s’arrête pas là. Le but de cette mobilisation est selon lui très clair : “À l’appel de plus de 140 organisations, le 16 mars, nous marcherons ensemble pour exiger un changement de système de production et de consommation afin de limiter le réchauffement global à 1,5 °C. Pour cela, d’autres politiques publiques sont nécessaires qui associent les travailleurs et les travailleuses à la construction d’une société juste, solidaire et écologique qui réponde aux besoins sociaux et préserve les limites de la planète”. SUD nous demande donc d’exiger “d’autres politiques publiques”, et naturellement il s’adresse ici à l’État en lui demandant d’entendre la complainte de la jeunesse pour “une société juste, solidaire et écologique”.
Pour ce syndicat, comme pour tous les organisateurs de la “Marche du siècle”, la solution ne peut se trouver que dans l’État ; il faut juste qu’il écoute les citoyens. L’appel de Générations futures est encore plus clair : “Nous devons renouveler la démocratie et contraindre les décideurs et décideuses à protéger les intérêts de toutes et tous plutôt que ceux de quelques un(e)s. Nous devons répartir les richesses pour obtenir la justice sociale, afin de garantir une existence digne pour chacun(e)”. (5)
Quand Greta Thunberg se plante devant le parlement de Stockholm pour manifester, elle demande en fait aux élus de l’État capitaliste suédois de faire “leur travail” en pensant à la jeunesse et à son futur ! C’est donc globalement un appel à voter : quand on demande à “renouveler la démocratie” et à mettre en place “d’autres politiques publiques”, il n’y a pas d’autre choix que d’aller voter pour les “bons” candidats, ceux qui prendront au sérieux les aspirations “de la jeunesse”. C’est oublier que les États sont les protecteurs de leurs capitaux nationaux dont la recherche frénétique de l’accumulation les laisse totalement indifférents aux conséquences catastrophiques que celle-ci engendre sur le milieu naturel. Nous avons donc affaire, derrière la légitime inquiétude que génère le changement climatique, à son instrumentalisation par toute la bourgeoisie internationale dans le but de mobiliser les jeunes dans l’impasse électorale ! Comme l’abstention ne cesse de progresser parmi les jeunes générations, fruit d’un discrédit croissant des institutions démocratiques bourgeoises, on comprend très bien que la classe dominante cherche un moyen d’inverser cette tendance, et que l’utilisation de la peur du changement climatique lui donne cette opportunité.
La jeunesse, un enjeu vital pour la bourgeoisie
Si le mouvement contre le réchauffement climatique vise principalement les jeunes lycéens et étudiants, c’est que, pour la bourgeoisie, la jeunesse représente une cible particulière. Dans tous les régimes totalitaires, les jeunes sont un enjeu fondamental, parce qu’ils sont prompts à se mobiliser, parce qu’ils ressentent très vivement toute menace sur le futur, parce qu’ils manquent d’expérience et sont donc plus facilement manipulables que les générations plus âgées.
La jeunesse est donc un enjeu, et dans les pays développés, la bourgeoisie veut en faire la “gardienne des principes démocratiques”. Que ce soit aux États-Unis avec le mouvement “anti-armes”, en Grande-Bretagne avec le mouvement “Extinction rebellion” ou en France à travers la “Marche du Siècle”, la bourgeoisie cherche d’abord à mobiliser les jeunes autour des thèmes démocratiques, et à les isoler des aînés. Cette jeunesse qui s’alarme à juste titre pour son futur se retrouve ici dans le piège démocratique qui vise à en faire des “citoyens responsables” et à empêcher les jeunes prolétaires de se mobiliser sur un terrain de classe : pourquoi en effet défendre ses conditions de vie et de travail quand c’est l’avenir de toute l’humanité qui est menacé ?
L’appel à soutenir la démocratie bourgeoise est bien entendu une complète mystification. Ce n’est pas en appelant “les jeunes” à se mobiliser sur le terrain électoral (en particulier au profit des partis écolos ou les partis de gauche), ce n’est pas non plus en replâtrant l’édifice étatique ou en obligeant les élus à faire “leur travail” que l’on risque de changer le futur qui prend forme aujourd’hui.
L’écologie est une machine de guerre idéologique
Lorsque la bourgeoisie elle-même se préoccupe de la question du réchauffement climatique, il faut bien constater que son souci essentiel est de sauvegarder les conditions de la poursuite de l’exploitation et non de sauvegarder l’environnement. La préoccupation de la bourgeoisie est d’abord et avant tout de produire des marchandises en extrayant de la plus-value par l’exploitation de la main-d’œuvre salariée. On sait déjà tout le profit qu’elle a pu tirer de l’engouement autour de l’alimentation “bio” ou du “veganisme”, qui polluerait moins et préserverait mieux l’environnement : les tarifs augmentant significativement dès que l’on achète de l’alimentation “bio”, la fracture entre riches qui se nourrissent plus sainement et pauvres condamnés à la “malbouffe” ne fait que s’élargir, avec toute la culpabilisation de ceux qui continuent à acheter de la nourriture industrielle, la moins chère évidemment !
Pire, la bourgeoisie verdit cyniquement sa stratégie industrielle pour justifier les attaques contre la classe ouvrière et renforcer la guerre économique. La pollution atmosphérique et le réchauffement climatique qui s’ensuivent étant en grande partie le produit de l’utilisation des moteurs thermiques, la bourgeoisie européenne a ainsi posé la question du remplacement des voitures utilisant ce mode de propulsion par des véhicules “non polluants”, électriques. C’est là une nouvelle escroquerie, car l’arrière-pensée qui se tapit derrière tout le scandale du “dieselgate” n’est pas et n’a jamais été le sort de l’humanité. Le gain pour les constructeurs pourrait au contraire être fort intéressant : selon certains scénarios, on pourrait ainsi, en Allemagne, réduire jusqu’à 16 % la main-d’œuvre de ce secteur industriel. Derrière le capitalisme prétendument “vert”, il y a surtout beaucoup à gagner, même si la course au lithium pour fabriquer les batteries aura des conséquences lourdes pour l’environnement. Les risques de pollution causés par les batteries, si elles brûlent ou sont en fin de vie, ne sont pas à prendre à la légère.
De la même façon, au nom de la “fiscalité écologique”, les taxes se multiplient partout dans le monde dans le cadre de la guerre commerciale entre les États, ou carrément sous la forme d’attaques directes contre la classe ouvrière. Là, comme ailleurs, l’écologie sert de masque à la course au profit et à faire accepter aux ouvriers les attaques au nom de la lutte contre la pollution. Ainsi, lorsque la nouvelle jeune égérie mondiale, Greta Thunberg, se fait écho de ce que la propagande lui martèle, à savoir qu’il faut abandonner notre “zone de confort” et donc faire des “sacrifices”, la pollution étant censée provenir du résultat de notre surconsommation, du gaspillage, bref, provenir du “comportement irresponsable de tous”, elle ne fait que justifier et donner des moyens supplémentaires aux discours idéologiques des États chargés de préparer les mesures anti-ouvrières à venir en créant non seulement un sentiment de culpabilité, mais en enfermant chacun dans la prison des “solutions” individuelles totalement stériles. Le système capitaliste produit comme s’il n’y avait aucune limite aux besoins, il produit parce qu’il a besoin de plus-value pour accumuler toujours plus de capital. C’est ainsi qu’il fonctionne, et vouloir le faire fonctionner autrement est une pure illusion. La seule possibilité d’agir efficacement, qui se présente aussi comme une nécessité vitale, c’est de le détruire afin de poser les bases d’une nouvelle société où le travail au sein de la société serait tourné vers les besoins de l’humanité sans entrer en contradiction avec la nature et notre environnement. Cela, seule la classe ouvrière peut le permettre par une révolution mondiale.
HD, 20 avril 2019
(1) Friedrich Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre (1844).
(2) François Jarrige et Thomas Le Roux, La contamination du monde (2017).
(3) Le 5 décembre 1952 et pendant cinq jours, un brouillard causé par un anticyclone se mêle aux fumées de charbon causant 12 000 décès.
(4) “De Londres à Delhi, comment le smog a migré vers l’Est”, Le Monde (17 novembre 2017).
(5) On peut encore signaler l’appel du Réseau Action Climat France : “Dans leur appel commun, les signataires demandent aux responsables du dérèglement climatique de prendre les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement global à 1,5 °C, tout en garantissant une justice sociale”.
Récent et en cours:
- Ecologie [9]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
L’impasse du "second Printemps arabe"
- 128 reads
“Les manifestants, venus des quatre coins du pays, ont ainsi réussi à atteindre l’un de leurs objectifs, celui de faire entrer cette marche pour la “dignité” dans l’histoire. Cette foule monumentale semble aimer se trouver et danser au son youyou et des darboukas pour dénoncer, dans une euphorie collective, les dérives d’un “pouvoir assassin”, comme elle le crie sans relâche depuis le 22 février, date de la première grande mobilisation. (…) Dans le cortège, au milieu des centaines de milliers d’hommes qui ont submergé les rues d’Alger, les femmes de tous âges, de toutes classes et générations ont répondu présent, et sont venues bien plus nombreuses que les deux semaines précédentes. (…) De 11 h à 18 h, c’est un concentré de l’Algérie qui a défilé dans les boulevards qui serpentent à travers Alger : jeunes hommes, jeunes filles coiffées à la dernière mode, hadjas (anciens), cadres, employés, moudjahidines (anciens combattants), femmes enroulées dans un haïk, le vêtement traditionnel”. (Le Monde du 11 mars 2019).
Depuis le 22 février, des manifestations massives se déroulent, chaque vendredi en Algérie, réunissant des centaines de milliers de participants dans toutes les grandes villes du pays. Celles du 8 mars ont été particulièrement suivies avec une participation record de plus d’un million de personnes à Alger. Ce sont désormais des millions de personnes dans la rue chaque semaine, particulièrement les étudiants et les lycéens en grève.
Les raisons de cette immense colère sont nombreuses : la misère sous toutes ses formes, un taux de chômage de 11 % (officiellement) de la population active, de plus de 26 % chez les jeunes de 16-24 ans, le manque de logements, la répression, et peut-être surtout la généralisation de la corruption, à commencer par celle du clan familial de Bouteflika et de ses fidèles alliés le chef d’état-major de l’armée (Ahmed Gaîd Salah), le patron des patrons algériens (Ali Haddad), le secrétaire général du syndicat UGTA (Abdelmadjid Sidi-Saïd) et tout l’appareil historique du FLN. Ce sont tous ces gangsters qui se partagent l’essentiel des rentes pétro-gazières. Le clientélisme a été érigé en mode de gouvernance par Bouteflika, qui a organisé une gigantesque politique de redistribution de la manne financière (issue des hydrocarbures) pour arroser (inégalement) toutes les catégories sociales : anciens combattants, ménages, automobilistes, usagers de transports en commun, agriculteurs, débiteurs, locataires d’HLM, retraités, banquiers, entrepreneurs, etc. Il va sans dire que tous ces citoyens “arrosés” sont sollicités pour réélire le président ou ses partisans à chaque occasion.
Le piège de l’interclassisme et du nationalisme
Le mouvement semble être né sur les réseaux sociaux, sans lien apparent avec un parti, syndicat, groupe ou individus connus, en s’auto-organisant et en dirigeant ses propres manifestations, en y attirant progressivement des masses croissantes de la population. Le mouvement a également fait preuve de courage en bravant systématiquement l’interdiction de manifester, notamment dans la capitale, tout en se montrant calme et tranquille (ou “pacifique” selon les médias), refusant la confrontation physique avec les forces de l’ordre et toutes provocations pouvant faciliter la répression policière.
Pour autant, ce mouvement n’est pas de nature prolétarienne. Il est avant tout interclassiste : en son sein se rassemblent pêle-mêle aussi bien des ouvriers (actifs ou réduits au chômage) que nombre d’éléments de la petite-bourgeoisie (cadres, notables, avocats, commerçants, petits chefs d’entreprise…). Le résultat est que dominent les revendications sur le terrain de la bourgeoisie : démocratie, légalisme… La classe ouvrière est diluée, elle n’est pas à la tête de ce mouvement.
L’autre caractéristique majeure de ce mouvement est son contenu fortement nationaliste, illustré par la présence massive et permanente du “drapeau national algérien” dans toutes les manifestations. En clair, il est loin de penser à s’unir ou à manifester sa solidarité avec les prolétaires des autres pays. Pourtant, par exemple, depuis décembre, des mouvements au Soudan s’expriment aussi massivement contre le terrible plan d’austérité du gouvernement soudanais, dirigé par un autre vieux dictateur Omar Al-Bachir, qui vient d’ailleurs d’être “déposé” par l’armée dans l’espoir de “calmer” la colère de la rue.
De fait, au lieu de s’emparer du mot d’ordre “prolétaires de tous les pays, unissez-vous !”, le mouvement social actuel préfère s’unir avec toutes les forces “démocratiques algériennes” (prétendument “non corrompues”). Sont en fait pratiquement dissoutes ou noyées, toutes les revendications véritablement prolétariennes contre le chômage massif, la dégradation des conditions de travail et de vie, etc. Au contraire, dominent les revendications “citoyennes” portées par la petite-bourgeoisie notamment dans le milieu étudiant où nombre de professeurs profitent des AG pour donner des cours sur la Constitution, les institutions et leur fonctionnement, ceci en vue de construire un “nouveau système plus démocratique”. De plus en plus des voix proposent même une issue à la “tunisienne”, c’est-à-dire l’instauration d’élections “libres et démocratiques”. Cette piste semble avoir les faveurs de la sphère de la bourgeoisie algérienne “éclairée”, des “gouvernements amis” de l’Algérie (notamment la France et l’UE) et de tous les autres pays qui redoutent d’être confrontés à de nouvelles vagues de migrants ou des incursions armées sur leur territoire (particulièrement les pays du Sahel).
Si certains médias parlent tantôt d’un “nouveau printemps arabe”, tantôt de “révolution”, en réalité, le mouvement d’Algérie s’inscrit surtout dans le sillage des plus grandes fragilités de la contestation de 2011/2012. L’actuel mouvement algérien prend quasi-exclusivement la forme de grandes manifestations, sans ou peu de grèves alors qu’en Tunisie et en Égypte, les manifestations s’accompagnaient d’importants mouvements de grèves touchant directement la production, les services publics et les transports. Pourtant, en 2011, le “printemps arabe” avait aussi débuté en Algérie, et même avec une extrême vigueur : “On oublie, mais le printemps arabe a commencé en janvier 2011 dans les grandes villes de l’Algérie presque en même temps qu’en Tunisie. Pour une fois, le mouvement a été national, n’épargnant aucune région, d’Alger à Annaba. Du 5 au 10 janvier la jeunesse a défilé, souvent derrière un drapeau tunisien, pour le pain et la dignité. (…) Un habitant de ces quartiers présent avoue sa surprise : “Je suis né ici, j’ai presque 50 ans et je n’ai jamais vu cela”. (…) Les autorités sont parvenues in extremis à contenir tant bien que mal les manifestations (…) en multipliant les promesses : les légumes secs ont été ajoutés aux douze produits alimentaires dont les prix sont réglementés et/subventionnés, les salaires relevés souvent jusqu’à 80 % avec dix-huit mois ou plus de rappel”. (Manière de voir, supplément du Monde diplomatique, mars 2012). À l’époque donc, le régime de Bouteflika était parvenu à étouffer le mécontentement.
Quelles perspectives pour le pouvoir en place ?
Pendant longtemps, le pouvoir algérien a fait face aux mouvements sociaux avec les armes dites “de la carotte et du bâton”. La carotte, en puisant quelques miettes dans les caisses de l’État (grâce aux prix élevés de l’or noir). Le bâton, en réprimant violemment les mouvements sociaux. Il faut se rappeler que la “décennie noire” (une guerre civile qui s’est soldée par 200 000 morts) des années 1990-2000 après l’écrasement sanglant du mouvement de grèves et de manifestations de 1988 se traduisant par 500 morts dans les rangs des grévistes. Aujourd’hui, il n’y a plus de “carotte”. La situation économique est désastreuse, avec un prix du baril en chute libre et des caisses d’État dévalisées par le clan mafieux gouvernemental. Reste le “bâton”...
Dans toutes les couches de la société, l’heure est à la dislocation du grand clan de Bouteflika et aux règlements de comptes. Pour ce dernier, l’enjeu est énorme car c’est une question de vie ou de mort, pour lui-même et sa famille. En effet après sa démission, le président ne veut pas subir le même sort que ses congénères tunisien et égyptien, Ben Ali et Moubarak, “dégagés” par le “printemps arabe” de 2011, qui ont connu la prison (ou l’exil) et la confiscation de leurs biens (des dizaines de milliards de dollars pour chacun). On comprend mieux pourquoi Bouteflika s’accrochait coûte que coûte au pouvoir en misant sur le “pourrissement” du mouvement et le soutien du chef de l’armée qui a fini par le renverser en cherchant, lui aussi, à sauver sa tête. Dès lors, la question est de savoir si les militaires vont préférer taire leurs divergences claniques pour préserver leurs “intérêts communs” en réprimant le mouvement actuel avec cependant le risque de reproduire une “nouvelle décennie noire” ou soutenir la carte de la démocratie et du renouvellement avec toutes les incertitudes que cela comporte. Dans les deux cas, la classe ouvrière sera perdante : écrasée dans un bain de sang ou assommée par la propagande bourgeoise martelant les “vertus” de la “démocratie”, pour mieux maintenir son système d’exploitation.
La responsabilité du prolétariat des pays centraux
Lors du premier “Printemps arabe” en 2011, nous écrivions : “C’est le prolétariat occidental, par son expérience et sa concentration, qui porte la responsabilité de donner une véritable perspective révolutionnaire. Les mouvements des Indignés en Espagne et des Occupy aux États-Unis et en Grande-Bretagne se sont explicitement référés à la continuité des soulèvements en Tunisie et en Égypte, à leur immense courage et leur incroyable détermination. Le cri poussé lors du “printemps arabe”, “Nous n’avons plus peur”, doit effectivement être source d’inspiration pour tout le prolétariat mondial. Mais c’est seulement le phare de l’affirmation des assemblées ouvrières, au cœur du capitalisme, dressées contre les attaques du capitalisme en crise qui peut offrir une alternative permettant réellement le renversement de ce monde d’exploitation qui nous plonge toujours plus profondément dans la misère et la barbarie. Il ne faut pas que la classe ouvrière minimise le poids réel dont elle dispose dans la société, de par sa place dans la production mais aussi et surtout dans ce qu’elle représente comme perspective pour toute la société et pour l’avenir du monde. En ce sens, si les ouvriers d’Égypte et de Tunisie ne doivent pas se laisser berner par les mirages de l’idéologie bourgeoise démocratique, il est de la responsabilité de ceux des pays centraux de leur montrer le chemin. C’est en Europe particulièrement que les prolétaires ont la plus longue expérience de confrontation à la démocratie bourgeoise et aux pièges les plus sophistiqués dont elle est capable. Ils se doivent donc de cueillir les fruits de cette expérience historique et d’élever bien plus haut qu’aujourd’hui leur conscience. En développant leurs propres luttes, en tant que classe révolutionnaire, ils briseront l’isolement actuel des luttes désespérées qui secouent nombre de régions à travers la planète et réaffirmeront la possibilité d’un nouveau monde pour toute l’humanité”.
Il en est de même aujourd’hui : un mouvement social dans lequel domine l’idéologie petite-bourgeoise et démocratique est une plaie pour l’ensemble du prolétariat mondial ; il indique l’exact opposé du chemin à prendre, celui de la lutte de la classe ouvrière, sur son terrain, ses grèves, ses assemblées générales, ses mots d’ordre. C’est au prolétariat d’Europe tout particulièrement que revient cette lourde tâche d’être le phare des exploités du monde.
Amina, avril 2019
Géographique:
- Algérie [39]
Rubrique:
Black blocs: des méthodes et une idéologie étrangères au prolétariat
- 250 reads
Lorsque l’on parle de black blocs, nous avons immédiatement à l’esprit des images de casseurs encagoulés, entièrement vêtus de noir, qui n’hésitent pas à détruire tout ce qui peut symboliser le capitalisme. Ces groupes font désormais partie du paysage de nombreuses manifestations. Comme nous l’écrivions en 2018 : “L’origine des black blocs est à chercher à la fin des années 1980 où la police de Berlin-Ouest invente l’expression schwarze block (bloc noir) pour désigner certains manifestants d’extrême-gauche cagoulés et armés de bâtons, eux-mêmes s’inspirant du mouvement Autonomia, né en Italie dans les années 1960. Leurs actions spectaculaires se répètent en 1999, à Seattle contre la conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ; à Gênes, en juillet 2001, en se fondant dans des marches pacifiques d’opposants au G8 ; à Strasbourg, en 2009, en marge du 60e anniversaire de l’OTAN ; en octobre 2011, à Rome, lors de la journée mondiale des Indignés contre la crise et la finance mondiale ; en février 2014, aux côtés des opposants à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ; en juillet 2017, à Hambourg, dans les manifs anti-G20 ; à l’occasion des manifestations contre la “loi travail” en France, cette même année…” 1)
Avec le mouvement des “gilets jaunes” et ses scènes de violences hebdomadaires, les images spectaculaires des affrontements entre les black blocs et la police ont largement fait le tour des médias. D’autant plus que la partie la plus radicale des “gilets jaunes” s’est mise à les soutenir et à les applaudir, quand ils ne leur ont pas prêté main forte.
L’escroquerie idéologique des black blocs
L’idéologie activiste est largement répandue dans les milieux anarchistes et gauchistes en général. Dans un texte sur les black blocs publié par deux anarchistes berlinois sur le site anarkhia.org, on peut lire ceci : “Aujourd’hui, sans avoir fait le recensement de toutes les nouvelles publications, il n’est pas anodin de voir un intérêt subit pour des personnages comme Blanqui, agitateur du XIXe siècle et apologue de l’émeute qui semblait depuis longtemps oublié, réédité récemment avec une nouvelle préface qui parvient à lui redonner son actualité. Cela sans mentionner le succès en librairie d’un texte évocateur au titre aussi suggestif que “L’insurrection qui vient”” et un peu plus bas, dans les lectures suggérées : “Maintenant, il faut des armes” d’Auguste Blanqui, republié par La Fabrique, une maison d’édition gauchiste. Comme on peut le voir, les black blocs se réfèrent aux premières heures du mouvement ouvrier en récupérant des figures comme celle d’Auguste Blanqui ; certes, un des promoteurs de l’action violente d’une minorité comme moteur de la lutte, mais dont la nature du combat est toute autre que celle de l’idéologie véhiculées par les black blocs.
Le courant blanquiste, malgré ses propres faiblesses, est en effet l’expression d’un réel effort de combat du prolétariat dans la première moitié du XIXe siècle pour se constituer en classe et affirmer la perspective communiste. Or, les black blocs n’ont strictement rien à voir avec cette tradition politique.
Pourquoi récupèrent-ils, aujourd’hui, l’héritage d’une des figures majeures des premières heures de la lutte du prolétariat contre le capital ? Alors que la bourgeoise cherche sans arrêt à discréditer l’arme théorique du prolétariat (notamment depuis la chute du mur de Berlin et l’effondrement du bloc de l’Est stalinien), la profonde hostilité des black blocs à l’égard du marxisme “autoritaire” explique leur attrait pour des figures comme Blanqui. Ce dernier n’a jamais véritablement adhéré à l’Association Internationale des Travailleurs qu’il percevait comme un lieu de “parlotte” et non comme un moyen d’action révolutionnaire. Blanqui voyait, en effet, l’action violente minoritaire comme le seul mode d’action capable de mobiliser le prolétariat pour renverser la société et construire le socialisme. Cela, à une époque où la classe ouvrière ne pouvait pas prendre le pouvoir du fait de son immaturité.
Politisé très tôt dans un contexte de lutte contre la monarchie (Charles X et Louis-Philippe), Blanqui militait au sein d’organisations secrètes, dans un tout autre contexte que celui d’aujourd’hui, et était souvent en première ligne lors de divers coups de force et complots. Évidemment, la répression lui fera passer de très nombreux séjours en prison au cours de sa vie, à tel point qu’il sera surnommé “l’enfermé”. Peut-être est-ce la force de ce qui en a fait un mythe qui fascine aujourd’hui tant nos radicaux encagoulés ? Malgré les échecs, malgré la répression, Blanqui garda une détermination et une combativité sans faille (jusque devant les juges qui l’accusent de tous les maux) et ce sont là des qualités essentielles qui ont sans doute contribué à sa popularité. À ce propos, Engels écrira même : “l’instinct révolutionnaire de Blanqui, sa résolution ne sont pas donnés à tout le monde”.
Blanqui fut donc un élément moteur et un leader reconnu dans de nombreux mouvements de lutte. C’est certainement cette qualité qui n’échappait pas à la bourgeoisie qui a poussé Thiers à remettre expressément Blanqui en prison à la veille de la Commune de Paris, le 17 mars 1871. En effet, tirant le bilan de la Commune dans La Guerre civile en France, Marx écrit “Le véritable meurtrier de l’archevêque Darboy, 2) c’est Thiers. La Commune, à maintes reprises, avait offert d’échanger l’archevêque et tout un tas de prêtres par-dessus le marché, contre le seul Blanqui, alors aux mains de Thiers. Thiers refusa obstinément. Il savait qu’avec Blanqui, il donnerait une tête à la Commune ; alors que c’est sous forme de cadavre que l’archevêque servirait au mieux ses desseins”. Bien entendu, le succès ou l’échec de la Commune de Paris n’était pas conditionnés par la seule présence de Blanqui. Mais il est probable que toute une série d’hésitations et d’erreurs aurait pu être évitée du fait de son expérience et de son crédit au sein du mouvement (par exemple, l’erreur de laisser partir librement le gouvernement de Thiers à Versailles…)
Ainsi, Blanqui était un véritable combattant de la classe ouvrière qui a apporté une contribution à la lutte révolutionnaire du prolétariat. Sa conception de l’insurrection, toujours orientée vers la prise du pouvoir de la classe ouvrière, n’a strictement rien à voir avec les bris de vitrines des magasins, les incendies de poubelles et la confrontation stérile avec les forces de répression pratiqués par les black blocs.
Face à la société capitaliste, Blanqui fut un des premiers à défendre la nécessité d’une dictature du prolétariat comme perspective de lutte révolutionnaire. Ce n’est pas le cas des black blocs, dont l’idéal petit-bourgeois fait au contraire la promotion de l’individu et du démocratisme libertaire sous autant de variantes qu’il existe de militants engagés dans ce mouvement hétéroclite “anti-autoritaire”. Un mouvement dont l’unité est seulement cimentée par une volonté de violence, d’affrontements avec la police et de destruction.
La violence des black blocs n’est pas celle de la classe ouvrière
Dans un article de 1874, “Le programme des émigrés blanquistes de la Commune”, Engels écrit : “Blanqui est essentiellement un révolutionnaire politique ; il n’est socialiste que de sentiment, par sympathie pour les souffrances du peuple, mais il n’a pas de théorie socialiste ni de projets pratiques de transformation sociale. Dans son activité politique, il fut avant tout un “homme d’action” qui croyait qu’une petite minorité bien organisée pourrait, en essayant au bon moment d’effectuer un coup de main révolutionnaire, entraîner à sa suite, par quelques premiers succès la masse du peuple et réaliser ainsi une révolution victorieuse”.
Cette conception fondée sur des actions d’éclat d’une minorité déterminée perd de vue qu’il ne peut y avoir de réel renversement du capitalisme sans un mouvement massif et conscient du prolétariat. Cette adhésion à un projet politique ne peut se faire en quelques jours à la suite d’une action héroïque et à l’initiative de quelques-uns. Il s’agit, au contraire, d’un processus historique basé sur un combat qui est nécessairement long et parsemé d’embûches. Rien à voir, donc, avec l’activisme sans perspective des black blocs ou l’agitation stérile de quelques milliers de manifestants radicaux prêts à en découdre.
De plus, l’action révolutionnaire n’a surtout de sens que si elle se situe dès le départ dans une perspective de renversement du pouvoir à l’échelle mondiale. Cela suppose donc une compréhension précise du rapport de force entre les classes au niveau international, comme condition de la réussite du mouvement, une condition totalement étrangère à la façon de penser et à la pratique des black blocs qui agissent ponctuellement, avec des œillières localistes, au gré des événements internationaux.
Dans l’article cité plus haut, Engels poursuit : “Ces idées sur la marche des événements révolutionnaires sont nettement périmées, en tout cas pour le parti ouvrier allemand, et en France même elles ne peuvent séduire que les ouvriers les moins mûrs ou les plus impatients. Nous verrons également que, dans le programme en question, ces idées ont subi certaines restrictions. Mais nos blanquistes londoniens s’inspirent, eux aussi, du principe que les révolutions ne se font pas d’elles-mêmes ; qu’elles sont l’œuvre d’une minorité assez restreinte qui agit suivant un plan préétabli ; enfin, que cela va “commencer bientôt”, d’un moment à l’autre”. En effet, la conception blanquiste se caractérise par un fort poids de l’immédiatisme, c’est-à-dire une volonté de faire “bouger les masses” tout de suite, quel que soit le contexte.
Cette caractéristique qui constituait en réalité une grave faiblesse pour le mouvement ouvrier se retrouve aujourd’hui, sous des formes encore totalement étrangères à la classe ouvrière chez des groupes activistes petits-bourgeois comme les black blocs. Sans perspective claire et solide, le désespoir est fatalement au bout du chemin. Du fait de la perte de son identité de classe et de son incapacité momentanée à développer ses luttes, la classe ouvrière peut être influencée par ces moyens d’action certes spectaculaires mais totalement stériles et dangereux.
En effet, loin de faire effectivement “bouger les masses” ou même de provoquer un début de mobilisation, l’activisme “radical” des black blocs conduit à la négation même de la lutte du prolétariat. La véritable boussole des révolutionnaires n’est pas la recherche de la confrontation en soi, mais l’expérience pratique du mouvement ouvrier et les leçons historiques que l’on peut tirer de cette expérience pour développer un réel combat de classe.
L’histoire nous enseigne que ce qui fait la force du prolétariat, c’est sa massivité et sa capacité à s’unir au-delà des frontières nationales et du cadre étriqué du corporatisme syndical. Cela, par une démarche consciente qui se nourrit de la théorie révolutionnaire, théorie que méprisent souverainement les activistes de tout poil, en premier lieu les black blocs.
Il y a tout juste cent ans, la vague révolutionnaire mondiale débutée en Russie montra le chemin aux générations futures. Elle nous enseigne comment l’unité de la classe se construit dans la lutte au moyen des armes que sont les assemblées générales ouvertes, puis les conseils ouvriers, l’élection de délégués responsables et révocables, la recherche de la solidarité de classe et de l’extension des luttes par la grève de masse. Cela, les black blocs l’ignorent ou le voient comme quelque chose d’anecdotique, de limité, voire de “réformiste” ! Ils préfèrent foncer tête baissée dans “l’action” qu’ils cherchent à transformer en une sorte de “guérilla urbaine” censée “affaiblir l’État”. À la limite, seul compte le coup d’éclat lui-même, celui d’un pavé lancé contre les flics ou d’une grille arrachée.
La recherche de la confrontation systématique avec l’appareil de répression bourgeois est pourtant un piège stérile que la bourgeoisie n’a aucun mal à retourner contre notre classe. Cette violence aveugle et stérile fait pleinement le jeu de l’État bourgeois en lui donnant une justification au renforcement et au déchaînement de la répression, contribuant ainsi à la paralysie du prolétariat dans la peur. Elle permet également à la classe dominante d’instiller la confusion au sein de la classe ouvrière en assimilant ces agissements nihilistes à l’action “révolutionnaire” et aux méthodes de lutte de la classe ouvrière.
La violence et l’insurrection armée s’inscrivent pleinement dans la perspective révolutionnaire quand la question de la prise du pouvoir se pose. Mais la nature de cette violence insurrectionnelle du prolétariat est totalement différente des expressions de révolte désespérée et sans lendemain véhiculées par les black blocs. Car elle ne pourra être mise en œuvre que par une classe dont la force réelle réside dans le développement de sa conscience et du caractère associé, solidaire et organisé de son action. La violence de la classe ouvrière s’inscrit dans une perspective politique et historique émancipatrice, celle du renversement d’un système basé sur l’exploitation et la violence des rapports sociaux, pour l’édification d’un autre type de société, sans classes ni exploitation : le communisme.
Marius, 18 avril 2019
1 “Black blocs : la lutte prolétarienne n’a pas besoin de masque”, Révolution Internationale n° 471 (juillet-août 2018).
2 Darboy était l’archevêque de Paris au moment de la Commune. Il fut gardé comme otage (avec une soixantaine d’autres prisonniers) pour faire pression sur les Versaillais. Soumis à de multiples provocations et à une répression impitoyable, les fédérés exécutèrent les otages, ce qui servit de prétexte à Thiers pour finir d’écraser la Commune dans la barbarie la plus impitoyable et sanglante.
Personnages:
- Auguste Blanqui [40]
Rubrique:
Suicides chez les policiers: le prolétariat ne tire pas sa force de la mort de ses ennemis de classe
- 141 reads
La police connaît depuis le début de l’année 2018 un taux de suicide record dans ses rangs. Selon l’information Service d’information et de communication de la police, 35 policiers se seraient donné la mort depuis le début de l’année 2018, un record à ce jour en France. Ce taux de suicide est supérieur de 35 % à celui qui sévit dans la population française en général.
Le prolétariat n’a pas pour habitude de se réjouir de la mort d’un être humain, même si celui-ci appartient aux forces de répression de l’État bourgeois. La classe ouvrière, seule classe révolutionnaire de la société, ne développe ni haine ni esprit de revanche. Elle est guidée par sa seule conscience qui contient à ce jour le plus haut point atteint par la morale humaine, c’est-à-dire par la morale prolétarienne. Par conséquent, la classe ouvrière exclut l’assassinat comme moyens de lutte. Certes, le prolétariat ne pourra pas faire l’économie de la violence de classe pour abattre la classe capitaliste, ses États et ses forces de répression. Mais l’histoire a montré que la classe des massacreurs, c’est justement la classe bourgeoise. Le sang des dizaines de milliers de fusillés, pendant les révolutions de 1848 et 1871 en France sont là pour le prouver. Comme l’ont été les massacres de masse en Allemagne et en Russie révolutionnaire par les armées capitalistes et les forces de la réaction des armées blanches russes. Sans oublier les pogroms de masse tout au long de l’histoire du capitalisme perpétrés par des fractions entières des couches petites-bourgeoises toujours aussi haineuses et souvent instrumentalisées par la classe bourgeoise elle-même.
Des policiers en proie à des cas de conscience
Les policiers sont les citoyens de France les plus mal-aimés. Ils sont de ce point de vue l’exact opposé du corps des sapeurs-pompiers. Cela n’est pas dû au hasard. Bien avant le mouvement des “gilets jaunes”, tel était déjà le cas. La répression permanente de tous les mouvements sociaux et de grèves ne date pas d’aujourd’hui ! Mais depuis maintenant près de six mois que dure le mouvement des “gilets jaunes”, les bavures, les provocations et la répression ont pris des proportions rarement vues en France. Il n’y a qu’à lire à ce sujet le témoignage d’un CRS publié sur notre site en date du 19 mars dernier. La pression sur les forces de l’ordre par le gouvernement et la hiérarchie policière est totale. On ne compte plus les estropiés, les blessés, et les tabassages y compris sur des personnes qui ne manifestaient même pas ! Tout cela est perpétré par des policiers touchant des salaires misérables, malgré les primes récemment octroyées par le gouvernement ! Ce niveau de répression ordonné par l’État dans une situation d’épuisement des forces de l’ordre ne pouvait que pousser une petite minorité d’entre eux à s’interroger sur le sens du sale boulot qu’on leur demande d’effectuer. Les ordres donnés, semaine après semaine, de gazer, matraquer ou tirer sur les manifestants, y compris les plus vulnérables comme les personnes âgées ou des adolescents, ne peuvent que provoquer un profond désarroi, voire de la honte qui, conjugués à un lourd épuisement, provoquent de véritables “crises de conscience” et poussent même certains policiers à se donner la mort.
La violence aveugle et les propos haineux ne profitent qu’à l’État
Les tags des casseurs en tout genre et autres black blocs, les “flics, suicidez-vous !” adressés aux policiers par des “gilets jaunes” décervelés sont tout simplement inacceptables. Ces slogans haineux, animés par le désir de se venger des bavures et de la répression violente ne sont d’ailleurs pas tombés dans les oreilles d’un sourd et ont même été largement exploités par les médias. Immédiatement et pendant des jours et des jours, ces slogans pourris ont tourné en boucle sur toutes les télévisions et ont fait la Une de tous les journaux. Bon nombre d’hommes politiques bourgeois se sont insurgés et se sont drapés d’une indignation hypocrite. Car c’est leur police qui ne fait là que son travail, celui qui consisterait à protéger les valeurs républicaines et la sacro-sainte propriété privée que l’on traiterait ainsi ! Macron, son gouvernement et son célébre ministre de l’Intérieur Castaner y sont tous allés de leurs petites larmes avec un seul mot à la bouche : il faut renforcer les moyens de notre police ainsi dénigrée et harcelée. Il faut davantage de policiers, davantage de gendarmes, de CRS, de flashballs et de blindés. La classe bourgeoise utilise donc cyniquement les comportements nihilistes d’une petite-bourgeoisie et d’un lumpen-prolétariat en voie de putréfaction pour tenter d’enchaîner la population et la classe ouvrière derrière son État et la défense de ses intérêts de classe. Voilà à quoi sert le désespoir des couches de la société en voie de décomposition, gagnées par la colère, l’impuissante et l’absence d’avenir. Face à la violence de la classe dominante, la petite-bourgeoisie réagit, elle aussi, de manière suicidaire. Tous les ouvriers qui seraient tentés de suivre ce chemin doivent savoir qu’il mène tout droit à l’impasse et à la répression étatique des luttes ouvrières.
La violence de masse, consciente et organisée du prolétariat
Plus le capitalisme est en crise, plus il attaque les conditions de vie du prolétariat et plus il renforcera son appareil répressif. C’est à une violence concentrée, organisée, spécialisée, entretenue, en constant développement et perfectionnement auquel le prolétariat aura affaire. C’est pour cela que les révolutionnaires ont toujours affirmé que la prise du pouvoir par la classe ouvrière signifiera la suppression de tous les moyens de répression de masse propre aux États bourgeois. Comme la révolution en Russie en 1917 l’a montré, ce n’est que dans les moments où le prolétariat est en mesure de monter à l’assaut du pouvoir de la bourgeoisie que des parties entières des forces de répression peuvent rejoindre la révolution en marche. Tel était le sens de l’appel de Trotsky à cette époque aux forces de répression tsariste qu’étaient les cosaques. “La lutte du prolétariat, comme toute lutte sociale, est nécessairement violence mais la pratique de sa violence est aussi distincte de la violence des autres classes et couches comme sont distincts leur projet et leur but. Sa pratique, y compris la violence est l’action d’immense masses et non de petites minorités ; elle est libératrice. l’acte d’accouchement d’une société nouvelle harmonieuse et non la perpétuation d’un état de guerre permanent, chacun contre tous et tous contre chacun”.1 Elle est la négation vivante de tous ces appels au meurtre et au suicide collectif, porteur d’une idéologie totalement déshumanisée et barbare.
Kern, 15 mai 2019
1 “Résolution : Terrorisme, terreur et violence de classe”, Revue Internationale n° 15, 4e trimestre 1978.
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Gilets jaunes [22]
Rubrique:
Incendie de Notre-Dame de Paris: le capitalisme est incapable de préserver le patrimoine de l’humanité !
- 290 reads
Le 15 avril dernier, les images spectaculaires de Notre-Dame en flammes faisaient le tour du monde. Une vive émotion s’emparait de la planète : cette cathédrale est l’un des plus beaux et impressionnants chefs-d’œuvre de Paris, un joyau de l’architecture gothique dont la construction s’est étendue sur pas moins de deux siècles et qui inspira de nombreux artistes : Victor Hugo, bien sûr, mais aussi le cinéaste Jean Delannoy ou le chanteur libertaire Léo Ferré. Les flammes ont notamment emporté la flèche de la cathédrale, œuvre de Viollet-le-Duc, et l’impressionnante charpente en bois de chêne datant du XIIe et du début du XIIIe siècle. L’architecture sublime de Notre-Dame n’a rien à voir avec celle de la Basilique du Sacré-Cœur, ce pompeux chou à la crème bâti à la va vite au sommet de la butte Montmartre pour célébrer la répression de la Commune de Paris et exorciser “les malheurs qui désolent la France et les malheurs plus grands peut-être qui la menacent encore” (1) (ceux d’une “odieuse” révolution prolétarienne !)
Le patrimoine de l’humanité menacé par la décomposition du capitalisme
L’incendie n’était pas encore éteint que les politiciens, gouvernement en tête, se précipitaient sur le parvis de Notre-Dame (ou sur les plateaux de télévision), larme de crocodile à l’œil, pour réaliser, telle Esméralda, leur numéro de saltimbanques devant les caméras. “Demain, nous reconstruirons tout, pierre par pierre, poutre par poutre, ardoise par ardoise”, déclarait ainsi l’ancien porte-parole du gouvernement (et postulant à la mairie de Paris), Benjamin Griveaux. “Meurtrissure pour nous tous. Nous reconstruirons Notre-Dame”, s’élevait le flamboyant mathématicien (et postulant à la mairie de Paris), Cédric Villani. “Tous solidaires face à ce drame”, s’écriait l’eurodéputée (et, elle aussi, postulante à la mairie de Paris), Rachida Dati. Au même moment, la maire de Paris (et candidate à sa propre réélection), Anne Hidalgo, serrait dans ses bras le chef de l’État, Emmanuel Macron, venu, le visage sombre, jouer son petit numéro de père de la nation : “C’est la cathédrale de tous les Français, même de ceux qui n’y sont jamais venus”.
Sans surprise, la bourgeoisie et ses médias sont partis à la chasse aux boucs-émissaires : qui est LE responsable ? Qui a oublié d’éteindre son fer à souder ? Qui n’a pas vérifié telle ou telle installation électrique ? D’autres ont plus clairement dénoncé le flagrant manque de moyens en affirmant sournoisement que la préservation du patrimoine ne représente “que” 3 % des 10 milliards d’euros du budget du ministère de la Culture, sous-entendu : les artistes, les théâtres, les salles de concert (le “spectacle vivant” en langage technocratique) coûtent trop cher !
Mais derrière les fougueuses déclarations d’amour à Notre-Dame et la recherche de boucs-émissaires, la froide réalité du capitalisme s’impose encore et toujours. Pour maintenir compétitif le capital national, l’État opère des coupes budgétaires partout où cela est possible : éducation, hôpitaux, prestations sociales, culture… tout y passe ! Ainsi, à l’exception des monuments les plus visités (c’est-à-dire rentables et, d’ailleurs, victimes d’une sur-fréquentation causant des dommages évidents), Macron et consorts se soucient comme d’une guigne des “vieilles pierres” trop coûteuses en entretien. Depuis 2010, le déjà ridicule budget alloué à la préservation du patrimoine a ainsi diminué de 15 %. (2) Cette année, le gouvernement prévoyait de consacrer seulement 326 millions d’euros à la préservation et à la restauration de pas moins de 44 000 “monuments historiques”. Heureusement, le président jupitérien a confié au chroniqueur mondain reconverti en historien de pacotille, Stéphane Bern, la mission de sauver le “patrimoine des Français”. Une loterie et quelques polémiques plus tard, l’animateur de télévision levait 19 millions d’euros… une paille comparée aux besoins.
Le cas de l’Italie est encore plus révoltant. L’exceptionnel patrimoine de la péninsule est littéralement en train de tomber en ruines suite à des coupes budgétaires massives rendues nécessaires par la crise et l’accroissement de la compétition mondiale : le site archéologique de Pompéi est dans un état désolant, le Colisée de Rome commence à montrer de graves signes de fragilité, tout comme le musée des Offices à Florence. Les monuments qui ne se trouvent pas sur les autoroutes touristiques sont, eux, carrément laissés à l’abandon. L’incendie du musée national de Rio de Janeiro, le 2 septembre 2018, relève de la même incurie de l’État brésilien qui est directement responsable de la perte de la quasi-totalité des 20 millions d’objets que renfermait le bâtiment, dont un fossile humain de 12 000 ans.
L’ensemble des spécialistes qui se sont exprimés depuis l’incendie de Notre-Dame, historiens de l’art, conservateurs ou architectes du patrimoine ont tous fait état d’un manque cruel de moyens et d’une très inquiétante dégradation des monuments. Didier Rykner, rédacteur en chef de La Tribune de l’art, a ainsi dénoncé le laxisme des normes de sécurité sur les chantiers de monuments historiques : “Il y a déjà eu une série d’incendies de ce type. Les prescriptions pour les travaux sur monuments historiques étaient insuffisantes. (…) Un architecte du patrimoine m’a dit qu’on aurait pu éviter ça avec certaines mesures”. (3) En effet, l’incendie de la cathédrale Notre-Dame est loin d’être un cas isolé : “J’ai visité, il y a quelque temps, l’église de la Madeleine. J’ai pris des photos de prises électriques dans tous les sens… ce n’est absolument pas aux normes. Demain, la Madeleine peut flamber”. En 2013, l’hôtel Lambert et ses décors peints du XVIIe siècle, situés non loin de la cathédrale, sur l’île Saint-Louis, étaient également partis en fumée pendant des travaux de rénovation. Plus récemment, le 17 mars dernier, un incendie frappait l’église Saint-Sulpice dans le VIe arrondissement de Paris. Maintenant, un nouveau “grand débat” est ouvert : Macron est-il réaliste quand il promet aux Français que “leur” cathédrale sera reconstruite “plus belle encore” d’ici cinq ans ? Faut-il reconstruire la charpente à l’identique en bois de chêne ou en béton ?, etc.
La barbarie du capitalisme détruit délibérément le patrimoine de l’humanité
Quand il s’agit de faire la guerre, la bourgeoisie se moque bien du patrimoine. Bombardements, incendies, destructions volontaires… la classe dominante ne manque pas d’imagination pour pulvériser les “grands trésors du monde” (Trump).
Lorsque Macron affirme : “nous avons bâti des villes, des ports, des églises”, il oublie de préciser que ce fut aussi sur les cendres de ce qu’avaient érigé d’autres “peuples de bâtisseurs”. Ainsi par exemple, la capitale du Vietnam, Hanoï, qui regorgeait de pagodes millénaires d’une grande beauté, fut sauvagement saccagée par l’impérialisme colonial français à la fin du XIXe siècle avec la bénédiction de l’Église catholique : le monastère Bao Thien (qui datait du XIe siècle) et la pagode Bao An furent ainsi volontairement incendiés au nom de l’évangélisation de la population autochtone bouddhiste. Entre 1882 et 1886, sur les cendres du monastère Bao Thien, les colons édifièrent, sur le modèle de Notre-Dame, la très laide et imposante cathédrale Saint-Joseph, symbole de la France coloniale, le tout financé, ironie de l’histoire… par une loterie nationale ! Le monastère Bao Thien, c’était aussi huit siècles d’histoire ravagés par les flammes d’un incendie criminel de la République française qui occupait le Tonkin !
Il en fut de même de la destruction du vieux temple et de la cité aztèque de Tenochtitlan, rasés par les colonisateurs espagnols aux ordres d’Hernan Cortés [41], qui fit édifier une église, devenue cathédrale sous Charles Quint et n’ayant rien de comparable avec les chefs-d’œuvre de l’art gothique, roman ou baroque.
En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés du camp démocratique bombardèrent la ville de Dresde, déversant sur une des plus belles cités d’Allemagne, la “Florence sur l’Elbe”, un torrent de fer et de feu. Dresde n’avait aucun intérêt stratégique sur le plan militaire et était même surnommée : la “ville-hôpital” avec ses 22 hôpitaux : près de 1 300 avions balancèrent des bombes incendiaires qui firent environ 35 000 victimes et anéantirent entièrement la vieille ville. La démocratie à l’œuvre contre le fascisme ! Il s’agissait surtout pour la bourgeoisie victorieuse de raser les grandes métropoles ouvrières de Hambourg comme de Dresde pour s’assurer qu’aucune tentative d’insurrection prolétarienne ne puisse surgir contre la barbarie guerrière (comme ce fut le cas en 1918 avec la révolution allemande).
D’après l’UNESCO, institution à qui le panier de crabes impérialistes onusien a confié la protection du “patrimoine mondial” : “la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde”. Quand, jour après jour, les “États membres” transforment le Moyen-Orient, de la Syrie au Yémen, en véritable champ de ruines, quand les grandes puissances démocratiques, États-Unis, France ou Royaume-Uni en tête, déversent chaque jour des tapis de bombes sur la planète, il y a de quoi vomir devant tant d’hypocrisie ! Personne ne s’étonnera donc que Trump, président de la première puissance impérialiste mondiale, préconise d’envoyer stupidement des “bombardiers d’eau” pour arroser Notre Dame ! (4)
Une nouvelle campagne d’union nationale sur les cendres de Notre-Dame
“C’est à nous, les Françaises et les Français d’aujourd’hui, qu’il revient d’assurer cette grande continuité qui fait la nation française”, déclarait Macron le lendemain de l’incendie de la cathédrale. Pour assurer la “grande continuité qui fait la nation française”, le gouvernement appelait, le soir même de la catastrophe, à la “générosité des Français” et mettait en place une “collecte nationale”.
La bourgeoisie s’en est mis plein les poches pendant des années sans rien sécuriser, sans rien entretenir et n’a aucun scrupule à désormais racketter le “citoyen” et le petit contribuable, en lui demandant de mettre la main à la poche au nom de la sauvegarde du symbole de la nation française. Tout le “peuple” de France, bourgeois et prolétaires devrait désormais se rassembler autour de la reconstruction de la cathédrale, parce que c’est “notre destin” (Macron) ! Les grandes et richissimes familles bourgeoises ont d’ailleurs montré l’exemple en débordant de “générosité”, chacune se bousculant au portillon pour être parmi les premières à vouloir remplir la cagnotte et étaler son hypocrite “philanthropie”.
La bourgeoisie a su instrumentaliser l’émotion pour lancer une nauséabonde campagne d’union nationale où tout le peuple de France est appelé à partager les larmes des grenouilles de bénitier de l’Église catholique, des grands patrons de la bourgeoisie, de Sarkozy à Mélenchon et de tous les “élus” de droite comme de gauche. Lorsque Macron promet de rebâtir Notre-Dame, “et je veux que cela soit achevé d’ici cinq années”, il n’a qu’un seul objectif, pathétiquement chauvin : finir les travaux avant les Jeux olympiques de Paris pour soigner et astiquer “l’image de la France”.
La classe ouvrière ne peut fonder sa perspective révolutionnaire que sur la véritable préservation du patrimoine culturel, artistique et scientifique de l’humanité, un patrimoine que le capitalisme ne peut que continuer à détruire ou à laisser s’effondrer morceau par morceau. Pour le prolétariat, l’art n’est pas un marché juteux ou une pompe à touristes ; il aspire plutôt à bâtir la première culture universelle et vraiment humaine de l’Histoire, une culture où aucun monument, aucun chef-d’œuvre ne sera le symbole du prestige de telle ou telle nation. Car le but ultime de la lutte révolutionnaire du prolétariat contre le capitalisme est l’abolition des frontières et des États nationaux. Dans la société communiste du futur, les œuvres d’art seront toutes considérées comme des “merveilles du monde” et des symboles de la créativité et de la puissance de l’imagination propre à l’espèce humaine.
En hommage à ce grand artiste que fut Léon Tolstoï, Trotski écrivait d’ailleurs : “S’il ne sympathise pas avec nos buts révolutionnaires, nous savons que c’est parce que l’histoire lui a refusé toute compréhension de ses voies. Nous ne le condamnerons pas pour cela. Et nous admirerons toujours en lui non seulement le génie, qui vivra aussi longtemps que l’art lui-même, mais aussi le courage moral indomptable qui ne lui permit pas de rester au sein de son Église hypocrite, de sa Société et de son État, et qui le condamna à rester isolé parmi ses innombrables admirateurs”.
EG, 22 avril 2018
1Alexandre Legentil, l’un des initiateurs de l’édification du Sacré-Cœur, cité par Paul Lesourd, Montmartre (1973).
2“Quelle politique patrimoniale la France va-t-elle mener pour éviter que ne se répètent ces tragédies ? [42]”, Le Monde (19 avril 2019).
3“Pourquoi les historiens de l’art et spécialistes du patrimoine sont en colère [43]”, France Info (16 avril 2019).
4Trump est tellement idiot qu’il ne se doutait pas qu’un largage aérien de trombes d’eau sur Notre Dame aurait provoqué un choc thermique et entraîné l’effondrement de la structure de la cathédrale !
Géographique:
- France [24]
Personnages:
- Quasimodo [44]
Rubrique:
Grèves dans les maquiladoras (Mexique): le mirage syndicaliste a stérilisé la combativité ouvrière
- 111 reads
Matamoros est une ville de l’État de Tamaulipas, qui est considérée comme l’une des régions les plus dangereuses du Mexique. Elle est le théâtre d’affrontements incessants entre les gangs mafieux qui se querellent pour leurs zones de contrôle, semant la mort et la terreur. Les enlèvements, l’extorsion et les meurtres sont des phénomènes auxquels sont fréquemment confrontés les habitants de cette région, mais il en va de même pour les migrants, mexicains ou centraméricains, qui doivent traverser la zone pour atteindre les États-Unis. 1 Matamoros, bien qu’étant marquée par cet environnement effroyable, fait partie de la zone frontalière industrielle formée à la fin des années 1960, qui a pu être renforcée et étendue au milieu des années 1990 grâce à l’ALENA. 2 Rien que sur cette partie de la frontière, près de 200 maquiladoras, 3 qui ne sont plus de petites et moyennes usines comme dans les années 1970, ont été installées. Certaines d’entre elles sont de grandes entreprises implantées sur différents sites et ont un effectif pouvant atteindre deux mille ouvriers.
Dans ces usines, les ouvriers travaillent à des rythmes effrénés. Depuis 2002, leur temps de travail est passé de 40 heures à 48 heures par semaine, tout en maintenant des salaires quasi-bloqués depuis 15 ans, avec parfois des variations annuelles minimes. Cependant, afin de pouvoir maintenir les seuils de productivité et d’importants bénéfices, il faut impérativement entretenir une surveillance ainsi qu’un contrôle technique et politique au sein de l’usine par le biais de superviseurs et de contremaîtres, mais plus encore au travers de l’organisation syndicale. Une productivité élevée et de bas salaires (qui rivalisent avec ou égalent les maigres salaires des ouvriers chinois) sont la combinaison qui a permis à ces projets d’investissement de faire de gros profits, mais la présence vigilante des syndicats est essentielle pour assurer la soumission des ouvriers et la pérennité de cette situation.
Compte tenu du climat général à la frontière, du contrôle politique féroce imposé aux usines de Matamoros par les syndicats et la direction, il semblait peu probable qu’une réaction ouvrière voit le jour dans cette zone, et plus encore, qu’elle puisse exprimer une grande combativité et une forte capacité à créer des liens de solidarité. Tout cela montre que la classe ouvrière a un potentiel et des capacités de lutte toujours vivants, mais qu’elle ne parvient pas à prendre le contrôle de son combat. Le poids de la confusion et le manque de confiance en ses forces est néanmoins un problème qui a caractérisé les mobilisations.
L’appareil gauchiste du capital assure que ce qui s’est passé récemment à Matamoros était une “révolte ouvrière”, d’autres affirment qu’il s’agissait d’une attaque contre le Président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) et de sa “quatrième transformation”, tandis que d’autres parlent d’une “grève sauvage de masse” Ces affirmations, en plus d’être fausses, sont trompeuses et attaquent directement les ouvriers : elles tendent un voile sur la réalité afin d’éviter que ces derniers puissent tirer les leçons de leurs luttes.
Les forces prolétariennes se noient dans le Code du travail de la bourgeoisie
Le slogan qui a unifié et mobilisé les ouvriers pendant un peu plus d’un mois, et leur permettait de simplifier leur revendication, était “20-32” : augmentation de salaire de 20 %, et versement d’une prime de trente-deux mille pesos (1 660 dollars). Le principal élément déclencheur ayant alimenté le mécontentement et animé la lutte a donc été la dégradation des conditions de vie des ouvriers, mais le contrôle exercé par les syndicats a canalisé cette combativité. Dès le début des mobilisations, une méfiance à l’égard des syndicats s’est exprimée, mais à aucun moment les ouvriers ne sont parvenus à comprendre que les syndicats n’étaient plus des instruments dont ils pouvaient se servir afin de défendre leurs intérêts. C’est pourquoi ils se sont soumis à leurs pratiques, faisant toujours preuve d’indécision et d’une certaine naïveté. Au début, lorsque le mécontentement ouvrier commençait à s’étendre, ils ont cru possible de “faire pression” sur le “leader syndical” et de l’obliger à “prendre leur défense”. Puis, cette indécision s’est transformée en confusion généralisée lorsque les ouvriers ont considéré qu’il suffisait de recevoir des “conseils juridiques honnêtes” pour faire valoir leurs “droits”.
En plaçant leurs espoirs dans les lois et dans une avocate pour “défendre leur intérêts”, la mobilisation ouvrière s’est affaiblie et la confusion a gagné du terrain. En se sentant “protégés” par l’avocate, ils n’ont plus cherché à prendre le contrôle de leur lutte, ce qui souligne un grave problème auquel est actuellement confrontée la classe ouvrière : le manque de confiance en ses propres forces et son absence d’identité de classe.
Cette difficulté a conduit à ce que, malgré leur méfiance à l’égard des organisations syndicales, ils sont restés sous leur contrôle et sur leur terrain, celui qu’encadrent les lois du travail. Ce sont ces mêmes lois qui donnent du pouvoir aux syndicats, en tant que signataires de conventions collectives. En s’accrochant fermement aux directives syndicales, les ouvriers ont cédé le contrôle de la lutte au syndicat lui-même, en lui permettant de contenir le mécontentement, de museler la combativité, et d’imposer le respect des lois bourgeoises, empêchant ainsi la réalisation d’une véritable unification des forces ouvrières, qui s’organiserait hors du syndicat.
En réduisant la lutte au simple respect des lois, les ouvriers, même s’ils s’affichent dans la rue de manière unie et qu’ils tiennent des assemblées générales, au moment de faire face au patron, à l’État et au syndicat, agissent séparément, usine par usine et contrat par contrat. C’est ce que prévoit la législation bourgeoise, qui de cette manière, divise et isole les travailleurs. Au bout du compte, les lois sont faites pour soumettre les exploités.
Alors, est-il possible de lutter hors du syndicat, et au-dessus des lois ? La classe ouvrière, de par son histoire, a connu diverses expériences qui confirment cette possibilité. Par exemple, en août 1980, les ouvriers polonais ont organisé une grève de masse qu’ils contrôlaient véritablement. Ni le déclenchement de la grève, ni la construction de leurs organes unitaires de combat n’étaient conformes aux directives légales, mais ils ont réussi à étendre la mobilisation à tout le pays et à imposer une négociation publique avec le gouvernement. Le caractère massif des mobilisations et leur capacité d’organisation leur ont permis de créer une grande force capable de prévenir la répression. 4
Le mécanisme que l’État polonais a utilisé pour diviser et affaiblir les travailleurs a précisément été le même qu’emploient toutes les bourgeoisies du monde entier : les syndicats. Avec la création du syndicat Solidarność (dirigé par Lech Walesa), l’État a brisé l’organisation et l’unité des travailleurs, ce qui lui a permis d’enfin étendre la répression. Quelque temps plus tard, le leader syndicaliste, Lech Walesa, est nommé chef de l’État polonais.
Les ouvriers et particulièrement ceux de Matamoros doivent recouvrer leur capacité d’analyse ; l’expérience de la grève de masse en Pologne et de sa répression en est le meilleur exemple. Elle montre clairement que le syndicat est une organisation qui agit à l’encontre des ouvriers et qu’il ne suffit pas de s’en méfier : il est impératif de s’organiser en dehors de lui, et en dehors de son terrain de mobilisation.
Les syndicats contre la classe ouvrière
La première grande leçon à tirer de la lutte des ouvriers des maquiladoras est que le syndicat est une arme de la bourgeoisie. 5 L’attitude éhontée des syndicats, en poussant les ouvriers à accepter une augmentation plus faible et à rejeter la prime, révèle de façon claire qu’ils ne sont désormais plus un instrument du prolétariat (comme c’était alors le cas au XIXe siècle). Les menaces et les agressions directes perpétrées par les Syndicats des travailleurs Journaliers et des Ouvriers Industriels et de l’Industrie Maquiladora (SJOIIM) et par le Syndicat industriel des travailleurs des usines de Maquiladoras et d’assemblage (SITPME) ont seulement confirmé ouvertement que les intérêts qu’ils défendent ne sont plus ceux des ouvriers. En opérant sous couverture dans les rangs prolétariens, ils se révèlent être des armes de la bourgeoisie, tels des loups déguisés en moutons.
Au cours des grèves, les syndicats ont agi en défendant les intérêts du patronat, c’est pourquoi la majorité des ouvriers, lors des mobilisations, ont fait part de leur rejet des dirigeants syndicaux, Juan Villafuerte et Jesús Mendoza, et que les cris “dehors les syndicats !” ont retenti sans cesse dans chaque usine et chaque manifestation. Ceci met en évidence le courage des ouvriers et la défiance envers les syndicats. Cependant, les ouvriers sont restés enfermés dans cette forme de bravoure et de combativité, sans réussir à la dépasser. Parce qu’ils n’ont pas confiance en leur propre force, au lieu de prendre le contrôle de la lutte, en s’organisant de façon unifiée en une structure qui les amènerait à rompre complètement avec la domination du syndicat et la division sur laquelle il joue, ils ont reproduit le même schéma : officiellement, ils ont cessé de suivre passivement la direction “traîtresse” du syndicat, pour suivre tout aussi passivement la “nouvelle direction” informelle, représentée par leur conseillère juridique, l’avocate Susana Prieto, qui a utilisé ses compétences de juriste 6 pour replacer la lutte de classe dans le cadre de la législation bourgeoise, et qui a suscité un espoir dans la création d’un syndicat “indépendant”, qui disputerait la convention collective aux anciennes organisations syndicales.
Le travail de confusion, de soumission et de contrôle que réalisent les syndicats n’est pas l’apanage de certains pays ou de certains syndicats, ils sont tous des armes de la bourgeoisie. Peut-on considérer qu’il existe une différence entre le SNTE et la CNTE ? 7 L’un utilise un langage traditionnel, tandis que l’autre a recours à des discours et des actions d’une apparente radicalité, alors que leur objectif est le même : la soumission et le contrôle des ouvriers.
Il n’est donc pas surprenant que le gouvernement de AMLO encourage très discrètement la création d’organisations syndicales qui lui permettront d’utiliser et d’orienter le mécontentement des ouvriers vers un affrontement avec des anciennes organisations syndicales, principalement associées au Parti de la Révolution Institutionnelle (PRI, comme c’est le cas de la CTM, la CROM et la CROC). 8 López Obrador n’a pas seulement “sauvé” le chef mafieux du Syndicat mexicain des mineurs et des métallurgistes, Napoleón Gómez Urrutia (“Napito”) de son prétendu exil au Canada, où il vivait luxueusement depuis les deux derniers sexennats, pour faire de lui un sénateur, mais surtout pour que celui-ci façonne une “nouvelle fédération syndicale”. Quelques mois après son retour à Mexico, “Napito” a créé la Confédération Internationale des Travailleurs (CIT), englobant des syndicats qui se sont détachés de la CTM et de la CROC, et a également conclu des alliances avec des syndicats américains et canadiens, en particulier l’AFL-CIO et les Métallos. 9
Le président Lopez Obrador, lors de son discours du 14 février dernier, a affirmé que le gouvernement n’interviendrait pas dans la vie des syndicats. Il a néanmoins ajouté : “Nous ne pouvons pas empêcher les travailleurs ou les cadres de pouvoir, conformément à la loi, de demander la création d’un nouveau syndicat” (d’après le quotidien La Jornada). 10 C’est dans cette optique qu’apparaissent de “nouveaux” syndicats, avec ceux qui cherchent à affaiblir les anciens syndicats répondant aux intérêts de fractions bourgeoises différentes de celles qui gravitent désormais autour du nouveau gouvernement. C’est ainsi que des projets syndicaux “alternatifs” ont vu le jour au sein de l’IMSS, de la PEMEX et de l’UNAM. 11
Au XIXe siècle, les syndicats ont été un instrument important du combat et de l’unité des ouvriers. Le capitalisme lui-même, en développant les forces productives, a permis la mise en œuvre de réformes économiques et sociales améliorant les conditions de vie des travailleurs. Aujourd’hui, il est impossible pour le système capitaliste d’apporter des améliorations durables au sort des ouvriers. Cette situation a conduit les syndicats à perdre leur caractère prolétarien et à leur intégration dans l’État. C’est pourquoi à chaque lutte que mènent les travailleurs, ces derniers trouvent le syndicat en train d’essayer de contenir et de saboter la lutte, en assujettissant le mécontentement aux directives des lois bourgeoises, en créant des confusions et des craintes pour affaiblir la confiance et ainsi empêcher l’unité et l’extension de la lutte.
Quelles sont les leçons à tirer du “Mouvement 20-32” ?
La mobilisation menée par les ouvriers des maquiladoras a sans aucun doute été un événement très combatif, mais elle n’a pas pu éviter que la majeure partie des ouvriers s’illusionnent sur les lois et le syndicat lui-même, car s’est étendu l’espoir confus selon lequel les lois, ainsi que les syndicats, s’ils sont dirigés “de manière honnête”, pourraient perdre leur nature anti-prolétarienne. Même la référence au décret de Lopez Obrador (“Décret sur les mesures d’incitation fiscale dans la région frontalière du Nord”) 12 pour montrer la “légalité” de l’augmentation salariale dans les maquiladoras, a permis de voir que la confusion est encore plus profonde, car elle nourrit l’espoir que le nouveau gouvernement puisse améliorer les conditions de vie des travailleurs. De plus, le gouvernement d’AMLO a profité de la mobilisation des travailleurs pour montrer à son partenaire nord-américain sa volonté de se conformer aux augmentations salariales dans les usines des secteurs automobiles et électroniques installées au Mexique, comme l’exige le gouvernement de Trump dans les accords ALENA 2.0 (ou rebaptisés USMCA, États-Unis-Mexique-Canada Agreement).
Il ne suffit pas de quantifier le nombre d’usines dans lesquelles le cahier des charges a été accepté pour faire le point sur les mobilisations. Cet aspect est important, mais il n’est pas suffisant. Pour avoir une vision plus large, il est nécessaire d’évaluer la force massive que les mobilisations ont pu unifier, mais il est surtout primordial de prendre en considération le niveau de conscience qui a été atteint et qui s’est exprimé au travers de formes organisationnelles que le mouvement a pu prendre. Par exemple, le manque de contrôle de la mobilisation par les travailleurs eux-mêmes et la dispersion à la fin de la plupart des grèves brisent les liens de solidarité et permettent que des représailles aient lieu. Selon les chiffres officiels, 5 000 ouvriers ont été licenciés pour avoir participé à la grève.
Pour résumer, les grèves ont permis à une combativité ouvrière, motivée par la dégradation de ses conditions de vie, de voir le jour, mais la bourgeoisie a rapidement soumis ces élans de courage, en entretenant le voile illusoire “du respect démocratique” des lois et en empêchant le développement de la conscience.
Plus grave encore, les problèmes qui se sont développés au cours de la mobilisation pourraient s’étendre et s’aggraver. Le manque de réflexion, et l’enthousiasme avec lequel les grèves ont été levées ont créé un environnement très propice au renouvellement des illusions dans les lois et dans les nouvelles organisations syndicales. La “conseillère juridique” des ouvriers a elle-même déclaré que durant la “seconde phase” du mouvement 20-32, ils s’orienteront vers la formation d’un syndicat “indépendant” qui concurrencera les anciennes organisations syndicales, et qui, en plus de cela, établira à Matamoros un cabinet d’avocats “honnêtes” pour “défendre” les ouvriers. Encore plus d’illusions et plus de confusion, c’est tout ce qui risque de se propager. La seule issue pour les ouvriers face à cette offensive est la lutte, en s’assurant d’en prendre le contrôle, et de réfléchir de manière approfondie sur la nature des syndicats et leur intégration à l’appareil d’Etat partout dans le monde.
Tatlin, avril 2019
Révolution Mundial, organe du CCI au Mexique
1 En 2010, a été faite une découverte macabre de 79 corps de migrants centraméricains. L’année suivante, en 2011, une fosse contenant environ 200 corps a été trouvée, bien que certaines sources ont déclaré qu’il y avait en réalité près de 500 cadavres.
2 ALENA : Accord de Libre-échange Nord-Américain signé par les États-Unis, le Canada, le Mexique, entré en vigueur en 1994 et renégocié par Trump dans l’ALENA 2.0.
3 Les maquiladoras, sont des usines de montage en zone franche qui assemblent des biens importés exemptés de droits de douane et destinés à être intégralement réexportés. Ce sont pour la plupart des usines de l’industrie textile ou des usines d’assemblages du secteur automobile. Elles servent aussi à retenir et à surexploiter une main-d’œuvre migrante latino-américaine à l’intérieur et tout le long de la zone frontalière mexicaine (NdT).
4 Sur l’expérience de la Pologne en 1980, voir “Grève de masse en Pologne 1980 : une nouvelle brèche s’est ouverte”, Revue Internationale n° 23 (4e trimestre 1980) et “Un an de luttes ouvrières en Pologne”, Revue Internationale n° 27 (4e trimestre 1981).
5 Voir notre brochure “Les syndicats contre la classe ouvrière”.
6 Nous n’avons pas l’intention de nous perdre en conjectures concernant “l’honnêteté” de l’avocate Susana Prieto. Le principe de sa profession l’amène à évoluer dans le cadre des lois bourgeoises. Le fait qu’elle maintienne une sympathie et un soutien (comme elle l’a elle-même déclaré) au gouvernement de López Obrador, la place sur un terrain clairement bourgeois.
7 SNTE : Syndicat National des Travailleurs de l’Éducation (syndicat officiel). CNTE : Centrale Nationale des Travailleurs de l’Éducation (syndicat “dissident”)
8 CTM : la Confédération de Travailleurs du Mexique, a été créée en 1936. CROM : la Confédération Régionale Ouvrière Mexicaine, fondée en 1918. CROC : la Confédération Révolutionnaire des Ouvriers et des Paysans, formée en 1952.
9 L’American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations, dite AFL-CIO, est la plus grande organisation et fédération syndicale des États-Unis, regroupant également des syndicats tel que les Métallos (United Steelworkers) du Canada dont “Napito” a une grande expérience de toutes les arcanes après y avoir exercé de hautes fonctions pendant 12 ans (entre 2006 et 2018) avant de rentrer au Mexique pour se faire élire sénateur sous l’étiquette du parti d’AMLO, Morena.
10 Il y a derrière cette illusion, une véritable lutte entre fractions bourgeoises pour le contrôle de l’appareil d’encadrement syndical, les syndicats traditionnels, largement discrédités, étant une courroie de transmission des anciens gouvernements (en particulier du PRI) alors que les “nouveaux” syndicats, dits “indépendants”, qui fleurissent aujourd’hui, sont plus ou moins ouvertement instrumentalisés par le nouveau gouvernement : pour gagner ce contrôle face à ses concurrents au sein de la bourgeoisie et parce qu’il est conscient de la nécessité et de l’urgence de recrédibiliser l’appareil syndical dont l’image est fortement ternie par l’implication de la plupart de ses dirigeants dans la corruption généralisée qui règne dans le pays, face aux attaques en préparation contre la classe ouvrière et ses luttes à venir (NdT).
11 IMSS : Institut Mexicain de la Sécurité Sociale. PEMEX : La première compagnie pétrolière mexicaine avec un rayonnement international. UNAM : Université nationale autonome du Mexique, considérée comme l’une des meilleures au monde.
12 Le 10 décembre 2018, le gouvernement de AMLO, a présenté un programme afin d’encourager l’emploi et l’investissement dans la zone frontalière. Leur objectif est de coopter une partie des migrants mexicains et centraméricains, dans le but de ralentir les flux migratoires vers les États-Unis.
Géographique:
- Mexique [45]
Récent et en cours:
Rubrique:
Salaire de Philippe Martinez (CGT): la bourgeoisie nourrit grassement ses chiens de garde
- 19820 reads
 Dernièrement, un fait-divers a discrètement fait les titres de quelques “petits” journaux et passant quasiment inaperçu dans les grands médias : le salaire de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, est gracieusement alimenté par une maternité déficitaire. Ce ponte syndical est, en effet, payé par la CGT-métallurgie, elle-même propriétaire de centres de réadaptation professionnelle et… d’une maternité dans le 12e arrondissement parisien à laquelle ce syndicat fait payer un loyer exorbitant (plus d’un million d’euros par an !), contribuant à mettre les comptes de la maternité dans le rouge et nécessitant, au bout du compte, la mise en œuvre d’un plan social.
Dernièrement, un fait-divers a discrètement fait les titres de quelques “petits” journaux et passant quasiment inaperçu dans les grands médias : le salaire de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, est gracieusement alimenté par une maternité déficitaire. Ce ponte syndical est, en effet, payé par la CGT-métallurgie, elle-même propriétaire de centres de réadaptation professionnelle et… d’une maternité dans le 12e arrondissement parisien à laquelle ce syndicat fait payer un loyer exorbitant (plus d’un million d’euros par an !), contribuant à mettre les comptes de la maternité dans le rouge et nécessitant, au bout du compte, la mise en œuvre d’un plan social.
À première vue, la CGT, propriétaire d’une maternité, ça peut surprendre, mais la réalité du fonctionnement de l’État bourgeois est implacable : derrière ce petit fait divers, toute la logique du fonctionnement des syndicats, en France comme ailleurs, est mis en lumière. En tant que force d’encadrement de la classe ouvrière, les syndicats sont pleinement intégrés à l’État bourgeois qui les finance en très grande partie. (1)
Mais ces larges subsides ne semblent pas suffire, il leur faut en plus mettre en œuvre tout un tas de magouilles pour, notamment, financer le train de vie dispendieux de leurs dirigeants. Pour ce faire, les moyens ne manquent pas : capital immobilier, placements, organismes et établissements à faire fructifier. En clair : des entreprises capitalistes à faire tourner, des salariés à exploiter… Ainsi, les syndicats eux-mêmes participent à l’extraction de la plus-value dans certaines entreprises qu’ils sont amenés à gérer directement, se nourrissant du surtravail et participant à l’exploitation pour garantir un train de vie et des locaux de choix. Cela, sur le dos des salariés qui payent l’addition.
Si certains ont pu imaginer que le syndicat, en tant que “bon” patron immobilier, fasse un geste social, “solidaire” envers les employés de sa maternité. Que nenni ! Impossible de baisser le loyer, explique-t-on à la CGT, car celui-ci “contribue au financement de plusieurs postes de permanents de la fédération pour l’activité syndicale” (sic !). La CGT est donc au service de l’emploi… mais de l’emploi de ses sbires et de sa nomenklatura ! Non contents d’avoir des boîtes à faire tourner, les syndicats (car la CGT n’est pas la seule) ont des permanents et toute une bureaucratie syndicale à entretenir afin de pouvoir assurer leur rôle de saboteurs des luttes, d’encadrement et de flicage de la classe ouvrière.
Ces diverses magouilles ou opérations capitalistes ne diffèrent en rien de celles des grandes entreprises ou de la bureaucratie étatique, avec leurs placements financiers, détournements de fonds, corruption, opacité des comptes… Les magouilles institutionnalisées ne sont en fait qu’un rouage du fonctionnement quotidien de ces organes de l’État.
Entre autres exemples, nous pouvons citer les frais de fonctionnement injustifiés du Comité d’entreprise d’Air France, d’EDF, de la SNCF, les 130 000 euros octroyés pour la rénovation de l’appartement de fonction de Thierry Lepaon, l’ancien secrétaire général de la CGT (un scandale qui obligea le syndicat à l’écarter et nommer… Martinez à sa place). (2)
Autres exemples encore plus outranciers de ces mœurs bourgeoises : selon un rapport de la Cour des Comptes, comme tous les bourgeois ou les Comités d’Entreprise des grands groupes, les syndicats et les “œuvres sociales” qu’ils contrôlent apprécient aussi la vie de château : château de Courcelle-sur-Yvette, dans l’Essonne, pour la CGT, devenu “Centre Benoit-Frachon”, château de Bierville, à Boissy-la-Rivière, non loin d’Étampes, pour la CFDT, où l’on discute retraites, temps de travail et épargne salariale à l’ombre d’un colombier du XIVe siècle. FO, quant à elle, forme ses stagiaires au cœur de la forêt de Compiègne, au château de la Brévière… On croit rêver !
Tout ça au service de quoi ? Officiellement, bien sûr, au service de la classe ouvrière, au service de sa lutte et de son émancipation, et contre les patrons. Les salariés licenciés de la maternité du 12e, comme tous ceux que le CGT exploite sans vergogne, apprécieront la bonne blague !
Mais l’indignation ne suffit pas. Dénoncer ces dérives et en appeler comme le font bon nombre de syndicalistes militants sincères, au retour d’un syndicalisme “propre”, “moral”, “éthique” et “solidaire”, vraiment au service de la lutte ouvrière, est une chimère qui cache l’essentiel. Ces magouilles et ces fastes, dignes des pires patrons, ne sont pas des dérapages ponctuels d’une poignée de dirigeants véreux, non ils sont la conséquence de ce que sont vraiment devenus les syndicats : des rouages de l’État, des structures aux mains de la bourgeoisie pour défendre son système d’exploitation en détruisant de l’intérieur des entreprises les tentatives de luttes ouvrières.
Depuis plus d’un siècle, les syndicats et le syndicalisme n’appartiennent plus à la classe ouvrière. (3) Ni dans leurs structures, ni dans leurs objectifs, ni dans leur fonctionnement.
Stopio, 26 avril 2019
(1) En 2016, les syndicats ont reçu 83 millions d’euros de la part de l’État via le fonds de financement du dialogue social, dont près de 19 millions d’euros pour la CGT. Les anciens dirigeants syndicaux sont également souvent intégrés, en marge des commissions parlementaires ou “groupes de travail”, en tant que “personnalités qualifiées”. C’est le cas de Bernard Thibault, ex-leader de la CGT, qui a participé en 2015, par exemple, à un “groupe de travail sur l’avenir des institutions” (tout un programme !) présidé par Claude Bartolone et Michel Winock.
(2) Dans la liste des “scandales” récents qui éclaboussent régulièrement les syndicats, on peut évoquer celui du fichage et de la surveillance étroite par FO de ses membres. Lire notre article : “Listing à FO,derrière le scandale, la logique du Capital !”, Révolution internationale n° 473 (nov.-déc. 2018).
(3) Voir notre brochure : “Les syndicats contre la classe ouvrière”.
Personnages:
- Philippe Martinez [48]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Révolution internationale n° 477 - juillet août 2019
- 163 reads
Tensions Iran – États-Unis: le capitalisme, c’est le chaos et la barbarie !
- 182 reads
Gaza, Liban, Syrie, Irak, Afghanistan, Yémen… la spirale infernale du chaos impérialiste ne cesse de plonger le Moyen-Orient dans la barbarie la plus profonde, concentrant sur cette région du monde ce que le capitalisme décadent a de plus ignoble. Après des décennies de déstabilisations, d’invasions, de guerres civiles et de toutes sortes de conflits meurtriers, c’est l’Iran qui se trouve à nouveau dans l’œil du cyclone. En 2015, sous l’ère Obama, l’Iran signait avec les membres du conseil de sécurité de l’ONU et l’Allemagne, un accord visant à contrôler son programme nucléaire en échange d’une levée des sanctions économiques qui frappent le pays depuis des décennies. Soutenu par les “faucons” américains, le Premier ministre israélien et la monarchie saoudienne, Donald Trump n’a cependant cessé, depuis son arrivée au pouvoir, de dénoncer “le pire accord de l’histoire” avant d’annoncer, en mai 2018, que les États-Unis s’en retiraient définitivement. (1)
Depuis, les tensions et les provocations se sont multipliées de toute part. Les États-Unis ont ouvert le bal en rétablissant un embargo féroce. Un an plus tard, l’Iran menaçait de suspendre ses engagements en augmentant ses réserves d’uranium enrichi, déclenchant une nouvelle salve de sanctions. Quelques jours avant l’annonce de Téhéran, invoquant d’obscures “indications d’une menace crédible”, les États-Unis déployaient dans le Golfe persique le porte-avions USS Abraham Lincoln et plusieurs bombardiers. Selon le New York Times, le Pentagone prévoirait de mobiliser pas moins de 120 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. L’USS Arlington et le système de défense aérienne Patriot ont déjà pris la route du détroit d’Ormuz où transite une part importante de la production pétrolière mondiale.
Le 13 juin, un mois après le sabotage de quatre navires dans les mêmes eaux, la pression montait à nouveau d’un cran, suite à l’attaque de deux tankers norvégien et japonais que Trump attribuait à l’Iran en dépit des dénégations de ces derniers. (2) Une semaine plus tard, l’Iran abattait un drone américain accusé d’avoir survolé le territoire iranien. Dénégation, cette fois, de Trump qui lançait aussitôt ses bombardiers avant de se raviser à la dernière minute. Et tout cela au milieu des invectives, des menaces et des déclarations belliqueuses ! (3)
De toute évidence, Trump, qui ne s’embarrasse même plus des mystifications de rigueur sur la guerre “propre” et “humanitaire”, joue la stratégie de ce qu’il a lui-même nommé : la “pression maximale”, l’armée américaine n’ayant pas intérêt à ouvrir un nouveau front. Mais force est de constater que tous les ingrédients d’un dérapage guerrier sont réunis : une stratégie qui a fait la preuve de son inefficacité face à la Corée du Nord, des troupes prêtes au combat des deux côtés de la frontière, des va-t-en-guerre cyniques au sommet de l’administration américaine comme de l’État iranien… La stratégie très audacieuse de la “pression maximale” est surtout celle du risque maximum de guerre !
L’affaiblissement du leadership américain
Trump peut bien jouer les gros bras avec ses déclarations à l’emporte-pièce, ces tensions sont en réalité la manifestation très claire de l’affaiblissement historique du leadership américain. Lors de ses aventures militaires en Irak (1990 et 2003) et en Afghanistan (2001), l’Amérique a pu faire la démonstration de son incontestable supériorité militaire, mais elle a également fait étalage de son impuissance croissante à maintenir un minimum de stabilité dans la région et à obliger ses alliés de l’ancien bloc occidental à resserrer les rangs autour d’elle. Cet affaiblissement devait finalement déboucher sur l’incapacité des États-Unis à engager leurs forces terrestres en Syrie, laissant le champ libre à leurs rivaux régionaux, au premier chef desquels se trouvent la Russie mais également l’Iran.
Téhéran a ainsi pu s’ouvrir un véritable corridor militaire à travers l’Irak et la Syrie, jusqu’à son allié historique, le Hezbollah libanais, suscitant l’ire de son principal concurrent arabe dans la région, l’Arabie saoudite, et d’Israël qui a déjà mené des raids aériens contre les positions iraniennes en Syrie. De même, au Yémen, théâtre d’une guerre des plus atroces, l’Iran décrédibilise très sérieusement l’Arabie saoudite, principale puissance militaire de la région et pivot de la politique américaine au Moyen-Orient.
Dans ce contexte, l’ancien président Obama ne pouvait que se résigner à négocier un deal avec Téhéran : les États-Unis permettaient à Téhéran de se rebrancher à l’économie mondiale si l’État iranien acceptait de réfréner ses ambitions impérialistes, notamment par l’abandon de son programme nucléaire. Obama avait aussi derrière la tête une vieille stratégie de déstabilisation consistant à desserrer, par l’ouverture économique, l’emprise de la bourgeoisie locale sur sa population et susciter ensuite des révoltes pour renverser le régime en place.
Encore embourbés en Afghanistan, confrontés à des alliés européens qui traînent de plus en plus les pieds, les États-Unis sont désormais contraints de s’appuyer davantage sur leurs alliés régionaux pour mener à bien leur politique d’endiguement de l’Iran. C’est la raison pour laquelle Trump a récemment multiplié les gages de soutien en direction d’Israël et de l’Arabie saoudite : fourniture massive d’armes à l’Arabie saoudite dans sa guerre au Yémen, reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l’État hébreu, soutien de Trump au prince héritier saoudien après l’assassinat de l’opposant Jamal Khashoggi… Si les décisions musclées et spectaculaires de Trump répondent à des besoins tactiques immédiats, cette stratégie ne fera, de toute évidence, qu’accélérer davantage le processus de contestation du leadership américain, en général, et le chaos au Moyen-Orient, en particulier.
“Populiste” ou “progressiste”, la bourgeoisie sème le chaos
S’il est clair que la bourgeoisie américaine vise l’écroulement du régime des mollahs, elle demeure néanmoins divisée sur la manière de procéder. L’entourage de Trump est en partie constitué de va-t-en-guerre notoires voire, à l’image de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, de cow-boys sans foi ni loi à la gâchette facile. Bolton s’était, en effet, déjà illustré par son ardeur en faveur de l’invasion de l’Irak sous la présidence de Bush junior. L’Iran et ses ambitions impérialistes sont désormais ses cibles. Voici ce que ce responsable de la politique étrangère américaine écrivait déjà en 2015 dans le New York Times : “La vérité qui dérange, c’est que seule l’action militaire (…) peut accomplir ce qui est nécessaire. (…) Les États-Unis pourraient faire un travail minutieux de destruction [des installations nucléaires iraniennes], mais seul Israël peut faire ce qui est nécessaire. Une telle action devrait s’accompagner d’un soutien vigoureux des États-Unis à l’opposition iranienne, en vue d’un changement de régime à Téhéran”. (4) On ne pourra pas reprocher à Bolton de ne pas avoir de la suite dans les idées, ni d’être un hypocrite ! Pas un mot, pas une once de compassion pour ceux qui se trouveront sous les bombes américaines et iraniennes.
Mais les ambiguïtés et décisions contradictoires de Trump, au-delà des gesticulations irréfléchies du personnage, s’expliquent aussi par le fait qu’une partie de la bourgeoisie américaine, plus consciente de l’affaiblissement des États-Unis, demeure attachée à la méthode plus habile d’Obama. Trois élus républicains de la Chambre des représentants, dont leur chef de file, Kevin McCarthy, ont ainsi dû signer un communiqué qui appelle le gouvernement, en chœur avec le parti démocrate, à réagir de manière plus “mesurée” face à l’Iran. Mais la “mesure” dont parlent ces politiciens bourgeois n’est évidemment qu’un synonyme de “contorsions” car les États-Unis se trouvent face à un dilemme insoluble : soit ils encouragent l’offensive de leurs rivaux en n’intervenant pas directement, soit ils alimentent encore plus la contestation et le chaos en déployant leurs troupes. Quoi qu’ils fassent, les États-Unis ne peuvent échapper, comme toutes les autres puissances impérialistes, à la logique et aux contradictions du militarisme.
Des grandes puissances aux groupuscules fanatiques, des puissances régionales aux richissimes pétro-monarchies, les vautours sont assoiffés de sang ! Uniquement préoccupés par la défense de leurs cupides intérêts impérialistes, ils ne se soucient guère des cadavres qui s’amoncellent, des innombrables réfugiés jetés sur les routes, des villes en ruine, des vies broyées par les bombes, la misère et la désolation. Tous ces fauteurs de guerre vomissent chaque jour les mots hypocrites de “paix”, de “négociation” ou de “stabilité”, mais la barbarie extrême qui s’enracine toujours davantage témoigne de la putréfaction de leur système : le capitalisme.
EG, 1er juillet 2019
1 Alléchés par l’aubaine d’un nouveau marché à conquérir, les autres pays signataires, y compris européens, ont tenté de maintenir l’accord avec l’Iran. En représailles, Trump a menacé de sanctionner les entreprises qui ne respecteraient pas le nouvel embargo américain, ce qui a sensiblement contenu les velléités européennes.
2 À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’origine de l’attaque est sujette à caution. Si l’Iran a parfaitement pu chercher à envoyer un message à Trump, vu la tradition de manipulation des grandes démocraties (comme en témoigne encore l’invention des “armes de destruction massive” irakiennes), il n’est pas à exclure que les États-Unis ou un de leurs alliés aient organisé un coup pour faire davantage monter la pression.
3 Les tensions ne cessent, encore aujourd’hui de croître : Téhéran vient d’annoncer avoir franchi le seuil de réserve d’uranium prévu par l’accord de 2015 et Israël a de nouveau bombardé des positions iraniennes en Syrie.
4 “To stop Iran’s bomb, bomb Iran”, The New York Times, (26 mars 2015). Traduit par nous.
Géographique:
- Moyen Orient [51]
Personnages:
- Donald Trump [52]
- John Bolton [53]
Rubrique:
Élections européennes: une aubaine pour relancer les mystifications démocratiques
- 99 reads
Les élections européennes qui se sont tenues en mai ont ravivé le piège du cirque électoral et de la mystification démocratique sur un terrain que les prolétaires n’ont aucun intérêt à défendre. Elles ont aussi redessiné quelque peu le paysage du parlement européen. Si les conservateurs et les sociaux-démocrates restent les principales forces politiques à Bruxelles, il n’en demeure pas moins qu’ils ont subi un véritable revers en perdant respectivement 43 et 36 sièges. Comme on pouvait s’y attendre, les partis populistes voient leur nombre de sièges augmenter mais on est loin du raz-de-marée annoncé par les analystes en tous genres au cours des semaines ayant précédé l’élection ! La véritable “surprise” reste la percée des écologistes, glanant près de 30 sièges supplémentaires, alors que ce courant politique était un peu en difficulté sur l’échiquier politique bourgeois depuis quelques années.
La campagne en faveur du climat a porté ses fruits !
Il n’aura échappé à personne que la bourgeoisie développe depuis plusieurs mois une intense campagne de propagande sur la question climatique (1) afin de mobiliser la classe ouvrière ainsi que la future jeunesse exploitée sur le terrain de l’écologie et de la défense de la démocratie. Cela pour détourner encore l’attention de la question centrale posée par la logique meurtrière et destructrice du système capitaliste.
Il n’est pas difficile d’entrevoir les effets de cette campagne lors de ces élections. D’une part, toutes les tendances politiques ont pu se réjouir de l’envolée du taux de participation en hausse de 9 points par rapport à 2014. Elles ont toutes applaudi ce score jamais vu pour des élections européennes et ont savouré la “victoire de l’Europe et de la démocratie” en martelant que ces Européennes consacraient la véritable souveraineté des peuples du vieux continent. Il semblerait que les jeunes générations se soient largement mobilisées pour venir aux urnes ce coup-ci. C’est une chose suffisamment rare pour être signalée, elles qui d’habitude sont pointées du doigt par tous les faiseurs de pensée de la bourgeoisie, accusées de négliger “leur devoir de citoyens” ! Pour ces élections, près de 40 % des 18-35 ans se sont déplacés selon l’institut de sondage Ipsos. C’est 14 points de plus que lors des élections de 2014. En France, près de 51 % des 18-35 ans sont allés voter, le plus gros score depuis 25 ans. Cette gonflée des urnes serait-elle due à une poussée subite “d’européophilie” de la part des jeunes générations ? Certainement pas ! Ces futurs exploités ont surtout été influencés par le mouvement Youth for climate et par son égérie Greta Thunberg qui préconisaient de faire pression sur la classe politique afin que cette dernière prenne des mesures énergiques contre le réchauffement climatique et la destruction de la planète. Comme nous l’avons affirmé en mars dernier au moment où cette mobilisation battait son plein : “Les manifestations se concentrent sur la réalisation de “conversations” avec des ministres, des parlementaires, des groupes de pression et des militants écologistes. Cela ne sert qu’à laver le visage de l’État démocratique et à se perdre dans le labyrinthe des lois et des politiques gouvernementales. Les tentatives de “dialogue” avec les porte-parole politiques ne débouchent que sur des promesses grandiloquentes qui ne résolvent rien”. (2)
Il ne fait pas de doute que la part significative des votes des 18-24 ans (28 %) et des 25-34 ans (25 %) en faveur d’Europe Ecologie Les Verts en France est une conséquence directe de toute cette grande mobilisation écologiste qui dure depuis des mois partout dans le monde, dans la rue et véhiculée par les médias. Face au discrédit des partis traditionnels et au peu d’engouement que soulèvent les nouvelles formations politiques, l’écologisme est un thème de mystification recyclé que la bourgeoisie a sorti de son chapeau afin de mobiliser la classe ouvrière sur le terrain électoral. Le capitalisme “vert”, soi-disant “moins prédateur” et “plus humain”, est une illusion totale qui ne vise qu’à dédouaner le capitalisme, un mode de production destructeur qui n’a plus rien à offrir à l’humanité si ce n’est de crever la gueule ouverte.
Un raz-de-marée populiste ?
Dès le résultat des élections, les fractions les plus responsables du capital se sont également félicitées d’avoir su contenir la percée des formations populistes. Dans les semaines précédant les élections, la presse et les médias annonçaient sans ambages une déferlante populiste en passe de redéfinir l’équilibre des forces dans l’hémicycle bruxellois. Ces pronostics largement exagérés visaient à mobiliser les exploités sur le terrain de l’anti-populisme. La bourgeoisie exhortait les populations européennes à se rendre aux urnes pour défendre les institutions démocratiques en passe d’être mises en péril.
En fait, les résultats des formations populistes varient fortement selon les pays. Si la victoire de la Ligue en Italie et du Brexit party en Grande-Bretagne confirme la difficulté pour les fractions les plus responsables de ces pays de refouler le populisme au sein de l’appareil politique, il n’en est pas de même dans d’autres pays comme en France où le Rassemblement national n’a pas profité autant que prévu de la mobilisation des “gilets jaunes”. C’est également le cas en Autriche et en Allemagne où l’AfD n’est arrivé qu’en quatrième position. Par conséquent, si le populisme, comme phénomène, continue de progresser en Europe, les partis populistes, eux, sont globalement contenus. Ces élections montrent ainsi une certaine capacité de la bourgeoisie à pouvoir résister malgré tout à l’avancée du populisme. Cette fois-ci, en préparant habilement le terrain aux formations écologistes.
L’Union Européenne, plus divisée que jamais
Le nouveau revers subi par les partis traditionnels dans plusieurs pays, la progression du populisme et la “surprise” écologiste dessinent un hémicycle européen en forme de mosaïque dans lequel on a du mal à voir se détacher une majorité parlementaire claire. Ces résultats confirment et renforcent donc la division qui règne entre les différentes bourgeoisies sur la politique de l’Union Européenne, l’antagonisme le plus aigu se situant entre les partis euro-sceptiques et les partis pro-européens. En effet, l’ancrage des fractions ultra-nationalistes favorables à la fermeture des frontières, accroît le chacun pour soi et les antagonismes politiques et économiques au sein de l’UE. Cette incapacité à mettre en œuvre une politique cohérente et coordonnée dans plusieurs domaines, affaiblit la capacité de l’UE à faire face à la concurrence venue d’Amérique ou d’Asie. Par exemple, si le Brexit est une catastrophe pour le Royaume-Uni, il affaiblit aussi fortement la puissance économique européenne.
Le morcèlement du parlement est aussi à l’origine de la foire d’empoigne qui s’est déroulée sous nos yeux au sujet de la nomination du futur président de la Commission européenne dont dépend également la nomination aux principaux autres postes importants de l’UE (présidence du conseil, chef de la diplomatie et de la sécurité, direction de la BCE, participation aux Sommets internationaux…). Le bras de fer auquel on a assisté ces dernières semaines au sujet de la candidature de Manfred Weber, le poulain d’Angela Merkel, témoigne des tensions qui s’instaurent sur le sujet entre les principaux leaders de l’Union européenne ; tous soucieux de défendre leur rang et de maintenir ou de renforcer leur influence en essayant de placer leur champion aux postes-clés.
Cet épisode a montré une nouvelle fois que le “couple franco-allemand” bat de l’aile puisque Emmanuel Macron était le principal opposant à ce qu’un proche d’Angela Merkel devienne le “chef” de l’UE. La volte-face de la présidente d’Outre-Rhin confirme l’affaiblissement de l’emprise de l’Allemagne au sein des 28, son leadership étant de plus en plus contesté par les principales puissances du continent, à commencer par la France. Les deux jours de négociations passés à Bruxelles sans le moindre résultat ont montré que l’Union européenne reste un terrain sur lequel les impérialismes européens s’expriment allègrement même si cela doit venir perturber momentanément les rouages de l’UE. Au final, les choses se sont réglées en catimini entre la France et l’Allemagne, ce qui a permis à Angela Merkel et à Emmanuel Macron de rappeler qui étaient les véritables leaders de l’Europe. Ursula von der Leyen, ministre de la défense du gouvernement Merkel est nommée présidente de la commission. En échange, la française Christine Lagarde, actuelle présidente du FMI, prendra les rênes de la BCE à compter de novembre. Ce coup de force, jetant aux orties le mode du spitzenkandidat, s’est attiré les foudres de la social-démocratie européenne et d’une partie du parlement qui élit son président en ce moment même.
Ainsi, ces luttes d’influence et ces tensions internes mettent une nouvelle fois en lumière que “l’unité européenne” n’est rien d’autre qu’un mythe. Si les bourgeoisies européennes ont de plus en plus besoin de coordonner leurs politiques pour faire face à la concurrence impérialiste extérieure et à la crise du capitalisme, cela ne met pas fin aux antagonismes au sein même de l’Europe qui, bien au contraire, ne font que se renforcer dans une Europe à 28 où chaque puissance, quel que soit son rang, veut défendre ses intérêts, les nouveaux entrants refusant de jouer les seconds couteaux.
Par conséquent, “l’idéal” de la “construction européenne” n’est en rien le signe d’un avenir meilleur mais une illusion entretenue par la classe dominante pour masquer la réalité du monde capitaliste suant par tous ses pores non seulement la concurrence acharnée entre États mais aussi le chaos, la misère et la mort que ce système sans avenir et enlisé dans ses contradictions porte dans ses entrailles.
Time, 3 juillet 2019
1 Voir à ce sujet notre article : “L’idéologie verte au service du capitalisme”, Révolution Internationale n° 476.
2 Tract international du CCI : “Le capitalisme menace la planète et la survie de l’humanité : seule la lutte mondiale du prolétariat peut mettre fin à cette menace”.
Géographique:
- Europe [54]
Récent et en cours:
Rubrique:
Grève dans les urgences: le piège de l’isolement !
- 79 reads
Ces dernières semaines, la situation catastrophique des hôpitaux est revenue sur le devant de la scène médiatique après le black-out qui frappait la mobilisation du personnel des urgences depuis mars.
La “crise des hôpitaux” illustre celle du capitalisme
Alors que la vague de grèves dans les services des urgences prend désormais de l’ampleur et touche plus d’une centaine d’établissements, le cri de colère du personnel hospitalier permet au gouvernement de justifier de manière cynique la “nécessité” et “l’urgence des réformes”. Ainsi, les attaques successives contre le secteur de la santé sont présentées non pas pour ce qu’elles sont, une dégradation continue des conditions de travail, mais comme une prétendue “solution nécessaire” pour dépasser les “blocages” et sortir de la “crise des hôpitaux” ! Pour la ministre de la santé, Agnès Buzyn, l’annonce, le 14 juin dernier, du déblocage par ordonnance de 70 millions d’euros pour les seuls services d’urgences cherche donc à donner du crédit à ce mensonge, à faire passer la pilule pour que soient passées, même si c’est aux forceps, les nouvelles attaques programmées par les “réformes”.
Cela fait bien longtemps que la situation ne cesse de se dégrader aussi bien dans les hôpitaux que dans les EHPAD et aucun gouvernement n’a de solution à proposer, si ce n’est de réduire toujours plus les dépenses au détriment de la santé du personnel et de celle des patients. (1) C’est bien là que se trouve le caractère ignoble et cynique du gouvernement et de toute la bourgeoise. À cela s’ajoutent les difficultés d’accès aux soins pour une part croissante du prolétariat. De plus en plus d’ouvriers ne peuvent plus se soigner correctement (manque de médecins, de spécialistes, rendez-vous pouvant parfois attendre une année) et se tournent également vers les urgences, rendant la situation encore plus tendue.
De plus en plus de personnes en difficulté, marginalisées, cumulant souvent les problèmes de santé se retrouvent, faute de mieux, contraintes de se tourner vers les services d’urgences. On ne compte plus les journées de grève et les actions pour dénoncer une situation intenable : manque d’effectifs pour faire face à l’afflux de patients, manque de moyens, suppression d’emplois, de lits, précarité, faibles salaires… la liste est longue ! Le ras-le-bol du personnel hospitalier est immense et l’attitude faussement bienveillante du gouvernement actuellement cache mal son mépris profond.
En mars dernier, l’agression du personnel soignant par des patients dans le service d’urgence d’un hôpital parisien était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Une des premières réponses du gouvernement consistait à mettre en avant la nécessité de “sécuriser” les hôpitaux tout en renforçant la pression sur les salariés, se moquant totalement de la surcharge de travail et de l’épuisement des travailleurs.
Une mobilisation pourrie par l’enfermement corporatiste
La grève s’est élargie à de nombreux établissements à travers le pays, notamment par le biais de collectifs, en particulier : “Inter-Urgences” créé fin mai, “Souffrance Infirmière”, “Infirmières Oubliées”, etc. En fait, il s’agit d’une forme de syndicalisme de base avec toutes ses illusions, le danger et les pièges que cela représente pour la lutte. 2) Ces prétendues “nouvelles formes de lutte” jouent exactement le même rôle que les centrales syndicales et exercent la même fonction, mais de façon plus crédible, à travers leur apparente radicalité, d’encadrement et de canalisation de la colère des éléments les plus combatifs dans la lutte en les poussant à s’enfermer dans le corporatisme et ainsi à s’isoler des autres secteurs et du reste de la classe ouvrière. Comme dans la plupart des secteurs de la fonction publique d’État, le corporatisme est traditionnellement très prégnant dans le milieu hospitalier. La classe dirigeante sait très bien utiliser cette faiblesse pour faire passer ses attaques. Aux urgences, cet isolement et ce cloisonnement corporatiste s’expriment de manière particulièrement caricaturale dans chaque hôpital puisqu’il n’y a aucune tentative des urgentistes d’aller trouver ne serait-ce que le personnel soignant des étages supérieurs pour tenter de les entraîner dans la lutte. De ce huis-clos, ne filtre pas le moindre écho d’assemblée générale ou de simples débats menés au sein du personnel. Seulement s’affichent les interventions publiques et dans les médias des représentants des collectifs.
Bien que le caractère prolétarien de ce mouvement des “blouses blanches” s’exprime par ses revendications (luttes pour les salaires, pour de meilleures conditions de travail, pour les emplois) au travers desquelles l’ensemble de la classe ouvrière peut se retrouver et s’exprimer massivement, son isolement tend au contraire à renforcer un sentiment d’impuissance et de découragement. Une telle situation a permis aux centrales syndicales, souvent en arrière-plan (mais avec des syndicalistes très présents et actifs au sein des collectifs) de se faire relativement discrets dans leur entreprise de “maintien de l’ordre” social.
Il est clair que face aux effets de la crise et de la décomposition de la société capitaliste, face à l’enfoncement dans la misère qui l’accompagne, les services d’urgences sont en première ligne. C’est pour cette raison que la bourgeoisie est d’autant plus préparée à faire face aux expressions de colère qu’elle sait inévitables. Évidemment, la colère des prolétaires en lutte s’est d’abord heurtée à l’opposition résolue du gouvernement et de l’administration hospitalière.
Après plus de deux mois de mobilisation sans réelle perspective et exaspérée par la situation, une équipe entière d’urgentistes s’est mise en arrêt-maladie. Cela s’est tout d’abord produit en Saône-et-Loire et dans le Jura, fin mai, puis début juin à l’hôpital Lariboisière à Paris. Cette décision ne pouvait répondre qu’à une situation devenue intenable. Il est significatif que la seule “solution” proposée aux équipes d’urgentistes soit l’arrêt de travail. Cette méthode est certes un réflexe de survie pour répondre à une situation devenue insupportable mais elle traduit surtout et reflète l’impasse de cette mobilisation, toute l’impuissance, le découragement et la démoralisation générés par l’isolement le plus complet. Ce que le gouvernement n’a d’ailleurs pas manqué d’exploiter avec sa ministre dénonçant “le manque de solidarité” du personnel face aux collègues alors contraints de travailler 18 heures d’affilée. Immédiatement, l’État a fait apparaître son visage au grand jour : “les deux préfectures ont par exemple fait intervenir les forces de l’ordre pour réquisitionner des médecins et des soignants, leur ordonnant de se rendre en poste aux urgences. À Lons-le-Saunier, la police avait sonné à la porte du personnel concerné… en pleine nuit”.
Un mouvement exploité par la bourgeoisie
C’est probablement ce geste de “solidarité” calculée de l’État qui a contribué à amplifier la mobilisation dans les hôpitaux : pendant les deux premières semaines de juin, le nombre d’établissements mobilisés a pratiquement doublé. Le gouvernement a alors pu orchestrer et mettre en place sa manœuvre en faisant dès lors une large publicité à la grève des urgentistes dont le point d’orgue a été l’annonce par la ministre de son ordonnance de 70 millions d’euros, faisant croire que ces miettes représentaient un recul et une “victoire” des urgentistes. (3)
Pour exécuter cette manœuvre qui renforce encore la division des travailleurs entre eux, le gouvernement sait sur qui il peut compter : aussi bien sur les organisations syndicales qui tiennent traditionnellement leur rôle de chiens de garde du capital en favorisant systématiquement les conditions permettant d’isoler les salariés les uns des autres, que sur les collectifs qui assurent aujourd’hui cet isolement par les mêmes moyens et les mêmes méthodes. Le seul et indispensable moyen d’échapper à ce piège, et de pousser le gouvernement à reculer dans ses “réformes” comme lors de la mobilisation massive contre le CPE en 2006, serait, au lieu de se mobiliser comme l’entendent les syndicats, pour les “blouses blanches” comme pour n’importe quel autre secteur du prolétariat, d’aller chercher la solidarité des autres secteurs de la classe ouvrière en les appelant à se joindre à la lutte, d’organiser des assemblées générales ouvertes à tous dans cette perspective. La colère et la détermination d’un secteur particulier, aussi combatif soit-il, ne suffisent pas, en aucun cas. Or, aujourd’hui, la bourgeoisie sait parfaitement que le risque que cela se produise est faible tant la classe ouvrière est engluée dans des difficultés liées à se mobiliser massivement, à unifier ses luttes, à son sentiment d’impuissance face au manque de perspective. La bourgeoisie peut d’autant plus profiter de ces faiblesses et de l’enfermement de la colère dans les hôpitaux, que la période estivale est toujours propice aux attaques contre le prolétariat qui est démobilisé par la “période des vacances”. L’ordonnance vise donc à pourrir la situation jusqu’à l’été afin de permettre à la ministre et à son équipe de défendre et mettre en avant l’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM). (4)
Si la bourgeoisie suit de près la situation dans les hôpitaux, c’est qu’elle est parfaitement consciente de son enjeu pour la préparation de la poursuite de ses attaques anti-ouvrières tous azimuts et qu’elle utilise pleinement les faiblesses de la classe ouvrière, en particulier celles des secteurs les plus perméables au poison du corporatisme comme celui des urgentistes. On le voit encore avec l’appel de l’intersyndicale CGT-FO-SUD à un rassemblement devant le ministère des finances, le 2 juillet, date initialement choisie par le collectif “Inter-Urgences” pour appeler à une manifestation nationale. Parce que le prolétariat n’arrive pas à se concevoir comme classe autonome, parce qu’il ne perçoit pas la dimension politique de son combat pour l’instant, ses efforts restent insuffisants et tendent même, finalement, à se retourner contre lui sous l’action malveillante de ses exploiteurs.
Tout cela ne signifie en rien que les luttes et les efforts entrepris soient vains. Au contraire ! Le chemin de la lutte de classe, long et tortueux, passe nécessairement par ce type d’expérience douloureuse et par la nécessaire réflexion sur les difficultés rencontrées. Ce n’est qu’en tirant les leçons de ce type d’expérience et en poursuivant sa volonté de combat que le prolétariat pourra prendre conscience de sa vraie nature : celle d’une classe sociale unie, mais aussi porteuse d’un projet révolutionnaire.
Marius, 19 juin 2019
1 On peut rappeler le cas d’une patiente retrouvée morte sur un brancard de l’hôpital Lariboisière à Paris, douze heures après son admission aux urgences, dans la nuit du 17 au 18 décembre dernier. À lire également : “Restrictions dans les hôpitaux : c’est l’État qui tue les malades !”, RI n° 397 (février 2009).
2 Ces collectifs ne sont pas sans rappeler, mais dans un tout autre contexte, les coordinations de la grève des infirmières en 1988. Voir notre brochure : “Octobre 1988, bilan de la lutte des infirmières : Les coordinations, nouvelle arme de la bourgeoisie”.
3 Précisons au passage que la générosité du gouvernement ne représente que 0,08 % du budget annuel des hôpitaux (82 milliards d’euros).
4 Pour 2019, un ONDAM à 2,5 % vise une économie de près de 700 millions d’euros (dix fois le montant de l’ordonnance annoncée !)
Géographique:
- France [24]
Situations territoriales:
Rubrique:
Réformes et licenciements: toute la classe ouvrière est attaquée
- 74 reads
Les licenciements, les attaques économiques et les réformes qui s’annoncent pour les mois à venir sont particulièrement violents. Toute la classe ouvrière est concernée : travailleurs du public et du privé, retraités, chômeurs, immigrés ou étudiants précaires. Tous.
Le même discours cynique et répugnant accompagne toutes ces mesures politiques : “Nous avons consulté les Français”. Utilisant comme un tremplin les complaintes issues du mouvement des “gilets jaunes” pour plus de “démocratie participative”, la bourgeoisie française multiplie partout les “consultations”, les “enquêtes”, les “assemblées de citoyens”… pour faire croire que sa politique est l’émanation de la “volonté du peuple”. Macron et son gouvernement, forts de leur “Grand débat national”, n’ont ainsi que le mot “démocratie” à la bouche pour légitimer toutes leurs actions anti-ouvrières. Derrière ce qui n’est qu’une caution idéologique, voilà concrètement ce qui attend les prolétaires :
– Dans tous les secteurs, les plans de fermetures et de licenciements tombent. Dans la grande distribution : chez Conforama,1 900 salariés et 32 magasins vont disparaître d’ici 2020. Dans l’éducation : 38 centres de formation sur 110 et 1 541 emplois vont être supprimés. Dans l’industrie, la liste des usines en train d’être rayées de la carte est interminable : Danzer à Souvans (Jura), Naturéo à Liévin (Pas-de-Calais), Matrot à Noyers-Saint-Martin (Oise), etc. Dans le secteur public, l’objectif du gouvernement est de supprimer 120 000 postes d’ici 2022.
– Qui dit moins d’emplois, dit plus de chômeurs. Alors le gouvernement anticipe, avec une seule idée en tête : faire des économies. En durcissant les droits d’accès et en mettant en place un énième nouveau mode de calcul des indemnités, toujours plus restrictif et excluant, l’UNEDIC anticipe la réduction des allocations de 1,2 millions de personnes ! Et le gouvernement de mettre en avant que “74 % des personnes interrogées seraient favorables à la dégressivité des allocations”. Puisque on vous dit que c’est “démocratique” !
– Pour ceux qui ont un emploi, l’exploitation va devenir encore plus féroce. Dans le privé, la réforme du Code du travail et des prud’hommes se traduit par une dégradation continue des conditions de travail. Dans le secteur public, la précarité est croissante : explosion des CDD, déplacements forcés, corvéabilité à merci au nom de l’ “adaptabilité” et de la “proximité des services”. La réforme de la fonction publique va encore aggraver cette situation dégradée. Le gouvernement prévoit, par exemple, la création de 2 000 “Maisons France Services”, rassemblant de nombreux “services publics”… officiellement, afin de favoriser le “service de proximité”. En réalité, pour fermer le maximum de structures d’État, regroupées dans un seul lieu avec le minimum de salariés à pressurer.
– La jeunesse ouvrière n’est pas épargnée. À l’image de l’instauration de Parcoursup, qui a multiplié le nombre de jeunes dans des formations non souhaitées, au nom de la rentabilité et de l’efficacité, la réforme du bac n’a aujourd’hui pas d’autre objectif qu’un diktat bureaucratique en faveur de la réduction des dépenses. Et n’oublions pas l’énorme augmentation des droits d’inscriptions en faculté pour les étudiants étrangers qui va les frapper directement dès septembre.
– Mais un jour, les jeunes deviennent vieux et du point de vue capitaliste, un ouvrier à la retraite est un ouvrier “inutile”, à “charge”. Alors Macron et son gouvernement ont courageusement décidé de taper sur les “papys” et les “mamies”. En mettant en place un “système universel par points” et “la fin des régimes spéciaux”, le niveau des pensions va être considérablement réduit, notamment grâce à un système de malus qui frapperait tous les travailleurs “choisissant” de partir avant “l’âge d’équilibre”. Autrement dit, tout ceux qui, usés par des décennies d’exploitation inhumaine, seront contraints de partir avant 64 ans, dans un premier temps, (puis 65, 66, 67,…) recevront une misère pour survivre.
– Pour finir cette liste révoltante, la bourgeoisie française n’oublie pas de durcir les “conditions d’accueil” (sic !) des immigrés, là aussi pour qu’ils puissent être exploités sans vergogne en coûtant le moins cher possible à la “société française”. Ces mesures inhumaines, Macron et le gouvernement les légitiment elles-aussi grâce aux fruits de la consultation du “Grand débat” et même directement à travers l’exploitation de certaines revendications d’une partie des “gilets jaunes”. (1)
Aujourd’hui, les prolétaires sont en grande difficulté ; ils n’ont plus confiance en eux, en leur force en tant que classe unie et organisée. Quand la situation devient intenable, comme dans les urgences des hôpitaux et qu’ils sont contraints à se battre, les prolétaires le font isolés de leurs frères de classe, enfermés dans leur secteur et donc impuissants face à la bourgeoisie et son État. Il est clair que le mouvement des “gilets jaunes”, en diluant les travailleurs dans la population en général, comme autant de citoyens-individus, en mettant en avant le “Peuple”, en promouvant les revendications et les méthodes de la petite bourgeoisie aux abois, en alimentant l’illusoire aspiration à être “mieux écoutés” des puissants par une “démocratie plus directe”, a affaibli encore un peu plus les capacités du prolétariat à lutter et à répondre massivement aux attaques. La bourgeoisie l’a parfaitement perçu et elle profite de cette situation de désarroi pour mener des attaques tous azimuts. Seule la lutte des ouvriers unis et organisés en tant que classe permettra de faire face à cette politique toujours plus inhumaine.
Pawel, le 6 juillet 2019
1 Parmi les 42 revendications officielles du mouvement des “gilets jaunes”, on peut par exemple y lire : “Que les déboutés du droit d’asile soient reconduits dans leur pays d’origine” ou encore : “Qu’une réelle politique d’intégration soit mise en œuvre. Vivre en France implique de devenir français (cours de langue française, cours d’histoire de France et cours d’éducation civique avec une certification à la fin du parcours)”.
Géographique:
- France [24]
Situations territoriales:
Rubrique:
Le 28 juin 1919, la paix de Versailles annonçait la prochaine guerre impérialiste
- 111 reads
Le 28 juin 1919, dans la galerie des Glaces du palais de Versailles, deux émissaires allemands, escortés par des soldats alliés, étaient sommés de signer le traité de Versailles. Obligés de défiler devant des “gueules cassées”, ils ressemblaient davantage à des “prisonniers conduits là pour la lecture de leur sentence”, note un diplomate anglais. Le colonel House, membre de la délégation américaine, rapporte quant à lui qu’il s’agissait d’une “mise en scène très élaborée et calculée pour humilier l’ennemi au maximum”. (1) Cinq ans jour pour jour après l’assassinat de l’archiduc François-Joseph qui avait alors mis le feu aux poudres, ce traité réglait la fin d’un conflit où les vainqueurs imposaient leurs conditions drastiques aux vaincus.
Pour les journaux de l’époque, ce traité de “paix” devait soi-disant montrer à la face du monde que les grandes démocraties travaillaient désormais à la concorde et à la paix universelle. L’humanité ne revivrait plus jamais un tel carnage. Cette guerre devait être la “der des ders”.
Ce traité était le produit de la Conférence de Paris qui se déroula du 18 janvier au mois d’août 1919, au cours de laquelle les représentants des puissances de l’Entente (Royaume-Uni, France, États-Unis, Italie) réglèrent la fin de la guerre sans l’avis des puissances vaincues.
Dans le même temps, la vague révolutionnaire qui s’était formée en Russie en Octobre 1917 trouvait son point culminant avec la création de l’Internationale communiste en mars 1919. Dans ces conditions, comme nous le verrons, la Conférence de Paris fut également le quartier général de “la sainte alliance des capitalistes pour réprimer la révolution des ouvriers”. (2)
“Une paix carthaginoise” (J.M Keynes)
Dans La crise de la social-démocratie parue en 1916, Rosa Luxemburg affirmait que la victoire ou la défaite de l’un des deux camps ne mettrait pas fin aux tensions impérialistes et au militarisme. La dynamique de l’impérialisme entraînerait fatalement une nouvelle conflagration mondiale. L’histoire a pleinement confirmé les projections de Rosa Luxemburg. Ainsi, ce traité de Versailles ne réglait rien du tout, il était une réponse capitaliste à la guerre ; consistant à repartager le monde en lésant les vaincus (en tout premier lieu l’Allemagne), ce qui ne manquerait pas d’attiser leurs désirs de revanche.
L’Allemagne et les empires centraux furent déclarés seuls responsables des dégâts causés par le conflit. Par conséquent, outre le fait de devoir payer le coût des réparations, l’Allemagne se vit imposer des conditions drastiques qui la rendaient exsangue dans le jeu impérialiste. Cette ligne politique fut avant tout défendue par la France, représentée par Clemenceau, qui voyait là le moyen d’assurer sa suprématie sur le continent européen. À l’issue du traité, l’Allemagne perdait 15 % de son territoire et 10 % de sa population au profit de la France, du Danemark, de la Belgique et de la Pologne. Sur le plan militaire, ses effectifs et son armement étaient limités, la rive gauche du Rhin était démilitarisée, elle devait également livrer 5 000 canons, 25 000 avions ainsi que toute sa flotte. Son empire colonial lui était retiré et passait sous l’administration des puissances de l’Entente et du Japon. Les deux autres principaux protagonistes du traité, le Royaume-Uni représenté par son premier ministre Lloyd Georges, et les États-Unis dirigés par Wilson restaient plus réservés. Non qu’ils n’étaient pas intéressés à dépecer l’Allemagne pour renforcer leur puissance respective, mais plutôt parce qu’ils craignaient une trop grande expansion de la France sur le continent européen. Comble de l’ironie, le rapport de force se jouait avant tout entre les charognards de l’Entente qui se disputaient le cadavre allemand. Au final, c’est la “ligne dure”, défendue par la France, qui finit par s’imposer. Une ligne qui accrut l’irritation de l’Allemagne “et par là même, les probabilités d’une revanche, rendant nécessaire encore d’autres dispositions draconiennes”. (3) Dans ces conditions, “une paix carthaginoise était inévitable, pour autant qu’on a momentanément la puissance pour l’imposer”. (4) Ce que la bourgeoisie française s’avéra incapable de faire par la suite. Le traité avait placé l’Allemagne et les autres vaincus dans des conditions “qui rendaient matériellement impossible leur existence économique, les privaient de tous droits et les humiliaient”. (5) Ainsi se préparait le terrain d’une future guerre.
L’affirmation de l’impérialisme américain
Avant que Wilson ne participe en personne à la conférence de Paris, jamais un président américain n’avait effectué un voyage sur le vieux continent pour des raisons politiques. Ce fait inédit révélait la volonté des États-Unis de s’affirmer comme une grande puissance impérialiste. Cette prétention s’appuyait sur des décennies de développement prodigieux du capitalisme aux États-Unis, devenus la deuxième puissance du monde après la guerre. Les quatorze points du président Wilson appelant à une paix juste et magnanime, à la prise en compte des volontés des peuples, à la liberté des mers, à la limitation du militarisme, n’avaient pas d’autre but, pour les États-Unis, que de concurrencer les grandes puissances européennes sur leur propre continent. Cependant, il était hors de question pour l’Angleterre de laisser les États-Unis mettre un pied en Europe. Première puissance mondiale, sa flotte militaire et commerciale lui permettait encore d’endiguer la poussée impérialiste américaine en Europe. C’est pour cette raison que Lloyd Georges repoussa les conditions de paix plus souples de Wilson. Comme le soulignait Trotsky lors du deuxième congrès de l’Internationale communiste : “Pendant la guerre, la lourde industrie américaine s’est dressée comme une colonne géante jusqu’aux cieux, et le capital américain a rejeté bien loin de lui la devise : l’Amérique aux Américains. Ou plutôt, nous dirons qu’il a modifié cette devise et qu’il a dit : non seulement l’Amérique aux Américains, mais le monde entier. C’est alors qu’il a envoyé l’apôtre Wilson avec son Nouveau Testament. Nous savons que Wilson n’a pas fait la commission. Mais la commission est toujours à faire, et l’oligarchie américaine est en train de faire ses comptes : notre flotte, se dit-elle, est plus faible que celle de la Grande-Bretagne de tant de tonnes, de tant de bouches de canons de tel ou tel calibre. Et le Département de la Marine américaine établit un nouveau programme, un programme qui doit, avant 1925, et quelques-uns disent encore plus tôt, en trois ans, rendre la flotte américaine incomparablement plus forte que celle de l’Angleterre”. Si ce coup-ci, la bourgeoisie américaine était obligée de faire un pas en arrière, elle n’abandonnait pas ses prétentions sur le vieux continent pour autant. Cet objectif passait inévitablement par son renforcement militaire.
Un traité contre la révolution prolétarienne
Contrairement à la version officielle de l’histoire, l’armistice du 11 novembre 1918 n’était pas dû à la situation militaire inextricable dans laquelle se trouvait l’Allemagne, mais à l’éclatement du soulèvement ouvrier qui allait mener à la chute de l’Empire dirigé par Guillaume II. La révolution prolétarienne était désormais le plus grand danger qui pesait sur toutes les bourgeoisies du monde. Alors que les plus puissantes d’entre elles s’étaient entre-déchirées durant quatre années de guerre, elles faisaient désormais cause commune pour la survie du système capitaliste. Depuis 1918, les principales puissances européennes soutenaient financièrement et militairement les armées blanches de la contre-révolution en Russie. (6) C’est pour cela, par exemple, que la bourgeoisie française, alors qu’elle voulait désarmer totalement l’Allemagne, autorisa le gouvernement social-démocrate et les militaires à garder des canons dans Berlin pour massacrer les ouvriers insurgés. La Conférence de Paris débuta d’ailleurs juste après la Semaine sanglante, et c’est depuis les salons diplomatiques parisiens que Clemenceau pouvait dire que “le danger bolchevik est très grand à l’heure présente. (...) Si le bolchevisme, après s’être étendu à l’Allemagne, devait traverser l’Autriche et la Hongrie et gagner l’Italie, l’Europe aurait à faire face à un très grand danger. C’est pourquoi il faut faire quelque chose contre le bolchevisme”. Ce front commun n’empêchait pas pour autant que chaque grande puissance fasse valoir ses propres intérêts, y compris dans la question russe. Si la France excluait toute relation avec le pouvoir des Soviets, les États-Unis étaient favorables à organiser des pourparlers lors d’une grande conférence. Cette proposition n’allait pas sans arrière-pensées, puisque comme le pressentait Lénine, les États-Unis lorgnaient sur la Sibérie et le Sud de la Russie. Au final, la Russie des Soviets fut totalement exclue des négociations qui devaient mener à la signature du traité de Versailles. Les puissances de l’Entente visaient à l’isoler et à l’affaiblir en annexant ses territoires et en pillant ses richesses, afin d’empêcher toute extension de la révolution prolétarienne.
La création de la Société des Nations, prévue par le traité de Versailles, fut une force supplémentaire forgée contre la classe ouvrière. Les révolutionnaires de l’époque la dénoncèrent comme telle. Pour Lénine, il s’agissait d’un “repaire de brigands”, rien de plus. Cette “association générale des Nations” (d’après les quatorze points de Wilson) avait la prétention de garantir la paix dans le monde, de réguler le militarisme, de protéger les “États faibles” de la domination des grandes puissances et même d’œuvrer à l’indépendance des peuples colonisés. Derrière ces belles paroles, les puissances de l’Entente mettaient en œuvre une politique d’annexion de tous les vaincus. Si désormais ces dernières prônaient la paix, après s’être enivrées de chaos et d’horreur durant quatre ans, c’est que celle-ci était synonyme du maintien de leur suprématie.
Mais surtout, comme l’affirme le deuxième congrès de l’IC : “la constitution de la Ligue des Nations [fut] le meilleur moyen de troubler la conscience de la classe ouvrière. À la place du mot d’ordre d’une Internationale des républiques révolutionnaires ouvrières, on propose celui d’une Union internationale des prétendues démocraties, qui pourrait être atteint par la coalition du prolétariat avec les classes bourgeoises”. (7) Cette politique de désunion du prolétariat à l’heure de la révolution mondiale était soutenue et appuyée par les partis social-traîtres qui, réunis lors de la conférence de Berne, avaient reconnus la SDN. Une position ouvertement opportuniste que ne manqua pas de dénoncer l’Internationale communiste qui appelait les ouvriers du monde entier à “mener une guerre implacable contre l’idée de la Ligue des Nations de Wilson et protester contre l’entrée de leur pays dans cette ligne de pillage, d’exploitation et de contre-révolution”. (8)
Au bout du compte, ce traité de Versailles mécontenta tout le monde. Forme de compromis diplomatique, il imposait à chaque puissance de réfréner ses prétentions impérialistes. Pour l’Italie, il s’agissait d’une “victoire mutilée” après que ses prétentions sur l’Istrie et la Dalmatie se soient envolées. Aux États-Unis, le Sénat américain refusa de le ratifier, désavouant complètement la politique de Wilson. Même la bourgeoisie française n’était pas satisfaite déplorant le refus de créer un État tampon indépendant en Rhénanie ; ce qui vaudra à Clemenceau le surnom de “Perd-la-victoire” ! Mais pour l’Allemagne et les empires centraux, le traité qui leur était imposé était vécu comme une véritable humiliation dont les réactions n’allaient pas tarder à se faire attendre comme l’avait prévu déjà Rosa Luxemburg en 1916 dans la Brochure de Junius : “La victoire de l’Angleterre et de la France conduirait très vraisemblablement, pour l’Allemagne, à la perte d’une partie au moins de ses colonies et du territoire du Reich et, à coup sûr, à la faillite de la position de l’impérialisme allemand dans la politique mondiale. Et cela signifie le démembrement de l’Autriche-Hongrie et la liquidation de la Turquie. (...) Avec cette option aussi, la victoire conduirait donc à une nouvelle et fébrile course aux armements dans tous les États (avec bien entendu, l’Allemagne en tête) et par là, préparerait une ère de domination incontestée du militarisme et de la réaction dans toute l’Europe avec, à terme, une nouvelle Guerre mondiale”.
Vincent, 21 juin 2019
1 Pour la bourgeoisie française, c’était l’occasion d’effacer symboliquement l’humiliation subie après la défaite lors de la guerre franco-prussienne de 1870/71, lorsque l’Empire allemand fut proclamé dans cette même galerie des Glaces du château de Versailles.
2 “Résolution sur la politique de l’Entente” adoptée par le 1ᵉʳ Congrès de l’Internationale communiste.
3 Les conditions économiques de la paix, J.M Keynes (1920). Lors du deuxième congrès de l’IC, Lénine s’appuya beaucoup sur Les conditions économiques de la paix de J.M Keynes lorsqu’il présenta le “Rapport sur la situation internationale et les tâches fondamentales de l’IC”. Voici ce qu’il pouvait dire du futur maître à penser de la bourgeoisie mondiale : “Keynes a abouti à des conclusions qui sont plus incisives, plus concrètes et plus édifiantes que celles d’un révolutionnaire communiste, parce qu’elles sont celles d’un bourgeois authentique, d’un ennemi implacable du bolchevisme dont il se fait, en petit-bourgeois anglais, une image monstrueuse, bestiale et féroce”.
4 Ibid.
5 Lénine, cité dans Jean-Jacques Marie dans Lénine. La révolution permanente (2018).
6 Voir à ce sujet, “La bourgeoisie mondiale contre la révolution”, Revue Internationale n° 160 et n° 162.
7 “Résolution sur la politique de l’Entente” adoptée par le 2ᵉ congrès de l’Internationale communiste.
8 Ibid.
Personnages:
- Wilson [57]
- Clémenceau [58]
- Lloyd George [59]
Evènements historiques:
Rubrique:
La bourgeoisie anglaise tend à perdre le contrôle de son jeu politique
- 65 reads
L’article ci-dessous est une introduction et une actualisation de la résolution sur la situation en Grande-Bretagne adoptée par la conférence territoriale de notre section au Royaume-Uni. Ce texte est disponible sur le site web du CCI.
Cette résolution, adoptée lors d’une conférence en janvier 2019, cherche à dégager les principales perspectives de la situation en Grande-Bretagne pour la période à venir. L’une des principales responsabilités d’une organisation révolutionnaire est de proposer la vision la plus cohérente possible des perspectives de la situation nationale. Cette tâche revêt d’autant plus d’importance que la situation sociale est dominée par une crise politique sans précédent de la classe dominante autour du Brexit, crise qui ne fera que s’accentuer dans la période à venir. Sans une compréhension des racines et des conséquences de cette tourmente, il est impossible d’en deviner les probables répercussions sur le prolétariat britannique et international dans les années à venir.
Le rôle de la résolution n’est pas de fournir une analyse détaillée des dynamiques à l’œuvre (ce qui est fait dans le rapport sur la situation nationale de cette même conférence), mais de poser un cadre théorique général et de ses implications. Dans le dernier numéro de World Revolution, nous avons publié la partie historique de ce rapport, à laquelle les lecteurs peuvent se référer.
Dans cette introduction, nous souhaitons donc examiner si la résolution a été vérifiée par les événements qui ont suivi depuis.
La résolution soutient que le Brexit est le produit de la combinaison du déclin séculaire de l’impérialisme britannique, des dissensions que cela a engendré au sein de la classe dominante, de l’aggravation de l’impact de la décomposition du capitalisme depuis la crise financière de 2008 et de la montée du populisme. La résolution démontre que la bourgeoisie est prise dans d'irréconciliables contradictions. Celles-ci ne se traduisent pas seulement par la montée du populisme, mais aussi par les divisions déjà existantes sur l’Europe au sein des principaux partis, divisions qui ont été poussées à un point tel qu’elles pourraient détruire l’appareil politique parlementaire, soigneusement construit, et qui a si bien servi la bourgeoisie britannique au cours des deux derniers siècles.
Cela s’est pleinement confirmé par la paralysie de la machine parlementaire aux cours des six derniers mois. Les deux principaux partis politiques ont été déchirés par des luttes de faction autour du Brexit. L’Accord de retrait du Royaume-Uni élaboré par l’Union Européenne (UE) et le gouvernement de May, visant à empêcher la Grande-Bretagne de s’effondrer une fois sortie de l’UE, a été sapé par l’incapacité des principales factions des deux partis à se mettre d’accord sur la manière de le mettre en œuvre. May n’a pas pu faire de compromis à cause de la pression exercée par les partisans d’un Brexit dur, tandis que Corbyn a été contraint par les divisions au sein du parti travailliste où des factions importantes demandent une union douanière ou un second référendum. Les pourparlers entre les deux partis représentaient le dernier espoir d’obtenir cet accord, mais ceux-ci étaient d’emblée condamnés car il était devenu évident que May allait être chassée du pouvoir par des factions du parti conservateur opposées à un accord avec les travaillistes. Ce qui fût en effet le cas lorsque May a annoncé sa démission le 7 juin. Aujourd’hui, cette paralysie a entraîné une bataille pour la direction du parti conservateur, avec en tête les partisans les plus enragés du Brexit, mais, quel que soit le résultat, cela ne résoudra pas l’impasse dans laquelle ils se trouvent.
Ce vide politique a engendré un nouveau regain de populisme, nourri par la colère et la frustration à l’encontre du parlement, incapable d’avancer sur le Brexit. Farage et ses partisans, bourgeois prospères, ont tiré avantage de ce vide en fondant le Parti du Brexit. Ce nouveau parti représente un sérieux danger pour les principales formations politiques. Il est le nouveau visage du populisme. Terminées, la véhémente rhétorique anti-immigration et les personnalités farfelues et aventurières qui ont rendu l’UKIP (UK Independance Party) intolérable pour beaucoup. Le nouveau parti est très rusé ; il mène une campagne sur internet très sophistiquée et se présente comme étant à la fois multiculturel et soutenu par des électeurs plus jeunes. Farage a fait grand cas de son rejet de l’islamophobie et du racisme croissants au sein d’UKIP. Ce stratagème, basé sur le fait d’être le seul parti capable de défendre le vote démocratique du “peuple”, constitue un véritable effort pour s’immiscer dans le jeu des principales formations politiques.
La popularité croissante du Parti du Brexit, cependant, pose problème. Le nouveau chef du parti conservateur ne voudra pas déclencher d’élections générales tant que le Brexit ne sera pas résolu, car, comme l’a dit un ancien collaborateur de Cameron, ils seraient “grillés”. Les travaillistes seraient également très réticents à se présenter à des élections parce que le Parti du Brexit s’efforce de se faire passer pour le parti des travailleurs.
Ainsi, trois ans après un référendum dont le but était de faire reculer le populisme, la classe dominante fait désormais face à un parti populiste revigoré et plus sophistiqué que jamais, exacerbant sa crise politique.
Comme le dit la résolution, cette crise menace l’identité territoriale de l’État britannique. L’élection d’un partisan intransigeant du Brexit à la tête du parti conservateur et/ou l’arrivée du Parti du Brexit au sein du Parlement ne feraient qu’empirer les tensions avec la fraction écossaise indépendantiste de la bourgeoisie.
L’impact de cette crise ne s’arrête pas aux frontières de l’Angleterre. Comme l’explique la résolution, le Brexit a contribué au renforcement du populisme en Europe ainsi qu’aux États-Unis. L’UE et les principales puissances européennes ont alors adopté une ligne très dure envers la bourgeoisie britannique. Cette stratégie a quelque peu payé : le chaos politique a suscité une peur réelle, même parmi les partis populistes et les gouvernements européens qui ont désormais abandonné ou tempéré leur demande de quitter l’UE. Cependant, l’extrême-droite populiste constitue toujours une menace sérieuse pour l’avenir de l’UE.
Les espoirs des partisans du Brexit en une Grande-Bretagne à nouveau “ouverte sur le monde” et capable de conclure des traités de libre-échange se heurtent déjà à la dure réalité. Le développement de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a clairement montré que ces derniers, dans leur lutte de plus en plus acharnée contre la Chine, n’hésiteront pas à saper les intérêts de leurs anciens alliés. Le scandale qui a touché Huawei a vu la Chine menacer ses investissements en Grande-Bretagne si le gouvernement britannique devait céder aux pressions américaines visant à bannir l’entreprise de ses infrastructures.
Sa lutte avec la Chine pour la domination mondiale, ainsi que son intention de saper ses rivaux européens, signifient que les États-Unis ont peu d’intérêt à voir une Grande-Bretagne affaiblie par sa sortie de l’UE. Trump s’est montré fervent supporter du Brexit afin de porter un coup à l’UE, mais, une fois le Brexit mis en place, quel rôle pourra jouer la Grande-Bretagne pour les États-Unis ?
L’analyse de la résolution sur l’aggravation de la crise politique a donc été vérifiée par les événements. Sa mise en garde contre la menace que représente le populisme dans cette situation de crise était bien justifiée. L’émergence du Parti du Brexit est un autre facteur de chaos et d’instabilité, mettant encore plus en danger les efforts de l’État britannique pour garantir le bon déroulement du Brexit.
Pour la classe ouvrière, les conséquences de cette situation s’annoncent sombres. Le prolétariat n’a apporté presque aucune réponse à plus d’une décennie d’austérité. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de mécontentement, mais celui-ci n’a pas trouvé son expression dans la lutte de classe, à cause du profond manque de confiance en soi du prolétariat. Cette désorientation et cette démoralisation ont été exacerbées par le Brexit et la crise politique. Le soutien au populisme et sa promesse simpliste d’un avenir meilleur pour certaines parties du prolétariat est une expression de cette détresse et de ce désespoir. Cependant, derrière l’anti-populisme et sa défense de la démocratie ainsi que de l’État démocratique, se profile un danger encore plus grand pour le prolétariat. Aujourd’hui et dans la période à venir, le prolétariat aura du mal à éviter de se mobiliser derrières les différentes factions bourgeoises.
Mais la crise économique continuera de s’aggraver, et quelles que soient les factions bourgeoises au pouvoir, elles s’attaqueront toutes au prolétariat. C’est seulement dans la lutte contre ces attaques que la classe ouvrière pourra défendre ses intérêts. Ces luttes futures trouveront les mêmes réponses de la part des conservateurs, des travaillistes ou des populistes, parce qu’au bout du compte, ils sont tous les défenseurs du capitalisme.
World révolution,
section du CCI au Royaume-Uni
Géographique:
- Grande-Bretagne [61]
Récent et en cours:
- Brexit [62]
Rubrique:
Exposition "Rouge" au Grand Palais: À menteur, menteur et demi !
- 172 reads
Au Grand Palais, à Paris, du 20 mars au 1er juillet 2019, s’exposent plus de 400 œuvres regroupées sous le titre alléchant de “Rouge : Art et utopie au pays des Soviets”.
L’art au “pays des Soviets”
Laissons parler la revue Télérama, ou plus exactement sa journaliste Yasmine Youssi, qui visiblement a été fortement impressionnée : “À partir de 1917, l’art envahit la vie (…). Soudain, les rues se sont couvertes d’affiches, les murs de pochoirs, les places de monuments (…). En témoignent les photos, tableaux, dessins, maquettes, affiches, livres, documents visuels, extraits de films, pièces de mobilier, de textiles signés des plus grands noms, mais aussi d’une flopée d’artistes rarement montrés en pareilles occasions”. Et de poursuivre avec le même enthousiasme : “Fusionner l’art et la vie. Riche de plusieurs centaines d’œuvres, “Rouge 1917-1953” plonge avec bonheur ses visiteurs au cœur de l’effervescence artistique russe au lendemain de la révolution bolchevique”. 1917 est un souffle dont la voile de l’art se gonfle. Voilà ce qu’il est effectivement possible de deviner au Grand Palais : peintures, sculptures, architectures, photographies, cinéma, design… Alexandre Rodtchenko, Kazimir Malevitch, Gustav Klutsis, Alexandre Deïneka, Sergueï Eisenstein, Varvara Stepanova… Avec la révolution, partout dans le monde, l’art part dans toutes les directions, une multitude de pistes nouvelles sont explorées, d’intenses débats agitent non seulement les milieux artistiques mais aussi les ouvriers. Ce vent nouveau artistique ne fut d’ailleurs pas limité à la seule Russie, comme en témoigne le développement du dadaïsme et de l’expressionnisme peu avant la révolution allemande ou celui du surréalisme en France.
Cette exposition ne se limite pas à la période révolutionnaire, elle se poursuit jusqu’en 1953 et la mort de Staline. Là encore, l’évolution du monde de l’art raconte l’Histoire : l’horreur de la contre-révolution incarnée par la victoire du stalinisme. Puisque, décidément, la plume de Yasmine Youssi est particulièrement acérée, poursuivons en sa compagnie notre lecture : “La prise des pleins pouvoirs par Staline, à partir de 1929, change la donne. C’est la fin des avant-gardes, et les différents groupes artistiques sont dissous. Pour le nouveau maître du Kremlin, la seule esthétique valable est celle du réalisme socialiste : une autre manière de nommer le réalisme russe du XIXe siècle, sauf qu’il se révèle encore plus kitsch et pompeux. Les œuvres qui s’en réclament réécrivent souvent l’histoire du pays. Tandis que les artistes qui firent les grandes heures de la révolution disparaissent peu à peu. Ils sont au mieux interdits d’exercer. Au pire, comme le metteur en scène Meyerhold, fusillés”. Comme les révolutionnaires d’Octobre 1917, la contre-révolution va signifier pour les artistes un choix morbide : refuser de se soumettre au pouvoir au prix de l’isolement, de la dépression, de la déportation, de l’exil, de la mort… ou se conformer en se reniant, en faisant de l’art un simple outil de propagande. Au fil de l’exposition, les œuvres deviennent ainsi de plus en plus grotesques et abjectes.
Une contribution au plus grand mensonge de l’histoire : le stalinisme égal au communisme
Seulement, l’histoire que nous content ces 400 œuvres est aussi accompagnée de commentaires et de silences, de citations et d’absences remarquables, autant de choix des exposants qui viennent orienter et, lâchons le mot, manipuler le visiteur.
Le ton est donné d’emblée : “Le coup d’État bolchevik plonge l’ancien Empire russe dans la guerre civile. Pour le nouveau pouvoir, il est crucial de mobiliser la population autour du projet porté par la révolution”. Cette exposition a beau se nommer “Rouge : Art et utopie au pays des Soviets”, pas un mot sur les Soviets (conseils ouvriers), sur la vie bouillonnante des assemblées générales permanentes, de la créativité des masses. Rien. Pas un mot de la réalité de la vie sociale de l’époque, des débats à tous les coins de rue.
Pour appuyer insidieusement la thèse que “le ver était dans le fruit”, que la propagande caricaturale et nauséabonde du stalinisme puise ses racines dans les premiers jours de la révolution (pardon, du “coup d’État”), toutes les œuvres sélectionnées sont présentées sous le seul prisme de l’art politique, de l’art d’État.
C’est ainsi que “Rouge : Art et utopie au pays des Soviets” fait, par exemple, disparaître l’utopie féerique d’un Chagall. Pas un tableau, pas une référence ! Pourtant, le génie de Chagall ne s’est jamais autant exprimé que pendant sa jeunesse dans la Russie révolutionnaire. “En 1914, le jeune homme, qui vit alors à Paris, rentre à Moscou pour épouser sa fiancée, Bella, et repartir avec elle. La guerre les coince. La Révolution russe éclate. En 1918, voilà Chagall, à 30 ans, propulsé à la tête d’une école d’art dans sa ville natale à Vitebsk. (…) “Je vivais comme dans un évanouissement”, écrira Chagall dans son autobiographie. Une extase quotidienne. C’est l’une de ces périodes miraculeuses qui ne durent qu’un ou deux printemps, au cours desquels tout est permis. Chagall, un juif, citoyen de seconde zone sous le tsarisme, est enfin libre, renouvelle le décor de sa ville. Tous ses tableaux sont marqués par son amour fou pour Bella : elle le porte comme une acrobate soutient l’artiste et ses verres de vin, qui trinque au sommet. Un ange veille sur le jeune couple. Il réalise de lui un autoportrait à la tête coupée, titré “N’importe où hors du monde”. C’est notre souffle qui est coupé devant tant d’audace”.(1)
Pas un mot non plus des débats enflammés entre les révolutionnaires sur l’art, pas une ligne des analyses profondément justes et flamboyantes de Léon Trotski. Il est vrai qu’une partie des artistes de l’époque s’était engagée dans la voie de la subordination à l’État. Mais l’activité artistique de l’époque ne se résumait pas à cela. C’est d’ailleurs ce qui poussa Trotski à rejeter la notion de “culture prolétarienne” et de subordination de l’art au Parti. En 1924, dans Littérature et Révolution, il écrivait : “L’art doit se frayer sa propre route par lui-même. Ses méthodes ne sont pas celles du marxisme. Si le Parti dirige le prolétariat, il ne dirige pas le processus historique. (…) L’art n’est pas un domaine où le Parti est appelé à commander. II protège, stimule, ne dirige qu’indirectement. Il accorde sa confiance aux groupes qui aspirent sincèrement à se rapprocher de la Révolution et encourage ainsi leur production artistique. Il ne peut pas se placer sur les positions d’un cercle littéraire. Il ne le peut pas et il ne le doit pas”.
Sans mention des débats des révolutionnaires sur l’art, sans Chagall, ni aucun tableau flamboyant d’aucun artiste, en focalisant tous les regards sur les affiches et les œuvres liées à la propagande politique, cette exposition fait entrer le visiteur dans les années 1930 comme en lui disant : “Voilà sur quoi inexorablement tout cela devait déboucher”. Là, comme par miracle, les explications et le contexte historique ne manquent plus. Si la vie des Soviets et tout le contexte historique de la vague révolutionnaire ont été tout bonnement effacés tels les personnages tombés en disgrâce sur les photographies truquées par le stalinisme, les crimes odieux, les procès de Moscou, les mensonges et le culte de la personnalité des années 1930 à 1950 sont étalés sur tous les murs : “La collectivisation forcée des campagnes est enclenchée, entraînant la “liquidation des koulaks (paysans propriétaires) en tant que classe”. Le premier plan quinquennal provoque une industrialisation à marche forcée ; les objectifs économiques deviennent des défis relevés grâce à l’ “émulation socialiste” entre “brigades de choc”. (…) Les “saboteurs” sont “démasqués” et jugés, tandis que la rhétorique du “complot” accapare l’espace public, amplement relayée par les arts visuels. Un vaste système concentrationnaire se met en place : le Goulag. En décembre 1934, l’assassinat de Sergueï Kirov, membre éminent du Politburo, ouvre la voie à une vague de répressions sans précédent. Les procès de Moscou (1936-1938) sont largement médiatisés. La “Grande Terreur” touche toutes les couches de la société et fait des millions de victimes”. Oui, le stalinisme a été d’une horreur insondable, mais il n’est en rien le continuateur d’Octobre 1917, il en est au contraire le fossoyeur !
Finalement, cette exposition donne involontairement une leçon pleine d’ironie : elle dénonce le burlesque et l’ignominie de la propagande mensongère du stalinisme, en utilisant les mêmes techniques de manipulation, les mêmes gommes et les mêmes ciseaux. En répétant, sous l’angle de l’art, le mensonge identifiant le stalinisme au communisme, elle s’inscrit dans les pas d’un autre Joseph, Goebbels, pour qui “un mensonge répété mille fois se transforme en vérité”.
Le visiteur attentif aura d’ailleurs remarqué, sur l’un des murs vers la fin du dédale, un petit aveu au passage d’une remarque discrète admettant que la propagande sous Staline ouvrait la voie à la propagande américaine pendant la Seconde Guerre mondiale qui utilisa les mêmes méthodes.
En effet, russe ou américaine, dictatoriale ou démocratique, fasciste ou socialiste, stalinienne ou libérale… sur les affiches ou dans les musées, la bourgeoisie falsifie l’Histoire !
Iskusstvo, 20 juin 2019
[1] “Quand Chagall était génial [63]”, Le Parisien (19 juin 2018).
Récent et en cours:
- Art [64]
Rubrique:
Avril 1939: Fin de la Guerre d’Espagne et prologue de la Deuxième Guerre mondiale
- 513 reads
Il y a 80 ans, prenait fin l’un des événements les plus importants du XXe siècle : la Guerre d’Espagne. Cet événement majeur a été au cœur de la situation mondiale dans les années 1930. Il a occupé le centre de l’actualité politique internationale pendant plusieurs années. Il a constitué un test décisif pour toutes les tendances politiques se réclamant du prolétariat et de la révolution. Par exemple, c’est en Espagne qu’on a vu à l’œuvre, pour la première fois en dehors de l’URSS, le stalinisme dans son rôle de bourreau du prolétariat. De même, c’est autour de la question espagnole que s’est opérée une décantation au sein des courants qui avaient lutté contre la dégénérescence et la trahison des partis communistes dans les années 1920, une décantation entre ceux qui allaient maintenir une position internationaliste lors de la Seconde Guerre mondiale et ceux qui se sont enrôlés dans celle-ci, comme le courant trotskiste, par exemple. Aujourd’hui encore, les événements de 1936-1939 en Espagne continuent d’être présents dans le positionnement et la propagande des courants qui se réclament de la révolution prolétarienne. C’est particulièrement le cas des différentes tendances de l’anarchisme et du trotskisme qui, au-delà de leurs divergences, sont toutes d’accord pour considérer qu’il y a eu une “révolution” en Espagne en 1936. Une révolution qui, d’après les anarchistes, serait allée bien plus loin que celle de 1917 en Russie du fait de la constitution des “collectivités” promues par la CNT, la centrale syndicale anarcho-syndicaliste. Une analyse qui à l’époque avait été rejetée par les différents courants de la Gauche communiste, par la Gauche italienne et aussi par la Gauche germano-hollandaise.
La première question à laquelle il nous faut donc répondre est celle-ci : a-t-on assisté à une révolution dans l’Espagne de 1936 ?
Qu’est-ce qu’une révolution ?
Avant de répondre à cette question, il faut évidemment se mettre d’accord sur ce qu’on entend par “révolution”. C’est un terme particulièrement galvaudé puisqu’il est revendiqué aussi bien par l’extrême-gauche (par exemple Mélenchon avec sa “Révolution citoyenne”) que par l’extrême-droite (la “Révolution nationale”). Macron lui-même avait intitulé, “Révolution”, le livre dans lequel il présentait son programme.
En fait, au-delà de toutes ses interprétations fantaisistes, ce terme “Révolution” qualifie dans l’histoire un changement violent de régime politique exprimant un bouleversement du rapport de forces entre les classes sociales au bénéfice de celles qui représentent un progrès pour la société. Ce fut le cas de la Révolution anglaise des années 1640 et de la Révolution française de 1789 qui, toutes les deux, se sont attaquées au pouvoir politique de l’aristocratie au bénéfice de la bourgeoisie.
Tout au long du XIXe siècle, les avancées politiques de la bourgeoisie au détriment de la noblesse constituaient des progrès pour la société. Et cela parce qu’à cette époque le capitalisme était un système en pleine prospérité, parti à la conquête du monde. Mais cette situation change radicalement au XXe siècle. Les puissances bourgeoises ont fini de se partager le monde. Toute nouvelle conquête, coloniale ou commerciale, se heurte au pré-carré d’une puissance rivale. On assiste alors à une montée du militarisme et à un déchaînement de tensions impérialistes qui aboutissent à la Première Guerre mondiale. C’est le signe que le capitalisme est devenu un système caduc et décadent. Les révolutions bourgeoises ne sont plus d’actualité. La seule révolution qui soit à l’ordre du jour est celle qui doit renverser le système capitaliste et instaurer une nouvelle société débarrassée de l’exploitation et des guerres, le communisme. Le sujet de cette révolution, c’est la classe des travailleurs salariés, producteurs de la plus grande partie de la richesse sociale, le prolétariat.
Il existe des différences fondamentales entre les révolutions bourgeoises et la révolution prolétarienne. Une révolution bourgeoise, c’est-à-dire la prise du pouvoir politique par les représentants de la classe bourgeoise d’un pays, constitue un aboutissement de toute une période historique au cours de laquelle la bourgeoisie a acquis un poids décisif dans la sphère économique grâce au développement du commerce et des techniques productives. La révolution politique, l’abolition des privilèges de la noblesse, constitue une étape importante (bien que non indispensable) dans la mainmise croissante de la bourgeoisie sur la société qui lui permet de faciliter et d’accélérer ce processus de mainmise.
La révolution prolétarienne ne se situe nullement à la fin du processus de transformation économique de la société mais au contraire au tout début. La bourgeoisie avait pu constituer des îlots d’économie bourgeoise dans la société féodale, les villes marchandes, les réseaux commerciaux, des îlots qui s’étaient étendus et renforcés progressivement. Rien de tel pour le prolétariat. Celui-ci ne pourra pas constituer des îlots de communisme au sein d’une économie mondiale dominée par le capitalisme et les rapports marchands. C’était le rêve des socialistes utopistes tels Fourier, Saint-Simon ou Owen. Mais, malgré toute leur bonne volonté et leurs analyses souvent profondes des contradictions du capitalisme, leurs rêves se sont heurtés et effondrés face à la réalité de la société capitaliste. En fait, la première étape de la révolution communiste consiste dans la prise du pouvoir politique par le prolétariat à l’échelle mondiale. C’est grâce à ce pouvoir politique que la classe révolutionnaire pourra transformer progressivement l’ensemble de l’économie en la socialisant, en abolissant la propriété privée des moyens de production ainsi que les échanges marchands.
Il existe encore deux autres différences fondamentales entre les révolutions bourgeoises et la révolution prolétarienne :
– Premièrement, alors que les révolutions bourgeoises ont eu lieu à des périodes différentes suivant les pays en fonction du développement économique de chacun d’eux (il s’écoule plus d’un siècle entre la révolution anglaise et la révolution française), la révolution prolétarienne doit se dérouler dans une même période historique. Si elle reste isolée dans un seul pays ou dans quelques pays, elle est condamnée à la défaite. C’est ce qu’on a vu avec l’exemple de la révolution russe de 1917.
– Deuxièmement, les révolutions bourgeoises, même extrêmement violentes, conservaient l’essentiel de l’appareil d’État de la société féodale (l’armée, la police, la justice, la bureaucratie). En fait, les révolutions bourgeoises consistaient en une modernisation, un perfectionnement de l’appareil d’État existant. C’était possible et nécessaire du fait que ce type de révolution signifiait que deux classes exploiteuses, la noblesse et la bourgeoisie, se succédaient à la tête de la société. Rien de tel avec la révolution prolétarienne. En aucune façon, le prolétariat, la classe exploitée spécifique de la société capitaliste, ne peut utiliser à son profit un appareil d’État conçu et organisé pour garantir cette exploitation, pour réprimer les luttes contre cette exploitation. La première des tâches du prolétariat lors de la révolution consiste à s’armer pour détruire de fond en comble l’appareil d’État et à mettre en place ses propres organes de pouvoir basés sur ses organisations unitaires de masse, avec des délégués élus révocables par les assemblées générales : les Conseils ouvriers.
1936 : une révolution en Espagne ?
Le 18 juillet 1936, face au coup d’État militaire contre le gouvernement de Front populaire, le prolétariat a pris les armes. Il a réussi à faire échouer dans la plupart des grandes villes l’entreprise criminelle dirigée par Franco et ses acolytes. A-t-il profité de cette situation, de sa position de force pour s’attaquer à l’État bourgeois ? Un État bourgeois qui, depuis l’instauration de la République en 1931, s’était déjà distingué dans la répression sanglante de la classe ouvrière, notamment aux Asturies en 1934 avec 3 000 morts. Absolument pas !
La riposte ouvrière était certes au départ une action de classe, empêchant le coup d’État de réussir. Mais, malheureusement, l’énergie ouvrière a été rapidement canalisée et récupérée idéologiquement derrière la bannière de l’État par la force mystificatrice de “l’antifascisme” du Front populaire. Loin de s’attaquer à l’État bourgeois et de le détruire, comme ce fut le cas en Octobre 1917 en Russie, les ouvriers ont été dévoyés et embrigadés dans la défense de l’État républicain. Dans cette tragédie, la CNT anarchiste, la centrale syndicale la plus puissante, a bel et bien joué un rôle moteur, en désarmant les ouvriers, en les poussant à abandonner le terrain de la lutte de classe pour capituler et le dévoyer en le livrant pieds et poings liés à l’État bourgeois. Au lieu de s’attaquer à l’État pour le détruire, comme ils ont toujours proclamé vouloir le faire, les anarchistes ont exercé des ministères, déclarant, comme l’a fait Federica Montseny, ministre anarchiste du gouvernement républicain : “Aujourd’hui, le gouvernement, en tant qu’instrument de contrôle des organes de l’État, a cessé d’être une force d’oppression contre la classe ouvrière, de même que l’État ne représente plus un organisme qui divise la société en classes. L’un et l’autre opprimeront même moins le peuple maintenant que des membres de la CNT y sont intervenus”. Les anarchistes, qui se proclament les meilleurs “ennemis de l’État”, ont donc pu, grâce à ce type de rhétorique, entraîner les ouvriers espagnols dans la défense pure et simple de l’État démocratique. La classe ouvrière était détournée de ses objectifs politiques propres pour soutenir la fraction “démocratique” contre la fraction “fasciste” de la bourgeoisie. On mesure là toute l’étendue de la faillite politique, morale, historique, de l’anarchisme. Politiquement dominant dans la péninsule ibérique, l’anarchisme a montré là sa totale incapacité à mener une politique de classe, d’émancipation de la classe ouvrière. Il a simplement abouti à pousser celle-ci vers la défense de la bourgeoisie démocratique, de l’État capitaliste. Mais la faillite de l’anarchisme ne s’arrête pas là. En prétendant mener la révolution en privilégiant “l’action locale” qui a mené aux “collectivisations” de 1936, il a en fait rendu un fier service à l’État bourgeois :
– d’une part, il a permis la réorganisation de l’économie espagnole au profit de l’effort de guerre de l’État républicain, c’est-à-dire du représentant de la bourgeoisie démocratique, contre la fraction “fasciste” de cette même bourgeoisie ;
– d’autre part, il a détourné le prolétariat d’une action politique globale au profit de cette gestion immédiate des unités de production, encore au profit de l’État et donc de la bourgeoisie. Contraints de s’occuper de la production au jour le jour, les ouvriers embrigadés dans les “collectivités” étaient amenés à se détourner de toute activité politique globale, au profit d’une gestion d’entreprises locales, sans liens entre elles, ni avec les besoins réels de la classe ouvrière.
Alors que le prolétariat était maître de la rue en juillet 1936, il a été soumis, en moins d’un an, par la coalition des forces politiques républicaines. Le 3 mai 1937, il a fait une dernière tentative pour s’opposer à cette soumission. Ce jour-là, les “Gardes d’Assaut”, unités policières du gouvernement de la Généralité de Catalogne, en fait des instruments des staliniens qui en avaient pris le contrôle, ont tenté d’occuper le central téléphonique de Barcelone entre les mains de la CNT. La partie la plus combative du prolétariat a répondu à cette provocation en s’emparant de la rue, en dressant des barricades, en partant en grève, une grève presque générale. Le prolétariat était bien mobilisé, disposait certes d’armes, mais restait cependant sans perspective. L’État démocratique était resté intact. Il était toujours présent et offensif, contrairement aux dires des anarchistes, et il n’avait aucunement renoncé à réprimer les tentatives de résistance prolétariennes. Alors que les troupes franquistes arrêtaient volontairement leur offensive sur le Front, les staliniens et le gouvernement républicain écrasaient ces mêmes ouvriers qui, en juillet 1936, avaient fait échouer le coup d’État fasciste. C’est à ce moment-là que Federica Montseny, la plus en vue des ministres anarchistes, a appelé les ouvriers à cesser le combat, à déposer les armes ! Ce fut donc un véritable coup de poignard dans le dos pour la classe ouvrière, une véritable trahison et une défaite cuisante. Voilà ce qu’écrivait à cette occasion la revue Bilan, la publication de la Gauche communiste italienne : “Le 19 juillet 1936, les prolétaires de Barcelone, AVEC LEURS POINGS NUS, écrasèrent l’attaque des bataillons de Franco, ARMES JUSQU’AUX DENTS. Le 4 mai 1937, ces mêmes prolétaires, MUNIS D’ARMES, laissent sur le pavé bien plus de victimes qu’en juillet, lorsqu’ils doivent repousser Franco et c’est le gouvernement antifasciste (comprenant jusqu’aux anarchistes et dont le POUM est indirectement solidaire) qui déchaîne la racaille des forces répressives contre les ouvriers”.
Dans la répression générale qui a suivi la défaite du soulèvement de mai 1937, les staliniens s’en sont donnés à cœur-joie pour procéder à l’élimination physique des “éléments gênants”. Ce fut le cas, par exemple, du militant anarchiste italien, Camilo Berneri, qui avait eu la lucidité et le courage de faire une critique en règle de la politique de la CNT et de l’action des ministres anarchistes dans une “Lettre ouverte à la camarade Federica Montseny”.
Dire que ce qui s’est passé en Espagne en 1936 était une révolution “supérieure” à celle qui a eu lieu en Russie en 1917 non seulement tourne totalement le dos à la réalité, mais constitue une attaque majeure contre la conscience du prolétariat en évacuant et en rejetant les expériences les plus précieuses de la révolution russe : notamment celles des Conseils ouvriers (les Soviets), de la destruction de l’État bourgeois et de l’internationalisme prolétarien, puisque cette révolution s’est conçue comme la première étape de la révolution mondiale et qu’elle a impulsé la constitution de l’Internationale communiste. Un internationalisme prolétarien qui, malgré ses affirmations, était bien étranger au mouvement anarchiste, comme on le verra plus loin.
La Guerre d’Espagne, préparation de la Seconde Guerre mondiale
Le premier élément qui nous permet d’affirmer que la Guerre d’Espagne n’a été qu’un prélude à la Seconde Guerre mondiale, et non une révolution sociale, c’est le caractère même des combats entre différentes fractions bourgeoises de l’État, républicains et fascistes, et entre nations. Le nationalisme de la CNT l’amènera d’ailleurs à appeler explicitement à la guerre mondiale pour sauver la “nation espagnole” : “L’Espagne libre fera son devoir. Face à cette attitude héroïque, que vont faire les démocraties ? Il y a lieu d’espérer que l’inévitable ne tardera pas longtemps à se produire. L’attitude provocatrice et grossière de l’Allemagne devient déjà insupportable. (…) Les uns et les autres savent que, finalement, les démocraties devront intervenir avec leurs escadres et avec leurs armées pour barrer le passage à ces hordes d’insensés…” (Solidaridad obrera, journal de la CNT, 6 janvier 1937, cité par Révolution prolétarienne n° 238, janvier 1937). Les deux factions bourgeoises en lutte ont immédiatement cherché à obtenir des soutiens extérieurs : non seulement, il y a eu une intervention militaire massive des États fascistes qui ont apporté une aviation et une armée blindée modernes aux franquistes, mais l’URSS, à travers des livraisons d’armes et ses “conseillers militaires”, s’est également impliquée dans le conflit. Il y a eu un soutien politique et médiatique énorme, partout dans le monde, pour un camp bourgeois ou pour l’autre. Par contre, aucune des grandes nations capitalistes n’avait soutenu la Révolution russe en 1917 ! Elles avaient toutes, au contraire, participé à l’isoler et à la combattre militairement, en essayant de l’écraser dans le sang.
Une des illustrations les plus spectaculaires du rôle de la guerre d’Espagne comme préparation de la Seconde Guerre mondiale est l’attitude de beaucoup de militants anarchistes par rapport à celle-ci. Ainsi, nombre d’entre eux se sont engagés dans la Résistance, c’est-à-dire l’organisation représentant le camp impérialiste anglo-américain sur le territoire français occupé par l’Allemagne. Certains se sont même engagés dans l’armée régulière française, notamment dans la Légion étrangère ou la 2e Division blindée du Général Leclerc, ce même Leclerc qui allait poursuivre sa carrière dans la guerre coloniale en Indochine. C’est ainsi que les premiers chars qui sont entrés dans Paris, le 24 août 1944, étaient conduits par des tankistes espagnols et arboraient le portrait de Durruti, dirigeant anarchiste commandant la célèbre “colonne Durruti”, mort devant Madrid en novembre 1936.
Tous ceux qui, tout en se réclamant de la révolution prolétarienne, ont pris fait et cause pour la République, pour le “camp démocratique”, l’ont fait en général au nom d’un “moindre mal” et contre le “péril fasciste”. Les anarchistes ont été les promoteurs de cette idéologie démocratique au nom de leurs principes “anti-autoritaires”. Selon eux, même s’ils admettent que la “démocratie” est une des expressions du capital, ils considèrent qu’elle constitue un “moindre mal” par rapport au fascisme parce que, évidemment, elle est moins autoritaire. C’est faire preuve d’une totale cécité ! La démocratie n’est pas un “moindre mal”. Au contraire ! C’est justement parce qu’elle est capable de créer plus d’illusions que les régimes fascistes ou autoritaires, qu’elle constitue une arme de prédilection de la bourgeoisie contre le prolétariat.
De plus, la démocratie n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de réprimer la classe ouvrière. Ce sont les “démocrates”, et même “social-démocrates”, Ebert et Noske, qui ont fait assassiner Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, ainsi que des milliers d’ouvriers, lors de la révolution allemande en 1919, provoquant un coup d’arrêt à l’extension de la révolution mondiale. À propos de la Seconde Guerre mondiale, les atrocités commises par le “camp fasciste” sont bien connues et médiatisées mais le “camp démocratique” n’a pas été en reste : ce n’est pas Hitler qui a envoyé deux bombes atomiques sur des populations civiles, c’est le “démocrate” Truman, président de la grande “démocratie” américaine.
Et si on revient sur le cas de la Guerre d’Espagne, on se doit de rappeler quel accueil la République française, championne des “droits de l’homme” et de la “Liberté-Égalité-Fraternité”, a réservé aux 400 000 réfugiés qui ont fui le territoire espagnol en hiver 1939 à la fin de la guerre civile. Pour la plupart d’entre eux, ils ont été parqués comme du bétail dans des camps de concentration entourés de barbelés, sous la garde armée des gendarmes de la démocratie française.
Le prolétariat doit tirer les leçons de la Guerre d’Espagne :
– Contrairement à ceux qui veulent enterrer le prolétariat et qui cherchent à discréditer son combat, à ceux qui pensent que la tradition de la Gauche communiste est “obsolète” ou une “vieillerie”, qu’il faudrait s’affranchir du passé révolutionnaire du prolétariat, que l’Espagne serait une expérience révolutionnaire “supérieure”, qu’il faudrait finalement oublier le passé pour “expérimenter autre chose”, nous affirmons que le combat ouvrier reste la seule issue pour l’avenir de l’humanité. Nous devons donc défendre impérativement la mémoire ouvrière et ses traditions de luttes. En particulier la nécessité de son autonomie de classe, de combattre de façon intransigeante pour ses propres intérêts, sur son terrain de classe, avec sa propre méthode de lutte, ses propres principes.
– Une révolution prolétarienne n’a rien à voir avec la lutte “antifasciste” et les événements en Espagne des années 1930. Elle doit se placer au contraire sur le terrain politique de la lutte ouvrière, consciente, basée sur la force politique des Conseils ouvriers. Le prolétariat doit conserver son auto-organisation, son indépendance politique vis-à-vis de toutes les fractions de la bourgeoisie, de toutes les idéologies qui lui sont étrangères. C’est ce que le prolétariat a été incapable de faire en Espagne puisque, au contraire, il s’est lié, et donc soumis, aux forces de gauche du capital !
– La Guerre d’Espagne montre aussi qu’il n’est pas possible de commencer à “construire une société nouvelle” au travers d’initiatives locales, sur le terrain économique, comme veulent le croire les anarchistes. La lutte de classe révolutionnaire est d’abord et avant tout un mouvement politique international et non limité à des réformes ou mesurettes économiques préalables (même par des “expérimentations” d’apparence très radicales). La Révolution prolétarienne, comme la Révolution russe nous l’a montré, doit avoir pour première tâche, une tâche politique : celle de la destruction de l’État bourgeois et de la prise du pouvoir par la classe ouvrière à l’échelle internationale. Sans cela, c’est fatalement l’isolement et la défaite.
– Enfin, l’idéologie démocratique est la plus dangereuse de toutes celles promues par l’ennemi de classe. C’est la plus pernicieuse, celle qui fait passer le loup capitaliste pour un agneau protecteur et “favorable” aux ouvriers. L’antifascisme a donc été l’arme parfaite en Espagne et ailleurs usée par les Fronts populaires pour envoyer les ouvriers se faire massacrer dans la guerre impérialiste. L’État et sa “démocratie”, comme expression hypocrite et pernicieuse du capital, reste notre ennemi. Le mythe démocratique est non seulement un masque de l’État et de la bourgeoisie pour cacher sa dictature, sa domination sociale et son exploitation, mais aussi et surtout, l’obstacle le plus puissant et le plus difficile à franchir pour le prolétariat. Les événements de 1936/37 en Espagne le montrent amplement et c’est un de leurs enseignements.
CCI, juin 2019
Géographique:
- Espagne [65]
Evènements historiques:
- Guerre d'Espagne [30]
Rubrique:
Révolution internationale n° 478 - septembre octobre 2019
- 163 reads
Nouvelle récession: Le capital exige davantage de sacrifices pour le prolétariat!
- 212 reads
En dépit de moyens sophistiqués pour masquer la progression du chômage, les mauvaises nouvelles sur ce plan tombent brutalement un peu partout, même si paradoxalement, comme en France, on annonce une baisse des demandeurs d’emploi. Il devient cependant de plus en plus difficile de faire croire que tout cela n’est pas si grave.
Comme chaque année, la période estivale a une nouvelle fois été mise à profit par la classe dominante de tous les pays pour porter de sérieuses attaques contre les conditions d’exploitation et les conditions de vie des salariés.
Mais cette fois, c’est pire. Que ce soit en catimini ou au grand jour, accompagnées ou non d’une propagande anesthésiante, on ne compte plus le nombre de mesures et de réformes qui ont été partout programmées ou mises en œuvre par la bourgeoisie pour faire face à l’accélération de la crise économique.
Les attaques brutales se renforcent
Dans les pays émergents, la situation des prolétaires se dégrade très fortement. En Argentine, la crise du peso et l’inflation galopante sont en train de plonger le pays dans un scénario qui rappelle de manière encore plus dramatique la chute vertigineuse de 2001 avec son lot de misère accrue pour les prolétaires. 1 Au Brésil, les effets de la réforme du travail avec les pertes de salaires se font lourdement sentir tandis que le système des retraites est attaqué. En Turquie, un plan d’austérité est lancé. En avril on notait déjà une hausse des prix des produits alimentaires de 32 % !
En Europe, au cœur du capitalisme, la crise économique commence à frapper durement. En Allemagne, les plans de licenciement se multiplient. La Deutsche Bank a annoncé en juillet la suppression de 18 000 emplois, le plus grand “plan de restructuration” de son histoire (soit 20 % des effectifs). Autre signe inquiétant pour l’emploi, “les commandes de machines-outils, le fer de lance de l’économie, ont ainsi reculé de 22 % sur un an entre avril et juin”. 2 Mais les suppressions d’emploi s’étendent déjà à pratiquement tous les secteurs : la grande distribution (par exemple, la fusion de Karstadt et Kaufhof va entraîner la suppression de 2 600 postes de travail ; cela va toucher entre 4 000 et 5 000 personnes car de nombreux salariés sont à temps partiel), 5 600 chez T-Systems, filiale informatique de Deutsche Telekom, les assurances (700 emplois en moins chez Allianz), dans les conglomérats industriels : Thyssenkrupp (6 000 dans le monde dont 4 000 en Allemagne), Siemens (2700 dans le monde, 1400 en Allemagne), Bayer (12000 d’ici 2021), etc. Dans le secteur automobile, alors que le travail à temps partiel dans le secteur avait disparu depuis cinq ans, il revient en force et touche aujourd’hui 150 000 personnes. 3
Au Royaume-Uni, dans le contexte chaotique du Brexit, la situation s’aggrave également. Ainsi, le géant bancaire britannique HSBC prévoit un plan de restructuration avec la perte de 4 000 postes, sachant qu’il avait déjà annoncé 30 000 départs en 2011 ! Aux États-Unis, la guerre commerciale et la hausse des droits de douanes impactent déjà les entreprises de produits manufacturés : “Ce qui nous intéresse aujourd’hui, ce sont les raisons avancées par les employeurs pour justifier les suppressions d’emplois. Dans le dernier rapport de juillet, les droits de douane étaient l’une des principales raisons. En effet, 1 053 réductions ont été annoncées en un mois en raison des tarifs, pour un total de 1 430 cette année et contre 798 en 2018”. 4
En Inde, une source qui émane de l’industrie a déclaré à l’agence Reuters que les premières estimations suggèrent que les constructeurs automobiles, les fabricants de pièces détachées et les concessionnaires ont licencié environ 350 000 travailleurs depuis avril !
On pourrait encore multiplier les exemples. Pourtant, malgré toutes les annonces de suppressions d’emploi, les chiffres du chômage restent étrangement relativement stables un peu partout. L’explication est simple : tout procède d’un maquillage statistique sophistiqué et de nouveaux modes d’évaluation. Outre les chômeurs de plus en plus nombreux qui ne sont plus comptabilisés, le phénomène a été totalement dilué ces dernières années par une explosion de la précarité et la dégradation de la qualité des emplois. Dans tous les pays, les indemnités du chômage sont réduites en même temps que des emplois à rémunérations et horaires faibles ont été autorisés pour généraliser les “petits boulots”. Ce sont ces “politiques actives” qui permettent artificiellement d’augmenter le taux d’emploi sur le dos des prolétaires et de leur famille.
Ainsi, au Royaume-Uni, l’hyperflexibilité du marché du travail et “l’ubérisation” des emplois ont ainsi boosté les contrats “zéro heure” qui n’offrent aucune garantie en termes de temps de travail. Les employeurs sont libres de puiser, comme bon leur semble, en fonction de leur activité qui se dégrade et des carnets de commande en baisse. En Allemagne, nous l’avons vu, les réformes Harz de 2003-2005, qui avaient permis le développement de “mini-jobs” à 450 euros par mois, sont aujourd’hui en expansion. Dans bien d’autres pays, comme la Suède, les CDD à temps partiel, mal rémunérés, se sont fortement développés. Aux Pays-Bas, des contrats “zéro heure” et les “mini-jobs” à l’allemande sont en forte progression aussi. Au Portugal, les recibos verde et en France le statut des auto-entrepreneurs vont dans le même sens, celui d’accroître la précarité. Partout, pour ceux qui ont encore un CDI, les licenciements sont largement facilités. Aujourd’hui, ces mesures prises dès les années 1990, surtout après la crise de 2008, portent leurs fruits et progressent de plus en plus vite du fait de la crise. Pour limiter la baisse du profit, le capital ne cesse d’accroître l’exploitation de la force de travail, ce qui conduit à une forte dégradation des conditions d’existence de la classe ouvrière : les inégalités s’accroissent et la pauvreté ne cesse ainsi d’augmenter. 5
Cette forte progression s’est accentuée durant l’été. Ceci est en partie visible à travers notamment des mouvements de grèves qui ont touché quelques secteurs comme au sein de l’entreprise Amazon en Europe et aux États-Unis au cours du mois de juillet ou dans différentes compagnies aériennes de plusieurs pays (en Espagne ou en Italie, par exemple). Cela, en opposition au fort “dumping contractuel et salarial”.
Les conditions de travail deviennent donc de moins en moins supportables : “On a tellement de gens privés d’emploi qu’on accepte des conditions de travail délétères dans une dimension sacrificielle”. 6 La peur de perdre son emploi génère diverses pathologies et la terreur au travail provoque des suicides ou des dégâts irréparables : “Nous avons des cadres ‘sup’ dont le cerveau est définitivement abîmé et qui ne pourront jamais retravailler. C’est une usure prématurée de l’organisme due à son utilisation intensive et beaucoup trop folle”. 7 Bien entendu, si de plus en plus de travailleurs laissent leur santé au travail, il est aussi de plus en plus difficile de se soigner quand c’est encore possible ! Et ce ne sont pas les attaques sur le secteur hospitalier, notamment en France avec la réforme “Ma santé 2022” qui permettront d’inverser la tendance. 8
Contrairement aux années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale où la force de travail exsangue devait être remise sur pied pour la reconstruction en développant une “protection sociale”, la main-d’œuvre pléthorique d’aujourd’hui nécessitant un moindre coût pour la “compétitivité” n’exige plus ce “luxe” de maintenir une couverture sociale et de santé digne de ce nom.
D’autre part, la durée d’exploitation de la force de travail ne cesse d’être rallongée. Partout, les régimes de retraites sont violemment attaqués. L’âge de départ à la retraite est en recul partout et les pensions ne cessent de s’éroder. En Allemagne, l’âge de la retraite qui est de 65,5 ans va passer à 69 ans en 2027, au Danemark, l’âge de 65,5 ans va passer à 67 ans cette année et à 68 ans en 2030. Dans les pays nordiques, comme en Suède ou en Norvège, un système dit “flexible” va “encourager” les départs tardifs et c’est ce qui se profile aussi en France. Au Royaume-Uni, la loi encourage même à travailler jusqu’à 70 ans. Dans la pratique, les faibles pensions poussent de plus en plus les anciens à travailler. Aux États-Unis, des vieillards de plus de 80 ans se retrouvent ainsi encore en activité. Bien entendu, face à la nouvelle crise ouverte qui s’annonce, une chose est sûre, les prolétaires du monde entier vont voir leur situation se dégrader fortement et l’avenir ne pourra donc que s’assombrir.
L’entrée en récession
Tout ceci s’est d’autant plus accentué que la situation globale de l’économie mondiale s’est encore dégradée : “Au plan économique, la situation du capitalisme est, depuis début 2018, marquée par un net ralentissement de la croissance mondiale (passée de 4 % en 2017 à 3,3 % en 2019), que la bourgeoisie prévoit comme durable et devant s’aggraver en 2019-20. Ce ralentissement s’est avéré plus rapide que prévu en 2018, le FMI ayant dû revoir à la baisse ses prévisions sur les deux prochaines années, et touche pratiquement simultanément les différentes parties du capitalisme : Chine, États-Unis, zone euro. En 2019, 70 % de l’économie mondiale ralentissent et particulièrement les pays “avancés”, (Allemagne, Royaume-Uni). Certains des pays émergents sont déjà en récession (Brésil, Argentine, Turquie) tandis que la Chine, en ralentissement depuis 2017 et avec une croissance évaluée à 6,2 % pour 2019 encaisse ses plus bas chiffres de croissance des trente dernières années”. 9
La période estivale confirme nettement et accentue cette tendance à l’enfoncement dans la crise. D’une part, les tensions commerciales se sont encore fortement accrues cet été entre la Chine et les États-Unis et d’autre part, les principaux indicateurs économiques restent bien au rouge. Au cœur de l’Europe, l’Allemagne est encore touchée de plein fouet par les effets d’un début de récession, ce qui confirme qu’elle est ainsi devenue le nouveau grand malade de l’Europe et bon nombre de spécialistes soulignent plus globalement la possibilité d’une grande secousse financière à venir, probablement encore plus grave que celle de 2008 du fait du niveau d’endettement record accumulé depuis et de la fragilisation des États sur ce plan. Comme nous le soulignons aussi dans notre résolution concernant la classe ouvrière : “ces nouvelles convulsions ne peuvent que se traduire par des attaques encore plus importantes contre ses conditions de vie et de travail sur tous les plans et dans le monde entier”. Même si tous les États qui portent des attaques ne le font pas à la même intensité ni au même rythme, tous doivent s’adapter dans un même sens aux conditions de la concurrence et à la réalité d’un marché toujours plus saturé du fait de la surproduction. Les États doivent également procéder à des coupes sèches dans leur budget afin de faire à tout prix des économies. 10 En fin de compte, c’est encore et toujours sur le dos des prolétaires que la classe dominante tente désespérément de freiner les effets du déclin historique de son propre mode de production et c’est toujours eux qui doivent payer la note !
Quelles perspectives pour la classe ouvrière ?
Face aux attaques programmées et à venir, le prolétariat est fortement exposé aux coups. Cependant, tôt ou tard, il n’aura pas d’autre choix que de réagir et de mener la lutte de manière massive et déterminée. Mais pour cela, il devra d’une part développer les conditions pour une réflexion en profondeur afin de mieux comprendre la façon dont la bourgeoisie se prépare pour faire face à la lutte de classe et, d’autre part, tenter de cerner la façon de mener efficacement le combat de classe sur et en dehors des lieux de travail. Une telle exigence devra nécessairement revenir sur les leçons des mouvements prolétariens qui se sont déroulés par le passé, notamment durant les années 1980. Cela, pour prendre en compte les pièges et les mystifications orchestrées par l’ennemi de classe afin de mieux pouvoir les identifier à l’avenir et ne pas se laisser surprendre. Outre la nécessité de prendre conscience de sa force, de briser l’isolement en contrant la propagande démocratique de l’État et les agissements du syndicalisme, notamment sous ses formes les plus “radicales” et pernicieuses, le prolétariat devra rester toujours vigilant face aux dangers qui menacent l’autonomie de son combat. Il devra tout particulièrement lutter contre l’influence d’idéologies étrangères propres aux couches intermédiaires, notamment petites-bourgeoises qui sont facteur de dilution, risquant de noyer les prolétaires dans la masse indifférenciée d’une notion abstraite : celle de “peuple”. Le mouvement interclassiste des “gilets jaunes” en France, mêlant des prolétaires égarés aux couches petites-bourgeoises, est à cet égard un des exemples les plus significatifs des dangers croissants qui guettent le prolétariat. Loin d’être un modèle de lutte, ce mouvement monté en épingle en a été l’antithèse par son enfermement sur les valeurs démocratiques du capital et ses préjugés nationalistes, voire xénophobes. 11 A contrario, seules les méthodes de lutte du prolétariat, de la grève aux assemblées de masse, sont les conditions pour un combat réellement autonome et conscient, sur un véritable terrain de classe, qui pourront permettre l’affirmation d’une perspective révolutionnaire en vue de mettre fin aux rapports d’exploitation.
WH, 17 août 2019
1) Le peso argentin était à parité avec le dollar au début du siècle ; il ne vaut plus qu’environ 0,02 dollars aujourd’hui. La hausse des prix a été de 50 % sur les douze derniers mois. Le prêt de 57 milliards du FMI en 2018 n’a été consenti qu’en échange d’un plan de rigueur drastique et de sévères coupes budgétaires qui ont déjà provoqué cinq grèves générales depuis le début de l’année. Selon des statistiques reconnues, un tiers des Argentins vivraient déjà en dessous du seuil de pauvreté. (Source : “Argentine : la descente aux enfers de la troisième économie d’Amérique latine”, BFM Business du 13 août 2019).
2) “Allemagne : la croissance marque un coup d’arrêt”, L’Express (17 août 2019).
3) Sans compter le nouveau plan de Volkswagen qui prévoit de supprimer entre 5 000 et 7 000 emplois supplémentaires d’ici 2023 (plus de 30 000 depuis 2017) ou celui de Ford-Allemagne (5 000). En plus d’une réduction d’effectifs de 570 personnes, les contrats d’intérimaires ou à durée déterminée seront supprimés chez Mercedes-Benz.
4) “États-Unis : la guerre commerciale frappe l’emploi de plein fouet !”, Capital (14 août 2019).
5) Depuis 1982, les CDD ont doublé et l’intérim a été multiplié par cinq !
6) “Épuisement professionnel : un tiers des salariés sont en très grande souffrance au travail”, Europe 1 (1er mai 2019).
7) Idem.
8) Déjà en 2012, un tiers de la population a dû renoncer à des soins pour des raisons financières, soit 33 % de plus qu’en 2009 (selon le “baromètre santé et société” d’Europe Assistance-CSA).
9) “Résolution sur la situation internationale du 23e congrès du CCI” disponible sur notre site internet.
10) C’est particulièrement le cas de l’État français comme nous le montrons dans notre article sur les attaques en France : “La bourgeoisie profite des faiblesses du prolétariat pour l’attaquer plus fortement” disponible sur le site internet du CCI.
11) Voir “Bilan du mouvement des “gilets jaunes” : un mouvement interclassiste, une entrave à la lutte de classe”, supplément à Révolution internationale n° 478.
Rubrique:
Incendies en Amazonie: Le capitalisme brûle la planète
- 77 reads
Cet été, les images de l’Amazonie en flammes ont fait le tour du monde. Cette forêt luxuriante, trésor unique de biodiversité et véritable “poumon vert de la planète”, a été consumée par plus de 40 000 incendies. L’ampleur de la catastrophe est telle que le cours du fleuve Amazone en est lui-même perturbé. Les scientifiques craignent que la baisse de son débit n’engendre des déséquilibres océaniques. 1
Face à ce désastre, les dirigeants de tous les pays ont réagi en multipliant les déclarations pour… mieux s’écharper par la suite dans une véritable foire d’empoigne. Le dernier G7, théâtre d’un affrontement entre l’État brésilien et l’État français, en est un exemple tragi-comique. La planète peut bien brûler, chaque nation capitaliste n’y voit qu’une occasion de porter des coups à ses concurrents dans l’arène économique mondiale, véritable métaphore d’un système en putréfaction.
La destruction par les flammes de l’Amazonie n’est pas un accident naturel ponctuel, ni le fruit d’une politique locale anormalement irresponsable. Elle est le symbole de ce que réserve le capitalisme à toute la planète, à toutes les espèces et à l’humanité.
Le nombre d’incendies augmente partout sur la planète
Au cours de la seule année 2018, 12 millions d’hectares de canopées ont disparu de la surface de la terre, dont 3,6 millions de forêts tropicales humides. Le système traditionnel de “brûlage” de la forêt pour les cultures vivrières et l’auto-consommation des communautés rurales a cédé la place aux ravages de la déforestation massive et aux incendies à l’échelle industrielle.
Dans toute l’Amérique du Sud, les arbres sont brûlés pour faciliter la pénétration de l’exploitation minière et forestière, pour créer de nouveaux pâturages destinés à nourrir un bétail à faible coût, et pour produire massivement du soja et de l’huile de palme. Cette politique de destruction massive est menée dans tous les pays, quel que soit le parti au pouvoir.
Au Brésil, avant le populiste Bolsonaro, la même politique de déforestation sauvage était pratiquée sous les gouvernements successifs de Lula, Dilma Roussef et Temer. Au Paraguay, au Pérou ou en Bolivie, c’est le même désastre. Le “révolutionnaire” Evo Morales, figure emblématique de toutes les gauches radicales dans le monde, a baissé les contrôles environnementaux et accordé aux entreprises l’autorisation de détruire davantage la forêt. Depuis le début de l’année, 400 000 hectares d’arbres ont ainsi disparu en Bolivie dans la région de la Chiquitanía (20 000 incendies).
Au Venezuela, sous le règne du “socialiste du XXIe siècle” Nicolás Maduro, “l’Arc minier” engendre lui aussi des destructions d’ampleurs : cette vaste région subit une exploitation incontrôlée afin de favoriser l’extraction de l’or et d’autres métaux, ce qui permet aux dirigeants civils et militaires du chavisme de conserver un certain revenu au pouvoir. Depuis l’époque de Chavez, “l’Arc minier” est en effet placé sous le contrôle d’une camarilla militaire.
En Colombie, la guérilla “marxiste” de l’Armée de libération nationale (ELN) est également active dans l’exploitation des ressources minières. Avec la bénédiction du duo Chavez-Maduro, ces mafias, qui occupent des positions élevées dans leur gouvernement, exploitent (sur un territoire beaucoup plus vaste qu’au Brésil, en Équateur et au Pérou) les mines d’or, de diamants et de coltan. 2 Ces activités détruisent les végétaux, la faune et engendrent une pollution élevée des rivières.
Au Mexique, le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a également lancé de grands travaux qui vont encore un peu plus grignoter les surfaces boisées : le “train Maya” et la raffinerie Dos Bocas. “Le président a affirmé que pas un seul arbre ne serait abattu pour construire le “train maya”, ce qui semble improbable puisque la péninsule du Yucatán est presque entièrement recouverte d’une végétation tropicale très dense, sans parler des forêts du Chiapas. Les scientifiques évoquent une menace pour la biodiversité, et notamment pour l’immense population de jaguars du Yucatán”. 3
Le même constat peut être établi en Afrique et en Asie. En Angola, gouverné par le MPLA, 130 00 incendies ont déjà eu lieu cette année. En 2015, en Indonésie, les forêts tropicales de Bornéo et Sumatra ont été frappées par de gigantesques feux, principalement à cause de la généralisation des plantations de palmiers (pour obtenir l’huile destinée à la fabrication de biocarburant).
Même en Alaska et dans la zone arctique, les terres grillent. En Sibérie, en un an, 1,3 million d’hectares ont brûlé et des villes comme Novossibirsk ou Krasnoiarsk ont subi des nuages de fumée toxiques qui ont amené des milliers de personnes aux urgences.
En Europe, l’État français, par la bouche de son président, s’est fait donneur de leçon au monde. Lors du récent sommet du G7 à Biarritz, Macron a ainsi brandi la menace de mettre un terme aux accords UE-Mercosur 4 et a dénoncé à grands renforts de trompettes l’incurie du président brésilien, incapable d’éteindre le feu. Mais ces grandes envolées lyriques sont d’une hypocrisie et d’un cynisme sans nom. Rappelons que la France est un des acteurs majeurs de la pollution environnementale (notamment par l’usage massif de pesticides) et détruit également les écosystèmes par son agriculture intensive. Il s’agit également d’un pays amazonien, propriétaire de la seule forêt tropicale européenne : la Guyane française, qui est la deuxième plus vaste région de France. Si pour l’instant son projet criminel de faciliter l’implantation d’opérations minières des multinationales dans ce qu’on appelle la “Montagne d’Or” semble abandonné par le gouvernement du fait de “l’incompatibilité du projet actuel avec les exigences de protection de l’environnement”, le fait d’en programmer désormais “une évaluation complète” ne signifie pas son abandon total et définitif. D’ailleurs, “les récentes annonces n’ont aucune valeur légale tant qu’une demande faite par la société minière n’aura pas été déboutée par les services de l’État”. 5
Toujours est-il qu’un tel projet a bien été envisagé sachant qu’il entraînerait des quantités énormes de déchets toxiques (arsenic, cyanure, etc.). Si aujourd’hui Macron et son gouvernement affirment vouloir laisser tomber le projet afin de se montrer responsables et soucieux de la défense de l’environnement, rappelons qu’en août 2015, le ministre de l’économie Macron était prêt à “tout faire pour qu’un projet de cette envergure puisse voir le jour”.
Le capitalisme entraîne l’humanité vers l’abîme
Ces feux de forêts, qui n’ont donc rien de “naturels”, sont une véritable catastrophe pour la vie. Au-delà des destructions qu’ils causent directement, ils aggravent aussi le réchauffement climatique. Aujourd’hui, la fumée des incendies est responsable d’environ 25 % des émissions mondiales de gaz à “effet de serre”. 6 L’industrie agroalimentaire est aujourd’hui plus polluante que les compagnies pétrolières ! C’est un cercle vicieux : le réchauffement favorise les incendies, ce qui facilite la déforestation, qui à son tour permet la propagation des incendies, qui libèrent plus de carbone, ce qui accroît le réchauffement climatique, dans une spirale infernale.
La pollution de l’air (comme celle qu’on a évoquée en Sibérie ou celle qui a obscurci le ciel de São Paulo, 15 heures après les incendies) est une des principales causes des décès prématurés. Une étude récente de l’ONU estime que 8,8 millions de personnes meurent chaque année de cette pollution. Ce taux est comparativement plus élevé dans les pays les plus “développés”.
Le capitalisme tue. Il détruit la planète et assassine les êtres humains. Voilà la vérité toute crue ! La bourgeoisie veut faire croire à la classe ouvrière qu’un capitalisme plus vert et plus juste est possible, un capitalisme où l’Amazonie ne serait plus considérée comme une entreprise mais comme une “réserve environnementale”, où partout la nature et ses forêts seraient plus raisonnablement cultivées. Mensonges ! Le capitalisme est basé sur l’exploitation par une minorité d’une immense majorité, sur la division de l’humanité en classes, la transformation des ressources naturelles et des êtres humains en marchandises. Le capitalisme est un système dont le moteur est la recherche de profit et l’accumulation. Rien d’autre ! Sa seule autre motivation a pour objet de masquer son exploitation sauvage en la recouvrant d’un voile hypocrite, celui de l’idéologie démocratique. Le capitalisme divise l’humanité en nations prêtes à se livrer une compétition à mort (jusqu’à la guerre).
La planète entière doit cesser d’être prisonnière de la dictature de ce système ; la nature doit être libérée de sa condition de marchandise. Mais cela n’est possible qu’en établissant un nouvel ordre sur toute la planète : le communisme, issu de la révolution internationale de la classe ouvrière.
Valerio, 30 août 2019
1) Le fleuve Amazone représente 18 % des eaux douces déversées dans les océans.
2) Minerai très convoité formé par deux minéraux (colombite et tantalite), exploité pour sa grande résistance à la corrosion et notamment utilisé pour la fabrication de composants électroniques (téléphonie mobile) mais également dans l’aéronautique et particulièrement la fabrication des réacteurs.
3) “Au Mexique, le projet présidentiel de train maya sur la voie de la polémique”, France Info (7 mars 2019).
4) Le Marché commun du Sud a d’abord été formé par l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, puis par le Venezuela (maintenant suspendu) et la Bolivie (cette dernière étant en voie d’adhésion).
5) “Montagne d’or : les paroles du gouvernement n’enterrent pas le projet”, Reporterre (19 juin 2019).
6) “Déforestation : anatomie d’un désastre annoncé”, Le Figaro (21 août 2017).
Géographique:
- Amérique Centrale et du Sud [14]
- Brésil [67]
Récent et en cours:
- environnement [68]
Rubrique:
Brexit: Une impasse pour toutes les factions de la classe dominante
- 125 reads
La formation d’un nouveau gouvernement à Londres sous la direction de Boris Johnson ne résout pas la crise politique et la lutte de pouvoir au sein de la classe dominante britannique, qui est devenue un facteur prépondérant dans la vie politique du pays depuis le référendum sur le Brexit en juin 2016. Au contraire : avec la désignation de Johnson par les conservateurs comme leur nouveau leader et Premier ministre, cette crise a atteint une nouvelle étape et la lutte de pouvoir, un nouveau degré d’intensité. La nouvelle phase de cette lutte de pouvoir n’est ni une lutte entre Johnson et ses soi-disant opposants modérés du parti conservateur, ni entre Johnson et l’opposition travailliste, ou avec le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, fervente partisane du maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne. Comme le journal du dimanche britannique The Observer et le quotidien suisse Neue Zürcher Zeitung l’ont affirmé, l’opposant que Johnson et les conservateurs essayent principalement de neutraliser est “Mister Brexit” lui-même : Nigel Farage. Le calcul (ou le pari) de Johnson est d’ “assurer la livraison du Brexit” d’ici au 31 octobre, avec ou sans deal (“le faire ou mourir”) et si possible sans avoir, au préalable, recours à des élection s générales. Faute de quoi, afin de pouvoir “livrer” son Brexit, il risquerait d’avoir à former un gouvernement de coalition avec le nouveau Parti du Brexit de Farage. Ce dernier, outsider insouciant de la politique britannique, aurait ainsi un droit de regard direct sur la politique gouvernementale (ce que les soi-disant élites établies veulent éviter). D’autre part, si le Parlement actuel l’empêchait de livrer son Brexit à temps, comme promis, cela donnerait probablement un élan supplémentaire et considérable à la carrière politique comme aux ambitions de Farage. Le problème que cela pose à Johnson (au moment où ces lignes ont été rédigées) est qu’il n’est pas certain que le Parlement actuel accepte le deal (ou le no deal) qu’il est susceptible de présenter. Le Premier ministre pourrait également détourner l’attention du Parlement en le suspendant temporairement, par exemple. Cependant, certains de ses opposants ont d’ores et déjà déclaré que telle procédure serait considérée comme un coup d’État (en français dans le texte), un véritable putsch. En un mot : le désordre devient un bourbier. Cette situation est une expression claire de la fragmentation qu’engendre le capitalisme dans sa phase de déclin et du chacun pour soi à tous les niveaux : économique, militaire, social et politique. Les acteurs de ce processus, bien que n’étant pas passifs, sont largement conditionnés par celui-ci.
La situation politique (qui, pour l’instant, est pire que l’économique) va de mal en pis. La paralysie progressive de ces trois dernières années menace d’échapper à tout contrôle. Il est important de souligner que, dans ce contexte, si le nouveau Premier ministre mise tout sur un Brexit rapide et à n’importe quel prix, ce n’est pas parce qu’il pense que cette orientation va forcément dans l’intérêt du capitalisme britannique. En réalité, il est de notoriété publique que Johnson était loin d’être convaincu des bienfaits du Brexit au moment du référendum dont le résultat l’avait à la fois surpris et rempli d’une certaine consternation. La principale raison de son soutien au camp pro-Brexit semble avoir été son désir de construire sa propre base d’influence au sein du Parti conservateur afin de pouvoir défier son leader et Premier ministre d’alors : David Cameron. Coincé par la victoire du camp du Leave au référendum, il a rapidement réalisé que la mise en pratique de ce verdict serait une tâche ingrate. Il a donc momentanément renoncé (ou plutôt : reporté) à briguer la tête du parti, préférant laisser le sale boulot à quelqu’un comme Theresa May. La principale préoccupation de Johnson semble donc n’avoir jamais été le Brexit mais sa propre carrière politique. Trois années plus tard, il a réussi à se placer à la tête du parti et de l’État, ce qui nous éclaire sur les changements qui, depuis 2016, ont bouleversé l’équilibre des forces au sein de la classe dominante. Au moment du référendum, les deux camps qui s’opposaient alors étaient clairement dessinés, chacun derrière leur leader respectif : Cameron et Farage.
Farage était un arriviste, évoluant hors du parti et de l’appareil politique établi. Cameron, par contre, en plus d’être Premier ministre, avait beaucoup d’appuis au sein des instances dirigeantes. Ses soutiens provenaient de son propre parti, du Parti travailliste (le principal parti d’opposition), mais aussi des libéraux-démocrates et des nationalistes écossais, tous deux fervents partisans du maintien du Royaume-Uni au sein de l’UE (Remain). Le résultat semblait donc, à première vue, acquis d’avance. Pourtant, plus la campagne de l’UKIP (Parti pour l’Indépendance du Royaume-Uni, extrême-droite) de Farage prenait de l’ampleur, plus les conservateurs (Johnson inclus) se mettaient à rejoindre les partisans du Brexit. Pour la plupart, ce n’était sans doute pas parce qu’ils avaient été convaincus par les arguments d’UKIP. Non pas qu’ils n’aient pas partagé le ressentiment de ce dernier à l’égard de l’Europe pour avoir poussé la Grande-Bretagne à tourner le dos à son ancien Empire mais leur principale motivation semble avoir été tactique : celle de couper l’herbe sous le pied de Farage et le détourner vers une voie de garage.
Mais les conservateurs ont fait une erreur de calcul et les partisans du Remain ont perdu. Ce qui, à son tour, a modifié l’équilibre des forces au sein de la politique bourgeoise britannique. Il suffit de rappeler que Theresa May (alias : “le Brexit signifie le Brexit”) 1 qui a succédé à Cameron, était à l’origine partisane du Remain, comme beaucoup de membres du Parti conservateur qui aujourd’hui se disent partisans d’un Brexit pur et dur. D’ailleurs, au sein du Parti conservateur, les partisans du Remain (les “hauts placés” comme Heseltine ou les députés actuels comme Dominic Grieve) passent un mauvais quart d’heure. Pour le moment, les partisans du Brexit ont plus ou moins pris les rênes du parti, mais surtout, ils ont fait main basse sur le gouvernement. En effet, l’un des architectes de la campagne du Brexit, Dominic Cummings, est désormais le conseiller principal du gouvernement.
Un environnement politique bouleversé par le résultat du référendum
Avant le référendum, il fallait choisir entre quitter ou bien rester au sein de l’Union européenne. Tant que c’était le cas, une majorité de la classe dominante était clairement en faveur de cette dernière option. Cependant, après le référendum, ce choix n’était désormais plus possible. Théoriquement, bien entendu, il serait toujours envisageable d’organiser un second référendum dans le but d’obtenir une majorité de voix en faveur du Remain. C’est une manœuvre bien délicate, cependant. En effet, il n’est absolument pas certain que l’issue serait cette fois différente et une telle tentative serait même périlleuse : elle risquerait d’aggraver les dissensions déjà existantes autour du Brexit ainsi que celles présentes au sein de la classe dominante. C’est pourquoi, parmi la classe exploiteuse, cette option n’est actuellement pas très populaire. Aujourd’hui, la dynamique est à un Brexit sans accord, même si, comme l’ont montré les élections européennes, il existe une polarisation entre le no-deal et le maintien du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne. Theresa May, lorsqu’elle était Premier ministre, a passé le plus clair de son temps à essayer de persuader la “classe politique” que son Brexit négocié devait être considéré comme un moindre mal. Sans succès. Du point de vue de la classe dominante, l’accord proposé par May est sans conteste beaucoup moins avantageux que le fait de rester dans l’UE. Un moindre mal ? Pour la plupart des responsables politiques et “faiseurs d’opinion” du pays, cette option n’en est absolument pas une. Pour eux, le Royaume-Uni devait encore suivre la politique de l’UE sur de nombreuses questions même sans avoir son mot à dire.
Ce dilemme a engendré une désorientation grandissante au sein de l’appareil d’État. Un des produits de cette désorientation est l’émergence de ce que l’on pourrait appeler les “hésitants”. Leur état d’esprit est mis en lumière par le discours et le comportement électoral de nombreux parlementaires : certains défendent une chose puis son contraire le lendemain, d’autres ne savent tout simplement pas quelle position adopter et semblent vouloir laisser leur indécision en l’état le plus longtemps possible. Impossible de deviner quel camp sera, au final, le leur.
Autre conséquence de cette désorientation : la cristallisation, au sein du Parti conservateur, d’une faction grandissante de partisans d’un véritable Brexit dur. “Véritable” car ils défendent le Brexit sans accord, non par opportunisme ou par considération tactique, mais parce qu’ils sont réellement d’accord avec Nigel Farage. Ce noyau dur se regroupe autour de personnes telles que Jacob Rees-Mogg, qui soutient qu’un no-deal est la meilleure chose qui puisse arriver. Ce groupe a indubitablement joué un rôle prépondérant dans la chute de May (après avoir maintes fois saboté ses tentatives pour que son deal soit accepté) et son remplacement par Johnson. Bien qu’il soit probablement encore minoritaire au sein du parti, il a l’avantage, par rapport aux autres conservateurs, de savoir exactement ce qu’il veut. De fait, leurs opposants au sein du parti sont fortement acculés à la défensive, leur rayon d’action étant limité par la crainte que leur vénérable Parti conservateur ne soit en danger existentiel. En effet, ils craignent que les partisans de la ligne dure, s’ils n’arrivent pas à leur fin, se rebellent et qu’ils rejoignent Farage d’une manière ou d’une autre. Scénarios possibles : une scission au sein du parti, ou son “détournement”, dans l’esprit de ce qu’a pu faire Trump avec le Parti républicain aux États-Unis.
Populisme et manipulation de la grogne sociale
Au moins, une chose ressort clairement : la soi-disant élite établie a sous-estimé le facteur du populisme politique en général et le rôle de Farage en particulier. Nous pouvons facilement convenir que le terme “populisme” n’est pas très précis et requiert d’être approfondi. Cela étant, le terme “populisme” lui-même contient déjà une part de vérité, comme l’illustre clairement la situation actuelle de la Grande-Bretagne. L’une des principales raisons du succès de Farage a été sa capacité à tirer parti du mécontentement populaire, à exacerber un ressentiment diffus et à manipuler les préjugés les plus répandus dans le but de contrer la propagande des factions dominantes de sa propre classe. La Grande-Bretagne était loin d’être le seul pays européen où la classe dirigeante, chaque fois qu’elle le pouvait, imputait à “Bruxelles” les effets de ses attaques contre sa “propre” population ouvrière. Cependant, en Grande-Bretagne, ce stratagème était systématiquement utilisé (sur une très longue période), avec une intensité et un degré d’hystérie qui ne se voyait quasi nulle part ailleurs.
De plus, cette politique a atteint un nouveau cap au début du siècle, lorsque certains pays de l’Europe de l’Est ont rejoint l’Union européenne. Une des conditions de leur intégration était que les États membres d’alors soient autorisés à limiter l’afflux de main-d’œuvre en provenance de l’Est pendant une phase de transition pouvant aller jusqu’à huit ans. Il s’agissait de faire en sorte que la pression à la baisse des salaires en Europe occidentale, que la concurrence de l’Est sur le marché du travail allait inévitablement exercer, puisse être introduite progressivement, afin d’éviter une aggravation trop brutale des tensions sociales. Trois pays seulement ont renoncé à ce mécanisme transitionnel : la Suède, l’Irlande et le Royaume-Uni. La principale raison, dans le cas de ce dernier, était évidente. Des pans entiers de l’industrie anglaise souffraient de la concurrence des entreprises allemandes qui bénéficiaient, entre autres, de salaires extrêmement bas grâce à la politique d’austérité de l’ “Agenda 2010”, mis en place par le gouvernement social-démocrate/vert de Gerhard Schröder. Face à cela, un afflux énorme de main-d’œuvre bon marché d’Europe de l’Est était exactement ce dont le capitalisme britannique avait besoin pour contrer cette offensive allemande. Au niveau de la politique du marché du travail, la mesure était un succès total. De nombreux ouvriers en Grande-Bretagne perdirent alors leur travail, remplacés par des “citoyens importés de l’Union européenne” qui se trouvaient dans une situation de détresse économique plus ou moins importante, obligés de travailler plus pour gagner moins. Ces derniers étaient non seulement “très motivés” (comme aime à le dire l’euphémisme capitaliste) mais nombre d’entre eux étaient également très qualifiés.
Cette politique n’a pas fait qu’aider à baisser les salaires réels. Cela a, au niveau social, entraîné une succession de mesures draconiennes, mieux décrite sous le terme : anarchie capitaliste. Presque rien n’avait été prévu pour faire face à l’afflux de centaines de milliers de nouveaux habitants. L’état déjà critique du logement, de la couverture médicale et des services publics tels que les transports et la santé, était désormais au bord de l’effondrement. Et ce, non seulement dans les environs de Londres, mais aussi dans des régions qui, jusqu’alors, étaient moins impactées par le flux migratoire des travailleurs européens. Afin d’illustrer l’ambiance qui régnait à cette époque, citons l’exemple du National Health Service de Londres, qui, au vu de la sur-affluence d’infirmières étrangères déjà compétentes, envisageait de ne plus en former.
Mais ce n’est pas tout. De manière plus ou moins unitaire, le gouvernement britannique et les médias démocratiques et pluralistes ont présenté cet afflux comme une chose que l’Union européenne avait imposé à la Grande-Bretagne et sur lequel Londres n’avait pas eu son mot à dire : un bel exemple de “fake news” ! Ainsi, lorsque Cameron commit l’erreur capitale d’organiser son référendum sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne au sein de l’UE, Farage savait exactement ce qu’il faisait en plaçant “le contrôle de nos frontières” au centre de sa stratégie. En procédant ainsi, il fit d’une pierre deux coups : en dirigeant la frustration populaire contre ses propres rivaux bourgeois et, en même temps, en dressant les ouvriers les uns contre les autres, sapant ainsi la solidarité de la classe ouvrière. La seule différence, par rapport à ses homologues populistes en Europe tels que Salvini en Italie ou l’AfD (Alternative für Deutschland) en Allemagne, est qu’il s’est davantage mobilisé contre les migrants de l’Union européenne que contre les réfugiés.
Une coopération transatlantique contre l’Union européenne
Néanmoins, un second point a permis à Farage de prendre ses opposants politiques par surprise : le soutien de puissantes factions bourgeoises hors du Royaume-Uni. Beaucoup de choses ont été dites au sujet du rôle de la Russie dans la campagne sur le Brexit. Il est évident que Moscou avait un intérêt à ce que le camp de l’UKIP sorte gagnant du référendum et il a probablement fait tout ce qui était en son pouvoir pour influer sur le résultat. Cependant, il n’est un secret pour personne que la classe dominante britannique aime blâmer la Russie pour tout et n’importe quoi et a, en réalité, un intérêt direct à exagérer son rôle. Non, l’aide étrangère à laquelle nous faisons ici référence vient d’Outre-Atlantique. Ce n’est pas pour rien que les médias américains comparaient le référendum du Brexit à une sorte de répétition générale de la victoire de Trump aux élections présidentielles américaines de 2016. Ces deux événements furent, en grande partie, pris en main par les mêmes structures, telles que les algorithmes électoraux (aujourd’hui disparus) de la firme Cambridge Analytica appartenant au mathématicien et milliardaire américain Robert Mercer, ou l’empire médiatique de l’Australien Rupert Murdoch, fervent partisan de Trump.
Il y a, entre les factions bourgeoises dominantes américaines et britanniques, une longue tradition d’étroite collaboration et ce même sur les questions économiques. Tristement célèbre est le rôle majeur joué par les efforts combinés de Margaret Thatcher (Royaume-Uni) et Ronald Reagan (États-Unis) dans la mise en place d’un ordre économique mondial “néo-libéral”. Plus récemment, précisément face au référendum sur le Brexit, Barack Obama tentait de venir à la rescousse de David Cameron en mettant son poids politique et ses talents d’orateur de son côté. Mais à cette occasion (peut-être pour la première fois à une telle échelle), le soutien “officiel” de l’administration Obama au gouvernement britannique fut contrecarré par un autre soutien transatlantique, “non officiel” celui-ci : celui des futurs “trumpistes” aux partisans du Brexit. Cette dernière collaboration fut motivée par la conviction commune que, dans la phase historique actuelle, “le multilatéralisme”, qu’il se présente sous la forme de l’Union européenne ou, par exemple, sous celle de la Nouvelle route de la soie chinoise, est de plus en plus susceptible d’être utilisé comme bélier contre les intérêts de la plus grande puissance mondiale, les États-Unis, mais également contre ceux de l’ancien leader mondial, le Royaume-Uni. Par dessus-tout, ils soupçonnent des entités comme l’Union européenne d’être sujettes à la manipulation par des rivaux potentiels tels que la Chine et l’Allemagne. Ces deux dernières puissances, en particulier, sont considérées à Londres et à Washington comme profitant du marché unique de l’UE pour étendre leur influence au travers de toute l’Europe continentale. De ce point de vue, partagé par Trump et d’autres, dans un monde plus fragmenté et privé d’une grande partie de sa structure “multilatérale”, les États-Unis s’en sortiraient mieux, étant plus à même de s’imposer aux autres. Mais, d’après les partisans du Brexit, le Royaume-Uni pourrait également tirer avantage d’un (dés-)ordre unilatéral ou bilatéral grâce à son expérience historique, à ses connexions de longue date dans le monde entier et à son statut de puissance financière mondiale.
Dans ce contexte, l’objectif, à long terme, de la droite dure des partisans du Brexit ne saurait se limiter à la seule éviction du Royaume-Uni de l’Union européenne. Comme cela a été maintes et maintes fois dénoncé (déjà par Cameron lors de la campagne sur le référendum), dans un monde dans lequel la Grande-Bretagne coexiste avec l’UE, mais se trouve en dehors de celle-ci, Londres risque de se trouver considérablement désavantagé par rapport à l’UE. Pour cette raison, la droite dure des partisans du Brexit ne peut se satisfaire du retrait du Royaume-Uni de l’UE. Leur but ultime est de contribuer à l’effondrement de l’Union européenne, du moins sous sa forme actuelle. Le Brexit représente donc, à leurs yeux, un premier pas dans cette direction.
Il va de soi que cette stratégie est un pari des plus risqués. Pas étonnant que ce ne soit pas du tout ce que la classe politique traditionnelle voulait. C’est la situation historique mondiale objective (l’effondrement de l’ordre capitaliste existant) qui confère à ce projet improbable une certaine crédibilité.
La réponse de l’UE
Il n’est assurément pas passé inaperçu à Londres que, ces dernières années, l’Allemagne a pris d’importantes mesures dans le but d’affirmer ses ambitions de leader au sein de l’Union européenne. À cette fin, elle a notamment utilisé des moyens économiques. Elle a ainsi largement réussi à transformer l’Europe de l’Est en une sorte de chaîne de montage élargie de l’Europe de l’Ouest, mais surtout de l’industrie allemande. Elle a également profité de son rôle clé de garant de l’Euro (monnaie commune à la majorité des États membres de l’UE) pour imposer, au moins partiellement, ses politiques économiques en Europe du Sud. Ces mesures ont aidé, pendant quelque temps, à contrer les tendances centrifuges au sein de l’Union européenne.
Cependant, ces dernières années, de nombreux événements sont venus menacer cette cohésion. Comme nous l’avons abordé dans cet article, le Brexit ainsi que la politique de Trump représentent, dans une certaine mesure, une attaque contre l’UE. Au sein de l’Union européenne également, en Europe continentale, la cohésion déjà précaire s’est vue de plus en plus fragilisée : par la montée du populisme, par exemple, qui tend en général à être plus ou moins hostile envers Bruxelles, ou encore par le mécontentement croissant des autres États membres à l’égard de la politique économique allemande (dont les deux autres poids lourds que sont la France et, en particulier, l’Italie).
L’interaction entre ces différentes tendances et contre-tendances est compliquée et réserve toujours des surprises. En effet, les 27 pays membres restants de l’Union européenne se sont étonnés d’avoir jusqu’à présent réussi à serrer les rangs lors des négociations autour du Brexit, résistant, jusqu’ici, à toute tentative de Londres de les monter les uns contre les autres. De fait, les turbulences mondiales, comme le Brexit et en particulier l’explosion de guerres commerciales centrées, mais pas seulement, sur les deux géants américain et chinois, ont rappelé aux 27 les avantages de faire partie d’une même zone commerciale qui a un réel poids sur la scène économique mondiale. Cela vaut d’autant plus pour les petits pays membres de l’UE qui, en outre, sont privés des avantages économiques et politiques sur lesquels la bourgeoisie britannique peut au moins placer ses espoirs. De plus, un certain nombre de gouvernements populistes se sont rendu compte à quel point il pouvait être difficile de quitter l’UE, comme c’est le cas actuellement pour le Royaume-Uni, d’où la position intransigeante de l’UE sur la question.
Un autre facteur de la résilience actuelle de l’UE est la préoccupation de beaucoup de ses États membres face aux succès que la Russie rencontre ces dernières années. L’Allemagne, qui ne dispose pas d’un poids militaire suffisant pour s’imposer sur le continent européen, est donc obligée de développer des partenariats et de rechercher des intérêts communs pour accroître sa domination, face à cela, elle a mis au point une politique étrangère extrêmement hostile envers la Russie (avec qui elle pourrait également avoir des intérêts communs). Ce faisant, elle tente de relancer le fameux “moteur” franco-allemand et d’améliorer ses relations tendues avec la Pologne.
Il est évident que l’évolution de la crise politique à Londres sera influencée par des événements qui prendront place en Europe comme aux États-Unis. Les partisans radicaux du Brexit (comme Farage, Cummings, Rees-Mogg) n’ont pas d’autre choix que celui d’espérer la réélection de Trump en 2020. Mais que se passera-t-il s’il n’est pas réélu ? Et même si c’était le cas, comment les partisans du Brexit peuvent-ils être certains que l’homme dans le Bureau Ovale ne finira pas par penser que l’éclatement, pas seulement de l’Union européenne, mais aussi du Royaume-Uni serait dans l’intérêt des États-Unis ?
Le capitalisme a toujours été, dans un sens, un véritable jeu de hasard, une loterie et Londres est l’un de ses chefs-lieux. Aujourd’hui, avec un capitalisme en pleine phase de décomposition, c’est plus que jamais le cas. Un jeu dangereux au détriment de la stabilité et de l’avenir de l’humanité toute entière. Quand ce jeu de hasard devient-il une sorte de “roulette russe” ? Nous ne tenterons nullement de prédire quelle sera l’issue du jeu du “Brexit”. En revanche, ce dont nous pouvons être sûrs, c’est que cette dernière ne sera certainement pas en faveur de la classe ouvrière britannique, ni de celle d’aucun autre pays.
Steinklopfer, 6 août 2019
1) Le surnom “Brexit means Brexit” a été donné à Theresa May par la presse britannique suite à la conférence de presse du 30 juin 2016 où elle annonçait sa candidature à la tête du Parti conservateur, déclarant : “Le Brexit signifie le Brexit et nous en ferons un succès” et s’opposant fermement à un second référendum. Theresa May a ensuite inlassablement répété et tenté d’appliquer ce mantra, “Brexit means Brexit”, jusqu’à sa démission. (Note du traducteur).
Géographique:
- Grande-Bretagne [61]
Récent et en cours:
- Brexit [62]
Rubrique:
Réunion publique à Marseille sur le centenaire de l’IC: Tirer les leçons du passé, un besoin pour le combat de la classe ouvrière
- 103 reads
Le 6 avril 2019 s’est tenue à Marseille une réunion publique sur le centenaire de la fondation de l’Internationale communiste. Outre la présence de sympathisants du CCI, cette réunion a vu aussi la participation d’un camarade du PCI–Le Prolétaire et d’un camarade de Fil Rouge.
La présence de ces camarades du courant bordiguiste sur un des événements les plus importants de l’histoire du mouvement ouvrier était l’occasion de confronter nos positions car “pour pouvoir construire le futur parti mondial du prolétariat, sans lequel le renversement du capitalisme sera impossible, les minorités révolutionnaires doivent se regrouper, aujourd’hui comme dans le passé. Ils doivent clarifier leurs divergences par le débat, la confrontation des idées et des positions, la réflexion collective et la discussion la plus large possible. Ils doivent être capables de tirer les leçons du passé pour pouvoir comprendre la situation historique présente et permettre aux nouvelles générations d’ouvrir les portes de l’avenir”. 1
Pour la confrontation des idées dans le camp prolétarien
Ce sont les participants à cette réunion publique qui ont interpellé les organisations présentes pour qu’elles développent un débat ouvert dans le milieu politique prolétarien, car comme l’a dit une camarade : “il ne faut pas attendre de grands mouvements prolétariens pour le faire. Aujourd’hui nous sommes dans une situation de faiblesse de la classe, il y a un rouleau compresseur de l’idéologie bourgeoise avec le poids très fort de l’individualisme, un tel débat serait une réaction contre une telle pression”. Pour une autre camarade : “ce serait aussi un pôle d’attraction pour les minorités en recherche et notamment des jeunes. Attendre des grands mouvements du prolétariat contient le risque de reproduire la même erreur que l’IC à savoir qu’elle s’est constituée alors qu’il y avait beaucoup de points à clarifier, sur la question syndicale, le rôle du parti… et une des leçons que met en évidence la fondation de l’IC, c’est que toutes ces questions doivent faire l’objet de débats aujourd’hui”. Tous les participants étaient particulièrement intéressés à connaître les positions de la Gauche communiste, cerner où sont les points d’accord et les divergences. Un tel débat, dans sa dimension internationale, romprait avec l’atomisation des organisations prolétariennes et stimulerait la réflexion chez des éléments ou groupes intéressés par la politique révolutionnaire.
Bien évidemment, le CCI a régulièrement soutenu de tels appels et les groupes se réclamant de la Gauche communiste doivent aussi les entendre. Le CCI a toujours défendu le débat dans le milieu révolutionnaire, malheureusement cela a abouti, jusqu’à maintenant, à un échec, en particulier les Conférences initiées par Battaglia comunista (Parti communiste internationaliste) à la fin des années 1970. Pourquoi ? “C’est essentiellement l’incapacité du milieu dans son ensemble à surmonter le sectarisme qui a mené au blocage et finalement au sabotage des conférences. Dès le début, le CCI avait insisté pour que les conférences ne restent pas muettes, mais qu’elles publient, dans la mesure du possible, un minimum de déclarations communes, afin de préciser au reste du mouvement les points d’accords et de désaccords qui ont été atteints, mais aussi face à des événements internationaux majeurs (comme le mouvement de classe en Pologne ou l’invasion russe en Afghanistan) qu’elles fassent des déclarations publiques communes sur des questions qui étaient déjà des critères essentiels pour les conférences, comme l’opposition à une guerre impérialiste”. 2
Un début d’ouverture pour un débat au sein la Gauche communiste ?
Or, lors de cette réunion publique du CCI, nous avons vu les camarades du PCI et de Fil Rouge répondre à cet appel en développant une véritable confrontation des positions politiques. Il est évident que les groupes révolutionnaires présents sont absolument d’accord pour la création d’un parti mondial de la révolution. Une des premières leçons que la réunion a tiré, c’est qu’il ne faut pas commettre l’erreur de l’IC, l’union tardive des forces militantes du prolétariat alors que la vague internationale de luttes révolutionnaires connaissait ses premiers échecs graves, particulièrement en Allemagne en 1919, renforçant l’isolement de la révolution en Russie. Cela dit, le PCI et Fil Rouge ne tirent pas les mêmes leçons que le CCI, et cela a été l’occasion d’un débat très riche.
Comme il a été affirmé dans la discussion, les conditions dans lesquelles va se créer la future Internationale ouvrière seront différentes de celles qui ont prévalu à la fondation de la Troisième Internationale, il serait alors intéressant que le débat puisse se développer sur ce que sont ces conditions différentes, comme le disent les camarades. S’il existe une convergence entre les camarades bordiguistes et le CCI sur la nécessité de regrouper et d’unir les forces révolutionnaires à l’échelle internationale, il s’agit alors de clarifier sur quelles bases. Les camarades bordiguistes rejettent toute politique qui vise à une fusion des différents groupes, ce qui n’est bien sûr en aucune manière la conception du CCI. Cependant, c’est dans cette question (par quel processus ce regroupement doit se faire ?), qu’apparaissent de véritables divergences. Pour le CCI, ce processus ne peut se faire qu’à travers une confrontation des positions de chaque groupe, et ce alors que l’IC a laissé en friche toute une série de questions politiques nécessitant une clarification. En ce sens, pour qu’ait lieu cette confrontation, il est nécessaire de combattre le poids du sectarisme qui a prévalu dans le passé et qui continue à peser dans le milieu politique prolétarien, comme nous l’écrivons dans notre presse. Le CCI a rappelé que lors de la guerre impérialiste au Kosovo, en 1991, il avait lancé un appel aux groupes politiques prolétariens pour réagir à la barbarie bourgeoise en mettant en avant le mot d’ordre : “le prolétariat n’a pas de patrie, prolétaires de tous les pays, unissez-vous !”, appel qui est resté lettre morte. Pourtant, c’est une des leçons que nous a légué le mouvement ouvrier avec la Conférence de Zimmerwald : alors qu’il existait de nombreuses divergences entre les participants, Zimmerwald a été une lumière pour le prolétariat mondial subissant la barbarie du capitalisme dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Cette Conférence a été le prélude à la création d’une nouvelle Internationale, alors que la Deuxième Internationale avait montré sa faillite en août 1914 en votant les crédits de guerre, entraînant le prolétariat dans la première boucherie impérialiste. Il ne s’agissait pas d’effacer les divergences politiques mais de défendre, face aux guerres impérialistes, un des principes prolétariens fondamental : l’internationalisme.
Cependant, le camarade de Fil Rouge a émis beaucoup de réserves sur les interventions de nos sympathisants et du CCI appelant à la clarification des divergences par la confrontation des positions de chaque groupe. Pour lui, les différentes organisations ont déjà dégagé des leçons et par conséquent un nouveau processus de clarification n’a pas lieu d’être. C’est pour cela que le camarade insiste sur l’idée de rejet de toute “fusion” des organisations prolétariennes et qu’un débat et une confrontation des positions ne sont pas nécessaires. Les deux camarades bordiguistes ont mis en avant ce que leur courant avait dégagé comme leçons : le rôle du parti, la dictature du prolétariat, la caractéristique de la Russie devant opérer une révolution double (comme le rappelait le camarade de Fil Rouge qui est la théorie de Marx en 1848 sur la “Révolution permanente”), ce qui a fait dire au camarade du PCI qu’il existe au sein de chaque pays des spécificités qu’il faut prendre en compte, ce qui était le cas justement de la révolution russe. Pour les camarades bordiguistes, le CCI a tiré d’autres leçons qui se rapprochent des positions conseillistes, notamment vis-à-vis de la question du parti et de la dictature du prolétariat. Nous avons rejeté une telle idée car il est indéniable que le CCI défend la nécessité d’un parti et de la dictature du prolétariat.
Or, ce sont justement sur toutes ces questions, en les élargissant à la question de l’émergence des Conseils ouvriers comme organes du pouvoir de la classe ouvrière, comme le disait Lénine, ou encore sur la question syndicale, que le processus de clarification doit avoir lieu. En ce sens, pour le CCI, toutes les leçons de l’IC, notamment, sur le changement de période historique du capitalisme, celui de la décadence, comme Rosa Luxemburg et Lénine l’avaient mis en évidence, n’ont pas été encore tirée en profondeur. Il reste en effet un gros travail à faire pour saisir les implications induites par la période de décadence en ce qui concerne l’intervention des révolutionnaires dans les luttes ouvrières. En fait, nous considérons qu’il faudrait aussi examiner plus en profondeur l’apport des différentes expressions de la Gauche communiste qui se sont battues contre la dégénérescence de l’IC.
Alors que les différentes organisations de la Gauche communiste devraient pouvoir s’engager dans un débat ouvert et fraternel dans ce sens, celle-ci demeure malheureusement encore aujourd’hui trop fragmentée.
Selon le camarade de Fil Rouge, “la situation de la classe ouvrière est catastrophique”. Un tel constat nécessite, de notre point de vue, grandement d’être discuté. Pour notre part, nous pensons qu’il faut débattre et fortement nuancer ce propos au regard de l’évolution des luttes et de la conscience de classe sur un plan plus historique. En effet, si les difficultés pour la classe ouvrière sont indéniables, nous ne pouvons pas pour autant les mettre sur le même plan que celles qu’a pu vivre la classe ouvrière durant la période de contre-révolution dans les années 1930. ll faudrait donc aller plus loin, comprendre pourquoi la classe ouvrière se retrouve dans une situation que nous qualifierions plutôt aujourd’hui de “grande faiblesse”. Tout cela nécessite bien une argumentation et un débat contradictoire pour permettre de nous inscrire dans un cadre général afin de prendre plus de recul et saisir de manière dynamique une perspective pour notre classe. Nous devons par exemple voir comment les leçons de l’IC et des groupes se réclamant de la Gauche communiste, comme Bilan par exemple, peuvent nous aider à nous orienter dans la situation complexe d’aujourd’hui. Un tel débat, vital pour le mouvement ouvrier et les organisations révolutionnaires, nécessite donc que les groupes se réclamant de la Gauche communiste se rassemblent pour des confrontations fraternelles, en développant les polémiques dans la presse et aussi par la discussion en organisant des réunions publiques face à la classe ouvrière. Cela, afin de créer un lieu de débat ouvert contre la propagande de la classe dominante. Cela est possible et nécessaire comme l’a montré la tenue de la réunion publique à Marseille sur la création de l’IC. En ce sens, la présence de la mouvance bordiguiste aux réunions publiques du CCI, qui est à saluer, montre que cette fragmentation des organisations de la Gauche communiste peut et doit être dépassée. Le CCI mettra toutes ses forces dans la bataille pour que se créent toutes les conditions pour une clarification politique dans le camp révolutionnaire.
André, 15 août 2019
1) “Centenaire de la fondation de l’IC : l’Internationale de l’action révolutionnaire ouvrière”, Révolution internationale n° 476 (mai-juin 2019).
2) Voir sur le site internet du CCI : “Il y a cinquante ans, Mai 68. La difficile évolution du milieu politique prolétarien”.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [69]
- Révolution Allemande [35]
Evènements historiques:
Rubrique:
Manifestations à Hong Kong: Quand l’impérialisme alimente le mythe démocratique
- 139 reads
Après une longue période de manifestations en série et les pressions accrues de la rue, la cheffe de l’exécutif hongkongais, véritable bureaucrate et marionnette de Pékin, a fini, le 4 septembre dernier, par céder en retirant le projet de loi très contesté qui portait sur les extraditions (de soi-disant criminels) vers la Chine.
Depuis la rétrocession britannique de Hong Kong à l’empire du Milieu en 1997, l’étau chinois s’était progressivement resserré et les événements de ces derniers mois traduisent une des plus graves crises politiques ayant secoué cette place financière où vivent sept millions de personnes. En 2014, la dite “révolution des parapluies” avait déjà mobilisé les pro-démocratie mais s’était heurtée de plein fouet à l’inflexibilité du prédécesseur de la “Dame de fer” actuelle, Carrie Lam. Or, depuis le mois de juin, des mobilisations analogues semblent aboutir cette fois à un camouflet pour Pékin : le retrait de la loi sur les extraditions vers la Chine. Comment expliquer cela, alors que Pékin restait droit dans ses bottes jusqu’ici et avait déjà fait la preuve de ses talents pour réprimer très durement toutes contestations, en particulier celle de la place Tiananmen en 1989 ? D’ailleurs, la présence pressante de l’État chinois et de ses tortionnaires aux portes de l’“îlot” hongkongais ne fait que traduire l’intention de réprimer fortement les manifestants. La répression a déjà frappé les leaders les plus en vue et tous ceux que l’État chinois assimile volontiers à des “terroristes”. 1
À elles seules, les mobilisations de millions de personnes chaque fois plus déterminées (jugeant d’ailleurs que le geste de Carrie Lam “c’est trop peu et trop tard”) n’expliquent pas totalement le recul de Pékin. Ceci, d’autant plus que la relative autonomie de Hong Kong, en théorie jusqu’en 2047, reste sur le fond intolérable pour le parti unique stalinien qu’est le PCC. Ce qui change fondamentalement la donne, c’est le rapport de force entre les grandes puissances et la réalité d’un aiguisement des tensions impérialistes, notamment entre les États-Unis et la Chine. 2 Face aux ambitions impérialistes affichées par cette dernière et la réalité de sa montée en puissance, bouleversant les équilibres notamment par son gigantesque projet des “routes de la soie”, les États-Unis ont été amenés à riposter par une véritable offensive dont l’objectif est, en grande partie, d’endiguer ce nouvel adversaire de plus en plus gênant et dangereux. Outre l’aiguisement des tensions commerciales, cet été, et les pressions militaires américaines dans le golfe Persique, 3 les manifestations de Hong Kong constituent une arme de la déstabilisation supplémentaire contre la Chine. Pékin ne s’y trompe d’ailleurs pas puisqu’elle accuse ouvertement les manifestants de “collusion avec l’Occident” et affirme que “nous nous opposons fermement à toute force extérieure intervenant dans les affaires législatives de Hong Kong”. 4
L’affaire de la “fuite” des propos privés de Carrie Lam prétendant vouloir “démissionner” de son poste semble attester de la fameuse “collusion” que la Chine dénonce à l’encontre des “occidentaux”. Bien entendu, si les “occidentaux” tant incriminés par Pékin se sont rapidement “indignés” de la fameuse loi d’extradition vers la Chine (Trump le premier), ce n’est certainement pas parce que cette dernière serait “contraire aux droits de l’homme” et parce qu’elle est utilisée pour torturer ou enfermer tous ceux qui contestent l’ordre établi par Pékin, que ce soit des journalistes, des ONG et bien sûr les militants de tous poils. Non ! Tout ceci relève uniquement d’un pur opportunisme politique, pour des motivations exclusivement impérialistes. En réalité, l’État américain, ou d’autres “occidentaux” incriminés, n’ont que faire du sort des extradés, des prisonniers, des torturés par les sbires de l’État chinois. Souvenons-nous d’ailleurs qu’eux-mêmes utilisent volontiers les mêmes méthodes dans certaines circonstances (comme les pratiques barbares des soldats de l’armée américaine en Irak ou en Afghanistan, à une époque où les dirigeants occidentaux étaient pourtant un peu plus “présentables” qu’un Trump). 5 Ainsi, si les opposants de Hong Kong bénéficient de tant de sympathie et d’appuis (au moins idéologiques si ce n’est matériels) de la part des grandes puissances occidentales et de leurs dirigeants, c’est non seulement pour des raisons impérialistes, mais également parce qu’un tel mouvement est totalement inoffensif pour le système capitaliste et qu’il permet même de le préserver.
En effet, les manifestants de Hong Kong ne sont en rien l’expression d’un mouvement de classe révolutionnaire remettant en cause le capitalisme ; “Peu importe combien ils sont et peu importe combien d’ouvriers ont participé à ce mouvement, les protestations de rue ne sont pas une manifestation du combat de la classe ouvrière. À Hong Kong, le prolétariat n’est pas et n’a pas été présent dans la lutte en tant que classe autonome. Au contraire ; les ouvriers de Hong Kong ont été complètement submergés, noyés dans la masse des habitants”. 6 Un tel mouvement présente donc un grand danger pour la classe ouvrière en renforçant l’idéologie dominante, en réactivant le mythe démocratique contre la lutte et l’autonomie de classe du prolétariat.
Quand l’impérialisme souffle sur les braises de l’idéologie démocratique pour masquer ses sordides intérêts capitalistes, indépendamment de la suite et de l’issue des événements futurs, cela ne peut que porter davantage de confusions dans les têtes des ouvriers. Cela n’augure que de la barbarie, favorise l’exploitation, les tensions, les guerres et le chaos.
WH, 6 septembre 2019
1) Plus de 1 100 arrestations, l’usage massif des lacrymogènes et de canons à eau estampillés “démocratie française”.
2) Les porte-parole du mouvement soupçonnent le gouvernement d’avoir été poussé à réagir à l’approche de la rentrée du Sénat américain qui doit reprendre l’examen du Hong Kong Human Rights and Democracy Act qui, s’il était adopté, pourrait remettre en cause le statut particulier, fiscal et commercial, de Hong Kong vis-à-vis des États-Unis.
3) Les menaces de représailles envers l’Iran ont ainsi permis un contrôle plus serré du détroit d’Ormuz par les États-Unis au détriment des ambitions de la Chine dans cette région géostratégique vitale.
4) “Cinq questions sur la crise à Hong Kong”, France Info (10 juin 2019).
5) On peut prendre l’exemple du “waterboarding”, qui consiste à simuler une noyade. Des photos du Pentagone montraient “des pyramides de détenus nus, des prisonniers tenus en laisse, menacés par des chiens ou contraints de se masturber” (“États-Unis : le Pentagone publie des photos de sévices sur des prisonniers en Irak et en Afghanistan”, France 24 du 6 février 2016).
6) “Manifestations massives dans les rues de Hong Kong : les illusions démocratiques sont un piège dangereux pour le prolétariat”, à lire sur le site Internet du CCI.
Géographique:
- Chine [71]
Récent et en cours:
- Hong Kong [72]
Rubrique:
Supplément à Révolution Internationale n°478
- 107 reads
Bilan du mouvement des “gilets jaunes”: Un mouvement interclassiste, une entrave à la lutte de classe
- 547 reads
De novembre 2018 à juin 2019, l’espace médiatique a été grandement occupé par le mouvement social des “gilets jaunes”. Contestation à la forme “inédite”, selon les experts, il s’agirait d’un nouveau modèle de lutte. Pour certains, il serait même mieux adapté à l’évolution de la société. Face à la crise de la “représentativité” des partis traditionnels et des syndicats, face aux excès de la mondialisation et du libéralisme, le “peuple” aurait trouvé ici le moyen de s’exprimer et de se faire entendre, de peser sur les grandes orientations politiques nationales, de dire non aux injustices, à la précarité et à la pauvreté grandissantes. Bref, la forme originale de ce mouvement devrait marquer de son empreinte l’avenir. Les syndicats appellent d’ailleurs à une future convergence des luttes entre le monde du travail et celui de cette nouvelle contestation sociale, promettant un nouveau “Front populaire”. Certaines organisations de gauche et d’extrême-gauche saluent même la créativité des manifestants en gilet. S’agit-il enfin d’une nouvelle forme efficace de lutte ouvrière ? En réalité, les “gilets jaunes” n’expriment en rien un combat de nature prolétarienne. Ils sont un mouvement interclassiste, une entrave à la lutte de classe. Ils noient les travailleurs qui s’y sont égarés dans la population en général, de manière indifférenciée, en dehors de toute considération de classe sociale, dilués dans un prétendu peuple. Les “gilets jaunes” distillent donc en cela le poison de l’idéologie de la petite bourgeoisie, fortement imprégnée de nationalisme et de xénophobie, bouffie de rêves de liberté… entrepreneuriale. Ce mouvement, sorte de fronde paradoxalement soumise au cadre institutionnel alimente les pires illusions démocratiques. Cela, comme si un capitalisme plus “juste” et plus “humain” pouvait en effet être possible à conditions d’améliorer les institutions républicaines. En réalité, tout montre que ce mouvement affaiblit la capacité des prolétaires à lutter comme une classe unie et organisée.
À l’origine du mouvement, l’esprit petit-bourgeois
Le 27 janvier 2018, à Périgueux, en Dordogne, 250 personnes défilent pour demander le retrait de la nouvelle limitation kilométrique sur les routes à 80 km/h. Quelques-uns portent des “gilets jaunes” avec des slogans écrits dans le dos contre la vie chère, la hausse de la CSG et les taxes liées à l’automobile (péages, essence…). Ils bloquent aussi la circulation sur des ronds-points. Cette action appelée “Colère”, lancée sur les réseaux sociaux le 12 janvier par un maçon, Leandro Antonio Nogueira, reçoit immédiatement le soutien de Jean Lassalle et des proches de Marine Le Pen. Si la lutte contre la limitation de vitesse glisse rapidement vers la question plus large des taxes, c’est parce que les 80 km/h sont vus comme un prétexte pour multiplier les amendes et donc piquer de l’argent dans les poches des automobilistes. Selon le journal Libération, “cette question des 80 km/h était bien plus qu’un enjeu de sécurité routière, (…) le point de départ d’une potentielle jacquerie fiscale”. Ici apparaissent donc les balbutiements du mouvement des “gilets jaunes”. Comme l’affirme Nogueira : “Moi je ne voulais pas trop dire que c’est parti de Colère. Mais si vous regardez les “gilets jaunes”, ce sont souvent d’anciens coléreux. Dans certains départements, comme la Dordogne ou la Corrèze, tous les “gilets jaunes” sont des anciens de Colère”.
Le 29 mars 2018, l’appellation “Les gilets jaunes” apparaît pour la première fois dans les médias, lors d’une manifestation contre la ligne à grande vitesse Paris-Rennes.
Le 29 mai 2018, une auto-entrepreneuse, Priscillia Ludosky, lance une pétition en ligne pour réclamer une baisse des prix du carburant à la pompe. Le succès est fulgurant. Elle deviendra plus tard l’une des représentantes officielles du mouvement.
Le 10 octobre 2018, le chauffeur-routier Éric Drouet appelle, lui aussi sur Facebook, à manifester pour le 17 novembre : “Blocage national contre la hausse du carburant”. Son message est relayé sur tous les réseaux sociaux. Le 17 novembre, selon le gouvernement, 287 710 personnes, réparties sur 2 034 points, paralysent carrefours routiers, ronds-points, autoroutes, péages et parkings de supermarchés. Le mouvement des “gilets jaunes” est définitivement lancé. Une nouvelle grande journée d’action est programmée pour le 24 novembre, baptisée : “Acte 2 : toute la France à Paris”. L’objectif est de bloquer les lieux prestigieux et de pouvoir de la capitale : l’avenue des Champs-Élysées, la place de la Concorde, le Sénat et, surtout, l’Élysée. “Il faut mettre un coup de grâce et tous monter sur Paris par tous les moyens possibles (covoiturage, train, bus, etc). Paris, parce que c’est ici que se trouve le gouvernement ! Nous attendons tout le monde, camion, bus, taxis, VTC, agriculteurs, etc. Tout le monde !”, proclame ainsi Éric Drouet. Le soir-même, est lancé, toujours via Facebook, l’appel à une troisième journée d’action, prévue pour le samedi 1er décembre : “Acte 3 : Macron démissionne !”, en mettant en avant deux revendications “La hausse du pouvoir d’achat et l’annulation des taxes sur le carburant”.
Comment expliquer le succès de ces différents appels via Internet ? L’ampleur de cette mobilisation témoigne avant tout de l’immense colère qui gronde dans les entrailles de la société. Hausse généralisée des taxes en tous genres, montée du chômage, systématisation des emplois précaires, y compris dans la Fonction publique, inflation touchant particulièrement les denrées de première nécessité, prix inabordables du logement… les raisons de la colère sont nombreuses. Cela dit, il faut mesurer la réelle ampleur de la mobilisation des ouvriers au sein de ce mouvement qui, même au plus haut, a rassemblé seulement quelques centaines de milliers de personnes tout au plus. Les gros bataillons de travailleurs ne se sont jamais réellement impliqués, ni sur les ronds-points, ni sur les Champs-Élysées, au-delà d’une platonique sympathie. Ce qui apparaît par contre clairement, c’est qu’à l’initiative de ce mouvement se trouvent des représentants de la petite bourgeoisie et leurs aspirations. Ce n’est pas un hasard si, parmi les huit porte-paroles des “gilets jaunes” désignés le 26 novembre, se compte une écrasante majorité de petits patrons ou d’autoentrepreneurs. Ce n’est pas par hasard si le meneur Éric Drouet en appelle en premier aux “camions, bus, taxis, VTC, agriculteurs”. Les “gilets jaunes” forment un mouvement interclassiste : y sont mélangées toutes les classes et couches exploitées et intermédiaires de la société ; et donc le la est donné par l’idéologie de la petite bourgeoisie.
La liste des 42 revendications des “gilets jaunes” établie le 29 novembre 2018 est révélatrice de cette nature interclassiste et du poids dominant de l’idéologie petite-bourgeoise. S’y trouvent ainsi pêle-mêle à la fois des revendications ouvrières sur les salaires et les retraites par exemple, mais aussi des requêtes nationalistes, localistes ou boutiquières sur l’économie des entreprises et les taxes, et même des réclamations xénophobes et nauséabondes sur l’immigration. En voici quelques extraits de cette liste sous forme de pot-pourri :
– “Zéro SDF : URGENT.
– SMIC à 1300 euros net.
– Favoriser les petits commerces des villages et centres-villes.
– Que les GROS (Macdo, Google, Amazon, Carrefour…) payent GROS et que les petits (artisans, TPE, PME) payent petit.
– Même système de sécurité social pour tous (y compris artisans et autoentrepreneurs).
– Le système de retraite doit demeurer solidaire et donc socialisé (pas de retraite à points).
– Fin de la hausse des taxes sur le carburant.
– Pas de retraite en dessous de 1 200 euros.
– Protéger l’industrie française : interdire les délocalisations. Protéger notre industrie, c’est protéger notre savoir-faire et nos emplois.
– Que les déboutés du droit d’asile soient reconduits dans leur pays d’origine.
– Qu’une réelle politique d’intégration soit mise en œuvre. Vivre en France implique de devenir Français (cours de langue française, cours d’Histoire de la France et cours d’éducation civique avec une certification à la fin du parcours).
– Moyens conséquents accordés à la justice, à la police, à la gendarmerie et à l’armée”.
Oui, avec le mouvement des “gilets jaunes”, des milliers de travailleurs, chômeurs, retraités ont poussé un cri de colère légitime face à la pauvreté. Mais, cette colère diffuse est très facilement monopolisée, depuis les premiers jours, par les petits patrons qui ont initié ces manifestations et les principaux mots d’ordre, afin de faire pression sur le gouvernement et obtenir gain de cause : la baisse des taxes qui asphyxient leur entreprise. Tout le reste, leurs revendications pour soutenir l’économie française, durcir le contrôle des migrants, etc. constitue le fond du décor de leur idéologie de petits-bourgeois.1
Un mouvement sans perspective
À l’origine, le mode d’action principal des “gilets jaunes” consiste à opérer des liens virtuels sur les réseaux sociaux et à occuper quotidiennement les ronds-points, à réaliser des barrages filtrants. En quelques semaines, ces lieux de rassemblement deviennent des lieux de vie, des îlots de résistance avec campements et barbecues. Se retrouvent là des agriculteurs, des artisans, des petits patrons mécontents, pris à la gorge et surtout des travailleurs précaires. Le sentiment dominant est l’envie “d’être visible” et de se montrer, d’être ensemble. Le port du gilet jaune sert donc de ralliement pour “tenter d’exister”. Les “gilets jaunes” apostrophent les automobilistes qui, pour beaucoup, les soutiennent en les saluant et/ou klaxonnant. Sur chaque point de blocage, des drapeaux tricolores sont brandis, La Marseillaise est très régulièrement entonnée. Mais la stérilité de cette méthode de lutte apparaît très vite aux yeux de beaucoup, d’où la décision, à partir de la fin novembre, d’occuper chaque samedi les lieux symboliques des grandes villes françaises, tout spécialement les Champs-Élysées à Paris. Ce qui nourrit principalement l’immense colère des “gilets jaunes”, c’est “le sentiment d’être méprisés”, ignorés par les gouvernants, l’envie d’être entendus et reconnus par “ceux d’en haut”, ce qui explique cette volonté d’aller sur les Champs-Élysées, “la plus belle avenue du monde”, pour s’y faire “voir” et “entendre”.
Ces jours de la fin novembre et du début décembre 2018 vont alors être marqués par une confrontation extrêmement violente avec les forces de répression de l’État.
Le samedi 1er décembre, au Puy-en-Velay (Haute-Loire), des affrontements avec la police dégénèrent après que certains manifestants aient été gazés ; la préfecture est incendiée. Mais c’est surtout à Paris que les heurts sont les plus spectaculaires. L’arc de Triomphe est envahi et vandalisé, des voitures sont incendiées et quelques boutiques pillées. Ces images font le tour du monde. Le pouvoir en place semble ponctuellement débordé, incapable de maintenir l’ordre au sein de la capitale. L’écrasante majorité des partis politiques bourgeois exploitent la situation pour tenter d’affaiblir le président Macron ; ils le critiquent soit pour son incompétence à maintenir la sécurité, soit pour sa morgue et son indifférence aux souffrances du “peuple”. Il y a un danger réel pour lui de se retrouver trop isolé sur l’échiquier politique et d’avoir une image internationale dégradée quant à sa stature de chef d’État. Surtout que le parti La République en marche n’est pas encore suffisamment implanté dans le Moloch étatique et qu’il fonde sa stabilité, justement, en très grande partie sur son leader, “l’homme providentiel et jupitérien”, Macron. Le pouvoir en place va donc réagir avec force et répondre sur les deux plans, en brandissant carotte et bâton, enfin plus exactement une toute petite carotte et un énorme bâton. Le samedi 8 décembre, 264 personnes sont blessées, y compris grièvement (perte d’yeux ou de mains), notamment en raison de l’utilisation des flash-balls et de grenades de désencerclement, résultat très concret du changement de stratégie du ministre de l’Intérieur et de son ordre donné aux policiers d’aller au contact des manifestants. Dans la foulée, le 10 décembre 2018, le président Macron prononce une allocution télévisée dans laquelle il annonce plusieurs mesures afin de prouver qu’il a “entendu” “les souffrances du peuple”. Cela dit, malgré les 10 milliards d’annonce, les manifestants ont conscience qu’en réalité les conditions de vie vont continuer à se dégrader. La colère ne retombe pas et le mouvement se poursuit. Le 15 décembre, 69 000 membres des forces de l’ordre sont déployés sur le territoire (soit un ratio de 1 membre des forces de l’ordre pour 1 manifestant), dont 8 000 à Paris ; 179 personnes sont interpellées et 144 placées en garde à vue. Les images qui tournent alors sur toutes les chaînes de télévision, aux quatre coins du globe, sont très différentes de celles du samedi 1er décembre. Cette fois, les Champs-Élysées sont occupés par des tanks et des cordons de “robocops”. L’État, avec Macron à sa tête, réalise là une véritable démonstration de force et révèle clairement ce que sont les quelques voitures brûlées et vitrines cassées de la semaine précédente pour le système capitaliste : une piqûre d’insecte sur la peau d’un éléphant. L’Ordre règne à Paris.
Le poison de l’illusion démocratique
Peu à peu, une revendication va supplanter toutes les autres : le référendum d’initiative citoyenne (RIC). Il s’agit là d’un dispositif de “démocratie directe”. Avec le RIC, des citoyens réunissant un nombre de signatures fixé par la loi pourrait saisir la population par référendum sans que soit nécessaire l’accord du Parlement ni du président de la République. Les “gilets jaunes” souhaitent quatre modalités pour le RIC : pour voter une proposition de loi, pour abroger une loi votée par le Parlement ou un traité, pour modifier la Constitution (référendum constitutionnel) et pour révoquer un élu.
A partir de janvier 2019, ces trois lettres, RIC, apparaissent donc progressivement sur presque tous les dos des “gilets jaunes”. Or, cette espérance en un capitalisme plus démocratique n’est pas qu’une simple illusion, c’est surtout un véritable poison pour la classe ouvrière.
Comme nous l’écrivions dès 1978 : “Pour les idéologues bourgeois, l’État est l’émanation de la souveraineté populaire. La démocratie est la forme suprême de l’État, l’achèvement et la perfection de son être. Le marxisme y voit cependant tout autre chose. Dévoilant la division de la société en classes, il démontre qu’il ne saurait y avoir communauté d’intérêts entre exploités et exploiteurs. Par conséquent, l’État, loin de gérer un prétendu bien commun, n’est jamais qu’une trique aux mains de la classe exploiteuse. Cela reste vrai même si la démocratie étend son voile hypocrite sur les rapports de classe et ne laisse paraître que les “citoyens égaux et libres”. Derrière la liberté et l’égalité formelles, descend l’ombre du bâton dont la classe oppresseuse se sert pour assujettir la classe opprimée. (…) Les luttes prolétariennes trouvent alors sur leur chemin le mirage démocratique et parlementaire, destiné à les égarer, à ramollir ou écarter les assauts qu’elles portent à l’État bourgeois, à freiner ou disloquer leur élan, à les emporter sans force loin de leur but. Car si “l’appareil exécutif, militaire et politique de l’État bourgeois organise l’action directe contre la révolution prolétarienne, la démocratie représente pour lui un moyen de défense indirecte en répandant dans les masses l’illusion qu’elles peuvent réaliser leur émancipation par un processus pacifique” (thèses de la Gauche italienne, 1920). De ce moyen de défense indirecte, aucun État de la classe dominante ne peut durablement se passer sans chauffer à blanc les antagonismes sociaux”.
La démocratie est l’organisation politique la plus sophistiquée et efficace de la domination de la classe bourgeoise sur l’ensemble de la société, en particulier la classe qu’elle exploite, le prolétariat. Tel ou tel détail du fonctionnement démocratique, tel le RIC, ne peut s’inscrire que dans ce cadre. D’ailleurs, ce type de référendum existe déjà dans plus d’une quarantaine de pays dont la Suisse, l’Italie, la Slovénie, l’Uruguay et même l’Allemagne et les États-Unis, autant de coins de la planète où l’exploitation capitaliste comme la domination économique et politique de la bourgeoisie y sont toutes aussi présentes qu’en France. La démocratie est l’arme la plus affûtée du capitalisme, et avec son RIC, le mouvement des “gilets jaunes” permet au pouvoir en place de l’aiguiser un peu plus encore. C’est pourquoi Macron et son gouvernement sautent sur cette trop belle occasion en lançant le 15 janvier 2019 un “Grand débat national”. Durant trois mois (janvier, février et mars), un débat particulièrement pourri va ainsi occuper l’actualité et toutes les têtes : participer au “Grand débat” ou organiser ses propres discussions entre “gilets jaunes”. En réalité, ces discussions, qu’elles soient orchestrées par le gouvernement ou par les “gilets jaunes” (dans des salles municipales prêtées… par les maires), sont les deux faces de la même médaille : opposées en apparence, elles forment un tout. Tous ces grands et petits débats, quels qu’ils soient, se fondent sur le souhait d’une “véritable démocratie”, c’est-à-dire d’une plus grande écoute, d’une meilleure prise en compte de la parole du “peuple” par les institutions démocratiques. Or, répétons-le, ce système démocratique n’est qu’une mystification masquant que tous les gouvernements sont les gestionnaires de leur capital national respectif, les représentants d’une classe minoritaire exploitant la majorité : les prolétaires.
Une répression étatique calculée pour entretenir la colère
Une partie des “gilets jaunes” ont conscience de la vacuité de ces palabres ; eux veulent imposer leurs revendications par la force. Au lendemain même de la fin du “Grand débat national”, le samedi 16 mars, la colère éclate. Quelques centaines de Black blocs et “gilets jaunes” émeutiers tentent d’abord, sans succès, de prendre d’assaut l’Arc de triomphe, comme le 1er décembre, puis saccagent l’avenue des Champs-Élysées et les rues avoisinantes, principalement en brûlant des kiosques et en brisant des vitrines pour attaquer les “symboles du capitalisme”. Les images du prestigieux restaurant Le Fouquet’s incendié lors de cet “acte XVIII” font le tour du monde. Selon Le Monde : “de plus en plus de manifestants considèrent que la casse est le seul moyen de se faire entendre et de faire plier le gouvernement”. Cette révolte du désespoir est donc infestée de manière croissante par le nihilisme des Black blocs qui prônent partout : “La France est une vitrine, moi un pavé”. Un tag revient de plus en plus sur les murs : “Le peuple applaudit les casseurs”. Le “peuple” peut bien applaudir, ces actes de destruction ne sapent en rien les fondements du système. Pire, ils permettent à la bourgeoisie et son gouvernement de légitimer le renforcement juridique et policier de son arsenal répressif à l’image de la loi anti-casseurs adoptée par le parlement. Si le gouvernement et son Ministre de l’Intérieur avaient voulu protéger la plus belle avenue du monde, ils auraient parfaitement pu déployer leurs cars de flics, leurs cordons de CRS et même les blindés de la gendarmerie pour bloquer tous les accès, comme lors de leur démonstration de force du 15 décembre 2018. Il faut être particulièrement naïf pour imaginer que le gouvernement a été complètement dépassé par une situation inattendue. D’ailleurs, selon l’aveu même du secrétaire général de l’UNSA-Police, les forces de l’ordre étaient “en mesure d’intervenir” mais n’ont pas été “autorisées à le faire”. Si Macron et sa clique du gouvernement ont laissé faire ce samedi 16 mars, c’était d’abord pour obliger les autres partis électoraux concurrents et “l’opinion publique” à resserrer les rangs autour de la défense de l’État républicain “menacé par le chaos” et les actes de destruction des casseurs déguisés en “gilets jaunes” ou en costumes noirs : la loi anti-casseurs ne devait plus être contestée. On a pu entendre Macron déclarer que “personne ne peut tolérer que la République soit attaquée au nom du droit de manifester”. Il fallait faire “l’union nationale”, contre le vandalisme avec “la plus grande fermeté”, et faire accepter à tout le “peuple de France” les mesures de renforcement de l’État policier contre tous ceux qui manifestent “illégalement” et veulent mettre “la République en danger”.
Ainsi, le 20 mars, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, annonce tranquillement la mobilisation du dispositif Sentinelle, c’est-à-dire l’intervention de l’armée. Conséquence directe de cette répression étatique accrue et de ces déclarations gouvernementales musclées, le 23 mars, à Nice, Geneviève Legay, une “gilet jaune” militante d’Attac, âgée de 74 ans, est gravement blessée au cours d’une charge des forces de l’ordre. Elle devient le symbole des victimes des violences policières incessantes. Les images sur les réseaux sociaux de manifestants aux yeux crevés ou aux mains arrachées se multiplient.
La haine anti-flic grimpe alors encore d’un cran parmi les “gilets jaunes” les plus radicaux et le 20 avril, lors de la manifestation appelée “Ultimatum”, certains manifestants crient : “Suicidez-vous !” à l’encontre de policiers.
Quelles leçons tirer de ces mois de mobilisation de mars et avril ? Le gouvernement a utilisé de manière continue la violence policière comme pour souffler sur les braises. Tel était en effet son but, entretenir la colère et faire durer ce mouvement des “gilets jaunes” qui lui rendait tant de services pour mystifier le prolétariat :
– occupation de l’espace médiatique et de toutes les préoccupations sociales, permettant de passer totalement sous silence la multitude de petites grèves isolées à travers l’hexagone ;
– focalisation de la réflexion sur comment rendre la République française plus démocratique (avec le Grand débat de Macron ou avec le RIC des “gilets jaunes” ?) ;
– mise en avant des destructions du mobilier urbain par une minorité de “gilets jaunes” et de Blacks blocs afin de présenter toute lutte non-démocratique comme un “acte criminel”, une violence aveugle et ainsi légitimer le renforcement de l’arsenal répressif pour y faire face ;
– et, enfin, faire passer encore un peu plus la lutte ouvrière comme “ringarde” au profit de la novatrice contestation du “peuple français”, drapeaux tricolores brandis et Marseillaise entonnée.
Les syndicats et l’extension… du poison interclassiste
Le mouvement des “gilets jaunes” ne s’est pas développé seulement en dehors des structures syndicales, il s’est aussi positionné en grande partie contre. L’ampleur de ce mouvement interclassiste s’explique par la difficulté de la classe ouvrière à exprimer sa combativité du fait de toutes les manœuvres syndicales de sabotage des luttes (comme on l’a encore vu récemment avec la longue grève perlée à la SNCF). Ce mécontentement contre les syndicats qui existe au sein de la classe ouvrière a été récupéré par ceux qui ont lancé le mouvement. Ce que beaucoup de supporters du mouvement des “gilets jaunes” veulent faire passer, c’est que les méthodes de lutte des salariés (grève, assemblées générales souveraines et manifestations massives, comités de grève…) ne mènent à rien. Il faut donc faire confiance maintenant aux petits patrons (qui protestent contre les taxes et l’augmentation des impôts) pour trouver “d’autres méthodes de lutte” contre la vie chère, pour améliorer les institutions démocratiques et la représentativité, et rassembler tout le “peuple de France”.
Cela dit, les syndicats en ont profité pour tenter de limiter leur discrédit. Certainement pas en défendant les méthodes de luttes de la classe ouvrière, puisqu’ils passent leur temps à briser toute possibilité d’assemblée générale ouvrière, souveraine et autonome. Non, ils y parviennent en partie en tentant de coller à l’idée du “peuple” révolté. Tel est le sens des appels successifs à la “convergence” entre le mouvement des “gilets jaunes” et les mobilisations syndicales. Se sont ainsi multipliés les gilets de toutes couleurs, pour chaque secteur ou corporation. Aux assistantes maternelles : le “gilet rose”, aux cégétistes : le “gilet rouge”, aux travailleurs indépendants des travaux publics : le “gilet orange”, aux enseignants (plus originaux) : le “stylo rouge” ! Non seulement, les syndicats ont accentué les divisions dans des luttes déjà très fragmentées, éclatées par secteur et par boîte, comme ils le font systématiquement depuis un siècle, mais, en plus, les ouvriers atomisés ont été appelé à se diluer dans le “peuple” en gilet et disparaître en tant que classe. Les syndicats, CGT en tête, ont ainsi organisé de grands carnavals multicolores du mois de février au 1er mai. Ces manifestations ont donné lieu, à Paris, à de véritables cacophonies où La Marseillaise et le drapeau tricolore des “gilets jaunes” faisaient écho à L’Internationale et aux drapeaux rouges ou noirs des trotskistes (du NPA et de LO) et des anarchistes (de la CNT).
La présence, le 1er mai, en tête du cortège, de milliers de “gilets jaunes” et de quelques centaines de Black-blocs avec la bénédiction des syndicats, est venue parapher cette atomisation des travailleurs et la dilution des quelques ouvriers présents dans l’interclassisme.
Le prolétariat doit recouvrer son identité de classe
Ce mouvement des “gilets jaunes” n’est, au mieux, rien de plus que la manifestation la plus visible et spectaculaire de l’énorme colère qui gronde au sein de la population et particulièrement dans toute la classe exploitée face à la vie chère et aux mesures d’austérité du gouvernement Macron. Il n’est, au mieux, rien d’autre qu’un signe annonciateur des futurs combats de classe du prolétariat. De nombreux ouvriers se sont mobilisés contre la pauvreté, les attaques économiques incessantes, le chômage, la précarité de l’emploi… Mais en rejoignant les “gilets jaunes”, ces ouvriers se sont momentanément égarés, ils se sont mis à la remorque d’un mouvement menant dans une impasse. C’est cette impasse qui permet aujourd’hui au gouvernement Macron de redoubler d’arrogance en continuant de plus belle à porter de nouvelles attaques.
La classe ouvrière traverse une période difficile. Depuis 1989, avec les campagnes sur l’effondrement du stalinisme identifié à la prétendue faillite du communisme, le prolétariat n’a pas été en mesure de retrouver son identité de classe et de se reconnaître en tant que classe et sujet révolutionnaire. Incapable d’esquisser les contours d’une société sans exploitation, la classe exploitée, manquant de confiance en ses forces, demeure très vulnérable et se sent impuissante sur le terrain de la lutte. La classe ouvrière n’est même pas consciente de son existence en tant que classe antagonique à la classe bourgeoise et distincte des couches sociales intermédiaires (notamment la petite bourgeoisie). Elle a perdu la mémoire de son propre passé, et ne parvient même pas se référer à son immense expérience historique, dont elle a même honte puisque sans cesse la bourgeoisie assimile le mot ouvrier à une espèce disparue et le mot communisme à la barbarie du stalinisme.
Cependant, malgré ces difficultés importantes, le prolétariat n’est pas battu. Compte tenu du mécontentement général et des attaques qui se profilent, les grandes masses prolétariennes peuvent très bien sortir de cette léthargie dans la période à venir. Certes, le prolétariat a perdu momentanément son identité de classe, il est coupé de son histoire et de son expérience. Mais il est toujours là, bien vivant. Il reste le fossoyeur du capitalisme. Au plus profond de lui-même, la réflexion sur l’absence de perspective de la société capitaliste se poursuit, notamment parmi les éléments les plus conscients et combatifs. Poussé par l’aggravation de la crise économique, au début sans avoir conscience de sa force, sans croire en sa possible unité et son auto-organisation, le prolétariat sera nécessairement contraint d’engager le combat pour la défense de ses conditions d’existence. Il faut rappeler ce qu’écrivait Marx : “Il ne s’agit pas de savoir quel but tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier, se représente momentanément. Il s’agit de savoir ce que le prolétariat est et ce qu’il sera obligé historiquement de faire, conformément à cet être” (La Sainte Famille). Les journées insurrectionnelles de juin 1848 et la Commune de Paris en 1871, les luttes des années 1890 en Belgique, les combats révolutionnaires en Russie de 1905 et 1917 en Europe orientale, la révolution allemande de 1918-1919, la nouvelle irruption du mouvement prolétarien de Mai 1968 en France et dans le monde après une longue période de contre-révolution, la grève de masse en Pologne de 1980, etc., n’ont rien de commun avec le mouvement populaire interclassiste, faussement radical et jusqu’au-boutiste des “gilets jaunes”. Quand le prolétariat développera sa lutte, ce seront les assemblées générales massives, souveraines et ouvertes à tout le monde qui seront au cœur du mouvement, des lieux où les prolétaires pourront ensemble s’organiser, réfléchir aux mots d’ordre unitaires, à l’avenir. Il n’y aura alors pas de place pour le nationalisme mais, au contraire, les cœurs vibreront pour la solidarité internationale et unitaire propres à la grève de masse car “les prolétaires n’ont pas de patrie”. Les ouvriers doivent refuser de chanter La Marseillaise et d’agiter le drapeau tricolore, ce drapeau des Versaillais qui ont assassiné 30 000 prolétaires lors de la Commune de Paris en 1871 !
Pour préparer cet avenir, tous ceux qui ont conscience de la nécessité de la lutte prolétarienne doivent essayer de se regrouper, discuter, tirer les leçons des derniers mouvements sociaux, se pencher à nouveau sur l’histoire du mouvement ouvrier et ne pas céder aux sirènes, en apparence radicales, des mobilisations citoyennes, populaires et interclassistes de la petite bourgeoisie !
“L’autonomie du prolétariat face à toutes les autres classes et couches de la société est la condition première de l’épanouissement de sa lutte vers le but révolutionnaire. Toutes les alliances, et particulièrement celles avec des fractions de la bourgeoisie, ne peuvent aboutir qu’à son désarmement devant son ennemi en lui faisant abandonner le seul terrain où il puisse tremper ses forces : son terrain de classe” (Plateforme du CCI).
L’avenir appartient toujours à la lutte de classe !
Révolution Internationale, 14 août 2019
1) C’est cette nature interclassiste du mouvement des “gilets jaunes” qui explique pourquoi Marine Le Pen a salué dès la première heure un “mouvement légitime” du “peuple français” ; pourquoi Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a soutenu ce mouvement : “Il faut bloquer toute la France…), il faut que la population française dise à ce gouvernement : maintenant ça suffit !” ; pourquoi Laurent Wauquiez, alors président de Les Républicains a qualifié les “gilets jaunes” de “personnes dignes, déterminées, et qui demandent juste qu’on entende les difficultés de la France qui travaille” ; pourquoi le député Jean Lassalle, à la tête de Résistons, a été l’une des figures du mouvement et arboré son gilet jaune à l’Assemblée nationale comme dans la rue. Tout mouvement prolétarien, à contrario, est toujours soumis à un puissant réflexe de rejet et aux calomnies de la part de la classe dominante.
Récent et en cours:
- Gilets jaunes [22]
Rubrique:
Révolution internationale n° 479 - novembre décembre 2019
- 166 reads
Seules la solidarité et l’unité dans la lutte peuvent repousser les attaques !
- 224 reads
Le 27 octobre, des cheminots écrivaient dans un communiqué : “Nous agents grévistes du matériel au Technicentre de Châtillon, sur le réseau TGV Atlantique, avons cessé le travail massivement depuis lundi 21 octobre au soir, sans se concerter ou être encadrés par les syndicats. (…) Notre colère est réelle et profonde, nous sommes déterminés à nous battre jusqu’au bout de nos revendications, pour le respect et la dignité. Nous ne pouvons plus accepter de travailler avec des salaires proches du SMIC et gelés depuis 5 ans, en sous-effectif et avec des agents qui démissionnent de plus en plus. Nous avons honte de voir comment la SNCF joue avec la sécurité ou encore le confort des voyageurs, pour des questions de flexibilité et de rentabilité. (…) Les voyageurs (…) payent de plus en plus cher des trains, avec de moins en moins de service, des siéges vétustes, des rames parfois avec des toilettes condamnées, des portes bloquées, ou encore des climatisations HS en période de canicule. (…) Marre des réorganisations, des bas salaires, des suppressions d’emplois et des sous-effectifs ! Nous appelons l’ensemble des cheminots à relever la tête avec nous, car la situation aujourd’hui à Châtillon est en réalité le reflet d’une politique nationale. (…) Nous avons trop longtemps laissé faire sans rien dire, mais aujourd’hui au TATL nous disons stop à cette politique d’entreprise. Nous ne braderons pas notre dignité, notre sécurité, ni notre santé !”
Toute la classe ouvrière est attaquée
Les mêmes conditions de travail dégradées et insoutenables sont le quotidien de tous les travailleurs, de toutes les corporations, de tous les secteurs, du privé comme du public. Il y a un an, les salariés des EPAHD criaient leur détresse face à la maltraitance des personnes âgées dont ils ont la charge et aux pressions qu’ils subissent pour être toujours plus rapides et rentables. Il y a quelques mois, les urgentistes dénonçaient les sous-effectifs, les cadences infernales, l’impossibilité de soigner dignement les blessés. Le mois de septembre 2019 a été marqué par le suicide d’une directrice d’école et sa lettre poignante, symboles de la souffrance au travail de tous les enseignants, croulant sous les tâches toujours plus nombreuses. Aucune partie de la classe ouvrière n’est épargnée. Partout, les salariés doivent être de plus en plus corvéables, flexibles, adaptables, précaires…
Et les réformes en cours annoncent un avenir plus dur encore. La chasse aux chômeurs et à leurs maigres allocations est ouverte. Les futurs retraités seront plus vieux et plus pauvres. À la réduction des effectifs de fonctionnaires et à la systématisation des CDD dans le public, font écho les vagues de licenciements et l’explosion de la précarité dans le privé.
Toute la classe ouvrière est en colère
Comme à la SNCF, la colère gronde et les grèves se multiplient. Ont ainsi arrêté le travail : les pilotes de Transavia, le 1er septembre, les agents des Finances publiques, le 16, et d’EDF, le 19, des laboratoires de biologie médicale, le 1er octobre en Bretagne, des écoles, le 8 octobre, en région parisienne, de Michelin à La Roche-sur-Yon, le lendemain, les éboueurs dans le Nord, le personnel des EPAHD en Indre-et-Loire, etc. En réalité, pas un jour ne passe sans que des travailleurs à bout se mettent en grève.
Seulement, toutes ces luttes, souvent peu médiatisées, demeurent isolées les unes des autres, enfermées à l’échelle locale et de leur corporation. Que dire, par exemple, de la mobilisation des urgentistes séparée de leurs collègues des autres services du même hôpital lui-même ? Les prolétaires ne parviennent pas, aujourd’hui, à lutter en tant que classe ; ils le font en tant que cheminots, urgentistes, électriciens, enseignants, pilotes, laborantins, etc. Tous touchés par les mêmes conditions de vie et de travail inacceptables, chaque salarié se bat pourtant pour des revendications qu’il croit spécifique à sa boîte, sa branche, son métier. La raison essentielle de ce morcellement est que les ouvriers ne se sentent plus appartenir à une classe, à une classe qui, unie et solidaire dans la lutte, représente la plus grande force sociale de la société. La bourgeoisie est parvenue à leur faire croire que la classe ouvrière n’existait plus, qu’ils n’étaient pas des ouvriers mais des cheminots, des urgentistes, des électriciens, des enseignants, des pilotes, des laborantins. Mieux encore, aux yeux de la classe dominante : des “citoyens”.
Divisions gouvernementales, divisions syndicales
Diviser pour mieux régner est un vieil adage. Le gouvernement l’applique à la lettre. Les agents de la RATP seraient des égoïstes qui “gagnent plus de 3 000 euros à la retraite”, les fonctionnaires seraient des “privilégiés” pour qui sont comptabilisés les six derniers mois de carrière pour le calcul de leur retraite. Les navigants et les infirmières refuseraient la solidarité en voulant conserver leur régime “autonome”... Les mensonges et les prétextes pour opposer les travailleurs les uns contre les autres sont sans fin. Toute cette propagande n’existe que pour justifier, au nom de “l’équité” et de la “justice”, une attaque généralisée contre les travailleurs.
Ce discours médiatique et gouvernemental est accompagné sur le terrain d’une séparation systématique des luttes entre elles par les syndicats. En septembre et octobre, toute une série de journées d’action a ainsi été programmée en ordre dispersé : RATP, Trésor public, Éducation nationale, Ministère de la Justice, EDF, pompiers… à chaque secteur sa journée, ses mots d’ordre, sa lutte.
Un seul exemple symbolise le travail permanent des syndicats pour saper l’unité ouvrière : alors que le 13 septembre, ils organisaient une grande journée d’action à la RATP pour défendre son régime spécial, le 16 septembre, les syndicats faisaient sortir les infirmières, les libéraux, les navigants et les avocats dans la rue en opposant ces travailleurs à tous les autres : “Les avocats comme les professions libérales dans leur ensemble bénéficient de ce qui s’appelle un régime autonome, qu’il ne faut pas confondre avec les régimes spéciaux” ; “Nous ne sommes absolument pas opposés à une réforme des retraites. (…) Un régime universel (…) peut être acceptable. (…) En revanche, nous exigeons de conserver notre régime complémentaire” ; “On ne demande pas à la fourmi de donner à la cigale !”…
Seulement, cette division par les syndicats était par trop caricaturale. Ils prenaient le risque que la colère ne déborde et, surtout, d’être trop discrédités. En octobre, ils ont donc annoncé une grande journée de grève rassemblant tous les salariés pour le… 5 décembre ! Pourquoi une date si tardive ? Pourquoi ne pas battre le fer tant qu’il est chaud ? Pour le laisser refroidir, justement. Le secrétaire d’État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a lui-même craché le morceau, jeudi 31 octobre, comme le rapporte le journal Ouest-France : “Ça bouillonne dans les rangs de la SNCF et la grève contre la réforme des retraites se profile à l’horizon… Dans ce contexte, l’exécutif “a un mois pour (…) faire baisser la tension, pour répondre à des angoisses qui souvent sont légitimes et pour tracer le chemin pour la convergence de ces régimes spéciaux”. (…) “Nous avons pris l’engagement, à la RATP comme à la SNCF, d’étudier toutes les options, y compris celles qui sont portées par les syndicats” (…), faisant référence à la “loi du grand-père” selon laquelle seuls les nouveaux embauchés seraient concernés par la réforme”. Pour calmer le jeu, le gouvernement mise donc encore et toujours sur l’action syndicale et… la division, celle entre les générations ouvrières cette fois.
Comment lutter ?
Les grèves spontanées des cheminots de la fin octobre montrent en partie la voie à suivre. À Châtillon, suite à l’annonce d’un plan de réorganisation du travail induisant, entre autres, une suppression de douze jours de congés, les agents du centre ont immédiatement arrêté le travail et déclaré la grève, sans attendre de consignes syndicales. Le plan a été retiré 24 heures plus tard. Quelques jours plus tôt, le 16 octobre, suite à une collision avec un convoi exceptionnel en Champagne-Ardenne, mettant en évidence la dangerosité de n’avoir qu’un seul agent (le conducteur) dans un train, les cheminots de la ligne avaient, eux aussi, refusé spontanément de maintenir les transports dans ces conditions. La contestation s’est étendue rapidement, dès le lendemain, aux lignes de l’Île-de-France. Le 17 au soir, les syndicats reprenaient le contrôle de la situation, en proclamant le droit de retrait au plan national pour les 18 et 19.
Ce n’est pas un hasard si ce sont les cheminots qui indiquent les premiers comment les travailleurs peuvent prendre en main leur lutte. C’est la conséquence à la fois de l’expérience et de la combativité historiques de ce secteur de la classe ouvrière en France, mais aussi de la réflexion qui mûrit depuis un an en son sein après l’amère défaite du long mouvement mené en 2018 par… les syndicats. Ils avaient alors enfermé les cheminots dans une lutte, seuls, isolés, jusqu’à l’épuisement de leur force.
Mais les difficultés et faiblesses sont encore nombreuses pour développer une lutte massive, unie et solidaire. Par exemple, ces cheminots grévistes sont demeurés cloîtrés au sein de la SNCF. Il n’y a pas eu d’assemblées générales autonomes décidant d’envoyer des délégations massives, voire toute l’assemblée, aux centres de travail le plus proche (un hôpital, une usine, une administration…) pour les entraîner dans la lutte, pour étendre géographiquement le mouvement, pour cultiver cette idée que les ouvriers ont tous les mêmes intérêts, qu’ils mènent la même lutte, que c’est unie et solidaire, au-delà des secteurs et des corporations, que la classe ouvrière est forte.
Cette étape est difficile. C’est un véritable cap. Elle implique de se reconnaître non plus comme cheminots, infirmiers, enseignants ou informaticiens, mais comme ouvriers. Pour la franchir, les ouvriers les plus conscients doivent diffuser l’idée que c’est possible, que l’histoire et l’expérience du mouvement ouvrier le prouvent, qu’en 1968 les travailleurs de France ou en 1980 ceux de Pologne l’ont fait, que le prolétariat est la principale force sociale de la société quand elle est unie, solidaire et organisée. Ces ouvriers doivent se regrouper, discuter, se réapproprier les leçons du passé, pour préparer l’avenir de la lutte de classe. Ces ouvriers, si peu nombreux soient-ils aujourd’hui, ont une grande responsabilité, celle de faire vivre la mémoire de l’immense expérience de lutte de la classe ouvrière.
Pawel, le 7 novembre 2019
Géographique:
- France [24]
Situations territoriales:
Rubrique:
Mouvement social au Chili: l’alternative dictature ou démocratie est une impasse
- 198 reads
Nous assistons depuis plusieurs semaines à l’émergence de nombreux mouvements sociaux dans plusieurs pays sur différents continents : Liban, Irak, Équateur, Bolivie, Haïti, Guinée, Algérie… Bien que ces mobilisations aient leurs particularités, elles expriment toutes une réaction de protestations et de colère face aux effets de la crise économique qui a connu un nouveau regain ces derniers mois. Nous traiterons prochainement sur notre site internet de ces mobilisations internationales de manière plus globale. En attendant, nous publions ci-dessous un article écrit par nos camarades en Amérique latine au sujet du mouvement social qui a lieu actuellement au Chili. Certaines analyses dressées dans cet article sont applicables à d’autres mobilisations actuelles. Tous ces mouvements, de par leur nature interclassiste et populaire, ainsi que par les illusions auxquelles ils sont prisonniers mènent fatalement à une impasse et constituent un piège pour le prolétariat mondial. Par conséquent, ils mettent en évidence la grande responsabilité qui incombe au prolétariat des pays centraux du capitalisme, le plus expérimenté, le plus aguerri aux pièges tendus par la bourgeoisie, et le seul capable de montrer la direction vers la lutte autonome de la classe ouvrière mondiale.
Ce qui se passe au Chili découle de la crise économique internationale qui se manifeste dans ce pays par le déficit budgétaire que l’État chilien traîne depuis plusieurs années. Des organismes tels que la Banque mondiale, le FMI et la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes indiquent une réduction progressive de la croissance au cours des trois ou quatre dernières années. En dépit des efforts déployés pour diversifier son économie, le Chili est essentiellement dépendant du cuivre dont le cours, en tant que manifestation de l’aggravation de la crise, a fortement chuté. Les mesures d’augmentation des tarifs du métro tentent de répondre à la situation de déficit de l’État chilien. À l’échelle mondiale, les premiers pas d’un important bouleversement économique sont en cours et, comme dans d’autres épisodes de la crise capitaliste, les pays les plus faibles sont les premiers touchés : le Brésil, la Turquie, l’Argentine, l’Équateur et maintenant le Chili.
L’idée que le Chili serait une “exception” en Amérique du Sud en raison de sa situation économique ou du prétendu “bien-être” de sa classe ouvrière est clairement démentie. Piñera a dû ravaler ses proclamations triomphalistes selon lesquelles “le Chili était une oasis de paix et de prospérité en Amérique du Sud”.
Ce qui apparaît derrière cet écran de fumée, c’est la moyenne des salaires à 368 €, la précarité généralisée, le coût disproportionné de la nourriture et des services, les graves lacunes en matière d’éducation et de santé, le système de retraite qui condamne les retraités à la pauvreté. Une réalité qui montre la dégradation croissante des conditions de vie de la classe ouvrière et de l’ensemble de la population.
L’explosion des troubles sociaux
Le gouvernement Piñera a sous-estimé le degré d’agitation sociale. Une attaque, apparemment anodine, provoquée par la hausse des tarifs du métro à Santiago, a déchaîné la colère générale. Cependant, la réponse ne s’est pas posée sur le terrain de classe du prolétariat, mais dans un autre contexte défavorable et dangereux pour lui : la révolte populaire et éventuellement favorisée par l’État, la violence minoritaire et l’action du lumpenproletariat.
Profitant de cette faiblesse de la riposte sociale, le gouvernement a lancé une répression brutale qui, selon les chiffres officiels, aurait fait 19 morts. L’état de siège est décrété depuis plus d’une semaine et le maintien de l’ordre a été confié à l’armée. Les tortures sont revenues comme dans les pires moments de Pinochet, démontrant que la démocratie et la dictature sont les deux faces du même État capitaliste. L’irruption du lumpenproletariat avec son vandalisme, les pillages, les incendies, la violence irrationnelle et minoritaire, typique de la décomposition capitaliste, (1) ont été utilisées par l’État pour justifier la répression, semer la peur dans la population et intimider le prolétariat, détournant ses tentatives de lutte vers le terrain de la violence nihiliste sans aucune perspective. (2)
Des mobilisations syndicales pour démobiliser et démoraliser les travailleurs
Cependant, la bourgeoisie chilienne a compris que la brutalité répressive ne suffisait pas pour calmer le mécontentement. Pour cette raison, le gouvernement Piñera a fait son mea culpa, le président si arrogant a adopté une pose “humble”, a déclaré “comprendre” le “message du peuple”, a “provisoirement” retiré les mesures et a ouvert la porte à un “accord social”. Il faut traduire cela par : les attaques seront imposées par la “négociation”, autour d’une “table de dialogue” où les partis de l’opposition, les syndicats, les employeurs, tous ensemble “représenteront la Nation”.
Pourquoi ce changement d’attitude ? Parce que la répression n’est pas efficace si elle n’est pas accompagnée de la tromperie démocratique, du piège de l’unité nationale et de la dissolution du prolétariat dans la masse amorphe du “peuple”. L’attaque économique requise par la crise nécessite la répression, mais surtout une offensive politique.
Le prolétariat, bien que subissant une situation de faiblesse importante au Chili et dans le monde, reste la menace historique à l’exploitation et à la barbarie capitaliste. Par conséquent, celui du Chili, l’un des plus concentrés en Amérique du Sud, a une certaine expérience politique. Il a, par exemple, participé au mouvement de grève de masse en 1907 à Iquique (3) et a subi le terrible coup de la duperie d’Allende (1970-1973) qui a préparé le terrain à la dictature brutale de Pinochet (1973-1990).
L’offensive politique de la bourgeoisie a connu une première étape avec les mobilisations syndicales appelant à une “grève générale” plus d’une semaine plus tard. Quel cynisme ! Lorsque le gouvernement a adopté la mesure de hausse de prix du métro, les syndicats n’ont appelé à rien. Lorsque le gouvernement a déployé l’armée dans les rues, ils ont gardé un silence complice. Lorsque l’armée et les carabiniers sont intervenus, ils n’ont pas davantage bougé le petit doigt. Et maintenant, ils appellent à la “mobilisation”.
Lorsque les travailleurs doivent se battre, les syndicats les paralysent. Lorsque les travailleurs se lancent dans la bataille, les syndicats les bloquent. Et lorsque les travailleurs n’ont plus de forces ou sont désorientés, les syndicats appellent à “la lutte”. Les syndicats agissent toujours contre les travailleurs, aussi bien lorsqu’ils s’opposent à une grève spontanée que lorsqu’ils appellent à se battre alors les travailleurs sont faibles, confus ou divisés. Les syndicats démobilisent la mobilisation des prolétaires et ne se mobilisent que pour parvenir à une démobilisation plus forte encore.
Les groupes de gauche d’obédience trotskiste, stalinienne ou maoïste parachèvent le piège en proposant “une grève générale illimitée”, leur parodie “d’auto-organisation des travailleurs” où, au lieu d’assemblées et de comités de grève élus et révocables, ils mettent en place une “coordination” composée de syndicalistes et de groupes gauchistes. Son “alternative politique” est de “jeter Piñera dehors”. Pourquoi ? Pour le remplacer par une Michelle Bachelet qui, au cours de ses deux mandats, a fait la même chose ou pire ? Choisir une “assemblée constituante” ? Derrière leur radicalisme de façade et leurs discours au nom de la “classe ouvrière”, les gauchistes défendent le capitalisme parce qu’ils enferment les travailleurs sur le terrain de la défense de la démocratie et dans le cadre des méthodes de “luttes” syndicales.
L’offensive politique de la bourgeoisie chilienne
La deuxième phase de l’offensive a été l’entrée sur la scène des partis d’opposition (la nouvelle majorité, le parti stalinien et le Front démocratique) qui ont appelé à la “négociation” et au “consensus” et qui ont salué comme une “victoire” les quelques miettes que Piñera a accordées. En liaison avec le gouvernement et l’armée, (4) la bourgeoisie chilienne s’est donnée un cadre pour porter un nouveau coup idéologique à la conscience du prolétariat, pour dissoudre toute tentative en son sein d’agir comme classe autonome, pour l’attacher au char de la Nation, l’accrocher aux idéologies de l’ennemi de classe, en particulier à la démocratie.
Des mobilisations importantes ont été organisées le week-end du 25 au 27 octobre avec les axes suivants :
– L’unité nationale : ainsi, lors de la manifestation de Santiago où un million de personnes se sont rassemblées, le slogan était : “Le Chili se réveille”. C’est-à-dire, qu’on affirme qu’il ne s’agissait pas d’une confrontation de classe mais d’une prétendue lutte de la “Nation entière” contre une minorité de corrompus et de voleurs. À l’époque d’Allende, le slogan était : “le peuple uni, jamais ne sera vaincu”. Nous devons nous rappeler contre cette mystification qui revient au goût du jour que “le prolétariat dilué dans le peuple et la nation toujours sera vaincu”.
– Réclamer une “nouvelle constitution”. Une “assemblée constituante” est revendiquée. C’est un piège crapuleux. En Espagne, en 1931, la “nouvelle constitution” affirmait que l’Espagne était une “République ouvrière”. C’est cette république qui a assassiné 1 500 personnes dans la répression des grèves ouvrières entre 1931 et 1933. En 1936, Staline proclamait pour l’URSS “la constitution la plus démocratique du monde”, en même temps qu’elle initiait les procès de Moscou où elle liquidait les derniers bolcheviks et intensifiait la terreur la plus féroce. La République de Weimar a réprimé la tentative de révolution prolétarienne en Allemagne (1918-1923) et a permis la montée légale d’Hitler et de la terreur nazie en 1933.
– L’orientation est de dissoudre le prolétariat dans la masse indistincte et manipulable du “peuple” où toutes les classes sociales “s’uniraient” dans le corps de la nation. Sur la place d’Italie de Santiago, une grande banderole indiquait “Pour la dignité de notre peuple, manifestez dans la rue sans crainte”. Le terme à la mode dans les médias chiliens est de parler de “mouvement transversal”. Ce mot signifie qu’il n’y aurait plus de lutte de classe, mais “un mouvement qui traverse toute la ville” dans lequel même les enfants des riches quartiers résidentiels de Santiago seraient inclus. Le président Piñera a publié ce tweet : “La marche massive, joyeuse et pacifique d’aujourd’hui, où les Chiliens demandent un Chili plus juste et plus équitable, ouvre de grandes voies pour l’avenir et donne de l’espoir. Nous avons tous entendu le message. Nous avons tous changé. Avec l’unité et l’aide de Dieu, nous ferons la route de ce Chili meilleur pour tous”. C’est le comble du cynisme ! Mais cela nous donne aussi la mesure de la manœuvre politique de la bourgeoisie. Même le responsable du métro de Santiago a affiché fièrement la photo de sa fille participant à la manifestation !
La bourgeoisie impose la misère, la barbarie et le meurtre, sous le drapeau de la démocratie
Nous dénonçons cette manœuvre politique de la bourgeoisie basée sur la démocratie. La démocratie est la forme la plus perverse et la plus retorse de la domination capitaliste. Au nom de la démocratie, les pires massacres contre les travailleurs ont été perpétrés. Pour se limiter au seul cas du Chili, il faut se souvenir que lors de la grève de masse d’Iquique en 1907, 200 travailleurs ont été tués rien qu’au cours du massacre dans l’école de Santa María. Le “champion de la démocratie”, Salvador Allende, a brutalement réprimé les luttes des mineurs contre la hausse des cadences et la baisse des salaires. “En mai-juin 1972, les mineurs se sont à nouveau mobilisés : 20 000 personnes se sont mises en grève dans les mines d’El Teniente et de Chuquicamata. Les mineurs d’El Teniente ont réclamé une augmentation de salaire de 40 %. Allende a placé les provinces de O’Higgins et de Santiago sous contrôle militaire, la paralysie d’El Teniente “menaçant sérieusement l’économie”. Les dirigeants “marxistes” de l’Union populaire ont expulsé les travailleurs et les ont remplacés par des briseurs de grèves. Cinq cents carabiniers ont attaqué les ouvriers à l’aide de gaz lacrymogène et de canons à eau. Quatre mille mineurs se sont rendus à Santiago pour manifester le 11 juin. La police les a chargés sauvagement. Le gouvernement a traité les mineurs comme des “agents du fascisme”. Le PC a organisé des défilés à Santiago contre les mineurs, appelant le gouvernement à faire preuve de fermeté”. (5)
Toutes les fractions de la bourgeoisie, et en particulier la gauche, ont resserré les rangs pour défendre l’État capitaliste “démocratique”. “En novembre 1970, Fidel Castro est venu au Chili pour cautionner les mesures anti-ouvrières d’Allende. Castro a réprimandé les mineurs, les traitant comme des agitateurs et des “démagogues”. À la mine de Chuquicamata, il a déclaré que “cent tonnes de moins par jour entraînent une perte de 36 millions de dollars par an”. (6)
Allende a envoyé l’armée réprimer les ouvriers, mais pire encore, lors d’un rassemblement devant le Palais de La Moneda, en juin 1972, il a fait applaudir Pinochet en le présentant comme “un militaire fidèle à la Constitution”.
Le rétablissement de la démocratie depuis 1990 n’a apporté aucune amélioration aux conditions de vie et de travail. Les différents présidents (d’Alwyn à Bachelet, en passant par Lagos ou le premier mandat de Piñera) ont préservé et renforcé la politique économique promue par l’École de Chicago qui a imposé la dictature de Pinochet. Ils n’ont pas du tout touché à un système de retraite qui condamne les retraités à recevoir une pension inférieure au salaire minimum, à continuer à travailler et à survivre avec de petits boulots jusqu’à 75 ans ou plus. Un système qui refuse toute pension future aux nombreux jeunes condamnés à des emplois précaires. Le Chili est aujourd’hui l’un des pays les plus inégalitaires au monde et l’inégalité s’est aggravée avec la démocratie : “Lorsque nous avons retrouvé la démocratie, le gouvernement militaire, qui avait également été mauvais en économie, a laissé un taux de pauvreté de 4,7 %. Aujourd’hui, notre PIB a plus que doublé, nous sommes plusieurs fois plus riches qu’alors. Mais le pourcentage de pauvres s’est élevé à 35 %”. (7)
La gauche agissant en tant que porte-parole privilégié de la bourgeoisie nous appelle à soutenir la démocratie et à considérer la dictature comme le mal suprême : comme si cette dictature avait le monopole de la répression et de la spoliation des travailleurs, sa devise étant “Non à la dictature, oui à la démocratie parlementaire”. Toute cette propagande fait beaucoup de dégâts dans la classe ouvrière, car elle lui fait croire qu’elle est “libre”, qu’elle peut “choisir”, qu’avec le vote elle aurait le “pouvoir” et surtout, elle atomise et individualise les travailleurs, où il s’agit d’effacer en eux tout sentiment de solidarité et d’unité en les poussant dans les eaux fangeuses d’un engrenage de la rivalité et du chacun pour soi, de “la loi du plus fort” et du “ôte-toi de là pour que je m’y mette”.
Les méthodes de lutte de la classe ouvrière
Les travailleurs et leurs minorités les plus conscientes doivent rejeter le piège tendu par la bourgeoisie et préparer méthodiquement le terrain pour l’émergence de véritables luttes ouvrières. Cette perspective est encore très lointaine et ne découlera pas d’une somme de processus dans chaque pays mais d’une dynamique internationale dans laquelle le rôle des grandes concentrations de main-d’œuvre expérimentée de l’Europe occidentale sera fondamental. (8)
La classe ouvrière au Chili et dans le monde entier doit se réapproprier les véritables méthodes de la lutte ouvrière qu’ont développé de nombreuses luttes à travers l’histoire (Mai 68 en France, 1980 en Pologne, le mouvement anti-CPE de 2006 en France, le mouvement des Indignés en Espagne en 2011). Ce sont des méthodes de lutte et d’organisation radicalement opposées à celles du syndicalisme :
– La grève massive que les travailleurs déclenchent par leur propre décision en dehors des voies légales et syndicales.
– Des assemblées générales ouvertes à tous les travailleurs, actifs et au chômage, à la retraite, aux étudiants, aux futurs travailleurs, aux émigrés comme aux natifs du pays, TOUS ENSEMBLE.
– L’extension directe des luttes à travers des délégations massives.
– La coordination et l’unification des luttes assurée par des comités élus et révocables.
Des conclusions claires s’imposent :
– Face aux attaques brutales telles que celles de l’Équateur ou du Chili, la réponse n’est pas la révolte populaire, le pillage ou la violence minoritaire, mais la lutte de classe autonome.
– La lutte doit être contrôlée par les travailleurs eux-mêmes contre le sabotage des syndicats.
– Contre la répression, les travailleurs doivent s’unir et se défendre par la solidarité et une réponse ferme et combative. Prolonger le combat et atteindre l’unité de la classe est la seule défense possible.
– Comme on l’a vu précédemment en Équateur et lors des révoltes au Chili, le drapeau national a été brandi. C’est le drapeau de l’exploitation, de la répression et de la guerre. C’est le drapeau du capital.
– Le capitalisme s’enfonce dans une crise mondiale qui causera toujours plus de misère et de souffrance et se joindra à de nouvelles guerres impérialistes et à une destruction accrue de l’environnement.
– Le problème est mondial et n’a pas de solution nationale. Il n’y a qu’une solution globale et cela ne peut être fait que par la lutte internationale des travailleurs.
Nous savons que cette perspective de combat va coûter cher. De nombreuses luttes, de nombreuses défaites, de nombreuses leçons douloureuses seront nécessaires. Cependant, nous avons les leçons de trois siècles d’expériences qui, élaborées par la théorie marxiste, nous donnent les moyens théoriques, organisationnels et politiques de contribuer à ce combat. L’organisation communiste internationale est l’organe qui défend cette continuité historique du prolétariat. Ses principes programmatiques, politiques, organisationnels et moraux sont la synthèse critique globale de cette expérience historique mondiale de trois siècles de lutte de classe. Construire l’organisation, la défendre, la renforcer, est la meilleure contribution au combat du prolétariat, aujourd’hui à contre-courant de toute cette campagne pour l’union nationale autour de la défense de la démocratie et demain en faveur de la renaissance de la lutte de classe internationale du prolétariat.
CCI, 1er novembre 2019
1) Voir : “La décomposition, phase ultime du capitalisme”, Revue internationale n° 107.
2) Le prolétariat a besoin de recourir à la violence de classe, mais celle-ci n’a rien à voir et s’oppose à la terreur de la bourgeoisie, au terrorisme de la petite bourgeoisie et au vandalisme sauvage du lumpen. Voir : “Terreur, terrorisme et violence de classe”, Revue internationale n°14 et la résolution à ce sujet dans la Revue internationale n° 15.
3) Voir, en espagnol sur notre site internet : “Le mouvement ouvrier au Chili au début du XXe siècle”.
4) Le chef de la Défense nationale, le militaire Iturriaga del Campo, a contredit le chef de l’État qui avait déclaré qu’il était “en guerre” en déclarant : “je suis un homme heureux, la vérité est que je ne suis en guerre avec personne”.
5) Voir : “Il y a 30 ans, la chute d’Allende : la dictature et la démocratie sont les deux visages de la barbarie capitaliste”, Révolution internationale n° 339.
6) Idem.
7) Voir en espagnol : “Crisis en Chile : es la desigualdad, estúpido” sur le site internet clarin.com.
8) Voir sur notre site la “Résolution sur le rapport de forces entre les classes” (2019) du 23e congrès international du CCI.
Géographique:
Rubrique:
Mort de Chirac: un représentant typique du cynisme de la bourgeoisie
- 133 reads
L’ancien président de la République Jacques Chirac est décédé et la classe ouvrière ne le pleurera pas. Il était prétendument un homme d’État exceptionnel qui marquera l’histoire, un homme au “charisme extraordinaire”, “proche du peuple”, “bon vivant”, “fidèle en amitié”, “défenseur de la paix” en 2002, “écolo d’avant-garde et éveilleur des consciences” en 2004. Que de mensonges ! Lui-même affirmait cyniquement en 1988 que “les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent”. Sa fidélité ne valait que pour les intérêts de sa classe, la bourgeoisie qui lui rend hommage aujourd’hui.
Pour le prolétariat, c’est une autre affaire : il a concrètement vécu dans sa chair toutes les activités de Chirac au service des intérêts bourgeois, contre les conditions de vie ouvrières, pendant plus de quarante ans. Alors oui, souvenons-nous…
40 ans d’attaques contre la classe ouvrière
Les débuts de la vie politique de Chirac heurtent d’ailleurs de plein fouet la lutte de la classe ouvrière en Mai 68. Face à une grève générale qui comptera jusqu’à 10 millions de grévistes, le pouvoir veut reprendre le contrôle des événements jugés de plus en plus dangereux. Pompidou, Premier ministre, confie le soin à son jeune secrétaire d’État à l’Emploi, Jacques Chirac, de secrètement prendre contact avec les syndicats, notamment la CGT pour négocier ce qui deviendra les Accords de Grenelle. Un journaliste (Guy Konopnicki) rapportera d’ailleurs une anecdote significative lors de la rencontre entre Jacques Chirac et Krasucki, numéro 2 de la CGT à l’époque : “Chirac faisait des bonds à chaque revendication… Dix millions de grévistes et l’envoyé du gouvernement qui s’agite sur sa chaise à chaque proposition. Il n’avait rien préparé. Pas une idée ! Il se figurait que la proclamation des Soviets était imminente, alors je lui ai dit qu’à notre avis, la prise du Palais d’hiver, ce n’était pas pour tout de suite”. La version de l’histoire est bien sûr toute autre quand Chirac prétend en 1977 que “la rencontre s’était déroulée dans une chambre de bonne, une sorte de planque clandestine”. Il se vantait même de s’y être rendu “avec un revolver dans la poche !” (sic). S’il a pu vendre un temps le journal du parti stalinien dans sa jeunesse et se donner l’illusion d’une activité sinon “prolétarienne”, du moins populaire, cela a toujours été en défense du capitalisme. Sa défense inflexible de l’État en 68 fut marquée par une détermination et une volonté de “rétablir l’ordre” le plus rapidement possible. Pompidou l’appelait d’ailleurs “mon bulldozer”.
S’il y a effectivement eu une constante chez Jacques Chirac, c’est bien pour attaquer la classe ouvrière. Après avoir gravi tous les échelons, ce “loup politique”, grand serviteur de l’État, s’est appliqué à attaquer la classe ouvrière dans la période qui s’ouvrait avec l’inflexion de la crise :
– Lors du mouvement social de 1995, un des plus massifs depuis 68 du fait d’une vaste manœuvre syndicale, Chirac fraîchement élu et son Premier ministre Juppé s’attaquent violemment aux régimes des retraites et à la sécurité sociale, signant ainsi le début d’attaques qui se poursuivent jusqu’à aujourd’hui.
– Fin 2003, après un autre mouvement social d’ampleur, Chirac inaugure une nouvelle offensive contre les chômeurs et une nouvelle aggravation des conditions de vie : pression accrue sur les salaires avec l’augmentation de la CSG, plan de démantèlement du système de protection sociale, licenciements dans le secteur privé, suppressions d’emplois dans le secteur public, etc.
– En 2006, la mobilisation massive des étudiants en France contre les attaques économiques du gouvernement voulant faire passer coûte que coûte le “Contrat première embauche” (CPE), aboutit à faire reculer le gouvernement par une lutte exemplaire.
Chirac, figure dégénérée du gaullisme
Avec cette nouvelle période, ouverte en 68 et la réapparition de la crise économique, la bourgeoisie française est consciente qu’elle doit se débarrasser de certains héritages archaïques du gaullisme et de son fonctionnement rigide, trop pyramidal. De plus, de façon chronique, la droite gaulliste, au lieu d’être le levier d’une politique cohérente au service des besoins supérieurs du capital français, s’avère n’être qu’un panier de crabes, de clans qui s’entre-déchirent, pire, un ramassis d’ambitions personnelles, où chaque chef de bande veut être calife à la place du calife. Chirac en est l’expression la plus aboutie ! Saboteur, traître à ses “amis”, opportuniste, arriviste… Chirac concentre tous les qualificatifs mais surtout les concrétise à merveille !
Clairement, Chirac n’a jamais fait l’unanimité au sein du camp gaulliste. Dès les années 1970, les gaullistes “historiques” s’insurgent contre cet arriviste. Chaban-Delmas, dont la candidature à la présidence de la république sera directement sabotée par Chirac au profit de Giscard d’Estaing, estime que “Chirac n’a découvert le gaullisme qu’en comptant les sièges de l’Assemblée”. De même, le ministre Robert Boulin, en 1974, qualifie son arrivée à la tête de l’UDR de “hold-up” et il n’est pas exclu que cette confrontation lui ait été facturée au prix fort : il sera en effet “suicidé” en 1979. Certains avancent que le Service d’action civique (SAC), officine gaulliste de barbouzes aurait commandité l’assassinat dans la crainte que Boulin ne dévoile le réseau de fausses factures participant au financement du RPR.
Pour autant, son appui à la fraction libérale de la bourgeoisie française, la plus à même d’être l’alternative cohérente au gaullisme déclinant, n’est que de circonstance. Dès 1976, il quitte son poste de Premier ministre avec fracas et dénonce dans la foulée le “parti de l’étranger”, c’est-à-dire l’UDF en accusant le parti de Valéry Giscard d’Estaing d’agir au nom de l’Europe et “contre les intérêts de la France” ! En 1995, c’est encore le clan autour de Chirac qui empêche la victoire de Balladur, alors que celui-ci représentait une possible transition permettant à la bourgeoisie française de se débarrasser des fractions gaullistes les plus rétrogrades et archaïques.
En 1997, la dissolution du parlement exigée par Chirac et l’organisation d’élections législatives anticipées échoue du fait que la majorité est de plus en plus discréditée par ses propres divisions. Cela, alors que le but était, dans un tel contexte, de resserrer l’équipe gouvernementale en vue d’accélérer les attaques anti-ouvrières (ce qui aurait pu également permettre au PS de se refaire une santé dans l’opposition).
En 2005, rebelote : en choisissant le référendum pour l’acceptation de la constitution européenne, Chirac prend le risque d’un “vote sanction”, alors qu’il aurait pu faire ratifier la constitution par voie parlementaire comme s’apprête à le faire la bourgeoisie en Allemagne. Le “Non” l’emporte.
Lors des élections présidentielles de 2002, Chirac sera élu massivement contre Le Pen. “Votez escroc, pas facho !” était le slogan repris massivement par les jeunes. Chirac était en effet caricaturé en “Super Menteur” tous les soirs dans une émission satirique à la télé et risquait d’être mis en examen s’il n’était pas réélu : ce n’était pas des casseroles que se trimballait Chirac mais une véritable batterie de cuisine !
Chirac et les affaires
La bourgeoisie est une classe de truands et de “ripoux” avec des mœurs de gangsters aux pratiques mafieuses. Les scandales n’ont cessé d’éclabousser les principaux partis bourgeois en France au cours de ces dernières décennies, à gauche comme à droite. Chirac n’a pas d’exclusivité en pratiques douteuses et clientélistes. Mais il atteint des sommets ! Difficile de faire un listing complet de toutes les affaires auxquelles Chirac est associé :
– Emplois fictifs de la Mairie de Paris : durant son bail à l’hôtel de ville (de 1977 à 1995), Chirac aura distribué les jobs comme on multiplie les pains : 699 “chargés de mission”, reflétant toute sa galaxie affective ou politique.
– L’ “affaire Karachi” : affaire politico-financière impliquant Chirac et Balladur et à l’origine de l’attentat du 8 mai 2002 dans cette ville du Pakistan.
– Affaire Elf : Elf-Gabon est devenue dans les années 1980-1990 la principale caisse noire de l’État français, au profit de chefs d’État africains (la politique impérialiste des réseaux Françafrique oblige !) et de plusieurs partis politiques français, dont le Parti socialiste et le RPR.
– L’affaire des HLM de la ville de Paris en 2006 : un marché de 2,2 milliards d’euros avec commissions destinées à alimenter, de façon occulte, les caisses du RPR. La cassette posthume de Jean-Claude Méry, faux facturier et membre du comité central du RPR, relatant les magouilles de Chirac sera envoyée… aux oubliettes !
– L’affaire de la rénovation des lycées d’Île-de-France entre 1988 et 1995 : un pactole de 24 milliards de francs, contre le reversement occulte de 200 millions à différents partis (tous, sauf le FN et les Verts).
L’ombre de Jacques Chirac plane également sur deux autres feuilletons judiciaires : l’affaire “Clearstream” et l’ “Angolagate”. Il n’est plus question de gros sous, mais de règlements de comptes en coulisses via un cabinet noir de l’Élysée consignant scrupuleusement les boules puantes visant les concurrents de droite comme de gauche.
La pourriture généralisée des mœurs de la classe dominante n’est qu’une des expressions de la décadence de ce système. L’avalanche des coups tordus et les affrontements sans merci témoignent de la violence exceptionnelle des règlements de compte entre les hommes et les clans rivaux au sommet de l’État. Cependant, les “affaires” à répétition du clan Chirac ont régulièrement discrédité l’État français sur la scène internationale, en particulier au sein de l’Europe.
Chirac, “le pacifiste”
Celui qu’on a fait passer pour le chef de file mondial de la cause “anti-guerre” en 2003, n’était en fait qu’un va-t-en-guerre de la pire espèce. Il l’a démontré à plusieurs occasions : au Kosovo en 1999, dans les bombardements sur la Serbie, en Afghanistan en 2001. Le refus de participation à la guerre en Irak en 2003 était une manière de prendre la tête d’une campagne dirigée directement contre les États-Unis. Le véritable objectif de ce vernis “anti-guerre”, c’était de pouvoir affirmer ses propres ambitions impérialistes en cherchant à contrecarrer la domination de l’impérialisme américain sur le Moyen-Orient.
Comble du cynisme, les puissances européennes avaient misé sur une guerre plus longue et meurtrière, sur davantage de résistance dans les populations ou l’armée de Saddam Hussein, sur un exode massif des populations et un grand nombre de réfugiés, espérant ainsi que les méthodes et le manque d’efficacité des États-Unis seraient discrédités.
Son “pacifisme” s’est concrétisé également dans la répression sanglante de la grotte d’Ouvéa. Le 5 mai 1988, sur l’île d’Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, des forces spéciales françaises et le GIGN prennent d’assaut une grotte dans laquelle des indépendantistes kanaks détiennent des gendarmes. Au terme de combats très violents, dix-neuf ravisseurs kanaks et deux militaires sont tués. À propos des kanaks, Chirac parlera de “la barbarie de ces hommes, si l’on peut les appeler ainsi”. Sans commentaire…
Chirac et l’immigration
Le portrait de Chirac serait incomplet sans son mépris, sa xénophobie vis-à-vis des prolétaires étrangers. En 1991, sa “compassion” pour les braves Français qui doivent “supporter les bruits et les odeurs” de leurs voisins de palier “musulmans” ou “noirs”, “polygames” et “profiteurs” sera certes dénoncée, mais comme un travers circonstanciel : des mots prononcés “sous l’effet de l’alcool” mais “ne reflétant pas le personnage”. Pourtant Chirac ne faisait que confirmer ce qu’il disait quelque temps auparavant : “Plus on aura d’immigration, plus on aura d’insécurité. Ce n’est pas une question ethnique, mais notre immigration est une immigration bas de gamme. On va vers de graves conflits raciaux qui seront la conséquence du refus des Français d’être envahis par d’autres cultures. Toute race a l’instinct de se préserver”. Un discours clairement xénophobe !
D’ailleurs, c’est sous sa houlette de chef de gouvernement que sont inaugurées en octobre 1988, la politique d’expulsions massives et musclées (exécutées par son ministre de l’intérieur Pasqua) par charters entiers “d’immigrés clandestins” qui devait devenir un modèle repris par tous ses successeurs, des “socialistes” à Macron en passant par Sarkozy.
Chirac et l’écologie
“Notre planète brûle !” La formule prononcée au Sommet de la Terre en 2002 a fait le tour du monde et nous est rappelée aujourd’hui. Chirac aurait été un précurseur en matière d’écologie. Foutaises ! On en rigolerait si le sujet n’était pas si dramatique : l’année de son élection, en 1995, il disait de l’écologie que c’était un “passe-temps pour amateurs de pâquerettes”. Il défendait d’ailleurs systématiquement une agriculture exportatrice et intensive utilisant massivement des pesticides et autres produits chimiques. La Charte de l’environnement, votée en 2005 et utilisée comme feuille de vigne, ne changeait donc rien à l’affaire !
En juin 1995, anniversaire des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki, juste après son entrée à l’Élysée, Chirac annonce au son des trompettes la fin des essais nucléaires à Mururoa. Mais cela, après en avoir réalisé six supplémentaires, après 20 ans d’interruption ! De fait, il se souciait de la question écologique comme de sa première chemise.
Voilà donc “l’héritage” de cet “humaniste éclairé”. Loin d’être une grande lumière de la bourgeoisie, il fut un arriviste sans états d’âme, prêt à tout pour exister au sommet du pouvoir.
Stopio, 27 octobre 2019
Géographique:
- France [24]
Situations territoriales:
Personnages:
- Jacques Chirac [75]
Rubrique:
Scandale Windrush: une campagne nationaliste orchestrée par la bourgeoisie
- 195 reads
Après 1945, le Royaume-Uni, affaibli par la guerre, dut faire face à sa reconstruction. Ses plus grandes colonies (l’Inde et le Pakistan) ayant obtenu leur indépendance, il ne lui était désormais plus possible d’y puiser des ouvriers corvéables à merci, comme cela avait été le cas lors de la Guerre mondiale de 1939-45.
Celui-ci se tourna donc vers ses colonies outre-Atlantique, les Antilles britanniques, où le taux de chômage était important, afin d’y importer la main-d’œuvre nécessaire à sa reconstruction.
Pour le capital, les migrants sont une marchandise comme les autres
Ainsi, “dès 1946, la Royal Commission on Population propose de faire venir une “population de remplacement” afin de renouveler la population britannique à moyen terme”. (1) Pour cela, le British Nationality Act de 1948 prévoyait l’octroi du statut de “citoyen du Royaume-Uni et des colonies” à toute personne née sur le territoire britannique ou dans une de ses colonies. Il s’agissait de disposer facilement et rapidement d’une main-d’œuvre peu coûteuse. Quelques mois plus tard, le navire Empire Windrush débarquait des Caraïbes avec une main-d’œuvre toute fraîche, prête à être exploitée par le capital national. Jusqu’en 1971, (2) près de 600 000 ouvriers, issus des anciennes colonies et attirés par les promesses d’emploi, de prospérité et de logement, émigrèrent au Royaume-Uni : c’est la “génération Windrush”.
D’emblée, les premiers ouvriers débarqués, alors sans-emploi, furent entassés dans des abris anti-aériens et ce sur leurs propres deniers ! Nombre d’entre eux furent employés par l’État lui-même (la poste, les hôpitaux ou encore les chemins de fer) pour des salaires dérisoires.
Le cas de la “génération Windrush” refit surface en 2010, lorsque Teresa May prit la tête du Home Office avec l’objectif de durcir la politique migratoire du pays. Celle qui déclarait en 2012, vouloir “instaurer en Grande-Bretagne un climat particulièrement hostile pour les migrants illégaux”, organisa dès son arrivée au ministère la destruction des tickets d’embarquement (3) prouvant que les travailleurs de la “génération Windrush” étaient arrivés au Royaume-Uni avant 1971, afin de lancer une chasse aux migrants devenus “illégaux”. Les employés du ministère eurent d’ailleurs pour ordre, en cas de demande de confirmation des dates d’arrivée sur le territoire par les migrants de la “génération Windrush”, de répondre qu’il n’existait pas de telles données.
Nombre de ces immigrés, ainsi que leurs descendants, furent alors dans l’incapacité de prouver que leur présence sur le territoire était “régulière”. Menacés d’expulsion, ils perdirent aussitôt leur emploi, l’accès aux soins et leur logement, puis furent expédiés dans des centres de détention, en attendant leur renvoi vers leur pays de naissance.
Le scandale éclate en novembre 2017, alors que May est devenue Premier ministre, et met momentanément un coup d’arrêt aux expulsions. Teresa May et Amber Rudd, la ministre de l’Intérieur (qui servira finalement de fusible et sera évincée) présentent leurs excuses en avril 2018 et promettent une compensation financière et une naturalisation d’office pour toute la “génération Windrush”.
Pourtant, la bourgeoisie continue encore aujourd’hui d’expulser ces ouvriers. En effet, malgré les promesses de May, et de toute la bourgeoisie britannique, une trentaine d’ouvriers ont encore été expulsés vers la Jamaïque en février dernier, alors que leurs demandes de régularisation étaient toujours à l’étude, et ce à cause de leur casier judiciaire.
Derrière les campagnes xénophobes et humanitaires : le nationalisme
En réalité, l’État a profité de tous ces événements pour mener sous deux angles d’attaque des campagnes nationalistes contre la classe ouvrière.
Dans un premier temps, de nombreuses campagnes xénophobes ont émergé, en lien avec la politique hostile et très offensive déclenchée par May à l’encontre des travailleurs caribéens et leurs descendants. Elle espérait en effet qu'un certain nombre d'immigrants “indésirables” et leurs descendants quitteraient “volontairement” le territoire britannique. Son “environnement hostile” est d’emblée mis sur pied grâce à la nouvelle loi sur l’immigration : pour travailler, louer un logement ou accéder à des prestations sociales et médicales, il faut désormais montrer ses papiers. Les propriétaires ont alors l’obligation de vérifier le statut migratoire de leurs potentiels locataires, sous peine de se voir infliger une amende et d’écoper de 5 ans de prison. Les médecins sont également incités à dénoncer les patients qui ne seraient pas en situation “régulière”. Le ministère de l’Intérieur utilise d’ailleurs les données du National Health Service pour traquer les “délinquants en matière d’immigration”, et ainsi, “empêcher que les personnes sans droit aux prestations et services y aient recours, et ce aux frais du contribuable britannique”, explique un porte-parole du gouvernement. Cette ambiance de terreur, conséquence de l’immonde campagne de May, est poussée à son paroxysme lors de la campagne officielle anti-immigrés, mise en œuvre en 2013 par le gouvernement tory, cultivant la suspicion en cherchant à induire et attiser la xénophobie au sein de la classe ouvrière. Le ministère de l’Intérieur avait en effet pour projet de faire circuler des camions publicitaires dans tout le pays avec un slogan qui n’était pas autre chose qu’un appel à la délation : “In the UK illegally ? Go home or Face arrest”, autrement dit : “En situation illégale au Royaume-Uni ? Rentrez chez vous, ou faites face à une arrestation”. Durant six semaines, mi 2013, plusieurs véhicules ont donc sillonné Londres et ses alentours, mais, loin de rencontrer le succès escompté, le gouvernement a dû renoncer à cette campagne.
 Face à l’indignation qu’a suscitée cette ignoble politique, la bourgeoisie britannique s’est vue dans l’obligation de retourner sa veste et d’orienter différemment le débat sur l’immigration. C’est May, elle-même, qui a impulsé une campagne qui se voulait plus “humaine”, forme plus pernicieuse de campagne nationaliste. Après avoir mis à la rue et expulsé un certain nombre d’ouvriers “Windrush”, le gouvernement May a décidé d’instaurer un hypocrite Windrush Day qui sera l’ “occasion annuelle de se souvenir du travail acharné et du sacrifice de la génération Windrush”. Le Windrush Day, objet de multiples célébrations officielles, se voit également doté d’un fonds spécial de 500 000 livres sterling, dans le but proclamé de rendre justice à ces travailleurs qui “ont traversé l’océan pour construire un avenir pour eux-mêmes, pour leurs communautés et surtout pour le Royaume-Uni, le pays qui sera toujours le leur”. Alors que ce sont ces mêmes travailleurs qui aujourd’hui, continuent d’être menacés d’expulsion.
Face à l’indignation qu’a suscitée cette ignoble politique, la bourgeoisie britannique s’est vue dans l’obligation de retourner sa veste et d’orienter différemment le débat sur l’immigration. C’est May, elle-même, qui a impulsé une campagne qui se voulait plus “humaine”, forme plus pernicieuse de campagne nationaliste. Après avoir mis à la rue et expulsé un certain nombre d’ouvriers “Windrush”, le gouvernement May a décidé d’instaurer un hypocrite Windrush Day qui sera l’ “occasion annuelle de se souvenir du travail acharné et du sacrifice de la génération Windrush”. Le Windrush Day, objet de multiples célébrations officielles, se voit également doté d’un fonds spécial de 500 000 livres sterling, dans le but proclamé de rendre justice à ces travailleurs qui “ont traversé l’océan pour construire un avenir pour eux-mêmes, pour leurs communautés et surtout pour le Royaume-Uni, le pays qui sera toujours le leur”. Alors que ce sont ces mêmes travailleurs qui aujourd’hui, continuent d’être menacés d’expulsion.
Ce scandale et cette nouvelle facette de la campagne nationaliste ont permis à la bourgeoisie britannique de diriger la classe ouvrière sur un terrain totalement pourri, en insinuant que les migrants se classent en deux catégories distinctes : ceux qui sont utiles (pour le capital), et ceux qui “profitent” indûment de la “générosité” de la nation.
La bourgeoisie a donc instrumentalisé l’indignation suscitée par la situation scandaleuse de la “génération Windrush”, occultant ainsi que ce même traitement est réservé à des millions de migrants dans le monde. Pendant que le gouvernement britannique légalise plus ou moins la situation des travailleurs qui “ont contribué à construire notre pays”, il laisse crever des Asiatiques dans des camions, contraints de prendre toujours plus de risques face aux murailles physiques et administratives que May et consorts ont dressées ! Sous ses airs hypocritement humanistes, la bourgeoisie cherche encore à diviser la classe ouvrière.
Que son discours soit ouvertement xénophobe ou prétendument plus humain, les frontières nationales de la bourgeoisie demeurent. Le gouvernement britannique peut bien instaurer son jour de commémoration, les morts continueront à s’échouer sur les barbelés comme sur les rivages. Seule la classe ouvrière, dans son combat pour le communisme, est en mesure de détruire ces frontières meurtrières en mettant fin au capitalisme.
Olive, 1er novembre 2019
1) “Royaume-Uni : il y a 70 ans, les débuts de la génération Windrush”, RFI (30 avril 2018).
2) À compter de 1971, le Royaume-Uni n’ayant plus besoin de ce type de main-d’œuvre, la loi migratoire évolue ; seuls les citoyens du Commonwealth résidant déjà au Royaume-Uni obtiennent le droit de rester sur le territoire britannique de manière permanente.
3) Aucun des travailleurs de la “génération Windrush” ne possédait de papier officiel attestant de leur nationalité, à l’exception des tickets d’embarquement détenus par le ministère de l’Intérieur.
Géographique:
- Grande-Bretagne [61]
Récent et en cours:
- Crise migratoire [76]
Rubrique:
Lubrizol: Derrière l’écran de fumée, la responsabilité du capital !
- 49 reads
Le 26 septembre à 2h40 du matin, Lubrizol, usine de produits chimiques classée Seveso, prend feu. Un épais nuage de fumées noires de 20 km de long envahit le ciel rouennais. À 7h00, les premières sirènes d’alertes à la population retentissent. 8h00, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, déclare sans sourciller : “Il n’y a pas d’éléments qui permettent de penser que les fumées seraient dangereuses”, comme si un incendie de 9050 tonnes de composés chimiques divers et variés pouvait être inoffensif ! Et le gouvernement de multiplier les fumisteries : “À ce stade, les mesures n’ont pas permis de voir des polluants préoccupants” (d’Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire !). “Nous sommes à un état habituel de la qualité de l’air à Rouen” (Pierre-André Durand, préfet de Seine Maritime) et de compléter quelques jours plus tard “ça ne veut pas dire que l’état de l’air habituel à Rouen est bon”… apprécions l’ironie de la déclaration !
Tandis que de nombreuses plaintes pour migraines, nausées, étourdissements (y compris au sein des forces de l’ordre que l’État lui-même n’a pas pris soin de protéger en les envoyant sans masque au plus fort de l’incendie), le Premier ministre Édouard Philippe (r)assure de nouveau : “Dès que [les analyses] seront réalisées, nous communiquerons l’ensemble des résultats. Je vous dis simplement ce que disent les analyses qui m’expliquent qu’elles ne sont pas nocives mais qu’elles sont gênantes”. Dans le même temps, un toxico-chimiste (le professeur André Picot) déclare : “les analyses livrées par la préfecture sont hors de propos”. Selon lui, “ce qui est recherché […] ce sont des produits classiques comme le dioxyde d’azote qu’émettent les moteurs diesel. Donc vous ne risquez pas de trouver des taux dans l’air différent de la normale. Il faudrait savoir exactement ce qui a brûlé au sein de l’entreprise”. (1) Il rajoutera plus tard que ce qui est bien plus préoccupant que la liste des composés qui ont brûlé, ce sont les réactions chimiques que peut provoquer le mélange de ces composés lors de l’incendie. D’autant plus que près de 80 tonnes de ces composés sont “sans papier”, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de “fiche d’identité fournie par Lubrizol”. (2)
Face à ce battage médiatique, les réactions dans la rue ne se font pas attendre. Des enseignants exercent leur droit de retrait. Des manifestations ont régulièrement lieu. Un mois après la catastrophe, les habitants sont toujours autant en colère face aux mensonges éhontés et aux faux-semblants de l’État.
Le 22 octobre, le patron de Lubrizol déclare toujours que ce qui a brûlé à Rouen n’est “pas plus toxique qu’un incendie de maison” ! Aujourd’hui, l’État parle d’indemnisations, de compensations pour les entreprises ou les agriculteurs ainsi que pour des habitants de certains quartiers ou communes. Mais le panache de fumée, s’il a duré moins de 24h de manière visible, s’est en réalité volatilisé plus haut dans l’atmosphère pour ensuite être dispersé par les vents jusqu’en… Belgique. Les retombées de cet incendie sont donc bien plus importantes que ce que le gouvernement nous laisse entendre. Lui se préoccupe des stocks de denrées du port de Rouen qui ont été impactées par les fumées, des pertes économiques, de la perte d’attractivité de la région… pas de la santé des personnes touchés par toutes les toxines et autres polluants.
Et ce n’est pas nouveau ! Ce sont bien les États et les patrons qui, main dans la main, œuvrent à obtenir toujours plus de profits en faisant fi des contraintes sécuritaires minimum. C’est l’État français qui a voté, en août 2018, la loi ESSOC (loi pour un État au Service d’une Société de Confiance) permettant la simplification des contrôles. Loi qui a directement permis au patron de Lubrizol, via l’autorisation du préfet, d’augmenter ses capacités de production (plus 1598 tonnes) et de stockage (plus 600 tonnes) dès janvier 2019, “en contournant le plus légalement du monde l’autorité environnementale, laquelle a pour mission de mener sur ce genre d’équipement des études de danger décisives”. (3) Ce sont les États qui, pour permettre l’accumulation, défendent par tous les moyens les intérêts du capital national et ce au détriment des exploités et de la planète. Et ce sont ces mêmes États qui jurent la main sur le cœur se préoccuper de l’écologie en jouant les mêmes rengaines à chaque nouvelle catastrophe depuis des décennies :
– 1976, Seveso en Italie, pollution chimique. Un nuage d’herbicide, contenant de la soude caustique et de la dioxine, s’est échappé durant vingt minutes d’un réacteur d’une usine chimique. Cette catastrophe a donné son nom à la directive “Seveso” (série de directives européennes qui imposent aux États membres de l’Union européenne d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs).
– 1978, pollution du Love Canal, banlieue proche des chutes du Niagara aux États-Unis : 21 000 tonnes de produits toxiques sont découverts à proximité de l’usine Hooker Chemical. La zone est à l’heure actuelle toujours interdite !
– 1979, accident nucléaire de Three Mile Island aux États-Unis.
– 1984, explosion d’une usine de pesticides à Bhopal en Inde. Bilan : plusieurs milliers de morts, 300 000 malades et une zone d’habitation toujours sinistrée par la pollution des sols et de la nappe phréatique.
– 1986, explosion d’un réacteur nucléaire à Tchernobyl en ex-URSS : l’État ne pouvait plus entretenir l’infrastructure. Heureusement, la radioactivité n’a jamais franchi la barrière naturelle des Alpes ! (4)
– 2011, catastrophe nucléaire à Fukushima au Japon : les infrastructures construites sur une zone sismique n’ont pas résisté à un tremblement de terre. Aujourd’hui encore, aucune solution n’a été trouvée !
– 2015, Tianjin en Chine : explosion meurtrière d’entrepôts de stockage de produits chimiques : 114 morts, 720 blessés, 700 tonnes de cyanure de soude déversés, et une zone urbaine à l’heure actuelle toujours polluée. (5)
Sans compter les ravages engendrés par de nombreuses marées noires : en 1978 sur les côtes bretonnes, en 1989 en Alaska, en 1999 à nouveau sur les côtes bretonnes, en 2002 sur les côtes de la Galice en Espagne, en 2010 en Louisiane aux États-Unis…
Les beaux discours de la bourgeoisie sur l’environnement n’ont jamais rien changé et ne changeront jamais rien à la course au profit d’un capitalisme toujours plus moribond. Seule la révolution prolétarienne peut mettre un terme à ce cycle sans fin de catastrophes et faire vivre l’humanité en harmonie avec l’environnement car, comme l’écrivait Engels dans sa Dialectique de la nature : “les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne régnons nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un peuple étranger, comme quelqu’un qui serait en dehors de la nature, mais que nous lui appartenons avec notre chair, notre sang, notre cerveau, que nous sommes dans son sein et que toute notre domination sur elle réside dans l’avantage que nous avons sur l’ensemble des autres créatures de connaître ses lois et de pouvoir nous en servir judicieusement”.
Manon, 1er novembre 2019
1) “Incendie de l’usine Lubrizol : ‘Les analyses livrées par la préfecture sont hors de propos’”, Paris-Normandie (30 septembre 2019).
2) “La com’ toxique de l’État à Rouen”, Le canard enchaîné (9 septembre 2019).
3) “Une fumée, des fumeux”, Le canard enchaîné (2 octobre 2019).
4) “Après Tchernobyl, Fukushima… ce ne sont pas les atomes qui sont à craindre, mais le capitalisme”, Révolution internationale n° 422 (mai 2011).
5) “Explosion meurtrière de Tianjin (Chine) : apprendre de tout, ne rien oublier !”, Révolution internationale n° 454 (septembre-octobre 2001).
Géographique:
- France [24]
Récent et en cours:
- Catastrophes [77]
Rubrique:
90 ans après la crise de 1929: Le capitalisme en décadence peine de plus en plus à endiguer la surproduction
- 157 reads
Il y a 90 ans, le krach boursier d’octobre 1929 qui annonçait la crise économique des années 1930 venait confirmer ce que la Première Guerre mondiale avait signifié, à savoir que le capitalisme était définitivement entré dans sa période de décadence. En quelques mois, des dizaines et des dizaines de millions de personnes allaient tomber dans un dénuement total. Bien-sûr, depuis cette période, la bourgeoisie a appris à atténuer la violence de la crise mais, malgré les leçons qu’elle a pu en tirer, cette crise n’a jamais été surmontée. Cela confirme que dans la période ouverte par la Première Guerre mondiale, les contradictions du capitalisme ne pouvaient qu’amener à la dégradation des conditions d’existence de la très grande majorité de l’humanité.
Une crise d’ampleur mondiale
La crise de 1929 correspond, sans aucune ambiguïté, au diagnostic qu’avaient fait Marx et Engels dans le Manifeste du Parti communiste au sujet des crises que connaissait déjà le capitalisme au XIXe siècle : “Une épidémie sociale éclate, qui, à toute autre époque, eût semblé absurde : l’épidémie de la surproduction”. Un tel diagnostic est d’autant plus vrai quand on se rend compte que la crise de 1929 n’a pas éclaté avec le krach boursier des 24 et 29 octobre 1929, mais que la situation du capital se dégradait avant ces dates dans de plus en plus de secteurs et de pays.
Ainsi, aux États-Unis, la production des secteurs de la construction et de l’automobile baissait depuis mars 1929, baisse qui s’est généralisée à l’ensemble de l’économie pendant l’été de la même année. Par ailleurs, l’activité économique en général était à la baisse dans les pays européens qui ont eux-mêmes connus le krach boursier avant les États-Unis ; dans ces conditions, la spéculation à la hausse à la bourse de New York ne pouvait que se heurter à la diminution des profits et finir par un krach.
Cette baisse de l’activité économique dans les pays centraux du capitalisme avait pour cause, d’une part, la surproduction mondiale des produits agricoles depuis le milieu des années 1920, ce qui impliquait une baisse de revenus dans l’agriculture et, d’autre part, la faiblesse persistante des salaires qui avaient augmenté beaucoup moins que la production dans l’ensemble des pays industrialisés. Une telle dynamique vérifie totalement la cause de la surproduction qu’avait identifiée Marx : “la raison ultime de toutes les crises réelles, c’est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendance de l’économie capitaliste de développer les forces productives, comme si elles n’avaient pour limites que le pouvoir de consommation absolu de la société”. (1)
Bien sûr, le krach boursier va amputer sévèrement les réserves du capital financier et provoquer la faillite de grandes banques comme la Bank of The United States, aggravant ainsi la surproduction car il devenait de plus en difficile de financer l’accumulation du capital. S’ensuivit une chute drastique de l’investissement venant surajouter une surproduction massive de biens de production à la tendance générale existant depuis plusieurs années. Cette dynamique a provoqué une accélération rapide de la chute de la production industrielle. Dans le même sens, du fait des relations financières et commerciales internationales, l’aggravation de la crise va être mondiale. Il faut signaler que c’est dans les deux pays les plus développés, à savoir les États-Unis et l’Allemagne, que la diminution de l’activité va être la plus profonde et la plus rapide.
Pourtant, pendant les premiers mois qui ont suivi le krach, la bourgeoisie et la plupart de ses économistes, aveuglés par l’idée que le système capitaliste est éternel, pensaient avec le président des États-Unis, Hoover, que “tout serait terminé en soixante jours” et que comme dans les crises du XIXe siècle, la reprise économique surviendrait spontanément. La violence de la crise a provoqué un profond désarroi au sein de la classe dominante mais, puisqu’il s’agissait d’abord de maintenir un minimum de profit, la réaction des entreprises a été de licencier massivement et de diminuer les salaires. Les États, quant à eux, malgré des hésitations, tentèrent de garder leur crédibilité financière en maintenant l’équilibre budgétaire par la diminution des dépenses publiques. C’est ainsi que fut menée aux États-Unis une politique de réduction de la masse monétaire et de hausse massive des impôts directs et indirects votée en juin 1932 ; en Allemagne, le chancelier Brüning, surnommé le chancelier de la faim, a augmenté les impôts, baissé les salaires des fonctionnaires de 10 % et les indemnités des chômeurs dès 1930 ; puis, dans ce même pays, des mesures encore plus dures furent prises contre les chômeurs en juin 1931 ; en France, dès 1933, les différents gouvernements baissèrent les dépenses publiques, les retraites et les salaires des fonctionnaires et en 1935 ces mêmes salaires furent amputés de 15 % puis de 10 %.
L’autre orientation adoptée par les États a été de protéger l’économie nationale par le protectionnisme : tous les pays ont emboîté le pas des États-Unis dont le Congrès avait voté, avant le krach d’octobre 1929, la loi Smoot-Hawley qui augmentait les droits de douane de 50 %. En fait, les années 1930 ont vu une véritable guerre commerciale et monétaire se développer entre les grandes puissances. En particulier, le flottement de la valeur de la Livre Sterling et sa dévaluation de plus de 30 % décidée en septembre 1931 ainsi que celle du dollar d’un montant de 40 % en 1933 montrent que chaque grande puissance, à l’image du Royaume-Uni et du Commonwealth qui décrètent la préférence impériale pour leur commerce extérieur, se repliait sur sa zone d’influence.
La mise en œuvre d’une telle politique révèle que la bourgeoisie n’avait pas compris que, contrairement à la période qui précède la Première Guerre mondiale, le capitalisme, qui était alors dans sa période ascendante, n’avait plus les moyens de juguler la surproduction vers laquelle poussent irrémédiablement ses contradictions. Dans cette période, les crises avaient débouché sur de nouvelles phases de croissance parce que le marché mondial était encore ouvert et permettait donc aux capitaux nationaux les plus modernes et dynamiques de trouver de nouveaux marchés qui permettaient de surmonter les problèmes cycliques de surproduction. Comme l’a montré Rosa Luxembourg, la Première Guerre mondiale était la manifestation du fait que le marché mondial était globalement partagé entre les grandes puissances et qu’il n’y avait plus assez de nouveaux marchés à conquérir. Ceci impliquait que l’issue de la crise ne pouvait être que la destruction du capitalisme par la classe ouvrière ou l’éclatement d’une nouvelle guerre mondiale. En conséquence, les politiques des États, inspirées par la situation du siècle précédent, dans les trois ou quatre premières années qui ont suivi le krach d’octobre 1929 n’ont même pas permis de diminuer l’impact de la surproduction ; au contraire, elles l’ont aggravé.
De fait, comme le dit l’économiste Kindleberger, ces années ont été “un glissement vers l’abîme”. Entre l’automne 1929 et le premier trimestre 1933, le PNB des États-Unis et de l’Allemagne a été divisé par deux, le niveau moyen des prix mondiaux a baissé de 32 %, le volume du commerce mondial a diminué de 25 %. Une telle dégradation de l’activité économique provoqua la chute des profits, ce qui explique qu’en 1932, l’investissement brut aux États-Unis était proche de zéro. En d’autres termes, beaucoup d’entreprises ne remplacèrent pas leurs machines usées. Comme l’avait dit Keynes, au-delà d’un certain niveau de baisse des prix et donc de pertes, les entreprises ne peuvent plus rembourser leurs dettes et les banques ne peuvent que s’effondrer ; et c’est bien ce qui s’est passé. Des grandes banques firent faillite dans tous les pays. Le 13 mai 1931, le KreditAnstaldt (2) était en cessation de paiements ; en juillet de la même année, la grande banque allemande Danatbank était aussi en situation de faillite et, du fait de la panique bancaire, toutes les banques allemandes fermèrent pendant trois jours ; aux États-Unis, au début 1932, le nombre de faillites bancaires était tel que Roosevelt, fraîchement élu Président, fut obligé de fermer l’ensemble du système bancaire (plus de 1 000 banques ne rouvriront jamais !).
Les conséquences pour la classe ouvrière furent terrifiantes : le chômage augmentait dans tous les pays : à la fin de 1932, le chômage atteignit au moins 25 % aux États-Unis (alors que, dans ce pays, il n’y a aucun secours pour les chômeurs) et 30 % en Allemagne. (3) Une grande partie des ouvriers travaillaient à temps partiel dans un total dénuement ; les allocations chômage furent diminuées en Allemagne et en Grande-Bretagne ; les files d’attente de gens hagards, presque en haillons, pour une soupe populaire, s’allongèrent, alors qu’étaient détruites des tonnes de marchandises invendables. Au Brésil, on en vint même à brûler les stocks de café dans les locomotives ! Enfin, les augmentations des impôts vinrent torpiller davantage une classe ouvrière paupérisée.
Quelles leçons la bourgeoisie tire de la crise de 1929 ?
L’effondrement de l’économie mondiale a obligé la classe dominante et certains de ses experts à remettre en cause leurs vieux préceptes libéraux de non-intervention de l’État et du respect de l’équilibre budgétaire et à se rendre compte que la cause de la crise était la surproduction que la bourgeoisie a habilement rebaptisée, avec la théorie de Keynes, “insuffisance de la demande”.
Pour stopper l’effondrement du capital, il s’est d’abord agi pour les États de prendre en mains l’appareil productif, quelquefois directement, comme ce fut le cas en France pour le transport ferroviaire ou en Grande-Bretagne pour les transports londoniens ou le transport aérien. Mais surtout, cette prise en mains par l’État a consisté dans le fait de contraindre l’ensemble des entreprises, par la réglementation, d’adopter des gestions conformes aux intérêts du capital national : c’est cela le contenu du fameux New Deal du Président Roosevelt aux États-Unis ou du plan De Man en Belgique. Aux États-Unis, par le Banking Act, l’Administration américaine a créé un organisme d’assurance auquel les banques devaient adhérer pour recevoir des fonds de la Banque centrale (la FED). Une autre loi organisait le soutien des prix agricoles en proposant des indemnités aux agriculteurs s’ils réduisaient les surfaces cultivées. Dans l’industrie, le NIRA demandait aux branches industrielles de s’organiser (en Allemagne, ce furent les corporations qui en furent chargées) pour fixer des quotas de production et les prix de vente des entreprises ; par ailleurs, il accordait le droit aux syndicats de signer des conventions collectives, ce qui d’ailleurs permettait à ces derniers d’accroître leur emprise sur la classe ouvrière. De telles lois (que l’on retrouvait de manière analogue dans les autres pays comme en France sous le Front Populaire) n’ont pas amélioré les salaires puisque les prix augmentaient davantage. Pour diminuer la surproduction, ces lois visaient non seulement à réduire la production mais aussi à relancer la demande par le déficit budgétaire. C’est ainsi que le NIRA a organisé une politique de grands travaux publics comme l’assainissement de la vallée des Appalaches, la construction du Triborough Bridge à New York ou encore l’aménagement de nombreux barrages dans la vallée du Tennessee. On retrouve la même volonté en Allemagne dès 1932 avec la construction d’autoroutes, le creusement de canaux, l’assainissement de certaines zones géographiques. Accroître artificiellement la demande tout en renforçant le contrôle sur la classe ouvrière fut aussi l’objectif de la bourgeoisie britannique dans le fait de réintroduire des allocations de chômage, puis un régime de retraite et de stimuler la construction de logements.
Le développement de l’emprise de l’État sur le capital qui s’est mis en place de manière assez chaotique dans les années 1930 va avoir un grand avenir. Il va même être théorisé dans ce que l’on a appelé le keynésianisme. Le contrôle de l’ensemble du capital par l’État en utilisant toute une série de moyens (de la nationalisation au soutien par des organismes publics aux entreprises) va être de plus en plus systématique. L’endettement de plus en plus massif (impulsé par l’État) de toute l’économie, ainsi que la pratique de déficits publics vont continuellement se développer dans le but d’atténuer les effets de la surproduction. De même, la mise en place après la Seconde Guerre mondiale de “l’État providence”, prolongeant ce qui avait été fait dans les pays de l’Europe de l’Ouest dans les années 1930, va constituer un régulateur de la demande tout en étant un instrument de contrôle idéologique de la classe ouvrière. Comme cela s’est passé dans les années 1930, le déploiement de tous ces moyens va permettre à l’État d’étaler dans le temps les effets de la surproduction. Mais en aucun cas, la bourgeoisie ne peut résoudre la crise et surmonter réellement la surproduction.
Aujourd’hui, la crise du système capitaliste continue à s’approfondir, même si c’est à un rythme bien plus lent que dans les années 1930. Elle confirme que le capitalisme d’État n’est pas un moyen permettant de mettre fin à la surproduction, celle-ci étant inhérente au capitalisme. En fait, la réponse du capital à la crise est elle-même une expression de la sénilité du mode de production capitaliste qui ne cesse de s’affermir. Elle ne permet que la gestion en vue de limiter les effets de sa crise permanente : cela, au prix de contradictions de plus en plus aiguës et destructrices.
Vitaz, 8 octobre 2019
1) Marx, Le Capital chapitre XVII
2) Banque dans laquelle est concentré le capital financier autrichien.
3) Certaines statistiques publiées par la bourgeoisie donnent des chiffres beaucoup plus élevés.
Questions théoriques:
- L'économie [78]