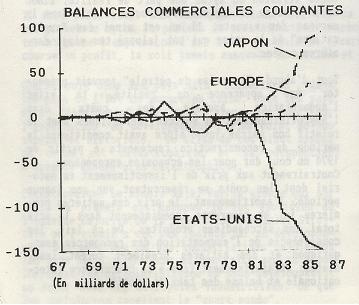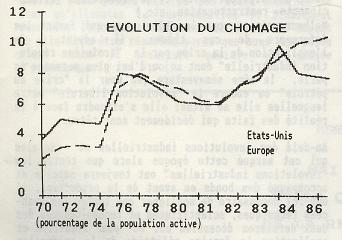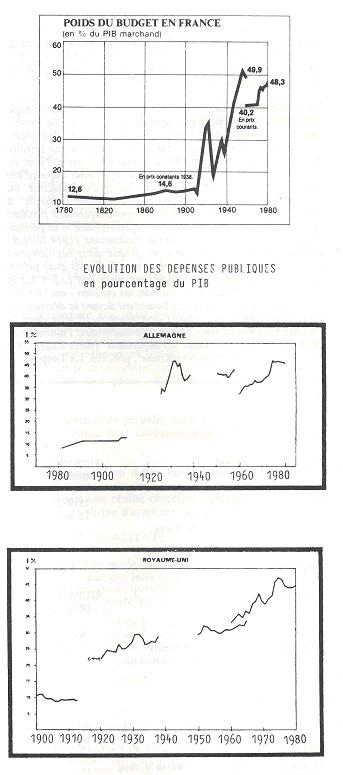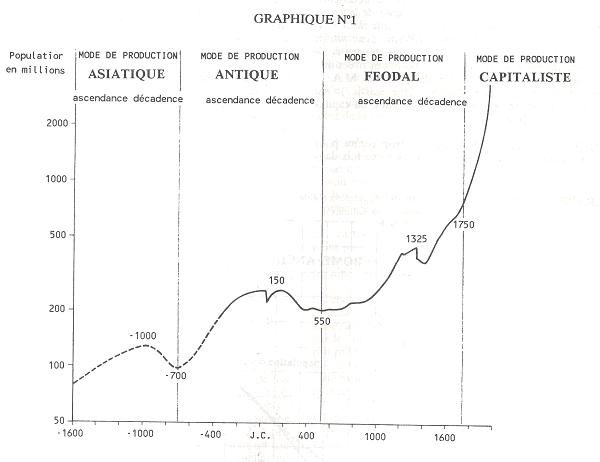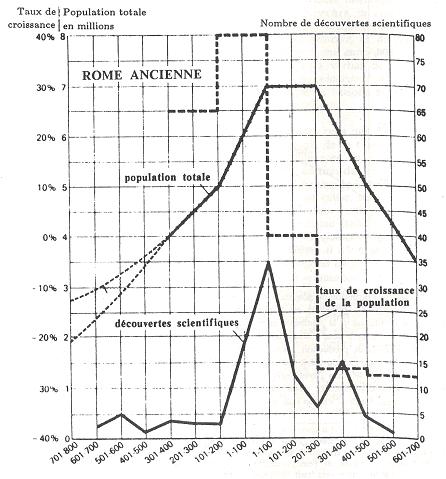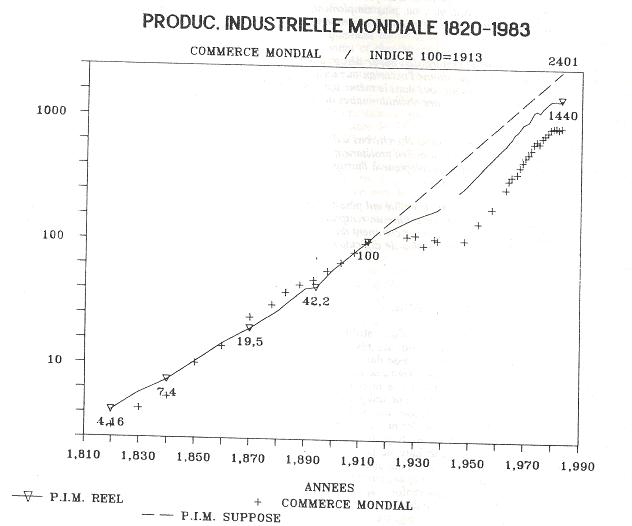Revue Int. 1988 - 52 à 55
- 3666 lectures
Revue Internationale no 52 - 1e trimestre 1988
- 2557 lectures
Editorial : la crise économique, la guerre et la révolution
- 4665 lectures
Effondrement boursier, nouvelle aggravation de la crise économique; mobilisation des armées des principaux pays industrialisés occidentaux dans la guerre du Golfe Persique. L'histoire s'accélère. Les forces contradictoires qui minent les rapports sociaux capitalistes s'exacerbent. Le système enfonce de plus en plus rapidement la société mondiale dans la barbarie de la misère et de la guerre.
Mais la crise économique n'est pas que cela. La crise dans laquelle se débat l'économie mondiale depuis près de 20 ans a aussi développé les contradictions entre les classes; elle crée les conditions pour l'unification de la seule force capable d'imposer une issue: la classe ouvrière mondiale.
La crise boursière annonce un enfoncement de l'économie dans la récession, c'est-à-dire dans le chômage, les bas salaires, la surexploitation, la misère, la répression, l'insécurité, et enfin les tensions guerrières. Tout le monde le sait ou le sent plus ou moins confusément. Mais, toute la pression de la classe dominante, avec la répression, avec les médias et la propagande idéologique omniprésente, s'emploie à entretenir le sentiment d'impuissance face à l'ordre régnant.
Pourtant, pour la classe exploitée l'heure n'est ni aux lamentations, ni à la résignation, ni aux politiques "de l'autruche" préconisées par la classe dominante. Plus que jamais son combat contre le capitalisme est à l'ordre du jour. Plus que jamais s'impose à elle la nécessité d'unifier ses combats épars de résistance immédiate, pour les porter jusqu'au bout, jusqu'au combat non plus contre les conséquences de l'exploitation, mais contre l'exploitation elle-même. La crise économique mondiale, développe les conditions d'un tel processus. Et c'est surtout cela que la classe ouvrière doit avoir à l'esprit devant les appels à la résignation de tous les défenseurs de "l'économie nationale".
LA CRISE ECONOMIQUE AFFAIBLIT LE POUVOIR DE LA BOURGEOISIE MONDIALE
La crise économique se traduit inévitablement par des attaques féroces contre les conditions d'existence des prolétaires. Mais cela ne traduit pas pour autant un renforcement de la bourgeoisie mondiale. Devant la crise de son système, la classe dominante ne connaît d'autre mode de vie que celui de la guerre de tous contre tous. La concurrence exacerbée sur le plan commercial et sur le plan militaire. Ceux qui gagnent dans ces combats ne créent plus de nouvelles richesses, ils ne s'enrichissent que des cadavres de leurs concurrents vaincus. La bourgeoisie ne parvient plus à assurer la seule fonction sociale qui lui permet de fonder son pouvoir autrement que sur la violence: la fonction d'organisateur de la production sociale des moyens de subsistance. La bourgeoisie ne peut plus produire: elle ne survit qu'en détruisant. Détruisant économiquement: chômage massif, fermetures d'entreprises, destruction de récoltes et de "surplus invendables"; détruisant militairement: production d'armement, guerres. De ce fait son pouvoir repose de plus en plus uniquement sur la répression et le mensonge idéologique. Et l'histoire montre que pour une classe dominante c'est une situation de faiblesse. "On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus", disait Talleyrand à l'époque où la bourgeoisie avait encore un rôle révolutionnaire et était sûre de son "utilité sociale".
Ce que doivent voir les prolétaires dans l'actuelle aggravation de la crise économique, c'est qu'en même temps que celle-ci érode les fondements du pouvoir de la bourgeoisie, elle développe des conditions objectives pour l'unification de la classe ouvrière mondiale, pour un développement de sa conscience de classe révolutionnaire et de ses combats contre le capitalisme.
LA CRISE CREE DES CONDITIONS POUR L'UNIFICATION PROLETARIENNE
La crise tend à unifier le prolétariat international parce que la crise unifie les conditions d'existence des exploités, parce que l'attaque tend à être de plus en plus simultanée sur tous les secteurs de la classe ouvrière, dans tous les pays. Ce ne sont plus surtout les pays les moins développés qui connaissent cette austérité. L'Allemagne occidentale, le Japon, tout comme les petits "miracles" d'Extrême-Orient (Singapour, Hong-Kong, Corée du Sud, Taiwan) ou l'Amérique Latine (Brésil, Mexique, Argentine, Venezuela), tout comme les pays pétroliers, tous ces pays qui, à un moment ou à un autre, apparaissaient dans les dernières années comme des zones épargnées par la crise, connaissent le développement du chômage et de la misère à l'égal des autres pays frappés plus tôt.
Lorsque le développement de la crise est relativement lent, la bourgeoisie parvient à disperser son attaque, géographiquement et dans le temps, cherchant consciemment à éviter des réactions brusques et surtout unifiées. Le fameux "Plan Davignon" réalisé par les gouvernements de la Communauté européenne, pour licencier des centaines de milliers de travailleurs dans la sidérurgie, sur tout le continent, en prenant soin de disperser les attaques au cours des années et en passant d'un pays à l'autre, est une illustration de ce genre de tactique. L'aggravation de la crise économique interdit de plus en plus ce genre de planification de la dispersion de l'attaque. Poussée par ses propres impératifs de concurrence et de rentabilité capitaliste, la bourgeoisie est contrainte de frapper de plus en plus simultanément et rapidement (donc violemment) toute la classe travailleuse. Les attaques massives de la bourgeoisie créent les bases pour les réponses massives du prolétariat. La bourgeoisie polonaise a appris à ses dépens, en 1970 comme en 1980, ce que coûtent au maintien de son ordre des mesures violentes telles que le doublement des prix de la viande et du lait du jour au lendemain. Les politiques de "privatisation", de "dérégulation", tout comme la "perestroïka" de Gorbatchev ou le "libéralisme" de Teng Shiao Ping ont aussi comme objectif d'éviter de telles secousses. Malheureusement. pour ces bourgeois attardés, il est trop tard et la crise économique mondiale est trop profonde pour réussir à masquer la massivité des attaques.
Le pire piège pour la classe ouvrière serait de "ne voir dans la misère que la misère" et ne pas saisir les moyens de son unification que lui offre l'effondrement du système économique. La classe ouvrière ne peut s'unifier que dans et pour le combat contre ce qui la divise: le capitalisme. C'est ce que confirme tous les jours la lutte ouvrière aux quatre coins de la planète. Le fait qu'en un peu plus d'un an la classe ouvrière ait développé des luttes massives comme en Belgique en 1986 ou en Corée du Sud pendant l'été 1987, qu'elle livre des combats importants simultanément en Yougoslavie et en Roumanie, en Italie et au Bangladesh, le montre sans ambiguïtés.
LA CRISE MET A NU LE VERITABLE ENJEU DES LUTTES OUVRIERES
La crise économique capitaliste fait éclater au grand jour cette vérité simple mais fondamentale que ce qui conduit à la situation d'impasse dans laquelle s'enfonce la société, ce ne sont pas des problèmes techniques ou de manque de moyens matériels, mais d'organisation sociale de la production. La bourgeoisie répond à la crise de son système en détruisant et en menaçant d'aller vers une nouvelle destruction mondiale, comme elle le fit à la suite de la crise des années 30. Les besoins économiques non satisfaits se développent à une vitesse vertigineuse en même temps que la société dispose des techniques les plus puissantes qui permettraient à l'humanité de vivre comme des "maîtres sans esclaves", avec comme seul objectif pour -l'activité productrice: satisfaire sans limites les besoins humains.
Plus la crise s'approfondit et plus ce contraste, entre ce qui est matériellement possible et ce qui existe dans la réalité capitaliste, apparaît clairement, montrant au prolétariat la justesse et l'ampleur historique de ses luttes si elles sont menées jusqu'à leurs ultimes conséquences.
LE TRIOMPHE DU MARXISME
La réalité de la dynamique capitaliste vérifie de façon éclatante l'analyse marxiste de l'inéluctabilité de la crise capitaliste et du fait que cette crise crée les conditions matérielles, objectives, nécessaires -même si non suffisantes- pour l'unification et l'action révolutionnaires de la classe ouvrière.
Cependant, les classes dominantes ne croient jamais à la possibilité de leur propre disparition... sauf peut-être dans un chaos sans retour. Elles ne voient de la réalité que ce que leurs lunettes de classe leur permettent de voir. La bourgeoisie mondiale ne comprend pas plus les raisons profondes de la crise violente qui secoue son système qu'elle ne voit dans les grèves ouvrières la possibilité d'une société communiste. Elle craint les luttes ouvrières qui se généralisent, par dessus tout, parce qu'elle craint de perdre le contrôle de la situation et donc ses privilèges, non parce qu'elle entreverrait une société sans misère ni exploitation.
Que la bourgeoisie ne voit pas comment la crise du capitalisme peut conduire à la transformation des luttes revendicatives ouvrières en luttes offensives révolutionnaires est en fait "normal". Ce qui est plus surprenant ce sont les objections aux fondements du marxisme de la part de courants se réclamant de la révolution communiste, voire de Marx.
Trois arguments, basés sur une observation -superficielle- de l'histoire sont souvent cités contre les analyses marxistes:
1. Au cours des années 80 la crise a été plus profonde et a plus frappé la classe ouvrière que pendant les années 70. Cependant il y eu moins de grèves.
2. La grande crise économique de 1929 n'a pas conduit à des luttes révolutionnaires mais à l'embrigadement des prolétaires derrière leurs bourgeoisies nationales pour s'entre-tuer dans une boucherie mondiale qui laissa 50 millions de morts.
3. Les luttes ouvrières du passé qui sont arrivées à remettre en question de façon révolutionnaire le pouvoir de la bourgeoisie, ne se sont pas produites pendant des périodes de crise économique "pure" mais pendant ou à la suite de guerres entre nations.
Nous avons souvent répondu à ce type d'arguments dans notre presse et plus particulièrement dans cette revue ([1] [1]). Cependant, à l'heure où les échéances historiques s'approchent de façon accélérée sous la pression de la crise économique, il nous semble important de rappeler quelques éléments importants pour la perspective actuelle des luttes ouvrières.
Et pourtant...
"IL Y A MOINS DE GREVES DANS LES ANNEES 80"
Il est vrai que de façon générale il y a eu moins de grèves, moins de journées "perdues pour fait de grève" ; comme disent les statistiques, au cours des dernières années que pendant la vague de luttes de la fin des années 60 ou au cours des années 70. Il est aussi vrai que la crise économique, si on en mesure les effets à l'ampleur du chômage par exemple, est plus profonde et plus étendue au cours des années 80. Mais en déduire qu'il v a là la preuve que la crise économique ne crée pas des conditions pour l'unification du prolétariat c'est tout ignorer de ce qu'est le processus d'unification de la classe ouvrière mondiale.
Ce processus ne se mesure pas mécaniquement au nombre de journées de grève dans tel ou tel pays. Le processus d'unification des luttes ouvrières se mesure tout autant à des critères tels que la conscience qui soutient la lutte ou l'ampleur internationale des combats.
Les grèves des années 80 sont moins nombreuses que celles de la décennie précédente mais elles sont beaucoup plus significatives. Partir en grève aujourd'hui, affrontant la menace du chômage, cette répression insidieuse qui est comme un fusil derrière le dos de chaque travailleur, cela implique beaucoup plus de volonté et de décision de combat que de participer à dix journées d'action syndicale bidon comme il y en eut tant pendant les années 70. Et pourtant cela comptabilisera bien moins d'heures de grève.
La conscience qui traverse les luttes ouvrières actuelles est beaucoup plus profonde que celle de ce qu'on a souvent appelé les années d'illusion: illusions sur les "libérations nationales", sur "la gauche au pouvoir" ou sur l'autogestion des entreprises en faillite, par exemple. Aujourd'hui, dans les principaux centres industriels d'Europe, ainsi que dans les pays où les formes "démocratiques" de la dictature bourgeoise ont duré suffisamment, le prolétariat a énormément perdu de ses illusions sur les institutions syndicales, sur les partis dits "ouvriers" mais appartenant à l'appareil de la classe dominante (PC, Socialistes, Démocrates, etc.), sur le rôle des élections, sur la possibilité de sortir de la crise économique en acceptant de faire des sacrifices pour l'entreprise ou la nation, etc. La quasi-totalité des mouvements importants de la classe ouvrière démarrent en dehors des syndicats, et les affrontements entre ouvriers et leurs prétendues organisations représentatives sont de plus en plus fréquents. Après les luttes de Belgique au printemps 1986 qui ont montré comment étendre un mouvement de lutte malgré les syndicats, après les grèves des cheminots pendant l'hiver 86-87 en France qui ont tenté de former des coordinations centralisées en dehors des syndicats, les luttes des travailleurs en Italie au cours de 1987 démontrent, dès le début, avec le mouvement des travailleurs de l'école puis d'autres secteurs, en particulier des transports, une farouche volonté de conduire le combat en dehors du contrôle syndical et en se donnant ses propres formes d'organisation basées sur les assemblées de base.
Il y a moins de grèves dans les années 80, mais elles traduisent une bien plus grande maturité en profondeur. Une maturité qui a été acquise et s'acquiert non malgré, la crise économique, mais sous sa pression directe.
Et pourtant...
"LA CRISE DE 1929 N'A PAS ABOUTI A L'UNIFICATION DE CLASSE OUVRIERE MAIS AU CONTRAIRE A SA NEGATION LA PLUS VIOLENTE: LA GUERRE IMPERIALISTE".
Le marxisme n'a jamais conçu la réalité sociale comme une mécanique simpliste et inconsciente. Sans conscience de classe, aucune crise capitaliste ne peut provoquer par elle même une unification effective des combats prolétariens. C'est pour cela que, comme nous l'avons dit, la crise économique est une condition nécessaire, mais non suffisante. L'expérience historique des années 30 ne démontre pas que la crise économique ne contribue pas au processus d'unification prolétarien, mais qu'à elle seule, la crise ne suffit pas.
En 1929, lorsque éclate le krach de Wall Street, le prolétariat européen est encore sous les coups de la répression de la vague révolutionnaire internationale qui secoua l'Europe à la fin de la première guerre mondiale. La révolution russe, cet événement qui avait suscité tant d'espoirs, cette lutte qui avait été le phare de tous les combats ouvriers mourait étouffée après la défaite sanglante de la révolution en Allemagne entre 1919 et 1923.
Dans ces conditions, subissant la défaite, le prolétariat n'avait pas les moyens de répondre au nouveau défi que lui jetait le capitalisme en crise.
Il faut ajouter à cette différence au niveau de la conscience de la classe, une autre de taille au niveau du déroulement de la crise elle-même: dans les années 30 les politiques de réarmement et de grands travaux qui préparaient à la guerre ont permis de résorber puissamment le chômage et de limiter les effets de la crise (voir l'article qui suit sur la crise actuelle et sa différence avec celle de 1929: "Crise: quand il faut payer le solde").
L'actuelle génération de prolétaires n'a pas connu de défaites de cette ampleur dans ses principales concentrations. 50 ans de décadence du capitalisme sont passés par là, avec leur lot de barbarie mais aussi avec leur somme d'expériences lentement digérées, avec leur pouvoir de destruction des illusions.
Le capitalisme en crise trouve aujourd'hui devant lui un prolétariat dont la conscience se débarrasse des pires mythes qui l'enchaînaient il y a 50 ans.
Et pourtant...
"TOUTES LES LUTTES REVOLUTIONNAIRES IMPORTANTES DU PROLETARIAT DANS LE PASSE ONT ETE LE PRODUIT DE GUERRES ET NON DE CRISES ECONOMIQUES PURES"
Il est vrai que les plus grandes luttes ouvrières jusqu'à présent ont été provoquées par des situations de guerre: la Commune de Paris de 1871, liée à la guerre franco prussienne, la révolution de 1905 en Russie, liée à la guerre russo-japonaise, la vague révolutionnaire internationale de 1917-1923 liée à la première guerre mondiale.
Mais il n'en découle nullement que la guerre crée les conditions optimales pour la révolution prolétarienne. Encore moins que la crise économique "pure" -car la guerre impérialiste n'est qu'une manifestation de la crise économique- ne favorise pas l'unification de la classe ouvrière.
Les guerres, par les souffrances extrêmes qu'elles imposent aux classes exploitées en très peu de temps, tendent à créer des situations révolutionnaires. Mais ceci ne se produit que dans les pays ayant été défaits (la France en 1871 défaite par la Prusse, la Russie en 1905 défaite par le Japon, fa Russie en 1917 défaite par l'Allemagne, l'Allemagne en 1918 défaite par les Alliés). Dans les pays victorieux la guerre ne provoque pas les mêmes conséquences.
La crise économique a un effet beaucoup plus lent sur les conditions de vie de la classe ouvrière. Mais cet effet est aussi plus profond et plus étendu géographiquement. Dans la crise économique mondiale du capital, il n'y a pas de pays "neutre", ni de vainqueur. C'est toute la machine capitaliste qui est vaincue par ses propres lois devenues contradictoires. La misère ne connaît plus de frontières.
En outre, les mouvements de lutte déclenchés par le combat contre la guerre trouvent un point d'arrêt, sinon un puissant ralentissement, si la bourgeoisie est contrainte à la paix. Par contre la crise économique, sans aboutissement révolutionnaire, ne peut avoir d'autre issue que la guerre. La guerre joue ici un rôle dans la prise de conscience, mais comme menace.
Le constat du rôle de la guerre dans les révolutions passées n'infirme donc en rien le rôle unificateur que peut avoir la crise économique aujourd'hui sur la lutte ouvrière. Au contraire.
L'unification de la classe ouvrière mondiale sera un effort conscient de celle-ci ou ne sera pas. Mais cette conscience ne peut se développer et vaincre que dans les conditions objectives que crée la crise économique du mode de production capitaliste.
Ce que montre l'évolution des luttes des années 80, ce que montre l'expérience des années 30, ce que montre le rôle joué par la guerre dans les révolutions prolétariennes passées, ce n'est pas que la crise empêche l'unification des luttes prolétariennes mais que jamais dans l'histoire les conditions objectives pour la révolution prolétarienne n'ont été aussi mûres.
Au prolétariat mondial de relever le défi qu'une fois encore lui jette l'histoire.
RV. 21/11/87
[1] [2] Voir entre autre les articles : « Le prolétariat dans le capitalisme décadent » (n°23, 3° trim. 1980), « les années 80 ne sont pas les années 30 » (n° 36, 1er trim. 1984), « Sur le cours historique » (n° 50, 3e trim. 1987).
Récent et en cours:
- Crise économique [3]
- Luttes de classe [4]
Questions théoriques:
- Guerre [5]
Où en est la crise économique ? : Krach : quand il faut payer le solde
- 7056 lectures
Quelques semaines après le fameux "jeudi noir" en octobre 1929, Hoover, le président des USA, déclarait: "La prospérité nous attend au prochain coin de rue". Nous connaissons la suite, les années 30 de si sinistre mémoire, la crise jamais surmontée, finalement la guerre mondiale.
Trente huit ans après, les mêmes propos sur la santé de l'économie mondiale ne rassurent plus personne. Si la volonté de rassurer reste la préoccupation obsessionnelle des pouvoirs établis, la perspective d'une nouvelle et très grave avancée de la récession mondiale est une chose tenue pour certaine, même pour les plus optimistes. Le jour même où les USA annonçaient pour "rassurer les marchés", qu'ils étaient prêts a réduire de quelques milliards de dollars leur déficit budgétaire, une étude de la très célèbre et puissante banque américaine "la Morgan" avançait l'analyse suivant laquelle la récession à venir "sera trois à quatre fois plus destructrice que la récession de 1981-1982". 1981-82 c'était déjà la flambée du chômage dans les pays développés, le fond de la misère pour les autres. Quand on connaît cette morsure qu'a infligée dans la chair de l'humanité la récession de 81-82, une telle perspective laisse rêveur.
Qu'ici l'on ne se trompe pas; la crise boursière d'octobre 87 ne représente que l'écume des vagues, elle n'est que le signe annonciateur, précurseur d'un raz de marée d'une puissance inouïe, aux conséquences encore difficilement mesurables.
UNE SITUATION BIEN PLUS GRAVE QUE DANS LES ANNEES 30
Il est normal que les récentes secousses du système financier international viennent rappeler le krach boursier de 1929 et, par analogie, la crise des années 30. Mais au-delà des apparences immédiates les situations historiques sont radicalement différentes et, contrairement à ce qui en est généralement dit, la comparaison entre les deux époques fait ressortir du strict point de vue économique les impasses et la gravité de la situation actuelle.
Comme à la fin des années 20, la crise boursière a été précédée par une orgie et une ivresse spéculatives où l'argent et le profit semblaient s'auto engendrer dans une spirale infinie. Miracle de l’argent dégageant des profits sans emprunter le classique circuit de la production. Spéculation sans précédent attirant tous les capitaux et toute l'épargne sociale dont les appétits de profit ne pouvaient être assouvis par le marché traditionnel et l'industrie.
Comme en 29 cette bulle spéculative va crever dès les premiers signes de récession et, comme en 29 encore, le coup d'envoi de la crise boursière est donné par un mouvement de retrait des capitaux européens. Retrait marqué en 1929 par le relèvement des taux d'escompte de la Banque d'Angleterre, en octobre 1987 par le relèvement des taux d'intérêt en RFA.
La similitude entre ces deux situations s'arrête là.
Il est vrai que le krach de 1929 ne tombe pas du ciel, il a lentement mûri tout au long d'une période où les industries traditionnelles comme les chemins de fer, les mines, le charbon, le textile souffrent d'une surcapacité chronique et où le pouvoir d'achat des ouvriers et des paysans, de 1920 à 1929, n'a cessé de baisser. Mais à part ces secteurs, les années précédant le krach sont des années de très grande prospérité dans des secteurs nouveaux et de plus en plus puissants comme l'automobile, la TSF', l'acier, l'électricité, le gaz et le pétrole.
De fait, le krach boursier de 1929 ouvre la période de crise économique, il la précède. Aujourd'hui il la suit et dans une situation où tous les secteurs sont touchés depuis des années.
La spéculation financière à l'origine du krach ne s'était vraiment développée que depuis 1928. Du seul point de vue de la spéculation, la fuite du capital hors des sphères de la production précédant la crise boursière d'octobre 1987 n'est pas un phénomène récent. La spéculation est depuis de longues années une activité chronique du capital et en tant que telle elle traduit toutes les difficultés du capital à se valoriser dans le processus de production. Bien qu'elle soit allée crescendo pour aboutir aux délires de l'année 1986, là spéculation se généralise depuis plus d'une décennie: spéculation par anticipation sur le prix des matières premières comme le pétrole dans les années 70, spéculation sur les monnaies comme le dollar dans le début des années 80, spéculation au travers de rachats d'entreprises depuis deux ans... Qu'après avoir fui massivement la sphère de la production industrielle, le capital se voit traqué et piégé dans les temples de la bourse où, fiévreusement réfugié dans la spéculation financière, il s'était retranché ces dernières années ne montre qu'une chose: la crise boursière est l'enfant de la crise économique et non le contraire.
Les rapports actuels entre les flux financiers et ceux des marchandises en sont un des principaux indicateurs:
"Les mouvements financiers sont devenus sans commune mesure avec ceux des marchandises: le rapport est de 50 à 1, puisque pour 5 milliards de dollars d'échanges commerciaux quotidiens, les flux monétaires à travers les frontières sont supérieurs à 200 milliards de dollars. " (Dossiers et documents, le Monde novembre 87)
La crise actuelle n'est pas seulement plus grave qu'en 1929 par la masse des contradictions accumulées mais aussi conjointement par le fait que toutes les recettes employées pour y faire face, ou tout au moins pour les contourner, sont aujourd'hui épuisées et usées jusqu'à la corde.
Si contrairement à 1929 la crise précède, et de loin, la tempête boursière, il en est de même des politiques économiques pour faire face à cette crise historique de surproduction. New-deal, politique de grands travaux, relance par la consommation et l'inflation, bref, tout ce que l'on recoupe sous le terme de Keynésianisme en fait l'intervention croissante de l'Etat dans l'économie, le développement du capitalisme d'Etat- ne sont plus devant nous mais derrière nous.
Les manipulations financières ont toujours été l'outil essentiel de ces politiques de fuite en avant: aujourd'hui, à force d'avoir abusé du crédit, de l'inflation, des déficits, de la spéculation, l'édifice du système financier international est incapable d'en supporter plus, il est un véritable château de cartes dont l'édifice totalement vermoulu menace chaque jour davantage de s'effondrer et dont l'équilibre relève du miracle.
Ce tableau ne serait pas complet si l'on n'y intégrait pas les questions des déficits budgétaires et la politique d'armement qui leur est liée.
Dans les années 30 la situation encore saine de la trésorerie des Etats, alimentée par des années de prospérité du capital, allait permettre l'illusion d'une relance de la production par une immense production d'armements. Aujourd'hui, cette production gigantesque d'armements qui aspire tout ce que la société a créé de plus productif de manière ininterrompue depuis la seconde guerre mondiale, est une des causes majeures du déficit budgétaire des États nationaux, des USA et de l'URSS particulièrement, et s'inscrit donc dans la situation historique actuelle comme un accélérateur important de la crise économique mondiale (voir l'article "Guerre, militarisme..." dans ce numéro). Toute la bourgeoisie mondiale, en particulier en Europe, montre du doigt les USA et accuse leur déficit budgétaire. Pourtant, le déficit budgétaire des USA a pour cause profonde une politique de surarmement, comme en URSS d'ailleurs, que personne ne conteste mais que les bourgeoisies mondiales rechignent à payer. Pour ces raisons incontournables du point de vue capitaliste, les récriminations des bourgeoisies européennes sont condamnées à rester des gesticulations. Pour l'essentiel, elles feront comme d'habitude, elles s'aligneront.
De quelque côté qu'elle se tourne, l'économie capitaliste mondiale, de Washington à Moscou, de Pékin à Paris, de Tokyo à Londres, est coincée.
LA PERSPECTIVE D'UNE ACCELERATION MAJEURE DE LA RECESSION MONDIALE
L'histoire économique de ces vingt dernières années n'est pas autre chose que l'histoire de cette course mondiale de l'économie capitaliste mondiale vers l'impasse actuelle. Dans cette période qui s'étend de la fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons distinguer plusieurs phases:
"Avec l’arrêt définitif de tous les mécanismes delà reconstruction au milieu des années 60, le capitalisme en Occident a commencé de vivre suivant des oscillations déplus en plus amples et violentes. Comme une bête enragée qui se cogne la tête contre les murs de sa cage, le capitalisme occidental s'est heurté déplus en plus violemment à deux écueils: d'une part des récessions de plus en plus profondes, d'autre part des relances de moins en moins efficaces et déplus en plus inflationnistes.
On peut brièvement résumer les principales phases de la crise dans l'économie occidentale depuis 1967 de la façon suivante:
- en 1967y ralentissement de la croissance;
- en 1968, relance;
- de 1969 à 1971, nouvelle récession plus profonde que celle de 1967;
- de 1972 au milieu de l'année 1973, deuxième relance faisant craquer le système monétaire international avec la dévaluation du dollar en 1971 et la mise en flotte ment des principales parités monétaires; les gouvernements financent une relance générale avec des tonnes de "monnaie de singe";
- au début de 1973, les "sept grands" connaissent le taux de croissance le plus élevé depuis dix-huit ans (8 1/3 en base annuelle au 1er semestre 1973); -fin 1973 afin 1975, nouvelle récession; la troisième, mais aussi la plus longue et la plus profonde; au second semestre 1973, la production n'augmente plus qu'au rythme de 2% annuel; plus d'un an plus tard, au début de 1975, elle recule de façon absolue au rythme de 4,3%par an;
-1976-1979, troisième relance; mais cette fois ci, malgré le recours à la politique keynésienne de relance par la création de déficits des budgets des Etats, malgré le nouveau marché constitué par les pays de l'OPEP qui grâce à la hausse du prix du pétrole ont représenté une forte demande pour les produits manufacturés de pays industrialisés, malgré enfin l'énorme déficit de la balance commerciale des Etats-Unis qui, grâce au rôle international du dollar, ont créé et entretenu un marché artificiel en important beaucoup plus qu 'ils n'exportaient, malgré tous ces moyens mis en oeuvre par les gouvernements, la croissance économique, après une brève reprise en 1976, ne cesse de s'effriter, lentement, mais systématiquement. (...) Comme on le voit, que ce soit le remède 'déficit budgétaire' ou que ce soit le remède 'déficit extérieur' des USA, tous les deux ont été administrés en doses massives à l’économie au cours des dernières années. La médiocrité des résultats obtenus ne prouve qu'une chose: leur efficacité ne cesse de se réduire. Et c'est là la deuxième raison qui permet de prévoir l'ampleur exceptionnelle de la récession qui commence avec le début des années 80." (Revue Internationale N° 20,1980).
Ecrits au début des années 80, ces pronostics ont été plus qu'amplement vérifiés.
Aujourd'hui, après avoir vu les capitaux du monde entier fuir la sphère de la production industrielle, laissant sur le carreau des millions de personnes, financer l'effort d'armement du bloc occidental en finançant le déficit budgétaire américain, nourrir la spéculation boursière, on aboutit à la situation actuelle où les déficits sont tellement colossaux, les rouages financiers et les structures monétaires tellement fragilisés, à la limite de la rupture, une surproduction totale dans tous les secteurs - qu'il s'agisse de l'agriculture, des matières premières, de l'industrie - qu'une nouvelle récession majeure doublée d'une nouvelle période d'inflation est inévitable.
Dans les pays de l'Est, la "libéralisation" ne fait pas illusion. A l'évidence elle couvre idéologiquement une diminution extrêmement grave des charges d'entretien de la force de travail, salaires, logements, santé, transports... Les émeutes en Roumanie sont là pour témoigner de l'insupportable paupérisation. De plus en plus, les conditions ouvrières intolérables des périodes de guerre se répandent sous la seule pression de la crise: rationnement, militarisation....
En Occident devant quel choix se retrouve la bourgeoisie, plus spécifiquement le chef d'orchestre américain ?
- soit maintenir le dollar par une politique de taux d'intérêt élevés. Et ces taux doivent être d'autant plus forts que le dollar est faible, pour soutenir le dollar et attirer les capitaux de toutes les places financières nécessaires au financement de là dette. Orientation qui implique immédiatement une tempête récessioniste aux USA et par contrecoup au niveau mondial;
- soit laisser "filer" le dollar avec une politique de taux d'intérêt bas pour soutenir l’exportation et la production. Ce qui ne peut que provoquer une vague inflationniste très forte. D'autant plus forte que les marchés, les banques sont littéralement assoiffés de devises, d'argent frais et particulièrement l'Etat avec sa dette colossale.
Bien que l'incertitude règne, et on peut-être sûr que cette incertitude sur l'orientation à prendre est essentiellement due à l'immensité et l'insolvabilité du problème plus qu'à une attitude tactique, à l'heure actuelle il semble bien que ce soit la dernière solution qui a été retenue: baisse des taux d'intérêt et du dollar. Donc dans l'immédiat politique inflationniste. Ici les commentateurs évoquent la période électorale aux USA qui dans cette situation ne veulent pas entendre parler de récession. Dans une certaine mesure, celle-ci joue. Mais dans le fond il faut souligner qu'aucun choix n'est donné par l'état de l'économie mondiale, la marge de manoeuvre est extrêmement réduite.
Ainsi si les USA optent dans l'immédiat pour une politique inflationniste en laissant filer le dollar par des taux d'intérêt bas, l'autre alternative d'une puissante récession n'en est pas moins terriblement pressante. Comment et jusqu'où les USA peuvent-ils laisser filer le dollar en le laissant s'approcher de sa valeur réelle ?
On a déjà vu ces deux dernières années qu'une dévaluation de 50% de la monnaie américaine n'a pas permis de rétablir la balance commerciale US. A considérer la compétitivité de l'économie américaine, les déficits accumulés (données qui fondent la valeur d'une monnaie), le dollar en termes réels ne vaut plus grand-chose et les USA ne peuvent se permettre de le laisser s'approcher de la valeur 0. Ils ne peuvent prendre le risque de provoquer avec une telle politique un effondrement du système bancaire américain déjà extrêmement fragilisé.
Donc l'inflation et la récession sont les perspectives immédiates, conjuguées et incontournables.
Le souffle de la crise financière de ce mois d'octobre 87 a brutalement balayé le bluff colossal que représentait la "reprise américaine", le "retour salvateur aux sources de la loi du marché". La situation laisse constater à qui veut le voir le délabrement total dans lequel se trouve l'économie mondiale. Ce qui est vrai pour la santé de l'économie mondiale, l'est aussi en ce qui concerne la condition ouvrière. Et plus spécifiquement en ce qui concerne le chômage qui résume à lui seul l'état général de la condition ouvrière.
A côté du bluff sur la "reprise américaine", nous avons assisté ces dernières années après l'explosion sans précédent du chômage -jusqu'à 12% en moyenne de la population active des pays industriels- à un maquillage de l'état général de ce qu'il est convenu d'appeler le "marché du travail".
Aux USA, tout d'abord, où la pseudo reprise s'accompagnait d'une pseudo baisse du taux de chômage (sans jamais revenir, même officiellement, aux taux d'avant 1980). Ce que cachaient les chiffres absolus n'était en fait qu'une paupérisation sans précédent de la condition ouvrière et de pans entiers des couches moyennes. Dans ces données absolues, la création d'emplois semblait suivre le rythme de leur disparition; mais là où il y avait auparavant dans l'industrie un emploi qualifié, assuré et à peu près "correctement" rémunéré, se substituait un emploi sans qualification dans "les services", instable, une rémunération correspondant à la moitié de ce qu'elle était auparavant.
Tel est le miracle américain.
En Europe, on a eu droit à d'inimaginables contorsions et manipulations de chiffre pour camoufler un tant soit peu "la honte" du chômage. Mieux encore on a pu voir la bourgeoisie "joindre l'utile à l'agréable" en créant des emplois dits "d'utilité publique" (dans beaucoup de pays d'Europe) pour la jeunesse, rémunérés quatre fois moins que le montant du salaire minimum garanti.
Avec le développement de la crise actuelle, comme le bluff de la santé de l'économie mondiale retrouvée, le bluff sur la condition des classes laborieuses va crever lamentablement et laisser apparaître au grand jour la vérité sur la misère de ce monde. Et cette misère va encore faire un bond en avant sans précédent. Telle est la vérité, la vérité à laquelle plus personne ne peut se soustraire, que l'on devra soit accepter avec ses conséquences économiques et militaires, soit combattre avec acharnement. Rappelons-nous ce qu'a signifié la récession de 81-82 pour imaginer les conséquences d'une nouvelle récession sur les plaies encore vives de la vague récessioniste précédente.
Si les années 70 ont été des années d'illusions et les années 80 les années de vérité couverte par un immense bluff, les années à venir seront les années d'une vérité qu'on ne peut plus fuir.
UNE IMMENSE CRISE DE SURPRODUCTION
Une grande majorité de personnes interrogées, avouerait ne rien entendre à l'évolution pourtant bien concrète de la crise économique mondiale. Il est vrai, rien n'est fait dans ce sens, et pour cause. Mais dans le fond, les déterminations essentielles de cette crise mondiale qui dure et s'approfondit depuis des années sont bien plus simples à saisir que ce qui en est dit le laisse supposer. Le développement même de la crise joue lui aussi un rôle de clarification.
La cause immédiate de l'effondrement de la bourse de New York et par sympathie de toutes les autres places boursières, c'est la chute du dollar. A la racine de la chute du dollar, il y a les déficits budgétaires et commerciaux américains. A la racine de ces déficits, la surproduction mondiale. Que cet effondrement ait tant fait de vagues est essentiellement dû au gonflement de la bourse par la spéculation. Cette fièvre spéculative a principalement pour cause la fuite des capitaux de la sphère de la production, cette fuite a elle-même pour cause la surproduction mondiale. De quelque côté que l'on prenne le problème on aboutit à cette détermination essentielle: la surproduction mondiale. Et finalement la crise boursière d'octobre 87, par rapport à toute l’ampleur du problème auquel se trouve confrontée l'humanité, n'est que du pipi de chat.
C'est parce que la société produit "trop" qu'elle engendre la misère. Qu'exprime cette crise de surproduction qui à d'autres époques aurait paru absurde ? sinon que les rapports de production actuels dits "modernes" appartiennent en fait à la préhistoire de l'humanité. Rapports de production anachroniques dominés par la production en fonction du marché et en vue du profit; caractérisés par la séparation des producteurs d'avec les forces productives, c'est-à-dire par l'exploitation du travail, et sa division entre travail intellectuel et travail manuel; rapports de production qui conditionnent la division du monde en nations, division où s'exprime et se concentre tout le déchirement de l'humanité comme le montrent les guerres.
Dans cette crise de surproduction où s'affrontent les nations, à l'Est où à l'Ouest, que nous demandent les classes dominantes, sinon d'être les soldats de la guerre économique avant d'être les soldats de la guerre totale, finale, définitive?
Du point de vue capitaliste la crise de surproduction c'est la guerre de tous contre tous, la guerre sous toutes ses formes, d'abord économique, ensuite par les armes; de notre point de vue, celui de l'avenir, la crise impose l'unification de l'humanité, la destruction des frontières. Soit nous serons capables de mettre sur pied un grand projet mondial qui abolira toutes les séparations, soit nous emprunterons misérablement le chemin de la fin du monde.
Prénat. 30/11/87
Questions théoriques:
- L'économie [6]
Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme
- 4383 lectures
La formidable armada déployée par le bloc occidental dans le Golfe persique (voir l'éditorial de la Revue Internationale n° 51) est venue rappeler avec brutalité la nature profonde du système capitaliste, un système qui depuis son entrée en décadence au début du siècle a conduit à une militarisation croissante de toute la société, a stérilisé ou détruit des proportions considérables du travail humain, a transformé la planète en une véritable poudrière. A l'heure où de grands discours sont prononcés par les principaux gouvernements du monde sur la limitation des armements, ou même le désarmement, les faits du Moyen-Orient viennent donc apporter un démenti cinglant aux illusions sur une "atténuation" des tensions militaires et illustrent en particulier de façon éclatante une des composantes majeures des enjeux impérialistes actuels: l'offensive du bloc américain en vue de poursuivre son encerclement du bloc russe et qui passe en premier lieu par la remise au pas de l'Iran. Ces événements, par la remarquable coopération des forces navales des principaux pays occidentaux qu'ils mettent en évidence, soulignent également que les rivalités économiques qui s'aiguisent entre ces mêmes pays n'entravent nullement leur solidarité en tant que membres d'un même bloc impérialiste alors qu'en même temps, le climat belliciste qui imprègne toute la planète ne se traduit pas seulement par des tensions guerrières entre les grands blocs mais se répercute également par des affrontements entre certains pays liés à un même bloc, comme c'est le cas dans le conflit entre l'Iran et l'Irak et, derrière ce dernier, les principaux pays occidentaux.
C'est de cet ensemble de questions, essentielles pour la classe ouvrière, son combat et sa prise de conscience, que se propose de traiter le présent article.
LA GUERRE ET LE MILITARISME DANS LA DECADENCE DU CAPITALISME
Le mouvement ouvrier face a la guerre
Depuis ses origines le mouvement ouvrier a porté une attention soutenue à l'égard des différentes guerres que se livraient entre elles les nations capitalistes. Pour ne citer qu'un exemple on peut rappeler les prises de position de la première organisation internationale de la classe ouvrière, l’A.I.T. à l'égard de la guerre de Sécession aux Etats-Unis en 1864 ([1] [7]) et de la guerre franco-allemande de 1870 ([2] [8]). Cependant l'attitude de la classe ouvrière à l'égard des guerres bourgeoises a évolué dans l'histoire, allant du soutien de certaines d'entre elles à un refus catégorique de toute participation. Ainsi, au siècle dernier, les révolutionnaires pouvaient appeler les ouvriers à apporter leur appui à telle ou telle nation belligérante (pour le Nord contre le Sud dans la guerre de Sécession, pour l'Allemagne contre la France du Second Empire au début de leur affrontement en 1870), alors que la position de base de tous les révolutionnaires au cours de la première guerre mondiale était justement le rejet et la dénonciation de tout appui à l'un ou l'autre des camps en présence.
Cette modification de la position de la classe ouvrière à l'égard des guerres, qui fut justement en 1914 le point de clivage crucial dans les partis socialistes (et particulièrement dans la Social-démocratie allemande) entre ceux qui rejetaient toute participation à la guerre, les internationalistes, et ceux qui se réclamaient des positions anciennes du mouvement ouvrier pour mieux soutenir leur bourgeoisie nationale ([3] [9]), cette modification correspondait en réalité à la modification de la nature même des guerres liée pour sa part à la transformation fondamentale subie par le capitalisme entre sa période ascendante et sa période de décadence ([4] [10]).
Cette transformation du capitalisme et de la nature de la guerre qui en découle, a été reconnue par les révolutionnaires depuis le début du siècle et notamment lors de la première guerre mondiale. C'est sur cette analyse, en particulier, que se base l'Internationale Communiste pour affirmer l'actualité de la révolution prolétarienne. Depuis ses origines, le CCI s'est réclamé de cette analyse et en particulier des positions de la Gauche Communiste de France qui, déjà en 1945, se prononçait de façon très claire sur la nature et les caractéristiques de la guerre dans la période de décadence du capitalisme:
"A l’époque du capitalisme ascendant, les guerres (nationales, coloniales et de conquêtes impérialistes) exprimèrent la marche ascendante de fermentation, de renforcement et d'élargissement du système économique capitaliste. La production capitaliste trouvait dans la guerre la continuation de sa politique économique par d'autres moyens. Chaque guerre se justifiait et payait ses frais en ouvrant un nouveau champ d’une plus grande expansion, assurant le développement d'une plus grande production capitaliste.
A l'époque du capitalisme décadent, la guerre au même titre que la paix exprime cette décadence et concourt puissamment à l'accélérer.
Il serait erroné de voir dans la guerre un phénomène propre, négatif par définition, destructeur et entrave au développement de la société, en opposition à la paix qui, elle, sera présentée comme le cours normal positif du développement continu de la production et de la société. Ce serait introduire un concept moral dans un cours objectif, économiquement déterminé.
La guerre fut le moyen indispensable au capitalisme lui ouvrant des possibilités de développement ultérieur, à l'époque où ces possibilités existaient et ne pouvaient être ouvertes que par le moyen de la violence. De même, le croulement du monde capitaliste ayant épuisé historiquement toutes les possibilités de développement, trouve dans la guerre moderne, la guerre impérialiste, l'expression de ce croulement qui, sans ouvrir aucune possibilité de développement ultérieur pour la production, ne fait qu’engouffrer dans l'abîme les forces productives et accumuler à un rythme accéléré ruines sur ruines.
Il n’existe pas une opposition fondamentale en régime capitaliste entre guerre et paix, mais il existe une différence entre les deux phases ascendante et déca dente de la société capitaliste et, partant, une différence de fonction de la guerre (dans le rapport de la guerre et de la paix) dans les deux phases respectives.
Si dans la première phase, la guerre a pour fonction d'assurer un élargissement du marché, en vue d'une plus grande production de biens de consommation, dans la seconde phase, la production est essentiellement axée su la production de moyens de destruction, c'est-à-dire en vue de la guerre. La décadence de la société capitaliste trouve son expression éclatante dans le fait que des guerres en vue du développement économique (période ascendante), l'activité économique se restreint essentiellement en vue de la guerre (période décadente).
Cela ne signifie pas que la guerre soit devenue le but de la production capitaliste, le but restant toujours pour le capitalisme la production de la plus-value, mais cela signifie que la guerre, prenant un caractère de permanence, est devenue le mode de vie du capitalisme décadent."
(Rapport à la Conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France, repris dans le rapport sur le Cours Historique adopté au 3e congrès du CCI, Revue Internationale n° 18, 3e trim. 1979).
LA CONFIRMATION DE L'ANALYSE DE LA GAUCHE COMMUNISTE
Ces lignes furent écrites en juillet 1945, alors que la guerre mondiale se terminait à peine en Europe et qu'elle se poursuivait encore en Extrême-Orient. Et tout ce qui s'est passé depuis cette date n'a fait que confirmer amplement l'analyse qu'elles expriment, bien au delà même de ce qu'on avait pu connaître auparavant. En effet, alors qu'au lendemain de la le guerre mondiale on avait pu assister, jusqu'au début des années 30, à une certaine atténuation des antagonismes inter impérialistes, de même qu'à une réduction significative des armements dans la monde, rien de tout cela ne s'est produit au lendemain de la 2e guerre mondiale. Les quelques 150 guerres qui, depuis que la "paix" a été rétablie, se sont déroulées dans le monde ([5] [11]), avec leurs dizaines de millions de tués, ont bien fait la preuve qu'"il n'existe pas une opposition fondamentale en régime capitaliste entre guerre et paix", et que "la guerre, prenant un caractère de permanence, est devenue le mode de vie du capitalisme décadent". Et ce qui caractérise toutes ces guerres, comme les deux guerres mondiales, c'est qu'à aucun moment, contrairement à celles du siècle dernier, elles n'ont permis un quelconque progrès dans le développement des forces productives, mais n'ont eu d'autre résultat que des destructions massives laissant complètement exsangues les pays où elles se sont déroulées (sans compter les horribles massacres qu'elles ont provoqués). Parmi une multitude d'exemples de guerres survenues depuis 1945, on peut prendre celle au Vietnam qui devait permettre, aux dires de ceux qui, dans les années 60 et 70, manifestaient avec les drapeaux du FNL, de construire un pays neuf et moderne, où les habitants seraient délivrés des calamités qui les avaient accablés avec l'ancien régime de Saigon. Depuis la réunification de ce pays en 1975, non seulement les populations vietnamiennes n'ont pas connu la paix (les anciennes "armées de libération" s'étant converties en armées d'occupation du Cambodge), mais leur situation économique n'a cessé de se dégrader à tel point que, lors de son dernier congrès, le parti dirigeant s'est vu obligé de dresser un constat de faillite de l'économie.
LES DESTRUCTIONS DES DEUX GUERRES MONDIALES ET LEURS CONSEQUENCES
Pour aussi catastrophiques qu'elles soient, les destructions provoquées par les différentes guerres qui se sont déroulées depuis 1945, et qui ont surtout affecté des pays faiblement développés, sont évidemment bien en deçà de celles de la première, et surtout de la seconde guerre mondiale qui, elles, avaient concerné les pays les plus développés du monde, notamment ceux d'Europe occidentale. Ces deux guerres, par les différences qu'elles comportent avec celles du siècle dernier «par exemple celle de 1870 entre la France et l'Allemagne sont bien à l'image des transformations subies par le capitalisme depuis cette époque. Ainsi, la guerre de 1870, en permettant la réunification de l'Allemagne, fut pour ce pays une des conditions majeures de son formidable développement de la fin du 19e siècle, alors même que, pour le pays vaincu, la France, elle n'eut pas de réelle conséquence négative malgré les 5 milliards de francs or versés à l'Allemagne pour obtenir le départ de ses troupes: c'est au cours des trois dernières décennies du 19e siècle que la France connaît son développement industriel le plus important (illustré notamment par les expositions universelles de Paris en 1878,1889 et 1900).
En revanche, les deux grandes guerres de ce siècle qui, au départ, ont mis aux prises les deux mêmes antagonistes, ont eu pour principale conséquence non pas un nouveau bond en avant dans le développement des forces productives, mais en premier lieu une dévastation sans précédent de celles-ci et notamment de la principale d'entre elles, la classe ouvrière.
Ce phénomène est déjà flagrant lors de la le guerre mondiale. Dans la mesure même où ce sont les principales puissances capitalistes qui s'y affrontent, la plus grande partie des soldats qui sont fauchés sur le front sont des ouvriers en uniforme. La saignée que la guerre représente pour la classe ouvrière est en proportion non seulement de l'acharnement des combats et de "l'efficacité" des nouvelles armes utilisées au cours de cette guerre (blindés, gaz de combat, etc.), mais aussi du niveau de mobilisation auquel elle donne lieu. Contrairement aux guerres du passé qui n'avaient jeté dans les combats qu'une proportion relativement faible de la population masculine, c'est la quasi-totalité de celle-ci dans la force de l'âge qui est affectée par la mobilisation générale ([6] [12]), plus d'un tiers qui est tuée ou blessée gravement dans les combats.
D'un autre côté, bien que la le guerre mondiale se soit déroulée du côté occidental sur une faible étendue territoriale et qu'elle ait par conséquent grandement épargné les principales régions industrielles, elle s'est traduite par une chute de près de 30% de la production européenne. C'était principalement la conséquence de la ponction énorme que représentait pour l'économie tant l'envoi sur le front de l'essentiel de la classe ouvrière que l'utilisation de plus de 50% du potentiel industriel dans la fabrication d'armements, ce qui se traduisait notamment par une chute vertigineuse des investissements productifs aboutissant au vieillissement, à l'usure extrême et au non remplacement des installations industrielles.
Expression de l'enfoncement du système capitalisme dans sa décadence, les destructions de la seconde guerre mondiale se situent à une échelle bien plus vaste encore que celles de la première. Si certains pays comme la France ont un nombre plus faible de tués que lors de la le guerre du fait qu'ils ont été rapidement vaincus dès le début des hostilités, le nombre total des morts est environ quatre fois plus élevé (de l'ordre de 50 millions). Les pertes d'un pays comme l'Allemagne, la nation la plus développée d'Europe, où vit le prolétariat le plus nombreux et le plus concentré, s'élèvent à plus de 7 millions, soit trois fois plus qu'entre 1914 et 1918, parmi lesquels figurent 3 millions de civils. Car dans sa barbarie croissante, le capitalisme ne se contente plus de dévorer les prolétaires en uniforme, c'est toute la population ouvrière qui, désormais, non seulement est mobilisée dans l'effort de guerre (comme ce fut déjà le cas lors du 1er conflit mondial) mais qui paye directement le prix du sang. Dans certains pays, la proportion de civils tués excède de très loin le nombre de soldats tués au front: par exemple sur les 6 millions de disparus que compte la Pologne (22% de la population), 600000 seulement (si on peut dire) sont morts dans les combats. En Allemagne, ce sont par exemple 135000 êtres humains (plus qu'à Hiroshima) qui sont tués pendant les 14 heures (en 3 vagues successives) que dure le bombardement de Dresde le 13 février 1945. Presque tous évidemment sont des civils, et la grande majorité des ouvriers. Les quartiers d'habitation ouvriers ont d'ailleurs la faveur des bombardements alliés car cela permet à la fois d'affaiblir le potentiel de production du pays à moindre frais que par l'attaque des installations industrielles souvent enterrées et bien protégées par la DCA (bien que ces installations ne soient pas épargnées évidemment) et, à la fois, de détruire la seule force susceptible de se révolter contre le capitalisme à la fin de la guerre comme elle le fit entre 1918 et 1923 dans ce même pays.
Sur le plan matériel, les dégâts sont évidemment considérables. Par exemple, si la France a eu un nombre "limité" de tués (600000 dont 400000 civils) son économie est ruinée du irait notamment des bombardements alliés. La production industrielle a baissé de près de moitié. De nombreux quartiers urbains ne sont plus que ruines; 1 million d'immeubles ont subi des dégâts. Tous les ports ont été systématiquement bombardés ou sabotés et sont obstrués par des bateaux coulés. Sur 83000 kilomètres de voies ferrées, 37000 sont avariés ainsi que 1900 viaducs et 4000 ponts routiers. Le parc ferroviaire, locomotives et wagons, est réduit au quart de celui de 1938.
L'Allemagne se retrouve aussi, évidemment, aux premiers rangs des destructions matérielles: 750 ponts fluviaux sont détruits sur 948, ainsi que 2400 ponts de chemin de fer et 3400 kilomètres de voies ferrées (pour le seul secteur occupé par les alliés occidentaux); sur 16 millions de logements, près de 2,5 millions sont inhabitables et 4 millions endommagés); un quart seulement de la ville de Berlin est épargné et Hambourg a subi à elle seule plus de dégâts que toute la Grande-Bretagne. En fait, c'est toute la vie économique du pays qui se trouve désarticulée provoquant une situation de détresse matérielle comme la population n'en a jamais connue:
"... en 1945, la désorganisation est générale, et dramatique. La reprise est rendue difficile par le manque de matières premières, l'exode des populations, la raréfaction de la main d'oeuvre qualifiée, l'arrêt de la circulation, l'effondrement de l'administration... Le mark étant devenu sans valeur, on commerce par troc la cigarette américaine sert de monnaie; la sous-alimentation est générale; la poste ne fonctionne plus; les familles vivent dans l'ignorance du sort de leurs proches, victimes de l'exode ou prisonniers de guerre; le chômage général ne permet pas de trouver de quoi vivre; l'hiver 1945-46 sera particulièrement dur, le charbon et l'électricité faisant souvent défaut... 39 millions de tonnes de houille seulement ont été extraites en 1945 et 3 millions de tonnes d'acier seront fabriqués en 1946; la Ruhr travaille à 12% de sa capacité."
(H.Michel, "La Seconde guerre mondiale", PUF, chapitre sur "L'effondrement de l'Allemagne").
Ce tableau —bien incomplet encore— des dévastations provoquées par les deux guerres mondiales, et notamment par la dernière, illustre donc d'une façon particulièrement crue les changements fondamentaux intervenus dans la nature de la guerre entre le 19e siècle et le 20e siècle. Alors qu'au siècle dernier les destructions et le coût des guerres n'étaient pas autre chose que des "faux frais de l'expansion capitaliste -faux frais qui, en général, étaient amplement rentabilisés depuis le début de notre siècle, elles sont des saignées considérables qui ruinent les belligérants, aussi bien les "vainqueurs" que les "vaincus" ([7] [13]). Le fait que les rapports de production capitaliste aient cessé e constituer la condition du développement des forces productives, qu'ils se soient au contraire convertis en de lourdes entraves à ce développement, s'exprime d'une façon on ne peut plus nette dans le niveau des ravages que subissent les économies des pays gui se sont trouvés au coeur du développement historique de ces rapports de production: les pays d'Europe occidentale. Pour ces pays notamment, chacune des deux guerres se traduit par un recul important de leur poids relatif à l'échelle mondiale tant au plan économique et financier u'au plan militaire au bénéfice des Etats-Unis dont ils deviennent de façon croissante une dépendance. En fin de compte, l'ironie de l'histoire a voulu que les deux pays qui se sont le mieux relevés économiquement à la suite de la seconde guerre mondiale malgré les destructions considérables qu'ils ont subies, sont justement les deux grands vaincus de cette guerre: l'Allemagne D’ailleurs amputée de ses provinces orientales) et le Japon. A ce phénomène paradoxal il existe une explication qui, loin de démentir notre analyse, la confirme au contraire amplement.
En premier lieu, le relèvement de ces pays n'a pu avoir lieu que par le soutien économique et financier massif apporté par les Etats-Unis à travers notamment le plan Marshall, soutien qui fut un des moyens essentiels par lesquels cette puissance s'est assurée une fidélité sans faille de ces pays. Par leurs propres forces, ces pays auraient été dans l'incapacité complète d'obtenir les "succès" économiques que l'on connaît. Mais ces succès s'expliquent aussi et surtout, notamment pour le Japon, par le rait que, durant toute une période, l'effort militaire de ces pays -en tant que pays vaincus- a été volontairement limité par les "vainqueurs" à un niveau bien moindre que celui de leur propre effort. C'est ainsi que la part du PNB du Japon consacré au budget des armées n'a jamais, depuis la guerre, dépassé le seuil de 1%, ce qui est très en deçà de la part qu'y consacrent les autres principaux pays.
LE CANCER DU MILITARISME RONGE L'ECONOMIE CAPITALISTE
Nous retrouvons donc là une des caractéristiques majeures du capitalisme dans sa période de décadence telle qu'elle a déjà été analysée par les révolutionnaires dans le passé: le fardeau énorme que représentent pour son économie les dépenses militaires, non seulement dans les périodes de guerre mais aussi dans les périodes de "paix". Contrairement à ce que pouvait écrire Rosa Luxemburg dans "L'accumulation du Capital" (et c'est la seule critique importante qu'on peut faire à ce livre), le militarisme ne représente nullement un champ d'accumulation pour le capitalisme. Bien au contraire: alors que les biens de production ou les biens de consommation peuvent s'incorporer dans le cycle productif suivant en tant que capital constant ou capital variable, les armements constituent un pur gaspillage du point de vue même du capital puisque leur seule vocation est de partir en fumée (y compris au sens propre) quand ils ne sont pas responsables de destructions massives. Ce fait s'est illustré de façon "positive" pour un pays comme le Japon qui a pu consacrer l'essentiel de sa production, notamment dans les secteurs de haute technologie, à développer les bases de son appareil productif, ce qui explique (outre les bas salaires payés à ses ouvriers) les performances de ses marchandises sur le marché mondial. Cette réalité s'est également illustrée de façon éclatante, mais de façon négative cette fois, dans le cas d'un pays comme l'URSS dont l'arriération présente et l'acuité des difficultés économiques résultent pour une large part de l'énorme ponction que représente la production d'armements: lorsque les machines les plus modernes, les ouvriers et les ingénieurs les plus qualifiés sont presque tous mobilisés dans la production de tanks, d'avions ou de missiles, il reste bien peu de moyens pour fabriquer par exemple des pièces détachées pour les innombrables tracteurs immobilisés, ou construire des wagons permettant d'acheminer des récoltes qui sont condamnées à pourrir sur place alors que les queues devant les magasins s'allongent dans les villes. Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui, l'URSS tente de desserrer cet étau que représentent pour son économie les dépenses militaires en prenant l'initiative d'un certain nombre de négociations avec les USA en vue de la réduction des armements.
Enfin, la première puissance mondiale n'échappe pas, elle non plus, aux conséquences catastrophiques des dépenses d'armement pour son économie: son énorme déficit budgétaire qui n'a cessé de progresser depuis le début des années 80 (et qui après avoir permis la "reprise" tant vantée de 1983, apparaît clairement aujourd'hui comme un des responsables de l'aggravation de la crise) accompagne avec un parallélisme remarquable l'accroissement considérable des budgets de défense depuis cette même date. L'accaparement par le secteur militaire du fleuron des forces productives (potentiel industriel et scientifique) n'est pas propre à l'URSS: la situation est identique aux USA (la différence étant que le niveau de technologie mis en oeuvre dans la fabrication des tanks en URSS est en deçà de celui qui est utilisé dans la fabrication des tracteurs aux USA et que les ordinateurs "grand public" américains sont copiés par PURSS pour ses besoins militaires). Dans ce dernier pays, par exemple, 60 % des efforts publics de recherche sont officiellement consacrés aux armements (95 % en réalité) ; le centre de recherche atomique de Los Alamos (celui qui a fabriqué la première bombe A) est systématiquement le bénéficiaire du premier exemplaire de chacun des ordinateurs les plus puissants du monde (Cray I, puis Cray II, Cray III) lors de leur apparition; l'organisme CODASYL gui a défini dans les années 60 le langage de programmation informatique COBOL (un des plus utilisés dans le monde) était dominé par les représentants de l'armée américaine; le nouveau langage ADA, qui est appelé à devenir un des "standards ' de l'informatique mondiale, a été directement commandité par le Pentagone... La liste pourrait encore s'allonger des exemples démontrant la mainmise totale du militaire sur les secteurs de pointe de l'économie, mettant en évidence la stérilisation considérable de forces productives, et particulièrement les plus performantes, que représentent les armements, tant aux Etats-Unis que dans les autres pays.([8] [14])
En effet, ces données concernant la première puissance mondiale ne sont qu'une illustration d'un des phénomènes majeurs delà vie du capitalisme dans sa phase de décadence: même en période de "paix" ce système est rongé par le cancer du militarisme. Au niveau mondial, d'après les estimations de PONU, ce sont 50 millions de personnes qui sont concernées dans leur emploi par le secteur de la défense et parmi elles 500000 scientifiques. Pour Tannée 1985 ce sont quelque 820 milliards de dollars qui ont été dépensés dans le monde en vue de la guerre (soit presque l'équivalent de toute la dette du tiers-monde).
Et cette folie ne fait que s'amplifier d'année en année: depuis le début du siècle les dépenses militaires (à prix constants) ont été multipliées par 35.
LES ARMES ET LES CONSEQUENCES D'UNE 3ème GUERRE MONDIALE: ILLUSTRATION DE LA BARBARIE DU CAPITALISME DECADENT
Cette progression permanente des armements se concrétise notamment par le fait qu'à l'heure actuelle, l'Europe -qui constitue le théâtre central d'une éventuelle 3e guerre mondiale - recèle un potentiel de destruction incomparablement plus élevé qu'au moment de l'éclatement de la seconde guerre mondiale: 215 divisions (contre 140), 11500 avions et 5200 hélicoptères (contre 8700 avions), 41600 chars de combat (contre 6000) auxquels il faut ajouter 86000 véhicules blindés de toutes sortes. A ces chiffres il faut ajouter, sans compter les forces navales, 31000 pièces d'artillerie, 32000 pièces anti-char et tous les missiles de toutes sortes, "conventionnels" et nucléaires. Les armes nucléaires elles-mêmes ne disparaîtront nullement avec la concrétisation (si elle a lieu) du récent accord entre URSS et USA sur l'élimination des missiles de portée intermédiaire. A côté de toutes les bombes transportées par des avions et des missiles à courte portée, l'Europe continuera d'être menacée par les quelque 20000 ogives "stratégiques" transportées par des sous-marins et des missiles intercontinentaux ainsi que par les dizaines de milliers d'obus et de mines nucléaires. Si une guerre devait donc éclater en Europe, sans même qu'elle prenne la forme nucléaire, elle provoquerait sur ce continent des ravages terrifiants (notamment du fait de l'utilisation des gaz de combat et des nouveaux explosifs dits "quasi-nucléaires" d'une puissance sans commune mesure avec celle des explosifs classiques, mais aussi par l'anéantissement de toute l'activité économique qui aujourd'hui dépend de façon vitale des transports et de la distribution d'électricité, lesquels seraient paralysés: les populations épargnées par les bombardements et les gaz mourraient de faim!). L'Allemagne, en particulier, qui constituerait le principal théâtre des combats, serait pratiquement rayée de la carte. Mais une telle guerre ne se contenterait pas de mettre en oeuvre les seuls armements conventionnels. Dès lors qu'un des deux camps verrait se dégrader sa situation, il serait amené à utiliser d'abord son arsenal nucléaire "tactique" (artillerie à obus nucléaires et missiles de courte portée munis de charges à "faible" puissance) pour en arriver, suite aux ripostes équivalentes de l'adversaire, à l'emploi de son arsenal "stratégique" composé d'une dizaine de milliers de charges à "forte" puissance: ce serait purement et simplement la destruction de l'humanité ([9] [15]).
Un tel scénario, pour dément qu'il paraisse, est de loin le plus probable si la guerre éclatait en Europe: c'est celui, par exemple, qu'a retenu l'OTAN pour le cas où ses forces seraient débordées par celles du Pacte de Varsovie dans des affrontements conventionnels dans cette région du monde (concept stratégique dit de "riposte graduée"). Car il ne faut pas se bercer d'illusions sur une possibilité de "contrôle" par les deux blocs d'une telle escalade: les deux guerres mondiales, et notamment la dernière -qui fut conclue par les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki— nous ont déjà montré que la totale absurdité que représente pour la société, depuis le début du siècle, le mode de production capitaliste, ne s'exprime pas seulement par le poids de plus en plus écrasant du militarisme sur l'économie, ni par le fait que la guerre ait perdu toute rationalité économique réelle, elle se manifeste également par l'incapacité pour la classe dominante de contrôler l'engrenage qui conduit à la guerre totale. Mais si cette tendance n'est pas nouvelle, son plein développement, qui accompagne l'enfoncement du capitalisme dans sa décadence, introduit une donnée nouvelle: la menace d'une destruction totale de l'humanité que seule la lutte du prolétariat peut empêcher.
La deuxième partie de cet article s'attachera à mettre en évidence les caractéristiques présentes des affrontements inter impérialistes et notamment la place et la signification que prend au sein de ces derniers le déploiement de l'armada occidentale dans le Golfe Persique.
RM. 30/11/87
[1] [16] Voir l'adresse envoyée le 29 novembre 1864 par le conseil central de PA.I.T. (Association Internationale des Travailleurs, le Internationale), à Abraham Lincoln à l'occasion de sa réélection et l'Adresse au président Andrew Johnson du 13 mai 1865.
[2] [17] Voir les deux adresses du Conseil Général sur la guerre franco-allemande des 23 juillet et 9 septembre 1870.
[3] [18] C'est ainsi que la presse officielle social-démocrate allemande saluait en 1914 la guerre contre la Russie: "La social-démocratie allemande a depuis longtemps accusé le tsarisme d'être le rempart sanglant de la réaction européenne, depuis l'époque où Marx et Engels poursuivaient tous les faits et gestes de ce régime barbare de leurs analyses pénétrantes... Puisse maintenant venir l'occasion d'en finir avec cette société effroyable sous les drapeaux de guerre allemands." (Frankfurter Volksstimme du 31 juillet, cité par Rosa Luxemburg dans "La Crise de la Social-Démocratie").
Ce à quoi Rosa Luxemburg répondait: "Le groupe social-démocrate avait prêté à la guerre le caractère d'une défense de la nation et de la civilisation allemandes; la presse social-démocrate, elle, la proclama libératrice des peuples étrangers. Hindenburg devenait l'exécuteur testamentaire de Marx et Engels." (Ibid)
De même, Lénine pouvait écrire en 1915: "Les sociaux-démocrates russes (Plekhanov en tête) invoquent la tactique de Marx dans la guerre de 1870; les social chauvins allemands (genre Lensch, David et Cie) invoquent les déclarations d'Engels en 1891 sur la nécessité pour les socialistes allemands de défendre la patrie en cas de guerre contre la Russie et la France réunies...Toutes ces références déforment d'une façon révoltante les conceptions de Marx et d'Engels par complaisance pour la bourgeoisie et les opportunistes... Invoquer aujourd'hui l'attitude de Marx à l'égard des guerres de l'époque de la bourgeoisie progressive et oublier les paroles de Marx: 'Les ouvriers n'ont pas de patrie', paroles qui se rapportent justement à l'époque de la bourgeoisie réactionnaire qui a fait son temps, à l'époque de la révolution socialiste, c'est déformer cyniquement la pensée de Marx et substituer au point de vue socialiste le point de vue bourgeois." (Lénine, le socialisme et la guerre, Oeuvres T. 21, p. 319-20).
[4] [19] C'est pour cela que les
courants politiques, tel le bordiguisme ou le GCI, qui, aujourd'hui encore sont
incapables de comprendre le caractère décadent du mode de production
capitaliste, sont bien en peine pour expliquer pourquoi, de points de vue aussi
prolétariens l'un que l'autre, Marx pouvait soutenir l'Allemagne contre la France au début de la
guerre de 70 (tant que Napoléon III n'était pas renversé et avant que la Prusse n'envahisse le
France) et Lénine dénoncer toute participation à la première guerre mondiale.
[5] [20] La liste de toutes ces guerres suffirait à remplir une page complète de cette Revue. On peut seulement citer, à titre d'illustration, quelques unes parmi les plus meurtrières : les guerres d’Indochine et d’Afrique du Nord entre 1945 et 1962, ont aboutit au départ de la France de ces régions, les cinq guerres dans lesquelles a été impliqué l’Etat d’Israël contre les pays arabes (1948, 1957, 1966, 1973 et 1982); les guerres du Vietnam et du Cambodge entre 1963 et 1975 (dans ce dernier pays après l’intervention du Vietnam fin 78, la guerre se poursuit encore), guerre, brève mais très meurtrière, entre la Chine et le Vietnam au début 1979 ; la guerre en Afghanistan qui dure depuis 8 ans, et celle entre l’Iran et l’Irak, vieille de 7 ans. On pourrait encore citer de multiples conflits dans lesquels l’inde a été mêlée après son indépendance sous la conduite du « non-violent Gandhi (guerres contre le Pakistan au Cachemire, au Bangladesh) et tout dernièrement, guerre contre les Tamouls au Sri lanka. A ce tableau il est également nécessaire d'ajouter les dizaines de guerres qui ont ravagé et continuent de ravager l'Afrique noire et l'Afrique du Nord-Est: Angola, Mozambique, Ouganda, Congo, Ethiopie, Somalie, etc., et évidemment Tchad.
[6] [21] Par exemple, les guerres napoléoniennes, qui furent les plus importantes du 19e siècle, n'ont jamais occupé du côté français plus de 500000 nommes pour une population totale de 30 millions de personnes, alors qu'au cours de la le guerre mondiale, ce sont plus de 5 millions de soldats qui ont été mobilisés pour une population française de 39,2 millions.
[7] [22] Aussi bien lors de la première guerre mondiale que lors de la seconde, le seul pays qu'on peut considérer comme Vainqueur" est les Etats-Unis dont le niveau de la production au lendemain des conflits est nettement au-dessus du niveau existant à la veille de ceux-ci. Mais ce pays, pour important qu'ait été son rôle dans ces guerres, et notamment lors de la seconde, a bénéficié d'un privilège qui était refusé aux pays qui se trouvaient à l'origine du conflit: son territoire se trouvait à des milliers de kilomètres des zones de combat, ce qui lui a permis de s'éviter tant les pertes civiles que la destruction du potentiel industriel et agricole. L'autre "vainqueur" de la seconde guerre, l'URSS, qui accède à la suite de celle-ci au rang de puissance mondiale, notamment en établissant sa domination sur l'Europe centrale et une partie de l'Extrême-Orient, a payé sa "victoire'" au prix fort de 20 millions de morts et de destructions matérielles considérables qui ont contribué grandement à maintenir son économie à un niveau de développement loin derrière celui de l'Europe occidentale et même derrière celui de la plupart de ses "satellites".
[8] [23] La thèse des "retombées technologiques positives pour l'économie et le secteur civil de la recherche militaire est une vaste fumisterie oui est immédiatement démentie quand on compare la compétitivité technologique civile du Japon et de la RFA (qui consacrent 0,01% et 0,10% PNB à la recherche militaire) a celle de la France et de la Grande-Bretagne (0,46% et 0,63%).
[9] [24] Des études sur les conséquences d'un conflit nucléaire généralisé mettent en évidence que les 3 milliards (sur 5) d'êtres humains qui seraient épargnés le premier jour ne pourraient pas survivre aux calamités qui surviendraient les jours suivants: retombées radioactives, rayons ultraviolets mortels suite à la disparition de la couche d'ozone de l'atmosphère, glaciation du fait du nuage de poussières plongeant la terre entière dans une nuit de plusieurs années. La seule forme de vie qui subsisterait aurait la forme de bactéries, au mieux d'insectes.
Questions théoriques:
- Guerre [5]
- Impérialisme [25]
Débat International : crise et décadence du capitalisme (Critique au CCA, Mexique)
- 2898 lectures
Grupo Proletario Internacionalista, Mexique
Présentation
Dans la Revue Internationale n° 50 nous avions rapidement présenté le Grupo Proletario Internacionalista du Mexique à l'occasion de la sortie du premier numéro de leur revue: Revolucion Mundial. Aujourd'hui, au moment où vient de sortir le deuxième numéro, nous publions ici un texte de critique du GPI aux "thèses du Collectif Communiste Alptraum" (CCA), lui aussi du Mexique ([1] [26]), publiées dans notre Revue Internationale n° 40 en janvier 1985.
Laissons le GPI lui-même se présenter à nos lecteurs:
"Nous nous sommes constitués il y a seulement quelques mois comme groupe politique avec le nom de GPI et unis autour des principes ([2] [27]) présentés dans le premier numéro de notre publication Revolucion Mundial. Dans la période immédiatement antérieure, nous étions fondamentalement un 'groupe de discussion', un regroupement en grande partie informel du point de vue organisatif (sans nom, sans normes de fonctionnement organique, etc.) et, dans un effort de discussion et de clarification politique, politiquement centré et orienté en son sein principalement vers la précision des frontières de classe' ou des principes à défendre.
Cette rapide esquisse de la formation du GPI serait incomplète si nous ne mentionnons pas un fait important: l'influence de la propagande du milieu communiste international et, en particulier de l'activité d'intervention que réalise le CCI depuis plusieurs années au Mexique.
Ainsi donc, en résumé, le GPI est un nouveau groupe, qui se constitue, en général, en rupture avec l'idéologie bourgeoise et nationaliste, plus particulièrement gauchiste, aux effets si néfastes en Amérique Latine. Le GPI ne revendique aucune continuité, ni organisationnelle, ni politique, avec aucun groupe ayant existé dans le pays -sauf l'exception représentée par le 'Groupe des Travailleurs Marxistes’ ([3] [28]), existant à la fin des années 30 dans le pays, qui fit partie des fractions de 'Gauche Communiste' et dont le GPI se revendique. La formation du GPI s'inscrit dans le processus de resurgissement de minorités communistes dans le monde, particulièrement à partir du resurgissement historique de la lutte de classe ouvrière mondiale depuis 1968."
L'existence de deux groupes communistes le CCA et le GPI- partageant grosso modo les mêmes positions politiques peut surprendre. Et effectivement, si cette situation devait se prolonger, elle deviendrait # l'expression d'une faiblesse des forces révolutionnaires au Mexique. Pour l'instant, elle n'est que le fruit des circonstances, d'éléments révolutionnaires surgissant, d'un milieu tout juste naissant. En liens étroits avec le milieu révolutionnaire international, l'établissement de rapports politiques entre les deux groupes, de discussions, de débats, est la condition sine qua non pour l'indispensable clarification politique de tous les éléments révolutionnaires du pays. Elle est la condition première pour le regroupement des deux groupes, et des éléments isolés, pour la création d'une présence politique du prolétariat unique et unie au Mexique.
Ne serait-ce que pour cette raison, nous devrions saluer l'existence du texte du GPI que nous publions ici: Crise et décadence du capitalisme (critique du CCA). Cette critique s'inscrit tout à fait dans l'esprit fraternel dont nous venons de souligner la nécessité: c'est un texte engageant le débat avec le CCA en vue de clarifier la question de l'explication des crises économiques du capitalisme et de la période actuelle de décadence de ce dernier.
Ensuite, le choix de la crise et de la décadence du capitalisme comme débat et discussion pour des nouveaux camarades qui viennent juste d'adopter des positions de classe est le signe de leur volonté d'établir sérieusement les fondements mêmes des positions révolutionnaires. Voici ce que nous écrivions sur ce débat de la décadence lors de notre salut à Comunismo n° 1, la publication du CCA:
"Et ne croyez pas que cette question ne concerne que des historiens pointilleux sur les dates, ni qu'elle constitue une question théorique en soi sans implications pratiques pour les révolutionnaires. La reconnaissance et la compréhension de la fin de la période historiquement progressiste du capitalisme et son entrée en déclin sont à la base de la formation de la 3e Internationale sur les ruines de la 2e Internationale morte en 1914. Elles fondent la cohérence de l'ensemble des positions de classe que les camarades partagent avec le CCI. Et en particulier la dénonciation des syndicats comme organes de l'Etat capitaliste au 20e siècle et des mouvements de libération nationale comme moment des antagonismes inter impérialistes aujourd'hui. " (Revue Internationale n ° 44).
Enfin, nous saluons ce texte par son sérieux, sa qualité, et surtout la critique et la prise de position juste que les camarades prennent vis à vis des Thèses du CCA. Nous avions déjà rapidement critiqué les prises de position du CCA ([4] [29]) sur son explication des crises du capitalisme par la seule loi de "la baisse tendancielle du taux de profit", et surtout l'incapacité du Collectif Alptraum à situer clairement l'entrée en décadence du capitalisme avec le 20e siècle marquée en particulier par l'éclatement du premier holocauste mondial en 1914. Malgré quelques erreurs que nous soulignons en note dans le cours du texte, les camarades du GPI défendent l’explication marxiste des crises et la réalité de la décadence du capitalisme depuis le début de ce siècle.
Le texte du GPI s'inscrit dans l'effort que nous avons accompli dernièrement dans les numéros 47, 48 et 49 de cette revue par la publication d'une série d'articles polémiques avec le GCI justement sur la question de la décadence. Et nous prévoyons de continuer cet effort dans notre prochain numéro. Que des groupes comme le CCA et le GPI —qui tous deux reconnaissent l'existence de la décadence du capitalisme-- participent à ce débat est signe que malgré les difficultés de tous ordres qu'affrontent les faibles forces révolutionnaires de par le monde, l'heure est au surgissement, au développement, à la clarification politique et au regroupement de ces forces. Par leur sérieux, par leur effort de réappropriation des leçons et des débats du passé, par leur soucis de clarification, par leur volonté de discussion, le CCA et le GPI interpellent l'ensemble des courants politiques prolétariens actuels, et ridiculisent les "théories anti-décadentistes" du GCI, les "découvertes" savantes de la FECCI sur le capitalisme d'Etat et autres élucubrations modernistes qui tournent le dos au marxisme.
CCI 25/10/87
CRISE ET DECADENCE DU CAPITALISME (Critique au CCA.)
L'objet de cet article est, au travers de la critique au Colectivo Comunista Alptraum, d'essayer de contribuer à la clarification des positions de notre groupe sur la crise et la décadence du capitalisme.
Nous avons choisi d'exposer notre point de vue sous la forme d'une polémique car les tentatives de le faire sous forme de thèses produisaient de pures généralités, des conclusions sans arguments, qui en ce moment n'aideraient pas à la discussion interne.
Nous sommes partis de la critique de vos positions car nous pensions commencer en même temps une discussion directe avec le CCA. Bien que sachant que cette dernière n'a pu se développer, la délimitation reste nécessaire car le Colectivo est un groupe en relation avec le milieu international.
Nous aborderons les questions suivantes:
1- les caractéristiques de la crise actuelle.
2- les causes de la crise.
3- les limites du marché.
4- les particularités de l'époque de la décadence du capitalisme.
Nous faisons la critique à partir de vos thèses et de parties de vos autres écrits où est développé le point traité. Nous utilisons votre revue "Comunismo" n°l et 2.
- "elle a une dimension mondiale", à cause de l'extension mondiale du capitalisme et de sa domination sur toutes les branches de la production. Une telle crise décrit une spirale qui part des pays développés vers le reste du système capitaliste mondial;
- "elle doit être conque comme une crise classique de suraccumulation " dans laquelle se vérifie le cycle prospérité-crise-stagnation.
La première particularité est de la plus grande importance pour comprendre le cours de la situation mondiale. Le capitalisme s'est étendu à toute la planète et, pour cela même, la crise, inhérente au capitalisme lui-même, est devenue elle aussi mondiale. L'interpénétration de l'économie de tous les pays, la création du marché mondial, empêche quiconque d'échapper au coup de fouet de la crise. De là, nous devons relever qu'il n'existe pas de solution nationale à la crise. Aussitôt^ qu'un pays ou une région donne des indices de reprise, il se retrouve de nouveau happé dans le tourbillon de cette crise mondiale. L'issue ne peut qu'être à l'échelle planétaire et, comme nous le verrons plus loin, seuls deux chemins y mènent: la guerre ou la révolution.
Mais alors le second point, le caractère cyclique de la crise, est un contresens; il nie la validité du premier à moins de penser qu'à partir de la moitié des années 60 le capitalisme ait connu une véritable phase de prospérité. L'idée que cette crise est "mondiale", et à la fois vérification du cycle prospérité-crise-stagnation conduit le Colectivo à réaliser des jongleries quand il s'agit d'analyser la situation concrète.
Parfois, il semble qu'effectivement il parle de crise mondiale qui se serait développée et approfondie à partir de la fin des années 60. Il mentionne "la crise qui s'est aggravée dans les dernières décennies", que les "prolégomènes de la crise actuelle se trouvent au milieu des années 60" et que depuis ces années le PIB décroît et que le chômage augmente. Mais en même temps il dit que "les crises cycliques de surproduction dans leur périodicité... tendent à être chaque fois plus profondes, surtout à partir de 1968." Le Colectivo résout ce contresens par l'introduction de deux concepts: la "récession" et la "reprise relative", nous apprenons que, selon le CCA.:
"En 1973-74, le renchérissement du pétrole a touché les aires centrales du capitalisme car il a accentué la chute de leur taux de profit. 1974-75 fut une phase de récession où les aires de la périphérie, fondamentalement pétrolières, se retrouvèrent moins affectées puisque, par la hausse du pétrole et le transfert de capital, on augmenta le capital et elles purent soutenir un rythme accéléré d'accumulation dans la phase suivante de relative reprise. 1980-83 est une autre phase de récession mais où s'est déroulé le contraire: le pétrole a baissé et cela a contrecarré la chute du taux de profit des aires centrales alors que les pays des aires périphériques restaient submergés par la dépression; situation aggravée par le transfert de plus-value du capital financier mondial. Ce transfert a contribué, dans la période de reprise relative, à renforcer l’aire centrale. Malgré cela, à la fin 85 les aires centrales recommencent à présenter des symptômes de récession par les mesures de réorganisations prises; et en outre, cette récession a touché aussi les pays pétroliers. (n°2, Editorial).
LES CARACTERISTIQUES DE LA CRISE
Dans ses thèses, le CCA. relève deux particularités de la crise actuelle:
De quoi s'agit-il, donc? Si depuis 1968, il y a eu plusieurs crises cycliques, nous devons supposer que pour le Colectivo ce qu'il appelle "récession" seraient précisément de telles crises et que les phases de "reprise relative" équivaudraient à la prospérité. Nous aurions eu crise en 74-75, en 80-83 et depuis 85, et prospérité " en 76-79, 84-85 et nous nous dirigerions vers une de plus. Dans un tel cas, on ne voit pas pourquoi utiliser ces termes, pris de l'arsenal de l'idéologie bourgeoise dont la signification est ambiguë.
Mais le Colectivo sait bien qu'en réalité la situation n'est pas comme cela. Si il parle de "reprise relative", c'est parce qu'il sait que l'économie mondiale n'a connu aucune "reprise absolue" depuis 68. Si il parle de "récession", c'est parce qu'il doit différencier les "transferts de capital" de la véritable crise générale mondiale.
Si on devait mener le raisonnement du Colectivo à ses conséquences ultimes où le "transfert de capital" dans les phases de "récession" ouvre la porte à la "reprise", nous arriverions: premièrement à ce que la crise soit seulement régionale (puisque dans la "récession" des aires sont "plus affectées que d'autres), et deuxièmement à ce que la crise ait une solution nationale. Ainsi, dans la phase de récession 74-75, les pays pétroliers gagnèrent une grande masse de capital ce qui leur permit de "soutenir un rythme accéléré d'accumulation dans la phase de relative reprise", bien sûr que le Colectivo ne partage pas le rêve des fractions bourgeoises: la possibilité de sortir de la crise au détriment des autres. Mais une telle idée découle de l'identification de la "récession" avec la "crise cyclique".
Nous devons donc reconnaître:
- que depuis le milieu des années 60, le capitalisme mondial n'a pas connu de phase de prospérité sinon que, compulsivement, chaque fois il s'enfonce encore plus dans la stagnation et la paralysie; et que la "reprise relative" de quelques régions n'est seulement que momentanée et au prix de la chute générale;
- que le caractère mondial des rapports de production capitalistes et, donc, de la crise, rend impossible une réelle issue nationale à cette dernière.
En d'autres termes, que depuis le milieu des années 60 a commencé une crise chronique du capitalisme comme système mondial, qui tend à s'approfondir et à se généraliser de manière inévitable. Qu'il n'existe plus le cycle crise-stagnation-prospérité.
Il est certain qu'en théorie ce cycle indique la vie du capitalisme: la crise se présente comme solution momentanée aux contradictions du capitalisme lui-même, comme destruction de forces productives qui ouvre la porte à une nouvelle phase de prospérité. Une crise "chronique" ou "permanente" ne pourrait pas exister théoriquement car elle signifierait la destruction totale de forces productives, la chute définitive du capitalisme. C'est probablement pour cela que le Colectivo soutient l'idée du "cycle classique".
Paradoxalement, par la forme dans laquelle elle s'est étendue et approfondie durant toutes ces années, comparée à la crise périodique du siècle passé, la crise actuelle se présente précisément comme une crise permanente. Plus encore. A partir du 20e siècle, nous voyons que les crises conduisent à des guerres de destruction e forces productives; que le capital, dans son esprit de conservation, tend réellement à la chute définitive, entraînant à sa suite l'humanité. Que ce cycle industriel "classique" s'est renversé en cycle barbare de crise-guerre-reconstruction. ([5] [30])
Ce dont il s'agit c'est d'expliquer les faits, et en dernière instance, d'"adapter la théorie à la réalité et, non comme le prétend parfois le Collectif, la réalité à la théorie. C'est pour cela que nous devons aller aux causes de la crise.
LES CAUSES DE LA CRISE
Le développement du capitalisme est déterminé par ses contradictions; celles-ci le mènent à la crise. La crise est l'expression ouverte de toutes les contradictions du capitalisme et en même temps leur solution momentanée. En dernière instance, la cause de la crise est la contradiction fondamentale du capitalisme. C'est pour cela que trouver la cause de la crise c'est définir les contradictions du capitalisme et spécialement la contradiction fondamentale.
De la manière la plus générale et la plus résumée, ces contradictions peuvent être exprimées ainsi: pour pouvoir vivre les hommes ont besoin de se lier pour produire, de contracter des rapports de production déterminés qui sont indépendants de leur volonté et qui correspondent à un degré déterminé de développement de leurs instruments de production et de leur forme d'organisation du travail, du développement des forces productives. A certains moments, les forces productives tendent à déborder les rapports de production. De cadre adéquat les rapports de production se convertissent en une entrave pour le développement ultérieur des forces productives. Ils ont besoin d'être transformés et ils le sont. S'ouvre une époque de révolution sociale où les vieux rapports de production doivent être détruits et à leur place s'instaurent d'autres, nouveaux, en accord avec les conditions matérielles de la production. Dans le capitalisme, la contradiction entre le développement des forces productives et les rapports capitalistes de production donne lieu à la crise.
La paralysie des usines et la masse de produits qui ne trouvent pas de sortie, tout comme l'armée de sans-emploi, indiquent que les forces productives sont excessives pour les rapports de production basés sur l'accumulation de capital, sur l'obtention de profits. Chaque crise met en question l'existence du capitalisme.
Mais en même temps, chaque crise se présente comme solution momentanée des contradictions. D'un côté par la destruction d'une partie des forces productives; de l'autre, par une extension du cadre des rapports de production ce qui ne fait rien d'autre que préparer de nouvelles crises chaque fois plus larges et plus profondes.
Dans ce sens, le Collectif souligne:
"La crise que nous vivons est le résultat du choc entre le développement énorme atteint par les forces productives, c'est à dire par la richesse existante, et les rapports capitalistes de production qui imposent l'appropriation privée de celle-ci". Dans les crises s'exprime
"le caractère historiquement limité de ses rapports de production qui ne peuvent contenir, en leur sein, le développement progressif des forces productives sociales. Les moments de crise sont ceux dans lesquels le capitalisme doit nécessairement détruire une masse croissante de forces productives, mettant en évidence, de cette manière sa nature décadente" (thèses du C.CA.; Revue Internationale 40).
Cependant, une explication si générale des contradictions ne nous explique pas ses causes déterminantes. Elle ne nous dit toujours rien de la contradiction fondamentale et elle n'est pas non plus une explication des caractéristiques de la crise actuelle.
Le Collectif n'élargit son point de vue dans les thèses que lorsqu'il touche à la question de la décadence. Mais avant de discuter la relation entre crise et décadence, nous devons arriver aux causes de la crise et pour cela, pour le moment, nous traiterons de manière séparée ce qu'il dit sur ce point. Le Colectivo fait découler la crise de la loi de la tendance décroissante du taux de profit:
"Aussi bien le développement que le déclin du système reposent sur deux déterminations essentielles, à savoir, une qui se manifeste par la baisse tendancielle du taux de profit"... (Revue Internationale 40).
Ensuite, il tente de résumer cette loi dans les points suivants:
- l’objectif du système est la "formation ininterrompue et croissante du capital";
- ce qui implique l'expansion du capital, l'augmentation de la productivité du travail et un développement accéléré des forces productives;
- ce qui précède se traduit par la croissance de la composition organique du capital: le volume du capital constant (moyens de production) croit plus par rapport au capital variable (force de travail) qui est celui qui produit la plus-value;
- ceci mène à la chute du taux de profit.
"C'est à ce moment qu 'apparaît la crise capitaliste"... "quand la composition organique croissante ne correspond pas une augmentation équivalente de valeur"... "la suraccumulation par rapport à la capacité d'exploiter le travail conduit le système capitaliste à la crise. "
Suivons la polémique du Collectif avec le C.C.I., là où il élargit son exposition (Comunismo 2, p.34; organe du CCA.). La critique du CCI. réside en ce que ce dernier considère insuffisante la loi du taux décroissant de profit comme explication des causes de la crise car pour le CCI. "la contradiction fondamentale du capitalisme se trouve dans son incapacité à créer indéfiniment les marchés pour son expansion. "
Le Collectif lui réplique qu'il "ne rejette pas le problème de la réalisation" mais que c'est une erreur "de situer la contradiction fondamentale dans la sphère de l'échange" (Comunismo 2).
Et le Collectif ajoute:
"quand nous nous référions au niveau des déterminations essentielles (dans les thèses), nous nous référions simplement au niveau où se génère et se produit la plus-value qui, suivant Marx, est la source de la richesse capitaliste"... "La contradiction fondamentale du mode de production et d'échange capitaliste se situe au pôle dominant de cette totalité, c'est-à-dire, dans le cadre de la production. Bien qu'aussi dans sa singularité, elle puisse être déterminée par l'échange, la distribution et la consommation. " La contradiction de la production est entre "le processus de valorisation du capital et le procès de travail." (Comunismo 2, p.35)
Le C.C.A. situe la contradiction fondamentale dans la production car c'est là que se génère la plus-value, car c'est le "pôle dominant" par rapport à l'échange. Cependant, nous "rappelant de Marx nous aussi, nous devons dire que si la plus-value se génère seulement dans la production, analogiquement, elle se réalise dans l'échange.
"Si, au travers du procès de production, le capital se reproduit comme valeur et valeur nouvelle, en même temps il se trouve comme non-valeur, comme quelque chose qui ne se valorise pas tant qu 'elle ne rentre pas dans l'échange... " (Marx, Grundisse, trad.par nous de l'espagnol).
"Les conditions de l'exploitation directe et celles de sa réalisation ne sont pas identiques. Elles divergent non seulement quant au temps et au lieu, mais aussi conceptuellement. Les unes sont limitées par la force productive de la société, alors que les autres le sont seulement par la proportionnalité entre les différentes branches de la production et par la capacité de consommation delà société. Mais cette capacité n'est pas déterminée par la force absolue de production ni par la capacité absolue de consommation, mais par la capacité de consommation sur la base des relations antagoniques de distribution qui réduit la consommation de la grande masse de la société à un minimum seulement modifiable dans des limites plus ou moins étroites..." (Marx, Le Capital, traduit par nous).
En d'autres termes: il existe une contradiction déterminante entre les conditions dans lesquelles se produit la plus-value et les conditions dans lesquelles celle-ci se réalise, c'est-à-dire entre la production et le marché. Quelle est donc la contradiction fondamentale? Entre travail-valorisation ou bien entre production-marché?
Nous considérons qu'il ne s'agit pas en réalité de deux contradictions différentes mais de la même dans ses différents aspects: la première indique le contenu comme catégorie abstraite; la seconde est la forme concrète dans laquelle elle se manifeste.
La contradiction interne travail-valorisation se dédouble vers l'extérieur comme production-échange. (De manière analogue, la contradiction interne de la marchandise entre valeur d'usage-valeur s'exprime dans la forme concrète de marchandise-argent).
De manière abstraite, la création de valeur et de plus-value se présente comme une barrière pour la création de la valeur d'usage. De manière concrète, le marché se présente comme limite réelle et déterminée pour la production.
La loi de l'accumulation croissante de capital qui s'accompagne d'un taux de profit décroissant n'existe pas indépendamment des problèmes du marché. Que le taux de profit diminue par l'augmentation du capital constant par rapport au variable, car une plus grande somme de capital total investi s'approprie en proportion une somme moindre de plus-value, va seulement se montrer de manière tangible sur le marché quand le capitaliste ne trouve pas d'acheteur pour ses marchandises aux prix de production établis.
Il n'existe pas non plus deux types de crise: de suraccumulation de capital et de surproduction de marchandises. C'est une seule crise dans ses deux déterminations. Par son contenu, c'est l'incapacité d'utiliser tout le capital existant étant donné un taux de profit déterminé, et de là, la dévalorisation de capital. Par sa forme, c'est le manque de sortie pour les marchandises, les entrepôts surchargés de stocks, et de là, la paralysie et la destruction des moyens de production et de consommation. La crise a son origine dans la contradiction travail-valorisation et elle se réalise comme contradiction entre la production et le marché.
Ceux qui expliquent la crise par la seule loi de la baisse tendancielle du taux de profit, pourront dire qu'ils arrivent au "fond" de la question, à l'origine de la plus-value. Mais une telle explication est insuffisante quand il s'agit de revenir sur le terrain de la réalité concrète. Si on fait abstraction du marché, c'est-à-dire si on le laisse de côté, les limites du capitalisme apparaîtront aussi comme une pure abstraction, comme quelque chose de lointain, comme une limite inaccessible, simplement théorique qui serait l'impossibilité absolue d'accroissement de la plus-value devant toute augmentation de capital comme le pose le Colectivo.
D'autre part, ceux qui fixent leur attention sur les problèmes de la réalisation du marché réussissent à mieux saisir le cours de la situation réelle dans ses multiples aspects et les vraies limites de la production; bien que s'il manque la base de l'origine de la plus-value, toute crise se présente à eux comme une limite absolument insurmontable.
Le C.C.A. penche pour le "pôle dominant". Il tend à expliquer la crise par la seule loi de la baisse tendancielle du taux de profit. C'est pour cela qu'il ne trouve pas les limites réelles auxquelles se heurte actuellement le capitalisme. L'évident caractère mondial de la crise n'a aucune signification spéciale pour le Colectivo: c'est seulement une autre de plus dans le "cycle classique". Ses tendances (à la guerre par exemple) sont les mêmes que dans toutes les autres. Pour le Colectivo, il n'y a rien de nouveau. Seulement la confirmation de la théorie.
Il est donc nécessaire non seulement de constater les traits communs à toute crise mais aussi d'étudier leurs particularités, les formes de chaque crise. C'est seulement ainsi nous comprendrons le véritable cours de la situation. En passant des "origines de la plus-value" aux limites qu'offre le marché.
LES LIMITES DU MARCHE
Expliquons maintenant comment l'accumulation de capital avec sa chute du taux de profit se manifeste dans l'impossibilité pour les capitalistes de vendre la totalité de leurs marchandises aux prix de production déterminés, c'est-à-dire dans la limite du marché.
On a déjà mentionné que l'objectif des capitalistes est l'obtention de profit, la croissance de capital; lesquels ne peuvent s'obtenir que par une extraction croissante de plus-value. Pour cela, les capitalistes ne doivent pas consommer toute la plus-value qu'ils obtiennent en articles de luxe; mais ils doivent continuellement réinvestir la majeure partie comme capital, en augmentant l'échelle de la production. L'accumulation de capital est le réinvestissement de plus-value pour qu'elle fonctionne comme capital.
L'accumulation de capital se traduit dans la croissance de la production. Ou, plus exactement, le développement des forces productives dans ce système adopte le caractère d'accumulation de capital. Mais la croissance de la production et de l'accumulation de capital n'est pas harmonieuse mais elle contient une contradiction, qui se reflète dans la chute du taux de profit, due au changement dans la composition organique du capital.
La composition organique du capital résume les deux aspects de la production capitaliste: - premièrement, la composition technique du capital, le rapport qui existe entre moyens de production et ouvriers utilisés. Le développement des forces productives signifie qu'un nombre déterminé d'ouvriers est capable d'employer des moyens de production chaque fois plus puissants qui permettent de créer une plus grande quantité de produits (valeurs d'usage) en moins de temps; deuxièmement, la composition de valeur du capital: la proportion qui existe entre la valeur qui se transfère simplement dans la marchandise (capital constant employé en moyens de production) et la valeur qui retourne se reproduire et permet la création de la plus- value (le capital variable investi en force de travail).
Le développement des forces productives dans son caractère d'accumulation de capital se traduit dans une croissance proportionnellement plus grande du capital constant par rapport au capital variable. Bien sûr le capital variable augmente, et donc, augmente aussi la quantité de plus-value appropriée; mais cette augmentation a lieu au prix d'une augmentation proportionnellement plus grande de capital constant, ce qui occasionne la réduction du taux de profit qui est la proportion entre la plus-value obtenue et le capital total investi (constant plus variable). A mesure qu'augmente l'accumulation de capital, l'obtention de plus-value est proportionnellement moindre, ce qui contredit l'objectif des capitalistes. A un moment donné, on a une suraccumulation, trop de capital par rapport aux nécessités d'exploitation du travail, et survient la paralysie de la production.
La chute du taux de profit rendrait impossible l'existence du capitalisme s'il n'existait pas en même temps des causes qui la contrecarre comme: la prolongation de la journée de travail, l'intensification des rythmes de travail et la réduction des salaires qui permettent d'extraire plus de plus-value sans faire un plus grand investissement; la diminution des coûts des moyens de production, la surpopulation et le commerce extérieur qui permettent de créer de nouvelles branches de production avec une faible composition organique de capital. Du fait de toutes ces causes, la chute du taux de profit se présente seulement comme une tendance qui, malgré tout, finit par s'imposer dans la crise.
La loi de la tendance à la baisse du taux de profit exprime de cette manière la contradiction entre les Forces productives et les rapports de production. La production se développe en laissant de côté la création de plus-value. C'est pour cela, qu'à un moment donné, la création de plus-value s'oppose à ce que continuent d'avancer les forces productives. Mais cette contradiction de la production est interne, invisible. Elle doit se manifester de manière concrète comme limite de l'échange, comme limite pour la réalisation de la plus-value. Cette limite est double, elle a deux aspects:
- Premièrement, comme disproportion entre les différentes industries.
Le capital global de la société est divisé entre les mains de la multitude de capitalistes privés qui sont en concurrence et luttent entre eux à la recherche du plus grand profit. Dans cet effort, chacun introduit de nouvelles méthodes de production, de meilleures machines, et enfin, impulse le développement des forces productives pour gagner le marché en introduisant plus de marchandises et moins chères.
Ce qui précède entraîne à la fois que la production sociale est divisée en une multitude d'industries individuelles, mais qui forment une chaîne, la division sociale du travail, où la production des unes entre comme matière première ou comme moyen de production dans la production des autres, jusqu'à arriver au produit de consommation personnel.
Cependant, la croissance de chaque industrie n'est pas proportionnelle aux demandes des autres mais est déterminée par l’intérêt privé. Elle s'oriente là où elle obtient le plus de profit. Les changements dans la composition organique du capital, c'est-à-dire la croissance plus grande du capital constant par rapport au variable, signifient ici, une croissance disproportionnée du secteur qui produit des moyens de production par rapport à celui qui produit des moyens de vie. De l'industrie lourde par rapport à l'industrie légère et de l'industrie en général par rapport à l'agriculture. Tout ce qui précède se traduit par une surproduction de marchandises, dans un excès de produits qui sont demandés par les autres capitalistes.
Si dans certains moments déterminés, un capitaliste, du fait de la croissance disproportionnée de son industrie, n'arrive pas à vendre toutes ses marchandises au prix équivalent à la réalisation de la plus-value, la production de son usine se verra freinée provoquant une réaction en chaîne. En amont ses fournisseurs ne pourront pas vendre non plus leurs produits, en aval ses clients ne pourront pas acheter le produit dont ils ont besoin; tout cela fermera aussi leur production et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il suffit que la surproduction se manifeste dans quelques industries-clé pour que la crise éclate et se généralise. Ici la crise apparaît comme le produit de l'anarchie de la production, en opposition à la division sociale du travail.
De là l'illusion des théories bourgeoises (ainsi que celles d'Hilferding et de Boukharine) sur la possibilité d'éviter de nouvelles crises au moyen d'un mécanisme régulateur de la production comme le monopole privé ou, mieux encore, le capitalisme d'Etat, lesquels « élimineraient la concurrence et les disproportions. De telles théories oublient tout simplement que derrière la disproportion se trouve la son0 de profit et que les monopoles et le capitalisme d'Etat cherchent aussi le profit maximum et qu'ils ne peuvent que reproduire 'anarchie de la production. C'est non seulement dans la concurrence entre les monopoles, mais au sein de ceux-ci que nous en trouvons la preuve la plus palpable. Comme par exemple, la guerre des prix à l'intérieur de l'OPEP provoquée par la croissance disproportionnée de chaque membre; ou encore le capitalisme étatique des pays comme l'URSS où la concurrence et l'anarchie sont reproduites entre les entreprises du même Etat par dessus la fameuse "planification".
De ce qui précède, on retient que le surgissement des monopoles modernes et des pays où domine le capitalisme d'Etat ne signifie pas un pas en avant, de "transition" du capitalisme au socialisme, ni n'entraîne une "socialisation croissante" de la production. La seule chose que cela indique, c'est que les conditions matérielles pour la société communiste sont déjà données depuis longtemps ([6] [31]) et que le capital engendre ces avortons de production sociale" comme tentative désespérée mais inutile pour ne pas s'enfoncer dans ses propres contradictions.
- La seconde limite à laquelle se confronte la réalisation de la plus-value, c'est la capacité de consommation des masses travailleuses. Bien sûr, il ne s'agit pas de la capacité absolue de consommation, la satisfaction totale de leurs nécessités vitales, mais de la capacité de consommation déterminée par les rapports antagoniques de distribution, de la capacité de paiement.
Dans ce cas, la croissance plus grande de capital constant par rapport au variable se révèle comme croissance plus grande des marchandises par rapport au salaire.
L'ouvrier reproduit la valeur équivalente de son salaire (capital variable) et en plus remet, sans rien recevoir en échange, une autre somme de valeur au capitaliste (la plus-value). Si le capitaliste, peut exploiter plus de force de travail avec le même capital variable, il obtiendra une plus grande plus-value. De là, la tendance du capital à augmenter les heures de travail, à le rendre plus intense et à réduire le salaire. Ceci a comme conséquence l'existence d'une armée industrielle de réserve qui fait pression sur les ouvriers actifs pour travailler pour un salaire moindre. Ce qui se traduit par un pouvoir d'achat chaque fois plus restreint de la classe ouvrière. Le capital cherche à augmenter la création de plus-value. Il l'obtient, mais d'un autre côté en réduisant les possibilités de réaliser cette même plus-value ([7] [32]).
Il faut noter que nous parlons en terme de valeur. Mais il peut aussi arriver qu'augmente la consommation de valeur d'usage et que diminue, malgré tout, la réalisation de la plus-value. En fait, si les méthodes de production des biens de consommation s'améliorent, cela signifie qu'on peut en produire une plus grande quantité dans un temps moindre, c'est-à-dire avec moins de valeur: les capitalistes réduisent de cette manière la valeur de la force de travail, le capital variable investi, car alors on peut acheter autant sinon plus de choses; et ainsi pour un temps de travail égal, ils s'approprient plus de plus-value. Mais cela se heurte à nouveau aux possibilités de réaliser cette plus-value. D'autre part, et c'est ce qui arrive actuellement, les capitalistes essayent de diminuer de manière absolue le salaire, lequel tend à être réduit à une valeur inférieure à la valeur de la force de travail, entraînant la dénutrition, des maladies et même la mort de faim parmi la population travailleuse.
La crise apparaît ici de nouveau comme une surproduction de marchandises, "paradoxalement", avec une masse d'affamés et de chômeurs. Entrent en scène de nouveau les idéologues de la bourgeoisie et tout spécialement ceux de gauche pour dire que la crise pourrait être évitée si on augmentait la capacité de consommation des travailleurs, si on augmentait les salaires. Mais toute augmentation des salaires se change en une diminution de la plus-value ce qui contredit les buts mêmes du capital. En réalité, les promesses "d'augmentation des salaires" que fait la gauche du capital dans les périodes d'élections ne sont que des vils mensonges pour s'attirer les votes ouvriers. C'est ce que montre la crise actuelle où aucun gouvernement, qu'il soit de "droite" ou de "gauche" n'a fait autre chose que de réduire les salaires.
"Vu que la finalité du capital n 'est pas la satisfaction des nécessités mais la production de profit... une scission doit se produire constamment entre les dimensions réduites de la consommation sur les bases capitalistes et une production qui tend constamment à dépasser cette barrière qui lui est immanente... "... périodiquement sont produits trop de moyens de travail et de subsistance pour qu’ils puissent agir en qualité de moyens d'exploitation des ouvriers à un taux de profit déterminé. Sont produites trop de marchandises pour pouvoir réaliser la valeur et la plus-value contenues ou enfermées en elles dans les conditions de distribution et de consommation données par la production capitaliste et la reconvertir en nouveau capital, c'est-à-dire, pour mener à terme ce processus en évitant les explosions qui surviennent constamment..." "La raison ultime de toutes les crises réelles continue toujours à être la pauvreté et la restriction de la consommation des massés en contraste avec la tendance de la production capitaliste à développer les forces productives comme si seule la capacité absolue de consommation de la société constituait sa limite. " (Marx, Le Capital, Tome III).
"Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises? D'un côté, en détruisant par la violence une masse de forces productives; de Vautre en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciens. A quoi cela aboutit-il? A préparer des crises plus générales et plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir." (Le Manifeste Communiste).
En effet, avec la dévalorisation du capital, au travers de la paralysie et la faillite d'usines et la destruction même de moyens de production et de consommation, qui ont lieu dans la crise, les capitalistes cherchent une solution à la surproduction par la recherche de nouveaux marchés. De là la tendance à créer le marché mondial.
Chaque capital national cherchera, dans un premier temps, à imposer ses rapports d'échange aux producteurs indépendants et aux nations où dominent encore des rapports de production précapitalistes. Mais ces marchés sont encore limités car dans la production précapitaliste s'échange seulement l'excédent par rapport à la satisfaction des nécessités individuelles. Le capital a besoin donc de créer son propre marché, "de forger un monde à son image et à sa ressemblance".
Donc, la bourgeoisie en s'alliant ou luttant' contre les seigneurs de la terre et les roitelets, réalise le dépouillement des petits producteurs. La richesse est concentrée dans peu de mains et susceptible d'être orientée vers la production de marchandises nécessaire pour les capitalistes; en même temps, elle crée une armée de prolétaires qui n'ont plus maintenant comme remède que de vendre leur force de travail pour pouvoir acheter toutes les choses dont ils ont besoin pour vivre. De cette manière, les capitalistes peuvent exporter leurs marchandises et réaliser leur plus-value et en acquérir d'autres. En outre les industries créées dans les nations plus arriérées fonctionnent avec un taux de profit plus élevé car la composition organique du capital est moindre: machines plus vieilles, matières premières, force de travail presque gratuite, journées de travail plus longues. Mais ceci ne mène pas à autre chose qu'à la reproduction à une échelle plus grande des mêmes contradictions du système capitaliste.
Les nations capitalistes les plus vieilles, à la recherche de débouchés pour leurs produits, les obtiennent en créant dans les nations plus arriérées de nouveaux concurrents établissant les bases pour de nouvelles crises plus étendues et plus profondes.
Ainsi, au début du siècle, nous assistons à la "fin du partage du monde entre les puissances", à la fin de l'expansion capitaliste pour le monde habité. Depuis lors, cette solution à la crise se trouve supprimée. Seule reste la destruction de forces productives, laquelle doit atteindre une telle ampleur qu'elle appelle le moyen de la guerre.
Les guerres inter bourgeoises actuelles ont pour objectif fondamental non la conquête ou le pillage de territoires ou de nations mais la pure destruction de forces productives, d'usines, de cultures, de ports, d'hôpitaux et de zones industrielles et de villes entières ([8] [33]). Maintenant c'est seulement ainsi que le capitalisme peut ouvrir une nouvelle période de "prospérité" tant que dure la reconstruction; jusqu'à ce que le capital recommence à rencontrer ses limites inhérentes et plonge la société dans une nouvelle crise mondiale. Le cycle industriel où la crise menait à une nouvelle phase d'essor et d'expansion, s'est transformé ainsi dans le cycle crise-guerre-reconstruction.
La fin de son oeuvre créatrice, le marché mondial, et le début des guerres pour détruire des forces productives marquent la fin de la mission historique progressiste du capitalisme et l'entrée dans sa phase de décadence. Depuis lors, son existence n'est pas seulement un obstacle pour le progrès social mais avec sa barbarie croissante, elle met en danger l'existence même de la société humaine. Pour les révolutionnaires du début du siècle, les changements ayant eu lieu dans le capitalisme représentaient sa "désagrégation" et son "effondrement définitif'. Avec ces changements, l'ère de la révolution communiste mondiale avait commencé.
Le Colectivo Comunista Alptraum considère aussi que nous vivons l'époque de la décadence du capitalisme. Continuons donc la critique de ses positions que nous avions laissée dans le chapitre II pour essayer de définir avec plus de clarté les caractéristiques de cette époque.
LA DECADENCE DU CAPITALISME
"Nous considérons -dit le Collectif dans sa thèse 6~ que le capitalisme se trouve en décadence"... "La décadence du système implique l'exacerbation et l'approfondissement de toutes ses contradictions"... "La loi qui nous explique le développement du système est la base pour comprendre sa nature décadente... tant le développement que le déclin du système reposent sur deux déterminations essentielles, à savoir, une qui se manifeste par la baisse tendancielle du taux de profit et l'autre qui constitue son contenu et s'exprime dans la subordination formelle et réelle du travail au capital. " (Revue Internationale 40).
Ainsi la décadence, tout comme l'ascendance, a une forme dans laquelle elle s'exprime, et un contenu.
La forme c'est la loi de la baisse du taux de profit. Nous avons déjà vu que de cette loi surgit la crise. Il y a donc un rapport entre la crise et la décadence. Selon le Collectif:
"Les moments de crise sont ceux dans lesquels le capitalisme doit détruire une masse croissante de forces productives mettant en évidence de cette manière sa nature décadente. " (thèse 1, Rint 40).
Mais la baisse du taux de profit et la crise ont existé tout au long du capitalisme. Dire que dans celles-ci s'exprime sa nature décadente pourrait faire penser que la décadence est présente depuis qu'ont surgi les crises (et le cycle "classique" de celles-ci commence en 1825) ou que le capitalisme vit des cycles d'ascendance et de décadence; bref, que la décadence ne signifie rien de différent du capitalisme en général. Evidemment ce n'est pas la pensée du CCA. S'il insiste sur la "nature décadente", ce n'est pas parce qu'il considère la décadence comme l'état éternel du capitalisme, mais simplement parce que le germe de la décadence se trouvait déjà dans ses origines. Bien. Mais alors, à part reconnaître que la décadence est une phase "naturelle" dans la vie du capitalisme, nous n'avons pas avancé d'un poil dans sa caractérisation. En quoi cette phase de décadence se distingue-t-elle de la précédente, de 1 ascendance? Peut-être trouvons-nous la solution dans le "contenu" de la décadence, dans la domination formelle et réelle du travail.
La domination formelle, c'est la période où le capitalisme exploite le travail salarié sous la forme où il se trouvait dans les modes de production antérieurs. L'ouvrier réalise le même procès de travail qu'il faisait quand il était artisan, mais il lui imprime déjà un caractère coopératif et, fondamentalement, les instruments et le produit même ne lui appartiennent déjà plus à lui mais au capitaliste sous les ordres duquel il travaille. La révolution industrielle a établi les bases pour la domination réelle, pour la transformation du processus même de travail, pour le surgissement du travail sous sa forme spécifiquement capitaliste avec son haut degré de coopération, de division et de simplicité. C'est le surgissement du prolétariat moderne dépouillé non seulement de ses moyens de production mais aussi de sa puissance spirituelle. Historiquement, le passage de la domination formelle du travail à la domination réelle n'est que le passage de la manufacture à la grande industrie. L'expansion postérieure du capital se présente comme une reproduction de ces phases de manière rapide et violente: premièrement le capital s'approprie la production sous sa forme précapitaliste telle qu'il la rencontre, et immédiatement il lui imprime son caractère capitaliste. Si l'époque de la décadence correspondait au passage de la domination formelle à la domination réelle du processus de travail, nous devrions la situer à la fin du 18e siècle et au début du 19e. Encore une fois, nous nous trouvons en face de la tendance à diluer l'époque déterminée de la décadence dans le développement général du capitalisme.
A un moment, il semble que le Collectif situe la décadence au début du siècle. Après avoir mentionné la nature décadente du capitalisme, il poursuit (thèse 1):
"Le capitalisme dans cette logique impose alors la destruction violente et périodique d'une masse croissante de forces productives"... "De cette tendance interne surgit la nécessité des guerres pour prolonger son existence comme un tout. Historiquement, on a vu qu'après chaque guerre apparaît une période de reconstruction."
Mais les guerres de ce type furent une réalité seule ment au début du siècle présent et nous supposons que c'est à elles que se réfère le Collectif et non à un autre type de guerre du siècle passé. Y compris dans sa réponse au BIPR, le CCA ajoute:
"Si nous observons comment le système capitaliste est devenu de plus en plus barbare depuis la première guerre mondiale jusqu 'à nos jours, il est possible de comprendre pourquoi plus le capitalisme se développe, plus il plonge dans la barbarie (ou décadence)..." (Comunismo n°l, p.22).
Donc la décadence se verrait située au début du 20e siècle ce qui coïnciderait avec la position que nous avons adoptée. Cependant, dans une note au paragraphe antérieur, le Collectif "clarifie":
"En étant strict en termes historique, nous pourrions dire que cette progressive 'barbarisation' du système capitaliste commence au milieu du 19e siècle, date ou moment où la bourgeoisie perd son rôle progressif dans l'histoire de l'Europe et où le prolétariat apparaît au niveau historique de la lutte des classes comme son pôle antagonique", "...nous pouvons situer le début de la décadence globale du système capitaliste à partir de 1858. Celle-ci se situe précisément dans le cours de son expansion progressive aliénée à l'échelle planétaire..."
Enfin le Collectif place la décadence à partir de la maturation du capitalisme en Allemagne et des révolutions de 1848, au milieu du siècle passé, ce qui amène toute tentative de caractériser cette époque à rester dans des généralités sur le capitalisme. Ainsi il n'y aura pas de différences substantielles entre le capitalisme actuel et celui du siècle passé car tout existait déjà: la crise cyclique, le marché mondial, la tendance à la guerre, la possibilité de la révolution. C'est à cela que mène la prétention de tout expliquer à partir du "pôle dominant" de la production, en laissant de côté les changements ayant eu lieu dans la sphère de l'échange.
Mais ceci est une erreur. Le Collectif ne se rend pas compte que déjà conceptuellement c'est un contresens de placer l'époque de la décadence, de déclin du capitalisme "précisément dans le cours de sa progressive expansion" et qu'ajouter l'adjectif "aliéné" ne résout rien.
Dans cette même note, le Collectif cite deux fois Marx pour argumenter sa position. La première est une fausse et lamentable interprétation. Marx dit que l'économie bourgeoise est en décadence. Il se réfère évidemment à la science économique bourgeoise, mais le CCA, loin de clarifier cela, laisse implicite que Marx se réfère au' mode de production. Cependant, il vaut la peine de reproduire la seconde citation:
"Nous ne pouvons nier que la société bourgeoise a expérimenté pour la seconde fois son 16e siècle, un 16e siècle qui, je l'espère, mettra à mort la société bourgeoise, de la même manière que le premier lui a donné le jour. La mission particulière de la société bourgeoise, c'est l'établissement d'un marché mondial. Comme le monde est rond, cela semble être achevé avec la colonisation de la Californie et de l'Australie et avec l'ouverture de la Chine et du Japon. Ce qui est difficile pour nous est ceci: sur le continent, la révolution est imminente et assumera immédiatement un caractère socialiste. Ne sera-t-elle pas destinée à être défaite dans ce petit coin en tenant compte que sur un territoire beaucoup plus grand le mouvement de la société est toujours en ascension ?" (Marx, prologo a la 2a edicion del Capital)
On peut difficilement conclure du passage antérieur qu'à l'époque de Marx, le capitalisme comme système mondial se trouvait déjà dans sa phase de décadence alors qu'un territoire beaucoup plus grand se trouvait en "ascension".
Marx comprenait que la révolution n'était pas possible à n'importe quel moment mais qu'elle requérait certaines conditions matérielles et sociales. Pour lui:
"Une formation sociale m disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir, jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s’y substituent avant que les conditions d'existence matérielles de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société" (Préface à la Contribution à la critique de l'économie politique, Editions Sociales, p.5. 1972).
Bien. Que tire-t-on du passage cité par le Collectif? Marx considérait-il déjà "mûres" les conditions pour la révolution? Pour l'Europe, oui. Pour le reste du monde, non.
La préoccupation des révolutionnaires à cette époque était les perspectives d'une révolution en Europe alors que dans le reste du monde la lutte du prolétariat était improbable ou inexistante. Peut-être le communisme aurait-il pu s'étendre aux nations arriérées; en Russie, par exemple, on pourrait de passer de la communauté patriarcale au communisme moderne. Mais aussi peut-être, la révolution européenne pourrait être écrasée par le poids du mouvement toujours ascendant de la société dans le reste du monde.
Marx, comme les révolutionnaires et la classe ouvrière en général, était limité par les conditions historiques. La révolution européenne se présentait comme la fin de la société bourgeoise car à cette époque la société bourgeoise se limitait pratiquement à l'Europe. Personne ne pouvait deviner à ce moment-là si la révolution dans cette "petite région" suffirait pour instaurer le communisme dans un monde encore arriéré.
Aujourd'hui, nous pouvons déjà dire crue ce n'était pas possible. Qu'à cette époque le capitalisme avait des réserves, que ses tendances au développement ascendant étaient plus puissantes que les tendances à son déclin et que les forces de la révolution; que l'ouverture de l'Orient ouvrait un champ d'expansion immense, que les limites du marché mondial étaient encore loin de s'exprimer ouvertement. En somme, que l'exacerbation des contradictions du capitalisme n'était pas arrivée au degré où s'ouvrirait réellement l'époque de sa décadence et de la révolution mondiale.
Marx posait les bases générales pour une théorie de la décadence mais ne pouvait pas la développer; seuls pouvaient le faire les révolutionnaires des débuts du 20e siècle; quand la décadence est devenue une réalité. Celle-ci est annoncée par la dépression chronique de la fin du 19e siècle, les guerres inter bourgeoises du début de ce siècle et la révolution russe de 1905, et déjà elle s'exprime avec une clarté aveuglante dans la transformation de la crise de 1913 en guerre impérialiste généralisée de 1914-18 et dans l'explosion révolutionnaire du prolétariat international en 1917-
La conception de la décadence du capitalisme définit l'époque à laquelle le capitalisme a accompli déjà définitivement sa "mission historique", et les contradictions ne se manifestent plus seulement en un quelconque "haut degré de développement" mais: le développement du capitalisme est tel qu'il se transforme en barbarie, car l'exploitation du travail salarié n'a déjà plus sa contrepartie dans l'oeuvre civilisatrice progressive des nations "barbares". Maintenant, la civilisation se présente comme généralisation de la barbarie. L'accumulation de capital n'a plus sa contrepartie dans le pur développement des forces productives, mais maintenant les forces productives se voient freinées et, en plus, leur développement tend à se transformer en puissances destructrices. Et la contrepartie à la crise périodique ne se manifeste plus dans des phases d'expansion et de prospérité mais dans la "solution" de la guerre généralisée.
La décadence du capitalisme ouvre l'époque de la révolution communiste mondiale, non seulement parce que, par la création du marché mondial, elle a déjà crée les conditions matérielles pour la nouvelle société, mais aussi parce que la désagrégation du capitalisme, l'avancée de la barbarie, a sa contrepartie dans l'avancée des forces de la révolution.
La crise, comme destruction de forces productives, ne signifie pas seulement destruction de moyens de production, mais surtout, destruction de forces productives humaines. Elle signifie plus de chômage, plus d'exploitation, d'accidents, de misère, et de morts même. L'antagonisme entre le capital et le travail salarié s'exprime de la manière la plus brutale et la plus ouverte. Ce sont les conditions pour la maturation de la conscience et du mouvement révolutionnaire du prolétariat.
"Une révolution est seulement possible comme conséquence d'une crise... mais celle-ci est aussi certaine que celle-là."
La crise actuelle avec son caractère mondial et sa longue durée ne tend pas seulement à une nouvelle guerre mondiale. Mais aussi, elle ouvre la perspective pour un assaut définitif du prolétariat de la forteresse ennemie. Elle crée comme jamais les conditions pour la révolution mondiale du prolétariat.
Ces conditions doivent être l'objet de toute notre attention.
GPI, août 1986.
[1] [34] Cf. la présentation du CCA dans la Revue Internationale 50.
[2] [35] La place nous manque pour les reproduire ici. Le GPI partage avec le CCI l'essentiel des positions politiques qui sont publiées au dos même de toutes les publications territoriales ainsi que de cette Revue Internationale.
[3] [36] Cf. Revue Internationale n° 10,19 et 20.
[4] [37] Revue Internationale 40.
[5] [38] Une remarque qui nous semble nécessaire ici: les cycles économiques dans la période actuelle de décadence ne s'arrêtent pas à la "reconstruction". Contrairement à la période ascendante dont les cycles se présentent dans la formule Production-Crise-Production élargie, les cycles actuels se caractérisent dans la formule Crise-Guerre-Reconstruction-Crise plus profonde. (NDLR)
[6] [39] Nous pensons que les camarades commettent ici une erreur. Il est faux de dire que « les conditions matérielles pour la société communiste sont déjà données ». En fait, les conditions matérielles rendent de plus en plus impossible la continuation du système capitaliste de production, d’où la décadence et la crise permanente. Ainsi sont indiquées la nécessité et la possibilité de s'engager vers l'unique n'est que dans la période de transition que les conditions matérielles seront achevées permettant l'instauration du communisme: "de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins". (NDLR)
[7] [40] Il est faux de dire que la baisse des salaires réduit la réalisation de la plus-value. Par définition, le salaire ne rachète jamais la plus-value. La baisse des salaires est toujours une augmentation de la production de plus-value aussi bien absolue que relative. (NDLR)
[8] [41] La destruction généralisée des forces productives n'est pas un "but" recherché par le capital mais une conséquence "aveugle" de ses contradictions. Cette idée de la guerre comme "recherche" de destruction est fausse. A la rigueur, peut-elle être valable pour un pays ou un bloc capitaliste pour détruire l'appareil industriel de pays rivaux ou s'en emparer. Une telle vision escamote une donnée déterminante: l'exacerbation de l'antagonisme inter impérialiste comme cause directe des guerres généralisées de notre période. (NDLR)
Géographique:
- Mexique [42]
Courants politiques:
Questions théoriques:
- Décadence [44]
Polémique : où va le F.O.R. ? ("Ferment Ouvrier Révolutionnaire")
- 4336 lectures
Le Ferment Ouvrier Révolutionnaire (FOR) est aujourd'hui une composante du milieu prolétarien révolutionnaire. Il est l’un des rares groupes qui défendent les positions communistes (contre les syndicats, le parlementarisme, les luttes de libération nationale, le frontisme, le capitalisme d'Etat, etc.) et interviennent dans la lutte de classe. Par ce fait, il n'est pas indifférent de faire un bilan politique de ce groupe dont les positions sont mal connues au sein du milieu prolétarien.
A travers un de ses militants les plus connus, G. Munis, le FOR est issu de l’ancien groupe trotskyste espagnol qui se constitua dans les années 30. L'évolution de Munis et de ses partisans vers des positions révolutionnaires ne se fit pas sans mal. Munis -suivant les consignes de Trotsky- fut partisan de l’entrée des "bolcheviks léninistes" dans les Jeunesses Socialistes/ mais par contre refusa la fusion avec le POUM, parti "socialiste de gauche" qui devait jouer un rôle essentiel dans la défaite des ouvriers espagnols en 1936-37. En 1936, Munis et ses amis allaient, temporairement, servir dans les milices socialistes sur le front de Madrid. Un itinéraire qui était loin d'être révolutionnaire et s'écartait notablement des positions intransigeantes de la Gauche communiste à l’époque (Gauche italienne, et même Gauche hollandaise). C'est seulement en 1937, lors des événements de Mai -où le prolétariat de Barcelone se fit massacrer par le gouvernement de Front Populaire— que le groupe de Munis commença à abandonner sa fausse trajectoire ([1] [45]) en se plaçant résolument du côté des insurgés, en dénonçant les staliniens ainsi que le POUM et la CNT-FAI. L'attitude révolutionnaire courageuse de Munis lui valut d'être emprisonné en 1938. En 1939, il réussit à s'évader, échappant à l'assassinat de la part des staliniens, pour gagner finalement le Mexique.
L'immense mérite de Munis et de ses amis au Mexique — dont le poète surréaliste Benjamin Péret— fut de dénoncer la politique de "défense de l'URSS" et l'intégration dans la guerre impérialiste de la "4e Internationale" trotskyste. Cela amena Munis à faire une rupture en 1948 avec l'organisation trotskyste, pour sa trahison de l'internationalisme, en même temps que d'anciens trotskystes espagnols. Mais, caractéristique du groupe de Munis —qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le FOR— celui-ci estimant que la révolution était une simple question de volonté, fit décider le départ du groupe pour une action clandestine en Espagne franquiste. Pris par la police, Munis subit un dur emprisonnement.
Il n'est pas indifférent que le rapprochement du groupe de Munis des positions de la gauche communiste, dans le début des années 50, fût favorisé par les discussions entamées avec les groupes issus de la gauche communiste italienne. Les discussions avec "Internationalisme" puis avec le groupe de Damen ([2] [46]) ne furent pas étrangères au fait que l'Union ouvrière internationaliste (nom du groupe de Munis) pût quelque peu se "décrotter" de toute une idéologie trotskyste, pour trouver une vraie trajectoire révolutionnaire.
Au cours des années 60, le groupe de Munis et de Benjamin Péret (mort en 1959) s'est maintenu courageusement, en une période de pleine contre-révolution, sur des positions révolutionnaires prolétariennes. C'est au cours de cette période difficile, où les éléments révolutionnaires étaient extrêmement peu nombreux et dispersés, que l'ancêtre du FOR actuel publia ses textes politiques de référence: "Les syndicats contre la révolution" et "Pour un second manifeste communiste" ([3] [47]). Ces textes, après la longue nuit de contre-révolution qui s'étendit sur le monde jusqu'à la reprise internationale des luttes prolétariennes qu'a marquée Mai 68 en France, ont joué un rôle non négligeable vis-à-vis de jeunes éléments qui, avec difficulté, se réappropriaient les positions de la Gauche communiste et cherchaient à combattre les théories nauséabondes du maoïsme et du trotskysme. Le FOR, qui publie aujourd'hui en France "Alarme" et en Espagne "Alarma" ([4] [48]), est la continuation organisationnelle de l'ancien groupe de Munis et défend en conséquence les positions politiques exprimées dans les anciens textes. Malheureusement, le FOR se réclame aussi de textes des années 40, où le groupe de Munis montre à l'évidence qu'il ne s'était guère débarrassé de sa gangue trotskyste, et qu'il continue à diffuser ([5] [49]), comme s'il y avait une continuité entre les anciens groupes trotskystes espagnol et mexicain de cette époque et le FOR d'aujourd'hui.
Il est donc nécessaire de voir dans quelle mesure le FOR actuel se situe clairement sur le terrain de la Gauche communiste et s'il lève les ambiguïtés de ses origines.
L'HERITAGE DU TROTSKYSME
On doit malheureusement constater que le FOR et Munis n'ont pas proclamé sans réticence la rupture avec le courant et l'idéologie trotskystes. Si d'un côté, il est affirmé que depuis la 2e Guerre mondiale le trotskysme est passé à la contre-révolution, de l'autre côté il subsiste une très forte nostalgie de ce courant, au temps où, dans les années 30, il conservait encore un caractère prolétarien.
C'est avec étonnement qu'on peut lire les assertions suivantes, dans la littérature du FOR:
"C'est l’opposition de gauche (trotskyste) qui formula le mieux l'opposition au stalinisme" (Munis, "Parti Etat, stalinisme, révolution", Cahiers Spartacus, 1975)
"L'oeuvre de Trotsky et du mouvement originel de la 4e Internationale a constitué un apport considérable pour la compréhension du Thermidor russe." ("Pour un second manifeste communiste", Losfeld Paris, 1965, p. 57)
Ou encore, tout récemment:
"Le trotskisme étant le seul courant internationaliste en activité dans des dizaines de pays et plusieurs continents, il incarnait la continuité du mouvement révolutionnaire depuis la Première Internationale et préfigurait la liaison pertinente avec le futur. " (Munis, "Analisis de un vacio", Barcelona, 1983, p. 3)
A lire ce panégyrique du trotskysme et de Trotsky des années 30, on croirait qu'il n'a jamais existé de Gauche communiste. En proclamant que seul le courant trotskyste a été "internationaliste" dans les années 30, on aboutit à une falsification grossière et éhontée de l'histoire. Munis et ses amis passent sous silence l'existence d'une Gauche communiste (en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Russie) oui, bien avant que le courant trotskyste n'existe, mena le combat contre la dégénérescence de la Révolution russe, pour l'internationalisme.
Ce travail d'escamotage du VERITABLE mouvement révolutionnaire des années 20 et 30 (KAPD, GIC, "Bilan" et la fraction italienne) ne peut avoir qu'un but: absoudre à tout prix la politique opportuniste originelle du trotskysme et de Trotsky et donner un brevet révolutionnaire à l'activité des trotskystes espagnols dont Munis faisait partie. Munis et le FOR ont-ils "oublié" que la politique de défense de l'URSS des trotskystes devait les amener directement à participer à la seconde boucherie impérialiste? Ont-ils oublié la politique antifasciste de ce mouvement, qui l'amena à proposer le "front unique" avec ces bouchers du prolétariat que furent et sont toujours les partis staliniens et social-démocrate ? Munis a-t-il "oublié" la politique d'entrisme dans le Parti socialiste espagnol qu'il soutint dans les années 30? De tels silences sur ces faits expriment dans le FOR des ambiguïtés graves qu'il est loin d'avoir surmontées.
De tels "oublis" ne sont pas innocents. Ils manifestent un attachement sentimental à l'ancien courant trotskyste, qui conduit directement à des falsifications et à des mensonges. Lorsque le FOR proclame allègrement que "Trotsky n'a jamais défendu même critiquement le Front populaire ni en Espagne ni ailleurs" (cf. "L'arme de la critique", organe du FOR, n°l, mai 1985), il s'agit d'un mensonge manifeste ([6] [50]). A moins que le FOR ignore complètement l'histoire réelle du mouvement trotskyste... Il n'est jamais trop tard pour apprendre.
Nous donnons sans commentaires, à l'intention de Munis et de ses amis, quelques citations "édifiantes" de Trotsky, extraites du recueil de Broué "La révolution espagnole (1930-1940)":
"Renoncer à soutenir les armées républicaines, seuls peuvent le faire les poltrons et les traîtres, agents du fascisme" (p.355); "Tout trotskyste en Espagne doit être un bon soldat au côté de la Gauche" (p.378); "Partout et toujours, là où les ouvriers révolutionnaires ne sont pas dans l'immédiat assez forts pour renverser le régime bourgeois, ils défendent, contre le fascisme, même la démocratie pourrissante, mais surtout ils défendent leurs propres positions à l'intérieur de la démocratie bourgeoise" (p. 431); "Dans la guerre civile espagnole, la question est démocratie ou fascisme" (p. 432).
En fait, on doit constater que cet attachement de Munis et de ses amis à l'ancien mouvement trotskyste des années 30 n'est pas seulement "sentimental". Il existe bel et bien des restes importants d'idéologie trotskyste aujourd'hui dans le FOR. Sans en dresser une liste exhaustive, on peut en relever quelques-uns parmi * les plus significatifs:
a) L'incompréhension du capitalisme d'Etat en Russie qui amène le FOR à parler, comme les trotskystes, de l'existence non d’une classe bourgeoise mais d'une bureaucratie:
". ..Il n'y (en Russie) existe pas une classe propriétaire, pas plus nouvelle que vieille. Les tentatives pour définir la bureaucratie comme une sorte de bourgeoisie sont aussi inconsistantes que taxer de bourgeoise la révolution de 1917... Ce n'est pas à l'heure où la concentration de son développement capitaliste atteint des proportions mondiales et élimine par sa propre dynamique la fonction des capitaux privés agissant chaotiquement qu'une bourgeoisie toute fraîche va se constituer. Le processus caractéristique de la civilisation capitaliste ne peut se répéter nulle part, même si l'on en imagine des formes modifiées. " (Munis, "Parti-Etat", idem p. 58)
Le FOR considère donc, comme les trotskystes, que le capitalisme se définit par sa forme juridique d'appropriation. La suppression de l'appropriation privée implique la disparition de la classe bourgeoise. Il n'entre pas dans l'esprit du FOR que la "bureaucratie" dans les pays de l'Est (et en Chine, etc.) est la forme que prend la bourgeoisie décadente en s'appropriant les moyens de production (Pour cette question, nous renvoyons à nos textes de base).
b) La mise en plan d'un nouveau "Programme de transition" à l'exemple de Trotsky en 1938, marque chez le FOR une incompréhension de la période historique, celle de la décadence du capitalisme. En effet, le FOR a cru bon -dans "Pour un second manifeste communiste"- de mettre en avant toutes sortes de revendications transitoires, en l'absence de mouvements révolutionnaires du prolétariat. Cela va de la semaine de 30 heures, de la suppression du travail aux pièces et du chronométrage; dans les usines, à la "revendication du travail pour tous, chômeurs et jeunes", sur le terrain économique. Sur le plan politique, le FOR exige de la bourgeoisie le "droit"(!) et la "liberté" démocratiques: "liberté de parole, de presse et de réunion; le droit d'élire pour les ouvriers, leurs délégués permanents d'atelier, d'usine, profession", "sans aucune formalité judiciaire ou syndicale" ("Second Manifeste", p. 65-71).
Cela se situe dans la "logique" trotskyste, selon laquelle il suffirait de poser des revendications bien choisies pour arriver graduellement à la révolution. Pour les trotskystes, le tout est de savoir être pédagogue avec les ouvriers, qui ne comprendraient rien à leurs revendications, et de brandir les carottes les plus appétissantes dans le but de pousser les ouvriers dans leur "parti"... Est-ce cela que veut Munis, avec son programme de transition "bis"?...
Aujourd'hui, ce n'est pas aux groupes révolutionnaires qu'il revient de dresser un catalogue de revendications e l'avenir; les ouvriers sont assez grands pour trouver eux-mêmes, dans la lutte, spontanément, des revendications précises.
Aujourd'hui telle ou telle revendication précise, comme le "droit au travail" pour les chômeurs, peut être reprise par des mouvements bourgeois et utilisée contre le prolétariat (camps de travail, chantiers collectifs des années 30, etc.).
Aujourd'hui, c'est seulement à travers la lutte massive que le prolétariat peut faire face aux attaques de la bourgeoisie, et c'est dans la lutte révolutionnaire contre la bourgeoisie que les ouvriers pourront réellement satisfaire leurs revendications. Le capitalisme décadent n'est plus en état de concéder des réformes durables au prolétariat.
De façon très caractéristique, le FOR met sur le même plan ses mots d'ordre réformistes de "droits et libertés" démocratiques pour les ouvriers et des mots d'ordre qui ne peuvent surgir que dans une période pleinement révolutionnaire. On trouve ainsi pêle-mêle les mots d'ordre de:
- "expropriation du capital industriel, financier et agricole";
- "gestion ouvrière de la production et de la distribution des produits";
- "destruction de tous les instruments de guerre, atomiques aussi bien que classiques, dissolution des armées, des polices, reconversion des industries de guerre en production de consommation";
- "armement individuel des exploités sous le capitalisme, territorialement organisé, selon le schéma des comités démocratiques de gestion et de distribution";
- "suppression du travail salarié en commençant par élever le niveau de vie des couches sociales les plus pauvres pour atteindre finalement la libre distribution des produits selon les besoins de chacun";
- "suppression des frontières et constitution d'un seul gouvernement et d'une seule économie au fur et à mesure de la victoire du prolétariat dans divers pays. "
Et le FOR d'ajouter à tout ce catalogue le commentaire suivant:
"C’est seulement sur les ailes de la subjectivité (sic) - révolutionnaire que l'homme franchira la distance du règne de la nécessité au règne de la liberté" (idem, p. 71).
En d'autres termes, le FOR prend ses désirs pour des réalités et considère la révolution comme une simple question de volonté subjective, et non de conditions objectives (la maturation révolutionnaire du prolétariat dans la crise historique du capitalisme plongé dans la crise économique).
Tous ces mots d'ordre montrent des confusions énormes. Le FOR semble avoir abandonné toute boussole marxiste. Aucune distinction n'est faite entre une période prérévolutionnaire, où domine politiquement le capital, une période révolutionnaire, où s'établit un double pouvoir, et la période de transition (après la prise du pouvoir par le prolétariat) qui seule peut mettre à l'ordre du jour (et non immédiatement!) la "suppression du travail salarié" et la "suppression des frontières".
A l'évidence, ces "mots d'ordre" du FOR montrent non seulement des restes mal digérés du programme de transition trotskyste, mais de fortes tendances anarchistes. Les mots d'ordre de "gestion ouvrière" font partie du bagage anarchiste, conseilliste ou "gramscien" mais certainement pas du programme marxiste. Quant à "l'armement individuel" (et pourquoi pas collectif?) du prolétariat et à l'exaltation de la "subjectivité" (individuelle, sans doute) ils s'inscrivent dans le confusionnisme anarchiste.
Finalement, la "théorie" du FOR apparaît comme un mélange de confusions héritées du trotskysme et de l’anarchisme. Les positions du FOR sur l'Espagne en 1936-37 le montrent de façon éclatante.
LA "REVOLUTION ESPAGNOLE" DANS L'EVANGILE DU FOR
Nous avons déjà eu l'occasion dans la presse du CCI ([7] [51]) de critiquer les conceptions de Munis et ses amis sur les événements d'Espagne de 1936-37. Il est nécessaire d'y revenir, car l’interprétation du FOR conduit aux pires aberrations politiques, inévitablement fatales pour un groupe se situant sur le terrain de la révolution prolétarienne.
Pour le groupe de Munis, les événements d'Espagne sont le moment le plus élevé de la vague révolutionnaire qui débuta en 1917. Mieux, ce qu'il appelle la "révolution espagnole" serait plus révolutionnaire que la révolution russe:
"Plus nous regardons rétrospectivement les années qui vont jusqu'en 1917, plus la révolution espagnole acquiert de l'importance. Elle fut plus profonde que la révolution russe.... " (Munis, "Jalons de défaite, promesse de victoire", Mexico, 1948; postface "Réaffirmation", 1972).
Bien plus, et rien moins que cela, les événements de Mai 37, où le prolétariat espagnol se fit écraser par les staliniens avec la complicité des "camarades ministres" anarchistes, est "le degré de conscience suprême de la lutte du prolétariat mondial" (Munis, "Parti-Etat; stalinisme-révolution", Spartacus, 1975, p. 66)
Munis ne fait que reprendre l'analyse trotskyste sur les événements en Espagne, et jusqu'aux conceptions anti-fascistes. Pour lui, les événements d'Espagne n'ont pas été une contre-révolution permettant à la bourgeoisie d'écraser le prolétariat, mais la révolution la plus importante de l'histoire. De telles assertions sont justifiées de la façon suivante:
- en juillet 36, l'Etat aurait quasiment disparu; des "comités-gouvernement" auraient surgi à la place de l'Etat ([8] [52]);
- les collectivités de 36 en Espagne auraient instauré un véritable communisme local! (et pourquoi pas le communisme dans un seul village?);
- la situation internationale était objectivement révolutionnaire, avec la France "au bord de la guerre ci-" vile" et "la renaissance de l'offensive ouvrière en Angleterre" ("Jalons", p.380).
Il est inutile d'insister sur la fausseté des paroles d'évangile contenues dans "Jalons". Elles sont caractéristiques d'une secte qui "s'élevant sur les ailes de la subjectivité", prend ses fantasmes pour la réalité, au point de devenir mystificateur et de s'auto mystifier. L'invention de "comités-gouvernement" par Munis, qui n'ont nullement existé -seules ont surgi les Milices qui étaient un cartel de partis de gauches et de syndicats— montre une tendance à l’automystification, et surtout au bluff, dont les trotskystes ont toujours été friands.
Mais le plus grave, chez Munis, est le fait qu'il reprend à son compte l'analyse des trotskystes et anarchistes de l'époque, pour finalement mieux les absoudre. En saluant l'action des trotskystes espagnols comme "révolutionnaire", Munis les absout de leur appel à "assurer la victoire militaire" de la République contre le fascisme (idem p. 305). Et que dire de l'enthousiasme manifesté pour les tristement célèbres "Brigades Internationales—avec Marty, le boucher des ouvriers d'Albacete- en lesquelles Munis voit un exemple magnifique où des milliers d'hommes offrirent "leur sang pour la révolution espagnole" (p. 395). Quant au sang ouvrier versé par les bouchers staliniens composant ces brigades, un pudique silence est gardé.
En continuant à répéter les mêmes erreurs que les trotskystes espagnols en 36, le FOR aboutit à une totale incompréhension qui est inévitablement fatale à tout groupe prolétarien:
- d'abord, l'incompréhension des conditions de la disparition de l'Etat capitaliste et de l'ouverture d'une véritable période de transition du capitalisme au communisme. En affirmant que le 19 juillet 36, "l'Etat capitaliste cessa d'exister" ("Jalons", p.280), non seulement Munis travestit la réalité historique mais considère que la disparition de l'Etat s'accomplit sur-le-champ, en quelques heures, dans un seul pays. Une telle vision est identique à celle de l'anarchisme.
- Munis et ses amis considèrent que la révolution prolétarienne peut s'accomplir sans l'existence et de conseils ouvriers et d'un parti révolutionnaire. Ainsi, sans organisation unitaire et sans organisation politique, la révolution se déroulerait spontanément. Malgré sa reconnaissance de la nécessité d'un parti révolutionnaire pour catalyser le processus de fa révolution, le FOR introduit par la bande les conceptions conseillistes.
Finalement, le FOR manifeste une totale incompréhension des conditions de la révolution prolétarienne aujourd'hui.
L'AVENIR D'UNE SECTE
Le FOR se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Toute sa raison d'être a été l'affirmation que la révolution était une question de volonté et de subjectivité. Pour cela, il n'a cessé d'affirmer que les conditions objectives (crise générale du capitalisme, décadence économique) importaient peu. De façon idéaliste, le FOR n'a cessé de prétendre qu'il n'y avait pas un déclin économique mais une décadence "morale" du capitalisme. Pire, il n'a voulu voir depuis les années 70 dans la crise économique du capitalisme qu'une "simple ruse de guerre de la bourgeoisie" comme l'affirmait Munis lui-même, au début de la 2ème conférence internationale des groupes de la gauche communiste ([9] [53]).
A l'heure où les deux "lundis noirs" du krach boursier d'octobre 1987 (19 et 26 octobre) sont la confirmation éclatante de la faillite économique du système capitaliste mondial, le FOR va-t-il continuer tranquillement à affirmer qu'il n'y a pas de crise? A l'heure où se confirme avec éclat l'effondrement du capitalisme, le FOR va-t-il répéter -comme en 1975- que "le capitalisme résout toujours ses propres contradictions -les crises de surproduction" (cf. RI n°14, mars 75, "Réponse à Alarma")?
Si le FOR continuait à se placer au delà de la réalité sur les "nuages" roses de sa "subjectivité", il apparaîtrait comme une secte condamnée par la réalité objective elle-même. Or, par définition, une secte qui est repliée sur elle-même, pour défendre ses propres "dadas" —comme la "révolution espagnole" et l'absence de crise économique- et nie la réalité, est condamnée soit à disparaître totalement, soit à éclater en multiples morceaux dans la pire confusion.
Le FOR se trouve à la confluence de trois courants: le trotskysme, le conseillisme et l'anarchisme.
Du trotskysme, le FOR conserve non seulement des résidus (Espagne 36, "revendications transitoires", volontarisme) mais aussi une singulière attraction pour ses éléments "critiques" en rupture. Si le FQR est clair aujourd'hui que "rien de révolutionnaire ne peut prendre sa source dans aucune tendance dite trotskyste" (Munis, "Analisis de un vacio", 1983), il garde l'illusion que des scissions du trotskysme "pourraient contribuer à bâtir une organisation du prolétariat mondial" (idem). C'est cette même illusion qu'il avait entretenue en 1975, lorsque s'était constitué le groupe Union Ouvrière, issu de "Lutte Ouvrière" en France. Le FOR n'avait pas hésité à voir dans cette scission sans lendemain le "fait organique le plus positif arrivé en France pour le moins depuis la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui" ("Alarma" n°28,1975, "Salut à Union Ouvrière").
Le FOR doit dire clairement maintenant, alors que les responsabilités des révolutionnaires sont autrement plus écrasantes aujourd'hui qu'il y a dix ans, si oui ou non il se considère comme une composante de la gauche communiste, oeuvrant à son regroupement, ou au contraire comme une composante du milieu marécageux dans lequel barbotent les différents groupuscules "critiques" issus du trotskysme. Le FOR doit se prononcer sans ambiguïtés sur les conditions de formation du parti révolutionnaire. Il doit dire clairement si celui-ci se constituera autour des groupes issus de la gauche communiste, qui se réclament de l'apport des gauches des années 20 et 30 (KAPD, "Bilan", Gauche hollandaise), ou autour des groupes issus du trotskysme. Une réponse claire à cette question déterminera la participation du FOR à des conférences de la Gauche communiste, participation qu'il a déclinée en 1978, de façon sectaire.
En deuxième lieu, il apparaît que le FOR a ouvert toutes grandes les portes vers le "conseillisme". En considérant comme secondaire et même inexistante la crise économique du capitalisme, en affirmant que la conscience du prolétariat ne peut surgir que de la lutte elle-même ([10] [54]), le FOR sous-estime non seulement les facteurs objectifs de la révolution mais le facteur subjectif, celui de l'existence d'une organisation révolutionnaire, qui est le point le plus haut, le plus élaboré de la conscience de classe.
En troisième lieu, le FOR montre des attaches et une attraction très dangereuses vers les conceptions anarchistes. Si le FOR a rejeté la vision trotskyste des "révolutions politiques c'est pour mieux proclamer que la révolution sera d'abord et avant tout "économique et non politique:
"Cette vision politique de la révolution partagée par l’extrême gauche et la plupart de ce qui est appelé l’ultra-gauche est une vision bourgeoise de la prise du pouvoir." ("L'arme de la critique", n°l, mai 1985). Cette conception était exactement la même que celle du GIC conseilliste hollandais (voir brochure à paraître sur la gauche communiste germano hollandaise), qui se rapprochait ainsi de l’anarchisme. En croyant et en faisant croire qu'une révolution fera disparaître immédiatement la loi de la valeur et réalisera rapidement les tâches économiques du communisme, le FOR tombe dans l'illusion anarchiste selon laquelle le communisme est une simple question économique, pour mieux évacuer la question du pouvoir politique du prolétariat (dictature es conseils à l'échelle mondiale, ouvrant réellement la période de transformation économique de la société).
Le FOR est à la croisée des chemins. Ou bien il restera une secte sans avenir amenée à mourir de sa belle mort, ou bien il se décomposera en morceaux attirés vers les courants trotskyste, anarchiste et conseilliste, ou bien il s'orientera résolument vers la Gauche Communiste. En tant que secte hybride, mariant la carpe et le lapin, dédaignant la réalité présente, le FOR n'est pas un groupe viable. Nous ne pouvons que souhaiter et contribuer de toutes nos forces à ce que le FOR s'oriente vers une réelle confrontation avec le milieu révolutionnaire. Pour cela, il devra faire une autocritique de son attitude négative en 1978, lors de la seconde conférence des groupes de la Gauche Communiste.
Le milieu révolutionnaire prolétarien a tout à gagner à ce que des éléments révolutionnaires, comme ceux du FOR, ne se perdent pas et s'unissent aux forces révolutionnaires existantes, celles de la Gauche communiste. L'accélération brutale de l'histoire met le FOR devant ses responsabilités historiques. Il y va de son existence, et surtout de celle des jeunes énergies révolutionnaires qui le composent.
Ch.
[1] [55] Les militants du FOR qui ironisent sur la "fausse trajectoire" de Révolution Internationale -titre de leur brochure diffusée à la seconde conférence des groupes de la gauche communiste- feraient mieux d'analyser la fausse trajectoire des trotskystes espagnols avant 1940 (cf. pour cela les textes cités par Munis lui-même dans son livre "Jalons d'une défaite, promesses de victoire" et le livre de Broué: "La Révolution» espagnole", éditions de Minuit, 1975).
[2] [56] Il s'agit du Parti communiste internationaliste de Damen, issu de la scission en 1952 d'avec la fraction de Bordiga, regroupé autour de la publication "Battaglia Comunista".
[3] [57] "Pour un second manifeste communiste", bilingue français et espagnol, Eric Losfeld, Paris, 1965; "Les syndicats contre la révolution" de B.Péret et de G. Munis, Eric Losfeld, Paris, 1968. Publier les textes de Péret des années 50 (qui se trouvent dans ce dernier recueil), dans le "Libertaire", organe de la Fédération anarchiste, était plus qu'ambigu. C'était donner un brevet révolutionnaire aux éléments anarcho-syndicalistes qui ont trempé dans la guerre antifasciste en 36-37, et continuent à être les chantres de la CNT, syndicat anarchiste.
[4] [58] Alarme, BP 329,75624 Paris cedex 13 (France); Alarma Apartado 5355 Barcelona (Espagne).
[5] [59] Ainsi les textes de critique de la 4e Internationale publiés au Mexique entre 1946 et 1949.
[6] [60] cf. la Revue Internationale n° 25,1981, "Critique de Munis et du FOR"; brochure du CCI en espagnol sur l'Espagne 36-37 (1987) et l'article "Critica de Jalones de derrota, promesas de Victoria'".
[7] [61] cf. la Revue Internationale n° 25,1981, "Critique de Munis et du FOR"; brochure du CCI en espagnol sur l'Espagne 36-37 (1987) et l'article "Critica de Jalones de derrota, promesas de Victoria'".
[8] [62] Ce n'est pas par hasard si le trotskyste Broué reprend à son compte l’affirmation de Munis, selon laquelle auraient existé des "comités-gouvernement" assimilables aux conseils ouvriers, pour mieux prouver l'existence d'une "révolution espagnole", cf. Broué, "La révolution espagnole. 1931-39", Flammarion, 1973, p. 71.
[9] [63] 2e Conférence des groupes de la Gauche communiste, novembre 1978. Le FOR, décidant de "rester en marge de la Conférence", la quitta finalement dès le début, ne voulant pas reconnaître l'existence d'une crise du capitalisme.
[10] [64] "...l'école du prolétariat ne sera jamais la réflexion théorique ni l'expérience accumulée et bien interprétée mais le résultat de ses propres réalisations EN PLEINE LUTTE. L'existence précède la conscience; le fait révolutionnaire sa propre conscience pour l'écrasante majorité des protagonistes..."
"En somme, la motivation MATERIELLE de la liquidation du capitalisme est donnée par la déclinante (?) contradiction existant entre le capitalisme et la liberté du genre humain" ("Alarme" n°13, juillet septembre 1981, "Organisation et conscience révolutionnaires".
Géographique:
- Espagne [65]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [66]
La Gauche hollandaise en 1919-1920 (2e partie) la troisième internationale
- 3485 lectures
LA QUESTION ALLEMANDE
C'est par une manoeuvre que la direction du KPD fit expulser du parti la majorité de gauche en septembre 1919. Cette majorité, depuis le congrès de décembre 1918, avait pour mot d'ordre "Sortez des syndicats!" (Heraus aus den Gewerkschaften). Les militants communistes, surtout à Bremen et Hamburg, attaquaient les bureaux du syndicat social-démocrate de Legien, prenaient les caisses et en distribuaient le contenu aux ouvriers chômeurs. Lorsque se formèrent les premières unions (Unionen), la centrale de Levi et Brandler avait d'abord appuyé: elle lança le mot d'ordre de formation d'Unionen dans les chemins de fer et chez les ouvriers agricoles. Les organisations d'usine (Betriebsorganisationen) composées d'ouvriers et de délégués révolutionnaires se centralisaient pour former les Unionen. Celles-ci, avec le déclin de la révolution, apparaissaient comme des organes de lutte politique, héritage des conseils d'usine. Elles se généralisèrent au cours de l'année 19 dans les principaux secteurs de la classe ouvrière: mineurs, chantiers navals, marins, métallurgie.
A partir de l'été 1919, la position de la centrale de Levi et Brandler changea du tout au tout, non sans arrière-pensées politiques. Il s'agissait pour elle de se rapprocher des Indépendants de l'USPD, qui contrôlaient l'opposition dans les syndicats officiels. Elle se mit à attaquer la gauche comme "tendance syndicaliste". Mais, dans les faits, cette tendance était représentée par une minorité: celle du Wasserkannte (Bremen et Hamburg) autour de Laufenberg et Wolffheim, qui rêvaient d'une IWW allemande, et celle de Saxe autour de Ruhle. Ces deux tendances sous-estimaient l'existence d'un parti politique du prolétariat, qu'elles tendaient à réduire à un cercle de propagande pour les Unions. Tel n'était pas le cas de la grande majorité qui allait former le KAPD en avril 1920: elle était fortement hostile à l’anarcho-syndicalisme et au syndicalisme révolutionnaire antipolitiques. Elle ne concevait les Unionen que comme des organismes de lutte appliquant les directives du parti. Elle n'était donc pas "syndicaliste" mais anti-svndicaliste. ([1] [67])
En août 1919, Levi, lors de la conférence nationale de Francfort, se prononça aussi bien pour un travail dans les syndicats que pour un travail au Parlement. Lors du congrès d'octobre, dit congrès d'Heidelberg, Levi présenta -sans que cela ait pu être discuté dans les sections du parti avant le congrès— une résolution d'exclusion des éléments refusant tout travail dans les syndicats et au parlement. Au mépris de toute démocratie ouvrière, dans le parti, chaque district disposait d'une voix quelle que soit sa taille et le droit de vote -en violation de la décision de la conférence de Francfort- était accordé à la centrale, d'accord pour l'exclusion de la gauche. Celle-ci, bien que majoritaire dans le KPD, fut expulsée. Il est notable que l'opposition en dehors du parti refusa de suivre Laufenberg, WoLffheim et Riïlhe qui voulaient former immédiatement un nouveau parti. Cette attitude de se battre jusqu'au bout pour la reconquête du parti est une constante de la Gauche communiste de l'époque, qui en cela est très proche de la Fraction de Bordiga.
La Gauche hollandaise se solidarisa avec la Gauche allemande. Pannekoek attaqua particulièrement Radek, qui avait soutenu théoriquement Levi ([2] [68]) dans son combat contre la Gauche allemande. Il dénonça le rapprochement du KPD avec les Indépendants, comme glissement vers l'opportunisme ([3] [69]). Cette politique traduisait une approche petite-bourgeoise, "blanquiste", de la conception du parti. En défendant la théorie non marxiste qu'une "petite minorité révolutionnaire pourrait conquérir le pouvoir politique et le — garder en main", Radek ne faisait que justifier la dictature de la centrale de Levi jusqu'à l'intérieur du parti. Sa position était étrangère en fait au bolchevisme. Celui-ci en octobre 1917 ne voulait pas une dictature de parti mais celle des conseils:
"Le véritable exemple russe, on le trouve dans les jours précédant novembre 1917. Là le parti communiste n'avait jamais déclaré ou cru qu'il devait prendre le pouvoir et que sa dictature soit la dictature des masses travailleuses. Il déclara toujours: les soviets, les représentants des masses devaient s'emparer du pouvoir; lui-même établit le programme, combattit pour, et lorsque finalement la majorité des soviets reconnut la justesse de ce programme elle prit le pouvoir en main...". ([4] [70])
Le Pannekoek de 1919 n'est pas encore le Pannekoek "conseilliste" des années 30 et 40. Il reconnaît - comme la Gauche communiste depuis les années 1920 – le rôle irremplaçable du parti. Contrairement à ce que le courant "bordiguiste" lui reprochera plus tard, Pannekoek et la Gauche hollandaise n'ont rien à voir avec les positions à la Ruhle antiparti et démocratistes, avec son culte de la démocratie spontanée et le suivisme des masses:
"Nous ne sommes pas des fanatiques de la démocratie, nous n'avons aucun respect superstitieux des décisions. majoritaires et ne nous adonnons pas à la croyance que tout ce que ferait la majorité serait bon et devrait se produire"
Ce que souligne en fait la Gauche hollandaise c'est la plus grande difficulté d'une révolution en Europe occidentale, dont le cours est "plus lent et plus difficile". Les recettes de Radek pour accélérer les événements au prix d'une dictature de la minorité dans le parti sont la voie de la défaite.
Dans les pays où domine la "vieille culture bourgeoise" avec un esprit d'individualisme et de respect devant l'éthique bourgeoise, la tactique blanquiste est impossible. Non seulement elle nie le rôle des masses, comme sujet révolutionnaire, mais elle sous-estime la force de l'ennemi et le nécessaire travail de propagande, comme préparation de la révolution.
C'est le développement de la conscience de classe, comme procès difficile, qui peut permettre le triomphe de la révolution. Dans cette direction, et pour la première fois de façon explicite, Pannekoek rejette la tactique syndicale. Il appuie pleinement la Gauche allemande qui préconise la formation d'organisations d'usine ([5] [71]) .Beaucoup moins claire restait Ta position des hollandais sur la question du parlementarisme révolutionnaire. Pannekoek avait fait paraître en effet une série d'articles dans Der Kommunist organe de l'opposition de Bremen, qui dans la plupart des questions avait une attitude d'oscillations centristes entre la droite et la gauche. Tout en montrant l'impossibilité d'utiliser le parlementarisme comme "méthode de la révolution prolétarienne" ([6] [72]) à "l'ère impérialiste et révolutionnaire", Pannekoek semblait envisager l'utilisation de la tribune parlementaire dans les pays moins développés; selon lui, cette utilisation dépendrait de "la force, du stade de développement du capitalisme dans chaque pays". Cette théorie des "cas particuliers" aboutissait à la négation implicite de l'antiparlementarisme comme principe nouveau du mouvement révolutionnaire à l'ère de l'impérialisme décadent -"période de crise et de chaos"- et valable mondialement, quel que soit le pays. Il ne s'agissait plus alors que d'une question de tactique à déterminer en fonction des forces productives d'un pays donné. Cette idée n'était qu'implicite, mais sera largement reprise par la suite par le courant "bordiguiste" dégénérescent. ([7] [73])
La conception théorique de la Gauche hollandaise se développait lentement; elle s'enrichissait par la confrontation polémique et avec l'expérience de la révolution allemande. Elle apprit en réalité autant de la Gauche allemande que celle-ci de la Gauche hollandaise. Il y avait une interpénétration des différentes gauches, italienne incluse, au niveau international. La cristallisation, de façon presque achevée, des positions de la gauche communiste, comme corps de doctrine, a été largement favorisée par la création du Bureau d'Amsterdam de l'Internationale communiste. Cette création est le point le plus haut de l'audience internationale de la Gauche hollandaise dans le mouvement révolutionnaire mondial.
LE BUREAU D'AMSTERDAM (1919-1920)
L'isolement, au cours de l'année 1919, du centre de la 3e Internationale établi dans un pays plongé dans la guerre civile et entouré du cordon sanitaire des armées alliées, avait conduit le comité exécutif à décider l'installation de bureaux de l'Internationale en Europe occidentale. Ceux-ci avaient autant des tâches de propagande que d'organisation des différents partis dépendant des bureaux respectifs. L'exécutif de PIC avait donc créé des bureaux en Scandinavie, dans les Balkans, dans le sud de la Russie et en Europe centrale à Vienne; simultanément était mis en place le "bureau latino-américain" de Mexico, à l'instigation de Borodine. Tous ces organismes, mal coordonnés, traduisaient encore une grande confusion dans la centralisation du travail international. Mais il était encore clair pour l'IC que dans un futur proche le centre de l'Internationale devrait être transporté, en Europe occidentale, avec le développement de la révolution. Les bureaux en question en étaient l'ébauche.
Mais à l'automne 1919, PIC mit en place simultanément un secrétariat provisoire pour l'Europe occidentale, siégeant en Allemagne, et un bureau provisoire, siégeant en Hollande et en contact permanent avec celui-là. Ces deux organismes reflétaient bien l'état des tendances dans PIC Le secrétariat était sous la coupe de la droite, celle de Levi et Clara Zetkin, qui penchait vers les Indépendants; celui d'Amsterdam regroupait les communistes de gauche hostiles au cours vers la droite du KPD.
L'IC accordait une place particulière aux Hollandais pour mener au sein du bureau d'Amsterdam la propagande et l'établissement de liens entre partis communistes d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Les Hollandais devaient diriger ce travail. Par une décision du 28 septembre 1919, l'Exécutif de PIC nommait Gorter, Pannekoek, Roland-Holst -tous à la gauche du CPN, Rutgers, Van Ravesteyn et Wijnkoop -ces deux derniers représentant la droite. Rutgers arriva début novembre pour mettre en place le "sous bureau" et organiser une conférence communiste internationale. Malgré les divergences avec les Hollandais, la confiance des bolcheviks était grande, particulièrement à l'égard de Pannekoek. Celui-ci était invité expressément à aller en Russie pour aider au travail théorique et servir d'expert. Pannekoek refusa pour rester indépendant matériellement du gouvernement russe.
Dès le départ, par une série de manoeuvres, Wijnkoop fit en sorte que Pannekoek et surtout Gorter -qu'il faisait calomnieusement passer pour psychopathe- ([8] [74]) soient éliminés de la direction au Bureau. Ne restèrent plus, au mépris de la décision de PIC, que Rutgers, Roland-Holst et Wijnkoop. Il est vrai que Wijnkoop, durant la brève existence dû bureau, se donna une apparence de radicalité, semblant se situer à "gauche" de PIC. Il prit position contre le rapprochement du KPD avec l’USPD, contre l’entrée du PC anglais dans le Labour Party. Malgré ce radicalisme, il fit en sorte que sur des questions, comme la question parlementaire – lui-même étant député- se manifestât une position médiane. Dans les faits, il refusait de prendre position explicitement pour la Gauche communiste: en Allemagne, la lutte entre l'opposition allemande et la droite de Levi étaient définies par lui comme "une lutte entre bonzes de parti des deux directions". Mais l'apparent radicalisme de Wijnkoop dura peu, juste le temps d'exiger au 2e congrès de TIC l'exclusion des Indépendants et de Cachin et Frossard ([9] [75]). La seule exclusion qu'il obtint fut finalement celle de la gauche dans le CPN en 1921 (cf. infra).
En vue de la conférence internationale, qui devait se tenir en février 1920, des Thèses avaient été rédigées, à l’écriture desquelles participèrent Pannekoek et Roland-Holst ([10] [76]). Elles étaient précédées d'un appel à l'unité des communistes qui devaient se fondre en un seul parti, conformément aux décisions de l'Exécutif de l'IC.
Mais ces Thèses s'éloignaient peu ou prou de la ligne de l'IC. Les Thèses sur le parlementarisme -probablement rédigées par Rutgers- étaient un compromis entre les positions de la gauche communiste et celles de l'Internationale. Elles affirment que "le parlementarisme ne peut jamais être une organe du prolétariat victorieux", ce qui est l'une des leçons de la Révolution d'octobre. La théorie du parlementarisme révolutionnaire est défendue avec force:
"(...) l'action parlementaire comprenant les formes les plus énergiques de la protestation contre les brutalités impérialistes, et ceci en combinaison avec l'action de l'extérieur, se révélera un moyen effectif d'éveiller les masses et de susciter leur résistance. "
Il est vrai que cette assertion était accompagnée de restrictions: d'un côté, on affirmait que les parlements "dégénèrent de plus en plus en parades de foires où des escrocs abusent des masses", ce qui démontrait la vacuité du parlementarisme "révolutionnaire", de l'autre on soutient que l’électoralisme est une simple question à déterminer localement et non mondialement:
"... la question de savoir quand et comment le parlementarisme devra être utilisé dans la lutte des classes doit être réglée par la classe ouvrière de chaque pays." ([11] [77])
Ces thèses n'étaient qu'un projet; elles furent modifiées et réécrites par Pannekoek, probablement. Le rejet du parlementarisme révolutionnaire apparaissait plus explicite, mais conditionnel, lié au surgissement des conseils ouvriers:
"(...) lorsque le parlement devient le centre et l'organe de la contre-révolution et que, d'autre part, la classe ouvrière construit les instruments de son pouvoir sous forme des soviets, il peut même s'avérer indispensable de répudier toute participation, quelle qu 'elle soit, à l'action parlementaire. "
Sur la question syndicale, les thèses étaient aussi une position de compromis. Il était préconisé que les ouvriers révolutionnaires forment une "opposition révolutionnaire à l'intérieur des syndicats", ce qui était la position de l'IC qui rêvait de "révolutionner" les syndicats contre-révolutionnaires, sous prétexte que de larges masses s'y trouvaient rassemblées. D'un autre côté le Bureau d'Amsterdam envisageait la possibilité de former des "organisations nouvelles". Celles-ci devaient être des syndicats d'industrie, et non des syndicats corporatistes basés sur le métier. Ces syndicats, d'inspiration révolutionnaire, seraient calqués sur les IWW et les shop stewards anglais. Là où, en fin de compte, le Bureau se démarquait expressément de l'IC, c'était sur le rôle des syndicats après la prise du pouvoir par le prolétariat: à la différence des Russes, qui ne voyaient plus dans les conseils -comme Trotsky ([12] [78])- qu'un "informe parlement ouvrier", les Hollandais rejetaient vigoureusement l'idée que les syndicats pourraient "construire la nouvelle société prolétarienne". Ce rôle incombe aux soviets, organismes politiques unitaires du prolétariat.
L'influence de la révolution allemande, mais aussi celle de Pankhurst et Fraina, amena le Bureau à prendre des positions beaucoup plus tranchées, mieux étayées théoriquement et plus proches de celles de l'Opposition allemande. Le Bureau pouvait devenir le centre de regroupement de toute la gauche communiste internationale, opposée aux orientations de l'IC dans les questions syndicale et parlementaire. C'est ce que montrèrent les travaux de la conférence communiste internationale tenue du 3 au 8 février 1920, à Amsterdam.
La conférence est très représentative des forces du communisme de gauche dans les pays développés. De cette tendance étaient présents Fraina des USA, Sylvia Pankhurst de Grande-Bretagne, Van Overstraeten de Belgique, Gorter, Pannekoek et Roland-Holst de Hollande, Cari Stucke ([13] [79]) de la gauche de Bremen. Les autres délégués se situaient soit au centre, comme Wijnkoop, Rutgers et Mannoury, soit carrément à droite, comme les membres du BSP, parti socialiste de "gauche", Willis et Hodgson. Etaient présents aussi un Indonésien et Maring-Sneevliet, délégué d'Indonésie ([14] [80]). Sans doute prévenus trop tard, arrivèrent après la fin de la conférence les délégués du KPD de Levi - Zetkin, Frôlich, Posener et Mûnzenberg -, le Suisse Herzog, anti-parlementaire, et le secrétaire du bureau latino-américain, F.K. Puerto ([15] [81]). Le délégué de Finlande et celui d'Espagne arrivèrent eux aussi trop tard...
Cette conférence s'apparentait à un congrès international par sa durée, l'ampleur de ses travaux et l'importante participation de délégués de différents pays de trois continents. Elle était plus représentative que les précédentes conférences d'Imola et de Francfort oui l'avaient annoncée ([16] [82]). Il faut noter que les Hollandais étaient pourtant loin d'être à la hauteur pour le travail clandestin. Toute la conférence se trouvait sous la surveillance de la police néerlandaise et d'espions, qui notèrent tout ce qui se décidait et disait ([17] [83]). Clara Zetkin fut arrêtée à son arrivée à Amsterdam et ne fut libérée que par l'intervention du social-démocrate de droite Wibaut, qui s'était rendu tristement célèbre en 17 dans la répression des ouvriers. Hommage rendu à la peu "extrémiste" direction du KPD?
Qualifiée de "conférence-croupion" par Clara Zetkin, la conférence internationale a représenté le communisme de gauche dans deux questions essentielles: le rejet du syndicalisme et le refus de tout entrisme dans les organisations liées à la 2e Internationale, tel le Labour Party.
Les thèses de Fraina sur le syndicalisme, votées à l'unanimité, vont plus loin que les thèses provisoires mentionnées plus haut. Elles excluent tout travail dans les "syndicats de métier", qui sont "intégrés définitivement dans le capitalisme", et rattachés politiquement au travaillisme, dont la "forme d'expression gouvernementale est le capitalisme d'Etat". Elles préconisent le syndicalisme révolutionnaire d'industrie après la prise du pouvoir, en les assimilant aux conseils d'usine, les thèses sont un rejet implicite de l’apolitisme des IWW. En préconisant l'unionisme industriel, la Gauche communiste du Bureau est bien plus proche, en apparence, du KAPD. Mais en apparence seulement, car plus tard le KAPD comme la minorité du CPN rejetteront la forme syndicale, fût-elle d'industrie et d'orientation révolutionnaire.
Mais dans le Bureau, la confusion demeurait entre parti politique et syndicat révolutionnaire. Malgré l'opposition très forte de Fraina et Pankhurst, la conférence acceptait la représentation des organisations économiques du type shop stewards dans le Bureau. Cette décision était d'ailleurs celle de l'IC jusqu'au 2e congrès...
La décision la plus importante de la conférence concerne la Grande-Bretagne. Dans ce pays existaient un très fort Labour Party, lié à la 2e Internationale, et des partis socialistes de gauche --BSP, ILP ([18] [84]), comparables à l'USPD en Allemagne. Lénine, et avec lui TIC voulaient que les groupes communistes adhérent au Labour Party pour gagner "les masses". Cela était en contradiction avec le mot d'ordre de scission des révolutionnaires d'avec la 2e Internationale, considérée comme morte, et dont les partis encore adhérant étaient considérés non comme l'aile droite du mouvement ouvrier mais comme l'aile gauche de la bourgeoisie, et là où la "gauche" prédominait comme courant "centriste". Au début de 1920, la politique de l'IC change en préconisant la formation de partis de masses: soit par la fusion des groupes communistes avec les courants centristes majoritaires, tels les Indépendants en Allemagne, soit par l'entrisme des petits groupes communistes dans un parti de la 2e Internationale, dans le "cas particulier" de la Grande-Bretagne. Mais une politique des "cas particuliers" aboutit toujours à une politique opportuniste.
La résolution adoptée par la conférence était celle de Fraina. Elle remplaçait celle de Wijnkoop, trop vague, qui éludait les questions de l'unité des communistes et de la scission. Fraina mit en avant la nécessité de se séparer non seulement des sociaux patriotes mais aussi des "opportunistes", c'est-à-dire du courant naviguant entre la 2e et la 3e Internationale. Position identique à celle de Bordiga ([19] [85]). Il est symptomatique que la résolution pour la scission en vue de former le parti communiste et contre la "prétendue possibilité que le nouveau parti communiste anglais puisse être lié au parti travailliste" -selon les termes de Pankhurst - fut rejetée par les délégués du BSP et un délégué hollandais (C. Van Leuven). Telle quel la résolution apparaissait comme une décision valable aussi bien contre le Labour Party que contre l'USPD.
De fait, le Bureau d'Amsterdam devenait le centre de l'opposition de gauche dans la 3e Internationale, avec pouvoir exécutif, puisqu'il exigeait que le Secrétariat de Berlin, aux mains de la droite, se cantonne dans les affaires d'Europe orientales. Le sous bureau américain ([20] [86]) pour lequel le PC d'Amérique de Fraina était mandaté, pouvait devenir un centre de propagande de la gauche sur tout le continent américain. Devant ce danger, et au moment même où le Bureau saluait la formation du KAPD en Allemagne, l'IC décida de le dissoudre -par simple message radio de Moscou- le 4 mai 1920. Désormais le centre de l'opposition se déplaçait vers l'Allemagne, mettant fin à toute velléité d'opposition de la part de la direction de Wijnkoop et de la majorité du CPN.
CH. (à suivre)
[1] [87] Le KAPD était très hostile à l'anarcho-syndicalisme, représenté par la FAUD, née en 1919, qui eut en mars 1920 une position pacifiste lors du putsch de Kapp, alors que la gauche communiste participait aux combats armés dans la Ruhr. Le KPD, de son côté, ne dédaignait pas le syndicalisme révolutionnaire de la FAU de Gelsenkirchen, qui en 1920-21 passa sous son contrôle.
[2] [88] Radek tentera néanmoins de s'opposer de sa prison à la volonté de scission de Levi. Une fois celle-ci consommée, Lénine, mis au courant, se prononça clairement pour l'unité du parti, voyant dans l'Opposition un signe de jeunesse et d'inexpérience.
[3] [89] A. Pannekoek, sous le pseudonyme de K. Horner: "Die Gewerkschaften", in Der Kommunist, 28 janvier 1920 et aussi cf. "Der Weg nach rechts", in Der Kommunist, 24.1.1920.
[4] [90] Cette citation et la suivante sont extraites de l'article de Karl Horner: "Der neue Blanquismus", in Der Kommunist, 1920, n° 27.
[5] [91] . Horncr, in Der Kommunist, n° 22, 1920.
[6] [92] K. Horner: "Taktische und organisatorische Streitfragen", in Der Kommunist, 13 déc. 1919.
[7] [93] Avant son éclatement en 1982, le courant "bordiguiste" envisageait de participer éventuellement aux élections dans certaines "aires géographiques" du "tiers-monde", où la "révolution bourgeoise" serait encore à l’ordre du jour.
[8] [94] C’est ce que déclara Wijnkoop au congrès de Groningue du CPN en juin 1919. Gorter rompit toute relation personnelle avec lui.
[9] [95] Sur les autres questions -parlementarisme, syndicalisme— Wijnkoop resta silencieux. A son retour en Hollande, il se chargea de faire appliquer la ligne de TIC dans le CPN.
[10] [96] Il est difficile de savoir si Rutgers ou Pannekoek, ou les deux ensemble, ont rédigé ces Thèses sur le parlementarisme.
[11] [97] Les Thèses du bureau d'Amsterdam furent publiées comme propositions dans l'organe de TIC en janvier 1920: "Vorschlâge aus Holland", in Die Kommunistische Internationale, n° 4-5. Traduction dans Broue, op. cit., p. 364.
[12] [98] Trotsky, Terrorisme et communisme, éd. Prométhée, 1980, p. 119: "... la dictature des soviets n'a été possible que grâce à la dictature du parti: grâce à la clarté de sa vision théorique, grâce à sa forte organisation révolutionnaire, le parti a assuré aux soviets la possibilité de se transformer d'informes parlements ouvriers qu'ils étaient en un appareil de domination du travail."
[13] [99] Cari Stucke était un des dirigeants de la tendance brêmoise. D'abord antiparlementaire, au moment de la conférence d'Amsterdam, il défendit quelques mois plus tard la participation aux élections en avril 1920.
[14] [100] Sneevliet ne souffla mot pendant la conférence. Il était accompagné du sino-indonésien Tjun Sju Kwa, correspondant du CPN en Indonésie, présenté comme un "camarade chinois" (sic).
[15] [101] il s'agit sans doute du pseudonyme du Russe Borodine, chargé du secrétariat du Bureau latino-américain, et plus tard agent du Kominterm en Chine, où il joua un rôle non négligeable dans la défaite du prolétariat chinois, avec la politique d'adhésion du PC chinois dans le Kuomintang.
[16] [102] La conférence d'Imola du 10 octobre 1919 était une rencontre internationale de quelques délégués d'Europe occidentale avec la direction du PSI, à titre d'information. Sauf Pankhurst, les délégués étaient loin d'être à gauche. La conférence de Francfort de décembre 19 n'avait qu'un caractère informel. Le secrétariat qui en sortit comprenait Radek, Levi, Thalheimer, Bronski, Munzenberg et Fuchs, qui représentaient la tendance de droite de l'IC.
[17] [103] Le courrier de Fraina, Nosovitsky, qui participait à la conférence, était un policier. La police néerlandaise enregistra tous les débats d'une pièce voisine de la salle de conférence; et elle communiqua à la presse bourgeoise le contenu de ceux-ci. Plusieurs délégués furent arrêtés par la police.
[18] [104] BSP: Parti Socialiste Britannique, crée en 1911; il est la principale force constituante du CPGB (PC de Grande-Bretagne) en juillet 1920. ILP: Indépendant Labour Party, crée dans les années 1890 à partir de la société fabienne; non marxiste, il dénonça la guerre en 1914.
[19] [105] En Italie, la tendance "centriste" était représentée par le courant dit "maximaliste" de Serrati.
[20] [106] Le Sous Bureau devint après le 2e congrès de l'IC le Bureau panaméricain du Kominterm. Installé à Mexico, il était composé du japonais Katamaya, de Fraina et d'un nord-américain utilisant différents pseudonymes à consonance espagnole.
Géographique:
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [66]
Revue Internationale no 53 - 2e trimestre 1988
- 2609 lectures
Editorial : luttes ouvrières en Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, émeutes et répression en Palestine
- 2702 lectures
SEUL LE PROLETARIAT PEUT METTRE FIN A LA BARBARIE
Les médias, les journaux télévisés, la presse sont pleins de nouvelles. Depuis un an, petit à petit on apprend tout, et même beaucoup plus, sur le passé nazi du président autrichien K.Naldheim, sur l'insulte de "couille" que Chirac aurait adressée à Thatcher , pour ne citer que deux des innombrables "nouvelles d'importance" qui font couler tant d'encre.
Par contre, il faut être un lecteur assidu, et sacrement fouineur, de plusieurs journaux par jour pour découvrir les rares nouvelles ayant trait aux Misères quotidiennes et aux luttes de millions d'hommes. Parfois dans un entrefilet, on apprend la fin d'une grève... dont personne n'avait parlé à son début. Ou bien à l'occasion d'un article sur le PS portugais, on apprend que le pays est secoué par une vague de mécontentement social (février 88). Et quand la nouvelle d'une lutte ou d'une révolte ouvrière ne peut être censurée à cause de son ampleur, de ses répercussions et de son écho dans la société, alors c'est le mensonge et la désinformation la plus complète. Quand ce ne sont pas les insultes sur les ouvriers en lutte.
LA BOURGEOISIE CONTRE LA PRISE DE CONSCIENCE DES ENJEUX DE LA SITUATION
La bourgeoisie fait le maximum pour occulter la réalité des luttes ouvrières. Aujourd'hui la faillite économique du capitalisme ne peut plus être cachée. La bourgeoisie internationale se prépare à accentuer encore plus dramatiquement ses attaques contre les conditions d'existence de l'humanité entière, et en premier lieu du prolétariat mondial. La censure des médias sur les luttes vise à limiter, si elle ne peut l'empêcher, le développement de la confiance en soi, dans sa force, dans son combat, du prolétariat.
Mais il n'y a pas que les luttes ouvrières que la bourgeoisie essaye de masquer. Alors qu'une véritable armada des principaux pays du bloc occidental se trouve sur le pied de guerre dans le golfe Persique face au bloc russe, avec pour prétexte de mettre au pas l'Iran de Khomeiny, c'est plutôt la discrétion qui règne dans les médias. Sauf campagne de propagande précise. Et pourtant il ne se passe pas de jour sans opérations militaires. Sans parler évidemment de la poursuite de la guerre Iran-Irak. Les grandes puissances se livrent en ce moment à un renforcement considérable de l'armement qu'elles essaient de masquer derrière les campagnes sur le "désarmement" est-ouest (sommet Reagan-Gorbatchev, sommet de l'OTAN). Partout, il s'agit de limiter autant que faire se peut la prise de conscience que le capitalisme c'est la guerre. S'il n'est pas détruit de fond en comble, il n'a rien d'autre à offrir à l'humanité qu'une 3ème guerre mondiale.
LA DECOMPOSITION DU CAPITALISME
L'avenir que nous prépare le capitalisme se manifeste dans toute son horreur au Moyen-Orient: la guerre Iran-Irak; non contents d'avoir déjà envoyé plus d'un million d'hommes à la mort sur le front, les Etats se livrent à la "guerre des villes" : la population civile massacrée à coups de missiles lancés à l'aveuglette, en plein coeur des villes. Pour "faire pression sur l'ennemi". Le Liban, dont on connaît l'horreur devenue endémique. Et maintenant les "territoires occupés" par Israël.
Nous dénonçons ici la répression sauvage que l'Etat bourgeois israélien exerce contre les populations en révolte des territoires occupés. En révolte contre la misère, le chômage massif, les famines, et contre la répression systématique et sauvage qu'elles subissent en permanence. Presque une centaine de morts. Tués par balles. Des blessés par milliers. Blessés par les sévices imposés: tortures, "passages à tabac", bastonnades. Et tout particulièrement des fractures des bras et des phalanges des mains à coup de pierre, de casque, infligés à froid et systématiquement par les soldats. Certains resteront infirmes à vie. Bref la terreur. La terreur capitaliste, banale et courante, telle qu'elle existe quotidiennement dans le monde. Rien qui soit exceptionnel à vrai dire.
Mais il ne suffit pas de dénoncer la répression. Il faut aussi dénoncer, et sans équivoque, toutes les forces qui agissent pour dévoyer cette colère, cette révolte, dans l'impasse du nationalisme. L'OLP certes. Mais aussi et surtout l'ensemble du bloc occidental, USA en tête évidemment, qui pousse l'OLP, qui pousse à son implantation dans les territoires occupés -jusque là relativement faible-, qui pousse, sinon à la constitution d'un Etat palestinien, du moins au contrôle de la population par l'OLP. Et qu'Israël, malgré sa bonne volonté, n'arrive plus à garantir. Il n'y a rien à attendre de l'OLP sinon l'exercice de la même terreur étatique que celle d'Israël. L'OLP a déjà largement fait ses preuves dans la répression et le maintien de l'ordre capitaliste dans les camps palestiniens du Liban.
Disons-le clairement. Que ce soit avec Israël ou avec un Etat palestinien, les populations des territoires occupés et en exil dans les camps palestiniens du Liban ou d'ailleurs vont souffrir encore plus de la misère, de la répression et de la guerre permanente qui existent et se développent en particulier dans cette région du monde. Tout comme pour l'ensemble des populations voisines. La seule façon de limiter les effets de cette barbarie croissante réside dans la capacité de la classe ouvrière de ces pays à entraîner les populations dans le refus de la logique guerrière et de la misère. Et c'est possible: les manifestations de rue au Liban contre les hausses de prix; la réalité du mécontentement ouvrier en Israël déjà exprimé par des grèves et des manifestations.
En troisième lieu, nous voulons aussi dénoncer le choeur des pleureuses, des démocrates de gauche, et autres humanistes, qui recommandent de "tout leur coeur" un traitement humain dans la répression. Une répression qui serait "humaine". Non violente sans doute. Et pourquoi pas rêver de guerre sans morts et sans souffrance. Guerre humaine quoi. Ces gens ne sont pas aussi idiots que cela. En fait, ce sont des hypocrites qui participent de toutes leurs larmes à la campagne médiatique et idéologique du bloc occidental visant à rendre la population otage de la fausse alternative: ou Israël ou l'OLP.
La publicité des médias faite autour des exactions de l'armée israélienne est le fait conscient du bloc US: il utilise la violence de la répression tout comme les massacres des camps palestiniens de Sabra et Chat Ila à Beyrouth en septembre 1982. Massacres accomplis sous les yeux complices des soldats israéliens. Massacres qui avaient servi à justifier aux yeux des populations occidentales l'envoi au Liban des armées US, britannique, française et italienne en 1982.
La situation dans les territoires occupés signifie que l'Etat d'Israël, à son tour, est en train de se "libaniser". C'est toute la région, tout le Moyen-Orient qui se "libanaise". C'est toute la société qui se décompose et pourrit. Cette décomposition est le produit du déclin, de la putréfaction du capitalisme. Il pourrit sur pied. Partout dans le monde.
SEUL LE PROLETARIAT PEUT EN FINIR AVEC LA BARBARIE DU CAPITALISME
Faillite économique, misère croissante et la guerre. Voilà dans toute son horreur ce que le capitalisme nous offre. Et cela alors qu'il existe potentiellement dans le monde un développement des forces productives suffisant amplement à mettre fin à la misère de la planète. C'est la réalité de ces contradictions qui forge la prise de conscience de la classe ouvrière
- du futur que nous prépare la bourgeoisie si on ne lui enlève pas le pouvoir;
- qu'elle seule, classe ouvrière, est en mesure d'enlever le pouvoir à la bourgeoisie parce que c'est elle qui produit tout, que c'est grâce à elle que tout fonctionne. Et qu'une classe dominante qui n'est plus obéie n'est plus une classe dominante.
La prise de conscience révolutionnaire qui passe obligatoirement par l'unification des prolétaires. Unification qui ne peut se faire que dans la lutte commune, sur des intérêts communs, contre un ennemi commun.
LE PROLETARIAT CONTINUE A LUTTER
A l'heure où nous écrivons, et malgré la censure de fait établie par l'ensemble de la presse internationale, le mouvement de lutte en Grande-Bretagne continue: grèves dans l'automobile, mécontentement constant et luttes parmi les infirmières et dans les services publics, dans l'enseignement. Malgré cela, au vu des informations fournies par les camarades de notre section en Grande-Bretagne, nous pouvons dire aujourd'hui que le mouvement semble marquer une pause.
Les premiers jours de février, les infirmières, 15 000 mineurs, 7 000 marins, 32 000 ouvriers de Ford et ceux de General Motors (Vauxhall), de Renault Truck industries (RVI), les enseignants, se mobilisent malgré l'opposition et les sabotages syndicaux ([1] [110]) . D'abord débordés, les syndicats vont vite obtenir une première victoire: en réussissant à retarder le déclenchement de la grève à Ford pour après la grève nationale des infirmières du 3 février. Malgré la simultanéité des luttes, malgré diverses manifestations de solidarité avec les mineurs et les infirmières, malgré l'éclatement d'une grève sauvage dès le 4, aux usines Ford de Londres,, les syndicats vont reprendre le contrôle de la situation en évitant toute tentative d'extension et d'unification à partir de Ford, véritable coeur du mouvement. L'isolement des ouvriers de Ford réussi, leur retour au travail obtenu au prix d'une promesse d'augmentation salariale de 14% sur 2 ans, la possibilité d'une première unification des différentes luttes ne s'est pas réalisée. Aujourd'hui les syndicats, pour le moment maîtres de la situation, préparent toute une série de journées d'action par secteur en vue d'épuiser la forte combativité dans des actions cloisonnées et sans perspective.
LES OUVRIERS BRITANNIQUES NE SONT PAS SEULS
Malgré la propagande bourgeoise selon laquelle les ouvriers sont passifs, résignés et sans combativité, ce mouvement de lutte en Grande-Bretagne vient confirmer l'existence d'une vague internationale de luttes. Ce mouvement succède à celui des ouvriers en Belgique au printemps 86, à la grève dans les chemins de fer français de l'hiver dernier, aux luttes ouvrières du printemps 87 en Espagne, à celles, massives, en Italie au cours de l'année 87 et au mouvement de colère et de lutte en Allemagne à la fin de cette même année. Sans parler des myriades de petits conflits qui ne font pas parler d'eux mais n'en représentent pas moins une immense acquisition d'expérience pour le prolétariat sur ce qu'est le capitalisme. Et ces luttes au coeur de la vieille Europe ne sont pas isolées: luttes en Yougoslavie, en URSS, en Roumanie, en Pologne pour les pays de l'Est; en Corée, à Taiwan, au Japon; en Suède, au Portugal, en Grèce; en Amérique Latine... Tout cela depuis le début 87. Même dans les pays où la bourgeoisie réussissait encore à empêcher l'éclatement de luttes ouvrières malgré le mécontentement, l'accélération brutale de la crise rompt l'équilibre fragile qui existait tant bien que mal.
Ce sont tous les continents qui sont touchés par le développement des luttes ouvrières. Outre la simultanéité dans le temps, ces mouvements manifestent les mêmes grandes caractéristiques: ils sont massifs; ils touchent plusieurs secteurs à la fois parmi les plus concentrés et les plus nombreux, et en particulier la fonction publique; ils posent tous la nécessité de briser le corporatisme et de réaliser l'unification entre les différents secteurs en lutte; ils manifestent une méfiance chaque fois plus grande à l'égard des syndicats en les débordant tout au moins au début; et en tentant de leur disputer le contrôle et l'organisation des luttes.
LES LUTTES ACTUELLES NE SUFFISENT PAS: IL FAUT ALLER PLUS LOIN
La situation actuelle est marquée par une accélération terrible de l'histoire sur tous les plans: économique par la chute dans la crise; guerrier par l'accentuation des antagonismes impérialistes; social par l'existence des luttes ouvrières de défense face aux attaques économiques. Cette accélération sur tous les plans signifie pour le prolétariat l'annonce d'attaques encore plus dramatiques sur ses conditions d'existence. Ces attaques vont nécessiter de sa part un effort important pour pouvoir développer à un niveau plus haut ses luttes. Il devra de plus en plus assumer l'aspect politique de ses luttes économiques:
"Dans les combats à venir de la classe ouvrière, une compréhension claire de leur enjeu véritable, du fait qu'ils ne constituent pas une simple résistance au coup par coup contre les agressions croissantes du capital nais qu'ils sont les préparatifs indispensables en vue de la seule issue pour l’humanité: la révolution communiste, une telle compréhension de l'enjeu sera la condition tant de leur efficacité immédiate que de leur aptitude à servir réellement de préparatifs pour les affrontements à venir.
Par contre, toute lutte qui se cantonne sur le terrain strictement économique, défensif contre l'austérité sera plus facilement défaite, tant au niveau immédiat que comme partie d'une lutte beaucoup plus vaste, fin effet, elle sera privée du ressort de cette arme, aujourd'hui si importante pour les travailleurs qu'est la généralisation et qui s'appuie sur la conscience du caractère social et non pas professionnel du combat de la classe. De même, par manque de perspectives, les défaites immédiates seront surtout un facteur de démoralisation au lieu d'agir comme éléments d'une expérience et d'une prise de conscience." (Revue Internationale n°21, 2è trimestre 1980)
Se limiter à combattre les conséquences économiques de la crise du capitalisme sans lutter contre la cause elle-même, c'est, à terme, rendre inefficaces les luttes même au plan économique. Lutter contre la cause des malheurs qui assaillent l'humanité, c'est non seulement lutter contre le mode de production capitaliste, mais aussi le détruire de fond en comble et en finir avec la misère et les guerres. Et cela seul le prolétariat peut le réaliser. Pour aller plus loin, la classe ouvrière doit tirer les leçons de ses luttes passées. Les travailleurs britanniques viennent de nous montrer qu'ils s'étaient remis de la défaite cuisante subie lors de la grève des mineurs. En particulier en en tirant la principale leçon: les luttes isolées, même si elles sont longues, sont vouées à l'échec.
EN ITALIE: L'OBSTACLE DU SYNDICALISME DE BASE
Déjà durant le "mai rampant" italien en 1969, les ouvriers s'étaient affrontés durement aux syndicats. La forte méfiance à leur égard est sans doute une des principales caractéristiques du prolétariat dans ce pays. En 1984, les ouvriers en lutte contre la remise en cause de l'échelle mobile des salaires avaient refusé d'obéir aux syndicats officiels. Et le mouvement était parti derrière les "conseils d'usines" qui en fait étaient de véritables organes syndicalistes de base. Son apogée, et en même temps son enterrement, fut la participation d'un million d'ouvriers à la manifestation de Rome en avril 84.
L'échec de cette lutte a nécessité trois ans de "digestion", de réflexion, de mûrissement de la conscience ouvrière. Le mouvement de 87 qui démarre dans les écoles au printemps rejette les syndicats officiels. Il s'organise en assemblées et en comités de délégués -les COBAS- pour s'étendre dans tout le pays. Quarante mille personnes manifesteront à Rome au mois de mai à l'appel des seuls COBAS. Mais il ne réussira pas à s'étendre à d'autres secteurs malgré la mobilisation existante. Après les vacances de l'été le mouvement dans l'école s'essouffle, et les autres mobilisations ouvrières -surtout dans les transports- restent isolées et dispersées sans réussir à prendre véritablement le relais de l'école. Et cela en particulier à cause de la mainmise de plus en plus forte du syndicalisme de base sur les COBAS qui se sont développés un peu dans tous les secteurs en lutte.
Quand la mobilisation retombe, quand le mouvement recule, ces comités de délégués deviennent une proie facile pour le syndicalisme. Celui-ci fait dévier l'indispensable recherche de la solidarité et de l'extension entre les différents secteurs en lutte vers de faux problèmes, en vérité des pièges, pour étouffer la combativité ouvrière:
- d'abord dans la question de l'institutionnalisation ou de la légalisation des COBAS en vue d'en faire de nouvelles formes syndicales qui ne veulent pas dire leur nom et ayant la confiance des ouvriers;
- dans le cadre du corporatisme (spécialement dans les chemins de fer parmi les conducteurs);
- dans la centralisation trop précipitée, hâtive des comités dans des assemblées au plan régional et surtout national où les syndicalistes de base gauchistes peuvent utiliser toute leur science de la manoeuvre bureaucratique et... syndicale.
Au nom de l'extension, les syndicalistes de base, qui y sont dans les faits opposés, n'hésitent pas à provoquer un contre-feu qui s'avère bien souvent efficace en provoquant, soit trop tôt, soit artificiellement, la "centralisation" des premières et immatures tentatives de prise en main de leur lutte par les ouvriers, pour mieux les étouffer dans les assemblées de base. Un peu comme les bourgeons se développant trop tôt et détruits par les dernières gelées de l'hiver. C'est le mouvement et la vitalité des luttes, l'existence des assemblées ouvrières, la recherche de l'extension, le processus vers l'unification par la prise en main des luttes par les ouvriers eux-mêmes, qui peuvent mener à la centralisation indispensable et effective des combats ouvriers.
LE GEANT PROLETARIEN ALLEMAND SE REVEILLE ET ANNONCE L'UNIFICATION DES LUTTES
Le mouvement de décembre 87 autour de l'opposition aux 5 000 licenciements à une usine Krupp à Duisburg a été la lutte la plus importante en Allemagne depuis les années 20. Le prolétariat allemand est appelé à jouer un rôle central dans le processus révolutionnaire de par sa concentration, sa puissance, son expérience historique particulièrement riche, ses liens avec le prolétariat de RDA et des pays de l'Est. Les luttes de décembre portent un coup au mythe de la prospérité allemande, de la discipline et de la docilité des ouvriers de ce pays. Nous sommes au début de luttes massives en RFA.
L'importance de cette lutte fut qu'elle provoqua la participation d'ouvriers de différentes villes et de différents secteurs dans un mouvement classiste de solidarité. Non dans la grève, mais dans les manifestations de rue, dans les meetings de masse et dans les délégations de masse. Alors que dans la grève des cheminots français (SNCF), la question centrale était encore l'extension d'un secteur isolé au reste de la classe, en Allemagne la question de l'unification autour des ouvriers de Krupp fut posée dès le début.
Nais surtout l'importance de cette lutte réside en ce qu'elle annonce. Malgré son manque d'expérience, d'affrontements aux syndicats et à leurs manoeuvres, aux partis de gauche et au gauchisme du syndicalisme de base, dès son entrée sur la scène sociale, le prolétariat allemand indique clairement la caractéristique principale et la perspective des mouvements à venir: ce sont les secteurs centraux, le coeur du prolétariat européen, qui vont être touchés par les attaques. Les principales concentrations ouvrières: la Ruhr, le Benelux, les régions de Londres et de Paris, et le nord de l'Italie. Ce sont ces fractions centrales qui vont entrer en lutte et ouvrir, "offrir" à l'ensemble de la classe ouvrière, la perspective concrète de l'unification des combats ouvriers dans chaque pays. Et la perspective de la généralisation internationale de la lutte ouvrière.
Les mouvements en Italie et en Allemagne synthétisent et cristallisent les principales nécessités de TOUTES les luttes actuelles dans le monde au-delà des particularités politiques locales et nationales:
- ne pas rester isolés dans le corporatisme;
- étendre les luttes;
- les organiser en assemblées générales en ne laissant pas le syndicalisme -officiel ou "masqué", "radical", de base- les étouffer par ses sabotages et ses manoeuvres;
- assumer le caractère général et politique des luttes: toute la classe ouvrière est attaquée, unifier les luttes en une seule lutte contre les différents Etats.
IL FAUT SE PREPARER AUX COMBATS A VENIR
Les luttes qui vont se produire ne sont pas gagnées d'avance. Automatiquement. Il faut que la classe ouvrière les prépare et s'y prépare. C'est ce qu'elle a fait et continue de faire par ses luttes mêmes. Par sa propre pratique. En développant son expérience. En en tirant les leçons. En prenant confiance dans sa propre force. C'est l'ensemble de la classe ouvrière qui renforce sa prise de conscience de manière massive et collective. Dans les luttes ou bien en dehors de celles-ci de manière "invisible", souterraine telle la taupe comme disait K. Marx.
Dans cette tâche, un rôle particulier est dévolu aux minorités d'ouvriers -organisées ou non- les plus combatives et les plus conscientes. Celles-ci doivent se préparer aux combats à venir si elles veulent remplir le rôle pour lequel le prolétariat les a produites. Parmi celles-ci, les groupes révolutionnaires sont irremplaçables et se doivent d'être à la hauteur de la situation. Etre à la hauteur de la situation signifie en premier lieu reconnaître celle-ci. Reconnaître la vague internationale de luttes actuelles et sa signification. Cette reconnaissance doit servir aux groupes communistes pour assurer une présence, une intervention politique sur le terrain, dans les luttes. Une intervention qui soit juste et efficace immédiatement et à plus long terme. Pour cela, il faut que les révolutionnaires ne tombent pas dans les pièges tendus par le syndicalisme de base. Et surtout n'en restent pas prisonniers. Prisonniers en particulier, comme nous l'avons vu ces dernières années:
- de la "fétichisation" de 1'auto-organisation au travers des coordinations et autres "assemblées nationales" centralisatrices mises en place par les syndicalistes gauchistes;
- du corporatisme et du localisme même au travers du radicalisme violent et du jusqu'au-boutisme véhiculés par les PC et les gauchistes.
Enfin, les révolutionnaires doivent pousser et participer aux regroupements ouvriers. En particulier, favoriser toutes les formations de comités de lutte. Car les ouvriers les plus combatifs ne doivent pas attendre l'éclatement de mouvements pour tisser des contacts entre eux, pour discuter, réfléchir ensemble, se préparer aux luttes afin d'en faire la propagande, l'agitation. Et par la suite, malgré les magouilles, les obstacles, voire l'opposition violente des syndicalistes, intervenir et prendre la parole dans les grèves, les assemblées, les manifestations de rue pour défendre les besoins des luttes et entraîner l'ensemble des ouvriers.
Il en va de la défense immédiate des conditions d'existence de la classe ouvrière. Il en va de l'avenir de l'humanité gravement menacée par l'absurdité aveugle et suicidaire du capitalisme. Seul le prolétariat international peut aujourd'hui limiter le développement de la misère. Et surtout, seul le prolétariat peut en finir à jamais avec la barbarie capitaliste.
R.L. 7/3/88.
[1] [111] Pour le suivi plus précis de ce mouvement, nous renvoyons nos lecteurs à nos différentes publications territoriales.
Géographique:
- Europe [112]
- Moyen Orient [113]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [4]
20 ANS depuis MAI 1968 : le mûrissement des conditions de la révolution prolétarienne
- 5094 lectures
Les commentateurs "officiels" de l'histoire et les nostalgiques déçus des années de gloire du "mouvement étudiant" fêtent l'anniversaire des 20 ans de Mai 1968 en étant d'accord sur un point: les "rêves révolutionnaires de 68" n'étaient que des rêves. La réalité des 20 années qui nous séparent de l'explosion sociale de Mai 68 n'aurait fait que confirmer le caractère utopique de l'idée de la révolution communiste. Les conditions d'une telle révolution loin d'avoir mûri, se seraient au contraire éloignées. Il suffit pourtant de ne pas chausser les lunettes opaques de 1'idéologie de la classe dominante pour percevoir que la dynamique profonde qui traverse ces deux décennies traduit un mûrissement, sans précédent dans l'histoire, des conditions d'une révolution communiste mondiale.
Il est impossible de traiter ici en détail ces 20 années de lutte de classe particulièrement riches en enseignements. Mous nous attacherons uniquement à répondre à deux questions : quelle fut la signification de Mai 68? Les conditions d'une révolution communiste mondiale se sont-elles développées depuis lors?
LA RUPTURE DE MAI 1968
Mène s'ils se sont déroulés en France, les événements du printemps 68 étaient par leurs racines comme par leurs conséquences d'une dimension internationale. C'est dans le monde entier que les relations entre les classes commençaient à connaître un changement profond. Ces événements ne faisaient que concrétiser de façon éclatante un processus qui se déroulait à l'échelle de la planète et c'est comme tel qu'ils doivent être envisagés.
La grève de nasses de 1968 en France, comme la quasi-totalité des grèves ouvrières importantes de ce siècle, fut au départ totalement spontanée: ce ne sont pas les syndicats qui ont déclenché le mouvement, au contraire. Ceux-ci tentèrent au début, en vain, d'arrêter par tous les moyens la mobilisation naissante.
Sur le plan immédiat, cette mobilisation trouva au départ un amplificateur gigantesque, dans la volonté de répondre la brutale répression à laquelle se livrait l'Etat contre des manifestations d'étudiants. Contre cette répression, le 13 mai, Paris connaissait une des plus grandes manifestions de son histoire. Puis, en quelques jours par centaines de milliers, dans toutes les villes de France, tous les secteurs de la classe ouvrière sont entrés en lutte. Tout aussi rapidement le mouvement de grève se faisait l'expression du profond mécontentement qui mûrissait dans l'ensemble de la classe travailleuse. 10 millions de travailleurs paralysaient l'essentiel de l'appareil productif du capital français.
L'arrogance coutumière de la classe dominante laissait la place à la surprise et au désarroi devant le déploiement de force de ce prolétariat qu'elle croyait définitivement soumis et vaincu. Après avoir subi la défaite sanglante des insurrections ouvrières qui ont marqué la fin de la 1ère guerre mondiale, après avoir subi le triomphe de la contre-révolution stalinienne en Russie, après avoir subi dans les années 30 les effets d'une dépression économique sans avoir les moyens de répondre, après avoir subi une deuxième guerre mondiale dont les horreurs et la barbarie étaient à peine prévisibles, après avoir subi 20 ans de reconstruction économique avec la robotisation et l'atomisation la plus effroyable de la vie sociale, après avoir vécu près de 40 ans sous le contrôle quasi militaire des partis politiques staliniens, fascistes ou démocratiques , après avoir entendu pendant des années qu'elle s'embourgeoisait, bref après des décennies d'écrasement, de soumission et de désorientation, en mai 1968 la classe ouvrière revenait par la grande porte sur la scène de l'histoire. Si l'agitation estudiantine qui se développait en France, depuis le début du printemps avait déjà bouleversé l'ambiance sociale du pays: affrontements répétés avec les forces de l'Etat sur des barricades où il n'y avait pas que des étudiants; s'il y avait déjà eu des premières grèves qui pouvaient annoncer un prochain orage (Sud-Aviation, Renault-Cléon), l'entrée massive en lutte de la classe ouvrière bouleversa tout. La classe exploitée relevait la tête et cela entraînait une secousse dans l'ordre social jusque dans ses fondements les plus profonds. Des "comités d'action", d'usine ou de quartier, des "comités de lutte", des "groupes ouvriers" se formaient partout rassemblant les éléments les plus combatifs qui cherchaient à comprendre et à se regrouper pour agir indépendamment des structures syndicales. Les véritables idées communistes y retrouvaient un droit de citer.
Cependant la classe ouvrière, qui fut certainement la première surprise par l'ampleur de sa propre force, n'en était pas, dans son ensemble, à se poser la question de jouer le tout pour le tout dans une tentative révolutionnaire. Loin de là. Elle en était à ses premiers nouveaux pas, sans expérience et encore pleine d'illusions.
La bourgeoisie, passé l'effet de surprise ne resta pas les bras croisés. Déployant une coopération sans faille entre tous ses secteurs politiques, de la droite à l'extrême gauche et des forces de répression policière aux structures syndicales, elle parvint à reprendre le contrôle de la situation. Il y eut les concessions économiques accordées à grand renfort d'appels à la reprise du travail après la "victoire des accords de Grenelle". Il y eut l'annonce d'élections dans le but a peine voilé de dévoyer les luttes du terrain de la rue vers celui des urnes. Mais il y eut surtout l'habituelle combinaison de la répression policière et du sabotage des luttes de l'intérieur par les syndicats et les forces de la gauche du capital. Dés le départ les syndicats orientèrent les travailleurs vers l'occupation des usines, nais une occupation qui devait s'avérer rapidement un moyen d'emprisonner les travailleurs et de les isoler les uns des autres, sous prétexte de "protéger l'outil de travail contre les étudiants provocateurs". Tout au long du mouvement, les syndicats se sont appliqués à entretenir cet éparpillaient et enfermement des forces. Les heurts directs sont fréquents entre ouvriers et responsables syndicaux, pourtant prêts à tout faire pour ne pas perdre toute crédibilité. Après la signature des dits "accords de Grenelle", le responsable du principal syndicat, Georges Séguy (secrétaire général de la CGT et membre du bureau politique du PCF), venu à Renault-Billancourt pour faire voter leur acceptation et la reprise du travail, se voit désavoué par l'assemblée générale. Il faudra toute la capacité manoeuvrière des syndicats pour parvenir enfin à faire reprendre le travail. Deux exemples concrets résument bien ce que fut le travail final de "rétablissement de l'ordre": le premier, les syndicats appelant à la reprise du travail dans les différents dépôts des chemins de fer et des transports de la capitale en affirmant mensongèrement que d'autres dépôts l'avaient déjà fait; le second, à Sochaux, dans la plus grande usine d'automobiles de France, relativement isolée à l'est du pays, au moment des très violents affrontements provoqués par les charges de police pour faire évacuer l'usine -DEUX OUVRIERS SONT TUES PAR LA POLICE- la CGT sabote matériellement l'organisation de la résistance dans l'usine, toujours pour "ne pas céder à la provocation".
Beaucoup d'ouvriers rentrèrent la rage au ventre. Beaucoup de cartes Syndicales furent déchirées. La presse "bien pensante" parlait élogieuse du sens des responsabi1ités des syndicats. La bourgeoisie parvint à rétablir l'ordre, son ordre.
Mais les événements de 1968 avaient bouleversé irréversiblement la situation historique. 10 millions d'ouvriers, au coeur de la zone la plus industrialisée du monde, avaient fermé avec fracas une porte de l'histoire: celle de près de 40 ans d'écrasement idéologique du prolétariat, de 40 ans de contre-révolution triomphante. Une nouvelle période historique commençait.
Mai 68 pose la question de la perspective révolutionnaire
Aujourd'hui la bourgeoisie ne parle plus de 68 avec la haine qu'elle inculquait à ses forces de police au moment des barricades ou de Sochaux. A travers ses médias elle prend même parfois un ton d'attendrissement pour parler des UTOPIES des jeunes de ce temps là. Mai 68 c'était un beau rêve, mais irréalisable. Car, sous-entendu, le capitalisme est éternel.
Il est vrai qu'en Mai 68 la question de la révolution devint à nouveau pour des millions de personnes un objet de débats et de réflexion. Il est vrai que pour une partie des étudiants "la révolution" était à l'ordre du jour, immédiatement. On voulait TOUT, TOUT DE SUITE! Et il est vrai aussi que c'était là une utopie.
Mais l'utopie n'était pas dans l'idée générale de la nécessité et la possibilité de la révolution -comme le dit la bourgeoisie- mais dans l'illusion de croire que celle-ci était, il y a 20 ans, immédiatement réalisable.
Tout d'abord une remarque. Pour la partie des étudiants qui se réclamait de "la révolution" (une petite minorité, contrairement à ce que certaines légendes laissent penser) le mot de révolution ne voulait souvent pas dire grand chose. Avant 1968 en France, comme dans la plupart des pays, il y avait déjà une agitation estudiantine. Beaucoup de jeunes étudiants s'intéressaient aux luttes de libération nationale des pays moins développés (car pensaient-ils, il n'y avait rien à attendre du prolétariat trop embourgeoisé des pays industrialisés); Che Guevara était la nouvelle idole; ils croyaient souvent au "socialisme" ou à "la nature ouvrière" des régimes des pays de l'Est... avec des préférences suivant les courants pour la Chine, Cuba, l'Albanie...; et quand l'idée de révolution n'était pas identifiée avec celle d'un capitalisme d'Etat à la stalinienne elle se perdait dans un flou artistique qui allait des élucubrations autogestionnaires aux utopies dépassées des socialistes pré-marxistes; les stupidités d'un Marcuse sur la disparition de la classe ouvrière et sur la nature révolutionnaire de couches comme les étudiants trouvaient un franc succès. Il n'en demeure pas moins que, indépendamment des confusions universitaires, la réalité posait la question de la perspective révolutionnaire. Le retour de la force du prolétariat sur la scène sociale, le fait que celui-ci démontrait dans la pratique sa capacité à se saisir de l'ensemble de l'appareil productif social, le fait que la chape de plomb du pouvoir des classes dominantes perdait soudain son apparence éternelle, immuable, inévitable, tout cela faisait que -même si ce n'était pas en termes de réalisation immédiate- la question de la révolution revenait hanter les esprits.
"A mieux considérer les choses, on verra toujours que la tache surgit là où les conditions matérielles de sa réalisation sont déjà formées, où sont en train de se créer".
Marx, Avant-propos à la Critique de l'économie politique.
Un nouveau développement des conditions de la révolution était "en train de se créer" en 1968. Ce même prolétariat qui avait été capable de se lancer à plusieurs reprises dans l'histoire à l'assaut révolutionnaire contre la société d'exploitation, était de retour et il se préparait encore une fois à recommencer. Mais on n'était qu'au début d'un processus.
* Quelles sont les conditions d'une situation révolutionnaire?
Lénine définissait les conditions d'une telle situation en disant en substance qu'il fallait "que ceux d'en haut ne puissent plus gouverner comme auparavant" et que "ceux d'en bas ne veuillent plus vivre comme auparavant". En effet, une révolution sociale implique un bouleversement de fond en comble des rapports sociaux existants pour tenter d'en établir de nouveaux. Cela exige la volonté révolutionnaire des lasses lais aussi un affaiblissement "objectif des conditions de pouvoir de la classe dominante. Or le pouvoir de cette classe ne repose pas uniquement sur les armes et la répression. (Contrairement à ce que prétend l'anarchisme). Ce pouvoir trouve ses fondements, en dernière instance, dans la capacité de la classe dominante à assurer le fonctionnement d'un mode de production permettant la subsistance matérielle de la société. Aussi n'y a-t-il pas de véritable affaiblissement de l'ordre établi sans crise économique, que cette crise prenne la forme "pure" ou celle "déguisée" d'une guerre. Cette crise économique est aussi une condition nécessaire, même si non suffisante, pour le développement de la volonté révolutionnaire de la classe ouvrière. C'est cette crise qui par l'aggravation des conditions d'existence qu'elle entraîne, pousse la classe exploitée à réagir et à s'unifier au niveau mondial.
A ces conditions "objectives", c'est-à-dire indépendantes de l'action de la classe révolutionnaire, doivent s'ajouter évidemment celles qui mesurent l'extension et la profondeur de la conscience et la volonté révolutionnaires dans cette classe: dégagement de l'emprise de l'idéologie dominante, assimilation de sa propre expérience historique, confiance en soi, réappropriation de son programme historique.
En 1968 ces conditions commençaient à se former, mais, ce développement était encore loin d'être parvenu à son terme.
Sur le plan économique, le capitalisme sortait à peine de la période de relative prospérité de la reconstruction. La récession de 67, si elle traduisait la fin de quelque chose et l'ouverture d'une nouvelle période de crise économique, restait encore fort modérée. La marge de manoeuvre de la bourgeoisie commençait de nouveau à se rétrécir de façon accélérée, mais elle avait encore les moyens de faire face aux secousses de la machine économique, même si c'était au prix de manipulations économiques des Etats qui ne faisaient que préparer de nouvelles et plus grandes difficultés pour l'avenir. Pour la classe ouvrière mondiale cette situation se traduisait encore par des illusions quant à la possibilité d'une nouvelle prospérité. Le caractère mondial de la crise économique, qui aujourd'hui semble si évident, ne l'était pas à l'époque. On croyait encore souvent que les difficultés économiques étaient d'ordre national et qu'une meilleure gestion des affaires publiques suffirait à rétablir la situation. Dans les pays les moins développés c'était les illusions sur les dites" luttes de libération nationale".
Le chômage recommençait à se développer, d'où une certaine inquiétude, mais son niveau restait encore proche de celui du "plein-emploi" (un terme employé à l'époque et tombé depuis quasiment en désuétude). De façon générale, le niveau de vie s'il se dégradait déjà, était encore loin de connaître les chutes violentes qu'il connaîtrait dans les deux décennies suivantes. (Voir l'article consacré à 20 ans de crise économique).
Cette immaturité générale se concrétisait aussi au niveau de l'autonomie du prolétariat à l'égard des forces syndicales du capital. Mai 68, comme toutes les luttes de notre époque, s'est caractérisé par l'intensification de l'opposition ouverte entre ouvriers et organisations syndicales. En Mai 68 comme en 69 en Italie, la lutte ouvrière devait se heurter souvent violemment à celles-ci. Mais ici encore ce n'était que le début d'un processus. Malgré la méfiance croissante, les illusions sur la nature des syndicats qu'on considérait "malgré tout ouvrière", restait importante.
Mais ce qui manquait le plus à la génération de prolétaires de 1968 c'était l'expérience des combats. Pour gigantesque qu'ait été le déploiement de forces de Mai 68, la classe ouvrière dans son ensemble était loin de comprendre ce qu'elle était en train de faire et encore moins de le maîtriser. De façon générale son expérience immédiate se résumait encore trop souvent aux ballades syndicales, aux enterrements des Premier Mai, aux grèves longues et isolées.
Mai 68 était très loin de constituer une véritable situation révolutionnaire. L'ensemble de la classe ouvrière le savait ou le sentait. Et toute l'impatience de la petite-bourgeoisie intellectuelle en révolte qui voulait "Tout, tout de suite" n'y pouvait rien. ([1] [114])
CE QUE LE PROLETARIAT A APPRIS EN 20 ANS
20 années de décomposition capitaliste
Cependant, les conditions d'une situation révolutionnaire au niveau mondial n'ont cessé de se développer et de s'approfondir pendant les dernières 20 années. Ceux qui le nient aujourd'hui sont souvent les mêmes qui croyaient la révolution immédiatement réalisable en 1968. Et ce n'est pas par hasard, car dans les deux cas le lien entre crise économique et lutte de classe est ignoré ou nié. L'évolution objective de la société capitaliste au cours de ces 20 dernières années peut se résumer en un bilan aussi catastrophique que menaçant. La misère la plus effroyable que l'humanité ait jamais connue s'est étendue comme tâche d'huile dans les zones les moins développées de la planète nais aussi de plus en plus dans les pays centraux; la destruction de tout avenir pour un nombre toujours croissant de chômeurs et une intensification impitoyable des conditions d'exploitation pour ceux qui travaillent encore; développement permanent de l'économie de guerre et exacerbation des rivalités commerciales et militaires entre nations: l'évolution de la vie économique et politique du capitalisme au cours des 20 dernières années a mis en évidence, encore une fois que la seule "issue" à la quelle conduit ce système social décadent est celle d'une nouvelle guerre mondiale.. De la guerre du Viêt-nam à la guerre Irak-Iran, en passant par la destruction du Liban et la guerre d'Afghanistan, le capitalisme menace toujours plus de transformer la planète en un bain de sang. (Voir dans ce numéro et le précédent l'article consacré à l'évolution des conflits impérialistes). L'évolution du capitalisme ruine elle même les bases sur lesquelles repose le pouvoir de la classe dominante.
Ces années ont détruit beaucoup d'illusions dans la conscience des ouvriers et développé quelques convictions importantes:
- caractère irréversible et mondial de la crise économique capitaliste;
- impossibilité de toute issue "nationale" et l'impasse que constituent "les guerres de libération nationale".
- impossibilité de réformer un système social qui est de plus en décomposé dans ses fondements mêmes.
- nature capitaliste des pays dits "communistes".
Mais ce n'est pas tant le développement de la NECESSITE de la révolution et de la conscience qu'en acquiert le prolétariat qu'il est difficile de percevoir. C'est plutôt le développement de la POSSIBILITE de celle-ci, à travers l'accumulation d'expériences au cours de 20 années de combats ouvriers, qui n'apparaît pas toujours au regard superficiel.
20 années de luttes
La lutte de classe pendant ces années ne s'est pas développée de manière linéaire. Son développement s'est fait au contraire de façon heurtée, complexe, connaissant des avancées et des reculs, à travers des vagues successives entrecoupées de périodes d'accalmie et de contre-offensive de la bourgeoisie. Si l'on regarde globalement ces 20 années de luttes sur le plan mondial -le seul plan qui soit valable pour comprendre la dynamique de la lutte prolétarienne- on peut distinguer trois vagues majeures de montée des luttes ouvrières. La première vague ouverte par mai 68 s'étend jusqu'en 1974. Pendant près de 5 ans dans la quasi-totalité des pays, industrialisés ou moins développés, de l'Est ou de l'Ouest, les luttes ouvrières connaissent un nouveau développement. Dès 1969 en Italie ("l'Automne chaud") une puissante vague de grèves, au cours de laquelle les heurts entre ouvriers et syndicats se sont multipliés, confirmait que 1968 avait bien été l'ouverture d'une nouvelle dynamique internationale de la lutte ouvrière; la même année en Argentine (Cordoba, Rosario), la classe ouvrière se lançait dans des combats massifs. En 1970 en Pologne la lutte ouvrière atteint de nouveaux sommets: affrontements généralisés dans la rue avec la milice; la classe ouvrière contraint le gouvernement à reculer. Pour les ouvriers des pays de l'Est c'est la confirmation qu'on peut se battre contre le totalitarisme étatique ; pour les ouvriers du monde entier, le mythe de la nature ouvrière des pays de l’Est subit un nouveau choc. Puis, dans un contexte international de combativité, des luttes particulièrement significatives se développent en Espagne (Barcelone en 1971), en Belgique et Grande-Bretagne (1972). Cependant dès 1973 la mobilisation ouvrière va se ralentir sur le plan international. Malgré les luttes importantes que développe la classe ouvrière au Portugal et en Espagne à l'occasion de la démocratisation des régimes politiques (1974-1977), malgré une nouvelle vague de grèves en Pologne en 1976, au niveau global -en particulier en Europe occidentale- la mobilisation ouvrière se réduit fortement.
Mais en 1978, une nouvelle vague de luttes ouvrières explose au niveau international. Plus courte dans le temps que la précédente, on y voit de 1978 à 1980, un nouveau déploiement des forces prolétariennes qui frappe par sa simultanéité internationale. Les grèves massives du secteur pétrolier en Iran en 1978, celles des métallurgistes allemands et brésiliens de 1978 à 1980; la lutte des mineurs aux USA en 1979 puis des transports de New-York en 1980; les violentes luttes des sidérurgistes français en 79 ou celles des dockers de Rotterdam la mène année; "l'hiver de mécontentement", 1979-80 en Grande-Bretagne qui aboutit à la grande grève des sidérurgistes et à la chute du gouvernement travailliste; les grèves de Togliattigrad en URSS en 1980 comme celles de Corée du Sud au même moment... Tous ces combats confirment que l'accalmie sociale du milieu des années 70 n'avait été que provisoire. Puis, en août 1980, en Pologne éclatait la plus importante lutte ouvrière depuis les années 20. Tirant les leçons des expériences de 1970 et 76, la classe ouvrière déploie un degré de combativité, d'organisation et de maîtrise de sa force, extraordinaires. Hais sa dynamique va échouer sur deux écueils meurtriers: les illusions des travailleurs des pays de l'Est sur la "démocratie occidentale" en particulier sur le syndicalisme; et deuxièmement le cadre national. Solidarnosc, le nouveau syndicat "démocratique", formé sous l'oeil attentif des forces "démocratiques" des pays occidentaux, imbibé et propagateur zélé de la plus insidieuse idéologie nationaliste, sut distiller et cultiver systématiquement ce poison. Dans les faits, l'échec de la grève de masse en Pologne qui aboutit au coup de force de Jaruzelski en décembre 1981, a posé ouvertement la question de la responsabilité du prolétariat des pays les plus centraux et disposant de la plus grande expérience historique: non seulement au niveau de l'internationalisation de la lutte ouvrière, mais aussi au niveau de sa contribution pour le dépassement des illusions sur les "démocraties occidentales" qui pèsent encore sur le prolétariat des pays de l'est.
Après la période de reflux qui au niveau international accompagne la lutte ouvrière à la fin du mouvement en Pologne, une troisième vague de combats commence à la fin 1983 avec la grève du secteur public en Belgique. En Allemagne occidentale, à Hambourg c'est l'occupation des chantiers navals. En 1984 l'Italie connaît une puissante vague de grèves contre l'élimination de l'échelle mobile qui aboutit à une manifestation de près d'un million de travailleurs à Rome. En Grande-Bretagne c'est la grande grève des mineurs qui dura un an et qui, malgré le caractère exemplaire de son courage et de sa combativité, mit en évidence, plus que tout autre, l'inefficacité à notre époque des grèves longues et isolées. Cette même année des luttes importantes se déroulent en Inde, aux USA, en Tunisie et au Maroc. En 1985 c'est la grève massive au Danemark; plusieurs vagues de grèves sauvages secouent cet autre "paradis socialiste" qu'est la Suède; les premières grandes grèves au Japon (chemins de fer), les grèves de la banlieue de Sao Paolo au Brésil en pleine transition "démocratique"; l'Argentine, la Bolivie, l'Afrique du Sud, la Grèce, la Yougoslavie connaissent aussi des luttes importantes. L'année 1986 est marquée par la grève massive du printemps en Belgique qui paralyse le pays en s'étendant par elle-même malgré les syndicats. Fin 1986, début 87 les travailleurs des chemins de fer en France développent une lutte caractérisée par les tentatives des ouvriers de s'organiser indépendamment des syndicats. Au printemps 87, 1’Espagne connaît une série de grèves qui s'opposent directement aux plans du gouvernement socialiste. Puis ce sont les luttes des mineurs d'Afrique du Sud, celles des travailleurs de l'électricité au Mexique et une grande vague de grèves en Corée du Sud. L'année restera marquée par les luttes des travailleurs de l'école en Italie qui parviennent à organiser leur combat en dehors et contre les syndicats. Enfin, la récente mobilisation des travailleurs de la Ruhr en Allemagne et la reprise des grèves en Grande-Bretagne en 1988 (voir l'éditorial de ce numéro) confirment que cette troisième vague internationale de luttes ouvrières, qui dure depuis maintenant plus de 4 ans est loin d'être terminée et ouvre des perspectives d'autant plus importantes que le capital mondial connaît une nouvelle aggravation de sa crise économique.
Ce que le prolétariat a appris de ses luttes
La simple comparaison des caractéristiques des luttes d'il y a 20 ans avec celles d'aujourd'hui permet de percevoir rapidement l'ampleur de l'évolution qui s'est lentement réalisée dans la classe ouvrière. Sa propre expérience, ajoutée à l'évolution catastrophique du système capitaliste, lui a permis d'acquérir une vision beaucoup plus lucide de la réalité de son combat. Cela s'est traduit par ;
- une perte des illusions sur les forces politiques de la gauche du capital et en premier lieu sur les syndicats à l'égard desquels les illusions ont laissé la place à la méfiance et de plus en plus à l'hostilité ouverte;
- l'abandon de plus en plus marqué de formes de mobilisation inefficaces, impasses dans lesquelles les syndicats ont tant de fois fourvoyé la combativité ouvrière:
- journées d'action, manifestations-ballades-enterrements,
- les grèves longues et isolées...
Mais l'expérience de ces 20 années de lutte n'a pas dégagé pour la classe ouvrière que des enseignements "en négatif" (ce qu'il ne faut pas faire). Elle s'est aussi traduite par des enseignements sur comment faire:
- la recherche de l'extension de la lutte (Belgique 1986 en particulier),
- la recherche de la prise en main des combats, en s'organisant par assemblées et comités de grève élus et révocables; (France fin 86, Italie 1987 principalement).
De façon générale, les ouvriers ont moins recours à la forme de lutte de la grève: quand le combat s'engage il tend à être massif et "la rue", l'action politique, prend de plus en plus d'importance. C'est la réponse à des attaques qui sont de plus en plus massives et font éclater de plus en plus crûment l'incompatibilité totale entre les intérêts ouvriers et ceux de l'ordre social existant.
Au cours de ces 20 années, lentement, de façon toujours heurtée, le prolétariat mondial a développé sa conscience en perdant ces illusions et gagnant en expérience et détermination.
Ce que la bourgeoisie a appris
La bourgeoisie mondiale a aussi beaucoup appris de ces années. Le problème du maintien de l'ordre social est devenu une priorité. Elle a développé tous les moyens de répression: tous les gouvernements du monde ont, dans les 20 dernières années, créé ou renforcé leurs polices "anti-émeutes", inventé de nouvelles armes pour "guerres civiles", développé leurs polices politiques... Nombre d'entre eux ont utilisé le désespoir de petits bourgeois déçus et se suicidant dans le terrorisme pour renforcer un climat de répression. Dans les usines, le chantage au chômage est systématiquement utilisé comme moyen de répression.
Mais ce qu'a le plus appris la bourgeoisie c'est à utiliser les forces politiques et syndicales qui travaillent au sein de la classe ouvrière : syndicats, partis "de gauche", organisations "gauchistes". Elle a ainsi "démocratisé" les régimes de nombreux pays, (Portugal, Espagne, Amérique Latine, Philippines, Corée du Sud...) non pas pour alléger le poids de sa dictature mais pour créer des organes syndicaux et politiques capables de compléter le travail que l'armée et la police ne pouvaient plus faire seules. Dans les pays à plus vieille tradition "démocratique", face à l'usure des syndicats officiels et des partis de gauche, elle a recours au "syndicalisme de base" ou à ses forces "extra-parlementaires" pour ramener les luttes sur le terrain syndical et "démocratique".
Nous sommes loin de 1'"effet de surprise" créé par les luttes ouvrières de la fin des années 60. Mais ce "réarmement" de la bourgeoisie ne traduit en fait que la nécessité de recourir à des moyens de plus en plus extrêmes pour faire face à une situation qui devient de plus en plus difficile à contrôler. Derrière ce "renforcement" se dessine l'effondrement des hases réelles de son pouvoir.
VERS DES AFFRONTEMENTS DIFFICILES ET DECISIFS
Pour l'impatiente petite bourgeoisie des années 60 tout cela est trop long, trop difficile et ne peut conduire à rien. Tout lui semble un recul par rapport aux années 60.
Pour les marxistes l'évolution de ces années n'a fait que confirmer la vision, que Marx formulait déjà au XIXe siècle, de ce qu'est la lutte de la seule classe de l'histoire qui soit à la fois EXPLOITEE ET REVOLUTIONNAIRE.
Contrairement au combat révolutionnaire de la bourgeoisie contre la féodalité, où chaque victoire se traduisait par un développement de son pouvoir politique réel sur la société aux dépens de celui de la noblesse, le combat révolutionnaire du prolétariat ne connait pas d'acquis progressifs et cumulatifs au niveau du pouvoir. Tant que le prolétariat n'est pas parvenu à la victoire politique finale, la Révolution, il reste classe exploitée, dépossédée, réprimée. C'est pourquoi ses luttes apparaissent comme un éternel recommencement.
"Les révolutions prolétariennes, par contre, comme celles du XIXe siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà accompli pour le recommencer à nouveau, raillent impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de leurs premières tentatives, paraissent n'abattre leur adversaire que pour mieux lui permettre de puiser de nouvelles forces dans la terre et se redresser à nouveau formidable en face d'elles, reculent constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts, jusqu'à ce que soit crée la situation gui rende impossible tout retour en arrière et que les circonstances elles-mêmes crient: 'Hic Rhodus, hic salta"'.([2] [115]) Marx, Le 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte.
On parle peut être moins facilement de révolution en 1988 qu'en 1968. Mais lorsqu' aujourd'hui le mot est crie dans une manifestation qui dénonce la nature bourgeoise des syndicats à Rome ou dans une manifestation de chômeurs à Bilbao il a un sens autrement plus concret et profond que dans les assemblées enfiévrées et pleines de fausses illusions de 1968.
1968 avait affirmé le retour de l'objectif révolutionnaire. Pendant 20 années les conditions de sa réalisation n'ont cessé de mûrir. L'enfoncement du capitalisme dans sa propre impasse, la situation de plus en plus insupportable que cela crée pour l'ensemble des classes exploitées, l'expérience cumulée par la combativité ouvrière, tout cela conduit à cette situation dont parlait Marx, gui rend "tout retour en arrière impossible".
RV.
[1] [116] Pour une histoire et analyse révolutionnaires des événements de Mai 68 voir Pierre Hempel, "Mai 68 et la question de la révolution".
[2] [117] Référence à une légende grecque: un vantard qui parcourait les villes de la Méditerranée en affirmant qu'il était capable de sauter par-dessus la statue du colosse de Rhodes, se trouva un jour dans cette ville. Il lui fut alors crié: "Voici Rhodes, c'est ici que tu dois sauter!".
Géographique:
- France [118]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [119]
Approfondir:
- Mai 1968 [120]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La lutte Proletarienne [121]
Vingt ans depuis mai 1968 : le capitalisme dans le tourbillon de la crise
- 3055 lectures
"L'année 67 nous a laissé la chute de la livre Sterling et 68 nous apporte les mesures de Johnson (...) voici que se dévoile la décomposition du système capitaliste, qui, durant quelques années, était restée cachée derrière l'ivresse du "progrès" gui avait succédé à la seconde guerre mondiale." ("Internacionalismo", Venezuela, janvier 1968)
Il y a vingt ans nous devions convaincre de l'existence de cette crise, aujourd'hui nous en sommes à l'expliquer et à en montrer les implications historiques.
"C'est en 1967 que les premiers symptômes se font sentir de façon certaine : la croissance annuelle de la production Mondiale tombe à son niveau le plus bas depuis 10 ans. Dans les pays de l'OCDE, le chômage et l'inflation connaissent des accélérations faibles, mais certaines. La croissance des investissements ralentit sans discontinuité de 65 à 67. En 1967, il y a officiellement 7 millions de chômeurs dans les pays de l'OCDE et le PUB croit de 3,51. Ce sont des chiffres qui aujourd'hui semblent bien négligeables comparés au niveau atteint par la crise actuellement, mais ils n'en marquaient pas moins la fin de la "prospérité" d'après-guerre (...). La deuxième récession dont le fond est touché en 1970 est beaucoup plus forte que celle de 67. Dans les pays de l'OCDE, elle est plus profonde, et dans l'ensemble du monde, elle est plus longue. Elle vient confirmer que la récession de 61 n'avait pas été un accident "allemand" mais l'annonce certaine d'une nouvelle période d'instabilité économique." (cf. notre brochure "La décadence du capitalisme", p. 4)
Il aura fallu vingt ans, une génération, pour que ce qui n'était que les premières manifestations d'une crise ouverte après la période de reconstruction consécutive à la seconde guerre mondiale apparaisse ouvertement comme l'expression d'une crise générale et insurmontable d'un mode de production aiguillonné par la course au profit, la soif jamais assouvie de marchés et fondé sur l'exploitation de l'homme par l'homme.
Que ce soit dans les pays dits "communistes", dans les pays de l'Est ou encore en Chine, dans les pays dits "développés" ou ceux hier désignés par l'appellation "en développement", d'un point de vue mondial et historique, le bilan de ces vingt années de crise est catastrophique et la perspective s'annonce encore plus catastrophique.
Catastrophique en absolu déjà. Par la misère qui sur toute la planète est devenue le lot quotidien de l'immense majorité de la population mondiale. Situation où l'avenir n'est pas indiqué par un développement des pays peu ou pas industrialisés rejoignant les pays développés, mais au contraire par un développement des caractéristiques du sous-développement au coeur même des métropoles industrielles, ce que les sociologues appellent le "quart monde".
Catastrophique relativement encore quand on considère l'immense gâchis comparé aux possibilités réelles en l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques et de toutes les richesses matérielles produites par le travail; toutes choses qui pourraient être le puissant levier d'une émancipation de l'humanité mais qui dans le carcan de la crise mondiale sont systématiquement orientées et transformées en forces de destructions.
L'évidence de cette crise d'une profondeur et d'une gravité extrême s'impose d'autant plus fortement que toutes les politiques économiques pour y faire face ont depuis vingt ans été, sans exception aucune, des échecs cuisants et que les perspectives de sortir de l'ornière où, à l'Est comme à l'Ouest, l'économie mondiale s'enfonce chaque jour plus, apparaissent aujourd'hui comme totalement illusoires.
De fait les questions que soulève cette crise sont des questions de fond qui touchent le coeur même de l'organisation sociale, de sa structure, des rapports qui s'y nouent et conditionnent l'avenir de la société mondiale.
A la veille d'une nouvelle et puissante récession mondiale inéluctable, cette rétrospective de vingt années de crise ne peut que prendre en compte le rappel des illusions et des mythes qui pendant des années, à tel ou tel moment, furent distillés par les voies officielles du pouvoir ou de la contestation de gauche.
CE QUI A ETE DIT A PROPOS DE LA CRISE
Ces vingt dernières années, au rythme d'une crise jamais surmontée, progressant par à-coups, sont en même temps l'histoire de l'effondrement des illusions qui ont marqué son parcours. Durant toutes ces années tout ou presque tout a été invoqué pour conjurer le démon.
LA "CRISE DU PETROLE" ET LA CRISE DE SURPRODUCTION
Dans la première moitié des années 70, la "crise du pétrole", "la crise énergétique", et la "pénurie" de matières premières en général furent rendues responsables de la récession de 74 et de la crise financière jamais surmontée.
A en croire les experts et les dirigeants mondiaux de tous bords la "pénurie" des sources énergétiques "qui provoquait une augmentation de leur prix" était responsable des soubresauts économiques. L'économie mondiale était en quelque sorte victime d'un problème "naturel", indépendant et extérieur à sa nature profonde.
Pourtant quelques années après, dès 78-79, alors que les soubresauts de l'économie mondiale furent devenus convulsions, nous étions amenés à constater non pas une pénurie des sources énergétiques accompagnée d'une augmentation de leurs prix, mais une surproduction générale de celles-ci et en particulier du pétrole, et conséquemment une chute de leur cours.
L'aspect flagrant de la nature de cette crise s'exprime caricaturalement dans les secteurs de la production des matières premières et en particulier dans l'agriculture: une crise manifeste de surproduction qui engendre la pénurie. C'est ainsi qu'alors que toutes les nations se livrent la guerre agricole la plus acharnée qui ait jamais existé nous sommes amenés à constater un développement ahurissant des famines et de la sous-nutrition dans le monde. C'est ainsi que:
"La production agricole mondiale est suffisante pour assurer à chaque individu plus de 3.000 calories par jour, soit 500 de plus que ce qu'il est nécessaire à la bonne santé d'un adulte moyen et, de 1969 à 1983, la croissance de la production agricole (40 %) a été plus rapide que celle de la production mondiale (35%)."
("L'insécurité alimentaire dans le monde", octobre 87, p. 4)
Ce qui n'empêche que, comme nous l'apprend an dernier rapport de la Banque mondiale, l'insécurité alimentaire concerne 700 millions de personnes et qu'il ne s'agit en aucune façon d'une question de capacité productive puisque:
"La faim persiste même dans les pays qui ont atteint l'autarcie alimentaire. Dans ces pays les famines touchent simplement ceux qui n'ont pas de revenus suffisants pour accéder au marché." (Banque mondiale: "Rapport sur la pauvreté et la faim" -1987)
D'autre part, les bourgeoisies occidentales se sont à l'époque beaucoup plaintes de cette augmentation des coûts dans l'approvisionnement en matières premières et sources énergétiques qui les "étranglait". Par contre, il n'est jamais fait référence au sort de ces masses de dollars qui à l'époque passèrent dans les mains des pays producteurs de matières premières. En fait, ces dollars se retrouvèrent vite dans les poches de ceux qui les avaient déboursés, car ils développaient la capacité d'importation des pays producteurs de matières premières. Mieux encore, ce qui fut acheté en majorité par les pays producteurs de matières premières dans les années 70, ce ne fut pas des moyens de consommation, ou des moyens de production, mais des armes.
"Entre 1977 et 1985, le tiers monde a acheté pour 286 milliards de dollars d'armement, ce qui équivaut à 30% de la dette que les pays du Sud avaient accumulée durant la même période (...). Le Proche-Orient a absorbé près de la moitié des exportations (...). Le marché a connu, entre 1910 et 1911, une expansion moyenne de 13%."
("Le Monde diplomatique", mars 88: "le grand bazar aux canons dans le tiers monde", p. 9)
Ravagé par la guerre et la crise, l'état de barbarie avancé dans lequel se trouve aujourd'hui le Moyen-Orient est une illustration parfaite des rapports étroits qu'entretiennent crise et guerre, et l'histoire de ces dernières années nous montre ici clairement comment la crise de surproduction se transforme en destruction pure et simple.
Il y a dans tout mensonge une part de vérité, dans toute illusion ou mythe une part de réalité; sinon aucun d'entre eux ne saurait trouver d'écho dans le cerveau des vivants. Il en est ainsi des "explications" de la crise qui ont jalonné ces vingt dernières années.
Tout d'abord, "la crise du pétrole" pouvait présenter une apparence de réalité. En effet l'augmentation brutale des coûts dans l'approvisionnement en sources énergétiques dont le relatif bon marché jusqu'alors avait conditionné la période de reconstruction représenta à partir de 1974 un coup dur pour les économies européennes. Contrairement aux prix de l'investissement en matériel dont les coûts se répercutent sur une longue période, l'amortissement, le prix des matières premières lui se répercute immédiatement dans le prix total des marchandises produites. De ce fait, les conséquences de l'augmentation des ressources énergétiques et des matières premières furent immédiates: affaiblissement face à la concurrence internationale et baisse des taux de profit.
Contrairement à ce qui en a été dit, ces augmentations n'avaient pas pour cause une pénurie naturelle des matières premières, les seules "pénuries" qui sévirent à cette époque ne furent que des "pénuries" organisées pour spéculer sur une anticipation à la hausse.
La brutale augmentation des coûts des ressources énergétiques et des matières premières en général avait par contre pour raison véritable la baisse brutale du dollar depuis 1971. Dans la mesure où tous les achats étaient libellés en dollars, les pays producteurs en augmentant le prix du pétrole ne faisaient que répercuter la baisse de la valeur du dollar.
Nous touchons ici du doigt le fond de la question. La chute du dollar, résultat direct de la décision des autorités américaines prise en 1973 de laisser flotter le dollar en vue de rendre l'économie américaine plus compétitive, venait consacrer l'effondrement des accords de Brettons Wood signés en juillet 1944.
"Ces accords étaient destinés i reconstruire, une fois la paix rétablie, le système monétaire international, disloqué depuis le début des années 30...Il s'agissait précisément d'éviter au monde le retour à l'expérience désastreuse des dévaluations "compétitives" et des "changes flottants" qu'il avait connue entre les deux guerres" ("Bilan économique et social 87" - Le Monde - page 41)
De fait, la baisse "compétitive" du dollar signifiait un retour aux conditions économiques de crise d'avant guerre.
L'économie mondiale dans une nouvelle période de crise économique aiguë se retrouvait face aux mêmes problèmes qui avaient précipité la seconde guerre mondiale, mais cette fois, multipliés par cent.
Prélude à cette situation, en 1967: l'apparition du déficit commercial américain.
En lui-même, ce déficit, mineur comparé au gouffre actuel (voir courbe du déficit USA), marquait la fin de la période de reconstruction. Il signifiait que les économies européennes et asiatiques désormais reconstruites ne constituaient plus un marché et que de plus elles s'inséraient dans la concurrence mondiale face à un marché réduit d'autant. Depuis tout ce qui a été fait en matière d'économie politique n'a eu pour raison d'être que la volonté de compenser l'effondrement des possibilités économiques que représentait la période de reconstruction.
La période qui s'étend de 1967 à 1981 n'est pas autre chose du point de vue économique que l'histoire de l'emploi massif et redoublé des recettes keynésiennes de soutien artificiel de l'économie. Rappelons rapidement en quoi consistent ces recettes keynésiennes:
"Le fondement de l'apport de Keynes à l'économie politique bourgeoise peut se résumer au fait d'avoir accepté de reconnaître, en plein marasme de la crise de 1929, l'ineptie de ce principe religieux de la science économique bourgeoise, inventé par l'économiste français Jean-Baptiste Say au 19ème siècle, suivant lequel le capitalisme ne peut pas connaître de véritable crise de marchés puisque "toute production est en même temps une demande". La solution keynésienne consisterait à créer une demande artificielle par l'Etat. Si le capital ne parvient pas à créer une demande nationale suffisante pour absorber la production, et si en outre, les marchés internationaux sont saturés, Keynes préconise que l'Etat se fasse acheteur des masses de produits qu'il paiera avec de la monnaie de singe émise par lui. Comme tout le monde a besoin de cet argent, personne ne protestera sur le fait qu'il ne représente que du papier." (Voir notre brochure "La décadence du capitalisme", P. 15)
Durant cette période:
"Les USA sont devenus la locomotive de l'économie mondiale en créant un marché artificiel pour le reste de leur bloc au moyen d'énormes déficits commerciaux. Entre 1976 et 1980, les USA ont acheté des marchandises à l'étranger pour 100 milliards de dollars, plus qu'ils n'en ont vendu. Seuls les USA -parce que le dollar est la monnaie de référence et de réserve mondiale- pouvaient mettre en oeuvre une telle politique sans qu'il soit nécessaire de dévaluer massivement leur monnaie. Ensuite, les USA ont inondé le monde de dollars sous forme de prêts aux pays sous-développés et au bloc russe. Cette masse de papier-monnaie a temporairement créé une demande effective qui a permis au commerce mondial de continuer". (Revue Internationale n° 26, p.4)
Nous pouvons ici citer encore en exemple pour cette période d'illusion, la RFA:
"L'Allemagne s'est mise à jouer à la "locomotive", cédant à la pression, il faut le reconnaître des autres pays (...) L'augmentation des dépenses publiques a en gros doublé, croissant de 1,7 fois la croissance du produit national. A tel point que la moitié de celui-ci est dorénavant canalisé par les services publics. Ainsi la croissance de l'endettement public a-t-elle été explosive. Stable autour de 18i du PNB au début des années 70, cet endettement est passé brusquement à 251 en 1975, puis à 351 en 81. Elle atteint un niveau inconnu depuis les années de banqueroute de 1'entre-deux-guerres.
Les Allemands qui n'ont pas la mémoire courte voient ressurgir le spectre des brouettes remplies de billets de la république de Weimar/" (cité dans la Revue Internationale n° 31 en 1982, p.22)
C'est la crise du dollar et la menace d'une faillite financière générale qui en 79 vont donner le signal d'un changement de politique économique mondiale sous le couvert de l'idéologie libérale de la "déréglementation" qui aboutira en 82 à la plus forte récession économique qu'ait connue le monde depuis les années qui précédèrent la seconde guerre mondiale.
LA "REVOLUTION LIBERALE"
Toutes les explications tant exploitées des causes "naturelles" de la crise mondiale dans les années 70 n'expliquaient rien du tout. On les oublia vite et on n'en entendit plus parler. La crise mondiale elle, inexorablement se développait, gagnait en profondeur et étendue, touchant au coeur même des métropoles industrielles. Il fallait l'expliquer; au moins trouver une caution idéologique aux "thérapies" douloureuses que l'on commença dès 1979 à administrer aux populations laborieuses. Le chômage allait passer brutalement du simple au double, les salaires étaient bloqués, dans les entreprises, les usines, les bureaux, la mentalité garde-chiourme était à l'honneur. Partout l'on demandait aux ouvriers et employés de se transformer en soldats de "l'Entreprise", de la "Nation" pour une guerre économique où ils avaient tout à perdre et rien à gagner. Et où en effet ils perdirent beaucoup.
Quel soulagement quand les causes de la maladie pernicieuse qui rongeait d'un mal secret l'économie mondiale furent mises à jour et le mystère enfin révélé.
La "société" souffrait de trop de "dirigisme". Mollement, elle se mourait dans ses "habitudes d'assistanat", qui accompagnèrent ce qui à l'occasion fut appelé "les trente glorieuses", c'est-à-dire toute la période après-guerre des reconstructions (1945-75) (sic). Ce "trop d'Etat" avait fini par briser les ressorts productifs, par casser "la soif d'entreprendre" et créer de lourds déficits dans les caisses des Etats, déficits qui grevaient d'autant le potentiel productif.
Au fond des choses, si "fond" dans de telles conceptions simplistes il y a, cet "interventionnisme" de l'Etat empêchait les "lois naturelles" de l'économie mondiale de jouer et d'assurer leur rôle "d'autorégulation". D'un seul coup les économistes avaient mis le doigt sur les causes de la crise et leur joie était d'autant plus profonde que ces révélations indiquaient du même coup les solutions et remèdes à y apporter. L'euphorie fut d'autant plus grande, le soulagement d'autant plus intense que ces remèdes qui furent administrés à haute dose aux populations laborieuses du monde entier durant la première moitié des années 80 avaient un goût qui n'était pas pour déplaire à la bourgeoisie mondiale: licencier, réduire les salaires, casser les assurances sociales de toutes sortes, montrer du doigt et mettre au pilori le "fonctionnaire" et autres employés d'Etat, enfin étrangler et laisser crever de tiers monde.
Mais tout comme la prétendue pénurie des matières premières et des sources énergétiques qui se révéla être en fait surproduction, ce "moins d'Etat" apparut rapidement comme un plus d'Etat. Ne serait-ce que par son intervention dans tous les aspects de la vie sociale, à commencer par la répression de toutes les manifestations de révolte que cette politique provoqua. Ou encore pour orienter une part croissante de l'effort productif, technologique et scientifique vers la production d'armement et l'investissement productif vers la bourse.
Pourtant en 84-85, le mythe d'une reprise économique aux USA a fait grand bruit. Les recettes reaganiennes semblaient avoir un impact salutaire sur la santé économique. Tous les indices cités, inflation, production, emploi reprenaient de la santé. Dans le monde entier, les financiers, les industriels, les hommes d'Etat, étaient éblouis par cette "révolution" et tout le monde dorénavant voulait faire du "libéralisme", y compris en ... URSS et en Chine. L'aventure échoua comme on le sait dans le spectaculaire effondrement boursier d'octobre 87, la menace d'une récession majeure et un renouveau de l'inflation.
Les déficits budgétaires et commerciaux loin de se dégonfler avaient atteint en quelques années des sommets vertigineux, en particulier sur le sol où cette idéologie avait trouvé à la fois un tremplin et un terrain de prédilection: les USA. C'est le bilan que nous tirions dès 1986:
"La croissance américaine s'est faite a crédit. En cinq ans, les USA, qui étaient le principal créditeur de la planète, sont devenus le principal débiteur, le pays le plus endetté du monde. La dette cumulée des USA, interne et externe, atteint aujourd'hui la somme pharamineuse de 8.000 milliards de dollars, alors qu'elle n'était que de 4.600 milliards de dollars en 1980, et 1600 en 1970. C'est-à-dire que pour parvenir à jouer son rôle de locomotive, en l'espace de cinq ans, le capital américain s'est endetté autant que durant les dix années qui ont précédé." (Revue Internationale n°48)
La production industrielle, elle, au lieu de prendre un nouvel essor ne fut jamais aussi poussive ou finit par franchement reculer aux USA encore. Cette "soif d'entreprendre", de "créer" qui libérée de ses contraintes, devait se trouver des ailes et prendre un nouvel essor, après avoir fui de façon massive la sphère industrielle, ne trouva d'autre refuge que la spéculation financière et boursière, seule activité fiévreuse du capital ces dernières années et qui a connu la fin lamentable que l'on sait.
Cela vaut pour toutes les grandes puissances industrielles et particulièrement pour la plus puissante, les USA. On a cité la baisse du chômage comme un des principaux acquis de cette "révolution libérale" aux USA, alors qu'un million d'emplois était définitivement perdu dans les secteurs industriels, que plus de 30 millions de personnes se trouvaient dorénavant dans des conditions d'existence en dessous du "seuil de pauvreté", et que les seuls emplois créés étaient des emplois à temps partiel dans le secteur des services :
"Alors que, dans les années 70, un emploi supplémentaire sur cinq était rémunéré moins de 7.000 dollars par an, cela a été le cas pour 6 emplois nouveaux sur dix i partir de 1979. (...) Entre 1979 et 1984, le nombre de travailleurs qui touchaient un salaire égal ou supérieur au salaire moyen a diminué de 1,8 million... Le nombre de travailleurs qui gagnaient moins a augmenté de 9,9 millions". ("Le Monde", "Dossiers et Documents, bilan économique et social", 1987).
Quant aux nations dites du "tiers monde" qui auraient dû trouver un stimulant dans la libération des "lois naturelles" du marché et de la concurrence, elles ont dans les dernières années touchées le fond du gouffre. Loin d'être "libérées" de la tutelle hégémonique des grandes puissances industrielles, elles ne furent jamais aussi dépendantes, écrasées par le poids d'une dette et de ses intérêts qui doublaient en même temps que la valeur monétaire du dollar alors que les exportations de matières premières, leur principale source de revenus, que l'appareil productif mondial n'absorbait plus, s'effondraient. Le Mexique, pour ne citer que cet exemple, en novembre 87 dévaluait le peso de 50%.
Comme dans la question de la crise du pétrole, il y a dans la "critique libérale" du "trop d'Etat" une part de vérité. Ce qu'il y a de juste ne concerne pas l'analyse, loin s'en faut, encore moins les solutions, mais un certain constat: de soutien essentiel à une activité économique dont les forces internes poussaient à l'éclatement, l'intervention de l'Etat dans tous les domaines de la vie économique et sociale a précipité la crise de surproduction qu'il avait pour tâche de contenir.
Au début des années 80, nous analysions ce changement de situation en soulignant ses caractéristiques essentielles qui ne concernaient pas uniquement un développement quantitatif de la crise économique, mais aussi un développement qualitatif des conditions historiques de son développement. Au sein de ces caractéristiques nous distinguions comme aspect essentiel que contrairement aux années de crise d'avant-guerre où les mesures keynésiennes de "New deal" furent prises après le plus fort de la crise, ce style de mesures pour le soutien artificiel de l'économie n'est pas devant mais irrémédiablement derrière nous alors que le plus fort de la crise lui, est devant nous.
Le déroulement des faits ou plutôt méfaits économiques depuis le début des années 80 est largement venu conforter ce constat. Plus encore, la concentration accélérée des activités des différents Etats sur les domaines militaires, production d'armements, stratégie mondiale, intervention et présence militaires accentuées alors que la disparition des "aspects sociaux" de cette intervention ne servait plus de masque et ne pouvait plus faire illusion, est venu souligner la gravité de la situation historique actuelle.
LA "REVOLUTION" TECHNOLOGIQUE »
Notre bref, trop bref, rappel de ce qui a tenu lieu d'analyse de la crise durant ces vingt dernières années ne serait pas complet si l'on ne mentionnait pas ici la fameuse "troisième révolution industrielle". A cheval entre deux époques, entre deux phases historiques de développement, les "soubresauts" économiques n'étaient finalement pas autre chose que la crise obligée et nécessaire du passage d'une époque à une autre. Que n'a t’on pas dit et imposé au nom de cette fameuse "révolution technologique", à commencer par les licenciements. Le premier intérêt de cette "analyse" historique était tout entier contenu dans l'idée que la crise du capitalisme que personne ne pouvait plus nier, ce qui était ennuyeux en soi, n'était somme toute qu'une crise de croissance. Au-delà de cette mauvaise passe l'avenir était radieux. A condition, bien sûr, de se soumettre aux impératifs douloureux, mais nécessaires de l'accouchement présent. Dans la continuité, cette analyse "révolutionnaire" offrait l'avantage de présenter comme "rétrograde", voire "réactionnaire", toute révolte contre les mesures qui allaient contre cette "révolution" (licenciements, restructuration, etc.) Malheureusement pour les idéologues qui furent les défenseurs de ces thèses, il advint de l'explication de la crise par la "troisième révolution industrielle" dont aujourd'hui plus personne ne parle, la même mésaventure que pour la "crise du pétrole" ou encore la "révolution libérale" entre lesquelles elle se situa: elle s'effondra face à la réalité des faits qui décidément sont têtus.
Au-delà des involutions industrielles et sociales qui ont marqué cette époque alors que toutes les "révolutions industrielles" ont toujours suscité et accompagné des bonds en avant de la production, il est ici nécessaire de souligner que toutes les avancées techniques, scientifiques et technologiques des deux dernières décennies ont eu pour aiguillon et application le domaine militaire de la production d'armement, les retombées civiles, elles, restant extrêmement limitées.
"Le monde consacre à des fins militaires une somme de ressources supérieures i ce qu'était la production mondiale de 1900 (...). De plus, le domaine militaire absorbe les deux tiers de la défense mondiale en matière de recherche et de développement." ("Armement et désarmement à l'âge nucléaire", "La documentation française" n° 4456, p. 13)
POUR EN FINIR AVEC LES MYTHES ET ILLUSIONS SUR LA CRISE
Toute la difficulté à comprendre la crise économique tient à sa nature. C'est en effet la première fois dans son histoire que l'humanité est amenée à subir une crise de surproduction générale. Alors que toutes les crises des modes de production qui nous ont précédés, esclavagisme, féodalisme, s'exprimaient dans de larges crises de sous-production, il en va tout autrement pour le capitalisme, ce qu'exprime K. Marx dans le "Manifeste Communiste:
"Dans ces crises, une grande partie, non seulement des produits déjà créés, mis encore des forces productives existantes est livrée à la destruction. Une épidémie éclate qui, à toute époque, eût semblé absurde: l'épidémie de la surproduction."
Et encore K. Marx n'a de son vivant assisté qu'à des crises de surproduction limitées dans le temps et dans l'espace. Limitées à des secteurs particuliers et précédées par de longues et larges périodes d'expansion du capitalisme à travers le monde.
Non seulement cette caractéristique de crise de surproduction la rend de prime abord incompréhensible par l'absurdité qu'elle représente, mais de plus, le fait que la crise économique soit une crise de surproduction a permis pendant des années toutes les manipulations pour en repousser les échéances. Face à une crise de sous-production, il n'y a pas d'alternative: quand il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. La crise de surproduction, surproduction qui est une surproduction relative, non en fonction des besoins humains mais de la capacité d'absorption du marché mondial, elle, peut être repoussée, masquée par toute une série de manipulations financières, commerciales et l'histoire économique récente n'est pas autre chose que l'histoire de ces manipulations. Mais ces manipulations dans lesquelles sont passés maîtres les Etats modernes ne font qu'alimenter la surproduction et finalement exacerber la crise. Fatalement il arrive un moment où elle doit être résorbée parce que sous son poids c'est toute la structure sociale qui menace d'effondrement.
Notre époque n'est pas autre chose qu'une telle situation d'échéance et de solde. Et au-delà de ces vingt dernières années, la crise actuelle n'est que le prolongement et l'aboutissement de toute une période historique qui commence dès le début de notre siècle avec la première guerre mondiale. Période où:
"Entre 1914 et 1980, on compte 10 années de guerre généralisée (sans compter les guerres locales permanentes), 39 années de dépression (1918-22, 1929-39, 1945-50, 1967-87), soit au total 49 années de guerre et de crise, contre seulement 24 années de reconstruction (1922-29 et 1950-67). Et le cycle de la crise n’est pas encore terminé !..."(Revue Internationale, n°48)
Résorbée, la surproduction mondiale ne peut l'être de mille manières. Soit elle est résorbée par une immense destruction, c'est le cas des guerres, soit par une transformation radicale des rapports sociaux et mondiaux de production où les buts, les moyens, les conditions de l'activité productrice seront enfin libérés des carcans du marché, du profit, de l'exploitation et de la division du travail entre travail manuel et travail intellectuel.
Y a t-il plus grande ineptie face à la crise économique mondiale et à son stade avancé que les injonctions de toutes les bourgeoisies nationales à vouloir transformer la population laborieuse en soldats de l'économie, à vouloir les faire s'affronter dans une guerre économique où ce sont des générations entières qui sont sacrifiées et qui en fin de compte -la triste expérience de deux guerres mondiales nous le prouve- ne peut qu'aboutir à la guerre tout court.
Prénat
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [119]
Récent et en cours:
- Crise économique [3]
Vingt ans depuis mai1968 : évolution du milieu prolétarien (1° partie) (1968-1977)
- 3396 lectures
Mai 1968: 10 millions de travailleurs en grève en France sont l'annonce du retour significatif du prolétariat sur la scène de l'histoire et ouvrent une vague de luttes qui va prendre une dimension internationale et qui jusqu'au milieu des années 1970 va manifester ses effets dans presque tous les pays de la planète.
Jamais depuis des décennies, depuis l'échec de la vague révolutionnaire commencée en 1917 et gui s'épuise à la fin des années 1920, la lutte de classe n'avait déployé une telle force, pris une telle ampleur. Après quarante longues années de contre-révolution où le triomphe de la bourgeoisie s'était exprimé par une domination idéologique sans précédent dans l'histoire, où la théorisation de l'intégration du prolétariat, de son embourgeoisement, de sa disparition comme classe révolutionnaire animait la réflexion d'intellectuels en mal de nouveautés, où le socialisme était identifié aux sombres dictatures staliniennes et à leurs caricatures "tiers-mondistes", où les jungles d'Amérique du sud et d'Indochine étaient présentées corne le centre de la révolution mondiale, le réveil du prolétariat vient remettre les pendules de l'humanité a l'heure. Un verrou vient de sauter, celui de la contre-révolution: une nouvelle période historique s'ouvre.
La lutte ouvrière renaissante va polariser le mécontentement qui s'accumule depuis des années bien au-delà du prolétariat dans de nombreuses couches de la société. La guerre du Vietnam qui s'éternise et s'intensifie, les premières attaques de la crise gui marque son retour au milieu des année 1960 après la période d'euphorie de la reconstruction d'après-guerre vont provoquer un profond malaise au sein d'une jeunesse élevée dans l'illusion d'un capitalisme triomphant, sans crise, et les promesses d'un avenir radieux. La révolte des étudiants sur tous les campus du monde va servir à la propagande bourgeoise pour masquer la reprise de la lutte de classe, mais aussi elle va répercuter l'écho déformé du regain de réflexion politique qui se développe au sein du prolétariat, ce qui se concrétise dans un intérêt renouvelé pour la classe ouvrière, son histoire et ses théories et donc pour le marxisme. Révolution devient un mot à la mode.
Brutalement, comme étonnée de sa propre force, une nouvelle génération de prolétaires s'affirme sur la scène historique et mondiale. Comme produit de cette dynamique, dans une ébullition juvénile mais aussi dans une grande confusion; sans expérience, sans liens avec les traditions révolutionnaires du passé, sans réelle connaissance de l'histoire de sa classe, fortement influencé par la contestation petite-bourgeoise, un nouveau milieu politique du prolétariat se forme. Une nouvelle génération de révolutionnaires est en train de naître dans l'enthousiasme et... l'inexpérience.
Bien sûr, lorsque nous traitons du milieu prolétarien, n'y sont pas incluses les organisations qui prétendent représenter le prolétariat et le défendre, nais qui ne sont en fait que les expressions destinées à le mystifier, à saboter ses luttes, de la "gauche" de l'appareil politique de contrôle de l'Etat capitaliste sur la classe ouvrière, quelles que soient les illusions qui existent dans la classe ouvrière à leur sujet. Ce sont non seulement les PC et PS depuis longtemps intégrés à tous les rouages de l'appareil d'Etat, nais aussi leurs émules maoïstes, qui ne sont qu'une excroissance tardive du stalinisme, les trotskystes dont l'abandon des principes de classe dans la IIème guerre impérialiste mondiale, dont la trahison par le soutien d'un camp impérialiste contre un autre, les a définitivement mis en dehors du camp prolétarien. Même si en 1968 et après, ces groupes dits "gauchistes" ont une influence déterminante et occupent le devant de la scène, leur histoire passée les situe radicalement en dehors du prolétariat et de son milieu politique. C'est d'ailleurs contre l'attitude politique de ces groupes de la "gauche" bourgeoise que se forme dans un premier temps la mouvance dont va surgir le renouveau du milieu prolétarien, et cela même si dans la confusion et le remue-ménage de l'époque, les idées gauchistes pèsent lourdement sur la naissance de ce nouveau milieu prolétarien.
Depuis les événements de mai 68, vingt ans se sont écoulés, 20 ans durant lesquels la crise économique a exercé ses ravages sur le marché mondial, a labouré le champ social, balayé les illusions de la reconstruction. 20 ans durant lesquels la lutte de classe a connu des flux et des reflux. 20 ans durant lesquels le milieu prolétarien a du retrouver ses racines et poursuivre la clarification nécessaire à l'efficacité de son intervention.
Durant ces 20 années, quelle a été l'évolution du milieu politique? Quel bilan tirer aujourd’hui? Quels fruits prolétariens a donnés la génération de 1968? Quelles perspectives tracer pour féconder le futur ?
LE MILIEU POLITIQUE PROLETARIEN AVANT 1968
Les groupes politiques qui avant le chambardement de la fin des années 60 ont pu résister à l'étouffement de la contre-révolution et maintenir contre vents et marées leur existence sur des positions révolutionnaires ne sont qu'une poignée, regroupant chacun une poignée d'individus. Ces groupes se définissent en fonction de leur filiation politique. Deux grands courants se distinguent essentiellement qui trouvent leur origine dans les fractions qui se sont opposées dans les années 20 à la dégénérescence politique de la Illème Internationale:
- la tradition des gauches dites "hollandaise" et "allemande" ([1] [122]) qui s est maintenue au travers de groupes politiques tel le "Spartacusbond" ([2] [123]) en Hollande ou de cercles plus ou moins formels comme celui regroupé autour de Paul Mattick aux USA, ICO en France ou Daad en Gedachte en Hollande apparus au début des années 60, sont le produit dégénéré de cette tradition du "communisme de conseils" incarnée principalement par le GIK dans les années 30, Ce courant, dans la continuité politique des théorisations d'Otto Riihle dans les années 20, puis d'Anton Pannekoek et de Canne Meier dans les années 30, se caractérise par une incompréhension profonde de l'échec de la révolution russe et de la dégénérescence de l'Internationale communiste, ce qui 1’amène à nier le caractère prolétarien de celles-ci et dans la foulée à rejeter la nécessité de l'organisation politique du prolétariat;
- la tradition de la gauche dite "italienne" exprimée dans sa continuité organisationnelle par le PCI ([3] [124]), fondé en 1945 autour d'Onorato Damen et d'Amadeo Bordiga, et qui publie Battaglia Comunista. * Les scissions dont la principale va se faire autour de Bordiga en 1952 qui va publier Programa Comunista ([4] [125]) vont donner lieu à de multiples avatars du PCI parmi lesquels on peut entre autre citer "Il Partito Comunista". Cependant, ces organisations, si elles ont pu maintenir une continuité organisationnelle avec les fractions communistes du passé ne se revendiquent paradoxalement pas du groupe qui dans les années 30 a représenté le plus haut niveau de clarté politique de cette tradition dont elles sont issues, et de ce point de vue, en rejetant ainsi les apports politiques de Bilan, expriment une continuité politique affaiblie. Cela va se traduire dans une rigidité dogmatique qui nie les nécessaires clarifications imposées par 60 ans de décadence du capitalisme, ainsi Bordiga et le PCI (Programa Comunista) vont caricaturalement se réclamer de l'invariance du Marxisme depuis...1848. Pour ces organisations, la critique insuffisante des positions erronées de la Illème Internationale va se traduire dans des positions politiques on ne peut plus floues et même souvent fausses sur des points aussi centraux que la question nationale ou la question syndicale. La juste volonté de défendre la nécessité du parti va pour ces groupes malheureusement s'exprimer dans une forme caricaturale, notamment chez Bordiga, où le parti est présenté et conçu de manière formelle comme la réponse à toutes les difficultés du prolétariat, comme la panacée universelle à laquelle les prolétaires doivent se soumettre. De ces groupes, seul le PCI (Programa Comunista) a une existence internationale, notamment en France et en Italie, alors que les autres n'existent qu'en Italie.
Dans cette tradition de la gauche "italienne" il faut inclure Internacionalismo au Venezuela, fondé en 1964 sous l'impulsion d'anciens membres de Bilan (1928-1939) ([5] [126]) et d'Internationalisme (1945-1953) ([6] [127]) qui, s'il n'exprime pas une réelle continuité organisationnelle, est par contre la plus claire expression de la continuité politique avec les acquis de Bilan et ensuite d'Internationalisme qui en a poursuivi le travail d'élaboration théorique. Cependant, si Internacionalismo se réclame explicitement des apports de Bilan et de la gauche "italienne", il a su aussi s'enrichir de manière critique, comme l'ont fait avant lui Bilan et Internationalisme, des apports des autres fractions de la gauche internationale du début du siècle et cela se concrétise dans la clarté de ses positions sur la question de la décadence du capitalisme, sur la question nationale, sur la question syndicale, comme sur celle du rôle du parti. Ce n'est certainement pas un hasard si Internacionalismo est le seul groupe à prévoir le retour historique de la lutte de classe.
Ce tableau du milieu politique avant 1968 ne serait pas complet s'il n'incluait également les groupes qui se sont formés au lendemain de la IIème guerre mondiale en réaction à la trahison de la IVème Internationale trotskyste et qui sont issus de ce courant. Il faut notamment citer le FOR ([7] [128]) qui se forme autour de Benjamin Perret et _G. Munis, et Socialisme ou Barbarie autour de Cardan-Chaulieu. Ces groupes issus d une tradition politique, le trotskisme, affaiblie par sa participation à la dégénérescence de la Illème Internationale et son abandon des principes de classe dans son soutien à la 2ème boucherie impérialiste mondiale, ont une originalité liée a leur filiation: leur incompréhension de la dégénérescence de la révolution en Russie et des fondements économiques du capitalisme d'Etat dans la période de décadence du capitalisme qui les mène à théoriser la fin des crises économiques du capitalisme et ainsi à se couper des bases d'une compréhension matérialiste, marxiste de l'évolution de la société. Socialisme ou Barbarie va explicitement renier le prolétariat et le marxisme pour développer «ne théorie fumeuse où la contradiction fondamentale de la société n'était plus celle entre capital et travail, entre bourgeoisie et prolétariat, mais dans le rapport idéologique entre dirigeants et dirigés! Niant la nature révolutionnaire du prolétariat, Socialisme ou Barbarie perd sa raison d'être comme organisation politique et disparaît au début des années 60. Pourtant l'influence pernicieuse de ses théories va lourdement peser non seulement sur les milieux intellectuels, nais aussi sur le milieu politique, notamment ICO, et sur sa marge l'Internationale situationniste. Le FOR quant à lui ne va jamais sombrer dans de telles extrémités, mais son refus de reconnaître la réalité de la crise économique affaiblit l'ensemble de ses positions politiques en les privant d'une cohérence indispensable.
LA FRAGILITE DU MILIEU QUI RENAIT APRES 1968
Les événements de la lutte de classe et notamment les grèves de mai 68 en France, le mai rampant italien en 1969, les émeutes de Pologne en 1970, par leur écho international, vont impulser une réflexion dans le prolétariat et même dans toute la société, et redonner ainsi une audience à la théorie révolutionnaire du marxisme. Portés par cette vague internationale de lutte de classe, une multitude de petits groupes, cercles ou comités vont naître dans la plus grande confusion mais à la recherche d'une cohérence révolutionnaire. De cette mouvance informelle va surgir le renouveau du milieu politique.
La confrontation concrète avec les manoeuvres de sabotage de la lutte de classe menées par ceux-là mêmes qui se prétendent les défenseurs les plus ardents des intérêts de la classe ouvrière, va être un facteur décisif de la prise de conscience brutale de la nature anti-ouvrière des syndicats et des partis de "gauche". La remise en cause de la nature prolétarienne des organisations syndicales, des partis socialistes naguère issus de la défunte Ilème Internationale, des partis communistes staliniens et de leurs émules "gauchistes" dans leurs différentes variantes maoïstes et trotskystes, est le produit immédiat de la lutte de classe qui sert de révélateur. Cependant l'intuition de positions politiques de base du prolétariat ne peut dissimuler la profonde fragilité politique de cette nouvelle génération qui renoue avec les positions révolutionnaires sans une réelle connaissance de l'histoire passée de sa classe, sans lien avec les organisations antérieures du prolétariat, sans expérience militante d'aucune sorte et sous l'influence pesante des illusions petite bourgeoises véhiculées par le mouvement des étudiants. Le poids de décennies de contre-révolution pèse extrêmement lourdement. "Cours camarade, le vieux monde est derrière toi!" clament les révoltés de 68. Mais si le rejet du "vieux monde" permet d'approcher certaines positions de classe telles que la nature capitaliste des syndicats, des partis dits de "gauche", des soi-disant "patries du socialisme", dans la foulée il tend allègrement à faire rejeter des acquis indispensables du prolétariat. Et en premier lieu celui de la nature révolutionnaire du prolétariat, mais aussi le marxisme, les organisations passées du prolétariat, la nécessité de l'organisation politique, etc. Immédiatement, les idées qui vont trouver le plus d'écho parmi une mouvance marquée du sceau de l'immaturité et de l'inexpérience propre à la jeunesse sont celles de courants "radicaux" telle l'Internationale Situationniste qui réactualise au goût du jour les théories de Socialisme ou Barbarie, et se fait l'expression la plus radicale du mouvement des étudiants. Diluant la lutte ouvrière dans la révolte des couches petites-bourgeoises, l'identifiant avec un réformisme radical de la vie quotidienne, tentant un savant amalgame entre Bakounine et Marx, l'Internationale Situationniste esquive le terrain marxiste pour réactualiser avec un siècle de retard les illusions utopistes.
Ainsi va le "modernisme" ([8] [129]) qui, tout dévoué à sa recherche de la nouveauté et au rejet de l'ancien, ne fait que redécouvrir des théories historiquement périmées. Mais alors que le courant "moderniste" est fondamentalement étranger à la classe ouvrière, le courant conseilliste ([9] [130]) lui, s'inscrit historiquement dans le milieu politique prolétarien. ICO en France est particulièrement représentatif de cette tendance, se réclamant des apports des gauches "allemande" et "hollandaise", il théorise, dans la continuité des errements de la gauche "hollandaise" dans les années 30, le rejet de la nécessité pour le prolétariat de se doter d'organisations politiques. Cette position va connaître un grand succès alors que, après des décennies de contre-révolution victorieuse, de trahison des organisations prolétariennes gui succombent sous la pression bourgeoise et s'intègrent à l'Etat capitaliste, et de manoeuvre anti-ouvrière des organisations qui prétendent pourtant parler en son nom, le sentiment de méfiance du prolétariat vis-à-vis des organisations quelles qu'elles soient est exacerbé. Cette tendance tend à culminer dans une peur de l'organisation en soi. Le mot même effraie.
Dans un premier temps ICO va polariser le milieu politique renaissant en France et même internationalement avec l'écho planétaire des événements de mai 68, et contribuer à la divulgation et à la réappropriation de l'expérience prolétarienne des révolutionnaires du passé (notamment du KAPD en Allemagne), bien que de manière partielle et déformée. Aux conférences qu'organise ICO participent de nombreux groupes; ainsi en France: les Cahiers du communisme de conseil de Marseille, le Groupe conseilliste de Clermont-Ferrand, Révolution Internationale de Toulouse, le GLAT, la Vieille Taupe, Noir et rouge, Archinoir; à la conférence de Bruxelles en 1969 vont participer des groupes belges et italiens ainsi que des "personnalités" telles que Daniel Cohn-Bendit et Paul Mattick. Mais cette dynamique de polarisation du milieu politique se fait plus sous la pression de la lutte de classe que grâce à la cohérence politique d'ICO ; avec la retombée de la lutte ouvrière en France au tout début des années 70, les conceptions anti-parti, anti-organisation d'ICO vont peser de plus en plus lourdement sur un milieu politique immature. Alors qu'au début ICO attire aux positions prolétariennes des groupes et éléments en rupture d'anarchisme et d'académisme intellectuel, avec le reflux des grèves c'est l'inverse qui se produit: c'est ICO qui est gagné par la gangrène anarchiste et "moderniste". Finalement ICO disparaîtra en 1971.
Cet itinéraire d'ICO est tout a fait exemplaire de la dynamique du conseillisme dans le milieu politique international, même si dans d'autres pays que la France ce phénomène a pu être décalé dans le temps. Les théorisations conseillistes en rejetant la nécessité de l'organisation, en niant la nature prolétarienne de la révolution russe, du Parti bolchevik et de la IIIème Internationale constituent un pôle de déboussolement et de décomposition au sein du milieu prolétarien en formation en le coupant de racines historiques essentielles et en le privant des moyens organisationnels et politiques de s'inscrire dans la durée. Le conseillisme est un pôle de dilution des énergies révolutionnaires de la classe.
Tous les groupes prolétariens qui surgissent dans l'enthousiasme de la jeunesse à la fin des années 60 sont peu ou prou marqués par l'influence pernicieuse du "modernisme" et du conseillisme: que de discours n'a-t-on entendu sur la fin des crises avec le capitalisme d'Etat, sur les méchants bolcheviks et la destinée inéluctable pour tout parti de trahir le prolétariat, sur l'aliénation suprême que constitue le militantisme révolutionnaire. Discours à la mode et qui vont disparaître avec elle! La décantation inévitable qui vient avec le reflux de la lutte de classe, en même temps qu'elle balaye les illusions, imposant ainsi une nécessaire clarification, va se traduire par la disparition des groupes politiquement les plus faibles. Dans la première moitié des années 70 c'est l'hécatombe: exit l'IS qui n'aura "brillé" qu'un fugace printemps, exit ICO morte sur le champ dérisoire de la critique de la vie quotidienne, exit Pouvoir Ouvrier, Noir et rouge et la Vielle Taupe en France, exit Lotta continua et Potere Operaio en Italie mal dégrossis du gauchisme maoïste, et la liste est évidemment loin d'être exhaustive. L'histoire est là, avec la lutte de classe qui reflue et la crise qui se développe, qui impose inéluctablement ses évidences et apporte sa sanction.
Les divers PCI issus de la gauche "italienne" incapables de comprendre que le réveil de la lutte de classe la fin des années 60 signifie le glas de la période de contre-révolution, sous-estimant complètement l'importance des grèves qui se déroulent sous leurs yeux vont être incapables de remplir la fonction pour laquelle ils existent: intervenir dans la classe et dans le processus de formation de son milieu politique. Ceux qui se prétendent la seule continuité organique et politique avec les organisations révolutionnaires du début du siècle, qui auraient dû renforcer le milieu politique renaissant en accélérant le nécessaire processus de réappropriation des acquis prolétariens du passé, ceux qui se prétendent le Parti de classe, ceux-là sont quasiment absents jusqu'au milieu des années 70. Ils dorment en croyant que continue la longue nuit de la contre-révolution et en serrant frileusement les "tables de la loi" du programme communiste. Le PCI (Programme Communiste), seule organisation à avoir une réelle existence internationale, traite avec un souverain mépris ces éléments à la recherche balbutiante d'une cohérence révolutionnaire et le PCI (Battaglia Comunista), plus enclin à la discussion politique, reste timidement replié sur l'Italie.
Même si les positions de ces groupes sur la question du parti, qui les distinguaient fondamentalement du conseillisme, ne pouvaient dans un premier temps polariser de la même manière le milieu politique renaissant, leur relative absence n'a pu que renforcer le poids destructeur du conseillisme sur les jeunes énergies révolutionnaires immatures.
Finalement, seule l'expression qui pouvait paraître superficiellement la plus "faible" des courants qui se rattachent à la gauche "italienne", parce qu'isolée au Venezuela, mais qui ne l'était certainement pas sur le plan politique qui nous intéresse, va parvenir à donner des fruits. A l'initiative de membres d'Internacionalismo immigrés en France va être formé le groupe Révolution Internationale à Toulouse, en plein bouillonnement de mai 68. Ce petit groupe, perdu dans la multitude de ceux qui surgissent à cette époque va être à même -parce qu'en son sein participent d'anciens militants de la gauche "italienne", de Bilan et d'Internationalisme, qui lui apportent une expérience politique irremplaçable- de jouer un rôle positif face à la tendance à la décomposition qui est à l'oeuvre dans ce nouveau milieu politique sous l'emprise dangereuse du conseillisme. Cela va notamment se concrétiser dans la dynamique de regroupement que va savoir incarner Révolution Internationale.
LA DYNAMIQUE DU REGROUPEMENT ET LE POIDS DU SECTARISME
Du sein même du nouveau milieu politique dominé par la confusion va apparaître une tendance qui va s'opposer au processus de décomposition qui se manifeste comme expression du poids des idées conseillistes. La volonté de clarification politique, le souci de réappropriation des acquis politiques du marxisme va se concrétiser dans une défense de la nécessité de l'organisation politique pour le prolétariat et une critique des erreurs conseillistes. Dès sa fondation RI va se consacrer à cette tâche: défendant des principes révolutionnaires sur la question de l'organisation, mais aussi proposant un cadre cohérent de compréhension des positions de classe et de l'évolution du capitalisme au XXème siècle au travers de la théorie de la décadence du capitalisme reprise de Rosa Luxemburg et de Bilan et des élaborations sur le capitalisme d'Etat héritées d'Internationalisme. Cela lui permet une plus grande clarté sur des questions comme celles du caractère prolétarien de la révolution russe, du parti bolchevik, de la IIIème Internationale qui sont celles qui sont posées au sein du milieu d'après 68. De plus, la cohérence plus solide des fondements politiques de RI va s'exprimer dans sa compréhension des événements de mai 68: tout en défendant l'importance et la signification historique des luttes ouvrières qui se développent internationalement RI s'oppose fermement aux surestimations délirantes de ceux qui au sein du courant conseillisto-moderniste voyaient la révolution communiste pour l'immédiat et préparaient ainsi leur démoralisation future. RI, même si dans un premier temps son audience est restreinte et noyée dans le conseillisme dominant, représente un pôle de clarté dans le milieu politique de l'époque. En France, la participation de RI aux réunions organisées par ICO va lui permettre de confronter la confusion conseilliste et de polariser l'évolution d'autres groupes. Le processus de clarification qui prend place alors permettra de développer une dynamique de regroupement qui aboutira en 1972 à la fusion du Groupe conseilliste de Clermont-Ferrand et des Cahiers du communisme de conseil au sein de RI.
La dynamique du regroupement et la formation du CCI ([10] [131])
Sur le plan international la dynamique est la même. Dans la retombée de la lutte de classe les débats s'accélèrent au sein du milieu politique prolétarien dans lesquels RI et Internacionalismo vont jouer un rôle de clarification déterminant. La lutte contre les conceptions conseillistes s'intensifie, poussant de nombreux groupes à rompre avec leurs premières amours libertaro-conseillistes. Internationalism aux USA se forme en contact étroit avec Internacionalismo, les discussions de clarification avec RI sont directement à l'origine de la formation de World Révolution et vont avoir beaucoup d'influence sur des groupes comme Worker's Voice et Revolutionary Perspective en Grande-Bretagne, c'est directement sous l'égide de RI que trois groupes fusionnent pour former Internationalisme en Belgique, de même en Espagne et en Italie c'est autour de la cohérence de RI que se forment Accion Proletaria et Rivoluzione Internazionale.
L'appel d'Internationalism (USA) à la constitution d'un réseau international de contacts entre les groupes prolétariens existants va permettre l'accélération de la clarification théorique et de la décantation politique. Dans cette dynamique sera tenue une conférence internationale en 1974 qui prépare et annonce la fondation du CCI en 1975 qui regroupe alors Internacionalismo (Venezuela), Révolution Internationale (France), Internationalism (USA), Nord Révolution (GB), Internationalisme (Belgique), Accion proletaria (Espagne), Rivoluzione Internazionale (Italie) sur la base d'une plate-forme commune. Existant ainsi dans sept pays, loin des conceptions anarcho-conseillistes qui cachent mal le poids du localisme le CCI appuiera son existence sur un fonctionnement centralisé à l'échelle internationale, à l'image de la classe ouvrière qui est une et n'a pas d'intérêt particulier suivant les pays où elle se trouve.
La décomposition du gauchisme et le développement du PCI (Programme Communiste)
La vague de lutte de classe qui a débuté de manière explosive en 1968 commence à marquer le pas dès le début des années 70, la classe dominante surprise dans un premier temps réorganise son appareil de mystification politique pour lieux confronter la classe ouvrière. Cet infléchissement de la situation qui provoque la débandade du milieu conseilliste marqué par l'immédiatisme et la déroute des conceptions qui le caractérisaient va aussi provoquer une certaine décomposition des groupes "gauchistes" trotskystes et maoïstes secoués par de nombreuses scissions dont certaines vont tendre à se rapprocher des positions révolutionnaires. Cependant ces groupes marqués par leur lourde hérédité vont être incapables de réellement s'intégrer au milieu prolétarien. Ainsi les deux scissions de Lutte ouvrière en France: Union ouvrière et Combat communiste dont la première,au début influencée par le FOR/fait une traversée météoritique du milieu prolétarien pour disparaître dans le "modernisme" alors que la seconde se révélera congénitalement incapable de rompre avec le trotskisme "radical".
La dynamique de sortie du sein des groupes de 1'extrême-gauche de nombreux éléments plus démoralisés que clarifiés va s'intensifier avec l'entrée de la lutte de classe dans une phase de recul au milieu des années 70. C'est sur cette base que va se développer le PCI (Programme communiste). Après être passé à côté de la lutte de classe à la fin des années 60 sans rien voir, le PCI bordiguiste commence à sortir de sa torpeur au début des années 70, mais ce sera pour traiter avec un souverain mépris le milieu prolétarien qui s'est constitué et développer un recrutement opportuniste vis-à-vis d'éléments au "gauchisme" mal dégrossi. Sur la base de positions erronées sur des questions cruciales telles que la question nationale ou la question syndicale, la dérive opportuniste du PCI va s'intensifier et s'accélérer tout au long des années 70. Il va ainsi successivement soutenir la lutte de libération nationale en Angola, la terreur des Khmers rouges au Cambodge et la "révolution" palestinienne. Et le PCI bordiguiste va enfler à la mesure de la gangrène "gauchiste" qui le gagne.
A la fin des années 70 le PCI (Programme Communiste) sera l'organisation la plus importante au sein du milieu politique prolétarien existant. Hais si le PCI est le pôle dominant du milieu politique durant cette période ce n'est pas seulement à son importance numérique et sa réelle existence internationale qu'il le doit. Le recul de la lutte de classe sème le doute sur la capacité révolutionnaire du prolétariat et un nouvel attrait pour les conceptions substitutionnistes du parti se développe en réaction aussi à l'évidente déroute des conceptions anti-organisationnelles du conseillisme. Le bordiguisme qui théorise le parti comme le remède souverain contre toutes les difficultés de la classe fondamentalement trade-unioniste qu'il doit diriger et organiser comme un état-major militaire dirige son armée, connaît un regain d'intérêt dont le PCI va bénéficier. Hais au-delà du PCI (Programme communiste) c'est l'ensemble du milieu politique qui va être polarisé par le nécessaire débat sur le rôle et les tâches du parti communiste.
Le poids du sectarisme
Cependant si le PCI (Programme communiste) est la principale organisation du milieu prolétarien dans la deuxième moitié des années 70, il n'est pas pour autant le produit d'une dynamique de clarification et de regroupement. Bien au contraire, son développement s'est opéré sur la base d'un opportunisme grandissant et d'un sectarisme constamment théorisé. Le PCI qui se considère comme la seule organisation prolétarienne existante refuse toute discussion avec d'autres groupes. Le développement du PCI bordiguiste n'est pas l'expression de la force de la classe mais celle de son affaiblissement momentané déterminé par le recul des grèves. Malheureusement le sectarisme n'est pas l'apanage du seul PCI de Bordiga même s'il en fait la théorisation la plus caricaturale, il pèse sur l'ensemble du milieu prolétarien comme expression de son immaturité. Cela se concrétise notamment dans:
- la tendance de certains groupes à se croire seuls au monde et à nier la réalité de l'existence d'un milieu politique prolétarien; à l'image du PCI de nombreuses sectes se réclamant du bordiguisme vont développer cette attitude;
- une tendance à être plus soucieux de se distinguer sur des points secondaires afin de justifier sa propre existence séparée que de se confronter au milieu politique pour pousser à la clarification. Cette attitude va en général de pair avec une profonde sous-estimation de l'importance du milieu prolétarien et des débats qui l'animent; ainsi, Revolutionary Perspective qui refuse la dynamique de regroupement avec World Révolution en Grande-Bretagne en 1973 en arguant d'une divergence "fondamentale": selon ce groupe, après 1921 le parti bolchevik n'était plus prolétarien. Cette "fixation" de RP sur cette question n'étant qu'un prétexte, ce qui va se traduire quelques années plus tard par l'abandon de cette position sans en tirer les conséquences sur l'échec antérieur du regroupement en GB;
- une tendance aux scissions immatures et prématurées comme celle du PIC qui se sépare de RI en 1973 sur une base activiste et immédiatiste mâtinée de conseillisme. Cependant, toute les scissions ne sont pas infondées; ainsi celle du CCI ([11] [132]) en 1977 à partir du CCI est justifiée dans la mesure où les camarades qui vont former le CCI rompent avec la cohérence du CCI sur des positions fondamentales telles que le rôle du parti et la nature de la violence de classe, rejoignant les conceptions bordiguistes. Cependant cette scission exprime quand même le poids du sectarisme en reprenant les conceptions sectaires du PCI sur bien des points;
- paradoxalement la tendance au sectarisme va aussi se manifester dans des tentatives de regroupement qui vont singer la dynamique qui fut celle du CCI. Ainsi le PIC va se faire l'initiateur de conférences qui essaieront dans la plus grande confusion de regrouper des groupes plus marqués par l'anarchisme que par les positions révolutionnaires. La fusion de Worker's Voice et de Revolutionnary Perspective en Grande-Bretagne au sein du CWO ([12] [133]), si elle marque une volonté positive vers le regroupement, est aussi malheureusement marquée par l'attitude sectaire que cette organisation déploie vis-à-vis du CCI, alors que les positions de base sont très proches.
Ce poids du sectarisme sur le milieu politique est l'expression de la rupture occasionnée par 50 ans de contre-révolution, et l'oubli de l'expérience des révolutionnaires du passé sur la question du regroupement et de la formation du parti communiste, situation encore accentuée à la fin des années 70 par le recul de la lutte de classe. Cependant parce que le milieu politique n'est pas un reflet mécanique de la lutte de classe mais l'expression d'une volonté consciente de celle-ci de lutter contre les faiblesses qui la marquent, la volonté des différents groupes du milieu politique de s'engager résolument dans la dynamique de clarification, avec en perspective le nécessaire regroupement des forces révolutionnaires, est l'expression concrète de leur clarté politique sur leur immense responsabilité dans la période historique présente.
Dans ces conditions l'appel de Battaglia Comunista à la tenue de conférences des groupes de la Gauche communiste, après une longue période de très grande discrétion de ce groupe sur la scène internationale, marque une évolution positive pour l'ensemble du milieu qui, avec le recul momentané de la lutte ouvrière, subit fortement le poids du sectarisme et de la dispersion.
Dans la deuxième partie de cet article nous verrons comment s'est située l'évolution du milieu politique à la fin des années 70 et durant les années 80, évolution marquée par la tenue des conférences et leur échec final, la crise que cette situation ouvre au sein du milieu et la brutale décantation qui en résulte et qui se traduit notamment par l'éclatement du PCI, et comment ce milieu va réagir face au développement d'une nouvelle vague de lutte de classe à partir de 1983 et aux responsabilités que cela implique pour les révolutionnaires.
JJ. 7/3/88
[1] [134] Remarque préliminaire: Il est évident que dans le cadre de ces notes il n'est pas possible de retracer l'itinéraire et les positions de tous les groupes mentionnés dans cet article et dont beaucoup ont d'ailleurs rejoint les poubelles de l'histoire. Nous nous bornerons donc à faire référence aux groupes de la tradition de la gauche communiste et à ceux toujours existants.
[2] [135] "Spartakusbond": voir Revue Internationale n*38 et 39. Sur la •gauche hollandaise", voir Revue Internationale n*30, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52.
[3] [136] "Partito Comunista Internazionalista", fondé en 1945, qui publie Battaglia Comunista et Prometeo: voir, entre autres, Revue Internationale n*36, 40 et 41. Adresse: Prometeo, Caselia Postale 1753, 20100 Milano, Italie.
[4] [137] "Parti Communiste International", scission en 1952 du précédent, qui publie en France Le Prolétaire et Programme Communiste. Voir Revue Internationale n'32, 33, 34, 38.
[5] [138] Bilan, publication de la "gauche italienne", formée en 1928, publié de 1333 à 1938. Voir la brochure du CCI La Gauche Communiste d'Italie. Voir Revue Internationale n°47
[6] [139] Internationalisme, publication de la Gauche Communiste de France, 1945-1952. Voir les rééditions d'articles dans la Revue Internationale. Voir La Gauche communiste d’ltalie,
[7] [140] "Ferment Ouvrier Révolutionnaire", qui publie Alarme, BP329,
Ï5624 PARIS Cedex 13. Voir Revue Internationale nf52.
[8] [141] Sur le "modernisme", voir Revue Internationale n'34.
[9] [142] Sur le "conseillisme", voir Revue Internationale n#37, 40, 41.
[10] [143] Voir la Revue Internationale n°40: "10 ans de CCI". Voir les différentes publications territoriales du CCI au dos de cette revue.
[11] [144] GC1, BP 54, BXL 31 Bruxelles, Belgique. Voir Revue Internationale n°48, 49, 50, sur la décadence du capitalisme.
[12] [145] CWO, PO Box 145, Head Post Office, Glasgow, Grande-Bretagne. Voir Revue Internationale n°39, 40, 41.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [119]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [66]
Décadence du capitalisme guerre, militarisme et blocs impérialistes (2eme partie)
- 3448 lectures
Dans la première partie de cet article nous mettions en évidence le caractère parfaitement irrationnel de la guerre dans la période de décadence du capitalisme. Alors qu'au siècle dernier, malgré les destructions et les Massacres qu'elles occasionnaient, les guerres constituaient un moyen de la marche en avant du mode de production capitaliste favorisant la conquête du marché mondial et stimulant le développement des forces productives de l'ensemble de la société, les guerres du 20ème siècle ne sont plus que l'expression extrême de toute la barbarie dans laquelle la décadence capitaliste plonge cette même société. Cette partie de l'article soulignait en particulier que les guerres mondiales, mais aussi les multiples guerres "locales", de même que toutes les dépenses militaires englouties dans leur préparation et leur entretien, ne sauraient nullement être considérées comme des "faux frais" du développement de l'économie capitaliste mais s'inscrivent de façon uniquement négative dans le bilan d'ensemble de celle-ci: résultat majeur des contradictions insolubles qui minent cette économie, elles constituent un facteur puissant d'aggravation et d'accélération de son effondrement. En fin de compte, la parfaite absurdité de la guerre aujourd'hui s'illustre de façon éclatante avec le fait qu'une nouvelle guerre généralisée, qui est la seule perspective que le capitalisme soit en mesure pour sa part de proposer malgré toutes les campagnes pacifistes actuelles, signifierait tout simplement la destruction de l'humanité.
Une autre illustration du caractère complètement irrationnel et absurde de la guerre dans la période de décadence du capitalisme, comme manifestation de l'absurdité même que représente pour l'ensemble de la société la survivance de ce système, est constituée par le fait que le bloc qui, en dernier ressort, déclenche la guerre mondiale est justement celui qui en sort "vaincu" (si tant est qu'on puisse considérer qu'il y a un "vainqueur"). C'est ainsi qu'en août 1914 c'est directement l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie qui déclarent la guerre aux pays de l'Entente. De même en septembre 1939, c'est l'invasion de la Pologne par l'Allemagne qui déclenche les hostilités en Europe alors que c'est le bombardement de la flotte américaine à Pearl Harbor en décembre 1941 par le Japon qui se trouve à l'origine immédiate de l'entrée en guerre des Etats-Unis.
LA DEMARCHE "SUICIDAIRE" DU CAPITALISME DECADENT
Cette démarche "suicidaire" des pays qui allaient en fin de compte être les principaux perdants de la conflagration mondiale ne peut évidemment pas s'expliquer par la "folie" de leurs dirigeants. En réalité, cette apparente "folie" dans la conduite des affaires de ces pays, n'est pas autre chose que la traduction de la "folie" générale du système capitaliste aujourd'hui; cette démarche "suicidaire", c'est avant tout celle du capitalisme dans son ensemble depuis qu'il est entré dans sa période de décadence, et qui ne fait que s'aggraver à mesure qu'il s'enfonce dans cette décadence. Plus précisément, la conduite "irrationnelle" des futurs "perdants" des guerres mondiales ne fait qu'exprimer deux réalités:
- le caractère inéluctable, lorsque fait dé faut l'obstacle de la lutte prolétarienne, de la guerre généralisée comme aboutissement de l'exacerbation des contradictions économiques du mode de production capitaliste;
- le fait que la grande puissance qui "pousse" le plus vers l'affrontement général soit la moins bien lotie dans le partage du butin impérialiste et qui trouve le plus grand intérêt dans la remise en cause de ce partage.
Le premier point fait partie du patrimoine "classique" du marxisme depuis le début du siècle. Il est un des fondements de toute la perspective de notre organisation pour la période actuelle et il a été amplement développé dans d'autres articles de notre presse. Ce qu'il importe de souligner plus particulièrement ici, c'est l'absence d'un réel contrôle de ce phénomène de la part de la classe dominante. De même que tous les efforts, toutes les politiques de la bourgeoisie en vue de surmonter la crise de l'économie capitaliste ne peuvent empêcher celle-ci de s'aggraver de façon inexorable, toutes les gesticulations des gouvernements, même lorsqu'elles visent "sincèrement" à préserver la paix, ne peuvent enrayer l'engrenage qui conduit le monde vers la boucherie impérialiste généralisée, le deuxième phénomène découlant d'ailleurs du premier.
En effet, devant l'impasse totale où se trouve le capitalisme et la faillite de tous les "remèdes" économiques, aussi brutaux qu'ils soient, la seule voie qui reste ouverte à la bourgeoisie pour tenter de desserrer l'étau de cette impasse est celle d'une fuite en avant avec d'autres moyens - eux aussi de plus en plus illusoires d'ailleurs - qui ne peuvent être que militaires. Depuis plusieurs siècles déjà, la force des armes est un des instruments essentiels de la défense des intérêts du capitalisme: c'est par les guerres coloniales en particulier que ce système s'est ouvert le marché mondial, que chaque puissance bourgeoise s'est constitué son "pré carré" lui permettant d'écouler ses marchandises et de se fournir en matières premières. Ce qu'exprimait l'explosion du militarisme et des armements dès la fin du siècle dernier, c'est l'achèvement de ce partage du marché mondial entre les grandes (et même les petites) puissances bourgeoises. Désormais, pour chacune d'entre elles, un accroissement (et partant la préservation) de sa part du marché passait nécessairement par un affrontement avec les autres puissances, et les moyens militaires qui suffisaient pour mettre au pas des populations indigènes munies de flèches et de lances devaient être plus que décuplés pour faire face à ceux des autres nations industrielles. Depuis cette époque, et même si la colonisation a fait place à d'autres formes de domination impérialiste, ce phénomène n'a fait que s'amplifier jusqu'à acquérir des proportions monstrueuses transformant complètement ses rapports avec l'ensemble de la société.
En effet, dans la décadence capitaliste, il en est de la guerre et du militarisme comme des autres instruments de la société bourgeoise et notamment de son Etat. A l'origine, ce dernier apparaît en tant que simple instrument de la société civile (de la société bourgeoise dans le cas de l'Etat bourgeois) pour assurer un certain "ordre" en son sein et empêcher que les antagonismes qui la divisent ne l'amènent à sa dislocation. Avec l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence, avec l'amplification des convulsions du système, se développe le phénomène du capitalisme d'Etat où ce dernier acquiert un poids sans cesse croissant jusqu'à absorber l'ensemble de la société civile, à devenir le principal, sinon le seul, patron. Même si l'Etat continue d'être un organe du capitalisme, et non l'inverse, en tant que représentant suprême de ce système, que garant de sa préservation, il tend à échapper au contrôle immédiat des différents secteurs de la classe bourgeoise dans la plupart de ses fonctions, pour imposer à celle-ci ses propres nécessités globales et sa propre logique totalitaire. Il en est de même du militarisme qui constitue une composante essentielle de l'Etat et dont le développement est justement un des facteurs majeurs de l'intensification du phénomène du capitalisme d'Etat. A l'origine simple moyen de la politique économique de la bourgeoisie, il acquiert avec l'Etat, et au sein de l'Etat, un certain niveau d'autonomie et tend de plus en plus, avec l'amplification de son rôle dans la société bourgeoise, à s'imposer à celle-ci et à l'Etat.
Cette tendance à la colonisation de l'appareil étatique par la sphère militaire s'illustre en particulier par l'importance du budget des armées dans le budget total des Etats (c'est en général le budget le plus élevé), mais pas uniquement. En fait, c'est l'ensemble de la conduite des affaires de l'Etat qui subit de façon massive l'emprise du militarisme. Dans les pays les plus faibles, cette emprise prend souvent la forme extrême de dictatures militaires, mais elle n'est pas moins effective dans les pays où c'est le personnel spécialisé des politiciens qui dirige l'Etat, de même que l'emprise du capitalisme d'Etat n'est pas moins forte là où, contrairement aux pays prétendus socialistes, il n'y a pas identification complète entre l'appareil politique et l'appareil économique du capital. D'ailleurs, même dans les pays les plus développés, les exemples ne manquent pas, depuis la première guerre mondiale, de la participation de militaires aux instances suprêmes de l'Etat: rôle éminent du Général Groener, premier quartier-maître général, comme inspirateur de la politique du chancelier social-démocrate Ebert dans la répression de la Révolution allemande en 1918-19, élection du Maréchal Hindenburg à la présidence de la République en 1925 et 1932 (c'est lui qui fera appel à Hitler dans la fonction de chancelier en 1933), nomination à la tête de l'Etat français du maréchal Péta in en 1940 et du général De Gaulle en 1944 puis en 1958, élection du général Eisenhower comme président des Etats-Unis en 1952 et 1956, etc. De plus, alors que, dans le cadre de la "Démocratie", le personnel et les partis politiques sont amenés à changer au sommet de l'Etat, 1'état-major et la hiérarchie militaire bénéficient d'une remarquable stabilité, ce qui ne peut que renforcer leur pouvoir réel.
Du fait de cette domination du militarisme dans la vie politique, à mesure que les "solutions" à la crise préconisées et mises en oeuvre par les appareils économiques et politiques de la société bourgeoises font la preuve de leur impuissance, les "solutions" spécifiques dont les appareils militaires sont les promoteurs tendent à s'imposer de façon croissante. C'est en ce sens, par exemple, qu'on peut comprendre l'accession au pouvoir du parti nazi en 1933: ce parti représentait avec le plus de détermination l'option militaire face à la catastrophe économique qui sévissait de façon particulièrement aiguë en Allemagne. Ainsi, à mesure que s'enfonce le capitalisme dans sa crise, s'impose à lui de façon croissante, irréversible et incontrôlable, la logique du militarisme, même si celui-ci n'est pas plus capable que les autres politiques de proposer (comme on l'a vu dans la première partie de cet article) la moindre solution aux contradictions économiques du système. Et cette logique du militarisme, dans un contexte mondial où tous les pays sont dominés par elle, où le pays qui ne prépare pas la guerre, qui n'emploie pas les moyens militaires lorsqu'ils "s'imposent", devient la "victime" des autres pays, ne peut conduire qu'à la guerre généralisée même si celle-ci ne saurait apporter à tous les belligérants que massacres et ruines, et même la destruction totale.
Cette pression inéluctable vers l'affrontement généralisé s'exerce d'autant plus fort sur les grandes puissances que celles-ci sont moins bien pourvues dans le partage du butin impérialiste alors que les mieux loties ont beaucoup plus intérêt à préserver le statu quo. C'est pour cela que lors de la première guerre mondiale, les deux puissances qui poussent le plus vers la guerre sont la Russie et surtout l'Allemagne et que le bloc qui engage le conflit est celui dominé par cette dernière laquelle se trouve avec un empire colonial de moindre envergure que ceux de la Belgique et du Portugal alors qu'elle est devenue la première puissance économique d'Europe. Cette situation est encore plus nette lors de la deuxième guerre mondiale où la situation de l'Allemagne s'est encore aggravée du fait des conditions du traité de Versailles de 1919 qui l'a dépouillée de ses rares possessions coloniales de même que d'une partie de "son" territoire national. De même, le Japon détruit la flotte américaine du Pacifique en 1941 dans l'espoir d'élargir dans cet océan un empire colonial qu'il estime insuffisant, compte tenu de sa nouvelle puissance économique, avec la seule Mandchourie acquise en 1937 au détriment de la Chine. Ainsi, les brigands impérialistes qui précipitent la guerre du fait de l'étroitesse de leur "espace vital" sont finalement les moins bien lotis pour la gagner:
- parce qu'ils disposent de moindres assises territoriales et économiques que leurs adversaires;
- parce que leur offensive, dans un monde entièrement partagé entre les grandes puissances bourgeoises, ne peut que souder entre elles celles qui sont déjà "installées" (comme c'est par exemple le cas de la France et de la Grande-Bretagne dont les rivalités en Afrique de la fin du 19ème siècle sont finalement surmontées face à la menace commune que représente l'Allemagne).
Par bien des côtés, l'URSS et son bloc se trouvent aujourd'hui dans une situation similaire à celle de l'Allemagne et de ses alliés en 1914 et 1939. En particulier, la cause première de la situation dont pâtissent l'une et l'autre de ces deux puissances est leur accession tardive au développement industriel et au marché mondial qui les a contraintes de se contenter des miettes laissées par les puissances industrielles plus anciennes (comme la France et la Grande-Bretagne notamment) lors de leur partage du gâteau impérialiste. Cependant, il faut noter une différence importante entre l'URSS d'aujourd'hui et l'Allemagne du passé. Si, comme l'Allemagne en 1914 et 1939, l'URSS est aujourd'hui la 2ème puissance économique du monde (bien qu'en termes de PNB elle soit passée derrière le Japon) elle se distingue de ce pays par le fait qu'elle ne dispose nullement d'une économie et d'une industrie à 1'avant-garde du développement. Bien au contraire: elle accuse dans ce domaine un retard considérable et insurmontable. C'est là on des phénomènes majeurs de la décadence capitaliste: l'impossibilité pour les capitaux nationaux nouveaux venus de se hisser au niveau de développement des puissances "installées". L'essor industriel de l'Allemagne prend place au moment (fin du 19ème siècle) où le capitalisme connaît sa plus grande prospérité ce qui permet de faire de l'économie de ce pays la plus moderne du monde au moment où le capitalisme entre en décadence. L'essor industriel de la Russie actuelle, après les terribles destructions de la première guerre mondiale et de la guerre civile qui a suivi la révolution, prend place au contraire en pleine période de décadence (la fin des années 20 et les années 30): de ce fait, ce pays n'est jamais parvenu à sortir réellement de son sous-développement et compte parmi les plus arriérés du bloc qu'il domine ([1] [146]).
Ainsi, à la moindre extension de son empire s'ajoute, pour l'URSS, une faiblesse économique et financière énorme par rapport à son rival occidental. Ce décalage économique est encore plus évident au niveau de l'ensemble des deux blocs: ainsi parmi les 8 premières puissances mondiales (en termes de PNB), 7 (l'URSS se trouvant en 2ème position) font partie de l'OTAN ou sont, comme le Japon, des alliés sûrs des Etats Unis. En revanche, les alliés de l'URSS au sein du pacte de Varsovie se situent respectivement aux 11ème, 13ème, 19ème, 32ème, 40ème et 55ème positions. Cette faiblesse se répercute sur toute une série de domaines dans la période actuelle.
Une des conséquences primordiales de la supériorité économique du bloc occidental, et notamment des Etats-Unis, consiste dans la variété des moyens dont il dispose pour asseoir et maintenir sa domination impérialiste. Ainsi, les Etats Unis peuvent établir leur domination aussi bien sur des pays gouvernés par des régimes "démocratiques", que sur des pays aux mains de l'armée, de partis uniques, et même de partis de type stalinien. L'URSS, par contre, n'arrive à contrôler que des régimes directement à son image (et encore!) ou des régimes militaires dépendant directement du soutien des troupes du bloc.
De même, le bloc occidental peut faire, à côté de la carte militaire, un large usage de la carte économique dans le contrôle de ses dépendances (aides bilatérales, intervention d'organismes comme le FMI, la Banque mondiale, etc.). Ce n'est pas le cas de l'URSS qui n'a pas, et n'a jamais eu, les moyens de jouer une telle carte. C'est uniquement à la force militaire que cette puissance doit la cohésion de son bloc.
Ainsi, la faiblesse économique d'ensemble du bloc russe explique sa situation stratégique nettement défavorable à l'échelle mondiale: le registre limité de ses moyens ne lui a jamais permis de se dégager vraiment de l'encerclement que fait peser sur lui le bloc américain. Elle explique également que même sur le terrain strictement militaire - qui est le seul qui lui reste - il n'ait pas de possibilité de s'affronter victorieusement à son rival.
En effet, alors que l'Allemagne du début du siècle ou des années 30 avait pu, grâce à son potentiel industriel moderne, prendre momentanément, avant les affrontements décisifs, une certaine avance militaire sur les pays dont elle contestait l'hégémonie, l'URSS et son bloc, du fait de leur arriération économique et technologique, ont toujours été en retard sur le bloc américain du point de vue des armements. De plus, ce retard est aggravé par le fait que, depuis la seconde guerre mondiale -comme manifestation de l'accentuation constante des grandes tendances de la décadence capitaliste- le monde entier n'a pas bénéficié d'un seul instant de répit dans le domaine des conflits locaux et des préparatifs militaires contrairement à ce qui avait prévalu à la suite de la première guerre mondiale.
Depuis la seconde guerre mondiale, l'URSS n'a pu donc que courir derrière -bien loin- la puissance militaire du bloc de l'Ouest sans jamais parvenir à l'égaler ([2] [147]). Les énormes efforts qu'elle a consacrés à ses armements, notamment dans les années 60-70, s'ils lui ont permis d'atteindre une certaine parité dans quelques domaines (notamment la puissance de feu nucléaire) ont eu comme résultat une aggravation encore plus dramatique de son retard industriel et de sa fragilité face aux convulsions de la crise économique mondiale. En revanche, ils ne lui ont pas permis de préserver les positions (à l'exception de l'Indochine) que les guerres de décolonisation (menées contre des pays du bloc de l'Ouest) lui avaient permis de conquérir en Asie (Chine) ou en Afrique (Egypte notamment).
Au tournant des années 70 et 80, se produit une modification importante du contexte général dans lequel se sont déployés les conflits impérialistes depuis la fin de la guerre froide. A la base de cette modification se situe la mise en évidence de plus en plus nette de l'impasse totale de l'économie capitaliste dont la récession de 81-83 constitue une illustration particulièrement claire. Cette impasse économique ne peut qu'accentuer de façon très importante la fuite en avant de tous les secteurs de la bourgeoisie mondiale dans une marche vers la guerre (voir en particulier l'article "Années 80, les années de vérité", in Revue Internationale n° 20, 1er trimestre 1980).
L'OFFENSIVE DU BLOC AMERICAIN
Dans ce contexte on assiste à une modification qualitative de l'évolution des conflits impérialistes. Sa caractéristique majeure consiste dans une offensive générale du bloc américain contre le bloc russe. Une offensive dont Carter, avec le lancement de sa campagne sur les "droits de l'homme" et les décisions essentielles sur le plan des armements (système de fusées nucléaires NX, construction des euromissiles, constitution de la force d'intervention rapide), avait jeté les bases et qui s'est déployée avec le mandat de Reagan notamment avec des augmentations considérables des budgets militaires, l'envoi des corps expéditionnaires US au Liban en 82, à la Grenade en 84, la décision de développer le dispositif de la "Guerre des étoiles" et, plus récemment, les bombardements de la Libye par l'US Air Force et le déploiement de l'US Navy dans le golfe persique.
Cette offensive vise à parachever l'encerclement de l'URSS par le bloc occidental, à dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct. Elle passe par une expulsion définitive de l'URSS du Moyen-Orient, d'ores et déjà réalisée avec l'insertion de la Syrie au milieu des années 80, dans les plans impérialistes occidentaux, par une lise au pas de l'Iran et la réinsertion de ce pays dans le bloc US comme pièce importante de son dispositif. Elle a pour ambition de se poursuivre par une récupération de l'Indochine. Elle vise en fin de compte à étrangler complètement l'URSS, à lui retirer son statut de puissance mondiale.
Une des caractéristiques majeures de cette offensive, c'est l'emploi de plus en plus massif par le bloc US de sa puissance militaire notamment par l'envoi de corps expéditionnaires américains ou d'autres pays centraux du bloc (France, Angleterre et Italie notamment) sur le terrain des affrontements, comme on a pu le voir en 1982 au Liban, dans le golfe persique en 1987. Cette caractéristique correspond au fait que la carte économique employée abondamment par le passé pour mettre la main sur les positions de l'adversaire ne suffit plus:
- du fait des ambitions présentes du bloc US;
- du fait de l'aggravation de la crise mondiale elle-même -qui crée une situation d'instabilité interne dans les pays du Tiers-monde sur lesquels s'appuyait auparavant le bloc US.
Sur ce point, les événements d'Iran ont été un révélateur. L'effondrement du régime du Shah et la paralysie que cela a occasionné pour le dispositif américain dans cette région ont permis à l'URSS de marquer des points en Afghanistan en installant ses troupes à quelques centaines de kilomètres des "mers chaudes" de l'océan Indien. Ils ont convaincu la bourgeoisie américaine de mettre sur pied sa force d'intervention rapide (et lui ont permis de faire "avaler" facilement cette décision à la population traumatisée par l'exploitation de l'affaire des otages de l'ambassade américaine de Téhéran en 1980) et de réorienter sa stratégie impérialiste.
Ainsi, la situation présente se différencie de celle qui a précédé la 2ème guerre mondiale par le fait que c'est maintenant»le bloc le mieux loti qui est à l'offensive:
- du fait que ce bloc dispose d'une énorme supériorité militaire et notamment d'une très grande avance technologique;
- du fait qu'en se prolongeant beaucoup plus longtemps que lors des années 30, sans qu'elle puisse déboucher sur un conflit généralisé, la crise prolonge et provoque un déploiement beaucoup plus vaste des préparatifs à un tel conflit, préparatifs pour lesquels, évidemment, le bloc économiquement le plus puissant est le mieux armé.
Cependant, cela ne veut pas dire que soit remis en cause le fait que ce soit le bloc le plus défavorisé qui déclenche en fin de compte le conflit généralisé. Pour l'URSS, les enjeux sont considérables. Pour ce pays, c'est une question de vie ou de mort qui est au bout de l'offensive actuelle du bloc US. Finalement, si le bloc américain peut poursuivre jusqu'au bout son offensive actuelle (ce qui suppose qu'il ne soit pas entravé par la lutte de classe) il ne restera à l'URSS pas d'autre alternative que de faire appel aux terribles moyens de la guerre généralisée:
- parce que, en règle générale, un bloc ne capitule jamais avant d'avoir usé de tous les moyens militaires dont il dispose (sauf s'il y est contraint par la lutte de classe);
- parce qu'une capitulation de l'URSS signifierait l'effondrement du régime et la dépossession complète de l'actuelle bourgeoisie du fait qu'elle est complètement intégrée à l'Etat (contrairement à la bourgeoisie allemande qui pouvait s*accommoder d'une victoire des Alliés et d'un changement de régime politique).
Si, en fin de compte, le schéma qui a prévalu en 1914 et en 1939 reste donc aujourd'hui valable sur l'essentiel (c'est le bloc le plus défavorisé dans le partage impérialiste qui fait le pas décisif), il faut s'attendre dans la période qui vient à une avancée progressive du bloc US qui va continuer à marquer des points (contrairement aux années 30 où c'est l'Allemagne qui a marqué des points: Anschluss en 37, Munich en 38, Tchécoslovaquie en 39...).
Face à cette avancée, il faut s'attendre à une résistance pied à pied, acharnée de la part du bloc russe partout ou il peut opposer une telle résistance, ce qui va se traduire par une poursuite et une intensification des confrontations militaires dans lesquelles le bloc US va s'engager de plus en plus directement. En ce sens, la carte diplomatique, si elle continuera à être jouée, tendra de plus en plus à être le résultat d'un rapport de forces obtenu au préalable sur le terrain militaire.
C'est bien d'ailleurs ce qui en est advenu encore récemment avec la signature, le 8 décembre 87, de l'accord de Washington entre Reagan et Gorbatchev sur les missiles "de portée intermédiaire (entre 500 et 5500 km) et des négociations qui se poursuivent à l'heure actuelle à propos d'un éventuel retrait des troupes russes de l'Afghanistan.
Dans ce dernier cas, si un tel retrait se produit, il résultera de l'impasse dans laquelle s'est lise c l'URSS dans ce pays depuis notamment que les Etats-Unis fournissent abondamment la guérilla en armements ultramodernes comme les missiles sol-air "Stinger" qui provoquent des dégâts considérables parmi les avions et les hélicoptères russes.
Pour ce qui concerne les accords de Washington sur l'élimination des "euromissiles", il faut relever qu'ils sont aussi un résultat de la pression militaire exercée par les Etats-Unis et leur bloc sur le bloc adverse, notamment l'installation des fusées "Pershing II" et des "missiles de croisière" dans différents pays d'Europe occidentale (Grande-Bretagne, RFA, Pays-Bas, Belgique et Italie) à partir de novembre 83. Le fait que cet accord résulte principalement d'une initiative russe et que le nombre de missiles et de têtes nucléaires supprimés par l'URSS soit bien plus élevé que du côté américain (857 missiles et 1667 têtes contre 429 missiles et autant de têtes) illustre que c'est bien l'URSS qui se trouve en position de faiblesse (notamment du fait que ses fusées SS20 sont bien moins précises que les Pershing II, qui peuvent frapper à moins de 40 mètres du but des cibles distantes de 1800 km, sans parler des "missiles de croisière" qui, après 3000 km de vol, sont encore bien plus précis).
Pour le chef de file du bloc de l'Ouest, l'opération est d'autant plus intéressante que le retrait de ses propres "euromissiles" n'implique ni le retrait, ni -. l'arrêt du déploiement de ceux de ses alliés: en ; fait, derrière l'accord de Washington, il y a la volonté des Etats-Unis de reporter vers les pays européens une partie du fardeau militaire. Cette plus grande implication de ces pays dans l'effort de défense de leur bloc s'est d'ailleurs illustrée durant l'été 87 de façon on ne peut plus significative par leur participation, souvent massive, à l'Armada occidentale déployée dans le golfe persique. Elle s'est confirmée clairement fin 87 avec la décision franco-britannique de construire en commun un missile nucléaire air-sol de plus de 500 km de portée de même qu'avec les manoeuvres militaires conjointes franco-allemandes préfigurant une plus grande intégration des armées des deux pays concernés et, à terme, de l'ensemble des pays d'Europe de l'Ouest. Elle s'est confirmée une nouvelle fois au dernier "sommet" de l'OTAN, début mars 88, où les membres de cette alliance, c'est-à-dire principalement les pays d'Europe occidentale, se sont engagés à moderniser régulièrement leurs armements (en fait à accroître encore leurs dépenses militaires).
Ainsi, les accords de Washington ne signifient nullement une remise en cause des caractéristiques générales des antagonismes inter impérialistes qui dominent le monde à l'heure actuelle. En particulier, la suppression des "euromissiles" ne constitue qu'une petite égratignure dans la phénoménale capacité de destruction dont disposent les grandes puissances. Malgré l'effroyable potentiel de destruction que représentent les 2100 bombes atomiques appelées à être éliminées (chacune plus puissante que celle qui a détruit Hiroshima en août 1945), cela ne constitue qu'une petite partie des quelques 40000 bombes qui restent prêtes à être expédiées par des missiles de toutes sortes installés à terre ou à bord d'avions, de sous-marins et de navires; sans compter tous les obus nucléaires (probablement des dizaines de milliers) que 6800 canons peuvent tirer.
LA CLASSE OUVRIERE DOIT COMBATTRE LES ILLUSIONS PACIFISTES
Si les accords de Washington n'impliquent aucune réduction sensible du formidable potentiel de destruction entre les mains des grandes puissances, ils ne signifient pas non plus l'ouverture d'une quelconque perspective de désarmement et de liquidation de la menace d'une guerre mondiale. Le "réchauffement" présent des relations entre les deux "grands", les amabilités échangées entre Reagan et Gorbatchev qui tranchent avec les échanges d'insultes d'il y a quelques années, n'indiquent nullement que la "raison" soit en train de l'emporter dans les relations internationales au détriment de la "folie" que représente l'affrontement entre puissances.
"En réalité, les discours pacifistes, les grandes manoeuvres diplomatiques, les conférences internationales de toutes sortes ont toujours fait partie des préparatifs bourgeois en vue de la guerre impérialiste (corne l’ont démontré par exemple les accords de Munich en 1938, un an avant le déchaînement de la seconde guerre mondiale). Ils interviennent en général en alternance avec les discours bellicistes et ont une fonction complémentaire. Alors que ces derniers ont pour objet de faire accepter à la population, et en particulier à la classe ouvrière, les sacrifices économiques commandés par l'explosion des armements, de la préparer à la mobilisation générale, les premiers ont pour objet de permettre à chaque Etat d'apparaître comme 'celui qui veut la paix', qui n'est pour rien dans l'aggravation des tensions, afin de pouvoir justifier par la suite la 'nécessité' de la guerre contre 'l'autre qui en porte toute la responsabilité". (Résolution sur la situation internationale du 7èrae congrès du CCI, Revue Internationale n°51, p.10) On pourrait même préciser que l'exemple de la conférence de Munich, qui avait été présentée comme un "grand pas vers la paix en Europe" après toute une période de développement des tensions diplomatiques et de déploiement des discours bellicistes, nous a enseigné que les phases "pacifistes" de la propagande bourgeoise ne signifient nullement que le danger de guerre soit moins imminent qu'au moment des phases "bellicistes". C'est tout le contraire qui est vrai: en réalité la fonction spécifique de chacun des deux types de campagnes conduit à justement utiliser les discours pacifistes à la veille même du déchaînement des conflits, afin de mieux pouvoir surprendre la classe ouvrière et paralyser toute résistance de sa part, alors que les discours pacifistes correspondaient à la phase antérieure de développement des armements.
Même si le déchaînement d'une troisième guerre mondiale n'est pas actuellement à l'ordre du jour du fait que le prolétariat d'aujourd'hui n'a pas été défait mais se trouve au contraire dans une période historique de développement de ses luttes, "c'est bien à une telle alternance entre discours bellicistes et discours pacifistes que nous avons assisté ces dernières années de la part de l'administration Reagan dont le 'jusqu'auboutisme' des premières années de son Mandat, destiné à justifier les énormes accroissements des dépenses militaires ainsi que diverses interventions à l'extérieur (envoi des corps expéditionnaires américains au Liban et à la Grenade en 82-83, etc.), a fait place à 1"ouverture' face aux initiatives soviétiques dès lors qu'était acquise et raffermie la nouvelle orientation d'accroissement des préparatifs militaires et qu'il convenait de faire preuve de 'bonne volonté'". (Ibid)
Le fait que le principal "destinataire" de ces différentes campagnes soit le prolétariat mondial est notamment illustré par le moment où chacune d'entre elles s'est développée. En effet, le point culminant de la campagne belliciste prend place au début des années 80 alors que la classe ouvrière a subi une importante défaite concrétisée et aggravée par la répression des ouvriers de Pologne en décembre 81. Ce qui momentanément domine au sein de la classe ouvrière c'est un sentiment d'impuissance et une forte désorientation. Dans ce contexte, les campagnes bellicistes promues par les gouvernements, les discours de guerre quotidiens, s'ils développent parmi les ouvriers une inquiétude justifiée face aux perspectives terribles que le système propose à toute l'humanité, ont finalement pour principal résultat d'accroître encore leur sentiment d'impuissance, leur désarroi, et d'en faire des "proies" plus faciles pour les grandes manifestations pacifistes de diversion organisées par les forces de gauche dans l'opposition. Pour sa part, la campagne pacifiste promue par les gouvernements occidentaux derrière le "chef d'orchestre" Reagan prend son essor en 84 juste après que toute une série de luttes massives en Europe aient fait la preuve que la classe ouvrière était sortie de son désarroi momentané et quelle reprenait confiance en elle-même. Dans ces conditions, l'inquiétude résultant des discours guerriers est beaucoup moins en mesure de développer un sentiment d'impuissance parmi les ouvriers. En revanche, elle risque d'accélérer parmi eux la prise de conscience du fait que leurs luttes présentes contre les attaques économiques du capitalisme constituent le seul obstacle véritable à un déchaînement de la guerre mondiale, qu'elles sont des préparatifs vers le renversement de ce système barbare. C'est justement à conjurer ce "risque" que les campagnes pacifistes visent aujourd'hui. Ne pouvant plus faire accepter avec fatalisme aux ouvriers la perspective d'un nouvel accroissement des conflits impérialistes et les effroyables implications contenues dans une telle perspective, il s'agit maintenant pour la bourgeoisie de tenter de les endormir, de leur faire croire que la "sagesse" des dirigeants du monde est en mesure de mettre un terne définitif à la menace d'une troisième guerre mondiale.
Ainsi, l'idée essentielle qu'avec des arguments différents ces deux types de campagnes se proposent d'ancrer dans la tête des ouvriers, c'est que les questions fondamentales de la vie de la société, et en particulier la question de la guerre, se jouent en dehors de toute possibilité pour le prolétariat d'y apporter sa propre réponse en tant que classe. C'est justement l'idée opposée que les révolutionnaires doivent défendre de façon permanente en intervenant dans la classe ouvrière: toutes les "conférences", tous les "accords" entre brigands impérialistes, toute la "sagesse" des hommes d'Etat n'y feront rien: seule la classe ouvrière peut empêcher que la crise actuelle du capitalisme ne débouche sur une troisième guerre mondiale et donc sur la destruction de l'humanité, seule la classe ouvrière, en renversant le capitalisme, peut libérer la société du fléau des guerres.
Aujourd'hui, alors que la bourgeoisie occidentale fait tout son possible pour masquer la véritable gravité de l'envoi de sa formidable armada dans le golfe persique -qui porte en elle la perspective d'une intensification considérable des tensions entre les grandes puissances-, alors qu'elle présente les décisions du dernier sommet de l'OTAN comme un appel à la poursuite du désarmement et à l'atténuation de ces tensions alors qu'en fait c'est un renforcement des armements et une aggravation de celles-ci qu'elles contiennent, alors que Gorbatchev se fait partout et ostensiblement le "grand champion de la paix", il appartient aux révolutionnaires de rappeler et souligner, comme se le proposait cet article, les dimensions et le caractère inéluctable, au sein du capitalisme, de la barbarie dans laquelle ce système a plongé et plongera de plus en plus la société. Il leur appartient en même temps de renforcer leur dénonciation de toutes les illusions pacifistes en poursuivant le combat engagé par leurs aînés depuis le début de ce siècle:
"Les formules du pacifisme: désarmement universel sous le régime capitaliste, tribunaux d'arbitrage, etc., apparaissent non seulement comme une utopie réactionnaire mais encore comme une véritable duperie des travailleurs, tendant à désarmer le prolétariat et à le distraire de sa tâche qui est le désarmement des exploiteurs." (Lénine, Programme du Parti Bolchevik, mars 1919)
F.M.
[1] [148] Notre revue, à plusieurs reprises (voir en particulier le "Rapport sur la situation internationale" du 3ème Congrès du CCI dans le n°18 et "A propos de la critique de la théorie du "maillon faible" dans le n°37), a mis suffisamment en évidence l'arriération considérable dont n'arrive pas à se défaire l'URSS pour qu'il soit nécessaire d'y revenir ici.
[2] [149] C'est d'ailleurs un des éléments qui expliquent que les conflits de la "guerre froide" de la fin des années 40 et du début des années 50 n'aient pu dégénérer en conflagration mondiale: les échecs de l'URSS dans ses tentatives à Berlin (blocus de Berlin-Ouest entre avril 48 et mai 49 déjoué par un pont aérien ais en place par les Occidentaux) et en Corée (invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord en juin 50 qui doit faire face à l'envoi des troupes américaines et aboutit en juillet 53 à un armistice par lequel la Corée du Nord perd une partie de son territoire) lui ont démontré, dès cette époque, qu'elle n'avait pas les moyens de ses objectifs. Les autres tentatives ultérieures de l'URSS pour améliorer ses positions se sont pour la plupart soldées aussi par des échecs. Il en fut ainsi, par exemple, en 1961, de sa tentative d'installer à Cuba des fusées nucléaires menaçant directement le sol américain et qu'elle a dû abandonner face au blocus naval des Etats-Unis. C'est pour cela que tous les discours sur la prétendue "supériorité* Militaire du Pacte de Varsovie sur l'OTAN, notamment en Europe, ne sont que pure propagande. En 82, la bataille aérienne de la Bekaa au Liban est concluante: quatre-vingt deux avions à zéro en faveur d'Israël, équipé de matériel américain, contre la Syrie équipée de Matériel russe. En Europe, l'OTAN n'a pas besoin d'avoir autant de tanks ou d'avions que le Pacte de Varsovie pour disposer d'une supériorité écrasante.
Questions théoriques:
- Internationalisme [150]
- Guerre [5]
Heritage de la Gauche Communiste:
Correspondance internationale : adresse au milieu prolétarien et à la classe ouvrière (GPI, Mexique)
- 2683 lectures
Présentation
Nous publions ci-dessous le communiqué du Grupo Proletario Internacionalista du Mexique sur l'agression dont il a été victime de la part d'éléments issus de la décomposition du gauchisme. Nous partageons entièrement les positions qui y sont développées et affirmons notre totale solidarité avec le GPI. Alors que de plus en plus se développent les luttes ouvrières sur un terrain de classe, contre les attaques des conditions de vie, contre les blocages et baisses des salaires, contre les licenciements, et ceci dans tous les pays y indus les pays moins développés, alors que de plus en plus ces luttes remettent en question ouvertement l'encadrement syndical, alors que commence à se développer un milieu politique prolétarien résolument internationaliste, qui défend la nécessité des luttes massives de la classe ouvrière et dénonce comme pratiques bourgeoises toutes les formes de syndicalisme, de nationalisme et de terrorisme, le "gauchisme" issu des "guérillas" et de la "libération nationale" qui ont dominé la vie politique en Amérique Latine depuis la fin des années 60, montre son vrai visage. Mon seulement cette idéologie "radicale" de la petite bourgeoisie prônant le terrorisme n'a jamais remis en question en quoi que ce soit la domination étatique de la bourgeoisie, mais l'impuissance d'hier de ses actes terroristes contre l'Etat se convertit aujourd'hui directement en un instrument indispensable de cet Etat contre les véritables groupes communistes, contre les intérêts immédiats et généraux du prolétariat. Ainsi, à peine quelques mois se sont-ils écoulés depuis la sortie de "Révolution mundial", publication du GPI, et en particulier du n°2 dénonçant le caractère bourgeois de cette idéologie gauchiste et l'impasse que constituent pour le prolétariat les guérillas et le terrorisme radical, que la riposte s'est organisée, usant des méthodes de la violence bourgeoise et de la terreur d'Etat contre les éléments prolétariens: torture, vol, intimidation, etc.
Les groupes politiques prolétariens et avec eux toute la GPI, et ceci sans aucune réserve.
Communiqué du Grupo Proletario Internacionalista ( Mexique ) .
Au milieu communiste international,
A la classe ouvrière mondiale,
Le mardi 9 février 1988, la terreur étatique à laquelle le capital soumet la classe ouvrière et ses forces révolutionnaires dans le monde entier s'est manifestée, cette fois, dans l'action de gangsters et de répression que le GPI a vécu des mains d'une des bandes des résidus du gauchisme terroriste du pays.
L'activité contre-révolutionnaire des groupes terroristes et de guérilla a une histoire néfaste dans cette région du monde (tout comme en Amérique Latine et ailleurs):
- comme une des expressions de l'action désespérée et sans perspective de la petite bourgeoisie urbaine et rurale, elle a dominé la scène sociale du pays de la moitié des années 60 jusqu'aux premières années 70, en diffusant dans la classe ouvrière, avec des nuances diverses, l'idéologie réactionnaire du capital;
- comme instrument indirect ou direct du capital quand les premiers signes du réveil du prolétariat se sont manifestés dans cette région -autour de 1973- elle propagea dans les luttes ouvrières l'impasse de l'idéologie contre-révolutionnaire de la terreur facilitant le travail de répression de l'Etat;
- aujourd'hui, alors qu'il ne reste que des résidus caricaturaux et de simples bandes de voleurs de la majorité des groupes terroristes ou de guérilla; maintenant, alors que depuis quelques années la classe ouvrière dans le pays est en train de s'incorporer à la lutte contre le capital que réalisent ses frères de classe dans le monde entier; maintenant, quand une vraie présence politique révolutionnaire dans la région est en train de se former au milieu de grandes difficultés; maintenant, de nouveau commence à s'agiter le fantôme de la "guérilla" et de la "terreur" fournissant là une utilisation beaucoup plus directe de la part de l'Etat de ces groupes en décomposition contre la classe ouvrière et ses forces révolutionnaires.
Un de ces groupes a attaqué plusieurs militants du GPI, en les torturant et en volant au groupe du matériel d'impression, des documents politiques, de la propagande du milieu communiste et les papiers officiels de camarades. Cette bande a répondu ainsi à la dénonciation politique du rôle contre-révolutionnaire du terrorisme et de la guérilla que le GPI a faite dans sa publication Revolucion Mundial; c'est ainsi que dans le futur ces bandes continueront à agir en collaboration directe ou indirecte avec le travail de répression du capital.
Face à l'action de cette bande et aux actions qui, en rapport avec elle, viendront dans le futur, et qui en accord avec la réalité de la lutte de classe constituent une attaque contre le prolétariat, contre ses forces révolutionnaires naissantes dans le pays et contre l'ensemble du milieu communiste international, et qui s'inscrivent en plein dans la logique de l'activité terroriste étatique, le GPI manifeste:
1- La réitération de sa dénonciation du rôle contre-révolutionnaire du terrorisme et de la guérilla et son avertissement à la classe ouvrière contre l'activité de ces individus et leurs tentatives de l'amener dans l'impasse de la violence minoritaire (individuelle ou de groupe).
2- Sa dénonciation de l'usage que ces individus ou l'Etat peuvent faire des documents politiques du GPI et de l'ensemble du milieu communiste international pour accroître le climat de répression étatique contre la classe ouvrière et ses forces révolutionnaires.
3- Le GPI n'a rien à voir avec les prédicateurs apeurés du pacifisme "démocratique" ni avec la petite bourgeoisie désespérée (ou des éléments déclassés) qui font du culte de la violence minoritaire terroriste le centre de leur existence; le GPI base son activité révolutionnaire dans la conviction que l'unique force capable de s'opposer à la violence réactionnaire de l'Etat capitaliste est la classe ouvrière dans l'exercice de sa lutte et de sa propre violence révolutionnaire.
Grupo Proletario Internacionalista. Mexico, 15 février 1988.
Géographique:
- Mexique [42]
Courants politiques:
Revue Internationale no 54 - 3e trimestre 1988
- 2744 lectures
Editorial : Reagan-Gorbatchev, Afghanistan, mensonges du "désarmement" et de la "paix"
- 3215 lectures
"Réduction des armements" et marche à la guerre
Une propagande quotidienne est faite en cette année 88 sur la "réduction des armements" et les "pourparlers de paix" entre USA et URSS avec les rencontres Reagan-Gorbatchev, le tout sur fond de "droits de l'homme" et de "perestroïka". Le "désarmement" est une fois encore à la mode, mais en réalité, comme chaque fois, la "réduction des armements" est un énorme mensonge. C'est une façade de propagande qui couvre dans les faits la marche forcée du capitalisme vers une recherche permanente pour perfectionner les moyens militaires. La part consacrée à l'armement dans les budgets nationaux de tous les pays n'a jamais été aussi élevée, et elle ne va en aucune manière diminuer. Comme nous l'avons largement développé dans les numéros précédents de cette Revue ([1] [153]), le capitalisme, dans sa période de déclin depuis la Ire guerre mondiale, survit dans une économie de guerre permanente et "même en période de 'paix' ce système est rongé par le cancer du militarisme". La course aux armements est de plus en plus démesurée et n'a de dénouement possible, dans le cadre des lois capitalistes, que la guerre généralisée, ce qui signifie, avec les moyens de notre époque, la destruction de la planète et de l'humanité.
La modernisation de l'armement
La propagande actuelle ne doit tromper personne. Le retrait de certains missiles en Europe sert pour les USA, à faire prendre en charge les dépenses militaires beaucoup plus directement par leurs alliés, le retrait étant tout à fait négligeable quant à la puissance de feu du bloc de l'ouest globalement. Pour l'URSS, cela lui permet de supprimer du matériel complètement dépassé face à la sophistication des armements occidentaux actuels. Les accords "START", de "limitation" des armements", comme le sont toujours ce genre de conférences de représentants des grandes puissances, sont une nouvelle concertation sur le renouvellement du matériel et ne constituent en rien une véritable réduction de celui-ci. Comme les accords "SALT 2" de l'été 79 avaient amené l'installation des fameux missiles de moyenne portée, avec pour justification à l'époque celle du "désarmement" d'ogives intercontinentales devenues obsolètes, les accords actuels font passer comme "réduction des armements" ce qui est en réalité l'abandon de matériel hors d'usage, tandis qu'on fait le point dans les "coulisses" sur les nouveaux systèmes militaires pour assurer leur modernisation.
Il est vrai aussi que, pour chaque Etat national, les dépenses d'armement ne font qu'aggraver la crise et ne permettent en rien de résoudre celle-ci. Mais ce ne sont pas des raisons d'économies qui expliquent la campagne sur la "réduction des armements". Le capitalisme n'a pas la possibilité de réduire l'armement. Lorsque les USA, dans leur volonté de diminuer leur gigantesque déficit, envisagent de diminuer leurs dépenses militaires, ce n'est pas pour les réduire globalement dans le bloc de l'ouest, mais pour accroître la part payée par leurs alliés européens et japonais pour la "défense du monde libre". Il en est de même pour l'URSS, de plus en plus étranglée par la crise économique, quand elle s'efforce de "rationaliser" ses dépenses militaires. La course aux armements est inhérente à l'impérialisme tel qu'il s'est développé dans la période de décadence, impérialisme de toutes les nations, de la plus petite à la plus grande "et auquel aucun Etat ne saurait se soustraire" comme le disait déjà Rosa Luxemburg.
Si actuellement les discours parlent de "fin de guerre froide" et autres formules du genre, cela doit être compris non dans le sens que la "paix" serait maintenant à l'ordre du jour, mais bien plutôt comme un avertissement que c'est une "guerre chaude" à laquelle le capitalisme est de plus en plus poussé mondialement. D'ailleurs, malgré la volonté de promouvoir la justification des menées guerrières par un langage pacifiste, l'administration Reagan, plus à l'aise dans le bellicisme, comme en général toute la droite de l'appareil politique de la bourgeoisie, n'a pas manqué d'émailler les déclarations de l'acteur pantin de la Maison Blanche de "soyons vigilants", "restons forts" et de saluer particulièrement Tchatcher parce que "sans jamais sacrifier son brevet d'anti-communisme, elle a été aussi la première à suggérer que l'on discute affaires avec Gorbatchev"; les "affaires" en question n'étant pas autre chose que la facette diplomatique de la pression militaire qui s'exerce sur le terrain.
L'intensification du conflit EST-OUEST
Les discours pacifistes d'aujourd'hui recouvrent la même réalité que les discours bellicistes du début des années 1980, quand Reagan pérorait sur "l'empire du mal" à propos de l'URSS. Lorsque aujourd’hui la diplomatie américaine rencontre à Moscou la diplomatie soviétique, la discussion porte sur les "règles" de la confrontation croissante à l'échelle mondiale sous le leadership de Moscou et de Washington, en aucun cas sur la fin de cette confrontation.
Seul le discours a changé. La réalité est toujours celle de la marche à la guerre du capitalisme mondial, marche qui se caractérise aujourd'hui par une offensive occidentale tous azimuts contre les positions stratégiques de l'URSS et par la recherche de moyens pour résister et riposter à cette offensive, là où c'est possible, de la part du bloc impérialiste russe.
Aujourd'hui règne une grande discrétion sur les incessants combats au Moyen-Orient et surtout sur la présence massive de la flotte des grandes puissances dans la région. Il semble évident que les médias aux ordres ont consigne de faire le moins de bruit possible sur ce qui se trame dans le Golfe Persique, sur les navires de guerre les plus perfectionnés, sur l'armement embarqué, qui sont à pied d'oeuvre depuis l'été 1987. Depuis ces vingt dernières années, la présence militaire directe de pays comme les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, et même la soi-disant "désarmée" RFA, n'a jamais été aussi forte hors de leurs frontières, sur ce que les "stratèges" appellent le "théâtre des opérations". Peut-on vraiment croire que toute cette armada n'est là que pour "régler pacifiquement la circulation des bateaux"? Bien évidemment, non. Cette présence fait partie de la stratégie militaire occidentale et celle-ci n'est pas dictée par les quelques vedettes iraniennes et les remorqueurs qui les ravitaillent, mais par la rivalité historique entre Est et Ouest. L'offensive occidentale vise l'URSS et elle vient de marquer des points avec le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan.
L'URSS est obligée de céder sous la pression militaire directe de la "résistance" afghane équipée de missiles Stingers américains qui ont permis à celle-ci de renforcer considérablement sa puissance de feu, sous la pression "indirecte" de la flotte occidentale dans le Golfe, et doit abandonner en partie l'occupation d'un des seuls pays hors de son "glacis" est européen. Et, à la différence des USA qui gagnèrent l'alliance avec la Chine lors de leur retrait du Vietnam en 1975, l'URSS aujourd'hui ne peut compter sur aucun marchandage. Les USA ne céderont rien; c'est d'ailleurs là le contenu réel du "parler affaires" de Reagan avec Gorbatchev au cours des dernières rencontres. Le bloc de l'ouest est déterminé à maintenir sa pression, ce que confirme également le projet de retrait de l'armée vietnamienne du Cambodge.
Mais que l'URSS recule ne signifie pas le retour de la "paix", au contraire. Tout comme les accords de "paix israélo-arabe" de Camp David il y a plus de dix ans entre Egypte et Israël, sous la bénédiction de Carter et Brejnev, se sont soldés en fait par un élargissement des conflits, des massacres de populations et de la décomposition sociale de la situation au Moyen-Orient, le retrait actuel des troupes russes n'ouvre pas une perspective de "paix" et de "stabilité", mais bien plutôt un renforcement des tensions, et en particulier une probable "libanisation" de l'Afghanistan comme c'est la tendance dans tous les pays de cette région.
La "perestroïka" de Gorbatchev, tout comme elle n'est qu'un vernis "démocratique" à l'intérieur pour tenter de faire passer en réalité des mesures anti-ouvrières redoublées, n'est également qu'un vernis "pacifiste" d'une politique extérieure d'occupation militaire de plus en plus impopulaire, mais qui va cependant se poursuivre et se renforcer, même si c'est sous la forme plus "discrète" du soutien politique et militaire à des fractions, clans et cliques des bourgeoisies nationales qui ne trouvent pas leur compte dans le camp de la "pax americana", notamment les Partis Communistes locaux et leurs appendices gauchistes.
Le conflit entre les grandes puissances se poursuivra en jouant en permanence sur les différentes fractions gouvernementales ou d'opposition dans des "conflits locaux" extrêmement sanglants, avec la participation militaire de plus en plus importante des principaux protagonistes, jusqu'à les mettre face à face directement, si ceux-ci ont les mains libres à l'intérieur pour faire régner l'ordre social et entraîner l'adhésion à leurs desseins impérialistes. Mais ceci est encore loin d'être le cas aujourd'hui.
Le "pacifisme" : un mensonge dirigé contre la classe ouvrière
C'est fondamentalement parce que la bourgeoisie est aux prises avec un prolétariat qui ne se plie pas docilement aux attaques de l'austérité, un prolétariat qui ne manifeste aucune adhésion profonde aux manoeuvres diplomatico-militaires qu'entraîne l'accélération des tensions inter impérialistes, que la propagande actuelle, d'une part fait le silence sur les grèves et les manifestations ouvrières, et d'autre part a converti son discours, hier "belliciste", en campagne "pacifiste" et de "désarmement".
Au début des années 1980, le prolétariat était sous le coup du reflux de plusieurs luttes importantes qui s'étaient développées internationalement, de 1978 à la défaite des ouvriers en Pologne en 1981. La propagande de la bourgeoisie pouvait au début des années 80 s'appuyer sur le sentiment diffus de déboussolement qu'avait engendré une telle situation, et elle ne s'est pas privée d'essayer d'entretenir un sentiment de fatalité, d'impuissance, d'immobilisation et d'intimidation, en particulier par un battage guerrier: guerre des Malouines, invasion US de l'île de La Grenade, diatribes de Reagan contre "l'Empire du mal", "Guerre des étoiles", etc., le tout accompagnant des actions militaires impliquant de plus en plus les grandes puissances sur les lieux des opérations jusqu'à l'installation de troupes occidentales au Liban en 1983.
Depuis 1983-84 grèves et manifestations ouvrières se sont multipliées contre les différents plans d'austérité dans les pays industrialisés et également dans les pays moins développés, marquant la fin de la courte période précédente de reflux et de passivité. Et si beaucoup de groupes révolutionnaires prolétariens sont malheureusement incapables de voir, au-delà de l'image quotidienne que distille la propagande de la bourgeoisie et de ses médias, la réalité du développement actuel de la lutte de classe ([2] [154]), la bourgeoisie, elle, a ressenti le danger. Au travers des différents moyens politiques et syndicaux dont elle dispose, il est évident que la bourgeoisie sait que le problème essentiel est la "situation sociale", partout, et particulièrement en Europe de l'ouest où se concentrent tous les enjeux de la situation mondiale. Et de plus en plus nombreux sont les bourgeois "éclairés" qui tirent la sonnette d'alarme sur le danger de la désyndicalisation de la classe ouvrière et le risque de mouvements "imprévisibles" et "incontrôlés". C'est à cause de ce danger que s'impose à la bourgeoisie de mettre en avant la fausse alternative de "guerre ou paix", l'idée que l'avenir dépend de la "sagesse" des dirigeants de ce monde, alors qu'il dépend de la prise en mains et de l'unification des combats de la classe ouvrière internationale pour son émancipation. C'est à cause de ce danger que tout est fait pour cacher et minimiser les mobilisations de travailleurs et de chômeurs, pour entretenir l'idée de faiblesse, d'impuissance ou même de "dislocation" de la classe ouvrière.
Si la bourgeoisie est une classe divisée en nations regroupées autour de blocs impérialistes, prêts à aiguiser leurs rivalités, jusqu'à en découdre avec tous les moyens dont ils disposent jusqu'à la guerre impérialiste généralisée, elle est par contre une classe unie lorsqu'il s'agit d'attaquer la classe ouvrière, de l'encadrer et de contenir ses luttes, de la maintenir au rang de classe exploitée soumise aux impératifs de chaque capital national. C'est seulement face à la classe ouvrière que la bourgeoisie trouve une unité, et le choeur unanime actuel sur la "paix" et le "désarmement" n'est qu'une mascarade destinée essentiellement à anesthésier la menace prolétarienne que la bourgeoisie rencontre de plus en plus.
Car, malgré leurs limites et de nombreux échecs, les luttes qui se déroulent depuis plusieurs années dans tous les pays, touchant tous les secteurs, de l'Espagne à la Grande-Bretagne, de la France à l'Italie, y compris dans un pays comme la RFA jusqu'à présent moins touché par les effets dévastateurs de la crise ([3] [155]), sont non seulement le signe que la classe ouvrière n'est pas prête à accepter passivement les attaques sur le terrain économique, mais aussi que les tentatives précédentes d'intimidation par les campagnes idéologiques "bellicistes", ou le battage sur la "reprise économique", ont fait long feu et n'ont pas eu l'impact escompté. Egalement symptomatique de la maturation de la conscience qui s'opère dans la classe ouvrière est le fait, qu'après l'Italie et l'Espagne l'an dernier, on a vu pendant les campagnes électorales, traditionnellement périodes de "trêve sociale", pour la première fois en France se déclencher de nombreuses grèves particulièrement combatives.
C'est ce développement de la lutte de classe qui pousse la bourgeoisie à travestir de "pacifisme" la propagande actuelle aussi bien en URSS et dans les pays de l'Est , que dans les pays de l'ouest.
MG. 6/7/88
Questions théoriques:
- Décadence [44]
- Impérialisme [25]
Pologne : les grèves sabotées par le syndicat "Solidarnosc"
- 3596 lectures
Une nouvelle démonstration éclatante du rôle de sabotage de la lutte par le syndicalisme vient d'être donné par les dernières grèves en Pologne au printemps. Solidarnosc, présenté par tous comme l’émanation du formidable mouvement des ouvriers polonais de 1980, vient de confirmer ouvertement, sept ans plus tard, la vraie raison de son existence : ramener les ouvriers dans le giron des institutions nationales capitalistes de la Pologne.
Face à un mouvement qui surgit spontanément pour réclamer des augmentations de salaires, contre une accumulation sans précédent de mesures prises par le gouvernement, Solidarnosc va déployer toute une panoplie de manoeuvres, digne des plus vieilles manigances du syndicalisme des pays occidentaux. L'élève a bien appris de ses maîtres : les multiples rencontres de Walesa et ses acolytes avec nombre de syndicats, en France et en Italie notamment, ont porté leur fruits.
En 1980, en quelques jours, la classe ouvrière par ses propres moyens était parvenue à s'organiser à l'échelle de tout le pays, sur la base des assemblées générales dans les usines, étendant et unifiant le mouvement, le centralisant dans les comités interentreprises de délégués des assemblées (les MKS), obligeant le pouvoir à venir discuter et négocier publiquement face à tous les ouvriers dans les usines. Il faudra plus d'un an d'efforts conjugués du gouvernement et de Solidarnosc fraîchement constitué comme pare-feu à la grève de masse pour faire rentrer dans le rang les ouvriers. Cette année, le syndicat "libre et indépendant", soigneusement "toléré" depuis lors par le gouvernement et qui, derrière les mascarades de répression de ses dirigeants, dispose d'un nombre non négligeable de moyens de contact et de propagande dans le pays, a pu cette fois-ci dès le début jouer son rôle de pompier social au service du capital national polonais.
Au début du mouvement, fin avril, lorsque les travailleurs des transports de Bygdoszcz, puis les ouvriers des aciéries de Nowa Huta près de Cracovie, suivis par ceux des autres aciéries Stalowa Wola, partent en grève, ils soulèvent les espoirs de toute la classe ouvrière, qui subit des attaques considérables sur les salaires et les conditions de travail. Dans une situation où règne un rationnement draconien des biens de consommation de première nécessité, où de plus viennent d'être annoncées des hausses de 40% des denrées de première nécessité et de 100% pour l'électricité et le gaz, tous les yeux sont braqués vers ces grèves qui mettent en avant des revendications générales pour tous les travailleurs, des aciéries, des hôpitaux, et d'autres secteurs. A ce moment-là, les dirigeants de Solidarnosc, Walesa et Kuron en tête, désapprouvent les grèves "qui sont des actes de désespoir compréhensibles mais qui ne peuvent que rendre les choses plus difficiles" (sic!), pour conseiller aux ouvriers de réclamer des "réformes politiques" et des "syndicats libres", jusqu'à un soutien ouvert à la "perestroïka" de Gorbatchev.
Le gouvernement se partage la tâche avec Solidarnosc, cédant rapidement aux revendications à Bygdoszcz et Stalowa Wola – car ces usines sont "compétitives"! -, emprisonnant pendant quelques heures des personnalités du syndicat, afin de crédibiliser pleinement leur rôle d'"opposants", ceci vis-à-vis en particulier des jeunes ouvriers auprès desquels passent très mal les appels de Solidarnosc à la modération. Enfin, face à la solidarité croissante qui se manifeste, solidarité caractéristique des luttes en Pologne depuis les combats de 1970, 1976 et surtout 1980, le syndicat va tout faire pour parvenir à chevaucher le mouvement. Il appuie l'entrée en grève aux chantiers navals de Gdansk, haut lieu du mouvement de 1980, et à l'usine de tracteurs d'Ursus près de Varsovie, focalisant l'élan de solidarité sur ces deux concentrations ouvrières où il est fortement implanté, au détriment bien sûr d'un véritable élargissement du mouvement. La manoeuvre est habile. Même si une réelle solidarité se manifeste parmi les ouvriers de ces usines, celles-ci sont des lieux où Solidarnosc a suffisamment de poids pour manoeuvrer. En particulier à Gdansk, il proclame un "comité de grève", nommé par lui et non par l'assemblée des ouvriers, manoeuvre typique du syndicalisme "démocratique" occidental. Il fait de même à Nowa Huta où il met en place son propre "comité de grève" alors que la lutte est déjà entamée depuis plusieurs jours sous le contrôle des ouvriers. Ensuite, alors que tout le début du mouvement est marqué par des revendications unificatrices (indexation des salaires sur l'inflation, amélioration du service de la santé, etc.), ces dernières disparaissent comme par enchantement lorsque Solidarnosc se retrouve "à l'avant" du mouvement, pour céder la place à la revendication "démocratique" de la "reconnaissance du syndicat". Enfin, ayant réussi à prendre le contrôle de la situation, Solidarnosc peut alors se permettre de lancer au gouvernement des "menaces" de "grève générale", "au cas où Jaruzelski enverrait les zomos (miliciens) à Nowa Huta", ce que ce dernier ne fera pas, bien sûr, Solidarnosc ayant rassuré le gouvernement en reprenant les choses en mains.
Malgré l'expérience considérable de la lutte, que les ouvriers polonais se sont forgée surtout depuis vingt ans au travers des trois précédentes vagues de grève, la classe ouvrière vient de se heurter au barrage syndical, à la manière dont celui-ci manoeuvre, à partir de P"opposition", dans les pays les plus industrialisés. Et ceci d'autant plus fortement que dans les régimes des pays de l'Est, les illusions sur le syndicalisme "libre et indépendant" sont très fortes, et qu'en Pologne Solidarnosc apparaît encore comme un résultat de la lutte de 1980.
La réponse aux obstacles auxquels viennent de se heurter les ouvriers en Pologne se trouve d'abord dans l'approfondissement des luttes actuelles dans les pays occidentaux. C'est dans ces pays que la bourgeoisie est la plus forte, c'est dans ces pays que se trouve la "clé" de sa domination sur le prolétariat international. Et surtout, pour le développement de l'expérience et de la conscience dans la classe, c'est dans ces pays que la classe ouvrière est la plus développée et confrontée aux obstacles à la lutte les plus sophistiqués, en particulier l'obstacle du syndicalisme et de ses variantes "à la base" ou "de combat".
Malgré le repli auxquels ils sont contraints dans l'immédiat, les ouvriers en Pologne viennent à nouveau de donner au prolétariat mondial un exemple de détermination, de combativité, de solidarité active, en reprenant le combat sept ans après la cuisante défaite de 1981. La réponse à cet exemple, la véritable solidarité avec les ouvriers en Pologne, c'est le renforcement des luttes dans les pays de l'Ouest et le développement de leur unification.
MG
Géographique:
- Pologne [159]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question syndicale [160]
Où en est la crise économique ? : La perspective d'une récession n'est pas écartée, au contraire
- 4192 lectures
Six mois après l'effondrement boursier d'octobre 87, les "experts économiques" révisent à la hausse leurs prévisions de croissance pour l'année 1988. Au même moment les craintes d'un nouvel effondrement boursier mondial ne cessent de croître.
En réalité les gouvernements des principales puissances économiques avaient soigné les convulsions d'octobre 87 avec les remèdes les plus dangereux. Les récents indicateurs de la croissance économique aux Etats-Unis, moins pires que ceux attendus, produits de cette médication, ne peuvent cacher que les problèmes économiques de fond du capitalisme décadent loin d'avoir été résolus, n'ont fait que s'aggraver. Une fois déplus les remèdes des gouvernements face aux difficultés immédiates s'avèrent de véritables poisons dont les effets, pour lents qu'ils soient n'en sont pas moins mortels.
"Que se passe-t-il ici ? D'après toutes les estimations, l'expansion économique qui dure maintenant depuis cinq ans et demi devrait être en train de partir en fumée. Déjà assez longue, si on la compare à celles du passé, cette expansion semblait avoir subi un coup dévastateur lorsque la bourse s'est effondrée en octobre dernier. Mais, défiant toutes les prévisions, l'économie tourne encore et cela avec suffisamment de pression pour inspirer des craintes de surchauffe. Oubliez la récession, disent certains économistes, commencez à vous faire du souci pour l'inflation. " TIME, mai 1988.
A entendre certains commentateurs économiques, ou des ministres de l’économie, tel Lawson de Grande Bretagne, le danger d'une nouvelle récession économique serait écarté. Ce serait le retour du monstre de l'inflation qui serait aujourd'hui à craindre.
La réalité est que tout indique que l'inflation - ou plutôt l'accélération de l'inflation, car l'inflation, même si elle s'est décélérée dans les dernières années n'a jamais disparue -fait un retour certain dans l'économie mondiale. Mais, par contre, rien ne permet d'affirmer que les risques de récession soient écartés. Au contraire.
Pour se rendre à l'évidence il faut regarder de plus près la réalité et les fondements financiers de cette fameuse période "d'expansion économique" qui dure depuis cinq ans et demi.
Le bilan réel de cinq ans de "non effondrement" et de dévastation
Depuis la récession de 1982, la plus profonde et étendue depuis la guerre, le capitalisme a connu effectivement une croissance de la production. La croissance du produit intérieur brut de l'ensemble constitué par les 24 pays les plus industrialisés du bloc occidental, l'OCDE ([1] [161]), entre 1983 et 1987 est restée positive (+ 3 % par an en moyenne). C'est à dire que la masse de valeur produite - telle qu'elle peut être mesurée par les comptabilités nationales ([2] [162]) - n'a pas diminué. Cependant ce chiffre en lui même ne dit pas grand-chose. Derrière cette moyenne se cache une autre réalité.
Une croissance faible et localisée
La croissance de cette période est restée EN-DESSOUS DES TAUX atteints pendant les périodes d'"expansion" des années 70 : 5,5 % entre 1972 et 1973, 4 entre 76 et 79. (taux annuels moyens).
Depuis 1984, cette croissance n'a cessé de se RALENTIR systématiquement, passant de 4,9 % en 1984 à 2,8 en 1987. Elle s'est manifestée surtout aux Etats-Unis et au Japon ; en Europe elle est restée à des niveaux misérables, proches d'une simple STAGNATION. Dans la plupart des pays faiblement industrialisés, sauf quelques exceptions, elle s'est traduite par un EFFONDREMENT.
La désertification industrielle
La stagnation ou la faible croissance de la production s'est faite en ne maintenant en vie que les centres de production les plus rentables et DETRUISANT tous ceux qui suivant les lois d'un marché qui se réduit comme peau de chagrin, ne parvenaient pas à produire suffisamment bon marché pour faire partie des privilégiés qui peuvent encore écouler leurs marchandises. L'Europe, par exemple, produit aujourd'hui sensiblement le même nombre de voitures qu'il y a dix ans en 1978. Mais le capital n'en a pas moins fermé des dizaines d'usines et supprimé des centaines de milliers de postes de travail dans l'industrie automobile. Hauts fourneaux en parfait état de fonctionnement qu'on fait sauter à la dynamite aux Etats-Unis, complexes industriels entiers laissés à l'abandon et au travail de la rouille : on a parlé de désertification industrielle. La communauté Européenne décide de geler des millions d'hectares de terre cultivable. Se déplaçant des bords vers le centre, ce fléau touche de plus en plus le coeur même des principales puissances industrielles.
Le chômage
Pendant ces cinq années de "croissance", LE CHOMAGE dans le monde n'a cessé de se développer. Cela n'a été que la suite de ce qui constitue un phénomène jamais vu auparavant dans l'histoire du capitalisme : 20 années d'augmentation sans discontinuité du chômage. Seuls, parmi les grandes puissances, les Etats-Unis - et pour, la seule année 1987, la Grande-Bretagne- affichent des chiffres de diminution du chômage. Pour l'ensemble de l'Europe le manque d'emplois a au contraire battu des records historiques, même si sa croissance s'est "officiellement" ralentie. Dans la plupart des autres pays du monde, le désemploi atteint des proportions sans précédents.
Et encore s'agit-il de mesures officielles qui sous-estiment délibérément l'ampleur du désastre. Ainsi les comptabilités gouvernementales considèrent que celui qui travaille un jour par semaine, ou celui qui suit un stage de formation pour chômeurs, ou les jeunes à qui on donne un semblant d'emploi pendant quelques mois pour une misère qui ne permet pas de vivre, ou l'adulte mis en préretraite, tous ces sans emploi, ne sont pas des "chômeurs". Il y a d'autre part la généralisation de la précarité de tout emploi : le développement du travail à temps partiel, du travail suivant les besoins immédiats du capital : 12 heures par jour pendant une période, 2 heures pendant une autre - avec la diminution correspondante du salaire, la menace de licenciement toujours.
La production d'armements
A toutes ces formes de destruction de capital, (pour le capital, le développement du chômage au-delà du minimum d'une "armée de réserve" est une destruction de capital, tout comme la destruction d'usines ou la stérilisation des terres), qui marquent profondément ces cinq années d'"expansion économique", U faut ajouter le développement de la production de moyens de destruction, l'ARMEMENT, en particulier aux Etats-Unis. Le capital américain, qui a, par son déficit public, joué le rôle de principal marché pour la croissance au niveau mondial y a consacré des sommes gigantesques.
"Depuis 1982, les dépenses de l'Etat fédéral ont augmenté de 24 % en valeur réelle (4 % Van), Cette expansion est entièrement imputable aux crédits de la défense nationale, en hausse de 37 %, les autres dépenses étant abaissées de 7 %. Un effort considérable a été accompli pour l’acquisition de matériel, presque un doublement en cinq ans : + 78 %".([3] [163])
Tel est le bilan, en termes réels, de ces cinq années dites d'"expansion économique". Malgré des taux de croissance de la production faibles, mais qui restent encore positifs, la misère économique n'a jamais cessé de croître, même dans les pays les plus industrialisés. La base de production même du capital ne s'est pas élargie mais rétrécie. La recomposition du capital mondial se fait au travers du plus puissant mouvement de concentration des capitaux qu'ait connu l'histoire, dans une guerre de requins dévorant les cadavres des faillites, à travers les "OPA" les plus importantes de tous les temps, le sang des uns aiguisant la voracité des autres.
Les résultats dans le domaine réel de la production de ces cinq dernières années, loin de traduire une nouvelle force du système capable d'écarter la perspective d'une nouvelle récession mondiale, concrétise, au contraire l'impuissance chronique du système à rétablir une véritable croissance, une croissance capable ne serait-ce que de résorber le chômage.
Le bilan sur le plan financier
Les résultats au niveau du financement ne font que confirmer l’inéluctabilité d'une telle récession : une récession qui tout comme celles de 1974-1975 et de 1980-1982 s'accompagnera de l'aggravation de cette autre maladie du capitalisme décadent : l'inflation.
"Les assassinats sur la grande route me semblent des actes de charité comparés à certaines combinaisons financières".Balzac.
Financer une production c'est fournir l'argent pour la réaliser. Dans le capitalisme cet argent le capitaliste le trouve par la vente de ce qu'il produit, ou par un crédit, ce qui n'est qu'une avance sur cette vente.
A qui les capitalistes du monde entier ont-ils vendu ce petit surplus qu'ils ont réussi à dégager tant bien que mal pendant ces années ? Essentiellement aux Etats-Unis. Comme en 1972-1973, comme en 1976-1977, en 1983 les Etats-Unis ont joué à nouveau au niveau mondial le rôle de marché locomotive pour sortir de la récession de 1980-1982 : en 1983 le volume des importations américaines fait un bond de près de 10 % ; en 1984 ce bond est de 24 % ! (record historique). Le capital américain achète de tout à tout le monde. En 1982 la part des importations américaines dans le commerce mondial est de 15 %, en 1986 cette part est de 24 % ! C'est-à-dire qu'un quart de tout ce qui est exporté dans le monde est acheté par les Etats-Unis !
En cinq ans le déficit commercial américain passe de 30 milliards de dollars à 160. Ce déficit s'élargit vis à vis de toutes les zones du monde : 40 milliards de déficit en plus avec le Japon, 36 milliards avec les autres pays d'Asie, 32 avec l'Europe, 8 milliards avec l'Amérique Latine.
Avec quel argent le capital américain a-t-il payé ? D'une part avec des dollars surévalués. De 1982 à 1985 la valeur du dollar ne cesse d'augmenter contre celle de toutes les autres monnaies. Cela revenait à payer ce qu'il importait à des prix d'autant plus réduits.
D'autre part, et surtout, en s'endettant à tous les niveaux, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est une véritable explosion du crédit. De fin 1983 au milieu de 1987 le total des dettes s'est accru de 3000 milliards de dollars - trois fois l'augmentation du produit national pendant la même période. Les Etats-Unis sont devenus l'Etat le plus endetté du monde vis-à-vis de l'extérieur. En 1983 la part de l'économie américaine financée par l'extérieur était de 5 %. En 1987 elle frôle les 20 %. Le seul poids des intérêts à verser est devenu monstrueux.
Les Etats-Unis peuvent-ils rembourser ces dettes ? Ils doivent commencer par tenter de réduire l'augmentation vertigineuse de celles-ci. Et pour cela ils n'ont pas d'autre choix que de réduire leur déficit commercial, augmenter les exportations, diminuer les importations. C'est ce qu'ils s'attachent à faire, entre autres en laissant se dévaluer le dollar de façon à rendre plus difficiles les importations et plus compétitives les exportations "made in USA". Cela s'est déjà traduit en 1987 par une diminution de la croissance du volume des importations à 7 % et par une augmentation de celui des exportations de près de 13 %. Une telle évolution est encore loin de fournir au capital américain de quoi rembourser ses dettes. Mais par contre elle fait déjà l'effet d'une douche d'eau glaciale sur tous ceux qui voient leurs exportations diminuer d'autant. Le marché locomotive américain se rétrécit en même temps que les marchandises américaines se font de plus en plus agressives et efficaces sur le marché mondial. Ce qui avait constitué le stimulant de l'économie mondiale disparaît sans qu'aucune autre fraction du capital mondial ne puisse jouer un rôle de locomotive équivalent.
La dévaluation du dollar constitue par elle même un autre moyen de réduire l'endettement. Ce que le capital américain avait acheté avec un dollar surévalué, il le rembourse aujourd'hui avec une monnaie dévaluée. C'est autant de moins à rembourser, mais c'est aussi autant ne pas vers l'inflation et autant de perte sèche pour des créditeurs tels que l'Allemagne ou le Japon... supposés assurer la relève de la relance.
Il reste enfin un troisième moyen au capital américain pour rembourser ses dettes : contracter de nouveaux emprunts, de nouvelles dettes pour rembourser les anciennes...tout comme les pays les moins industrialisés. C'est ce qu'il continue de faire, et c'est ce qui l'a contraint en 1987 à recommencer à augmenter ses taux d'intérêts en vue d'attirer les capitaux nécessaires au financement de son déficit. Le résultat de cette hausse, ainsi que de la dévaluation du dollar (qui dévalue d'autant les actions en dollars) ne fut autre que l'effondrement boursier d'octobre. L'écart entre les bénéfices tirés de la bourse et les coûts des emprunts nécessaires pour y participer était devenu trop grand.
Mais dans tous les cas de figure - augmentation des exportations américaines et diminution des importations, dévaluation du dollar et inflation généralisée, fuite en avant dans l'endettement - le problème posé par le financement de la dette accumulée par l'économie mondiale et celle de la première puissance économique en particulier, n'ouvrent d'autre perspective que celle d'une nouvelle récession inflationniste.
L'effondrement boursier
Le véritable miracle que saluent certains économistes aujourd'hui, tels ceux dont parle Time cité au début de cet article, c'est que la croissance ne se soit pas écroulé comme en 1929 au lendemain du "crash" d'octobre 1987.
La plupart des économistes avaient prédit un fort ralentissement de la croissance économique au lendemain de l'effondrement boursier d'octobre 1987. Les gouvernements avaient révisé à la baisse leurs déjà peu reluisantes prévisions de croissance.
C'était oublier, premièrement, qu'il ne s'agissait pas d'une situation comme celle de 1929. L'effondrement boursier de 1929 se situait au début d'une crise économique ouverte. Celui d'octobre 1987 explose après 20 ans de lent enfoncement du capitalisme dans la crise : il n'est pas l'ouverture de la crise mais une convulsion au niveau financier qui sanctionne le délabrement économique qui l'a précédé.
Deuxièmement, c'était oublier que le capital qui est comptabilisé à la bourse, est, pour une grande part du capital purement spéculatif, du papier, ce que Marx appelait déjà le capital fictif : pour une part donc, surtout lors d'un premier effondrement, la destruction de celui-ci n'est pas une destruction d'usines, mais de papier. Le secteur économique qui a été le plus touché est le secteur bancaire, plus directement lié à la spéculation.
Troisièmement c'était oublier que, contrairement à 1929, et contrairement aux légendes dites "libérales" sur une soi-disant réduction actuelle du rôle de l'Etat dans l'économie, le capitalisme d'Etat a atteint un développement aussi vertigineux que systématique et généralisé dans le capitalisme décadent. Tous les gouvernements du monde, derrière le premier d'entre eux, celui des Etats-Unis, ont immédiatement réagi pour parer au danger d'une dégénérescence sous forme d'effondrement économique immédiat et non contrôlé.
Mais les remèdes qu'ils ont apportés ne résolvent pas les problèmes de fond du système, au contraire ils les aggravent.
Ces remèdes ont consisté essentiellement dans une baisse forcée des taux d'intérêt et une plus grande facilité pour se procurer des crédits, surtout aux Etats-Unis. En d'autres termes, aux problèmes posés par l'excessif endettement, le capital n'a répondu que par un accroissement de l'endettement.
Cela a permis les "surprenants résultats de la croissance américaine" à la fin 1987 et début 1988. Mais cela n'a résolu en rien le problème de fond. Dès le mois de mai les pressions vers une nouvelle hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, qui doivent financer un nouvel emprunt d'Etat de 26 milliards de dollars, se font sentir puissamment. Or, comme le notait The Economist :
"Même si l'économie a surmonté le crash, le poids intérieur de sa dette Va laissée en un bien piètre état pour supporter des taux d'intérêt plus élevés. Et le Texas est prêt à déclencher une crise bancaire de plusieurs milliards de dollars." The Economist, 7 mai 1988.
Fondée sur l'endettement massif, sur une véritable explosion du crédit sans espoir de remboursement, l'actuelle évolution économique ne peut aboutir, une fois de plus, qu'à la conjugaison de ces deux maladies du capitalisme décadent : l'inflation ET la récession - comme ce fut déjà le cas pendant les récessions de 1970-71, 1974-75 et 1980-82 (dans les années 70 on avait déjà inventé un terme :"la stagflation"). Cette fois-ci il faudra ajouter les effondrements financiers.
Les experts économiques de la bourgeoisie ne se font d'ailleurs pas trop d'illusions. S'ils ont révisé à la hausse les taux de croissance pour 1988 c'est de façon fort modeste, et leurs prévisions pour l'année 1989 demeurent sombres.
Lorsque le capital est confronté à sa crise, on reproche souvent aux marxistes et à leurs "sombres perspectives" pour le capitalisme, d'être comme une horloge arrêtée qui a raison deux fois par jour. Pour les marxistes, et pour eux seulement, le capitalisme est, sur le plan économique, historiquement condamné, comme tous les systèmes économiques qui l'ont précédé dans l'histoire. Ils ont, il est vrai, parfois commis des erreurs dans leurs prévisions quant à l'imminence d'un nouvel effondrement économique. Ils ont parfois sous-estimé l'efficacité des mesures de capitalisme d'Etat, des "tricheries" du système avec ses propres lois (voir dans ce numéro l'article Comprendre la décadence du capitalisme) qui permettent au système de pallier à ses contradictions et de retarder les échéances. Mais aujourd'hui, lorsque les "économistes" comprennent aussi peu les causes profondes de la crise économique que les raisons qui empêchent une "véritable reprise", la théorie marxiste est la seule qui permet de comprendre pourquoi le "non effondrement" des cinq dernières années n'est que l'annonce d'une prochaine récession aussi profonde qu'inévitable.
RV
[1] [164] Tous les pays d'Europe Occidentale, plus les Etats-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie et la Nouvelle Zélande.
[2] [165] D'après ces
comptabilités, par exemple, un agent de police ou un fonctionnaire de l'armée
est censé créer une valeur équivalente à celle de son salaire.
[3] [166] Banque française du commerce extérieur, Actualités, décembre 1987.
Récent et en cours:
- Crise économique [3]
L’évolution du milieu politique depuis 1968 (2eme partie)
- 3481 lectures
La première partie de cet article est parue dans le numéro 53 de Revue Internationale.
Au milieu des années 70, le milieu politique prolétarien est écartelé entre deux pôles qui sont de manière caricaturale le produit de quarante ans de théorisation non pas de ce qui constituait la force des fractions de gauche italienne ([1] [167]) et germano hollandaise ([2] [168]), mais au contraire de leurs faiblesses et cela notamment par rapport à une question cruciale pour un milieu prolétarien qui renaît après des décennies d'effacement sur la scène de l'histoire, sans grande expérience historique : celle de l'organisation. D'un coté, il y a le courant conseilliste qui tend à nier la nécessité de l'organisation et, de l'autre, le courant bordiguiste qui s'exprime notamment au travers du PCI (Programme communiste) et qui fait du parti le remède mécanique à toutes les difficultés de la classe ouvrière. Le premier courant va connaître son heure de gloire dans la foulée des événements de 1968 et des années qui suivent, mais il va rencontrer de grands déboires avec le recul de la lutte de classe qui marque le milieu des années 70, tandis que le second, après être resté on ne peut plus discret durant la période de développement de la lutte de classe, connaît un regain d'écho avec le reflux des luttes ouvrières, notamment auprès d'éléments issus du gauchisme.
Dans la seconde moitié des années 70, le pôle conseilliste s'est effondré tandis que le PCI (Programme communiste) tient de manière arrogante le haut du pavé : il est LE PARTI et en dehors de lui, rien n'existe. Le milieu politique prolétarien est extrêmement dispersé, divisé. La question qui se pose avec le plus d'acuité -et qui est intimement liée à celle de l'organisation- est celle du développement des contacts entre les divers groupes existants sur la base d'une cohérence révolutionnaire, afin d'accélérer le processus de clarification indispensable pour le nécessaire regroupement des forces révolutionnaires. Le CCI, dans la continuité de Révolution Internationale, a montré l'exemple en 1974-75, et le Manifeste qu'il publie en 1976 est un appel à l'ensemble du milieu prolétarien à oeuvrer dans ce sens :
"Avec ses moyens encore modestes, le CCI s'est attelé à la tâche longue et difficile du regroupement des révolutionnaires à l’échelle mondiale autour d'un programme clair et cohérent. Tournant le dos au monolithisme des sectes, il appelle les communistes de tous les pays à prendre conscience des responsabilités immenses qui sont les leurs, à abandonner les fausses querelles qui les opposent, à surmonter les divisions factices que le vieux monde fait peser sur eux. Il les appelle à se joindre à cet effort afin de constituer avant les combats décisifs, l'organisation internationale et unifiée de son avant-garde. Fraction la plus consciente de la classe, les communistes se doivent de lui montrer son chemin en faisant leur le mot d'ordre : REVOLUTIONNAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS !"
C'est dans ce contexte mouvant d'un milieu politique en pleine décantation et profondément marqué par la dispersion et le poids du sectarisme que se situe l'appel de Battaglia comunista ([3] [169]) à la tenue d'une conférence internationale des groupes de la gauche communiste en 1976.
En 1972, Battaglia comunista avait refusé de s'associer à l'appel d'Internationalism (USA) proposant le développement d'une correspondance internationale dans la perspective d'une conférence internationale, appel qui avait ouvert la dynamique qui a mené à la formation du CCI en 1975. A l'époque BC répondait au lendemain de 1968 :
"- qu'on ne peut pas considérer qu'il existe un développement conséquent de la conscience de classe,
- que même la floraison de groupes n'exprime pas autre chose que le malaise et la révolte de la petite-bourgeoise,
- qu'il nous fallait admettre que le monde est encore sous le talon de l'impérialisme."
Qu'est-ce qui a donc déterminé ce revirement? Une question fondamentale pour BC : la "social démocratisation" des PC staliniens! BC prend ainsi le tournant "euro-communiste" des PC, tournant purement conjoncturel au milieu des années 70, comme on peut le vérifier clairement aujourd'hui avec le recul du temps, comme raison de son changement d'attitude vis-à-vis des autres organisations du milieu politique. C'est pour discuter de cette question "fondamentale" que le PCI (Battaglia comunista) propose la tenue d'une conférence. Par ailleurs, il n'y aura aucun critère politique de délimitation du milieu prolétarien dans la lettre d'appel de Battaglia comunista, et BC exclura de son invitation les autres organisations du milieu prolétarien en Italie telles que le PCI (Programma Comunista) où II Partito comunista. Malgré l'orientation vers la tenue de conférences, "bougnat veut rester maître chez soi" !
Cependant, malgré ce manque de clarté de l'appel, le CCI conformément aux orientations déjà concrétisées par le passé dans sa propre histoire et réaffirmées dans le Manifeste publié en janvier 1976, va répondre positivement et se faire conjointement avec BC le promoteur de cette conférence en proposant des critères politiques délimitant les organisations du milieu prolétarien de celles de la bourgeoisie, en appelant à ouvrir cet appel aux organisations "oubliées" par Battaglia comunista, en essayant d'inscrire cette conférence dans une dynamique de clarification politique au sein du milieu communiste, étape nécessaire vers le regroupement des révolutionnaires.
La dynamique des conférences internationales des groupes de la Gauche Communiste
La première conférence ([4] [170])
A l'appel de Battaglia comunista plusieurs groupes vont répondre pour donner leur accord de principe : le FOR (Fomento Obrero Revolucionario) de France et d'Espagne, Arbetarmakt de Suède, la CWO (Communist Workers' Organisation) de Grande-Bretagne ([5] [171]), le PIC (Pour une intervention communiste) de France. Mais cet accord restera platonique et seul le CCI participera activement aux côtés de BC à la tenue de la première conférence, tandis que, sous divers prétextes plus ou moins valables, mais qui tous, de fait, traduisent une sous-estimation de l'importance des conférences, les autres groupes brilleront par leur absence.
Quant aux chantres du conseillisme et du bordiguisme : Spartakusbond (Hollande) et PCI (Programme communiste) ([6] [172]) inintéressés par de telles conférences, ils se réfugient dans un splendide isolement sectaire.
Cependant, cette première conférence qui se tient en mai 1977, si elle ne réunit finalement que deux organisations : le CCI et BC - ce qui témoigne bien de la réalité du sectarisme ambiant - est malgré tout un grand pas en avant pour l'ensemble du milieu prolétarien.
Cette première conférence n'a pas été un débat fermé entre seulement deux organisations mais va, au contraire, permettre de démontrer à l'ensemble du milieu prolétarien qu'il est possible de briser la méfiance sectaire, qu'il est possible de créer un lieu de confrontation et de clarification des positions divergentes. L'importance des questions abordées le prouve amplement :
- analyse de la situation de la crise économique et de l'évolution de la lutte de classe ;
- fonction contre-révolutionnaire des partis dits "ouvriers" : PS, PC et leurs acolytes gauchistes ;
- fonction des syndicats ;
- les problèmes du parti ;
- tâches actuelles des révolutionnaires ;
- conclusions sur la portée de cette réunion.
Cependant, une faiblesse importante de la conférence et de celles qui l'ont suivie, sera son incapacité à prendre une position commune sur les débats qui l'ont animée ; ainsi le projet de déclaration commune proposé par le CCI et synthétisant les accords et divergences qui se sont manifestés, notamment par rapport à la question syndicale, sera rejeté par BC sans proposition alternative.
La publication en deux langues (italien et français) des textes de contribution à la conférence et des comptes-rendus des discussions qui s'y sont déroulées, va susciter un grand intérêt dans l'ensemble du milieu prolétarien et permettre d'élargir la dynamique ouverte avec la première conférence. Cela va se concrétiser avec la tenue, un an et demi plus tard, de la deuxième conférence fin 1979.
La deuxième conférence ([7] [173])
Cette conférence a été mieux préparée, mieux organisée que la première, cela tant du point de vue politique qu'organisationnel. Ainsi l'invitation a été faite sur la base de critères politiques plus précis :
"- reconnaissance de la révolution d'octobre comme une révolution prolétarienne ;
•reconnaissance de la rupture avec la social-démocratie effectuée par le premier et le deuxième congrès de l’Internationale Communiste ;
- rejet sans réserve du capitalisme d'Etat et de l'autogestion ;
- rejet de tous les partis communistes et socialistes en tant que partis bourgeois ;
- orientation vers une organisation de révolutionnaires qui se réfère à la doctrine et à la méthodologie marxiste comme science du prolétariat".
Ces critères - certes insuffisants pour établir une plateforme politique pour un regroupement et dont le dernier point demande certainement à être précisé- sont, par contre, amplement suffisants pour permettre de délimiter le milieu prolétarien et de donner un cadre de discussion fructueux.
A la deuxième conférence qui se tient en novembre 1978, ce sont cinq organisations prolétariennes qui vont participer aux débats : le PCI (Battaglia comunista) d'Italie, la CWO de Grande-Bretagne, le Nucleo Comunista Internaziona-lista (NCI) d'Italie, Fur Komunismen de Suède et le CCI qui, à l'époque, était présent par ses sections dans neuf pays, tandis que le groupe II Leninista fait parvenir des textes de contribution aux débats de la conférence sans pouvoir physiquement y participer, et que Arbetarmakt de Suède et POCRIA de France apportent un soutien purement platonique à la conférence. Quant au FOR, son cas est un peu particulier. Après avoir apporté sa pleine adhésion à la première conférence, fait parvenir des textes pour la préparation de la seconde et y être venu pour y participer, il va provoquer Un coup de théâtre à l'ouverture de celle-ci : sous prétexte de ne pas être d'accord avec l'ordre du jour qui comportait un point sur la crise économique dont le FOR nie de manière surréaliste l'existence, il va quitter spectaculairement la conférence ! Les épigones du conseillisme et du bordiguisme pur quant à eux persévèrent dans leur rejet des conférences : le Spartacusbond de Hollande finalement imité par le PIC de France parce qu'ils rejettent la nécessité du Parti, le PCI (Programme communiste) et le PCI (Il Partito Comunista) d'Italie parce qu'ils se considèrent chacun comme le seul parti existant et donc qu'en dehors d'eux, aucune organisation prolétarienne ne peut exister.
L'ordre du jour de la conférence témoigne de la volonté militante qui l'anime :
- l'évolution de la crise et les perspectives qu'elle ouvre pour la lutte de la classe ouvrière ;
- la position des communistes face aux mouvements dits de "libération nationale" ;
- les tâches des révolutionnaires dans la période présente.
La deuxième conférence internationale des groupes de la gauche communiste est un succès, non seulement parce qu'un plus grand nombre de groupes y participe, mais aussi parce qu'elle permet une meilleure délimitation des accords et des divergences politiques existants entre les différents groupes y participant. En permettant aux diverses organisations présentes de mieux se connaître, la conférence offre un cadre de discussion qui permet d'éviter les faux débats et de pousser à la clarification des divergences réelles. En ce sens, les conférences sont un pas en avant dans le sens de la perspective du regroupement des révolutionnaires qui, même si elle n'est pas immédiate, à court terme, est cependant à l'ordre du jour, étant donné la situation de dispersion du milieu prolétarien après des décennies de contre-révolution.
Cependant, les faiblesses politiques dont souffre le milieu prolétarien pèsent aussi sur les conférences elles-mêmes. Cela va notamment se traduire dans l'incapacité des conférences à ne pas rester muettes, c'est-à-dire dans l'incapacité des groupes y participant à prendre collectivement position sur les questions qui ont été discutées afin de mettre au clair le point où elles sont parvenues. Le CCI a proposé des résolutions dans ce sens mais, en dehors du NCI, s'est heurté au refus des autres organisations présentes et notamment du PCI (Battaglia comunista) et de la CWO ; cette attitude traduit le climat de méfiance qui perdure au sein du milieu communiste, même chez les plus ouverts à la confrontation, et qui entrave le nécessaire processus de clarification politique qui doit se développer.
Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les propositions du CCI de voter une résolution fustigeant le sectarisme des groupes refusant de participer aux conférences se soient heurtées au refus des autres groupes ; cela touchait évidemment un point sensible.
Ces faiblesses vont malheureusement trouver leur concrétisation au lendemain de la deuxième conférence dans les polémiques qui vont être lancées par Battaglia comunista et la CWO qui qualifient allègrement le CCI d'"opportuniste" et nient qu'il existe un problème de sectarisme, la dénonciation du sectarisme n'étant, selon eux, qu'un moyen de nier les divergences politiques existantes. Cette position de BC et de la CWO ne voit pas que la question du sectarisme est une question politique à part entière puisqu'elle traduit la perte de vue d'une question essentielle : celle du rôle de l'organisation dans un de ses aspects déterminants qui est la nécessité permanente du regroupement des révolutionnaires. En niant le danger du sectarisme, ces organisations sont bien mal armées pour y faire face en leur propre sein, et malheureusement, cela va se concrétiser avec la troisième conférence.
La troisième conférence ([8] [174])
La IIIème conférence se tient au printemps 1980 à un moment où les luttes ouvrières de l'année précédente montrent que le reflux du milieu des années 70 est terminé, et où l'intervention des troupes "soviétiques" en Afghanistan montre l'actualité de la menace de la guerre mondiale, ce qui pose de manière aiguë la responsabilité des révolutionnaires.
De nouveaux groupes vont s'associer à la dynamique des conférences : I Nuclei Leninisti est le produit de la fusion du NCI et de II Leninista en Italie qui s'étaient déjà associés à la seconde conférence, le Groupe Communiste Internationaliste qui est le produit d'une scission bordiguisante du CCI en 1977, l'Eveil Internationaliste qui provient d'une rupture en France d'avec le maoïsme en pleine décomposition, le groupe américain Marxist Workers' Group qui s'associe à la conférence sans pouvoir y participer physiquement. Pourtant, malgré l'écho grandissant au sein du milieu révolutionnaire que rencontre la dynamique des conférences, la Illème conférence internationale des groupes de la gauche communiste va se solder par un échec.
La demande du CCI que la conférence adopte une résolution commune sur le danger de la guerre impérialiste à la lumière des événements d'Afghanistan, est rejetée par BC, la CWO et, à leur suite, par l'Eveil Internationaliste, car même si les différents groupes avaient une position commune sur cette question, il eût été selon eux "opportuniste" d'adopter une telle résolution, "parce qu'on a des divergences sur ce que sera le rôle du parti révolutionnaire de demain". Le contenu de ce brillant raisonnement "non-opportuniste" est le suivant : puisque les organisations révolutionnaires ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur toutes les questions, elles ne doivent pas parler de celles sur lesquelles elles sont d'accord depuis longtemps. Les spécificités de chaque groupe priment par principe sur ce qu'il y a de commun à tous. C'est cela le sectarisme. Le silence, l'absence de prise de position collective des groupes lors des trois conférences est la plus nette démonstration de l'impuissance à laquelle mène le sectarisme.
Deux débats étaient à l'ordre du jour de la IIIème conférence :
- où en est la crise du capitalisme et ses perspectives ?
- perspectives de développement de la lutte de classe et les tâches qui en découlent pour les révolutionnaires.
Le débat sur le deuxième point à l'ordre du jour va permettre que s'amorce le début d'une discussion sur le rôle du parti qui fut un des points discutés lors de la IIème Conférence. Cette question du rôle du parti est une des plus graves et des plus importantes à laquelle sont confrontés les groupes révolutionnaires actuels, en particulier eu égard à l'appréciation que Ton a sur les conceptions du parti bolchevik à la lumière de l'expérience historique qui s'est accumulée depuis et avec la Révolution russe.
Et pourtant le PCI (Battaglia comunista) et la CWO, par impatience... ou par peur, à moins que ce ne soit misérablement par tactique opportuniste, ce qui est malheureusement le plus probable, alors même que lors de la précédente conférence ils déclaraient sur cette question qu'elle "nécessitera de longues discussions", vont refuser de poursuivre ce débat sur le problème du parti et vont prendre prétexte de soi-disant conceptions "spontanéistes" du CCI pour déclarer la question close et faire de leur propre position un critère d'adhésion aux conférences, provoquant ainsi l'exclusion du CCI et finalement la dislocation des conférences. En brisant ainsi la dynamique qui avait permis de resserrer les liens entre différents groupes du milieu prolétarien et de pousser l'ensemble du milieu politique sur la voie de la clarification indispensable au nécessaire regroupement des forces révolutionnaires, la CWO et BC portent une lourde responsabilité dans le renforcement des difficultés qui devaient se répercuter sur l'ensemble du milieu.
La CWO et BC rejoignaient ainsi dans l'irresponsabilité, celle du GCI qui n'était venu à la troisième conférence que pour mieux en dénoncer le principe et y pratiquer la "pèche à la ligne" la plus éhontée.
L'éclatement, trois mois après l'échec de la conférence: de la grève de masse en Pologne ne peut que mettre pleinement en relief l'irresponsabilité de ces groupes qui ne croient exister qu'en fonction de leur propre ego et qui oublient que c'est la classe ouvrière qui pour ses besoins les a produits. Ces défenseurs "intransigeants" du Parti oublient que la première tâche de ce parti, ce n'est pas le repli sectaire, mais au contraire la volonté de confrontation politique afin d'accélérer le processus de clarification au sein du milieu prolétarien et de renforcer sa capacité d'intervention au sein de la classe.
La pseudo quatrième conférence qui va se tenir en 1982 n'aura dans ces conditions plus rien à voir avec la dynamique qui a présidé à la tenue des trois conférences internationales des groupes de la gauche communiste. La CWO et BC vont trouver un troisième larron pour tenir la bougie qui éclairera leurs amours en la personne du SUCM d'Iran. Ce groupe nationaliste mal dégagé du stalinisme était certainement un interlocuteur plus valable pour Battaglia comunista et la CWO que le CCI. Etait-ce parce qu'il défendait une position "correcte" sur le rôle du parti contrairement au CCI? Le sectarisme a de ces vicissitudes ; il mène au plus plat opportunisme et finalement à l'abandon des principes !
Quel bilan pour les conférences?
Le premier acquis des conférences c'est d'abord qu'elles aient eu lieu.
Les conférences internationales des groupes de la gauche communiste ont été un moment particulièrement important de l'évolution du milieu politique prolétarien international qui s'était reconstitué au lendemain de 1968. Elles ont constitué un cadre de discussion entre les différents groupes qui ont directement participé de leur dynamique et ainsi permis une clarification positive sur les débats qui animent le milieu prolétarien, offrant ainsi un cadre de référence politique pour toutes les organisations ou éléments du milieu prolétarien en recherche d'une cohérence politique révolutionnaire. Les bulletins publiés en trois langues à la suite de chaque conférence et contenant les diverses contributions écrites et le compte-rendu de toutes les discussions sont restés une référence indispensable pour tous les éléments ou groupes qui depuis ont rejoint les positions révolutionnaires.
En ce sens, malgré l'échec final qu'ont connu les conférences, celles-ci ont constitué un moment fructueux de l'évolution du milieu politique prolétarien en permettant aux différents groupes de mieux se connaître, en offrant un cadre qui a permis une clarification et une décantation politique positive.
Le rôle positif des conférences et l'écho grandissant qu'elles ont rencontré, ne se manifeste pas seulement dans le nombre croissant des groupes qui y participent, mais elles montrent à l'ensemble des groupes du milieu prolétarien l'intérêt de telles rencontres. La conférence d'Oslo en septembre 1977 qui regroupe des groupes Scandinaves et à laquelle participe le CCI, même si elle se tient sur des bases encore trop floues, témoigne du besoin ressenti dans le milieu prolétarien international.
Mais avec le recul, c'est dans le vide qui est créé par leur disparition, et dans la crise du milieu politique qui va suivre l'échec de la IIIème conférence, que se mesure paradoxalement le plus clairement l'apport positif des conférences.
La crise du milieu politique prolétarien
Au même moment où se tiennent les conférences, le milieu politique de la fin des années 70 est marqué par un double phénomène : d'une part l'effondrement de la mouvance conseilliste, pôle de débat dominant du début de la décennie, et d'autre part le développement du PCI (Programme communiste) qui devient l'organisation la plus développée du milieu prolétarien.
La dégénérescence politique du PCI bordiguiste
Si le PCI (Programme communiste) est devenu l'organisation la plus développée du milieu politique, ce n'est pas seulement par son existence internationale dans plusieurs pays: Italie, France, Suisse, Espagne, etc., publiant en français, italien, anglais, espagnol, arabe, allemand, mais aussi par ses positions politiques qui, dans une période de reflux de la lutte de classe, connaissent un succès certain pas uniquement auprès d'éléments produits par la décomposition du gauchisme mais aussi au sein même du milieu prolétarien constitué. L'incapacité du « conseillisme » à résister à la lutte de classe et à son reflux traduit concrètement la faillite où mène le rejet de la nécessité du parti politique de la classe ouvrière et la sous-estimation profonde de la question de l'organisation que cette position implique. L'insistance du PCI sur la nécessité du parti est donc tout à fait juste, cependant sa conception "substitutionniste" absolument caricaturale pour laquelle le parti est tout et la classe n'est rien, forgée durant les plus profondes années de contre-révolution au lendemain de la seconde guerre mondiale lorsque la classe exsangue est mystifiée comme elle ne l'avait jamais été auparavant, est la théorisation de la faiblesse du prolétariat. Le Parti est présenté comme la panacée à toutes les difficultés de la lutte de classe. A un moment où la lutte reflue le développement de l'écho des positions du PCI sur la question du parti est le reflet des doutes sur la classe ouvrière ; ce doute sur les capacités révolutionnaires de la classe ouvrière va trouver sa concrétisation éclatante dans la dérive opportuniste du PCI (Programme communiste) qui va aller en s'accélérant tout au long de ces années. Alors que les travailleurs des pays développés sont censés toucher les dividendes de l'impérialisme, gages de leur passivité, c'est à la périphérie du capitalisme, dans les soi-disant "luttes de libération nationale" que le PCI voit se développer les potentialités révolutionnaires. Cette dérive nationaliste va ainsi amener Programme communiste à soutenir la terreur des Khmers rouges au Cambodge, les luttes nationalistes en Angola et la "révolution palestinienne" ainsi que pour faire bonne mesure l'OLP, tandis qu'en France par exemple l'intervention privilégiée du PCI dans les luttes des travailleurs "immigrés" va tendre à renforcer le fardeau pesant des illusions nationalistes. Les conceptions fausses du bordiguisme sur la question du parti, sur la question nationale mais aussi sur la question syndicale sont autant de portes largement ouvertes à la pénétration de l'idéologie dominante à laquelle le PCI est en train de succomber. Le développement du bordiguisme comme principal pôle politique au sein du milieu prolétarien est l'expression du recul de la lutte de classe, sa théorisation. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que le PCI (Programme communiste) qui préfère ouvrir les portes au gauchisme bourgeois plutôt que de discuter au sein du milieu communiste révolutionnaire, paye cette attitude d'une dégénérescence politique accélérée qui se traduit par un abandon des principes mêmes qui avaient présidé à sa naissance.
Les débats au sein du milieu prolétarien au début des années 80
Cependant, si le PCI (Programme communiste) pousse ses positions politiques jusqu'à la caricature, les conceptions erronées qui les sous-tendent et qui sont issues de positions débattues au sein de la IIIème Internationale, sont présentes dans les conceptions générales d'autres groupes (sans atteindre cependant le même niveau d'aberration), et notamment ceux qui comme le PCI de Bordiga trouvent leur origine à des degrés divers dans le Parti Communiste Internationaliste constitué principalement en Italie au lendemain de la IIème guerre impérialiste mondiale : le PCI (Battaglia comunista) qui en est la continuité la plus claire sur ses principes révolutionnaires, Il Partito comunista d'Italie scission de Programme communiste en 1973 et le NCI par exemple.
Dans ces conditions, il n'est donc pas surprenant que les débats qui ont lieu au sein des conférences, tendent à se polariser autour des mêmes questions fondamentales : question du parti, question nationale, question syndicale car ce sont les questions de l'heure déterminées par la situation mondiale et l'histoire propre du milieu prolétarien. Dans les conférences, le NLI(NCI+I1 Leninista) est le groupe le plus proche des positions bordiguistes, Battaglia comunista faisant des concessions à ces conceptions sur les questions nationale et syndicale. Quant à la question du parti, on a vu qu'elle fut un prétexte au sabotage de la dynamique des conférences. La CWO de son côté a poursuivi durant les conférences une évolution qui, à partir d'une plate-forme très proche de celle du CCI, la mène à se rapprocher des conceptions du PCI (Battaglia comunista).
L'accélération de l'histoire au début des années 80 et la décantation au sein du milieu politique
Avec l'échec des conférences, c'est donc un milieu prolétarien encore profondément divisé qui va se trouver confronté à une très forte accélération de l'histoire au début des années 80 qui sera marquée par :
- le développement international de la vague de luttes ouvrières qui met fin au reflux qui avait succédé à la vague commencée en 1968 et qui culmine avec la grève de masse en Pologne, sa répression brutale et le fort reflux international de la lutte de classe qui suit ;
- l'exacerbation des tensions inter impérialistes entre les deux "grands" avec l'intervention russe en Afghanistan et l'intense propagande guerrière qui se déchaîne tandis que la course aux armements s'accélère ;
- la plongée dans la crise de l'économie mondiale, la récession américaine de 1982, la plus forte depuis celle des années 30 entraîne celle de l'ensemble de l'économie mondiale.
Si les leçons de l'histoire peuvent échapper à certains, par contre nul ne peut échapper à celles-ci. Inévitablement, une décantation politique doit se faire au sein du milieu prolétarien, l'expérience historique doit apporter sa sanction.
La vague de lutte de classe qui se lance à la fin des années 70 va poser concrètement la nécessité de l'intervention des révolutionnaires.
Les luttes des sidérurgistes de Lorraine et du nord de la France en 1979, la grève des sidérurgistes de G.B. en 1980 et finalement la grève de masse des ouvriers de Pologne en 1980 vont se heurter à la radicalisation de l'appareil syndical, au syndicalisme de base. Les luttes vont être dévoyées, défaites et la victoire de Solidarnosc signifie l'affaiblissement de la classe ouvrière qui va permettre la répression. L'avortement de la vague internationale de lutte de classe et le brutal reflux qui suit vont être une épreuve de vérité pour le milieu politique prolétarien.
Dans ces conditions; alors que l'échec des conférences ne permet plus au milieu prolétarien d'avoir un lieu où se poursuit la confrontation des positions politiques,l'inévitable décantation ne pourra permettre que la sélection politique se traduise par la polarisation des énergies révolutionnaires dans la dynamique de regroupement ; au contraire, au feu de l'accélération de l'histoire, la sélection politique va se faire par le vide, par une hémorragie des énergies militantes qui sont happées par la débâcle des organisations incapables de répondre aux besoins de la classe ouvrière. Le milieu politique prolétarien est entré dans une phase de crise ([9] [175]).
La question de l'intervention : la sous-estimation du rôle des révolutionnaires et la sous-estimation de la lutte de classe
Confronté à la nécessité de l'intervention, le milieu prolétarien va réagir en ordre dispersé et montrer la profonde sous-estimation du rôle des révolutionnaires qui le mine. L'intervention du CCI au sein des luttes ouvrières, et notamment avec les événements de Longwy Denain en France va être la cible des critiques ([10] [176]) de l'ensemble du milieu prolétarien, mais au moins, celle-ci a le mérite d'exister. En dehors du CCI, le milieu politique brille plutôt par son absence du terrain des luttes ouvrières : le PCI (Programme communiste) par exemple, la principale organisation, qui s'était caractérisé par son activisme dans la période précédente, ne voit pas la lutte de classe sous ses yeux ; hypnotisé par ses rêves tiers-mondistes il continue par ailleurs sa dérive syndicaliste.
La faiblesse de l'intervention du milieu politique traduit sa profonde sous-estimation de la lutte de classe, son manque d'expérience et son incompréhension de celle-ci. Cela se cristallise particulièrement autour de la question syndicale, non seulement par les concessions politiques vis-à-vis de celle-ci exprimées à des degrés divers par les groupes issus du PCI de 1945, mais aussi par une tendance à rejeter l'importance et la positivité des luttes qui se mènent, car celles-ci restent prisonnières du carcan des syndicats, du terrain "économique". Ainsi, paradoxalement, les tendances conseillistes et celles issues du PCI de 1945 se rejoignent pour rejeter l'importance des luttes ouvrières au nom de l'emprise syndicale qui persiste. Programme communiste, Battaglia comunista comme bien d'autres, par exemple le FOR, persistent à nier la réalité du développement de la lutte de classe depuis 1968 et à affirmer que la contre-révolution continue son règne. Dans ce contexte, la CWO va se singulariser par son appel à l'insurrection en Pologne, mais cette grave surestimation ponctuelle ne fait que traduire les mêmes incompréhensions qui dominent malheureusement le milieu politique en dehors du CCI.
L'explosion du PCI (Programme communiste)
La défaite en Pologne, le recul international de la lutte de classe qui avec la plongée dans la récession économique vont être autant de coups de boutoir de la réalité, vont faire des ravages au sein d'un milieu qui n'avait pas su pleinement être à la hauteur de ses responsabilités historiques. Les plus touchés par la crise du milieu politique vont d'abord être les groupes qui se sont signalés par leur refus de la dynamique des conférences. C'est dans l'indifférence que le Spartakusbond en Hollande et le PIC en France (ainsi que sa continuité avortée, le Groupe Volonté Communiste au nom si mal choisi) vont être emportés comme des fétus de paille par la tempête de l'accélération de l'histoire. Par contre, l'explosion du PCI (Programme communiste) en 1982 va bouleverser le paysage du milieu politique. Le parti bordiguiste monolithique, l'organisation la plus "importante" du milieu, paye le prix de longues années de sclérose et de dégénérescence politique dans l’isolement le plus sectaire qui en a accéléré le processus : il va éclater sous l'impulsion des éléments nationalistes d'El Oumami, et imploser avec l'hémorragie brutale de ses forces militantes qui, déboussolées et démoralisées se perdent dans la nature. De cette crise le PCI sort exsangue, le centre s'est effondré, les liens internationaux se sont perdus, ce qu'il reste des sections à la périphérie se retrouve isolé ; le PCI n'est plus qu'un pâle reflet de l'organisation pôle qu'il a été au sein du milieu. Cette débandade du PCI (Programme communiste) marque l'effondrement définitif du bordiguisme comme pôle politique dominant au sein du milieu prolétarien.
Les effets de la crise sur les autres groupes du milieu prolétarien
Cependant, si l'éclatement du PCI (Programme communiste) est la preuve la plus claire de la crise du milieu politique, celle-ci est bien plus large et touche aussi les groupes qui ont participé à des degrés divers à la dynamique des conférences.
Les groupes les plus faibles, ceux qui sont le produit des circonstances immédiates, sans tradition et identité politiques propres vont disparaître avec la fin des conférences ; Arbetarmakt en Suède, l'Eveil internationaliste en France, le Marxist Workers' Group aux USA, etc. D'autres groupes plus solides, car mieux enracinés dans une tradition politique mais qui lors des conférences avaient montré leur faiblesse, non seulement par leurs positions politiques mais aussi, comme le FOR et le GCI, par leur irresponsabilité sectaire, vont connaître avec la confrontation à l'accélération historique une dégénérescence politique grandissante :
- le NLI en Italie va suivre un chemin identique à celui déjà tracé par Programme communiste par des abandons répétés des principes sur les questions nationales et syndicales et un flirt de plus en plus poussé avec le gauchisme bourgeois ;
- le GCI quant à lui, ses positions confuses sur la question de la violence de classe inspirées du bordiguisme vont, moins paradoxalement qu'il n'y paraît à première vue, l'amener à se rapprocher de la mouvance anarchiste ;
- le FOR dans sa folle négation de la réalité de la crise économique va prendre des positions de plus en plus surréalistes où le radicalisme de la phrase remplace toute cohérence.
Le CCI, lui-même ne sera pas à l'abri des effets de cette crise du milieu prolétarien. L'implication du CCI dans l'intervention a soulevé d'importants et riches débats en son sein, mais en même temps le manque d'expérience organisationnelle qui pèse encore lourdement sur la génération présente de révolutionnaires va permettre à un élément à l'aventurisme douteux, Chenier, de cristalliser les tensions par des manoeuvres secrètes et finalement fomenter un vol contre le matériel de l'organisation. Les quelques éléments qui suivront Chenier dans son aventure publieront l'Ouvrier Internationaliste qui ne survivra pas à son premier numéro. Au même moment le Communist Bulletin Group qui se forme dans la même dynamique douteuse avec des éléments issus de la section du CCI en GB se met en dehors du milieu prolétarien par son soutien aux comportements gangstéristes d'un Chenier.
La formation opportuniste du BIPR
La formation en 1983 du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire ([11] [177]) qui regroupe la CWO de Grande-
Bretagne et le PCI (Battaglia comunista) d'Italie dans ce contexte de crise du milieu prolétarien semble être une réaction positive. Cependant si ce regroupement constitue une clarification du paysage politique sur le plan organisationnel, il n'en va pas de même sur le plan politique. Ce regroupement se situe dans la dynamique de l'échec des conférences, et ce sont les deux groupes qui sont responsables de cet échec qui en sont les acteurs ; il est dans la droite ligne de l'opportunisme et de l'esprit sectaire qu'ont manifesté ces deux organisations lors de la IIIème Conférence et par la suite.
Pour être un apport politique, il est indispensable que la dynamique de regroupement se fasse dans la clarté politique. Or, ce n'est certainement pas la dynamique qui préside au "regroupement" qui permet la formation du BIPR. Les débats qui déterminent la CWO à prendre ses distances d'avec sa plateforme d'origine qui d'ailleurs était très proche de celle du CCI - ce qui n'a pas empêché la CWO de refuser en 1974 tout regroupement avec Word Révolution, future section du CCI en GB car selon elle après 1921, après Kronstadt il n'y a plus de vie prolétarienne au sein du parti Bolchevik et des PCs, prétexte sectaire bien vite oublié quelques années plus tard- resteront un mystère pour l'ensemble du milieu politique. Ce ne sera que deux ans après la soi-disant IVème Conférence que seront publiés les comptes-rendus de discussion qui en fait n'apportent pas de réelle clarté sur l'évolution politique des deux groupes. La plate-forme d'adhésion au BIPR comporte les mêmes confusions et ambiguïtés caractéristiques que celles manifestées lors des conférences par BC sur la question syndicale, sur la question nationale, sur la possibilité du parlementarisme révolutionnaire, et évidemment sur la question du parti et du cours historique.
Mais surtout, la formation du BIPR traduit une conception fausse du regroupement des révolutionnaires. Le BIPR est un cartel d'organisations existantes plus qu'une nouvelle organisation produit d'un regroupement où les forces fusionnent autour de la clarté d'une plate-forme commune, chaque organisation adhérente garde sa spécificité. En plus de la plate-forme du BIPR, chaque groupe garde la sienne propre sans expliquer les importantes différences qui peuvent exister, cela permet de mesurer la fausse homogénéité du BIPR et l'opportunisme qui a présidé à sa formation.
La formation du BIPR n'est donc pas le signe annonciateur de la fin de la crise du milieu qui continue ses ravages, ni d'une nouvelle dynamique de clarification au sein des forces révolutionnaires mais l'expression d'un reclassement des forces du milieu politique qui se fait dans la confusion opportuniste et dans l'isolement sectaire.
En 1983, avec la crise qui a sévi, la face du milieu prolétarien est transformée. Le PCI bordiguiste a quasiment disparu et le CCI est devenu l'organisation la plus importante du milieu communiste, son pôle politique dominant et dans la mesure où l'histoire a apporté sa sanction historique, un pôle de clarté confirmé dans les débats qui animent le milieu. Le CCI est une organisation centralisée à l'échelle internationale qui par ses sections est présente dans dix pays et publie en sept langues. Cependant, si le CCI est devenu le principal pôle de regroupement, il n'est pas pour autant seul au monde. Le BIPR malgré la confusion qui a déterminé ses origines, par rapport à la déliquescence politique des autres groupes qui forment alors le milieu prolétarien constitue l'autre pôle de référence et de relative clarté politique qui va polariser les débats.
Comme on le voit les groupes qui ont le mieux résisté à la crise du milieu prolétarien, sont ceux qui ont su le mieux participer à la dynamique des conférences internationales ; ce seul fait permet de mesurer l'apport positif de celles-ci et rétrospectivement donc d'apprécier l'erreur politique majeure qu'a constitué leur dislocation dont le PCI (Battaglia comunista) et la CWO portent la lourde responsabilité.
A la mi-1983, après la courte mais profonde phase de recul de la lutte de classe qui a suivi la défaite en Pologne, les premiers signes d'une reprise des luttes ouvrières commencent à se manifester. Nous avons vu comment, à la fin des années 70 et au début des années 80, la question de l'intervention des révolutionnaires a été une épreuve de vérité pour le milieu prolétarien, c'est la question que l'histoire pose de nouveau aux révolutionnaires ; nous verrons dans la troisième partie de cette article si les organisations du milieu politique sauront, après 1983, se hisser à la hauteur des responsabilités qui sont les leurs.
JJ
[1] [178] Voir brochure "LA GAUCHE COMMUNISTE D'ITALIE".
[2] [179] Voir articles in Revue Internationale 11-16-17-21-25-28-36-37-38-45 et suivantes.
[3] [180] Voir article "Rencontre internationale convoquée par le PCI-"Battaglia comunista"(mai 1977) in Revue Internationale 10.
Voir Bulletin de la 1ère conférence des groupes de la gauche communiste.
[4] [181] Sur la CWO voir Revue Internationale 12-17-39.
[5] [182] Sur le PCI-Battaglia comunista voir Revue Internationale 13-33-34-36.
[6] [183] Sur le PCI-Programme communiste voir Revue Internationale 14-23-32-33.
[7] [184] Voir articles sur la Ilème conférence in Revue Internationale 16 et 17, sur le cours historique voir article in Revue Internationale 18. Voir Bulletin ( 2 volumes) de la Ilème conférence des groupes de la Gauche communiste.
[8] [185] Voir article sur la Ilème conférence in Revue Internationale 22. Voir Bulletin ( 3 volumes) de la Même conférence des groupes de la gauche communiste.
[9] [186] Sur la crise du milieu révolutionnaire, voir article in Revue Internationale 28-32.
[10] [187] Sur les débats sur l'intervention voir Revue Internationale 20-24.
[11] [188] Sur la formation du BIPR voir article in Revue Internationale 40-41.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [119]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [66]
Polémique : Comprendre la décadence du capitalisme (4)
- 4659 lectures
- Nous poursuivons ici la série d'articles entamée dans les n°48, 49 et 50 de la Revue Internationale qui s'attachait à défendre l'analyse de la décadence du capitalisme contre les critiques dont elle a été l'objet de la part de groupes du milieu révolutionnaire et plus particulièrement du GCI ([1] [189]).
- Dans le présent article nous tenterons de développer, sous différents aspects, les bases de la décadence du mode de production capitaliste et de répondre aux arguments qui les récusent.
- Au tournant des années 60-70 le CCI a dû se battre pour convaincre le milieu politique de la fin des "Golden Sixties" et de l'entrée du capitalisme mondial dans une nouvelle période de crise. Les graves secousses monétaires internationales d'octobre 87 et la stagnation effective de l'économie réelle depuis 10 ans ne laissent plus aucun doute et achèvent de démontrer l'ineptie de la position d'un groupe comme le FOR ([2] [190]) qui nie toujours la réalité de la crise économique. Mais il y a plus grave, alors qu'aujourd'hui le monde est au seuil de l'alternative Guerre ou Révolution, il se trouve encore des groupes révolutionnaires qui, reconnaissant pourtant la crise, se font le chantre de la vitalité du capitalisme.
Face à l'enjeu historique actuel (soit développement de l'actuel cours aux affrontements de classes vers une perspective révolutionnaire, soit défaite de la classe ouvrière et ouverture d'un cours vers la guerre) qui met en balance l'avenir de l'humanité, alors que la tâche des révolutionnaires est la démonstration de la faillite historique du mode de production capitaliste, de la nécessité et de l'actualité du socialisme, des groupes politiques se grattent le nombril sur les 'formidables taux de croissance de la reconstruction". Abandonnent la conception marxiste de la succession des modes de production en rejetant la notion de décadence et ils s'échinent à prouver que "... le capitalisme croît sans arrêt au-delà de toute limite". Il n'est pas étonnant que sur de telles bases, en l'absence d'un cadre d'analyse cohérent de la période, ces groupes défendent une perspective défavorable pour la classe ouvrière et des préoccupations essentiellement académistes pour l'activité des minorités révolutionnaires.
La réflexion théorique et la discussion constituent, pour la FECCI ([3] [191]) , la tâche prioritaire de l'heure (cf. Perspective Internationaliste. n°9 p38 et 32). Interloquée par l'urgent problème "d'une reconstruction de la longueur et de l'ampleur de celle qui a suivi la 2ème guerre mondiale", elle propose à tout le milieu de discuter des "graves questions" que cela pose (Perspective Internationaliste n°5 p30 et n°7 p20). Pour Communisme ou civilisation ([4] [192]) nous vivons toujours dans la période de contre-révolution qui perdure depuis les années 20 ("Communisme ou civilisation" n°22, p2); "avec la fin de la seconde guerre mondiale le mode de production capitaliste est entré dans une période d'accumulation pratiquement sans précédent" (p6) et "...en l'absence de rupture qualitative et quantitative..." de la lutte de classe, ce groupe se propose de produire par fascicule... semestriel... une grande fresque encyclopédique sur la théorie des crises et l'histoire du mouvement ouvrier. Pour le GCI, depuis la vague de luttes de 68-74 "la paix sociale, la paix des Versaillais règne" (éditorial du n°25 et n°26 p5, 6 et 9). La préoccupation essentielle de ce dernier groupe est la liquidation des acquis du socialisme; dans sa publication (Le Communiste n°23 pll) il assimile la conception marxiste de la décadence des modes de production aux visions religieuses du monde telles celles de Moon, des témoins de Jéhovah, etc.... La scission du GCI A Contre Courant ([5] [193]) reste sur le même terrain tant sur le plan historique "...nous rejetons dos à dos tant les schémas sclérosés de type décadentiste vulgaire (plaqués idéologiquenient sur une réalité qui les infirme chaque fois plus fort)...", que sur le plan actuel des rapports de force entre les classes "...ce qui matérialise pour nous essentiellement la dite crise boursière d'aujourd'hui est l'absence du prolétariat en tant que force révolutionnaire..." (A contre courant. n°1 p7).
La decadence du capitalisme
Pour voiler son involution anarchiste et l'abandon de toute référence au cadre marxiste d'analyse des sociétés, le GCI se couvre de l'autorité d'une conception erronée du "très marxiste" Bordiga ([6] [194]): "La conception marxiste de la chute du capitalisme ne consiste pas du tout à affirmer qu'après une phase historique d'accumulation, celui-ci s'anémie et se vide de lui-même. Ca, c'est la thèse des révisionnistes pacifistes. Pour Marx, le capitalisme croît sans arrêt au-delà de toute limite" (Le Communiste n°23 p10).
Si les décadences des modes de production antérieurs sont clairement identifiables (nous développerons ce point ultérieurement) soit parce qu'il y a recul absolu des forces productives -mode de production asiatique et antique- soit parce qu'il y a stagnation avec fluctuations séculaires -mode de production féodal- il n'en va pas de même pour le capitalisme. Mode de production éminemment dynamique, les bases de sa reproduction élargie ne lui permettent aucun répit, croître ou mourir tel est sa loi. Cependant tout comme dans les modes de production antérieurs, le capitalisme connait également une phase de décadence qui commence dans la seconde décennie de ce siècle et est caractérisée par le frein qu'exerce le rapport social fondamental de production (le salariat qui à terme se traduit par une insuffisance de marché solvables par rapport aux besoin de l'accumulation), devenu suranné, sur le développement des forces productives.
Ceci est violemment contredit par nos censeurs. Les affirmations péremptoires mises de côté, quels sont leurs argumcnts ?
1- Sur un plan théorique général l'on nous rétorque que l'analyse Luxembourgiste de la crise, sur laquelle nous nous appuyons, est incapable de féconder une explication cohérente de la "soit-disant" décadence du capitalisme: "Si nous suivons la logique luxembourgiste, c'est à dire la logique sur laquelle repose le raisonnement du CCI et la théorie de la décadence, on est amené à conclure que décadence doit rimer avec effondrement immédiat de la production capitaliste puisque toute Plus-Value destinée à l'accumulation ne peut être réalisée et, par suite, accumulée." (Communisme ou civilisation n°22 p5)
2- Sur un plan quantitatif général, il est affirmé que la dite période de décadence du capitalisme connaît, en réalité, une croissance bien plus rapide qu'en ascendance: "Pour l'ensemble du monde capitaliste, la croissance a été, au cours des vingt dernières années (1952-72 NDLR), au moins deux fois plus rapide qu'elle ne l'avait été de 1870 à 1914, c'est à dire pendant la période qui était généralement considérée comme celle du capitalisme ascendant. L'affirmation que le système capitaliste était entré depuis la première guerre mondiale dans sa phase de déclin est tout simplement devenue ridicule..." (P. Souyri cité dans Le Communiste n°23 pll), "Que plus de 70 ans après la date fatidique de 1914 le mode de production capitaliste accumule de la plus-value tandis que le taux et la masse de cette plus-value ont cru à un rythme supérieur à celui du 19ème siècle, siècle de la soi-disant phase ascendante du mode de production capitaliste ...".
3- Sur un plan circonstancié, en coeur avec tous les pourfendeurs du marxisme, les taux de croissance consécutifs à la seconde guerre mondiale (les plus élevés de toute l'histoire du capitalisme) sont brandis comme preuves décisives de l'inanité d'une décadence du mode de production capitaliste: "Car avec la fin de la seconde guerre mondiale, le mode de production capitaliste est entré dans une période d'accumulation pratiquement sans précédent depuis le passage à la phase de soumission réelle du travail au capital." (Communisme ou civilisation n°22 p6), "L'accumulation effrénée qui a suivi la 2ème guerre mondiale est venue balayer tous les sophismes à base de Luxembourgisme..." p41.
Sur le plan théorique
Nous n'allons pas revenir ici sur un sujet déjà largement traité et argumenté dans notre presse (Revue Internationale n°13,16,19,21,22,29,30). Bornons nous à relever le procédé foncièrement malhonnête de nos contradicteurs qui déforment sciemment nos propos afin de faire apparaître une absurdité qui n'existe que dans leur cerveau. Il consiste à prétendre que pour le CCI décadence = inexistence de marchés extra-capitalistes: "Si comme l'affirme par ailleurs le CCI les marchés extra capitalistes ont -du moins qualitativement- disparu, on ne voit pas ce que peut bien signifier cette exploitation des marchés anciens. Soit il s'agit de marchés capitalistes et alors leur rôle est nul pour l'accumulation soit il s'agit de marchés extra-capitalistes et on ne voit pas comment ce qui n'existe plus peut jouer un rôle quelconque."
Sur une telle base il n'est pas difficile à Communisme ou Civilisation de montrer l'impossibilité de toute accumulation élargie depuis 1914. Mais, pour Rosa Luxembourg et pour nous, la décadence du capitalisme se caractérise non par une disparition des marchés extra-capitalistes mais par une insuffisance de marchés extra-capitalistes par rapport aux besoins de l'accumulation élargie atteint par le capitalisme. C'est-à-dire que la masse de Plus-Value réalisée par les marchés extra-capitalistes est devenue insuffisante pour réaliser la part de Plus-Value produite par le capitalisme et destinée à être réinvestie. Une fraction du capital total ne trouve plus à s'écouler sur le marché mondial, signalant une surproduction qui, d'épisodique en période ascendante, deviendra un obstacle permanent auquel sera confronté le capitalisme en décadence. L'accumulation élargie s'en trouve donc ralentie mais n'en a pas disparu pour autant. L'histoire économique du capitalisme depuis 1914 est l'histoire du développement des palliatifs à ce goulot d'étranglement et l'histoire de l'inefficacité de ces derniers est signalée, entre autres, par les deux guerres mondiales (cf.ci-dessous).
Sur le plan quantitatif general
Pour illustrer la réalité d'un frein des forces productives par les rapports sociaux de production capitalistes, c'est-à-dire la décadence du mode de production capitaliste, nous avons calculé le développement qu'aurait eu la production industrielle sans le frein constitué par ces rapports sociaux de production depuis 1913. Ensuite nous comparons cet indice de production industrielle hypothétique (2401) à l'indice de production industriel réel (1440) pendant la même période (1913-83).
Pour ce faire, nous appliquons le taux de croissance de la dernière phase de l'ascendance du capitalisme à l'ensemble de la phase de décadence (1913-83) et nous comparons la croissance réelle en 83 (=1440) à la croissance potentiellement possible (=2401 -application du taux de croissance de 4,65% à la même période-) c'est à dire sans l'obstacle de l'insuffisance des marchés. Nous constatons que la production industrielle en décadence atteint 60% de ce qui eut été possible, bref que le freinage des rapports sociaux capitaIistes de production sur la croissance des forces productives est dé l'ordre de 40%. Et, ceci est encore sous-estimé pour trois raisons:
a- Nous devrions extrapoler non pas linéairement au taux de 4,65% mais sur base d'un taux à progression exponentielle car telle est la tendance au cours des différentes phases de prospérité du capitalisme ascendant étant donné le processus de technicité croissant du capital (1786-1820: 2,48%, 1840-70: 3,28%, 1894-1913: 4,65%).
b- La croissance réelle en décadence est surestimée dans la mesure où cette dernière est droguée par une série d'artifices (point que nous développerons dans un prochain article) qu'il faudrait défalquer. Par exemple, la part de la production d'armement -secteur improductif- dans le produit intérieur mondial augmente fortement en décadence (1,77% en 1908, 2,5% en 1913, 8,3% en 1981 ([7] [195])) et donc plus fortement encore dans la production industrielle mondiale car la part de cette dernière dans le produit intérieur mondial baisse au cours de la décadence.
c- La crise actuelle se poursuivant, la stagnation du taux de croissance après 1983 ne ferait qu'accroître davantage le décalage.
Si l'on additionne l'ensemble de ces phénomènes nous atteignons facilement un frein au développement des forces productives de l'ordre de 50% !
Pourquoi avoir choisi le taux de croissance de la période 1895-1913 et non le taux de l'ensemble de la phase ascendante?
a- Parce qu'il faut comparer des choses comparables. A ses débuts, le capitalisme est entravé par d'autres freins: la subsistance de rapports de production hérités de la féodalité. La production n'est pas encore pleinement capitaliste (forte subsistance du travail à domicile ([8] [196]), etc...), alors qu'elle l'est en 1895-1913.
b- Parce que la période 1895-1913 fait suite à la poussée majeure de l'impérialisme (conquêtes coloniales) qui s'est déroulée dans la phase précédente (1873-95) ([9] [197]). Nous avons donc là une période qui reflète au mieux les potentialités productives du capitalisme puisqu'il a à sa disposition un marché "sans limites". Ceci rejoint tout à fait notre objectif qui était de comparer un capitalisme sans frein et avec frein.
c- Parce qu'autrement l'on supprimerait la tendance exponentielle à l'accroissement des taux de croissance au cours du temps.
Ces éléments récusent définitivement toutes les affabulations sur "un capitalisme croissant deux fois plus rapidement en décadence qu'en ascendance". La "démonstration" de Souyri (cf. citation ci-dessus) sur laquelle s'appuie le GCI n'est qu'une grossière mystification car elle compare deux périodes incomparables :
a- Pour le GCI et Souyri, 1952-72 est la période censée représenter la décadence alors qu'elle exclut les deux guerres mondiales (14-18 et 39-45) et les deux crises (29-39 et 67-...) !
b- Elle compare une phase homogène de 22 ans de croissance droguée à une phase hétérogène de 44 ans de vie normale du capitalisme (cette dernière phase inclut une phase de ralentissement relatif du capitalisme 1870-94 (3,27%) qui se décloisonne par le colonialisme massif débouchant sur une phase de forte croissance 1894-1913 (4,65%).
c- Elle compare deux périodes dont les bases qui sous-tendent la croissance sont qualitativement différentes (cf. ci-dessous).
La décadence est loin d'être un "schéma sclérosé vulgaire plaqué idéologiquement sur une réalité qui l’infirme chaque fois plus" mais une réalité objective depuis le début de ce siècle qui se confirme d'avantage de jour en jour.
Sur le plan qualitatif
La décadence d'un mode de production ne saurait se mesurer à la seule aune des indices statistiques. C'est à un faisceau de manifestations quantitatives mais également qualitatives et superstructurelles qu'il faut se référer pour bien saisir le phénomène.
Nos censeurs feignent de les ignorer pour ne pas avoir à se prononcer, tout heureux d'avoir pu brandir un chiffre dont nous avons vu ce qu'il fallait en penser.
a/ Cycle de vie du capitalisme en ascendance et en décadence.
Le graphique n°1 est illustratif de la dynamique générale du capitalisme. En ascendance, la croissance est en progresston continue avec de faibles fluctuations. Elle est rythmée par des cycles de crise - prospérité - crise atténuée -prospérité accrue -etc... En décadence, outre un frein global sur la croissance (cf. ci-dessus), elle connait d'intenses fluctuations jamais vues auparavant. Deux guerres mondiales et un fort ralentissement ces quinze dernières années, voire une stagnation depuis moins de 10 ans. Le commerce mondial n'a lui-même jamais connu d'aussi fortes contractions (stagnation de 1913 à 48 et violent freinage ces dernières années) illustrant le problème permanent, en décadence, de l'insuffisance de marchés solvables.
Le Tableau n°l illustre le cycle qui rythme la vie du capitalisme en décadence: une spirale grandissante de crise - guerre - reconstruction - crise décuplée - guerre décuplée - reconstruction droguée.... Mais la décadence a une histoire et n'est pas un éternel recommencement du cycle. Nous vivons le début de la 3ème spirale et l'enjeu pour aujourd'hui c'est le vieux cri de guerre de Engels: "socialisme ou barbarie": "Le triomphe de l'impérialisme aboutit à l'anéantissement de la civilisation, sporadiquement pendant la durée d'une guerre moderne et définitivement si la période des guerres mondiales qui débute maintenant (1914 NDLR) devait se poursuivre sans entrave jusque dans ses demières conséquences. C'est exactement ce que F. Engels avait prédit, une génération avant nous, voici quarante ans (...). C'est là un dilemme de l'histoire du monde, un ou bien - ou bien encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. Celui-ci doit résolument jeter dans la balance le glaive de son combat révolutionnaire: l'avenir de la civilisation et de l'humanité en dépendent" (Rosa Luxembuug in "La crise de la social-démocratie", p68, Ed. La Taupe).
TABLEAU 1
1er spirale
Crise Guerre Reconstruction droguée
1913 1914-18 1918-24
1.5 ans de crise 4 ans et 20 millions de morts 10 ans
2ème spirale
Crise Guerre Reconstruction droguée
1929-39 1939-45 1945-67
10 ans de crise 6 ans, 50 millions de mort 26 ans
et destructions massives
3ème spirale
Crise Guerre Reconstruction droguée
1967-….
20ans de crise déjà guerre irrémédiable pour ……
L’humanité ou révolution
b/ Les guerres en ascendance et en décadence du capitalisme.
"Depuis l'ouverture de la phase impérialiste du capitalisme au début du siècle actuel, l'évolution oscille entre la guerre impérialiste et la révolution prolétarienne. A l'époque de la croissance du capitalisme, les guerres frayaient la voie de l'expansion des forces productives par la destruction des rappons surannés de production. Dans la phase de décadence capitaliste, les guerres n'ont d'autre fonction que d'opérer la destruction de l'excédent des richesses..." Résolution sur la constitution du Bureau International des Fractions de la Gauche Communiste, OCTOBRE n°1 de février 1938, p4 et 5.
En période ascendante, les guerres se manifestent essentiellement en phase d'expansion du capitalisme comme produit de la dynamique d'un système en expansion:
1790-1815: Guerres de la révolution, guerres de l'empire (Napoléon).
1850-1873: Guerres de Crimée, de Sécession, du Mexique, d'unification nationale (Allemagne et Italie), Franco-Prussienne (1870).
1895-1913: Guerres Hispano-U.S., Russo-Japonaise, Balkaniques.
Au 19ème siècle, la guerre a, en général, la fonction d'assurer à chaque nation capitaliste une unité (guerre d'unification nationale) et/ou une extension territoriale (guerres coloniales) nécessaire à son développement. En ce sens, malgré les calamités qu'elle entraîne, la guerre est un moment de la nature progressive du capital; tant qu'elle permet un développement de celui-ci, ce sont des frais nécessaires à l'élargissement du marché et donc de la production. C'est pourquoi Marx parlait de guerres progressives pour certaines d'entre elles. Les guerres sont alors: a) limitées à 2 ou 3 pays généralement limitrophes, b) elles sont de courte durée, c) elles provoquent peu de dégâts, d) elles sont le fait de corps spécialisés et mobilisent peu l'ensemble de l'économie et de la population, e) elles sont déclenchées dans un but rationnel de gain économique. Elles déterminent, tant pour les vaincus que pour les vainqueurs, un nouvel essor. La guerre franco-prussienne est typique de cc genre de guerre: elle constitue une étape décisive dans la formation de la nation allemande, c'est à dire la création des bases pour un formidable développement des forces productives et la constitution du secteur le plus important du prolétariat industriel d'Europe; en même temps, cette guerre dure moins d'un an, n'est pas très meurtrière et ne constitue pas, pour le pays vaincu, un réel handicap.
En période de décadence, par contre, les guerres se manifestent à l'issue des crises (cf. tableau 1) comme produit de la dynamique d'un système en contraction. Dans une période où il n'est plus question de formation d'unités nationales ou l'indépendance réelle, toute guerre prend un caractère inter-impérialiste. Les guerres sont par nature:
a) généralisées au monde entier car trouvant leurs racines dans la contraction permanente du marché mondial face aux nécessité de l'accumulation, b) elles sont de longue durée, c) elles provoquent d'énormes destructions, d) elles mobilisent l'ensemble de l'économie mondiale et de la population des pays belligérants, e) elles perdent, du point de vue du développement du capital global toute fonction économique progressistes, devenant purement irrationnelles. Elles ne relèvent plus du développement des forces productives mais de leur destruction. Elles ne sont plus des moments de l'expansion du mode de production mais des moments de convulsion d'un système décadent. Alors que par le passé un vainqueur émergeait et que l'issue de la guerre ne préjugeait pas du développement futur des protagonistes, dans les deux guerres mondiales ni les vainqueurs, ni les vaincus, n'en sortent renforcés mais affaiblis, au profit d'un troisième larron, les E.U.. Les vainqueurs n'ont pu faire payer leurs frais de guerre aux vaincus (comme la forte rançon en Marks OR payés à l'Allemagne par la France suite à la guerre franco-prussienne). Dans la période de décadence, le développement des uns se fait sur la ruine des autres. Autrefois, la force militaire venait appuyer et garantir les positions économiques acquises ou à acquérir; aujourd'hui, l'économie sert de plus en plus d'auxiliaire à la stratégie militaire.
A Contre Courant et Communisme ou Civilisation se refusent à reconnaître cette différence qualitative entre les guerres d'avant et d'après 1914 « A ce niveau nous tenons à relativiser même l'affirmation de guerre mondiale (...) Toutes les guerres capitalistes ont donc essentiellement un contenu international (...) Ce qui change réellement n'est pas le contenu mondial invariant (n'en déplaise aux décadentistes) mais bien l'étendue et la profondeur chaque fois plus réellement mondiale et catastrophique." (A Contre Courant n°l, p18). Communisme ou Civilisation, avec une pointe d'ironie, essaie de nous opposer Rosa Luxemburg pour qui "..le militarisme n'est pas caractéristique d'une phase particulière du mode de production capitaliste" (Communisme ou Civilisation n°22, p4). Ce groupe oublie que si effectivement pour Rosa Luxembourg "..le militarisme accompagne toutes les phases historiques de l'accumulation", pour elle également, la nature et la fonction des guerres et du militarisme changent avec l'entrée en décadence du système capitaliste "La force impérialiste d'expansion du capitalisme qui marque son apogée et constitue son dernier stade a pour tendance, sur le plan économique, la métamorphose de la planète en un monde où règne le mode de production capitaliste (...) La guerre mondiale est un tournant dans l'histoire du capitalisme (...) Aujourd'hui la guerre ne fonctionne plus comme une méthode dynamique susceptible de procurer au jeune capitalisme naissant les conditions de son épanouissement national (...) la guerre produit un phénomène que les guerres précédentes des temps modernes n'ont pas connu: la ruine économique de tous les pays qui y prennent part..." (Rosa Luxemburg in "La crise de la social-démocratie").
Si l'image de la décadence est celle d'un corps qui croît dans un habit devenu trop étroit, la guerre marque la nécessité pour ce corps de s'auto-phagocyter, de dévorer sa propre substance pour ne pas faire craquer l'habit, telle est la signification de ces destructions massives de forces productives. La vie en blocs rivaux, la guerre, sont devenues des données permanentes, le mode de vie même du capitalisme
LE DEVELOPPEMENT DU CAPITALISME D'ETAT
Le développement de l'Etat dans tous les domaines, son emprise croissante sur l'ensemble de la vie sociale est une caractéristique inéquivoque d'une période de décadence. Chaque mode de production antérieur, asiatique, antique, féodal, a connu une telle hypertrophie de l'appareil d'Etat (nous y reviendrons ultérieurement). Il en va de même pour le capitalisme. Un mode de production qui, sur le plan économique, devient une entrave au développement des forces productives, se matérialisant par un disfonctionnement et des crises d'ampleur croissante. Qui, sur le plan social, est contesté par la nouvelle classe révolutionnaire porteuse des nouveaux rapports sociaux de production et par la classe exploitée ([10] [198]) au travers d'une lutte de classe de plus en plus âpre. Qui, sur le plan politique, est constamment déchiré par les antagonismes internes à la classe dominante débouchant sur des guerres intestines de plus en plus meurtrières et destructrices. Qui, sur le plan idéologique, voit ses valeurs se décomposer, et réagit en blindant ses structures à l'aide d'une intervention massive de l'Etat.
Dans la décadence du capitalisme l'Etat supplante l'initiative privée qui survit de plus en plus mal au sein d'un marché sur-saturé. Au travers des anciennes organisations ouvrières (PS, PC et syndicats) et d'un ensemble de mécanismes sociaux rattachant la classe ouvrière à l’Etat (sécurité sociale, etc...) il encadre un prolétariat développé, devenu un danger permanent pour la bourgeoisie, et discipline les fractions particulières du capital derrière l'intérêt général du système. Une mesure, encore que très partielle, de ce processus nous est fournie par le développement de l'intervention de l'Etat dans la formation du P.N.B.. Nous reproduisons, ci-dessus les graphiques illustrant cet indicateur pour trois pays ([11] [199]).
La rupture en 1914 est nette, la part de l'Etat dans l'économie est constante tout au long de la phase ascendante du capitalisme alors qu'elle croît au cours de sa décadence pour atteindre aujourd'hui une moyenne avoisinant les 50% du P.N.B. ! (47% en 1982 pour les 22 pays les plus industrialisés de l'OCDE).
La FECCI ne critique pas encore ouvertement la théorie de la décadence du capitalisme mais elle l'abandonne petit à petit, insidieusement, au fil de ses "contributions à la discussion" qui constituent autant de bornes qui jalonnent sa régression. Sa "contribution" sur le capitalisme d'Etat dans "Perspective Intemationnaliste" n°7 en est une illustration flagrante.
Pour la FECCI la décadence ne s'explique plus essentiellement par l'insuffisance mondiale de marchés extra-capitalistes mais par le mécanisme du passage de la domination formelle à la domination réelle du capital: "C'est ce passage qui pousse le MPC vers sa crise permanente, qui rend insolubles les contradictions du procès de production capitaliste (...) le lien inextricable entre ce passage et la décadence du capitalisme" (p25 et 28). Il en va de même pour le développement du capitalisme d'Etat: 'A cet égard, il est essentiel de reconnaître le rôle non moins décisif joué par le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital dans le développement du capitalisme d'Etat (...) L'origine du capitalisme d'Etat doit également être cherchée dans la transformation économique fondamentale interne au mode de production capitaliste amenée par le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital" (p24 et 20). Sur cette base la FECCI, qui n'en est plus à une régression près, critique notre thèse de la restriction du champ d'application de la loi de la valeur sous le capitalisme d'Etat au nom du développement du libre-échange après la seconde guerre mondiale: "Donc, loin de s'accompagner d'une restriction de l'application de la loi de la valeur, le capitalisme d'Etat en marque la plus grande extension" (p20). Dans un même élan la FECCI introduit l'idée que le but de la guerre est la destruction de capital (p25 et 26). Découvrant le 6ème chapitre inédit du Capital de Marx avec 20 ans de retard sur les modernistes, la FECCI y trouve l'inspiration nécessaire pour abandonner la cohérence des positions révolutionnaires.
a/ Ce "groupe" confond deux choses diamétralement opposées, d'une part, le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital, c'est à dire, le passage à un mode d'organisation plus productif de la production et un mode d'extraction plus efficace de la plus-value et, d'autre part, le capitalisme d'Etat qui est une réponse face aux difficultés du capitalisme à survivre, à réaliser l'entièreté de la plus-value produite. L'un est une réponse à "comment mieux développer le capital", l'autre est une réponse au blo cage de ce développement. L'un propose un nouveau mécanisme d'extraction de la plus-value, l'autre est une perversion de ce mécanisme afin de survivre dans le cadre d'une crise permanente.
b/ En plaçant le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital à la charnière du 20ème siècle, la FECCI se trompe ... d'un siècle. Le capitalisme d'Etat se développe avec la décadence du capitalisme, le passage à la domination réelle se réalise au cours de la phase ascendante. Marx montre que les rapports capitalistes de production s'emparent tout d'abord de la production telle qu'elle est héritée des modes de production précédents, c'est la période de soumission formelle qu'il situe au 17ème, début du 18ème, ce n'est qu'ultérieurement que le capital se soumet réellement les forces de production déterminant la révolution industrielle du 18ème et du début du 19ème siècle. Comme l'explique très bien le G.P.I. critiquant le C.CA. ([12] [200]): "Si l'époque de la décadence correspondait au passage à la domination réelle du processus de travail, nous devrions la situer à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème. Encore une fois, nous nous trouvons en face de la tendance à diluer l'époque déterminée de la décadence dans le développement général du capitalisme" (Revue Internationale n°52 p19).
c/ Le capitalisme d'Etat est l'expression de la contradiction entre la socialisation mondiale de la production et la base nationale des rapports sociaux de production capitalistes. Il montre l'incapacité du capitalisme en décadence à dépasser le cadre de fEtat devenu trop étroit pour contenir le développement des forces productives. Toute la décadence du capitalisme est là pour nous le démontrer:
1- Les limites des organisations internationales (tant invoquées par la FECCI dans son argumentation). Nous assistons à un développement croissant des rivalités nationales que seul l'Etat peut prendre en charge et non 'à une coopération croissante entre Etats. Même si cela passe par , un minimum de coopération dans le cadre d'une politique obligée de blocs.
2- Dans ce cadre, chaque pays, en décadence, doit tricher avec la loi de la valeur s'il ne veut pas, soit être mangé par un pays plus puissant, soit voir son économie se désagréger sous le poids de ses contradictions insurmontables. La décadence correspond au plein développement des tricheries avec la loi de la valeur, à une restriction relative de son champ d'application. Quelques exemples: les pays dits "socialistes" (1/4 de la production manufacturière mondiale !) qui pour survivre ont du s'isoler du marché mondial et pratiquer sur leur propre marché une politique de prix en porte à faux avec la loi de la valeur, toute la production agricole européenne qui pour se vendre est artificiellement soutenue et vendue à un prix qui ne correspond pas à la logique de la loi de la valeur, il en va de même pour les prix de toute une série de produits des pays sous-développés, toutes les formes de protectionnisme déguisé qui touchent près des deux tiers du commerce mondiale selon le GATT (droits de douanes, quotas d'importation, subsides à l'exportation, réglementation à l'importation, etc...), les marchés 'protégés" (dotation d'une aide financière à la condition qu'elle serve à s'approvisionner en produits chez le pays donateur), marché des commandes publiques (monopole aux entreprises nationales), accords entre firmes nationales, cartels et monopoles sur les marchés et les prix, etc... Tous ces exemples illustrent ce processus de restriction relative du champ d'application de la loi de la valeur. Eblouie par la reconstruction, le GATT, la Banque Mondiale... et surtout par la propagande bourgeoise, la FECCI prend des vessies pour des lanternes.
d/ Enfin et surtout, la vision développée par la FECCI pour expliquer le développement du capitalisme d'Etat est celle d'un mécanisme strictement économique, une adaptation à un mode d'organisation de la production alors que le capitalisme d'Etat est une réaction d'un système qui craque de toute part et qui est obligé de blinder ses structures sur tous les plans tant social, politique, économique et militaire. Aspects que la FECCI se garde bien d'aborder.
S'il y a bien une chose sur laquelle Communisme ou Civilisation a raison c'est lorsqu'il parle de l'avenir de la FECCI en ces termes: "La FECCI a entrepris de penser, pour l'instant en se débattant dans les insurmontables contradictions de la théorie de la décadence, et elle ne fait que resserrer le noeud coulant qui l'étrangle. A toute cette agitation théorique il n'existe que deux issues: ou la FECCI rompra avec la théorie de la décadence, ou ce qui est pour l'instant plus probable, elle s'arrêtera de penser par elle même" (n°22 p24).
Toutes les décadences antérieures ont connu un arrêt de l'expansion géographique de leurs rapports sociaux de production et un frein dans l'intégration de forces de travail à ces derniers. Arrêt de l'expansion romaine, diminution de la population, expulsion croissante de travailleurs du processus de production, développement de nouveaux rapports de production à la périphérie de l'empire romain, tel est le tableau de la décadence de Rome. Arrêt des défrichements, stagnation de la population, émigration, fuite des paysans vers les villes, développement des rapports de production capitaliste, tel est le tableau de la décadence féodale.
Un processus analogue se développe au sein de la décadence du capitalisme (hormis pour le développement de nouveaux rapports de production qui ne pourront s'instaurer qu'après la prise du pouvoir au niveau mondial). En phase ascendante, l'existence de marchés vierges à conquérir, tant internes qu'externes, le faible capital nécessaire au démarrage industriel, la faiblesse de la pénétration du capital des pays dominants, permettaient à divers pays d'accrocher les wagons de leur économie au train de la révolution industrielle et d'acquérir une réelle indépendance politique.
TABLEAU 2
Evolution de l'écart entre le P.N.B./habitant des pays sousdéveloppés et développés de 1850 à 1980. Source: P. Bairoch et Banque, Mondiale.
Écart moyen
1850 1/5
1900 1/6
1930 1/7.5
1950 1/10
1970 1/14
1980 1/16
Depuis, la situation s'est quasi figée, les conditions économiques de la décadence n'offrent plus de possibilités réelles d'émergence et de développement de nouveaux pays, pire, l'écart relatif entre les premiers pays industrialisés et les autres se creuse.
Alors que l'écart est quasi constant au cours de la phase ascendante il saute de 1 à 6 à 1 à 16 en décadence. Bairoch, dans son livre "Le Tiers-monde dans l'impasse" (Ed. Idées/Gallimard, 1971) a publié un tableau illustrant l'arrêt de l'expansion géographique de la révolution industrielle et de la réduction relative de la population (!) touchée par celle-ci dans la décadence du capitalisme.
TABLEAU 3
Dates Nombre de pays: Pourcentage de la population mondiale:
1700 0 0
1760 1 1
1800 6 6
1860 11 14
1930 28 37
1960 28 32
1970 28 30
Alors qu'en phase ascendante la population intégrée au processus productif croissait plus rapidement que la population elle-même, aujourd'hui c'est au rejet d'une masse grandissante de travailleurs en dehors du système que nous assistons. Le capitalisme a achevé son rôle progressif notamment au travers de la fin du développement d'une des principales forces productives: la force de travail. Communisme ou Civilisation a beau nous bassiner des pages de sa prose avec des chiffres qui montrent l'augmentation plus importante dans la décadence de la part des salariés dans la population active pour la ... France ([13] [201]) cela ne change rien à la réalité du phénomène au niveau mondial (seule échelle valable pour appréhender le phénomène). A ce niveau les chiffres de la population active avancés par Communisme ou Civilisation ne démontrent rien du tout... si ce n'est l'explosion démographique du Tiers-Monde ! En effet, la population active n'est en rien un indicateur d'intégration de la population aux rapports de production capitaliste, il mesure tout simplement un rapport démographique de classes d'âges des actifs (15 ou 20 ans à 60 ou 65 ans selon les définitions) sur la population totale ([14] [202]). Si Communisme ou Civilisation se donnait la peine de raisonner, d'apprendre à lire des statistiques et à compter, il constaterait, ce qu'il entre-aperçoit au détour d'une phrase, l'ampleur du développement de cette "..masse croissante de sans réserves absolus qui n'ont d'autre ressources que de mourir de faim.." (p46).
Dans une prochaine contribution, nous développerons les bases qui ont rendu possible la reconstruction d'après guerre et ainsi répondre au 3ème type d'arguments qui nous sont rétorqués (taux de croissance « faramineux » consécutifs à la seconde guerre mondiale). Mais surtout, nous montrerons en quoi ce soubresaut du capitalisme dans sa phase de décadence est un soubresaut de croissance droguée qui constitue une fuite en avant d'un système aux abois. Les moyens mis en oeuvre (crédits massifs, interventions étatiques, production militaire croissante, frais improductifs, etc...) pour la réaliser viennent à épuisement ouvrant la porte à une crise sans précédent. Nous montrerons également que derrière le rejet de la notion de décadence, se cache en réalité le rejet de la conception marxiste de l'évolution de l'histoire qui fonde la nécessité du communisme.
C.McI
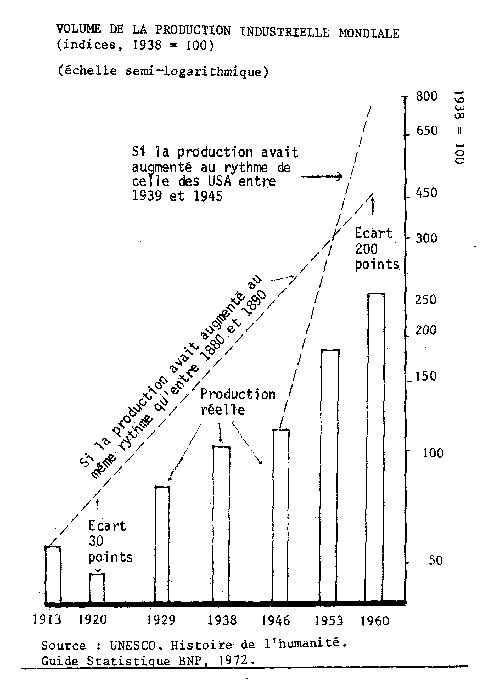
[1] [203] GCI : Groupe Communiste Internationaliste en Belgique, qui publie la revue Le Communiste (LC). , Bp 54, Bxl 31, lOGO Bruxelles
[2] [204] FOR: Ferment ouvrier Révolutionnaire. Cedex 13, France, qui publie la revue Alarme, BP 329, 75624 Paris
[3] [205] F.E.C.C.L: Fraction Externe du CCI, B.P. 1181 / 1000 Brux. / Belgique, qui publie la revue Perspective Internationaliste (P.L).
[4] [206] CoC: Communisme ou Civilisation, B.1'. 88 / 75722 Paris Cedex 15 / France, qui publie la revue du même nom.
[5] [207] A.C.C.: A Contre Courant, B.P. 1666 / Centre monnaie / 1000 Bruxelles / Belgique, qui publie la revue du même nom.
[6] [208] Fondateur et chef de file du P.C. d'Italie pendant ses premières années d'existence. Ensuite, après une éclipse politique, animateur du P.C. Internationaliste (1946) aujourd'hui disparu.
[7] [209] Pourcentage calculé à l'aide de la série du P.N.B.M. (1750-1980) de Bairoch P. ("International Industrial levels from 1750 to 1980" in Journal of european economic history) et des statistiques du S.I.P.R.I. sur les dépenses militaires mondiales depuis 1908 jusqu'à nos jours.
[8] [210] En G-B le sommet en effectif et en production du travail domestique et artisanal se situe autour de 1820. En France, autour de 1865-70. En Belgique, second pays à connaître la révolution industrielle après l'Angleterre, il y a en 1846, 406.000 travailleurs travaillant dans l'industrie mais encore 225.000 travailleurs à domicile (plus encore si l'on compte les travailleurs occasionnels). (Données tirées de Dockès P. et Rosier B. in "Rythmes économiques", Ed. Maspéro; et thèse de Doctorat, inédite, de Vandermotten C. sur l'industrialisation de la Belgique).
[9] [211] "Le capital trouve à vendre ses marchandises à l'extérieur de sa propre sphère. Il produit pour les paysans lorsque la montée du capitalisme agraire ne les a pas pratiquement remplacé par des salariés agricoles, comme en Angleterre, il produit pour les fermiers, pour les propriétaires fonciers, pour les autres rentiers, pour les classes "moyennes" commerçantes et artisanales (...) Lorsque le salariat se développe -seulement dans les années 1850-1860- en France, mais beaucoup plus tôt en Grande-Bretagne- sans qu'augmente suffisamment sa puissance consommatrice, lorsque la paysannerie se prolétarise et que l'importance de l'agriculture décline relativement (le cas de la GB), avec ses revenus et ses rentes foncières, une "solution" provisoire devra être et sera trouvée dans l'impérialisme et le colonialisme. Il y a là une explication possible de la précocité colonialiste britannique, mais à la fin du siècle, tous les pays capitalistes se conduiront de même. Rosa Luxemburg, comme d'ailleurs les capitalistes et les hommes politiques de ce temps (de Disraeli à Jules Ferry), comprend qu'il faut chercher là des débouchés pour les produits finis, ouvrir du même coup des perspectives de profits et donc développer sur cette base une demande interne de biens d'équipement (...) La grande dépression des années 1880 nous montre déjà les limites de la réalisation par la demande paysanne, d'où l'intensification des luttes impérialistes pour trouver à tout prix des acheteurs extérieurs. La grande dépression des années 1930, comme nous le verrons, est, de façon caractéristique, une crise de réalisation interne". (Rosier B., op. cité, p73 et 69).
[10] [212] Dans le capitalisme le prolétariat cumule ces deux caractéristiques, c'cst à dire d'être à la fois la classe exploitée et la future classe révolutionnaire, ce qui n'était pas le cas pour tous les modes de production antérieur.
[11] [213] Ces trois graphiques sont illustratifs d'une évolution qui est identique pour tous les pays. Pour d'autres graphiques et pour plus de renseignements, se référer au n°390, 1983/1, de la revue "Statistiques et Etudes financières":
"Matériaux pour une comparaison internationale des dépenses publiques en longues période".
[12] [214] G.P.L: Grupo Proletario Intemacionalista du Mexique (écrire à notre boîte postale). Pour une présentation de ce nouveau groupe révolutionnaire lisez la Revue Internationale n°52.
[13] [215] Ce pays constitue d'ailleurs une exceptiônpour iliustrer ce proreagus. Après 1871, avec les accords de Méline, la bovrgeoisie-dût s'appuyer-sur la fraction aisée de la paysannerie pour asseoir son pouvoir face à l'aristocratie.
La contre-partie à payer en fut le frein de la pénétration du capitalisme dans les campagnes. Ainsi, la France se retrouve en décadence avec une part importante de sa population active dans la petite agriculture (40% en 1930) contrairement aux autres pays (moins de 10% dès 1914 pour la GB). II n'est donc pas si étonnant de constater une telle croissance de la part des salariés dans la population active en décadence.
[14] [216] De plus, la comparaison de CoC est dénuée de sens dans la mesure ou les actifs en 1750 sont en grande majorité sous d'autres rapports de production que capitalistes.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [44]
Polémique : La confusion des groupes communistes sur la période actuelle
- 2928 lectures
LA SOUS-ESTIMATION DE LA LUTTE DE CLASSE
Dans sa lutte contre le capitalisme, en vue de son renversement et de l’édification de la société communiste, la classe ouvrière secrète des organisations politiques qui, non seulement expriment son devenir révolutionnaire, mais sont la condition indispensable de celui-ci. Si les buts généraux exprimés par ces organisations, leur programme, ne sont pas sujets à des fluctuations dans le temps, sinon à un constant enrichissement, les formes qu'elles prennent, leur impact, les moyens d'action et le mode d'intervention qu'elles se donnent dépendent, en revanche, des conditions historiques spécifiques dans lesquelles agit la classe, et tout particulièrement du rapport de forces existant entre elle et la classe ennemie. En d'autres termes, il ne suffit pas à une organisation communiste de défendre un programme révolutionnaire pour être un instrument efficace dans le développement de la lutte du prolétariat. Elle n'y parviendra réellement que si elle comprend les tâches qui lui incombent dans chacun des moments spécifiques de ce développement et si elle est capable, donc, d'analyser de façon correcte ces différents moments. Et c'est justement une question sur laquelle la plupart des organisations actuelles se situant sur un terrain de classe prolétarien éprouvent les plus grandes difficultés à s'orienter. En particulier des points aussi fondamentaux que le développement de la crise économique du capitalisme et les perspectives qui en découlent pour l'ensemble de la vie de la société : guerre impérialiste mondiale ou généralisation des combats de classe, constituent pour la plupart de ces organisations des sujets d'une énorme confusion alors que la plus grande clarté est plus que jamais indispensable pour contribuer au développement des combats présents de la classe ouvrière.
Ces derniers mois les confusions considérables qui pèsent sur le milieu politique prolétarien ont eu l'occasion de se manifester sous forme d'une sorte de tir groupé de plusieurs organisations contre les positions du CCI. Assurément, ce n'est pas de façon concertée que ces différentes organisations ont développé leurs attaques, mais cette simultanéité trouve en partie son origine dans une commune incapacité à apprécier la véritable importance des combats que mène à l'heure actuelle la classe ouvrière ([1] [218]). Parmi ces attaques, certaines comme celles du Groupe Communiste Internationaliste dans le n°26 du Communiste ([2] [219]), se situent sur un terrain d'une telle bassesse qu'elles ne sauraient donner lieu à une réponse dans le cadre de cet article de débat. De même, si on trouve dans le n°39 d'Alarme (publiée par le Ferment Ouvrier Révolutionnaire) et dans le n°10 de Perspective Internationaliste (publié par la "Fraction Externe du CCF), toute une série d'articles qui sont consacrés à notre organisation, et si les positions qui s'y expriment sont en partie tributaires d'une sous-estimation de l'importance des combats actuels de la classe ouvrière, nous n'y répondrons pas directement dans cet article car, sur cette question, nous avons affaire avec ces organisations à des caricatures (le FOR est probablement la seule organisation au monde qui reste encore incapable de reconnaître l'existence de la crise économique du capitalisme, ce qui est vraiment le comble quand on se veut "marxiste", et la FECCI, pour sa part, ne fait pas autre chose que nous présenter une caricature des positions du CCI). Plutôt que de nous attaquer à ces caricatures, il nous semble plus profitable, pour la clarté des questions que nous nous proposons d'aborder dans cet article, de nous intéresser à d'autres textes de polémique publiés récemment qui ont le mérite, outre qu'ils émanent d'organisations plus sérieuses que celles qu'on vient de citer, de présenter une orientation élaborée nettement différente de celle du CCI et représentant de façon claire la sous-estimation générale de la portée des combats actuels de la classe ouvrière. Ces articles nous les trouvons dans le n°4 de Comunismo, revue publiée par les camarades de l'ancien Colectivo Comunista Alptraum, et dans le n° ll (décembre 87) de Prometeo publié par le Par-tito Comunista Intemazionalista (Battaglia Comunista). Il s'agit, dans le premier cas, d'une lettre envoyée par la Communist Workers' Organisation (qui est associée au PCInt au sein du Bureau International Pour le Parti Révolutionnaire) au CCA à propos du communiqué de cette organisation "Sur les grèves récentes au Mexique" (avril 87) dont nous avons publié de larges extraits dans la Revue Internationale n°50. Dans le second cas, il s'agit d'un article intitulé "La crise du capital entre objectivité historique et subjectivité de classe" ("La crisi del capitale traoggettivita storica e sog-gettivita di classe") qui attaque, sans nommer à aucun moment le CCI, notre analyse du rapport de forces actuel entre bourgeoisie et prolétariat et particulièrement notre conception du cours historique.
Dans la mesure où la question du cours historique est la clé de voûte de toute compréhension de l'évolution présente de la lutte de classe, et bien que nous l'ayons déjà souvent abordée dans ces colonnes (en particulier dans la Revue Internationale n°50 où nous répondions déjà à un article de Battaglia Comunista n°3 de mars 87 intitulé "Le CCI et le cours historique, une méthode erronée"), nous devons y revenir ici pour mettre en évidence les absurdités auxquelles on est conduit lorsqu'on est incapable d'avoir une vision claire sur ce problème.
"Battaglia Comunista et le cours historique, une méthode inexistante
L'analyse du CCI sur la question du cours historique a été maintes fois exprimée dans l'ensemble de nos publications. On peut la résumer ainsi : dans la période de décadence du capitalisme qui débute avec le siècle, les crises ouvertes de ce mode de production, comme la crise des années 30 et la crise présente, n'offrent, du point de vue du capitalisme, d'autre perspective que la guerre impérialiste mondiale (1914-1918 et 1939-1945). La seule force qui puisse empêcher le capitalisme de déchaîner une telle "issue" est la classe ouvrière dont la bourgeoisie doit s'assurer de la soumission avant que de se lancer dans la guerre mondiale. Contrairement à la situation des années 30, la classe ouvrière d'aujourd'hui n'est pas défaite ni embrigadée derrière les idéaux bourgeois comme l'anti-fascisme, et c'est la combativité qu'elle a manifestée depuis une vingtaine d'années qui seule permet d'expliquer que la guerre mondiale n'ait pas encore été déclenchée.
Pour sa part, le PCInt partage une partie de cette analyse comme on peut le voir dans le passage qui suit :
"Le monde est constellé de telles tensions qui souvent dégénèrent en conflits ouverts (depuis sept ans fait rage la guerre entre l'Iran et l'Irak) et qui prennent les formes les plus variées (des coups d'Etat aux luttes de "libération nationale", etc.) : c'est là le signe des difficultés rencontrées par le capitalisme pour résoudre les questions internes au marché mondial
La crise pousse à une concurrence encore plus impitoyable. Dans les périodes "normales" les coups sont moins douloureux. Dans les périodes critiques les coups augmentent en fréquence et intensité et, de ce fait, très souvent, ils engendrent des ripostes. Pour survivre, le capitalisme ne peut qu'employer la force. Un coup aujourd'hui, un coup demain, on en arrive de cette façon à une situation véritablement explosive dans laquelle les conditions de la dégénérescence (élargissement et généralisation des conflits localisés) se trouvent désormais à l'ordre du jour. La phase qui conduira au déchaînement d'une nouvelle et terrifiante pierre impérialiste est ouverte.
POURQUOI LA GUERRE "MONDIALE" N'A-T-ELLE PAS ENCORE ECLATE ?
Tous les épisodes d'affrontements entre Etats, puissances et superpuissances nous indiquent qu'existe déjà la tendance qui nous conduira vers un troisième conflit mondial. Au niveau objectif sont présentes toutes les raisons pour le déclenchement d'une nouvelle guerre généralisée. Au niveau subjectif, de façon évidente, il n'en est pas ainsi. Le processus par lequel se meuvent les forces de la subjectivité est asymétrique par rapport à celui avec lequel s'exprime la situation historique objective* S'il n'en était pas ainsi, la guerre aurait déjà éclaté depuis un certain temps et des épisodes comme celui du Golfe persique, parmi d'autres, auraient pu constituer des motifs valables pour le déchaînement du conflit. Mais en quoi se manifeste le décalage entre les aspects subjectifs et le processus qui implique tout le monde de la structure ?"
On pourrait s'attendre à ce que BC fasse ici intervenir le prolétariat comme élément "subjectif" surtout qu'on trouve ailleurs dans le texte l'affirmation suivante :
"Il est clair qu'aucune guerre ne pourra jamais être menée sans la disponibilité (au combat et dans la production de guerre) du prolétariat et de toutes les classes laborieuses. Il est évident que, sans un prolétariat consentant et embrigadé, aucune guerre ne serait possible. Il est évident, de même, qu'un prolétariat en pleine phase de reprise de la lutte de classe serait la démonstration du surgissement d'une contre tendance précise, celle de l'antithèse à la guerre, celle de la marche vers la révolution socialiste. "
Cependant, BC poursuit ainsi :
"Nous sommes en présence, malheureusement, d'un phénomène inverse. Nous avons une crise à un niveau de gravité extrêmement élevé. La tendance à la guerre avance d'un pas rapide mais le niveau de l'affrontement de classe, par contre, est absolument en dessous de celui imposé par la situation objective ; il est en dessous de ce qui serait nécessaire pour repousser les pesantes attaques lancées par le capitalisme contre le prolétariat international. " (page 34)
Dans la mesure où la lutte du prolétariat ne permet pas, aux yeux de BC, d'expliquer le fait que la guerre n'ait pas encore eu lieu voyons par conséquent qu'elles sont les causes subjectives de ce "retard" :
"L'attention doit se tourner principalement vers des facteurs qui transcendent les initiatives particulières pour être situés dans un processus plus vaste qui voit les équilibres internationaux non encore définis et tracées en fonction de ce que seront les coalitions guerrières proprement dites, coalitions qui sont appelées à constituer les fronts de la guerre... Mais tout le cadre des alliances est encore assez fluide et plein d'inconnues. Le développement de la crise ne manquera pas de tracer de profonds sillons à l'intérieur desquels se glisseront les intérêts de chacun, qui iront s'y réunir avec ceux des autres. En un processus inverse et parallèle, le heurt des intérêts opposés tracera une ligne de division entre Etats qui se retrouveront dans des camps opposés de chaque côté de la barricade...
"Un autre aspect à prendre en considération est la dissuasion que représente la question nucléaire. Une guerre se déroulant dans les conditions historiques de prolifération maximale des armes nucléaires devient problématique pour un quelconque, hypothétique front militaire. La théorie du "suicide collectif, vers laquelle imprudemment et sentencieusement s'étaient tournés les apocalyptiques de service, s'est révélée - et il ne pouvait en être autrement - absolument dépourvue de fondement. Le retard dans le déclenchement de la guerre trouve une de ses causes dans l'absence d'un désarmement nucléaire (même partiel) auquel semblent vouloir parvenir, dans un proche avenir, les plus hauts représentants des plus grandes puissances impérialistes.
La rencontre au sommet entre Reagan et Gorbatchev, claironnée comme une volonté tenace de paix, se présente en réalité comme un sommet destiné à faire tomber les dernières barrières qui empêchaient la guerre d'éclater. Et cela en faisant abstraction de ce que peuvent penser réellement et subjectivement Reagan et Gorbatchev. La guerre naît de causes objectives. Les facteurs subjectifs n'en sont que des effets induits qui peuvent être, suivant les cas, retardés ou accélérés mais jamais empêchés." (page 34)
Il semble que nous ayons dans ces passages la quintessence de la pensée de Battaglia puisque ces deux idées apparaissent en de multiples occasions dans la presse de cette organisation. Il importe donc de les examiner de façon attentive. Nous commencerons par la plus sérieuse (en essayant de la formuler d'une façon un peu plus simple que ne le fait BC chez qui la boursouflure du langage semble avoir pour fonction de masquer l'indigence et l'imprécision des analyses).
"Si la guerre mondiale n'a pas encore eu lieu c'est parce que les alliances militaires ne sont pas encore suffisamment constituées et stabilisées".
Preuve qu'il s'agit là d'un point important dans l'analyse du PCInt, cette idée est reprise une nouvelle fois, et de façon détaillée, dans un tout récent article de Battaglia Comunista (^'Accord USA-URSS, Un nouveau pacte Molotov-Ribben-trop ?" dans BC n°5) où cet accord est supposé chercher "à délimiter, dans cette phase, les aires et les intérêts plus directement en conflit entre les USA et l'URSS et à permettre aux deux de concentrer les ressources et les stratégies à différents niveaux .et préparer de nouveaux et plus stables équilibres et systèmes d'alliances, en vue d'un futur affrontement plus profond et généralisé," De même on peut lire plus loin que "...l'aggravation de la crise générale du mode de production capitaliste...ne pouvait pas ne pas provoquer l'approfondissement des motifs de conflits entre les partenaires atlantiques même, et en particulier entre ceux qu'on appelle les 7 grands". Enfin, toute cette "démonstration" aboutit à la conclusion que "Tout cela (l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché mondial) ne peut que favoriser ultérieurement la guerre commerciale de tous contre tous, basée sur le dumping les contingentements, le protectionnisme, les accords secrets sur le dos d'autres rivaux, etc., mais aussi la formation de nouvelles agrégations d'intérêts tendant à leur concrétisation en alliances politico-militaires dont les nouveaux axes préférentiels trouveront leur place ou bien à différents niveaux au sein du même système, qui va en se déstructurant malgré les déclarations contraires et les diverses proclamations de "fidélité" durable, ou bien dans la perspective de possibles changements de camp,"
Cette analyse n'est pas nouvelle. Par le passé nous l'avons rencontrée à plusieurs reprises, notamment sous la forme développée par le groupe (aujourd'hui disparu) Pour une Intervention Communiste qui parlait de la tendance à "l'effritement" et à la recomposition des blocs en fonction des rivalités commerciales. De son côté, le PIC ne faisait que reprendre la thèse développée par le courant "bordiguiste" qui aboutissait à considérer que ces rivalités commerciales allaient provoquer une dislocation du bloc occidental et la formation d'une alliance entre les pays d'Europe de l'Ouest et l'URSS. Enoncée depuis plusieurs décennies, cette prévision attend encore sa réalisation. Précisons, pour compléter ce rappel, que le PIC attribuait, pour sa part, cette tendance vers la "dislocation des blocs" à... la force du développement de la lutte de classe (!) ce qui, évidemment, ne saurait être le cas de Battaglia.
A de nombreuses reprises dans notre presse, nous avons fait justice de la thèse suivant laquelle les blocs impérialistes se constituent directement sur la base des rivalités commerciales ([3] [220]). Nous ne reviendrons pas ici sur les arguments que nous avons développés pour réfuter cette analyse. Nous nous contenterons de rappeler que cette question n'est pas nouvelle dans le mouvement ouvrier et qu'elle a fait en particulier l'objet d'un débat au sein de l'Internationale Communiste où Trotski fut conduit à combattre la thèse majoritaire suivant laquelle les deux têtes de bloc pour la seconde guerre mondiale devaient être les USA et la Grande Bretagne qui, à l'époque, constituaient les deux principales puissances commerciales concurrentes ([4] [221]). L'histoire s'est chargée (avec quel sinistre éclat !) de valider la position de Trotski en confirmant que le lien - réel - existant entre exacerbation des rivalités commerciales et aggravation des antagonismes militaires n'est pas de nature mécanique. En ce sens, le système d'alliances existant à l'heure actuelle entre grandes puissances ne saurait être remis en cause par l'aggravation de la guerre commerciale entre tous les pays. Bien que les USA, le Japon et l'Europe occidentale constituent les principaux rivaux sur un marché mondial où la lutte pour les débouchés se fait chaque jour plus vive et impitoyable, cela ne saurait remettre en cause leur appartenance à la même alliance militaire.
Il faut donc être clair sur le fait que si la guerre mondiale n'a pas encore éclaté, cela n'a rien à voir avec une quelconque nécessité de modification ou de renforcement des alliances existant à l'heure actuelle. C'est vrai que les deux premières guerres mondiales ont été précédées de toute une série de conflits locaux et d'accords qui participaient de sa préparation et qui ont permis que se dégagent les alignements de l'affrontement généralisé (par exemple la constitution de la "Triple Entente" Grande-Bretagne-France-Russie au début du 20ème siècle et la création de l'"Axe" Allemagne-Italie au cours des années 30). Mais pour ce qui concerne la période historique actuelle, ces "préparatifs" se sont déroulés depuis des décennies déjà (en fait dès le lendemain de la seconde guerre mondiale avec l'ouverture de la "Guerre Froide") et il faut remonter à plus de vingt ans (rupture entre l'URSS et la Chine au début des années 60 et intégration de ce dernier pays dans le bloc occidental à la fin de cette décennie) pour constater un changement d'alliances important. En fait, à l'heure actuelle, les alliances impérialistes sont bien plus solidement constituées que celles existant à la veille des deux guerres mondiales où l'on a vu des pays majeurs entrer dans le conflit bien après qu'il se soit engagé (Italie en mai 1915, Etats-Unis en avril 1917, lors de la première, URSS en juin 1941, Etats-Unis en décembre 1941, lors de la seconde). De plus, chacun des deux blocs dispose depuis de très nombreuses années d'un commandement unique de l'essentiel de son dispositif militaire (OTAN dès avril 1949, Pacte de Varsovie en mai 1955), alors qu'un tel commandement unique n'a été créé (et uniquement par les puissances occidentales au niveau du front européen) que dans la seconde partie des deux guerres mondiales.
Ainsi, affirmer qu'aujourd'hui les préparatifs diplomatiques ou militaires pour une troisième guerre mondiale ne seraient pas encore achevés, c'est faire preuve d'une incroyable méconnaissance de l'histoire de ce siècle, ce qui est impardonnable pour une organisation révolutionnaire. Mais encore plus impardonnable est la thèse suivant laquelle :
"C'est l'existence des armements atomiques, du fait de la dissuasion qu'ils représentent, qui explique que la guerre mondiale n'ait pas encore eu lieu."
Est-il possible que des révolutionnaires sérieux puissent encore croire une telle fable ? La bourgeoisie l'a racontée un certain temps lorsqu'il s'agissait pour elle de déployer les arsenaux nucléaires. En particulier, la stratégie dite de "représailles massives", d'"équilibre de la terreur", était sensée agir comme moyen de dissuasion : dès lors qu'un pays aurait utilisé la bombe atomique, ou même qu'il aurait menacé les intérêts vitaux d'un autre, il s'exposerait à la destruction de ses principales concentrations urbaines et industrielles dans l’heure suivante. L'arme la plus meurtrière dont l'humanité se soit jamais dotée, aurait eu comme mérite d'empêcher désormais toute guerre mondiale. Qu'un tel mensonge ait pu avoir un certain impact sur des populations ayant des illusions sur la "raison" des gouvernements, et plus généralement dans la "rationalité" du système capitaliste, s'explique encore. Mais qu'aujourd'hui, alors que tous les derniers développements des armements nucléaires (bombes à neutrons, obus nucléaires, missiles à courte portée, missiles de "croisière" capables d'atteindre leur cible à quelques mètres près, programme de "la guerre des étoiles"), de même que l'élaboration de stratégies dites de "riposte graduée" (c'est la doctrine officielle de l'OTAN) font la preuve que les gouvernements et les états-majors envisagent sérieusement de mener une guerre atomique en vue de la "gagner", il se trouve encore des révolutionnaires qui se veulent "marxistes" pour croire et véhiculer de telles sornettes est proprement sidérant. Et pourtant, c'est malheureusement le cas avec nos camarades de "Battaglia" qui, sur ce point, défendent des absurdités dignes de celles du FOR lorsqu'il nie que le capitalisme soit aujourd'hui en crise. Car, la thèse qu'on trouve dans le n°11 de Prometeo n'est pas une erreur de plume, un raté d'un camarade un peu farfelu qui aurait échappé à la vigilance de l'organisation. Elle était déjà exposée avec encore plus de détail dans un article du n°4 de Battaglia Comunista (avril 86) intitulé 'Premières notes sur la guerre prochaine" où l'on peut lire :
"Un autre facteur à ne pas sous-évaluer, parmi ceux concourant à la dilatation des temps de préparation de la guerre ([5] [222]), est le chantage nucléaire, dans la mesure où l'affrontement direct entre les blocs ne peut raisonnablement dépendre du hasard des moments de plus grande tension entre les deux superpuissances, sous peine du risque-certitude de l’extinction de la vie sur la terre. "Le jour après la signature de l'accord sur le non-emploi des armes nucléaires, la guerre sera déclarée" est une boutade désormais classique entre nous et qui a tout le goût de la vérité. "
Nos camarades de Battaglia peuvent trouver à cette boutade le goût qu'ils veulent ; pour notre part nous dirons que leurs remarques ont "tout le goût" d'une naïveté affligeante. En effet, quel est le scénario-fiction que nous proposent les articles d'avril 86 dans BC et de décembre 87 dans Prometeo ? En poursuivant le processus de "désarmement nucléaire" engagé par l'accord de Washington de décembre 87 ([6] [223]), les deux super-puissances parviennent à une élimination totale des armements nucléaires ou bien à un accord de non-emploi de ces armements. Elles ont alors les mains libres pour déchaîner la guerre mondiale sans danger d"'extinction de la vie sur terre" dans la mesure où elles font confiance à leurs ennemis pour ne pas utiliser les armements prohibés ou pour n'en avoir pas conservé en secret. On peut se demander pourquoi les deux blocs, qui sont décidés à être "fair-play" en tout état de cause, n'ont pas poursuivi leur démarche de désarmement en éliminant ou en interdisant l'utilisation des armements conventionnels les plus meurtriers. Après tout, l'un et l'autre sont intéressés à limiter au maximum les destructions que pourraient provoquer ce type d'armements dont les ruines et les massacres de la seconde guerre mondiale ne nous donnent qu'une très faible idée. Et il n'y a pas de raison que les dirigeants du monde s'arrêtent en si bon chemin. Certes, ils n'ont pas renoncé à se faire la guerre puisque nous vivons toujours dans le capitalisme et que les antagonismes entre bourgeoisies rivales subsistent et s'attisent avec l'aggravation de la crise économique. Mais animés par le même souci initial que cette guerre soit la moins meurtrière possible, ces dirigeants en viennent progressivement à s'interdire tout emploi des armements modernes qui tous sont très meurtriers : interdiction des missiles, de l'aviation, des bombardements, de l'artillerie lourde, puis, sur la lancée, interdiction de l'artillerie légère, des mitrailleuses et, pourquoi pas, des armes à feu... On connaît la phrase célèbre : "Si la troisième guerre mondiale a lieu, la quatrième se déroulera avec des bâtons". La perspective qui se dégage de l'analyse de Battaglia est légèrement différente : c'est la troisième guerre mondiale qui se fera avec des bâtons. A moins qu'elle ne se déroule sous la forme d'un combat singulier, "à la loyale", entre les deux chefs d'Etat Major comme cela se pratiquait parfois au Moyen Age ou dans l'Antiquité. Si l'arme choisie était le jeu d'échecs, l'URSS aurait alors quelque chance de gagner la guerre.
Il va sans dire que les camarades de Battaglia ne racontent ni ne pensent de telles sornettes : ils ne sont pas fous. Mais ce conte de fées découle logiquement de l'idée qui se trouve au centre de leur "analyse" : la bourgeoisie est capable de se fixer des règles de "tempérence" dans l'utilisation de ses moyens de destruction, elle est disposée à respecter les traités qu'elle signe, et cela même quand elle est prise à la gorge, même quand ses intérêts vitaux sont menacés. Les deux guerres mondiales sont pourtant là pour montrer que tous les moyens dont dispose le capitalisme sont bons dans la guerre impérialiste, y compris - et surtout - les plus meurtriers ([7] [224]), y compris les armes nucléaires (nos camarades ont-ils oublié Hiroshima et Nagasaki ?). Nous ne prétendons pas qu'une troisième guerre mondiale devrait commencer d'emblée avec l'utilisation des armes de l'Apocalypse. Mais nous devons être sûrs que la bourgeoisie qui se retrouverait acculée le dos au mur après l'utilisation es armes conventionnelles, finirait par les employer quels Sue soient les traités qu'elle aurait pu signer auparavant. De même, il n'existe aucune chance pour que les .(très minimes) réductions actuelles des armements nucléaires puissent aboutir un jour à leur élimination totale. Aucun des deux blocs, et particulièrement celui qui se trouve en état d'infériorité technologique dans le domaine des armements conventionnels, le bloc de l'Est, ne consentira jamais à se démunir complètement de l'arme qui constitue son dernier recours, même s'il sait pertinemment que l'utilisation de cette arme signifie son propre arrêt de mort. Et cela n'a rien à voir avec un quelconque "comportement suicidaire" des dirigeants du monde capitaliste. C'est le système comme un tout, dans la barbarie engendrée par sa décadence, qui mène l'humanité vers son autodestruction ([8] [225]). En ce sens, l'article de Prometeo a tout à fait raison de souligner que le processus qui conduit à la guerre généralisée ne résulte pas "de ce que peuvent penser réellement et subjectivement Reagan et Gorbatchev" et que "la guerre naît de causes objectives". Le PCInt connaît les fondements du Marxisme. Le problème c'est qu'il lui arrive de les "oublier" et de se laisser piéger par les mystifications bourgeoises les plus éculées.
Ainsi on peut constater que pour tenter de défendre son analyse sur le cours historique actuel, le PCInt en est conduit non seulement à aligner contradiction après contradiction, mais aussi à "oublier" l'histoire du 20ème siècle et, plus grave encore, un certain nombre d'enseignements fondamentaux du marxisme au point de reprendre à son compte, avec la plus grande des naïvetés, un certain nombre des illusions répandues par la bourgeoisie pour peindre son système en rose.
La question qu'il faut donc se poser est donc : comment se fait-il qu'une organisation communiste, qui pourtant base ses positions sur le marxisme et qui connaît l'expérience du mouvement ouvrier soit victime de tels "trous de mémoire" et fasse preuve d'autant de naïveté vis à vis des mystifications capitalistes ? La réponse, nous la trouvons en partie dans l'article publié par BC n°5 de mars 87 et en Anglais dans la Communist Revue n°5 intitulé "Le CCI et le cours historique : une méthode erronée". Nous avons déjà répondu à cet article dans la Revue Internationale n°50. En particulier, nous avons rectifié un certain nombre d'erreurs sur l'histoire du mouvement ouvrier, et notamment sur l'histoire de la Fraction de Gauche du Parti Communiste dont pourtant se réclame en partie le PCInt. Il sera donc inutile d'y revenir longuement ici. Nous nous contenterons de mettre en évidence la complète incompréhension par le PCInt de la notion même de cours historique.
Cours historique ou cours fluctuant ?
Dans cet article, le PCInt écrit :
"Le procédé implicite du raisonnement du CCI est le suivant : pour toutes les années 30 le cours était vers le guerre impérialiste de façon univoque, comme le disait la Fraction en France. Cette période est terminée, révolue : maintenant le cours est de façon univoque vers la révolution (ou vers les affrontements qui la rendent possible).
C'est sur cette question nodale; ce point méthodologique, que nous divergeons de façon extrêmement profonde... La Fraction (particulièrement sa Commission Exécutive et, en son sein, Vercesi) évaluait dans les années 30 la perspective vers la guerre comme un absolu. Avait-elle raison ? Certes, l'ensemble des faits lui ont donné raison. Mais même alors, le fait de considérer le "cours' comme quelque chose d'absolu a conduit la Fraction à commettre des erreurs politiques...
L’erreur politique fut la liquidation de toute possibilité d'intervention politique révolutionnaire en Espagne avant même que le prolétariat ait été réellement défait...
L'erreur de méthode qui la soutenait se situait dans l’"absolutisation" du cours, dans l'exclusion méthodologique de toute possibilité de surgissements prolétariens significatifs dans lesquels pouvaient intervenir les communistes de façon active en vue de la perspective, toujours ouverte dans la phase impérialiste, d'une rupture révolutionnaire. "
Effectivement, c'est là le coeur de la divergence entre le PCInt et le CCI bien que, comme il est normal, le PCInt n'ait pas tout à fait compris notre analyse ([9] [226]). En particulier, nous n'établissons pas une complète symétrie entre un cours à la guerre et un cours aux affrontements de classe, de même que nous ne prétendons pas qu'un cours ne puisse s'inverser :
"...ce que nous voulons dire par cours aux affrontements de classe est que la tendance à la guerre -permanente en décadence et aggravée par la crise - est entravée par la contre-tendance aux soulèvements prolétariens. Par ailleurs, ce cours n'est ni absolu ni éternel: il peut être remis en question par une série de défaites de la classe ouvrière. En fait, simplement parce que la bourgeoisie est la classe dominante de la société, un cours vers les affrontements de classe est plus fragile et réversible qu'un coure à la guerre." (Revue Internationale n°50, "Réponse à Battaglia Comunista sur le cours historique'1)
"L'existence d'un cours vers la guerre, comme dans les années 30, signifie que le prolétariat a subi une défaite décisive qui l'empêche désormais de s'opposer à l'aboutissement bourgeois de la crise. L'existence d'un cours à "l'affrontement de classes" signifie que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour déchaîner une nouvelle boucherie mondiale ; auparavant elle devra affronter et battre la classe ouvrière. Mais cela ne préjuge pas de l'issue de cet affrontement, ni dans un sens ni dans un autre. C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser ce terme plutôt que celui de "cours à la révolution"." (Revue Internationale n°35, "Résolution sur la situation internationale" du 5ème congrès du CCI, juillet 83)
Ceci étant rappelé, on peut donc voir facilement où se situe la divergence. Quand nous parlons d'un "cours historique" c'est pour qualifier une période... historique, une tendance globale et dominante de la vie de la société qui ne peut être remise en cause que par des événements majeurs de celle-ci (telle la guerre impérialiste, comme ce fut le cas au cours de la première mondiale avec le surgissement de la vague révolutionnaire de 1917, ou encore une série de défaites décisives, comme au cours des années 20). En revanche, pour Battaglia, qui emploie il est vrai plus souvent le terme "cours" que le terme "cours historique", il s'agit d'une perspective qui peut être remise en cause, dans un sens comme dans l'autre, à chaque instant puisqu'il n'est pas exclu qu'au sein même d'un cours à la guerre il puisse intervenir "une rupture révolutionnaire". C'est pour cela également, que ces camarades sont totalement incapables de comprendre les enjeux de la période historique présente et qu'ils attribuent le fait que la guerre généralisée n'ait pas encore eu lieu, bien que ses conditions objectives soient présentes depuis longtemps, à l'absence d'un désarmement nucléaire complet ou d'un traité de non-utilisation de l'arme atomique et autres stupidités retentissantes.
Là aussi la vision de Battaglia ressemble à une auberge espagnole : dans la notion de cours historique chacun apporte ce qu'il veut. On trouvera la révolution dans un cours vers la guerre comme la guerre mondiale dans un cours aux affrontements de classe. Ainsi chacun y trouve son compte : en 1981, le CWO qui partage la même vision du cours historique que BC, appelait les ouvriers de Pologne à la révolution alors que le prolétariat mondial était supposé n'être pas encore sorti de la contre révolution. Finalement c'est la notion de cours qui disparaît totalement ; voila où en arrive BC : éliminer toute notion d'une perspective historique.
En fait, la vision du PCInt (et du BIPR) porte un nom : l’immédiatisme. C'est le même immédiatisme qui se trouvait à l'origine de la proclamation du Parti au lendemain de la seconde guerre mondiale alors que le prolétariat était au plus profond de la contre révolution. C'est ce même immédiatisme qui explique qu'aujourd'hui les participants au BIPR fassent en permanence la fine bouche devant les combats que mène la classe dans la mesure où ces combats, et c'est normal, ne prennent pas encore une forme révolutionnaire et qu'ils continuent à se heurter aux multiples entraves des syndicats et de la gauche du capital.
La sous estimation des combats présents de la classe ouvrière
Notre appréciation des caractéristiques actuelles du combat prolétarien a été présentée de façon régulière dans la Revue Internationale (de même que dans l'ensemble de la presse territoriale du CCI). Nous n'y reviendrons pas ici. Par contre il est intéressant d'examiner, pour conclure cet article, comment le BIPR, à travers un document du CWO publié dans Comunismo n°4, concrétise l'analyse du cours historique qui est la sienne dans la critique de notre appréciation de ces luttes.
"... les événements en Europe montrent que la pression vers la lutte n'est pas directement liée à la gravité de la crise ni à la sévérité des attaques contre le prolétariat... Nous ne pensons pas que la fréquence et l'extension de ces formes de lutte indiquent -tout au moins jusqu'à aujourd'hui- une tendance vers leur développement progressif. Par exemple, après les luttes des mineurs britanniques, des cheminots en France, nous avons l'étrange situation dans laquelle les couches agitées sont celles... de la petite bourgeoisie I (docteurs, pilotes d'avion, magistrats, moyens et hauts fonctionnaires et maintenant, les enseignants)"
Il est déjà significatif que, pour le BIPR, les enseignants du primaire et du secondaire soient des "petits bourgeois" et que la lutte remarquable menée l'an dernier par ce secteur de la classe ne puisse rien représenter du point de vue prolétarien. On se demande pourquoi certains camarades de Battaglia, qui sont enseignants, ont tout de même jugé utile d'y intervenir (c'est vrai que les militants du CCI ont contribué de façon non négligeable à les réveiller en fustigeant leur passivité du départ).
S'adressant à Comunismo, le BIPR poursuit :
"Vous avez été probablement influencés par l'emphase mise par le CCI dans les luttes épisodiques des ouvriers en Europe
- emphase hors de toute proportion avec la réalité... à côté d'épisodes de lutte héroïque (en termes de durée et de sacrifices consentis par les travailleurs) comme ceux des mineurs britanniques, nous voyons, pour notre part, la passivité des autres secteurs de la classe en Angleterre et ailleurs en Europe."
Il ne nous paraît pas utile de rappeler ici tous les exemples donnés dans notre revue et dans notre presse territoriale qui contredisent cette affirmation. Nous y renvoyons le lecteur, de même que les camarades du BIPR, tout en sachant qu'ils n'y verront pas mieux pour cela : il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais poursuivons ces citations pour ce qui concernée les causes de cette triste situation et les conditions de son dépassement :
"Pour expliquer la relative passivité de la classe et son incapacité à répondre aux attaques du capital, les boucs émissaires (les syndicats, les partis) ne suffisent pas. Le pouvoir de persuasion des partis et des syndicats n'est pas la cause mais la manifestation du phénomène essentiel, qui est la domination réelle du capital sur la société... L'équilibre sur lequel repose la société bourgeoise existe encore. Il a été consolidé en Europe pendant près de 2 siècles et un mouvement de la classe puissant, matériel, est nécessaire pour le rompre...
Plus la domination capitaliste devient réelle, et plus elle s'exprime dans la superstructure, renforçant la domination réelle de telle façon que plus elle se cristallise, plus difficile et plus violent sera le processus qui la détruira."
Et voilà ! En jonglant un peu, pour "faire profond" sur le terme de "domination réelle du capital", que Marx utilisait dans un tout autre contexte (voir l'article sur la Décadence du capitalisme dans ce même n° de la Revue), on allonge de bonnes banalités quand ce ne sont pas des tautologies : "aujourd'hui le prolétariat est encore incapable de renverser le capitalisme parce que celui-ci exerce une domination réelle sur la société". Bravo le BIPR ! Voila une thèse qui fera date dans l'histoire du mouvement ouvrier et de la théorie marxiste. De même, l'histoire retiendra les phrases suivantes:
"L'intervention révolutionnaire du Parti est nécessaire pour vaincre toute influence bourgeoise, de quelque forme qu'elle soit, afin de rendre possible le passage des protestations et des revendications vers une attaque frontale contre l'Etat bourgeois...
La condition pour la victoire du programme révolutionnaire dans le prolétariat est la déroute de ce que nous avons défini comme les influences bourgeoises sur et dans la classe".
De nouveau, le BIPR nous propose des banalités agrémentées d'un raisonnement qui se mord la queue :
"Il n'existe pas un développement significatif des luttes parce qu 'il n 'existe pas le parti ; et le parti ne pourra exister sans que la classe ne se trouve dans un processus de développement des luttes". Comment peut-on rompre ce cercle vicieux ? Le BIPR ne nous le dit pas. C'est sans doute ce que ces camarades, qui sont très friands de formules "marxistes" tape à l'oeil, appellent la "dialectique"
En réalité, en sous estimant complètement la place qu'occupe le prolétariat dès à présent sur la scène de l'histoire, en empêchant le capitalisme de déchaîner une troisième guerre mondiale, la vision du BIPR sous estime de la même façon l'importance des combats actuels de la classe, tant par leur capacité de constituer un frein aux attaques bourgeoise que par l'expérience qu'elles représentent en vue des affrontements décisifs, révolutionnaires, contre l'Etat capitaliste. C'est pour cela que cette organisation, non seulement est conduite, comme on l'a vu plus haut, à tomber dans les pièges les plus grossiers de la propagande bourgeoise sur la "dissuasion nucléaire", mais qu'en plus elle néglige la responsabilité des révolutionnaires à l'heure actuelle-, tant du point de vue du travail de regroupement des forces communistes (voir article sur le Milieu politique dansée numéro de la revue) que du pointa vue du travail d'intervention dans les luttes. En particulier, le texte du BIPR est significatif à cet égard :
"Nous, les avant gardes révolutionnaires, nous pouvons seulement avoir une influence très limitée -presque inexistante -sur ce processus (de rupture de l’équilibre sur lequel repose le capitalisme), précisément parce que nous sommes en dehors de la dynamique matérielle de la société"
Si par "dynamique matérielle" le BIPR entend l'évolution de la crise, il est évident que les révolutionnaires n'ont aucun impact là dessus. Mais, il ne peut s'agir uniquement de cela puisque, par ailleurs, le BIPR estime que "l'affrontement de classe est absolument en dessous de celui imposé par la situation objective" : il faut donc supposer que d'après le BIPR, la crise est pour sa part suffisamment développée pour permettre la "rupture" qu'attend cette organisation. En fin de compte, derrière les jeux de mots sur la "domination réelle", etc., derrière le refrain perpétuel sur le "rôle indispensable du parti" (idée que nous revendiquons également d'ailleurs), le BIPR ne fait qu'abdiquer devant ses responsabilités. Ce n'est pas en clamant en permanence : "Il faut le Parti ! Il faut le Parti !) qu'on assume son rôle, dans la classe face aux besoins actuels du développement de sa lutte. Il existe un proverbe russe qui dit : "quand il n'y pas de vodka parlons de vodka". En fin de compte, beaucoup de groupes du milieu prolétarien font aujourd'hui la même chose. Seul le dépassement de cette attitude de scepticisme vis à vis des luttes de la classe, et notamment de leur impact sur le cours historique, leur permettra d'assumer réellement la responsabilité qui est celles des révolutionnaires, et contribuer efficacement à la préparation des conditions du parti mondial du prolétariat.
FM
[1] [227] Une autre raison permettant d'expliquer cette convergence des attaques contre les positions du CCI réside probablement dans le fait que notre organisation, qui depuis la dislocation du Parti Communiste International (bordiguiste) constitue la formation la plus importante du milieu révolutionnaire international, est devenue de ce fait le point de référence pour tous les groupes et éléments de ce milieu. Ce fait n'est pas pour nous un motif de satisfaction particulière : nous sommes bien trop conscients et préoccupés par la faiblesse générale du milieu révolutionnaire vis à vis des responsabilités qui sont les siennes dans la classe pour nous réjouir de cette situation.
[2] [228] Ce n° du Communiste contient un article dont le titre seul : "Une fois déplus... le CCI du côté des flics, contre les révolutionnaires" en dit long sur la teneur.
[3] [229] On peut se reporter en particulier à la Résolution sur la situation internationale adoptée lors de notre 3ème congrès (Revue Internationale n°18) et à l'article "Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme" publié dans la Revue Internationale n°52 et n°53.
[4] [230] Voir en particulier "Europe et Amérique".
[5] [231] Il faut remarquer que dans un passage précédent du même article, on explique la "dilatation des temps de préparation de la guerre" par les transformations économiques subies par le capitalisme depuis la seconde guerre mondiale, ce qui est en contradiction flagrante avec la thèse énoncée dans Prometeo n°ll suivant laquelle "au niveau objectif sont présentes toutes les raisons pour le déclenchement d'une nouvelle guerre généralisée". Quand on s'appuie sur une théorie fausse, il ne faut pas s'étonner de s'enfermer dans toutes sortes de contradictions lorsqu'on essaye de la faire cadrer avec la réalité.
[6] [232] A propos de cet accord, l'article déjà cité de BC de mai 88 souligne avec pertinence qu'il n'affecte que 3,5% du potentiel de destruction des signataires, et qu'il a pour but de leur permettre de "concentrer les efforts (économiques, de recherche, etc.) à la restructuration et la modernisation des armements nucléaires et conventionnels respectifs^. Décidément, les analyses du PCInt ressemblent à une auberge espagnole : il n'y a pas de menu fixe, chaque article de la presse y apporte ses propres conceptions, mêmes si elles sont en contradiction avec celles des autres articles. Il faudrait que BC et Prometeo accompagnent chacun des articles qui y sont publiés d'une note précisant s'il exprime les positions de l'organisation ou une position particulière d'un camarade afin que le lecteur puisse s'y retrouver. La même suggestion restant valable lorsque c'est au sein d'un même article qu'on énonce des affirmations contradictoires.
[7] [233] Les camarades de Battaglia estiment que la non utilisation des gaz de combat au cours de la seconde guerre mondiale illustre la capacité de la bourgeoisie à se donner un certain nombre de règles du jeu. Ce qu'illustre en fait leur affirmation c'est qu'ils prennent pour argent comptant les mensonges utilisés par la bourgeoisie lorsqu'elle veut démontrer qu'elle est capable de "raison" et d'"humanité" même dans les manifestations les plus extrêmes de la barbarie de son système. La seconde guerre mondiale n'a pas fait appel à ce type d'armes parce que la première avait montré qu'il était à double tranchant et pouvait se retourner contre ceux qui l'employaient. Depuis, l'Irak "barbare" dans la guerre du Golfe, et avant lui, les très "civilisés" Etats-Unis au Vietnam, ont fait la preuve qu'avec les moyens modernes on pouvait de nouveau les utiliser "efficacement".
[8] [234] Sur cette question voir l'article "Guerre, militarisme et blocs impérialistes..."
[9] [235] Il faut en finir avec le mensonge sur "la liquidation par la Fraction de toute possibilité d'intervention politique révolutionnaire en Espagne". La Fraction est intervenue par sa presse de façon publique et dans le milieu prolétarien, pour dénoncer la politique de collaboration de classe sous prétexte de "sauver la République", pour apporter un soutien total à la révolte des ouvriers de Barcelone en juillet 36 et en mai 37, par son soutien à la lutte des ouvriers des Asturies en 34. Mais il y a intervention et intervention : intervenir pour combattre "l'alliance républicaine anti-fasciste" ou intervenir pour s'intégrer dans les milices pour le soutien de la République bourgeoise. "Battaglia" condamne la position de la majorité de la Fraction (la première) même si elle critique aussi celle de la minorité (l'embrigadement anti-fasciste). Qu'elle était finalement la bonne position d'après le PCInt, celle qui a conduit cette organisation à lancer en 45 un "Appel aux comités d'agitation des partis à direction prolétarienne" (en fait les PC, les PS et les anarchistes) pour un "front unique de tous les travailleurs" (voir à ce sujet notre Revue Internationale n°32)
Courants politiques:
- Gauche Communiste [66]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La lutte Proletarienne [121]
Revue Internationale no 55 - 4e trimestre 1988
- 2945 lectures
Editorial : les "paix" de l'été 88
- 2406 lectures
L'intensification des préparatifs guerriers
L’été 1988 serait selon toute la presse du monde capitaliste l'été de la paix dans le monde, ou du moins de tous les espoirs de paix. Ce serait la paix entre l'Iran et l'Irak, en Angola et au Cambodge et bientôt en Afghanistan. Ce serait aussi le début d'un processus de désarmement des missiles nucléaires entre les deux têtes de bloc - les USA et l'URSS -, processus garant de la volonté réelle de paix de la part des dirigeants des deux principales puissances capitalistes du monde. Bref la perspective de la paix l'emporterait sur celle, supposée opposée, d'une 3ème guerre mondiale.
LE CAPITALISME, C'EST LA GUERRE
Une des principales positions de toujours de la théorie du prolétariat, du marxisme, est que, dans le capitalisme, la paix et la guerre ne sont pas contradictoires, ni ne s'excluent. Mais qu'elles sont deux moments de la vie même de ce mode de production, que la paix n'est que la préparation de la guerre. Malgré "l'été 88", malgré les accords de "désarmement" entre Reagan et Gortbachev, malgré toute la propagande pacifiste actuelle, l'alternative historique qui s'offre à l'humanité n'est pas paix ou guerre, mais reste toujours socialisme ou 3ème guerre impérialiste mondiale, socialisme ou barbarie. Plus exactement aujourd'hui : socialisme ou continuation et développement encore plus dramatique de la barbarie capitaliste.
Nous nous trouvons donc en face de deux thèses: celle de la propagande bourgeoise et celle de la théorie révolutionnaire du prolétariat. L'une contribue à essayer de maintenir l'ordre social actuel en tentant de développer l'illusion que la paix est possible dans le capitalisme. Pour la seconde, pour le marxisme: "la guerre est un produit nécessaire du capitalisme" (Lénine, "Le congrès socialiste international de Stuttgart", 1907), et: "L'humanité (...) est menacée de destruction. Il n'est plus qu'une force capable de la sauver, et cette force c'est le prolétariat." ("Plate-forme de l'Internationale communiste", 1919).
LA CRISE ECONOMIQUE IRREVERSIBLE DU CAPITALISME POUSSE A LA GUERRE IMPERIALISTE
Depuis 1945, l'antagonisme impérialiste entre le bloc de l'Ouest et celui de l'Est n'a cessé de s'exprimer dans des guerres (Corée, Indochine, Moyen-Orient, etc.). Mais aujourd'hui, l'impasse économique et la chute dans la crise, ne font qu'exacerber ces antagonismes et poussent le capitalisme à la fuite en avant dans la guerre, à l'éclatement d'une 3ème guerre mondiale.
"A partir du moment où cette crise ne peut trouver d'issue temporaire dans une expansion du marché mondial, la guerre mondiale de notre siècle exprime et traduit ce phénomène d'autodestruction d'un système qui, par lui-même, ne peut dépasser ses contradictions historiques." ("La guerre dans le capitalisme", Revue Internationale n°41, 1985).
C'est dans l'impossibilité pour le capitalisme en déclin d'éviter et de surmonter la crise économique que se trouve la base même de la guerre impérialiste, expression la plus haute de cette crise et de la décadence de ce mode de production lui-même.
LES "PAIX" DE L'ETE 88 : UNE ETAPE DE L'OFFENSIVE OCCIDENTALE
C'est la paix partout, clament les journaux et les télévisions: en Angola, au Cambodge, en Afghanistan, et surtout entre l'Irak et l'Iran. Et cela après les accords de désarmement entre les USA et l'URSS ([1] [236]). Selon les médias, la raison et la sagesse l'emporteraient. Gorbatchev et Reagan seraient touchés par la grâce pacifiste. Les dirigeants des principales puissances réussiraient à s'entendre pour dépasser l'antagonisme impérialiste qui menace le monde. Les bonnes volontés l'emporteraient donc sur les lois mêmes du capitalisme.
La preuve serait ainsi faite que le capitalisme n'est pas forcément la guerre comme le proclame le marxisme. Et pourtant nous continuons d'affirmer que c'est ce dernier qui a raison.
Essayons donc d'y voir de plus près. Ces différentes "paix" apparaissent toutes comme des "pax americana": l'armée russe quitte l'Afghanistan, les forces cubaines l'Angola, et les Vietnamiens le Cambodge. En fait, ces différents retraits russes sont le résultat du soutien économique et surtout, et de plus en plus, militaire des USA à la résistance afghane et à la guerre menée par l'Afrique du Sud et le mouvement de guérilla l'UNITA contre l'Angola. Tout comme c'est bien l'immense pression militaire et économique du bloc de l'Ouest qui a eu raison des ayatollahs iraniens dans le conflit avec l'Irak. Si raison il y a, c'est celle du plus fort, celle qui s'exprime sans ambiguïté par la présence de l'armada occidentale dans le golfe Persique et l'efficacité des missiles Stinger américains contre l'aviation russe en Afghanistan.
A la vérité, les différentes "paix" ne sont pas le produit de la raison, ni de la bonne volonté pacifiste, mais du rapport de forces actuel entre les deux blocs. Les "paix" de l'été 88 sont le produit de la guerre.
LES "PAIX" DE L'ETE PREPARENT LA GUERRE IMPERIALISTE
Produits de la guerre, les "paix" de l’été 88 préparent les guerres à venir vérifiant ainsi la thèse marxiste. Seule celle-ci permet de révéler la réalité cachée des conflits impérialistes et même bien souvent de prévoir leur issue. Voilà comment nous caractérisions en 1984 l'évolution des conflits impérialistes:
"Contrairement à la propagande assenée quotidiennement par tous les médias du bloc occidental, la caractéristique majeure de cette évolution consiste en une offensive du bloc américain contre le bloc russe. Celle-ci vise à parachever l’encerclement de l'URSS par le bloc occidental, à dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct. Elle a pour but d'expulser définitivement l'URSS du Moyen-Orient en réintégrant la Syrie au sein du bloc occidental. Elle passe par une mise au pas de l'Iran et la réinsertion de ce pays dans le bloc US comme pièce majeure de son dispositif militaire. Elle a pour ambition de se poursuivre par une récupération de l'Indochine. Elle vise, en fin de compte, à étrangler complètement l'URSS; et à lui retirer son statut de puissance mondiale." (Revue Internationale n°36, 1er trimestre 1984, p.2).
Nous sommes en train de vivre l'aboutissement de la deuxième phase de cette offensive du bloc US contre l'URSS: la remise au pas de l'Iran alors qu'il y a déjà un certain temps que la Syrie manifeste sa réintégration dans le bloc occidental - première phase de cette offensive - en assumant le rôle du gendarme américain au Liban. Cette remise au pas de l'Iran va signifier le retour plus ou moins rapide de ce pays à la discipline du bloc de l'Ouest qui en avait fait le gendarme de l'Occident dans cette région du temps du Shah. Et pour cela, l'impérialisme US est tout disposé à laisser, le temps qu'il faudra, ses forces militaires dans le golfe Persique pour "aider" l'Iran à bien comprendre le rôle qui lui revient: exercer une pression directe sur la frontière sud de l'URSS.
Celle-ci, après son expulsion du Moyen-Orient, est maintenant pratiquement exclue de l'Afrique -sauf de l'Ethiopie mais pour combien de temps encore ?- avec les projets de retrait des forces cubaines de l'Angola et doit donc aussi retirer ses troupes d'Afghanistan. Cette offensive occidentale va se poursuivre en Indochine: nous le voyons déjà avec les projets de retrait de l'armée vietnamienne du Cambodge. Elle vise à retirer à l'URSS les dernières places fortes qu'elle détient encore en dehors de l'Europe.
Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
L'UNIQUE PERSPECTIVE DU CAPITALISME : UNE 3ème GUERRE MONDIALE
Le succès de l'offensive américaine contre l'URSS signifie pour cette dernière une situation croissante d'isolement et d'affaiblissement de plus en plus critique. Elle va se retrouver de plus en plus acculée sur son glacis est européen et dans les faits, étranglée.
Si ce processus d'affrontements impérialistes entre le bloc de l’Ouest et de l'Est allait jusqu'à son terme, l'URSS se retrouverait dans la situation de l'Allemagne lors des deux premières guerres mondiales: contrainte en dernière instance, sous peine de mourir étouffée, de déclencher une 3ème guerre mondiale. Et cela malgré une situation économique et militaire extrêmement défavorable par rapport au rival de l'Ouest. Et cela malgré toutes les conséquences dramatiques pour l'avenir même de l'humanité avec les armements actuels. Car ce processus d'affrontements menant à la guerre est inhérent au capitalisme et ne peut être stoppé que par la destruction même de ce mode de production.
AUJOURD'HUI LE CAPITALISME C'EST LA CHUTE DANS LA MISERE, LA GUERRE ET LA BARBARIE
Pour l'instant ce processus menant sans doute à la destruction de la plus grande partie de l'humanité, sinon à sa disparition complète, ne peut se développer jusqu'à son terme. Nous allons y revenir.
Mais, il n'en demeure pas moins que le capitalisme continu de survivre, et tel un fruit trop mûr, de pourrir sur pied. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'alternative historique n'est plus "socialisme ou barbarie", mais socialisme ou continuation et développement de la barbarie capitaliste. Quatre-vingts ans de décadence historique marquée par une misère jamais vue encore dans l'histoire de l'humanité -en particulier les 2/3 des êtres humains souffrant de la faim !-, des massacres sans fin au cours de guerres ininterrompues -dont deux guerres mondiales avec des millions de morts- ont fait la preuve de l’obsolescence du mode de production capitaliste qui, porteur de progrès historique dans le passé, s'est transformé en une entrave et en un risque mortel pour le développement et la survie même de l'humanité.
Et, pour ceux qui douteraient de la validité de la thèse marxiste sur l'existence de la décadence du capitalisme, rappelons brièvement la réalité macabre du conflit sciemment provoqué, déclenché et entretenu par les USA et leurs alliés occidentaux entre l'Iran et l'Irak. Selon la presse (22/8/88): 1 200 000 morts dont 900 000 du côté iranien parmi lesquels un grand nombre d'enfants, de vieillards et même de femmes. Le nombre des blessés et des invalides est deux fois plus élevé encore. Inutile ici de revenir sur l'utilisation massive des gaz. L'économie de ces pays se retrouve dévastée: les dépenses d'armements des deux pays s'élevant à plus de 200 milliards de dollars tout comme le total des destructions.
Et toute cette horreur sans aucun "bénéfice" historique, économique, ni même territorial pour les deux belligérants sinon une place de choix assurée dans les conflits à venir!
Car, malgré les différents cessez-le-feu, ce n'est pas la paix qui attend les pays directement concernés. Qu'ils soient destinés ou non à servir de place forte d'un impérialisme -tel l'Iran-, c'est la guerre, la misère et la décomposition sociale qui vont se développer. Leur futur immédiat, c'est l'instabilité comme au Liban. Pour les pays africains et le Moyen-Orient en particulier, ainsi que pour l'Afghanistan, le Cambodge, l'Iran, etc., les "paix" de 88 sont un pas de plus dans la décomposition sociale, dans la famine et la misère, et dans les guerres interminables des différentes fractions et bandes locales. Pour ces pays, ce n'est pas la paix, c'est la "libanisation" qui s'annonce, le développement encore plus dramatique de la putréfaction économique et sociale du capitalisme.
Cette "libanisation" s'exprime en particulier dans l'explosion de massacres entre ethnies -dernier en date au Burundi où il y aurait 25 000 morts dans les affrontements entre les "Hutus" et les "Tutsis"- et aussi dans "l'explosion des nationalités" tout autant accompagnée de massacres comme avec les Sikhs en Inde, les Kurdes en Iran et en Irak, et même en URSS, en Azerbaïdjan. Ces conflits sont une des expressions de la décomposition croissante du tissu social dans tous les pays.
Toute cette horreur est la réalité du capitalisme décadent. La guerre et la décomposition sont les seules perspectives que cette société en putréfaction puisse offrir à l'humanité.
LE PROLETARIAT EST LE SEUL FREIN A LA GUERRE IMPERIALISTE
Nous avons affirmé précédemment que le processus de développement des antagonismes impérialistes entre l'Ouest et l'Est ne réussissait pas pour l'instant à se développer jusqu'à son terme apocalyptique. Malgré la profondeur de la crise économique et son accélération, malgré la constitution depuis 1945 des deux grands blocs impérialistes, malgré une économie dirigée principalement vers la production d'armement et par conséquent leur abondance, la 3ème guerre mondiale n'a toujours pas éclaté.
Certes, le temps travaille pour les USA. Cette puissance a pu attendre durant 8 ans de guerre l'épuisement de l'Iran pour sa remise au pas. Elle a adopté la même attitude en Afghanistan par rapport à l'URSS. Le bloc de l'Ouest peut se permettre, car c'est lui qui a l'initiative, de laisser s'épuiser l'URSS dans la course aux armements. D'autant que le bloc de l'Est se trouve dans une situation intérieure difficile. Tout particulièrement sa puissance dominante: l'URSS elle-même se trouve confrontée à "l'explosion des nationalités" -encore dernièrement dans les pays baltes- qui, nous l'avons vu, est une des expressions de la décomposition.
D'un autre côté, l'URSS est sur la défensive et assume de plus en plus mal le poids de l'économie de guerre et les frais de ces diverses occupations militaires. Elle cherche désespérément de l'air face à l'étouffement qui la guette et un répit pour pouvoir faire face et se préparer.
Mais ce n'est pas là la raison du non-déclenchement aujourd'hui du conflit mondial entre les deux blocs. Toutes les conditions sont réunies. Sauf une: l'adhésion et la soumission des populations et en tout premier lieu des ouvriers qui produisent l'essentiel de la richesse sociale et toutes les armes, et qui constitueraient les principaux contingents lors d'une guerre généralisée. Les ouvriers ne sont pas prêts aujourd'hui au sacrifice de leur vie dans une guerre. A l'heure où nous écrivons, au delà des particularités polonaises et de leurs limites propres, les grèves ouvrières en Pologne ([2] [237]) manifestent une fois de plus la combativité du prolétariat international et son refus d'accepter sans réaction les attaques économiques imposées par la crise et l'immense misère accompagnant inévitablement le développement de l'économie de guerre.
Cette combativité ouvrière s'est exprimée dans les luttes de ces dernières années pour la défense des conditions de vie et contre leur brutale et croissante détérioration, principalement en Europe Occidentale ([3] [238]). Elle constitue le frein et l'obstacle au développement du processus capitaliste à la guerre et à son aboutissement logique dans un 3ème conflit impérialiste mondial.
Beaucoup d'ouvriers individuellement, nombre de militants révolutionnaires et presque tous les groupes politiques du prolétariat, victimes de la propagande bourgeoise, désespèrent des luttes de la classe ouvrière et même certains vont jusqu'à nier leur existence ([4] [239]). Et face à la question pourquoi la guerre n'a-t-elle pas encore éclaté alors que toutes les conditions sur le plan objectif sont réunies, ces camarades désespèrent du marxisme et remettent alors en cause ses principes mêmes.
LE PACIFISME DESARME LA CLASSE OUVRIERE ET PREPARE LA GUERRE
La bourgeoisie, elle, ne doute pas de l'existence et du danger des luttes ouvrières. En lien avec la combativité ouvrière, elle sait aussi très bien que les populations civiles ne sont pas disposées aux sacrifices d'une guerre. C'est la raison d'être des campagnes de propagande pacifiste dirigées à l'Ouest comme à l'Est essentiellement contre les ouvriers.
Malgré toute sa puissance idéologique, l'Etat capitaliste US aurait aujourd'hui le plus grand mal à envoyer un corps expéditionnaire de 500 000 soldats du contingent sur un champ de bataille, comme à l'époque du Vietnam, sans susciter des réactions populaires, et sans doute ouvrières, très dangereuses. Et, même si ce n'est pas la première, une des raisons du retrait russe est aussi le mécontentement croissant parmi la population en URSS et même parmi la troupe comme on a pu s'en apercevoir lors des violents troubles qui ont eu lieu à l'occasion d'un rassemblement de plus de 8 000 parachutistes, anciens soldats d'Afghanistan, le 2 août dernier à Moscou (presse du 9/8/88).
Après les accords entre Reagan et Gorbatchev sur les euromissiles, et après les accords et les négociations concernant l'Afrique Australe, l'Iran et l'Irak, le Vietnam, la bourgeoisie internationale utilise le retrait de l'URSS de l'Afghanistan pour entretenir les illusions pacifistes au sein de la classe ouvrière. La "paix" imposée à l'Iran est aussi l'occasion de présenter la présence de l'immense flotte occidentale dans le golfe Persique comme une entreprise civilisatrice et pacificatrice en opposition au fanatisme islamiste des ayatollahs.
Ces campagnes pacifistes sont organisées aussi bien par les gouvernements, les médias, les partis de gauche et les syndicats. Elles ont pour but d'endormir la classe ouvrière en lui faisant croire que la paix est possible dans le capitalisme. Elles essayent ainsi d'empêcher la prise de conscience des dramatiques enjeux historiques actuels: révolution prolétarienne ou 3ème guerre mondiale.
"L'une des formes de mystification de la classe ouvrière est le pacifisme et la propagande abstraite de la paix. En régime capitaliste, et particulièrement à son stade impérialiste, les guerres sont inévitables." (Lénine, Résolution sur "Le pacifisme et la consigne de la paix" de la Conférence des sections du POSDR à l'étranger, mars 1915).
Et surtout, en faisant croire à l'opposition entre la guerre et la paix, le pacifisme au nom de la paix abstraite rejette dans ce mal absolu que serait la guerre, la lutte des classes, et plus particulièrement la lutte de la classe ouvrière et la perspective de la révolution prolétarienne. Le pacifisme veut mener la classe ouvrière à l'abandon de ses combats, à l'acceptation de l'exploitation, de la misère et des sacrifices croissants. Il veut rendre les ouvriers impuissants face au drame historique qui vient en les détournant du terrain de l'opposition aux attaques économiques croissantes du capital en crise.
Que la classe ouvrière ne cède pas aux sirènes du pacifisme et n'abandonne pas ses luttes pour gagner la paix. Elle n'y gagnerait que la défaite d'abord. Et ensuite la guerre généralisée.
Dans le capitalisme, la seule paix possible c'est celle des cimetières. Les "paix de l'été 88" préparent l'intensification de la guerre impérialiste. Et les campagnes pacifistes visent à masquer aux yeux des ouvriers cette monstrueuse réalité.
"Historiquement, le dilemme devant lequel se trouve l’humanité d'aujourd'hui se pose de la façon suivante: chute dans la barbarie, ou salut par le socialisme. Ainsi nous vivons aujourd'hui la vérité que justement Marx et Engels ont formulée pour la première fois, comme base scientifique du socialisme, dans le grand document qu'est le Manifeste communiste: le socialisme est devenu une nécessité historique." (Rosa Luxemburg, "Discours sur le programme du Parti Communiste d'Allemagne", 1/1/1919).
RL. 26/8/88
[1] [240] Sur le mensonge du désarmement et la réalité des accords sur les euro-missiles et du développement des armements, voir éditorial de notre Revue Internationale n°54.
[2] [241] Voir l'article suivant sur les grèves en Pologne dans ce numéro.
[3] [242] Sur la réalité et la signification des luttes ouvrières actuelles, voir les différents articles dans les numéros antérieurs de cette revue (éditorial du n° 53) et dans notre presse territoriale.
[4] [243] Voir dans ce numéro l'article "Décantation du milieu politique prolétarien et oscillations du BIPR".
Questions théoriques:
- Impérialisme [25]
Lutte de classe internationale : luttes ouvrières en Pologne
- 2641 lectures
Une nouvelle fois le prolétariat de Pologne, face à une dégradation insupportable de ses conditions d'existence, a repris le chemin du combat de classe : ses luttes de la deuxième moitié du mois d'août 88, qui ont succédé à celles du printemps, sont les plus importantes depuis les combats de l'été 80. Une nouvelle fois la bourgeoisie a démontré son savoir-faire pour mener dans une impasse et défaire la combativité ouvrière, grâce à un remarquable partage des tâches entre gouvernement et forces d'"opposition" avec en tête "Solidamosc". Ces luttes sont un appel aux ouvriers de tous les pays, et particulièrement à ceux des pays les plus développés : par leur ampleur, leur détermination, leur combativité, mais aussi parce que seul le prolétariat des pays les plus avancés, et notamment celui d'Europe occidentale, est en mesure de montrer le chemin de la lutte contre les pièges et mystifications qui sont venus à bout des ouvriers de Pologne.
Pologne : 31 août 1980 - 31 août 1988 : à huit ans de distance, deux rencontres entre les autorités gouvernementales et des "représentants de la classe ouvrière" symbolisent l'évolution de la situation sociale et des rapports de force entre classes dans ce pays.
Du côté du gouvernement les acteurs ont changé, le ministre de l'intérieur de 88, Kiszczak, a remplacé le vice-Premier ministre de 80, Jagielski, mais le mandataire est toujours le même : le représentant suprême du capital national polonais. En face, par contre, c'est toujours le même Lech Walesa qui sert d'interlocuteur, mais en août 80 il est mandaté par l'organe que s'est donné la classe ouvrière au cours des grèves, le MKS (Comité de grève inter-entreprises), alors qu'aujourd'hui ce n'est pas la classe ouvrière en lutte qu'il représente mais lui aussi le capital national.
En août 80, la classe ouvrière, en un combat qui demeure à ce jour le plus important depuis la reprise historique du prolétariat mondial à la fin des années 60, avait réellement réussi à faire reculer momentanément l'Etat bourgeois. Aujourd'hui, la formidable combativité qu'elle a manifestée depuis plusieurs mois, et tout particulièrement en ce mois d'août, a été dévoyée et bradée par de sordides manoeuvres entre ses ennemis notoires, le gouvernement et le parti au pouvoir (bien que ce dernier se dise toujours "Parti Ouvrier"), et l'organisation qui, malgré (ou plutôt grâce à) sa non existence légale, bénéficie encore de sa confiance : le syndicat "Solidarité".
Le 31 août 80, Lech Walesa n'était que le porte parole des ouvriers en lutte, lesquels pouvaient à chaque instant contrôler les négociations qu'il menait avec les représentants du gouvernement qui avaient été contraints de se rendre dans le bastion ouvrier du chantier naval "Lénine". Le 31 août 88, le même Lech Walesa a rencontré à huis clos, dans une villa gouvernementale des beaux quartiers de Varsovie, le ministre de l'intérieur, c'est-à-dire le spécialiste gouvernemental du "maintien de l'ordre" capitaliste, avec un seul objectif : rechercher le meilleur moyen de rétablir cet "ordre" remis en cause par les grèves ouvrières.
Le 31 août 80, Walesa appelle à la reprise parce que le pouvoir a donné satisfaction aux 21 revendications élaborées par les grévistes. Le 31 août 88, il met à profit la popularité dont il continue encore à jouir auprès des ouvriers pour leur demander qu'ils mettent fin à leur mouvement en échange de vagues promesses sur l'ordre du jour d'une "table ronde" où devrait être abordée la question du "pluralisme syndical", c'est-à-dire du pluralisme des organes destinés à encadrer la classe ouvrière et à saboter ses luttes. C'est d'ailleurs pour cela que, si le 1er septembre 80 l'ensemble des grévistes était retourné au travail avec le sentiment d'avoir gagné, cette fois-ci il a fallu à Walesa une bonne partie de la nuit pour convaincre le comité de grève inter-entreprises de Gdansk d'appeler à la reprise et toute une matinée pour obtenir des ouvriers du chantier "Lénine" qu'ils mettent fin à la grève, alors que dans d'autres villes la grève s'est poursuivie jusqu'à la venue du "pompier volant".
En bref, en août 80, la classe ouvrière avait remporté une victoire (provisoire certes, mais il ne peut en exister d'autre dans la période actuelle), en août 88 elle a subi une défaite.
Faut-il en conclure à un recul général de la classe ouvrière dans tous les pays ? Les derniers événements de Pologne sont-ils significatifs de l'évolution des rapports de force entre classes au niveau mondial ?
Rien n'est moins vrai. En réalité, les dernières luttes du prolétariat en Pologne constituent une confirmation éclatante de toute la perspective mise en avant par notre organisation depuis une vingtaine d'années : plus que jamais l'heure est au déploiement, à l'intensification du combat de classe dans la mesure même où ses conditions n'ont fait que se développer depuis son renouveau historique débuté il y a deux décennies.
L'AGGRAVATION INEXORABLE DE LA CRISE ECONOMIQUE ET L'INTENSIFICATION DES ATTAQUES CAPITALISTES
A l'origine des luttes ouvrières qui ont secoué la Pologne ces derniers mois se trouvent des attaques d'une brutalité incroyable contre le niveau de vie de la classe ouvrière. Ainsi, au début de l'année le gouvernement décide pour le premier de chacun des mois suivants, février, mars, avril, des trains de hausses massives sur les produits alimentaires, les transports, les services... Le taux d'inflation sur cette période se monte à 60%. Malgré les augmentations de salaires qui accompagnent ces hausses, la perte de revenus pour la population est de 20%. En un an, certains prix ont fait plusieurs fois la culbute : ainsi les loyers ont doublé, le prix du charbon a été multiplié par trois, celui des poires par quatre, celui des chaussures en toile pour enfants par cinq, et ce ne sont que des exemples parmi beaucoup d'autres. Par ailleurs, vue la pénurie (par exemple la viande, le lait pour enfants, le papier hygiénique), beaucoup de biens élémentaires doivent être achetés au marché noir ou bien dans les "Pewex" où il faut payer en devises fortes dont le taux délirant au marché noir (seul moyen pour un ouvrier de se les procurer) ramène le salaire moyen mensuel à 23 dollars. Dans ces conditions il n'est pas surprenant que les autorités elles mêmes reconnaissent que 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
Cette misère est vécue de façon particulièrement dure par les jeunes ouvriers qui constituent les bataillons les plus déterminés des combats actuels. D'après Tygodnik Mazowsze, l'hebdomadaire clandestin de Solidarnosc pour Varsovie, les jeunes ouvriers forment "une génération sans perspectives" : "La vie qu'ils vivent est un cauchemar. Leurs chances de trouver un logement à eux sont pratiquement nulles. La plupart d'entre eux vivent dans de prétendus foyers fournis par l'entreprise. Ils sont parfois six entassés dans deux chambres. Un couple avec trois enfants vit dans une petite pièce et une cuisine de quatre mètres carrés où il n'y a que l'eau froide."
Cette dégradation incroyable des conditions de vie de la classe ouvrière, malgré (ou plutôt à cause de) toutes les "réformes économiques" successives mises en oeuvre par le régime depuis de nombreuses années, ne saurait évidemment pas être considérée comme une sorte d'"exception", de "particularité" réservée à la Pologne ou même aux pays dits "socialistes". Même si dans ce pays elle prend une forme extrême, caricaturale, du fait de l'acuité de la crise économique (la dette extérieure de la Pologne se monte à quelque 50 milliards de dollars dont 39 envers les pays occidentaux), on la retrouve dans tous les pays d'Europe de l'Est comme dans les pays les plus avancés. En URSS par exemple, les pénuries n'ont jamais été aussi catastrophiques malgré les hausses des prix qui étaient sensées les faire disparaître. La fameuse "perestroïka" (restructuration) de l'économie est totalement absente des réfrigérateurs, comme le constatent avec humour les habitants de la "patrie du socialisme" et la "glasnost" (transparence) est avant tout celle des rayons des magasins qui restent désespérément vides. Ce que viennent souligner en premier lieu les grèves en Pologne et la catastrophe économique qui les alimente, c'est la faillite de la politique de "perestroïka" chère à Gorbatchev. Et à cela il n'y a nul mystère : alors que l'économie des pays les plus avancés ne réussit à donner l'illusion d'une certaine stabilité qu'au prix d'une fuite en avant vers le gouffre d'un endettement astronomique, il revient aux économies les plus faibles, comme celles d'Europe de l'Est, et notamment en Pologne, d'être les premières à faire les frais de l'effondrement mondial du capitalisme. Et nulle "restructuration" n'y peut rien. Comme partout dans le monde, la "réforme économique" ne peut avoir comme unique conséquence que de nouvelles et encore plus brutales attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière.
Ainsi, ce qu'illustre en premier lieu la situation actuelle en Pologne, c'est le caractère insurmontable de la crise du capitalisme. Le délabrement économique de ce pays, la misère qui en résulte pour la classe ouvrière, ne font qu'indiquer la direction vers laquelle s'acheminent aussi les pays les plus avancés, ceux qui, jusqu'ici, ont été les plus "épargnés" par la crise.
POUR LA CLASSE OUVRIERE UNE SEULE VOIE : LE DEVELOPPEMENT DE SES LUTTES
Le deuxième enseignement qu'il faut tirer de cette situation c'est que, face à l'effondrement irréversible de l'économie mondiale, face à des attaques capitalistes sans cesse croissantes, il ne reste d'autre voie pour la classe ouvrière de tous les pays que de reprendre et développer ses combats. Et les luttes des ouvriers de Pologne font la preuve, une nouvelle fois, que c'est bien sur cette voie que s'est engagé le prolétariat mondial.
A cet égard, les luttes récentes en Pologne sont particulièrement significatives. Dans ce pays les ouvriers ont subi, suite à leur lutte magnifique et leur première victoire de 1980, une défaite cuisante qui s'est en particulier concrétisée par l'instauration de l'état de guerre en décembre 81. Ils ont été emprisonnés par dizaines de milliers, leur résistance a été réduite par la force au prix de la vie de dizaines d'entre eux, ils ont dû subir les matraquages, les sévices, ils ont dû affronter pendant des années la terreur policière, la hantise permanente, au cas où ils voudraient résister aux attaques capitalistes, à perdre leur travail, leur logement ou même d'aller moisir en prison. Malgré cette pression énorme, malgré la démoralisation qui pesait sur beaucoup d'entre eux depuis 1981, ils ont repris le chemin de la lutte au printemps dernier, dès que sont tombées les attaques économiques. Point désarmés par l'échec de cette première tentative (où toute l'habileté de Walesa avait été nécessaire pour convaincre les jeunes ouvriers de Gdansk de reprendre le travail) ([1] [244]), ils se sont replongés dans le combat de classe au cours de l'été, en un mouvement bien plus vaste que le précédent, ce qui illustre bien une des caractéristiques majeures de la période actuelle : l'accélération de l'histoire sous la pression de l'aggravation de la crise économique et qui se manifeste, sur le plan du combat de classe, par une tendance à des vagues de lutte de plus en plus rapprochées dans le temps.
Ce mouvement avait débuté le 16 août de façon spontanée dans le coeur ouvrier de la Pologne, les mines de Silésie. Il était particulièrement significatif puisqu'il affectait un des secteurs les plus anciens et expérimentés de la classe ouvrière et, par ailleurs, traditionnellement les plus "choyés" par le gouvernement (salaires et rations plus élevés,) du fait notamment de son importance économique (le charbon constitue la matière première et la source d'énergie la plus importante du pays et représente 1/4 des exportations), et qui n'en demandait pas moins de fortes augmentations de salaire (jusqu'à 100%, chiffre jamais vu jusqu'à présent dans des luttes ouvrières en Europe). Jour après jour le mouvement s'est étendu à de nouvelles mines et dans d'autres régions, notamment à Szczecin où le port et les transports ont été paralysés par la grève. Partout, la pression en faveur de la grève est très forte notamment de la part des jeunes ouvriers. A Gdansk, au chantier naval "Lénine", entreprise phare pour tous les ouvriers du pays, les jeunes ouvriers veulent en découdre à nouveau malgré leur échec du mois de mai. De nouveau Walesa joue les temporisateurs. Mais le lundi 22 août, il ne peut faire autre chose qu'appeler lui même à la grève qui paralyse aussitôt le chantier "Lénine". La grève se propage en quelques heures à Varsovie (aciérie Huta Warszawa, usine de tracteurs d'Ursus), Poznan, Stalowa Wola et d'autres entreprises de Gdansk. Il y a de 50 000 à 70 000 ouvriers en grève. Le mardi 23 août, la grève continue de s'étendre notamment à Gdansk, dans d'autres chantiers navals, et dans de nouvelles mines de Haute-Silésie. La classe ouvrière semble avoir renoué avec la dynamique de l'été 80. Mais en fait, le mouvement a atteint son apogée et il commence à refluer dès le lendemain car, cette fois-ci, la bourgeoisie est beaucoup mieux préparée que huit ans auparavant.
LA DEFAITE DU MOUVEMENT : GOUVERNEMENT ET OPPOSITION SE PARTAGENT LE TRAVAIL
Il est possible que le gouvernement ait été surpris par l'ampleur des luttes. Cependant, sa conduite tout au long de celles-ci a démontré qu'il avait beaucoup appris depuis l'été 80 et à aucun moment il n'a été débordé par la situation. En particulier il a pris soin, chaque fois qu'une nouvelle entreprise entrait en grève, de l'encercler par un cordon de "zomos" (unités spéciales anti-émeutes). Ainsi, à chaque fois, l'occupation du lieu de travail se refermait comme un piège sur les ouvriers en lutte les empêchant d'entrer en contact avec leurs frères de classe et, partant, d'unifier le mouvement, de le rassembler en un seul front de combat. La répression et l'intimidation n'en restent pas là. Le 22 août, jour où le mouvement s'étend le plus, le ministre de l'intérieur, le général Kiszczak, apparaît en uniforme à la télévision pour annoncer une série de mesures destinées à briser cette extension : établissement du couvre feu dans les trois régions les plus touchées par les grèves : Katowice, Szczecin et Gdansk; toute personne étrangère à une entreprise en grève sera évacuée et risque l'emprisonnement. Il accuse les grévistes d'être armés et il agite la menace d'une "effusion de sang". Au même moment, sa prestation est soutenue par celle de la télévision soviétique qui diffuse des images des entreprises en grève en traitant les grévistes d’"extrémistes qui exercent des pressions et des menaces sur leurs camarades par des grèves illégales". Les barres de fer que tiennent les ouvriers pour faire face à une éventuelle intervention policière sont présentées comme les instruments de ces "menaces". Ainsi, quand il s'agit de faire face à un mouvement de la classe ouvrière, Gorbatchev s'asseoit sur sa "glasnost" et retrouve la langue de bois classique de la terreur stalinienne : il ne faudrait pas que les ouvriers de Russie aient l'idée d'imiter leurs frères de classe de Pologne et ces derniers doivent savoir qu'ils n'ont rien à attendre de la "libéralisation" (d'ailleurs, ils ne se font guère d'illusions depuis le venue de Gorbatchev en Pologne, début juillet, lorsque ce dernier leur a dit qu'"Il doivent être fiers d'avoir un leader comme Jaruzelski" et qu'il a présenté ce dernier comme son "ami personnel".
Mais les menaces n'en restent pas au stade des paroles. Les actes viennent les "crédibiliser" : la Silésie est coupée du reste du pays par des barrages de la police et de l'armée; chaque jour les "zomos" interviennent dans de nouvelles entreprises pour déloger les ouvriers (notamment en Silésie où, au fond des puits, les mineurs manquent de nourriture, de médicaments et de couvertures); les arrestations se multiplient. Celles-ci frappent les grévistes mais aussi des membres de l'opposition et particulièrement des dirigeants de Solidarnosc, tel Frasyniuk, chef du syndicat de Wroclaw et membre de la direction nationale. Dans le premier cas il s'agit d'inciter les grévistes à reprendre le travail et de dissuader les autres ouvriers de les rejoindre dans la lutte. Mais les arrestations de syndicalistes ont une autre fonction : crédibiliser Solidarnosc afin que cette organisation puisse pleinement jouer son rôle de saboteur des luttes. Car, une nouvelle fois, la défaite ouvrière résulte avant tout de l'action du syndicalisme.
Les objectifs anti-ouvriers de Solidarnosc nous sont décrits sans pudeur dès le mois de mai par Kuron, un des principaux "experts" de Solidarnosc et fondateur de l'ex-KOR : "Seul un gouvernement qui aura la confiance sociale pourra stopper le cours des événements, et appeler à l’austérité dans le cadre de réformes. Le véritable enjeu de la bataille actuelle est la constitution d'un tel gouvernement." (Interview au journal français "Libération" du 5 mai 1988). On ne peut être plus clair, le but de Solidarnosc est le même que celui du gouvernement : faire accepter "l'austérité" aux ouvriers.
C'est pour cela que, dès le début du mouvement, le syndicat a développé son action de sabotage. Une des composantes essentielles de sa stratégie a été de détourner dans une impasse le mécontentement ouvrier. Alors que le mouvement débute pour des revendications salariales, Solidarnosc met tout son poids dans la balance pour que ne subsiste qu’'"une seule revendication : la légalisation du syndicat". Ainsi, lorsque Walesa appelle à la grève dans les ateliers du chantier "Lénine", le 22 août, c'est avec le slogan : "Fini les plaisanteries ! Maintenant nous voulons Solidarnosc !" Comme si la défense des conditions de vie les plus élémentaires, la résistance contre la misère, étaient de simples plaisanteries ! Pour sa part, le président du comité de grève du chantier "Lénine", réputé "radical", affirme également : "La seule revendication est le rétablissement de Solidarnosc".
C'est de façon très sélective que Solidarnosc lance ses appels à la grève. D'une part, en beaucoup d'endroits où la pression en faveur de la lutte est très forte, Solidarnosc se garde bien d'appeler à l'arrêt du travail, préférant décréter, afin de "défouler" la combativité ouvrière, l’"état de préparation à la grève"y ou bien menaçant d'appeler à celle-ci dans le cas où les autorités déchaîneraient une répression générale, ce qu'elles ont évité de faire, évidemment. D'autre part, l'appel direct à la grève aux chantiers navals "Lénine" de Gdansk, qui restent depuis l'été 80 un symbole pour toute la classe ouvrière en Pologne, participe également d'une manoeuvre. C'est une des entreprises où Solidarnosc est le mieux implanté, notamment du fait que c'est là où Walesa travaille; de ce fait, il sera plus facile qu'ailleurs de faire reprendre le travail et cette reprise fera figure à son tour de symbole : dans le reste du pays, les ouvriers auront le sentiment qu'il ne leur reste plus qu'à imiter leurs camarades de Gdansk. D'ailleurs, aux chantiers "Lénine", afin de faciliter cette reprise, Walesa a fait tout son possible pour présenter dès son début la grève comme une calamité, inévitable du fait de la mauvaise volonté du gouvernement qui n'a pas voulu entendre ses appels répétés à la négociation : "Je voulais éviter les grèves. Nous ne devrions pas être en grève, nous devrions travailler. Mais nous n'avions pas le choix... Nous attendons toujours des discussions sérieuses." (22 août). Et en fait, afin de mieux fatiguer les ouvriers, le gouvernement et Solidarnosc jouent au chat et à la souris pendant plus d'une semaine, l'un et l'autre faisant preuve d'"intransigeance" sur LA question du pluralisme syndical (polarisant ainsi les ouvriers sur une fausse question) jusqu'au moment où les deux parties "acceptent" de se rencontrer pour discuter "sans tabous" (sic)... de l'ordre du jour d'une hypothétique "table ronde" qui ne pourra se tenir, évidemment, que... lorsque le travail aura repris.
Ainsi, la totale complicité entre les autorités et Solidarnosc est évidente. Elle est encore plus évidente lorsque l'on sait qu'un des sports favoris des dirigeants de Solidarnosc est de franchir impunément les cordons policiers isolant les entreprises et les régions en lutte pour aller rejoindre les grévistes (tel Jan Litynski, fondateur du KOR et responsable de Solidarnosc pour Varsovie qui réussit à rejoindre le comité de grève des mines de Silésie pour en devenir le principal "expert", et Lech Walesa lui-même qui rentre dans le chantier "Lénine" en "faisant le mur"). Décidément, les flics polonais sont des incapables !
A ce partage des tâches participe, comme toujours en Pologne, l'Eglise qui se paie même le luxe de faire entendre deux sons de cloche : le son modéré tel celui de l'aumônier du chantier "Lénine" qui, la veille de la grève, prend position contre en affirmant qu'elle "mettrait le feu à la Pologne", et le son "radical" qui apporte son plein soutien aux grévistes et à leur revendication de "pluralisme syndical". Même les forces au pouvoir font étalage de leurs "désaccords" pour mieux désorienter les ouvriers. Ainsi, le 24 août, les syndicats officiels (OPZZ), dont le président est membre du Bureau politique du Parti, lancent une mise en garde au gouvernement pour qu'"il entende leur opinion" et "menacent" d'appeler à la grève générale. Jaruzelski a du avoir vraiment très peur !
Finalement, grâce à toutes ces manoeuvres, la bourgeoisie est arrivée à ses fins : faire reprendre le travail sans que les ouvriers n'aient RIEN obtenu. C'est une défaite ouvrière importante qui laissera des marques. C'est d'autant plus une défaite que Solidarnosc a réussi, comme organisation, à ne pas se démasquer dans le travail de sabotage en laissant le soin à Walesa, qui est toujours volontaire pour ce genre de besognes, d'apparaître comme celui qui a "vendu la grève". Sa popularité y laissera sans doute quelques plumes, mais "on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs". L'essentiel est que la majorité des ouvriers conserve ses illusions sur le syndicalisme "libre". En refusant de légaliser Solidarnosc (alors qu'en fait cette organisation a déjà "pignon sur rue" : nombreux hebdomadaires, collectes de cotisations, réunions régulières de ses membres et de ses dirigeants, tout cela est "toléré"), en continuant à "persécuter" ses dirigeants, le pouvoir apportera sa contribution à ces illusions.
EN POLOGNE COMME PARTOUT DANS LE MONDE, LA PERSPECTIVE EST PLUS QUE JAMAIS AUX AFFRONTEMENTS DE CLASSE
Août 80 - août 88 : la comparaison des résultats des grèves de ces deux périodes, semble donc indiquer un recul très sensible de la force de la classe ouvrière. Un examen superficiel de ces deux moments de lutte peut confirmer une telle vision : c'est vrai qu'il y a huit ans la classe ouvrière avait été capable de mener des combats beaucoup plus massifs, déterminés, c'est vrai en particulier, qu'en 80, elle avait réussi à se doter d'une organisation de sa lutte lui permettant de la contrôler de bout en bout jusqu'à la victoire. Mais on ne peut s'arrêter à ces simples éléments. En réalité, la faiblesse actuelle de la classe ouvrière en Pologne est fondamentalement l'expression du renforcement politique de la bourgeoisie dans ce pays, tout comme sa force d'août 80 lui venait en grande partie de la faiblesse de la classe dominante. Et ce renforcement de la bourgeoisie, plus qu'à une plus grande habileté des dirigeants du pays, elle le doit à l'existence d'une structure d'encadrement de la classe ouvrière absente en 80 : le syndicat Solidarnosc. Cela est très bien exprimé par Kuron : "Contrairement à juillet-août 1980, l'opposition dispose aujourd'hui de structures organisées capables de contrôler les événements".(Ibid.)
En fait la classe ouvrière de Pologne se trouve aujourd'hui confrontée au même type de pièges que les ouvriers des pays les plus avancés ont dû affronter depuis des décennies. C'est justement parce qu'elle n'avait pas encore fait cette expérience, qu'elle a pu se laisser piéger de cette façon par les manoeuvres du syndicalisme après sa lutte remarquable de l'été 80. En revanche, toute l'expérience accumulée par le prolétariat des grandes métropoles capitalistes, notamment celui d'Europe occidentale, lui permet aujourd'hui de se dégager progressivement de l'emprise syndicale (comme on l'a vu lors de la grève dans les chemins de fer en France fin 86, ou en Italie dans le secteur de l'Ecole, en 87) et de prendre de plus en plus en main et unifier ses luttes comme l'avaient fait les ouvriers de Pologne en 80. Mais quand il y sera pleinement parvenu, la bourgeoisie ne pourra plus le faire revenir en arrière comme elle l'a fait pour le prolétariat de Pologne. Ce sont bien ces secteurs les plus avancés du prolétariat mondial qui pourront alors montrer le chemin à leurs autres frères de classe, et notamment ceux de Pologne et d'Europe de l'Est.
Les luttes de l'été 88 en Pologne ne démontrent nul recul de la classe ouvrière à l'échelle internationale. Au contraire, elles font la preuve des énormes réserves de combativité du prolétariat d'aujourd'hui que les défaites partielles ne réussissent pas à épuiser, mais qui, au contraire, ne font que s'accumuler avec l'intensification des attaques capitalistes. De même, la force des illusions syndicalistes, démocratiques, et même nationalistes pesant sur le prolétariat en Pologne met en relief les pas accomplis par celui des centres décisifs, des grandes concentrations ouvrières d'Europe occidentale, et donc du prolétariat mondial comme un tout; elle met donc en évidence son avancée vers des combats de plus en plus autonomes, puissants et conscients.
FM 4/9/1988
[1] [245] Au sujet des grèves du printemps 88 en Pologne et de leur sabotage par "Solidarnosc", voir la Revue Internationale n°54.
Géographique:
- Pologne [159]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [4]
Grupo Proletario Internacionalista : crise et luttes ouvrières au Mexique
- 3036 lectures
Nous publions ici un article du Grupo Proletario Internacionalista du Mexique. Nous avons déjà présenté ce groupe dans les numéros 50, 52 et 53 de notre revue. Cet article sur la situation au Mexique exprime la position du GPI. Cette prise de position est parue dans la publication du groupe Revolucion Mundial n°4 avant les élections présidentielles mexicaines de juillet dernier.
Par sa publication, outre l'expression de notre accord avec le contenu politique, nous voulons aussi porter à la connaissance du plus grand nombre la réalité du désastre économique que vit le capitalisme au Mexique ainsi que sur les 3/4 de la planète. Nous voulons aussi dénoncer les conditions d'existence dramatiques de milliards d'êtres humains aujourd'hui. Le texte de nos camarades du GPI montre que la barbarie capitaliste n'est pas une fatalité et que la classe ouvrière - même si elle ne peut avoir la même force locale que dans les grandes concentrations industrielles d'Amérique du Nord et d'Europe - lutte contre la misère et s'affirme comme la seule force sociale capable d'offrir une perspective autre que la barbarie à l'ensemble des couches populaires sans travail et miséreuses de ces pays. Oui, le prolétariat au Mexique, tout comme dans le reste de l'Amérique Latine, se bat et se trouve amené à développer les mêmes armes que ses frères de classe des autres continents contre les mêmes difficultés et les mêmes obstacles que sont en tout premier lieu les partis de gauche, les syndicats et la répression étatique.
La réalité de la combativité ouvrière au Mexique se trouve confirmée par le déroulement même des dernières élections présidentielles qui ont vu pour la première fois depuis plus de 60 ans le candidat du PRI - le parti au pouvoir - n'obtenir que 50% des votes dans la confusion la plus totale et de toute évidence grâce à la fraude. Cuauhtemoc Cardenas, son concurrent et lui-même issu du... PRI, était soutenu par une coalition de partis de gauche - dont le PC et les trotskystes. C'est sur les thèmes mystificateurs de la démocratie contre la corruption et la fraude électorale, et du nationalisme contre le remboursement de la dette mexicaine, contre la ''dictature du FMI" et l'impérialisme US que la bourgeoisie a tenté - et semble-t-il réussi - de constituer une force politique de gauche autour de Cardenas afin de dévoyer la colère et le désespoir croissants sur le terrain inoffensif et sans danger de la "démocratie". Et cette adaptation nouvelle des forces politiques de la bourgeoisie au Mexique s'accompagne du développement du "syndicalisme indépendant", indépendant du syndicat unique la CTM, version mexicaine du syndicalisme de base.
Bref, sous les conseils éclairés des USA, la bourgeoisie mexicaine met en place des forces politiques et syndicales de gauche dans l'opposition afin de dévoyer les inévitables luttes ouvrières à venir avec en particulier la mystification démocratique déjà employée dans la plupart des pays latino-américains tel le Chili aujourd'hui.
Dans l’abîme de la crise chronique
Durant ces dernières années, nous constatons une aggravation constante de la crise au Mexique. De fait, cette situation ne peut être comprise dans sa totalité qu'en prenant en compte le fait que le pays fait partie intégrante du système capitaliste mondial et que, de ce fait, il se trouve immergé dans la crise chronique mondiale qui s'étend et s'aggrave inexorablement depuis la fin des années 60, sous la forme de "récessions" (croissance industrielle et commerciale en voie de paralysie) toujours plus dures et profondes suivies de "reprises" toujours plus courtes et factices.
Ainsi, alors que la dernière "récession" de 1980-82 frappa littéralement le monde entier, la "reprise" qui s'en suivit de 1983 à 86 ne concerna que les grandes puissances, et la majorité des pays restèrent plongés dans la stagnation. Aujourd'hui, le monde entier reprend le chemin d'une nouvelle "récession" dont les effets seront certainement encore plus désastreux que ceux de la précédente.
Dans le cas du Mexique, nous assistons depuis 1982 à l'effondrement de l'industrie. Depuis cinq ans, le pourcentage de croissance du PIB reste en dessous de zéro... Tous les secteurs industriels sont stagnants ou en recul... ce qui entraîne une aggravation de la situation des travailleurs. En 1987, "la croissance industrielle continue à être totalement arrêtée" ([1] [246]).
Nous n'allons mettre ici en évidence que trois signes extérieurs, visibles, de l'approfondissement de la crise en 1987 :
1) Le maigre accroissement du PIB (1,4 %) est loin de rééquilibrer la chute de l'année précédente (- 3,8 %). Ceci indique clairement que la production continue à stagner, à cause de l'absence de motifs pour investir due à la surproduction mondiale et à la chute des cours de toutes les matières premières dont le Mexique est producteur (pétrole, minéraux, produits agricoles).
2) Une inflation qui tourne annuellement autour de 159 %. Comme le marché interne reste épuisé, le gouvernement tente de le ranimer par une augmentation de ses dépenses. Il accélère pour cela la fabrication de billets de banque (papier-monnaie) avec lesquels il paye ses employés, vacataires, etc., ce qui permet à ces derniers de continuer à consommer, faire des crédits, etc.
Cependant, la fabrication incontrôlée de papier-monnaie a sur celui-ci les mêmes effets qu'aurait, par exemple, la production d'une marchandise quelconque à moindre coût : sa valeur baisserait. Et plus il y a du papier-monnaie sans valeur mis en circulation, plus il est déprécié par rapport à l'ensemble des marchandises, ce qui revient à dire que les marchandises coûtent plus cher.
S'il est vrai que toutes les marchandises coûtent plus cher, elles n'augmentent pas dans les mêmes proportions ; le prix de la force de travail (les salaires), en particulier, reste très en arrière par rapport au prix des autres marchandises, mécanisme si bien connu par tous les ouvriers et qui est utilisé par la classe capitaliste pour s'approprier de meilleurs bénéfices par le biais de la chute des salaires.
Le problème, pour le capital, réside dans le fait que chaque hausse des prix provoque une accélération de l'émission de billets... et ainsi de suite, provoquant une "spirale inflationniste " dans laquelle la quantité de monnaie va croissant au même rythme accéléré qu'elle se déprécie, jusqu'à parvenir à une situation où les prix augmentent si rapidement -au jour le jour et même d'heure en heure (la dite "superinflation")- que la monnaie perd toute utilité, puisqu'elle ne sert plus ni à mesurer la valeur des marchandises, ni aux échanges, ni à faire des économies, ni à rien.
Ainsi, le mécanisme utilisé dans un premier temps pour réanimer la circulation des marchandises se transforme en son contraire : un obstacle supplémentaire pour cette même circulation, ce qui approfondit la stagnation.
L'inflation est un exemple clair de la façon dont les mesures de politique économique appliquées actuellement par les Etats nationaux parviennent momentanément à contenir la crise, mais non à en finir avec elle. Et ces derniers mois, l'économie mexicaine courait tout droit vers l’hyperinflation" ([2] [247]).
3) L'accroissement démesuré des valeurs boursières mexicaines en quelques mois et leur effondrement fin octobre 1987, en même temps que s’effondrait toutes les valeurs boursières du monde. La chute de la bourse au Mexique et la simultanéité avec la chute des autres bourses dans le monde n'est pas une simple coïncidence : elle a obéi aux mêmes causes profondes, elle a mis en évidence l'interpénétration totale de l'économie mondiale.
Les principales bourses du monde (New York, Europe et Japon) ne cessaient de croître ces deux dernières années, de façon totalement disproportionnée par rapport à la croissance industrielle. Les capitaux fuyaient les investissements productifs pour se placer dans des opérations financières spéculatives, signe que la "reprise" commencée en 1983 touchait à sa fin. Les principaux centres financiers étant en voie d'être saturés, les moins importants aussi voyaient affluer des capitaux. Ainsi, durant l'année 1987, beaucoup de capitaux "retournèrent" au Mexique, non pour être investis dans l'industrie, mais fondamentalement pour être placés sur le marché boursier, dans l'émission de valeurs papier (actions), s'appropriant l'argent d'autres investisseurs, qui achetaient des actions attirés par la promesse de juteux bénéfices (promesses qui allaient jusqu'à plafonner à 1000 %). Ainsi, par le pur jeu de l'offre et de la demande, jeu animé par la presse et le gouvernement, la bourse mexicaine gonfla en quelques mois de 600 % ... pour s'effondrer avec toutes les autres bourses du monde, quand il s'avéra que ni la production mondiale ni la production nationale n'avaient subi de croissance suffisante et que les bénéfices n'étaient pas réels; la bourse au Mexique alla jusqu'à perdre 80 % de la valeur qu'elle était parvenu à manipuler. Les seuls qui ont pu tirer des bénéfices sont ceux qui connaissent et manipulent l'information et qui ont pu en conséquence se défaire rapidement des actions et garder l'argent liquide, cependant que les autres se ruinaient. ([3] [248])
Ainsi donc, dans les conditions présentes de surproduction et de saturation des marchés, la production industrielle est bloquée cependant que les capitaux s'orientent vers la recherche de bénéfices spéculatifs.
C'est dans cette situation que le gouvernement mexicain décide en décembre 1987 d'adopter un nouveau programme économique, baptisé "Pacte de solidarité économique".
L'Etat reconnaît l'échec des plans antérieurs pour contenir la crise (ce qui confirme que les déclarations officielles optimistes étaient mensongères), que la crise persiste et s'aggrave, et la nécessité d'opérer un autre recul de la façon la plus ordonnée possible, en "distribuant" (dans la mesure où l'Etat peut le faire) les pertes entre les différents secteurs capitalistes mais, fondamentalement, en augmentant encore plus l'exploitation de la classe ouvrière.
Pour lancer ce programme, l'Etat a développé une énorme campagne idéologique, en utilisant tous les moyens de diffusion existant, afin de convaincre les travailleurs qu'ils doivent l'accepter, que le "pacte" servirait de base pour trouver une solution aux "problèmes nationaux", qu'il doit exister une "solidarité" entre tous les "secteurs" sociaux, en d'autres termes, qu'ils doivent se sacrifier encore davantage pour sauver les bénéfices des capitalistes.
Par sa forme, le "pacte de solidarité" est un programme anti-inflationniste, semblable dans une certaine mesure à ceux qui sont appliqués dans d'autres pays comme l'Argentine, le Brésil ou Israël. En partant d'une hausse générale des prix des marchandises, subite et inattendue, jointe au blocage des salaires et à une diminution drastique des dépenses de l'Etat (5,8 %), il s'agit de tenter de contenir peu à peu l'inflation. Ce qui ne signifie rien d'autre qu'une nouvelle et terrible contraction du commerce interne, bien que "régulée" par l'Etat, et davantage de fermetures d'entreprises, en commençant par les entreprises étatisées (fermetures qui à leur tour se répercutent sur le terrain du privé).
De fait, durant ces cinq dernières années, il y a eu une constante liquidation des entreprises semi nationalisées, et elles ont été vendues à des prix d'enchères. Ce processus, nommé par le gouvernement "désincorporation", a atteint quelques 600 entreprises, dont certaines, importantes comme Fundidora Monterrey, ont entraîné dans la liquidation tout un ensemble de filiales et de fournisseurs. Le "pacte" ne fait qu'accélérer ce processus : rien que pendant les trois premiers mois du "pacte", le gouvernement a autorisé la disparition de quelques 40 entreprises (le cas le plus significatif étant celui de Aeroméxico qui employait plus de 10000 travailleurs) et la vente de 40 autres (parmi lesquelles se trouve la mine de cuivre Canaena, la plus importante du pays).
Tel est le sens de l'approfondissement de la crise : l'accélération du processus de destruction-dévalorisation du capital, par la destruction matérielle des moyens de production ou leur dévalorisation, et par la baisse des salaires
Avec le "pacte de solidarité", donc, les conditions de vie de la classe ouvrière ne font qu'empirer. L'épuisement physique au travail, le chômage et la misère s'approfondissent. L'exploitation capitaliste devient toujours plus insupportable.
LA SITUATION DE LA CLASSE OUVRIERE DANS LE PAYS
Comme dans le reste du monde, la situation du prolétariat au Mexique continue d'empirer. Les chiffres donnés par la bourgeoisie ne constituent qu'un reflet bien pâle de cette réalité.
L'effondrement de la base productive trouve son complément dans le chômage massif. On calcule ([4] [249]) qu'au Mexique, plus de 4 millions de travailleurs ont été licenciés ces cinq dernières années, ce qui, joint à la population jeune qui cherche du travail sans en trouver, amène à 6 millions le nombre de chômeurs.. Un dramatique exemple est donné par le groupe DINA, qui employa jusqu'à 27 000 ouvriers, pour ne plus en employer que 10 000 en 1982 et à peine 5 000 en 87; le pacte va réduire davantage cette quantité, d'autant plus du fait de la décision de vendre sept filiales du groupe (opération qui sera accompagnée des mesures de "restructuration" adéquates, ce qui implique pour les ouvriers des licenciements supplémentaires).
Le lancement du "pacte de solidarité" a entraîné, de façon immédiate, 30 000 postes de travail en moins (17 000 dans les industries semi-étatisées et 13 000 dans le secteur central) ([5] [250]), et les licenciements continuent.
Au chômage il faut ajouter la chute du salaire réel de la classe ouvrière. On peut se faire une idée de cette chute en regardant l'évolution de la "distribution des recettes", le pourcentage des salaires dans le PIB par rapport à la quantité du gouvernement et du patronat. En 1977, la part des salaires dans le PIB était de 40 % ; en 1986, elle était de 36 % et en 1987 elle est arrivée juste à 26 %.
Tous reconnaissent la chute libre du salaire minimum (officiellement, le pouvoir d'achat de ce SMIG n'aurait diminué que de 6 % en 1987). Il faudrait ajouter qu'il existe dans ce pays un nombre incalculable de salariés qui gagnent encore moins que ce salaire minimum ; exemple : les travailleurs de la municipalité de Tampico (ville-port de la côte atlantique de 230 000 habitants - ndlr) ont fait grève pour... exiger le salaire minimum ! Il y a, en plus, une tendance à ce que les salaires des travailleurs des plus hautes catégories (aussi bien des ouvriers gue d'autres sortes de travailleurs) aillent vers le bas : en 1976, par exemple, un professeur d'université arrivait à gagner l'équivalent de 4 SMIG et un travailleur de l'université 1 et demi ; aujourd'hui, celui-là ne perçoit que 2,8 fois le SMIG et celui-ci 1,2 fois ([6] [251]).
D'autres exemples : les salaires dans les maquiladoras ([7] [252]) de la frontière nord du pays sont tombés au point d'être les salaires d'usine de montage les plus bas du monde ; les retraités y touchent une pension de moins de la moitié du salaire minimum...
Les chercheurs sont obligés de reconnaître les conséquences de la réduction des salaires sur les conditions de vie des travailleurs. Ainsi, par exemple, "dans les années 81-85, les familles avec bas revenus (40 % de la population nationale) ont souffert une chute très sévère de leurs niveaux alimentaires de sorte qu'elles se trouvent au dessous des niveaux recommandés par la FAO" ([8] [253]). On reconnaît aussi que 100 000 petits enfants meurent chaque année dans ce pays pour des raisons dues à la misère (dénutrition, parasitoses...).
Le "pacte" signifia un nouveau et brutal laminage des salaires et ceci sous deux aspects : d'un côté, les coupes dans les dépenses gouvernementales entraînent des coupes dans le salaire social : éducation, santé et autres services ; d'un autre coté, le mécanisme de base pour le contrôle de l'inflation repose, comme nous le disions plus haut, sur le ralentissement des hausses salariales par rapport à la montée des prix, autrement dit, sur la chute du pouvoir d'achat des salaires.
Au chômage massif et à la chute des salaires, il faudrait ajouter les conditions de travail que le capital impose : rupture complète des conventions collectives, partout, avec le remplacement des postes fixes par des temporaires (avec perte de toute sorte d'avantages, tels que les vacances etc.), augmentation des cadences de travail, des mesures que le "pacte" ne fait qu'accélérer. Un exemple récent est celui de Nissan, où les patrons voulaient en finir avec le temps de tolérance (10 minutes à l'entrée et 10 à la sortie du travail), ce qui reviendrait à produire 12 automobiles de plus par jour.
Enfin, conséquence directe de l'économie de capital (ce qui implique économie en mesures de sécurité) et de l'augmentation des cadences, il y a augmentation des "accidents" de travail, ce qui est même reconnu officiellement. Un cas récent est P"accident" survenu le 25 janvier dernier dans la mine Cuatro y Medio de Cohauila, où 49 travailleurs ont perdu la vie ; les autorités ont eu beau vouloir occulter les causes de l'effondrement qui enterra les mineurs , les faits sont là : l'effondrement a eu lieu à cause de l'explosion d'un transformateur électrique, qui fit exploser à son tour une haute concentration de grisou, ce qui mit en évidence aussi bien le manque d'entretien approprié dans les installations que le manque d'une équipe pour détecter et extraire le gaz. Les autres mineurs furent ensuite obligés de revenir au travail dans les mêmes conditions.
Voilà. Toute la situation au Mexique met en relief les mêmes traits du capitalisme mondial. Une crise chronique, qui n'est pour le prolétariat qu'encore plus d'exploitation, encore plus de misère, et, même, sa destruction physique. Une barbarie sociale croissante, une barbarie sans fin. Aucune "restructuration", aucun "programme" ne fera sortir le capitalisme d'une telle situation.
Pour la classe capitaliste mondiale (y incluse sa fraction mexicaine), la seule "solution" à la crise serait une nouvelle guerre mondiale en tant que moyen de destruction à une échelle mille fois plus grande des moyens de production, seule base qui, d'une façon hypothétique, pourrait donner passage à des nouvelles forces productives et à une nouvelle répartition du marché mondial entre les vainqueurs ([9] [254]).
Mais la crise capitaliste actuelle, avec l'aggravation des conditions de vie et de travail qu'elle entraîne, fait bouger les têtes des millions de prolétaires. Elle réveille leur volonté de lutter contre l'exploitation capitaliste, volonté qui est restée écrasée sous le poids de plus de 50 années de contre-révolution triomphante, mais qui resurgit au niveau international, depuis la fin des années 60 avec des grèves massives.
Le prolétariat mexicain a lui aussi fait montre de ce réveil prolétarien.
LA LUTTE DE CLASSE AU MEXIQUE
A l'échelle mondiale, il n'y a qu'une seule classe ouvrière. Sa condition de classe productrice des richesses matérielles, et, à la fois, exploitée, l'unit face aux mêmes intérêts et objectifs historiques : l'abolition du travail salarié. La crise chronique qui traverse toute la planète rend encore plus évident le fait que les conditions de l'exploitation capitaliste sont fondamentalement les mêmes dans tous les pays du monde, qu'ils s'appellent "développés", "sous-développés" ou "socialistes", et rend encore plus évident le caractère unique, international de la classe ouvrière.
Dans ce sens, la lutte du prolétariat "au Mexique" est une petite partie d'une lutte unique et mondiale du prolétariat, même si, pour le moment, cette unité n'est déterminée qu'"objectivement", à cause de l'exacerbation de l'exploitation qui pousse les ouvriers de partout à résister, et qu'elle exige encore l'unité "subjective", c'est-à-dire, consciente et organisée par la classe ouvrière au niveau international, pour pouvoir mener à terme ses objectifs révolutionnaires.
Dans le numéro précédent de Revolucion Mundial, nous reconnaissions l'existence d'une réponse ouvrière dans ce pays face aux attaques économiques du capital, réponse qui, malgré sa faiblesse, ses limites et les obstacles que le capital met devant elle, s'inscrivait dans l'ensemble des luttes qui parcourt le monde depuis 1983.
Cette réponse a eu comme axe la grève des 36 000 électriciens du début 87, grève qui, malgré le fait d'être restée sous contrôle syndical, réussit à attirer dans une manifestation des centaines de milliers de travailleurs d'autres secteurs, au même moment où d'autres fractions de la classe ouvrière luttaient dans d'autres parties du monde.
Récemment, dans ces trois premiers mois de 1988, nous avons assisté au Mexique à un nouvel élan de la classe ouvrière, à des grèves en série qui, même si elles ont été relativement petites, même si elles n'ont pas eu l'amplitude des grèves qui ont récemment eu lieu dans d'autres pays, n'en expriment pas moins les mêmes tendances générales, les mêmes difficultés et elles affrontent les mêmes attaques de l'Etat.
Presque simultanément, à cause de la période de révision des contrats, des grèves ont éclaté dans tout le pays, aussi bien dans le "secteur public" que dans le "privé" : dans les usines d'automobiles Ford à Chihuahua, chez General Motors à Mexico, chez Volkswagen à Puebla et peu après chez Nissan dans le Morelos ; dans d'autres industries, telles que Quimica y Derivados et Celanese dans le Jalisco ; chez Central de Malta et les transports à Puebla ; Produc-tos Pesqueros à Oaxaca ; Aceitera B y G à San Luis Potosi ; les dockers du port de Veracruz ; chez les carrossiers CASA à Mexico. Une grève éclata aussi dans 25 compagnies d'assurances et dans 10 universités du pays. Les travailleurs du ministère de l'Agriculture ont fait des arrêts de travail dans le Tamaulipas et le Sinaloa ; ceux du Métro de Mexico firent une marche de protestation. Et les travailleurs de la Sécurité Sociale ont réalisé des arrêts de travail et des mobilisations dans Mexico et aussi dans d'autres villes de province. Toutes ces grèves et ces mobilisations exprimaient la revendication centrale d'augmentation des salaires et de rejet des licenciements massifs que le capital avait planifiés.
Mais toutes ces grèves sont restées isolées les unes des autres, sous le contrôle d'airain des syndicats, aussi bien "officiels" (Congrès du Travail) qu'"indépendants" (Bureau de Concertation) ; à une exception près : le mouvement dans la Sécurité Sociale (IMSS) dont nous parlerons plus bas.
Le contrôle syndical s'est exprimé, par exemple, dans les accords qu'ils prenaient et qu'ils faisaient apparaître comme de la "solidarité ouvrière", mais qui n'avaient d'autre but que de soumettre les luttes : l'accord, par exemple, des cinq syndicats de l'industrie automobile, de décompter 1 000 pesos par semaine et par travailleur restant au travail pour "soutenir" ceux qui étaient en grève ; ils annulèrent ainsi toute possibilité de véritable solidarité (laquelle ne peut être que l'extension de la grève à d'autres usines de n'importe quel secteur), faisant croire à un "soutien" qui n'était en fait que passivité et isolement. Un autre exemple similaire est le nouveau genre que se donne le SUNTU (une espèce de fédération de syndicats de l'Université), dont le travail consiste principalement à maintenir dans un cadre de négociation séparée chaque université en grève.
Les syndicats sont toujours le premier obstacle que les ouvriers trouvent dans le développement de leurs luttes. Le syndicat est le principal moyen dont dispose le capital pour empêcher que les luttes dépassent le cadre de la protestation isolée et ne prennent le chemin de leur coordination et unification, laissant de côté les divisions par secteur ou régionales (ce gui est aujourd'hui possible du fait de la simultanéité même des luttes).
C'est là l'importance de la lutte des travailleurs de la Sécurité Sociale, eux dont les efforts pour se libérer du joug syndical ont été un exemple pour d'autres secteurs qui se posaient, à ce moment-là, la question d'entrer en lutte. Depuis déjà 1986, différentes catégories de l'IMSS ont réalisé des mobilisations dans différentes régions du pays ; maintenant ces catégories se sont mobilisées ensemble : les infirmières, les médecins, les travailleurs de l'intendance, etc.
La raison immédiate de cette nouvelle lutte fut le sabotage de la part de la direction et des syndicats de la révision de la convention collective, exigeant des travailleurs qu'ils se contentent de l’"augmentation" octroyée par le "pacte de solidarité".
Les travailleurs, en riposte, commencèrent à faire des arrêts de travail spontanés dans tous les services de la capitale mexicaine et dans d'autres villes de province, des arrêts de travail en dehors et contre le syndicat officiel ; les délégués syndicaux furent explicitement identifiés comme faisant partie des autorités du pouvoir. Le sommet de la lutte fut la manifestation combative du 29 janvier avec 50 000 travailleurs dans la rue et qui attira la solidarité des travailleurs d'autres services du secteur de la santé et des "colons" (habitants des quartiers marginaux). Les travailleurs firent aussi des efforts pour se doter d'un organisme représentatif, mais qui ne réussirent pas à se concrétiser.
La lutte fut durement attaquée par l'Etat. Les média ne faisaient que répéter que les autorités et les syndicats n'accepteraient aucune demande faite en dehors du "cadre juridique et syndical". Beaucoup de travailleurs reçurent des menaces de sanction dans leurs centres de travail ; plus d'une centaine furent mise à pied. La police aussi est venue réprimer ceux qui bloquaient les rues au moment des grèves. Mais la partie la plus importante de l'attaque contre les travailleurs fut prise en charge par la gauche du capital.
A chaque fois que les travailleurs essayent de sortir du contrôle des syndicats officiels, c'est la gauche du capital qui se met en branle pour mettre en avant une politique, tout aussi bourgeoise et néfaste pour les travailleurs, de "démocratisation" du syndicat ou de création d'un quelconque syndicat "indépendant". Cette fois-ci, cette gauche a agi sur deux versants : en essayant, d'un côté, de former un "front" qui appelait à "faire pression sur le syndicat pour que celui-ci remplisse son rôle"...comme s'il ne l'avait pas rempli, en réprimant ouvertement les travailleurs ! D'un autre côté, en minant le mouvement "de l'intérieur", en dévoyant les efforts d'auto organisation des travailleurs vers la création d'une coordination, laquelle, loin de mettre en avant les exigences de la lutte, se posa comme but celui de "gagner des postes dans le syndicat pour le démocratiser". En même temps, la gauche du capital essayait de renforcer les fortes tendances corporatistes dans ce secteur pour le tenir isolé du reste des travailleurs en grève. Et c'est ainsi que la lutte s'est épuisée sans avoir obtenu la moindre revendication.
Malgré tout, la lutte dans l'IMSS a encore une fois montré que non seulement le syndicat, en tant qu'organe du capital, peut très bien arriver à réprimer ouvertement les travailleurs, mais, et c'est le plus important, qu'il est possible de se mobiliser sans faire appel au syndicat. C'est donc un pas en avant, un exemple à suivre pour l'ensemble de la classe ouvrière, même s'il faut encore rompre avec les divisons sectorielles et régionales, rompre l'isolement des luttes.
En bref : les grèves que nous avons connues au Mexique, reflètent les mêmes tendances qu'à l'heure actuelle on a pu déceler dans des luttes ouvrières d'autres pays :
- d'abord, une tendance croissante à leur simultanéité : des séries de grèves qui éclatent un peu partout, dans différents secteurs, en même temps.
- tentatives de rompre le contrôle syndical, de s'auto- organiser dans les luttes les plus exemplaires.
- et, dans une moindre mesure, quelques manifestations de solidarité entre secteurs différents.
Les grèves affrontent l'attaque concentrée de l'Etat, dont le premier front est constitué par les syndicats. Les syndicats n'ont pas réussi à empêcher l'éclatement des grèves, mais, par contre, ils ont réussi à les maintenir isolées et dans le cadre des revendications "particulières" de chaque secteur.
Le contrôle syndical est en mesure de changer d'habit, là où les ouvriers sont décidés à s'en défaire, que ce soit en remplaçant un syndicat officiel par un autre "radical" ou "indépendant", que ce soit en présentant comme de l’ "auto organisation" ce qui n'est qu'une coquille sans le moindre contenu prolétarien et qui joue le même rôle que le syndicat : isolement et usure des luttes.
En même temps l'attaque se concrétise dans un renforcement continu des appareils répressifs, l'énorme déploiement policier contre les mobilisations, la répression directe dans certaines luttes.
A ce qui précède, il faut encore ajouter les campagnes pour maintenir la domination politique sur les travailleurs, par le jeu de la "démocratie", question qui est aujourd'hui au : Mexique, à plein rendement face au prochain changement de président. C'est ainsi que les partis d'opposition ont essayé de canaliser le mécontentement dû au "pacte de solidarité" vers les élections, en particulier avec des marches convoquées soi-disant contre le "pacte" et qui finissent en fait en demandant l'appui à tel ou tel candidat.
Enfin, l'Etat bourgeois veut apparaître aux yeux du prolétariat comme quelque chose d'inamovible et intouchable.
La dernière expression de la récente vague de grèves au Mexique a été la grève d'Aeroméxico. Plus de 10 000 travailleurs (fondamentalement ceux au sol) se sont soulevés contre le souhait de la compagnie de mettre hors service 13 avions, ce qui aurait entraîné un bon paquet de licenciements.
Etant assuré du fait que le syndicat tenait bien en main le contrôle de ces travailleurs, le gouvernement, contraire ment à ce qu'ils craignaient, n'a pas "réquisitionné" l'entreprise (ce qui aurait impliqué l'entrée de la police et des jaunes), tel qu'il le fait en général dans les entreprises para-étatiques, mais il laissa éclater la grève pour, peu de j jours après, sous prétexte des "pertes dues à la grève" déclarer la compagnie en faillite, jetant à la rue des milliers de travailleurs.
Il est évident qu'à cette occasion, l'Etat a voulu donner une "leçon", non seulement à ce secteur, mais à toute la classe ouvrière. Le message, diffusé à profusion par tous les média du capital, était on ne peut plus clair : "les travailleurs doivent se résigner...la grève ne sert à rien".
Mais, pour la classe ouvrière les leçons que ces luttes ont laissées sont bien différentes; et bien différentes sont les perspectives que nous devons en extraire.
PERSPECTIVES DE LA LUTTE OUVRIERE
Pour le moment, les grèves ont cessé dans ce pays. Mais il n'est pas nécessaire d'être sorcier pour deviner que face à l'approfondissement de la crise, les ouvriers continueront à être poussés à résister, et il ne se passera pas longtemps avant de revoir des nouvelles luttes. De fait, la tendance actuelle dans tous les pays du monde va vers la multiplication des grèves, même s'il s'agit de luttes à caractère défensif, des grèves de résistance face aux attaques économiques du capital.
Cependant, au fur et à mesure que les grèves s'étendent, en embrassant d'autres fractions de la classe ouvrière de par le monde entier, en montrant des tentatives de rupture avec les syndicats, d'auto organisation et de solidarité, les contre-attaques du capital sont aussi de plus en plus dures. Chaque nouvelle lutte devient de plus en plus difficile, elle exige une plus grande détermination, une plus grande énergie ouvrière, car elle affronte un ennemi de moins en moins disposé à ne céder à aucune revendication. Chaque fraction nationale du capital essayera d'écraser les luttes par tous les moyens à sa portée pour ne pas prendre le risque de perdre la moindre parcelle de terrain dans la concurrence sur les marchés.
Depuis longtemps déjà, les grèves de résistance isolées ne réussissent pas à arracher au capital la moindre solution aux revendications. Aujourd'hui, seule une lutte vraiment massive et combative, qui embrasse des centaines de milliers de travailleurs peut avoir l'espoir d'arrêter momentanément les attaques économiques du capital, mais même cela aussi devient de plus en plus difficile. Cela veut dire que le développement des luttes de résistance ne pourra culminer en aucune façon dans une amélioration réelle et durable pour les travailleurs, tant que le contexte de crise chronique subsiste.
Le développement des luttes, dans un sens progressif, ne peut être, par conséquent, en plus de l'extension, que l'approfondissement des objectifs, le passage des luttes isolées pour des revendications particulières à une lutte générale et organisée pour des objectifs de classe. Les efforts actuels pour la solidarité et l'auto organisation des ouvriers nous démontrent cette tendance.
Mais le fait que les luttes de résistance prennent cette voie n'est pas un produit automatique de la crise, mais cela exige un effort supplémentaire de la classe ouvrière : l'effort de récupération, d'assimilation et de transmission de l'expérience de ses luttes, historiques et récentes, de ces expériences qui lui montrent la nécessité de se hisser à partir des luttes qui ont seulement pour but de résister seulement face aux effets de l'exploitation capitaliste, jusqu'à la lutte qui a pour but d'en finir définitivement avec cette exploitation; et pour cela elle devra renverser la bourgeoisie et prendre le pouvoir politique, instaurer la dictature du prolétariat.
Cela exige, donc, que le prolétariat se hisse à la conscience de ses objectifs historiques révolutionnaires. C'est là un effort collectif, de l'ensemble de la classe, dans lequel l'organisation des révolutionnaires (et plus le Parti Mondial), en tant que partie la plus active et consciente de la classe, joue un rôle déterminant.
Le résultat du combat pour la conscience de classe sera décisif, en dernier ressort, dans l'issue des affrontements de classe à venir.
Ldo Mai 1988.
[1] [255] Voir Revolucion Mundial n° 1 et 3. Le PIB (Produit Intérieur Brut) c'est un chiffre de l'économie bourgeoise qui, d'une certaine manière, exprime la croissance d'une année sur l'autre. Il faut cependant avoir à l'esprit que, étant donné les présupposés théoriques utilisés (division de l'économie en "secteurs" industriel, agraire et financier ; "valeur ajoutée" etc.) et la manipulation que les "scientifiques" font des résultats, ce genre de chiffres présente une réalité déformée en fonction des intérêts du capital.
[2] [256] La tendance à "hyperinflation" était évidente pour quiconque sait que deux et deux font quatre :
INFLATION : Pourcentage de variation annuel
1983 1984 1985 1986 1987
% 80 60 64 106 160
[3] [257] Dans la phase suivante du jeu, les gagnants récupèrent aussi, à des prix donnés, les papiers émis, en gardant finalement aussi bien l'argent que les actions. C'est pour cela que la bourse paraît se récupérer dans une certaine mesure par la suite et les licenciements massifs d'ouvriers (qui vont de pair avec l'augmentation des cadences pour ceux qui continuent à avoir un travail). Sur cette base, le capital tente de compenser la chute des profits, en s'appropriant davantage de plus-value par rapport au capital investi, ce qui, sur le plan du marché international, signifie présenter des produits moins chers, plus compétitifs.
[4] [258] D'après les données du SIPRO (Servicios Informativos y Procesados A.C.), qui coïncident avec d'autres sources
[5] [259] Rapport officiel sur le "pacte" du Secrétariat de la Présidence, mars 88.
[6] [260] Du journal Uno mâs uno du 27-1-88
[7] [261] Les "maquiladoras" sont pour la plupart, des industries de composants électroniques et automobiles à capital étranger, dont la production est dirigée vers le marché des Etats-Unis (c'est pour cela qu'elles sont installées de préférence sur la frontière nord). Le tableau suivant montre le salaire payé dans ces "maquiladoras" par rapport à d'autres installées dans d'autres pays :
Moyenne du salaire de base/heure (1986) : Corée du Sud : 3,65 $ ; Taïwan : 2,95 $ ; Singapour : 2,30 $ ; Hong-Kong : 2,05 $ ; Jamaïque : 1,25 $ ; Costa-Rica : 1,05 $ ; R. Dominicaine : 0,95 $ ; Mexique : 0,85 $. Source : El Financière, 10/08/87
[8] [262] Le Monde Diplomatique, version espagnole, Décembre 87.
[9] [263] La bourgeoisie mexicaine participa, par exemple, à la 2ème Guerre Mondiale, pas tant avec des soldats (ce fut purement symbolique), mais avec la fourniture des matières premières. Par la suite, elle tira profit de la période de reconstruction d'après-guerre, ce qui a permis l'industrialisation accélérée du pays
Géographique:
- Mexique [42]
Récent et en cours:
- Crise économique [3]
- Luttes de classe [4]
Comprendre la décadence du capitalisme (5) : l'analyse marxiste du développement de l'histoire
- 15026 lectures
Dans cette cinquième partie (cf. Revue Internationale n° 48, 49, 50 et 54) nous revennons sur la critique ou le rejet de la notion de décadence par une série de groupes du milieu politique prolétarien (Parti Communiste Intemationaliste (Programma, bordiguiste; PCI), Groupe Communiste Internationaliste (GCI), A Contre Courant (récente scission du GCI), Communisme ou Civilisation (CoC), en partie la Fraction Externe du CCI (FECCI) etc.). Ici encore nous montrerons en quoi ces critiques cachent en réalité un abandon de la conception marxiste de l'évolution de l'histoire qui fonde la nécessité du communisme, et, par là même, affaiblissent la nécessaire dimension historique dans la prise de conscience du prolétariat, ou, pour certains comme le GCI, aboutissent à présenter la révolution comme la vieille utopie anarchiste.
L'analyse marxiste du developpement de l'histoire
"Les visions décadentistes correspondent non pas au point de vue prolétarien mais à celui bourgeois de l'évolutionnisme" (Le Communiste - LC - n° 23). Le GCI ([1] [264]) ne se limite pas à récuser l'idée même d'une décadence du mode de production capitaliste (cf. articles précédents), il généralise ce refus à toute l'histoire de l'humanité. Ce "groupe" s'écarte ainsi de l'analyse de Marx pour qui chaque mode de production connait une phase où les nouveaux rapports sociaux de production aiguillonnent le développement des forces productives et une phase où ces rapports constituent un frein à la croissance de celles-là: « A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore fontes de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale" ("Avant-Propos à la critique de l'économie politique", Ed. La Pléiade).
Pour mieux pouvoir nier toute phase de décadence, le GCI nie son corollaire : l'existence même d'une phase ascendante ! Au nom de la défense des classes exploitées le GCI enfourche la vision morale des anarchistes qui, arguant du développement de l'exploitation tout au long de l'histoire, refuse de reconnaître le rôle progressiste du développement des forces productives. "Pour nous qui partons de la vision de tout l'arc historique du communisme primitif au comnuanisnte intégral, il s'agit au contraire de voir en quoi la marche forcée du progrès et de la civilisation a signifié chaque fois plus l'exploitation, la production de surtravail, en fait la réelle afflinnation de la barbarie par la domination de plus en plus totalitaire de la valeur." (LC n° 23). A l'instar de Proudhon, le GCI ne voit dans la misère que la misère sans voir son côté révolutionnaire. Concevoir, avec Marx, la succession des "modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne comme des époques progressives de la formalion économique de la société"("Avant-Propos"), montrer le rôle progressiste des classes exploiteuses du passé reviendrait à défendre ces dernières contre les classes exploitées... Ainsi, Marx deviendrait le pire des contre-révolutionnaires lui qui, tout au long des pages du Manifeste Communiste, souligne ce rôle de la bourgeoisie dans sa phase ascendante : "La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire (...). Elle a accompli des merveilles qui sont autre chose que les pyramides égyptiennes, les aqueducs romains, les cathédrales gothiques (...) Au cours de sa domination de classe à peine séculaire, la bourgeoisie a créé des forces productives plus massives et plus colossales que ne l'avaient fait dans le passé toutes les générations dans leur ensemble" ("Le Manifeste Communiste").
Bordiga et ses epigones
Se couvrir de l'autorité de Bordiga ([2] [265]) pour masquer son involution anarchiste n'est d'aucun secours pour le GCI "La vision marxiste (du développement historique NDLR) peut se représenter en autant de branches, de courbes toutes ascendantes jusqu'à ses sommets auxquelles succède une violente chute brusque, presque verticale, et, au fond, un nouveau régime social surgit; on a une autre branche historique d'ascension." (Bordiga, Procès verbal de la réunion de Rome 1951, publié dans Invariance n° 4) car c'est une planche pourrie pour plusieurs raisons et nous allons le montrer dans ce point et au suivant.
Bordiga écrivit ce texte contre ceux qui, au sein du PCInt, défendaient encore les acquis de la Gauche Communiste Internationale. L'acte de naissance du courant bordiguiste (1951) correspond à la liquidation des restes des positions politiques de la Fraction Italienne de la G.C.I. de 1926 à 45 au sein du PCInt ([3] [266]). Et pour cause, toutes les analyses et positions politiques de la Fraction s'articulaient autour de la compréhension que le capitalisme était entré dans sa phase de décadence depuis 1914: « Aujourd'hui dans la phase extrêrne de décadence capitaliste, il n'y a plus de territoire à conquérir pour le mode bourgeois de production, car celui-ci est arrivé au point ultime de sa situation et les pays arriérés ne peuvent être industrialisés que par le prolétariat luttant pour la société communiste (..) L'accumulation progressive de plus-value capitalisée porte ce contraste (entre le travail payé et le travail spolié) à son terme extrême lorsque les forces productives, débordant du cadre limité de la production bourgeoise, heurtent les limites historiques du champ d'écoulement et de réalisation des produits capitalistes." (Extraits du Manifeste et de la Résolution de constitution du Bureau International des Fractions de la Gauche Communiste Internationale, Octobre n° 1, février 1938) ([4] [267]).
Quant aux autres références du GCI elles parlent d'elles mêmes : "La Gauche Internationaliste", un groupe moderniste issu de la décomposition du maoïsme et aujourd'hui disparu, et "Socialisme ou Barbarie" un groupe qui n'a pu véritablement rompre d'avec le trotskysme et qui, tout au long de son existence, a combattu les continuateurs de la Fraction Italienne : la Gauche Communiste de France ([5] [268]).
Critique de la conception bordiguiste de l'evolution historique
Bordiga s'écarte sur trois plans de la conception marxiste. C'est ce que nous allons développer à l'aide d'exemples puisés dans la réalité historique elle-même. Cette dernière constitue un violent démenti à la vision développée par Bordiga, mais confirme par contre, pleinement, toutes les thèses de Marx.
La nécessité d'une période de transition
Aucune société dans le passé n'a disparu à la suite d'une "violente chute brusque". La courbe d'évolution de la population mondiale que nous reproduisons ci-dessous est une magistrale confirmation d'une part, de la succession des modes de production (primitif, asiatique, antique, féodal et capitaliste), d'autre part, du mouvement lent d'ascendance et de décadence de chaque mode de production et, enfin, de la longue transition entre eux. Nous sommes loin "des branches de courbes toutes ascendantes jusqu'à leur sommet auxquelles succède une violente chute brusque" de Bordiga ([6] [269]).
GRAPHIQUE N°1
SOURCE : « Essai sur l'évolution du nombre des hommes », J.N. Biraben, Population, n° 1, 1979. Ce graphique est la plus cohérente et récente reconstitution de l'évolution de la population mondiale. Nous avons, nous même, subdivisé cette courbe pour y distinguer clairement les différentes phases de chaque mode de production. L'évolution démographique des sociétés passées était, du fait du faible développement de leurs forces productives, étroitement liée aux fluctuations de la production agricole qui constituait l'activité productrice essentielle de celles-ci. Le mouvement de la population est donc un bon indicateur des grandes tendances économiques, des fluctuations dans le développement des forces productives. Pour les sociétés qui précèdent le féodalisme nous constatons ce lien direct entre la production agricole et le mouvement de la population. Dans la décadence féodale, par contre, la courbe de population, après une chute, continue de croître. Ceci est le résultat de la montée du capitalisme (l6ème siècle), qui, par l'accroissement de la productivité du travail qu'il induit, rompt ce lien. En fait, si l'on isole la production strictement féodale, celle-ci stagne globalement du 14ème au 18ème siècle.
Les récentes reconstitutions d'histoire économique nous fournissent de précieuses indications qui confirment cette évolution globale :
FEODALISME. Après une transition qui dure 7 siècles (de 300 à l'an 1000), pendant laquelle la nouvelle classe féodale et les nouveaux rapports sociaux de production du servage prennent place, se développe la phase ascendante de l'an 1000 au 14ème siècle. "...Vers la fin du ler millénaire les forces de production ne différaient que fort peu de celles de l'Antiquité (..). Du l0ème au 13ème siècle c'est la révolution agricole qui nourrit le développement de toutes les branches de la société (...) un nouveau système agraire dont la capacité de production est doublée par rapport à celle de l'ancien (..). C'est pourquoi, en relation avec la croissance démographique, la production céréalière augmenta jusqu'au 14ème siècle (...)". A cette date, la féodalité entre en décadence jusqu'au 18ème siècle. "Inversement il y a arrêt de la croissance agricole et démographique à la fin du 13ème siècle (...). On conjecture donc que l'agriculture médiévale avait atteint dès la fin du 13ème siècle un niveau technique moyen équivalent à celui du début du 18ème siècle." (citations tirées de : Agnès Geshard, "La Société Médiévale", 1985, Ed. M.A. et Antonetti Guy, "L'économie féodale", Que sais-je?). Au sein de cette décadence commence la transition au capitalisme à partir du l6ème siècle
ANTIQUITE. Le cas de l'Antiquité est trop connu pour devoir s'y étendre; tout le monde a au moins une fois dans sa vie entendu parler de la décadence de Rome ! Les besoins croissants de l'empire, la pression démographique, la gestion d'un territoire de plus en plus grand imposait à Rome d'aller au-delà des limites permises par ses rapports de production. L'appropriation privée du sol et la faible productivité de l'esclavagisme obligeaient Rome à piller du blé pour se nourrir et à importer des esclaves pour travailler la terre. A un certain stade de son expansion, Rome n'est plus à même de s'alimenter : les conquêtes sont de plus en plus lointaines et difficiles à assurer et l'esclave se fait cher (son prix est multiplié par 10 entre l'an 50 et 150 après J.C.). Dépasser la faible productivité de l'esclavagisme nécessitait d'autres rapports de production plus productifs. Mais ceci passe nécessairement par une révolution sociale, par la perte de pouvoir de l'ancienne classe dominante liée à ces rapports de production. C'est pourquoi, s'additionnant aux blocages économiques, la classe au pouvoir bloque le développement des forces productives afin de préserver sa domination politique. En l'absence d'innovations technologiques (c'est-à-dire d'accroissement de la productivité du travail) l'agriculture subit la loi des rendements décroissants, la famine se développe, la natalité baisse, la population décroît, c'est la décadence romaine. Nous publions ci-dessous un graphique intéressant dans la mesure où il illustre clairement l'action de frein exercée par les rapports de production sur le développement des forces productives : nous y constatons l'antécédence du déclin des découvertes scientifiques sur la chute de la population.
GRAPHIQUE N°2
SOURCE : “The effects of population on nutrition and economic wellbeing", Julian L. Simon, in Hunger and History, Ed. Cambridge University Press.
Ce graphique montre, d'une part, l'évolution de la population (en millions d'habitants, 2ème échelle de gauche), d'autre part, le taux de croissance de cette dernière (en %, lère échelle de gauche) et, enfin, le nombre de découvertes scientifiques (échelle de droite).
SOCIETE DE TYPE ASIATIQUE. Un phénomène analogue se développe au sein des sociétés vivant sous la domination des rapports de production de type asiatique ([7] [270]). Ces dernières disparaissent pour la plupart d'entre elles entre 1000 et 500 avant J.C. (cf. courbe de la population). La décadence de ces sociétés se manifeste par d'incessantes guerres entre sociétés royales cherchant par le pillage de richesses une solution aux blocages productifs internes, des révoltes paysannes incessantes, un développement, gigantesque des dépenses étatiques improductives. Les blocages politiques et rivalités intestines au sein de la caste dominante épuisent les ressources de la société dans des conflits sans fin et les limites d'expansion géographique des empires attestent que le maximum du développement, compatible avec les rapports de production, a été atteint.
SOCIETES PRIMITIVES. De même, les sociétés de classes n'ont pu naître que de la décadence des sociétés primitives, comme le disait Marx : "L'histoire de la décadence des sociétés primitives (...) est encore à faire. Jusqu'ici on n'a fourni que de maigres ébauches (..). Deuxièmement, les causes de leur décadence dérivent de données économiques qui les empêchaient de dépasser un certain degré de développement (...). En lisant les histoires de communautés primitives, écrites par des bourgeois, il faut être sur ses gardes." (Lettre à Vera Zassoulitch dans "L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat", Ed. Sociales). "Durant la période paléolithique qui a précédé le néolithique, la croissance de la population a été très lente (0,01 à 0,03 % par an), mais cela a quand même permis à la population mondiale d'atteindre quelque 9 à 15 millions de personnes (vers -8000). Chiffres certes très faibles, mais qui, dans le contexte d'une économie de chasse et de cueillette, a atteint un niveau qui ne permettait plus la poursuite de la croissance de la population SANS UNE MODIFICATION RADICALE DE L'ECONOMIE. (...) D'après les estimations de Hassan (1981), la capacité optimum de la population du monde dans le contexte d'une société basée sur la chasse et la cueillette serait de l'ordre de 8,6 millions de personnes." (P.Bairoch, "De Jéricho à Mexico", Gallimard-Arcades, 1985).
Condition de l'émergence d'une nouvelle classe révolutionnaire et de nouveaux rapports sociaux
Décréter l'inexistence d'une phase de décadence pour toute société comme le fait Bordiga, c'est rendre impossible tout passage à un nouveau mode de production. La nécessité de celui-ci est un douloureux enfantement qui ne peut émerger que face aux blocages de l'ancien mode de production. Pourquoi tout à coup les hommes s'ingénieraient-ils à produire autrement si le système dans lequel ils vivent est toujours ascendant et productif ? Pourquoi, sous quelles nécessités - restons matérialistes tout de même ! -, une partie de la société développerait de nouveaux rapports de production plus productifs si les anciens sont toujours pcrformants ? "... jamais des rapports de production ne se mettent en place avant que les conditions matérielles ne se soient écloses dans le sein même de la vieille société." (Marx, Avant-Propos).
Le pouvoir de la classe dominante et l'attachement de celle ci à ses privilèges sont de puissants facteurs de conservation d'une forme sociale. Or ce pouvoir est à son maximum au moment de l'apogée d'un mode de production et, seule une longue décadence est à même de l'éroder et de remettre en cause la légitimité de cette domination. L'épuisement historique du rôle d'une classe sociale n'apparaît pas du jour au lendemain dans la conscience sociale, et quand bien même apparaîtrait-elle, que cette dernière, à l'image d'un gentleman anglais, ne laisserait pas le libre passage à une nouvelle classe dominante. C'est par les armes et la répression qu'elle défendra son pouvoir jusqu'au bout. Il aura fallu des dizaines d'années de famines, d'épidémies, de guerres et d'anarchie avant que l'ancien mode de production soit abandonné: 7 siècles pour l'esclavagisme, 4 siècles pour le féodalisme ! Un ensemble de rapports sociaux ayant lié entre eux des hommes pendant des siècles n'est pas dépassé du jour au lendemain. Seuls de tels événements parviennent à venir à bout de siècles de coutumes, d'idées et de traditions. La conscience collective retarde toujours sur la réalité objective qu'elle vit.
Un nouveau mode de production ne peut s'instaurer que s'il existe une classe porteuse de nouveaux rapports sociaux de production plus productifs, or seule une décadence crée les conditions de son développement. De plus, et conjointement, le développement du mécontentement de la classe exploitée doit également mûrir pendant une longue période. Ce sont des dizaines d'années de famines et d'humiliation qui pousseront les exploités à se révolter aux côtés de la nouvelle classe dominante contre l'ancienne.
Le développement de nouveaux rapports sociaux de production plus productifs est un long processus, d'une part, parce que les hommes n'abandonnent pas un outil avant d'avoir fait la preuve de son inutilité et, d'autre part, parce qu'ils naissent en milieu hostile, subissant la gangue et la répression de l'ancien mode de production.
Les castes des sociétés du mode de production asiatique n'ont pu se développer que dans la déstructuration des rapports sociaux de production "égalitaires" du communisme primitif.
La classe des propriétaires fonciers esclavagistes naît dans la décadence du mode de production asiatique. Concrètement, à Rome, du combat entre la nouvelle force constituée par les propriétaires terriens qui s'approprient le sol de façon privée et la caste princière de la société royale étrusque qui vit encore à partir du tribut extorqué à un ensemble de collectivités villageoises produisant sous des rapports communautaires hérités des sociétés post-néolithiques.
La féodalité naît au sein de la décadence de Rome. C'est à la périphérie de l'empire que commencent à s'instaurer de nouveaux rapports sociaux de production : le servage. Les anciens maîtres romains affranchissent leurs esclaves, ces derniers peuvent alors cultiver un lopin de terre et posséder leurs moyens de production en contrepartie d'une fraction de leur récolte.
La bourgeoisie naît au sein de la décadence féodale, écoutons Marx : "...les moyens de production et d'échange qui servirent de base à la formation de la bourgeoisie furent créés dans la société féodale (nous sommes aux antipodes de la chute brusque, verticale, au fond de laquelle un nouveau régime social surgit de Bordiga, NDLR). "La société bourgeoise moderne est issue des ruines de la société féodale (...) Ils (le commerce mondial, les marchés coloniaux) hâtèrent le développement de l'élément révolutionnaire au sein d'une société féodale en décomposition. L'ancien mode de production, féodal ou corporatif, ne suffisait plus aux besoins qui augmentaient en même temps que les nouveaux marchés (...) A un certain stade du développement de ces moyens de production et d'échange, les conditions dans lesquelles la société féodale produisait et commerçait, l'organisation féodale de l'agriculture et de la manufacture, en un mot, les rapports féodaux de propriété, cessèrent de correspondre aux forces productives en pleine croissance. Ils entravaient la production au lieu de la faire avancer. Ils se transformèrent en autant de chaînes. Ces chaînes, il fallait les briser: elles furent brisées." ("Le Manifeste Communiste"). "... L'ère capitaliste ne date que du 16ème siècle. Partout où elle éclôt, l'abolition du servage est depuis longtemps un fait accompli, et le régime des villes souveraines, cette gloire du Moyen Age, est déjà en pleine décadence. (...) L'histoire moderne du capital date de la création du commerce et du marché des deux mondes au 16ème siècle." (Marx, "Le Capital", Ed. La Pléiade). Le régime des villes souveraines, c'est la pleine ascendance du Moyen Age (llème - 14ème siècle). Le capitalisme naît au sein de la décadence féodale (14ème - 18ème siècle) au 16ème siècle au moment des grandes découvertes.
Il aura fallu deux siècles de décadence de Rome pour que s'ébauchent de nouveaux rapports sociaux de production (le colonat, forme primitive du servage) à la périphérie de l'empire et encore 4 à 6 siècles pour qu'ils se développent et se généralisent. Il faudra attendre 2 siècles de décadence féodale avant que n'apparaissent les rapports capitalistes de production et encore 3 siècles avant qu'ils ne se généralisent. Nous sommes donc très loin également de la pétition de principe du GCI, dénuée de tout fondement théorique et historique, qui pour nier toute phase ascendante postule que dès sa naissance le capitalisme est "directement et invariablement universel (...) Ainsi le capital pose lui-même tous ses présupposés, il est lui-même auto présupposition de sa domination mondiale, dès qu'il apparaît comme mode de production il pose en bloc et mondialement son caractère universel ..." (LC n° 23). Par ce biais, le GCI élimine d'un trait de plume l'existence des marchés extra-capitalistes. Comme il postule "l'existence pleine et entière du marché mondial comme présupposition de l'apparition du mode de production capitaliste (...) l'échange entre production capitaliste et production extra-capitaliste est un non-sens, ... ".
Ainsi sont gommées de l'histoire les dizaines d'années mises par la bourgeoisie pour se développer et se dégager des rapports trop étroits du féodalisme. Sont également gommées des dizaines de pages où Marx décrit ce difficile et long procès qu'est l'accumulation primitive du capital... "La grande industrie a fait naître le marché mondial (...) en retour, ce développement a entraîné l'essor de l'industrie (où est la présupposition du marché mondial chez Marx ? ) (...) Nous voyons donc que la bourgeoisie moderne est elle-même le produit d'un long processus de développement de toute une série de révolutions survenues dans les modes de production et d'échange." ("Le Manifeste").
Comment peut-on prendre au sérieux un "groupe" qui invente et réécrit l'histoire au gré de ses humeurs?
La prise de conscience de la nécessité politique de la destruction du capitalisme ne peut venir que de la crise historique de celui-ci et non d'une simple crise de croissance ou de restructuration. C'est face à l'enjeu actuel : socialisme ou barbarie, révolution communiste ou guerre impérialiste généralisée irrémédiable pour l'humanité, que le prolétariat pourra comprendre et mesurer toute l'immensité de sa tâche. Nier la décadence c'est amoindrir la nécessité du communisme et affaiblir la dimension historique dans la prise de conscience du prolétariat. Si le capitalisme se développe "...au moins deux fois plus rapidement que dans sa phase ascendante" comme le prétend le GCI ([8] [271]), la révolution est encore moins possible aujourd'hui qu'hier; elle devient une lointaine utopie anarchiste. C'est ce que le GCI propose aujourd'hui à la classe ouvrière.
ANALYSE DE LA DECADENCE ET TROTSKYSME
Nos censeurs se plaisent à nous confondre avec le trotskysme. "Une telle conception (la décadence) pouvait à la limite s'expliquer dans l'entre-deux-guerres où effectivement la production capitaliste a stagné. C'est à cette époque qu'un Trotsky pouvait déclarer en tête du Programme de Transition que « les forces productives de l'humanité ont cessé de croître. Les nouvelles inventions et les nouveaux progrès techniques ne conduisent plus d’un accroissement de la richesse matérielle ». C'est à cette époque aussi que certains courants de gauche (la Gauche Communiste) fondent une analyse de la décadence du mode de production capitaliste sur des thèses luxemburgistes en considérant que la plus-value a cessé d'augmenter." (CoC n° 22), "Pour les décadentistes trotskystes, les forces productives ont cessé de croître, en l'occurrence à partir de 1914 pour le capitalisme (...) la conception de la décadence est étroitement liée à celle de la dégénérescence du caractère ouvrier de l'URSS chère tant aux staliniens qu'aux trotskystes" (LC n° 23).
De Marx à la troisième Internationale, la problématique de la décadence est devenue une question centrale au sein du courant marxiste. Avec la dégénérescence de la vague révolutionnaire de 1917-23 et de ses organisations politiques, débutait, pour le mouvement ouvrier, une longue nuit de plus de 50 ans, qui a fait dire à Victor Serge qu'il était "minuit dans le siècle". Depuis, les contributions sur cette question se concentrèrent dans les groupes de gauche issus du combat contre la dégénérescence de la troisième Internationale, y compris l'Opposition Internationale de Gauche animée par Trotsky jusqu'en 1939 ([9] [272]). Ces groupes ont certes balbutié sur bien des questions. Nous ne sommes pas des bordiguistes qui considérons les textes anciens comme des tables de lois intouchables. Néanmoins ces groupes, malgré certaines erreurs, ont eu le mérite de développer la théorie révolutionnaire dans un cadre marxiste contrairement à nos critiques qui renient ce cadre à la simple vue des taux de croissance d'après 1945 ! Les premiers nous lèguent un cadre de compréhension fécond même entaché d'imprécisions, les autres nous mènent à l'impasse ou à l'anarchisme.
Mais faisant flèche de tout bois, le GCI et CoC nous attribuent à tort la conception développée par la "IVème Internationale" trotskyste. A y regarder de plus près, c'est CoC et le GCI qui sont de bien pâles copistes des positions de Mandel et Cie ! Certains trotskystes ont depuis belle lurette abandonné la sentence de Trotsky du "Programme de Transition" pour reprendre la vision de Lénine pour qui "Dans l'ensemble, le capitalisme se développe infiniment plus vite qu'auparavant". Pour Mandel "...ce n'est donc pas la baisse des forces productives, mais un parasitistne exacerbé et un gaspillage accru qui accompagnent la croissance et s'en emparent (...). La forme la plus néfaste du gaspillage inhérent au 3ème âge du capitalisme est dès lors la mauvaise utilisation des forces productives", le pourrissement du système se manifeste par "...les résultats pitoyables en comparaison des possibilités de la troisième révolution technologique et de l'automation (..). Mesuré en rapport à ces possibilités, le gaspillage de forces productives potentielles et réelles à crû de façon démesurée. En ce sens - mais uniquement sur la base d'une telle définition - la description donnée par Lénine de l'impérialisme comme phase de pourrissement généralisée du mode de production capitaliste' demeure justifiée". Pour Mandel, le capitalisme connaît trois phases, "...le capitalisme de libre concurrence de Waterloo à Sedan, l'époque de l'impérialisme classique et entre les 2 guerres mondiales et le 3ème âge du capitalisme aujourd'hui" et de nous spécifier que, "en valeur absolue, les forces productives ont augmenté plus vite à l'époque du 3ème âge du capitalisme qu'auparavant': Voilà CoC et le GCI en belle compagnie ! Plus loin Mandel réinterprète explicitement la définition que donne Marx de la décadence d'un mode de production exprimée dans "L'Avant-Propos" : "Ceci est d'autant plus évident que Marx ne se réfère pas ici à la chute du capitalisme, mais à la chute de toutes les sociétés de classes. II ne lui serait sûrement pas venu à l'idée de caractériser la période qui a précédé la victoire des révolutions bourgeoises dans l'histoire moderne (celle de la révolution des Pays-Bas du XVIème siècle, de la révolution anglaise du XVilème siècle, de la révolution américaine et de la grande révolution française du XVIIIème siècle) comme une phase où les forces productives auraient stagné ou même diminué" ("Le troisième âge du capitalisme", Ed. 10/18,1976).
GRAPHIQUE N°3
SOURCES: Rostow W. W., -ne world economy, history and prospect"., University of Texas Press, 1978.
Ce graphique nous montre l'évolution de la Production Industrielle Mondiale (P.LM.) depuis 1820 jusqu'en 1983 (traits continus avec des valeurs pour l'indice - sous les petits triangles - à certaines dates clefs). L'échelle des indices est logarithmique, ce qui permet d'apprécier le taux de croissance à la pente plus ou moins forte de la courbe. Le graphique est illustratif de la dynamique générale du capitalisme au cours de ses deux phases historiques. En ascendance, la croissance est en progression continue avec de faibles fluctuations. Elle est rythmée par des cycles de crise / prospérité / crise atténuée / prospérité accrue / etc. En décadence, outre un frein global sur la croissance (le phénomène de frein des rapports sociaux de production capitaliste sur la croissance des forces productives produit un différentiel entre la croissance potentiellement possible sans frein (droite en pointillé: indice 2401) et la croissance effective (indice: 1440), elle connaît d'intenses fluctuations jamais vues auparavant : deux guerres mondiales et un fort ralentissement ces quinze dernières années, voire une stagnation depuis moins de 10 ans. Si nous défalquons les frais improductifs de la production réelle le frein à la croissance des forces productives atteint et dépasse les 50% ! Le commerce mondial (suite de petites croix) n'a lui-même jamais connu d'aussi fortes contractions (st.ignation de 1913 à 1948, violent freinage ces dernières années : un taux de croissance nul s'exprime par une droite horizontale sur le graphe) illustrant le problème permanent, en décadence, de l'insuffisance de marchés solvables. La forte croissance du commerce mondial de 1948 à 1971 est artificiellement gonflée par la comptabilisation des échanges internes aux multinationales. ('_e biais statistique représente près du tiers (33%) du commerce mondial !
Qu'est-ce qui se dégage de ce fouillis inextricable ? Une négation pure et simple de la conception marxiste de l'évolution historique. Le déclin d'un mode production n'est plus le résultat d'une entrave des forces productives par les rapports de production, c'est-à-dire du décalage entre une croissance potentielle sans frein et la croissance effective mais, dit Mandel, est défini comme la différence entre ce qui est techniquement possible sous un mode de production socialiste (!) et la croissance actuelle, entre une économie d'automation et d'abondance et la croissance d'aujourd'hui "infiniment plus rapide qu'auparavant" mais ô! combien "gaspilleuse" et "mal utilisée". Définir le pourrissement du capitalisme en montrant la supériorité du socialisme ne démontre rien du tout et ne répond sûrement pas à la question pourquoi, quand et comment une société entre en déclin. Mais Mandel contourne la question en niant toute décadence à l'instar de nos censeurs. Ainsi il prétend que l'époque qui va du 16ème au 18ème siècle est une période non de décadence du mode de production féodale et de transition au capitalisme mais de pleine croissance, se permettant d'attribuer à Marx une conception contraire à tout ce qu'il a développé à ce sujet. Mandel additionne deux dynamiques opposées dans une période où s'enchevêtrent deux modes de production différents : le déclin du féodalisme du 14ème au 18ème siècle qui engendre guerres, famines, épidémies et crises agricoles et la transition au capitalisme (16ème au 18ème) qui dynamise la production (marchands, artisans...).
Le graphique ci-dessus illustre ce que nous avons développé jusqu'ici (pour un commentaire détaillé de ce graphique voir l'article précédent dans la Revue Internationale n° 54) et montre ce qu'il faut entendre par décadence pour le mode de production capitaliste : non une chute ou une stagnation, comme pour les modes de production antérieurs, mais un frein, une entrave au développement des forces productives par les rapports sociaux de production capitalistes. Ceci est illustré par le freinage général de la croissance en décadence et par la spirale infernale de crise / guerre / reconstruction / crise décuplée / guerre plus meurtrière / reconstruction droguée / etc. dans laquelle s'est enfoncé le capitalisme.
C.Mcl
[1] [273] Pour les références concernant les groupes cités dans cet article voir l'article précédent dans le n° 54.
[2] [274] Voir l'article du n° 54..
[3] [275] Les éléments qui continueront à défendre, tant bien que mal, les positions de la Fraction scissionneront pour créer le Parti Communiste Internationaliste (Battaglia Comunista) qui existe encore de nos jours. Lire notre brochure "Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire : La Gauche Communiste d'Italie" .
[4] [276] Pourquoi diable le GCI ose-t-il encore se réclamer de la Fraction italienne ? C'est eux plus que tout autre groupe qui ont développé l'analyse de la décadence. Pourquoi ne traitent-ils pas la Gauche Communiste Internationale d'adepte de Moon, de Témoins de Jéhovah, puisque la décadence constitue l'ossature de toutes leurs positions politiques puisqu'elle est inscrite dans tous leurs textes programmatiques ?
[5] [277] Lire notre brochure "Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire : La Gauche Communiste d'Italie".
[6] [278] Cette courbe a été réalisée à partir d'une reconstitution de l'évolution de la population dans 12 régions du monde (Chine / Inde-PakistanBangladesh / Sud Ouest asiatique / Japon / Reste de l'Asie / Europe / URSS / Afrique du Nord / Reste de l'Afrique / Amérique du Nord / Amérique Centrale et du Sud / Océanie). Toutes, à de petits décalages près dans le temps, suivent la même évolution que le total mondial (un test statistique qui mesure la significativité des différences entre ces évolutions a été réalisé et confirme ce parallélisme dans l'évolution de la population de ces différentes régions). Nous n'avons pas la place ici pour développer toutes les implications qui en découlent, nous y reviendrons ultérieurement.
[7] [279] Ces sociétés (4000 à 500 av. J.C. - sociétés mégalithiques, égyptiennes, etc.) sont l'aboutissement du processus de néolithisation, de division en classe de la société. Une caste dominante a pu s'ériger par l'accaparement des surplus dégagés de l'augmentation de la production. Celle-ci est encore le fait d'une multitude de collectivités villageoises produisant selon des rapports communautaires. L'esclavage existe pour les besoins de la caste dominante (serviteurs, grands travaux, etc.) mais pas encore dans la production agricole.
[8] [280] La réfutation de cette assertion a été largement développée dans notre précédent article.
[9] [281] 'L.e capitalisme, oui ou non, a-t-il fait son temps? Est-il en mesure Cie développer dans te monde les forces productives et de faire progresser l'humanité? Cette question est fondamentale. Elle a une importance décisive pour le prolétariat (...) S'il s'avérait que le capitalisme est encore capable de remplir une mission de progrès, de rendre les peuples plus riches, leur travail plus productif, cela signifierait que nous, parti communiste de 1't]MS'S, nous nous sommes hâtés de chanter son DE PROFUNDIS; en d'autres termes, que nous avons pris trop tôt le pouvoir pour essayer de réaliser le socialisme. Car, comme l'expliquait Marx, aucun régime social ne disparaît avant d'avoir épuisé toutes ses possibilités latentes. (...) Mais la guerre de 1914 n'a pas été un phénomène fortuit. Cela a été le soulèvement aveugle des forces de production contre !es formes capitalistes, y compris celles de l'F_tat national. Les forces de production créées par le capitalisme ne pouvaient plus tenir dans le cadre des formes sociales du capitalisme." fI'rotsky, Europe et Amérique, 1924, Ed. Anthropos) .
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [44]
Décantation du milieu politique prolétarien et oscillations du BIPR
- 4424 lectures
Si on se limite à une vision superficielle de l'état du milieu politique international, on risque sûrement d’être immédiatement déprimé. Les groupes existants se scindent (à Contre-Courant du GCI, le Groupe Leninista Internazionalista de l OCI), dégénèrent (Daad en Gedachte capitule, cède au frontisme démocratique à travers la stratège du front anti-apartheid en Afrique du Sud ; la FECCI met de plus en plus en discussion les bases programmatiques du CCI dont elle est sortie), perdent la boussole (Communisme ou Civilisation se discrédite en proposant défaire sans aucun sérieux "des revues communistes" a qui veut bien l'écouter ; Comunismo, ex-Alptraum, prétend d'un jour à l'autre ne plus être d'accord avec le concept de décadence du capitalisme sur lequel il fondait ses positions), ou, plus simplement, disparaissent (auto-dissolution du groupe Wildcat ; disparition progressive par auto-dissolution dans le néant des nombreux fragments qui avaient survécu à l'explosion de Programma Comunista).
C'est effectivement sur la base de l'impression qui se dégage d'une telle observation que se répand dans le milieu une ambiance de dépression et de pessimisme qui donne l'occasion aux anciens de 68 de proclamer qu'est venu le temps des "bilans autocritiques"1. Et ces bilans vont presque tous dans le même sens : malgré la crise, malgré des luttes même importantes de la classe, l'influence et l'importance numérique des révolutionnaires ne se sont pas accrues, alors que la guerre désormais menace... donc tout est perdu ou presque.
Dans la première partie de cet article, nous chercherons à démontrer en quoi cette attitude de "reflux" :
-
ne correspond pas en réalité à l'état du milieu prolétarien ;
-
ne sert qu'à fournir une couverture idéologique à l'incapacité d'une bonne partie du milieu d'assumer ses responsabilités par rapport aux nécessités de la lutte de classe.
Dans ce contexte de confusion, la responsabilité qui pèse sur les épaules des deux pôles de regroupement, le CCI et le BIPR, est d'autant plus grande, et ils sont appelés à faire un rempart contre cette vague insidieuse de méfiance et de désertion. Dans la deuxième partie de l'article nous montrerons comment du fait de son incapacité congénitale à affronter et à résoudre ses contradictions internes, le BIPR a de plus en plus de difficultés à remplir la tâche de donner des orientations aux débats du milieu dans son ensemble.
Le défaitisme contre le militantisme révolutionnaire
Bien qu'on puisse retrouver des signes d'une attitude de méfiance par rapport à la possibilité pour les révolutionnaires de jouer un rôle dans la lutte de classe dans presque tous les groupes, leur expression la plus claire se manifeste évidemment dans les groupes qui font de la méfiance envers l'intervention des révolutionnaires leur unique raison d'exister. Le cas le plus exemplaire est sans aucun doute la Fraction externe du CCI (FECCI) dont les militants ont déserté de façon irresponsable le CCI, sous le prétexte que sa dégénérescence était telle qu'aucune lutte ne pouvait plus l'empêcher de jeter sa plate-forme d'origine aux orties. La fausseté de cette affirmation est évidente aujourd'hui : trois ans après, le CCI est plus que jamais renforcé sur sa plate-forme alors que c'est la FECCI qui lui découvre toujours de nouvelles "limites". En réalité, la divergence portait sur l'analyse de la dynamique de la lutte de classe et la tendance de ces camarades à privilégier arbitrairement le débat interne par rapport à l'intervention militante dans les luttes ouvrières. La FECCI l'a d'abord nié avec une vertueuse indignation pendant trois années de suite, puis, étant donné l'ambiance de pessimisme qui règne dans le milieu, elle a pris courage et a mis cartes sur table. Dans le n°9 de Perspective Internationaliste, on découvre "qu'à la base de la dégénérescence" du CCI, il y a la stagnation et la dégénérescence de tout le milieu et que, loin de se renforcer il est aujourd'hui beaucoup plus faible et beaucoup plus divisé par le sectarisme qu'il ne l'était dans les années 70. En conséquence il faut avoir le courage de reconnaître que "dans cette période, l'élaboration théorique (dont la clarté dans l'intervention fait partie intégrante) doit être une priorité bien supérieure par rapport au développement organisationnel. En conséquence la clarification théorique est aujourd'hui notre travail principal". (PI n°9)
Est enfin théorisé ce qui est déjà depuis 3 ans la pratique de non intervention dans la lutte de classe de la part de la FECCI. Naturellement, une telle régression, un tel abandon de l'engagement militant ne peuvent qu'être salués avec enthousiasme par cette fraction du milieu qui base justement son existence sur le refus de cette responsabilité militante dans les affrontements de la lutte ouvrière. Communisme ou Civilisation s'était déjà réjoui des pas qui menaient dans cette direction : "face au désert théorique du CCI, la prose de la FECCI peut être comparée à un oasis" (Communisme ou Civilisation n°22, mai 87).
Mais c'est une autre secte qui fait de la lutte contre le CCI sa raison d'exister, le Communist Bulletin Group (CBG), qui a manifesté le plus grand enthousiasme. Ce groupe (qui s'est mis en dehors du camp politique prolétarien avec son soutien aux actions de gangstérisme de l'aventurier Chenier contre le CCI) s'est empressé de se déclarer "entièrement d'accord" avec les conclusions de la FECCI, ou mieux, a de façon juste, souligné que la FECCI aujourd'hui se met au niveau de la lutte contre toute activité communiste militante et centralisée, niveau que le CBG a atteint triomphalement dès le début des années 80. Il saisit donc le moment favorable pour sa propagande défaitiste qui finalement "trouve un écho". Le n°13 de son bulletin a immédiatement mis à disposition de ceux qui ont des doutes ou des hésitations une théorisation "cohérente" du défaitisme qui se base sur les points suivants :
-
"Comme le souligne la FECCI, notre affirmation de base selon laquelle l'approfondissement de la crise économique trouverait sa contrepartie dans un approfondissement de la lutte de classe et un accroissement correspondant de la taille et de l'influence des fractions révolutionnaires, a été démentie par la réalité".
-
Le milieu s'est développé positivement de 68 à 75 ; "à ce point, le mouvement révolutionnaire avait atteint un plateau". Par la suite "il n'y a eu d'accroissement ni en nombre, ni en influence. (...) Sous beaucoup d'aspects, le milieu est beaucoup plus faible qu'il y a dix ans".
-
"Les divisions qui ont surgi dans les années 70 se sont aujourd'hui solidifiées en barrières dogmatiques d'une telle résistance qu'il est difficile de voir comment elles peuvent être surmontées. Il est certain qu'il ne semble pas correct du tout de croire qu'une plus grande combativité de la classe ouvrière pousserait les révolutionnaires à s'unir".
Les conclusions sont prévisibles : il faut arrêter les efforts de construction d'une organisation centralisée en vue de l'intervention dans la lutte de classe, il faut se dédier à un travail d'étude et de débat "ouvert", auquel participeraient, sur un plan d'égalité formelle, les organisations militantes, les individus et les cercles qui n'ont rien de mieux à faire. Ce débat académique "fraternel" ne manquera pas de poser les bases du futur parti du prolétariat.
De telles théorisations ne manqueront pas de "trouver un écho" de ci, de là. Le Collectif mexicain Alptraum (Comunismo) sera certainement d'accord, lui qui a finalement résolu ses longues hésitations par rapport à l'intervention dans la lutte de classe, en niant la nécessité de l'intervention et la réalité de la lutte de classe (toutes deux inventions du CCI...) et en se donnant comme seule tâche la publication d'une revue théorique (avec Communisme ou Civilisation comme par hasard) dans l'attente du parti tout puissant de demain.
Le comique de cette tendance à la retraite stratégique, c'est qu'en fait elle agglomère en un seul front aussi bien les partisans du Parti unique, de fer, monolithique (Communisme ou Civilisation, Comunismo) que les admirateurs d'un parti "ouvert", démocratique, dans lequel tout le monde est libre de dire et de faire ce qui lui plaît (FECCI, CBG). Les deux seules choses qui unissent ce front disparate sont :
-
l'espoir de vivre assez longtemps pour assister à cet "écroulement du CCI" qu'ils attendent tous et qui ne vient jamais ;
-
l'absolue conviction que dans les conditions actuelles de la lutte de classe, l'intervention des révolutionnaires ne joue aucun rôle réel.
Les deux choses sont naturellement liées entre elles : le CCI est aujourd'hui le principal pôle de regroupement du milieu prolétarien international et le défenseur le plus décidé du rôle des révolutionnaires dans la lutte de classe. Ceci signifie que toute tentative de remettre ce rôle en discussion est obligée de régler des comptes avec le CCI. Mais ça veut dire aussi que le CCI est prêt à régler les comptes à toute tentative qui va dans ce sens, en revenant sur les arguments un par un. C'est ce que nous avons fait et entendons continuer à faire.
Les avances difficiles du milieu politique prolétarien
On trouvera une réponse plus détaillée aux tentatives de falsification de la vie du mouvement révolutionnaire dans les vingt dernières années, dans la série d'articles "L'évolution du milieu politique prolétarien après 68" et nous renvoyons nos lecteurs à ces articles. Dans celui-ci, nous nous limiterons donc à répondre aux différentes affirmations de base contenues dans le de profundis sur le milieu théorisé par CBG et partagées par une bonne partie du milieu lui-même.
Commençons par l'observation centrale, selon laquelle le mouvement révolutionnaire croît numériquement et politiquement de 68 à 75, puis stagne de nouveau numériquement et régresse politiquement. Pour présenter les choses de cette manière, il est nécessaire de falsifier sans pudeur la dynamique réelle des événements. Il est absolument vrai que les années 68-75 ont vu tout un processus de décantation et de politisation autour du groupe français Révolution Internationale, qui conduira à un regroupement international dans le CCI, et à celui limité à l'Angleterre dans la CWO. Mais c'est vrai aussi que les années 72-75 ont vu l'explosion de la mode "moderniste", avec l'abandon qui s'ensuit du marxisme de la part d'un nombre énorme de militants qui, dans ces années-là, en étaient à peine à rompre avec les groupes extra-parlementaires en redécouvrant les positions de la Gauche communiste. Si CBG pense nous émouvoir en nous parlant des "beaux jours" où il semblait que tous se dirigeaient vers les positions de la Gauche communiste, alors il se trompe complètement d'adresse. Le fait que des milliers d'individus, qui la veille encore, ne juraient que par le Programme de transition de Trotsky ou le Bloc des quatre classes de Mao, se soient mis à l'improviste à citer à tort et à travers Pannekoek et Bordiga, n'était pas une force mais une faiblesse, et surtout, un très grave danger pour le mouvement révolutionnaire.
Si nous avons été capables de regrouper une petite partie de ces camarades dans une organisation politique homogène, c'est parce que tout cela nous l'avions compris et dit à l'époque et pas seulement aujourd'hui : "la réapparition internationale d'un courant communiste est laborieuse, tâtonnante, incertaine et en retard par rapport à la reprise de la lutte de classe. De plus, elle est encore trop souvent due à la conjoncture d'éléments relevant du hasard plus que d'une détermination historique. Mais en même temps, le long purgatoire traversé par les groupes existant actuellement et les crises que provoquera en leur sein le cours de plus en plus opportuniste, racoleur et lèche-bottes des courants radicaux issus de la contre-révolution (trotskysme principalement) débouchera et débouche déjà sur de brusques accès de mode pour nos idées. La faiblesse numérique ne sera plus alors le lourd boulet traîné par notre courant mais bien le danger de 'trop plein' et de dilution dans une masse d'éléments n'ayant pas encore pleinement compris nos positions et leurs implications."2
Nous avons été capables de constituer ce qui est aujourd'hui le principal pôle de regroupement justement parce qu'alors nous ne nous sommes pas fait prendre par "l'enthousiasme" par le fait que les positions de la Gauche communiste devenaient à la mode tout à coup, mais nous nous sommes rigoureusement différenciés de tous ceux qui refusaient des délimitations politiques sur des positions claires. Ce n'est pas par hasard que déjà à l'époque, en 1975, la constitution du CCI ait été saluée par un chœur unanime d'accusations de "monolithisme", "sectarisme", "fermeture à l'égard des autres groupes", "isolement paranoïaque", "conviction d'être les uniques dépositaires de la vérité", etc. de la part d'une foule de cercles et d'individus qui, un an plus tard, se sont heureusement dissous dans le néant.
Les années comprises entre 1975 et 1980, loin de montrer une nouvelle stagnation du milieu révolutionnaire, sont caractérisées par le fait qu'elles voient tous ces groupes (la majorité) évoluer, alors qu'ils avaient stagné pendant la phase de confrontation et de regroupement des années 68-75. Le milieu entier se subdivise en trois grandes tendances :
-
l'isolement dans la passivité et l'académisme (les restes du courant conseilliste historique) ;
-
l'isolement dans l'activisme dépourvu de principes (Programme Communiste qui pendant toutes les années 70 a été la principale organisation communiste) ;
-
la rupture de l'isolement à travers la confrontation et le débat politique (Conférences internationales des groupes de la Gauche communiste animées par Battaglia Comunista et le CCI).
Le premier bilan qu'on peut tirer est que les conférences ont été le premier élément dynamique capable de polariser TOUT le milieu ; en fait, même les groupes qui N'ONT PAS participé (Spartacusbond, Programma, etc.) se sont sentis obligés de motiver publiquement leur refus. Le second bilan est que, au-delà des résultats immédiats qui cependant existent (rapprochement de Battaglia Comunista de la CWO, fusion des NLI et d'Il Leninista, naissance d'une section du CCI en Suède), les conférences restent un acquis pour le futur.
"Les bulletins publiés en trois langues à la suite de chaque conférence et contenant les diverses contributions écrites et le compte-rendu de toutes les discussions sont restés une référence indispensable pour tous les éléments ou groupes qui depuis ont rejoint les positions révolutionnaires."3
De tout ceci, les idéologues du reflux se gardent bien de parler : le fait que les positions de la gauche communiste sont aujourd'hui présentes en Inde et défendues en Amérique latine n'est probablement pour eux qu'une "curiosité exotique". Mais passons à un autre point, au fait que l'influence de la minorité communiste n'aurait pas grandi parallèlement à la crise et à la lutte de classe. Naturellement, si par influence, on entend le nombre d'ouvriers directement organisés dans les organisations révolutionnaires, alors il est clair qu'elle a très peu grandi ! Mais dans la phase décadente du capitalisme, l'influence de la minorité révolutionnaire se manifeste d'une tout autre façon, elle se manifeste en tant que capacité de jouer un rôle de direction politique à l'intérieur des luttes significatives de la classe. C'est sur la base du renforcement de cette capacité à pousser les luttes en avant, à influencer politiquement les éléments ouvriers les plus actifs, les plus combatifs, que se développeront les conditions pour l'intégration toujours croissante de militants ouvriers dans les organisations révolutionnaires.
Si nous considérons les choses de ce point de vue, le point de vue marxiste, c'est une donnée de fait que dans les dernières années les organisations qui, comme le CCI, ont maintenu une pression constante au niveau de l'intervention dans la lutte de classe, ont été pour la PREMIERE FOIS capables d'influencer des secteurs minoritaires de la classe dans le cours de luttes de grande ampleur comme celle des cheminots français ou des enseignants italiens. Ceci n'était jamais arrivé et NE POUVAIT PAS arriver dans les années 70, parce que les conditions n'existaient pas encore4. Aujourd'hui, ÇA COMMENCE A ETRE POSSIBLE, grâce à la maturation de la crise, de la lutte de classe ET des organisations communistes qui ont été capables de faire face victorieusement à la sélection qui s'est opérée pendant ces années.
Venons en enfin à la troisième question douloureuse : le fait qu'aujourd'hui, le milieu serait plus divisé et sectaire que dans les années 70 et que la lutte de classe elle-même ne pourrait pas pousser les révolutionnaires à discuter entre eux.
Nous avons déjà vu que cette vision pessimiste ne tient pas compte du fait que la majorité du milieu révolutionnaire dans les années 1968-75 était restée rigoureusement étrangère à toute dynamique de contact et de discussion, alors qu'aujourd'hui, les deux principaux pôles de regroupement qui existent à l'échelle internationale -le CCI et le BIPR- sont tous les deux des défenseurs -même si c'est en termes différents- de la nécessité de ce débat.
Ce n'est pas par hasard si les nouveaux groupes qui sont en train d'apparaître, en particulier à la périphérie du capitalisme, tendent immédiatement à faire référence aux débats entre ces deux pôles. Aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui croient que le débat entre les révolutionnaires est une espèce de supermarché, qui, pour être riche et satisfaisant, devrait offrir le choix entre des milliers de produits divers, cette sélection n'est pas un "appauvrissement", mais un pas en avant. Cette polarisation permet aux nouveaux éléments qui surgissent de se situer clairement par rapport aux divergences politiques FONDAMENTALES qui existent parmi les grands courants essentiels du mouvement révolutionnaire, au lieu de se perdre dans les mille finasseries secondaires de telle ou telle secte. Que les sectes s'en attristent, c'est évident, qu'elles poussent de grands cris sur le "renforcement des divisions", c'est encore plus évident : ce qui leur fait pousser de hauts cris, ce n'est pas autre chose que l'accélération de l'histoire, c'est-à-dire de la crise et de la lutte de classe, qui pousse toujours plus à la décantation du camp révolutionnaire. C'est cette accélération qui a contraint les camarades de Wildcat à reconnaître qu'ils s'étaient engagés dans une impasse et à dissoudre un groupe qui n'était que source de confusion. C'est cette accélération qui a permis le processus relativement rapide par lequel tout un milieu de militants mexicains a réussi à rompre avec la contre-révolution, faisant surgir un nouveau groupe communiste, le Grupo Proletario Internacionalista. C'est l'obligation de prendre en compte cette accélération qui a fait surgir au sein du même pays un groupe communiste MILITANT qui a finalement poussé le groupe déjà existant, le collectif Alptraum à résoudre ses hésitations de six ans face à l'engagement militant, en se suicidant dans la régression académique. Même un choix négatif de ce type est préférable de toute façon à l'ambiguïté : à partir de maintenant, les éléments mexicains à la recherche d'une cohérence de classe, auront face à eux une alternative claire : ou l'engagement dans le militantisme révolutionnaire avec le GPI ou le hobby de la discussion sans implications dans Comunismo ex-Alptraum (si toutefois il survit).
La question de l'intervention militante dans la lutte de classe devient donc facteur de clarification et de sélection. Mais ce qui est le plus important, c'est que –contrairement aux sombres prophéties des oiseaux de mauvais augure– l'intervention commence à devenir un facteur d'INTERACTION entre les révolutionnaires. Le dégagement progressif d'une minorité nettement classiste, qui se manifestait ouvertement dans la lutte des travailleurs de l'école en Italie, a été aussi et surtout le résultat d'un travail ORGANISE et COMMUN de la part des militants internationalistes qui participaient à la lutte (militants du CCI, de Battaglia et du groupe bordiguiste II Partito Comunista). Il s'agit d'un petit exemple, mais c'est le PREMIER EXEMPLE d'une collaboration dans la lutte que l'approfondissement de la lutte de classe ne manquera pas de multiplier.
Les conséquences pour l'ensemble du milieu sont évidentes : les débats -souvent abstraits- du passé, vont tendre à s'approfondir grâce à la confrontation des positions dans la réalité de la lutte de classe. Très bon pour le débat, très mauvais pour les groupes parasites qui n'ont que peu ou rien à voir avec la lutte de classe.
Le BIPR et la lutte de classe : quelques contradictions de trop
Dans cette seconde partie de l'article, nous allons chercher à retracer les difficultés que le BIPR (le plus grand pôle de regroupement international après le CCI) rencontre pour établir une résistance adéquate à la vague de défaitisme qui déferle sur le milieu révolutionnaire.
La première difficulté vient du fait que le BIPR est lui-même victime d'une vision pessimiste du mouvement actuel de lutte de classe et qu'il se trouve donc dans une position difficile pour résister à la propagande défaitiste. Dans le numéro précédent de la Revue Internationale, nous avons abordé spécifiquement la question de la sous-estimation de la lutte de classe actuelle par le milieu et en particulier par le BIPR, alors que dans les numéros 50 et 51 de cette revue, nous avons traité des incompréhensions du BIPR sur le cours historique et la question "syndicale". Dans cet article, nous reviendrons spécifiquement sur un problème que nous avons cependant souligné plus d'une fois : les contradictions croissantes dans les prises de position du BIPR sur l'ensemble des questions qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour.
Pour une question de place, nous nous limiterons évidemment à une seul exemple qui paraît particulièrement significatif. Nous voulons parler de la question centrale, c'est-à-dire du niveau de la lutte de classe et la possibilité qui s'ensuit ou non pour les révolutionnaires de jouer un rôle en son sein. Dans la désormais fameuse lettre du BIPR au Collectif Alptraum de juin 87, amplement critiquée par nous dans l'article sur la sous-estimation de la lutte de classe dans le numéro précédent de la Revue Internationale, les luttes des travailleurs de l'école en Italie, organisées pendant des mois dans les COBAS, étaient mises sur le même pied que celles des professionnels de certains milieux (pilotes, magistrats, etc.) et donc abandonnées à elles-mêmes à peu près jusqu'à l'été. A l'automne 87 se tient l'assemblée annuelle de la CWO, qui fait une théorie sur le profond coma du prolétariat anglais, cauchemar de Thatcher, et dans ses perspectives, étant donné "la période de calme social", affirme que "nous avons plus besoin -et plus le temps- de nous réorienter vers le travail théorique" (Workers'Voice n°39, février-mars 1988).
En février 1988, l'assemblée annuelle de Battaglia Comunista affirme qu'« avec l'affaire des Cobas, débute une phase nouvelle et intéressante de la lutte de classe en Italie et que s'offre pour notre organisation la possibilité de susciter dans les mouvements un intérêt certainement plus grand que par le passé (...). Les camarades de CWO qui sont intervenus à la réunion ont fait référence aux développements récents de la lutte de classe en Grande-Bretagne (...) : les grèves, inexistantes jusqu'alors, et les grèves de solidarité entre travailleurs de secteurs différents.
Ces luttes aussi confirment le commencement d'une période marquée par l'accentuation des conflits de classe. » (d'après le rapport publié dans BC n°3 de mars 88)
Comme on le voit, aussi bien l'analyse ponctuelle de la situation en Italie qu'en Angleterre, que les conséquences qui en sont tirées sur le plan général ("le commencement d'une période marquée par l'accentuation des conflits entre classes") sont en totale contradiction (heureusement !) avec les analyses précédentes. Ce qui frappe, c'est que pourtant, on trouve encore dans le n°39 de Workers'Voice, A LA SUITE de la vague de luttes en Grande-Bretagne, publié tel quel, SANS UN MOT DE CRITIQUE, les perspectives de la réunion annuelle de la CWO qui sont fondées sur la "démoralisation et la passivité" du prolétariat anglais et mondial. Quelle est donc en février-mars 1988, la position des camarades de la CWO ? Celle, optimiste qui est publiée dans Battaglia, ou celle, pessimiste, qu'eux-mêmes publient dans Workers'Voice ?
La situation semble s'éclaircir dans le n°40 d'avril-mai 1988 où, dans l'introduction à un article sur mai 68 ("le premier réveil généralisé de la lutte de classe après les années de la reconstruction d'après-guerre") on affirme clairement : "les derniers mois ont vu en Angleterre, Allemagne et ailleurs une agitation qui est le signe avant-coureur d'une reprise des affrontements sociaux". Mais l'espoir d'avoir enfin compris quelque chose à la position de ces camarades est de courte durée. Quelques semaines après, la CWO expédie au Communist Bulletin Group une lettre sur les mêmes questions : "l'article (sur les 20 ans après 68) paraîtra dans Workers'Voice n°41, mais globalement, nous avons rejeté ce que nous ressentons comme notre dernier bagage du CCI, c'est-à-dire l'idée que mai 68 a ouvert une nouvelle période, la fin de la contre-révolution, et le commencement d'une nouvelle période révolutionnaire... Nous voyons définitivement la période comme une continuation de la domination capitaliste qui a régné, en étant seulement sporadiquement contestée, depuis la fin de la vague révolutionnaire qui a suivi la première guerre mondiale. Cela a beaucoup de conséquences et je suis sûr que vous serez d'accord là-dessus... L'avant-garde va mal parce que ce n'est pas une période 'pré-révolutionnaire' mais une période de domination capitaliste (croissante)."5
Cette lettre n'est pas qu'un démenti total de ce qui est écrit dans le n°40 de Workers'Voice, qui était diffusé à ce moment-là, mais aussi une CAPITULATION SANS CONDITION devant la pression du défaitisme de la partie parasitaire du milieu et du CBG en particulier. Notons que la CWO s'est donnée la peine de préciser qu'elle ne s'opposait pas à la publication de cette lettre. C'est donc très préoccupés que nous avons ouvert le n°41 de Workers'Voice, où devait se trouver l'article mentionné dans la lettre. Mais, énième volte-face, l'article sur 1968 n'y est pas alors qu'au contraire, il y a un article sur le milieu révolutionnaire où on affirme que : "Cependant, les événements de mai 68 en France ont été les premières de beaucoup dégrèves ouvrières qui marquaient la fin du boum capitaliste d'après-guerre...ceci a donné naissance au camp politique prolétarien actuel (...). Dans les récentes années, il y a eu un développement des groupes communistes à la périphérie du capitalisme."
C'est exactement le contraire de ce qui est écrit dans la lettre qui était publiée au même moment dans le Bulletin.
Le minimum qu'on puisse dire, c'est que sur cette question essentielle, il y a dans le BIPR au moins trois positions différentes :
-
CWO n°l : hier, fin de la contre-révolution en 68 ; aujourd'hui, reprise de la lutte.
-
CWO n°2 : hier, aucun changement en 68 ; aujourd'hui, domination croissante du capital.
-
BC n°3 : hier, aucun changement en 68 ; aujourd'hui, "quelque chose se met à bouger, même si ce n'est pas encore suffisant" (Prometeo n°11, décembre 87).
Nous avons donc trois positions ou peut-être quatre, puisqu'à la réunion publique tenue par le CCI en juin 88 à Milan, un camarade de BC est intervenu pour soutenir que "nous sommes moins nombreux aujourd'hui qu'en 68".
Il est évident que "cela a beaucoup de conséquences". La première, c'est que le BIPR non seulement est tout à fait incapable de réagir de manière adéquate à la propagande défaitiste qui infiltre le milieu, mais qu'il tombe lui-même dans le piège du défaitisme, à la profonde satisfaction de tous les groupes parasites en lutte contre l'engagement militant dans les luttes.
La seconde constatation qu'on peut faire, c'est que le BIPR, qui rejette la nécessité de définir clairement le cours historique (à la guerre ou aux affrontements de classe) est nécessairement forcé de se faire secouer ad eternam dans les balançoires de l'IMMEDIATISME, en ce qui concerne son analyse des affrontements de classe.
Nous avons vu comment BC et la CWO, en l'absence de luttes en Italie et en Grande-Bretagne, avaient parlé de passivité de la classe, en considérant comme des "exceptions" sans importance les vagues de luttes en Allemagne, en Espagne, etc. (Perspectives pour la CWO, Workers Voice n°39). Avec le développement des luttes, d'abord en Italie, puis en Angleterre, BC d'abord, la CWO ensuite, ont commencé à parler de reprise des luttes. Avec le reflux de ces deux périodes de luttes, aussi bien dans BC que dans la CWO (surtout) sont ressorties les analyses pessimistes, les discours sur l'isolement des communistes, etc. Nous savons bien que BC dans le n°11 de sa revue Prometeo a tout juste nié que ses analyses dépendent d'influences localistes et/ou immédiatistes. Il nous semble cependant que les faits sont plus convaincants que les démentis de BC.
Le dernier problème qui naît du développement des contradictions dans lesquelles tourne en rond le BIPR concerne l'existence même du BIPR, c'est le fait même que sur une question aussi décisive que "qu'est ce qui se passe et que devons-nous faire ?", il y ait dans l'organisation au moins trois positions; cela en dit long sur leur désorientation. Mais ce qui est le plus grave, ce n'est pas qu'il existe des positions différentes, mais qu'elles s'expriment côte à côte, en s'ignorant et sans le moindre souci de débat pour chercher à résoudre les divergences.
La chose est d'autant plus grave qu'en 1980, BC et la CWO, pour justifier leur sabotage des Conférences internationales, affirmaient qu'il fallait en finir avec la méthode utilisée par le CCI "pour résoudre les divergences politiques -c'est-à-dire les minimiser- pour maintenir l'unité" (Revolutionary Perspectives n°18). Le BIPR, créé au contraire pour "favoriser l'harmonisation politique (des organisations qui lui sont affiliées) en vue de leur centralisation organisationnelle" (statuts du BIPR) se retrouve aujourd'hui, après cinq ans d'existence, avec ces résultats : la non-homogénéité n'a pas diminué entre BC et la CWO, en revanche cependant, elle a augmenté à l'intérieur de la CWO. Ce n'est pas nous qui nous en étonnerons vu qu'on notait déjà en 1985 : "ce qui est sûr, c'est que nous, nous ne pourrons jamais accuser BC et la CWO de 'minimiser' leurs divergences ; en réalité, ils les font purement et simplement disparaître"6.
Le résultat de cette méthode erronée, c'est une difficulté croissante pour le BIPR à remplir le rôle qui incombe à un pôle de regroupement international. Ce rôle ne consiste pas seulement à chercher à regrouper autour de soi les noyaux avec lesquels on a des points de contact, mais aussi à savoir faire un barrage aux tendances négatives qui menacent l'ensemble du milieu révolutionnaire. La lettre, déjà citée, au Collectif Alptraum, qui est une exhortation à ne pas SUR-évaluer la lutte de classe, envoyée à un groupe sur le point de couler à cause de sa SOUS-estimation de la lutte de classe, est un bon exemple de cette difficulté.
Mais le risque le plus grand réside dans la contamination des bases politiques du BIPR lui-même. Les virages périodiques de la CWO, la tendance manifeste à se retirer de l'intervention pour "faire de la théorie", ne mènent à aucun approfondissement théorique, mais seulement à une remise en discussion systématique de la clarté atteinte précédemment ("le moteur de l'histoire n'est plus la lutte de classe, mais la guerre" ; "le capitalisme d'Etat n'est plus la tendance dominante à notre époque" ; "nous sommes dans une phase de domination croissante du capital" ne sont que quelques exemples de ces résultats intéressants.)
Ce n'est pas en tournant le dos à l'engagement militant qu'on avancera en quoi que ce soit théoriquement. Il y a trois ans, en saluant l'apparition des thèses du collectif Alptraum, nous mettions déjà en garde : "Le CCA doit se situer plus activement, plus directement sur le terrain de l'intervention politique au sein du mouvement actuel du prolétariat (...). La théorie révolutionnaire ne peut vivre et se développer qu'en vue de cette intervention, surtout dans la période historique actuelle."7
Cette mise en garde, nous la réitérons aujourd'hui auprès des camarades de la CWO, du BIPR, de tous les groupes du milieu révolutionnaire. Les batailles décisives sont devant nous. Veillons à ce qu'elles ne nous trouvent pas la tête dans le sable.
Beyle
1 Pour le bilan des 20 ans depuis 68 tiré par le CCI, voir l'ensemble des articles publiés dans le numéro 53 de la Revue Internationale et la série d'articles sur le milieu dans les numéros 53 et 54 et à paraître dans le n°56.
2 Bulletin d'études de discussion de Révolution Internationale n°4, janvier 74.
3 "L'évolution du milieu révolutionnaire depuis 1968 (II)", Revue Internationale n°54, p.l9.
4 Programme Communiste a tenté de forcer la cadence dans les années 70, avec une bataille politique complètement inadéquate : la catastrophe était inévitable.
5 Lettre publiée dans le n°13 du bulletin du Communist Bulletin Group
6 "BIPR : un regroupement-bluff". Revue Internationale n°40
7 "Une nouvelle voix de classe à Mexico". Revue Internationale n°40.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [66]
- TCI / BIPR [282]
- Battaglia Comunista [283]
- Communist Workers Organisation [284]
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
1918-1919 : il y a 70 ans, a propos de la révolution en Allemagne (1ere partie)
- 3560 lectures
INTRODUCTION
Il y a 70 ans, le prolétariat en Allemagne se lançait dans la plus importante expérience de son histoire. Il s'attelait à la tâche de porter plus loin la flamme de la révolution que le prolétariat russe avait allumée en 1917, pour l'étendre à l'Europe de l'ouest.
Partout en Allemagne des conseils d'ouvriers et de soldats surgirent dans les premiers jours de novembre 1918. L'exemple des ouvriers en Russie, qui était également repris par les ouvriers en Autriche et en Hongrie, et, dans une certaine mesure, en Italie, constituait un formidable stimulant.
Les révolutionnaires avaient mis tous leurs espoirs dans l'Allemagne parce que, plus que toute autre, la classe ouvrière dans ce pays, du fait de sa position-clé en Europe, pouvait venir en aide aux ouvriers isolés en Russie, en battant la classe capitaliste en Allemagne, ouvrant ainsi la voie de la révolution mondiale.
Le destin de la classe ouvrière internationale, et même celui de toute l'humanité, se trouvait entre les mains de la classe ouvrière en Allemagne. La capacité de celle-ci à pousser vers une révolution victorieuse, à conquérir le pouvoir et à le maintenir, devait être décisive pour le cours ultérieur des luttes en Russie, au centre de l'Europe, et même à l'échelle mondiale. Mais les obstacles à affronter étaient à la mesure de l'immense responsabilité qui reposait sur la classe ouvrière en Allemagne. Le prolétariat faisait face à une classe capitaliste fortement expérimentée et bien armée contre la classe ouvrière. Classe dominante d'un pays industrialisé, elle était capable d'opposer une résistance bien plus âpre que la bourgeoisie en Russie qui avait été chassée relativement rapidement sans bain de sang pour le prolétariat en octobre 1917.
Tous les révolutionnaires étaient conscients de cela. Ainsi Lénine écrivait le 23 juillet 1918: "Tour nous, il était plus facile de commencer la révolution, mais il est extrêmement difficile pour nous de la poursuivre et de l’accomplir. Et la révolution a des difficultés énormes pour aboutir dans un pays aussi industrialisé que l'Allemagne, dans un pays avec une bourgeoisie aussi bien organisée." (Discours à la Conférence de Moscou des délégués de comités d'usines).
En comprenant ce qui était en jeu, les révolutionnaires en Russie en particulier étaient prêts à venir en aide aux ouvriers en Allemagne. Bien avant le véritable surgissement des ouvriers, Lénine écrivait le 1er octobre 1918: "Pour les masses ouvrières allemandes nous sommes en train de préparer... une alliance fraternelle, une aide alimentaire et militaire. Nous allons tous mettre nos vies en jeu pour aider les ouvriers allemands, pour pousser en avant la révolution qui a commencé en Allemagne." (Lettre à Sverdlov, dans "Lénine: sur l'Allemagne et le mouvement des ouvriers allemands", Berlin-Est 1957).
Mais la bourgeoisie allemande a aussi reçut le soutien de la classe dominante d'autres pays, en particulier des "vainqueurs" de la 1ère guerre mondiale qui étaient effrayés par le spectre de l'extension de la révolution prolétarienne mondiale. Alors qu'auparavant les différentes bourgeoisies nationales s'étaient entre-déchirées pour la conquête de territoires sur les champs de bataille de la guerre impérialiste au prix de plus de 20 millions de morts et un nombre innombrable de blessés, elles étaient désormais prêtes à resserrer leurs rangs vis-à-vis d'une classe ouvrière combattant sur son terrain de classe. Une fois encore était confirmé que la classe dominante, divisée par nature, tend à s'unifier dans une situation révolutionnaire pour faire face à la classe ouvrière.
Le soulèvement de la classe ouvrière en Allemagne contre le régime capitaliste put être enrayé par la bourgeoisie. Plus de 20 000 ouvriers furent massacrés et plus encore furent blessés entre 1918 et le début des années 1920. La bourgeoisie en Allemagne parvint en 1919 à décapiter la direction du prolétariat, le KPD (Parti Communiste). Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht furent assassinés par les corps francs organisés du SPD (Parti Social-Démocrate) au cours du soulèvement de janvier 1919. Même si le KPD qui venait d'être fondé au feu des luttes de décembre 1918-jan-vier 1919 fut un des premiers à se prononcer contre les syndicats et le parlement, il était engagé dans les luttes avec des positions programmatiques insuffisamment élaborées, mal préparé organisationnellement, et divisé peu de temps après sa fondation. Politiquement affaibli, le prolétariat ne put faire la preuve de sa capacité dans le cours des luttes à surmonter ces faiblesses.
Les tentatives d'étendre la vague révolutionnaire au-delà des frontières russes échouèrent avec la défaite de la classe ouvrière en Allemagne. Ceci devait avoir des conséquences catastrophiques pour la classe ouvrière internationale. Avec la défaite des luttes en Allemagne, la bourgeoisie était capable d'entreprendre une offensive à l'échelle mondiale contre la classe ouvrière. Ceci plaça les ouvriers en Russie dans une situation d'isolement encore plus grand face aux attaques des armées blanches. L'écrasement des luttes révolutionnaires en Allemagne, et, du fait de celui-ci, l'isolement des ouvriers en Russie, accélérèrent ainsi la défaite de la révolution en Russie; l'échiné du prolétariat isolé pouvait être ainsi brisée.
LES LUTTES EN ALLEMAGNE ET EN RUSSIE : LA MEME FORCE LES DYNAMISAIT LA MEME PERSPECTIVE LES UNISSAIT
Les luttes en Allemagne furent stimulées par la même force que les luttes de la classe ouvrière en Russie.
Après la mobilisation de la classe ouvrière en Allemagne sur le champ de bataille pour les buts de la guerre impérialiste de la bourgeoisie allemande, à travers la trahison ouverte de la fraction parlementaire qui était à la tête du SPD en août 1914, et après que les syndicats aient maintenu un calme relatif dans les usines et dans la classe ouvrière dans son ensemble dans les premières années de la guerre, la classe ouvrière, surtout à partir de 1916, releva lentement la tête. La vague de grèves sauvages qui, à partir de l'hiver 1917, commença à secouer l'industrie d'armement à l'arrière, et la résistance contre une politique amenant la famine, mit le feu au mouvement particulièrement au cours de l'hiver 1917-18. Ces luttes ouvrières contre la guerre et ses misères, sous l'influence de la révolution russe, montrèrent clairement qu'en Allemagne aussi, la classe ouvrière, malgré un affaiblissement significatif à cause de la guerre, se remettait de la défaite et de l'ivresse chauviniste et guerrière. Au contraire elle était en train de se dresser contre la politique de guerre à l'extérieur et de paix sociale à l'intérieur (Burgfrieden). Cette vague de grèves brisa cette paix sociale sur laquelle s'étaient mis d'accord les syndicats et le capital au début de la guerre. Cet accord non seulement emporta irréversiblement les syndicats dans le camp de la bourgeoisie, mais constitua aussi un pilier de la domination du capital.
Le mouvement de novembre 1918 mit en avant les mêmes revendications que celles avancées un an auparavant par les ouvriers en Russie: du pain et la paix. Le mouvement contre la guerre partit non du front, mais des usines.
Son axe central unificateur était alors la lutte contre la faim, contre la continuation de la guerre. Il était nécessaire de mettre à bas la classe dominante pour satisfaire ces revendications.
C'est pourquoi les Spartakistes et Rosa Luxemburg résumèrent le but et les premières mesures qu'il y aurait à prendre dans les termes suivants: "Le but de la révolution (l'abolition de la domination du capital, la réalisation de l'ordre socialiste de la société) indique clairement sa marche, la tâche dicte sa méthode. Tout le pouvoir dans les mains des masses, dans les mains des conseils d'ouvriers et de soldats assurant le travail de la révolution face à ses lâches ennemis : telle est l'orientation pour toutes les mesures du gouvernement révolutionnaire :
- le développement futur et la réélection des conseils locaux d'ouvriers et de soldats pour que ce premier geste impulsif et chaotique de leur surgissement puisse être remplacé par le processus conscient d'auto-compréhension sur les buts, les tâches et la marche de la révolution;
- le rassemblement permanent de ces représentants des masses et la prise en main du pouvoir politique réel depuis le plus petit comité ('Vollzugsrat') à la plus large formation de conseils d'ouvriers et de soldats;
- la formation d'une garde rouge prolétarienne;
- l'appel immédiat à un congrès mondial d'ouvriers en Allemagne pour indiquer directement et clairement le caractère socialiste et international de la révolution. La révolution internationale, mondiale, du prolétariat est le seul point d'ancrage du futur de la révolution allemande" (Le début, 18 novembre 1918, Rosa Luxemburg, Oeuvres Choisies, Vol.4, édition est-allemande, p.398).
Partout les ouvriers étaient au centre des luttes. Les ouvriers se rassemblèrent en conseils d'ouvriers et de soldats dans presque toutes les grandes villes. Les syndicats, qui durant la guerre s'étaient eux-mêmes révélés être le meilleur rempart du capital, perdirent de l'influence pendant cette phase initiale. Comme Lénine l'avait dit, les conseils d'ouvriers et de soldats se révélaient être la forme enfin trouvée de l'organisation de la révolution ouvrière. Les ouvriers formaient des manifestations pour resserrer leurs rangs comme une seule classe, pour montrer leur véritable force dans la société. D'innombrables manifestations eurent lieu en novembre, décembre, dans la plupart des grandes villes allemandes. Elles étaient le point d'unification de la classe ouvrière par-delà toutes les limites d'usine et de région. C'est pourquoi les communistes y attachèrent autant d'importance dans leur agitation:
"En période de crise révolutionnaire, la rue appartient naturellement aux masses. Elles sont le seul refuge, la seule sécurité de la révolution... Leur présence même, les contacts entre elles, sont une menace et un avertissement contre tous les ennemis ouverts et cachés de la révolution." (Devoirs inaccomplis, Rosa Luxemburg, 8 janvier 1919, vol.4, p.524).
Tout comme en Russie, des résolutions étaient adoptées, des délégations mandatées, et des mesures prises contre les institutions étatiques. Les formes de lutte qui dans la décadence du capitalisme devaient devenir les armes typiques du prolétariat étaient en place : grèves sauvages, formation de conseils d'ouvriers et de soldats comme organes unitaires de la classe, manifestations de masse rassemblant tous les ouvriers quelle que soit leur profession, qu'ils aient ou non du travail, initiatives des ouvriers eux-mêmes.
Comme l'avaient proclamé en Russie les conseils ouvriers et les révolutionnaires à leur tête, la perspective du mouvement consistait en l'extension immédiate de la révolution aux autres pays pour la construction d'une société communiste:
"... Le moment des comptes avec la domination capitaliste est venu. Mais cette grande tâche ne peut pas être remplie par le seul prolétariat allemand. Ce dernier ne peut lutter et vaincre que s'il appelle à la solidarité des prolétaires du monde entier." ("Aux prolétaires de tous les pays", 25 novembre 1918, Spartakusbund).
Les ouvriers s'étaient entre massacrés comme chair à canon de chaque capital national dans la guerre impérialiste. La classe ouvrière en Europe était paralysée par le poison nationaliste. Surtout dans les pays "Vainqueurs" comme la France en particulier où la bourgeoisie sut utiliser la "victoire" pour entretenir le chauvinisme et le nationalisme parmi la classe ouvrière.
Les spartakistes, considérant cette faiblesse du prolétariat international, et convaincus qu'ils étaient de la nécessité de l'extension de la révolution, proclamaient ainsi:
"Souvenons-nous ! Vos capitalistes victorieux sont prêts à f supprimer dans le sang notre révolution qu'ils craignent tout autant que la vôtre. Vous n'êtes vous-mêmes pas devenus plus libres à travers la 'victoire', vous êtes seulement devenus plus esclaves. Si vos classes dominantes réussissent à étrangler la révolution prolétarienne en Allemagne et en Russie, elles se retourneront contre vous avec une férocité redoublée...Elisez des conseils d'ouvriers et de soldats partout pour prendre le pouvoir politique et établir la paix ensemble avec nous...". (Ibid.)
LA BATAILLE POUR LA PRISE DU POUVOIR PAR LES CONSEILS OUVRIERS
La classe ouvrière en Russie réussit à renverser le gouvernement bourgeois, après des mois de polarisation du pouvoir entre les soviets et le gouvernement provisoire, pour prendre le pouvoir elle-même à travers les soviets. Le gouvernement provisoire put être renversé sans bain de sang. Les conseils d'ouvriers et de soldats furent rapidement capables d'exercer un contrôle réel dans tout le pays. Ce fut seulement quelque temps APRES la prise du pouvoir victorieuse à travers les conseils de soldats et d'ouvriers, que la bourgeoisie put commencer une contre-offensive effective qui jeta le pays dans une guerre civile qui fit couler le sang des ouvriers et des paysans, avec le soutien des armées blanches, pour finalement pas à pas complètement les priver de leur pouvoir (Voir Revue internationale n°2).
Bien que le mouvement en Allemagne ait été mené par la classe ouvrière, qui mit en avant les mêmes perspectives en lien direct avec les luttes des ouvriers en Russie, les ouvriers en Allemagne ne réussirent pas à renverser la classe capitaliste. La bourgeoisie torpilla le pouvoir des conseils d'ouvriers et de soldats dès le début. Elle ne permit jamais la formation d'un nouveau centre de pouvoir des ouvriers. Elle provoqua des affrontements militaires prématurés pour la classe ouvrière, à un moment où celle-ci n'était pas encore mûre pour l'insurrection. Elle lança immédiatement des confrontations armées et infligea des coups dévastateurs aux ouvriers sur le terrain militaire, APRES avoir préparé politiquement ce terrain.
L'aspect le plus important fut le véritable désarmement politique, et la destruction politique des conseils d'ouvriers et de soldats de Berlin, qui survécurent seulement de nom (nom qui fut employé par le capital contre la révolution).
La mainmise des sociaux-démocrates sur les conseils, la transformation de ceux-ci en organes contrôlés par l'Etat bourgeois, la dénaturation des conseils ouvriers, ont eu pour effet de détruire de l'intérieur les conseils. De conseils-organes prolétariens pour l'organisation en classe du prolétariat et la destruction de l'Etat bourgeois, ils deviennent la caution de l'Etat social-démocrate avant que celui-ci les supprime définitivement par l'instauration de l'Assemblée nationale; fort de son contrôle sur les conseils, la social-démocratie peut organiser la provocation de janvier 1919 à Berlin pour décapiter le mouvement prolétarien et le parti spartakiste.
La montée du mouvement en novembre-décembre 1918 fut brisée dès les premiers mois de 1919.
Avec l'aide des corps francs, force militaire contre-révolutionnaire mise en place à la veille de la dissolution de l'armée régulière, à la fin de la guerre, avec l'aide du gouvernement social-démocrate SPD, la bourgeoisie parvint à massacrer les ouvriers de Berlin en janvier 19, de Brème en février, en mars en Allemagne centrale et dans la région de la Ruhr, en avril-mai à Munich, les uns après les autres, ville par ville, région par région, paquet par paquet, écrasant la colonne vertébrale du mouvement.
Bien que ceci n'ait pas mis fin à la combativité de la classe ouvrière, et que la classe ouvrière ait encore repris la lutte jusqu'en 1923 (du soulèvement contre le putsch du général Kapp en avril 1920, jusqu'au soulèvement en Allemagne centrale en mars 1921 et à Hambourg en octobre 1923), en fait le mouvement était défait dès les premiers mois de 1919.
LES ORIGINES DE LA DEFAITE AU COEUR DE LA VAGUE REVOLUTIONNAIRE
Tout comme l'échec des révolutions ouvrières les plus importantes de 1848, 1871, 1905, la vague révolutionnaire de 1917-23 ne fut pas simplement le résultat des fautes, ou même de l'absence d'une avant-garde révolutionnaire; dans le même sens, la défaite de la classe ouvrière en Allemagne ne peut pas simplement être expliquée par la faible influence et le manque d'expérience du Parti Communiste (nouvellement créé). L'influence relativement faible du KPD reflétait à son tour une faiblesse profondément ancrée dans la classe ouvrière elle-même : la difficulté à comprendre le changement fondamental pour la perspective communiste que constituait l'ouverture d'une nouvelle période historique de décadence et de décomposition du mode de production capitaliste.
Il est vrai que le retard dans la formation de fractions révolutionnaires en Allemagne a été une cause déterminante du retard des révolutionnaires allemands à affronter la nouvelle situation. Le parti communiste s'est formé trop tard et trop rapidement sous la poussée de la révolution de novembre, sans une longue tradition de luttes et de combat contre la bourgeoisie et les fractions bourgeoises dans la social-démocratie, dont la politique contre-révolutionnaire s'était révélée pleinement en 1914.
LA GUERRE n'est pas la meilleure condition pour l'issue victorieuse de la révolution
Néanmoins, bien qu'à la fois la Commune de Paris et la grève de masse de 1905 aient surgi dans des moments de guerre, le mouvement marxiste s'attendait à ce que la révolution soit déclenchée non en réaction à la guerre, mais comme conséquence ultime de la résistance du prolétariat à la crise économique.
La chute rapide du capitalisme dans le bain de sang de la 1ère Guerre mondiale rendait incomparablement plus difficile pour la classe ouvrière le développement d'une pleine conscience de la gravité réelle et la signification de cette guerre. Après avoir subi le massacre bestial de la guerre, la classe ouvrière était surtout consciente des conséquences de la guerre, sans être déjà consciente des autres conséquences de la décadence du capitalisme.
Ce fait avait déjà amené Rosa Luxemburg à tirer la conclusion suivante: "En partant de la base du développement historique, on ne peut pas attendre d'une Allemagne qui a présenté la terrible image du 4 août 1914 et des quatre années qui ont suivi, de pouvoir soudainement faire le 9 novembre 1918 l’expérience d'une magnifique révolution de classe consciente de ses buts. Ce que nous avons vécu le 9 novembre 1918 était aux trois-quarts plus un effondrement de l'impérialisme existant que la victoire d'un nouveau principe. Le moment était simplement venu pour que l'impérialisme, comme un géant aux pieds d'argile, pourri de l'intérieur, n'ait qu'à s'effondrer. Ce qui s'ensuivit fut un mouvement plus ou moins chaotique, sans plan, très peu conscient, dans lequel l'unique lien et principe resté sauf était résumé dans le seul slogan: formation de conseils d'ouvriers et de soldats." (Congrès de fondation du KPD, 1918-19, Oeuvres Choisies, vol.4, p.497).
Bien que le capitalisme soit à cette époque entré dans une phase de décomposition, ceci n'amena pas automatiquement et mécaniquement la classe ouvrière à comprendre toutes les implications du changement de période. La classe ouvrière souffrait encore du poids du réformisme et n'était pas capable de tirer toutes les leçons de cette nouvelle époque aussi rapidement que l'évolution des événements eux-mêmes.
L'illusion d'un retour à la prospérité du 19ème siècle fut renforcée à partir du moment où la bourgeoisie accordait la paix.
LES LEÇONS DE LA REVOLUTION EN ALLEMAGNE
Les anciennes armes du prolétariat se retournent contre les ouvriers
En Allemagne où la classe ouvrière au siècle dernier avait développé le plus le pouvoir des syndicats et du parti de masse, le SPD, ceci pesait d'un poids particulier. Les anciens piliers du prolétariat servaient désormais directement de gardes-chiourmes contre la classe ouvrière:
- les SYNDICATS passèrent un accord avec les patrons en 1914 pour interdire les grèves; sans cela, l'énorme production d'armements et la paix du début sur le "front de la production" n'auraient pas été possibles; ils agirent désormais comme forteresse contre les conseils d'ouvriers et de soldats;
- la participation aux ELECTIONS PARLEMENTAIRES, l'espoir d'obtenir des concessions de la part de la bourgeoisie dans la phase de décadence et d'utiliser la tribune du Parlement pour gagner les ouvriers hésitants à la cause de la révolution, se révéla non seulement être une illusion, mais aussi un dangereux poison;
- le SPD, sous le contrôle de la direction de droite, avec plusieurs millions de membres du parti, n'était pas seulement devenu inutile comme parti de masse, mais une arme directe du capital soutenant la guerre, puis ensuite dans l'écrasement des luttes révolutionnaires.
L'aile droite du SPD passa dans le camp de la bourgeoisie en 1914, à travers son vote aux crédits de guerre. Ceci se fit contre l'âpre résistance d'une petite minorité qui gagna du terrain au cours de la guerre, mais qui, en 1917, fut expulsée par la direction du SPD, et dont la majorité de cette minorité constitua l'USPD (Parti Social-Démocrate Indépendant). Après avoir été une arme du prolétariat, le SPD devait devenir le bourreau du prolétariat en 1918-19. En Allemagne où résidaient les plus importantes concentrations du prolétariat en Europe et où les ouvriers avaient accumulé l'expérience organisationnelle la plus étendue, la classe ouvrière souffrait aussi le plus du poids du réformisme et de l'influence de l'opportunisme.
Avec le surgissement des luttes révolutionnaires en 1918, la classe ouvrière non seulement ne put faire face aux armes qu'elle avait elle-même forgées et utilisées au siècle dernier et qui étaient maintenant tombées dans les mains de ses bourreaux, mais elle avait aussi à combattre contre le poids des traditions du réformisme.
Mais la reconnaissance que ces anciennes armes (parlement, syndicats) sont devenues caduques ne tombe pas du ciel et doit être élaborée dans la pratique. Le prolétariat n'a pas d'autre chemin d'apprentissage qu'à travers sa propre expérience.
La transition du capitalisme de sa phase ascendante à sa phase de décadence était un facteur objectif. Mais la classe ouvrière elle-même n'avait fait que commencer à tirer les premières leçons du changement de situation. Même les organisations révolutionnaires, l'avant-garde du prolétariat, étaient loin d'avoir tiré les leçons de cette nouvelle période.
La gauche de la social-démocratie avait déjà commencé avant la guerre à se confronter à la reconnaissance de l'apparition d'une nouvelle période (cf. les positions de Luxemburg, Pannekoek, Radek, etc., sur la grève de masse, le parti, la question nationale, la lutte contre le réformisme et l'opportunisme). Mais l'avant-garde révolutionnaire ne prit elle-même position que dans le feu de la lutte sur beau coup de ces questions. Dans les premières années après 1914, il n'y avait pas encore d'assimilation profonde et étendue de toutes les implications du changement de période.
La leçon première de la révolution allemande - sur laquelle nous reviendrons dans un prochain article - est évidemment la question du rapport du prolétariat à l'Etat bourgeois, des conseils comme organes du pouvoir dont le rôle est non seulement d'organiser unitairement le prolétariat mais de détruire l'ensemble de l'Etat capitaliste. L'échec de l'Allemagne vérifie par la négative la justesse des Thèses d'Avril de Lénine en 1917. Les conseils ouvriers doivent prendre le pouvoir et détruire l'ensemble de l'appareil politique de la bourgeoisie, dont la social-démocratie en Allemagne était le principal défenseur idéologique, et même le corps armé par l'organisation des corps francs dès décembre 1918. Nous reviendrons sur ces principales leçons, décisives pour l'avenir de la future révolution mondiale.
Le capitalisme était entré dans sa période de décadence avec la 1ère guerre mondiale. La nécessité de sa transformation par une révolution prolétarienne mondiale se trouva ainsi à l'ordre du jour de l'histoire ainsi que le souligna 1l'Internationale communiste
"Une nouvelle époque est née. Epoque de désagrégation du capitalisme, et de son effondrement intérieur. Epoque de la révolution communiste du prolétariat". (Plate-forme de l’IC, 1919).
Les pré conditions objectives de la révolution prolétarienne étaient remplies. Mais, par elles-mêmes, elles ne suffisent pas. Bien que le capitalisme développe un cours irrésistible vers la destruction, il ne se détruira pas lui-même. Seule la classe ouvrière est capable de l'abolir. Mais pour ce faire, le fossoyeur de l'ancienne société, le prolétariat, doit avoir suffisamment développé ses armes (sa conscience et sa capacité organisationnelle) pour détruire véritablement le système capitaliste. La première vague révolutionnaire, dont la clé de la généralisation à l'échelle mondiale résidait dans les mains de la classe ouvrière en Allemagne, échoua finalement parce que le prolétariat, après quatre ans de boucherie dans les tranchées, ne réussit pas à se relever de la déroute politique d'août 14 avec la trahison des grands partis sociaux-démocrates appelant à l'union nationale et à la participation à la guerre impérialiste.
Bien que l'insurrection ait échoué et ait abouti à une défaite, elle reste néanmoins une partie de l'expérience internationale et historique de la classe ouvrière mondiale. L'insurrection victorieuse en Russie, tout autant que la défaite rapide des ouvriers en Allemagne, sont deux éléments- clés dans la vague révolutionnaire, deux parties d'un seul et même processus, deux expériences d'une seule et même tentative de la classe ouvrière de renverser le système capitaliste.
(à suivre) Dino. Eté 88.
Quelques dates :
1914
4 août : la fraction parlementaire du SPD vote à l'unanimité (moins Ruhle) les crédits de guerre ; l'opposition commence à se rassembler.
1915
Février : Liebknecht mobilisé, Rosa Luxemburg emprisonnée.
Mars : Liebknecht et Ruhle votent contre les crédits de guerre.
Mai : tract de Liebknecht "L'ennemi est dans notre pays".
Décembre : 18 députés "centristes" votent contre les crédits militaires.
1916
1er Mai : manifestations ouvrières pour la paix.
Juin : grèves et manifestations en faveur de Liebknecht
1er Septembre : première Lettre de Spartakus
1917
Février : début de la révolution en Russie.
Avril : grèves à Berlin, premiers conseils ouvriers à Berlin et Leipzig ; l'opposition contre la guerre, exclue par la droite du SPD, forme l'USPD.
Août : manifestations de marins.
Octobre : le prolétariat prend le pouvoir en Russie.
Décembre : négociations de paix russo-allemande de Brest-Litovsk.
1918
Janvier : vague de grèves en Autriche et en Hongrie; vague de grèves à Berlin de 400 000 ouvriers ; le Conseil ouvrier de Berlin est formé.
Printemps et été : série de grèves, en particulier dans l'armement.
Octobre:
le 3 : le SPD entre au le gouvernement,
le 30 : les marins de Kiel refusent de repartir au front.
Novembre :
le 4 : la répression contre les marins provoque une vague de solidarité ; des conseils d'ouvriers et de soldats sont formés dans une douzaine de villes;
le 8 : le premier Gouvernement républicain est formé en Bavière ;
le 9 : accord entre le SPD et le Commandement militaire suprême contre la révolution ; l'Empereur abdique; Ebert, dirigeant SPD, chancelier du Conseil des commissaires du peuple; 3 membres du SPD et 3 membres de l'USPD forment ce gouvernement bourgeois au nom de la révolution.
le 10 : formation du Conseil d'ouvriers et de soldats du grand Berlin; son pouvoir est contrebalancé par le Conseil des commissaires du peuple.
le 11 : armistice ; organisation de la Ligue Spartakus avec une centrale.
le 12 : capitalistes et syndicats mettent en place le code du travail (journée de 8 heures sans perte de salaire décrétée pour le 1er janvier 1919).
le 16 : le SPD organise les corps francs (troupes contre-révolutionnaires).
le 23 : le Conseil d'ouvriers et de soldats de Berlin délègue le pouvoir exécutif au Conseil des commissaires du peuple.
Décembre :
les 6 et 8 : affrontements militaires et grandes manifestations à Berlin.
du 16 au 21 se tient le congrès des Conseils d'ouvriers et de soldats de Berlin ; 250 000 ouvriers manifestent sous la direction des Spartakistes.
le 23 : affrontements militaires à Berlin.
le 25 : manifestation de masse à Berlin; le quotidien du SPD est occupé.
le 29 : l'USPD quitte le gouvernement, Noske Ministre de la guerre.
les 30,31 et le 1er janvier 1919 se tient le Congrès de fondation du KPD
1919
Janvier:
le 5 : grandes manifestations à Berlin.
du 6 au 12 : batailles de rue à Berlin, Stuttgart, Nurenberg, Brème, Dusseldorf ; les corps francs rétablissent l'ordre à Berlin.
le 10 : proclamation d'une République des Conseils à Brème.
le 15 : assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht à Berlin.
le 16 : le "Rote Fahne", journal quotidien du KPD, est déclaré illégal.
le 26 : élections de l'assemblée constituante.
Février :
du 2 au 4 : écrasement de la République de Brème par les corps francs
le 11 : vague de grèves dans la Ruhr, Ebert élu président.
du 18 au 22 : intervention militaire par les mêmes corps francs
le 24 : grève générale en Allemagne centrale, en Saxe.
Mars :
le 2 : congrès de fondation de l'Internationale communiste à Moscou.
du 3 au 8 : grève générale à Berlin et "semaine sanglante" : intervention des mêmes corps francs de retour de la Ruhr
7 Avril : proclamation de la République des conseils de Bavière.
1er Mai : prise de Munich et massacre par les corps francs.
28 Mai : fin de la grève dans la Ruhr.
Fin Juin : grève des cheminots.
Août : liquidation de la République des conseils de Hongrie.
Géographique:
- Allemagne [107]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [287]