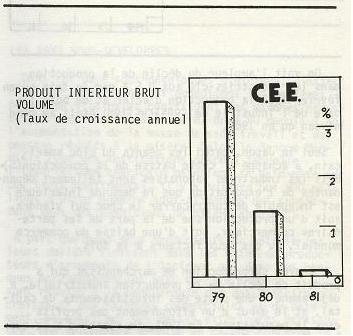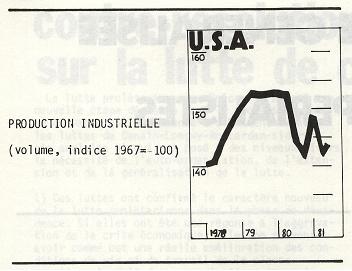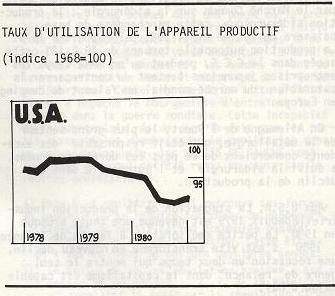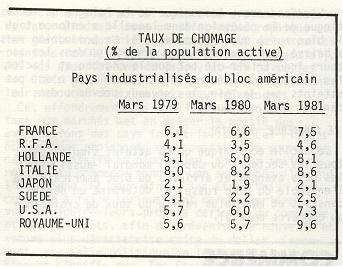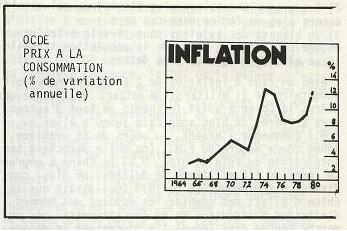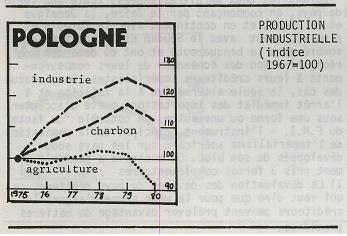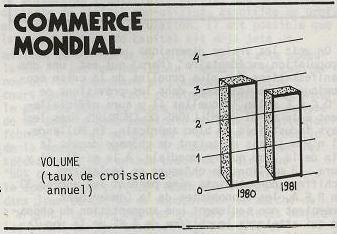Revue Int. 1981 - 24 à 27
- 3746 lectures
Revue Internationale no 24 - 1e trimestre 1981
- 2631 lectures
La dimension internationale des luttes ouvrières en Pologne
- 2430 lectures
1) Dans la Revue Internationale du CCI n°20, nous définissions les années 80 dans lesquelles nous allions entrer comme "les années de vérité", celles où allait se décider pour une bonne part l'alternative historique ouverte par la crise aiguë du capitalisme : guerre mondiale ou révolution prolétarienne.
Première année de cette
décennie, l'année 80 est venue illustrer de façon on ne peut plus significative
cette perspective. Ainsi, alors que la
première moitié de l'année est, malgré les mouvements sociaux importants comme
celui de la sidérurgie en Grande-Bretagne, dominée par l'aggravation
considérable des tensions inter-impérialistes faisant suite à l'invasion de
J'Afghanistan, la seconde moitié est déjà marquée par une accentuation sans
précèdent des luttes du Prolétariat qui atteignent en Pologne le point le plus
élevé depuis la reprise historique des combats de la classe ouvrière mondiale
en 1968. Si, pendant six mois, la bourgeoisie a paru avoir les mains libres
pour déchaîner ses campagnes bellicistes et pour préparer un troisième
holocauste mondial, l'inquiétude qui s'exprime aujourd'hui dans la classe
dominante de tous les pays face aux luttes ouvrières de Pologne, 1’unité
qu'elle manifeste dans sa tentative de les faire taire, constituent une
nouvelle illustration du fait que le prolétariat, par sa lutte, est la seule
force dans la société qui peut empêcher le capitalisme d'apporter sa réponse
guerrière à la crise de son économie.
2) L'heure n'est pas encore venue de faire un bilan définitif des luttes du prolétariat en Pologne car le mouvement est encore en cours et na pas épuisé toutes ses potentialités présentes . Cependant 5 mois après le début des luttes, on peut dores et déjà en tirer un certain nombre d’enseignements importants et il est nécessaire de situer le point où il est parvenu aujourd'hui.
Dès à présent, en effet, on peut mettre en évidence deux éléments :
- l’énorme importance de ce mouvement, le pas considérable qu'il représente pour le prolétariat de tous les pays,
- le fait qu'on ne peut le
comprendre et qu'on ne peut en dégager les perspectives que dans le
cadre mondial.
3) Un peu partout, la bourgeoisie et ses valets de presse s'emploient à essayer de démontrer que les luttes ouvrières en Pologne s'expliquent par des caractéristiques propres à la Pologne ou, au mieux, par des caractéristiques propres aux pays d'Europe de l'Est. A Moscou, on raconte que, s'il y a des difficultés en Pologne (ce qu'on ne peut plus cacher), cela résulte "d'erreurs"'de la précédente direction polonaise. Rien à voir avec la situation en Russie, évidemment ! A Paris, Bonn, Londres et Washington, on aime dire que c'est parce qu'ils n'ont pas de "libertés" à l'occidentale, qu'il manque la démocratie et qu'ils sont fatigués des queues devant les magasins, que les ouvriers d'Europe de l'Est sont mécontents. En Occident, par contre, ils n'ont aucune raison majeure de se plaindre. Que les ouvriers en Pologne résistent contre les atteintes d'une même crise, qu'ils luttent contre une même exploitation que celles que subissent leurs frères de classe de l'Ouest et de partout ailleurs, qu'ils montrent le chemin en quelque sorte : quelles idées absurdes !
Lorsque quelque part dans le
monde se dévoile un pan du tableau qui risque d'être son cauchemar : la
lutte généralisée du prolétariat contre le capitalisme, la bourgeoisie
s'empresse de hurler bien fort : "cas particulier" et s'emploie
fébrilement à découvrir toutes les différences qui distinguent ce "quelque
part" des autres endroits. Et ces
différences, elle n'a pas besoin de les inventer toutes. C'est vrai que dans les pays du monde, tous
ne sont pas dans une situation identique.
C'est vrai que certaines caractéristiques du mouvement en Pologne sont
données par le cadre spécifique de ce pays, de sa situation économique,
politique et sociale propre, de ses particularités historiques, comme aussi par
le cadre des pays de l'Est et du bloc russe.
Mais, pour les révolutionnaires et la classe ouvrière, il doit être
clair également que les caractéristiques particulières ont une importance
seulement circonstancielle et qu’elles ne peuvent se comprendre elles-mêmes que
dans une vision qui, évidemment tient compte des rythmes différents selon les
pays d'enfoncement dans la crise mais qui englobe l'ensemble du monde
capitaliste.
4) Le cadre général dans lequel se déroulent les évènements de Pologne est donné par les éléments suivants :
a) le caractère mondial et général de la crise économique;
b ) l'aggravation inexorable de celle-ci et les sacrifices de plus en plus cruels qu'elle impose aux exploités;
c) la reprise historique du prolétariat mondial depuis la fin des années 60;
d) la nature des problèmes et des difficultés auxquels se heurte la classe ouvrière, les nécessités qui s'impose à elle dans sa lutte ;
- la confrontation avec l'obstacle syndical,
- l'auto organisation de sa lutte, l'importance des assemblées générales,
- l'élargissement du combat, l'emploi de la grève de masse;
e) les moyens mis en avant par la bourgeoisie pour briser le combat prolétarien et imposer à la classe les exigences économiques et militaires du capital national :
- emploi d'une répression et d'un encadrement policiers de plus en plus systématiques,
- utilisation de multiples mystifications destinées soit à prévenir, soit, quand ce n'est plus possible, à dévoyer dans des impasses les explosions ouvrières.
Les différents secteurs de
la bourgeoisie des pays avancés se partageant en général aujourd'hui le travail
avec une droite au gouvernement et une gauche dans l'opposition.
5) Les conditions particulières dans lesquelles s inscrivent les évènements en Pologne relèvent, soit de son appartenance au bloc de l'Est,' soit à des spécificités propres à ce pays.
Comme pour l'ensemble des pays de ce bloc, la situation en Pologne se caractérise par :
a) l'extrême gravité de la crise qui jette aujourd'hui des millions de prolétaires dans une misère proche de la famine ;
b) la grande rigidité des institutions qui ne laissent pratiquement aucune place pour une possibilité de surgissement de forces politiques bourgeoises d'opposition capables de jouer le rôle de tampons : en Russie et par suite dans ses pays satellites, tout mouvement de contestation risque de cristalliser l'énorme mécontentement qui existe au sein d'un prolétariat et d'une population soumis depuis des décennies à la plus violente des contre-révolutions. laquelle est à la hauteur du formidable mouvement de la classe qu'elle eut à écraser : la révolution de 1917
c) l'énorme importance de la terreur policière comme moyen
pratiquement unique de maintien de l'ordre;
Par ailleurs, la Pologne se distingue par
a) l'oppression nationale plus que séculaire subie de la part surtout de la Russie et qui, en se perpétuant aujourd'hui sous d'autres formes donne un poids très grand au nationalisme parmi les mystifications qui pèsent sur la classe ouvrière ;
b) l'importance de la religion catholique ressentie depuis des
siècles comme une manifestation de résistance contre cette oppression, comme un
symbole de l'identité nationale de la Pologne (qui est le seul pays catholique du monde
slave) et qui a canalisé depuis 30
ans une part du mécontentement contre le régime stalinien.
6) Les spécificités de la situation en Pologne permettent
d'expliquer certains aspects des mystifications que le capitalisme fait peser
sur le cerveau des prolétaires :
- les illusions démocratiques relèvent directement du caractère totalitaire du régime qui règne dans les pays d'Europe de l'Est ;
- le nationalisme et l'opium religieux résultent pour une grande part de l'histoire de la nation polonaise.
En fait, les aspects du mouvement des ouvriers de Pologne qui sont les plus tributaires des spécificités de ce pays concernent justement les faiblesses de ce mouvement : ce qui relève encore l'influence des idées bourgeoises et du poids du passé dans les rangs prolétariens trouve dans les particularités son meilleur complice dans la mesure où elles sont l'expression d'un monde divisé, déchiré en nations, en classes, en catégories de toutes sortes, comme d’une classe qui ne peut vivre que par la reproduction de ces divisions.
Par contre, ce qui fait la force du prolétariat en Pologne n'est nullement spécifique aux luttes qu'il mène dans ce pays. Est un élément de force pour le prolétariat tout ce qui exprime son autonomie de classe, sa rupture avec l'atomisation et les divisions du passé, tout ce qui annonce les objectifs généraux et ultimes de son mouvement, tout ce qui rejète les aliénations locales et ancestrales pour se tourner avec audace vers le seul avenir possible pour l'humanité : le communisme qui abolira les antagonismes entre les hommes, qui réalisera la communauté humaine.
Dans ce contexte, les spécificités de la situation en Pologne ont surtout pour résultat de faire apparaître, souvent de façon beaucoup plus nette qu'ailleurs et parfois caricaturale, les caractéristiques fondamentales -et qui demain concerneront tous es pays- tant, du mouvement prolétarien de notre époque, que des conditions qui le font surgir et des bouleversements qu'il provoque dans la société et au sein de la classe dominante.
Extrême gravité de la crise économique, brutalité de l'attaque contre la classe ouvrière, rejet croissant par le prolétariat du cadre syndical, auto-organisation de la classe, grève de masse, convulsions politiques de la bourgeoisie : autant de "spécificités" qui ne sont pas "polonaises", mais qui sont celles de notre époque et concernent toute la société.
7) La situation catastrophique de l'économie des pays du bloc de l'Est, et notamment de la Pologne, non seulement ne peut s'expliquer hors du cadre de la crise générale du capitalisme (ce qui à l'Est et à l'Ouest devient une évidence même pour ces ânes qu'on appelle "économistes") mais montre, par bien des aspects, le chemin dans lequel s'engage de plus en plus l'économie de tous les pays, y compris celle des grandes puissances industrielles les plus épargnées jusqu'ici. L'état de misère de plus en plus intolérable qui se développe aujourd'hui dans le prolétariat polonais préfigure, quant à lui, celui qui va tendre à frapper de plus en plus le prolétariat de ces grandes puissances, même si les modalités immédiates de cette misère (bas salaires et pénurie à l'Est, chômage à l'Ouest), diffèrent suivant que le régime est capable d'éjecter de la production tout un secteur de la classe ouvrière, ou incapable de le faire sous peine de voir sa production chuter encore plus et de perdre tout contrôle sur cette masse d'ouvriers qui seraient soustraits à l'encasernement des bagnes industriels.
Enfin, de la même façon que l'aggravation de la
misère en Pologne (notamment par les brusques augmentations des prix de la
nourriture) a été l'élément décisif qui a poussé le prolétariat à se révolter
malgré une terreur policière et un écrasement physique comparables à l'état de
siège des temps de guerre, l'aggravation de la misère dans les autres pays
contraindra le prolétariat à secouer le joug de la répression et des
mystifications bourgeoises.
8) De même, si c'est la
totale et évidente intégration des syndicats dans l'appareil étatique, telle
qu'elle existe dans les régimes staliniens qui a d’emblée posé pour les
ouvriers polonais le nécessité de rejeter ces organes, ces ouvriers n'ont fait
en cela que montrer le chemin à leurs frères de classe des pays où les
syndicats n'ont pas encore dévoilé aussi clairement leur nature
capitaliste. Mais la démarche du
prolétariat en Pologne ne s'est arrêtée à la dénonciation des syndicats
officiels, il tend de plus en plus à déborder les syndicats "libres"
à l'idée desquels il s'était rallié dans son aspiration à se pourvoir
d'organisations indépendantes de l'Etat afin de se prémunir contre la riposte
prévisible de la bourgeoisie. En
quelques mois, l'expérience vivante des ouvriers de Pologne a fait la démonstration
de 1 'impossibilité pour la classe ouvrière, dans la période de décadence, du
capitalisme de se doter, sans qu'ils deviennent des obstacles à la lutte, d'organes permanents de type syndicats. Là encore le prolétariat de Pologne ne fait que montrer le chemin au reste de la classe qui devra, à son tour, repousser les chants de sirène de toutes les formes de syndicalisme "radical", "de combat" ou"de base" dans sa lutte contre le capital.
9\ La Pologne constit,ue une nouvelle illustration de cette loi qui veut que dans les périodes de crise aiguë de la société on assiste à une accélération de l'histoire. Dans le domaine de la dénonciation du rôle des syndicats, les ouvriers de Pologne ont accompli en quelques mois le chemin que le prolétariat des autres pays a mis plusieurs générations à parcourir. Mais ces progrès accélérés ne concernent pas seulement le problème des syndicats. Sur deux autres plans également, celui de l'auto organisation et celui de la généralisation des luttes, (évidement liés entre eux et à la question syndicale), la classe ouvrière de Pologne a été projetée à l'avant-garde du prolétariat mondial.
Là encore, les "particularités" de la situation en Pologne et en Europe de 1"Est (qui sont des caractéristiques générales du capitalisme décadent mais poussées encore plus loin qu'ailleurs) ont conduit les ouvriers de ce pays à réouvrir des voies dans lesquelles devront s'engouffrer les prolétaires du monde entier.
Ainsi, l'habituel emploi massif et systématique du mensonge par les autorités de même que le contrôle totalitaire exercé par l'Etat sur chaque aspect de la vie sociale a poussé les ouvriers polonais à faire faire à l'auto organisation de la classe d'immenses progrès par rapport à ce que nous avions connu jusqu'ici. La mise a profit de la technique moderne (hauts parleurs branchés sur les salles de négociation, répercussion à la base des débats en assemblées centrales grâce à leur enregistrement sur cassettes) pour permettre un meilleur contrôle des assemblées générales sur les organes dont elles se sont dotées, une plus grande participation des travailleurs à leur lutte, sont un exemple à suivre pour les ouvriers de tous les pays.
De même, face à un Etat ayant une forte propension à employer la répression sanglante, qui gouverne par la terreur et par une atomisation extrême des individus, le prolétariat polonais, malgré les tentatives gouvernementales de diviser le mouvement, a su employer de façon efficace cette arme si importante de ses combats dans la période actuelle et seule capable de paralyser le bras de la répression comme de surmonter l’atomisation : la grève de masse, la généralisation de ses luttes. Son aptitude à se mobiliser de façon massive non seulement pour la défense de ses intérêts spécifiques mais aussi en solidarité avec la lutte des autres secteurs de la classe est une expression de l'être profond de la classe ouvrière, de cette classe qui porte en elle le communisme, et qui devra partout dans le monde manifester cette unité qui lui est vitale pour être à la hauteur de ses tâches historiques.
10) Ce n'est pas seulement sur le plan de la lutte du prolétariat que les événements de Pologne préfigurent la situation qui va tendre à se généraliser dans tous les pays industrialisés. Sur le plan des convulsions internes de la classe dominante ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays donne une idée y compris dans ses aspects caricatu raux, de ce qui couve dans les entrailles de la société. Depuis le mois d'août c'est une véritable panique qui s'est emparée des sphères dirigeantes du pays. Dans les sphères gouvernementales, c'est, depuis 5 mois, la valse des porte-feuilles ministériels dont on est allé jusqu'à en confier un à un catholique. Mais c'est dans la principale force dirigeante, le parti, que se manifestent avec le plus de violence ces convulsions. A l'heure actuelle, le POUP donne l'impression d'une immense foire d'empoigne où les différentes cliques se tirent dans les jambes à qui mieux mieux, règlent leurs vieux comptes, satisfont des vengeances personnelles, font passer leurs intérêts particuliers par dessus l'intérêt du parti et du capital national. Dans l'appareil, les limogeages vont bon train; l'instance suprême, le Bureau Politique, est bouleversée. L'homme "qui savait parler aux ouvriers", Gierek, subit le même sort qu'il avait infligé en 71 à Gomulka. Il est même chassé comme un malpropre du Comité Central, en violation de la loi du parti. A tous les échelons, on trouve des boucs émissaires, au point qu'on doit faire appel pour les remplacer à des vieux chevaux de retour, déjà déconsidérés en leur temps comme l'anti-sémite virulent Moczsar. Même la base du parti, cette base d'habitude si servile, si silencieuse, est atteinte par ces bouleversements. Plus de la moitié des militants ouvriers ont quitté les syndicats officiels (ces "forces saines" comme dit "la Pravda") pour rejoindre les syndicats indépendants. On voit même des organismes de base se coordonner en dehors des structures officielles et dénoncer "le bureaucratisme de l'appareil".
Cette panique qui s'est abattue sur le parti est à la mesure de l'impasse dans laquelle se trouve la bourgeoisie polonaise. Face à l'explosion du mécontentement ouvrier, elle a été conduite à laisser apparaître et se développer des forces d'opposition -les syndicats indépendants- dont la fonction s'apparente à la gauche dans l'opposition telle qu'on la connaît aujourd'hui dans la plupart des pays occidentaux. Même langage, en apparence "radical" et "ouvrier" pour mieux canaliser et dévoyer la combativité prolétarienne, même solidarité de fond avec "l'intérêt national". Mais, pas plus aujourd'hui qu'hier, le régime stalinien ne peut tolérer sans dommage ni danger l'existence de telles forces d'opposition. Sa fragilité et sa rigidité congénitales n'ont pas disparu par enchantement, par la grâce de l’explosion des luttes ouvrières. Bien au contraire! Ainsi, contraint de tolérer dans ses entrailles un corps étranger, dont il a besoin pour survivre, bien qu'il arrive à peine à tenir son rôle, mais que rejette toutes les fibres de son organisme, le régime est plongé aujourd'hui dans les convulsions les plus douloureuses de son histoire.
Les antagonismes au sein de la classe dominante d'un pays ne sont chose nouvelle. Ce sont ces antagonismes -réels- qui sont aujourd'hui utilisés en occident pour désorienter la classe ouvrière avec une droite au gouvernement qui prend des mesures d'austérité de plus en plus violentes, et une gauche qui les dénonce avec fracas pour mieux les faire accepter par les ouvriers. En "temps normal", ces divisions au sein de la bourgeoisie, si d'un côté elles constituent une faiblesse, notamment dans la compétition internationale, d'un autre côté, sont un facteur de renforcement face à la classe ouvrière, lorsqu'elles sont exploitées correctement comme élément de mystification. Mais, à un certain degré de ces divisions et de puissance de la lutte de classe. elles se retournent contre la classe dominante elle-même. Incapable de faire adhérer plus longtemps les ouvriers à l'une ou l'autre des fausses alternatives qu'elle présente, celle-ci, par ses déchirements, fait au contraire la preuve qu'elle devient incapable de gouverner la société. De facteur de paralysie pour, le prolétariat, ces antagonismes deviennent alors des stimulants de sa lutte.
Ainsi, alors que les réticences de l'appareil devant l'acceptation du principe des syndicats indépendants (fin août) et devant l'enregistrement de leurs statuts (fin octobre) avaient permis, en polarisant une bonne part de l'attention des ouvriers sur cette question, d'affaiblir leurs revendications économiques, l'arrestation (fin novembre) de deux militants de "solidarité" a abouti à une reculade sans gloire du pouvoir, y compris sur une question aussi épineuse que le contrôle sur les forces de répression, devant la menace d'une nouvelle grève généralisée.
L'exemple donné par les convulsions de la bourgeoisie polonaise nous montre d'une certaine façon à quoi ressemble une classe dominante lorsqu'elle est acculée par la lutte de classe. Ces dernières années, les crises politiques n'ont pas manqué (comme celle du Portugal en 1974-75) mais, jusqu'à présent, nulle part le prolétariat n'avait été un facteur aussi important des convulsions internes de la bourgeoisie. Des crises politiques au sein de la classe dominante provoquées directement par la lutte de classe : voilà un phénomène qui lui aussi, va se généraliser dans les années qui viennent!
11) Ce que traduit l'ampleur des convulsions de la bourgeoisie polonaise, c'est évidemment la grande fragilité de son régime, mais c'est aussi, d'une manière beaucoup plus fondamentale, la force du mouvement des ouvriers de Pologne, de cette lame de fond qui depuis 5 mois bouleverse le pays et secoue l'Europe et même le monde.
La force du mouvement, on l'a déjà mise en évidence, dans sa capacité à briser le carcan syndical, à déborder celui des syndicats de rechange, à se donner les moyens d'une réelle auto-organisasation de la classe, d’une généralisation effective et efficace des luttes. Mais elle réside également dans sa durée : 5 mois de mobilisation quasi permanente des ouvriers, de discussions incessantes et de réflexion sur les problèmes qui se posent à leur classe.
5 mois, pendant lesquels, loin de s'essouffler, le mouvement s'est durci, où il est passé d'une simple réaction contre les hausses de prix de la viande à une suite d'épreuves de force frontales avec l'Etat, culminant avec une mobilisation de 1a concentration ouvrière la plus décisive du pays, celle de la capitale, pour faire capituler les autorités et leur imposer la libération des travailleurs arrêtés.
5 mois pendant lesquels le combat a assumé de plus en plus ses implications politiques, où les revendications économiques ont gagné en ampleur et en profondeur, où les revendications politique ont acquis un caractère de plus en plus radical, passant de demandes encore influencées par l’idéologie bourgeoise. comme celle des syndicats libre ou du droit d'expression à la télévision pour l'Eglise, aux exigences carrément intolérables pour n'importe quel gouvernement au monde -parce que relevant d'une dualité de pouvoir- de contrôle et de limitation de l'appareil répressif.
5 mois au cours desquels ceux qui au début, tel Walesa faisaient figure de "radicaux" , "d'extrémistes" sont devenus de véritables pompiers volants, dépêchés par les autorités vers chaque nouvel incendie, au cours desquels la petite minorité qui avait rechigné pour accepter les accords de Gdansk est devenue une forte minorité qui ne s'en laisse plus compter facilement par tous les Kuron et Walesa réunis, où, même si ces "dirigeants" conservent leur popularité, la dynamique n'est pas à un renforcement de leur autorité mais-à une remise en cause croissante de l'orientation "responsable" qu'ils préconisent de la part des assemblé ouvrières lesquelles ne se laissent plus convaincre en quelques minutes de "la nécessité des compromis" comme à Gdansk , le 30 août, mais font la sourde oreille pendant des heures aux chants de sirène du "réalisme", comme à Huta Warsawa le 27 novembre.
5 mois enfin, pendant
lesquels le prolétariat a gardé l'initiative face à des réactions brouillonnes
et incohérentes de la bourgeoisie.
12) Il en est qui font grand cas des faiblesses -réelles- du
mouvement des ouvriers en Pologne illusions démocratiques, et néo-syndicales,
influence de la religion et du nationalisme, pour conclure à la faible
importance ou profondeur de ce mouvement.
Il est évident que si l'on s'attend à ce que la classe ouvrière, dès
qu'elle surgit quelque part, ait totalement rompu avec l'ensemble des mystifications
que le capitalisme fait peser sur elle depuis des siècles, qu'elle ait du jour
au lendemain une claire vision des buts ultimes et des moyens de son mouvement,
qu'elle ait, en d'autres termes, une conscience communiste, alors effectivement
on risque d'être déçu par ce qui se passe en Pologne, comme d'ailleurs par tout
mouvement ouvrier avant le triomphe de la révolution. L'inconvénient avec une telle vision qui en
général se targue de "radicalisme", c'est qu'en plus d'exprimer
l'impatience et le scepticisme, typiques de la petite bourgeoisie, elle tourne
complètement le dos au mouvement vivant de la lutte de classe. Le mouvement du
prolétariat est un processus qui se dégage péniblement de la gangue du
capitalisme dans lequel il est né. Comme
les révolutionnaires, et en particulier Marx, l'ont souvent souligné, les oripeaux du vieux monde lui collent
longtemps à la peau et ce n'est qu'à travers une expérience douloureuse, à la
suite de tentatives répétées, qu'il parvient progressivement à s'en dépouiller
pour découvrir et affirmer ses desseins propres et véritables. Le "révolutionnaire" de la phrase
confond le début et la fin du mouvement.
Il voudrait qu'il soit arrivé avant d'être parti. Il en fait une photographie et, après avoir
confondu l'image et son modèle, il accuse ce dernier d'être immobile. Dans le cas de la Pologne, au lieu de voir
la rapidité avec laquelle les ouvriers ont franchi des étapes essentielles de
leur mouvement : le rejet de la peur, de l'atomisation, la conquête de la solidarité,
de l'auto organisation, l'emploi de la grève de masse, il ne voit que le
nationalisme et la religion, que l'expérience ne leur a pas encore permis de
surmonter. Au lieu de voir la dynamique
de rejet et de débordement de la structure syndicale, il ne voit que les
illusions qui subsistent à l'égard de celle-ci.
Au lieu de prendre la mesure du chemin considérable déjà parcouru par le
mouvement , il n’a d'yeux que pour celui qui lui reste à faire et s’en
décourage.
Les révolutionnaires ne cachent jamais à leur classe la longueur du chemin et les difficultés qui J'attendent. ils ne sont pas des "docteurs tant mieux! ". Mais, pour qu'ils puissent jouer leur rôle de stimulation de la lutte, qu'ils participent réellement à une prise de conscience par la classe de sa propre force, il ne sont jamais des "docteurs tant pis".
Ceux qui font aujourd'hui la moue devant les luttes des ouvriers de Pologne auraient pu dire en mars 1871 : "Bah! les ouvriers parisiens, sont nationalistes" et en janvier 1905 :"Bof! les ouvriers russes manifestent derrière des icônes."et ils seraient passés à côté des deux expériences révolutionnaires du prolétariat mondial les plus importantes avant 1917.
13) Une autre façon de sous-estimer l'importance du mouvement actuel en Pologne consiste à considérer qu'il serait allé moins loin qu'en 1970 ou 1976 parce qu'il ne se serait pas affronté de façon violente à l'Etat et à ses hordes répressives . Ce qu'ignore une telle conception, c est que :
-le nombre de tués que laisse la classe ouvrière dans un combat n'a jamais été une manifestation
de sa force,
-ce qui a fait reculer la bourgeoisie polonaise en 1976 ou en 1970, ce n'est pas l'incendie de quelques sièges du parti, mais bien la menace d'une généralisation du mouvement, notamment après le massacre des ouvriers,
- en 1980, la bourgeoisie s'est interdit jusqu présent d'employer la répression sanglante car c'était le meilleur moyen de radicaliser le mouvement surtout tant qu'il est ascendant,
- forts de leur expérience passée, les ouvriers savaient que leur force véritable ne résidait pas dans affrontements ponctuels avec la police, mais dans l'organisation et l'ampleur du mouvement de grève,
-si l'insurrection armée est
une étape indispensable du prolétariat sur le chemin du pouvoir et de son
émancipation, elle est une toute autre chose que les émeutes qui jalonnent en
grand nombre sa lutte contre l'exploitation.
L'émeute, telle qu'on l'a vu
en 1970 et 1976 par exemple, à Gdansk, à Gdynia, à Radom est une réaction
élémentaire, ponctuelle et relativement peu organisée de la classe sous le coup
de la colère ou du désespoir. Sur le
plan militaire, elle est finalement condamnée à la défaite même si, par
ailleurs, elle peut faire reculer momentanément la bourgeoisie. L'insurrection, par contre, telle qu' elle
prend place au point culminant d'un processus révolutionnaire comme en octobre
1917, est un acte délibéré, réfléchi, organisé et conscient de la classe.
Parce qu'elle a pour objectif la prise du pouvoir, elle vise non pas à faire
reculer la bourgeoisie, à lui arracher des concessions, mais bien à la battre
militairement et à détruire de fond en comble ses organes de pouvoir et de
répression. Cependant, bien plus qu'une
question militaire et technique, l’insurrection est une question politique :
ses armes essentielles sont l'organisation et la conscience du
prolétariat. C'est pour cela que, malgré
les apparences, et quel que soit le chemin qu'il lui reste encore à parcourir
pour arriver à une telle issue, le prolétariat de Pologne, parce que plus
organisé, plus expérimenté et plus conscient, est plus proche de l'insurrection
aujourd’hui! qu'il ne 1’était en 1970 ou en 1976
14) La thèse d'une moindre importance du mouvement en 1980 qu'en 1970, si elle pouvait avoir une apparence de vérité en juillet, au début du mouvement, est devenue après 5 mois parfaitement indéfendable. Que l'on juge le mouvement présent par sa durée, ses revendications, son extension, son organisation, sa dynamique, de même que sur le niveau des concessions faites par la bourgeoisie, et la gravité de sa crise politique, et l'on peut aisément constater qu'il est bien plus puissant qu'en 1970.
Cette différence entre les deux mouvements s'explique par l'expérience accumulée par les ouvriers polonais depuis 70. Mais c'est là un cadre partiel et encore insuffisant d'explication. En fait, on ne peut comprendre l'ampleur du mouvement présent en le replaçant dans le contexte général de la reprise historique du prolétariat mondial a la fin des années 60 et en tenant compte des différentes phases de cette reprise.
L'hiver 70 polonais s'inscrit dans une première vague de luttes -celle qui inaugure la reprise historique- qui va de mai 68 en France aux grèves de l'hiver 73-74 en Grande-Bretagne en passant par "l'automne chaud" italien de 1969, le "Cordobazo" argentin et les grèves sauvages d'Allemagne de la même année et par une multitude d'autres luttes qui touchent TOUS les pays industrialisés. Déclenchée alors que la crise commence à peine à faire sentir ses effets (bien qu'en Pologne la situation soit déjà catastrophique), cette offensive ouvrière surprend la bourgeoisie (comme elle surprend le prolétariat lui-même) qui, un peu partout, se trouve momentanément désemparée. Mais elle se reprend rapidement et, à travers toutes sortes de mystifications, elle réussit à repousser jusqu'en 78 la deuxième vague de luttes où l'on voit tour à tour les mineurs américains en 78, les ouvriers de la sidérurgie en France début 79, les travailleurs du port de Rotterdam à l'automne 79, les ouvriers de la sidérurgie de Grande-Bretagne début 80 ainsi que les métallurgistes brésiliens durant toute cette période... reprendre le chemin du combat! C'est à cette deuxième-vague de luttes qu'appartient le mouvement présent du prolétariat polonais.
Celle-ci se distingue de la première, par :
- la gravité bien plus catastrophique de la crise du capitalisme.
- une meilleure préparation de la bourgeoisie face aux luttes.
- une expérience plus grande de la classe ouvrière, et notamment sur le problème syndical, expérience qui s'est manifestée ces dernières années par une dénonciation explicite des syndicats par des minorités significatives d'ouvriers de même que par une clarification des positions de classe de certains groupes révolutionnaires sur cette question.
Dans ces conditions, la
deuxième vague des luttes ouvrières s'annonce, malgré tous les pièges que
tendra une bourgeoisie avertie, bien plus considérable que la précédente. C'est
ce que confirme aujourd'hui la lutte des ouvriers de Pologne.
15) Le constat de l'ampleur sans précédent, tant du mouvement
de luttes en Pologne que de la crise politique de la bourgeoisie et de la
gravité de la situation économique dans le monde entier peut suggérer que s'est
créé dans ce pays une situation révolutionnaire. Ce n'est nullement le cas.
Lénine définit la crise révolutionnaire par le fait que "ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner comme avant" et "ceux d'en bas ne veulent plus vivre comme avant". A première vue, telle est la situation en Pologne. Cependant, dans la période présente, après l'expérience historique accumulée par la bourgeoisie notamment avec octobre 17, il serait illusoire de croire qu'elle va laisser ses secteurs les plus faibles affronter tous seuls le prolétariat. De même qu'on a pu voir toutes les "bonnes fées" du bloc occidental se pencher sur le berceau de la nouvelle née "démocratie" en Espagne en 1976 pour lui éviter tout faux pas face à un des prolétariats les plus combatifs du monde à l'époque, on peut constater aujourd'hui que "ceux d'en haut" ne sont pas seulement à Varsovie mais également surtout à Moscou ainsi que dans d'autres capitales importantes. Cette unité que manifeste la bourgeoisie face à la menace prolétarienne, notamment dans le cadre du bloc, signifie qu’une période révolutionnaire ne pourra s'ouvrir réellement que lorsque le prolétariat de tous les pays susceptibles de prêter main forte à une bourgeoisie aux abois sera sur le pied de guerre.
A un autre titre encore, cette maturité internationale du mouvement est indispensable pour que puisse s'ouvrir une période révolutionnaire. Elle seule en effet peut permettre aux ouvriers polonais de rompre complètement avec le nationalisme qui obscurcit encore leur esprit et qui leur interdit d' atteindre le niveau de conscience sans lequel il n'y a pas de révolution possible. Enfin, un tel niveau de conscience se manifeste nécessairement par l'apparition d'organisations politiques communistes au sein de la classe. Or la terrible contre-révolution qui s'est abattue en Russie et dans les pays de son bloc a liquidé physiquement et de façon totale tous les courants politiques du prolétariat de ces pays et ce n'est qu'en desserrant l'étau de la contre-révolution comme il le fait aujourd'hui qu'il peut commencer à recréer ces organismes.
Si l'heure n'est pas encore venue pour une insurrection en Pologne, par contre une première brèche s'est ouverte dans le bloc de l'Est, après un demi siècle de contre-révolution permettant que prenne place le processus de reformation des organisations politiques révolutionnaires.
16) De même que les causes et les caractéristiques du présent mouvement en Pologne ne peuvent être comprise que dans le cadre mondial, c'est ce cadre mondial seul qui permet de définir ses perspectives.
Avant même qu'elle ne puisse se traduire sur le plan des combats de classe, la dimension mondiale des événements en Pologne et de leur futur est mise en évidence par les manœuvres présentes de la bourgeoisie de toutes les grandes puissances, qui soit s'inquiètent avec insistance des "menaces qui pèsent sur le socialisme" dans ce pays, soit se disent "disposées à répondre aux préoccupations des autorités polonaises dans les différents domaines où elles se sont exprimées" (Giscard d'Estaing recevant Jagielski le 21 novembre) et mettent en garde l'URSS contre toute intervention en Pologne.
La préoccupation de la bourgeoisie de tous les pays est réelle et profonde. En fait, si elle peut tolérer que des événements comme ceux de Pologne affectent comme c'est le cas encore aujourd'hui, des pays de second plan (comme elle supportait la crise tant qu'elle bouleversait des pays de la périphérie), elle ne peut supporter qu'une telle situation s'installe dans des pays du centre, des métropoles comme l'URSS, la France, l'Angleterre, ou l'Allemagne. Or la Pologne est comme une flammèche sur une traînée de poudre qui risque de s'étendre à l'ensemble de l'Europe de l'Est, y compris la Russie, et mettre le feu a certains des grands pays d'Europe de 1'ouest parmi les plus touchés par la crise. C'est pour cela que l'évolution de la situation en Pologne est prise en charge par la bourgeoisie mondiale. Dans cette opération les deux blocs se partagent le travail :
- à l'Occident échoie la responsabilité d'essayer de donner un peu d'oxygène à une économie polonaise au bord de la banqueroute : dans les prêts consentis par l'Allemagne, la France et les USA et qui viennent s'ajouter aux 20 milliards de dollars de dettes de l'Etat polonais, il n'y a nulle perspective de rentabilisation économique : chacun sait que ce sont des prêts à fonds perdus qui doivent permettre de donner à manger aux ouvriers polonais pendant l'hiver et les empêcher de se révolter.
- à la Russie revient le rôle de menacer aujourd'hui et éventuellement d'apporter demain une "aide fraternelle" blindée à la bourgeoisie polonaise si elle n'arrive pas à s'en sortir toute seule.
Malgré les mises en garde de l'Occident, contre toute "aventure" de l'URSS et malgré les dénonciations par celle-ci des "menées de l'impérialisme américain et des revanchards de Bonn", il existe une solidarité de fond entre les deux blocs pour faire taire le plus vite possible le prolétariat de Pologne.
Les diatribes moscovites, tchèques et est-allemandes appartiennent à l'arsenal classique de la propagande. Elles révèlent une certaine inquiétude que Occident n'utilise à son profit la dépendance financière à son égard dans laquelle se trouve chaque jour plus la Pologne et les autres pays de l'Est. Mais elles ont surtout comme fonction d'exercer un avantage sur les ouvriers de Pologne et de préparer e éventuelle intervention bien que cette "solution" n'ait été envisagée que comme dernier recours (en cas de liquéfaction de l'Etat polonais), tant est réelle l'appréhension qu'elle n'allume un incendie social en Europe de l'Est.
Quant aux mises en garde occidentales, si elles font partie, elles aussi des armes classiques de la propagande anti-russe, elles ont une toute autre signification que celles énoncées dans le passé, par exemple, à propos du Golfe Persique à la suite de l'invasion de l'Afghanistan. La Pologne fait partie intégrante du bloc de l'Est et une entrée plus massive sur son territoire de troupes russes (dont on dégarnirait de toute façon les avant-postes de l’Allemagne de 1 'Est) ne changerait rien au rapport de forces entre les blocs. Le Secrétaire Général de OTAN, Luns, n'a-t-il pas déclaré nettement que son organisation ne bougerait pas en cas d'intervention soviétique ? Fondamentalement, le destinataire de ces mises en garde répétées n'est pas le gouvernement de l'URSS, bien qu'à travers elles on puisse partie tenter de dissuader une bourgeoisie moins subtile et expérimentée que celle d'Occident de se lancer dans une"aventure"aux conséquences sociales prévisibles non seulement à l'Est mais également l'Ouest. Ce que visent essentiellement ces mises garde, c'est de faire un barrage idéologique préventif auprès du prolétariat occidental, afin que, cas d'intervention russe, celle-ci ne soit pas comprise par lui comme ce qu'elle serait réellement, c’est-à-dire une opération de police de tout le capitalisme contre la classe ouvrière mondiale, mais comme une nouvelle manifestation de la "barbarie du totalitarisme "soviétique" contre la "liberté des peuples. L'indignation et la colère qu'une telle intervention ne manquerait pas de provoquer parmi les ouvriers d'occident, la bourgeoisie se donne pour tâche de les dévier contre le "méchant russe afin de "souder la solidarité" au sein du "camp démocratique" entre toutes les classes de la société et empêcher le prolétariat de manifester solidarité de classe en engageant partout le combat contre son ennemi véritable : le capital. Quel que soit le caractère dramatique de leur ton, les mises en garde occidentales ne traduisent donc pas une nouvelle aggravation des tensions entre blocs impérialistes. Pour que les choses soient en claires et comme gage de la "bonne foi" et des bonnes intentions" des Etats-Unis, Reagan s'est empressé d'envoyer, fin novembre, son ambassadeur personnel Percy, à Moscou, annoncer aux dirigeants du bloc de l'Est que son pays était prêt à réexaminer de façon positive la négociation Salt. En réalité, malgré certaines apparences, la lutte des ouvriers de Pologne est venue réchauffer les relations Est-Ouest que l'invasion de l'Afghanistan avait considérablement refroidies il y a moins d'un an.
Ainsi se trouve de nouveau illustré le fait que le prolétariat est la seule force dans la société capable, par sa lutte, d’empêcher le capitalisme de déchaîner un troisième holocauste impérialiste.
17) Les évènements de Pologne font apparaître deux grands dangers qui menacent le prolétariat :
- la capitulation devant la bourgeoisie : les ouvriers cèdent à l'intimidation, se rendent aux arguments de Walesa sur "l'intérêt national", acceptent les terribles sacrifices que requière le sauvetage (qui de toute façon ne saurait être que momentané) du capital national sans pour cela s'épargner un développement progressif de la répression qui n'aura de cesse avant que ne soit rétablie la chape de plomb dont ils s'étaient dégagés ;
- l'écrasement physique sanglant : les troupes du Pacte de Varsovie (car les forces de police et militaires polonaises ne seraient ni suffisantes ni sûres) apportent "une aide fraternelle au socialisme et à la classe ouvrière de Pologne" (lire au capitalisme et à la bourgeoisie).
Face à ces deux menaces, le prolétariat de Pologne ne peut que :
- maintenir sa mobilisation face aux tentatives de normalisation que la bourgeoisie a engagées, conserver cette solidarité et cette unité qui jusqu'à présent ont fait sa force, mettre à profit cette mobilisation, non pour se lancer immédiatement dans un affrontement militaire décisif contre la bourgeoisie qui serait prématuré tant que les ouvriers des autres pays de l'Est n'auront pas développé leur combativité, mais pour continuer son effort d'auto organisation, pour assimiler l'expérience de son mouvement, en tirer un maximum de leçons politiques pour les combats de demain et s'atteler à la tâche de formation de ses organisations politiques révolutionnaires
- lancer un appel aux ouvriers de Russie et des pays satellites dont seule la lutte peut paralyser le bras meurtrier de leur bourgeoisie et permettre aux ouvriers de Pologne de mettre en échec les manœuvres de leurs faux amis à la Walesa préparant la "normalisation" à la Kania.
Le prolétariat de Pologne n'est pas seul. Partout dans le monde se créent les conditions qui pousseront ses frères de classe des autres pays à le rejoindre dans le combat. Il est du devoir des révolutionnaires et des prolétaires conscients d'opposer à la solidarité manifestée par la bourgeoisie de tous les pays pour mettre au pas les ouvriers de Pologne, la solidarité de la classe ouvrière mondiale.
Ce que la bourgeoisie veut à tout prix empêcher, le prolétariat doit le réaliser : les combats de Pologne ne doivent pas rester sans lendemain mais doivent être au contraire l'annonce d'un nouveau pas de la combativité et de la prise de conscience du prolétariat de tous les pays.
Si le mouvement des ouvriers polonais a atteint aujourd’hui un palier, il n'y a nul lieu de considérer que c'est un signe de faiblesse. Au contraire, ce palier se situe à un niveau élevé et, en ce sens, la classe ouvrière de Pologne a d'ores et déjà répondu à l'exigence pour le prolétariat mondial de faire reculer la menace de guerre en "portant son combat à un niveau supérieur" comme le constatait la prise de position du CCI du 20 janvier 1980 à la suite de l'invasion de l'Afghanistan. D'autre part, ce mouvement n'est condamné à rester à ce stade que s'il reste isolé, mais rien ne le condamne à un tel isolement. C'est pour cela que, paraphrasant ce qu'écrivait en 1918 Rosa Luxemburg de la révolution russe, on peut dire avec espoir :
"En Pologne, le problème ne peut être que posé, c'est au prolétariat mondial de le résoudre."
CCI 4/12/80
Géographique:
- Pologne [1]
Heritage de la Gauche Communiste:
A la lumière des évènements en Pologne, le rôle des révolutionnaires
- 2544 lectures
Dans un monde aux sinistres perspectives, menacé de famines et de guerre, les grèves de masse des ouvriers polonais jettent un éclat lumineux d'espoir.
Comparé à la période effervescente de la fin des années 60 et du début des années 70, époque où le réveil international de la lutte de classe avait tiré des poubelles l'idée de la révolution, le reste des années 70 a semblé sinistre et troublant. Au moins dans les pays capitalistes majeurs, la lutte de classe est entrée dans une phase de retrait; et, alors que l'économie mondiale se désintégrait visiblement, parmi toutes les classes montait la prise de conscience que la seule lumière au bout du tunnel du capitalisme était le feu sinistre des bombes thermonucléaires.
Parmi les jeunes générations de la classe ouvrière et d'autres couches opprimées, les drapeaux de la révolte totale qu'ils avaient dressés dans ces dernières années, laissèrent place à l'apathie et au cynisme. Beaucoup de jeunes ouvriers mécontents ont dérivé vers la violence nihiliste, pendant qu'un nombre considérable d'étudiants révoltés d'hier optait pour les pâturages plus calmes du retour à la vie organique et à la cuisson du pain complet. Le mouvement communiste révolutionnaire qui était né de cette première vague de luttes sociales atteignit un certain point de développement et de maturité, mais il est resté remarquablement petit et avec un impact direct encore bien faible sur la lutte de classe. En réponse à cette situation objective, certains courants révolutionnaires se sont égarés dans l'individualisme et les théories sur l'intégration du prolétariat dans l'ordre bourgeois. D'autres ont cherché à compenser leur manque de confiance dans la classe et leur isolement politique, en s'adonnant à des rêves sur le parti omniscient qui, comme Jésus descendant des cieux dans toute sa gloire, sauvera le prolétariat de ses pêchés originels.
Mais, en regardant au-delà des apparences -ce qui est, par définition la méthode du marxisme- il était possible de discerner un autre processus se développant dans cette période. Oui, la lutte prolétarienne était en reflux, mais un reflux n'est pas la même chose que l'écrasement de la défaite. Derrière l'apathie apparente, des millions de prolétaires réfléchissaient avec simplicité et sérieux se posant des questions telles que : pourquoi ne gagnons nous plus rien lorsque nous nous mettons en grève ? Pourquoi les syndicats agissent-ils de cette façon ? Y a t’il quelque chose qui puisse être fait par rapport à la menace de guerre ? Pour la plupart de telles questions se sont posées d'une façon incohérente, inorganisée, et la conclusion première à laquelle est arrivée la plupart des ouvriers, c'est qu'il valait peut-être mieux ne pas secouer le bateau, et qu'il pouvait être plus sage d'attendre pour voir si la crise allait montrer des signes de ralentissement. Mais une minorité d'ouvriers a commencé à se poser ces questions de façon plus organisée, et est arrivée à des conclusions beaucoup plus radicales. Ainsi, l'apparition de cercles de discussion ouvriers dans des pays comme l'Italie, où la crise économique et sociale est extrêmement avancée, fut une expression de quelque chose de beaucoup plus large et plus profond, d'un processus souterrain de réflexion qui se poursuivait dans l'ensemble de la classe. Et, par dessus tout, alors que la population entière subissait de plus en plus les attaques du chômage et de l'inflation, le mécontentement qui s'accumulait dans les entrailles de la société portait nécessairement en lui le potentiel d'énormes explosions imprévues de la lutte de classe -d'autant plus qu'il devenait clair que la bourgeoisie était incapable de faire quoi que ce soit contre la crise de son système.
Les années 78-79 ont vu à la fois un approfondissement net de la crise, et les premiers signes d'une réaction contre celle-ci de la part du prolétariat des pays avancés : la grève des mineurs américains, la grève des sidérurgistes en Allemagne de l'Ouest, 1"'hiver de mécontentement" anglais qui a précipité la chute du gouvernement travailliste. Qu'une nouvelle phase de la lutte de classe se soit ouverte, les violentes bagarres à Longwy et Denain, l'auto organisation des hospitaliers italiens et des dockers hollandais, la grève prolongée et combattive des sidérurgistes anglais l'ont confirmé. Mais la grève de masse en Pologne -à cause de sa large extension, de son niveau d'auto organisation, de ses répercussions internationales, de son caractère politique évident a pleinement confirmé qu'en dépit des bruits de bottes de toutes les bourgeoisies et des dangers réels de guerre mondiale, la classe ouvrière peut encore agir à temps pour empêcher le système capitaliste de précipiter le monde dans l'abîme.
Le but de cet article n'est pas de tirer toutes les leçons de cette expérience immensément riche, ni de décrire la situation présente en Pologne, qui continue à être marquée par des signes d'extrême fermentation et d'instabilité, même si les aspirations des ouvriers sont dans une certaine mesure canalisées vers les fausses solutions de la démocratie et du syndicalisme "indépendant". Pour un plus grand développement sur cette question et sur la situation récente, nous renvoyons le lecteur à l'article d'orientation de la Revue Internationale n°23, à l'article dans ce numéro, ainsi qu'aux publications territoriales du CCI. Notre intention est ici d'examiner comment les événements polonais éclairent une question qui est presque toujours la principale pierre de touche des désaccords dans le mouvement révolutionnaire d’aujourd’hui, tout comme elle l’a été dans le passé : la nature et la fonction de l’organisation des révolutionnaires.
Il est vrai que les groupes du mouvement révolutionnaire actuel ne sont pas tous parvenus aux mêmes conclusions sur d’autres aspects des événements polonais – loin de là. Il a été particulièrement difficile pour un bon nombre de groupes révolutionnaires d’éviter la tentation de voir les syndicats « indépendants » comme une sorte d’expression prolétarienne, en particulier parce qu’il semble en continuité avec les organes authentiques de la lutte de la classe ouvrière : les comités de grève. Cette difficulté s'est surtout rencontrée chez les groupes 1es plus éloignés des sol ides racines de la tradition communiste de gauche.
Ainsi, les ex-maoïstes du Bochevik en France crient : " Longue vie aux syndicats " 1ibres" des ouvriers polonais", pendant que le Marxist Workers Comittee américain, également ex-maoïste, les voit comme un acquis positif de la lutte, même si le manque de direction révolutionnaire les expose au danger de la corruption. Les libertaires du groupe anglais Solidarity ont été si enthousiasmés par ces instituons apparemment "autonomes", "auto-gérées" (qu'importe si elles s'appellent syndicats !) qu'ils ont applaudi (de façon critique) les trotskistes du SWP anglais pour leur soutien aux syndicats libres. Pire encore, Solidarity a organisé un meeting à Londres pour exprimer son accord avec l'idéal des syndicats indépendants pour les ouvriers polonais et ne s'est guère sentie embarrassé de partager une plate-forme avec un conseiller du parti travailliste et les sociaux-démocrates polonais. Dans sa dernière revue (n°14), Solidarity tente; de s'en sortir en disant qu'il n'a pas réellement partagé une telle plate-forme; il a simplement donné cette impression à cause de l'arrangement "traditionnel" des sièges à la réunion (c'est à dire une table d’orateurs faisant face à l'audience assise sur des rangées de chaises, au lieu de la pratique plus libertaire de s'asseoir en cercle !). En tout cas, Solidarity se défend lamentablement d'avoir mis en place un front uni avec ces autres groupes, et prétend n'avoir fait qu'organiser un "forum ouvert" où chacun pouvait donner son point de vue. C'est ainsi que les libertaires se dévoilant comme les défenseurs de la mystification bourgeoise libérale selon laquelle les points de vue sont également intéressants, également sujets à discussion. Les frontières de classe disparaissent, et seules les formes restent.
Les groupes de la gauche communiste ne se sont pas laissés prendre tout à fait aussi facilement, bien qu'à la fois, le PCI (Programme Communiste) le GCI (Groupe communiste internationaliste) montrent à quel point il est dangereux de ne pas avoir une compréhension claire que nous vivons l'époque décadente du capitalisme et que le syndicalisme est mort. Le PCI semble rejeter les syndicats libres actuels mais veut laisser la porte ouverte à l'idée qu’ils pourraient exister de réels syndicats libres à condition qu'ils soient dirigés par un parti révolutionnaire. Quant au GCI, tout comme les bordiguistes officiels, il défend l’idée d'un "associationnisme ouvrier" éternel qui serait la forme "immédiate" d'organisation créée par les ouvriers en lutte, et dont le nom et la forme sont indifférente, quelle que soit la période de l’histoire. Selon eux, syndicat, groupe ouvrier, soviet, peu importe : seuls les formalistes, comme le CCI, par exemple se soucient des formes ! L’important, c’est que ces expressions de l’associationnisme sont "des épisodes dans l’histoire du parti, que ce soit dans le temps ou dans l’espace" (cf. "Rupture avec le CCI, p9). Ainsi, fidèle à son anti-formalisme, le GCI a ardemment soutenu l’idée d’une possible transformation des syndicats libres en Pologne en "vrais organismes ouvriers, larges, ouverts à tous les prolétaires en lutte, coordination et centralisation des comités de grève" et a également soutenu l’idée que ces syndicats libres pourraient se transformer en organes d'Etat sous la pression des autorités et des dissidents (cf."Le Communiste" n°7. -p. 4). Mais ces hésitations se sont placées plus dans le domaine de la spéculation que dans le monde matériel d'aujourd'hui : le dernier numéro du Communiste (n°8) est très clair quant à la dénonciation des nouveaux syndicats.
Dans l'ensemble, les groupes
de la gauche communiste ont su apprécier l'importance des évènements en Pologne
et défendre les positions de classe de base : opposition au capitalisme à l'Est
et à l'Ouest, soutien à l'organisation et à l'unité de la lutte des ouvriers
polonais, rejet des mystifications démocratiques et des syndicats libres. Mais si vous interrogiez le CCI, la CWO, le PCI Battaglia
Communista, le GCI, le PIC (Pour une Intervention communiste) ou
d'autres au sujet de ce que les évènements en Pologne nous enseignent sur le
rôle de l'organisation révolutionnaire, vous seriez certains d’avoir une
grande variété de réponses. En fait,
c'est l'incapacité des groupes communistes à se mettre d'accord sur cette
question de base qui a sapé la possibilité pour le mouvement révolutionnaire
international de faire une intervention commune en réponse aux grèves
polonaises : peu de temps avant qu'elles n'éclatent, les conférences
internationales des groupes communistes ont échoué à cause d'une incapacité à
se mettre d'accord ne serait-ce que sur le sujet, comment doit-on mener le
débat sur le rôle du parti révolutionnaire (voir la Revue Internationale
n°22).
Etant donné que l'humanité vit encore dans la phase préhistorique où l'inconscient tend à dominer le conscient, il n'est pas surprenant que l'avant-garde révolutionnaire puisse être également affligée de cette difficulté générale qui rend plus facile aux hommes de comprendre ce qui se passe dans le monde extérieur, que de comprendre leur propre nature subjective.
Mais comme nous n’avons jamais cessé de le répéter lors des conférences internationales, les débats théoriques entre révolutionnaires, y compris le débat sur leur propre nature et fonction, ne peuvent être simplement résolus à travers l'auto-analyse ou les discussions " entre nous". Ils ne peuvent être posés qu'à travers l'interaction de la pensée révolutionnaire et l'expérience pratique de la lutte de classe.
Pour nous, la classe ouvrière n'a pas encore accumulé une expérience historique suffisante pour dire aujourd'hui, que toutes les questions sur le rôle de l’organisation révolutionnaire sont résolues une fois pour toutes. même si nous pouvons être clairs sur ce que l'organisation ne peut pas faire.
C'est sans aucun doute un débat qui continuera -à la fois chez les révolutionnaires et la classe dans son ensemble- bien après que d'autres problèmes, comme la nature des syndicats aient cessé d'être controversés. En fait, seule la révolution elle-même rendra clairs à l'ensemble du mouvement révolutionnaire les principaux points de la "question du parti".
Mais si aujourd'hui le débat doit quitter le domaine de la grandiose abstraction et des vagues affirmations, il doit être mené en rapport avec le développement actuel de la lutte de classes.
Depuis sa constitution, le CCI a mené un combat implacable contre les deux principales distorsions de la compréhension marxiste du rôle de l'organisation révolutionnaire : d'un côté, contre le conseillisme, le spontanéisme, les libertaires ... etc., toutes ces conceptions qui minimisent ou nient l'importance de l'organisation révolutionnaire, et en particulier son expression la plus avancée, le parti communiste mondial; de l'autre côté, contre le fétichisme du parti, l'idée qu'une minorité révolutionnaire peut se substituer à l’action de la classe ..., toutes ces conceptions qui surestiment et exagèrent le rôle du parti. Nous pensons que les récents évènements en Pologne ont été dans le sens de notre lutte sur ces deux faits et nous allons à présent essayer de montrer pourquoi et comment.
LA BANQUEROUTE DU SPONTANEISME
Les courants révolutionnaires qui ont surgi à la fin des années 60 et au début des années 80 ont été fortement marqués par différentes formes d'idéologie spontanéiste. En partie, c'était une inévitable réaction aux aberrations du stalinisme et du trotskisme. Durant des décennies, ces tendances contre-révolutionnaires sont apparues comme des expressions du marxisme, et pour beaucoup de gens, l'idée même du parti révolutionnaire était irrémédiablement associée aux répugnantes caricatures offertes par les partis communistes et leurs acolytes trotskistes et maoïstes. En outre, après mai 68 et d'autres expressions de la révolte prolétarienne, les révolutionnaires furent naturellement enthousiastes face au fait que les ouvriers montraient alors leur capacité à lutter et à s'organiser sans la "direction" des partis officiels de gauche. Mais, étant donné le caractère purement viscéral de leurs réactions au stalinisme et au trotskisme, nombre de révolutionnaires sont arrivés à la conclusion facile qu'un parti révolutionnaire, et dans certains cas, toute forme d'organisation révolutionnaire ne pouvait être qu'une barrière au mouvement spontané de la classe.
Une autre raison à la prédominance des idées spontanéistes dans cette phase initiale de reprise du mouvement révolutionnaire, fut que les révoltes sociales qui avaient donné naissance à beaucoup de ces courants n'étaient pas toujours clairement le fait de la classe ouvrière et n'étaient pas dirigées de façon évidente contre une économie en crise profonde. Mai 68 en est l'exemple classique, avec son interaction entre les révoltes étudiantes et les grèves ouvrières, et donnait l'impression que c'était un mouvement contre les excès de la "société de consommation" plutôt qu'une réponse aux premières manifestations de la crise économique mondiale qui s'annonçait. La majorité des groupes révolutionnaires, nés dans cette période, était composée d’éléments qui venaient, soit directement du mouvement étudiant, soit de secteurs marginaux du prolétariat. Les attitudes de ces couches de la société qu'ils apportaient avec eux, prirent différentes formes "théoriques", mais elles étaient souvent marquées par le sentiment général que la révolution communiste était une activité ludique, plutôt qu'une lutte sérieuse, d'une portée historique. Il est vrai que les révolutions sont "la fête des opprimés" et qu'elles auront toujours des aspects humoristiques et ludiques, mais ceux-ci ne peuvent être que le contre-point lumineux du drame révolutionnaire qui se joue, tant que la classe ouvrière doit encore gagner une guerre civile dure et violente contre un ennemi de classe sans pitié. Mais les situationnistes et courants apparentés ont souvent parlé comme si la révolution allait apporter une réalisation immédiate de tous les désirs. La révolution devait être faite pour le plaisir ou ne valait pas le coup d'être faite, et on ne devenait révolutionnaire que pour ses propres besoins. Tout autre chose n'était que "sacrifice" et "militantisme".
Les attitudes comme celles-ci se basaient sur un une incapacité fondamentale à comprendre que les révolutionnaires, qu'ils le sachent ou non, sont produits par les besoins de la classe dans son ensemble. Pour le prolétariat, classe associée par excellence, il ne peut y avoir de séparation entre les besoins de la collectivité et les besoins de l'individu. Le prolétariat donne constamment naissance à des fractions révolutionnaires parce qu'il est appelé à devenir conscient de ses buts généraux, parce que sa lutte ne peut se développer qu'en brisant la prison de l'immédiatisme. Qui plus est, le seul facteur qui puisse appeler le prolétariat à lutter de façon massive, est la crise du système capitaliste. Les mouvements majeurs de classe ne se produisent pas parce que les ouvriers en ont assez et veulent protester contre l'ennui de la vie quotidienne dans le capitalisme De tels sentiments existent certainement dans la classe ouvrière, mais ne peuvent donner jour qu'à de sporadiques explosions de mécontentement. La classe ouvrière ne bougera à une échelle massive que lorsqu'elle sera forcée de défendre ses conditions d'existence, comme les ouvriers polonais l'ont montré en plusieurs occasions mémorables. La guerre de classe est une affaire sérieuse car c'est une question de vie ou de mort pour le prolétariat.
Alors que la crise balaye la dernière illusion selon laquelle nous vivons une société de consommation dont l'abondante richesse peut nous tomber dans les mains grâce à la volonté situationniste, il devient clair que le choix qui nous est offert par le capitalisme n'est pas socialisme ou ennui, mais socialisme ou barbarie. La lutte révolutionnaire de demain dans ses méthodes et ses buts, ira bien au delà des mouvements révolutionnaires de 1917-1923, mais elle ne perdra rien du sérieux et de l'héroïsme de ces jours-là. Au contraire, avec le menace de l'anéantissement nucléaire suspendue sur nos têtes, bien plus lourd sera l'en jeu. Tout cela nous conduit a la conclusion que les révolutionnaires d'aujourd'hui doivent avoir le sens de leurs propres responsabilités.
Alors que la guerre de classes commence à s'intensifier, il devient clair que la seule façon "authentique" de vivre sa vie quotidienne est de déclarer la guerre totale au capitalisme, et que ce besoin individuel correspond au besoin collectif qu' a le prolétariat que ses éléments révolutionnaires s'organisent et interviennent de la façon la plus efficace possible. Et comme de plus en plus de révolutionnaires sont engendrés directement par la lutte de classe, du cœur du prolétariat industriel, ce rapport entre les besoins collectifs et individuels ne sera plus ce grand "mystère" qu'il reste encore pour beaucoup de libertaires et de spontanéistes d'aujourd'hui.
A vrai dire, la banqueroute des spontanéistes apparaissait déjà pendant le reflux qui a suivi la première vague de lutte de classes internationale. La majorité des courants conseillistes et modernistes qui ont fleuri au début de la décennie 70, I.C.O., l'Internationale Situationniste, le GLAT, Combate, Mouvement Communiste, et beaucoup d'autres, ont simplement disparu : c'était après tout, la conséquence logique de leurs théories anti-organisationnelles. Parmi les groupes qui ont pu survivre à la période de reflux, ce furent en majorité ceux qui, même à partir de points divergents, ont pris au sérieux la question de l'organisation : le CCI, la CWO, le PCI-Battaglia Comunista, le PCI-Programma Communista, etc.
Dans les Conditions actuelles, simplement survivre est déjà un pas important pour un groupe révolutionnaire, tant la pression de l'isolement et de l'idéologie dominante est grande. En fait, il est absolument crucial que des groupes révolutionnaires fassent montre d'une capacité à continuer leur marche dans les périodes difficiles ; sinon ils ne sont pas capables d'agir comme pôle de référence et de regroupement lorsque les conditions de la lutte de classe redeviennent plus favorables. Mais si le reflux a déjà révélé l'inadéquation des idées et de la pratique spontanéistes, alors la résurgence de la lutte de classe va achever leur déroute. Les événements polonais en sont , de loin, l'exemple le plus éloquent.
LA NECESSITÉ D'UNE ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE
Personne n ' a pu suivre les récentes luttes de masse en Pologne, sans être frappé par les éléments profondément contradictoires dans la conscience de classe des ouvriers. D'un côté, les ouvriers polonais ont montré qu'ils se considéraient comme une classe, parce qu’ils ont placé la solidarité de classe au-dessus des intérêts immédiats de tel ou tel groupe d'ouvriers et parce qu'ils ont considéré leur patron, l'Etat polonais, comme une force tout à fait étrangère à eux et ne méritant pas un iota de confiance et de respect de leur part. Ils ont montré une claire connaissance des principes de base de la démocratie ouvrière dans la façon dont ils ont organisé leurs assemblées et leurs comités de grève. Ils ont montré leur compréhension du besoin d'aller du terrain économique vers le terrain politique en établissant des revendications politiques et en faisant face à l'appareil d'Etat tout entier. Et pourtant, au même moment, la conscience d'eux-mêmes comme classe a été sévèrement entravée par la tendance à se définir comme des polonais ou des catholiques ; le rejet de l'Etat a été compromis par les illusions sur les possibilités de le réformer; la capacité d'auto organisation s'est trouvée détournée vers la dangereuse illusion des syndicats "indépendants". Ces faiblesses idéologiques ne sont pas, bien sûr, une justification pour sous-estimer la force et la signification des grèves. Comme nous l'avons montré dans la Revue Internationale n°23, dans la révolution de 1905, les ouvriers qui marchaient derrière le pope Gapone en portant des images du Tsar, brandissaient la minute d'après les drapeaux rouges de la Social-Démocratie. Mais nous ne devons pas oublier qu'un des facteurs qui a permis aux ouvriers de faire cette transition si rapidement en 1905 fut précisément la présence du parti révolutionnaire marxiste au sein de la classe ouvrière. De tels bonds soudains de la conscience politique seront plus durs aujourd'hui pour la classe ouvrière, surtout dans le bloc russe, car la contre-révolution stalinienne a anéanti le mouvement communiste.
Néanmoins, le mouvement en Pologne a inévitablement fait surgir des groupes d'ouvriers qui sont plus intransigeants dans leur hostilité à l'Etat, moins impressionnés par les appels au patriotisme et l'intérêt national, plus préparés à repousser les limites de l'ensemble du mouvement. Ce sont ces ouvriers qui ont hué Walesa lorsqu'il a annoncé les accords à la fin de la grève du mois d'août, criant "Walesa, tu nous a vendu". Ce sont ces ouvriers qui, même après la "grande victoire" de la reconnaissance du syndicat Solidarité -qui était supposée suffire à faire rentrer joyeusement tout le monde au travail pour l'économie nationale- ont fait pression pour que les structures des nouveaux syndicats soient complètement séparées de l'Etat (signe de combativité, même si ce but en soi est illusoire. Ce sont ces ouvriers, qui, avec ou sans la bénédiction de Solidarité, ont continué à secouer l'économie nationale avec des actions de grèves sauvages. Nul doute que c'est à ce genre d'ouvriers que se référait récemment un député catholique de la Diète polonaise en les qualifiant "d'extrémistes de part et d'autre, qui, objectivement forment une sorte d'alliance contre les forces de dialogue" (Le Monde 23/11/80).
C'est des rangs d'ouvriers de ce genre que nous verrons, tout aussi inévitablement, l'apparition de groupes ouvriers, de publications"extrémistes", de cercles de discussion politique, et d'organisations qui, même si c'est de manière confuse, tentent de se réapproprier les acquis du marxisme révolutionnaire. Et, sauf si on en est au spontanéisme le plus rigide et le plus dogmatique, il n'est pas difficile de voir quelle fonction une telle avant-garde prolétarienne sera appelée à jouer : elle aura à essayer de mettre en lumière pour l'ensemble des ouvriers, les contradictions entre les actions radicales qu'ils font en pratique et les idées conservatrices qu'ils ont toujours dans la tête, idées qui ne peuvent que bloquer le développement futur du mouvement.
Si cette avant-garde est capable de devenir de plus en plus claire sur la signification réelle de la lutte des ouvriers polonais; si elle est capable de comprendre la nécessité de mener un combat politique contre les illusions nationaliste, syndicaliste, religieuse et autres qui existent dans la classe ; si elle voit pourquoi la lutte doit devenir internationale et révolutionnaire ; et si, en même temps, elle est capable de s'organiser effectivement et de faire connaître ses positions, le mouvement entier sera alors capable de faire d'énormes pas vers l'avenir révolutionnaire. D'un autre côté, sans l'intervention d'une telle minorité politique, les ouvriers polonais seront plus vulnérables aux pressions de l'idéologie bourgeoise, politiquement désarmés face à une opposition sans merci.
En d'autres termes, le
développement de la lutte elle-même démontre qu'il y a un besoin criant d'une
organisation de révolutionnaires basée sur une plate-forme communiste
claire. La classe ouvrière ne sera pas
capable d'atteindre la maturité politique requise par le haut niveau de la
lutte, si elle ne donne pas naissance aux organisations politiques
prolétariennes. Les spontanéistes qui
clament que les ouvriers développeront une conscience révolutionnaire sans
organisations révolutionnaires oublient le simple fait que les organisations
révolutionnaires sont un produit "spontané" des efforts du
prolétariat pour briser le carcan de l'idéologie bourgeoise et ouvrir une
alternative-révolutionnaire.
Ce n'est pas en opposant à
la légère les "luttes autonomes" et 1"intervention d'une
organisation politique que les spontanéistes peuvent échapper à ce fait que le
mouvement ne peut rester autonome -c'est à dire indépendant de la bourgeoisie
et de son Etat- que s'il est clair politiquement sur ce qu'il veut et où
il va. Comme l'ont montré les événements de la fin de la grève d'août 80, les
formes d'organisation de la classe ouvrière les mieux organisées et les plus
démocratiques ne sont pas capables de se maintenir si elles sont confuses sur
des questions vitales telles que le syndicalisme : plus les conceptions syndicalistes
ont dominé dans le MKS, plus celui-ci a commencé à échapper des mains des
ouvriers. Et les organisations de masse
de la classe ne seront pas capables de dépasser de telles confusions s'il
n'existe pas de minorité communiste combattant en leur sein, exposant les
manœuvres de la bourgeoisie et de tous ses agents et traçant une perspective
claire pour le mouvement. L'organisation
révolutionnaire est le meilleur défenseur de l'autonomie des ouvriers. 1
LA STRUCTURE DE L ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE
Si les événements de Pologne montrent que l'organisation révolutionnaire est un élément indispensable de l'autonomie prolétarienne, ils nous aident également à clarifier quelle forme une telle organisation doit prendre. Les travailleurs en Pologne, comme beaucoup d'autres secteurs de la classe dans les maillons les plus faibles du capital (Pérou, Corée, Egypte, etc. ... ) ont été contraints de se lancer dans des luttes de masse contre l'Etat alors qu'ils étaient cruellement isolés des courants révolutionnaires qui n'ont qu'une existence limitée dans les principaux pays occidentaux industrialisés. L'isolement politique de tels mouvements primordiaux de la classe ouvrière prouve que c'est un leurre de vouloir limiter le rôle des organisations révolutionnaires à un niveau local, celui d'une ville ou d'un pays. Cependant, beaucoup de groupes spontanéistes théorisent vraiment de telles limitations locales au nom du fédéralisme ou des organisations "autonomes". Ainsi alors que les ouvriers polonais faisaient face à l'Etat stalinien et que les organisations révolutionnaires qui existent principalement en Europe Occidentale et en Amérique du Nord, étaient obligées de se résigner à un rôle de propagande éloignée, dans l'incapacité de participer directement au mouvement, les tenants du fédéralisme ne peuvent que considérer cet isolement réciproque que comme une bonne chose! Nous pouvons donc nous rendre compte à quel point le localisme est une barrière au développement de l'autonomie de la classe ouvrière: en effet, si le mouvement révolutionnaire, là où il est le plus fort, ne comprend pas la nécessité de créer un pôle international de regroupement, de clarté politique, comment pourra t-il être d'une utilité quelconque à des groupes de travailleurs radicaux du bloc de l'Est ou du Tiers Monde, à ceux qui essaient de surmonter l'actuelle faiblesse idéologique de la lutte de classe dans ces régions? Devons-nous condamner ces travailleurs à tout retrouver par eux-mêmes, sans essayer de les aider, sans chercher à accélérer leur évolution politique? Quelle serait la signification de la solidarité de classe si nous ne faisions pas d'efforts pour aider les idées des révolutionnaires à briser les innombrables remparts du capitalisme ?
Si l'organisation des révolutionnaires doit être crée sur une base internationale, elle doit de plus être également centralisée. En créant les comités de grève inter entreprises, les ouvriers polonais ont montré que non seulement, la centralisation est le seul moyen pour organiser et unir réellement la lutte de classe, mais encore qu'elle est entièrement compatible avec la plus profonde démocratie ouvrière. Si les ouvriers polonais le comprennent, pourquoi est-ce un tel problème pour beaucoup de révolutionnaires aujourd'hui, pour ces camarades qui sont terrorisés par le seul mot de centralisation et pensent que le fédéralisme ou une simple addition de petits groupes autonome est la vraie manière de s'organiser? Il est étrange que les"conseillistes" soient à ce point effrayés par la centralisation, alors que les Conseils Ouvriers, tout comme le M.K.S, expriment simplement la compréhension qu'ont les ouvriers de la nécessité de centraliser toutes les assemblées et comités d'usine locaux dans un seul organe unifié ! Bien qu'une organisation révolutionnaire ne suive pas exactement la forme d'organisation des Conseils , les principes organisationnels de base -centralisation, élection et révocabilité des organes centraux, etc.- sont les mêmes.
Quelques conseillistes ou semi-conseillistes peuvent faire valoir une dernière démarcation défensive. Ils peuvent être d'accord sur la nécessité d'une organisation révolutionnaire; qu'elle doit être internationale et même centralisée. Mais ils se fixent comme politique de ne jamais considérer un tel organe comme un parti. Par exemple, le PIC, dans sa dernière publication (Jeune Taupe n°33), nous informe qu'il est en train d'écrire une brochure de 100 à 150 pages dans laquelle il montre que "le concept de parti est lié au processus de la révolution bourgeoise et doit en conséquence être rejeté par les révolutionnaires". Mais, dans la même publication (page 4), il est dit que l'intervention des révolutionnaires. "ce n'est pas simplement d’être parmi les travailleurs, c'est faire connaître ses positions et proposer des actions afin d'aller dans le sens d'une clarification politique de l’ensemble du mouvement". Selon nous un jour nous avons la chance d'avoir une organisation communiste internationale capable de faire connaître ses positions à des millions de travailleurs dans tous les principaux centres capitalistes, de "proposer des actions" qui soient prises en charge et menées par un grand nombre d'ouvriers, alors, dans notre vocabulaire, qui est peut-être plus modeste que 150 pages sur ce point particulier, nous parlerons de parti communiste international . Le PIC peut préférer 1 'appeler autrement, mais qui alors sera intéressé par de telles discussions sémantiques en plein milieu de la guerre civile révolutionnaire ?
LES CONTRADICTIONS DU SUBSTITUTIONISME
Jusque là, certains courants du mouvement révolutionnaire pourraient être d'accord avec nos critiques du spontanéisme. Mais cela n'est pas suffisant pour les convaincre qu'ils ont beaucoup de points communs avec le CCI. Pour des groupes comme la CWO, le GCI, Battaglia Comunista, etc., le CCI est mal placé pour attaquer les conseillistes parce qu'il est trop fondamentalement conseilliste; parce que, tout en admettant "formellement" la nécessité d'un parti, nous le réduirions à un rôle purement propagandiste. Ainsi, le GCI dit : "Là où les communistes, depuis l'aube de leur existence, ont toujours cherché à assumer toutes les tâches de la lutte, à prendre une part active à tous les domaines du combat communiste, (... ) le CCI, quant à lui, estime avoir une fonction en propre : la propagande" ' (Rupture avec le CCI , p. 5). Et, plus loin, le GCI cite Marx contre nous, quand il dit que: "la tâche de l’internationale est d'organiser et de coordonner les forces ouvrières pour le combat qui les attend". L'Internationale, dit Marx, est "l 'organe central " pour 1 'action internationale des travailleurs. Le GCI et d'autres groupes considèrent donc que nous sommes vraiment des conseillistes parce que nous insistons sur le fait que la tâche de l'organisation révolutionnaire n'est pas d'organiser la classe ouvrière.
Ce n'est pas un hasard si le GCI essaie de confronter notre position sur le parti à celle de Marx. Pour cette organisation, peu de choses ont changé depuis le 19ème siècle. Pour nous, l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence n'a pas seulement altéré l'approche que pouvaient avoir les communistes des questions "stratégiques" comme les syndicats ou les luttes de libération nationales elle a aussi rendu nécessaire la réévaluation des rapports entre le parti et la classe. Avec le changement des conditions de la lutte de classe, il est impossible de conserver les conceptions initiales que les révolutionnaires avaient de leur rôle et de leurs fonctions. Au 19ème siècle, la classe ouvrière pouvait être organisée dans des organisations de masse comme les syndicats ou les partis sociaux-démocrates. Les partis politiques agissaient comme les "organisateurs" de la classe, dans la mesure où ils le pouvaient, par un travail quotidien ; ils impulsaient la formation de syndicats et autres organisations ouvrières de masse (la première Internationale était en fait un parti constitué d'organes syndicaux, d'associations et de sociétés ouvrières, etc.). A cause de leurs liens étroits avec ces organisations, ils pouvaient planifier, préparer et déclencher des grèves et autres actions de masse. Puisque les partis de la classe ouvrière agissaient encore dans le cadre du parlementarisme, et qu'ils se concevaient comme les seuls organes spécifiques de la classe ouvrière, il est également compréhensible qu'ils aient pu se concevoir comme les organisations au travers desquelles la classe ouvrière se saisirait éventuellement du pouvoir politique. Selon cette conception, le parti était naturellement "l'organe central", le quartier général "militaire" du mouvement prolétarien dans son ensemble.
Il n 'est pas ici de notre propos de donner une description détaillée de la manière dont les nouvelles conditions de la lutte de classes apparues avec le 20ème siècle, ont rendu ces conceptions caduques. Dans sa brochure "Grève de Masse partis et syndicats", Rosa Luxemburg a montré comment, dans la nouvelle période, le mouvement de la classe ne pouvait pas être déclenché et arrêté à travers les directives du comité central du parti. Dans la décadence, la lutte de classe explose de manière inopinée et imprévisible:
"La révolution russe (1905) nous apprend une chose: c'est que la grève de masse n'est ni 'fabriquée' artificiellement ni 'décidée'.. ou 'propagée', un éther immatériel et abstrait, mais que c’est un phénomène historique résultant à un certain moment d'une situation sociale à partir d'une nécessité historique ... Entreprendre une propagande en règle pour la grève de masse comme forme de l 'action prolétarienne, vouloir colporter cette idée pour y gagner peu à peu la classe ouvrière serait une occupation aussi oiseuse, aussi vaine et insipide que d'entreprendre une propagande pour l'idée de la révolution ou du combat sur les barricades". ("Grève de masse". Ch 2)
D'autres révolutionnaires ont souligné la signification des Soviets surgis dans les révolutions 1905 et 1917: en tant qu'organes du pouvoir politique de la classe ouvrière, ils remettent effectivement en cause l'idée du parti prenant et détenant le pouvoir au nom de la classe ouvrière.
Bien sûr, cette compréhension ne s'est pas développée parmi les révolutionnaires de manière homo gène : au contraire, les partis communistes qui furent construits pendant la période révolutionnaire de 1917-1923 étaient empreints de beaucoup des conceptions social-démocrates sur le parti en tant qu'organisateur de la lutte de classes et de la dictature du prolétariat. Et plus la vague révolutionnaire perdait de sa force vive, plus la vie de la classe cessait de s'exprimer dans les soviets, et plus ces relents social-démocrates infestèrent l'avant-garde révolutionnaire. En Russie en particulier, l'identification du parti à la dictature de la classe est devenue un facteur supplémentaire de dégénérescence de la révolution.
Aujourd'hui, alors que nous émergeons d'une longue période de contre-révolution, le mouvement communiste a encore très inégalement compris ces problèmes. Une des raisons à cela est que, alors que nous avons eu 50 ans ou plus pour comprendre la nature des syndicats ou des luttes de libération nationale, tout ce siècle ne nous fournit quasiment pas d'expérience concernant les rapports entre parti et classe. Pendant la plus grande partie de ce siècle, la classe ouvrière n'a pas eu de parti politique du tout. Ainsi, quand le CCI essaie de convaincre les groupes "partidistes" qu’il est nécessaire d'examiner le rôle du parti à la lumière des nouvelles circonstances historiques, quand il dit que les révolutionnaires ne peuvent plus se concevoir comme les organisateurs de la classe, ils mettent cela sur le compte d'un manque de volonté de notre parti d'une peur névrotique d'altérer la spontanéité pure et originelle du prolétariat. Le problème réel, que nous posons est immanquablement éludé dans leurs polémiques.
Ce n'est pas une question de volonté qui fait qu'il est impossible aux organisations révolutionnaires d'être "l'organe central" de la classe ouvrière, mais les changements historiques, structurels et irréversibles qui sont intervenus dans la vie du capitalisme. Mais plutôt que d'essayer de le démontrer abstraitement, voyons de quelle manière les événements de Pologne ont démontré dans la pratique ce qu'une organisation révolutionnaire ne peut pas faire ainsi que ce qu'elle peut et doit faire pour assumer ses responsabilités.
LA POLOGNE : UN EXEMPLE DE GREVE DE MASSE
Peut-être plus que toute autre lutte depuis la dernière vague révolutionnaire, les récentes grèves de Pologne donnent un modèle exemplaire du phénomène de la grève de masse. Elles ont explosé brutalement et se sont étendues comme une traînée de poudre; elles ont fait surgir des formes autonomes d'organisation de classe ; elles ont rapidement amené les ouvriers à faire face aux conséquences politiques de leurs luttes économiques ; elles ont tendu à unir les ouvriers comme classe au-delà des divisions corporatistes, et contre ensemble de l’ordre bourgeois. Comment cela nous permet-il de comprendre le rôle des révolutionnaires aujourd'hui ?
D'abord, cela montre que les grands mouvements de classe ne peuvent plus être planifiés et préparés à l'avance (au moins jusqu'à ce que la classe soit déjà en train de commencer à s'organiser elle-même de manière explicitement révolutionnaire). Les conditions des grèves de masse mûrissent presque imperceptiblement dans les profondeurs de la société bien qu'elles surgissent généralement en réponse une attaque particulière de la classe dominante, il est impossible de prédire avec précision quelle attaque est susceptible de provoquer une réponse massive.
La plupart des groupes révolutionnaires aujourd'hui sont d'accord sur le fait que la classe n'a plus aucune organisation de masse permanente pour préparer la lutte à l'avance, mais ils parlent encore de la préparation matérielle, technique ou organisationnelle des luttes prise en charge par une minorité combative ou par des groupes de communistes dans les usines. C'est un des thèmes favori du GCI par exemple.
Mais quels sortes de préparatifs matériels pourrait apporter une poignée de communistes ou de groupes ouvriers à un mouvement de l'ampleur de la vague de grèves de l'été 80 en Pologne ?
Il serait ridicule de les imaginer récoltant quelques sous pour un fond de grèves ou traçant des plans pour montrer aux ouvriers les routes les plus rapides pour traverser la ville pour appeler les autres usines à la grève. Il serait également absurde d'envisager des groupes de révolutionnaires dressant des listes précises de revendications économiques qui pourraient séduire les ouvriers et les encourager à entrer en grève massivement. Comme le disait Rosa Luxemburg, on ne peut gagner les ouvriers à "l'idée" de la grève de masse par une "agitation méthodique".
De tels préparatifs "matériels" seraient tout aussi ridicules hors d'une période où les ouvriers sont organisés massivement. Mais, comme le montrent les événements de Pologne, ces organisations ne peuvent être créées que par la lutte elle-même. Ceci ne veut pas dire que les révolutionnaires, dans ou hors des usines, ne peuvent rien faire jusqu'à ce que la lutte éclate à une échelle massive. Cela signifie que la seule préparation sérieuse qu'ils peuvent entreprendre est essentiellement une préparation politique : encourager les ouvriers les plus combatifs des différentes usines à se grouper et discuter les leçons de la lutte et ses perspectives, en propageant les formes et les méthodes les plus efficaces de lutte, en démontrant la nécessité de voir la lutte dans une usine ou une ville comme partie d'une lutte historique et mondiale.
Sur la question particulière des revendications économiques, des buts immédiats de la lutte, les grèves de Pologne démontrent que, comme les formes organisationnelles de la lutte, les revendications immédiates sont aussi le produit de la lutte elle-même, et suivent de près son évolution générale.
Les ouvriers polonais ont montré qu'ils étaient tout à fait capables de décider quelles revendications économiques avancer, quelles sortes de revendications peuvent être une réponse efficace à l'offensive de la bourgeoisie, quelles revendications peuvent le mieux servir l'unité et l'extension du mouvement. Confrontés aux augmentations de prix du gouvernement, ils se sont groupés et ont dressé des listes de revendications sur des principes de classe élémentaires : rejet des augmentations des prix, augmentation des salaires. Avec le développement des luttes, les revendications se sont posées de façon plus systématique.
Le MKS à Gdansk a publié des articles informant les ouvriers sur les revendications qu'ils devaient émettre et sur la manière de conduire les grèves. Par exemple, il a conseillé aux ouvriers de demander une augmentation uniforme pour tous, et insisté pour "qu'elle soit effectivement uniforme, simple et facilement compréhensible pour tous dans son application"(Solidarnosc no3, cité par Solidarity n°14)
Lorsque la lutte s'est élargie, lorsqu'elle a pris une dimension de plus en plus sociale et politique, les revendications économiques ont vu leur importance se réduire relativement. Ainsi, les mineurs silésiens déclarèrent simplement qu'ils se battraient pour les "revendications de Gdansk", rien de plus. A de tels moments, la lutte elle-même commence à aller au-delà des buts qu'elle s'était consciemment fixés. Ceci ne fait qu'amplifier le fait qu'il serait ridicule pour les révolutionnaires en de telles circonstances de limiter à l'avance les buts de la lutte en présentant une liste fixe de revendications que les ouvriers devraient reprendre. Les révolutionnaires prendront certainement part à la formulation des revendications économiques par les assemblées de travailleurs, mais ils doivent également insister sur la souveraineté des assemblées dans la décision finale des revendications à avancer. Cela ne tient pas à un respect abstrait pour la démocratie, mais au fait que le processus d'élaboration des revendications dans son ensemble - et qui va au-delà de cet aspect - n'est rien d'autre que le développement de la conscience du prolétariat à travers sa pratique.
Les revendications avancées pendant les grèves en Pologne illustrent un autre aspect de la lutte de classe à notre époque : la manière dont elle passe rapidement du terrain économique au terrain politique. Contrairement à ce que beaucoup de "partidistes" peuvent clamer, les luttes immédiates de la classe ne sont pas "purement économiques", leur caractère politique ne pouvant se développer que par la médiation du parti. Dans Workers'Voice n°l (nouvelle série), la CWO reproche à Rosa Luxemburg sa sous-estimation du rôle du parti qui, dit-elle, a sa source dans une incompréhension des rapports entre les luttes politiques et les luttes économiques :
"Son culte de ‘spontanéité' l’a conduite à dire que les grèves politiques et économiques sont la même chose. Elle n'a pas compris que, bien que les luttes économiques constituent le terrain pour que se développent les luttes politiques, elles ne conduisent pas automatiquement au renversement du capitalisme sans une décision consciente des travailleurs".
Il semble que Rosa Luxemburg maîtrisait mieux la dialectique que la CWO. Elle n'a jamais dit que les grèves politiques et les grèves économiques sont la même chose, pas plus que la grève politique conduit automatiquement au renversement du capitalisme, ni que le capitalisme peut être renversé "sans une décision consciente des travailleurs", ou encore sans l'intervention d'un parti révolutionnaire, comme la CWO l'admet d'ailleurs quand elle expose dans les pages voisines les positions de Luxemburg sur le rôle des révolutionnaires. Par contre, ce que Luxemburg a dit, c'est que, particulièrement dans notre siècle, la lutte de classe n'est pas une série "d'étapes", mais un mouvement unique, dynamique, dialectique :
"Grèves économiques et politiques, grèves de masse et grèves partielles, grèves de démonstration ou de combat, grèves générales touchant des secteurs particuliers ou des villes entières, luttes revendicatives pacifiques ou batailles de rue, combats de barricades - toutes ces formes de lutte se croisent ou se côtoient, se traversent ou débordent l'une sur l'autre : c'est un océan de phénomènes éternellement nouveaux et fluctuants".
("Grève de masse...")
De plus, il est sans intérêt de vouloir séparer chaque phase du processus :
"La théorie subtile dissèque artificiellement à l'aide de la logique, la grève de masse pour obtenir une "grève politique pure " ; or une telle dissection comme toutes les dissections- ne nous permet pas de voir le phénomène vivant, elle nous livre un cadavre".("Grève de masse...")
La lutte de classe comme Marx le soulignait, est toujours une lutte politique ; mais, dans les conditions de la décadence et du capitalisme d'Etat, le mouvement qui va des grèves économiques aux grèves politiques est beaucoup plus rapide, puisque chaque lutte ouvrière sérieuse est amenée à faire face à l'Etat. En Pologne, les ouvriers étaient clairement conscients du caractère politique de leur lutte, à la fois parce qu'ils insistaient sur la nécessité de passer par-dessus la tête des représentants locaux en négociant avec le vrai "manager" de l'économie, l'Etat, et à la fois parce que, de plus en plus, ils comprenaient que leur lutte ne pourrait aller de l'avant qu'en avançant des revendications politiques et en se posant en adversaire de l'organisation du pouvoir politique en place.
Il est vrai que la plupart -sinon toutes- des revendications politiques des ouvriers polonais étaient confuses, empreintes de l'illusion de pouvoir réformer l'Etat capitaliste. Il est vrai que cela met en évidence la nécessité de l'intervention d'une minorité communiste qui sache expliquer la différence entre les revendications prolétariennes (qu'elles soient économiques ou politiques) et des revendications qui ne peuvent qu'embarquer la lutte hors de ses rails propres. Mais rien de tout ceci ne change le fait que même sans l'intervention d'un parti, la classe ouvrière est capable d'élever ses luttes à un niveau politique important. C'est d'ailleurs ce fait là qui fera que les ouvriers seront de plus en plus réceptifs aux idées révolutionnaires. C'est seulement quand les ouvriers sont déjà en train de réfléchir et de parler en termes politiques qu'une minorité révolutionnaire peut espérer avoir un impact direct sur la lutte.
AUTO-ORGANISATION DES OUVRIERS OU "ORGANISER LA CLASSE"
"La conception clichée, bureaucratique et mécanique veut que la lutte soit seulement un produit de l'organisation à un certain niveau de sa force. L'évolution dialectique vivante fait au contraire naître l'organisation comme un produit de lutte. Nous avons déjà vu un exemple grandiose de ce fait en Russie, où un prolétariat presque pas organisé s'est en un an et demi de luttes révolutionnaires orageuses, créé un vaste réseau d'organisations.,,
("Grève de masse...")
A nouveau les termes de R. Luxemburg s'appliquent quasiment à la perfection aux récentes grèves de Pologne. Tout comme la Russie de 1905 -où le caractère "inorganisé" du prolétariat était moins une expression de 1'arriération des conditions russes qu'un signe avant-coureur de la situation qui attendait l'ensemble du prolétariat tout entier, à une époque où commençait à surgir le capitalisme d'Etat, les ouvriers polonais sont entrés en lutte sans aucune organisation préalable. Et pourtant, sans avant-garde révolutionnaire pour leur dire ce qu'il fallait faire ou pour leur apporter des structures organisationnelles toutes prêtes, ils ont montré une formidable capacité à s'organiser en assemblées de masse, comités de grève d'usines, comités de grève inter-usines, milices ouvrières ...
En réalité, l'auto organisation des ouvriers polonais a montré que, sous beaucoup d'aspects,,ils ont assimilé les leçons de la décadence de façon bien plus pénétrante que beaucoup de nos super-partidistes. Le GCI par exemple, tout en reconnaissant que les comités de grève inter-usines constituaient un réel acquis organisationnel du mouvement, s'est retenu d'en tirer les conclusions logiques. Quand le CCI dit que les assemblées de masse, les comités de grève et les conseils sont la forme d'organisation unitaire du prolétariat à notre époque, le GCI nous accuse de formalisme. Pourquoi le GCI ne critique t'il pas les ouvriers polonais d'avoir créé "formellement" des assemblées de masse et des comités de grève centralisés, composés de délégués élus et révocables. Le fait est qu'alors que le GCI voudrait quitter la table à la recherche de quelque forme nouvelle, mystérieuse d'organisation de classe, les ouvriers polonais ont montré que la forme des assemblées, des comités de grève et des conseils est la forme la plus simple, efficace, unifiante et démocratique pour l'organisation de la lutte de classe à notre époque. Là, il n'y a pas de mystère, seulement l'admirable simplicité d'une classe qui recourt à des réponses pratiques posées par des problèmes pratiques.
Au contraire du GCI, la CWO n'a pas oublié que le capitalisme est un système décadent et que les vieilles formes de 1"associationisme ouvrier" ne sont plus utiles. Dans Workers'Voice n°l, elle montre qu'elle a compris l'importance certaine des assemblées générales, des comités de grève et de la forme soviet. Dans son article sur la Pologne, la CWO dit que "la façon dont ils ont relié les comités de grève à Gdansk pour former un corps unifié représentant plus de 200 usines, et leur refus d'accepter le prix de la crise capitaliste, ont fait des ouvriers polonais l'avant-garde de la classe ouvrière mondiale". Et elle publie un long article célébrant le 75ème anniversaire du premier soviet, montrant que la démocratie ouvrière de la forme soviet est qualitativement supérieure à la "démocratie" des institutions parlementaires bourgeoises :
"Il ne fait pas de doute que la différence la plus importante avec la démocratie capitaliste est l'idée de "délégation". Cette idée fut d'abord utilisée par la classe dans la Commune de Paris de 1871 et permit aux ouvriers de révoquer leurs représentants à tout moment (au lieu d'attendre 5 ans avant l'élection suivante). De plus le délégué n'est pas un libre agent comme les députés du parlement. Quand un délégué ouvrier parle et vote sur un problème, il ne peut se contenter de dire ce qu'il sent à ce moment. Il vote sur la base des ordres des ouvriers qui l'ont élu. S'il faillit à défendre et mettre en oeuvre leur volonté, il peut être révoqué instantanément... "
La CWO conclut que le système du soviet "a prouvé en pratique à tous les sceptiques que les ouvriers peuvent se diriger eux-mêmes". Plus loin, il attaque même le "partidisme", l'idée social-démocrate (et, selon elle, bordiguiste) selon laquelle "tout ce dont la révolution a besoin, c'est d'un général pour dresser des plans de campagne, et la classe ouvrière suivra son chef". Elle insiste sur le fait que "les révolutions ne peuvent être soigneusement organisées, quand le voudraient et comme le voudraient les "partidistes et que tout d'abord doivent exister une situation politique et des conditions qui amènent les masses des gens à la révolte ouverte".
La CWO exagère lorsqu'elle attribue des vues aussi grossières aux bordiguistes. Mais c'est néanmoins un signe positif qu'elle soit si enthousiaste à défendre les formes de démocratie ouvrière créées par la classe, dans le passé et dans le présent. Mais lorsqu'elle tente de combiner cet enthousiasme avec son idée bien arrêtée selon laquelle le parti doit organiser la classe et prendre le pouvoir en sa faveur, elle se met dans toutes sortes de contradictions. Ainsi, d’un côté elle montre clairement comment les ouvriers polonais ont "spontanément" créé les comités de grève inter usines (à savoir sans l'intervention d'un parti révolutionnaire). Mais en même temps, elle se sent obligée d'avancer que le soviet de 1905 -qui était à sa façon un comité de grève inter-usines ne fut pas créé spontanément mais fut en réalité "produit" par le parti. Comment arrive t'elle à démontrer cela, alors qu'ailleurs elle admet qu'initialement les bolcheviks "ramenaient le Soviet à un simple corps syndical" ? Principalement en reproduisant soigneusement une citation de Trotsky sortie de son contexte. Selon la CWO, Trotsky disait que le soviet n'a pas émergé spontanément, mais "a été en fait un produit des divisions existant dans le parti social-démocrate, entre les fractions bolcheviks et mencheviks. Comme Trotsky le dit dans 1905, le Parti produisit Le Soviet". Ce que disait en fait Trotsky, c'est que les divisions entre les fractions social-démocrates "rendaient la création d'une organisation non affiliée au parti absolument essentielle". Mais Trotsky ne disait pas que , parce qu'un tel corps était essentiel, il pouvait être produit par le parti à volonté. En fait, la nature divisée du parti le rendit moins capable de jouer un rôle d'avant-garde dans ces événements ; et de toutes -façons, s'il n'y avait pas eu des centaines de milliers d'ouvriers formant déjà des comités d'usines, tendant déjà vers la centralisation de leur mouvement de grèves, le parti n'aurait pas été du tout capable de contribuer à la création des soviets. La CWO oublie aussi cela quand elle montre que les "mencheviks prirent l'initiative d'opérer à rejoindre le soviet qui avait commencé avec seulement 30 ou 40 délégués ne représentant pas plus que quelques milliers d'ouvriers". "Appeler" au soviet, n'est pas la même chose que le "produire". Les mencheviks et d'autres révolutionnaires ont certainement pris une admirable initiative lorsqu'ils ont appelé activement à la formation d'un comité de grève central, mais personne ne les aurait entendus s'ils n'avaient été en relation avec un puissant mouvement de classe qui allait déjà de l'avant.
"Quand la vague de grève s'étendit de Moscou à St Petersbourg, le11 octobre, les ouvriers sortirent spontanément pour des actions concertées. Des députés furent élus dans plusieurs usines, y compris les usines de Poutilov et Obukhov; un certain nombre de députés avaient été auparavant membres de comités de grève ... Le 10 octobre., une scission du groupe menchevik (de St Petersbourg) proposa de fonder un "comité ouvrier" à
l’échelle de la ville, pour conduire la grève générale, et commencer la propagande pour son élection. Le jour suivant environ cinquante agitateurs commencèrent à faire circuler parmi les ouvriers un appel proposant l'élection d'un député pour 500 ouvriers.. "
(0. Answeiler "Les soviets en Russie" Ed. Gallimard)
L'intervention des mencheviks -dans ce cas précis les mencheviks étaient bien en avance sur les bolcheviks- est un bon exemple de comment une organisation révolutionnaire peut accélérer et pousser en avant l'auto organisation de la classe. Mais elle montre aussi que les organisations que sont les soviets, ne sont pas "produites" par les partis dans le sens propre du terme. En proclamant cela, la CWO oublie qu'elle insiste elle-même sur le fait que "tout d'abord, il doit exister une situation politique et des conditions qui amènent des masses de gens à la révolte ouverte". Si les ouvriers ne sont pas déjà en train de créer leurs propres organisations dans le feu de la lutte, alors les appels des révolutionnaires à des formes d'organisations autonomes et centralisées tomberont dans des oreilles sourdes, et si les révolutionnaires essayent de se substituer au mouvement réel en dressant artificiellement des structures alternatives de différentes sortes (par exemple des unités de combat du Parti
ou des comités ouvriers auto-proclamés), ou bien ils se rendront ridicules, ou bien ils se transformeront en de dangereux obstacles au développement de la conscience de la classe.
Les contradictions de la position de la CWO peuvent être perçues en creusant un peu leur distinction entre délégation et représentation. Nous sommes d'accord sur le fait que la délégation prolétarienne est tout à fait différente de la "représentation" capitaliste. Mais pourquoi la CWO n’en tire t'elle pas la conclusion logique que dans le système du soviet, où tous les délégués sont sujets à être révoqués à tout moment, il ne peut être question d'ouvriers élisant le parti au pouvoir, parce que c'est précisément la façon dont opèrent les parlements bourgeois ? Jusqu'à présent nous n'avons remarqué aucune prise de position de la CWO montrant qu'elle a changé sa position sur le parti prenant le pouvoir. Au lieu de cela, écrivant à propos des grèves polonaises, elle dit que nous pouvons apprendre beaucoup de Walesa et autres activistes des syndicats libres (c'est à dire des militants qui ont défendu une orientation politique bourgeoise) parce qu'ils ont su s'implanter dans la classe et "contrôler" la lutte :
"Les amis politiques de Walesa ont contrôlé la lutte jusqu'à la"victoire" parce qu'ils avaient la confiance et le soutien des ouvriers -une confiance qui s'est construite pendant 10 ans de sacrifices et de lutte. Cette minorité a su assurer une présence dans la classe ouvrière. Dans ses actions (mais en clair PAS dans sa politique) il y a des leçons à suivre pour les communistes".
C'est un argument extrêmement dangereux, et il embrasse l'idée trotskyste que le problème qu'affronte la classe ouvrière est sa "direction bourgeoise" et que tout ce dont elle a besoin est de la remplacer par une direction prolétarienne. En fait, pour le prolétariat, il ne peut y avoir aucune séparation entre les moyens et les fins, les"actions" et la "politique". Dans le cas de Walesa, il y a un lien clair entre ses idées politiques et une tendance à se séparer de la masse des ouvriers et devenir une "idole" du mouvement (un processus que la presse occidentale a tout fait pour accélérer bien sûr). De même, une des expressions de l’immaturité politique des ouvriers polonais fut une certaine tendance, spécialement vers la fin de la grève, à remettre les prises de décision à des "experts" et à des personnalités individuelles comme Walesa. La "direction" pour une minorité communiste, ne peut obéir à la même logique. L'intervention communiste ne cherche pas à avoir le "contrôle" des organes de masse de la classe, mais à encourager les ouvriers à prendre tout le pouvoir dans leurs mains, à abandonner toute idée de se remettre en confiance à des "sauveurs venus du ciel" (pour citer l'Internationale). il n'y a aucune contradiction entre cela et "gagner les ouvriers au programme communiste" car le programme communiste, dans son essence, signifie que la classe ouvrière assume la maîtrise consciente des forces sociales qu'elle a créées elle-même.
LA CONSCIENCE DE CLASSE ET LE ROLE DES REVOLUTIONNAIRES
"La doctrine matérialiste qui veut que les hommes soient des produits des circonstances et de l'éducation, que, par conséquent, des hommes transformés soient des produits d'autres circonstances et d'une éducation modifiée, oublie que ce sont précisément les hommes qui transforment les circonstances et que l'éducateur lui-même a besoin d'être éduqué. C'est pourquoi elle tend inévitablement à diviser la société en deux parties dont l'une est au-dessus de la société (par exemple chez Robert Owen). La coïncidence du changement des circonstances et de l'activité humaine ne peut être considérée et comprise rationnellement qu'en tant que révolutionnaire. "
Marx – Thèses sur Feuerbach Ed. Sociales p.88)
La théorie kautskyste selon laquelle la conscience de classe socialiste n'est pas produite par la lutte de classe, mais est importée dans la classe "de l'extérieur", sous-tend toutes les conceptions substitutionistes que nous avons critiquées dans cet article. Bien que seuls quelques groupes, comme Battaglia Comunista, défendent explicitement cette thèse, les autres y glissent constamment parce qu'ils n'ont pas de théorie claire de la conscience de classe à y opposer. Tous ceux qui soutiennent que la classe ouvrière est trop aliénée pour devenir consciente d'elle même sans la médiation "extérieure" d'un parti, oublient que "les éducateurs ont besoin d'être éduqués"- que les révolutionnaires font partie de la classe et sont donc sujets aux mêmes aliénations. Ils oublient aussi que c'est précisément parce que le prolétariat souffre d'aliénation dans sa situation au sein du capitalisme, qu'il est une classe communiste, une classe capable de donner naissance à un parti communiste et d'aller vers une vision du monde, claire, démystifiée et unifiée. Nous ne pouvons entrer ici dans une longue discussion sur ces questions difficiles. Mais un exemple évident de la façon dont l'héritier moderne de Kautsky "tend inévitablement à diviser la société en deux parties, dont l'une est au-dessus de la société" c'est sa vision du mouvement "spontané" de la classe, c'est à dire tout mouvement non dirigé par le parti, comme un mouvement essentiellement inconscient.
Battaglla Comunista l'a clairement exprimé en disant que, sans le parti, on peut parler d"'instinct de classe", mais pas de "conscience de classe" (cf. "Classe et Conscience" , Prometeo n" 1978). Ainsi, le mouvement spontané de la classé n’est rien qu'un instinct, une force naturelle aveugle qui nécessite le parti comme cerveau ; en termes philosophiques un "ça" sans "moi". De telles conceptions laissent penser que la classe est aiguillonnée dans l'action par les circonstances matérielles, comme le chien qui salive dans les expériences de Pavlov. Elles peuvent aller jusqu'à admettre que de telles réactions spontanées puissent donner naissance à un certain niveau d'auto organisation. Mais sans le parti, insiste t’on, de tels mouvements ne peuvent devenir vraiment conscients : comme les animaux, les ouvriers ne peuvent avoir de mémoire ni de vision du futur. Ils sont condamnés à vivre le présent immédiat car le parti est leur mémoire, leur conscience. Une fois de plus, les ouvriers polonais ont démenti de telles théories. Comme nous l'avons écrit dans la Revue Internationale n°23:
"Le parti n'est pas 1'unique siège de la conscience de la classe, comme le prétendent., avec outrance, tous les épigones qui s'intitulent léninistes. Il n'est ni infaillible, ni invulnérable. Toute l'histoire du mouvement ouvrier est là pour en témoigner. Et l'histoire est aussi là pour montrer que la classe dans son ensemble accumule des expériences et les assimile directement. Le récent mouvement formidable de la classe ouvrière en Pologne témoigne de sa capacité remarquable à accumuler et assimiler ses expériences de 70 et 76 et à les dépasser, cela malgré l’absence qui se fait cruellement sentir, d'un parti. "
Les ouvriers polonais ont montré que la classe possède en fait une mémoire. Ils se sont rappelés l'expérience des luttes passées et ont tiré les leçons appropriées. Les ouvriers de Lublin, ont démoli les voies de chemin de fer parce qu'ils se souvenaient qu'en 1970, les troupes avaient été envoyées par rail pour briser le soulèvement ouvrier. Les ouvriers se sont rappelés que les mouvements de 70 et 76 avaient été au départ vulnérables face à la répression à cause de leur isolement, aussi, ils ont étendu leurs grèves et les ont coordonnées par les comités de grève. Ils se sont souvenus que à chaque soulèvement contre l'Etat, le gouvernement a essayé de les apaiser en faisant sauter la clique dirigeante du moment et en la remplaçant par une brochette de bureaucrates plus "populaires" et plus "libéraux". Mais quand on voit comment le "libéral" Gomulka de 1956 est devenu le Gomulka de la "ligne dure" de 1970, et comment le "libéral" Gierek de 1970 est devenu le Gierek de la "ligne dure" de 1980, les ouvriers n'ont pas été dupes une seule minute de la dernière série de purges dans le gouvernement. Déjà en 1970, les ouvriers polonais se racontaient la blague suivante :
Question : "Quelle est la différence entre Gomulka et Gierek ?"
Réponse : "Aucune, mais Gierek ne le sait pas encore
En 1980, le cynisme des ouvriers sur tout ce que fait ou dit le gouvernement est même plus profondément enraciné : d'où leurs efforts pour s'assurer que les acquis de la lutte seraient imposés et sauvegardés par la force et non pas en mettant une confiance quelconque dans le gouvernement.,
Mais peut-être la preuve la plus certaine de la capacité des ouvriers à assimiler les leçons du passé, s'est montrée dans leur attitude par rapport à la question de la violence. Ils n'ont pas oublié l'expérience de 1970, où furent tués des centaines d'ouvriers alors engagés dans des affrontements avec l'Etat impréparés et non coordonnés. Ceci n'en fait pas des pacifistes : ils ont organisé rapidement des milices ouvrières dans les usines occupées. Mais ils ont compris que la force réelle de la classe, son auto-défense véritable, se trouve sans sa capacité à organiser et étendre sa lutte à une échelle de plus en plus massive. Ici encore, les ouvriers se sont montrés plus avancés que ces groupes d"'avant-garde" qui jacassent sur le terrorisme ouvrier et condamnent comme "kautskyste" l'idée que la violence de classe doit être sous le contrôle et la direction des organes de masse de la classe. Les ouvriers étaient préparés à la violence, mais ils ne voulaient pas être entraînés dans des affrontements militaires prématurés, ou laisser des groupes isolés d'ouvriers engager des assauts désespérés contre la police ou l'armée. Le fait que les ouvriers polonais aient commencé à penser la "question militaire" comme un aspect de l'organisation générale de la lutte augure bien de l'avenir : parce que lorsque le moment arrivera de prendre d'assaut directement l'Etat, les ouvriers seront d'autant mieux placés comme force unie, organisée, consciente.
Cette "mémoire
prolétarienne" n'est pas transmise génétiquement Les ouvriers polonais ont
pu assimiler les expériences du passé parce que, même en l'absence d'une
organisation révolutionnaire, il y a toujours des discussions et des débats
dans la classe, à travers des centaines de canaux, certains plus formels
-assemblées de masse, cercles ouvriers de discussion, etc.- d'autres moins
formels -discussions dans les cantines d'usines, dans les cafés, les autobus
... Et comme ces canaux assurent la mémoire collective de la classe ouvrière,
ils permettent aussi aux ouvriers de développer une vision du futur -et pas
seulement le futur d'une industrie ou d'une usine particulière, mais l'avenir
du pays entier et même de la planète entière.
Ainsi, les ouvriers polonais ne pouvaient pas simplement éviter
d'essayer de comprendre l'effet que leurs grèves auraient sur l'économie
nationale, sur le gouvernement futur du pays ; ils ont été obligés de discuter
ce que la Russie
ferait au sujet des grèves, comment la réaction de la Russie serait affectée par
son intervention en Afghanistan, comment l'Ouest répondrait, etc. ... Ce n'est
pas l'intervention du parti qui oblige les ouvriers à regarder plus loin que la
porte de l'usine et plus loin devant eux que le jour suivant : c'est le
mouvement historique de la société capitaliste dans son ensemble.
Mais, attendez, crient nos adorateurs de parti, si la classe ouvrière est son propre cerveau, à quoi donc sert le parti ? Ce n'est là une question réelle que pour ceux dont la pensée est enfermée dans des schémas poussiéreux, qui voient la lutte de classe comme une série d'étapes fragmentées sans
liens sous-jacents.
Oui, la classe ouvrière en tant que tout a sa propre mémoire. Mais l'organisation révolutionnaire constitue une partie particulière et cruciale de cette mémoire . Seule l'organisation révolutionnaire peut offrir un point de vue qui englobe le tout de l'histoire de la classe ouvrière, qui la rend capable, non seulement de relier l'expérience polonaise de 1980 avec les expériences polonaises de 1956, 1970 et 1976, mais encore de relier toutes ces expériences aux leçons de la révolution de 1917 en Russie, à l'expérience que les ouvriers de l'Ouest ont faites des syndicats soi-disant libres depuis 1914, à ce que Marx, Lénine, Bordiga, Pannekoek, et d'autres révolutionnaires ont écrit sur la façade que constitue la démocratie bourgeoise, etc... Parce que les révolutionnaires peuvent offrir une vue globale du système capitaliste entier, ils peuvent aussi fournir une estimation réaliste du rapport de forces de classes à tout moment. De plus, une telle vision globale peut aider les ouvriers à voir qu'il ne peut y avoir de solutions nationales à la crise, que la lutte doit s'étendre au-delà des frontières nationales si elle veut survivre et grandir. En bref, seuls les révolutionnaires peuvent clairement montrer le lien entre la lutte d'aujourd'hui et la révolution de demain. Les révolutionnaires ne peuvent "injecter" la conscience chez les ouvriers, mais ils contribuent à donner des réponses aux questions que les ouvriers sont déjà en train de se poser, ils peuvent mettre ensemble tous les différents enchaînements dans la pensée collective de la classe et présenter dans la classe ouvrière un tableau global et clair de la signification et de l'orientation de sa lutte.
Les superpartidistes
objecteront probablement : cela sonne comme du simple propagandisme. Quelles sont les tâches "pratiques"
du parti ? En posant de telles questions, ils oublient la remarque de Marx "La théorie aussi devient force
matérielle dès qu'elle étreint les masses" (Contribution à la critique de la philosophie du droit de
Hegel). Dans le feu de la guerre de
classe, les ouvriers deviennent théoriciens, et ainsi, ils transforment la
théorie en propagande, la propagande en agitation, et 1 'agitation en
action. En d'autres termes, plus les
idées des révolutionnaires correspondent à ce que la classe ouvrière est en
train de mettre en pratique, moins elles sont abstraites : ce qui était hier
une critique théorique de la démocratie bourgeoise peut, dans une situation
révolutionnaire, devenir un slogan agitatoire pratique comme "Tout le
pouvoir aux soviets". Et pour
l'organisation révolutionnaire, ce n'est pas de l'activité "simplement
propagandiste" dans le sens d'une répétition pédante de vérités générales,
issues de la lutte. L'organisation
révolutionnaire doit rechercher constamment à rendre ses analyses de plus en
plus concrètes, de plus en plus liées à des suggestions pratiques pour l'action
; et elle ne peut le faire que si elle est dans la lutte, si ses membres sont
sur le front du mouvement de classe, s'ils interviennent dans chaque expression
de la lutte du prolétariat, depuis le piquet de grève jusqu'au soviet central .
Il est pourtant ironique de voir que ceux qui soulignent le fait que la classe ne peut être consciente sans le parti, sont les mêmes qui ricanent presque toujours à l'idée que la tâche centrale et spécifique du parti est d'approfondir et d'étendre la conscience de la classe. Pour eux, tout ce qui parle de généralisation de la conscience de classe n'est que "propagandisme" : pour eux, ce qui distingue l'organisation révolutionnaire sont les tâches "pratiques", "organisationnelles".
Quand on leur demande d'être plus précis sur ces tâches, soit ils répondent avec encore plus de ces généralités que personne ne pourrait désavouer ("le parti doit jouer un rôle d'avant-garde dans les soviets", "les révolutionnaires doivent être préparés à se mettre à la tête des grèves", etc.), soit ils sortent des fantasmes semi-terroristes sur les groupes de combat du parti stimulant les ouvriers à résister (quand donc cela a-t-il été le cas dans l'histoire de la classe ouvrière ?). Ou bien, encore plus ridicule, ils iront jusqu'à vous dire comment, un jour, le parti va "avoir le pouvoir"sur le monde entier.
La vérité est que la classe ouvrière n'a pas besoin de révolutionnaires parce qu'ils seraient de bons administrateurs ou spécialistes pour faire sauter les ponts. Très certainement, les révolutionnaires auront des tâches administratives et militaires, mais ils ne peuvent mener effectivement de telles tâches que s'ils les assument en tant que partie du vaste mouvement prolétarien, comme membres des conseils ouvriers ou des milices ouvrières. La chose réellement précieuse, irremplaçable, qu'ont les révolutionnaires est leur clarté politique, leur capacité à synthétiser l'expérience historique, collective de la classe et la renvoyer au prolétariat sous une forme qui puisse être aisément comprise et utilisée comme guide pour l'action. Sans cette synthèse, la classe ouvrière n'aura tout simplement pas le temps d'assimiler toutes les leçons de l'expérience passée : elle sera condamnée à répéter les erreurs du passé et être ainsi défaite une fois de plus. Certains révolutionnaires peuvent voir ça comme une piètre tâche pour le formidable parti révolutionnaire, mais le succès ou la faillite de la révolution dépendra de la capacité du parti à s'en acquitter.
La lutte des ouvriers polonais est un avant-goût de ce qui s'accumule partout pour le capitalisme. Parce que la bourgeoisie sera appelée, par la logique de la crise, à attaquer de plus en plus sauvagement la classe ouvrière, et parce que la classe ouvrière reste invaincue, il y aura d'autres "Pologne", pas seulement dans le tiers-monde et le bloc de l'Est, mais aussi dans les principaux pays de l'impérialisme occidental . L'issue de ces confrontations déterminera le sort de l'humanité. Si la classe ouvrière est capable de développer son autonomie politique et organisationnelle dans ces batailles, si ces batailles fournissent une ouverture pour l'intervention des révolutionnaires et un élan vers la formation d'un parti communiste international, alors elles seront les répétitions de la 2ème révolution prolétarienne du 20ème siècle. Si par contre, les cauchemars du passé pèsent trop lourd sur les cerveaux des vivants, si les ouvriers sont incapables de voir les mensonges de l'ennemi de classe, si le prolétariat reste isolé de son avant-garde révolutionnaire, alors ces batailles finiront en défaites qui peuvent ouvrir la porte à la 3ème guerre mondiale. L'unique chose sûre est que la classe ouvrière ne peut briser les chaînes de l'aliénation et de l'oppression en faisant appel à une quelconque force en dehors d’elle-même. La minorité révolutionnaire comme partie de la classe partagera le sort de la classe, dans la défaite ou dans la victoire. Pourtant, parce que ce que font les révolutionnaires dès aujourd’hui sera demain un des facteurs déterminants pour la victoire ou la défaite de la classe ouvrière, une immense responsabilité pèse sur leurs épaules ; Ils ne peuvent être fidèles à cette responsabilité que s’ils se libèrent à la fois du dilettantisme et de la mégalomanie et apprennent à regarder en face la réalité sans illusions.
C.D. Ward
Novembre 1980
Géographique:
- Pologne [1]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le mouvement révolutionnaire et la question syndicale après la défaite des années 20
- 3496 lectures
Les courants prolétariens
qui ont échappé à la dégénérescence de l'Internationale Communiste (IC )
se sont retrouvés face à l’énorme tâche de résister à l'offensive contre-révolutionnaire
sur tous les plans, politique, théorique et organisationnel. Cette résistance s'est accomplie dans une
situation de déboussolement généralisé dont une des raisons majeures tenait
dans les erreurs de l'IC elle-même, notamment sur les questions parlementaire
et syndicale. Le recul de l'activité
révolutionnaire de la classe ouvrière n'avait pas permis que les débats sur ces
questions se déroulent de façon positive.
Les critiques des gauches communistes (italienne, allemande et
hollandaise) à l'égard de la politique de l'IC n'avaient pu être réellement
approfondies. A la fin des années 20, au
moment du stalinisme triomphant, c'est donc dans des conditions encore plus
difficiles et plus complexes que ce débat va se continuer. Ainsi, sur la question syndicale, l'évolution
des différentes branches de l'opposition communiste internationaliste (gauche
italienne, communistes de conseils, opposition de gauche animée par Trotsky,
etc.) va être tâtonnante. En fait, le courant révolutionnaire se trouvait
devant une double situation en ce qui concernait l'évolution des
syndicats. D'une part, il s'agissait de
reposer la question du syndicalisme dans la période de décadence, et d'autre
part de comprendre les effets de la contre-révolution sur ce plan. Il s'agissait de saisir toutes les
implications politiques du passage des syndicats dans le camp bourgeois et en
même temps de passer au crible la tactique de l'IC d'entrisme dans les
syndicats "réformistes" afin d'y provoquer des scissions qui devaient
permettre l'émergence de syndicats de classe dirigés et contrôlés par les
révolutionnaires.
Les orientations au sein de l’internationale communiste
Dès la formation de la 3ème Internationale, la question syndicale fut au centre de toute une série de discussions et de polémiques. C'est au sein du mouvement révolutionnaire allemand que ce problème fut posé de la façon la plus cruciale et que se dessina la compréhension la plus nette de la nécessité de la rupture avec les syndicats, mais aussi avec le "syndicalisme". Au Congrès de constitution du Parti Communiste d'Allemagne (KPD) fin décembre 1918, c'est-à-dire dans une période pré-révolutionnaire, une tendance majoritaire se prononçait pour la sortie des syndicats. Ainsi Paul Frölich disait: "Nous posons en principe que la séparation des ouvriers entre organisations politiques et organisations syndicales, nécessaire jadis doit maintenant prendre fin. Pour nous, il ne peut y avoir qu'un mot d'ordre : 'Hors des syndicats ! "'.
Rosa Luxemburg refusait ce mot d'ordre, mais d'un point de vue tactique :
"(les syndicats) ne sont plus des organisations ouvrières, mais les protecteurs les plus solides de l'Etat et de la société bourgeoise. Par conséquent, il va de soi que la lutte pour la socialisation ne peut pas être menée en avant sans entraîner celle pour la liquidation des syndicats. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Mais mes opinions diffèrent en ce qui concerne la voie à suivre. J'estime erronée la proposition des camarades de Hambourg tendant à former des organisations uniques économico-politiques (einheitsorganisation), car à mon avis, les tâches des syndicats doivent être reprises par les Conseils d'ouvriers, de soldats et d'usines." (Congrès de la Ligue Spartacus, Ed.Spartacus n°83B).
Malheureusement, la même clairvoyance n'animait pas la direction de l'IC, bien au contraire. Si l'IC dénonçait les syndicats dominés par la Social-démocratie, elle n'en conservait pas moins l'illusion de pouvoir arracher à celle-ci la direction des syndicats. Malgré les critiques de la gauche, surtout la gauche allemande qui scissionnera du KPD pour former le Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne (KAPD), l'IC développait une analyse erronée. En mars 1920, dans une "Adresse aux syndicats de tous les pays", après une analyse sommaire de la dégénérescence des "vieux" syndicats réformistes, l’IC expliquait :
"Les syndicats reprendront-ils à nouveau la vieille voie éculée, réformiste, c'est-à-dire effectivement bourgeoise ? Telle est la question décisive qui se pose à présent précisément au mouvement ouvrier international. Nous sommes fermement convaincus que cela ne se produira pas. Un courant d'air frais a pénétré dans les bâtiments étouffante de vieux syndicats. La décantation a déjà commencé dans les syndicats. Dans un ou deux ans, les vieux syndicats seront méconnaissables. Les vieux bureaucrates du mouvement syndicat deviennent des généraux sans armée. La nouvelle époque produira une nouvelle génération de dirigeants prolétariens dans les syndicats renouvelés". ("Du 1er au 2ème Congrès de l'IC",Ed. EDI).
Dans la même "Adresse" dirigée en fait contre les thèses du KAPD qui prônait la sortie des syndicats et la mise sur pied d'organismes unitaires d'usines, Zinoviev allait même jusqu'à travestir la réalité des syndicats en Europe :
"Dans toute une série de pays s’opère une
forte décantation dans les syndicats. Le
bon grain se sépare de l'ivraie. En
Allemagne, sous la direction de Legien
et de Noske, qui fut le soutien principal du mouvement syndical jaune bourgeois, un grand nombre de syndicats tournent le dos aux social-damocrates jaunes et passent au côté de la révolution prolétarienne. Les
syndicats d'Italie se tiennent presque
sans exception sur le terrain du pouvoir
soviétique. Dans les syndicats de Scandinavie, le courant révolutionnaire
prolétarien grandit de jour en jour.
En France, en Angleterre, en Amérique, en Hollande et en Espagne, la masse des membres des syndicats se défait de la vieille
bourgeoisie et exige de nouvelles
méthodes révolutionnaires".
Bien loin d'aider les Partis Communistes à rompre avec la Social-démocratie, cette orientation fondée sur l'illusion d'un véritable syndicalisme de classe prônait au contraire la même pratique -quoique concurrentielle- que la contre-révolution sur le plan du "contrôle des masses".
Cette orientation entrava fortement la possibilité d'un approfondissement de la question syndicale au sein des différentes organisations qui composaient l'IC. Qui plus est, l'analyse de la nature des syndicats et du syndicalisme restait souvent confuse et contradictoire, compte-tenu de l'influence de plusieurs courants qui subissaient la tradition du syndicalisme révolutionnaire, ce qui rendait le problème encore plus complexe.
En février 1920, la Conférence Internationale d'Amsterdam adopte les thèses présentées par Fraina, secrétaire du Communist Party of America et militant des IWW dans lesquelles on peut lire : "(… ) 11. L'agitation pour la construction de syndicats d'industrie fournit de façon immédiate et pratique la possibilité de mobiliser l'esprit militant de mécontentement qui se développe dans les vieux syndicats, de mener la lutte contre la bureaucratie corrompue et 'l’aristocratie ouvrière'. Le syndicalisme d'industrie fournit en outre la possibilité d'appeler à l’action les ouvriers non qualifiés, inorganisés, et de libérer les ouvriers non qualifiés, organisés dans les syndicats de la tutelle des couches réactionnaires de la classe ouvrière. La lutte pour le syndicalisme révolutionnaire d'industrie est un facteur de développement de la connaissance communiste et pour la conquête du pouvoir". (idem).
Cette analyse reprenait la thèse ambiguë de "l'aristocratie ouvrière" conçue comme une des bases du caractère conservateur du syndicalisme et faisait par ailleurs des syndicats de métier la forme réactionnaire du syndicalisme opposée à celle des syndicats d'industrie. Tout en tentant de cerner l'évolution des syndicats en fonction de l'impérialisme et de la tendance au capitalisme d'Etat, tout en mettant l'accent sur les limites du syndicalisme, cette orientation ne parvenait qu'à s'opposer à une forme de syndicalisme sans remettre en question le syndicalisme
" ( ... ) 5. Le développement de l'impérialisme intègre définitivement les syndicats de métier dans le capitalisme (…)
(…)
(…) 8. La forme d'expression gouvernementale du travaillisme est le capitalisme d'Etat, la fusion dans l'Etat des capitalistes, de la petite bourgeoisie et des couches supérieures de la classe ouvrière qui dominent les syndicats (...) .
(… ) 10. (…) La lutte contre cette forme de syndicalisme (le syndicalisme de métier) est par conséquent une phase inséparable de la lutte contre le travaillisme à travers :
a) de façon générale, l'agitation du parti communiste pour pousser les syndicats à une action plus résolue ;
b) l'encouragement à tout mouvement dans les syndicats qui tend à briser la permanence de la bureaucratie et à donner le contrôle aux masses au moyen de délégués directement mandatés et révocables ;
c) la formation d'organisations comme les comités de Shop-stewards, les comités ouvriers, les conseils ouvriers économiques et des organisations directes du Parti Communiste dans les ateliers, les usines, les mines, qui ne servent pas seulement à lancer les masses et les syndicats vers une action plus révolutionnaire, mais peuvent aussi, au moment de la crise se développer en soviets ;
d) l’effort pour transformer
les syndicats de métier en syndicats d'industrie, c’est à-dire, un syndicalisme
dans une forme parallèle à l'intégration économique du capitalisme moderne et
dans un esprit inspiré par la lutte pour le pouvoir politique et la domination
économique." (idem).
Certaines de ces thèses
étaient en fait très proches des positions régnant au sein des gauches
allemande et hollandaise. Elles
tentaient de dépasser et de critiquer l'économisme, le réformisme et le
syndicalisme "apolitique", mais elles restaient sur le terrain de la
"forme" d'organisation.
L'impossibilité de nouvelles organisations unitaires de masse permanentes
n'était pas encore entrevue. L'idée
était de trouver des formes organisationnelles préservant l'indépendance de
classe et préparant le surgissement des conseils ouvriers. Cette vision était loin d'offrir une garantie
d'indépendance au prolétariat par rapport à la bourgeoisie ; démarche
consistant à faire de la rupture avec le syndicalisme une simple question de
forme d'organisation.
C'est peut-être le
révolutionnaire italien Gramsci qui, au nom de la critique du syndicalisme a
été le plus loin dans la détermination d'une ligne Politique erronée qui
contribua grandement à désorienter la classe ouvrière italienne dans les années
20. Dans un article publié dans son
journal, L'Ordine Nuovo en novembre 1919, Gramsci développait
apparemment une critique prometteuse du syndicalisme : "La théorie syndicaliste a complètement échoué dans I’expérience
concrète des révolutions prolétariennes.
Les syndicats ont démontré leur incapacité organique à incarner la
dictature du prolétariat. Le développement normal du syndicat est caractérisé par une ligne de décadence de
l'esprit révolutionnaire des masses : la force matérielle augmente t'elle ?
L'esprit de conquête s'affaiblit ou disparaît. tout à fait, l'élan vital se
brise, la pratique de l'opportunisme, "du pain et du beurre" succède
à l’intransigeance héroïque ( ... ), le syndicalisme n'est pas un moyen pour la
révolution, n'est pas un élément de la révolution prolétarienne, n’est pas la
révolution qui se réalise, qui se fait : Le syndicalisme n'est révolutionnaire
que par sa possibilité grammaticale d'accoupler les deux expressions. Le syndicalisme s'est révélé n'être rien
d'autre qu-une forme de la société capitaliste et non un développement
potentiel de la société capitaliste."
Mais derrière cette critique résidait en fait une incapacité à tirer les leçons de la révolution russe et à comprendre la base de surgissement des conseils ouvriers. Bien loin d'être un organe politique de pouvoir et un lieu de développement de la conscience de la classe ouvrière, le Conseil Ouvrier était pour Gramsci un organe de gestion économique. Et c'est sur ce plan qu'il bâtissait une critique des syndicats, critique insuffisante pour contribuer à ce que les ouvriers prennent conscience de la fonction des syndicats :
"Le syndicat de métier ou de l'industrie, en groupant entre eux les compagnons de métier ou de telle industrie, qui, dans le travail utilisent le même instrument ou qui transforment la matière première contribue à renforcer cette psychologie, contribue à empêcher toujours davantage les travailleurs à se concevoir comme producteurs..." (Ordine Nuovo. 8/11/19).
Chez Gramsci, cette analyse consistait à évacuer la question de la destruction de l'Etat bourgeois et à faire du prolétariat et de l'usine des catégories économiques : "les lieux où l'on travaille, où les producteurs vivent et oeuvrent ensemble, seront demain les- centres de l’organisme social et devront remplacer les organes directeurs de la société contemporaine" (Ordine Nuovo. 13/9/19). En restent sur le terrain de la production et de la gestion économique, c'est donc en fin de compte la sauvegarde de l'économie que Gramsci défendait dans sa propagande auprès de la classe ouvrière, et donc de la défense du capitalisme :
"Les ouvriers veulent en, finir avec cette situation de désordre, de marasme, de gaspillage industriel L’économie nationale va à vau-l'eau, le taux de change augmente, la production diminue, tout l'appareil, national de production industrielle et agricole s 'achemine vers la paralysie(…) Si les industriel ne sont plus capables d'administrer l'appareil de production et de le faire produire au maximum (qu'ils n'en soient pas capables, chaque jour le démontre davantage) pour sauver de la ruine et de la banqueroute la société, les ouvriers assumeront cette tâche, consciente de la grave responsabilité qu'ils assument et ils l’expliqueront avec leurs méthode et leurs systèmes communistes à travers leurs conseils de productions. " (L'Avanti. 21/11/19).
La fraction animée par Bordiga dénonça ces analyses :
"C'est une grave erreur de croire qu'en introduisant dans le milieu prolétarien actuel, parmi les
salariés du capitalisme, des structures formelles dont on pense qu'elles pourront se constituer pour la gestion de la production communiste, on développe des forces intrinsèquement et par elles même révolutionnaires. Cela a été l'erreur des syndicalistes et c'est aussi l’erreur des zélateurs trop enthousiastes des conseils d’ usine". (Il Soviet. ler février 1920, cité par Programme Communiste n°72).
Cependant, ce que la gauche italienne n'expliquait pas, c'est pourquoi le surgissement d'une nouvelle forme d'organisation unitaire de la classe antagonique aux syndicats et au syndicalisme. Mais la critique juste de solutions préconisées au niveau de formes d'organisation devait amener à l'erreur bordiguiste caricaturée aujourd'hui par le PCI (Programme Communiste), de tirer un trait d'égalité entre toutes les formes d'organisations de la classe et d'insister uniquement sur le rôle prépondérant du parti. On pourra même lire dans "Il Soviet" du 21/9/19 que les soviets de demain doivent avoir leur source dans les sections locales du parti communiste ",(dans Programme Comuniste n°74, p.64). A l'ouvriérisme et à l’usinisme, on finit par opposer le fétichisme du parti et non pas une analyse matérialiste de la phase déclinante du capitalisme et de son incidence sur le mode d'organisation de la classe. Seule une telle analyse permet de cerner les causes de la faillite des syndicats comme organes prolétariens et de comprendre en quoi le contenu du syndicalisme "classique" de la période ascendante du capitalisme est devenu caduc dans l'ère des "guerres et des révolutions", c'est à dire dans la période de décadence du capitalisme.
Dans les années qui vont suivre, ce débat qui se déroulait dans l'ensemble des sections de l'IC va s'enliser. Le recul généralisé de la classe ouvrière en Europe, les défaites du prolétariat allemand, l'isolement de la Russie, la cristallisation des erreurs de l'IC, sa dégénérescence accélérée, tout cela va favoriser les thèses de la défense du bastion prolétarien menant à des conciliations et étouffant la voie des communistes de gauche. Puis, à l'opportunisme ouvert va succéder une phase de liquidation directe de toute position révolutionnaire marquant la mort de l'IC comme organisation prolétarienne internationale. Les syndicats contrôlés par l'IC furent les premières forces qui permirent au stalinisme en Europe d'isoler les communistes restés fidèles à l'internationalisme et à la révolution et de faire reprendre à la classe ouvrière le chemin de la soumission à l'Etat et à la nation capitaliste.
Contradictions et limites des analyses du milieu révolutionnaire
Bien qu'exclu du Parti Bolchevik par la clique de Staline et exilé de Russie, Trotsky n'en avait pas moins une lourde responsabilité dans les orientations de l'IC et dans la politique menée par l'Etat russe, notamment la répression des grèves de Kronstadt. Trotsky avait soutenu Lénine contre"la maladie infantile du communisme" (les gauches communistes, Confronté à la dégénérescence de l'IC et à la politique contre-révolutionnaire de l'Etat russe, Trotsky ne remit pas en cause les fondements de la politique de l'IC. Il ne relia pas son combat à celui des gauches. Cette attitude exprimait toutes les limites de l'opposition de Trotsky au stalinisme contre-révolutionnaire. Toute l'orientation de l'opposition de gauche ralliée autour de sa personne fut marquée par la même faiblesse, c'est-à-dire l'incapacité à réévaluer la politique de l'IC sur les questions parlementaire et syndicale, l'incapacité à comprendre et reconnaître le processus contre-révolutionnaire en Russie même.
l.Trotsky
Paradoxalement, la question syndicale est abordée par Trotsky sur deux plans. Trotsky défendait au sein du Parti Bolchevik au pouvoir dans les années 20 la nécessité de l'intégration des syndicats à l'Etat soviétique contrairement à Lénine :
"Notre Etat actuel est tel que la totalité du pro1étariat organisé doit se défendre lui-même. Nous devons utiliser ces organisations ouvrières pour la défense des ouvriers contre leur Etat".
Quel aveu de Lénine sur le caractère conservateur de l'Etat de la période de transition et sur la nécessité du maintien de l'indépendance de la classe ouvrière par rapport à l'Etat ! Mais la position de Lénine comme celle d'ailleurs de l'opposition 0uvrière de Kollontaï qui prônait un renforcement des syndicats était illusoire et n'ouvrait pas sur une réelle compréhension de la nature des syndicats. La position, étatiste jusqu'au bout, était plus "logique". Pour Trotsky, le syndicat était un instrument étatique par excellence et en cela il ne se trompait pas ; c'est sur la question de l'Etat "prolétarien" que Trotsky se trompait !
En ce qui concerne l'intervention des révolutionnaires dans les syndicats, Trotsky défendait au sein de l'IC les analyses "officielles" :
"L'importance du syndicat consiste en ce que sa majorité est ou doit être composée d’éléments qui ne sont pas encore soumis l’influence d'un parti. Mais il est évident qu'il y a dans les syndicats des couches différentes : des couches tout à fait conscientes, des couches conscientes avec un reste de préjugés, des couches qui cherchent encore à former leur conscience révolutionnaires . Alors, qui doit prendre la direction ? ( ... ) Oui, nous voulons subordonner la conscience de la classe ouvrière aux idées révolutionnaires. C'est notre prétention". (Rapport au 4ème Congrès mondial, décembre 1922).
Une fois dans l'opposition, face à la contre-révolution, Trotsky nuança ses analyses ou plutôt dépassa le simplisme de la propagande des premières années de l'IC. Dans un texte de septembre 1933, Trotsky résumait une position beaucoup plus lucide sur la question syndicale :
"Les syndicats sont apparus dans la période de croissance et de montée du capitalisme. Leur tâche était d'élever le niveau matériel et culturel du prolétariat et d'étendre ses droits politiques. Ce travail, qui s'est étendu en Grande-Bretagne sur plus d'un siècle, a donné aux trade-unions une autorité immense au sein du prolétariat. La décadence du capitalisme britannique, dans les conditions du déclin du système capitaliste mondial, a sapé les bases même du travail réformiste des trade-unions Le rôle des syndicats, nous l'avons dit plus haut n'est plus un rôle progressif mais un rôle réactionnaire". (Trotsky,Oeuvres T.II, EDI, p.178).
Certes Trotsky conservait l'illusion d'un travail possible et nécessaire des communistes dans ces organes :
"C'est précisément à l’époque actuelle, où la bureaucratie réformiste du prolétariat s'est transformé en police économique du capital, que le travail révolutionnaire dans les syndicats, mené avec intelligence et persévérance, peut donner des résultats décisifs dans un délai relativement bref". (souligné par nous) (idem). Dans le même temps, Trotsky fixait une perspective de rupture avec les syndicats : "il faut absolument préparer dès maintenant les ouvriers avancés à l'idée de créer des comités d'ateliers et des conseils ouvriers au moment d'un tournant brutal". (idem).
Mais une telle vision restait abstraite et tout à fait contradictoire avec l'expérience du mouvement ouvrier lui-même. Trotsky réduisait en fait la question de l'apparition de véritables organes de lutte prolétariens à une simple tactique pouvant être décidée par l'organisation des révolutionnaires. Le volontarisme de Trotsky masquait mal un manque de confiance dans les capacités de la classe. Certes, les capacités commençaient à se réduire dès la fin des années 20, mais, tout à la défense de la révolution russe, Trotsky comme beaucoup de révolutionnaire ne pouvait se résoudre à voir la défaite du prolétariat et à en tirer les conclusions nécessaires tant sur le plan théorique qu'organisationnel.
2. La Gauche Italienne, Bilan.
C’est une toute autre démarche que développa la fraction de la gauche italienne regroupée autour de la revue "Bilan" :
"Affirmer aujourd'hui que l'on veut fonder des nouveaux partis sur la base des quatre premiers Congrès de l'IC, c'est commander à l'histoire de faire machine arrière de dix ans, c'est s’interdire la compréhension des évènements survenus après ces Congrès et c'est, en définitive, vouloir placer les nouveaux partis dans un endroit historique qui n'est pas le leur. L'endroit où devront se placer demain les nouveaux partis est d'ores et déjà délimité par l'expérience issue de l'exercice du pouvoir prolétarien et par toute l'expérience du mouvement communiste mondial. Les quatre premiers Congrès sont, dans ce travail, un élément d'étude qui doit être passé au crible de la critique la plus intense".(Bilan n°l, novembre 1933).
Comprenant la défaite politique du
prolétariat, la gauche italienne envisagea le problème de la présence des
révolutionnaires dans les syndicats uniquement du point de vue de la lutte
défensive et revendicative. La possibilité
resurgisse ment d'organes révolutionnaires de classe du type des conseils étant
repoussée pour toute une période, Bilan comprenait qu'il n'y avait plus de
place pour une activité misant, sur un
tel processus. De la même façon,
l'effondrement de 1’IC excluait la reconstitution à court terme du parti de
classe international. Il ne s'agissait
donc pas pour Bilan de déterminer une stratégie syndicale perpétuant
l’orientation de l'IC"de Lénine", mais de préserver la capacité
défensive de la classe. Bilan conservait
donc beaucoup d'illusions sur la continuité du rôle historique des syndicats
"Même aux mains des réformistes, les syndicats restent, pour nous, les endroits où les ouvriers doivent se rassembler, et d’où peuvent surgir des élans de conscience prolétarienne balayant toute la pourriture actuelle (... ). Si des mouvements se produisaient en dehors des syndicat, il faudrait évidemment les soutenir(…)". (Bilan n°25, nov.déc. 35)[1] [4]
La gauche italienne comme Trotsky restait donc prisonnière des analyses erronées de l'IC et surtout d'une période où il était difficile de tirer toutes les conclusions d'une vague révolutionnaire qui n'avait pas pu aller à terme et n'avait de ce fait pas pu trancher de façon suffisamment nette la question de la rupture avec le syndicalisme. De plus, le triomphe de la contre-révolution fasciste, démocratique et stalinienne ne favorisait pas la défense des thèses s'appuyant sur les capacités d'organisation spontanée du prolétariat démontrées par le surgissement des conseils ouvriers. La période était surtout marquée par le constat des insuffisances des révolutionnaires tant en Allemagne lors de la vague révolutionnaire qu'en Russie, là où le prolétariat avait conquis le pouvoir. La question décisive du parti, de sa nature et de sa fonction était la plus discutée et formait en quelque sorte un écran qui empêchait les fractions révolutionnaires de prendre du recul et d'avoir une vision plus globale de ce qu'avait été le processus révolutionnaire du point de vue du développement de l'activité et de la conscience du prolétariat dans son ensemble. Sans une telle vision d'ensemble de ce qu'avait été le mouvement de classe confronté au capitalisme décadent, il n'était pas possible de clarifier la question syndicale.
3. Les communistes de conseils.
C'est aux mêmes limites que se heurtèrent les communistes de conseils dans leur critique du syndicalisme. Ce courant, issu en partie de la gauche hollandaise et allemande développait dans les années 30 une critique cinglante du "léninisme" qui remettait en cause la nature même de la révolution russe, jusqu'à la qualifier de "bourgeoise". En fait, recourant conseilliste finissait par reprendre une série de préjugés "anti-parti" (empruntés à la tradition anarchiste et syndicaliste révolutionnaire). Au parti et aux syndicats, les conseillistes opposaient le "pouvoir des conseils ouvriers", seule forme d'organisation de la classe où celle-ci pouvait acquérir par elle-même la conscience de ses buts historiques et assurer ses taches historiques. La critique du syndicalisme consistait donc essentiellement en une critique des structures syndicales impropres à une véritable vie et activité autonome de la classe ouvrière :
"Les syndicats croissent à mesure que se développe te capitalisme
et la grande industrie, jusqu'à devenir de gigantesques organisations qui
comprennent des milliers d'adhérents à travers tout un pays et ont des
ramifications dans chaque ville et dans chaque usine. Des fonctionnaires y sont nommés ( ces
fonctionnaires sont les dirigeants du syndicat. Ce sont eux qui conduisent les
pourparlers avec les capitalistes, tache dans laquelle ils sont passés maîtres
(... ). Une telle organisation n'est plus uniquement une assemblée d'ouvriers ;
elle forme un corps organisé, qui possède une politique, un caractère, une
mentalité, des traditions et des fonctions qui lui sont propres. Ses intérêts sont différente de ceux de la
classe ouvrière et elle ne reculera devant aucun combat pour les
défendre". (A.Pannekoek, Janvier 1936,
in "International Council Correspondence").
Toutes ces critiques étaient justes et restent aujourd'hui un aspect important de la position des révolutionnaires sur les syndicats. Mais ne voir dans les syndicats que leur bureaucratisme, leur mentalité rétrograde, leur impuissance à combattre le capitalisme restait insuffisant. Ce caractère bureaucratique était apparu relativement rapidement dès la fin du 19ème siècle. Ce constat avait le mérite de rappeler ce que depuis longtemps le marxisme avait décelé : le caractère "étroit"'du syndicalisme. Dans "Salaire, prix et profit", Marx en 1865, en définissait très bien les limites : "Les syndicats agissent utilement en formant des centres de résistance aux empiètements du capital. Ils manquent en partie leur but quand ils font un usage peu judicieux de leur force. Ils le manquent entièrement lorsqu’ils se contentent de mener une guerre d'escarmouches contre les effets du système actuel, au lieu d'essayer en même temps de le changer en se servant de leur force organisée comme d'un levier pour l'émancipation finale de la classe ouvrière, c'est-à-dire pour abolir une fois pour toutes le salariat".
Même en ce qui concerne la fin des syndicats comme mode d'organisation de la classe, le mouvement marxiste avait développé les bases d'une analyse de ce processus. Engels, dans un article publié dans "Labour Standard", organe des syndicats anglais, en mai-juin 1881, expliquait :
"Qui plus est, de nombreux symptômes
indiquent que la classe ouvrière de ce pays commence à se rendre compte qu’elle
s'est engagée depuis quelques temps, sur la mauvaise voie. En effet, elle commence d comprendre que
l'agitation actuelle, parce qu’elle tourne exclusivement autour de questions
d'augmentations de salaires et de diminutions d'horaires de travail, la maintient
dans un cercle vicieux sans issue, car le mal fondamental ne réside pas dans le
bas niveau des salaires, mais dans le système du salariat lui-même. Si elle se répand largement au sein de la
classe ouvrière, cette prise de conscience doit changer considérablement la
position des syndicats : ils ne jouiront plus longtemps du privilège. d'être
tes seules organisations de la classe ouvrière.
A côté ou au-dessus des syndicats de chaque branche d'industrie surgira
une Union générale, une organisation politique de la classe ouvrière dans son
ensemble".
La critique des syndicats par les conseillistes consistait donc en une reprise à peine approfondie de certains points de l'analyse des marxistes, mais à moins de faire des syndicats des organes ayant toujours appartenu à la bourgeoisie (position à la quelle aboutissent certaines sectes comme le PIC aujourd'hui), ce courant ne parvenait pas à saisir le fondement matériel du passage des syndicats dans le camp bourgeois, leur intégration dans l'Etat et leur fonction contre-révolutionnaire. D'ailleurs Pannekoek, dans une critique de certaines positions de Grossmann sur l'écroulement nécessaire du capitalisme exprimait son incompréhension et son rejet de la notion de décadence du capitalisme :
"L'impuissance de l'action syndicale, impuissance qui est apparue depuis longtemps déjà, ne doit pas être attribuée à un écroulement économique mais à un déplacement des pouvoirs au niveau de la société (…). Le parlementarisme et la tactique syndicale n'ont pas attendu la crise présente pour s'avérer incapables, ils l’ont déjà démontré au long de plusieurs décennies. Ce n'est pas à cause de l'écroulement économique du capitalisme, mais à cause du monstrueux déploiement de sa puissance, de son extension à toute la terre, de l'exacerbation en lui des oppositions politiques, du renforcement violent de sa force interne, que le prolétariat doit passer à l'action de masse, déployer la force de toute la classe". (A.Pannekoek, juin 1934, n°l de Rätekorrespondenz, organe du Groupe des Communistes Internationalistes de Hollande):
L'article était dirigé contre les thèses de Rosa Luxemburg schématisées par Grossmann. La critique de l'économisme mécaniste de Grossmann était facile, mais Pannekoek ne répondait pas au problème de fond posé : est-ce que le syndicalisme avait toujours été caduc, est-ce que la possibilité de réformes économiques et politiques dans la période ascendante n'avait pas été la base matérielle du parlementarisme et du syndicalisme ? Il ne suffisait pas de comprendre les effets néfastes de cette réalité sur le mouvement ouvrier (réformisme, économisme, opportunisme, au sein de la Social-démocratie), il fallait encore comprendre que cette phase particulière du développement de l'activité de la classe était irrémédiablement finie, que, par exemple, le stalinisme n'était pas une déviation "néo-réformiste" ou "néo-opportuniste" du mouvement ouvrier, mais une expression du capitalisme décadent. Reconnaître l'entrée du capitalisme mondial dans sa phase de décadence, de déclin historique, ne signifiait pas le développement d'une vision fataliste et attentiste de l'histoire, mais la rupture de classe avec les thèses social-démocrates et les méthodes politiques et organisationnelles qui avaient prévalu dans la phase ascendante du capitalisme.
Les conseillistes avaient une vision de la nécessité de cette rupture, mais elle restait partielle. D'une part, ce courant était loin d'être homogène (cf nos articles sur la Gauche Hollandaise dans les Revues Internationales n°.16, 17 et 21). D'autre part, les conseillistes recherchaient les causes de la défaite dans la seule politique erronée de l'IC et du Parti Bolchevik. Ceci devait les amener à une sous-estimation de l'activité des communistes et à un abandon de la nécessité de la préparation révolutionnaire sur le plan de la reconstitution du parti. Progressivement, Pannekoek abandonnera la défense de la nécessité du parti pour se, limiter à un plaidoyer en faveur de l'autonomie de la classe.
Mais même si cette faiblesse du courant conseilliste mène à des erreurs profondes sur la question du parti, oublier que ce courant a approfondi la question de l'auto-organisation de la classe et a ainsi abordé un problème crucial de la période de décadence serait une profonde erreur. A partir du moment où les syndicats et le syndicalisme étaient compris comme des forces antagoniques à l'activité révolutionnaire de la classe ouvrière, il s'agissait de cerner les modalités nouvelles des luttes ouvrières elles-mêmes. Pannekoek va aborder cette question dans un ouvrage sur les conseils ouvriers écrit pendant la 2ème Guerre Mondiale :
"L'action directe, c'est donc l'action des travailleurs, celle qui ne passe pas par l'intermédiaire des bureaucrates syndicaux. Une grève est dite "sauvage" (illégale ou non-officielle) par opposition aux grèves déclenchées par les syndicats en respectant les règlements et les Lois (… ). Ces grèves sauvages sont les annonciatrices des grandes luttes du futur que, poussées par les nécessités sociales importantes, par une répression toujours plus lourde et une détresse plus profonde, les masses seront conduites à engager". (Pannekoek, Les Conseils Ouvriers)
Pannekoek insistait donc sur l'importance de la capacité des ouvriers amener leurs luttes par eux-mêmes, à faire 1'expérience de leurs propres possibilités et de leur force collective sans pour autant tomber dans une sorte de "spontanéisme" béat ou dans une vision schématique et linéaire du processus d'auto organisation de la classe :
"L'auto-organisation des travailleurs en lutte, ce n'est pas une de ces exigences déduites de l'étude théorique, à partir de discussions sur sa nécesaité et ses possibilités d'utilisation, c'est simplement la constatation d'un fait, découlant de la pratique. Il est souvent arrivé au cours de grands mouvements sociaux - et sans aucun doute il arrivera encore - que les actions menées ne soient pas conformes aux décisions prises. Parfois, des comités centraux lancent un appel à la grève générale et ne sont suivis qu'ici ou là, par de petits groupes. Ailleurs, les comités pèsent tout minutieusement sans s’aventurer à prendre une décision et les travailleurs déclenchent une grève de masse. Il est possible aussi que les mêmes travailleurs qui s'étaient résolus à la grève avec enthousiasme, reculent au moment d'agir ou, inversement, qu'une hésitation prudente se reflète dans les décisions et que, soudain, résultat de l'action de forces intérieures cachées, une grève non décidée éclate irrésistiblement. Alors que dans leur manière de pensée consciente, les travailleurs utilisent de vieux mots d'ordre et de vieilles théories qui s'expriment dans leurs opinions et leurs arguments, ils font preuve, au moment de la décision dont dépend leur bonheur ou leur malheur d'une intuition profonde, d'une compréhension instinctive des conditions réelles qui finalement déterminent leurs actes. Cela ne veut pas dire que ces intuitions sont toujours un guide sûr ( …). Ainsi s'opposent Les deux formes d'organisation et de lutte. L'ancienne, celle des syndicats et des grèves réglementées ; la nouvelle, celle des grèves spontanées et des conseils ouvriers. Cela ne signifie pas que la première sera tout simplement remplacée un jour par la seconde. Des formes intermédiaires peuvent être imaginées. Elles constitueraient des tentatives pour corriger les maux et les faiblesses du syndicalisme tout en sauvegardant les bons principes". (idem)
La défense de Pannekoek d'une véritable autonomie du prolétariat dans la lutte reflétait certes des ambiguïtés et des faiblesses, mais celles-ci exprimaient bien plus profondément l’état général du milieu révolutionnaire dans une phase de contre révolution triophante à laquelle venait s'ajouter l'horreur d'une deuxième Guerre Mondiale rendant encore plus difficile l'activité de le classe et des révolutionnaires. Ce qui était important, décisif, dans ce texte, comme dans ceux des autres courants prolétariens internationalistes, c'était la confiance dans le prolétariat comme force révolutionnaire.
- C'est pourquoi il serait erroné d'opposer la trajectoire de la Gauche Italienne à celle des communistes de conseils et de chercher dans l'un ou l'autre de ces courants l'expression pure et dure de la continuité "marxiste". Par ailleurs, il ne s'agit pas non plus de faire une synthèse écléctique des positions politiques développées par ceux-ci dans les années 30 puis dans les années de l'immédiat après-guerre. Le mérite de la Gauche Communiste de France qui publia Internationalisme fut justement d'éviter un certain fétichisme de la "tradition" vue comme la simple glorification apologique d'un courant contre les autres vers laquelle malheureusement s'achemina une partie de la Guache Italienne remettant en cause l'esprit de Bilan. Pour accomplir cette démarche, la courant bordiguiste dû rejeter Bilan est sa conclusion aux oubliettes, permettant à Bordiga de reprendre le travail théorique à zéro, c'est à dire à retourner aux erreurs leninistes contre les acquis de la Gauche Italienne, notamment sur la question nationale ou la question de la décadence.
[1] [5] Fort peu de textes de Bilan traitent directement de la question syndicale, mais même s'il y avait une sorte de position officielle qui restait attachée à l'optique léniniste, la reconnaissance de la décadence du capitalisme amena une tendance au sein de Bilan à réévaluer ce point sur les syndicats.
Questions théoriques:
- Décadence [6]
Heritage de la Gauche Communiste:
Notes sur la question paysanne
- 3965 lectures
Nous voulons montrer dans cet article :
- que le prolétariat doit considérer d'un oeil différent les différentes couches de la population agricole et s'appuyer sur les ouvriers agricoles et les paysans pauvres
- que la question paysanne s'est aggravée avec la décadence du capitalisme, ce qui laisse un legs très lourd au prolétariat
- que toutes les tentatives de "réformes agraires" sont des mystifications bourgeoises; que seule la révolution prolétarienne mondiale est la SEULE et VRAIE solution à la misère croissante dans les campagnes du Tiers-Monde.
QU’EST CE QUE LA PAYSANNERIE ?
A la différence des sociologues qui parlent de manière indifférenciée de la paysannerie comme d'une catégorie sociale homogène, les marxistes ont toujours montré son hétérogénéité. Ils ont démontré l'existence à la campagne de différentes classes sociales antagoniques, et à l'intérieur de celles-ci de strates produites par le régime juridique de la propriété foncière ou la possession de moyens de production. C'est en étudiant les clivages de classe existant au sein des campagnes et dans les différentes aires géographiques que le marxisme peut saisir les contradictions sociales explosives qui règnent à la campagne et saisir leurs liens avec la lutte du prolétariat industriel.
Il est d'autant plus nécessaire de définir les classes sociales à la campagne, que consciemment la bourgeoisie occulte leur existence. Pour elle, les ouvriers agricoles, les sans-travail, les paysans sans terre qui s'entassent dans les villages, c'est du pareil au même. Un fermier capitaliste est pour elle identique à un fermier du tiers-monde; un capitaliste de plantation sera défini comme "exploitant agricole" au même titre que le petit paysan disposant tout juste d'un lopin de terre.
En second lieu, il faut bien prendre soin de distinguer la population rurale (l'ensemble des classes vivant à la campagne) de la population agricole (ensemble des classes vivant de l'agriculture). Il est évident qu'un ouvrier vivant et travaillant à la campagne n'est pas un paysan, et inversement, un paysan travaillant et vivant à la ville ou dans un gros bourg n'est pas ni commerçant, ni ouvrier. Il existe une différence qualitative entre la campagne industrialisée des pays hautement développés et la campagne sans industrie des pays du tiers-monde.
En troisième lieu, on doit mettre en évidence le fait que la population agricole ne recouvre pas la population active. Si 50% de la population allemande ou japonaise travaille ce chiffre tombe souvent à moins de 30% dans les pays sous-développés. Il faut insister aussi sur le fait que dans ces derniers, le chômage et le sous-emploi touchent de 20 à 40% de la population agricole.
Toutes ces précisions sont d'autant plus nécessaires que la bourgeoisie, par tous les moyens (idéologiques, statistiques) cache l'existence des classes à la campagne et donc les antagonismes de classes sous la catégorie fourre-tout : "paysannerie".
Il n'existe pas de paysannerie en soi, mais un prolétariat rural d'un côté et différentes couches sociales du paysannat de l'autre côté depuis le grand propriétaire jusqu'au sans-travail.
LES OUVRIERS AGRICOLES
Les ouvriers agricoles ne font pas partie de la paysannerie, même si bien souvent, ils peuvent en partager les préjugés et l'idéologie. Ils sont un détachement du prolétariat à la campagne et leurs intérêts de classe ne se distinguent en rien de ce ceux du prolétariat tout entier. Ils constituent sans doute la catégorie la plus exploitée de la classe ouvrière par leurs salaires extrêmement bas et la précarité de leurs conditions d'existence qui les mettent à la merci des propriétaires fonciers : chômage, violence de ces derniers qui bien souvent disposent de véritables armées privées pour les mettre à raison en cas de révolte, comme c'est le cas en Amérique Latine. Le fait que, bien souvent, à l'exception des pays industrialisés et des régions de plantations, ils soient faiblement concentrés et minoritaires au sein des campagnes souligne leur dramatique isolement du reste du prolétariat. Ce sera précisément une tâche du prolétariat urbain de porter la lutte de classe à la campagne et de s'appuyer solidement sur les prolétaires ruraux. Cette tâche sera néanmoins difficile, compte tenu de l'éparpillement, et dans la majorité des cas, de la faiblesse numérique de ces ouvriers : bien souvent, ils ne dépassent guère le chiffre de 10 à 20% de la population agricole dans l'ensemble du monde.
Cependant, le principal obstacle à l'union du prolétariat urbain et rural réside dans la perméabilité des couches sociales à la campagne; souvent des ouvriers agricoles sont propriétaires d'un lopin de terre qui leur permet de survivre du point de vue alimentaire; fréquent peut-être aussi le cas de paysans-ouvriers qui font une double journée de travail. Bien souvent encore, dans le tiers-monde, une masse énorme de sans-travail ne vend qu'une partie de l'année sa force de travail. Nous verrons plus loin que les réformes agraires opérées dans les pays de l'Est et du tiers-monde, donnant des lots de terre aux ouvriers agricoles ont souvent occulté leur différenciation d'avec la paysannerie et atténué ainsi momentanément les clivages sociaux.
L'existence de grands domaines non cultivés ou sous-utilisés dans les pays du tiers-monde peut pousser les ouvriers agricoles à les occuper en période révolutionnaire. Dans ce cas, comme le montre l'exemple de la Russie en 1917-18, ils cessent d'être des ouvriers agricoles. En opérant le partage des terres, ils deviennent alors des petits exploiteurs agricoles, avec tous les privilèges que cela implique. L'existence d'une idéologie "partageuse" (on se partage les terres entre tous) est un frein dans la prise de conscience de classe des ouvriers. Elle permet toutes les manœuvres des fractions bourgeoises de gauche qui se font les porte-parole de la petite propriété.
Tout autre est le cas des ouvriers agricoles des pays développés. La disparition progressive des journaliers agricoles et la concentration des ouvriers dans de vastes usines (ou coopératives) alimentaires, dans des unités mécanisées, ont simplifié favorablement la situation. Les ouvriers effectuent un travail associé, sont de véritables ouvriers d'industrie, pour lesquels le partage des terres et des usines agricoles n'a aucun sens. C’est pourquoi, étrangers à l'idéologie "partageuse" ils s’intégreront sans problème dans la lutte révolutionnaire qui secouera les pays développés.
Le poids du passé, l'archaïsme des structures agraires rendent par contre extrêmement hétérogène e paysannat qui coexiste avec les ouvriers agricoles.
LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PAYSANS
Elles sont délimitées en fonction de 3 critères :
- les structures juridiques : possession ou non possession de la terre; propriété pleine ou usufruit de la terre (fermage et métayage); coopératives agricoles
- la taille des exploitations : grande, moyenne ou petite
- l'importance de la capitalisation et la mécanisation des exploitations.
C'est en fonction de ces critères que l'on pourra limiter les clivages de classes existant dans les campagnes. Il est bien évident que la domination du capitalisme, même formelle, à la campagne, fait passer au premier plan pour cette délimitation, le critère économique au détriment du critère juridique. Ce qui prime du point de vue du capital, c’est moins la propriété juridique que la possession des moyens de production et du capital permettant de mettre en exploitation la force de travail et la terre. De plus, dans les pays industriels, la question de la taille de l'exploitation a perdu beaucoup de son importance: à la culture extensive a succédé la culture intensive, à la "faim de terre", la faim de capital.
Pour définir les classes à la campagne, il faudra essentiellement tenir compte de deux critères
- le revenu du "paysan",
- sa place dans les rapports de production selon qu'il se trouve en situation d'exploiteur de la
force de travail ou non, de dépendance absolue ou non vis à vis du capitaliste ou du propriétaire foncier,
Enfin, les différenciations géographiques doivent nécessairement être prises en considération. Il n'y a aucune mesure entre le petit propriétaire de la Beauce ou du Middle West et le petit propriétaire du Cameroun.
LA BOURGEOISIE RURALE
L'une des grandes mystifications développées par la bourgeoisie consiste très souvent à considérer purement et simplement les grands propriétaires fonciers ou les fermiers capitalistes comme ... des "paysans". Non moins pernicieuse est l'idée que dans les pays du tiers-monde, de l'Asie à l'Amérique Latine, les "latifundiaires", les "aghas" musulmans ou les "zamindar" indiens seraient des ... féodaux comme il en existait au Moyen-Age.
A cela on peut répondre
1) Si jadis, sous l'Ancien Régime, les "riches laboureurs" de la fable pouvaient être considérés comme une couche supérieure de la paysannerie, l'emprise de la bourgeoisie sur la terre et sa domination sur cette couche dès l'aube de l'essor capitaliste ont définitivement créé dans les pays même les plus arriérés une bourgeoisie agraire organiquement reliée à l'ensemble de cette classe par le triomphe économique et politique des nouveaux rapports de production. Elle est une bourgeoisie, non en fonction d'un formalisme juridique, ou du degré de ses revenus, mais par sa possession des moyens de production (terre, capital technique) et l'exploitation capitaliste de la force de travail (salariat en argent ou en nature), et enfin, par son insertion dans le marché capitaliste (produire pour vendre).
2) Ce ne sont pas les titres nobiliaires, ni la dimension et l'origine féodale des grands domaines (latifundia), ni même la domination quasi féodale des grands propriétaires sur des paysans encore soumis à des corvées et à des rapports de servage (Moyen-Orient, les pays les plus arriérés d'Amérique Latine) qui définissent et délimitent aujourd'hui les rapports de production dans les zones les plus arriérées, mais le marché mondial. La pénétration du capitalisme, la nature capitaliste de l'Etat soumis aux lois du capital tendent à transformer en bourgeois les anciens féodaux. Qu'ils soient latifundiaires, usuriers ou chefs de tribus, le capital en les intégrant dans le marché et surtout au sein de l'Etat, les a progressivement lié à l'ensemble de la classe dominante capitaliste. Qu'ils circulent à cheval ou en voiture, qu'ils soient en "boubous" ou en costume de ville, ils sont irréversiblement devenus partie intégrante de la bourgeoisie, à laquelle ils participent par l'appropriation de la rente foncière et par le profit des marchandises agricoles qu'ils écoulent sur le marché capitaliste.
C'est cette vision mondiale qui permet de déterminer qu'il ne peut y avoir en aucun cas une classe "féodale réactionnaire" et une "classe bourgeoise progressiste" dans les pays les plus arriérés. Il s'agit d'une seule et même classe réactionnaire dans la décadence capitaliste : la classe dominant les exploités !
3) Il ne s'agit pas, bien sûr, de nier l'existence de restes de modes de production antérieurs au capitalisme. Au 20ème siècle, on peut voir co-exister en Océanie, par exemple, aussi bien les plantations les plus modernes que des tribus cultivant la terre avec des outils de l'âge de pierre. Cette réalité qui est le produit même de la perpétuation du système capitaliste devenu stérile, ne contredit pas la domination mondiale du capital dans tous les pays. C'est essentiellement dans la sphère de la circulation des marchandises (échange) que le capital s'est imposé partout. Même les grands "féodaux" de l'Asie doivent écouler leur production sur un marché capitaliste.
4) La théorie qui parle aujourd'hui de possibilité de révolutions"anti-féodales" bourgeoises, en se basant sur l'existence de vestiges de modes de production non capitalistes, rappelle étrangement la vieille conception du "développement inégal" chère ,à feu Staline, voire celle de la "révolution par étapes".
Une telle théorie n'est pas neutre; elle part d’une vision nationale et donc nationaliste, des rapports de production dominants; elle est le cache-sexe de tous les mouvements bourgeois tiers-mondistes trotskystes, etc. qui affirment que l'ennemi du prolétariat agricole et des paysans pauvres dans les pays sous-développés, c'est ... le"féodal".
LA PETITE BOURGEOISIE
A cette catégorie appartiennent les petits paysans, petits propriétaires indépendants ou non (exploitant ou non la force de travail), petits fermiers et métayers des pays développés. L'hétérogénéité de cette couche est le produit historique de l'interpénétration des rapports précapitalistes avec le capitalisme moderne. Elle trouve sa source dans les structures juridiques, économiques, géographiques les plus diversifiées. On pourrait même affirmer que cette situation complexe détermine l'existence de véritables "sous-classes à l'intérieur de cette petite bourgeoisie. Toutes se trouvent dans un état de dépendance vis à vis du marché, mais d'inégale indépendance par rapport au capital. Deux couches principales peuvent ainsi se dégager
- les exploitants agricoles à leur compte, véritables artisans puisqu'ils sont possesseurs de leurs moyens de production (terre, tracteurs, bâtiments). A l'intérieur de cette couche se délimitent les exploitants qui achètent la force de travail, et ceux dont la main d’œuvre est purement familiale.
- les exploitants dépendants ne possédant pas la terre dont ils sont les locataires (usufruitiers: métayers et fermiers). Ces deux couches s'opposent puisque les premiers ne disposent pas de leurs moyens de travail qu'ils louent, alors que les seconds possèdent nécessairement leurs outils de travail, mais l'évolution du capitalisme a transformé les fermiers peu à peu en petits capitalistes qui se différencient eux-mêmes selon la grandeur de leur capital. Quant aux métayers, héritage précapitaliste en voie de disparition dans les pays développés comme la France, l'Italie, etc., ils sont directement soumis à l'arbitraire du propriétaire et aux aléas de leur récolte, compte tenu du fait que leur mode d'exploitation est primitif et qu'ils doivent donner en nature une partie déterminée de leur récolte comme loyer de la location de terre et d'outils.
C'est dire toute la complexité du problème et l'extraordinaire difficulté du prolétariat à intervenir dans ces couches.
En fait, c'est la force même
du prolétariat, sa division inébranlable qui sera à même de créer des clivages
au sein de la petite bourgeoisie agricole.
Dans les pays sous-développés, un prolétariat décidé peut entraîner derrière
lui ces couches petites bourgeoises que la crise jette dans le paupérisme absolu. Dans les pays développés, le prolétariat
s'affrontera à l'hostilité la plus vive de ces couches qui s'identifient à la
propriété privée. Dans le meilleur des
cas, si la révolution internationale s'étend rapidement, le prolétariat pourra
compter au moins sur la "neutralité" résignée de ces couches
particulièrement rétrogrades.
LES PAYSANS PAUVRES ET SANS TERRE
Dans le tiers-monde, ils constituent une véritable couche de miséreux et de crève-la-faim, vivant dans des conditions inhumaines. Qu'ils soient métayers dans les pays musulmans, petits propriétaires végétant sur un maigre lopin de terre (microfundia), ou sans terre, proie des usuriers, vagabonds ou entassés dans des villages-bidonvilles, tous vivent la même situation de misère absolue, sans espoir de s'intégrer dans la société capitaliste où ils vivent en marge. Bien souvent, ils sont à la fois petits propriétaires, ouvriers agricoles, métayers et fermiers quand une partie de leur terre a été hypothéquée. Selon les statistiques officielles, 900 millions d'hommes sont définis comme paysan sans terre. Leur situation se rapproche de celle des sans-travail, puisque la majorité d'entre eux ne travaille que 80 jours par an en moyenne, entre 20 et 40% de la population agricole du tiers-monde. En proie aux famines, aux violences des propriétaires fonciers, ils vivent dans un état d'apathie profonde jalonnée de révoltes brutales et sans espoir, écrasées férocement. C'est cette couche majoritaire dans les campagnes arriérées qui illustre de façon frappante qu'ils n'ont que leurs chaînes à perdre, et un monde à gagner lors de la révolution prolétarienne.
Cependant, leur adhésion à la révolution prolétarienne sera fonction de l'esprit de décision du prolétariat. La situation de vagabonds, voire du lumpenprolétariat en ont fait dans le passé, et peuvent en faire aujourd'hui, des instruments des propriétaires fonciers ou de mouvements capitalistes d'Etat ("libération nationale"), des mercenaires utilisés contre les ouvriers.
Si cette couche, hybride, dont l'unité est la misère absolue, n'a rien à perdre, elle ne pourra être gagnée par la flamme révolutionnaire que si le prolétariat lutte sans merci contre la bourgeoisie rurale en la réduisant à néant.
LE POIDS DE LA DECADENCE
1) Le marxisme et la question paysanne au 19e siècle
Si à la veille de la "révolution industrielle", la paysannerie représentait encore plus de 90% de la population mondiale, le développement du capitalisme s'est traduit par une prolétarisation considérable des paysans jetés brutalement dans les nouveaux bagnes industriels. Toute l'histoire du capitalisme depuis ses origines est celle d'une expropriation violente des petits propriétaires agricoles par le capitalisme agricole, paysans sans terre contraints au vagabondage afin de les transformer brutalement en prolétaires. L'accumulation primitive en Angleterre étudiée par Marx dans le Capital en est l'exemple le plus cruel.
La mécanisation de l'agriculture au 19ème siècle en Europe occidentale, signe d'une capitalisation croissante de la terre, n'a fait que précipiter ce phénomène en ne laissant aux paysans pauvres que le choix entre mourir lentement asphyxiés par la concurrence de l'agriculture capitalisée (ce fut le cas des paysans irlandais qui laissèrent un million de morts lors de la grande famine de 1847) ou devenir des prolétaires d'usines. Ce que le capitalisme avait obtenu à ses débuts par la violence physique, il l'obtenait dorénavant par la violence de ses lois économiques : trouver une force de travail abondante et bon marché pour la pressurer impitoyablement dans les nouveaux centres industriels.
Le second avantage pour le capitalisme de cette expropriation n'était pas moindre. En concentrant et remembrant les terres, le capital pouvait produire des aliments bon marché susceptibles autant de répondre à la brutale croissance démographique que de faire pression sur les salaires, en réduisant le coût de production des biens nécessaires de la reproduction de la force de travail.
Sur le plan théorique, Marx, lorsqu'il mit en relief les lois auxquelles était soumis le capitalisme, divisait la société en trois grandes classes sur le plan économique : la bourgeoisie, le prolétariat, et la classe des grands propriétaires agricoles (landlords) accaparant la rente foncière. Sur le plan politique, il dégageait deux classes historiques fondamentales : l'ancienne classe révolutionnaire (la bourgeoisie) et son fossoyeur, le prolétariat.
Cependant, à la fin du siècle dernier, si le capitalisme dominait l'ensemble du monde, on était loin d'une intégration des paysans au niveau mondial dans la production, et cela même en Europe. Kautsky, étudiant d'ailleurs uniquement le cas de l'agriculture européenne et américaine, pensait que la tendance générale du développement capitaliste allait dans le sens de la disparition de la petite propriété au profit de la grande, et donc de l'industrialisation de l'agriculture. Il soulignait la prolétarisation des paysans transformés en ouvriers agricoles en Allemagne[1] [8]
Cette vision optimiste d'une fusion entre industrie et agriculture, sur la "résolution pacifique" par le capital du problème paysan et agraire reposait en fait sur la croyance en une impossibilité d'une décadence du capitalisme et sur l'espoir (inavoué encore chez Kautsky) réactionnaire d'une croissance harmonieuse et infini de ce système.
La décadence du capitalisme n'a fait que pousser à son comble le problème paysan et agraire. Ce n'est pas, si l'on prend un point de vue mondial, le développement de l'agriculture moderne qui s'est réalisé, mais son sous-développement. La paysannerie, comme il y a un siècle constitue toujours la majorité de la population mondiale.
2) Développement et sous-développement dans le tiers-monde
Ces pays représentent 69% de la population mondiale et n'entrent que pour 15,4% du PNB mondial[2] [9]. Ils ne produisent que 7% de la production industrielle mondiale et leur taux d'analphabétisme est d'environ 75%. Leur part dans le commerce international n'a fait que continuer à diminuer passant de 31,2% en 1948 à 17% en 1972[3] [10].
Mondialement la population agricole n'a pas diminué depuis la seconde guerre mondiale mais elle a augmenté en absolu. Elle passe de 700 millions d'hommes en 1950 à 750 en 1960, pour atteindre sans doute -par déduction statistique- environ 950 millions d'actifs agricoles. Si l'on considère que le nombre d'actifs considérés comme tel, selon ces "critères capitalistes" est de 1,7 milliard, on a une idée du poids écrasant de la population agricole. Quant à la part active de cette population, elle a à peine diminué : 60% de la population active en 1950; 57% en 1960; peut-être 55% en 1980. (Tous ces chiffres prennent uniquement en considération l'ensemble du monde).
Bien entendu ces chiffres sont incertains faute de statistiques sérieuses, non manipulées par les économistes bourgeois.
Dans la réalité, 66% de la
population mondiale semble vivre à la campagne dont l'immense majorité, à
l'exception du monde industriel, est constituée de paysans pauvres avec ou sans
terre.
Non seulement, le capitalisme ne peut intégrer les paysans dans l'industrie, mais il les fait croupir dans la misère la plus absolue. Sur 60 millions de décès annuels, en majorité dans le tiers-monde, 20 millions sont dus à la faim ou à ce que les économistes appellent pudiquement "malnutrition" L'immense majorité de la population ne dépasse pas l'âge de 40 ans, et la moitié des enfants meurt avant un an. Officiellement, 900 millions de paysans sont considérés comme vivant au seuil de la pauvreté absolue, et peut-être plus puisque les chômeurs (les paysans du tiers-monde trouvent souvent un appoint comme ouvriers agricoles) ne sont pas comptabilisés (cf. R.Fabre. "Paysans sans terre")
Cette misère absolue, les famines menaçantes comme au Sahel et en Asie, condamnent d'autant plus le capitalisme que les possibilités existent aujourd'hui de nourrir bien au-delà des besoins toute la population mondiale :
- un tiers seulement de la surface agricole utile mondiale est cultivée
- la surproduction agricole des pays développés par rapport aux marchés solvables entraîne une gigantesque sous-production par rapport aux besoins vitaux; les USA préfèrent transformer leurs excédents en alcool, et même diminuer la surface de blé cultivée plutôt que de voir la chute des cours
- le développement constant de l'économie de guerre, en développant toujours plus les stocks stratégiques en vue de la guerre mondiale, entraîne une réduction constante de la consommation de produits vivriers.
Les menaces de faim sont aujourd'hui tout aussi réelles qu'elles l'étaient dans les économies antérieures : la production agricole par habitant est intérieure au niveau de 1940 (cf. R.Fabre, "Paysans sans terre"). Signe de l'anarchie totale du système capitaliste, la plupart des anciens pays agricoles producteurs du tiers-monde sont devenus depuis la seconde guerre mondiale importateurs : l'Iran, par exemple, importe 40% de ses produits alimentaires consommés. Contrairement aux encenseurs du capital qui parlent sans rire de "pays en voie de développement", la cause en est, non l'arriération du tiers-monde, mais l'existence du capitalisme qui a pénétré partout dans le monde.
3) Pénétration du capitalisme
Plus aucune région du monde, même en Afrique ou en Asie, ne vit en état d'autarcie et d'autosubsistance, à l'exception des tribus primitives d'Amazonie et d'Afrique Centrale qui font les délices des ethnologues. Par la violence, par l'emprise croissante de l'Etat, le capital a pénétré toutes les campagnes à l'aide de l'économie de traite, soumettant les paysans à l'échange et par l'imposition de l'impôt. Désormais, chaque paysan producteur, même le plus arriéré, vend une partie toujours croissante de sa production pour le marché.
Le capitalisme a imposé partout la culture de produits agricoles destinés non à la consommation locale mais à l'exportation sur le marché mondial. La polyculture traditionnelle répondant à l'autosubsistance a été démantelée au profit de la monoculture, que ce soit dans les grandes plantations ou les petites exploitations agricoles.
Cependant, si les produits agricoles circulent comme marchandises, le capitalisme n'a pas pu et ne peut socialiser l'agriculture, développer une fusion entre la ville et la campagne.
C'est pourquoi l'immense majorité de la population agricole cultive toujours dans des conditions moyenâgeuses :
- sans tracteurs, voire sans charrue et sans outils,
- sans engrais, ni pesticides, etc.,
- en sous-utilisant la terre cultivée au rythme des saisons,
- en sous-employant les bras disponibles,
- en étant soumise à un état de surmortalité ou d'épuisement physique faisant chuter les rendements agricoles.
Par ses lois juridiques et économiques, le capitalisme a achevé sa domination formelle des campagnes, mais il n'a pu les intégrer réellement dans l'économie capitaliste.
On pourrait cependant objecter à cela la réelle prolétarisation des paysans d'Europe et d'Amérique, surtout depuis la seconde guerre mondiale, avec la période de reconstruction. Il est vrai que la population agricole active ne représente plus aux USA en en Grande-Bretagne que 3% de la population active totale; en France, pays de petits paysans, que 10%; en RFA 7%; en RDA 10%; en Tchécoslovaquie 14%, etc.. Il est vrai aussi que la production agricole de ces pays s'est considérablement modernisée par l’utilisation de machines et d'engrais modernes. Mais on ne saurait en aucun cas tirer du cas européen une généralisation à l'ensemble du monde. Plus des 2/3 du paysannat mondial vit encore dans des conditions moyenâgeuses et n'a bénéficié aucunement de la "manne" de la reconstruction.
LA DANSE MACABRE DE LA SURPRODUCTION ET DE LA SOUS-PRODUCTION AGRICOLE
Cette domination mondiale du capitalisme s'est accompagnée d'une véritable régression des forces productives dans l'agriculture. Là où elles se sont développées, c'est uniquement dans les secteurs agroalimentaires destinés non au marché intérieur mais au marché mondial. C'est pourquoi la crise du capitalisme se traduit sur le plan de la production alimentaire par :
- l'impossibilité d'écouler les stocks agricoles sur le marché saturé en corrélation avec la chute de la production industrielle,
- l'impossibilité de développer la production agricole en raison du manque de capital dans les pays sous-développés et du surplus de capital dans les pays industrialisés.
Même si, par hypothèse, on
envisageait dans le tiers-monde un développement considérable de la production
agricole, celle-ci se heurterait aux lois du capitalisme. Elle entraînerait un effondrement des cours
mondiaux agricoles, du profit capitaliste, et en fin de compte, de la production
mondiale agroalimentaire.
D'un autre côté, la faible
productivité dans les campagnes arriérées où s'entassent des millions d'hommes
sous-employés, sans moyens techniques modernes, rend nécessairement non
rentable cette agriculture. Pour donner
un exemple : la culture de 1’hectare de riz demande plus de 100 jours de
travail en Asie, tandis que celle de 1’hectare de blé aux USA ne demande qu'un
jour de travail, et ce pour le même rendement (cf. J.Klatsmann, "Nourrir 10 milliards
d'hommes ?". Ed. PUF 1975).
Enfin, le capitalisme d'Etat,
en prélevant une partie croissante du produit agricole, diminue la part
revenant à la subsistance du paysan producteur.
D'où la situation absurde et générale de la quasi totalité des pays
agricoles du tiers-monde obligés d'importer de plus en plus des produits
alimentaires de base, pour limiter les famines.
Le résultat, l'endettement, ne fait que pousser encore plus à la
désagrégation de cette agriculture arriérée.
De par les lois capitalistes, il est plus avantageux à l'Etat
capitaliste d'acheter une tonne de blé produite à bas prix en Europe ou en
Australie, qu’au propriétaire foncier ou au petit paysan dont le rendement est
au moins 100 fois plus faible.
Tous ces facteurs montrent quelle est la voie du capitalisme mondial : dislocation de l'agriculture, chute de la production alimentaire, exacerbation des antagonismes sociaux à la campagne et à la ville, où s'entassent toujours plus les sans-travail chassés de la terre par la faim et la misère.
A cette misère sans nom, on a prétendu opposer le "bilan positif" des "réformes agraires" accomplies dans différents pays du tiers-monde.
LA MYSTIFICATION DES REFORMES AGRAIRES
Lorsque la révolution bourgeoise en France éclata, en 1789, elle expropria les seigneurs et démantela les biens communaux villageois, amenant le triomphe de la propriété privée. Elle libéra le paysan des corvées et redevances féodales, le transforma en "citoyen", c'est à dire en petit propriétaire capable de produire pour vendre "librement", d'échanger ses produits avec la ville, brisant juridiquement le cadre autarcique dans lequel croupissait la communauté villageoise. La bourgeoisie trouvait ainsi la possibilité d'acheter "librement" la terre, avec en prime, une base sociale solide pour sa révolution.
Cependant, la tendance naturelle du capitalisme ne pouvait être de développer la petite propriété et de parcellariser l'exploitation de la terre. Comme le montre l'exemple de l'Angleterre et des Etats-Unis où le capitalisme s'est développé de la façon la plus classique, le but du capitalisme est fondamentalement la concentration de la terre et des instruments de production agricoles, et non leur démembrement. Sa domination à la campagne passe par l'existence de grands domaines de cultures extensives d'abord, puis intensives par le développement du capital technique. Pour répondre aux besoins de l'industrie naissante, il doit non seulement exproprier le paysan et le soumettre au travail salarié, mais encore développer la productivité par la concentration des terres et des machines. Le but de toute agriculture capitaliste est en effet, de produire pour le marché mondial, et non pour le marché national trop étroit malgré des fortes concentrations de population.
Cela entraîne donc remembrement et non partage des terres, exode rural et non fixation d'une masse de producteurs agricoles excédentaires. Tournée directement vers le marché, l'agriculture capitaliste connaît inévitablement les crises de surproduction déterminées par le degré de solvabilité de l'ensemble du marché mondial. La crise avec la diminution de la demande solvable n'a fait qu'exacerber cette tendance. Aujourd'hui, les grands pays capitalistes agricoles doivent pousser leurs exploitants à diminuer leur production et les surfaces cultivées pour ne pas occasionner une chute catastrophique des cours des grands produits agricoles de base. A la surproduction succède la sous-production par rapport aux capacités réelles de production de la grande agriculture mécanisée capable de nourrir, selon les spécialistes bourgeois eux-mêmes, à elle seule l'ensemble de l'humanité. Et pourtant la moitié de l'humanité vit à la limite des famines, 100 millions de chinois sont menacés de mourir de faim. Dans les pays du tiers-monde, en dépit du fait qu'en 30 ans la population a fait plus que doubler, la production alimentaire par tête diminue régulièrement. Condamnation sans appel du capitalisme qui pousse l'humanité vers sa perte !
Face à une telle situation, déjà existante au 19éme siècle mais exacerbée par la décadence du capitalisme, idéologues bourgeois, agronomes, tiers-mondistes, gauchistes, n'ont pas manqué, pour préconiser, qui la "collectivisation", qui la "réforme agraire", qui la "révolution verte" ou "blanche" selon les goûts de chacun. Sur tous les tons, ils ont chanté les "communes populaires" chinoises, "l'agriculture collectivisée" à Cuba, "la révolution bourgeoise" en Algérie, où la terre des colons a été expropriée et partagée. Il n'est pas un pays du tiers-monde qui n'ait prétendu et prétende avoir réalisé sa "révolution" ou sa "réforme" agraire et n'ait trouvé toute une meute de supporters gauchistes et "progressistes" pour psalmodier alléluia ou hosanna.
LES CAUSES DES
"REFORMES AGRAIRES" DANS LE TIERS MONDE ET DANS LE BLOC RUSSE.
Comme nous l'avons vu, la clef des contradictions insolubles du capitalisme se trouve dans le marché mondial et la concurrence entre les multiples fractions du capital mondial pour le conquérir et se le partager.
Dans le Tiers-Monde, la colonisation par les grands pays industriels a eu un double but : en premier lieu, non seulement trouver des débouchés à leurs produits industriels, mais réaliser leurs surplus agricoles que leur marché intérieur était trop étroit pour absorber. En second lieu, par un contrôle militaire, politique et économique, empêcher que puisse se développer une économie nationale capable de concurrencer l'industrie et l'agriculture des métropoles. C'est pourquoi le capital des pays industrialisés a laissé l'économie agricole des pays colonisés en état de léthargie, à la seule exception des grandes plantations ou des grands domaines dont la production était orientée vers le marché mondial et la métropole et qui, pour des raisons climatiques fournissaient des denrées non cultivables en Europe. Le perfectionnement de la division internationale du travail délimitant pays industriels et pays agricoles a achevé de donner leur physionomie d'arriération aux pays colonisés : Ceylan pour le thé; la Malaisie pour l'hévéa; la Colombie pour le café; le Sénégal pour 1 'arachide, etc.
Cette division internationale s'est accompagnée nécessairement de la monoculture au détriment de la polyculture de subsistance. En détruisant peu à peu l'économie naturelle, elle a intégré progressivement une fraction croissante de petits paysans dans le marché, en les contraignant de cultiver les cultures obligatoires, voire en les soumettant à de véritables corvées sur les plantations ou les domaines coloniaux. En concentrant la terre, en se l'appropriant, en forçant le petit paysan à abandonner ses terres aux mains des usuriers et des grands propriétaires par l'impôt forcé ou par la force, la culture d'autosubsistance s'est rapidement effondrée occasionnant des famines qui, comme en Chine, en Inde, en Afrique, laissaient des millions de cadavres.
Les innombrables révoltes paysannes qui ont éclaté de l'Inde (Cipayes et tenanciers) à la Chine (Taïping) jusqu'au Mexique avec Zapata ont montré la situation explosive que créait le capitalisme mondial dans 1es zones arriérées précapitalistes .
Elles ont montré autant la vanité pour les paysans de compter sur une bourgeoisie nationale "progressiste et antiféodale" toujours alliée aux grands propriétaires fonciers, que l'impossibilité d'améliorer leur sort dans le cadre d'un capitalisme fut-il en apparence le plus "libéral" et "démocratique". C'est ce que montrent les révoltes paysannes du Mexique au début de ce siècle où le paysannat fut le jouet des différentes fractions bourgeoises pro-anglaises ou pro-américaines.
Face à cette révolte permanente menaçant d'ébranler la cohésion de la société (mais dans un sens révolutionnaire en l'absence d'une révolution prolétarienne), la bourgeoisie comprit qu'à défaut de supprimer les causes de la révolte, elle pouvait du moins en atténuer les effets, par des concessions. Au risque de diminuer la productivité agricole, elle officialisa le partage des terres au Mexique, espérant s'attacher les paysans pauvres et sans terre qui se retrouvaient avec un lot de terre ou élargissaient leur champ.
Mais c'est surtout après la deuxième guerre mondiale que la question va se poser dans les ex-colonies proclamées "indépendantes", ou les semi-colonies. Les tensions interimpérialistes, l'avancée du bloc russe par le biais des "luttes de libération nationale" vont contraindre le bloc américain à prendre une attitude "réaliste", particulièrement en Amérique Latine, où sa politique au Guatemala et surtout à Cuba s'était révélée désastreuse. Tout le programme de Kennedy élaboré en 1961 à Punta del Este et pompeusement nommé "Alliance pour le progrès" ne visait qu'à contraindre les bourgeoisies locales à adopter des mesures de "réformes agraires", pour éviter de nouveaux Cuba. De 1964 à 1969 au Pérou, on redistribua 600 000 ha; au Chili de 1964 à 1967, 1 050 000 ha furent expropriés pour être redistribués; 8 000 000 ha entre 67 et 72[4] [11]. Dans d'autres pays, des mesures similaires furent prises.
Au Maghreb, l'appropriation
par l'Etat des terres des colons permit de lotir des paysans sans terre ou
microfundiaire qui furent organisés de force en coopératives
"autogérées". On pourrait
multiplier les exemples dans l'ensemble du Tiers-Monde.
Dans le bloc russe, pour des raisons politiques aussi, l'URSS poussa au lendemain de la guerre au démembrement des grands domaines et redistribua les terres appartenant aux nationaux allemands et aux grands propriétaires fonciers.
Toutes ces mesures visaient à limiter les tensions agraires et à s'attacher une fraction de la paysannerie pauvre, et surtout moyenne, quitte à sacrifier, dans les cas extrêmes, la bourgeoisie rurale. Cependant, a surtout prévalu la nécessité économique pour le capital national de freiner la chute vertigineuse de la production agricole sur une immense majorité de petites exploitations ou tenures microscopiques, coexistant avec d'immenses latifundias dont une infime partie est cultivée. Autant dire que dans ces conditions la productivité agricole, et la capacité de concurrence sont quasi nulles. Si l'on ajoute que mondialement la population est passée de 3 milliards d'hommes en 1965 à 4,2 en 1980, on aura une idée de l'entassement ou plutôt du pourrissement sur place de myriades de paysans pauvres sur quelques hectares et même ares, à côté de latifundias de 100 000 ha à peine défrichées. Dans cette situation, les petites parcelles concédées pour l'exploitation sont plus productives en fournissant parfois l'essentiel d'une production agricole nationale; même sans engrais et machines, elles sont plus intensément cultivées avec une main d’œuvre pléthorique. Les différents pays capitalistes arriérés qui ont partagé une partie des grands domaines et créé des "'coopératives" de paysans rêvaient ainsi d'augmenter la production agricole autant pour des raisons sociales qu’économiques. Chaque pays du tiers monde peu industrialisé tentait de dégager des surplus agricoles pour l'exportation sur le marché mondial. Et l'imposition de cultures forcées, l'impôt, en échange de ce "cadeau" de la terre, soumettait plus que jamais le petit paysan, fermier ou propriétaire, aux lois du marché et à ses fluctuations.
Une autre méthode a consisté à racheter les terres expropriées aux latifundiaires, pour les capitaliser.; celles-ci se trouvaient ainsi dorénavant cultivées de façon capitaliste par l'Etat ou le capital industriel, et transformaient en prolétaires des paysans. Une grande majorité d'entre eux n’eurent plus que le choix de fuir vers la ville, s'entassant dans de monstrueuses métropoles-bidonvilles regroupant, comme au Mexique, jusqu'au tiers de la population du pays.
LES RESULTATS
Du point de vue capitaliste, le seul résultat "positif" a été de développer dans certains pays, en Inde particulièrement, une couche de "koulaks", paysans moyens qui se sont enrichis et forment à la campagne un tampon social entre grands propriétaires et paysans parcellaires. Attachés par ce biais à la bourgeoisie, ils ne forment cependant qu'une couche très mince compte tenu de l'arriération et du pourrissement de l'économie.
Dans la réalité, les "riches" se sont enrichis, et les "pauvres" appauvris; les contrastes entre les classes se sont accrus. Le partage successoral des parcelles s'est perpétué, en dépit des quelques hectares concédés; la productivité a continué de s 'effondrer.
Sa chute s'est même accélérée dans les grandes propriétés ex-coloniales partagées, faute de machines et d'engrais: les campagnes algériennes ont aujourd'hui 40% de chômeurs. Là où la terre a été capitalisée et cultivée mécaniquement, la masse des sans-travail s'est gonflée démesurément.
Là où la propriété privée a été transmise aux mains de l'Etat, comme dans le bloc russe, si le chômage a officiellement disparu dans les campagnes, la productivité s'est effondrée : un cultivateur américain de blé produit 13 fois plus qu'un cultivateur russe.
Sachant que, du point de vue économique, la bourgeoisie ne pourrait pas grand chose, elle a prétendu par la bouche de ses agronomes que la "révolution verte" allait au moins, à défaut d'augmenter la productivité, assurer l'alimentation de l'humanité par des plantes à plus fort rendement et plus nutritives. On fit ainsi grand battage dans les années 60-70 sur les blés et maïs hybrides. Les famines en Afrique et Asie montrent éloquemment le résultat ... Seule la bourgeoisie rurale du tiers monde, disposant de capital, de machines, et d'engrais a pu en profiter et y a trouvé là son compte ; autant dire une minorité infinitésimale.
- Ainsi , la décadence du capitalisme a rendu encore plus lourde et difficile la question paysanne. Le legs terrible du capitalisme au prolétariat, c'est la destruction des forces productives à la campagne ou leur complète inutilisation; la misère pour des milliards d'hommes.
- Il serait faux de considérer seulement les effets négatifs de cette misère. Celle-ci est lourde de potentialités révolutionnaires dans les campagnes
- - Le prolétariat saura les utiliser, s’il est capable d’agir de façon autonome, avec la plus grande décision, sans abandonner son programme.
Ce ne sont pas les
révolutions bourgeoises qui sont à l’ordre du jour. Dans les villes, comme dans
les campagnes, le seul espoir des milliards d’être paupérisés, misérables,
réside dans le triomphe mondial de la révolution prolétarienne.
Chardin
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 25 - 2e trimestre 1981
- 2695 lectures
El Salvador, Espagne, Pologne : Face a la menace proletarienne , la bourgeoisie se prepare
- 2821 lectures
Espagne, Pologne, El Salvador, c'est en des lieux bien éloignés et différents que se sont manifestés dernièrement les soubresauts d'une société en crise mortelle. mais, si ces pays appartiennent à des mondes très dissemblables, l'occident développé pour le premier, le bloc de l'Est pour le second, le tiers monde pour le troisième, si les circonstances immédiates des évènements qui les ont placés au devant de l'actualité n'ont rien à voir les unes avec les autres, il n'en demeure pas moins que c'est une même logique qui traverse ces évènements et qui exprime l'unité fondamentale de destinée de la société humaine aujourd'hui.
LA CRISE ÉCONOMIQUE DU CAPITALISME MONDIAL
Au Salvador, c'est la poursuite de la plongée dans l'abîme avec des massacres quotidiens, une illustrations tragique de ce que les révolutionnaires n'ont cessé de répéter depuis plus d'un demi siècle : le caractère parfaitement réactionnaire du mode de production capitaliste, son incapacité absolue d'assurer un quelconque développement significatif des forces productives dans les zones qui n'avaient pas encore bénéficié d'un tel développement à l'aube de ce 20ème siècle. Au Salvador, c'est une image insoutenable de la réalité du monde d'aujourd'hui avec son cortège de famines et de massacres, de terreur et de déchéance de l'être humain, qui sont le lot quotidien de la plus grande partie des membres de la société et qui attend les autres demain avec l'aggravation de la crise et des convulsions qui l'accompagnent.
En Pologne, c'est la fin du mythe du soi-disant "socialisme" de l'Europe de l’Est qui aurait mis fin aux crises du capitalisme, à exploitation de l'homme par l'homme et à l'antagonisme entre classes. La crise violente qui frappe aujourd'hui la Pologne et les pays "frères" fait la démonstration éclatante de l'absurdité de l'idée de l'existence dans ces pays de quelconques "acquis" économiques. Ces fameux "acquis ouvriers", tant vantés par les trotskystes, que sont la planification et le monopole étatique du commerce extérieur se sont révélés totalement inefficaces pour endiguer la crise du capitalisme, pour s’opposer à l'anarchie croissante de la production, à la pénurie des biens les plus nécessaires et, par rapport à l'extérieur, à un endettement astronomique.
Ainsi s'illustre une fois de plus la nature parfaitement capitaliste des pays soi-disant "socialistes", de même que l'incapacité totale de toutes les mesures d'étatisation de l'économie à faire face aux affres de la crise mondiale.
En Espagne, c'est un autre mythe qui s'est effondré ces dernières années, celui de "Japon européen". La crise s'est chargé de liquider de façon spectaculaire l'expansion économique de la copie européenne du "modèle japonais" célébré par les technocrates des années 60. Exploitant les derniers fastes de la reconstruction de l'après 2ème guerre mondiale pour tenter de s'arracher à marche forcée de son arriération, l'économie espagnole paye aujourd'hui à la crise le prix fort pour ses exploits passés : après le record d'Europe du taux d'expansion, c'est maintenant le record du taux de chômage (officiellement 12,6% de la population active).
Qu'elle se manifeste par une nouvelle aggravation de la famine dans les pays du tiers-monde, par une montée du chômage sans précédent en occident, par la pénurie généralisée dans les pays de l'Est, la crise révèle que le monde est un, que toute la société humaine est embarquée dans la même galère.
Cette unité du monde ne s'exprime pas seulement dans l'universalité des manifestations de la crise économique. Elle s'exprime également dans le type de réponses que donne la classe dominante sur tous les continents face à la menace de révolte des exploités contre l'aggravation insupportable de leurs conditions de vie.
LA RÉPONSE DE LA BOURGEOISIE DE TOUS LES PAYS A LA CRISE ÉCONOMIQUE FACE A LA MENACE DE LA LUTTE DE CLASSE
Cette réponse s'articule autour de différents axes complémentaires :
- La mise en place de gouvernements"forts", ouvertement répressifs, utilisant abondamment l'intimidation à l'égard de la classe ouvrière, gouvernements qui sont pris en charge par les secteurs de droite de l'appareil politique bourgeois.
- Le rôle assuré par les secteurs de gauche de cet appareil dans l'opposition (et non plus au gouvernement comme il y a quelques années), pour saboter de l'intérieur les luttes prolétariennes, pour immobiliser la classe ouvrière face aux coups portés par le capital.
- La prise en charge par les grandes puissances de la conduite du maintien de l'ordre social au sein de leur bloc et leur collaboration étroite, par dessus leurs antagonismes, pour museler la classe ouvrière.
Ce sont des illustrations de cette politique qui sont en bonne partie à la base des évènements au Salvador depuis de nombreux mois, en Espagne avec le "coup d'Etat" de février 1981, et en Pologne avec les grèves ouvrières de 1980-81.
Au Salvador, on voit se réaliser concrètement la "doctrine Reagan" de soutien à des gouvernements musclés et de "lutte contre la subversion". L'heure n'est plus à de nouveaux Nicaragua où, par social-démocratie internationale interposée, les USA avaient laissé accéder au pouvoir les partis de gauche. Aujourd'hui, les USA ne parlent plus des "droits de l'homme" mais prêchent la croisade"contre le terrorisme international fomenté par l'URSS". En réalité, ce n'est pas tellement l'URSS que vise cette politique car cette puissance a des moyens limités en Amérique Latine même si elle ne répugne pas à favoriser l'instabilité dans les chasses gardées de l'adversaire américain. La véritable "subversion", le réel "terrorisme", ce sont ceux que représente la lutte de classe sur le continent américain.
Reagan est très clair pour annoncer que son aide à la Junte qui gouverne de façon sanglante le Salvador dépasse en portée le cadre de ce pays et le type d'affrontements qui s'y déroulent. La guérilla populiste qui agit dans ce pays n'est pas plus dangereuse pour l'impérialisme américain que celles qui ont existé par le passé dans d'autres pays d'Amérique Latine. Cuba est resté une exception et l'appartenance de ce pays au bloc russe ne menace pas les USA. Par contre, ce qui inspire une crainte certaine à la bourgeoisie américaine, c'est le développement de luttes de classe comme celles des années passées au Brésil par exemple, et qui ne sont pas une spécialité réservée à des pays"exotiques" mais une "déstabilisation" qui risque d'atteindre les métropoles impérialistes elles-mêmes.
En apportant un soutien actif aux massacres au Salvador, c'est un avertissement limpide que Reagan adresse aux ouvriers des deux Amériques : "Pas de 'terrorisme' - entendez pas de luttes contre l'aggravation des conditions d'existence - sinon je n'hésiterai pas à faire donner la répression". Et pour être sûr que ce message sera bien compris, qu'il ne sera pas interprété comme un "coup de gueule" sans lendemain d'un ancien cowboy, Reagan a pris le soin de s'assurer le soutien de Trudeau, premier Ministre du Canada (au départ réticent) en même temps qu'il appelle les gouvernements européens à suivre l'exemple de son acolyte canadien. C'est à l'échelle de tout le bloc américain que la bourgeoisie se donne comme tâche de maintenir l'ordre social.
C'est également à l'échelle de tout le bloc que la gauche ("Internationale Socialiste", Willy Brandt en tête) "proteste" contre cette politique de Reagan et qu'elle apporte son soutien à l'opposition "démocratique" du Salvador. Pour elle, toutes les occasions sont bonnes (surtout maintenant que ses déclarations sont destinées à rester platoniques) pour tenter de détourner le mécontentement ouvrier vers les impasses de la "défense de la démocratie" et autres thèmes bourgeois. C'est là une des façons par lesquelles la gauche bourgeoise s'attache dans "l'opposition" à saboter les luttes du prolétariat.
En Espagne, c'est également la "défense de la démocratie" qui est aujourd'hui à la mode suite au putsch manqué du 23 février 1981. Cependant, ce n'est pas de façon identique que cette mystification est mise en oeuvre : ici, c'est le pouvoir central qui se présente comme le meilleur garant de la "démocratie menacée". Cela ne veut pas dire que la logique globale à laquelle obéissent les évènements en Espagne est différente de la logique des évènements au Salvador quant à la réponse de la bourgeoisie. Bien au contraire. En réalité, la tentative de putsch du 23 février a eu pour la bourgeoisie les "mérites" suivants :
- renforcement du pouvoir central, notamment en la personne du roi (comme ce fut le cas quelques mois auparavant en Italie avec la mise en avant du président de la République Pertini) ;
- renforcement de l'orientation a droite du gouvernement espagnol : le Putsch"manqué"a apporté à Calvo Sotelo les voix toutes cuites de la droite ("Alliance Populaire") qui lui faisaient défaut, d'autre part la tentative de certains secteurs du centre et du Parti Socialiste de constituer une alliance de centre-gauche est mise en sourdine, au nom du veto de l'armée ;
- renforcement du chantage au coup d'Etat militaire auprès de la classe ouvrière : il s'agit s'insuffler une nouvelle vie au croquemitaine franquiste qu'on dit se profiler derrière chaque caserne, afin de dissuader les ouvriers de renouer avec leurs luttes de 1976 face à une misère de plus en plus intolérable.
Il est clair que ce n'est pas avec cette perspective que se sont lancés dans l'aventure les putschistes Tejero, Milans del Bosch et Armada : c'est bien à la prise du pouvoir qu'ils aspiraient. Mais les avantages que tire la bourgeoisie de leur tentative et de son échec (nous ne sommes pas en 1936: l'heure n'est pas en Europe occidentale aux dictatures militaires) incite à croire que ces officiers se sont laissés manipuler par les secteurs les plus lucides de la classe dominante. S'agit-il là d'une vision par trop "machiavélique" ? Il est évidemment difficile de faire la part entre ce qui a été minutieusement préparé par la bourgeoisie et ce qui revient à sa capacité d'adaptation et d'improvisation. Il serait cependant dangereux pour la classe ouvrière et pour les révolutionnaires de sous-estimer la force et l'intelligence de l'ennemi de classe. Souvenons-nous seulement que, depuis 7 mois, c'est la cinquième fois qu'on nous sort un scénario qui, à chaque fois, a le"miraculeux"effet de créer un grand sursaut de "solidarité nationale" face à un "ennemi fasciste" assez fantomatique : Bologne en août 80, Munich en septembre 80, attentat de la rue Copernic à Paris en octobre 80, attentat à Anvers en Belgique en novembre 80, putsch à Madrid en Espagne en février 81. S'agit-il de hasards ?
En Poloqne, c'est également la menace des chars qu'on agite pour inciter les ouvriers à être raisonnables même si, dans ce cas, ce n'est pas tant ceux de l'armée nationale que ceux du "grand frère". Mais le mécanisme idéologique est du même type : dans les deux cas, le gouvernement en place justifie sa politique dure,-ce refus des concessions et les appels au calme non pas tant en menaçant de réprimer directement lui-même mais par son prétendu souci d'épargner à la population et à la classe ouvrière le déchaînement d'une répression féroce qui se ferait contre sa volonté. Réprimer pour éviter une répression plus grande: la ficelle est ancienne et serait peu crédible si justement la gauche ne venait prêter main forte au chantage de la droite :
- en Espagne, en s'associant à tous les autres partis bourgeois pour agiter la menace d'un "retour du fascisme" et organiser de grandes manifestations de soutien à la démocratie et au roi ;
- - en Pologne en protestant bien fort contre le refus du gouvernement de tenir ses promesses, contre le développement de la répression, mais en appelant en même temps les ouvriers à la"modération"'afin de ne pas "mettre en danger la Pologne", ce qui signifie en fait l'acceptation passive de l'offensive bourgeoise contre la classe ouvrière.
Ainsi, s'est mise en place en Pologne une orientation de la vie politique qui a déjà fait ses armes ces dernières années dans les pays industrialisés d'occident : le partage des tâches entre d'une part une droite au pouvoir qui n'aspire nullement à une quelconque popularité auprès des ouvriers mais est chargée de mettre en oeuvre avec cynisme un renforcement de l'exploitation et de la répression, et d'autre part une gauche dans l'opposition chargée, grâce à la confiance qu'elle peut conserver parmi les travailleurs de par son langage radical, vise à casser toute tentative de s'opposer à l'offensive de la droite.
Par une ironie de l'histoire, c'est un parti soi-disant "communiste" qui joue en Pologne le rôle de la"droite" (mais dans le domaine de l'impopularité et du cynisme, les équipes dirigeantes dans l'Europe de l'Est battent tous les records mondiaux),alors que c'est un intime d'un cardinal, Primat d'une des Eglises les plus réactionnaires du monde qui prend celui de porte-parole de la"gauche".
Mais, au delà de ces particularités, les mécanismes politiques sont les mêmes et la nomination en février de Jaruzelski au poste de Premier Ministre qui constitue la première initiative cohérente de la bourgeoisie polonaise depuis août 80, exprime la prise en charge consciente par l'équipe dirigeante de ces nécessités. En effet, pour la bourgeoisie polonaise, il s'agit de "rétablir l'ordre" (en tant que militaire, le nouveau premier Ministre est un homme à poigne) : c'en est assez d'une situation où le pouvoir est à chaque fois obligé de reculer devant les exigences ouvrières, ce qui ne peut qu'inciter à des nouvelles exigences.
Mais ce rétablissement de l'ordre ne pourra s’appuyer, comme par le passé, sur la seule répression, il devra compter sur la collaboration du syndicat "Solidarité" (Jaruzelski s'est fait la réputation d'être favorable à la négociation) : il s'agit pour le moment de neutraliser les éléments de l'appareil politique qui n'avaient pu "se faire" à l'existence d’une force d'opposition dans le pays.
Mais la situation en Pologne n'illustre pas seulement la tactique adoptée par la bourgeoisie au niveau interne. Elle fait une nouvelle démonstration que c'est à l'échelle internationale que la bourgeoisie fourbit ses armes contre la lutte ouvrière.
C'est en premier lieu au niveau du bloc russe tout entier qu'est prise en charge la situation en Pologne : par la menace d'une intervention des forces du Pacte de Varsovie (et éventuellement par sa réalité si les autorités polonaises perdent le contrôle de la situation) et aussi par l'élaboration depuis Moscou de la politique à suivre localement. En effet, celle-ci ne doit pas seulement tenir compte des intérêts particuliers du capital national. Elle doit être conforme à ceux de tout le bloc : même si les autorités polonaises étaient trop enclines à lâcher du lest, Moscou se chargerait de leur rappeler que trop de "laxisme" en Pologne risque de donner du crédit à l'idée que "la lutte paye" parmi les ouvriers des autres pays du bloc.
Mais cette prise en charge
de la situation en Pologne dépasse le cadre du bloc russe ; elle concerne toute
la bourgeoisie mondiale et notamment celle des grandes puissances occidentales
qui, par leur aide économique, ont tenté de calmer le mécontentement ouvrier
permettant la distribution de quelques miettes et qui, à leur façon, ont
collaboré en compagnie de "Solidarité", au chantage à l'intervention
russe. En effet, toute la campagne
occidentale sur la menace d'une telle intervention, entre autres, avait pour
but par Radio Europe Libre et BBC interposées, de persuader les ouvriers
d'Europe de l'Est peu enclins à croire la propagande de l'Agence Tass, que
cette menace est bien réelle.
Ainsi, c'est de façon mondiale que la bourgeoisie fourbit son offensive. Cette classe a tiré les leçons du passé. Elle sait que, face au danger prolétarien, elle doit faire preuve d'unité et de coordination de son action, même si celle-ci passe par un partage des tâches entre différentes fractions de son appareil politique. Pour la classe ouvrière, la seule issue réside dans le refus de se laisser piéger par les chausse-trappes que lui tend la classe dominante, et d'opposer sa propre offensive de classe à l'offensive bourgeoise :
- face au partage des tâches entre droite et gauche, rejet en bloc de ces deux forces du capital ;
- face à l'intimidation et au chantage à la répression, lutte résolue la plus large possible : seule la menace d'une riposte massive du prolétariat peut arrêter la main criminelle de la bourgeoisie
- face au sabotage des luttes par les partis de gauche et les syndicats, auto-organisation de la classe et extension de ses luttes ;
- face à la prise en charge à l'échelle internationale de l'offensive anti-ouvrière de la bourgeoisie, extension des luttes à l'échelle internationale, seule capable d'éviter un écrasement par paquets du prolétariat mondial.
Plus que jamais est à l'ordre du jour le vieux mot d'ordre du mouvement ouvrier "Prolétaires de tous les pays unissez-vous ! "
Mars 81 F. M.
Géographique:
- Espagne [17]
- Amérique Centrale et du Sud [18]
- Pologne [1]
Heritage de la Gauche Communiste:
L'aristocratie ouvrière : une théorie sociologique pour diviser la classe ouvrière
- 7293 lectures
Il y aurait un antagonisme de classe au sein de la classe ouvrière elle-même, un antagonisme entre les couches "les plus exploitées" et les couches "privilégiées". Il y aurait une "aristocratie ouvrière jouissant des plus hauts salaires, des meilleures conditions de travail, une fraction ouvrière qui partagerait avec "son impérialisme" les miettes des sur profits tirés de l'exploitation coloniale. Il y aurait donc une frange de la classe ouvrière qui en fait n'appartiendrait pas à la classe ouvrière, mais à la bourgeoisie, une couche d"'ouvriers-bourgeois".
Voila les grandes lignes communes à toutes les théorisations sur l'existence d'une "aristocratie ouvrière". C'est un instrument théorique dont la principale utilité est de permettre d'estomper dans un flou plus ou moins étendu, suivant les besoins, les frontières qui opposent la classe ouvrière au capital mondial.
Cette théorisation "permet" de taxer des parties entières de la classe ouvrière (les ouvriers des pays les plus industrialisés par exemple) de "bourgeois", et de qualifier des organes bourgeois (les partis de "gauche", les syndicats, par exemple) d"'ouvriers".
Cette théorie trouve son origine dans les formulations de Lénine pendant la 1ère Guerre Mondiale, formulations reprises par la 3ème Internationale. Certains courants politiques prolétariens, ceux qui tiennent à se désigner par l'étrange qualificatif de "léninistes", traînent encore aujourd'hui avec eux cet avatar théorique dont ils ne savent pas toujours que faire, si ce n'est de maintenir un flou sur des questions de première importance dans la lutte de classe. La contre-révolution stalinienne, elle, s'est depuis des décennies servi de cette théorie à tout propos pour tenter de recouvrir ses politiques du prestige de Lénine.
Mais cette théorie est aussi reprise avec plus ou moins d'aménagements et de variantes par des groupes en provenance du stalinisme -via le maoïsme- et qui ont rompu avec beaucoup des principaux mensonges du stalinisme officiel (en particulier le mythe des Etats socialistes, que ce soit la Russie, la Chine ou autre).
Ces groupes, tels "Operai e teoria" en Italie, "Le Bolchevik" en France, le "Marxist Workers' Committee "aux USA, affichent une intervention très radicale contre les syndicats et les partis de gauche. Ils parviennent ainsi, dans certains cas, à faire illusion parmi des travailleurs combatifs. Mais cette critique repose pour ces courants ex-"tiers-mondistes" sur une exaltation de la DIVISION de la classe ouvrière entre les "couches les plus basses" - le vrai prolétariat d'après eux - et "l'aristocratie ouvrière".
Voila comment Operai e Teoria formule cette théorisation de la division de la classe ouvrière :
"Ne pas reconnaître l'existence de différenciation interne parmi les ouvriers productifs, l'importance de la lutte contre l'aristocratie ouvrière, la nécessité pour les révolutionnaires de travailler en vue de la réalisation d'une scission, d'une rupture nette entre les intérêts des couches basses et ceux de l'aristocratie ouvrière, cela signifie, non seulement ne pas avoir compris un événement de l'histoire du mouvement ouvrier, mais -et ceci est plus grave- laisser le prolétariat à la traîne de la bourgeoisie".
(Operai et Teoria n°7, oct-nov 80, c'est nous qui soulignons) ([1] [19])
Dans cet article, nous ne nous attacherons pas tant à suivre les groupes "léninistes" dans leurs contradictions théoriques, qu'à démontrer l'inconsistance théorique et la nocivité politique de la théorie de l'aristocratie ouvrière, telles que la propagent des groupes ex-maoïstes semant la plus néfaste confusion parmi les travailleurs qui croient y reconnaître une explication de la nature contre-révolutionnaire des 'syndicats et des partis de gauche.
Pour cela, nous mettrons en évidence :
1°) que cette théorie repose sur une analyse sociologique qui ignore le caractère de CLASSE HISTORIQUE du prolétariat ;
2°) que la définition, ou plutôt LES définitions de "l 'aristocratie ouvrière" sont d'autant plus floues et contradictoires que le capitalisme a multiplié les divisions au sein de la classe ouvrière;
3°) que le RESULTAT PRATIQUE de ce genre de conceptions n'est autre que celui DE DIVISER LES TRAVAILLEURS pour la lutte, d'isoler les travailleurs des "couches les plus exploitées" du reste de leur classe;
4°) qu'elles entretiennent des confusions sur une soi-disant nature "ouvrière-bourgeoise" des syndicats et des partis "de gauche" (ambiguïté qui existait déjà au sein de l'Internationale Communiste);
5°) que c'est à tort qu'elle prétend se réclamer de "Marx, Engels, Lénine" dont les formulations plus ou moins précises sur l'existence d'une "aristocratie ouvrière" ou sur "l'embourgeoisement de la classe ouvrière anglaise au XIXème siècle" n'ont jamais soutenu une théorie de la nécessité de DIVISER LES OUVRIERS, au contraire.
U n e t h e o r i e s o c i o l o g i q u e
On peut voir la classe ouvrière de deux façons : on peut la voir seulement telle QU’ELLE EST la plupart du temps, c'est à dire : soumise, divisée et même atomisée en des millions d'individus solitaires, sans rapports entre eux.
On peut la voir aussi en tenant compte SIMULTANEMENT de ce qu'elle est HISTORIQUEMENT, c'est à dire en prenant en considération le fait qu'il s'agit d'une classe sociale qui a un passé de plus de 2 siècles de luttes et qui a comme avenir d'être le protagoniste du plus grand bouleversement de l'histoire de l'humanité.
La première vision, IMMEDIATISTE est celle de la classe défaite, alors que la seconde est celle de la classe en lutte. La première est celle que mettent en avant les "sociologues" de la bourgeoisie, pour dire "c'est ÇA la classe ouvrière", la seconde est celle du marxisme qui comprend ce qu'est la classe ouvrière non seulement à partir de ce qu'elle est MAINTENANT, mais aussi et surtout de CE QU'ELLE EST APPELEE A DEVENIR. Le marxisme n'est pas une étude sociologique du prolétariat vaincu. Il est l'effort de comprendre comment lutte le prolétariat, et c'est toute autre chose.
La théorie selon laquelle il y aurait des ANTAGONISMES FONDAMENTAUX AU SEIN DE LA CLASSE OUVRIERE est une conception qui repose sur la seule prise en compte de la réalité immédiate de la classe ouvrière vaincue, atomisée. Quiconque connaît l'histoire des révolutions ouvrières sait que le prolétariat n'est parvenu à ses moments les plus élevés de combat que par une généralisation maximum de son unité.
Dire que l'unité de la classe ouvrière, de ses éléments les plus exploités à ses éléments les moins exploités, est impossible, c'est ignorer toute l'histoire du mouvement ouvrier. L'histoire de toutes les grandes étapes de la lutte ouvrière est traversée par le problème de parvenir à l'union la plus large possible des prolétaires.
Il y a un sens précis dans le mouvement qui va des premières corporations d'ouvriers artisans, aux soviets, en passant par les syndicats de métier. Ce sens est celui de la recherche de la plus grande unité. Les CONSEILS, créés pour la première fois spontanément par les ouvriers en Russie en 1905 constituent le système d'organisation le plus unitaire qui puisse être conçu pour permettre la participation du plus grand nombre d'ouvriers, puisqu'il repose sur les assemblées générales.
Cette évolution ne reflète pas seulement un développement de la conscience de la classe et de son unité et de la nécessité de celle-ci. L'évolution de cette conscience trouve elle-même son explication dans l'évolution des conditions matérielles dans lesquelles travaillent et luttent les prolétaires.
Le développement du machinisme détruit les spécialisations héritées de l'artisanat féodal et antique. IL UNIFORMISE le prolétaire pour en faire une marchandise qui peut produire aussi bien des chaussettes que des canons, sans pour autant être ni tisserand, ni forgeron.
En outre, le développement du capital entraîne le développement de gigantesques centres urbains industriels où les prolétaires sont entassés par millions. Dans ces centres, la lutte prend un caractère explosif par la rapidité même avec laquelle ces millions d'hommes peuvent s'organiser et se coordonner pour agir unis.
"Le développement de l'industrie n'a pas pour seul effet d’accroître le prolétariat, mais aussi de l'agglomérer en masses de plus en plus compactes. Le prolétariat sent sa force grandir. Les intérêts, les situations se nivellent de plus en plus au sein du prolétariat, à mesure que le machinisme efface les différences du travail et ramène presque partout le salaire à un niveau également bas ."
(Marx Engels. Le Manifeste Communiste.: Bourgeois et prolétaires.
Dans les récentes luttes en Pologne où les ouvriers ont déployé des capacités d'unification et d'organisation qui n'ont pas fini d'étonner le monde, ce n'est pas à un affrontement entre ouvriers qualifiés et non qualifiés qu'on a assisté mais à leur unification dans les assemblées pour la lutte et dans la lutte.
Mais, il faut pour comprendre de tels miracles ne pas avoir les yeux fixés, tels les sociologues, sur la réalité IMMEDIATE de la classe ouvrière LORSQU'ELLE NE LUTTE PAS. Lorsque le prolétariat ne lutte pas, lorsque la bourgeoisie parvient à subvenir au minimum social nécessaire pour la subsistance des ouvriers, ceux-ci se retrouvent effectivement totalement divisés.
Dès sa naissance, le prolétariat, cette classe qui subit la dernière mais aussi la plus absolue exploitation sociale qu'une classe exploitée ait connue dans l'histoire, vit de façon totalement différente lorsqu'il est soumis et passif face à la bourgeoisie, ou lorsqu'il relève la tête face à son oppresseur.
Cette séparation entre ces deux formes d'existence (uni et en lutte, divisé et passif) n'a cessé de se creuser avec l'évolution même du capitalisme. A l'exception des années de la fin du XIXème siècle où le prolétariat parvient à imposer momentanément à la bourgeoisie l'existence de véritables syndicats et partis de masse ouvriers, les ouvriers tendent à être de plus en plus unitaires lorsque le combat les rassemble, mais aussi à être de plus en plus divisés et atomisés dans les périodes de "calme social"
La même évolution des conditions de vie et de travail qui conduit la classe ouvrière à LUTTER de façon DE PLUS EN PLUS UNIE, cette même évolution matérielle conduit, en dehors des périodes de lutte, à la concurrence, à la division et même à l'atomisation, en individus solitaires que nous connaissons aujourd'hui.
La concurrence entre ouvriers en dehors des périodes de lutte est une caractéristique du prolétariat depuis sa naissance. Mais elle était MOINS forte aux premiers temps du capital, lorsque les ouvriers "avaient un métier", lorsque l'éducation n'était pas généralisée et que le savoir de chaque prolétaire était un précieux outil de travail. "Le tisserand n'était pas un concurrent pour le forgeron". Mais au fur et à mesure que "n'importe qui peut produire n'importe quoi", grâce aux progrès de la machine et de l'éducation, cela se traduit dans le capitalisme par : "n'importe qui peut prendre le travail de n'importe qui."
Face au problème de trouver du travai1, 1 'ouvrier dans le capitalisme industriel sait que cela dépend du nombre de postulants au même emploi. LE DEVELOPPEMENT DU MACHINISME TEND AINSI A OPPOSER LES OUVRIERS INDIVIDUELLEMENT DE PLUS EN PLUS LORSQU'ILS NE SONT PAS EN LUTTE. Marx décrivait ainsi ce processus : "L'accroissement du capital productif implique l'accumulation et la concentration des capitaux. La concentration des capitaux amène une plus grande division du travail et une plus grande application des machines. La plus grande division du travail détruit la spécialité du travail, détruit la spécialité du travailleur, et en mettant à la place de cette spécialité un travail que tout le monde peut faire, elle augmente la concurrence entre les ouvriers." ("Discours sur le libre échange", p.8 -publié en général avec "Misère de la philosophie".)
Le développement du machinisme crée donc les conditions matérielles pour l'existence d'une humanité unie et consciente, mais en même temps, dans le cadre des lois capitalistes où la survie du travailleur dépend du fait qu'il puisse vendre sa force de travail, ce qu'il engendre c'est une concurrence plus grande que jamais.
Prétendre fonder une théorie de ce que sera le prolétariat en lutte, en ignorant l'expérience historique des luttes passées au profit de l'étude IMMEDIATISTE du prolétariat défait, divisé, conduit inévitablement à concevoir le prolétariat comme un corps qui ne parviendra jamais à s'unifier. Et, plus on fait appel à une vision A-HISTORIQUE, IMMEDIATISTE, -sous couvert de "il faut être concret", "il faut faire quelque chose qui ait des résultats immédiats"- et plus on tourne le dos à une véritable compréhension de ce qu'est réellement le prolétariat.
Une conception qui nie la possibilité de l'unité de la classe ouvrière est de prime abord une théorisation de la défaite du prolétariat, des moments où il ne lutte pas. Elle traduit la vision qu'ont les bourgeois des ouvriers : des individus ignorants, divisés, atomisés, vaincus. Elle relève de l'espèce des sociologues.
Une conception "ouvrieriste".
Ne parvenant pas à voir la classe ouvrière en tant que sujet historique, cette conception la conçoit comme une SOMME D'INDIVIDUS REVOLUTIONNAIRES. L'"OUVRIERISME", ce n'est pas la mise en avant du caractère révolutionnaire de la classe ouvrière mais le culte sociologique des INDIVIDUS OUVRIERS en tant que tels. Imbus de ce genre de vision, les courants d'origine maoïste attachent la plus grande importance à 1 'origine sociale des membres d'une organisation politique. Au point qu'une grande partie de leurs militants d'origine bourgeoise ou petite bourgeoise ont abandonné -surtout dans la période qui suivit 1968- leurs études pour devenir ouvriers en usine (ce qui par la suite ne pouvait que renforcer ce culte de l'ouvrier individuel).
Ainsi, le Marxist Workers'Committee, un groupe qui est parvenu cependant à évolue jusqu'à considérer aujourd'hui qu'il n'existe plus d'Etat ouvrier et que la Russie est bourgeoise depuis 1924 (mort de Lénine), écrit dans un article du n°l de leur publication "Marxist Worker's" (été 79), intitulé: "25 ans de lutte - notre histoire"
"Notre expérience dans le vieux parti révisionniste CPUSA (Parti communiste des USA) et dans le AWCP (American Workers Communist Party -organisation maoïste) nous a conduit à conclure que les fondateurs du socialisme scientifique avaient raison en affirmant qu'un véritable parti ouvrier doit développer un cadre d'OUVRIERS THEORIQUEMENT AVAN CES, que non seulement l'ensemble de ses membres mais aussi sa direction doivent provenir en premier lieu de la classe ouvrière".
Quelle conception de la classe ouvrière peut-on bien "apprendre" dans une organisation bourgeoise stalinienne ? Rappelons ici deux occasions dans l'histoire du mouvement ouvrier où ce principe ouvriériste a sévi.
Rappelons la lutte de "l'ouvrier" TOLAIN, délégué français aux premiers congrès de l'AIT, contre l'acceptation de Marx comme délégué. Pour Tolain, il fallait rejeter Marx, au nom du principe "l'émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes", car Marx n'était pas un ouvrier mais un intellectuel. Après un débat, la motion de Tolain fut rejetée. Quelques années plus tard, Tolain, l'ouvrier, se retrouvait aux côtés des Versaillais contre l'insurrection ouvrière de la Commune de Paris.
Rappelons encore comment la Social Démocratie allemande réussit à interdire en novembre 1918 à Rosa Luxembourg de prendre la parole au Congrès des conseils ouvriers parce qu'elle n'était pas elle non plus ouvrière, et la fit assassiner quelques semaines plus tard par les corps francs aux ordres de l'ouvrier Noske, qui écrasèrent dans le sang l'insurrection de Berlin en janvier 1919. CE N'EST PA CHAQUE INDIVIDU OUVRIER QUI EST REVOLUTIONNAIRE, C'EST LA CLASSE OUVRIERE QUI L'EST.
L'ouvriérisme ne comprend pas cette différence et du coup il ne comprend ni l’ouvrier individuel, ni la classe ouvrière comme classe.
L'aristocratie ouvriere: u n e d e f i n i t i o n i m p o s s i b l e
Qu'il y ait des différences de salaires, de conditions de vie et de travail parmi les ouvriers est une évidence. Que, en règle générale, plus un individu a une situation confortable dans la société, plus il tend à vouloir la conserver, c'est aussi ne trivialité. Mais de là à définir au sein du prolétariat une couche stable dont les intérêts seraient antagonistes à ceux du reste de leur classe et la rattacheraient au camp de la bourgeoisie, ou encore vouloir établir un lien mécanique entre exploitation et conscience et combativité, il y a un saut particulièrement périlleux.
Aux premiers temps du capitalisme, lorsqu'en grande partie les ouvriers étaient encore quasiment des artisans, avec des qualifications très particulières, avec des prérogatives de "corporation", on pouvait momentanément, pendant les périodes de prospérité économique, discerner plus facilement des parties de la classe ouvrière ayant des privilèges particuliers.
Ainsi, Engels pouvait reconnaître circonstancielle ment dans une correspondance personnelle, une aristocratie ouvrière "dans" les mécaniciens, les charpentiers et menuisiers, les ouvriers du bâtiment", qui constituaient au XIXème siècle des travailleurs organisés à part et jouissant de certains privilèges par l'importance et le monopole qu'ils avaient de leur qualification.
Mais avec l'évolution du capitalisme, avec d'une part la déqualification du travail, et avec d'autre part la multiplication des divisions artificielles parmi les travailleurs, tenter de définir une "aristocratie ouvrière" au sens d'une couche précise ayant des privilèges qui la distingueraient de façon qualitative du reste des ouvriers, c'est se condamner à nager dans l'arbitraire. Le capitalisme a systématiquement divisé la classe ouvrière tentant toujours de créer des situations où l'intérêt des uns soit opposé à l'intérêt des autres travai11eurs.
Nous avons insisté déjà sur comment le développement du machinisme conduit, dans les périodes de non lutte du prolétariat, par la "destruction de la spécialité du travailleur" au développement de la concurrence entre ouvriers. Cependant le capitalisme ne se contente pas des divisions que peut engendrer le processus de production lui-même. Comme les classes exploiteuses du passé, la bourgeoisie connaît et applique le vieux principe : DIVISER POUR REGNER. Et elle le fait avec un cynisme et une science sans précédent dans l'histoire.
Le capitalisme a repris des sociétés du passé l’emploi des divisions "naturelles" par sexe et par âge. Alors que la force physique, prérogative du mâle adulte disparaît progressivement avec le développement des machines, le capital entretient sciemment ces divisions dans le seul but de diviser et de payer moins cher la force de travail de la femme, de l'enfant ou du vieux.
Le capitalisme reprend aussi du passé les divisions raciales ou d'origine géographique.
Dans sa genèse, le capital, encore essentiellement sous sa forme de capital commercial, s'est enrichi entre autres grâce au commerce des esclaves. Dans sa forme achevée, le capital n'a cessé de se servir des différences d'origine ou de race pour exercer une pression permanente vers la baisse des salaires. De la situation faite aux travailleurs irlandais dans l'Angleterre du XVIIIème et XIXème siècle, à celle des ouvriers turcs ou yougoslaves dans l'Allemagne de 1980, il y a la poursuite d’une même politique de division. Le capital sait parfaitement tirer profit des divisions tribales en Afrique, comme des divisions religieuses en Ulster, des différences de castes en Inde ou des différences raciales aux USA ou dans les principales puissances européennes reconstruites après la guerre avec l'importation massive de travailleurs d'Asie, d'Afrique et des pays moins développés d'Europe (Turquie, Grèce, Irlande, Portugal, Espagne, Italie, etc..)
Mais le capitalisme ne se contente pas d'entretenir et d'attiser ces divisions dites "naturelles" parmi les travailleurs. En généralisant le salariat et l'organisation "scientifique" de l'exploitation en usine (taylorisme, système de primes, etc.), il a porté le travail de division des ouvriers au niveau des professionnels : sociologues, psychiatres, syndicalistes travaillent la main dans la main avec les managers du personnel pour mieux concevoir une organisation "rentable" de la production et faire régner dans les ateliers et les bureaux la loi du chacun pour soi, l'intérêt de chacun est antagoniste de celui de tout autre. C'est dans le capitalisme que la fameuse sentence: "l'homme est un loup pour l'homme" s'est le mieux concrétisée. En faisant dépendre le salaire des uns de la productivité des autres, en multipliant les différences de salaire artificielles pour un même travail (ce qui est actuellement poussé à l'extrême grâce à l'emploi de l'informatique dans la gestion des entreprises), il s'attache à créer des antagonismes entre les exploités.
Dans ces conditions, il est presque impossible de ne pas trouver pour chaque catégorie de travailleurs, une autre catégorie qui soit moins "privilégiée" ou plus "privilégiée".
Si l'on tient compte des privilèges que peut donner à un ouvrier son âge, son sexe, sa race, son expérience, le contenu de son travail: manuel ou non, sa position dans le processus de production, les primes qu'il reçoit, etc., etc., on peut multiplier à l'infini les définitions de ce que pourrait être une "aristocratie ouvrière". On aura coupé la classe ouvrière en tranches sociologiques comme un salami, mais on aura pas avancé d'un pas dans la compréhension de son être révolutionnaire.
Les élucubrations d'origine maoïstes sur l'aristocratie ouvrière incluent en toute logique "antiaristocratie-ouvrière", la nécessité d'organiser le "vrai prolétariat" : "les couches les plus exploitées". Il faut donc à ces groupes non seulement se livrer à un travail de définition sociologique de ce que peut bien être une "aristocratie ouvrière", mais encore de ce que sont les couches "pures" du prolétariat. Ils dépensent une grande partie de leur travail "théorique"à cela et les résultats varient suivant le groupe, la tendance, le pays, la période, etc...
Ainsi, par exemple, dans des pays comme l'Angleterre, la France ou l'Allemagne, ce sont les travailleurs immigrés qui constituent le vrai prolétariat, le reste, les travailleurs blancs étant "l'aristocratie". Aux Etats Unis, suivant une telle conception, toute la classe ouvrière peut être considérée comme embourgeoisée (le niveau de vie d'un ouvrier noir aux USA pouvant être 100 fois supérieur à celui d'un ouvrier de l'Inde), mais on peut aussi, suivant la même idée, trouver que ce ne sont que les ouvriers blancs qui sont des "aristocrates" les ouvriers noirs américains étant des"aristocrates" d'un certain point de vue, mais "les plus exploités" d'un autre. Pour "Operai e Teoria", ce seraient les ouvriers qui travaillent à la chaîne qui constituent "la vraie classe ouvrière". Dans les pays sous-développés, les ouvriers de l'industrie sont de la même façon catalogués par certains groupes comme des "aristocrates", leur niveau de vie étant souvent beaucoup plus élevé que celui des masses de "sans-travail" qui s'entassent à la périphérie des villes.
Les définitions de cette fameuse "aristocratie" peuvent ainsi varier d'un groupe à l'autre, passant allègrement de 100% des travailleurs à 50% ou 20% suivant les humeurs des théoriciens de service.
Une theorie pour diviser la classe
En attendant de déterminer ou de préciser leurs différentes définitions sociologiques des couches du prolétariat, le travail d'intervention de ces organisations parmi les ouvriers est d'agir à des degrés divers pour la DIVISION des ouvriers, comme ils le disent eux-mêmes.
Cela consiste essentiellement à créer des organisations qui regroupent uniquement des ouvriers dont ils croient avoir la certitude qu'ils ne font pas partie de 1"'aristocratie ouvrière". Des organisations d'ouvriers noirs, des organisations d'ouvriers à la chaîne, des organisations d'ouvriers immigrés, etc ...
C'est ainsi par exemple que certains groupes développent parmi les travailleurs immigrés dans les pays les plus industrialisés d'Europe un racisme particulier qui remplace le racisme classique "anti-blancs" en un racisme "marxiste-léniniste" anti-aristocratie-ouvrière-blanche. Dans des pays moins développés, exportateurs de main d’œuvre, c'est à faire de 1"'anti-ouvrier-qualifié" parmi les ouvriers les moins qualifiés que se dédient les défenseurs de cette théorie.
Au sein de ces organisations, on cultive la méfiance envers "l'aristocratie ouvrière" qui devient rapidement l'explication de tous les maux qui frappent "les couches les plus exploitées".
On prétend, dans le meilleur des cas, que l'unification SEPARFE des secteurs les plus exploités de la classe constitue un exemple et un facteur vers une unification plus large de la classe. Mais c'est tout ignorer de comment se fait 1'unification des ouvriers.
L'exemple vivant de la Pologne 80 est parfaitement clair sur la question. L'unification des ouvriers n'a pas été le résultat d'une série d'unifications partielles cumulées les unes à la suite des autres, un secteur après l'autre, au cours de plusieurs années d'un travail de fourmi. C'est sous la forme d'une explosion que cette unification se réalise en quelques jours ou quelques semaines. Le point de départ de la lutte, le cheminement de la généralisation du combat sont imprévisibles et multiples.
La Pologne n'a d'ailleurs fait que confirmer à nouveau ce qu' avaient déjà mis en évidence toutes les explosions de lutte ouvrières depuis 1905 en Russie. Depuis 75 ans le prolétariat ne s'unifie que dans la lutte et pour la lutte. Mais, quand il le fait, il le fait d'emblée à l'échelle la plus large possible. Depuis 75 ans, lorsque les ouvriers luttent sur leur terrain de classe, ce à quoi on assiste, ce n'est pas à un pugilat entre fractions de la classe ouvrière, mais au contraire à une unification sans précédent dans l'histoire. LE PROLETARIAT EST LA PREMIERE CLASSE DANS L'HISTOIRE QUI N'EST PAS DIVISEE EN SON SEIN PAR DE REELS ANTAGONISMES ECONOMIQUES. Contrairement aux paysans, aux artisans, le prolétariat ne possède pas ses moyens de production. Il ne possède que sa force de travail et sa force de travail, elle, est COLLECTIVE.
La seule arme du prolétariat face à la bourgeoisie armée, c'est le NOMBRE. MAIS LE NOMBRE SANS L'UNITE, CE N'EST RIEN. La conquête de cette unité, c'est le combat fondamental du prolétariat pour affirmer sa force. Ce n'est pas par hasard que la bourgeoisie s'acharne tant à briser tout effort en ce sens.
C'est se moquer du monde que d'affirmer, comme le fait Operai e Teoria, que l'idée de la nécessité de l’unité de la classe ouvrière est une idée bourgeoise :
" ... pas une voix de la bourgeoisie ne s'élève aujourd'hui pour soutenir cette division (entre les couches les plus basses et "l'aristocratie") au contraire, ils font de la propagande tous en chœur en faveur de la nécessité des sacrifices parce que "nous sommes tous dans la même barque". " (0. et T. n°7, page 10).
Ce n'est pas d'unité de la classe ouvrière que la bourgeoisie parle dans tous les pays, mais d'UNITE DE LA NATION. Ce qu'elle dit, ce n'est pas "tous les ouvriers sont dans la même barque", mais "les ouvriers sont dans la même barque que la bourgeoisie de leur pays". Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais cela est difficile à comprendre pour ceux qui ont "appris" le marxisme de la bouche des nationalistes à la Mao, Staline ou Ho-chi-Minh. Face à toutes ces élucubrations d'origine stalinienne, les communistes ne peuvent qu'opposer les leçons de la pratique historique du prolétariat. Et, tout comme le préconisait déjà le Manifeste en 1848 : "METTRE EN AVANT ET FAIRE VALOIR LES INTERETS COMMUNS DU PROLETARIAT TOUT ENTIER" (Prolétaires et Communistes - souligné par nous
Une conception ambiguë des partis et des syndicats
Comment une telle théorie peut-elle avoir un minimum d'écho parmi les travailleurs ?
Probablement, la raison principale pour laquelle cette conception peut être entendue par certains travailleurs sans rire ni colère, c'est parce qu'elle semble donner une explication du pourquoi et du comment de l’écœurant travail de sabotage mené par les centrales syndicales dites "ouvrières ".
D'après cette théorie, les syndicats, ainsi que les partis de gauche, seraient l'expression des intérêts matériels de certaines couches du prolétariat, les couches les plus privilégiées, "l'aristocratie ouvrière". En temps de "calme social", pour certains ouvriers, victimes du racisme des ouvriers blancs, du mépris ou du contrôle d'ouvriers plus qualifiés, écœurés par l'attitude de "gestionnaire du capital" des partis de gauche et leurs syndicats, cette théorie semble d'une part donner une explication cohérente de ces phénomènes et d'autre part offrir une perspective IMMEDIATE d'action : s'organiser séparément des "aristocrates". Malheureusement, cette conception est fausse théoriquement et néfaste politiquement.
Voici, par exemple, comment "Le Bolchevik" (Organisation communiste bolchevik) en France, formule cette idée :
"Le PCF n'est pas un parti ouvrier. Par sa composition, en grande partie intellectuelle, petite bourgeoise, et surtout par sa ligne politique réformiste, ultra-chauvine, le PCF de Marchais et Séguy est un parti bourgeois.
Il n'est pas le représentant politique et idéologique de la classe ouvrière. Il est le représentant des couches supérieures de la petite bourgeoisie et de l'aristocratie ouvrière." ("Le Bolchevik" n'112, février 1980.
En d'autres termes, les intérêts d'une fraction de la classe ouvrière, "l'aristocratie", seraient les mêmes que ceux de la bourgeoisie, puisque le parti qui en représente les intérêts est "bourgeois". Cette identité de ligne politique entre les partis de "l'aristocratie ouvrière" et ceux de la bourgeoisie, reposerait sur des bases ECONOMIQUES, l'aristocratie recevant des "miettes" des surprofits arrachés par leur capital national aux colonies et semi-colonies.
Lénine formula une théorie analogue pour tenter d'expliquer la trahison de la Social Démocratie lors de la 1ère guerre mondiale.
"L'opportunisme (c'est le nom que donne Lénine aux tendances réformistes qui dominaient les organisations ouvrières et qui ont participé à la 1ère guerre mondiale) a été engendré, tout au long de décennies par les particularités d'un certain développement du capitalisme, dans lequel une couche d'ouvriers privilégiés, qui avaient une existence relativement tranquille et civile, avait été "embourgeoisée", recevait quelques miettes du profit de leur propre capital national et parvenait ainsi à être dégagée de la misère, de la souffrance et de l'état d'esprit révolutionnaire de masses misérables et ruinées." (... ) "La base économique du chauvinisme et de l'opportunisme dans le mouvement ouvrier est le même ; l'alliance des couches supérieures, peu nombreuses, du prolétariat et de la petite bourgeoisie, qui reçoivent les miettes des privilèges de "leur" capital national contre les masses ouvrières et contre les masses travailleuses opprimées en général".
("La faillite de la II" Internationale)
Critique de l‘explication de Lenine de la trahison de la seconde internationale
Avant de traiter des théories des épigones, arrêtons nous quelque peu sur la conception définie par Lénine pour rendre compte de la nouvelle NATURE DE CLASSE des partis ouvriers social-démocrates qui venaient de trahir le camp prolétarien.
L'histoire posait aux révolutionnaires la question suivante : on savait que pendant des décennies, la Social-Démocratie européenne, fondée en particulier par Marx et Engels, formée au prix de luttes ouvrières acharnées, avait constitué un véritable instrument de défense des intérêts de la classe ouvrière. Maintenant que la quasi-totalité de la Social Démocratie, partis de masse et syndicats y compris, s'était alignée dans chaque pays derrière SA bourgeoisie nationale CONTRE les ouvriers des autres nations, comment devait-on définir la nature de classe de ce monstrueux produit de l'histoire ?
Pour donner une idée du choc que provoqua cette trahison sur la toute petite minorité d'éléments restés sur les positions révolutionnaires internationalistes, rappelons, par exemple, l'étonnement de Lénine lorsqu'il eut devant les yeux le numéro du "VORWARTS" (organe du Parti Social-démocrate en Allemagne) annonçant le vote des crédits de guerre par les parlementaires socialistes : il crut qu il s'agissait d"'un faux" destiné à renforcer la propagande en faveur de la guerre. Rappelons encore les difficultés des spartakistes allemands, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht en tête, pour rompre définitivement le cordon ombilical qui les liait organiquement à 1"'organisation mère".
Lorsque explose la guerre, la politique social-démocrate est ouvertement bourgeoise, mais la majorité des membres de ses partis et syndicats reste ouvrière. Comment expliquer une telle contradiction ?
Les social-démocrates, devenus patriotes, disaient : "voilà la preuve que l'internationalisme n'est pas une idée véritablement ouvrière". Pour rejeter une telle analyse Lénine répondit -en se situant sur le même plan- que ce n'était pas TOUS les ouvriers qui avaient rejeté l'internationalisme, mais seulement "une minorité privilégiée" qui s'était "dégagée de la misère, de la souffrance, et de l'état d'esprit révolutionnaire de masses misérables et ruinées". Lénine a un souci parfaitement juste : montrer que le fait que le prolétariat européen se soit laissé embrigader dans la guerre inter-impérialiste ne signifiait pas que ce genre de guerre répondait aux intérêts de la classe ouvrière de chaque pays. Mais les arguments qu'il emploie sont faux et démentis par la réalité vivante. Lénine dit que les ouvriers "patriotes" sont ceux qui ont des intérêts économiques communs avec "'leur' capital national". Ce dernier corromprait une "aristocratie ouvrière" en lui octroyant une partie, "quelques miettes du profit".
Combien grande est cette partie corrompue de la classe ouvrière ? Une "partie infinitésimale" répond Lénine dans "La faillite de la II° Internationale" ; "Les chefs ouvriers et la couche supérieure de l'aristocratie ouvrière" dit-il dans sa préface à "L'impérialisme stade suprême du capitalisme".
Mais la réalité démontre
1°) que ce n'est pas une minorité "infinitésimale" du prolétariat qui a profité, à la fin du XIX°, et au début du XX° siècle, de l'expansion du capital européen, mais l'ensemble des ouvriers de l'industrie. L'interdiction du travail des enfants, la limitation du travail des femmes, la réduction de la journée de travail à 10 heures, la création d'écoles et d'hôpitaux publics, etc., toutes ces mesures arrachées par la lutte ouvrière au capital en pleine expansion, ont bénéficié en premier lieu aux couches les plus "basses", les plus exploitées de la classe ouvrière;
2°) que la vision de Lénine d'une infime minorité d'ouvriers corrompus, isolés au milieu de gigantesques masses d'ouvriers misérables et possédés par un "état d'esprit révolutionnaire" est, à la veille de la première guerre mondiale, une pure invention de l'esprit. C'est la quasi-totalité des ouvriers, pauvres et riches, qualifiés et non qualifiés, syndicalisés et non syndicalisés qui dans les principales puissances vont, "la fleur au fusil", étriper "l'ennemi" et se faire massacrer pour la défense de "ses" maîtres nationaux;
3°) que "l'explication économique" des "miettes du profit" que les impérialismes partageraient avec leurs ouvriers les plus qualifiés n'a aucun sens. D'abord parce que, comme on l'a vu, ce n'est pas une toute petite minorité d'ouvriers qui a vu sa situation s'améliorer fortement avec l'expansion capitaliste, mais L'ENSEMBLE des ouvriers des pays industrialisés. Ensuite parce que par définition, les capitalistes ne partagent ni leurs profits, ni leurs surprofits, avec les exploités.
Les augmentations de salaires, la puissante élévation du niveau de vie des ouvriers des pays industrialisés fut le résultat non pas de la générosité de capitalistes prêts à partager leurs profits, mais de la pression que les ouvriers pouvaient à cette époque exercer sur leurs capitaux nationaux avec succès. La prospérité économique du capitalisme de la fin du XIX° siècle réduit partout la masse des chômeurs de "l'armée de réserve" du capital. Sur le marché où se vend la force de travail, cette marchandise est d'autant plus rare et donc chère que les usines tournent à plein et se multiplient. C'est ce qui se produit au cours de cette période. Les ouvriers parviennent ainsi, en s'organisant même partiellement (syndicats et partis de masse), à vendre leur force de travail à un prix plus élevé et à obtenir des améliorations réelles de leurs conditions d'existence.
L'ouverture du marché mondial aux quelques centres industriels de la planète, localisés essentiellement en Europe et en Amérique du Nord, permettait au capital de se développer avec une puissance foudroyante. Les crises périodiques de surproduction étaient surmontées avec une rapidité et une énergie qui semblait toujours plus puissante. Dans certaines régions, la grisaille des centres industriels se développait comme une tâche d'huile absorbant un nombre toujours croissant de paysans et d'artisans qui se voyaient ainsi transformés en ouvriers, en prolétaires. La force de travail des ouvriers qualifiés, ceux qui avaient appris le métier de longue date, devenait une marchandise précieuse pour les capitalistes.
Il y a donc bien un lien entre expansion mondiale du capitalisme et élévation du niveau de vie des ouvriers de l'industrie, mais ce lien n'est pas celui décrit par Lénine. L'amélioration de la condition prolétarienne ne touche pas une minorité "infinitésimale", mais l'ensemble de la classe. Elle n'est pas le résultat d'une "corruption" des ouvriers par une magie capitaliste, mais de la lutte ouvrière en période de prospérité capitaliste.
Si les ouvriers européens et américains ont, en masses, identifié leurs intérêts avec ceux de leur capital, avec en tête leurs organisations politiques et syndicales, c'est parce qu'ils avaient subi, pendant des décennies, l'ivresse de la période la plus prospère matériellement que l'humanité ait jamais connu. Si l'idée de la possibilité du passage pacifique au socialisme faisait tant de ravages dans le mouvement ouvrier ([2] [20]), c'est parce que la prospérité sociale semblait parfois maîtrisée par les forces conscientes de la société. La barbarie de la première guerre mondiale jeta dans la boue des tranchées de Verdun toutes ces illusions. Mais ces illusions n'avaient pas moins permis entre temps aux généraux du capital d'envoyer à la boucherie inter-impérialiste plus de 2O millions d'hommes.
La guerre mondiale signe définitivement la fin de toute cohabitation possible entre "réformistes" et révolutionnaire au sein du mouvement ouvrier.
En se transformant en sergents recruteurs des armées impérialistes, les tendances réformistes majoritaires dans la Social-Démocratie sont passées corps et âme dans le camp de la bourgeoisie.
DES LORS, ELLES N’ETAIENT PLUS DES TENDANCES OUVRIERES FORTEMENT INFLUENCEES PAR L'IDEOLOGIE DE LA CLASSE DOMINANTE, MAIS DES ROUAGES, DES ORGANES DE L'APPAREIL POLITIQUE DE LA BOURGEOISIE.
Les partis social-démocrates NE SONT PLUS DES OR GANISATIONS "OUVRIERES EMBOURGEOISEES", mais des organisations BOURGEOISES TRAVAILLANT AU SEIN DE LA-CLASSE OUVRIERE. Ils ne représentent plus les intérêts de la classe ouvrière, ni même d'une fraction de celle-ci. Ils incarnent les intérêts du capital national tout entier.
La Social-Démocratie n'est pas plus "ouvrière" parce qu'elle encadre des ouvriers que les barreaux d'une cage sont fauves parce qu'ils encadrent des fauves. Le massacre des ouvriers allemands au lendemain de la guerre par la Social Démocratie au gouvernement, confirma dans le sang de quel côté de la barricade elle se situait désormais.
La théorie suivant laquelle les partis de gauche et leurs syndicats seraient les défenseurs des intérêts d'une "aristocratie ouvrière" entretient d'une façon ou d'une autre l'idée qu'il s'agit tout de même d'organisations ouvrières, même si ce n'est que partiellement.
Cette question "théorique" prend toute son importance pratique lorsque les masses ouvrières sont confrontées à une attaque d'une fraction de la bourgeoisie contre ces organisations. C'est au nom de la défense de ces organisations "ouvrières" que les "démocraties occidentales" ont conduit les ouvriers à la lutte "contre le fascisme" de l'Espagne 1936 à Hiroshima.
C'est cette "ambiguïté" que les épigones actuels revendiquent. Le courant maoïste provient des partis communistes. Ce sont des pans du bloc stalinien qui se sont détachés sous les coups du développement des conflits inter-impérialistes (en particulier entre la Chine et la Russie) et de l'intensification de la lutte de classe.
Beaucoup de groupes d'origine maoïste affirment que les PC sont des organisations "bourgeoises", mais ils s'empressent toujours de préciser qu'elles s'appuient sur l’ "aristocratie ouvrière", et que par-là elles sont partiellement des organisations "ouvrières embourgeoisées" ... On peut deviner l'importance que peut avoir cette "nuance" pour des groupes qui, tels le "Marxist Worker’s Committee", se revendiquent fièrement de leur "25 ans de lutte ([3] [21]) dont plus des 3/4 chez les staliniens. On ne travaillait pas pour la bourgeoisie... on travaillait pour "l'aristocratie ouvrière".
Toute ambiguïté sur savoir de quel côté de la barricade se trouvent les partis de gauche et les syndicats est meurtrière pour la classe ouvrière. Depuis 60 ans, presque tous les mouvements ouvriers importants ont été écrasés par "la gauche" ou avec sa complicité. La théorie de "l'aristocratie ouvrière", en cultivant cette ambiguïté, désarme la classe en rendant flou ce qui doit être le plus clair et le plus net possible au moment d'engager une bataille : QUI EST AVEC QUI.
Une deformation grossière du marxisme
Nous avons montré en quoi la théorie de l'aristocratie ouvrière, telle qu'elle est défendue par les groupes maoïstes et ex-maoïstes, traduit une vision sociologique de la classe ouvrière, vision acquise par ces courants au cours de leur expérience stalinienne.
L'incapacité à concevoir la véritable dimension historique du prolétariat s'accompagne chez ces groupes qui se disent prolétariens de l'ignorance de toute la pratique réelle historique des masses ouvrières.
La compréhension de cette expérience est remplacée par une étude quasi religieuse de certains textes sacrés des évangélistes "prolétariens" dont on cite des extraits comme la preuve absolue de la véracité de ce qu'ils disent. (L'évolution des groupes maoïstes se mesure au nombre de têtes d'évangélistes qu'ils éliminent de leurs icônes : au début il y avait Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao ; bientôt il n'y eut plus Mao et, à un stade plus avancé, lorsque certains d'entre eux commencent à ouvrir les yeux sur ce que fut la contre-révolution stalinienne, on élimine aussi Staline. Mais, du coup, les 3 restants voient leur valeur religieuse encore plus renforcée).
Pour savoir si telle idée ou telle position politique est juste, ou fausse, on ne se pose pas la question : est-ce que cela a été confirmé ou non par la pratique réelle et vivante des luttes ouvrières dans le passé, mais : est-ce que ça peut être justifié par une citation de Marx, Engels, Lénine ou non.
C'est ainsi que, pour démontrer "scientifiquement la justesse de leur théorie de l'aristocratie ouvrière, ces groupes abreuvent leurs lecteurs et leur public de citations savamment choisies de Marx, Engels, Lénine.
Ces ultra-léninistes se réfèrent aux erreurs de Lénine sur "l'aristocratie ouvrière", mais ils "oublient" que Lénine n'en déduisit jamais des positions aberrantes, telles celle d'Operai e Teoria, suivant laquelle les révolutionnaires ne doivent plus "mettre en avant et faire valoir les intérêts communs du prolétariat tout entier" -comme le disait le Manifeste- mais "travailler en vue" de la réalisation d'une scission, d'une rupture nette entre les intérêts des couches basses et celles de l'aristocratie ouvrière" (O et T).
Jamais Lénine ne préconise que les ouvriers ne s'organisent indépendamment et contre le reste de leur classe. Au contraire, autant Lénine combattit la Social-Démocratie patriotarde comme courant politique, autant il défendit la nécessité de l'unité de l'ensemble des ouvriers dans leurs organisation unitaires. Le mot d'ordre "Tout le pouvoir aux Soviets", c'est à dire tout le pouvoir aux organisations les plus larges et unitaires que la classe ait pu engendrer, mot d'ordre dont il fut un des plus puissants défenseurs, ne constitue pas un appel à la division mais au contraire un appel à l'unité la plus forte pour la prise du pouvoir.
Quant aux références de ces courants à certaines citations de Engels, elles sont tout simplement une tentative de faire dire à des phrases isolées d'Engels quelque chose qu'elles n'ont jamais dit. Engels parle à plusieurs reprises d'une "aristocratie" au sein de la classe ouvrière. Mais de qui parle-t-il ?
Dans certains cas, il parle de la classe ouvrière anglaise, qui dans son ensemble jouit de conditions de vie et de travail bien supérieures à celles des travailleurs des autres pays.
Dans d'autres cas, il parle d'ouvriers au sein de la classe ouvrière anglaise elle-même, des plus spécialisés, possédant encore des connaissances artisanales (les mécaniciens, les charpentiers et menuisiers, les ouvriers du bâtiment). Mais s'il en parle, c'est pour combattre les illusions que pouvait entretenir la classe ouvrière anglaise d'être effectivement une "aristocratie" et pour insister sur le fait que l'évolution du capitalisme et surtout les crises économiques auxquelles il est condamné égalisent par le bas les différences entre ouvriers et détruisent les bases mêmes des" privilèges" de certaines minorités, même au sein de la classe ouvrière en Angleterre. Ainsi, dans un débat au sein de l'Association Internationale des Travailleurs (1ère Internationale), il dit: "En l'occurrence, cela (l'adoption de la motion de Halos sur la section irlandaise dans l'AIT) ne ferait que renforcer l'opinion déjà trop longuement répandue parmi les ouvriers anglais selon laquelle, par rapport aux irlandais, ils sont des êtres supérieurs et représentent une sorte d'aristocratie comme les blancs des états esclavagistes se figuraient l'être par rapport aux noirs"([4] [22]). Et Engels annonce comment c'est la crise économique qui va se charger de balayer cette opinion déjà trop largement répandue:
"Avec la ruine de la suprématie industrielle, la classe ouvrière d'Angleterre va perdre sa condition privilégiée. Dans son ensemble -y compris avec sa minorité privilégiée et dirigeante- elle se verra alignée au niveau des ouvriers de l'étranger". (idem)
Et parlant des vieux syndicats qui regroupaient exclusivement et jalousement les ouvriers les plus spécialisés:
"Finalement, elle (la crise aiguë du capitalisme)devra éclater, et il faut espérer qu'elle mettra fin alors aux vieux syndicats".
L'expérience pratique des luttes ouvrières au XXème siècle avec ses "nouvelles" formes d'organisation fondées sur les assemblées générales et leurs délégués organisés en comités ou en conseils a effectivement mis fin non seulement aux vieux syndicats d'ouvriers spécialisés, mais aussi aux syndicats de tout genre, inévitablement fondés sur des catégories strictement professionnelles. C'est pour renforcer le mouvement par l'indispensable unité de la classe ouvrière qu'Engels parlait d'une "sorte d'aristocratie" ouvrière.
C'est une falsification grossière que d'en déduire la nécessité de diviser la classe ouvrière.
Pour en finir avec les références "marxistes", signalons ponctuellement la trouvaille de "Operai e Teoria" qui prétend trouver dans Marx une explication aux antagonismes qui opposeraient les ouvriers entre eux.
"Tous les ouvriers ensemble organiquement produisent de la plus-value, mais pas tous la même quantité parce qu'il ne sont pas tous soumis à l'extorsion massive de plus-value relative".
De toute évidence, ces gens ne se sont même pas donné la peine de savoir ce qu'est la "plus-value relative". Par ce terme, Marx définit le phénomène de l'accroissement du temps de travail volé par le capital à la classe ouvrière grâce à l'accroissement de la productivité.
Contrairement à l'extraction de la "plus-value absolue" qui dépend essentiellement de la durée du temps de travail, la "plus value relative dépend de la productivité sociale en premier lieu de l'ensemble des ouvriers.
L'accroissement de la productivité se traduit par le fait qu'il faut moins d'heures de travail pour produire une même quantité de biens. L'accroissement de la productivité sociale se traduit par le fait qu'il faut moins de temps de travail social pour produire les biens de subsistance.
Les produits nécessaires à l'entretien de la force de travail, ceux que l'ouvrier doit acheter avec son salaire contiennent de moins en moins de valeur. Même s'il peut désormais s'acheter deux chemises au lieu d'une, ces deux chemises ont coûté moins de travail à être produite qu'une seule auparavant grâce à l'élévation de la productivité. La différence entre la valeur du travail fourni par l'ouvrier et la valeur de la contre-partie qu'il reçoit sous forme de salaire, la plus-value que s'approprie le capitaliste, augmente même si la durée absolue de son travail reste inchangée.
La plus-value relative c'est l'exploitation par le renforcement de la domination de 1'emprise de domination du capital sur toute la vie sociale.([5] [23]) Elle est la forme d'exploitation la plus collective dont soit capable une société de classe.(C'est pourquoi elle est la dernière.)
En ce sens elle est subie par tous les ouvriers avec une intensité égale.
Le développement du recours à la
plus-value relative ne conduit pas à un développement d'antagonismes
économiques au sein de la classe ouvrière comme le prétend 0 et T", mais
au contraire à 1'uniformisation de sa situation objective face au capital.0
On ne peut lire Marx avec des yeux de sociologues staliniens.
Certains courants politiques en provenance du maoïsme affichent un anti-syndicalisme radical. Cela crée des illusions en paraissant être un pas en avant vers des positions de classe. Mais la théorie qui soutend cette position ainsi que les conclusions politiques auxquelles elle conduit font de cet anti-syndicalisme un nouvel instrument de division de classe ouvrière.
Ce qui a rendu caduque
historiquement la forme d'organisation syndicale pour le combat ouvrier, c'est
précisément son incapacité à permettre une véritable unification de la classe.
L’organisation par branches, par métiers, sur un plan strictement économique ne
permet plus l'unification indispensable à l'efficacité de toute lutte dans le
capitalisme totalitaire.
Rejeter les syndicats pour
diviser autrement, c'est à cela que conduit l'anti-syndicalisme fondé sur
"l'anti-aristocratie ouvrière".
R.V.
[1] [24] il s'agit d'un article où 0 e T tente de répondre aux critiques de Battaglia Comunista (Pcint.) qui, tout en étant "léniniste" leur reproche :
-de"favoriser le processus capitaliste de division de la classe ouvrière" ;
-de faire reposer leur théorie sur"la fausseté objective des privilèges" au sein de la classe ;
-de ne pas comprendre "la tendance du capitalisme dans sa phase de crise à provoquer un appauvrissement progressif des conditions de vie de tout le prolétariat et donc à réaliser l'unification économique de celui-ci".
BC a certainement raison dans ces critiques, mais ne va pas jusqu'au bout, de crainte de mettre en question la parole du "maître".
[2] [25] Les "compromis"que devait faire passer la IIIème Internationale avec les partis sociaux-démocrates dès 1920, au détriment de tendances ouvrières taxées d"ultra-gauchisme", ont trouvé une justification théorique dans l'ambiguïté du terme "ouvrier-bourgeois" employé à l'égard des partis social-démocrates patriotes. L'Internationale de Lénine en arriva ainsi jusqu'à demander aux communistes anglais de s'intégrer dans le parti "travailliste" !
[3] [26] Marxist Worker, N°l, en 1979. "25 years of struggle. Our history".
[4] [27] Extrait d'une intervention à la séance du conseil général de l'AIT en Mai 1872. Cité par Dangeville dans K-Marx. F-Engels - Syndicalisme, Tome 1.
[5] [28] La prédominance par la plus value relative sur la plus value absolue constitue une des caractéristiques essentielles de ce que Marx appelle "la domination réelle de capital".
Courants politiques:
- Bordiguisme [29]
Heritage de la Gauche Communiste:
La question syndicale, après 1920 : comment les groupes révolutionnaires ont tire les leçons du passe
- 3796 lectures
L'après-guerre va marquer une sorte de tournant, une sorte de croisée des chemins pour les groupes communistes internationalistes : le trotskisme et sa logique étaient passés dans le camp bourgeois, la nature de classe capitaliste de l'URSS était définitivement tranchée, les illusions sur une éventuelle vague révolutionnaire s'évanouirent rapidement; dans ce contexte, il s'agissait donc de tracer des lignes générales pour le futur, tant du point de vue du développement du capitalisme mondial que du point de vue de la lutte de classes.
LA GAUCHE COMMUNISTE
En ce qui concerne la question syndicale, la gauche communiste de France ("Internationalisme") issue du courant de la gauche italienne, après quelques hésitations, sut développer une analyse claire de la nécessaire rupture avec les syndicats
"Les luttes ouvrières ne peuvent se mouvoir et se faire qu'en dehors des syndicats par la constitution dans chaque lutte d'organismes nouveaux que sont les comités de grève, les comités locaux de lutte, les conseils ouvriers. Ces organismes ne vivent qu'autant que subsiste la lutte elle-même et disparaissent avec elle. Dans la période présente, il est impossible de construire des organisations de masse permanentes. Cela ne deviendrait possible que dans la période de lutte généralisée du prolétariat, posant à l'ordre du jour la révolution sociale. Vouloir maintenir une organisation permanente actuellement sous la forme de minorités ou de fractions dans les anciens syndicats ou en formant de nouvelles centrales syndicales, ou syndicats autonomes et syndicats d'usine, ne mène à rien et trouble le processus de prise de conscience des ouvriers. Finalement, les nouveaux syndicats ne se maintiendront qu'en devenant autant d'organisations anti-ouvrières que les anciennes ou deviendront simplement des sectes. ( ) C'est en cela que réside la différence fondamentale entre l'attitude des révolutionnaires face aux syndicats réformistes d'hier qu'ils pouvaient chercher à transformer et à faire servir pour la défense des intérêts immédiats des ouvriers et les syndicats dans la période présente du capitalisme d'Etat qui ne sont et ne peuvent être que des organismes de l'Etat, et qui, tout comme l'Etat capitaliste, doivent être dénoncés et combattus par les révolutionnaires et brisés par l'action de classe du Prolétariat". ("Internationalisme"N°22, mai 1947)
Cette position n'était pourtant ni une innovation théorique, ni une rupture avec l'esprit de la fraction italienne regroupée autour de "Bilan" ([1] [31]).'Déjà, au sein de "Bilan" s'étaient dégagées certaines orientations remettant en cause à terme l'engagement des révolutionnaires dans les syndicats. Dans un rapport sur la situation internationale, Vercesi, un des principaux animateurs de "Bilan" avait jeté les bases d'une remise en cause du syndicalisme
"L'époque impérialiste du capitalisme se révèle être celle où la zone déterminant le contraste de classe est celle dont les objectifs ne sont plus limités aux luttes partielles, mais seulement à la lutte suprême pour la révolution communiste. ( Les fractions de gauche se relient au processus réel de la lutte de classes à la condition toutefois de ne pas conditionner l'appartenance de leurs membres aux organisations syndicales, à la discipline que ces dernières, encastrées dans 1'appareil de l'Etat capitaliste (souligné par nous), pourraient leur imposer. Les tendances qui agissent au sein des organisations syndicales dans le but de déboucher sur une action de classe des ouvriers, et qui proclament leur discipline aux directions (devenues des représentants de l'Etat capitaliste au sein des masses), proclament par voie détournée leur discipline à l'Etat capitaliste lui-même." ("Bilan" n°41, mai-juin 1937)
C'est contre cette optique que Bordiga et sa tendance vont lutter au sein du Parti Communiste Internationaliste d'Italie (PCI), reconstitué après-guerre sur des bases volontaristes. Dans un premier temps, on assista donc à un retour aux Thèses de l'Internationale Communiste
"Le parti aspire à la reconstruction d'une confédération syndicale unitaire, indépendante des commissions d'Etat et agissant avec les méthodes de la lutte de classe et de l'action directe contre le patronat, depuis les revendications locales et de catégories jusqu'aux revendications générales de classe. (…) Les communistes ne proposent et ne provoquent la scission des syndicats du fait que les organismes de direction seraient conquis ou détenus par d'autres partis"
(Plate-forme politique du P.C.I. 1946)
Pourtant, deux ans plus tard, le congrès du PCI déclarait à propos de la question syndicale
"Le Parti affirme catégoriquement que le syndicat actuel est un organe fondamental de l'Etat capitaliste, ayant pour but d'emprisonner le prolétariat dans le mécanisme productif de la 'collectivité nationale'. Cette caractéristique d'organe étatique est imposée aux organismes syndicaux et de masse par les nécessités internes du totalitarisme capitaliste. (… ) C'est pourquoi, on doit rejeter catégoriquement toute perspective de redressement du syndicat, toute tactique visant à la "conquête" de ses organes centraux ou locaux, toute participation à la direction des commissions internes et organismes syndicaux en général. La classe ouvrière, au cours de son attaque révolutionnaire, DEVRA DETRUIRE LE SYNDICAT comme un des mécanismes les plus sensibles de la domination de classe du capitalisme". ("Battaglia Communista" n'19. 3-10 juin 1948)
Malgré les aspects positifs de cette déclaration, le PCI n'avait pas véritablement tranché la question syndicale et laissait la porte ouverte à l'activité "syndicaliste" du Parti. En fait, le courant bordiguiste était tiraillé par plusieurs tendances qui exprimaient l'immaturité d'une organisation qui se voulait "le Parti", indépendamment du niveau de la lutte de classe, indépendamment de l'état du milieu révolutionnaire international, indépendamment même de l'absence d'une clarification théorique suffisante sur des points aussi cruciaux que les enseignements de la contre révolution en Russie, la nature de la période historique du capitalisme, la question du parti, etc.. Toutes ces contradictions vont aboutir à la scission du PCI en 195Z, la tendance de Bordiga publiant une nouvelle revue "Il Programma Comunista" et la tendance Damen continuant la parution de "Battaglia Comunista". Il faut noter qu'en France, le courant bordiguiste (Fraction française de la gauche communiste) avait déjà souffert deux scissions dont la seconde avait vu une bonne partie du groupe rejoindre "Socialisme ou Barbarie", groupe issu de la Quatrième Internationale trotskiste et qui rejetait l'analyse de l'URSS comme "Etat ouvrier", sans d'ailleurs se rattacher à la tradition de la gauche communiste.
Le groupe de Bordiga va exprimer un véritable recul théorique au sein d'un milieu révolutionnaire considérablement déboussolé. Rejetant tout le travail et les acquis de "Bilan", Bordiga va développer une orientation soi-disant orthodoxe de retour au "marxisme invariant" qui sera en fait une caricature dogmatique de certaines positions de l'Internationale Communiste et un retour aux erreurs de Lénine sur les questions nationale et syndicale.
Si "Battaglia Comunista" va se tenir à une position ambiguë sur le problème de l'activité syndicale des révolutionnaires, "Programma Comunista" va devenir un modèle d'inconstance et d'hésitation dans les années qui vont suivre ([2] [32]).
AUJOURD’HUI, LE PCI - PROGRAMME COMMUNISTE
Au moment où des groupes issus du trotskisme comme "Socialisme ou Barbarie" ou le groupe de Munis (aujourd'hui "Alarme" tentaient d'élaborer une critique du syndicalisme, le P.C.1. (Programme Communiste) allait se retrouver en deçà même de certaines positions de Trotski et de celles de "Bilan". Ainsi, dans les années 60, on pouvait lire dans les premiers numéros du "Prolétaire"(journal en France du PCI) des analyses qui ne sont pas à la gloire du mouvement révolutionnaire et qui relevaient de la myopie la plus avancée. Dans un article intitulé "Les révolutionnaires doivent-ils militer dans les syndicats révolutionnaires ?", on pouvait lire :
"Mais la contre-révolution ne peut détruire le programme communiste, l'âme même, la conscience impersonnelle de la classe où sont consignés le but qu'elle doit atteindre et les moyens qu'elle doit employer pour y parvenir. Le travail qui incombe aux quelques éléments qui sont restés sur le terrain de la défense de ce programme, est d'expliquer celui-ci. Ils doivent le faire dans les organisations réactionnaires que sont devenus les syndicats, parce que ceux-ci, bien que momentanément dirigés par des équipes de bonzes qui font adopter des positions allant à l'encontre des intérêts les plus immédiats des ouvriers, sont des organes de la classe prolétarienne : "car toute la tâche des communistes est de savoir convaincre les retardataires, de savoir travailler parmi eux et non de se séparer d'eux par des mots d'ordre "de gauche"d'une puérile invention' (Lénine)".
("Le Prolétaire" n°6)
Cette perspective était d'autant plus erronée que le PCI traçait une frontière de classe entre la C.G.T. stalinienne et les autres syndicats considérés comme "jaunes" :
"La C.G.T. est en France la seule organisation syndicale rattachée à une tradition authentiquement prolétarienne (!) (... ) C'est donc au sein de la C.G.T. que le parti de classe de demain doit s'efforcer de faire entendre sa voix... "
("Programme Communiste" n°31 - 1965)
Dans cette vision, le PCI allait jusqu'à dénoncer les tractations unitaires de la C.G.T. à l'égard de F.O. et de la C.F.T.C. comme si cela était contre-nature. Dans sa lancée, il posa même la possibilité de quitter le syndicat :
"Lorsque statutairement, il ne sera plus possible de préconiser la lutte de classe et sa ligne politique dans les syndicats, ces organismes n'auront plus rien de prolétarien et agir en leur sein n'aura plus de sens pour des révolutionnaires". Peut-être faudra-t-il en passer par-là".
("Le Prolétaire" n°6)
Non seulement le PCI distinguait encore des syndicats "prolétariens" à côté des syndicats "jaunes", mais encore il ne fixait rien de moins que le but de les conquérir, remettant en cause ses propres positions de 1'après-guerre ! Jusqu'en 72, le PCI va développer une orientation de "syndicalisme de classe" au sein de la C.G.T., critiquant l'entrisme dans les autres syndicats, comme l'expliquait un article intitulé "Pas dans les syndicats jaunes ! "
"Là où les militants du parti de classe pourraient parler, il n'y a rien à faire pour la défense des intérêts du prolétariat, là où il y aurait une seule chance d'agir, on se garde bien de les laisser parler. La lutte de classe, dans la phase totalitaire et impérialiste passe A L'INTERIEUR du syndicat. On DOIT lutter contre l'opportunisme dans la C.G.T.. on NE PEUT PAS le faire dans les syndicats jaunes 1".
("Le Prolétaire" n°75 - février-mars 1970)
S'apercevant, un peu tard, qu'on ne pouvait attribuer à la C.G.T. une nature de classe différente des autres syndicats, que sa fonction était similaire, c’est à dire tout à fait contre révolutionnaire, le PCI décida en 1972 de rejeter "les directives de défense du syndicat de classe, puis de reconstitution du syndicat de classe comme une répétition vide des années 20... " ("Le Prolétaire" N°128 - mai-juin 1972) tout cela, pour justifier l'entrisme... dans les syndicats 1
Pour ce faire, le PCI n’hésita pas à aller chercher des arguments chez Trotski qui défendait en 1940 l'intervention des révolutionnaires dans tous les syndicats, y compris les syndicats fascistes.
Le plus étonnant dans ce revirement n'était pas la décision somme toute "logique" d'intervenir dans les syndicats et dans tous les syndicats, mais l’absolue insouciance théorique et historique des bordiguistes, qui, tout en rejetant la théorie de la décadence impérialiste ne voyaient aucun lien entre cette question et celle du syndicalisme. Au moins, Trotski d'avant-guerre, dans la lignée de l'Internationale Communiste comprenait que la décadence du capital modifiait les données du problème syndical. Malheureusement, il en tira des conclusions "tactiques" désastreuses qui firent ultérieurement du trotskisme un appendice de la contre-révolution, notamment à travers son activité syndicale !
Le PCI, incapable de tirer les leçons d'une telle expérience, au moment où la classe reprenait le chemin de sa lutte historique, était tout juste capable de rebalbutier les erreurs faites trente années auparavant ! En fait, en 1972, le PCI venait confirmer son incompréhension totale de la période historique et s'investissait encore plus dans le travail syndical au moment où les prolétaires commençaient à rompre avec les syndicats, les déborder et même à les affronter !
Mis à part le PCI et les différentes ruptures "orthodoxes" qu'il a subies ces dernières années ("Il Partito Comunista"notamment) dont la sclérose avancée ne semble plus pouvoir être enrayée, i1 faut prendre en considération l'évolution de tout un courant qui a subi la double influence des thèses conseillistes et des positions de "Socialisme ou Barbarie" (I.C.O.,Pouvoir Ouvrier, GLAT en France, Solidarity en Grande-Bretagne, Collegamenti en Italie, divers groupes conseillistes américains, etc.) et qui a développé sur la question syndicale des positions incomplètes et surtout ambiguës. Faute d'une analyse sérieuse de la décadence capitaliste, ce courant n'a pas su créer les caractéristiques de la lutte du prolétariat dans la phase historique actuelle et s'est fourvoyé dans une série d'impasses qui a provoqué la disparition de la plupart des groupes qui le composaient.
"SOCIALISME OU BARBARIE"
Pour comprendre ces
positions et leurs dangers, i1 est nécessaire de revenir sur la trajectoire du
groupe "Socialisme ou Barbarie" qui a dans un sens cumulé les
erreurs à ne pas faire sur le problème syndical, erreurs qui restent
d'actualité notamment pour les nouveaux groupes prolétariens confus qui
surgissent aujourd'hui. Après avoir
rompu avec le trotskisme, "Socialisme ou Barbarie" va
s'engager dans la voie de l'innovation et du rejet de la tradition des Gauches
Communistes, notamment de la Gauche Italienne.
Cette orientation se concrétisa par
la thèse que le bloc russe représentait le pouvoir d'une nouvelle classe
exploiteuse : la bureaucratie opposée aussi bien à la bourgeoisie capitaliste
classique qu'à la classe ouvrière. "Socialisme
ou Barbarie" ne sut pourtant pas se prononcer clairement sur le
caractère progressiste ou non d’une telle classe non "prévue" par le
marxisme, et, de là, il s'ensuivit chez ce groupe une incapacité à déterminer
des positions solides à l'égard des partis staliniens (représentants d'une
nouvelle classe ?), des forces nationalistes du "tiers-monde", des
contradictions inter-impérialistes, et aussi des syndicats. Dans un article de 1958, "Socialisme
ou Barbarie" exprimait sa vision des rapports entre les syndicats et
la classe ouvrière :
"Les Syndicats ne sont plus que des "intermédiaires" entre les travailleurs et le patronat, dont le rôle est de calmer les travailleurs, de les maintenir attachés à la Production, d'éviter qu’il y ait des luttes en obtenant de temps en temps, et lorsque cela ne gêne pas trop le patronat, quelques concessions (...). Si les syndicats peuvent agir ainsi, c'est que, depuis longtemps, ils ne sont plus dirigés par la masse de leurs adhérents. La bureaucratie qui les dirige, formée de permanents privilégiés, échappe entièrement au contrôle de la base. Il y a certainement beaucoup de professions, de localités ou d'entreprises où les sections syndicales ou bien les syndicats locaux restent liés à leurs adhérents et essaient d'exprimer leurs aspirations. Et certainement la grande majorité des militants syndicaux de base sont des militants ouvriers sincères et honnêtes. Mais, ni ces militants, ni les sections qu'ils animent, ne peuvent influer sur l'attitude des Fédérations ou des Confédérations. Plus on s'approche des sommets de l'organisation syndicale, plus on constate que celle-ci mène sa propre vie, suit sa propre politique, indépendamment de sa base" ("Socialisme ou Barbarie", n°23, janvier-février 1958).
C'est de cette base syndicale que "Socialisme ou Barbarie" qui continuait à défendre le travail à l'intérieur des syndicats attendait en fait un renouveau, c'est-à-dire l'émergence d'un nouveau syndicalisme réellement contrôlé par les travailleurs. Et si "Socialisme ou Barbarie" prônait la nécessité de l'auto-organisation des ouvriers dans la lutte, c'était avec le secret espoir d'y voir les bases de nouvelles organisations permanentes de la classe
"Il faut que les organes de lutte créés par les travailleurs, et en particulier les comités de grève démocratiquement élus, ne se dissolvent pas une fois les revendications satisfaites. Il faut que ces organes se maintiennent, qu’ils organisent leurs contacts permanents d'entreprise à entreprise et de localité à localité, qu'ils proclament publiquement leur intention de contrôler l'évolution de la situation en général et du Pouvoir d'achat en particulier, et d'appeler à nouveau les travailleurs à la lutte à la moindre tentative, d'où qu'elle vienne d’attenter à leur niveau de vie" (idem).
Puis ces illusions vont peu à peu disparaître pour laisser la place à une Vision plus "moderniste" mais toujours aussi ambiguë et confuse :
"Les organisations traditionnelles s'appuyaient sur l'idée que les revendications économiques forment le problème central pour les travailleurs, et que le capitalisme est incapable de les satisfaire. Cette idée doit être catégoriquement répudiée car elle ne correspond en rien aux réalités actuelles. L'organisation révolutionnaire et l'activité des militants révolutionnaires dans les syndicats ne peuvent pas se fonder sur une surenchère autour des revendications économiques tant bien que mal défendues par les syndicats et réalisables par le système capitaliste sans difficulté majeure (souligné par nous). C'est dans la possibilité des augmentations de salaire que se trouve la base du réformisme permanent des syndicats et une des conditions bureaucratique irréversible. Le capitalisme ne peut vivre qu'en accordant des augmentations de salaire, et pour cela, des syndicats bureaucratisés et réformistes lui sont indispensables. Cela ne signifie pas que les militants révolutionnaires doivent nécessairement quitter les syndicats ou se désintéresser des revendications économiques, mais que ni l'un, ni l'autre ce ces points n'ont l'importance centrale qu'on leur accordait autrefois". ("Socialisme ou Barbarie", n°35, janvier-mars 64).
Deux erreurs de fond caractérisaient ces thèses, erreurs qui allaient amener la disparition de ce groupe et son tronçonnement en plusieurs appendices. La première résidait dans l'incapacité à reconnaître la décadence du mode de production capitaliste et la nature catastrophique des crises économiques dans cette phase. Pour "Socialisme ou barbarie" qui avait vu l'émergence d'une nouvelle classe historique et qui n'avait connu comme groupe que la phase de reconstruction de l'après guerre, il y avait certes une nouvelle époque de restructuration, de revitalisation de la société divisée en classes et non pas une période de déclin posant la question de la nécessité historique de la révolution communiste. La vision profondément pessimiste de "Socialisme ou Barbarie" de la période était en même temps liée à une incapacité à rompre avec une des principales forces de la contre-révolution : le syndicalisme. En accordant aux syndicats un rôle encore "réformiste", "Socialisme ou Barbarie" justifiait en quelque sorte leur existence auprès des travailleurs, perpétuait l'illusion des réformes toujours possibles et posait la révolution comme un besoin moral détaché des contingences immédiates. Cette position était une rupture franche avec le marxisme et ouvrait la voie au modernisme, c'est-à-dire au rejet du prolétariat comme SEULE force révolutionnaire. Dans la mesure où le capitalisme était censé améliorer la condition immédiate du prolétariat de façon permanente, il n'y avait plus de raisons pour que celui-ci devienne son fossoyeur. C'est donc en toute logique que le principal animateur de ce groupe, Chaulieu-Cardan-Castoriadis, rejeta le marxisme au moment même où le prolétariat mondial recommençait à lutter contre les premiers effets de la crise.
Cependant, tout un courant issu de "Socialisme ou Barbarie" perpétua le côté "ouvriériste" et volontariste du groupe. Ce fut le cas de "Pouvoir ouvrier" qui justifiait sa présence dans les syndicats en les présentant comme des organes défendant les "intérêts immédiats" des travailleurs tout en voulant conserver le capitalisme, comme des organes ayant une "double nature", ouvrière en temps de calme social, "contre-révolutionnaire" en période de lutte de classe. Non seulement "Pouvoir Ouvrier" rééditait la vieille erreur consistant à opposer intérêt immédiat de la classe et lutte…, pour la révolution mais en plus prétendait comme les gauchistes en tant que groupe révolutionnaire assurer des tâches à ces deux niveaux antagoniques ! Au moins le modernisme était logique en dénonçant les luttes revendicatives comme des moments de soumission au capital, "Pouvoir Ouvrier ", au contraire, se complaisait dans une position semi-trotskisante, se bornant à regretter l'étroitesse de vue des directions syndicales quand même utiles au prolétariat.
On peut dire que cette
confusion entre luttes revendicatives de la classe et action des syndicats est
un des points cruciaux de l'incompréhension de ce que doit être l'attitude des
groupes révolutionnaires face aux syndicats.
Si les révolutionnaires combattent les syndicats, c'est justement parce
que ceux-ci ont comme rôle de faire avorter les luttes revendicatives, de détruire
leur potentialité POLITIQUE et REVOLUTIONNAIRE.
Ce sont les syndicats et les gauchistes qui tentent justement d'opposer
le caractère revendicatif des luttes ouvrières à leur contenu objectivement
POLITIQUE dans la décadence. Ce contenu
révolutionnaire est d'autant plus latent qu'il n'y a plus de place pour une
POLITIQUE REFORMISTE EFFECTIVE comme au XIXème siècle. C'est pourquoi la lutte contre les syndicats
est un point crucial pour la classe à tout moment de sa lutte.
Aujourd'hui, le développement général des luttes revendicatives de la classe
ouvrière mondiale est le creuset dans lequel se forge l'activité consciente du
prolétariat à travers la rupture avec l'encadrement contre-révolutionnaire des
syndicats. Cette activité consciente ne
peut que s'opposer à la FORME
et au CONTENU des syndicats ce point essentiel qui est à la base du rejet
de" l'activité des révolutionnaires au sein des syndicats a donné lieu à
des caricatures ou des incompréhensions dues d'abord à un bilan insuffisant de
la vague révolutionnaire des années 20.
AUJOURD'HUI : LE FOR, LE GCI, LE PIC
C'est sur ce dernier plan qu'il faut développé la critique de groupes comme le FOR, le Groupe Communiste Internationaliste (GCI) et aussi le PIC (Jeune Taupe) ([3] [33]). Tous ces groupes font la critique des syndicats et rejettent tout travail en leur sein. Mais, en même temps, ces groupes ne parviennent pas à saisir ce qu'a représenté le surgissement des Conseils Ouvriers en tant que forme d'organisation unitaire de la classe.
Ce qu'a représenté le Conseil Ouvrier, le soviet, comme nouvelle forme d'organisation du prolétariat, c'était une rupture de fond avec l'organisation syndicale. Le Conseil était d'abord un organe POLITIQUE de masse dont la pratique ne pouvait qu'être antagonique aux syndicats, la nature "anti-bureaucratique" du Conseil Ouvrier n'est pas une question formelle mais une question de vie du Conseil lui-même. Ce caractère déterminant des Conseils Ouvriers fut ainsi décrit par Trotski dans son ouvrage sur 1905
"Le Conseil des députés ouvriers fut formé pour répondre à un besoin objectif, suscité par les conjonctures d'alors : il fallait avoir une organisation jouissant d'une autorité indiscutable, libre de toute tradition, qui grouperait du premier coup les multitudes disséminées et dépourvues de liaison ; cette organisation devait être un confluent pour tous les courants révolutionnaires à l'intérieur du prolétariat ; elle devait être capable d'initiative et se contr6ler elle-même d'une manière automatique ; l'essentiel, enfin, c'était de pouvoir la faire sortir de terre dans les 24 heures. L'organisation sociale-démocrate qui unissait étroitement, dans ses retraites clandestines, quelques centaines, et, par la circulation des idées, plusieurs milliers d'ouvriers à Petersbourg, était en mesure de donner aux masses un mot d'ordre qui éclaircirait leur expérience naturelle à la lumière fulgurante de la pensée politique, mais le parti n'aurait point été capable d'unifier par un lien vivant, dans une seule ORGANISATION, les milliers et les milliers d'hommes dont se composait la multitude... Le soviet organisait les masses ouvrières, dirigeait les grèves et les manifestations, armait les ouvriers, protégeait la population contre les pogroms. Mais d'autres organisations révolutionnaires remplirent la même tâche avant lui, à côté de lui et après lui ; elles n'eurent pourtant pas l'influence dont le soviet jouissait. Le secret de cette influence est en ceci : cette assemblée sortit ORGANIQUEMENT du prolétariat au cours de la lutte directe, prédéterminée par les événements, que mena le monde ouvrier POUR LA CONQUETE DU POUVOIR... Le soviet réalisait le pouvoir dans la mesure où la puissance révolutionnaire des quartiers ouvriers le lui garantissait... Le soviet devient immédiatement l'organisation même du prolétariat ; son but est de lutter POUR LA CONQUETE DU POUVOIR REVOLUTIONNAIRE".
(Trotski, extraits de 1905).
Ce que Trotski indiquait, c'est que le Conseil Ouvrier était en fait la FORME la plus apte à exprimer l'activité révolutionnaire du prolétariat et il ne s'agissait pas pour lui de nier le rôle des organisations révolutionnaires, du Parti, mais de montrer- la SUPERIORITE fondamentale des Conseils Ouvriers comme centre vital de l'action consciente de la classe. C'est la permanence de l'activité révolutionnaire des masses ouvrières qui permet au Conseil d'exister. Bien au contraire, ce qui caractérisa au départ les syndicats, c'était leur tendance au conservatisme de par leur fonction et leurs liens avec la classe ouvrière. C'est ce point qu'un groupe comme le GCI ne comprend absolument pas
"Pour plusieurs raisons, le problème fondamental d'une alternative ouvrière face aux syndicats n'est pas une question de forme d'organisation. En premier lieu, le remplacement de la forme syndicale par une forme différente (le conseil, par exemple), n'implique pas obligatoirement la rupture avec le réformisme et peut même représenter l'une ou l'autre de ses formes extrêmes"
("Le Communiste", n° 4, page 29).
L'indifférence à la question des formes d'organisation du prolétariat est en fait une indifférence à son expérience historique qui est à la base de la compréhension de l'importance de cette question. Il ne s'agit pas de faire ici une idéalisation des Conseils Ouvriers qui peuvent dégénérer rapidement dans certaines conditions, qui peuvent être détruits de l'intérieur par des forces bourgeoises. Il s’agit de RECONNAITRE le processus qui exprime l'activité révolutionnaire de la classe dans la phase de décadence. Un groupe incapable d'assurer cette analyse ne peut qu'osciller entre l'attentisme et le volontarisme. C'est le cas du FOR qui, ne sachant pas comment la classe lutte et s'organise, porte sur le passé et le présent les jugements les plus contradictoires; ainsi, pour ce groupe, il y avait une révolution prolétarienne en 36 en Espagne
"En Espagne 36 par contre, il n'existait pas un seul conseil avant que le prolétariat ne mit en pièces l'armée nationale et, avec elle, toutes les structures capitalistes".
(Texte présenté par le FOR à la 2ème Conférence Internationale - compte-.rendu page 36).
L'indifférence par rapport à la question de l'organisation du prolétariat amène ainsi à des erreurs tragiques qui consistent à voir la révolution alors qu'il n'y a que la mobilisation contre-révolutionnaire du prolétariat derrière des intérêts qui lui sont étrangers. En Espagne, non seulement il n'y avait plus de groupes communistes internationalistes conséquents, mais il n'y avait même pas la base même d'une action organisée et consciente de la classe qui fut entraînée au massacre. Aujourd'hui, le FOR, malgré la multiplicité des signes qui révèlent une reprise de la vie de la classe ouvrière, prononce une sentence tout aussi arbitraire et irresponsable :
"Aujourd'hui, la majorité des grèves sont des grèves misérables qui, loin de démontrer la combativité révolutionnaire du prolétariat, marquent en fait sa profonde soumission... Les grèves d'aujourd'hui pour la grande majorité des cas sont en fait des NON-GREVES qui, loin de faire trembler le système dans son ensemble, le renforcent".
("Alarme" n° 3, janvier 1979).
En
voulant opposer aux luttes et aux grèves encore encadrées par les syndicats un
contenu réellement "subversif", ces groupes se contentent d'émettre
des vœux pieux, des souhaits qui, aussi justes soient-.ils, n'aident en rien
l'action de la classe ouvrière. Nous
sommes dans une période où les positions des révolutionnaires sur le contenu et
la forme des luttes peuvent commencer à avoir une influence sur le cours des
choses. La critique, la dénonciation des
syndicats doit porter sur tous les aspects de leurs interventions dans la
classe; à ce moment-là, la question de savoir "comment lutter ?" est
un point décisif pour la classe ouvrière.
Des révolutionnaires attachés à la seule critique des mots d'ordre
revendicatifs de la classe seraient tout aussi inutiles à la classe ouvrière
que des révolutionnaires obnubilés par la question du mode d'organisation de la
lutte. En ce sens, la rupture avec les
syndicats et le syndicalisme n'est pas une simple position abstraite ou
"de principe", elle prend aujourd'hui tout son sens PRATIQUE. Si, dans la période de contre-révolution, la
question syndicale, en l'absence de toute vie de la classe, avait pu avoir un
caractère non directement essentiel, aujourd'hui, la compréhension HISTORIQUE
de cette question est directement liée à
la compréhension de ce qu’est 1’auto-organisation du prolétariat. La bataille au sein des luttes pour des
Assemblées générales souveraines, pour des comités de grève élus et révocables
est un ASPECT ESSENTIEL de l'intervention des révolutionnaires. Et cela n'a rien à voir avec du fétichisme
démocratique : la vie et l'activité consciente de la classe ouvrière est une
condition nécessaire pour que celle-ci assume ses tâches révolutionnaires. Contrairement à ce que pense le FOR, sans
organes unitaires de masse, le prolétariat ne peut pas affronter l'Etat
capitaliste. Les petites organisations
révolutionnaires, quand bien même elles gagneraient une influence, seraient
bien incapables d'assurer ce rôle irremplaçable d'unificateur de la classe
ouvrière. Cette bataille pour
l'auto-organisation de la classe dans ses luttes est inséparable de la
dénonciation des syndicats et de leurs tactiques multiples partout où les
ouvriers se posent la question de "comment lutter ?".
Les révolutionnaires doivent montrer en quoi ce mode d'organisation de lutte préfigure la lutte révolutionnaire du prolétariat, c'est-à-dire exige la rupture avec les forces contre-révolutionnaires de gauche et des syndicats. Les assemblées générales doivent être la concrétisation de la rupture de la classe avec les syndicats, les comités de grève élus et révocables doivent être les embryons des Conseils d'usine et des Soviets. Les groupes révolutionnaires qui sous-estimeraient l'importance cruciale pour la classe de se doter de tels organes s'avéreraient être des facteurs d'affaiblissement et de dispersion de l'activité de la classe ouvrière. Ce que le FOR et le GCI perpétuent, c'est un manque de confiance dans la force autonome du prolétariat qui les amène à développer une analyse parcellaire de son mouvement, à mythifier certains aspects secondaires des luttes, à sous-estimer d'autres aspects décisifs.
Le PIC, quant à lui, reproduit aujourd'hui les vieux préjugés conseillistes "anti-parti", ce qui l’a amené à plusieurs reprises à des contorsions politiques tout à fait stériles sur la question de l'intervention des révolutionnaires l'amenant à faire une séparation entre les "groupes ouvriers" et les organisations communistes (voir RI n° 43) et à développer un type de propagande abstrait axé sur la défense des buts finaux du prolétariat (abolition du salariat, des rapports marchands, à bas le droit au travail, etc.), comme si de tels mots d'ordre diffusés au sein des luttes pouvaient accélérer l'auto-organisation de la classe. Là encore, il s'agit d'une démarche consistant à insister sur ce qui sépare, au niveau de la conscience, les révolutionnaires des autres prolétaires au lieu de mettre l'accent sur les nécessités des luttes telles qu'elles sont, de dire clairement ce que les prolétaires pensent confusément. S'il est essentiel de défendre les buts historiques de la classe, de les mettre en avant à chaque étape des luttes, cela est insuffisant et procède d'ailleurs d'une démarche partitiste typique qui consiste à agir dans le seul but de gagner la classe aux "idées" communistes. Le rôle des communistes dans la période est aussi de participer à toutes les étapes pendant lesquelles la classe reprend confiance en sa force et en sa capacité d'organisation autonome.
Aujourd’hui dans une certaine mesure, la question syndicale comme telle commence à être dépassée. De plus en plus nettement, la lutte réelle va saper les dernières illusions syndicalistes auxquelles certains groupes restent attachés. Pour ces groupes il va falloir choisir et même choisir rapidement s'ils ne veulent pas se retrouver au service de la contre-révolution, se traînant derrière le tacticisme anti-prolétarien des trotskistes. Sur ce plan, il ne suffit pas de nuancer ses positions comme le fait actuellement le courant bordiguiste, il faut répondre clairement à la question de savoir si l'existence d'associations économiques prolétariennes est encore possible dans la décadence, si le ressurgissement de telles associations est un préalable à la révolution. Mais pour toutes les autres organisations prolétariennes qui ont su dépasser cette fausse problématique se pose maintenant la question du mouvement autonome de la classe, la question de l'intervention des révolutionnaires dans ce mouvement, en fait, la question du Parti et de son rôle et aussi la question de sa formation. Ce débat va devenir une question de plus en plus pratique et dans un sens, la résolution de ce qu'a été le problème syndical nous donne une partie des éléments de la résolution de ces "nouveaux" problèmes qui n'ont pas pu être tranchés lors de la dernière vague révolutionnaire.
Août 1980 - Chénier
[1] [34] Fort peu de textes de "BILAN" traitent directement de la question syndicale, mais même s'il y avait une sorte de position officielle qui restait attachée à l'optique léniniste, la reconnaissance de la décadence du capitalisme amena une tendance au sein de "BILAN" à réévaluer ce point des syndicats comme l'exprime notamment l'extrait du rapport de Vercesi cité plus loin dans cet article.
[2] [35] Aujourd'hui, Battaglia Comunista reste toujours aussi confuse sur le point de l'activité syndicale des militants révolutionnaires. D'un côté, ce groupe prône la formation de groupes d'usines "intemationalistes", sorte de courroie de transmission du Parti dans les entreprises, d'un autre côté, Battaglia Comunista défendait clairement lors de la Première Conférence Internationale la nécessité de la présence de ses militants dans les syndicats et parlait même d'une plate-forme syndicale du Parti (page 53 du compte-rendu), tout cela au nom de la tactique.
[3] [36] En ce qui concerne la CWO, nous n'avons pas de divergences de fond et de principe sur la question syndicale avec ce groupe. Cependant, à la lecture des critiques incessantes que la CWO porte au CCI sur la question de l'intervention dans les luttes immédiates, on peut relever que ce groupe, bien que virant au partitisme de secte, continue à défendre des préjugés conseillistes typiques faisant une distinction entre luttes partielles du prolétariat et luttes généralisées. Ainsi, ce groupe se refuse à intervenir dans les organes de lutte des ouvriers si la lutte n'a pas atteint un certain niveau d'extension et d'auto-organisation. Par ailleurs, la CWO s'est mise à découvrir le caractère "positif" de certaines revendications économiques immédiates par rapport à d'autres qui seraient négatives. Cette constatation empirique que chaque prolétaire peut faire par lui-même sans le secours au marxisme et qui consiste à comprendre par exemple que les augmentations en pourcentage sont moins "unificatrices" que les augmentations uniformes fait maintenant partie de 1 'arsenal programmatique de la CWO qui, dans ce cas-là, ne fait que reprendre les préjugés des bordiguistes. Malheureusement, ce n'est pas en reprenant les erreurs des différents courants politiques qu’on arrive à développer une orientation cohérente, et, sur ce plan, la CWO a encore beaucoup à apprendre.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Heritage de la Gauche Communiste:
Réponse au COMMUNISME DE CONSEIL (Danemark)
- 2738 lectures
Les "21 Thèses du Communisme de Conseil aujourd'hui" écrites par un groupe de communistes de Conseil du Danemark expriment le fait que la résurgence des groupes et des idées révolutionnaires entamée en 1968 continue. Ce n'est pas un hasard si ces Thèses sont parues au printemps 80, à la suite d'un haut niveau de lutte de classe en France, en Grande Bretagne, en Hollande, etc, et seulement quelques semaines avant la grève générale en Suède. Nous ne pouvons ignorer en outre l'exemple magnifique donné récemment par la grève de masse en Pologne, qui confirme que nous sommes dans une période de montée de luttes de classe ouvrant la voie à une série d'insurrections prolétariennes. Les contributions des camarades danois ne sont vues que dans cette optique -comme un autre signe des temps que nous vivons. Espérons que leurs contributions stimuleront d'autres discussions et aideront à clarifier les positions dont les révolutionnaires ont besoin pour leur intervention dans cette période décisive de l'histoire.
Nous ne croyons pas que la discussion entre révolutionnaires serve à marquer des points contre les autres groupes ou à comparer différentes informations locales de façon académique. Nous croyons que les groupes révolutionnaires ont la responsabilité de discuter dans le but de clarifier leurs idées. Ils le font parce qu'il est crucial d'avoir des idées claires quand on intervient dans la lutte de classe. En fin de compte, c'est dans le feu de la lutte de classe, dans la pratique, que la validité des positions révolutionnaires est testée. Les discussions entre groupes révolutionnaires sont donc une partie vitale de leur activité. Avec ceci en tête, nous pensons que la façon la plus efficace pour les révolutionnaires d'intervenir dans la lutte de classe internationale, c'est de regrouper leurs forces sur des bases claires, et à une échelle internationale. C'est un processus qui ne peut s'établir que grâce à une clarification politique systématique et fraternelle, qui permette la confrontation ouverte des idées. C'est dans cet esprit, avec ce but ultime, que nous contribuons à la discussion entre révolutionnaires avec ces remarques critiques, en réponse aux "Thèses du communisme de conseil"
I."LE CAPITALISME, LA CRISE, LA REVOLUTION, LE COMMUNISME"
Cette partie des Thèses défend beaucoup de positions de classe qui font partie intégrante du mouvement communiste. Les camarades affirment, avec Marx, que la seule solution progressive à la crise capitaliste, c'est la révolution prolétarienne. Ils défendent donc la dictature du prolétariat, sans l'identifier avec la domination d'un parti, comme le font les substitutionistes d'aujourd'hui. Au lieu de cela, la dictature du prolétariat est identifiée avec la domination des conseils ouvriers :
"Le résultat de la révolution c'est la prise de possession autonome du pouvoir et de la production pour les besoins humains. Le conseil ouvrier est donc l'élément fondamental de la lutte anti-capitaliste, de la dictature de la classe ouvrière re et de la société communiste future." (Thèse n°4).
Cependant, il est aussi affirmé que :
" ... le capitalisme sera et devra être détruit dans le procès de production, c'est à dire dans la lutte autonome des ouvriers pour le contrôle de telle ou telle usine. Les ouvriers sont directement et pratiquement les maîtres des machines." (Thèse n°2).
Cette conception nous semble fallacieuse parce qu'elle place tout le centre de la lutte de classe au niveau de la production ou dans le procès de production, comme le fait la tradition anarcho-syndicaliste. Mais l'histoire a prouvé que cette perspective est fausse. De plus, il n'est pas vrai que les ouvriers sont directement et pratiquement les maîtres des machines. Il est clair que le capitalisme possède et maîtrise les machines, et le capitalisme, ce n'est pas simplement du capital fixe, c'est avant tout un rapport social basé sur l'exploitation du travail salarié. C'est vrai, les ouvriers ne peuvent s'émanciper sans détruire tout l'appareil hiérarchisé servant à l'exploitation qui règne dans l'industrie. Mais, ce n'est pas seulement le despotisme à l'usine qui assure les conditions d'exploitation de la classe ouvrière. Tout l'appareil politique de l'Etat aide à assurer, indirectement et directement, à l'aide de mystifications ou en utilisant ouvertement la terreur, la subordination totale du prolétariat au capitalisme. L'Etat, comme nous le savons, fait partie de la superstructure du capitalisme. Mais cela ne l'en rend pas moins décisif ou moins important. Au contraire, en tant que gardien de tous les intérêts capitalistes, il joue un rôle bien plus pernicieux pour la classe ouvrière que les patrons ou les contremaîtres de telle ou telle usine particulière.
Les ouvriers devront donc détruire cette domination politique de l'Etat sur la société. Les ouvriers prendront conscience de cette nécessité quand ils commenceront à se voir eux-mêmes comme une force capable de transformer l'ensemble de la société, et pas seulement une somme d'usines particulières, grâce à leur action de masse unitaire. A partir de ce moment là, le mouvement de la lutte de classe prendra des proportions réellement insurrectionnelles. Il est clair que les ouvriers ne peuvent apprendre à agir collectivement à cette échelle, s'ils restent à l'intérieur de "leur" usine particulière. Ils doivent dépasser les séparations artificielles que leur impose le capitalisme, et qui sont symbolisées par les portes des usines. Nous ne sommes donc pas d'accord non plus avec cette conception :
"La base de la révolution c'est le pouvoir économique des conseils, organisé sur la base de chaque usine, mais quand l'action des ouvriers est devenue si puissante que les organes même du gouvernement s'en trouvent paralysés, alors les conseils doivent aussi prendre en charge des fonctions politiques".
Ici, nous voudrions faire remarquer que le "pouvoir économique des conseils", sur la base de chaque usine, est illusoire tant que l'Etat capitaliste domine encore la société et défend l'économie nationale. La condition préalable de toute transformation économique et sociale réelle et durable, c'est l'abolition de l'Etat capitaliste. Les conseils ouvriers, bien loin de devoir attendre de passer par une période de "pouvoir économique" avant d'assumer des fonctions politiques, doivent adopter immédiatement des fonctions politiques s'ils veulent survivre aux manœuvres de l’Etat.
La récente grève de masse en Pologne confirme amplement cette tendance qui n'émerge clairement que dans la décadence du capitalisme (voir notre éditorial : "La dimension internationale des luttes ouvrières en Pologne" dans la Revue Internationale n°24). Là, les mesures prises par les ouvriers pour se défendre économiquement se sont mêlées à des poussées politiques qui tendent vers la confrontation avec l'Etat, qui visent à exposer sa police terroriste secrète, etc. Imaginer que pendant une grève de masse, les ouvriers devraient limiter leurs actions aux occupations d'usines, comme ils l'ont fait, malheureusement, en Italie en 1920, revient à limiter arbitrairement l'ampleur révolutionnaire de leurs activités. La classe ouvrière n'a pas besoin de passer par une sorte d'apprentissage scolaire de "maîtrise de la production" pour pouvoir confronter l'Etat.
L'Etat ne peut pas être isolé ou paralysé si les ouvriers mènent des actions essentiellement défensives et isolées sur le lieu de production. La seule façon de saper 1’Etat, c'est par un processus de double pouvoir, dans lequel les organes de domination de masse du prolétariat imposent sans cesse davantage leur volonté politique à l'Etat. Ceci ne peut pas être un processus permanent, et très certainement, ça ne peut pas être non plus une "période d'apprentissage" permettant d'acquérir des qualifications en une prétendue maîtrise économique. La période de double pouvoir, qui combine dès le début les offensives économiques et politiques, doit tôt ou tard aboutir à une tentative insurrectionnelle par les conseils ouvriers. C'est la seule façon de renverser l'Etat. Ne croyons pas que l'Etat, cette machine de terreur si rusée, acceptera tout simplement sa défaite du fait des occupations d'usines.
D'accord, il y aura un moment où l'offensive des conseils ouvriers sera si puissante que l'Etat devra reculer, et commencera même à se désintégrer. Mais cela n'arrivera que si, dès le début, les organes ouvriers de masse réussissent à combiner les méthodes de lutte économiques et politiques. Le processus de la grève de masse implique non seulement le contrôle des usines (de l'ensemble des usines, et non pas "une par une"), mais aussi l'armement croissant du prolétariat et de la population qui se range du côté des ouvriers (l'analyse de la grève de masse par Rosa Luxemburg dans "Grève de masse, parti et syndicats" nous parait être fort à propos pour la période actuelle. Particulièrement les parties qui traitent des rapports entre les luttes politiques et économiques du prolétariat).
Les conceptions que défendent les Thèses sur les conseils ouvriers nous paraissent similaires à celles d'Antonio Gramsci, le révolutionnaire italien, qui a théorisé son point de vue dans le journal "L'Ordine Nuovo" au début des années 20. Gramsci déclarait que ses idées résultaient des expériences concrètes du prolétariat russe. Mais en cela, il avait tort. Toute la dynamique des soviets ouvriers en Russie de février à octobre 17 a consisté à s'opposer à l'Etat capitaliste de Kerenski. Le mouvement des comités d'usine et pour le "contrôle ouvrier" faisait partie dès le début de cette attaque massive. C'est un cas classique de dualité de pouvoir, comme Trotski le décrit si bien dans son "Histoire de la révolution russe". C'était facile pour la classe ouvrière en mouvement de comprendre que si elle ne jetait pas Kerenski dehors, rien de durable ne pourrait être fait dans les usines. Ce n'est qu'après le renversement de Kerenski en octobre qu'il a été possible de réorganiser les ressources économiques internes du prolétariat russe afin de les mettre à la disposition de la révolution mondiale. Que la révolution d'Octobre se soit trouvée isolée à la fin, et qu'elle ait encore plus dégénéré sous la politique erronée des bolcheviks et du Kominterm n'est pas le sujet de notre discussion aujourd'hui. Ce que nous essayons d'expliquer c'est que Gramsci a déformé l'expérience des soviets ouvriers en Russie. Nous allons développer cette idée.
Gramsci a théorisé pour
l'Italie une révolution fondée sur une prise de contrôle graduelle de la
société par les soviets ouvriers.
D'après les conceptions de Gramsci, les comités d'usine russes et les
soviets ouvriers avaient assumé ce processus de prise de contrôle économique en
Octobre. Mais cela ne s'est pas passé
ainsi : en Russie, les comités d'usines et leurs tentatives en vue du
"contrôle ouvrier" étaient des armes politiques de la classe
ouvrière, non seulement contre les patrons, mais aussi contre le
gouvernement. Ce que les ouvriers ont
appris dans ce processus de dualité de pouvoir était politique, en d'autres
termes, ils ont appris comment gagner l'hégémonie politique sur la société
contre l'Etat capitaliste. Mais d'après
le point de vue de Gramsci, l'ouvrier devrait d'abord se concevoir lui-même
comme un "producteur" dans telle ou telle usine particulière. Ensuite seulement il pourrait gravir quelques
échelons de plus sur l'échelle de la conscience de classe
"Partant de sa totalité originelle, l'usine (sic) vue comme unité, comme acte qui crée un produit particulier, l'ouvrier en arrive à la compréhension d'unités toujours plus vastes, et cela jusqu'au niveau de la nation elle-même".([1] [38])
A partir de cette hauteur sublime, la nation, Gramsci a élevé son ouvrier individuel jusqu'au niveau du monde, puis du communisme :
"A ce point précis, il est conscient de sa classe; il devient communiste, parce que la propriété privée n'est pas nécessaire à la productivité; il devient révolutionnaire parce qu'il voit le capitaliste, le détenteur de la propriété privée, comme un poids mort, comme une gêne dans le processus productif qu'il faut supprimer". ([2] [39])
Du haut de cette "conscience accrue" (que certains pourraient appeler du délire technocratique) Gramsci fait atteindre à son ouvrier le pinacle de l'illumination : la prise de conscience de l'Etat ce "gigantesque appareil de production" qui développera "l'économie communiste" d'une façon "harmonieuse et hiérarchique". ([3] [40])
D'après le schéma de Gramsci, les ouvriers parviennent à la conscience de classe non pas au travers de la lutte de classe, comme Marx l'a décrit, mais en passant par un processus pédagogique graduel d'acquisition d'une "maîtrise économique". Gramsci voyait les ouvriers comme une somme de fourmis isolées qui, à partir de leur vile existence, ne pouvaient atteindre la rédemption qu'en prenant conscience de leur place dans un plan économique grandiose, dans une fourmilière étatique. Mis à part l'aspect entomologique, c'est une vision idéaliste de la lutte de classe, et qui a été un élément dans l'évolution de Gramsci vers l'opportunisme. La révolution prolétarienne n'est pas déterminée par le niveau d'éducation préalable des ouvriers, ni par leur culture ou leur habileté technique. Au contraire, la révolution prolétarienne a lieu précisément pour obtenir et généraliser à toute l'humanité ces progrès culturels et techniques qui existent déjà dans la société. La révolution est produite par la crise du système capitaliste. Vous l'affirmez correctement quand vous dites :
"Les actions capitalistes surgissent de façon spontanée. C'est le capitalisme qui force les ouvriers à les mener. L'action n'est pas proclamée à l'avance avec une intention consciente; elle surgit spontanément et irrésistiblement " (thèse n°3)
C'est pourquoi il est faux d'imaginer que la révolution prolétarienne se développera graduellement, partant de l'unité cellulaire d'une usine particulière pour arriver à la société toute entière, à travers le processus pédagogique envisagé par Gramsci. Historiquement, les grands surgissements révolutionnaires de la classe ouvrière ne se sont pas développés de cette façon schématique. C'est vrai, des incidents particuliers ont servi de détonateurs à des actions de masse dans le passé, et cela arrivera encore. Mais ceci n'a rien à voir avec l'idée que la conscience de classe croit comme un conglomérat de tous ces petits incidents, ou comme le résultat de 1"'expérimentation" du "contrôle ouvrier". En tous les cas, les incidents particuliers qui peuvent servir de détonateurs à une réaction de masse ne sont pas limités à telle ou telle usine et encore moins au lieu de production. Ils peuvent arriver lors d'une manifestation, à un piquet de grève, dans une queue devant une boulangerie, à un bureau de chômage, etc. En ce qui concerne le contrôle ouvrier, Paul Mattick est tout à fait correct quand il dit :
"Le contrôle ouvrier de la production présuppose une révolution sociale. Il ne peut être réalisé graduellement par des actions de la classe ouvrière au sein du système capitaliste".
Les idées de Gramsci avaient fondamentalement une substance réformiste et ouvraient la porte à l'idée que les ouvriers peuvent apprendre à contrôler la production capitaliste de façon permanente au sein même du capitalisme. Cette idée est doublement incorrecte puisque la raison d'être de la révolution ouvrière n'est pas le contrôle de la production capitaliste, et ce n'est pas non plus 1"'autogestion" ou la "maîtrise de la production" au sein du capitalisme. Tout ça, ce sont des mythes capitalistes, même s'ils sont présentés à la façon vénérable et "violente" des anarcho-syndicalistes.
Comme vous en faites la remarque, les conseils ouvriers apparaissent spontanément et massivement dans la société durant une situation pré-révolutionnaire. Ils ne sont pas préparés à l'avance, "techniquement" ou "économiquement". La crise du capitalisme pousse finalement les ouvriers à s'unifier à tous les niveaux. -économique, politique, social - dans les usines, dans les quartiers, dans les docks et les mines, dans tous les lieux de travail. Leur but final ne peut être que la destruction de l'Etat capitaliste. Leur but "immédiat" est donc de se préparer pour le pouvoir politique. Quelles que soient les mesures "de contrôle ouvrier" prises dans les lieux de travail ou dans la société en général, ces mesures sont strictement subordonnées à ce but urgent et immédiat : désorganiser et isoler le pouvoir de l'Etat capitaliste. Sans ce but, les actions autonomes des ouvriers seront désordonnées et fragmentées, car elles n'auraient ni axe, ni but à poursuivre. Le but de "la maîtrise économique" de chaque usine fournirait une myriade de "petits objectifs particuliers", qui tous disperseraient les forces unifiées des ouvriers. Ce but émousserait l'offensive des conseils ouvriers, réduisant leur tâche à celle de faibles "comités d'usine" préoccupés uniquement des affaires de leur "usine particulière". Mais, de la même façon que le socialisme ne peut être préparé ou réalisé dans un seul pays, de même il ne peut l'être dans une seule usine.
La dernière Thèse de cette partie (n°7) explique que le fondement de la société communiste, c'est la production de valeurs d'usage :
"Il est décisif pour l'économie politique du communisme que le principe du travail abstrait ait été aboli : que la loi de la valeur ne domine plus la production de valeur d'usage. L'économie politique du communisme est tout à fait simple : les deux éléments fondamentaux sont le temps de travail concret et les statistiques."
Ceci est correct mais incomplet puisqu'il n'est pas fait mention de la dimension internationale de la révolution prolétarienne. En fait, c'est l'élément décisif dans l'élimination graduelle de la loi de la valeur : la révolution mondiale qui permettra à la classe ouvrière d'avoir un accès illimité à toutes les ressources crées précédemment par le capitalisme. Nous n'appellerions pas le mode de production communiste une "économie politique du communisme" puisque cette formule implique la survivance de la politique et de l'économie qui sont les traits fondamentaux du capitalisme. Nous remarquons aussi que la période de transition du capitalisme au communisme n'est pas mentionnée mais la révolution mondiale n'arrivera pas en un jour. Nous devons donc nous attendre à toute une période historique, plus ou moins longue, durant laquelle l'Etat capitaliste sera renversé partout, et les vestiges du capitalisme éliminés sur toute la planète. Ce n'est qu'alors que la classe ouvrière sera vraiment capable de rejeter les vestiges de la loi de la valeur et de dépasser les mesures temporaires, quelles qu'elles soient, qu'elle a dû prendre contre la pénurie ou les difficultés techniques. Supposer l'existence "d'une économie communiste" dans un seul pays serait donc une erreur fondamentale. C'est l'une des ambiguïtés qui apparaissent dans les "Principes fondamentaux de la production et de la distribution communistes" écrit par le GIK-H (Groupe des communistes internationaux de Hollande) et une question que les révolutionnaires aujourd'hui doivent clarifier.
Avant de discuter de la deuxième partie de vos Thèses, nous voudrions vous signaler que, votre analyse même courte des causes de la crise capitaliste ne mentionne pas un principe fondamental du matérialisme dialectique. A savoir, est-ce que, le mode de production capitaliste est devenu caduque ? Ou, pour employer le concept même de Marx, est-ce qu'il est entre dans son déclin ? C'est une question décisive pour les révolutionnaires et la classe ouvrière. Pour le CCI, le système capitaliste est un système de production décadent depuis la première guerre mondiale. Cette position est au cœur de notre plate-forme politique.
Affirmer que le capitalisme est encore ascendant ou jeune (même si ce n'est "que" dans certaines zones du monde), équivaudrait à dire que la révolution communiste ne serait pas à l'ordre du jour au moins pour cette période historique a venir. Une pratique politique, spécifique et fausse, résulterait de cette affirmation.
D'autre part, nier que le concept marxiste de décadence s'applique aussi au mode de production capitaliste serait une grave erreur méthodologique, conduisant à des pratiques aberrantes.
Vous mentionnez aussi le fait que la surproduction n'est pas la raison de la crise économique. Ceci peut sembler être une critique à l'encontre de Rosa Luxemburg, qui a précisément analysé ce problème dans "L'accumulation du capital ". Cependant l'analyse de Luxemburg est avant tout une analyse du déclin historique du système capitalistes et de son époque impérialiste. C'est clairement une question pertinente ici que de poser la question du marché et donc de la surproduction, et non quelque chose qu'on peut ignorer en invoquant l'idée de "sous-consommation" (ce qui n'était pas la position de Luxemburg). Même Mattick, qui a critiqué les conceptions de Luxemburg de façon consistante ne peut laisser de côté la question des marchés
"(…) la crise doit d'abord faire son apparition à la surface du marché, même si elle était déjà présente dans les rapports de valeur modifiées dans le procès de production. Et c'est par la vole du marché que la réorganisation nécessaire du capital est accomplie, même si ceci doit être rendu réel par des changements dans les rapports d'exploitation capital-travail au niveau de la production". (5)
Nous n'avons pas à suivre le réductionnisme de Mattick qui transforme la crise de surproduction en une simple manifestation du changement des rapports de valeur au niveau de la production. Mais il est évident que la crise des marchés exprime la limite historique du capitalisme dans son époque impérialiste. Cette limite est violemment confirmée par la guerre impérialiste de 1914. Mattick n'a pas répondu clairement à cette question le capitalisme est-il entré dans sa phase décadente ou non ? Luxemburg a répondu OUI et a fourni l'analyse pour appuyer cette affirmation matérialiste. Ceux qui insistent pour dire que la seule raison de la crise, c'est la baisse du taux de profit, avec sa lutte de la classe correspondante "au niveau de la production", passent généralement sous silence la question de la décadence, et laissent donc de côté l'analyse globale du capital faite par Marx, qui incluait les crises de surproduction. Depuis 1914, cette crise est devenue permanente, au moment où l'expansion capitaliste atteignait une limite structurelle dans un marché mondial divise par l'impérialisme.
Comment et quand le capitalisme atteindrait son apogée, puis son déclin, de même que les modes de production précédents avaient connu un déclin, cela, Marx ne pouvait pas le comprendre complètement. Mais c'est certainement une question légitime pour les révolutionnaires. Elle était au cœur du débat entre Luxemburg et Bernstein à propos du réformisme, et plus tard entre Luxemburg et la gauche de la Social-démocratie allemande (marxiste) contre la droite et le "centre" de Kautsky dans le SPD. Nous disons donc sans hésitation que le problème vraiment fondamental contenu dans la question : "quelle est la raison de la crise capitaliste ? " c'est le problème de la DECADENCE CAPITALISTE.
Nous sommes d'accord sur le fait que le capitalisme décadent souffre de façon interne de la croissance de la composition organique qui rendra impossible (tendanciellement) davantage d'accumulation, et qu'il souffre aussi d'un problème externe (qui affecte aujourd'hui l'ensemble de l'économie mondiale) qui consiste dans le manque de marché profitable.
Comment ces deux crises mortelles réagissent réciproquement et comment elles se complètent l'une l'autre est un problème très complexe. La question n'est pas de nier l'une au profit de l'autre, la question c'est de voir comment elles expriment le pourrissement total du système aujourd'hui.
POUR LES MARXISTES, LA QUESTION DE LA DECADENCE CAPITALISTE EST UNE QUESTION CRUCIALE ET TRES PRATIQUE.
II "LES ORGANISATIONS OUVRIERES CAPITALISTES"
"La base de la social-démocratie, c'est la conscience immédiate des masses".
Mais cette définition ambiguë implique que la social-démocratie est une étape dans la conscience de la classe ouvrière. Rien ne peut être plus loin de la vérité. L'histoire des partis sociaux-démocrates montre qu'à partir de 1914, ils sont passés du côté du capitalisme. La première guerre mondiale a été le test décisif quand ils ont soutenu la boucherie impérialiste. Ce test allait bientôt être confirmé encore davantage par l'attaque de la révolution d'Octobre par ces partis -social-démocratie, menchévisme, "Internationale socialiste"- quel que soit le nom sous lequel se présente cette répugnante faction capitaliste, elle a définitivement traversé la frontière de classe. Dans tous les pays où ils existent, les partis sociaux-démocrates font partie de l'appareil politique de la bourgeoisie. La social-démocratie n'est pas au service de la bourgeoisie, ELLE EST UNE FRACTION DE LA CLASSE CAPITALISTE.
Dire que les ouvriers ont des illusions sur la social-démocratie est une chose. Mais c'en est une autre de dire que ces illusions constituent quelque chose comme un niveau ou une phase de la conscience propre à la nature de la classe ouvrière. La conscience de classe n'est pas une masse d'illusions et de mystifications. C'est la perception juste de sa position de classe dans la société, de son rapport aux moyens de production, à l'Etat, aux autres classes, et, avant tout, la perception de ses buts révolutionnaires. Les illusions, l'idéologie, les mystifications, sont produites par la société capitaliste qui affectent inévitablement le prolétariat en déformant sa conscience de classe. Marx dit que les idées dominantes d'une société sont les idées de sa classe dominante. C'est vrai en général, mais pour le prolétariat, cela veut seulement dire qu'il peut être sous l'influence de ces idées étrangères à lui-même, et non pas qu'il a une "conscience bourgeoise". L’idéologie social-démocrate faisant partie de l'idéologie capitaliste, affecte donc des couches de la classe ouvrière. Vous dites vous-mêmes que :"la social-démocratie est un mouvement contre-révolutionnaire" (thèse n°8). Pour un parti aujourd'hui, être contre-révolutionnaire, signifie être capitaliste. Autrement le mot "contre-révolutionnaire" ne serait rien de plus qu'une insulte, et non pas une définition sociale et politique comme cela l'est pour le marxisme.
La même chose s'applique aux syndicats. Ils ne prennent pas, comme vous le dites, "une part plus ou moins grande de plus-value au capital" (thèse n°9). Au contraire, en tant qu'organes capitalistes, ils aident le capitalisme à extraire le maximum de plus-value possible. Ils le font en termes relatifs, ou absolus, mais quel que soit le cas, ils le font. Dans les moments de crise profonde comme aujourd'hui, ils aident, à "rationaliser" l'économie en soutenant les mesures d'austérité draconiennes du gouvernement contre la classe ouvrière. Ils contribuent directement à l'accroissement du chômage. Ils essaient de dévoyer, de fragmenter et de disperser la combativité des ouvriers. Quand les ouvriers réussissent, ici ou là, à maintenir provisoirement leur niveau de vie précaire, ils ne le doivent qu'à leur propre détermination, à leur propre auto-organisation et non aux syndicats.
Les syndicats sont, comme vous le dites, "opposés aux conseils ouvriers révolutionnaires" (thèse n°9). Mais pourquoi projeter leur rôle réactionnaire seulement pour le futur ou pour le passé ? (Quand, par exemple, les syndicats du SPD se sont opposés à la révolution allemande de 1918-19).
Ils s’opposent AUJOURD'HUI à toute forme de lutte pouvant préparer les conseils ouvriers de demain. Les syndicats ne jouent pas un rôle de médiateur dans la vente de la force de travail. Ils ne sont pas les "intermédiaires" des ouvriers sur le marché du travail. En réalité, ils font baisser constamment la valeur de la force de travail. Ils sont une force de police capitaliste dans le prolétariat. Quand la situation l'exige, les syndicats défendent physiquement l'Etat capitaliste de concert avec les autres forces de répression. Les syndicats sont tout aussi capitalistes et contre-révolutionnaires que la Social-Démocratie. Si les cinquante années de défaites prolétariennes passées nous montrent quelque chose, c'est bien cela.
Le terme "organisations ouvrières capitalistes" est fallacieux, puisqu'il implique que les organes capitalistes ont une double nature, mi-prolétarienne et mi-capitaliste. Cette formulation pourrait faire aussi supposer que pendant les périodes de boum économique, ces organes capitalistes "serviraient" les ouvriers, pour ne s'opposer à eux que dans les périodes de dépression ou de crise. Ceci est faux. En tous les cas, ce terme ne peut pas définir avec précision leur nature de classe, ce qui ouvre donc la porte à toutes sortes d'opportunismes "trade-unionistes".
Lénine et le Kominterm ont inventé 1’idée confuse de "parti ouvrier capitaliste", en référence au parti travailliste britannique et aux partis sociaux-démocrates. C'était pour des motifs opportunistes, comme la tactique du "Front Unique" en 1921 allait le montrer. Le Kominterm appelait à "l'unité d'action" avec ces partis, qui étaient passés clairement dans le camp de la bourgeoisie pour toujours. Une fois qu'une organisation ouvrière a trahi et est devenue capitaliste, elle ne peut redevenir prolétarienne à nouveau. En faisant des offres à ces ennemis de classe, le Komintern hâtait son propre déclin et sa propre dégénérescence. Le fait que les partis sociaux-démocrates et les syndicats avaient des millions d'ouvriers ne change rien au fait fondamental, irréfutable, que politiquement, et donc aussi sociologiquement, ces organisations étaient devenues une partie intégrante du système capitaliste.
Les partis "communistes" font aussi partie de l'appareil politique de la bourgeoisie. Avec le stalinisme, ils sont devenus les instigateurs actifs de la contre-révolution qui a écrasé la révolution d'octobre et corrompu le Komintern dans les années 20 et 30. Ces faux partis communistes ne sont cependant pas des agents de Moscou ou de Pékin, mais les fidèles serviteurs de leurs Etats nationaux respectifs. Les nommer "partis léninistes", c'est un travestissement de l'histoire. Le parti de Lénine, le parti bolchevique, ainsi que le Komintern à ses débuts, étaient des organes de la classe ouvrière en dépit de toutes les déformations qu'ils contenaient. Les identifier avec la contre-révolution la plus brutale que le prolétariat ait jamais subi, est une erreur profonde.
Ceci nous amène à la question de la révolution russe. Vous déclarez que : "c'était une révolution paysanne" (Thèse n°10). Une révolution BOURGEOISE par conséquence ? Mais ceci révèle une incompréhension fondamentale de ce qu'est une révolution prolétarienne et de ce qu'est une révolution bourgeoise. Voyons tout d'abord la question de la nature prolétarienne de la révolution.
Le fait que la révolution d'octobre 17 fut une révolution prolétarienne a été reconnue par l'ensemble du mouvement communiste international de l'époque. Affirmez-vous que tous les révolutionnaires étaient incapables de voir la vraie nature de la révolution d'octobre ? Ceci est une hypothèse tout à fait gratuite, qui fait partie des préjugés mencheviks et sociaux-démocrates. Ce ne sont pas seulement R.Luxemburg et les Spartakistes qui se sont reconnus dans la révolution d'octobre, mais aussi Görter, Pannekoek, les "Etroits" bulgares Pankhurst, etc. ... Et aussi, les ouvriers révolutionnaires de l'époque. En fait, ce qui a arrêté la première guerre mondiale impérialiste, c'est que les gouvernements impérialistes avaient peur d'une "contagion bolchevique" dans leurs armées et dans leurs populations. Les révolutionnaires pensaient que la révolution d'octobre serait la première d'une série de révolutions internationales dans cette époque de décadence capitaliste. C'est pour cela que le Komintern fut fondé en 1919, afin de hâter le processus de la révolution mondiale. Finalement, la vague révolutionnaire a échoué, mais ce n'est pas parce qu'octobre était condamné à n'être qu'une "révolution paysanne".
A propos de l'idée que la révolution d'octobre était une "révolution bourgeoise". Beaucoup de "communistes de gauche" et plus tard, des "communistes de conseil" ont défendu cette idée, alors qu'ils subissaient le poids et l'isolement de la contre-révolution. A l'origine, ceci était une conception menchevik. Mais ce point de vue ne tenait pas compte de la décadence du système mondial, manifestée par la guerre impérialiste. Partout la bourgeoisie était devenue une classe socialement décadente, la période des "révolutions bourgeoises" avait donc touché à sa fin. La révolution communiste était posée objectivement dans le monde entier. La Russie était mûre pour le socialisme, non pas du fait de ses ressources intérieures (qui étaient arriérées) mais parce que toute l'économie mondiale nécessitait de toute urgence une réorganisation communiste et la socialisation des forces productives, qui elles, étaient "plus que mûres" pour le socialisme. Les bolcheviks ont vu cela clairement et ils ont placé tous leurs espoirs dans l'extension de la révolution mondiale. Les mencheviks, qui voyaient tout en terme d'économies nationales isolées, et "d'étapes" furent incapables de saisir la nature de la nouvelle période du capitalisme. Ils furent ainsi amenés à s'opposer à la révolution prolétarienne la considérant comme "prématurée" ou "anarchiste". Les "communistes de gauche" qui ont défendu cette idée de la "révolution bourgeoise" en Russie, ne s'étaient sûrement pas, eux, opposés à la révolution ouvrière. Mais ils défendaient néanmoins un cadre politique incohérent.
Le parti bolchevik que vous représentez faussement comme "un parti d'avant-garde bien discipliné et uni" (Thèse n°10) était un parti prolétarien basé sur les conseils ouvriers et les comités d'usine. Ses idées, son programme révolutionnaire (en dépit de ses imperfections) provenaient de la classe ouvrière internationale. A qui d'autre pouvaient appartenir des slogans comme "A bas la guerre impérialiste", "Transformez la guerre impérialiste en guerre civile", et "Tout le pouvoir aux soviets" ? A la bourgeoisie ? A la paysannerie ? Non, ces slogans exprimaient les besoins du prolétariat mondial à cette époque. L'idée que le parti bolchevik représentait la "bureaucratie"-"la nouvelle classe dominante"- est une idée anti-marxiste. Tout d'abord, parce que c'est complètement faux en ce qui concerne le parti bolchevik, et en deuxième lieu, parce que cette conception, non seulement, défend l'idée d'une nouvelle classe, mais aussi suggère l'existence d'un nouveau, d'un "troisième" mode de production, qui n'est ni capitaliste ni communiste. Le dilemme de l'humanité ne serait plus "Socialisme ou barbarie", puisque la solution prolétarienne semblerait avoir échoué, mais "capitalisme ou barbarie" (sic !). Les premiers à soutenir des variantes de cette théorie furent les pontes sociaux-démocrates Kautsky, Hilferding et Bauer compris, dans les années 20. Elle fut ensuite défendue par de nombreux renégats du marxisme, comme Burnham, Wittfogel, Cardan, etc... Ce type d"'anti-léninisme" est complètement capitaliste.
Encore une fois, ce n'est pas vrai que le but de la révolution prolétarienne est que "... les ouvriers eux-mêmes soient les maîtres de la production" (Thèse n°l0). Ceci est en désaccord avec 1 'objectif que vous défendez dans la première section, c'est à dire la création d'un mode de production fondé sur le besoin, sur les valeurs d'usage. Il est évident que le communisme ne peut être crée par une élite ou par un "parti d'avant-garde" d'aucune sorte. Son avènement exige la plus large participation de l'ensemble de la classe, de l'ensemble de la population, à la construction d'un monde débarrassé des nations, libéré de la guerre, de la famine et du désespoir. Un monde de solidarité humaine, où l'individu ne sera plus en contradiction avec la communauté, et vice-versa. Voilà certainement le but de la révolution ouvrière ! Sur la voie menant vers ce but, les ouvriers, bien sûr, seront les"maîtres de la production", non pas pour conserver leur statut d'ouvrier atomisé, mais pour se transformer en libres producteurs associés. Si le communisme est une société sans classes, alors la classe ouvrière doit disparaître, en tant que catégorie de production spéciale ou même "privilégiée". L'humanité communiste essaiera sans cesse de maîtriser l'ensemble de la société, pas seulement les procès de production et de distribution.
III "LA SITUATION PRESENTE"
Quand vous affirmez que "la reproduction du capital n'a pas encore été jetée dans une crise qui change totalement toute la vie sociale" (Thèse n°1l) pour expliquer que les besoins immédiats de la classe ouvrière, en Europe occidentale ne sont pas révolutionnaires, que voulez vous dire ?
Quels faits vous convaincront que le capitalisme en Europe occidentale (sans parler du reste du monde) connaît la crise la plus profonde depuis les années 30 ? La recherche d'un niveau de profondeur adéquat de la chute du taux de profit n'est sûrement pas ce que vous proposez, car cela, ce serait le fatalisme le plus sûr. Les circonstances objectives pour un bouleversement révolutionnaire sont mûres. En fait, elles le sont depuis 60 ans Ce qui est important, décisif, c'est que le capitalisme sombre dans sa crise économique la plus grave, et c'est cela qui fournira à la classe ouvrière l'occasion de perdre ses illusions sur la possibilité de survivre dans le capitalisme. Les révolutionnaires doivent donc se préparer pour être capable d'intervenir systématiquement dans cette période, pour être capable d'expliquer avec patience les buts du mouvement, de participer à la lutte de classe et d'apprendre d'elle, afin que leur intervention serve réellement de facteur actif dans la prise de conscience communiste.
Les temps sont mûrs, si mûrs que les conditions pour la révolution pourraient "pourrir" si la classe ouvrière échouait à détruire le capitalisme. Le seul résultat de cet échec serait une troisième guerre mondiale impérialiste, et peut-être l'anéantissement de tout futur monde communiste.
Dire que l'Europe occidentale est dans une "situation pré-révolutionnaire" (Thèse n°l1) ne peut vouloir dire qu'une chose : qu'AUJOURD'HUI, la lutte de classe se prépare, qu'elle mûrit les conditions de toute une série d'assauts contre le système capitaliste. Ignorer cette conclusion serait de l'aveuglement. La violence étatique croissante et ouverte en Europe occidentale confirme cette tendance : la bourgeoisie se prépare pour la guerre civile contre la menace de la révolution prolétarienne. Dire que le niveau de conscience de la classe n'est pas encore assez homogène et actif pour tenter un bouleversement révolutionnaire est une chose. Mais il est faux de dire que les besoins de la classe ne sont pas révolutionnaires. Que seraient-ils d'autre alors ? De passer par d'autres niveaux sociaux-démocrates de "conscience immédiate" ? De recevoir d'autres leçons sur les "justifications et les limites" des syndicats aujourd'hui ?
Vous semblez dire que la défense des intérêts économiques immédiats des ouvriers est capitaliste, et que les syndicats assument cette fonction (bien ou mal, selon les conditions économiques). Mais c'est ignorer le fait que la classe ouvrière est à la fois une classe EXPLOITEE et une classe REVOLUTIONNAIRE. Elle DOIT défendre ses conditions d'existence au sein du capitalisme. En fin de compte, à cause de la crise, et à cause de la menace d'une nouvelle guerre impérialiste, elle comprendra qu'elle ne peut se défendre qu'en passant à l'offensive politique. Autrement dit, les natures de classe exploitée et de classe révolutionnaire du prolétariat sont toujours entremêlées, et elles tendent à fusionner consciemment lorsque le système capitaliste se décompose et devient la barbarie totale. Le système n'a jamais été objectivement aussi vulnérable qu'aujourd'hui. Et la classe ouvrière s'en rendra compte, à un certain moment de sa lutte. Comme nous l'avons dit plus haut, le rôle des syndicats est de troubler cette unité de la conscience, de séparer les luttes économiques des luttes politiques, afin de saboter et de détruire LES DEUX. Les syndicats défendent le capitalisme, et non pas une quelconque absurdité "ouvrière capitaliste".
Dans votre thèse n°l7, vous parlez du "mouvement de l'aile gauche". Nous supposons que vous voulez dire les groupes d'extrême gauche. Ces groupes défendent, d'une façon ou d'une autre, les syndicats, la social-démocratie, le stalinisme et le capitalisme d'Etat. Ils participent aux farces électorales, ils soutiennent les luttes inter-impérialistes ou entre factions bourgeoises (au Salvador, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du Sud-Est, etc...) Ils ne sont que des annexes capitalistes de groupes capitalistes plus grands. Ils font partie de la "gauche du capital". Ils ne sont pas opportunistes ou réformistes. L'opportunisme, le réformisme et le révisionnisme étaient des déviations historiques spécifiques dans le mouvement ouvrier avant l4. Le Komintern aussi a souffert de ces maux, quoique pas longtemps, avant de mourir. Ces déviations n'existent nulle part sous forme de phénomène de masse aujourd'hui. La décadence du capitalisme, qui a érodé toute possibilité matérielle d'un mouvement ouvrier de masse permanent (comme l'était la seconde Internationale), a éliminé aussi indirectement la base de ces déformations historiques dont a souffert le prolétariat au siècle dernier. Au sein du petit milieu révolutionnaire qui existe aujourd'hui, on peut encore trouver des formes d'opportunisme, allant de pair généralement avec une autre maladie jumelle : le sectarisme. Mais ceci est du à la sclérose théorique et au conservatisme, pas à une quelconque "base de masse réformiste". Les groupes d'extrême gauche, cependant, sont d'une nature différente de ce milieu. Les sociaux-démocrates de gauche (et leurs groupes "de jeunesse"), les trotskistes, les "communistes", les maoïstes, et le reste du menu fretin populiste et gauchiste, font partie complètement du camp capitaliste.
La destruction de tout l'appareil politique du capitalisme, de sa gauche et de sa droite, et y compris de ses chiens de garde gauchistes, est la tâche de l'ensemble de la classe ouvrière. Ce que doivent faire les révolutionnaires, c'est dénoncer sans trêve les idées et les actions réactionnaires, capitalistes, de ces groupes, et particulièrement des gauchistes, puisqu'ils affectent la classe directement. Il faut le faire ouvertement, face à la classe. Si la social-démocratie est, comme vous le dites, "...l'obstacle le plus sérieux pour la révolution et ... le dernier espoir de la bourgeoisie" (thèse n°17), il s'ensuit que tous ses parasites politiques sont aussi des ennemi de la classe ouvrière. Le dire à notre classe est une responsabilité élémentaire.
EN CONCLUSION
Le terme "communiste de gauche" est impropre aujourd'hui car le précédent mouvement communiste de masse de la première vague révolutionnaire (1917-19Z7) est mort. Les "communistes de gauche" de la fin des années 20, et des années 30 et 40 étaient des fractions marxistes minuscules qui essayaient de survivre à la contre-révolution et donc de préparer le réarmement théorique et pratique du futur. Les camarades du GIK de Hollande et d'Allemagne en faisaient partie, ainsi que les camarades en exil de la Gauche Italienne, qui publiaient Bilan, etc. Des tendances diverses, issues théoriquement de ces fractions, existent aujourd'hui et croissent. Mais il n'est pas nécessaire de nous donner le nom de "communistes de gauche", puisque nous constituons une partie du SEUL mouvement communiste, c'est à dire marxiste, qui existe aujourd'hui. L'appareil de la gauche du capitalisme n'a rien à voir avec le marxisme. C'est l'ennemi mortel du communisme et de la classe ouvrière. C'est un mouvement décadent qui défend le capitalisme d'Etat et la contre-révolution. Nous ne sommes pas sa
"gauche".
De la même façon, le nom "communisme de conseil" est inadéquat, puisqu'il identifie le communisme avec les conseils ouvriers. C'est une affirmation mal venue. Les conseils ouvriers expriment encore le fait que la société est divisée en classes. Le terme n'est donc pas synonyme avec le mode de production communiste. Ce terme implique aussi qu'il y a des "variétés" diverses de communistes - les "communistes de parti", les "communistes d'Etat", les "communistes de village", ou les "communistes de ville" ? Mais, en fait nous sommes tout simplement des COMMUNISTES.
Nous attribuer le nom de "groupes ouvriers anti-capitalistes" serait aussi impropre. Les révolutionnaires se définissent de façon affirmative, et ne cachent pas leurs points de vue. "Ouvrier anti-capitaliste" est une définition purement négative. Les groupes révolutionnaires aujourd'hui ne peuvent se borner à être des "centres d'information", ou des lieux où discuter d'expériences locales. Ils ne sont pas non plus des cercles de discussion
ouvriers, qui eux sont par nature temporaires. Bien que vitaux pour l'ensemble de la classe, ces cercles n'assument pas et ne peuvent assumer le travail actif et systématique de propagande et d'agitation au niveau international. De même, les groupes révolutionnaires ne sont pas des comités de grève ou des "porteurs d'eau" au service des grèves. Un groupe révolutionnaire est une partie de la classe, mais il en est une partie politique, et volontaire. Il essaie de défendre une plate-forme politique claire et cohérente, il met en avant les buts généraux et finaux de la révolution prolétarienne. La tâche d'auto organisation véritable de la classe retombe sur la classe elle-même, à travers son action de masse spontanée. Les révolutionnaires ne peuvent prendre l'initiative de cette tâche unitaire, qui ne peut être effectuée que par des centaines de milliers, si ce n'est des millions, d'ouvriers. La tâche des révolutionnaires c'est de s'organiser eux-mêmes, de clarifier leurs idées, de façon à pouvoir participer et aider à fertiliser l'ensemble du mouvement de masse de demain avec les leçons de l'expérience historique du prolétariat mondial. La lutte de la classe ouvrière a un passé, un présent, et un futur plein de promesses. Il y a un lien organique qui unit ces différents moments de sa trajectoire historique. Les révolutionnaires essaient de démêler ce lien, tout d'abord sous sa forme théorique. Participer pleinement à cette tâche, avec toute sa volonté et son enthousiasme, apporter la contribution de ses meilleures idées et de ses meilleures années à cette lutte pour l'émancipation humaine, voilà le seul sens qu'on peut donner à l'espoir et au bonheur auJourd'hui
Courant Communiste International
Janvier 1981-.
[1] [41] Antonio Gramsci, "Le syndicalisme et les Conseils", article de l'Ordine Nuovo, 8 novembre 1919
[2] [42] idem
[3] [43] Pour une critique plus étendue de cette période (y compris des occupations d'usines), voir "Révolution et contre-révolution en Italie" dans la Revue Internationale du CCI n°2.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
Les confusions du « Fomento Obrero Revolucionario » sur RUSSIE 1917 et Espagne 1936
- 3686 lectures
"Bien loin d'être une somme de prescriptions toutes faites qu'on n'aurait qu'à mettre en application, la réalisation pratique du socialisme comme système économique, social et juridique est une chose qui réside dans le brouillard de l'avenir. Ce que nous possédons dans notre programme, ce ne sont que quelques grands poteaux indicateurs, montrant la direction dans laquelle les mesures à prendre doivent être recherchées, indications, d'ailleurs d'un caractère surtout négatif. Nous savons à peu près ce que nous aurons à supprimer tout d'abord pour rendre la voie libre à l'économie socialiste; mais, par contre, de quelle nature sont les mille et mille mesures pratiques, grandes et petites, propres à faire entrer les principes socialistes dans l'économie, dans le droit, dans tous les rapports sociaux, là-dessus il n'y a pas de programme de parti, pas de manuel socialiste qui donne des renseignements. Ce n'est pas un défaut : c'est au contraire l'avantage du socialisme scientifique sur le socialisme utopique." [1] [46]
C'est ainsi que Rosa Luxemburg pose la question des mesures économiques et sociales que doit assumer la dictature du prolétariat. Cette affirmation reste toujours vraie aujourd'hui. Le prolétariat doit avant tout s'assurer d'avoir détruit l'appareil d'Etat capitaliste. Le pouvoir politique est l'essence de la dictature du prolétariat. Sans ce pouvoir, il lui sera impossible d'effectuer aucune transformation sociale, économique, juridique dans la période de transition du capitalisme au communisme.
L'expérience de la contre-révolution stalinienne a apporté d'autres indications très concrètes de caractère négatif. Les nationalisations par exemple, ne peuvent être identifiées à la socialisation des moyens de production. La nationalisation stalinienne, et même celle de la période du "communisme de guerre"(1918-1920), ont consolidé le pouvoir totalitaire de la bureaucratie étatique russe, lui ouvrant l'accès direct à la plus-value extraite des travailleurs russes. La nationalisation est devenue partie intégrante de la tendance au capitalisme d'Etat, basé sur une économie de guerre croissante et permanente. En Russie, la nationalisation a directement stimulé la contre-révolution.
Pourtant il existe des tendances dans le mouvement révolutionnaire actuel qui, bien que prétendant défendre cette position générale du marxisme, la déforment et la"révisent" avec toutes sortes de recettes "économiques et sociales" ajoutées au pouvoir politique de la dictature du prolétariat.
Parmi ces tendances, nous pensons que le F.O.R ("Fomento Obrero Revolucionario": : Ferment ouvrier révolutionnaire, qui publie Alarma, Alarme, Focus, entre autres) se distingue par de dangereuses confusions. Notre critique portera sur les positions de ce groupe sur les mesures politiques et économiques que doit prendre la dictature de la classe ouvrière.
L"EXPERIENCE D'OCTOBRE
1917, SELON LE F.O.R
Pour le F.O.R, l'expérience de la révolution russe montre la nécessité de socialiser les moyens de production dès le premier jour de la révolution. La révolution communiste, selon le F.O.R, est en même temps sociale et politique, et :
"..la révolution russe constitue un avertissement décisif, et la contre-révolution qui l'a supplantée, la plus cruelle leçon : La dégénérescence de la révolution a été facilitée en 1917 par l'étatisation des moyens de production qu'une révolution ouvrière doit socialiser. Seule l'extinction de l'Etat, telle que l'envisageait le marxisme aurait permis de transformer en socialisation l'expropriation de la bourgeoisie. Or, l'étatisation
s'est avérée l'étrier de la contre-révolution." [2] [47]
Le F.O.R se trompe en affirmant qu'en 1917, il y a eu étatisation des moyens de production. Mais c'est nécessaire de le dire pour présenter ensuite le "communisme de guerre" comme un "dépassement" du projet bolchevik initial. La vérité, c'est que :
"Presque toutes les nationalisations qui se font avant l'été 1918 sont dues à des raisons punitives,
provoquées par l'attitude des capitalistes, qui se refusent à collaborer avec le nouveau régime ." [3] [48]
En 1917, le parti bolchevik n'a aucune intention d'étendre à une grande échelle le secteur étatisé. C'est déjà un secteur énorme qui montre toutes les caractéristiques bureaucratiques et militarisées de l'économie de guerre. Au contraire, ce que les bolcheviks veulent, c'est CONTROLER POLITIQUEMENT ce capitalisme d'Etat, dans l'attente de la révolution mondiale. La désorganisation du pays et de l'administration est si profonde qu'il n'existe pratiquement aucun impôt d'Etat. Les bolcheviks contribueront sans le vouloir à une inflation monstrueuse, étant donné que les banques ne les aidaient pas, obligés à émettre ainsi leur propre papier-monnaie (en 1921, il y a plus de 80 000 roubles-billets pour 1 rouble-or).
Les bolcheviks n'ont aucun plan économique concret en 1917 , seulement le maintien du pouvoir ouvrier des soviets, dans l'attente de la révolution mondiale, particulièrement en Europe. Le mérite des bolcheviks, comme disait Rosa Luxemburg, est "d'avoir pris la tête du prolétariat international en conquérant le pouvoir politique" [4] [49]. Sur le plan économique et social, R. Luxemburg les critique sévèrement, non parce qu'ils défendent une somme de recettes théoriques, mais parce que beaucoup des mesures du gouvernement soviétique ne sont pas adéquates en la circonstance. Elle les critique parce qu'elle voit dans ces mesures empiriques des obstacles pour le développement futur de la révolution.
Le "communisme de guerre" qui s'est développé durant la guerre civile, marque cependant une théorisation dangereuse des mesures prises. Pour le FOR, cette période contient des "rapports non capitalistes" [5] [50]. En réalité, le FOR ignore romantiquement que c'était une ECONOMIE DE GUERRE, laissant entendre que c'était une production et une distribution "non capitalistes". Les bolcheviks, Lénine, Trotski, Boukharine, entre autres, en sont arrivés à affirmer que cette politique économique les menait vers le communisme. Boukharine, de façon délirante, écrit en 1920 :
"La révolution communiste du prolétariat s'accompagne, comme toute autre révolution, d'une diminution des forces productives. La guerre civile, les dimensions gigantesques à la mesure de la guerre de classes moderne où non seulement la bourgeoisie, mais aussi le prolétariat, sont organisés en pouvoir d'Etat, signifie une pure perte sur le plan économique." Mais, il n'y a rien à craindre, nous console Boukharine : "Vus dans cette perspective, les faux-.frais de la révolution et de la guerre civile apparaissent comme une diminution temporaire des forces productives, qui crée néanmoins la base de leur puissant développement ultérieur en ceci que les rapports de production ont été reconstruits selon un nouveau plan." [6] [51].
Le FOR remarque : "L'échec de cette tentative (le "communisme de guerre"), dû à la chute verticale de la production (au-dessous de 3% de celle de 1913) provoqua le retour au système mercantile qui reçut le nom de Nouvelle Politique Economique (N.E.P.)." [7] [52]
Mais le FOR ne critique pas le"communisme de guerre" de façon sérieuse. Si on suit sa critique contre la NEP, c'est comme si cette politique avait marqué un " retour au capitalisme". Etant donné que, pour le FOR, le "communisme de guerre" était une politique "non capitaliste", il est logique de supposer que la NEP était son contraire. Mais ceci est faux.
Il faut dire ouvertement que le "communisme de guerre" n'a rien à voir avec la "production et la distribution communistes". Identifier le communisme et la guerre est une monstruosité, même entre guillemets. La Russie soviétique de 1918-1920 est une société militarisée au plus haut point. LA CLASSE OUVRIERE A PERDU SON POUVOIR DANS LES SOVIETS PENDANT CETTE PERIODE que le FOR idéalise. C'est vrai que la guerre contre la contre-révolution devait être menée et gagnée, et elle ne pouvait se faire qu'en conjonction avec la révolution mondiale et la formation d'une armée rouge. Mais la révolution mondiale n'a pas eu lieu et toute la défense de la Russie a reposé sur l'Etat organisé comme une caserne. La classe ouvrière et les paysans ont appuyé de manière héroïque et fervente cette guerre contre la réaction mondiale, mais il ne faut pas idéaliser, ni dépeindre les choses de manière différente de ce qui s'est passé en réalité.
La guerre civile et les méthodes sociales, économiques et policières, en plus des méthodes militaires, ont énormément accru la bureaucratie étatique infectant le parti et écrasant les soviets. Cet appareil répressif, qui n'avait déjà plus rien de "soviétique" est celui que la NEP a organisé. Entre le "communisme de guerre" et la NEP il y a une indubitable continuité. Le FOR ne répond pas à la question : quel était le mode de production dans le "communisme de guerre" ? "Non capitaliste" n'explique rien et ne fait au contraire que tout embrouiller. Une économie de guerre ne peut être autre que capitaliste. C'est l'essence de l'économie décadente, de la production systématique d'armements, de la domination totale du militarisme.
Le "communisme de guerre" était un effort POLITIQUE ET MILITAIRE de la dictature du prolétariat contre la bourgeoisie. Ce qui importe, c'est L'ASPECT POLITIQUE DE CONTROLE ET D’ORIENTATION PROLETARIENS, plus que tout. C'était un effort temporaire, passager, qui est devenu nocif par le fait que la révolution mondiale se faisait attendre. C'était un effort qui contenait des dangers énormes pour le prolétariat, déjà organisé dans les casernes, pratiquement sans voix propre. Ce contenu "non capitaliste" n'existe pas, sauf au niveau politique déjà mentionné. S'il n'en était pas ainsi, l'empire inca et sa production et distribution "non capitaliste serait un bon précurseur de la révolution. Communiste !
Le "communisme de guerre" russe se basait sur ces procédés dits "anti-capitalistes" :
- concentration de la production et de la distribution à travers des départements bureaucratiques (les "glavki") ;
- administration hiérarchique et militaire de toute la vie sociale ;
- système "égalitaire" de rationnement
- utilisation massive de la force de travail à travers des "armées industrielles" ;
- application des méthodes terroristes de la Tcheka dans les usines, contre les grèves et les éléments "contre-révolutionnaires" ;
- accroissement énorme du marché noir
- politique de réquisition à la campagne
- élimination des stimulants économiques et utilisation effrénée des méthodes de choc (udarnost) pour éliminer les déficiences dans les secteurs industriels ;
- nationalisation effective de toutes les branches qui servaient à l'industrie de guerre
- élimination de la monnaie ;
- utilisation systématique de la propagande étatique pour relever le moral de la classe ouvrière et du peuple ;
- service gratuit des transports, communication et loyers d'habitation ;
Si nous ne considérons pas l'aspect politique du pouvoir de la classe ouvrière -quoique celui-ci existe- c'est là une description d'une économie de guerre, UNE ECONOMIE DE CRISE. Il est intéressant de noter que le "communisme de guerre" n'a jamais pu être planifié. Une telle mesure, qui aurait signifié une consolidation rapide, permanente et totalitaire de la bureaucratie, aurait rencontré une résistance de la classe ouvrière. La planification militaire n'était possible que sur un prolétariat complètement écrasé et défait. C'est pour cela que le stalinisme en 1928 et après, a ajouté la planification (décadente) à une économie qui, pour le reste, ressemblait au "communisme de guerre". La différence fondamentale était que la classe ouvrière AVAIT PERDU LE POUVOIR POLITIQUE EN 1928. Si en 1918-20, elle pouvait contrôler quelque peu le "communisme de guerre" (qui en fin de compte exprimait des nécessités passagères, quoique urgentes), et même l'utiliser pour battre la réaction extérieure, pendant les dernières années de la NEP, elle avait déjà perdu tout le pouvoir politique. Mais, autant sous le "communisme de guerre" que sous la NEP, et le plan quinquennal stalinien, la loi de la valeur continue à dominer. Le salariat pu être déguisé, la monnaie a pu "disparaître", mais le capitalisme n'a pas cessé d'exister pour autant. Il ne peut être détruit par des mesures administratives ou purement politiques dans un seul pays.
Que le parti bolchevik bureaucratisé se soit rendu compte que le "communisme de guerre" ne pourrait survivre à la fin de la guerre civile, montre que ce parti ouvrier conservait un certain contrôle politique sur l'Etat qui surgit de la révolution russe. Il faut dire "un certain contrôle", car ce contrôle était relatif, et toujours plus faible. Il ne faut pas oublier non plus que la nécessité d'en finir avec le "communisme de guerre", ce sont les ouvriers et les marins de Petrograd et Kronstadt qui l'ont rappelé aux bolcheviks. Ces derniers ont payé très cher leur audace. En réalité, la rébellion de Kronstadt s'est faite contre les soi-disant "production et distribution non capitalistes" et contre tout l'appareil terroriste étatique et du parti unique déjà dominant en Russie durant la guerre civile.
Nous ne pouvons pas simplement répéter sans cesse que tout ceci était du à l'isolement de la révolution. C'est vrai. Mais c'est insuffisant. La manière dont un tel isolement s'est manifesté A L'INTERIEUR de la révolution russe est aussi important, parce qu'elle nous donne des exemples et des leçons concrètes pour la future révolution mondiale. Le "communisme de guerre" fut une expression inévitable mais funeste de cet isolement Politique de la classe ouvrière en Russie vis-à-vis de ses frères de classe en Europe.
En théorisant le "communisme de guerre", certains bolcheviks, comme Boukharine, Kritsman, etc.. ont défendu implicitement une sorte de COMMUNISME DANS UN SEUL PAYS. Bien sûr, aucun bolchevik en 1920, n'en était arrivé à le dire ouvertement. Mais c'était contenu dans l'idée de la "production et la distribution non capitalistes" faites dans un pays ou un "Etat prolétarien" (conception également fausse que le FOR semble tantôt défendre, tantôt réfuter).
L'erreur fondamentale INTERNE de la révolution russe fut celle d'avoir identifié la dictature du parti et la dictature du prolétariat qui était la dictature des conseils ouvriers. Ce fut une erreur substitutionniste fatale de la part des bolcheviks Sur un plan historique plus général, cette erreur exprimait toute une période de pratique et de théorie révolutionnaire qui n'existe plus. Chez les bordiguistes, on retrouve des restes caricaturaux de cette vieille conception substitutionniste désormais caduque et réactionnaire. Mais l'erreur des bolcheviks, ou la limitation de la révolution russe si on veut, n'est pas qu'ils n'ont pas dépassé le niveau "purement politique" de la révolution sociale. Comment y parvenir si la révolution reste isolée ? Ce qui s'est fait sur le plan économique et social est le plus qui pouvait se faire. Cela est vrai par rapport au "communisme de guerre" et même à la NEP. Ces deux politiques contenaient des dangers profonds et des pièges insoupçonnés pour le pouvoir politique du prolétariat. Mais tant que le prolétariat se maintient au pouvoir, les erreurs économiques peuvent se résoudre et s'arranger tout en attendant la révolution mondiale. S'il n'était pas possible d'arriver au communisme "intégral" (formule creuse de la "Comunist Workerls Organisation" en Grande-Bretagne), ce n’était pas parce que la classe ouvrière ne cherchait pas ou n'avait pas d'autres "grandes expériences" (comme les collectivités de 1936 en Espagne ...) La pauvreté en Russie, le niveau culturel très bas, la saignée par la guerre mondiale et la guerre civile, tout cela n'a pas permis à la classe ouvrière de conserver son pouvoir politique, et la trahison des bolcheviks doit aussi être ajoutée comme une raison interne fondamentale.
Mais l'absence de mesures "non capitalistes", comme la disparition de la loi de la valeur, du salariat, de la marchandise, de l'Etat et même des classes (dans un seul pays ?), tout ceci peut-il expliquer la défaite interne de la révolution russe ? C'est ce que semble dire le FOR.
"Le capitalisme s'ouvrira toujours une brèche, si dès le début sa source n'est pas asséchée : la production et la distribution basées sur le travail salarié. Ce qui doit compter pour chaque prolétariat est le niveau industriel du monde, et pas celui de "sa" nation seulement." [8] [53]
Pourtant, contrairement à ce que le FOR suggère ici, la "source" du capitalisme mondial ne se trouve pas dans de petites plaques à assécher pays par pays. Le FOR semble ne pas prendre en compte que le capitalisme, comme système social, existe à l'échelle mondiale, comme un rapport international. Pour cela, la loi de la valeur ne peut être éliminée qu'à l'échelle mondiale. Comme elle touche tout le prolétariat mondial, il est impossible de penser qu'un secteur isolé du prolétariat puisse échapper à ses lois. C'est une mystification typique du volontarisme anarchiste qui pensait que l'Etat et le capitalisme pouvaient être éliminés à travers un faux communautarisme de village et de canton. Dans la tradition anarcho-syndicaliste, l'idée a trouvé sa variante "industrielle" mais suit la même mystification localiste, étroite, égoïste.
Dans l'article de Munis cité plus haut, on nous dit que le prolétariat ne doit pas compter"seulement"sur le niveau industriel de "sa" nation. Sage conseil, mais peu clair. S'il s'agit de la possibilité et la nécessité de prendre le POUVOIR POLITIQUE dans un pays, quel qu'il soit, c'est un bon conseil, quoique pas tellement nouveau !
C'est vrai que ce qui importe c'est le niveau mondial, non celui de chaque pays. Cependant, si on met en avant l'idée que la production et la distribution communistes peuvent commencer "immédiatement", comme le fait le FOR, ceci implique que le niveau industriel de chaque pays est absolument important. Il serait l'aspect fondamental, décisif. Il est clair qu'une telle affirmation amènerait le FOR -bien qu'il soit une tendance révolutionnaire- dans la tradition chauviniste d'un Volmar ou d'un Staline. Mais ce qui est réellement tragique est qu'il devrait accepter, pour être logique avec lui-même, que le communisme est impossible, étant donné qu'il n'est pas possible dans un pays. Le FOR répondra avec colère qu'il ne défend pas l'idée du "socialisme en un seul pays". C'est bien, mais on ne peut nier que sa manière de poser la question des taches économiques et sociales, considérées de son point de vue comme aussi importantes que les tâches politiques, suggère une sorte de "communisme en un seul pays". Quel autre sens peut avoir l'affirmation que le capitalisme s'ouvrira toujours une brèche, à moins d"'assécher" sa "source" ? Nous avons déjà dit qu'on ne peut "assécher" dans un seul pays
Est-ce que le travail salarié peut être éliminé dans un seul pays ou une seule région ?
Selon le FOR, il semble que oui. C'est là la question. Si on accepte cela, on accepte le socialisme dans un seul pays. Il faut être cohérent.
Dans une polémique (excellente sur d'autres aspects) contre les bordiguistes du "Prolétaire", Munis répète :
"Dans notre conception ... c'est là le plus important de ce que doit imposer la dictature du prolétariat, et sans cela, il n'existera jamais de période de transition au communisme".[9] [54]
On se réfère ici à la nécessité d'abolir le travail salarié, quant à la nécessité du pouvoir politique, Munis la taxe de "... lieu commun plus que centenaire". Mais on peut en dire autant de l'abolition du salariat !
Maintenant, il est certain que sans abolition du salariat, il n'y aura pas de communisme. La même chose s'applique aux frontières, à l'Etat, aux classes. Il n'est pas nécessaire de répéter que le communisme est un mode de production basé sur la libération la plus complète de l'individu, sur la production de valeurs d'usage, sur la disparition complète des classes et de la loi de la valeur. Là dessus, nous sommes d'accord avec le FOR.
La différence apparaît lorsque nous abordons la primauté des mesures économiques et sociales. Nous allons voir que la question du pouvoir politique, loin d'être un "lieu commun", est ce qui est décisif pour la révolution mondiale. Pas pour le FOR.
L'insistance de Munis est enfermée dans toute l'optique (myope) des oppositions trotskistes et même boukhariniennes, à la contre-révolution stalinienne. Il pense que les garanties contre la contre-révolution, ce sont les mesures économiques et sociales de type "non capitaliste" qui vont les donner. Malgré l'importance de beaucoup d'écrits de Préobrajensky, Boukharine et autres économistes bolcheviks, leurs apports n'éclairent pas sur les problèmes réels qu'a affronté la classe en 1924-1930. Préobrajensky parlait d'une "accumulation socialiste", de la nécessité d'établir un équilibre économique entre la ville et la campagne, etc. Boukharine, malgré ses divergences politiques avec l'opposition de gauche, a utilisé des arguments semblables. Tous sont restés prisonniers de l'idée qu"'on peut faire quelque chose économiquement dans un seul pays" pour survivre.
C'est un faux problème qui a surgi quand la classe ouvrière a déjà perdu son pouvoir de classe, son pouvoir politique. A ce point, toute discussion sur 1"'économie" soviétique devient une pure charlatanerie et une mystification technocratique. La racaille stalinienne a donné la réponse définitive à ces faux débats avec ses plans quinquennaux barbares, avec sa terreur policière, et le massacre définitif du parti bolchevik déjà vaincu.
S'il est vrai que la révolution prolétarienne d'aujourd'hui se produira dans des conditions plus favorables qu'en 1917-27, nous ne pouvons nous consoler en pensant que les énormes problèmes vont disparaître. Le prolétariat héritera d'un système économique en putréfaction et décadent. La guerre civile accentuera encore cette usure. Le délire apologétique de Boukharine par rapport à cette accentuation doit être évité à tout prix, comme tout type de pensée apocalyptique ou messianique sur une révolution communiste "immédiate". Il ne s'agit pas de gradualisme. Il s'agit d'appeler les choses par leur nom.
Il est évident que si la classe ouvrière prend le pouvoir, en Bolivie par exemple (même momentanément), sa capacité à "socialiser" sera très limitée. Il est possible que pour le FOR, cet inconvénient ne soit pas gênant. Le prolétariat bolivien pourrait, par exemple, ressusciter l'esprit "communiste" aymara et même ressusciter Tupac Amarù comme commissaire du peuple. Au Paraguay, pour donner un autre exemple, le prolétariat pourrait retourner à une vieille forme de "communisme" jésuite du temps de la conquête. Il faut bien, comme on peut embellir les mauvais jours. Marx lui-même ne parlait-il pas d'un "communisme barbare", basé sur la misère généralisée ? On pourrait arguer : est-ce que cela ne serait pas un type de "communisme" ? Mais, est-il applicable à notre époque ? Que le FOR nous le dise. Il semble que son attachement aux "Collectivités" en Espagne lui a transmis une nostalgie particulière sur le "communisme primitif"
Si on laisse de côté les blagues (que nous espérons que le FOR ne prendra pas de travers), il faut dire que le prolétariat prend le pouvoir politique dans la perspective de la révolution communiste mondiale. Pour cette raison, les mesures sur le plan économique et social doivent être dirigées dans ce sens. Pour cela, elles sont subordonnées la nécessité de conserver le pouvoir politique des conseils ouvriers, libres, souverains et autonomes en tant qu'expression de la classe révolutionnaire dominante. Le pouvoir politique est la CONDITION PREMIERE de toute "transformation sociale" ultérieure, immédiate, médiate, ou comme on voudra l'appeler. LA PRIMAUTE, C'EST LE POUVOIR POLITIQUE. On ne peut rien y changer. Sur le plan économique il y a un énorme champ d'expérience (relativement) et donc aussi le risque de commettre des erreurs qui ne doivent pas être fatales. Mais toute altération sur le plan politique implique rapidement le retour complet du capitalisme.
La profondeur des transformations sociales possibles dans chaque pays dépendra, bien sûr, du niveau matériel concret de ce pays. Mais en aucun cas, ces transformations ne tourneront le dos aux nécessités de la révolution mondiale. Dans ce sens, on peut imaginer un type de "communisme de guerre", ou bien une économie de guerre sous le contrôle direct des conseils ouvriers. Non pas les nationalisations, mais la participation active et responsable d'un appareil de gouvernement soviétique contrôlé par la classe ouvrière. Le FOR pense t'il que c'est impossible ? C'est cela être "trop attaché au modèle russe" ?
Donner la primauté à l'abolition du salariat en pensant qu'avec cela, on arrive à "l'affaiblissement immédiat de la loi de la valeur (échange d'équivalents) jusqu'à sa disparition médiate..."[10] [55], est une pure fantaisie "moderniste". C'est ce type d'illusion qui, à certains moments, aidera à désarmer le prolétariat, l'isolant du reste de la classe ouvrière mondiale. Lui dire qu'il a"socialisé""son" secteur de l'économie mondiale, qu'il a "brisé" la loi de la valeur dans "sa" région, c'est lui dire qu'il doit défendre ce secteur "communiste" qualitativement supérieur au capitalisme extérieur. Rien ne serait plus faux que cette démagogie. Ce que nous défendons est le POUVOIR POLITIQUE DE LA CLASSE.
Ce qui abattrait tout secteur de la classe ouvrière ayant pris le pouvoir, c'est l'isolement de la révolution, c'est à dire le manque de conscience claire de la part du reste de la classe mondiale sur la nécessité d'étendre la solidarité et la révolution mondiale. C'est là le vrai problème. Le FOR ne le met pas en évidence, même si parfois il daigne porter son attention sur la question. Le problème n'est pas que le capitalisme va "resurgir", là où n'a pas été "asséchée" sa "source", mais que le capitalisme CONTINUE A EXISTER à l'échelle mondiale bien qu'un ou quelques Etats capitalistes aient été détruits. Penser qu'on peut le détruire dans un seul pays est une charlatanerie pure qui implique une profonde ignorance de l'économie capitaliste selon l'analyse de Marx. Ou alors, il s'agit d'une "révolution simultanée" dans tous les pays, capable d'écourter énormément la période de guerre civile pour passer à la période de transition proprement dite (à l'échelle mondiale). Ce serait l'idéal, mais il est probable que cela ne se passera pas ainsi, de manière simultanée, malgré les efforts du FOR. Avoir des espoirs, être ouvert aux possibilités inespérées idéales est une chose. Mais c'est autre chose de baser toute la perspective révolutionnaire là-dessus et jusqu'à écrire un "Second Manifeste Communiste" dans cet esprit. La liberté véritable, c'est la reconnaissance de la nécessité qui nous la donne et non les simagrées volontaristes.
Malgré ses confusions de base sur ce qu'a été le "communisme de guerre" dans la révolution d'Octobre, le FOR comprend au moins qu'il s'agissait d'une révolution prolétarienne, d'un effort politique de la classe pour conserver le pouvoir. Mais voyons maintenant ce que dit le FOR sur l'Espagne 36.
LES COLLECTIVITES DE 1936 EN ESPAGIE,
SELON LE F.O.R.
Selon le FOR, la tentative du "communisme de guerre", même si elle a introduit des rapports "anti-capitalistes", n'a jamais dépassé le stade de l'exercice du pouvoir politique par la classe ouvrière. Comme exemple beaucoup plus profond de mesures ou rapports "non-capitalistes", le FOR présente les collectivités de 1936-37 en Espagne. Munis les décrit ainsi :
"Les collectivités de 1936-37 en Espagne ne sont pas un cas d'autogestion... Certaines organisèrent une sorte de communisme local (sic), sans autre rapport marchand que vers l'extérieur, précisément comme les anciennes sociétés de communisme primitif. D'autres étaient des coopératives de métier ou de village, dont les membres se distribuaient les anciens bénéfices du capital. Toutes abandonnèrent plus ou moins la rétribution des travailleurs selon les lois du marché de la force de travail -et certaines plus que d'autres- en fonction du travail nécessaire et du surtravail d'où le capital tire la plus-value et toute la substance de son organisation sociale. De plus, les collectivités firent aux milices de combat des dons en espèces aussi abondants que répétés. On ne peut pas alors définir les collectivités sinon par leurs caractéristiques révolutionnaires (sic !), en somme par le système de production et de distribution en rupture avec les notions capitalistes de valeur (d'échange nécessairement)..." [11] [56]
Dans son livre "Jalons de défaite; promesse de victoire" (1948), Munis est encore plus enthousiaste :
"Ayant pris l’industrie, sans autre exception, que celle de petite échelle, les travailleurs la remirent en marche, organisés en collectivités locales et régionales par branches d'industrie. Phénomène qui contraste avec celui de la révolution russe, qui met en évidence l'intensité du mouvement révolutionnaire espagnol, la grande majorité des techniciens et des gens spécialisés en général, loin de se montrer hostiles à l'intégration dans la nouvelle économie, collaborèrent valeureusement dès le premier jour avec les travailleurs des collectivités. La gestion administrative et la production en bénéficièrent : le pas vers l'économie sans capitaliste s'effectua sans les heurts et la perte de productivité que le sabotage des techniciens infligea à la révolution russe de 1917. Bien au contraire, l'économie régie par les collectivités réalisa des progrès rapides et énormes. Le stimulant d'une révolution considérée triomphante, la jouissance de travailler pour un système qui substituerait à l'exploitation de l'homme son émancipation du joug de la misère salariée, la conviction d'apporter à tous les opprimés de la terre une espérance, une occasion de victoire sur les oppresseurs, réalisèrent des merveilles. La supériorité productive du socialisme sur le capitalisme a été éminemment démontrée par l’œuvre des collectivités ouvrières et paysannes, tant que l'intervention de l'Etat capitaliste régi par les voyous politiques du Front Populaire n'a pas reconstitué le joug détruit en juillet (de 1936) " [12] [57]
Ce n'est pas là le lieu de poursuivre une polémique sur la guerre civile d'Espagne. Nous avons déjà souvent publié des textes sur ce chapitre tragique de la contre-révolution qui a ouvert la marche au second massacre impérialiste [13] [58]. Nous dirons ici brièvement que Munis et le FOR ont toujours défendu l'idée erronée qu'en Espagne a eu lieu une "révolution". Rien n'est plus étranger à la réalité. S'il est bien sûr que la classe ouvrière en Espagne a bousculé l'appareil bourgeois en 1936 et qu'en mai 1937 elle s'est, bien tardivement, soulevée contre le stalinisme et le gouvernement de front populaire, ceci n'élimine pas le fait que la lutte de classe a été déviée et absorbée par la lutte inter-impérialiste entre la République et le fascisme. La classe a succombé idéologiquement sous le poids de cette vile campagne antifasciste; elle a été massacrée dans la guerre et écrasée par la dictature franquiste, une des pires du siècle.
Les collectivités furent idéales pour dévier l'attention du prolétariat de son véritable objectif immédiat : la destruction totale de l'appareil d'Etat bourgeois et de tous ses partis, de gauche inclus. Ces derniers revitalisèrent l'appareil d'Etat bousculé en 1936 par les ouvriers armés. Mais, après cela, la classe fut séduite par la lutte du front populaire contre le soulèvement franquiste. Les collectivités et les comités de fabrique se plièrent devant cette ignominie. L'appareil d'Etat se reconstitua en intégrant la classe ouvrière à son front militaire, déviant ainsi la lutte ouvrière vers le massacre entre fractions bourgeoises.
Le groupe "Bilan" (de la fraction italienne de la Gauche Communiste) s'opposa à toute idée d'appuyer cette "révolution espagnole". "Bilan" écrivit correctement : " ... quand le prolétariat n'a pas le pouvoir -et c'est le cas en Espagne- , la militarisation des usines équivaut à la militarisation des usines dans n'importe quel Etat capitaliste en guerre" [14] [59]. "Bilan" appuyait la classe ouvrière en Espagne en ces heures tragiques ; il lui indiquait le seul chemin à suivre :
"Quant aux prolétaires de la péninsule ibérique, ils n'ont qu'une sortie : celle du 19 juillet : grèves dans toutes les entreprises, qu'elles soient de guerre ou non, tant du côté de Companys que du côté de Franco ; contre les chefs des organisations syndicales et du Front Populaire et pour la destruction du régime capitaliste" [15] [60].
Combien ces paroles sont loin des bavardages sur la "supériorité du socialisme sur le capitalisme" démontrée par les collectivités ! Non, la vérité doit être dite clairement : IL N'Y A PAS EU EN ESPAGNE DE REVOLUTION SOCIALE. Le capitalisme a survécu parce que la classe ouvrière en Espagne, isolée de la révolution mondiale agonisante, fut entraînée à "autogérer" l'économie de guerre "collectivisée", en faveur du capitalisme espagnol. Dans ces conditions, affirmer que la "révolution espagnole" alla plus loin que la révolution russe au niveau des rapports "non capitalistes" est une tricherie idéologique.
Munis et le FOR révèlent ici une incapacité à comprendre ce que fut la révolution d'Octobre et ce que fut la contre-révolution d’Espagne. Erreur de taille pour une tendance révolutionnaire ! Minimiser le contenu de la première en faveur de la seconde est tout simplement incroyable. En réalité, en défendant les collectivités, Munis et le FOR "théorisent" l'appui donné au gouvernement républicain par les trotskistes pendant la guerre civile. Il n'y a pas d'autre manière d'expliquer cet attachement fanatique aux "collectivités", appendices de la bourgeoisie républicaine en 1936-37. Nous savons que selon le FOR, la tradition trotskyste est révolutionnaire -le FOR étant son héritier historique. Mais voyons en passant ce que disaient les trotskistes de la section bolchévik-léniniste d'Espagne (pour la 4ème Internationale)
"Vive l'offensive révolutionnaire !
"Pas de compromis. Désarmement de la Garde Nationale Républicaine (garde civile) et de la Garde d'Assaut réactionnaire. Le moment est décisif. La prochaine fois, il sera trop tard. Grève générale dans toutes les industries qui ne travaillent pas pour la guerre. Seul le pouvoir prolétarien peut assurer la victoire militaire.
Armement total de la classe ouvrière ! Vive l'unité d'action CNT-FAI-POUM ! Vive le front révolutionnaire du prolétariat ! Dans les ateliers, dans les usines, dans les quartiers : comités de défense révolutionnaire" [16] [61].
Le caractère réactionnaire
de la position trotskyste saute aux yeux : assurer la victoire
militaire". De qui ? De la République ! Cette
"victoire militaire" ne doit pas être menacée par des grèves
irresponsables dans les industries de guerre, selon les trotskistes
Oui, il y avait -il y a- une différence fondamentale entre le trotskisme et le marxisme. Les premiers ne savaient pas distinguer la révolution de la contre-révolution, et les seconds, non seulement le savaient, mais confirmèrent aussi la position marxiste sur la primauté, la nécessité fondamentale d'assurer le pouvoir politique comme condition première à toute tentative de "réorganiser" la société. Si la guerre bourgeoise d'Espagne a apporté quelque chose pour la théorie révolutionnaire, ce fut de confirmer cette leçon de la classe ouvrière.
Dans le chapitre XVII de "Jalons...", intitulé "La propriété", Munis dit ouvertement qu'en Espagne "naissait un nouveau système économique, le système socialiste" [17] [62]. La révolution communiste future, nous dit il, devra continuer et perfectionner cette oeuvre. Peu importe pour Munis que tout cet effort "socialiste" était attaché à une guerre 100 % capitaliste, un massacre et la préparation à la seconde boucherie mondiale avec ses 60 millions de cadavres. Au fond, Munis continue à appuyer la guerre antifasciste de 1936-39 et dans ce sens, il n'a pas rompu avec les mythes du trotskisme La mystification subie par le prolétariat, Munis l'admet, mais sans savoir quoi dire : "Le prolétariat a continué de considérer l'économie comme sienne, et le capitalisme a définitivement disparu " [18] [63].
Au lieu de critiquer les mystifications qui illusionnent le prolétariat, Munis s'adapte à elles, les idolâtre et les "théorise". C'est là ce qu'il y a de négatif, de rétrograde dans le FOR et ses litanies sur la "révolution espagnole". Sa critique est purement économique : elle se réfère surtout au manque de planification à l'échelle nationale. Pour Munis, "la prise et la mise en marche des centres productifs par les travailleurs de ces centres, étaient un premier pas obligatoire. Rester à ce niveau devait avoir des résultats funestes" [19] [64]. Il parle ensuite aussi du pouvoir politique qui était"décisif" (!) pour la révolution. Mais c'est pour dire que la CNT n'était pas à la hauteur des choses, admettant par là que la CNT était un organisme des travailleurs, autre mensonge. Selon le FOR, la CNT était une organisation prolétarienne qui oublia le "lieu commun" de la nécessité du pouvoir politique. C'est ainsi que le FOR, clair et tranchant, pose la question de la "révolution espagnole".
Le livre de Munis est paru en 1948, Il se peut que ses idées aient changé. Mais au moins, dans sa "Réaffirmation" de mars 1972 (à la fin du livre), il ne fait ni commentaire, ni critique des activités trotskistes en Espagne. Dans ce sens, Munis n'a pas changé ses idées sur la "révolution espagnole" en plus de 45 ans. Etre trop attachés au "modèle russe" n'est pas un crime pour les révolutionnaires ; cela peut être une "entrave conservatrice", mais la révolution russe appartient à l'histoire de notre classe et pour cela nous devons en tirer toutes les leçons, car il s'agit d'une révolution prolétarienne. C'est le contraire pour 1a dite "révolution espagnole". Là, notre classe n'a jamais pris le pouvoir politique -au contraire, elle fut convaincue, en partie à travers l'expérience des "collectivités", que c'était un "1ieu commun" à laisser entre les mains de ces messieurs de la CNT-FAI-POUM. Ainsi la classe fut immobilisée et massacrée par les républicains et par leurs bourreaux staliniens, puis par les franquistes. Pour Munis, ce massacre n'enlève rien à la sublime oeuvre des collectivités. Face à un tel lyrisme, nous disons qu'être attaché -même un peu- au "modèle espagnol", est une monstrueuse erreur pour les révolutionnaires
Pour Munis et le FOR, le pouvoir politique de la classe apparaît parfois comme quelque chose d'important et de décisif, et parfois comme quelque chose qui peut -et même doit- venir après. Un "lieu commun" qui n'a pas à soulever de grandes discussions puisque "on le sait déjà". Mais en vérité, le FOR ne le sait pas. L'expérience d'Espagne montre, de manière négative la PRIMAUTE DU POUVOIR POLITIQUE SUR LES DITES MESURES OU RAPPORTS "SOCIALISTES". Munis et le FOR ne voient pas que dans la guerre d'Espagne, pouvoir politique et mystification "collectivistes" ont existé en proportion inverse l'un de l'autre. L'un niait l'autre, et il ne pouvait en être autrement. [20] [65].
Dans sa "Réaffirmation", Munis écrit : "Plus nous regardons rétrospectivement les années qui vont jusqu'en 1917, plus la révolution espagnole acquiert de l’importance. Elle fut plus profonde que la révolution russe... dans le domaine de la pensée, on ne peut élaborer aujourd'hui que de méprisables ersatz de théorie, si on se passe de l'apport de la révolution espagnole, et précisément en ce qu’il diffère, en le dépassant et en le niant, de l'apport de la révolution russe".
Pour notre part, nous préférons baser nos orientations sur les expériences véritables du prolétariat et non sur les "innovations"modernistes comme celle du FOR.
En tant que classe exploitée et révolutionnaire, la classe ouvrière exprime au travers de ses luttes cette nature complémentaire. C'est ainsi qu'elle utilise ses luttes revendicatives, pour s'aider à avancer dans la compréhension de ses tâches historiques. Cette compréhension révolutionnaire trouve son obstacle immédiat dans chaque Etat capitaliste, qui doit être détruit par la classe ouvrière dans chaque pays.
Mais la classe ne peut se dissoudre comme catégorie exploitée qu'à l'échelle universelle, parce que cette possibilité est intimement liée à l'économie mondiale qui dépasse les recours existant au niveau de chaque économie nationale. Mais le caractère capitaliste de l'économie mondiale, du marché mondial, ne peut être éliminé qu'à l'échelle universelle. La classe ouvrière peut instaurer sa dictature (quoique pour peu de temps) dans un seul pays ou dans une poignée de pays isolés, mais ne peut pas créer le communisme dans un seul pays ou une région du monde. Son pouvoir révolutionnaire s'exprime par son orientation nettement internationaliste, engagé surtout à détruire l'Etat capitaliste partout, à détruire cet appareil terroristo-policier dans le monde entier. Cette période peut durer quelques années, et tant qu'elle n'est pas terminée, il sera difficile, sinon impossible, de prendre des mesures réellement et définitivement communistes. La destruction totale des bases économiques du mode de production capitaliste ne peut être la tâche que de toute la classe ouvrière mondiale, centralisée et unie, sans nation ni échange marchand. D'une certaine manière, jusqu'à ce que la classe ouvrière atteigne ce niveau, elle restera une classe économique, étant donné que les conditions de pénurie et de déséquilibre économique subsistent encore. C'est ainsi que les deux caractères de la nature de classe du prolétariat (classe exploitée et classe révolutionnaire) tendent à fusionner consciemment dans le feu du processus historique qui est la dictature du prolétariat et la transformation communiste totale.
ooooooooooo
Nous ne prétendons pas en finir avec une discussion aussi importante. Mais nous voulons présenter nos critiques des conceptions du FOR sur ces problèmes de la révolution prolétarienne. Rien de ce qui est défendu par rapport au "communisme immédiat" ne nous convainc que l'affirmation de Rosa Luxemburg citée au début de cet article est erronée. Les idées du FOR sur les taches de notre époque, sont liées à cette vision d'un socialisme qui peut être atteint à tout moment et quand le prolétariat en aura envie. Cette conception immédiatiste, volontariste, a déjà été critiquée plusieurs fois dans nos publications [21] [66]
Les confusions dangereuses du FOR cachent une incapacité à comprendre ce qu'est la décadence du capitalisme et quelles sont les tâches de la classe ouvrière dans cette période historique. De même, le FOR n'a jamais été capable de comprendre la signification des cours historiques qui se sont manifestés au cours de ce siècle depuis 1914. Il n'a jamais compris, par exemple, que la lutte du prolétariat espagnol en 1936 ne pouvait changer le cours vers le second conflit mondial. La confirmation cruciale de cela fut la confusion politique terrible du prolétariat en Espagne, qui, au lieu de continuer sa lutte contre l'appareil d'Etat et toutes ses ailes politiques et syndicales, s'est laissé immobiliser par ces dernières, abandonnant son terrain de classe [22] [67].
Là est la véritable tragédie du prolétariat mondial en Espagne ! Mais, pour le FOR, ce "jalon de défaite" a confirmé la "supériorité du socialisme sur le capitalisme".
Combien est fausse cette
appréciation sur la révolution communiste, appréciation incapable de montrer à
quel moment ce mouvement pour la libération totale de l'humanité s'est vue précipiter
dans l'abîme le plus barbare. Si le
prolétariat est incapable de comprendre quand et comment sa lutte, ses
perspectives et ses forces les plus dévouées, ont été vaincues par la classe
ennemie, et récupérées par elle momentanément, le prolétariat ne sera
jamais à la hauteur de sa mission historique.
Sa future libération mondiale requiert constamment un bilan profond des
50 dernières années. Que le FOR prenne
conscience de cette nécessité et surtout de ce qu'a été le trotskisme et la
dite "révolution espagnole", alors seulement il pourra réellement
avancer et réaliser la promesse de cette énorme passion révolutionnaire
contenue dans ses publications.
MACK.
[1] [68] Rosa Luxembourg, "la révolution russe", ed. Spartacus, dans "démocratie et dictature"
[2] [69] FOR, "Pour un second manifeste communiste" Losfeld, Paris 1965, p.24.
[3] [70] cité dans l'intéressant fascicule de José Antonio Garcia Diez, "URSS, 1917-1929 : de "la révolution à la planification" (traduit par nous), Madrid 1969, p.53. Cela est aussi développé par d'autres historiens de la révolution russe comme Carr, Davies, Dobb, Erlich, Lewin, Nove, etc...
[4] [71] Luxembourg, idem.
[5] [72] FOR, idem, p.25.
[6] [73] Nicolas Boukharine, "théories économiques de la période de transition" ed. EDI.
[7] [74] FOR, idem, p.25.
[8] [75] Grandizo-Munis, "Classe révolutionnaire organisation politique, dictature du prolétariat dans "Alarma" n°24, ler trimestre 73, p.9 (traduit par nous)
[9] [76] Munis, idem, dans "Alarma" n°'25, deuxième trimestre 1973, p.13 (traduit par nous).
[10] [77] Munis, idem, "Alarma" n'25,p.6 (traduit par nous).
[11] [78] Munis, "Lettre de réponse à la revue autogestion et socialisme" dans "Alarma n° 22, 23, 3ème et 4ème trimestre, 1972, p11.
[12] [79] Munis, "Jalons de défaite et promesse de victoire'(Espagne 1930-39), Mexico 1948, p.340. (traduit par nous).
[13] [80] Nous citons ici les articles de "Bilan" parus dans la "Revue Internationale" du CCI Nos 4, 6, 7 et l'article "Le mythe des collectivités anarchistes" dans le N°15.
[14] [81] Bilan, "textes sur la révolution espagnole"'(sic !), 1936-38, Barcelone 1978, p.103.
[15] [82] Idem, p.116.
[16] [83] Munis dans "Jalons ... " p.305
[17] [84] Munis idem, p. 339-340.
[18] [85] Munis idem, p.346.
[19] [86] Munis, idem, p. 345.
[20] [87] Comme nous l'avons dit, Munis insiste parfois sur le fait que le pouvoir politique est décisif. Voir par exemple, dans "Jalons..." p.357-58. C'est un dualisme auquel n'échappe pas le FOR
[21] [88] Nous mentionnons entre autres : des articles dans "Révolution internationale" Nos 7, 14,54, 56, 57, 58, la "Revue Internationale" n°l6, la "critique à Focus" dans "Internationalism" (USA) n°25, "Le FOR, une confusion dangereuse" dans "Accion Proletaria" n°'17.
[22] [89] Dans une récente polémique, plus qu'acerbe, le FOR répète ses affirmations habituelles sur l'Espagne 36, sans ajouter rien de nouveau, en continuant à parler de la fameuse "révolution espagnole" (voir l'article "la trajectoire tordue de révolution Internationale").
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [90]
Evènements historiques:
- Espagne 1936 [91]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Critique de «LÉNINE PHILOSOPHE» de Pannekoek (Internationalisme, 1948) (1ère partie)
- 4311 lectures
Quand le groupe de la Gauche Communiste en France (G.C.F) décide de traduire et de publier "Lénine philosophe" de A. Pannekoek, c'est non seulement son pseudonyme de J. Harper, mais le nom même de Pannekoek qui est pratiquement inconnu en France. Ceci ne peut être expliqué comme un fait "français", même en tenant compte du fait que la France n'a jamais brillé par son empressement dans la publication des oeuvres du mouvement ouvrier et marxiste, car cela est vrai pour tous les pays d'Europe et du monde, cet "oubli" ne concerne pas particulièrement Pannekoek. C'est toute la Gauche Communiste -à commencer par Rosa Luxemburg- qui s'est trouvée à la pointe des combats révolutionnaires de la classe ouvrière à la sortie de la première guerre mondiale, c'est toute son oeuvre théorique, son action politique, et ses luttes passionnées qui se trouvent englouties dans 1"'oubli". On a peine à croire qu'il a suffit d'une dizaine d'années de dégénérescence de l'I.C. et de contre-révolution stalinienne pour "effacer" des mémoires les enseignements d'un mouvement révolutionnaire pourtant si riches, si denses, d'une génération qui venait elle-même de le vivre. On dirait qu'une épidémie d'amnésie venait de frapper brusquement ces millions de prolétaires qui avaient participé activement à ces événements et de les plonger dans un désintérêt total pour tout ce qui est la pensée révolutionnaire. De cette vague qui a failli "ébranler le monde", ne subsistent que quelques traces, représentées par les maigres groupes dispersés de par le monde, isolés les uns des autres, et donc incapables d'assurer la continuation de la réflexion théorique, autrement que dans des petites revues à tirage réduit à l'extrême, et souvent même pas imprimées.
Rien d'étonnant que le livre de Harper, "Lénine philosophe" paru en 1938 en allemand à la veille de la guerre, ne rencontre aucun écho et passe complètement inaperçu, même dans le milieu extrêmement réduit des révolutionnaires, et c'est le mérite incontesté d d'"Internationalisme", une fois la bourrasque de la guerre passée, d'avoir été le premier à le traduire et le publier en feuilleton, dans ses numéros 18 à 29 (février à décembre 1947).
En saluant le livre de Harper "comme une contribution de premier ordre, au mouvement révolutionnaire et à la cause de l'émancipation du prolétariat", "Internationalisme" ajoute dans son avant propos (n°18, février 1947) : "que l'on soit d'accord ou non, avec toutes les conclusions qu'il donne, personne ne saurait nier la valeur énorme de son travail qui fait de cet ouvrage, au style simple et clair, un des meilleurs écrits théoriques des dernières décades".
Dans ce même avant-propos, "Internationalisme" exprime sa préoccupation fondamentale en écrivant: "La dégénérescence de l'I.C. a entraîné un désintéressement inquiétant dans le milieu de l'avant garde pour la recherche théorique et scientifique. A part la revue "Bilan" publiée avant-guerre par la fraction italienne de la Gauche Communiste et les écrits des Communistes de Conseil dont fait partie le livre de Harper, l'effort théorique du mouvement ouvrier européen est quasi inexistant. Et rien ne nous paraît plus redoutable pour la cause du prolétariat que l'engourdissement théorique dont font preuve ses militants."
C'est pourquoi "Internationalisme", tout en considérant hautement sa valeur, ne se contente pas de publier simplement l'ouvrage de Pannekoek, mais se propose et soumet cet ouvrage à la discussion et en fait la critique dans une série d'articles qui vont du n°30 (janvier 48) au n°33 (avril 48). Si "Internationalisme" accepte et partage pleinement la démonstration de Pannekoek sur le fait que, dans sa polémique contre les tendances idéalistes des néo-machistes (Bogdanov), Lénine tombe dans des arguments qui relèvent du matérialisme bourgeois (mécaniste et positiviste), il (Internationalisme) rejette catégoriquement les conclusions politiques que Pannekoek se croit en droit d'en tirer, pour faire du Parti Bolchevique un parti non-prolétarien, une "intelligentsia" (?), et de la révolution d'Octobre une révolution bourgeoise.
Cette thèse servira de fond à toute une analyse de la révolution d'Octobre et du parti Bolchevique par le courant conseilliste et qui le distingue nettement de la Gauche Communiste, et également du K.A.P.D, du moins à ses débuts. Le conseillisme se présente ainsi comme une involution de la Gauche allemande de laquelle il se réclame. Avec quelques variantes, on retrouvera cette thèse, aussi bien dans "Socialisme ou Barbarie" que dans "Socialisme des Conseils", allant de Chaulieu à P. Mattik , de M. Rubel à K. Korsch. Ce qui est le plus frappant dans cette démarche et commun à tous, y compris les modernistes, consiste dans la réduction de la révolution d'Octobre à un phénomène strictement russe, perdant complètement de vue sa signification internationale et historique.
Une fois arrivé là, il ne restait plus qu'à rappeler l'état arriéré du développement industriel de la Russie, pour conclure à l'absence des conditions objectives pour une révolution prolétarienne. L'absence d'une vision globale de l'évolution du capitalisme comme un tout, amène le conseillisme, par un détour propre, à la position de toujours des mencheviks : l'immaturité des conditions objectives en Russie et l'inévitabilité du caractère bourgeois de la révolution.
De toute évidence, ce qui a motivé le travail de Pannekoek n'est pas tant la rectification théorique de la démarche erronée de Lénine dans le domaine philosophique, mais fondamentalement le besoin politique de combattre le parti Bolchevik, considéré par lui , à priori et par nature, comme un parti marqué par le caractère "mi-bourgeois, mi-prolétarien du bolchevisme et de 1a révolution russe elle-même,, ([1] [92]). C'est pour "élucider la nature du bolchevisme et de 1a révolution russe" comme l'écrit P Mattick, "que Pannekoek entreprit un examen critique de ses fondements philosophiques en publiant en 1938 son "Lénine Philosophe". On peut douter de la validité d’une telle démarche et sa démonstration est loin d'être convaincante. Faire découler la nature d'un événement historique aussi important que celui de la révolution d'Octobre ou le rôle joué par le parti Bolchevik d'une polémique philosophique -pour si importante qu'elle pouvait être- est loin de pouvoir constituer la preuve de ce qu'on avance. Les erreurs philosophiques de Lénine en 1908 pas plus que le triomphe ultérieur de la contre-révolution stalinienne ne prouvent pas qu'Octobre 17 n'était pas une révolution prolétarienne, mais ... la révolution d'une troisième classe : l'intelligentsia (?). En fondant artificiellement ses confusions politiques fausses sur des prémisses théoriques justes, en établissant un lien à sens unique entre causes et effets, Pannekoek tombe à son tour dans la même démarche non marxiste qu'il venait de critiquer à juste raison chez Lénine.
Avec 1968 et la reprise de la lutte de classes, le prolétariat renoue le fil rompu par près d'un demi-siècle de contre-révolution triomphante et se réapproprie les travaux de cette gauche qui avait survécu au naufrage de l'Internationale Communiste.
Aujourd'hui, les écrits et les débats de cette Gauche, longtemps ignorés, ressortent et trouvent des lecteurs de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, "Lénine philosophe" de Pannekoek -comme tant d'autres ouvrages d'autres auteurs- a pu être imprimé et lu par des milliers de militants ouvriers. Mais pour que ces travaux théorico-politiques puissent vraiment servir au développement de la pensée et de l'activité révolutionnaire aujourd'hui, ils doivent être étudiés dans un esprit critique, en se gardant de l'esprit d'un certain milieu d'universitaires qui, découvrant tel ou tel auteur, sont prompts à en faire une nouvelle tarte à la crème, une nouvelle idolâtrie, et s'en font les apologistes inconditionnels.
Face à un "néo anti-bolchevisme" à la mode aujourd'hui chez certains groupes et revues comme le PIC ou l'ex-Spartacus, qui raye tout simplement tout le mouvement socialiste et communiste de Russie, y compris la révolution d'Octobre, de l'histoire du prolétariat, nous pouvons reprendre ce qu'écrivait Internationalisme dans son avant propos au livre de J. Harper :
°Cette déformation du marxisme, que nous devons aux "marxistes" aussi empressés qu'ignorants, trouve son pendant en ceux qui, non moins ignorants, font de 1"'anti-marxisme" leur spécialité propre. L'anti-marxisme est devenu aujourd'hui l'apanage de toute une couche de semi-intellectuels petits bourgeois déracinés, déclassés, aigris et désespérés qui, répugnant au monstrueux système russe issu de la révolution prolétarienne d'Octobre, et répugnant au travail ingrat, dur, de 1a recherche scientifique, s'en vont par le monde, les cendres de deuil sur la tête, dans une "croisade sans croix", à la recherche de nouveaux idéaux, non à comprendre, mais à adorer".
Ce qui était vrai hier pour le marxisme, l'est aujourd'hui également pour le bolchevisme et la révolution d'Octobre.
M.C.
POLITIQUE ET PHILOSOPHIE DE LENINE A HARPER
I1 est indiscutable, après la lecture du document de Harper sur Lénine, que nous nous trouvons devant une étude sérieuse et profonde sur l'oeuvre philosophique de Lénine et devant une esquisse très claire et très nette de la dialectique marxiste que Harper oppose à la conception philosophique de Lénine.
Le problème pour Harper s'est posé de la façon suivante : plutôt que de séparer les conceptions du monde d'un Lénine de son activité politique, il est préférable, pour mieux voir et comprendre ce que le révolutionnaire a entrepris, de discuter et de saisir ses origines dialectiques. L'oeuvre qui, pour Harper, caractérise le mieux Lénine, sa pensée, est "Matérialisme et Empiriocriticisme", où, partant à l'attaque d'un net idéalisme qui pointait dans l'intelligentsia russe avec la conception philosophique d'un Mach, Lénine essaye de revivifier un marxisme qui venait de subir des révisions, non seulement de la part de Bernstein, mais également de la part de Mach.
Harper introduit le problème par une analyse très perspicace et approfondie de la dialectique chez Marx et Dietzgen. Bien mieux, tout au long de son étude, Harper tâchera de faire une discrimination profonde entre le Marx des premières études philosophiques et le Marx mari par la lutte de classe et se dégageant de l'idéologie bourgeoise. Au travers de cette discrimination, il dégage les fondements contradictoires du matérialisme bourgeois de l'époque prospère du capitalisme qu'il caractérise dans les sciences naturelles, et du matérialisme révolutionnaire concrétisé dans les sciences du développement et du devenir social. Harper s'efforcera de réfuter certaines assertions de Lénine qui, à son avis, ne correspondent pas à la pensée "machiste", mais sont uniquement du ressort de la polémique de la part de ce Lénine qui aurait cherché plus à résoudre "l'unité du parti socialiste russe qu'à réfuter la vraie pensée de Mach".
Mais si le travail de Harper présente un intérêt dans son étude sur la dialectique, ainsi que dans la correction de la pensée de Mach à la manière de Lénine, la partie la plus intéressante parce que lourde de conséquences, est sans conteste l'analyse des sources du matérialisme chez Lénine, et leur influence sur l'oeuvre et l'action de ce dernier dans la discussion socialiste internationale et dans la révolution de 1917 en Russie.
La première phase de la critique commence par l'étude des ancêtres philosophiques de Lénine.
De d'Holbach, en passant par certains matérialistes français tels Lamétrie et jusqu'à Avenarius, la pensée de Lénine s'y dessine noir sur blanc. Tout le problème réside sur la théorie de la connaissance. Même Plekhanov n'a pas échappé à cette embûche du matérialisme bourgeois. Marx est précédé par Feuerbach. Et ceci sera un lourd handicap dans la pensée sociale de tout le marxisme russe, Lénine en tête.
Harper, très justement, délimite, dans la théorie de la connaissance, les sources du matérialisme bourgeois qui sombrera par statisme, et du matérialisme révolutionnaire qui ne suit pas ou ne dépasse pas la dialectique bourgeoise, mais est de nature et d'orientation différentes.
D'une part, la bourgeoisie considère la connaissance comme un phénomène purement réceptif (Engels -d'après Harper- sur ce point seulement partagera cette conception). Qui dit connaissance dit perception, sensation du monde extérieur, notre esprit se comportant comme un miroir reflétant plus ou moins fidèlement le monde extérieur. On comprend à ce moment-là que les sciences naturelles furent le cheval de bataille du monde bourgeois. La physique, la chimie, la biologie dans leurs premières expressions, représentent plus un travail de traduction de phénomènes du monde extérieur qu'une tentative d'interprétation. La nature semble être un grand livre grâce auquel on transcrit en signes intelligibles des manifestations naturelles. Tout parait ordonné, rationnel, ne souffrant aucune exception, si ce n'est l'imperfection de nos moyens de réception. En conclusion, la science devient une photographie d'un monde dont les lois sont toujours les mêmes, indépendantes de l'espace et du temps, mais dépendantes de l'un et de l'autre pris séparément.
Cette tentative première des sciences doit naturellement prendre pour objet ce qui est extérieur à l'homme, car ce choix exprime une facilité plus grande à saisir le monde extérieur sensible, que le monde humain plus enchevêtré et dont les lois se refusent aux signes équationnels à un seul sens, des sciences naturelles. Mais aussi doit-on voir là surtout un besoin pour la bourgeoisie dans son développement de saisir rapidement et empiriquement ce qui extérieur à elle, peut servir le développement de sa force sociale de production. Rapidement, car les assises du système économico social ne sont pas encore solides, empiriquement, car la genèse du capitalisme se déroule sur un terrain fertile, qui, aux yeux des humains fait ressortir surtout les résultats et les conclusions, plutôt que le cheminement parcouru pour y arriver.
Les sciences naturelles dans le matérialisme bourgeois devaient influencer la connaissance des autres phénomènes et donner naissance aux sciences humaines, histoire, psychologie, sociologie, où les mêmes méthodes de la connaissance étaient appliquées.
Et le premier objet de la connaissance humaine qui préoccupe les esprits se trouve être la religion, laquelle est étudiée comme un problème historique pour la première fois, et non comme un problème philosophique. Cela aussi exprime le besoin d'une bourgeoisie jeune à se débarrasser du fixisme religieux qui nie la rationalité naturelle du système capitaliste.
Cela s'exprime par l'éclosion d'une floraison de savants bourgeois, comprenant Renan, Strauss, Feuerbach, etc. Mais c'est toujours une dissection méthodologique qui s'opère, l'homme cherchant non à critiquer socialement un corps idéologique, tel la religion, mais plutôt à retrouver ses fondements humains, pour la réduire au niveau des sciences naturelles et avec un scalpel permettre la photographie des documents poussiéreux et des altérations subies dans le cours des siècles. Enfin, le matérialisme bourgeois normalise un état de fait, fixe pour l'éternité un mode immuable de développement. C'est regarder la nature comme une répétition indéfinie de causes rationnelles. L'homme ramène la nature à un désir de statisme conservateur. I1 sent qu'il domine la nature d'une certaine manière, il ne voit pas que ses instruments de domination sont en train de se libérer de l'homme et de se retourner contre lui. Le matérialisme bourgeois est une étape progressive dans la connaissance humaine. I1 devient conservateur jusqu'à être rejeté par la bourgeoisie elle-même quand le système capitaliste à son apogée dessine déjà sa chute.
De ce mode de pensée qui se fait encore sentir dans l'oeuvre de jeunesse de Marx, Harper voit dans la prise de conscience de la lutte de classe, chez les masses travailleuses, au travers des premières contradictions importantes du régime capitaliste, le chemin qui conduit la pensée de Marx vers le matérialisme révolutionnaire.
Le matérialisme révolutionnaire, insiste Harper, n'est pas un produit rationnel ; si le matérialisme bourgeois éclot dans un milieu économico social spécifique, le matérialisme révolutionnaire aura lui aussi besoin d'un milieu économico social spécifique. Marx à ces deux époques prend conscience d'une existence qui se modifie. Mais là où la bourgeoisie n'a vu que rationalisme, répétition de cause à effet, Marx sent, dans le milieu économico social évoluant,un élément nouveau qui s'introduit dans le domaine de la connaissance. Sa conscience n'est pas une photographie du monde extérieur, son matérialisme est animé de tous les facteurs naturels, l'homme en premier lieu.
La bourgeoisie pouvait négliger la part de l'homme dans la connaissance, car son système à ses débuts se déroulait comme les lois astronomiques, avec une régularité précise, de plus son système économique laissait l'homme en dehors.
Cette négligence du système par rapport à l'homme commence vers le milieu du 19ème siècle à se faire sentir dans les rapports sociaux. La conscience révolutionnaire alors mûrit, sa connaissance n'est pas seulement un miroir du monde extérieur, comme le prétend le matérialisme bourgeois, l'homme entre dans la connaissance du monde comme un facteur réceptif et de plus comme un facteur agissant et modifiant.
La connaissance pour Marx devient alors le produit de la sensation du monde extérieur et de l'idéeaction de l'homme facteur moteur de la connaissance.
Les sciences du développement social et du devenir social sont nées, éliminant les vieilles sciences humaines, exprimant une progression et un déroulement senti et agi. Les sciences naturelles elles-mêmes sortent de leur cadre étroit. La science du 19ème siècle bourgeois s'écroule à cause de sa cécité.
C'est ce manque de praxis dans la connaissance qui spécifiera la nature idéologique de Lénine. Si Harper recherche les sources philosophiques de Lénine, il ne leur attribuera pas d'influence décisive dans l'action de Lénine.
L'existence sociale conditionne la conscience. Lénine est issu d'un milieu social retardé, la féodalité règne encore, et la bourgeoisie n'est pas une classe forte et capable révolutionnairement. Le phénomène capitaliste en Russie se présente à une période où la bourgeoisie développée et mûrie en Occident dessine déjà sa courbe décadente. La Russie devient un terrain capitaliste, non par le fait d'une bourgeoisie nationale s'opposant à l'absolutisme féodal du Tsar, mais par l'ingérence du capital étranger, qui crée ainsi, de toutes pièces, l'appareil capitaliste en Russie. Parce que le matérialisme bourgeois s'enlise par le développement de son économie et de ses contradictions, l'intelligentsia russe ne trouve pour lutter contre l'absolutisme impérial que le matérialisme révolutionnaire. Mais l'objet de la lutte dirigera le matérialisme révolutionnaire contre la féodalité et non contre le capitalisme qui ne représente aucune force effective. Lénine fait partie de cette intelligentsia en ce que puisant dans la seule classe révolutionnaire, le prolétariat, il tente de réaliser la transformation capitaliste retardée de la Russie féodale.
Cette énonciation n'est qu'une interprétation de Harper qui verra dans la révolution russe une maturité objective de la classe ouvrière et un contenu politique bourgeois exprimé par Lénine qui subit dans sa conscience des tâches de l'heure en Russie. l'existence économico sociale de ce pays se comportant au point de vue du capital comme une colonie, dont la bourgeoisie nationale serait nulle, et dont les deux forces en présence serait l'absolutisme et la classe ouvrière.
Le prolétariat s'exprime alors en fonction de ce retard qui est caractérisé par l'idéologie matérialiste bourgeoise d'un Lénine.
Voila la pensée d'un Harper sur Lénine et la révolution russe. Une phrase de Harper :
"Cette philosophie matérialiste était précisément la doctrine qui convenait parfaitement à 1a nouvelle masse d'intellectuels russes qui dans les sciences physiques et dans la technique ont vite reconnu avec enthousiasme la possibilité de gérer la production et comme nouvelle classe dominante d'un immense empire ont vu s'ouvrir devant eux l'avenir -avec la seule résistance de la vieille paysannerie religieuse". (« Lénine philosophe » Ch.VIII)
La méthode de Harper, ainsi que son mode d'interprétation du problème de la connaissance, sont dignes avec "Lénine philosophe" de figurer parmi les meilleures oeuvres du marxisme. I1 nous entraîne cependant, quant à ses conclusions politiques, vers une telle confusion, que nous nous sentons obligés de l'examiner de près pour tenter de dissocier l'ensemble de sa formulation du problème de la connaissance d'avec ses conclusions politiques qui nous paraissent erronées et ne pas même être en rapport avec le niveau général du travail.
Harper nous dit : "...le matérialisme n'a dominé l'idéologie de la classe bourgeoise que pendant un temps très court...". Ce qui lui permet par la suite -après avoir prouvé que la philosophie de Lénine dans "Matérialisme et Empiriocriticisme" était essentiellement matérialiste bourgeoise- de dire que la révolution bolchevik d'octobre 1917 était une "révolution bourgeoise appuyée sur le prolétariat".
Harper s'enferme ici dans sa propre dialectique et ne nous explique pas ce premier phénomène de sa pensée et de l'histoire : comment se fait-il que la révolution bourgeoise produisant elle-même sa propre idéologie, cette idéologie étant dans la période révolutionnaire, matérialiste, comment se fait-il qu'au moment où s'engage la crise la plus aigue du capitalisme (entre 1914 et 1920), crise qui ne semble pas troubler Harper, comment se fait il qu'à ce moment une révolution bourgeoise ait été propulsée exclusivement par la partie la plus consciente et l'avant-garde des ouvriers et des soldats russes, avec qui se solidarisèrent des ouvriers et des soldats du monde entier, et, principalement, du pays (l'Allemagne) où le capitalisme était le plus développé ? Comment se fait-il que justement à cette époque, les marxistes, les dialecticiens les plus éprouvés, les meilleurs théoriciens du socialisme défendant aussi bien sinon mieux que Lénine la conception matérialiste de l'histoire , comment se fait-il que par exemple des Plekhanov et des Kautsky se trouvaient justement dans le camp de la bourgeoisie contre les ouvriers et les soldats révolutionnaires du monde entier en général, et contre Lénine et les bolcheviks en particulier ? Harper ne pose même pas toutes ces questions ; comment pourrait-il y répondre ? Mais c'est justement le fait qu'il ne les ait pas posées qui nous étonne.
De plus, le long développement philosophique, quoique juste dans l'ensemble de son développement, comporte certaines affirmations qui en altèrent la portée. Harper tend à faire (parmi les théoriciens du marxisme) une séparation entre deux conceptions fondamentalement opposées, au sein de ce courant idéologique, quant au problème de la connaissance (et la manière de l'aborder). Cette séparation qui remonterait à l'oeuvre et à la vie de Marx lui-même est quelque peu simpliste et schématique. Harper voit d'une part dans l'idéologie de Marx lui-même deux périodes :
1) Jusqu'à 1848, Marx matérialiste bourgeois progressiste : "...la religion est l'opium du peuple...", phrase reprise ensuite par Lénine et que pas plus Staline que la bourgeoisie russe n'ont cru nécessaire d'enlever des monuments officiels ni même en tant que but de propagande du parti ;
2) Ensuite, Marx 2ème manière, matérialiste et dialecticien révolutionnaire, l'attaque contre Feuerbach, le Manifeste Communiste, etc. : « ...1'existence conditionne la conscience ».
Harper pense que ce n'est pas un hasard que l'oeuvre de Lénine ("Matérialisme et Empiriocriticisme") soit essentiellement représentative du marxisme première manière, et il en arrive, partant de là, à l'idée selon laquelle l'idéologie de Lénine était déterminée par le mouvement historique auquel il participait et dont la nature profonde apparaîtrait selon Harper, être fournie par la nature même, matérialiste bourgeoise de l'idéologie de Lénine (Harper ne s'en tenant qu'à "Matérialisme et Empiriocriticisme").
Cette explication mène à la conclusion de Harper, selon laquelle 1"'Empiriocriticisme" serait aujourd'hui la bible des intellectuels techniciens et autres, représentants de la nouvelle classe capitaliste d'Etat montante : la révolution russe et les bolcheviks en tête, aurait été une préfiguration d'un mouvement plus général d'évolution révolutionnaire, du capitalisme au capitalisme d'Etat, et de mutation révolutionnaire de la bourgeoisie libérale en bourgeoisie bureaucratique d'Etat, dont le stalinisme serait la forme la plus achevée.
Cette conception de Harper laisse ainsi à penser que cette classe qui prendrait partout pour bible "Empiriocriticisme" (que Staline et ses amis continueraient à défendre) s'appuierait essentiellement sur le prolétariat pour faire sa révolution capitaliste d'Etat et, d'après Harper, ce serait la raison qui déterminerait cette nouvelle classe à s'appuyer sur le marxisme dans cette révolution.
Cette explication tendrait donc à prouver, pour qui le voudrait bien, que le marxisme première manière, conduit directement à Staline en passant par Lénine (ce que nous avons déjà entendu de la bouche de certains anarchistes pour ce qui est du marxisme en général, dont Staline serait l'aboutissement logique -la logique anarchiste!?) et qu'une nouvelle classe révolutionnaire capitaliste appuyée sur le prolétariat surgirait dans l'histoire justement au moment où le capitalisme lui-même entre dans une crise permanente du fait d'un hyper développement de ses forces productives dans le cadre d'une société basée sur l'exploitation du travail humain (la plus-value).
Ces deux idées que Harper tend à introduire dans son ouvrage "Lénine philosophe" qui date d'avant la guerre de 1939-45, sont elles-mêmes énoncées par d'autres que lui, venant de milieux sociaux et politiques différents que lui, et sont devenues très en vogue après cette guerre. Elles sont défendues actuellement, la première par de très nombreux anarchistes, et la seconde par de très nombreux bourgeois réactionnaires dans le genre de James Burnham.
Que les anarchistes arrivent à de telles conceptions mécanistes et schématiques, selon lesquelles le marxisme serait à la base du stalinisme et de "l'idéologie capitaliste d'Etat", ou de la nouvelle classe "directoriale", ceci n'est pas étonnant de leur part. Ils n'ont jamais rien compris aux problèmes de la philosophie comme les révolutionnaires l'entendent : ils font découler Marx d'Auguste Comte, comparent cette assimilation à Lénine, et font découler de là "l'idéologie bolcheviste staliniste" et y rattachent tous les courants marxistes, sans exception, prenant pour leur, en tant que mode de pensée philosophique, tous les dadas à la mode, tous les idéalismes, de l'existentialisme au nietzschéisme, ou de Tolstoi à Sartre.
Or, cette affirmation de Harper selon laquelle "Empiriocriticisme" de Lénine serait un ouvrage philosophique dont l'interprétation du problème de la connaissance n'y dépasserait pas la méthode d'interprétation matérialiste bourgeoise mécaniste, et faisant découler de cette constatation la conclusion selon laquelle les bolcheviks, le bolchevisme et la révolution russe ne pouvaient pas dépasser le stade de la révolution bourgeoise, ces affirmations, comme nous le voyons, ne nous mènent pas seulement aux conclusions des anarchistes et de bourgeois comme Burnham ; cette affirmation est avant tout en contradiction avec une autre affirmation de Harper qui est, celle-là, en partie juste :
"Le matérialisme n'a dominé l'idéologie de la classe bourgeoise que pendant un temps très court. Tant que celle-ci pouvait croire que la société avec son droit à la propriété privée, sa liberté individuelle et sa libre concurrence pouvait résoudre tous les problèmes vitaux de chacun grâce au développement de la production sous l'impulsion du progrès illimité de la science et de la technique, elle pouvait admettre que la science avait résolu les principaux problèmes théoriques et n'avait plus besoin d'avoir recours aux forces spirituelles supranaturelles. Mais le jour où la lutte de classe du prolétariat eût révélé le fait que le capitalisme n'était pas en mesure de résoudre le problème de l'existence des masses, sa philosophie optimiste et matérialiste du monde disparut. Le nouveau, le monde apparût plein d'incertitudes et de contradictions insolubles, plein de puissances occultes et menaçantes...".
Nous reviendrons par la suite sur le fond de ces problèmes, mais nous sommes contraints de noter, sans vouloir faire de vaine polémique, les contradictions insolubles dans lesquelles Harper s'est mis lui-même, d'une part en attaquant le problème si complexe qu'il a attaqué d'une manière quelque peu simpliste et d'autre part les conclusions auxquelles il devait être amené quant au bolchevisme et au stalinisme.
Comment peut-on expliquer, répétons-nous, d'après les idées de Harper, le fait que, au moment où la lutte de classe du prolétariat apparut, la bourgeoisie devenait idéaliste et que c'est justement au moment où la lutte de classe se développe avec une ampleur inconnue jusque là dans l'histoire, que naît, de la bourgeoisie un courant matérialiste donnant naissance à une nouvelle classe bourgeoise capitaliste. Ici Harper introduit une idée selon laquelle, si la bourgeoisie devait devenir absolument idéaliste, si on peut déceler chez Lénine un courant matérialiste bourgeois, Lénine "était obligé d'être matérialiste pour entraîner derrière lui les ouvriers". Nous pouvons nous poser la question suivante : que ce soient les ouvriers qui aient adopté l'idéologie de Lénine, ou Lénine qui se soit adapté aux besoins de la lutte de classe, selon les conclusions de Harper, ou bien le prolétariat suivait un courant bourgeois, ou un mouvement ouvrier se promouvait en sécrétant une idéologie bourgeoise. Mais de toute façon, le prolétariat ne nous apparaît pas ici avec une idéologie propre. Quel piètre matérialiste marxiste pourrait affirmer une telle chose : le prolétariat entre en action indépendante en produisant une idéologie bourgeoise. C'est là que nous mène Harper.
Du reste, il n'est pas entièrement exact que la bourgeoisie soit elle-même à une certaine époque totalement matérialiste et à une certaine autre totalement idéaliste. Dans la révolution bourgeoise de 1789, en France, le culte de la Raison n'a fait que remplacer celui de Dieu et était typique du double caractère des conceptions à la fois matérialiste et idéaliste de la bourgeoisie en lutte contre le féodalisme, la religion et le pouvoir de l'Eglise (sous la forme aiguë de persécutions des prêtres, des incendies d'églises, etc.). Nous reviendrons également sur ce double aspect permanent de l'idéologie bourgeoise ne dépassant pas, même aux heures les plus avancées de la "Grande Révolution" bourgeoise en France, le stade de "...la religion est l'opium du peuple".
Cependant, nous n'avons pas tiré encore toutes les conclusions vers lesquelles Harper nous entraîne, nous en tirerons quelques unes et nous ferons quelques rappels historiques qui peuvent intéresser tous ceux qui "rejettent" la révolution d'octobre dans le camp bourgeois.
Si ce premier regard jeté sur les conclusions et les théories philosophiques de Harper nous a entraîné vers certaines réflexions qui seront l'objet de développements ultérieurs, il y a des faits que nous devons pour le moins relever immédiatement car il s'agit de faits historiques que Harper semble n'avoir pas même voulu effleurer.
En effet, Harper nous parle pendant des dizaines de pages de la philosophie bourgeoise, de la philosophie de Lénine, et arrive à des conclusions pour le moins osées et qui demandaient, tout au plus, un examen sérieux et approfondi. Or, quel matérialiste marxiste peut accuser un homme, un groupe politique ou un parti de ce dont Harper accuse Lénine, les bolcheviks et leur parti, d'avoir représenté un courant et une idéologie bourgeoise « ...s'appuyant sur 1e prolétariat... », sans avoir auparavant examiné -au moins pour mémoire- le mouvement historique auquel ils ont été mêlés : ce courant, la Social-démocratie russe et internationale, d'où est issue (au même titre que toutes les autres fractions de gauche de la Social-démocratie) la fraction des bolcheviks.
Comment s'est formée cette fraction ? Quelles luttes a-t-elle été amenée à entreprendre sur le plan idéologique pour arriver à former un groupe à part, puis un parti, puis l'avant-garde d'un mouvement international ?
De la lutte contre le menchevisme, de l'Iskra et de "Que faire ?" de Lénine et de ses camarades, de la révolution de 1905 et du rôle de Trotski, de sa "Révolution permanente" (qui devait l'amener à fusionner avec le mouvement bolchevik entre février et octobre 1917), de la seconde révolution de février à octobre (sociaux-démocrates, socialistesrévolutionnaires de droite, etc., au pouvoir), des thèses d'avril de Lénine, de la constitution des soviets et du pouvoir ouvrier, de la position de Lénine dans la guerre impérialiste, de tout cela Harper ne dit mot. On ne peut croire que cela soit un hasard.
Mousso et Philippe
(à suivre)
[1] [93] "Lénine philosophe", introduction de Paul Mattick, édition Spartacus, 1978.
Courants politiques:
- Le Conseillisme [94]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 26 - 3e trimestre 1981
- 2632 lectures
Présentation des rapports et résolutions du 4eme congrès du CCI.
- 2619 lectures
« Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi »
L'histoire s'accélère. Les plaies béantes du vieux monde s'approfondissent et se multiplient.
En un an dans les pays sous-développés, la faim a tué autant d'hommes que l'a fait la Deuxième Guerre Mondiale en six ans de feu. Les prolétaires des pays dits "communistes" connaissent les pénuries alimentaires des temps de guerre. L'économie du bloc occidental s'enlise de plus en plus, irréversiblement, jetant des millions de prolétaires dans la rue.
La seule production qui augmente réellement c'est celle de l'armement.
Simultanément, la réponse de la classe ouvrière - du Brésil à la Chine, de la Grande Bretagne à la Pologne - s’accélère, se confirme et s'approfondit posant de plus en plus dans les faits la question de la nécessité de 1'INTERNATIONALISATION de l'action des prolétaires de tous les pays.
Avec les luttes en Pologne, à nouveau le monde entier a été obligé de dire : "Les ouvriers ont fait ...". La classe révolutionnaire que porte en elle la classe ouvrière est une fois de plus apparue au grand soleil.
Et cela a donné un violent coup d'accélérateur à l'histoire. Le vieux monde craque de toutes parts alors même que son fossoyeur relève la tête.
Le vent de Gdansk annonce de prochaines tempêtes révolutionnaires.
Il y a deux ans, au IIIe Congrès nous disions que les années 80 seraient "LES ANNEES DE VERITE". Les événements ont déjà entrepris de vérifier cette affirmation.
De plus en plus les révolutionnaires seront confrontés à la difficulté de comprendre et d'analyser "calmement" les choses, alors que tout va de plus en plus vite.
Le IVe Congrès a été traversé par le nouveau rythme de l'histoire et l'organisation a pu prendre l'exacte mesure des nouvelles difficultés qu'entraine pour les révolutionnaires cette "accélération" tant attendue.
Marx disait dans le Manifeste Communiste que "du point de vue théorique, (les communistes) ont sur la masse prolétarienne l'avantage de comprendre les conditions, la marche et les résultats généraux du mouvement ouvrier." Mais cet "avantage" ne leur est donné ni automatiquement ni miraculeusement par le simple fait qu'ils se constituent en organisation politique. S'ils l'acquièrent c'est par un constant travail COLLECTIF de confrontation permanente de leurs analyses avec la réalité historique et vivante ainsi que par un débat généralisé et conséquent au sein de leurs organisations.
Les textes du IVe Congrès que nous publions dans ce numéro illustrent l'effort du Courant pour réellement comprendre "les conditions, la marche et les résultats généraux du mouvement ouvrier".
Les rapports et les résolutions sont des textes introductifs ou de conclusion des débats. La "contre-résolution sur la lutte de classe" a été une contribution et un instrument du débat, développant un point de vue différent de celui "majoritaire" adopté finalement par le Congrès.
Le rapport "CRISE ECONOMIQUE GENERALISEE ET CONFLITS INTER-IMPERIALISTES" ainsi que la RESOLUTION SUR LA SITUATION INTERNATIONALE" tracent la perspective de l'aggravation de la crise économique capitaliste et de l'évolution des tensions entre puissances et blocs capitalistes.
Le rapport "PERSPECTIVES DE LA LUTTE DE CLASSE INTERNATIONALE (UNE BRECHE OUVERTE EN POLOGNE)" et la «RESOLUTION SUR LA LUTTE DE CLASSE" font le point sur l'évolution de l'affrontement entre les deux principales classes de la société. Ils analysent aussi bien les forces et les faiblesses du prolétariat que celles de son ennemi : la bourgeoisie mondiale.
Le texte "LES CONDITIONS HISTORIQUES DE LA GENERALISATION DE LA LUTTE DE LA CLASSE OUVRIERE" aborde le principal problème posé par les luttes ouvrières en Pologne : la nécessité de l'internationalisation des combats prolétariens pour qu'ils puissent épanouir leur puissance révolutionnaire.
La "CONTRE-RESOLUTION SUR LA LUTTE DE CLASSE" (signée Chénier) se penche surtout sur le rapport entre le développement de la crise politique de la bourgeoisie et celui de la lutte prolétarienne.
Contrairement à la résolution adoptée par le Congrès qui insiste sur les efforts de la bourgeoisie pour mettre en place internationalement une même stratégie face au prolétariat {"la gauche dans l'opposition") et pour répondre de façon coordonnée à la menace ouvrière internationale, le texte du camarade Chenier insiste surtout sur "la bourgeoisie décadente, sénile et incapable d'homogénéité face à son ennemi historique".
L'ensemble de ces travaux donneront au lecteur l'analyse générale de la situation historique au point où est parvenu le CCI lors de son 4ème congrès international.
"Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés par tel ou tel réformateur du monde.
Elles ne font qu'exprimer, en termes généraux, les conditions réelles d'une lutte de classe qui existe, d'un mouvement historique qui se déroule sous nos yeux".
(Manifeste Communiste)
Conscience et organisation:
Perspectives de la lutte de classe internationale (une brèche ouverte en Pologne)
- 2779 lectures
1/LES ANNEES DE VERITE
"Dans les années 60, la bourgeoisie nous a donné de la misère en échange de miettes, dans les années 70, elle nous a donné encore plus de misère en échange de promesses ; pour les années 80, elle nous réserve beaucoup plus de misère. en échange de l a misère." ([1] [96])
.1. La situation actuelle de la crise capitaliste oblige les deux classes fondamentales de la société -le prolétariat et la bourgeoisie- à lutter à mort, sans ambigüité, pour imposer leurs alternatives historiques respectives : la Révolution ou la Guerre, le Communisme ou la Barbarie.
.2. D'une part la bourgeoisie a vu la faillite de tous les plans de "relance" économique expérimentés par tous les moyens dans les années 70, et prouvant chaque fois plus que sa seule "solution" est une 3ème guerre mondiale impérialiste.
D'autre part, le fait que le prolétariat n'est pas vaincu et les manifestations constantes de résistance de la classe ouvrière (dont la Pologne est l'expression la plus haute) obligent la bourgeoisie à poser radicalement la "question sociale", c'est-à-dire que toute son activité politique et économique en direction de la guerre ne peut avoir comme axe qu'une stratégie conséquente d'affrontement et de défaite du prolétariat.
.3. Pour le prolétariat, la perspective d'une "solution" à la crise à l'intérieur du capitalisme, qui a pu désorienter et freiner sa lutte au cours des années 70, laisse la place à une réalité amère de dégradation permanente et absolue de ses conditions d'existence. La misère que lui impose le capitalisme cesse d'être un simple phénomène quantitatif pour devenir une réalité QUALITATIVE de dégradation, d'insécurité et d'humiliation de toute son existence.
Le prolétariat apprend que les luttes purement économiques et les affrontements exclusivement partiels et limités finissent par n'avoir aucun effet sur la bourgeoisie et que les miettes RELATIVES ET MOMENTANEES arrachées comme fruit des grands combats de 1965 à 1973 ont disparu sans laissé de trace au cours de ces 5 dernières années et ont cédé le pas à une chute sans précédent et sans frein de son niveau de vie. Tout cela indique une seule perspective : l'affrontement généralisé avec le capital dans la dynamique de la révolution.
.4. C'est à partir de cet ensemble de conditions historiques globales que nous devons évaluer l’état actuel de la lutte de classe. La question est : comment le prolétariat et la bourgeoisie répondent-ils à cette situation historique de croisée des chemins ? C'est en partant de là que nous allons analyser la stratégie et les armes qu'emploie la bourgeoisie et faire le bilan des expériences, des forces et des faiblesses des luttes développées par la classe ouvrière.
2/LA REPONSE DE LA BOURGEOISIE
.5. Au 3ème Congrès international du CCI (cf. "Revue Internationale" n°18), nous avons constaté la réalité d'une crise politique généralisée de la bourgeoisie mondiale et analysé en détails les caractéristiques et manifestations de cette réalité. Ses causes -nous pouvons aujourd'hui les déterminer avec plus de perspective- provenaient de l'INADEQUATION de la politique bourgeoise à la conjoncture imposée par l'aggravation de la crise et des conflits impérialistes, étant donnée la reprise de la lutte ouvrière commencée en 1978 et, plus globalement, à cette situation de croisée des chemins que nous avons définie dans le premier point comme les années de vérité.
Le dénouement de cette crise politique a été la REORIENTATION TOTALE de la stratégie bourgeoise face à la situation et en particulier face au prolétariat. La réorientation de l'appareil et de l'action politique de la bourgeoisie lui ont permis une plus grande cohérence et une offensive plus systématique, plus concentrée et plus efficace contre le prolétariat. Dans l'immédiat la bourgeoisie S'EST RENFORCEE, quoique, comme nous le verrons, plus loin, ce renforcement s'inscrive da dans un affaiblissement à long terme de la bourgeoisie.
.6. L'axe essentiel de cette réorientation est, comme nous l'avions mis en évidence au 3ème congrès du CCI, le passage de la gauche dans l'opposition, ce qui a pour conséquence l'accès de la droite au pouvoir. Mais avant d'analyser en détail cet axe, il faut déterminer le cadre idéologique qui caractérise l'ensemble de la politique bourgeoise dans la situation actuelle.
La domination capitaliste s'appuie sur deux piliers. L'un est la répression et la terreur, l'autre, cachant et renforçant le premier, est la mystification, le mensonge idéologique. Ce second pilier doit toujours s'appuyer sur une base matérielle qui le rend crédible. S'il existe, dans l'idéologie bourgeoise, toute une série de mystifications qui s'appuient dans les fondements les plus profonds du capitalisme (démocratie, "droits de l'homme"), l'ensemble de l'idéologie bourgeoise, c'est-à-dire 1'ensemble des mystifications et des choix qui cimentent sa domination, doit se modifier suivant les différentes conjonctures imposées par la crise, la lutte de classe, et les conflits impérialistes, sous peine de perdre toute crédibilité et, pour autant, affaiblir son contrôle sur le prolétariat.
Dans les années 70, ce cadre idéologique tournait autour de l'illusion que les ouvriers, en faisant toute une série de sacrifices et en acceptant une politique d'austérité croissante, pourront "sortir de la crise" et retrouver la "prospérité" perdue. A travers le mythe d'une solution nationale et négociée à la crise, qui était incarnée dans la perspective de la gauche au pouvoir et dont l'idéologie constante était "l'avance des forces progressistes et le changement social", la bourgeoisie a pu maintenir sa domination en freinant et en paralysant momentanément la lutte des ouvriers, en leur faisant avaler des doses croissantes d'austérité et en reconstruisant l'union nationale autour de ses plans.
Le 3ème congrès du CCI a pris acte de la crise de cette orientation idéologique et a analysé l'ensemble des conditions objectives qui l'ont jetée par terre ; en même temps, il a fait le bilan de la reprise de la lutte prolétarienne qui, conséquence et cause à la fois de cet affaiblissement de la domination bourgeoise, se développait. Si la bourgeoisie avait continué avec les mêmes orientations politiques et idéologiques que celles de l'étape antérieure, elle aurait aggravé le vide dangereux qui se produisait dans son contrôle sur la société. Les deux dernières années (1977-79) montraient à travers toute une série de crises politiques et idéologiques, le processus par lequel la bourgeoisie réorientait sa stratégie et son idéologie.
La bourgeoisie reconnait ouvertement la gravité de ïa crise, et nous présente, même en l'exagérant, un cadre terrorisant de catastrophes et de dangers qui menacent la "communauté nationale", elle parle sans détour de la perspective de la guerre...C'est le nouveau "langage" de la "sincérité" et de la "vérité".
Dans ce sombre cadre démoralisant et sans perspectives, où la " communauté nationale" serait soumise à toutes sortes de dangers produits par toutes sortes de forces ténébreuses et difficiles à situer quelque part -le "terrorisme", 1'"encerclement impérialiste ", le "totalitarisme", etc.- il ne resterait plus d'autre remède que d'accepter les pires sacrifices et avaler la politique "de sang, de sueur et de larmes" pour sauver "le peu que nous avons".
La bourgeoisie tente de refaire l'union nationale à travers la "sincérité" en cherchant la démoralisation totale des ouvriers. Ainsi la bourgeoisie s'adapte à la situation de chaos et de décomposition de son système social, tente d'y enfoncer le prolétariat et cherche à profiter de l'attitude actuelle de la classe ouvrière de préoccupation et de maturation face à la gravité du moment historique et face aux énormes responsabilités que pose celui-ci, en la transformant en son contraire : DEMORALISATION, APATHIE, DESESPOIR, DEBANDADE...
Naturellement, cette orientation idéologique de la bourgeoisie ne peut avoir comme finalité que la déroute du prolétariat et sa soumission inconditionnelle aux plans de guerre, et ne peut être appliqué qu'au moyen de la gigantesque action d'usure et de division que réalisent la gauche et les syndicats à partir de l'opposition.
.7. Sous le capitalisme décadent, l'Etat, "démocratique" ou "dictatorial", se transforme en un appareil totalitaire monstrueux qui étend ses tentacules sur toute la vie sociale et soumet le prolétariat à une OCCUPATION absolue et systématique. Dans les pays du totalitarisme "démocratique" cette occupation est la FONCTION SPECIFIQUE des partis de gauche (staliniens, social-démocrate avec leurs appendices gauchistes) et des syndicats.
Comme nous l'avons souligné au 3ëme congres du CCI, l'orientation de la gauche au pouvoir qui a dominé les années 70, a produit une usure énorme de ses appareils, affaiblissant son contrôle sur le prolétariat, manquant ainsi à cette FONCTION SPECIFIQUE au sein de l'Etat bourgeois, qui est l'encadrement du prolétariat. Tout cela a produit une crise profonde au sein de ces appareils qui ont été conduits à se situer sur un terrain d'où ils peuvent réaliser d'une façon plus adéquate leur rôle, c'est à dire l'opposition.
En effet, c'est seulement à partir de l'opposition (libérés des responsabilités gouvernementales directes) que la gauche et les syndicats peuvent se consacrer à fond, sans hypothèque ni ambigüité, à leur rôle spécifique d'étrangler toute tentative de lutte ouvrière et d'encadrer les ouvriers derrière le plan de solidarité nationale et de guerre qu'organise le capital.
Mais le passage de la gauche dans l'opposition n'obéit pas simplement à un changement de tactique pour restaurer le contrôle sur les ouvriers, mais constitue la meilleure adéquation de cette fraction bourgeoise à la stratégie de l'ensemble du capital, dont les bases sont, comme nous l'avons analysé plus haut, la démoralisation et la déroute du prolétariat pour ouvrir les portes d'un cours vers la guerre :
1°- parce que c'est seulement dans une orientation générale d'opposition que la gauche et les syndicats peuvent enfermer les ouvriers dans une tactique de "lutte" fondée sur la défensive et le désespoir :
- des luttes isolées, corporatives, atomisant les ouvriers dans toutes sortes de divisions en usine, profession, secteur, etc..
- des actions humiliantes et désespérantes: grèves de la faim, enchaînements publics, sitting, pétitions aux autorités et personnalités publiques ;
- la solidarité réduite à des formes individualistes et moralistes qui produisent systématiquement le sentiment d'impuissance et de division,
- la méfiance consciencieusement entretenue des ouvriers pour leur propre auto-activité et auto-organisation, en leur faisant confier la "médiation" de l'action à tout type d'institution, d'organisme, de personnalités 'progressistes', etc.
2°- Parce que c'est seulement à partir de Top-position que la gauche et les syndicats peuvent rendre crédible leur alternative de se "partager la misère en se soumettant aux impératifs de l'économie nationale" qui imprègne toutes les luttes.
En s'adaptant à la conscience instinctive des ouvriers que, dans la situation actuelle, il n'y a pas de possibilité d'imposer les revendications immédiates, et pour éviter le passage nécessaire à un niveau supérieur de luttes massives, la gauche et les syndicats essaient de convertir cette prise de conscience en un défaitisme où l'unique chose qui reste à faire face à la crise est de SE PARTAGER LA MISERE ENTRE TOUS. Un tel projet -qui est 100% cohérent avec la stratégie de l'isolement et l'usure des luttes- est la meilleure forme pour mener les ouvriers vers la SOLIDARITE NATIONALE : ainsi, dans le cadre d'une "communauté nationale" menacée, les ouvriers devraient accepter les plus grands sacrifices, à condition qu'on leur accorde un traitement "juste et équitable" en luttant pour cela contre tous les partis et patrons '!non solidaires", anti-démocratiques", et apatrides.
Mais pour paraphraser Marx, toute la démarche de la gauche et des syndicats repose sur l'idée que les ouvriers NE VERRAIENT DANS LA MISERE QUE LA MISERE et vise a empêcher qu'ils comprennent que de leur misère actuelle surgissent les bases pour L'ABOLIR DEFINITIVEMENT.
3°- Parce que c'est uniquement à partir de l'opposition que la gauche peut noyer les ouvriers dans l'idéologie de la démoralisation et du nihilisme qui imprègne l'orientation d'ensemble de la bourgeoisie. Dans cette ligne, la gauche :
- présente, en mettant la réalité à l'envers, son passage dans l'opposition COMME LE RESULTAT DE L'ASCENSION DE LA DROITE AU POUVOIR, donnant à entendre que c'est là le résultat d'une' défaite des ouvriers et de l’échec des tentatives de "changement social" et de 'réformes profondes" qui ont dominé les années 70, inculquant de toutes parts que la société se "droitise" et, avec elle, les ouvriers ;
- présente le phénomène actuel de maturation de la conscience des ouvriers, avec ses conséquences d'apathie apparente et négative, comme une "preuve" de la "défaite" et de la "droitisation" des ouvriers, cherchant ainsi effectivement leur démoralisation et leur défaite ultérieure ;
- consciemment, elle ne donne aucune alternative à la situation actuelle, sauf les alternatives démoralisantes d'accepter la misère, de se sacrifier pour la nation et de se battre pour des vieux mythes auxquels plus personne ne croit : le "socialisme", la "démocratie", etc. Tout cela est essentiellement dû à la nécessité de démoraliser et de désanimer les ouvriers pour faire d'eux la chair et le sang de la situation de barbarie qu'impose la bourgeoisie. En réalité, le rôle de la gauche dans l'opposition ressemble à celui d'un avocat défenseur des ouvriers qui prétend faire tout son possible pour eux, mais, comme les "circonstances sont mauvaises", comme "l'ennemi est puissant" et comme "les clients ne coopèrent pas", il ne peut rien faire de plus.
4°- Parce que c'est exclusivement à partir d'un rôle d'opposition que la gauche et les syndicats peuvent déployer L'EVENTAIL DES TACTIQUES AVEC UN PLUS GRANDE AMPLITUDE ET UNE PLUS GRANDE FACILITE D'ADAPTATION que par le passé, face aux luttes ouvrières, pour développer une ligne générale de dispersion et d'usure. Ainsi, l'expérience de ces dernières années nous a montré cette variété :
- accepter la généralisation de la lutte y compris ses réactions de violence de classe mais en jugulant totalement 1'auto-organisation (comme on a pu le voir à Longwy-Denain en France en 1979) ;
- permettre un développement local et ponctuel de l'auto-organisation et de la généralisation de la lutte ouvrière mais en maintenant un ferme contrôle à l'échelle nationale (sidérurgie anglaise) ;
- établir un cordon sanitaire autour d'une lutte radicale et auto-organisée en empêchant totalement sa généralisation (dockers de Rotterdam) ;
- se répartir les rôles de "modération" et de "radicalisme" entre deux fractions d'un syndicat (le métro de New-York), entre deux syndicats (France, Espagne) ou entre le parti et le syndicat (Fiat), avec comme objectif le maintien du contrôle de l'ensemble des ouvriers ;
- prévenir le mécontentement ouvriers par des simulacres de lutte qui peuvent même atteindre des caractéristiques massives et spectaculaires (Suède) ;
- empêcher la maturation de la force ouvrière en provoquant des combats limités, dans des moments et dans des conditions défavorables.
Cet éventail varié de tactiques permet de plus à la gauche et aux syndicats de se couvrir mieux face aux ouvriers; il permet de diluer ses responsabilités, de se laver les mains de la situation et de ne pas se présenter comme un appareil unifié et monolithique, mais comme un organe "vivant", "démocratique", où "il y a de tout", ce qui rend plus difficile et plus complexe la dénonciation des syndicats et de la gauche.
D'une manière générale, nous pouvons conclure que le tournant de la gauche dans l'opposition signifie un renforcement à court terme de son contrôle sur le prolétariat, en lui permettant de développer une tactique d'usure, d'isolement et de démoralisation des luttes ouvrières, en les encadrant dans la stratégie générale de la bourgeoisie de démoralisation et de défaite du prolétariat.
Mais, à plus long terme, ce tournant ne traduit pas, à la différence des années 30, une capacité de la gauche pour enfermer le prolétariat sur un terrain bourgeois à travers des alternatives propres a coloration ouvrière, mais toute une réalité d'encadrement physique du prolétariat, c'est-à dire la tentative de la soumettre à un contrôle éhonté asphyxiant sans aucune perspective politique pour le justifier.
.8. La ligne de la gauche dans l'opposition est complétée par deux autres éléments de l'actuelle stratégie globale de la bourgeoisie :
1°- Le renforcement systématique de la répression et de la terreur d'Etat ;
2°- Les campagnes idéologiques d'hystérie guerrière et nationaliste.
1) En se cachant derrière les feuilles de vigne de 1'"anti-terrorisme" et de la "sécurité des citoyens", tous les Etats du monde développent quantitativement et qualitativement des forces gigantesques, des instruments policiers, juridiques, militaires et propagandistes de leur appareil de répression et de terreur. L'objectif de toute cette orientation est chaque fois plus évident :
- créer un dispositif adéquat pour, en combinaison avec la tactique d'usure et de dispersion qu'emploient la gauche et les syndicats, intervenir efficacement contre les luttes ouvrières ;
- prévenir les affrontements généralisés qui mûrissent.
Ce renforcement massif de l'arsenal terroriste de l'Etat est justifié et appuyé par la gauche qui participe sans faiblir aux campagnes anti-terroristes et réclame sans arrêt le renforcement répressif de 1'Etat :
- au nom de 1'antifascisme ou de 1'antiracisme (Belgique), elle exige toujours plus de répression et plus de police ;
- elle ne cesse pas de réclamer l'augmentation des budgets militaires au nom de la défense de la souveraineté nationale.
Ces soi-disant protestations contre les actes répressifs ne mettent jamais en question ce renforcement et la gauche se limite à formuler des plaintes pieuses sous les aspects les plus éhontés et extrêmes, et à fustiger (au nom de la paix sociale et de l'intérêt national) l'utilisation peu intelligente, excessivement partisane et trop provocatrice de la répression.
En réalité, malgré leur séparation formelle, les appareils syndicaux, de gauche et l'appareil policier SE COMPLETENT face à la lutte ouvrière. La répression s'abat sur les ouvriers une fois qu'ils sont isolés et désarmés par la politique et les pratiques de la gauche et des syndicats. En même temps, la répression se dirige sélectivement contre les secteurs ouvriers les plus combatifs et pousse la majorité à accepter les méthodes et les alternatives boiteuses de la gauche et des syndicats.
2) Sur le terrain des orientations idéologiques fondamentales que nous avons expliqué dans le point 6, la bourgeoisie a tenté de développer des campagnes d'hystérie guerrière et nationaliste pour, d'un côté affaiblir politiquement le prolétariat et pour, d'un autre côté, le mobiliser avec le reste de la population pour ses plans de sacrifice et de guerre.
La très forte usure des vieux thèmes de mystifications ("antifascisme", anti-terrorisme, démocratie et défense nationale, etc.) a fait que ces campagnes ont eu en général peu de succès et que, loin de prendre une forme cohérente et systématique, elles ont été plus des mouvements ponctuels basés sur l'exploitation d'événements particuliers tels que :
- les otages utilisés par les Etats Unis pour développer une campagne de solidarité nationale ;
- les attentats perpétrés par 1'extrême-droite en France, en Italie, et en Belgique qui ont servi de base à des campagnes antifascistes;
- la menace d'invasion de la Pologne par la Russie employée comme plateforme de paix sociale et d'union nationale;
- 1'anti-terrorisme en Espagne et en Italie; les élections générales en Allemagne, base d'une gigantesque campagne pacifiste de préparation à la guerre.
Le bilan de ces campagnes n'est pas positif pour la bourgeoisie : elles n'ont pas eu un impact réel sur le prolétariat, du moins immédiatement. Elles se sont vues discréditées et démystifiées par les contradictions internes de la bourgeoisie et l'impact même des événements (le tremblement de terre en Italie, ou le cas Arregui en Espagne en relation avec l'hystérie anti-terroriste). Elles ont plus cherché à créer un climat d'insécurité, de confusion et de démoralisation, qu'à présenter un cadre cohérent de mobilisation idéologique du prolétariat, cadre que la bourgeoisie, pour le moment, est loin de trouver.
.9. Tout au long de ce chapitre, nous avons analysé en détail la réponse qu'a développée la bourgeoisie face à la situation actuelle qui est un carrefour historique. La question que nous devons nous poser est : cette réponse signifie-t-elle un renforcement de la bourgeoisie face au prolétariat ? Peut-elle détruire la reprise de la lutte prolétarienne commencée en 1978?
Toute la réorientation de la politique de la bourgeoisie qui s'est produite les trois dernières années, si elle a signifié un renforcement à court terme, constitue une position de faiblesse et d'affaiblissement à long terme.
Nous allons développer cette thèse apparemment contradictoire.
A court terme, cette réorientation renforce la bourgeoisie :
1) Elle lui permet d'utiliser de façon cohérente, sans compromis et sans ambiguïté l'ensemble de ses forces politiques et sociales :
- la droite au pouvoir se dédie à organiser l'attaque frontale contre le prolétariat, sans courir le risque de se voir contredite par sa base sociale ;
- la gauche dans l'opposition peut se consacrer, sans le handicap de la responsabilité des affaires gouvernementales, à démobiliser les ouvriers, à user et à épuiser les luttes en facilitant ainsi le succès des attaques capitalistes, et en créant un climat de démoralisation et d'immobilisation.
2) Elle lui permet de concentrer de façon cohérente toutes ses forces et tous ses instruments contre le prolétariat. Aujourd'hui, malgré les conflits internes du capital, et malgré les faiblesses et les anachronismes qui subsistent, nous assistons à une OFFENSIVE SYSTEMATIQUE et COORDONNEE de l'ensemble des forces de la bourgeoisie contre les travailleurs. Il y a une tentative de synchronisation des efforts, une capacité à se compléter et une unité des stratégies entre les différentes fractions de la bourgeoisie jamais vues par le passé. La gauche et la droite, les patrons et les syndicats, les corps de répression, les moyens de communication, les médias, l'Eglise et les institutions laïques, etc., coordonnent leurs efforts dans un même sens anti-prolétarien, en faisant converger les attaques partants de différents points, divergents et contradictoires, vers un même front : celui de la défense de l'ordre bourgeois. Ceci constitue un NIVEAU SUPERIEUR de l'action bourgeoise contre le prolétariat par rapport à la période précédente, période dans laquelle, ou bien la bourgeoisie utilisait la répression sans s'unifier réellement dans la mystification, ou bien la bourgeoisie utilisait la mystification sans recourir à la répression ouverte.
3) Elle lui permet de développer une stratégie d'isolement et d'épuisement des surgissements de la lutte ouvrière, en essayant de les noyer dans un climat général de démobilisation, sans perspective, en cherchant à immobiliser et à désorienter le prolétariat , pour tenter en fin de compte de créer les conditions d'une défaite totale et d'ouvrir ainsi définitivement un cours vers la guerre.
Cette "réorientation de l'appareil d’"Etat bourgeois" connaît une efficacité immédiate, car elle parvient à maintenir dans certaines limites le développement des antagonismes de classe dans les principales concentrations ouvrières, en lui donnant une apparence spectaculaire.
Ceci dit, même si nous NE DEVONS JAMAIS SOUS-ESTIMER, de quelque façon que ce soit, la force de la bourgeoisie et que nous devons pousser le plus possible et dans les détails la dénonciation de ses campagnes et de ses manœuvres, une telle dénonciation demeurerait inutile si elle ne mettait pas clairement en évidence la situation de FAIBLESSE et de FRAGILITE, les PROFONDES CONTRADICTIONS, que cache cette apparente supériorité que se donne aujourd'hui le pouvoir bourgeois.
Nous ne devons jamais oublier que toute cette réorientation s'est faite POUR AFFRONTER la réémergence prolétarienne de 1978, c'est à dire que son point de départ est une position de faiblesse et de surprise de la part de la bourgeoisie.
Comme l'a démontré la bataille de la classe ouvrière en Pologne, la situation actuelle est toujours dominée par TIMPOSSIBILITE POUR LA BOURGEOISIE DE FAIRE PLIER LE PROLETARIAT ET D'ESTOMPER LES ANTAGONISMES DE CLASSE. A ce niveau de la crise capitaliste, une telle incapacité constitue un danger très grave pour le pouvoir, car elle l'affaiblit aussi bien économiquement que politiquement, et elle approfondit ses contradictions et accroît son impuissance à imposer à la société la "solution" guerrière.
Pour cela, la cohérence et la puissance actuelles de la politique bourgeoise doivent être interprétées dans leur essence comme le dernier recours, l'effort suprême de l'Etat bourgeois pour éviter un affrontement de classe généralisé.
CECI NE PEUT NOUS CONDUIRE A SOUS-ESTIMER LA FORCE DE LA BOURGEOISIE : LES POSSIBILITES OUVERTES PAR LA REORIENTATION DE SA POLITIQUE SONT LOIN D'ETRE EPUISEES, ET LE PROLETARIAT VA TRAVERSER UNE PERIODE DURE, OU LE DANGER D'ETRE ECRASE PAR LA CONCENTRATION ACTUELLE DES RESSOUR CES COMBINEES DE LA BOURGEOISIE GARDERA SA PLEIN VIGUEUR. Mais en même temps, nous ne pouvons oublier que le PROLETARIAT CONTINUE A AVOIR LE MOT DE LA FIN. Tant que celui-ci sera capable d'ELAR GIR LA BRECHE OUVERTE PAR LES LUTTES MASSIVES EN POLOGNE, il pourra surmonter la terrible concentration des forces ennemies et ouvrir un processus DE RUPTURE DU FRONT BOURGEOIS, au cours duquel TOUS LES ASPECTS QUI AUJOURD'HUI APPARAISSENT COMME DES POINTS FORTS DU CAPITAL SE TRANSFORMERONT EN AUTANT DE LEVIERS DE SA FAIBLESSE.
Comme nous avons vu au début, la ligne actuelle de la bourgeoisie, qui reconnaît ouvertement la faillite de son système et la réalité qu'elle n'a rien à offrir à l'exception de la guerre, peut avoir pour effet immédiat et dangereux de démoraliser le prolétariat et de l'enliser dans la barbarie qu'impose le capital; mais dans la mesure où le prolétariat parvient à élargir son front de combat et à rompre la chaîne d'isolement et d'usure, cette ligne de "sincérité" crée un immense vide dans lequel les ouvriers peuvent développer leur alternative révolutionnaire, étant donné qu'ils ont une certitude claire du fait que le seul avenir, c'est le chaos, et l'incapacité de gouverner de la part de la bourgeoisie :
"Que la bourgeoisie indique ouvertement que son système est en faillite, qu'elle n'a rien d'autre à proposer que la boucherie impérialiste, contribue à créer les conditions pour que le prolétariat trouve le chemin de son alternative historique au système capitaliste." ([2] [97])
La gauche dans l'opposition démontre son efficacité momentanée pour contenir les luttes ouvrières. Peut-elle finir par épuiser et noyer l'immense combativité ouvrière actuelle ?
A la fois cette orientation contient un danger, et à la fois, comme nous l'avons montré, du fait qu'elle repose sur un manque total de perspectives capables de créer chez les ouvriers des illusions dans le camp bourgeois, cette orientation dévoile que la CARACTERISTIQUE FONDAMENTALE de la gauche et des syndicats est celle de constituer de simples compléments d1"opposition" à la politique de guerre et de misère du capital, et les fait apparaître ouvertement comme des instruments d'encadrement physique et de surveillance du prolétariat.
De même, si le renforcement de la répression et de la terreur de l'Etat bourgeois, crée dans les rangs prolétariens momentanément un climat de peur et d'impuissance, à la longue ce renforcement dévoile de plus en plus son caractère de classe, mettant en évidence la nécessité de l'affrontement violent, sans illusion pacifiste, démocratique et légaliste.
Enfin, les campagnes d'hystérie nationaliste et guerrière qu'entreprend le capital peuvent intoxiquer le prolétariat avec des poisons chauvinistes et interclassistes. Mais la faiblesse de leur base idéologique et les contradictions capitalistes qui les démystifient peuvent finir par se transformer en leur contraire, en facteurs supplémentaires qui obligent le prolétariat à préciser son alternative révolutionnaire et à approfondir son autonomie de classe.
La tendance à la gauche dans l'opposition et au renforcement de l'appareil répressif expriment un processus de RENFORCEMENT FORMEL de l'Etat bourgeois qui cache un autre aspect, plus profond : sa FAIBLESSE REELLE.
En fin de compte, la façade actuelle de cohésion et de renforcement momentané du front bourgeois cache les pieds d'argile que constitue l'incapacité profonde de la bourgeoisie à surmonter ses contradictions internes et à canaliser l'ensemble de la société vers ses alternatives. Tout ceci, qui aujourd'hui reste dans l'ombre, peut apparaître brusquement à la lumière du jour si le prolétariat développe un front de combat massif sur son terrain de classe. Ceci, loin d'être une simple hypothèse, ou l'écho lointain de vieilles expériences historiques, est une possibilité réelle, clairement annoncée par la grève de masse en Pologne :
"Ce n'est pas seulement sur le plan de la lutte prolétarienne que les événements de Pologne préfigurant une situation qui tend à se généraliser à tous les pays industrialisés. Sur le plan des convulsions internes de la classe dominante, ce qui est en train de se produire aujourd'hui dans ce pays donne une idée, même dans ses aspects caricaturaux, de ce qui est en train de mûrir dans les entrailles de la société. Depuis le mois d'août 80, c'est une véritable panique qui s'est emparée des sphères dirigeantes du pays. Depuis 5 mois, la danse des portefeuilles ministériels s'est installée au sein du gouvernement jusqu'à faire échoir un de ces portefeuilles aux mains d'un catholique, biais c'est au sein de la principale force dirigeante, le parti, que se manifestent avec la plus grande violence ces convulsions." ([3] [98])
3/LA REPONSE DU PROLETARIAT
.10. Après avoir vu la stratégie de la bourgeoisie, il nous faut faire maintenant un bilan de la réponse qu'est en train de donner le prolétariat à l'actuelle situation historique. Pour cela, nous avons à nous poser trois questions:
1) Est-ce que le prolétariat prend conscience du carrefour historique que nous sommes en train de vivre et des graves responsabilités qui en découlent pour lui ?
2} Dans quelle mesure ses luttes les plus récentes traduisent une telle conscience et constituent un pas en avant vers son alternative : la révolution ?
3) Quelles sont les leçons et les perspectives qui découlent de ces luttes ?
L'objet du présent chapitre est de répondre à ces trois questions.
"Lorsqu'il s'agit de rendre compte des grèves, des coalitions, et des autres formes dans lesquelles les prolétaires devant nos yeux s'organisent en tant que classe, les uns sont pris d'une véritable épouvante, les autres étalent un dédain transcendantal". ([4] [99])
Le processus à travers lequel la classe ouvrière mûrit sa compréhension de la situation historique et des tâches que celle-ci lui impose n'a rien de simple ni d'évident.
La réponse, la pensée et la volonté de la classe s'expriment exclusivement dans ses actes massifs de lutte contre l'ordre bourgeois et même pour comprendre la véritable signification historique de ces actes, il est nécessaire d'en saisir la dynamique objective, car il existe toujours un violent décalage ENTRE L'IMPACT OBJECTIF DES LUTTES ET LA REPRESENTATION SUBJECTIVE QUE S'EM FONT LES OUVRIERS.
La situation concrète présente de façon exacerbée ces difficultés à saisir la direction réelle des luttes ouvrières. Le 3ème congrès du CCI. annonçait une nouvelle période de montée des luttes prolétariennes à partir de 78, mais il signalait aussi qu'une telle montée suivrait un cours contradictoire, lent et pénible, qui se manifesterait dans une succession de luttes brusques et explosives et non de façon linéaire, progressive, cumulative, graduelle. Les luttes de 79-80, et en particulier la grève en Pologne, sont venues confirmer de façon éclatante cette prévision. Cependant, saisir la dynamique montante du mouvement et en apprécier les pas en avant est devenu quelque chose de très difficile, aussi bien pour la classe que pour ses groupes révolutionnaires.
Ceci est apparu clairement face aux événements de Pologne. De nombreux groupes ont manifesté à leur égard un "dédain transcendantal", ne les voyant que superficiellement -sous la forme déformée qu'en donne la bourgeoisie- , n'y voyant que des ouvriers en train de communier, des drapeaux polonais, Walesa, etc. Le CCI a du combattre toutes les manifestations de ce type d'évaluation, qui révèlent en fait une conception du développement de la lutte et de la conscience de classe absolument néfaste dans la situation actuelle.
Laissons clair une fois pour toutes que le prolétariat constitue la classe qui porte en elle toute l'inhumanité de la société bourgeoise et qui souffre d'une dépossession et d'une aliénation radicales. En conséquence, dans son existence se manifeste de façon extrêmement aiguë une plaie fondamentale de la société bourgeoise : LA SEPARATION ENTRE L'ETRE ET SA CONSCIENCE, c'est-à-dire le décalage, voire même l'opposition, entre la réalité objective des actions sociales et les représentations subjectives que s'en font les protagonistes de ces actions. La classe ouvrière n'est pas étrangère à ce phénomène, et ce décalage existera toujours, jusqu'à la fin de son mouvement d'émancipation.
Mais la classe ne répond pas à ce décalage en créant une "nouvelle culture" ou en élaborant une "nouvelle science", mais en rompant dans son combat la séparation entre l'être et la conscience, en faisant de ses luttes la conscience en action, le mouvement qui, par delà les différentes représentations subjectives qu'on puisse se faire de lui, tend à abolir les conditions objectives qui engendrent ce décalage (exploitation capitaliste, division en classes).
Ainsi, si l'on analyse en profondeur les événements de Pologne, nous voyons que, malgré toutes ses faiblesses, le prolétariat y a MANIFESTE, DANS LA LUTTE, UNE COMPREHENSION DES BESOINS FONDAMENTAUX DE LA SITUATION HISTORIQUE ACTUELLE :
1°- sa capacité à généraliser sa lutte, en exerçant de manière soutenue et à plusieurs reprises une PRESSION MASSIVE sur l'Etat, soutenue par des coups de force, mais évitant à la fois des affrontements prématurés ou en position de faiblesse, met en évidence une compréhension active du moment présent au niveau historique et des responsabilités de la classe ouvrière dans cette situation;
2°- sa volonté d'auto-organisation et d'unité démontre qu'il a clairement compris l'affrontement de classes qu'il doit livrer;
3°- le fait d'avoir répondu par la lutte aux divers appels de la bourgeoisie à la responsabilité face à l'économie nationale, met en évidence qu'il comprend instinctivement l'opposition irréconciliable qui existe entre l'intérêt de classe et l'intérêt national et la nécessité d'une alternative révolutionnaire.
Il ne s'agit pas de glorifier cette compréhension plus ou moins instinctive mais de reconnaître sa réalité et de la prendre comme base pour l'action des minorités communistes du prolétariat et le développement de nouvelles luttes.
Ceci dit, la question qui se pose immédiatement est : le reste du prolétariat mondial a-t'il compris le "message" de ses frères polonais ? Pouvons-nous affirmer avec certitude que l'ensemble du prolétariat mondial se prépare et répond devant la croisée des chemins actuelle ?
A première vue, il semblerait que les combats de Longwy-Denain en France, des sidérurgistes anglais, des travailleurs du port de Rotterdam, et surtout de Pologne, n'ont laissé aucune trace immédiate puisqu'on n'a pas vu à leur suite l'extension des luttes à l'échelle internationale. Est-ce que cela veut dire que ce que nous annoncions au 3ème Congrès sur un nouveau cycle dans la lutte de classe était erroné ? Pas du tout l'analyse des conditions historiques que nous avons faite dans la première partie de ce rapport et celle que nous ferons postérieurement en tant que bilan des luttes vécues, nous confirment clairement une telle perspective ; cependant, ce que nous devons préciser, c'est le CHEMIN CONCRET que le prolétariat est en train de parcourir pour s'y rendre.
Longwy-Denain, la sidérurgie anglaise, Rotterdam, etc., ont été les premières tentatives, les premiers jalons de cette nouvelle vague ; en quelque sorte une RECONNAISSANCE DU TERRAIN. Leur dénouement immédiat qui, en général a été la défaite, a montré à la classe ouvrière l'énorme chemin qu'elle doit parcourir, la concentration féroce de forces qu'elle a en face d'elle, la faiblesse des moyens dont elle dispose, une réalité où, pour l'instant, il y a bien plus de problèmes posés que de problèmes résolus. Tout cela l'a fait reculer, se replier, mûrir souterrainement.
Apparemment la Pologne a accentué le repli du prolétariat occidental. Bien qu'elle ait fourni des réponses à beaucoup des problèmes que se posaient les luttes de Longwy-Denain, de la sidérurgie anglaise, etc., elle n'a aussi que trop clarifié l'énorme envergure qu'ont aujourd'hui les luttes prolétariennes, la quantité de conditions qu’elles doivent remplir pour lutter avec un minimum de possibilités de vaincre. Tout cela pousse, jusqu'à un certain point, à accentuer le calme tendu que nous sommes en train de vivre.
Cependant, nous devons affirmer clairement l'énorme impact qu'a eu la lutte du prolétariat polonais sur ses frères de classe dans le reste du monde. Le cri magnifique des ouvriers de la Fiat "Gdansk, Turin, même combat." en témoigne ; les luttes qui ont eu lieu par la suite en Roumanie, en Hongrie, en Russie, en Tchécoslovaquie, celle des employés du chemin de fer de Berlin, le mettent en- évidence ; l'anxiété qu'elle a éveillée parmi les ouvriers d'Allemagne, d'Espagne, de France, en est une manifestation...
La situation actuelle de la conscience de classe peut être formulée ainsi : les ouvriers ressentent instinctivement, d'une part l'énorme gravité du moment historique, l'énorme responsabilité que contient chaque lutte, la réalité que chaque lutte doit affronter une concentration et une combinaison maximale d'armes que l'ennemi peut opposer, et d'autre part la précarité des armes de lutte avec lesquelles ils peuvent compter. Tout cela pousse vers une certaine paralysie, vers un processus de réflexion donnant une atmosphère de doutes qui n'est pas exempte de désorientation,
Cette situation de maturation difficile contient de grands dangers. En face, la bourgeoisie agit de manière décidée, cherchant à isoler et à épuiser chaque surgissement de lutte, présentant ce qui est une maturation comme une défaite entraînant la démoralisation. Le danger existe ! Mais ce serait abdiquer face à lui que de ne pas voir la dynamique objective de luttes qui est en train de se développer et ne pas intervenir résolument pour transformer tout ce magma actuel d'anxiété, d'apathie apparente, de recherche, en DEBUTS DE LUTTES qui accéléreront et fortifieront l'immense processus de luttes qui est en train de mûrir.
.12. Lors du 3ème congrès international, avec les données encore embryonnaires des luttes des mineurs aux USA, de la sidérurgie en Allemagne, d'Iran et de Longwy-Denain, nous prenions le risque, fondé sur une analyse solide et globale, de voir dans ces luttes l'annonce d'une nouvelle vague de luttes prolétariennes qui mettrait fin au reflux relatif de 1973-78. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer catégoriquement une telle annonce :
- septembre 1979 : grève de Rotterdam ;
- janvier-avril 1980 : grève des sidérurgistes anglais ;
- mars-avril 1980 : révoltes sociales en Syrie, Algérie et Hollande ;
- avril 1980 : mouvement de grèves au Brésil dont le centre est la grève des métallos de Sao Paulo ;
- mai 1980 : grèves au métro de New-York, des autobus à Gorki et Togliattigrad, dans les deux métropoles de l'impérialisme ;
- mai 1980 : mouvement semi-insurrectionnel en Corée du Sud et grèves en Afrique du Sud et au Zimbabwe ;
- juillet-août 1980 : grève de masse en Pologne ;
- après la Pologne, des grèves à la Fiat de Turin, à Berlin, en Tchécoslovaquie, en Roumanie, en Hongrie, en Russie, en Bulgarie; -:octobre-novembre 1980 : vague de luttes relativement vaste au Portugal et en Irlande;
- à partir de décembre 1980 : mouvement ouvrier et paysan au Pérou.
A l'épicentre de ce cours de lutte de classe se trouve la Pologne. Les luttes qui la précèdent développent des aspects partiels positifs, mais, globalement, ils ratent :
- les affrontements de Longwy-Denain mettent en avant la violence de classe et la poussée à la généralisation, mais 1'auto-organisation ne se fait pas:
- les sidérurgistes anglais développent à l'échelle locale l'auto-organisation et la généralisation, mais ils ne réussissent pas au niveau national;
- en Corée du Sud, le mouvement semi-insurrectionnel s'écrase devant une absence totale de coordination et d'auto-organisation;
- au Brésil et à Rotterdam 1'auto-organisation triomphe, mais la généralisation rate.
Ce que fait le mouvement de classe en Pologne c'est unifier toutes les tendances partielles de ces luttes en une grande grève de masse qui, à son tour, donne une réponse -ou début de réponse- à toutes les questions non résolues par les premières. La Pologne est le mouvement de classe le plus important non seulement depuis la reprise prolétarienne de 1978 mais depuis l'écrasement de la vague de 1917-26. Elle place tout le cycle actuel |de la lutte de classe à un niveau supérieur, rien qu'en cristallisant tout un ensemble de tendances ; qui ont mûri dans les luttes antérieures. Evidemment, les leçons de la Pologne mettront du temps à être assimilées par ses frères de classe et cela va coûter du temps et du travail avant qu'elles ne se cristallisent dans des combats supérieurs. Mais cela ne doit pas nous cacher l'immense pas qu'a fait le prolétariat en Pologne et la nécessité de généraliser ses leçons à l'ensemble de la classe.
4/ PERSPECTIVES FONDAMENTALES POUR LES LUTTES FUTURES
.13. Les leçons de la grève de masse en Pologne, à la lumière des positions de classe tracées par la lutte historique du prolétariat, nous fournissent la plateforme de principes que doivent réunir les prochaines luttes pour être à la hauteur de ce NIVEAU SUPERIEUR qu'exige la situation historique et auquel la Pologne a contribué de manière fondamentale.
L'AUTONOMIE DE LA CLASSE.
.14. La révolte du prolétariat contre l'ordre bourgeois ouvre un immense processus d'auto-organisation et d'auto-activité des masses ouvrières dont l'expression unitaire et centrale sont les assemblées générales et les comités élus et révocables.
Ces organismes représentent le minimum commun qui unifie l'ensemble du mouvement de classe à une étape donnée de son développement, car s'ils fournissent une plateforme pour le développement des tendances plus avancées de la classe, ils ont en même temps des difficultés, de par leur liaison avec une étape déterminée du mouvement à évoluer selon les nécessités d'avancées du mouvement de classe. Cela fait qu'ils n'ont jamais une forme et une composition achevées, et qu'ils souffrent une évolution de brusques ruptures ou de recompositions selon les nécessités de la lutte prolétarienne.
Ces limitations les rendent vulnérables à l'action de la bourgeoisie. Celle-ci n'abandonne pas le terrain des organes ouvriers mais, au contraire elle essaie, à travers ses forces syndicales et d'opposition, de les occuper, de bombarder de l'intérieur l'action prolétarienne et de les dénaturer totalement même si elle en conserve la forme et le nom pour mieux tromper les ouvriers. Cela fait des organes ouvriers, tant que la révolution n'aura pas triomphé, un champ de bataille entre le prolétariat et la bourgeoisie (en utilisant les syndicats et la gauche).
Cependant, cette réalité, produit du caractère totalitaire du capitalisme décadent, ne doit pas nous conduire à considérer les organes ouvriers comme de simples formes dépourvues de contenu ou comme es organismes hybrides sans caractère de classe défini. Et surtout, cela ne doit pas nous conduire à l'erreur, encore plus grave, de les comparer à des organismes créés par les syndicats pour devancer 1'auto-organisation prolétarienne (intersyndicale en France, ou "comités de grèves" en Angleterre) ou aux divers types d'organismes syndicaux.
Les organes qui émanent des grèves de masses expriment la volonté de la classe pour :
- se constituer comme force organisée contre le capital ;
- unifier et centraliser son effort d'auto-activité et d'auto-organisation;
- prendre le contrôle souverain de la lutte.
Ceci, malgré leurs limitations temporaires liées à leur composition et leur forme et à la pénétration des forces bourgeoises dont ils souffrent, les place dans un camp diamétralement opposé à celui de tout type d'organisation para-syndical.
LA GENERALISATION
.14. Dans la période actuelle, la solidarité de classe, la généralisation des luttes, prennent pour le prolétariat un caractère plus profond que celui qu'elles avaient dans les années 60-70.
Dans les années 60-70, la classe ouvrière a été le protagoniste de grands mouvements de solidarité et d'auto-organisation. Mais les conditions de cette période permettaient encore des luttes partielles relativement victorieuses parce que, soit elles arrachaient des améliorations momentanées, soit, elles faisaient reculer temporairement le capital. Dans un tel cadre, la généralisation, malgré toutes ses potentialités, n'était comprise que de façon très limitée, comme un simple appui ou comme l'idée : "qu'ils gagnent, eux, après nous gagnerons nous".
Ces idées tout en étant élémentaires pour toute lutte ouvrière, sont insuffisantes face à la situation actuelle. Dans les conditions actuelles, la solidarité de classe ne peut être conçue que dans le sens de se joindre à la lutte, d'étendre l'affrontement avec une volonté de se constituer comme FORCE SOCIALE qui s'oppose victorieusement à l'Etat bourgeois et ouvre le chemin vers la révolution. Dans la situation actuelle, la solidarité de classe doit se poser comme une question de vie ou de mort : à partir de la compréhension que telle ou telle bataille commencée par tel ou tel secteur de la classe ouvrière, exprime inéluctablement la bataille que doit livrer l'ensemble de la classe ouvrière.
LUTTE REVENDICATIVE ET LUTTE REVOLUTIONNAIRE
.16. Un des problèmes qui rend pour le moment plus difficile le surgissement des luttes, c'est l'impossibilité, chaque fois plus évidente, d'obtenir des victoires économiques qui durent au moins quelques mois. Ceci est apparu clairement en Pologne : la gigantesque grève de masse n'a pu obtenir satisfaction que sur quelques points des accords de Gdansk.
Cela veut-il dire que la lutte économique ne sert à rien et qu'elle doit être abandonnée au profit d'"une lutte politique" abstraite ou d'une non moins éthérée grève générale et simultanée pour le jour J ?
Pas du tout ! La lutte revendicative est la base profonde de la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière parce qu'elle est à la fois la classe exploitée et la classe révolutionnaire de la société capitaliste, parce que ses intérêts immédiats de résistance contre l'exploitation coïncident avec ses intérêts historiques d'abolition de l'exploitation.
On l'a vu en Pologne, où la lutte politique de masse (grèves du mois d'août) est préparée par une vague de luttes économiques partielles (grèves depuis juillet) et cède le pas à un nouveau torrent de luttes économiques.
La base révolutionnaire de la lutte revendicative du prolétariat réside en ce qu'elle exprime une logique diamétralement opposée à celle qui régit la société capitaliste. La logique du capital exige que les ouvriers subordonnent leurs intérêts et besoins à la marchandise et à l'intérêt national. Face à elle, les ouvriers opposent la logique de leurs besoins humains, ce qui est le fondement profond du communisme : A CHACUN SELON SES BESOINS, DE CHACUN SELON SES POSSIBILITES.
"Les ouvriers doivent déclarer qu'en tant qu'hommes, ils ne peuvent se plier aux conditions existantes, mais que les conditions elles-mêmes doivent s'adapter à eux, hommes" ([5] [100]).
La lutte politique du prolétariat n'est pas "d'abandonner" ou de "dépasser" la lutte revendicative mais de prendre comme base la logique profonde qu'elle contient, en la prenant sur le seul terrain où elle peut donner toute sa potentialité : celui de l'affrontement de classes, celui de la lutte à mort contre l'Etat bourgeois. Elle ne réside pas dans une soi-disant "réforme politique de l'Etat", ni en un simple programme de transition, ni dans l'attente du jour J où "on" appellera à la grève générale politique; elle réside dans la compréhension qu'avec l'aggravation inexorable de la crise- les fils qui meuvent les destinées de l'humanité dépendent exclusivement du rapport de force entre bourgeoisie et prolétariat, dont If intérêts objectifs sont diamétralement opposés. De ce point de vue, le problème "politique" de la classe ouvrière est : comment se constituer en une FORCE SOCIALE capable de détruire l'Etat bourgeois ?
Si l'on part de ce point de vue, disparaît la question métaphysique : lutte économique OU lutte politique. Le problème de chaque lutte n'est pas seulement le résultat immédiat mais, surtout, sa contribution au changement de rapport de force en tre les classes, en faveur du prolétariat. Ce ne sera pas son éventuelle victoire temporaire, qui ne durera que quelques jours, mais sa capacité à exprimer et donner des réponses à des problèmes qui sont ceux de l'ensemble de la classe. Dans ce sens, les luttes revendicatives prennent toute leur valeur :
"En général, les grèves ne sont que des escarmouches d'avant-garde, parfois ce sont des affrontements d'une certaine ampleur : elles ne décident rien par elles-mêmes mais elles sont la meilleur preuve que la bataille entre la bourgeoisie et le prolétariat est en train as se rapprocher. Elles sont l'école de guerre des ouvriers dans laquelle ils se préparent pour la grande lutte désormais inévitable ce sont les soulèvements de certains secteurs ouvriers pour leur adhésion au grand mouvement ouvrier" ([6] [101]).
L'INTERNATIONALISATION
.17. Lors du 3ème congrès du CCI, nous avons noté comme "principale et première caractéristique" de la reprise prolétarienne ouverte en 1978 "l'internationalisation objective des luttes". Une telle internationalisation se basait sur le fait que "nous avançons vers une EGALISATION DANS LA MISERE des ouvriers de toutes les entreprises, de tous les pays, de toutes les régions". La dynamique des événements vécus depuis cette époque confirme une telle analyse et ouvre la porte à des perspectives que nous devons éclaircir et approfondir.
La maturation du nouveau cycle de luttes ouvrières n'est pas le produit d'une addition de processus nationaux mais elle se réalise selon une dynamique directement mondiale. Ainsi, la continuation de Longwy-Denain ne se trouve pas malgré les conséquences que cette lutte a pu avoir pour le prolétariat en France, mais à Rotterdam ou dans la sidérurgie anglaise, la grève de masse en Pologne est, comme nous l'avons démontré, la synthèse des luttes de Longwy-Denain, Rotterdam, Brésil, de l'acier anglais, de la Corée, de la Russie. Las ouvriers polonais connaissaient par exemple les grèves de Gorki-Togliattigrad et s'en sont servi pour leur lutte. Mais, ce qui est plus important : les problèmes qu'a soulevée la dynamique postérieure des grèves polonaises (contrôle de l'appareil répressif étatique, des moyens de communication, poursuite des affrontements) sont l'expression des problèmes qui ne peuvent être résolus que si la lutte prolétarienne se généralise à l'échelle internationale.
Tout cela exige que la classe ouvrière conçoive l'internationalisme moins comme une question de simple appui mutuel mais plus comme une compréhension qu'elle EST UNE CLASSE MONDIALE, avec des intérêts communs et un ennemi commun, et, surtout, avec une responsabilité historique correspondante à cette croisée des chemins : guerre ou révolution.
LA LUTTE CONTRE LA GUERRE
.18. S'il y quelque chose que l'expérience des trois dernières années nous a démontré de façon écrasante, c'est que le prolétariat est la seule, force sociale capable de s'opposer à la tendance capitaliste à la guerre.
La lutte du prolétariat a déstabilisé l'Iran -bastion pro-américain - en coulant son armée -la cinquième du monde- sans laisser de chances au bloc russe de profiter de cette conjoncture, c'est à dire, en attaquant de front la machine de guerre de l'ensemble du capital mondial. Mais en 1980, la lutte du prolétariat polonais a déstabilisé brutalement un bastion pro-russe sans que le bloc américain n'est pu profiter de l'occasion en dehors d'une pression purement propagandiste.
Qui plus est, l'année 1980, qui a commencé avec un pas très grave vers la guerre -l'invasion russe en Afghanistan- s'est terminée sous le poids écrasant des événements de Pologne, dans une limitation relative de conflits inter-impérialistes et avec le phénomène de la COOPERATION INTER-IMPERIALISTE des deux blocs pour affronter leur ennemi commun : le prolétariat. Tout cela nous démontre la force décisive qu'a le prolétariat contre les plans de guerre du capital. Une telle force ne se situe pas sur le terrain d'une "pression morale" pour "obliger les deux bloc-à vivre en paix". Avec ou sans lutte de classes, les tensions inter-impérialistes se poursuivent et s'aggravent car elles trouvent leur source dans les contradictions insolubles du capital. L'effet de la lutte du prolétariat est de déstabiliser les plans du capital, d'aggraver ses contradictions internes et ainsi de changer le rapport de forces dans le sens de la révolution. En faisant cela, elle bloque et détruit l'issue historique à laquelle est liée l'existence du capital : la guerre.
L'expérience de guerres locales en 1980, comme celle entre l'Irak et l'Iran ou entre le Pérou et l'Equateur, nous démontre que, si au niveau historique, l'alternative du prolétariat est de lutter contre le capital pour le détruire et empêcher son issue guerrière, au niveau des guerres locales et, en tant que moment de cette alternative, la lutte ouvrière dans ces pays doit tourner autour des principes du défaitisme révolutionnaire : désertion massive, fraternisation des soldats des deux camps, retourner les fusils contre leurs propres chefs capitalistes, transformation de la guerre impérialiste en guerre civile de classe.
Les guerres locales du genre -Pérou-Equateur ou Iran-Irak, constituent à la fois des opérations de police à l'intérieur d'un bloc et des tentatives des capitaux nationaux impliqués pour ramener le - prolétariat derrière le drapeau national. En ce sens, elles ne sont pas un pas vers la guerre mais sont le produit des contradictions du capital exacerbées. Ceci implique que, malgré le leurs éventuels succès immédiats dans la reconstitution d'une union nationale, à terme elles l'affaiblissent aiguisant encore plus et de façon plus violente les antagonismes de classe.
LA LUTTE CONTRE LA REPRESSION
.19. Au 3ème congrès du CCI, nous avons affirmé clairement que face à une répression chaque fois plus systématique et féroce, la défense des ouvriers n'est pas dans les "garanties démocratiques" ni dans les groupes armés qui prépareraient militairement la classe, mais dans sa lutte massive et violente.
L'expérience de la grève de masse en Pologne a confirmé catégoriquement cette idée, tout en nous permettant de mieux la préciser, en relation avec l'expérience historique du prolétariat.
"Les ouvriers -polonais ont neutralisé la répression -de l'Etat non pas par- leur "pacifisme " mais parce que, depuis le début, ils ont pris toutes les mesures de force pour- la désarmer à la racine : en occupant les usines jour et nuit avec des piquets massifs, en restant mobilisés dans les quartiers ouvriers face à n'importe quelle provocation policière, en préparant partout des mesures D'AUTO-DEFENSE OUVRIERE DE MASSE et surtout, en faisant le pas qui donne un sens à tout ce qui précède : EN ETENDANT ET UNIFIANT LES GREVES DANS TOUT LE PAYS" ([7] [102]).
L'expérience polonaise nous clarifie en profondeur sur le sens de la violence prolétarienne et de sa lutte contre l'appareil répressif du capital. La classe ouvrière ne peut jamais tomber dans le légalisme et la mansuétude, mais cela ne veut pas dire que sa lutte consiste à chercher l'affrontement à tout prix, à fabriquer des "héros", à verser le sang ou à imposer un "châtiment exemplaire". Ces deux alternatives sont radicalement fausses et elles se cachent l'une l'autre : la première est 1'hypocrisie cynique du capital qui cache la deuxième, sa pratique réelle de la violence aveugle, inhumaine et irrationnelle.
La lutte de la classe ouvrière se situe sur un autre terrain, social et politique à la fois : celui de se constituer au moyen de la lutte de masse, en une FORCE REVOLUTIONNAIRE capable :
- d'exercer sur le capital et son Etat une pression chaque fois plus asphyxiante;
- d'isoler politiquement le capital et l'Etat;
- de multiplier les contradictions internes y compris au sein de l'appareil répressif;
- de diviser, disperser et finalement neutraliser le dit appareil.
"Tout le secret et toute la force de l'assurance de la victoire de la révolution des travailleurs réside dans le fait qu'à la longue, aucun gouvernement du monde ne peut se maintenir en lutte contre une masse populaire consciente, si cette lutte s'étend sans cesse et grandit en ampleur. Le carnage et la domina lion brutale du gouvernement ne constitue qu'une supériorité apparente sur la masse" ([8] [103]).
Naturellement, cette tendance historique de la lutte de classe ne constitue pas une formule infaillible pour "solutionner" le problème de la répression, et même celui de l'insurrection, de la façon la "plus pacifique possible" mais c'est une orientation de base pour toutes les étapes de l'affrontement prolétarien avec le capital. C'est pourquoi nous ne défendons pas l'idée d'un écroulement spontané de l'Etat sous la pression de la grève de masse mais deux autres choses totalement différentes :
1) qu'une explosion de grève de masse affaiblit et paralyse momentanément la répression de 1'Etat capitaliste;
2) que c'est ce terrain massif et déterminant d'une immense force sociale qu'il faut conserver et sur lequel il faut se baser pour passer à des affrontements supérieurs.
Pour un affrontement supérieur -l'insurrection- il serait très dangereux de compter sur un simple écroulement spontané de l'Etat. Il faut savoir que l'Etat, devant une situation décisive, tire des forces de sa faiblesse, il se recompose, se réoriente et se réorganise et, généralement concentré autour de "forces ouvrières" (par exemple, les menchéviks en Russie), essaie d'écraser de manière sanglante le mouvement de classe. Donc, si celui-ci veut passer à un stade supérieur -révolutionnaire- il doit se poser le problème de la destruction totale de l'Etat bourgeois au moyen de l'INSURRECTION, laquelle, comme le disait Marx, et un ART qui requiert une préparation consciente et minutieusement organisé de la part de la classe ouvrière. Ceci dit, cette ART se trouve uniquement sur le terrain de la MOBILISATION ET ORGANISATION MASSIVES DE LA CLASSE.
LE PROLETARIAT ET LES COUCHES NON-EXPLOITEUSES
.20. "Les mouvements de révolte sociale contre l'ordre existant participent, d'une part au processus d'isolement de l'Etat, et d'autre part, ils constituent le contexte social dans lequel le prolétariat émerge et trouve sa propre voix comme seule force capable de présenter une alternative".
Cette affirmation peut nous servir de base pour continuer à approfondir la question du rapport entre le prolétariat et les autres couches non-exploiteuses.
La grève de masse crée un terrain de rébellion, d'action directe et de remise en question de l'ordre bourgeois, auquel finissent par se joindre, avec une intensité différente, les différents secteurs des couches opprimées et non-exploiteuses. Cela ne veut pas dire évidemment, que celles-ci doivent attendre que le prolétariat saute sur la scène sociale pour se lancer dans la bagarre. Personne ne prétend "donner des leçons" sur l'action de ces couches sans avenir ni s'opposer à un processus qui est inévitable, ni d'un autre côté les prendre comme plateforme pour un soi-disant réveil du prolétariat. Il s'agit au contraire de les reconnaitre comme une maturation des contradictions qu'accumulent le capitalisme, de les stimuler dans le sens profond de leur révolte contre une existence chaque fois plus inhumaine et de leur donner comme perspectives leur union à la lutte prolétarienne qui est en train de mûrir partout.
5/ LA PERSPECTIVE DE LA REVOLUTION
.21. Une conclusion claire s'impose : nous vivons une époque décisive où sont en gestation les affrontements de classe qui détermineront le cours futur de l'humanité vers la révolution ou vers la guerre. Comme nous l'avons indiqué plus haut (point 2) une des armes principales de la bourgeoisie face à la situation actuelle est de noyer le prolétariat dans un manque total de perspective, en lui faisant croire qu'il n'existe aucune issue au monde de catastrophes et de barbarie qu'elle nous impose. Ce manque de perspectives n'est pas seulement un produit de son action idéologique, mais surtout de l'action matérielle immédiate de ses appareils de gauches et syndicaux chargés d'isoler et d'épuiser les luttes.
Les luttes massives qui se préparent doivent avoir une conscience claire de la situation qu'elles vont trouver : leur but n'est pas de conquérir des satisfactions immédiates, pas même momentanément; leur véritables effet va être de mettre en lumière le chaos latent de l’économie capitaliste en le précipitant dans une gigantesque déstabilisation de sa structure politique, économique et sociale. Certes, dans le cadre de cette déstabilisation, la classe ouvrière, protégée par le rapport de force en sa faveur qu'elle a su imposer, va pouvoir satisfaire une quantité de revendications immédiates, mais au pris d'aggraver jusqu'au paroxysme le chaos capitaliste et d'aller jusqu'aux conséquences révolutionnaires de son action. Si face à cela, la classe ouvrière se perd en une multitude d'actions locales et partielles aussi radicales soient-21'les, elle finira à la longue par se disperser dans 1s chaos de l'ordre bourgeois et du capital qui opère de façon mondiale et centralisé, et qui reprend le contrôle une fois l'épidémie passée. C'est pourquoi, face à ces futures mobilisations massives de la classe ouvrière, une des principales lignes de défense que le capital va utiliser, c'est l'action de la gauche et des syndicats qui vont tenter d'enfermer ces explosions en une multitude d'actions chaotiques et radicales, dans les ornières de l'autogestion, du fédéralisme, du populisme.
La réponse à ce problème n'est en aucun cas que les ouvriers renoncent à cette salutaire et implacable action revendicative; il s'agit de la concentrer dans l'attaque révolutionnaire contre l'Etat bourgeois pour le détruire et élever sur ces ruines LA DICTATURE DES CONSEILS OUVRIERS, seule plate-forme possible pour qu'elle passe à un niveau supérieur et développe ses immenses possibilités historiques.
En conséquence, une des nécessités fondamentales de la situation actuelle est que la PERSPECTIVE DE LA REVOLUTION prenne corps chaque fois plus clairement et plus concrètement dans la préoccupation et la conscience des ouvriers. L'alternative révolutionnaire est l'orientation indispensable pour vivifier et pour renforcer les batailles de classe qui vont être livrées. Les révolutionnaires doivent contribuer activement par leurs analyses et leur défense des expériences historiques du prolétariat à cette orientation.
.22. Une autre nécessité impérieuse de la situation actuelle, directement liée à la précédente, c'est le développement à un stade supérieur des forces communistes de la classe qui doivent converger dans son PARTI DE LA REVOLUTION MONDIALE.
Si la première étape de l'actuelle reprise historique de la lutte du prolétariat (années 60 et 70) a donné comme fruit le développement de toute une série de noyaux communistes capables de se réapproprier programmatiquement les expériences historiques de la classe et de reprendre le fil de la continuité avec les organisations ouvrières du passé, coupé par 50 ans de contre-révolution, il faut comprendre que la nouvelle étape de cette reprise doit entraîner également un stade supérieur. La classe ouvrière doit créer, au cours des luttes à venir, les forces révolutionnaires qui, autour des pôles communistes internationalistes qui sont déjà constitués aujourd'hui, concentreront ses énergies, orienteront ses luttes et renforceront ses mouvements en direction de la REVOLUTION COMMUNISTE ET SON PARTI MONDIAL.
[1] [104] Accion Proletaria n°28 "Révolution communiste ou barbarie capitaliste" (Edito)
[2] [105] Revue Internationale n°23 "La lutte de classes internationale"
[3] [106] Revue Internationale n°24 "La dimension internationale des luttes ouvrières en Pologne"
[4] [107] K. Marx "Misère de la philosophie"
[5] [108] F.Engels "La situation de la classe ouvrière en Allemagne"
[6] [109] F.Engels "La situation de la classe ouvrière en Angleterre"
[7] [110] Accion Proletaria n°33 "Pologne au centre de la situation mondiale"
[8] [111] R. Luxemburg "A l'heure révolutionnaire" Œuvres choisies T.1 (traduit de l'espagnol par nous)
Géographique:
- Pologne [1]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [112]
Heritage de la Gauche Communiste:
Les conditions historiques de la généralisation de la lutte de la classe ouvrière
- 3604 lectures
CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES: LUTTE ECONOMIQUE ET LUTTE POLITIQUE.
1- Si toute lutte économique du prolétariat contient en elle un élément politique et vice-versa, si, contrairement à la thèse de Lénine il n'est pas possible de séparer dans le fond la lutte du prolétariat en lutte trade-unioniste et lutte socialiste (ces deux volets constituant un seul but) comme il est impossible de séparer ce caractère du prolétariat unique dans l'histoire d'être à la fois une classe exploitée et le sujet révolutionnaire, il ne reste pas moins vrai que ces deux aspects -la lutte économique et la lutte politique- qui sont des données constantes dans une même lutte unique de la classe, représentent des moments particuliers dans le temps et des niveaux différents de la lutte, et en conséquence ne restent pas toujours dans un même rapport. Autant il faut rejeter toute idée tendant à séparer lutte économique et lutte politique de la classe (et donc tendant a diviser l'unité de la classe elle-même), autant on doit se garder de méconnaitre (comme l'avait fait le syndicalisme révolutionnaire à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle) les spécificités significatives de chacun de ces deux aspects de la lutte et ce qu'ils recouvrent.
2- On peut aussi établir une correspondance entre le rapport lutte économique et lutte politique dans la lutte générale du prolétariat, avec des périodes historiques de la société capitaliste. Ce rapport se modifie avec le changement de période, jusqu'au point de se renverser complètement.
Le changement de rapport de forces entre classes sociales est déterminé par le changement de période; le changement de période est lui-même a son tour déterminé par l'évolution du capitalisme et le développement interne de ses contradictions. Dans la période ascendante du capitalisme et dans la mesure où la révolution n'est pas posée objectivement et pratiquement à l'ordre du jour, la lutte pour la défense des intérêts économiques ([1] [113]) prend nécessairement le pas sur la lutte politique dans la lutte générale du prolétariat. Les explosions révolutionnaires (politiques) pour si importantes qu'elles soient, ne sont à cette époque que des phénomènes circonstanciels et isolés. Cela est vrai pour les journées de Juin 1848 comme pour la Commune de Paris. La lutte économique est alors l'aspect prédominant dans la lutte globale de la classe. Ce rapport tend à se renverser au fur et à mesure que le capitalisme entre dans sa phase de déclin (1905 est la manifestation de cette tendance dans cette période charnière), et ce renversement trouve son achèvement à partir de la première guerre mondiale.
3- Comme nous l'avons déjà montré dans d'autres textes ([2] [114]), la lutte économique dans la période ascendante se déroule inévitablement sous la forme corporatiste, professionnelle, autrement dit limitée et en ordre dispersée. Et il en est ainsi parce que les prolétaires trouvent face à eux le capital lui-même dispersé en des millions de patrons et de petites fabriques dispersées et isolées. A ce stade, les syndicats sont la forme appropriée: à ce contenu de la lutte. Mais avec le changement de période, lorsque le capitalisme fortement concentré et-centralisé entre en décadence et prend la forme politico-économique du capitalisme d'Etat, déterminant la prédominance du caractère politique de la lutte du prolétariat, la lutte économique de la classe subit également des changements profonds:
-impossibilité du maintien d'une organisation unitaire permanente de défense strictement économique,
-inévitabilité d'une fusion entre la défense économique et le caractère général politique de la lutte, -nécessité de la participation massive et active dans la lutte,- grève de masse et assemblées générales.
Les conditions nouvelles de la lutte "économique" posent l'exigence impérative qui peut se formuler en deux points : l'autonomie et auto-organisation de la classe et l’extension de la lutte.
4- L'extension de la lutte qui est absolument inséparable de son auto organisation ouverte et généralisée à l'ensemble de la classe, doit être fondamentalement comprise comme un dépassement indispensable de toute parcellisation catégorielle, corporatiste, professionnelle, usiniste, régionale, de toute division entre chômeurs et ouvriers dans les usines, entre ouvriers immigrés et ouvriers du pays. Nous appellerons l'extension de la lutte un tel dépassement qui reste encore dans un cadre national, dans les frontières politico-géographiques d'un pays .L'extension a encore généralement pour point de départ le terrain les revendications économiques, la lutte contre l'austérité et les conséquences de la crise sur la vie quotidienne des ouvriers. Nous distinguerons la notion d'extension de la notion de généralisation dans laquelle nous entendons mettre en évidence essentiellement les deux caractères suivants: la généralisation est la lutte s'étendant au delà des frontières à d'autres pays, la généralisation ne peut se faire qu'en prenant d'emblée un caractère politique et_ révolutionnaire.
L'objet de ces thèses est l'examen des conditions historiques de cette généralisation. Cela ne pouvait se faire tant que nous ne l'avions pas dégagé de toutes autres considérations et questions adjacentes dont il faut tenir compte mais qui risquaient d'embrouiller et entraver cet examen. C'est ce que nous espérons avoir réussi à faire dans ces préliminaires, et pouvons donc maintenant passer directement à l'examen de la généralisation.
L'IMMATURITE DES CONDITIONS DE LA REVOLUTION
La lutte de classe au 19ème siècle
5-Dans "Principes du Communisme", fascicule écrit en Octobre-Novembre 1847 et qui devait servir d'ébauche au "Manifeste Communiste") Engels écrit:
"Question 19: Cette révolution se fera-t-elle dans un seul pays? Réponse; Non. La grande industrie, en créant le marché mondial, a déjà rapproché si étroitement les uns des autres les peuples de la terre, et notamment les plus civilisés, que chaque peuple dépend de ce qui se passe chez les autres. Elle a, en outre, uniformisé dans tous les pays civilisés le développement social à un tel point que, dans tous ces pays, la bourgeoisie et le prolétariat sont devenues les deux classes décisives de la société, et que la lutte entre ces deux classes est devenue la principale lutte de notre époque. La révolution communiste, par conséquent, ne sera pas une révolution pure ment nationale; elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés, c'est à dire tout au moins en Angleterre, en Amérique, en France, en Allemagne".
Ici, il ne s'agit pas de répondre a la théorie aberrante du "socialisme en un seul pays" au nom de laquelle devait s'accomplir la contre-révolution stalinienne: il s'agit de la révolution elle-même qui "se produira en même temps dans tous les pays civilisés". Cette thèse énoncée pour la première fois par Engels, certes pas suffisamment développée ni étayée dans sa démonstration, est néanmoins fondamentale et servira de pilier à la théorie et au mouvement marxistes, car elle contient l'idée du caractère obligatoire de la généralisation internationale, dans son contenu comme dans son étendue, de la révolution prolétarienne.
6- Nous retrouvons cette thèse à la base du "Manifeste Communiste", comme des autres écrits de Marx et Engels précédents et suivants la révolution de 1848. Dans "Les luttes de classe en France" par exemple, Marx commentant la défaite de Juin écrit:
" Enfin, les victoires de la Sainte Alliance ont donné à l'Europe une forme telle que tout nouveau soulèvement prolétarien en France sera immédiatement le signal d'une guerre mondiale. La nouvelle révolution française sera obligée de quitter aussitôt le terrain national et de conquérir le terrain européen, le seul où pourra l'emporter la révolution sociale au 19ème siècle".
Non seulement est réaffirmée avec force la thèse a caractère obligatoirement international de la révolution "le seul (terrain) où pourra l'emporter la révolution sociale du 19èrne siècle", mais elle se trouve encore renforcée en précisant le fondement historique de cette révolution: la crise du système économique du capitalisme.
" Nous voyons se dérouler actuellement sous nos yeux un processus analogue. Les conditions bourgeoises de production et d'échange, le régime bourgeois de la propriété, la société bourgeoise moderne, qui a fait surgir de si puissants moyens de production et d'échange, ressemble au magicien qui ne sait plus maîtriser les puissances infernales qu’il a invoqué"(Manifeste Communiste),
7- On peut mettre en doute"l'actualité" (en 1848!) du déclin du système capitaliste. L'histoire devait démentir cette "actualité" et les révolutionnaires, à commencer par Marx et Engels eux-mêmes devaient corriger cette erreur. Seuls des gens qui s'attachent à la lettre plutôt qu'à l'esprit du "Manifeste Communiste", peuvent encore soutenir aujourd'hui, que dés 1848, la révolution prolétarienne était à l'ordre du jour de l'histoire, que dès 1848, la révolution était une possibilité, voir une nécessité. On trouve en effet dans le "Manifeste Communiste":
" Les forces productives dont vile dispose ne servant plus à faire avancer le régime de la propriété bourgeoise, -elles sont devenues au contraire pour elle, qui leur fait obstacle. . Les rapports bourgeois sont devenus trop étroits pour contenir les richesses qu'ils ont crées".
Si 1848 n'a pas vu la généralisation de la révolution prolétarienne (à commencer par l'Angleterre et l'Amérique), cela est indubitablement du au fait que les conditions historiques n'étaient pas encore présentes, contrairement à ce que pouvaient penser Marx et Engels. 1848 annonçait l'ouverture d'une ère d'épanouissement du capitalisme. Mais ce qui est fondamental et qui reste un acquis de granit du "Manifeste" est l'analyse qui détermine l'inévitabilité de la révolution prolétarienne par la crise du système économique du capitalisme, ce qui constituera la colonne vertébrale de la théorie marxiste.
8- Cette double affirmation du déterminisme que constitue la crise, et de la nécessité impérieuse de l'internationalisation de la révolution reste par trop générale, c'est à dire trop abstraite et sans lien précis interne tant qu'on n'est pas parvenu à démontrer concrètement les conditions historiques nécessaires à la généralisation de la révolution. Par exemple, comprenant le caractère bourgeois de la révolution en Allemagne en 1848, et dans le feu des événements, Marx et Engels croyaient, durant un temps, pouvoir greffer sur elle la révolution prolétarienne. C'était leur vision de "la révolution en permanence" proclamée dans "L'adresse du Conseil Central à la Ligue'' en Mars 1850. Mais cette fois encore, la réponse sera infirmée et rapidement abandonnée par eux. Ils devaient se rendre compte que la révolution bourgeoise ne constitue pas la détermination de la révolution prolétarienne, et encore moins la condition de la généralisation. Ils devaient, comme le disait Engels dans ses "Quelques mots sur l'histoire de la Ligue des Communistes" en Octobre 1885, prendre conscience "qu'une nouvelle période de prospérité inouïe s'était ouverte" et de se rappeler ce qu'ils écrivaient dans la "Neue Rheinische Zeitung" fin 1850:
En présence de cette prospérité générale où les forces productives de la société bourgeoise s'épanouissent avec toute la luxuriance somme toute possible dans le cadre bourgeois, il ne saurait être question d'une véritable révolution. Une telle révolution n'est possible que dans des périodes où il y a conflits entre ces deux facteurs, les formes productives modernes et les formes de production bourgeoise.
9- Suite à l'expérience et aux enseignements de la révolution de 1848-50, Marx et Engels rompront avec "ces radicaux faiseurs de révolutions" et se maintiendront fermement au prémisse de la crise économique, fondement de la révolution. Ils attendront et scruteront impatiemment le retour de la crise (voir leur correspondance de 1854-55) et décèleront effectivement son arrivée en 1856. Mais leurs espoirs seront de nouveau déçus, car ils restent encore attachés à la vision du Manifeste qui voit dans les crises cycliques un retour constant de la prémisse de la révolution. Il y a ici une ambiguïté entre la crise cyclique et la crise historique, permanente du capitalisme.
Les crises cycliques indiquent bien la contradiction existante dans le système capitaliste entre forces productives et rapports de production, mais qui reste latente et non explosive, et même stimulante, Citant que le capitalisme trouve des solutions, notamment dans la rencontre de nouveaux marchés. En effet, les crises cycliques qui se sont succédées dans la deuxième moitié du 19ème siècle, ne donneront jamais lieu à des explosions révolutionnaires et encore moins à leur généralisation. Marx et Engels seront parfaitement convaincus désormais de cette réalité, et les premiers à mettre en garde les ouvriers de Paris contre une insurrection prématurée et vouée à l'échec. Ils seront les plus sévères critiques du blanquisme, et les plus acharnés contre les aberrations volontaristes de Bakounine et de ses adeptes champions de la phraséologie révolutionnaire et des actions volontaristes.
10- L'écrasement sanglant de la Commune de Paris devait apporter la preuve, non pas de l'inanité de la révolution communiste (qui reste une nécessité et possibilité historique), ni de la nécessité indispensable de sa généralisation pour triompher mais de l’immaturité de ses conditions infirmant et confirmant à la fois la perspective émise par Marx dans "Les luttes de classe en France" que "la nouvelle révolution française sera obligée de quitter aussitôt le terrain national et de conquérir le terrain européen, le seul où pourra l'emporter la révolution sociale, du 19ème siècle".
La défaite de la Commune et l'épanouissement plus fort que jamais du capitalisme mondial devaient jeter pour des décennies un grand désarroi dans le mouvement ouvrier, donnant naissance d'une part à 1'anarcho-syndicalisme qui, désorienté et jetant par dessus bord toute investigation théorique, et emporté par son "impatience" cherchait coûte que coûte dans la lutte économique immédiate la révolution et les conditions de sa généralisation, et croyait les avoir enfin découvertes dans la "grève générale" faisant des artifices de leur imagination et de leur désir de panacée universelle; d'autre part produisant une séparation dans la lutte de classe entre la lutte économique (syndicats) et la lutte politique (partis), et provoquant au sein même du mouvement socialiste l'affrontement entre une majorité subissant les nouvelles conditions qui va évoluer de plus en plus ouvertement vers le gradualisme et le réformisme de la démocratie bourgeoise, et une minorité dispersée qui s'efforçait de se maintenir sur les bases du marxisme révolutionnaire.
En dépit de la persistance de la lutte de classe et de son élargissement, la révolution et les conditions de sa généralisation semblaient s'éloigner de la réalité, au fur et à mesure du développement du capitalisme, et le socialisme devenait un idéal lointain. La révolution et le socialisme deviennent l'objet de recherches essentiellement théoriques et de spéculations abstraites. La caractéristique de la lutte de classes dans les dernières décades du 19ëme siècle n'est pas tant dans les difficultés qu'éprouvent les révolutionnaires à trouver la réponse adéquate, mais dans la situation elle-même, qui parait ne pas la contenir, ou plus exactement ne pas vouloir révéler son secret.
LA GREVE DE MASSE : LA REVOLUTION DE 1905
11 - 1905 sera un coup de tonnerre dans un ciel serein. Non pas que des mouvements de bouleversements n'étaient prévus, au contraire. Tout le monde les .attendait, et plus particulièrement les socialistes qui s'y préparaient. Déjà le vieil Engels les avait, annoncés quelques temps avant sa mort. Mais ce qui surprenait, c'était la force impétueuse du jeune prolétariat russe et la .pusillanimité de la bourgeoisie. Les socialistes s'y préparaient, mais dans quel désordre et confusion politique! Les menchéviks y voyaient une stricte révolution antiféodale et assignaient au prolétariat un simple soutien au gouvernement de la bourgeoisie. Les bolcheviks de leur coté y voyait une révolution démocratico-bourgeoise avec une participation prépondérante de la classe ouvrière et préconisait une "dictature démocratique des ouvriers et paysans". D'autres comme Trotsky-Parvus parlaient de "gouvernement ouvrier" et reprenaient en l'actualisant le vieux slogan de la "révolution permanente". Pour tous, le modèle auquel ils se référaient était la révolution bourgeoise de 1789 et de 1848. A la base de toutes les analyses était la spécificité des conditions en Russie. Le contexte de la situation mondiale et la période historique du capitalisme passaient au second plan. Et pourtant, nous assistions à des phénomènes absolument nouveaux: une totale impuissance de la bourgeoisie se réfugiant dans le giron de la monarchie tsariste; une immobilité de l'immense population de la paysannerie et de l'armée dont elle était la principale composante; un mouvement spontané encore jamais vu entrainant l'immense majorité des ouvriers, s'auto-organisant, prenant des initiatives dans toutes les villes, faisant reculer le pouvoir, débordant largement les partis socialistes et leurs consignes, et enfin le surgissement d'un type nouveau d'organisation du prolétariat unifiant la lutte économique et politique: les Soviets ouvriers. Et alors que les partis socialistes se chamaillaient sur la nature des événements et les perspectives, les masses agissaient spontanément, montrant une capacité créative surprenante. Ce dernier fait remet en question le concept classique du rôle et de la fonction du parti politique, son rapport à la classe, son rôle qu'il avait joué au 19ëme siècle d'organisateur de la classe ainsi que le mode d'action classique de la lutte d'autrefois -les grèves corporatistes et syndicales- dépassé par un mode nouveau à caractère de masse et plus dynamique, ce que Rosa Luxembourg mettra en évidence: la grève de masses. 1905 est le type même de l'extension et de l'auto-organisation spontanée de la lutte du prolétariat. La répercussion dans d'autres pays est encore faible, mais elle est néanmoins une indication d'une tendance à la généralisation.
L'aile droite de la 2ème Internationale, majoritaire, surprise par la violence des événements ne comprend rien à ce qui vient de se passer sous ses yeux, mais manifeste bruyamment sa réprobation et sa répugnance face au développement de la lutte de classe, annonçant ainsi le processus qui va l'amener rapidement à passer dans le camp de l'ennemi de classe. L'aile gauche trouve dans ces événements une confirmation de ses positions révolutionnaires, mais elle est loin de saisir toute sa signification, à savoir que le monde capitaliste se trouve dans une période charnière de son évolution, de son apogée vers son déclin. La nouvelle situation leur imposera le besoin d'une profonde réflexion théorique, d'un réexamen du mouvement du capital, et surtout d'une analyse de sa phase finale: l'impérialisme et la marche vers l'effondrement du capitalisme. Cette étude est à peine ébauchée et très insuffisamment développée et comprise quand les événements se précipitent.
LES CONDITIONS DE LA GENERALISATION DE LA LUTTE DE CLASSE
La guerre de 1914-18, la révolution de 1917, la 2ème Guerre Mondiale
12- 1914 viendra confirmer pleinement et globalement l'analyse de la nouvelle période historique, qui sera résumée par Lénine dans la formule ; "l'ère des guerres impérialistes et des révolutions prolétariennes"
Les points forts de cette analyse sont:
a) Le capitalisme comme système connait des périodes de développement et de déclin.
b) Les crises cycliques de la période ascendante ne pouvaient amener la révolution prolétarienne. Seule la période de déclin de l'ensemble du système économique capitaliste fait de la révolution une nécessité et une possibilité.
c) Cette révolution ne peut donc être que mondiale et, plus vite elle se généralise à un plus grand nombre des pays industrialisés, plus grandes sont ses chances de triompher.
On peut constater ici, non seulement un retour en force aux positions énoncées par Engels dans les "Principes du Communisme", mais encore leur renforcement avec la précision apportée sur la période historique de la révolution que seule la réalité a permis de dégager pleinement. Mais il subsistait encore toute une série de questions qui demeurent non clarifiées : la définition de l'impérialisme et le problème de la saturation des marchés ([3] [115]), la théorisation d'une soi-disant '' loi du développement inégal du capitalisme" ([4] [116]), la théorisation du "chainon le plus faible" ([5] [117]) et l'anachronisme de se tenir aux anciens modes de lutte, absolument inadéquat dans la nouvelle période ([6] [118]). C'est à dire que ce sont 'précisément, les questions qui touchent le plus directement aux problèmes de la généralisation qui restent le moins élaborées ou auxquelles on donne des réponses carrément fausses.
13- De plus, si les révolutionnaires trouvent dans l'éclatement de la guerre mondiale la preuve irréfutable de "l'effondrement catastrophique" du capitalisme sous le poids de ses propres contradictions internes arrivées à terme, fondant ainsi la détermination objective de la révolution, ils croient trouver également en elle les conditions nécessaires de sa généralisation.
N'est-il pas vrai que les révolutions à ce jour étaient étroitement liées à des guerres capitalistes? Ceci est vrai pour la Commune de Paris -suite directe de la guerre prusso-française - et est également vrai pour 1905 qui suit la guerre russo-japonaise. S'appuyant sur ces exemples, les révolutionnaires devaient logiquement raisonner en ces termes: la guerre étant mondiale crée les conditions de la généralisation de la révolution.
L'éclatement effectif de la révolution russe et la vague révolutionnaire qui l'a suivie servant de preuve, devaient renforcer cette conviction qui reste dominante parmi les révolutionnaires jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, n'est-il pas vrai que les bordiguistes et bien d'autres attachent si peu d'importance à la question du "Cours Historique" parce qu'ils misent sur la guerre qui, à leurs yeux, devraient donner naissance à la révolution? Or, si nous examinons de plus prés les expériences de l'histoire, les arguments avancés en faveur de cette conviction sont loin d'être aussi convaincants qu'ils ne l'apparaissent. Il est vrai que les guerres déterminent des convulsions sociales allant jusqu'à des explosions révolutionnaires et même à des triomphes. Mais ces triomphes sont isolés et de courte durée, comme c'était le cas pour la Commune de Paris ou pour la révolution de 190b (qui de plus se produit dans une période d'immaturité historique) ou pour la Hongrie, et même si le prolétariat parvient à garder le pouvoir pour un temps assez long, son isolement le condamne rapidement à la dégénérescence et finalement à la contre révolution comme le montre la révolution russe.
14- Pourquoi cela? Parce qu'il ne peut y avoir de mouvement révolutionnaire triomphant s'il ne contient pas et ne développe pas la tendance à l'internationalisation de la lutte, comme il ne peut y avoir de réelle internationalisation sans qu'elle soit révolutionnaire. Cela implique que les conditions de la révolution triomphante soient données à la fois dans la situation économico-politique et dans le rapport de forces favorables au prolétariat contre le capitalisme, à l'échelle mondiale. La guerre est certainement un haut moment de la crise du capitalisme, mais on ne doit pas perdre de vue que c'est aussi une réponse du capitalisme à sa crise, c'est à dire un moment avancé de sa barbarie qui, comme tel, ne favorise pas les conditions de la généralisation de la révolution.
Voyons cela de plus près. Déjà durant la première guerre mondiale, Rosa Luxembourg jetait un cri d'alarme et attirait l'attention, de sa prison, sur le fait que la bourgeoisie était en train de massacrer, sur ses champs de bataille, la fine fleur du prolétariat, sa jeunesse, les meilleurs combattants de la classe révolutionnaire. La deuxième guerre mondiale devait démontrer, dans la technique et l'organisation, la capacité de la bourgeoisie de multiplier le massacre (au moins par 2 et demi), d'étouffer toute velléité de lutte de classe et de faire table rase de tout organisme de la classe ouvrière. Et cela aussi bien dans l'armée que dans la population civile.
Sur le plan du massacre, ce que pouvait être les implications d'une guerre, avec toute la technique moderne, mieux vaut ne pas y penser. Sur un autre plan: la première guerre mondiale était une guerre de tranchée, ce qui permettait dans une certaine mesure le contact entre soldats des camps ennemis, d'où le mot d'ordre et une certaine possibilité de sa réalisation effective: la fraternisation. Ce n'est plus le cas dans la deuxième guerre mondiale au cours de laquelle l'infanterie joue déjà un rôle secondaire. Dans une prochaine guerre, les gens seraient massacrés par centaines de mille comme à Hiroshima, sans même avoir vu "l'ennemi".
Dans le mouvement de la révolution en Russie il est à constater que les soldats sont les derniers bastions à être gagnés ou simplement neutralisés. Ce sont les marins, ces "prolétaires flottants", qui sont le bras armé de la révolution. Cela est encore plus net en Allemagne. La raison en est très simple: parce que l'armée n'est pas le lieu de la concentration ouvrière mais le lieu où les ouvriers sont noyés dans une masse de paysans et autres couches.
La bourgeoisie a montré dans la deuxième guerre comment elle a parfaitement assimilé les enseignements de la première pour ce qui concerne les dangers de révoltes ouvrières.
En 1943, c'est volontairement que l'Angleterre ne profite pas de l'avantage donne par l'effondrement de l'armée de Mussolini et s'abstient d'envahir le nord de l'Italie, laissant à l'armée allemande le soin de réprimer les luttes des ouvriers de Milan et de Turin. Comme l'expliquait Churchill, c'était la politique de "laisser les italiens mijoter le temps nécessaire dans leur jus". La même politique sera employée par l'armée russe qui pendant 3 jours reste devant les portes de Varsovie et de Budapest qui sont soulevées, pour laisser le temps nécessaire à l'armée allemande en déroute pour accomplir la saignée judicieuse. Ce sera ensuite l'avance précipitée des armées aussi bien russes qu'américaines, en Allemagne pour relever au plus vite l'appareil défaillant hitlérien afin d'écraser dans l'œuf toute tentative de soulèvement.
Mais ce qui reste important et qui diminue de beaucoup l'efficacité du défaitisme révolutionnaire est le fait que la guerre produit des vainqueurs aussi bien que des vaincus, en même temps que la rage révolutionnaire contre la bourgeoisie se produit également dans la population une tendance revancharde. Et cette tendance revancharde pénètre jusque dans les rangs des révolutionnaires comme en témoigne la tendance du national-communisme dans le K.A.P.D. et la lutte contre le traité de Versailles qui va devenir l'axe de la propagande du K.P.D. Pire encore est l'effet produit sur les ouvriers dans les pays vainqueurs. Comme l'a démontré déjà le premier après-guerre et encore plus le second, ce qui prévaut, à coté d'une réelle et lente reprise de la lutte déclasse, c'est un esprit de la lassitude sinon un délire chauvin tout court.
15- Non, la guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à la généralisation. Contrairement à la thèse misant sur la guerre et qui implique la vision d'un cours extrêmement rapide surprenant la bourgeoisie -modèle russe- la révolution se présente - comme l'a dit Rosa Luxembourg au Congrès de fondation du PC en Allemagne - comme un long et douloureux processus, plein d'embûches, d'avancées et de reculs de la lutte. C'est dans ce processus que mûrissent les conditions de la généralisation, de la prise de conscience et de la capacité de la classe à s'organiser. Les révolutionnaires devaient cesser de faire de leur impatience un point de référence et apprendre à travailler à long terme, comme la réalité l'indique.
16-Nous avons défini la période de reconstruction comme un intervalle dans le mouvement de "crise-guerre- reconstruction- crise" qui est 1° mouvement du capital dans sa décadence. Ce qui est fondamental dans ce mouvement ce ne sont pas les termes intermédiaires (la guerre et la reconstruction), mais le point de départ et le point d'arrivée. Aucun des termes intermédiaires n'est fatal. Seuls les termes extrêmes "crise-crise" déterminent la caractéristique permanente de la période historique.
La guerre n'est possible qu'après une défaite du prolétariat laissant les mains libres à la bourgeoisie pour conduire la société aux pires catastrophes.
Depuis le début de la crise aiguë, à la fin des années 60, le prolétariat a repris sa lutte et à travers des hauts et des bas, il n'a fait que la développer pour atteindre aujourd'hui avec la Pologne le point le plus haut depuis un demi-siècle.
Mais la Pologne n'est pas le point final, et ce serait pur verbiage aventuriste de lui demander autre chose que ce qu'elle est. En Pologne, c'est une position avancée atteinte et occupée par un section de l'armée prolétarienne. Il importe maintenant que le gros de la classe l'ait rejoint. En attendant le prolétariat n'a aucun intérêt à sacrifier une de ses parties les plus combatives dans des affrontements militaires prématurés qui, isolée, est inévitablement vouée à la défaite. La victoire ne peut s'obtenir que par un avancement généralisé de la classe.
Les conditions de la généralisation se trouvent dans la crise elle-même. L'inexorable enfoncement du capitalisme dans une crise de plus en plus profonde crée 1'inexorabilité de la marche vers la généralisation de la lutte, condition de 1'ouverture de la révolution à l'échelle mondiale et sa victoire finale.
[1] [119] Pour éviter toute équivoque, précisons que sous le terme "économique" nous entendons tout ce qui concerne l'aménagement des conditions de vie générales et immédiates de la classe, en la distinguant du terme "politique" qui se réfère strictement au devenir et buts historiques dont le prolétariat est porteur.
[2] [120] Voir RINT n°23: "La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme".
[3] [121] La non définition exacte de la nature de l'impérialisme conduira à une division du monde en pays impérialistes et pays anti-impérialistes et de ce fait, à un lien qui existerait entre la révolution prolétarienne et les luttes de libération nationale.
[4] [122] Ce qui remettra en question 1'unité indispensable de la vague de révolutions simultanées et permettra ensuite à Staline de fonder là-dessus sa théorie du "Socialisme en un seul pays". L'inégalité du développement du capitalisme agit dans le sens du développement de l’interdépendance et donc de l'unification de la production mondiale qui trouve son achèvement dans la période de déclin en entrainant tous les pays dans la barbarie.
[5] [123] Prise à la lettre et en en faisane n axe, cette "théorie" finit par privilégier la maturité des conditions de la révolution dans les pays sous-développés aux dépens des pays hautement industrialises avec un prolétariat le plus concentré, le plus expérimenté, ce qui renverse complètement la vision juste de Marx et Engels à ce sujet.
[6] [124] Parlementarisme, syndicalisme, question nationale, front unique etc...
Questions théoriques:
- Le cours historique [125]
Heritage de la Gauche Communiste:
Résolution sur la lutte de classe
- 2483 lectures
C'est sur trois plans, complémentaires mais distincts, qu'il est nécessaire d'analyser la lutte de classe aujourd'hui pour en comprendre les caractéristiques et en dégager les perspectives :
- sur le plan historique général de la décadence du capitalisme,
- sur le plan de la reprise de la lutte du prolétariat à partir de la fin des années 60 à la suite d'un demi-siècle de contre-révolution,
- sur le plan du moment présent de ces luttes marquées par un nouveau déploiement qui succède à la pause observée par la classe à la suite de la première poussée des années 68-74.
1) Comme l'ensemble des luttes ouvrières dans la période de décadence du capitalisme, les luttes d'aujourd'hui ont les caractéristiques suivantes :
- elles se développent en même temps que s'aggrave la crise de la société capitaliste, contrairement à celles du siècle dernier (surtout sa 2e moitié) à qui les crises cycliques de cette époque étaient en général fatales,
- elles n'ont pas de ce fait, comme perspective une amélioration progressive des conditions de vie du prolétariat au sein du système mais elles participent directement des préparatifs de son renversement,
- leur dynamique les pousse à dépasser les catégories (métiers, branches industrielles) pour préfigurer et créer les conditions de l'affrontement révolutionnaire futur où ce ne sera pas une somme de secteurs partiels de la classe ouvrière qui entrera en action mais l'ensemble du prolétariat comme classe,
- comme en tous temps, elles sont organisées mais el les ne peuvent l'être de façon préalable : bien que les ouvriers ne puissent à aucun moment renoncer à la lutte pour la défense de leurs intérêts économiques, bien au contraire, toute organisation permanente basée sur la défense de ces intérêts (syndicats) est condamnée à être récupérée par le capitalisme et intégrée au sein de son Etat; depuis l'entrée du capitalisme dans sa phase de période de décadence, il n'est plus possible au prolétariat de s'organiser pour la lutte, il organise la lutte et cette organisation prend la forme des assemblées générales, des comités de grève élus et révocables, et, dans les périodes révolutionnaires, des conseils ouvriers,
- face à un capitalisme ultra-concentré, elles ne peuvent avoir d'efficacité réelle que si elles tendent à s'élargir; contrairement au passé, la durée n'est plus une arme véritable d'une lutte si elle reste isolée et de ce fait, la véritable solidarité prolétarienne ne peut plus s'exercer sous forme de collectes, de soutien aux grévistes mais bien par une extension du combat; dans la période de décadence du capitalisme, l'arme la plus importante du prolétariat pour repousser les attaques féroces d'un système aux abois et pour préparer son renversement, la véritable manifestation de la solidarité de classe, c'est la grève de masse.
2) Depuis 1847, il est clair pour les révolutionnaires que "la révolution communiste ...ne sera pas une révolution purement nationale, (qu') elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés.." (Engels. "Les principes du communisme"). Et, effectivement, c'est à l'échelle mondiale que s'est déployée la première vague révolutionnaire de ce siècle (1917-23). Sur ce plan, la présente reprise de la lutte de classe qui devra culminer dans la révolution communiste ne se distingue pas de la précédente : d'emblée, elle a eu le monde entier pour théâtre. Mais les conditions spécifiques dans lesquelles elle se développe (crise économique aigue du capitalisme et non guerre impérialiste) lui donnent de bien meilleurs atouts que n'en a disposés la précédente pour conduire à son terme le processus de mondialisation du combat révolutionnaire.
En effet, si la guerre impérialiste a eu comme résultat de plonger brutalement le prolétariat des pays belligérants dans une situation commune de misère atroce et de massacres absurdes ce qui, lors de la première guerre, a provoqué une dislocation rapide des mystifications capitalistes et a contraint la classe à se poser d'emblée le problème de la politisation et du caractère mondial de sa lutte, cette même guerre impérialiste portait en elle toute une série d'obstacles à la généralisation des luttes révolutionnaires à 1'échelle mondiale :
- la division entre pays belligérants et pays "neutres" : dans ces derniers pays, le prolétariat ne subit pas de dégradation massive de ses conditions de vie;
- la division entre "pays vainqueurs" et "pays vaincus" : dans les premiers, le prolétariat a été le plus souvent une proie facile pour la fierté chauvine déversée massivement par la bourgeoisie; dans les seconds, si la démoralisation nationale créait de meilleures conditions pour le développement de l'internationalisme, elle ne fermait pas la porte, au contraire, au développement de sentiments de revanche (cf. "national bolchévisme" en Allemagne);
- face à un mouvement révolutionnaire né de la guerre impérialiste, il restait comme recours à la bourgeoisie d'interrompre celle-ci (cf. Allemagne en novembre 1918),
- une fois la guerre impérialiste terminée, la possibilité de reconstruction qui s'offre au capitalisme et donc d'une certaine amélioration du fonctionnement de son économie a brisé l'élan prolétarien en le privant de son aliment de base : la lutte économique et le constat de faillite du système.
Par contre, le développement progressif d'une crise générale de l'économie capitaliste, s'il ne permet pas une prise de conscience aussi rapide des véritables enjeux de la lutte ni de la nécessité de l'internationalisme, élimine cependant les obstacles énumérés ci-dessus en ce sens :
- qu'il tend à mettre le prolétariat de tous les pays sur le même plan : la crise mondiale n'épargne aucune économie nationale,
- qu'il n'offre à la bourgeoisie aucune porte de sortie sinon celle d'une nouvelle guerre impérialiste qu'elle ne pourra déchaîner tant que le prolétariat n'aura pas été battu.
3) Si c'est dès le resurgissement historique de la lutte de la classe ouvrière à la fin des années 60 que se sont imposées à elle les exigences que nous avons signalées, ce n'est que progressivement, à travers tout un processus, que le prolétariat pourra acquérir une claire conscience de ces exigences. Dès les combats qui commencent en 1968 et s'étendent jusqu'en 74 (76 pour l'Espagne) la classe est confrontée à l'obstacle syndical, au besoin d'auto-organisation et d'extension de la lutte, de même qu'au caractère mondial de son combat. Cependant, c'est encore de façon tout à fait embryonnaire et minoritaire que se fait jour dans la classe une conscience de ces enjeux et de ces exigences (grève générale en France mais contrôlée par les syndicats; débordement des syndicats en Italie, mais récupération par les "comités de base"; mouvement des assemblées en Espagne mais canalisé vers un "syndicalisme de base"; impact international des grèves en France ou en Italie mais reçu de façon passive par les ouvriers des autres pays, etc.).
Et c'est en particulier en s'appuyant sur ces faiblesses du prolétariat, résultant notamment du poids du demi-siècle de contre-révolution d'où il sort.que la bourgeoisie a pu mener de façon efficace au milieu des années 70 sa contre-offensive basée sur la carte de la "gauche au pouvoir" ou sur "le chemin du pouvoir". Mais ce type d'offensive de la bourgeoisie était également permis par le caractère relativement supportable de la crise jusqu'en 74 et sur l'illusion amplement partagée dans toutes les couches de la société que l'effondrement de 74-75 n'était qu'un incident de parcours sans lendemain.
Avec la nouvelle aggravation de la crise économique qui prend place à la charnière des deux décennies 70 et 80 s'ouvre une situation nouvelle tant pour la vie de la bourgeoisie que pour celle du prolétariat. Après les "années d'illusion" viennent maintenant "les années de vérité", celles où se posera avec une bien plus grande acuité l'alternative historique guerre mondiale ou révolution, celles où seront balayées les illusions sur une possible "alternative" permettant au système de sortir de sa crise, celles où les exigences et les enjeux de la lutte de classe se poseront au prolétariat avec une insistance inconnue jusqu'à présent.
4) Ces "années de vérité" imposent à la bourgeoisie un autre type de contre-offensive face à la classe ouvrière, un type d'offensive beaucoup moins basée sur les illusions et la croyance en des "lendemains qui chantent" et beaucoup plus basée, justement, sur des "vérités" qu'on n'arrive plus â dissimuler et qu'on tente d'employer pour démoraliser le prolétariat.
Cette offensive se base également sur un partage systématique des tâches entre les différents secteurs de la bourgeoisie afin que cette classe puisse couvrir, à travers les diverses manifestations de son Etat, l'ensemble de la scène sociale, qu'elle puisse colmater du mieux possible les fissures que la crise provoque de plus en plus dans son système de domination.
Dans ce partage, il revient à la droite -c'est à dire le secteur politique qui, au delà des étiquettes n'est pas directement lié à l'encadrement et à la mystification des ouvriers- la tâche de 'parler franc" et d'agir en conséquence depuis la position gouvernementale qu'elle tend à occuper de plus en plus. De l'autre côté, il revient à la gauche -c'est à dire lés fractions bourgeoises qui, de par leur langage et leur implantation en milieu ouvrier ont pour tâche spécifique de mystifier et encadrer les travailleurs- depuis l'opposition où elle tend à passer dans presque tous les pays, de faire en sorte que ce "franc parler" ne puisse servir au prolétariat pour développer une conscience claire de la situation ni l'encourager à pousser plus avant sa riposte de classe.
C'est ainsi que lorsque la droite au pouvoir affirme que la crise est internationale et qu'elle n'a pas de solution à l'échelle nationale, la gauche dans l'opposition clame bien fort le contraire pour empêcher la classe ouvrière de prendre conscience de la faillite de l'économie capitaliste et de la dimension mondiale de ses luttes.
Lorsque la droite avance de plus en plus l'idée que la guerre est une menace réelle, il revient à la gauche de masquer cette réalité à travers toutes sortes de bavardages pacifistes et empêcher le prolétariat de comprendre le véritable enjeu de la situation présente. Lorsque la droite présente comme inévitable l'augmentation de l'austérité et du chômage, il revient à la gauche de prétendre le contraire en parlant de la "mauvaise gestion" des partis de droite, du "rôle des grands monopoles" et en appellent à "faire payer les riches", afin de masquer aux ouvriers le fait qu'il n'y a pas de solution de rechange, que, quel que soit le remède, c'est le capitalisme sous toutes ses formes qui est condamné et porte avec lui une misère croissante.
Lorsque la droite au pouvoir augmente les moyens et mesures de répression au nom de "l'insécurité, de la menace "terroriste" ou même "fasciste", il revient à la gauche de les faire accepter par la classe ouvrière en évoquant fébrilement ces mêmes dangers ou, en appelant à une utilisation plus "démocratique" de cette répression, de l'empêcher de prendre conscience que c'est toute la société d'exploitation, quelles que soient les forces qui la dirigent, qui porte en elle l'oppression et la répression.
Ainsi, dans tous les domaines où la bourgeoisie mène son offensive, il appartient aux secteurs de gauche, ceux en qui la classe ouvrière garde le plus d'illusions, de faire en sorte que cette offensive ne rencontre pas une résistance croissante, qu'elle n'ouvre de plus en plus les yeux des prolétaires jusqu'à leur faire comprendre qu'il n'y a d'autre issue que le renversement du capitalisme, de faire en sorte que cette offensive ne provoque et ne rencontre que désorientation, résignation et désespoir.
Le fait qu'aujourd'hui, la bourgeoisie soit conduite à jouer la carte de "la gauche dans l'opposition" contre la classe ouvrière ne signifie pas que cette carte soit la seule jouable en tout temps et toutes circonstances. En particulier, dans certaines situations, la gauche joue mieux son rôle en participant au pouvoir : soit dans des gouvernements "d'union nationale" lors des guerres impérialistes, soit directement à la tête du gouvernement dans des périodes révolutionnaires. D'autre part, si sa prise en charge d'un rôle d'opposition "décidée" correspond à une exigence générale pour la bourgeoisie dans la période actuelle de reprise des luttes de classe à la suite de la pause du milieu des années 70, cela ne veut pas dire que cette exigence trouve en toutes circonstances une concrétisation immédiate ou optimale. Mais tous les exemples spécifiques d'incapacités (qu'elles soient de nature électorale ou autre) pour la bourgeoisie de mettre résolument ses partis de gauche dans l'opposition doivent être compris comme expression des faiblesses particulières de cette classe qui manifestent sa crise politique et ne peuvent que l'aggraver à terme,
5) Seul le passage ou le maintien de la gauche dans l'opposition lui permet de se faire encore écouter par les travailleurs, de leur faire avaler ses mensonges, seul ce passage ou ce maintien lui permet également de saboter efficacement, de l'intérieur, les luttes que l'aggravation de la misère provoque et provoquera nécessairement.
Libérée de ses responsabilités gouvernementales, la gauche peut aujourd'hui tenir un langage plus "radical", plus "ouvrier". Elle peut reprendre à son compte, afin de pouvoir mieux les détourner, certaines aspirations de la classe. Elle peut appeler à la lutte, appeler à l'extension de celle-ci, même à son "auto-organisation" quand elle a la garantie que ses syndicats contrôlent bien cette "extension" ou que cette "auto-organisation" reste isolée.
Dans la période qui vient, la gauche et les syndicats, comme ils ont commencé à le faire, ne ménageront aucun effort pour assourdir les prolétaires d'un tapage "combatif", pour les désorienter par une intransigeance de façade et par un adroit partage des tâches entre les appareils syndicaux et le syndicalisme "de base". Tout cela dans le but d'épuiser la combativité prolétarienne, de l'épar piller, de lui interdire d'accéder à une classe consciente des véritables enjeux de la lutte.
6) Même si elle est menée de façon préventive, systématique et coordonnée à l'échelle mondiale, cette nouvelle offensive de la bourgeoisie n'a pas rencontré jusqu'à présent un succès complet. En effet, depuis deux ans, avec la grève de Rotterdam (septembre 1979), celle des sidérurgistes de Grande-Bretagne (janvier-avril 80), celle des métallurgistes du Brésil (avril 80), celle des transports à New York et des ouvriers de Gorki et Togliatti rad en URSS (mai 80), les affrontements en Corée du Sud (mai 80), et surtout l'immense mouvement des ouvriers de Pologne, s'est trouvée confirmée la perspective dégagée par le 3ème Congrès du CCI : "... Après une période de relatif recul des luttes couvrant le milieu, des années 70, la classe ouvrière tend â renouer aujourd'hui avec une combativité qui s'était manifestée de façon généralisée et souvent spectaculaire à partir de 1968" (Résolution sur la situation internationale).
Ainsi, si le passage de la gauche dans l'opposition a pu représenter pour la bourgeoisie un renforcement de ses positions, il s'agit d'un renforcement par rapport à la formule antérieure de "gauche au gouvernement" qui devenait caduque face à l'aggravation de la crise et la reprise des combats de classe et nullement d'un renforcement absolu face à la classe ouvrière.
7) De la même façon, ce renforcement, s'il est pour le moment indiscutable, ne saurait être que momentané. Au fur et à mesure que les luttes vont se développer, seront dépassés les obstacles que la gauche oppose à la prise.jie conscience de la classe. Ainsi dans les deux années passées s'est également trouvée confirmée l'analyse du 3ëme Congrès : "Bien qu'elle n'apparaisse vas immédiatement en pleine lumière, une des caractéristiques essentielles de cette nouvelle vague de luttes sera de redémarrer au niveau qualitatif le plus élevé atteint par la vague précédente. Cette caractéristique se manifestera essentiellement par une tendance plus marquée que par le passé à un débordement des syndicats, à l'élargissement des combats au-delà des limites catégorielles et professionnelles} à une conscience plus claire du caractère international de la lutte de classe". (Résolution sur la situation internationale).
Cette confirmation, c'est essentiellement la lutte des ouvriers de Pologne qui l'a apportée. En effet, cette lutte a donné une réponse à toute une série de questions que les luttes précédentes avaient posée sans pouvoir y répondre ou le faire clairement :
- la nécessité de l'extension de la lutte (grève des dockers de Rotterdam) ;
- la nécessité de son auto-organisation (sidérurgie en Grande-Bretagne) ;
- l'attitude face à la répression (lutte des sidérurgistes de Longwy-Denain).
Sur tous ces points, les combats de Pologne représentent un grand pas en avant de la lutte mondiale du prolétariat et c'est pour cela que ces combats sont les plus importants depuis plus d'un demi-siècle. Mais ces combats ont à leur tour posé une nouvelle question, fondamentale, au prolétariat à laquelle les ouvriers de Pologne ne peuvent répondre par eux-mêmes : la nécessité de la généralisation mondiale du combat de classe.
Cette question, c'est le capitalisme qui a déjà commencé à y répondre par son unité face à la classe ouvrière, unité au sein des blocs impérialistes, et également, malgré tous les antagonismes inter-impérialistes, entre les blocs. De l'ouest à l'est, face à la menace prolétarienne, tous les pays capitalistes font passera l'arrière-plan leurs divisions internes; ils tirent des leçons communes au niveau de l'efficacité des mesures à prendre face à la classe ouvrière : utilisation de la mystification nationaliste, démocratique, syndicaliste; menaces d'interventions militaires ; répression.
Dans des zones comme l'Amérique Centrale (El Salvador), le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-est, le prolétariat se trouve isolé, n'étant pas fortement concentré et avec des traditions de lutte moindres qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Dans ces zones se mène une répression féroce et sanglante derrière les larmes hypocrites des ai de-fossoyeurs, les chefs d'Etat des grandes puissances.
Il importe de souligner par conséquent que c'est en Europe et dans les principaux pays industrialisés que seront posés les réels solides jalons pour la prochaine vague révolutionnaire qui concernera et entraînera par contrecoup le prolétariat de tous les pays "sous-développés" ou faiblement industrialisés. Il n'est jamais possible d'envisager une simultanéité complète, mais c'est dans le sens d'une généralisation de la lutte de classe à plusieurs pays à la fois que se trouvera posé sérieusement le chemin de l'internationalisation de la lutte de classe mondiale.
De la réponse à cette question de la généralisation de la lutte, dépend un nouveau développement et approfondissement de la lutte prolétarienne internationale. Et cela y compris en Pologne même où les obstacles présents : menaces d'intervention, nationalisme, illusions syndicales et illusions démocratiques, ne pourront être levés que par le développement des luttes mondiales et plus particulièrement dans le bloc russe pour les deux premiers, dans le bloc occidental pour les deux autres.
En Pologne, le problème crucial de la généralisation mondiale de la lutte de classe ne pouvait être que posé. Il appartient au prolétariat mondial d'y répondre.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [126]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [112]
Contre résolution sur la lutte de classe
- 2452 lectures
Contre résolution sur la lutte de classe ([1] [127])
La lutte prolétarienne en
Pologne a marque une nouvelle étape décisive dans le processus de grève de
masse qui a commencé à s'enclencher avec les luttes de Denain-Longwy-Rotterdam-sidérurgie
anglaise et qui ont posé à des niveaux divers la nécessité de
l'auto-organisation, de l'extension
et de la généralisation de la lutte.
1) Ces luttes ont confirmé le caractère nouveau de la lutte prolétarienne dans la phase de décadence. Si elles ont été une réponse à l'aggravation de la crise économique, elles ne peuvent avoir connue but une réelle amélioration des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière. Au delà des revendications économiques qui sont à la base du démarrage des luttes, il y a la préfiguration et la préparation de l'assaut généralisé futur qui est la seule réponse historique à la crise généralisée du capitalisme.
Dans ces luttes, on a pu voir le véritable antagonisme entre les besoins et la pratique de la classe ouvrière et toutes les thèses et stratégies relevant du syndicalisme. Ces stratégies ont toutes été des réponses de la bourgeoisie au prolétariat, elles ont toutes tenté de SAPER l'auto-organisation de la dynamique de la généralisation, de DEVOYER la prise de conscience politique du prolétariat qui commençait à s'amorcer.
2) Dans le futur, la seule voie pour le prolétariat résidera dans l'accentuation du dépassement du corporatisme, de l'usinisme, du nationalisme, à travers la mise sur pied dans la lutte d'assemblées générales, de comités de grève élus et révocables, et l'approfondissement de l'antagonisme POLITIQUE entre toutes les fractions bourgeoises agissant dans la classe et le prolétariat organisé.
3) L'autre aspect fondamental des luttes actuelles réside en ce qu'elles constituent le frein historique à la tendance à la guerre contenue dans les contradictions aveugles du système capitaliste décadent en crise. Pour la première fois dans l'histoire, nous sommes dans une phase où le prolétariat a su imposer a la bourgeoisie son initiative de la lutte. Contrairement aux années 30 où la crise économique est venue accentuer la défaite prolétarienne des années 20, les années 70 ont vu la reconstitution lente et chaotique de la force prolétarienne. Cette reprise de la lutte prolétarienne a empêché la bourgeoisie d'entraîner la société dans la guerre mondiale. Cette incapacité de la bourgeoisie réside dans le fait que les partis susceptibles d'embrigader le prolétariat dans un nouvel holocauste, les PARTIS DE GAUCHE sont justement ceux qui ont été remis en cause par la reprise prolétarienne.
4) Face à un prolétariat qui retrouve ses forces, la gauche a vu se réduire son champ de manœuvre, sa capacité de mystification accumulée pendant des décennies de contre-révolution. Cette situation a vu, au cours de ces dix dernières années, développement de la crise de ces partis, crise faite de scissions, d'usure, d'apparition de nouvelles fractions (gauchisme) qui correspondent toutes à des réponses à la lutte du prolétariat mais qui en même temps constituent autant de faiblesses potentielles pour le futur.
5) Cette usure de l'édifice contre-révolutionnaire stalinien et social-démocrate s'est répercutée sur l'ensemble de l'appareil politique de la bourgeoisie. Cet appareil, partie intégrante de l'Etat, possède toutes les caractéristiques de la bourgeoisie décadente, sénile et incapable d'homogénéité face à son ennemi historique. En fait, c'est l'Etat lui-même qui s'est affaibli face aux coups portés par la classe ouvrière. CET AFFAIBLISSEMENT N'EST PAS UN EFFONDREMENT. Chaque parti bourgeois, avec ses méthodes, avec ses armes spécifiques, tente de le freiner. Face au prolétariat qui menace, mais aussi contrainte de prendre les mesures d'austérité indispensables pour éviter la faillite, la bourgeoisie tente, 1à où elle le peut, de riposter, de répondre à travers une série de tournants et de tactiques politiques fondés essentiellement sur les mystifications et les illusions démocratiques. L'autre aspect de ces tentatives de la bourgeoisie réside dans 1a nécessité de casser les luttes de l'intérieur soit par le sabotage ouvert, soit par le dévoiement politique.
6) Aujourd'hui, l'action des partis de gauche est au centre des problèmes posés à la bourgeoisie : comment battre le prolétariat, comment lui faire accepter 1'austérité puis la guerre ? En fait, nous allons assister dans les temps qui viennent à une instabilité croissante de la politique de la bourgeoisie au sens où les partis de gauche vont être contraints de développer des orientations politiques de plus en plus incohérentes :
- dans l'opposition, ils "risquent de perdre leur influence faute d'être capables de se présenter éternellement comme des défenseurs du prolétariat, et par là-même, ils risquent de perdre leur capacité de sabotage;
- au pouvoir, organisant l'austérité, ils perdront rapidement tout crédit auprès de la classe ouvrière qui oubliera de moins en moins les actes de la gauche au pouvoir.
7) Les années qui viennent vont voir le mûrissement de la crise politique généralisée de la bourgeoisie. Mais contrairement aux années précédentes où le prolétariat n'avait pu utiliser cette crise pour son propre compte, nous entrons dans la période où il va devenir crucial pour la classe ouvrière de tirer profit de cette crise. En ce sens, le caractère POLITIQUE contenu dans les luttes que nous venons de vivre, va devenir de plus en plus explicite posant en termes plus clairs l'importance du rôle et de l'intervention des groupes révolutionnaires. Dans cette phase, la capacité des révolutionnaires à analyser les contradictions de la bourgeoisie, de chaque bourgeoisie, dans le cadre de la compréhension de l'homogénéisation du prolétariat mondial, sera un facteur décisif dans la maturation de la conscience de classe.
Ch.
[1] [128] Le projet de contre résolution proposé a été : reprendre les points 1, 2, 7, de La Résolution et remplacer le reste par la résolution ci-dessus
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [126]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [112]
Crise économique généralisée et conflits inter-impérialistes
- 3792 lectures
LE COURS DE LA CRISE ECONOMIQUE
Dans le rapport sur "La crise et les conflits inter-impérialistes" adopté au 3ème Congrès du CCI. en 1979, nous avions souligné l'échec de tous les palliatifs que le capital mondial avait utilisés pour relancer l'économie après la récession de 1974-75 (la 3ème et la plus grave des récessions depuis la crise ouverte de surproduction en 1967).
La capacité industrielle excédentaire, la baisse des taux d'investissement dans les pays avancés du bloc américain, la quasi-banqueroute des pays sous-développés de l'orbite occidentale, la faillite des différents plans quinquennaux dans le bloc russe, tous ces indices nous avaient amené alors à conclure que le capitalisme mondial était au bord d'un autre déclin de la production, de l'investissement et du commerce -plus aigu que les chutes de 1971-74- pour le début des années 80" ([1] [129]).
Dans le 3ème tome du Capital, Karl Marx met à nu le lien entre la baisse du Taux de profit et la saturation des marchés ([2] [130]). Que ce soit sous sa forme cyclique dans la phase ascendante, ou sous la forme de la crise historique qui caractérise la phase de décadence (et qui pose l'alternative: guerre impérialiste ou révolution prolétarienne), selon Marx, la crise du capitalisme éclate et se caractérise par trois manifestations principales liées entre elles : la surproduction des marchandises, la surproduction du capital, et la surproduction de la force de travail. Nous pouvons juger du bien-fondé de notre prévision de 1979 selon laquelle le capitalisme "est au bord d'une nouvelle catastrophe économique encore plus dévastatrice" ([3] [131]), en étudiant aujourd'hui les effets de la crise économique sur ces trois plans dans les grands pays industriels de l'Occident, ceux qui dominent l'économie mondiale.
LE MONDE OCCIDENTAL
Le ralentissement dans la croissance de la production industrielle ([4] [132]) qu'ont subi les pays de la C.E.E., le Japon, et les U.S.A. en 1979 s'est transformé aujourd'hui en une chute accentuée de la production industrielle dans le marché commun.
C'est en Grande-Bretagne qu'on voit le mieux la nature catastrophique de cet effondrement de la production : en Grande-Bretagne, la production manufacturière est tombée de 15% depuis 1979 pour arriver aujourd'hui au point le plus bas depuis 1967. On mesure l'étendue de la surproduction dans les industries-clé en observant le contrôle imposé par le Marché Commun sur la sidérurgie : la production sidérurgique, cette marchandise de base, baissera de 20% en Avril 1981 par rapport à 1979. La production automobile tombera de 10 à 12% cette année dans la C.E.E, pendant qu'en même temps les entreprises japonaises tentent de contrecarrer la saturation du marché mondial en faisant du dumping en Europe.
En Allemagne de l'Ouest, le plus grand secteur de la métallurgie, qui était responsable des excédents commerciaux de ce pays ces dernières années, a suivi la sidérurgie et l'automobile dans un déclin de la production.
Aux U.S.A, La stagnation de la production industrielle depuis 1979 est devenue une chute brusque en 1980. La petite amélioration à la fin de l'année 1980 s'est vite transformée en nouveau déclin, une récession "en deux temps" qui montre le seul genre de "relance" dont le capitalisme est capable aujourd'hui.
On voit l'ampleur du déclin de la production dans les industries-clé aux U.S.A par le fait qu'en février 1981 la production d'acier et de bois (la base de l'industrie de construction) était au même niveau qu'en 1967.
Seul le Japon, parmi les géants du bloc américain, a échappé à cette baisse de la production ([5] [133]). Mais les industries japonaises sont tellement dépendantes de l'exportation que la demande intérieure est incapable de contrecarrer le choc qui viendra, soit d'un protectionnisme de la part de ses partenaires commerciaux, soit d'une baisse du commerce mondial, ou des deux facteurs à la fois.
L'énorme surproduction de marchandises qui a produit ce déclin de la production industrielle, a déjà amené à une chute des investissements de capital, et le début d'un effondrement des profits dans la manufacture. En 1981, on s'attend à ce que les dépenses réelles en usines et équipements tombent de 2 à 3% en R.F.A, de 7% en Italie et de 10,25% en Grande-Bretagne. Aux U.SA, l'utilisation de la capacité industrielle a baissé et les investissements sont tombés en dessous du niveau nécessaire pour maintenir la compétitivité des, produits industriels américains.
De plus, les 4 milliards de dollars perdus par l'industrie automobile américaine en 1980 sont certainement le signe avant-coureur le plus spectaculaire de l'effondrement général des profits qui sera le résultat inévitable de cette surproduction de marchandises.
L'obstacle que constitue le marché mondial saturé le manque de demande solvable par rapport à la capa cité productive hyper-développée du capitalisme mondial , signifie, que, au niveau du capital global, tout effort pour contrebalancer la baisse du taux de profit par de nouveaux investissements en vue d'accroitre la productivité du capital, ne peut qu'exacerber la difficulté de réalisation de la masse de plus-value en venant ajouter aux stocks des marchandises invendables. Au fur et à mesure que la production industrielle baisse, une masse grandissante de capital non-utilisé, assoiffée de profit est jetée dans la spéculation. Il est possible que la surproduction du capital ait déjà jeté un million de milliards de dollars dans cette spéculation. C'est une véritable inondation de capital non-utilisé cherchant un placement rentable à court terme qui a fait continuellement augmenter le prix du pétrole, alors que la demande a baissé de 6% dans le bloc américain en 1980. L'agitation fébrile sur les marchés de l'or face à un déclin de la demande d'or pour l'industrie, a amené les spécialistes des métaux précieux à dire que "50% de la demande est aujourd'hui orientée vers la spéculation"([6] [134]). Le fiasco des frères Hunt dans leur tentative de monopoliser le marché de l'argent, le fait que les grandes sociétés mondiales ainsi que les institutions financières s'orientent de plus en plus vers le commerce des devises, témoignent de la recherche frénétique de profits à court terme de la part du capital inutilisé. En effet aujourd'hui, le prix des principales devises du monde est de plus en plus déterminé par les hauts et les bas des taux d'intérêts -dont les fluctuations font passer des milliards de dollars d'un pays à l'autre, presque du jour au lendemain. Cette vaste surproduction de capital a donné naissance à une énorme bulle de spéculation qui risque d'éclater avec des conséquences catastrophiques pour le capital mondial.
Avec la baisse de la production en 1980-81, le chômage a augmenté à un taux accéléré dans tous les pays industrialisés du bloc américain.
On voit les vraies dimensions de cette "population excédentaire" (Marx) qui est une des manifestations des plus cruelles de la crise économique du capitalisme, dans les prévisions de l'O.C.D.E selon lesquelles il y aura officiellement à la mi-81 23 MILLIONS DE CHOMEURS dans les pays industriels du bloc américain. En Hollande, il n'y a jamais eu autant de chômage depuis la fin de la 2ème guerre mondiale. A la mi-81, il y aura 3 millions de chômeurs en Angleterre, chiffres non atteints même pendant les années 30. En R.F.A, les économistes de la Commerzbank prévoient non seulement une augmentation du chômage qui atteindra le chiffre de 4,8% de la population active, mais aussi une augmentation du nombre d'ouvriers réduits au chômage partiel : de 130.000, ce chiffre passera à 520.000 ouvriers au travail partiel cette année. Les attaques racistes contre les ouvriers immigrés en France (orchestrées par le gouvernement et la gauche dans l'opposition), les projets d'entreprises géantes telles que la Fiat en Italie qui a annoncé 24000 licenciements, et Rhône-Poulenc en France qui projette une réduction de 25% de la force de travail qu'elle utilise, et qui cherchent encore à réduire leurs effectifs, sont les signes du destin tragique que le capital réserve à des millions d'ouvriers dans les années 80.
On doit ajouter à ces manifestations dévastatrices de la crise ouverte de surproduction (surproduction de marchandises, de capital et de la force de travail), une autre manifestation non moins dangereuse pour le capital : l'inflation galopante en même temps que l'effondrement de la production et des profits. Pris dans l'engrenage de la crise permanente, le capital a réagi en utilisant la drogue de l'inflation (création d'argent et de crédit) dans un effort désespéré pour contrebalancer le manque de demandes solvables dû à la saturation définitive du marché mondial. Ce gonflement continuel et délibéré de la masse d'argent en circulation a tellement accru les frais de production qu'il a contribué à accélérer la baisse du taux de profit et à accentuer les difficultés mêmes auxquelles il voulait remédier dans la production. Tandis que l'inflation avait baissé au cours des 3 précédentes récessions -1967, 1971 et 1974-75- l'inflation a grimpé davantage dans la récession actuelle
Dans les pays sous-développés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine qui produisent les matières premières vitales et constituent des marchés nécessaires pour le bloc américain, on a vu depuis 2 ans l'augmentation de la masse de sans-travail et des paysans réduits à la misère. Selon la Banque Mondiale (une des institutions grâce à laquelle l'impérialisme américain maintient sa mainmise sur ces trois continents), il y a aujourd'hui 800 millions d'êtres humains sous-alimentés qui subsistent dans des conditions de "misère absolue".
LES PAYS SOUS-DEVELOPPES
A part quelques pays producteurs de pétrole (et leurs dollars finissent dans les mains de producteurs d'armements de l'Occident ou dans les banques occidentales, les pays du "tiers-monde" sont réduits à la banqueroute par des déficits croissants des balances commerciales et de paiement, et aussi par des dettes extérieures écrasantes. Une dépendance absolue en ce qui concerne la nourriture qui est importée- le sinistre produit de la crise agricole permanente provoquée par le capitalisme- veut dire que les déficits globaux de ces pays ont encore augmenté allant de 12 milliards de dollars en 1973 à 82 en 1981. De plus, les emprunts continuels auprès des banques privées et publiques de l'Occident, en grande partie pour couvrir des dettes, ont donné comme résultats une dette extérieure astronomique : un total de 290 milliards de dollars pour l'ensemble de ces pays affamés.
Durant les deux dernières années, toute une série de pays, en commençant par le Zaïre, la Jamaïque et le Pérou, et en continuant avec la Turquie et plus récemment avec le Soudan et la Bolivie, ont sombré dans la banqueroute et ont dû demander une réorganisation des échéances- de leurs remboursements à leurs créditeurs impérialistes. Dans chacun des cas, la seule alternative à la faillite et à l'arrêt immédiat des importations a été d'accepter, sous une forme ou une autre, un contrôle "de facto" du F.M.I. - l'instrument principal de la domination de l'impérialisme américain sur les pays sous-développés de son bloc. Ce contrôle a généralement pris 3 formes complémentaires ;
1) La dévaluation des devises du pays débiteur, ce qui veut dire que pour la même somme d'argent les créditeurs peuvent prélever davantage de matières premières.
2) Des prix alimentaires plus élevés, ce qui signifie encore plus de famine dans ces pays.
3) Un blocage des salaires pour pouvoir extraire encore plus de plus-value de la population travailleuse afin de rembourser les dettes.
Avec un taux d'inflation de 7 à 15% et un déficit budgétaire de 11 milliards de dollars de l'année dernière, la Chine a suivi le chemin de tant d'autres pays arriérés du bloc américain jusqu'à aller au F.M.I quémander l'argent. Au cours de sa première année comme membre du F.M.I (ce qui a parachevé son intégration au sein du bloc U.S) la Chine a emprunté prés de 1,5 milliards de dollars. De plus, confirmant notre prévision de 1979 (qui disait que la Chine n'allait pas combler les espoirs des hommes d'affaires occidentaux et ne constitueraient pas un marché énorme dans lequel ils pourraient se débarrasser de leur surproduction), la Chine a déjà annulé ou "reporté" cette année des contrats d'investissements de capital avec des entreprises occidentales, qui se montaient à 3,5 milliards de dollars. La réduction de 13% des dépenses étatiques annoncée en Février montre que le régime de Pékin est officiellement embarqué sur le même chemin d'austérité draconienne que connait le reste du monde capitaliste.
L'exemple de la Pologne montre comment l'activité économique a été maintenu face à un marché mondial saturé et à une pénurie de capital. En 1971, la dette extérieure de la Pologne se montait à un minuscule 800 millions de dollars. En 1980 (juste avant la grève de masse en Août) elle atteignait 23,5 milliards de dollars-Déjà en 1979, la plus grande partie des emprunts servaient à rembourser les anciens, plutôt qu'à une expansion de la production. Par conséquent, même avant la grève de masse, 1'économie polonaise commençait à s'effondrer.
LE BLOC RUSSE
Dans le rapport sur "La crise et les conflits inter-impérialistes" de 1979, nous avons dit qu'une des manifestations les plus importantes de la crise économique dans le bloc russe était une pénurie chronique de capital. Pendant les années 70, le bloc russe a évité la baisse de production à laquelle cette pénurie de capital l'aurait condamné en empruntant massivement auprès des banques et des Etats occidentaux. Ce flot de capital-argent à l'Est (qui a financé l'importation de marchandises et de technologie occidentale) a permis la croissance des économies du bloc russe, bien qu'à un taux de croissance moindre qu'avant la crise ouverte de surproduction mondiale.
L'effondrement économique de la Pologne ne se distingue de la récession dans laquelle s'enfonce tout le bloc russe que par son acuité. La production russe a baissé de 3% en 1980 et la production dans les secteurs industriels-clé tel que le charbon et l'acier, les réacteurs nucléaires et l'électricité n'ont pas atteints, et de loin, les niveaux prévus dans le dernier plan quinquennal.
LE COMMERCE MONDIAL
Le déclin économique qui a atteint simultanément tous les secteurs du capital mondial -aussi bien les pays avancés et arriérés du bloc américain que l'ensemble du bloc russe, a déterminé un déclin constant et même plus rapide du taux de croissance du commerce mondial.
Une brève description de la façon dont le capital mondial a cherché à "se reprendre" de la récession de 1974-75, et de l'échec de sa tentative, est nécessaire pour démontrer pourquoi le commerce mondial est actuellement quasiment stagnant.
Deux stratagèmes économiques-clé ont été utilisés pour créer une reprise temporaire de l'activité économique. D'abord, les Etats-Unis sont devenus la "locomotive" de l'économie mondiale en créant un marché artificiel pour le reste de son bloc au moyen d'énormes déficits commerciaux.
Entre 1976 et 1980, les U.S.A ont acheté des marchandises à l'étranger pour 100 milliards de dollars, plus qu'ils n'en ont vendues. Seuls les U.S.A -parce que le dollar est la monnaie de réserve mondiale- pouvaient mettre en œuvre une telle politique sans qu'il soit nécessaire de dévaluer massivement sa monnaie. Ensuite, les U.S.A ont inondé le monde de dollars avec une expansion sans précédent du crédit sous forme de prêts aux pays sous-développés et au bloc russe (ces derniers essentiellement au moyen d'institutions financières existants en Europe). Cette masse de papier monnaie a temporairement créé une demande effective qui a permis au commerce mondial de continuer. L'actuelle banqueroute des pays sous-développés du bloc américain, qui les a amenés l'un après l'autre à se mettre sous la coupe de la dictature fiscale du F.M.I et à se soumettre à ses plans d'austérité pour éviter le pire, a déjà supprimé l'une des béquilles qui avait soutenu le commerce mondial durant ces dernières années. La réduction drastique des importations de ces pays -nécessaire si l'on s'attend à un train de banqueroutes et éventuellement à un coup mortel contre le système monétaire international- aura un effet catastrophique sur les géants industriels du monde : 55% des exportations de la C.E.E (pris comme un tout commercial), 46% des exportations du Japon, et 46% de celles des Etats Unis et du Canada trouvent actuellement leur débouché dans les pays sous-développés.
Cet effondrement des pays sous-développés en tant que marchés met en danger la moitié des exportations des pays industrialisés! Les risques économiques croissants que constitue la poursuite de prêts massifs au bloc russe, sont en train de retirer au commerce mondial une autre béquille qui l'a soutenu. Et pour finir, les Etats-Unis ont commencé à faire sérieusement marche arrière en vue de réduire leurs-propres déficits du commerce et des paiements, afin de prévenir une nouvelle et encore plus dévastatrice crise du dollar. Cependant, une telle politique de la part de la Maison. Blanche signifie que les Etats Unis ne peuvent plus jouer le rôle de locomotive de l'économie mondiale, un rôle qu'aucun autre pays ne pourra jouer à sa place.
La stagnation et l'irréversible déclin du commerce mondial qui va en résulter, auront des effets dévastateurs sur la production industrielle des Etats Unis, du Japon et de l'Europe où le marché intérieur est déjà -nous l'avons vu- sursaturé. Le Japon et l'Europe ont longtemps été dépendants de leurs exportations vers les Etats-Unis, les pays sous-développés et particulièrement pour l'Europe -le bloc russe, dans le développement de leur activité industrielle. Le capitalisme américain, longtemps protégé des vicissitudes du marché mondial par l'existence d'un énorme marché intérieur, est aujourd'hui à peine moins dépendant de ses exportations que les autres : les exportations atteignent maintenant le taux sans précédent de 20% de la production industrielle nationale.
C'est cette réalité d'un enfoncement économique mondial qui a amené des représentants de la bourgeoisie comme les auteurs du nouveau plan économique de 5 ans pour la France, à dire avec assurance "que demain sera pire qu'aujourd'hui". Les révolutionnaires marxistes (qui seuls peuvent comprendre pourquoi le cours de la crise économique mène le capitalisme à l'abîme), qui comprennent que cette CRISE HISTORIQUE a créé les conditions mêmes pour la destruction du capitalisme par le prolétariat, ne peuvent que dire de tout cœur :. Salut à la crise !
LA REPONSE DE LA BOURGEOISIE
Ayant tracé le cours de la crise économique, il nous faut maintenant examiner brièvement les politiques économiques que la classe capitaliste, dans chacun des blocs russe et américain, va tenter de mettre en place face au déclin général.
LE CAPITALISME D'ETAT
Dans le bloc américain, la crise économique accélère fortement la tendance au capitalisme d'Etat ([7] [135]). Le capitalisme d'Etat ne peut se réduire seulement à la nationalisation des moyens de production, qui n'est qu'une de ses manifestations. L'un des architectes du capitalisme d'Etat dans les années 30, Hjalman Schacht, premier conseiller économique d'Hitler a montré qu'en réalité, le principe fondamental du capitalisme d'Etat était : "l'Etat, gouvernail de l'économie". Dans le contexte de l'anarchie du marché mondial dont le seul régulateur est, en dernière instance, la loi de la valeur, c'est l'Etat qui guide la voie économique à chaque capital national ; on a pu voir clairement cela en France, sous le gouvernement de centre-droit de Giscard-Barre. L'Etat a sélectionné les industries "stratégiques" comme la force nucléaire, l'aérospatiale et les télécommunications, dans lesquelles il a prévu d'investir, ou de guider des investissements, en milliards de dollars, pendant qu'il décide, par ailleurs, de restreindre certaines industries traditionnelles comme la sidérurgie, la construction navale et le textile. Combinant les nationalisations, le financement par l'Etat, les plans indicatifs et les pressions politiques, l'Etat français a organisé des fusions (la réorganisation des industries d'aciers spéciaux, la centralisation de la construction mécanique de camions entre les mains de la firme nationalisée de Renault), créant de nouveaux groupes industriels (la formation d'un trust des télécommunications, commençant avec l'absorption de Hachette par Matra), et manœuvre pour éloigner les capitaux étrangers des secteurs clés de l'économie (l'absorption d'Empain-Schneider par Paribas).
Complétant ce processus d'organisation de chaque capital national en une seule unité économique, l'Etat capitaliste doit affronter le dilemme de la mise en place d'une politique monétaire et fiscale cohérente qui permette à l'économie de naviguer entre l'effondrement simultané de la production industrielle ET l'inflation galopante. Aujourd'hui, aucun pays occidental important n'envisage une politique réflationniste élaborée. Le spectre de l'hyperinflation et de l'effondrement définitif de la monnaie interdit la mise en place de programmes de travaux publics massifs tels qu'Hitler en Allemagne, le Front Populaire en France ou Roosevelt aux Etats-Unis ont pu en promouvoir dans les années 30, lorsque l'effondrement de la production avait entraîné avec lui une chute rapide des prix. Cependant l'alternative d'une politique déflationniste, si elle semble la seule issue pour prévenir 1'hyperinflation n'amènera ultérieurement qu'une diminution désastreuse de la production industrielle, des profits et des investissements (tout comme un chômage croissant). En Grande-Bretagne, où le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher a eu recours à une politique déflationniste (bien qu'avec des exceptions), les résultats ont été catastrophiques pour le capital : une diminution de la production industrielle de 15% depuis 1979 ; les principales "multinationales", comme GKN et LUCA, qui ont fait des profits même dans les mauvaises passes économiques de 67, 71 et 74-75, ont enregistré des pertes; les faillites ont augmenté de 50% en 1980 (pendant que le chômage croissait de 900 000 personnes rien qu'en un an). Cette désindustrialisation qui est en train de faire du cœur industriel de la Grande-Bretagne un désert, a également provoqué pour les finances une victoire à la Pyrrhus : le taux annuel d'inflation a baissé de 20% à un encore dangereux 13%. On ne devrait pas s'étonner que la Confédération de l’industrie Britannique (l'organe du capital industriel) ait désespérément demandé un renversement de la politique déflationniste de Thatcher au moyen d'un programme de réflation massif des investissements publics (routes, pipelines, énergie nucléaire, transport et communications) en vue de les sauver de la catastrophe.
LE "SUPPLY-SIDE ECONOMICS" L'ECONOMIE DE L'OFFRE
La banqueroute des politiques déflationnistes orthodoxes comme des politiques réflationnistes classiques, face aux attaques combinées de la surproduction et de l'inflation, a poussé a la recherche désespérée de "nouvelles" panacées économiques de la part de la bourgeoisie et de ses épigones intellectuels. La dernière de ces panacées est le "supply-side économies" ("économie de l'offre") qu'une importante partie de l'Administration Reagan aux Etats-Unis veut appliquer fermement. La base du "supply-side économies" c'est de croire que des réductions importantes des impôts (d'abord pour les affaires et pour les riches) produiront un tel accroissement des investissements et une augmentation conséquente de la production industrielle que les revenus du gouvernement augmenteront et qu'il pourra atteindre l'équilibre de son budget. La fausseté de ce "raisonnement" se révélera vite si les 54 milliards de dollars de réduction des impôts sont vraiment mis en œuvre sans modification et sans restriction drastique des budgets que les déflationnistes, qui dirigent le "treasury and fédéral reserve Board" (ministère des finances et banques d'Amérique) demandent ; les réductions sur les impôts n'iront pas en investissements dans de nouvelles usines ou affaires productives, à une époque où il y a déjà une surproduction démesurée de capital. Ces milliards soutiendront plutôt la spéculation, avançant ainsi sur le chemin, de l'effondrement de la valeur monétaire nominale, ou bien ils permettront un boom à court terme de la consommation improductive chez les riches, ce qui développera encore l'inflation qui ravage l'économie. Plus encore, derrière la rhétorique d'extrême-droite de ses partisans, le "supply-side économies" n'est qu'une variante du keynésianisme qui a dominé l'économie mondiale depuis les années 30. Les projets de travaux publics du keynésianisme traditionnel comme les réductions d'impôts du "supply-side économies" cherchent tous deux vainement à compenser le manque chronique de demande solvable par rapport à la masse de marchandises que vomit un appareil industriel hyper-développé. Et, dans un monde marqué par l'inflation galopante, toute tentative de cette sorte de compenser le manque de demande par des déficits budgétaires, risque de pousser le capitalisme vers l'abîme.
L'ATTAQUE CONTRE LES CONDITIONS DE VIE DE LA CLASSE OUVRIERE
Plus les coups dévastateurs de la crise mondiale détruisent la possibilité même de poursuivre une politique économique cohérente, plus la bourgeoisie doit se livrer à un assaut direct contre les conditions de vie du prolétariat comme première réaction à une réalité objective qui échappe à son contrôle. En tentant de modifier de façon drastique le rapport entre les salaires et la plus-value, la bourgeoisie ne peut résoudre le problème de la surproduction globale qui empêche la reprise, quel que puisse être le taux de profit ; cependant une telle politique -si elle réussit - peut accroître la compétitivité d'un capital national aux dépens de ses rivaux. Ceci a amené une double offensive de la part du capital. Premièrement contre 1'emploi : des réductions drastiques de la force de travail employée et leurs conséquences : la "rationalisation" et l'augmentation des cadences pour les ouvriers qui restent, sont vitales pour chaque entreprise (bien que l'augmentation du chômage ne fasse qu'exacerber les difficultés de chaque économie nationale prise comme un tout). En Grande-Bretagne, par exemple, GKN a diminué de 27% la force de travail qu'elle employait, dans les 15 derniers mois, pendant que British Steel licenciait 60 000 ouvriers et prévoyait 20 000 licenciements de plus. Deuxièmement contre les salaires : en Belgique, les syndicats et les patrons, sous l'impulsion du gouvernement, ont signé un pacte de deux ans sur les salaires en février, et le gouvernement a proposé depuis de supprimer l'indexation des salaires (qui s'accroissent sous la poussée de l'inflation) ainsi qu'une réduction de 10% des salaires des ouvriers dont les entreprises reçoivent une aide financière de 1'Etat-La stabilité économique des pays du bloc américain est maintenant complètement dépendante du succès de cette offensive contre le prolétariat.
LE BLOC DE L'EST
La situation économique du bloc russe est encore plus désespérée que celle des pays du bloc américain. Les effets cumulatifs de la pénurie chronique de capital, les obstacles croissants auij prêts venant de l'Ouest, avec lesquels le bloc russe peut se munir de la technologie qui lui manque, le marché toujours chancelant pour ses exportations, se sont combinés pour mettre fin au "socialisme du Goulash" avec lequel Kroutchev d'abord, Brejnev ensuite ont cherché à contenir des explosions de lutte de classe que la mort de Staline avait rendues possibles. Dans tout le bloc, une austérité draconienne et un nouvel assaut direct contre les conditions de vie et de travail misérables du prolétariat constituent la seule base du nouveau plan quinquennal adopté au 26ëme Congrès du Parti Communiste (sic!) Russe cette année. Dans son rapport au congrès, Brejnev a dit que la Russie "fera plus, tout en utilisant! Moins de ressources, dans la production" avec le plan de 1981-85. C'était la reconnaissance voilée d'une pénurie de capital. L'orientation vers des méthodes de travail plus intensives n'était plus selon Brejnev une question "de choix, mais de nécessité". L'effort pour accroître la productivité de 17 à 20% dans les cinq prochaines années, avec moins de capital investi que dans les cinq précédentes, ne peut que vouloir dire que, non pas la productivité (qui dépend du capital constant), mais l'intensité du travail doit s'accroître. Donc le rapport de Brejnev annonçait que l'économie russe devra de plus en plus dépendre de l'extraction de la plus-value absolue plutôt que de la plus-value relative -précisément la même orientation qu'a dû prendre le bloc américain. A l'Est aussi, l'existence même du régime capitaliste dépend du succès de la bureaucratie dans son attaque contre la classe ouvrière.
LES ANTAGONISMES INTER-IMPERIALISTES
Au fur et à mesure que la courbe de la crise économique se prolonge et s'amplifie, elle intensifie les antagonismes inter-impérialistes jusqu’au point de rupture. Il y a un lien direct et immédiat entre l'approfondissement de la crise économique mondiale et les affrontements entre les blocs impérialistes. Pour le capital, il n'y a qu'une "solution" à sa crise historique : la guerre impérialiste mondiale. Plus vite les différents palliatifs prouvent leur futilité, plus délibérément chaque bloc impérialiste doit se préparer à un repartage violent du marché mondial.
La présidence de Reagan correspond à une nouvelle détermination de la bourgeoisie américaine d'assurer une position belliqueuse croissante dans le monde. Derrière cette agressivité grandissante, c'est la reconnaissance de plus en plus claire par la bourgeoisie que la guerre avec la Russie est la seule option réelle -un point de vue qui n'est pas exprimé habituellement de façon aussi ouverte que l'a fait Richard Pipes, le spécialiste russe au Conseil national de sécurité, lorsqu'il a dit en mars que la guerre était inévitable si les russes n'abandonnaient pas le "communisme". La stratégie qui se dégage des cercles dirigeants de l'impérialisme américain n'est plus simplement basée sur le point de vue que l'ennemi russe ne doit pas sortir de son cadre euro-asiatique : aujourd'hui, la conviction va croissant, et au Pentagone et à Wall Streets, qu'après avoir établi sa domination militaire jusqu'aux rives de l'Elbe après deux guerres mondiales, l'Amérique doit maintenant achever son œuvre et étendre son hégémonie au-delà de l'Oural. Telle est la signification réelle de la détermination de l'Administration Reagan d'accroître ses dépenses militaires de 1% chaque année en termes réels (ce qui veut dire plus d'un tiers du budget fédéral). Les 200 000 hommes de la force d'intervention rapide, le renforcement des bases au Moyen-Orient (y inclus les installations ultramodernes du Sinaï que les américains espèrent reprendre lorsque Israël se retirera l'année prochaine), le nouveau "consensus stratégique" que le secrétaire d'Etat Haig est en train de forger dans cette région, de la Palestine à l'Egypte (et de façon significative en Irak), le projet d'une force navale de 600 bateaux pour 1990 et le nouveau bombardier pour l'Air Force, constituent autant de préparatifs directs pour une offensive guerrière dans les années à venir.
Pendant que l'équilibre entre les blocs américain et russe a continué de pencher en faveur de Washington (l'armée russe est bloquée en Afghanistan, le surgissement de la classe ouvrière en Pologne peut encore forcer le Kremlin à tenter d'écraser le prolétariat ce qui, même si il y arrive, nécessiterait une immense armée d'occupation et des problèmes pour le Pacte de Varsovie), cela ne veut pas dire que l'impérialisme russe va adopter désormais une stratégie défensive. Comme on l'a mis en évidence dans le rapport du 3ème congrès du CCI, le bloc russe, plus faible économiquement ne peut espérer contrecarrer la domination industrielle américaine qu'en gagnant l'infrastructure industrielle de l'Europe ou du Japon. La stratégie russe qui recherche la domination sur le Moyen-Orient riche en pétrole, a comme premier but, de rendre l'Europe et le Japon aussi dépendants de Moscou pour s'approvisionner en pétrole nécessaire à leur industrie, qu'ils le sont actuellement des Etats-Unis, et donc, de les détacher du bloc américain.
La belliquosité croissante des USA ne peut qu'accroître la peur du Kremlin de perdre au Moyen-Orient alors qu'il y a encore des chances de succès. Il faut encore ajouter à cela un autre facteur qui pousse l'impérialisme russe sur le chemin de l'aventure militaire : la pénurie de capital avec lequel il pourrait développer ses ressources en pétrole de Sibérie, signifie qu'à la fois son industrie de guerre et sa capacité à contrôler le bloc en lui fournissant cette ressource vitale, courront vite des risques -tout cela ne peut qu'intensifier la pression pour gagner les champs de pétrole arabes dans les années a venir.
La poursuite de ces stratégies guerrières par l'impérialisme russe et américain, dépend de la consolidation et du renforcement de leurs blocs respectifs. Cependant, l'approfondissement même de la crise qui pousse l'impérialisme américain à faire des plans plus directs en vue de la guerre, crée également des tiraillements au sein de l'Alliance occidentale. L'offensive japonaise d'exportations massives qui a provoqué un déficit du commerce de la C.E.E. avec Tokyo de 115 milliards de dollars, et un déficit du commerce américain avec le Japon de 122 milliards de dollars en 1980, a provoqué un sentiment protectionniste croissant de la part de puissantes fractions de la bourgeoisie en Europe et aux Etats-Unis. Pendant que les Etats-Unis s'orientaient rapidement vers l'affirmation de leur cohésion en tant que bloc, à travers une pression sur le Japon pour qu'il limite "volontairement" ses exportations et supprime ses propres barrières contre les importations et l'investissement étranger, les demandes de protectionnisme (et même d'autarcie) de la part des fractions bourgeoises en Europe constituent un danger croissant auquel Washington doit répondre.
Pendant que la France et la Grande-Bretagne soutenaient résolument les Etats-Unis dans leur position de plus en plus agressive vis à vis des russes, la pression américaine sur l'Europe pour réduire ses liens commerciaux avec le bloc russe et pour revoir sa participation au projet de construction d'un pipe-line de gaz naturel venant de Sibérie, a amené une résistance croissante, surtout de la part de l'Allemagne de l'Ouest. L'Europe et la Russie constituent l'un des quelques marches où le capital allemand (et plus généralement, le capital européen) ne rencontre pas de concurrence aiguë de la part du Japon et des U.S.A. La limitation des liens économiques et commerciaux avec la Russie, que sous-entend la stratégie américaine, réduira considérablement le faible degré d'autonomie qu'a acquis le capital allemand depuis la seconde guerre mondiale. A ces considérations économiques, il faut ajouter que d'importantes parties de la bourgeoisie européenne hésitent encore à accepter toutes les conséquences de la stratégie que Washington veut imposer (les bases de missiles Pershing II en Europe) parce qu'une guerre transformerait immédiatement l'Europe en champ de bataille. Néanmoins, et dans la mesure où ces hésitations ne sont pas une simple façade pour dévoyer le prolétariat de son terrain de classe, ou un écran derrière lequel se cachent des fractions de la bourgeoisie pro-Moscou, elles laisseront en dernière instance la place à 1'impérieuse nécessité de renforcer le bloc dans la préparation à la guerre.
Comme l'impérialisme russe évolue vers le renforcement de son bloc, il rencontre de la résistance de la part de certaines bureaucraties à l'Est. Les bureaucraties roumaines et hongroises, en particulier, sont peu tentées de risquer leurs propres liens économiques et commerciaux complexes avec l'Europe occidentale, dans la mesure où c'est seulement à travers ces liens qu'elles ont acquis un peu d'autonomie vis à vis de Moscou. Néanmoins, la dépendance croissante vis à vis des prêts russes (car ces pays atteignent les limites de leurs crédits à l'Ouest), leur dépendance pour les matières premières, et la doctrine "pure" de Brejnev prévaudront en dernière instance sur les hésitations des petits Staline...
Si la courbe de la crise économique mène inexorablement la bourgeoisie vers la guerre impérialiste, l'issue de la crise historique n'est pas déterminée par le cours de la crise économique seulement. C'est l'intersection entre la courbe de la crise économique et la COURBE DE LA LUTTE DE CLASSES qui détermine si la crise historique se terminera en guerre mondiale ou en REVOLUTION PROLETARIENNE. Si la courbe ascendante de la crise économique croise une courbe descendante de la lutte de classes (comme dans les années 30), la guerre impérialiste est inévitable. Si, cependant, la courbe de la crise économique croise une courbe ascendante de la lutte de classe, alors la voie à la guerre est barrée et un cours historique vers LA GUERRE DE"CLASSE entre la bourgeoisie et le prolétariat est à l'ordre du jour. Le cours ascendant actuel de la lutte de classes constitue aujourd'hui la véritable clé de la situation internationale. La menace du prolétariat détermine de façon croissante les actes de la classe capitaliste, partout, dans le monde entier. Le vaste arsenal d'armes avec lequel les classes capitalistes des deux blocs se sont armées pour une guerre inter-impérialiste est maintenant préparé en vue d'une guerre de classe. Le renforcement des blocs, qui constitue une pré-condition pour la guerre contre le bloc rival, est aujourd'hui également une préparation immédiate et directe pour confronter le prolétariat où qu'il soit, qui est en train de mettre en cause la domination du capital.
[1] [136] Revue Internationale n° 18, p.9.
[2] [137] Le fait que Marx n'ait pas pu écrire les tomes sur le "commerce extérieur" et le "marché mondial", éléments de sa vaste analyse du "système économique bourgeois" fait que son analyse se présente de façon unilatérale ayant comme axe la suraccumulation du capital due à la baisse du taux de profit Aujourd'hui, en se basant sur les analyses de Marx lui-même dans " Le Capital" et "Les théories de la Plus-value", il revient au marxisme révolutionnaire de clarifier l'interaction complexe entre la surproduction de capital et la surproduction de marchandises. Seule une compréhension correcte de la tendance imminente du capitalisme à saturer le marché mondial rend cette tâche possible.
[3] [138] Revue Internationale n° 18, p.3.
[4] [139] Bien que les statistiques officielles et officieuses soient truquées dans les pays et ne traduisent pas la réalité de l'économie, les chiffres pour la production industrielle correspond mieux au vrai niveau de 1'activité économique que les chiffres du PNB dans lequel -entre autre- la distinction entre travail productif et non-productif (essentielle pour comprendre la situation réelle d'une économie capitaliste) est complètement escamotée.
[5] [140] Une baisse de 2,6% de la production industrielle pendant l'automne 1980 a été vite suivie d'un dumping massif sur les marchés extérieurs (essentiellement les USA. et la CEE) qui continue toujours.
[6] [141] "New York Times", International Economie Survey, 8 février 81.
[7] [142] Dans le bloc russe, en partie à. cause de l'expropriation des capitalistes privés par la révolution prolétarienne de 17-18, en partie comme résultat de l'arriération économique qui a rendu la nationalisation des moyens de production absolument vitale si le capitalisme voulait survivre et poursuivre une politique impérialiste, le capital "privé" a été éliminé.
Récent et en cours:
- Crise économique [143]
Questions théoriques:
- Impérialisme [144]
Résolution sur la crise
- 3100 lectures
1) En juin 1979, le Sème congrès du CCI affirmait :
"Dans la période qui vient, nous allons assister à un nouvel approfondissement de la avise mondiale du capitalisme sous forme, notamment d'une nouvelle flambée d'inflation et d'un ralentissement sensible de la production qui risque de faire oublier celui de 1974-75 et provoquera une aggravation brutale du chômage". (Résolution sur la situation internationale)
Nullement basée sur une prophétie mystique mais bien sur l'application de la théorie marxiste aux conditions actuelles de vie de la société et sur une analyse de la faillite inévitable des palliatifs usés par le capitalisme pour tenter de sortir de l'effondrement des années 74-75, cette prévision s'est trouvée confirmée ces deux dernières années. La situation présente illustre bien ce que le CCI a toujours dit de la nature de la crise : qu'il s'agit d'une crise générale de surproduction qui s'exprime, dans les métropoles du capitalisme, par une surproduction de marchandises, de capital et de force de travail.
2) La surproduction de marchandises trouve sa manifestation dans la chute de la production industrielle qui atteint des sommets avec un pays comme la Grande-Bretagne (- 15% entre 1979-80) mais frappe également de façon violente des puissances comme l'Allemagne Fédérale (où, après la sidérurgie et l'automobile, c'est un secteur aussi décisif pour ce pays que la métallurgie qui est en recul), et comme les USA, où une récession en deux temps (phénomène qui illustre la vanité croissante des politiques de "reprise") a provoqué un recul de la production à acier à son niveau de 1967 et de celle d'automobiles à un niveau encore inférieur à celui de cette date là. Seul, le Japon, grâce à son exceptionnelle productivité dans ces secteurs a échappé pour le moment à un tel sort; ceci n'est que partie remise, compte-tenu du développement du protectionnisme à son égard et de la poursuite du déclin des capacités d'absorption de ses marchés aux USA et en Europe occidentale.
3) Le recul de la production industrielle a provoqué et tendra à provoquer de plus en plus une chute des investissements et des profits. En une année (79-80), on a assisté à des baisses de 3% pour la RFA, 7% pour l'Italie, 10,25% pour la Grande- Bretagne dans les dépenses en usines et équipements industriels. Quant à la chute des profits, elle s'est illustrée de façon spectaculaire par des pertes de 4 milliards de dollars dans l'industrie automobile aux USA en 1980.
La tentative mise en évidence par Marx dans "Le Capital" de contrecarrer la baisse du taux de profit par une augmentation de la masse de plus-value se heurte à la saturation croissante des marchés. Plutôt que de s'investir dans une production pour laquelle on sait ne pouvoir trouver d'acquéreurs solvables, les capitaux existants se jettent dans la spéculation ce qui explique notamment les flambées sur le prix de l'or et la hausse des prix du pétrole alors que la consommation de ce bien est en baisse. Ce sont ainsi plus de 1000 milliards de dollars de capitaux "flottants" qui se meuvent dans le monde au gré des fluctuations des prix des matières premières, des devises et des taux d'intérêt et qui, dans leur recherche au jour le jour de placements rentables sont complètement stérilisés pour le développement de la production.
4} La surproduction de capital et de marchandise s’accompagne, notamment dans les pays occidentaux, d'une surproduction de la marchandise-force de travail. En deux ans, ce sont 5 millions de chômeurs supplémentaires qui sont venus rejoindre, dans les seuls pays avancés de l'OCDE, l'armée déjà immense des sans-travail jusqu'à atteindre 23 millions à la mi-81. A ceux qui s'obstinent à vouloir trouver des différences de nature entre la crise des années 30 et la crise présente, les chiffres sont en train d'apporter un démenti cinglant : avec 3 millions de chômeurs à la mi-81, la Grande-Bretagne a d'ores et déjà dépassé les chiffres d'avant-guerre et bien d'autres pays d'Europe sont en passe de battre à leur tour ce type de record avec des taux de chômage dépassant les 10% de la population active.
5) Résultant de l'effort désespéré pour contre balancer le manque de demande solvable par la création de crédit et de monnaie, l'inflation s'est maintenue à des taux élevés malgré la récession présente, contrairement à 67, 71 et 74-75 où le recul de la production s'était accompagné d'un certain recul du taux de hausse des prix. Ainsi se trouve confirmée la gravité croissante de la crise, qui ne peut plus naviguer entre l'inflation et la récession mais se manifeste simultanément sous ces deux formes. Se trouve ainsi confirmé l'échec patent de la politique qui avait permis une certaine "reprise" après la récession de 74-75 : la mise en œuvre d’énormes déficits tant budgétaires que commerciaux par les USA à qui était dévolu le rôle de "locomotive" de l'économie mondiale. Seul ce pays, par son importance économique et parce que sa monnaie est la principale monnaie de réserve, pouvait jouer un tel rôle. Mais ce rôle ne pouvait être que de courte durée car, véritable fuite en avant basée sur un simple fonctionnement accéléré de la planche à billets verts, ce mécanisme qui avait permis la "reprise" ne faisait qu'accélérer l'inflation tant aux USA que dans le monde et qu'accumuler les risques d'explosion de tout l'édifice monétaire international et, avec lui, de toute l'économie mondiale. C'est une béquille importante du commerce mondial qui se casse avec l'incapacité pour les USA de poursuivre leur rôle de locomotive.
6) Cette aggravation sans précédent de la crise économique ne touche donc pas seulement les pays occidentaux les plus industrialisés. Un des événements les plus significatifs de ces dernières années a été l'effondrement définitif du mythe des pays dits "socialistes", pouvant échapper à la crise générale du système. La grève de masse en Pologne a ouvert les yeux du monde entier sur la faillite économique et le caractère capitaliste des pays de l'Est. Ces pays, dépendants d'une puissance impérialiste - la Russie- arrivé trop tard sur l'arène d'un marché mondial déjà dominé par un capitalisme en déclin, ont depuis des décennies subi le poids de leur faiblesse concurrentielle vis à vis des pays les plus industrialisés du bloc occidental, et n'ont d'autre recours que de s'engager totalement dans l'économie de guerre en vue d'une domination militaire de l'ensemble da bloc impérialiste sur des zones de conquêtes. Cette situation a engendré une stérilisation des capitaux dans des secteurs improductifs ou non rentables, qui traduit une même incapacité a utiliser les forces productives que celle qui caractérise les pays plus industrialisés, mais avec des conséquences bien plus tragiques dans la mesure où ces pays tendent à être toujours perdants sur le marché mondial. Pendant les années 70, le bloc russe, acculé par cette pénurie relative de capital vis-à-vis des pays plus forts économiquement, n'a reculé la baisse de la production à laquelle le retour de la crise mondiale le condamnait qu'en empruntant massivement auprès des banques et Etats occidentaux. Ainsi, le maintien à flot de ces économies s'est effectué au prix d'un endettement colossal, qui les place dans une situation semblable à celle des pays du "tiers-monde" :
- la dette extérieure d'un pays comme la Pologne est passée de 800 millions de dollars en 1971, à 23,5 milliards de dollars en 1980, faisant un bond de près de 10 milliards de dollars ces deux dernières années ;
- le déficit annuel global des pays du "tiers-monde", est passé de 12 milliards de dollars en 1973, a 82 milliards de dollars en 1981 pour porter le total des dettes de ces pays à 290 milliards de dollars.
Cet endettement ne peut plus se poursuivre à ce rythme dans la mesure où :
- les marchandises produites grâce aux investissements réalisés dans ces pays trouvent de plus en plus difficilement à se vendre et quand elles le peuvent, c'est au détriment des marchandises produites par les pays bailleurs de fonds ;
- le simple paiement des intérêts absorbe une part croissante des exportations de ces pays (souvent plus de la moitié), de même qu'il ne peut être effectué que par de nouveaux endettements, ce qui met en péril les organismes financiers préteurs qui ont de moins en moins de perspectives d'être un jour remboursés.
Malgré les besoins immenses existant dans ces pays, leur capacité d'absorption des marchandises jetées sur le marché mondial s'amenuise donc de plus en plus, avec ses conséquences catastrophiques :
- la prise en charge par le FMI de l'économie des pays arriérés de son bloc qui tend à réduire encore plus leur consommation (dévaluation de leurs devises, blocage des salaires ouvriers) ;
- les réductions drastiques des dépenses d'Etat de la Chine (- 13% en 1980), l'annulation ou le report de 3,5 milliards de dollars de commandes faites par ce pays à l'étranger ;
- les difficultés économiques inextricables des pays du bloc russe (incapacité générale à atteindre les objectifs pourtant modestes du plan) qui auront de moins en moins de quoi échanger avec l'Occident.
7) Ainsi se sont trouvées épuisées en quelques années les recettes ("locomotive" américaine, endettement des pays sous-développés) qui avaient permis une certaine reprise de l'activité économique après 1976. Ces recettes-miracles dont la bourgeoisie faisait grand cas, se sont révélées en fin de compte pires que le mal dans la mesure où elles ne constituaient qu'une simple fuite en avant. Et ce n'est pas la nouvelle panacée baptisée "économie de l'offre" (chère aux Reagan et Thatcher) qui sera en mesure de changer quoi que ce soit : le fait d'alléger la fiscalité pesant sur le capital risque de ne pas avoir d'autre effet que de jeter les capitaux ainsi dégagés dans la spéculation et non dans les investissements productifs pour lesquels, de toute façon, les marchés sont saturés.
Une telle politique ne peut avoir d'autre objectif que de réduire massivement le coût de la fore de travail (à travers de nouvelles mises au chômage et baisses du salaire), ce qui pourra permettre une amélioration de la compétitivité commerciale des pays qui la mettent en œuvre, mais au détriment des autres pays et sans bénéfice aucun pour le marché mondial dont les capacités d'absorption iront de toute façon en s'amenuisant.
8) A l'aube des années 80, le capitalisme mondial se trouve donc confronté à une impasse économique totale. Les illusions que la bourgeoisie a pu avoir et véhiculer dans les années 70 sur une possible "reprise", "sortie du tunnel", se sont effondrées tant pour elle-même que pour l'ensemble de la société. Les années 80 se présentent donc comme les "années de vérité" : celles où se posera a la société avec toute son acuité l'alternative historique définie par l'Internationale Communiste ; "guerre impérialiste mondiale ou guerre de classe".
L'année 1980 a résumé de façon claire à la fois cette alternative, et à la fois la tendance qui domine cette alternative : le cours vers l'intensification de la lutte de classe entravant les tendances guerrières de la bourgeoisie. Si sa première moitié est dominée par une aggravation très sensible des tensions impérialistes à la suite de l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, sa deuxième moitié les relègue au second plan et est au contraire dominée par 1 riposte de la classe ouvrière a la misère crois santé que lui impose la crise capitaliste et qui a trouvé son expression la plus haute dans les formidables combats de Pologne.
9) Tant que la révolution prolétarienne ne l'au pas balayé, le capitalisme ne cessera de fourbi ses préparatifs en vue d'un nouvel holocauste mondial. Ainsi, on assiste aujourd'hui à une nouvelle escalade dans ces préparatifs, notamment à travers une augmentation considérable des dépenses d'armement qui n'ont nullement une fonction de relance de l'économie, mais bien et uniquement de renforce ment des positions militaires de chaque bloc comme conséquence :
- de la préparation de la guerre ;
- du renforcement de la concurrence inter impérialiste ;
- de la mise au pas de toute la société.
Bien que l'approfondissement de la crise économique puisse provoquer des déchirements politiques au sein de certaines bourgeoisies nationales, affaiblissant leur participation à l'unité et la solidarité de leur bloc, les préparatifs se poursuivent également sur le plan du renforcement politique des blocs en vue de leur affrontement : les velléités d'indépendance de quelques pays basées sur des intérêts économiques et politiques particuliers (commerce avec le bloc de l'Est pour la RFA, "indépendance" de la Roumanie à l'égard de l'URSS) ou sur la réticence à se trouver en 1ère ligne d'un éventuel conflit (réserves à l'égard des fusées Pershing II) devront de plus en plus céder la place à une solidarité sans arrière-pensée derrière leurs chefs de file respectifs seuls capables de garantir leur sécurité militaire et la survie de leur économie.
10) L'élection de Reagan à la tête de la 1ère puissance mondiale s'inscrit dans cette orientation de chaque bloc vers encore plus de préparatifs politiques d'une confrontation généralisée. Mais elle n'a pas cette seule fonction ; elle s'inscrit également et encore plus dans le cadre de l'offensive présente de la bourgeoisie contre le prolétariat mise en œuvre par des gouvernements de plus en plus "forts" et "muscles", qui ont remplacé le "langage des illusions" du passé par celui de "la vérité". Car, si d'un côté la crise pousse de plus en plus la bourgeoisie vers la guerre généralisée, elle pousse également son ennemi mortel, le prolétariat, vers le développement de ses combats de classe.
Le seul fait que la guerre mondiale n'ait pas encore eu lieu alors que ses conditions objectives et ses préparatifs militaro-stratégiques sont plus que mûrs, démontre la force de l'obstacle que représente aujourd'hui la combativité prolétarienne face au jeu de l'impérialisme. Si l'aggravation de la crise ne pourra qu'attiser de plus en plus les antagonismes entre Etats capitalistes, le développement de la lutte de classe, comme l'ont mis en évidence les événements de Pologne, contraindra de plus en plus ces Etats à reporter une partie croissante de leurs forces vers le front principal, celui qui menace leur existence même, et les obligera à manifester leur solidarité jamais démentie dans l'histoire face au prolétariat.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [126]
Récent et en cours:
- Crise économique [143]
Revue Internationale no 27 - 4e trimestre 1981
- 2623 lectures
Un an de luttes ouvrières en Pologne.
- 2670 lectures
Les luttes ouvrières de Pologne constituent le mouvement le plus important du prolétariat mondial depuis plus d'un demi-siècle. Un an après leur début, le bilan est riche d'enseignements pour la classe ouvrière de tous les pays et pour ses secteurs les plus avancés, les groupes révolutionnaires. Ce sont des éléments pour un tel bilan, ainsi que pour les perspectives qui s'en dégagent, que nous donnons dans cet article. Des éléments seulement, car cette expérience du prolétariat est tellement importante et riche, qu’on ne saurait la traiter de façon exhaustive dans le cadre d'un seul article. De même, la situation créée en Pologne est, par certains côtés, tellement nouvelle, elle évolue encore à une telle rapidité, qu'elle commande aux révolutionnaires la plus grande ouverture d'esprit, beaucoup de prudence et d'humilité dans les jugements qu'il convient de porter quant au devenir du mouvement.
UN BILAN QUI CONFIRME LES POSITIONS DE LA GAUCHE COMMUNISTE
Le mouvement ouvrier a une longue histoire. Chacune de ses expériences successives constitue un pas dans un chemin qui a commencé il y a près de deux siècles. En ce sens, si toute nouvelle expérience est confrontée a des conditions et circonstances inédites qui permettent d'en tirer des leçons spécifiques une des caractéristiques de ce mouvement est qu'à chacune de ses étapes, il est en général conduit, avant que de pouvoir aller glus loin, à redécouvrir des méthodes et des enseignements qui avaient déjà été siens dans le passe.
Au siècle dernier, et au cours des premières années de ce siècle, ces enseignements du passé faisaient partie de la vie quotidienne des prolétaires à travers notamment l'activité et la propagande de leurs organisations : syndicats et partis ouvriers. Avec l'entrée du capitalisme dans une autre phase de son existence, celle de sa décadence, le mouvement de la classe avait du s'adapter aux nouvelles conditions ainsi créées : la révolution de 1905 dans l'Empire russe constitue la première expérience d'une nouvelle époque de la lutte de classe, celle qui doit aboutir au renversement violent du capitalisme et à la prise du pouvoir par le prolétariat mondial. Ce mouvement de 1905 était riche d'enseignements pour les combats qui allaient suivre et tout particulièrement pour la vague révolutionnaire qui va de 1917 à 1923. Il avait fait découvrir au prolétariat deux instruments essentiels de sa lutte dans la période de décadence du capitalisme : la grève de masse et son auto-organisation en conseils ouvriers.
Mais si les enseignements de 1906 étaient présents dans la mémoire des prolétaires russes en 1917, si l'exemple d'octobre 1917 a éclairé les combats du prolétariat en Allemagne, en Hongrie, en Italie et dans beaucoup d'autres pays entre 1918 et 1973 et jusqu'au 1927 en Chine, la période suivante a connu une toute autre situation. En effet, cette vague révolutionnaire qui suit la première guerre mondiale a laissé la place à la plus longue et profonde contre-révolution de l'histoire du mouvement ouvrier. Tout l'acquis des luttes du premier quart du 20ème siècle a progressivement été perdu pour les masses prolétariennes et seuls quelques petits groupes ont été en mesure de conserver et défendre contre vents et marées ces acquis : les groupes de la gauche communiste (la fraction de gauche du Parte Communiste d'Italie, le KAPD, les Communistes Internationalistes de Hollande et les noyaux qui se sont rattachés politiquement à ces courants).
Ce qui se dégage des événements de Pologne, c'est-à-dire de l'expérience la plus importante du prolétariat mondial depuis la reprise historique de ses combats à la fin des années 60, c'est une confirmation éclatante des positions défendues par la gauche communiste depuis des décennies. Que ce soit sur la nature des pays soi-disant ''socialistes'' sur l'analyse de la période actuelle de la vie du capitalisme, sur la fonction des syndicats, et les caractéristiques du mouvement prolétarien dans cette période, sur le rôle des révolutionnaires dans ce mouvement, les luttes ouvrières en Pologne ont constitué une vérification vivante de la justesse de ces positions progressivement élaborées par les différents courants de l'entre-deux guerres et qui devaient trouver: avec la Gauche Communiste de France (qui publiait ''Internationalisme'' jusqu'au 1952) et avec le CCI aujourd'hui, leur formulation la plus complète et synthétique.
LA NATURE DES PAYS DITS ''SOCIALISTES''
Tous les courants de la gauche communiste n'ont pas su analyser avec la même clarté et la même promptitude la nature de la société qui s'était établie en URSS à la suite de la défaite de la vague révolutionnaire du premier après-guerre et de la dégénérescence du pouvoir issu de la révolution d'octobre 1917 en Russie. Pendant longtemps, la gauche italienne a parlé d'un ''Etat ouvrier'' alors que, dès les bénies 20, la gauche germano-hollandaise a analysé cette société comme un ''capitalisme d'Etat''. Mais le mérite commun de tous les courants de la gauche communiste a été, contre le stalinisme , évidemment, et également contre le trotskyste, de dire de façon claire que le régime existant en URSS était contre-révolutionnaire, que le prolétariat y était exploité comme partout ailleurs, qu'il n'avait dans ce pays aucun ''acquis'' à défendre et que tout mot d'ordre de ''défense de l’URSS'' n'était pas autre chose qu'un drapeau de ralliement pour la participation è une nouvelle guerre impérialiste.
Depuis, la nature capitaliste de la société existant en Russie et dans les pays dits ''socialistes'' est parfaitement claire pour l'ensemble des courants de la gauche communiste. Dans la classe ouvrière mondiale cette idée est également en train de se développer à tel point que certains sociaux-démocrates n'hésitent pas à parler de ''capitalisme d'Etat'' pour qualifier ces pays? Dans le but de damer le pion aux partis staliniens et de tenter de propager les prolétaires à une défense de l'occident capitaliste certes, mais ''démocratique'', contre le bloc de l'Est capitaliste et totalitaire.
Mais, contre les mystifications que continuent à faire peser les staliniens et les trotskistes sur la véritable nature de ces régimes, les luttes ouvrières de Pologne constituent une arme décisive. Elles mettent en évidence pour les ouvriers de tous les pays que dans le ''socialisme réel'' comme partout ailleurs, la société est diviser en classes aux intérêts irréconciliables, qu'il existe des exploiteurs avec des privilèges tout à fait semblables à ceux des exploiteurs d'occident et des exploités sur qui pèse une misère et une oppression croissantes au fur et è mesure que sombre l'économie mondiale. Elles jettent une lumière crue sur ces prétendues ''conquêtes'' ouvrières dont les prolétaires de ces pays n'ont entendu parler que dans les discours de la propagande officielle. Elles font justice des ''mérites'' de ''l'économie planifiée'' et du ''monopole du commerce extérieur'' chantés par les trotskistes : ces grands ''acquis'' n'ont pas empêché l'économie polonaise d'être totalement désorganisée et endettée jusqu'au cou. Ces luttes, enfin, par leurs objectifs et leurs méthodes, font la preuve que le combat prolétarien est le même dans tous les pays et cela parce que partout il est mené contre un même ennemi : le capitalisme.
Ce coup porté par les ouvriers de Pologne aux mystifications sur la nature véritable des pays dits ''socialistes'' est de la plus haute importance pour la lutte du prolétariat mondial même si, depuis quelque temps l'étoile du ''socialisme réel'' était quelque peu ternie. En effet, c'est la mystification de l'URSS ''socialiste'' qui avait été au centre de l'offensive contre-révolutionnaire du capitalisme avant et après la seconde guerre mondiale : soit pour dévoyer les luttes prolétariennes vers la ''défense de la patrie socialiste'' soit pour écœurer les ouvriers et leur faire tourner le dos à toute lutte et à toute perspective révolutionnaire.
Pour pouvoir aboutir, le mouvement révolutionnaire dont on voit aujourd'hui les signes avant- coureurs devra faire la plus grande clarté sur le fait qu'il est confronté partout à un même ennemi, qu'il n'existe aucun ''bastion ouvrier'' même dégénéré, dans le monde. Les luttes de Pologne lui ont fait accomplir un grand pas dans cette direction
LA PERIODE PRESENTE DE LA VIE DU CAPITALISME
A la suite de l'Internationale Communiste, la gauche communiste ([1] [145]) qui s'en est dégagée au cours des années 20, a basé ses positions sur l'analyse de la période ouverte par la première guerre mondiale comme celle de la décadence du capitalisme. La période où ce système ne se survit plus qu'à travers un cycle infernal de crise aiguë, guerre, reconstruction, nouvelle crise, etc.
Après toutes les illusions sur un ''capitalisme enfin libéré des crises'' que les prix Nobel d'économie et leurs comparses ont pu répandre è la faveur de la reconstruction du deuxième après-guerre, la crise qui depuis glus de dix ans frappe tous les pays a commencé a redonner corps è cette position classique du marxisme. Cependant, la thèse a longtemps été maintenue par des idéologies de à gauche, et non sans succès parmi certains secteurs du prolétariat, que l'étatisation de l'économie ne pouvait constituer un remède à cette maladie. Un des grands enseignements des luttes ouvrières en Pologne, avec tout le délabrement de l'économie nationale qu'elles mettent en évidence, est que ce ''remède'' n'en est pas un, et qu'il est même capable d'être pire que le mal. La faillite dans 1aquelle s'enfonce le modèle de capitalisme qui prime en occident n'est pas liée au ''Jeu des grands monopoles'' et autres ''multinationales''. La faillite des modèles complètement étatisés fait la preuve que ce n'est pas telle ou telle forme de capitalisme qui est caduque et en putréfaction. C'est le mode de production capitaliste comme un tout qui se trouve dans ce cas et qui doit donc laisser la place à un autre mode de production.
LA NATURE DES SYNDICATS
Un des enseignements les plus importants des luttes de Pologne concerne le rôle et la nature des organisations syndicales déjà mis en évidence par la gauche allemande et hollandaise.
En effets ces luttes ont démontré que le prolétariat n'a pas besoin de syndicats pour engager le combat de façon massive et déterminée. S'ils existaient en aout 1980 en Pologne, 1es syndicats n'étaient pas autre chose - et chaque ouvrier en avait conscience - que l'auxiliaire servile du Parti gouvernant et de la police. C'est donc en dehors et contre les syndicats que le prolétariat s'est mis en action en Pologne, se dotant de ses organes de combat, les MKS (comités de lutte reposant sur les assemblées générales et les délégués élus et révocables de celles-ci), au cours de la lutte et non de façon préalable.
Depuis août 1980 toute l'action de Solidarité a fait la démonstration que même ''libres'', ''indépendants'' et jouissant de la confiance des travailleurs les syndicats étaient les ennemis de la lutte de classe. L’expérience que vivent aujourd'hui les ouvriers de Pologne est riche d'enseignement pour le prolétariat mondial. Elle est une preuve vivante du fait que si partout dans le monde la lutte de classe se heurte aux syndicats, ce n est pas seulement parce que ceux-ci sont bureaucratisés ou que leurs dirigeants sont des vendus. L'idée que la lutte de classe va redonner une vie prolétarienne aux syndicats existants ou bien celle que les travailleurs doivent créer de nouveaux syndicats qui échapperont aux tares des anciens, sont démenties chaque jour en Pologne. Dans ce pays, à peine créé et avec à sa tête les principaux dirigeants de la grève d'août 1980, le nouveau syndicat ne fait pas autre chose que ce que faisaient les anciens et que font partout dans le monde les organisations syndicales : saboter les luttes, démobiliser et décourager les ouvriers, dévoyer leur mécontentement vers les voies de garage de ''l'autogestion'' et de la défense de l'économie nationale. Et ce n'est nullement ici une affaire de ''mauvais dirigeants, de ''manque de démocratie'' : la structure syndicale, c'est-à-dire une organisation permanente basée sur la défense des intérêts immédiats des travailleurs, ne peut se maintenir du côté de la classe ouvrière. Dans le capitalisme décadent, à l'époque où il n'y a plus de réformes possibles dans un système en putréfaction, où l'Etat tend à intégrer en son sein toute la société civile, une telle structure ne peut être qu'aspirée par l'Etat et devenir un instrument de sa devenue et de celle du capital national. Et une telle structure se donne les dirigeants et les rouages qui correspondent à sa fonction. Le meilleur militant ouvrier deviendra un bonze syndical cogne les autres s'il accepte de prendre une place dans cette structure. La plus grande démocratie formelle comme celle qui existe en principe dans Solidarité, ne pourra empêcher un Walesa de négocier directement avec les autorités les conditions et les modalités du sabotage des luttes, de passer son temps à jouer les ''pompiers volants'' aux quatre coins du pays lorsque se déclenche le moindre incendie social.
Le bilan d'une année de luttes en Pologne est clair. Jamais le prolétariat n'a été aussi fort que lorsqu'il n'y avait pas de syndicats, lorsque c'étaient les assemblées des ouvriers en lutte qui avaient l'entière responsabilité de la conduite de celle-ci, qui élisaient, contrôlaient et éventuellement révoquaient les délégués envoyés dans les organes de centralisation du mouvement.
Depuis, la création et le développement de Solidarité, ont permis qu'à une aggravation de leurs conditions de vie sans commune mesure avec celle qui avaient provoqué les grèves de l'été 1980 les ouvriers n'aient pu apporter qu'une réponse bien plus faible et disperser. C'est Solidarité qui a permis de faire accepter ce que les anciens syndicats ne pouvaient plus imposer : un allongement de la semaine de travail (renonciation aux samedis libres), un triplement du prix du pain et des augmentations massives des prix d'autres biens de première nécessité, une pénurie chaque jour plus intenable. C'est Solidarité qui a réussi à engager les prolétaires polonais dans l'impasse de l'autogestion dont ils se détournaient l'année dernière et qui va les conduire à désigner eux-mêmes (quand cela sera compatible avec les vues du Parti règnent) celui qui va se charger d'organiser leur exploitation. C'est Solidarité enfin qui a préparé, en démobilisant chaque lutte, le terrain de l'offensive présente des autorités sur le plan de la censure et de la répression.
Le prolétariat de Pologne est beaucoup plus faible aujourd'hui avec une organisation syndicale ''libre'' et en qui ''il a 'confiance'' que lorsqu'il ne comptait sur aucun syndicat pour défendre ses intérêts. Et toutes les éventuelles ''rénovations'' du syndicat par des éléments plus ''radicaux'' que Walesa n'y pourront rien. Dans tous les pays du monde, le syndicalisme ''de base'' ou ''de combat'' a fait ses preuves : il n'a d'autre fonction, quelles que soient les illusions de ses promoteurs: que de redorer le blason d'un mode d'organisation qui ne peut servir d'autres intérêts que ceux du capitalisme.
Voila ce que les courants les plus lucides de la gauche communiste affirment depuis longtemps. Voila ce que devront finir par comprendre les courants communistes qui, à travers des bavardages sur ''l’associationnisme ouvrier'' maintiennent des illusions sur la possibilité pour le prolétariat de se doter d'organisations de type syndical.
Les luttes de Pologne, même si aujourd'hui les ouvriers de ce pays sont en bonne partie enfermés dans le piège de Solidarité, et justement à cause de cela, ont mis les pieds dans le plat d'une des mystifications les plus tenaces et dangereuses pour le prolétariat : la mystification syndicale.
Aux prolétaires et aux révolutionnaires de tous les pays d'en tirer les enseignements.
LES CARACTERISTIQUES DES LUTTES PRESENTES DE PROLETARIAT ET LE ROLE DES REVOLUTIONNAIRES
Dans les colonnes de cette revue, nous avons amplement traité de cette question (''Grève de masse en Pologne 1980'', n°23 ; ''Notes sur la grève de masse, hier et aujourd'hui dans ce n° ; ''A la 1umière des évasements de Pologne, le rôle des révolutionnaires'', n°24). Nous n'y reviendrons brièvement dans cet article que pour mettre en évidence deux points :
1) en renouant avec le combat, le prolétariat retrouve nécessairement l'arme de la grève de masse ; 2) le développement de la lutte en Pologne éclaire la nature des tâches des révolutionnaires dans la période actuelle de décadence du capitalisme.
C'est Rosa Luxemburg (cf. article dans ce no de la revue) qui, la première en 1906, a mis en évidence les caractéristiques nouvelles du combat prolétarien et a analysé avec profondeur le phénomène de la grève de masse. Elle basait son analyse sur l'expérience de la révolution de 1905- 1906 dans l'empire russe et notamment en Pologne où elle se trouvait au cours de cette période.
Par une ironie de l'histoire c'est encore en Pologne au sein du bloc impérialiste russe, que le prolétariat a renoué avec le plus de détermination avec cette méthode de lutte. Ce n'est d'ailleurs pas totalement le fruit du hasard. Comme en 1905, le prolétariat de ces pays est un de ceux qui subit le plus violemment les contradictions du capitalisme. Comme en 1905, il n'y avait pas dans ces pays de structures syndicales ou ''démocratiques'' capables de constituer des tampons face au mécontentement et à la combativité des ouvriers.
Mais au delà de ces analogies, il est nécessaire de mettre en évidence l'importance de l'exemple des grèves de masse en Pologne, et notamment le fait que la lutte prolétarienne de notre époque, contrairement à ce qui était le cas au siècle dernier et à ce que pensaient les bonzes syndicaux contre lesquels polémiquait Rosa Luxemburg: que cette lutte ne résulte pas d’une organisation préalable, mais qu’elle surgit spontanément du sol de la société en crise. L’organisation ne précède pas la lutte, elle se crée dans la lutte.
Ce fait fondamental donne aux organisations révolutionnaires une fonction très différente de celle qui était la leur au siècle dernier. Lorsque l'organisation syndicale était une condition de la lutte (voir ''La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme, Revue Internationale no23), le rôle des révolutionnaires était de participer activement à 1’édification de ces organes de combat. On peut considérer que, d'une certaine façon, à cette époque, les révolutionnaires ''organisaient'' la classe ouvrière en vue de ses luttes quotidiennes contre le capital. Par contre, lorsque l'organisation est un produit de la lutte, laquelle surgit spontanément à partir des convulsions qui assaillent la société capitaliste, il ne saurait plus être question pour les révolutionnaires « d’organiser » la classe ou de « préparer » ses mouvements de résistance contre les attaques croissantes du capital. Le rôle des organisations révolutionnaires se situe alors sur un tout autre il plan : non la préparation des luttes économiques immédiates, mais la préparation de la révolution prolétarienne par une défense au sien de ces luttes de leurs perspectives mondiale, globale et historique et plus généralement de l'ensemble des positions révolutionnaires.
L'expérience des luttes ouvrières en Pologne, les enseignements que des secteurs importants du prolétariat mondial commencent à en tirer (comme ces ouvriers de la FIAT de Turin qui manifestaient en scandant ''Gdansk, Gdansk !''), sont une illustration vivante de comment procède le développement de la conscience révolutionnaire de la classe ouvrière. Comme on l'a vu, un grand nombre des enseignements des luttes de Pologne faisaient depuis des décennies partie du patrimoine programmatique de la gauche communiste. Mais toute la propagande patiente et obstinée des groupes de ce courant pendant des décennies a moins fait, et de très à loin, que quelques mois de luttes des ouvriers en Pologne pour faire assimiler au prolétariat mondial ces enseignements. La conscience du prolétariat ne précède pas son être mais accompagne l'épanouissement de celui-ci. Et cet épanouissement ne se réalise que par ce combat contre le capitalisme et par son auto-organisation dans et pour ce combat.
Ce n'est que lorsqu’il commence à agir comme classe, donc à lutter à une échelle massive, que le prolétariat est en mesure de tirer les leçons de ses luttes tant présentes que passées. Cela ne veut pas dire que les organisations révolutionnaires n'ont aucun rôle à jouer dans ce processus. Leur fonction est justement de systématiser ces enseignements de les intégrer dans une analyse globale et cohérente, de les rattacher à toute l'expérience passée de la classe et aux perspectives d'avenir de son combat: Mais leur intervention et leur propagande au sein de la classe ne peuvent réellement rencontrer d'écho dans les masses ouvrières que lorsque celles-ci sont confrontées, dans 1a pratique, par une expérience vivante, aux questions fondamentales soulevées par cette intervention.
Ce n'est qu'en s'appuyant sur les premiers éléments d'une prise de conscience, prise de conscience dont elles sont elles-mêmes une manifestation, que les organisations révolutionnaires sont en mesure de se faire entendre par l'ensemble de la classe, de féconder son combat.
LES PROBLEMES NOUVEAUX QUE LES LUTTES DE POLOGNE METTENT EN EVIDENCE
Si les mouvements importants du prolétariat sont en général l'occasion d'une redécouverte par les travailleurs de méthodes et d'enseignements déjà valables dans le passé, il ne faudrait pas en déduire que la lutte de classe est constituée d'une simple répétition monotone du même scénario. Dans la mesure où il se déroule dans des conditions en évolution constante, chaque mouvement de la classe apporte ses propres enseignements qui viennent enrichir le patrimoine de son expérience globale. A certains moments cruciaux de la vie de la société, copie les révolutions ou les périodes charnière entre deux époques de celle-ci, il arrive même qu'une lutte particulière apporte au prolétariat mondial des éléments nouveaux si fondamentaux pour son mouvement historique que c'est toute la perspective de celui-ci qui en est affectée. Il en fut ainsi de la Commune de Paris, des révolutions de 1905 et 1917 en Russie. La première fit découvrir au prolétariat la nécessité de détruire de fond en comble l'Etat capitaliste. La deuxième, située au tournant de la vie du capitalisme, entre sa phase ascendante et sa phase de décadence, lui montra de quels instruments elle avait besoin dans cette nouvelle période, tant pour résister aux attaques du capital que pour partir à l'assaut du pouvoir : la grève de masse et les conseils ouvriers. La troisième, seule expérience sérieuse à ce jour de la prise du pouvoir politique par le prolétariat dans un pays, doit lui permettre d'aborder, mieux armé que par le passé, les problèmes de la dictature du prolétariat, de ses rapports avec l'Etat de la période de transition et de la place du parti prolétarien dans l'ensemble du processus révolutionnaire.
Les luttes ouvrières en Pologne: malgré toute leur importance, n'ont pas apporte è l'expérience du prolétariat des éléments aussi fondamentaux que ceux qu'on vient d'évoquer. Cependant, il est nécessaire de signaler certains problèmes auxquels la pratique n'a pas encore donné de réponse décisive, bien qu'ils se soient posés depuis longtemps sur le plan théorique, et que les évasements de Pologne remettent au premier plan des préoccupations de la classe.
En premier lieu, les luttes de Pologne sont une illustration claire d'un phénomène général que nous avons déjà signalé dans notre presse et qui est nouveau dans l'histoire du mouvement ouvrier le développement d'une vague révolutionnaire du prolétariat non à partir de la guerre (comme en 1905 et 1917 en Russie, en 1918 en Allemagne et dans le reste de l'Europe), mais à partir d'un effondrement économique du capitalisme, ''conformément'' pourrait-on dire, au schéma que Marx et Engels avaient envisagé au siècle dernier. Nous avons dans d'autres textes amplement analysé les caractéristiques qu'imposent à la vague présente des combats ouvriers les conditions dans lesquelles elle se développe : mouvement de longue durée, mobilisation à partir de revendications essentiellement économiques (alors qu'en 1917, par exemple, la revendication principale, la paix, était directement politique). Nous n'y reviendrons pas ici sinon pour constater que ces circonstances nouvelles exigent des révolutionnaires vigilance, esprit critique, modestie, ouverture d'esprit afin d'éviter d'être empêtrés dans des schémas du passé devenus caducs aujourd'hui. C'est dans de tels schémas rigides que se sont enfermés les groupes qui considèrent que le prochain mouvement révolutionnaire de la classe surgira, comme par le passé, de la guerre impérialiste. Les luttes de Pologne démontrent justement que le capitalisme ne sera en mesure d'apporter sa réponse propre à la crise générale de son économie qu'après avoir mis au pas le prolétariat. Tant que les diverses fractions nationales de la bourgeoisie seront menacées dans leur survie comme classe par la combativité ouvrière, elles ne prendront pas le risque de laisser leurs luttes pour l'hégémonie mondiale dégénérer en une confrontation centrale qui les affaiblirait devant leur ennemi commun et mortel : le prolétariat. C'est ce qu'a démontré l'année 1980 : si la première partie est marquée par une aggravation très sensible des tensions entre les deux blocs impérialistes, ces tensions, tout en se maintenant, passent au second plan pour la bourgeoisie mondiale après les grèves du mois d'août. Ce qui importe à la bourgeoisie, après ces luttes, c'est de faire tout son possible, et de façon coordonnée, pour étouffer la combativité ouvrière. Et pas un de ses secteurs ne manque à l'appel. L'URSS et ses acolytes font force manœuvres militaires et promesses d'''aide fraternelle'' pour intimider les ouvriers polonais ; ils dénoncent soigneusement Walesa et Kuron chaque fois que ceux-ci ont besoin de redorer un blason qui a tendance à se ternie au fil de leurs incessantes opérations antigrèves. Les pays occidentaux accordent des reports de dettes et des livraisons de denrées de base à bas prix ; ils envoient leurs syndicalistes apporter matériel de propagande et bons conseils à Solidarité ; ils font tout leur possible pour rendre crédible la thèse d'une intervention du Pacte de Varsovie au cas où l'agitation ne se calmerait pas, ils confient au chancelier ''socialiste'' d'Autriche Kreisky et à Brandt, président de l'''internationale Socialiste'' , le soin d'exhorter les prolétaires polonais ''au travail '' .
En d'autres termes, si les différents gangsters qui se partagent le monde ne perdent pas une occasion de se tirer dans le dos, ils sont prêts à réaliser l'''union sacrée'' dès que se manifeste l'ennemi prolétarien. La lutte de la classe ouvrière, telle qu'elle est engagée aujourd'hui, est bien le seul obstacle à une nouvelle guerre généralisée. Les événements de Pologne démontrent une nouvelle fois que la perspective n'est pas à celle-ci, mais à la guerre de classe. La prochaine révolution ne surgira pas de la guerre mondiale, c'est uniquement sur le cadavre de la révolution que la guerre pourra éventuellement surgir.
L'autre problème que posant les évasements de Pologne concerne plus spécifiquement la nature des armes bourgeoises que la classe ouvrière devra affronter dans les pays du bloc russe.
En Pologne, on a pu constater que la bourgeoisie a du adopter , à son corps défendant , la tactique couramment employée en occident : le partage du travail entre des équipes gouvernementales à qui revient la tâche de ''parler clair'' le langage de 1'austérité de la répression et de 1'intransigeance (modèle Reagan ou Tchatcher) , et des équipes d'opposition au langage ''ouvrier'' chargées de paralyser la riposte ouvrière face aux attaques capitalistes . Mais alors que les bourgeoisies occidentales sont rompues à ce genre de partage des responsabilités pour lequel elles disposent d'un système ''démocratique'' bien rodé , les bourgeoisial du bloc de 1'Est dont le mode de domination est basé sur l'existence d'un parti-Etat , maître absolu de tous les rouages de la société , ces bourgeoisies éprouvent les plus grandes difficultés à maitriser un tel jeu .
En décembre 1980, nous mettions déjà en évidence cette contradiction : ''...pas plus aujourd'hui qu'hier, le régime stalinien ne peut tolérer sans dommage ni danger l'existence de telles forces d'opposition. Sa fragilité et sa rigidité congénitales n'ont pas disparu par enchantement par la grâce de l'explosion des luttes ouvrières. Bien au contraire ! Ainsi, contraint de tolérer dans ses entrailles un corps étranger dont il a besoin pour survivre, mais que rejettent toutes les fibres de son organisme , le régime est plongé aujourd'hui dans les convulsions les plus douloureuses de son histoire (Revue Internationale n°24, p.3).
Depuis, le Parti a réussi, notamment après son 9ème Congrès et grâce, une fois encore, à la collaboration des grandes puissances, à stabiliser sa situation interne autour de Kania et à établir un modus vivendi avec Solidarité. Ce modus vivendi n'est pas exempt d'attaques et de dénonciations acerbes. Comme en occident, elles font partie du jeu qui permet è chacun des protagonistes d'être crédible dans son rôle : en montrant les dents, le ''méchant'' veut faire la preuve que, si c'est nécessaire, il n'hésitera pas à réprimer et en même temps, il attire la sympathie du public sur le ''gentil'', lequel, en bravant le premier, se donne des allures de ''héros''.
Mais, les affrontements entre Solidarité et le POUP ne sont pas uniquement du cinéma, comme n'est pas uniquement du cinéma l'opposition entre droite et gauche dans les pays occidentaux. En occident, cependant, le cadre institutionnel permet en général, de ''gérer'' ces oppositions afin qu'elles ne menacent pas la stabilité du régime et que les luttes pour le pouvoir soient contenues et se résolvent dans la formule la plus appropriée pour affronter l'ennemi prolétarien. Par contre, si en Pologne même, la classe dominante est parvenue, avec beaucoup d'improvisation, mais momentanément avec succès, à instaurer des mécanismes de ce style, rien ne dit qu'il s'agisse d'une formule définitive et exportables vers d'autres pays ''frères''. Les mêmes invectives qui servent à crédibiliser un partenaire-adversaire quand celui-ci est indispensable au maintien de l'ordre, peuvent accompagner son écrasement quand il n'est plus utile (celles relations entre fascisme et démocratie entre les deux guerres mondiales).
En la contraignant à un partage des tâches auquel la bourgeoisie d'Europe de l'Est est structurellement réfractaire, les luttes prolétariennes de Pologne ont créé une contradiction vivante. Il est encore trop tôt pour prévoir comment elle se résoudra. Face è une situation historiquement inédite (''une époque des jamais vus'' comme disait un leader de Solidarité, Gwiazda), la tâche des révolutionnaires est de se mettre modestement à 1’écoute des faits.
LES PERSPECTIVES
Prévoir dans le détail de quoi demain sera fait est une tâche qui échappe, comme on vient de le voir, à la compétence des révolutionnaires. Par contre, ils doivent être capables de dégager de l'expérience les perspectives plus générales du mouvement, d'identifier le prochain pas que devra accomplir le prolétariat sur son chemin vers la révolution. Et ce pas, nous l'avons défini dès le lendemain des luttes d'août 1980 dans le tract international diffusé par le CCI, ''Pologne: à l'Est conte à l'Ouest, une même lutte ouvrière contre l'exploitation capitaliste'' (6/9/82) : la généralisation mondiale des combats.
L'internationalisme est une des positions de base du programmer prolétarien si non la plus importante. Il est exprimé avec force par la devise de la Ligue des Communistes de 1847, ainsi que par l’hymne de la classe ouvrière. C'est la 1igne de partage entre courants prolétariens et courants bourgeois dans les 2ème et 3ème Internationales dégénérescences. Cette place privilégiée de 1'internationalisme n'est pas la traduction d'un principe général de fraternité humaine. Elle exprime une nécessité vitale de la lutte pratique du prolétariat. Dès 1847, Engels pouvait écrire : ''La révolution communiste ne sera pas une révolution purement nationale. Elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés . . .''( ''Principes du communisme'' ) .
Les événements de Pologne mettent en évidence combien était juste cette affirmation. Ils démontrent la nécessité d'une unité mondiale du prolétariat face à une bourgeoisie qui, de son côté, est capable d'agir de façon concertée et solidaire par dessus tous ses antagonismes impérialistes. Puisqu'elle est face à son ennemi mortel. En ce sens, on ne peut que dénoncer le mot d'ordre parfaitement absurde de la ''Communist Workers' organisation'' qui dans le n°4 de ''Workers'voice'' appelle les ouvriers polonais à la ''révolution maintenant ! '' . Dans cet article, la CWO prend soin de préciser que ''appeler à la révolution aujourd'hui: n'est pas de l'aventurisme propre à un simple d'esprit, tout en précisant que : ''Du fait que l'ennemi de classe a eu 12 mois pour se préparer à écraser la classe et que les ouvriers polonais n'ont pas encore créé une direction révolutionnaire consciente de l'enjeu de la situation, les chances de victoire apparais- sent très minces. Malgré son inconscience: la CWO se rend quand même compte que I'URSS ne laisserait pas impunément le prolétariat faire la révolution a ses portes, mais elle a trouvé la solution : ''Nous appelons les travailleurs de Pologne à prendre le chemin de la lutte armée contre l'Etat capitaliste et à fraterniser avec les travailleurs en uniforme qui seront envoyés pour les écraserai. Voila ! Il suffisait d'y penser : il n'y a qu'à '' fraterniser avec les soldats russes''. Il est sûr qu'une telle possibilité n'est pas à exclure : c'est une des raisons qui expliquent que l'URSS ne soit pas intervenue en Pologne pour mettre au pas le prolétariat. Mais de là à penser que le Pacte de Varsovie ne pourrait déjà plus trouver en son sein les moyens d'exercer une répression, c'est se faire d'incroyables illusions sur la maturité présente des conditions de la révolution dans toute l'Europe de l'Est et dans le monde entier. Car c'est bien de cela qu'il s'agit : le prolétariat ne pourra faire la révolution dans un pays que si, partout ailleurs, il est déjà en marche. Et ce ne sont pas les quelques grèves qui ont pu se produire en tchécoslovaque, en Allemagne de l'Est, en Roumanie et même en URSS depuis août 1980 qui permettent de dire que la situation est mûre dans ces pays pour l'affrontement de classe généralisé.
Le prolétariat ne pourra faire la révolution ''par surprises''. Un tel bouleversement sera le résultat et le point culminant d'une vaque de luttes internationales dont nous n'avons vu jusqu'à présent qu'un tout petit début ; Toute tentative du prolétariat dans un pays donné de se lancer à l'assaut du pouvoir sans tenir compte du niveau des luttes dans les autres pays est condamnée à un échec sanglant. Et ceux, comme la CWO, qui appellent les prolétaires à se lancer dans de telles tentatives sont des imbéciles irresponsables.
L'internationalisation des luttes n'est pas seulement indispensable en tant qu'étape vers la révolution prolétarienne, comme moyen d'arrêter le bras meurtrier de la bourgeoisie face aux premières tentatives de prise du pouvoir par le prolétariat. Elle est une condition du dépassement par les prolétaires polonais et ceux des autres pays à des mystifications qui pèsent sur eux et conduisent à une paralysie de leur combat. En effet, si on examine les causes du succès présent des manœuvres de Solidarité, on constate qu'elles tiennent pour l'essentiel, à l'isolaient où se trouve encore le prolétariat en Pologne
Tant que le prolétariat des autres pays du bloc de l'Est, et notamment de Russie, n'aura pas engagé le combat, le chantage è l'intervention des '' frères'' pourra fonctionner, le nationalisme pays anti-russe et la religion qui va avec conserveront un poids.
Tant que les ouvriers d'occident n'auront pas développé les luttes contre ''leurs'' syndicats l'indépendants'' et ''leurs'' régimes ''démocratiques'' ceux de l'Est ne pourront combattre jusqu'au bout leurs illusions sur le ''syndicalisme libre'' et la ''démocratie'' Tant que la pratique même d'une lutte mondiale n'aura pas fait comprendre aux prolétaires qu'ils n'ont pas d’''économie nationale'' à défendrezà qu'il n'y a pas de possibilité d'améliorer la gestion de celle-ci dans le cadre d'un pays et des rapports de production capitalistes, les sacrifices au nom de l'''intérêt national'' pourront être acceptés, les mystifications sur l'''autogestion'' avoir un impact.
En Pologne, comme partout, le prochain pas qualitatif des luttes dépend de leur généralisation à l'échelle mondiale. C'est ce que les révolutionnaires doivent dire clairement a leur classe au lieu de présenter les luttes ouvrières de Pologne
Comme le résultat des conditions historiques particulières de ce pays. En ce sens, un article comme celui de ''Programme Communiste'' n'en qui remonte aux partages de 1773. 1792 et 1796 et à ''l'héroïsme de Kosciuszko'' pour expliquer les luttes présentes au lieu de les resituer dans le cadre de la reprise mondiale des combats de classe, un article qui fait du prolétariat polonais l'héritier héroïque de la bourgeoisie polonaise révolutionnaire du siècle dernier et brocards la bourgeoisie polonaise aujourd'hui pour sa soumission à la Russie, un tel article, malgré les phrases internationalistes qu'on peut y trouver, n'est pas fait pour contribuer à une prise de conscience de la classe ouvrière.
Plus que jamais il s'agit d'affirmer clairement comme nous le faisions en décembre 1980 : ''En Pologne, le problème ne peut être que posé, c'est au prolétariat mondial de le résoudre'' (Revue Internationale, n°24, p.7). Et c'est le capitalisme mondial lui-même qui, par la généralisation de son effondrement économique, est en train de créer les conditions de ce surgissement mondial de la lutte de classe.
FM 03/10/81
[1] [146] Bordiga, de fondateur de la gauche italienne réfutait l’analyse de la décadence du capitalisme: ce courant par contre, notamment avec ''Bilan'', s’est tenu ferme sur cette analyse jusqu’à la 2ème guerre.
Géographique:
- Pologne [1]
Heritage de la Gauche Communiste:
Lutte de classe en Europe de l'est (1920-1970) : la nécessite de l'internationalisation des luttes
- 3668 lectures
REVOLUTION ET CONTRE-REVOLUTION
Ce n'est pas un hasard si la contre-révolution qui s'est abattue contre les soulèvements de l'après première guerre et qui devait maintenir son étreinte sinistre jusqu'à la fin des années 60 prit sa forme la plus vicieuse précisément dans les pays où la résistance prolétarienne avait été la plus forte : en Russie, en Allemagne, en Bulgarie, en Pologne et dans tous les pays frontaliers, de la Finlande à la Yougoslavie. Les ouvriers vivant entre l'Oural et le Rhin furent les premiers et les plus déterminés dans la révolte contre le massacre impérialiste de 14-18, et contre les souffrances endurées par leur classe à cause d'un capitalisme historiquement en faillite. C'est pourquoi ils sont devenus la principale cible d'une bourgeoisie mondiale momentanément unie contre un ennemi commun. La bourgeoisie des pays de l'ouest victorieux armèrent et renforcèrent les gouvernements et les gangs armés dans toute cette zone d'autant plus qu'ils attaquent plus violemment les ouvriers. Ils ont même envoyé leurs propres armées pour tenter d'occuper l'URSS, les Balkans, la Ruhr, etc., se battant entre eux pour le butin mais toujours unis contre la résistance prolétarienne.
Déjà en 1919, après la chute de la république des soviets, la terreur blanche régnait ouvertement en Hongrie. De Budapest en 1919 à Sofia ou Cracovie en 1923, tous les soulèvements révolutionnaires furent écrasés et les jeunes partis communistes dramatiquement affaiblis, souvent à la limite de l'extermination physique. Ceci fut par exemple le cas pour la Yougoslavie, où des centaines et des milliers de militants communistes furent tués ou emprisonnés.
LA CONTRE-REVOLUTION NATIONALISTE
Ainsi, alors que la défaite de la classe ouvrière dans les pays avancés de l'ouest devait être complétée par la mobilisation idéologique pour la guerre des Etats "démocratiques" dans les années 30, l'écrasement du prolétariat à l'Est devint très vite un anéantissement physique. Mais ce ne furent pas tant les machines de guerre et les chambres de torture de la terreur d'Etat qui brisèrent l'échiné du prolétariat dans ces années fatales de l'après guerre, que le poids du NATIONALISME dans les pays de l'Est et celui de la SOCIAL-DEMOCRATIE en Allemagne et en Autriche. La création d'une mosaïque d'Etats nationaux en Europe de l'Est à la fin de la 1ère guerre mondiale remplit le rôle immédiatement contre-révolutionnaire de dresser une barrière nationale entre le prolétariat russe et la classe ouvrière allemande. C'est pourquoi les communistes polonais, déjà en 1917, étaient opposés à l'indépendance nationale pour la bourgeoisie polonaise que proclamaient les bolcheviks en URSS. Continuant le combat contre le nationalisme polonais, en lien surtout avec Rosa Luxembourg, ils déclaraient effectivement la guerre aux sociaux-démocrates polonais, à cette pourriture chauvine, dont nous retrouverons plus tard un dernier héritier avec le KOR. Les bolcheviks avaient raison d'insister sur les droits culturels et linguistiques des ouvriers et des opprimés des minorités nationales et d'insister sur ce droit surtout en Europe de l'Est. Mais ils auraient dû savoir que ces "droits" ne seraient jamais respectés par la bourgeoisie! En effet, le jeune Etat polonais de l'après guerre, par exemple, a commencé immédiatement à établir une discrimination insidieuse contre les lithuaniens, les russes blancs et autres minorités culturelles existant à l'intérieur de ses frontières. Mais par dessus tout, les bolcheviks eurent tort de fixer aux ouvriers le but de défendre ou de créer des ETATS NATIONAUX, ce qui ne peut être qu'un moyen de se soumettre à la direction politique de la bourgeoisie, et ceci à une époque où la révolution prolétarienne destruction de tous les Etats nationaux était historiquement à l'ordre du jour.
Quand l'armée rouge a essayé de prendre Varsovie en 1920, les ouvriers polonais se sont ralliés derrière leur bourgeoisie, repoussant l'offensive. Ceci montre l'impossibilité d'étendre la révolution prolétarienne militairement. Ceci montre aussi la force de l'idéologie nationaliste dans les pays où l'Etat national vient juste d'être crée, et où l'exploitation s'est toujours accomplie avec l'assistance pesante de parasites étrangers, de telle sorte que les parasites autochtones peuvent se donner plus facilement une image populaire. Le nationalisme, qui dans ce siècle a toujours signifié une sentence de mort pour notre classe, a continué a peser sur la lutte de notre classe pour sa libération dans les pays de l'Est, et il pèse encore aujourd'hui.
L'UNITE DU PROLETARIAT DE L'EST A L'OUEST
Le fait que la révolution prolétarienne tant attendue ait éclaté en Europe de l'Est et non dans les cœurs de la puissance industrielle, causa une grande confusion chez les révolutionnaires de l'époque. Ainsi les bolcheviks par exemple voyaient les événements de février 1917 comme une révolution bourgeoise dans une certaine mesure, et même par la suite existaient dans le parti, certaines positions voyant des tâches bourgeoises à accomplir dans la révolution prolétarienne. Mais s'il était juste de considérer que l'Europe de l'Est était le maillon faible de la chaine de l'impérialisme, qui de plus manquait de tradition démocratique bourgeoise, de syndicats établis et d'une social-démocratie forte, il n'était pas moins vrai que ce jeune prolétariat numériquement faible, était très combatif.
Dans l'immédiat après-guerre, la préoccupation du mouvement prolétarien était d'étendre la vague révolutionnaire vers l'ouest, vers les centres industriels du capitalisme. A cette époque, comme aujourd'hui, la tâche centrale du prolétariat international ne pouvait être que de construire un pont au dessus du fossé qui séparait l'est et l'ouest, fossé creusé par la division de l'Europe en nations victorieuses et nations vaincues, division due à la loi de la guerre. A cette époque, comme aujourd'hui où toute la bourgeoisie entretient le mensonge qu'il y aurait deux systèmes différents à l'Est et à l'Ouest, les révolutionnaires avaient à combattre bec et ongles contre l'idée qu'il y ait quelque chose de fondamentalement différent dans les conditions ou les buts de la lutte des ouvriers de l'est ou de l'ouest. Ce combat était nécessaire, par exemple, contre les mensonges de la social-démocratie allemande, selon laquelle la domination de classe était spécialement brutale et totalitaire à l'Est, mensonges destinés à justifier le support du SPD à son gouvernement dans la guerre contre la Russie. Il était nécessaire d'insister sur le fait que cette brutalité particulière était conjoncturelle, et que les démocraties de l'ouest sont tout autant sauvages et dictatoriales en réalité. Cette guerre politique menée par les communistes contre ceux qui défendaient l'impérialisme démocratique, contre ceux qui versaient des larmes de crocodile sur le massacre d'ouvriers dans la lointaine Finlande ou la Hongrie pendant qu'ils tuaient tranquillement les prolétaires en Allemagne, cette guerre doit être encore menée aujourd'hui contre les social-démocrates, les staliniens, les gauchistes. De tous temps, la tâche des communistes est de défendre l'unité fondamentale de la lutte internationale du prolétariat; de montrer que le rideau de fer ne doit pas être une barrière empêchant la lutte collective des ouvriers du monde entier. Aujourd'hui, comme pendant la vague révolutionnaire, les tâches du mouvement sont les mêmes partout. Aujourd'hui comme hier; l'Europe de l'Est est le maillon faible de l'impérialisme mondial, et les ouvriers de ces pays peuvent pendant un temps devenir l'avant-garde du prolétariat mondial. Comme en 1917, quand les ouvriers du monde avaient à suivre l'exemple de leurs frères de classe russes aujourd'hui ils ont à tirer des leçons de la lutte de classe en Pologne. Mais ils doivent aller au delà de cet exemple, comme l'Internationale Communiste l'avait compris, et devenir à leur tour une source d'inspiration et de clarification pour les ouvriers de l'Est.
L'HERITAGE DE LA CONTRE REVOLUTION
La terreur ouverte qui s'abattit sur l'Europe de l'Est et du centre dans les années 20 et les années 30, associée à jamais à des noms comme Noske, Morthy, Pilsduski, Hitler, Staline, a fini par éliminer presque physiquement la social-démocratie aussi, lorsque les besoins des différents capitaux nationaux changèrent radicalement dans une région où la classe ouvrière avait été lourdement vaincue et dominée par l'Allemagne et la Russie. Mais cela ne pouvait en rien aboutir à l'affaiblissement des ILLUSIONS sociale-démocrates au sein de la classe, qui ne peuvent être dépassées qu'à travers l'expérience de la lutte de classe. PRECISEMENT PARCE QUE le capitalisme décadent a pris si vite la forme d'une dictature ouverte dans ces pays, se passant de raffinements tels que le cirque parlementaire ou les "syndicats indépendants", le leurre de ces organes, qui, autrefois, dans la jeunesse du capitalisme, ont fait avancer les positions de la classe, devient de plus en plus évident avec l'avancée de la contre-révolution. Ni le fascisme, ni le stalinisme ne pouvaient effacer la nostalgie qu'avaient les ouvriers à l'Est pour des instruments qui, aujourd'hui, à l'ouest, sont le corps des forces anti-prolétariennes. L'héritage social-démocrate,1a, croyance en la possibilité de transformer la vie des ouvriers à l'intérieur du capitalisme, qui ne peut offrir aujourd'hui que misère et destruction, et l'héritage nationaliste de la période qui a suivi la1ère guerre mondiale sont aujourd'hui le cauchemar qui pèse sur la lutte pour un nouveau monde, et la freine, une époque où la base matérielle de ces illusions disparaît rapidement. Le coup le plus mortel que "la contre-révolution ait porté contre le mouvement ouvrier fut le renforcement de ces illusions.
Les ouvriers n'ont pas simplement subi passivement les défaites de 1930. Partout en Europe centrale et en Europe de l'Est, nous trouvons des exemples de batailles héroïques d'arrière-garde qui ne furent toutefois pas assez fortes pour changer le mouvement de la marée. Nous pourrions parler par exemple de la résistance acharnée des ouvriers chômeurs en Allemagne au début des années 30, ou de la vague massive de grèves sauvages et d'occupations qui a ébranlé la Pologne dans les années 30, mouvement ayant pour centre le bastion de Lodz. En Russie même, le prolétariat a continué à résister à la contre-révolution victorieuse jusque dans les années 30.
Mais ce furent réellement des tentatives désespérées d'auto-défense d'une classe qui n'était plus capable de développer une perspective propre. Le caractère de plus en plus désespéré de la situation avait déjà été mis en évidence par le soulèvement de Cronstadt en 1921, qui a essayé de restaurer le rôle central des Conseils Ouvriers en Russie. Le mouvement fut écrasé par le même parti bolchevik qui avait été quelques années auparavant l'avant-garde du prolétariat mondial mais désormais englouti dans l'Etat dit "ouvrier". La dégénérescence de toute l'Internationale Communiste face à la retraite mondiale et l'écrasement final des luttes révolutionnaires de la classe ouvrière, a ouvert la voie à un triomphe complet du stalinisme. Le stalinisme fut la forme la plus perverse que prit la contre-révolution bourgeoise, parce qu'il a détruit les organisations, enterré les acquis programmatiques du prolétariat DE L'INTERIEUR, transformant les partis d'avant-garde du COMINTERN en organisations défendant le capitalisme d'Etat et la terreur, et réprimant la classe au nom du "socialisme". Ainsi furent effacées toutes les traditions du mouvement ouvrier, d'abord en Russie et ensuite dans toute l'Europe de l'Est. Les noms de Marx et de Lénine, brandis par les staliniens pour travestir leur nature capitaliste, furent identifiés à l'exploitation aux yeux des ouvriers comme Siemens ou Krupp en Allemagne. En 1956, les ouvriers hongrois en révolte ont même entrepris de brûler ces "livres sacrés" du gouvernement dans les rues. Rien ne symbolisait mieux le triomphe du stalinisme.
LA RESISTANCE DES OUVRIERS DANS LA PERIODE D'APRES 1945
L'enterrement de la révolution d'octobre et de la révolution internationale, l'anéantissement du parti bolchevik et de l'Internationale Communiste de l'intérieur, la liquidation du pouvoir des conseils ouvriers : telles furent les principales conditions à remplir pour l'avènement de l'impérialisme "rouge" "soviétique". Rouge du sang des ouvriers et des révolutionnaires qu'il a massacrés, symbolisé par Staline le bourreau, qui était le digne successeur du tsarisme et de l'impérialisme international contre lequel Lénine avait déclaré une guerre civile en 1914.
Les nazis affichaient le slogan "liberté de travail" "le travail rend libre" sur les grilles d'Auschwitz. Mais ils gazaient leurs victimes. Dans la Russie stalinienne, de l'autre côté, les mots de national socialisme furent repris littéralement. Dans les camps de Sibérie, c'est par millions qu'ils étaient conduits à la mort. Trotski dans les années 30, oubliant les critères politiques de classe, oubliant les ouvriers, appela ce sinistre bastion de la contre-révolution un "Etat ouvrier dégénéré" à cause de la façon spécifique dont les exploiteurs organisaient leur économie. Ses disciples finirent par saluer les conquêtes de l'URSS en Europe de l'Est comme une extension des acquis d'octobre.
La fin de la guerre de 39-45 amena une explosion de combativité des ouvriers en Europe, non seulement en France et en Italie, mais aussi en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie. Mais les ouvriers n'étaient pas capables d'affronter le capitalisme comme une classe autonome, ou même de se défendre effectivement. Au contraire, la classe tout entière était aveuglée par 1'antifascisme et la fièvre patriotique, et les comités qu'elle a fait surgir à cette époque n'ont fait que servir de soutien à l'Etat antifasciste et à l'organisation de la reconstruction de l'économie sous la botte de Staline/Churchill/Roosevelt. A la fin de la guerre, il y eut des actes suicidaires de rébellion contre la terreur nazie d'Etat. Par exemple, les grèves à Lodz et dans d'autres villes de Pologne, les révoltes dans les ghettos juifs et dans les camps de concentration, résistance ouvrière armée -même en Allemagne- et des moments de mutinerie ou même de fraternisation chez les prolétaires en uniforme. Mais ces soubresauts de résistance, qui pendant un moment ont pu raviver les espoirs des quelques révolutionnaires qui restaient en Europe, de ceux qui n'avaient pas été supprimés par les Etats démocratiques, staliniens ou fascistes, restaient une exception. La seconde guerre mondiale fut en fait le sommet de la défaite la plus écrasante que le prolétariat ait jamais souffert. Il n'y a qu'à voir la barbarie sans précédent que fut le front de l'Est, où les classes ouvrières allemandes et russes furent lancées l'une contre l'autre dans un combat fratricide et sanglant qui fit presque 25 millions de morts.
LE SOULEVEMENT DE VARSOVIE
Sans espoir de perspective propre ; prolétariat pouvait être conduit à des actes de désespoir complet. Le meilleur exemple en fut le soulèvement de Varsovie qui a commencé en août 1944. L'insurrection fut déclarée par le "Conseil Polonais d'Unité Nationale", comprenant toutes les forces antiallemandes de la bourgeoisie, incluant le vieux général Pilsduski et le SP polonais, qui avaient à eux deux réprimé plus d'un mouvement des ouvriers. Bien que les staliniens furent forcés de participer pour ne pas perdre leur dernière influence sur les ouvriers et leur "place d'honneur" dans la bourgeoisie dans l'après-guerre, le soulèvement fut autant antirusse qu'antiallemand. C'était supposé être le dernier grand pas par lequel les polonais se "libéreraient eux-mêmes" et leur capitale, avant que Staline ne le fit. L'armée russe stationnait à 30 km de Varsovie. Les ouvriers polonais n'avaient besoin d'aucune aide. Ils avaient combattu la Gestapo pendant 63 jours, tenant tous les quartiers de la ville pendant de longues périodes. Les instigateurs bourgeois du mouvement, qui siégeaient à Londres, savaient très bien que la Gestapo ne quitterait pas la ville sans avoir détruit la résistance des ouvriers. Ce qu'ils voulaient en réalité, ce n'était pas une "libération polonaise de Varsovie"- ce qui n'a jamais été mis en question- mais plutôt un bain de sang qui scellerait l'honneur national et l'unité pour les années à venir. Et quand la Gestapo eut écrasé toute résistance, elle abandonna la ville à Staline, laissant un quart de million de morts derrière elle. Et l'armée soviétique qui 12 ans auparavant aurait été si rapide à entrer dans Budapest et à écraser les conseils ouvriers, attendit patiemment que ses amis fascistes eussent fini leur travail. Le Kremlin ne voulait pas avoir affaire à des ouvriers armés ou aux fractions populaires pro-occidental es de la bourgeoisie polonaise.
L'ETABLISSEMENT DU REGIME STALINIEN
Pour tempérer l'orage des dernières hostilités et de la démobilisation et pour ne pas aiguiser trop tôt les tensions inter-impérialistes entre les alliés victorieux, les staliniens ont réuni des gouvernements de front populaire dans les pays de l'Est à la fin de la guerre; des gouvernements qui comprenaient des sociaux-démocrates, des gouvernements de droite et même fascistes.
Du fait de la présence des armées staliniennes en Europe de l'Est, la mise en place d'un contrôle absolu de l'Etat par les staliniens ne fut pas un problème et s'imposa presque "organiquement" partout. En Tchécoslovaquie, quelques manifestations furent organisées par les PC avec l'aide de la police à Prague en 1948, manifestations qui s'inscrivirent dans les livres d'histoire staliniens comme héroïque insurrection tchécoslovaque? Seule la complète étatisation de l'économie et la fusion de l'Etat et des PC en Europe de l'Est pouvaient garantir le passage définitif des "démocraties populaires" sous l'influence russe; le principal problème auquel furent confrontés les nouveaux dirigeants fut l'établissement de régimes qui devaient avoir un certain soutien dans la population, particulièrement chez les ouvriers.
Dans l'Europe de l'Est de 1'entre-deux-guerres, les staliniens avaient été peu nombreux et isolés dans beaucoup de ces pays et même dans les endroits où ils étaient le plus influents comme en Tchécoslovaquie, en Allemagne, en Pologne, ils avaient eu à combattre sur un autre front les sociaux-démocrates.
Néanmoins, les staliniens en Europe de l'Est étaient en mesure de gagner certaines bases de soutien dans la société. Ils n'avaient pas imposé leur règne dès le début au travers de la terreur d'Etat, à la différence des régimes staliniens en URSS. En aucun endroit en dehors de la Russie les staliniens ne furent identifiés à des instruments directs de la contre-révolution jusqu'en 1945, les staliniens avaient toujours été un parti d'opposition, non un parti de gouvernement. Plus encore, le racisme acharné, le chauvinisme et 1'antifascisme de cette fraction du capital lui attira des bénéfices dans les débuts de son règne. Le stalinisme en Europe de l'Est bénéficia du fait qu'il venait au pouvoir au point le plus profond de la contre-révolution. Dès le début, il put utiliser l'anti-germanisme pour diviser la classe ouvrière, expulser des millions de paysans et d'ouvriers du bloc selon les théories raciales les plus "scientifiques". Plus de cent mille ex-occupants des camps de concentration de langue allemande, qui avaient résista à la terreur nazie, furent ainsi par exemple expulsés de Tchécoslovaquie. Mais même 1'anti-germanisme ne fut qu'un complément et n'a pu remplacer le déjà traditionnel antisémitisme de l'arsenal stalinien.
Après 1948, il y eut un accroissement des tensions impérialistes entre les blocs dominés par les américains et les russes, qui s'exprima principalement par une compétition accrue au niveau militaire. Mais, de plus à cette époque, la période de reconstruction d'après-guerre commençait à battre son plein. A l'Est et à l'Ouest, cela signifiait la même chose pour les ouvriers :
- de plus hauts niveaux d'exploitation, des salaires réels plus bas, un accroissement de la répression étatique, et une plus grande militarisation de la société. Ce processus contribua à un renforcement de l'unité au sein de chaque bloc, qui dans le camp russe ne pouvait être accompli que par des méthodes terroristes : voir les procès anti-titistes..
Vu la faiblesse économique relative du bloc de l'Est, les attaques contre le niveau de vie ouvrier dans le camp russe devaient être plus brutales qu'à l'Ouest. La répression étatique amorça une nouvel-la escalade pour étouffer l'agitation sociale.
LES LUTTES DE 1953
En 1953, la résistance prolétarienne surgit ouvertement pour la première fois depuis la guerre. En l'espace de deux mois, trois éclats de lutte de classe ébranlèrent la confiance en soi de la bourgeoisie. Au début de juin, des émeutes à Pilsen, en Tchécoslovaquie, durent être écrasées par l'armée. Dans le vaste camp de travail de Vorkuta en Russie, un demi-million de prisonniers se révoltèrent, conduits par mille mineurs, déclarant la grève générale. Et en Allemagne de l'ouest, il y eut le 17 juin une révolte ouvrière qui paralysa les forces nationales de répression, et dut être écrasée par les tanks russes.
Le jour où les ouvriers d'Allemagne de l'Est se soulevèrent, des manifestations et des émeutes se produisirent dans sept villes polonaises. La loi martiale fut promulguée à Varsovie, à Cracovie et en Silésie, et les tanks russes durent participer pour réprimer les désordres. Presqu'au même moment également, les premières grandes grèves depuis les années 40 surgirent en Hongrie dans les grands centres du fer et de l'acier Matyas Rakosi de Csepel à Budapest. Les grèves s'étendirent à beaucoup de centres industriels de Hongrie, et des manifestations de masse paysannes eurent lieu dans la grande plaine hongroise ([1] [147]).
Le 16 juin, des ouvriers du bâtiment à Berlin Est posèrent leurs outils, marchèrent sur les immeubles gouvernementaux et commencèrent à appeler à une grève générale contre l'accroissement des normes de production et l'abaissement des salaires réels. 24 heures plus tard, la plupart des centres industriels du pays étaient paralysés. Des comités de grève spontanément créés, coordonnant leurs luttes au niveau de villes entières organisèrent l'extension de la grève. Les bâtiments de l'Etat et du Parti furent attaqués, les prisonniers relâchés, la police était combattue partout où elle apparaissait. POUR LA PREMIERE FOIS MEME, LA TENTATIVE FUT FAITE D'ETENDRE LA LUTTE AU DELA DES FRONTIERES DES BLOCS IMPERIALISTES. A Berlin, les manifestants marchèrent vers le secteur ouest de la ville, appelant à une solidarité des ouvriers de l'Ouest. Les alliés occidentaux, qui auraient certainement préféré que le mur de Berlin ait déjà été construit à cette époque, durent fermer leur secteur pour éviter la généralisation. ([2] [148])
La révolte en Allemagne de l'Est, soumise comme elle l'était à des illusions sur la démocratie occidentale, le nationalisme, etc...ne pouvait pas menacer le pouvoir de classe de la bourgeoisie. Mais elle a par contre, certainement affaibli la stabilité des régimes staliniens et l'efficacité de: la RDA comme remparts du bloc russe. Les événements de 1953 encouragèrent la bourgeoisie du bloc à prendre des initiatives :
- réduction de la terreur étatique permanente et ouverte contre le prolétariat, qui devenait trop dangereuse,
- diminution de l'emploi de la terreur intérieure dans le Parti comme méthode de résoudre les combats de factions. De cette façon, on espérait devenir plus souple pour traiter avec une situation sociale de plus en plus difficile,
- moins de terreur ouverte employée dans la production, méthode plus appropriée à la période de dépression mondiale et de guerre des années 30 et 40 qu'à la stabilité relative de la période de reconstruction d'après-guerre,
- déclaration de l'ouverture d'une période de 'coexistence pacifique" avec le bloc américain" dans l'espoir de bénéficier du boom d'après-guerre de 1'Ouest.
La mort curieusement propice de Staline permit à Kroutchev d'introduire l'initiative politique et économique dans cette direction. Mais 1953 sembla menacer l'exécution de ce changement de politique. La bourgeoisie craignait que ce changement lui-même puisse être interprété comme un signe de faiblesse, à la fois par les ouvriers et par ses "rivaux impérialistes occidentaux. En conséquence, le stalinisme suivit une course en zig-zag pendant 3 ans oscillant entre l'ancien style et le nouveau. En fait, l'expression classique d'une crise politique ouverte en Europe de l'Est n'est pas les purges et les procès massifs, qui ne font que révéler qu'une fraction a pris le dessus, mais ces oscillations hésitantes entre différentes fractions et orientations
LE SOULEVEMENT DE 1956
Attention ! Citoyens de Budapest ! Soyez sur vos gardes ! Presque dix millions de contre-révolutionnaires se sont répandus dans le pays. Dans les anciens quartiers aristocratiques comme Csepel et Kispest, plus de 10000 anciens propriétaires, capitalistes, généraux et évêques se sont retranchés. A cause des ravages de ces gangs, seuls six ouvriers sont restés en vie, et ils ont formé un gouvernement sous la présidence de Janos Kadar." (Affiche sur un mur de Budapest, novembre 1956
En 1956, la lutte de classe éclata en Pologne et en Hongrie. Le 28 juin, une grève quasi insurrectionnelle éclata à Poznam, en Pologne, et dut être réprimée par l'armée. Cet événement, qui était le point culminant d'une série de grèves sporadiques en Pologne -centrées en Silésie et sur la côte Baltique- accéléra la venue au pouvoir de la fraction "réformiste" conduite par Gomulka, nationaliste ([3] [149]), acharné. Gomulka comprit l'importance de 1'anti stalinisme et de la démagogie nationaliste dans une situation dangereuse. Mais le Kremlin craignait que son nationalisme extrême n'encourage la croissance de tendances antistaliniennes organisées en Pologne, et il s'opposa aux plans de Gomulka qui voulait isoler le prolétariat en faisant des concessions à la paysannerie sur la question de la collectivisation. Mais malgré la désapprobation des russes qui allèrent jusqu'à menacer d'une invasion militaire, Gomulka était convaincu de son rôle messianique de sauveur du capital polonais face à un surgissement prolétarien. En fait, il savait qu'afficher leur opposition à Moscou ne pouvait que raffermir la popularité légèrement entamée des staliniens en Pologne. Il ordonna donc à l'armée polonaise de bloquer les frontières avec la Russie et menaça même d'armer les ouvriers de Varsovie dans l'éventualité d'une invasion. Mais contrairement à ce que disent encore par exemple les trotskistes aujourd'hui,- c'est à dire que Gomulka a-vait menacé les russes d'un soulèvement populaire-ce que faisait alors le stalinisme polonais n'était qu'essayer d'AVERTIR ses amis du Kremlin du DANGER d’un tel soulèvement.
Kroutchev savait très bien que la Pologne, coincée comme elle est entre la Russie et ses avant-postes militaires en Allemagne, ne pouvait pas s'allier avec le bloc américain, qu'elle soit gouvernée par Gomulka ou par un autre. Les russes furent ainsi persuadés de céder, et ce "triomphe national" ajouta de l'auréole aux mensonges qui faisaient vivre les partisans de Gomulka. Bien que la bourgeoisie polonaise ait de façon évidente réussi à empêcher des explosions plus fortes, la situation est restée critique. Le 22 octobre il y eut de violents affrontements entre les ouvriers et la police à Wroclaw. Un jour plus tard, il y eut des manifestations orageuses à Gdansk, et des grèves éclatèrent dans différents endroits du pays, y compris dans le secteur clé de l'automobile Zeran à Varsovie.
Le même jour, le 23 octobre, une manifestation appelée par des groupes d'étudiants staliniens oppositionnels à Budapest en Hongrie, en solidarité avec la Pologne, attira des centaines de milliers de gens. La manifestation était comprise comme une manifestation de soutien à Gomulka, et non aux ouvriers qui étaient en grève contre le gouvernement. Son but immédiat était de mettre au pouvoir l'aile "réformiste" de la bourgeoisie hongroise, conduite par Nagy. La manifestation finit par de violents affrontements entre de jeunes ouvriers et la police politique aidée par des unités de tanks russes. Les batailles de rue firent rage toute la nuit. Les ouvriers avaient commencé à s'armer. ([4] [150])
Quand les premières dramatiques nouvelles des évènements de Budapest arrivèrent à Varsovie, Gomulka était en train de tenir un meeting d'un quart de million de gens. Il avertit les ouvriers polonais qu'il ne fallait pas "se mêler des affaires hongroises". La principale tâche de l'heure était de "défendre les acquis de l'octobre polonais", et de s'assurer qu'aucune dissension ne déchire plus la patrie.
24 heures après les premiers affrontements à Budapest, un gouvernement "progressiste" conduit par Nagy était instauré, et appela immédiatement à la restauration de l'ordre avec la collaboration étroite et constante des généraux russes. Le soir du même jour, la révolte s'était développée jusqu'à un niveau insurrectionnel. 2 jours après, le pays tout entier était paralysé par une grève de masse de plus de 4 millions d'ouvriers. L'extension de la grève de masse, la diffusion des nouvelles et le maintien des services essentiels avaient été pris en charge par les conseils ouvriers. Ces derniers avaient surgi partout, élus dans les usines et responsables devant les assemblées. Pendant des jours, ces conseils assuraient la centralisation de la grève. En une quinzaine de jours, cette centralisation était établie dans l'ensemble du pays.
Les régimes du bloc de l'Est sont rigides comme des cadavres, insensibles aux besoins changeants de la situation. Mais quand ils voient leur existence directement menacée, ils deviennent remarquablement souples et ingénieux. Quelques jours après le début de la lutte, le gouvernement Nagy arrêta de dénoncer ces résistances et essaya même d'en prendre la tête, pour éviter une confrontation directe avec l'Etat. On annonça que les conseils ouvriers seraient reconnus et légalisés. Puisqu'il n'était pas possible de les écraser, il fallait les étrangler par la bureaucratie, en les intégrant à l'Etat capitaliste. Et on promit le retrait des forces armées russes.
Pendant 5 jours, les divisions de l'armée russe, durement touchées, se retirèrent. Mais pendant ces 5 jours, la position politique des staliniens hongrois empira dangereusement. La fraction de Nagy, qui avait été présenté comme le "sauveur de la nation", après seulement UNE SEMAINE au pouvoir, était en train de perdre rapidement la confiance de la classe ouvrière. Maintenant avec le temps qui passait, elle n'avait plus d'autre alternative que de se faire le faux porte-parole du mouvement, utilisant à plein toutes les mystifications bourgeoises qui pouvaient empêcher la révolte de devenir une révolution. Les illusions démocratiques et surtout nationalistes des ouvriers devaient être renforcées, pendant que le gouvernement essaierait d'arracher la direction du mouvement aux conseils ouvriers qui le tenaient en main. Pour cela, Nagy déclara la neutralité de la Hongrie, et son intention de retirer sa participation à l'alliance militaire du Pacte de Varsovie. C'était un pari désespéré, une tentative de faire un nouveau Gomulka mais dans des circonstances beaucoup plus défavorables. Et il échoua. D'un côté, parce que Moscou n'était pas prêt à retirer ses troupes d'un pays en bordure du bloc de l'Est. D'un autre côté, parce que les conseils ouvriers bien qu'en majeure partie sous l'emprise du mouvement de Nagy ne voulaient pas perdre le contrôle de leurs propres luttes.
Ce qui était décisif pour le sort de la révolte prolétarienne en Hongrie alors, c'était l'évolution de la situation en Pologne. Des manifestations de solidarité avec la Hongrie avaient encore lieu dans de nombreuses villes. Un meeting de masse en solidarité fut tenu à Varsovie. Mais, fondamentalement, les Gomulkistes avaient le contrôle de la situation. L'identification des ouvriers polonais avec "la patrie" était encore forte. Une lutte internationale des ouvriers polonais et de leurs frères de classe hongrois n'était pas encore à l'ordre du jour.
Avec Gomulka et le poison nationaliste qui assuraient l'ordre en Pologne, les forces armées russes avaient une main libre pour s'occuper du prolétariat hongrois. 5 jours après avoir quitté Budapest, l'armée soviétique revint pour écraser les soviets ouvriers. Ils rasèrent les quartiers ouvriers, tuant 30.000 personnes selon les estimations. Mais malgré cette occupation, la grève de masse continua pendant des semaines, et ceux qui défendaient la position de l'arrêt de la grève dans les conseils étaient révoqués. Et même après que la grave de masse fut terminée, des actes de résistance continuèrent à se produire régulièrement jusqu'en janvier 1957. En Pologne, les ouvriers manifestèrent à Varsovie et s'affrontèrent à la police à Bydgoscz et Wroclaw, et essayèrent de saccager le consulat de Russie à Szczecin. Mais les ouvriers en Pologne n'avaient pas identifié leurs PROPRES exploiteurs aux massacreurs du prolétariat hongrois. Et même en Hongrie, les conseils ouvriers continuèrent, jusqu'à leur dissolution, à négocier avec Kadar et ne voulaient pas croire que lui et son mouvement avaient collaboré avec le Kremlin à écraser la classe ouvrière.
1956 : QUELQUES CONCLUSIONS
Les grèves de 1953-56 dans les pays de l'Est n'inauguraient pas un surgissement de la lutte de classe au niveau mondial, ou même une nouvelle période de résistance de la part des ouvriers des pays de l'Est eux-mêmes. Elles représentaient plutôt le dernier grand combat du prolétariat mondial prisonnier de l'étau de la contre-révolution. Et pourtant, dans l'histoire du mouvement de libération du prolétariat, elles étaient d'une grande importance. Elles affirmaient le caractère révolutionnaire de la classe ouvrière, et montraient clairement que les revers qu'essuyait la classe ouvrière dans le monde entier n'étaient pas éternels. En tant que telles, elles annonçaient déjà la venue d'une remontée de la lutte prolétarienne, qui arriva plus de 10 ans plus tard. Elles commençaient à montrer le chemin pour un second assaut contre le capitalisme, qui aujourd'hui pour la première fois depuis la fin de la 1ère guerre mondiale, entre en mouvement, lentement mais sûrement. Les luttes de 1956 ont prouvé :
- que la bourgeoisie ne peut pas garder éternellement le prolétariat sous son contrôle, une fois qu'elle a commencé à perdre son contrôle IDEOLOGIQUE,
- que la classe ouvrière, loin d'avoir besoin de "syndicats indépendants" et de "droits démocratiques" pour mener sa lutte, développe sa résistance et s'affronte à l'Etat capitaliste d'autant plus tôt que ces organes de la bourgeoisie sont plus absents ou inefficaces,
- que les organes de masse de la lutte prolétarienne, les conseils ouvriers, et les assemblées et les comités d'ouvriers en lutte qui les précèdent, sont la seule forme d'organisation des ouvriers possible clans la période de décadence du capitalisme,
- plus encore, 1953-56 prouva que les buts et les méthodes de la lutte des ouvriers sont aujourd'hui les mêmes partout. La notion d'une différence entre l'Est et l'Ouest ne peut sa baser que sur :
-soit un mensonge contre-révolutionnaire des staliniens et des trotskistes pour soutenir le "socialisme" ou "l'Etat ouvrier" dans le bloc russe
-soit une légende occidentale selon laquelle il y aurait un "monde libre" en conflit avec un "monde totalitaire"
-soit une conception bordiguiste sur l'existence d'un "jeune capitalisme" dans la Russie stalinienne et dans les pays de l'Est après la guerre, qui achèverait les tâches de la révolution bourgeoise
-soit la tendance, très forte dans les premiers temps dans le KAPD, et clairement formulée par Gorter dans sa "Réponse au camarade Lénine" à diviser l'Europe en Est et Ouest suivant une ligne
- disons de Gdansk à Venise! - et à croire que les ouvriers à l'ouest de cette ligne sont plus capables de s'organiser de façon autonome qu'à l'Est.
Tout cela est faux! Il n'y a PAS DE DIFFERENCE QUALITATIVE entre l'Est et l'Ouest. Ce qu'on peut dire, c'est que la situation à l'Est est un exemple extrême, sous beaucoup d'aspects, des conditions générales du capitalisme décadent partout dans le monde. Les manifestations et l'évolution différentes de la MEME lutte de classe, que nous devons analyser, nous montre que la lutte de classe dans le bloc russe est EN AVANCE sous certains aspects et en RETARD sous d'autres aspects par rapport à l'ouest. Et cela prouve seulement Ta nécessite que l'ensemble de la classe tire les leçons de ses luttes où qu'elles aient lieu.
Il est vital que les ouvriers et les révolutionnaires de l'ouest tirent les leçons de la façon dont leurs frères de classe à l'Est AFFRONTENT IMMEDIATEMENT ET SOUVENT VIOLEMMENT L'ETAT PAR LA GREVE DE MASSE, ETENDANT LEUR MOUVEMENT A AUTANT D'OUVRIERS QU'IL EST POSSIBLE, et faisant de cette généralisation la préoccupation la plus pressante de tout le combat. Cette nature particulièrement explosive de la lutte de classe à l'Est est le résultat de plusieurs circonstances :
- Le manque d'amortisseurs, comme les syndicats "indépendants", de partis politiques d'"alternative", de procédures légales et "démocratiques", qui pourraient détourner les heurts directs avec l'Etat
- Du fait que les ouvriers de l'Europe de l'Est ont de façon plus évidente le même employeur -l'Etat- la mystification des ouvriers ayant des intérêts différents selon l'entreprise, l'industrie, la ville etc., a beaucoup moins de poids. Plus encore, l'Etat est l'ennemi immédiat de tout mouvement de classe ; même les plus simples revendications de salaire prennent plus vite une nature politique. Il est d'une évidence claire que l'Etat est l'ennemi collectif de tous les ouvriers.
- La menace omniprésente de la répression étatique ne laisse aux ouvriers AUCUNE ALTERNATIVE AUTRE que d'étendre leur lutte, s'ils ne veulent pas être massacrés.
Ces conditions existent aussi à l'Ouest, mais sous une forme moins aiguë. Mais l'important est de voir comment la généralisation de la crise économique mondiale ne pourra qu'accentuer inévitablement ces conditions à l'ouest. Ainsi, la crise internationale du capitalisme est en train aujourd'hui de jeter les bases d'une résistance internationale demain. Elle ouvre déjà la perspective de l'internationalisation des luttes.
En fait il n'y a rien de plus naturel pour les ouvriers, qui ont partout les mêmes intérêts à défendre, que d'unir leurs forces et de lutter comme une seule classe. C'est la bourgeoisie divisée en d'innombrables capitaux nationaux au sein desquels existent d'aussi innombrables factions, qui a besoin d'ordre dans l'Etat capitaliste pour défendre ses intérêts de classe communs. Mais dans la période où le capitalisme se désagrège, l'Etat n'a pas seulement à maintenir par la force le tissu social et: économique, mais il doit aussi s'organiser en permanence pour éviter l'unification de la classe ouvrière. Il renforce la division du prolétariat en différentes nations, industries, régions, blocs impérialistes etc., de toute sa puissance, travestissant le fait que ces divisions représentent des conflits d'intérêts à l'intérieur du camp des exploiteurs. C'est pour cela que l'Etat entretient si soigneusement ces armes, du nationalisme aux syndicats, qui empêchent l'unification du prolétariat.
Les limites des luttes ouvrières des années 50 étaient en dernière instance déterminées par la période de contre-révolution dans laquelle elles se situaient, même si ces limites ont pu être quelquefois dépassées, ici et là. En Pologne, et même en Hongrie, le mouvement n'est jamais au-delà d'une tentative de faire pression sur le parti stalinien ou d'en soutenir une fraction contre une autre. En Allemagne de l'Est en 1953, les illusions démocratiques et nationalistes sont restées intactes s'exprimant dans les sympathies des ouvriers pour "l'ouest" et la social-démocratie allemande. Tous ces surgissements furent dominés par le nationalisme, et par l'idée que ce n'est pas le capitalisme qui est à blâmer mais "les russes". En dernière analyse, alors que les Gomulka et Nagy s'étaient trop exposés, le nationalisme restait la seule protection de l'Etat, détournant la colère ouvrière vers l'Armée russe coupable de tout. C'étaient des mouvements ouvriers, pas des mouvements nationalistes, et c'est pour ça que le nationalisme les a détruits. Il empêcha l'extension de la lutte au delà des frontières, et ceci fut décisif. En 1917, il fut possible au prolétariat de prendre le pouvoir- en Russie- alors que la lutte de classe restait souterraine dans la grande majorité des autres pays. Cela était du au fait que la bourgeoisie mondiale était enfermée dans le conflit mortel de la 1ère guerre mondiale, et les ouvriers de Petrograd et de Moscou purent entreprendrai le renversement de la bourgeoisie russe, seuls. Mais déjà en 1919, alors que la vague révolutionnaire commençait à s'étendre à d'autres pays, la bourgeoisie commença à s'unir contre elle. Aujourd'hui comme en 1919 et en 1956, les exploiteurs sont unis à travers le monde entier contre le prolétariat. En même temps qu'ils se préparent à la guerre les uns contre les autres, ils se viennent mutuellement en aide lorsque leur système comme un tout est mis en danger.
En novembre 1956 le prolétariat hongrois était confronté à la réalité que MEME LE RENFORCEMENT DU MOUVEMENT DES CONSEILS, LE MAINTIEN D'UN SOLIDE FRONT DE GREVE COMPRENANT DES MILLIONS D'OUVRIERS, PARALYSANT L'ECONOMIE, ET LA COMBATIVITE INTACTE DE LA CLASSE MALGRE LA POIGNE DE L'OCCUPATION MILITAIRE RUSSE RESTAIENT INSUFFISANTS. La classe ouvrière hongroise, avec son cœur de lion, RESTAIT DESEMPAREE, PRISONNIERE DES FRONTIERES NATIONALES, DE LA PRISON NATIONALISTE;
Ce fut l'isolement national, et non les panzers de l'impérialisme moderne, qui les a vaincus. Quand la bourgeoisie sent que son règne est en danger, elle ne se préoccupe plus guère de l'état de son économie, et elle aurait pu se préparer à une grève totale pendant des mois et des mois, si elle pensait qu'elle pourrait de cette façon briser son adversaire. Ce fut précisément l'idéologie nationaliste, cette ordure ingurgitée et revomie par les ouvriers sur les "droits du peuple hongrois", cette pourriture dont les a gavés le parti stalinien, mais aussi la BBC et Radio Free Europe, qui a épargné au parti stalinien et à l'Etat capitaliste d'être malmenés sévèrement. Malgré toute la puissance de leur mouvement, les ouvriers hongrois n'ont pas réussi à détruire l'Etat ou une de ses institutions. Pendant qu'ils s'attaquaient à la police politique hongroise et aux tanks russes, dans les premiers jours de la révolte, Nagy était en train de réorganiser la police régulière et les forces armées, dont certaines unités l'avaient rejoint, lui et sa croisade nationaliste. Certains conseils ouvriers semblent avoir pensé que ces unités avaient rejoint les rangs du prolétariat mais en fait ils ne faisaient que faire semblant de faire cause commune avec les ouvriers à condition qu'ils servent les intérêts nationaux. 48 heures après que Nagy ait restructuré la police et l'armée, elles étaient déjà envoyées contre des groupes intransigeants d'ouvriers insurgés! Les conseils ouvriers, fascinés par le tambour patriotique, ont même voulu participer au recrutement d'officiers pour cette armée. Voilà comment le nationalisme sert à attacher le prolétariat à ses exploiteurs et à l'Etat.
L'extension de la lutte de la classe ouvrière au delà des frontières nationales est aujourd'hui une PRE-CONDITION absolue pour renverser l'Etat dans n'importe quel pays. La valeur des luttes des années 50 a été de montrer à quel point elle était indispensable. Seule la lutte internationale peut aujourd'hui être efficace et permettre au prolétariat d'accomplir ses réelles potentialités.
Comme le montre 1956, avec la généralisation de la crise et la simultanéité de la lutte de classe dans différents pays, une autre clé de l'internationalisation du combat prolétarien est la prise de conscience de la part des ouvriers qu'ils s'affrontent A UN ENNEMI UNI A L'ECHELLE MONDIALE. En Hongrie, les ouvriers chassèrent les troupes, la police et les douaniers des régions frontalières, pour rendre possible une aide de l'extérieur. Les bourgeoisies russes, tchèques et autrichiennes réagirent en fermant les frontières autour de la, Hongrie avec leurs armées.
Les autorités autrichiennes invitèrent même les russes à inspecter le bon déroulement de l'opération. ([5] [151]) Face au front uni de la bourgeoisie mondiale, à l'Est et à l'Ouest, les ouvriers commencèrent à briser la prison nationale et à lancer des appels à leurs frères de classe des autres pays. Les conseils ouvriers dans plusieurs zones frontalières commencèrent à en appeler directement au soutien des ouvriers en Russie, en Tchécoslovaquie et en Autriche, et la proclamation des conseils ouvriers de Budapest à l'occasion des dernières 48 heures de grève générale des ouvriers en décembre, appelait des ouvriers du monde entier à des grèves de solidarité avec les luttes du prolétariat en Hongrie ([6] [152]).
Condamnée par la période de défaite mondiale pendant laquelle elle se produisit, la vague de l'Europe de l'Est et des années 50 fut isolée par la division du monde industriel en deux blocs impérialistes, dont l'un d'eux, le bloc américain, connaissait alors "l'euphorie" du boom de la reconstruction d'après-guerre. Les conditions objectives pour une internationalisation, surtout par delà les frontières des blocs -c'est à dire la généralisation de la crise et de la lutte de classe- n'existait pas à l'échelle mondiale, ce qui empêcha la rupture décisive avec le nationalisme en Europe de l'Est. Seul un combat ouvert des ouvriers dans différentes parties du monde pourra permettra de démontrer aux ouvriers du monde entier que ce n'est pas CE gouvernement ou CE syndicat mais toutes les parties et tous les syndicats qui défendent la barbarie capitaliste contre les ouvriers et qu'ils doivent être détruits. Aucune perspective fondamentale de la révolution prolétarienne ne peut être défendue autrement qu'à l'échelle mondiale.
LA FIN DE LA CONTRE REVOLUTION
LA LUTTE DE CLASSE EN RUSSIE
Dans cette étude de la lutte de classe en Europe de l'Est nous n'avons pas encore parlé de la Russie, le chef de file du bloc de l'Est. Comme partout dans le monde, les années 1948 ont vu en URSS une attaque frontale contre le niveau de vie ces exploités comme dans les pays satellites, cette attaque a provoqué une réaction décidée des ouvriers. Mais si nous parlons de la Russie séparément c'est à cause de certaines conditions spécifiques qui jouent dans la situation du pays :
- le niveau de vie des ouvriers et des paysans en URSS est beaucoup plus bas que dans les autres pays de l'Est, surtout quand on tient compte de la Russie asiatique ;
- la bourgeoisie en URSS exerce un contrôle sur tous les aspects de la vie à un degré inimaginable dans d'autres pays de l'Est, même en RDA
- le stalinisme en Russie ne jouit d'aucune confiance de la part de la classe ouvrière ; il n'y a jamais eu des Nagy et des Gomulka pour induire les ouvriers en erreur.
Mais la force des illusions que les ouvriers peuvent nourrir à l'égard de leurs oppresseurs -et en Russie c'est très peu- n'est qu'un des éléments qui déterminent le rapport de forces entre les classes. Un autre élément, et de taille, est la capacité du prolétariat à développer une perspective propre, une alternative de classe. Pour les ouvriers de la Russie stalinienne cette tâche est plus difficile qu'elle n'a jamais été dans toute l'histoire du mouvement ouvrier. On doit ajouter à cette situation la profondeur de la contre-révolution en Russie et aussi les énormes distances qui séparent les centres ouvriers, d'une part en URSS les uns des autres et, d'autre part des concentrations ouvrières de l'Europe occidentale. Cet isolement géographique est exacerbé politiquement et militairement par 1'Etat.
Au début des années 50 ce prolétariat russe qui trente années auparavant avait ébranlé le monde capitaliste commence à reprendre le chemin de sa lutte. Les premiers épisodes de résistance ont eu lieu dans les camps de concentration en Sibérie: à Ekibadus en 1951; dans toute une série de camps -Pestscharij, Wochruschewo, Oserlag, Goxlag, Norilsk- en 1952; a Retschlag-Vorkuta en juil-letl953 et à Kengir et Kazakstan en 1954. Ces grèves insurrectionnelles, touchant des millions d'ouvriers, ont été férocement réprimées par le KGB. Soljenitsyne, un des hommes le mieux documenté sur les camps staliniens, insiste sur le fait que ces luttes n'ont pas été vaines et qu'elles ont contribué à des fermetures de ces institutions du "réalisme socialiste".
La première grève des ouvriers "libres" que nous connaissons dans la période d'après -guerre concerne l'usine Thalmans de Voroneschen en 1959. Cette grève a gagné le soutien de l'ensemble de la ville ; elle s'est terminée avec l'arrestation de tous les grévistes par le KGB. L'année d'après; dans un chantier à Ternir-Tau au Kazakstan une grève violente a éclaté pour protester contre les "privilèges" dont jouissent les ouvriers bulgares. Ce conflit, où les ouvriers se sont divisés les uns contre les autres, a crée un terrain favorable à la répression du KGB. Ce dernier a rempli des camions entiers de cadavres.
Dans les années 1960-62 une série de grèves éclate dans la métallurgie du Kasaskstan et dans la région minière de Dombass et le Kouzbass. Le point culminant de cette vague est atteint à Novotschkesk où une grève de 20.000 ouvriers de l'usine de locomotives contre l'augmentation des prix et des cadences provoque une révolte de toute la ville. Le KGB est envoyé par avion après que la police et les unités de l'armée locales aient refusé de tirer sur les ouvriers. Le KGB fit un massacre ; ensuite il renvoya tous les "meneurs" en Sibérie et fusilla les troupes qui avaient refusé de tirer. C'était la première fois que les ouvriers répondaient par la violence de classe au KGB : ils tentèrent de prendre les casernes et les armes. Un des slogans de cette grève était : "tuer Kroutchev".
Dans les années 1965-69 de grandes grèves éclatent pour la première fois dans les CENTRES urbains de la Russie européenne, dans l'industrie chimique à Leningrad, dans la métallurgie et l'automobile à Moscou. A la fin des années 60 on a beaucoup de témoignages de grèves dans plusieurs endroits en URSS : à Kiev, dans la région de Sverdlovsk, en Moldavie, etc..
La bourgeoisie russe, consciente du danger d'une généralisation des grèves, réagit toujours immédiatement à de tels événements. En quelques HEURES elle fait des concessions ou elle envoie le KGB ou les deux à la fois. L'histoire de la lutte de classe en Russie dans les années 50-60 est une série d'éclatements brusques, spontanés, violents ; souvent les grèves ne durent pas plus que quelques heures et n'arrivent pratiquement jamais à rompre l'isolement géographique. Dans toutes les grèves -et nous n'en mentionnons qu'un petit nombre ici- nous ne connaissons pas de formation de comités de grève bien qu'il y eut des assemblées de masse. Ces luttes d'un courage et d'une détermination incroyables témoignent aussi d'un élément de désespoir, d'un manque de perspective pour une lutte collective contre l'Etat. Mais le seul fait qu'elles aient surgi était le signe annonçant que la longue période de contre-révolution mondiale prenait fin. ([7] [153])
LA TCHECOSLOVAQUIE 1968
Un autre signe de la fin de la contre-révolution est le développement des luttes ouvrières en Tchécoslovaquie à la fin des années 60. La Tchécoslovaquie dans les années 40 et 50 avait l'économie la plus développée et prospère de toute l'Europe de l'Est. Elle était un moteur de la reconstruction d'après-guerre en exportant des capitaux à ses voisins ; elle avait le niveau de vie le plus élevé du Comecon. Mais elle commence à perdre sa compétitivité rapidement dans les années 60. Le meilleur moyen pour la bourgeoisie de contrecarrer cette tendance était de moderniser l'industrie à travers des accords commerciaux et technologiques avec l'occident, financés par une réduction des salaires réels. Mais le danger d'une telle politique apparut dès les années 50 et fut confirmé par l'éclatement de grèves dans différents endroits du pays dans la période 1966-67.
C'était cette situation de crise qui amena la fraction Dubcek de l'appareil du Parti-Etat au pouvoir. Cette fraction inaugura une politique de libéralisation dans l'espoir d'amener les ouvriers à accepter l'austérité; comme contrepartie les ouvriers avaient le "privilège" de lire des "mots durs" de critiques contre certains leaders dans la presse du parti. Le "printemps de Prague" en 1968, se déroulant sous l'œil paternel du gouvernement et de la police, défoulait le zèle nationaliste et régionaliste des étudiants, des intellectuels et des petits fonctionnaires du parti qui se sentaient tout fraichement solidaires avec l'Etat. Mais cette ferveur patriotique, rapprochée d'une réapparition des partis oppositionnels -le tout ayant pour unique but de faire croire à un stalinisme "à visage humain" et venant en même temps qu'une ouverture économique vers 1'occident est allé trop loin pour Moscou et Berlin/Est.
L'occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie était plus une réaffirmation de l'unité militaire et politique du bloc russe qu'un coup porté directement contre le prolétariat. Dubcek, qui croyait avoir la situation bien en main et qui ne nourrissait aucune illusion sur la possibilité d'un détachement du bloc russe, était furieux contre cette invasion. Tout en utilisant cette occasion pour renforcer les sentiments nationalistes, Dubcek avait le souci d'éviter une réaction ouvrière à l'invasion. En réalité le "Dubcekisme" qui inspirait tant d'intellectuels avait très peu d'impact sur les ouvriers. Pendant le "printemps de Prague", toute une série de grèves sauvages surgirent un peu partout dans le pays surtout dans les secteurs industriels et dans les transports. Des comités de grèves se sont formés pour centraliser la lutte et pour protéger les grévistes contre la répression de l'Etat. Dans toutes les usines principales on a revendiqué des augmentations de salaire en compensation des années de pénurie. Dans plusieurs usines, les ouvriers ont voté des résolutions condamnant la pierre angulaire du "réformisme" à la Dubcek -la fermeture des usines non-rentables. Les ouvriers sont restés indifférents aux efforts de l'Etat pour former des "conseils ouvriers" de cogestion qui devaient mêler les ouvriers à l'organisation de leur propre exploitation. Quand les élections à ces "conseils" ont finalement eu lieu, moins de 20% des ouvriers ont participé au vote.
Cette réponse de classe au "Dubcekisme" a été brisée par 1'invasion d'août 1968 qui "enfin" commençait à ramener les ouvriers sous la bannière de l'hystérie nationaliste, La lutte de classe a aussi été brisée par une radicalisation importante des syndicats. Après avoir soutenu le programme d’austérité de Dubcek ils se sont mis dans l'opposition, soutenant les hommes de Dubcek qui restaient au gouvernement. (Ces derniers pour leur part, se sont attachés à rétablir l'ordre en collaboration avec les forces armées autochtones et "invitées"). Pendant que les étudiants et les oppositionnels appelaient les ouvriers à des manifestations de masse -des réaffirmations bien encadrées de patriotisme et de condamnations de la trahison de Dubcek (par rapport au capital national)- les syndicats menaçaient en même temps de déclencher des grèves générales si les Dubcekistes étaient éliminés du gouvernement. Mais le rôle historique de Dubcek s'est achevé, pour le moment en tout cas. Et quand les pontes de Dubcek ont tranquillement disparu du haut de l'appareil, les syndicats ont laissé tomber leurs projets "combatifs", ayant plus peur de "leurs" ouvriers, qui pouvaient échapper à leur contrôle, que des russes. Ils se sont adaptés à nouveau à des formes plus paisibles de patriotisme.
LA POLOGNE 1970
La lutte de classe des ouvriers tchèques au printemps et en été 1968 est significative non seulement de cette résistance momentanée des ouvriers face au barrage nationaliste et démocratique de la bourgeoisie (cette résistance a effectivement marque une brèche importante) mais surtout parce que cette lutte se situe dans le contexte d'un surgissement mondial de la lutte prolétarienne en réponse a la crise de l'économie mondiale à la fin de la période de reconstruction. Les ouvriers en Tchécoslovaquie ne sont pas allés aussi loin que leurs frères de classe en France au printemps 1968, surtout parce que le poids des mystifications nationalistes s'est montré une fois de plus, trop fort à l'Est. Mais il y a beaucoup de points communs entre les deux situations, ce qui confirme la CONVERGENCE fondamentale des conditions auxquelles se heurtent les ouvriers à l'Est et à 1"Ouest dans la crise du capitalisme ; par exemple :
- l'éclatement brusque et inattendu de la lutte de classe, prenant de court les syndicats qui se sont trouves dans des situations compromettante ; ébranlant la confiance des équipes gouvernemental les (Dubcek, de Gaulle) qui croyaient avoir la situation bien en main ;
- une réponse claire des ouvriers refusant de payer la crise capitaliste;
- le poids de l'idéologie oppositionnelle, véhiculée essentiellement par les étudiants, empêchant le développement de la conscience prolétarienne et l'autonomie de classe.
Mais l'affirmation la plus définitive et dramatique de la fin de la nuit de la contre-révolution vient avec la Pologne 1970-71.
En décembre 1970 la classe ouvrière polonaise réagit massivement, totalement, spontanément, à une hausse des prix de plus de 30%. Les ouvriers détruisent les sièges du parti stalinien à Gdansk, Gdynia et Elblag. Le mouvement de grève s'étend de la côte bal tique à Poznan, à Katowice, et à la Haute-Silésie, à Wroclav et à Cracovie. Le 17 décembre Gomulka envoie ses tanks dans les ports de la Baltique. Plusieurs centaines d'ouvriers sont tués. Des batailles de rue ont lieu à Stettin et à Gdansk. La répression ne réussit pas à écraser le mouvement. Le 21 décembre une vague de grèves éclate à Varsovie, Gomulka est renvoyé ; son successeur Gierek devait aller tout de suite négocier personnellement avec les ouvriers des docks de Warski à Stettin. Gierek fait quelques concessions mais refuse d'annuler les hausses de prix. Le 11 février une grève de masse éclate à Lodz, déclenchée par 10.000 ouvriers du textile. Gierek cède alors , les augmentations des prix sont annulées. ([8] [154])
LA GENERALISATION du mouvement à travers le pays a eu raison de la répression de l'Etat polonais. Mais pourquoi les forces du pacte de Varsovie ne sont-elles pas intervenues comme deux ans auparavant à Prague?
- Les luttes des ouvriers polonais se situent fermement sur le terrain des revendications ouvrières ; les ouvriers ont résisté aux attaques contre leur niveau de vie et n'ont pas appelé à un quelconque "renouvellement national". Les ouvriers ont compris que l'ennemi est autant dans leur propre pays et pas seulement en Russie.
- Il n'y avait pas d'appels à des forces démocratiques ni dans le PC polonais ni en Occident. Il y avait des ouvriers qui croyaient en la possibilité de "réconcilier" le parti et les ouvriers mais il n'y avait plus de fractions dans l'appareil qui jouissaient de la confiance des ouvriers et donc il n'y avait personne qui pouvait mystifier les ouvriers.
- Pour la première fois depuis la vague révolutionnaire de 1917-23, l'Europe de l'Est a connu une lutte de masse qui s’est GENERALISEE AU DELA DES FRONTIERES NATIONALES. Les événements polonais ont déclenché une vague de grèves et de protestations dans les républiques baltiques de l'URSS et dans la Russie occidentale, centrée sur les villes de Lvov et Kaliningrad.
Le surgissement polonais a été le produit de tout un processus de maturation dans la classe au cours des années 50 et 60. D'une part le prolétariat retrouve sa confiance en soi et sa combativité au fur et à mesure qu'une nouvelle génération d'ouvriers grandit avec les promesses d'après-guerre sur un monde meilleur, une génération qui n'est pas aigrie par les défaites amères de la période contre-révolutionnaire, qui n'est pas résignée à accepter la misère. D'autre part, ces années ont vu l'affaiblissement de toute une série de mystifications au sein de la classe'. Le poids de 1'antifascisme de la guerre et de la période d'après-guerre S'est beaucoup affaibli quand on s'est rendu compte que les "libérateurs" eux-mêmes ont employé des camps de concentration, la terreur policière et le racisme ouvert pour assurer leur domination de classe. Et l'illusion en une espèce de "socialisme" ou en l'abolition des classes dans le bloc russe était brisée par les informations sur l'incroyable richesse dans laquelle vit "la bourgeoisie rouge" et par la constante détérioration des conditions de vie de la classe ouvrière. De plus, les ouvriers ont vite compris que la défense de leurs intérêts de classe les amènerait à des confrontations violentes avec "l'Etat ouvrier". Si la Hongrie en 1956 a montré la futilité de lutter dans une perspective nationaliste, les luttes de 1970-71 en Pologne et le nord-ouest de l'URSS ont montré la voie à suivre. Depuis la Hongrie en 56 et la Tchécoslovaquie en 68, l'idée qu'il y aurait des fractions radicales du parti stalinien qui se mettraient du côté des ouvriers a été largement discréditée. Aujourd'hui, dans les pays comme la Pologne, la Tchécoslovaquie; la Roumanie ou l'URSS, seuls des oppositionnels EN DEHORS du PC peuvent gagner l'oreille des ouvriers C'est vrai que les ouvriers ont encore des illusions à perdre à propos des oppositionnels mais au moins ils savent où ils en sont par rapport aux staliniens et c'est un pas énorme. Enfin l'accélération de la crise elle-même détruit les illusions sur la possibilité de "réformer" le système. La crise actuelle agit comme un catalyseur dans le processus de prise de conscience révolutionnaire du prolétariat.
L'affaiblissement de la mainmise de l'idéologie bourgeoise sur le prolétariat a permis le développement d'une AUTONOMIE ouvrière -et la Pologne 1970-71 en était le premier exemple- à un niveau beaucoup plus élevé que dans les années 50. L'autonomie ouvrière n'est jamais une question purement organisationnelle bien que l'organisation indépendante de la classe dans ses assemblées de masse et comités de grève soient absolument indispensables à la lutte prolétarienne. L'autonomie est aussi indissolublement liée à L'ORIENTATION POLITIQUE que les ouvriers se donnent. Dans la période de totalitarisme du capitalisme d'Etat, la bourgeoisie réussira inévitablement à infiltrer les organes de lutte des ouvriers en utilisant ses fractions syndicales et radicales. Mais c'est précisément pourquoi les organes de masse, regroupant les ouvriers indépendamment des autres classes dans la société, sont si vitaux. Avec ces organes autonomes la lutte idéologique continuelle entre les deux classes se poursuit sur un terrain favorable à la classe ouvrière. Voilà le monde de la lutte collective, de la participation massive de tous les ouvriers.
C'est le chemin qu'ont suivi les ouvriers en 1970 en Pologne et sur lequel ils sont restés depuis. Ce n'est pas seulement le chemin de la lutte généralisée, de la grève de masse, mais c'est aussi la condition première pour la politisation de la guerre de classe, pour la création du parti de classe et pour la discussion dans l'ensemble de la classe, afin de se rendre capable de briser de fond en comble toute la structure de l'idéologie bourgeoise. En 1970-71 la base radicalisée du parti stalinien et des syndicats, même les fonctionnaires de l'Etat, pouvaient rentrer dans les comités de grève et assemblées pour y défendre le point de vue de la bourgeoisie. Et cependant, à la fin, c'est le prolétariat qui est sorti renforcé du conflit.
En 1970-71 a eu lieu la première lutte importante de la classe ouvrière en Europe de l'Est depuis la révolution d'Octobre, une lutte que la bourgeoisie n'est pas arrivé à canaliser ni à réprimer immédiatement. Cette brèche s'est produite dès que l'hégémonie de l'idéologie bourgeoise s'est affaiblie. L'Etat a reculé provisoirement parce que sa tentative d'écraser son ennemi a échoué. La violence étatique et le contrôle idéologique ne sont pas deux méthodes alternantes que la bourgeoisie peut utiliser séparément l'une de l'autre. La répression ne peut être efficace que si elle est renforcée par le contrôle idéologique qui empêche les ouvriers de se défendre ou de riposter. La lutte de classe en Pologne, déjà en 1970 a montré que la classe ouvrière n'a pas été intimidée par l'Etat terroriste si elle est consciente de ses propres intérêts de classe et si elle s'organise de façon autonome et unie pour les défendre. Cette autonomie politique et organisationnelle est le facteur le plus important favorisant la généralisation et la politisation de la lutte. Cette perspective révolutionnaire, le développement parmi tous les ouvriers du monde entier de la compréhension de la nécessité d'une lutte unie et internationale contre une bourgeoisie prête à s'unir contre le danger prolétarien, voilà la seule perspective que les communistes peuvent offrir à leurs frères de classe à l'Est et à l'Ouest.
Krespel
[1] [155] Ces événements sont décrits par Lomax dans "The working class in the Hungarian Révolution", Critique n°l2
[2] [156] Voir la Revue Internationale du CCI, n°15 "L'insurrection ouvrière en Allemagne de l'Est de juin 1953"
[3] [157] Voir F.Lewis "The Polish Volcano", N.Bethell "Gomulka".
[4] [158] Sur la Hongrie 1956, voir par exemple : "Pologne-Hongrie 1956" (JJ Maireand) "Nagy" (P.Broué) ; Laski "Hungarian révolution" pour documentation, les proclamations des Conseils Ouvriers, etc. Voir aussi A.Andersen "Hungary 1956" (Solidarity London), ou Goszotony "Der Ungarische Volksaufstand in Augen zeugenberichten". Dans la presse du CCI, "Hungary 1956 : The Sceptre of the Workers Councils", dans World Révolution n°9
[5] [159] "Le gouvernement autrichien ordonna la création d'une zone Interdite le long de la frontière austro- hongroise Le ministre de la Défense Inspecta la zone, accompagné des attachés militaires des quatre grandes puissances, y inclus l'URSS. Les attachés militaires pouvaient ainsi constater par eux-mêmes 1'efficacité des mesures prises pour protéger la sécurité des frontières autrichiennes et de la neutralité." Tiré d'un mémorandum du gouvernement autrichien, cité dans "Die Ungarische Révolution der Arbeiterràte", p.83-84.
[6] [160] Reportage du Daily Mail, 10 décembre 1956
[7] [161] cf. par exemple : "Arbeiteropposition in der Sowjetunion'.' A. Schwendtke (Hrg) ; "Workers Against the Goulag"; "Politische Opposition in der Sowjetunion 1960-72"
Sakarov "Die URSS ist ein grosses Konzentrationslager"; Soljénitsyne. "L'archipel du Goulag";
T. Cliff. "State capitalism in Russia". Dans la presse du CCI : "La lutte de classe en URSS" (Révolution Internationale n°30 et 31); (World Révolution n°10).
[8] [162] cf. Paul Barton."Misère et révolte de l'ouvrier polonais";
"Pologne : Le crépuscule des Bureaucrates", Cahiers Rouges n°3
"Rote Fahnen Polen" (Minutes of the Debate between Gierek and the Workers on the Warski Docks in Szczecin).
La meilleure source : "Capitalisme et luttes de classe en Pologne 1970-71". ICO
La presse du CCI : voir Révolution Internationale n°80 : "Pologne. De 1970 à 1980. Un renforcement de la classe ouvrière".
Géographique:
- Europe [163]
- Russie, Caucase, Asie Centrale [164]
Heritage de la Gauche Communiste:
Notes sur la grève de masse
- 3011 lectures
La vague da grèves de l'été 80 en Pologne a été très justement décrite comme un exemple classique du phénomène de la grève de masse analysé par Rosa Luxemburg en 1906. Une telle clarté de corrélation entre les mouvements récents en Pologne et les évasements décrits par Luxemburg dans sa brochure ''Grève de masse, partis et syndicats''([1] [165]) il y a 75 ans, impose aux révolutionnaires de réaffirmer pleinement la validité de l'analyse de Luxemburg applicable à la lutte de classe aujourd'hui.
Pour poursuivre dans ce sens, nous essaierons dans cet article de voir jusqu'à quel point la théorie de Luxemburg correspond à la réalité des combats actuels de la classe ouvrière.
LES CONDITIONS ECONOMIQUES, SOCIALES ET POLITIQUES DE LA GREVE DE MASSE.
Pour Rosa Luxemburg, la grève de masse était le résultat d'une étape particulière dans le développement du capitalisme, étape observable au tournant de ce siècle. La grève de masse ''est un phénomène historique se produisant à un certain moment par une nécessité historique sortant des conditions sociales''. La grève de masse n'est pas une chose accidentelle; elle ne résulte pas plus de la propagande que de préparatifs qui seraient faits d'avance; elle ne peut être créée artificiellement; elle est le produit d'une étape définie de l'évolution des contradictions du capitalisme. Bien que Rosa Luxemburg se réfère souvent à des grèves de masse particulières, tout le sens de sa brochure est pour montrer qu'une grève de masse ne peut pas être vue isolément; elle ne prend son sens que comme produit d'une nouvelle période historique.
Cette nouvelle période était valable pour tous les pays. En argumentant contre l'idée que la grève de masse était particulière à l'absolutisme russe, Luxemburg montre que ses causes doivent être trouvées non seulement dans les conditions de la Russie mais aussi dans les circonstances de l'Europe occidentale et de l'Afrique du Nord, c'est à dire ''dans l'industrie à grande échelle avec toutes ses conséquences, divisions de classe modernes, contrastes sociaux aigus''. Pour elle, la révolution russe de 1905, dans laquelle la grève de masse a tenu une place si importante, ne s'est concrétisée que "... dans les affaires particulières de la Russie absolutiste: résultats généraux du développement capitaliste international''. La révolution russe était, selon Luxemburg, le "prélude d'une nouvelle série de révolutions prolétariennes à l'Ouest".
Les conditions économiques qui ont engendré la grève de masse, selon Luxemburg, n'étaient pas circonscrites à un pays, mais avaient une signification internationale. Ces conditions avaient fait surgir un type de lutte aux dimensions historiques, une lutte qui était un aspect essentiel du surgissement des révolutions prolétariennes. Pour conclure, selon les propres termes de Rosa Luxemburg, la grève de masse ''n'est rien d’autre que la forme universelle de la lutte de classe prolétarienne résultant de l'étape actuelle du développement capitaliste et de ses rapports production''.
Cette ''étape actuelle'' était le fait que le capitalisme vivait ses dernières années de prospérité. La croissance des conflits inter-impérialistes et la menace de la guerre mondiale: la fin de toute amélioration graduelle des conditions de vie de la classe ouvrières en bref, la menace croissante contre l'existence même de la classe ouvrière dans le capitalisme, telles étaient les circonstances historiques nouvelles accompagnant l'avènement de la grève de masse.
Luxemburg a vu clairement que la grève de masse était un produit du changement des conditions économiques à un niveau historique, conditions que nous savons aujourd'hui être celles de la fin de l'ascendance capitaliste, conditions qui préfiguraient celles de la décadence capitaliste.
Des concentrations puissantes d’ouvriers existaient alors dans les pays capitalistes avances, habitués à la lutte collective, dont les conditions de vie et de travail étaient partout semblables. La bourgeoisie, comme conséquence du développement économique, devenait une classe plus concentrées et s'identifiait de manière croissante avec l'appareil d'Etat. Comme le prolétariat, les capitalistes avaient appris à faire face ensemble contre leur ennemi de classe.
Tout comme les conditions économiques rendaient plus difficiles pour les ouvriers l'obtention de réformes au niveau de la production, de même. les ''ruines de la démocratie bourgeoise'' que Luxemburg mentionne dans sa brochure, rendaient de plus en plus difficile pour le prolétariat la consolidation des gains au niveau parlementaire. Ainsi, le contexte politique, tout comme le contexte économique de la grève de masse n'était pas le contexte de l'absolutisme russe mais celui de la décadence croissante de la domination bourgeoise dans tous les pays.
Dans chaque domaine économique, social et politique, le capitalisme avait jeté les bases pour des énormes affrontements de classe è l'échelle mondiale.
LE BUT DE LA GREVE DE MASSE
La grève de masse n'a pas exprimé un nouveau bu de la lutte prolétarienne. Elle a exprimé plutôt le ''vieux'' but de cette lutte d'une manière appropriée aux nouvelles conditions historiques. La motivation derrière chaque combat de la classe ouvrière sera toujours la même : la tentative de limiter l'exploitation capitaliste au sein de la société bourgeoise et d'abolir l'exploitation en même temps que la société bourgeoise elle-même. Dans la période ascendante du capitalisme, la lutte ouvrière était, pour des raisons historiques, séparée entre un aspect défensif, immédiat, impliquant mais repoussant l'offensive révolutionnaire pour le futur.
Mais la grève de masse de par les causes objectives déjà mentionnées (liée l'impossibilité pour la classe de se défendre elle-même au sein du système) a rassemblé dans la lutte ces deux aspects du combat prolétarien. C'est pourquoi, selon Luxemburg, n'importe quelle petite grève apparemment défensive peut exploser en confrontations généralisées, ''au contact du souffle de la révolution''. Par exemple, ''le conflit des deux ouvriers renvoyés des chantiers de Poutilov s'est transformé en prologue de la plus grosse révolution des temps modernes''. Réciproquement, le surgissement révolutionnaire, lorsqu'il marque le pas peut se disperser en de nombreuses grèves isolées, qui, plus tard, fertiliseront un nouvel assaut général contre le système.
Tout comme les combats offensifs, les luttes généralisées ont fusionné avec les combats localisés, défensifs, faisant ainsi réagir l'un sur l'autre les aspects économiques et politiques de la lutte ouvrière dans la perfide de grève de masse. Dans la période parlementaire (c'est à tire, à l'apogée de l'ascendance capitaliste) les aspects économiques et politiques de la lutte étaient séparés artificiellement, une fois encore pour des raisons historiques déterminées. La lutte politique n'était pas dirigée par les masses elles-mêmes dans l'action directe, mais en correspondance avec la forme de l'Etat bourgeois, de manière représentative par la présence de députés. Mais, ''dès que les masses apparaissent sur la scène'' tout ceci change, parce que ''dans une action révolutionnaire de masses la lutte politique et économique forme une unité''. Dans ces conditions, la lutte politique des ouvriers devient intimement liée à la lutte économique, en particulier du fait que le combat politique indirect, (par l'intermédiaire du parlement) n'est plus réaliste.
En décrivant le contenu de la grève de masse, Luxemburg met en garde, par dessus tout, contre la séparation de ses différents aspects. Ceci parce que la caractéristique de la période de la grève de masse est la convergence des différentes facettes d'une lutte prolétarienne: offensive/défensive, généralisée/localisée, politique/économique -le mouvement dans son ensemble menant à la révolution-. La véritable nature des conditions auxquelles le prolétariat répond dans la grève de masse crée une interconnexion indissociable entre les différents aspects de la lutte de la classe ouvrière. Vouloir les disséquer, vouloir trouver par exemple ''la brève de masse politique pureté, mènerait par cette direction, ''comme pour toute autre, non pas à percevoir le phénomène dans son essence, mais à la tuer''.
LA FORME DE LA LUTTE DANS LA PERIODE DE LA GREVE DE MASSE
L'objectif de la forme d'organisation syndicale -obtenir des acquis au sein de système- est de moins en moins réalisable dans les conditions qui font surgir la grève de masse. Comme le dirait Luxemburg dans sa polémique avec Kautsky, dans cette période, le prolétariat n'entrait pas en lutte avec la perspective certaine de gagner de véritables acquis. Elle montre statistiquement qu'un quart des grèves n'obtenaient absolument rien, Mais les ouvriers se mettaient en grève parce qu’il n’y avait pas d'autres moyens de survivre; une situation qui ouvrait inévitablement à son tour la possibilité d'une lutte offensive généralisée. Par conséquent, les acquis du combat n'étaient pas tellement une amélioration économique graduelle, mais la croissance intellectuelle, culturelle du prolétariat malgré les défaites au niveau économique. C'est pourquoi, Rosa Luxemburg dit que la phase insurrection ouverte ''ne peut venir d'aucune autre voie que l’école de séries de défaites en apparences''.
En d'autres termes: la victoire réelle ou la défaite de la grève de masse ne sont pas déterminées par aucun de ses épisodes mais par son point de culmination, le soulèvement révolutionnaire lui-même.
Ainsi, il n'était pas accidentel que les réalisations économiques et politiques des ouvriers en Russie, obtenues par l'orage révolutionnaire de 1905 et avants, aient été ré arrachées après la défaite de la révolution.
Le rôle des syndicats, gagner des acquis économiques au sien du système capitaliste, était donc éclipsé. Il y a d'autres implications révolutionnaires qui découlent de l'ébranlement des syndicats par la grève de masse :
1) la grève de masse ne pouvait pas être propagée d'avance, elle a surgi sans plan du style ''méthode de mouvement de la masse prolétarienne. Les syndicats, dédiés à une organisation permanente préoccupés par leurs comptes en banque et leurs lestes d’adhésions ne pouvaient même pas espérer être à la hauteur de l'organisation des grèves de masse, forme qui a évolué dans et par la lutte elle-même.
2) Les syndicats ont divisé les ouvriers et leurs intérêts entre toutes les différentes branches de l'industrie alors que la grève de masse ''a fusionné à partir des différents points particuliers, de différentes causes'', et ainsi a tendu à éliminer toutes les divisions dans le prolétariat.
3) Les syndicats n'organisaient aucune minorité de la classe ouvrière alors que la grève de masse a rassemblé toutes les couches de la classe syndiqués et non syndiqués.
Plus les nouvelles formes de luttes s’imposaient à celles propres aux syndicats plus les syndicats eux-mêmes n’appuyaient l'ordre capitaliste contre la grève de masse. L'opposition des syndicats à la grève de masse s'est exprimée de deux manières selon Rosa Luxemburg. L'une était l'hostilité directe des bureaucrates tels que Bomelberg accentuée en plus par le refus du Congrès des syndicats à Cologne ne serait-ce que de discuter de la grève de masse. Le faire était, selon les bureaucrates ''jouer avec le feu''. L’autre forme de cette opposition était le soutien apparent des syndicalistes radicaux et des syndicalistes français et italiens. Ils étaient beaucoup plus en faveur d'une ''tentative'' de grève de masse, comme si cette forme de lutte pouvait se plier aux quatre volontés de l'appareil syndical.
Mais ceux qui s'y opposaient comme ceux qui la soutenaient partageaient tous sur la grève de masse le point de vue qu'elle n'est pas un phénomène émergeant des profondeurs de l'activité de la classe ouvrière mais des moyens techniques de lutte décidés ou repoussés au gré de la volonté des syndicats. Inévitablement, les représentants des syndicats à tous les niveaux ne pouvaient pas comprendre un mouvement dont l'impulsion non seulement ne pouvait pas être contrôlée par eux mais exigeait de nouvelles formes antagoniques aux syndicats.
La réponse de l'aile radicale et de base des syndicats ou des syndicalistes à la grève de masse était sans aucun doute une tentative d'être à la hauteur des nécessités de la lutte de classe. Mais c’était la forme et la fonction du syndicalisme lui-même -quelle que soit la volonté de ses militants- qui était dépassé par la grève de masse.
Le syndicalisme radical exprimait une réponse prolétarienne au sein des syndicats. Mais après la trahison définitive des syndicats lors de la première guerre mondiale et de la vague révolutionnaire qui s'en est suivis le syndicalisme radical a aussi été récupéré et est devenue une arme de valeur pour émasculer la lutte de classe.
Nous ne disons pas que telle était la conception de Rosa Luxemburg dans sa brochure sur la grève de masse. Pour elle, la banqueroute de l'approche syndicaliste pouvait encore être corrigée et c'était compréhensible à l'époque, alors que les syndicats n'étaient pas encore devenus que les simples agents du capital qu'ils sont aujourd'hui. Le dernier chapitre de la brochure suggère que la subordination des syndicats à la direction du parti social-démocrate pourrait enrayer les tendances réactionnaires. Mais ces tendances étaient irrémédiables.
Luxemburg voyait aussi l'émergence en nombre de syndicats pendant les grèves de masse en Russie comme un résultat sain et naturel de la vague de luttes. Mais nous pouvons voir aujourd’hui, alors que seule l'auto-organisation peut développer de véritables luttes, que cette démarche compréhensible était la perpétuation d'une tradition qui a été rapidement dépassée. De plus, Luxemburg voit le Soviet de Petrograd de 1905 comme une organisation complémentaire des syndicats. En fait, l'histoire a prouvé que seuls ouvriers devaient exprimer l'époque des grèves de masse et des révolutions. Les syndicats étaient les organes de l'ère des luttes ouvrières défensives et localisées.
Ce n'est pas un hasard si le premier conseil ouvrier a surgi dans le sillage des grèves en Russie. Créés par et pour la lutte avec des délégués élus et révocables, ces organes pouvaient non seulement regrouper tous les ouvriers en lutte, mais pouvait centraliser tous les aspects du combat économique et politique, offensif et défensif, dans la vaque révolutionnaire. Ce fut le conseil ouvrier anticipant la structure et le but des futurs comités de grèves et assemblées générales qui était naturellement le plus conforme à la direction et aux buts du mouvement de grève de masse en Russie.
Même s'il était indispensable pour Rosa Luxemburg de tirer tontes les leçons pour l'action de la classe ouvrière dans la nouvelle période ouverte a tournant du siècle, les révolutionnaires aujourd’hui sont redevables de la compréhension des conséquences organisationnelles de la grève de masse. La plus importante est que la grève de masse et les syndicats sont, par essence, antagoniques, conséquence implicite quoique non explicite dans la brochure de Rosa Luxemburg.
Nous devons essayer de comprendre comment appliquer ou ne pas appliquer l'analyse de Rosa Luxemburg pour la période actuelle de la lutte de classe ; pour voir à quel degré la lutte prolétarienne en période de décadence du capitalisme, confirme ou contredit les lignes générales de la grève de masse telles qu'elle les a analysées.
LES CONDITIONS OBJECTIVES DE LA LUTTE DE CLASSE DANS LA PERIODE DE DECADENCE DU CAPITALISME
La période depuis 1968 exprime le point culminant de la crise permanente du capitalisme, l'impossibilité d'expansion du système, l'accélération des antagonismes inter-impérialistes, dont les conséquences menacent toute la civilisation humaine.
Partout, l'Etat, avec l'extension terrible de son arsenal répressif, prend en charge les intérêts de la bourgeoisie. En face, il trouve une classe ouvrière qui, quoiqu’affaiblie en nombre par rapport au reste de la société depuis les années 1900, est encore plus concentrée, et dont les conditions d'existence ont été égalisées dans tous les pays à un degré sans précédent. Au niveau politique, la ''ruine de la démocratie bourgeoise'' est si évidente que sa véritable fonction l'écran de fumée de la terreur d'Etat capitaliste est à peine voilée.
De quelle manière les conditions objectives de lutte de classe actuelle correspondent aux conditions de la grève de masse décrites par Rosa Luxemburg ? Leur identité réside dans le fait que les caractéristiques de la période actuelle constituent le point le plus aigu atteint par les tendances à développement capitaliste, qui commençaient à prévaloir dans les années 1900.
Les grèves de masse des premières années de ce siècle étaient une réponse à la fin de l‘aire ascendance capitaliste et à l’aube des conditions de la décadence capitaliste.
Si on considère que ces conditions sont devenues absolument ouvertes et chroniques aujourd'hui, on peut penser que ce qui pousse objectivement vers la grève de masse est mille fois plus large et plus fort aujourd'hui qu'il y a 80 ans.
Les "résultats généraux du développement capitaliste international" qui, pour Luxemburg, étaient la racine de l'émergence du phénomène historique de la grève de masse, n'ont pas cessé de mûrir depuis le début du siècle. Aujourd'hui, ils sont plus évidents que jamais.
Bien sûr, les grèves de masse que Luxemburg a décrites ne se produisaient pas strictement dans la période de décadence capitaliste définie en général par les révolutionnaires. Nous savons que la date de 1914 marque un événement vital de l'entrée du capitalisme dans sa phase sénile pour les positions politiques qui en découlent, l'éclatement de la 1ère guerre mondiale a été la confirmation de l'impasse économique des dix années qui l'ont précédée. 1914 a été une preuve irréfutable que les conditions économiques, sociales et politiques de la décadence capitaliste, étaient désormais pleinement et réellement réunies.
Dans ce sens, les nouvelles conditions historiques qui ont fait surgir la grève de masse au premier plan sont encore présentes aujourd'hui. Sinon, il faudrait montrer comment les conditions qu'affronte l'infrastructure du capitalisme aujourd’hui sont différentes de celles qu'elles étaient il y a 80 ans. Ce qui serait difficile, parce que les conditions du monde en 1905 - exacerbation des contradictions inter impérialistes et développement de confrontations de classe généralisées - existent aujourd'hui plus que jamais ! La première décade du 20ème siècle n'était certainement pas l'apogée du capitalisme ! Le capitalisme était déjà dépassé et engagé vers le cycle de crise-guerre mondiale-reconstruction-crise : "...la révolution russe actuelle arrive à un point historique qui a déjà passé le sommet, qui est de l’autre coté du point culminant de la société capitaliste. Quelle perspicacité sur les phases d'ascendance et de déclin du capitalisme de la part de cette révolutionnaire en 1906 !
LA GREVE DE MASSE ET LA PERIODE DE REVOLUTION
La grève de masse est donc le résultat des circonstances du capitalisme en déclin. Mais, pour Luxemburg, les causes matérielles qui ont été en dernier ressort responsables de la grève de masse ne sont pas entièrement suffisantes pour expliquer pourquoi ce type de combat a surgi à ce moment. Pour elle, la grève de masse est le produit de la période révolutionnaire. La période de déclin ouvert du capitalisme doit coïncider avec le mouvement ascendant non battu de la classe, pour que la classe soit en état d'utiliser la crise comme un levier pour mettre en avant ses propres intérêts de classe à travers la grève de masse. Réciproquement, après des défaites décisives, les conditions de la décadence vont tendre à renforcer la passivité du prolétariat plutôt qu'à donner naissance à des grèves de masse.
Ceci permet d'expliquer pourquoi la période de grève de masse disparaît au milieu des années 1920 et n'a resurgi que récemment, dans la période actuelle depuis 1968.
La période actuelle mène-t-elle alors à une révolution comme dans les années 1896-1905 en Russie ? Oui sans aucun doute.
1968 a marqué la fin de la contre-révolution et ouvert une époque menant à des confrontations révolutionnaires, pas seulement dans un pays, mais dans le monde entier. On peut dire que, malgré le fait que 1968 a marqué la fin de l'ère de la défaite prolétarienne, nous ne sommes pas encore cependant dans une période révolutionnaire. Ceci est tout à fait juste si par "période révolutionnaire", nous entendons seulement la période de double pouvoir et d'insurrection armée. Mais Luxemburg entendait" période révolutionnaire" dans un sens beaucoup plus large. Pour elle, la révolution russe n'avait pas commencé à la date officielle du 22 janvier 1905 ; elle trace ses origines à partir de 1896 - neuf ans avant - l'année des grandes grèves de Saint-Pétersbourg. L'époque de l'insurrection ouverte de 1905 était pour Luxemburg le point culminant d'une longue période de révolution de la classe ouvrière russe.
En fait, c'est la seule manière d'interpréter de façon cohérente le concept de période révolutionnaire. Si une révolution est l'exercice du pouvoir par une classe aux dépends de l'ancienne classe dominante, alors, le renversement souterrain de l'ancien rapport de forces entre classes en faveur de la classe révolutionnaire est une part vitale de la période révolutionnaire au moment du combat ouvert, des heurts militaires, etc. Ceci ne veut pas dire que ces deux aspects de la période révolutionnaire soient exactement la même chose - 1896=1905 -, mais qu'on ne peut les diviser arbitrairement et séparer et opposer la phase d'insurrection ouverte et sa phase préparatoire.
En le faisant, on serait incapable d'expliquer pourquoi Luxemburg date le début du mouvement de grève de masse en Russie en 1896, ou pourquoi elle donne de nombreux exemples de grève de masse dans des pays où aucune insurrection ne s'est produite à l'époque.
Qui plus est, la fameuse affirmation de Luxemburg selon laquelle la grève de masse était "l'idée de ralliement" d'un mouvement qui devait "s'étendre sur des décades" serait incompréhensible si on ne voit que la période d'insurrection elle-même comme responsable des grèves de masse.
Bien sûr au moment du renversement de l'ancienne classe dominante, les grèves de masse atteindront leur plus haut développement, mais ceci ne contredit pas du tout le fait que la période de grèves de masse commence quand en premier lieu la perspective de la révolution est ouverte. Pour nous, ceci signifie que l'époque de grèves de masse d'aujourd'hui commence en 1968.
LA DYNAMIQUE DE LA LUTTE ACTUELLE
Nous avons déjà dit que le contenu fondamental de la lutte prolétarienne reste le même mais qu'il s'exprime différemment selon la période historique. La tendance des différents aspects de cette lutte à se fondre ensemble - la tentative de limiter l'exploitation et la tentative de l'abolir -dans des grèves de masse, qui est décrite par Luxemburg, est aujourd'hui poussée par les mêmes nécessités matérielles qu'il y a 80 ans. La nature caractéristique de la lutte des 12 dernières années (c'est-à-dire ce qui distingue la lutte depuis 1968 de la lutte pendant les 40 années précédentes) est l'interaction constante de la défensive et de l'offensive, l'oscillation entre confrontation économique et politique.
Il n'est pas nécessaire de faire intervenir une question de plan conscient de la classe ouvrière ; c'est le résultat du fait que la perspective de ne serait-ce que préserver son niveau de vie, devient de moins en moins possible aujourd'hui. C'est pour cette raison que toutes les grèves tendent à devenir une bataille pour la survie, des "grèves qui s'accroissent, toujours plus fréquentes, qui se terminent pour la plupart sans 'victoire définitive' aucune, mais qui, malgré cela ou à cause de cela, sont d'une plus grande signification comme explosions de contradictions intenses profondes qui surgissent sur le terrain politique" (Theory and Practice, Brochure News and Letters).
Ce sont les conditions de crise ouverte qui, comme dans les années 1900, mettent en avant la dynamique de la grève de masse et commencent à concentrer les différents aspects de la lutte de la classe ouvrière.
Mais peut-être qu'en décrivant la phase actuelle comme une période de grève de masse, nous faisons erreur. La plupart des luttes de ces 12 dernières années ne sont-elles pas appelées, menées et terminées par les syndicats ? Ceci ne signifie-t-il pas que les luttes actuelles sont syndicales, qu'elles sont motivées par des intérêts strictement défensif et économique qui n'ont pas de lien avec le phénomène de la grève de masse ? A côté du fait que les plus significatives des batailles de ces dernières années ont brisé l'encadrement syndical, une telle conclusion échouerait à prendre en compte une caractéristique de base de la lutte de classe en période de décadence du capitalisme : dans chaque grève qui apparaît contrôlée par les syndicats, il y a deux forces de classe en action. Dans toutes les grèves contrôlées par les syndicats aujourd'hui, c'est un combat réel même s'il est encore dissimulé qui se mène entre les ouvriers et leurs soi-disant représentants : les bureaucrates syndicaux de la bourgeoisie. Ainsi les ouvriers sous le capitalisme décadent ont une double malchance : non seulement leurs adversaires reconnus comme les patrons et les partis de droite sont leurs ennemis, mais leurs prétendus amis, les syndicats et tous ceux qui les soutiennent, le sont aussi.
Aujourd'hui, les ouvriers sont poussés par la crise et la confiance qu'ils prennent en eux-mêmes en tant que classe non vaincue, à se poser le problème des limitations de la pure défense économique et sectorielle imposées à leurs luttes. Les syndicats ont pour tâche de maintenir l'ordre dans la production et de terminer les grèves. Les organisations capitalistes tentent sans cesse de dévoyer les ouvriers dans les impasses du syndicalisme. La bataille entre les syndicats et le prolétariat, parfois ouverte, mais plus souvent encore cachée, n'est fondamentalement pas une conséquence de plans conscients des ouvriers ou des syndicats, mais un résultat de causes économiques objectives qui, en dernière analyse, les forcent à agir les uns contre les autres.
La force motrice de la lutte de classe actuelle ne doit donc pas être recherchée dans la profondeur des illusions des ouvriers dans les syndicats à un moment donné, ni dans les actions les plus radicales des syndicats pour coller à la lutte à un certain moment, mais dans la dynamique des intérêts de classe antagoniques des ouvriers et des syndicats.
Ce mécanisme interne de la période qui mène à des confrontations révolutionnaires, avec la force et la clarté grandissantes de l'intervention communiste, révèle aux ouvriers la nature de la lutte qu'ils ont déjà engagée, alors que la tentative des syndicats à la fois de mystifier les ouvriers et de défendre l'économie capitaliste de plus en plus en faillite, amènera les ouvriers à détruire en pratique ces organes de la bourgeoisie.
Il serait donc désastreux pour qui se prétend révolutionnaire de juger la dynamique de la lutte des ouvriers par son apparence syndicaliste, comme le font toutes les variantes de l'opinion bourgeoise. La pré condition pour mettre en lumière et clarifier les possibilités révolutionnaires de la lutte ouvrière est évidemment la reconnaissance que ces possibilités existent réellement. Il n'est pas accidentel que l'été polonais de 1980, le moment le plus haut dans la période actuelle des grèves de masse depuis 1968, a révélé clairement la contradiction entre la véritable force de la lutte des ouvriers et celle du syndicalisme.
La vague de grèves en Pologne a embrassé littéralement la masse de la classe ouvrière dans ce pays, touchant toutes les industries et les activités. De points dispersés et pour des causes différentes au départ, le mouvement s'est fondu, à travers les grèves de soutien et les actions de 'solidarité, en une grève générale contre l'Etat capitaliste. Les ouvriers ont commencé à tenter de se défendre eux-mêmes contre le rationnement et la hausse des prix. Face à un Etat brutal, intransigeant, et une économie nationale en faillite, le mouvement est passé à l'offensive et a développé des objectifs politiques. Les ouvriers ont rejeté les syndicats et créé leurs propres organisations : les assemblées générales et les comités de grève pour centraliser leur lutte, engageant l'énergie énorme de la masse prolétarienne. C'est un exemple incomparable de grève de masse.
Le fait que la revendication de syndicats libres est devenue prédominante dans les objectifs de la grève, le fait que les MKS (comités de grève inter-entreprises) se sont eux-mêmes dissout pour ouvrir la voie au nouveau syndicat Solidarité, ne peuvent cacher la véritable dynamique de millions d'ouvriers polonais qui ont fait trembler la classe dominante.
De façon historique, le point de départ pour l'activité révolutionnaire en 1981 est de reconnaître que la grève de masse en Pologne est annonciatrice de futures confrontations révolutionnaires, tout en reconnaissant les illusions immenses que les ouvriers ont encore dans le syndicalisme. aujourd'hui. Les événements de Pologne ont porté un coup cruel à la théorie que la lutte de classe de notre époque est syndicaliste, malgré les impressions qui découlent des apparences superficielles.
Mais si une théorie prétend que la lutte de classe est par nature une lutte trade-unioniste, même a ses moments les plus hauts, une autre théorie est que ces moments les plus hauts exprimés dans les grèves de masse, sont un phénomène exceptionnel, tout à fait distinct dans ses caractéristiques des épisodes moins dramatiques du combat de classe. Selon cette supposition, la plupart du temps, la lutte des ouvriers est simplement défensive et économiste et tombe ainsi organiquement sous l'égide des syndicats, alors que par ailleurs, en des occasions isolées comme en Pologne, les ouvriers passent à l'offensive, mettant en avant des revendications politiques, en reflétant un objectif qui serait différent. Outre son incohérence -impliquant que la lutte prolétarienne peut être syndicaliste (c'est à dire capitaliste), ou prolétarienne à différents moments- cette vision tombe dans le piège de la séparation entre les différents aspects de la grève de masse -offensive/défensive, économique/politique- et ainsi, comme le disait Luxemburg, sape l'essence vivante de la grève de masse et la vide de son contenu d'ensemble. Dans la période de grève de masse, toute lutte défensive, même modeste, contient le germe ou la possibilité d'un mouvement offensif, et toute lutte offensive est basée sur la nécessité constante de la classe de se défendre. L'interconnexion entre lutte économique et politique est identique.
Mais la vision qui sépare ces aspects interprète la grève de masse de manière isolée -comme une grève avec des masses de gens surgissant tout d'un coup- comme résultat fondamentalement de circonstances conjoncturelles, telles que la faiblesse des syndicats dans un pays donné, ou l'amélioration de telle ou telle économie. Cette vision ne voit la grève de masse que comme une offensive, une affaire politique, sous-estimant le fait que cet aspect de la grève de masse est nourri par les luttes défensives, localisées et économiques. Par dessus tout, ce point de vue ne voit pas que nous vivons dans une période de grève de masse aujourd'hui, provoquée non par des conditions locales ou temporaires, mais par la situation générale de la décadence capitaliste qui se retrouve dans chaque pays.
Cependant, le fait que quelques uns des exemples de grève de masse les plus significatifs ont eu lieu dans les pays arriérés et du bloc de l’Est, semble donner du crédit à l'idée de la nature exceptionnelle de ce type de luttes, tout comme l'apparition de la grève de masse en Russie dans les années 1900 semblait justifier la vision qu'on ne la verrait pas surgir en Occident. La réponse que Rosa Luxemburg a donné à l'idée de l'exclusivité russe de la grève de masse, est parfaitement valable encore pour aujourd'hui. Elle admettait que l'existence du parlementarisme et du syndicalisme à l'Ouest pouvait temporairement repousser l'impulsion vers la grève de masse, mais pas l'éliminer, parce que celle-ci a surgi des bases mêmes du développement capitaliste international. Si la grève de masse en Allemagne et ailleurs, a pris un caractère "caché et latent", plus qu'une qualité pratique et active comme en Russie, ceci ne peut cacher le fait que la grève de masse était un phénomène historique et international. Cet argument s'applique aujourd'hui à l'idée que la grève de masse ne peut surgir à l'Ouest. H est vrai que la Russie en 1905 a représenté un pas qualitatif énorme dans le développement de la lutte de classe tout comme la Pologne 1980 aujourd'hui. Mais il est vrai également que ces points forts, comme la Pologne, sont intimement liés aux manifestations "cachées et latentes" de la grève de masse à l'Ouest, parce qu'elle émerge des mêmes causes et s'affronte aux mêmes problèmes. Ainsi, même si le parlementarisme et les syndicats sophistiqués de l'Ouest peuvent étouffer ces tendances qui explosent en d'énormes grèves de masse comme en Pologne, ces tendances n'ont pas disparu. Au contraire, les grèves de masse ouvertes qui ont, jusqu'à présent été contenues à l'Ouest auront accumulé d'autant plus de forces lorsque les obstacles seront bousculés. En fin de compte, c'est l'échelle des contradictions du capitalisme qui déterminera l'ampleur de l'explosion des grèves de masse futures : "(...) plus l'antagonisme entre capital et travail est développé plus effectives et décisives devront être les grèves de masse". Plus que par une rupture brutale et complète avec les luttes économiques, défensives contenues par les syndicats, les bonds qualitatifs de la conscience, de l'auto-organisation de la grève de masse avanceront en une spirale accélérée de luttes ouvrières. Les phases cachées et latentes du combat, qui suivront souvent les confrontations ouvertes, comme cela s'est déroulé en Pologne, continueront à fertiliser les explosions futures. Le mouvement d'oscillations d'avances et de reculs, d'offensive et de défensive, de dispersion et de généralisation, deviendra plus intense, en liaison avec l'impact grandissant de l'austérité et la menace de guerre. Finalement,"(...) dans l'orage de la période révolutionnaire, le terrain perdu est repris, les inégalités sont égalisées et le pas d'ensemble du progrès social change, double d'un coup son avance".
Cependant, si nous avons présentée la possibilité objective de l'évolution de la grève de masse, on ne doit pas oublier que les ouvriers devront devenir de plus en plus conscients de la lutte qu'ils ont engagée pour la mener à la conclusion victorieuse. C'est particulièrement vital en ce qui concerne les syndicats, qui se sont mieux adaptés au cours de ce siècle à contenir la grève de masse. Ce n'est pas le lieu ici d'envisager tous les moyens d'adaptation que peuvent employer les syndicats; nous mentionnerons qu'ils prennent généralement la forme de faux substituts pour les véritables choses : semblant de généralisation des luttes, tactiques radicales vides de toute efficacité, revendications politiques qui poussent à soutenir un clown dans le cirque parlementaire.
Le développement victorieux de la grève de masse dépendra en derniers recours de la capacité de la classe ouvrière à battre la "cinquième colonne" que constituent les syndicats aussi bien que ses ennemis "ouverts" comme la police, les patrons, les politiciens de droite, etc.
Mais le but de ce texte n'est pas de définir les obstacles de la conscience sur la voie, vers le point culminant, victorieux de la grève de masse. Il est plutôt de tracer les possibilités objectives de la grève de masse à. notre époque, à l'échelle de la nécessité et de l'organisation économique.
LES FORMES DE LA LUTTE DE CLASSE AUJOURD'HUI
La période de grève de masse tend à briser les syndicats à long terme. La forme apparente de la lutte de classe moderne -la forme syndicaliste- n'est que cela : une apparence. Son but réel ne correspond pas à la fonction des syndicats mais obéit à des causes objectives qui poussent la classe dans la dynamique de la grève de masse. Quelle est alors la forme adéquate, la plus appropriée de la grève de masse à notre époque ? L'assemblée générale des ouvriers en lutte et ses comités élus et révocables.
Cependant, cette forme, qui est animée du même esprit que les soviets eux-mêmes, est l'exception et non la règle de l'organisation de la majorité des luttes des ouvriers aujourd'hui. C'est seulement au plus haut niveau de la lutte que surgissent des assemblées générales et des comités de grèves hors du contrôle syndical. Et même dans ces situations, comme en Pologne 1980, les organisations des ouvriers succombent souvent à la fin au syndicalisme. Mais nous ne pouvons pas expliquer ces difficultés des luttes actuelles en affirmant que, parfois, elles sont trade-unionistes, et parfois sous la direction de l'auto-organisation, prolétariennes. La seule interprétation cohérente des faits est qu'il est extrêmement difficile pour une auto-organisation véritable des ouvriers d'émerger.
La bourgeoisie a les avantages suivants en ce domaine : tous ses organes de pouvoir, économiques, sociaux, militaires, politiques et idéologiques sont déjà en place de manière permanente, essayés et testés depuis des décades. En particulier, les syndicats ont l'avantage de dévoyer la confiance des ouvriers du fait du souvenir historique de leur nature autrefois ouvrière. Les syndicats ont aussi une structure organisationnelle permanente au sein de la classe ouvrière. Le prolétariat n'a surgi que récemment de la plus profonde défaite de son histoire sans aucune organisation permanente pour le protéger. Combien est donc difficile pour le prolétariat de trouver la forme la plus appropriée à sa lutte ! A peine le mécontentement lève t-il la tête que les syndicats sont là pour le "prendre en charge" avec la complicité de tous les représentants de l'ordre capitaliste. De plus, les ouvriers n'entrent pas en lutte aujourd'hui pour réaliser des idéaux, pour combattre délibérément les syndicats, mais pour des buts très pratiques et immédiats -pour essayer de préserver leurs moyens de vie. C'est pourquoi, dans la plupart des cas aujourd'hui, les ouvriers acceptent la "direction" autoproclamée des syndicats. Il n'est pas étonnant que ce soit principalement lorsque les syndicats n'existent pas ou sont ouvertement contre les grèves que la forme de l'assemblée générale émerge. C'est seulement après des confrontations répétitives avec les syndicats, dans le contexte d'une crise économique mondiale et avec le développement en force de la grève de masse que la forme de l'assemblée générale deviendra vraiment la caractéristique générale plutôt que l'exception qu'elle est encore à l'étape présente de la lutte de classe. En Europe de l'Ouest, ceci signifiera l'ouverture de confrontations avec l'Etat.
Malgré cela, les ouvriers se confronteront cependant à d'autres problèmes même si le contrôle conscient élémentaire de leur lutte aura déjà donné une énorme impulsion sur la voie de la révolution. La présence permanente de syndicats au niveau national continuera d'être une énorme menace pour la classe.
Parce que la grève de masse n'est pas un simple événement mais l'idée de ralliement à un mouvement qui s'étend sur des années, sa forme, comme résultat, n'émergera pas immédiatement, parfaitement, de façon pleinement mûre. Cette forme adéquate prendra des formes en réponse au rythme accéléré de la période de grève de masse, ponctuée par des sauts qualitatifs dans l'auto-organisation, comme par des retraites partielles et des récupérations, sous le feu constant des syndicats, mais aidés par l'intervention claire des révolutionnaires. Plus que tout autre, la loi historique du mouvement de la lutte de classe aujourd'hui ne réside pas dans sa forme mais dans les conditions objectives qui la poussent en avant. La dynamique de la grève de masse "ne réside pas dans la grève de masse elle-même ni dans ses détails techniques, mais dans les dimensions sociales et politiques des forces de la révolution".
Ceci signifie t-il que la forme de la lutte de classe n'a pas d'importance aujourd'hui, qu'il in porte que les ouvriers restent ou ne restent pas dans l'encadrement syndical ? Pas du tout. Si la force motrice derrière ces actions reste l'intérêt économique, ces intérêts ne peuvent se réaliser que par le niveau nécessaire de conscience et d'organisation. Et l'intérêt économique de la classe ouvrière -abolir l'exploitation- requiert un degré d'auto-organisation et de conscience jamais réalisée par aucune autre classe dans l'histoire. Par conséquent, harmoniser sa conscience subjective avec ses intérêts économiques est la tâche primordiale du prolétariat. Si le prolétariat s'avère incapable de se libérer lui-même aux moments décisifs de l'emprise organisationnelle et politique des syndicats, alors la classe ne réalisera jamais la promesse de la grève de masse -la révolution- mais sera écrasé par la contre-offensive de la bourgeoisie.
Cet article a essayé de montrer que le mouvement en Pologne en été 1980 n'était pas un exemple isolé du phénomène de là grève de masse, mais plutôt la plus haute expression d'une tendance internationale générale dans la lutte de classe prolétarienne dont les causes objectives et la dynamique essentielle étaient analysées par Rosa Luxemburg il y a 75 ans.
FS
[1] [166] Sauf lorsque cela est mentionné, toutes les citations sont extraites de cette brochure.
Heritage de la Gauche Communiste:
Critique de «LÉNINE PHILOSOPHE» de Pannekoek (Internationalisme, 1948) (2ème partie)
- 2960 lectures
La première partie de cet article est parue dans la Revue Internationale n° 25.
Il existe un phénomène dans le tracé de la connaissance en société bourgeoise et dont Harper n'a pas parlé. C'est celui de l'influence de la division du travail capitaliste sur la formation de la connaissance et la synthèse des sciences de la nature, d'une part; d'autre part le procès de la formation de la connaissance dans le mouvement ouvrier.
Harper dit à un certain moment que la bourgeoisie doit à chaque révolution apparaitre différente de ce qu'elle était précédemment et de ce qu'elle est en réalité dans le moment même et cacher ainsi son but réel.
Ceci est vrai, mais Harper, en ne nous parlant pas du processus de formation de la connaissance dans l'histoire et en ne posant pas de problème explicitement, le pose implicitement de la manière aussi mécaniste que celle qu'il reproche lui-même à Plekhanov et à Lénine.
Le processus de formation de la connaissance dépend des conditions de production des conceptions scientifiques et des idées en général conditions qui sont liées aux conditions de la production en général, c'est à dire aux applications pratiques.
La société bourgeoise en se développant, développe, (en même temps que ses conditions de production - c'est à dire que son mode d'existence économique-) sa propre idéologie : ses conceptions scientifiques ainsi que ses conceptions du monde et sur le monde.
La science est une branche bien particulière dans la production des idées nécessaires à la vie de la société capitaliste, la continuation, l'évolution et la progression de sa propre production.
Le mode de production économique, de même qu'il applique pratiquement ce que la science élabore, a une grande influence sur la façon dont s’élaborent pratiquement les idées et les sciences. La division du travail capitaliste, de même qu'elle contraint à l'extrême spécialisation dans tous les domaines de la réalisation pratique de la production, contraint à l'extrême spécialisation et à l'ultime division du travail dans le domaine de la formation des idées et principalement dans le domaine des sciences.
Les sciences et les savants confirment, par leur présence et leurs spécialisations, la division universelle du travail capitaliste, ils sont aussi nécessaires que les généraux d'armée et la science militaire, ou les administrateurs et directeurs.
La bourgeoisie est parfaitement capable de faire la synthèse dans le domaine particulier des sciences qui ne touche pas directement à son mode d'exploitation. Aussitôt qu'elle touche à ce dernier domaine, elle tend inconsciemment à travestir la réalité : histoire, économie, sociologie, philosophie.
Elle ne peut donc qu'arriver à des essais de synthèse incomplets.
La bourgeoisie se borne aux applications pratiques, aux investigations scientifiques, et elle est dans ce domaine essentiellement matérialiste. Mais comme elle ne peut arriver à une synthèse complète, comme elle est obligée inconsciemment de masquer le fait de sa propre existence contre les lois scientifiques du développement de la société, -découvertes par les socialistes- elle ne peut réaliser cette barrière psychologique de la réalité de son existence historico-sociale qu'au travers de l'idéalisme philosophique qui embue toute son idéologie. Ce travestissement nécessaire à la société bourgeoise en tant que mode d'existence sociale, elle est capable de l'élaborer elle-même au travers de sa propre philosophie, (de ses différents systèmes) mais elle est égale ment encline à prendre dans les anciennes philosophies et idéologies de l'existence sociale d'anciens modes d'exploitation, du fait qu'elles ne touchent pas sa propre existence mais peut au contraire continuer a voilera et aussi parce que toutes les classes dominantes dans l'histoire, en tant que classes conservatrices arrivent a avoir besoin des anciens modes de conservation qu'elles arrangent bien entendu, selon leurs propres à besoins -c'est è dire qu’elles les déforment a leur propre forme.
C'est pour cela que même les philosophes bourgeois, au début de l'histoire de la bourgeoisie, pouvaient être, dans une certaine mesure, matérialistes (dans la mesure où ils mettaient l'accent sur la nécessité du développement des sciences de la nature), mais qu'ils étaient foncièrement idéalistes aussitôt qu'ils essayaient de raisonner sur l'existence de la bourgeoisie elle-même et de la justifier. Ceux qui mettent plus l'accent sur les premiers aspects de la pensée bourgeoise pouvaient apparaisse plus matérialistes, ceux qui tentaient plus de justifier l'existence de la bourgeoisie étaient appelés à être plus idéalistes.
Seuls les socialistes scientifiques à partir de Marx, sont capables de faire une synthèse des sciences et du développement social humain. Et même cette synthèse est nécessaire au préalable pour leur point de départ révolutionnaire. C'est ce que Marx a fait.
Dans la mesure où ils posaient de nouveaux problèmes scientifiques, les matérialistes de l'époque révolutionnaire de la bourgeoisie étaient tentés et contraints de faire la synthèse de leurs connaissances et de leurs conceptions du développement social, mais sans jamais toucher à l'existence sociale de la bourgeoisie, au contraire en justifiant cette existence. C'est ainsi que des individualités ont pu surgir qui tentèrent de faire cette synthèse, de Descartes è Hegel. Il est bien difficile en toute honnêteté de séparer le matérialisme de l'idéalisme, dans la philosophie de Descartes ou de Hegel. Leur essai de synthèse a voulu être complet, il a voulu embrasser d'un regard dialectique l'évolution et le mouvement du monde et des idées, qu'ils n'ont pu faire autrement que traduire d'une manière totale et absolue le comportement idéologique de la bourgeoisie sous son double aspect contradictoire. Mais ils sont des exceptions.
Ce qui a contribué à pousser des individus vers cette activité reste encore dans l'ombre, la connaissance sociale, historique, économique et psychologique n'en étant qu'à son stade primaire. Nous ne pouvons que dire cette banalité qu'ils obéissaient à des préoccupations de leur société en général.
Dans le capitalisme, et quoique tendant vers l'édification d'une nouvelle société, les socialistes d'une part et le prolétariat d'autre part, sont contraints, par leur existence et leur développement au sein du capitalisme, d'obéir, dans le domaine de la connaissance, à ses propres lois.
La politique devient la spécialisation des militants communistes, quoique des connaissances et une vue de synthèse universelle leur seraient utiles.
C'est ce qui fait que la division l'opère dans le mouvement ouvrier, entre les courants politiques d'une part, et d’autre part, souvent même de la politique d'avec les théoriciens dans les domaines scientifiques de l’histoire, de économie, de la philosophie. Le processus de formation des théoriciens du socialisme s'est opéré assez sensiblement de la même façon que celle des savants et des philosophes bourgeois de l'époque révolutionnaire.
L'influence ambiante de l'adulation et du milieu bourgeois restant toujours une forte influence dans le procès de formation des idées dans le mouvement ouvrier. Le développement de la société elle-même, d'une partie des sciences d'autre part, sont des facteurs décisifs dans l'évolution du mouvement ouvrier. Cela peut apparaitre comme une tautologie, et cependant, on ne le répète jamais assez.
C'est cette constante évolution parallèle à l'évolution du prolétariat et des socialistes qui est pour eux une lourde entrave.
Les restes des religions: c'est à dire des époques historiques pré-capitalistes deviennent un atavisme de la bourgeoisie ''réactionnaire'' certes, mais surtout de la bourgeoisie en tant que dernière classe exploiteuse de l'histoire. Malgré cela, la religion n'est pas ce qu'il y a de plus dangereux dans idéologie des classes exploitantes, mais cette idéologie dans son en- semble, où voisinent à côté des religions, du chauvinisme et de tous les idéalistes verbeux, un matérialisme sec, étriqué et statique. A l'aspect idéaliste de la pensée de la bourgeoisie, il est donc nécessaire d'y joindre son matérialisme des sciences de la nature qui fait partie intégrante de son idéologie. Ces différents aspects de l’idéologie bourgeoise, s’ils ne font pas partie d'un tout pour la bourgeoisie qui tend à masquer l'unité de son existence sociale sous la pluralité de ses mythes, doivent être conçus comme tels par les socialistes.
C'est ainsi que l'on s'aperçoit que le mouvement ouvrier a du mal à se dégager de 1'idéologie bourgeoise dans son ensemble, de ses idéalistes comme de son matérialisme incomplet. Bergson n'a t-il pas influencé la formation de courants dans le mouvement ouvrier en France?
La grande difficulté consiste à faire de chaque nouvelle idéologie ou formulation d'idée, l'objet d'une étude critique et non l'objet d'un dilemme adoption-rejet. Elle consiste également à concevoir tout progrès scientifique, non comme un progrès réel, mais comme un progrès ou un enrichissement (dans le domaine de la connaissance) seulement en puissance dans la société, et dont, en dernier ressort, les possibilités réelles pratiques d'application sont soumises aux fluctuations de la vie économique du capitalisme.
Dans ce sens là, les socialistes en arrivent donc à avoir uniquement une position critique permanente, Faisant des idées l'objet d'une étude; ils ont face à la science uniquement une position d'assimilation chronique de ses résultats en en comprenant les applications pratiques comme ne pouvant servir l'humanité réellement pour ses besoins que dans une société évoluant vers le socialisme.
Le processus de la connaissance dans le mouvement ouvrier considère comme une acquisition sienne, le développement théorique des sciences, mais il l’intègre dans un ensemble de connaissances dont l'axe est la réalisation pratique de là révolution sociale, axe de tout progrès réel de la société.
C'est ce qui fait que le mouvement ouvrier se trouve spécialisé de par son existence sociale révolutionnaire, luttant au sein du capitalisme contre la bourgeoisie, dans le domaine strictement politique qui est jusqu'à l'insurrection (1a prise de conscience), le point névralgique de la lutte de classe bourgeoisie-prolétariat.
C'est ce qui fait le double aspect du développement de la connaissance dans le mouvement ouvrier, différent et relié, se développant au fur et à mesure de la libération REELLE du prolétariat : politique d'une part (qui pose les problèmes immédiats et brulants); théoriques et scientifiques, qui évoluent plus lentement, se poursuivent surtout (jusqu'à présent) dans les époques de recul du mouvement ouvrier, et aborde d problèmes certes au moins aussi importants, certes en rapport avec des problèmes politiques, mais d'une façon moins immédiate et brulante.
Dans la politique se marque, au fur mesure du développement de la société, la frontière immédiate de classe, au travers de la lutte politique du prolétariat. C'est donc dans le développement de la lutte politique du prolétariat que se suit pas à pas l'évolution de la lutte de classe et le processus de formation du mouvement ouvrier révolutionnaire en opposition à la bourgeoisie dont les formes de lutte politique évoluer en fonction de l'évolution constante de la société capitaliste.
La politique de classe du prolétariat varie donc au jour le jour et même dans une certaine mesure localement (nous verrons plus tard dans quelle mesure). C'est dans cette lutte au jour le jour, dans ces divergences de partis et de groupes politiques, dans la tactique du lieu et du moment que se traduisent immédiatement les frontières de classe. Viennent ensuite, d'une façon plus générale, moins immédiate, et posant ils objectifs plus lointains, les buts de la lutte révolutionnaire du prolétariat, qui sont contenus dans les grands principes directeurs des partis et des groupes politiques.
C'est donc dans les programmes d'abord, ensuite dans l'application pratique, dans l’action journalière, que se posent les divergences dans l'action politique, reflétant dans leur évolution, en même temps que l'évolution générale de la société, l'évolution des classes, de leurs méthodes de lutte, de leurs moyens et de leurs idéologies, de la théorie et de la pratique du mouvement de leur lutte politique.
Au contraire, la synthèse de la dialectique scientifique dans le domaine purement philosophique de la connaissance, se développe non pas à la manière dialectiquement immédiate de la lutte de classe pratique politique, mais bien d'une manière dialectique beaucoup plus lointaines sporadique, sans lien apparent, ni avec le milieu local, ni avec le milieu social, a peu près comme le développement des sciences appliquées, sciences de la nature, de la fin du féodalisme et de la naissance du capitalisme.
Harper n'a pas fait ces différenciations, il n'a pas su nous montrer la connaissance comme différentes manifestations de la pensée humaine, extrêmement divisée en spécialisations, dans le temps, dans les différents milieux sociaux, au cours de leur évolution, etc.
La connaissance humaine se développe (grossièrement et vulgairement) en fonction des besoins auxquels les différents milieux sociaux ont à faire face et les différents domaines de la connaissance se développent en fonction du développement des applications pratiques envisagées. Plus le domaine de la connaissance touche immédiatement et de près l'application pratique, plus est sensible son évolution; au contraire , glus nous avons affaire à une tentative de synthèse et moins il est possible de suivre cette évolution car la synthèse ne se fait que suivant les lois purement accidentelles du hasard, c'est à dire des lots tellement compliquées, découlant de facteurs tel- moment divers et complexes qu'il est pratiquement impossible de nous plonger aujourd'hui dans de telles études.
De plus, la pratique englobe de grandes masses sociales alors que la synthèse s'opère très souvent par des individualités. Le social tombe sous les lois générales plus facilement et plus immédiatement contrôlables. L'individu tomba sous l'angle des particularités quasi imperceptibles pour ce qui est de la science historique qui n'en est encore qu'à ses premiers pas.
C'est pour cette raison que nous relevons, en premier liquidée grave erreur de ce côté chez Harper, d'avoir engagé une étude sur le problème de la connaissance en ne nous parlant que de la différence qui existe entre la manière bourgeoise d'aborder les problèmes et la manière socialiste et révolutionnaire: en laissant dans l'ombre le processus historique de formation des idées. En opérant de cette manicle, la dialectique de Harper reste impuissante et vulgaire.
D'un petit essai intéressant, critiquant la manière dont Lénine aborde la critique de l’empiriocriticisme, et montrant ce qui est vrai (c'est à dire que c'est un mélange de mauvais goût dans la polémique de vulgarité dans le domaine scientifique -ainsi d'ailleurs que de choses erronées- de matérialisme bourgeois et de marxisme), Harper nous livre cet essai intéressant, plus des conclusions d'une platitude encore plus criante que la dialectique de Lévige dans matérialisme et Empiriocriticisme.
Le prolétariat se dégage révolutionnairement du milieu social capitaliste par un combat continuel, cependant il n'a acquis totalement une idéologie indépendante dans le plein sens du terme, que le jour de la réalisation pratique de l'insurrection généralisée faisant de la révolution socialiste une réalité vivante et lui permettant de marcher ses premiers pas. En même temps que le prolétariat arrive à une indépendance politique et idéologique totale, à la seule conscience de la seule solution révolutionnaire au marasme économico-social du capitalisme, la construction d'une société sans classes, au moment du développement généralisé de l'insurrection du prolétariat, à ce moment précis, ça n'existe déjà plus en tant que classe pour le capitalisme, et, par la dualité de pouvoir acquise en sa faveur, il a créé un milieu historico-social favorable à sa propre disparition en tant que classe.
La révolution socialiste comporte donc deux actions du prolétariat : avant et après l'insurrection.
Il n'arrive à développer totalement une idéologie indépendante que lorsqu'il a créé le milieu favorable a sa disparition, c'est à dire après l'insurrection. Avant l'insurrection, son idéologie a surtout comme but d'arriver à réaliser pratiquement l'insurrection: la prise de conscience de la nécessité de réaliser cette insurrection ainsi que de l'existence des possibilités et des moyens de la réaliser. Après l'insurrection se posent pratiquement de front, d'une part la gestion de la société, d'autre part la disparition des contradictions léguées par le capitalisme. Au premier rang de ces préoccupations se pose donc, après l’insurrection, d'évoluer vers le socialisme et le communisme, c'est à dire résoudre pratiquement ce que doit être la période transitoire. La conscience sociale, même celle du prolétariat, ne peut être totalement libérée de l'idéologie bourgeoise qu'à partir de cette période, jusqu'à cet acte de libération par la violence; toutes les idéologies bourgeoises, toute la culture bourgeoise la science et l'art, commandent aux socialistes jusque dans la réaction de leur raisonnement. Ce n'est qu'avec lenteur qu'une synthèse socialiste se dégage de l'évolution du mouvement ouvrier et de son étude.
Dans l'histoire de l'évolution du mouvement ouvrier, on voit que très souvent il est arrivé que ceux qui sont capables de raisonner et d'analyser très profondément les choses de la des classes et de l'évolution du capitalisme ou sur un mouvement insurrectionnel, ont été, en dehors du mouvement réel lui-même, plus comme des observateurs que comme des acteurs. C'est le cas pour Harper comparé à Lénine.
De même il peut arriver un décalage dans le mouvement de la connaissance du point de vue du socialisme, décalage qui fait que certaines études théoriques restent valables alors que les hommes qui les ont formulées pratiquent une politique qui n'est plus adéquate à la lutte du prolétariat. Il arrive également l'inverse.
Dans le mouvement qui a entraîné les classes russes dans trois révolutions successives en douze ans, les taches pratiques de la lutte de classe furent tellement prenantes, les besoins de la pratique de la lutte, puis la prise du pouvoir, puis du pouvoir lui-même, appelaient beaucoup plus la formation de politiciens du prolétariat comme Lénine et Trotsky, des hommes d'actions, des tribuns et des polémistes, que des philosophes et des économistes, les hommes qui l'ont été dans la 2ème ou la 3ème Internationale étaient très souvent en dehors du mouvement pratique révolutionnaire et en tout cas dans des périodes de recul du cours révolutionnaire.
Lénine entre 1900 et 1924, a été poussé par le flot de la révolution montante, toute son œuvre est palpitante de l'âpreté de cette lutter de ses hauts et de ses bas, de toute sa tragédie historique et humaine avant tout. Son œuvre est surtout politique et polémique, de combat. Son œuvre essentielle pour le mouvement ouvrier est donc surtout cet aspect politique et non sa philosophie et ses études économiques d'une qualité plus douteuse, parce que manquant de profondeur dans l'analyse, de connaissances scientifiques et de possibilités de synthèse théorique. A coté de cette houleuse situation historique de la Russie, la situation calme de la Hollande en marge de la lutte de classe d'Allemagne, permet le développement idéologique d'un Harper, dans une période de reflux de la lutte de classe.
Harper attaque violemment Lénine dans son point faible, en laissant dans l'ombre la partie la plus importante et la plus vivante de son neutre, et il tombe à faux quand il veut en tirer des conclusions sur la pensée de Lénine et sur le sens de la portée de son neutre.
D'incomplètes et erronées quant à Lénine, les conclusions de Harper tombent dans des platitudes journalistiques quant à celles qu'il tend à tirer sur la révolution russe dans son ensemble. Pour ce qui est de Lénine, cela prouve qu'il n'a rien compris à son œuvre principale pour s'attacher à ''Matérialisme et Empiriocriticisme'' uniquement. Pour ce qui est de la révolution russe, c'est beaucoup plus grave et nous y reviendrons.
(A suivre)
Philippe
Courants politiques:
- Le Conseillisme [94]
Heritage de la Gauche Communiste:
Correspondance internationale : contre la guerre Pérou-équateur
- 3424 lectures
Nous publions ci-dessous un tract rédigé et diffusé par des contacts en Equateur au moment de la guerre Pérou-Equateur en janvier 1981.
Les évasements guerriers qui en ce moment provoquent des morts et des tensions entre des populations du Pérou et d'Equateur ont une explication historique et matérielle. La paix dans le capitalisme n'est pas autre chose que la continuation de la guerre par des moyens diplomatiques. Les Etats capitalistes s'arment pour défendre leur base territoriale et les ressources sur les- quelles se développe le processus d'accumulation.
Au nom de la souveraineté nationale, les bourgeoisies nationales demandent au peuple de verser son sang pour sauvegarder ses intérêts économiques.
Ce n'est pas une coïncidence si peu de jours après que l'impérialisme ait installé aux commandes de l'Etat un gouvernement conservateur, se soient réveillés les foyers guerriers de ces pays semi-coloniaux. La crise du capitalisme est une crise mondiale qui conduit follement les sociétés du capital vers la guerre. Les USA ont reçu le poids de la crise avec force: mais ils ont la capacité politique, le pouvoir militaire et le pouvoir économique pour le transférer vers les sociétés dépendantes de la périphérie. L'enjeu est de taille.
Les courants de démocratisation des peuples en Amérique Latine qui, pour la plupart , se déguisent avec les droits de 1'homme, n'ont cessé de constituer un déséquilibre pour les plans et les stratégies globales de 1'impérialisme. Quand les affrontements du capitalisme international, menés par les deux grandes puissances, sont des affrontements de blocs, 1'impérialisme yankee essaie d'homogénéiser les gouvernements sous des régimes militaires marionnettes qui peuvent répondre d'une seule voix aux patrons du nord. D'un autre côté, 1a revitalisation de 1'économie yankee, qui souffre des effets de la crise capitaliste - étroitesse de la base d’accumulation, inflation, saturation des marchés, difficultés a trouver des investissements productifs , chômage massif et tensions - nécessite de se consolider à travers une concurrence guerrière . Ainsi la balance des paiements yankee peut tendre vers un équilibre, imbibé du sang des ouvriers et des paysans d ' Equateur et du Pérou.
En temps de guerre, il n'y a ni agresseur, ni agressé. Chaque Etat essaie de justifier la raison de sa lutte par la déraison de l'ennemi. Avec le nationalisme, il essaie de mater le prolétariat et de le lancer dans la défense de ses ressources, les ressources de la bourgeoisie. Le territoire équatorien et le territoire péruvien ne sont pas ceux des équatoriens et des péruviens. Ils appartiennent à la bourgeoisie. Les soldats du peuple, équatoriens et péruviens doivent prendre les armes et tirer en 1’air. L’ennemi, c'est le capital.
La crise du capitalisme mondial se manifeste avec une profonde gravité pour les peuples des pays périphériques et dépendant de l'impérialisme yankee. Cette crise est relativement plus profonde au Pérou où les gens, particulièrement dans les villes s'entassent dans les rues à la recherche d'emplois et de nourriture. L'inflation et le coût de la vie au Pérou amènent à un état de décomposition et de tension sociale qui peuvent être difficilement contrôlés sauf par la répression et les armes. La bourgeoisie péruvienne, influencée par une politique continentale formulée bien avant que Reagan ne vienne au pouvoir, a opté pour lancer l'armée péruvienne dans une invasion. Ainsi, les contradictions que provoque le capital - la misère humaine, la famine la malnutrition, le chômage - peuvent être oubliées temporairement au nom de l’unité nationale.
La politique du cow-boy Reagan vis-à-vis de l'Equateur a aussi son explication. Un gouvernement social-démocrate en gestation, qui s'exprime faiblement par Roldos, contaminé par la démocratie- chrétienne, alliée de l'impérialisme, a porté comme drapeau national le drapeau mystificateur des droits de l'homme. Dans le peu de temps de vie démocratique, les alliés extérieurs de l'Equateur sont les pays les plus faibles politiquement de l'Amérique Latine : E1 Salvador et le Nicaragua. Le Mexique ne constitue pas un allié direct, malgré la coïncidence de quelques thèses avec le gouvernement capitaliste équatorien. Isoler l'Equateur, le mettre dans une situation de dépendance plus grande, déstabiliser la fausse démocratie qui, de toute manière. se trouve être une barrière au pian de subordination continental, est le plan de l'impérialisme. Ainsi, le pétrole coulera avec plus de fluidité, les armes se vendront plus, les multinationales ne trouveront plus d'obstruction à l'intérieur du Pacte Andin, et en politique, l'impérialisme pourra instaurer une démocratie dictatoriale menée par la démocratie-chrétienne.
Le peuple sortira dans la rue mobilisé par la droite du capital. Il coulera beaucoup de sang si les négociations diplomatiques n'aboutissent pas, au nom de l’impérialisme, du nationalisme, et avec la bénédiction internationale du pape qui appellera sans doute à la paix des peuples.
Les prolétaires du monde n'ont pas de patrie ; leur véritable ennemi est le capital. C'est le moment de prendre les terres et les usines, au Pérou et en Equateur.
CCI
REPONSE DU C. C. I.
Les maîtres des médias, à l'Est comme à l'Ouest, entretiennent depuis des décennies un chiche publicitaire : en Amérique Latine, la révolte contre la misère est toujours et inévitablement une révolte patriotique, nationaliste. Son symbole-vedette serait Guevara dont on vend l'image imprimée sur des tee-shirts ou des cendriers.
Et pourtant, s'il est une partie du monde où, depuis 1968, la classe ouvriers a commencé à relever la tête en se situant sur son propre terrain de classe, s'opposant non seulement à 1''impérialisme yankee'' mais aussi à ''son'' capital national, aux patrons ''patriotes '' et aux exploiteurs ''autochtones'' c'est en Amérique du sud. Les luttes massives et violentes des ouvriers de l'automobile en Argentine en 1969, les grèves des mineurs chiliens sous le gouvernement Allende (grèves que Fidel Castre a tenté en personne d'arrêter au nom durera défense de la patries), les grèves des mineurs boliviens, les luttes des ouvriers du pétrole et des mineurs de fer au Pérou au début de 1981, la récente grève massive des métallurgistes de Sac Prolo au Brésil , ce ne sont là que quelques-uns des plus puissants mouvements de la classe ouvrière sur ce continent.
Ces luttes prolétariennes ont mis en question le nationalisme plus de façon intrinsèque, dans les faits - par le refus de faire des distinctions entre capitaux du pays et capitaux étrangers - que de manière explicite et claire. Il n'y a pas encore de force politique prolétarienne importante capable de défendre et impulser de façon explicite le contenu internationaliste des luttes ouvrières elles-mêmes, qui plus est, c'est dans les organisations politiques plus spécialisées dans l'encadrement des travailleurs que se recrutent les éléments les plus nationalistes.
Fin janvier 1981 une ''guerre'' a éclaté entre le Pérou et l'Equateur ; l'enjeu : des territoires qui pourraient éventuellement recéler du pétrole et sur le plan interne de chaque pays, une tentative de rétablir ''l'enthousiasme nationaleste'' et le fouet des lois militaires, un minimum d'unité nationale, en particulier au Pérou violemment secoué par des luttes ouvrières à la fin 1980.
Comme d'habitude, toutes les forces politiques ''nationalistes'', des militaires aux syndicalistes radicaux, ont appelé, au Pérou comme en Equateur, les prolétaires et les paysans à la défense de ''leur'' patrie.
C'est dire l'importance qu'a dans ces conditions une voix, aussi faible soit-elle, qui se dresse dans un des pays belligérants pour dire : ''Au nom de la souveraineté nationale, les bourgeoisies nationales demandent au peuple de verser son sang pour sauvegarder ses intérêts économiques. Les prolétaires du monde n'ont pas de patrie, leur véritable ennemi est le capital. Une telle voix exprime le mouvement réel et profond qui murit dans les entrailles de la société capitaliste mondiale et doit le prolétariat inter national est le premier protagoniste.
Le texte publié ci-dessus a été rédigé et diffusé en Equateur pendant les évasements. Il est signé CCI mais il ne s'agit pas d'un texte de notre organisation. Les camarades qui ont élaboré ce texte ont probablement choisi de signer ainsi par sympathie avec nos idées ; en aucun cas parce qu'ils feraient partie de notre organisation.
L'aspect essentiel de ce texte réside dans sa claire position internationaliste. Le document aborde cependant d'autres questions. Parmi elles, celle de la ''démocratie'' en Amérique Latine et ses rapports avec l'impérialisme US. Et à ce sujet, ,il est écrit que le plan de 1’impérialisme (...) est de déstabiliser la fausse démocratie qui de toute manière se trouve être une barrière au plan de subordination continentales. Une telle formulation laisse entendre que la mise en place dans les pays d'Amérique Latine de mascarades démocratiques irait à l'encontre des plans de l’impérialisme US dans la région.
Dans la période actuelle et dans les pays semi coloniaux, le problème n°1 pour la métropole de l'empire US, c'est de s'assurer d'un minimum de stabilité : stabilité du pays sous la botte du bloc, stabilité sociale, entre autre pour diminuer tout risque de ''déstabilisation'' par l'infiltration des partis prosoviétiques dans les mouvements sociaux.
Dans les pays sous-développé, où l'armée constitue la seule force administrative cohérente et centralisée è l'échelle nationalistes dictatures militaires constituent le moyen le plus simple de constituer une structure de pouvoir. Mais lorsque le développement de mouvements sociaux, ouvriers, ''incontrôlés'' menace trop l'ordre social, les USA savent à l'occasion mettre en place des régimes ''plus démocratiques, permettant essentiellement l'existence au grand jour de véritables appareils d'encadrement des travailleurs (partis ''de gauche'', syndicats). Ces démocraties ne sont en général que des paravents qui couvrent le pouvoir réel et maintenu de l'armée. Les stratèges du capital américain responsables de la stabilité de la région peuvent aussi bien s'accommoder de régimes militaires durs que de ''démocraties'' tout aussi dures d'ailleurs, du moment qu'ils pensent que celle contribue à maintenir l'ordre.
Il s'agit peut-être dans le texte simplement d'une question de formulation peu précise. Ainsi, quelques lignes plus loin, il est question de « démocratie dictatoriale menée par la démocratie chrétienne » comme « plan de l’impérialisme ». Mais alors pourquoi tous ces développement sur les pays « alliés de l’Equateur » ?
Si le nationalisme est un piège pour les ouvriers d’Amérique Latine, la démocratie bourgeoise en est un autre. Les ouvriers chiliens savent à quel prix ils ont dû payer leurs illusions sur Allende et les appels à rester fidèle à l’armée nationale « démocratique ». ([1] [167]).
C’est pourquoi il est indispensable d’éviter toute ambiguïté sur la question.
[1] [168] Au lendemain du coup d’Etat qui avait échoué, Allende avait convoqué des meetings de masse pour appeler la population au calme et à obéir aux troupes restées fidèles, il y avait fait applaudir entre autres noms celui de Pinochet….
Géographique:
Questions théoriques:
- Guerre [169]