Revue Int. 2007 - 128 à 131
- 4457 reads
Revue Internationale n° 128 - 1er trimestre 2007
- 3205 reads
Editorial - Du Moyen-Orient à l'Afrique : Quand le chaos atteint des sommets
- 2866 reads
La situation dramatique du Moyen-Orient livré au chaos révèle le cynisme et la duplicité profonde de la bourgeoisie de tous les pays. Chaque bourgeoisie prétend en effet apporter la paix et établir davantage de justice ou de démocratie pour les populations qui subissent quotidiennement ces horreurs et ces massacres depuis des années. Mais ces beaux discours ne servent qu'à masquer la défense de sordides intérêts impérialistes concurrents et à justifier des interventions qui constituent le facteur prépondérant de l'aggravation des conflits et de l'accumulation de la barbarie guerrière du capitalisme. Ce cynisme et cette hypocrisie viennent également d'être confirmés par un événement récent, l'exécution précipitée de Saddam Hussein, illustrant, sur un autre plan, les sanglants règlements de compte entre fractions rivales de la bourgeoisie.
Pourquoi l'exécution précipitée de Saddam Hussein ?
Le jugement et l'exécution de Saddam Hussein ont été salués spontanément par Bush comme une "victoire de la démocratie". Il y a une part de vérité dans cette déclaration : c'est souvent au nom de la démocratie et de sa défense présentée comme l'idéal de la bourgeoisie que celle-ci a perpétré ses règlements de compte ou ses crimes. Nous avons déjà consacré un article de cette revue à le démontrer (Lire Revue Internationale n°66 [1], 3e trimestre 1991, "Les massacres et les crimes des grandes démocraties"). Avec un cynisme sans bornes, Bush a également osé déclarer le 5 novembre 2006, à l'annonce du verdict de la condamnation à mort de Saddam Hussein, alors qu'il était lui-même en pleine campagne électorale dans le Nebraska, que cette sentence pouvait apparaître comme une "justification des sacrifices consentis par les forces américaines" depuis mars 2003 en Irak. Ainsi, pour Bush, la peau d'un assassin valait celle de plus de 3000 jeunes Américains tués en Irak (soit davantage de victimes que la destruction des Twin Towers), la plupart à la fleur de l'âge ! Et il ne compte pour rien la peau de celles des centaines de milliers d'Irakiens depuis le début de l'intervention américaine. En fait, depuis l'occupation des troupes américaines, il y a eu plus de 600 000 morts côté irakien que le gouvernement irakien vient d'ailleurs de décider de ne plus décompter pour ne pas "saper le moral" de la population.
Les Etats-Unis étaient au plus haut point intéressés à ce que l'exécution de Saddam Hussein ait lieu avant que ne se tiennent les procès suivants. La raison en est qu'ils ne tenaient en rien à ce que soient évoqués trop d'épisodes compromettants pour eux. Il s'agit de faire le maximum pour ne pas rappeler le soutien total des Etats-Unis et des grandes puissances occidentales à la politique de Saddam Hussein entre 1979 et 1990, à commencer par la guerre entre l'Irak et l'Iran (1980 -88).
En effet, un des multiples chefs d'accusation requis contre Saddam Hussein dans l'un de ces procès concernait le gazage à l'arme chimique de 5000 Kurdes à Halabjah en 1988. Ce massacre intervenait dans le cadre et à la fin de la guerre entre l'Irak et l'Iran, qui a fait plus de 1.200.000 morts et deux fois plus de blessés et d'invalides. C'était alors les Etats-Unis et, derrière eux, la plupart des puissances occidentales qui soutenaient et armaient Saddam Hussein. Prise par les Iraniens, cette ville avait été reprise par les Irakiens qui avaient décidé d'une opération de représailles à l'encontre de la population kurde. Ce massacre n'était d'ailleurs que le plus spectaculaire au sein d'une campagne d'extermination baptisée "'Al Anfal"("le butin de guerre") qui fit 180.000 victimes parmi les Kurdes irakiens entre 1987 et 1988.
Lorsque, à l'époque, Saddam Hussein initie cette guerre en attaquant l'Iran, il le fait avec le plein soutien de toutes les puissances occidentales. Face à l'avènement d'une république islamiste chiite en 1979 en Iran où l'ayatollah Khomeiny se permettait de défier la puissance américaine en qualifiant les Etats-Unis de "grand Satan" et que le président démocrate de l'époque, Carter, avait échoué à le renverser, Saddam Hussein a joué le rôle de gendarme de la région pour le compte des Etats-Unis et du camp occidental en lui déclarant la guerre et en la faisant durer pendant 8 ans, pour affaiblir l'Iran. La contre-attaque iranienne aurait d'ailleurs amené ce pays à la victoire si l'Irak n'avait pas bénéficié du soutien militaire américain sur place. En 1987, le bloc occidental sous la houlette des Etats-Unis avait mobilisé une formidable armada dans les eaux du Golfe persique avec le déploiement de plus de 250 bâtiments de guerre en provenance de la quasi-totalité des pays occidentaux, avec 35.000 hommes à leur bord et équipés des avions de guerre les plus sophistiqués de l'époque. Cette armada, présentée comme une "force d'interposition humanitaire", a détruit, notamment, une plate-forme pétrolière et plusieurs des navires les plus performants de la flotte iranienne. C'est grâce à ce soutien que Saddam Hussein a pu signer une paix le ramenant sur les mêmes frontières qu'au moment où il avait déclenché les hostilités.
Déjà, Saddam Hussein était parvenu au pouvoir, avec le soutien de la CIA, en faisant exécuter ses rivaux chiites et kurdes mais aussi les autres chefs sunnites au sein du parti Baas, accusés à tort ou à raison de fomenter des complots contre lui. Il a été courtisé et honoré pendant des années par ses pairs comme un grand homme d'Etat (devenant par exemple le "grand ami de la France" - et de Chirac et Chevènement en particulier). Le fait qu'il se soit distingué tout au long de sa carrière politique par des exécutions sanguinaires et expéditives en tous genres (pendaisons, décapitation, tortures des opposants, gazage à l'arme chimique, charniers de populations chiites ou kurdes) n'a jamais gêné le moindre homme politique bourgeois jusqu'à ce que l'on "découvre", à la veille de la guerre du Golfe de 1991 qu'il était un affreux tyran sanguinaire[1], ce qui lui valut à cette époque le "titre" de "boucher de Bagdad" qui ne lui avait pas pourtant été "décerné" lorsque précédemment il était l'exécutant sanguinaire de la politique occidentale. Il faut également rappeler que Saddam Hussein était tombé dans un piège quand il a cru bénéficier du feu vert de Washington lors de son invasion du Koweït à l'été 1990, fournissant le prétexte aux Etats-Unis pour engager la plus monstrueuse opération militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi qu'ils ont monté la première guerre du Golfe, en janvier 1991, en désignant dès lors Saddam Hussein comme l'ennemi public n°1. L'opération montée sous la houlette américaine et baptisée par eux "Tempête du Désert ", que la propagande a voulu faire passer comme une guerre propre avec ses images de "war game" en vidéo, aura fauché près de 500.000 vies humaines en 42 jours, opéré 106.000 raids aériens en déversant 100.000 tonnes de bombes, expérimentant toute la gamme des armes les plus meurtrières (bombes au napalm, à fragmentation, à dépression...). Elle avait pour but essentiel de faire une démonstration de la suprématie militaire écrasante des Etats-Unis dans le monde et de forcer leurs anciens alliés du bloc de l'Ouest, devenus leurs plus dangereux rivaux impérialistes potentiels, à y participer derrière eux. Il s'agissait ainsi de donner un coup d'arrêt à la tendance de ces derniers à vouloir se dégager de la tutelle américaine depuis la dissolution du bloc de l'Ouest et des alliances qui le sous-tendaient.
Avec le même machiavélisme, les Etats-Unis et leurs "alliés" ont ourdi une autre machination. Après avoir appelé les Kurdes au Nord et les Chiites au Sud à se soulever contre le régime de Saddam Hussein, ils ont laissé dans un premier temps intactes les troupes d'élite du dictateur pour lui permettre cyniquement de noyer dans le sang ces rébellions, n'ayant aucun intérêt à voir remettre en cause l'unité du pays, la population kurde en particulier étant livrée une nouvelle fois à d'atroces massacres.
Les médias européens aux ordres et jusqu'au très pro-américain Sarkozy en France lui-même peuvent hypocritement dénoncer aujourd'hui "le mauvais choix", "l'erreur", "la maladresse" que constituerait l'exécution précipitée de Saddam Hussein. Pas plus que la bourgeoisie américaine, la bourgeoisie des pays d'Europe occidentale n'a intérêt à ce que soit rappelée la part qu'elle a pris à tous ces crimes, même au travers du prisme déformant des "procès" et "jugements". Il est vrai que les circonstances de cette exécution débouchent sur un regain d'exacerbation des haines entre communautés : elle s'est déroulée alors qu'avait débuté la période de l'Aïd, la plus grande fête religieuse de l'année pour l'islam, ce qui pouvait plaire à la partie la plus fanatisée de la communauté chiite vouant une haine mortelle à la communauté sunnite à laquelle appartenait Saddam Hussein ; elle ne pouvait par contre qu'indigner les Sunnites et choquer la plupart des populations de confession musulmane. De plus, Saddam Hussein a pu être présenté, auprès des générations qui n'ont pas connu sa férule, comme un martyr.
Mais toutes les bourgeoisies n'avaient pourtant pas d'autre choix car elles partagent le même intérêt que l'administration Bush à cette exécution hâtive qui permet de masquer et de faire oublier leurs propres responsabilités et leur entière complicité face à ces atrocités qu'elles continuent à alimenter aujourd'hui. Les sommets de barbarie et de duplicité atteints au Moyen-Orient ne sont en fait qu'un concentré révélateur de l'état du monde, ils constituent le symbole de l'impasse totale du système capitaliste qui est de mise partout ailleurs[2]
La fuite en avant guerrière au Moyen-Orient
Les récents développements du conflit entre Israël et les différentes fractions palestiniennes, de même que l'intensification des affrontements entre ces différentes fractions du camp palestinien, ont atteint les sommets de l'absurdité. Ce qui frappe, c'est en effet comment les différentes bourgeoises en présence sont, par la dynamique de la situation et la force des contradictions, amenées à prendre des décisions qui sont tout à fait contradictoires et irrationnelles, y inclus du point de vue de leurs intérêts stratégiques à court terme.
Lorsque Ehoud Olmert tend la main au président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avec à la clé quelques concessions faites aux Palestiniens, notamment concernant la levée de quelques barrages ou la promesse de débloquer 100 millions de dollars au nom de "l'aide humanitaire", les médias parlent aussitôt de relance du processus de paix au Proche-Orient et Mahmoud Abbas fait valoir cette avancée, face à son rival du Hamas, car ces pseudo-concessions sont censées faire la preuve de la validité de sa politique de coopération avec Israël en permettant d'obtenir des "avantages".
Mais c'est Ehoud Olmert lui-même qui saborde en partie ces quelques atouts qu'il partageait avec le président de l'Autorité palestinienne, lorsqu'il est contraint, le lendemain, sous la pression des fractions ultra-conservatrices de son gouvernement, de prendre la décision de renouer avec la politique d'implantations de colonies israéliennes dans les territoires occupés et d'accélérer la destruction d'habitations palestiniennes à Jérusalem.
Les accords entre le Fatah et Israël avaient pour conséquence l'autorisation donnée par cette dernière à l'Egypte de livrer des armes au Fatah pour le favoriser dans sa lutte contre le Hamas. Cependant l'énième sommet de Charm-el-Cheikh entre Israël et l'Egypte a été totalement parasité par une nouvelle opération militaire de Tsahal à Ramallah en Cisjordanie et par une reprise des raids aériens dans la Bande de Gaza, en réponse à de sporadiques tirs de roquettes. Ainsi, les messages d'apaisement ou les proclamations d'une volonté de renouer les fils du dialogue sont singulièrement brouillés et les intentions d'Israël apparaissent totalement contradictoires.
Autre paradoxe, c'est au moment où Olmert et Abbas se rencontrent, ou encore juste avant le sommet israélo-égyptien, qu'Israël se proclame puissance nucléaire et menace directement d'utiliser la bombe atomique. Bien que cette menace ait été essentiellement dirigée contre l'Iran qui vise le même statut, elle vaut aussi indirectement pour tous ses voisins. Comment entamer des pourparlers avec un interlocuteur si dangereux et belliqueux ?
De plus, cette déclaration ne peut que pousser l'Iran à poursuivre dans cette voie et à légitimer ses ambitions de devenir le bouclier et le gendarme de la région, dans la même logique de détention d'une "force de dissuasion" que toutes les grandes puissances.
Mais I'Etat hébreu n'est pas seulement en cause. Tout se passe comme si chaque protagoniste devenait incapable de s'orienter pour assurer la défense de ses intérêts.
De son côté, Abbas a pris le risque de déclencher l'épreuve de force avec les milices du Hamas et a mis le feu aux poudres en annonçant sa volonté de recourir à des élections anticipées à Gaza, ce qui ne pouvait être vécu par le Hamas "démocratiquement élu" que comme une véritable provocation. Mais cette épreuve de force qui s'est traduite par de sanglants combats de rue était le seul moyen pour l'Autorité palestinienne de chercher à sortir du blocus israélien et du gel de l'aide internationale depuis l'arrivée au pouvoir du Hamas. Non seulement ce blocus s'avère catastrophique pour les populations incapables d'aller travailler hors des territoires bouclés par la police et l'armée israéliennes mais il a aussi suscité la grève de 170.000 fonctionnaires palestiniens dont les salaires ne sont plus payés dans la Bande de Gaza comme en Cisjordanie depuis des mois (notamment dans des secteurs aussi vitaux que l'enseignement et la santé). La colère des fonctionnaires, qui s'étend jusque dans les rangs de la police ou de l'armée, est exploitée aussi bien par le Hamas que le Fatah comme base de recrutement dans leurs milices respectives, selon que la responsabilité de cette situation est imputée à un camp ou à l'autre, alors que des gamins entre 10 et 15 ans continuent à se retrouver massivement enrôlés comme chair à canon dans ces tueries.
De son côté, le Hamas cherche à exploiter cette situation de chaos pour tenter de négocier directement avec Israël un échange de prisonniers entre le caporal israélien enlevé en juin 2006 et ses activistes.
Le chaos sanglant issu de la cohabitation explosive depuis un an entre le gouvernement élu du Hamas et le président de l'Autorité palestinienne reste la seule perspective. Face à cette politique qui ne peut qu'affaiblir considérablement chaque partie, la trêve décidée en fin d'année entre les milices du Fatah et celle du Hamas ne peut faire illusion. Elle ne cesse d'être émaillée d'affrontements meurtriers : attentats à la voiture piégée, combats de rue, enlèvements à répétition reprennent de plus belle, semant la terreur et la mort parmi les populations de la bande de Gaza déjà réduites à la misère. Et pour couronner le tout, les raids israéliens en Cisjordanie ou les interventions musclées de la police israélienne lors de contrôles constituent autant de "dérapages" supplémentaires : des enfants, des écoliers sont régulièrement tués dans ces multiples règlements de compte. Le prolétariat israélien déjà saigné à blanc par l'effort de guerre se retrouve tout aussi exposé aux opérations de représailles lancées par le Hamas d'un côté et le Hezbollah de l'autre.
En même temps, la situation n'est pas davantage sécurisée au Sud-Liban où sont déployées les forces de l'ONU. Depuis l'assassinat du leader chrétien Pierre Gemayel en novembre 06, l'instabilité règne. Alors que le Hezbollah et des milices chiites (ou chrétiennes du général Aoun provisoirement rallié à la Syrie) se livraient à une démonstration de force en assiégeant pendant plusieurs jours le palais présidentiel à Beyrouth, parallèlement, des groupes armés sunnites menaçaient le parlement libanais et son président chiite Nabil Berri. La tension entre fractions rivales est à son comble. Quant à la mission de l'ONU, désarmer le Hezbollah, personne ne peut la prendre au sérieux.
En Afghanistan, le déploiement de 32.000 soldats des forces internationales de l'OTAN et de 8500 soldats américains, reste inefficace. Les combats contre Al Qaïda et les talibans qui ont effectué une centaine d'attaques dans le Sud du pays, s'enlisent inexorablement. Le bilan de cette guérilla est de 4000 morts pour la seule année 2006. Le Pakistan, en principe allié des Etats-Unis, ne cesse en même temps de servir de base arrière aux talibans et à Al Qaïda.
Chaque Etat, chaque fraction est poussée en avant dans l'aventure guerrière, malgré les revers subis.
'impasse la plus révélatrice est celle de la première puissance du monde. La politique de la bourgeoisie américaine est la première en proie à ces mêmes contradictions. Alors que le rapport Baker, ancien conseiller de Bush père et diligenté par le gouvernement fédéral, dresse un constat d'échec de la guerre menée en Irak, et préconise un changement d'orientation, prônant d'une part une ouverture diplomatique envers la Syrie et l'Iran, d'autre part un retrait graduel des 144.000 soldats américains embourbés sur le sol irakien, à quoi assiste-t-on ? Bush Junior, contraint au renouvellement partiel du gouvernement, notamment le remplacement de Rumsfeld par Robert Gates au secrétariat d'Etat à la Défense, se contente de faire tomber quelques têtes à qui il fait porter la responsabilité du fiasco de la guerre en Irak (l'exemple le plus récent est le limogeage des deux principaux chefs de l'état-major des forces d'occupation en Irak, qui se sont d'ailleurs opposés au déploiement de nouvelles forces américaines à Bagdad, ne croyant pas à l'efficacité d'une telle mesure). Mais surtout il décide un renforcement des troupes américaines en Irak, 21 500 recrues supplémentaires qui devraient être envoyées prochainement sur le front irakien pour "sécuriser" Bagdad, alors que, d'ores et déjà, ce sont des réservistes qui sont mobilisés d'office. Le changement de majorité au Congrès et jusqu'au Sénat américain désormais dominé par le camp des démocrates n'y change rien : tout désengagement ou tout refus de débloquer de nouveaux crédits militaires pour la guerre en Irak serait perçu comme un aveu de faiblesse des Etats-Unis, de la nation américaine dont le camp démocrate ne veut pas assumer la responsabilité. Toute la bourgeoisie américaine, comme chaque clique bourgeoise ou chaque Etat, se retrouve bel et bien coincée dans un engrenage guerrier où chaque décision, chaque mouvement l'enferre davantage dans une fuite en avant irrationnelle pour défendre ses intérêts impérialistes face à ses rivaux.
Le continent africain : une autre illustration édifiante de la barbarie capitaliste
Les atrocités guerrières s'exercent quotidiennement depuis des années sur le continent africain.
Après des décennies de massacres autour du Zaïre et du Rwanda, après les affrontements de clans en Côte d'Ivoire, déjà attisés par les rivalités entre grandes puissances, de nouvelles régions se retrouvent à feu et à sang.
Au Soudan, la "rébellion" contre le gouvernement pro-islamiste de Khartoum est aujourd'hui morcelée en une myriade de différentes fractions qui se combattent entre elles, instrumentalisées par telle ou telle puissance dans un jeu d'alliances de plus en plus précaire. En trois ans, la région du Darfour à l'Ouest du Soudan aura connu 400 000 morts et plus d'un million et demi de réfugiés, les centaines de villages que les populations occupaient naguère, ont été entièrement détruits et celles-ci s'entassent désormais dans des camps immenses, mourant de faim, de soif, d'épidémies en plein désert, subissant périodiquement les pires exactions de la part de différentes bandes armées comme des forces gouvernementales soudanaises. L'exode des rebelles a conduit à l'extension et à l'exportation du conflit ailleurs même qu'au Darfour, notamment en Centrafrique et au Tchad, ce qui pousse la France à s'impliquer militairement de plus en plus dans la région pour préserver les derniers bastions de ses "chasses gardées" en Afrique, en particulier en participant activement aux combats contre le pouvoir soudanais depuis le sol tchadien.
Depuis le renversement de l'ancien dictateur-président Siyad Barré en 1990, accompagnant la chute de son protecteur, l'URSS, la Somalie est un pays livré au chaos, miné par une guerre continuelle entre d'innombrables clans, qui sont autant de gangs mafieux et de bandes armées de pillards, des véritables tueurs à gages vendant leurs services au plus offrant, faisant régner la terreur et semant la misère et la désolation sur tout le territoire. Les puissances occidentales qui s'étaient ruées entre 1992 et 1995 sur ce pays ont dû battre en retraite face à l'ampleur du chaos et de la décomposition ; le débarquement spectaculaire des "marines" américains s'était lui-même soldé par un fiasco piteux en 1994, laissant la place à l'anarchie la plus totale. Les tueries entre ces cliques sanguinaires rivales ont fait 500.000 morts depuis 1991.
L'Union des tribunaux islamiques qui constituait une de ces bandes sous le vernis de la charia et d'un islam "radical" s'était finalement emparée de la capitale Mogadiscio, avec quelques milliers d'hommes armés, en mai 2006. Le gouvernement de transition réfugié à Baidoa a alors appelé son puissant voisin, l'Ethiopie à la rescousse[3]. L'armée éthiopienne, avec le soutien ouvert des Etats-Unis, a bombardé la capitale, faisant fuir en quelques heures les troupes islamistes, dont le plus grand nombre a gagné le Sud du pays. Mogadiscio est un effroyable champ de ruines dont la population misérable est réduite à vivre d'expédients. Un nouveau gouvernement provisoire, soutenu à bout de bras par l'armée éthiopienne, s'y est installé mais sans aucune autorité politique comme le montre le fait que sa demande à la population de rendre les armes soit restée sans effet. Après la victoire éclair de l'Ethiopie, la trêve elle aussi ne pouvait être que provisoire et précaire car les "rebelles" islamistes sont en train de se réarmer notamment à travers la frontière poreuse du Sud avec le Kenya. Mais les rebelles peuvent bénéficier d'autres points d'appui, au Soudan, en Erythrée- adversaire traditionnel de l'Ethiopie - ou au Yémen. Cette situation incertaine ne pouvait qu'inquiéter les Etats-Unis dans la mesure où la corne de l'Afrique, avec la base de Djibouti et le pont qu'offre la Somalie vers l'Asie et le Moyen-Orient, constitue une zone parmi les plus stratégiques du monde. Ceci a incité les Etats-Unis à intervenir directement le 8 janvier pour bombarder le Sud du pays où se sont réfugiés les "rebelles" dont la Maison Blanche prétend qu'ils sont directement manipulés et sous l'emprise d'Al Qaïda.
Les Etats-Unis, la France ou toute autre grande puissance, chacune de son côté, ne peuvent nullement parvenir à jouer un rôle stabilisateur ni même constituer un frein au déchaînement de la barbarie guerrière, quel que soit le gouvernement en place, chez eux, en Afrique ou n'importe où ailleurs dans le monde. Au contraire, leurs intérêts impérialistes les pousseront toujours davantage à propager les tueries.
L'enfoncement d'une partie de plus en plus étendue de l'humanité dans ce chaos et cette barbarie, les pires de toute l'histoire, est le seul avenir que nous réserve le capitalisme. La guerre impérialiste mobilise aujourd'hui toute la richesse de la science, de la technologie, du travail humain non pas pour apporter le bien-être à l'humanité, mais au contraire pour détruire ses richesses, pour accumuler les ruines et les cadavres. Cette guerre impérialiste qui dilapide un patrimoine édifié au fil des siècles d'histoire, et menace à terme d'engloutir et de détruire toute l'humanité, est une des expressions de l'aberration profonde de ce système.
Plus que jamais, le seul espoir possible réside dans le renversement du capitalisme, dans l'instauration de rapports sociaux libérés des contradictions qui étranglent la société, par la seule classe porteuse d'un avenir pour l'humanité : la classe ouvrière.
Wim (10 janvier)[1] D'ailleurs, un autre tyran de la région, le Syrien Hafez-el-Assad, éternel rival de Saddam, lui, sera resté au-delà de ses funérailles un "grand homme d'Etat", en compensation de son ralliement au camp occidental à l'époque des blocs, malgré une carrière aussi sanguinaire et l'usage des mêmes procédés que Saddam Hussein.
[2] Certains plumitifs de la bourgeoisie sont même capables de constater la nausée que provoque cette accumulation insoutenable de barbarie dans le monde actuel : "La barbarie châtiant la barbarie pour enfanter à son tour la barbarie. Une vidéo circulant sur Internet, dernière contribution au festival d'images de l'innommable, depuis les décapitations orchestrées par Zarkaoui jusqu'à l'amoncellement de chairs humiliées à Abou Ghraïb par les GI (...) Aux terribles services secrets de l'ex-tyran succèdent les escadrons de la mort du ministre de l'Intérieur dominés par les brigades Al-Badr pro-iraniennes. (...) Qu'ils se réclament de la terreur ben-ladiste, de la lutte contre les Américains ou qu'ils se disent les relais du pouvoir (chiite), les meurtriers qui enlèvent les civils irakiens ont un trait commun : ils opèrent sous la loi de la pulsion individuelle. Sur les décombres de l'Irak pullulent les charognards de toutes espèces, de tous clans. Le mensonge étant la norme, la police pratique le rapt et le brigandage, l'homme de Dieu décapite et éviscère, le Chiite applique au Sunnite le traitement qu'il a lui-même subi" (l'hebdomadaire français Marianne daté du 6 janvier). Mais cela est mis sur le compte de la "pulsion individuelle", et finalement de "la nature humaine". Ce qu'ils ne peuvent pas reconnaître et comprendre, c'est que cette barbarie est au contraire un produit éminemment historique, un produit du système capitaliste et qu'il existe historiquement une classe sociale tout aussi capable d'y mettre un terme : le prolétariat.
[3] L'Ethiopie, elle aussi ancien bastion de l'URSS, est devenue, depuis la fuite de Mengistu en 1991, la place forte des Etats-Unis dans la région de la Corne de l'Afrique.
Géographique:
- Afrique [2]
- Moyen Orient [3]
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [4]
Histoire du mouvement ouvrier - La CNT : Naissance du syndicalisme révolutionnaire en Espagne (1910-1913)
- 10121 reads
Dans la continuation de la série sur le syndicalisme révolutionnaire que nous publions depuis la Revue Internationale n°118 [5], nous débutons ici une étude de l’expérience de la CNT espagnole. Actuellement une nouvelle génération de travailleurs s’implique progressivement dans la lutte de classe contre le capitalisme. Dans le combat, de nombreuses questions sont soulevées. Une des plus récurrentes est la question syndicale. Alors que les grands syndicats suscitent une méfiance notoire, l’idée d’un "syndicalisme révolutionnaire" exerce une certaine attraction : s’organiser en dehors des structures de l’Etat en visant à unifier la lutte immédiate et la lutte révolutionnaire. L’étude des expériences de la CGT française et des IWW d'Amérique du Nord a démontré que cette idée est aussi irréalisable qu'utopique, mais le cas de la CNT, comme nous allons le voir, est encore plus éloquent de cette impossibilité.
Depuis le début du 20e siècle l’histoire a démontré, à travers des expériences répétées, que Syndicalisme et Révolution sont deux termes antithétiques, qu’il est impossible de réunir.
Les conditions du capitalisme espagnol et l'influence de l'anarchisme
Aujourd'hui, CNT et anarchisme se présentent, comme deux termes unis et inséparables. L’anarchisme, qui fut absent des grands mouvements ouvriers des 19e et 20e siècles[1], considère la CNT comme la preuve que son idéologie est à même d'agglomérer une grande organisation de masse ayant un rôle décisif dans les luttes ouvrières qui se déroulèrent en Espagne de 1919 à 1936. Cependant, ce ne fut pas l’anarchisme qui créa la CNT, puisqu'à son origine celle-ci s'était donnée une orientation syndicaliste révolutionnaire. Cela ne signifie pas que l’anarchisme fût absent à sa fondation et n’ait pas imprimé sa marque dans l’évolution de l’organisation. [2]
Comme nous l’avons exposé précédemment dans d’autres articles de cette série - nous n’y reviendrons pas ici - le syndicalisme révolutionnaire est une tentative de réponse aux nouvelles conditions historiques : la fin de l’apogée du capitalisme et son entrée progressive dans sa phase de décadence qui se manifestèrent clairement par la gigantesque hécatombe de la Première Guerre mondiale. Face à cette réalité, des secteurs de plus en plus nombreux de la classe ouvrière constataient l’opportunisme galopant des partis socialistes - corrompus par le crétinisme parlementaire et le réformisme -, ainsi que la bureaucratisation et le conservatisme des syndicats. Deux types de réponses se firent jour : d’un côté, une tendance révolutionnaire au sein des partis socialistes (la gauche constituée par des groupes dont les militants les plus en vue furent Lénine, Rosa Luxemburg, Pannekoek, etc.) et, de l’autre, le syndicalisme révolutionnaire.
Ces conditions historiques générales sont valables pour l’Espagne également, bien que dans ce cas elles soient marquées par le retard et les contradictions particulières du capitalisme espagnol. Deux de celles-ci eurent un poids décisif qui affecta négativement le prolétariat de l’époque.
La première de ces contradictions était l’absence évidente d’unification et de centralisation économiques réelles entre les divers territoires de la péninsule, ce qui générait une dispersion locale et régionale, donnant lieu à une prolifération de soulèvements dans le cadre des municipalités dont la plus importante fut l’insurrection républicaine cantonale de 1873. L’anarchisme, de par ses positions fédéralistes, était prédisposé à devenir le porte-parole de ces conditions historiques archaïques : l’autonomie de chaque municipalité ou territoire qui se déclarait souverain et n’acceptait que la fragile et aléatoire union du "pacte de solidarité". Comme le remarque Peirats[3] dans son ouvrage La CNT dans la révolution espagnole, "ce programme, celui de l’Alliance de Bakounine, convenait très bien au tempérament des espagnols déshérités. La version fédérale introduite par les bakouninistes était comme la pluie sur un sol mouillé puisqu’elle réactivait les réminiscences des droits locaux, des chartes villageoises et des municipalités libres du Moyen-Âge." (Page 3, tome I) [4]
Face au retard et aux différences explosives de développement économique entre les régions, l’État bourgeois, bien que formellement constitutionnel, s’était appuyé sur la force brute de l’armée pour donner de la cohésion à la société, déchaînant des répressions périodiques dirigées essentiellement contre le prolétariat et, dans une moindre mesure, contre les couches moyennes des villes. Non seulement les ouvriers et les paysans, mais aussi de larges couches de la petite bourgeoisie se sentaient complètement exclus d’un État théoriquement libéral mais violemment répressif, autoritaire, entre les mains de caciques, ce qui déconsidérait totalement la politique et le système parlementaire. Cela suscitait un apolitisme viscéral exprimé par l’anarchisme mais également très répandu dans le milieu ouvrier. Ces conditions générales entraînèrent, d’un côté, la faiblesse de la tradition marxiste en Espagne et, de l’autre, l’influence considérable de l’anarchisme. Le groupe autour de Pablo Iglesias [5] resta fidèle au courant marxiste dans l’AIT et forma en 1881 le Parti Socialiste. Cependant, cette organisation fut toujours affectée d’une extrême faiblesse politique, au point que Munis [6] disait que nombre de ses dirigeants n’avaient jamais lu aucun ouvrage de Marx : "Les ouvrages les plus fondamentaux et les plus importants de la pensée théorique n’avaient pas été traduits. Et ceux qui avaient été publiés, (le Manifeste communiste, l'Anti-Dühring, Misère de la Philosophie, Socialisme utopique et Socialisme scientifique) étaient davantage lus par les intellectuels bourgeois que par les socialistes. Les écrits ou les discours de Pablo Iglesias ainsi que ceux de ses héritiers, Besteiro, Fernando de los Rios, Araquistain, Pietro y Caballero, ignorent complètement le marxisme, quand ils ne le contredisent pas délibérément." (Jalons de Défaite, promesses de Victoire, pages 59) [7]. C'est pour cette même raison que ce parti a dérivé rapidement vers l’opportunisme qui en a fait l'un des partis les plus à droite de toute l’Internationale.
Concernant la tendance anarchiste, nous ne pouvons ici y consacrer l'étude détaillée nécessaire pour comprendre ses différents courants et les multiples positions qu’elle a adoptées. Il serait également nécessaire de distinguer une majorité de militants sincèrement dévoués à la cause prolétarienne et ceux qui se sont fait passer pour leurs dirigeants, lesquels en général, à part quelques exemples d'honnêteté, ont bafoué à chaque pas les "principes" dont ils se revendiquaient ostensiblement. Il suffit de rappeler les agissements ignominieux des partisans directs de Bakounine en Espagne lors de l’insurrection cantonaliste de 1873 qu’Engels dénonce si brillamment dans sa brochure "Les bakouninistes à l'oeuvre": "ces mêmes hommes qui se donnent le titre de révolutionnaires, d’autonomistes, anarchistes etc., se sont lancés dans la politique à cette occasion ; mais la pire des politiques, la politique bourgeoise ; ils n’ont pas œuvré pour donner le Pouvoir politique à la classe ouvrière, c’est une idée qui leur fait horreur, mais pour aider une fraction de la bourgeoisie à conquérir le Gouvernement. Laquelle fraction est constituée d’aventuriers, d'arrivistes et d’ambitieux, se disant républicains intransigeants." [8]
Après cet épisode, dans le contexte du reflux international des luttes qui suivit la défaite de la Commune de Paris, la bourgeoisie espagnole déchaîna une répression féroce qui allait se poursuivre de longues années. Dans ces conditions de terreur étatique et de confusion idéologique, le courant anarchiste n’avait que deux certitudes inébranlables : le fédéralisme et l’apolitisme. Au-delà de ces certitudes, il s'est débattu constamment dans un dilemme : fallait-il mener une action publique afin de créer une organisation de masse ? Ou bien mener une lutte minoritaire et clandestine sur la base du slogan anarchiste de "la propagande par le fait" ? Ce dilemme plongea le mouvement dans une complète paralysie. En Andalousie cette oscillation pendulaire prenait parfois la forme de "grève générale" consistant en soulèvements locaux isolés qui étaient facilement écrasés par la Garde civile et auxquels succédait une répression implacable. D’autres fois, elle prenait celle d’"actions exemplaires" (incendies des récoltes, mises à sac de fermes, etc.) que les gouvernements en place mettaient à profit pour déchaîner de nouvelles vagues de répression. [9]
La décennie 1900-1910 : la tendance internationale à la grève de masse
La CNT va naître à Barcelone, principale concentration industrielle d’Espagne, à partir des conditions historiques qui prédominaient à l’échelle mondiale dans la première décennie du 20e siècle. Comme nous l'avons vu ailleurs[10], la lutte ouvrière tendait à s’orienter vers la grève de masse révolutionnaire dont la Révolution Russe de 1905 constitue la manifestation la plus avancée.
En Espagne aussi, le changement de période historique s'est manifesté dans les nouvelles formes qu'ont tendu à prendre les réactions ouvrières. Deux épisodes, que nous allons relater brièvement ci-dessous, expriment cette tendance : la grève de 1902 à Barcelone et la Semaine Tragique de 1909 également à Barcelone.
La grève a démarré dans le secteur de la métallurgie en décembre 1901 pour réclamer la journée de 9 heures. Face à la répression et au refus des patrons, la solidarité du prolétariat barcelonais s’exprima dans les rues. Celle-ci se manifesta massivement et spontanément à la fin janvier 1902 sans qu’il y ait eu le moindre appel à la lutte de la part des organisations syndicales ou politiques. Pendant plusieurs journées, eurent lieu des réunions massives avec la participation d’ouvriers de tous les secteurs confondus. Cependant, du fait de son absence d’écho dans le reste du pays, la grève s'affaiblira progressivement. A cette situation contribuèrent, d’une part le sabotage ouvert de la part du Parti Socialiste qui en arriva même à bloquer les fonds de solidarité recueillis par les Trade Unions britanniques et, d'autre part, aussi, la passivité des sociétés de tendance anarchiste[11]. Par ailleurs, la Fédération de Travailleurs de la Région Espagnole nouvellement reconstituée en 1900 sur la base d'une orientation "apolitique"[12] était aussi absente en invoquant comme argument que "les ouvriers de l’industrie métallurgique de Barcelone n’avaient jamais appartenu à aucun groupement politique ou social et n’avaient en rien la mentalité pour s’associer"[13]. Cependant, cette expérience ébranla profondément les organisations ouvrières constituées puisqu’elle n'avait suivi aucun des "schémas" traditionnels de lutte : ni la grève générale conçue par les anarchistes ni les actions de pression dans un cadre sectoriel et strictement économique selon la vision des socialistes.
Ce qu'on a appelé "La Semaine Tragique" de 1909 a eu lieu à cause de la réponse populaire massive contre l'embarquement des troupes pour le Maroc[14]. A nouveau, ce mouvement s'est exprimé par la solidarité de classe active, l’extension des luttes et la conquête de la rue par les manifestations à partir de l’initiative directe des ouvriers sans aucune sorte d’appel ou planification préalable. La lutte économique et la lutte politique se sont unies. D'un côté, la solidarité de tous les secteurs ouvriers avec les grévistes du textile, principale industrie catalane, de l'autre, le refus de la guerre impérialiste manifesté dans la mobilisation contre l’embarquement de soldats pour la guerre du Maroc. Sous l’influence néfaste du républicanisme bourgeois, mené par le démagogue notoire Lerroux[15], le mouvement a dégénéré en actions violentes stériles dont les plus spectaculaires furent les incendies d’églises et de couvents. Le gouvernement profita de tout cela pour déchaîner une nouvelle vague de répression qui prit des formes particulièrement barbares et sadiques.
C'est dans ce contexte qu'est née en 1907 Solidarité Ouvrière (qui deviendra trois ans plus tard la CNT). Solidarité Ouvrière unit cinq tendances présentes dans le milieu ouvrier :
- le syndicalisme "pur", apolitique et corporatiste bien que fortement radical ;
- les socialistes catalans, qui agissaient pour leur propre compte, en marge des directives rigides et du schématisme du centre madrilène ;
- les syndicalistes révolutionnaires, une tendance récente, sortie des rangs des syndicats socialistes mais également influencée par l’anarchisme[16] ;
- les anarchistes qui étaient, en Catalogne, partisans de l’action syndicale ;
- et enfin, les adhérents du parti démagogue républicain de Lerroux déjà cité.
Ce qui domine, c'est le projet de constituer une seule organisation unitaire qui soude l’ensemble de la classe pour la lutte.
Au cours de ces années, les théories du syndicalisme révolutionnaire français circulent largement. Anselmo Lorenzo, anarchiste espagnol de premier plan, avait traduit en 1904 l’œuvre d’Emile Pouget, Le Syndicat ; José Prat traduisit et diffusa d’autres ouvrages comme ceux de Pouget, Pelloutier ou Pataud[17]. Le même Prat dans son ouvrage La Bourgeoisie et le Prolétariat (1908) résume l’essence du syndicalisme révolutionnaire en affirmant que celui-ci "n’accepte rien de l’ordre actuel ; il le subit en espérant avoir la force syndicale pour le détruire. Par des grèves de plus en plus généralisées, il révolutionne progressivement la classe ouvrière et l’achemine vers la grève générale. Sans négliger d’arracher à la bourgeoisie patronale toutes les améliorations immédiates pouvant être positives, son but est la transformation complète de la société actuelle en société socialiste, se passant dans son action de l'agent politique : révolutionnarisme économico-social."
La fondation de la CNT au Congrès de 1910
Solidarité Ouvrière avait prévu de tenir son Congrès fin septembre 1909 à Barcelone ; cependant le congrès ne put avoir lieu à cause des événements de la Semaine Tragique et de la répression qui s’ensuivit. Le Premier Congrès de la CNT se tint donc en 1910.
L’organisation qui s'est présentée depuis comme le modèle de l'anarcho-syndicalisme, surgit pourtant sur la base de positions du syndicalisme révolutionnaire : "il n’apparaît nulle part la plus petite référence à l’anarchisme, ni comme but, ni comme base d’action, ni comme principes, etc. Ni lors du Congrès au cours des discussions, ni dans ses résolutions ou les manifestes ultérieurs de la Confédération, il n'y a la moindre allusion au thème de l'anarchisme qui pourrait faire penser à une prédominance de ce courant politique ou, au moins, à son poids dans la nouvelle Confédération. Celle-ci apparaît comme un organisme totalement neutre, si comme tel on peut comprendre la pratique exclusive du syndicalisme révolutionnaire ; apolitique dans le sens où elle ne participe pas au jeu politique ou au processus de gouvernement de la société, mais politique dans le sens où elle se propose de remplacer le système actuel de gouvernement social par un système différent, basé sur la propre organisation syndicale" (A. Bar, La CNT dans les années rouges, page 223) [18]
Cela dit, il serait faux de croire que la CNT n’était pas influencée par les positions anarchistes. Le poids de celles-ci était évident sur les trois piliers du syndicalisme révolutionnaire que nous avons analysés dans les articles précédents de la série évaluant l’expérience de la CGT française et des IWW nord américains : l’apolitisme, l’action directe et la centralisation.
L’apolitisme
Comme nous avons vu dans les articles précédents de cette série, le syndicalisme révolutionnaire prétend surtout "se suffire à lui-même" : le syndicat doit offrir à la classe ouvrière son organisation unitaire de lutte, le moyen d’organisation de la société future, et même le cadre de sa réflexion théorique, même si l’importance de cette dernière est très largement sous-estimée. Les organisations politiques étaient souvent considérées moins comme nocives qu’inutiles. En France, ce courant produisit néanmoins des travaux théoriques et des réflexions, à travers lesquels, par exemple, ses positions parvinrent en Espagne. Mais ici au contraire, le syndicalisme révolutionnaire avait une vocation éminemment "pratique", il ne produisit pratiquement aucun travail théorique et on peut dire que ses documents les plus importants ont été les résolutions adoptées lors des congrès, dans lesquels le niveau de discussion était réellement limité. "Le syndicalisme révolutionnaire espagnol fut fidèle à un des principes de base du syndicalisme : être un mode d’action, une pratique, et non une simple théorie ; de ce fait, contrairement à ce qui advint en France, il est très rare de disposer d’ouvrages théoriques du syndicalisme révolutionnaire espagnol… Les manifestations les plus claires de syndicalisme révolutionnaire sont justement les documents des organisations, les manifestes et les accords, aussi bien de Solidarité Ouvrière que de la CNT." (A. Bar, opus cité)
Il est remarquable que le Congrès ne consacrât aucune session à la situation internationale, ni au problème de la guerre (pourtant présente dans tous les esprits à l’époque comme une menace imminente). Il est encore plus significatif qu’aucune discussion n’ait eu lieu à propos des récents événements de la Semaine Tragique qui englobait une multitude de problèmes brûlants (la guerre, la solidarité directe dans la lutte, le rôle néfaste du républicanisme de Lerroux)[19]. Nous pouvons constater ici la désaffection envers l’analyse des conditions de la lutte de classe et de la période historique, la difficulté à mener une réflexion théorique et par conséquent à tirer les leçons des expériences de lutte. Au lieu de cela, toute une session fut consacrée à un débat embrouillé et interminable sur la manière dont il convenait d’interpréter la formule "l’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes", qui se traduisit par la proclamation selon laquelle seuls les travailleurs manuels pouvaient mener cette lutte et que les travailleurs intellectuels devaient en être écartés et acceptés uniquement comme "collaborateurs".
L’action directe
Ce point était considéré par la majorité des ouvriers comme celui différenciant la pratique de l’UGT socialiste de la nouvelle organisation, la CNT. De fait on pourrait dire que c’est la base même de la constitution de la CNT en tant que syndicat à l’échelle nationale (et non plus en Catalogne seule comme au début) : "L’initiative de transformer Solidarité Ouvrière en Confédération espagnole est partie non pas de cette Confédération elle-même mais de nombreuses entités hors de Catalogne, qui, désireuses de se solidariser avec les sociétés qui à ce jour ne font pas partie de l’Union Générale des Travailleurs, considèrent en revanche avec intérêt les moyens de la lutte directe" (José Negre, cité par A. Bar, op cité)
De nombreux regroupements ouvriers d’autres régions d’Espagne en avaient assez du crétinisme réformiste, de la rigidité bureaucratique et du "quiétisme" –comme le reconnaissaient beaucoup de socialistes critiques- de l’UGT. Ils accueillirent donc avec enthousiasme la nouvelle centrale ouvrière qui préconisait la lutte directe de masse et une perspective révolutionnaire bien que celle-ci fût assez floue. Il faut cependant éclaircir un malentendu : l’action directe n'est pas la même chose que la grève de masse. Les luttes qui se déclenchent sans appel préalable comme résultat d’une maturation souterraine, les assemblées générales où les ouvriers réfléchissent et décident ensemble, les manifestations de rue massives, l’organisation directe des ouvriers eux-mêmes sans attendre les directives des dirigeants, tous ces traits qui vont caractériser la lutte ouvrière dans la période historique de décadence du capitalisme, n’ont rien à voir avec l’action directe. Cette dernière est l'action par laquelle des groupes constitués spontanément par affinité réalisent des actions minoritaires d’"expropriation" ou de "propagande par l'exemple". Les méthodes de la grève de masse émanent de l’action collective et indépendante des ouvriers alors que les méthodes de l’action directe dépendent de la "volonté souveraine" de petits groupes d’individus. L'amalgame entre l' "action directe" et les nouvelles méthodes de lutte développées par la classe comme en Russie en 1905 ou dans les expériences de Barcelone (1902 et 1909) que nous venons de mentionner, produisit une énorme confusion qui allait poursuivre la CNT tout au long de son histoire.
Cette confusion allait se manifester dans un débat stérile entre adversaires et partisans de la "grève générale". Les membres du PSOE s’opposaient à la grève générale dans laquelle ils voyaient le positionnement abstrait et volontariste de l’anarchisme consistant à se jeter sur telle ou telle lutte pour "la transformer arbitrairement en révolution". Pas plus que leurs acolytes des partis socialistes des autres pays d'Europe, ils ne parvenaient à comprendre le changement des conditions historiques qui impliquait que la révolution cessait d’être un lointain idéal pour devenir l’axe principal autour duquel devaient s’unir tous les efforts de lutte et de conscience de classe [20]. Rejetant la vision anarchiste de la révolution "sublime, grande et majestueuse", ils ignoraient et rejetaient aussi les changements concrets dans la situation.
Face à eux, les syndicalistes révolutionnaires englobaient dans la vieille outre de la grève générale, complètement tributaire du syndicalisme, leur volonté sincère de prendre en charge la lutte, de développer des assemblées et des luttes massives. Les thèses de l' "action directe" et de la "grève générale", si radicales en apparence, devaient se limiter au terrain économique et apparaissaient ainsi comme un économisme syndical plus ou moins radicalisé. Elles n’exprimaient pas la profondeur de la lutte, mais au contraire ses limites : "La Confédération et les sections qui l’intègrent devront toujours lutter sur le plus pur terrain économique, c'est-à-dire celui de l’action directe" (Statuts).
Le centralisme
Une grande partie de la discussion au Congrès de 1910 a été dédiée à la question organisationnelle : comment un syndicat de niveau national devait-il se structurer ? Le refus de la centralisation et le fédéralisme le plus extrême firent triompher sur ce point les positions anarchistes et la CNT allait adopter dans un premier temps (jusqu’au changement que marque le Congrès de 1919) une organisation complètement anachronique basée sur la juxtaposition de sociétés de métiers d’une part et de fédérations locales d'autre part.
Alors que les évènements de 1905 en Russie faisaient la preuve que l’unité de la classe ouvrière était une force sociale révolutionnaire, s'organisant de façon centralisée et se rassemblant dans le soviet de Petersbourg, au-delà des secteurs et des catégories, et qui de plus était ouvert à l’intervention des organisations politiques révolutionnaires, la CNT approuvait en Espagne des propositions qui allaient malheureusement dans le sens contraire.
D’une part, influencés par le fédéralisme et en réponse à l’extrême misère et à la brutalité odieuse du régime capitaliste, des groupes locaux se lançaient périodiquement dans des insurrections qui débouchaient sur la proclamation du communisme libertaire dans une municipalité. A celles-ci, le pouvoir bourgeois répondait par une répression sauvage. Cela se produisit très fréquemment en Andalousie au cours des cinq années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, mais également dans des régions, comme le Valenciennois, où l'agriculture était plus développée, ainsi que l'illustre l'exemple suivant. En 1912, à Cullera, riche agglomération agro-industrielle, un mouvement de journaliers éclate, prend la Mairie et proclame le "communisme libertaire" dans la localité. Complètement isolés, les ouvriers subirent une répression sauvage et conjointe de la part des forces de l'armée et de la Garde civile.
D’autre part, par groupes entiers les ouvriers se faisaient happer par le corporatisme[21]. La méthode de ce dernier est de calquer l’organisation ouvrière sur les subdivisions multiples et complexes de l’organisation capitaliste de la production, ce qui a pour effet de développer parmi les ouvriers une étroitesse d'esprit du style "charbonnier est maître chez soi". Pour le corporatisme, l’unité ne consiste pas en l’union de tous les travailleurs, toutes catégories et entreprises confondues, en un seul et unique collectif, mais dans l'établissement d'un "pacte de solidarité et de défense mutuelle" entre des parties indépendantes et souveraines de la classe ouvrière. Une telle vision se trouve entérinée par le Règlement adopté par le Congrès qui va jusqu'à admettre l’existence de deux sociétés distinctes pour le même métier dans une même localité.
Conclusion
Le Congrès de 1910 fut parcouru par un thème fort significatif. Le jour même où il commença, les ouvriers de Sabadell (localité industrielle près de Barcelone) étaient en grève généralisée en solidarité avec leurs camarades de Seydoux frappés par plusieurs licenciements disciplinaires. Les grévistes envoyèrent des délégués au Congrès pour demander que soit déclarée la grève générale en solidarité. Le Congrès témoigna d’un grand enthousiasme et d’un fort courant de sympathie. Cependant il adopta une résolution basée sur les conceptions syndicalistes les plus rancies, toujours plus dépassées par le vent frais de la lutte ouvrière de masse : "Nous proposons au Congrès qu'il adopte comme mesure de solidarité avec les grévistes de Sabadell que tous les délégués présents encouragent leurs entités respectives à accomplir leur devoir inéluctable : appliquer les décisions des assemblées de délégués de Solidarité Ouvrière de Barcelone d'aider matériellement les grévistes." Cette motion confuse et hésitante constitua une douche glacée pour les ouvriers de Sabadell qui finirent par se remettre au travail complètement vaincus.
Cet épisode symbolise la contradiction dans laquelle allait évoluer la CNT dans la période suivante. Si une vie ouvrière impétueuse battait en son sein, désireuse de riposter à la situation de plus en plus explosive dans laquelle le capitalisme s’enfonçait, par contre la méthode de riposte, le syndicalisme révolutionnaire, allait se montrer de plus en plus inadéquate et contreproductive et, en définitive, constituer un obstacle plus qu’un stimulant.
Nous traiterons de cette question dans le prochain article où nous analyserons l’action de la CNT dans la période tourmentée de 1914-1923 : la CNT face à la guerre et à la révolution.
RR et CMir (15 juin 2006)
[1] Son influence fut très limitée pendant la Commune de Paris et sa présence fut insignifiante en 1905 et 1917 en Russie, tout comme en 1918-23 en Allemagne.
[2] La préface d’un livre sur le procès-verbal du Congrès de Constitution de la CNT (Editorial Anagramme 1976) considère que la CNT "n’était ni anarco-collectiviste ni anarco-communiste ni même pleinement syndicaliste révolutionnaire mais apolitique et fédéraliste".
[3] Parmi les historiens anarchistes, il est l'un des plus connus et réputés par sa rigueur. L’ouvrage cité est considéré comme une référence dans le milieu anarchiste espagnol.
[4] Une page plus loin, Peirats développe l’idée suivante : "en contrepartie à l’esprit unitaire, reflet d’une géographie unitaire - celle de la meseta - les bords de la péninsule, avec leurs chaînes montagneuses, leurs vallées et leurs plaines, forment un cercle de compartiments auxquels correspondent des variétés infinies de types, de langues et de traditions. Chaque zone ou recoin de ce paysage accidenté, représente une entité souveraine, jalouse de ses institutions, orgueilleuse de sa liberté. C’est ici le berceau du fédéralisme ibérique. Cette configuration géographique fut toujours un semis d’autonomies côtoyant parfois le séparatisme, réplique à l’est de l’absolutisme (…) Entre le séparatisme et l’absolutisme, s’égarait le fédéralisme. Celui-ci se fonde sur le rapprochement libre et volontaire de toutes les autonomies, depuis celle des individus jusqu’à celle des régions naturelles ou ayant des affinités, en passant par les municipalités libres. L’accueil chaleureux qui fut réservé en Espagne à certaines influences idéologiques venant de l’étranger, est loin de démentir mais affirme plutôt l’existence – à peine mitigée par des siècles d’extorsion - d’un fédéralisme autochtone.(…) Les émissaires bakouninistes semèrent leur fédéralisme, le libertaire, parmi la classe ouvrière espagnole" (opus cité, page 18.) La classe ouvrière, par son travail associé à l’échelle internationale, représente l’unification consciente –et pour autant librement consentie- de toute l’humanité. Ce qui s’oppose radicalement au fédéralisme qui est une idéologie reflétant la dispersion, la fragmentation liées à la petite bourgeoisie ainsi qu’aux modes de production archaïques qui précédèrent le capitalisme.
[5] Pablo Iglesias (1850-1925) fondateur et dirigeant du PSOE jusqu’à sa mort.
[6] Révolutionnaire espagnol (1911-1989) provenant de l’Opposition de Gauche de Trotski qui rompit avec celle-ci lors de sa capitulation devant la 2e Guerre mondiale et qui défendit des positions de classe face à cette dernière. Fondateur du groupe FOR (Ferment Ouvrier Révolutionnaire). Voir notre article dans la Revue Internationale n°58 [6], "à la mémoire de Munis, militant de la classe ouvrière".
[7] Voir nos commentaires sur ce livre dans notre brochure en espagnol : "1936 : Franco et la République massacrent les ouvriers".
[8] Voir Archives d’auteurs marxistes : "Los Bakuninistas en Acción [7]".
[9] En 1882-1883, l’Etat déchaîna une répression féroce contre des journaliers et des anarchistes, en la justifiant par la lutte contre une société qui organisait des attentats : La Mano Negra. L’existence de cette société n’a jamais été prouvée.
[10] Voir, à partir de la Revue Internationale n°120 [8], notre série sur la révolution de 1905.
[11] L’historien de tendance ouvertement anarchiste Francisco Olaya Morales, dans son livre Histoire du mouvement ouvrier espagnol (1900-1936)" apporte le témoignage suivant : "fin décembre, le Comité de Grève contacta certaines sociétés de tendance anarchiste, mais elles refusèrent de rejoindre le comité en invoquant qu’il avait transgressé les règles de l’action directe" (sic) (page 54).
[12] Nous reviendrons ultérieurement sur cette expérience
[13] Voir le livre de Olaya cité à la note précédente, page 54
[14] Le capital espagnol, en défense de ses propres intérêts impérialistes (se procurer une série de territoires coloniaux en récupérant les restes dont ne voulaient pas les grandes puissances) s'était engagé dans une guerre coûteuse au Maroc qui requérait un envoi continu de troupes sacrifiant de nombreux ouvriers et paysans. Beaucoup de jeunes savaient que leur envoi au Maroc allait signifier leur mort ou leur invalidité pour le reste de leur vie de même que la misère de la vie en caserne.
[15] 1864-1949. Individu trouble et aventurier, fondateur du Parti radical, qui eut un grand poids dans la politique espagnole jusque dans les années 1930.
[16] A la différence de l’expérience française (voir les articles de cette série dans les numéros 118 [5] et 120 [9] de la Revue Internationale) ou de l’expérience des IWW (voir les articles dans les numéros 124 [10] et 125 [11]), en Espagne il n’y a pas d'ouvrages ni même d'articles à travers lesquels s’exprime une tendance syndicaliste révolutionnaire différenciée. Elle est formée par des sociétés de métiers ayant rompu avec le syndicat socialiste –UGT- et aussi par des anarchistes plus ouverts aux différentes tendances existant dans le mouvement ouvrier comme José Prat dont on parlera par la suite.
[17] Théoriciens du syndicalisme révolutionnaire français. Voir l’article dans la Revue Internationale n°120 [9].
[18] L'historien de tendance anarchiste, Francisco Olaya Morales, lorsqu'il se réfère à la période de la fondation de la CNT dans son livre "Histoire du mouvement ouvrier espagnol (1900-1936)", indique clairement (page 277 et suivantes) que les socialistes ont participé à la fondation et à la première étape de la CNT. Il cite José Prat, auteur anarchiste bien qu'indépendant dont nous avons parlé plus haut, qui a affirmé une position ouverte et favorable à une telle participation.
[19] Il y eut seulement une brève mention au problème douloureux des nombreux prisonniers.
[20] C'est le problème que va appréhender au cours de ces années-là Rosa Luxemburg lors de son examen de la gigantesque grève de masse de 1905 : "Et inversement, la guerre économique incessante que les ouvriers livrent au capital tient en éveil l'énergie combative même aux heures d'accalmie politique; elle constitue en quelque sorte un réservoir permanent d'énergie d'où la lutte politique tire toujours des forces fraîches; en même temps le travail infatigable de grignotage revendicatif déclenche tantôt ici, tantôt là des conflits aigus d'où éclatent brusquement des batailles politiques. En un mot la lutte économique présente une continuité, elle est le fil qui relie les différents nœuds politiques; la lutte politique est une fécondation périodique préparant le sol aux luttes économiques. La cause et l'effet se succèdent et alternent sans cesse et ainsi le facteur économique et le facteur politique, bien loin de se distinguer complètement ou même de s'exclure réciproquement, comme le prétend le schéma pédant, constituent dans une période de grève de masse deux aspects complémentaires de la lutte de classe prolétarienne en Russie." (Grève de masse, parti et syndicat)
[21] On peut donner l'exemple suivant du poids du corporatisme. En 1915, le comité de Reus, agglomération industrielle proche de Tarragone – dominé cette fois-ci par les socialistes – a signé un accord avec le patronat dans le dos des ouvrières en grève et dont il résulta la défaite de celles-ci. Les pétitions que firent circuler les ouvrières afin que le Comité fasse campagne pour une grève générale de solidarité furent enterrées. Le comité, dominé par des hommes, n'eut que du mépris pour les revendications des femmes et fit prévaloir les intérêts du secteur – la métallurgie - dont il était l'émanation majoritaire au détriment de l'intérêt fondamental de la classe ouvrière dans son ensemble constitué par la nécessaire solidarité avec les camarades femmes en lutte.
Géographique:
- Espagne [12]
Courants politiques:
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Réponse à la CWO sur la guerre dans la phase de décadence du capitalisme (II)
- 10149 reads
La baisse tendancielle du taux de profit et l'entrée en décadence, la crise, la guerre
Dans la première partie de cet article, nous avons vu que, contrairement à ce qui est souvent affirmé, ce n'est pas le mécanisme de la baisse tendancielle du taux de profit qui constitue le coeur de l'analyse des contradictions économiques du système capitaliste élaboré par Marx, mais le frein que le rapport salarial met à la croissance de la demande finale de la société : "La raison ultime de toutes les crises réelles, c'est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendance de l'économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n'avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolu de la société"[1]. Ceci découle de la soumission du monde à la dictature du salariat permettant à la bourgeoisie de s'approprier un maximum de surtravail. En conséquence nous dit Marx, cette frénésie de production de marchandises engendrée par l'exploitation des travailleurs génère un amoncellement de produits qui croît plus rapidement que la demande solvable globale dans l’ensemble de la société : "En étudiant le procès de production, nous avons vu que toute la tendance, tout l'effort de la production capitaliste consiste à accaparer le plus possible de surtravail ... bref par la production sur une grande échelle, donc la production de masse. L'essence de la production capitaliste implique donc une production qui ne tienne pas compte des limites du marché"[2]. Cette contradiction provoque périodiquement un phénomène inconnu jusqu'alors dans toute l'histoire de l'humanité : les crises de surproduction : "Une épidémie sociale, qui, à toute autre époque, eût semblé absurde : l'épidémie de la surproduction"[3] ; "L’expansibilité immense et intermittente du système de fabrique, jointe à sa dépendance du marché universel, enfante nécessairement une production fiévreuse suivie d’un encombrement des marchés dont la contraction amène la paralysie. La vie de l’industrie se transforme ainsi en série de périodes d’activité moyenne, de prospérité, de surproduction, de crise et de stagnation"[4].
Plus précisément, Marx situe cette contradiction entre la tendance à un développement effréné des forces productives et la limitation de la croissance de la consommation finale de la société suite à l'appauvrissement relatif des travailleurs salariés : "Chacun des capitalistes sait que ses ouvriers ne lui font pas face comme consommateurs dans la production, et s'efforce de restreindre autant que possible leur consommation, c'est-à-dire leur capacité d'échange, leur salaire"[5]. Or, poursuit Marx : " la capacité de consommation de la société n'est déterminée ni par la force productive absolue, ni par la capacité absolue de consommation, mais par la capacité de consommation sur la base de rapports de distribution antagoniques[6], qui réduit la consommation de la grande masse de la société à un minimum susceptible de varier seulement à l'intérieur de limites plus ou moins étroites"[7]. Il s’ensuit donc que "La surproduction a spécialement pour condition la loi générale de production du capital : produire à mesure des forces productives (c'est-à-dire selon la possibilité qu'on a d'exploiter la plus grande masse possible de travail avec une masse donnée de capital) sans tenir compte des limites existantes du marchés ou des besoins solvables..."[8]. Le cœur de l'analyse marxiste des contradictions économiques du capitalisme découle donc du fait que ce dernier doit accroître sans cesse sa production alors que la consommation ne peut pas, dans le cadre de la structure de classe capitaliste, suivre un rythme identique.
Dans la première partie de notre article, nous avons également vu que, dans son mécanisme interne, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit pouvait très bien concourir à l'émergence de crises de surproduction : "La limite du mode de production se manifeste dans les faits que voici : 1° Le développement de la productivité du travail engendre, dans la baisse du taux de profit, une loi qui, à un certain moment, se tourne brutalement contre ce développement et doit être constamment surmontée par des crises"[9]. Cependant, elle ne constitue chez Marx ni la cause exclusive ni même la cause principale des contradictions du capitalisme. D'ailleurs, lorsque dans la préface à l’édition anglaise (1886) du Livre I du Capital, Engels résume la conception de Marx, ce n’est pas à la baisse tendancielle du taux de profit qu’il fait référence mais à cette contradiction soulignée en permanence par Marx entre "un développement absolu des forces productives" et "la limitation de la croissance de la consommation finale de la société" : "Alors que les forces productives s’accroissent en progression géométrique, l’extension des marchés se poursuit tout au plus en progression arithmétique. Le cycle décennal de stagnation, prospérité, surproduction et crise, que l’on a vu se reproduire de 1825 à 1867, paraît certes avoir achevé sa course, mais uniquement pour nous plonger dans le bourbier sans issue d’une dépression permanente et endémique "[10].
Ainsi, comme nous venons de le mettre en évidence, et comme il est très clair pour quiconque aborde cette question sérieusement et avec honnêteté, la CWO défend sur la question des causes fondamentales des crises économiques du capitalisme et de la décadence de ce mode de production une analyse différente de celle défendue en leur temps par Marx et Engels. C'est tout à fait son droit, et même sa responsabilité si elle l'estime nécessaire. En effet, quelles que soient la valeur et la profondeur de la contribution, considérable, qu'il a apportée à la théorie du prolétariat, Marx n'était pas infaillible et ses écrits ne sont pas à considérer comme des textes sacrés. Ce serait là une démarche religieuse totalement étrangère au marxisme, comme à toute méthode scientifique d'ailleurs. Les écrits de Marx doivent eux aussi être soumis à la critique de la méthode marxiste. C'est la démarche qu'a adoptée Rosa Luxemburg dans L'accumulation du capital (1913) lorsqu'elle relève les contradictions contenues dans le livre II du Capital. Cela dit, lorsqu'on remet en cause une partie des écrits de Marx, l'honnêteté politique et scientifique commande d'assumer explicitement et en toute clarté une telle démarche. C'est bien ce qu'a fait Rosa Luxemburg dans son livre, ce qui lui a valu une levée de boucliers de la part des "marxistes orthodoxes", scandalisés qu'on puisse critiquer ouvertement un écrit de Marx. Ce n'est pas, malheureusement, ce que fait la CWO lorsque, non seulement elle s'écarte de l'analyse de Marx tout en prétendant y rester fidèle mais qu'elle accuse les analyses du CCI de s'écarter du matérialisme, et donc du marxisme. Pour notre part, si sur cette question nous reprenons les analyses de Marx, c'est parce que nous considérons qu'elles sont justes et qu'elles rendent compte de la réalité de la vie du capitalisme.
Ainsi, après avoir examiné cette question sur un plan théorique dans la première partie de cet article, nous allons montrer ici en quoi la réalité empirique invalide totalement la théorie de ceux qui font de l’évolution du taux de profit l’alpha et l’oméga de l'explication des crises, des guerres et de la décadence. Pour cela, nous continuerons à nous appuyer sur la critique de l'analyse de Paul Mattick, reprise par le BIPR, selon laquelle, à la veille de la Première Guerre mondiale, la crise économique aurait atteint des proportions telles que celle-ci ne pouvait plus se résoudre par les moyens classiques de la dévalorisation du capital fixe (faillites) comme lors des crises au XIXè siècle, mais devait désormais passer par les destructions physiques de la guerre : "Dans les conditions du XIXè siècle, une crise affectant plus ou moins toutes les unités de capital à l'échelle internationale arrivait sans difficultés excessives à résorber la suraccumulation. Mais au tournant du siècle fut atteint un point à partir duquel les crises et la concurrence ne parvinrent plus à détruire du capital dans des proportions suffisantes ... le cycle économique ... se métamorphosa en un cycle de guerres mondiales ... la guerre a pour effet de ranimer et d'amplifier l'activité économique. (...) Et cela ... à cause ... de la destruction de capital" (Paul Mattick, cité dans l’article de Revolutionary Perspectives n°37 de la CWO, la branche anglaise du BIPR)[11].
Telle est l'analyse économique de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence faite par le BIPR. Sur cette base, ce dernier nous accuse d’idéalisme parce que nous n’avancerions pas une analyse clairement économique comme soubassement à chacun des phénomènes de la société et de la décadence en particulier : "Dans la conception matérialiste de l'histoire le procès social comme un tout est déterminé par le procès économique. Les contradictions de la vie matérielle déterminent la vie idéologique. Le CCI affirme, de la façon la plus superficielle, qu'une période entière de l'histoire du capitalisme est terminée et qu'une nouvelle s'est ouverte. Un tel changement majeur ne peut advenir sans un changement fondamental dans l'infrastructure capitaliste. Le CCI doit dans tous les cas soutenir ses assertions avec une analyse tirant ses racines dans la sphère de production ou admettre qu'elles sont de pures conjectures" (Revolutionary Perspectives n°37). C'est ce que nous allons aborder maintenant.
Matérialisme historique et entrée en décadence d'un mode de production
Pensant faire oeuvre de bonne méthode marxiste, le BIPR a trouvé chez le conseilliste Paul Mattick les 'bases matérielles' à l'ouverture de la période de décadence du capitalisme. Malheureusement pour lui, si la méthode marxiste - le matérialisme historique et dialectique - se résumait à concevoir une explication économique à tous les phénomènes qui traversent le capitalisme alors, comme nous l'enseignait Engels, "l’application de la théorie à n’importe quelle période historique, serait, ma foi, plus facile que la résolution d’une simple équation du premier degré"[12]. Ce que le BIPR oublie tout simplement ici c’est que le marxisme n’est pas seulement une méthode d’analyse matérialiste mais également historique et dialectique. Or, que nous enseigne l’histoire sur cette question de l’entrée en décadence d’un mode de production sur le plan économique ?
L’histoire nous enseigne qu’aucune période de décadence n'a débuté par une crise économique ! Il n'y a rien de bien surprenant à cela puisque l'apogée d'un mode de production se confond avec sa période de plus grande prospérité. Les premières manifestations de son entrée en décadence ne peuvent donc se manifester que très faiblement sur ce plan, elles se manifestent avant tout dans d’autres domaines et sur d’autres plans. Ainsi, par exemple, avant de s'enfoncer dans des crises sans fin sur le plan matériel, la décadence romaine se manifesta d’abord par l'arrêt de son expansion géographique au cours du IIè siècle après JC ; par les premières défaites militaires aux marges de l'Empire romain au cours du IIIè siècle ainsi que par l’éclatement de révoltes d’esclaves un peu partout dans les colonies pour la première fois de façon simultanée. De même, avant de s'enfoncer après le début du XIVè siècle dans la crise économique, les famines et les affres des épidémies de peste et de la guerre de cent ans, c'est d'abord par l'arrêt des défrichements aux limites ultimes des fiefs dans le dernier tiers du XIIIè siècle que se marquèrent les premiers signes de la décadence du mode de production féodal. Dans ces deux cas, les crises économiques comme produits des blocages infrastructurels ne se développèrent que bien après leur entrée en décadence. Le passage de l'ascendance à la décadence d'un mode de production sur le plan économique peut se comparer à une inversion de marée : à son point le plus haut, la mer paraît au faîte de sa puissance et le retournement semble imperceptible. Même si les contradictions dans les soubassements économiques commencent à miner en profondeur les tréfonds de la société, ce sont d'abord les manifestations dans le domaine superstructurel qui apparaissent en premier.
Il en va de même pour le capitalisme, avant de se manifester sur le plan économique et quantitatif, la décadence apparaîtra d’abord comme un phénomène qualitatif se traduisant d’abord sur les plans sociaux, politiques et idéologiques par l’exacerbation des conflits au sein de la classe dominante aboutissant au premier conflit mondial, par la prise en main de l’économie par l’Etat pour les besoins de la guerre, par la trahison de la Social‑démocratie et le passage des syndicats dans le camp du capital, par l’irruption d’un prolétariat désormais capable de mettre à bas la domination de la bourgeoisie et par la mise en place des premières mesures de contrôle social de la classe ouvrière.
Il est donc tout à fait logique et en pleine cohérence avec le matérialisme historique que l’entrée en décadence du capitalisme ne se manifeste pas, d’abord, par une crise économique. Les événements qui adviennent à ce moment n'expriment pas encore pleinement toutes les caractéristiques de sa phase de décadence mais une exacerbation des dynamiques propres à son ascendance dans un contexte qui est en train de profondément se modifier. Ce n’est qu’ultérieurement, lorsque les blocages infrastructurels auront fait leur oeuvre, que les crises économiques vont pleinement se déployer. La cause de la décadence et de la première guerre mondiale ne sont donc pas à rechercher dans une introuvable baisse du taux de profit ou une crise économique en 1913 (cf. infra) mais dans un faisceau de causes économiques, politiques, inter‑impérialistes et hégémoniques comme nous l’expliquions dans notre Revue Internationale n°67 [16][13]. Cette prospérité du capitalisme au cours de la dite Belle Epoque était d’ailleurs pleinement reconnue par le mouvement révolutionnaire puisque l'Internationale Communiste (1919-28) constatait à son troisième congrès, dans son "Rapport sur la situation mondiale" écrit par Trotsky, que : "Les deux dizaines d’années qui avaient précédé la guerre furent une époque d’ascension capitaliste particulièrement puissante".
Une invalidation empirique de la thèse de Mattick et du BIPR
Ce constat théorique et empirique tiré de l’évolution des modes de production passés se confirme pleinement concernant le capitalisme. Que ce soit l'examen du taux de croissance, d'autres paramètres économiques ou du taux de profit, rien ne vient attester la théorie de Mattick et du BIPR selon laquelle l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence et l'éclatement de la première guerre mondiale seraient le produit d'une crise économique consécutive à une baisse du taux de profit nécessitant de recourir à une dévalorisation massive de capital par les destructions de guerre.
En effet, le taux de croissance du PNB par habitant en volume (donc inflation déduite) n'a fait que croître durant toute la phase ascendante du capitalisme pour culminer à la veille de 1914. Toutes les données que nous publions ci-dessous montrent que cette dernière période, à la veille de la première guerre mondiale, fut la plus prospère de toute l'histoire du capitalisme jusqu'alors. Ce constat est identique quels que soient les indicateurs pris en compte :
|
Croissance du Produit Mondial Brut |
|
|
1800-1830 |
0,1 |
|
1830-1870 |
0,4 |
|
1870-1880 |
0,5 |
|
1880-1890 |
0,8 |
|
1890-1900 |
1,2 |
|
1900-1913 |
1,5 |
|
Source : Bairoch Paul, Mythes et paradoxes de l'histoire économique, 1994, éditions la découverte, p.21. |
|
|
Production industrielle mondiale |
Commerce mondial |
|
1786-1820 |
2,48 |
0,88 |
|
1820-1840 |
2,92 |
2,81 |
|
1840-1870 |
3,28 |
5,07 |
|
1870-1894 |
3,27 |
3,10 |
|
1894-1913 |
4,65 |
3,74 |
|
Source : W.W. Rostow, The world economy, history and prospect, 1978, University of Texas Press. |
Il en va de même si l’on examine l'évolution du taux de profit qui est la variable prise en compte par tous ceux qui font de ce dernier la clé de compréhension de toutes les contradictions économiques du capitalisme. Les graphiques pour les Etats-Unis et la France que nous avons reproduits ci-dessous nous montrent également que rien ne vient attester la théorie défendue par Mattick et le BPR. En effet, en France, ni le niveau, ni l'évolution du taux de profit ne peuvent guère expliquer l'éclatement de la Première Guerre mondiale puisque ce taux était croissant depuis 1896 et même très fortement croissant à partir de 1910 ! Quand aux Etats-Unis, ce n'est pas non plus l'évolution de leur taux de profit qui peut expliquer l'entrée de ce pays dans la guerre de 1914-18 puisque, oscillant autour de 15 % depuis 1890, il était reparti dans un cycle à la hausse à partir de 1914 jusqu'à atteindre 16 % au moment de l'engagement de ce pays dans le conflit en mars-avril 1917 ! Ni le niveau, ni l'évolution du taux de profit à la veille de la première guerre mondiale ne sont donc à même d'expliquer l'éclatement du conflit et l'entrée du système capitaliste dans sa phase de décadence.
Néanmoins, il est indubitable que les premiers signes perceptibles marquant le tournant entre la phase ascendante et décadente du capitalisme commencèrent à se manifester et cela non pas au niveau de l'évolution du taux de profit, comme le pensent de façon erronée Mattick et le BIPR, mais au niveau d'une l'insuffisance de la demande finale avec l'apparition des prémisses de la saturation relative des marchés solvables eu égard au besoin de l'accumulation à l'échelle mondiale comme l’avait prévu Marx, Engels et Rosa Luxemburg (cf. première partie). C'est aussi ce que consignait ce même rapport de la Troisième Internationale dans la suite de la citation : "Enserrant le marché mondial par leurs trusts, leurs cartels et leurs consortiums, les maîtres des destinées du monde se rendaient compte que le développement de la production devait se heurter aux limites de la capacité d’achat du marché capitaliste mondial". Ainsi, aux Etats-Unis, après une vigoureuse croissance pendant 20 années (1890-1910) au cours desquelles l’indice de l’activité industrielle est multiplié par 2,5, ce dernier se met à stagner entre 1910 et 1914 et ne redémarre qu'en 1915 grâce aux exportations de matériel de guerre à destination de l’Europe en guerre. Non seulement l'économie américaine perd en dynamisme à la veille de 1914 mais l’Europe également connaît certaines difficultés conjoncturelles face à une demande mondiale contrainte et tente de plus en plus vainement de se tourner vers les débouchés extérieurs : "Mais, sous l’influence de la crise qui se développait en Europe, l’année suivante [1912] connut à nouveau un renversement de conjoncture [aux Etats-Unis] (...) L'Allemagne traversait alors une période d'expansion accélérée. La production industrielle dépassa, en 1913, de 32 % le niveau de 1908 (...) Le marché intérieur étant incapable d’absorber une telle production, l’industrie se tourna vers les débouchés extérieurs, les exportations s'élevaient de 60 % contre 41 % pour les importations (...) le renversement s’amorça au début de 1913 (...) Le chômage se développa en 1914. La dépression fut légère et de courte durée ; une reprise se manifesta temporairement au printemps 1914. La crise, ainsi commencée en Allemagne, se propagea au Royaume-Uni. (...) La répercussion de la crise allemande se fit sentir en France en août 1913 (...) Aux Etats-Unis ce ne fut qu'au début de 1915 que la production se développa sous l'influence de la demande de guerre..." (toutes les données, ainsi que la citation de ce paragraphe, proviennent de l'ouvrage sur "Les crises économiques", PUF n°1295, 1993, p.42 à 48).
Ces difficultés conjoncturelles qui se développèrent à la veille de 1914 constituaient autant de signes précurseurs de ce que sera la difficulté économique permanente du capitalisme en décadence : une insuffisance structurelle de marchés solvables. Cependant, force est de constater que la première guerre mondiale éclate dans un climat général de prospérité et non de crise c’est-à-dire dans le prolongement de la Belle Epoque : "Les dernières années de l'avant-guerre, comme toute la période 1900-1910, furent particulièrement bonnes dans les trois grandes puissances qui participèrent à la guerre (France, Allemagne et Royaume-Uni). Du point de vue de la croissance économique, les années 1909 à 1913 représentaient sans doute les quatre meilleures années de leur histoire. Hormis la France où l'année 1913 fut marquée par un ralentissement de la croissance, cette année fut une des meilleures du siècle, avec un taux annuel de 4,5% en Allemagne, 3,4% en Angleterre et seulement 0,6% en France. Les mauvais résultats français s'expliquent en totalité par la baisse de 3,1% en volume de la production agricole"[14]. La guerre éclate donc avant le début d'une véritable crise économique, un peu comme si cette dernière avait été anticipée ‑ ce que note d'ailleurs aussi ce même rapport de l'IC dans la suite de la citation : "...les maîtres des destinées du monde essayèrent de sortir de cette situation par les moyens de la violence ; la crise sanglante de la guerre mondiale devait remplacer une longue période menaçante de dépression économique..." ‑. C'est pourquoi, tous les révolutionnaires de l'époque, de Lénine à Rosa Luxemburg en passant par Trotsky et Pannekoek, s'ils ont signalé le facteur économique parmi les causes de l'éclatement de la première guerre mondiale, ne l’évoquent pas sous la forme d’une crise économique ou d’une baisse du taux de profit mais comme l'exacerbation de tendances impérialistes antérieures : la poursuite de la curée impérialiste pour s'accaparer des derniers restes de territoires non capitalistes du globe[15] ou le repartage et non plus la conquête de nouveaux marchés[16].
A côté de ces constats "économiques", tous ces illustres révolutionnaires développèrent longuement une série d'autres facteurs d'ordre hégémoniques, politiques, sociaux et inter-impérialistes. Ainsi, par exemple, Lénine insistera sur la dimension hégémonique de l'impérialisme et ses conséquences dans la phase de décadence du capitalisme : "(...) premièrement, le partage du monde étant achevé, un nouveau partage oblige à tendre la main vers n'importe quels territoires ; deuxièmement, ce qui est l'essentiel même de l'impérialisme, c'est la rivalité de plusieurs grandes puissances tendant à l'hégémonie, c'est-à-dire la conquête de territoires , non pas tant pour elles-mêmes que pour affaiblir l'adversaire et saper son hégémonie (la Belgique est surtout nécessaire à l'Allemagne comme point d'appui contre l'Angleterre ; l'Angleterre a surtout besoin de Bagdad comme point d'appui contre l'Allemagne, etc.)" (Oeuvres, tome 22 : 290). Cette caractéristique nouvelle de l'impérialisme soulignée par Lénine est fondamentale à comprendre car elle signifie que "la conquête de territoires" au cours des conflits inter-impérialistes dans la période de décadence aura de moins en moins de rationalité économique mais prendra une dimension stratégique prépondérante : "(la Belgique est surtout nécessaire à l'Allemagne comme point d'appui contre l'Angleterre ; l'Angleterre a surtout besoin de Bagdad comme point d'appui contre l'Allemagne, etc.)"[17].
Si l'on peut effectivement percevoir les premiers indices de difficultés économiques à la veille de 1914, d'une part, ceux-ci restèrent encore forts ténus (analogues en gravité aux crises conjoncturelles antérieures et sans commune mesure avec la longue crise qui va commencer en 1929 ou avec la profondeur des crises actuelles) et, d'autre part, ils se manifestèrent non pas au niveau d'une baisse du taux de profit mais au niveau d'une saturation des marchés qui constituera la caractéristique marquante de la décadence du capitalisme sur le plan économique comme Rosa Luxemburg l’avait magistralement prévu : "Plus les pays qui développent leur propre industrie capitaliste sont nombreux, et plus le besoin d'extension et les capacités d'extension de la production augmentent d'un côté, et moins les capacités de réalisation de la production augmentent en rapport avec les premières. Si l'on compare les bonds par lesquels l'industrie anglaise a progressé dans les années 1860 et 1870, alors que l'Angleterre dominait encore le marché mondial, avec sa croissance dans les deux dernières décennies, depuis que l'Allemagne et les Etats-Unis d'Amérique ont fait considérablement reculer l'Angleterre sur le marché mondial, il en ressort que la croissance a été beaucoup plus lente qu'avant. Le sort de l'industrie anglaise attend aussi l'industrie allemande, l'industrie nord-américaine et finalement l'industrie du monde. A chaque pas de son propre développement, la production capitaliste s'approche irrésistiblement de l'époque où elle ne pourra se développer que de plus en plus lentement et difficilement"[18].
En conclusion de notre petit examen empirique, la première guerre mondiale n'éclate indubitablement ni à la suite d’une chute du taux de profit, ni à la suite d’une crise économique comme le pensent à tort Mattick et le BIPR. Reste maintenant à examiner le complément de la thèse du BIPR, à savoir vérifier empiriquement si les destructions de guerre ont été à la base d’une "prospérité" retrouvée en temps de paix en prenant appui sur un rétablissement du taux de profit suite aux destructions de guerre.
L'entre-deux guerres vient démentir la thèse du BIPR
Fort bien ‑ nous répondra sans doute le BIPR ‑ mais si l’éclatement de la première guerre mondiale ne peut s’expliquer ni par une baisse du taux de profit ni par une crise économique forçant le capitalisme à massivement dévaloriser son capital, toujours est-il qu'une dévalorisation a bien eu lieu au cours de la guerre suite aux destructions massives et qu’elle est à la base de la reprise de la croissance économique et du taux de profit au lendemain du conflit : "Ce fut sur la base de cette dévaluation de capital et de dévalorisation de la force de travail que le taux de profit se rétablit et c'est en s'appuyant sur cela que le rétablissement fut basé jusqu'en 1929" (Revolutionary Perspectives n°37)’.
Qu’en fut-il en réalité ? Y a-t-il bien eu "dévaluation du capital" et "dévalorisation de la force de travail" durant la guerre permettant un "rétablissement jusqu’en 1929", rétablissement qui aurait été permis par la remontée du taux de profit suite aux destructions de guerre ? La réfutation de cette idée de rationalité économique à la première guerre mondiale est empiriquement très simple à effectuer puisque les "35 % de biens accumulés par l’humanité et détruits au cours de la première guerre mondiale" (Revolutionary Perspectives n°37), loin de "poser les bases pour des périodes d'accumulation renouvelée du capital" (Revolutionary Perspectives n°37), ont au contraire engendré une stagnation du commerce mondial durant toute l’entre-deux guerres ainsi que les pires performances économiques de toute l'histoire du capitalisme[19].
Si l’on examine un peu plus en détail la croissance du PIB par habitant durant cette période trouble de l’entre-deux guerre en prenant le début de la période de décadence du capitalisme comme point de référence (1913), la fin de la première guerre mondiale (1919), l’année de l’éclatement de la grande crise des années 1930 (1929) ainsi que la situation à la veille de la seconde guerre mondiale (1939), nous pouvons constater les évolutions suivantes :
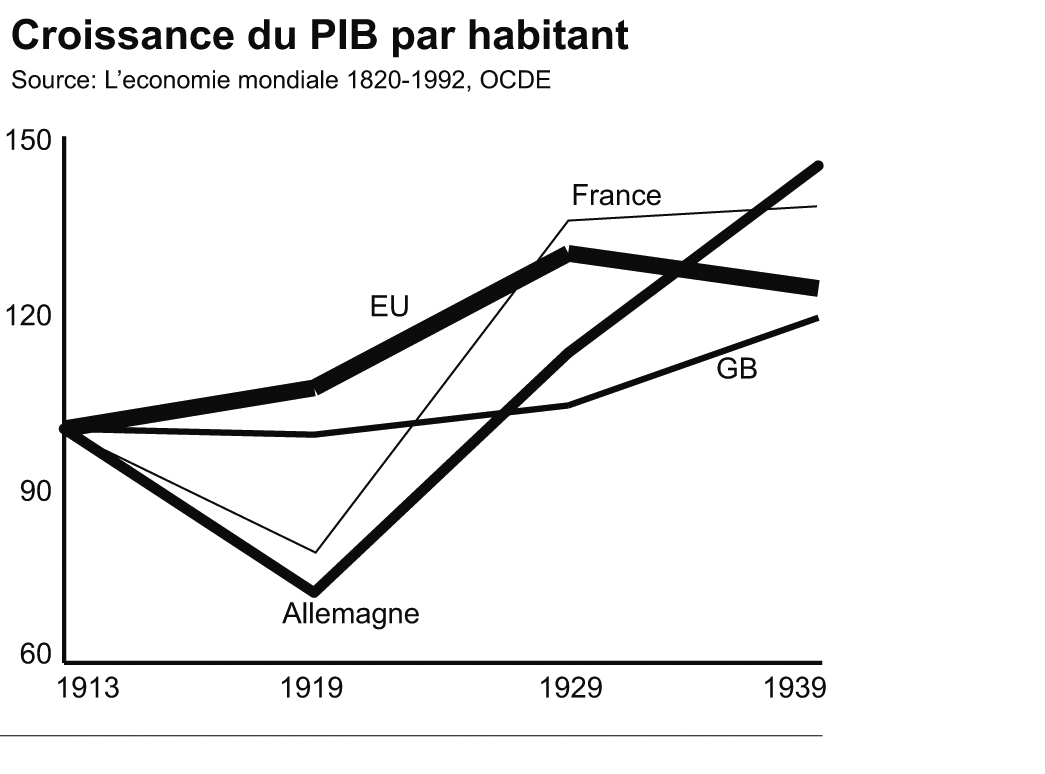
La très faible croissance sur l’ensemble de la période (de l’ordre de +/- 1% l’an seulement en moyenne) montre que les destructions de guerre n’ont pas constitué ce stimulant à l’activité économique tel que nous l’affirment Mattick et le BIPR. Ce tableau montre aussi que les situations furent très contrastées et que ce ne sont pas systématiquement les pays les plus impliqués dans la guerre qui s’en sortent le mieux durant la très courte période de reconstruction et de reprise entre 1919 et 1929. La guerre ne fut certainement pas une bonne affaire, ni pour l’Angleterre, puisqu’elle ne dépasse son niveau de 1913 que de 4 points seulement, ni pour l’Allemagne avec 13 points à peine ! Pour ce dernier pays, la forte croissance durant les années 1929-39 relève essentiellement des dépenses de réarmement généralisées au cours des années 1930 puisque l'indice de sa production industrielle qui était de 100 en 1913, n'en est encore qu’au niveau 102 en 1929 alors que la part des dépenses militaires dans le PNB, qui n'étaient toujours que de 0,9% pendant la période 1929-32, commencent à s'élever brutalement en 1933 à 3,3 %, et continuent leur progression sans discontinuer jusqu'à atteindre 28 % en 1938[20] !
En conclusion, rien, ni théoriquement, ni historiquement et encore moins empiriquement ne vient conforter cette idée de Mattick reprise par le BIPR selon laquelle la guerre aurait des vertus régénératrices pour l'économie : "la guerre a pour effet de ranimer et d’amplifier l’activité économique" (Revolutionary Perspectives n°37). S'il y a bien une vérité dans ce que dit le BIPR, c'est cette vérité proclamée par tous les révolutionnaires depuis 1914 selon laquelle la guerre fut une catastrophe incomparable dans toute l’histoire de l’humanité. Une catastrophe non seulement sur le plan économique (un peu plus d’un tiers de la richesse du monde fut dilapidée), mais également sur les plans sociaux (exploitation féroce d’une force de travail réduite à la plus extrême des misères), politiques (avec la trahison des grandes organisations dont le prolétariat s’était péniblement doté pendant un demi siècle de combats : les partis socialistes et les syndicats) et humaine (10 millions de soldats morts ‑ auxquels il faudrait encore ajouter les civils décédés ‑, 20 millions de soldats blessés et 20 millions de morts suite à l’épidémie de grippe espagnole consécutive aux désastres de la guerre). Dès lors, si rien sur le plan économique ne vient apporter une quelconque rationalité économique à la guerre, le BIPR devrait réfléchir à deux fois avant de se moquer de notre position selon laquelle les guerres en phase de décadence du capitalisme sont devenues irrationnelles : "Au lieu de voir la guerre comme ayant une fonction économique pour la survie du système capitaliste, il a été défendu par certains groupes de la Gauche Communiste, notamment le Courant Communiste International (CCI), que les guerres n'avaient pas de fonction pour le capitalisme. Au lieu de cela, les guerres furent caractérisées comme 'irrationnelles', sans aucune fonction ni à court ni à moyen terme dans l'accumulation du capital" (Revolutionary Perspectives n°37).
Au lieu de se précipiter pour nous caractériser d'idéalistes, le BIPR ferait mieux de retirer ses lunettes matérialistes vulgaires et en revenir à une analyse un peu plus historique et dialectique, car l’examen minutieux de ce que le BIPR appelle "le procès économique", "la vie matérielle", "l’infrastructure capitaliste", "la sphère de production", nous enseigne qu’il n’y eu ni crise, ni baisse du taux de profit avant la Première Guerre mondiale, ni reprise miraculeuse en temps de paix sur la base des destructions de guerre. Nous invitons donc le BIPR à sérieusement vérifier ce qu’il professe comme vérité avant d’accuser les autres d’idéalisme alors que cette organisation ne parvient même pas à produire une "analyse matérialiste" permettant de restituer la réalité de façon un temps soit peu cohérente.
La baisse tendancielle du taux de profit ne peut rendre compte des crises, des guerres, ni des reconstructions
Si la théorie de Mattick et du BIPR ne se vérifie pas du tout concernant la première guerre mondiale, ne serait-elle pas valable pour d’autres périodes ? L’invalidation de cette théorie est-elle généralisable ? C’est ce que nous nous proposons d’examiner ici. Pour aborder cette question, nous nous appuierons sur deux seules courbes reconstituant l'évolution du taux de profit à très long terme et qui concernent respectivement les Etats-Unis et la France. Nous aurions bien évidemment aimé présenter celle relative à l'Allemagne, mais, malgré nos recherches, nous n’avons pu disposer que de son évolution pour la période d’après 1945 ainsi que pour quelques dates antérieures. Malheureusement, le manque d’homogénéité dans le mode de calcul à ces différentes dates rend toute analyse de son évolution délicate. D’après les données dont nous disposons cependant, à quelques variations près, nous pouvons considérer la courbe de la France comme caractéristique de l'évolution sur le vieux continent[21].
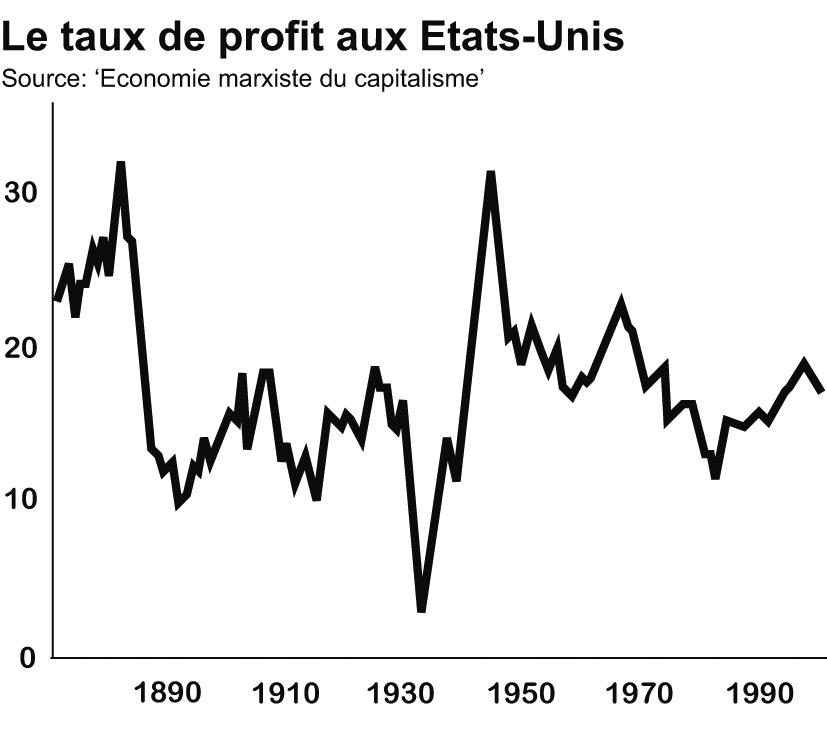
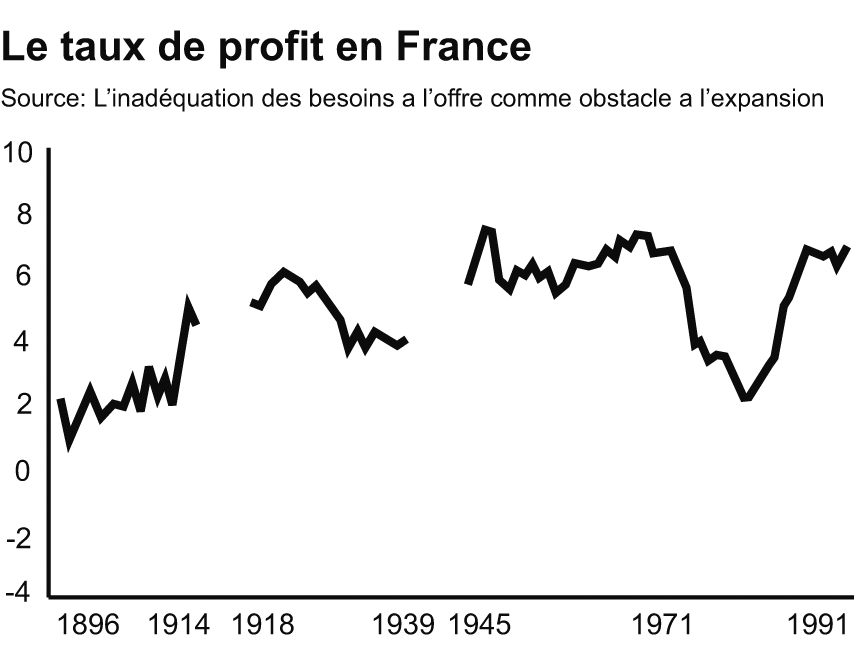
Ainsi, il est légitime de considérer que l'évolution du taux de profit au 20e siècle, observée à la fois en France et aux Etats-Unis est suffisamment représentative de la tendance du monde industrialisé pour valider le constat que nous faisons de la totale inadéquation de la théorie économique de Mattick et du BIPR à la réalité. Ainsi, non seulement les Etats-Unis étaient devenus la première économie dans le monde dès 1880 mais ces deux pays représentaient à eux seuls, 50% de la richesse mondiale produite vers 1926-29 (W.W. Rostow, op. cité, tome II-2 : 52) ! S'il s'avérait que, malgré l'indisponibilité de statistiques officielles permettant de le vérifier, des tendances économiques spécifiques à certains pays et à certaines périodes prennent le contre-pied de la tendance largement dominante sur laquelle nous nous sommes basés, il ne pourrait s'agir là, tout au plus, que de cas particuliers et limités ne pouvant qu'en apparence vérifier la théorie du BIPR qui est en réalité globalement invalidée par ailleurs.
Le niveau et/ou l'évolution du taux de profit est-il à même d'expliquer les guerres ?
Comme nous l’avons déjà montré ci-dessus, le graphique de l’évolution du taux de profit en France signale très clairement que l'on ne peut expliquer l'éclatement de la première guerre mondiale puisque ce taux était croissant depuis 1896 et même très fortement croissant à partir de 1910 ! De plus, nous constatons qu'il en va tout autant pour la seconde guerre mondiale puisque, à la veille de son éclatement, le niveau du taux de profit de l'économie française était très élevé (le double de la période de grande prospérité économique allant de 1896 à la première guerre mondiale !) et, qu’après une baisse pendant les années 1920, il est resté stable tout au long des années 1930.
De surcroît, si la guerre devait s'expliquer par le niveau et/ou la tendance à la baisse du taux de profit, alors on ne comprend pas pourquoi la troisième guerre mondiale n'aurait pas éclaté durant la seconde moitié des années 1970 puisque sa tendance était clairement à la baisse à partir de 1965 et que son niveau passe nettement en-dessous de celui de 1914 et de 1940, tant pour les Etats-Unis que pour la France, seuils qui étaient pourtant censés avoir déclenché la première et la seconde guerre mondiale selon le BIPR !
Quant aux Etats-Unis, ce n'est pas non plus l'évolution de leur taux de profit qui peut expliquer l'entrée de ce pays dans la première guerre mondiale puisque sa tendance repart à la hausse quelques années avant son entrée dans le conflit. Il en va de même pour la seconde guerre mondiale puisque le taux de profit américain remonte très vigoureusement pendant la dizaine d'années qui précède l'engagement de ce pays dans le conflit, qu'il retrouve en 1940 son niveau d'avant la crise et qu’il atteint un niveau encore plus élevé au moment de son entrée en guerre (début 1942).
En conclusion, contrairement à la théorie de Mattick et du BIPR, que ce soit sur l'ancien ou sur le nouveau continent, ni le niveau, ni l’évolution du taux de profit ne peuvent expliquer l'éclatement des deux guerres mondiales ! Non seulement nous constatons que les taux de profit n'étaient pas orientés à la baisse à la veille des conflits mondiaux mais ils étaient la plupart du temps à la hausse depuis plusieurs années ! Pour le moins, ceci devrait remettre en question la théorie de la rationalité économique de la guerre professée par le BIPR car quelle rationalité y aurait-il pour le capitalisme d'entrer en guerre et de procéder à une destruction massive de son capital fixe alors que son taux de profit vole vers des sommets !? Comprenne qui pourra !
Le niveau et/ou l'évolution du taux de profit est-il à même d'expliquer la prospérité d'après-guerre ?
La dynamique de remontée du taux de profit aux Etats-Unis est bien antérieure à la seconde guerre mondiale à tel point qu'en 1940, c'est-à-dire avant l'éclatement de la guerre et avant l'engagement américain dans le conflit, les Etats-Unis retrouvent leur niveau moyen d'avant la grande crise de 1929, niveau moyen qui sera aussi celui des "trente glorieuses". Au moment de l'entrée en guerre ce niveau est encore plus élevé. Dès lors, ni le rétablissement du taux de profit, ni la prospérité économique d'après-guerre ne peuvent s'expliquer par les destructions de guerre. Il en va de même pour la grande guerre puisque la dynamique de reprise du taux de profit aux Etats-Unis est antérieure à l'engagement américain dans la première guerre mondiale et il n'y a pas d'amélioration sensible de ce taux après la guerre. A nouveau, ni le niveau, ni la tendance du taux de profit après la Première Guerre mondiale ne peuvent s'expliquer par l'engagement américain dans la guerre.
Quant à la France, son taux de profit ne s'améliore pas sensiblement après la grande guerre puisque, après une micro hausse de 1% entre 1920-23, ce taux chute de 2% au cours des années 20 pour se stabiliser ensuite pendant les années 30. Seul le niveau nettement supérieur – pendant 4 ans seulement - du taux de profit après la seconde guerre mondiale par rapport à la situation d'avant-guerre pourrait donner du crédit dans ce cas ‑ mais seulement dans ce cas – à l'hypothèse du BIPR. Nous verrons cependant dans les suites de cet article que la prospérité d'après guerre ne doit rien aux destructions et autres conséquences économiques de la guerre.
En conclusion, force est de constater que le retour à la rentabilité des capitaux est bien antérieure aux conflits militaires et aux destructions de guerre ! La guerre et ses destructions n’ont donc pas grand chose à voire dans la remontée du taux de profit ! Les supposées destructions de guerre régénérant un taux de profit qui, à son tour, permettrait une prospérité au lendemain des guerres sont tout aussi fantomatiques que le reste de la théorie du BIPR !
Le niveau et/ou l'évolution du taux de profit est-il à même d'expliquer les crises ?
Est-ce que le niveau et/ou l'évolution du taux de profit peuvent rendre compte du krach de 1929 et de la crise des années 1930 ? Contrairement à ce que professe le BIPR, ce ne peut être le niveau atteint par le taux de profit aux Etats-Unis qui pourrait expliquer en quoi que ce soit l'éclatement de cette crise puisqu'il atteint, en 1929, une valeur nettement supérieure aux deux décennies précédentes de croissance économique. Quant à l'orientation du taux de profit, il est, certes, à la baisse juste avant la crise de 1929 ‑ tant aux Etats-Unis qu'en France ‑ mais cette baisse est très limitée en intensité et dans le temps. Ainsi, en France, la chute du taux de profit entre 1973-80 est bien plus drastique que lors de la crise de 1929 sans pour cela engendrer de conséquences de même ampleur (une brutale déflation générant un recul très prononcé de la production). Quoique se déroulant sur une plus longue période, un même constat peut être tiré pour les Etats-Unis car la chute du taux de profit entre la fin des années 1960 et le début des années 1980 est à peine plus faible que pendant la crise de 1929 sans engendrer non plus les mêmes conséquences spectaculaires. Dans les deux cas, la différence d'avec la crise actuelle tient aux mesures de capitalisme d'Etat destinées à soutenir artificiellement la demande solvable, démontrant par là que cette dernière est également une variable déterminante au niveau de l'explication des crises.
Force est cependant de constater que le taux de profit chute effectivement de façon drastique entre 1929 et 1932 aux Etats-Unis (très faiblement en France cependant). Cette dernière remarque vaut également pour la crise qui émerge de nouveau à la fin des années 1960 : l'orientation du taux de profit est nettement à la baisse entre 1960-80 aux Etats-Unis et entre 1965-80 en France. Ceci signale bel et bien l'existence d'une crise de la profitabilité du capital. Ce que l’on peut affirmer ici dans le cadre de notre discussion, c'est que le taux de profit, s'il a pu constituer un facteur aggravant dans le mécanisme de ces deux crises économiques (celles de 1929 et de la fin des années 1960) n'est cependant pas le seul facteur à entrer en ligne de compte. La saturation des marchés et les mesures de capitalisme d'Etat y ont joué un rôle déterminant. Par ailleurs, il n’épuise absolument pas la question de la crise et de son évolution car l’on constate que le taux de profit remonte vigoureusement dès 1932 aux Etats-Unis alors que l’état de crise perdure et qu’il remonte aussi vigoureusement dès le début des années 1980 dans les pays de l’OCDE alors que l’état de crise continue à s’aggraver ! Dès lors, si le taux de profit a pu constituer un facteur aggravant de ces deux crises, il est bien incapable d’en expliquer le déroulement et la permanence dans le temps bien au-delà de son rétablissement !
L'incapacité totale du BIPR à comprendre l'évolution de la crise actuelle
Le déroulement de la crise actuelle montre à l’évidence en quoi la théorie de la crise exclusivement basée sur l’évolution du taux de profit est totalement insatisfaisante. Le BIPR affirme que le cycle d'accumulation se bloque ou stagne lorsque le taux de profit atteint un seuil trop faible et que ce dernier ne peut véritablement redémarrer que suite aux destructions de guerres permettant de dévaloriser et renouveler le capital fixe : "La loi de la baisse tendancielle du taux de profit signifie qu'à un certain seuil le cycle d'accumulation s'arrête ou stagne. Lorsque ceci advient, seule une dévaluation massive de capitaux existants peut faire redémarrer l'accumulation. Au XXè siècle, les deux guerres mondiales en furent le résultat. Aujourd'hui nous avons eu plus d'une trentaine d'années de stagnation et le système n'a pu que boitiller au travers d'une accumulation massive de dettes tant privées que publiques"[22]. Mais alors :
-
a) Comment le BIPR peut-il valablement expliquer que la crise perdure et s'aggrave alors que le taux de profit est vigoureusement orienté à la hausse depuis le début des années 1980 et qu’il a même retrouvé son niveau des Trente glorieuses depuis un bon bout de temps (cf. graphiques ci-dessus) ?
-
b) Comment le BIPR peut-il valablement expliquer qu'avec un niveau de profit analogue aux années 1960, ni la productivité, ni la croissance, ni l'accumulation n'ont redémarré[23] comme sa théorie le prévoit ?
-
c) Comment le BIPR peut-il valablement expliquer que le taux de profit ait pu retrouver toutes ses couleurs alors que, nous dit-il, "ceci ne peut advenir que s’il y a une dévaluation massive de capitaux existant" ? En effet, comme la troisième guerre mondiale n’a pas eu lieu, où le BIPR peut-il bien aller chercher cette "dévaluation massive de capitaux" pouvant expliquer la remontée du taux de profit ?
Le BIPR a tenté de répondre à la troisième question ci-dessus : comment expliquer la spectaculaire remontée actuelle du taux de profit sans une dévaluation massive suite aux destructions de guerre ? A cette fin, il avance deux arguments. Le premier consiste à reprendre les arguments que nous lui rétorquions dans notre article polémique du n°121 de cette Revue, à savoir que le taux de profit n'augmente pas seulement à la suite d'une dévalorisation massive de capital fixe mais qu'il peut aussi s'accroître suite à une augmentation du taux de plus-value (ou taux d'exploitation)[24]. Or, ceci est très nettement le cas depuis l'austérité drastique qui s'est abattue sur la classe ouvrière (blocage et baisse des salaires, accroissement des rythmes et du temps de travail, etc.) et permet d'expliquer cette remontée du taux de profit. Le second argument du BIPR consiste à substituer les destructions et dévaluations d'une guerre qui n'a pas eu lieu par les balivernes de la propagande bourgeoise concernant une soi-disant nouvelle révolution technologique. Cette dernière aurait eu le même effet ; celui de diminuer le prix du capital fixe suite aux gains de productivité induits par cette nouvelle révolution technologique. Ceci est doublement faux puisque les gains de productivité stagnent à un très faible niveau dans l'ensemble des pays développés, démontrant par-là que cette soi-disant "nouvelle révolution technologique" dont le BIPR nous rebat constamment les oreilles n'est autre que de la pure propagande issue des médias bourgeois[25].
A l'aide de ces deux arguments (hausse du taux de plus-value suite à l'austérité et diminution de la valeur du capital fixe suite à la nouvelle révolution technologique), le BIPR pense triomphalement être parvenu à expliquer la remontée du taux de profit ! Fort bien, mais le problème reste entier pour lui et il se tire même une balle dans le pied en aggravant ses propres contradictions car :
-
a) Comme le BIPR reconnaît maintenant la remontée du taux de profit[26], comment peut-il alors expliquer qu'un nouveau cycle d'accumulation ne s'est pas enclenché puisque toutes les conditions sont présentes : "Dès lors, dans l'expression du taux de profit, le numérateur (la plus value) augmente et le dénominateur (la composition organique) diminue, et donc le taux de profit augmente. C'est sur la base de cet accroissement du taux de profit qu'un nouveau cycle d'accumulation peut démarrer" (Revolutionary Perspectives n°37). La perduration de la crise devient un mystère incompréhensible.
-
b) Suivant en cela les théories de Paul Mattick, nous avons vu que, selon le BIPR, lorsque le taux de profit remonte sur la base d'une diminution de la composition organique du capital et d'une hausse du taux de plus-value, la crise se résorbe[27]. Comment alors le BIPR peut-il valablement nous expliquer que la crise continue à s'aggraver alors que le taux de profit n'a fait qu'augmenter depuis le début des années 1980 ?
-
c) Toute l'argumentation du BIPR était de nous dire qu'en décadence, "au tournant entre le XIXè et le XXè siècle fut atteint un point à partir duquel les crises et la concurrence ne parvinrent plus à détruire du capital dans des proportions suffisantes pour transformer la structure du capital total dans le sens d'une rentabilité accrue. Le cycle économique avait fait son temps et se métamorphosa en un 'cycle' de guerres mondiales". Force est bien de constater que, malgré les nouvelles explications que nous offre le BIPR, le capitalisme a visiblement été capable de relancer son taux de profit sans avoir eu recourt à des dévalorisations massives de capital fixe pendant une guerre. Ce fut aussi le cas aux Etats-Unis dès 1932, c'est-à-dire dix années avant l'entrée de ce pays en guerre (cf. graphique ci-dessus) !
-
d) Si le capitalisme est en pleine nouvelle révolution technologique permettant de fortement diminuer le coût du capital fixe sans passer par des destructions de guerre et qu'il parvient en même temps à notablement augmenter son taux de plus-value, qu'est-ce qui le différencie de sa phase ascendante ? Comment le BIPR peut-il continuer à argumenter le caractère sénile du capitalisme puisque ce dernier a pu faire remonter son taux de profit sans devoir recourir à des destructions massives de guerre, seule possibilité de relancer son cycle d'accumulation dans la période de décadence selon le BIPR ?
-
e) Enfin, si le capitalisme connaît une nouvelle révolution technologique et que le BIPR reconnaît que le taux de profit a sensiblement remonté, pourquoi continue-t-il cependant à nous chanter le même refrain affirmant que le capitalisme est en crise parce que le taux de profit est "très bas" : "La crise au début des années 1970 est la conséquence de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Cela ne signifie pas que les capitalistes s'arrêtent de faire du profit mais cela signifie que leur taux de profit moyen est très bas..." ? Comprenne qui pourra ! Il est effectivement très difficile pour le BIPR de se débarrasser d'un dogme et de se remettre en question lorsqu’il en a fait son fond de commerce depuis sa constitution !
Toutes ces contradictions et questions insolubles invalident purement et simplement la thèse de Mattick et du BIPR qui professent que seul le niveau et/ou la variation du taux de profit sont à même d’expliquer la crise et son évolution ! Pour notre part, tous ces mystères ne sont évidemment compréhensibles que si l’on intègre la thèse centrale énoncée par Marx, à savoir la "restriction de la capacité de consommation de la société", c'est-à-dire la saturation des marchés solvables (cf. première partie de cet article). Pour nous, la réponse est extrêmement claire, le taux de profit n'a pu remonter que suite à la hausse du taux de plus-value consécutive aux attaques incessantes contre la classe ouvrière et non suite à un allégement de la composition organique sur la base d'une fantomatique "nouvelle révolution technologique". C'est cette insuffisance de marchés solvables qui explique qu'aujourd'hui, malgré un taux de profit rétabli, l'accumulation, la productivité et la croissance ne redémarrent pas : "La raison ultime de toutes les crises réelles, c'est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendance de l'économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n'avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolu de la société". Cette réponse est extrêmement simple et claire mais incompréhensible pour le BIPR.
Cette incapacité à comprendre et intégrer la globalité des analyses de Marx et à en rester au dogme de la monocausalité des crises par la baisse du taux de profit est un des obstacles majeurs à leur bonne compréhension. C'est ce que nous allons examiner au point suivant en allant à la racine des divergences entre l'analyse de Marx des crises et la pâle copie émasculée qu'en restitue le BIPR.
C. Mcl
[1] Marx, Le Capital, Livre III, La Pléiade, Economie II : 1206. Cette analyse élaborée par Marx n’a évidemment strictement rien à voir avec la théorie sous-consommationiste des crises qu'il dénonce par ailleurs : "...on prétend que la classe ouvrière reçoit une trop faible part de son propre produit et que l'on pourrait remédier à ce mal en lui accordant une plus grande part de ce produit, donc des salaires plus élevés. Mais il suffit de rappeler que les crises sont chaque fois préparées précisément par une période de hausse générale des salaires, où la classe ouvrière obtient effectivement une plus grande part de la fraction du produit annuel qui est destiné à la consommation. Du point de vue de ces chevaliers du 'simple' (!) bon sens..." (Le Capital, La Pléiade, Economie II : 781). Il faut effectivement être bien naïf comme dit Marx pour croire que la crise économique pourrait se résoudre par une augmentation de la part salariale puisque cette dernière ne peut se faire qu'au détriment de la part des profits et donc de l’investissement productif.
[2] Marx, Le Capital, Edition Sociales, Théories sur la Plus-Value, Livre IV, tome II : 621.
[3] Marx, Le Manifeste, La Pléiade, Economie I : 167.
[4] Marx, Le Capital, La Pléiade, Economie I : 1298-1300.
[5] Marx, Gründrisse, chapitre du Capital : 227, édition 10/18.
[6] Marx parle ici du salariat qui est au centre de ce "rapport de distribution antagonique" et dont la lutte de classe règle la répartition entre la tendance des capitalistes à s’accaparer un maximum de surtravail et la résistance à cette appropriation de la part des travailleurs. C'est cet enjeu qui explique la pente naturelle du capitalisme à restreindre au maximum la part des salaires au bénéfice de la part des profits, ou, autrement dit, d’augmenter le taux de plus-value : plus-value / salaires, également appelé le taux d'exploitation : "La tendance générale de la production capitaliste n’est pas d’élever, mais d’abaisser le niveau moyen des salaires"(Marx, Salaire, prix et profit, La Pléiade, Economie I : 533).
[7] Marx, Le Capital, Editions Sociales, 1974, Livre III°, tome 1 : 257-258
[8] Marx, Le Capital, Edition Sociales, Théories sur la Plus-value, Livre IV, tome II : 636-637.
[9] Marx exprime cette idée dans de nombreux autres passages dans toute son oeuvre dont voici encore un exemple : "Surproduction de capital ne signifie jamais que surproduction de moyens de production ... une baisse du degré d'exploitation au-dessous d'un certain point provoque, en effet, des perturbations et des arrêts dans le processus de production capitaliste, des crises, voire la destruction de capital" (La Pléiade, Economie II : 1038)
[10] Cité dans les œuvres de Marx, La Pléiade – Economie II : 1802.
[11] "Dans les conditions du XIXè siècle, une crise affectant plus ou moins toutes les unités de capital à l'échelle internationale arrivait sans difficultés excessives à résorber la suraccumulation. Mais au tournant du siècle fut atteint un point à partir duquel les crises et la concurrence ne parvinrent plus à détruire du capital dans des proportions suffisantes pour transformer la structure du capital total dans le sens d'une rentabilité accrue. Le cycle économique, en tant qu'instrument d'accumulation, avait dès lors visiblement fait son temps ; plus exactement, il se métamorphosa en un ‘cycle’ de guerres mondiales. Bien qu'on puisse donner de cette situation une explication politique, elle fut tout autant une conséquence du processus de l'accumulation capitaliste. (...) La reprise de l'accumulation du capital, consécutive à une crise 'strictement' économique, s'accompagne d'une augmentation généralisée de la production. De même, la guerre a pour effet de ranimer et d'amplifier l'activité économique. Dans un cas comme dans l'autre, le capital refait surface à un moment donné, plus concentré et plus centralisé que jamais. Et cela, en dépit et à cause, tout à la fois, de la destruction de capital" (Paul Mattick, Marx et Keynes : 167-168, Edition Gallimard, 1972).
[12] "D’après la conception matérialiste de l’histoire, le facteur déterminant dans l’histoire est, en dernière instance, la production et la reproduction de la vie réelle. Ni Marx, ni moi-même n’avons jamais affirmé davantage. Si ensuite, quelqu’un (le BIPR, ndlr) torture cette proposition pour lui faire dire que le facteur économique est le seul déterminant, il la transforme en une phrase vide, abstraite, absurde. La situation économique est la base, mais les divers éléments de la superstructure - les formes politiques de la lutte des classes et ses résultats -, les Constitutions établies une fois la bataille gagnée par la classe victorieuse, etc., les formes juridiques, et même les reflets de toutes ces luttes réelles dans le cerveau des participants, théories politiques, juridiques, philosophiques, conceptions religieuses, et leur développement ultérieur en systèmes dogmatiques, exercent également leur action sur le cours des luttes historiques et, dans beaucoup de cas, en déterminent de façon prépondérante la forme. Il y a action et réaction de tous ces facteurs au sein desquels le mouvement économique finit par se frayer son chemin comme une nécessité à travers la foule infinie de hasard. (...) Sinon, l’application de la théorie à n’importe quelle période historique, serait, ma foi, plus facile que la résolution d’une simple équation du premier degré. (...) C’est Marx et moi-même, partiellement, qui devons porter la responsabilité du fait que, parfois, les jeunes (le BIPR, ndlr) donnent plus de poids qu’il ne lui est dû au côté économique. Face à nos adversaires, il nous fallait souligner le principe essentiel nié par eux, et alors nous ne trouvions pas toujours le temps, le lieu, ni l’occasion de donner leur place aux autres facteurs qui participent à l’action réciproque. (...) Mais, malheureusement, il n’arrive que trop fréquemment que l’on (le BIPR, ndlr) croit avoir parfaitement compris une nouvelle théorie et pouvoir la manier sans difficulté, dès qu’on s’en est approprié les principes essentiels, et cela n’est pas toujours exact" (Engels, lettre du 21 septembre 1890 à J. Block).
c) la démobilisation du prolétariat européen sur son terrain de classe face à la menace de guerre mondiale (contrairement à la situation de 1912, lorsque se tient le Congrès de Bâle) et son embrigadement derrière les drapeaux bourgeois permis, en premier lieu, par la trahison avérée (et vérifiée par les principaux gouvernements) de la majorité des chefs de la Social‑démocratie. Ce sont donc principalement des facteurs politiques qui déterminent, une fois que le capitalisme est entré en décadence, qu'il a fait la preuve qu'il arrivait à une impasse historique, le MOMENT du déclenchement de la guerre" (pages 25-26).
[14] Bairoch Paul, Mythes et paradoxes de l'histoire économique, 1994, Editions La Découverte, p.193.
[15] "L’impérialisme actuel n’est pas comme dans le schéma de Bauer, le prélude à l’expansion capitaliste mais la dernière étape de son processus historique d’expansion : la période de la concurrence mondiale accentuée et généralisée des Etats capitalistes autour des derniers restes de territoires non capitalistes du globe. Dans cette phase finale, la catastrophe économique et politique constitue l’élément vital, le mode normal d’existence du capital..." (Rosa Luxemburg, L’Accumulation du capital - Anti-critiques, Maspéro, p.229) ; "...ce jeune impérialisme (L’Allemagne), plein de force ... fit son apparition sur la scène mondiale avec des appétits monstrueux, alors que le monde était déjà pour ainsi dire partagé, devait devenir très rapidement le facteur imprévisible de l’agitation générale" (Rosa Luxemburg, Junius brochure).
[16] "Grâce à ses colonies, l’Angleterre a augmenté ‘son’ réseau ferré de 100 000 kilomètres, soit quatre fois plus que l’Allemagne. Or, il est de notoriété publique que le développement des forces productives, et notamment de la production de la houille et du fer, a été pendant cette période incomparablement plus rapide en Allemagne qu’en Angleterre et, à plus forte raison, qu’en France et en Russie. En 1892, l’Allemagne produisait 4,9 millions de tonnes de fonte contre 6,8 en Angleterre ; en 1912, elle en produisait déjà 17,9 contre 9 millions, c’est-à-dire qu’elle avait une formidable supériorité sur l’Angleterre ! Faut-il se demander s’il y avait, sur le terrain du capitalisme, un moyen autre que la guerre de remédier à la disproportion entre, d’une part, le développement des forces productives et l’accumulation des capitaux et, d’autre part, le partage des colonies et des ‘zones d’influences’ pour le capital financier ? (...) 5) fin du partage territorial du globe entre les plus grandes puissances capitalistes. L’impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où ... s’est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes" (Lénine, L’impérialisme stade suprême du capitalisme, Oeuvres complètes, tome 22, p.297 et 287).
[17] Ceci renvoie bien entendu à la polémique que nous avions menée avec le BIPR à propos des multiples guerres aux Moyen-Orient. Ce dernier soutenait la thèse de la rationalité économique de ces conflits du côté américain par la volonté de préserver leur rente pétrolière alors que nous lui opposions la thèse de Lénine en montrant que "la conquête du territoire irakien n'a pas tant été menée pour elle-même mais pour affaiblir l'Europe et saper son hégémonie". Le fait actuellement patent que ce conflit est un gouffre sans fond pour les Etats-Unis, qu'ils ne verront jamais la couleur du moindre revenu pétrolier puisqu'ils sont totalement incapable de contrôler le territoire et qu'ils aimeraient pouvoir se désengager, montrent toute la justesse du cadre d'analyse de Lénine !
[18] Introduction à l'économie politique, édition 10/18, p.298-299.
[19] Pour le commerce mondial : 0,12 % entre 1913-1938 soit 25 fois moins qu'entre 1870-1893 (3,10 %) et 30 fois moins qu'entre 1893-1913 (3,74 %) (W.W. Rostow, 1978, The World Economy History and Prospect, University of Texas Press).
La croissance mondiale du PNB par habitant sera seulement de 0,91 % pendant la période 1913-50 contre 1,30 % entre 1870 et 1913 ‑ soit 43 % de plus ‑, 2,93 % entre 1950 et 1973 ‑ soit trois fois plus ‑ et 1,33 % entre 1973 et 1998 ‑ soit 43 % de plus encore pendant cette longue période de crise ‑ (Maddison Angus, L'économie mondiale, 2001, OCDE).
[20] C'est en partie aussi le cas pour le Japon où ce pourcentage n'était que de 1,6 % en 1933 pour s'élever à 9,8 % en 1938. Ce ne fut par contre pas le cas pour les Etats-Unis où le pourcentage n'était encore qu'à 1,3 % en 1938 (toutes ces données sont tirées de Paul Bairoch, Victoires et déboires III, Folio, p.88-89).
[21] Il serait très mal venu de la part du BIPR de nous rétorquer que sa théorie ne s’applique qu’à l'Allemagne, à savoir le pays ayant déclaré la guerre, car, d’une part, ce serait à lui de nous en apporter la preuve empirique et, d’autre part, cela entrerait en contradiction totale avec toute son argumentation qui traite des racines mondiales de l’éclatement de la guerre de 1914-18 et de l'entrée en décadence du capitalisme (il parle d'ailleurs indifféremment de l’Europe ou des Etats-Unis dans son article). Jamais son argumentation ‑ et c’est bien logique ‑ ne se situe au seul niveau national. De plus, à supposer même que le taux de profit en Allemagne évoluait à la baisse à la veille de la première guerre mondiale et à la hausse ensuite, le problème resterait entier car comment démontrer l’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence au niveau mondial alors que la baisse du taux de profit ne se vérifierait que dans un seul pays ?
[23] cf. le graphique publié ci-dessus pour la France ainsi que celui paru dans notre Revue n°121 concernant l'ensemble des pays du G8. Tout deux nous montrent une évolution similaire, à savoir un découplage très net entre un taux de profit à la hausse et une baisse de toutes les autres variables économiques.
[24] "La crise en elle-même, cependant, a comme résultat de rétablir les bonnes proportions entre les éléments du capital et de permettre à l'accumulation de redémarrer. Elle réalise cela essentiellement par deux moyens, la dévaluation du capital fixe et l'accroissement du taux de plus value". (Revolutionary Perspectives n°37)
[25] Nous pouvons constater ce maintien de la productivité à un faible niveau sur le graphique pour la France que nous avons publié ci-dessus ainsi que sur le graphique pour les pays du G8 (les huit pays les plus importants économiquement dans le monde) publié dans le n°121 de cette Revue. En réalité, seuls les Etats-Unis ont connu une faible remontée de leurs gains de productivité mais l'explication de cette remontée conjoncturelle dépasserait le cadre de cet article.
[26] Cette reconnaissance n'est en réalité que très partielle, en tendance, faite du bout des lèvres ... alors qu'il est manifeste que le taux de profit est en augmentation vigoureuse et continue depuis le début des années 1980 et qu'il atteint désormais une hausse analogue à celle des années 1960.
[27] "Selon la théorie marxienne, une augmentation adéquate de la masse de la plus-value suffit à transformer la stagnation en expansion" (Paul Mattick, Marx et Keynes, Gallimard, 1972 : 116), ou encore : "Mais, dans le monde en général comme dans chaque pays pris séparément, la cause de la surproduction n'est autre que le degré insuffisant de l'exploitation. Voilà pourquoi une exploitation accrue permet de la résorber - à condition, il va de soi, que cet accroissement soit assez fort pour relancer l'expansion du capital et, par là, celle de la demande du marché" (idem, p.104) ... malheureusement pour Mattick, la configuration du capitalisme depuis 1980 (mais aussi entre 1932 et la seconde guerre mondiale) vient apporter un démenti cinglant à ses théories puisque, malgré un très fort accroissement de l'exploitation, il n'y a pas eu de relance de l'expansion du capital et de la demande du marché.
Courants politiques:
Questions théoriques:
- Décadence [20]
- Guerre [21]
- L'économie [22]
Débat interne au sein du CCI - Texte d'orientation : sur le marxisme et l'éthique (juin 2004)
- 4753 reads
Dans le numéro précédent [23] de notre Revue nous avons commencé la publication de larges extraits d'un texte d'orientation soumis à la discussion interne dans notre organisation et traitant de Marxisme et éthique. Dans les extraits publiés on peut lire :
"Nous avons toujours insisté sur le fait que les statuts du CCI ne sont pas une liste de règles définissant ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, mais une orientation pour notre attitude et notre conduite, incluant un ensemble cohérent de valeurs morales (notamment en ce qui concerne les rapports des militants entre eux et envers l’organisation). C’est pourquoi nous exigeons de tous ceux qui veulent devenir membres de notre organisation un accord profond avec ces valeurs. Nos statuts sont une partie intégrante de notre plate-forme, et ne servent pas seulement à établir qui peut devenir membre du CCI et dans quelles conditions. Ils conditionnent le cadre et l’esprit de la vie militante de l’organisation et de chacun de ses membres.
La signification que le CCI a toujours attachée à ces principes de comportement est illustrée par le fait qu’il s’est toujours engagé à les défendre, même au risque de subir des crises organisationnelles. De ce fait, le CCI s’est situé de façon consciente et inébranlable dans la tradition de lutte de Marx et Engels au sein de la Première Internationale, des Bolcheviks et de la Fraction italienne de la Gauche communiste. C’est pour cela qu’il a été capable de surmonter toute une série de crises et de maintenir les principes fondamentaux d'un comportement de classe.
Cependant, c’est de façon plus implicite qu’explicite que le CCI a défendu le concept d’une morale et d’une éthique prolétariennes ; il l’a mis en pratique de façon empirique plutôt que généralisé d’un point de vue théorique. Face aux grandes réticences de la nouvelle génération de révolutionnaires qui a surgi à la fin des années 1960 envers tout concept de morale, considéré comme étant nécessairement réactionnaire, l’attitude développée par l’organisation a consisté à accorder plus d’importance à ce que soient acceptés les attitudes et les comportements de la classe ouvrière plutôt que de mener ce débat très général à un moment où ce dernier n’était pas encore mûr.
Les questions de morale prolétarienne ne sont pas le seul domaine envers lequel le CCI a procédé de cette manière. Dans les premières années d’existence du CCI, il existait des réserves similaires concernant la nécessité de la centralisation, le caractère indispensable de l’intervention des révolutionnaires et le rôle dirigeant de l’organisation dans le développement de la conscience de classe, la nécessité de combattre le démocratisme ou la reconnaissance de l’actualité du combat contre l’opportunisme et le centrisme."
Cette première partie des extraits publiés traitait des thèmes suivants :
- Le problème de la décomposition et la perte de confiance dans le prolétariat et dans l’humanité
- Les causes des réserves parmi les révolutionnaires envers le concept de morale prolétarienne après 1968
- La nature de la morale
- L’éthique, c'est-à-dire la théorie de la morale, précède le marxisme
- Le marxisme et les origines de la morale
- La lutte du prolétariat contre la morale bourgeoise
- La morale du prolétariat
Dans ce numéro, nous allons poursuivre cette publication d'extraits en revenant sur les combats menés par le marxisme contre différentes formes et manifestations de la morale bourgeoise et sur le combat nécessaire que le prolétariat devra mener contre les effets de la décomposition de la société capitaliste, notamment dans la perspective de la reconquête de cet élément essentiel de son combat et de sa perspective historique, la solidarité.
Le combat du Marxisme contre l’idéalisme éthique
A la fin du 19e siècle, le courant autour de Bernstein au sein de la Deuxième Internationale mettait en avant que dans la mesure où le marxisme se revendiquait d’une démarche scientifique, il excluait le rôle de l’éthique dans la lutte de classe. Considérant qu’une démarche scientifique et une démarche éthique s’excluaient mutuellement, ce courant prêchait le renoncement à la démarche scientifique au profit de l’approche éthique. Il proposait de ‘compléter’ le marxisme avec l’éthique de Kant. Derrière cette volonté de condamner moralement l’avidité des individus capitalistes, se faisait jour la détermination du réformisme bourgeois d’enterrer ce qui est fondamentalement irréconciliable entre le capitalisme et le communisme.
Loin d’exclure l’éthique, la démarche scientifique du marxisme introduit pour la première fois une dimension réellement scientifique à la connaissance sociale et par là même à la morale. Il assemble le puzzle de l’histoire par la compréhension que le rapport social essentiel est celui qui existe entre la force de travail (le travail vivant) et les moyens de production (le travail mort). Le capitalisme avait préparé la voie à cette découverte, exactement comme il a préparé la voie au communisme en dépersonnalisant le mécanisme de l’exploitation.
En réalité, l’appel à revenir à l’éthique de Kant représentait une régression théorique bien en deçà du matérialisme bourgeois qui avait déjà compris quelles étaient les origines sociales du "bien et du mal". Depuis lors, chaque avancée dans le savoir social a confirmé et approfondi cette compréhension. Ceci s’applique au progrès, pas seulement dans les sciences comme dans le cas de la psychanalyse, mais aussi à l’art. Comme l’a écrit Rosa Luxemburg, "Hamlet, à travers le crime de sa mère, est confronté à la dissolution de tous les liens de l’humanité et à un monde hors de son entendement. Il en va de même avec Dostoïevski, quand il envisage le fait qu‘un être humain puisse en assassiner un autre. Il ne trouve pas de repos, il se sent responsable de cet horrible fardeau qui pèse sur ses épaules, comme il en est pour chacun d’entre nous. Il doit entrer dans l'âme du meurtrier, il doit traquer sa misère, son affliction, jusqu’aux replis les plus cachés de son coeur. Il souffre toutes ses tortures et est aveuglé par la terrible compréhension que le meurtrier lui même est la victime la plus malheureuse de la société... Les romans de Dostoïevski sont des attaques féroces contre la société bourgeoise à la face de laquelle il crie : le vrai meurtrier, le meurtrier de l’âme humaine, c’est vous"[1]
C’était aussi le point de vue défendu par la jeune dictature du prolétariat en Russie. Elle demandait aux tribunaux de "se libérer entièrement de tout esprit de revanche. Ils ne peuvent pas se venger des gens simplement parce qu’ils ont dû vivre dans une société bourgeoise".[2]
C’est justement cette compréhension que nous sommes tous victimes des circonstances qui fait de l’éthique marxiste l’expression la plus élevée du progrès moral de nos jours. Cette démarche n’abolit pas la morale, comme le prétendent les bourgeois, ou n’exclut pas la responsabilité individuelle comme l’individualisme petit bourgeois le ferait. Mais elle représente un pas de géant car elle fonde la morale sur la compréhension plutôt que sur la faute, le sentiment de culpabilité qui handicape le progrès moral en faisant une séparation entre la personnalité propre de chacun et les autres humains. Elle remplace la haine des personnes, cette source primordiale de pulsion anti-sociale, par l’indignation et la révolte vis-à-vis des rapports et des comportements sociaux.
La nostalgie réformiste vis-à-vis de Kant était en réalité l’expression de l’érosion de la volonté de combattre. L’interprétation idéaliste de la morale, en lui déniant son rôle de transformation des rapports sociaux, est une concession émotionnelle à l’ordre existant. Bien que les idéaux les plus élevés de l’humanité aient toujours été ceux de la paix intérieure et de l’harmonie avec le monde social et naturel qui nous entoure, ils ne peuvent être atteints que par une lutte constante. La première condition du bonheur humain est de savoir qu’on fait ce qui est nécessaire, qu’on sert, volontairement, une grande cause.
Kant avait beaucoup mieux compris que les théoriciens utilitaristes bourgeois comme Bentham [3] la nature contradictoire de la morale bourgeoise. En particulier, il avait compris que l’individualisme débridé, même sous la forme positive de la recherche du bonheur personnel, pouvait mener à la dissolution de la société. Le fait qu’au sein du capitalisme, il ne puisse y avoir uniquement que des vainqueurs dans la lutte concurrentielle, rend inévitable la division entre ce à quoi on aspire et le devoir. L’insistance de Kant sur la prééminence du devoir correspond à la reconnaissance du fait que la valeur la plus élevée de la société bourgeoise n’est pas l’individu mais l’État et, en particulier, la nation.
Dans la morale bourgeoise, le patriotisme est une valeur beaucoup plus élevée que l’amour de l’humanité. En fait, derrière le manque d’indignation au sein du mouvement ouvrier face au réformisme, l’érosion de l’internationalisme prolétarien transparaissait déjà.
Pour Kant, un acte moral motivé par le sens du devoir a une plus grande valeur éthique qu’un acte accompli avec enthousiasme, passion et plaisir. Ici, la valeur éthique est liée au renoncement, à l’idéalisation du sacrifice de soi par l’idéologie nationaliste et étatique. Le prolétariat rejette absolument ce culte inhumain du sacrifice en soi que la bourgeoisie a hérité de la religion. Bien que la joie du combat renferme nécessairement le fait d’être prêt à souffrir, le mouvement ouvrier n’a jamais fait de ce mal nécessaire une qualité morale en soi. D’ailleurs, même avant le marxisme, les meilleures contributions à l’éthique ont toujours souligné les conséquences pathologiques et immorales d’une telle démarche. Contrairement à ce que croit l’éthique bourgeoise, le sacrifice de soi ne sanctifie pas un but qui n’est pas valable.
Comme Franz Mehring l’a souligné, même Schopenhauer qui fondait son éthique sur la compassion plutôt que sur le devoir, représentait un pas décisif par rapport à Kant.[4]
La morale bourgeoise, incapable même d’imaginer le dépassement de la contradiction entre individu et société, entre égoïsme et altruisme, prend parti pour l’un contre l’autre, ou cherche un compromis entre les deux. Elle n’arrive pas à comprendre que l’individu lui-même a une nature sociale. Contre les morales idéalistes, le marxisme défend l’idéalisme moral comme une activité qui donne du plaisir, et comme un des atouts les plus puissants d’une classe montante contre une classe en décomposition.
Un autre attrait de l’éthique kantienne pour l’opportunisme est que son rigorisme moral, sa formule de "l’impératif catégorique", contenait la promesse d’une sorte de code qui permettrait de pouvoir résoudre automatiquement tous les conflits moraux. Pour Kant, la certitude qu’on a raison est caractéristique de l’activité morale. (…) Là encore, s’exprime la volonté d’éviter le combat.
Le caractère dialectique de la morale est nié, là où la vertu et le vice, dans la vie concrète, ne sont pas toujours aisément distinguables. Comme Josef Dietzgen l’a souligné, la raison ne peut déterminer le cours de l’action à l’avance, puisque chaque individu et chaque situation sont uniques et sans précédent. Les problèmes moraux complexes doivent être étudiés de façon à être compris et résolus de manière créative. Cela peut quelquefois exiger une investigation particulière et même la création d’un organe spécifique, comme le mouvement ouvrier l’a compris depuis longtemps[5].
En réalité, les conflits moraux font inévitablement partie de la vie, et non pas seulement au sein de la société de classe. Par exemple, différents principes éthiques peuvent entrer en conflit les uns avec les autres (…), ou les différents niveaux de la socialisation de l’homme (ses responsabilités vis-à-vis de la classe ouvrière, de la famille, l’équilibre de la personnalité, etc.). Cela requiert d’être prêt â vivre momentanément avec des incertitudes, de façon à permettre un véritable examen, en évitant la tentation de faire taire sa propre conscience ; la capacité de remettre en question ses propres préjugés ; et par dessus tout, une méthode collective rigoureuse de clarification.
Dans le combat contre le néo-Kantisme, Kautsky a montré comment la contribution de Darwin sur les origines de la conscience dans les pulsions biologiques, à l’origine animales, avait brisé l’emprise la plus forte des morales idéalistes. Cette force invisible, cette voix à peine audible, qui n’opère que dans les profondeurs intérieures de la personnalité, a toujours été le point crucial des controverses éthiques. L’éthique idéaliste avait raison d’insister sur le fait que la mauvaise conscience ne peut pas être expliquée par la peur de l’opinion publique ou des sanctions de la majorité. Au contraire, cette conscience peut nous obliger à nous opposer à l’opinion publique et à la répression, ou à regretter nos actions, même si celles-ci rencontrent une approbation universelle. "La loi morale n'est pas autre chose qu'une pulsion animale. De là provient sa nature mystérieuse, cette voix en nous qui n’est en relation avec aucune pulsion extérieure, aucun intérêt visible, ce démon ou ce Dieu, que de Socrate et Platon jusqu’à Kant, les théoriciens de la morale ont entendue, eux qui ont refusé de faire découler la morale de l’ego ou du plaisir. Une pulsion réellement mystérieuse, mais pas plus mystérieuse que l’amour sexuel, l’amour maternel, l’instinct de conservation... Le fait que la loi morale soit un instinct universel, comparable à l’instinct de conservation et de reproduction, explique sa force, son insistance, faisant qu’on lui obéit sans réfléchir"[6]
Ces conclusions ont été confirmées depuis lors par la science, par exemple par Freud qui insistait sur le fait que les animaux les plus évolués et les plus socialisés possèdent un dispositif psychique de base comme l’homme et pouvaient souffrir de névroses comparables. Mais Freud n’a pas seulement approfondi notre compréhension de ces questions. Comme la démarche psychanalytique n’est pas seulement une investigation mais qu’elle est aussi thérapeutique et cherche à intervenir, elle partage avec le marxisme un souci pour le développement progressif du dispositif moral de l’homme.
Freud fait des distinctions entre les pulsions (le "Ça"), le "Moi" qui permet de connaître l’environnement et d’assurer l’existence (une sorte de principe de réalité) et le "Surmoi" qui comprend la bonne conscience et assure l’appartenance à la communauté. Bien que Freud ait parfois affirmé dans des polémiques que la "bonne conscience" n’est "rien d’autre que la peur sociale", toute sa conception de comment les enfants internalisent la morale de la société exprime clairement que ce processus dépend de l’attachement affectif et émotionnel aux parents et du fait qu’ils sont acceptés en tant qu’exemple d’émulation.[7] (…)
Freud examine aussi les interactions entre les facteurs conscients et inconscients de la bonne conscience elle-même. Le "Surmoi" développe la capacité de réfléchir sur lui-même. Le "Moi", pour sa part, peut et doit réfléchir sur les réflexions du "Surmoi". C’est à travers cette "double réflexion" que le cours d’une action devient un acte conscient, propre à soi-même. Cela correspond à la vision marxiste selon laquelle le dispositif moral de l’homme est basé sur des pulsions sociales; qu’il comprend des composantes inconscientes, semi-conscientes et conscientes ; qu’avec l’avancée de l’humanité, le rôle du facteur conscience s’accroît jusqu’à ce que, avec le prolétariat révolutionnaire, l’éthique, basée sur une méthode scientifique, devienne de plus en plus le guide du comportement moral; qu’au sein de la bonne conscience elle-même, le progrès moral est inséparable du développement de la conscience aux dépens des sentiments de culpabilité.[8] L’homme peut de plus en plus assumer ses responsabilités, pas seulement vis-à-vis de sa propre bonne conscience, mais aussi à cause de ce que contiennent ses propres valeurs morales et ses convictions.
Le combat du marxisme contre l’utilitarisme éthique
En dépit de ses faiblesses, le matérialisme bourgeois, en particulier sous sa forme utilitariste - avec le concept que la morale est l’expression d’intérêts réels et objectifs - représentait un énorme pas en avant dans la théorie éthique. Il préparait la voie à une compréhension historique de l’évolution morale. En révélant la nature relative et transitoire de tous les systèmes de morale, il a porté un grand coup à la vision religieuse et idéaliste d’un code, éternellement invariable, et prétendument établi par Dieu.
Comme nous l’avons vu, la classe ouvrière, dès les premiers temps, tirait déjà ses propres conclusions socialistes de cette démarche. Bien que les premiers théoriciens socialistes tels que Robert Owen ou William Thompson soient allés bien au delà de la philosophie de Jeremy Bentham, qu’ils avaient prise comme point de départ, l’influence de la démarche utilitariste est restée forte au sein du mouvement ouvrier, même après le surgissement du marxisme. Les premiers socialistes ont révolutionné la théorie de Bentham, en appliquant ses postulats de base aux classes sociales plutôt qu’aux individus, préparant ainsi la voie à la compréhension de la nature sociale et de classe de l’histoire de la morale. La reconnaissance que les propriétaires d’esclaves n’avaient pas le même registre de valeurs que les marchands ou les nomades du désert, ni le même que les bergers des montagnes, avait déjà été sérieusement confirmée par l’anthropologie au cours de l’expansion coloniale. Le marxisme a profité de ce travail préparatoire, comme il a profité des études de Morgan et de Maurer en donnant un éclairage sur la "généalogie des morales"[9]. Mais malgré le progrès que cela représentait, cet utilitarisme, même sous sa forme prolétarienne, laissait tout un tas de questions sans réponse.
Premièrement, si la morale n’est rien d’autre que la codification d’intérêts matériels, elle devient elle-même superflue et disparaît en tant que facteur social en lui-même. Le matérialiste radical anglais, Mandeville, avait déjà affirmé sur cette base que la morale n’est rien d’autre que de l’hypocrisie servant à cacher les intérêts fondamentaux des classes dominantes. Plus tard, Nietzsche devait tirer des conclusions quelque peu différentes des mêmes prémisses : la morale est le moyen de la multitude qui est faible d’empêcher la domination de l’élite, et donc que la libération de cette dernière demandait la reconnaissance que pour elle tout est permis. Mais comme Mehring l’a souligné, la prétendue abolition de la morale chez Nietzsche, dans Par delà le Bien et le Mal, n’est rien d’autre que l’établissement d’une nouvelle morale, celle du capitalisme réactionnaire et de sa haine du prolétariat socialiste, libérée des entraves de la décence petite bourgeoise et de la respectabilité de la grande bourgeoisie[10]. En particulier, l’identité entre intérêt et morale implique, comme les jésuites l’avaient déjà affirmé, que la fin justifie les moyens[11].
Deuxièmement, en prenant pour postulat que les classes sociales représentent des "individus collectifs" qui poursuivent simplement leurs propres intérêts, l’histoire apparaît comme une dispute sans aucun sens, dont ce qu’il en ressort est peut être important pour les classes concernées mais pas pour la société dans son ensemble. Cela représente une régression par rapport à Hegel qui avait déjà compris (bien que sous une forme mystifiée) non seulement la relativité de toute morale mais aussi le caractère progressiste de l’édification de nouveaux systèmes éthiques en violation de la morale établie. C’était dans ce sens que Hegel déclarait: "On peut s’imaginer qu’on dit quelque chose de grand en affirmant : l’homme est naturellement bon. Mais on oublie qu’on dit quelque chose de beaucoup plus grand en disant : l’homme est naturellement mauvais"[12].
Troisièmement, la démarche utilitaire conduit à un rationalisme stérile qui élimine les émotions sociales de la vie morale.
Les conséquences négatives de ces restes utilitaristes bourgeois sont devenues visibles quand le mouvement ouvrier, avec la Première Internationale, a commencé à dépasser la phase des sectes. L’investigation sur le complot de l’Alliance contre l’internationale, -en particulier, les commentaires de Marx et Engels sur le "catéchisme révolutionnaire" de Bakounine- révèle "l’introduction de l’anarchie dans la morale" au travers d’un "jésuitisme" qui "pousse l’immoralité de la bourgeoisie jusqu'à ses ultimes conséquences". Le rapport rédigé sur mandat du Congrès la Haye en 1872 souligne les éléments suivants de la vision de Bakounine : le révolutionnaire n’a pas d’intérêt personnel, pas d’affaires ni de sentiments personnels ou d’envies qui lui soient propres ; il a rompu non seulement avec l’ordre bourgeois, mais avec la morale et les coutumes du monde civilisé tout entier ; il considère comme une vertu tout ce qui favorise le triomphe de la révolution et comme un vice tout ce qui la freine ; il est toujours prêt à tout sacrifier, y compris sa propre volonté et sa personnalité ; il élimine tous les sentiments d’amitié, d’amour ou de reconnaissance ; confronté à la nécessité, il n’hésite jamais à liquider n’importe quel être humain ; il ne connaît d’autre échelle de valeurs que celle de l’utilité.
Profondément indignés face à cette démarche, Marx et Engels déclarent que c’est la morale des bas-fonds, celle du lumpen-prolétariat. Aussi grotesque qu’infamant, plus autoritaire que le communisme le plus primitif, Bakounine fait de la révolution "une série d’assassinats individuels puis de masse" où "la seule règle de conduite est la morale jésuite exagérée"[13].
Comme nous le savons, le mouvement ouvrier dans son ensemble n’a pas assimilé en profondeur les leçons de la lutte contre le bakouninisme. Dans son Matérialisme historique, Boukharine présente les normes de l’éthique comme de simples règles et règlements. La tactique remplace la morale. Encore plus confuse est l’attitude de Lukacs face à la révolution. Après avoir au départ présenté le prolétariat comme la réalisation de l’idéalisme moral de Kant et Fichte, Lukacs verse dans l’utilitarisme. Dans Que signifie une action révolutionnaire ? (1919), il déclare : "la règle du tout qui prime sur la partie implique le sacrifice de soi déterminé... Ne peut être révolutionnaire que celui qui est prêt à tout pour faire aboutir ces intérêts".
Mais le renforcement de la morale utilitariste après 1917 en URSS était par dessus tout l’expression des besoins de l’État transitoire. Dans «Morale et normes de classe", Preobrajensky présente l’organisation révolutionnaire comme une espèce d’ordre monastique moderne. Il veut même soumettre les relations sexuelles au principe de la sélection eugénique, dans un monde où la distinction entre individu et société est abolie et dans lequel les émotions sont subordonnées aux résultats des sciences naturelles. Même Trotsky n’est pas indemne de cette influence, puisque dans Leur morale et la nôtre, dans une défense inavouée de la répression de Cronstadt, il défend au fond la formule selon laquelle "la fin justifie les moyens".
C’est tout à fait vrai que chaque classe sociale tend à identifier le "bien" et la "vertu" à ses propres intérêts. Néanmoins, intérêt et morale ne sont pas identiques. L’influence de classe sur les valeurs sociales est extrêmement complexe, puisqu’elle intègre la position d’une classe donnée dans le processus de production et la lutte de classe, ses traditions, ses buts et ses attentes pour le futur, sa part dans la culture tout autant que la façon dont tout cela se manifeste sous la forme du mode de vie, des émotions, des intuitions et des aspirations.
En opposition à la confusion utilitariste entre intérêt et morale, (ou "devoir" comme il le formule ici), Dietzgen distingue les deux. "L’intérêt représente davantage le bonheur concret, présent, tangible ; le devoir au contraire, le bonheur général, élargi, conçu aussi pour l’avenir. (...). Le devoir se préoccupe également du coeur, des besoins de la société, de l’avenir, du salut de l’âme, bref de la totalité de nos intérêts ; et il nous enseigne à renoncer au superflu pour obtenir et conserver le nécessaire"[14].En réaction aux affirmations idéalistes de l’invariance de la morale, l’utilitarisme social tombe dans l’autre extrême et insiste si unilatéralement sur sa nature transitoire qu’il perd de vue l’existence de valeurs communes qui donnent une cohésion à la société, et de progrès éthiques. La continuité du sentiment de communauté n’est pas cependant une fiction métaphysique.
Ce "relativisme exagéré" voit les classes individuelles et leur combat mais ne voit pas "le processus social global, l’interconnexion des différents épisodes et, par là, ne réussit même pas à distinguer les différentes étapes du développement moral comme faisant partie de processus liés entre eux. Il ne possède pas de critères généraux avec lesquels évaluer les différentes normes, il n‘est pas capable d’aller au delà des apparences immédiates et temporaires. Il ne rassemble pas les différentes apparences dans une unité au moyen de la pensée dialectique"[15].
En ce qui concerne les rapports entre la fin et les moyens, la formulation correcte du problème n’est pas que la fin justifie les moyens mais que le but influe sur les moyens et que les moyens influent sur le but. Les deux termes de la contradiction se déterminent mutuellement et se conditionnent l’un l’autre. De plus, la fin et les moyens ne sont autres que des maillons dans une chaîne historique, dont chaque fin est en retour un moyen d’atteindre un but plus élevé. C’est pourquoi la rigueur méthodologique et éthique doit s’appliquer à tout le processus, en se référant au passé et au futur, et pas seulement à l’immédiat. Les moyens qui ne servent pas à un but donné, ne font que le déformer et s’en éloigner. Le prolétariat, par exemple, ne peut pas vaincre la bourgeoisie en utilisant les armes de celle-ci. La morale du prolétariat s’oriente à la fois d’après la réalité sociale et d’après les émotions sociales. C’est pourquoi elle rejette à la fois l’exclusion dogmatique de la violence et le concept d’indifférence morale vis-à-vis des moyens employés.
En parallèle avec cette fausse compréhension des liens entre but et moyens, Preobrajensky considère aussi que le sort des parties, et en particulier de l’individu, n’est pas important et peut aisément être sacrifié dans l’intérêt du tout. Ce n’était cependant pas l’attitude de Marx qui considérait la Commune de Paris comme prématurée, mais s’est néanmoins rallié à elle par solidarité ; ni celle d’Eugène Léviné et du jeune KPD qui sont entrés dans le gouvernement de la République des Conseils de Bavière en train d’échouer, et à la proclamation de laquelle ils s’étaient opposés ; pour organiser sa défense de façon à minimiser le nombre de victimes prolétariennes. Le critère unilatéral de l’utilitarisme de classe ouvre en fait la porte à une solidarité de classe très conditionnelle.
Comme Rosa Luxemburg l’a souligné dans sa polémique contre Bernstein, la contradiction principale au coeur du mouvement prolétarien est que son combat quotidien se situe au sein du capitalisme alors que ses buts sont en dehors et représentent une rupture fondamentale avec ce système. Il en résulte que l’usage de la violence et de la ruse contre l’ennemi de classe est nécessaire, et l’expression d’une haine de classe et d’agressions anti-sociales difficiles à éviter. Mais le prolétariat n’est pas moralement indifférent face à de telles manifestations. Même quand il emploie la violence, il ne doit jamais oublier, comme Pannekoek l’a dit, que son but est d’éclairer les esprits, non de les détruire. Et comme Bilan[16] en a tiré la conclusion de l’expérience russe, le prolétariat doit éviter l’usage de la violence autant que possible contre les couches non exploiteuses et l’exclure, par principe, au sein des rangs de la classe ouvrière. Même dans le contexte de la guerre civile contre l’ennemi de classe, le prolétariat doit être convaincu de la nécessité d’agir contre l’apparition de sentiments anti-sociaux tels que la vengeance, la cruauté, la volonté de détruire puisqu’ils conduisent à l’abrutissement et affaiblissent la lumière de la conscience. De tels sentiments sont le signe de la pénétration de l’influence d’une classe étrangère. Ce n’est pas pour rien qu’après la révolution d’Octobre, Lénine considérait que, juste après l’extension de la révolution, la priorité devait être l’élévation du niveau culturel des masses. Nous devons aussi nous rappeler que c’est d’abord parce qu’il avait vu la cruauté et l’indifférence morale de Staline, que Lénine a été capable d’identifier (dans son "testament") le danger qu’il représentait.
Les moyens employés par le prolétariat doivent correspondre, autant que possible, à la fois au but et aux émotions sociales qui correspondent à sa nature de classe. Ce n’est pas pour rien qu’au nom de ces émotions, le programme du 14 décembre 1918 du KPD, tout en défendant résolument la nécessité de la violence de classe, rejetait l’usage de la terreur.
- "La révolution prolétarienne n’a nul besoin de la terreur pour réaliser ses objectifs. Elle haie et abhorre l’assassinat. Elle n ‘a pas besoin de recourir à ces moyens de lutte parce qu’elle ne combat pas des individus, mais des institutions, parce qu’elle n’entre pas dans l’arène avec des illusions naïves qui, déçues, entraîneraient une vengeance sanglante"[17].
En opposition à cela, l’élimination du côté émotionnel de la morale par la démarche de l’utilitarisme matérialiste mécaniciste est typiquement bourgeoise. Dans cette démarche, l’usage des mensonges, de la tromperie est moralement supérieur s’il sert à l’accomplissement d’un but donné. Mais les mensonges qu’ont fait circuler les bolcheviks pour justifier la répression de Cronstadt, ont non seulement miné la confiance de la classe dans le parti mais ont aussi sapé la conviction des bolcheviks eux-mêmes. La vision selon laquelle "la fin justifie les moyens", nie dans la pratique la supériorité éthique de la révolution prolétarienne sur la bourgeoisie. Elle oublie que, plus la préoccupation d’une classe correspond au bien-être de l’humanité, plus cette classe peut en tirer sa force morale.
Le slogan qui a cours dans le monde des affaires suivant lequel il n’y a que le succès qui compte, quels que soient les moyens employés, ne saurait s'appliquer à la classe ouvrière. Le prolétariat est la première classe révolutionnaire dont la victoire finale est préparée par une série de défaites. Les leçons inestimables, mais aussi l’exemple moral des grands révolutionnaires et des grandes luttes ouvrières sont les conditions pour une victoire future.
Les effets de la décomposition du capitalisme
Dans la période historique présente, l’importance de la question de l’éthique est plus grande que jamais. La tendance caractéristique à la dissolution des liens sociaux et de toute pensée cohérente, a obligatoirement des effets particulièrement négatifs sur la morale. De plus, la désorientation éthique au sein de la société est elle-même une composante centrale du problème qui se trouve au coeur de la décomposition du tissu social. La situation de blocage qui s’est produite entre la réponse de la bourgeoisie à la crise du capitalisme et la réponse du prolétariat, entre la guerre mondiale et la révolution mondiale, est directement liée à la sphère de l’éthique sociale. La sortie de la contre-révolution due à une nouvelle génération du prolétariat qui n’avait pas été défaite après 68, n’exprimait pas moins que le discrédit historique du nationalisme, surtout dans les pays où se trouvent les secteurs les plus forts du prolétariat mondial. Par ailleurs cependant, les luttes ouvrières massives après 68 ne se sont pas accompagnées, pour le moment, d’un développement correspondant de la dimension théorique et politique du combat prolétarien, en particulier d’une affirmation explicite et consciente du principe de l’internationalisme prolétarien. En conséquence, aucune des deux classes majeures de la société contemporaine n’a été capable, pour le moment, de faire progresser son idéal spécifique de classe concernant la communauté sociale.
En général, la morale dominante est celle de la classe dominante. Pour cette raison précisément, toute morale dominante, de façon à servir les intérêts de la classe dominante, doit en même temps contenir des éléments d’intérêt moral général de façon à assurer la cohésion de la société. Un de ces éléments est le développement d’une perspective ou d’un idéal de communauté sociale. Un tel idéal est un facteur indispensable pour réfréner les pulsions anti-sociales.
Comme nous l’avons vu, le nationalisme est l’idéal spécifique de la société bourgeoise. Ceci correspond au fait que l’État national est l’unité la plus développée que peut réaliser le capitalisme. Quand le capitalisme entre dans sa phase décadente, l’État-Nation cesse définitivement d’être un instrument de progrès dans l’histoire, devenant en fait le principal instrument de la barbarie sociale. Mais déjà, bien avant que cela ne se soit produit, le fossoyeur du capitalisme, la classe ouvrière -justement parce qu’elle est le porteur d’un idéal plus élevé, internationaliste- a été capable de mettre en limière la nature trompeuse de la communauté nationale. Bien qu’en 1914, les travailleurs aient oublié cette leçon au début, la Première Guerre mondiale allait révéler la réalité de la principale tendance, non seulement de la morale bourgeoise, mais de la morale de toutes les classes exploiteuses. Celle-ci consiste en la mobilisation des élans les plus héroïques, les plus altruistes, des classes laborieuses au service de la plus étroite et de la plus sordide des causes.
Malgré son caractère trompeur et de plus en plus barbare, la nation est le seul idéal que la bourgeoisie peut brandir pour donner une cohésion à la société. Il n’y a que cet idéal qui corresponde à la réalité contemporaine de la structure étatique de la société bourgeoise. C’est pourquoi tous les autres idéaux sociaux qui se font jour aujourd’hui -la famille, l’environnement local, la religion, la communauté culturelle ou ethnique, le style de vie en groupe ou en gang- sont réellement des expressions de la dissolution de la vie sociale, de la putréfaction de la société de classe. Ce n’est pas moins vrai pour toutes les réponses morales qui essaient d’embrasser la société dans son ensemble, mais sur la base de l’interclassisme : l’humanitarisme, l’écologisme, "l’altermondialisation". En prenant comme postulat que l’amélioration de l’individu est à la base du renouveau de la société, elles représentent des expressions démocratistes de la même fragmentation individualiste à la base de la société. Il va sans dire que toutes ces idéologies servent admirablement la classe dominante dans son combat pour bloquer le développement d’une alternative de classe, prolétarienne, internationaliste, au capitalisme.
Au sein de la société en décomposition, nous pouvons identifier certains traits qui ont des implications directes au niveau des valeurs sociales.
D’abord, le manque de perspective fait que les comportements humains tendent à se tourner vers le présent et le passé. Comme nous l’avons vu, une part centrale du coeur rationnel de la morale est la défense des intérêts à long terme contre le poids de l’immédiat. L’absence d’une perspective à long terme favorise la perte de solidarité entre individus et groupes de la société contemporaine, mais aussi entre les générations. Il en résulte que tend à se développer la mentalité pogromiste c’est-à-dire la haine destructrice envers un bouc émissaire rendu responsable de la disparition d’un passé meilleur idéalisé. Sur la scène politique mondiale, nous pouvons observer cette tendance au développement de l’anti-sémitisme, de l’anti-occidentalisme ou de l’anti-islamisme, à la multiplication des "nettoyages ethniques", à la montée du populisme politique contre les immigrants et d’une mentalité de ghetto chez les immigrants eux-mêmes. Mais cette mentalité tend à imprégner la vie sociale dans son ensemble, comme l’illustre le développement du "mobbing" comme phénomène général.
Ensuite, le développement de la peur sociale tend à paralyser à la fois les instincts sociaux et la réflexion cohérente, les principes de base de la solidarité humaine et surtout de classe aujourd’hui. Cette peur est le résultat de l’atomisation sociale qui donne à chaque individu le sentiment d’être seul avec ses problèmes. Cette solitude donne en retour un éclairage particulier à la façon dont est vu le reste de la société, rendant le mode de réaction des autres êtres humains plus imprévisible, ce qui fait que ces derniers sont considérés comme menaçants et hostiles. Cette peur -qui nourrit tous les courants irrationnels de pensée qui sont tournés vers le passé et le néant- doit être distinguée de la peur résultant d’une insécurité sociale croissante provoquée par la crise économique. Car un tel sentiment d’insécurité matérielle peut devenir un puissant stimulant de la solidarité de classe face à cette crise économique.
Enfin, le manque de perspective et la dislocation des liens sociaux font que, pour de nombreux êtres humains, la vie semble être dépourvue de sens. Cette atmosphère de nihilisme est en général insupportable pour l’humanité, parce qu’elle est en contradiction avec l’essence consciente et sociale du genre humain. Elle donne donc lieu à toute une série de phénomènes très intriqués, dont le plus important est le développement d’une nouvelle religiosité et d’une fixation sur la mort.
Dans les sociétés principalement fondées sur l’économie naturelle, la religion est avant tout l’expression d’une arriération, d’une ignorance et d’une peur des forces de la nature. Dans le capitalisme, la religion se nourrit principalement de l’aliénation sociale, de la peur des forces sociales qui sont devenues inexplicables et incontrôlables. A l’époque de la décomposition du capitalisme, c’est avant tout le nihilisme ambiant qui alimente le besoin de religion. Alors que la religion traditionnelle, pour aussi réactionnaire qu’ait été son rôle, faisait toujours partie de la vision d’un monde communautaire et que la religion modernisée de la bourgeoisie représentait l’adaptation de cette vision traditionnelle du monde à la perspective de la société capitaliste, le mysticisme de la décomposition capitaliste se nourrit du nihilisme ambiant. Que ce soit sous la forme d’une pure atomisation d"es "âmes" ésotériques à la recherche du fameux "se retrouver soi-même" en dehors de tout contexte social, ou sous la forme de la mentalité totalement fermée des sectes et du fondamentalisme religieux, qui offrent l’effacement de la personnalité et l’élimination de la responsabilité individuelle, cette tendance, alors qu’elle prétend donner une réponse, n’est en réalité que l’expression poussée à l’extrême de ce nihilisme.
De plus, c’est ce manque de perspective et cette dislocation du lien social qui fait que la réalité biologique de la mort semble enlever son sens à la vie individuelle. L’aspect morbide qui en découle (dont se nourrit pour une bonne part le mysticisme d’aujourd’hui) trouve son expression soit dans une peur démesurée de la mort, soit dans une aspiration pathologique à mourir. La première expression se concrétise par exemple dans la mentalité "hédoniste" de la "fun society" (dont la devise pourrait être : "mangeons, buvons et éclatons-nous, car demain nous mourrons") ; l’autre, dans des cultes tels que le satanisme, les sectes de la fin du monde et dans le culte croissant de la violence, de la destruction et du martyr (comme dans le cas des kamikazes).
Le marxisme en tant que vision matérialiste, révolutionnaire du prolétariat, a toujours été caractérisé par son profond attachement au monde et son affirmation passionnée de la valeur de la vie humaine. En même temps, son point de vue dialectique a compris la vie et la mort, l’être et le néant comme faisant partie d’une unité indivisible. Il n’ignore pas la mort et ne surestime pas non plus son rôle dans la vie. Le genre humain fait partie de la nature. Comme tel, la croissance, l’épanouissement, mais aussi la maladie, le déclin et la mort font autant partie de son existence que le coucher de soleil ou la chute des feuilles en automne. Mais l’homme est un produit non seulement de la nature mais également de la société. En tant qu’héritier des acquis de la culture humaine, porteur de son devenir, le prolétariat révolutionnaire se rattache aux sources sociales d’une force réelle, enracinée dans la clarté de pensée et la fraternité, la patience et l’humour, la joie et l’affection, la sécurité réelle d’une confiance bien placée.
La solidarité et la perspective du communisme aujourd’hui
Pour la classe ouvrière, l’éthique n’est pas quelque chose d’abstrait, à côté de son combat. La solidarité, la base de sa morale de classe, est en même temps la première condition de sa véritable capacité à s’affirmer en tant que classe en lutte.
Aujourd’hui, le prolétariat est confronté à la tâche de reconquérir son identité de classe, qui a subi un énorme recul après 1989. Cette tâche est inséparable de la lutte pour se réapproprier ses traditions de solidarité.
La solidarité n’est pas simplement une composante centrale de la lutte quotidienne de la classe ouvrière, mais porte aussi en germe la société future. Les deux aspects qui se relient au présent et au futur, s’influencent mutuellement. Le redéploiement de la solidarité de classe au sein des luttes ouvrières est un aspect essentiel de la dynamique actuelle de la lutte de classe et de l’ouverture du chemin vers une nouvelle perspective révolutionnaire. Une telle perspective, en retour, lorsqu’elle sera dégagée, sera un puissant facteur du renforcement de la solidarité dans les luttes immédiates du prolétariat.
Cette perspective est donc décisive face aux problèmes que posent à la classe ouvrière la décadence et la décomposition du capitalisme. Il en est ainsi, par exemple, de la question de l’immigration. Dans le capitalisme ascendant, la position du mouvement ouvrier, en particulier de la Gauche, était de défendre l’ouverture des frontières et le libre mouvement du travail. Cela faisait partie du programme minimum de la classe ouvrière. Aujourd’hui, le choix entre frontières ouvertes ou fermées est une fausse alternative puisque c’est uniquement l’abolition de toutes les frontières qui peut résoudre la question. Dans les conditions de la décomposition, la question de l’immigration tend à éroder la solidarité de classe, menaçant même d’infester les ouvriers avec la mentalité pogromiste. Face à cette situation, la perspective d’une communauté mondiale, basée sur la solidarité, est le facteur le plus efficace de la défense du principe de l’internationalisme prolétarien.
A condition que la classe ouvrière, à travers une longue période de développement de ses luttes et de réflexion politique, parvienne â regagner son identité de classe, le fait de reconnaître à quel point les émotions sociales, les liens et les modes de comportement sont minés par le capitalisme de nos jours, peut devenir en lui-même un facteur qui pousse le prolétariat à formuler de façon consciente ses propres valeurs de classe. L’indignation de la classe ouvrière face aux comportements provoqués par le capitalisme en décomposition, et la conscience que seule la lutte prolétarienne peut offrir une alternative, sont centrales pour que le prolétariat puisse réaffirmer sa perspective révolutionnaire.
L’organisation révolutionnaire a un rôle indispensable à jouer dans ce processus, non seulement à travers la propagande des principes de classe mais aussi, et par dessus tout, en donnant elle-même un exemple vivant de leur mise en application et de leur défense.
Par ailleurs, la défense de la morale prolétarienne est un instrument indispensable dans la lutte contre l’opportunisme et donc, dans la défense du programme de la classe ouvrière. Plus fermement que jamais, les révolutionnaires doivent se situer dans la tradition du marxisme en menant un combat intransigeant contre tout comportement venant d’une classe étrangère.
- "Le bolchevisme a créé le type du véritable révolutionnaire qui, à des buts historiques incompatibles avec la société contemporaine, subordonne les conditions de son existence individuelle, ses idées et ses jugements moraux. Les distances indispensables à l’égard de l’idéologie bourgeoise étaient maintenues dans le parti par une vigilante intransigeance dont l’inspirateur était Lénine. Il ne cessait de travailler du scalpel, tranchant les liens que l’entourage petit-bourgeois créait entre le parti et l’opinion publique officielle. En même temps, Lénine apprenait au parti à former sa propre opinion publique, s‘appuyant sur la pensée et les sentiments de la classe qui montaient. Ainsi, par sélection et éducation, dans une lutte continuelle, le parti bolchevique créa son milieu non seulement politique mais aussi moral, indépendant de l’opinion publique bourgeoise et irréductiblement opposé à celle-ci. C’est seulement cela qui permit aux Bolcheviks de surmonter les hésitations dans leurs propres rangs et de manifester la virile résolution sans laquelle la victoire d’Octobre aurait été impossible"[18].
[1] Luxemburg: "l’esprit de la littérature russe" (Introduction à Korolenko). 1919
[2] Boukharine et Preobrajensky : l’ABC du communisme - Commentaire du programme du 8e Congrès du Parti, 1919. Chapitre IX. La justice prolétarienne. § 74 : Les méthodes pénales prolétariennes.
[3] Jeremy Bentham (1748-1832) était un philosophe, juriste et réformateur britannique. Il était ami, notamment, d'Adam Smith et de Jean-Baptiste Say deux économistes majeurs de la bourgeoisie à l'époque où celle-ci était encore une classe révolutionnaire. Il a influencé des philosophes "classiques" de celle-ci comme John Stuart Mill, John Austin, Herbert Spencer, Henry Sidgwick ou James Mill. Il a apporté son soutien à la révolution française de 1789 et lui a fait plusieurs propositions concernant l’établissement du droit, le système judiciaire, pénitentiaire, l’organisation politique de l’État, et la politique vis-à-vis des colonies (Emancipate your Colonies). La jeune République française le fait d’ailleurs citoyen d’honneur le 23 août 1792. Son influence se retrouve dans le Code civil (appelé aussi "Code Napoléon") qui, encore aujourd'hui, continue de régir le droit privé français. La pensée de Bentham part du principe suivant : les individus ne conçoivent leurs intérêts que sous le rapport du plaisir et la peine. Ils cherchent à "maximiser" leur bonheur, exprimé par le surplus de plaisir sur la peine. Il s’agit pour chaque individu de procéder à un calcul hédoniste. Chaque action possède des effets négatifs et des effets positifs, et ce, pour un temps plus ou moins long avec divers degrés d’intensité ; il s’agit donc pour l’individu de réaliser celles qui lui apportent le plus de bonheur. Il donnera le nom d'Utilitarisme à cette doctrine dès 1781.
Bentham avait mis au point une méthode, "Le calcul du bonheur et des peines", qui vise à déterminer scientifiquement – c'est-à-dire en usant de règles précises – la quantité de plaisir et de peine générée par nos diverses actions.
Ces critères sont au nombre de sept :
- Durée : Un plaisir long et durable est plus utile qu'un plaisir passager.
- Intensité : Un plaisir intense est plus utile qu'un plaisir de faible intensité.
- Certitude : Un plaisir est plus utile si on est sûr qu'il se réalisera.
- Proximité : Un plaisir immédiat est plus utile qu'un plaisir qui se réalisera à long terme.
- Étendue : Un plaisir vécu à plusieurs est plus utile qu'un plaisir vécu seul.
- Fécondité : Un plaisir qui en entraîne d'autres est plus utile qu'un plaisir simple.
- Pureté : Un plaisir qui n'entraîne pas de souffrance ultérieure est plus utile qu'un plaisir qui risque d'en amener.
Théoriquement, l'action la plus morale sera celle qui réunit le plus grand nombre de critères.
[4] Mehring : "Retour à Schopenhauer". Neue Zeit. 1908/09
[5] Ainsi, la plupart des organisations politiques du prolétariat se sont dotées, à côté des organes de centralisation chargés de traiter des "affaires courantes" d'organes tels que des "commissions de contrôle" ou "commissions des conflits", composées de militants expérimentés et bénéficiant de la plus grande confiance de leurs camarades, et chargés spécifiquement des questions délicates touchant notamment à des aspects sensibles et nécessitant la discrétion du comportement des militants au sein ou en dehors de l'organisation.
[6] Kautsky : Ethique et Matérialisme historique. Chapitre : "l’Éthique du Darwinisme" (Les instincts sociaux)
[7] Cela a été confirmé par les observations d’Anna Freud selon lesquelles les orphelins sortis des camps de concentration, alors qu’ils établissaient entre eux une sorte de solidarité rudimentaire, sur des bases égalitaires, n’acceptaient les références morales et culturelles de la société dans son ensemble que lorsqu'ils étaient regroupés dans de plus petites unités "familiales", dirigées chacune par une personne adulte respectée, à l’égard de qui les enfants pouvaient développer de l’affection et de l’admiration.
[8] Le livre de Kautsky sur l’éthique est la première étude marxiste globale de cette question et sa principale contribution à la théorie socialiste. Cependant, il surestime l’importance de la contribution de Darwin. En conséquence, il sous-estime les facteurs spécifiquement humains de la culture et de la conscience, tendant à une vision statique dans laquelle les différentes formes sociales favorisent ou handicapent plus ou moins des pulsions sociales fondamentalement invariantes.
[9] Voir par exemple Paul Lafargue : Recherche sur l’origine de l’idée du bien et du juste. 1885, republié dans la Neue Zeit, 1899-1900
[10] Mehring : Sur la philosophie du capitalisme, 1891. Nous devons ajouter que Nietzsche est le théoricien du comportement de l’aventurier déclassé.
[11] L’avant-garde de la Contre-réforme contre le protestantisme, le jésuitisme, était caractérisée par l’adoption des méthodes de la bourgeoisie pour défendre l’église féodale. C’est pourquoi, très tôt, il est l’expression de la base de la morale capitaliste, bien avant que la classe bourgeoise dans son ensemble (qui jouait encore un rôle révolutionnaire) n’ait ouvertement révélé les côtés les plus ignobles de sa domination de classe. Voir par exemple Mehring : L'histoire de l'Allemagne depuis le début du Moyen-Âge, 1910. Partie 1. Chapitre 6 : "Jésuitisme, Calvinisme, Luthéranisme."
[12] Une remarque en passant. La réponse la plus appropriée à cette question du fond des temps, de savoir si l’être humain est bon ou mauvais, peut être probablement donnée en paraphrasant ce que Marx et Engels, dans La Sainte Famille écrivaient à propos du roman d’Eugène Sue, Les mystères de Paris, dans le chapitre consacré à "Fleur de Marie" : "l’humanité n’est ni bonne ni mauvaise, elle est humaine".
[13] Un complot Contre l’internationale- Rapport sur les activités de Bakounine. 1874. Chapitre VIII. L’Alliance en Russie (le catéchisme révolutionnaire. l’appel de Bakounine aux officiers de l’armée russe)
[14] Dietzgen : L’essence du travail intellectuel humain, 1869.
[15] Henriette Roland Holst Communisme et Morale. 1925. Chapitre V. ("le sens de la vie et les tâches du prolétariat"). Malgré quelques faiblesses importantes, ce livre contient surtout une excellente critique de la morale utilitariste.
[16] Revue en langue française de la fraction de gauche du parti communiste d'Italie (devenue par la suite, Fraction italienne de la Gauche communiste internationale)
[17] Que veut la Ligue Spartacus ? Ici, comme dans d’autres écrits de Rosa Luxembourg, nous trouvons une compréhension profonde de la psychologie de classe du prolétariat.
[18] Trotsky : Histoire de la Révolution russe, 1930. Fin du chapitre : "Lénine appelle à l’insurrection".
Le communisme : l’entrée de l’humanité dans sa véritable histoire (IV) - Les problèmes de la période de transition
- 3625 reads
Dans l’article précédent de cette série (Revue Internationale n° 127 : "Les années 1930 : le débat sur la période de transition [24]"), nous avons entrepris l'étude des leçons tirées par la Gauche communiste d’Italie de la première vague révolutionnaire internationale, et de la révolution russe en particulier, et des efforts qu'elle a engagés pour comprendre comment appliquer ces leçons dans l'avenir à la transformation révolutionnaire. Nous avions mis en évidence la méthode caractéristique de la Fraction italienne dans l'accomplissement de cette tâche :
- l'intransigeance dans la défense des principes de classe, mais aussi l'ouverture à la discussion avec d’autres courants internationalistes. Ces deux aspects étaient particulièrement appropriés vis à vis du problème de la période de transition à cette époque puisque le mouvement ouvrier était confronté à la prétention monstrueuse de Staline selon laquelle l’URSS était en passe d’atteindre le "socialisme" et qu’une énorme confusion régnait chez les différents groupes internationalistes sur la nature du développement économique qui s’effectuait sous la houlette de l’Etat "soviétique" ;
- la modestie et la prudence, l'insistance sur la nécessité de se tenir au cadre fondamental du marxisme – mais en même temps la volonté de remettre en question les idées du passé et de chercher des réponses nouvelles à des problèmes nouveaux.
Nous avons montré comment cette méthode s’était concrétisée dans une série d’articles écrits par Vercesi sous le titre : "Parti, Etat, Internationale". Dans ce numéro de la Revue, nous entamons la publication d’une autre série d’articles fondamentaux sur le même thème : Les problèmes de la période de transition, écrits par Mitchell qui, à l’époque où cette série commence, était membre du groupe belge, la Ligue des Communistes internationalistes (LCI) et qui, par la suite, contribua à la fondation de la fraction belge de la Gauche communiste. Cette dernière allait se séparer de la LCI sur la question de la Guerre d’Espagne et former, avec la fraction italienne, la Gauche communiste internationale. A notre connaissance, c’est la première fois depuis les années 30 que cette série d’articles est publiée et qu’elle est traduite en d’autres langues.
La série d'articles de Bilan
Dans l’introduction de cet article, Mitchell dit clairement qu’il est "en accord avec tout le cadre et l’esprit de Bilan", qu’il rejette toute approche spéculative des problèmes de la période de transition et affirme que "le marxisme est une méthode expérimentale et non un jeu de devinettes et de prévisions", puisqu’il fonde ses conclusions et ses prévisions sur les événements historiques réels et sur l’expérience authentique du mouvement prolétarien. Il poursuit en mettant en avant les principaux axes de la série qu’il se propose d’écrire :
- les conditions historiques dans lesquelles surgit la révolution prolétarienne ;
- la nécessité de l'Etat de la période de transition ;
- les catégories économiques et sociales qui, inévitablement, subsistent pendant la phase transitoire ;
- certaines conditions requises pour une gestion prolétarienne de l'Etat de transition.
Les articles ont plus ou moins suivi ces grandes lignes, encore que, du fait de la complexité des problèmes économiques de la période de transition, ce sont finalement cinq articles qui ont constitué cette série dans Bilan les années suivantes. Le débat avec le courant internationaliste hollandais, en particulier, a fait l’objet d’une grande attention, notamment la démarche adoptée par ce courant vis à vis de la transformation économique et développée dans l'ouvrage : Principes fondamentaux de la production et de la distribution communiste par Jan Appel et Henrik Canne-Meyer. Ces travaux sont résumés dans Bilan par A. Hennaut, militant de la LCI.
Dans le premier article que nous publions[1] ici, Mitchell s’intéresse aux conditions historiques de la révolution prolétarienne. Il se centre sur les questions et les débats cruciaux suivants :
- le communisme est une nécessité historique parce que le capitalisme, dernière forme de société de classe, est entré dans sa phase de décadence et est devenu une entrave définitive au développement des forces productives de l’humanité. Les rapports de production bourgeois ont créé la possibilité d’une société d’abondance et de liberté dans laquelle le principe communiste "à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses moyens" peut enfin devenir une réalité. Cependant, une société d’abondance et de liberté ne peut être établie du jour au lendemain, mais seulement après une période plus ou moins longue de transformation économique et sociale mise en mouvement par la victoire politique du prolétariat ;
- cette transformation ne peut être sérieusement entreprise qu’à l’échelle mondiale. A la différence des modes de production précédents qui pouvaient exister dans différentes régions du globe, relativement isolés les uns des autres, le capitalisme est nécessairement un système mondial ; il a créé un réseau d’interdépendance complexe qui rend totalement impossible l’existence de rapports communistes de production dans des endroits séparés. De même, c'est en tant que système mondial que le capitalisme atteint son époque de déclin historique et non dans certaines régions ou pays particuliers, ce qui impose les mêmes tâches révolutionnaires à la classe ouvrière du monde entier ;
C’est sur cette base résolument internationaliste que Mitchell entreprend de polémiquer contre les erreurs théoriques les plus importantes de l’époque. D’abord et avant tout, il rejette la doctrine stalinienne du "socialisme en un seul pays" et son prétendu soubassement théorique : "la loi du développement inégal", explication donnée au fait que les différentes parties du système capitaliste mondiale évoluent à des rythmes différents et atteignent des niveaux différents de développement technologique et social. On doit rappeler que Staline avait fait un usage sélectif et abusif d’un passage d’un article de Lénine d’août 1915, "Du mot d’ordre des Etats-Unis d’Europe" pour justifier son argumentation : "L'inégalité du développement économique et politique est une loi absolue du capitalisme. Il s'ensuit que la victoire du socialisme est possible au début dans un petit nombre de pays capitalistes ou même dans un seul pays capitaliste pris à part. Le prolétariat victorieux de ce pays, après avoir exproprié les capitalistes et organisé chez lui la production socialiste, se dresserait contre le reste du monde capitaliste en attirant à lui les classes opprimées des autres pays, en les poussant à s'insurger contre les capitalistes, en employant même, en cas de nécessité, la force militaire contre les classes d'exploiteurs et leurs États." Staline a pris une phrase de Lénine ("la victoire du socialisme est possible au début dans un petit nombre de pays capitalistes ou même dans un seul pays capitaliste pris à part.") pour tirer la conclusion totalement sans fondement selon laquelle, par cette expression, Lénine ne parlait pas essentiellement de la victoire politique de la classe ouvrière comme premier pas de la révolution mondiale, mais de la réalisation d’un mode de production complètement socialiste à l’intérieur de frontières nationales.
Dans son texte La Troisième Internationale après Lénine (critique du projet de programme qui allait être adopté au 5ème Congrès de l’IC en 1928 et représentait fondamentalement le faire-part du suicide de l’Internationale en la faisant adhérer à la théorie du socialisme dans un seul pays), Trotski montre avec brio pourquoi cette nouvelle théorie ne découle en rien logiquement, ni de l'expression "victoire du socialisme" utilisée par Lénine, ni de la conception de ce dernier du développement inégal. Trotski insiste en particulier sur le fait que le développement du capitalisme est toujours à la fois "inégal" et "combiné", de telle façon que toutes les parties du système capitaliste mondial, bien que se situant clairement à des étapes différentes dans leur développement matériel, fonctionnent comme un ensemble déterminé mutuellement. Il en concluait qu’une évolution autarcique vers le socialisme était complètement impossible.
Mitchell reconnaît que Trotski et ses disciples ont été parmi les premiers à s’opposer à la théorie du socialisme dans un seul pays. Mais en même temps, il leur reproche d’accepter le développement inégal comme une "loi inconditionnelle" et de faire des concessions à la possibilité d’avancées nationales vers le socialisme. Dans La Troisième Internationale après Lénine, Trotski va même si loin qu’il en arrive à défendre l'idée que cette loi a gouverné l’ensemble de l’histoire de l'humanité. En réalité, il est plus juste de défendre que le développement inégal est une conséquence particulière des rapports sociaux qui "gouvernent" les différents modes de production : dans le capitalisme, c’est le résultat des lois de l’accumulation, qui font que la production de richesses à un pôle a engendre la pauvreté à l'autre. . Les disparités entre différentes régions géographiques sont particulièrement claires à l'époque de l'impérialisme On pourrait aussi argumenter que l’acceptation de la "loi" du développement inégal par les trotskistes les a conduits à faire des concessions à la notion d’Etats ouvriers isolés, capables de faire des avancées significatives sur la voie du socialisme au sein d’un cadre national. Une bonne partie des articles de Mitchell, dans cette série, est dirigée contre la tendance des trotskistes à perdre tout sens critique face à la croissance frénétique de la production industrielle en URSS pendant les années 1930.
Mitchell critique aussi les thèses mencheviques et kautskistes, relayées par des internationalistes authentiques comme Hennaut et les communistes de conseil hollandais, qui voyaient l'origine des échecs de la révolution russe dans l’arriération des conditions matérielles en Russie même. Contre cette vision selon laquelle il existe des pays particuliers qui sont "mûrs pour le socialisme et d'autres qui ne le sont pas, Mitchell insiste encore une fois sur le fait que le problème ne peut être envisagé que dans un cadre international : "Nous avons souligné au début de cette étude que le capitalisme, bien qu'il ait puissamment développé la capacité productive de la société, n'a pas réuni, de ce fait, tous les matériaux permettant l'organisation immédiate du socialisme. Comme Marx l'indique, seulement les conditions matérielles pour résoudre ce problème existent 'ou du moins sont en voie de devenir' (…) A plus forte raison, cette conception restrictive s'applique-t-elle à chacune des composantes nationales de 1'économie mondiale. Toutes sont historiquement mûres pour le socialisme, mais aucune d'entre elles n'est mûre au point de réunir toutes les conditions matérielles nécessaires à l'édification du socialisme intégral et ce, quel que soit le degré de développement atteint."
En republiant la série d’articles de Mitchell, nous aurons l’occasion de pointer quelques faiblesses et quelques incohérences de sa contribution, certaines mineures, d’autres plus importantes, mais des passages comme celui que nous venons de citer confirment que, lorsqu'il s’agit des questions fondamentales, nous le CCI, comme Mitchell, nous travaillons toujours "en accord avec l’ensemble du cadre et de l’esprit de Bilan".
CDWBilan n°28 (février-mars 1936) : Les problèmes de la période de transition
Du titre de cette étude, il ne peut être déduit que nous allons nous livrer à des investigations dans les brumes de l'avenir ou que même nous esquisserons des solutions aux multiples et complexes tâches qui s'imposeront au prolétariat érigé en classe dirigeante. Le cadre et l'esprit de Bilan n'autorisent de tels desseins. Nous laissons à d'autres, aux "techniciens" et aux fabricants de recettes, ou aux "orthodoxes" du marxisme le plaisir de se livrer à des anticipations, de se promener dans les sentiers de l'utopisme ou de jeter à la face des prolétaires des formules vidées de leur substance de classe.
Pour nous, il ne peut être question de construire des schémas - panacées valables une fois pour toutes et qui, mécaniquement, s'adapteraient à toutes les situations historiques. Le marxisme est une méthode expérimentale et non un jeu de devinettes et de pronostics. Il plonge ses racines dans une réalité historique essentiellement mouvante et contradictoire : il se nourrit des expériences passées, se trempe et se corrige dans le présent pour s'enrichir au feu des expériences ultérieures.
C'est en traçant la synthèse des événements historiques, que le marxisme dégage du fatras idéaliste, la signification de l'Etat, qu'il forge la théorie de la dictature du prolétariat et affirme la nécessité de l'Etat prolétarien transitoire. Si de celui-ci, il parvient à définir le contenu de classe, il ne peut que se borner à une esquisse de ses formes sociales. Il lui est encore impossible d'asseoir les principes de gestion de l'Etat prolétarien sur des bases solides et il ne parvient pas non plus à tracer avec précision la ligne de démarcation entre Parti et Etat. De sorte que cette immaturité principielle devait peser inévitablement sur l'existence et l'évolution de l'Etat soviétique.
Il appartient précisément aux marxistes naufragés de la débâcle du mouvement ouvrier de forger l'arme théorique qui fera de l'Etat prolétarien futur l'instrument de la Révolution mondiale et non pas la proie du capitalisme mondial.
La présente contribution à cette recherche théorique traitera successivement : a) des conditions historiques où surgit la révolution prolétarienne ; b) de la nécessité de l'Etat transitoire ; c) des catégories économiques et sociales qui, nécessairement, survivent dans la phase transitoire ; d) enfin de quelques données quant à une gestion prolétarienne de l'Etat transitoire.
La révolution prolétarienne et son milieu historique
C'est devenu un axiome que de dire que la société capitaliste, débordée par les forces productives qu'elle ne parvient plus à utiliser intégralement, submergée sous l'amas des marchandises qu'elle ne parvient plus à écouler, est devenue un anachronisme historique. De là à conclure que sa disparition doit ouvrir le règne de l'abondance, il n'y a pas loin.
En réalité, l'accumulation capitaliste est arrivée au terme extrême de sa progression et le mode capitaliste de production n'est plus qu'un frein à l'évolution historique.
Cela ne signifie nullement que le capitalisme est comme un fruit mûr que le prolétariat n'aurait plus qu'à cueillir pour faire régner la félicité, mais bien que les conditions matérielles existent pour édifier la base (seulement la base) du socialisme, préparant la société communiste.
Marx fait remarquer "qu'au moment même où la civilisation apparaît, la production commence à se fonder sur l'antagonisme des ordres, des états des classes, enfin sur l'antagonisme du travail accumulé et du travail immédiat. Pas d'antagonisme, pas de progrès. C'est la loi que la civilisation a suivie jusqu'à nos jours. Jusqu'à présent, les forces productives se sont développées grâce à ce régime de l'antagonisme des classes" (Misère de la Philosophie). Engels, dans L'Anti-Dühring constate que l'existence d'une société divisée en classes n'est que "la conséquence nécessaire du faible développement de la production dans le passé" et il en déduit que, "si la division en classes a une certaine légitimité historique, elle ne l'a pourtant que pour un temps donné, pour des conditions sociales déterminées. Elle était fondée sur l'insuffisance de la production, elle sera balayée par le plein épanouissement des forces productives modernes."
Il est évident que le développement ultime du capitalisme correspond non pas à "un plein épanouissement des forces productives" dans le sens qu'elles seraient capables de faire face à tous les besoins humains, mais à une situation où la survivance des antagonismes de classe non seulement arrête tout le développement de la société mais entraîne sa régression.
Telle est bien la pensée d'Engels lorsqu'il dit que l'abolition des classes "suppose une évolution de la production parvenue à un niveau où l'appropriation par une certaine classe de la société des moyens de production et des produits, et par là de la souveraineté politique du monopole d'éducation et de direction intellectuelle, sera devenue non seulement une superfétation, mais aussi économiquement, politiquement et intellectuellement, une entrave à l'évolution". Et, lorsqu'il ajoute que la société capitaliste a atteint cette évolution et que "la possibilité existe d'assurer à tous les membres de la société par le moyen de la production sociale une existence non seulement parfaitement suffisante et plus riche de jour en jour au point de vue matériel, mais leur garantissant encore le développement et la mise en œuvre absolument libre de leurs facultés physiques et intellectuelles", il n'est pas douteux qu’il vise seulement la possibilité de s'acheminer vers une pleine satisfaction des besoins et non ici les moyens matériels pour y pourvoir immédiatement. Engels d'ailleurs précise que "la libération des moyens de production est l'unique condition préalable d'un développement des forces productives ininterrompu et constamment accéléré et par là, d'un accroissement pratiquement illimité de la production elle-même."
Par conséquent, la période de transition (qui ne peut avoir qu'une configuration mondiale et non particulière à un Etat), est une phase politique et économique qui, inévitablement, enregistre encore une déficience productive par rapport à tous les besoins individuels, même en tenant compte du niveau prodigieux déjà atteint par la productivité du travail. La suppression du rapport capitaliste de production et de son expression antagonique donne la possibilité immédiate de pourvoir aux besoins essentiels des hommes (en faisant abstraction des nécessités de la lutte des classes qui pourront temporairement abaisser la production).
Aller au-delà, nécessite le développement incessant des forces productives. Quant à la réalisation de la formule "à chacun selon ses besoins", elle se place au terme d'un long processus, avançant non en ligne droite mais en courbes sinueuses agitées de contradictions et de conflits, et qui se superpose au processus de la lutte mondiale des classes.
La mission historique du prolétariat consiste, comme le disait Engels, à faire faire à 1'humanité le saut "du règne de la nécessité dans le règne de la liberté" ; mais il ne peut le réaliser que pour autant qu'une analyse des conditions historiques où se place cet acte de libération lui en fasse découvrir la nature et les limites, afin d'en imprégner toute son activité politique et économique. Le prolétariat ne peut donc pas opposer abstraitement le capitalisme au socialisme, comme s'il s'agissait de deux époques entre lesquelles n'existerait aucune interdépendance, comme si le socialisme n'était pas le prolongement historique du capitalisme, fatalement chargé des scories de celui-ci mais quelque chose de propre et de net que la Révolution prolétarienne apporterait dans ses flancs.
On ne peut dire que ce soit par indifférence ou négligence que nos maîtres n'aient pas abordé dans les détails les problèmes de la période de transition. Mais Marx et Engels étaient aux antipodes des utopistes; ils en étaient la vivante négation. Ils ne cherchaient pas à construire abstraitement, à imaginer ce qui ne pouvait être résolu que par la science.
Encore en 1918, Rosa Luxembourg qui, cependant, apporta une immense contribution théorique au marxisme, dut s'en tenir à la constatation (La Révolution Russe) que : "bien loin d'être une somme de prescriptions toutes faites qu'on n'aurait qu'à mettre en application, la réalisation pratique du socialisme comme système économique social et juridique, est une chose qui réside dans le brouillard de l'avenir. ...Le socialisme a pour condition préalable une série de mesures violentes contre la propriété, etc. Ce qui est négatif, la destruction, on peu le décréter ; ce qui est positif, la construction, non".
Marx avait déjà indiqué dans sa préface au Capital que : "lors même qu'une société est arrivée à découvrir la piste de la loi naturelle qui préside à son mouvement — et le but final de cet ouvrage est de dévoiler la loi économique du mouvement de la société moderne — elle ne peut ni dépasser d'un saut, ni abolir par des décrets les phases de son développement naturel, mais elle peut abréger la période de la gestation et adoucir les maux de l'enfantement".
Une politique de gestion prolétarienne ne pourra donc que s'attacher essentiellement à la direction et aux tendances à imprimer à l'évolution économique, tandis que les expériences historiques (et la Révolution Russe, bien qu'incomplète, en est une gigantesque) constitueront le réservoir où le prolétariat puisera les formes sociales adaptables à une telle politique. Celle-ci aura un contenu socialiste seulement si le cours économique reçoit une orientation diamétralement opposée à celle du capitalisme, si donc il se dirige vers une élévation progressive et constante des conditions de vie des masses et non vers leur abaissement.
Si l'on veut apprécier la Révolution, non comme un fait isolé, mais comme un produit du milieu historique, il faut s'en rapporter à la loi fondamentale de l'Histoire qui n'est autre que la loi générale de l'évolution dialectique dont le centre moteur est la lutte des classes, celle-ci formant la substance vivante des événements historiques.
Le marxisme nous enseigne que la cause des révolutions ne doit pas être recherchée dans la Philosophie mais dans l'Economie d'une société déterminée. Ce sont les changements graduels apportés dans le mode de production et d'échange, sous l'aiguillon de la lutte de classes, qui aboutissent inévitablement à la "catastrophe" révolutionnaire qui rompt l'enveloppe des rapports sociaux et de production existants.
A cet égard, le XXe siècle correspond, pour la société capitaliste, a ce qu'ont signifié, pour la société féodale, les XVIIIe et XIXe siècles, c'est-à-dire à une ère de violentes convulsions révolutionnaires ébranlant la société dans son ensemble.
Dans l'ère de la décadence bourgeoise, les révolutions prolétariennes sont donc le produit d'une maturité historique de toute la société, et les mailles d'une chaîne d'événements, qui peuvent fort bien alterner avec des défaites du prolétariat et des guerres, comme l'histoire n'a pas manqué de nous le prouver depuis 1914.
L'inégalité de l'évolution économique et politique
La victoire d'un prolétariat déterminé, tout en étant la résultante immédiate de circonstances particulières, n'est en définitive qu'une partie d'un tout : la révolution mondiale. Nous verrons que, pour cette raison fondamentale, il ne peut être question d'assigner à cette révolution un cours autonome qui se justifierait par l'originalité de son milieu géographique et social.
Nous nous heurtons ici à un problème qui fut au centre des controverses théoriques dont le centrisme russe[2] (et avec lui l'Internationale Communiste) tira sa thèse du "socialisme en un seul pays". Il s'agit de l'interprétation à donner au développement inégal qui se vérifia tout au long de l'évolution historique.
Marx observe que la vie économique offre un phénomène analogue à ce qui se passe dans d'autres branches de la biologie. Dès que la vie a dépassé une période donnée de développement et passe d'un stade à un autre, elle commence à obéir à d'autres lois et ce, bien qu'elle dépendra toujours des lois fondamentales qui régissent toutes les manifestations vitales.
Il en est de même de chaque période historique qui possède ses lois propres, bien que toute l'histoire soit régie par la loi de l'évolution dialectique. C'est ainsi, par exemple, que Marx nie que la loi de la population soit la même dans tous les temps et dans tous les lieux. Chaque degré de développement a sa loi particulière de la population et Marx le démontre en réfutant la théorie de Malthus.
Dans Le Capital, où il dissèque la mécanique du système capitaliste, Marx ne s'attarde pas aux multiples aspects inégaux de son expansion car pour lui, "il ne s'agit pas, en somme, du développement plus ou moins considérable des antinomies sociales qui découlent des lois naturelles de la production capitaliste. Il s'agit de ces lois elles-mêmes, de ces tendances qui agissent et s'affirment avec une inéluctable nécessité. Le pays qui est industriellement le plus avancé ne fait que montrer au pays moins développé l'image de l'avenir qui l'attend". (Préface du Capital).
De cette pensée de Marx ressort clairement que ce qui doit être considéré comme élément fondamental, ce n'est pas l'aspect inégal imprimé à l'évolution des différents pays constituant la société capitaliste —aspect qui ne serait que l'expression d'une pseudo-loi de nécessité historique du développement inégal— mais que ce sont les lois spécifiques de la production capitaliste, régissant l'ensemble de la société et subordonnées elles-mêmes à la loi générale de l'évolution matérialiste et dialectique.
Le milieu géographique explique pourquoi l'évolution historique et les lois spécifiques d'une société se manifestent sous des formes variées et inégales de développement, mais il ne fournit nullement l'explication du processus historique lui-même. Autrement dit, le milieu géographique n'est pas le facteur actif de l'histoire.
Marx remarque que si la production capitaliste est favorisée par un climat modéré, celui-ci n'apparaît que comme une possibilité qui ne peut être utilisée que dans des conditions historiques indépendantes des conditions géographiques. Il dit notamment :
- "qu'il n'est nullement établi que le sol le plus fertile soit le plus propice au développement de la production capitaliste, qui suppose toujours la domination de l'homme sur la nature.
Le berceau du Capital ne se trouve pas sous les tropiques à la végétation luxuriante, mais dans les zones tempérées. Ce n’est pas la fertilité absolue du sol, mais sa variété, la multiplicité de ses produits naturels qui forment la base naturelle de la division sociale du travail et qui excitent l'homme, par le changement perpétuel des conditions naturelles où il vit, à multiplier ses besoins, ses capacités, ses moyens et ses modes de travail". (Le capital, Livre I).
Le milieu géographique ne put donc être l'élément primordial en fonction duquel les différents pays se seraient développés suivant des lois propres à leur milieu original, et non suivant des lois générales surgies de conditions historiques déterminées s'étendant à toute une époque. Sinon la conclusion s'imposerait que l'évolution de chaque pays a suivi un cours autonome, indépendant du milieu historique.
Mais, pour que l'historique se réalisât, il a fallu l'intervention de l'homme s'effectuant toujours sous l'empire de rapports sociaux antagoniques (abstraction faite du communisme primitif) variant avec l'époque historique et imprimant à la lutte des classes des formes correspondantes : lutte entre esclave et maître, entre serf et seigneur, entre bourgeois et féodal, entre prolétaire et bourgeois.
Cela ne signifie évidemment pas que, pour ce qui est des périodes pré-capitalistes, les différents types de sociétés qui les jalonnent : asiatique, esclavagiste, féodal, se succèdent rigoureusement et que leurs lois spécifiques agissaient universellement. Semblable évolution était exclue par le fait que ces formations sociales étaient toutes basées sur des modes de production peu progressifs par nature.
Chacune de ces sociétés ne put franchir certaines limites mesurées par un rayon déterminé, un bassin (comme le bassin méditerranéen dans l'antiquité esclavagiste), pendant qu'aux antipodes vivaient des conglomérats régis par d'autres rapports sociaux et de production, moins ou plus évolués, sous l'action de multiples facteurs parmi lesquels le facteur géographique n'était pas l'essentiel.
Mais, avec l'avènement du capitalisme, le cours de l'évolution put s'élargir. S'il recueillit une succession historique s'illustrant par des différenciations de développement considérables, il ne lui fallut pas longtemps pour maîtriser ces dernières
Dominé par la loi de l'accumulation de plus-value, le capitalisme apparut sur l'arène de l'histoire comme le mode de production le plus puissant et le plus progressif, tout comme le système économique le plus expansif. Bien qu'il se caractérisât par une tendance à universaliser son mode de production, bien qu'il favorisa un certain nivellement, il ne détruisit nullement toutes les formes sociales antérieures. Il se les annexa et y puisa les forces le poussant irrésistiblement en avant.
Nous avons déjà donné notre avis (voir Crises et Cycles) sur la perspective que Marx aurait soi-disant esquissée d'un avènement d'une société capitaliste pure et équilibrée ; nous n'avons donc pas à y revenir, les faits ayant démenti éloquemment non pas cette pseudo-prédiction de Marx, mais les hypothèses de ceux qui s'en servaient pour renforcer l'idéologie bourgeoise. Nous savons que le capitalisme entra dans sa phase de décomposition avant d'avoir pu parachever sa mission historique parce que ses contradictions se développèrent beaucoup plus vite que l'expansion de son système. Le capitalisme n'en fut pas moins le premier système de production engendrant une économie mondiale se caractérisant, non par une homogénéité et un équilibre inconciliable avec sa nature, mais par une étroite interdépendance de ses parties subissant toutes, en dernière analyse, la loi du Capital et le joug de la bourgeoisie impérialiste.
Le développement de la société capitaliste, sous l'aiguillon de la concurrence, a produit cette complexe et remarquable organisation mondiale de la division du travail qui peut et doit être perfectionnée, assainie (c'est la tâche du prolétariat) mais ne peut pas être détruite. Elle n'est nullement révoquée par le phénomène du nationalisme économique, qui apparaît, dans la crise générale du capitalisme, comme la manifestation réactionnaire de la contradiction exacerbée entre le caractère universel de 1'économie capitaliste et sa division en Etats nationaux antagoniques. Bien plus, sa vivace réalité s'affirme avec plus de vigueur encore dans l'étouffante ambiance créée par l'existence de ce qu'on pourrait appeler des économies obsidionales. N'assistons-nous pas aujourd'hui, sous le couvert du protectionnisme quasi-hermétique, à toute une efflorescence d'industries édifiées au prix d'énormes faux-frais, s'encastrant dans les diverses économies de guerre, mais pesant lourdement sur l'existence des masses ? Organismes parasitaires, non viables économiquement et qu'une société socialiste expulsera de son sein.
Sans cette base mondiale de la division du travail, une société socialiste est évidemment impensable.
L'interdépendance et la subordination réciproque des diverses sphères productives (aujourd'hui confinées dans le cadre des nations bourgeoises) sont une nécessité historique et le capitalisme leur a donné leur complète signification, tant au point de vue politique qu'au point de vue économique. Que cette structure sociale, élevée à l'échelle mondiale, soit désarticulée par mille forces contradictoires, ne l'empêche pas d'exister. Elle se greffe sur une répartition des forces productives et des richesses naturelles (exploitées) qui est précisément le travail de toute l'évolution historique. Il ne dépend nullement de la volonté du capitalisme impérialiste de répudier l'étroite solidarité de toutes les régions du globe, en se cloisonnant dans les cadres nationaux. S'il tente aujourd'hui cette folle entreprise, c'est parce qu'il y est acculé par les contradictions de son système, mais au prix de la destruction de richesses matérialisant la plus-value arrachée à de multiples générations de prolétaires, précipitant une destruction gigantesque de forces de travail dans le gouffre de la guerre impérialiste.
Le prolétariat international, non plus, ne peut méconnaître la loi de l'évolution historique. Un prolétariat ayant fait sa révolution devra payer le "socialisme en un seul pays" de l'abandon de la lutte mondiale des classes et par conséquent de sa propre défaite.
Que l'évolution inégale puisse être considérée comme la loi historique d'où résulterait la nécessité de développements nationaux autonomes n'est, d'après ce qui précède, que la négation même du concept mondial de la société.
Comme nous l'avons indiqué, l'inégalité de l'évolution économique et politique, loin de constituer une "loi absolue du capitalisme" (programme du 6e Congrès de l'IC) n'est qu'un ensemble de manifestations se déroulant sous l'empire des lois spécifiques du système bourgeois de production.
Dans sa phase d'expansion, le capitalisme, au travers d'un processus contradictoire et sinueux, tendit au nivellement des inégalités de croissance, tandis que dans sa phase de régression, il approfondit celles qui subsistaient, de par les nécessités de son évolution : le capital des métropoles épuisait la substance des pays retardataires et détruisait les bases de leur développement.
De cette constatation d'une évolution rétrograde et parasitaire, l'Internationale Communiste déduisit "que l'inégalité augmente et s'accentue encore à l'époque de l'impérialisme" et elle en tira sa thèse du "socialisme national" qu'elle crut renforcer en jetant la confusion entre "socialisme" national et "révolution" nationale et en se fondant sur l'impossibilité historique d'une révolution prolétarienne mondiale en tant qu'acte simultané.
Pour étayer ses arguments, elle eût, de plus, recours à une sophistication de certains écrits de Lénine et, notamment, de son article de 1915, sur le mot d'ordre des Etats-Unis mondiaux (Contre le Courant) où il considérait que "l'inégalité de progression économique et politique est 1'inéluctable loi du capitalisme; de là, il sied de déduire qu'une victoire du Socialisme est possible, pour commencer, dans quelques Etats capitalistes seulement, ou même dans un seul."
Trotsky fit bonne justice de ces falsifications dans L'Internationale Communiste après Lénine et nous n'avons donc pas à nous attarder à une nouvelle réfutation.
Mais il reste que Trotsky, se prévalant de Marx et de Lénine, crut pouvoir se servir de la "loi" du développement inégal - érigée également par lui en loi absolue du capitalisme - pour expliquer d'une part, l'inévitabilité de la révolution sous sa forme nationale et, d'autre part, son explosion, en premier lieu, dans les pays arriérés : "de l'évolution inégale, saccadée du capitalisme dérive le caractère inégal, saccadé de la révolution socialiste, tandis que de l'interdépendance mutuelle des divers pays poussée à un degré très avancé, découle l'impossibilité non seulement politique, mais aussi économique de construire le Socialisme dans un seul pays." (L'I C. après Lénine); et encore que "la prévision de ce fait que la Russie, historiquement arriérée, pouvait connaître une révolution prolétarienne plus tôt que l'Angleterre avancée, était entièrement fondée sur la loi du développement inégal". (La Révolution Permanente).
Tout d'abord, Marx, pour reconnaître la nécessité des révolutions nationales, n'a nullement invoqué l'inégalité de l'évolution et il ne fait pas de doute que pour lui cette nécessité découle de la division de la société en nations capitalistes, qui n'est que le corollaire de sa division en classes.
Le Manifeste communiste dit que : "comme le prolétariat de chaque pays doit, en premier lieu, conquérir le pouvoir politique, s'ériger en classe nationalement dirigeante, devenir lui-même la Nation, il est encore par là national, quoique nullement au sens bourgeois du mot". Et plus tard, Marx, dans sa Critique du Programme de Gotha, précisera "qu'il va absolument de soi que pour pouvoir lutter d'une façon générale, la classe ouvrière doit s'organiser chez elle en tant que classe et que l'intérieur du pays est le théâtre immédiat de sa lutte. C'est en cela que sa lutte de classe est nationale, non pas quant à son contenu mais, comme le dit Le Manifeste, quant à sa forme".
Cette lutte nationale, lorsqu'elle éclate en révolution prolétarienne, devient le produit d'une maturité historique des contrastes[3] économiques et sociaux de la société capitaliste dans son ensemble, avec cette signification que la dictature du prolétariat est un point de départ et non un point d'arrivée. Aspect développé de la lutte mondiale des classes, elle doit rester intégrée à celle-ci si elle veut vivre. C'est aussi dans le sens de cette continuité du processus révolutionnaire qu'il peut être parlé de révolution "permanente".
Trotsky, tout en rejetant absolument la théorie du "socialisme dans un seul pays" et en la considérant comme réactionnaire, en arrive cependant, en se fondant sur la "loi" du développement inégal du capitalisme, à déformer la signification des révolutions prolétariennes. Cette "loi" s'incorporera même à ce qui constitue sa théorie de la Révolution permanente qui, d'après lui, comprend deux thèses fondamentales : l'une, basée sur une "juste" conception de la loi de l'évolution inégale et l'autre, sur une compréhension exacte de l'économie mondiale.
Si, pour se borner à l'époque de l'Impérialisme, ses diverses manifestations inégales ne devaient pas se rattacher aux lois spécifiques du capitalisme, modifiées dans leur activité par la crise générale de décomposition, mais être l'expression d'une loi historique de l'inégalité, relevant du caractère de nécessité, on ne comprendrait pas pourquoi l'action de cette loi se limiterait à l'éclosion de révolutions nationales commençant dans les pays arriérés -au lieu de s'étendre - jusqu'à favoriser le développement d'économies autonomes, c'est-à-dire aussi le "socialisme national".
En donnant la prépondérance au milieu géographique (car c'est à cela que revient l'élévation de l'évolution inégale en loi) et non au véritable facteur historique, la lutte des classes, on ouvre la porte à toute justification du "socialisme" économique et politique s'appuyant sur des possibilités physiques de développement indépendant, porte par où n'a pas manqué de pénétrer le centrisme, pour ce qui concerne la Russie.
Trotsky, vainement, accusera Staline de "faire de la loi du développement inégal un fétiche et de la déclarer suffisante pour servir de fondement au socialisme national" car, partant de la même prémisse théorique, il devrait logiquement aboutir aux mêmes conclusions s'il ne s'arrêtait arbitrairement en route.
Pour caractériser la révolution russe, Trotsky dira "qu'elle fut la plus grandiose de toutes les manifestations de l'inégalité de l'évolution historique; la théorie de la révolution permanente qui avait donné le pronostic du cataclysme d'Octobre était par ce fait même fondée sur cette loi".
Le retard du développement de la Russie peut, dans une certaine mesure, être invoqué pour expliquer le saut de la révolution par dessus la phase bourgeoise, bien que la raison essentielle soit qu'elle surgit dans une période qui enregistre l'incapacité, pour une bourgeoisie nationale, de réaliser ses objectifs historiques. Mais ce retard prend toute sa signification sur le plan politique, parce qu'à l'incapacité historique de la bourgeoisie russe se juxtapose sa faiblesse organique, celle-ci entretenue évidemment par le climat impérialiste. Dans l'ébranlement de la guerre impérialiste, la Russie devait apparaître comme le point de rupture du front capitaliste. La révolution mondiale s'amorça précisément là où existait un terrain favorable au prolétariat et à la construction de son parti de classe.
La critique de la thèse des "pays mûrs" ou "non mûrs" pour le socialisme
Nous voudrions, pour terminer cette première partie, examiner la thèse de "pays mûrs" ou "non mûrs" pour le socialisme, thèse chère aux "évolutionnistes" et qui a laissé quelques traces dans la pensée de communistes oppositionnels, lorsqu'il s'est agi pour eux de définir le caractère de la révolution russe ou de rechercher l'origine de sa dégénérescence.
Dans sa préface à la Critique de 1'économie politique, Marx a donné l'essentiel de sa pensée sur ce que signifiait une évolution sociale arrivée à l'état de maturité, en affirmant "qu'une société ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir et que jamais de nouveaux et supérieurs rapports de production ne se substituent à elle avant que les conditions d'existence matérielles de ces rapports aient été couvées dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne se pose jamais que les problèmes qu'elle peut résoudre car, à regarder de plus près, il se trouvera toujours que le problème lui-même ne se présente que lorsque les conditions matérielles pour le résoudre existent ou du moins sont en voie de devenir".
C'est dire que les conditions de maturité ne peuvent se rapporter qu'à l'ensemble de la société régie par un système de production prédominant. En outre, la notion de maturité n'a qu'une valeur relative et non absolue. Une société est "mûre" dans ce sens que sa structure sociale et son cadre juridique sont devenus trop étroits par rapport aux forces matérielles qu'elle a développées.
Nous avons souligné au début de cette étude que le capitalisme, bien qu'il ait puissamment développé la capacité productive de la société, n'a pas réuni, de ce fait, tous les matériaux permettant l'organisation immédiate du socialisme. Comme Marx l'indique, seulement les conditions matérielles pour résoudre ce problème existent "ou du moins sont en voie de devenir".
A plus forte raison, cette conception restrictive s'applique-t-elle à chacune des composantes nationales de 1'économie mondiale. Toutes sont historiquement mûres pour le socialisme, mais aucune d'entre elles n'est mûre au point de réunir toutes les conditions matérielles nécessaires à l'édification du socialisme intégral et ce, quel que soit le degré de développement atteint.
Aucune nation ne contient, à elle seule, tous les éléments d'une société socialiste et le national-socialisme s'oppose irréductiblement à l'internationalisme de 1'économie impérialiste, à la division universelle du travail et à l'antagonisme mondial entre la bourgeoisie et le prolétariat
C'est pure abstraction que de concevoir une société socialiste comme étant la juxtaposition d'économies socialistes complètes. La distribution mondiale des forces productives (qui n'est pas un produit artificiel) exclut aussi bien pour les nations "supérieures" que pour les régions "inférieures" la possibilité de réaliser intégralement le socialisme. Le poids spécifique de chacune d'elles dans l'économie mondiale mesure leur degré de dépendance réciproque et non l'ampleur de leur indépendance. L'Angleterre, un des secteurs les plus avancés du capitalisme, où celui-ci s'exprime à peu près à l'état pur, n'est pas viable, considérée isolément. Les faits montrent aujourd'hui que, privées en partie seulement du marché mondial, les forces productives nationales périclitent. C'est le cas pour l'industrie cotonnière et l'industrie charbonnière en Angleterre. Aux Etats-Unis, l'industrie automobile, limitée au marché intérieur, cependant vaste, doit rétrograder. Une Allemagne prolétarienne isolée, assisterait impuissante à la contraction de son appareil industriel, même en tenant compte d'une large expansion de la consommation.
Il est donc abstrait de poser la question de pays "mûrs" ou "pas mûrs" pour le socialisme, car le critère de maturité est à rejeter aussi bien pour les pays à développement supérieur que pour les pays retardataires.
Dès lors, c'est sous l'angle d'une maturation historique des antagonismes sociaux résultant du conflit aigu entre les forces matérielles et les rapports de production, que le problème doit être abordé. Limiter les données de celui-ci à des facteurs matériels, c'est se placer sur la position des théoriciens de la IIe Internationale, celle de Kautsky et des socialistes allemands, qui considéraient que la Russie, en tant qu'économie arriérée où le secteur agricole -techniquement faible- occupait une place prépondérante, n'était pas mûre pour une révolution prolétarienne, mais seulement pour une révolution bourgeoise, conception allant rejoindre celle des mencheviks russes. Otto Bauer, de "l'immaturité" économique de la Russie, avait déduit que l'Etat prolétarien devait inévitablement dégénérer.
Rosa Luxembourg (La Révolution russe) faisait cette remarque que, d'après la conception de principe des sociaux-démocrates, la Révolution russe aurait dû s'arrêter à la chute du tsarisme : "Si elle a passé au-delà, si elle s'est donné pour mission la dictature du prolétariat, ça a été, selon cette doctrine, une simple faute de l'aile radicale du mouvement ouvrier russe, les bolcheviks, et tous les mécomptes que la révolution a subis dans son cours ultérieur, tous les embarras dont elle a été victime, se présentent comme un résultat de cette faute fatale".
La question est de savoir si la Russie était mûre ou non pour la révolution prolétarienne n'avait pas à être résolue en fonction des conditions matérielles de son économie, mais en fonction des rapports de classe bouleversés par la situation internationale. La condition essentielle était l'existence d'un prolétariat concentré, bien qu'en proportion infime par rapport à l'immense masse des producteurs paysans, et dont la conscience s'exprimait par un parti de classe, puissant par son idéologie et son expérience révolutionnaire. Avec Rosa Luxemburg, nous disons que "le prolétariat russe ne pouvait être considéré que comme l'avant garde du prolétariat mondial, avant-garde dont les mouvements exprimaient le degré de maturité des antagonismes sociaux à l'échelle internationale. C'est le développement de l'Allemagne, de 1'Angleterre et de la France qui se manifestait à Saint-Pétersbourg. C'est ce développement qui décidait du sort de la révolution russe. Celle-ci ne pouvait atteindre son but que si elle était le prologue de la révolution du prolétariat européen".
Certains camarades de l'Opposition communiste ont cependant basé leur appréciation de la révolution russe sur le critère de "l'immaturité" économique.
Le camarade Hennaut, dans son étude sur les "Classes dans la Russie des Soviets" se place sur cette position.
Faisant état des considérations d'Engels, que nous avons déjà commentées au début, Hennaut les interprète comme ayant une signification particulière pouvant s'appliquer à un pays déterminé et non comme se rapportant à toute la société parvenue au terme historique de son évolution.
Engels se trouverait ainsi en contradiction évidente avec ce que Marx disait dans la préface de sa "Critique". Mais de notre commentaire résulte qu'il ne peut en être ainsi.
D'après Hennaut, pour la justification d'une révolution prolétarienne, c'est le facteur économique qui doit prévaloir et non le facteur politique. Il dit ceci : "appliquées à l'époque contemporaine de l'histoire humaine, ces constatations (d'Engels, ndlr) ne peuvent signifier autre chose que la prise du pouvoir par le prolétariat, le maintien et l'utilisation de ce pouvoir à des fins socialistes, n'est guère concevable que là où le capitalisme a préalablement déblayé le chemin du socialisme, c'est-à-dire que là où il a fait surgir un prolétariat industriel nombreux, englobant sinon la majorité, du moins une forte minorité de la population et où il a créé une industrie développée, capable d'imprimer son cachet au développement ultérieur de l'économie toute entière". Plus loin, il soulignera que : "c'était en dernier lieu les capacités économiques et culturelles du pays qui allaient déterminer le sort ultérieur de la révolution russe lorsqu'il s'avéra que les prolétariats non russes n'étaient pas prêts à faire leur révolution. L'état arriéré de la société russe devait ici faire sentir tous ses côtés négatifs". Mais peut-être le camarade Hennaut n'a-t-il pas remarqué que, partir des conditions matérielles pour "légitimer" ou pas une révolution prolétarienne, entraîne irrésistiblement, qu'on le veuille ou non, dans l'engrenage du "socialisme national".
Nous répétons que la condition fondamentale d'existence de la révolution prolétarienne, c'est la continuité de sa liaison en fonction de laquelle doit se définir la politique intérieure et extérieure de l'Etat prolétarien. C'est précisément parce que la Révolution, si elle doit commencer sur le terrain national, ne peut s'y maintenir indéfiniment, quelles que soient la richesse et l'ampleur du milieu national ; c'est parce qu'elle doit s'élargir à d'autres révolutions nationales jusqu'à aboutir à la révolution mondiale, sous peine d'asphyxie ou de dégénérescence, que nous considérons comme une erreur de se fonder sur des prémisses matérielles.
C'est en se rattachant aux mêmes considérations politiques que l'on doit expliquer, en dernière analyse, le "bond" de la révolution russe, par dessus les étapes intermédiaires. La Révolution d'Octobre a démontré que, dans l'époque de l'Impérialisme décadent, le prolétariat ne pouvait s'arrêter à la phase bourgeoise de l'évolution mais devait la dépasser en se substituant à la bourgeoisie incapable de réaliser son programme historique. Pour atteindre cet objectif, les bolcheviks n'avaient nullement à inventorier le capital matériel, les forces productives disponibles, mais bien à évaluer le rapport des classes.
Encore une fois, le saut n'était pas conditionné par des facteurs économiques, mais politiques, tandis qu'il ne pouvait prendre toute sa signification, au point de vue du développement matériel, que par la soudure via la révolution prolétarienne avec la révolution mondiale. L'"immaturité" des pays retardataires, qui impliquait le saut aussi bien que "la maturité" des pays avancés se trouvait ainsi incorporée au même processus de l'évolution mondiale de la lutte des classes.
Lénine a fait justice des reproches adressées aux bolcheviks d'avoir pris le pouvoir : "ce serait une faute irréparable de dire que, puisqu'il y a déséquilibre reconnu entre nos forces économiques et notre force politique, il ne fallait pas prendre le pouvoir ! Pour raisonner ainsi, il faut être aveugle, il faut oublier que cet équilibre n'existera jamais et ne peut pas exister dans l'évolution sociale, non plus que dans l'évolution naturelle et que c'est seulement à la suite de nombreuses expériences, dont chacune prise à part sera incomplète et souffrira d'un certain déséquilibre, que le socialisme triomphant peut être créé par la collaboration révolutionnaire des prolétaires de tous les pays".
Un prolétariat, si "pauvre" soit-il, n'a pas à "attendre" l'action de prolétariats plus "riches" pour faire sa propre révolution. Qu'après celle-ci les difficultés se multiplieront par rapport à celles rencontrées par un prolétariat plus favorisé, c'est l'évidence même, mais l'histoire n'offre pas le choix !
La nature de l'époque historique fait que les révolutions bourgeoises, dirigées par la bourgeoisie, sont révolues. La survivance du capitalisme est devenue un frein au progrès de l'évolution et, par conséquent, un obstacle à l'épanouissement d'une révolution bourgeoise qui se trouve privée de la soupape d'un marché mondial saturé de marchandises. En outre la bourgeoisie ne peut plus s'assurer le concours des masses ouvrières, comme ce fut le cas en 1789, mais comme ce ne fut déjà plus le cas en 1848, en 1871 et en Russie, en 1905.
La révolution d'Octobre fut la saisissante illustration d'un de ces apparents paradoxes de l'histoire, et elle donna l'exemple d'un prolétariat achevant une éphémère révolution bourgeoise, mais obligé d'y substituer ses propres objectifs pour ne pas retomber sous la coupe de l'Impérialisme.
La bourgeoisie russe fut originellement affaiblie par l'hégémonie du capital occidental sur l'économie du pays. Ce dernier, comme prix de soutien au tsarisme, préleva une part importante du revenu national, entravant ainsi le développement des positions économiques de la bourgeoisie.
1905 apparaît comme une tentative de révolution bourgeoise d'où la bourgeoisie est absente. Un prolétariat fortement concentré avait déjà pu se constituer en une force révolutionnaire indépendante, obligeant la bourgeoisie libérale, politiquement incapable, à se maintenir dans le sillage de l'impérialisme autocratique et féodal, mais la révolution bourgeoise de 1905 ne put aboutir à une victoire prolétarienne parce que, bien que surgie de l'ébranlement provoqué par la guerre russo-japonaise, elle ne correspondait pas à une maturation des antagonismes sociaux à l'échelle internationale et qu'aussi le tsarisme put recevoir l'appui financier et matériel de toute la bourgeoisie européenne.
Comme le remarque Rosa Luxembourg : "La révolution de 1905-1907 n'avait trouvé qu'un faible écho en Europe, aussi devait-elle rester un chapitre préliminaire. La suite et la fin étaient liées à l'évolution européenne."
La révolution de 1917 devait éclore dans des conditions historiques plus évoluées.
Dans La révolution prolétarienne, Lénine en a caractérisé les phases successives. Nous ne pouvons mieux faire que de les citer :
- "Nous avons été d'abord avec toute la classe paysanne contre la monarchie, contre les grands propriétaires fonciers, contre la féodalité et ça a été la révolution bourgeoise, démocratique bourgeoise. Ensuite, nous avons été avec la classe paysanne pauvre, avec le demi-prolétariat, avec tous les exploités contre le capitalisme, y compris les riches campagnards, les accapareurs, les spéculateurs et, dès lors, la révolution est devenue socialiste... Tenter de dresser une muraille de Chine entre ces deux révolutions, de les séparer autrement que par le degré de préparation du prolétariat et le degré de son union avec la classe pauvre des campagnes, c'est dénaturer le marxisme, l'avilir et le remplacer par le libéralisme. C'est vouloir, en se référant au progrès que représente le régime bourgeois par rapport à la féodalité, faire œuvre de réaction en défendant ce régime contre le socialisme".
La dictature du prolétariat fut l'instrument qui permit, d'une part d'amener la révolution bourgeoise à terme et, d'autre part, de la dépasser. C'est ce qui explique le mot d'ordre des bolcheviks : "la terre aux paysans" contre lequel s'est élevée Rosa Luxembourg, erronément à notre avis.
Avec Lénine, nous disons que "les bolcheviks ont rigoureusement distingué la révolution démocratique bourgeoise de la révolution prolétarienne ; en menant jusqu'au bout la première, ils ont ouvert la porte à la seconde. C'est la seule politique révolutionnaire, la seule politique marxiste."
(A suivre)
[1] En plus de deux notes destinées à éclairer le sens de certains termes, nous avons également ajouté, par rapport au texte original, deux intertitres destinés à en faciliter la lecture.
[2] Terme par lequel Bilan désignait le stalinisme.(ndlr)
[3] Terme par lequel Bilan désigne les "antagonismes" (ndlr).
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Communisme [27]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale n° 129 - 2e trimestre 2007
- 2937 reads
Editorial - chaos impérialiste, désastre écologique : le capitalisme en perdition
- 2738 reads
Il y a plus d'un siècle, Friedrich Engels prédisait que, laissée à elle-même, la société capitaliste plongerait l'humanité dans la barbarie. Et effectivement, durant ces cent dernières années, la guerre impérialiste n'a cessé d'apporter son lot croissant d'épisodes chaque fois plus abominables venant illustrer la façon dont cette prévision se réalisait. Aujourd'hui, le monde capitaliste a ouvert une autre voie vers l'apocalypse qui vient compléter celle de la guerre impérialiste : celle d'une catastrophe écologique "man-made" -"fabriquée par l'homme"- qui, en l'espace de quelques générations, pourrait transformer la terre en une planète aussi inhospitalière pour la vie humaine que la planète Mars. Bien que les défenseurs de l'ordre capitaliste soient conscients de cette perspective, ils n'y peuvent absolument rien, car c'est la perpétuation contre nature elle-même de leur mode de production agonisant qui provoque la guerre impérialiste tout comme la catastrophe écologique.
Guerre impérialiste = barbarie
Le fiasco sanglant auquel a abouti l'invasion de l'Irak par la "coalition" dirigée par les États-Unis en 2003, marque un moment fatidique dans le développement de la guerre impérialiste vers la destruction même de la société. Quatre ans après l'invasion, bien loin d'être "libéré", l'Irak s'est transformé en ce que les journalistes bourgeois appellent pudiquement "une société en panne", où la population, après avoir subi les massacres de la Guerre du Golfe de 1991, puis avoir été saignée à blanc pendant une décennie de sanctions économiques[1], est soumise quotidiennement aux attentats suicides, aux pogromes de divers "insurgés", aux assassinats des escadrons de la mort du Ministère de l'Intérieur ou à l'élimination arbitraire par les forces d'occupation. Et la situation en Irak n'est que l'épicentre d'un processus de désintégration et de chaos militarisés qui s'étend en Palestine, en Somalie, au Soudan, au Liban, en Afghanistan et menace sans cesse d'engloutir de nouvelles régions du globe dont ne sont pas exclues les métropoles capitalistes centrales comme l'ont montré les attentats terroristes à New York, Madrid et Londres pendant la première décennie de ce siècle. Loin de construire un nouvel ordre au Moyen Orient, le pouvoir militaire américain n'a fait que répandre un chaos militaire croissant.
En un sens, il n'y a rien de nouveau dans ce carnage militaire de masse. La Première Guerre mondiale de 1914-18 constituait déjà un premier pas majeur vers un "avenir" barbare. Le massacre mutuel de millions de jeunes ouvriers envoyés dans les tranchées par leurs maîtres impérialistes respectifs, fut suivi d'une pandémie, la "grippe espagnole", qui a emporté la vie de millions d'autres, tandis que les nations industrielles européennes les plus puissantes du capitalisme se retrouvaient économiquement à genoux. Après l'échec de la révolution d'Octobre 1917 et des révolutions ouvrières qu'elle avait inspirées dans le reste du monde au cours des années 1920, la voie était ouverte vers un épisode de guerre totale encore plus catastrophique, la Seconde Guerre mondiale de 1939-45. Ce sont alors les populations civiles sans défense qui devinrent la cible principale d'un massacre de masse systématique par les forces aériennes et qu'un génocide de plusieurs millions d'êtres humains fut perpétré au cœur de la civilisation européenne.
Puis la "Guerre froide" de 1947 à 1989 a produit toute une série de carnages aussi destructeurs, en Corée, au Vietnam, au Cambodge et à travers l'Afrique, tandis que l'antagonisme entre les États-Unis et l'URSS contenait la menace permanente d'un holocauste nucléaire global.
Ce qui est nouveau dans la guerre impérialiste aujourd'hui, ce n'est pas le niveau absolu de destruction, puisque les récents conflits militaires, tout en étant menés avec une puissance de feu bien plus mortelle qu'auparavant, au moins de la part des États-Unis, n'ont pas encore emporté dans l'abîme les principales concentrations de populations au cœur du capitalisme, comme ce fut le cas pendant les Première et Deuxième Guerres mondiales. Ce qui est différent, c'est que l'anéantissement de toute la société humaine qu'apporterait une telle guerre, apparaît aujourd'hui bien plus clairement. En 1918, Rosa Luxemburg comparait la barbarie de la Première Guerre mondiale au déclin de la Rome antique et aux années sombres qui ont suivi. Aujourd'hui, même cette comparaison dramatique semble inadéquate pour exprimer l'horreur sans fin que la barbarie capitaliste nous réserve. Malgré toute la brutalité et le chaos destructeur des deux guerres mondiales du siècle dernier, il existait toujours une perspective - même si elle était en fin de compte illusoire - de reconstruire un ordre social dans l'intérêt des puissances impérialistes dominantes. Les foyers de tension de l'époque contemporaine au contraire n'offrent aux protagonistes en guerre aucune autre perspective que de descendre encore plus dans la fragmentation sociale à tous les niveaux, dans la décomposition de l'ordre social, dans un chaos sans fin.
L'impasse de l'impérialisme américain est celle du capitalisme
La plus grande partie de la bourgeoisie américaine a été forcée de reconnaître que sa stratégie impérialiste d'imposition unilatérale de son hégémonie mondiale, que ce soit sur le plan diplomatique, militaire ou idéologique, a mal tourné. Le rapport du Groupe d'Étude sur l'Irak (Irak Study Group) présenté au Congrès américain ne cache pas ce fait évident. Au lieu de renforcer le prestige de l'impérialisme américain, l'occupation de l'Irak l'a affaibli quasiment à tous les niveaux. Mais quelle alternative à la politique de Bush proposent les plus sévères critiques au sein de la classe dominante américaine ? Le retrait est impossible sans affaiblir encore plus l'hégémonie américaine et accélérer le chaos. Une partition de l'Irak en fonction de groupes ethniques aurait aussi le même résultat. Certains proposent même de revenir à une politique d'endiguement comme pendant la Guerre froide. Mais il est clair qu'il ne peut y avoir de retour à l'ordre mondial des deux blocs impérialistes. Aussi le fiasco en Irak est-il bien pire que celui du Vietnam puisque, contrairement à cette dernière guerre, c'est le monde entier que les États-Unis essaient maintenant d'endiguer et pas seulement leur bloc rival, l'URSS.
Aussi, malgré les critiques acerbes du ISG et le contrôle du Congrès américain par le parti démocrate, le président Bush a été autorisé à augmenter d'au moins 20 000 le nombre des soldats en Irak et se lance dans une nouvelle politique de menaces militaire et diplomatique vis-à-vis de l'Iran. Quelles que soient les stratégies alternatives qu'étudie la classe dominante américaine, elle sera, tôt ou tard, contrainte de donner une nouvelle preuve sanglante de son statut de superpuissance avec des conséquences encore plus abominables pour les populations du monde, ce qui accélérera encore l'extension de la barbarie.
Cela n'est le résultat ni de l'incompétence ni de l'arrogance de l'administration républicaine de Bush et des néo conservateurs comme les bourgeoisies des autres puissances impérialistes ne cessent de nous le répéter. S'en remettre aux Nations Unies et au multilatéralisme ne constitue pas une option de paix comme ces bourgeoisies le proclament ainsi que les pacifistes de toutes sortes. Depuis 1989, Washington l'a très bien compris : les Nations Unies sont devenues une tribune pour contrecarrer les projets américains : un lieu où ses rivaux moins puissants peuvent retarder, délayer et même mettre leur veto à la politique américaine afin d'empêcher que leurs propres positions soient affaiblies. En présentant les États-Unis comme les seuls responsables de la guerre et du chaos, la France, l'Allemagne et les autres ne font que révéler la part pleine et entière qu'elles prennent à la logique destructrice actuelle de l'impérialisme : une logique où chacun joue pour soi et doit s'opposer à tous les autres.
Il n'est pas surprenant que les manifestations régulières sur le thème "Stop the War" - "Arrêtez la guerre" - dans les grandes villes des principales puissances apportent en général un soutien bruyant à de petits gangsters impérialistes du Moyen-Orient, comme les insurgés d'Irak ou le Hezbollah du Liban qui combattent les États-Unis. Ce que cela révèle, c'est que l'impérialisme est un processus dont aucune nation ne peut se tenir à l'écart et que la guerre n'est pas seulement le résultat de l'agression des plus grandes puissances.
D'autres proclament toujours, contre toute évidence, que l'aventure américaine en Irak est une "guerre pour le pétrole", obscurcissant ainsi complètement le danger posé par ses objectifs géostratégiques fondamentaux. C'est là une sous-estimation considérable de la gravité de la situation actuelle. En réalité, l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui l'impérialisme américain en Irak n'est que la manifestation de l'impasse globale dans laquelle se trouve la société capitaliste. George Bush père avait annoncé qu'avec la disparition du bloc russe s'était ouverte une ère nouvelle de paix et de stabilité, un "nouvel ordre mondial". Rapidement, notamment avec la première guerre du Golfe puis avec le conflit barbare en Yougoslavie, au cœur de l'Europe, la réalité s'était chargée de démentir cette prévision. Les années 1991 n'ont pas été celles de l'ordre mondial mais celles d'un chaos militaire croissant. Ironiquement, il est revenu à George Bush fils d'être un acteur de premier plan dans un nouveau pas décisif de ce chaos irréversible.
La détérioration de la biosphère
En même temps que le capitalisme en décomposition attise son cours impérialiste vers une barbarie plus clairement perceptible, il a également accéléré un assaut contre la biosphère d'une telle férocité qu'un holocauste climatique artificiellement créé pourrait lui aussi balayer la civilisation et la vie humaines. Selon le consensus auquel sont arrivés les scientifiques en écologie du monde, dans le rapport de février 2007 du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC), il est clair que la théorie selon laquelle le réchauffement de la planète par l'accumulation de hauts taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère serait dû à la combustion à grande échelle d'énergies fossiles, n'est plus une simple hypothèse mais est considérée comme "très probable". Le dioxyde de carbone de l'atmosphère retient la chaleur du soleil réfléchie par la surface de la terre et l'irradie dans l'air environnant, menant à "l'effet de serre". Ce processus a commencé vers 1750, au début de la révolution capitaliste industrielle et, depuis, l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone et le réchauffement de la planète n'ont cessé de croître. Depuis 1950, cette double augmentation s'est accélérée avec une pente beaucoup plus raide de la courbe de croissance, et de nouveaux records planétaires de température ont été atteints quasiment chaque année durant la dernière décennie. Les conséquences de ce réchauffement de la planète ont déjà commencé à apparaître à une échelle alarmante : une modification du climat conduisant à la fois à des sécheresses répétées et à des inondations à grande échelle, des vagues de chaleur mortelles en Europe du Nord et des conditions climatiques extrêmes d'une grande puissance destructrice qui, à leur tour, sont déjà responsables du développement de famines et de maladies dans le Tiers Monde et de la ruine de villes entières comme la Nouvelle Orléans après le cyclone Katrina.
On ne saurait bien sûr blâmer le capitalisme pour avoir commencé à brûler des énergies fossiles ou à agir sur l'environnement avec des conséquences imprévues et dangereuses. En fait, ceci a lieu depuis l'aube de la civilisation humaine :
"Les gens qui, en Mésopotamie, en Grèce, en Asie mineure et autres lieux essartaient les forêts pour gagner de la terre arable, étaient loin de s'attendre à jeter par là les bases de l'actuelle désolation de ces pays, en détruisant avec les forêts les centres d'accumulation et de conservation de l'humidité. Les Italiens qui, sur le versant sud des Alpes, saccageaient les forêts de sapins, conservées avec tant de soins sur le versant nord, n'avaient pas idée qu'ils sapaient par là l'élevage de haute montagne sur leur territoire; ils soupçonnaient moins encore que, ce faisant, ils privaient d'eau leurs sources de montagne pendant la plus grande partie de l'année et que celles ci, à la saison des pluies, allaient déverser sur la plaine des torrents d'autant plus furieux. Ceux qui répandirent la pomme de terre en Europe ne savaient pas qu'avec les tubercules farineux ils répandaient aussi la scrofule. Et ainsi les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne régnons nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un peuple étranger, comme quelqu'un qui serait en dehors de la nature, mais que nous lui appartenons avec notre chair, notre sang, notre cerveau, que nous sommes dans son sein, et que toute notre domination sur elle réside dans l'avantage que nous avons sur l'ensemble des autres créatures, de connaître ses lois et de pouvoir nous en servir judicieusement." (Friedrich Engels, Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme)
Le capitalisme est néanmoins responsable de l'énorme accélération de ce processus de détérioration de l'environnement. Non à cause de l'industrialisation en soi mais comme résultat de sa recherche d'un profit maximal et de l'indifférence qui en découle vis-à-vis des besoins écologiques et humains sauf lorsqu'ils coïncident avec le but d'accumuler des richesses. De plus, le mode de production capitaliste a d'autres caractéristiques qui contribuent à la destruction effrénée de l'environnement. La concurrence intrinsèque entre capitalistes, en particulier entre chaque État national, empêche, en dernière instance au moins, toute coopération véritable à l'échelle mondiale. Et, en lien avec cette caractéristique, la tendance du capitalisme à la surproduction dans sa recherche insatiable de profit.
Dans le capitalisme décadent, dans sa période de crise permanente, cette tendance à la surproduction devient chronique. C'est apparu de façon particulièrement claire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale quand l'expansion des économies capitalistes a eu lieu artificiellement, en partie à travers la politique de financement des déficits, par une énorme extension de toutes sortes d'endettement dans l'économie. Ceci n'a pas mené à la satisfaction des besoins de la masse de la population ouvrière qui est restée embourbée dans la pauvreté, mais à un énorme gaspillage : à des montagnes de marchandises invendues, au dumping de millions de tonnes de nourriture, à l'obsolescence planifiée dès leur production d'une immense quantité de produits, depuis les voitures jusqu'aux ordinateurs qu'il faut rapidement mettre au rebut, à une masse énorme de marchandises identiques produites par des concurrents sans nombre pour le même marché.
De plus, tandis que le rythme du changement et de la sophistication technologiques s'accroît dans la décadence, les innovations qui en résultent, contrairement à la situation de la période d'ascendance du capitalisme, tendent à être stimulées principalement par le secteur militaire. En même temps, sur le plan des infrastructures : construction, système sanitaire, production d'énergie, systèmes de transport, nous assistons à très peu de développements révolutionnaires à une échelle comparable à celle qui a caractérisé l'émergence de l'économie capitaliste. Dans la période de décomposition capitaliste, la phase finale de la décadence, il y a une accélération de la tendance opposée, une tentative de réduire le coût de la maintenance, même des vieilles infrastructures, dans la recherche de profits immédiats. On voit la caricature de ce processus dans l'expansion actuelle de la production en Chine et en Inde où est largement absente toute infrastructure industrielle. Au lieu de donner un nouvel élan de vie au capitalisme, cette expansion donne lieu à des niveaux de pollution faramineux : la destruction de l'ensemble des systèmes fluviaux, d'énormes couches de smog qui recouvrent plusieurs pays, etc.
Ce long processus de déclin et de décomposition du mode de production capitaliste peut permettre d'expliquer pourquoi il y a eu une telle accélération dramatique des émissions de dioxyde de carbone et du réchauffement de la planète durant les dernières décennies. Il permet aussi d'expliquer pourquoi, face à une telle évolution économique et climatique, le capitalisme et ses "décideurs" seront incapables de renverser les effets catastrophiques du réchauffement climatique.
Ces deux scénarios apocalyptiques qui peuvent détruire la civilisation humaine elle-même, sont dans une certaine mesure reconnus et rendus publics par les porte-parole et les médias des dirigeants de toutes les nations capitalistes. Le fait qu'ils recommandent d'innombrables remèdes pour éviter ces issues fatales, ne veut pas dire qu'un seul d'entre eux ait une alternative réaliste aux perspectives barbares que nous avons esquissées. Au contraire. Face au désastre écologique qu'il génère comme face à la barbarie impérialiste, le capitalisme est également impuissant.
"Beaucoup de vent" autour du réchauffement climatique
Les gouvernements du monde ont généreusement financé à travers les Nations Unies la recherche du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC) depuis 1990, et leurs médias ont largement divulgué ses conclusions récentes les plus affligeantes.
A leur tour, les principaux partis politiques de la bourgeoisie de tous les pays se parent de diverses nuances de vert. Mais à y regarder de plus près, la politique écologique de ces partis, aussi radicale qu'elle puisse paraître, obscurcit délibérément la gravité du problème parce que la seule solution à y apporter mettrait en cause le système même dont ils chantent les louanges. Le dénominateur commun de toutes ces campagnes "vertes" est d'empêcher le développement d'une conscience révolutionnaire dans une population horrifiée à juste titre par le réchauffement climatique. Le message écologique permanent des gouvernements, c'est que "sauver la planète est la responsabilité de chacun" alors que la vaste majorité est privée de tout pouvoir économique ou politique, de contrôle sur la production et sur la consommation, sur ce qui est produit et comment. Et la bourgeoisie qui, elle, a ce pouvoir de décision, a moins que jamais l'intention de satisfaire les besoins écologiques et humains aux dépens de ses profits.
Al Gore qui a manqué de peu devenir président démocrate des États-Unis en 2000, s'est porté à la tête d'une campagne internationale contre les émissions de carbone avec son film "Une vérité qui dérange" qui a gagné un Oscar à Hollywood pour la façon vivante dont il traite le danger de la montée des températures planétaires, de la fonte des glaces polaires, de la montée des mers et de toutes les dévastations qui en découlent. Mais le film est aussi une plateforme électorale pour Al Gore lui-même. Il n'est pas le seul vieux politicien à prendre conscience que la peur justifiée de la population vis-à-vis d'une crise écologique peut être exploitée dans la ruée pour le pouvoir qui caractérise le jeu démocratique des grands pays capitalistes. En France, les candidats à la présidence ont tous signé le "pacte écologique" du journaliste Nicolas Hulot. En Grande-Bretagne, les principaux partis politiques rivalisent pour être plus "verts" que les autres. Le rapport Stern commandé par Gordon Brown du New Labour a été suivi par plusieurs initiatives gouvernementales pour réduire les émissions de carbone. David Cameron, chef de l'opposition conservatrice, va en vélo au Parlement (pendant que son entourage arrive derrière en Mercedes).
Il suffit d'examiner les résultats des précédentes politiques gouvernementales pour réduire les émissions de carbone pour constater l'incapacité des États à faire preuve d'une quelconque efficacité. Au lieu de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre au niveau de 1990 en l'an 2000, ce à quoi les signataires du protocole de Kyoto s'étaient modestement engagés en 1997, il y a eu une augmentation de 10,1% des émissions dans les principaux pays industrialisés à la fin du siècle et il est prévu que cette pollution aura encore augmenté de 25,3% en 2010 ! (Deutsche Umwelthilfe)
Il suffit aussi de constater la totale négligence des États capitalistes envers les calamités qui se sont déjà abattues à cause du changement climatique pour juger de la sincérité des interminables déclarations de bonnes intentions.
Il y a ceux qui, reconnaissant que le mobile du profit constitue un facteur puissant de démotivation dans la limitation efficace de la pollution, croient qu'on peut résoudre le problème en remplaçant les politiques libérales par des solutions organisées par l'État. Mais il est clair, surtout à l'échelle internationale, que les États capitalistes, même s'ils s'organisent chez eux, sont incapables de coopérer entre eux sur cette question car chacun devrait faire des sacrifices économiques de son côté. Le capitalisme, c'est la concurrence, et aujourd'hui plus que jamais, il est dominé par le chacun pour soi.
Le monde capitaliste est incapable de s'unir autour d'un projet commun aussi massif et coûteux qu'une transformation complète de l'industrie et des transports afin de parvenir à une réduction drastique de la production d'énergie brûlant du carbone. Au contraire, la principale préoccupation de toutes les nations capitalistes est de chercher à utiliser ce problème pour promouvoir leurs propres ambitions sordides. Comme sur le plan impérialiste et militaire, sur le plan écologique le capitalisme est traversé par des divisions nationales insurmontables et ne peut donc pas répondre de façon significative aux besoins les plus pressants de l'humanité.
Tout n'est pas perdu pour les prolétaires, ils ont toujours un monde à gagner
Mais il serait tout à fait erroné d'adopter une attitude de résignation et de penser que la société humaine sombrera inévitablement à cause de ces puissantes tendances - l'impérialisme et la destruction écologique - à la barbarie. Face à la fatuité de toutes les demi-mesures que le capitalisme nous propose pour apporter la paix et l'harmonie avec la nature, le fatalisme est une attitude aussi erronée que la croyance naïve en ces cures cosmétiques.
En même temps qu'il sacrifie tout à la course au profit et à la concurrence, le capitalisme a aussi, malgré lui, produit les éléments de son dépassement comme mode d'exploitation. Il a produit les moyens potentiels technologiques et culturels pour créer un système de production mondial, unifié et planifié, en harmonie avec les besoins de l'humanité et de la nature. Il a produit une classe, le prolétariat, qui n'a pas besoin de préjugés nationaux ou concurrents, et qui a tout intérêt au développement de la solidarité internationale. La classe ouvrière n'a aucun intérêt dans le désir rapace de profit. En d'autres termes, le capitalisme a jeté les bases pour un ordre supérieur de la société, pour son dépassement par le socialisme. Le capitalisme a développé les moyens de détruire la société humaine mais il a aussi créé son propre fossoyeur, la classe ouvrière, qui peut préserver cette société humaine et lui faire accomplir un pas décisif dans son épanouissement.
Le capitalisme a permis la création d'une culture scientifique qui est capable d'identifier et de mesurer les gaz invisibles comme le dioxyde de carbone tant dans l'atmosphère d'aujourd'hui que dans celle d'il y a 10 000 ans. Les scientifiques savent identifier les isotopes de dioxyde de carbone spécifiques produits par la combustion des énergies fossiles. La communauté scientifique a été capable de tester et de vérifier l'hypothèse de "l'effet de serre". Pourtant, elle est loin l'époque où le capitalisme en tant que système social était capable d'utiliser la méthode scientifique et ses résultats dans l'intérêt du progrès de l'humanité. La plus grande partie des recherches et des découvertes scientifiques d'aujourd'hui est dédiée à la destruction, au développement de méthodes toujours plus sophistiquées de mort massive. Seul un nouvel ordre social, une société communiste, peut mettre la science au service de l'humanité.
Malgré les cent dernières années de déclin et de pourrissement du capitalisme et les sévères défaites qu'a subies la classe ouvrière, le soubassement nécessaire pour créer une nouvelle société est toujours intact.
Le resurgissement du prolétariat mondial depuis 1968 en est la preuve. Le développement de sa lutte de classe contre la pression constante sur le niveau de vie des prolétaires durant les décennies qui ont suivi, a empêché l'issue barbare promise par la Guerre froide : une confrontation totale entre les blocs impérialistes. Depuis 1989 cependant et la disparition des blocs, la position défensive de la classe ouvrière n'a pas permis d'empêcher la succession d'horribles guerres locales qui menacent de s'accélérer hors de tout contrôle et d'impliquer de plus en plus de régions de la planète. Dans cette période de décomposition capitaliste, le prolétariat n'a plus le temps pour lui, d'autant plus qu'une catastrophe écologique pressante doit maintenant être ajoutée à l'équation historique.
Mais nous ne pouvons pas dire encore que le déclin et la décomposition du capitalisme ont atteint "un point de non retour" - un point où sa barbarie ne pourrait plus être renversée.
Depuis 2003, la classe ouvrière a commencé à reprendre la lutte avec une vigueur renouvelée, après que l'effondrement du bloc de l'Est a mis momentanément un terme à son resurgissement depuis 1968.
Dans ces conditions de développement de la confiance de la classe, les dangers croissants représentés par la guerre impérialiste et la catastrophe écologique, au lieu d'induire des sentiments d'impuissance et de fatalisme, peuvent conduire à une plus grande réflexion politique et à une plus grande conscience des enjeux de la situation mondiale, à une conscience de la nécessité du renversement révolutionnaire de la société capitaliste. C'est la responsabilité des révolutionnaires de participer activement à cette prise de conscience.
Como, 3/04/2007.
[1] La mortalité infantile en Irak est passée de 40 pour 1000 en 1990 à 102 pour 1000 en 2005, The Times, 26 mars 2007.
courrier d'un lecteur : les revendications nationales et démocratiques, hier et aujourd'hui
- 3067 reads
Nous avons échangé récemment une correspondance avec un lecteur de Montreal (Canada) qui nous a conduits à présenter une nouvelle fois notre vision sur les luttes de "libération nationale" que nous avons largement traitée dans nos publications mais également celle, plus générale, des "revendications démocratiques" qui n'avait pas fait l'objet, jusqu'à présent, de texte développé spécifique de notre part. Dans la mesure où les arguments que nous présentons à notre lecteur ont une portée générale et répondent à un questionnement réel existant au sein de la classe ouvrière, notamment du fait de l'influence auprès de celle-ci des partis de gauche et d'extrême gauche, nous avons estimé utile de publier de larges extraits de cette correspondance.
Dans un de ses premiers courriers, notre lecteur nous demandait ce que le CCI pensait de la question nationale québécoise.
Voici ce que fut notre première réponse :
Quant à la question nationale québécoise, elle n'est pas différente de celle posée par tout mouvement d'indépendance nationale depuis plus d'un siècle maintenant, signifiant un renforcement des illusions nationalistes pour le prolétariat et un affaiblissement de ses luttes. Nous considérons que toute organisation qui, au Québec, soutient la revendication de l'indépendance de la "Belle Province" participe, qu'elle en soit consciente ou non, à l'affaiblissement du prolétariat québécois, canadien et nord-américain.
Les dangers du nationalisme québécois
Dans un deuxième courrier sur cette question nous précisions notre position :
Pour ce qui concerne la question spécifique du Québec et de l'attitude à adopter face au mouvement indépendantiste tu écris dans ton message du 1er janvier : "Concernant le Québec, je comprends votre opposition à l'indépendance du Québec et au nationalisme québécois, mais je ne crois pas que le nationalisme canadien soit plus "progressiste" loin de là. Je crois qu'il faut s'opposer résolument à toutes les campagnes pour la défense de l'État canadien et pour le maintien de l"unité nationale" du Canada. Le Canada est un État impérialiste et oppresseur qui doit être détruit de fond en comble. Je ne veux pas dire qu'il faille appuyer l'indépendance du Québec et des peuples autochtones, mais il faut aussi rejeter tout appui au chauvinisme canadien-anglais qui est dominant au sein de l'État canadien."
Il est clair qu'il est hors de question pour des communistes d'apporter le moindre soutien au chauvinisme canadien-anglais, comme à tout chauvinisme d'ailleurs. Cependant tu parles de "chauvinisme canadien-anglais" et de "nationalisme québécois". A quoi correspond cette différence de qualification ? Penses-tu que le nationalisme québécois soit moins nocif pour la classe ouvrière que le nationalisme canadien-anglais ? Ce n'est certainement pas notre avis. Et pour illustrer cela on peut envisager une situation hypothétique mais qui n'est pas absurde, celle d'un puissant mouvement de la classe ouvrière au Québec qui, dans un premier temps, ne toucherait pas les provinces anglophones. Il est clair que la bourgeoisie canadienne (y compris celle du Québec) fera tout son possible pour qu'il ne s'étende pas dans ces provinces et un des meilleurs moyens pour que ce ne soit pas le cas, c'est que les ouvriers du Québec mêlent à leurs revendications de classe prolétariennes des revendications indépendantistes ou autonomistes. Ainsi, le nationalisme québécois se présente comme un des pires poisons pour le prolétariat du Québec et de l'ensemble du Canada, probablement plus dangereux encore que le nationalisme canadien-anglais puisqu'il paraît peu probable qu'un mouvement de classe des ouvriers anglophones soit inspiré par la condamnation de l'indépendance du Québec.
Dans une situation qui peut avoir des ressemblances avec celle du Québec au sein de l'État canadien, Lénine écrivait à propos de la question de l'indépendance de la Pologne [1]:
"La situation est sans contredit très embrouillée mais il y a une issue qui permettrait à tous les participants de rester des internationalistes : les social-démocrates russes et allemands exigeant "la liberté de séparation" inconditionnelle de la Pologne ; les social-démocrates polonais s'attachant à réaliser l'unité de la lutte prolétarienne dans un petit et dans les grands pays sans lancer pour le moment le mot d'ordre de l'indépendance de la Pologne." (Bilan d'une discussion sur le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, 1916)
Ainsi, si on veut vraiment être fidèle à la position de Lénine, il faudrait que les communistes défendent l'indépendance du Québec dans les provinces anglophones mais se refusent à une telle attitude au Québec même. (...)
Pour notre part, nous ne partageons pas la position de Lénine : nous pensons qu'il faut tenir le même langage à tous les ouvriers quelle que soit leur nationalité ou leur langue. C'est ce que nous faisons par exemple en Belgique où notre journal Internationalisme publie exactement les mêmes articles en français et en flamand. Cela dit, il faut reconnaître que la position, même erronée, de Lénine était inspirée par un internationalisme sans faille ce qui n'est certainement pas le cas si, au Québec, on ne dénonce pas vigoureusement le nationalisme et les revendications indépendantistes.
La réponse de notre lecteur à ce courrier avait été assez vive :
"Je crois que vous avez une vision profondément erronée du rapport entre le nationalisme québécois et le chauvinisme canadien-anglais. Ce dernier est DOMINANT au sein de l'État canadien et nourrit le racisme anti-québécois et anti-francophone. L'existence de ce chauvinisme et son enracinement dans la classe ouvrière anglo-canadienne empêche toute unité de la classe ouvrière pancanadienne. Il encourage le développement de tendances nationalistes chez les travailleurs québécois. Un de ses aspects est le refus du bilinguisme, qui de toute façon est davantage un mythe qu'une réalité au Canada. La plupart des francophones sont obligés de parler anglais et la plupart des anglophones ne parlent ou refusent de parler français.
Contrairement à ce que vous dites le mouvement ouvrier au Canada anglais est basé sur la défense de l'unité canadienne et de l"intégrité" de l'État canadien et ce au détriment des Québécois et des Premières Nations. Il n'y aura JAMAIS d'unité de la classe ouvrière au Canada tant que durera l'oppression des minorités nationales et le racisme anglo-chauvin. (...)
C'est une chose de rejeter le nationalisme québécois et de considérer l'indépendance du Québec comme une impasse et même une tromperie pour la classe ouvrière mais de là à prétendre qu'il est plus "dangereux" que le chauvinisme anglophone, qui s'apparente à l'orangisme protestant en Irlande du Nord, il y a une marge gigantesque!
Le gouvernement canadien fait tout en son pouvoir pour garder le Québec de force dans la Confédération, allant jusqu'à menacer de ne pas reconnaître un résultat positif lors du référendum de 1995 et même de dépecer un éventuel Québec indépendant selon des lignes ethniques, ce que l'on a appelé la partition du Québec. Ensuite ce fut la loi sur la Clarté référendaire où le gouvernement fédéral s'arrogeait le droit de décider des règles d'un prochain référendum sur la souveraineté au niveau de la question et du seuil de majorité nécessaire pour réaliser l'indépendance du Québec.
Ne venez surtout pas me dire que le chauvinisme anglo-canadien est moins nocif pour l'unité de la classe ouvrière. Je vous invite fortement à vous renseigner et vous documenter sur la question nationale québécoise."
A ce courrier nous répondions ainsi :
Au vu de tes messages, ce qui t'a fait réagir très vivement c'est que nous puissions écrire que, par certains côtés, le nationalisme québécois puisse être "plus dangereux que le nationalisme canadien-anglais".
Nous ne contestons pas les faits que tu donnes pour appuyer ta critique de notre position, notamment que : "le chauvinisme canadien-anglais soit DOMINANT au sein de l'État canadien, qu'il nourrit le racisme anti-québécois et anti-francophone" et que "il encourage le développement de tendances nationalistes chez les travailleurs québécois". De même, nous sommes prêts à admettre que "le chauvinisme anglophone s'apparente à l'orangisme protestant en Irlande du Nord".
Et c'est d'ailleurs à partir de ce dernier argument que nous allons baser notre réponse.
En effet, il nous semble qu'il y a de ta part une interprétation fausse de notre analyse. Lorsque nous écrivons que le nationalisme québécois peut s'avérer plus dangereux pour la classe ouvrière que le nationalisme anglophone, cela ne signifie nullement qu'on puisse considérer ce dernier comme une sorte de "moindre mal" ou qu'il soit moins odieux que le premier. En fait, c'est vrai que, dans la mesure où la population francophone subit de la part de l'État canadien une forme d'oppression nationale, les revendications indépendantistes peuvent se présenter comme une sorte de lutte contre l'oppression. Et c'est vrai que la lutte de classe du prolétariat est aussi une lutte contre l'oppression. Et c'est justement là que réside le plus grand danger.
Lorsque les ouvriers anglophones entrent dans la lutte, notamment face aux attaques portées contre la classe ouvrière par le gouvernement fédéral, il y a peu de chances que leur combat puisse se donner comme revendication le maintien de l'oppression nationale sur les ouvriers francophones puisque ce derniers sont aussi victimes de la politique de ce gouvernement. Même si les ouvriers anglophones n'ont pas de sympathie particulière pour les francophones en temps normal, il serait surprenant que lors d'un affrontement avec leur bourgeoisie, ils prennent pour boucs émissaires ces derniers. En effet, l'histoire nous montre que lorsque les ouvriers entrent dans la lutte (une lutte véritable s'entend et non des "actions" comme ont l'habitude de les organiser les syndicats dont la fonction est justement de saboter et dévoyer la combativité ouvrière), il existe une forte tendance chez eux à exprimer une forme de solidarité à l'égard des autres travailleurs avec qui ils ont un ennemi en commun.
Encore une fois, nous ne connaissons pas bien la situation au Canada, mais nous avons de multiples expériences de ce type en Europe. Par exemple, malgré tous les battages nationalistes dont sont la cible les ouvriers flamands et francophones en Belgique, malgré le fait que les partis politiques et les syndicats soient organisés sur un plan communautaire, nous avons constaté lors des luttes importantes dans ce pays qu'à cette occasion les ouvriers se souciaient bien peu de leur origine linguiste et géographique et qu'ils éprouvaient même une réelle satisfaction à se retrouver au coude à coude, alors qu'en "temps normal" on ne cesse de les opposer. Un autre exemple nous a été donné il y a juste un an dans un des pays où le nationalisme a pesé avec le plus de force, l'Irlande du Nord. En effet, c'est au coude à coude que les postiers catholiques et protestants de Belfast ont fait la grève en février 2006 et ont manifesté dans les quartiers protestants et catholiques contre leur ennemi commun (voir notre article https://fr.internationalism.org/ri367/greves.htm [30]).
Tu écris : "Il n'y aura JAMAIS d'unité de la classe ouvrière au Canada tant que durera l'oppression des minorités nationales et le racisme anglo-chauvin." Tu sembles dire, par conséquent, que le rejet par les ouvriers anglophones de leur propre chauvinisme constitue une sorte de préalable avant que puissent s'engager des combats unitaires contre la bourgeoisie canadienne. En fait, l'ensemble des expériences historiques dément un tel schéma : c'est au cours du développement des combats de classe, et non comme préalable, que les ouvriers sont amenés à dépasser les mystifications de tous ordres, y compris les mystifications nationalistes, utilisées par la bourgeoisie pour maintenir sa domination sur la société.
En fin de compte, si nous disons que le nationalisme québécois peut s'avérer plus dangereux que le nationalisme anglophone, c'est JUSTEMENT parce qu'il existe une forme d'oppression nationale des ouvriers francophones. Lorsque ces derniers engagent la lutte contre l'État fédéral, ils risquent d'être plus réceptifs aux discours qui présentent la lutte de classe et la lutte contre l'oppression nationale comme deux luttes complémentaires.
Il en est de cette question comme de la question de la démocratie et du fascisme. Ce sont deux formes de la domination de classe de la bourgeoisie, de la dictature de cette classe. La deuxième se distingue par une plus grande brutalité dans l'exercice de cette dictature mais cela ne veut pas dire que les communistes aient à choisir le "moindre mal" entre les deux. En fait, l'histoire de la révolution russe et allemande entre 1917 et 1923 nous enseigne que le plus grand danger pour la classe ouvrière était représenté non pas par les partis ouvertement réactionnaires ou "liberticides" mais par les "social-démocrates", ceux qui bénéficiaient de la plus grande confiance de la part des ouvriers.
Un dernier exemple à propos du danger du nationalisme des nations opprimées : celui de la Pologne.
L'indépendance de la Pologne contre l'oppression tsariste était une des revendications centrales des 1ère et 2e Internationales. Cependant, dès la fin du 19e siècle, Rosa Luxemburg et ses camarades polonais ont remis en cause cette revendication en indiquant, notamment, que la revendication par les socialistes de l'indépendance de la Pologne risquait d'affaiblir le prolétariat de ce pays. En 1905, le prolétariat de Pologne a été à l'avant-garde de la révolution contre le régime tsariste. Par contre, en 1917 et par la suite, il n'a pas poursuivi sur cette lancée. Au contraire : un des moyens les plus importants qu'a trouvé la bourgeoisie anglo-française pour paralyser et défaire le prolétariat polonais a été d'accorder l'indépendance de la Pologne. Les ouvriers de ce pays ont été alors emportés par un tourbillon nationaliste qui leur a fait tourner le dos à la révolution qui se déroulait de l'autre côté de leur frontière orientale et même à s'enrôler, pour certains, dans les troupes qui ont combattu cette révolution.
Finalement quel est le nationalisme qui s'est révélé le plus dangereux : l'odieux chauvinisme "grand-russien" que dénonçait Lénine, plein de mépris pour les polonais et autres nationalités mais qui a été dépassé par les ouvriers russes au moment de la révolution, ou bien le nationalisme des ouvriers de la nation opprimée par excellence, la Pologne ?
La réponse va de soi. Mais il faut ajouter que le fait que les ouvriers polonais aient majoritairement suivi les sirènes nationalistes après 1917 a eu des conséquences tragiques. Leur non participation à la révolution, leur hostilité même à son égard, ont empêché la révolution russe et la révolution allemande de se rejoindre géographiquement. Et si cette jonction avait pu se faire, il est probable que la révolution mondiale aurait pu l'emporter épargnant à l'humanité toute la barbarie du 20e siècle et qui se poursuit aujourd'hui.
Suite à ce courrier, notre lecteur nous écrivait :
"Concernant la question nationale, je peux comprendre que vous êtes opposés aux revendications nationalistes, mais je ne crois pas que ceci doit conduire à fermer les yeux sur l'oppression nationale. Par exemple dans les années 60 et 70 une des revendications principales des travailleurs québécois était le droit de travailler en français, car un grand nombre d'entreprises et de commerces surtout dans la région de Montréal fonctionnaient uniquement en anglais. De grands progrès ont été accomplis à ce niveau, mais il en reste encore à faire. Selon moi il est indispensable de soutenir ce genre de revendications démocratiques. Il ne faut pas dire aux travailleurs "attendez l'avènement du socialisme pour régler ça" même si le capitalisme est incapable, de par sa nature, de mettre fin à l'oppression nationale. (...)
... je ne pense pas que ce genre de revendications [démocratiques], tout en n'étant pas révolutionnaires, puissent nuire à l'unité du prolétariat. Bien au contraire ! Le droit de travailler dans sa langue, même s'il ne met pas fin à l'exploitation, est un droit indispensable pour les travailleurs. Dans les années 60, les travailleurs québécois n'avaient même pas le droit de s'adresser en français aux contremaîtres dans plusieurs entreprises de la région de Montréal. Certains restaurants de l'ouest de Montréal avaient des menus unilingues anglais et les grands commerces de ce secteur ne fonctionnaient qu'en anglais.
Comme j'ai mentionné dans mon message, la situation s'est beaucoup améliorée depuis ce temps, mais il y a encore du progrès à faire, surtout pour les petites entreprises de moins de 50 employés. Au niveau pancanadien le bilinguisme est loin d'être une réalité malgré les beaux discours officiels.
Concernant la question nationale québécoise, vous m'avez demandé pourquoi j'emploie le terme chauvinisme pour le nationalisme canadien-anglais et que je ne fais pas la même chose pour le nationalisme québécois. Généralement les organisations de gauche utilisent le mot chauvinisme pour désigner le nationalisme canadien-anglais, car c'est la nation dominante au sein de l'État canadien. Ça ne veut pas dire que le nationalisme québécois soit plus "progressiste" que sa contrepartie canadienne-anglaise. (...)
Le mouvement ouvrier canadien-anglais a déjà levé l'étendard de l'unité canadienne lors de la grève générale de 1972 au Québec. En effet le NPD (Nouveau Parti Démocratique) et le CTC (Congrès du Travail du Canada) ont dénoncé cette grève comme étant "séparatiste" et "nuisible pour l'unité canadienne" ! Selon moi une position internationaliste doit s'opposer résolument et sans compromis aux deux camps bourgeois et aux deux nationalismes (canadien-anglais et québécois). Même si aujourd'hui un mouvement de la classe ouvrière au Canada Anglais a peu de chances de se baser sur la défense de l'oppression des Québécois, le chauvinisme anglophone est encore bien présent partout au Canada et est nuisible à l'unité de la classe ouvrière. Toute défense de l'État canadien et de sa soi-disant "unité" est au moins aussi réactionnaire que la promotion de l'indépendance du Québec".
Aux différents courriers du camarade qui revenaient sur cette question des revendications contre l'oppression linguistique nous avons apporté une longue réponse :
Cher camarade,
Avec cette lettre, nous poursuivons avec toi la discussion sur la question nationale, et notamment sur la question québécoise.
En premier lieu, nous tenons à souligner que nous sommes absolument d'accord avec toi lorsque tu affirmes que :
"... il faut être clair que l'opposition au mouvement indépendantiste québécois n'a rien à voir avec la défense de l'État impérialiste canadien et qu'elle rejette complètement le nationalisme canadien. Le camp fédéraliste canadien ne mérite pas plus d'appui que le camp indépendantiste québécois."
Et aussi :
"... une position internationaliste doit s'opposer résolument et sans compromis aux deux camps bourgeois et aux deux nationalismes (canadien-anglais et québécois)"
Effectivement, l'internationalisme aujourd'hui signifie qu'on ne peut apporter son appui à AUCUN État national. Il faut préciser aujourd'hui car il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, au 19e siècle, il était tout à fait possible pour des internationalistes de soutenir non seulement certaines luttes d'indépendance nationale (classiquement, la lutte d'indépendance de la Pologne par exemple), mais également certains États nationaux. C'est ainsi que dans les différentes guerres qui ont affecté l'Europe au milieu du 19e siècle, Marx et Engels prenaient souvent parti pour l'un ou l'autre camp dans la mesure où ils considéraient que la victoire de telle nation ou la défaite de telle autre favorisait l'avancée de la bourgeoisie contre la réaction féodale (symbolisée par le tsarisme). De même, Marx, au nom du Conseil général de l'AIT, a envoyé au Président américain Lincoln, en décembre 1864, un message de félicitations pour sa réélection et de soutien à sa politique contre la tentative de sécession des États du Sud (dans ce cas, Marx et Engels se sont donc opposés, et avec la plus grande vigueur, à une revendication d'indépendance nationale !).
En fait, nous sommes là au cœur de la question des "revendications démocratiques" que tu soulèves :
"... dans les années 60 et 70 une des revendications principales des travailleurs québécois était le droit de travailler en français... Selon moi il est indispensable de soutenir ce genre de revendications démocratiques. Il ne faut pas dire aux travailleurs "attendez l'avènement du socialisme pour régler ça" même si le capitalisme est incapable, de part sa nature, de mettre fin à l'oppression nationale.
... je ne pense pas que ce genre de revendications, tout en n'étant pas révolutionnaires, puissent nuire à l'unité du prolétariat"
Les revendications démocratiques au 19e siècle
Pour pouvoir aborder correctement le cas spécifique des revendications d'ordre "linguistique" (et notamment celles de l'ostracisme des autorités canadiennes envers les locuteurs français), il est nécessaire de revenir sur la question générale des "revendications démocratiques".
La formule elle-même est significative :
- revendication : c'est une demande exprimée (y compris par le moyen de la violence) auprès d'une autorité qui est censée la satisfaire, de gré ou de force ; cela suppose donc que le pouvoir de décision n'appartient pas à ceux qui expriment la revendication, même s'ils peuvent évidemment "forcer la main" aux détenteurs de ce pouvoir grâce à un rapport de forces favorable (exemple : augmentation salariale ou retrait d'une mesure anti-ouvrière obtenue grâce à une mobilisation massive des travailleurs obligeant le patron à reculer, ce qui ne veut pas dire qu'il soit désormais privé de son pouvoir de décision dans l'entreprise).
- démocratie : étymologiquement "pouvoir du peuple" ; c'est Athènes qui a inventé la "démocratie" (très limitée d'ailleurs puisque les esclaves, les "métèques" et les femmes en étaient exclus) mais c'est la bourgeoisie qui lui a apporté ses "lettres de noblesse", si l'on peut dire.
En effet, l'ascension de la bourgeoisie dans la société s'accompagne du développement des différents attributs de la "démocratie". Ce n'est évidemment pas le fait du hasard mais correspond à la nécessité pour la classe bourgeoise d'abolir les privilèges politiques, économiques et sociaux de la noblesse. Pour cette dernière, et particulièrement pour son représentant suprême, le Roi, le pouvoir est d'essence divine. Elle n'a de compte à rendre, en principe, qu'au Tout Puissant, même si, en France, par exemple, se sont réunis 21 fois, entre 1302 et 1789, les états généraux, représentant la noblesse, le clergé et le "tiers état", pour donner leur avis sur des questions financières ou de mode de gouvernement. C'est justement lors de la dernière réunion des états généraux que ceux-ci, sous la pression des révoltes paysannes et urbaines et devant la faillite financière de la monarchie, enclenchent le processus de la révolution française (notamment en abolissant les privilèges de la noblesse et du clergé et en limitant les pouvoirs du Roi). Dès lors, à l'image de ce qu'avait fait la bourgeoisie anglaise un siècle et demi plus tôt, la bourgeoisie française va établir son pouvoir politique qui, d'ailleurs, n'est pas encore très "démocratique" (notamment si on pense au pouvoir autocratique de Napoléon 1er, pourtant héritier de la Révolution de 1789).
Le suffrage universel
Effectivement, si elle considère que la noblesse ne doit plus avoir voix au chapitre, la bourgeoisie ne conçoit la "démocratie" que pour son propre compte. Sa devise est "Liberté, Égalité, Fraternité" et elle proclame que "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits" (Déclaration des droits de l'homme). Cependant, bien que le suffrage universel fût inscrit dans la Constitution de 1793, celui-ci ne deviendra effectif en France que le 2 mars 1848, dans la foulée de la révolution de février. Et ce n'est que bien plus tard que le suffrage universel sera instauré dans les autres pays "avancés" : Allemagne : 1871, Pays-Bas : 1896, Autriche : 1906, Suède : 1909, Italie : 1912, Belgique : 1919 juste après... la très "démocratique" Angleterre en 1918. En fait, dans la plupart des pays d'Europe, c'est le suffrage censitaire qui constitue, au 19e siècle, la base de la démocratie bourgeoise : dans la mesure où seuls peuvent voter ceux qui payent un certain niveau d'impôt (dans certains cas, un impôt élevé donne même droit à plusieurs voix), les ouvriers et les autres pauvres, c'est-à-dire la grande masse de la population, sont exclus du processus électoral. C'est pour cela que le suffrage universel constitue une des revendications principales du mouvement ouvrier à cette époque. C'est notamment le cas en Angleterre où le premier mouvement de masse de la classe ouvrière mondiale, le Chartisme, s'est constitué autour de la question du suffrage universel. Si la bourgeoisie a fait opposition pendant de nombreuses années à ce dernier, c'est évidemment qu'elle craignait que les ouvriers n'utilisent les bulletins de vote pour contester son pouvoir au sein de l'État. Cette crainte était plus particulièrement portée par les secteurs les plus archaïques de la bourgeoisie, notamment ceux qui étaient restés proches de l'aristocratie (laquelle, dans certains pays, avait abandonné ses privilèges économiques, comme l'exemption de l'impôt, mais avait conservé des positions fortes au sein de l'État, notamment dans l'appareil militaire ou le corps diplomatique). C'est pour cela qu'à cette époque, on a pu assister à des alliances entre la classe ouvrière et certains secteurs de la bourgeoisie. Ce fut le cas notamment à Paris en février 1848 où la révolution reçut le soutien des ouvriers, des artisans, de la bourgeoisie "libérale" (exemple du poète Lamartine), et même des monarchistes "légitimistes" qui avaient vu dans le Roi Louis-Philippe un usurpateur. Cela dit, l'antagonisme de classe entre bourgeoisie et prolétariat allait rapidement apparaître au grand jour avec les "journées de juin" 1848 où, après le soulèvement des ouvriers contre la fermeture des ateliers nationaux, 1500 d'entre eux furent assassinés et 15 000 déportés en Algérie. En fait, c'est à partir de cette époque que certains secteurs de la bourgeoisie, les plus dynamiques, ont compris qu'ils pouvaient tirer parti du suffrage universel pour contrer les secteurs archaïques qui faisaient obstacle au progrès économique. D'ailleurs, durant la période suivante, la bourgeoisie française s'est accommodée d'un système politique qui combinait une forme d'autocratie (Napoléon III) avec le suffrage universel, grâce notamment au poids de la paysannerie réactionnaire. C'est en fait une assemblée élue au suffrage universel où dominent les élus des campagnes (les "ruraux") qui décide la répression de la Commune de Paris en 1871 et donne les pleins pouvoirs à Thiers pour diriger le massacre de 30 000 ouvriers au cours de la "semaine sanglante" de la fin mai.
Ainsi, deux décennies de suffrage universel en France ont fait la preuve que la classe dominante pouvait fort bien s'accommoder de ce mode d'organisation de ses institutions. Pourtant, dans toute la période qui suit, bien qu'ils mettent en garde contre le "crétinisme parlementaire" et que, tirant les leçons de la Commune, ils soulignent la nécessité de détruire l'État bourgeois, Marx et Engels, avec l'ensemble du mouvement ouvrier (à l'exception des anarchistes), continuent de considérer le suffrage universel comme une des revendications principales de la lutte du prolétariat.
A cette époque, malgré les dangers qu'il contenait, le soutien à cette "revendication démocratique" se justifiait totalement :
- permettre aux partis ouvriers, en présentant leurs propres candidats, de se distinguer clairement des partis bourgeois sur le terrain même des institutions bourgeoises ;
- faire des campagnes électorales des moments de la propagande pour les idées socialistes ;
- utiliser éventuellement l'action au sein du Parlement (discours, propositions de lois) comme une tribune pour cette même propagande ;
- apporter un soutien aux partis bourgeois progressistes contre les partis réactionnaires afin de favoriser les conditions politiques du développement du capitalisme moderne.
La liberté de la presse et d'association
En lien avec la revendication du suffrage universel, clé de voûte de la démocratie bourgeoise, la classe ouvrière revendiquait aussi d'autres droits tels que la liberté de la presse et la liberté d'association. En fait, ce sont là des revendications que la classe ouvrière mettait en avant en même temps que les secteurs progressistes de la bourgeoisie. Par exemple, le premier texte politique publié par Marx traite de la censure exercée par la monarchie prussienne (Remarques sur la récente réglementation de la censure prussienne, 1842). En tant que responsable de la Gazette Rhénane (1842-43) qui était encore d'inspiration bourgeoise radicale aussi bien qu'en tant que responsable de la Nouvelle Gazette Rhénane (1848-49) qui était d'inspiration communiste, il n'a pas cessé de vilipender la censure des autorités : c'est une sorte de résumé du fait qu'à cette époque il y avait une convergence à propos des revendications démocratiques entre le mouvement ouvrier et la bourgeoisie qui était encore une classe révolutionnaire devant se débarrasser des vestiges de l'ordre féodal.
Pour ce qui concerne la liberté d'association, on retrouve le même type de convergence entre les intérêts du prolétariat et ceux de la bourgeoisie progressiste. D'ailleurs, la liberté d'association, au même titre que la liberté de la presse évidemment, est une des conditions fondamentales du fonctionnement de la démocratie bourgeoise fondée sur le suffrage universel puisque les partis politiques sont un élément essentiel de ce mécanisme. Cela dit, ce qui s'applique au droit d'association sur le plan politique ne s'appliquait nullement sur le plan de l'organisation des ouvriers pour la défense de leurs intérêts économiques. Même la bourgeoisie la plus révolutionnaire qui fut, celle qui a conduit la révolution française de 1789, s'est opposée farouchement à ce droit malgré ses grands principes de "Liberté, Égalité, Fraternité". C'est ainsi que, par une loi organique du 14 juin 1791, les coalitions entre travailleurs étaient interdites en tant que "attentat contre la liberté et la Déclaration des Droits de l'Homme" et il a fallu attendre la révolution de 1848 pour que cette loi soit modifiée (avec toutefois des réserves puisque, dans la nouvelle formulation, étaient encore stigmatisées les "atteintes au libre exercice de l'industrie et de la liberté du travail"). Finalement, ce n'est qu'en 1884 que les syndicats ont pu se constituer librement. Quant à la "Patrie de la Liberté", la Grande-Bretagne, elle n'a reconnu légalement les "Trade Unions" qu'en juin 1871 (il faut dire que leurs dirigeants, et notamment ceux qui siégeaient au sein du Conseil Général de l'AIT, ont pris position contre la Commune de Paris).
Les revendications nationales
Les revendications nationales qui occupent une place très importante à partir du milieu du 19e siècle (et qui sont au cœur de la révolution de 1848 à travers l'Europe) font partie intégrante des "revendications démocratiques" dans la mesure, notamment, où il existe une convergence entre les anciens empires (l'empire russe et l'empire autrichien) et la domination de l'aristocratie. Une des raisons fondamentales de l'appui du mouvement ouvrier à certaines de ces revendications c'est qu'elles affaiblissent ces empires et donc la réaction féodale tout en ouvrant la voie à la constitution d'États-nations viables. A cette époque, le soutien à ces revendications nationales était d'ailleurs une question de tout premier plan pour la classe ouvrière. Une des meilleures illustrations en est que l'AIT a été constituée en 1864 à Londres par des ouvriers anglais et français lors d'un rassemblement de soutien à l'indépendance de la Pologne. Mais ce soutien du mouvement ouvrier ne s'applique pas à toutes les revendications nationales. Ainsi, Marx et Engels condamnent les revendications nationales des petits peuple slaves (Serbes, Croates, Slovènes, Tchèques, Moraves, Slovaques...) car elles ne peuvent conduire à la constitution d'un État national viable et qu'elles sont un obstacle aux progrès du capitalisme moderne en faisant le jeu de l'Empire russe et en entravant le développement de la bourgeoisie allemande (voir à ce propos l'article d'Engels de 1849 Le panslavisme démocratique,).
Les revendications démocratiques au 20e siècle
L'attitude de soutien du mouvement ouvrier aux revendications démocratiques se fondait essentiellement sur une situation historique où le capitalisme était encore progressif. Dans cette situation, certains secteurs de la bourgeoisie pouvaient encore agir de façon "révolutionnaire" ou "progressiste". Mais la situation change radicalement au début du 20e siècle et particulièrement avec la Première Guerre mondiale. Désormais, tous les secteurs de la bourgeoisie sont devenus réactionnaires puisque le capitalisme a achevé sa tâche historique fondamentale en soumettant l'ensemble de la planète à ses lois économiques et en développant à une échelle sans précédent les forces productives de la société (à commencer par la principale d'entre elles, la classe ouvrière). Ce système n'est plus une condition du progrès de l'humanité mais au contraire un obstacle à celui-ci. Nous sommes entrés, comme l'a dit l'Internationale communiste en 1919, dans "l'Ère des guerres et des révolutions". Et si on passe en revue les principales revendications démocratiques signalées plus haut, et qui ont été au centre des luttes ouvrières au cours du 19e siècle, on peut voir comment elles cessent de constituer un terrain pour la lutte du prolétariat.
Le suffrage universel
Le suffrage universel (qui pourtant n'a pas encore été accordé dans la totalité des pays développés, comme on l'a vu) devient un des moyens privilégiés utilisés par la bourgeoisie pour préserver sa domination. On peut prendre deux exemples qui concernent les deux pays où la révolution est allée le plus loin : la Russie et l'Allemagne.
En Russie, après la prise du pouvoir par les soviets en Octobre 1917, sont organisées des élections au suffrage universel pour une assemblée constituante (les bolcheviks en avaient fait une revendication avant octobre afin de démasquer le gouvernement provisoire et les partis bourgeois qui s'opposaient à l'élection d'une Constituante). Ces élections donnent une majorité aux partis, notamment aux socialistes-révolutionnaires, qui avaient constitué avec le Gouvernement provisoire le dernier rempart de l'ordre bourgeois. Cette Constituante soulève de grands espoirs dans les rangs de la bourgeoisie russe et internationale qui y voit le moyen de priver la classe ouvrière de sa victoire et de reprendre le pouvoir. C'est pour cette raison que, dès la première réunion de cette assemblée, le pouvoir soviétique la dissout.
Un an plus tard, en Allemagne, la guerre, comme en Russie, a accouché de la révolution. Début novembre, des conseils d'ouvriers et de soldats sont constitués dans tout le pays mais ils sont dominés (comme au début de la révolution russe) par les sociaux-démocrates majoritaires, ceux qui avaient participé à l'Union nationale dans la guerre impérialiste. Ces conseils remettent le pouvoir à un "Conseil des Commissaires du Peuple" entre les mains du SPD (mais où participent aussi des "indépendants" de l'USPD qui servent de caution aux véritables "patrons"). Tout de suite, le SPD en appelle à l'élection d'une assemblée constituante (prévue pour le 15 février 1919) :
"Qui veut le pain, doit vouloir la paix. Qui veut la paix, doit vouloir la Constituante, la représentation librement élue de l'ensemble du peuple allemand. Qui contrecarre la Constituante ou bien tergiverse, vous ôte la paix, la liberté et le pain, vous dérobe les fruits immédiats de la victoire de la révolution : c'est un contre-révolutionnaire." [Ainsi, les Spartakistes sont des "contre-révolutionnaires". Les staliniens n'ont rien inventé lorsque, plus tard, ils ont désigné ainsi ceux qui restaient fidèles à la révolution.]
"La socialisation aura lieu et devra avoir lieu (...) de par la volonté du peuple du travail qui, fondamentalement, veut abolir cette économie animée par l'aspiration des particuliers au profit. Mais cela sera mille fois plus facile à imposer si c'est la Constituante qui le décrète, que si c'est la dictature d'un quelconque comité révolutionnaire qui l'ordonne (...)." (Tract du SPD, voir notre série d'articles sur la révolution allemande dans la Revue Internationale)
C'est évidemment un moyen de désarmer la classe ouvrière et de l'entraîner sur un terrain qui n'est pas le sien, de vider de toute utilité les conseils ouvriers (qu'on présente comme une institution provisoire jusqu'à la prochaine Constituante) et d'empêcher que ces derniers ne connaissent une évolution semblable à celle des soviets en Russie où les révolutionnaires ont progressivement conquis la majorité en leur sein.
En même temps qu'ils font de grandes proclamations "démocratiques" pour endormir la classe ouvrière, les dirigeants socialistes planifient avec l'état major de l'armée le "nettoyage des bolcheviks", c'est-à-dire la répression sanglante contre les ouvriers insurgés et la liquidation des révolutionnaires. C'est ce qu'ils réalisent à la mi-janvier suite à une provocation qui pousse les ouvriers de Berlin dans une insurrection prématurée. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht (taxés de "contre-révolutionnaires" puisqu'ils dénonçaient par avance l'assemblée constituante) sont assassinés, en même temps que des centaines d'ouvriers, le 15 janvier. Le 19 janvier se tiennent des élections anticipées à l'Assemble constituante. C'est le triomphe du suffrage universel... contre la classe ouvrière.
La liberté de la presse
Concernant la liberté de la presse, elle a été, dans la plupart des pays d'Europe, progressivement conquise pour les journaux ouvriers à la fin de 19e siècle. En Allemagne, par exemple, les lois anti-socialistes qui entravaient la presse sociale-démocrate (qui est publiée en Suisse) sont levées en 1890. Cependant, si à la veille de la Première Guerre mondiale le mouvement ouvrier peut s'exprimer avec une liberté presque complète dans les pays les plus avancés, cette conquête est abolie du jour au lendemain dès le déclenchement de la guerre. La seule position qui peut librement s'exprimer dans les journaux est celle de soutien à l'Union nationale et à l'effort de guerre. Dans les pays qui participent à la guerre, c'est de façon illégale et clandestine, comme dans la Russie tsariste, que les révolutionnaires publient et diffusent leur presse. A tel point que la Russie d'après la révolution de février 1917 devient le pays "le plus libre du monde". Cette abolition soudaine de la liberté de la presse pour le mouvement ouvrier, cette remise en cause du jour au lendemain des acquis de décennies de luttes, prise en charge non par des secteurs archaïques de la classe dominante mais par la bourgeoisie la plus "avancée", est un des signes que nous sommes entrés dans une nouvelle période où, désormais, il ne peut exister le moindre intérêt commun entre le prolétariat et quelque secteur bourgeois que ce soit. Ce que révèle cette atteinte à la liberté d'expression des organisations ouvrières, ce n'est pas une plus grande force de la bourgeoisie mais au contraire une plus grande faiblesse, une faiblesse qui résulte du fait que la domination de la bourgeoisie sur la société n'est plus en adéquation avec les besoins historiques de celle-ci mais constitue, au contraire, l'antithèse criante et définitive de ces besoins.
Évidemment, après la Première Guerre mondiale, la liberté de la presse a été rétablie pour les organisations ouvrières dans les pays avancés. Mais cette liberté de la presse retrouvée n'était plus le résultat des combats de la classe ouvrière coïncidant avec les intérêts des secteurs les plus dynamiques de la bourgeoisie, comme cela avait été le cas au cours du 19e siècle. Bien au contraire, elle correspondait au fait que la bourgeoisie avait réussi à prendre le dessus sur le prolétariat au cours de la vague révolutionnaire des années 1917-23 ce qui la mettait en position de force face à ce dernier. Un des éléments majeurs de cette force de la bourgeoisie c'est qu'elle avait réussi à prendre le contrôle des anciennes organisations de la classe ouvrière, les partis socialistes et les syndicats. Ces organisations continuaient, évidemment, à se présenter comme les défenseurs de la classe ouvrière utilisant, pour cela, un langage "anticapitaliste" ce qui obligeait la classe dominante à "organiser" la liberté de la presse pour qu'elle permette le "débat démocratique". Il ne faut d'ailleurs pas oublier qu'au lendemain de la révolution russe, c'est au nom de la "démocratie" que la bourgeoisie a établi un cordon sanitaire autour de celle-ci accusée d'être "liberticide". Cependant, on a pu voir rapidement que cet amour des "libertés démocratiques" pouvait parfaitement être mis entre parenthèses par la bourgeoisie, non pas par ses secteurs les plus archaïques mais bien par ses secteurs les plus modernes. C'est ce qui est arrivé avec la montée du fascisme au début des années 20 en Italie et au début des années 30 en Allemagne. En effet, contrairement à ce que pensait l'Internationale communiste, critiquée en cela par la Gauche communiste italienne, le fascisme ne représentait nullement une sorte de "réaction féodale" (même si certains aristocrates amoureux de "l'ordre" ont pu le soutenir). Au contraire, c'était une orientation politique soutenue par les secteurs les plus modernes de la bourgeoisie qui y voyaient le moyen d'impulser la politique impérialiste du pays. Cela s'est d'ailleurs parfaitement confirmé dans le cas de l'Allemagne où Hitler, avant même son accession au pouvoir, a reçu un soutien massif des secteurs dominants et les plus modernes de l'industrie, particulièrement la sidérurgie (Krupp, Thyssen) et la chimie (BASF).
La liberté d'association
Pour ce qui concerne la question de la "liberté d'association", elle est évidemment en lien avec celle de la "liberté de la presse" et du suffrage universel. Dans la plupart des pays avancés, les organisations de la classe ouvrière ont droit de cité. Mais il faut insister encore une fois sur le fait que cette "liberté" est la contrepartie de l'intégration dans l'appareil d'État des anciens partis ouvriers[2]. D'ailleurs, après la Première Guerre mondiale, suite à la démonstration de l'efficacité de l'action de ces partis contre la classe ouvrière, la bourgeoisie leur fait de plus en plus confiance et leur confie le pouvoir dans plusieurs pays d'Europe au cours des années 30 dans le cadre des politiques de "Front populaire". Elle s'appuie d'ailleurs non seulement sur les partis socialistes mais également sur les partis "communistes" qui ont à leur tour trahi le prolétariat. Ces derniers joueront d'ailleurs le rôle de fer de lance de la contre-révolution, notamment en Espagne où ils se distingueront dans l'assassinat des ouvriers les plus combatifs. Mais dans plusieurs autres pays d'Europe, ils sont les sergents recruteurs de la Seconde Guerre mondiale et les principaux protagonistes de la "Résistance", particulièrement en France et en Italie. Il faut d'ailleurs noter que la défense des idées internationalistes et révolutionnaires est devenue particulièrement difficile au cours de cette période. C'est ainsi que Trotsky se voit interdire l'asile politique dans la plupart des pays du monde (qui devient pour lui une "planète sans visa" comme il l'écrit dans son autobiographie), qu'il est soumis, en même temps que ses camarades, à une surveillance et des persécutions policières permanentes. Les difficultés pour les révolutionnaires seront encore plus grandes à la fin de la Seconde Guerre mondiale où ceux qui sont restés fidèles aux principes internationalistes seront traités, en premier lieu par les staliniens, de "collabos", persécutés et même assassinés pour certains d'entre eux (comme en Italie).
Concernant la liberté d'association, il faut faire une mention spéciale à propos des syndicats. Eux aussi ont bénéficié, après la Première Guerre mondiale, d'une sollicitude toute particulière de la part de la bourgeoisie. Au cours des années 30, ils participent à leur place dans le sabotage des luttes et surtout à la canalisation du mécontentement ouvrier vers le soutien des partis bourgeois les plus en pointe dans la préparation de la guerre impérialiste (soutien à Roosevelt aux États-Unis, soutien en Europe aux "fronts populaires" pourvoyeurs en chair à canon au nom de "l'antifascisme"). Il faut d'ailleurs noter qu'il n'y a pas que les secteurs "démocratiques" de la bourgeoisie qui s'appuient sur les syndicats, le fascisme lui-même fait appel à eux ayant compris la nécessité d'un encadrement "à la base" de la classe ouvrière. Évidemment, dans les régimes fascistes, comme dans les régimes staliniens, le rôle d'organes de l'État et d'auxiliaires de la police des syndicats est beaucoup plus clair que dans les régimes démocratiques. Cela dit, même dans ces derniers, c'est de façon ouverte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que les syndicats se présentent comme les meilleurs défenseurs de l'économie nationale et font la police dans les entreprises pour inciter les ouvriers aux sacrifices au nom de la reconstruction.
Le "droit" de participer aux élections pour lequel se sont battus les travailleurs au 19e siècle est devenu, au cours du 20e siècle le "devoir électoral" orchestré à grands renforts médiatiques par la bourgeoisie (quand le vote ne devient pas obligatoire sous peine de sanctions, comme en Belgique). De la même façon, le "droit" à se syndiquer pour lequel ils se sont battus à la même période est devenu "l'obligation" de se syndiquer (puisque dans certains secteurs l'appartenance au syndicat est indispensable pour trouver un travail) ou de s'en remettre au syndicat pour la mise en avant des revendications ou pour se mettre en grève.
Les revendications nationales
Une des grandes forces de la bourgeoisie au cours du 20e siècle, et qui s'est affirmée clairement dès la Première Guerre mondiale, est d'avoir réussi à retourner contre la classe ouvrière les "acquis" démocratiques pour lesquelles cette dernière s'était battue farouchement, quelquefois en versant son sang, au cours du siècle précédent.
Et cela est particulièrement valable pour cette "revendication démocratique" particulière que constituait l'autodétermination nationale ou la défense des minorités nationales opprimées. On a vu plus haut que cette revendication n'avait rien de prolétarien en soi mais qu'elle pouvait, et devait, être soutenue (bien que de façon sélective) par la classe ouvrière et son avant-garde. Contrairement à ce qui advenu avec les syndicats, les revendications "nationales" n'ont pas acquis leur caractère bourgeois avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence. Elles étaient bourgeoises dès l'origine. Mais du fait que la bourgeoisie a cessé d'être une classe révolutionnaire ou même progressiste, ces revendications ont acquis un caractère totalement réactionnaire et contre-révolutionnaire et sont devenues un poison pour le prolétariat.
Les exemples ne manquent pas. Ainsi, un des thèmes majeurs invoqués par les bourgeoisies européennes pour justifier la guerre impérialiste a été la défense des nationalités opprimées. Et comme la guerre opposait des empires qui, nécessairement, opprimaient des peuples divers, les "arguments" ne manquaient pas : Alsace et Lorraine sous la coupe, contre le gré de leur population, de l'Empire allemand ; slaves du Sud dominés par l'Empire autrichien, peuples des Balkans opprimés par l'Empire Ottoman, Pays baltes et Finlande (sans compter des dizaines de nationalités dans le Caucase ou en Asie centrale) enfermés dans la "prison des peuples" (comme on désignait l'empire tsariste), etc. A cette liste de peuples opprimés par les principaux protagonistes de la guerre mondiale, il faut évidemment ajouter la multitude des populations colonisées d'Afrique, d'Asie et d'Océanie
De même, on a déjà vu dans notre courrier précédent comment l'indépendance de la Pologne constitua une arme de guerre décisive contre la révolution mondiale à la suite de la guerre mondiale. On peut ajouter que le mot d'ordre de "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" ne trouva pas de meilleur défenseur à cette époque que le président américain Woodrow Wilson. Si la bourgeoisie qui venait de prendre la première place mondiale manifestait une telle sollicitude envers les peuples opprimés ce n'est évidemment pas par "humanisme" (quels qu'aient pu être les sentiments personnels de Wilson) mais bien parce qu'elle y trouvait un intérêt. Et ce n'est pas difficile à comprendre : la plus grande partie du monde étant encore sous la domination coloniale des puissances européennes qui avaient gagné la guerre (ou qui s'en étaient tenues à l'écart comme les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal), une décolonisation de ces contrées ouvrait la voie de leur prise de contrôle (avec des moyens moins voyants que la simple administration coloniale) par l'impérialisme américain qui était singulièrement dépourvu de colonies.
Dernier point là-dessus : alors que l'émancipation nationale du 19e siècle était associée aux conquêtes démocratiques contre les empires féodaux, les nations européennes qui obtiennent leur "indépendance" au lendemain de la Première Guerre mondiale sont, pour la plupart dirigées par des dictatures de type fasciste. C'est notamment le cas de la Pologne (avec le régime de Pilsudski) mais également des trois pays baltes et de la Hongrie.
La Seconde Guerre mondiale, de même que sa préparation, n'échappent pas à l'utilisation des revendications nationales. Ainsi, par exemple, c'est au nom des "droits" de la minorité allemande des Sudètes que le régime nazi s'empare d'une partie de la Tchécoslovaquie en 1938 (accords de Munich). De même, c'est au nom de l'indépendance de la Croatie que les armées nazies envahissent la Yougoslavie en 1941, opération qui reçoit le soutien de la Hongrie venue au secours des "droits nationaux" de la minorité hongroise de Voïvodine.
En fait, ce qui s'est passé dans le monde depuis la Première Guerre mondiale confirme totalement l'analyse faite par Rosa Luxemburg dès la fin du 19e siècle : la revendication de l'indépendance nationale avait cessé de jouer le rôle progressiste qu'elle avait, dans un certain nombre de cas, joué auparavant. Non seulement elle était devenue une revendication particulièrement néfaste pour la classe ouvrière mais elle s'intégrait efficacement dans les visées impérialistes des différents États en même temps qu'elle servait souvent de drapeau aux cliques les plus réactionnaires et xénophobes de la classe dominante.
"Droits démocratiques" et lutte du prolétariat aujourd'hui
Pour ce qui est de la situation d'aujourd'hui, il est clair que le prolétariat doit se défendre contre toutes les attaques qu'il subit au sein du capitalisme et que ce n'est pas le rôle des révolutionnaires de dire aux ouvriers : "laissez-là vos luttes, elles ne servent à rien, ne pensez qu'à la révolution". De même, les luttes ouvrières ne peuvent se limiter au seul plan des intérêts économiques. Par exemple, la mobilisation pour défendre des travailleurs victimes de la répression ou de discriminations racistes ou xénophobes fait partie intégrante de la solidarité de classe qui est au cœur de l'être même du prolétariat combattant.
Cela dit, faut-il en conclure que la classe ouvrière peut encore aujourd'hui appuyer des "revendications démocratiques" ?
On a vu ce que sont devenus les "droits démocratiques" conquis par les luttes ouvrières du 19e siècle :
- Le suffrage universel constitue un des moyens majeurs pour masquer la dictature du capital derrière le paravent de l'idée que le "peuple est souverain" ; c'est un des instruments de choix pour canaliser et stériliser le mécontentement et les espoirs de la classe ouvrière.
- La "liberté de la presse" s'accommode parfaitement du contrôle totalitaire de l'information à travers les grands médias aux ordres, chargés de dispenser les vérités officielles. En "Démocratie", il peut y en avoir plusieurs mais elles convergent toutes autour de l'idée qu'il n'y a pas d'autre système possible que le capitalisme sous l'une ou l'autre de ses variantes. Et quand c'est nécessaire, la "liberté de la presse" est mise officiellement en veilleuse au nom des contraintes de la guerre (comme ce fut le cas lors des guerres du Golfe de 1991 et 2003).
- La "liberté d'association" (au même titre que la liberté de la presse) n'est tolérée, y compris dans les plus grandes démocraties, que pour autant qu'elle ne puisse pas porter atteinte au pouvoir bourgeois et à ses objectifs impérialistes. Les exemples ne manquent pas de violations flagrantes de cette liberté. Pour ne citer que le champion mondial de la "démocratie" et la "patrie des droits de l'homme" nous avons aux États-Unis les persécutions des sympathisants de la gauche lors du Maccarthisme et, en France, la dissolution des groupes d'extrême gauche et l'arrestation de leurs dirigeants après l'immense grève de mai 68 (sans oublier les persécutions et même les assassinats des opposants à la guerre d'Algérie au cours des années 50). Depuis sa formation en 1975, notre propre organisation elle-même, malgré sa très petite taille et sa très faible influence, n'a pas été épargnée : perquisitions, filatures, intimidations des militants...
- Quant au "droit syndical", nous avons vu que c'est le moyen le plus efficace pour l'État capitaliste d'exercer son contrôle "à la base" sur les exploités et de saboter leurs luttes. Il vaut d'ailleurs la peine, à ce sujet, d'évoquer ce qui advenu en Pologne en 1980-81. En août 80, les ouvriers, sans organisation syndicale préalable (les syndicats officiels étant complètement discrédités), organisés en assemblées générales et comités de grève, sont capables d'empêcher l'État stalinien de les réprimer (comme cela avait été le cas en 1970 et 1976) et réussissent à le faire reculer. Leur première revendication[3], la constitution d'un syndicat "indépendant", ouvre la voie à la formation de "Solidarnosc". Dans les mois qui suivent, les dirigeants de celui-ci, ceux-là même qui peu auparavant étaient encore emprisonnés ou victimes de toutes sortes de persécutions, se mobilisent dans tout le pays pour faire arrêter de nombreuses grèves si bien que, peu à peu, la classe ouvrière se démobilise. C'est lorsque ce travail est terminé que l'État stalinien peut reprendre les choses en main en instaurant l'état de guerre, le 13 décembre 1981. La répression est particulièrement brutale (des dizaines de morts, 10 000 arrestations) et les poches de résistance des ouvriers sont isolées. En août 1980, le gouvernement n'aurait jamais pu exercer une telle répression sans provoquer un embrasement généralisé : 15 mois de travail de Solidarnosc l'a permise...
En fait, les "droits démocratiques", et plus généralement les "droits de l'homme", sont devenus aujourd'hui le thème majeur des campagnes politiques de la plupart des secteurs de la bourgeoisie.
C'est au nom de la défense de ces "droits" que le bloc occidental a mené la guerre froide pendant plus de 40 ans contre le bloc russe. C'est toujours pour la défense des "droits démocratiques" contre la "barbarie du terrorisme et du fondamentalisme musulman" ou "la dictature de Saddam Hussein" que le gouvernement américain s'est lancé dans les guerres dévastatrices du Moyen-Orient. Nous passons sur de nombreux autres exemples, mais il vaut aussi la peine de rappeler que la défense de la "démocratie", avant qu'elle ne soit le drapeau de l'impérialisme américain et de ses alliés après 1947, leur avait déjà servi de thème de mobilisation pour l'embrigadement des ouvriers comme chair à canon dans le plus grand massacre de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. A ce propos, il est intéressant de relever que, tant qu'il était leur allié contre l'Allemagne, le régime stalinien, qui pourtant valait bien les régimes fascistes en termes de terreur policière et de massacres de populations (et qui les avait précédés dans ce domaine) ne provoquait pas beaucoup d'objections de la part des gouvernements occidentaux croisés de la "démocratie".
Pour ce qui concerne les partis de gauche, c'est-à-dire les partis bourgeois qui ont le plus d'impact sur la classe ouvrière, la revendication des "droits démocratiques" est, en règle générale, un excellent moyen de noyer les revendications de classe des ouvriers et de faire obstacle à l'identité de classe du prolétariat. En fait, il en est des "revendications démocratiques" comme du pacifisme : face à la guerre, on assiste régulièrement à des mobilisations orchestrées par toutes sortes de secteurs politiques allant de l'extrême gauche à certains éléments de la droite et chauvins estimant que telle ou telle guerre n'est pas opportune pour les "intérêts de la nation" (c'est assez fréquent aujourd'hui en France où même la droite est majoritairement contre la politique américaine). Derrière la banderole "Non à la guerre", les ouvriers, et surtout leurs intérêts de classe, sont complètement noyés au milieu d'une marée de bonne conscience pacifique et démocratique (quand ce n'est pas de chauvinisme : il n'est pas rare de voir dans les manifestations contre la guerre au Moyen-Orient des musulmans barbus en costume traditionnel et des femmes voilées).
La position des révolutionnaires face au pacifisme a toujours été, depuis la Première Guerre mondiale, de combattre résolument les illusions petites-bourgeoises qu'il véhiculait. Les révolutionnaires ont toujours été au premier rang pour dénoncer la guerre impérialiste mais cette dénonciation ne s'est jamais basée sur des considérations simplement morales. Ils ont mis en évidence que c'est le capitalisme comme un tout qui est responsable des guerres, qu'elles sont inévitables tant que survivra ce système et que la seule force de la société en mesure de lutter réellement contre la guerre était la classe ouvrière qui devait préserver son indépendance de classe face à tous les discours pacifistes, humanistes et démocratiques.
Les revendications "démocratiques" concernant le droit d'utiliser sa langue maternelle
Une première chose qu'il faut dire, c'est que le mouvement ouvrier n'a jamais considéré comme "progressiste" ou "démocratique" la persistance des langues autochtones et donc les revendications en faveur d'une telle persistance. En fait, une des caractéristiques de la bourgeoisie révolutionnaire a été de réaliser l'unification de nations viables ce qui passait par le dépassement des particularismes provinciaux et locaux liés à la période féodale. L'imposition d'une langue nationale unique a constitué, dans bien des cas, un des instruments de cette unification nationale (au même titre que l'unification des systèmes de poids et mesures, par exemple). Cette unification de la langue s'est faite la plupart du temps par la force, la répression, voire par des bains de sang : en fait, les méthodes classiques avec lesquelles le capitalisme a étendu son emprise sur le monde. Tout au long de leur vie, Marx et Engels ont évidemment dénoncé les méthodes barbares avec lesquelles le capitalisme avait établi son hégémonie sur la planète, que ce soit lors de son accumulation primitive (voir à ce sujet les pages admirables de la dernière section du livre I du Capital traitant de l'accumulation primitive)[4] ou lors des conquêtes coloniales. En même temps, ils ont toujours expliqué que, malgré sa barbarie, la bourgeoisie s'était faite l'agent inconscient du progrès historique en créant un marché mondial, en libérant le développement des forces productives de la société, en généralisant le travail associé en même temps que le salariat, bref en préparant les conditions matérielles de l'avènement du socialisme.[5]
Beaucoup plus encore que tous les autres systèmes sociaux réunis, le capitalisme a semé autour de lui la destruction des civilisations et des cultures, et donc des langues. Il ne sert à rien de le déplorer ou de vouloir revenir en arrière : c'est un fait historique accompli et irréversible. On ne peut faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. C'est comme si l'on voulait revenir à l'artisanat ou à la petite exploitation agricole autosuffisante du Moyen-Âge.[6]
Cette marche irrésistible du capitalisme a sélectionné un certain nombre de langues dominantes, non pas sur la base d'une quelconque supériorité linguistique, mais tout simplement sur la base d'une supériorité militaire et économique des peuples et des États qui les utilisaient. Certaines de ces langues nationales sont devenues des langues internationales, parlées par les habitants de plusieurs pays. Elles ne sont pas très nombreuses dans ce cas : aujourd'hui, il ne reste essentiellement que l'Anglais, l'Espagnol, le Français[7] et l'Allemand. Concernant cette dernière langue, qui pourtant est d'une grande richesse et d'une grande rigueur, et qui a été le support initial d'ouvrages fondamentaux de la culture mondiale (les œuvres philosophiques de Kant, Fichte, Hegel, etc. ; les œuvres de Freud, la théorie de la relativité d'Einstein et... les œuvres de Marx) elle n'est utilisée qu'en Europe et son avenir est derrière elle.
En fait, comme véritables langues internationales utilisées en tant que langue principale par plus d'une centaine de millions de locuteurs, il n'y a que l'espagnol et, évidemment, l'anglais. Cette dernière langue est aujourd'hui la véritable langue internationale. C'est la conséquence inévitable du fait que les deux nations qui ont successivement dominé le capitalisme étaient l'Angleterre puis les États-Unis. Quiconque aujourd'hui ne connaît pas l'anglais se trouve handicapé tant pour voyager que pour naviguer sur Internet, de même que pour faire des études scientifiques sérieuses, notamment dans les domaines les plus en pointe comme l'informatique. Ce qui n'est évidemment pas le cas du français (qui était pourtant, par le passé, la langue internationale des cours européennes et de la diplomatie, ce qui ne concernait finalement que bien peu de monde).
C'est pour cela, pour en revenir à une remarque que tu fais dans tes messages, que même s'il était promu de façon active par l'État fédéral canadien, le bilinguisme ne serait jamais une réalité au Canada. On a aujourd'hui un exemple édifiant dans le cas de la Belgique. Historiquement, ce pays a été dominé par la bourgeoisie francophone. A Anvers ou à Gand, les ouvriers flamands avaient souvent affaire à un patron qui parlait français. Cela avait d'ailleurs provoqué parmi beaucoup d'entre eux le sentiment qu'en refusant de parler français, ils résistaient à leur patron et à la bourgeoisie. Néanmoins, s'il n'a jamais existé de façon intégrale pour l'une ou l'autre des communautés, le bilinguisme était beaucoup plus répandu parmi les flamands que parmi les wallons francophones. Depuis plusieurs décennies, la Wallonie, berceau de la grande industrie en Belgique, est en perte de vitesse sur le plan économique par rapport à la Flandre. Un des thèmes des nationalistes flamands actuels est que cette région, avec son taux de chômage plus élevé et ses industries vieillies, est un fardeau pour la Flandre. Aux ouvriers flamands on essaye de raconter qu'ils doivent travailler et payer des impôts pour subvenir aux besoins des ouvriers wallons : c'est une des thématiques du parti d'extrême droite indépendantiste Vlaams Belang.
Le fait que les ouvriers flamands d'aujourd'hui aient de plus en plus l'occasion de parler flamand avec leur patron ne change évidemment pas leur condition d'exploités. Cela dit, la population de la Flandre est de plus en plus bilingue mais la deuxième langue qui se développe n'est pas le français, qui permettrait une meilleure communication avec les populations francophones du pays, mais l'anglais. C'est d'ailleurs aussi le cas pour ce qui concerne les populations francophones. Et le fait que, dans leurs discours, le Roi et le chef du gouvernement s'expriment, de façon très équitable, en français et en flamand n'y change rien.
On peut prendre un autre exemple, celui du catalan.
La Catalogne est, historiquement, la principale région industrielle d'Espagne et la plus avancée sur beaucoup de plans comme le niveau de vie, le niveau culturel et d'éducation. La classe ouvrière de Catalogne a représenté, depuis le 19e siècle, le secteur le plus combatif et conscient du prolétariat d'Espagne. Dans cette région, la question des revendications linguistiques s'est posée aussi depuis longtemps puisque la langue officielle de toutes les régions d'Espagne était le castillan alors que la langue courante, celle qu'on parle en famille, avec ses amis comme dans la rue, est le catalan. Cette question a évidemment été soulevée au sein du mouvement ouvrier. D'ailleurs, parmi les anarcho-syndicalistes qui ont dominé ce dernier pendant longtemps, c'était souvent une question qui fâchait puisque certains, au nom du "fédéralisme" cher aux anarchistes, préconisaient la prééminence du catalan dans la presse ouvrière alors que d'autres faisaient valoir, avec raison, que si le patron de l'entreprise était catalan, beaucoup d'ouvriers ne l'étaient pas et parlaient le castillan (langue qui était aussi parlée par les ouvriers catalans). L'emploi du catalan était un excellent moyen pour le patron pour diviser les ouvriers.
Pendant la période franquiste, où le catalan n'avait pas droit de cité ni dans les médias, ni à l'école, ni encore moins dans les administrations, son usage est apparu pour une grande partie de la population de Catalogne comme une forme de résistance contre la dictature. Loin d'affaiblir l'utilisation du catalan, la politique de Franco a réussi fondamentalement le contraire à tel point que les immigrés des autres régions apprenaient cette langue, tant pour se faire accepter par les autochtones[8] que pour participer, eux aussi, à cette "résistance".
Avec la fin du franquisme et l'instauration de la "démocratie" en Espagne, le mouvement autonomiste a pu s'épanouir. Les régions, et particulièrement la région catalane, ont obtenu des prérogatives qu'elles avaient perdues dans le passé. Une de ces prérogatives est de faire du catalan la langue officielle de la région, c'est-à-dire que les administrations ne doivent plus fonctionner qu'en catalan et que cette langue est enseignée de façon exclusive pour les petites classes des écoles, le castillan ne figurant au programme que comme langue "étrangère".
Parallèlement, dans les universités de Catalogne, de plus en plus de cours ont lieu en catalan ce qui, évidemment, pénalise les étudiants provenant d'autres régions ou de l'étranger (qui, s'ils apprennent dans leurs études l'espagnol, langue internationale, n'ont pas l'idée d'apprendre une langue régionale). Résultat : alors que la qualité des enseignements des universités catalanes est réputée, et particulièrement celle de Barcelone, et que de ce fait elles attiraient les meilleurs étudiants espagnols, européens ou sud-américains, ces derniers tendent de plus en plus à choisir les universités où ils ne risquent pas de buter sur une langue qu'ils ne connaissent pas. L'ouverture sur l'Europe et le monde dont s'enorgueillit la Catalogne ne peut que souffrir de l'hégémonie croissante du catalan et dans la concurrence ancestrale entre Barcelone et Madrid, cette dernière ville risque de prendre un avantage décisif non, comme au temps du franquisme, à cause d'une centralisation forcée, mais au contraire du fait des "conquêtes démocratiques" de la Catalogne. Cela dit, si la bourgeoisie et la petite bourgeoisie catalanes sont en train de mener une politique qui revient à se tirer une balle dans le pied, cela ne consterne pas particulièrement les révolutionnaires internationalistes. En revanche, la scolarisation en catalan a des conséquences beaucoup plus graves. Les nouvelles générations de prolétaires de Catalogne auront plus de difficultés qu'auparavant à communiquer avec leurs frères de classe du reste du pays et ils n'auront plus l'aisance de leurs parents dans cette langue internationale qu'est l'espagnol, même s'ils maîtrisent beaucoup mieux qu'eux la grammaire catalane.
Pour en revenir aux brimades linguistiques qui existaient au Québec par le passé et que tu signales dans tes messages (et qui ressemblent un peu à ce qui existait en Flandre auparavant au détriment des ouvriers flamands), elles sont typiques des comportements de toutes les bourgeoisies et constituent un moyen supplémentaire d'affirmer leur force par rapport aux ouvriers à qui il s'agit de faire comprendre "qui est le maître". En même temps, c'est un excellent moyen de diviser les ouvriers entre ceux qui parlent la langue du patron (à qui on veut faire croire qu'ils sont "privilégiés") et ceux qui ne la parlent pas ou mal. C'est enfin un moyen de canaliser le mécontentement des ouvriers contre leur exploitation vers un terrain qui n'est pas celui de la classe ouvrière et qui ne peut que saper l'unité de classe. Même si tous les bourgeois ne sont pas assez intelligents pour faire ce calcul machiavélique, l'existence de situations où, en plus de l'exploitation classique, les ouvriers doivent subir des brimades supplémentaires, est un excellent moyen de se ménager une soupape lorsque la pression sociale devient trop forte. Les bourgeois, même s'ils sont stupides et aveuglés par le chauvinisme, ont la faculté de comprendre où sont leurs véritables intérêts. Plutôt que de céder sur des questions essentielles, tant pour les ouvriers que pour les profits capitalistes, comme le niveau des salaires ou les conditions de travail, les bourgeois sont prêts à "céder" sur ce qui "ne coûte rien", notamment la question linguistique. En cela, ils seront aidés par les forces politiques, et notamment par celles de gauche et d'extrême gauche, qui ont inscrit dans leur programme les revendications linguistiques et qui présenteront la satisfaction de ces revendications comme une "victoire", même si les autres n'ont pas été satisfaites (surtout si ces revendications sont considérées comme "principales", comme tu le signales dans ton message du 18 février). En réalité, si au cours des dernières décennies, les situations de brimade linguistique pour les ouvriers ont tendu à reculer au Québec, ce n'est pas seulement une conséquence des politiques des partis nationalistes. C'est aussi une conséquence des luttes ouvrières qui se sont développées partout dans le monde, et aussi au Canada, à partir de la fin des années 60.
Face à une situation de ce type, quel doit être le discours des révolutionnaires ? Eh bien de dire la vérité aux ouvriers, de leur dire ce qui vient d'être présenté ci-dessus. Ils doivent encourager les luttes des ouvriers pour la défense de leurs conditions d'existence et, en cela, ils ne se contentent pas de parler de la révolution qui abolira toute forme d'oppression. Mais leur rôle est aussi de mettre en garde les ouvriers contre tous les pièges qui leur sont tendus, toutes les manœuvres qui visent à saper la solidarité de l'ensemble de la classe ouvrière et ils ne doivent pas avoir peur de critiquer des revendications lorsqu'ils estiment qu'elles ne vont pas dans ce sens.[9] Sinon, ils ne jouent pas leur rôle en tant que révolutionnaires :
"1. Dans les différentes luttes nationales des prolétaires, ils mettent en avant et font valoir les intérêts indépendants de la nationalité et communs à tout le prolétariat.
2. Dans les différentes phases que traverse la lutte entre prolétaires et bourgeois, ils représentent toujours les intérêts du mouvement dans sa totalité." (Manifeste Communiste)
Dans l'attente de tes commentaires sur cette lettre, reçois, cher camarade, nos meilleures salutations communistes.
Pour le CCI,
[1] Avec une différence de taille cependant : l'oppression que faisait subir le régime tsariste aux différentes nationalités de l'empire russe est sans commune mesure avec l'attitude du gouvernement d'Ottawa vis-à-vis des différentes nationalités du Canada.
[2] Dans un de tes messages tu écris que : "Le mouvement ouvrier canadien-anglais a déjà levé l'étendard de l'unité canadienne lors de la grève générale de 1972 au Québec. En effet le NPD (Nouveau Parti Démocratique) et le CTC (Congrès du Travail du Canada) ont dénoncé cette grève comme étant 'séparatiste' et 'nuisible pour l'unité canadienne' !". En fait, ce n'est pas "le mouvement ouvrier canadien-anglais" qui a adopté cette attitude mais les partis bourgeois à langage ouvrier et les syndicats au service du capital.
[3] En fait, dans un premier temps, cette revendication ne figurait pas en première position, les revendications économiques et touchant à la répression se trouvaient devant. Mais ce sont les "experts" politiques du mouvement, issus de la "mouvance démocratique" (Kuron, Modzelewski, Michnik, Geremek...), qui ont insisté pour qu'elle se trouve à cette place.
[4] "Ce régime industriel de petits producteurs indépendants, travaillant à leur compte, présuppose le morcellement du sol et l'éparpillement des autres moyens de production. Comme il en exclut la concentration, il exclut aussi la coopération sur une grande échelle, la subdivision de la besogne dans l'atelier et aux champs, le machinisme, la domination savante de l'homme sur la nature, le libre développement des puissances sociales du travail, le concert et l'unité dans les fins, les moyens et les efforts de l'activité collective. Il n'est compatible qu'avec un état de la production et de la société étroitement borné. L'éterniser, ce serait, comme le dit pertinemment Pecqueur, 'décréter la médiocrité en tout'. Mais, arrivé à un certain degré, il engendre de lui-même les agents matériels de sa dissolution. A partir de ce moment, des forces et des passions qu'il comprime commencent à s'agiter au sein de la société. Il doit être, il est anéanti. Son mouvement d'élimination transformant les moyens de production individuels et épars en moyens de production socialement concentrés, faisant de la propriété naine du grand nombre la propriété colossale de quelques-uns, cette douloureuse, cette épouvantable expropriation du peuple travailleur, voilà les origines, voilà la genèse du capital. Elle embrasse toute une série de procédés violents, dont nous n'avons passé en revue que les plus marquants sous le titre de méthodes d'accumulation primitive." (Chapitre XXXII : Tendance historique de l'accumulation capitaliste)
"Dans le même temps que l'industrie cotonnière introduisait en Angleterre l'esclavage des enfants, aux États-Unis elle transformait le traitement plus ou moins patriarcal des noirs en un système d'exploitation mercantile. En somme, il fallait pour piédestal à l'esclavage dissimulé des salariés en Europe, l'esclavage sans phrase dans le nouveau monde.
Tantœ molis erat ! Voilà de quel prix nous avons payé nos conquêtes ; voilà ce qu'il en a coûté pour dégager les 'lois éternelles et naturelles' de la production capitaliste, pour consommer le divorce du travailleur d'avec les conditions du travail, pour transformer celles-ci en capital, et la masse du peuple en salariés, en pauvres industrieux (labouring poor), chef-d'œuvre de l'art, création sublime de l'histoire moderne. Si, d'après Augier, c'est "avec des taches naturelles de sang, sur une de ses faces" que "l'argent est venu au monde", le capital y arrive suant le sang et la boue par tous les pores." (Chapitre XXXI : Genèse du capitaliste industriel)
[5] "Or, aussi triste qu'il soit du point de vue des sentiments humains de voir ces myriades d'organisations sociales patriarcales, inoffensives et laborieuses se dissoudre, se désagréger en éléments constitutifs et être réduites à la détresse, et leurs membres perdre en même temps leur ancienne forme de civilisation et leurs moyens de subsistance traditionnels, nous ne devons pas oublier que ces communautés villageoises idylliques, malgré leur aspect inoffensif, ont toujours été une base solide du despotisme oriental, qu'elles enfermaient la maison humaine dans un cadre extrêmement étroit, en en faisant un instrument docile de la superstition et l'esclave des règles admises, en la dépouillant de toute grandeur et de toute force historique... Il est vrai que l'Angleterre, en provoquant une révolution sociale en Hindoustan, était guidée par les intérêts les plus abjects et agissait d'une façon stupide pour atteindre ses buts. Mais la question n'est pas là. Il s'agit de savoir si l'humanité peut accomplir sa destinée sans une révolution fondamentale dans l'état social de l'Asie. Sinon, quels que fussent les crimes de l'Angleterre, elle fut un instrument inconscient de l'histoire en provoquant cette révolution. Dans ce cas, quelque tristesse que nous puissions ressentir au spectacle de l'effondrement d'un monde ancien, nous avons le droit de nous exclamer avec Goethe :
"Doit-elle nous affliger
La peine qui de la joie est grosse ?
Le règne de Timour n'a-t-il pas fauché
Les âmes par myriades ?""
(Marx, "La domination britannique en Inde", New York Daily Tribune, 25 juin 1853)
[6] Il faut noter que c'était le rêve d'un certain nombre d'éléments révoltés après les événements de mai 1968 en France. Voulant échapper au capitalisme et à l'aliénation qu'il engendre, ils sont allés fonder des communautés en Ardèche, dans des villages désertés par leurs habitants, pour vivre du tissage et de l'élevage de chèvres. Ce fut, pour la plupart, une catastrophe : obligés de produire au plus bas prix pour vendre leur production, ils ont vécu dans la misère, ce qui a provoqué rapidement des conflits entre "associés", ranimant la chasse aux "fainéants qui vivaient sur le dos des autres", suscitant la réapparition de "petits chefs" soucieux de la "bonne marche des affaires", pour finir par s'intégrer, pour les plus avisés, dans les circuits commerciaux du capitalisme.
[7] Il faut noter que le français s'est imposé en réduisant à l'état de dialectes folkloriques d'autres langues comme le breton, le picard, l'occitan, le provençal, le catalan, et bien d'autres...
[8] Il faut noter que même sous l'ère franquiste, lorsqu'on était perdu dans Barcelone, il n'était pas bien vu de demander son chemin en castillan. Paradoxalement, la personne à qui l'on demandait de l'aide comprenait beaucoup mieux cette langue lorsqu'elle était parlée avec un fort accent français ou anglais que lorsqu'elle était parlée sans accent.
[9] Les révolutionnaires ne doivent pas hésiter à reprendre l'idée fondamentale de Marx : l'oppression et même la barbarie dont le capitalisme est responsable, et qu'il faut dénoncer, n'ont pas que des côtés négatifs : elles créent les conditions pour l'émancipation future de la classe ouvrière et même du succès de ses luttes présentes. S'ils sont obligés d'apprendre l'anglais ou de progresser dans cette langue pour pouvoir trouver du travail ou simplement aller faire des achats, les ouvriers québécois doivent aussi y trouver un avantage : cela ne peut que faciliter leur communication avec leurs frères de classe anglophones dans le pays même et dans le grand voisin nord-américain. Il ne s'agit pas pour les révolutionnaires de dédouaner les comportements xénophobes et odieux des bourgeois anglophones mais bien d'expliquer aux ouvriers francophones qu'ils ont la possibilité de retourner contre la bourgeoisie elle-même les armes qu'elle emploie contre eux. La grande révolutionnaire Rosa Luxemburg, née dans la partie de la Pologne dominée par la Russie, a été contrainte d'apprendre la langue de ce pays. Elle ne s'en est jamais plainte, au contraire. C'était pour elle une facilité pour communiquer avec ses camarades de Russie (par exemple Lénine avec qui elle a eu de longues discussions après la révolution de 1905 ce qui a permis aux deux révolutionnaires de mieux se connaître, se comprendre et s'apprécier). Cela a été aussi pour elle l'occasion de connaître et d'apprécier la littérature russe dont elle a traduit certains ouvrages en Allemand afin de les faire connaître aux lecteurs de cette langue.
Heritage de la Gauche Communiste:
Rapport sur la conférence en Corée - octobre 2006
- 4334 reads
En Juin 2006, le CCI a reçu une invitation de la part de la Socialist Political Alliance (SPA), un groupe de Corée du Sud qui se réclame de la tradition de la Gauche communiste, pour participer à une "Conférence internationale de Marxistes révolutionnaires" ; cette Conférence allait se tenir dans les villes de Séoul et de Ulsan, dans le courant du mois d'octobre de cette même année. Nous avions été en contact avec la SPA pendant environ un an et, malgré les inévitables difficultés de langue, nous avions pu entamer des discussions, en particulier sur les questions de la décadence du capitalisme et des perspectives pour le développement des organisations communistes dans la période actuelle.
La déclaration préliminaire de la SPA souligne avec force l'état d'esprit qui animait l'appel à la Conférence : "Nous connaissons très bien les différentes conférences ou réunions de Marxistes qui se tiennent régulièrement en différents endroits de la planète. Mais nous savons aussi très bien que ces conférences focalisent leurs discussions sur une théorie abstraite de type universitaire et la solidarité rituelle entre tous ceux qui se disent être à la "gauche" du capitalisme. Au-delà de ça, nous reconnaissons profondément la vision de la nécessité d'une véritable révolution prolétarienne contre la barbarie et la guerre, dans la phase de décadence du capitalisme.
Bien que les ouvriers coréens expriment leurs difficultés sur leur lieu de travail et que les forces politiques révolutionnaires en Corée soient très confuses sur la perspective d'une société communiste, nous devons réaliser la solidarité du prolétariat mondial au-delà d'une usine, d'un pays et d'une nation et réfléchir à la base sur les lourdes défaites qui ont négligé les principes de l'internationalisme dans le mouvement révolutionnaire passé."
Même l'examen le plus bref de l'histoire de l'Extrême Orient suffit à révéler l'immense importance de cette initiative. Nous l'avons mis en évidence dans notre "Salut à la Conférence" : "En 1927, le massacre des ouvriers de Shanghai a été l'épisode final d'un combat révolutionnaire qui a ébranlé le monde pendant dix ans, à partir de la Révolution d'Octobre en Russie en 1917. Dans les années qui ont suivi, la classe ouvrière mondiale et l'ensemble de l'humanité ont subi les pires horreurs de la plus terrible des contre-révolutions que l'histoire ait jamais connue. En Orient, la population a dû supporter les prémisses de la Deuxième Guerre mondiale avec l'invasion de la Mandchourie par le Japon, ensuite la Guerre mondiale elle-même qui a culminé dans la destruction de Hiroshima et de Nagasaki, ensuite, la guerre civile en Chine et la guerre de Corée ; puis la terrible famine en Chine pendant le prétendu "Grand bond en avant" sous Mao Zedong, la guerre du Vietnam...
Tous ces événements terrifiants, qui ont ébranlé le monde, ont submergé un prolétariat qui, en Orient, était encore jeune et inexpérimenté et très peu en contact avec le développement de la théorie communiste en Occident. Pour autant que nous le sachions, aucune expression de la Gauche communiste n'a pu survivre, ni même n'est apparue chez les ouvriers d'Orient.
En conséquence, le fait qu'aujourd'hui, en Orient, une conférence de communistes internationalistes ait été initiée par une organisation qui s'identifie explicitement à la Gauche communiste est un événement d'importance historique pour la classe ouvrière. Elle contient la promesse - peut-être pour la première fois dans l'histoire - de l'élaboration d'une véritable unité entre les ouvriers d'Orient et ceux d'Occident. Ce n'est pas non plus un événement isolé : celui-ci fait partie d'un lent éveil de la conscience du prolétariat mondial et de ses minorités politiques". La délégation du CCI a donc assisté à la Conférence avec pour objectif, non seulement de contribuer au mieux de ses capacités à l'émergence d'une voix internationaliste de la Gauche communiste en Extrême Orient, mais aussi d'apprendre : quelles sont les questions les plus importantes pour les ouvriers et les révolutionnaires en Corée ? Quelles formes prennent dans ce pays les questions qui touchent l'ensemble des ouvriers ? Quelles leçons l'expérience des ouvriers coréens peut-elle offrir aux ouvriers ailleurs, spécialement en Extrême Orient mais, aussi de manière plus générale, dans l'ensemble du monde ? Et enfin, quelles leçons le prolétariat coréen peut-il tirer de l'expérience de ses frères de classe du reste du monde ?
La Conférence se proposait au départ de discuter des sujets suivants : la décadence du capitalisme, la situation de la lutte de classe et la stratégie que doivent adopter les révolutionnaires dans la situation actuelle. Cependant, dans les jours qui ont précédé la Conférence, l'importance politique à long terme des objectifs qu'elle s'était fixés a été éclipsée par l'exacerbation dramatique des tensions impérialistes dans la région causée par l'explosion de la première bombe nucléaire de la Corée du Nord et par les manœuvres qui ont suivi, en particulier de la part des différents pouvoirs présents dans la région (Etats-Unis, Chine, Japon, Russie, Corée du Sud). Lors d'une réunion qui a précédé la Conférence, la délégation du CCI et le groupe de la SPA de Séoul ont été d'accord pour estimer qu'il était de la plus grande importance, pour des internationalistes, de prendre publiquement position sur cette situation et ont décidé de présenter conjointement à la Conférence une Déclaration internationaliste contre la menace de guerre. Comme nous le verrons, la discussion que cette Déclaration a provoquée a constitué une partie importante des débats pendant la Conférence elle-même.
Dans ce Rapport, nous nous proposons d'examiner quelques uns des thèmes principaux qui ont été débattus à la Conférence, dans l'espoir non seulement de donner son expression la plus large à la discussion elle-même, mais aussi de contribuer à la réflexion des camarades coréens en offrant une perspective internationale aux questions auxquelles ils sont aujourd'hui confrontés.
Le contexte historique
Avant d'en venir à la Conférence elle-même, il est toutefois nécessaire de placer brièvement la situation en Corée dans son contexte historique. Au cours des siècles qui ont précédé l'expansion du capitalisme en Extrême Orient, la Corée a à la fois bénéficié et souffert de sa position géographique en tant que petit pays coincé entre deux grandes puissances historiques : la Chine et le Japon. D'un côté, celle-ci a servi de pont et de catalyseur culturel pour les deux pays : il ne fait par exemple aucun doute que l'art de la céramique en Chine et spécialement au Japon doit beaucoup aux artisans potiers de Corée qui ont développé les techniques aujourd'hui disparues du vernissage des porcelaines céladon.[1] D'un autre côté, le pays a été victime d'invasions fréquentes et brutales de la part de ses deux puissants voisins, et pour la plus grande partie de son histoire récente, l'idéologie dominante a été sous le contrôle d'une caste d'érudits confucéens qui travaillait en langue chinoise et résistait à l'influence des idées nouvelles qui ont accompagné l'arrivée des puissances européennes dans la région. Pendant le 19e siècle, la rivalité acharnée et croissante entre la Chine, le Japon et la Russie - cette puissance coloniale étendait maintenant son influence jusqu'aux frontières de la Chine et sur l'Océan Pacifique - a conduit à une compétition intense pour développer leur influence en Corée même. Toutefois, l'influence que recherchaient ces puissances était essentiellement d'ordre stratégique : du point de vue du retour sur investissement, les possibilités qu'offraient la Chine et le Japon étaient beaucoup plus importantes que celles dont disposait la Corée, surtout compte tenu de l'instabilité politique causée par les luttes intestines entre les différentes factions des classes dirigeantes coréennes qui étaient divisées à la fois sur les bénéfices de la "modernisation", et par les tentatives de chacune d'utiliser l'influence des voisins impérialistes de la Corée pour renforcer leur propre pouvoir. Au début du 20e siècle, la Russie a intensifié ses tentatives d'établir une base navale en Corée, ce qui ne pouvait être perçu par le Japon que comme une menace mortelle envers sa propre indépendance : cette rivalité devait mener en 1905 à l'éclatement de la guerre russo-japonaise au cours de laquelle le Japon a anéanti la flotte russe. En 1910, le Japon a envahi la Corée et y a établi un régime colonial qui allait durer jusqu'à la défaite du Japon en 1945.
Le développement industriel, avant l'invasion des Japonais, était donc extrêmement timide et l'industrialisation qui suivit fut largement dépendante des besoins de l'économie de guerre du Japon : vers 1945, il y avait environ deux millions d'ouvriers de l'industrie en Corée, largement concentrés dans le Nord. Le Sud du pays restait essentiellement rural et souffrait d'une grande pauvreté. Et, comme si la population ouvrière de Corée n'avait pas suffisamment souffert de la domination coloniale, de l'industrialisation forcée et de la guerre,[2] elle se trouvait maintenant sur la zone frontière du nouveau conflit impérialiste qui allait dominer le monde jusqu'en 1989 : la division de la planète entre les deux grands blocs impérialistes des Etats-Unis et de l'URSS. L'URSS avait décidé de soutenir l'insurrection déclenchée par le "Parti ouvrier coréen", stalinien, pour sonder les nouvelles frontières de la domination impérialiste américaine, tout comme elle l'avait fait en Grèce après 1945. Le résultat y fut le même, quoique d'une bien plus grande importance, à une échelle plus destructrice : une guerre civile cruelle entre le Nord et le Sud de la Corée, dans laquelle les autorités coréennes de chaque camp - même si elles se battaient pour défendre leurs propres intérêts de bourgeoisie - n'étaient rien d'autre que des pions entre les mains de puissances bien plus grandes s'affrontant pour la domination du monde. La guerre a duré trois ans (1950-53). Au cours de celle-ci, toute la péninsule a été ravagée d'un bout à l'autre par les avancées et les reculs successifs des deux armées rivales. La guerre s'est terminée sur la partition définitive en deux pays séparés : la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les Etats-Unis ont, jusqu'à aujourd'hui, maintenu une présence militaire en Corée du Sud, avec plus de 30.000 hommes de troupes stationnés dans le pays.
Avant même la fin de la guerre, les Etats-Unis étaient déjà parvenus à la conclusion que l'occupation militaire ne stabiliserait pas, par elle-même, la région[3] et avaient décidé de mettre en œuvre l'équivalent d'un plan Marshall pour l'Asie du Sud-Est et l'Extrême Orient. "Sachant que la misère économique et sociale est le principal argument sur lequel s'appuient les fractions nationalistes pro-soviétiques pour arriver au pouvoir dans certains pays d'Asie, les Etats-Unis vont faire des zones qui se situent au voisinage immédiat de la Chine (Taiwan, Hongkong, Corée du Sud et Japon), les avant-postes de la "prospérité occidentale". La priorité pour les Etats-Unis sera d'établir un cordon sanitaire par rapport à l'avancée du bloc soviétique en Asie".[4] Cette politique eut des implications importantes pour la Corée du Sud : "Dépourvu de matières premières et dont l'essentiel de l'appareil industriel se localisait au Nord, ce pays se retrouvait exsangue au lendemain de la guerre : la baisse de la production atteint 44 % et celle de l'emploi 59 %, les capitaux, les moyens de production intermédiaires, les compétences techniques et les capacités de gestion étaient quasi inexistants. (...) De 1945 à 1978, la Corée du Sud a reçu quelques 13 milliards de dollars, soit 600 par tête, et Taiwan 5,6 milliards, soit 425 par tête. Entre 1953 et 1960, l'aide étrangère contribue pour environ 90 % à la formation du capital fixe de la Corée du Sud. L'aide fournie par les Etats-Unis atteignait 14 % du PNB en 1957. (...) Mais les Etats-Unis ne se sont pas bornés à fournir aide et soutien militaires, aide financière et assistance technique ; ils ont en fait pris en charge dans les différents pays toute la direction de l'Etat et de l'économie. En l'absence de véritables bourgeoisies nationales, le seul corps social pouvant prendre la tête de l'entreprise de modernisation voulue par les Etats-Unis était représenté par les armées. Un capitalisme d'Etat particulièrement efficace sera instauré dans chacun de ces pays. La croissance économique sera aiguillonnée par un système qui alliera étroitement le secteur public et privé, par une centralisation quasi militaire mais avec la sanction du marché. Contrairement à la variante est européenne de capitalisme d'Etat qui engendrera des caricatures de dérives bureaucratiques, ces pays ont allié la centralisation et la puissance étatique avec la sanction de la loi de la valeur. De nombreuses politiques interventionnistes ont été mises en place : la formation de conglomérats industriels, le vote de lois de protection du marché intérieur, le contrôle commercial aux frontières, la mise en place d'une planification tantôt impérative, tantôt incitative, une gestion étatique de l'attribution des crédits, une orientation des capitaux et ressources des différents pays vers les secteurs porteurs, l'octroi de licences exclusives, de monopoles de gestion, etc. Ainsi en Corée du Sud, c'est grâce à la relation unique tissée avec les "chaebols" (équivalents des "zaibatsus" japonais), grands conglomérats industriels souvent fondés à l'initiative ou avec l'aide de l'Etat, que les pouvoirs publics sud-coréens ont orienté le développement économique".[5]
La classe ouvrière de la Corée du Sud était donc confrontée à une politique d'exploitation féroce et à une industrialisation forcenée, exécutées par une succession de régimes militaires instables, à demi démocratiques et à demi autoritaires, qui maintenaient leur pouvoir par la répression brutale des grèves et des révoltes ouvrières, notamment le soulèvement massif de Kwangju, au début des années 1980.[6] A la suite des événements de Kwangju, la classe dirigeante coréenne a essayé de stabiliser la situation sous la présidence du général Chun Doo-hwan (précédemment à la tête de la CIA coréenne), en donnant un vernis démocratique à ce qui demeurait essentiellement un régime militaire autoritaire. Cette tentative échoua lamentablement : l'année 1986 a vu le rassemblement d'une opposition de masse à Séoul, Inch'on, Kwangju, Taegu et Pusan, alors qu'en 1987, "Plus de 3 300 conflits mobilisèrent des travailleurs de l'industrie qui réclamaient des salaires plus élevés, de meilleurs traitements et de meilleures conditions de travail, forçant le gouvernement à faire des concessions en accédant à certaines de leurs revendications."[7] L'incapacité du régime militaire corrompu du général Chun d'imposer la paix sociale par la force conduisit à un changement de direction ; le régime Chun adopta le "programme de démocratisation" proposé par le général Roh Tae-woo, leader du Democratic Justice Party, parti gouvernemental, qui gagna les élections présidentielles de décembre 1987. Les élections présidentielles de 1992 portèrent au pouvoir un leader de longue date de l'opposition démocratique, Kim Young-Sam, et la transition de la Corée vers la démocratie fut achevée. Ou bien, comme nous l'ont dit les camarades de la SPA, la bourgeoisie coréenne a finalement réussi à édifier une façade démocratique suffisante pour cacher la poursuite de la domination de l'alliance entre l'appareil militaire, les "chaebols", et l'appareil de sûreté.
Conséquences du contexte historique
En ce qui concerne l'expérience récente de ses minorités politiques, le contexte historique de la Corée présente des analogies avec celui d'autres pays de la périphérie, en Asie mais aussi en Amérique latine.[8] Il a eu des conséquences importantes pour l'émergence d'un mouvement internationaliste en Corée même.
Au niveau de ce que nous pourrions appeler "la mémoire collective" de la classe, il est clair qu'il existe une différence importante entre l'expérience politique et organisationnelle accumulée par la classe ouvrière en Europe - qui commençait déjà en 1848 à s'affirmer comme force indépendante dans la société (la fraction "force physique" du mouvement chartiste en Grande-Bretagne) - et celle de la classe en Corée. Si nous nous souvenons que les vagues de la lutte de classe en Europe dans les années 1980 ont vu le lent développement d'une méfiance générale à l'égard des syndicats et la tendance des ouvriers à prendre leurs luttes entre leurs propres mains, il est particulièrement frappant de constater que, pendant la même période, les mouvements en Corée étaient marqués par une tendance à fondre les luttes ouvrières pour les revendications propres à leur classe dans les revendications du "mouvement démocratique", pour une réorganisation de l'appareil d'Etat. En conséquence, l'opposition fondamentale entre les intérêts de la classe ouvrière et ceux des fractions démocratiques n'était pas immédiatement évidente pour les militants qui entraient dans une activité politique dans cette période.
Nous ne voudrions pas non plus sous-estimer les difficultés créées par les barrières de langue. La "mémoire collective" de la classe ouvrière est plus forte lorsqu'elle prend une forme écrite et théorique. Alors que les minorités politiques qui ont surgi en Europe dans les années 1970 ont eu accès, dans le texte original ou dans leur traduction, aux écrits de la gauche de la Deuxième Internationale (Lénine, Luxemburg), puis de la gauche de la Troisième Internationale et de la Gauche communiste qui en a émergé (Bordiga, Pannekoek, Gorter, le groupe de la Gauche italienne autour de Bilan et la Gauche communiste de France), en Corée, le travail de Pannekoek (Les Conseils ouvriers) et celui de Luxemburg (L'Accumulation du Capital) commencent à peine à être publiés grâce aux efforts conjoints du Seoul Group for Workers'Councils (SGWC) et de la SPA auquel le SGWC est étroitement associé.[9]
Plus spécifique à la situation coréenne, a été l'effet de la partition du pays entre le Nord et le Sud imposée par le conflit impérialiste entre les blocs américain et russe, la présence militaire américaine en Corée du Sud et le soutien qu'ont apporté les Etats-Unis aux régimes militaires successifs qui ont disparu en 1988. La combinaison de l'inexpérience générale de la classe ouvrière en Corée et de l'absence en son sein d'une voix clairement internationaliste, à laquelle il faut ajouter la confusion entre le mouvement ouvrier et l'opposition démocratique bourgeoise que nous avons citée plus haut, tout ceci a conduit à ce que la société est globalement contaminée par un nationalisme coréen insidieux, souvent déguisé en "anti-impérialisme" où ce sont seulement les Etats-Unis et leurs alliés qui apparaissent comme une force impérialiste. L'opposition au régime militaire, voire même au capitalisme, tend à être identifiée à l'opposition aux Etats-Unis.
Enfin, une caractéristique importante des débats au sein du milieu politique coréen est la question des syndicats. Pour la génération actuelle de militants en particulier, l'expérience des syndicats remonte aux luttes des années 1980 et du début des années 1990, au cours desquelles les syndicats étaient en grande partie clandestins, pas encore "bureaucratisés" et certainement animés et dirigés par des militants profondément dévoués (incluant des camarades qui, aujourd'hui, font partie de la SPA et du SGWC). A cause des conditions de clandestinité et de répression, les militants impliqués à cette époque ne voyaient pas clairement que le "programme" des syndicats non seulement n'était pas révolutionnaire, mais ne pouvait pas non plus défendre les intérêts des ouvriers. Pendant les années 1980, les syndicats étaient étroitement liés à l'opposition démocratique au régime militaire dont l'ambition n'était pas de renverser le capitalisme, mais tout à fait l'inverse : renverser le régime militaire et s'approprier comme tel l'appareil de capitalisme d'Etat. En revanche, la "démocratisation" de la société coréenne, depuis les années 1990, a mis en évidence l'intégration des syndicats dans l'appareil d'Etat, et cela a provoqué un désarroi profond parmi les militants sur la façon de réagir à cette situation nouvelle : comme l'a déclaré un camarade, "les syndicats se sont transformés au point de devenir les meilleurs défenseurs de l'Etat démocratique". Il en résulte une impression générale de "déception" par rapport aux syndicats et la recherche d'une autre méthode pour l'activité militante au sein de la classe ouvrière. C'est à maintes reprises que nous avons pu sentir, dans les interventions au cours de la Conférence et dans des discussions informelles, à quel point il est urgent pour les camarades coréens d'avoir accès à la réflexion sur la nature des syndicats dans la décadence du capitalisme qui a constitué une partie tellement importante de la réflexion dans le mouvement ouvrier européen depuis la révolution russe et, en particulier, depuis l'échec de la révolution en Allemagne.
Le nouveau millénaire est donc témoin du développement d'un effort réel chez de nombreux militants coréens pour remettre en question les bases de leur activité passée qui avait été, comme nous l'avons vu, fortement influencée à la fois par l'idéologie stalinienne et par celle de la démocratie bourgeoise. Dans le but de préserver une certaine unité et de fournir un espace de discussion pour ceux qui sont engagés dans ce processus, un certain nombre de groupes et d'éléments ont pris l'initiative de créer un "Réseau de révolutionnaires marxistes", plus ou moins formel.[10] Il est inévitable que la rupture avec le passé soit extrêmement difficile et il y a une grande hétérogénéité parmi les différents groupes du Réseau. Les conditions historiques que nous avons décrites brièvement plus haut impliquent que la différenciation entre les principes de l'internationalisme prolétarien et la perspective bourgeoise, essentiellement nationaliste, qui caractérise le stalinisme et le trotskisme, a juste commencé à se faire ces toutes dernières années, sur la base de l'expérience pratique des années 1990 et, pour une large part, grâce aux efforts de la SPA pour introduire les idées et les positions de la gauche communiste au sein du Réseau.
Dans ce contexte, il y a, à notre avis, deux aspects absolument fondamentaux dans l'introduction qu'a faite la SPA de la Conférence :
- D'abord, la déclaration explicite selon laquelle il est nécessaire pour les révolutionnaires en Corée de placer l'expérience des ouvriers coréens dans le cadre historique et théorique plus large de la classe ouvrière internationale : "Le but de la Conférence internationale est d'ouvrir largement l'horizon de la reconnaissance par la théorie et par la pratique des perspectives de la révolution mondiale. Nous espérons qu'au cours de cette Conférence importante, les révolutionnaires marxistes marcheront main dans la main, dans le sens de la solidarité, de l'unité et de l'accomplissement de la tâche historique de cristallisation de la révolution mondiale avec le prolétariat mondial."
- Deuxièmement, ceci ne peut être réalisé que sur la base des principes de la Gauche communiste : "La Conférence internationale des marxistes révolutionnaires en Corée constitue la réunion précieuse, le champ de discussions entre les communistes de gauche du monde et les révolutionnaires marxistes de Corée, et la première manifestation pour exposer les positions politiques [c'est-à-dire, des communistes de gauche] au sein du milieu révolutionnaire."
Les débats et la Conférence
Il n'y a pas la place dans cet article pour faire un compte-rendu exhaustif des discussions de la Conférence. Nous chercherons plutôt à souligner ce qui nous a semblé être les points les plus importants qu'elles ont fait apparaître, dans l'espoir de contribuer à la poursuite des débats commencés à la Conférence, à la fois entre les camarades coréens eux-mêmes et, plus généralement, au sein du mouvement internationaliste du monde entier.
Sur la décadence du capitalisme
C'était le premier sujet soumis à la discussion. Avant d'examiner le débat, nous devons d'abord affirmer que nous soutenons totalement la préoccupation qui sous-tend la démarche de la SPA : commencer la Conférence en donnant une base théorique solide aux autres questions en débat, c'est-à-dire la situation de la lutte de classe et la stratégie des révolutionnaires. De plus, nous saluons les efforts héroïques des camarades de la SPA pour présenter une brève synthèse des différents points de vue qui existent sur cette question au sein de la Gauche communiste. Etant donné la complexité de la question - qui a été objet de débat au sein du mouvement ouvrier depuis le début du 20e siècle et sur laquelle se sont penchés ses plus grands théoriciens - cette initiative est extrêmement hardie.
Avec du recul, on peut cependant estimer que c'était un peu trop audacieux ! Alors qu'il était particulièrement frappant de voir comment le concept de la décadence du capitalisme recevait "instinctivement" un accueil favorable (si on peut l'exprimer ainsi), il est apparu tout aussi clairement, d'après les questions posées tant dans la discussion formelle qu'en dehors de celle-ci, que la plupart des participants manquaient de bases théoriques pour s'attaquer en profondeur à la question.[11] Dire cela n'est nullement une critique : de nombreux textes de base ne sont pas disponibles en Corée, ce qui en soi est une expression, comme nous l'avons dit plus haut, de l'inexpérience objective du mouvement ouvrier coréen. Nous espérons en tous cas que les questions soulevées, et aussi les textes introductifs présentés en particulier par la SPA et par le CCI, permettront aux camarades de commencer à se situer dans le débat et aussi, de façon tout aussi importante, de comprendre pourquoi cette question théorique ne se pose pas en dehors de la réalité et des préoccupations concrètes de la lutte, mais qu'elle est le facteur déterminant fondamental de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui.[12]
Cela vaut la peine de reprendre une question d'un jeune étudiant qui a exprimé, en peu de mots, la contradiction flagrante entre l'apparence et la réalité dans le capitalisme d'aujourd'hui : "De nombreuses personnes ressentent la décadence, nous - les étudiants sans diplôme - sommes soumis à l'idéologie bourgeoise, nous avons le sentiment qu'il existe une société opulente, comment pouvons-nous exprimer la décadence avec des mots plus concrets ?". Il est vrai qu'un aspect de l'idéologie bourgeoise (au moins dans les pays industrialisés) est la prétention que nous vivons dans un monde de "consommation abondante" - et il est vrai que dans les rues de Séoul, les magasins croulant sous les matériels électroniques paraissent donner un semblant de réalité à cette idéologie. Cependant, il est d'une évidence flagrante que la jeunesse coréenne rencontre aujourd'hui les mêmes problèmes que les jeunes prolétaires de partout ailleurs : chômage, contrats de travail précaires, difficulté générale à trouver du travail, prix élevé du logement. Cela fait partie de la tâche des communistes de montrer clairement à la classe ouvrière d'aujourd'hui le lien entre le chômage de masse dont elle est la victime et la guerre permanente et généralisée qui est l'autre aspect fondamental de la décadence du capitalisme, comme nous avons essayé de le mettre en évidence dans notre brève réponse à cette question.
Sur la lutte de classe
Certainement l'une des questions parmi les plus importantes en discussion, non seulement à la Conférence mais dans le mouvement en Corée en général, est celle de la lutte de classe et de ses méthodes. Comme nous l'avons compris, d'après les interventions au cours de la Conférence et aussi dans les discussions informelles à l'extérieur, la question syndicale pose un réel problème aux militants qui ont pris part aux luttes de la fin des années 1980. D'une certaine façon, la situation en Corée est analogue à celle de la Pologne, à la suite de la création du syndicat Solidarnosc et elle constitue, jusqu'à aujourd'hui, une autre démonstration de la profonde vérité des principes de la Gauche communiste : dans la décadence du capitalisme, il n'est plus possible de créer des organisations de masse permanentes de la classe ouvrière. Même les syndicats formés dans le feu de la lutte, comme ce fut le cas en Corée, ne peuvent que devenir des accessoires de l'Etat, des moyens non de renforcer la lutte ouvrière mais de renforcer l'emprise de l'Etat sur celle-ci. Pourquoi en est-il ainsi ? La raison fondamentale est qu'il est impossible pour la classe ouvrière d'obtenir du capitalisme dans sa période de décadence, des réformes durables. Les syndicats perdent la fonction qu'ils avaient à l'origine et restent attachés à la préservation du capitalisme. Ils ont acquis un point de vue national, souvent en outre restreint à un seul corps de métier ou d'industrie, et non un point de vue international commun à tous les travailleurs : ils sont inévitablement soumis à la logique du capitalisme et de ses questions comme "qu'est-ce que le pays peut se permettre ?", ou "qu'est-ce qui est bon pour l'économie nationale ?". C'est en fait un reproche que nous avons entendu adresser aux syndicats en Corée - ces derniers en étaient même arrivés à pousser les ouvriers à limiter leurs revendications à ce que les patrons étaient prêts à payer, plutôt que de se baser sur les besoins des ouvriers eux-mêmes.[13]
Face à cette inévitable trahison des syndicats et à leur intégration à l'appareil d'Etat démocratique, les camarades coréens ont cherché une réponse dans les idées de la Gauche communiste. En conséquence, la notion de "conseils ouvriers" a soulevé parmi eux un grand intérêt. Le problème est qu'il y a une tendance générale à voir les conseils ouvriers non comme l'organe du pouvoir ouvrier dans une situation révolutionnaire, mais comme une nouvelle sorte de syndicat, capable d'exister en permanence au sein du capitalisme. En fait, cette idée a même été théorisée sur un plan historique dans une présentation sur "La stratégie du mouvement des conseils dans la période actuelle en Corée du Sud, et comment la mettre en pratique", par le Militants Group for Revolutionary Workers' Party. Nous devons dire que cette présentation met l'histoire complètement sur la tête quand elle proclame que les conseils ouvriers créés en 1919, pendant la révolution allemande, se sont développés à partir des syndicats ![14] A notre avis, il ne s'agit pas ici d'une simple inexactitude historique qui pourrait être corrigée par un débat universitaire. Plus profondément le problème vient du fait qu'il est extrêmement difficile d'accepter qu'en dehors d'une période révolutionnaire, il est simplement impossible aux ouvriers d'être en lutte de manière permanente. Les militants qui sont pris dans cette logique, indépendamment de la sincérité de leur désir de travailler pour la classe ouvrière, et même indépendamment des positions politiques prolétariennes qu'ils peuvent défendre de manière authentique, courent le risque de tomber dans le piège de l'immédiatisme, de courir sans cesse après une activité "pratique" qui n'a rien à voir avec ce qui est concrètement possible dans la situation historique telle qu'elle existe.
Selon la vision prolétarienne du monde, poser la question de cette façon rend la réponse impossible. Comme l'a dit un délégué du CCI : "Si les ouvriers ne sont pas en lutte, il est alors impossible de leur mettre un pistolet sur la tempe et de leur dire ‘Vous devez combattre !' ". Il n'est pas possible non plus pour les révolutionnaires de lutter "au nom de la classe ouvrière". Les révolutionnaires ne peuvent pas provoquer la lutte de classe : ce n'est pas un principe, c'est un simple fait historique. Ce qu'ils peuvent faire, c'est contribuer au développement de la prise de conscience par la classe ouvrière de son identité de classe, de sa place dans la société en tant que classe ayant ses intérêts propres et surtout des objectifs révolutionnaires qui vont au-delà de la lutte immédiate, au-delà de la situation immédiate des ouvriers dans les usines, dans les bureaux ou dans les files d'attente pour l'allocation chômage. C'est l'une des clés pour comprendre des soulèvements en apparence "spontanés", tel celui de 1905 en Russie : malgré le fait que les révolutionnaires de cette époque n'ont pas joué un grand rôle dans l'explosion soudaine de la lutte, le terrain avait été préparé depuis des années par l'intervention systématique de la Social-Démocratie (les révolutionnaires de l'époque), qui a joué un rôle décisif en développant la conscience de l'identité de classe des ouvriers.[15] En quelques mots, en dehors des périodes de luttes ouvrières ouvertes, une des tâches essentielles des révolutionnaires est de faire la propagande pour le développement des idées qui renforceront la lutte à venir.
Il y a une autre question, soulevée dans la présentation faite par Loren Goldner et par le délégué de Perspective Internationaliste, qui ne doit pas rester sans réponse : l'idée que la "recomposition" de la classe ouvrière - en d'autres termes, d'un côté, la tendance vers la disparition des usines géantes caractéristiques de la fin du 19e et du 20e siècles en faveur d'unités de production géographiquement dispersées et, d'un autre côté, le développement croissant des conditions de travail précaires pour les ouvriers, spécialement pour les jeunes travailleurs (contrats à court terme, chômage, travail à temps partiel, etc.) - a conduit à la découverte de "nouvelles méthodes de lutte" qui vont "au-delà du lieu de travail". Les exemples les plus notables de ces "nouvelles méthodes de lutte" sont les "piquets volants", prétendument inventés en 2001 par le mouvement des piqueteros en Argentine et par les émeutiers des banlieues françaises en 2005. Nous ne nous proposons pas dans cet article de répondre à l'enthousiasme des camarades pour les émeutes françaises et pour le mouvement des piqueteros et qui, à notre avis, est profondément erroné.[16] Cependant nous pensons vraiment nécessaire de nous attaquer à une erreur politique plus générale qui est exprimée dans ces positions et selon laquelle la conscience révolutionnaire des ouvriers dépend de leur expérience immédiate, au jour le jour, sur leur lieu de travail.
En fait, non seulement les conditions de travail précaires et les "piquets volants" ne sont pas une nouveauté historique,[17] mais les supposées "nouvelles formes de luttes" qui sont en général offertes à notre admiration ne sont rien d'autre que l'expression de l'impuissance des ouvriers dans une situation donnée : les émeutes des gamins des banlieues françaises en 2005 en sont un exemple classique. La réalité, c'est que (dans la période de décadence du capitalisme) à chaque fois que la lutte ouvrière acquiert une certaine indépendance, elle tend à s'organiser non dans des syndicats mais dans des assemblées de masse avec élection de délégués ; en d'autres termes, dans une forme organisée qui, à la fois, vient des soviets et les préfigure. L'exemple historique récent le plus frappant est sans doute celui des luttes en Pologne en 1980 ; une autre expérience, elle aussi dans les années 1980, a été celle des COBAS (des comités de base) formés pendant les luttes massives des enseignants en Italie (pas vraiment un secteur industriel "traditionnel" !). Plus proche de nous dans le temps, nous pouvons signaler les grèves à Vigo (Espagne) en 2006.[18] Ici, les ouvriers des constructions mécaniques qui ont commencé la grève, travaillaient avec des contrats précaires dans de petits ateliers industriels. Puisqu'il n'y avait pas une seule grande usine sur laquelle la lutte pouvait se focaliser, ils ont tenu des assemblées massives, non sur les lieux de travail, mais sur les places de la ville. Ces assemblées massives se rapportaient à une forme d'organisation qui avait déjà été utilisée en 1972, dans cette même ville.
La question est donc celle-ci : pourquoi, à la fin du 19e siècle, le développement d'une force de travail massive et précaire a-t-il conduit à la formation des premiers syndicats de masse d'ouvriers non spécialisés, alors qu'au 21e siècle ce n'est plus le cas ?
Pourquoi les ouvriers de Russie ont-ils, en 1905, inventé les conseils ouvriers - les soviets - que Lénine a appelés "La forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat" ? Pourquoi les assemblées massives sont-elles devenues la forme d'organisation ouvrière typique pour la lutte, chaque fois que les ouvriers réussissent à développer leur autonomie et leur force ?
A notre avis, comme nous l'avions dit lors de la Conférence, la réponse se trouve non dans des comparaisons sociologiques, mais dans une compréhension politique beaucoup plus profonde du changement dans la période historique qui a eu lieu au début du 20e siècle, changement qui a été décrit par la Troisième Internationale comme l'ouverture d'une "époque de guerres et de révolutions".
En outre, la vision sociologique de la classe ouvrière défendue par PI et par Loren Goldner est frappante dans le fait qu'elle révèle une sous-estimation totale des capacités théoriques et politiques du prolétariat : c'est presque comme si les ouvriers n'étaient pas capables de penser au-delà de ce qui peut leur arriver sur leur lieu de travail, comme si leur cerveau s'éteignait sitôt qu'ils quittaient leur travail, comme s'ils ne se sentaient pas concernés par l'avenir de leurs enfants (problèmes d'école, éducation, décomposition de la société), par la solidarité avec ceux qui sont âgés ou malades, avec les générations à venir (problèmes par rapport au déclin des services de santé, des régimes de retraites), comme s'ils étaient incapables d'avoir un regard critique sur les problèmes d'environnement ou la barbarie sans fin de la guerre et de faire le lien entre ce qu'ils apprennent sur ce qui se passe dans le monde et leur expérience directe propre par rapport à l'exploitation capitaliste sur le lieu de travail.
Cette compréhension politique et historique large du monde n'est pas nécessaire seulement pour la lutte immédiate. Si le prolétariat mondial réussit à renverser le capitalisme, il devra bâtir à sa place une société entièrement nouvelle, une société telle qu'elle n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Pour accomplir une telle tâche, il doit pouvoir développer la compréhension la plus profonde de l'histoire de l'humanité, il doit pouvoir se revendiquer comme étant l'héritier des plus grandes réalisations de l'humanité en matière d'art, de science et de philosophie. C'est ce pourquoi précisément sont faites les organisations politiques de la classe ouvrière : elles sont un moyen par lequel les ouvriers accèdent à une pensée plus générale sur leur condition et sur les perspectives qui leur sont ouvertes.[19]
La Déclaration contre la menace de guerre
Nous avons déjà publié le texte de la Déclaration sur notre site Web et dans notre presse, et nous ne répéterons pas ici son contenu.[20] Le débat autour de cette Déclaration s'est concentré sur la proposition, mise en avant par un membre du Ulsan Labour Education Committee, d'attribuer la responsabilité majeure des tensions croissantes dans la région à la présence américaine et, par conséquent, de présenter la Corée du Nord comme une "victime" de la politique américaine d' "endiguement". Nous pensons que cette proposition, ainsi que le soutien qu'elle a reçu de la part de quelques uns des membres de la Conférence les plus influencés par le trotskisme, était significative de la difficulté que rencontrent de nombreux camarades coréens pour rompre avec l'idéologie "anti-impérialiste" des années 1980 (c'est-à-dire essentiellement anti-américaine) et d'un attachement persistant à la défense de la Corée du Nord et donc au nationalisme coréen, malgré leur rejet indubitablement sincère du stalinisme.
Le CCI et plusieurs membres de la SPA ont vigoureusement argumenté contre le fait de vouloir altérer ce qui constituait la force principale de la Déclaration. Comme nous l'avons souligné dans le débat sur cette Déclaration, à la fois à Séoul et à Ulsan, l'idée que, dans un conflit impérialiste, un pays est plus à "blâmer" qu'un autre est exactement la même que celle qui a permis aux traîtres de la Social-Démocratie d'appeler les ouvriers à soutenir "leur" nation en 1914 : les ouvriers allemands contre la "barbarie tsariste", les ouvriers français contre le "militarisme prussien", les ouvriers britanniques en soutien à la "courageuse petite Belgique" et ainsi de suite. Pour nous, la période de décadence du capitalisme a démontré toute la profondeur de la compréhension de Rosa Luxemburg du fait que l'impérialisme n'est pas la faute de tel ou tel pays, mais que c'est une caractéristique fondamentale du capitalisme lui-même : dans cette période, tous les Etats sont impérialistes. La seule différence entre le géant américain et le nain nord coréen est la dimension de leurs appétits impérialistes et leur capacité à les satisfaire.
Deux autres objections qui, à notre avis valent la peine d'être mentionnées, sont apparues au cours de la discussion. La première a été la proposition d'un camarade du groupe Solidarity for Workers' Liberation d'inclure un point dénonçant le fait que le gouvernement de la Corée du Sud a pris prétexte de la situation de tension pour renforcer les mesures de répression. Cette suggestion pleinement justifiée a été formulée pendant la discussion à Séoul, et la version finale qui a été débattue à Ulsan le jour suivant (et depuis publiée) a été modifiée en conséquence.
La deuxième objection, de la part d'un camarade du groupe Sahoejueo Nodongja,[21] était que la situation présente n'était pas si grave et que si on la dénonçait maintenant, cela accréditerait l'idée d'une guerre épouvantable orchestrée par la bourgeoisie pour poursuivre ses objectifs propres. A notre avis, cette objection n'est pas déraisonnable, mais elle est néanmoins erronée. Qu'elle soit ou non imminente, cette menace de guerre en Extrême Orient est bel et bien suspendue au dessus de cette région et il ne fait aussi aucun doute que les tensions entre les principaux acteurs sur la scène impérialistes (Chine, Taiwan, Japon, Etats-Unis, Russie) sont en train de s'aggraver. Nous considérons que, dans cette situation, il est d'une grande importance que les internationalistes soient capables de dénoncer la responsabilité de tous les camps impérialistes : en agissant ainsi, nous suivons les pas de Lénine, de Luxemburg et de la Gauche de la Seconde Internationale qui ont combattu pour que la résolution internationaliste soit votée par le Congrès de Stuttgart en 1907. C'est une responsabilité primordiale des organisations révolutionnaires que de prendre position, au sein du prolétariat, sur les événements cruciaux des conflits impérialistes ou de la lutte de classe.[22]
Pour conclure sur ce point, nous voulons saluer le soutien internationaliste fraternel apporté à la Déclaration par la délégation de PI et par d' autres camarades en tant qu'individus présents à la Conférence.
Bilan
A la réunion finale, avant le départ de notre délégation, le CCI et la SPA se sont trouvés totalement d'accord sur l'évaluation générale de la Conférence. Les points soulevés les plus significatifs ont été les suivants :
1. Le fait que cette Conférence ait pu avoir lieu constitue en lui-même un événement d'importance historique, puisque pour la première fois, les positions de la Gauche communiste sont défendues et commencent à prendre racine dans un pays hautement industrialisé d'Extrême Orient.
2. La SPA a considéré que les discussions qui ont eu lieu pendant la Conférence ont été d'une importance particulière puisqu'elles ont mis en évidence de manière concrète la différence fondamentale entre la Gauche communiste et le Trotskisme. En agissant ainsi, la Conférence a renforcé la détermination de la SPA de développer sa propre compréhension des principes de la Gauche communiste et de les rendre plus largement disponibles pour le mouvement ouvrier coréen.
3. La Déclaration sur les essais nucléaires de la Corée du Nord a été l'expression des positions internationalistes de la Gauche communiste, en particulier de la SPA et du CCI. Le débat sur la Déclaration a révélé le problème des tendances nationalistes qui subsistent dans le mouvement ouvrier coréen. Dans le "Réseau", il y a des divergences sur cette question qui demeurent non résolues dans le milieu et la SPA est déterminée à œuvrer pour, à terme, les surmonter.
4. L'une des questions les plus importantes pour les débats à venir est celle des syndicats. Il sera nécessaire pour les camarades en Corée d'analyser leur histoire là-bas, notamment depuis les années 1980, à la lumière de l'expérience historique du prolétariat mondial telle qu'on la trouve concentrée dans les positions défendues par la Gauche communiste.
Perspectives
En même temps que toute l'importance qu'elle revêt, nous sommes bien conscients que cette Conférence ne représente qu'un premier pas dans le développement de la présence des principes de la Gauche communiste en Extrême Orient et d'un travail commun entre les révolutionnaires de l'Est et de l'Ouest. Ceci dit, nous considérons que le fait que la Conférence ait eu lieu, ainsi que les débats en son sein, ont confirmé deux points sur lesquels le CCI a toujours insisté et qui seront fondamentaux pour la construction du futur parti communiste mondial de la classe ouvrière.
Le premier des deux est le fondement politique sur lequel une telle organisation sera construite. Sur toutes les questions fondamentales - la question syndicale, la question parlementaire, la question du nationalisme et des luttes de libération nationale - le développement d'un mouvement internationaliste nouveau ne peut s'accomplir qu'à partir des bases établies par les petits groupes de la Gauche communiste entre les années 1920 et 50 (notamment par Bilan, le KAPD, le GIK, la GCF), d'où le CCI tire sa filiation.[23]
Pour le second, la conférence en Corée et l'appel explicite de la SPA à "réaliser la solidarité du prolétariat mondial" constitue déjà une nouvelle confirmation que le mouvement internationaliste ne se développe pas sur les bases d'une fédération de partis nationaux existants, mais directement à un niveau international [24]. Ceci représente une avancée historique par rapport à la situation dans laquelle la Troisième Internationale s'est créée, en pleine révolution et sur la base des fractions de gauche qui sont sorties des partis nationaux de la Seconde Internationale. Ceci est aussi le reflet de la nature de la classe ouvrière aujourd'hui : une classe qui, plus que jamais dans l'histoire, est unie dans un processus de production mondial et dans une société capitaliste globale dont les contradictions ne peuvent être surmontées que par son renversement à l'échelle mondiale, pour être remplacée par une communauté humaine mondiale.
John Donne / Heinrich Schiller
[1] Nous devrions aussi mentionner l'invention, au 15e siècle, de l'alphabet hangeul (han-gûl), peut-être la première tentative de transcription d'une langue sur la base d'une étude scientifique de sa phonologie.
[2] Ceci inclut la prostitution imposée à des milliers de femmes coréennes dans les bordels de l'armée japonaise et la destruction de l'ancienne économie agraire, dans la mesure où la production coréenne était de plus en plus dépendante des exigences du Japon lui-même.
[3] "Les Etats-Unis sont intéressés par la création de barrières militaires entre les régions non communistes et les régions communistes. Pour que cette barrière soit efficace, les régions séparées doivent être stables (...). Les Etats-Unis doivent déterminer les causes particulières de l'instabilité et contribuer, de manière intelligente et audacieuse, à sa suppression. Notre expérience en Chine a montré qu'il est inutile de temporiser avec les causes de l'instabilité, qu'une politique qui cherche une stabilisation temporaire est condamnée à l'échec quand le désir général est à un changement permanent." Melvin Conant Jnr, "JCCR : an object lesson", dans Far Eastern Survey, 2 Mai 1951.
[4] "Les dragons asiatiques s'essoufflent" [32] , Revue Internationale n°89 (1997)
[5] "La première et la plus importante source de financement a été l'acquisition par les "chaebols" des biens assignés, à des prix nettement sous-évalués. Au lendemain de la guerre ils représentaient 30 % du patrimoine sud-coréen anciennement détenu par les japonais. Initialement placés sous la tutelle de l'Office américain des biens assignés, ils ont été distribués par l'Office lui-même et par le gouvernement ensuite." Ibid., Revue Internationale n°89.
[6] Nous ne proposons pas, dans cet article, de traiter de la situation de la classe ouvrière en Corée du Nord, qui a eu à souffrir toutes les horreurs d'un régime stalinien ultra militariste.
[7] Andrew Nahm, A history of the Korean people.
[8] Les cas des Philippines et du Brésil sont des exemples qui viennent immédiatement à l'esprit.
[9] Quelques camarades du SGWC ont pris part à la Conférence de façon individuelle.
[10] En plus de la SPA, les groupes coréens suivants appartenant au "Réseau" ont donné des présentations à la Conférence : Solidarity for Workers' Liberation, Ulsan Labour Education Committee, Militants group for Revolutionary Workers' Party. Une présentation sur la lutte de classe a aussi été faite, à titre individuel, par Loren Goldner.
[11] Ceci a été particulièrement vrai de la discussion sur la décadence qui s'est tenue à Séoul : cette partie de la Conférence était ouverte au public et incluait la présence d'un certain nombre de jeunes étudiants ayant peu ou même aucune expérience politique.
[12] Nous ne nous proposons pas d'examiner ici la position du groupe Perspective Internationaliste sur "la domination formelle et réelle du capital". Nous avons déjà assez longuement traité de ce sujet dans la Revue Internationale n°60 [33] , publiée en 1990, à une époque où PI continuait encore à s'appeler la "Fraction Externe du CCI". Il est néanmoins intéressant de mentionner que les premiers efforts de PI pour démontrer dans la pratique la supériorité de sa "nouvelle" compréhension théorique ont peu convaincu, puisque PI continuait à affirmer, deux ans après la chute du Mur de Berlin, que les événements d'Europe de l'Est représentaient un véritable renforcement de la Russie !
[13] Ce compte-rendu reste inévitablement extrêmement schématique et susceptible d'être corrigé et précisé. Nous pouvons seulement regretter que la présentation du camarade de ULEC (Ulsan Labour Education Committee) sur l'histoire du mouvement ouvrier coréen ait été beaucoup trop longue pour être traduite en anglais et nous soit donc inaccessible. Nous espérons qu'il sera possible aux camarades de préparer et de traduire une version plus brève de leur texte qui en résumerait les points principaux.
[14] En fait, les syndicats ont été, pendant la révolution allemande, les pires ennemis des soviets. Pour un compte-rendu de la révolution allemande, voir les articles publiés dans la Revue Internationale n° 80 à 82 [34] .
[15] Voir notre série sur la révolution de 1905 [35] publiée dans les n° 120,122,123,125 de la Revue Internationale.
[16] Pour plus de détails sur ces sujets, voir, par exemple, "Emeutes dans les banlieues françaises : face au désespoir, seule la classe ouvrière est porteuse d'avenir" [36] et "Argentine : la mystification des piqueteros" [37] , publié dans la Revue Internationale n° 119.
Nous devons dire aussi que le fait de mettre en avant l'idée de la "disparition" de l'industrie à main d'œuvre massive, est apparu comme quelque chose de surréaliste dans la ville de Ulsan où l'usine Hyundai emploie à elle seule 20.000 ouvriers !
[17] Si nous prenons pour exemple l'idée que le "travail précaire" a conduit à l'invention des "piquets volants" comme "nouvelle forme de lutte", nous pouvons voir que cette idée est simplement dépourvue de fondement historique. Le piquet volant (c'est-à-dire une délégation d'ouvriers en lutte allant dans d'autres lieux de travail pour entraîner les autres ouvriers dans le mouvement) est quelque chose qui existe depuis longtemps : pour prendre le seul exemple de la Grande-Bretagne, le piquet volant a été très utilisé dans deux luttes importantes des années 1970 : les grèves des mineurs en 1972 et en 1974, lorsque les mineurs ont envoyé des piquets aux centrales électriques, ou la grève des ouvriers du bâtiment en 1972, à l'occasion de laquelle ils envoyèrent des piquets pour répandre la grève sur différents chantiers. L'existence d'une force de travail "précaire" n'a elle non plus rien de nouveau. C'est précisément l'apparition d'une force de travail non qualifiée et précaire (spécialement dans les docks) qui a conduit à la formation du "General Labourers' Union" par le syndicaliste révolutionnaire Tom Mann, en 1889 (Engels et Eleonor, la fille de Marx, ont aussi été impliqués dans le développement de ce syndicat).
[18] Voir l'article [38] publié dans Internationalisme.
[19] Les communistes "n'établissent pas de principes particuliers sur lesquels ils voudraient modeler le mouvement ouvrier. Les communistes ne se distinguent des autres partis ouvriers que sur deux points : 1. Dans les différentes luttes nationales des prolétaires, ils mettent en avant et font valoir les intérêts indépendants de la nationalité et communs à tout le prolétariat. 2. Dans les différentes phases que traverse la lutte entre prolétaires et bourgeois, ils représentent toujours les intérêts du mouvement dans sa totalité. Pratiquement, les communistes sont donc la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui stimule toutes les autres; théoriquement, ils ont sur le reste du prolétariat l'avantage d'une intelligence claire des conditions, de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien." Le Manifeste communiste.
[20] La Déclaration peut-être lue ici [39]
[21] "Ouvrier socialiste". Malgré son nom, ce groupe n'a rien à voir avec le Socialist Workers' Party de Grande-Bretagne. Nous présentons par avance nos excuses au camarade si nous nous sommes mépris sur sa ligne de pensée. La barrière de la langue a pu nous amener à une erreur d'interprétation.
[22] Le fait que, dans cette Conférence, les internationalistes ne soient pas demeurés sans voix face à la menace de guerre constitue, à notre avis, un vrai pas en avant, si on le compare aux Conférences de la Gauche communiste de la fin des années 1970 où les participants - et notamment Battaglia Comunista et de la CWO - ont refusé toute déclaration commune sur l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS.
[23] D'après PI, nous devons aller "au-delà de la Gauche communiste". Aucun des groupes que nous avons cités n'aurait prétendu avoir le dernier mot sur ces questions : l'histoire va de l'avant et nous parvenons à une meilleure compréhension de l'expérience historique. Mais il est impossible de construire une maison sans en avoir au préalable posé les fondations et, à notre avis, les seules fondations sur lesquelles il est possible de construire sont celles posées par nos prédécesseurs de la Gauche communiste. La logique de la position de PI est de jeter par-dessus bord l'histoire d'où nous provenons - et de déclarer que "l'histoire commence avec nous". Aussi détestable que cette idée puisse paraître à PI, elle n'est rien d'autre qu'une variante de la position bordiguiste selon laquelle "le Parti" (ou, pour le BIPR, le "Bureau") est l'unique source de sagesse et n'a rien à apprendre de qui que ce soit.
[24] Cet aspect du développement de la future organisation internationale a été matière à polémique entre le CCI et le BIPR dans les années 1980, le BIPR soutenant qu'une organisation internationale ne peut être construite que sur la base d'organisations politiques préexistant dans les différents pays. La pratique réelle du mouvement internationaliste d'aujourd'hui invalide totalement cette théorie du BIPR.
Vie du CCI:
Géographique:
- Corée du Sud [41]
Le communisme : l'entrée de l'humanité dans sa véritable histoire (V) - les problèmes de la période de transition
- 2976 reads
Dans ce numéro de la Revue internationale, nous republions le deuxième article de Bilan n° 31 (mai-juin 1936) de la série Les problèmes de la période de transition, écrite par Mitchell. Après avoir exposé, dans le premier article de cette série [42] (republié dans la Revue Internationale n° 128), les conditions historiques générales de la révolution prolétarienne, Mitchell retrace l'évolution de la théorie marxiste de l'Etat, en lien étroit avec les moments les plus importants de la lutte de la classe ouvrière contre le capitalisme - 1848, la Commune de Paris et la Révolution russe. Suivant les traces de L'Etat et la Révolution (1917) de Lénine, il montre comment le prolétariat a progressivement clarifié la question de ses relations à l'Etat au cours de ces expériences fondamentales : depuis le concept général selon lequel l'Etat, en tant qu'instrument d'oppression d'une classe par l'autre, devait nécessairement disparaître dans la société communiste, jusqu'aux étapes les plus concrètes de la compréhension de la manière dont le prolétariat atteindrait ce but, en détruisant l'ordre bourgeois et en érigeant à sa place une nouvelle forme d'Etat destinée à dépérir après une période de transition plus ou moins longue. Les études de Mitchell vont plus loin que le niveau de compréhension atteint par le livre de Lénine en étant capables de prendre en compte les leçons cruciales de la révolution d'Octobre et les terribles difficultés auxquelles elle a fait face du fait de son isolement international : avant tout, la nécessité d'éviter toute identification entre le prolétariat, ses organes de classe spécifiques (que Mitchell définissait comme étant les soviets, le parti et les syndicats) et l'appareil d'ensemble de l'Etat de transition qui constitue, par nature, un fléau hérité de la vielle société et qui est inévitablement plus vulnérable au danger de corruption et dégénérescence. De ce point de vue, le parti bolchevique s'était complètement trompé à la fois en identifiant la dictature du prolétariat avec l'Etat de transition, et en s'identifiant lui-même de façon croissante avec ce dernier.
Produit d'un processus intense de réflexion et de clarification, le texte de Mitchell contient certaines faiblesses de la Gauche communiste italienne et belge des années 1930, mais aussi recèle ce qui en fait la force : ainsi, alors qu'il argumente que le parti ne devrait pas se fondre dans l'Etat, le texte continue à soutenir que la tâche du parti est d'exercer la dictature du prolétariat ; ou encore, alors qu'il débute en posant clairement que la collectivisation des moyens de production n'est pas identique au socialisme, il se termine en continuant à défendre que, l'économie de l'URSS étant collectivisée, celle-ci n'était pas à cette époque un Etat capitaliste, cependant tout en reconnaissant bien sûr que le prolétariat russe était soumis à l'exploitation capitaliste. Nous avons plus amplement examiné ces contradictions dans des articles précédents (voir "L'énigme russe et la Gauche communiste d'Italie" [43], 1933-1946 dans la Revue internationale n° 106 et "Les années 1930 - le débat sur la période de transition" [42], dans la Revue internationale n° 128), mais ces faiblesses ne compromettent pas la clarté d'ensemble de ce texte qui demeure une contribution fondamentale à la théorie marxiste de l'Etat.
Dans notre exposé introductif nous pensons avoir dégagé l'idée essentielle qu'il n'existe et ne peut exister aucun synchronisme entre la maturité historique de la Révolution prolétarienne et sa maturité matérielle aussi bien que culturelle. Nous vivons dans l'ère des révolutions prolétariennes parce que le progrès social ne peut se poursuivre qu'à la condition que disparaisse l'antagonisme de classe qui, jusqu'ici, fut le fondement de ce même progrès à une époque considérée comme la préhistoire du genre humain.
Mais la réappropriation collective des richesses développées par la société bourgeoise supprime seulement la contradiction entre la forme sociale des forces productives et leur appropriation privée. Elle n'est rien de plus que la condition "sine qua non" du développement ultérieur de la société. Elle ne comporte aucun automatisme pour l'épanouissement social. Elle ne contient en soi aucune des solutions constructives du Socialisme tout comme elle ne peut faire d'emblée table rase de toutes les inégalités sociales.
Point de départ, la collectivisation des moyens de production et d'échange n'est pas le socialisme, mais sa condition fondamentale. Elle n'est encore qu'une solution juridique aux contradictions sociales et, par elle-même, ne comble nullement les déficiences matérielles et spirituelles dont le prolétariat hérite du capitalisme. L'Histoire "surprend" le prolétariat et l'oblige à réaliser sa mission dans un état d'impréparation que le plus ferme idéalisme et le plus grand dynamisme révolutionnaires ne peuvent transformer d'emblée en une pleine capacité pour lui de résoudre tous les redoutables et complexes problèmes qui surgissent.
Tant après qu'avant la conquête du pouvoir, le prolétariat doit suppléer à l'immaturité historique de sa conscience en s'appuyant sur son parti - qui reste son guide et son éducateur dans la période de transition entre le capitalisme et le communisme. De même le prolétariat ne peut parer à l'insuffisance temporaire des forces productives que le capitalisme lui lègue qu'en recourant à l'Etat, organisme de contrainte, "fléau dont le prolétariat hérite dans sa lutte pour arriver à sa domination de classe mais dont il devra, comme l'a fait la Commune, et dans la mesure du possible atténuer les plus fâcheux effets, jusqu'au jour où une génération élevée dans une société d'hommes libres et égaux, pourra se débarrasser de tout fatras gouvernemental." (Engels).
La nécessité de "tolérer" l'Etat pendant la phase transitoire s'échelonnant entre le capitalisme et le communisme, résulte du caractère spécifique de cette période définie par Marx dans sa Critique de Gotha : "Nous avons affaire à une société communiste non pas telle qu'elle s'est développée sur les bases qui lui sont propres, mais telle qu'elle vient, au contraire, de sortir de la société capitaliste ; par conséquent une société qui, sous tous les rapports : économique, moral, intellectuel, porte encore les stigmates de l'ancienne société des flancs de laquelle elle sort."
Nous examinerons quels sont ces stigmates lorsque nous analyserons les catégories économiques et sociales que l'économie prolétarienne hérite du capitalisme mais qui sont appelées à "dépérir" en même temps que l'Etat prolétarien.
Evidemment, il serait vain de se dissimuler le danger mortel qu'offre, pour la révolution prolétarienne, la survivance de cette servitude que constitue l'Etat, même ouvrier. Mais partir de l'existence en soi de cet Etat pour conclure à l'inévitable dégénérescence de la Révolution équivaudrait à faire fi de la dialectique historique comme à renoncer à la Révolution elle-même.
D'autre part, subordonner le déclenchement de la Révolution à la capacité pleinement réalisée par les masses d'exercer le pouvoir, reviendrait à renverser les données du problème historique tel qu'il se pose, à nier en somme la nécessité de l'Etat transitoire tout comme celle du parti. En définitive, ce postulat rejoint logiquement celui qui fonde la Révolution sur la "maturité" des conditions matérielles, et que nous avons examiné dans la première partie de cette étude
Nous reviendrons par la suite sur le problème de la capacité de gestion des masses prolétariennes.
L'Etat, instrument de la classe dominante
Si le prolétariat victorieux se trouve donc amené, de par les conditions historiques à devoir subir un Etat pendant une période plus ou moins prolongée, il lui importe cependant de savoir de quel Etat il s'agira.
La méthode marxiste permit, d'une part, de découvrir la signification de l'Etat dans les sociétés divisées en classes, d'en définir la nature, d'autre part, par une analyse des expériences révolutionnaires vécues dans le cours du siècle dernier par le prolétariat, de déterminer le comportement de celui-ci vis-à-vis de l'Etat bourgeois.
Marx et surtout Engels dégagèrent la notion de l'Etat de tout son fatras idéaliste. Mettant à nu la véritable nature de l'Etat, ils découvrirent qu'il n'était qu'un instrument d'asservissement aux mains de la classe dominante, dans une société déterminée, qu'il ne servait qu'à sauvegarder les privilèges économiques et politiques de cette classe et à imposer, par la contrainte et la violence, les règles juridiques correspondant au mode de propriété et de production sur lequel ces privilèges étaient fondés ; qu'enfin, l'Etat n'était que l'expression de la domination d'une minorité sur la majorité de la population. La charpente de l'Etat, en même temps aspect concret de la scission en classes de la société, c'était sa force armée et ses organes coercitifs, placés au-dessus de la masse du peuple, s'opposant à elle et excluant toute possibilité, pour la classe opprimée, de maintenir sa propre organisation "spontanée" de défense armée. La classe dominante ne pouvait tolérer la coexistence de ses propres instruments répressifs avec une force armée du peuple.
Pour ne prendre que des exemples tirés de l'Histoire de la société bourgeoise : en France, la révolution de février 1848 arma les ouvriers "qui se constituèrent en force dans l'Etat" (Engels) ; la bourgeoisie n'eut qu'une préoccupation : désarmer les ouvriers ; elle les provoqua en liquidant les ateliers nationaux et elle les écrasa au cours du soulèvement de juin. En France encore, après septembre 1870, fut formée, en vue de la défense du pays, une garde nationale, composée en majorité d'ouvriers : "L'antagonisme entre le gouvernement où il n'y avait, ou presque, que des bourgeois et le prolétariat en armes, éclata aussitôt... Armer Paris, c'était armer la Révolution. Pour Thiers, la domination des classes possédantes serait menacée tant que les ouvriers parisiens resteraient en armes. Les désarmer fut son premier souci." (Engels). D'où le 18 mars et la Commune.
Mais ayant pénétré le "secret" de l'Etat bourgeois (qu'il fût monarchique ou républicain, autoritaire ou démocratique), le prolétariat avait à définir à son égard sa propre politique. La méthode expérimentale du marxisme lui en donna les moyens.
A l'époque du Manifeste Communiste (1847), Marx avait bien marqué la nécessité pour le prolétariat de conquérir le pouvoir politique, de s'organiser en classe dominante, mais sans pouvoir préciser qu'il s'agissait pour lui de fonder son propre Etat. Il avait déjà prévu la disparition de tout Etat avec l'abolition des classes, mais il n'avait pu dépasser une formulation générale, encore abstraite. L'expérience française de 1848-1851 fournit à Marx la substance historique qui allait renforcer en lui l'idée de la destruction de l'Etat bourgeois, sans lui permettre cependant de délimiter les contours de l'Etat prolétarien appelé à le remplacer. Le prolétariat apparaît comme la première classe révolutionnaire dans l'histoire, à qui incombe la nécessité d'anéantir la machine bureaucratique et policière, de plus en plus centralisée, dont toutes les classes exploiteuses s'étaient servies jusqu'ici pour écraser les masses exploitées. Dans son 18 Brumaire, Marx souligna que "toutes les révolutions politiques n'ont fait que perfectionner cette machine au lieu de la briser." Le pouvoir centralisé de l'Etat, avec ses organes répressifs, remontait à la monarchie absolue ; la Bourgeoisie naissante s'en servit pour lutter contre la féodalité, la Révolution française ne fit que le débarrasser des dernières entraves féodales et le Premier Empire paracheva l'Etat moderne. La société bourgeoise développée transforma le pouvoir central en une machine d'oppression du prolétariat. Pourquoi l'Etat ne fut jamais détruit par aucune des classes révolutionnaires, mais conquis, Marx en donna l'explication fondamentale dans Le Manifeste : "les moyens de production et d'échange, sur la base desquels s'est édifiée la bourgeoisie, furent créés à l'intérieur de la société féodale". La Bourgeoisie, sur la base de positions économiques conquises graduellement, n'eut pas à détruire une organisation politique dans laquelle elle était parvenue à s'installer. Elle n'eut à supprimer ni la bureaucratie, ni la police, ni la force armée, mais à subordonner ces instruments d'oppression à ses fins propres, parce que la révolution politique ne faisait que substituer juridiquement une forme d'exploitation à une autre forme d'exploitation.
Etat prolétarien et Etat bourgeois
Par contre, le prolétariat était une classe exprimant les intérêts de l'Humanité et non des intérêts particuliers pouvant s'encastrer dans un Etat fondé sur l'exploitation : "Les prolétaires n'avaient rien à sauvegarder qui leur appartenait ; ils avaient à détruire toute garantie privée, toute sécurité privée existante" (Le Manifeste). La Commune de Paris fut la première réponse historique, encore bien imparfaite, à la question de savoir en quoi l'Etat prolétarien se différencierait de l'Etat bourgeois : la domination de la majorité sur la minorité dépossédée de ses privilèges, rendait inutile le maintien d'une machine bureaucratique et militaire, spécialement au service d'intérêts particuliers, à laquelle le prolétariat substituait, et son propre armement - pour briser toute résistance bourgeoise - et une forme politique lui permettant d'accéder progressivement à la gestion sociale. C'est en cela que "la Commune ne fut déjà plus un Etat au sens propre du mot". (Engels). Lénine souligna "qu'elle arrivait ainsi - œuvre gigantesque - à remplacer certaines institutions par des institutions de principe essentiellement différent".
Mais l'Etat prolétarien n'en conservait pas moins le caractère foncier de tout Etat : il restait un organe de coercition qui, bien qu'assurant la domination de la majorité sur la minorité, ne pouvait toujours qu'exprimer l'impuissance à supprimer temporairement le droit bourgeois ; il était, suivant l'expression de Lénine "un Etat bourgeois sans bourgeoisie" qui, sous peine de se retourner contre le prolétariat, devait être maintenu sous le contrôle direct de celui-ci et de son parti.
La théorie de la dictature du prolétariat, ébauchée dans Le Manifeste, mais qui puisa dans la Commune de 1871 ses premiers matériaux historiques - juxtaposa à la notion de destruction de l'Etat bourgeois, celle du dépérissement de l'Etat prolétarien. L'idée de la disparition de tout Etat, on la trouve déjà chez Marx, à l'état embryonnaire, dans sa Misère de la Philosophie ; mais ce fut surtout Engels qui la développa dans L'origine de la Propriété et L'Anti-Dühring tandis que par après, Lénine la commenta lumineusement dans L'Etat et la Révolution. Quant à la distinction fondamentale entre destruction de l'Etat bourgeois et extinction de l'Etat prolétarien, elle a été faite avec suffisamment de vigueur par Lénine pour que nous n'ayons pas à y insister ici, d'autant plus que nos considérations antérieures ne permettent aucune équivoque à ce sujet.
Ce qui doit retenir notre attention, c'est que le postulat du dépérissement de l'Etat prolétarien est appelé à devenir en quelque sorte la pierre de touche du contenu des révolutions prolétariennes. Nous avons déjà indiqué que celles-ci surgissaient dans un milieu historique obligeant le prolétariat victorieux à supporter encore un Etat, bien que ce ne pût être "qu'un Etat en dépérissement, c'est-à-dire constitué de telle sorte qu'il commence sans délai à dépérir et qu'il ne puisse pas ne point dépérir".(Lénine).
Le grand mérite du marxisme fut d'avoir démontré irréfutablement que jamais l'Etat ne fut un facteur autonome de l'Histoire, mais qu'il n'était qu'un produit de la société divisée en classes - la classe précédant l'Etat - tandis qu'il disparaîtrait avec les classes elles-mêmes. Si après la dissolution du communisme primitif, l'Etat avait toujours existé sous une forme plus ou moins évoluée, parce qu'il se superposait nécessairement à une forme d'exploitation de l'homme par l'homme, il n'en était pas moins vrai qu'il devait tout aussi nécessairement mourir au terme d'une évolution historique qui rendrait superflues toute oppression et toute contrainte, parce qu'elle aurait éliminé le "droit bourgeois" et que, suivant l'expression de Saint-Simon "la politique se serait résorbée toute entière dans l'économie".
Mais la science marxiste n'avait pas encore élaboré la solution au problème de savoir comment et par quel processus l'Etat disparaîtrait, problème qui était lui-même conditionné par celui du rapport entre le prolétariat et "son" Etat.
La Commune - ébauche de la dictature du prolétariat, expérience gigantesque qui n'évita ni la défaite, ni la confusion parce que. d'une part, elle naquit dans une période d'immaturité historique et que d'autre part, il lui manqua le guide théorique, le parti - n'apporta que quelques éléments premiers esquissant encore vaguement les rapports entre Etat et Prolétariat.
Marx, en 1875, dans sa Critique de Gotha dut encore s'en tenir à cette interrogation : "Quelle transformation subira l'Etat, dans une société communiste ?" (Marx vise ici la période de transition. N. d. l. R.) "Quelles fonctions sociales s'y maintiendront qui soient analogues aux fonctions actuelles de l'Etat ? Cette question ne peut être résolue que par la science et ce n'est pas en accouplant de mille manières le mot Peuple au mot Etat qu'on fera avancer le problème d'un saut de puce."
Dans la Commune, Marx vit surtout une forme politique tout à fait expansive, tandis que les anciennes formes étaient essentiellement répressives ; " ...la forme politique, enfin trouvée, sous laquelle il était possible de réaliser l'émancipation du travail". (La Guerre Civile). Ce faisant, il posait seulement les données du problème capital de l'initiation et de l'éducation des masses qui auraient à se dégager de plus en plus de l'emprise de l'Etat pour enfin faire coïncider la mort de celui-ci avec la réalisation de la société sans classes. En ce sens, la Commune posait quelques jalons sur la voie de cette évolution. Elle montrait que si le prolétariat ne pouvait supprimer d'emblée le système des délégations, "il avait à prendre ses précautions contre ses propres subordonnés et ses propres fonctionnaires en les déclarant sans exception et en tout temps amovibles." (Engels). Et pour Marx, "rien ne pouvait être plus étranger à l'esprit de la Commune que de remplacer le suffrage universel (pour la désignation des mandataires N. d. l. R.) par un système de nominations hiérarchiques."
Mais l'élaboration théorique dut s'en tenir là. Et quarante ans plus tard, Lénine n'aura pas avancé en ce domaine. Dans son Etat et la Révolution, il s'en tiendra à des formulations banales et sommaires, se bornera à souligner la nécessité de "transformer les fonctions de l'Etat en des fonctions de contrôle et d'enregistrement si simples qu'elles soient à la portée de l'énorme majorité de la population et peu à peu de la population toute entière". Il ne pourra que se limiter, comme Engels, à énoncer ce à quoi correspondra la disparition de l'Etat, c'est-à-dire à l'ère de la liberté véritable en même temps qu'à la mort de la démocratie qui aura perdu toute signification sociale. Quant au processus suivant lequel s'élimineront toutes les servitudes qui seront comme l'arrière-faix du capitalisme, Lénine constatera que la "question reste ouverte du moment et des formes concrètes de cette mort de l'Etat, car nous n'avons pas de donnée qui nous permette de la trancher."
Ainsi restait non résolu le problème de la gestion d'une économie et d'un Etat prolétariens s'exerçant en fonction de la révolution internationale. Des principes régissant la solution politique de ce problème, le prolétariat russe se trouva dépourvu au moment où il s'engagea en Octobre 1917 dans la plus formidable expérience historique. Inévitablement les bolcheviks devaient sentir peser sur eux le poids écrasant de cette carence théorique au cours de leurs tentatives de délimiter les rapports entre Etat et Prolétariat.
Pouvoir du prolétariat et Etat de la période de transition
Avec le recul d'où nous pouvons aujourd'hui considérer l'expérience russe, il apparaît que très probablement, si les bolcheviks et l'Internationale avaient pu acquérir une claire vision de cette tâche capitale, le reflux révolutionnaire à l'Occident, bien qu'il eût constitué quand même une entrave considérable au développement de la Révolution d'octobre, n'en aurait pas altéré le caractère internationaliste, et n'aurait pas provoqué sa rupture avec le prolétariat mondial en la conduisant à l'impasse du "socialisme en un seul pays".
Mais l'Etat soviétique ne fut pas considéré par les bolcheviks, au travers des terribles difficultés contingentes, essentiellement comme un "fléau dont le prolétariat hérite et dont il devra atténuer les plus fâcheux effets", mais comme un organisme pouvant s'identifier complètement avec la dictature prolétarienne, c'est-à-dire le Parti.
D'où résulta cette altération principale que le fondement de la dictature du prolétariat, ce n'était pas le Parti, mais l'Etat qui, par le renversement des rapports qui s'ensuivit, se trouva placé dans des conditions d'évolution aboutissant non à son dépérissement mais au renforcement de son pouvoir coercitif et répressif. D'instrument de la révolution mondiale, l'Etat prolétarien était appelé à devenir inévitablement une arme de la contre-révolution mondiale.
Bien que Marx, Engels et surtout Lénine eussent maintes fois souligné la nécessité d'opposer à l'Etat prolétarien son antidote prolétarien, capable d'empêcher sa dégénérescence, la Révolution russe, loin d'assurer le maintien et la vitalité des organisations de classe du prolétariat, les stérilisa en les incorporant à l'appareil étatique et ainsi dévora sa propre substance.
Même dans la pensée de Lénine, la notion "Dictature de l'Etat" devint prédominante. C'est ainsi qu'à la fin de 1918, dans sa polémique avec Kautsky (Révolution prolétarienne) il ne parvint pas à dissocier les deux notions opposées : Etat et Dictature du prolétariat. Il répliqua victorieusement à Kautsky pour ce qui concernait la définition de la dictature du prolétariat, sa signification fondamentale de classe (tout le pouvoir aux Soviets) ; mais à la nécessité de la destruction de l'Etat bourgeois et de l'écrasement de la classe dominante, il lia celle de la transformation des organisations prolétariennes en organisations étatiques. Il est vrai de dire que cette affirmation n'avait rien d'absolu, parce qu'elle se rapportait à la phase de guerre civile et de renversement de la domination bourgeoise et que Lénine visait les Soviets qui se substituaient en tant qu'instrument d'oppression sur la bourgeoisie à l'appareil d'Etat de cette dernière.
La difficulté énorme d'une juste orientation dans la question des rapports entre l'Etat et le Prolétariat et que Lénine ne put vaincre, provint précisément de cette double nécessité contradictoire de maintenir un Etat, organe de contrainte économique et politique restant sous le contrôle du prolétariat (donc de son parti) pendant que d'autre part devait être assurée la participation de plus en plus élargie des masses à la gestion et à l'administration de la société prolétarienne, alors que précisément cette participation ne pouvait s'exercer transitoirement qu'au sein d'organismes étatiques, corruptibles par nature.
L'expérience de la révolution russe révéla au prolétariat combien s'affirmait complexe et difficile la tâche de produire un climat social où put s'épanouir l'activité et la culture des masses.
La controverse sur la Dictature et la Démocratie se concentra précisément sur ce problème dont la solution devait donner la clef des révolutions prolétariennes. A cet égard, il faut souligner que les considérations opposées de Lénine et Luxembourg sur la "démocratie prolétarienne", partaient de la préoccupation qui leur était commune, de créer les conditions d'une expansion incessante des capacités des masses. Mais pour Lénine, le concept de la démocratie, même prolétarienne, impliquait toujours celui de l'oppression inévitable d'une classe sur une autre classe, que ce fût la domination bourgeoise écrasant le prolétariat ou la dictature du prolétariat s'exerçant sur la bourgeoisie. Et la "démocratie" disparaissait, comme nous l'avons déjà dit, au moment où elle se trouvait entièrement réalisée avec l'extinction des classes et de l'Etat, c'est-à-dire au moment où le concept de liberté recevait sa pleine signification.
A l'idée de Lénine d'une démocratie "discriminatoire", Luxembourg (Révolution russe) opposait celle de la "démocratie sans limites" qui représentait pour elle la condition nécessaire d'une "participation sans entraves des masses populaires" à la dictature du prolétariat. Celle-ci ne pouvait se réaliser qu'au travers de l'exercice total des libertés "démocratiques" : liberté illimitée de la presse, liberté politique entière, parlementarisme (bien que, par après, dans le programme de Spartacus, le sort du parlementarisme se trouvera subordonné à celui de la Révolution).
Le souci prédominant de Luxembourg, de ne pas voir les organes de la machine étatique entraver l'épanouissement de la vie politique du prolétariat et sa participation active aux tâches de la dictature, l'empêcha d'apercevoir le rôle fondamental conféré au Parti, puisqu'elle alla jusqu'à opposer Dictature de classe et Dictature de Parti. Son énorme mérite fut cependant d'avoir opposé, comme Marx le fit pour la Commune, le contenu social de la domination bourgeoise à celui de la domination prolétarienne : "la domination de classe de la bourgeoisie n'avait pas besoin d'une instruction et d'une éducation politique de toute la masse du peuple ou du moins pas au delà de certaines limites fort étroites, tandis que pour la dictature prolétarienne, elle est l'élément vital, l'air sans lequel elle ne peut pas exister". Dans le programme de Spartacus, elle reprit les données du problème capital de l'éducation des masses (dont la solution revient au parti) en posant que "l'histoire ne nous rend pas la tâche aussi facile qu'elle l'était pour les révolutions bourgeoises ; il ne suffit pas de renverser le pouvoir officiel au centre et de le remplacer par quelques douzaines ou quelques milliers d'hommes nouveaux. Il faut que nous travaillions de bas en haut."
L'impuissance des bolcheviks à maintenir l'Etat au service de la révolution
Emporté par le processus contradictoire de la révolution russe, Lénine mettait sans cesse l'accent sur la nécessité d'opposer un "correctif" prolétarien et des organes de contrôle ouvrier, à la tendance de l'Etat transitoire à se faire corrompre.
Dans son rapport au Congrès des Soviets d'avril 1918 sur Les tâches actuelles du pouvoir soviétique, il soulignait la nécessité de surveiller constamment l'évolution des Soviets et du pouvoir soviétique : "il y a une tendance "petite bourgeoise" qui transforme les membres des Soviets en "parlementaires" ou en bureaucrates. Il faut lutter contre cela en attirant dans l'administration, tous les membres des Soviets". Dans ce but, Lénine préconisait "la participation de tous les pauvres à la pratique de l'administration, la participation gratuite de tout travailleur à l'administration de l'Etat, ses huit heures de travail productif une fois achevées. Il est bien difficile d'atteindre ce but, mais cette transition est essentielle pour le socialisme. La nouveauté des difficultés de cette tâche provoque naturellement des tâtonnements, de nombreuses fautes, des hésitations - tout cela est inévitable au cours de tout mouvement brusque en avant. L'originalité du moment présent aux yeux de beaucoup de ceux qui s'appellent socialistes, réside dans le fait qu'on s'était habitué à opposer le capitalisme au socialisme, mettant entre les deux le mot "bond" ".
Que dans le même rapport, Lénine fut amené à légitimer les pouvoirs dictatoriaux individuels, était l'expression non seulement d'une sombre situation contingente engendrant le "communisme de guerre", mais également du contraste déjà souligné entre, d'une part, un régime nécessaire de contrainte appliqué par la machine d'Etat et, d'autre part, le besoin pour la sauvegarde de la dictature prolétarienne de diluer ce régime dans l'activité grandissante des masses. "Autant, disait-il, nous devons mettre d'énergie à défendre les pouvoirs dictatoriaux des individus à de certaines fins exécutives déterminées, autant nous devons veiller à ce que les formes et les procédés de contrôle des masses soient multiples et variés afin de parer à toute ombre de déformation du pouvoir des Soviets et d'arracher sans cesse l'ivraie bureaucratique".
Mais trois ans de guerre civile et la nécessité vitale d'un redressement économique empêchèrent les bolcheviks de rechercher une ligne politique claire quant aux rapports entre les organes étatiques et le prolétariat. Non pas qu'ils n'eussent pas pressenti le péril mortel qui menaçait le cours de la Révolution. Le programme du 8e Congrès du Parti russe en mars 1919, parlait du danger de la renaissance partielle de la bureaucratie qui s'effectuait à l'intérieur du régime soviétique, et cela bien que tout l'ancien appareil bureaucratique tsariste eût été détruit de fond en comble par les Soviets. Le 9e Congrès de décembre 1920 traitait encore de la question bureaucratique. Et au 10e Congrès, celui de la NEP, Lénine en discuta longuement pour aboutir à cette conclusion : que les racines économiques de la bureaucratie soviétique ne s'implantaient pas sur des bases militaires et juridiques comme dans l'appareil bourgeois mais qu'elles partaient des services ; que la bureaucratie, si elle avait repoussé, surtout dans la période du "communisme de guerre", n'avait fait qu'exprimer le "côté négatif" de cette période, avait été en quelque sorte la rançon de la nécessité d'une centralisation dictatoriale donnant la maîtrise au fonctionnaire. Après une année de Nouvelle Politique économique, Lénine au 11e Congrès, souligna avec force la contradiction historique s'exprimant par l'obligation pour le prolétariat de prendre le pouvoir et de l'utiliser dans des conditions d'impréparation idéologique et culturelle : "Nous avons en mains un pouvoir politique absolument suffisant ; nous avons aussi des ressources économiques suffisantes ; mais l'avant-garde de la classe ouvrière qui s'est lancée en avant n'a pas assez de savoir-faire pour conduire elle-même directement ses affaires, pour fixer les bornes, pour se départager, pour subordonner elle-même et ne pas se laisser subordonner. Pour cela, il faut avant tout du savoir-faire et c'est ce qui nous fait défaut ; c'est une situation qui ne s'est jamais encore vue dans l'histoire".
A propos du Capitalisme d'Etat qu'il avait fallu accepter, Lénine exhortait le parti : "Apprenez donc, communistes, ouvriers, partie consciente du prolétariat qui s'est chargée de diriger l'Etat, apprenez à faire de la sorte que l'Etat que vous avez pris entre vos mains agisse selon votre gré... l'Etat reste entre vos mains, mais est-ce qu'en fait de politique économique nouvelle il a marché selon nos désirs ? NON!... Comment a-t-il donc marché? La machine vous glisse sous la main : on dirait qu'un autre homme la dirige, la machine court dans une autre direction que celle qu'on lui a tracée".
Lénine, en posant comme tâche de "construire le communisme avec des mains non-communistes" ne faisait que reprendre une des données du problème central à résoudre par la révolution prolétarienne. En marquant que le parti avait à diriger dans la voie tracée par lui, l'économie que "d'autres" géraient, il ne faisait qu'opposer la fonction du parti à celle, divergente, de l'appareil étatique.
La sauvegarde de la Révolution russe et son maintien sur les rails de la Révolution mondiale n'étaient donc pas conditionnés par l'absence de l'ivraie bureaucratique - excroissance accompagnant inévitablement la période transitoire - mais par la présence vigilante d'organismes prolétariens où pût s'exercer l'activité éducatrice du Parti, conservant au travers de l'Internationale la vision de ses tâches internationalistes. Ce problème capital, les Bolcheviks ne purent le résoudre par suite d'une série de circonstances historiques et parce qu'ils ne disposaient pas encore du capital expérimental et théorique indispensable. L'écrasante pression des événements contingents leur fit perdre de vue l'importance que pouvaient représenter la conservation des Soviets et Syndicats en tant qu'organisations se juxtaposant à l'Etat et le contrôlant, mais ne s'y incorporant pas.
L'expérience russe n'a pu démontrer dans quelle mesure les Soviets eussent pu constituer suivant l'expression de Lénine "l'organisation des travailleurs et des masses exploitées, auxquels ils faciliteraient la possibilité d'organiser et de gouverner l'Etat eux-mêmes" ; dans quelle mesure ils eussent pu concentrer en eux "le législatif, l'exécutif et le judiciaire", si le centrisme (c'est à dire le stalinisme NdlR) ne les avait castrés de leur puissance révolutionnaire.
En tout état de cause, les Soviets apparurent comme la forme russe de la dictature du prolétariat plutôt que comme sa forme spécifique, acquérant une valeur internationale. Ce qui est acquis, au point de vue expérimental c'est que, dans la phase de destruction de la société tsariste, les Soviets constituèrent la charpente de l'organisation armée que les ouvriers russes substituèrent à la machine bureaucratique et militaire et l'autocratie et dirigèrent ensuite contre les réactions des classes expropriées.
Quant aux syndicats, leur fonction fut altérée dans le processus même de dégénérescence de tout l'appareil de la dictature prolétarienne. Dans sa Maladie infantile (datant du début de 1920), Lénine soulignait toute l'importance des syndicats par lesquels "le parti se trouvait intimement lié avec la classe et avec la masse et par lesquels, sous la direction du parti, la dictature de classe était réalisée". Tout comme avant la conquête du pouvoir "le parti se trouvait d'autant plus obligé, et par les anciennes méthodes et par les nouvelles, à s'attacher à l'éducation des syndicats, à les diriger, sans oublier, en même temps qu'ils restaient et resteraient longtemps l'indispensable "école du communisme", l'école préparatoire des prolétaires pour la réalisation de leur dictature, l'association indispensable des ouvriers pour le passage définitif de toute l'économie du pays, d'abord aux mains de la classe ouvrière (et non de professions isolées), puis de tous les travailleurs".
La question du rôle des syndicats prit de l'ampleur à la fin de 1920. Trotsky se basant sur l'expérience qu'il avait réalisée dans le domaine des transports, considérait que les syndicats devaient être des organismes d'Etat chargés de maintenir la discipline du travail et d'assurer l'organisation de la production, il allait même jusqu'à proposer leur suppression, prétendant que dans un Etat ouvrier, ils faisaient double emploi avec les organes de l'Etat !
La discussion rebondit au 10e Congrès du Parti, en mars 1921, sous la pression des événements (Cronstadt). La conception de Trotsky s'y heurta tant à l'Opposition ouvrière, dirigée par Chliapnikov et Kollontaï, qui proposait de confier aux syndicats la gestion et la direction de la production qu'à celle de Lénine, qui considérait l'étatisation des syndicats comme prématurée et estimait que "l'Etat n'étant pas ouvrier, mais ouvrier et paysan avec de nombreuses déformations bureaucratiques", les syndicats avaient à défendre les intérêts ouvriers contre un tel Etat. Mais la thèse partagée par Lénine soulignait bien que le désaccord avec la thèse de Trotsky ne portait pas sur une question de principe, mais résultait de considérations contingentes.
Le fait que Trotsky fut battu à ce Congrès, n'indiqua nullement que la confusion se trouva dissipée quant au rôle que les syndicats avaient à jouer dans la dictature prolétarienne. En effet, les thèses du 3e Congrès de l'I.C. reproduisirent cette confusion en marquant, d'une part que : "avant, pendant et après la conquête du pouvoir, les syndicats demeurent une organisation plus vaste, plus massive, plus générale que le parti et, par rapport à ce dernier, jouent jusqu'à un certain point, le rôle de la circonférence par rapport au centre", et aussi que "les communistes et les éléments sympathisants doivent constituer à l'intérieur des syndicats des groupements communistes entièrement subordonnés au parti communiste dans son ensemble". D'autre part, "qu'après la conquête et l'affermissement du pouvoir prolétarien, l'action des syndicats se transporte surtout dans le domaine de l'organisation économique et ils consacrent presque toutes leurs forces à la construction de l'édifice économique sur les bases socialistes, devenant ainsi une véritable école pratique de communisme".
On sait que, par la suite, les syndicats, non seulement perdirent tout contrôle sur la direction des entreprises, mais qu'ils devinrent des organismes chargés de pousser la production et non de défendre les intérêts des ouvriers. En "compensation", le recrutement administratif de l'industrie s'opéra parmi les dirigeants syndicaux et le droit de grève "théorique" fut maintenu, tandis qu'en fait, les grèves se heurtaient à l'opposition des directions syndicales.
Le critère sûr servant d'appui aux marxistes pour affirmer que l'Etat soviétique est un Etat dégénéré, qui a perdu toute fonction prolétarienne, qui est passé au service du capitalisme mondial, se fonde sur cette vérification historique que l'évolution de l'Etat russe, de 1917 à 1936, loin de tendre vers le dépérissement de celui-ci, s'orienta au contraire vers son renforcement, ce qui devait conduire inévitablement à en faire un instrument de l'oppression et de l'exploitation des ouvriers russes. On assiste à un phénomène tout à fait nouveau dans l'histoire, résultant d'une situation historique sans précédent : l'existence au sein de la société capitaliste d'un Etat prolétarien basé sur la collectivisation des moyens de production, mais où se vérifie un processus social déterminant une exploitation effrénée de la force de travail, sans que cette exploitation puisse être rattachée à la domination d'une classe possédant des droits juridiques sur la production et y exerçant son initiative. Ce "paradoxe" social ne peut, d'après nous, être expliqué par l'affirmation de l'existence d'une bureaucratie érigée en classe dominante (deux notions qui s'excluent réciproquement du point de vue du matérialisme historique) ; mais il ne peut être que l'expression d'une politique qui livra l'Etat russe à l'emprise de la loi d'évolution du capitalisme mondial aboutissant à la guerre impérialiste. Au chapitre consacré à la gestion de l'économie prolétarienne, nous reviendrons sur l'aspect concret de cette caractéristique essentielle de la dégénérescence de l'Etat soviétique, en vertu de laquelle le prolétariat russe se trouve être la proie, non d'une classe exploiteuse nationale, mais de la classe capitaliste mondiale ; un tel rapport économique et politique contient évidemment toutes les prémices capables demain, dans la tourmente de la guerre impérialiste, de provoquer la restauration du capitalisme en Russie, si le prolétariat russe, avec l'aide du prolétariat international, ne parvient pas à balayer les forces qui l'auront précipité dans le massacre.
Tenant compte des considérations que nous avons énoncées quant aux conditions et à l'ambiance historique dans lesquelles naît l'Etat prolétarien, il est évident que le dépérissement de celui-ci ne peut se concevoir en tant que manifestation autonome, se limitant à des cadres nationaux, mais seulement comme le symptôme du développement de la Révolution mondiale.
L'Etat soviétique ne pouvait que dépérir dès l'instant où le parti et l'Internationale ne concevaient plus la révolution russe comme une étape et un chaînon de la révolution mondiale et lui assignaient au contraire, la tâche de construire le "Socialisme en un seul pays". Cela explique pourquoi le poids spécifique des organes étatiques et l'exploitation des ouvriers russes s'accrurent avec le développement de l'industrialisation et des forces économiques, pourquoi la "liquidation des classes" détermina non l'affaiblissement de l'Etat, mais son renforcement, s'exprimant par le rétablissement des trois forces formant la charpente de l'Etat bourgeois : la bureaucratie, la police et l'armée permanente.
Ce phénomène social n'apporte dans la moindre mesure, la démonstration que la théorie marxiste est fausse, qui fonde la révolution prolétarienne sur la collectivisation des forces productives et sur la nécessité de l'Etat transitoire et de la dictature du prolétariat. Ce phénomène est seulement le fruit amer d'une situation historique qui empêche les bolcheviks et l'Internationale d'asservir l'Etat à une politique internationaliste, qui fit d'eux, au contraire, les serviteurs de l'Etat contre le prolétariat, en les engageant dans la voie du socialisme national. Les bolcheviks ne parvinrent pas, au travers des difficultés gigantesques qui les assaillaient, à formuler une politique qui les eut prémunis contre la confusion qui s'établit entre l'appareil étatique de répression, (lequel aurait dû être dirigé seulement contre les classes dépossédées) et les organisations de classe du prolétariat qui auraient dû exercer leur contrôle sur la gestion administrative de l'économie. La disparition de ces organismes obligea l'Etat prolétarien, sur la base de la réalisation du programme national, à diriger ses organes répressifs aussi bien contre le prolétariat que contre la bourgeoisie, afin d'assurer la marche de l'appareil économique. L'Etat, "fléau inévitable" se retourna contre les ouvriers bien que le maintien nécessaire du "principe d'autorité" pendant la période transitoire n'impliquât nullement l'exercice de la contrainte bureaucratique.
Précisément, le problème consistait à ne pas approfondir le décalage existant entre l'impréparation politique et culturelle du prolétariat même et l'obligation que le cours historique lui imposa d'avoir à gérer un Etat. La solution devait tendre, au contraire, à combler cette contradiction.
Mais avec Rosa Luxembourg nous disons qu'en Russie la question de la vie de l'Etat prolétarien et de l'édification du socialisme ne pouvait être que posée et non résolue. C'est aux fractions marxistes à extraire de la Révolution russe les données essentielles qui permettront au prolétariat, dans le flux des révolutions nouvelles, de résoudre les problèmes de la Révolution mondiale et de l'instauration du communisme.
(A suivre)
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Communisme [27]
Heritage de la Gauche Communiste:
Histoire du mouvement ouvrier : la CNT face à la guerre et à la révolution (1914-1919)
- 5536 reads
Les quatorze premières années du 20e siècle marquent l'apogée du capitalisme. On les appelait "La Belle Époque". L'économie prospérait sans cesse, les inventions et les découvertes scientifiques s'enchaînaient les unes aux autres, une atmosphère d'optimisme envahissait la société. Le mouvement ouvrier a été contaminé par cette ambiance, ce qui s'exprimait par l'accentuation en son sein des tendances réformistes et des illusions selon lesquelles on pourrait arriver pacifiquement au socialisme à travers des conquêtes successives[1].
Pour toutes ces raisons, l'éclatement de la Première Guerre mondiale a constitué, pour ceux qui vivaient à cette époque, un choc brutal, une énorme décharge électrique. Les doux espoirs d'un progrès ininterrompu qui avaient émoussé les esprits, se sont transformés d'un seul coup en un terrible cauchemar. Une guerre d'une brutalité et d'une étendue inédites apportait de toutes parts ses effets dévastateurs : les hommes tombaient comme des mouches sur les champs de bataille ; le rationnement, l'état de siège, le travail militarisé s'implantaient à l'arrière. L'optimisme débordant s'est transformé en un pessimisme paralysant.
Les organisations prolétariennes se voyaient soumises à une épreuve dramatique. Les événements se sont précipités à une vitesse vertigineuse. En 1913 - malgré les gros nuages des tensions impérialistes - tout semblait rose. En 1914, la guerre éclatait. En 1915 commençaient les premières ripostes contre la guerre. En 1917 la révolution éclatait en Russie. Du point de vue historique, c'est un laps de temps extrêmement court. La conscience prolétarienne, qui n'a pas de réponses toutes faites, ni de recettes toutes prêtes pour faire face à toutes les situations mais qui se base sur une réflexion et un débat en profondeur, se trouvait face à un énorme défi. Les épreuves de la guerre et de la révolution - les deux événements décisifs de la vie contemporaine -se sont présentées successivement dans un délai de trois ans à peine.
Les organisations prolétariennes en Espagne face à l'épreuve de la guerre
Nous avons déjà mis en évidence dans le premier article sur l'histoire de la CNT[2] le retard du capitalisme espagnol et les contradictions qui le tenaillaient. L'Espagne s'est déclarée neutre face à la guerre et certains secteurs du capital national (surtout en Catalogne) ont fait des affaires florissantes en vendant aux deux camps toutes sortes de produits. Cependant, la guerre mondiale a frappé durement les ouvriers et toutes les couches travailleuses, notamment à travers une forte inflation. En même temps, le sentiment élémentaire de solidarité face aux souffrances que subissaient leurs frères des autres pays, a provoqué une forte inquiétude. Tout cela a interpellé les organisations ouvrières.
Cependant, les deux grandes organisations ouvrières qui existaient alors - le PSOE et la CNT - ont réagi de façon très différente. La majorité du PSOE a précipité son intégration définitive à l'État capitaliste. Par contre, la majorité de la CNT s'est orientée vers une position internationaliste et révolutionnaire.
Le Parti socialiste (PSOE) a accéléré sa dégénérescence qui était déjà en cours dans la période précédente[3] : il a pris clairement parti pour la gang de l'Entente (l'axe franco-britannique) et a fait de l'intérêt national sa devise[4]. Avec un cynisme indigne, le rapport du 10e Congrès (octobre 1915) déclarait : "En ce qui concerne la guerre européenne, depuis le début nous suivons le point de vue de Iglesias et des circulaires du comité national : les nations alliées défendent les principes démocratiques contre l'attaque barbare de l'impérialisme allemand et, par conséquent, sans méconnaître l'origine capitaliste et le germe de l'impérialisme et du militarisme qui existaient dans toutes les nations, nous préconisons la défense des pays alliés". Seule une toute petite minorité, assez confuse et timide, a affirmé un point de vue internationaliste. Verdes Montenegro a émis un vote particulier rappelant que "la cause de la guerre est le régime capitaliste dominant et non le militarisme ou la volonté des puissances couronnées ou non couronnées des divers pays" et exigeant que le Congrès "s'adresse aux partis socialistes de tous les peuples en lutte en leur demandant d'accomplir leurs devoirs envers l'Internationale".
La CNT face à la guerre mondiale : une courageuse réponse internationaliste
Quand éclate la guerre mondiale, la CNT est légalement dissoute. Cependant, des sociétés ouvrières de Barcelone maintiennent leur tradition et publient, en mai 1914, un Manifeste contre le militarisme. Anselmo Lorenzo, militant ouvrier survivant de la Première Internationale et fondateur de la CNT, dénonce dans un article posthume[5] la trahison de la social-démocratie allemande, de la CGT française et des Trade Unions anglaises pour "avoir sacrifié leurs idéaux sur l'autel de leurs patries respectives, en niant le caractère fondamentalement international du problème social"[6]. Face à la guerre il comprend que la solution n'est pas "une hégémonie signée par des vainqueurs et des vaincus", mais la renaissance de l'Internationale : "animés par un optimisme rationnel, les salariés qui conservent la tradition de l'Association internationale des Travailleurs, avec son programme historique et intangible, se présentent comme les sauveurs de la société humaine".
En novembre 1914, un autre Manifeste signé par des groupes anarchistes, des syndicats et des sociétés ouvrières de toute l'Espagne développe les mêmes idées : dénonciation de la guerre, dénonciation des deux gangs rivaux, nécessité d'une paix sans vainqueurs ni vaincus qui "ne pourra être garantie que par la révolution sociale" et il se termine par un appel à la constitution urgente d'une Internationale[7].
L'inquiétude et la réflexion face au problème de la guerre conduit le cercle culturel syndicaliste de El Ferrol[8] (Galice) à lancer, en février 1915, un appel "à toutes les organisations ouvrières du monde pour organiser un congrès international" contre la guerre.
Les organisateurs n'ont pas réussi à se donner les moyens de réaliser cette proposition, les autorités espagnoles ont interdit immédiatement la tenue du Congrès et ont pris des dispositions pour arrêter les délégués étrangers. De plus, le PSOE a lancé une campagne féroce contre cette initiative. Cependant, le Congrès a réussi à se réunir, malgré tout, le 29 avril 1915 avec la participation de délégués anarcho-syndicalistes en provenance du Portugal, de la France et du Brésil[9].
Une deuxième cession a pu être organisée. La discussion sur les causes et la nature de la guerre fut très pauvre : on rendait "tous les peuples" responsables de celle-ci[10] et on mentionnait formellement la méchanceté du régime capitaliste. Tout était centré sur "que faire ?". Sur ce terrain, il était proposé "comme moyen pour mettre fin à la guerre européenne l'approbation de la grève générale révolutionnaire".
On n'a pas tenté de comprendre les causes de la guerre d'un point de vue historique et mondial, il n'y a pas eu non plus d'effort pour comprendre la situation du prolétariat mondial et de quels moyens il disposait pour lutter contre la guerre. On ne faisait confiance qu'au volontarisme activiste de l'appel à la "grève générale révolutionnaire". En dépit de ces faiblesses, le Congrès est parvenu à des conclusions très concrètes. Une campagne énergique contre la guerre fut organisée qui s'est exprimée dans de nombreux meetings, des démonstrations de rue et des manifestes ; un appel a été lancé pour la constitution d'une Internationale ouvrière "dans le but d'organiser tous ceux qui luttent contre le Capital et l'État" ; et, surtout, a été pris la décision de reconstituer la CNT qui, effectivement, s'est réorganisée en Catalogne à partir d'un noyau de jeunes participants au Congrès de Ferrol qui ont décidé de reprendre la publication de la Soli (Solidaridad Obrera -"Solidarité ouvrière"- l'organe traditionnel de la Confédération). A l'été 1915, la CNT compte déjà 15 000 militants qui, par la suite, augmentent de manière spectaculaire.
Il est très significatif que la force ayant impulsé la reconstitution ait été l'opposition à la guerre. L'activité centrale de la CNT dans cette période était la lutte contre la guerre en lien avec le soutien enthousiaste aux luttes revendicatives qui se multipliaient depuis la fin de 1915.
La CNT manifeste une claire volonté de discussion et une grande ouverture face aux positions des Conférences de Zimmerwald et de Kienthal qui sont saluées avec enthousiasme. Elle discute et collabore avec les groupes socialistes minoritaires qui, en Espagne, s'opposent à la guerre. Il y a un grand effort de réflexion pour comprendre les causes de la guerre et les moyens de lutter contre celle-ci. Face aux visions idéalistes et basées sur l'idée que "tous les peuples sont coupables" qui s'étaient exprimées à Ferrol, les éditoriaux de la Soli sont beaucoup plus clairs : ils insistent sur la culpabilité du capitalisme et de ses gouvernements, ils soutiennent les positions de la Gauche de Zimmerwald (Lénine) et signalent que "les classes capitalistes alliées veulent que la paix soit due à une victoire militaire ; nous et tous les travailleurs, que la fin de la guerre soit imposée par le soulèvement du prolétariat des pays en guerre."("Sobre la paz dos criterios" ("Deux critères sur la paix"), Solidaridad Obrera , juin 1917).
Il est très important qu'ait eu lieu au sein de la CNT cette polémique très ferme contre les positions favorables à la participation à la guerre émanant du secteur de l'anarchisme dirigé par Kropotkine et Malato (auteurs du fameux Manifeste des 16 où est préconisé le soutien au gang de l'Entente) et qu'une minorité soutenait au sein même de la CNT. La Soli et Tierra y Libertad se prononcent clairement contre le Manifeste des 16 et réfutent systématiquement ses positions. La CNT rompt clairement avec la CGT française, dont la position est qualifiée d' "orientation tordue, qui n'a pas répondu aux principes internationalistes".
En 1916, un éditorial de la Soli réaffirme catégoriquement le principe internationaliste : "Quel est le nerf de l'internationalisme ? Karl Marx et Michel Bakounine nous l'ont présenté dans toute sa robustesse. Nous le défendons sans nous préoccuper des conséquences et nous comprenons qu'après la guerre, les principes de l'internationalisme redeviendront le stimulant de la Révolution Sociale (...) Nous, les ouvriers espagnols, nous avons plus d'affinité avec les ouvriers de France, d'Allemagne, de Russie, etc. qu'avec la bourgeoisie compatriote. Celle-ci est notre ennemie, pour laquelle nous ne faisons pas de quartier, et le prolétariat des autres pays, pour défendre des intérêts et des aspirations identiques aux nôtres, est notre allié, notre compatriote dans l'Internationale qui se donne pour but la disparition du régime capitaliste (...). Nous ne pouvons avoir aucune solidarité avec l'État, même pour défendre l'intégrité nationale".(cité par A. Bar, pages 433-4).
La CNT face à la révolution russe
La révolution de février 1917, bien qu'elle ait été considérée comme de nature bourgeoise, fut saluée avec joie : "Les révolutionnaires russes n'ont pas abandonné les intérêts du prolétariat qu'ils représentaient, entre les mains des capitalistes comme l'ont fait les socialistes et les syndicalistes des pays alliés" ; il a été souligné l'importance du "Soviet, c'est-à-dire, le Conseil des ouvriers et des soldats", qui a opposé son pouvoir à celui de la bourgeoisie représentée par le Gouvernement provisoire, de façon telle que celle-ci "a dû capituler, lui [au Soviet] reconnaître une personnalité propre, accepter sa participation directe et effective... La véritable force réside dans le prolétariat".[11]
Les soviets sont identifiés aux syndicats révolutionnaires : "Les Soviets représentent aujourd'hui en Russie ce qu'étaient les fédérations ouvrières en Espagne, bien que leur composition soit plus hétérogène que celles-ci, puisqu'ils ne sont pas des organismes de classe bien que la majorité de leurs composants soient ouvriers et dans lesquels ont une influence prépondérante ceux qu'on appelle maximalistes, anarchistes, pacifistes, qui suivent Lénine et Maxime Gorki" (Buenacasa dans la Soli, novembre 1917). Comme nous le verrons dans un prochain article, cette identification entre soviets et syndicats révolutionnaires eut des conséquences négatives ; cependant le plus important est que la forme soviet ait été perçue comme l'expression de la force révolutionnaire du prolétariat international. Le 5e Congrès national des Agriculteurs[12] qui se tint en mai 1917 déterminait clairement la perspective : "le capitalisme et l'État politique se précipitent vers leur ruine ; la guerre actuelle, en provoquant des mouvements révolutionnaires comme celui de Russie et d'autres qui vont lui succéder de façon inévitable, accélère leur chute".
La Révolution d'Octobre a provoqué un énorme enthousiasme. Elle était vue comme un véritable triomphe du prolétariat. Tierra y Libertad affirmait, dans son numéro du 7 novembre 1917, que "les idées anarchistes ont triomphé" et, dans celui du 21 novembre, que le régime bolchevique était "guidé par l'esprit anarchiste du maximalisme". La réception, dans cette période, du livre de Lénine L'État et la Révolution a suscité une étude très attentive qui tirait la conclusion que cette brochure "établissait un pont intégrateur entre le marxisme et l'anarchisme". La Soli affirme dans un éditorial que Octobre est "le chemin à suivre" : "Les russes nous montrent le chemin à suivre. Le peuple russe triomphe : nous apprenons de ses actes pour triompher à notre tour, en arrachant par la force ce qu'on nous refuse et ce qu'on nous a pris".
Buenacasa, un remarquable militant anarchiste de l'époque, rappelle dans son ouvrage El movimiento obrero espanol 1886-1926 ("Le mouvement ouvrier espagnol "), édité à Barcelone, 1928 : "Qui en Espagne -étant anarchiste - a dédaigné pour lui-même le qualificatif de Bolchevik ?" Dans le but de faire le bilan d'une année de révolution, la Soli publie en première page rien moins qu'un article de Lénine dont le titre est "Un an de dictature prolétarienne : 1917-1918. L'œuvre sociale et économique des Soviets russes", accompagné d'une note de la Soli dans laquelle est défendue la dictature du prolétariat, signalant l'importance du travail transformateur "que les ouvriers russes ont réalisé dans tous les domaines de la vie en un an seulement, lesquels sont les maîtres du pouvoir", et les Bolcheviks y sont également qualifiés de héros : "Idéalistes sincères, mais hommes pratiques et réalistes à la fois, le moins que nous puissions désirer c'est qu'en Espagne se produise une transformation au moins aussi profonde qu'en Russie, et pour cela il est nécessaire que les travailleurs espagnols, manuels et intellectuels, suivent l'exemple de ces héros bolcheviques" (Soli, 24 novembre 1918) ; il est ajouté, dans un article d'opinion, que "le bolchevisme représente la fin de la superstition, du dogme, de l'esclavage, de la tyrannie, du crime (...) Le bolchevisme, est la nouvelle vie à laquelle nous aspirons ; c'est la paix, l'harmonie, la justice, l'équité, c'est la vie que nous désirons et que nous imposerons dans le monde". (J. Viadiu, "Bolcheviks ! Bolcheviks !", dans Soli , 16 décembre 1918).
Tierra y Libertad, en décembre 1917, en vient même à écrire qu'une révolution, du fait de la nécessité d'une confrontation violente, exige des "dirigeants et de l'autorité".
Afin qu'il n'y ait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait de la position officielle de la CNT, le livre de Bar cité précédemment fait référence à un Manifeste, publié par le Comité national de la CNT à l'occasion de la fin de la guerre mondiale, intitulé : "La paix et la révolution", qui avait comme sous-titre une consigne de Lénine - "Seul le prolétariat doit être maître du pouvoir" (12 novembre 1918) - dans lequel il était mis en avant que la révolution russe avait aboli la propriété privée, l'exploitation de l'homme par l'homme et avait établi les lois du communisme, la liberté et la justice (page 445).
Dès le début de la révolution, la CNT a reconnu la vague révolutionnaire internationale et a pris parti en faveur de la formation d'une Internationale qui dirigerait la révolution mondiale : "Brisée par la trahison d'une grande partie de ses représentants les plus significatifs, les Première et Seconde Internationale, il faut former la Troisième, à partir de puissantes organisations exclusivement de classe, pour mettre fin, par la révolution, au système capitaliste et à son fidèle soutien, l'État"(Soli, octobre 1918) et dans le Manifeste : "L'Internationale ouvrière, et personne d'autre, doit être celle qui a le dernier mot, celle qui donnera l'ordre et fixera la date de la poursuite de la guerre sociale sur tout le front contre le capitalisme universel, déjà triomphante en Russie et qui s'étendra aux empires centraux. Le tour de l'Espagne viendra aussi. Fatalement pour le capitalisme".
De la même façon, la CNT a suivi avec le plus grand intérêt les événements révolutionnaires en Allemagne : elle dénonçait la direction social-démocrate comme des "opportunistes, centristes et socialistes nationalistes", en même temps qu'elle saluait "l'idéologie maximaliste de Spartacus" comme "une projection de celle qui triomphait en Russie et dont l'exemple, comme celui de Russie, était quelque chose qu'il fallait imiter en Espagne". Le Manifeste de la CNT se référait effectivement aussi à la révolution en Allemagne : "Regardons la Russie, regardons l'Allemagne. imitons ces champions de la Révolution prolétarienne".
Il est important de noter les débats très intenses au Congrès de la CNT de 1919 qui a discuté séparément deux rapports, l'un sur la révolution russe et l'autre sur la participation à l'IC.
Le premier rapport affirme : "Que la révolution russe incarne, en principe, l'idéal du syndicalisme révolutionnaire. Qu'elle a aboli les privilèges de classe et de caste en donnant le pouvoir au prolétariat, afin qu'il puisse lui-même se procurer le bonheur et le bien-être auxquels il a droit indiscutablement, en instaurant la dictature prolétarienne transitoire afin d'assurer la conquête de la révolution ; (...) [Le Congrès devrait déclarer la CNT unie à celle-ci] inconditionnellement, en la soutenant dans toute la mesure de ses moyens moraux et matériels"[13]. (cité dans A. Bar, page 526).
Un des rapporteurs sur la révolution russe fut très tranchant : "La révolution russe incarne l'idéal du syndicalisme révolutionnaire qui est de donner le pouvoir, tous les éléments de la production et de la socialisation de la richesse au prolétariat ; je suis absolument d'accord avec l'action révolutionnaire russe ; les actes ont plus d'importance que les mots. Une fois que le prolétariat s'est rendu maître du pouvoir, tout ce qu'il aura décidé sera réalisé dans ses différents syndicats et assemblées". Autre intervention : "Je me propose de démontrer que la révolution russe, en adoptant dès la seconde révolution d'Octobre une réforme complète de son programme socialiste, est d'accord avec l'idéal qu'incarne la CNT espagnole".
De fait, comme le dit Bar : "Contre la révolution russe, il n'y a pas eu une seule manifestation ; absolument toutes les interventions se sont exprimées sur des tons admiratifs et laudatifs envers l'action révolutionnaire russe... La grande majorité des interventions se sont exprimées clairement en faveur de la révolution russe, soulignant l'identité existant entre les principes et les idéaux de la CNT et ceux incarnés par cette révolution ; le rapport lui-même s'était exprimé dans ce sens".
Cependant, il n'y avait pas la même unanimité sur la question de l'adhésion à l'Internationale communiste que beaucoup hésitaient à considérer comme le prolongement de la révolution russe et comme un instrument de son extension au niveau mondial et qu'ils considéraient a priori comme un organisme "autoritaire". Le rapport sur l'adhésion à l'IC lui-même préconisait une Internationale syndicaliste et considérait que l'IC "bien qu'adoptant les méthodes de lutte révolutionnaires, poursuit des buts fondamentalement opposés à l'idéal anti-autoritaire et décentralisateur dans la vie des peuples proclamé par la CNT".
Concernant l'adhésion à l'IC, le Congrès était divisé. Il y avait trois tendances fondamentales :
- la première, syndicaliste "pure", considérait l'IC comme un organe politique et bien qu'elle ne lui fût pas hostile, elle préférait organiser une "Internationale syndicaliste révolutionnaire". Segui - militant qui avait un poids très important dans la CNT de l'époque - sans s'opposer à l'entrée dans celle-ci, voyait plutôt cette entrée comme un "moyen tactique" : "nous sommes partisans de l'entrée dans la Troisième Internationale parce que cela cautionnera notre conduite dans l'appel que la CNT d'Espagne va lancer aux organisations syndicales du monde pour constituer la véritable, l'unique, l'authentique Internationale des travailleurs" (cité dans A. Bar, page 531).
- la seconde tendance se prononçait de façon décidée pour l'entrée dans l'IC et était défendue par Arlandis Buenacasa et Carbo qui considéraient l'Internationale comme le produit et l'émanation de la révolution russe[14].
- la troisième, plus anarchiste, était partisane de collaborer fraternellement mais considérait que l'IC ne partageait pas les principes anarchistes.
La motion approuvée finalement par le Congrès disait :
"Au Congrès :
Le Comité National, comme résumé des idées exposées par les différents camarades qui ont pris la parole dans la session du 17 en se référant au thème de la révolution russe, propose :
Premièrement, que la Confédération Nationale du Travail se déclare un ferme défenseur des principes de la Première Internationale, soutenus par Bakounine.
Deuxièmement, elle déclare adhérer, et provisoirement, à la Troisième Internationale pour le caractère révolutionnaire qui y préside, tandis que s'organise et se tient le Congrès international en Espagne qui doit jeter les bases devant régir la véritable Internationale des travailleurs.
Le Comité Confédéral. Madrid, 17 décembre 1919."[15]
Éléments de bilan
Ce survol nécessairement rapide de la réaction de la CNT face à la Première Guerre mondiale et à la première vague révolutionnaire mondiale démontre de façon frappante la profonde différence entre la CGT française anarcho-syndicaliste et la CNT espagnole de l'époque : alors que la CGT sombre dans la trahison en soutenant l'effort de guerre de la bourgeoisie, la CNT travaille pour la lutte internationaliste contre la guerre et se déclare partie prenante de la révolution russe.
En partie, cette différence est le résultat de la situation spécifique de l'Espagne. Le pays n'est pas impliqué directement dans la guerre, et la CNT n'est donc pas confrontée directement au besoin de prendre position face à l'invasion par exemple ; de même, la tradition nationale en Espagne est évidemment beaucoup moins forte qu'en France où même les révolutionnaires ont tendance à être obnubilés par les traditions de la Grande Révolution française. On peut comparer la situation espagnole à celle de l'Italie qui n'est pas impliquée dans la guerre dès 1914 et où le Parti socialiste reste majoritairement sur des positions de classe.
De même, et contrairement à la CGT française, la CNT n'est pas un syndicat bien établi dans la légalité qui risque de perdre ses fonds et son appareil à cause des mesures d'exception prises en temps de guerre. On peut ici faire un parallèle avec les Bolcheviks en Russie, également aguerris par des années de clandestinité et de répression.
L'internationalisme sans compromis de la CNT en 1914 est la démonstration éclatante de sa nature prolétarienne à l'époque. De même, face à la révolution en Russie et en Allemagne, ce qui la distingue est la capacité d'apprendre du processus révolutionnaire et de la pratique de la classe ouvrière elle-même, à un point qui peut étonner aujourd'hui. Ainsi la CNT prend clairement position pour la révolution sans essayer d'imposer les schémas organisationnels du syndicalisme révolutionnaire (la révolution russe "incarne, en principe, l'idéal du syndicalisme révolutionnaire") ; elle reconnaît la nécessité de la dictature du prolétariat et se range fermement et explicitement du côté des Bolcheviks. A partir de cette position, il ne fait aucun doute qu'elle a collaboré loyalement et discuté avec un esprit ouvert avec les organisations internationalistes en laissant de côté toute considération sectaire. Les militants de la CNT n'ont pas regardé la révolution russe à travers le prisme du mépris pour le "politique" ou "l'autoritaire" mais en sachant apprécier à travers elle le combat collectif du prolétariat. Ils ont exprimé cette attitude avec un esprit critique sans renoncer en aucune façon à leurs propres convictions. Le comportement prolétarien de la CNT dans la période de 1914-1919 constitue sans aucun doute un des meilleurs apports qui ont émané de la classe ouvrière en Espagne.
Néanmoins, on peut distinguer certaines faiblesses spécifiques au mouvement anarcho-syndicaliste qui pèseront sur le développement ultérieur de la CNT et sur son engagement aux côtés de la révolution en Russie. Il faut souligner que la CNT en 1914 se trouve essentiellement dans la même situation que Monatte, de l'aile internationaliste de la CGT française. Ni les anarcho-syndicalistes, ni les syndicalistes révolutionnaires n'ont réussi à bâtir une Internationale au sein de laquelle pouvait surgir une gauche révolutionnaire comparable à la gauche de la social-démocratie autour de Lénine et de Luxemburg notamment. La référence à l'AIT est une référence historique à une période révolue, qui n'est plus vraiment de mise dans la nouvelle situation. En 1919, la seule Internationale qui existe, c'est la nouvelle Internationale communiste. Le débat dans la CNT sur l'adhésion à l'IC et, notamment, la tendance à lui préférer une Internationale syndicale qui en 1919 n'existait pas (une Internationale syndicale rouge allait être créée en 1921 dans une tentative de concurrencer les syndicats qui avaient soutenu la guerre), sont indicatifs du danger du rejet doctrinaire par les anarchistes de tout ce qui ressemble à la "politique".
La CNT dans la période de 1914-1919 répondit clairement à partir d'un terrain internationaliste et d'ouverture à l'Internationale communiste (avec l'impulsion active, comme nous venons de le voir, de militants remarquables et de groupes anarchistes). Face à la barbarie de la guerre mondiale qui révélait la menace dans laquelle le capitalisme enfonce l'humanité, face au début de la réponse prolétarienne à la barbarie avec la révolution russe, la CNT a su être avec le prolétariat, avec l'humanité opprimée, avec la lutte pour la transformation révolutionnaire du monde.
L'attitude de la CNT changea radicalement à partir de la moitié des années 1920, où on a observé un net repli vers le syndicalisme, l'apolitisme, le rejet de l'action politique et une attitude fortement sectaire face au marxisme révolutionnaire. Pire encore, lorsqu'on arrive aux années 1930, la CNT n'est plus l'organisation résolument internationaliste et prolétarienne de 1914, elle est devenue l'organisation qui allait participer au gouvernement de la Catalogne et de la République espagnole et, à ce titre, participer au massacre des ouvriers, notamment lors des évènements de 1937.
Comment et pourquoi ce changement s'est opéré sera l'objet des prochains articles de cette série.
RR et CMir (30 mars 2007)
[1] La résistance face à cette marée réformiste s'exprimait d'un côté, dans l'aile révolutionnaire de la social-démocratie et, de façon plus partielle, dans le syndicalisme révolutionnaire et également dans des secteurs de l'anarchisme.
[2] Revue internationale n°128, "La CNT : naissance du syndicalisme révolutionnaire en Espagne (1910-1913)" [44]
[3] Ce n'est pas l'objet de cet article d'analyser l'évolution du PSOE. Cependant, rappelons que ce parti - comme nous l'avions déjà mis en évidence dans le premier article de cette série - était un des plus à droite de la 2e Internationale ; il souffrait d'une forte dérive opportuniste qui l'a précipité dans les bras du capital. La "Conjuncion Republicano-socialista" de 1919, une alliance électorale bancale qui a fourni un siège électoral à son leader, Pablo Iglesias, fut un des moments clef dans ce processus.
[4] Fabra Ribas, membre du PSOE critique vis-à-vis de la direction mais clairement belliciste, se lamentait du fait que le capital espagnol ne participerait pas à la guerre : "Si la force militaire et navale de l'Espagne avait une valeur effective, si elle pouvait contribuer avec son aide à la défaite du kaiserisme et si l'armée et la marine espagnoles étaient des institutions vraiment nationales, nous serions de fervents partisans de l'intervention armée avec les alliés". (Extrait de son livre El socialismo y el conflicto europeo ("Le socialisme et le conflit européen"), Valencia, sans date de publication, approximativement à la fin de 1914).
[5] Il mourut le 30 novembre 1914.
[6] Publié dans l'Almanach annuel de Tierra y Libertad ("Terre et Liberté"), janvier 1915. Tierra y Libertad était une revue anarchiste proche des milieux de la CNT.
[7] On peut noter la convergence de ces idées avec celles que défendirent Lénine, Rosa Luxemburg et d'autres militants internationalistes dès le début de la guerre.
[8] Ferrol est une ville industrielle, basée sur les chantiers navals et les arsenaux, avec un prolétariat ancien et combatif.
[9] Ceux-ci purent seulement assister à la première session car ils furent arrêtés par les autorités espagnoles et expulsés immédiatement.
[10]"Que cessent les critiques sur le fait que les socialistes allemands portent la responsabilité, ou les français, que Malato ou Kropotkine étaient des traîtres à l'Internationale. Belligérants et neutres, nous avons notre part de culpabilité dans le conflit pour avoir trahi les principes de l'Internationale". (Texte de convocation du Congrès publié dans Tierra y Libertad, mars 1915).
[11] Cité dans A. Bar, La CNT en los anos rojos ("La CNT dans les années rouges"), page 438. Ce livre, que nous avons déjà cité dans le premier article de la série sur l'histoire de la CNT, est assez bien documenté.
[12] En étroite relation avec la CNT.
[13] Livre de Bar, cité précédemment, page 526.
[14] La délégation du syndicat de la métallurgie de Valence déclara : "s'il existe une affinité claire et concrète entre la Troisième Internationale et la révolution russe et que la CNT appuie celle-ci, comment pouvons-nous être séparés de cette Troisième Internationale ?"
[15] Il convient d'ajouter que quand, l'été 1920, Kropotkine a envoyé un "Message aux travailleurs des pays d'Europe occidentale", s'opposant à la révolution russe et aux Bolcheviks, Buenacasa (remarquable militant anarchiste auquel nous avons fait référence précédemment) qui était alors l'éditeur de Solidaridad Obrera à Bilbao et un des porte-parole officiels de la CNT, a dénoncé ce "message" et a pris parti pour la révolution russe, les Bolcheviks et la dictature du prolétariat.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [45]
Evènements historiques:
Courants politiques:
- Anarchisme officiel [47]
Approfondir:
Revue Internationale n° 130 - 3e trimestre 2007
- 2906 reads
Editorial : partout dans le monde, face aux attaques capitalistes, la reprise de la lutte de classe
- 2410 reads
La reprise de la lutte internationale de la classe ouvrière se poursuit. Combien de fois au cours de sa longue histoire, les patrons et les gouvernants ont-ils répété à la classe ouvrière qu'elle n'existait plus, que ses luttes pour défendre ses conditions d'existence étaient anachroniques et que son but ultime, renverser le capitalisme et construire le socialisme, était devenu un vestige désuet du passé ? Après 1989, suite à l'effondrement de l'URSS et du bloc de l'Est, ce vieux message sur la non existence du prolétariat a connu un nouveau souffle qui a permis de maintenir la désorientation dans les rangs ouvriers pendant plus d'une décennie. Aujourd'hui, ce rideau de fumée idéologique se dissipe et, à nouveau, on peut voir et reconnaître un développement des luttes prolétariennes.
En fait, depuis 2003, les choses ont commencé à changer. Dans la Revue internationale n°119, du quatrième trimestre de 2004, le CCI a publié une résolution sur la lutte de classe dans laquelle il identifiait un tournant dans les perspectives de la lutte prolétarienne à la suite des luttes significatives contre les attaques sur les retraites en France et en Autriche. Trois ans plus tard, cette analyse semble se confirmer de plus en plus. Mais avant d'en venir aux illustrations les plus récentes de cette perspective, examinons l'une des conditions majeures pour le développement de la lutte de classe.
L'intensification de l'austérité et l'usure des discours "d'accompagnement" des attaques
L'une des explications avancée en 2003 au renouveau de la lutte de classe était constituée par la brutalité renouvelée des sacrifices imposés à la classe ouvrière, une classe ouvrière qu'on prétendait inexistante. "La dernière période, principalement depuis l'entrée dans le 21e siècle, a remis à l'ordre du jour l'évidence de la crise économique du capitalisme, après les illusions des années 1990 sur la "reprise", les "dragons" et sur la "révolution des nouvelles technologies". En même temps, ce nouveau pas franchi par la crise du capitalisme a conduit la classe dominante à intensifier la violence de ses attaques économiques contre la classe ouvrière, à généraliser ces attaques." (Revue internationale n°119 [48])
En 2007, l'accélération et l'extension des attaques contre le niveau de vie de la classe ouvrière n'ont pas ralenti mais se sont, au contraire, amplifiées. Parmi les pays capitalistes avancés, l'expérience britannique en est une illustration parlante et tout à fait significative ; mais elle montre aussi comment l'"emballage" idéologique qui accompagne ces attaques perd de son pouvoir de mystification aux yeux de ceux qui les subissent.
L'ère du gouvernement "New Labour" du premier ministre Tony Blair, entré en fonction en 1997 à un moment où l'optimisme ambiant à propos du capitalisme était au beau fixe, vient juste de se terminer. A l'époque, dans la lignée de l'euphorie des années 1990 qui a suivi l'effondrement du bloc de l'Est, le "New Labour" annonçait qu'il avait rompu avec les traditions du "vieux" Labour ; il ne parlait plus de "socialisme" mais d'une "troisième voie" ; il ne parlait plus de la classe ouvrière mais du peuple, plus non plus de division dans la société mais de participation. De vastes sommes d'argent furent dépensées pour propulser ce message populiste. Il fallait démocratiser la bureaucratie étatique à tous les niveaux. L'Ecosse et le Pays de Galles furent gratifiés de parlements locaux. Une nouvelle mairie fut attribuée à la ville de Londres. Et surtout, toutes les coupes dans le niveau de vie de la classe ouvrière, en particulier dans le secteur public, furent présentées comme des "réformes" de "modernisation". Et les victimes de ces réformes avaient même leur mot à dire sur la façon de les mettre en œuvre.
Ce nouvel emballage pour des mesures d'austérité des plus traditionnelles ne pouvait connaître un certain succès que dans la mesure où la crise économique pouvait être plus ou moins dissimulée. Mais aujourd'hui les contradictions deviennent trop criantes. L'ère Blair, au lieu de réaliser une plus grande égalité, a vu au contraire une augmentation de la richesse à un pôle de la société et de la pauvreté à l'autre. Cela n'affecte pas seulement les secteurs les plus pauvres de la classe ouvrière comme les jeunes, les chômeurs et les retraités qui sont réduits à une pauvreté abjecte, mais également des secteurs un peu plus à l'aise financièrement qui font un travail qualifié et ont accès au crédit. Selon les experts-comptables Ernst & Young, ces derniers ont perdu 17% de leur pouvoir d'achat dans les quatre dernières années comme conséquence notamment de l'augmentation du coût des frais domestiques (alimentation, services, logement, etc.).
Mais au delà de raisons purement économiques, d'autres facteurs poussent la classe ouvrière à réfléchir plus en profondeur sur son identité de classe et ses buts propres. La politique étrangère britannique ne peut plus prétendre revendiquer les valeurs "éthiques" que le "New Labour" proclamait en 1997 puisque, comme les aventures en Afghanistan et en Irak l'ont montré, cette politique se base sur de sordides intérêts typiquement impérialistes, qu'on avait essayé de masquer par des mensonges aujourd'hui avérés. Au coût des aventures militaires supporté par le prolétariat, s'ajoute un nouveau fardeau : c'est sur lui que s'exercent le plus lourdement les effets de la dégradation écologique de la planète.
La semaine du 25 au 29 juin dernier, celle où Gordon Brown a succédé comme premier ministre à Tony Blair, a été tout à fait caractéristique de la situation : la guerre en Irak a fait de nouvelles victimes dans les forces britanniques, 25 000 maisons ont été endommagées par les inondations à la suite de chutes de pluie sans précédent en Grande-Bretagne, et les employés des postes ont commencé, pour la première fois depuis plus d'une décennie, une série de grèves nationales contre la baisse des salaires réels et les menaces de réduction d'effectifs. Ces symptômes des contradictions de la société de classe n'ont été que partiellement obscurcis par une campagne d'unité nationale et de défense de l'Etat capitaliste lancée par ce dernier à la suite d'une offensive terroriste "bâclée".
Gordon Brown a donné le ton de la période à venir : il y aura moins de "poudre aux yeux", plus de "travailler dur" et de "faire son devoir".
Dans les autres principaux pays capitalistes aussi on voit s'élever la facture que la bourgeoisie présente à la classe ouvrière pour payer sa crise économique, même si elle ne suit pas le "modèle" britannique.
En France, le mandat du nouveau président Sarkozy est clair : prendre des mesures d'austérité. Il faut faire des sacrifices pour combler le trou de douze milliards d'euros du budget de la Sécurité sociale. Une stratégie, risiblement appelée "flexisécurité", a pour but de faciliter l'augmentation des heures de travail, la limitation des salaires et le licenciement des ouvriers. De nouvelles attaques visant le service public sont aussi en préparation
Aux Etats-Unis, qui exhibent les meilleurs taux de profit officiels des pays capitalistes avancés, il y avait, en 2005, 37 millions de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté, soit 5 millions de plus qu'en 2001 quand l'économie était officiellement en récession.[1]
Le boom immobilier, alimenté par des facilités d'accès au crédit, a permis jusqu'à présent de masquer la paupérisation croissante de la classe ouvrière américaine. Mais les taux d'intérêt ont augmenté, les crédits non remboursés et les saisies de logement poussent comme des champignons. Le boom immobilier s'est arrêté, le marché des emprunts à garantie minimale s'est effondré en même temps que beaucoup d'illusions sur la sécurité et la prospérité des ouvriers.
Le salaire des ouvriers américains a chuté de 4% entre 2001 et 2006[2]. Les syndicats apportent sans vergogne leur caution à cette situation. Par exemple, le United Auto Workers Union (syndicat des ouvriers de l'automobile) a récemment accepté une réduction de presque 50% du taux horaire et une baisse brutale des indemnités de licenciements pour 17 000 ouvriers de l'usine Delphi à Detroit qui produit des pièces détachées automobiles[3]. (Au début de l'année, était annoncée la fermeture de l'usine de Puerto Real (Cadix, Espagne) de la même entreprise Delphi, avec à la clé 4000 ouvriers à la rue.)
Il ne s'agit pas d'une spécificité américaine. Le syndicat ver.di en Allemagne a récemment négocié une baisse de 6% des salaires et une augmentation du temps de travail de 4 heures pour les employés de Deutsche Telekom et a eu le culot d'annoncer qu'il était parvenu à un accord très valable !
Toujours dans l'automobile, aux Etats-Unis, General Motors projette 30 000 licenciements et Ford 10 000 ; en Allemagne, Volkswagen prévoit 10 000 nouveaux licenciements ; en France 5 000 sont prévus à PSA.
BN Amro, première banque des Pays-Bas, et la britannique Barclays, ont annoncé le 23 avril leur fusion qui va entraîner la suppression de 12 800 emplois, tandis que 10 800 autres seront sous-traités. L'avionneur Airbus a d'ores et déjà annoncé la suppression de 10 000 emplois et l'entreprise de télécommunication Alcatel-Lucent, le même nombre.
L'échelle internationale de la reprise de la lutte de classe est étroitement liée au fait que les ouvriers sont fondamentalement confrontés à la même évolution de leurs conditions économiques sur toute la planète. Aussi les tendances que nous venons de décrire brièvement dans les pays développés se reproduisent-elles sous différentes formes pour les travailleurs des pays capitalistes périphériques. Là, nous assistons à l'application encore plus brutale et meurtrière de l'austérité croissante.
L'expansion de l'économie chinoise, loin de représenter une nouvelle ouverture du système capitaliste, dépend en grande partie du dénuement de la classe ouvrière chinoise, c'est-à-dire la réduction de ses conditions de vie en dessous du niveau où elle peut se reproduire et continuer à vivre en tant que classe ouvrière. Le récent scandale sur les méthodes de "recrutement" dans 8 000 briqueteries et petites mines de charbon dans les provinces du Shanxi et du Henan en est un exemple frappant. Ces manufactures dépendaient du kidnapping d'enfants qu'on mettait au travail comme esclaves dans des conditions infernales et qui ne pouvaient être sauvés que si leurs parents réussissaient à les trouver et à venir les chercher. Il est vrai que l'Etat chinois vient d'introduire des lois sur le travail pour empêcher de tels "abus" du système et apporter plus de protection aux travailleurs migrants. Cependant, il est probable que, comme dans le passé, ces lois ne seront pas appliquées. Ce qui sous-tend de telles pratiques ignobles, c'est de toutes façons la logique du marché mondial. Les compagnies américaines font une forte pression contre ces nouvelles lois du travail malgré leur faible portée. Les entreprises multinationales "disent que ces règles accroîtraient de façon substantielle les coûts du travail et réduiraient la flexibilité et certains hommes d'affaires étrangers ont averti qu'ils n'auraient pas d'autre choix que de transférer leurs opérations hors de Chine si on ne changeait pas ces dispositions."[4]
La situation est la même en substance pour la classe ouvrière des pays périphériques qui ne se sont pas ouverts comme la Chine aux capitaux étrangers. En Iran, par exemple, le mot d'ordre économique du président Ahmadinejad est "khodkafa'j" ou "autosuffisance". Cela n'a pas empêché l'Iran de subir la pire crise économique depuis les années 1970, qui a provoqué une chute drastique du niveau de vie de la classe ouvrière, confrontée aujourd'hui à 30% de chômage et 18% d'inflation. Malgré l'augmentation des revenus issus de la hausse des prix du pétrole, l'essence a récemment dû être rationnée vu que, de son exportation, dépend la capacité d'importer les produits raffinés du pétrole ainsi que la moitié des besoins en nourriture.
La lutte de classe est mondiale
Le développement et l'élargissement des attaques contre la classe ouvrière dans le monde entier constituent l'une des principales raisons pour lesquelles la lutte de classe a continué à se développer ces dernières années. Nous ne pouvons faire ici la liste de toutes les luttes ouvrières qui ont eu lieu depuis 2003 à travers la planète et nous avons parlé de beaucoup d'entre elles dans les précédents numéros de la Revue internationale. Nous nous réfèrerons aux dernières.
D'abord, il nous faut insister sur le fait que nous ne pouvons donner une vue d'ensemble complète puisque la lutte de classe internationale n'est pas officiellement reconnue par la société bourgeoise ni par ses médias comme un force historique et distincte qu'il faut comprendre et analyser, et sur laquelle il faudrait attirer l'attention. Tout au contraire, beaucoup de luttes ne sont pas connues ou sont complètement dénaturées. Ainsi, la lutte extrêmement importante des étudiants en France contre le CPE au printemps 2006 a d'abord été ignorée par les médias internationaux pour n'être présentée ensuite que comme une suite des épisodes de violence aveugle qui avaient eu lieu dans les banlieues françaises à l'automne précédent. En d'autres termes, les médias ont cherché à enterrer les leçons de valeur sur la solidarité ouvrière et l'auto-organisation qu'avait apportées ce mouvement.
De façon typique, l'Organisation internationale du Travail, généreusement fondée par les Nations Unies, ne s'intéresse absolument pas aux événements de la lutte de classe internationale. Elle se propose, à la place, de soulager l'horrible situation des milliards de victimes de la rapacité du système capitaliste en défendant leurs droits humains individuels dans le cadre légal des institutions de ce même système.
Cependant, l'ostracisme officiel auquel la classe ouvrière est soumise, constitue a contrario une expression de son potentiel de lutte et de sa capacité à renverser le capitalisme.
Durant l'année passée, en gros depuis que le mouvement massif des étudiants français a pris fin avec le retrait du CPE par le gouvernement la lutte de classe dans les principaux pays capitalistes a cherché à répondre à la pression accélérée sur les salaires et les conditions de travail. Cela a souvent eu lieu à travers des actions sporadiques, dans beaucoup de différents pays et de différentes industries, et il y a eu aussi des menaces de grève.
En Grande-Bretagne, en juin 2006, les ouvriers de l'usine automobile de Vauxhall ont débrayé spontanément. En avril de cette année, 113 000 fonctionnaires en Irlande du Nord ont fait un jour de grève. En Espagne, le 18 avril, une manifestation réunissait 40 000 personnes, des ouvriers en provenance de toutes les entreprises de la Baie de Cadix, exprimant leur solidarité dans la lutte avec leurs frères de classe licenciés de Delphi. Le premier mai, un mouvement plus ample encore mobilisait des ouvriers en provenance des autres provinces d'Andalousie. Un tel mouvement de solidarité a en réalité été le résultat de la recherche active d'un soutien, à l'initiative des ouvriers de Delphi, de leurs familles et, notamment, de leurs femmes organisées pour la circonstance dans un collectif ayant pour but de gagner la solidarité la plus large possible.
Au même moment, il y a eu des débrayages spontanés en dehors de toute consigne syndicale dans les usines d'Airbus dans plusieurs pays européens pour protester contre le plan d'austérité de la compagnie. Ce sont souvent de jeunes ouvriers, une nouvelle génération de prolétaires qui ont pris la part la plus active dans ces luttes, notamment à Nantes et Saint-Nazaire en France, où s'est avant tout manifestée une réelle et profonde volonté de développer une solidarité active avec les ouvriers de la production de Toulouse qui avaient cessé le travail.
En Allemagne, pendant 6 semaines a eu lieu toute une série de grèves des employés de Deutsche Telekom contre les réductions dont nous avons parlé plus haut. Au moment où nous écrivons, les cheminots allemands sont en lutte pour les salaires. Il y a eu de nombreuses grèves sauvages, notamment des ouvriers des aéroports italiens.
Mais c'est dans les pays périphériques que nous avons assisté dans la période récente à la poursuite d'une remarquable série de luttes ouvrières explosives et étendues malgré le risque d'une répression brutale et sanglante.
Au Chili, les mineurs du cuivre, une des principales activités économiques du pays, se sont mis en grève. Au Pérou au printemps, une grève illimitée à l'échelle nationale des mineurs du charbon a eu lieu - pour la première depuis 20 ans. En Argentine, en mai et juin, les employés du métro de Buenos Aires ont tenu des assemblées générales et organisé une lutte contre l'accord sur les salaires concocté par leur propre syndicat. L'an dernier en mai au Brésil, les ouvriers des usines Volkswagen ont mené des actions à Sao Paulo. Le 30 mars de cette année, face à la dangerosité de l'état du trafic aérien dans le pays et à la menace que 16 des leurs soient emprisonnés pour fait de grève, 120 contrôleurs aériens ont refusé de travailler, paralysant ainsi 49 des 67 aéroports du pays. Cette action est d'autant plus remarquable que ce secteur est essentiellement soumis à une discipline militaire. Les ouvriers ont néanmoins résisté à l'intense pression exercée par l'Etat, aux menaces et aux calomnies contre eux, y compris de celles émanant de ce prétendu ami des ouvriers qu'est le président Lula lui-même. Depuis plusieurs semaines, un mouvement de grèves affectant en particulier la métallurgie, le secteur public et les universités constitue le plus important mouvement de classe depuis 1986 dans ce pays.
Au Moyen-Orient, de plus en plus ravagé par la guerre impérialiste, la classe ouvrière a relevé la tête. Des grèves dans le secteur public ont eu lieu à l'automne dernier en Palestine et en Israël sur une question similaire : les salaires non payés et les retraites. Une vague de grèves a touché de nombreux secteurs en Egypte au début de l'année : dans les usines de ciment, les élevages de volaille, les mines, les secteurs des bus et des chemins de fer, dans le secteur sanitaire et, surtout, dans l'industrie textile, les ouvriers ont déclenché une série de grèves illégales contre la forte baisse des salaires réels et les réductions de primes. Des prises de position particulièrement claires d'ouvriers du textile mettent clairement en évidence la conscience d'appartenir à une même classe, de combattre un même ennemi de même que .la nécessité de la solidarité de classe contre les divisions entre entreprises et celles créées par les syndicats (lire à ce propos notre presse territoriale, Révolution Internationale n° 380, pour nos lecteurs en langue française). En Iran, selon le journal d'affaires, le Wall Street Journal, "une série de grèves a eu lieu à Téhéran et dans au moins 20 grandes villes depuis l'automne dernier. L'an dernier, une grande grève des ouvriers des transports à Téhéran a paralysé cette ville de 15 millions d'habitants pendant plusieurs jours. Actuellement, des dizaines de milliers d'ouvriers d'industries aussi diverses que les raffineries de gaz, les usines de papier et les imprimeries de journaux, l'automobile et les mines de cuivre sont en grève."[5]Le premier mai, les ouvriers iraniens ont manifesté dans différentes villes au cri de "Non à l'esclavage salarié ! Oui à la liberté et à la dignité !".
En Afrique occidentale, un mouvement de grèves en Guinée, contre des salaires de famine et l'inflation du prix de l'alimentation, a embrasé tout le pays en janvier et février, alarmant non seulement le régime de Lansana Conté mais aussi la bourgeoisie de toute la région. La répression sanglante du mouvement a fait 100 morts.
La perspective
Il ne s'agit pas de parler d'une révolution imminente ; ces manifestations de la lutte de classe qui se produisent partout dans le monde ne traduisent pas non plus la conscience des ouvriers que leur lutte procède d'une dynamique internationale. Ces luttes sont essentiellement défensives et, comparées aux luttes ouvrières qui ont eu lieu de mai 68 en France à 1981 en Pologne et au delà, elles apparaissent bien moins marquantes et plus limitées. La longue période de chômage, la décomposition croissante pèsent encore très fort sur le développement de la combativité et de la conscience. Néanmoins, ces événements ont une signification mondiale ; ils sont indicatifs de la perte de confiance des ouvriers partout dans le monde vis-à-vis des politiques catastrophiques poursuivies par la classe dominante au niveau économique, politique et militaire.
En comparaison avec les décennies précédentes, les enjeux de la situation mondiale sont bien plus grands, l'ampleur des attaques bien plus vaste, les dangers contenus dans la situation mondiale bien plus accrus. L'héroïsme des ouvriers qui aujourd'hui défient le pouvoir de la classe dominante et de l'Etat, est de ce fait bien plus impressionnant, même s'il est plus silencieux. La situation actuelle demande des ouvriers une réflexion allant au delà du niveau économique et corporatiste. Par exemple, partout l'attaque contre les retraites met en lumière les intérêts communs des différentes générations d'ouvriers, des vieux et des jeunes. La nécessité de chercher la solidarité a constitué une caractéristique frappante de beaucoup de luttes ouvrières actuelles.
La perspective à long terme de la politisation des luttes ouvrières s'exprime dans le surgissement de minorités infimes mais cependant significatives à plus long terme puisqu'elles cherchent à comprendre et à rejoindre les traditions politiques internationalistes de la classe ouvrière ; un écho croissant de la propagande de la Gauche communiste vient également témoigner de ce processus de politisation en développement.
La grève générale des ouvriers français en mai 1968 a mis fin à la longue période de contre-révolution qui a suivi l'échec de la révolution mondiale dans les années 1920. Cette reprise historique de la classe ouvrière s'est manifestée par plusieurs vagues de luttes prolétariennes internationales qui ont pris fin avec la chute du Mur de Berlin en 1989. Aujourd'hui, un nouvel assaut contre le système capitaliste se profile à l'horizon.
Como (5/07/2007)
[1] New York Times, 17 avril 2007
[2] The Economist, 14 septembre 2006.
[3] International Herald Tribune, 30 juin/1er juillet 2007
[4] ibid.
[5] Wall Street Journal, 10 mai 2007
Récent et en cours:
- Luttes de classe [49]
17e congrès du CCI : un renforcement international du camp prolétarien
- 3588 reads
A la fin du mois de mai, le CCI a tenu son 17e congrès international. Dans la mesure où les organisations révolutionnaires n'existent pas pour elles-mêmes mais sont des expressions du prolétariat en même temps que facteurs actifs dans la vie de celui-ci, il leur appartient de rendre compte à l'ensemble de leur classe des travaux de ce moment privilégié que constitue la réunion de leur instance fondamentale : le congrès. C'est le but du présent article que vient compléter la résolution sur la situation internationale [50] adoptée par le congrès et qui est publiée dans ce même numéro de la Revue Internationale.
Tous les congrès du CCI sont évidemment des moments très importants dans la vie de notre organisation, des jalons qui marquent son développement. Cependant, la première chose qu'il importe de souligner, concernant celui qui s'est tenu au printemps dernier, c'est que son importance est encore bien plus grande que celle des précédents, qu'il marque une étape de première grandeur dans sa vie plus que trentenaire.[1]
La présence des groupes du milieu prolétarien
La principale illustration de ce fait est la présence dans notre congrès de délégations de trois groupes du camp prolétarien international : Opop du Brésil[2], la SPA[3] de Corée du Sud et EKS[4] de Turquie. Un autre groupe était également invité au congrès, le groupe Internasyonalismo des Philippines, mais, malgré sa profonde volonté d'y envoyer une délégation, cela s'est avéré impossible. Ce groupe a tenu cependant à transmettre au congrès du CCI un salut à ses travaux et des prises de position sur les principaux rapports qui y avaient été soumis.
La présence de plusieurs groupes du milieu prolétarien à un congrès du CCI n'est pas une nouveauté. Dans le passé, au tout début de son existence, le CCI avait déjà accueilli des délégations d'autres groupes. C'est ainsi que sa conférence constitutive en janvier 1975 avait vu la présence du Revolutionary Worker's Group des États-Unis, de Pour une Intervention Communiste de France et Revolutionary Perspectives de Grande-Bretagne. De même, lors de son 2e congrès (1977) était présente une délégation du Partito Comunista Internazionalista (Battaglia Comunista). A son 3e congrès (1979) étaient présentes des délégations de la Communist Workers' Organisation (Grande-Bretagne), du Nucleo Comunista Internazionalista et d'Il Leninista (Italie) et d'un camarade non organisé de Scandinavie. Par la suite, malheureusement, cette pratique n'avait pu être poursuivie, et cela pour des raisons indépendantes de la volonté de notre organisation : disparition de certains groupes, évolution d'autres groupes vers des positions gauchistes (tel le NCI), démarche sectaire des groupes (CWO et Battaglia Comunista) qui avaient pris la responsabilité de saborder les conférences internationales des groupes de la Gauche communiste qui s'étaient tenues à la fin des années 1970.[5] En fait, cela faisait plus d'un quart de siècle que le CCI n'avait pu accueillir d'autres groupes prolétariens à un de ses congrès. En soi, la participation de quatre groupes à notre 17e congrès[6] constituait pour notre organisation un événement très important.
La signification du 17e congrès
Mais cette importance va bien au-delà du fait d'avoir pu renouer avec une pratique qui était celle du CCI à ses débuts. C'est la signification de l'existence et de l'attitude de ces groupes qui constitue l'élément le plus fondamental. Elles s'inscrivent dans une situation historique que nous avions déjà identifiée lors du précédent congrès : "Les travaux du 16e congrès (...) ont placé au centre de leurs préoccupations l'examen de la reprise des combats de la classe ouvrière et des responsabilités que cette reprise implique pour notre organisation, notamment face au développement d'une nouvelle génération d'éléments qui se tournent vers une perspective politique révolutionnaire." ("16e Congrès du CCI - Se préparer aux combats de classe et au surgissement de nouvelles forces révolutionnaires", Revue Internationale n° 122)
En effet, lors de l'effondrement du bloc de l'Est et des régimes staliniens en 1989 : "Les campagnes assourdissantes de la bourgeoisie sur la 'faillite du communisme', la 'victoire définitive du capitalisme libéral et démocratique', la 'fin de la lutte de classe', voire de la classe ouvrière elle-même, ont provoqué un recul important du prolétariat, tant au niveau de sa conscience que de sa combativité. Ce recul était profond et a duré plus de dix ans. Il a marqué toute une génération de travailleurs, engendrant désarroi et même démoralisation. (...) Ce n'est qu'à partir de 2003, notamment à travers les grandes mobilisations contre les attaques visant les retraites en France et en Autriche, que le prolétariat a commencé réellement à sortir du recul qui l'avait affecté depuis 1989. Depuis, cette tendance à la reprise des luttes de la classe et du développement de la conscience en son sein ne s'est pas démentie. Les combats ouvriers ont affecté la plupart des pays centraux, y compris les plus importants d'entre eux comme les États-Unis (Boeing et transports de New York en 2005), l'Allemagne (Daimler et Opel en 2004, médecins hospitaliers au printemps 2006, Deutsche Telekom au printemps 2007), la Grande-Bretagne (aéroport de Londres en août 2005, secteur public au printemps 2006), la France (mouvement des étudiants et des lycéens contre le CPE au printemps 2006) mais aussi toute une série de pays de la périphérie comme Dubaï (ouvriers du bâtiment au printemps 2006), le Bengladesh (ouvriers du textile au printemps 2006), l'Égypte (ouvriers du textile et des transports au printemps 2007)." (Résolution sur la situation internationale adoptée par le 17e congrès)
"Aujourd'hui, comme en 1968 [lors de la reprise historique des luttes ouvrières qui avait mis fin à quatre décennies de contre-révolution], la reprise des combats de classe s'accompagne d'une réflexion en profondeur dont l'apparition de nouveaux éléments se tournant vers les positions de la Gauche communiste constitue la pointe émergée de l'iceberg." (Ibid.)
C'est pour cela que la présence de plusieurs groupes du milieu prolétarien au congrès, l'attitude très ouverte à la discussion de ces groupes (qui tranche avec l'attitude sectaire des "vieux" groupes de la Gauche communiste) ne sont nullement le fait du hasard : elles sont partie prenante de la nouvelle étape du développement du combat de la classe ouvrière mondiale contre le capitalisme.
En fait, les travaux du congrès, notamment à travers des témoignages des différentes sections et des groupes invités, sont venu confirmer cette tendance, depuis la Belgique jusqu'à l'Inde, du Brésil à la Turquie et à la Corée, dans les pays centraux comme dans ceux de la périphérie, tant à la reprise des luttes ouvrières qu'au développement d'une réflexion parmi de nouveaux éléments s'orientant vers les positions de la Gauche communiste. Une tendance qui s'est également illustrée par l'intégration de nouveaux militants au sein de l'organisation, y compris dans des pays où il n'y avait pas eu de nouvelle intégration depuis plusieurs décennies mais aussi par la constitution d'un noyau du CCI au Brésil. C'est pour nous un événement de grande importance qui vient concrétiser le développement de la présence politique de notre organisation dans le premier pays d'Amérique latine, avec les plus grosses concentrations industrielles de cette région du monde et qui comptent aussi parmi les plus importantes à l'échelle mondiale. La création de notre noyau est le résultat d'un travail engagé par le CCI de façon ponctuelle il y a plus de 15 ans et qui s'est intensifié ces dernières années, notamment à travers la prise de contact avec différents groupes et éléments, en particulier Opop, dont une délégation était présente au 17e congrès, mais aussi, dans l'État de São Paulo, avec un groupe en constitution influencé par les positions de la Gauche communiste, avec lequel nous avons établi plus récemment des relations politiques régulières, dont la tenue de réunions publiques en commun. La collaboration avec ces groupes n'est nullement contradictoire avec notre volonté de développer spécifiquement la présence organisationnelle du CCI au Brésil. Bien au contraire, notre présence permanente dans ce pays permettra que se renforce encore la collaboration entre nos organisations, et cela d'autant plus qu'entre notre noyau et OPOP existe déjà une longue histoire commune, faite de confiance et de respect mutuels.
Les discussions du congrès
Compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles se tenait le congrès, c'est la question des luttes ouvrières qui a constitué le premier point de l'ordre du jour alors que le deuxième point était consacré à l'examen des nouvelles forces révolutionnaires qui surgissent ou se développent à l'heure actuelle. Nous ne pouvons pas, dans le cadre de cet article, rendre compte de façon détaillée des discussions qui se sont déroulées : la résolution sur la situation internationale en constitue une synthèse. Ce qu'il faut souligner fondamentalement ce sont les caractéristiques particulières et nouvelles du développement actuel des combats de classe. Il a en particulier été mis en évidence le fait que la gravité de la crise du capitalisme, la violence des attaques qui s'abattent aujourd'hui et les enjeux dramatiques de la situation mondiale, caractérisée par l'enfoncement dans la barbarie guerrière et par les menaces croissantes que le système fait peser sur l'environnement terrestre, constituent des facteurs de politisation des luttes ouvrières. Une situation quelque peu différente de celle qui avait prévalu au lendemain de la reprise historique des combats de classe en 1968 où les marges de manœuvre dont disposait alors le capitalisme avaient permis de maintenir l'illusion que "demain sera meilleur qu'aujourd'hui". Aujourd'hui, une telle illusion n'est guère plus possible : les nouvelles générations de prolétaires, de même que les plus anciennes, sont conscientes que "demain sera pire qu'aujourd'hui". De ce fait, même si une telle perspective peut constituer un facteur de démoralisation et de démobilisation des travailleurs, les luttes qu'ils mènent, et mèneront nécessairement de plus en plus en réaction aux attaques, vont les amener de façon croissante à prendre conscience que ces luttes constituent des préparatifs pour des affrontements bien plus vastes contre un système moribond. Dès à présent, les luttes auxquelles nous avons assisté depuis 2003 "incorporent de façon croissante la question de la solidarité, une question de premier ordre puisqu'elle constitue le 'contrepoison' par excellence du 'chacun pour soi' propre à la décomposition sociale et que, surtout, elle est au cœur de la capacité du prolétariat mondial non seulement de développer ses combats présents mais aussi de renverser le capitalisme" (Ibid.)
Même si le congrès s'est préoccupé principalement de la question de la lutte de classe, les autres aspects de la situation internationale ont également fait l'objet de discussions importantes. C'est ainsi qu'il a consacré une part importante de ses travaux à la crise économique du capitalisme en se penchant notamment sur la croissance actuelle de certains pays "émergents", tels l'Inde ou la Chine, qui semble contredire les analyses faites par notre organisation, et les marxistes en général, sur la faillite définitive du mode de production capitaliste. En fait, suite à un rapport très détaillé et une discussion approfondie, le congrès a conclu que :
"Les taux de croissance exceptionnels que connaissent à l'heure actuelle des pays comme l'Inde et surtout la Chine ne constituent en aucune façon une preuve d'un "nouveau souffle" de l'économie mondiale, même s'ils ont contribué pour une part non négligeable à la croissance élevée de celle-ci au cours de la dernière période. (...) ... loin de représenter un "nouveau souffle" de l'économie capitaliste, le "miracle chinois" et d'un certain nombre d'autres économies du Tiers-monde n'est pas autre chose qu'un avatar de la décadence du capitalisme. (...) ... tout comme le "miracle" représenté par les taux de croissance à deux chiffres des "tigres" et "dragons" asiatiques avait connu une fin douloureuse en 1997, le "miracle" chinois d'aujourd'hui, même s'il n'a pas des origines identiques et s'il dispose d'atouts bien plus sérieux, sera amené, tôt ou tard, à se heurter aux dures réalités de l'impasse historique du mode de production capitaliste." (Ibid.)
Il faut noter que, sur la question de la crise économique, le congrès s'est fait l'écho des débats qui se mènent actuellement au sein de notre organisation sur comment analyser les mécanismes qui ont permis au capitalisme de connaître sa croissance spectaculaire après la seconde guerre mondiale. Les différentes analyses existant actuellement au sein du CCI (qui toutes rejettent cependant l'idée défendue par le BIPR ou les groupes "bordiguistes" que la guerre constituerait une "solution momentanée" aux contradictions du capitalisme) se répercutent sur la façon de comprendre le dynamisme actuel de l'économie de certains pays "émergents", notamment la Chine. Et c'est justement parce que le congrès s'est penché particulièrement sur ce dernier phénomène que les divergences existant au sein de notre organisation ont eu l'occasion de s'exprimer au congrès. Bien évidemment, comme nous l'avons toujours fait par le passé, nous allons publier dans la Revue Internationale des documents rendant compte de ces débats dès lors qu'ils seront parvenus à un degré de clarté suffisant.
Enfin, l'impact que provoque au sein de la bourgeoisie l'impasse dans laquelle se trouve le mode de production capitaliste et la décomposition de la société que celle-ci engendre a fait l'objet de deux discussions : l'une portant sur les conséquences de cette situation au sein de chaque pays, l'autre sur l'évolution des antagonismes impérialistes entre États, ces deux aspects étant en partie liés entre eux, notamment dans la mesure où les conflits existant au sein des bourgeoisies nationales peuvent provenir d'approches différentes par rapport aux conflits impérialistes (quelles alliances entre États, modalité d'utilisation des forces militaires, etc.). Sur le premier point, le congrès a notamment mis en évidence que tous les discours officiels sur "le moins d'État" ne faisaient que masquer un renforcement continuel de la place de l'État dans la société dans la mesure où cet organe est le seul qui puisse garantir que celle-ci ne succombe au "chacun pour soi" qui caractérise la phase de décomposition du capitalisme. Il a été en particulier fortement souligné le renforcement spectaculaire du caractère policier de l'État, y compris dans les pays les plus "démocratiques" comme la Grande-Bretagne et les États-Unis, un renforcement policier qui, s'il est officiellement motivé par la montée du terrorisme (un autre phénomène lié à la décomposition mais à l'origine duquel les bourgeoisies les plus puissantes ne sont pas étrangères), permet à la classe dominante de se préparer aux futurs affrontements de classe avec le prolétariat. Concernant la question des affrontements impérialistes, le congrès a notamment mis en évidence la faillite, en particulier suite à l'aventure irakienne, de la politique de la première bourgeoisie du monde, la bourgeoisie américaine, et le fait que celle-ci ne fait que révéler l'impasse générale du capitalisme :
"En fait, l'arrivée de l'équipe Cheney, Rumsfeld et compagnie aux rênes de l'État n'était pas le simple fait d'une monumentale "erreur de casting" de la part de cette classe. Si elle a aggravé considérablement la situation des États-Unis sur le plan impérialiste, c'était déjà la manifestation de l'impasse dans laquelle se trouvait ce pays confronté à une perte croissante de son leadership, et plus généralement au développement du "chacun pour soi" dans les relations internationales qui caractérise la phase de décomposition." (Ibid.)
Plus généralement, le congrès a souligné que :
"Le chaos militaire qui se développe de par le monde, plongeant de vastes régions dans un véritable enfer et la désolation, notamment au Moyen-Orient mais aussi et surtout en Afrique, n'est pas la seule manifestation de l'impasse historique dans laquelle se trouve le capitalisme ni, à terme, la plus menaçante pour l'espèce humaine. Aujourd'hui, il est devenu clair que le maintien du système capitaliste tel qu'il a fonctionné jusqu'à présent porte avec lui la perspective de la destruction de l'environnement qui avait permis l'ascension de l'humanité." (Ibid.)
Il a conclu cette partie de la discussion en mettant en avant que :
"L'alternative annoncée par Engels à la fin du 19e siècle, socialisme ou barbarie, est devenue tout au long du 20e siècle une sinistre réalité. Ce que le 21e siècle nous offre comme perspective, c'est tout simplement socialisme ou destruction de l'humanité. Voila l'enjeu véritable auquel se confronte la seule force de la société en mesure de renverser le capitalisme, la classe ouvrière mondiale." (Ibid.)
La responsabilité des révolutionnaires
Cette perspective souligne d'autant plus l'importance décisive des combats que développe actuellement la classe ouvrière mondiale sur lesquelles le congrès s'était penché particulièrement. Elle souligne également le rôle fondamental des organisations révolutionnaires, et notamment du CCI, pour intervenir dans ces combats afin que s'y développe la conscience des enjeux du monde actuel.
Sur ce plan, le congrès a tiré un bilan très positif de l'intervention de notre organisation dans les luttes de la classe et face aux questions cruciales qui se posent à elle. Il a souligné en particulier la capacité du CCI à se mobiliser internationalement (articles dans la presse, sur notre site Internet, réunions publiques, etc.) pour faire connaître les enseignements d'un des épisodes majeurs de la lutte de classe au cours de la dernière période : le combat de la jeunesse étudiante contre le CPE au printemps 2006 en France. A ce propos, il a été relevé que notre site Internet a connu une augmentation spectaculaire de sa fréquentation au cours de cette période, preuve que les révolutionnaires ont non seulement la responsabilité mais aussi la possibilité de contrecarrer le black-out que les médias bourgeois organisent de façon systématique autour des combats prolétariens.
Le congrès a également tiré un bilan extrêmement positif de notre politique en direction des groupes et éléments se situant dans une perspective de défense ou de rapprochement des positions de la Gauche communiste. Ainsi, au cours de la dernière période, comme il a été dit au début de cet article, le CCI a vu l'arrivée d'un nombre significatif de nouveaux militants, arrivée qui faisait suite à des discussions approfondies avec ces camarades (comme c'est toujours le cas avec notre organisation qui n'a pas pour habitude de "recruter" à tout prix, contrairement à ce qui se pratique dans les organisations gauchistes). De même, le CCI s'est impliqué activement dans différents forums Internet, notamment en langue anglaise, la plus importante à l'échelle mondiale, où peuvent s'exprimer des positions de classe, ce qui a permis à un certain nombre d'éléments de mieux connaître nos positions et notre conception de la discussion et, partant, de surmonter une certaine méfiance entretenue par la multitude de petites chapelles parasitaires dont la vocation n'est pas de contribuer à la prise de conscience de la classe ouvrière mais de semer la suspicion à l'égard des organisations qui se donnent justement cette tache. Mais l'aspect le plus positif de cette politique a été sans aucun doute la capacité de notre organisation d'établir ou de renforcer des liens avec d'autres groupes se situant sur des positions révolutionnaires et dont l'illustration était la participation de quatre de ces groupes au 17e congrès. Cela a représenté un effort très important de la part du CCI, notamment avec l'envoi de nombreuses délégations dans de multiples pays (le Brésil, la Corée, la Turquie, les Philippines, évidemment, mais pas seulement).
Les responsabilités croissantes qui incombent au CCI, tant du point de vue de l'intervention au sein des luttes ouvrières que de la discussion avec les groupes et éléments se situant sur un terrain de classe, supposent un renforcement de son tissu organisationnel. Celui-ci avait été sérieusement affecté au début des années 2000 par une crise qui avait éclaté au grand jour à la suite de son 14e congrès et qui avait motivé la tenue d'une conférence extraordinaire un an après, de même qu'elle avait donné lieu à une réflexion approfondie lors de son 15e congrès, en 2003[7]. Comme ce congrès l'avait constaté et comme le 16e congrès l'avait confirmé, le CCI avait largement surmonté les faiblesses organisationnelles qui se trouvaient à l'origine de cette crise. Un des éléments de premier plan dans la capacité du CCI à surmonter ses difficultés organisationnelles consiste en un examen attentif et approfondi de ces difficultés. Pour ce faire, le CCI s'était doté, à partir de 2001, d'une commission spéciale, distincte de son organe central, et nommée comme lui par le Congrès, chargée de mener ce travail de façon plus spécifique. Cette commission a également rendu son mandat qui constate, à côté des progrès très importants accomplis par notre organisation, la persistance de séquelles et de "cicatrices" des difficultés passées dans un certain nombre de sections. C'est la preuve que la construction d'un tissu organisationnel solide n'est jamais achevée, qu'elle nécessite un effort permanent de la part de l'ensemble de l'organisation et des militants. C'est pour cela que le congrès a décidé, sur la base de cette nécessité et partant du rôle fondamental joué par cette commission dans les années passées, de lui donner un caractère permanent en inscrivant son existence dans les statuts du CCI. Ce n'est nullement là une "innovation" de la part de notre organisation. En fait, cela correspond à une tradition dans les organisations politiques de la classe ouvrière. C'est ainsi que le Parti social démocrate allemand, qui était la référence de la 2e Internationale, disposait d'une "Commission de contrôle" ayant le même type d'attributs.
Cela dit, un des éléments majeurs ayant permis cette capacité de notre organisation de surmonter sa crise, et même d'en sortir renforcée, avait été sa capacité à se livrer à une réflexion en profondeur, avec une dimension historique et théorique, sur l'origine et les manifestations de ses faiblesses organisationnelles, réflexion qui s'est notamment menée autour de différents textes d'orientation dont notre Revue a publié des extraits significatifs.[8] Le congrès a poursuivi dans cette direction en consacrant, dès le début, une partie de ses travaux à discuter d'un texte d'orientation sur la culture du débat qui avait été mis en circulation dans le CCI plusieurs mois auparavant (et qui sera publié prochainement dans la Revue internationale). Cette question ne concerne d'ailleurs pas seulement la vie interne de l'organisation. L'intervention des révolutionnaires implique qu'ils soient capables de produire les analyses les plus pertinentes et profondes possibles de même qu'ils puissent défendre avec efficacité ces analyses au sein de la classe afin de contribuer à sa prise de conscience. Et cela suppose qu'ils soient en mesure de discuter du mieux possible ces analyses de même que d'apprendre à les présenter dans l'ensemble de la classe et auprès des éléments en recherche en ayant le souci de tenir compte des préoccupations et questionnements qui les traversent. En fait, dans la mesure où le CCI est confronté, aussi bien dans ses propres rangs que dans l'ensemble de la classe, à l'émergence d'une nouvelle génération de militants ou d'éléments qui s'inscrivent dans le combat pour le renversement du capitalisme, il lui appartient de faire tous les efforts nécessaires pour se réapproprier pleinement et communiquer à cette génération un des éléments les plus précieux de l'expérience du mouvement ouvrier, indissociable de la méthode critique du marxisme : la culture du débat.
La culture du débat
La présentation et la discussion de cette question ont mis en évidence que, dans toutes les scissions que nous avions connues dans l'histoire du CCI, une tendance au monolithisme avait joué un rôle fondamental. Dès que des divergences apparaissaient, certains militants commençaient à dire que nous ne pouvions plus travailler ensemble, que le CCI était devenu ou était en train de devenir une organisation bourgeoise, etc. alors que ces divergences pouvaient tout à fait, pour la plupart, être contenues au sein d'une organisation non monolithique. Pourtant, le CCI avait appris de la Fraction italienne de la Gauche communiste que même lorsqu'il y a des divergences concernent des principes fondamentaux, la clarification collective la plus profonde est nécessaire avant toute séparation organisationnelle. En ce sens, ces scissions étaient pour la plupart une manifestation des plus extrêmes d'un manque dans la culture du débat et même d'une vision monolithique. Cependant ces problèmes n'ont pas été éliminés par le départ des militants. C'était également l'expression d'une difficulté plus générale du CCI sur cette question car il y avait des confusions dans nos propres rangs qui peuvent conduire à des glissements vers le monolithisme, qui ont tendance à annihiler le débat plutôt qu'à le développer. Et ces confusions continuent d'exister. Il ne faut pas exagérer l'envergure de ces problèmes. Ce sont des confusions, des glissements qui apparaissent de façon ponctuelle. Mais l'histoire nous a montré, l'histoire du CCI mais aussi celle du mouvement ouvrier, que de petits glissements et de petites confusions peuvent devenir de grands et dangereux glissements si on ne comprend pas les racines des problèmes.
Dans l'histoire de la Gauche communisme, il existe des courants qui ont défendu et théorisé le monolithisme. Le courant bordiguiste en est une caricature. Le CCI au contraire est l'héritier de la tradition de la Fraction italienne et de la Gauche communiste de France qui ont été les adversaires les plus résolus du monolithisme et qui ont mis en pratique de manière très déterminée la culture du débat. Le CCI a été fondé sur cette compréhension qui est entérinée dans ses statuts. Pour cette raison, il est clair que, s'il subsiste encore des problèmes dans la pratique avec cette question, d'une façon générale aucun militant du CCI ne se prononce contre le développement d'une conception de culture du débat. Cela dit, il est nécessaire de signaler la persistance d'un certain nombre de faiblesses. La première de ces faiblesses est une tendance à poser chaque discussion en terme de conflit entre le marxisme et l'opportunisme, entre le bolchevisme et le menchevisme ou même de lutte entre le prolétariat et la bourgeoisie. Une telle démarche n'aurait de sens que si nous avions la conception de l'invariance du programme communiste. Et là au moins le bordiguisme est conséquent : l'invariance et le monolithisme dont se revendique ce courant vont ensemble. Mais si nous acceptons que le marxisme n'est pas un dogme, que la vérité est relative, qu'elle n'est pas figée mais constitue un processus et donc que nous n'arrêtons jamais d'apprendre parce que la réalité elle-même change en permanence, alors il est évident que le besoin d'approfondir, mais aussi les confusions et même les erreurs, sont des étapes normales, voire nécessaires, pour arriver à la conscience de classe. Ce qui est décisif, c'est l'impulsion collective, la volonté et la participation active vers la clarification.
Il faut remarquer que cette démarche tendant à voir partout, dans tous les débats, la présence de l'opportunisme, c'est-à-dire une tendance vers des positions bourgeoises, peut conduire à une sorte de banalisation du danger de l'opportunisme, à mettre toutes les discussions sur le même niveau. L'expérience nous montre justement que, dans les rares discussions où les principes fondamentaux étaient remis en cause, on a souvent éprouvé des difficultés à le voir : si tout est opportunisme alors, en fin de compte, rien n'est opportunisme.
Une autre conséquence d'une telle démarche consistant à voir l'opportunisme et l'idéologie bourgeoise partout et dans tous les débats, c'est l'inhibition du débat. Les militants "n'ont plus le droit" d'avoir des confusions, de les exprimer ou de faire des erreurs parce que, immédiatement, on les verra, ou ils se verront eux-mêmes, comme des traîtres en puissance. Certains débats ont effectivement un caractère de confrontation entre les positions bourgeoises et les positions prolétariennes : c'est l'expression d'une crise et d'un danger de dégénérescence. Mais dans la vie du prolétariat ce n'est pas la règle générale. Si on met tous les débats sur ce plan, on peut finir avec l'idée que le débat lui-même est l'expression d'une crise.
Un autre problème qui, encore une fois, existe plus dans la pratique que de façon théorisée, consiste à adopter une démarche dans la discussion visant à convaincre les autres aussi vite que possible de la position correcte. C'est une attitude qui mène à l'impatience, à une tentative de monopoliser la discussion, à vouloir en quelque sorte "écraser l'adversaire" dans celle-ci. Une telle démarche conduit à une difficulté à écouter ce que disent les autres. C'est vrai que dans la vie en général, dans une société marquée par l'individualisme et la concurrence, il est difficile d'apprendre à écouter les autres. Mais ne pas écouter conduit à une attitude de fermeture vis-à-vis du monde, ce qui est tout à fait à l'opposé d'une attitude révolutionnaire. En ce sens, il est nécessaire de comprendre que le plus important dans un débat, c'est qu'il ait lieu, qu'il se développe, qu'il y ait une participation aussi large que possible et qu'une véritable clarification puisse émerger. En fin de compte, la vie collective du prolétariat, lorsqu'elle est capable de se développer, va apporter une clarification. La volonté de clarification est une caractéristique du prolétariat en tant que classe ; c'est son intérêt de classe. En particulier, elle exige la vérité et non pas la falsification. C'est pour cela que Rosa Luxemburg a mis en avant que la première tache des révolutionnaires est de dire ce qui est. Les attitudes de confusion ne sont pas la règle, ni même dominantes dans le CCI, mais elles existent et peuvent être dangereuses et ont besoin d'être dépassées. En particulier, il faut apprendre à dédramatiser les débats. La plupart des discussions au sein de l'organisation, et beaucoup de discussions que nous avons en dehors, ne sont pas des confrontations entres des positions bourgeoises et des positions prolétariennes. Ce sont des discussions où, sur la base de positions partagées et d'un but commun, nous approfondissons de façon collective dans une démarche allant de la confusion vers la clarté.
En fait, la capacité de développer une véritable culture du débat dans les organisations révolutionnaires est un des signes majeurs de leur appartenance à la classe ouvrière, de leur capacité à rester vivantes et en phase avec les besoins de celle-ci. Et une telle démarche n'est pas propre aux organisations communistes, elle appartient au prolétariat comme un tout : c'est aussi à travers ses propres discussions, notamment dans ses assemblées générales, que l'ensemble de la classe ouvrière est capable de tirer les leçons de ses expériences et d'avancer dans sa prise de conscience. Le sectarisme et le refus du débat qui, aujourd'hui, caractérisent malheureusement un certain nombre d'organisations du camp prolétarien ne sont nullement une preuve de leur "intransigeance" face à l'idéologie bourgeoise ou face à la confusion. C'est au contraire une manifestation de leur peur de défendre leurs propres positions et, en dernier ressort, la preuve d'un manque de conviction dans la validité de celles-ci.
Les interventions des groupes invités
Cette culture du débat a traversé l'ensemble des travaux du congrès. Et elle a été saluée comme telle par les délégations des groupes invités qui ont en même temps fait part de leur expérience et livré leurs propres réflexions :
C'est ainsi qu'un des camarades de la délégation venue de Corée a fait part de son "impression frappante face à l'esprit de fraternité, de débat, de relations de camaraderie auquel son expérience précédente ne l'avait pas habitué et qu'il nous envie". Un autre camarade de cette délégation a fait part de sa conviction que "la discussion sur la culture du débat serait fructueuse pour le développement de leur propre activité et qu'il était important que le CCI, de même que leur propre groupe, ne se voie pas comme 'seul au monde'."
Pour sa part, la délégation de Opop a tenu à "exprimer avec la plus grande fraternité un salut à ce congrès" et sa "satisfaction de participer à un événement d'une telle importance". Pour la délégation : "Ce congrès n'est pas seulement un événement important pour le CCI mais également pour la classe ouvrière comme un tout. Nous apprenons beaucoup avec le CCI. Nous avons beaucoup appris ces trois dernières années à travers les contacts que nous avons eus, les débats que nous avons menés ensemble au Brésil. Nous avons déjà participé au précédent congrès [celui de la section en France, l'an dernier] et nous avons pu constater le sérieux avec lequel le CCI traite le débat, sa volonté d'être ouvert pour le débat, de ne pas avoir peur du débat et de ne pas avoir peur de confronter des positions différentes des siennes. Au contraire, sa démarche est de susciter le débat et nous voulons remercier le CCI pour nous avoir fait connaître cette approche. De même, nous saluons la façon dont le CCI considère la question des nouvelles générations, actuelles et futures. Nous apprenons de cet héritage auquel se réfère le CCI et qui nous a été transmis par le mouvement ouvrier depuis qu'il existe." En même temps, la délégation a fait part de sa conviction que "le CCI avait également appris aux côtés de Opop", notamment lorsque sa délégation au Brésil a participé aux côtés d' Opop à une intervention dans une assemblée ouvrière dominée par les syndicats.
De son côté, le délégué de EKS a également souligné l'importance du débat dans le développement des positions révolutionnaires dans la classe, notamment pour les nouvelles générations :
"Pour commencer j'aimerais souligner l'importance des débats pour la nouvelle génération. Nous avons des jeunes éléments dans notre groupe et nous nous sommes politisés à travers le débat. Nous avons vraiment beaucoup appris du débat, en particulier parmi les jeunes éléments avec lesquels nous sommes en contact... Je pense que pour la jeune génération le débat sera à l'avenir un aspect très important de son développement politique. Nous avons rencontré un camarade qui venait d'un quartier ouvrier très pauvre d'Istanbul et qui était plus âgé que nous. Il nous a dit que dans le quartier d'où il venait les ouvriers voulaient toujours discuter. Mais les gauchistes qui faisaient du travail politique dans les quartiers ouvriers essayaient toujours de liquider le débat très vite pour passer aux 'choses pratiques', comme on peut s'y attendre. Je pense que la culture prolétarienne que l'on discute ici, maintenant, et que j'ai expérimentée dans ce congrès est une négation de la méthode gauchiste de discussion vue comme une compétition. Je voudrais faire quelques commentaires sur les débats entre les groupes internationalistes. Premièrement je pense qu'il est évident que de tels débats devraient être constructifs et fraternels autant que possible et que nous devrions toujours garder à l'esprit que les débats sont un effort collectif pour arriver à une clarification politique parmi les révolutionnaires. Et ce n'est absolument pas une compétition ou quelque chose qui pourrait créer de l'hostilité ou de la rivalité. Ça c'est la négation totale de l'effort collectif pour arriver à de nouvelles conclusions, pour se rapprocher de la vérité. Il est important aussi que le débat parmi les groupes internationalistes soit régulier autant que possible parce que cela aide beaucoup dans la clarification pour tous ceux qui sont impliqués internationalement. Je pense que c'est nécessaire aussi pour le débat d'être ouvert à tous les éléments prolétariens qui sont intéressés. Je pense aussi que c'est significatif que les débats soient publics pour les éléments révolutionnaires qui sont intéressés. Le débat n'est pas limité à ceux qui sont impliqués directement. Le débat lui-même, ce qui est discuté, sont d'une grande aide pour quelqu'un qui lit tout simplement. Par exemple je me souviens qu'il y a un certain temps j'avais très peur de débattre mais j'étais très intéressé à lire. Cette idée de lire les débats, les résultats, çà aide énormément et donc c'est très important que les débats qui ont lieu soient publics pour tous ceux que cela intéresse. C'est une façon très efficace de se développer théoriquement et politiquement."
Les interventions très chaleureuses des délégations des groupes invités n'avaient rien à voir avec une attitude de flatterie envers le CCI. C'est ainsi que les camarades de Corée ont porté un certain nombre de critiques aux travaux du congrès, regrettant notamment qu'il ne soit pas plus revenu sur l'expérience de notre intervention lors du mouvement contre le CPE en France ou que l'analyse de la situation économique de la Chine ne prenne pas plus en compte la situation sociale et les luttes de la classe ouvrière dans ce pays. L'ensemble des délégués du CCI a apporté une grande attention à ces critiques qui permettront à notre organisation aussi bien de mieux prendre en compte les préoccupations et les attentes des autres groupes du camp prolétarien que de stimuler notre effort pour approfondir nos analyses d'une question aussi importante que celle de la situation en Chine. Évidemment, les éléments et analyses que pourront apporter les autres groupes sur cette question, notamment des groupes d'Extrême-Orient, seront précieux pour notre propre travail.
D'ailleurs, au cours du congrès lui-même, les interventions des délégations ont constitué un apport important à notre compréhension de la situation mondiale, notamment lorsqu'elles ont donné des éléments précis concernant la situation dans leur propre pays. Nous ne pouvons pas dans le cadre de cet article reproduire intégralement les interventions des délégations dont des éléments vont figurer ultérieurement dans les articles de notre presse. Nous nous contenterons d'en signaler les éléments les plus marquants. Concernant la lutte de classe, le délégué de EKS a insisté sur le fait qu'après la défaite des combats massifs de 1989, il y avait aujourd'hui une reprise des luttes ouvrières, une vague de grèves avec des occupations d'usines, face à une situation économique qui est dramatique pour les travailleurs. Devant cette situation, les syndicats ne se contentent pas seulement de saboter les luttes comme ils le font partout, mais ils essaient également de développer le nationalisme parmi les ouvriers en menant campagne sur le thème de la "Turquie séculaire". Pour sa part, la délégation de Opop a signalé que, du fait du lien entre les syndicats et le gouvernement actuel (puisque le président Lula était le principal dirigeant syndical du pays), il existe une tendance aux luttes en dehors du cadre syndical officiel, une "rébellion de la base", comme s'était lui-même nommé le mouvement dans le secteur des banques, en 2003. Les nouvelles attaques économiques que prépare le gouvernement Lula vont évidemment pousser la classe ouvrière à poursuivre ses combats, même si les syndicats adoptent une attitude beaucoup plus "critique" vis-à-vis de Lula.
Une autre contribution importante des délégations de Opop et EKS au congrès a concerné la politique impérialiste de la Turquie et du Brésil. C'est ainsi que Opop a donné des éléments permettant de mieux comprendre le positionnement de ce pays qui, d'un côté se montre un fidèle allié de la politique américaine en tant que "gendarme du monde" (notamment avec une présence militaire à Timor et a Haïti, pays où il assure le commandement des forces étrangères) mais qui, en même temps, tente de développer sa propre diplomatie, avec des accords bilatéraux, notamment en direction de la Russie (à qui elle achète des avions), de l'Inde et de la Chine (dont les produits industriels sont concurrents de la production brésilienne). Par ailleurs, le Brésil développe une politique de puissance impérialiste régionale où elle tente d'imposer ses conditions à des pays comme la Bolivie ou le Paraguay. Quant au camarade de EKS, il a fait une intervention très intéressante sur les tenants et aboutissants de la vie politique de la bourgeoisie turque (notamment les enjeux du conflit entre le secteur "islamiste" et le secteur "laïc") et de ses ambitions impérialistes. Encore une fois ne nous ne pouvons reproduire cette intervention dans cet article. Nous voulons seulement souligner l'idée essentielle figurant dans la conclusion de cette intervention : le risque que, dans une région voisine d'une des zones où se déchaînent avec le plus de violence les conflits impérialistes, notamment en Irak, la bourgeoisie turque ne s'engage dans une spirale militaire dramatique, faisant payer encore plus à sa classe ouvrière le prix des contradictions du capitalisme.
Les interventions des délégations des groupes invités ont constitué, à côté de celles des délégations des sections du CCI, un apport de premier plan aux travaux de l'ensemble du congrès et à sa réflexion sur toutes les questions, lui permettant de "synthétiser la situation mondiale" comme l'a remarqué la délégation du SPA de Corée. En fait, comme nous le signalions au début de cet article, une des clés de l'importance de ce congrès a été la participation des groupes invités ; cette participation a constitué un des éléments majeurs de sa réussite et de l'enthousiasme qui était partagé par toutes ses délégations au moment de sa clôture
oOo
A quelques jours d'intervalle se sont tenues deux réunions internationales : le sommet du G8 et le congrès du CCI. Évidemment, il existe des différences quant à l'ampleur et à l'impact immédiat de ces deux rencontres mais il vaut la peine de souligner combien est frappant le contraste entre elles, tant du point de vue des circonstances, que des buts et du mode de fonctionnement. D'un côté il y a avait une réunion derrière des fils de fer barbelés, un déploiement policier sans précédent et la répression, une réunion où les déclarations sur la "sincérité des débats", sur la "paix" et sur "l'avenir de l'humanité" n'étaient qu'un écran de fumée destiné à masquer les antagonismes entre États capitalistes, à préparer de nouvelles guerres et à préserver un système qui n'offre aucun avenir à l'humanité. De l'autre, il y avait une réunion de révolutionnaires de 15 pays combattant tous les écrans de fumée, tous les faux-semblants, menant des débats réellement fraternels, avec un profond esprit internationaliste, afin de contribuer à la seule perspective capable de sauver l'humanité : la lutte internationale et unie de la classe ouvrière en vue de renverser le capitalisme et d'instaurer la société communiste.
Nous savons que le chemin qui y conduit est encore long et difficile mais le CCI est convaincu que son 17e congrès constitue une étape très importante sur ce chemin.
CCI
[1] Voir notre article "Les trente ans du CCI : s'approprier le passé pour construire l'avenir" [51] dans la Revue Internationale n° 123.
[2] Opop : Oposição Operária, Opposition Ouvrière. Il s'agit d'un groupe implanté dans plusieurs villes du Brésil qui s'est constitué au début des années 1990, notamment avec des éléments en rupture avec la CUT (Centrale syndicale) et le Parti des Travailleurs de Lula (actuel président de ce pays) pour rejoindre les positions du prolétariat, notamment sur la question essentielle de l'internationalisme, mais aussi sur la question syndicale (dénonciation de ces organes comme instruments de la classe bourgeoise) et parlementaire (dénonciation de la mascarade "démocratique"). C'est un groupe actif dans les luttes ouvrières (notamment dans le secteur des banques) avec qui le CCI entretient des discussions fraternelles depuis plusieurs années (notre site en langue portugaise a notamment publié un compte-rendu de notre débat sur le matérialisme hisorique).Par ailleurs, nos deux organisations ont organisé plusieurs réunions publiques communes au Brésil (voir notamment à ce sujet Quatre interventions publiques du CCI au Brésil : Un renforcement des positions prolétariennes au Brésil" [52] dans Révolution Internationale n° 365) et ont publié une prise de position commune sur la situation sociale de ce pays. Une délégation de Opop était déjà présente lors du 17e congrès de notre section en France, au printemps 2006 (voir notre article : "17e Congrès de RI : l'organisation révolutionnaire à l'épreuve de la lutte de classe" [53] dans RI n° 370).
[3] SPA : Socialist Political Alliance, Alliance Politique Socialiste. C'est un groupe qui s'est donné comme tâche de faire connaître en Corée les positions de la Gauche communiste (notamment à travers la traduction de certains de ses textes fondamentaux) et d'animer dans ce pays, et aussi internationalement, les discussions entre groupes et éléments autour de ces positions. Le SPA a organisé en octobre 2006 une conférence internationale où le CCI, qui menait des discussions avec cette organisation depuis près d'un an, a envoyé une délégation (voir notre article "Rapport sur la conférence en Corée - octobre 2006" [54] dans la Revue Internationale n° 129). Il faut noter que les participants à cette conférence, qui s'est tenue juste après les essais nucléaires de la Corée du Nord, ont adopté une "Déclaration internationaliste depuis la Corée contre la menace de guerre" (voir RI n° 374 [39]).
[4] EKS : Enternasyonalist Komünist Sol, Gauche Communiste Internationaliste ; groupe constitué récemment en Turquie, qui se situe résolument sur les positions de la Gauche communiste et dont nous avons publié des prises de position [55].
[5] Sur ces conférences internationales voir notre article "Les conférences internationales de la Gauche Communiste (1976-1980) - Leçons d'une expérience pour le milieu prolétarien" [56] dans la Revue Internationale n° 122). Le sabotage de ces conférences par les groupes qui allaient constituer le Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR) n'avait cependant pas empêché le CCI d'inviter cette organisation à son 13e congrès, en 1999. En effet, nous avions pensé que la gravité des enjeux impérialistes au cœur de l'Europe (c'était le moment des bombardements de la Serbie par les armées de l'OTAN) méritait que les groupes révolutionnaires laissent leurs griefs de côté pour se retrouver en un même lieu afin d'examiner ensemble les implications du conflit et, éventuellement, de produire une déclaration commune. Malheureusement, le BIPR avait décliné cette invitation.
[6] Puisque Internasyonalismo était présent politiquement, même si sa délégation n'avait pu être présente physiquement.
[7] Voir à ce sujet nos articles "Conférence extraordinaire du CCI : Le combat pour la défense des principes organisationnels" et "15e Congrès du CCI : Renforcer l'organisation face aux enjeux de la période" dans les numéros 110 [57] et 114 [58] de la Revue Internationale.
[8] Voir "La confiance et la solidarité dans la lutte du prolétariat" ainsi que "Marxisme et éthique" dans les numéros 111 [59], 112 [60], 127 [23] et 128 [61] de la Revue internationale.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [62]
17e congrès du CCI : résolution sur la situation internationale
- 3702 reads
Décadence et décomposition du capitalisme
1) Un des éléments les plus importants déterminant la vie actuelle de la société capitaliste est l'entrée de celle-ci dans sa phase de décomposition. Le CCI a déjà, depuis la fin des années 1980, rendu compte des causes et des caractéristiques de cette phase de décomposition de la société. Il a notamment mis en évidence les faits suivants :
a) La phase de décomposition du capitalisme est partie intégrante de la période de décadence de ce système inaugurée avec la Première Guerre mondiale (comme la grande majorité des révolutionnaires l'avait mis en évidence à ce moment-là). A ce titre, elle conserve les principales caractéristiques propres à la décadence du capitalisme, auxquelles viennent s'ajouter des caractéristiques nouvelles et inédites dans la vie de la société.
b) Elle constitue la phase ultime de cette décadence, celle où non seulement se cumulent les traits les plus catastrophiques de ses phases précédentes, mais où l'on assiste à un véritable pourrissement sur pied de l'ensemble de l'édifice social.
c) Ce sont pratiquement tous les aspects de la société humaine qui sont affectés par la décomposition, et particulièrement ceux qui sont déterminants pour la survie même de celle-ci comme les conflits impérialistes et la lutte de classe. En ce sens, c'est avec en toile de fond la phase de décomposition et ses caractéristiques fondamentales qu'il convient d'examiner le moment présent de la situation internationale sous ses aspects majeurs : la crise économique du système capitaliste, les conflits au sein de la classe dominante, et particulièrement sur l'arène impérialiste, et enfin la lutte entre les deux classes fondamentales de la société, bourgeoisie et prolétariat.
2) Paradoxalement, la situation économique du capitalisme est l'aspect de cette société qui est le moins affecté par la décomposition. Il en est ainsi principalement parce que c'est justement cette situation économique qui détermine, en dernière instance, les autres aspects de la vie de ce système, y compris ceux qui relèvent de la décomposition. A l'image des autres modes de production qui l'ont précédé, le mode de production capitaliste, après avoir connu une période d'ascendance qui culmine à la fin du 19e siècle, est entré à son tour, au début du 20e, dans la période de sa décadence. A l'origine de cette décadence, comme pour celle des autres systèmes économiques, se trouve l'inadéquation croissante entre le développement des forces productives et les rapports de production. Concrètement, dans le cas du capitalisme, dont le développement est conditionné par la conquête de marchés extra capitalistes, la Première Guerre mondiale constitue la première manifestation significative de sa décadence. En effet, avec la fin de la conquête coloniale et économique du monde par les métropoles capitalistes, celles-ci sont conduites à s'affronter entre elles pour se disputer leurs marchés respectifs. Dès lors, le capitalisme est entré dans une nouvelle période de son histoire qualifiée par l'Internationale communiste en 1919 comme celle des guerres et des révolutions. L'échec de la vague révolutionnaire qui avait surgi de la Première Guerre mondiale a ainsi ouvert la porte à des convulsions croissantes de la société capitaliste : la grande dépression des années 1930 et sa conséquence, la Seconde Guerre mondiale bien plus meurtrière et barbare encore que la Première. La période qui a suivi, qualifiée par certains "experts" bourgeois de "Trente Glorieuses", a vu le capitalisme donner l'illusion qu'il avait réussi à surmonter ses contradictions mortelles, illusion qui a été partagée par des courants qui pourtant se réclamaient de la révolution communiste. En réalité, cette période de "prospérité" résultant à la fois d'éléments circonstanciels et des mesures palliatives aux effets de la crise économique, a de nouveau laissé la place à la crise ouverte du mode de production capitaliste à la fin des années 1960, avec une forte aggravation à partir du milieu des années 1970. Cette crise ouverte du capitalisme débouchait de nouveau vers l'alternative déjà annoncée par l'Internationale communiste : guerre mondiale ou développement des luttes ouvrières en direction du renversement du capitalisme. La guerre mondiale, contrairement à ce que pensent certains groupes de la Gauche communiste, ne constitue nullement une "solution" à la crise du capitalisme, permettant à celui-ci de se "régénérer", de renouer avec une croissance dynamique. C'est l'impasse dans laquelle se trouve ce système, l'aiguisement des tensions entre secteurs nationaux du capitalisme qui débouche sur une fuite en avant irrépressible sur le plan militaire dont l'aboutissement final est la guerre mondiale. Effectivement, conséquence de l'aggravation des convulsions économiques du capitalisme, les tensions impérialistes ont connu à partir des années 1970 une aggravation certaine. Cependant, elles n'ont pu déboucher sur la guerre mondiale du fait même du surgissement historique de la classe ouvrière à partir de 1968 en réaction aux premières atteintes de la crise. En même temps, si elle avait été capable de contrecarrer la seule perspective possible de la bourgeoisie (si l'on peut parler de "perspective"), la classe ouvrière, au-delà d'une combativité inconnue depuis des décennies, n'a pu mettre en avant sa propre perspective, la révolution communiste. C'est justement cette situation où aucune des deux classes déterminantes de la société ne peut présenter de perspective à cette dernière, où la classe dominante en est réduite à "gérer" au jour le jour et au coup par coup l'enfoncement de son économie dans une crise insurmontable, qui est à l'origine de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décomposition.
3) Une des manifestations majeures de cette absence de perspective historique est le développement du "chacun pour soi" qui affecte tous les niveaux de la société, depuis les individus jusqu'aux États. Cependant, l'on ne peut considérer qu'il y ait, sur le plan de la vie économique du capitalisme, de changement majeur dans ce domaine depuis l'entrée de la société dans sa phase de décomposition. En fait, le "chacun pour soi", la "concurrence de tous contre tous", sont des caractéristiques congénitales du mode de production capitaliste. Ces caractéristiques, il a dû les tempérer lors de l’entrée dans sa période de décadence par une intervention massive de l’État dans l’économie mise en place dès la Première Guerre mondiale et qu’il a réactivées dans les années 30, notamment avec les politiques fascistes ou keynésiennes. Cette intervention de l’État a été complétée, à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, par la mise en place d’organismes internationaux, tels le FMI, la Banque mondiale et l’OCDE et, ultérieurement, la Communauté économique européenne (ancêtre de l’Union européenne actuelle) afin d’empêcher que les contradictions économiques n’aboutissent à une débandade générale comme ce fut le cas à la suite du "jeudi noir" de 1929. Aujourd'hui, malgré tous les discours sur le "triomphe du libéralisme", sur le "libre exercice des lois du marché", les États n'ont renoncé ni à l'intervention dans l'économie de leurs pays respectifs, ni à l'utilisation des structures chargées de réguler quelque peu les rapports entre eux en en créant même de nouvelles, telle l'Organisation mondiale du commerce. Cela dit, ni ces politiques, ni ces organismes, s'ils ont permis de ralentir de façon significative le rythme d'enfoncement du capitalisme dans la crise, n'ont permis de venir à bout de celle-ci malgré les présents discours saluant les niveaux "historiques" de croissance de l'économie mondiale et les performances extraordinaires des deux géants asiatiques, l'Inde et surtout la Chine.
Crise économique : l'emballement de la fuite en avant dans l'endettement
4) Les bases sur lesquelles reposent les taux de croissance du PIB mondial aux cours des dernières années, et qui provoquent l’euphorie des bourgeois et de leurs laquais intellectuels, ne sont pas fondamentalement nouvelles. Elles sont les mêmes que celles qui ont permis d’empêcher que la saturation des marchés à l’origine de la crise ouverte à la fin des années 60 ne provoque un étouffement complet de l’économie mondiale et se résument dans un endettement croissant. A l’heure actuelle, la "locomotive" principale de la croissance mondiale est constituée par les énormes déficits de l'économie américaine, tant au niveau de son budget d'État que de sa balance commerciale. En réalité, il s'agit là d'une véritable fuite en avant qui, loin de permettre une solution définitive aux contradictions du capitalisme ne fait que lui préparer des lendemains encore plus douloureux et notamment des ralentissements brutaux de la croissance, comme celui-ci en a connus depuis plus de trente ans. Dès à présent, d'ailleurs, les menaces qui s'amoncellent sur le secteur des logements aux États-Unis, un des moteurs de l'économie américaine, et qui portent avec elles le danger de faillites bancaires catastrophiques, sème le trouble et l'inquiétude dans les milieux économiques. Cette inquiétude est renforcée par la perspective d'autres faillites touchant les "hedge funds" (fonds spéculatifs) faisant suite à celle d’Amaranth, en octobre 2006. La menace est d'autant plus sérieuse que ces organismes, dont la raison d'être est de réaliser de forts profits à court terme en jouant sur les variations des taux de change ou des cours des matières premières, ne sont nullement des francs tireurs en marge du système financier international. Ce sont en réalité les institutions financières les plus "sérieuses" qui placent une partie de leurs avoirs dans ces "hedge funds". De même, les sommes investies dans ces organismes sont considérables au point d'égaler le PIB annuel d'un pays comme la France et elles servent de "levier" à des mouvements de capitaux encore bien plus considérables (près de 700 000 milliards de dollars en 2002, soit 20 fois plus que les transactions sur les biens et services, c'est-à-dire des produits "réels"). Et ce ne sont pas les péroraisons des "alter mondialistes" et autres pourfendeurs de la "financiarisation" de l'économie qui y changeront quoi que ce soit. Ces courants politiques voudraient un capitalisme "propre", "équitable", tournant notamment le dos à la spéculation. En réalité, celle-ci n'est nullement le fait d'un "mauvais" capitalisme qui "oublie" sa responsabilité d'investir dans des secteurs réellement productifs. Comme Marx l'a établi depuis le 19e siècle, la spéculation résulte du fait que, dans la perspective d'un manque de débouchés suffisants pour les investissements productifs, les détenteurs de capitaux préfèrent les faire fructifier à court terme dans une immense loterie, une loterie qui transforme aujourd'hui le capitalisme en un casino planétaire. Vouloir que le capitalisme renonce à la spéculation dans la période actuelle est aussi réaliste que de vouloir que les tigres deviennent végétariens (ou que les dragons cessent de cracher du feu).
5) Les taux de croissance exceptionnels que connaissent à l'heure actuelle des pays comme l'Inde et surtout la Chine ne constituent en aucune façon une preuve d'un "nouveau souffle" de l'économie mondiale, même s'ils ont contribué pour une part non négligeable à la croissance élevée de celle-ci au cours de la dernière période. A la base de cette croissance exceptionnelle, c'est à nouveau la crise du capitalisme que, paradoxalement, l'on retrouve. En effet, cette croissance tire sa dynamique essentielle de deux facteurs : les exportations et les investissements de capitaux provenant des pays les plus développés. Si les réseaux commerciaux de ces derniers se tournent de plus en plus vers la distribution de biens fabriqués en Chine, en lieu et place de produits fabriqués dans les "vieux" pays industriels, c'est qu'ils peuvent les vendre à des prix bien plus bas, ce qui devient une nécessité absolue au moment d'une saturation croissante des marchés et donc d'une compétition commerciale de plus en plus exacerbée, en même temps qu'un tel processus permet de réduire le coût de la force de travail des salariés des pays capitalistes les plus développés. C'est à cette même logique qu'obéit le phénomène des "délocalisations", le transfert des activités industrielles des grandes entreprises vers des pays du Tiers-monde, où la main-d'œuvre est incomparablement moins chère que dans les pays les plus développés. Il faut d'ailleurs noter que si l'économie chinoise bénéficie de ces "délocalisations" sur son propre territoire, elle-même tend à son tour à les pratiquer en direction de pays où les salaires sont encore plus faibles, notamment en Afrique.
6) En fait, l'arrière plan de la "croissance à 2 chiffres" de la Chine, et notamment de son industrie, est celui d'une exploitation effrénée de la classe ouvrière de ce pays qui connaît souvent des conditions de vie comparables à celles de la classe ouvrière anglaise de la première moitié du 19e siècle dénoncées par Engels dans son ouvrage remarquable de 1844. En soi, ce n'est pas un signe de la faillite du capitalisme puisque c'est sur la base d'une exploitation aussi barbare du prolétariat que ce système s'est lancé à la conquête du monde. Cela dit, il existe des différences fondamentales entre la croissance et la condition ouvrière dans les premiers pays capitalistes au 19e siècle et celles de la Chine d'aujourd'hui :
- dans les premiers, l'augmentation des effectifs de la classe ouvrière industrielle dans tel ou tel pays n'a pas correspondu à leur réduction dans les autres : c'est de façon parallèle que se sont développés les secteurs industriels dans des pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne ou les États-Unis. En même temps, notamment grâce aux luttes de résistance du prolétariat, les conditions de vie de celui-ci ont connu une amélioration progressive tout au long de la seconde moitié du 19e siècle ;
- dans le cas de la Chine d'aujourd'hui, la croissance de l'industrie de ce pays (comme dans d'autres pays du Tiers-monde), se fait au détriment de nombreux secteurs industriels des pays de vieux capitalisme qui disparaissent progressivement ; en même temps, les "délocalisations" sont les instruments d'une attaque en règle contre la classe ouvrière de ces pays, attaque qui a commencé bien avant que celles-ci ne deviennent une pratique courante mais qui permet de l'intensifier encore en termes de chômage, de déqualification, de précarité et de baisse de leur niveau de vie.
Ainsi, loin de représenter un "nouveau souffle" de l'économie capitaliste, le "miracle chinois" et d'un certain nombre d'autres économies du Tiers-monde n'est pas autre chose qu'un avatar de la décadence du capitalisme. En outre, l'extrême dépendance de l'économie chinoise à l'égard de ses exportations constitue un facteur certain de fragilité face à une rétractation de la demande de ses clients actuels, rétractation qui ne saurait manquer d'arriver, notamment lorsque l'économie américaine sera contrainte de remettre de l'ordre dans l'endettement abyssal qui lui permet à l'heure actuelle de jouer le rôle de "locomotive" de la demande mondiale. Ainsi, tout comme le "miracle" représenté par les taux de croissance à deux chiffres des "tigres" et "dragons" asiatiques avait connu une fin douloureuse en 1997, le "miracle" chinois d'aujourd'hui, même s'il n'a pas des origines identiques et s'il dispose d'atouts bien plus sérieux, sera amené, tôt ou tard, à se heurter aux dures réalités de l'impasse historique du mode de production capitaliste.
L'aggravation des tensions impérialistes et du chaos
7) La vie économique de la société bourgeoise, ne peut échapper, dans aucun pays, aux lois de la décadence capitaliste, et pour cause : c'est d'abord sur ce plan que se manifeste cette décadence. Néanmoins, pour cette même raison, les manifestations majeures de la décomposition épargnent pour l'heure la sphère économique. On ne peut en dire autant de la sphère politique de la société capitaliste, notamment celle des antagonismes entre secteurs de la classe dominante et tout particulièrement celle des antagonismes impérialistes. En fait, la première grande manifestation de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décomposition concernait justement le domaine des conflits impérialistes : il s'agit de l'effondrement, à la fin des années 1980, du bloc impérialiste de l'Est qui a provoqué rapidement la disparition du bloc occidental. C'est en premier lieu sur le plan des relations politiques, diplomatiques et militaires entre États que s'exprime aujourd'hui le "chacun pour soi", caractéristique majeure de la phase de décomposition. Le système des blocs contenait le danger d'une troisième guerre mondiale, issue qui n'aurait manqué de survenir si le prolétariat mondial n'avait été capable d'y faire obstacle dès la fin des années 1960. Néanmoins, il représentait une certaine "organisation" des tensions impérialistes, notamment par la discipline imposée au sein de chacun des deux camps par sa puissance dominante. La situation qui s'est ouverte en 1989 est toute différente. Certes, le spectre de la guerre mondiale a cessé de menacer la planète mais, en même temps, on a assisté à un déchaînement des antagonismes impérialistes et des guerres locales avec une implication directe des grandes puissances, à commencer par la première d'entre elles, les États-Unis. Il revenait à ce pays, qui s'est investi depuis des décennies du rôle de "gendarme du monde", de poursuivre et renforcer ce rôle face au nouveau "désordre mondial" issu de la fin de la guerre froide. En réalité, s'il a pris à cœur ce rôle, ce n'est nullement pour contribuer à la stabilité de la planète mais fondamentalement pour tenter de rétablir son leadership sur celle-ci, un leadership sens cesse remis en cause, y compris et notamment par ses anciens alliés, du fait qu'il n'existe plus le ciment fondamental de chacun des blocs impérialistes, la menace d'un bloc adverse. En l'absence définitive de la "menace soviétique", le seul moyen pour la puissance américaine d'imposer sa discipline est de faire étalage de ce qui constitue sa force principale, l'énorme supériorité de sa puissance militaire. Ce faisant, la politique impérialiste des États-Unis est devenue un des principaux facteurs de l'instabilité du monde. Depuis le début des années 1990 les exemples ne manquent pas : la première guerre du Golfe, celle de 1991, visait à resserrer les liens, qui commençaient à disparaître, entre les anciens alliés du bloc occidental (et non pas à "faire respecter le droit international" bafoué par l'annexion irakienne du Koweït qui avait été présenté comme prétexte). Peu après, à propos de la Yougoslavie, l'unité entre les principaux anciens alliés du bloc occidental volait en éclats : l'Allemagne avait mis le feu aux poudres en poussant la Slovénie et la Croatie à se déclarer indépendantes, la France et la Grande-Bretagne nous servaient un remake de "l'Entente cordiale" du début du 20e siècle en soutien des intérêts impérialistes de la Serbie alors que les États-Unis se présentaient comme les parrains des musulmans de Bosnie.
8) La faillite de la bourgeoisie américaine, tout au long des années 1990, à imposer de façon durable son autorité, y compris à la suite de ses différentes opérations militaires, l'a conduite à rechercher un nouvel "ennemi" du "monde libre" et de la "démocratie", capable de ressouder derrière elle les principales puissances du monde, notamment celles qui avaient été ses alliées : le terrorisme islamique. Les attentats du 11 septembre 2001, dont il apparaît de plus en plus clairement (y compris aux yeux de plus d'un tiers de la population américaine et de la moitié des habitants de New York) qu'ils avaient été voulus, sinon préparés, par l'appareil d'état américain, devaient servir de point de départ de cette nouvelle croisade. Cinq ans après, l'échec de cette politique est patent. Si les attentats du 11 septembre ont permis aux États-Unis d'impliquer des pays comme la France et l'Allemagne dans leur intervention en Afghanistan, ils n'ont pas réussi à les entraîner dans leur aventure irakienne de 2003, réussissant même à susciter une alliance de circonstance entre ces deux pays et la Russie contre cette dernière intervention. Par la suite, certains de leurs "alliés" de la première heure au sein de la "coalition" qui est intervenue en Irak, tels l'Espagne et l'Italie, ont quitté le navire. Au final, la bourgeoisie américaine n'a atteint aucun des objectifs qu'elle s'était fixés officiellement ou officieusement : l'élimination des "armes de destruction de masse" en Irak, l'établissement d'une "démocratie" pacifique dans ce pays, la stabilisation et un retour à la paix de l'ensemble de la région sous l'égide américaine, le recul du terrorisme, l'adhésion de la population américaine aux interventions militaires de son gouvernement.
La question des "armes de destruction massive" a été réglée rapidement : très vite, il a été clair que les seules qui étaient présentes en Irak étaient celles apportées par la "coalition", ce qui, évidemment, a mis en évidence les mensonges de l'administration Bush pour "vendre" son projet d'invasion de ce pays.
Quant au recul du terrorisme, on peut constater que l'invasion en Irak ne lui a nullement coupé les ailes mais a constitué, au contraire, un puissant facteur de son développement, tant en Irak même que dans d'autres parties du monde, y compris dans les métropoles capitalistes, comme on a pu le voir à Madrid en mars 2004 et à Londres en juillet 2005.
Ainsi, l'établissement d'une "démocratie" pacifique en Irak s'est soldé par la mise en place d'un gouvernement fantoche qui ne peut conserver le moindre contrôle du pays sans le soutien massif des troupes américaines, "contrôle" qui se limite à quelques "zones de sécurité", laissant dans le reste du pays le champ libre aux massacres entre communautés chiites et sunnites ainsi qu'aux attentats terroristes qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de victimes depuis le renversement de Saddam Hussein.
La stabilisation et la paix au Proche et Moyen-Orient n'ont jamais paru aussi éloignées : dans le conflit cinquantenaire entre Israël et la Palestine, ces dernières années ont vu une aggravation continue de la situation que les affrontements inter palestiniens entre Fatah et Hamas, de même que le discrédit considérable du gouvernement israélien ne peuvent que rendre encore plus dramatiques. La perte d'autorité du géant américain dans la région, suite à son échec cuisant en Irak, n'est évidemment pas étrangère à l'enlisement et la faillite du "processus de paix" dont il est le principal parain.
Cette perte d'autorité est également en partie responsable des difficultés croissantes des forces de l'OTAN en Afghanistan et de la perte de contrôle du gouvernement Karzaï sur le pays face aux Talibans.
Par ailleurs, l'audace croissante dont fait preuve l'Iran sur la question des préparatifs en vue d'obtenir l'arme atomique est une conséquence directe de l'enlisement des États-Unis en Irak qui leur interdit toute autre intervention militaire.
Enfin, la volonté de la bourgeoisie américaine de surmonter définitivement le "syndrome du Vietnam", c'est-à-dire la réticence au sein de la population des États-Unis face à l'envoi de soldats sur des champs de bataille, a abouti au résultat inverse à celui qui était escompté. Si, dans un premier temps, l'émotion provoquée par les attentats du 11 septembre avait permis un renforcement massif au sein de cette population des sentiments nationalistes, de la volonté d'une "union nationale" et de la détermination à s'impliquer dans la "guerre contre le terrorisme", le rejet de la guerre et de l'envoi des soldats américains sur les champs de bataille est revenu en force au cours des dernières années.
Aujourd'hui, en Irak, la bourgeoisie américaine se trouve dans une véritable impasse. D'un côté, tant du point de vue strictement militaire que du point de vue économique et politique, elle n'a pas les moyens d'engager dans ce pays les effectifs qui pourraient éventuellement lui permettre d'y "rétablir l'ordre". De l'autre, elle ne peut pas se permettre de se retirer purement et simplement d'Irak sans, d'une part, afficher encore plus ouvertement la faillite totale de sa politique et, d'autre part, ouvrir les portes à une dislocation de l'Irak et à la déstabilisation encore bien plus considérable de l'ensemble de la région.
9) Ainsi le bilan du mandat Bush fils est certainement un des plus calamiteux de toute l'histoire des États-Unis. L'accession en 2001 à la tête de l'État américain des "neocons" a représenté une véritable catastrophe pour la bourgeoisie américaine. La question qui se pose est : comment a-t-il été possible que la première bourgeoisie du monde ait fait appel à cette bande d'aventuriers irresponsables et incompétents pour diriger la défense de ses intérêts ? Quelle est la cause de cet aveuglement de la classe dominante du principal pays capitaliste ? En fait, l'arrivée de l'équipe Cheney, Rumsfeld et compagnie aux rênes de l'État n'était pas le simple fait d'une monumentale "erreur de casting" de la part de cette classe. Si elle a aggravé considérablement la situation des États-Unis sur le plan impérialiste, c'était déjà la manifestation de l'impasse dans laquelle se trouvait ce pays confronté à une perte croissante de son leadership, et plus généralement au développement du "chacun pour soi" dans les relations internationales qui caractérise la phase de décomposition.
La meilleure preuve de cela est bien le fait que la bourgeoisie la plus habile et intelligente du monde, la bourgeoisie britannique, s'est elle-même laissé entraîner dans l'impasse de l'aventure irakienne. Un autre exemple de cette propension aux choix impérialistes calamiteux de la part des bourgeoisies les plus "efficaces", de celles qui avaient réussi jusqu'à présent à manier avec maestria l'emploi de leur puissance militaire, nous est donné, à une moindre échelle, par l'aventure catastrophique d'Israël au Liban au cours de l'été 2006, une offensive qui, avec le feu vert des "stratèges" de Washington, visait à affaiblir le Hezbollah et qui a réussi le tour de force de renforcer ce parti.
La destruction accélérée de l'environnement
10) Le chaos militaire qui se développe de par le monde, plongeant de vastes régions dans un véritable enfer et la désolation, notamment au Moyen-Orient mais aussi et surtout en Afrique, n'est pas la seule manifestation de l'impasse historique dans laquelle se trouve le capitalisme ni, à terme, la plus menaçante pour l'espèce humaine. Aujourd'hui, il est devenu clair que le maintien du système capitaliste tel qu'il a fonctionné jusqu'à présent porte avec lui la perspective de la destruction de l'environnement qui avait permis l'ascension de l'humanité. La poursuite de l'émission des gaz à effet de serre au rythme actuel, avec le réchauffement de la planète qui en résulte, annonce le déchaînement de catastrophes climatiques sans précédent (canicules, ouragans, désertification, inondations…) avec tout un cortège de calamités humaines effrayantes (famines, déplacement de centaines de millions d'êtres humain, surpopulation dans les régions les plus épargnées…). Face aux premiers effets visibles de cette dégradation de l'environnement, les gouvernements et les secteurs dirigeants de la bourgeoisie ne peuvent plus cacher aux yeux des populations la gravité de la situation et l'avenir catastrophique qui s'annonce. Désormais, les bourgeoisies les plus puissantes et la presque totalité des partis politiques bourgeois se peignent de vert pour promettre qu'ils vont prendre les mesures pour épargner à l'humanité la catastrophe annoncée. Mais il en est du problème de la destruction de l'environnement comme de celui de la guerre : tous les secteurs de la bourgeoisie se déclarent CONTRE cette dernière, mais cette classe, depuis que le capitalisme est entré en décadence est incapable de garantir la paix. Et ce n'est nullement là une question de bonne ou mauvaise volonté (même si derrière les secteurs qui poussent le plus à la guerre on peut trouver les intérêts les plus sordides). Même les dirigeants bourgeois les plus "pacifistes" ne peuvent échapper à une logique objective qui lamine leurs velléités "humanistes" ou la "raison". De la même façon, la "bonne volonté" affichée de façon croissante par les dirigeants de la bourgeoisie vis-à-vis de la protection de l'environnement, même lorsqu'elle n'est pas un simple argument électoral, ne pourra rien contre les contraintes de l'économie capitaliste. S'attaquer efficacement au problème de l'émission des gaz à effet de serre suppose des bouleversements considérables dans les secteurs de la production industrielle, de la production d'énergie, des transports, de l'habitat et donc des investissements massifs et prioritaires dans tous ces secteurs. De même, cela suppose de remettre en cause des intérêts économiques considérables, tant au niveau d'immenses entreprises qu'au niveau des états. Concrètement, si un État prenait à son niveau les dispositions nécessaires pour apporter une contribution efficace à la solution du problème, il se verrait immédiatement pénalisé de façon catastrophique face à la compétition sur le marché mondial. Il en est des États face aux mesures à prendre pour combattre le réchauffement climatique comme des bourgeois face aux augmentations des salaires ouvriers. Ils sont tous POUR de telles mesures… chez les autres. Tant que survivra le mode de production capitaliste, l'humanité est condamnée à subir de façon croissante les calaminés en tous ordres que ce système à l'agonie ne peut éviter de lui imposer, des calamités qui menacent l'existence même de celle-ci.
Ainsi, comme le CCI l'avait mis en évidence il y a plus de 15 ans, le capitalisme en décomposition porte avec lui des menaces considérables pour la survie de l'espèce humaine. L'alternative annoncée par Engels à la fin du 19e siècle, socialisme ou barbarie, est devenue tout au long du 20e siècle une sinistre réalité. Ce que le 21e siècle nous offre comme perspective, c'est tout simplement socialisme ou destruction de l'humanité. Voila l'enjeu véritable auquel se confronte la seule force de la société en mesure de renverser le capitalisme, la classe ouvrière mondiale.
La poursuite des combats de la classe ouvrière et de la maturation de sa conscience
11) A cet enjeu, le prolétariat s'y est déjà confronté, comme on l'a vu, depuis plusieurs décennies puisque c'est son surgissement historique à partir de 1968, mettant fin à la plus profonde contre-révolution de son histoire, qui a empêché le capitalisme d'apporter sa propre réponse à la crise ouverte de son économie, la guerre mondiale. Pendant deux décennies, les luttes ouvrières se sont poursuivies, avec des hauts et des bas, avec des avancées et des reculs, permettant aux travailleurs d'acquérir toute une expérience de la lutte, et notamment du rôle de sabotage qui revient aux syndicats. En même temps, la classe ouvrière a été soumise de façon croissante au poids de la décomposition, ce qui explique notamment le fait que le rejet du syndicalisme classique se soit souvent accompagné d'un repliement vers le corporatisme, témoin du poids du chacun pour soi au sein même des luttes. C'est finalement la décomposition du capitalisme qui a porté un coup décisif à cette première série de combats prolétariens à travers sa manifestation la plus spectaculaire à ce jour, l'effondrement du bloc de l'Est et des régimes staliniens en 1989. Les campagnes assourdissantes de la bourgeoisie sur la "faillite du communisme", la "victoire définitive du capitalisme libéral et démocratique", la "fin de la lutte de classe", voire de la classe ouvrière elle-même, ont provoqué un recul important du prolétariat, tant au niveau de sa conscience que de sa combativité. Ce recul était profond et a duré plus de dix ans. Il a marqué toute une génération de travailleurs, engendrant désarroi et même démoralisation. Ce désarroi n'a pas été provoqué uniquement par les événements intervenus à la fin des années 80 mais aussi par ceux qui en ont résulté comme la première guerre du Golfe en 1991 et la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Ces événements avaient apporté un démenti cinglant aux déclarations euphoriques du président George Bush père annonçant, avec la fin de la guerre froide, l'ouverture d'une "ère nouvelle de paix et de prospérité" mais, dans un contexte général de désarroi de la classe, celle-ci n'a pas pu en profiter pour reprendre le chemin de sa prise de conscience. Au contraire, ces événements ont aggravé un profond sentiment d'impuissance en son sein venant saper encore plus sa confiance en soi et sa combativité.
Au cours des années 1990, la classe ouvrière n'a pas renoncé totalement au combat. La poursuite des attaques capitalistes l'a obligée à mener des luttes de résistance mais ces luttes n'avaient ni l'ampleur, ni la conscience, ni la capacité à se confronter aux syndicats qui étaient celles de la période précédente. Ce n'est qu'à partir de 2003, notamment à travers les grandes mobilisations contre les attaques visant les retraites en France et en Autriche, que le prolétariat a commencé réellement à sortir du recul qui l'avait affecté depuis 1989. Depuis, cette tendance à la reprise des luttes de la classe et du développement de la conscience en son sein ne s'est pas démentie. Les combats ouvriers ont affecté la plupart des pays centraux, y compris les plus importants d'entre eux comme les États-Unis (Boeing et transports de NY en 2005), l'Allemagne (Daimler et Opel en 2004, médecins hospitaliers au printemps 2006, Deutsche Telekom au printemps 2007), la Grande-Bretagne (aéroport de Londres en août 2005, secteur public au printemps 2006), la France (mouvement des étudiants et des lycéens contre le CPE au printemps 2006) mais aussi toute une série de pays de la périphérie comme Dubaï (ouvriers du bâtiment au printemps 2006), le Bengladesh (ouvriers du textile au printemps 2006), l'Égypte (ouvriers des textiles et des transports au printemps 2007).
12) Engels a écrit que la classe ouvrière mène son combat sur trois plans : économique, politique et théorique. C'est notamment en comparant les différences sur ces trois plans entre la vague de luttes débutées en 1968 et celle qui commence en 2003 que l'on peut dégager les perspectives de cette dernière.
La vague de luttes qui commence en 1968 avait une importance politique considérable : elle signifiait en particulier la fin de la période de contre-révolution. De même, elle a suscité une réflexion théorique de premier plan puisqu'elle a permis une réapparition significative du courant de la Gauche communiste dont la formation du CCI, en 1975, a constitué l'expression la plus importante. Les combats de mai 1968 en France, de "l'automne chaud" italien de 1969, avaient pu laisser penser, du fait des préoccupations politiques qui s'y étaient exprimées, qu'on allait assister à une politisation significative de la classe ouvrière internationale au cours des luttes qu'elle allait mener par la suite. Mais cette potentialité ne s'est pas réalisée. L'identité de classe qui s'est développée au sein du prolétariat au cours de ces luttes était bien plus celle d'une catégorie économique que d'une force politique au sein de la société. En particulier, le fait que ce soient ses propres luttes qui ont empêché la bourgeoisie de s'acheminer vers une troisième guerre mondiale est passé complètement inaperçu pour la classe (y compris, d'ailleurs, pour la grande majorité des groupes révolutionnaires). De même, le surgissement de la grève de masse en Pologne en août 1980, s'il a représenté un sommet à ce jour (depuis la fin de la période révolutionnaire du premier après guerre) dans la capacité organisationnelle du prolétariat, a manifesté une faiblesse politique considérable, la seule "politisation" dont il ait fait preuve étant son adhésion aux thèmes démocratiques bourgeois, voire au nationalisme.
Il en a été ainsi pour toute une série de raisons que le CCI a déjà analysées, notamment :
- le rythme lent de la crise économique qui, contrairement à la guerre impérialiste d'où était surgie la première vague révolutionnaire, n'a pu mettre en évidence d'emblée la faillite du système ce qui a favorisé le maintien d'illusions sur la capacité de celui-ci à garantir un niveau de vie décent à la classe ouvrière ;
- la méfiance vis-à-vis des organisations politiques révolutionnaires du fait de l'expérience traumatisante du stalinisme (qui a pris la forme parmi les prolétaires des pays du bloc russe de profondes illusions sur les "bienfaits" de la démocratie bourgeoise traditionnelle) ;
- le poids de la rupture organique entre les organisations révolutionnaires du passé et celles d'aujourd'hui qui a coupé ces dernières de leur classe.
13) La situation dans laquelle se développe aujourd'hui la nouvelle vague des combats de classe est très différente :
- près de quatre décennies de crise ouverte et d'attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière, notamment la montée du chômage et de la précarité, ont balayé les illusions que "ça pourrait aller mieux demain" : les vieilles générations de prolétaires aussi bien que les nouvelles sont de plus en plus conscientes du fait que "demain sera encore pire qu'aujourd'hui" ;
- plus généralement, la permanence des affrontements guerriers prenant des formes de plus en plus barbares de même que la menace dès à présent sensible de la destruction de l'environnement engendrent la montée, encore sourde et confuse, du sentiment de la nécessité de transformer en profondeur la société : l'apparition des mouvements alter mondialistes et la mise en avant par ceux-ci de leur slogan "un autre monde est possible" constituent une sorte de contrepoison sécrétée par la société bourgeoise en vue de dévoyer ce sentiment ;
- le traumatisme provoqué par le stalinisme et par les campagnes qui ont suivi sa chute, il y a maintenant presque deux décennies, s'est éloigné dans le temps : les nouvelles générations de prolétaires qui entrent aujourd'hui dans la vie active et, potentiellement, dans la lutte de classe n'en étaient qu'au stade de l'enfance lorsque s'est déchaîné le gros des campagnes sur la "mort du communisme".
Ces conditions déterminent toute une série de différences entre la vague actuelle de luttes et celle qui a pris fin en 1989.
Ainsi, même si elles répondent à des attaques économiques par certains côtés bien plus graves et générales que celles qui avaient provoqué les surgissements spectaculaires et massifs de la première vague, les luttes actuelles n'ont pas atteint, jusqu'à présent, tout au moins dans les pays centraux du capitalisme, leur même caractère massif. Il en est ainsi pour deux raisons essentielles :
- le resurgissement historique du prolétariat à la fin des années 60 a surpris la bourgeoisie mais cela ne saurait évidemment plus être le cas aujourd'hui et elle prend un maximum de mesures pour anticiper les mouvements de la classe et limiter leur extension comme l'atteste notamment les black-out systématiques qui les accompagnent ;
- l'emploi de l'arme de la grève est beaucoup plus difficile aujourd'hui du fait, notamment, du poids du chômage qui agit comme élément de chantage sur les ouvriers et aussi parce que ces derniers sont de plus en plus conscients que la marge de manœuvre dont dispose la bourgeoisie pour satisfaire leurs revendications est toujours plus mince.
Cependant, ce dernier aspect de la situation n'est pas que facteur de timidité des travailleurs envers la lutte massive. Il porte avec lui une prise de conscience en profondeur de la faillite définitive du capitalisme laquelle constitue la condition de la prise de conscience de la nécessité de renverser ce système. D'une certaine façon, même si c'est encore de façon très confuse, c'est l'ampleur des enjeux que posent les combats de la classe, rien de moins que la révolution communiste, qui détermine l'hésitation de la classe ouvrière à engager ces combats.
Ainsi, même si les luttes économiques de la classe sont pour le moment moins massives que lors de la première vague, elles contiennent, du moins implicitement, une dimension politique bien plus importante. Et cette dimension politique est déjà passée à une manifestation explicite comme le démontre le fait qu'elles incorporent de façon croissante la question de la solidarité, une question de premier ordre puisqu'elle constitue le "contrepoison" par excellence du "chacun pour soi" propre à la décomposition sociale et que, surtout, elle est au cœur de la capacité du prolétariat mondial non seulement de développer ses combats présents mais aussi de renverser le capitalisme :
- ouvriers de l'usine de Bremen de Daimler se mettant en grève spontanée face au chantage exercé par la direction à l'égard des ouvriers de Stuttgart de la même entreprise ;
- grève de solidarité des bagagistes de l'aéroport de Londres contre le licenciement des travailleurs d'une entreprise de restauration, et cela en dépit du caractère illégal d'une telle grève ;
- grève des travailleurs des transports de New York en solidarité avec les nouvelles générations à qui la direction se proposait d'imposer des contrats beaucoup plus défavorables.
14) Cette question de la solidarité a été au cœur du mouvement contre le CPE du printemps 2006 en France qui, s'il a concerné principalement la jeunesse scolarisée (étudiants et lycéens), s'est situé pleinement sur un terrain de classe :
- solidarité active des étudiants des universités les plus en pointe pour venir soutenir leurs camarades des autres universités ;
- solidarité envers les enfants de la classe ouvrière des banlieues dont la révolte désespérée de l'automne précédent révélait les terribles conditions qu'ils subissent au quotidien et l'absence de perspective que leur offre le capital ;
- solidarité entre générations, entre ceux qui s'apprêtent à devenir chômeurs ou travailleurs précaires et ceux qui ont déjà rejoint la situation de salariés, entre ceux qui s'éveillent aux combats de classe et ceux qui avaient déjà une expérience de ces derniers.
15) Ce mouvement a été également exemplaire en ce qui concerne la capacité de la classe à prendre en main ses luttes à travers les assemblées et les comités de grève responsables devant celles-ci (une capacité qu'on a vue également se manifester dans la lutte des ouvriers de la métallurgie de Vigo, en Espagne, au printemps 2006 qui, toutes entreprises confondues, tenaient des assemblées quotidiennes dans la rue). Cela a été permis notamment par le fait que les syndicats sont extrêmement faibles en milieu étudiant et qu'ils n'ont pu jouer le rôle de saboteurs des luttes qu'ils jouent traditionnellement, et qu'ils continueront de jouer jusqu'à la révolution. Une illustration du rôle anti-ouvrier que continuent de jouer les syndicats est le fait que les luttes massives auxquelles on a pu assister jusqu'à présent ont surtout affecté des pays du tiers-monde, là où les syndicats sont très faibles (comme au Bengladesh) ou bien totalement identifiés comme des organes de l'État (comme en Égypte).
16) Le mouvement contre le CPE, qui s'est produit dans le même pays où s'était déroulé le premier et plus spectaculaire combat de la reprise historique du prolétariat, la grève généralisée de mai 1968, nous apporte également d'autres enseignements concernant les différences entre la vague actuelle de luttes et la précédente :
- en 1968, le mouvement des étudiants et celui des ouvriers, s'ils s'étaient succédés dans le temps, et s'il existait une sympathie entre eux, exprimaient deux réalités différentes en rapport avec l'entrée du capitalisme dans sa crise ouverte : la révolte de la petite bourgeoisie intellectuelle face à la perspective d'une dégradation de son statut dans la société du côté des étudiants, une lutte économique des ouvriers contre le début de la dégradation de leurs conditions d'existence ; en 2006, le mouvement des étudiants était un mouvement de la classe ouvrière, ce qui illustre le fait que la modification du type d'activité salariée qui a affecté les pays les plus développés (croissance du secteur tertiaire au détriment du secteur industriel) ne remet pas en cause la capacité du prolétariat de ces pays de mener des combats de classe ;
- dans le mouvement de 1968, la question de la révolution était discutée au quotidien, mais cette préoccupation concernait principalement les étudiants et l'idée que la majorité d'entre eux s'en faisait relevait de variantes de l'idéologie bourgeoise : le castrisme à Cuba ou le maoïsme en Chine ; dans le mouvement de 2006, la question de la révolution était fort peu présente mais il existait en revanche une claire conscience que seules la mobilisation et l'unité de la classe des salariés étaient en mesure de faire reculer les attaques bourgeoises.
17) Cette dernière question renvoie au troisième aspect de la lutte du prolétariat tel qu'Engels l'a établi : la lutte théorique, le développement de la réflexion au sein de la classe sur les perspectives générales de son combat et le surgissement d'éléments et organisations produits et facteurs actifs de cet effort. Aujourd'hui, comme en 1968, la reprise des combats de classe s'accompagne d'une réflexion en profondeur dont l'apparition de nouveaux éléments se tournant vers les positions de la Gauche communiste constitue la pointe émergée de l'iceberg. Il existe, en ce sens, des différences notables entre le processus actuel de réflexion et celui qui s'était déroulé à partir de 1968. La réflexion qui a débuté à partir de cette date faisait suite au surgissement de luttes massives et spectaculaires alors que le processus actuel n'a pas attendu que la classe ouvrière soit en mesure de mener des luttes de la même ampleur pour débuter. C'est une des conséquences de la différence des conditions auxquelles fait face aujourd'hui le prolétariat par rapport à celles qui prévalaient à la fin des années 1960.
Une des caractéristiques de la vague de luttes qui débute en 1968 est que, du fait même de son ampleur, elle démontre la possibilité de la révolution prolétarienne, possibilité qui avait disparu des esprits du fait de la profondeur de la contre-révolution et des illusions créées par la "prospérité" qu'avait connue le capitalisme à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce n'est pas la possibilité de la révolution qui constitue l'aliment principal du processus de réflexion mais, au vu des perspectives catastrophiques que nous offre le capitalisme, sa nécessité. De ce fait, s'il est moins rapide et moins immédiatement visible que dans les années 1970, ce processus est beaucoup plus profond et ne sera pas affecté par les moments de repli des luttes ouvrières.
En fait, l'enthousiasme pour l'idée de révolution qui s'était exprimé en 1968 et les années suivantes, du fait même des bases qui l'avaient déterminé, avait favorisé le recrutement par les groupes gauchistes d'une grande majorité des éléments qui avaient adhéré à cette idée. Seule une toute petite minorité de ces éléments, ceux qui étaient les moins marqués par l'idéologie petite-bourgeoise radicale et l'immédiatisme émanant du mouvement des étudiants, avaient réussi à s'approcher des positions de la Gauche communiste et à devenir militants des organisations de celle-ci. Les difficultés qu'a nécessairement rencontrées le mouvement de la classe ouvrière, notamment suite aux différentes contre-offensives de la classe dominante et dans un contexte où pouvaient encore peser les illusions sur une possibilité pour le capitalisme de redresser la situation, a favorisé un retour significatif de l'idéologie réformiste dont ces groupes gauchistes se sont faits les promoteurs "radicaux" à la gauche d'un stalinisme officiel de plus en plus discrédité. Aujourd'hui, notamment à la suite de l'effondrement historique du stalinisme, les courants gauchistes tendent de plus en plus à prendre la place laissée vacante par celui-ci. Cette "officialisation" de ces courants dans le jeu politique bourgeois tend à provoquer une réaction parmi les plus sincères de leurs militants qui partent à la recherche des authentiques positions de classe. C'est pour cela que l'effort de réflexion au sein de la classe se manifeste par l'émergence non seulement d'éléments très jeunes qui d'emblée se tournent vers les positions de la Gauche communiste mais également d'éléments plus âgés ayant derrière eux une expérience dans les organisations bourgeoises d'extrême gauche. C'est, en soi, un phénomène très positif et qui porte avec lui la promesse que les énergies révolutionnaires, qui surgiront nécessairement au fur et à mesure que la classe développera ses luttes, ne pourront pas être captées et stérilisées avec la même facilité et la même ampleur qu'elles ne le furent au cours des années 1970 et qu'elles rejoindront en bien plus grand nombre les positions et les organisations de la Gauche communiste.
La responsabilité des organisations révolutionnaires, et du CCI en particulier, est d'être partie prenante de la réflexion qui se mène d'ores et déjà au sein de la classe, non seulement en intervenant activement dans les luttes qu'elle commence à développer mais également en stimulant la démarche des groupes et éléments qui se proposent de rejoindre son combat.
CCI
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Le communisme (VI) : les problèmes de la période de transition (Bilan n° 34, 1936, les stigmates de l'économie prolétarienne)
- 2629 reads
Dans les deux derniers numéros de la Revue internationale, nous avons publié les premiers articles de Mitchell sur les problèmes de la période de transition, qui font partie d'une série parue au cours des années 1930 dans Bilan, revue théorique de la Gauche communiste d'Italie. Ces deux articles ont posé le cadre historique de l'avènement de la révolution prolétarienne - le fait que le capitalisme était "mûr" au niveau mondial et non dans un pays ou une région en particulier - et ont examiné les principales leçons politiques à tirer de l'isolement et de la dégénérescence de la révolution en Russie, en particulier concernant les rapports entre le prolétariat et l'Etat de transition. Les deux articles suivants de Mitchell poursuivent sur cette question en examinant le problème du contenu économique de la révolution prolétarienne.
L'article publié ci-dessous, paru dans Bilan n°34 (août - septembre 1934), se présente comme une polémique avec un autre courant internationaliste de l'époque, le GIK des Pays-Bas, dont le document "Principes fondamentaux de la production et de la distribution communistes" avait été publié dans les années 1930 et résumé en français dans Bilan par Hennaut, du groupe belge la Ligue des Communistes internationalistes. C'était tout à fait dans l'esprit de Bilan et de son engagement de principe dans le débat entre révolutionnaires, de publier ce résumé et de lancer une discussion avec la tendance "communiste de conseils" que représentait le GIK. L'article porte un certain nombre de critiques à la démarche adoptée par le GIK sur la période de transition mais ne perd jamais de vue qu'il s'agissait d'un débat au sein du camp prolétarien.
Dans le futur, nous publierons un article plus détaillé qui prend position sur ce débat. Ce que nous voulons, pour le moment, c'est souligner, comme nous l'avons fait de nombreuses fois auparavant, que si nous ne sommes pas toujours d'accord avec tous les termes ni toutes les conclusions de Bilan, nous partageons totalement le fond de sa méthode : la nécessité de se référer aux contributions de nos prédécesseurs dans le mouvement révolutionnaire, l'effort constant de les réexaminer à la lumière de la lutte de classe, en particulier de l'expérience gigantesque apportée par la révolution russe, et le rejet de toute solution facile et simpliste aux problèmes sans précédent qui seront posés par la transformation communiste de la société. Dans cet article en particulier, il existe une claire démarcation vis-à-vis du faux radicalisme qui imagine que la loi de la valeur et, de façon générale, tout l'héritage de la société bourgeoise, pourraient être abolis par décret du jour au lendemain après la prise du pouvoir par la classe ouvrière.
Bilan n°34 (août-septembre 1936)
Les stigmates de l'économie prolétarienne
Le marxiste fonde toujours ses analyses et ses perspectives sur le matérialisme dialectique et non sur des aspirations idéalistes. Marx disait "Lors même qu'une société est arrivée à découvrir la piste de la loi naturelle qui préside à son mouvement (…) elle ne peut ni dépasser d'un saut ni abolir par des décrets les phases de son développement naturel; mais elle peut abréger la période de la gestation, et adoucir les maux de leur enfantement" (Préface du Capital). De même le Prolétariat, après avoir fait faire un "bond" à la société, par la révolution politique, ne peut que se soumettre à la loi naturelle d'évolution, tout en agissant pour que se précipite le rythme de la transformation sociale. Les formes sociales intermédiaires, "hybrides", qui surgissent dans la phase reliant le capitalisme au communisme, le prolétariat doit les diriger dans la voie du dépérissement - s'il veut réaliser ses buts historiques - mais il ne peut les supprimer par décret. La suppression de la propriété privée - même si elle est radicale - ne supprime pas ipso facto l'idéologie capitaliste ni le droit bourgeois : "la tradition de toutes les générations de morts pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants". (K.Marx.)
La persistance de la loi de la valeur dans la période transitoire
Nous aurons, dans cette partie de notre étude, à nous étendre assez longuement sur certaines catégories économiques (valeur travail, monnaie, salaire), dont l'économie prolétarienne hérite - sans bénéfice d'inventaire - du capitalisme. C'est important, parce qu'on a tenté (nous visons surtout les Internationalistes hollandais, dont nous examinerons les arguments) de faire de ces catégories, des agents de décomposition de la Révolution russe, alors que la dégénérescence de celle-ci n'est pas d'ordre économique, mais politique.
En premier lieu, qu'est ce qu'une catégorie économique ?
Marx répond : "les catégories économiques ne sont que les expressions théoriques, les abstractions des rapports sociaux de la production (…) Les mêmes hommes qui établissent les rapports sociaux conformément à leur productivité matérielle, produisent aussi les principes, les idées, les catégories, conformément à leurs rapports sociaux. Ces idées, ces catégories, sont aussi peu éternelles que les relations qu'elles expriment. Elles sont des produits historiques et transitoires". (Misère de la Philosophie)
On pourrait être tenté de déduire de cette définition, qu'un nouveau mode de production (ou l'instauration de ses bases) apporte automatiquement avec lui les rapports sociaux et les catégories correspondants : ainsi l'appropriation collective des forces productives éliminerait d'emblée les rapports capitalistes et les catégories qui en sont l'expression, ce qui au point de vue social, signifierait la disparition immédiate des classes. Mais Marx a bien précisé qu'au sein de la société "il y a un mouvement continuel d'accroissement dans les forces productives, de destruction dans les rapports sociaux, de formation dans les idées" (Misère de la Philosophie) ; c'est-à-dire qu'il y a interpénétration de deux processus sociaux, l'un, de décroissance des rapports et catégories appartenant au système de production en déclin, l'autre, de croissance des rapports et catégories qu'engendre le système nouveau : le mouvement dialectique imprimé à l'évolution des sociétés est éternel (tout au plus prendra-t-il d'autres formes dans une société communiste achevée).
A plus forte raison, sera-t-il tourmenté et puissant dans une période de transition entre deux types de société.
Certaines catégories économiques, qui auront survécu à la "catastrophe" révolutionnaire, ne disparaîtront par conséquent qu'avec les rapports de classe qui les auront engendrées, c'est-à-dire, avec les classes elles-mêmes, lorsque s'ouvrira la phase communiste de la société prolétarienne. Dans la phase transitoire, leur vitalité s'exercera certes en raison inverse du poids spécifique des secteurs "socialisés", au sein de l'économie prolétarienne, mais en fonction surtout du rythme de développement de la Révolution mondiale.
La catégorie fondamentale à envisager, c'est la Valeur travail, parce qu'elle constitue le fondement de toutes les autres catégories capitalistes.
Nous ne sommes pas riches en littérature marxiste traitant du "devenir" des catégories économiques dans la période transitoire ; nous possédons sur ce sujet quelques bribes dispersées de la pensée d'Engels dans son Anti-Dühring et de Marx dans Le Capital ; de ce dernier nous avons en outre sa Critique du programme de Gotha, dont chaque terme relatif à la question qui nous occupe, prend de ce fait une importance considérable, dont le sens véritable ne peut être restitué que s'il est rapporté à la théorie de la valeur elle-même.
La valeur possède cette étrange caractéristique que, tout en trouvant sa source dans l'activité d'une force physique, le travail, elle n'a elle-même aucune réalité matérielle. Avant d'analyser la substance de la valeur, Marx, dans sa préface du Capital, prend soin de nous avertir de cette particularité : "La forme valeur, qui a son plein épanouissement dans la forme argent, est fort simple, parce que très peu substantielle. Et cependant, c'est en vain que, depuis plus de 2 000 ans, l'esprit humain s'est efforcé de la pénétrer, alors qu'il a réussi, du moins approximativement, à analyser des formes plus riches et beaucoup plus complexes. Et pourquoi cela ? Parce que le corps complet est plus facile à étudier que la cellule. Ajoutons que, dans l'analyse des formes économiques, on ne peut recourir ni au microscope, ni aux réactifs chimiques : l'abstraction doit tenir lieu de tout."
Et au cours de cette analyse de la valeur, Marx ajoute que : "Par un contraste direct avec la nature physique et matérielle des corps de marchandises, pas un atome de matière naturelle n'entre dans la réalité de leur valeur. On a donc beau retourner dans tous les sens une marchandise déterminée, on ne saurait lui trouver le caractère d'objet de valeur. La réalité de valeur des marchandises est purement sociale."
En outre, pour ce qui concerne la substance de la valeur, c'est-à-dire le travail humain, Marx sous-entend toujours que la valeur d'un produit exprime une certaine quantité de travail simple, lorsqu'elle affirme sa réalité sociale. La réduction du travail complexe à du travail simple est un fait qui se réalise constamment : "Le travail complexe ne vaut que comme puissance du travail simple, ou plutôt comme travail simple multiplié, en sorte qu'une somme moindre de travail complexe équivaut à une somme supérieure de travail simple... Peu importe qu'une marchandise soit le produit du travail le plus complexe ; elle est toujours, quant à la valeur, ramenée au produit du travail simple et ne représente donc qu'une somme déterminée de travail simple". Encore faudrait-il savoir comment cette réduction s'opère. Mais Marx est homme de science et il se borne à nous répondre : "Les proportions diverses dans lesquelles diverses espèces de travail se ramènent au travail simple comme unité de mesure, sont fixées par un processus social, derrière le dos des producteurs et leur paraissent pour cette raison établies par l'usage". (nous soulignons. N.D.L.R.)
C'est un phénomène que Marx constate mais qu'il ne peut expliquer, parce que l'état de ses connaissances sur la valeur ne le lui permet pas. Ce que nous savons seulement c'est que dans la production de marchandises, le marché est le creuset où se fondent tous les travaux individuels, toutes les qualités de travail, où se cristallise le travail moyen réduit à du travail simple : "la société ne valorise pas la maladresse fortuite d'un individu ; elle ne reconnaît comme travail humain général que le travail d'une habileté moyenne et normale (...) ce n'est que dans la mesure où il est socialement nécessaire que le travail individuel contient du travail humain général". (Engels : Anti-Dühring)
A tous les stades historiques du développement social, il a fallu que l'homme connaisse avec plus ou moins de précision la somme des dépenses de travail nécessaires à la production des forces productives et des objets de consommation. Jusqu'ici, cette évaluation a toujours pris des formes empiriques et anarchiques ; avec la production capitaliste, et sous la poussée de la contradiction fondamentale du système, la forme anarchique a atteint ses limites extrêmes, mais ce qu'il importe de souligner encore une fois, c'est que la mesure du temps de travail social ne s'établit pas directement d'une manière absolue mathématique, mais tout à fait relativement, par un rapport qui s'établit sur le marché, à l'aide de la monnaie : la quantité de travail social que contient un objet ne s'exprime pas réellement en heures de travail mais en une autre marchandise quelconque qui, sur le marché, apparaît empiriquement comme renfermant une même quantité de travail social : en tout état de cause, le nombre d'heures de travail social et simple qu'exige en moyenne la production d'un objet reste inconnu. D'ailleurs, Engels fait remarquer que "la science économique de la production marchande n'est nullement la seule science qui aurait à compter avec des facteurs connus seulement d'une manière relative" (Anti-Dühring). Et il fait un parallèle avec les sciences naturelles qui utilisent, en physique, le calcul moléculaire et, en chimie, le calcul atomique : "De même que la production marchande et la science économique de cette production obtiennent une expression relative pour les quantités de travail inconnues d'elles, contenues dans chaque marchandise, en comparant ces marchandises au point de vue de leur teneur relative en travail ; de même la chimie se crée une expression relative pour les poids atomiques qu'elle ignore, en comparant les divers éléments au point de vue de leur poids atomique, en exprimant le poids atomique de l'un par une multiplication ou une fraction de l'autre (soufre, oxygène, hydrogène). Et de même que la production marchande élève l'or au rang de marchandise absolue, d'équivalent général de toutes les autres marchandises, de mesure de toutes les valeurs, de même la chimie élève l'hydrogène au rang de monnaie chimique, en posant le poids atomique de l'hydrogène comme égal à 1, en réduisant les poids atomiques de tous les autres éléments à l'hydrogène, en les exprimant par divers multiples du poids atomique de l'hydrogène".(Anti-Dühring)
Si on se rapporte à la caractéristique essentielle de la période transitoire, à savoir que celle-ci exprime encore une certaine déficience économique exigeant un développement plus grand de la productivité du travail, on en déduira sans difficulté que le calcul du travail consommé continuera de s'imposer, non seulement en fonction d'une répartition rationnelle du travail social, nécessaire dans toutes les .sociétés, mais surtout par besoin d'un régulateur des activités et rapports sociaux.
L'illusion de l'abolition de la loi de la valeur par le calcul du temps de travail
La question centrale est donc celle-ci : sous quelles formes le temps de travail sera-t-il mesuré ? La forme valeur subsistera-t-elle ?
La réponse est d'autant moins facile que nos maîtres n'ont pas complètement développé leur pensée à ce sujet et qu'elle peut même apparaître parfois comme contradictoire.
Dans l'Anti- Dühring, Engels commence par affirmer que "dès que la société se met en possession des moyens de production et les emploie à la production par voie de socialisation sans intermédiaire, le travail de tous, quelque divers que puisse être son caractère spécifique d'utilité, est du travail immédiatement et directement social. La quantité de travail social contenue dans un produit n'a pas besoin alors d'être fixée seulement par un détour ; l'expérience quotidienne indique combien il en faut en moyenne. La société n'a qu'à calculer combien d'heures de travail sont incorporées dans une machine à vapeur, dans un hectolitre de froment de la dernière récolte, dans cent mètres carrés d'étoffe d'une qualité déterminée. Il ne saurait donc lui venir à l'esprit d'exprimer en outre les quantités de travail déposées dans les produits et qu'elle connaît d'une manière directe et absolue, en une mesure seulement relative, flottante, inadéquate, naguère indispensable comme pis-aller, en un tiers produit, au lieu de le faire en ce qui est leur mesure naturelle, adéquate et absolue : le temps" (nous soulignons N.D.L.R.). Et Engels d'ajouter, à l'appui de son affirmation sur les possibilités de calcul d'une manière directe et absolue, que "pas plus que la chimie ne s'aviserait de donner aux poids atomiques une expression relative par le détour de l'atome d'hydrogène, dès qu'elle serait en état de les exprimer d'une manière absolue, en une mesure adéquate, c'est à savoir en poids réels, en billionnièmes ou quadrillionnièmes de gramme, la société, dans les conditions sus indiquées, n'assignera de valeurs aux produits" (nous soulignons N.D.L.R.). Mais précisément le problème est de savoir si l'acte politique que constitue la collectivisation apporte au prolétariat - même si cette mesure est radicale - la connaissance d'une loi nouvelle, absolue, de calcul du temps de travail, qui se substituerait d'emblée à la loi de la valeur. Aucune donnée positive n'autorise une telle hypothèse qui reste exclue du fait que le phénomène de réduction du travail composé en travail simple (qui est la réelle unité de mesure) reste inexpliqué et que par conséquent l'élaboration d'un mode de calcul scientifique du temps de travail, nécessairement fonction de cette réduction, est impossible : probablement même que les conditions d'éclosion d'une telle loi ne s'avéreront réunies que lorsqu'elle deviendra inutile ; c'est-à-dire lorsque la production pourra faire face à tous les besoins et que, par conséquent, la société n'aura plus à s'embarrasser de calculs de travail, l'administration des choses n'exigeant plus qu'un simple enregistrement de matière. Il se passera alors dans le domaine économique un processus parallèle et analogue à celui qui se déroulera dans la vie politique où la démocratie sera superflue au moment où elle se trouvera pleinement réalisée.
Engels, dans une note complémentaire à son exposé précité, accepte implicitement la valeur lorsqu'il dit que : "l'évaluation de l'effet utile et de la dépense de travail des produits est tout ce qui, dans une société communiste, pourrait subsister du concept de valeur de l'économie politique". Ce correctif d'Engels, nous pouvons le compléter par ce que dit Marx dans Le Capital (Tome 14, P. 165) : "après la suppression du mode de production capitaliste, la détermination de la valeur, si l'on maintient la production sociale, sera toujours au premier plan, parce qu'il faudra plus que jamais régler le temps de travail, ainsi que la répartition du travail social entre les différents groupes de production, et en tenir la comptabilité."
La conclusion qui se dégage donc de la connaissance de la réalité s'affirmant devant le prolétariat qui prend la succession du capitalisme est que la loi de la valeur continue à subsister dans la période transitoire, bien qu'elle doive subir de profondes modifications de nature à la faire progressivement disparaître.
Comment et sous quelles formes cette loi s'exercera-t-elle ? Encore une fois, nous savons à partir de ce qui existe dans l'économie bourgeoise où la réalité de la valeur matérialisée dans les marchandises, ne se manifeste que dans les échanges. Nous savons que cette réalité de la valeur est purement sociale, qu'elle ne s'exprime que dans les rapports des marchandises entre elles et dans ces rapports seulement. C'est dans l'échange que les produits du travail manifestent comme valeurs une existence sociale, sous une forme identique bien que distincte de leur existence matérielle en tant que valeurs d'usage. Une marchandise exprime sa valeur par le fait de se poser comme pouvant être échangée contre une autre marchandise, de se poser comme valeur d'échange, mais elle ne le fait que de cette façon. Cependant, si la valeur se manifeste dans le rapport d'échange, ce n'est pas l'échange qui engendre la valeur. Celle-ci existe indépendamment de l'échange.
Dans la phase transitoire, il ne pourrait également s'agir que de la valeur d'échange et non pas d'une valeur absolue "naturelle" contre laquelle Engels s'est élevé en termes sarcastiques dans sa polémique avec Dühring :
"Vouloir abolir la forme capitaliste de la production en instaurant la "valeur véritable", c'est vouloir abolir le catholicisme en instaurant le pape "véritable" : c'est vouloir instituer une société où les producteurs seront maîtres enfin de leur produit, en poussant à ses conséquences logiques une catégorie économique qui est l'expression la plus complète de l'asservissement des producteurs à leur propre produit".(Anti-Dühring)
La survivance du marché traduit celle de la valeur
L'échange sur la base de la valeur, dans l'économie prolétarienne, étant un fait inévitable pour une période plus ou moins longue, il n'en est pas moins vrai qu'il doit se rétrécir et disparaître dans la mesure où le pouvoir prolétarien parvient à asservir, non pas les producteurs à la production comme dans le capitalisme, mais au contraire la production aux besoins sociaux. Evidemment "aucune société ne saurait, d'une façon durable, rester maîtresse de ses propres produits ni conserver un contrôle sur les effets sociaux de son système de production, sans se débarrasser d'abord de l'échange entre individus" (Engels, L'Origine de la Famille). Mais les échanges ne peuvent se supprimer uniquement par la volonté des hommes, mais seulement dans le cours de tout un processus dialectique. C'est ainsi que Marx conçoit les choses lorsque, dans sa Critique du programme de Gotha, il nous dit : "au sein d'un ordre social communiste fondé sur la propriété commune des moyens de production, les producteurs n'échangent pas leurs produits ; de même, le travail incorporé dans des produits n'apparaît pas davantage ici comme la valeur de ces produits, comme une qualité réelle possédée par eux, puisque désormais, au rebours de ce qui se passe dans la société capitaliste, ce n'est plus par la voie d'un détour, mais directement que les travaux de l'individu deviennent partie intégrante au travail de la communauté". Cette évolution, Marx la situe évidemment, dans une société communiste développée et non pas telle qu'elle vient, au contraire, "de sortir de la société capitaliste ; une société par conséquent, qui, sous tous les rapports, économique, moral, intellectuel, porte encore les stigmates de l'ancienne société des flancs de laquelle elle est issue".
L'appropriation collective sur une plus ou moins grande échelle permet la transformation de la nature des rapports économiques à un degré correspondant au poids spécifique dans l'économie du secteur collectif et du secteur capitaliste, mais la forme bourgeoise de ces rapports est maintenue, parce que le prolétariat ne connaît pas d'autres formes à y substituer et parce qu'aussi il ne peut s'abstraire de l'économie mondiale continuant à évoluer sur des bases capitalistes.
A propos de l'impôt alimentaire institué par la NEP, Lénine disait que c'était "une des formes de notre passage d'une espèce originale de communisme, le "communisme militaire", rendue nécessaire par la guerre, la ruine et la misère extrême, à l'échange des produits qui sera le régime normal du socialisme. Cet échange, à son tour, n'est qu'une des formes du passage du socialisme (avec ses particularités résultant de la prédominance du petit paysan dans notre population) au communisme". Et Trotski dans son rapport sur la NEP, au 4eme Congrès de l'IC, marquait que, dans la phase transitoire, les rapports économiques devaient être régularisés par la voie du marché et au moyen de la monnaie.
La pratique de la Révolution russe a à cet égard confirmé la théorie : la survivance de la valeur et du marché ne fit que traduire l'impossibilité de l'Etat prolétarien à pouvoir, et coordonner immédiatement tous les éléments de la production et de la vie sociale, et supprimer le "droit bourgeois". Mais l'évolution de l'économie ne pouvait être orientée vers le socialisme que si la dictature prolétarienne étendait de plus en plus son contrôle sur le marché jusqu'à l'asservir totalement au plan socialiste, c'est-à-dire jusqu'à l'abolir ; par conséquent, si la loi de la valeur, au lieu de se développer comme elle le fît en allant de la production marchande simple à la production capitaliste, suivait le processus inverse de régression et d'extinction qui va de l'économie "mixte" au communisme intégral.
Nous n'avons pas à nous étendre sur la catégorie argent ou monnaie, puisqu'elle n'est qu'une forme développée de la valeur. Si nous admettons l'existence de la valeur, nous devons admettre celle de l'argent qui perd cependant son caractère de "richesse abstraite", son pouvoir d'équivalent général capable de s'approprier n'importe quelle richesse. Ce pouvoir bourgeois de la monnaie, le prolétariat l'annihile d'une part par la collectivisation des richesses fondamentales et de la terre, qui deviennent inaliénables et, d'autre part, par sa politique de classe : rationnement, jeu des prix, etc. L'argent perd aussi, effectivement si pas formellement, sa fonction de mesure des valeurs du fait de l'altération progressive de la loi de la valeur ; et en réalité il ne conserve que sa fonction d'instrument de circulation et de paiement.
Les internationalistes hollandais dans leur essai sur le développement de la société communiste[1] se sont inspirés bien plus de la pensée idéaliste que du matérialisme historique. C'est ainsi que leur analyse de la phase transitoire (qu'ils ne délimitent pas avec la netteté désirable de la phase communiste) procède d'une appréciation anti-dialectique du contenu social de cette période.
Certes, les camarades hollandais partent d'une juste prémisse lorsqu'ils établissent la distinction marxiste entre la période de transition et le communisme intégral. Pour eux également, c'est seulement dans la première phase que la mesure du temps de travail est valable[2]. Mais où ils commencent à quitter le terrain solide de la réalité historique c'est lorsqu'ils opposent à celle-ci une solution comptable et abstraite de calcul du temps de travail. A vrai dire ils ne répondent pas en marxistes à la question essentielle : comment, dans la phase de transition, et par quel mécanisme social, se déterminent les frais de production sur la base du temps de travail ? Ils l'escamotent plutôt par leurs démonstrations arithmétiques assez simplistes. Ils diront bien que l'unité de mesure de la quantité de travail que nécessite la production d'un objet, c'est l'heure de travail social moyen. Mais par là ils ne solutionnent rien : ils ne font que constater ce qui constitue le fondement de la loi de la valeur, en transposant la formule marxiste : temps de travail socialement nécessaire. Pourtant ils proposent une solution : "chaque entreprise calcule combien de temps de travail se trouve incorporé dans sa production...." (Page 56), mais sans indiquer par quel procédé mathématique le travail individuel de chaque producteur devient du travail social, le travail qualifié ou complexe du travail simple qui, comme nous l'avons vu, est la commune mesure du travail humain. Marx nous décrit par quel processus social et économique cette réduction se réalise dans la production marchande et capitaliste ; pour les camarades hollandais, il suffit de la Révolution et de la collectivisation des moyens de production pour faire prévaloir une loi "comptable" qui surgit on ne sait comment et dont on nous laisse ignorer le fonctionnement. Pour eux, une telle substitution est cependant très explicable : puisque la Révolution abolit le rapport social privé de production, elle abolit en même temps l'échange, qui est une fonction de la propriété privée (Page 52) :
"Dans le sens marxiste, la suppression du marché n'est pas autre chose que le résultat des nouveaux rapports de droit" (Page 109). Ils conviennent cependant justement que "la suppression du marché doit être interprétée dans le sens qu'apparemment le marché survit dans le communisme, tandis que le contenu social sur la circulation est entièrement modifié : la circulation des produits sur la base du temps de travail est l'expression du nouveau rapport social" (page 110). Mais, précisément, si le marché survit (bien que le fond et la forme des échanges soient modifiés), il ne peut fonctionner que sur la base de la valeur. Cela, les internationalistes hollandais ne l'aperçoivent pas, "subjugués" qu’ils sont par leur formulation de "temps de travail" qui, en substance, n'est cependant pas autre chose que la valeur elle-même. D'ailleurs pour eux, il n'est pas exclu que dans le "communisme", on parlera encore de "valeur" ; mais ils s'abstiennent de dégager la signification, du point de vue du mécanisme des rapports sociaux, qui résulte du maintien du temps de travail et ils s'en tirent en concluant que, puisque le contenu de la valeur sera modifié, il faudra substituer à l'expression "valeur", celle de "temps de production", et qui évidemment ne modifiera en rien la réalité économique ; tout comme ils diront qu'il n'y a plus échange des produits, mais passage des produits (Pages 53 et 54). Egalement, "au lieu de la fonction de l'argent, nous aurons l'enregistrement du mouvement des produits, la comptabilité sociale, sur la base de l'heure de travail social moyenne" (Page 55).
Nous verrons que leur méconnaissance de la réalité historique entraîne les internationalistes hollandais à d'autres conclusions erronées, lorsqu'ils examinent le problème de la rémunération du travail.
(A suivre.)
[1] Les fondements de la production et de la distribution communiste, dont Bilan a publié un résumé du camarade Hennaut (Nos 19, 20, 22).
[2] A cet égard, nous indiquons qu'un lapsus s'est glissé dans le résumé du camarade Hennaut qui dit ceci : "Et contrairement à ce que certains imaginent, cette comptabilité s'applique non seulement à la société communiste qui a atteint un niveau de développement très élevé, mais elle s'applique à toute société communiste - donc dès le moment où les travailleurs ont exproprié les capitalistes -quel que soit le niveau qu'elle a atteint". (Bilan page 657.)
Questions théoriques:
- Communisme [27]
Histoire du mouvement ouvrier : le syndicalisme fait échouer l'orientation révolutionnaire de la CNT (1919-1923)
- 6178 reads
Dans le 2ème article de cette série nous avons mis en évidence comment la CNT avait donné le meilleur d'elle-même dans la période 1914-1919, marquée par les épreuves décisives de la guerre et de la révolution. En même temps, nous soulignions le fait que cette évolution n'avait pas permis de surmonter la contradiction que contient le syndicalisme révolutionnaire dès des origines, en voulant concilier deux termes antithétiques : syndicalisme et révolution.
En 1914, la plupart des syndicats s'étaient rangés du côté du capital et avaient activement participé à la mobilisation des ouvriers dans la terrible boucherie constituée par la Première Guerre mondiale. Cette trahison fut entérinée lorsque, face aux mouvements révolutionnaires du prolétariat qui éclatèrent à partir de 1917, les syndicats se rangèrent à nouveau aux côtés du capital. Ce fut particulièrement manifeste en Allemagne où, aux côtés de la Social-Démocratie, ils apportèrent leur soutien à l'Etat capitaliste face aux soulèvements ouvriers entre 1918 et 1923.
La CNT fut, avec les IWW[1], l'une des rares organisations syndicales de cette époque à rester fidèle au prolétariat. Cependant, nous allons voir comment, dans la période traitée par cet article, sa composante syndicale a de plus en plus pris le dessus dans la vie de l'organisation et est venue à bout de la composante révolutionnaire qui existait dans son sein.
Août 1917, l'échec de la grève générale révolutionnaire : la CNT entraînée sur le terrain des "réformes" bourgeoises
Les syndicats ne sont pas des organisations créées pour la lutte révolutionnaire. Au contraire, "ils luttent sur le terrain de l'ordre politique bourgeois, de l'Etat de Droit libéral. Pour se développer, ils ont besoin d'un droit de coalition sans obstacle aucun, une égalité de droits strictement appliqués, point final. Leur idéal politique, en tant que syndicats, n'est pas l'ordre socialiste, mais la liberté et l'égalité de l'Etat bourgeois". (Pannekoek, Les divergences tactiques dans le mouvement ouvrier, 1909, souligné dans l'original)
Comme nous l'avons montré dans cette série[2], le syndicalisme révolutionnaire tente d'échapper à cette contradiction en s'imposant une double tâche : celle, spécifiquement syndicale, d'essayer d'améliorer les conditions de vie des ouvriers dans le capitalisme et, par ailleurs, celle de lutter pour la révolution sociale. L'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence a montré de façon claire que les syndicats ne répondaient pas à la seconde tâche et qu'ils ne pouvaient survivre qu'en aspirant à une fonction au sein de l'Etat bourgeois dans des conditions "d'égalité et de liberté" ce qui ne pouvait manquer de rendre la réalisation de la première tâche également impossible. Cette réalité apparut nettement au cœur de la CNT pendant l'épisode de la grève générale d'août 1917.
Il y avait en Espagne un énorme mécontentement social dû aux conditions d'exploitation infâmes des ouvriers, à la brutalité de la répression, auxquelles s'ajoutait une inflation galopante qui engloutissait les salaires déjà très bas. Sur le plan politique, le vieux régime de la Restauration[3] était entré dans une crise terminale : la formation de juntes militaires, l'attitude rebelle des représentants les plus significatifs de la bourgeoisie catalane, etc. suscitaient des convulsions croissantes.
Le PSOE, qui avait majoritairement défendu une politique d'alliances avec d'autres formations politiques[4], crut trouver dans cette situation l'occasion de réaliser la "révolution démocratique bourgeoise" alors que les conditions historiques ne s'y prêtaient plus. Il tenta d'utiliser l'immense mécontentement ouvrier comme levier pour abattre le régime de la Restauration et conclut une double alliance : il s'engagea du côté de la bourgeoisie avec les républicains, les réformistes du régime et la bourgeoisie catalaniste. Du côté prolétarien il parvint à impliquer la CNT.
Le 27 mars 1917, l'UGT (au nom du PSOE) mena une réunion avec la CNT (représentée par Segui, Pestana et Lacort) où ils s'accordèrent sur un manifeste qui proposait, avec des formules ambiguës et équivoques, une "réforme" de l'Etat bourgeois, dont la teneur était très modérée. Le ton du document nous est donné par ce passage très clairement nationaliste, qui propose la défense à outrance de l'Etat bourgeois : "ceux qui sont le plus à même de soutenir les charges publiques continuent à se soustraire à leur devoir de citoyenneté : ceux à qui profitent les bénéfices de guerre n'emploient pas leurs revenus à augmenter la richesse nationale, ni ne consacrent une part de leurs bénéfices à l'Etat."[5] Le manifeste propose de préparer la grève générale "dans le but d'obliger les classes dominantes à adopter les changements fondamentaux du système qui garantiront au peuple un minimum de conditions de vie décentes et le développement de ses activités émancipatrices." C'est-à-dire qu'on demande des "réformes" du système bourgeois afin d'obtenir "le minimum décent" (ce que garantit en termes généraux le capitalisme dans son fonctionnement "normal" !) et, comme but "révolutionnaire", de "permettre les activités émancipatrices" !
Malgré les nombreuses critiques qui leur furent adressées, les dirigeants confédéraux continuèrent à soutenir le "mouvement". Largo Caballero et d'autres dirigeants de l'UGT se rendirent à Barcelone afin de convaincre les militants plus récalcitrants de la CNT. Les doutes de ces derniers furent balayés quand on leur fit miroiter "l'action". Bien que la grève générale fût appelée pour des buts nettement bourgeois, on croyait dur comme fer (selon le schéma du syndicalisme révolutionnaire) que le seul fait qu'elle se produise déclencherait une dynamique révolutionnaire.[6]
Dans une situation sociale de plus en plus agitée, où les grèves étaient fréquentes, avec l'effet stimulant des nouvelles en provenance de Russie, une grève des chemins de fer éclata à Valence le 20 juillet et s'étendit rapidement à toute la province du fait de la solidarité massive de tous les ouvriers. Le patronat céda le 24 juillet mais posa une condition provocatrice : le renvoi de 36 grévistes. Le syndicat UGT des cheminots annonça une grève générale de ce secteur pour le 10 août, si ces licenciements avaient lieu. Le gouvernement, qui était informé des préparatifs de grève générale nationale, obligea la compagnie ferroviaire à adopter une position intransigeante afin de provoquer prématurément un mouvement qui n'était pas encore mûr.
Le 10 août, fut déclarée la grève générale dans les chemins de fer et un appel à la grève générale nationale fut lancé pour le 13 août par un comité constitué de membres de la direction du PSOE et de l'UGT. Le manifeste d'appel était une honte : après avoir impliqué la CNT - "le moment est arrivé de mettre en pratique, sans hésitation aucune, les propositions annoncées par les représentants de l'UGT et de la CNT, dans le manifeste adopté au mois de mars dernier" - il se terminait avec la proclamation suivante : "Prenons garde : nous ne sommes pas des instruments du désordre, ainsi que nous qualifient avec impudence les gouvernements qui nous font souffrir. Nous acceptons la mission de nous sacrifier pour le bien de tous, pour le salut du peuple espagnol, et nous sollicitons votre concours. Vive l'Espagne !"[7]
La grève fut suivie inégalement selon les secteurs et les régions mais ce que l'on a pu percevoir, par la suite, ce fut une désorganisation notoire et le fait que les politiciens qui avaient appelé à cette grève, s'étaient défilés - en s'exilant en France - ou bien s'étaient rétractés en l'interdisant, comme ce fut le cas du politicien catalan Cambó (nous reviendrons ultérieurement sur ce personnage). Le gouvernement déploya l'armée partout, déclara l'état de siège et laissa la soldatesque se livrer à ses forfaits habituels[8]. La répression fut sauvage : détentions massives, jugements sommaires... Quelques 2000 militants de la CNT furent emprisonnés.
La "grève générale" du mois d'août s'est traduite par un bain de sang pour les ouvriers, causant la démoralisation et le reflux de parties de la classe ouvrière qui, par la suite, ne relevèrent pas la tête durant plus d'une décennie. Nous avons ici le résultat d'une des positions classiques du syndicalisme révolutionnaire - la grève générale. La majorité des militants de la CNT se méfiait des objectifs bourgeois contenus dans l'appel à la grève mais s'imaginait que "la grève générale" serait l'occasion de déclencher la révolution. Ils supposaient - selon leur schéma abstrait et arbitraire - que cela provoquerait une sorte de "gymnastique révolutionnaire" qui soulèverait les masses. La réalité a démenti brutalement des telles spéculations. Les ouvriers espagnols étaient fortement mobilisés depuis l'hiver 1915, aussi bien sur le plan des luttes que sur celui de la prise de conscience (comme nous l'avons vu dans le deuxième article de la série, la révolution en Russie avait suscité un grand enthousiasme). L'épisode de la grève générale a constitué un grand frein à cette dynamique : le fameux manifeste commun UGT-CNT de mars 1917 avait mis les ouvriers dans l'attente, dans l'illusion vis-à-vis des bourgeois "réformistes" et des militaires "révolutionnaires" des juntes, leur avait donné confiance dans les bon offices des dirigeants socialistes et de l'UGT.
1919, la grève de "La Canadiense" : le germe de la grève de masse avorté par le syndicalisme
En 1919, la vague révolutionnaire mondiale qui avait commencé en Russie, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, etc., atteignait son point culminant. La Révolution russe avait suscité un enthousiasme gigantesque qui embrasa aussi la lutte du prolétariat en Espagne. Mais cet enthousiasme se manifesta de diverses façons. Les mobilisations furent très puissantes en Catalogne mais n'eurent presque pas d'écho dans le reste de l'Espagne ([9]). Leur point culminant fut la grève de "La Canadiense"[10] qui démarra comme une tentative inspirée par la CNT pour s'imposer au patronat catalan ; l'entreprise fut délibérément choisie pour l'impact qu'elle pouvait avoir sur le tissu industriel de Barcelone. En janvier 1919, face à la décision du patronat de baisser les salaires de certaines catégories de travailleurs, certains d'entre eux protestèrent auprès de l'entreprise et huit d'entre eux furent licenciés. La grève commence en février et après 44 jours, confrontée à l'intransigeance du patronat soutenu par les autorités[11], elle se généralise à tout Barcelone et atteint une ampleur jamais vue en Espagne (une grève de masse authentique comme l'avait identifiée Rosa Luxemburg dans le mouvement de 1905 en Russie : en quelques jours les ouvriers de toutes les entreprises et concentrations ouvrières de la zone urbaine catalane s'unissent dans la lutte, sans appel préalable mais de façon tout à fait unanime comme si une volonté commune les dominait tous). Quand les entreprises tentèrent de publier un communiqué menaçant les ouvriers, le syndicat des imprimeurs imposa la "censure rouge" qui empêcha toute publication.
Malgré la militarisation, malgré la détention de près de 3000 ouvriers dans la sinistre prison de Montjuich, malgré la déclaration de l'état de siège, les travailleurs poursuivirent leur lutte. Les locaux de la CNT étaient fermés par les autorités mais les travailleurs s'organisaient eux-mêmes dans des assemblées spontanées, comme le reconnaît le syndicaliste Pestaña : "Comment mener à terme une grève de ce niveau alors que les syndicats étaient fermés et que leurs membres étaient pourchassés par la police ? (...) nous qui comprenions que la véritable souveraineté est entre les mains du peuple, nous n'avions qu'un pouvoir consultatif ; le pouvoir exécutif se trouvait dans l'assemblée de tous les délégués des syndicats de Barcelone, qui se réunissait chaque jour malgré l'état de siège et la persécution et chaque jour prenait des décisions pour le lendemain, et chaque jour décidait quelles corporations ou quels secteurs devaient être paralysés par la grève le jour suivant" (Conférence de Pestaña à Madrid, octobre 1919, sur la grève de "la Canadiense", extrait de Trajectoire syndicaliste, A. Pestaña, éd. Giner, Madrid, traduit par nos soins).
Les leaders de la CNT catalane - tous de tendance syndicaliste - voulurent terminer la grève quand le gouvernement central, dirigé par Romanones[12], négocia un virage à 180° et envoya son secrétaire personnel discuter un accord qui acceptait les principales revendications. Beaucoup d'ouvriers se méfiaient de cet accord, y voyant, notamment, qu'il ne contenait aucune garantie concernant la libération des nombreux camarades emprisonnés. De façon confuse et cependant stimulés par les nouvelles de Russie et d'autres pays, ils voulaient poursuivre le combat dans une perspective d'offensive révolutionnaire. Le 19 mars, au Théâtre "del Bosque", l'assemblée rejeta l'accord ; les leaders syndicaux convoquèrent alors une réunion pour le lendemain aux arènes taurines, à laquelle participèrent 25 000 travailleurs. Segui (leader indiscutable de la tendance syndicaliste de la CNT et excellent orateur) prit la parole et après une heure de discours posa l'alternative : accepter l'accord ou aller à Montjuich libérer les prisonniers, mettant en branle la révolution. Cette façon "maximaliste" de poser les choses désorienta complètement les ouvriers qui acceptèrent de reprendre le travail.
Les craintes de beaucoup d'ouvriers se vérifièrent. Les autorités refusèrent de libérer les prisonniers, provoquant une énorme indignation et, le 24 mars, éclata une nouvelle grève générale massive qui paralysa Barcelone, débordant la politique officielle des syndicats. Mais la confusion habitait cependant la majorité des ouvriers. La perspective révolutionnaire était pour le moins confuse. Le reste du prolétariat espagnol ne bougeait pas. Dans ces conditions, et malgré la combativité et l'héroïsme des ouvriers de Barcelone qui durent survivre sans salaire pendant plusieurs mois, le moteur de la grève restait l'activisme et la pression des groupes d'action de la CNT dans lesquels confluaient vieux militants et jeunes radicaux.
Les ouvriers finirent par reprendre le travail très démoralisés, ce dont profita le patronat pour imposer un lock-out généralisé qui amena les familles ouvrières au bord de la famine. La tendance syndicaliste ne proposait aucune riposte. La proposition faite par Buenacasa (militant anarchiste radical) d'occuper les usines fut rejetée.
La grève de "la Canadiense", sommet atteint en Espagne par la vague révolutionnaire mondiale, permet de dégager trois leçons :
1. La lutte était restée enfermée dans Barcelone et avait pris la forme d'un conflit "industriel". Nous voyons ici clairement le poids du syndicalisme qui empêche la lutte de s'étendre territorialement et de prendre une dimension politique et sociale qui pose clairement la question de l'affrontement contre l'Etat bourgeois[13]. Le syndicat reste un organe corporatif qui n'exprime pas une alternative à la société mais situe ses propositions au sein du cadre économique du capitalisme. La tendance réelle à la politisation de la grève de "la Canadiense" ne parvint pas à s'exprimer réellement et, à aucun moment, cette grève ne fut pas perçue par la société espagnole comme une lutte de classe mettant en question le système.
2. Les assemblées générales, comme les conseils ouvriers, sont des organes unitaires de la classe alors que le syndicat est un organe qui ne peut dépasser la division sectorielle - qui est aussi l'unité de base de la production capitaliste. Il y eut dans la grève de "la Canadiense" des tentatives d'assemblées générales souveraines directes de la part des ouvriers, qui se superposaient aux structures sectorielles du syndicat mais, en dernier recours, celui-ci gardait le pouvoir de décision, affaiblissait et dispersait les assemblées ouvrières.[14]
3. Les conseils ouvriers surgissent comme un pouvoir dans la société qui défie plus ou moins consciemment l'Etat capitaliste. C'est comme pouvoir qu'il est perçu par l'ensemble de la société et, particulièrement, par les classes sociales non exploiteuses qui tendent à s'adresser à lui pour trancher leurs problèmes. Les organisations syndicales, en revanche, aussi puissantes qu'elles paraissent, sont perçues à juste titre comme des organes corporatifs limités aux questions "de la production". En dernière instance, les autres travailleurs et les classes opprimées les perçoivent comme quelque chose d'étranger, de particulier, et qui ne les concerne pas directement et irrévocablement. Ceci se manifesta particulièrement dans la grève de "la Canadiense" qui ne parvint pas à intégrer dans un même mouvement unitaire la forte agitation sociale des paysans andalous qui atteignait alors son point culminant (le fameux "Triennat" bolchevique, 1917-1920). Bien que les deux mouvements se soient inspirés de la Révolution russe et malgré la sympathie réelle existant entre leurs protagonistes, ils suivirent des chemins parallèles sans connaître la moindre tentative d'unification[15].
La tendance syndicaliste domine la CNT
La concrétisation de cette troisième leçon, c'est le travail de sabotage réalisé par la tendance syndicaliste au sein de la CNT, couvert dans la pratique par la direction de la confédération (Segui et Pestaña[16] en étaient les représentants principaux). Alors que la lutte était à son sommet,cette direction accepta et parvint à imposer à la CNT la constitution d'une Commission mixte avec le patronat, chargée de régler "équitablement" les conflits du travail. Dans la pratique, elle ne fut qu'une espèce de pompier volant qui se consacrait à isoler et démobiliser les foyers de lutte. Face au contact et à l'action directe collective des ouvriers, la Commission mixte représentait la paralysie et l'isolement de chaque foyer de lutte. Dans son livre Histoire de l'anarcho-syndicalisme espagnol (2006), Gomez Casas reconnaît que "les ouvriers manifestèrent leur répulsion pour la Commission qui finit par se dissoudre. Elle avait approfondi le divorce entre les représentants ouvriers et les ouvriers, provoquant une certaine démoralisation qui affaiblit l'unité ouvrière" (traduit par nos soins).
La tendance syndicaliste qui, dans un premier temps, avait pourtant éprouvé une sympathie sincère pour la Révolution russe[17], dominait toujours plus la CNT et constituait un facteur de sa bureaucratisation : "Il semble évident qu'à la veille de la répression de 1919 commençait à se développer quelque chose comme une bureaucratie syndicaliste malgré les obstacles à ce processus que constituaient l'attitude et la tradition cénétistes et, en particulier, parce qu'il n'y avait pas d'agents syndicaux salariés dans les syndicats pas plus que dans les comités (...). Cette évolution de la spontanéité et de l'amateurisme anarchiste vers la bureaucratie syndicale et le professionnalisme fut, dans des conditions normales, la voie quasi inévitable des organisations ouvrières de masses - y compris celles qui étaient enracinés dans le milieu catalan - et la CGT française y avait eu recours au Nord des Pyrénées" (Meaker, The Revolutionnary Left in Spain, 1974, traduit par nos soins).
Buenacasa constate que "... le syndicalisme, guidé à présent par des hommes qui ont jeté par-dessus bord les principes anarchistes, qui se font appeler Monsieur et Madame, [qui] accordent des consultations et signent des accords dans les bureaux du gouvernement et dans les ministères, qui voyagent en automobile et... en wagon-lit... évolue rapidement vers la forme européenne et nord-américaine qui permet aux leaders de devenir des personnages officiels" (cité par Meaker, ibid.).
La tendance syndicaliste se servait de l'apolitisme de l'idéologie anarchiste et du syndicalisme révolutionnaire pour appuyer de façon à peine dissimulée la politique de la bourgeoisie. Elle se déclara "apolitique" face à la Révolution russe, face à la lutte pour la révolution mondiale et, en définitive, face à toute tentative de politique prolétarienne internationaliste. Cependant, nous avons déjà vu comment en août 1917, elle avait été loin de mépriser une initiative politique de réforme de l'Etat bourgeois en compagnie du PSOE. Elle appuya aussi sans se cacher la "libération nationale" de la Catalogne. Fin 1919, lors d'une grande conférence à Madrid, Segui affirma que "... Nous, les travailleurs, comme nous n'avons rien à perdre à une Catalogne indépendante mais au contraire beaucoup à gagner, nous n'avons pas peur de l'indépendance de la Catalogne (...). Je vous assure, amis madrilènes, qu'une Catalogne libérée de l'Etat espagnol serait une Catalogne amie de tous les peuples de la péninsule hispanique" [18].
Lors du Congrès de Saragosse de 1922, la tendance syndicaliste défendit la fameuse résolution "politique" qui ouvrait la voie à la participation de la CNT à la vie politique espagnole (c'est-à-dire à son intégration à la politique bourgeoise) et c'est d'ailleurs ainsi que la presse bourgeoise le comprit en se réjouissant de cet évènement [19]. La rédaction de la résolution en question fut cependant réalisée très habilement afin de ne pas heurter une majorité qui résistait à passer sous le joug. Deux passages de la résolution sont particulièrement significatifs.
Dans le premier il est affirmé de façon rhétorique que la CNT est "un organisme nettement révolutionnaire qui rejette, franchement et explicitement, l'action parlementaire et de collaboration avec les partis politiques". Mais ceci n'est que le miel avec lequel on essaie de faire passer la pilule amère de la nécessité de participation à l'Etat capitaliste dans le cadre du capital national, au moyen d'une formulation délibérément difficilement compréhensible : "sa mission [à la CNT]est de conquérir ses droits de contrôle et de jugement de toutes les valeurs de solution de la vie nationale et, à cette fin, son devoir est d'exercer une action déterminante au moyen de l'action conjuguée découlant des manifestations de force et des dispositifs de la CNT"[20]. Des expressions comme "les valeurs de solution de la vie nationale" ne constituent rien d'autre qu'une formule alambiquée destinée à faire parcourir aux militants combatifs de la CNT les pas nécessaires à son intégration dans l'Etat capitaliste.
L'autre passage est plus explicite. Il dit clairement que l'intervention politique dont se revendique la CNT consiste à "élever la conscience politique à un niveau supérieur ; réclamer que soit réparée une injustice ; veiller à que soient respectées les libertés conquises et demander une amnistie" (op. cit.). On ne peut exprimer plus clairement la volonté d'accepter le cadre de l'Etat démocratique avec tout son éventail de "droits", de "libertés", de "justice", etc. !
L'incapacité des tendances révolutionnaires de la CNT à s'opposer à la tendance syndicaliste
Une forte résistance, animée fondamentalement par deux tendances, les anarchistes d'un côté et les partisans de l'adhésion à l'Internationale communiste de l'autre, finit par se dresser contre la tendance syndicaliste. Sans amoindrir les mérites de ces deux tendances, il faut signaler cependant qu'elles furent incapables de discuter ensemble ou même de collaborer contre la tendance syndicaliste. Elles eurent toutes deux à souffrir aussi d'une profonde faiblesse théorique. La tendance pro bolchevique qui forma des Comités syndicalistes révolutionnaires (CSR), du type de ceux qui étaient animés dans la CGT française en 1917 par Monatte, se contentait de réclamer un retour à la CNT d'avant-guerre sans tenter de comprendre les nouvelles conditions, marquées par le déclin du capitalisme et l'irruption révolutionnaire du prolétariat. Quant à la tendance anarchiste, elle basait tout sur l'action, ce qui explique qu'elle était capable de bien réagir dans les moments de lutte ou face à des positions trop évidentes de la tendance syndicaliste mais cependant incapable de mener un débat ou une stratégie méthodique de lutte.
L'élément décisif de sa faiblesse cependant était son adhésion inconditionnelle au syndicalisme, défendant à outrance que les syndicats continuaient à être des armes valables de lutte pour le prolétariat.
La tendance pro bolchevique souffrit de la dégénérescence de l'IC qui, dans son IIe Congrès, adopta les Thèses sur les syndicats et, à son IIIe Congrès, préconisa le travail dans les syndicats réactionnaires. Elle fonda alors l'Internationale syndicale rouge (ISR) et proposa à la CNT de s'y intégrer. Ces orientations ne faisaient que renforcer la tendance syndicaliste au sein de la CNT et effrayaient la tendance anarchiste qui se réfugiait de plus en plus dans l'action "directe".
La tendance syndicaliste argumentait avec raison que, sur les questions pratiques et de cohérence syndicale, elle était bien plus compétente que l'ISR et les CSR, ces derniers avançant des revendications et des méthodes de lutte totalement irréalistes, dans une conjoncture de reflux croissant. Elle leur reprochait en outre leur "politisation", s'appuyant pour cela sur la politisation opportuniste préconisée par l'IC dégénérescente : le front unique, le gouvernement ouvrier, le front syndical, etc.
Le peu de discussions existantes tournait autour de thèmes qui ne faisaient qu'accroître la confusion : la politisation basée sur le frontisme versus l'apolitisme anarchiste, l'adhésion à l'ISR ou la formation d'une "Internationale" du syndicalisme révolutionnaire[21]. Ces deux questions tournaient résolument le dos aux réalités de l'époque : dans la période tourmentée de 1914-22, on avait pu voir que les syndicats avaient exercé le triple rôle de sergents recruteurs pour la guerre (1914-18), de bourreaux de la révolution et de saboteurs des luttes ouvrières. La Gauche communiste en Allemagne avait développé une réflexion intense sur le rôle des syndicats qui permit à Bergmann de dire[22], lors du IIIe Congrès de l'Internationale communiste, que "la bourgeoisie gouverne en combinant l'épée et le mensonge. L'armée est l'épée de l'Etat et les syndicats sont les organes du mensonge". Mais rien de tout cela n'eut de répercussions sur la CNT, dont les tendances les plus conséquentes restaient prisonnières de la conception syndicale.
La défaite du mouvement et la deuxième disparition de la CNT
Après le recul du mouvement de grève de "la Canadiense" (fin 1919), la bourgeoisie espagnole, et sa fraction catalane en première ligne, déchaînèrent une attaque impitoyable contre les militants de la CNT. Des bandes de "pistoleros" furent organisées, payées par le patronat et coordonnées par le Préfet et le Gouverneur militaire de la région, qui traquaient les syndicalistes et les assassinaient dans le plus pur style mafioso. On arriva à compter 30 morts quotidiens. Les emprisonnements se succédaient parallèlement et la Garde civile (Gendarmerie espagnole) rétablit la pratique barbare de la "corde de prisonniers" : les syndicalistes détenus étaient conduits à pied à des centres de détention situés à des centaines de kilomètres. Beaucoup mouraient en chemin victimes d'épuisement, des passages à tabac ou, tout simplement, tirés comme des lapins. La terrible pratique de la "loi de fuite" fut mise au goût du jour et la bourgeoisie espagnole allait la rendre tristement célèbre : le détenu était relâché dans une rue ou sur un chemin, puis criblé de balles pour s'être "évadé".
Les organisateurs de cette barbarie furent les bourgeois catalans eux-mêmes, si "modernes" et si "démocrates", qui avaient toujours reproché à leurs collègues aristocrates castillans leur brutalité et leur manque de "manières". Mais la bourgeoisie catalane avait vu la menace prolétarienne et voulait prendre une vengeance totale. C'est ainsi que son principal dirigeant, Cambó, dont nous avons déjà parlé, fut le principal protagoniste des "pistoleros". Le Gouverneur militaire, Martinez Anido, lié à la vieille aristocratie castillane, et les bourgeois catalans "progressistes" se réconciliaient définitivement dans la persécution des militants ouvriers. C'était tout un symbole de la nouvelle situation : il n'était plus question de fractions progressistes ou réactionnaires dans la bourgeoisie ; elles étaient toutes d'accord et complices dans la défense réactionnaire d'un ordre social caduc et décadent.
Les tueries durèrent jusqu'en 1923, date du coup d'Etat du général Primo de Rivera qui instaura une dictature avec l'appui non dissimulé du PSOE et de l'UGT. Dans une ambiance de forte démobilisation des masses ouvrières, la CNT s'est engagée dans une terrible spirale : elle riposta aux "pistoleros" par l'organisation de corps d'autodéfense qui rendaient coup pour coup en assassinant des politiques, des cardinaux et des patrons bien choisis. Cette dynamique dégénéra rapidement en une succession sans fin de morts qui accéléra le découragement et la démoralisation des travailleurs. Par ailleurs, amenée sur un terrain où elle était inévitablement la moins forte, la CNT souffrit une hémorragie sans fin de militants, assassinés, emprisonnés, invalides, en fuite... Plus nombreux encore étaient ceux qui se retiraient, complètement démoralisés et dans la confusion. Dans sa dernière époque, en outre, les corps d'autodéfense de la CNT furent infiltrés par toutes sortes d'éléments douteux et marginaux qui n'avaient comme activité que l'assassinat et ne contribuaient qu'à faire perdre son prestige à la CNT et à l'isoler politiquement.
La CNT fut de nouveau lourdement affectée en 1923 par une répression ignoble. Mais sa deuxième disparition n'a pas les mêmes caractéristiques que la première :
- en 1911-15, le syndicalisme pouvait encore, dans certaines circonstances particulières, jouer un rôle favorable à la classe ouvrière, même si cette possibilité diminuait de jour en jour ; mais en 1923, le syndicalisme avait perdu définitivement toute capacité de contribuer à la lutte ouvrière ;
- en 1911-15, la disparition de l'organisation ne provoqua pas une disparition de la réflexion et de la recherche de positions de classe (ce qui permit la reconstitution de 1915 basée sur la lutte contre la guerre impérialiste et la sympathie pour la révolution mondiale) ; en 1923, elle permit le renforcement de deux tendances, syndicale et anarchiste, qui ne pouvaient rien apporter à la lutte ni à la conscience prolétarienne ;
- en 1911-15, l'esprit unitaire et ouvert n'avait pas disparu permettant que cohabitent anarchistes, syndicalistes révolutionnaires et socialistes au sein de la même organisation ; en 1923, toutes les tendances marxistes s'étaient soit auto-exclues soit avaient été éliminées ; il ne restait alors que les tendances fortement sectaires enfermées dans un apolitisme extrême, l'anarchiste et la syndicaliste.
Comme nous le verrons dans un prochain article, la reconstitution de la CNT à la fin des années 20 se fit sur des bases totalement différentes de celles qui avaient présidé à sa naissance en 1910 et à sa première reconstitution en 1915.
RR et C. Mir, 19-6-07
[1] Voir les articles de cette série dans les numéros 124 [64] et 125 [65] de la Revue internationale
[2] Voir en particulier le premier article de cette série dans le numéro 118 [5] de la Revue internationale
[3] Régime de la Restauration (1874-1923) : système monarchique libéral que s'était donnée la bourgeoisie espagnole et qui était basé sur un ensemble de partis dynastiques dont étaient exclus non seulement les ouvriers et paysans mais aussi des couches significatives de la petite bourgeoisie et même de la bourgeoisie
[4] Voir le 2e article de cette série dans la Revue internationale n°129 [66].
[5] Les citations du manifeste mentionné sont extraites du livre Historia del Movimiento Obrero en España (tome II page 100) de Tuñón de Lara
[6] Comme le raconte Victor Serge (militant belge d'origine russe et d'orientation anarchiste qui cependant a collaboré avec les bolcheviks) qui à ce moment se trouvait à Barcelone : "Le comité national de la CNT ne se posait aucune question fondamentale. Il est entré dans la bataille sans connaître la perspective et sans évaluer les conséquences de son action".
[7] Page 107 du livre cité précédemment.
[8] Nous avons parlé précédemment des juntes militaires qui étaient soi-disant "très critiques" envers le régime (encore que, contrairement au rôle progressiste qu'avait joué l'armée dans la première moitié du XIXe siècle et que Marx avait signalé dans ses écrits sur l'Espagne dans le New York Daily Tribune , les juntes ne faisaient que demander "davantage de saucisson !")
[9] "Mais si la bourgeoisie parvenait, au travers de l'armée, à relier les parties contrastées de son économie, à maintenir une centralisation des régions des plus opposées du point de vue de leur développement, le prolétariat, par contre, réagissant sous la pression des contrastes de classe, avait tendance à se localiser dans les secteurs où ces contrastes s'exprimaient le plus violemment. Le prolétariat de Catalogne fut jeté dans l'arène sociale non en fonction d'une modification de l'ensemble de l'économie espagnole, mais en fonction du développement de la Catalogne. Le même phénomène se vérifie pour les autres régions, y compris pour les régions agraires" (Bilan n° 36, Oct-nov 1936, La leçon des événements en Espagne). [Le terme "contraste" doit être compris par "antagonisme" ndlr]
[10] Ebro Power and Irrigation, une entreprise britano-canadienne connue sous le nom populaire de La Canadiense. Elle fournissait l'électricité aux entreprises et aux zones d'habitation de Barcelone.
[11] Dans un premier temps, l'entreprise était disposée à négocier, mais le Gouverneur civil Gonzalez Rothwos fit pression pour qu'elle ne le fasse pas et envoya la police sur le lieu du conflit.
[12] Comte de Romanones (1863-1950), homme politique du parti libéral, plusieurs fois premier ministre.
[13] C'est là toute la différence entre ce que Rosa Luxemburg avait appelé la "grève de masse" à partir de l'expérience de la Révolution russe de 1905 et les méthodes syndicales de lutte. Voir la série d'articles sur 1905 dans la Revue internationale, nos 120 [8], 122 [67] et 123 [68].
[14] Par ailleurs, il est important de se rendre compte que, y compris avec la meilleure volonté - comme c'était alors le cas - le syndicat tend à kidnapper et à neutraliser l'initiative et la capacité de pensée et de décision des travailleurs. La première phase de la grève s'était terminée, comme nous l'avons vu précédemment, non par une assemblée générale où tous les ouvriers pouvaient apporter leur contribution et décider collectivement, mais par un meeting Plaza de Toros où les grands leaders parlèrent à n'en plus finir, manipulèrent émotionnellement les masses et les placèrent en situation, non pas de pouvoir décider consciemment, mais de se laisser entraîner par les conseils des beaux parleurs.
[15] Cette dispersion a été imputée à la nature fondamentalement paysanne du mouvement andalou, en opposition à la nature ouvrière de la lutte à Barcelone. Il est important d'observer à ce niveau les différences avec l'expérience russe, où l'agitation paysanne prit une forme généralisée et s'unit consciemment et fidèlement à la lutte prolétarienne (bien qu'elle ait eu son rythme et ses revendications propres, certaines d'entre elles étant d'ailleurs contradictoires avec la lutte révolutionnaire) ; les paysans étaient fortement politisés (beaucoup d'entre eux étaient des soldats démobilisés) et tendirent à former des conseils de paysans solidaires des conseils ouvriers ; les Bolcheviks assuraient parmi eux une présence minoritaire mais significative. La situation était très différente en Espagne : l'agitation paysanne est restée localisée à l'Andalousie et n'a jamais dépassé le niveau de luttes locales ; les paysans et les journaliers ne se posaient pas de questions sur le pouvoir et la situation générale, restant concentrés sur la réforme agraire ; les liens avec la CNT étaient davantage des liens de sympathie que d'influence politique.
[16] Nous avons déjà parlé de Segui (1890-1923) précédemment. Il fut le leader incontestable de la CNT entre 1917 et 1923. Il était partisan de l'union avec l'UGT, ce qui l'entraînait non pas à la "modération" mais à une position syndicaliste à outrance. Il fut assassiné par les bandes du Syndicat Libre dont nous parlerons plus tard. Pestaña (1886-1937) a fini par scissionner de la CNT en 1932 pour fonder un "Parti syndicaliste" inspiré par le travaillisme britannique.
[17] Segui par exemple vota l'adhésion à la Troisième Internationale au fameux Congrès de la Comédie - du nom du théâtre où il eut lieu - en décembre 1919. Ce furent autant la déception progressive face à la dégénérescence de la Révolution en Russie - et de l'Internationale communiste - que la nécessité d'assumer jusqu'au bout le syndicalisme qui firent que cette tendance finit par rejeter totalement la Révolution russe, au nom de l'apolitisme.
[18] Juan Gomez Casas, op. cit.
[19] Cette résolution annonce clairement ce que sera la politique de la CNT à partir de 1930 : appui tacite au changement politique en faveur de la République espagnole, abstention sélective, appui au Front populaire en 1936, etc.
[20] Olaya, Histoire du mouvement ouvrier en Espagne, traduit par nos soins.
[21] La Conférence de Berlin en 1922 ressuscita l'AIT et prétendit donner une cohérence anarchiste au syndicalisme révolutionnaire. Nous aborderons cette question dans un prochain article.
[22] Représentant du KAPD au IIIe Congrès de l'IC, en 1921.
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale n° 131 - 4e trimestre 2007
- 2989 reads
Crise financière : de la crise des liquidités à la liquidation du capitalisme !
- 6426 reads
L'été 2007 a confirmé la plongée du capitalisme dans des catastrophes toujours plus fréquentes : le bourbier impérialiste illustré par les constants bains de sang de civils en Irak ; les dévastations causées parle changement climatique provoqué par la recherche effrénée du profit ; et un nouveau plongeon dans la crise économique qui promet un plus grand appauvrissement de la population mondiale. A l'inverse, la classe ouvrière, la seule force capable de sauver la société humaine, est de plus en plus mécontente du système capitaliste pourrissant. Mais c'est sur la crise économique que nous allons nous pencher ici, étant donné les événements dramatiques qui ont débuté dans l'immobilier aux États-unis et qui ont ébranlé la finance internationale et le système économique du monde entier.
La bulle éclate
La crise a été déclenchée par la chute des prix immobiliers en Amérique de pair avec un ralentissement de l'activité dans l'industrie du bâtiment et l'incapacité de très nombreux débiteurs, n'ayant pas les moyens de faire face à la hausse des taux d'intérêts, de rembourser les crédits, maintenant célèbres sous le nom de subprime ou emprunts à risques. De cet épicentre, les ondes de choc se sont répandues dans tout le système financier mondial. En août, des fonds d'investissement et des banques commerciales entières dont les avoirs comprenaient des milliards de dollars de ces prêts à risques, se sont effondrés ou ont dû être secourus. Ainsi deux hedge funds de la banque américaine Bear Sterns se sont effondrés, coûtant un milliard de dollars aux investisseurs. La banque allemande ADF a dû être sauvée in extremis et la banque française BNP Paribas a été brutalement secouée. Les actions des organismes de prêts immobiliers et d'autres banques ont sérieusement baissé, menant à une chute vertigineuse sur toutes les principales places boursières de la planète, anéantissant des milliards de dollars de "travail accumulé". Afin de juguler la perte de confiance et la réticence des banques à accorder des prêts, les banques centrales -la Réserve fédérale américaine (la FED) et la Banque européenne- sont intervenues pour mettre à disposition de nouveaux milliards pour des prêts moins chers. Cet argent n'était pas destiné, bien sûr, aux centaines de milliers de gens ayant perdu leur toit dans le fiasco des subprimes, ni aux dizaines de milliers d'ouvriers jetés au chômage par la crise du bâtiment, mais aux marchés du crédit eux-mêmes. Ainsi, les institutions financières qui ont dilapidé des quantités énormes de liquidités, ont été récompensées par de nouveaux apports pour continuer leurs paris. Mais cela n'a aucunement mis fin à la crise. En Grande Bretagne, cela allait se transformer en farce.
En septembre, la Banque d'Angleterre a critiqué les autres banques centrales pour avoir cautionné les investisseurs dangereux et imprudents qui avaient déclenché la crise et a recommandé une politique plus sévère qui punisse les mauvais acteurs et empêche la réapparition des mêmes problèmes de spéculation. Mais le lendemain même, le président de la Banque, Mervyn King, a pris un virage à 180°. La banque devait secourir le cinquième fournisseur de prêts immobiliers du Royaume-Uni, la Northern Rock. La "stratégie d'entreprise" de cette dernière était d'emprunter sur le marché du crédit puis de re-prêter l'argent aux gens qui achetaient des logements à un taux d'intérêt supérieur. Quand les marchés du crédit ont commencé à s'effondrer, la Northern Rock a fait de même.
Après que le secours à la banque fut annoncé, on a vu se former d'énormes queues devant les différentes agences : les épargnants venaient retirer leur argent -en 3 jours, 2 milliards de Livres sterling ont été retirés. C'était la première ruée de ce type sur une banque anglaise depuis 140 ans (1866). Pour prévenir le risque de contagion, le gouvernement a dû intervenir à nouveau et donner 100% de garantie aux clients de la Northern Rock et aux épargnants d'autres banques menacées[1]. Finalement, "la vieille dame de Threadneedle Street" -la Banque d'Angleterre- a été obligée, à l'instar de toutes les autres banques centrales qu'elle venait de critiquer, d'injecter d'énormes sommes d'argent dans le système bancaire décrépi. Résultat : la crédibilité de la direction même du centre financier de Londres -qui représente aujourd'hui un quart de l'économie britannique- était en ruines.
L'acte suivant du drame qui se poursuit à l'heure où nous écrivons, concerne l'effet de la crise financière sur l'économie en général. La première baisse depuis cinq ans des taux d'intérêt par la FED en vue de rendre le crédit plus disponible n'a pas, pour l'instant, été une réussite. Elle n'a pas mis fin à l'effondrement continu du marché immobilier aux États-Unis et n'écarte pas non plus la même perspective pour les 40 autres pays où s'est développée la même bulle spéculative. Elle n'a pas non plus empêché le développement des restrictions de crédit et leurs effets inévitables sur l'investissement et les dépenses des ménages dans leur ensemble. Au lieu de cela, elle a amené une chute rapide du dollar qui est à son plus bas niveau par rapport aux autres devises depuis que le président Nixon l'avait dévalué en 1971, et une montée record de l'Euro et des matières premières comme le pétrole et l'or.
Ce sont des signes annonciateurs à la fois d'une chute de la croissance de l'économie mondiale, voire d'une récession ouverte de celle-ci, et d'un développement de l'inflation pour la période à venir.
En un mot, la période de croissance économique des six dernières années, bâtie sur le crédit hypothécaire et à la consommation et sur la gigantesque dette extérieure et du budget des États-Unis, arrive à son terme.
Telles sont les données de la situation économique actuelle. La question est : est-ce que la récession qui se profile et que tout le monde pense probable, s'inscrit dans les hauts et bas inévitables d'une économie capitaliste fondamentalement saine, ou est-elle un signe d'un processus de désintégration, de panne interne du capitalisme lui-même qui sera ponctué par des convulsions de plus en plus violentes.
Pour répondre à cette question, il est d'abord nécessaire d'examiner l'idée selon laquelle le développement de la spéculation et la crise du crédit qui en découle seraient, d'une certaine façon, une aberration ou encore un écart par rapport au fonctionnement sain du système et pourraient donc être corrigés par le contrôle de l'État ou par une meilleure régulation. En d'autres termes, la crise actuelle est-elle due aux financiers qui prennent l'économie en otage ?
Le rôle du crédit dans le capitalisme
Le développement du système bancaire, de la Bourse et d'autres mécanismes de crédit fait partie intégrante du développement du capitalisme depuis le 18e siècle. Ils ont été nécessaires pour amasser et centraliser le capital financier et permettre les niveaux d'investissement requis pour une vaste expansion industrielle que même le capitaliste individuel le plus riche ne pouvait envisager. L'idée de l'entrepreneur industriel qui acquiert son capital en économisant et en risquant son argent propre est une pure fiction. La bourgeoisie doit avoir accès aux sommes de capital qui ont déjà été concentrées sur les marchés du crédit. Sur les places financières, ce ne sont pas leurs propres fortunes personnelles que les représentants de la classe bourgeoise mettent en jeu, mais la richesse sociale sous forme monétaire.
Le crédit, beaucoup de crédit, a donc joué un rôle important dans l'accélération énorme de la croissance des forces productives -par rapport aux époques précédentes- et dans la constitution du marché mondial.
D'un autre côté, étant donné les tendances inhérentes à la production capitaliste, le crédit a également constitué un puissant facteur accélérateur de la surproduction, de la surévaluation de la capacité du marché à absorber des produits et a donc catalysé les bulles spéculatives avec leurs conséquences sous forme de crise et de tarissement du crédit. En même temps qu'ils facilitaient ces catastrophes sociales, les Bourses et le système bancaire ont encouragé tous les vices tels que l'avidité et la duplicité, caractéristiques d'une classe exploiteuse qui vit du travail d'autrui ; des vices que nous voyons prospérer aujourd'hui sous la forme de délits d'initiés et de paiements fictifs, de "primes" scandaleuses équivalentes à des fortunes énormes ou de "parachutes dorés", de fraudes comptables ou de vols tout à fait ouverts, etc.
La spéculation, les prêts à risque, les escroqueries, les crashs boursiers qui en découlent et la disparition d'énormes quantités de plus-value sont donc une caractéristique intrinsèque de l'anarchie de la production capitaliste.
En dernière analyse, la spéculation est une conséquence, pas une cause des crises capitalistes. Et si aujourd'hui, il semble que l'activité spéculative de la finance domine l'ensemble de l'économie, c'est parce que depuis 40 ans, la surproduction capitaliste est entrée de façon croissante dans une crise continue, où les marchés mondiaux sont saturés de produits, l'investissement dans la production de moins en moins lucrative ; l'inévitable recours qui reste au capital financier est de parier dans ce qui est devenu une "économie de casino"[2].
Un capitalisme sans excès financiers n'est donc pas possible ;ceux-ci font intrinsèquement partie de la tendance du capitalisme à produire comme si le marché n'avait pas de limites, d'où l'incapacité même d'un Alan Greenspan, l'ancien président de la FED, de savoir si "le marché est surévalué".
Le récent effondrement du marché immobilier aux États-Unis et dans d'autres pays est une illustration du rapport véritable entre la surproduction et la pression du crédit
L'industrie de l'immobilier illustre l'anachronisme de la production capitaliste
Les caractéristiques de la crise du marché immobilier rappellent les descriptions des crises capitalistes par Karl Marx dans Le Manifeste communiste : "Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société, -l'épidémie de la surproduction... la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce."
Ainsi, ce n'est pas à cause d'une pénurie de logements qu'il y a des masses de sans abri ; paradoxalement, il y en a trop, une véritable surabondance de maisons vides. L'industrie de la construction a travaillé sans relâche ces cinq dernières années. Mais en même temps, le pouvoir d'achat des ouvriers américains a chuté car le capitalisme américain cherchait à augmenter ses profits. Un fossé s'est créé entre les nouveaux logements mis sur le marché et la capacité de paiement de ceux qui en avaient besoin. D'où les prêts à risque -les subprimes- pour séduire les nouveaux acheteurs qui n'en avaient pas les moyens. La quadrature du cercle. Finalement, le marché s'est effondré. Aujourd'hui, alors que des propriétaires de logements de plus en plus nombreux sont expulsés et leurs biens saisis à cause des taux d'intérêt écrasants de leurs emprunts, le marché immobilier sera encore plus saturé -aux États-Unis, on s'attend à ce que 3 millions de personnes perdent leur toit par incapacité à rembourser leurs emprunts subprime. On s'attend au même phénomène de misère dans d'autres pays où la bulle immobilière a éclaté ou est sur le point de le faire. Ainsi, le développement de l'activité dans le bâtiment et des prêts hypothécaires pendant la dernière décennie, loin de réduire le nombre de sans abri, a mis le logement décent hors de portée de la masse de la population ou les propriétaires de maison dans une situation précaire[3].
Évidemment, ce qui préoccupe les dirigeants du système capitaliste -ses managers de hedge funds, ses ministres des finances, ses banquiers des banques centrales, etc.- dans la crise actuelle, ce ne sont pas les tragédies humaines provoquées par la débâcle des subprimes, et les petites aspirations à une vie meilleure (sauf dans le cas où elles pourraient mener à mettre en question l'insanité de ce mode de production), mais l'impossibilité des consommateurs à payer les prix qui flambent des maisons et les taux d'intérêts usuraires sur les prêts.
Le fiasco des subprimes illustre donc la crise du capitalisme, sa tendance chronique, dans sa course au profit, à la surproduction par rapport à la demande solvable, son incapacité, malgré des ressources matérielles,technologiques et humaines phénoménales à sa disposition, à satisfaire les besoins humains les plus élémentaires[4].
Cependant, aussi absurdement gaspilleur et anachronique que le système capitaliste apparaisse à la lumière de la récente crise, la bourgeoisie essaie toujours de se rassurer elle-même ainsi que l'ensemble de la population : au moins, cela n'ira pas aussi mal qu'en 1929.
La situation actuelle : le même problème qu'en 1929
Le crash de Wall Street en 1929 et la Grande Dépression continuent à hanter la bourgeoisie comme en témoigne la couverture par les médias des récents événements. Des éditoriaux, des articles de fond, des analogies historiques tentent de nous convaincre que la crise financière actuelle ne mènera pas à la même catastrophe, que 1929 était un événement unique qui s'est transformé en désastre à cause de mauvaises décisions.
Les "experts" de la bourgeoisie encouragent plutôt l'illusion selon laquelle la crise financière actuelle serait une sorte de répétition des crashs financiers du 19e siècle qui étaient relativement limités dans le temps et l'espace. En réalité, la situation actuelle a plus en commun avec 1929 qu'avec cette période antérieure de l'ascendance du capitalisme ; elle partage beaucoup des caractéristiques communes aux crises économiques et financières catastrophiques de sa décadence, période qui s'est ouverte avec la Première Guerre mondiale, de désintégration du mode de production capitaliste, une période de guerres et de révolutions.
Les crises économiques de l'ascendance capitaliste et l'activité spéculative qui les ont souvent accompagnées et précédées, constituaient les battements du cœur d'un système sain et ouvraient la voie à une nouvelle expansion capitaliste à travers des continents entiers, à des avancées technologiques majeures, à la conquête de marchés coloniaux, à la transformation des artisans et des paysans en des armées de travailleurs salariés, etc.
Le crash de la Bourse à New York en 1929 qui a annoncé la première crise majeure du capitalisme en déclin a rejeté dans l'ombre toutes les crises spéculatives du 19e siècle. Durant "les années folles" de 1920, la valeur des actions de la Bourse de New York, la plus importante du monde, avaient été multipliée par cinq. Le capitalisme mondial n'avait pas surmonté la catastrophe de la Première Guerre mondiale et, dans le pays devenu le plus riche du monde, la bourgeoisie cherchait des débouchés dans la spéculation boursière.
Mais le "jeudi noir" du 24 octobre 1929, ce fut le déclin brutal. Les ventes en catastrophe se poursuivaient le "mardi noir" de la semaine suivante. Et la Bourse continua à s'effondrer jusqu'en 1932 ; entre temps, les titres avaient perdu 89% de leur valeur maximum de 1929. Ils étaient revenus à des niveaux jamais vus depuis le 19e siècle. Le niveau maximum de la valeur des actions de 1929 ne fut retrouvé qu'en 1954 !
Pendant ce temps, le système bancaire américain qui avait prêté de l'argent pour acheter les titres, s'est lui-même effondré. Cette catastrophe annonça la Grande Dépression des années 1930, la crise la plus profonde jamais connue par le capitalisme. Le PIB américain fut divisé par deux. 13 millions d'ouvriers furent jetés au chômage avec quasiment aucun secours. Un tiers de la population sombra dans la pauvreté la plus abjecte. Les effets résonnèrent sur toute la planète.
Mais il n'y eut pas de rebond économique comme après les crises du 19e siècle. La production ne reprit qu'après avoir été orientée vers la production d'armements en préparation d'une nouvelle re-division du marché mondial dans le bain de sang impérialiste de la Deuxième Guerre mondiale ; en d'autres termes, quand les chômeurs eurent été transformés en chair à canon.
La dépression des années 1930 semble être le résultat de 1929 mais, en réalité, le crash de Wall Street ne fit que précipiter la crise, crise de la surproduction chronique du capitalisme dans sa phase de décadence et qui est l'essence de l'identité entre la crise des années1930 et celle d'aujourd'hui qui a commencé en 1968.
La bourgeoisie des années 1950 et 1960 a proclamé avec suffisance qu'elle avait résolu le problème des crises et les avait réduites à l'état de curiosité historique grâce aux palliatifs tels que l'intervention de l'État dans l'économie sur le plan national et international, par le financement des déficits et la taxation progressive. A sa consternation, la crise mondiale de surproduction est réapparue en 1968.
Depuis 40 ans, cette crise a titubé d'une dépression à une autre, d'une récession ouverte à une autre plus grave, d'un faux eldorado à un autre. La crise depuis 1968 n'a pas pris la forme abrupte du crash de 1929.
En 1929, les experts financiers de la bourgeoisie prirent des mesures qui n'ont pas endigué la crise financière. Ces mesures n'étaient pas des erreurs mais des méthodes qui avaient fonctionné lors des précédents crashs du système, comme celui de 1907 et de la panique qu'il avait engendré ; mais elles n'étaient plus suffisantes dans la nouvelle période. L'État refusa d'intervenir. Les taux d'intérêt augmentèrent, on laissa les réserves monétaires diminuer, les restrictions de crédit se renforcer et la confiance dans le système bancaire et de crédit voler en éclat. Les lois tarifaires Smoot-Hawley imposèrent des barrières aux importations, ce qui accéléra le ralentissement du commerce mondial et, par conséquent, empira la dépression.
Dans les 40 dernières années, la bourgeoisie a compris comment utiliser les mécanismes étatiques pour réduire les taux d'intérêt et injecter des liquidités dans le système bancaire afin de faire face aux crises financières. Elle a été capable d'accompagner la crise, mais au prix d'une surcharge du système capitaliste par des montagnes de dettes. Le déclin a été plus graduel que dans les années 1930 ; néanmoins, les palliatifs s'usent et le système financier est de plus en plus fragile.
L'augmentation phénoménale de la dette dans l'économie mondiale pendant la dernière décennie est illustrée parla croissance extraordinaire, sur le marché du crédit, des hedge funds aujourd'hui célèbres. Le capital estimé de ces fonds a augmenté de 491 milliards de dollars en 2000 à 1745 milliards en 2007[5]. Leurs transactions financières compliquées, pour la plupart secrètes et non régulées, utilisent la dette comme une sécurité négociable dans la recherche de gains à court terme. Les hedge funds sont considérés comme ayant répandu de mauvaises dettes à travers le système financier, accélérant et étendant rapidement la crise financière actuelle.
Le Keynésianisme, système de financement du déficit par l'Etat afin de maintenir le plein emploi, s'est évaporé avec l'inflation galopante des années 1970 et les récessions de 1975 et 1981. Les Reaganomics et le Thatcherisme, moyen de restaurer les profits par la réduction du salaire social, la diminution des impôts, et en laissant les entreprises non rentables faire faillite et provoquer un chômage de masse, ont expiré avec le crash boursier de 1987, le scandale de la Savings and Loans (Société de crédit pour le logement social) et la récession de 1991. Les Dragons asiatiques se sont essoufflés en 1997, avec d'énormes dettes. La révolution Internet, la "nouvelle économie", s'est avérée n'avoir "aucun revenu apparent"et le boom de ses actions a fait faillite en 1999. Le boom de l'immobilier et l'explosion du crédit à la consommation des cinq dernières années, et l'utilisation de la gigantesque dette extérieure des Etats-Unis pour fournir une demande pour l'économie mondiale et l'expansion "miracle" de l'économie chinoise -cela aussi est mis en question.
On ne peut prédire exactement comment l'économie mondiale va poursuivre son déclin mais, ce qui est inévitable, ce sont des convulsions croissantes et une austérité toujours plus grande.
Le capitalisme a préparé les conditions du socialisme
Dans le Volume III du Capital, Karl Marx argumente que le système de crédit développé par le capitalisme a révélé de façon embryonnaire un nouveau mode de production au sein de l'ancien. En élargissant et en socialisant la richesse, en l'ôtant des mains des membres individuels de la bourgeoisie, le capitalisme a pavé le chemin pour une société où la production pourrait être centralisée et contrôlée par les producteurs eux-mêmes et où la propriété bourgeoise pourrait être abolie comme un anachronisme historique : le système du crédit "accélère par conséquent, le développement matériel des forces productives et la création du marché mondial. Le système capitaliste a pour tâche historique de porter à un certain niveau ces bases matérielles du nouveau type de production. En même temps, le crédit accélère les manifestations violentes de cet antagonisme, c'est-à-dire les crises, et, par conséquent, les éléments de dissolution de l'ancien mode de production. [6]"
Cela fait maintenant plus d'un siècle que les conditions sont mûres pour que soient abolis le règne de la bourgeoisie et l'exploitation capitaliste. En l'absence d'une réponse radicale du prolétariat l'amenant à renverser le capitalisme à l'échelle mondiale, les contradictions de ce système moribond, la crise économique en particulier, ne font que s'aggraver. Si aujourd'hui, le crédit continue de jouer un rôle dans l'évolution de ces contradictions, ce n'est plus vis-à-vis de la conquête du marché mondial alors que le capitalisme a établi depuis longtemps la domination de ses rapports de production sur l'ensemble de la planète. En revanche, ce que l'endettement massif de tous les Etats a effectivement permis au capitalisme, c'est d'éviter des plongeons brutaux de l'activité économique, mais pas à n'importe quel prix. Ainsi, après avoir pendant des décennies constitué un facteur d'aplanissement de l'antagonisme entre le développement des forces productives et les rapports de production capitalistes devenus caduques, la folle fuite en avant dans l'utilisation massive et généralisée du crédit, "les manifestations violentes de cet antagonisme", va être appelée à connaître des accélérations brutales qui ébranleront comme jamais l'édifice social. Cependant, prises en elles-mêmes, de telles secousses ne constituent pas une menace pour la division de la société en classes. Elles le deviennent par contre dès lors qu'elles participent à mettre le prolétariat en mouvement.
Or, comme les révolutionnaires l'ont toujours mis en évidence, c'est la crise qui va accélérer le processus déjà en cours de prise de conscience de l'impasse du monde actuel. C'est elle qui, à terme, va précipiter dans la lutte, de plus en plus massivement, de nombreux secteurs de la classe ouvrière permettant à celle-ci de multiplier les expériences. L'enjeu de ces expériences futures est la capacité, parla classe ouvrière, de se défendre et de s'affirmer face à toutes les forces de la bourgeoisie, de prendre confiance en ses propres forces et d'acquérir progressivement la conscience qu'elle seule constitue cette force de la société capable de renverser le capitalisme.
Como, 29/10/2007[1] Selon la revue d'affaires britannique The Economist, cette garantie était en réalité un bluff.
[2] "Et ce ne sont pas les péroraisons des "altermondialistes" et autres pourfendeurs de la "financiarisation"de l'économie qui y changeront quoi que ce soit. Ces courants politiques voudraient un capitalisme "propre", "équitable", tournant notamment le dos à la spéculation. En réalité, celle-ci n'est nullement le fait d'un "mauvais" capitalisme qui "oublie" sa responsabilité d'investir dans des secteurs réellement productifs. Comme Marx l'a établi depuis le 19e siècle, la spéculation résulte du fait que, dans la perspective d'un manque de débouchés suffisants pour les investissements productifs, les détenteurs de capitaux préfèrent les faire fructifier à court terme dans une immense loterie, une loterie qui transforme aujourd'hui le capitalisme en un casino planétaire. Vouloir que le capitalisme renonce à la spéculation dans la période actuelle est aussi réaliste que de vouloir que les tigres deviennent végétariens (ou que les dragons cessent de cracher du feu)." (Résolution sur la situation internationale [50] adoptée par le17e congrès du CCI - Voir la Revue internationale n° 130)
[3] Benjamin Bernanke, président de la FED, parle des arriérés de loyer comme étant des actes de "délinquance" : en d'autres termes, des infractions contre Mammon. En conséquence, les "criminels" ont été punis... par des taux d'intérêt encore plus élevés !
[4] Nous ne pouvons entrer ici dans la question de l'état des sans abri dans l'ensemble du monde. Selon la Commission des Nations Unies sur les Droits de l'Homme, un milliard de personnes sur la planète n'ont pas de logement adéquat et 100 millions pas de logement du tout.
[5] www.mcclatchydc.com [69]
[6] Section 5, chapitre "Le rôle du crédit dans la production capitaliste".
Récent et en cours:
- Crise économique [70]
Octobre 1917 : la plus grande expérience révolutionnaire de la classe ouvrière
- 3135 reads
Il y a 90 ans avait lieu un des événements les plus importants de toute l'histoire de l'humanité.
Alors que la Première Guerre mondiale était en train de ravager la plupart des pays avancés, qu'elle fauchait des générations entières en même temps qu'elle engloutissait des siècles de progrès de la civilisation, le prolétariat de Russie ranimait avec éclat l'espoir de dizaines de millions d'êtres humains écrasés par l'exploitation et la barbarie guerrière.
La boucherie impérialiste signait le fait que le système capitaliste avait fait son temps, qu'il avait cessé de représenter la condition du développement de la civilisation comme cela avait été le cas par le passé contre le système féodal, qu'il était au contraire devenu la principale entrave à tout développement ultérieur de la civilisation et une menace pour celle-ci. La révolution d'Octobre 1917 faisait la preuve que le prolétariat était bien la classe capable de renverser la domination capitaliste et de prendre en main la direction de la planète afin de l'acheminer vers une société débarrassée l'exploitation et des guerres.
Suivant la nuance à laquelle il appartient, chacun des secteurs de la classe dominante et de son appareil politique va célébrer à sa façon cet anniversaire.
Certains feront en sorte qu'on en parle le moins possible à grand renfort de "scoops" sur toutes sortes de sujets"spectaculaires" comme le drame de la disparition de la petite Maddie Mc Cann, la coupe du monde de rugby ou l'avenir de la monarchie en Espagne.
D'autres l'évoqueront mais uniquement pour répéter une nouvelle fois ce qu'on a entendu jusqu'à la nausée au lendemain de l'effondrement de l'URSS et de son bloc : le stalinisme est le fils légitime de la révolution, toute tentative des exploités de se libérer de leurs chaînes ne peut conduire qu'à la terreur et à l'assassinat de masse.
Certains,enfin, feront l'éloge de l'insurrection ouvrière de1917, de Lénine et des bolcheviks qui étaient à sa tête, mais ils finiront par tomber d'accord sur le fait qu'aujourd'hui la révolution n'est pas nécessaire ou qu'elle n'est pas possible.
Il appartient aux révolutionnaires de mener le combat contre les divers mensonges que les défenseurs de l'ordre capitaliste déversent inlassablement pour détourner la classe ouvrière de sa perspective révolutionnaire. C'est ce que nous faisons dans les deux articles que nous publions ci-dessous.
Le premier a pour but essentiel de montrer que la révolution n'est pas un simple vœu pieux, qu'elle est, non seulement nécessaire mais aussi possible et réalisable.
Le second revient sur un des plus grands mensonges de l'histoire :l'idée suivant laquelle la société qui existait en URSS était une société "socialiste"puisqu'elle avait aboli la propriété individuelle des moyens de production, un mensonge que se sont partagé, de façon intéressée, aussi bien les secteurs classiques de la bourgeoisie "démocratique" que le stalinisme, un mensonge qui a été cautionné également par le trotskisme, un courant politique qui représente pourtant comme "révolutionnaire","communiste" et "anti-stalinien".
Cet article a paru pour la première fois en 1946 dans la revue Internationalisme que publiait le groupe de la Gauche communiste de France, ancêtre du CCI et notre Revue Internationale l'a repris dans son numéro 61, au printemps1990. Sa lecture n'est pas très facile, et c'est pour cela que nous l'avions fait précéder d'une présentation que nous reproduisons ici[1].Nous avons ajouté quelques notes à l'article de 1946dans la mesure où il fait référence à des faits ou des organisations dont la mémoire n'est pas très présente parmi les nouvelles générations qui aujourd'hui, 60 années après, s'ouvrent à la réflexion communiste.
Évidemment, le CCI a consacré de nombreux autres textes à un événement aussi important que la révolution de1917 et nous souhaitons que les deux articles que nous publions ici soient une incitation pour nos lecteurs à lire ces textes[2].
[1] 1Cette présentation est signée MC, c'est-à-dire notre camarade décédé à la fin de cette même année. C'est le dernier article qu'il a écrit pour notre Revue mais il exprime la vigueur de sa pensée qu'il a conservée jusqu'à sa mort. Le fait que ce camarade, qui avait été le principal animateur de la GCF, ait lui-même vécu la révolution de 1917 surplace, dans sa ville de Kichinev, donne à ce document une valeur toute particulière au moment où l'on commémore les 90 ans de cette révolution. (A propos de MC, voir notre article "Marc" dans les numéros 65 [71] et 66 [72] de la Revue Internationale)
[2] Il s'agit notamment de nos brochures Octobre 1917 début de la révolution mondiale [73] et Russie 1917 : La plus grande expérience révolutionnaire de la classe ouvrière [74] ainsi que des articles publiés dans la Revue Internationale (numéros 51 [75], 89 [76], 90 [77] et 91 [78])
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [45]
Octobre 1917 : les masses ouvrières prennent leur destin en main
- 4022 reads
Dansnos discussions, surtout avec de jeunes éléments, nousentendons fréquemment "C’est vrai que ça vatrès mal, qu’il y a de plus en plus de misère et deguerre, que nos conditions de vie se dégradent, que l’avenirde la planète est menacée. Il faut faire quelque chose,mais quoi ? Une révolution ? Alors ça, c’estde l’utopie, c’est impossible !" C’est la grandedifférence entre mai 1968 et aujourd’hui. En 1968, l’idéede révolution était partout présente alors quela crise commençait juste à frapper à nouveau.Aujourd’hui, le constat de la faillite du capitalisme est devenugénéral mais il existe par contre un grand scepticismequant à la possibilité de changer le monde. Les termesde communisme, de lutte de classe, résonnent comme un rêved’un autre temps. Parler de classe ouvrière et debourgeoisie serait même dépassé.
Or,il existe dans les faits, dans l’histoire, une réponse àces doutes. Il y a 90 ans, le prolétariat a apportéla preuve, par ses actes, qu’on pouvait changer le monde. Larévolution d’Octobre 1917 en Russie, la plus grandioseaction des masses exploitées à ce jour, a en effetmontré que la révolution n’est pas seulementnécessaire mais qu’elle est aussi possible !
Laforce d’Octobre 1917 : le développement de laconscience…
La classedominante déverse un flot continuel de mensonges sur cetépisode. Les ouvrages comme La Fin d’une illusion ouLe Livre noir du communisme ne font que reprendre àleur compte une propagande circulant déjà àl’époque : la révolution n’aurait étéqu’un "putsch" des bolcheviks, Lénine aurait étéun agent de l’impérialisme allemand, etc. Les bourgeoisconçoivent les révolutions ouvrières comme unacte de démence collective, un chaos effrayant qui finitépouvantablement1.L’idéologie bourgeoise ne peut pas admettre que lesexploités puissent agir pour leur propre compte. L’actioncollective, solidaire et consciente de la majoritétravailleuse est une notion que la pensée bourgeoise considèrecomme une utopie anti-naturelle.
Pourtant,n'en déplaise à nos exploiteurs, la réalitéc'est bien qu'en 1917, la classe ouvrière a su se dressercollectivement et consciemment contre ce système inhumain.Elle a démontré que les ouvriers n'étaient pasdes bêtes de somme, juste bons à obéir et àtravailler. Au contraire, ces événementsrévolutionnaires ont révélé les capacitésgrandioses et souvent même insoupçonnées duprolétariat en libérant un torrent d'énergiecréatrice et une prodigieuse dynamique de bouleversementcollectif des consciences. John Reed résume ainsi cette viebouillonnante et intense des prolétaires au cours de l'année1917 :
"LaRussie tout entière apprenait à lire ; elle lisaitde la politique, de l'économie, de l'histoire, car le peupleavait besoin de savoir. (...) La soif d'instruction si longtempsrefrénée devint avec la révolution un véritabledélire. Du seul Institut Smolny sortirent chaque jour, pendantles six premiers mois, des tonnes de littérature, qui partombereaux et par wagons allaient saturer le pays. (...) Et quel rôlejouait la parole ! On tenait des meetings dans les tranchées,sur les places des villages, dans les fabriques. Quel admirablespectacle que les 40 000 ouvriers de Poutilov allant écouterdes orateurs social-démocrates, socialistes-révolutionnaires,anarchistes et autres, également attentifs à tous etindifférents à la longueur des discours ; pendantdes mois, à Petrograd et dans toute la Russie, chaque coin derue fut une tribune publique. Dans les trains, dans les tramways,partout jaillissait à l'improviste la discussion. (...) Danstous les meetings, la proposition de limiter le temps de parole étaitrégulièrement repoussée ; chacun pouvaitlibrement exprimer la pensée qui était en lui."2.
La"démocratie"bourgeoise parle beaucoup de "libertéd'expression" quand l’expérience nousdit que tout en elle est manipulation, théâtre et lavagede cerveau. L’authentique liberté d’expression est celleque conquièrent les masses ouvrières dans leur actionrévolutionnaire :
"Danschaque usine, dans chaque atelier, dans chaque compagnie, dans chaquecafé, dans chaque canton, même dans les bourgadesdésertes, la pensée révolutionnaire réalisaitun travail silencieux et moléculaire.Partout surgissaient des interprètesdes événements, des ouvriers à qui on pouvaitdemander la vérité sur ce qui s'était passéet de qui on pouvait attendre les mots d'ordre nécessaires.(...) Ces éléments d'expérience, de critiqued'initiative, d'abnégation, se développaient dans lesmasses et constituaient la mécanique interne inaccessible auregard superficiel, cependant décisive, du mouvementrévolutionnaire comme processus conscient."3.
Cettecapacité de la classe ouvrière à entrer en luttecollectivement et consciemment n’est pas un miracle soudain ;elle est le fruit de nombreuses luttes et d’une longue réflexionsouterraine. Marx comparait souvent la classe ouvrière àune vielle taupe creusant lentement son chemin pour surgir plus loinà l’air libre de façon soudaine et impromptue. Atravers l’insurrection d’Octobre 1917 apparaît la marquedes expériences de la Commune de Paris de 1871 et de larévolution de 1905, des batailles politiques de la Ligue descommunistes, des Ie et IIe Internationales, dela gauche de Zimmerwald, des Spartakistes en Allemagne et du Partibolchevique en Russie. La Révolution russe est certes uneréponse à la guerre, à la faim et à labarbarie du tsarisme moribond, mais c’est aussi et surtout uneréponse consciente, guidée par la continuitéhistorique et mondiale du mouvement prolétarien. Concrètement,les ouvriers russes ont vécu avant l’insurrectionvictorieuse les grandes luttes de 1898, 1902, la Révolution de1905 et les batailles de 1912-14.
"Ilétait nécessaire de compter nonavec une quelconque masse, mais avec la masse des ouvriers dePetrograd et des ouvriers russes en général, quiavaient vécu l'expérience de la Révolution de1905, l'insurrection de Moscou du mois de décembre dela même année, et il étaitnécessaire qu'au sein de cette masse, il y eut des ouvriersqui avaient réfléchi sur l'expérience de 1905,qui avaient assimilé la perspective de la révolution,qui s'étaient penchés une douzaine de fois sur laquestion de l'armée."4
C’estainsi qu’Octobre 1917 fut le point culminant d’un long processusde prise de conscience des masses ouvrières aboutissant, àla veille de l’insurrection, à une atmosphèreprofondément fraternelle dans les rangs ouvriers. Cetteambiance est perceptible, presque palpable dans ces quelques lignesde Trotski : "Les massesressentaient le besoin de se tenir serrées, chacun voulait secontrôler lui-même à travers les autres, et tous,d'un esprit attentif et tendu, cherchaient à voir comment uneseule et même pensée se développait dans leurconscience avec ses diverses nuances et caractéristiques.(...) Des mois de vie politique fébrile (...) avaient éduquédes centaines et des milliers d'autodidactes. (...) La masse netolérait déjà plus dans son milieu leshésitants, ceux qui doutent, les neutres. Elle s'efforçaitde s'emparer de tous, de les attirer, de les convaincre, de lesconquérir. Les usines conjointement avec les régimentsenvoyaient des délégués au front. Les tranchéesse liaient avec les ouvriers et les paysans du plus prochearrière-front. Dans les villes de cette zone avaient lieud'innombrables meetings, conciliabules, conférences, danslesquels les soldats et les matelots combinaient leur action aveccelle des ouvriers et des paysans."5.
Grâceà cette effervescence de débats, les ouvriers purentainsi, effectivement, gagner à leur cause les soldats et lespaysans. La révolution de 1917 correspond à l’êtremême du prolétariat, classe exploitée etrévolutionnaire à la fois qui ne peut se libérerque si elle est capable d’agir de manière collective etconsciente. La lutte révolutionnaire du prolétariatconstitue l’unique espoir de libération pour toutes lesmasses exploitées. La politique bourgeoise est toujours auprofit d’une minorité de la société. Al’inverse, la politique du prolétariat ne poursuit pas unbénéfice particulier mais celui de toute l’humanité."La classe exploitée et opprimée(le prolétariat) ne peut plus se libérer de la classequi l'exploite et l'opprime (la bourgeoisie), sans libérer enmême temps et à tout jamais, la sociétéentière de l'exploitation, de l'oppression et des luttes declasses."6
...et de l'organisation de la classe ouvrière
Cetteeffervescence de discussion, cette soif d’action et de réflexioncollective se sont matérialisées trèsconcrètement à travers les soviets (ou conseilsouvriers), permettant aux ouvriers de s’organiser et de luttercomme une classe unie et solidaire.
La journéede mobilisation du 22 octobre, appelée par le Soviet dePetrograd, scella définitivement l’insurrection : desmeetings et des assemblées se tinrent dans tous les quartiers,dans toutes les usines, et ils furent massivement d’accord :"A bas Kerenski !"7,"Tout le pouvoir aux Soviets !". Ce ne furentpas seulement les bolcheviks, mais tout le prolétariat dePetrograd qui décida l’insurrection. Ce fut un actegigantesque dans lequel les ouvriers, les employés, lessoldats, de nombreux cosaques, des femmes, des enfants, marquèrentouvertement leur engagement.
"L'insurrectionfut décidée, pour ainsi dire, pour une date fixée :le 25 octobre. Elle ne fut pas fixée par une réunionsecrète, mais ouvertement et publiquement, et la révolutiontriomphante eut lieu précisément le 25 octobre (6novembre dans le calendrier russe) comme il était prévud'avance. L'histoire universelle a connu un grand nombre de révolteset de révolutions : mais nous y chercherions en vain uneautre insurrection d'une classe opprimée qui ait étéfixée à l'avance et publiquement, pour une dateannoncée, et qui ait été accomplievictorieusement, le jour annoncé. En ce sens et en de nombreuxautres, la révolution de novembre est unique etincomparable."8.
Leprolétariat se donna les moyens d'avoir la force nécessaire- armement général des ouvriers, formation du ComitéMilitaire Révolutionnaire, insurrection - pour que le Congrèsdes soviets puisse prendre effectivement le pouvoir.
Dans toutela Russie, bien au delà de Petrograd, une infinité desoviets locaux appelaient à la prise du pouvoir ou leprenaient effectivement, faisant triompher partout l’insurrection.Le parti bolchevique savait parfaitement que la révolutionn’était l’affaire ni du seul parti ni des seuls ouvriersde Petrograd mais du prolétariat tout entier. Les événementsont prouvé que Lénine et Trotsky avaient raison demettre en avant que les soviets, dès leur surgissementspontané dans les grèves de masse de 1905,représentaient la "forme enfin trouvée de ladictature du prolétariat". En 1917, cetteorganisation unitaire de l’ensemble de la classe en lutte joua, àtravers la généralisation d’assembléessouveraines et leur centralisation par déléguéséligibles et révocables à tout moment, un rôlepolitique essentiel et déterminant dans la prise de pouvoir,alors que les syndicats n’y jouèrent aucun rôle.
Aux côtésdes soviets, une autre forme d’organisation de la classe ouvrièrejoua un rôle fondamental et même vital pour la victoirede l’insurrection : le parti bolchevique. Si les sovietspermirent à toute la classe ouvrière de luttercollectivement, le parti (représentant quant à lui lafraction la plus consciente et déterminée) eut pourrôle de participer activement au combat, de favoriser ledéveloppement le plus large et profond de la conscience etd’orienter de façon décisive (par des mots d’ordre)l’activité de la classe. Ce sont les masses qui prennent lepouvoir, ce sont les soviets qui assurent l’organisation mais leparti de classe est une arme indispensable à la lutte. Enjuillet 1917, c’est le parti qui épargnait à laclasse une défaite décisive9.En octobre 1917, c’est encore lui qui mit la classe sur le chemindu pouvoir. Par contre, la révolution d’Octobre a montréde façon vivante que le parti ne peut et ne doit pas remplacerles soviets : s’il est indispensable que le parti assume ladirection politique autant dans la lutte pour le pouvoir que dans ladictature du prolétariat, ce n’est pas sa tâche deprendre le pouvoir. Celui-ci doit rester dans les mains non d’uneminorité (aussi consciente et dévouée soit-elle)mais de toute la classe ouvrière à travers le seulorganisme qui la représente comme un tout : les soviets.Sur ce point, la révolution russe fut une douloureuseexpérience puisque le parti étouffa peu à peu lavie et l’effervescence des conseils ouvriers. Mais sur cettequestion, ni Lénine et les autres bolcheviks, ni lesSpartakistes en Allemagne n’étaient complètementclairs en 1917 et ils ne pouvaient pas l’être. Il ne faut pasoublier qu’Octobre 1917 est la première expériencepour la classe ouvrière d’une insurrection victorieuse àl’échelle de tout un pays !
Larévolution internationale n'est pas le passé maisl'avenir de la lutte de classe
"LaRévolution russe n’est qu’un détachement de l’arméesocialiste mondiale, et le succès et le triomphe de larévolution que nous avons accomplie dépendent del’action de cette armée. C’est un fait que personne parminous n’oublie (...). Le prolétariat russe aconscience de son isolement révolutionnaire, et il voitclairement que sa victoire a pour condition indispensable et prémissefondamentale, l’intervention unie des ouvriers du mondeentier." (Lénine, 23 juillet 1918).
Pour lesbolcheviks, il était clair que la révolution russen’était que le premier acte de la révolutioninternationale. L’insurrection d’octobre 1917 constituait de faitle poste le plus avancé d’une vague révolutionnairemondiale, le prolétariat livrant des combats titanesques quiont failli venir réellement à bout du capitalisme. En1917, il renverse le pouvoir bourgeois en Russie. Entre 1918 et 1923,il mène de multiples assauts dans le principal pays européen,l’Allemagne. Rapidement, cette vague révolutionnaire serépercute dans toutes les parties du monde. Partout oùil existe une classe ouvrière développée, lesprolétaires se dressent et se battent contre leursexploiteurs : de l’Italie au Canada, de la Hongrie à laChine.
Cetteunité et cet élan de la classe ouvrière àl’échelle internationale ne sont pas apparus par hasard. Cesentiment commun d’appartenir partout à la même classeet au même combat correspond à l’être mêmedu prolétariat. Quel que soit le pays, la classe ouvrièreest sous le même joug de l’exploitation, a en face d’ellela même classe dominante et le même systèmed’exploitation. Cette classe exploitée forme une chaînetraversant les continents, chaque victoire ou défaite de l’unede ses parties touche inexorablement l’ensemble. C’est pourquoila théorie communiste a placé depuis ses originesl’internationalisme prolétarien, la solidarité detous les ouvriers du monde, à la tête de ses principes."Prolétaires de tous les pays, unissez-vous",tel était le mot d’ordre du Manifeste communisterédigé par Marx et Engels. Ce même manifesteaffirmait clairement que "les prolétaires n’ont pasde patrie". La révolution du prolétariat,qui seule peut mettre fin à l’exploitation capitaliste et àtoute forme d’exploitation de l’homme par l’homme, ne peutavoir lieu qu’à l’échelle internationale. C’estbien cette réalité qui était expriméeavec force dès 1847 : "La révolutioncommuniste (...) ne sera pas une révolution purementnationale ; elle se produira en même temps dans tous lespays civilisés (...). Elle exercera égalementsur tous les autres pays du globe une répercussionconsidérable et elle transformera complètement etaccélérera le cours de leur développement. Elleest une révolution universelle ; elle aura, parconséquent, un terrain universel."10.La dimension internationale de la vague révolutionnaire desannées 1917-1923 prouve que l’internationalisme prolétarienn’est pas un beau et grand principe abstrait mais qu’il est aucontraire une réalité réelle et tangible. Faceau nationalisme sanguinaire et viscéral des bourgeoisies sevautrant dans la barbarie de la Première Guerre mondiale, laclasse ouvrière a opposé sa lutte et sa solidaritéinternationale. "Il n’y a pas de socialisme en dehors de lasolidarité internationale du prolétariat", telétait le message fort et clair des tracts circulant dans lesusines en Allemagne11.La victoire de l’insurrection d’octobre 1917 puis la menace del’extension de la révolution en Allemagne ont contraint lesbourgeoisies à mettre un terme à la premièreboucherie mondiale, à cet ignoble bain de sang. En effet, laclasse dominante a dû faire taire ses antagonismesimpérialistes qui la déchiraient depuis quatre annéesafin d’opposer un front uni et endiguer la vague révolutionnaire.
La vaguerévolutionnaire du siècle dernier a étéle point culminant atteint par l’humanité jusqu’àce jour. Au nationalisme et à la guerre, àl’exploitation et à la misère du monde capitaliste,le prolétariat a su ouvrir une autre perspective, saperspective : l’internationalisme et la solidarité detoutes les masses opprimées. La révolution d’Octobre17 a ainsi prouvé la force de la classe ouvrière. Laclasse exploitée a eu le courage et la capacité desaisir le pouvoir des mains des exploiteurs et d’inaugurer larévolution prolétarienne mondiale ! Même sila révolution devait être bientôt défaite,à Berlin, à Budapest et à Turin et bien que leprolétariat russe et mondial ait dû payer cette défaited’un prix terrible (les horreurs de la contre-révolutionstalinienne, une Deuxième Guerre mondiale et toute la barbariequi n’a cessé depuis), la bourgeoisie n’a toujours pas étécapable d’effacer complètement de la mémoire ouvrièrecet événement exaltant et ses leçons. L’ampleurdes falsifications de la bourgeoisie sur Octobre 17 est à lamesure des frayeurs qu’elle a éprouvées. La mémoired’Octobre est là pour rappeler au prolétariat que ledestin de l’humanité repose entre ses mains et qu’il estcapable d’accomplir cette tâche grandiose. La révolutioninternationale représente plus que jamais l’avenir !
Pascale
1)Le dessin animé de Don Bluth et Gary Goldman nommé"Anastasia" qui présente la Révolution russecomme un coup de Raspoutine ayant jeté un sort maléfiqueet démoniaque au peuple russe en est une caricature trèsgrossière mais aussi très révélatrice !
2)John Reed, Dix jours qui ébranlèrent le monde.
3)Trotsky, Histoire de la Révolution russe, chap."Regroupement dans les masses".
4)Trotsky, Histoire de la Révolution russe, chap. "Leparadoxe de la révolution de février".
5)Trotsky, Ibid., chap. "La sortie dupré-parlement".
6)Engels, Préface de 1883 au Manifeste communiste.
7)Chef du Gouvernement provisoire bourgeois formé depuisFévrier.
8)Trotsky, la Révolution de novembre, 1919.
9)Lire notre article “Les journées de Juillet, le parti déjoue une provocation de la bourgeoisie [77]” .
10)F. Engels, Principes du communisme.
11)Formule de Rosa Luxemburg dans la Crise de la social-démocratie,reprise par de très nombreux tracts spartakistes.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [45]
La culture du débat : une arme de la lutte de classe
- 6794 reads
La "culture du débat" n'est pas une question nouvelle, ni pour le mouvement ouvrier, ni pour le CCI. Néanmoins, l'évolution historique oblige notre organisation -depuis le tournant du siècle- à revenir sur cette question et à l'examiner de plus près. Deux évolutions principales nous ont contraints à le faire, la première étant l'apparition d'une nouvelle génération de révolutionnaires et, la seconde, la crise interne que nous avons traversée au début de ce siècle.
La nouvelle génération et le dialogue politique
C'est avant tout le contact avec une nouvelle génération de révolutionnaires qui a obligé le CCI développer et cultiver de manière plus consciente son ouverture vers l'extérieur et sa capacité de dialogue politique.
Chaque génération constitue un maillon dans la chaîne de l'histoire de l'humanité. Chacune d'elle fait face trois tâches fondamentales : recueillir l'héritage collectif de la génération précédente, enrichir cet héritage sur la base de son expérience propre, le transmettre à la génération suivante sorte que cette dernière aille plus loin que la précédente.
Loin d'être faciles à mettre en œuvre, ces tâches représentent un défi particulièrement difficile relever. Ceci est également valable pour le mouvement ouvrier. La vieille génération doit offrir son expérience. Mais elle porte aussi les blessures et les traumatismes de ses luttes ; elle a connu des défaites, des déceptions, elle a dû y faire face et prendre conscience du fait qu'une vie ne suffit souvent pas pour construire des acquis durables de la lutte collective[1] Cela nécessite l'élan et l'énergie de la génération suivante mais également les questions nouvelles qu'elle se pose et la capacité qu'elle a de voir le monde avec des yeux nouveaux.
Mais même si les générations ont besoin les unes des autres, leur capacité à forger l'unité nécessaire entre elles ne va pas automatiquement de soi. Plus la société s'éloigne d'une économie traditionnelle naturelle, plus le capitalisme "révolutionne" de façon constante et rapide les forces productives et l'ensemble de la société, plus l'expérience d'une génération diffère de celle de la suivante. Le capitalisme, système la concurrence par excellence, monte aussi les unes contre les autres les générations dans la lutte de tous contre tous.
C'est dans cadre que notre organisation a commencé à préparer à la tâche de forger ce lien. Mais, plus que cette préparation, c'est la rencontre avec cette nouvelle génération dans la vie réelle qui a donné la question de la culture du débat une signification particulière à nos yeux. Nous nous sommes trouvé sen présence d'une génération qui, elle-même, attache à cette question une importance bien plus grande que ne l'avait fait celle de "1968". La première indication majeure de ce changement, au niveau de la classe ouvrière dans son ensemble, a été donnée par le mouvement massif des étudiants et lycéens en France contre la "précarisation" de l'emploi au printemps 2006. L'insistance, en particulier dans les assemblées générales, sur le débat le plus libre et le plus large possible était très frappante, au contraire du mouvement étudiant de la fin des années 1960 qui a souvent été marqué par une incapacité à mener un dialogue politique. Cette différence vient avant tout du fait qu'aujourd'hui le milieu étudiant est bien plus prolétarisé qu'il y a 40 ans. Le débat intense, à l'échelle la plus large, a toujours été une marque importante des mouvements prolétariens de masse et caractérisait aussi les assemblées ouvrières en France en 1968 ou en 1969 en Italie. Mais en 2006, ce qui était nouveau, c'était l'ouverture de la jeunesse en lutte envers les générations plus âgées et son avidité à apprendre de leur expérience. Cette attitude est très différente celle du mouvement étudiant de la fin des années 1960, notamment en Allemagne (qui constituait peut-être l'expression la plus caricaturale de l'état d'esprit de l'époque). L'un de ses slogans était : "Les plus de 30 ans dans les camps de concentration !" Concrètement, cette idée s'exprimait par la pratique de se huer mutuellement, d'interrompre violemment les réunions "rivales", etc. La rupture de la continuité entre les générations de la classe ouvrière constituait une des racines du problème puisque les relations entre générations sont le terrain privilégié, depuis les temps anciens, pour forger l'aptitude au dialogue. Les militants de 1968 considéraient la génération de leurs parents soit comme une génération qui "s'était vendue" au capitalisme, ou (comme en Allemagne et en Italie) comme une génération de fascistes et de criminels de guerre. Pour les ouvriers qui avaient supporté l'horrible exploitation de la phase qui a suivi 1945 dans l'espoir que leurs enfants vivraient mieux qu'eux, c'était une déception amère d'entendre leurs enfants les accuser d'être des"parasites" qui vivaient de l'exploitation du Tiers-Monde. Mais il est aussi vrai que la génération de parents de cette époque avait en grande partie perdu, ou n'avait jamais réussi à acquérir, l'aptitude au dialogue. Cette génération avait été sauvagement meurtrie et traumatisée par la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre froide, par la contre-révolution fasciste, stalinienne et social-démocrate.
Au contraire, 2006 en France a annoncé quelque chose de nouveau et d'extrêmement fécond[2]. Mais déjà quelques années auparavant, cette préoccupation de la nouvelle génération avait été annoncée par des minorités révolutionnaires de la classe ouvrière. Ces minorités, dès le moment où elles sont apparues sur la scène la vie politique, étaient armées de leur propre critique du sectarisme et du refus de débattre. Parmi les premières exigences qu'elles ont exprimées, il y avait la nécessité du débat, non comme un luxe, mais comme un besoin impérieux, la nécessité que ceux qui y participent prennent les autres au sérieux, et apprennent à les écouter ; également la nécessité que dans la discussion, les armes soient l'argumentation et non la force brutale, ni l'appel à la morale ou à l'autorité de "théoriciens".Par rapport au milieu prolétarien internationaliste, ces camarades ont, en général (et tout à fait juste titre), critiqué l'absence de débat fraternel entre les groupes existants (et en ont été profondément choqués). Ils ont tout de suite rejeté la conception du marxisme comme un dogme que la nouvelle génération devrait adopter sans esprit critique[3].
De notre côté, nous avons été surpris par la réaction de cette nouvelle génération envers le CCI lui-même. Les nouveaux camarades qui sont venus à nos réunions publiques, les contacts du monde entier qui ont commencé une correspondance avec nous, les différents groupes et cercles politiques avec lesquels nous avons discuté nous ont dit, de façon répétée, qu'ils avaient vu la nature prolétarienne du CCI autant dans notre comportement, en particulier à travers la façon de discuter, que dans nos positions programmatiques.
D'où vient, chez la nouvelle génération, cette profonde préoccupation vis-à-vis de cette question ? Nous pensons qu'elle est le résultat de la crise historique du capitalisme qui est aujourd'hui bien plus grave et bien plus profonde qu'en 1968. Cette situation requiert la critique la plus radicale possible du capitalisme, la nécessité d'aller aux racines les plus profondes des problèmes. L'un des effets les plus corrosifs de l'individualisme bourgeois est la façon dont il détruit la capacité de discuter et, en particulier, d'écouter et d'apprendre les uns des autres. Le dialogue est remplacé par la "parlotte", le gagnant étant celui qui parle le plus fort (comme dans les campagnes électorales bourgeoises). La culture du débat est le principal moyen de développer, grâce au langage humain, la conscience qui est l'arme principale du combat de la seule classe porteuse d'avenir pour l'humanité. Pour le prolétariat, c'est le seul moyen de surmonter son isolement et son impatience et de se diriger vers l'unification de ses luttes.
Une autre préoccupation actuelle réside dans la volonté de surmonter le cauchemar du stalinisme. En effet, beaucoup de militants qui, aujourd'hui, recherchent les positions internationalistes viennent d'un milieu influencé par le gauchisme ou directement issu de ses rangs ; l'objectif de ce dernier étant de présenter des caricatures de l'idéologie et du comportement bourgeois décadents comme étant du "socialisme". Ces militants ont reçu une éducation politique qui leur a fait croire que l'échange d'arguments est équivalent au "libéralisme bourgeois", "qu'un bon communiste" est quelqu'un qui "la ferme" et fait taire sa conscience et ses émotions. Les camarades qui sont aujourd'hui déterminés à rejeter les effets de ce produit moribond de la contre-révolution comprennent de mieux en mieux qu'une telle démarche ne nécessite pas seulement le rejet de ses positions mais aussi de sa mentalité. Ce faisant, ils contribuent au rétablissement d'une tradition du mouvement ouvrier qui menaçait de disparaître avec la rupture organique qu'a provoquée la contre-révolution[4].
Les crises organisationnelles et les tendances au monolithisme
La seconde raison essentielle qui a poussé le CCI à revenir sur la question d'une culture du débat a été notre propre crise interne, au début de ce siècle, qui a été caractérisée pas le comportement le plus indigne jamais vu dans nos rangs. Pour la première fois, depuis sa fondation, le CCI a dû exclure de ses rangs non pas un mais plusieurs de ses membres[5]. Au début de cette crise interne, s'étaient exprimées au sein de notre section en France des difficultés et des divergences d'opinion sur la question de nos principes organisationnels de centralisation. Il n'y a pas de raison pour que des divergences de ce type, en elles-mêmes, soient la cause d'une crise organisationnelle. Et elles ne l'étaient pas. Ce qui a provoqué la crise, cela a été le refus du débat interne et, en particulier, les manœuvres visant à isoler et calomnier -c'est-à-dire à attaquer personnellement- les militants avec lesquels on n'était pas d'accord.
A la suite de cette crise, notre organisation s'est engagée à aller jusqu'aux racines les plus profondes de l'histoire de toutes ses crises et de ses scissions. Nous avons déjà publié des contributions sur certains de ses aspects[6]. L'une des conclusions à laquelle nous sommes parvenus est qu'une tendance au monolithisme avait joué un rôle majeur dans toutes les scissions que nous avons connues. A peine des divergences apparaissaient-elles que certains militants affirmaient déjà qu'ils ne pouvaient plus travailler avec les autres, que le CCI était devenu une organisation stalinienne, ou qu'il était en train de dégénérer. Ces crises ont donc éclaté face à des divergences qui, pour la plupart, pouvaient parfaitement exister au sein d'une organisation non monolithique et, en tous cas, devaient être discutées et clarifiées avant qu'une scission ne soit nécessaire.
L'apparition répétée de démarches monolithiques est surprenante dans une organisation qui se base spécifiquement sur les traditions de la Fraction italienne qui a toujours défendu que, quelles que soient les divergences sur les principes fondamentaux, la clarification la plus profonde et la plus collective devait précéder toute séparation organisationnelle.
Le CCI est le seul courant de la Gauche communiste aujourd'hui qui se place spécifiquement dans la tradition organisationnelle de la Fraction italienne (Bilan) et de la Gauche communiste de France (GCF). Contrairement aux groupes qui sont issus du Parti communiste internationaliste fondé en Italie vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Fraction italienne reconnaissait le caractère profondément prolétarien des autres courants internationaux de la Gauche communiste qui avaient surgi en réaction à la contre-révolution stalinienne, en particulier la Gauche allemande et hollandaise. Loin de rejeter ces courants comme "anarcho-spontanéistes" ou "syndicalistes révolutionnaires", elle a appris tout ce qu'elle pouvait de ces derniers. En fait, la principale critique qu'elle a portée contre ce qui est devenu le courant "conseilliste" était son sectarisme exprimé à travers le rejet des contributions de la Seconde Internationale et du Bolchevisme en particulier[7]. C'est ainsi que la Fraction italienne a maintenu, en pleine contre-révolution, la compréhension marxiste selon laquelle la conscience de classe se développe collectivement et qu'aucun parti ni aucune tradition ne peut proclamer en détenir le monopole. Il en résulte que la conscience ne peut pas se développer sans un débat fraternel, public et international[8].
Mais cette compréhension essentielle, bien que faisant partie de l'héritage fondamental du CCI, n'est pas facile à mettre en pratique. La culture du débat ne peut se développer que contre le courant de la société bourgeoise. Comme la tendance spontanée au sein du capitalisme n'est pas la clarification des idées mais la violence, la manipulation et la lutte pour obtenir une majorité (dont le cirque électoral de la démocratie bourgeoise est le meilleur exemple), l'infiltration de cette idéologie bourgeoise au sein des organisations prolétariennes contient toujours les germes de crises et de dégénérescence. L'histoire du Parti bolchevique l'illustre parfaitement. Tant que le parti était le fer de lance de la révolution, les débats les plus vivants et souvent les plus vifs constituaient une de ses principales forces. En revanche, l'interdiction des véritables fractions (après le massacre de Cronstadt en 1921) a constitué un signe majeur et a été un facteur actif de sa dégénérescence. De même, la pratique de la"coexistence pacifique" (c'est-à-dire de l'absence de débat) entre les positions conflictuelles qui caractérisait déjà le processus de fondation du Parti communiste internationaliste, ou la théorisation par Bordiga et ses adeptes des vertus du monolithisme ne peuvent être comprises que dans le contexte de la défaite historique du prolétariat au milieu du 20e siècle.
Si les organisations révolutionnaires veulent remplir leur rôle fondamental de développement et d'extension de la conscience de classe, la culture d'une discussion collective, internationale, fraternelle et publique est absolument essentielle. Il est vrai que ceci requiert un haut niveau de maturité politique (mais aussi, de façon plus générale, de maturité humaine). L'histoire du CCI est une illustration du fait que cette maturité ne s'acquiert pas en un jour mais qu'elle est le produit d'un développement historique. Aujourd'hui, la nouvelle génération a un rôle essentiel à jouer dans ce processus qui mûrit.
La culture du débat dans l'histoire
La capacité de débattre est une caractéristique essentielle du mouvement ouvrier. Mais ce n'est pas lui qui l'a inventée. Dans ce domaine, comme dans d'autres aussi fondamentaux, la lutte pour le socialisme a été capable d'assimiler les meilleurs acquis de l'humanité, de les adapter à ses besoins propres. Ce faisant, elle a transformé ces qualités en les élevant à un niveau supérieur.
Fondamentalement, la culture du débat est une expression de la nature éminemment sociale de l'humanité. C'est en particulier une émanation de l'utilisation spécifiquement humaine du langage. L'utilisation du langage comme moyen d'échanger des informations est quelque chose que l'humanité partage avec beaucoup d'animaux. Ce qui distingue l'humanité du reste de la nature sur ce plan, c'est sa capacité à cultiver et à échanger une argumentation (en lien avec le développement de la logique et de la science) et à parvenir à connaître les autres (le développement de l'empathie liée, entre autres, au développement de l'art).
Par conséquent cette qualité n'est pas nouvelle. En fait elle a précédé les sociétés de classe et a certainement joué un rôle décisif dans le développement de l'espèce humaine. Engels, par exemple, parle du rôle des assemblées générales chez les Grecs à l'époque d'Homère, chez les premières tribus germaniques ou chez les Iroquois d'Amérique du Nord et fait en particulier l'éloge de la culture du débat de ces derniers[9]. Malheureusement, malgré les travaux de Morgan à cette époque et de ses confrères du 19e siècle ainsi que de ceux qui leur ont succédé, nous sommes encore insuffisamment informés sur les tout premiers développements, certainement les plus décisifs, dans ce domaine.
Mais ce que nous savons, en revanche, c'est que la philosophie et les débuts de la pensée scientifique ont commencé à prospérer là où la mythologie et le réalisme naïf -ce couple antique à la fois contradictoire et inséparable- étaient mis en question. Ces deux modes d'appréhension sont prisonniers de l'incapacité de comprendre plus profondément l'expérience immédiate. Les pensées que les premiers hommes ont formées sur leur expérience pratique étaient religieuses par nature. "Depuis les temps très reculés, où les hommes, encore dans l'ignorance de leur propre configuration physique et incités par des apparitions en rêve, en arrivèrent à l'idée que leurs pensées et leurs sensations n'étaient pas une activité de leur propre corps, mais d'une âme particulière, habitant dans ce corps et le quittant au moment de la mort -depuis ce moment, il leur fallut se forger des idées sur les rapports de cette âme avec le monde extérieur. Si au moment de la mort, elle se séparait du corps, il n'y avait aucune raison de lui attribuer encore une mort particulière ; et c'est ainsi que naquit l'idée de son immortalité qui, à cette étape du développement, n'apparaît pas du tout comme une consolation mais, au contraire, comme une fatalité contre laquelle on ne peut rien, et souvent même, chez les Grecs en particulier, comme un véritable malheur."[10]
C'est dans ce cadre d'un réalisme naïf qu'ont eu lieu les premiers pas d'un très lent développement de la culture et des forces productives. Pour sa part, la pensée magique, tout en contenant un certain degré de sagesse psychologique, avait avant tout pour tâche de donner un sens à l'inexplicable et donc de canaliser la peur. Les deux constituèrent d'importantes contributions à l'avancée du genre humain. L'idée selon laquelle le réalisme naïf aurait une affinité particulière avec la philosophie matérialiste, ou que cette dernière se serait développée directement à partir du premier, est sans fondement.
"Il y a une vieille thèse de la dialectique passée dans la conscience populaire qui dit : les extrêmes se touchent. Il y aura donc peu de chances que nous nous trompions si nous cherchons le comble de l'esprit chimérique, de la crédulité et de la superstition, non pas dans ce courant des sciences naturelles qui, comme la philosophie de la nature en Allemagne, a cherché à contraindre le monde objectif à entrer dans le cadre de sa pensée subjective, mais bien plutôt dans la direction opposée, dans cette direction qui, se targuant d'utiliser uniquement l'expérience, traite la pensée avec un souverain mépris et, en fait, est allée le plus loin dans la pauvreté de la pensée. Cette école est prédominante en Angleterre."[11]
La religion, comme l'a indiqué Engels, est née non seulement d'une vision magique du monde mais aussi à partir du réalisme naïf. Ses premières généralisations, souvent audacieuses, sur le monde ont nécessairement un caractère qui fait autorité.
Les premières communautés agraires ont vite compris qu'elles dépendaient de la pluie par exemple, mais elles étaient loin de comprendre les conditions dont dépendaient les chutes de pluie. L'invention d'un Dieu de la pluie est un acte créateur pour se rassurer, donnant l'impression qu'il est possible, au moyen de cadeaux ou par la dévotion, d'influencer le cours de la nature. Homo sapiens est l'espèce qui a misé sur le développement de la conscience pour assurer sa survie. En tant que tel, il est confronté à un problème sans précédent : la peur souvent paralysante de l'inconnu. Les explications de l'inconnu se doivent donc de ne permettre aucun doute. De ce besoin, et en tant que son expression la plus développée, résulte l'émergence des religions révélées. Toute la base émotionnelle de cette vision du monde est la croyance, et non pas la connaissance.
Le réalisme naïf n'est que l'autre face de la même médaille, une sorte de "division du travail" mental élémentaire. Tout ce qu'on ne peut pas expliquer dans un sens pratique immédiat, entre nécessairement dans la sphère du magique. De plus, la compréhension pratique est elle-même fondée sur une vision religieuse, à l'origine la vision animiste. Dans cette vision, le monde entier est fétichisé. Même les processus que les êtres humains peuvent, consciemment, produire et reproduire, semblent avoir lieu grâce à l'assistance de forces personnalisées existant indépendamment de notre volonté.
Il est clair que, dans un tel monde, il y a une possibilité limitée pour le débat dans le sens moderne du terme. Il y a environ 2500 ans, une nouvelle qualité a commencé à s'affirmer plus fortement mettant immédiatement et directement en question les jumeaux qu'étaient la religion et "le bon sens commun". Elle s'est développée à partir de l'ancien mode de pensée traditionnel dans le sens où ce dernier s'est transformé en son contraire. Ainsi, le premier mode de pensée dialectique qui a précédé la société de classe - exprimé en Chine par exemple dans l'idée de la polarité entre le yin et le yang, le principe masculin et le principe féminin - s'est transformé en pensée critique, basée sur les composants essentiels de la science, de la philosophie et du matérialisme. Mais tout ceci était inconcevable sans l'apparition de ce que nous avons appelé la culture du débat. Le mot grec pour dialectique signifie, en fait, dialogue ou débat.
Qu'est-ce qui a permis cette nouvelle démarche ? De façon très générale, c'est l'extension du monde des relations sociales et de la connaissance. A un niveau très global, c'était la nature de plus en plus complexe du monde social. Comme Engels aimait le répéter, le bon sens est un garçon fort et vigoureux tant qu'il reste chez lui entre ses quatre murs, mais il connaît toutes sortes de déboires dès qu'il s'aventure dans le monde. Mais la religion a aussi révélé ses limites dans sa capacité à apaiser la peur. En fait, elle n'avait pas éliminé la peur, elle n'avait fait que la rejeter à l'extérieur. A travers ce mécanisme, l'humanité a tenté de confronter une terreur qui, sinon, l'aurait écrasée à une époque où elle n'avait pas d'autres moyens d'autodéfense. Mais ce faisant, elle a fait de sa propre peur une force supplémentaire qui la dominait.
"Expliquer"ce qui est encore inexplicable signifie renoncer à une investigation véritable. C'est donc là que surgit le conflit entre la religion et la science ou, comme le dit Spinoza, entre la soumission et l'investigation. Les philosophes grecs se sont opposés au départ à la religion. Thalès, le premier philosophe que nous connaissions, avait déjà rompu avec la vision mystique du monde. Anaximandre, qui lui a succédé, demandait qu'on explique la nature à partir d'elle-même.
Mais la pensée grecque était également une déclaration de guerre contre le réalisme naïf. Héraclite a expliqué que l'essence des choses n'est pas écrite sur leurs fronts. "La nature aime se cacher", disait-il, ou, comme le dit Marx, "toute science serait superflue si l'apparence répondait directement à la nature des choses."[12]
La nouvelle démarche mettait en cause à la fois la croyance mais aussi les préjugés et la tradition qui sont le credo de la vie quotidienne (en allemand, les deux mots ont un lien : Glaube=croyance et Aberglaube=superstition). Leur étaient opposées la théorie et la dialectique. "Quel que soit le dédain qu'on nourrisse pour toute pensée théorique, on ne peut tout de même pas mettre en liaison deux faits de la nature ou comprendre le rapport existant entre eux sans pensée théorique"[13]
Le développement des rapports sociaux était bien sûr le produit du développement des forces productives. Apparurent donc, en même temps que le problème -l'inadéquation des modes de pensée existants- les moyens de le résoudre. Avant tout, un développement de la confiance en soi, dans la puissance de l'esprit humain en particulier. La science ne peut se développer que lorsqu'il y a une capacité et une volonté d'accepter l'existence du doute et de l'incertitude. Contrairement à l'autorité de la religion et de la tradition, la vérité de la science n'est pas absolue mais relative. Surgissent donc non seulement la possibilité mais également la nécessité d'échanger des opinions
Il est clair que revendiquer le gouvernement de la connaissance ne pouvait se poser que si les forces productives (au sens culturel le plus large) avaient atteint un certain degré de développement. Il ne pouvait même pas être imaginé sans un développement concomitant des arts, de l'éducation, de la littérature, de l'observation de la nature, du langage. Et cela va de pair avec l'apparition, à un certain stade de l'histoire, d'une société de classe dont la couche dirigeante est libérée du fardeau de la production matérielle. Mais ces développements n'ont pas automatiquement fait naître une démarche nouvelle et indépendante. Ni les Égyptiens, ni les Babyloniens, malgré les progrès scientifiques qu'ils ont apportés, ni les Phéniciens qui, les premiers, développèrent un alphabet moderne, ne sont allés aussi loin que les Grecs dans cette voie.
En Grèce, c'est le développement de l'esclavage qui a permis l'émergence d'une classe de citoyens libres à côté des prêtres. Cela a fourni la base matérielle qui a miné la religion. (Nous pouvons ainsi mieux comprendre la formulation d'Engels dans l'Anti-Dühring : sans l'esclavage de l'antiquité, pas de socialisme moderne). En Inde, vers la même époque, un développement de la philosophie, du matérialisme (appelé Lokayata) et de l'étude de la nature coïncide avec la formation et le développement d'une aristocratie guerrière qui s'opposait à la théocratie brahmine et était en partie basée sur l'esclavage agricole. Comme en Grèce où la lutte d'Héraclite contre la religion, l'immortalité et la condamnation des plaisirs charnels étaient dirigées à la fois contre les préjugés des tyrans et contre ceux des classes opprimées, la nouvelle démarche combattante en Inde était portée par une aristocratie. Le Bouddhisme et le Jaïnisme, qui sont apparus à la même époque, étaient beaucoup plus répandus dans la population laborieuse mais se maintenaient dans un cadre religieux -avec leur conception de la réincarnation de l'âme, typique de la société de castes à laquelle ils voulaient s'opposer (qu'on rencontre également en Égypte).
En Chine en revanche, où il y avait un développement de la science et une sorte de matérialisme rudimentaire (par exemple dans la Logique de Mo-ti), ce développement fut limité par l'absence d'une caste dirigeante de prêtres contre laquelle aurait pu se développer une révolte. Le pays était dirigé par une bureaucratie militaire formée à travers la lutte contre les barbares qui l'entouraient[14].
En Grèce existait un facteur supplémentaire et, à bien des égards, décisif qui a également joué un rôle important en Inde : un développement plus avancé de la production de marchandises. La philosophie grecque n'a pas commencé en Grèce même, mais dans les colonies portuaires d'Asie mineure. La production de marchandises implique l'échange non seulement de biens mais aussi de l'expérience contenue dans leur production. Elle accélère l'histoire, favorisant ainsi une expression supérieure de la pensée dialectique. Elle permet un degré d'individualisation sans lequel l'échange d'idées à un niveau aussi élevé n'est pas possible. Et elle commence à mettre fin à l'isolement dans lequel a eu lieu jusqu'alors l'évolution sociale. L'unité économique fondamentale de toutes les sociétés agricoles basées sur l'économie naturelle est le village ou, au mieux, la région autarcique. Mais les premières sociétés d'exploitation fondées sur une coopération plus large, souvent pour développer l'irrigation, étaient toujours des sociétés fondamentalement agricoles. En revanche, le commerce et la navigation ont ouvert la société grecque sur le monde. Elle a reproduit, mais à un niveau supérieur, l'attitude de conquête et de découverte du monde qui caractérise les sociétés nomades. L'histoire montre que, à un certain stade de son développement, l'apparition du phénomène de débat public était inséparable d'un développement international (même s'il était concentré dans une région) et, en un sens, avait un caractère "inter-nationaliste". Diogène et les Cyniques étaient contre la distinction entre Hellènes et Barbares et se sont déclarés citoyens du monde. Démocrite est passé en jugement avec l'accusation d'avoir dilapidé un héritage qu'il avait utilisé pour des voyages éducatifs en Égypte, à Babylone, en Perse et en Inde. Il s'est défendu en lisant des extraits de ses écrits, fruits de ses voyages -et il fut déclaré non coupable.
Le débat est né pour répondre à une nécessité matérielle. En Grèce, il se développe à partir de la comparaison entre différentes sources de connaissance. On compare différents modes de pensée, différents modes d'investigation et leurs résultats, les méthodes de production, les coutumes et les traditions. On découvre qu'ils se contredisent, se confirment ou se complètent l'un l'autre. Ils se combattent ou se complètent, ou les deux. A travers la comparaison, les vérités absolues sont rendues relatives.
Ces débats sont publics. Ils ont lieu dans les ports, sur les places de marché (les forums), dans les écoles et les académies. Sous forme écrite, ils remplissent les bibliothèques et s'étendent à tout le monde connu.
Socrate -ce philosophe qui a passé son temps à débattre sur les places de marché- a incarné l'essence de cette évolution. Sa préoccupation principale -comment atteindre une véritable connaissance de la morale- constitue déjà une attaque contre la religion et contre les préjugés qui supposent qu'on a déjà la réponse à ces questions. Socrate a déclaré que la connaissance était la condition principale pour une éthique correcte et l'ignorance son principal ennemi. C'est donc le développement de la conscience et non la punition qui permet le progrès moral puisque, pour la plupart, les humains ne peuvent pas aller pendant longtemps de façon délibérée à l'encontre de la voix de leur propre conscience.
Mais Socrate est allé plus loin en jetant les bases théoriques de toute science et de toute clarification collective : la reconnaissance que le point de départ de la connaissance, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire la nécessité de laisser les préjugés de côté. Cela ouvre le chemin de l'essentiel : la recherche. Il s'opposait vigoureusement aux conclusions précipitées, aux opinions non critiques et satisfaites d'elles-mêmes; à l'arrogance et à la vantardise. Il croyait à "la modestie de la non connaissance" et à la passion qui découle de la connaissance véritable, fondée sur une vision et une conviction profondes. C'est le point de départ du Dialogue socratique. La vérité est le résultat d'une recherche collective qui consiste dans le dialogue entre tous les élèves et où chacun est à la fois élève et maître. Le philosophe n'est plus un prophète qui annonce des révélations, mais quelqu'un qui recherche, avec d'autres, la vérité. Ceci apporte une nouvelle conception des dirigeants : le dirigeant est celui qui est le plus déterminé à faire avancer la clarification sans jamais perdre de vue le but final. Le parallèle avec la façon dont le rôle des communistes dans la lutte de classe est défini dans Le Manifeste communiste, est frappant.
Socrate était maître pour stimuler et diriger les discussions. Il a fait évoluer le débat public jusqu'à la hauteur d'un art ou d'une science. Son élève, Platon, a développé le dialogue à un point qui a rarement été atteint depuis.
Dans l'Introduction à La Dialectique de la Nature, Engels parle de trois grandes périodes dans l'histoire de l'étude de la nature jusqu'à présent : "le génie de l'intuition" des anciens Grecs, les résultats "hautement significatifs mais sporadiques" des Arabes en tant que précurseurs de la troisième période,"la science moderne", dont les premiers pas sont accomplis à La Renaissance. Ce qui est frappant dans "l'époque culturelle arabo-musulmane", c'est sa remarquable capacité à absorber et à faire une synthèse des acquis de différentes cultures antiques et son ouverture à la discussion. August Bebel cite un témoin oculaire de la culture du débat public à Bagdad : "Imaginez simplement qu'à la première réunion, il n'y avait pas seulement des représentants de toutes les sectes musulmanes existantes, orthodoxes et hétérodoxes, mais aussi des adorateurs du feu (Parsi) ; des matérialistes, des athées ; des Juifs et des chrétiens, en un mot toutes les sortes d'infidèles. Chaque secte avait son porte-parole qui devait la représenter. Quand l'un de ces dirigeants de parti entrait dans le hall, tout le monde se levait respectueusement de son siège et personne ne se serait rassis avant qu'il n'ait rejoint sa place. Quand le hall fut presque plein, l'un des infidèles dit : 'Tout le monde connaît les règles. Les musulmans n'ont pas le droit de nous combattre avec des preuves tirées de leurs livres saints ou par des discours basés sur ceux de leur prophète, puisque nous ne croyons ni en vos livres ni en votre prophète. Ici on ne peut se baser que sur des arguments fondés sur la raison humaine'. Ces paroles furent accueillies par une réjouissance générale." [15] Bebel ajoute : "La différence entre la culture arabe et la culture chrétienne était la suivante : les arabes collectaient durant leurs conquêtes toutes les œuvres qui pouvaient servir leurs études et les instruire sur les peuples et les pays qu'ils avaient conquis. Les chrétiens détruisaient, en répandant leur doctrine, tous ces monuments de la culture comme des produits du diable ou des horreurs païennes." Et il conclut : "L'époque de la culture arabo-musulmane est le chaînon qui relie la culture gréco-romaine condamnée et la culture antique dans son ensemble à la culture européenne qui a fleuri depuis la Renaissance. Sans la première, cette dernière n'aurait pas pu atteindre les sommets actuels. Le christianisme était hostile à tout ce développement culturel."
L'une des raisons du fanatisme et du sectarisme aveugles du christianisme a déjà été identifiée par Heinrich Heine et confirmée plus tard par le mouvement ouvrier :plus une culture demande de sacrifice et de renonciation, plus la pensée même que ses principes puissent être mis en question est intolérable.
En ce qui concerne la Renaissance et la Réforme, qu'il qualifie de "plus grand bouleversement progressiste que l'humanité eût jamais connu", Engels souligne non seulement le rôle du développement de la pensée, mais aussi celui des émotions, de la personnalité, du potentiel humain et de la combativité. C'était une époque "qui avait besoin de géants et qui engendra des géants : géants de la pensée, de la passion et du caractère, géants d'universalité et d'érudition. (...) Les héros de ce temps n'étaient pas encore esclaves de la division du travail dont nous sentons si souvent chez leurs successeurs quelles limites elle impose, quelle étroitesse elle engendre. Mais ce qui les distingue surtout, c'est que, presque sans exception, ils sont pleinement plongés sans le mouvement de leur temps, dans la lutte pratique ; ils prennent parti, ils entrent dans le combat, qui par la parole et l'écrit, qui par l'épée, souvent des deux façons." (Engels, ibid., "Introduction")
Le débat et le mouvement ouvrier
Si l'on considère les trois époques "héroïques"de la pensée humaine qui ont abouti, selon Engels, au développement de la science moderne, on note à quel point elles étaient limitées dans le temps et l'espace. D'abord elles commencent très tard par rapport à l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Même en incluant les chapitres chinois et indien, ces phases étaient limitées sur le plan géographique. Elles n'ont pas non plus duré bien longtemps (la Renaissance en Italie et la Réforme en Allemagne quelques décennies seulement). Et les parties des classes exploiteuses (elles-mêmes extrêmement minoritaires) qui y ont vraiment participé de façon active étaient minuscules.
A ce sujet, deux choses semblent étonnantes. D'abord que ces moments de surgissement du débat public et de la science aient tout simplement eu lieu, et que leur impact ait été si important et si durable -malgré toutes les ruptures et les impasses. Deuxièmement à quel point le prolétariat- malgré la rupture de la continuité organique de son mouvement au milieu du 20e siècle, malgré l'impossibilité d'organisations de masse permanentes dans la décadence du capitalisme- a été capable de maintenir et, parfois, d'élargir considérablement le but du débat organisé. Le mouvement ouvrier a maintenu cette tradition vivante, malgré des interruptions, pendant presque deux siècles. Et à certains moments comme dans les mouvements révolutionnaires en France, en Allemagne et en Russie, ce processus a englobé des millions d'hommes. Ici la quantité se transforme en qualité.
Cette qualité n'est pas, cependant, uniquement produit du fait que le prolétariat -dans les pays industrialisés au moins- compose la majorité de la population. Nous avons déjà vu comment la science moderne et la théorie, après de glorieux débuts pendant la Renaissance, ont été gâchées et entravées dans leur développement par la division bourgeoise du travail. Au cœur de ce problème réside la séparation de la science d'avec les producteurs à un degré impossible à l'époque arabe ou à la Renaissance. "(Cette scission) s'achève enfin dans la grande industrie qui fait de la science une force productive indépendante du travail et l'enrôle au service du capital."[16]
La conclusion de ce processus, Marx la décrit dans le brouillon de sa réponse à Vera Zassoulitch : "Cette société mène une guerre contre la science, contre les peuples et contre les forces productives qu'elle a créées."
Le capitalisme est le premier système économique qui ne peut exister sans une application systématique de la science à la production. Il doit limiter l'éducation du prolétariat afin de maintenir sa domination de classe. Et il doit développer l'éducation du prolétariat pour maintenir sa position économique. Aujourd'hui la bourgeoisie est de plus en plus une classe sans culture, arriérée, tandis que la science et la culture sont entre les mains soit de prolétaires, soit de représentants rémunérés de la bourgeoisie dont la situation économique et sociale ressemble de plus en plus à celle de la classe ouvrière.
- "L'abolition des classes sociales (...) suppose donc un degré d'élévation du développement de la production où l'appropriation des moyens de production et des produits, et par suite, de la domination politique, du monopole de la culture et de la direction intellectuelle par une classe sociale particulière est devenue non seulement une superfétation, mais aussi, au point de vue économique, politique et intellectuel, un obstacle au développement. Ce point est maintenant atteint."[17]
Le prolétariat est l'héritier des traditions scientifiques de l'humanité. Plus encore que par le passé, toute future lutte révolutionnaire prolétarienne apportera nécessairement une floraison sans précédent du débat public et les débuts d'un mouvement vers la restauration de l'unité entre la science et le travail, l'accomplissement d'une compréhension globale plus à la hauteur des exigences de l'époque contemporaine.
La capacité du prolétariat à atteindre de nouveaux sommets a déjà été prouvée avec le développement du marxisme, première démarche scientifique concernant la société humaine et l'histoire. Seul le prolétariat a été capable d'assimiler les plus hauts acquis de la pensée philosophique bourgeoise : la philosophie de Hegel. Les deux formes de dialectique connues dans l'Antiquité étaient la dialectique du changement (Héraclite) et la dialectique de; l'interaction (Platon, Aristote). Seul Hegel est parvenu à combiner ces deux formes et à créer la base pour une dialectique vraiment historique.
Hegel a apporté une nouvelle dimension à tout le concept de débat en attaquant, plus profondément que cela n'avait jamais été fait auparavant, l'opposition rigide, métaphysique entre le vrai et le faux. Dans l'Introduction à La Phénoménologie de l'Esprit, il montre comment des phases différentes et opposées d'un processus de développement -telle l'histoire de la philosophie- constituent une unité organique, comme le sont la fleur et le fruit. Hegel explique que l'incapacité à comprendre cette unité vient de la tendance à se concentrer sur la contradiction et à perdre de vue le développement. En remettant la dialectique sur ses pieds, le marxisme a été capable d'absorber l'aspect le plus progressif de Hegel, la compréhension des processus qui mènent vers le futur.
Le prolétariat est la première classe à la fois exploitée et révolutionnaire. Contrairement aux précédentes classes révolutionnaires qui étaient exploiteuses, sa recherche de la vérité n'est limitée par aucun intérêt de sa préservation en tant que classe. Contrairement aux précédentes classes exploitées, qui ne survivaient qu'en se consolant avec des illusions (religieuses en particulier), son intérêt de classe, c'est la perte des illusions. Comme tel, le prolétariat est la première classe dont la tendance naturelle, dès qu'il réfléchit, s'organise et lutte sur son terrain, va vers la clarification.
Les bordiguistes ont oublié cette caractéristique unique du prolétariat quand ils ont inventé le concept d'invariance. Leur point de départ est correct : la nécessité de rester loyal aux principes de base du marxisme face à l'idéologie bourgeoise. Mais la conclusion selon laquelle il est nécessaire de limiter ou même d'abolir le débat afin de maintenir les positions de classe, est le produit de la contre-révolution. La bourgeoisie a bien mieux compris que, pour attirer le prolétariat sur le terrain du capital, il faut avant tout supprimer et étouffer ses débats. Ayant tenté cela au début à travers la répression violente, elle a, depuis, développé des armes bien plus efficaces tels la "démocratie" parlementaire et le sabotage de la gauche du capital. L'opportunisme a aussi compris cela depuis longtemps. Comme sa caractéristique essentielle est l'incohérence, il doit se cacher, fuir le débat ouvert. La lutte contre l'opportunisme et la nécessité d'une culture du débat, non seulement ne sont pas contradictoires, mais elles sont indispensables l'une à l'autre.
Une telle culture n'exclut pas du tout la confrontation passionnée de positions politiques divergentes, au contraire. Mais cela ne signifie pas que le débat politique doit être conçu comme un duel nécessairement traumatisant, avec des vainqueurs et des vaincus, menant à des ruptures et des scissions. L'exemple le plus édifiant de l'"art" ou de la "science" du débat dans l'histoire est celui du Parti bolchevique entre février et octobre 1917. Même dans un contexte d'intrusion massive d'une idéologie étrangère, ces discussions étaient passionnées mais extrêmement fraternelles et source d'inspiration pour tous les participants. Par dessus tout, elles ont rendu possible ce que Trotsky a appelé "le réarmement" politique du parti, le réajustement de sa politique aux besoins changeants du processus révolutionnaire, qui est une des conditions de la victoire.
Le "Dialogue bolchevique" nécessite de comprendre que tous les débats n'ont pas la même signification. La polémique de Marx contre Proudhon était une"démolition" car elle se donnait pour tâche de jeter aux poubelles de l'histoire et de se débarrasser d'une vision qui était devenue une entrave pour le développement de la conscience de l'ensemble du mouvement ouvrier. En revanche, le jeune Marx, tout en engageant une lutte titanesque contre Hegel et contre le socialisme utopique, ne perdit jamais son immense respect pour Hegel, Fourier, Saint Simon ou Owen qu'il a permis d'intégrer pour toujours dans notre héritage commun. Engels devait écrire plus tard que, sans Hegel, il n'y aurait pas eu le marxisme et, sans les utopistes, pas de socialisme scientifique tel que nous le connaissons.
Les plus graves crises du mouvement ouvrier, y compris celles du CCI, pour leur plus grande part, n'ont pas été suscitées par l'existence de divergences en tant que telles, même si elles pouvaient être fondamentales, mais par le sabotage ouvert du débat et du processus de clarification. L'opportunisme utilise tous les moyens pour parvenir à cette fin. Non seulement il peut minimiser des divergences importantes, mais également exagérer des divergences secondaires ou inventer des divergences là où il n'y en a pas. Il utilise également les attaques personnelles et même le dénigrement et la calomnie.
Le poids mort que font peser sur le mouvement ouvrier le "bon sens commun" de tous les jours d'un côté et le respect a-critique, quasi religieux de certaines coutumes et traditions de l'autre, est lié à ce que Lénine a appelé l'esprit de cercle. Il avait profondément raison dans son combat contre la soumission du processus de construction de l'organisation et de sa vie politique à la "spontanéité" du bon sens commun et à ses conséquences : "Mais pourquoi -demandera le lecteur- le mouvement spontané, qui va dans le sens du moindre effort, mène-t-il précisément à la domination de l'idéologie bourgeoise ? Pour cette simple raison que, chronologiquement, l'idéologie bourgeoise est bien plus ancienne que l'idéologie socialiste, qu'elle est plus achevée sous toutes ses formes et possède infiniment plus de moyens de diffusion "[18]
Ce qui est caractéristique de la mentalité de cercle, c'est la personnalisation du débat, l'attitude consistant à substituer l'argumentation politique à la polarisation non pas sur "ce qui est dit" mais sur "qui le dit". Il va sans dire que cette personnalisation constitue une énorme entrave à la discussion collective fructueuse.
Déjà le "Dialogue socratique" avait compris que le développement du débat n'est pas seulement une question de pensée ; c'est une question éthique. Aujourd'hui, la recherche de la clarification sert les intérêts du prolétariat et son sabotage lui fait du tort. En ce sens, la classe ouvrière pourrait adopter le slogan de l'Allemand de l'époque des Lumières, Lessing, qui affirmait que s'il est une chose qu'il aimait plus que la vérité, c'était la recherche de la vérité.
La lutte contre le sectarisme et l'impatience
Les exemples les plus éclatants de culture du débat en tant qu'élément essentiel des mouvements prolétariens de masse sont fournis par la révolution russe[19]. Le parti de classe, loin de s'y opposer, était lui-même à l'avant-garde de cette dynamique. Les discussions au sein du parti en Russie en 1917 concernaient des questions comme la nature de classe de la révolution, s'il fallait ou non soutenir la poursuite de la guerre impérialiste, et quand et comment prendre le pouvoir. Cependant, tout au long de cette période, l'unité du parti fut maintenue malgré des crises politiques au cours desquelles le destin de la révolution mondiale et, avec lui, celui de l'humanité, étaient enjeu.
Cependant, l'histoire de la lutte de classe prolétarienne, du mouvement ouvrier organisé en particulier, nous enseigne que de tels niveaux de culture du débat ne sont pas toujours atteints. Nous avons déjà mentionné l'intrusion répétée de démarches monolithiques dans le CCI. Il n'est pas surprenant que cela ait souvent donné lieu à des scissions de l'organisation. Dans le cadre d'une démarche monolithique, les divergences ne peuvent être résolues à travers le débat et conduisent nécessairement à la rupture et à la séparation. Cependant, le problème n'est pas résolu par la scission des militants qui ont été porteurs de cette démarche de façon caricaturale. La possibilité que de telles démarches non prolétariennes surgissent et ressurgissent indique l'existence de faiblesses plus répandues sur cette question au sein de l'organisation elle-même. Elles consistent souvent en de petites confusions et des idées fausses à peine perceptibles dans la vie et la discussion quotidiennes mais qui peuvent ouvrir le chemin à des difficultés plus graves dans certaines circonstances. L'une d'entre elles consiste en une tendance à poser tout débat en termes de confrontation entre marxisme et opportunisme, de lutte polémique contre l'idéologie bourgeoise. L'une des conséquences de cette démarche est l'inhibition du débat, donnant l'impression aux camarades qu'ils n'ont plus le droit de se tromper ni d'exprimer des confusions ou des désaccords. Une autre conséquence réside dans la "banalisation" de l'opportunisme. Si nous le voyons partout (et crions tout le temps "Au loup !" dès qu'apparaît la moindre divergence), nous ne le reconnaîtrons probablement pas quand il est vraiment là. Un autre problème, c'est l'impatience dans le débat qui a pour résultat de ne pas écouter les arguments des autres et une tendance à vouloir monopoliser la discussion, à écraser ses "adversaires", à convaincre les autres "à tout prix"[20].
Ce que toutes ces démarches ont en commun, c'est le poids de l'impatience petite-bourgeoise, le manque de confiance dans la pratique vivante de la clarification collective au sein du prolétariat. Elles expriment une difficulté à accepter que la discussion et la clarification soient un processus. Comme tous les processus fondamentaux de la vie sociale, ce processus a un rythme interne et sa propre loi de développement. Son déroulement correspond au mouvement de la confusion vers la clarté, il comprend des erreurs et des orientations fausses ainsi que leur correction. De tels processus requièrent du temps pour être vraiment profonds. Ils peuvent être accélérés mais pas court-circuités. Plus la participation est large dans ce processus, plus la participation de l'ensemble de la classe est encouragée et bienvenue, plus riche sera ce processus.
Dans sa polémique contre Bernstein[21], Rosa Luxemburg a souligné la contradiction fondamentale de la lutte de classe en tant que mouvement au sein du capitalisme mais qui tend vers un but qui se situe en dehors de ce dernier. De cette nature contradictoire naissent les deux principaux dangers qui menacent ce mouvement. Le premier est l'opportunisme, c'est-à-dire l'ouverture à l'influence fatale de la classe ennemie. Le mot d'ordre de cette déviation du chemin de la lutte de classe est : "le mouvement est tout, le but n'est rien". Le second danger principal est le sectarisme, c'est-à-dire le manque d'ouverture envers l'influence de la vie de sa propre classe, le prolétariat. Le mot d'ordre de cette déviation est : "le but est tout mais le mouvement n'est rien".
Dans le sillage de la terrible contre-révolution qui a suivi la défaite de la révolution mondiale à la fin de la première Guerre mondiale, s'est développée au sein de ce qui restait du mouvement révolutionnaire l'idée fausse et fatale suivant laquelle il était possible de combattre l'opportunisme par le sectarisme. Cette démarche quia mené à la stérilisation et à la fossilisation, ne parvenait pas à comprendre que l'opportunisme et le sectarisme sont les deux faces de la même médaille puisqu'elles séparent toutes deux le mouvement et le but. Sans la pleine participation des minorités révolutionnaires à la vie réelle et au mouvement de leur classe, le but du communisme ne peut être atteint.
[1] Même de jeunes révolutionnaires aussi mûrs et clairs théoriquement que Marx et Engels pensaient -à l'époque des convulsions sociales de 1848- que le communisme était à l'ordre du jour plus ou moins rapidement. Une supposition qu'ils ont dû rapidement revoir et abandonner.
[2] Lire les Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [79], Revue internationale n° 125.
[3] Au sein du camp prolétarien, ce point de vue est théorisé par le courant dit "bordiguiste".
[4] Les biographies et les souvenirs des révolutionnaires du passé sont pleins d'exemples de leur capacité à discuter et, en particulier, à écouter. A cet égard, Lénine était réputé mais il n'était pas le seul. Pour donner ici un seul exemple : les souvenirs de Fritz Sternberg sur ses Conversations avec Trotsky (rédigées en 1963). "Dans ses conversations avec moi, Trotsky était extraordinairement poli. Il ne m'interrompait quasiment jamais, seulement pour me demander d'expliquer ou de développer un mot ou un concept la plupart du temps".
[5] A ce sujet, lire les articles des n °110 et 114 de la Revue internationale, "Conférence extraordinaire du CCI : Le combat pour la défense des principes organisationnels [57]" et "15e Congrès du CCI : Renforcer l'organisation face aux enjeux de la période [58]".
[6] Voir "La confiance et la solidarité dans la lutte du prolétariat" et "Marxisme et éthique"dans la Revue internationale n° 111 [59], 112 [60], 127 [23] et 128 [61].
[7] Voir nos livres sur La Gauche communiste d'Italie [80] et La Gauche communiste de Hollande [81].
[8] La Gauche Communiste de France allait maintenir cette vision après la dissolution de la Fraction italienne. Voir par exemple la critique du concept de "chef génial" republié dans la Revue internationale n° 33 [82] et celle de la notion de discipline concevant les militants de l'organisation comme de simples exécutants qui n'ont pas à discuter des orientations politiques de l'organisation, dans la Revue internationale n° 34 [83].
[9] Engels, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État.
[10] Engels, Ludwig Feuerbach, début du 2e chapitre.
[11] Engels, La dialectique de la nature, chapitre : "La science de la nature dans le monde des esprits".
[12] Le Capital, Livre III, section 7, Chapitre 48 : "La formule tripartite" (début de la 3e partie).
[13] Engels, La dialectique de la nature, fin du chapitre : "La science de la nature dans le monde des esprits"
[14] Sur les développements en Asie dans les années 500 avant JC, voir les Conférences d'August Thalheimer à l'Université Sun-Yat-Sen à Moscou, 1927 :"Einführung in den dialektischen Materiailismus" (Introduction au matérialisme dialectique). Une édition américaine est parue en 1938.
[15] August Bebel : Die Mohamedanisch-Arabische Kulturepoche (1889), Chapitre VI, "Le développement scientifique, la poésie". Traduit de l'allemand par nous.
[16] Le Capital, Livre I, 4e section, chapitre 14 : "Division du travail et manufacture", 5 "Caractère capitaliste de la manufacture"
[17] Anti-Dühring, 3e partie : "Le socialisme", "Notions théoriques"
[18] Que faire ?, 2e partie "La spontanéité des masses et la conscience de la social-démocratie", partie b) "Le culte du spontané. La Rabotchaïa Mysl"
[19] Voir par exemple le livre de Trotsky : Histoire la révolution russe ou celui de John Reed : Dix jours qui ébranlèrent le monde
[20] Voir le développement à ce sujet dans le rapport sur les travaux du 17e Congrès du CCI, "17econgrès du CCI : un renforcement international du camp prolétarien [84]" dans la Revue internationale n° 130.
[21] Rosa Luxemburg, Réforme sociale ou révolution
(L'expérience russe : propriété privée et propriété collective (Internationalisme, 1946) [85] et Le communisme (VII) : les problèmes de la période de transition (Bilan n°35, septembre-octobre 1936) [86])
Heritage de la Gauche Communiste:
- Conscience de classe [87]
Le communisme (VII) : les problèmes de la période de transition (Bilan n°35, septembre-octobre 1936)
- 3144 reads
Avec cet article de Bilan n° 35, publication théorique des communistes de gauche italiens, nous poursuivons la republication de la série d'études sur la période de transition réalisées par Mitchell. L'article précédent de la série (publié dans la Revue Internationale n° 130 [88]) ouvrait la discussion sur les tâches économiques de la dictature du prolétariat, en réponse aux effort des communistes de gauche hollandais du GIK et en mettant en évidence les"principes fondamentaux de la production et de la distribution communistes" à la lueur de l'expérience en Russie. Le débat entre ces deux courants de la Gauche communiste, quia été dans une grande mesure enterré par l'histoire, avant tout du fait de la contre-révolution,nécessite d'être exhumé alors qu'une nouvelle génération cherche des réponses concernant une réelle alternative au système capitaliste.
Nous allons revenir plus profondément sur les questions posées par ce débat. L'article qui suit se concentre en particulier sur le problème de la répartition du produit social durant la transition vers une société totalement communiste, période pendant laquelle il n'est pas encore possible d'appliquer le principe universel "à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités". Comme nous le disions dans l'introduction à l'article précédent,nous ne partageons pas toutes les positions de Mitchell (et de Bilan)sur cette question, par exemple celle selon laquelle l'URSS aurait d'une certaine manière éliminé le capitalisme à travers l'abolition de la propriété formelle des moyens de production ; de même il y a certainement une discussion à avoir concernant la question de savoir si la principale mesure économique de transition défendue par Marx, le GIK et la Gauche italienne -le système des bons de travail- constitue la base la plus adaptée pour le développement des relations sociales communistes après la destruction du capitalisme d'Etat. Mais cet article porte en lui beaucoup des qualités les meilleures de la Gauche italienne :
- la démarche consistant à baser ses investigations sur un re-examen critique de la tradition marxiste, en particulier la Critique du programme de Gotha de Marx ;
- sa capacité à examiner le problème de la distribution avec une certaine profondeur, notamment en se référant à la Loi de la valeur ;
- sa capacité à éviter toutes les solutions faciles aux tâches immenses que le prolétariat confrontera une fois qu'il aura pris le contrôle sur la société. Il est particulièrement frappant, par exemple, que là où, pour le GIK, la rémunération du travail en fonction du calcul de "l'heure-travail sociale" garantit une progression presque automatique vers le communisme intégral (à ne pas confondre avec le communisme lui-même), pour Mitchell, la persistance d'un tel système est la preuve que le prolétariat ne s'est pas encore libéré de la loi de la valeur qui, en ce sens, représente une survivance du travail salarié. Il peut sembler que la différence n'est pas autre que celle existant entre un verre à moitié vide et un verre à moitié plein, mais c'est néanmoins symptomatique d'une approche très différente de la réalité de la révolution prolétarienne.
Bilan n°35 (septembre-octobre 1936)
On a beaucoup bavardé sur le "produit du travail social" et sa répartition "intégrale" et "équitable", formulations confuses dont la démagogie a pu facilement s'emparer. Mais le problème capital de la destination, du produit social, c'est-à-dire de la somme des activités du travail, se concentre en deux questions fondamentales : comment se répartit le produit total ? Et comment se répartit la fraction de ce produit qui entre immédiatement dans la consommation individuelle ?
Répartion du produit du travail destiné à la consommation
Nous savons évidemment qu'il n'existe pas une réponse unique valable pour toutes les sociétés et que les modes de répartition sont fonction des modes de production. Mais nous savons aussi qu'il existe certaines règles fondamentales que n'importe quelle organisation sociale se doit de respecter si elle veut subsister : les sociétés, comme les hommes qui les composent, sont soumises aux lois de la conservation qui suppose la reproduction, non pas simple, mais élargie. C'est là un truisme qu'il faut rappeler.
D'autre part, dès que l'économie brise son cadre naturel, domestique et se généralise en économie marchande, elle acquiert un caractère social qui, avec le système capitaliste, prend une signification immense, parle conflit qui l'oppose irréductiblement au caractère privé de l'appropriation des richesses.
Avec la production "socialisée" du capitalisme, nous nous trouvons donc en présence, non plus de produits d'individus isolés, mais de produits sociaux, c'est-à-dire, de produits qui, non seulement ne répondent pas à l'usage immédiat des producteurs, mais sont, outre cela, les produits communs de leur activités : "le fil, le tissus, les objets en métal venant de la fabrique sont dès lors le produit commun de nombreux ouvriers entre les mains desquels il leur faut successivement passer avant d'être achevés. Aucun individu ne peut en dire : c'est moi qui ai fait cela ; ceci est mon produit" (Engels : Anti-Dühring). En d'autres termes, la production sociale est la synthèse des activités individuelles et non pas leur juxtaposition ; d'où la conséquence que "dans la société, le rapport du producteur au produit, dès que ce dernier est achevé est purement extérieur, et le retour du produit à l'individu dépend des relations de celui-ci avec d'autres individus. Il ne s'en empare pas immédiatement. Aussi bien l'appropriation immédiate du produit n'est pas son but quand il produit dans la société. Entre le producteur et les produits se place la distribution, laquelle, par des lois sociales, détermine sa part du monde des produits et se place donc entre la production et la consommation" (K. Marx : Introduction de la critique... souligné par nous, N. D. L. R.).
Cela reste vrai en société socialiste ; et quand nous disons que les producteurs doivent rétablir leur domination sur la production que le capitalisme leur a enlevée, nous ne visons pas le bouleversement du cours naturel de la vie sociale, mais celui des rapports de production et de répartition.
Dans sa Critique du Programme de Gotha, Marx, en dénonçant l'utopisme réactionnaire de la conception de Lassalle sur le"produit du travail", pose la question en ces termes :"qu'est-ce que c'est que le "produit du travail" ? L'objet créé par le travail ou sa valeur ? Et dans ce dernier cas, la valeur totale du produit ou seulement la fraction de valeur que le travail est venu ajouter à la valeur des moyens de production mis en œuvre" (nous soulignons N.D.L.R.). Il indique comment dans la production sociale -où ne domine plus le producteur individuel mais le producteur social - le concept de "produit du travail" diffère essentiellement de celui qui considère le produit du travailleur indépendant : si nous prenons d'abord le mot "produit du travail" dans le sens d'objet créé par le travail, alors le produit du travail de la communauté, c'est la "totalité du produit social" ; produit social dont il faut défalquer les éléments nécessaires à la reproduction élargie, ceux du fonds de réserve, ceux absorbés par les frais improductifs et les besoins collectifs,ce qui transforme le "produit intégral du travail" en un "produit partiel" c'est-à-dire "la fraction des objets de consommation qui est répartie individuellement entre les producteurs de la collectivité."
En somme ce "produit partiel" non seulement ne comprend pas la partie matérialisée du travail ancien fourni dans les cycles productifs précédents et qui est absorbée par le remplacement des moyens de productions consommés, mais encore il ne représente pas l'entièreté du travail nouveau ajouté au capital social, puisqu'il faut opérer les déductions dont nous venons de parler ;cela revient à dire que le "produit partiel" est l'équivalent du revenu net de la société ou la fraction du revenu brut qui devrait revenir à la consommation individuelle du producteur, mais que la société bourgeoise ne lui répartit pas intégralement.
Voilà donc la réponse à la première question :"comment se répartit le produit total ?" Il en ressort simplement cette conclusion : le surtravail, c'est-à-dire la fraction du travail vivant ou nouveau exigé par l'ensemble des besoins collectifs, ne saurait être aboli par aucun système social, mais d'entrave qu'il est dans le capitalisme, au développement de l'individu, il doit être la condition du plein épanouissement de celui-ci dans la Société communiste. "Dans le monde capitaliste comme dans le système esclavagiste, le surtravail affecte simplement la forme d'un antagonisme, puisqu'il a pour complément l'oisiveté absolue d'une partie de la société" (Le Capital). Ce qui, en effet, détermine le taux du surtravail capitaliste ce sont les nécessités de la production de plus-value, mobile de la production sociale ; la domination de la valeur d'échange sur la valeur d'usage subordonne les besoins de la reproduction élargie et de la consommation à ceux de l'accumulation de capital ; le développement de la productivité du travail incite à augmenter le taux et la masse de surtravail.
Par contre le surtravail socialiste doit être amené au minimum correspondant aux besoins de l'économie prolétarienne comme aux nécessités de la lutte des classes se poursuivant nationalement et internationalement. En réalité, la fixation du taux de l'accumulation et du taux des frais administratifs et improductifs (absorbés par la bureaucratie) se trouvera placée au centre des préoccupations du prolétariat ; mais cet aspect du problème, nous l'examinerons dans un autre chapitre.
Il faut maintenant répondre à la deuxième question posée : "Comment se répartit à son tour le produit partiel" ? Donc la fraction du produit total qui tombe immédiatement dans la consommation individuelle, donc le fonds des salaires, puisque la forme capitaliste de rémunération du travail subsiste pendant la période transitoire.
Appropriation collective, nivellement et disparition des salaires
Commençons par marquer qu'il existe une conception trop facilement accréditée chez certains révolutionnaires et suivant laquelle une appropriation collective, pour être réelle, doit entraîner ipso facto la disparition des salaires et l'instauration d'une rémunération égale pour tous ; à cette proposition s'ajoute ce corollaire, que l'inégalité des salaires présuppose l'exploitation de la force de travail.
Cette conception, que nous retrouverons en examinant les arguments des internationalistes hollandais, procède d'une part -il faut le souligner une nouvelle fois- de la négation du mouvement contradictoire du matérialisme historique, et d'autre part de la confusion créée entre deux catégories différentes : force de travail et travail ; entre la valeur de la force de travail, c'est-à-dire la quantité de travail exigée pour la reproduction de cette force, et la quantité totale de travail que cette même force fournit dans un temps considéré.
Il est exact de dire qu'au contenu politique de la dictature du prolétariat doit correspondre un nouveau contenu social de la rétribution du travail qui ne peut plus être l'équivalent seulement des produits strictement nécessaires à la reproduction de la force du travail. Autrement dit, ce qui constitue le fondement de l'exploitation capitaliste : l'opposition entre la valeur d'usage et la valeur d'échange de cette marchandise particulière qui s'appelle la force de travail, disparaît par la suppression de la propriété privée des moyens de production et par conséquent disparaît aussi l'usage privé de la force du travail. Evidemment l'utilisation nouvelle de cette force et la masse de surtravail qui en résulte peuvent fort bien être détournées de leurs objectifs prolétariens (l'expérience soviétique le démontre) et ainsi peut surgir un mode d'exploitation d'une nature particulière qui, à proprement parler, n'est pas capitaliste. Mais ça c'est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons. Pour l'instant nous n'avons à nous arrêter qu'à cette proposition : le fait que dans l'économie prolétarienne le mobile fondamental n'est plus la production, sans cesse élargie de plus-value et de capital, mais la production illimitée de valeurs d'usage, ne signifie pas que les conditions sont mûres pour un nivellement des "salaires" se traduisant par une égalité dans la consommation. D'ailleurs, pas plus unetelle égalité ne se place au début de la période transitoire, qu'elle ne se réalise dans la phase communiste avec la formule inverse "à chacun selon ses besoins".En réalité l'égalité formelle ne peut exister à aucun moment, tandis que le communisme enregistre finalement l'égalité réelle dans l'inégalité naturelle.
Il reste cependant à expliquer pourquoi la différenciation des salaires subsiste dans la phase transitoire en dépit du fait que le salaire, tout en conservant son enveloppe bourgeoise, a perdu son contenu antagonique. Immédiatement se pose la question : quelles sont les normes juridiques de répartition prévalant dans cette période ?
Marx, dans sa Critique de Gotha, nous répond : "le droit ne peut jamais être à un niveau plus élevé que l'état économique et que le degré de civilisation sociale qui y correspond". Lorsqu'il constate que le mode de répartition des objets de consommation n'est que le reflet du mode de répartition des moyens de production et du mode de production lui-même, il ne s'agit pour lui que d'un schéma qui se réalise progressivement. Le capitalisme n'instaure pas d'emblée ses rapports de répartition ; il le fait par étapes, sur les ruines accumulées du système féodal. Le prolétariat ne peut non plus régler immédiatement la répartition suivant des normes socialistes, mais il le fait en vertu d'un droit qui n'est autre que celui "d'une société qui, sous tous les rapports : économique, moral, intellectuel, porte encore les stigmates de l'ancienne société des flancs de laquelle elle sort". Mais il y a en outre une différence capitale entre les conditions de développement du capitalisme et celles du socialisme. La bourgeoisie, en développant ses positions économiques au sein de la société féodale, construit en même temps les bases de la future superstructure juridique de son système de production et sa révolution politique consacre cet acquis économique et juridique. Le prolétariat ne bénéficie d'aucune évolution semblable et ne peut s'appuyer sur le moindre privilège économique ni sur le moindre embryon concret de "droit socialiste", car pour un marxiste, il ne peut être question de considérer comme un tel droit les"conquêtes sociales" du réformisme. Il lui faut donc appliquer temporairement le droit bourgeois, restreint il est vrai au mécanisme de la répartition. C'est ce qu'entend Marx lorsque, dans sa Critique de Gotha, il parle de droit égal et, à son tour, Lénine, lorsque dans son Etat et la Révolution, il constate avec son réalisme clair et puissant que : " dans la première phase du communisme, on trouve le phénomène curieux de la survivance de "l'horizon étroit du droit bourgeois", par rapport à la distribution des produits de consommation. Le droit bourgeois suppose inévitablement un Etat bourgeois, car le droit n'est rien sans l'appareil qui peut contraindre à observer les normes de ce droit. Donc, sous le régime du communisme, non seulement le droit bourgeois, mais même l'Etat bourgeois - sans bourgeoisie - va subsister pendant un certain espace de temps."
Marx, toujours dans sa Critique de Gotha a analysé comment et en vertu de quels principes le droit égal bourgeois est appliqué : "le droit du producteur est proportionnel au travail qu'il a fourni ; l'égalité consiste ici dans l'emploi du travail comme unité commune.[1]"
Et la rémunération du travail s'effectue comme suit :"le producteur reçoit donc individuellement -les défalcations une fois faites- l'équivalent exact de ce qu'il a donné à la Société. Ce qu'il lui a donné c'est son quantum individuel de travail." (Nous soulignons. N.D.L.R.) Par exemple, la journée sociale de travail représente la somme des heures de travail individuel ; le temps de travail individuel de chaque producteur est la portion qu'il a fournie de la journée sociale de travail, la part qu'il y a prise. Il reçoit de la société un bon constatant qu'il a fourni tant de travail (défalcation faite du travail effectué pour le fonds collectif) et, avec ce bon, il retire des stocks sociaux une quantité d'objets de consommation correspondant à la valeur de son travail[2]. Le même quanta de travail qu'il a fourni à la société sous une forme, il le reçoit d'elle sous une autre forme.
C'est évidemment ici le même principe que celui qui règle l'échange des marchandises pour autant qu'il est un échange de valeurs égales. Le fond et la forme diffèrent parce que, les conditions étant différentes, nul ne peut rien fournir d'autre que son travail et que, par ailleurs, rien d'autre que des objets de consommation individuelle ne peut entrer dans la propriété de l'individu. Mais en ce qui concerne le partage de ces objets entre producteurs pris individuellement, le principe directeur est le même que pour l'échange de marchandises équivalentes : une même quantité de travail sous une forme s'échange contre une même quantité de travail sous une autre forme.
L'injuste répartition des objets de consommation d'après le travail et non d'après les besoins
Lorsque Marx parle d'un principe analogue à celui qui règle l'échange des marchandises et de quantum individuel de travail, il sous-entend incontestablement le travail simple, substance de la valeur, ce qui signifie que tous les travaux individuels doivent être réduits à une commune mesure pour pouvoir être comparés, évalués et par conséquent rémunérés par application du "droit qui est proportionnel au travail fourni". Nous avons déjà marqué qu'il n'existe encore aucune méthode scientifique de réduction en travail simple et que, par conséquent, la loi de la valeur subsiste dans cette fonction, bien qu'elle n'agisse plus que dans certaines limites déterminées par les conditions politiques et économiques nouvelles. Marx se charge d'ailleurs de lever les doutes qui pourraient subsister à cet égard lorsqu'il analyse la mesure du travail : "mais un individu l'emporte physiquement et moralement sur un autre, il fournit donc dans le même temps (souligné par nous) plus de travail, ou peut travailler plus de temps ; et le travail, pour servir de mesure doit avoir sa durée ou son intensité précisées, sinon il cesserait d'être unité. Ce droit égal est un droit inégal pour un travail inégal. Il ne reconnaît aucune distinction de classe parce que tout homme n'est qu'un travailleur comme un autre ; mais il reconnaît tacitement l'inégalité des dons individuels (souligné par nous) et, par suite, des capacités productives comme des privilèges naturels. C'est donc, dans sa teneur, un droit fondé sur l'inégalité, comme tout droit. Le droit, par sa nature, ne peut consister que dans l'emploi d'une même unité ;mais les individus inégaux (et ce ne seraient pas des individus distincts, s'ils n'étaient pas inégaux) ne sont mesurables d'après une unité commune qu'autant qu'on les considère d'un même point de vue, qu'on ne les saisit que sous un aspect déterminé, par exemple, dans le cas donné, qu'on ne les considère que comme travailleurs, rien de plus et indépendamment de tout le reste.
Autre chose : un ouvrier est marié, l'autre non ; l'un a plus d'enfants que l'autre, etc., etc. A égalité de travail et par conséquent à égalité de participation au fonds social de consommation, l'un reçoit donc effectivement plus que l'autre, l'un est plus riche que l'autre, etc. Pour éviter toutes ces difficultés, le droit devrait être, non pas égal, mais inégal.
Mais ce sont là difficultés inévitables dans la première phase de la société communiste, telle qu'elle est sortie de la société capitaliste, après un long et douloureux enfantement."
De cette analyse, il ressort avec évidence : d'une part, que l'existence du droit égal bourgeois est indissolublement liée à celle de la valeur ; d'autre part, que le mode de répartition renferme encore une double inégalité : l'une, qui est l'expression de la diversité des "dons individuels", des"capacités productives", des "privilèges naturels" ; et l'autre qui, à égalité de travail, surgit des différenciations de condition sociale (famille, etc.). "Dans une phase supérieure de la société communiste, quand auront disparu l'asservissante subordination des individus à la division du travail et avec elle, l'antagonisme entre le travail intellectuel et le travail manuel (souligné par nous), quand le travail sera devenu, non seulement le moyen de vivre, mais même le premier besoin de l'existence ; quand, avec le développement en tous sens des individus, les forces productives iront s'accroissant ; et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l'étroit horizon du droit bourgeois pourra être complètement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux : "De chacun selon ses capacités,à chacun selon ses besoins !". Mais dans la phase transitoire, le droit bourgeois consacre une inégalité de fait qui est inévitable parce que le prolétariat ne peut encore réaliser la justice et l'égalité : des différences de richesse subsisteront et des différences injustes ; mais ce qui ne saurait subsister, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme... Marx indique les phases par lesquelles doit passer la société communiste obligée de ne détruire au début que l'injuste accaparement privé des moyens de production, mais incapable de détruire du même coup l'injuste répartition des objets de consommation d'après le travail et non d'après les besoins". (Lénine : L'Etat et la Révolution)
L'échange de quantités égales de travail, bien qu'il se traduise en fait par une inégalité dans la répartition, n'implique donc nullement une exploitation, pour autant que le fond et la forme de l'échange soient modifiés et que subsistent les conditions politiques qui ont déterminé ce changement, c'est-à-dire que se maintienne réellement la dictature du prolétariat. Il serait donc absurde d'invoquer la thèse marxiste pour justifier une forme quelconque d'exploitation résultant en réalité de la dégénérescence de cette dictature. Par contre,la thèse tendant à démontrer que la différenciation des salaires, que la démarcation entre travail qualifié et travail non qualifié, travail simple et travail composé, sont des signes certains de dégénérescence au sein de l'Etat prolétarien et les indices de l'existence d'une classe exploiteuse, cette thèse doit être catégoriquement rejetée, d'une part,parce qu'elle implique l'inévitabilité de cette dégénérescence et, d'autre part, parce qu'elle ne peut en rien contribuer à expliquer l'évolution de la Révolution russe.
Nous avons déjà laissé entendre que les Internationalistes hollandais dans leur essai d'analyse des problèmes de la période de transition, s'étaient beaucoup plus inspirés de leurs désirs que de la réalité historique. Leur schéma abstrait, d'où ils excluent, en gens parfaitement conséquents avec leurs principes, la loi de la valeur, le marché, la monnaie devait, tout aussi logiquement, préconiser une répartition "idéale"des produits. Pour eux puisque "la révolution prolétarienne collectivise les moyens de production et par là ouvre la voie à la vie communiste, les lois dynamiques de la consommation individuelle doivent absolument et nécessairement se conjuguer parce qu'elles sont indissolublement liées aux lois de la production, cette liaison s'opérant de 'soi-même' par le passage à la production communiste". (Page 72 de leur ouvrage déjà cité, Essai sur le développement de la société communiste)
Les camarades hollandais considèrent donc que le nouveau rapport de production, par la collectivisation, détermine automatiquement un nouveau droit sur les produits. "Ce droit s'exprimerait par des conditions égales pour la consommation individuelle qui résident uniquement dans une mesure égale de consommation. Tout comme l'heure de travail individuelle est la mesure du travail individuel, elle est en même temps la mesure de la consommation individuelle. Par là, la consommation est socialement réglée et se meut dans une voie juste. Le passage à la révolution sociale n'est pas autre chose que l'application de la mesure de l'heure-travail sociale moyenne à toute la vie économique. Elle sert de mesure pour la production et aussi de mesure du droit des producteurs sur le produit social". (Page 25.)
L'évolution réactionnaire de l'URSS : causes économiques ou résultat de l'abandon de l'internationalisme
Mais encore une fois, cette affirmation ne peut devenir positive que pour autant qu'on en transcrive la signification concrète,c'est-à-dire pour autant qu'on reconnaisse qu'il ne peut s'agir pratiquement que de la valeur, lorsqu'on parle de temps de travail et de mesure du travail. C'est ce qu'ont omis de faire les camarades hollandais et cela les a conduit à fausser leur jugement sur la révolution russe et surtout à restreindre singulièrement le champ de leurs recherches quant aux causes profondes de l'évolution réactionnaire de l'U.R.S.S. L'explication de celle-ci ils ne vont pas la chercher dans le tréfonds de la lutte nationale et internationale des classes (c'est une des caractéristiques négatives de leur étude, qu'elle fait quasi abstraction des problèmes politiques), mais dans le mécanisme économique,lorsqu'ils proposent : "quand les Russes allèrent jusqu'à rétablir la production sur la base de la valeur, ils proclamèrent par là et l'expropriation des travailleurs, des moyens de production et qu'il n'y aurait aucun rapport direct entre l'accroissement de la masse des produits et la part des ouvriers dans cette masse". (Page 19.)
Maintenir la valeur équivaudrait pour eux à poursuivre l'exploitation de la force de travail, alors que nous pensons avoir démontré, sur la base de la thèse marxiste, que la valeur peut subsister sans son contenu antagonique, c'est-à-dire sans qu'il y ait rétribution de la valeur de la force de travail.
Mais outre cela, les internationalistes hollandais faussent la signification des paroles de Marx quant à la répartition des produits. Dans l'affirmation que : l'ouvrier émarge à la répartition au prorata de la quantité de travail qu'il a donnée, ils ne découvrent qu'un aspect de la double inégalité que nous avons soulignée et c'est celui qui résulte de la situation sociale de l'ouvrier (page 81) ; mais ils ne s'arrêtent pas à l'autre aspect qui exprime le fait que les travailleurs, dans un même temps de travail fournissent des quantités différentes de travail simple (travail simple qui est la commune mesure s'exerçant par le jeu de la valeur) donnant donc lieu à une répartition inégale. Ils préfèrent s'en tenir à leur revendication de : suppression des inégalités des salaires, qui reste suspendue dans le vide parce qu'à la suppression du salariat capitaliste ne correspond pas immédiatement la disparition des différenciations dans la rétribution du travail.
Le camarade Hennaut apporte une solution semblable au problème de la répartition dans la période de transition, solution qu'il tire également d'une interprétation erronée parce qu'incomplète des critiques de Marx du programme de Gotha. Dans Bilan, page 747, il dit ceci :"l'inégalité que laisse subsister la première phase du socialisme résulte non pas de la rémunération inégale qui serait appliquée à diverses sortes de travail : le travail simple du manœuvre ou le travail composé de l'ingénieur avec, entre ces deux extrêmes, tous les échelons intermédiaires. Non, tous les genres de travail se valent, seules "sa durée" et "son intensité" devant être mesurées ; mais l'inégalité provient de ce qu'on applique à des hommes ayant des capacités et des besoins différents,des tâches et des ressources uniformes". Et Hennaut renverse la pensée de Marx lorsqu'il lui fait découvrir l'inégalité dans le fait que "la part au profit social restait égale -à prestation égale, bien entendu- pour chaque individu, alors que leurs besoins et l'effort déployé pour atteindre à une même prestation étaient différents"tandis que, comme nous l'avons indiqué, Marx voit l'inégalité dans le fait que les individus reçoivent des parts inégales,parce qu'ils fournissent des quantités inégales de travail et que c'est en cela que réside l'application du droit égal bourgeois.
Une politique d'égalisation des salaires ne peut se placer dans la phase de transition, non seulement parce qu'elle y serait inapplicable, mais parce qu'elle mènerait inévitablement à l'effondrement de la productivité du travail.
Si, pendant le "communisme de guerre" les Bolcheviks ont appliqué le système de la ration égale, indépendamment de la qualification et du rendement du travail, il ne s'agissait pas là d'une méthode économique capable d'assurer le développement systématique de l'économie, mais du régime d'un peuple assiégé qui bandait toutes ses énergies vers la guerre civile.
En partant de la considération générale que les variations et différences dans la qualification du travail (et sa rétribution) sont en raison inverse du degré de la technique de production, on comprend pourquoi en U.R.S.S., après la N.E.P., les variations très grandes des salaires des ouvriers qualifiés et non qualifiés[3] résultaient de l'importance plus grande que prenait la qualification individuelle de l'ouvrier, par rapport aux pays capitalistes hautement développés. Dans ceux-ci, après la Révolution, les catégories de salaires pourront se rapprocher bien davantage qu'en U.R.S.S., en vertu de la loi par laquelle le développement de la productivité du travail tend au nivellement des qualités de travail. Mais les marxistes ne peuvent oublier que "l'asservissante subordination des individus à la division du travail", et avec elle le "droit bourgeois", ne peuvent disparaître que sous la poussée irrésistible d'une prodigieuse technique mise au service des producteurs.
(A suivre.)
Mitchell[1] Nous avons jugé utile de reproduire par après le texte intégral de la Critique de Gotha qui se rapporte à la répartition, parce que nous considérons que chaque terme y revêt une importance capitale.
[2] Marx entend ici par "valeur du travail", la quantité de travail social fourni par le producteur car il va de soi que, puisque le travail crée la valeur, qu'il enforme la substance, il n'a pas lui-même de valeur car, comme le fait remarquer Engels, il s'agirait dans ce cas d'une valeur de la valeur et ce serait comme si on voulait donner un poids à la pesanteur ou une température quelconque à la chaleur.
[3] Nous ne visons évidemment pas ici les formes de"Stakhanovisme" qui ne sont qu'un produit monstrueux du Centrisme.
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [25]
La contribution de la CNT à l'instauration de la République espagnole (1921-1931)
- 4352 reads
Nous allons montrer dans ce quatrième article de la série sur la CNT comment le syndicalisme avait affaibli les courants révolutionnaires existants au sein de la CNT (aussi bien ceux d'orientation marxiste qui étaient partisans de l'intégration à la 3e Internationale que ceux d'orientation anarchiste). En 1923, la CNT, affaiblie par la démoralisation des ouvriers après la défaite des luttes de1919-1920 et par la brutale répression menée par les bandes de pistoleros à la solde du patronat et coordonnées par les autorités militaires et préfectorales[1], est de nouveau mise hors la loi par la dictature de Primo de Rivera qui ferme systématiquement ses locaux et emprisonne les Comités dirigeants au fur et à mesure de leur formation.
Malgré ces conditions de persécution constante de ses militants, la CNT va poursuivre une certaine activité. Mais, comme nous l'exposions à la fin du troisième article de cette série, cette activité va prendre une orientation très différente de celle de la période 1911-1915. Alors que,dans cette période, elle se consacrait au soutien des initiatives de lutte qui pouvaient surgir et à une réflexion générale sur les attaques qui frappaient la classe ouvrière et l'humanité (notamment concernant le problème de la guerre impérialiste[2]), elle va maintenant se centrer de manière presque systématique dans le soutien à toutes sortes de conspirations ourdies par des politiciens bourgeois en opposition à la Dictature et elle jouera un rôle décisif dans l'avènement de la République espagnole en 1931, une façade de "libertés" et de "droits", une "République des Travailleurs" (comme elle se présentait elle-même) qui massacrera sans pitié aucune les luttes ouvrières.
La dictature de Primo de Rivera
La dictature du Général Primo de Rivera résultait de causes multiples.
Tout d'abord, l'épuisement de l'ancien Régime de la Restauration qui avait dominé l'Etat espagnol depuis1876[3] : un système d'alternance entre deux partis (conservateur et libéral) qui représentaient la partie dominante de la bourgeoisie espagnole. Toutefois, ce système n'était pas capable d'intégrer des fractions importantes de la bourgeoisie, en particulier les régionalistes, et marginalisait la petite bourgeoisie (traditionnellement républicaine et anti-cléricale) ; de plus, face aux paysans et aux ouvriers, elle avait pour unique langage la répression féroce.
Deuxièmement, avec l'après-guerre, le capital espagnol avait vu fondre et disparaître les bénéfices faciles obtenus avec la vente, sous couvert de "neutralité", de toutes sortes de produits aux deux camps. La crise était revenue dans toute sa violence et frappait à grands coups de chômage, d'inflation et d'extrême misère.
Troisièmement, la bourgeoisie espagnole se fourvoyait dans une impasse avec la guerre coloniale du Maroc qui allait de désastre en désastre (le plus connu fut le massacre de soldats espagnols entre les mains des guérillas marocaines au cours de l'année 1921). Affaiblie par des luttes internes, par l'incapacité du personnel politique à la diriger et par une bureaucratie pharaonique (il y eut jusqu'à un général pour deux sergents et cinq soldats), l'armée espagnole avait besoin d'être renforcée.
Cependant, sans négliger l'importance de ces trois facteurs, la cause fondamentale à l'instauration de la dictature fut la nouvelle situation internationale. La Première Guerre mondiale marquait l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence qui est dominée par trois facteurs : la crise tend à devenir chronique ; la dynamique guerrière s'impose fortement à tous les Etats, petits ou grands ; la vague révolutionnaire de1917-23 montre l'existence de la menace du prolétariat contre l'ordre social bourgeois. Face à cette situation, chaque capital national a besoin de se renforcer autour de l'Etat, pilier fondamental de sa défense -en développant la tendance générale au capitalisme d'Etat. Dans un premier temps, cette tendance se concrétisa par l'instauration de régimes autoritaires qui supprimèrent les droits constitutionnels et placèrent à la tête de l'Etat des généraux ou des hommes politiques érigés en caudillos charismatiques[4]. Ce fut le cas du Duce italien Mussolini, du Général Horthy en Hongrie qui parvient au pouvoir après l'échec de la tentative de révolution prolétarienne en 1919, ou le cas du général Pildsuki en Pologne etc.
La Dictature de Primo de Ribera fut très bien accueillie par la bourgeoisie espagnole, particulièrement en Catalogne[5], et fut surtout soutenue de manière quasi inconditionnelle parle PSOE dont le syndicat, l'UGT, se transforma en syndicat du régime. Son leader, Largo Caballero, également dirigeant du PSOE, fut nommé conseiller d'Etat du dictateur.
Pour se garantir le monopole syndical, l'UGT fut très active dans la persécution de la CNT et nombre de ses cadres agirent comme des mouchards qui dénonçaient les ouvriers cénétistes ou tout simplement les ouvriers combatifs.
Face à cette situation, la principale réaction de la CNT, impulsée en particulier par ses deux dirigeants les plus représentatifs,Joan Peiró[6] et Angel Pestaña, fut de prendre contact avec toutes sortes de dirigeants de partis bourgeois d'opposition afin d'organiser des"mouvements révolutionnaires" contre la dictature.
Dans son Histoire de l'anarchosyndicalisme, Gomez Casas[7], auteur ouvertement anarchiste[8] le reconnaît sans détour : "la CNT entretint des contacts avec les forces d'opposition à la dictature. Début 1924, Peiró, secrétaire du Comité National de la CNT, qui se trouvait alors à Zaragoza, entra en relation à Paris avec le colonel Macia,représentant de l'opposition catalaniste et tête du mouvement révolutionnaire qui se formait alors" (page 177). En 1924-1926, s'effectua une série de tentatives d'incursion depuis la frontière française, des tentatives de soulèvements militaires combinées avec la CNT qui devait appeler à la grève générale,et en 1926, eut lieu la rocambolesque tentative de séquestration du monarque espagnol à Paris par des anarchistes radicaux (Durruti, Ascaso, et Jover). A chaque fois, la CNT fournissait les militants, c'est-à-dire la chair à canon. Le résultat était toujours le même : la dictature déclenchait une répression sauvage contre les éléments de la CNT en les condamnant à mort, en les envoyant au bagne ou en les torturant atrocement.
En 1928 et1930 eurent lieu d'autres tentatives avec la collaboration active de la CNT. Parmi celles-ci il y eu la célèbre journée de la Saint-Jean "sanjuanada"[9] et la bouffonnerie appelée "complot de Sanchez Guerra", politicien monarchiste libéral qui avait comploté avec le capitaine général de Valence lequel le trahit à la dernière minute. Sanchez Guerra caractérise ainsi les évènements : le plenum clandestin de juillet 1928 autorisa une entente avec les politiciens et les militaires opposés à la dictature. C'est pourquoi, cette fois-ci non plus, la CNT ne fut pas étrangère à la conspiration de Sanchez Guerra. La proclamation à Valence de ce politicien s'opposait à la dictature et à la monarchie absolue. Elle était pour la souveraineté nationale, pour la dignité et l'unité de la marine et de l'armée nationales. Il s'engageait également au maintien énergique de l'ordre public. (page 181)
Comment la CNT pouvait-elle soutenir la souveraineté nationale, l'unité de l'armée et de la marine et le maintien énergique de l'ordre public ?
Joan Peiró, principal promoteur de cette politique la justifie ainsi : "si nous pouvions parler aujourd'hui librement dans un congrès normal, nous modifierions tout ce qui peut l'être- comme l'ont été les conférences et les plenum confédéraux- mais les deux principes fondamentaux de la CNT seraient inamovibles : l'action directe et l'antiparlementarisme sans lesquels la CNT n'aurait pas de raison d'être." (série d'articles intitulés "Délimitation des Camps", publiée dans Action Sociale Ouvrière, 1929).
En quoi consistent donc "l'action directe et l'antiparlementarisme" ? Le sens que leur donnent alors les dirigeants cénétistes n'a rien à voir avec celui qu'ils eurent au début du syndicalisme révolutionnaire[10].
Dans une note, Peirats[11] désigne par action directe le fait " que les conflits doivent se résoudre par le contact direct entre les parties concernées : les questions de travail avec le patronat et celle de l'ordre public avec les autorités" (page 52, opus cité). Cette conception n'a plus rien à voir avec la vision première de la CNT pour qui elle signifiait la lutte directe des masses en dehors des voies imposées par la bourgeoisie. On parle maintenant de négociations directes entre les syndicats et le patronat lors de "conflits du travail" et entre syndicats et les autorités pour les conflits d'ordre public ! En définitive la nouvelle action directe n'est autre que la vision libérale corporatiste d'accords directs entre patronat et syndicats. Ce que nul politicien bourgeois ne désavouerait !
Par rapport à l'antiparlementarisme, au cours d'une intervention au Congrès de juin 1931 (sur lequel nous reviendrons), Peiró donne sa vision en explicitant les conversations avec le colonel Macia : "il nous a demandé quelles seraient les conditions que la confédération poserait pour appuyer ce mouvement révolutionnaire dont le but était d'instaurer une République fédérale. Réponse des représentants de la Confédération : 'Il nous importe peu ce qui pourrait se réaliser après que la révolution soit faite. Ce qui compte est la libération de tous nos prisonniers, sans exception aucune, et que les libertés collectives et individuelles soient absolument garanties'". L'idée correcte mais insuffisante du syndicalisme révolutionnaire à ses débuts, "dénoncer le parlement en tant que masque trompeur de l'Etat", est à présent remplacée par la neutralité syndicale, donnant carte blanche aux "politiques"afin qu'ils configurent un Etat qui garantirait toujours la liberté d'action syndicale.
Cette "adaptation" de concepts tant chéris par le syndicalisme révolutionnaire et par l'anarchisme, sert à s'adapter à une politique d'intégration à l'Etat bourgeois. Ce ne fut pas la conséquence d'une machination malveillante de "dirigeants réformistes" mais une nécessité à laquelle le syndicalisme ne pouvait se soustraire. Celui-ci doit s'adapter à l'Etat capitaliste et pour cela "la seule chose qui l'intéresse" ce sont les libertés juridiques et institutionnelles nécessaires pour pouvoir faire son travail de contrôle des travailleurs et de soumission de leurs revendications aux besoins du capitalisme national, comme nous allons maintenant le voir.
La contribution de la CNT à la proclamation de la République
Les répercutions de la dépression de 1929 frappèrent violemment le capital espagnol, provoquant une avalanche de licenciements, une forte augmentation du coût de la vie et étendant la famine parmi les travailleurs journaliers à la campagne. De nouvelles générations ouvrières s'incorporaient alors au monde du travail et simultanément les anciennes commençaient à récupérer des effets des défaites de 1919-20. Les grèves prirent une telle ampleur en 1930 que le dictateur se vit contraint à s'exiler en laissant le pouvoir aux mains du général Berenguer. Celui-ci entama immédiatement des pourparlers avec l'opposition et finit par légaliser la CNT le 20 avril 1930, dont l'organe, Solidaridad obrera (Solidarité ouvrière, dite "Soli") reparut légalement en juillet 1930[12]. Ces petits arrangements n'empêchèrent pas de grandir la vague de grèves. Le régime, mais aussi la monarchie elle-même, étaient totalement débordés,les vieux politiciens "libéraux-monarchistes" eux-mêmes passaient dans l'opposition, jetant aux orties la couronne royale pour la remplacer par le bonnet phrygien républicain. En avril 1931, les élections municipales donnèrent une écrasante majorité aux forces d'opposition auxquelles s'était uni le PSOE qui, depuis 1929, commençait à retourner lui aussi sa veste, illustrant que les rats quittaient le navire de la dictature agonisante. Le monarque dut abdiquer et s'exiler à Paris. La République fut proclamée, soulevant d'immenses illusions populaires[13]. Le gouvernement provisoire de la République regroupait dans une Union nationale le PSOE, les républicains et beaucoup d'ex-monarchistes alignés derrière Alcala Zamora, grand propriétaire terrien andalou proclamé Président de la République.
Cette coalition traita les luttes ouvrières par la traditionnelle répression brutale. Comme le signale Peirats, "les bourgeois de la République ne veulent pas de conflits qui pourraient épouvanter la bourgeoisie. Il ne faut pas non plus faire peur à la droite à laquelle il a été promis que tout continuerait comme avant, au prix modique d'une valse des symboles réels. Et si on ne peut supprimer par décret ni la famine ni les grèves et que celles-ci se multiplient, la loi de "Défense de la République" et celle des "Fainéants et Malfaiteurs", appuyées par la loi dite du "Tir sans sommation", mettraient au pas les agités" (op. cit., p. 52).
La bourgeoisie espagnole poursuivit sa politique traditionnelle de marginalisation et de répression de la CNT, malgré sa légalisation. L'influence éhontée du PSOE, qui voulait maintenir le monopole syndical de l'UGT comme aux plus beaux jours de la dictature, pesa beaucoup dans ce sens. En mai 1931, le ministre du Travail, Largo Caballero, promulguait la "Loi du Jury mixte", une prolongation des comités paritaires imposés sous la dictature[14], qui impliquait l'exclusion de la CNT qui se voyait obligée de passer par le joug bureaucratique étatique pour pouvoir appeler à une grève. Comme le signale Peirats, c'était "une flèche envoyée en plein cœur de la CNT et de sa tactique d'action directe" puisque, comme le disait Peiró, la raison d'être de la CNT se trouvait dans la voie libérale de négociation directe entre patrons et syndicats[15]. La CNT se trouvait ainsi placée dans une situation où elle devait soit accepter le nouveau cadre légal soit se retrouver une fois de plus marginalisée[16], comme s'en plaignait Adolfo Casas : "[les cénétistes] représentaient une source d'énergie, de générosité et de capacité créative que la société n'avait pas su comprendre. Les pouvoirs publics et les institutions bourgeoises préférèrent les réprimer que les respecter, détruire leurs syndicats et provoquer ainsi des réactions violentes et une mentalité favorable à la réaction terroriste et à la loi du talion[17] plutôt que de permettre le développement naturel de leurs entités" (op.cit., p. 164).
La bourgeoisie espagnole fût pour le moins ingrate. En 1930-31, alors que se multipliaient les grèves dans l'ensemble du pays, la principale activité de la CNT fraîchement légalisée ne fût en rien d'impulser ni de développer la force potentielle du mouvement mais, contrairement à ce qu'elle avait fait au cours de périodes antérieures, de contribuer à l'objectif politique bourgeois de remplacer le régime de la dictature par la nouvelle façade de la République. Elle se chargea pendant cette période de mobiliser la chair à canon ouvrière dans tout un travail d'agitation de rue pour soutenir le changement auquel se ralliaient en catastrophe l'immense majorité des politiciens bourgeois qui devenaient soudain les "sauveurs de la situation". Francisco Olaya[18] fournit des témoignages éloquents qui prouvent ce que fût alors l'orientation prioritaire de la CNT.
Il parle (p. 622 et 623) de meetings à Barcelone et à Valence organisés par la CNT dans lesquels interviennent comme orateurs des républicains, ce qui leur donnait une image positive dans la classe ouvrière. Il cite aussi les événements de La Corogne, où la CNT appela à la grève générale pour démanteler les dernières résistances des partisans de la monarchie[19].
En novembre 1930, une grève massive qui s'étendait à tout Barcelone en solidarité avec les travailleurs des transports victimes de la répression violente d'une manifestation (cinq morts) fut brisée par la propre CNT : "La grève se durcissant, le Comité révolutionnaire[20], qui avait prévu le soulèvement républicain pour le 18 du mois, envoya Rafael Sanchez Guerra à la capitale catalane pour demander à la CNT de ne pas gêner le mouvement républicain subversif, et les délégués syndicaux, réunis à Gava, décidèrent du retour au travail" (p. 628, note de la rédaction).Cette action créa un précédent : pour la première fois, la CNT sabotait une lutte pour faciliter un mouvement politique bourgeois d'opposition.
Lors de sélections municipales d'avril 1931 qui allaient précipiter la proclamation de la République, les leaders cénétistes favorisèrent discrètement le recours aux urnes, comme le reconnaît Olaya : "On votait pour la première fois depuis 8 ans, comme si c'était un droit conquis et le vote fut massif, même de la part des militants de la CNT, influencés par leur aversion envers la monarchie et sensibilisés par la situation critique de milliers de détenus sociaux" (p. 646). Dans un article tirant le bilan des élections, Solidaridad obrera affirmait que "le vote avait été en faveur de l'amnistie et pour la République, contre les atrocités et les injustices commises par la Monarchie". Ce fût là un autre précédent marquant qui se concrétisera à nouveau de façon beaucoup plus ouverte lors des fameuses élections de février 1936 !
Olaya reconnaît sans détours que la CNT fût mise au service de l'avènement du régime bourgeois républicain : "Par leur action pendant la période critique allant du 13 au 16 avril 1931, les militants de la CNT furent les artisans de la proclamation de la République, d'autant plus que leurs votes furent déterminants, alors même qu'ils se firent au détriment de leurs principes. Le Manifeste publié par leur Comité le 14 avril à Barcelone faisait cependant état du fait que nous ne sommes pas enthousiasmés par la République bourgeoise, mais nous n'accepterons pas une nouvelle dictature" (p. 660). Il recourt aussi bien sûr à l'éternelle justification de la gauche et des gauchistes, tant de fois pourtant décriée par les anarchistes : "Conscients qu'ils n'étaient pas en mesure de mettre en avant leurs postulats maximalistes, les comités choisissaient la politique du moindre mal" (idem).
L'argument du moindre mal est un leurre. Il consiste à affirmer ne pas renoncer à ses objectifs finaux tout en appuyant dans la pratique de prétendus "objectifs minimaux", qui ne sont en rien des revendications minimales du prolétariat mais bien le programme de la bourgeoisie. Le "moindre mal" n'est pas autre chose que la manière démagogique de faire passer le programme de la bourgeoisie dans une situation politique déterminée tout en maintenant l'illusion qu'on continue à lutter pour un "futur révolutionnaire".
Le Congrès de juin 1931
Au cours de ce congrès extraordinaire, la CNT fit un énorme effort pour effectuer une percée dans le système capitaliste. Bien sûr, de nombreuses critiques furent faites et les débats furent houleux, mais les travaux du Congrès allèrent systématiquement dans le sens de l'intégration dans les structures de la production capitaliste et dans les voies institutionnelles de l'Etat bourgeois.
Un mois auparavant, dans un éditorial du 14 mai 1931, Solidarité Ouvrière avait donné le ton. Rejetant l'odieux amalgame avec le pouvoir dans lequel les socialistes voulaient l'enfermer, et qui parlait d'une entente entre monarcho-fascistes d'un côté, et extrémistes anarcho-syndicalistes de l'autre, Solidarité Ouvrière protestait en disant qu'on ne peut pas "situer sur le même plan la manœuvre réactionnaire des monarchistes, aristocrates et religieux, et la protestation virile d'un peuple libéral et honnête qui, aujourd'hui comme hier, a oeuvré plus que tous les républicains officiels pour la chute de la monarchie et le soutien des libertés conquises" (Page 664 op. cit.) Là où l'organe le plus avancé de la CNT (Solidarité Ouvrière) se trouvait en pointe, ce n'était ni sur les objectifs majeurs, ni sur les revendications ouvrières mais sur les revendications du "peuple libéral", sur un "extrémisme" dans la défense de la République.
Pour cela, le Congrès donna son aval à la politique des Pactes avec les conspirateurs bourgeois comme Gomez Casas le reconnaît à travers un euphémisme : "le rapport du Comité national fut discuté avec une grande ferveur, étant donné que l'activité de l'organisme représentatif, surtout dans la référence à la conspiration passée, avait montré une certaine différence avec l'orthodoxie à laquelle le militantisme confédérale était habitué." (Op. cit. page 196.) Comme il est doux de parler de "certaines différences avec l'orthodoxie" alors qu'il s'agit d'un changement radical de la conduite de la CNT en 1910-1923 !
Concernant l'Assemblée constituante[21], l'exposé initial déclarait : "l'Assemblée constituante est le produit d'une action révolutionnaire, à laquelle, directement ou indirectement, nous avons participé. Nous sommes intervenus parce que nous pensons qu'au-delà de la Confédération il existe un peuple assujetti, peuple qu'il faut libérer étant donné que nos postulats, vastes, justes, humains, cheminent vers un pays où il sera impossible qu'un seul homme vive en esclavage" (Gomez Casas, op. cit. page 202). Face à cette rhétorique qu'aurait pu signer le plus modéré des démocrates bourgeois, se produisirent "de très vives discussions, parfois même acharnées" (Gomez Casas) parce qu'il fut inclus l'amendement suivant : "nous sommes en guerre ouverte contre l'Etat. Notre mission, haute et sacrée, est d'éduquer le peuple pour qu'il comprenne la nécessité de se joindre à nous en toute conscience et d'établir notre émancipation pleine et entière au moyen de la révolution sociale. En dehors de ce principe qui fait partie de notre être, nous ne craignons pas de reconnaître que nous avons le devoir indispensable d'indiquer au peuple un plan de revendications minimales qu'il doit exiger en créant sa propre force révolutionnaire." (op. cit. page203)
Si nous analysons avec sérieux cet amendement, nous voyons qu'en réalité il ne change strictement rien. La rhétorique modérée de l'exposé se radicalise dans les termes, avec l'invocation "des principes" parmi lesquels le "plan de revendication minimal", c'est-à-dire la politique quotidienne du syndicat conforme au fait que -comme dit Gomez Casas-"l'anarcho-syndicalisme, bien qu'implicitement, avait accordé une marge de confiance à la timide et naissante République" (op. cit. page203) qui mettait en pratique les objectifs du monarchiste libéral Sanchez Guerra auparavant cité : la souveraineté nationale, la dignité et l'unité de la marine et de l'armée, et surtout, le maintien énergique de l'ordre public. Ce "maintien de l'ordre public" signifia l'assassinat, entre avril et décembre 1931, de plus de 500 ouvriers et journaliers !
Ce compromis de la CNT avec la République était très grave. Cependant, il est important de comprendre que la manière dont le Congrès avait défini son "programme maximum" (sa haute et sacrée mission), démontrait que la "nouvelle société" à laquelle aspirait le syndicat était en réalité la vieille société capitaliste ! L'exposé sur les Fédérations nationales d'Industrie du syndicat définissait ainsi son rôle : "le fait violent de la révolution sociale ayant été réalisé au préalable dans la réorganisation de la machine économique-industrielle-agricole, c'est-à-dire de toutes les sources de la richesse nationale, la FNI sera l'organe adéquat qui coordonnera la production des différentes industries et équilibrera celle-ci avec les besoins de la consommation nationale et de l'échange avec l'étranger" (op. cit. page 200).
Le "fait violent de la révolution sociale" mène selon l'exposé à une société nationale, à une sorte de "socialisme dans un seul pays" -comme le stalinisme- car la question est posée en termes de nation : consommation nationale et échange avec l'étranger. De plus, "équilibrer" la production pour qu'elle satisfasse la consommation nationale plus l'exportation n'est pas une tâche "révolutionnaire" mais constitue la gestion (courante) habituelle de l'économie bourgeoise. Il n'est pas étonnant que l'un des délégués ait protesté avec véhémence contre cet exposé en le qualifiant de "marxiste"[22] : "Ce sont des raisons de type marxiste, ce sont des raisons en accord avec le développement de l'économie bourgeoise dans la période historique présente, en fonction du degré de l'évolution et du développement de cette économie" (op. cit. page 200)
Le délégué mettait les pieds dans le plat en demandant "serait-il possible que nous capitulions simplement à cause du stade d'évolution de l'économie bourgeoise?" (Op. cit. page 201) Le délégué ne pouvait pas comprendre que le syndicat avait besoin de cette capitulation face à l'économie bourgeoise car l'objectif du syndicat dans la période de décadence du capitalisme n'est autre que de faire partie des rouages de l'Etat et de l'économie nationale.
Gomez Casas dit que le rapport concernant les Fédérations de l'Industrie "doit servir de base de réflexion à ceux qui ne voient que l'aspect destructeur révolutionnaire de l'anarcho-syndicalisme." (page 200). Etre "constructif" consiste donc à s'intégrer dans les structures de l'économie bourgeoise comme le signale Gomez Casas lui-même, en tirant le bilan des travaux du Congrès à propos du rôle "présent et futur" des Fédérations d'Industrie : "L'accord des fédérations d'Industrie a démontré avant tout la nécessité pressentie par l'anarcho-syndicalisme, à ce moment là, de réaffirmer ses tendances constructives, sans abandonner pour autant ses objectifs révolutionnaires classiques." (p. 201)
Un pas en avant important dans l'intégration à l'Etat bourgeois
La période que nous venons d'analyser montre un virage fondamental dans l'histoire de la CNT. Elle a été le principal fournisseur de chair à canon dans la bataille bourgeoise pour la République ; elle a frelaté les notions d'action directe et d'antiparlementarisme ; elle a accepté le "moindre mal" de la "Liberté"républicaine ; elle a fait du programme de la bourgeoisie le "programme minimum" du prolétariat, tout en faisant de son "programme maximum" une version radicale des nécessités de l'économie nationale bourgeoise.
Ces modifications évidentes étaient cependant dures à avaler tant par les vieux militants -qui avaient connu la période où, malgré ses difficultés et ses importantes contradictions, la CNT avait été une organisation ouvrière- que par les jeunes qui affluaient vers elle poussés par une situation insupportable et par la profonde déception qu'allait rapidement provoquer la République dans les masses ouvrières.
Les résistances et l'opposition vont alors être constantes. Les convulsions au sein de la CNT vont être violentes : les "modérés", partisans de laisser de côté ceux qu'ils appelaient les"maximalistes anarchistes" et d'assumer un syndicalisme pur et dur, scissionneront momentanément pour former des syndicats d'opposition et seront réintégrés en1936, tandis que Angel Pestaña, partisan d'un "travaillisme" à l'espagnole, scissionnera définitivement pour former un éphémère Parti syndicaliste.
La situation est cependant très différente de celle de1915-19 au cours de laquelle -comme nous l'avons vu dans le deuxième article de cette série- l'orientation de la majorité des militants allait vers le développement d'une conscience révolutionnaire. Les résistances et l'opposition actuelles souffrent d'une désorientation profonde et ne sont pas à même de proposer une perspective réelle.
Il y a de nombreuses raisons à cette différence. L'approfondissement de la décadence du capitalisme et, plus concrètement, le développement de la tendance générale au capitalisme d'Etat ont définitivement fait perdre au syndicalisme toute capacité à recueillir les efforts et les initiatives ouvrières. Les syndicats n'existent plus que comme organes au service du capital, dont la fonction est d'encadrer et de stériliser les énergies de la classe ouvrière. Cette réalité s'impose comme une force aveugle et implacable aux militants d'un syndicat comme la CNT, malgré la bonne volonté et l'indubitable désir d'agir en sens contraire.
En second lieu, les années 1930 sont l'époque du triomphe de la contre-révolution, dont les fers de lance sont alors tant le stalinisme que le nazisme. La combativité et la réflexion ouvrières ne disposent plus, comme en 1915-19, de la boussole qu'avaient été les bolcheviks et les spartakistes, vers qui avaient convergé beaucoup d'anarchistes et de syndicalistes révolutionnaires. Ce qui prédomine est maintenant la destruction de la réflexion prolétarienne par l'alternative infernale entre fascisme et antifascisme, qui prépare l'enfoncement dans la guerre impérialiste. Les grèves et les luttes sont canalisées vers l'union nationale et l'antifascisme, comme on le verra en 1936 tant en Espagne qu'en France.
En troisième lieu, alors que la CNT était encore en1910-23 une organisation ouverte dans laquelle collaboraient et discutaient diverses tendances prolétariennes, elle est à présent monopolisée idéologiquement par l'anarchisme qui, dans sa variante anarcho-syndicaliste, ne fait qu'envelopper un syndicalisme pur et dur dans un flot de radicalisme grandiloquent et un activisme forcené qui ne favorisent ni la réflexion ni l'initiative prolétariennes.
Enfin, la domination de l'anarchisme et de sa vision romantique de la révolution sera favorisée par la politique de la République qui va reprendre à son compte la vieille tendance de la bourgeoisie espagnole à la répression et à la persécution de la CNT. Cette politique va donner à la CNT une auréole de victime et "d'héroïsme radical et intransigeant" qui, dans le contexte que nous venons de décrire de désorientation idéologique du prolétariat mondial, va lui permettre d'intégrer dans ses rangs les meilleurs éléments du prolétariat espagnol.
En1931-36, dans un contexte de convulsions gigantesques du capital espagnol, la CNT, malgré les persécutions dont elle est victime, sera une gigantesque organisation de masse qui réunira l'essentiel des forces vives du prolétariat espagnol. Comme nous le verrons dans le prochain article de cette série, ce pouvoir immense contribuera à la défaite du prolétariat, à son encadrement dans la guerre impérialiste que préparent les fractions de la bourgeoisie en 1936-39.
RR - C. Mir (1er septembre 2007)
[1] Voir à ce propos le troisième article [89] de la série dans la Revue internationale n° 130, au sein du paragraphe"La défaite du mouvement et la deuxième disparition de la CNT".
[2] Voir le deuxième article [66] de cette série dans la Revue internationale n° 129.
[3] Voir le premier article [44] de cette série dans la Revue internationale n° 128.
[4] L'établissement de régimes autoritaires basés sur un parti unique eut lieu essentiellement dans les pays les plus faibles ou plus soumis à des contradictions insolubles -comme ce fut le cas pour l'Allemagne nazie. En revanche, dans les pays plus puissants, ils se développèrent de façon plus graduelle, en respectant plus ou moins les formes démocratiques.
[5] Primo de Rivera était un conspirateur représentant les petits seigneurs andalous, propriétaires terriens brutaux et arrogants, qui menaient une vie oisive de luxe oriental. Mais, en même temps, il entretenait de très bonnes relation avec les négociants et hommes d'affaires catalans, dynamiques, travailleurs et progressistes, réputés être aux antipodes des petits seigneurs andalous.
[6] Juan Peiró fut un militant de la CNT dès sa fondation, bien qu'il n'ait eu de responsabilités dans l'organisation qu'à partir de 1919. Il fut ministre de l'industrie de la République. Il fut fusillé par les autorités franquistes en 1942.
[7] La référence et les dates des éditions du livresont mentionnées dans le deuxième [66] et le troisième [89] article de cette série (Revue internationale n°129 et 130).
[8] Il fut secrétaire général de la CNT dans les années 70.
[9] Conspiration militaire appuyée par la CNT qui devait avoir lieu au cours de la nuit de la saint Jean (24 juin) mais qui échoua car de nombreux militaires se rétractèrent à la dernière minute.
[10] Voir à ce sujet le premier article [5] de la série générale sur le syndicalisme révolutionnaire dans la Revue internationale n°118.
[11] Auteur du livre sur la "CNT dans la révolution espagnole", déjà cité dans le premier article [44] de la série.
[12] Dans son ouvrage déjà cité, Gomez Casas raconte que le général Berenguer envoya Mola, le directeur de la Sécurité (qui plus tard devint un des plus inflexibles militaires putschistes), discuter avec un délégué de la CNT, Pestaña. Gomez Casas observe que pendant ces discussions "Pestaña confirma le caractère fondamentalement apolitique de la CNT et son absolue indépendance à l'égard de tout parti. Néanmoins, l'organisation considérerait avec sympathie "le régime qui s'approcherait le plus de son idéal""(p. 185). Ces paroles ambiguës montrent bien déjà la volonté de s'intégrer à l'Etat capitaliste.
[13] Pour une étude plus approfondie de cette période, voir notre livre 1936 :Franco et la République massacrent les travailleurs [90] (disponible en espagnol).
[14] Aux Etats-Unis, la bourgeoisie a poursuivi une politique semblable de marginalisation et répression des IWW (voir à ce sujet la Revue internationale n °125 [11]). Cependant ces organismes syndicalistes-révolutionnaires n'ont jamais atteint le niveau d'influence que la CNT a eu sur le prolétariat espagnol.
[15] L'idéologie libérale privilégie "l'action directe" des "forces sociales" sans "interférence de l'Etat". Tout ceci n'est bien sûr que supercherie,car les organisations patronales tout comme les organisations syndicales "ouvrières" sont des forces étatiques qui travaillent -et il ne peut qu'en être ainsi- dans le cadre économique et juridique strictement délimité par l'Etat.
[16] La bourgeoisie américaine avait imposé une politique de ce type, mêlant marginalisation et répression, contre les IWW (voir Revue internationale no 125 [11]). Ces organisations syndicales n'avaient cependant jamais atteint le niveau d'influence qu'avait la CNT dans le prolétariat espagnol.
[17] Note de la rédaction : il n'y a que deux voies selon la bourgeoisie : celle de l'intégration dans le cadre démocratique de l'Etat bourgeois ou la voie "radicale"du terrorisme et, comme le dit Gomez Casas, la loi du talion. En réalité, l'alternative de la classe ouvrière est la lutte autonome internationale sur son propre terrain de classe, alternative qui s'oppose à ces deux voies propres à l'univers aliéné de la bourgeoisie.
[18] Anarchiste très engagé et bien moins nuancé que Gomez Casas. Les citations qui suivent (traduites par nos soins) sont extraites de son ouvrage Histoire du mouvement ouvrier espagnol que nous avons déjà cité dans les précédents articles.
[19] La même orientation politique fut mise en œuvre à Madrid et ailleurs contre des réunions ou des meetings des cercles monarchistes de plus en plus isolés.
[20] Organe d'opposition républicain avec lequel collaboraient parfois quelques leaders de la CNT comme Peiró, signataire du Manifeste d'Intelligence républicaine.
[21] Parlement de la République qui allait adopter la nouvelle constitution laquelle proclamait l'Espagne "République des Travailleurs".
[22] Le délégué raisonnait d'après la version du marxisme présentée par les staliniens et les sociaux-démocrates, pour qui le socialisme équivaut à l'étatisation économique et sociale.
Evènements historiques:
- Espagne 1936 [91]
Courants politiques:
- Anarchisme officiel [47]