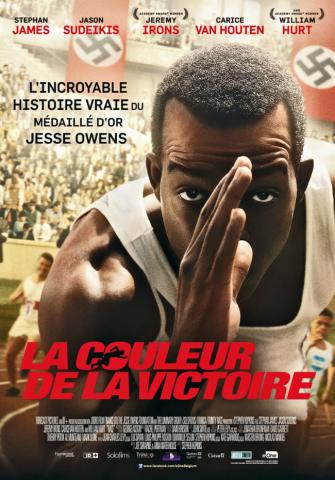Révolution Internationale 2016 - n° 456 - 461
- 1496 lectures
Révolution Internationale n°456 - janvier février 2016
- 1290 lectures
COP21: seule une révolution mondiale peut empêcher le capitalisme de détruire la planète
- 2015 lectures
“Les changements climatiques représentent une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète (…). Ils nécessitent donc la coopération la plus large possible de tous les pays ainsi que leur participation dans le cadre d’une riposte internationale efficace et appropriée, en vue d’accélérer la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre (…)” 1. L’accord “historique” trouvé “à la dernière minute” ne mâche pas ses mots : la planète est en danger, l’heure de la réaction internationale a sonné ! Et le Premier ministre anglais d’affirmer : “Cet accord sur le changement climatique est significatif. Nos petits-enfants sauront que nous avons fait notre devoir pour garantir l’avenir de notre planète”. Évidemment, la réalité est toute autre…
Un rideau de fumée toxique
Il est vrai que par le passé, les “décideurs” ont parfois pu se mettre d’accord ponctuellement. L’accord de Montréal en 1987 avait, par exemple, acté l’arrêt de l’utilisation des gaz fluorés stables et surtout peu coûteux qui avaient provoqué un trou dans la couche d’ozone. Cette décision fut efficace puisque, aujourd’hui, la couche d’ozone s’est renforcée.
La bourgeoisie a intérêt à avoir sous la main des ouvriers suffisamment en bonne santé pour être capables de travailler et de se reproduire ; comme elle a intérêt à avoir une nature sous contrôle qui peut lui livrer ses “marchandises” (matières premières, etc.) et ne surtout pas représenter un “surcoût inutile” (de par la multiplication des tempêtes et autres catastrophes 2). Accessoirement, la bourgeoisie elle aussi subit, même si souvent dans une bien moindre mesure, l’impact de la pollution, du réchauffement climatique 3… Pour toutes ces raisons, la classe dominante aurait intérêt à lutter réellement contre sa tendance à détruire l’environnement. Elle y parvient parfois ponctuellement, comme pour les gaz détruisant l’ozone. Nous pourrions également citer les grands travaux d’assainissement de la Tamise à Londres qui furent entrepris au xix siècle, alors que l’économie capitaliste était florissante et en pleine ascension, pour faire face à une épidémie de choléra devenue incontrôlable.
Seulement, de tels exemples sont rares pour une raison simple : la nature même du capitalisme est d’exploiter la force de travail comme la nature. Pour ce système, tout est objet, la vie sous toutes ses formes est méprisée, voire niée. Seul le profit compte pour lui. Cette course aux profits qui piétine tout sur son passage, sous les pieds de laquelle l’herbe ne repousse pas, est d’autant plus folle que les participants sont tous animés du même esprit de concurrence. “Exploite ou crève”, telle est l’impitoyable loi du Capital. C’est pourquoi l’histoire de ces sommets et conférences internationales sur le climat est dominée par des vœux pieux et des échecs lamentables.
Ainsi, à Berlin, en 1995, les États fixaient déjà “pour chaque pays ou région des objectifs chiffrés en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de réductions correspondantes à atteindre”. Vingt ans après (vingt “COP” plus tard !) nous en sommes aux mêmes objectifs. A Copenhague en 2009, les États-Unis et la Chine avaient obtenu que leurs objectifs de réduction soient non contraignants.
Et cette fois alors ? Quel est le résultat concret de cet “accord historique” de Paris ? Eh bien, des jours et des nuits de “concertations” ont permis d’écrire un texte… “non contraignant”. Car au fond, chaque bourgeoisie nationale sait parfaitement que l’ensemble de l’infrastructure de son pays va inexorablement continuer à augmenter la production de gaz à effet de serre. La logique du capital est implacable. Juste un exemple. Au niveau des transports, l’augmentation des émissions de carbone ne peut que croître : “selon les professionnels, le trafic aérien de passagers devrait doubler, le fret aérien tripler et le trafic maritime de conteneurs quadrupler d’ici à 2030” 4. Cela, sans polluer ? Pendant la conférence même, la circulation automobile a été arrêtée à Pékin : “Le 1 décembre était un jour d’‘airpocalypse’ à Pékin. La nuit en pleine journée. Et des données plutôt alarmantes : un indice de la qualité de l’air (AQI) de 619 et un taux de particules fines de 680 microgrammes par mètre cube, soit près de 30 fois plus que le seuil maximal recommandé par l’OMS…” (le Monde du 2/12/2015). Le réchauffement climatique à cause de l’émission de CO² est aujourd’hui mis en exergue par la bourgeoisie mais la destruction de la planète est beaucoup plus globale : déforestation, pillage des océans, disparition massive d’espèces, poisons de toutes sortes dans l’eau et dans l’air, bétonnage, etc. Ainsi, alors que nous écrivons ces lignes, une gigantesque fuite sur une exploitation gazière au large de la Californie déverse entre 30 et 58 tonnes de méthane par heure, et ce depuis le 23 octobre !
Il faut être clair : au-delà d’éventuelles mesures et avancées technologiques qui permettront peut-être de faire face à telle ou telle partie du problème, l’état général de la planète ne va cesser de se dégrader. Pire, le capitalisme en décadence va détruire l’environnement de manière de plus en plus massive, en particulier par la guerre, jusqu’à mettre en péril toute forme de vie… s’il n’est pas renversé à temps.
Du réchauffement climatique à l’enfer capitaliste
La réalité n’est pas celle proférée dans les beaux discours de tous ceux qui se sont auto-congratulés d’avoir “garanti l’avenir de la planète” pour leurs “petits-enfants”. Non ! La réalité, c’est la situation toujours plus dramatique que vivent des parties croissantes de l’humanité. La pénurie des ressources planétaires pousse déjà à l’exode des millions d’hommes, femmes et enfants. Dans toute la Corne de l’Afrique et autour de l’Himalaya, l’eau potable est de plus en plus rare. Surtout, cette “crise écologique” va aussi entraîner une compétition militaire exacerbée. Comme le pétrole aujourd’hui, l’eau devient un enjeu géostratégique majeur, source de nouvelles tensions et de nouvelles guerres impérialistes. Ce qui détruira un peu plus la planète et accentuera encore le réchauffement climatique. L’engrenage infernal et destructeur du capitalisme apparaît-là crûment.
D’ailleurs, la bourgeoisie voit même dans cette catastrophe quelques “opportunités”. La fonte des glaces aux pôles, sur la toundra (au nord de la Russie) ne va-t-elle pas faciliter l’accès à de nouvelles ressources naturelles exploitables ? L’exploitation du gaz de schiste représente un autre exemple des contradictions insolubles dans lesquelles le capitalisme s’enfonce : d’un coté le gaz de schiste tend à diminuer l’émission de gaz à effet de serre, de l’autre, il pollue les sols comme jamais et engendre des déstabilisations géopolitiques à travers le monde susceptibles de déclencher de nouveaux conflits armés. Il est vrai que les principaux dirigeants des pays industrialisés se sont mis d’accord pour ne pas se disputer les ressources du sous-sol de l’Antarctique lors de l’accord de Madrid en 1991. Mais ces mêmes dirigeants se disputent déjà les ressources de l’Arctique. La perspective n’est pas à la “coopération internationale et désintéressée” pour “sauver la planète” mais bien à la lutte de tous contre tous pour accaparer les ressources. Avec l’aggravation inexorable de la crise économique mondiale, cette lutte se fera toujours plus acharnée et ravageuse.
La responsabilité historique du prolétariat
Le capital détruit l’environnement, parce qu’il doit croître pour croître ; la seule réponse est donc de supprimer le principe même de l’accumulation capitaliste, de produire non pas pour le profit, mais pour satisfaire les besoins humains. Le capital ravage les ressources du monde parce qu’il est divisé en unités nationales concurrentes, parce qu’il est fondamentalement anarchique et produit sans penser au futur ; la seule solution consiste par conséquent dans l’abolition de l’Etat national, la mise en commun de toutes les ressources naturelles et humaines de la terre, et l’établissement de ce que Bordiga appelait “un plan de vie pour l’espèce humaine”. Bref, le problème ne peut être résolu que par une classe ouvrière consciente du besoin de révolutionner les bases mêmes de la vie sociale, détenant les instruments politiques pour assurer la transition vers la société communiste. “À chaque pas il nous est rappelé, qu’en aucune façon, nous ne régnons sur la nature comme un conquérant sur un peuple étranger, comme quelqu’un étant en dehors de la nature, mais que nous, avec notre chair, notre sang et notre cerveau, appartenons à la nature, existons en son sein, et que toute notre supériorité consiste dans le fait que nous avons l’avantage sur toutes les autres créatures d’être capables d’apprendre ses lois et de les appliquer correctement” (Engels).
Organisé à l’échelle mondiale, amenant dans son sillage toutes les masses opprimées du monde, le prolétariat international peut et doit mettre en oeuvre la création d’un univers où une abondance matérielle sans précédent ne compromettra pas l’équilibre de l’environnement naturel, où l’une sera la condition de l’autre ; un monde où l’homme, enfin libéré de la domination du travail et de la pénurie, pourra commencer à jouir de la planète sans la détruire. C’est cela sûrement le monde que Marx a entrevu, à travers l’épais brouillard d’exploitation et de pollution dans lequel la civilisation capitaliste a plongé la terre, quand il prévoyait, dans les Manuscrits de 1844, une société qui exprimerait “l’unité de l’être de l’homme avec la nature – la véritable résurrection de la nature, la naturalisation de l’homme et l’humanisation de la nature enfin accomplies”.
Révolution communiste ou destruction de l’humanité et de la planète. Socialisme ou barbarie.
LD, 9 janvier 2016
1 Texte de la Convention-cadre sur les changements climatiques (Framework Convention on Climate Change).
2 “Des membres de l’Initiative du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) pour les institutions financières – partenariat unique en son genre entre le PNUE et 295 banques et compagnies d’assurance et d’investissement – affirment que les conséquences économiques des catastrophes naturelles induites par le changement climatique pourraient ruiner les marchés boursiers et les places financières du monde”.
3 Depuis le Moyen-Age, les quartiers chics de la région parisienne sont situés à l’Ouest alors que les quartiers “populaires” sont à l’Est, pour la simple raison que les vents dominants vont de l’Ouest vers l’Est et que les odeurs suivent.
4 Revue Nature Climate Change. Pour rappel : le trafic maritime représente 90 % du trafic mondial (8,2 milliards de tonnes en 2011) !
Récent et en cours:
- Ecologie [3]
Élections régionales en France: le populisme exprime l’impasse du capitalisme
- 1508 lectures
Avec près de 28 % des voix au premier tour des élections régionales, le Front national, principale formation d’extrême-droite en France, a réalisé un score historiquement élevé, l’autorisant à se présenter comme “le premier parti de France”. Si le Parti socialiste et le parti de droite, Les Républicains, ont pu écarter les candidats d’extrême-droite des présidences de deux grandes régions 1 convoitées par le Front national, ce dernier améliorait encore son score au soir du second tour, cumulant 6 820 477 suffrages. Ce résultat confirme la montée en puissance inexorable du parti d’extrême-droite depuis 2010, élections après élections.
Ces résultats, loin d’être une “exception culturelle” française, s’inscrivent dans une montée en puissance depuis plusieurs années du populisme à travers le monde. Aux États-Unis, le succès fulgurant du candidat du Parti républicain Donald Trump et du Tea Party en sont une expression caricaturale. Le favori des sondages multiplie les déclarations aussi démagogiques que provocatrices et stupides. En Europe, l’extrême-droite a déjà participé, au gré des alliances parlementaires, au gouvernement en Italie ou en Autriche. Le populisme de “gauche” progresse également avec les succès électoraux de Syriza en Grèce et son allié d’extrême-droite, Anel, et, plus récemment, de Podemos en Espagne. Il peut paraître étonnant de qualifier de “populistes” des partis qui semblent si différents au premier abord. Pourtant, le Front national de Marine Le Pen et Podemos de Pablo Iglesias Turrión sont tous l’expression de la phase de décomposition du capitalisme qui marque de son empreinte la vie politique bourgeoise.
Le développement du populisme, une expression de la décomposition
L’incapacité actuelle des deux classes fondamentales et antagonistes, que sont la bourgeoisie et le prolétariat, à mettre en avant leur propre perspective (guerre mondiale ou révolution) a engendré une situation de “blocage momentané” et de pourrissement sur pied de la société. Si la décomposition touche l’ensemble des classes sociales, ses effets affectent en premier lieu la classe dominante et son appareil politique. Comme l’a toujours défendu le marxisme, l’État est l’organe exclusif de la bourgeoisie. Même sous ses formes les plus démocratiques, il est toujours l’expression de la dictature de la classe dominante sur le reste de la société. Avec la décadence du capitalisme, l’État a eu la mainmise sur l’ensemble de la vie sociale et cela s’est exprimé, dans les pays dotés d’un jeu électoral sophistiqué, par l’émergence du “bipartisme” (deux partis échangent régulièrement leur rôle dans l’exercice du pouvoir) où l’exécutif conserve un rôle prépondérant. Ce schéma a parfaitement fonctionné depuis la Seconde Guerre mondiale dans tous les pays démocratiques d’Europe, d’Amérique du Nord, etc.
Cependant, avec l’accélération sans répit de la crise et le poids de la décomposition, le bipartisme a souffert d’une usure considérable. Les partis de gouvernement, en particulier ceux de “gauche”, censément “protecteurs” et champions de la “répartition des richesses”, sont de plus en plus contraints d’assumer la gestion de la crise et les cures d’austérité contraires aux promesses faites plus tôt dans l’opposition.
Par ailleurs, la décomposition du système capitaliste a engendré dans les rangs des partis de gouvernement des comportements de plus en plus irresponsables du point de vue des besoins politiques de l’appareil étatique, une perte du “sens de l’État”. Des fractions toujours plus larges de la bourgeoise ne voient plus, dans l’immédiat, que leurs propres intérêts de clique et perdent de vue les intérêts généraux de la classe dominante. Cette situation se caractérise aussi par la difficulté croissante à contrôler le jeu politique des différentes composantes rivales de la bourgeoisie, notamment au moment des élections.
L’évolution du paysage politique français s’inscrit pleinement dans cette dynamique où la droite française a longtemps souffert de ses archaïsmes et se retrouve historiquement affaiblie et très divisée. Ces tares congénitales, renforcées par le développement du chacun pour soi, typique de la période de décomposition, ont ressurgi avec la défaite du président Nicolas Sarkozy en 2012 où François Fillon et Jean-François Copé se sont déchirés pour prendre le leadership de la droite. Sur les ruines de l’UMP, devenue “les Républicains”, Nicolas Sarkozy et l’ancien Premier ministre Alain Juppé ont à nouveau déterré la hache de guerre dans le cadre de la “campagne pour les primaires de la droite” en vue de désigner le prochain candidat à l’élection présidentielle. Leur affrontement déjà violent pourrait bien annihiler les chances de la droite pour revenir au pouvoir aux prochaines présidentielles de 2017, tant le pouvoir de nuisance du futur perdant semble important.
Au-delà des ambitions personnelles exacerbées et des rivalités de cliques, les clivages de la droite s’articulent aussi autour de la stratégie à adopter face au Front national. Ces dernières années, le clan Sarkozy a ouvertement “flirté” avec les positions de l’extrême-droite au moyen de discours plus musclés et de postures démagogiques, en contradiction flagrante avec les intérêts du capital national, afin d’endiguer la montée en puissance du Front national et de glaner au passage quelques voix supplémentaires 2. Mais le décalage entre les discours démagogiques du clan Sarkozy et la pratique du pouvoir n’a fait que renforcer l’extrême-droite et diviser un peu plus la droite gouvernementale. Cette situation contraint le Parti socialiste, déjà décrédibilisé en tant que parti de “gauche” par les années Mitterrand et Jospin, à s’user encore au pouvoir en le condamnant à assumer seul les attaques contre la classe ouvrière. Du point de vue de la bourgeoisie, cela pose problème pour l’encadrement idéologique, d’autant qu’aucune force politique conséquente, aucun Podemos français, n’a pu véritablement émerger à la gauche du Parti socialiste pour assurer ce rôle. Face à une droite embourbée dans ses divisions et une gauche appliquant un programme de rigueur encore plus brutal que celui de Nicolas Sarkozy, le Front national a eu tout loisir de prospérer en dénonçant le système “UMPS” 3.
La dynamique de la décomposition est également au cœur des formes idéologiques que prend le populisme. Historiquement, il est une expression d’un manque de perspective qui favorise les idéologies de la petite-bourgeoisie, classe intermédiaire sans cesse menacée par l’évolution du capitalisme. Cette classe sans principes, indépendamment des formes qu’ont pu revêtir ses expressions politiques (anarchisme, boulangisme, poujadisme, le Parti socialiste révolutionnaire en Russie…) a constamment et invariablement cherché à dissoudre les classes dans le grand fourre-tout du “peuple”. Avec la décomposition et l’absence de perspective, ces pires expressions idéologiques étriquées, prisonnières des peurs et de l’immédiat, se répandent toujours plus, poussant des millions de personnes à trouver refuge dans les bras du populisme de droite ou de gauche. L’idéologie bourgeoise décomposée pèse de tout son poids sur la société, notamment sur une partie de la classe ouvrière qui, victime de sa perte d’identité et des campagnes de propagande destinées à la déboussoler, n’arrive pas pour le moment à affirmer sa perspective révolutionnaire. Contrairement à ce que ressasse la presse bourgeoise, le Front national n’est pas “le nouveau parti des ouvriers”. L’idéologie du Front national est celle de la petite-bourgeoisie 4 qui se répand d’autant plus facilement que l’avenir semble aux yeux de beaucoup d’ouvriers totalement bouché, que le manque de confiance dans le futur, en eux-mêmes et dans les autres s’enracine.
Mais si la montée en puissance du populisme déstabilise le jeu politique de la bourgeoisie, cette dernière sait très bien retourner ce produit de la décomposition contre la classe ouvrière.
L’instrumentalisation du populisme contre la classe ouvrière
Le rôle institutionnel croissant des populistes dans la machine étatique ne représente nullement un danger pour la classe dominante dans son ensemble. Les fractions populistes véhiculent, certes, des programmes en complet décalage avec les besoins objectifs du capital national, tant au niveau de la gestion de l’économie que des conceptions impérialistes. L’extrême-droite rencontre, certes, des difficultés pour comprendre les enjeux centraux de l’encadrement idéologique de la classe ouvrière. C’est notamment pour ces raisons que la classe dominante ne souhaite pas laisser ses fractions populistes disposer du pouvoir, préférant muscler le discours des partis traditionnels de la droite ou créer de toute pièce des oppositions “de gauche” 5. Néanmoins, partout où l’extrême-droite a eu l’occasion de participer à la gestion de l’État, les éléments programmatiques les plus en contradiction avec les intérêts nationaux ont été soigneusement enterrés. En 1995, par exemple, le Mouvement social italien, parti alors ouvertement néo-fasciste de Gianfranco Fini, adopta un programme pro-européen de centre-droit afin de se maintenir dans le gouvernement de Silvio Berlusconi, tandis que la Ligue du Nord, tout en conservant son verbiage populiste, enterra rapidement son programme indépendantiste. La même logique s’imposa, en Autriche, à Jörg Haider, contraint d’assouplir ses positions et d’adopter un programme plus “responsable”, tout comme elle s’impose encore aujourd’hui à la coalition indépendantiste flamande (Vlaamsblok) en Belgique. Quant à la “gauche radicale”, Syriza et le gouvernement d’Alexis Tsipras, loués par les gauchistes de tout poil, ont déjà fait la démonstration pratique de leur appartenance à la classe dominante en ensevelissant les ouvriers en Grèce sous un déluge de mesures d’austérité et de discours ultra-nationalistes. Derrière ces partis de gauche “tout neufs” se dissimulent en fait bien souvent le visage sinistre du stalinisme et son nationalisme outrancier.
En réalité, la principale crainte de la bourgeoisie réside dans le fait qu’en donnant aux populistes des responsabilités institutionnelles, l’instrumentalisation idéologique de ces courants s’amenuise. En France, depuis les années 1980, la bourgeoisie instrumentalise en effet le vote d’extrême-droite afin de pousser les “citoyens” aux urnes au nom de la “défense de l’État démocratique” bourgeois et du “danger fasciste” 6. Ce véritable piège continue à servir le Parti socialiste et son image de “dernier rempart de la République”. Les tentatives d’intrusion institutionnelle du Front national et la “lepénisation” forcée de l’aile droite des Républicains pourrait lui faire perdre son aura de parti repoussoir, laissant ce terrain à des groupuscules radicaux et ultra-violents mais sans potentiel électoral.
Quant aux populistes de gauche, tout comme les partis gauchistes historiques (mais avec un corpus idéologique d’une rare pauvreté), leur rôle consiste avant tout à encadrer les expressions de mécontentement sur le terrain pourri du réformisme et de la défense de l’État. Ils sont les rabatteurs du “citoyennisme” et de la “vraie démocratie”. L’entrée au gouvernement de ces fractions représente donc à la fois un dernier recours et un problème d’encadrement idéologique dans la mesure où, comme l’illustre très bien Syriza, elles doivent se plier aux exigences du capitalisme d’État et ainsi perdre leur crédibilité en matière de radicalité.
Si bien des ouvriers ont conscience que l’avenir n’appartient pas aux partis traditionnels, le populisme est tout autant une impasse. La classe dominante retourne toujours les expressions de la décomposition contre le prolétariat. Il lui faut donc résister pour ne pas se laisser duper par les campagnes médiatiques et idéologiques. Il doit absolument prendre conscience qu’il représente la perspective du communisme, que lui seul est porteur d’avenir.
EG, 4 janvier 2016
1 Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
2 La “droitisation” d’une partie des Républicains n’est pas seulement tactique. Les provocations de la “droite décomplexée” et, dernièrement, les déclarations racistes de Nadine Morano expriment aussi la pénétration de visions de plus en plus irrationnelles au sein même des partis de gouvernement.
3 Contraction de UMP (ancien acronyme du parti de droite) et PS (Parti socialiste) utilisée par l’extrême-droite pour renvoyer dos-à-dos les deux grands partis de gouvernement accusés d’appliquer le même programme et de faire preuve de “laxisme” en matière migratoire.
4 La petite-bourgeoisie constitue historiquement le gros de l’électorat frontiste.
5 C’est ainsi qu’émerge au sein du Parti socialiste, les “frondeurs”, ce groupe de parlementaires prétendument plus soucieux du sort des ouvriers.
6 Pour une analyse plus approfondie sur la réalité du “danger fasciste” et son instrumentalisation, nous invitons les lecteurs à lire notre brochure, Fascisme et démocratie.
Géographique:
- France [4]
Situations territoriales:
- France [5]
Récent et en cours:
- élections [6]
Rubrique:
Les attentats et le Parti socialiste: le poison du patriotisme
- 1365 lectures
“Le marxisme ne peut se concilier avec le nationalisme, celui-ci serait-il le “plus juste”, “le plus pur” et d’une “facture plus raffinée et civilisée”” (Lénine, Remarques sur la question nationale).
Les vagues d’attentats qui ont frappé la région parisienne en 2015 ont été l’occasion pour la bourgeoisie française et mondiale d’encourager les peurs pour mieux légitimer les guerres impérialistes et présenter l’État et la nation comme les garants de la sécurité de tous, voire comme le nec plus ultra de la solidarité. Après les attentats du 13 novembre, un appel répugnant a ainsi été lancé à l’échelle internationale pour accrocher aux fenêtres le drapeau tricolore et entonner la Marseillaise, ces deux “symboles” entachés du sang des victimes de l’impérialisme français.
Le nouveau coup de clairon patriotique donné par François Hollande le soir du 31 décembre a donc une résonance toute particulière :
“Mes chers compatriotes, (...) nous venons de vivre une année terrible. (…) Mais, malgré le drame, la France n’a pas cédé. (...) Face à la haine, elle a montré la force de ses valeurs. Celles de la République. Françaises, Français, je suis fier de vous. (…) En cet instant, je salue la bravoure de nos soldats, de nos policiers, de nos gendarmes. (…) Mais je vous dois la vérité, nous n’en avons pas terminé avec le terrorisme. (...) Aussi, mon premier devoir, c’est de vous protéger. Vous protéger, c’est agir à la racine du mal : en Syrie, en Irak. C’est pourquoi, nous avons intensifié nos frappes contre Daesh. (...) Vous protéger, c’est agir ici sur notre sol. Au soir des attentats, j’ai (...) instauré l’état d’urgence. (…) J’ai d’abord décidé de renforcer les effectifs et les moyens de la police, de la justice, du renseignement et des armées. (…) Françaises, Français, les événements que nous avons vécus nous l’ont confirmé : nous sommes habités par un sentiment que nous partageons tous. Ce sentiment, c’est l’amour de la patrie. La patrie, c’est le fil invisible qui nous relie tous, (…) C’est ainsi que la France sortira plus grande avec cette belle idée de nous faire réussir tous ensemble. (...)”. Joignant le geste à la parole en ce début 2016 et ne reculant devant aucune récupération honteuse, le gouvernement socialiste a organisé à l’occasion de “l’anniversaire” des attentats contre Charlie hebdo un véritable hommage national 1.
Quelle est la portée d’une telle propagande nationaliste sur la classe ouvrière ? Apparemment, cet impact a été limité. En France, il n’y a eu, par exemple, que très peu de drapeaux réellement étendus aux fenêtres. Et les cris va-t-en-guerre de la bourgeoisie, même au nom de “l’anti-terrorisme”, n’engendrent ni enthousiasme ni réelle adhésion en faveur des bombardements au Moyen-Orient. Mais l’idéologie nationaliste et patriotique est bien plus pernicieuse, son poison bien plus subtil.
Le Président “socialiste”, comme d’ailleurs son Premier ministre Manuel Valls, dévoilent ainsi dans leurs discours le caractère éminemment belliciste et la nature fondamentalement guerrière du patriotisme. Il y a ainsi un lien direct entre la capacité du PS de faire croire, d’une part, à un patriotisme “ouvert”, “respectueux des autres nations et cultures”, à un patriotisme basé sur “la solidarité nationale et la confiance mutuelle” ou tout autre baratin de la même veine et, d’autre part, l’intensification sous ce gouvernement “socialiste” des menées guerrières et des interventions militaires de la France : en Afrique ou au Moyen-Orient. Les partis sociaux-démocrates en général ont été depuis 1914 les meilleurs et les plus efficaces propagandistes de la guerre en direction des classes exploitées. Le nationalisme ou le patriotisme “soft”, cela n’existe pas et n’exprime avant tout que la logique va-t-en guerre et militariste de la défense du capital national. L’“union nationale”, l’“union sacrée” que les politiciens prônent par-delà la division en classes sociales, le ralliement de tous derrière le drapeau et l’hymne national mène inévitablement et imparablement à la guerre et aux massacres impérialistes. Le nationalisme, le patriotisme et leurs dérivés, la xénophobie et le chauvinisme, constituent les maillons d’une même chaîne, d’un engrenage qui révèle la nature viscéralement concurrentielle, militariste, barbare et meurtrière du capitalisme et de ses divisions nationales. C’est bien le patriotisme qui est le terreau permettant de cultiver et de nourrir ensuite la haine “de l’étranger”, de “l’ennemi à abattre”, qui pousse vers l’exaltation exacerbée du “sentiment national”. Tous les rituels et les parades militaires, toutes les cérémonies de commémorations nationales de la bourgeoisie se drapent et se vautrent dans un tel patriotisme que les poilus de 1914 dénonçaient comme étant du “bourrage de crâne”. Le patriotisme constitue d’ailleurs une justification classique et particulièrement hypocrite de la guerre entre les bourgeoisies nationales, présentée comme “purement défensive” ou “en défense d’une noble cause” pour embrigader idéologiquement et enrôler physiquement au bout du compte les populations en général et les prolétaires en particulier comme chair à canon. Ce patriotisme fait toujours porter le chapeau à une autre nation, à une autre entité désignée comme “l’agresseur” ou constituant une “menace pour la démocratie, la liberté, etc.” On l’a vu lors des deux boucheries mondiales du xx siècle mais aussi lors des prétendues luttes de “libération nationale”, et on le voit encore aujourd’hui dans la prolifération des conflits, des bombardements, des attentats et des affrontements qui ensanglantent la planète. Le patriotisme ne peut agir que comme un conditionnement idéologique pour pourrir les consciences, asservir les cerveaux à la défense du capital national et comme un poison mortel pour le prolétariat.
Le capitalisme divise l’humanité en nations concurrentes. Et l’ensemble de la vie sociale subit le joug de ce morcellement mortifère. Le patriotisme et le nationalisme agissent comme des œillères, ils restreignent la vue et la pensée ; ils poussent aussi à la confrontation guerrière ; ils engendrent la peur, voire la haine de l’étranger ; surtout ils attachent les exploités à leurs exploiteurs en leur faisant croire qu’ils représentent une seule et même communauté d’intérêts ; ils annihilent la nécessaire solidarité internationale des travailleurs les mettant en concurrence les uns contre les autres. L’idéologie nationaliste sert les intérêts de la classe dominante, la bourgeoisie. Car c’est bien son monde à elle qui est fracturé en nations concurrentes, c’est bien au sein des frontières nationales que se développe la domination de la classe capitaliste sur le prolétariat. “Les prolétaires n’ont pas de patrie !” Leur force a pour source la solidarité internationale, comme l’exprime ce cri de ralliement qui s’étale sur tous les textes du mouvement ouvrier depuis 1848 : “Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !”. C’est en cela que le combat prolétarien représente un espoir pour toute l’humanité. Comme l’a magistralement exprimé Rosa Luxemburg dans son livre sur La question nationale et l’autonomie (1908-1909), le nationalisme porté par la bourgeoisie et l’internationalisme porté par le prolétariat se livrent en permanence un combat qui porte sur tous les aspects de la vie de la société humaine :
“Dans chaque nation, il y a des classes aux intérêts et aux “droits” antagonistes. Il n’y a littéralement aucun domaine social, des conditions matérielles les plus frustes aux plus subtiles des conditions morales, où les classes possédantes et le prolétariat conscient adoptent la même attitude, où ils se présentent comme un “peuple” indifférencié. Dans le domaine des rapports économiques, les classes bourgeoises défendent pied à pied les intérêts de l’exploitation, le prolétariat ceux du travail. Dans le domaine des rapports juridiques, la propriété est la pierre angulaire de la société bourgeoise ; l’intérêt du prolétariat, en revanche, exige que ceux qui n’ont rien soient émancipés de la domination de la propriété. Dans le domaine de la juridiction, la société bourgeoise représente la “justice” de classe, la justice des repus et des dominants ; le prolétariat défend l’humanité et le principe qui consiste à tenir compte des influences sociales sur l’individu. Dans les relations internationales, la bourgeoisie représente une politique de guerre et d’annexions, dans la phase actuelle du système, la politique douanière et la guerre commerciale ; le prolétariat, en revanche, représente une politique de paix générale et de libre-échange. Dans le domaine de la sociologie et de la philosophie, les écoles bourgeoises et celle qui défend le point de vue du prolétariat sont en nette contradiction. Idéalisme, métaphysique, mysticisme, éclectisme sont représentatifs des classes possédantes et de leur vision du monde ; le prolétariat moderne a sa propre école, celle du matérialisme dialectique. Même dans le domaine des relations humaines prétendument universelles, de l’éthique, des opinions sur l’art, l’éducation : les intérêts, la vision du monde et les idéaux de la bourgeoisie d’une part, ceux du prolétariat conscient de l’autre constituent deux camps séparés l’un de l’autre par un abîme profond. (...) Le fondement historique des mouvements nationaux modernes de la bourgeoisie n’est rien d’autre que l’aspiration au pouvoir de classe, ces aspirations trouvant leur expression dans une forme sociale spécifique : l’État capitaliste moderne, qui est “national” en ce qu’il permet à la bourgeoisie d’une nationalité donnée d’exercer sa domination sur toute la population mélangée de l’État. (…) Du point de vue des intérêts du prolétariat, les choses sont bien différentes. (…) La mission historique de la bourgeoisie est la création d’un État ‘national’ moderne ; mais la tâche historique du prolétariat est d’abolir cet État, en ce qu’il est une forme politique du capitalisme dans laquelle lui-même émerge en tant que classe consciente afin d’établir le système socialiste.”
Il est aujourd’hui crucial de poursuivre cette réflexion théorique et profonde sur la question du nationalisme comme du patriotisme et ainsi de s’armer dans la lutte contre cette idéologie réactionnaire et suicidaire. Car la société est en train de peu à peu se décomposer ; l’individualisme, la peur de l’autre, le repli et la haine gagnent du terrain, y compris dans les rangs de la classe ouvrière. L’idéologie nationaliste est comme un poisson dans l’eau croupie de la décomposition du capitalisme.
C’est donc dans cet esprit de combat contre l’idéologie bourgeoise en général et, ici, contre son nationalisme en particulier que nous publions dans ce numéro de très larges extraits d’un livre fondamental du mouvement ouvrier sur la question nationale, celui d’Anton Pannekoek, Lutte de classe et nation (1912). De cette œuvre souffle le vent vivifiant de la conscience et de l’internationalisme prolétariens.
Javan, 10 janvier 2016
1 Le chœur de l’armée française est même allé jusqu’à entonner la Marseillaise. Rappelons qu’à son enterrement la famille de Charb avait refusé que soit joué l’hymne national et insisté pour que l’Internationale résonne, comme il l’avait toujours souhaité.
Géographique:
- France [4]
Situations territoriales:
- France [5]
Récent et en cours:
- Attentats [7]
- Terrorisme [8]
Rubrique:
Courrier de solidarité: à la mémoire de la camarade Bernadette !
- 947 lectures
Nous publions ci-dessous la lettre de soutien de Internationalist Voice que nous avons reçu en hommage à la mémoire de notre camarade Bernadette disparue récemment. Nous tenons à souligner que nous sommes particulièrement sensibles à la solidarité qui nous est apportée, à ce témoignage qui exprime un des principes les plus nobles du combat de classe et a fortiori de celui qui doit animer les révolutionnaires. Nous partageons également la peine qui inévitablement affecte la classe ouvrière et ses combattants quand elle perd un des siens. Il s’agit bien, avec la disparition de notre camarade, d’une perte qui dépasse celle qui a été occasionnée pour le CCI. Nous ne pouvons donc que saluer et soutenir à notre tour les camarades qui poursuivent le même combat que le nôtre, celui que Bernadette avait mis au centre de sa vie, celui du communisme. Oui, nous devons le poursuivre avec la même passion et le même esprit de combat solidaire. C’est en effet, comme le soulignent les camarades, le “meilleur hommage qu’on puisse rendre à sa mémoire”.
CCI
À la mémoire de la camarade Bernadette !
C’est une grande tristesse que le cœur d’une internationaliste, celui de la camarade Bernadette, se soit arrêté et que le Courant communiste international ait perdu un de ses membres. Le silence d’un internationaliste qui a lutté contre la barbarie du capitalisme est non seulement une perte pour le CCI, mais aussi pour la classe ouvrière, la Gauche Communiste et tous les internationalistes.
Camarade Bernadette : sans aucun doute tu serais d’accord avec nous pour dire que la persistance des principes prolétariens auxquels tu as cru et de la lutte contre la barbarie de la société capitaliste que tu as combattue est le meilleur hommage à ta mémoire.
Nous tenons à exprimer notre solidarité avec les camarades, la famille et tous les amis de Bernadette et notre détermination à poursuivre le travail révolutionnaire dans lequel elle croyait si passionnément.
Internationalist Voice, 28 novembre 2015
www.internationalist.tk [9]
Vie du CCI:
Rubrique:
Anton Pannekoek - Lutte de classe et nation (1912)
- 1312 lectures
Alors que la bourgeoisie cherche à réactiver le sentiment national, nous publions ci-dessous des extraits d’une œuvre classique de la gauche germano-hollandaise, une des plus claires avec “La question nationale et l’autonomie” de Rosa Luxemburg, sur cette question vitale pour le prolétariat.
Les nations modernes sont intégralement le produit de la société bourgeoise ; elles sont apparues avec la production des marchandises, c’est-à-dire avec le capitalisme et leurs agents sont les classes bourgeoises. La production bourgeoise et la circulation des marchandises ont besoin de vastes unités économiques, de grands domaines dont elles unissent les habitants en une communauté à administration étatique unifiée. Le capitalisme développé renforce sans cesse la puissance étatique centrale ; il accroît la cohésion de l’État et le démarque nettement par rapport aux autres États. L’État est l’organisation de combat de la bourgeoisie. Dans la mesure où l’économie de la bourgeoisie repose sur la concurrence, sur la lutte avec ses semblables, les associations dans lesquelles elle s’organise doivent nécessairement lutter entre elles : plus le pouvoir d’État est puissant, plus grands sont les avantages auxquels aspire sa bourgeoisie. (…) L’étendue de l’État national et son développement capitaliste font qu’une extrême diversité de classes et de populations y coexistent. (…) La concurrence est le fondement de l’existence des classes bourgeoises. (…) La nation en tant que communauté solidaire constitue pour ceux qui en font partie une clientèle, un marché, un domaine d’exploitation où ils disposent d’un avantage par rapport aux concurrents d’autres nations. (...) La nation se présente à nous comme une puissante réalité dont nous devons tenir compte dans notre lutte. (...) La nation est une entité économique, une communauté de travail, y compris entre ouvriers et capitalistes. Car le capital et le travail sont tous deux nécessaires et doivent se conjuguer pour que la production capitaliste puisse exister. C’est une communauté de travail de nature particulière ; dans cette communauté, le capital et le travail apparaissent comme des pôles antagonistes ; ils constituent une communauté de travail de la même manière que les animaux prédateurs et leurs proies constituent une communauté de vie. (...) Plus les ouvriers prennent conscience de leur situation et de l’exploitation, plus fréquemment ils luttent contre les patrons pour l’amélioration des conditions de travail, plus les relations entre les deux classes se transforment en inimitié et en lutte. Il y a tout aussi peu de communauté entre eux qu’il peut s’en créer entre deux peuples qu’oppose constamment un conflit de frontière. Et plus les ouvriers se rendent compte du développement social et plus le socialisme leur apparaît comme le but nécessaire de leur lutte, plus ils ressentent la domination de la classe des capitalistes comme une domination étrangère, et par ce mot, on se rend compte à quel point la communauté de caractère s’estompe. (...) Peut-on imaginer plus antagonistes que les orientations de la volonté de la bourgeoise et du prolétariat ? (...) Toutes les autres classes s’enthousiasment ensemble pour ce qui fait la grandeur et la puissance extérieure de leur État national – le prolétariat combat toutes les mesures qui y conduisent. Les classes bourgeoises parlent de la guerre contre d’autres États pour accroître leur propre pouvoir – le prolétariat pense à la manière d’empêcher la guerre ou de trouver dans la défaite de son propre gouvernement l’occasion de sa propre libération. (...) Le prolétariat n’a rien à voir avec ce besoin de concurrence des classes bourgeoises, avec leur volonté de constituer une nation. (...) Sous la domination du capitalisme, la nation ne peut jamais être pour eux [les prolétaires] synonyme de monopole de travail. Et ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’on entend parler, chez des ouvriers rétrogrades (...) d’un désir de restreindre l’immigration. (...) Dans la lutte pour de meilleures conditions de vie, pour le développement intellectuel, pour la culture, pour une existence plus digne, les autres classes de leur nation sont les ennemis jurés des ouvriers alors que leurs camarades de classe allophones sont leurs amis et leurs soutiens. La lutte de classe crée dans le prolétariat une communauté internationale d’intérêts. Il ne peut donc être question pour le prolétariat d’une volonté de se constituer en nation par rapport aux autres nations qui serait fondée sur les intérêts économiques, sur sa situation matérielle. (...) Entre les travailleurs et la bourgeoisie une communauté de culture ne peut exister que superficiellement, en apparence et de façon sporadique. Les travailleurs peuvent bien lire en partie les mêmes livres que la bourgeoisie, les mêmes classiques et les mêmes ouvrages d’histoire naturelle, il n’en résulte aucune communauté de culture. Les fondements de leur pensée et de leur vision du monde étant totalement divergents, les travailleurs lisent dans ces œuvres tout autre chose que la bourgeoisie. Comme on l’a démontré plus haut, la culture nationale n’est pas suspendue dans l’air ; elle est l’expression de l’histoire matérielle de la vie des classes dont l’essor a créé la nation. Ce que nous trouvons exprimé dans Schiller et dans Goethe ne sont pas des abstractions de l’imagination esthétique, mais les sentiments et les idéaux de la bourgeoisie dans sa jeunesse, son aspiration à la liberté et aux droits de l’homme, sa manière propre d’appréhender le monde et ses problèmes. L’ouvrier conscient d’aujourd’hui a d’autres sentiments, d’autres idéaux et une autre vision du monde. Lorsqu’il est question dans sa lecture de l’individualisme de Guillaume Tell ou des droits des hommes, éternels et imprescriptibles, éthérés, la mentalité qui s’y exprime n’est pas la sienne, qui doit sa maturité à une compréhension plus profonde de la société et qui sait que les droits de l’homme ne peuvent être acquis que par la lutte d’une organisation de masse. Il n’est pas insensible à la beauté de la littérature ancienne ; c’est précisément son jugement historique qui lui permet de comprendre les idéaux des générations précédentes à partir de leur système économique. Il est à même de ressentir la force de ceux-ci et ainsi d’apprécier la beauté des œuvres dans lesquelles ils ont trouvé leur plus parfaite expression. Car le beau est ce qui embrasse et représente le plus parfaitement l’universalité, l’essence et la substance la plus profonde d’une réalité. À cela vient s’ajouter que, en beaucoup de points, les sentiments de l’époque révolutionnaire bourgeoise suscitent en lui un puissant écho ; mais ce qui trouve en lui un écho n’en trouve justement pas auprès de la bourgeoisie moderne. Cela vaut encore davantage en ce qui concerne la littérature radicale et prolétarienne. De ce qui enthousiasme le prolétaire dans les œuvres de Heine et de Freiligrath la bourgeoisie ne veut rien savoir. La lecture par les deux classes de la littérature dont elles disposent en commun est totalement différente ; leurs idéaux sociaux et politiques sont diamétralement opposés, leurs visions du monde n’ont rien en commun. Cela est vrai dans une beaucoup plus large mesure encore en ce qui concerne l’histoire. Ce que dans l’histoire la bourgeoisie considère comme les souvenirs les plus sublimes de la nation ne suscite dans le prolétariat conscient que haine, aversion ou indifférence. Rien n’indique ici la possession d’une culture commune. Seules les sciences physiques et naturelles sont admirées et honorées par les deux classes. Leur contenu est identique pour toutes deux. Mais combien différente de l’attitude des classes bourgeoises est celle du travailleur qui a reconnu en elles le fondement de sa domination absolue de la nature comme de son sort dans la société socialiste à venir. Pour le travailleur, cette vision de la nature, cette conception de l’histoire, ce sentiment de la littérature ne sont pas des éléments d’une culture nationale à laquelle il participe, mais sont des éléments de sa culture socialiste. Le contenu intellectuel le plus essentiel, les pensées déterminantes, la véritable culture des sociaux-démocrates allemands ne plongent pas leurs racines dans Schiller et dans Goethe, mais dans Marx et dans Engels. Et cette culture, issue d’une compréhension socialiste lucide de l’histoire et de l’avenir de la société, de l’idéal socialiste d’une humanité libre et sans classe, ainsi que de l’éthique communautaire prolétarienne, et qui par-là s’oppose dans tous ses traits caractéristiques à la culture bourgeoise, est internationale. Quand bien même elle diffère d’un peuple à l’autre par des nuances - tout comme la manière de voir des prolétaires varie selon leurs conditions d’existence et la forme de l’économie, quand bien même elle est, surtout là où la lutte des classes est peu développée, fortement influencée par les antécédents historiques propres à la nation, le contenu essentiel de cette culture est partout le même. Sa forme, la langue dans laquelle elle s’exprime, est différente, mais toutes les autres différences, même nationales, sont de plus en plus réduites par le développement de la lutte des classes et la croissance du socialisme. En revanche, la séparation entre la culture de la bourgeoisie et celle du prolétariat s’accroît sans cesse. (...) Ce que nous appelons les effets culturels de la lutte des classes, l’acquisition par le travailleur d’une conscience de soi, du savoir et du désir de s’instruire, d’exigences intellectuelles élevées, n’a rien à voir avec une culture nationale bourgeoise, mais représente la croissance de la culture socialiste. (...) Évidemment, cela ne veut pas dire que la culture bourgeoise, elle aussi, ne continuera pas à régner encore longtemps et puissamment sur l’esprit des travailleurs. Trop d’influences en provenance de ce monde agissent sur le prolétariat, volontairement et involontairement ; non seulement l’école, l’Église et la presse bourgeoise, mais toutes les belles lettres et les ouvrages scientifiques pénétrés de la pensée bourgeoise. Mais c’est de plus en plus fréquemment et de manière sans cesse élargie que la vie même et l’expérience propre triomphe dans l’esprit des travailleurs de la vision bourgeoise du monde. Et il doit en être ainsi. Car dans la mesure où celle-ci s’empare des travailleurs, elle les rend moins capables de lutter ; sous son influence, les travailleurs sont remplis de respect à l’égard des forces dominantes, on leur inculque une pensée idéologique, leur conscience de classe lucide est obscurcie, ils sont dressés les uns contre les autres d’une nation à l’autre, se font disperser et sont donc affaiblis dans la lutte et dépossédés de leur confiance en eux-mêmes. Or notre objectif exige un genre humain fier, conscient de soi, audacieux dans ses pensées comme dans l’action. Et c’est pour cette raison que les exigences mêmes de la lutte délivrent les travailleurs de ces influences paralysantes de la culture bourgeoise. Il est donc inexact de dire que les travailleurs accèdent par leur lutte à une “communauté nationale de culture”. C’est la politique du prolétariat, la politique internationale de la lutte des classes, qui engendre en lui une nouvelle culture, internationale et socialiste. (...) La classe ouvrière n’est pas seulement un groupe d’hommes qui ont connu le même destin et ont par conséquent le même caractère. La lutte de classe soude le prolétariat en une communauté de destin. Le destin vécu en commun est la lutte menée en commun contre le même ennemi. (...) Des ouvriers de nationalités différentes sont confrontés au même patron. Ils doivent mener la lutte en tant qu’unité compacte, ils en connaissent les vicissitudes et les effets dans la plus étroite des communautés de destin. (...) [Et fondamentalement], c’est l’État qui est la véritable organisation solide de la bourgeoisie pour protéger ses intérêts. L’État protège la propriété, s’occupe de l’administration, aménage la flotte et l’armée, lève les impôts et contient les masses populaires. Les “nations” ou mieux encore : les organisations actives qui se présentent en leur nom, c’est-à-dire les partis bourgeois ne servent qu’à lutter pour conquérir une influence adéquate sur l’État, une participation au pouvoir de l’État. Pour la grande bourgeoise dont le domaine d’intérêts économiques embrasse tout l’État et va même au-delà, qui a besoin de privilèges directs, de douanes, de commandes et de protection à l’étranger, c’est un État assez vaste qui constitue la communauté naturelle d’intérêts (...) C’est pourquoi le centre de gravité de la lutte politique de la classe ouvrière se déplace de plus en plus vers l’État. (...) Le pouvoir d’État et tous les puissants moyens dont il dispose, est le fief des classes possédantes ; le prolétariat ne peut se libérer, ne peut éliminer le capitalisme qu’en battant d’abord cette organisation puissante. La conquête de l’hégémonie politique n’est pas seulement une lutte pour le pouvoir d’État mais une lutte contre le pouvoir d’État. La révolution sociale qui débouchera sur le socialisme consiste essentiellement à vaincre le pouvoir d’État par la puissance de l’organisation prolétarienne. [Et] là aussi, le caractère international du prolétariat ne cesse de se développer. Les ouvriers des différents pays s’empruntent théorie et tactique, méthodes de lutte et conceptions et les considèrent comme une affaire commune. Certes, c’était aussi le cas de la bourgeoisie montante ; dans leurs conceptions économiques et philosophiques générales, les Anglais, les Français, les Allemands se sont influencés mutuellement en profondeur par l’échange des idées. Mais il n’en est résulté aucune communauté car leur antagonisme économique les a conduits à s’organiser en nations hostiles les unes aux autres ; c’est justement la conquête par la bourgeoisie française de la liberté bourgeoise que la bourgeoisie anglaise avait depuis longtemps, qui provoqua les âpres guerres napoléoniennes. Un tel conflit d’intérêts est totalement absent dans le prolétariat et c’est pourquoi l’influence spirituelle réciproque qu’exerce la classe ouvrière des différents pays peut agir sans contrainte dans la constitution d’une communauté internationale de culture. Mais ce n’est pas à cela que se limite la communauté. Les luttes, les victoires et les défaites dans un pays ont de profondes conséquences sur la lutte de classe dans les autres pays. Les luttes que mènent nos camarades de classe à l’étranger contre leur bourgeoisie n’est pas seulement sur le plan des idées notre propre affaire mais aussi sur le plan matériel ; elles font partie de notre propre combat et nous les ressentons comme telles. (...) Le prolétariat de tous les pays se perçoit comme une armée unique, comme une grande union que seules des raisons pratiques – puisque la bourgeoisie est organisée en États et que par conséquent de nombreuses forteresses sont à prendre – contraignent à se scinder en plusieurs bataillons qui doivent combattre l’ennemi séparément. C’est aussi sous cette forme que notre presse nous relate les luttes à l’étranger : les grèves des dockers anglais, les élections en Belgique, les manifestations de rue de Budapest sont toutes l’affaire de notre grande organisation de classe. Ainsi, la lutte de classe internationale devient l’expérience commune des ouvriers de tous les pays. Dans cette conception du prolétariat se reflètent déjà les conditions de l’ordre social à venir, où les hommes ne connaîtront plus d’antagonismes étatiques. Avec le dépassement des organisations étatiques rigides de la bourgeoisie par la puissance organisationnelle des masses prolétariennes, l’État disparaît en tant que puissance de coercition et terrain de domination qui se délimite nettement par rapport à l’extérieur. Les organisations politiques revêtent une nouvelle fonction ; “le gouvernement des personnes fait place à l’administration des choses” dirait Engels dans l’Anti-Dühring. (...) La production mondiale organisée, transforme l’humanité future en une seule et unique communauté de destin. Pour les grandes réalisations qui les attendent, la conquête scientifique et technique de la terre entière et son aménagement en une demeure magnifique pour une race de seigneurs heureuse et fière de sa victoire et qui s’est rendue maître de la nature et de ses forces, pour ces grandes réalisations – que nous ne pouvons aujourd’hui qu’à peine imaginer – les frontières des États et des peuples sont trop étroites et trop restreintes. (...) Notre recherche a démontré que sous la domination du capitalisme avancé qui s’accompagne de la lutte des classes, le prolétariat ne saurait trouver aucune force constitutive de la nation. Il ne forme pas de communauté de destin avec les classes bourgeoises, ni une communauté d’intérêts matériels, ni une communauté qui serait celle de la culture intellectuelle. Les rudiments d’une telle communauté qui s’ébauchent au tout début du capitalisme disparaissent nécessairement avec le développement de la lutte des classes. Alors que dans les classes bourgeoises de puissantes forces économiques créent l’isolement national, un antagonisme national et toute l’idéologie nationale, elles font défaut dans le prolétariat. (...) La bourgeoisie trouve-t-elle un intérêt véritable à mettre un terme aux luttes nationales ? Bien au contraire... les antagonismes nationaux constituent un moyen excellent de diviser le prolétariat, de détourner son attention de la lutte des classes à l’aide des slogans idéologiques, et d’empêcher son unité de classe. De plus en plus, les aspirations instinctives des classes bourgeoises d’empêcher que le prolétariat devienne uni, lucide et puissant, constituent un élément majeur de la politique bourgeoise. Dans des pays comme l’Angleterre, la Hollande, les États-Unis et même l’Allemagne, nous observons que les luttes entre les deux grands partis bourgeois – il s’agit généralement d’un parti “libéral” et d’un parti “conservateur” ou “clérical” – se font d’autant plus acharnées, et les cris de combat d’autant plus stridents, que l’antagonisme réel de leurs intérêts décroît et que leur antagonisme consiste en des slogans idéologiques hérités du passé. (...) Ils ont compris instinctivement qu’il est impossible d’écraser le prolétariat par la simple force et qu’il est infiniment plus important de déconcerter et de diviser le prolétariat aux moyens des mots d’ordre idéologiques. (...) Le rôle joué (...) par les cris de combat : “Avec nous pour la chrétienté !”, “Avec nous pour la liberté de conscience”, [est de] détourner des questions sociales l’attention des ouvriers, (...) Notre politique et notre agitation ne peuvent porter que sur la nécessité de mener toujours et seulement la lutte de classe, d’éveiller la conscience de classe afin que les travailleurs grâce à une claire compréhension de la réalité, deviennent insensibles aux mots d’ordre du nationalisme.”
Anton Pannekoek, 1912
Personnages:
- Anton Pannekoek [11]
Rubrique:
Révolution Internationale n°457 - mars avril 2016
- 1341 lectures
Le Parti socialiste au pouvoir, une politique d’attaques et de désorientation de la classe ouvrière
- 1308 lectures
Avec sa réforme du Code du travail, le gouvernement socialiste mène une énième attaque contre les conditions de vie des travailleurs. Jour après jour, mesure après mesure, la précarité des salariés, des chômeurs et des retraités augmente lentement mais inexorablement. La gauche de la bourgeoisie profite ici de la faiblesse de notre classe ; elle sait que le prolétariat, empêtré dans de lourdes difficultés, est incapable d’opposer à ces attaques incessantes un grand mouvement de masse. Mais la bourgeoisie la plus clairvoyante sait aussi autre chose : la classe ouvrière n’a peut-être plus conscience qu’elle est capable de renverser le capitalisme et d’offrir une alternative à toute l’humanité, elle n’a peut-être plus conscience de sa propre force quand elle est unie et organisée, ni même qu’elle existe. Il n’en reste pas moins qu’elle existe, qu’elle a en elle une immense force potentielle et qu’elle est bel et bien en mesure de faire surgir la société communiste ! La bourgeoisie est intelligente, c’est même la classe dominante la plus intelligente de l’histoire. Elle tire des leçons et si cette histoire lui a bien appris une chose, c’est qu’elle ne doit surtout pas sous-estimer son ennemi mortel. C’est pourquoi le Parti socialiste, si habile et expérimenté contre la classe ouvrière, mène une politique intense pour désorienter et atomiser les travailleurs. Sa démarche est préventive. Il travaille sans relâche à entretenir et même à renforcer les faiblesses actuelles du prolétariat. Tel est le sens des grandes campagnes médiatiques de ces derniers mois.
Par exemple, les manifestations des taxis et des agriculteurs ont bénéficié d’une immense publicité. Pourquoi ? D’abord, l’ampleur du mécontentement à contenir est une réalité. Ceci dit, les blocages de taxis ou de tracteurs ne présentent pas une réelle menace pour l’ordre établi. C’est pour cette raison que les projecteurs ont pu être braqués sur les pneus qui brûlent, les autoroutes bloquées, les supermarchés dévastés : autant d’actions spectaculaires présentées comme radicales et... “efficaces”, puisque les portes des ministères se sont immédiatement ouvertes, elles aussi avec grand bruit. La grande distribution a été reçue par le Premier ministre et les fameux VTC, véhicules de tourisme avec chauffeurs, concurrents directs des taxis, ont été soumis à une réglementation beaucoup plus stricte.
Ce n’est pas exactement par hasard si, au même moment, les syndicats de fonctionnaires ont appelé à une journée de grève stérile sur la question des salaires. Le gouvernement a clamé haut et fort que d’augmentation, il n’en était pas question. Les médias en chœur ne se sont pas privés de souligner le contraste entre “l’impuissance” des “fonctionnaires en lutte” et la “relative réussite” des agriculteurs et des taxis. La bourgeoisie cherche ainsi à faire croire que la lutte efficace n’est pas celle des ouvriers, mais celle d’autres catégories sociales minoritaires et spectaculaires. Blocage et sabotage, tel serait le nec plus ultra du combat. En 2010-2011, lors du mouvement contre la réforme des retraites, la bourgeoisie française n’avait déjà eu de cesse de mettre en avant le blocage des raffineries prôné par les syndicats les plus “radicaux” et le risque de paralysie de l’économie qui en découlait prétendument (voir notre article : “Bilan du blocage des raffineries” 1). La classe dominante sait que ce type d’action est parfaitement inoffensif, comme des piqûres de moustique sur la peau d’un éléphant puisqu’elles participent à diviser, à épuiser et à isoler les éléments les plus combatifs de la majorité des travailleurs. Les méthodes réelles de lutte de la classe ouvrière sont l’exact opposé.
Les agriculteurs et autres chauffeurs de taxis n’ont pas d’avenir en dehors du capitalisme. Ils forment cette couche intermédiaire de la société qui n’appartient pas aux grands groupes, qui n’a pas les moyens d’investir et d’exploiter en masse mais qui pour autant n’appartient pas au rang des prolétaires qui n’ont, eux, que leur force de travail à vendre pour vivre. Ce sont de petits propriétaires, de quelques champs ou de leurs véhicules ou de tout autre capital relativement modeste, qui ne rêvent que d’une seule chose : prospérer, accroître leurs biens et “réussir”. Leur déception est d’autant plus grande quand, inexorablement, ils sont tour à tour broyés par le capital, sa concurrence effrénée et impitoyable comme par sa crise économique mondiale. De la déception à la frustration, de l’humiliation à la haine. Ces couches sociales qui s’apparentent plus ou moins à la petite-bourgeoisie sont incapables de mener des luttes qui remettent en cause le capitalisme. Au contraire, leurs actions coups de poings sont des cris qui reviennent à implorer la grande bourgeoisie de les respecter, voire de les protéger ou, plus exactement, de les réintégrer. Les petits propriétaires détenant leurs moyens de production se battent en regardant derrière eux. Ils tentent de résister à la force du capitalisme en se raccrochant à un passé idéalisé où ils gardaient une place plus importante au sein de l’économie. Finalement, pour eux, le salut vient du retour à ce passé mythifié.
La classe ouvrière, quant à elle, est porteuse d’une autre société et cela change tout. Son combat n’est pas une simple lutte de résistance tournée vers le passé ou des objectifs strictement immédiats, mais une lutte fortement marquée et inspirée par le futur. En inscrivant cette perspective dans chacune de ses luttes, elle s’éloigne inévitablement de la destruction et de la désorganisation pour aller vers le développement de la solidarité et de la prise en charge organisée et centralisée de ses luttes. La classe ouvrière ne porte pas dans ses combats la destruction aveugle, ni un quelconque blocage. Elle porte en elle le mouvement, la potentialité et la possibilité de construire une nouvelle société. Elle ne défend pas sa survie dans le capitalisme, elle lutte au contraire pour sa propre disparition en tant que classe, pour une société nécessitant d’unifier l’humanité. Les méthodes de lutte qu’elle emploie doivent être en cohérence avec ce but : favoriser l’unité et la solidarité la plus large possible de tous les secteurs de la classe ouvrière par des revendications communes, débattre en organisant des assemblées générales souveraines ou des cercles de discussion ou tout autre lieu de parole libre permettant la confrontation des idées. Ces méthodes de lutte, la bourgeoisie se doit de les disqualifier et de les combattre avec énergie, comme elle l’a toujours fait dans l’histoire, car elles contiennent en germe la remise en cause réellement radicale du capitalisme et de son mode de vie basé sur la concurrence de tous contre tous.
Les derniers événements judiciaires à propos des luttes à Goodyear sont éloquents de cette volonté constante de la bourgeoisie de décourager la majorité de la classe exploitée à lutter tout en poussant la minorité qui demeure malgré tout combative vers des impasses. Lors d’une grève contre la fermeture de leur usine, des ouvriers exaspérés sont encouragés par les syndicats à séquestrer les cadres de leur entreprise. Ces derniers finissent par renoncer aux plaintes qu’ils avaient initialement portées. Mais l’État ne l’entend pas de cette oreille et maintient les poursuites qui s’achèvent par une condamnation à de la prison ferme (peine aménageable). Le message est clair : lutter ne sert à rien. Pire, cela conduit au tribunal, puis en prison. Dans une situation où le prolétariat est victime de démoralisation et de déboussolement, de tels messages n’ont d’autre volonté que l’intimidation. Voilà pour la majorité poussée à la résignation.
Dans le même temps, ces condamnations permettent de faire croire que la bourgeoisie craint ce type d’actions-commando de séquestration, puisqu’elle les juge si sévèrement. Voilà pour la minorité combative, encouragée à se perdre dans le piège du corporatisme, de l’isolement et l’impasse d’actions coups de poing, aussi spectaculaires que stériles. Il y a même dans cette affaire politico-judiciaire une dimension encore plus sournoise et dangereuse : les syndicats (et en particulier à la CGT), ces chiens de garde du capitalisme, passent pour la partie la plus déterminée du prolétariat qu’il s’agirait de soutenir et suivre.
En fait, cette fausse alternative vise non seulement à diviser les ouvriers entre eux mais surtout à renforcer une attaque idéologique contre la conscience de tous les prolétaires en leur faisant croire que ce sont eux qui seraient l’expression d’une classe réduite soit à la résignation, soit à mener des combats désespérés et sans avenir.
Pourquoi la bourgeoisie s’évertue-t-elle tant à nous dresser un tableau si sombre ? Dans notre article publié page 4, “Podemos, des habits neufs au service de l’empereur capitaliste”, nous écrivons : “La spécificité de Podemos qui justifie le coup de pub que lui fait le capitalisme espagnol est que les troupes d’Iglesias (son leader) remplissent une mission spéciale, très importante pour la bourgeoisie aussi bien espagnole que mondiale, qui est celle d’effacer les empreintes du mouvement du 15 mai qui ont fait trembler les rues il y a quatre ans et demi.” “Effacer les empreintes”, cette formule résume parfaitement le but des campagnes et des manœuvres permanentes de la bourgeoisie. Le mouvement des Indignés de 2011 en Espagne, celui contre le CPE de 2006 en France, plus en arrière la grève de masse de 1980 en Pologne et en mai 1968 de nouveau en France, ou bien plus anciennement encore les vagues révolutionnaires de 1919-1921 en Allemagne et de 1917 en Russie, en remontant jusqu’à la Commune de Paris de 1871..., toutes ces expériences plus ou moins grandes, parfois gigantesques, sont autant “d’empreintes” inestimables que la bourgeoisie n’a de cesse de recouvrir de ses mensonges. Car la classe dominante craint que le prolétariat ne redécouvre ses empreintes, constate qu’il s’agit des pas d’un géant et surtout que ces empreintes sont celles qui peuvent potentiellement conduire, au bout d’un très long chemin, à la révolution mondiale !
GD, 26 février 2016
Rubrique:
Moyen-Orient : l’obsolescence historique de l’État-Nation
- 2214 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’une contribution d’un sympathisant du CCI sur la situation au Moyen-Orient. La version originale est disponible sur notre site en anglais [17].
Le militarisme et la guerre, expressions principales du mode de vie du capitalisme depuis environ un siècle, sont devenus les synonymes de la désintégration du système capitaliste et de la nécessité de le renverser. La guerre, dans cette période et dans l’avenir, est une question cruciale pour la classe ouvrière.
Dans la période ascendante du capitalisme, les guerres pouvaient encore être un facteur de progrès historique, conduisant à la création d’unités nationales viables et servant à étendre le mode de production capitaliste à l’échelle mondiale : « depuis la formation de l’armée des citoyens, de la Révolution française au Risorgimento italien, de la guerre d’Indépendance américaine à la Guerre Civile, la révolution bourgeoise a pris la forme de luttes de libération nationale contre les royaumes réactionnaires et les classes abandonnées par la féodalité (…) Ces luttes avaient pour principal but de détruire les superstructures politiques surannées de la féodalité, de balayer l’esprit de clocher et l’autosuffisance, qui empêchaient la marche vers l’unification du capitalisme.» (Brochure du CCI : Nation ou Classe) Comme Marx l’a écrit dans sa brochure à propos de la Commune de Paris, La Guerre Civile en France : « Le plus gros effort d’héroïsme dont la vieille société est encore capable est la guerre nationale.»
En revanche, la guerre d’aujourd’hui et depuis les cent dernières années ne peut jouer qu’un rôle réactionnaire et destructeur et menace maintenant l’existence même de l’humanité. La guerre devient un mode d’existence permanent pour tous les États-nations, qu’ils soient grands ou petits. Alors que chaque État ne dispose pas des mêmes moyens pour poursuivre la guerre, ils sont tous soumis à la même dynamique impérialiste. L’impasse du système économique oblige les nations, vieilles ou jeunes, à adopter une politique de capitalisme d’État, sous peine de mort ; et cette politique est mise en œuvre par les partis bourgeois, de l’extrême-droite à l’extrême-gauche. Le capitalisme d’État constitue une défense raffinée de l’État-nation et une attaque permanente contre la classe ouvrière.
Dans la période ascendante du capitalisme, la guerre avait tendance à se payer elle-même, à la fois économiquement et politiquement, en brisant les barrières du développement capitaliste. Dans la phase de décadence, la guerre est une dangereuse absurdité, devenant de plus en plus séparée de toute justification économique. Il suffit de regarder les vingt-cinq dernières années de prétendue « guerre pour le pétrole » au Moyen-Orient pour s’apercevoir qu’il faudrait des siècles pour qu'elle soit rentable, et encore, à condition que la guerre cesse dès maintenant.
La nation est un symbole de la décadence du capitalisme
Consacrer une grande part des ressources nationales à la guerre et au militarisme est maintenant normal pour tout État, et c’est ce qui se passe depuis le début du XXe siècle ; cela s’est seulement intensifié aujourd’hui. Ce phénomène est directement lié à l’évolution historique du capitalisme : « La politique impérialiste n’est pas l’œuvre d’un pays ou d’un groupe de pays. Elle est le produit de l’évolution mondiale du capitalisme à un moment donné de sa maturation. C’est un phénomène international par nature, un tout inséparable qu’on ne peut comprendre que dans ses rapports réciproques et auquel aucun État ne saurait se soustraire.»1 La position qu’on adopte sur la guerre impérialiste détermine de quel côté de la barrière de classe on se trouve ; soit l’on défend la domination du capital à travers la défense de la nation et du nationalisme (compatibles avec à la fois le trotskysme et l’anarchisme), soit l’on défend la classe ouvrière et l’internationalisme contre toute forme de nationalisme. Les « solutions » nationales, les identités nationales, la libération nationale, les « conflits » nationaux, la défense nationale : tout cela ne sert que les intérêts impérialistes, donc capitalistes. Ceux-ci sont diamétralement opposés aux intérêts de la classe ouvrière : la guerre de classe devra en finir avec l’impérialisme, ses frontières et ses États-nations.
En 1900, il y avait quarante nations indépendantes ; au début des années 1980, il y en avait presque 170. Aujourd’hui, il y en a 195. Le dernier État, le Soudan du Sud, reconnu et soutenu par la « communauté internationale », s’est immédiatement effondré dans la guerre, la famine, la maladie, la corruption, la loi des seigneurs de guerre, le gangstérisme : c’est une autre expression concrète de la décomposition du capitalisme et de l’obsolescence de l’État-nation. Les nouveaux États-nations des XXe et XXIe siècles ne sont pas l’expression d’une croissance de jeunesse, mais sont nés séniles et stériles, aussitôt empêtrés dans les rêts de l’impérialisme, avec leurs propres moyens de répression interne (ministère de l’Intérieur, services secrets et armée nationale) et de militarisme externe avec les pactes, les protocoles d’accords de défense mutuelle, l’implantation de conseillers et de bases militaires par les plus grandes puissances.
« [Aujourd’hui, la phrase nationale] ne sert plus qu’à masquer tant bien que mal les aspirations impérialistes, à moins qu’elle ne soit utilisée comme cri de guerre, dans les conflits impérialistes, seul et ultime moyen idéologique de capter l’adhésion des masses populaires et de leur faire jouer leur rôle de chair à canon dans les guerres impérialistes. »2 Depuis que Rosa Luxemburg a écrit ces lignes, il n’y a plus eu de révolution bourgeoise dans les pays sous-développés, mais seulement des luttes de cliques entre gangs bourgeois rivaux et leurs appuis impérialistes locaux et mondiaux. L’État militariste et la guerre deviennent le mode de survie pour l’ensemble du système comme pour chaque nation, chaque proto-État, toute expression nationaliste, chaque identité ethnique ou religieuse deviennent l’expression directe de l’impérialisme.
Regardons de plus près le rôle réactionnaire de l’État-nation à travers un bref aperçu de la situation au siècle dernier dans l’importante région du monde que constitue le Moyen Orient.
La guerre au Moyen Orient : de la Première Guerre mondiale à la Guerre du Golfe
La nation capitaliste a été préservée, et même multipliée par quatre, tout au long des cent dernières années. Mais son programme démocratique bourgeois et sa tendance unificatrice sont morts et enterrés ; désormais ses « peuples » ne peuvent qu’être soumis à la répression ou mobilisés pour défendre les intérêts impérialistes comme chair à canon. « Pour compléter le tableau, les nouvelles nations surgissent avec un péché originel : ce sont des territoires incohérents, formés par un agrégat chaotique de différentes religions, économies, cultures. Leurs frontières sont pour le moins artificielles et incluent des minorités appartenant aux pays limitrophes ; tout cela ne peut que mener à la désagrégation et à des confrontations permanentes. »3
Cela est illustré par la multitude des nationalismes, des ethnies et des religions qui cohabitent au Moyen-Orient. Les trois religions principales sont ici démultipliées en en une myriade de sectes, avec des conflits internes et externes permanents : les Chiites, Sunnites, Maronites, Chrétiens orthodoxes et coptes, les Alaouites, etc. Il y a des minorités linguistiques importantes et de plus en plus de peuples sans terre : les Kurdes, les Arméniens, les Palestiniens et maintenant les Syriens.
La Première Guerre mondiale a vu l’effondrement de l’Empire Ottoman et de ses trésors, ainsi que l’effondrement de la position stratégique du Moyen-Orient (entre l’Est et l’Ouest, l’Europe et l’Afrique, le canal de Suez, le détroit des Dardanelles) qui suscitait la cupidité des grandes puissances. Même avant que le pétrole ne soit découvert dans cette région, et bien avant que l’on ne se rende compte de l’ampleur des réserves de pétrole, la Grande-Bretagne avait mobilisé 1,5 million d’hommes de troupes dans la région. Ayant résisté à la menace représentée par l’Allemagne et la Russie, et malgré les rivalités existant entre la Grande-Bretagne et la France, ces deux puissances ont donné leur forme aux pays de cette région : la Syrie, l’Irak, le Liban, la Transjordanie, l’Iran, l’Arabie Saoudite, le « protectorat » Palestinien, les frontières de ces pays ont été dessinées par les deux pouvoirs impérialistes victorieux, chacun surveillant à la fois ses partenaires et les anciens rivaux du coin de l’œil. Ces « nations » absurdes sont devenues un terreau fertile pour une instabilité et des conflits ultérieurs, pas seulement à cause des rivalités entre grandes puissances mais aussi à cause de luttes régionales entre elles. Cela a souvent donné lieu à des déplacements massifs de populations, justifiés par la nécessité de former des entités nationales distinctes : en un mot, elles ont fertilisé le sol pour les pogroms, l’exclusion, la violence entre les religions et les sectes que nous sommes obligés de supporter aujourd’hui ; de plus, cette violence se répand et devient de plus en plus dangereuse : Sunnites contre Chiites, Juifs contre Musulmans, Chrétiens contre Musulmans et des sectes encore plus anciennes qui auparavant étaient laissées tranquilles, mais qui sont maintenant entraînées dans le maelstrom impérialiste. La région est devenue une fusion violente des régimes totalitaires, de conflits religieux, de terrorisme et de la loi des seigneurs de guerre, une preuve supplémentaire qu’il n’y a pas de solution à la barbarie capitaliste, à part la révolution communiste. Avec la Déclaration Balfour, en novembre 1917, l’Angleterre avait promis un soutien à l’installation d’une patrie juive en Palestine ; elle pensait l’utiliser en tant qu’alliée locale contre ses grands rivaux. C’est dans le cadre militariste de luttes sanglantes avec les dirigeants arabes que l’État sioniste est né.4 Les États-Unis, principal bénéficiaire de la Première Guerre mondiale, commencèrent à supplanter la Grande-Bretagne comme premier gendarme du monde et cela devint une évidence au Moyen-Orient.
La contre-révolution stalinienne des années 1920-30, aidée et encouragée par les puissances occidentales, a entraîné l’augmentation des machinations impérialistes au Moyen-Orient, jusqu’à et pendant la Deuxième Guerre mondiale. À cette période, les Turcs, les factions arabes et les sionistes oscillaient entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne ; la majorité choisit l’Allemagne. Cette région était importante pour les deux grandes puissances5, mais elle a été relativement épargnée par les destructions, dans la mesure où les champs de bataille principaux se trouvaient en Europe et dans le Pacifique. Dans l’ensemble, et la fin de la guerre devait le confirmer, la Grande-Bretagne et la France ont mené une guerre perdue d’avance au Moyen-Orient et ailleurs, car la hiérarchie impérialiste a été bousculée par l’émergence de la superpuissance américaine. Ceci fut encore renforcé par la création d’un État sioniste, qui a été fortement soutenu par les États-Unis (et aussi au début par la Russie), au détriment des intérêts nationaux britanniques. L’établissement de l’État-nation d’Israël a déterminé une nouvelle zone de conflits dont la naissance a entraîné la création d’un énorme et permanent problème de réfugiés, qui, en grossissant, a renforcé un état de siège militaire permanent. L’existence d’Israël est probablement l’un des exemples les plus frappants de la façon dont un pays formé dans la décadence capitaliste est encadré par la guerre, survit par la guerre et vit dans la peur constante de la guerre.
Un autre chapitre de l’impérialisme a été ouvert lorsque le Moyen-Orient est devenu un enjeu de la Guerre Froide entre les blocs américain et russe qui se sont consolidés après la Deuxième Guerre mondiale et ont effectué plusieurs interventions par l'engagement interposé de puissances militaires entre les deux grands. Ainsi, lors des guerres israélo-arabes de 1967 et 1973, les deux blocs s’affrontaient d’une certaine façon par procuration ; les victoires écrasantes d’Israël ont considérablement réduit la capacité de l’URSS à maintenir les points d’appui qu’elle avait établis dans la région, en particulier en Égypte. Dans le même temps, déjà dans les années 1970 et au début des années 1980, on a pu voir les germes des conflits multipolaires et chaotiques qui ont caractérisé la période qui a suivi l’effondrement de l’URSS et de son bloc. Le renversement du Shah d’Iran en 1979 a entraîné la formation d’un régime qui a tendu à s’affranchir du contrôle des deux blocs. La tentative de la Russie de se renforcer en profitant du nouvel équilibre des forces dans la région, sa tentative d’occupation de l’Afghanistan en 1980, l’a entraînée dans une longue guerre d’usure qui a grandement contribué à l’effondrement de l’URSS. Au même moment, en favorisant le développement des Moudjahidines islamistes, incluant le noyau qui allait devenir Al Qaïda pour lutter contre l’occupation russe, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Pakistan étaient en train de fabriquer un monstre qui leur mordrait bientôt la main. Pendant ce temps, l’impérialisme américain procédait au retrait de ses troupes du Liban, qu’il n’avait pas réussi à soustraire aux forces agissant comme mandataires de l’Iran et de la Syrie.
C’est durant cette période que l’on assiste au début de la perte de puissance des États-Unis, qui est à la fois une expression et une contribution à la décomposition ambiante d’aujourd’hui. Après l’effondrement du bloc russe, est venue la désintégration des alliances autour des États-Unis et le développement centrifuge du chacun pour soi des différentes nations. Les États-Unis ont réagi énergiquement à cette situation, tentant de rassembler leurs alliés en lançant la Guerre du Golfe de 1990-91, qui a abouti à la mort d’environ un demi-million d’Irakiens (alors que Saddam Hussein restait en place). Mais la réalité de cette tendance était trop forte et la domination américaine avait irrémédiablement vécu. Après le 11 septembre 2001, les néo-conservateurs évangéliques agissant pour le compte de l’impérialisme américain ont engagé de nouvelles guerres en Afghanistan et en Irak, prenant l’apparence d’une croisade contre l’Islam, attisant ainsi les flammes du fondamentalisme islamique.
Aujourd’hui, on assiste à un glissement plus profond dans la barbarie capitaliste
Dans le film de 1979 réalisé par Francis Ford Coppola Apocalypse now, un colonel renégat américain demande au tueur à gages appointé par la CIA ce qu’il pense de ses méthodes ; l’assassin répond : « je ne vois aucune méthode. » Il n’y a pas de méthode dans les guerres d’aujourd’hui au Moyen-Orient, à l’exception d’un grand précepte : « faites ce que vous voulez ». Il n’y a aucune justification économique (des milliards de dollars sont partis en fumée juste pour les guerres d’Irak et d’Afghanistan), seulement une descente permanente dans la barbarie. Aussi fictif qu’il soit, le personnage du colonel Kurtz dans le film est le symbole de l’exportation de la guerre « du cœur des ténèbres », qui se trouve en fait dans les centres principaux du capital plutôt que dans les déserts du Moyen-Orient ou les jungles du Vietnam et du Congo.
En Syrie aujourd’hui, il y a une bonne centaine de groupes qui combattent le régime et se battent entre eux, tous plus ou moins téléguidés par des pouvoirs locaux ou plus importants. La nouvelle « nation », le prétendu califat de l’État islamique, avec son propre impérialisme, sa chair à canon, sa brutalité et son irrationalité, est à la fois une expression à part entière de la décadence du capitalisme et le reflet de toutes les grandes puissances qui, d’une façon ou d’une autre, l’ont créé. L’État islamique est actuellement en expansion partout dans le monde, gagnant de nouvelles filiales en Afrique, s’emparant de Boko Haram au Nigeria. L’État islamique est également en concurrence avec les Talibans en Afghanistan, qui eux-mêmes sont en danger dans la région de l’Helmand, qui a été si longtemps la base de l’armée britannique. Mais si l’État islamique était éliminé demain, il serait remplacé immédiatement par d’autres entités djihadistes, tels que Jahbat al-Nusra, une filiale de Al Qaïda. La « guerre contre le terrorisme » chapitre 2, comme pour le chapitre 1, ne fera qu’augmenter le terrorisme existant au Moyen-Orient avec son exportation au cœur du capitalisme.
L’une des caractéristiques du nombre grandissant de guerres au Moyen-Orient est la réémergence de la Russie sur le plan militaire, avec pour couverture idéologique les « valeurs » de la vieille nation russe. Pendant la Guerre Froide, la Russie a été expulsée de l’Égypte et du Moyen- Orient en général, car sa puissance avait décliné. Maintenant, la Russie est réapparue, non sous la forme d’une tête de bloc comme avant (elle a seulement quelques ex-républiques anémiques comme alliées) mais comme une force drapée dans la décomposition qui doit soutenir l’impérialisme pour son « identité » nationale. La faiblesse de la Russie est évidente dans ses tentatives désespérées pour installer des bases en Syrie, les plus importantes pour elle à l’extérieur de son territoire. Un autre facteur qui aura une incidence importante, y compris pour elle, est l’actuel rapprochement entre les États-Unis et l’Iran, lié à l’accord sur le nucléaire de 2015. Cet accord exprime aussi une faiblesse fondamentale de l’impérialisme américain et est la source de tensions importantes entre les États-Unis et leurs principaux alliés régionaux, Israël et l’Arabie Saoudite.
Quel que soit le côté où l’on regarde, le désordre impérialiste au Moyen-Orient devient de plus en plus impossible à démêler. Il existe aussi dans cette situation le positionnement de la Turquie, qui n’a pas hésité à verser de l’huile sur le feu de la guerre. Sa guerre contre les Kurdes n’aura pas de fin et par ses agissements, elle monte les uns contre les autres, les États-Unis, la Russie et l’Europe. Ses relations avec la Russie en particulier se sont refroidies après la destruction d’un avion de chasse russe, alors qu’elle a utilisé le grossier prétexte d’attaquer l’État islamique pour pilonner des bases Kurdes. Il y a la participation de l’Arabie Saoudite qui, bien que prétendument alliée des États-Unis et de la Grande-Bretagne, a été un bailleur de fonds important pour différentes bandes islamistes dans la région, grâce à l’exportation non seulement de son idéologie wahhabite mais aussi des armes et de l’argent.
Aussi loin que les États-nations s’enfoncent dans la décadence, l’Arabie Saoudite est l’une des pires farces historiques qu’on puisse trouver.6 Minée par la chute des prix du baril d’or noir, qui a été encouragée par l’Iran (désignant le pétrole non comme un facteur d'ajustement économique mais comme une arme impérialiste) et craignant que la théocratie iranienne rivale ne redevienne le gendarme de la région après ses récents accords avec les États-Unis, le régime saoudien a porté un coup contre l’Iran avec l’exécution du célèbre imam chiite Sheikh Nimr al-Nimr, et d’autres décapitations qui ont été à peine mentionnées dans les médias occidentaux. Cette provocation planifiée contre l’Iran montre un certain désespoir et une faiblesse du régime saoudien ainsi qu'un danger que la situation ne dérape et devienne hors de contrôle. Les actions récentes du régime saoudien révèlent à nouveau les tendances centrifuges de chaque nation au chacun pour soi et la difficulté des grandes puissances, particulièrement des États-Unis, à les contenir. Une chose est certaine concernant l’épisode actuel de rivalité Iran/Irak : la perspective de l’aggravation de la guerre, des pogroms et du militarisme à travers la région, avec de multiples tensions et la précarité des alliances provisoires gagnant du terrain. Des accrochages étaient signalés plus loin en Égypte (que l’Arabie Saoudite a financés dans le cadre de son combat contre les Frères Musulmans) et tout cela ne pourra que s’aggraver.
L’État-nation du Liban a déjà été déchiré dans les années 1980 ; les tensions vont s’accroître maintenant et les conséquences de la rupture de cet État fragile seraient désastreuses, du moins pour Israël dont la guerre larvée avec les factions palestiniennes et le Hezbollah continuent.
Enfin, il faut mentionner le rôle grandissant de la Chine, même si ses principaux points de rivalités impérialistes (avec les États-Unis, le Japon et d’autres) se portent plutôt sur l’Extrême-Orient. Ayant émergé comme alliée subalterne de la Russie à la fin des années 1940 à 1950, la Chine a commencé à avoir un parcours indépendant dans les années 1960 (la « rupture sino-soviétique »), conduisant rapidement à une nouvelle entente avec les États-Unis. Mais, depuis les années 1990, la Chine est devenue le deuxième pouvoir économique mondial et cela a sérieusement élargi ses ambitions impérialistes, on le voit dans ses efforts pour pénétrer en Afrique. Pour le moment, elle a eu tendance à opérer aux côtés de l’impérialisme russe au Moyen-Orient, bloquant les tentatives américaines de discipliner la Syrie et l’Iran, mais son potentiel pour semer la panique dans l’équilibre mondial des puissances, accélérant ainsi la chute dans le chaos, reste dans une large mesure inexploité. Cela nous donne une preuve supplémentaire que le démarrage économique d’une ancienne colonie comme la Chine n’est plus désormais un facteur de progrès humain, mais apporte avec lui de nouvelles menaces de destructions, tant militaires qu’écologiques.
Nous avons commencé par étudier la nature réactionnaire de l’État-nation, autrefois expression du progrès, qui est maintenant devenue non seulement une entrave à l’avancée de l’humanité mais aussi une menace pour son existence même. L’éclatement virtuel des nations syrienne et irakienne, obligeant des millions de personnes à fuir la guerre et à éviter de se faire enrôler d’un côté ou d’un autre, la naissance de l’État islamique, le projet national de Jahbat al-Nusra, la défense patriotique du peuple kurde, tout cela sont des expressions de la décadence, de l’impérialisme qui n’a rien d’autre à offrir aux populations de ces régions que la misère et la mort. Il n’y a pas de solution à la décomposition du Moyen-Orient au sein du capitalisme. Face à cela, il est vital que le prolétariat maintienne et développe ses propres intérêts contre ceux de l’État-nation. La classe ouvrière dans les pays centraux du capitalisme détient les clés de la situation, compte-tenu de l’extrême faiblesse du prolétariat dans les zones en guerre. Et, bien que la bourgeoisie soumette la classe ouvrière des pays du cœur du capitalisme à un battage idéologique permanent autour des thèmes des réfugiés et du terrorisme, elle n’ose pas encore la mobiliser directement pour la guerre. Potentiellement, la classe ouvrière demeure la plus grande menace contre l’ordre capitaliste. Mais elle doit transformer ce potentiel en réalité si nous voulons éviter le désastre vers lequel nous courrons. Comprendre que les intérêts prolétariens sont internationaux, que l’État-nation n’est plus un cadre viable pour la vie humaine, sera une part essentielle de cette transformation.
Boxer, sympathisant du CCI (13 janvier 2016)
1 Brochure de Junius, la crise de la social-démocratie, 1915, Rosa Luxemburg. Ed. Les Amis de Spartacus, 1994, ch. VII, p. 127.
2 Idem, ch. VII, p. 128.
[3] Bilan de 70 années de luttes de libération nationales, 3
3 2ème partie : les nouvelles nations, Revue Internationale n° 69, pp. 20-21.
4 Voir les Notes sur le conflit impérialiste au Moyen-Orient 1ère partie, Revue Internationale n° 115, p. 21.
5 Voir les Notes sur le conflit impérialiste au Moyen-Orient 3ème partie, Revue Internationale n° 118, été 2004.
6 Nous reviendrons sur ce sujet dans un prochain article.
Géographique:
- Moyen Orient [18]
Rubrique:
Podemos: des habits neufs au service de l’empereur capitaliste
- 1743 lectures
A en croire le bombardement médiatique que l’on nous assène ces derniers mois, nous serions à la veille d’un tremblement de terre qui chamboulerait de haut en bas le scénario traditionnel des trente dernières années selon lequel le Parti Populaire de droite (PP) et le parti socialiste (PSOE) se succèdent alternativement au pouvoir sans que personne n’y trouve à redire. Cet échiquier politique se verrait aujourd’hui perturbé par l’irruption de “forces émergentes”, et en particulier par la plus récente d’entre elles : Podemos. Mais Podemos ne représente rien de nouveau.
Son programme politique et son idéologie sont des classiques des régimes staliniens 1 défendus par les partis soi-disant communistes (en réalité furieusement anticommunistes) et leurs acolytes gauchistes de tout poil (trotskistes, syndicalistes de base, mouvements altermondialistes) 2 qui sont les principaux soutiens de cette pantomime de “politique nouvelle”. La spécificité de Podemos qui justifie le coup de pub que lui fait le capitalisme espagnol est que les troupes d’Iglesias (son leader) remplissent une mission spéciale, très importante pour la bourgeoisie aussi bien espagnole que mondiale, qui est celle d’effacer les empreintes du mouvement du 15 mai qui ont fait trembler les rues il y a quatre ans et demi.
La “fierté de l’Espagne” d’Iglesias contre l’internationalisme du mouvement du 15 mai
Il y a 4 ans, de grandes foules ont occupé les rues et les places non seulement en Espagne mais également en Grèce, aux États-Unis, en Israël, etc. “Le mouvement d’indignation s’est étendu internationalement. Il a surgi en Espagne où le gouvernement socialiste avait mis en place un des premiers plans d’austérité et un des plus durs ; en Grèce, devenue le symbole de la crise économique mondiale à travers l’endettement ; aux États-Unis, temple du capitalisme mondial ; en Égypte et en Israël pays pourtant situés de chaque côté du front du pire conflit impérialiste et le plus enkysté, celui du Moyen-Orient” . Il y a eu des tentatives, encore très timides et embryonnaires, de solidarité internationale. “En Espagne, la solidarité avec les travailleurs de Grèce s’est exprimée aux cris de “Athènes tiens bon, Madrid se lève !”. Les grévistes d’Oakland (États-Unis, novembre 2011) proclamaient leur “solidarité avec les mouvements d’occupation au niveau mondial”. En Égypte, a été approuvée une Déclaration du Caire en soutien au mouvement aux États-Unis. En Israël, les Indignés ont crié “Netanyahou, Moubarak, El Assad, c’est la même chose” et ont pris contact avec des travailleurs palestiniens” 3.
L’internationalisme qui s’est exprimé spontanément même de façon embryonnaire dans les moments les plus forts du mouvement des Indignés est quelque chose de très dangereux pour la bourgeoisie qui justifie sa domination sur le prolétariat par l’existence d’une supposée communauté d’intérêts entre exploiteurs et exploités de chaque pays.
Ainsi, dès l’origine, Podemos s’est caractérisé par ce qu’ils appellent un discours “transversal”, c’est-à-dire s’adressant aussi bien aux “défavorisés” qu’aux chefs d’entreprises à qui ils n’ont cessé depuis lors d’envoyer des messages rassurants. Mais cette supposée communauté “transversale”, c’est aussi celle qu’invoque le parti frère de Podemos, le parti grec Syriza pour justifier son respect des exigences de la Communauté européenne, qui sous-tend une intensification des attaques contre les conditions de vie et de travail des travailleurs grecs. Au lieu de se solidariser envers les victimes, les Iglesias, Errejon et consorts ont été solidaires de leur bourreau Tsipras.
Dans cette escalade patriotique, les “podémistes” en sont arrivés à prendre des distances envers les propositions d’envoyer des soldats dans les zones occupées par l’État islamique en Syrie et en Irak en invoquant le fait “qu’ils pourraient se faire tuer”. Nous avons vu que, en opposition à leur appel initial d’envoyer des troupes dans les zones occupées par l’État islamique (en Syrie et en Irak), ils ont allégué ensuite que “des soldats espagnols pourraient se faire tuer”. “L’argument” de “l’homme au catogan” est massue, très efficace pour nous inoculer le poison du nationalisme, en nous proposant de nous enfermer dans le petit monde étroit et endogamique de la “nation espagnole”.
Qu’importe que des ouvriers et des paysans syriens ou irakiens se fassent massacrer ? Qu’importe que la population de Rakka, la “capitale” proclamée du bastion de l’État islamique, soit soumise à une triple terreur de ses “gouvernants islamistes”, des bombardements de la Russie, des États-Unis et de la France et aussi des milices d’El Assad ? Qu’importe que ces territoires se soient transformés en trou noir où il est devenu purement et simplement impossible de vivre ? Rien de tout cela ne devrait nous préoccuper, selon la “philosophie nationale” et patriotarde du sieur Iglesias ! La seule chose qui compte est qu’aucun “compatriote”, aucun ressortissant espagnol n’aille mourir là-bas !
C’est pour cette raison que les “podémistes” ont adhéré en tant qu’observateurs” au pacte anti-djihadiste signé à la fois par les parties prenantes de l’invasion de l’Irak (le Parti populaire), de l’invasion de l’Afghanistan (le PSOE) et par les aspirants à l’invasion de n’importe quel territoire qui se ferait sous la bannière du drapeau espagnol (le mouvement des citoyens). C’est pour cette raison que Podemos a promis à Rajoy tout le soutien nécessaire pour faire face aux attaques terroristes comme il l’a déjà fait pour les victimes lors du récent attentat au centre de Kaboul 4.
Si nous mettons nos rêves dans les urnes, ce sera un cauchemar !
Un des mots d’ordre les plus repris par le mouvement du 15 mai a été “nos rêves ne rentrent pas dans vos urnes !” En effet, le mouvement des Indignés a surgi avec une forte tendance au rejet de la politique bourgeoise, des élections 5, etc. Dans les mouvements de 2011 a commencé à être mis en avant, avec encore beaucoup de faiblesses et d’hésitations, un fait qui, aujourd’hui, c’est-à-dire quatre ans après, nous paraît insolite : “Ces personnes-là, les travailleurs, les exploités, tous ceux qu’on dépeint comme des ratés indolents, des gens incapables d’initiative ou de faire quelque chose en commun, sont arrivés à s’unir, à partager, à créer et à briser la passivité étouffante qui nous condamne à la sinistre normalité quotidienne de ce système. (…) On a fait les premiers pas pour que surgisse une véritable politique de la majorité, éloignée du monde des intrigues, des mensonges et des manœuvres troubles qui est la caractéristique de la politique dominante. Une politique qui aborde tous les sujets qui nous touchent, pas seulement l’économie ou la politique, mais aussi l’environnement, l’éthique, la culture, l’éducation ou la santé” 6.
La politique bourgeoise préconise au contraire le repli sur soi de chacun d’entre nous, que chacun doit se considérer absurdement comme son propre maître en face des problèmes qui ont un caractère social et doit déléguer la recherche de leur solution à travers l’acte individuel du vote en faveur de politiciens professionnels, ce qui, à la longue, se traduit par une plus grande atomisation et une plus grande résignation.
L’évolution de la trajectoire de Podemos est très significative. À ses débuts et pour renforcer l’illusion d’une continuité avec le mouvement du 15 mai, ils ont reproduit et plagié le caractère formel des assemblées et des débats publics pour comprendre les causes de nos souffrances, les possibles alternatives à offrir, etc. Mais aujourd’hui, les prétendues “assemblées” de Podemos sont devenues une bagarre à couteaux tirés non dissimulée entre les différentes tendances concurrentes sur les listes électorales 7. Par ailleurs, les débats en sont aujourd’hui réduits à une approbation de la liste de recettes défendues comme simple programme électoral à géométrie variable, en fonction des besoins électoraux d’Iglesias et ceux de sa bande.
À quoi va servir Podemos par la suite ?
L’organisation du fonctionnement “interne” de Podemos n’est pas en contradiction avec sa fonction, comme voudraient nous le faire croire les représentants de l’aile la plus critique de cette formation. Elle est en réalité pleinement en conformité avec la mission assignée à ce parti par l’ensemble de la bourgeoisie : convaincre les travailleurs que tout mouvement de protestation, que toute remise en cause des réseaux de contrôle établis par l’État démocratique pour canaliser l’indignation – même dans sa forme domestiquée, inoffensive ou réduite à un simulacre – face au futur que nous réserve le capitalisme, est fatalement voué à mourir en finissant dans leurs filets. Il s’agit finalement de convaincre qu’il est inutile de penser pouvoir lutter contre le système, parce que le système capitaliste finit toujours par récupérer cette lutte dans une forme même plus caricaturale qu’à l’origine.
Le mouvement des Indignés en Espagne, tout comme celui qui a surgi les mois suivants aux États-Unis ou en Israël, ou encore comme d’autres expressions de la lassitude envers ce système capitaliste qui transforme les êtres humains en vulgaires marchandises, n’a pas réussi à dépasser le piège tendu par l’État bourgeois, et particulièrement par ses fractions les plus aptes au sabotage de tout mouvement de remise en cause du capitalisme. Cela ne veut pas dire que la possibilité d’une réflexion, d’une recherche pour tirer les leçons sur les causes de l’épuisement de ces mouvements, n’existe pas – même de façon latente – dans la dynamique de la situation actuelle. Les stimulants pour alimenter cette réflexion ne manquent pas. Le capitalisme s’enfonce chaque jour davantage dans l’abîme d’une misère croissante pour d’énormes masses de population, dans une multiplication de foyers de guerre et de terreur, dans un éparpillement de scénarios de catastrophes écologiques. La classe exploiteuse aura toujours besoin, et sera toujours prête à rémunérer grassement quiconque proclame à tous les coins de rue que le roi n’est pas nu, qu’il a seulement besoin de nouveaux habits, comme ceux qu’il porte déjà, que Podemos ou encore la “nouvelle gauche” en Grande-Bretagne sont prêts à lui tailler et confectionner sur mesures.
Paolo, 13 décembre 2015
(AP, organe du CCI en Espagne)
1 Comme nous l’avons déjà dénoncé dans notre précédent numéro d’Acción Proletaria. Voir notre article en espagnol [20].
2 De fait, une grande partie de la main d’œuvre de la formation “podémiste” est constituée par les militants de la dénommée “gauche anticapitaliste” formée à partir des débris des organisations gauchistes des années 1980 et de la énième scission “de gauche” du Parti “communiste” espagnol.
3 Extrait de notre tract diffusé internationalement sur le bilan des mouvements de 2011 : “De l’indignation à l’espoir”, publié sur notre site le 30 mars 2012.
http ://fr.internationalism.org/files/fr/tract_inter_2011.pdf [21]
4 Perpétré par les talibans dans le quartier diplomatique et dans lequel ont péri quatre policiers afghans et deux espagnols, à la suite duquel le gouvernement espagnol avait déclaré que c’était “une attaque contre l’Espagne”, NdT.
5 Ce n’est pas pour rien que les assemblées sur les places ont refusé avec défi de suivre l’appel à leur dissolution au cours de la “journée de réflexion” du 21 mai.
6 Extrait du tract international [21] du CCI déjà cité.
7 Des quelques 380 000 sympathisants que compte Podemos, seuls 15 % ont pris part aux primaires et à peine 4 % se sont mobilisés pour l’adoption de son programme électoral.
Récent et en cours:
- Podemos [22]
Rubrique:
Scandale sanitaire à Flint (Michigan): le capitalisme est un poison
- 1167 lectures
L’eau est vitale à la vie, à l’humanité. Les deux-tiers de la planète sont recouverts par l’eau. Et pourtant… l’eau potable devient une denrée rare, précieuse, y compris dans les zones urbaines les plus développées. Vivre ou survivre en buvant un simple verre d’eau n’est plus chose aisée ! Et là, point de sécheresse ou désertification climatique comme dans beaucoup de zones arides africaines ou australiennes. Non, seules les pollutions industrielles ou agricoles sont en cause.
Le scandale de l’eau polluée de Flint, une petite ville du Michigan aux États-Unis, en est le dernier exemple en date. Les faits : en 2014, pour réduire ses coûts, la municipalité de Flint, plutôt que de continuer de l’acheter à la ville de Detroit, a décidé de puiser son eau dans la rivière locale, à la qualité douteuse. Après la découverte d’une bactérie, les autorités municipales entament un traitement chimique qui finit par ronger les conduites en plomb du réseau de distribution. Pendant un an et demi, entre avril 2014 et l’automne 2015, les habitants de cette ville de 100 000 habitants majoritairement noirs et pauvres ont utilisé et consommé cette eau contaminée au plomb. Malgré les plaintes à répétition, sans résultat, 87 cas de légionellose sont constatés dont 10 mortels, des milliers d’enfants sont contaminés avec risques de dommages irréversibles sur le système nerveux.
Le scandale sanitaire qui suit contraint Barack Obama à décréter une situation d’urgence, le président affirmant lui-même, la main sur le cœur : “Si j’étais en charge d’une famille là-bas, je serais hors de moi à l’idée que la santé de mes enfants puisse être en danger”. La mobilisation politique alors déclenchée est presqu’un exemple d’unanimité ! Le gouverneur de l’État du Michigan et l’administration municipale de Flint sont accusés de négligence et d’avoir fermé les yeux sciemment pendant des mois. Les appels à la démission se multiplient, à l’image de celui lancé par l’une des figures de Flint, le réalisateur de cinéma Michael Moore : “Ce n’est pas seulement une crise de l’eau. C’est une crise raciale, une crise de la pauvreté”, lance le cinéaste, estimant qu’un tel scandale ne serait jamais arrivé dans une ville aisée et blanche du Michigan. Car Flint, ancien pôle industriel dans l’ombre de Détroit, a subi de plein fouet l’effondrement de l’industrie automobile, en particulier celles de General Motors (fondée à Flint en 1908). En un demi-siècle, Flint a perdu la moitié de ses habitants. Le taux de chômage y est aujourd’hui près de deux fois supérieur à la moyenne nationale et 40 % de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté.
Alors, ça y est : tout est dit ! Les responsables de la crise de l’eau sont trouvés : ils sont racistes et profitent de la misère des laissés-pour-compte pour faire des économies sur leur dos ! Voilà les coupables, les “méchants” !
Est-ce aussi simple ? Que ces autorités locales ou régionales portent une lourde responsabilité, c’est une évidence. En bons gestionnaires capitalistes qu’ils sont, toutes ces administrations se doivent de rentabiliser leurs comptes face à la crise. Et elles n’ont souvent pas d’états d’âme en la matière ! Mais l’État américain, comme tous les États capitalistes, s’est refait une virginité à bon compte : “Les coupables doivent être punis et la situation doit revenir à la “normale””, “Plus jamais ça !”. Ces mêmes phrases-type ont déjà été entendues à chaque scandale financier, sanitaire ou écologique dans le monde depuis des années et des années, ou même lors de tel ou tel épisode barbare, guerrier, terroriste sur l’ensemble de la planète. De Bhopal à Fukushima, en passant par le sang contaminé, l’Amoco Cadiz, l’usine AZF et des milliers d’autres épisodes, il faut toujours jeter des coupables à la vindicte pour tenter de calmer l’indignation et empêcher toute réflexion sur les causes profondes de tels scandales.
En l’occurrence, l’État américain, Obama en tête, se permet d’apparaître comme garant de la salubrité publique face à tous les margoulins ou politiques avides de profit ! Ils seraient donc les champions de la moralité et les chevaliers blancs de la qualité de vie ? On croit rêver… ou plutôt cauchemarder ! Ce sont les États qui, les premiers, réduisent les budgets de fonctionnement, les budgets sociaux, instaurent les programmes d’austérité, réduisent les populations au chômage de masse et les font tomber dans la précarité permanente. Qu’à cela ne tienne : il faut un coupable à sacrifier et surtout éviter que les États et le système capitaliste comme un tout n’en soient rendus responsables !
Cette logique cache en fait l’essentiel et c’est le but de la manœuvre : derrière chaque scandale ou catastrophe, il y a effectivement souvent la recherche du profit. Mais le principe du profit n’est pas l’apanage de tel ou tel bourgeois malintentionné ou corrompu : c’est la logique permanente d’un système aux abois, barbare, d’une classe bourgeoise qui ne vit que de la concurrence, du profit. Ce sont ses lois implacables, inhérentes du capitalisme.
Engels déclarait en 1845 déjà : “Je n’ai jamais vu une classe si profondément immorale, si incurablement pourrie et intérieurement rongée d’égoïsme que la bourgeoisie anglaise, et j’entends par là surtout la bourgeoisie proprement dite (…) Avec une telle rapacité et une telle cupidité il est impossible qu’il existe un sentiment, une idée humaine qui ne soient souillés (…) toutes les conditions de vie sont évaluées au critère du bénéfice et tout ce qui ne procure pas d’argent est idiot, irréalisable, utopique (…)” 1.
Rien n’a fondamentalement changé depuis. Au contraire. Avec la décadence du capitalisme depuis près d’un siècle, sa décomposition sur pied jour après jour, la recherche du profit pousse à la guerre de tous contre tous, au niveau planétaire comme au simple niveau local. Le capitalisme, est une catastrophe permanente. Et, pour survivre, il doit trouver à chaque épisode spectaculaire et désastreux, un responsable particulier, un bouc émissaire : un “mauvais choix politique”, un dirigeant pourri”, une “erreur humaine”, le “climat”, le “hasard”, la “folie”... Les États bourgeois, États-Unis en tête, se dédouanent ainsi à bon compte pour préserver leur monde en putréfaction.
Soyons clairs : il n’est pas question pour nous de défendre une analyse “fataliste” de l’histoire où tout serait écrit d’avance, où chaque catastrophe serait annoncée, inéluctable et banalisée. C’est même exactement l’inverse ! C’est la bourgeoisie elle-même, avec toutes ses variantes idéologiques, qui défend la “fatalité” de l’existence du monde capitaliste en nous poussant à nous y résigner ; il suffirait d’un peu plus de “bonne volonté” individuelle ou de faire confiance à un État “réellement démocratique” pour atténuer les effets de ces catastrophes inévitables, pour rendre ce “sort” plus tolérable.
Les partis de la gauche de l’appareil politique bourgeois se sont ainsi fait les champions de la “solution démocratique”. Le parti démocrate au pouvoir et les mouvances de gauche l’ont répétés à l’unisson : avec un État sincèrement à l’écoute des besoins du “peuple” tout irait pour le mieux : finis les scandales ! Finies les guerres ! Finie l’exploitation ! Mais la raison d’être de l’État est précisément la préservation des intérêts du capital, dont les profits sont à l’origine des scandales sanitaires en tout genre. Avec la “démocratie renouvelée”, la gauche capitaliste n’aspire qu’à anesthésier la classe ouvrière pour la rendre docile et renforcer son impuissance.
Le scandale de Flint, après bien d’autres, est l’occasion d’une nouvelle instrumentalisation politicienne de la part des démocrates bourgeois. Leur monde nous indigne toujours davantage et nous refusons la logique de mort au quotidien qu’ils défendent, celle des marchands et du système capitaliste qui est lui-même la catastrophe permanente. C’est bien ce système qui doit être renversé, radicalement, à l’échelle mondiale. Malgré les préjugés et des apparences contraires, les difficultés et le sentiment d’impuissance qui domine, la classe laborieuse, comme le disait Engels, reste la seule classe sociale apte à le faire. L’affirmation de la force collective internationale du prolétariat a en effet fait la preuve par l’histoire qu’elle pouvait renverser l’ordre établi et s’attaquer à la dictature du capital.
Stopio, 21 février 2016
1 La situation de la classe laborieuse en Angleterre.
Géographique:
- Etats-Unis [23]
Récent et en cours:
- Ecologie [3]
Révolution Internationale n°458 - mai juin 2016
- 1045 lectures
Quelle est la véritable nature du mouvement Nuit debout ?
- 3109 lectures
Rassemblant chaque soir quelques milliers de participants, notamment place de la République à Paris, le mouvement “Nuit debout” fait la Une de l’actualité depuis le 31 mars. S’y réunissent des personnes de tous horizons, des lycéens et des étudiants, des précaires et des travailleurs, des chômeurs et des retraités, dont le point commun est l’envie d’être ensemble, de discuter, de se serrer les coudes contre les adversités de ce système... La sincérité de nombreux participants est indéniable ; les injustices les indignent et ils aspirent au fond à un autre monde, plus solidaire et plus humain. Pourtant, Nuit debout ne développera en rien leur combat et leur conscience. Au contraire, ce mouvement les conduit dans l’impasse et renforce les visions les plus conformistes qui soient. Pire, Nuit debout permet même à des idées nauséabondes, telle la personnalisation des maux de la société sur quelques représentants du système (les banquiers, l’oligarchie...), de s’épanouir sans complexe. Nuit debout ne va ainsi pas seulement égarer tous ceux qui y participent sincèrement, mais représente dès à présent un nouveau coup porté par la bourgeoisie à la conscience de toute la classe ouvrière.
Gouvernement socialiste et syndicats, main dans la main contre la classe ouvrière
Le projet de la loi Travail symbolise à lui seul la nature bourgeoise et anti-ouvrière du Parti socialiste. Cette réforme, qui implique une très forte dégradation des conditions de vie, cherche à diviser toujours plus les salariés en les mettant en concurrence les uns contre les autres. Ce qui fonde ce projet, c’est la généralisation de la négociation “boîte par boîte”, pour la durée de travail, la rémunération, les licenciements…
Pour accompagner l’acceptation de cette nouvelle loi, les syndicats ont joué leur rôle habituel : ils ont crié au scandale, exigé la modification ou le retrait de certaines parties du texte initial et prétendu “faire pression” sur le gouvernement socialiste par l’organisation de multiples journées d’actions et de manifestations. Ces défilés syndicaux qui consistent à battre le pavé les uns derrière les autres, au bruit de la sono et de slogans rabâchés ad nauseam (“Les travailleurs sont dans la rue, El Khomri, t’es foutue”, “Grève, grève, grève générale ! Grève, grève, grève générale !”, etc.), sans pouvoir débattre et construire quoi que ce soit ensemble, n’ont pour seul effet que de démoraliser et véhiculer un sentiment d’impuissance.
En 2010 et 2011, face à la réforme des retraites, ces mêmes journées d’action syndicale s’étaient succédées les unes aux autres durant des mois, rassemblant souvent plusieurs millions de personnes, pour finalement laisser passer l’attaque et, pire, entraîner un épuisement moral qui pèse encore aujourd’hui très fortement sur toute la classe ouvrière.
Il y a en revanche aujourd’hui une différence notable par rapport aux mouvements 2010 et 2011 : le phénomène Nuit debout, qui bénéficie d’une couverture médiatique et politique d’une ampleur et d’une bienveillance rares pour un mouvement prétendument social et contestataire.
Nuit debout, un mouvement plébiscité par... la bourgeoisie
“Nuit debout : le camp des possibles” ou “Nuit debout, ranimons l’imaginaire citoyen” titre le journal Libération pour qui “Peu importe l’issue politique du mouvement Nuit debout... Et si, sur les places publiques et ailleurs, se fabriquait de manière balbutiante une politique plus digne et quotidienne ?”. Ce soutien est d’ailleurs aussi vrai à l’échelle internationale. De très nombreux médias à travers le monde font une véritable publicité aux assemblées générales de Nuit debout qui réinventeraient, selon eux, la politique et le monde. Certains hommes politiques de gauche et d’extrême-gauche, dont beaucoup sont allés y pointer le bout de leur nez, sont également dithyrambiques. Jean-Luc Mélenchon, cofondateur du Parti de gauche, s’est réjoui de ce rassemblement tout comme le secrétaire national du Parti communiste français, Pierre Laurent. Pour Julien Bayou (EELV), Nuit debout “est un exercice de démocratie radicalisée en temps réel”. Même Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate à la primaire de la droite, entend sur la place des slogans “intéressants”, comme, par exemple : “Nous ne sommes pas seulement des électeurs, nous sommes aussi des citoyens”. Le Président de la République en personne, François Hollande, y est allé de son petit salut : “Je trouve légitime que la jeunesse, aujourd’hui par rapport au monde tel qu’il est, même par rapport à la politique telle qu’elle est, veuille s’exprimer, veuille dire son mot. (…) Je ne vais pas me plaindre qu’une partie de la jeunesse veuille inventer le monde de demain...” Même son de cloche à l’international : “Ces mouvements sont des étincelles magnifiques au milieu d’un ciel obscur” pour Yanis Varoufakis, l’ancien ministre grec des Finances.
Réformisme et démocratisme, les deux piliers idéologiques des Nuits debout
Que valent autant d’éloges de la part d’une partie des grands médias internationaux et des hommes politiques ? La réponse se trouve dans les deux textes fondateurs du mouvement. Le tract distribué par le collectif Convergence des luttes lors de la manifestation du 31 mars à Paris et qui a lancé le premier rassemblement sur la Place de la République affirme : “Nos gouvernants sont murés dans l’obsession de perpétuer un système à bout de souffle, au prix de “réformes” de plus en plus rétrogrades et toujours conformes à la logique du néolibéralisme à l’œuvre depuis 30 ans : tous les pouvoirs aux actionnaires et aux patrons, à ces privilégiés qui accaparent les richesses collectives. Ce système nous est imposé, gouvernement après gouvernement, au prix de multiples formes de déni de démocratie...”. Le manifeste est du même tonneau : “L’humain devrait être au cœur des préoccupations de nos dirigeants...”
L’orientation est très claire : il s’agit d’organiser un mouvement pour faire “pression” sur les “dirigeants” et les institutions étatiques afin de promouvoir un capitalisme plus démocratique et plus humain. C’est effectivement cette politique qui imprime de son sceau l’ensemble de la vie de Nuit debout. Il suffit d’observer les actions qui sortent du travail des commissions et des assemblées : “Apéro chez Valls” (quelques centaines de manifestants ont essayé d’aller prendre l’apéro chez le Premier ministre le 9 avril), manifestation vers l’Élysée (le 14 avril, à la suite d’une émission de télévision à laquelle participait François Hollande), occupation d’une agence BNP Paribas à Toulouse, pique-nique dans un hypermarché grenoblois, perturbation de la tenue du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et des conseils municipaux de Clermont-Ferrand et de Poitiers, établissement d’une ZAD à Montpellier, occupation d’un MacDonald’s à Toulouse, tags sur les vitrines des banques, dépôt de poubelles devant les portes de certaines mairies de Paris, etc.
Les propositions les plus populaires lors des assemblées générales parisiennes sont toutes aussi révélatrices de cette orientation politique d’espérer quelques aménagements superficiels ou faussement radicaux du système capitalistes : manifeste pour une “démocratie écologique”, salaire à vie, revenu de base, baisse des hauts revenus, plein emploi, développement de l’agriculture biologique, meilleure reconnaissance des minorités, démocratie par tirage au sort, meilleur engagement de l’État pour l’enseignement scolaire, notamment en banlieue, prix libre, partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, etc.
Face aux syndicats, Marx écrivait déjà en 1865 dans Salaire, prix et profit : “Il leur faut effacer cette devise conservatrice ‘Un salaire équitable pour une journée équitable’, et inscrire le mot d’ordre révolutionnaire ‘Abolition du salariat !”. C’est précisément cette logique révolutionnaire à laquelle ceux qui tirent les ficelles dans l’ombre du mouvement Nuit debout tournent volontairement le dos, engageant ceux qui s’y laissent prendre, en particulier dans les rangs des jeunes générations qui se posent des questions sur cette société, sur un terrain pourri : celui du réformisme et des urnes.
La plus emblématique des revendications est sans nul doute la volonté de faire pression pour une nouvelle Constitution établissant une “République sociale”. Ainsi selon l’économiste Frédéric Lordon, l’un des initiateurs de Nuit debout : “Le premier temps de la réappropriation, c’est bien la réécriture d’une Constitution (...). Qu’est-ce que la république sociale ? C’est la prise au sérieux de l’idée démocratique posée en toute généralité par 1789...” .
Tout est dit. L’objectif central de ceux qui ont lancé Nuit debout c’est de réaliser une “vraie démocratie” telle que la Révolution française de 1789 l’avait promis ; seulement ce qu’il y avait de révolutionnaire il y a de deux siècles et demi, à savoir instaurer le pouvoir politique de la bourgeoisie en France, dépasser le féodalisme par le développement du capitalisme, bâtir une nation... tout cela est aujourd’hui devenu irrémédiablement réactionnaire. Ce système d’exploitation est décadent, il ne s’agit plus de l’améliorer, car cela est devenu impossible, mais de le dépasser, de le mettre à bas par une révolution prolétarienne internationale. Ainsi, est semée l’illusion que l’État est un agent “neutre” de la société sur lequel il faudrait “faire pression” ou qu’il faudrait protéger des “actionnaires”, des “politiciens corrompus”, des “banquiers cupides”, de “l’oligarchie”. Alors qu’en réalité, l’État est le plus haut représentant de la classe dominante, le pire ennemi des exploités.
Surtout, il ne faudrait pas sous-estimer le danger que représente la focalisation sur les “banquiers”, “les actionnaires”, les “politiciens corrompus”. Ce procédé consistant à accuser telle ou telle fraction, telle ou telle personne à la place du système d’exploitation comme un tout n’a pas d’autre signification que la préservation des rapports sociaux capitalistes. Il remplace ainsi la lutte de classe, la lutte contre le capitalisme et pour un autre monde, par une haine ciblée et dirigée contre les personnes qu’il suffirait d’écarter du pouvoir pour que tous les maux de la société s’évanouissent comme par enchantement (1.
Nuit debout, l’anti-Indignados
Nuit debout prétend reprendre le flambeau des mouvements de 2006 et 2011. Mais en réalité, il vise à travestir leur mémoire en déformant totalement ce qui avait fait la force du mouvement contre le CPE et celui des Indignados, en prônant la discussion citoyenniste et républicaine, en focalisant la réflexion sur comment rendre le capitalisme plus humain et plus démocratique.
En 2006 en France, les étudiants précaires ont débattu dans de véritables assemblées générales souveraines qui ont libéré la parole. Ils ont aussi eu le souci d’élargir le mouvement aux travailleurs, aux retraités 2 et aux chômeurs, d’abord en leur ouvrant leurs AG, en mettant en avant des revendications larges dépassant le simple cadre du CPE 3 et en laissant de côté toutes les requêtes spécifiquement estudiantines. Cinq ans plus tard, en 2011, c’est en Espagne avec le mouvement des Indignados, aux États-Unis et en Israël avec celui des Occupy, qu’à nouveau s’est fait jour le besoin vital de se rassembler et de discuter des maux de ce monde capitaliste qui nous impose sa dictature faite d’exploitation, d’exclusion et de souffrances. Cette fois, les assemblées n’eurent pas lieu dans des amphithéâtres mais dans la rue et sur les places 4.
Lors du mouvement des Indignados en Espagne, dans un contexte différent, les mêmes ficelles avaient été tirées qu’aujourd’hui avec Nuit debout. Les altermondialistes de la DRY (Démocratie réelle maintenant), et donc d’Attac, s’étaient dissimulés sous le masque de “l’apolitisme” pour mieux saboter toute possibilité de réelle discussion. Là-aussi, ils avaient focalisé toutes les énergies sur la “vie des commissions” au détriment des débats en assemblées générales et sur les “bons choix” à faire “dans les urnes” (Podemos étant l’aboutissement de cette démarche). Mais le mouvement social était alors un peu plus profond. De nombreux manifestants avaient eu la force politique de tenter de prendre l’organisation de la lutte en main ; et de véritables assemblées générales, avec débat et réflexion sur la société, s’étaient tenus en parallèle à celles de DRY avec un black-out complet des médias. Voici ce que nous écrivions alors : “Le dimanche 22, jour d’élections, a lieu une nouvelle tentative d’en finir avec les assemblées. DRY proclame que “les objectifs sont atteints” et que le mouvement doit s’achever. La riposte est unanime : “Nous ne sommes pas ici pour les élections !” Lundi 23 et mardi 24, tant en nombre de participants que par la richesse des débats, les assemblées atteignent leur point culminant. Les interventions, les mots d’ordre, les pancartes prolifèrent qui démontrent une profonde réflexion : “Où se trouve la gauche ? Au fond à droite !”, “Les urnes ne peuvent contenir nos rêves !”, “600 euros par mois, ça c’est de la violence !”, “Si vous ne nous laissez pas rêver, nous vous empêcheront de dormir !”, “Sans travail, sans logement, sans peur !”, “Ils ont trompé nos grands-parents, ils ont trompé nos enfants, qu’ils ne trompent pas nos petits-enfants !”. Ils démontrent aussi une conscience des perspectives : “Nous sommes le futur, le capitalisme c’est le passé !”, “Tout le pouvoir aux assemblées !”, “Il n’y a pas d’évolution sans révolution !”, “Le futur commence maintenant !”, “Tu crois encore que c’est une utopie ?” (…) Cependant, c’est surtout la manifestation à Madrid qui exprime le virage du 19 juin vers la perspective du futur. Elle est convoquée par un organisme directement lié à la classe ouvrière et né de ses minorités les plus actives. Le thème de ce rassemblement est “Marchons ensemble contre la crise et contre le capital”. Les revendications sont : “Non aux réductions de salaires et des pensions ; pour lutter contre le chômage : la lutte ouvrière, contre l’augmentation des prix, pour l’augmentation des salaires, pour l’augmentation des impôts de ceux qui gagnent le plus, en défense des services publics, contre les privatisations de la santé, de l’éducation... Vive l’unité de la classe ouvrière !”” 5.
Nous ne partageons pas chaque revendication des Indignados. Des faiblesses, des illusions sur la démocratie bourgeoise étaient également très présentes ; mais la dynamique du mouvement était animée par un souffle prolétarien, une critique profonde du système, de l’État, des élections, un combat contre les organisations de gauche et d’extrême-gauche qui déployaient toutes leurs forces politiques pour limiter la réflexion et la rabattre dans les limites de ce qui est acceptable par le capitalisme.
La faiblesse actuelle de notre classe n’a pas permis que se dégage une telle critique prolétarienne de Nuit debout ni donc de faire fructifier l’envie d’être ensemble, de se solidariser et de débattre qui pouvait animer une partie des participants. Surtout, la bourgeoisie a tiré les leçons des mouvements précédents, elle a beaucoup mieux préparé le terrain et l’encadrement, consciente de ses capacités de manœuvre compte-tenu de l’état de faiblesse actuelle du prolétariat. Aujourd’hui, ce sont ainsi Attac, le NPA, le Front de gauche et tous les adeptes du réformisme et d’une prétendue “vraie démocratie”, qui restent les maîtres d’œuvre des Nuits debout et qui profitent du déboussolement et du manque de perspective comme de l’incapacité des prolétaires à se reconnaître comme classe et à identifier leur intérêts de classe pour occuper le terrain social. Ces groupes agissent en réalité comme expression et force d’appoint du capitalisme.
La véritable nature de Nuit debout
Il faut être clair : Nuit debout n’a rien de spontané. C’est un mouvement mûrement réfléchi, préparé et organisé de longue date par des animateurs et défenseurs radicaux du capitalisme. Derrière ce mouvement prétendument “spontané” et “apolitique” se cachent des professionnels, des groupes de gauche et d’extrême-gauche qui mettent en avant “l’apolitisme” pour mieux contrôler le mouvement en coulisses. D’ailleurs, l’appel du 31 mars avait déjà pour le premier soir une dimension d’emblée professionnelle : “Au programme : animation, restauration, concerts, partage d’informations, Assemblée citoyenne permanente et plein de surprises”.
L’origine de Nuit debout est une rencontre publique organisée à la Bourse du travail de Paris, le 23 février 2016. Cette rencontre, baptisée : Leur faire peur, est motivée par les réactions enthousiastes du public au film de François Ruffin, Merci Patron !. La décision est prise d’occuper la Place de la République à l’issue de la manifestation du 31 mars. “Le collectif “de pilotage”, une quinzaine de personnes, réunit : Johanna Silva du journal Fakir, Loïc Canitrot, intermittent de la compagnie Jolie Môme, Leila Chaibi du Collectif Jeudi noir et adhérente du Parti de gauche, une syndicaliste d’Air France également au PG, un membre de l’association Les Engraineurs, ou encore un étudiant à Sciences Po, l’économiste atterré Thomas Coutrot et Nicolas Galepides de Sud-PTT (…). L’association Droit au logement offre son aide, notamment juridique et pratique, l’organisation altermondialiste Attac et l’union syndicale Solidaires se joignent également au collectif. C’est l’économiste Frédéric Lordon qui est sollicité par le collectif d’initiative pour ouvrir cette première nuit parisienne du 31 mars. [Son idée :] “Pour la république sociale”, (...) trouvera un écho dans les ateliers de réflexion sur l’écriture d’une nouvelle Constitution (Paris, Lyon...)”. Ces quelques lignes extraites de Wikipédia révèlent à quel point toutes les forces politiques officielles, syndicales et associatives de la gauche ont contribué à préparer en amont puis à prendre en charge le mouvement Nuit debout.
En particulier, qui est François Ruffin ? Rédacteur en chef du journal gauchiste Fakir, il est un proche du Front de gauche et de la CGT. Son objectif est de faire “pression sur l’État et ses représentants” ou, pour reprendre ses propres mots, “leur faire peur” (sic). Pour qu’un mouvement réussisse, selon lui, il faut que “le combat dans les rues et l’expression dans les urnes convergent”, comme en 1936 et “même en 1981”. C’est oublier volontairement un peu vite que 1936 a préparé l’embrigadement de la classe ouvrière dans la Seconde Guerre mondiale ; quant à 1981, ce prétendu “mouvement social” a permis au Parti socialiste d’arriver au pouvoir pour mener l’une des politiques les plus efficacement anti-ouvrières de ces dernières décennies ! Voilà la coulisse de Nuit debout : une entreprise grandement destinée à faire croire à tous ses participants de bonne foi et plein d’espoirs qu’ils luttent de manière efficace et radicale pour mieux les diriger vers les urnes et l’illusion que la société capitaliste peut-être plus humaine si on vote pour les “bons partis” 6.
Cette initiative de la gauche du PS et de l’extrême-gauche arrive à un moment extrêmement opportun pour la bourgeoisie : à un an des élections présidentielles, alors que le PS est très largement discrédité. Ce qui se joue à court et moyen terme, c’est en grande partie la capacité de la bourgeoisie à dégager une nouvelle gauche crédible devant la classe ouvrière, une gauche “radicale, alternative et démocratique”. Cette même dynamique se joue d’ailleurs de manière assez semblable dans de nombreux pays, avec Podemos en Espagne et Sanders aux États-Unis, par exemple. Il n’est pas du tout certain que cette partie de la manœuvre, son versant électoraliste, aboutisse à un succès pour la bourgeoisie, c’est-à-dire à une mobilisation dans les urnes, car la classe ouvrière est très profondément dégoûtée par l’ensemble des partis politiques. De même, la tentative de François Ruffin de rabattre les participants de Nuit debout vers les syndicats 7, en particulier la CGT, a jusque-là été un échec. Par contre, l’idéologie véhiculée par ce mouvement, le citoyennisme, qui dilue encore un peu plus l’identité de classe du prolétariat et la personnalisation au lieu du combat contre le système capitaliste, est un poison particulièrement efficace et dangereux pour l’avenir.
Nuit debout, plus encore qu’une énième manœuvre des forces de gauche et d’extrême-gauche de la bourgeoise, est le symbole des très grandes difficultés actuelles des ouvriers à se reconnaître comme une classe, comme une force sociale porteuse d’un avenir pour l’ensemble de l’humanité. Et ces difficultés ne sont pas ponctuelles : elles s’inscrivent dans un processus profond et historique de la société. Les graines plantées par des mouvements comme la lutte contre le CPE ou les Indignados qui ont été des expressions de besoins réels du prolétariat pour développer son combat sont aujourd’hui comme endormies dans un sol gelé. Quant aux mouvements plus anciens, ceux de la Commune de Paris ou de la révolution d’Octobre 1917, ils sont ensevelis pour l’instant sous des tonnes de mensonges et d’oublis.
Mais si l’atmosphère sociale se réchauffait, sous les coups de boutoir de la crise et de l’aggravation inévitable des attaques contre toutes nos conditions d’existence, alors quelques fleurs pourraient germer. Cette confiance en l’avenir se fonde sur la conscience que le prolétariat est une classe historique qui porte toujours en elle cet autre monde, libéré des rapports d’exploitation, nécessaire et possible pour l’humanité.
Germain, 15 mai 2016
1) Cette dénonciation de l’oligarchie est d’ailleurs très proche de la focalisation sur l’Establishment par Donald Trump aux États-Unis. Si les apparences sont différentes, il s’agit en réalité du même fond idéologique, celui de la personnalisation.
2) “Vieux croûtons, jeunes lardons, la même salade !” était l’une des pancartes ayant le plus grand succès.
3) À propos du CPE, lire sur notre site : “Salut aux jeunes générations de la classe ouvrière !”
4) Lire sur notre site notre : “Dossier spécial sur le mouvement des Indignés et des Occupy”.
5) Extraits de notre article publié sur le web : “La mobilisation des indignés en Espagne et ses répercussions dans le monde : un mouvement porteur d’avenir”.
6) Pour mieux comprendre la pensée de François Ruffin et les origines de Nuit debout, lire notre article dans ce même journal sur le film : Merci patron !.
7) “Je souhaite qu’on fasse un très gros 1er Mai, que la manifestation se termine à République et qu’on fasse un meeting avec les syndicats qui sont opposés à la loi travail.”
Géographique:
- France [4]
Récent et en cours:
- Nuit debout [26]
Rubrique:
Le terrorisme, un instrument de la guerre impérialiste et contre la lutte de classe
- 1470 lectures
Il se peut que les récentes attaques terroristes en France et en Belgique sont une expression des difficultés rencontrées par l’État islamique dans la guerre en Irak et en Syrie, mais les attaques meurtrières soudaines sur la population des pays centraux du capitalisme sont rapidement en train de devenir une réalité quotidienne, tout comme elles le sont depuis plusieurs années en Syrie, en Irak, au Pakistan, en Afghanistan, en Turquie, en Libye, au Nigeria, en Somalie, au Soudan et dans de nombreux autres pays pris dans la zone de guerre aujourd’hui en expansion. En somme, les terroristes ont “rapporté la guerre à la maison”, et même si Daech est en train d’être militairement affaibli dans l’aire de son “Califat”, il existe de nombreux signes montrant que l’influence de ce groupe ou d’autres similaires se répand en Afrique et ailleurs. C’est parce que les conditions qui engendrent le terrorisme moderne continuent de mûrir. Tout comme Al-Qaïda fut poussé à l’arrière-plan en tant qu’ “ennemi no 1” avec la montée de l’EI, de nouveaux gangs peuvent émerger, et pas nécessairement islamistes : il semblerait que les deux plus récentes atrocités commises en Turquie aient été réalisées par une tendance ou une ramification du “Parti des travailleurs du Kurdistan”.
Nous vivons dans une civilisation, le mode de production capitaliste, qui depuis longtemps a cessé d’être un facteur de progrès pour l’humanité, ses idéaux les plus élevés se sont révélés être complètement dégénérés et corrompus. Dès 1871, à la suite de la Commune de Paris, Marx nota la coopération des grands rivaux nationaux, la France et la Prusse, dans l’écrasement du soulèvement des exploités, et prédit qu’à l’avenir l’appel à la “guerre nationale” ne deviendrait rien de plus qu’une excuse hypocrite pour l’agression et le vol, en tout cas dans les zones capitalistes avancées. En 1915, dans sa Brochure de Junius, Rosa Luxemburg soutint que désormais, sur une planète dominée par d’immenses puissances impérialistes, la guerre nationale n’était partout qu’une couverture pour les appétits impérialistes. Les guerres mondiales et les conflits entre superpuissances qui dominèrent le xxe siècle lui ont donné entièrement raison.
Et depuis l’effondrement des blocs à la fin des années 1980, la guerre, l’expression la plus manifeste de la compétition et de la crise capitalistes, est devenue de plus en plus irrationnelle et chaotique, une situation soulignée par le carnage en Syrie, qui est en train d’être réduite à l’état de décombres par une foule d’armées et de milices qui à la fois se font la guerre entre elles et se disputent le soutien des nombreux vautours impérialistes survolant la région (les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, l’Iran, l’Arabie saoudite...).
L’idéologie irrationnelle de l’État islamique est un clair produit de cette folie généralisée. Dans la période des blocs, l’opposition aux puissances impérialistes dominantes avait tendance à employer des formes plus classiques de nationalisme : l’idéologie de “libération nationale” dans laquelle le but était de développer de nouveaux États nations “indépendants”, souvent accompagnée d’un zeste de verbiage “socialiste” lié au soutien des impérialismes russe ou chinois. Dans une période où non seulement les blocs mais aussi les entités nationales elles-mêmes se fragmentent, le pseudo-universalisme de l’État islamique suscite un attrait plus étendu ; mais par-dessus tout, dans une période de l’histoire qui porte constamment la menace d’une fin de l’humanité, d’un effondrement dans la barbarie sous le poids de la guerre et des crises économique et écologique, une idéologie de l’apocalypse, du sacrifice de soi et du martyre, devient un véritable appât pour les éléments les plus marginalisés et brutalisés de la société bourgeoise. Ce n’est pas par hasard si la plupart du personnel recruté pour les attaques en France et en Belgique vient des rangs des petits délinquants qui ont pris le chemin du suicide et du massacre de masse.
Terrorisme et guerre impérialiste
Le terrorisme a toujours été une arme du désespoir, particulièrement des couches de la société qui souffrent de l’oppression de la société capitaliste et qui n’ont aucun avenir en son sein, du petit-bourgeois ruiné par le triomphe du grand capital. Mais le terrorisme du xixe siècle visait habituellement les symboles du vieux régime, les monarques et autres chefs d’État et ciblait rarement les rassemblements de citoyens ordinaires. Les terroristes d’aujourd’hui semblent essayer de se surpasser mutuellement en cruauté. La faction talibane qui a mené l’attaque le jour de Pâques dans un parc de Lahore au Pakistan a déclaré qu’elle “visait les chrétiens”. En réalité, elle visait une aire de jeux d’enfants. Pas seulement des chrétiens, mais des enfants chrétiens. Et peu importe finalement à ces vaillants apôtres de la Vraie Foi que la majorité des tués aient été de toutes façons musulmans. À Paris, des personnes aimant écouter de la musique rock, danser et prendre un verre ont été considérées comme méritant la mort dans le communiqué de l’EI glorifiant les attaques. Mais même ces putrides justifications “religieuses” ne peuvent être poussées bien loin. Frapper un métro ou un aéroport vise d’abord et avant tout à tuer un maximum de personnes. Le terrorisme aujourd’hui, de manière écrasante, n’est plus en rien l’expression d’une classe opprimée, bien que non-révolutionnaire, dans sa résistance contre le capitalisme. C’est un instrument pur et simple de la guerre impérialiste, d’un combat à mort entre régimes capitalistes.
Il est parfois affirmé, pour justifier les attaques-suicides perpétrées par des Palestiniens en Israël, par exemple, que la ceinture d’explosifs est le drone ou le bombardier du pauvre. Ceci est vrai uniquement si l’on reconnaît que le “pauvre” recruté pour la cause de Daech ou du Hamas ne combat pas en réalité pour les pauvres mais pour un groupe rival d’exploiteurs en état d’infériorité impérialiste, que ce soit un proto-État local ou de plus grandes puissances impérialistes qui les arment et les couvrent diplomatiquement ou idéologiquement. Et qu’il soit mené par des groupes semi-indépendants comme Daech, ou directement par les services secrets de pays comme la Syrie et l’Iran (comme ce fut le cas de nombre d’attaques sur des cibles européennes dans les années 1980), le terrorisme est devenu un complément utile de la politique étrangère de tout État ou aspirant à le devenir, essayant de se tailler un créneau sur l’arène mondiale.
Cela ne signifie pas que des actes de terrorisme ne sont pas également utilisés par des États plus respectables : les services secrets de pays démocratiques comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, sans oublier Israël, bien sûr, ont une longue tradition d’assassinats ciblés et même d’opérations sous fausse bannière, sous l’apparence de factions ouvertement terroristes. Mais retournons à la comparaison entre la ceinture d’explosifs et le chasseur-bombardier sophistiqué. Il est vrai que le modèle pour les terroristes est moins la liquidation habile de tel ou tel individu gênant par la CIA ou le Mossad que l’effarant pouvoir de destruction des canons et des avions d’armées établies, des armes qui peuvent pulvériser des villes entières en l’espace de quelques jours. La logique de la guerre impérialiste est le massacre systématique de populations entières ; et c’est quelque chose qui s’est visiblement accéléré ces cent dernières années, de la Première Guerre mondiale et ses combats principalement entre armées sur le champ de bataille, en passant par le nombre immense de civils arrosés de bombes ou exterminés dans les camps de la mort durant la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à la potentielle menace d’annihilation du genre humain tout entier.
“Vos armées tuent nos enfants avec vos avions, nous vous rendons donc la monnaie de votre pièce en tuant vos enfants avec nos bombes”. C’est la justification des terroristes fréquemment entendue sur leurs vidéos antérieures ou postérieures à leurs atrocités. Encore une fois, ceci montre à quel point ils suivent fidèlement l’idéologie de l’impérialisme. Loin de s’en prendre aux réels responsables de la guerre et de la barbarie, la petite classe d’exploiteurs et leurs systèmes étatiques, leur haine est dirigée vers des populations entières de vastes régions du globe, qui deviennent toutes des cibles légitimes, et ils jouent ainsi leur rôle dans le renforcement de la fausse unité entre exploiteurs et exploités qui empêche tout ce système pourri de craquer. Et cette attitude consistant à diaboliser des pans entiers de l’humanité est en pleine adéquation avec la déshumanisation de groupes particuliers qui peuvent ensuite faire l’objet de pogroms et d’attentats à la bombe dans des zones d’opérations plus courantes : les hérétiques chiites, les chrétiens, les yazidis, les juifs, les Kurdes, les Turcs...
Cette idéologie de vengeance et de haine résonne le plus souvent dans le discours de la droite en Europe et en Amérique, qui tend aujourd’hui à voir tous les musulmans et l’islam lui-même comme représentant la vraie menace pour la paix et la sécurité, désigne chaque réfugié des zones déchirées par la guerre comme une potentielle “taupe” terroriste, justifiant ainsi les mesures les plus impitoyables d’expulsion et de répression à leur encontre. Cette sorte de bouc-émissarisation est un autre moyen de masquer les réels antagonismes de classes dans cette société : le capitalisme est en crise profonde et insoluble, mais ne cherchez pas à savoir comment le capitalisme fonctionne au bénéfice de quelques-uns et pour le malheur du plus grand nombre, faites porter le chapeau à une partie du plus grand nombre, pour l’empêcher ainsi de s’unir contre les quelques-uns. C’est un stratagème très ancien, mais la montée du populisme en Europe et en Amérique nous rappelle qu’il ne faut jamais le sous-estimer.
L’État démocratique n’est pas notre ami
Mais l’expansion du terrorisme, de l’islamisme radical et de ses images en miroir islamophobe et populiste ne devraient pas nous masquer une autre vérité très importante : dans les pays du centre du capitalisme, la principale force de conservation du système est l’État démocratique. Et tout comme l’État démocratique ne répugne pas à utiliser des méthodes terroristes, directement ou indirectement, dans sa politique étrangère, il utilisera chaque attaque terroriste pour renforcer tous ses pouvoirs de contrôle social et de répression politique. En Belgique, dans les jours suivant les attaques de Bruxelles, les pouvoirs policiers de l’État ont été considérablement renforcés : une nouvelle loi a été mise en place, augmentant la possibilité de descentes de police et d’écoutes téléphoniques, introduisant un suivi plus rapproché des financements “douteux”. Comme toujours, il y a eu une présence particulièrement ostensible de la police et de l’armée dans les rues. Des leçons ont été tirées de l’attaque contre Charlie hebdo à Paris qui a initialement donné lieu à des rassemblements spontanés exprimant la colère et l’indignation, requérant un effort majeur des médias et des politiciens pour être sûrs que tout ceci serait contenu dans le cadre de l’unité nationale. Cette fois, il y a eu des appels clairs de la police pour que les gens restent chez eux. En somme, faisons confiance à l’État démocratique, la seule force qui puisse nous protéger contre cette horrible menace. Les médias, pendant ce temps, poussaient la population à s’habituer à cette nouvelle et quotidienne ambiance de peur. Bien sûr, il y a eu un grand débat sur l’apparente incompétence des services de sécurité belges, qui ont ignoré un certain nombre d’indices avant les attaques. Mais le résultat final des investigations sur de telles carences sera de trouver des moyens d’améliorer la surveillance et le contrôle de la population entière.
Accroître les pouvoirs de l’État policier peut être utilisé contre la population, et la classe ouvrière en particulier, face à toute future explosion sociale provoquée par la crise du système, tout comme les lois contre les groupes terroristes qui “méprisent la démocratie” peuvent être utilisées contre des groupes politiques authentiquement révolutionnaires qui mettent en question l’ensemble du système capitaliste. Mais par-dessus tout, de la même manière que les idéologies islamiste et/ou nationaliste des terroristes servent à enterrer les réels conflits de classes dans tous les pays, l’appel à l’unité nationale derrière l’État démocratique sert à empêcher les exploités et les opprimés de n’importe quel pays de reconnaître que leur seul avenir réside dans la solidarité avec leurs frères et sœurs de classe à travers le monde, et dans la lutte commune contre un ordre capitaliste en pleine putréfaction.
D’après WR, organe de presse
du CCI au Royaume-Uni
Récent et en cours:
- Terrorisme [8]
Rubrique:
Scandale des abattoirs : le capitalisme détruit et méprise la vie
- 1629 lectures
Il y a plus d’un mois, des vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux montrant des comportements d’une cruauté sans nom au sein de certains abattoirs français. L’association L214 Éthique & Animaux a filmé en caméra cachée et diffusé sa vidéo montrant comment sont traités les animaux d’un abattoir près de Pau. Cette vidéo a été reprise par les réseaux sociaux et les principaux médias dès le 29 mars. Le traitement infligé aux animaux, les atrocités et sévices commis parfois directement par les employés sont insoutenables. Le personnel découpe les animaux encore vivants, les assommant parfois à coups de crochet. Certains poussent des animaux en leur assénant des coups d’aiguillon électrique sur la tête, on voit même un agneau écartelé vivant, pris entre deux crochets en l’absence de l’opérateur. Ce sont des images analogues qui avaient poussé à la fermeture de l’abattoir d’Alès en octobre 2015 et à sa suite l’abattoir du Vigan en février 2016.
Une telle banalisation de pratiques barbares ne saurait signifier qu’elles sont la simple conséquence du sadisme ou du manque de scrupule du personnel. Soumis à des cadences mécanisées infernales, poussés par la rentabilité dans un contexte ultra-concurrentiel, par la compression des effectifs, leurs gestes sont par nécessité expéditifs, provoquant des souffrances inimaginables aux animaux, mais aussi, d’une certaine manière, aux hommes qui doivent les abattre. Cette situation oblige en effet les personnels à se forger une carapace, à la désensibilisation forcée. La bestialité du personnel est avant tout celle du système capitaliste, celle de son pouvoir totalitaire. Les actes de sauvagerie, les plaisanteries et les rires d’employés qui les accompagnent parfois, en apparence totalement assumés, sont autant de mécanismes de défense face à des tâches quotidiennes institutionnalisées et imposées par la logique meurtrière du capital.
Au-delà des pratiques dénoncées, assez courantes, nous devons comprendre que la marque de fabrique de cette société capitaliste est la standardisation, la transformation par la violence de la qualité en quantité. Dans quel but ? La rentabilité, le sacrifice de la nature et de l’homme lui-même à cette seule fin. Tout ce qui ose résister à la quantification est éliminé, méticuleusement disqualifié et exclu.
La concurrence pousse aux élevages en batteries, à des complexes hors sol, au mépris des animaux sauvagement engraissés et bourrés d’antibiotiques 1. Les animaux sont systématiquement transformés en usine à viande, en véritable monstres. Les bovins des feed-lots (parcs d’engraissement), par exemple, sont non seulement entassés en masse dans des espaces ultra-réduits, mais déformés physiquement au point de présenter une hypertrophie musculaire. Les vaches laitières ont une espérance de vie très réduite du fait des traites intensives, cela, alors que la surproduction pousse en même temps les éleveurs en colère à épandre leur lait invendu dans les champs ! Les pollutions de ces élevages massifs sont un des fléaux majeurs, les animaux baignant dans leurs déjections avec des risques de maladies accrus.
Les mêmes méthodes d’élevages sont utilisées lors de la sélection des canards ou des oies pour la production du foie gras. On inflige à ces animaux des souffrances terribles et souvent inutiles. D’abord, on sélectionne les mâles car leur foie grossit plus vite et on demande au personnel de jeter les femelles dans des broyeurs pour les tuer. Certaines agonisent lentement dans des bacs mouroir. Le gavage lui-même “occasionne des lésions, des inflammations (œsophagites, entérites), et des infections (notamment des candidoses et des infections bactériennes)” 2. On pourrait continuer ainsi la description de cruautés tout aussi scandaleuses, par exemple sur les porcs ou les animaux domestiques. Mais il est clair que la réalité de cette violence ne se limite en rien aux actes sur les animaux. Elle ne fait que parachever une logique d’uniformisation industrielle totalitaire pour laquelle les animaux sont réduits à des marchandises, tout comme les producteurs à de la force de travail échangeable.
L’association déjà évoquée milite surtout pour l’application de l’article L 214 du Code rural reconnaissant les animaux comme êtres “sensibles” 3.
Même si nous pouvons le comprendre, le combat de cette association est voué à l’échec ou du moins ne peut provoquer que des changements très éphémères puisqu’il en appelle simplement à “appliquer la loi”. Les lois ne sont en réalité que des “cache-sexes” qui cherchent à nous faire croire que les réactions d’indignation des hommes politiques et leur soutien médiatique peuvent modifier sur le fond de telles pratiques liées fondamentalement à la logique bien réelle du capitalisme et du profit. C’est pourquoi, l’association L214, qui dénonce fort justement de nombreuses pratiques barbares lors d’abattage d’animaux, participe à la mystification sur la légalité bourgeoise lorsqu’elle en appelle aux “élus de la nation” pour “faire appliquer la loi”. Elle invite même les “citoyens” à faire pression sur “les personnalités politiques” : “Politique-animaux.fr se veut un outil au service des citoyens. Les ressources mises à leur disposition pourront les aider à interpeller les élus ou candidats, ainsi qu’à orienter leur vote lors des échéances électorales”.
Quand on voit la manière dont le capitalisme traite les êtres humains, les ouvriers dans les “unités de production” ou les migrants qui fuient les atrocités de la guerre et l’horreur de la faim, on voit mal comment le sort des animaux d’élevage pourrait le préoccuper. La réalité et le caractère éminemment mystificateur des “libertés publiques” et de “l’égalité entre les hommes” érigées en “Droits de l’homme” il y a plus de deux cents ans laissent déjà deviner à quel point le “droit animal” est voué à n’être qu’une coquille vide.
La mise à jour de pratiques alliant l’inhumanité de la production de marchandises et l’excès de cruautés jusqu’au sadisme dans l’abattage des animaux, si elle indigne, n’a pas d’autres finalité que mystifier les “citoyens” sur le terrain de l’ordre capitaliste à l’origine de ces horreurs. Le système a établi des règles hypocrites (des lois) contournées du fait de la logique économique de productivité et du contexte de guerre commerciale généralisée. Dans plusieurs sites de production de viande animale où des comportements barbares commis lors d’abattage d’animaux ont été signalés, au moins une partie de la viande produite avait acquis des labels de qualité (Label rouge et IGP) et, dans plusieurs cas, elle était certifiée bio. Ce qui devrait signifier, en principe, un maximum de précaution et de respect. Le directeur d’un abattoir donne pourtant une explication très limpide sur la raison de ces pratiques barbares lorsqu’il décrit les cadences de travail : “Il faut tuer 15 000 agneaux en quinze jours pour Pâques. Si on travaillait plus sereinement, ils ne commettraient pas ce type d’action” 4.
En fait, plus la barbarie se développe au sein de cette société, plus sont utilisés n’importe quel argument ou règlement pour en masquer les causes et continuer à vendre n’importe quel produit en tentant d’augmenter les profits. Pour cela, le marketing imagine de nouveaux “labels” qui visent à inciter le consommateur à acheter des produits d’une marque qui revendique une prétendue “éthique” ou “qualité supérieure”. Mais ces labels ne préservent pas de la réalité de la décadence en marche du système capitaliste. Comme le dit un expert, consultant en sécurité alimentaire, nous sommes là devant des images “révélatrices du fonctionnement standard des abattoirs en France [dans lesquels] les cas de maltraitance ou de négligence sont quotidiens” )(5.
En fait, on ne prend pas plus de précaution dans l’abattage d’animaux que lorsqu’on découpe du bois ou que l’on trie des pierres. Et il en va de même pour les êtres humains robotisés par les rapports sociaux et qui ne sont que de la force de travail à exploiter, des “choses”, plus exactement des marchandises qu’on achète et qu’on vend sur le marché du travail.
Le capital se fiche totalement des êtres humains et des animaux. Son organisation implacable n’a pas pour finalité la satisfaction des besoins humains. Elle ne répond qu’à la loi du marché et du profit. On prétend que la folie destructrice du capital serait le prix à payer pour nourrir les hommes. Ceci est faux. La réalité est que les industriels produisent de manière aveugle avec un objectif quasiment unique : vendre à tout prix la marchandise. Nourrir n’est donc qu’une simple conséquence dont se moque le système. Et en l’occurrence, il faudrait bien souvent plutôt parler d’empoisonnement (voir nos articles sur la malbouffe sur https ://fr.internationalism.org). C’est ce qui explique que cette logique totalitaire puisse aussi permettre que “toutes les cinq secondes un enfant de moins de dix ans meurt de faim. Sur une planète qui regorge pourtant de richesses… Dans son état actuel, en effet, l’agriculture mondiale pourrait nourrir sans problèmes 12 milliards d’êtres humains, soit deux fois la population actuelle. Il n’existe donc à cet égard aucune fatalité. Un enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné” 6.
Rappelons aussi comment les gouvernements des pays européens viennent de marchander avec le gouvernement de Turquie l’acceptation ou le rejet des nouveaux migrants, traités comme du bétail qu’on parque et déplace sans aucune préoccupation de respect et de dignité. L’État capitaliste traite les êtres humains comme il traite les animaux et réciproquement.
Bien sûr, les bourgeois ne pratiquent pas eux-mêmes directement ces gestes horribles qu’ils commanditent et que bien souvent ils méprisent en prenant bien soin de les observer à distance. Jamais, pour la plupart, ils ne supporteraient de se salir les mains ! Ils disposent pour cela d’une masse d’exploités. Peu importe les conséquences sur les humains ou les animaux, ces “êtres sensibles” que le capital méprise et broie. Tout cela, Rosa Luxemburg le reconnaissait déjà et le dénonçait, il y a un siècle, affirmant par là-même son grand sens moral, comme en témoigne une de ses lettres (voir la republication de ce texte de Rosa Luxemburg ci-dessous). Elle savait se sentir proche d’un animal qui souffrait après avoir été battu violemment par un soldat parce qu’il n’arrivait pas à franchir un obstacle. Et elle était capable d’assimiler cette férocité aux actes barbares commis entre êtres humains en temps de guerre : “Et devant mes yeux, je vis passer la guerre dans toute sa splendeur...”.
Paco, 22 avril 2016
1 Ce qui favorise au passage la prolifération de bactéries résistantes et réduit l’efficacité des médicaments pour les hommes également.
2 “Des canetons broyés et mutilés pour produire du foie gras” (Le Monde, 21 décembre 2015).
3 “Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce” (Article L 214-1 du Code rural).
4 “Un abattoir du Pays basque fermé après la découverte d’actes de cruauté [27]” (Le Monde, 29 mars 2016).
5 “Actes de cruauté dans un abattoir du Gard certifié bio” (Le Monde, 23 février 2016).
6 Destruction massive – Géopolitique de la faim, 2011, Jean Ziegler (rapporteur spécial à l’ONU pour le droit à l’alimentation entre 2000 et 2008).
Géographique:
- France [4]
Rubrique:
Merci patron ! Une dénaturation de ce qu’est la lutte de classe
- 1489 lectures
Le film-documentaire Merci patron ! sorti en février 2016 connaît un grand succès en France avec plus de 300 000 entrées et un large relais dans les médias. Comment expliquer ce succès ? Le thème du film a évidemment attiré une partie de la population qui ne supporte plus la société dans laquelle nous vivons. Merci patron ! dénonce, avec dérision, la paupérisation de la classe ouvrière et la misère physique et psychologique dans laquelle la plonge le chômage de masse. Ainsi, il n’est pas surprenant qu’une partie des ouvriers se reconnaisse dans la dénonciation des conditions de vie que soulève ce documentaire. Merci patron ! exalte également un désir de combat, une volonté de ne pas se laisser faire face à la rapacité des capitalistes, mais sur un terrain où brille l’impuissance et l’absence de perspective. La volonté de s’opposer au patron est un aspect qui a sans doute séduit ceux qui se sont reconnus dans cette attitude de combat. Ainsi, d’une certaine façon, ce documentaire semble offrir un bol d’air frais dans une période où la classe ouvrière ne parvient pas réellement à faire entendre sa voix.
Ce film-documentaire est réalisé par le journaliste et membre fondateur du journal Fakir, François Ruffin. Ce dernier s’assume ouvertement comme un journaliste engagé, très critique sur le monde des médias en général. A l’image du journal Fakir, il se réclame indépendant politiquement mais ne cache pas ses sympathies pour le Front de gauche. Il se déclare même être un “compagnon de route” de cette formation politique.
Par ailleurs, François Ruffin ne se réclame pas de la classe ouvrière mais prétend plutôt appartenir “à la petite-bourgeoisie intellectuelle”. Ce qui selon lui, n’est pas un obstacle pour “entrer en contact avec une autre classe”. François Ruffin souhaite donc unir la classe ouvrière aux couches intermédiaires comme la petite-bourgeoisie, considérant celle-ci comme le moteur d’un changement social. Voici ce que le fondateur de Fakir répondait dans une interview accordée dernièrement au site Ballast : “Lénine disait : “Une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d’en haut ne peuvent plus, ceux d’en bas ne veulent plus et ceux du milieu basculent avec ceux d’en bas”. Il y a un gros travail à faire sur la classe intermédiaire pour la faire basculer avec ceux d’en bas. Sans prétention, j’estime que c’est sur ce point que je suis le meilleur. Faire une jonction de classes. Avec Merci patron !, j’ai fait un film transclasse”. François Ruffin a au moins le mérite d’exposer ouvertement ses buts politiques !
Il était important de revenir sur l’identité politique de François Ruffin et du journal Fakir pour bien comprendre que Merci patron ! draine un certain nombre de “tares” précisément apparentées aux couches intermédiaires de la société qui ne sont porteuses d’aucune perspective en mesure de changer réellement la société.
Dans ce film, François Ruffin se fait passer pour un “fan” de Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH. Il souhaite rétablir le dialogue entre les ex-salariés du groupe, licenciés suite à des délocalisations et le milliardaire français. Sur son parcours, il croise la route de Jocelyne et Serge Klur, deux anciens salariés d’une usine textile proche de Valenciennes, désormais au chômage, vivant avec trois euros par jours et sous le coup d’une expropriation. A la manière d’un super-héros qui n’a pas peur de se battre seul contre les “puissants”, François Ruffin s’engage à sauver la famille Klur en montant un stratagème contre Bernard Arnault.
Le premier miroir aux alouettes tendu par ce documentaire-fiction est de se polariser sur la figure de Bernard Arnault. Il s’agit en fait de réduire le mécanisme de l’exploitation capitaliste à des patrons véreux, sans dénoncer globalement le système, c’est-à-dire une forme de société basée sur un rapport social d’exploitation entre les salariés et les “patrons”. Cette façon de présenter les choses laisse la porte grande ouverte à l’idée qu’il puisse exister des patrons modèles se préoccupant davantage du bien-être de leurs employés que de l’augmentation des profits de leurs entreprises. D’ailleurs, la bourgeoisie utilise très souvent la légende du “bon” ou du “mauvais” patron en claironnant les prétendues vertus du réformisme social d’un Louis Gallois ou d’un Guillaume Pépy, deux PDG classés plutôt à gauche. En creux, le documentaire dissimule également que le fer-de-lance du capitalisme décadent n’est autre que l’État bourgeois et ses innombrables tentacules totalitaires qui s’enfoncent toujours plus profondément pour mieux contrôler tous les aspects de la vie sociale et... économique. Merci patron ! laisse donc planer l’idée que la classe ouvrière pourrait détenir de meilleures conditions de vie si le “droit patronal” était mieux “régulé” et si le capitalisme était “moralisé” ou “humanisé”. Cette posture franchement réformiste nie la validité d’un conflit d’intérêts irrémédiable dans la société capitaliste entre les salariés et les détenteurs des moyens de production. Rien d’étonnant pour un François Ruffin qui doute, à juste titre, “d’être réellement un révolutionnaire” et qui se reconnaît davantage dans le portrait que dresse à son égard le sociologue libertaire Jean-Pierre Garnier, à savoir “un réformiste allant jusqu’au bout de ses idées plutôt qu’un révolutionnaire en peau de lapin”.
Afin de sauver la famille Klur, Ruffin se fait passer pour leurs fils, et fait savoir au groupe LVMH que “ses parents” souhaitent faire connaître leur situation à différents médias, au journal Fakir et même au président de la République afin qu’elle soit rendue publique. Le chantage porte ses fruits puisque LVMH accepte de recouvrir les dettes de la famille et offre un CDI à Serge Klur dans un magasin Carrefour appartenant à Bernard Arnault. Même si ce combat semble partir d’un sentiment apparemment légitime, les méthodes employées (le chantage, la manipulation, l’intimidation) sont totalement étrangères à la classe ouvrière. Celle-ci lutte ouvertement et unie pour un seul et même objectif : la destruction du capitalisme. Elle ne se reconnaît en rien dans ces méthodes indignes, manœuvrières et dénuées de franchise animées par la simple révolte individuelle.
Enfin, ce film est une caricature de la façon dont la gauche du capital dépeint la classe ouvrière, à savoir des individus atomisés, soumis, sans courage, nageant en plein désespoir, incapables de s’indigner face à leur condition de vie insoutenable. Pour preuve, ce passage où Serge Klur se dit prêt à accepter tout boulot que pourrait lui donner Bernard Arnault pour 1500 euros.
François Ruffin nous dépeint en définitive une classe ouvrière prête à se prostituer qui ne peut se défendre sans l’aide des syndicats et des couches intellectuelles “éclairées”. S’il est vrai que les salariés ont aujourd’hui beaucoup de mal à se considérer en tant que classe exploitée, cela ne signifie pas que l’indignation, le combat uni par-delà les frontières, l’aspiration à une société sans exploitation ni guerre, autrement dit le potentiel politique qu’a démontré la classe au cours de son histoire ait à jamais disparu. Le but historique de la lutte du prolétariat n’est pas la défense de salaires “justes” mais d’abolir définitivement toute forme d’exploitation. Ce documentaire ignore autant qu’il dissout complètement cet héritage.
Il est significatif que ce documentaire ait trouvé un écho au sein du mouvement Nuit debout (dans lequel François Ruffin et des individus de son acabit jouent un rôle de premier plan) où la multitude des revendications individuelles parvient à prendre le pas sur l’affirmation pourtant nécessaire d’un objectif commun et unifié propre à la classe ouvrière et finit par noyer cet objectif.
Paul, 3 mai 2016
Rubrique:
Brexit : savoir ce qui est le mieux pour le capitalisme est une question qui ne concerne pas la classe ouvrière
- 1345 lectures
Les arguments de chaque camp dans le référendum pour le maintien ou non du Royaume-Uni dans l’Union Européenne sont d’une grande bêtise. Tous font des déclarations extravagantes sur les avantages de rester ou de quitter l’UE tout en avertissant des dangers de la politique du camp adverse dans une pantomime perpétuelle à base de : “Oh non, ce n’est pas ça !” ou de : “Oh oui, ça l’est !”.
Cependant il est clair dès le départ qu’il ne peut y avoir qu’un seul gagnant : la classe dirigeante capitaliste britannique. On nous a demandé de considérer la question sous l’angle et la préoccupation de l’intérêt supérieur de la Grande-Bretagne : “Qu’est-ce qui est le mieux pour la Grande-Bretagne ?” L’emploi, les prix, les prestations sociales, les pensions, le revenu familial, les perspectives pour les grandes et petites entreprises, la sécurité, l’immigration, la souveraineté, le terrorisme… et tout ce à quoi on peut penser, tout devrait être examiné à l’aune de l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE. Or “ce qui est le mieux pour le capitalisme britannique”, dès qu’il est considéré dans un contexte international, signifie “ce qui est le mieux pour l’impérialisme britannique”.
Le fait que les ouvriers sont exploités par la classe capitaliste implique que leurs intérêts ne sont pas du tout les mêmes. Beaucoup de groupes et de partis, prétendant parler au nom de la classe ouvrière, donnent des recommandations sur comment voter. Le Parti travailliste dit que le fait de rester dans l’UE garantit des emplois, de l’investissement et une “protection sociale”. Beaucoup de gauchistes font campagne contre l’adhésion à l’Union Européenne, au motif que l’Europe des patrons est contre les nationalisations, impose l’austérité et attaque les droits des travailleurs. En réalité, l’une des principales attaques contre la classe ouvrière en Grande-Bretagne aujourd’hui, réside précisément dans la propagande autour du referendum et dans les illusions semées sur le processus démocratique et l’Union européenne que tous les discours mensongers de la bourgeoisie essaient de répandre.
Les divisions de la bourgeoisie anglaise
Ce qui est approuvé par ceux qui veulent sortir et ceux qui veulent rester (ce qui profitera aux entreprises britanniques, ce qui sera bon pour l’État capitaliste britannique) est la base commune d’une campagne idéologique qui ne peut avoir comme effet que de désorienter davantage une classe ouvrière qui ne sait déjà pas où sont ses propres intérêts et dans quelle mesure elle a la capacité de changer la société. Cependant, cette campagne n’est pas que du cirque (bien qu’il y ait beaucoup de cela), dans la mesure où elle exprime et a exprimé depuis des décennies, de réelles divergences au sein de la classe dominante sur l’adhésion à l’UE.
La fraction dominante de la bourgeoisie britannique voit des avantages à faire partie de l’Union Européenne sur le plan économique, impérialiste et social. Les grandes entreprises du FTSE100, la majorité de l’industrie manufacturière, les grandes banques et autres institutions financières, les corporations multinationales, beaucoup de collectivités locales, des organismes représentant les hommes de loi et les scientifiques, tous reconnaissent l’importance d’accéder à un marché européen de 500 millions de personnes. Les affaires possibles avec l’UE, le fait que les échanges de l’Europe avec le reste du monde représentent 20 % des importations et exportations mondiales, l’attraction qu’exerce l’UE sur les autres pays pour les investissements est une nécessité pour le Royaume-Uni dans le cadre de sa stratégie impérialiste. A l’extérieur, les principales fractions de plusieurs grands pays capitalistes savent aussi que leur intérêt va dans le sens d’un maintien de la Grande-Bretagne dans l’UE. En Europe même, les dirigeants allemands, français, espagnols et suédois se sont exprimés en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l’UE.
En dehors de l’Europe, il est significatif que le président des États-Unis, Obama, fasse partie de ceux qui soutiennent le maintien du Royaume-Uni dans l’Europe. La question des rapports entre les États-Unis et la Grande-Bretagne n’est pas simple. Pendant la période des deux blocs impérialistes dirigés par les Etats-Unis et l’URSS, l’Angleterre était un membre à part entière du bloc de l’Ouest, un allié loyal de l’Amérique. C’est durant cette période que furent fondés les précurseurs de l’Union européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et son successeur, la Communauté économique européenne, qui faisaient aussi partie du bloc impérialiste dirigé par les États-Unis. Mais, avec l’effondrement du bloc de l’Est et la dissolution du bloc de l’Ouest qui en a été la conséquence, les intérêts impérialistes et économiques du capitalisme britannique se sont déplacés. Au niveau impérialiste, la Grande-Bretagne a essayé de suivre une voie indépendante tout en gardant des alliances avec d’autres puissances quand la situation l’exigeait. Au niveau économique, près de la moitié du commerce anglais s’effectue avec l’Europe, alors que 20 % des exportations sont dirigés vers les États-Unis. Dans un article publié dans WR no 353 en 2012, Pourquoi le capitalisme britannique a besoin de l’Europe, nous disions que “l’examen du marché international britannique montre que ses intérêts économiques se focalisent sur l’Europe et les États-Unis. Ceci aide à comprendre les actions de la classe dominante britannique ces dernières années (…). D’un côté, ce serait une erreur de voir une relation mécanique entre les intérêts économiques et impérialistes de la Grande-Bretagne, d’un autre côté, ce serait aussi une erreur de n’y voir aucun lien. L’analyse de la dimension économique révèle quelques-uns des fondements de la stratégie de la Grande-Bretagne dans le maintien de la position d’équilibre entre l’UE et les États-Unis.” Pour l’Oncle Sam, le Royaume-Uni est toujours un cheval de Troie en Europe, un moyen potentiel d’empêcher l’Allemagne de menacer la puissance américaine. Pour le Royaume-Uni, l’Allemagne est un partenaire commercial important, mais aussi un rival impérialiste potentiel.
Mais qu’en est-il de ceux qui font campagne pour sortir de l’UE ? Qui sont-ils ? Que représentent-ils ? Sur le plan économique, on a entendu les gestionnaires des fonds spéculatifs privilégier la sortie de l’UE ainsi qu’en général, les petits patrons et les responsables des petites et moyennes entreprises. S’il n’y avait rien d’autre à considérer, leur position serait facile à expliquer. La loi actuelle profite aux fonds spéculatifs, mais ces catégories sont naturellement enclines à se plaindre de toute forme de régulation qui entrave leur quête de profit. Quant à la taille des petites entreprises, elle ne pourrait bien être que la conséquence d’un manque de compétitivité mais cela ne les empêche pas d’en blâmer l’UE, le gouvernement anglais, les collectivités locales ou encore les pratiques des plus grosses entreprises. Tout peut être la cible de leur frustration, alors qu’en réalité, elles souffrent tout simplement des lois du marché.
Cependant, sur le plan politique, les fractions de la bourgeoisie qui soutiennent le Brexit sont remarquables par leur diversité et ne sont pas de manière évidente liées à un groupe ou à des couches sociales en particulier. On y retrouve les partis d’extrême-droite de l’UKIP au BNP, les eurosceptiques du Parti conservateur, et à gauche, un panel de staliniens et de trotskistes. Voici un rassemblement très disparate doté d’un large éventail de rhétorique et d’hypocrisie. Quand on voit un Michael Gove ou un Duncan Smith (qui sont au gouvernement depuis 2010 et appartiennent à un parti qui a été au pouvoir pendant 60 ans au cours des 100 dernières années) oser brandir des banderoles clamant : “Reprenons le contrôle !”, on a là un exemple édifiant du double langage de ces fonctionnaires blanchis de longue date sous le harnais de l’appareil d’État capitaliste. Cependant, les fractions favorables au “Brexit” ont autre chose en commun : c’est leur attachement à la rhétorique du populisme, se donner l’air d’être contre “l’ordre établi”, évoquant la nostalgie d’un passé mythique, jouant les perpétuels va-t’en guerre contre une menace extérieure. Dans une période de décomposition sociale croissante, le populisme est un phénomène en vogue. Aux États-Unis, il y a le Tea Party et Donald Trump, en Allemagne AFD et Pegida, en France le Front national et, à gauche, il y a Podemos en Espagne et Syriza en Grèce. Plus près de nous, lors des élections générales au Royaume-Uni de 2015, la campagne populiste du Parti national écossais fut la cause de la déroute de presque tous les députés travaillistes écossais.
Nous avons l’exemple de l’union de deux politiciens populistes lors d’un meeting anti-UE, lorsque Nigel Farage de l’UKIP (extrême-droite) a présenté Georges Galloway du Respect Party comme “l’un des plus grands orateurs de ce pays” et comme “une figure imposante de la gauche de l’appareil politique britannique”. Galloway a expliqué de son côté : “Nous ne sommes pas des amis ni du même bord mais nous défendons une cause commune. Comme Churchill et Staline…” La comparaison est limpide… Galloway voit le rapprochement entre la gauche et la droite classique comme une alliance impérialiste dans une guerre dont les enjeux sont la mort et la destruction à une grande échelle. Il n’a pas tort. Mais Farage et Galloway représentent eux-aussi les forces de guerre impérialiste et la destruction, au même titre que toutes les autres fractions de la classe dominante. Le problème le plus immédiat posée par la montée du populisme est celui-ci : alors que c’est de toute évidence un phénomène qui peut être utilisé par la bourgeoisie, le danger existe que ce phénomène échappe au contrôle des principaux partis politiques et constitue une entrave aux manœuvres politiques habituelles de la bourgeoisie.
Les intérêts de la classe ouvrière
Nous n’avons pas l’intention de spéculer sur les résultats du référendum à venir. Il est difficile de savoir quelles fractions de la bourgeoisie tireraient un bénéfice de la sortie de l’UE dans la mesure où cette sortie poserait un grave problème au capitalisme britannique. Mais la bourgeoisie britannique est la plus expérimentée du monde et sera certainement capable d’assumer une victoire du maintien dans l’UE de même qu’elle sera capable de s’adapter à tout autre résultat.
Ce qui est important pour la classe ouvrière, c’est de voir que la campagne autour du référendum sur l’UE est entièrement sur le terrain de la classe dominante. Il n’y a pas à choisir entre les deux propositions, dans la mesure où les deux commencent et finissent par la continuation du capitalisme britannique et de ses exigences impérialistes.
Pour la classe ouvrière, les possibilités d’un changement social ne résident pas dans un processus électoral et démocratique du capitalisme. Parce que, pour être efficace, la lutte de la classe ouvrière doit être consciente. A ce stade, lorsque les ouvriers gardent quelque idée sur leur identité de classe, ils sont en mesure de résister à la propagande de toutes les fractions de la bourgeoisie. Il y a quarante ans, en 1975, il y a déjà eu un referendum sur l’adhésion à l’UE. Comme aujourd’hui, il y a eu un accord entre les principales fractions des partis les plus importants, mais là aussi, on avait pu voir dans le camp du “non”, le rapprochement entre le champion de l’extrême-droite, Enoch Powell et le représentant de l’aile la plus à gauche des travaillistes, Tony Benn. A cette époque, la campagne pour ou contre l’adhésion à l’UE faisait partie des tâches du Parti travailliste au pouvoir, essayant de convaincre les ouvriers qu’ils avaient intérêt à se prononcer et à laisser leurs luttes de côté et à mettre leurs espoirs dans le suivi des consignes d’un parti de gauche. Aujourd’hui, la classe ouvrière ne lutte pas du tout au même niveau que dans les années 1970 et 1980, mais toujours avec la perspective d’un monde basé sur des relations de solidarité et non plus sur l’exploitation, elle a toujours le potentiel pour transformer la société.
CAR, 9 avril 2016
Rubrique:
Migrants et réfugiés : victimes du capitalisme (Partie III)
- 1403 lectures
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la démobilisation et le désastre des destructions dues aux affrontements impérialistes généraient un monde de ruines et de désolation. En mai 1945, 40 millions de personnes étaient déplacées ou réfugiées en Europe. A cela, il fallait ajouter les 11,3 millions de travailleurs qui avaient été enrôlés de force par l'Allemagne durant la guerre. Dans les autres grandes régions du monde, l'affaiblissement des puissances coloniales conduisait à une instabilité et de nouveaux conflits, notamment en Asie et en Afrique, entraînant au fil du temps des millions de migrants. Tous ces déplacements de populations provoquèrent de terribles souffrances et de nombreux morts.
Le « rideau de fer » : terreur et militarisation des frontières
Sur les ruines encore fumantes de ce conflit mondial, suite aux conférences de Yalta (février 1945) et de Potsdam (juillet 1945), le « rideau de fer » qui s'abattait entre les ex-alliés (les grandes puissances occidentales derrière les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre) poussait des millions de gens à fuir les haines et la vengeance. Le repartage du monde en zones d'influence dominées par les vainqueurs et leurs alliés, Etats-Unis et Grande-Bretagne d'un côté, URSS de l'autre, la nouvelle ligne des affrontements inter-impérialistes était tracée. A peine la guerre était-elle terminée que s'enclenchait la confrontation entre le bloc de l'Ouest emmené par les Etats-Unis et le bloc de l'Est sous la houlette de l'URSS. Les mois qui suivirent la fin de la guerre furent marqués par les expulsions de 13 millions d'Allemands des pays de l'Est et par l'exil de plus d'un million de Russes, Ukrainiens, Biélorusses, Polonais et Baltes, tous fuyant les régimes staliniens. En fin de compte, « Entre 9 et 13 millions périrent comme résultat de la politique de l'impérialisme allié entre 1945 et 1950. Ce monstrueux génocide eut trois sources principales :
– d'abord, parmi les 13,3 millions d'Allemands d'origine qui furent expulsés des régions orientales (...), cette épuration ethnique fut si inhumaine que seuls 7,3 millions arrivèrent à destination, derrière les nouvelles frontières allemandes de l'après-guerre ; le reste ‘disparut’ dans les circonstances les plus horribles ;
– ensuite, parmi les prisonniers de guerre allemands qui moururent à cause des conditions de famine et de maladie dans les camps alliés – entre 1,5 et 2 millions ;
– enfin, parmi la population en général qui n'avait que des rations de 1000 calories par jour ne garantissant qu'une lente famine et la maladie – 5,7 millions en moururent. »1
Un grand nombre de rescapés juifs ne savaient pas où aller du fait du regain de l'antisémitisme, notamment en Pologne (où éclataient de nouveaux pogroms, comme celui de Kielce en 1946) et en Europe centrale. Les frontières des pays démocratiques de l'Ouest leurs avaient été fermées. Les Juifs ne furent souvent hébergés que dans des camps. En 1947, certains avaient cherché à rejoindre la Palestine pour trouver une issue face à l'hostilité à l'Est et au rejet à l'Ouest. Ils le firent contraints, de façon illégale à l'époque et furent arraisonnés par les Britanniques pour être aussitôt internés à Chypre. Le but était alors de dissuader et contrôler ces populations pour maintenir l'ordre capitaliste. C'est à la même période que le nombre des détenus dans les camps du Goulag explosait en URSS. Entre 1946 et 1950, les effectifs doublèrent pour atteindre plus de deux millions de prisonniers. Un grand nombre de réfugiés et migrants, ou "déplacés", finissaient dans ces camps pour y mourir. Ce nouveau monde de la Guerre froide façonné par les « vainqueurs de la liberté » avait généré de nouvelles fractures, de brutales divisions coupant tragiquement les populations les unes des autres, provoquant les exils forcés.
L'Allemagne avait été divisée sur le plan impérialiste. Et pour éviter les migrations et le flux de ses populations vers l'Ouest, la RDA avait dû construire en 1961 le « mur de la honte ». D'autres Etats comme la Corée ou le Vietnam furent également coupés en deux par le « rideau de fer ». La guerre de Corée, entre 1950 et 1953, avait séparé une population désormais prisonnière de deux nouveaux camps ennemis. Cette guerre fit disparaître près de 2 millions de civils et provoqua une migration de 5 millions de réfugiés. Durant toute la période qui s'était ouverte jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989, de nombreuses populations furent contraintes de fuir les incessants conflits locaux de la Guerre froide. Au sein de chaque bloc, les déplacements nombreux étaient souvent un enjeu politique direct entre les deux grandes puissances américaine et russe. Ainsi, dès la répression des soulèvements de Berlin-Est en 1953 et de Budapest en 1956 par l'armée rouge, toute une propagande allait alimenter les discours idéologiques des deux camps rivaux à propos des 200 000 réfugiés qui s'étaient rendus en Autriche et en Allemagne. Toutes les guerres qui avaient été alimentées ensuite par ces deux grands blocs militaires Est-Ouest continuaient de faire l'objet d'un grand nombre de victimes qu'exploitait systématiquement la propagande de chaque camp opposé.
Tensions, « luttes de libération nationales » et migrations
Ces clivages brutaux, liés à la Guerre froide, se poursuivirent dans les années 1950 avec les mouvements de décolonisation qui allaient alimenter des migrations et diviser davantage le prolétariat. Depuis les débuts de la période de décolonisation et surtout les années 1980, où les conflits de la Guerre froide se sont intensifiés et exacerbés, les prétendues « luttes de libération nationale » (en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou au Moyen-Orient) ont été très meurtrières. Relayés à la périphérie géographique des grandes puissances capitalistes, ces conflits avaient pu donner l'illusion d'une « ère de paix » en Europe alors que s'ouvraient des plaies durables et que des déplacements forcés pour les nombreux migrants étaient autant de tragédies apparaissant comme « lointaines » (sauf naturellement pour les anciens colons venus de ces contrées et les nations directement touchées). En Afrique, depuis la fin de l'ère coloniale, les guerres ont été très nombreuses, parmi les plus meurtrières au monde. Tout au long de ces conflits, les grandes puissances comme la Grande-Bretagne ou la France (qui faisait alors office de « gendarme de l'Afrique » pour le compte du bloc occidental face à l'URSS) étaient largement impliquées militairement sur le terrain où la logique des blocs Est/Ouest prévalait. A peine le Soudan avait-il gagné son indépendance en 1956 qu'une terrible guerre civile allait par exemple impliquer les puissances coloniales et être ainsi instrumentalisée entre les blocs, faisant au moins 2 millions de morts et plus de 500 000 réfugiés (obligés de trouver asile dans les pays voisins). L'instabilité et la guerre s'installèrent de manière durable. La terrible guerre du Biafra générant famines et épidémies fit au moins 2 millions de morts et autant de réfugiés. Entre 1960 et 65, la guerre civile dans l'ex-Congo belge et la présence de mercenaires fit de très nombreuses victimes et de nombreux déplacés. On pourrait multiplier les exemples, comme celui de l'Angola qui avait été ravagée par la guerre depuis les premiers soulèvements de sa population à Luanda en 1961. Après son indépendance en 1975, de nombreuses années de guerres opposaient les forces du MPLA au pouvoir (Mouvement de Libération de l'Angola, soutenu par Moscou) et les rebelles de l'UNITA (soutenus par l'Afrique du Sud et les Etats-Unis) : pas moins d’un million de morts et 4 millions de déplacés parmi lesquels un demi-million de réfugiés aboutirent dans des camps. C'est de manière permanente que les coups de forces multiples sur ce continent déstabilisaient des régions entières, comme l'Afrique de l'Ouest ou la région stratégique des Grands lacs. On pourrait tout autant prendre des exemples en Amérique centrale, en Asie, avec les phénomènes de guérillas meurtrières. L'intervention soviétique en Afghanistan en 1979 marquait une accélération de cette spirale infernale conduisant à l'exode de 6 millions de personnes, la plus grande population de réfugiés au monde.
Le nationalisme et la mécanique de l'exclusion
Les nouveaux Etats ou nations qui émergeaient suite aux grands déplacements étaient le produit direct des clivages impérialistes et de la misère, le fruit du nationalisme, des expulsions et de l'exclusion. Bref, un pur produit du climat de guerre et de crise permanente généré par le capitalisme décadent. La formation de ces nouveaux États était une impasse qui ne pouvait aboutir qu'à alimenter les tensions destructrices. C'est ainsi que la partition de l'Inde, dès 1947, puis la création du Bangladesh ensuite, contraignirent plus de 15 millions de personnes à se déplacer sur le sous-continent indien. La fondation de l’État d'Israël, en 1948, véritable forteresse assiégée, fut également un exemple significatif. Ce nouvel État, passant de 750 000 habitants à 1,9 millions en 1960, avait entraîné dès sa naissance une spirale infernale de guerres interminables et provoqué l'installation de camps de réfugiés palestiniens un peu partout. Dès 1948, 800 000 Palestiniens furent ainsi déplacés de force et la bande de Gaza devint peu à peu un immense camp à ciel ouvert. Les camps de réfugiés palestiniens de Beyrouth, Damas, Amman, se transformèrent peu à peu en quartiers de banlieue de ces capitales.
Les problèmes similaires des réfugiés et migrants s'exprimaient largement sur l'ensemble de la planète. En Chine, des millions de personnes avaient été déplacées elles-aussi, victimes des massacres de la féroce oppression japonaise pendant la guerre. Après la victoire des troupes maoïstes en 1949, quelques 2,2 millions de Chinois s'enfuirent de Taïwan pour la Chine et 1 million s'orientèrent vers Hong-Kong. La Chine s'isolait par la suite dans une relative autarcie pour tenter de combler son retard économique. Au début des années 1960, elle entreprit alors une industrialisation forcée et lança la politique du « Grand bond en avant ». Elle enfermait ainsi ses populations locales dans l'enfer nationaliste du travail en prévenant toute tentative de migration. Cette politique brutale de déracinement et de répression pratiquée depuis l'ère Mao multiplia les camps de concentration (laogai). Les famines et la répression provoquèrent pas moins de 30 millions de morts en tout. Plus récemment, dans les années 1990, l'urbanisation massive de ce pays arrachait de la terre pas moins de 90 millions de paysans. D'autres crises frappèrent en Asie, comme la guerre civile au Pakistan et la fuite des Bengalis en 1971. De même, la prise de Saïgon en 1975 (par un régime de type stalinien) provoqua l'exode de millions de réfugiés, les « boat-people ». Plus de 200 000 d'entre eux périrent.2 Suivait le terrible génocide des Khmers rouges au Cambodge faisant 2 millions de morts : les réfugiés étant les rares rescapés.
Les réfugiés ont toujours été des monnaies d'échange permettant les pires chantages politiques, la justification pour des interventions militaires par puissances interposées, l'utilisation parfois comme "boucliers humains". Il est difficile d'évaluer le nombre de victimes qui ont fait les frais des affrontements de la Guerre froide et d'en donner un chiffre précis, mais « L'ancien Secrétaire d’État à la Défense de Kennedy et de Johnson, Robert McNamara, a dressé en 1991 devant une conférence de la Banque mondiale un tableau des pertes enregistrées sur chaque théâtre d'opérations dont le total dépasse les quarante millions ».3 Le nouvel après-guerre n'avait donc fait qu'ouvrir une nouvelle période de barbarie, qu’accroître davantage les divisions au sein des populations et de la classe ouvrière, semer la mort et la désolation. En militarisant davantage les frontières, les États exerçaient un contrôle globalement supérieur et plus violent sur des populations sorties exsangues de la Seconde Guerre mondiale.
Les migrants : une aubaine pour exploiter la force de travail
Aux débuts de cette guerre froide, toutes les migrations ne furent pas seulement provoquées par les conflits guerriers ou par des facteurs de nature politique. Les pays d'Europe qui avaient en grande partie été dévastés par la guerre avaient besoin d'une reconstruction rapide. Ces besoins de reconstruction devaient combler également une baisse de la croissance démographique (10 à 30% des hommes avaient été tués ou blessés durant la guerre). Le facteur économique et démographique jouait donc un rôle important dans le phénomène des migrations. Partout, il fallait une main d'œuvre disponible, à faible coût.
C'est pour cela que l'Allemagne de l'Est avait été obligée de construire un mur pour arrêter la fuite de sa population (3,8 millions avaient déjà franchi la frontière vers l'Ouest). Les ex-puissances coloniales favorisaient l'immigration, en premier lieu des pays de l'Europe du Sud (Portugal, Espagne, Italie, Grèce...). Au départ, bon nombre de ces migrants arrivaient légalement mais aussi clandestinement grâce à des rabatteurs et des passeurs souvent organisés. Le besoin de main-d’œuvre permettait alors aux autorités de l'époque de fermer les yeux en favorisant ces migrations irrégulières. Entre 1945 et 1974, bon nombre de Portugais et d'Espagnols fuyaient ainsi les régimes de Franco et de Salazar. Jusqu'au début des années 1960, les Italiens étaient recrutés en France, venant d'abord du nord de l'Italie et ensuite du sud, jusqu'à la Sicile. Puis ce fut un peu plus tard au tour des ex-colonies d'Asie et d'Afrique de fournir de nouveaux contingents pour une main-d’œuvre docile et bon marché. En France, par exemple, entre 1950 et 1960, le nombre de Maghrébins est passé de 50 000 à 500 000. Des foyers de travailleurs migrants étaient alors construits par l'Etat où ils étaient maintenus à l'écart de la population. Cette main-d’œuvre étrangère était en effet jugée « à risque », ce qui permettait de justifier sa marginalisation. Mais cela n'empêchait pas de les embaucher à bas prix pour des travaux pénibles, sachant qu'on pouvait les renvoyer du jour au lendemain. L'exploitation forcenée et sans scrupules autorisait même un turn over très important, bien supérieur à la moyenne pour ces ouvriers fraichement arrivés, notamment dans les industries chimiques et métallurgiques. Pour répondre aux besoins de l'activité, entre 1950 et 1973, près de 10 millions de personnes émigraient vers l'Europe de l'Ouest.4
Cette situation allait inévitablement être exploitée par la bourgeoisie afin de diviser les ouvriers et de les monter les uns contre les autres, de générer la concurrence et la méfiance de part et d'autre. Avec la reprise des luttes ouvrières en 1968 et les vagues de luttes qui suivirent, ces facteurs de divisions allaient alimenter les nombreuses manœuvres de divisions par les syndicats et les discours idéologiques clivants de la bourgeoisie. D'un côté étaient encouragés les préjugés raciaux et xénophobes ; de l'autre, la lutte de classe était en partie détournée par l'antiracisme, utilisé souvent comme dérivatif aux revendications ouvrières. Au fur et à mesure, le poison s'était installé et les étrangers devenaient « indésirables », étaient présentés comme des « assistés » et des « profiteurs », presque des « privilégiés ». Tout cela allait permettre de favoriser les idéologies populistes facilitant les expulsions qui se sont multipliées par charters entiers depuis les années 1980.
WH (avril 2016)
Dans le prochain et dernier article de cette série, nous aborderons le sujet des migrants des années 1980 à la période actuelle marquée par la phase ultime de décomposition du système capitaliste.
1 Voir : fr.internationalism.org/rinte95/berlin1948.htm
2 Source : HCR (Haut-commissariat aux Réfugiés).
3 D'après André Fontaine, La Tache rouge. Le roman de la Guerre froide, Editions La Martinière, 2004.
4 Source : www.coe.int/en/web/history-teaching [29]
Récent et en cours:
- Immigration [30]
Rubrique:
Révolution Internationale n°459 - juillet août 2016
- 1291 lectures
Lutter contre tous les nationalismes!
- 1721 lectures
“En outre, on a accusé les communistes de vouloir abolir la patrie, la nationalité. Les ouvriers n’ont pas de patrie. On ne peut leur ravir ce qu’ils n’ont pas” (Le Manifeste communiste, 1848).
Le capitalisme, le système d’exploitation qui domine toute la planète, ne peut se maintenir par la seule force et la violence. Il ne peut se passer de la puissance de l’idéologie – la production sans fin d’idées qui renversent le rapport à la réalité pour faire croire aux exploités qu’ils ont tout intérêt à soutenir ceux qui les exploitent. Il y a exactement cent ans, des centaines de milliers d’ouvriers en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne ont payé de leur vie la croyance à ce grand mensonge de la classe dominante : les ouvriers doivent “se battre pour leur pays”, ce qui veut dire tout simplement se battre et mourir pour les intérêts de la classe dominante.
Les massacres horribles de la Première Guerre mondiale ont démontré une fois pour toutes que le nationalisme est l’ennemi idéologique le plus mortel de la classe ouvrière.
Aujourd’hui, après des décennies d’attaques contre les conditions de vie, le démantèlement de pans entiers de l’industrie et l’exode massif de populations entières, après des décennies de crise économique et de programmes d’austérité, et aussi après toute une série de luttes défaites, la classe ouvrière est soumise à un déversement de poison nationaliste sous la forme des campagnes populistes de Trump aux États-Unis, de Le Pen en France, des “pro-Brexit” en Grande-Bretagne et de divers politiciens dans beaucoup d’autres pays. Ces campagnes s’appuient ouvertement sur une colère et une désorientation réelles au sein de la classe ouvrière, sur une frustration croissante à cause du manque d’emplois, de logements, de soins et sur des sentiments très répandus d’impuissance face à la globalisation et aux puissances impersonnelles du capital. Ces campagnes cherchent surtout à empêcher les ouvriers de se mettre à réfléchir de façon critique sur les véritables origines de tous ces problèmes. Au contraire, la fonction du populisme est de contrer toute tentative pour comprendre un système social complexe et apparemment mystérieux qui gouverne nos vies, de proposer une solution beaucoup plus simple : trouver quelqu’un sur qui rejeter la faute.
C’est la faute aux “élites”, hurlent-ils : les banquiers cupides, les politiciens corrompus, les bureaucrates qui dirigent l’Union européenne dans l’ombre et nous étouffent avec des règlements et la paperasserie. Tous ces personnages font certes bel et bien partie de la classe dominante et jouent leur rôle dans l’augmentation de l’exploitation et la destruction des emplois. Mais l’idée selon laquelle “c’est la faute aux élites” ne provient pas de la conscience de classe, elle en est au contraire un complet dévoiement. On peut démonter la supercherie en posant la question : qui sont ceux qui veulent nous vendre ce nouvel “anti-élitisme” ? Il suffit de voir Donald Trump, les dirigeants de la campagne du Brexit ou les médias qui les soutiennent, pour constater que cette espèce d’anti-élitisme est l’œuvre d’une autre partie de l’élite elle-même. Dans les années 1930, les nazis se sont servis d’une escroquerie analogue, prenant comme boucs-émissaires une supposée “élite internationale de financiers juifs”, sur qui ils rejetaient toute la responsabilité des effets dévastateurs de la crise économique mondiale, afin d’attirer les ouvriers derrière une fraction de la classe dominante qui prétendait défendre les “véritables intérêts de l’économie nationale”. Josef Goebbels, le ministre de la propagande nazie, a dit une fois que “plus un mensonge est gros, plus il a de chances d’être cru”. Et quand des politiciens de l’acabit du milliardaire Trump prétendent défendre “le petit peuple” contre l’élite, il s’agit là d’un mensonge digne de la propagande de Goebbels lui-même.
 Mais cette nouvelle campagne nationaliste ne vise pas seulement une fraction parmi les riches, elle cible surtout les couches les plus opprimées de la classe ouvrière elle-même, les victimes les plus immédiates de la crise économique capitaliste, de la barbarie impérialiste et de la destruction de l’environnement. Elle vise notamment la masse des migrants économiques et des réfugiés, poussés vers les pays capitalistes centraux, à la recherche d’un refuge face à la pauvreté et aux tueries de masse. Une autre solution “simple” est proposée par les populistes : si on pouvait les empêcher de venir, si on pouvait les “mettre dehors”, les ouvriers “natifs” auraient plus de chances de trouver un emploi et un logement. Mais ce bon sens commun apparent cache le fait que le chômage et le manque de logements sont les produits du fonctionnement du système capitaliste mondial, des “forces du marché” qui ne peuvent être bloquées par des murs ou des gardes-frontières. En réalité, les migrants et les réfugiés sont les victimes du capitalisme au même titre que les prolétaires des vieilles régions industrielles réduits au chômage par les fermetures d’usines ou les délocalisations qui transfèrent la production de l’autre côté du monde où la main-d’œuvre est moins chère.
Mais cette nouvelle campagne nationaliste ne vise pas seulement une fraction parmi les riches, elle cible surtout les couches les plus opprimées de la classe ouvrière elle-même, les victimes les plus immédiates de la crise économique capitaliste, de la barbarie impérialiste et de la destruction de l’environnement. Elle vise notamment la masse des migrants économiques et des réfugiés, poussés vers les pays capitalistes centraux, à la recherche d’un refuge face à la pauvreté et aux tueries de masse. Une autre solution “simple” est proposée par les populistes : si on pouvait les empêcher de venir, si on pouvait les “mettre dehors”, les ouvriers “natifs” auraient plus de chances de trouver un emploi et un logement. Mais ce bon sens commun apparent cache le fait que le chômage et le manque de logements sont les produits du fonctionnement du système capitaliste mondial, des “forces du marché” qui ne peuvent être bloquées par des murs ou des gardes-frontières. En réalité, les migrants et les réfugiés sont les victimes du capitalisme au même titre que les prolétaires des vieilles régions industrielles réduits au chômage par les fermetures d’usines ou les délocalisations qui transfèrent la production de l’autre côté du monde où la main-d’œuvre est moins chère.
Face à un système d’exploitation qui est par nature planétaire, les exploités ne peuvent se défendre qu’en s’unissant au-delà et contre toutes les divisions nationales, en forgeant une puissance internationale face à la puissance internationale du capital. La tactique qui consiste à diviser pour mieux régner, utilisée par tous les partis et toutes les factions capitalistes, poussée à l’extrême par les populistes, va directement à l’encontre de ce besoin. Quand une partie de la classe ouvrière se laisse convaincre de rejeter la responsabilité de ses problèmes sur d’autres ouvriers, quand elle pense que ses intérêts sont défendus par des partis qui exigent des mesures fortes contre l’immigration, elle abandonne toute possibilité de se défendre et elle affaiblit la capacité de résistance de la classe ouvrière dans son ensemble.
Les fausses alternatives au populisme
 Derrière la rhétorique anti-immigrés des populistes existe une vraie menace de violence et de pogrom. Dans des pays comme la Grèce ou la Hongrie, la haine toxique des “étrangers”, la montée de l’islamophobie et l’antisémitisme ont engendré des groupements carrément fascistes qui sont prêts à terroriser, à assassiner les migrants et les réfugiés : Aube dorée en Grèce, Jobbik en Hongrie, etc., la liste serait encore longue. Depuis la victoire du Brexit en Grande-Bretagne, nous avons assisté à une recrudescence d’attaques, de menaces et d’insultes racistes et xénophobes, par exemple contre les Polonais et autres immigrants de l’UE, ainsi qu’à l’encontre des Noirs et des Asiatiques. Les courants les plus ouvertement racistes sentent ainsi que le moment est venu de faire davantage entendre leur propagande nauséabonde.
Derrière la rhétorique anti-immigrés des populistes existe une vraie menace de violence et de pogrom. Dans des pays comme la Grèce ou la Hongrie, la haine toxique des “étrangers”, la montée de l’islamophobie et l’antisémitisme ont engendré des groupements carrément fascistes qui sont prêts à terroriser, à assassiner les migrants et les réfugiés : Aube dorée en Grèce, Jobbik en Hongrie, etc., la liste serait encore longue. Depuis la victoire du Brexit en Grande-Bretagne, nous avons assisté à une recrudescence d’attaques, de menaces et d’insultes racistes et xénophobes, par exemple contre les Polonais et autres immigrants de l’UE, ainsi qu’à l’encontre des Noirs et des Asiatiques. Les courants les plus ouvertement racistes sentent ainsi que le moment est venu de faire davantage entendre leur propagande nauséabonde.
Mais l’exemple de la Grande-Bretagne montre qu’il existe également une fausse alternative au populisme qui “reste”1 prisonnière de l’idéologie capitaliste. La situation politique chaotique créée par la victoire du Brexit (que nous analyserons dans un autre article), la menace croissante à l’encontre des ouvriers immigrés, ont poussé beaucoup de gens bien intentionnés à voter pour le remain et à participer, suite au référendum, à des manifestations importantes en faveur de l’UE. Nous avons même vu des anarchistes paniqués face aux expressions ouvertes de racisme encouragées par la campagne pour le Brexit, oublier leur opposition aux élections capitalistes pour finalement voter en faveur du remain.
Voter ou manifester en faveur de l’UE est une autre façon de rester ligoté par la classe dominante. L’UE n’est pas une œuvre charitable mais bien une alliance capitaliste qui impose l’austérité sans merci à la classe ouvrière, comme on peut le voir clairement à travers les exigences imposées aux ouvriers grecs (cela en contrepartie de fonds par l’UE à l’économie grecque en faillite). L’UE n’est certainement pas un gentil protecteur des migrants et des réfugiés. Elle est en faveur de la libre circulation de la main-d’œuvre lorsque cela convient à la rentabilité et elle est tout autant capable de construire des murs de barbelés quand les réfugiés et les migrants sont trop nombreux pour ses besoins, négocie des arrangements sordides pour renvoyer ces réfugiés dont elle ne peut se servir vers les camps dont ils essaient de s’échapper – comme elle l’a fait par son accord récent avec la Turquie.
La tour de Babel nationaliste et le mensonge de la démocratie bourgeoise
La division entre les pro et anti-UE va au-delà de la division politique traditionnelle bourgeoise entre gauche et droite. La campagne pour rester (remain) dans l’UE a été menée par une fraction du Parti conservateur et soutenue officiellement par une majorité des Travaillistes et par le SNP2 en Écosse. La gauche était également divisée entre les pro et anti-UE. Corbyn3 défendait le remain, mais son point de vue idéologique trouve ses origines chez les Travaillistes traditionnels partisans d’une “Grande-Bretagne socialiste”, c’est-à-dire d’un îlot de capitalisme d’État autarcique. Il était évident qu’il soutenait la campagne pour Rester avec peu d’enthousiasme. Ses supporters dans le Socialist Workers’ Party4 et autres groupes semblables soutenaient le “Left Exit” (sortie à gauche), un reflet caricatural du camp Brexit. Cette tour de Babel des nationalismes, qu’ils soient pro ou anti-UE, crée un brouillard idéologique de sorte qu’il en émerge seulement les intérêts de la Grande-Bretagne et ceux du système existant.
Et tous les groupes et partis capitalistes rendent le brouillard encore plus épais en répandant leurs mensonges sur la “démocratie”, l’idée que les élections capitalistes peuvent vraiment exprimer “la volonté du peuple”. Un élément clé dans la campagne pour “Sortir” (Leave) était l’idée de “reprendre le contrôle de notre pays” des mains des bureaucrates étrangers – un pays qui pour l’immense majorité n’a jamais été “à eux” parce qu’il appartient et est contrôlé par une petite minorité qui utilise les institutions démocratiques pour assurer sa domination. Finalement, indépendamment du vainqueur des élections, la classe ouvrière sera toujours exclue du pouvoir et exploitée. L’isoloir démocratique n’est pas – comme la “gauche” le prétend souvent – un moyen pour que la classe ouvrière puisse exprimer sa conscience, même de façon défensive. Les référendums, en particulier, ont depuis toujours été un moyen de mobiliser les forces les plus réactionnaires de la société, ce qui était déjà évident sous le régime dictatorial de Louis-Napoléon Bonaparte en France au xixe siècle. Pour toutes ces raisons et malgré les convulsions politiques créées par le vote en faveur du Brexit, le référendum est un “succès” pour la démocratie bourgeoise présentée comme le seul modèle possible de débat politique.
L’alternative ouvrière
Face à un système mondial qui semble déterminé à transformer chaque pays en bunker où seuls les patriotes sont dignes de survie, certains groupes ont défendu le slogan : “À bas les frontières !” (“No borders”). C’est un objectif louable, mais pour se débarrasser des frontières, il faut se débarrasser des États-nations. Et pour se débarrasser de l’État, il faut se débarrasser des rapports sociaux capitalistes qu’il protège. Tout cela nécessite une révolution mondiale des exploités qui établiront une nouvelle forme de pouvoir politique qui démantèlera l’État bourgeois et remplacera la production capitaliste soumise à la loi du profit par la production communiste visant à satisfaire les besoins universels de l’humanité.
Ce but semble infiniment éloigné aujourd’hui, la décomposition progressive de la société capitaliste – surtout sa tendance à emporter la classe ouvrière dans sa propre chute matérielle et sa déchéance morale – contient le danger que cette perspective soit définitivement perdue. Pourtant, cela reste le seul espoir pour l’avenir de l’humanité et il ne s’agit pas de l’attendre passivement comme on attendrait le Jugement dernier. Les graines de la révolution se trouvent dans le renouveau de la lutte de classe, retrouvant le chemin de la résistance contre les attaques de droite et de gauche, dans les mouvements sociaux contre l’austérité, la répression et la guerre ; dans la lutte pour la solidarité avec tous les exploités et les exclus, dans la défense des ouvriers “étrangers” contre les commandos xénophobes et les pogroms. C’est la seule lutte qui puisse ranimer la perspective d’une communauté mondiale.
Alors que devons-nous faire, nous communistes, en tant que minorité de la classe ouvrière qui reste convaincus que la perspective d’une communauté mondiale humaine est possible ? Nous devons reconnaître que dans la situation actuelle nous nageons totalement à contre-courant. Comme les fractions révolutionnaires du passé qui ont résisté face à la marée de la réaction et de la contre-révolution, nous devons rejeter tout ce qui compromet nos principes révolutionnaires issus de décennies d’expérience de la classe ouvrière. Nous devons insister sur le fait qu’il ne peut y avoir aucun soutien en faveur d’un État capitaliste ou une alliance d’États, aucune concession à l’idéologie nationaliste, aucune illusion sur le fait que la démocratie capitaliste nous offrirait le moyen de nous défendre contre le capitalisme. Nous refusons de participer aux campagnes capitalistes d’un côté ou de l’autre, précisément parce que nous avons la responsabilité de participer à la lutte de classes. D’autant plus que la lutte de la classe ouvrière doit être indépendante de toutes les forces du capitalisme qui cherchent à la dévoyer ou l’embrigader. Face à l’immense confusion et au désarroi qui règne actuellement dans notre classe, nous devons engager un effort théorique sérieux pour comprendre un monde qui devient de plus en plus compliqué et imprévisible. Le travail théorique ne signifie pas s’abstraire de la lutte de classe, il aide à préparer le moment où, comme le disait Marx, la théorie devient une force matérielle en se saisissant des masses.
Amos, 9 juillet 2016
1 En anglais, remains, un jeu de mots sur le slogan “Remain” de ceux qui menaient campagne pour le maintien de la Grande-Bretagne au sein de l’UE.
2 Parti nationaliste écossais.
3 Jeremy Corbyn, dirigeant du Parti travailliste.
4 Le plus important groupement trotskiste en Grande-Bretagne, qui joue un rôle dans la politique bourgeoise similaire à celui de Lutte ouvrière en France.
Géographique:
- Grande-Bretagne [33]
Personnages:
- Donald Trump [34]
- Marine Le Pen [35]
- Aube Dorée [36]
- Jobbik [37]
- Jeremy Corbyn [38]
Rubrique:
Le “radicalisme” syndical au service des attaques!
- 1229 lectures
“L’épreuve de force” ! La “guerre d’usure” ! La “montée des tensions” ! Telles sont les expressions consacrées dans les médias depuis plusieurs semaines pour caractériser l’affrontement supposé entre le gouvernement français et les syndicats à propos de la loi “El Khomri”. La confrontation est spectaculaire, médiatisée, pleine de rebondissements. Elle a même été jusqu’au point où le gouvernement a, pendant quelques heures, interdit une manifestation syndicale avant de se dédire et l’autoriser : du jamais vu depuis plus de cinquante ans !
Un réel mécontentement s’est exprimé et s’exprime encore face à cette attaque contre les conditions de travail de l’ensemble de la classe ouvrière. Ce mécontentement a donné lieu à une combativité et une mobilisation relativement importantes lors de certaines journées d’action. Pourtant, cette combativité, contrairement à ce qu’on voudrait nous faire croire, n’a pas embrasé la majorité des salariés. Malgré les images de barrages, de pneus enflammés sur les routes, les grèves sont très souvent restées minoritaires et rien n’a été dans le sens de dynamiser et développer la confiance, l’unité et la conscience dans les rangs ouvriers. Au contraire ! “Les défilés syndicaux qui consistent à battre le pavé les uns derrière les autres, au bruit de la sono et de slogans rabâchés ad nauseam, sans pouvoir débattre et construire quoi que ce soit ensemble, n’ont pour seul effet que de démoraliser et véhiculer un sentiment d’impuissance” (1). Il en est de même pour les questionnements de nombreux salariés, de jeunes lycéens, étudiants et chômeurs qui sentent bien que l’omniprésence syndicale et les journées d’action sans lendemain ne vont pas dans le sens de la lutte. Mais ils n’ont pas aujourd’hui la capacité de remettre en cause cette chape de plomb ni de développer une critique collective et ouverte. Même le mouvement Nuit debout, censé offrir un “espace” de réflexion plus profonde, “les conduit dans l’impasse et renforce les visions les plus conformistes qui soient. Pire, Nuit debout permet même à des idées nauséabondes, telle la personnalisation des maux de la société sur quelques représentants du système (les banquiers, l’oligarchie...), de s’épanouir sans complexe” (2). Souvent, parmi les plus jeunes, certains sont tentés de s’illusionner sur une “guerre de classe”, un avant-goût de “grand soir”, un “Mai 68”, une mobilisation ouvrière telle qu’on ne l’a pas vu depuis des années. Mais le gouvernement n’est pas prêt à reculer sous la pression de la rue comme en 2006 lors de la lutte contre le CPE. Même si la cohérence est loin d’être effective au sein du pouvoir gouvernemental socialiste, dans un premier temps du moins, gouvernement et syndicats, CGT en tête, ont largement mis en scène la confrontation sociale, l’ensemble de la classe ouvrière se trouvant manipulé pour renforcer sa désorientation actuelle.
La “radicalisation” de la CGT, à la pointe de la contestation, a été grandissante. Pendant plusieurs mois, le mouvement social ne s’est pas calmé et chacun des acteurs syndicaux et gouvernementaux a alimenté à sa façon cette “confrontation” : la CGT par des blocages de raffineries, de centrales nucléaires, des barrages routiers, des grèves à répétition dans les transports en commun, dans le secteur public, dans les secteurs de l’énergie. Le gouvernement, particulièrement Manuel Valls, a multiplié les mises en demeure, les déclarations provocatrices jusqu’à cette décision momentanée, mais stupéfiante, d’interdire une manifestation syndicale à Paris. Tout cela sur fond de violences des “casseurs”, médiatisées et instrumentalisées à l’extrême. La tension aurait ainsi été à son comble et le pays à feu et à sang. Quasiment l’état de guerre… si l’on en croit la bourgeoisie et sa presse qui ne manquent pas une occasion d’employer ce vocabulaire guerrier et de tout dramatiser au point que cela en devient surréaliste si l’on prend la peine de quitter son écran de télévision et de regarder la réalité en face.
Le paroxysme de la confrontation a, nous dit-on, été atteint lors des opérations de “blocage de l’économie”, en particulier des raffineries et des ports pétroliers. Bloquer les raffineries serait, comme en 2010 contre la loi sur les retraites, l’arme ultime face à la bourgeoisie, une manière de “taper là où ça fait mal”. Or, non seulement la réalité de la paralysie du secteur pétrolier a été plus faible qu’en 2010, mais cela a constitué un puissant facteur de division au sein de la classe ouvrière. D’un côté, les secteurs les plus combatifs se sont trouvés enfermés derrière des barrières dérisoires, coupés du reste de leur classe, à la merci de la répression policière ; de l’autre, des ouvriers mécontents mais dans l’expectative, peu impliqués dans un mouvement social qui leur échappe complètement et qui sont parfois exaspérés par des grèves à répétition dans les transports, par des blocages qui les pénalisent en priorité.
La CGT et l’ensemble des syndicats dits “combatifs” ne sont pas soudainement devenus “révolutionnaires”, pas plus qu’ils ne se battent pour la défense des intérêts ouvriers. Avec la décadence du système capitaliste, les syndicats, dont la raison d’être originelle (l’aménagement de l’exploitation capitaliste) est profondément conservatrice, sont devenus un rouage essentiel de l’appareil étatique qui a pour objectif d’enfermer la classe ouvrière sur le terrain de la négociation afin de saboter les luttes et la conscience ouvrière, d’étouffer toute perspective révolutionnaire. Le rôle fondamental des syndicats, depuis près d’un siècle et leur passage dans le camp bourgeois, c’est la division et le cloisonnement des luttes pour saper tout mouvement de masse susceptible de remettre en cause l’ordre capitaliste (3). Le radicalisme actuel des syndicats leur sert donc à faire oublier leur complicité directe dans les attaques portées depuis des décennies par le gouvernement socialiste et leur gestion de l’exploitation dans les entreprises et les administrations.
La complicité des syndicats et du gouvernement n’empêche pas les luttes d’influence et la confrontation entre cliques. La volonté du gouvernement de recrédibiliser l’appareil syndical passait aussi par une remise au pas de l’hégémonie de la CGT dans le paysage syndical français, au profit de syndicats plus “tolérants”, plus “gestionnaires” comme la CFDT. L’article 2 de la loi Travail visant à faire passer les accords d’entreprise avant les accords de branche aboutirait surtout à voir le “fonds de commerce” financier et le pouvoir syndical de la CGT s’étioler au bénéfice d’autres syndicats dits “réformistes”, particulièrement dans les petites et moyennes entreprises qui sont majoritaires en France. Voilà quel est le sens de la radicalité de la CGT : préserver son leadership syndical au sein de l’État et maintenir sa position dans l’appareil d’exploitation !
Du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, la CGT est tout sauf radicale. Alors que notre classe tire sa force de sa capacité à s’unir, à étendre ses luttes par-delà les frontières corporatistes et nationales, chacun se doit de défiler derrière “son” syndicat catégoriel, avec “sa” chasuble bien visible, “ses” mots d’ordre et “ses” banderoles spécifiques. “Tous ensemble” peut-être, mais dans la limite de sa propre boutique syndicale. Rien à voir avec une recherche d’extension de la lutte, de propositions pour entraîner tous les secteurs à se battre ensemble, comme ce fut le cas en 2006 pendant plusieurs semaines.
De la même manière, les assemblées qui devraient être le poumon de la lutte laissent place à des simulacres réunissant une minorité de salariés, où les syndicats décident de tout, où sont entérinées des décisions d’appareils prises à l’avance. Rien à voir avec des AG ouvertes à tous, jeunes ou vieux, sans considération d’appartenance professionnelle, syndicale ou politique, des AG où sont élus les comités de grève, où doit se discuter ouvertement la conduite de la lutte, son extension, pour établir un rapport de force avec l’État. La lutte anti-CPE de 2006, dont l’État et ses syndicats veulent nous faire oublier les enseignements, fut exemplaire à ce niveau et décrédibilisa ouvertement les pratiques syndicales.
Ce partage du travail de la part des agents de l’État, gouvernementaux et syndicaux, a pour but de profiter au maximum de la faiblesse de la classe ouvrière pour faire passer les attaques, la manipuler, la diviser et en définitive la démoraliser, tout en lui faisant prendre des vessies pour des lanternes : au bout du compte, il faut arriver à lui faire croire que seuls des syndicats combatifs comme la CGT ou FO sont capables de tenir tête à un gouvernement arrogant, pire que la droite, et sont susceptibles de faire gagner les revendications ouvrières. Sans eux, rien ne serait possible.
C’est pourquoi la classe ouvrière se doit de faire l’analyse la plus profonde et lucide de ce mouvement social pour pouvoir reconnaître ses ennemis et préparer les véritables luttes du futur.
Stopio, 24 juin 2016
1) “Quelle est la véritable nature du mouvement Nuit debout ?”, RI no 458.
2) Idem.
() Voir notre brochure, Les syndicats contre la classe ouvrière.
Géographique:
- France [4]
Récent et en cours:
- Loi El Khomri [39]
Rubrique:
La répression montre le vrai visage de l’État démocratique!
- 1593 lectures
Le 24 mars dernier, une scène filmée par un téléphone portable faisait le tour des réseaux sociaux et des journaux télévisés : trois policiers saisissaient un lycéen à terre et tandis que le jeune garçon se relevait, un policier le frappait d’un violent coup de poing au visage. Il ne s’agit là que d’un exemple parmi tant d’autres. La répression policière a en effet été féroce tout au long de ce mouvement contre la loi El Khomri. Et cela, avec la bénédiction d’un gouvernement prétendument “socialiste” qui, depuis plusieurs mois, a instauré un climat ultra-sécuritaire. Chaque manifestation, chaque blocage de lycée, d’université ou de raffinerie, ont été le théâtre de la brutalité des forces de l’ordre. C’est surtout la jeune génération qui a fait les frais des interpellations musclées, des passages à tabac et des provocations en tout genre, comme s’il fallait marquer dès le plus jeune âge les enfants d’ouvriers du sceau de la force et de l’ordre bourgeois.
L’État avait d’ailleurs très bien préparé le terrain de la répression. Comme nous l’écrivions dans nos articles sur les attentats de Paris de janvier et de novembre 2015, le renforcement inouï du quadrillage policier et la mise en place de l’État d’urgence ont été de formidables leviers pour créer une situation, tant sur le plan matériel qu’idéologique, où la répression et les provocations policières peuvent s’exercer plus facilement, notamment en exploitant le phénomène des “casseurs” qui servent en grande partie d’alibi à l’action des flics.
La nature répressive de l’État bourgeois
L’État et ses forces de répression sont le produit des contradictions de classes inconciliables et l’instrument de l’exploitation des opprimés au service exclusif de la bourgeoisie. Comment “l’ordre” est-il maintenu ? “Pour que les antagonistes, les classes aux intérêts économiques opposés, ne se consument pas en une lutte stérile, le besoin s’impose d’un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de l’“ordre” ; et ce pouvoir, né de la société mais qui se place au-dessus d’elle et lui devient de plus en plus étranger, c’est l’État”. Mais “Ce pouvoir, en quoi consiste-t-il principalement ? En des détachements spéciaux d’hommes armés, disposant de prisons, etc. (…) L’armée permanente et la police sont les principaux instruments de la force du pouvoir d’État” (1). Ainsi, la réalité de la violence policière n’est ni nouvelle, ni un accident de l’Histoire ou le produit d’une réalisation imparfaite de la démocratie ; elle est une claire expression de la nature profondément oppressive de l’État. La classe dominante a ainsi toujours été extraordinairement brutale face à toute expression de remise en cause de son ordre social. À chaque poussée du prolétariat, la bourgeoisie a tenté de l’ensevelir sous un déluge de fer et de feu. C’est ainsi que sur les pavés mêmes où la police matraque aujourd’hui la jeunesse ouvrière, les armées versaillaises noyaient, en 1871, la Commune de Paris dans le sang.
Dès les origines du mouvement ouvrier, les organisations révolutionnaires ont été confrontées non seulement à la violence de l’État mais à la question même du recours à la violence dans les rangs du prolétariat. Les actions violentes, en elles-mêmes, n’ont jamais été perçues comme une expression de la force politique du mouvement, mais étaient considérées dans un cadre et un contexte historique plus généraux. Même quand elles s’expriment contre les forces de l’ordre, les actions violentes, pas moins que les réponses individuelles, contiennent le danger de saper l’unité de la classe ouvrière. Ceci ne signifie pas pour autant que le mouvement des travailleurs soit “pacifiste”. Il utilise forcément une certaine forme de violence : celle de la lutte de classe contre l’État bourgeois. Mais il s’agit là d’une violence d’une autre nature, libératrice, celle qui accompagne une démarche consciente qui n’a rien à voir avec la violence et la brutalité des classes dominantes dont le pouvoir n’est assuré que par la terreur et l’oppression. Ainsi, l’expérience d’un prolétariat, qui se constituait alors peu à peu en classe distincte, organisée et consciente, a permis de progressivement lutter contre les tentations immédiates de violence aveugle qui furent une des caractéristiques des premières émeutes ouvrières. Par exemple, au xviie siècle, de nombreux ouvriers, un peu partout en Europe, s’étaient soulevés très violemment contre l’introduction de machines à tisser en les détruisant. Ces actes violents, exclusivement contre les machines, étaient le produit du manque d’expérience et d’organisation propre à l’enfance du mouvement ouvrier. Comme le soulignait Marx : “il faut du temps et de l’expérience avant que les ouvriers, ayant appris à distinguer entre la machine et son emploi capitaliste, dirigent leurs attaques non contre le moyen matériel de production, mais contre son mode social d’exploitation” (2).
Les “casseurs”, un phénomène qui se nourrit de la décomposition
En revanche, les expressions politiques cédant à la violence aveugle qui ont émergé au cours du xxe siècle sous des formes diverses et caricaturales, particulièrement après 1968, par exemple en Italie, inspirant les idéologies de type “opéraïstes”,3 ou en Allemagne de l’Ouest, sous de multiples tendances “autonomes”, ne faisaient qu’exprimer l’absence de réflexion et d’orientation sur les moyens nécessaires pour un projet politique contre le capitalisme. À Berlin, par exemple, depuis les années 1980, le Premier mai est devenu le moment ritualisé d’affrontements sans lendemain entre la police et toutes sortes de “casseurs” qui cherchent encore aujourd’hui la confrontation avec les flics, saccagent des magasins et des voitures, identifiant faussement cela avec l’idée de “faire la révolution”.
Les forces “autonomes” d’aujourd’hui, de plus en plus assimilées à celles des “terroristes” par l’État, traduisent l’impuissance et le vide politique laissé actuellement par la grande faiblesse d’une classe ouvrière qui, si elle a pu sortir de plusieurs décennies de contre-révolution stalinienne traumatisante, ne parvient pas encore à se reconnaître comme une classe sociale, à affirmer ses authentiques moyens de lutte et a fortiori sa perspective communiste. Déboussolée, sans orientation, manquant totalement de confiance en ses propres forces, le prolétariat ne parvient pas à reconnaître son identité propre et encore moins sa force historique. Il laisse donc le champ libre à toute l’impatience d’une jeunesse exaspérée, privée du legs de l’expérience politique et momentanément privée de son futur.
C’est ce qui explique en grande partie l’attrait relatif aux yeux de certains jeunes pour les méthodes “autonomes” et “insurrectionnalistes”, ou le succès des théories fumeuses comme celles de la brochure L’insurrection qui vient,4 publiée en 2007 par un certain “Comité invisible”. On peut notamment y lire : “L’offensive visant à libérer le territoire de son occupation policière est déjà engagée, et peut compter sur les inépuisables réserves de ressentiment que ces forces ont réunies contre elles. Les “mouvements sociaux” eux-mêmes sont peu à peu gagnés par l’émeute”. Ce type de discours que partagent peu ou prou bon nombre d’autonomes regroupés sous diverses bannières protéiformes (Black Blocs, défenseurs de “zones autonomes” et certains antifascistes) les propulse de plus en plus sur les devants de la scène sociale. Depuis quelques années, de plus en plus de jeunes qui subissent la violence sociale du capitalisme, la précarité et le chômage, expriment leur colère et leur exaspération par la révolte, parfois de manière violente. Leur ras-le-bol les conduit facilement à affronter les forces de l’ordre lors des manifestations. Une partie de ces jeunes s’expose ainsi aux influences et agissements de “casseurs” ou de ces groupes se revendiquant comme “autonomes” qui se singularisent par des actes stériles tels que dégradations, saccages de vitrine, etc., qui peuvent malheureusement fasciner les plus désespérés.
Il ne s’agit nullement de mettre sur un pied d’égalité, comme s’y emploie sans vergogne la presse bourgeoise, la violence de l’État, par l’entremise de policiers suréquipés, et celle de quelques manifestants souvent armés de projectiles dérisoires, comme si la première était la conséquence “légitime” de la seconde. Mais le problème de cette violence stérile, de ces rixes avec la police, c’est que l’État les instrumentalise totalement à son profit. Ainsi, le gouvernement a volontairement poussé tous ces “casseurs” et autres “autonomes” dans une souricière tout en cherchant à “démontrer par les faits” à l’ensemble des prolétaires que la violence et la révolte conduisent inévitablement au chaos. La dégradation de l’hôpital Necker à Paris en est une parfaite illustration : le 14 juin, la police chargeait avec une rare violence une manifestation qui passait aux abords d’un hôpital pour enfants. Des groupes de casseurs, probablement excités par des agents provocateurs infiltrés,5 ont fini par s’en prendre à quelques vitrines de l’hôpital sous l’œil tout à coup passif et satisfait de plusieurs compagnies de CRS. Le soir-même, la presse bourgeoise faisait évidement ses choux gras de l’événement et des déclarations scandalisées du gouvernement qui n’a pas raté l’occasion d’opposer les “radicaux” aux enfants malades. La bourgeoisie polarise ainsi l’attention sur les éléments les plus radicaux à la marge de toute une jeunesse meurtrie, victimes eux-mêmes de l’ordre bourgeois, pour justifier la brutalité de la répression policière. Pour mieux présenter l’État et ses institutions comme les ultimes remparts face à ceux qui menacent “l’ordre public” et la démocratie, les média exhibent les violences et les destructions symboliques des “casseurs”. Cela a également pour effet de diviser les manifestants, de générer de la méfiance au sein de la classe ouvrière et surtout d’étouffer, par l’amalgame, la moindre idée de solidarité et de perspective révolutionnaire. Ainsi, loin d’ébranler le système, ces phénomènes permettent à la bourgeoisie d’exploiter leurs actions pour imprimer sa volonté de discréditer toute forme de lutte contre l’État mais surtout de mieux déformer la perspective révolutionnaire. Les manifestations de violence actuelles sont à la fois le reflet d’une faiblesse de la lutte de classe et le produit d’une décomposition sociale que l’État et son gouvernement utilisent en s’appuyant sur la désorientation de notre classe, pour développer une ambiance pouvant donner libre cours à des comportements propres aux couches sociales sans avenir, frustrées et incapables d’opposer à la barbarie du capitalisme d’autre perspective que la rage aveugle et nihiliste. Les actes de minorités révoltées (telle que l’agression au cocktail Molotov, le 18 mai dernier, de deux policiers dans leur véhicule, en marge d’un rassemblement totalement téléguidé par l’État pour dénoncer la “haine anti-flics”) expriment un certain désespoir et sont animés par un esprit de haine et de vengeance. Ces jeunes tombent ainsi dans un piège, celui de la spirale d’un déchaînement de violence aveugle.
Tout au long de son existence comme à travers son expérience, le mouvement ouvrier a démontré que la construction et la manifestation d’un véritable rapport de forces avec son ennemi de classe s’engage sur un tout autre chemin et avec des méthodes radicalement à l’opposé. Pour ne prendre que quelques exemples : durant l’été 1980 en Pologne, face aux menaces de répression, les ouvriers s’étaient immédiatement mobilisés massivement par-delà les secteurs dans les villes de Gdansk, Gdynia et Sopot, faisant reculer le gouvernement. Lorsque l’État menaçait d’intervenir militairement pour réprimer, les ouvriers de Lublin, solidaires, menacèrent à leur tour de paralyser les transports, les chemins de fers qui reliaient les casernes russes en RDA au reste de l’Union soviétique. L’État polonais avait fini par reculer. Face aux répressions passées des années 1970 et 1976, la réponse ouvrière n’avait pas été celle de la vengeance, de la violence, mais celle du souvenir et de la solidarité.6 Plus récemment en France, dans un contexte différent, au moment de la lutte contre le CPE en 2006, la jeunesse prolétarisée des universités avait pris en main ses luttes en organisant des assemblées générales ouvertes à tous pour étendre le mouvement. Le gouvernement Villepin, craignant l’extension, dut reculer. En 2011, lors du mouvement des Indignés en Espagne, les gens s’étaient réunis dans des assemblées de rue pour discuter, échanger leur expérience et ainsi forger une commune volonté de lutte. La bourgeoisie espagnole a tenté de casser cette dynamique en provoquant des affrontements avec la police et en déchaînant des campagnes médiatiques sur les “casseurs”. Mais la force et la confiance accumulées dans les assemblées ouvertes ont permis au prolétariat de répondre par des manifestations massives, en particulier à Barcelone où des milliers de personnes ont plusieurs fois su résister courageusement aux attaques policières.
Ainsi, ce n’est pas la violence en soi, l’esprit de revanche, l’action coup-de-poing minoritaire et isolée qui crée la puissance d’un mouvement face à l’État capitaliste mais au contraire une dynamique d’actions conscientes dans la perspective de son renversement et de sa destruction.
La force de notre classe réside donc précisément dans sa capacité à opposer à la provocation policière sa massivité et sa conscience.
Le pourrissement sur pied du capitalisme, générant une tendance à la fragmentation du tissu social et dévalorisant tout effort de pensée et de réflexion cohérente, poussant à “l’action pour l’action” et aux solutions simples et immédiates,7 alimentées par un ras-le-bol et des rancœurs accumulées, un esprit de revanche, favorisent l’élan de groupuscules qui agissent d’autant plus facilement qu’ils sont eux aussi la proie choisie des provocations et manipulations policières. Les éléments les plus violents sont souvent le produit décomposé d’individus issus des couches petites-bourgeoises ou d’une intelligentsia parfois déclassée, connaissant une révolte exacerbée face à la barbarie du système capitaliste. Sans avenir, leurs actions marquées par l’individualisme, l’aveuglement de la haine et l’impatience, sont les expressions d’impulsions immédiates, souvent sans véritable but à atteindre. On retrouve ainsi les mêmes racines nihilistes qui poussent par exemple les jeunes qui partent pour le djihad et certains de ces “autonomes” vers la violence pure, la fascination pour la casse et les destructions. Ce n’est donc pas un hasard si les autorités utilisent et laissent délibérément entrer ces “casseurs” dans les manifestations, aidés en cela par les supplétifs de la police que sont les “gros bras” qui composent le service d’ordre syndical, notamment celui de la CGT, pour pourrir toute expression de lutte.
Cette réalité sociale correspond bien aujourd’hui à une situation où l’État se sent suffisamment fort pour porter ses attaques brutales contre la classe ouvrière tout en pouvant disqualifier toute idée de perspective révolutionnaire. La bourgeoisie utilise les violences et les saccages pour faire peur et recrédibiliser en partie l’action syndicale, pour rabattre “faute de mieux” certains ouvriers combatifs vers les syndicats qui, malgré la méfiance dont ils font l’objet, apparaissent comme les seuls capables “d’organiser et mener la lutte”. Une telle situation ne fait qu’affaiblir les consciences en redorant le blason de ces saboteurs de la lutte, accentuer l’exposition à la répression, renforcer la terreur étatique par la surveillance et le flicage.
Qu’est-ce qu’une perspective révolutionnaire?
Un authentique mouvement de la classe ouvrière n’a rien à voir avec ces fausses alternatives à l’encadrement des syndicats officiels, aux violences “émeutières” qui ne font que conduire ceux qui veulent vraiment lutter, notamment les jeunes présents dans les manifestations, vers le néant politique et la répression. Ce qui, a contrario, caractérise la nature du combat ouvrier, c’est la solidarité, la recherche de l’unité dans la lutte, la volonté de combattre le plus massivement possible contre l’exploitation capitaliste. L’essence de ce combat est celle de l’unification des luttes, celle d’un point de vue international faisant l’union de tous, chômeurs, actifs, jeunes, vieux, retraités, etc., une forte mobilisation capable de rallier toutes les autres couches de la société victimes des souffrances générées par le système. Cela, afin de créer un véritable rapport de force capable de faire reculer la bourgeoise et ses attaques et de retenir le bras de la répression de l’appareil d’État. C’est bien cette mobilisation en grand nombre, avec une réelle prise en main par les ouvriers eux-mêmes, générant une autonomie de classe basée sur la confiance, qui peut seule avoir la capacité de faire reculer l’État et la bourgeoisie. L’arme principale de cette lutte est avant tout son caractère solidaire et massif, son unité et sa conscience, sa volonté de faire la clarté maximale sur les moyens et les buts du combat. C’est pour cela que la classe ouvrière ne recherche pas d’emblée à utiliser la violence pour créer un rapport de forces face à la classe dominante, mais s’appuie d’abord sur son nombre et son unité.
La lutte du prolétariat n’a rien à voir avec les escarmouches et les heurts filmés par les journalistes. Loin des impasses et de l’instrumentalisation auxquelles nous assistons, son combat historique et international repose au contraire sur son action consciente et massive. Elle incarne un vaste projet dont la dimension culturelle et morale contient en germe l’émancipation de toute l’humanité. Comme classe exploitée, le prolétariat n’a aucun privilège à défendre et que des chaînes à perdre. C’est pour cela, par exemple, que dans la programme de la Ligue spartakiste, rédigé par Rosa Luxemburg, le point 3 énonce que : “pour atteindre ses buts, la révolution prolétarienne n’a pas besoin de terreur ; elle hait et méprise l’assassinat des hommes. Elle n’a pas besoin de ces moyens de lutte, car elle ne combat pas des individus mais des institutions”. Le projet d’épanouissement social de tous et de chacun, par son esprit de solidarité et de lutte collective, préfigure la véritable communauté humaine mondiale du futur. Sa lutte n’est pas celle d’un état-major qui dirige du sommet à la base mais prend la forme d’une résistance consciente, faite d’initiatives multiples et créatrices : “La grève de masse (…) voit tantôt la vague du mouvement envahir tout l’Empire, tantôt se diviser en un réseau infini de minces ruisseaux ; tantôt elle jaillit du sol comme une source vive, tantôt elle se perd dans la terre. Grèves économiques et politiques, grèves de masse et grèves partielles, grèves de démonstration ou de combat, grèves générales touchant des secteurs particuliers ou des villes entières, luttes revendicatives pacifiques ou batailles de rue, combats de barricades – toutes ces formes de lutte se croisent ou se côtoient, se traversent ou débordent l’une sur l’autre c’est un océan de phénomènes éternellement nouveaux et fluctuants” (8). Cet élan vivant, libérateur, s’exprimant par la grève de masse puis les conseils ouvriers devant mener à l’insurrection, est une des conditions de la prise du pouvoir à l’échelle internationale. Pour l’instant, cette perspective n’est pas à la portée du prolétariat qui est bien trop faible. Bien que non défait, il n’a pas la force suffisante pour s’affirmer et a besoin d’abord de prendre conscience de lui-même, de renouer avec sa propre expérience et son histoire. La révolution n’a rien d’immédiat et d’inéluctable. Un long et difficile chemin, chaotique, semé d’embûches, reste encore à parcourir. Un véritable bouleversement des esprits doit encore s’opérer en profondeur avant de pouvoir imaginer l’affirmation d’une perspective révolutionnaire.
EG-WH, 26 juin 2016
1) Lénine, L’État et la révolution.
2) Marx, Le Capital, livre I.
3 L’opéraïsme est un courant “ouvriériste” apparu en 1961 [40] autour de la revue Quaderni Rossi. Mario Tronti et [41]Toni Negri [42] en étaient les principaux théoriciens. En 1969 [43], le courant opéraïste se divisa en deux organisations rivales : Potere Operaio [44] et Lotta Continua [45]. À partir de 1972 [46], les opéraïstes s’engagèrent dans le mouvement autonome prônant les émeutes et les actions violentes dites “exemplaires”.
4 Cette brochure se serait vendue à plus de 40 000 exemplaires.
5 Comme ce fut, par exemple, le cas pour les policiers démasqués en Espagne par les manifestants eux-mêmes lors du mouvement des Indignés en 2011. En France, l’infiltration des manifestations par des policiers de la BAC chargés d’exciter les foules est de notoriété publique.
6 Les ouvriers avaient parmi leurs revendications demandé un monument pour commémorer leurs morts, les victimes de la répression sanglante des mouvements précédents en 1970-71 et en 1976.
7 À l’image des slogans entonnés : “Nous devons détester la police” ou “Tous les flics sont des bâtards”.
8) R. Luxemburg, Grève de masse, Parti et Syndicats.
Géographique:
- France [4]
Récent et en cours:
- Loi El Khomri [39]
- Hôpital Necker [47]
Rubrique:
Des difficultés croissantes pour la bourgeoisie et pour la classe ouvrière
- 2042 lectures
Lorsque 52 % des votants au référendum en Grande-Bretagne sur le maintien du pays dans l’Union européenne ont choisi la porte de sortie, ceci n’était pas un événement isolé mais un exemple supplémentaire du poids grandissant de populisme. Cela se voit aux États-Unis dans le soutien à Donald Trump dans la bataille pour la présidence du pays, en Allemagne avec l’apparition de forces politiques à la droite des Démocrates chrétiens (Pegida et Alternative für Deutschland), aux dernières élections présidentielles en Autriche où les Sociaux-démocrates comme les Démocrates chrétiens ont été dépassés par la concurrence entre les Verts et la droite populiste, en France, avec la montée en puissance continue du Front national, en Italie, avec le mouvement Cinq Étoiles ou encore à travers les gouvernements actuels en Pologne et en Hongrie.
Le populisme n’est pas un acteur de plus dans le jeu politique entre partis de gauche et de droite ; il doit son existence à un mécontentement très répandu qui ne trouve aucun autre moyen de s’exprimer. Il se place entièrement sur le terrain bourgeois et s’appuie sur un rejet des élites et de l’immigration, comme sur une méfiance envers les promesses et l’austérité de la gauche et de la droite, exprimant ainsi une perte de confiance à l’égard des institutions de la société et l’incapacité de reconnaître l’alternative révolutionnaire de la classe ouvrière.
Dans nos “Thèses sur la décomposition” publiées en 1990, nous parlions déjà de “... cette tendance générale à la perte de contrôle par la bourgeoisie de la conduite de sa politique”, et “la perte du contrôle sur sa propre stratégie politique”. Bien que l’utilisation de la démocratie ait été un outil et une idéologie très efficaces pour la classe capitaliste, lui permettant de maintenir son contrôle de la situation politique, la montée du populisme traduit la tendance latente à ce qu’émergent de plus en plus de difficultés pour la classe capitaliste.
A un certain niveau, la montée du populisme renforce la démocratie : les mécontents se rallient aux partis populistes, alors que d’autres s’y opposent farouchement. Cependant, le vote en Grande-Bretagne pour “Sortir” (Leave) de l’Union européenne nous rappelle les difficultés que le populisme peut engendrer pour le contrôle politique de la bourgeoisie. La classe dominante utilise la démocratie pour essayer de légitimer son règne, mais le populisme mine ses tentatives de maintenir cette légitimité. Le populisme pose des problèmes à l’ensemble de la bourgeoisie parce que son développement provoque des bouleversements imprévisibles du “bon fonctionnement de la démocratie”.
La bourgeoisie britannique face au problème du populisme
Nous avons souvent, à juste titre, souligné que la bourgeoisie britannique est la plus expérimentée au monde, capable de manœuvrer sur les plans diplomatique, politique, et électoral à tel point que les autres États capitalistes de toute la planète l’envient. Or, le vote pour le Brexit remet en cause ces capacités.
Bien que le capitalisme au Royaume-Uni ait une longue tradition de l’utilisation des élections, il n’a que rarement eu recours à des référendums. Après celui pour l’adhésion à la CEE (le prédécesseur de l’Union européenne actuelle) en 1975 et mis à part des référendums locaux en Irlande du Nord, au Pays de Galles et en Écosse, avant cette année, il n’y avait eu que celui sur la modification du système de vote parlementaire en 2011. Éviter les référendums est une politique sage pour la bourgeoisie, puisqu’il y a toujours le danger que le vote soit utilisé comme moyen de protestation à propos de n’importe quoi. En fait, la mise en place de ce référendum sur le Brexit par David Cameron était une immense erreur de calcul compte tenu de la croissance du populisme. Loin d’être limité à une bataille avec l’UKIP1 et les Conservateurs eurosceptiques, des gens de toute obédience politique étaient attirés dans la bagarre. Ceci explique aussi la faiblesse de la campagne pour “Rester” (Remain) dans l’UE qui présentait des arguments de bon sens et des considérations rationnelles (du point de vue capitaliste), alors que la campagne “Sortir” a fait appel, avec davantage de succès, aux émotions irrationnelles.
Les “Brexitistes” ont personnalisé le débat en ciblant les riches Cameron et Osborne2 qui ne comprenaient pas les soucis des gens ordinaires ; en disant que les gens en avaient marre des experts, et qu’ils devaient faire confiance à leurs pulsions tout en pointant l’immigration comme un problème, aggravé de surcroît par l’appartenance à l’UE. Ils ont aussi promis 350 millions de Livres supplémentaires par semaine pour le NHS,3 disant après coup qu’il s’agissait d’une “erreur”. Face à cela, la campagne “Rester” appuyait ses arguments sur le besoin de continuer de profiter de l’appartenance à l’UE, affichait les analyses d’une armée d’économistes et relayait les témoignages de nombreux hommes d’affaires reconnaissant l’importance de l’UE. Lorsque la campagne “Rester” parlait de l’immigration, elle était d’accord avec les “Brexitistes” pour dire que c’était un problème mais insistait sur le fait que le cadre de l’UE offrait la meilleure garantie pour limiter l’arrivée de gens à la recherche d’un emploi ou tout simplement venant sauver leur peau.
Les conséquences prévisibles et imprévisibles du Brexit
Après le référendum, il n’y aura pas de “retour à la normale”. Aucun parti n’avait prévu de plan en cas de victoire du Leave. Quoi qu’il arrive, ce seront ceux qui souffrent déjà qui souffriront le plus. Alors qu’Osborne annonçait rapidement une baisse de l’impôt sur les entreprises afin d’attirer les investisseurs en Grande-Bretagne, il est clair que c’est la classe ouvrière qui subira les pires attaques. Sur le plan économique, il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui va se passer désormais. Comment le capitalisme peut-il au mieux défendre ses intérêts ? Comment les pays de l’UE peuvent le mieux se défendre contre les dommages collatéraux du résultat du référendum ? Les répercutions sont évidemment internationales. Bien sûr, il y aura des tentatives d’en limiter l’impact sur l’UE. Les dangers d’une contagion du Brexit vers d’autres pays sont réels. Une sortie complète de la Grande-Bretagne pourrait renforcer ces forces centrifuges.
Une autre perspective est le renforcement des tendances séparatistes. Suite au vote écossais largement majoritaire pour “Rester” et aux élections parlementaires de 2015 à l’issue desquelles presque tous les députés écossais appartenaient au SNP,4 il existe la possibilité d’une perte de contrôle encore plus grande au point même de mettre en danger l’unité du Royaume-Uni. La situation est différente en Irlande du Nord, mais là aussi la majorité était pour “Rester”, ce qui pourrait créer des difficultés supplémentaires pour le Royaume-Uni.
Sur le plan politique, il y aura de nouvelles alliances et il n’y a aucune garantie que nous verrons un retour à la division classique entre la Gauche et la Droite. Les choses ne vont pas se calmer si facilement après toutes les luttes intestines au sein du Parti conservateur. Le gouvernement conservateur était profondément divisé par la campagne et suite au référendum la bagarre entre Gove5 et Johnson6 a révélé encore plus de divisions dans le camp du Brexit. Des deux candidates pour la direction du Parti conservateur, Theresa May7 était du côté “Rester” mais dit maintenant que “Brexit veut dire Brexit” alors qu’ Andrea Leadsom déclarait en 2013 qu’une sortie de l’Europe “serait une catastrophe pour notre économie”, mais elle a rejoint la campagne pour “Sortir” en 2016.8
La situation au sein du Parti travailliste reflète bien les difficultés politiques auxquelles est confrontée la bourgeoisie. Ce parti n’est pas au gouvernement, mais son rôle dans l’opposition est important et il doit se préparer pour l’avenir lorsque la classe ouvrière se mettra à bouger. Il y a un fossé entre les députés travaillistes qui ne soutiennent pas Corbyn en tant que dirigeant, et les militants du parti qui l’ont élu.9 Les syndicats, quant à eux, ne sont pas unis, mais ils joueront un rôle dans la situation et pas forcément dans le sens de la stabilité.
Le résultat du référendum en Grande-Bretagne est un fait majeur qui inquiète la bourgeoisie des autres pays. Si la bourgeoisie britannique, droite et gauche confondues, a du mal à maîtriser le populisme, alors ce sera pareil dans tous les États. Si la démocratie est un des principaux moyens pour contenir et dévoyer les poussées de la classe ouvrière et d’autres couches sociales, la force du populisme montre que le contrôle du processus démocratique par la bourgeoisie a ses limites et ne suit pas toujours la volonté de ses fractions les plus éclairées.
La classe ouvrière face au populisme
Une des raisons de la montée du populisme est la faiblesse de la classe ouvrière sur le plan de ses luttes, de sa conscience et de la compréhension de sa propre identité. Si la classe ouvrière se reconnaissait comme étant capable de présenter une alternative au capitalisme, ce serait un facteur déterminant dans la perspective de l’édification d’une réelle communauté humaine. Mais ce n’est pas le cas aujourd’hui.
En plus de cela, beaucoup d’ouvriers se sont laissés berner par le populisme, trompés par l’idée que “le peuple” doit se dresser contre “les élites”. Il est significatif que les ouvriers ont eu plus tendance à voter “Sortir” dans les vieilles régions industrielles qui ont été les plus appauvries et négligées. Le Parti travailliste a pensé que le soutien des ouvriers dans ces régions lui était acquis, mais bien que la majorité de l’électorat travailliste ait voté pour “Rester”, une minorité significative a voté dans le sens inverse. Ce sont ces secteurs de la classe ouvrière qui ont le plus souffert des politiques “néo-libérales” qui ont démantelé des pans entiers d’industrie dans les anciens pays centraux du capitalisme, qui ont transformé le marché du logement en une arène de spéculation débridée,10 et qui ensuite ont proposé l’austérité comme le seul remède permettant d’éviter une désintégration du système financier international.
Face à ces attaques, souvent présentées comme les agissements d’une sorte “d’internationale” capitaliste, il n’est pas étonnant que de larges secteurs de la classe ouvrière ressentent une réelle colère contre les élites, qui en elle-même ne mène nullement à un développement de la conscience de classe. L’attraction exercée par des démagogues populistes est due au fait qu’ils proposent concrètement des cibles faciles sur lesquelles rejeter la faute : l’UE, une élite de la métropole londonienne, les immigrés, les étrangers, etc. Le capitalisme génère une perception abstraite et déformée de la réalité, ce qui explique que les populistes peuvent changer de cible comme ils changent de chemise : les réglementations de l’UE, le terrorisme islamiste, la globalisation, les riches parasitaires... Le populisme représente un danger pour la classe ouvrière car il n’a pas besoin d’être cohérent pour être efficace. C’est un défi majeur pour les révolutionnaires d’analyser la signification de tout ce phénomène et nous ne faisons qu’entamer ce travail.
Le référendum en Grande-Bretagne, à la fois sa campagne et son résultat, n’est qu’une expression d’une situation mouvante, directement influencée par la montée du populisme. C’est un problème qui ne peut qu’empirer tant que le prolétariat ne comprendra pas son rôle historique en tant que classe exploitée ayant la capacité de renverser le capitalisme et de mettre en place une communauté humaine mondiale.
Car, 9 juillet 2016
1 United Kingdom Independence Party, un parti de droite britannique fondé essentiellement sur un programme de sortie de l’UE.
2 Ministre des Finances du gouvernement Cameron.
3 National Health Service (services de santé).
4 Scottish National Party (Parti nationaliste écossais).
5 Michael Gove, ministre de la Justice dans le gouvernement Cameron.
6 Boris Johnson, ancien maire de Londres jusqu’aux dernières élections municipales.
7 Secrétaire d’État à l’Intérieur dans le gouvernement Cameron
8 Depuis que cet article a été écrit, Gove et Leadsom se sont retirés de la course, laissant Theresa May comme nouveau dirigeant du Parti conservateur. Selon la constitution britannique elle devient donc automatiquement Premier ministre.
9 Les dirigeants du Parti travailliste sont élus selon un système qui inclut les voix des membres des syndicats affiliés au Parti ainsi que celles des militants ayant rejoint le Parti individuellement. Jeremy Corbyn était élu suite à la défaite de son prédécesseur Ed Milliband dans les élections parlementaires de 2015. Fortement marqué à gauche, il a reçu le soutien en particulier d’un grand nombre de jeunes qui venaient tout juste de s’inscrire au Parti.
10 Ceci se réfère notamment à la politique introduite par Thatcher, qui donnait aux locataires des HLM appartenant aux municipalités, le droit d’acheter leur logement.
Personnages:
- Jeremy Corbyn [38]
- David Cameron [49]
- Theresa May [50]
- Boris Johnson [51]
Récent et en cours:
- Brexit [52]
Rubrique:
La société bourgeoise est la principale responsable des catastrophes!
- 1199 lectures
Au mois de mai dernier, une partie de l’Europe a été marquée par de fortes précipitations. Ces intempéries ont touché essentiellement l’Allemagne, la France, la Belgique et une partie de l’Europe centrale, faisant au moins dix-neuf morts et causant d’importants dégâts matériels d’un montant de près d’un milliard d’euros.
Au début du mois de juin, lors d’un Conseil des ministres, le Premier ministre Manuel Valls et son ministre de l’Intérieur ont salué “l’intervention des services de l’État, totalement mobilisés pour venir en aide aux populations sinistrées” avant de mettre en œuvre une prétendue “solidarité” en débloquant “plusieurs millions d’euros” visant à aider les personnes “sans ressources ayant tout perdu”. On voit ici toute l’hypocrisie et le cynisme du gouvernement qui prétend racheter le malheur et le désarroi de ces populations qui, du jour au lendemain, perdent leur maison, leur voiture, leurs biens de première nécessité, mais surtout leurs amis ou des membres de leur famille. Car ce gouvernement a voulu nous faire croire que cette “catastrophe” a été maîtrisée, que les victimes ont bien été prises en charge, ce qui aurait permis de limiter le nombre de disparus. Mais dix-neuf morts dans des inondations touchant l’une des zones les plus développées du monde, c’est dix-neuf morts de trop !
Alors que les puissances capitalistes, comme la France ou l’Allemagne, sont capables de déployer des moyens technologiques inouïs dans le domaine militaire par exemple, elles ne voient aucun intérêt à prendre des mesures durables pour éviter de telles catastrophes, dès lors que ce n’est pas rentable. En Allemagne, où ces inondations ont fait le plus de morts (onze au total), les experts soulignent l’archaïsme des infrastructures berlinoises et la mise en œuvre d’un programme de protection rendue compliquée par des conflits d’intérêts entre les différents acteurs.1 Ce seul exemple montre le côté suicidaire de ce système, incapable de voir ce qui est bénéfique au développement de l’humanité.
Bien entendu, on ne peut pas rendre le capitalisme totalement responsable de la météo d’autant plus que le réchauffement climatique ne semble pas avoir joué un rôle primordial dans ces intempéries. En revanche, cet événement démontre une nouvelle fois “l’incapacité de la civilisation bourgeoise à organiser une protection efficace dans la mesure où la prévention n’est pas une activité rentable” (2). Le désintérêt du capitalisme envers tout ce qui ne génère pas du profit rend la société extrêmement vulnérable et démunie face à ce genre de catastrophes, beaucoup plus sociales que naturelles.
L’une des grandes tendances historiques du capitalisme réside dans l’urbanisation du monde. Désormais, des millions de personnes s’agglutinent dans de grandes agglomérations pour servir de main-d’œuvre. Cette concentration nécessite la construction effrénée de bâtiments et d’infrastructures (parking, lotissements, zones commerciales et industrielles, routes, zones de loisirs). Dès lors, cette “bétonisation” anarchique provoque l’imperméabilité des sols et accentue le ruissellement, ce qui accroît le débit de l’eau. La “canalisation” de certains fleuves, comme la Seine par exemple, ne permet plus au tissu végétal d’absorber les quantités d’eau qui peuvent tomber en quelques jours. Ce phénomène est aggravé par l’irresponsabilité des promoteurs immobiliers et des autorités publiques qui, obnubilés par les gains financiers, ne cessent d’ériger des logements, y compris sur des zones inondables, sans se soucier le moins du monde des répercussions que cela peut entraîner sur les populations.
Dans un précédent article,3 nous insistions sur la multiplication de ces catastrophes pseudo-naturelles ainsi que sur l’augmentation du nombre de victimes. Entre 1994 et 2013, environ 6800 catastrophes naturelles ont coûté la vie à 1,35 millions de personnes.
Si la fréquence des phénomènes géophysiques (séismes, éruptions volcaniques, tsunami, etc.) reste constante, celle des catastrophes liées au climat (inondations, tempêtes) ne cesse d’augmenter.4 Le GIEC5 souligne que l’augmentation de ces précipitations extrêmes et des inondations est causée en grande partie par le dérèglement climatique. L’actualité de ces dernières semaines voit ces assertions se vérifier. Le 23 juin, au moins 26 personnes ont trouvé la mort en Virginie-Occidentale. Quelques jours avant, au moins 22 personnes périssaient dans le centre de la Chine et près de 200 000 personnes ont dû être déplacées. Le séisme qui a dévasté l’Équateur en avril dernier a fait 646 morts et plus de 26 000 personnes sans logements.6 Ces quelques exemples montrent la contradiction de plus en plus flagrante entre la société capitaliste et la nature. Désormais incapable de favoriser le progrès général de l’humanité, la bourgeoisie gère ces catastrophes à la fois avec cynisme et impuissance.
Pour le moment, la classe ouvrière encaisse ces chocs avec fatalisme et désarroi. Son incapacité à identifier le vrai responsable de ces drames à répétition l’empêche de s’indigner et de transformer ces épreuves en un élan de combativité contre la société bourgeoise. Pourtant, la survie du capitalisme en décomposition ne peut rendre ces drames que plus fréquents et meurtriers et encourager la plongée de l’humanité dans le chaos. Seule l’instauration d’une société où le travail sera tourné vers les propres besoins de la communauté humaine mondiale pourra permettre un pas supplémentaire dans le développement de l’humanité, en harmonie avec la nature.
FP, 1er juillet 2016
1 “L’Allemagne face aux difficultés de prévenir les inondations”, La Croix, 2 juin 2016.
2) Amedeo Bordiga, Espèce humaine et croûte terrestre, Petite bibliothèque Payot, 1978.
3 “Intempéries, tremblements de terre, inondations... catastrophes “naturelles” ? Non, catastrophes capitalistes !”, Révolution internationale no 455.
4 D’après l’EM-DAT (la base internationale de données sur les situations d’urgence).
5 Groupe d’experts inter-gouvernemental sur l’évolution du climat.
6 Voir à ce sujet l’article écrit par nos camarades en Equateur sur notre site en espagnol [53] dont la traduction en français paraîtra prochainement également sur notre site.
Géographique:
- France [4]
Récent et en cours:
- Inondations [54]
Rubrique:
Révolution Internationale n°460 - septembre octobre 2016
- 803 lectures
Attentats en France, Allemagne, États-Unis... le capitalisme porte en lui la terreur comme la nuée porte l’orage
- 1529 lectures
Juin et juillet 2016 resteront comme des mois sanglants ayant plongé la population vivant en Occident dans la peur. Le 12 juin, 49 personnes sont abattues dans un club gay d’Orlando en Floride. Le lendemain, le 13, un policier et sa compagne sont assassinés près de Paris, par un homme ayant prêté allégeance à l’État islamique (EI). Le 14 juillet, un homme fonce au volant d’un camion dans la foule à Nice, tuant 84 personnes, dont plusieurs enfants, et faisant plus de 330 blessés. L’attaque est revendiquée par l’EI. Le 18 juillet, en Allemagne, un jeune de 17 ans blesse cinq personnes, dont deux grièvement, dans un train régional, en les attaquant à la hache et au couteau. L’EI revendique l’attaque. Le 22 juillet éclate une fusillade dans un centre commercial de Munich. Dix personnes perdent la vie. Là aussi le tireur est très jeune (18 ans). Le 24 juillet, nouvelle attaque à la machette en Allemagne. Un jeune de 21 ans tue une femme dans un restaurant de Reutlingen et s’enfuit en courant, blessant d’autres personnes sur son passage. Le 24 juillet, un réfugié syrien de 27 ans se fait exploser dans le centre d’Ansbach, à proximité d’un festival de musique en plein air. Le 26 juillet, près de Rouen, un prêtre est égorgé au nom de Daesh lors d’une prise d’otage dans une église.
Au cœur même des grandes nations capitalistes, la barbarie vient donc de prendre une ampleur insoutenable. Dans un monde déliquescent, où des pans de plus en plus larges du globe plongent dans le trafic, la guerre et le terrorisme 1, l’Europe était présentée comme un havre de paix depuis 1945. Il s’agissait donc de protéger au mieux la forteresse, à coups de murs et de barbelés, de la barbarie “étrangère” c’est-à-dire, en réalité, des effets des affrontements meurtriers dans lesquels les armées et les bombes des grandes puissances démocratiques sont particulièrement actives. Mais l’horreur revient aujourd’hui frapper comme un boomerang le cœur historique du capitalisme. Non seulement les conflits mondiaux pénètrent les murailles de Schengen, mais la violence accumulée et intériorisée par toute une partie de la population “locale” explose. Ainsi, en cette période estivale, particulièrement en Allemagne, symbole de la stabilité et de la prospérité, l’atmosphère est devenue étouffante. La description du politologue allemand Joachim Krause est à ce titre édifiante 2 : “On a pu observer vendredi [lors de la tuerie de Munich] à quel point règne une ambiance de peur. Quand la population a appris qu’un attentat avait eu lieu dans un centre commercial dans le nord-ouest de Munich, des scènes de panique se sont produites sur des places du centre-ville, c’est-à-dire à plusieurs kilomètres du lieu du crime. A Karlsplatz, des gens se sont enfuis en masse à cause d’une prétendue fusillade. Dans la grande brasserie Hofbräuhaus, des gens ont fui par les fenêtres, car la rumeur courait qu’un terroriste islamiste était entré dans l’établissement.”
Ce climat de panique est à l’évidence le fruit de la politique délibérée de l’état-major de Daesh, assoiffé de vengeance 3. L’EI vise à déstabiliser ses ennemis impérialistes en terrorisant les populations. Mais la liste des actes violents de juin et juillet révèle un problème bien plus ample et profond. Aucune de ces tueries n’a été commise par un soldat de Daesh surentraîné. Non. Loin de là. Des jeunes gens à peine sortis de l’enfance et se sentant exclus. Un père de famille violent et vivant très mal son divorce. Un réfugié que l’État refuse de régulariser. Leurs trajectoires et origines sont diverses : certains sont nés et ont grandi en Europe, d’autres au Moyen-Orient ou en Orient. Presque tous sont “radicalisés” depuis peu et sans réel lien direct avec l’EI autre que quelques vidéos sur internet. Quand les crimes n’ont tout simplement aucun rapport avec le djihadisme, comme la fusillade de Munich menée par un sympathisant de l’extrême-droite, fasciné par Hitler, ou cette attaque à la machette dans le restaurant de Reutlingen qualifiée finalement de crime passionnel. La propagande haineuse djihadiste n’explique donc pas tout ; au contraire, le succès de son influence est lui-même le produit d’une situation nauséabonde bien plus grave et historique. Quelle force destructrice et meurtrière pousse donc ces individus aux motivations apparemment si différentes à passer à l’acte ? Et pourquoi maintenant ? Que nous dit toute cette barbarie de l’évolution de l’ensemble de la société à l’échelle mondiale ?
Le capitalisme est un système de terreur
Ces jeunes meurtriers ne sont pas des monstres. Ce sont des êtres humains qui commettent des actes monstrueux. Ils ont été enfantés par une société mondiale malade, agonisante. Leur haine et leur ivresse meurtrière ont d’abord été intériorisées sous la terreur permanente que font régner les rapports sociaux capitalistes, puis ont été libérées sous la pression de ce même système en explosant, générant une série d’actes ignobles.
En effet, le capitalisme est une société intrinsèquement basée sur la terreur. L’exploitation est inconcevable sans violence, organiquement inséparables l’une de l’autre. Autant la violence peut être conçue hors des rapports d’exploitation, autant ces derniers ne sont réalisables qu’avec et par une violence coercitive. Mais le capitalisme est aussi depuis plus d’un siècle un système décadent 4. Ne pouvant plus offrir de réel avenir à l’humanité, il maintient son existence par le recours de plus en plus systématique et direct à cette violence tant sur le plan idéologique et psychologique que physique. L’éclatement de la Première Guerre mondiale et de sa boucherie en août 1914 en sont une image saisissante. Ainsi, la violence, combinée à l’exploitation, acquiert dès lors une qualité toute nouvelle et particulière. Elle n’est plus un fait accidentel ou secondaire, mais devient un état constant à tous les niveaux de la vie sociale. “Elle imprègne tous les rapports, pénètre dans tous les pores du corps social, tant sur le plan général que sur celui dit personnel. Partant de l’exploitation et des besoins de soumettre la classe travailleuse, la violence s’impose de façon massive dans toutes les relations entre les différentes classes et couches de la société, entre les pays industrialisés et les pays sous-développés, entre les pays industrialisés eux-mêmes, entre l’homme et la femme, entre les parents et les enfants, entre les maîtres et les élèves, entre les individus, entre les gouvernants et les gouvernés ; elle se spécialise, se structure, se concentre en un corps distinct : l’État, avec ses armées permanentes, sa police, ses prisons, ses lois, ses fonctionnaires et tortionnaires et tend à s’élever au-dessus de la société et la dominer. Pour les besoins d’assurer l’exploitation de l’homme par l’homme, la violence devient la première activité de la société pour laquelle la société dépense une partie chaque fois plus grande de ses ressources économiques et culturelles. La violence est élevée à l’état de culte, à l’état d’art, à l’état de science. Une science appliquée, non seulement à l’art militaire, à la technique des armements, mais à tous les domaines, à tous les niveaux, à l’organisation des camps de concentration, aux installations de chambres à gaz, à l’art de l’extermination rapide et massive de populations entières, à la création de véritables universités de la torture scientifique, psychologique, où se qualifient une pléiade de tortionnaires diplômés et patentés. Une société qui, non seulement “dégouline de boue et de sang par tous ses pores” comme le constatait Marx, mais qui ne peut plus vivre ni respirer un seul instant hors d’une atmosphère empoisonnée et empestée de cadavres, de mort, de destruction, de massacre, de souffrance et de torture. Dans une telle société, la violence ayant atteint cette Nième puissance, change de qualité, elle devient la Terreur” 5. Autrement dit, le capitalisme porte en lui la terreur comme la nuée porte l’orage 6.
Le capitalisme nie la valeur de la vie
Tous ces actes barbares commis ces dernières semaines sont la négation même de la vie, de la vie des autres comme de la sienne. Mais l’idéologie de Daesh comme celle de l’extrême-droite au nom desquelles ces attentats ont été commis ne sont qu’une caricature sanglante de l’absence de valeur accordée à la vie par le capitalisme tout entier.
Les guerres menées partout par les grands États en sont la preuve la plus flagrante. Comme le contraste entre la richesse opulente accumulée entre quelques mains et la misère qui entraîne parfois la faim et la mort de millions d’âmes. Comme ces médicaments rassemblant les plus hautes connaissances humaines sans pouvoir être distribués au nom du profit. Comme ces marchandises choyées, éclairées, chauffées ou refroidies selon les besoins, quand des millions d’êtres vivent dans le plus simple dénuement. Dans le film de Charlie Chaplin Les Temps modernes, il y a cette scène mythique durant laquelle Charlot est maltraité par un robot-fou programmé pour le laver, l’habiller et le nourrir afin de le préparer le plus efficacement et rapidement possible pour aller travailler à l’usine. Il s’agit là d’une critique humoristique mais aussi féroce du monde capitaliste dans son ensemble, pas seulement de ses usines ; car c’est bien au quotidien, sous tous les aspects de la vie, que l’homme est traité comme un objet. Nous ne vivons plus selon nos besoins corporels, psychiques et sociaux. Tout est rythmé, organisé, pensé selon les besoins du capital. L’exploitation capitaliste demande toujours plus à l’humanité de se nier elle-même pour s’incorporer à la machine.
Cette robotisation de l’homme entraîne l’exclusion de ceux qui ne peuvent s’adapter à ce rythme avilissant et infernal. En découlent la marginalisation, l’humiliation, un sentiment d’infériorité et bien d’autres grandes souffrances encore renforcées par la stigmatisation de ces “inadaptés” par l’État, par la répression des forces de polices ou des prétendus organismes “sociaux”. Se trouve certainement là l’une des racines profondes de la haine et de l’esprit de vengeance suicidaire.
Des individus sans espoir ni morale et le terrorisme
La terreur et la négation de la valeur de toute vie, voilà sur quel terreau capitaliste grandissent ces individus qui deviennent terroristes.
Parfois écrasés matériellement, sans aucun avenir devant eux, végétant dans un présent aux horizons complètement bouchés, piétinant dans une médiocrité quotidienne, ces individus sont dans leur désespoir la proie facile à toutes les mystifications les plus sanglantes (Daesh, pogromistes, racistes, Ku Klux Klan, bandes fascistes, gangsters et mercenaires de tout acabit, etc.). Dans cette violence, ils trouvent “la compensation d’une dignité illusoire à leur déchéance réelle que le développement du capitalisme accroît de jour en jour. C’est l’héroïsme de la lâcheté, le courage des poltrons, la gloire de la médiocrité sordide. C’est dans ces rangs que le capitalisme, après les avoir réduites à la déchéance extrême, trouve une réserve inépuisable pour le recrutement de ses héros de la terreur” 7.
L’attentat du 14 juillet à Nice révèle ainsi ce qui se cache derrière tous les autres : la haine et la soif de meurtre d’individus écrasés. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, l’homme qui a tué avec un camion des dizaines de personnes à Nice, est décrit par ses proches comme ultra-violent, souffrant de “crises” au cours desquelles il “cassait tout”. Son ex-femme l’a quitté notamment pour cette agressivité. Mais pour percuter ainsi volontairement et durant plusieurs minutes hommes, femmes et enfants, il faut encore bien plus : une véritable désintégration psychique. Dans un tel acte, tous les interdits fondamentaux de la société humaine sont comme pulvérisés. Cet homme a intériorisé toute la violence du capitalisme en la subissant, puis l’a extériorisé dans une explosion destructrice. De tels tueurs de masse existent déjà depuis plusieurs décennies aux États-Unis. Les hécatombes dans les collèges et les universités américaines font régulièrement la une de l’actualité ; chaque fois les tireurs sont des jeunes se sentant exclus et marginalisés par le système scolaire, stigmatisés par leurs camarades et professeurs. L’idéologie de Daesh n’est donc en rien la cause première de ces actes barbares. C’est bien parce que le système avait d’abord produit ces individus broyés et assoiffés de vengeance que ceux-ci sont attirés par les discours haineux et irrationnels de l’EI, sont fascinés par les armes. Et c’est à ce stade que l’EI joue un rôle considérable : il permet à ces individus de légitimer leur barbarie. Il leur fait croire qu’ils peuvent venger leur vie ratée et réussir leur mort. Il libère les pires pulsions meurtrières enfantées par la société.
Cette succession d’actes barbares est d’autant plus traumatisante pour la population que de plus en plus nombreux sont les victimes réfugiées et les anciens combattants (des soldats officiels des armées démocratiques aux mercenaires intervenant pour des boites privés, en passant par tous ces jeunes partis pour Daesh, Al Qaïda, Aqmi...) et qui tous reviennent broyés, marqués par le syndrome du stress post traumatique. Cette partie de la population, confrontée à des lésions psychiques et enfermée dans les pires cauchemars, subit la violence de tous ces attentats comme les répétions atroces de ses souvenirs. La spirale est ici infernale : car ces victimes peuvent être emportées par la peur, la haine et les comportements les plus irrationnels et donc générer à leur tour d’autres souffrances et traumatismes.
Une aggravation de la décomposition du capitalisme
La multiplication de tels attentats, le fait qu’un pays comme l’Allemagne soit à son tour touché, que les terroristes soient souvent issus de l’Europe elle-même en dit long sur l’aggravation considérable de la situation sociale internationale. Les raisons en sont nombreuses :
• Les conflits impérialistes de l’après septembre 2001, de l’Afghanistan à l’Irak, ont déstabilisé des régions entières du globe, particulièrement le Moyen-Orient. Ces guerres ont attisé les haines et l’esprit de vengeance 8.
• La crise économique mondiale de 2007/2008 a entraîné bien plus que de la pauvreté : elle a engendré une immense vague d’inquiétude sur l’avenir ; elle a rendu le monde apparemment plus incompréhensible encore avec ses faillites bancaires et ses krachs boursiers. Elle a ruiné des millions d’épargnants qui ont perdu toute confiance dans la monnaie qui est, sous le capitalisme, l’un des plus forts liens sociaux qui unit la société... Bref, cette crise économique a rendu la planète plus incertaine de son avenir, elle a engendré une plus grande peur des uns envers les autres.
• Le “Printemps arabe”, présenté comme une vague de révolutions, en 2010 et 2011, a été suivi par une augmentation considérable des tensions sociales, des régimes de tortures et par l’horreur de la guerre civile. L’impression est donc que la lutte sociale massive ne peut déboucher que sur plus de chaos, que l’avenir ne peut donc qu’empirer pour tous.
• Les groupes terroristes ont prospéré, engendrés par la guerre et entretenus par les sordides jeux d’alliances, de soutien et d’instrumentalisation des grandes puissances 9.
• Fuyant cette barbarie allant du Mali à l’Afghanistan, en passant par le Soudan et même le sud de la Turquie, des millions d’êtres humains tentent de fuir, mois après mois, pour survivre. Ils deviennent alors des “réfugiés”, qui partout sont parqués et souvent rejetés. Ces arrivées se produisant en même temps que l’aggravation de la crise économique et de la montée du terrorisme, la xénophobie s’est elle-aussi accrue.
• Et surtout, par dessus tout, alors que le capitalisme avance dans son obsolescence et que les liens sociaux le suivent en se décomposant, la classe ouvrière ne parvient pas pour l’instant à offrir à l’humanité une autre perspective. Incapable de développer sa combativité et sa conscience, son souffle de solidarité et de fraternité internationales, elle est le grand absent de la situation mondiale.
Cette convergence de facteurs, et sûrement d’autres, explique l’aggravation de la situation sociale mondiale. La peur, la haine et la violence se propagent aujourd’hui comme une gangrène. Et chaque nouvelle explosion, chaque nouvel attentat, nourrit à son tour cette dynamique suicidaire. L’esprit de vengeance se développe de toute part. Le racisme, la bouc-émissarisation du musulman, participent à ce cercle vicieux infernal. Telle est d’ailleurs la stratégie de Daesh : si la population musulmane est persécutée, les candidats au djihad seront encore plus nombreux.
Le danger de cette putréfaction actuelle de toute la société n’est pas à sous-estimer : menée jusqu’à son terme, elle pousse toute l’humanité vers sa destruction.
Quelles perspectives ?
Fondamentalement, la bourgeoisie n’a aucune solution réelle à proposer à cette situation dramatique. Il est vrai que ses fractions les plus intelligentes prônent un discours de tolérance et d’accueil pour limiter l’extension des haines et éviter que la situation ne devienne incontrôlable, comme la bourgeoisie au pouvoir en Allemagne, Merkel en tête. Plus nombreuses sont les fractions à instrumentaliser les peurs et les haines, jouant là aux apprentis sorciers, comme le font la droite et une grande partie de la gauche en France.
Concrètement, les réponses les plus répandues sont de mener une guerre plus féroce et meurtrière encore au Moyen-Orient, de monter des barbelés plus épais et hauts partout autour de l’Europe et de l’Amérique du Nord, et de fliquer (pardon “sécuriser”) l’ensemble de la société, en surveillant toute la population en permanence et en armant toujours plus la police. Autrement dit, plus de terreur et de haine encore, partout, tout le temps.
Mais bien plus fondamentalement encore, la bourgeoisie n’a aucune solution réelle à offrir car son objectif est de maintenir son système, le capitalisme, alors que c’est lui, comme un tout, qui est obsolète, décadent et la cause de tous ces maux. Son monde est divisé en nations concurrentes, en classes exploitées et exploiteuses, l’activité y est mise en mouvement dans l’intérêt de l’économie et du profit et non de la satisfaction des besoins humains, autant d’obstacles qui engendrent aujourd’hui la décadence et le pourrissement sur pied de la société. Et cela, aucun gouvernement au monde, dictatorial ou démocratique, de droite ou de gauche, ne le remettra en cause. Au contraire, tous défendront ce système tel qu’il est, quitte à en faire agoniser l’humanité dans d’horribles souffrances.
Le seul contrepoison à cette dérive barbare réside dans le développement massif et conscient des luttes prolétariennes qui seules peuvent offrir aux individus écrasés une véritable identité, l’identité de classe, une véritable communauté, celle des exploités et non celle des “croyants”, une véritable solidarité, celle qui se développe dans la lutte contre l’exploitation entre travailleurs et chômeurs de toutes races, nationalités et religions, un véritable ennemi à combattre et terrasser, non pas le juif ou le prêtre catholique ou le musulman ou le rom ou le chômeur ou le réfugié, ni même le banquier, mais le système capitaliste. Des luttes ouvrières qui, en se développant dans tous les pays, devront de plus en plus comprendre et prendre en charge la seule perspective qui puisse sauver l’humanité de la barbarie : le renversement du capitalisme et l’instauration de la société communiste.
Camille, 3 août 2016
1 Deux exemples seulement. Le 28 juin, 47 personnes sont tuées dans un triple attentat suicide à l’aéroport international Atatürk d’Istanbul. Le 23 juillet, à Kaboul en Afghanistan, un attentat-suicide fait 80 morts et 231 blessés.
2 Professeur de politique internationale à la Christian Albrechts Universität de Kiel et directeur de l’Institut politique de la sécurité.
3 Une grande partie de cet état-major est constitué par exemple d’anciens généraux du régime de Sadam Hussein mis à bas par l’armée américaine en 2003. Lire notre article sur les attentats de novembre 2015 sur notre site Internet : “Attentats à Paris : à bas le terrorisme ! à bas la guerre ! à bas le capitalisme !”.
4 À lire sur notre site : “Qu’est-ce que la décadence ?”.
5 Extrait de Terreur, terrorisme et violence de classe, disponible sur notre site Internet.
6 Inspiré de Jaurès écrivant face à la Première Guerre mondiale : “Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage”.
7 Terreur, terrorisme et violence de classe.
8 “En menant toutes ces guerres, en semant la mort et la désolation, en imposant la terreur des bombes et en attisant la haine au nom de la “légitime défense”, en soutenant tel ou tel régime assassin, selon les circonstances, en ne proposant aucun autre avenir que toujours plus de conflits, et tout cela pour défendre leurs seuls sordides intérêts impérialistes, les grandes puissances sont les premières responsables de la barbarie mondiale, y compris celle de Daesh. En cela, lorsque ce prétendu “État islamique” a pour sainte trinité le viol, le vol et la répression sanglante, lorsqu’il détruit toute culture (la même haine de la culture que le régime nazi), lorsqu’il vend des femmes et des enfants, parfois pour leurs organes, il n’est rien d’autre qu’une forme particulièrement caricaturale, sans artifice ni fard, de la barbarie capitaliste dont sont capables tous les États du monde, toutes les nations, petites ou grandes” (in “Attentats à Paris : à bas le terrorisme ! à bas la guerre ! à bas le capitalisme !”).
9 “L’EI est composé des fractions les plus radicales du sunnisme et a donc pour ennemi premier la grande nation du chiisme : l’Iran. C’est pourquoi tous les ennemis de l’Iran (l’Arabie saoudite, les États-Unis, Israël, le Qatar, le Koweït…) ont tous soutenu politiquement, financièrement et parfois militairement Daesh. La Turquie a, elle-aussi, appuyé l’État islamique afin de s’en servir contre les Kurdes. Cette alliance de circonstance et hétéroclite montre que les différences religieuses ne sont pas le réel ferment de ce conflit : ce sont bien les enjeux impérialistes et les intérêts nationaux capitalistes qui déterminent avant tout les lignes de clivages et transforment les blessures du passé en haine moderne” (idem).
Récent et en cours:
- Terrorisme [8]
La “nouvelle Turquie”, un creuset pour l’instabilité mondiale
- 1446 lectures
La tentative de coup d’État des 15 et 16 juillet a été, selon les mots du président turc Erdogan, « un cadeau du Ciel ». Il ajoutait que l’« épuration » continuerait et que « le virus serait éradiqué », c’est-à-dire les « terroristes » traqués où qu’ils se trouvent. Cette purge, qui rappelle celles des staliniens avec ses listes de noms déjà préparées, a en effet été menée avec force. La guerre contre les Kurdes dans le Sud-est de la Turquie s’est également immédiatement intensifiée.
Coup d’État et « contre-coup d’État »
Sans spéculer sur l'implication éventuelle de services secrets étrangers ni sur leur anticipation des événements, il semble que la tentative de coup d’État a impliqué une large partie des hauts gradés de l’armée turque, celles que la BBC a appelées, alors que le coup d’État échouait, « les garants du sécularisme et de l’État laïc en Turquie ». Ce putsch pour éjecter Erdogan et son AKP était selon toute probabilité bien plus profondément et largement ancré dans la société qu’un simple mouvement « guleniste »1, quoique les alliances et liens entre les différentes factions dans l’ombre et tendances diverses au sein de l’État turc sont d’une complexité réellement byzantine. Par exemple, les Gulenistes sont depuis longtemps accusés d’être impliqués dans une énorme conspirations, un véritable « État dans l’État » appelée Ergenekon2, laquelle suppose-t-on aurait été mise en place dans les années 1990 en tant que garant des traditions laïques turques. Traditionnellement les principaux opposants du parti islamiste modéré d’Erdogan, l’AKP, ne sont pas les Gulenistes, mais les factions kémalistes3 au sein de l’armée et de la société civile. Ce coup d’État n'est cependant pas une nouvelle confrontation entre les islamistes de l’AKP et les kémalistes laïcs – bien sûr, à l’annonce du coup d’État, le principal parti kémaliste, le CHP, s’est rallié au gouvernement dans un grand élan de solidarité nationale. En réalité, de complexes rivalités religieuses sont ici à l’œuvre : entre les Sunnites et les Alevis hétérodoxes, entre la vision d’Erdogan sur l’Islam sunnite et celle des Gulenistes. Mais pour l’heure, Erdogan et l’AKP ont renforcé leur emprise totalitaire sur l’État turc, à l’aide d’un État d’urgence de trois mois qui rend possible de gouverner par décret dans une atmosphère de peur et de surveillance étatique renforcée…
Pour l’instant, (d’après la chaîne CNN, le 9 août dernier), 22 000 personnes sont détenues et 16 000 autres ont été arrêtées sur des accusations précises, y compris des milliers de militaires, dont presque un tiers des généraux et amiraux turcs. Des centaines de journalistes ont été aussi arrêtés, emprisonnés, perquisitionnés ou licenciés ainsi que des milliers de personnes, pour beaucoup interdites de voyage à l’étranger. En tout 68 000 personnes ont été licenciées ou suspendues et 2000 institutions ont été fermées. L’État d’urgence s’est traduit par de nombreux cas de tortures, de brimades, de bastonnade et de privation de nourriture, parmi les emprisonnés.
Dans le propre cercle des collaborateurs d’Erdogan, des arrestations ont eu lieu et la Garde présidentielle a été dissoute. Environ 250 soldats et civils ont été tués du côté gouvernemental lors de la tentative de coup d’État ainsi qu’un nombre indéterminé de tués, sciemment ou non, du côté des putschistes. Des douzaines de chasseurs-bombardiers, d’hélicoptères, des centaines de blindés et trois bateaux ont été utilisées lors de la tentative de putsch. D’après certains rapports, Erdogan aurait échappé in extremis à la mort suite à des avertissements de la Russie.
De nombreux « suspects » gradés de l’armée sont « en fuite » (BBC, 10 août 2016), y compris l’adjoint du chef d’état-major de commandement et de contrôle de l’OTAN, l’amiral Mustafa Urgurlu. Plus important encore, beaucoup d’exclus, de suspects et même ceux qui veulent simplement garder la tête baissée vont chercher à se venger et espérer riposter à un autre niveau. Au-delà du renforcement à court terme de l’État, les divisions se sont exacerbées et l’émasculation de l’armée pourrait conduire dans une certaine mesure au même genre de bévues commises par les États-Unis et le premier ministre Malaki en Irak après la chute de Saddam Hussein qui avait créé un vide dans la sécurité, lequel avait en parti mené à l’émergence de l’État islamique. La situation en Turquie est imprévisible, mais dans un pays de 80 millions d’habitants avec une armée de 600 000 hommes, la situation actuelle ne peut mener qu’à l’affaiblissement du pays et à une instabilité grandissante.
La déstabilisation interne de la Turquie
Cela fait plusieurs années que la Turquie est citée en exemple comme une îlot de stabilité économique, voire en plein essor, et un exemple d’Islam démocratique et modéré, au milieu de l’océan de problèmes du Proche-Orient. Bien sûr, en tant qu’État, la Turquie possède une implantation historique plus solide que beaucoup de ses voisins déchirés par la guerre, que ce soit la Syrie ou l’Irak. Mais le fait est que la Turquie a beaucoup de points communs avec la Syrie et l’Irak, tant du point de vue de la diversité ethnique que des divisions sectaires.
La force de l’AKP d’Erdogan a résidé dans les mesures qui ont été prises au niveau économique, quand le niveau de vie a connu une hausse dans beaucoup de campagnes et dans les quartiers urbains pauvres. Des emplois ont été créés en empruntant d’énormes sommes pour que l’État investisse et mène divers projets. En même temps, Erdogan a profité de la réémergence de l’Islam pour poursuivre une forme modérée de fondamentalisme, afin de développer l’image d’une « nouvelle Turquie », en montrant sa force et sa capacité à être un leader potentiel du monde sunnite.
Derrière le conflit traditionnel entre l’islamisme et le nationalisme séculier, il y a un autre élément religieux. Le système kémaliste séculier en place était vu comme favorisant indirectement la minorité chiite alevie aux dépends de la majorité sunnite, vu que la forme alévie de l’Islam semble plus adaptée au monde moderne. À ce niveau, il y a une certaine ressemblance entre l’ancien système kémaliste en Turquie et le régime d’Assad qui régnait sur une majorité sunnite alors qu’il était largement composé de membres d’une autre secte chiite, les Alaouites.4 L’actuelle guerre en Syrie entre les Alaouites et les Sunnites ne peut qu’affecter et accentuer les rivalités religieuses et culturelles avec des éléments comparables à ceux que l’on trouve en Turquie. À l’annonce du coup d’État, par exemple, il a été fait état d’attaques de type pogromiste contre les maisons et les boutiques des Alevis.
La Turquie d’aujourd’hui n’est plus le même pays que lors du précédent coup d’État militaire en 1980, dont la justification était le désordre grandissant généré par les conflits entre les factions politiques de gauche et de droite, ou même qu’il y a dix ans quand l’AKP a pris le pouvoir. Du fait du boom économique, qui semble aujourd’hui tirer vers sa fin, un prolétariat moderne et une nouvelle élite de spécialistes et d’intellectuels sont apparus dans les grandes villes. Une grande partie de ces éléments ne se sentent pas attirés par « l’islamisation ». C’est une situation dangereuse qui se fait jour, dans la mesure où le putsch émanant de vieilles élites nationales (dans la mesure où elles y ont pris part) aura provoqué la haine et la soif de vengeance des soutiens de l’AKP. D’un autre côté, Erdogan doit prendre au sérieux l’avertissement que cette tentative de coup d’État représente. S’il va trop loin dans son « contre-coup d’État », il peut prendre le risque de provoquer une guerre civile et un conflit ouvert sous la forme de révoltes armées et de nouvelles formes de terrorisme – même si la résistance de ces forces a pour l’instant été maîtrisée.
Aujourd’hui, alors que le pays est en train de basculer d’un état de « miracle économique » à un autre que la banque Morgan Stanley appelle les « cinq fragiles »5, bien plus risqué du fait d’une productivité et d’une croissance faibles liées aux coûts du travail, à l’inflation et à l’endettement qui augmentent, le résultat d’une instabilité économique grandissante pourrait être dramatique : effondrement du tourisme, émigration de la nouvelle génération d’ouvriers qualifiés, etc.
Qui plus est, la bourgeoisie turque a une longue tradition d’« exclusion », tradition sur laquelle la Turquie moderne est née : le génocide des Arméniens, le massacre des Grecs et l’opposition continuelle à toute possibilité d’existence d’un État kurde. La vision de l’AKP pour qui tout opposant est un ennemi qui doit être réprimé possède une longue tradition en Turquie.
Toujours plus de déstabilisation du Proche-Orient
Depuis l’effondrement du bloc de l’Est en 1989, la Turquie a été durement touchée par les tendances centrifuges qui se sont déchaînées. L’affaissement des blocs impérialistes américain et russe a permis à la Turquie a développer ses propres ambitions, se posant comme leader régional des régimes sunnites. Le régime Erdogan s’est brouillé avec Israël, a renforcé ses liens avec le Hamas et a qualifié d’« illégitime » le gouvernement égyptien d’Al Sissi qui s’est débarrassé des Frères musulmans. Ses relations avec la Russie, qui ont l’air de se réchauffer après le coup d’État et la rencontre entre Erdogan et Poutine le 9 août à Saint-Petersbourg, sont compliquées et fluctuantes. Dans la situation actuelle, la Turquie peut rejeter l’Occident du fait de ses liens avec la Russie, la Chine -et l’Iran, et elle aspire à jouer sa propre carte au Proche-Orient.
Le pire cauchemar de la bourgeoisie turque serait l’établissement d’un État kurde. Ici, les Occidentaux sont face à un dilemme : dans leur guerre contre l’État Islamique (EI), ils se servent des Kurdes comme chair à canon en leur fournissant des armes, une couverture aérienne et des « conseillers ». De tels développements ne peuvent que renforcer le nationalisme kurde et ses ambitions d’établir un État « indépendant », quand bien même les nationalistes kurdes sont eux-mêmes divisés en de multiples factions différentes. Par rapport à la question kurde, les intérêts sont fortement opposés, entre les Etats-Unis, l’Allemagne et la Grande-Bretagne d’un côté, et la Turquie de l’autre. Erdogan était proche du régime d’Assad avant la guerre, et depuis qu’elle a éclaté, ils ont tous deux utilisé les forces de l’EI pour les avantages qu’ils en retiraient respectivement. Assad a également utilisé le PKK kurde pour les mêmes raisons. Mais après cinq ans de guerre et l’intervention de la Russie (et d’autres puissances) aux côtés d’Assad, il y a des signes montrant que le gouvernement d’Ankara considère qu’il faut laisser Assad au pouvoir en faisant une sorte de compromis avec lui. Ni Assad, ni la Turquie n’ont intérêt à ce qu’émerge un État kurde, ou tout type de région autonome kurde le long de leurs frontières. Des pourparlers ont eu lieu depuis environ un an entre les représentants alaouites d’Assad à Damas et des représentants du Parti de la nation turque6, auxquels ont participé des membres des services secrets turcs, dans le but, entre autres, de faire cesser le soutien militaire de la Turquie aux ennemis d’Assad. Ces « interlocuteurs » turcs n’ont pas été touchés par la répression dans l’atmosphère post-coup d’État, ce qui suggère que ces pourparlers vont continuer. Dans ce cas, cela se fera aux dépends des Occidentaux et de leurs « alliés » kurdes7.Il est significatif qu’Erdogan, chef État d’un pays membre de l’OTAN, ait accusé les autres gouvernements membres de l’OTAN, et en particulier les États-Unis, d’avoir soutenu le putsch, alors qu’en même temps, il remerciait la Russie de l’avoir prévenu des préparatifs du coup d’État. Plus concrètement, cela pose question sur l’utilisation de la base aérienne d’Inçirlik : jusqu’ici elle était considérée comme une base de l’OTAN, mais Erdogan a annoncé qu’il ne s’opposerait pas à ce que la Russie l’utilise pour ses opérations contre l’EI. Ces développements, ce jeu de marchandage et de chantage, sont un nouveau signe de la grandissante fragilité des alliances impérialistes dans la région.
Les réfugiés : « un baril d’essence à côté du feu »
Sir Richard Dearlove, ex-patron du MI6 britannique, a comparé l’accord entre la Turquie et l’UE sur les réfugiés à « stocker de l’essence à côté d’un feu » (Belfast Telegraph du 15 mai 2016). La Turquie va utiliser ces millions de réfugiés comme futurs éléments de chantage contre l’UE (qu’Erdogan a qualifiée de « club de chrétiens »). Il a déjà menacé d’annuler cet accord et les Européens ont été contraints d’essayer de l’apaiser. L’actuelle purge et la chasse aux opposants signifient qu’à plus de 2 millions de Syriens et autres migrants, pourraient s’ajouter des Turcs fuyant leur pays et venant aggraver la crise générale des réfugiés.
Incertitude sur le long terme
Du fait que le système est dans une décadence qui s’accélère, la tendance à l’instabilité et au chaos ne peut qu’être dominante à une échelle historique. Mais cela veut dire que la classe dominante est impuissante face à cela, et qu’il n’y a aucune contre-tendance. Nous l’avons vu, par exemple, en Grande-Bretagne à la suite du désastreux résultat du référendum sur l’UE : la classe dominante a très vite réagi face au très sérieux danger de fractures en son sein, et a réorganisé ses cartes gouvernementales d’une façon particulièrement adroite de façon à présenter une réponse unique à la crise du Brexit. Et nous pouvons discerner de semblables tendances en Turquie. Gulenistes et Kemalistes ont collaboré au coup d’État, le fait pour les Gulenistes d’avoir été choisis comme cibles étant significatif. À la suite du putsch, Erdogan a de plus en plus rappelé l’héritage d’Atatürk et plutôt joué la carte du nationalisme turc que de l’islamisme. Cela pourrait signifier une importante tentative de se concilier les Kemalistes, autant que les Alevis et d’autres factions bourgeoises, derrière l’option d’un leader autocratique agissant selon les désirs de la nation turque (inspiré en quelque sorte par le modèle de Poutine en Russie).
L’actuel culte d’Erdogan mis en avant au cours de manifestations de rue massivement médiatisées pourrait être un élément d’une stratégie de construction d’une nouvelle unité au sein de la classe dominante turque. D’un autre côté, les images officielles montrant un soutien massif à Erdogan et à l’AKP ne doivent pas être prises pour argent comptant… Pour l’instant, il est le vainqueur, il a écrasé les cliques rivales, mais le projet de régime autoritaire mis en avant par Erdogan a des limites. L’une des forces d’Erdogan et de son parti était une économie forte, mais nous avons vu que cette phase touche à sa fin. Jamais il n’a été aussi populaire que le claironnait la propagande ; les manifestations anti-gouvernementales que l’on a vues à différents endroits en 2013, provoquées par les protestations autour du Park Taksim sur la place Gezi8, ont montré l’existence d’un rejet largement répandu des forces de police particulièrement au sein d’une jeunesse éduquée et urbaine. Et il reste un profond ressentiment au sein de l’armée directement vis-à-vis d’Erdogan et de son parti. Il y a tout juste un an, les ministres de l’AKP devaient affronter les insultes publiques et le ridicule face à des hauts gradés de l’armée lors des funérailles de soldats tués en opération contre le PKK kurde. Le gouvernement d’Erdogan a répondu à cette humiliation publique – qui a eu lieu au cours de ce qui devait être une vitrine de la propagande étatique – en demandant aux médias d’arrêter leur couverture de ces funérailles (le Times, 31 août 2015). Les militaires ont publiquement répondu en appelant les soldats tués des « martyrs » et en disant publiquement que la tension militaire contre le PKK n’était qu’une façon de renforcer la position électorale de l’AKP contre le Parti Démocratique du Peuple (HDP) pro-kurde.
Pour le moment, la clique d’Erdogan a renforcé sa position et a réussi à récupérer le contrôle des affaires contre les putschistes, mais sa capacité de contrôle social est incertaine, avec des conséquences aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Turquie.
Boxer, 15 août 2016
1Fetullah Gülen, un ex-allié d’Erdogan maintenant en exil aux États-Unis, possède pratiquement un empire qui contrôle de nombreuses institutions et des actifs estimés à 50 milliards de dollars. Le mouvement guleniste (ou Hizmet) dispose de 80 millions de fidèles dans le monde et a ouvertement soutenu les Clinton et le parti démocrate. Son islamisme apparaît plus fondamentaliste que celui de l’AKP. Les Gülenistes, qui sont anti-kemalistes, ont été capables de faire pénétrer certains de leurs éléments au sein de l’État turc du fait de leur alliance avec Erdogan et l’AKP entre 2002 et 2011. Cependant, leur structure très sectaire a progressivement été considérée par Erdogan comme une menace envers son autorité.
2 Ergenekon est le nom d'un réseau criminel turc composé de militants d’extrême- droite ainsi que de la gauche républicaine, d'officiers de l'armée et de la gendarmerie, de magistrats, de mafieux, d'universitaires et de journalistes. Son procès pour « conspiration contre l'État » et contre l'AKP avait donné lieu à 300 arrestations entre juin 2007 à novembre 2009 et l'inculpation de 194 personnes pour des motifs divers : conspirations, tentatives d'assassinat ou de meurtres contre des journalistes, organisation d'escadrons de la mort contre le PKK Kurde... De nombreuses caches d'armes avaient alors été découvertes, ainsi que des plans d'attentats, ce qui a amené à considérer Ergenekon comme une sorte de « contre-guérilla », une espèce de Gladio (réseau « anticommuniste » de l'OTAN pendant la guerre froide) « à la Turque », avec une orientation anti-occidentale et anti-européenne.
3Les Kémalistes sont des nationalistes laïcs qui se réclament de la tradition de Kemal Atatürk, le fondateur de l’État turc moderne dans les années 1920.
4Les Alevis et les Alaouites ne sont pas la même secte, bien que leurs noms fassent tous deux référence à Ali, le gendre de Mahomet et le personnage-clé de la branche chiite de l’Islam. Il y a des différences ethniques entre la majeure partie de leurs adhérents.
5 Outre la Turquie, il s’agit du Brésil, de l’Afrique du Sud, de l’Indonésie et de l’Inde.
6Le Parti de la Nation (YP) est un petit parti conservateur de droite fondé en 2002.
7Le 29 août, les Etats-Unis ont sévèrement condamné les nouveaux combats entre l’armée turque et les combattants kurdes dans le nord de la Syrie. Par le passé, la Turquie avait utilisé une offensive contre l’EI (qui avait délogé l’EI de la ville de Jarabulus) comme moyen de lancer une escalade militaire contre les Kurdes, et ce conflit est aujourdhui complètement inversé sur le théâtre d’opération syrien.
8Sur ces manifestations, lire https://fr.internationalism.org/revolution-internationale/201307/8012/mo... [57]
Géographique:
- Turquie [58]
Polémique autour du burkini : un bouillon de culture pour la mentalité de pogrom !
- 1149 lectures
Alors que le gouvernement français a récemment prolongé l’état d’urgence jusqu’en 2017, qu’une ambiance de suspicion et de peur pèse lourdement sur une population encore sous le choc de multiples actes terroristes, une polémique, venant renforcer de façon très démagogique l’actuelle campagne anti-islam, a fait la une de la presse nationale, et même internationale, durant l’été : le port du burkini par quelques dizaines de femmes sur les plages. Cette tenue rétrograde a mobilisé l’ensemble de la classe politique, des maires de stations balnéaires aux plus éminentes autorités de l’État, la plupart, de droite comme de gauche, n’hésitant pas à plonger les deux bras dans la pire des fanges idéologiques.
Au début du mois d’août, l’association islamiste des Sœurs marseillaises, initiatrices de loisirs et d’entraide (tout un programme !), “avait privatisé un centre aquatique pour y faire venir des femmes musulmanes le 10 septembre prochain. Les consignes préconisaient le port du burkini” 1. Il n’en fallait pas plus à l’extrême-droite pour faire étalage de la paranoïa dont elle est porteuse et dénoncer, avec des mots à peine voilés, “l’invasion musulmane du pays”. Sous la pression des élus locaux, qui ne voulaient surtout pas apparaître “laxistes” dans cette région où le populisme et la xénophobie sont bien implantés, la “journée burkini” fut rapidement annulée.
Mais le 12 août, le maire de Cannes soufflait à nouveau sur les braises en interdisant par arrêté le port du burkini sur ses plages au motif de garantir l’ordre public. Plusieurs maires de la région, de Corse et du Nord-Pas-de-Calais, souvent issus de la faction la plus droitière et démagogique du parti de droite (Les Républicains – LR) ont adopté dans la foulée les mêmes types d’arrêtés. En réalité, en instrumentalisant le port du burkini, la bourgeoisie française poursuit sa campagne récurrente sur l’Islam 2 visant à pourrir les consciences, à diviser les populations en accentuant la propagande nationaliste.
Le danger du pogromisme
Dans un contexte de tendance à la dislocation croissante du corps social, dans lequel la classe ouvrière ne parvient pour le moment pas à défendre une perspective révolutionnaire, le communautarisme, et toutes les tendances irrationnelles au repli sur soi se renforcent. Cette dynamique alimente les peurs, les incompréhensions, les préjugés xénophobes et raciaux, voire la haine aveugle et obsessionnelle d’une partie des “autochtones” envers les “étrangers”, et inversement.
C’est dans ce contexte qu’une rixe éclatait le 14 août dernier dans une crique de Sisco, en Corse, entre trois familles de musulmans, qui d’après les autorités voulaient “privatiser la plage”, et une partie de la population locale. L’altercation, dont les circonstances restent encore très floues, déclenchait dès le lendemain une manifestation de 500 excités à Bastia aux cris identitaires de : “On est chez nous !” Ce type d’événement n’est malheureusement pas nouveau : déjà, en 2015, Ajaccio avait connu plusieurs journées de manifestations ouvertement xénophobes, avec destruction publique de livres par le feu (dont le Coran), provocations et mise à sac de boutiques arabes.
Ceci illustre la réalité du danger d’installation et de banalisation de la mentalité de pogrom au cœur même du capitalisme. Les difficultés actuelles de la classe ouvrière, même si elle n’a pas entièrement perdu sa capacité de résistance, sa capacité à renouer avec sa propre alternative révolutionnaire, tendent en effet à miner l’espérance en un monde meilleur dans l’esprit de nombreux prolétaires. Faute, pour le moment, de comprendre la nature réelle des rapports sociaux capitalistes et ce qu’ils contiennent de contradictions inextricables, faute de réelle perspective, le danger est de vouloir trouver des boucs émissaires aux “malheurs du monde”. Cette démarche réactionnaire, préconisant le retour chimérique à un “ordre ancien” où les rapports sociaux étaient prétendument plus “harmonieux” et “équitables”, perçoit les immigrés et les éléments les plus fragilisés par la crise comme les principaux responsables de cette illusion perdue et comme des fauteurs de troubles.
La xénophobie n’est pas un phénomène inédit dans l’histoire, loin s’en faut. Mais ce qui caractérise aujourd’hui l’évolution des mentalités dans le capitalisme, c’est une forte tendance à la libération brutale des plus bas instincts, par la parole et par les actes. Le danger de substituer la recherche de boucs émissaires à la destruction physique et mentale de victimes expiatoires est bien réel.
Si pour la bourgeoisie, la montée en puissance du populisme trouble son jeu électoral et peut contrarier ses véritables orientations politiques (rejet de l’Union européenne, de la monnaie unique, etc.), elle parvient néanmoins à instrumentaliser les idéologies les plus rétrogrades et nauséabondes pour réaffirmer sa domination. C’est ainsi qu’avec la polémique sur le burkini, l’État n’hésite pas à alimenter un faux-débat et les divisions au moyen d’une campagne médiatique hystérique. Pour ou contre l’interdiction du burkini, défenseurs du “droit des femmes” ou de la “liberté de conscience outragée”, de la droite à la gauche de l’appareil politique bourgeois, tous entretiennent la confusion dans la tête des ouvriers. Ce jeu dangereux avec le populisme ne peut, à terme, que renforcer sa dynamique. Mais tout en avivant les flammes de la haine, l’État peut, d’un autre côté, se présenter à bon frais comme le garant de la démocratie et de l’unité nationale. La classe ouvrière n’a rien à gagner en prenant partie sur ce terrain pourri et piégé de bout en bout par le nationalisme.
La société capitaliste génère l’aliénation
L’apparition du burkini sur les plages est un phénomène encore très limité 3, mais il est aussi un signe tangible, comme l’essor spectaculaire des produits halal et du port du voile ces dernières années, de la montée en puissance de l’obscurantisme religieux qui, loin de “donner du sens à la vie”, est “tout à la fois l’expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée, l’âme d’un monde sans cœur, de même qu’elle est l’esprit d’un état de choses où il n’est point d’esprit. Elle est l’opium du peuple” 4.
Ces tenues sont de véritables camisoles de force contre les femmes, souvent victimes consentantes de leur propre prison vestimentaire et surtout idéologique. Le consentement à la soumission, dont les femmes voilées sont loin d’avoir le monopole, est une expression directe de l’aliénation généralisée et totalitaire que fait subir la société capitaliste à l’humanité, une intériorisation des rapports sociaux de domination. Alors que les sciences et technologies se développent de façon inouïe, les rapports sociaux de production enferment l’humanité dans la pire sauvagerie et l’aliénation. A ce titre, le burkini et les images aberrantes de Fantômas déambulant à la plage ou dans les rues aussi bien que l’humiliation publique qu’elles subissent face à des policiers en armes les faisant apparaître comme des “criminelles” à l’égard des lois démocratiques sont une caricature de discrimination entre les sexes que la “civilisation” dont s’enorgueillit la classe dominante est incapable d’abolir. Il suffit d’observer également comment la “libération des femmes” après 1968 n’a fait que renforcer de manière très insidieuse les rapports de domination machistes au quotidien. La transformation des êtres humains en marchandises pour le travail salarié, le fait que des hommes et femmes deviennent de simples “kleenex” au travail, deviennent de la chair à canon, des objets sexuels, des faire-valoir publicitaires ou des porte-manteaux anorexiques de luxe pour la mode, tout cela n’a rien à envier au scandale du burkini. L’obtention ou la conservation de “droits” et d’autres formes d’idéologies hypocrites, comme les “libertés”, les “valeurs républicaines” et “droits de l’homme” sont en réalité complètement illusoires dans la société capitaliste. Ses véritables principes, ses “vraies valeurs”, ce sont la terreur, l’exploitation et la barbarie.
WH-EG, 30 août 2016
1 La Voix du Nord, le 5 août 2016.
2 Quand il ne s’agit pas du burkini, les médias s’emballent pour le niqab, la burqa ou des phénomènes plus répandus comme les produits halal ou la construction de mosquées.
3 A l’heure où nous écrivons ces lignes, une trentaine de femmes seulement ont été verbalisées durant l’été, la plupart ayant fait leur sortie en burkini suite à la médiatisation du “phénomène”.
4 Marx, Critique de la philosophie du droit de Hegel, 1843.
Géographique:
- France [4]
Rubrique:
Sport, idéologie et propagande au service du nationalisme (sur le film La couleur de la victoire)
- 1754 lectures
Au début du mois d’août, juste avant les jeux Olympiques au Brésil est sorti un film : La couleur de la victoire. Ce film retrace une partie de la vie de l’athlète noir américain Jesse Owens qui remportera 3 médailles d’or individuelle sur 100 et 200 mètres, au saut en longueur et une médaille d’or sur le relais 4x100, aux jeux Olympiques de Berlin en 1936.
Le film débute alors que Jesse Owens commençait à faire parler de lui dans le milieu universitaire en gagnant toutes les courses auxquelles il participait. Conscient de ses capacités, il intègre une université où un entraîneur renommé lui apprendra toutes les techniques de la course et le préparera aux jeux Olympiques de Berlin. Le film montre bien comment Jesse Owen a subi la ségrégation présente aux États-Unis vis-à-vis des Noirs, tant dans la vie de tous les jours que dans la vie universitaire. Ceci dit, aidé de son entraîneur, celui-ci parviendra à faire abstraction de cette situation et, grâce à ses victoires et à ses records, à retourner le public en sa faveur.
Le film montre également les conflits politiques qui existaient au sein du Comité olympique des États-Unis autour de la participation américaine aux JO de Berlin. Pour une partie de la bourgeoisie, la participation aux JO était importante : elle devait faire oublier les affres de la crise de 1929 et surtout renforcer l’idéologie nationaliste afin de mieux embrigader la classe ouvrière pour la Seconde Guerre mondiale qui s’annonçait 1. Pour convaincre la fraction bourgeoise qui n’était pas favorable à la participation, gênée par l’utilisation qu’Hitler allait faire des JO de Berlin à des fins de propagande nazie, un membre du comité olympique américain était envoyé à Berlin. La bourgeoisie allemande, consciente de l’importance que représentent ces Jeux pour montrer sa force politique et impérialiste, n’hésitera pas à accepter d’enlever les affiches antisémites qui se trouvaient sur les murs de Berlin pour répondre aux exigences américaines. La bourgeoisie allemande pour être sûre d’avoir l’accord des États-Unis ira jusqu’à corrompre le membre du comité américain. A son retour, Avery Brundage, par son discours sur les bienfaits du sport et de l’olympisme, parvint à convaincre ceux qui voulaient boycotter les JO de Berlin. Il fallait maintenant convaincre Jesse Owens lui-même d’y participer.
Pour la bourgeoisie américaine, il était important que Jesse Owens soit présent et ceci pour différentes raisons. Détenteur de plusieurs records du monde, il avait de fortes chances de gagner. De plus, Owens, grâce à ses victoires, jouissait d’une certaine notoriété au sein de la population américaine et s’attirait la sympathie de la classe ouvrière dont il faisait partie. Tous les ingrédients étaient réunis pour provoquer une émotion collective forte sur cet événement, pour “dépasser les clivages de couleurs et de classes”, c’est-à-dire pour entraîner les esprits dans l’union nationale. Malgré quelques pressions de la communauté noire qui feront un peu hésiter Owens, celui-ci, par goût de la compétition mais aussi pour ce que représentent les JO pour un athlète comme marque et couronnement d’une carrière sportive, donnera son accord. Pour que celui-ci soit mis dans les meilleures dispositions pour gagner, mais surtout pour donner une bonne image de la bourgeoisie américaine, celle-ci n’hésitera pas, à l’occasion de ces Jeux, à dissimuler tout ce qui pouvait rappeler la ségrégation que subissaient les Noirs. C’est ainsi qu’Owens fut surpris que les Blancs et les Noirs puissent manger ensemble, à la même table et dormir dans le même établissement.
Les Jeux de 1936 furent certainement les premiers Jeux où l’on assista à une véritable guerre de propagande entre États et notamment entre les États-Unis et l’Allemagne. Le contexte de l’approche de la Seconde Guerre mondiale l’explique. Toute la technologie cinématographique avancée de l’époque fut mobilisée pour donner une image de la puissance de l’Allemagne et du régime nazi. Il en sera de même pour la “démocratie” américaine. Toutes les courses d’Owens furent retransmises en direct à la radio. Owens ne réalisait pas qu’il n’était qu’un instrument entre les mains de la bourgeoisie américaine, agissant pour la défense de ses seuls intérêts idéologiques nationaux, qu’il servait de symbole et d’image à sa propagande, ou s’il le réalisait, cela lui importait peu. Ne comptait pour lui que la compétition, mais comprise de manière communautaire, fraternelle. D’ailleurs, au nom de cette fraternité entre sportifs, il nouera une amitié avec le sauteur en longueur allemand (Luz Long), son principal concurrent dans cette discipline. Celui-ci n’hésitera pas à aider Owens à trouver ses marques lors de cette épreuve, n’hésitera pas à lui serrer la main et à s’exposer avec lui bras-dessus, bras-dessous à la fin de cette compétition, au grand dépit d’Hitler. Ce rapprochement entre les deux athlètes, outre l’aspect de respect sportif, s’explique aussi par le fait qu’Owens subissait la ségrégation et que l’athlète allemand n’était pas d’accord avec la politique antisémite et raciste du régime nazi. Cette fraternité affichée avec Owens vaudra d’ailleurs ensuite à Luz Long de partir en première ligne dès le début de la guerre sur le front russe.
Depuis, la propagande s’est amplifiée au centuple. Tous les responsables de la propagande de l’époque étaient de petits joueurs au vu de ce que vont développer par la suite aussi bien la bourgeoisie stalinienne que la bourgeoisie démocratique. Aujourd’hui, à l’ère du chacun pour soi suite à la disparition des blocs Est-Ouest, la propagande a pris une dimension plus fortement nationaliste. C’est ainsi que chaque victoire lors des épreuves des JO voit l’athlète faire un tour d’honneur avec le drapeau national sur les épaules. A chaque médaille d’or gagnée, l’hymne national résonne et tourne en boucle sur tous les médias 2.
Les sanctions disciplinaires contre tout athlète critiquant le régime de son pays n’a pas été le propre des régimes nazi ou stalinien. Aux jeux Olympiques de Mexico en 1968, les sprinters noirs américains Tommie Smith et John Carlos qui finiront respectivement premier et troisième du 200 mètres seront exclus de l’équipe américaine pour avoir tendu le poing avec un gant noir lors des hymnes. Par la suite, les deux athlètes seront exclus à vie des jeux Olympiques. Toutes les compétitions internationales ressemblent désormais à une mission-commando pour chaque équipe nationale qui rappelle fortement les missions militaire en temps de guerre. Tout comportement suspect d’un athlète vis-à-vis des “valeurs de la nation” (ne pas chanter l’hymne national, par exemple) est sanctionné sévèrement ou donné en pâture à la vindicte populaire et souvent les deux.
Vu que la bourgeoisie américaine avait tout fait pour que les succès d’Owens soient retentissants pour servir ses intérêts, celui-ci sera célébré comme un héros à son “retour au pays”. La bourgeoisie démocratique américaine ne pouvait pas réemployer immédiatement les lois ségrégationnistes à l’encontre d’Owens. Par contre, une fois l’euphorie nationaliste et médiatique retombée, Owens se verra, lors des réceptions officielles, interdit d’accès par l’entrée principale. Il sera obligé d’emprunter les portes de service. De même, le président des États-Unis Roosevelt, refusera de lui serrer la main tout comme Hitler lors des JO. Tout ceci démontre bien que les soi-disant “grandes démocraties” n’ont rien à envier au régime nazi.
Ce film cherche à montrer que la prétendue “fraternité sportive” peut et permet de dépasser les divisions entre races et entre nations. Il participe en ce sens à développer l’idéologie humaniste qui est une utopie purement mystificatrice dans une société divisée en classes aux intérêts antagonistes. Il a malgré tout le mérite de nous rappeler, sans doute aux détriment des préjugés et du message idéologique volontairement colporté par le réalisateur, qu’en 1936, les mensonges et l’hypocrisie de la propagande démocratique n’avaient rien à envier au nazisme, comme par la suite, elles n’auront rien à envier au stalinisme. Toutes ont pour dénominateur commun d’être des expressions d’un même système : le capitalisme.
Cealzo, 16 août 2016
1 Voir notre article concernant Pearl Harbor : “Pearl Harbor 1941, les Twin Towers 2001 : le machiavélisme de la bourgeoisie”, Revue internationale no 108, 1er trimestre 2002.
2 Voir notre série sur “l’Histoire du sport” (RI nos 437 à 440, de novembre 2012 à avril 2013).
Rubrique:
Le régime Duterte aux Philippines, attrait pour “l’homme fort” et faiblesse de la classe ouvrière
- 1278 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article rédigé par la section du CCI aux Philippines suite à l’élection de Rodrigo Duterte à la tête de l’État.
En août 2015, dans notre article : “Boycottons les élections, le point de vue marxiste à l’époque du capitalisme décadent”, nous écrivions : “L’échec du régime Aquino n’est pas dû seulement à la personne du sénateur Benigno Aquino et au Parti libéral. Bien avant le règne de la faction actuelle, le système capitaliste aux Philippines était déjà en faillite. De concert avec la pourriture de l’administration actuelle, l’opposition dirigée par le concurrent le plus fort de la présidence, le vice-président Jojimar Binay, a des relents de corruption et de cupidité. C’est la preuve que l’opposition et l’administration sont également corrompues ; chacune dénonce les scandales de ses rivaux politiques. Nous n’avons pas besoin des “radicaux” et des “progressistes” du Parlement pour constater la décadence du capitalisme. Un effet négatif du capitalisme décadent dans sa phase de décomposition est la montée du désespoir et l’absence de perspective notamment parmi les masses pauvres. Un indicateur de cela est la “lumpen-prolétarisation” de parties entières de la classe laborieuse, entraînant une augmentation du nombre de suicides, le développement d’une culture pourrie chez les jeunes et de la criminalité. Tous ces éléments sont des manifestations du mécontentement croissant des masses à l’égard du système actuel, mais elles ne savent pas quoi faire pour remédier à cette situation. En d’autres termes, il y a un malaise croissant mais pas de perspective pour l’avenir. Voilà pourquoi la tendance au “chacun pour soi” et au “chacun contre tous” influence fortement une fraction significative de la classe ouvrière. Mais le pire effet de l’absence de perspective, la démoralisation, est l’espoir fallacieux en un homme fort, miraculeux, un dictateur éclairé, qui empêcherait la majorité de la population de sombrer dans la pauvreté. Cela n’est pas très différent de la croyance en un dieu tout-puissant qui descendrait sur terre pour sauver ceux qui ont foi en lui et punirait les autres. La classe qui est principalement à l’origine de cette illusion est la petite-bourgeoisie.” Globalement, les faits ont confirmé nos analyses.
Les différents “analystes politiques” ont admis que les votes pour Rodrigo Duterte sont des votes contre les défaillances de l’administration de B.S. Aquino. Ce qu’ils n’ont pas dit et ne veulent pas dire, c’est que la haine et le mécontentement du peuple se porte contre le système bourgeois démocratique comme un tout, croyant avoir éliminé la dictature de Marcos Senior en 1986. Au cours des trente dernières années, les échecs et la corruption des institutions démocratiques ont été révélés et se sont montrés de même nature que la dictature de Marcos. Ils estiment que la situation actuelle est pire que du temps de la dictature de Marcos senior.
Le régime Duterte : un gouvernement de la gauche du capital ?
Duterte a déclaré qu’il était un “socialiste” et un “gauchiste”. Il s’est vanté de devenir le premier président philippin de gauche. Presque toutes les fractions de gauche aux Philippines approuvent et soutiennent ce régime. L’avant-garde de ce soutien est le parti communiste maoïste des Philippines et ses institutions juridiques 1.
Quel que soit le “socialisme” de Duterte, ce n’est certainement pas un socialisme ou un marxisme scientifique. C’est évidemment une autre branche de socialisme bourgeois qui va décevoir les masses et raviver les mensonges de la bourgeoisie au sujet du socialisme et du communisme : le “socialisme” de Duterte est du capitalisme d’État 2. Sur la base des déclarations de Duterte avant et pendant sa campagne électorale, il apparaît que l’objectif de la plate-forme gouvernementale concerne les intérêts de la classe capitaliste, pas ceux des masses laborieuses. En lien avec cela, il a menacé de mort les militants ouvriers qui appelleraient à la grève sous son mandat.
Pire, Duterte utilise le langage (et le comportement) d’un chef de gang de truands et utilise l’intimidation. Ceci est une expression du fait qu’il voit le gouvernement comme une grande mafia dont il serait le parrain. Sa vague politique de fédéralisme prétend s’appuyer sur la reconnaissance que l’apport des pouvoirs locaux serait plus important que celui du gouvernement national ; la réalité est que la pouvoir central favorise l’autonomie des mafias locales dans leurs propres territoires.
Pour les ouvriers communistes révolutionnaires, le régime Duterte est un défenseur enragé du capitalisme national 3 mais reste totalement dépendant des investissements du capital étranger.
Le régime Duterte : un gouvernement de la classe capitaliste pour la classe capitaliste
La promesse “audacieuse” de Duterte de faire cesser la corruption, la criminalité et le trafic de stupéfiants au cours des trois à six premiers mois de sa présidence a exercé une forte attraction sur les électeurs. Cela a eu un fort impact sur les capitalistes et la classe moyenne, qui sont les premières cibles du crime organisé. Les capitalistes aspirent à un cadre paisible pour assurer leur prospérité. C’est pourquoi, pour les capitalistes, les grèves ouvrières sont une expression du chaos aussi bien que la peste de la criminalité.
Le nouveau gouvernement ne peut pas résoudre les problèmes du chômage massif, des bas salaires et de la précarisation croissante. Au sein d’une crise de surproduction qui s’aggrave, le principal souci des capitalistes est d’avoir un avantage concurrentiel sur leurs rivaux, dans un marché mondial saturé. Réduire le coût de la force de travail par le biais des licenciements et des contrats précaires est la seule façon pour eux de rendre leurs marchandises moins chères que celles de leurs concurrents. Essentiellement, la solution du régime est de renforcer le contrôle de l’État sur la vie de la société et d’obliger la population à respecter strictement les lois et la politique de l’État par le biais de la propagande et de la répression.
Dans le cadre du nouveau régime, les luttes de factions au sein de la classe dominante s’amplifieront au fur et à mesure de l’aggravation de la crise du système. En apparence, la plupart des politiciens élus des autres partis, particulièrement ceux du Parti libéral du prédécesseur de Duterte, le régime Aquino, font maintenant allégeance au nouveau gouvernement. Mais dans le fond, chaque faction a son propre programme qu’elle veut faire valoir en vertu de la nouvelle administration. De plus, à l’intérieur du camp Duterte, existent plusieurs factions rivales qui intriguent pour obtenir des avantages et de bons postes : la faction maoïste pro-Duterte, la faction anti CPP-NPA, les seigneurs de la guerre de Mindanao-Visayas, ceux de Luzon, particulièrement le groupe autour de Cayetano, candidat à la vice-présidence de Duterte.
Les effets de la décomposition du capitalisme sur la conscience des masses aux Philippines
Nous avons aussi écrit, dans notre article : “Appel à ne pas voter…” : “Si Duterte se présente aux élections présidentielles de 2016 et que la classe dominante aux Philippines décide que le pays a besoin d’un dictateur, comme à l’époque de Marcos, pour tenter de sauver le capitalisme moribond aux Philippines et condamner les masses pauvres à la peur et à la soumission au gouvernement, il vaincra sûrement. En fin de compte, la classe capitaliste (locale comme étrangère) n’est pas concernée par la gestion de l’État philippin : le plus important pour elle est d’accumuler du profit.” Il y a certainement des indices montrant que Duterte est un individu psychologiquement perturbé qui rêve de devenir un dictateur tout puissant. Mais la question de savoir s’il va gouverner comme un dictateur ou comme un bourgeois libéral dépend de la décision finale de la classe dominante (locale et internationale) et de la solidité du soutien de l’AFP/PNP et même de la faction maoïste qui lui est favorable.
Pour nous, ce qui est important, c’est d’analyser et de comprendre en tant que communistes pourquoi une fraction importante de la population est prête à accepter Duterte comme dictateur et “parrain”. Cette analyse est cruciale car, dans les autres pays, particulièrement en Europe et aux États-Unis, les personnalités ultra-conservatrices qui ont recours à un franc-parler et à l’intimidation (comme Donald Trump) gagnent en popularité. De même, un nombre significatif de jeunes sont attirés par la violence et le fanatisme de Daech-EI.
Pour comprendre la popularité phénoménale de Rodrigo Duterte et de Ferdinand Marcos Junior, le fils du dictateur précédent, il est nécessaire d’avoir une vision mondiale. Globalement, cela fait plus de trente ans que la décomposition capitaliste infecte la conscience de la population. Cette infection englobe de nombreux domaines : l’économie, la politique, la culture-idéologie. La popularité de Duterte et de Marcos Junior est un indicateur de l’impuissance, du désespoir et d’un manque de perspective ; elle montre également la perte de confiance dans l’unité de la classe ouvrière et dans les luttes des masses laborieuses. En conséquence, on assiste à la recherche d’un sauveur au lieu de la recherche d’une identité de classe.
Le contexte et le caractère insoluble de la crise du capitalisme s’expriment par l’aggravation de la pauvreté, le chaos croissant, la propagation des guerres, la dévastation de l’environnement, les scandales et la corruption des gouvernements. Mais un facteur majeur contribue également à la décomposition : c’est l’absence d’un mouvement fort de la classe ouvrière depuis plus de vingt ans aux Philippines. Les combats militants à l’époque de la dictature de Marcos Junior ont été dévoyés et sabotés par le gauchisme, vers la guérilla et l’électoralisme. En raison de la forte influence du nationalisme, le mouvement ouvrier aux Philippines est isolé des luttes internationales de la classe ouvrière.
Le développement de la criminalité
Depuis près de cinquante ans, les masses laborieuses philippines subissent à la fois la guérilla maoïste et la faillite des promesses de réformes de toutes les factions de la classe dirigeante installée au Malacañang Palace (la résidence présidentielle). De plus, la militarisation à la campagne des rebelles armés et de l’État a entraîné une dislocation massive qui génère un accroissement de la paupérisation des populations pauvres et inemployées venant grossir les bidonvilles insalubres et saturés des villes. Cette situation est exploitée par les syndicats du crime. C’est pourquoi, la criminalité liée au trafic de stupéfiants, aux cambriolages, aux enlèvements et aux vols de voitures, augmente chaque année. Les règlements de comptes, les tueries, les viols et autres formes de violence sont des événements banals dans les villes et de plus en plus, les auteurs comme les victimes sont des jeunes, voire des enfants.
Comme un nombre significatif de policiers sont les protecteurs des syndicats, l’État lui-même est devenu incapable de contrôler les crimes et la violence. Même si les premiers à être affectés par la montée de la criminalité – particulièrement les vols et les enlèvements – sont les riches, les pauvres portent aussi le fardeau de ces crimes, car la plupart des “soldats” ou chair à canon de ces syndicats du crime sont recrutés au sein de la population affamée et sans emploi.
Le poids de l’impuissance
Il y a un sentiment largement répandu d’impuissance parmi les Philippins. Étant atomisés et isolés, ils se demandent qui peut les protéger. Derrière cette réflexion, se trouve l’attente que l’État doit les protéger. Mais l’État les abandonne. L’impuissance et l’atomisation créent une aspiration à l’apparition d’un sauveur, une personne ou un groupe de personnes qui pourraient les sauver de leur misère ; cette aspiration est plus forte que la somme de la population atomisée. Le prétendu sauveur devrait contrôler le gouvernement puisque seul le gouvernement est censé les protéger.
Cette impuissance est un terrain fertile pour la recherche d’un bouc-émissaire et la personnalisation. Le fait de trouver un responsable à la cause de leur misère, comme les fonctionnaires gouvernementaux corrompus et les criminels, la perte de perspectives et le sentiment grandissant d’impuissance ont dopé la popularité de Duterte et de Marcos Junior. La popularité de ces personnages est un produit de la pourriture du système, non l’expression du développement de la conscience politique des masses. Cette pourriture a été également une raison de la popularité d’Hitler et de Mussolini avant la Seconde Guerre mondiale.
Comme la tendance à la recherche d’un bouc-émissaire et à la personnalisation grandit, le nombre de personnes qui sont favorables à l’élimination physique, par tous les moyens, des fonctionnaires corrompus et des criminels, augmente aussi. Ils applaudissent chaque fois qu’ils entendent Duterte déclarer : “Tuez-les tous !”.
La nécessité de s’ancrer dans l’internationalisme prolétarien
Il est plus difficile pour nous de lutter contre les effets de la société en décomposition dans le cadre de la situation politique actuelle. Néanmoins, nous ne sommes pas seuls et isolés pour lutter. Nous faisons partie d’un mouvement de résistance ouvrière internationale qui a surgi depuis 1968. La classe ouvrière internationale, malgré les difficultés à retrouver sa propre identité de classe indépendante, lutte toujours contre les attaques du capitalisme décadent.
Nous ne pouvons envisager un avenir favorable qu’en rejetant toute forme de nationalisme. Nous ne pouvons pas appréhender la lutte de classe si nous nous contentons de porter notre regard sur la seule “situation nationale”. Nous ne devons pas oublier que, depuis 2006, nos frères de classe en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis, ont lutté contre la décomposition à travers des mouvements de solidarité (mouvement anti-CPE en France, des Indignados en Espagne, la lutte de classe en Grèce, le mouvement Occupy aux États-Unis). Nous devons également nous rappeler que des centaines de milliers de nos frères de classe en Chine ont lancé des grèves généralisées.
Nous devons persévérer dans la clarification théorique, le renforcement organisationnel et les interventions militantes pour préparer les futures luttes à un niveau international. Nous ne sommes pas nationalistes comme les différentes fractions gauchistes : nous sommes des prolétaires internationalistes.
Rappelons le dernier paragraphe du Manifeste du parti communiste : “Les communistes ne s’abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets. Ils déclarent ouvertement que leurs objectifs ne peuvent être atteints que par le renversement violent de tout l’ordre social passé. Que les classes dirigeantes tremblent devant la Révolution communiste ! Les prolétaires n’ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à gagner !”
Internasyonalismo, juin 2016
1 Malgré la “protestation” initiale des maoïstes contre le programme économique néo-libéral en huit points du régime, ils sont tous unis dans le soutien au “boucher” Duterte. Pour preuve : il y a des représentants maoïstes au sein du cabinet Duterte.
2 Les régimes comme ceux de Chine, du Vietnam, de Cuba, qui prétendent être des pays “socialistes” sont également des versions du capitalisme d’État. Même les régimes capitalistes barbares d’Hitler (le nazisme), de Saddam Hussein et d’Assad, ont déclaré sans vergogne être “socialistes”. Aujourd’hui, une majorité de la population philippine croit encore que le Parti “communiste” des Philippines est une organisation communiste.
3 Pas fondamentalement différent du programme du CPP (Communist Philippine Party)-NPA (New People’s Army) pro-maoïste.
La question des rapports entre nature et culture (à propos du livre de Patrick Tort Sexe, race & culture)
- 2745 lectures
Les discussions autour du projet de loi sur le “mariage pour tous” en 2013 en France ont suscité beaucoup d’émoi, de postures, de grandiloquence et de sottises, et plus encore lorsque les “études de genre” furent brandies comme un argument décisif par un camp ou par l’autre. Puis les controverses passionnées, changeant d’objet, prirent un tour dramatique lorsque des milliers de réfugiés, chassés de chez eux par la misère et la guerre, vinrent frapper aux portes des pays développés, et lorsque se firent entendre les rafales de kalachnikov destinées à anéantir, à Paris des jeunes pour leur mode de vie, à Orlando des jeunes pour leur orientation sexuelle. La gauche, la droite, l’extrême-droite et l’extrême-gauche, toutes les familles de l’appareil politique de la bourgeoisie s’étripèrent sur la scène du théâtre médiatique – entre elles et à l’intérieur de chacune –, proclamant “je suis Charlie” ou encore “je ne suis pas Charlie”, redoublant de démagogie pour ne pas être en reste face à la concurrence.
Abandonnons le théâtre de la politique officielle et revenons aux questions de fond posées par le racisme et la xénophobie, le sexisme et l’homophobie, par toutes ces conduites sociales qui relèvent de l’aliénation humaine et qui peuvent aller jusqu’au meurtre. Comment expliquer un tel déchaînement de violence sociale, comment comprendre les préjugés qui en forment la base et qui semblent provenir d’un âge obscur et révolu ? Comment, face à ce type de problèmes, se prémunir contre la pensée idéologique que le système bourgeois diffuse abondamment pour masquer la réalité et accentuer les divisions qui affaiblissent son ennemi historique, la classe des prolétaires ?
Bien entendu, on peut deviner la cause profonde de ces phénomènes. Dans une société divisée en classes antagoniques, fondée sur l’exploitation de l’homme par l’homme et où la marchandise s’est imposée comme un tyran sur tous les plans de l’existence, y compris les plus intimes, une société enfin où l’État, ce monstre froid, domine et surveille chaque individu, il n’est pas étonnant que la violence sociale soit extrêmement élevée. Dans ce type de société, l’Autre, l’individu qui nous fait face, est d’emblée ressenti comme suspect, comme un danger potentiel, au mieux comme un concurrent, au pire comme un ennemi. Il est stigmatisé pour mille raisons, parce qu’il n’a pas la même couleur de peau, le même sexe, la même culture, la même religion, la même nationalité, la même orientation sexuelle. Ainsi, les multiples facettes de la concurrence qui se trouve à la base de la société capitaliste provoquent régulièrement la paupérisation, les guerres, les génocides, mais aussi, à une autre échelle, le stress, l’agressivité, le harcèlement et la souffrance psychologique, la mentalité pogromiste, la superstition, le nihilisme, la dissolution des liens sociaux les plus élémentaires 1.
Mais cette explication reste générale et ne suffit pas ; il faut encore identifier la dynamique qui génère ces préjugés et les actes qu’ils prétendent justifier, expliquer sa survivance et ses causes immédiates et lointaines. C’est une question qui concerne au plus haut point la classe ouvrière. Tout d’abord parce que, dans ses luttes, elle est sans cesse confrontée à la nécessité de rassembler ses forces, de se battre pour conquérir son unité. Le combat pour rejeter ou neutraliser les préjugés qui divisent ses forces, comme le racisme, le sexisme ou le chauvinisme par exemple, est indispensable et il n’est pas gagné d’avance. Ensuite parce que la perspective révolutionnaire portée par le prolétariat s’assigne comme but la construction d’une société sans classes, sans frontières nationales, c’est-à-dire la création d’une communauté humaine enfin unifiée à l’échelle mondiale. Cela veut dire que la révolution prolétarienne entend clore et conclure toute une période de l’histoire humaine où, depuis les premiers regroupements, mélanges et alliances au sein des sociétés primitives jusqu’aux luttes du xixe siècle pour l’unité nationale, chaque palier dans le développement de la productivité du travail a conduit à une révolution des rapports de production et à un élargissement de l’échelle de la société.
La défense de l’œuvre de Darwin
Si le prolétariat, en tant que classe historique dotée du projet communiste, en tant que représentant par excellence du principe actif de la solidarité, est déjà poussé par la pratique à dépasser ces divisions, le racisme, le sexisme ou la xénophobie restent pour lui un problème réel qui touche au facteur subjectif de la révolution. Les conditions objectives ne suffisent pas ; pour que la révolution soit victorieuse il faut encore que la classe soit en mesure subjectivement de mener jusqu’au bout sa tâche historique, qu’elle soit en mesure d’acquérir dans le cours même de son mouvement la capacité de s’unifier et de s’organiser, une volonté, une combativité et une conscience suffisamment développées, une profondeur théorique, une morale suffisamment ancrée, et, du côté de la minorité communiste, une réelle aptitude à donner des orientations politiques claires et convaincantes, et à se constituer en parti mondial dès que les conditions de la lutte de classe le permettent.
Le petit livre de Patrick Tort, Sexe, race et culture, peut nous aider à mieux comprendre ces questions et constituer un réel stimulant pour la réflexion des ouvriers les plus conscients. On connaît la rigueur scientifique de cet auteur 2, qui ne rend pas toujours aisée la lecture de ses livres, mais la volonté de rendre accessible à tous ce type de problématiques est clairement revendiquée ici. Conçu sous la forme d’un entretien, le livre est composé de deux parties : la première aborde la question du racisme et prend position sur la décision, prise récemment en France par plusieurs institutions étatiques ou scientifiques, d’abandonner l’utilisation du mot “race” ; la seconde aborde la question du sexisme et tente de définir les rapports entre le sexe et le “genre”. Toutes ces questions se trouvent au carrefour de la biologie et des sciences sociales, et ne peuvent trouver un début de clarification sans une critique des conceptions dominantes sur la “nature humaine”, sans une critique de la vieille opposition figée entre “nature” et “culture”.
Ici l’apport de Darwin est considérable. Dans le champ qui est le sien, la science du vivant, Darwin propose toute une série d’outils théoriques et une démarche scientifique qui permettent de construire une vision matérialiste du passage de la nature à la culture, du règne animal au monde social de l’Homme. Patrick Tort est à l’échelle internationale l’un des meilleurs connaisseurs de Darwin, dont il publie actuellement les œuvres complètes en français aux éditions Slatkine (Genève) et Champion (Paris). La publication du monumental Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, dirigée par lui, a permis de mettre à la disposition de tous un instrument inestimable. À travers la notion d’effet réversif de l’évolution, notamment, il a fortement contribué à rendre intelligible ce qui dans l’œuvre anthropologique de Darwin avait été occulté en raison de son contenu subversif 3. Ce combat reste d’actualité car on trouve encore des résistances devant les avancées fondamentales permises par Darwin. Il y a ceux qui, pour éviter les questions de fond, feignent la surprise : “Qu’est-ce que vous lui trouvez donc à ce Darwin ? S’agit-il d’un nouveau culte rendu à un scientifique à la mode ?” 4. Il y a ceux que Patrick Tort appelle les “jubilateurs précoces” qui, oubliant que Darwin n’était pas socialiste, qu’il était un homme de son temps et donc qu’il partageait une part de ses préjugés, agitent une citation, soigneusement isolée, comme un trophée censé disqualifier l’ensemble et la logique de l’œuvre 5.
Bien entendu, nous ne sommes pas forcément d’accord avec toutes les positions politiques induites par le texte de Patrick Tort. L’essentiel est ici de s’appuyer sur les apports de différentes disciplines scientifiques pour donner plus de chair, plus de clarté à des notions que, pour la plupart, le marxisme a depuis longtemps intégrées à son patrimoine théorique. Les grandes qualités de cet auteur, outre une méthode matérialiste rigoureuse, sont sa capacité de croiser les différentes disciplines, sa critique des idées reçues et du bon sens commun, produits aussi bien, selon sa terminologie, par “la droite libérale” que par “l’idéologie progressiste dominante”, ce qui le conduit à se tenir à l’écart du capharnaüm des médias, ces “grands appareils d’influence”.
Vers le renversement de la civilisation bourgeoise
L’apport fondamental de l’anthropologie de Darwin consiste dans une description cohérente et matérialiste de l’émergence de l’espèce humaine à travers le mécanisme de la sélection naturelle, qui permet aux individus présentant une variation avantageuse d’avoir une descendance plus adaptée et plus nombreuse. Sur le fond, le processus est le même pour toutes les espèces. Dans la lutte pour l’existence les moins aptes sont éliminés, ce qui aboutit, lorsque certaines conditions sont réunies, à la transformation des espèces par sélection prolongée des variations avantageuses, et à l’apparition de nouvelles espèces. Ce qui est transmis à la descendance, dans le cas des animaux supérieurs 6, ce sont non seulement les variations biologiques avantageuses, mais également les instincts sociaux, le sentiment de sympathie et l’altruisme, qui servent eux-mêmes d’amplificateurs au développement des capacités rationnelles et des sentiments moraux. Ce qui se passe avec l’Homme, c’est précisément que le développement de la sympathie et de l’altruisme vient contredire l’élimination des plus faibles et s’y oppose. La protection des faibles, l’assistance envers les déshérités, la sympathie à l’égard de l’étranger qui nous apparaît comme semblable malgré les différences dans la culture et dans l’apparence extérieure, ainsi que toutes les institutions sociales chargées de les encourager, Darwin appelle cela la civilisation. Tort en rappelle brièvement le contenu :
“Par la voie des instincts sociaux (et de leurs conséquences sur le développement des capacités rationnelles et morales), la sélection naturelle sélectionne la civilisation, qui s’oppose à la sélection naturelle. C’est la formule simplifiée et courante de ce que j’ai nommé l’effet réversif” (p. 21). C’est une conception parfaitement matérialiste et dialectique. Un renversement s’est opéré dans le cas de l’apparition de l’Homme, qui de plus en plus adapte son milieu à ses besoins au lieu de s’adapter à lui, et se libère ainsi de l’emprise éliminatoire de la sélection naturelle : au début du processus c’est l’élimination des faibles qui prédomine ; puis, au cours d’une inversion progressive, c’est la protection des faibles qui finit par s’imposer, marque éminente de la solidarité du groupe. L’erreur originelle de la sociobiologie consiste à concevoir la société humaine comme une collection d’organismes en lutte ; elle postule donc une continuité simple entre le biologique (réduit à une hypothétique concurrence des gènes) et le social. Ce n’est pas le cas chez Darwin. Il y a bien chez lui une continuité, mais c’est une continuité réversive. En effet, le renversement que nous venons de décrire produit non pas une rupture entre le biologique et le social mais un effet de rupture. Cette notion permet de comprendre selon Tort l’autonomie théorique des sciences de l’homme et de la société, tout en maintenant la continuité matérielle entre nature et culture. C’est un rejet de tout dualisme, de toute opposition figée entre l’inné et l’acquis, entre nature et culture.
Les découvertes de Darwin, auxquelles on ajoutera l’effet réversif comme clé indispensable de compréhension de l’œuvre elle-même, représentent un véritable bouleversement de nos conceptions scientifiques sur l’apparition de la société humaine. En remettant en cause les certitudes anciennes (le fixisme) et l’apparente stabilité du monde vivant, et en adoptant la perspective de sa généalogie réelle, Darwin ouvrait des horizons nouveaux. C’est le même type de bouleversement qu’avait provoqué Anaximandre dans l’Antiquité grecque lorsqu’il remit en cause la conception dominante selon laquelle notre planète devait forcément reposer sur quelque chose. En réalité, affirmait-il, la Terre flotte dans le ciel et dans ce sens il n’y ni haut ni bas. En changeant simplement le regard porté sur la réalité sensible, Anaximandre ouvrait la voie à la découverte de la Terre comme une sphère – où les personnes qui vivent aux antipodes ne marchent pas la tête en bas – et à toutes les avancées scientifiques qui en découlent 7.
Les conséquences des découvertes de Darwin sont rappelées par Patrick Tort :
• La sélection naturelle n’est plus, à ce stade de l’évolution, la force principale qui gouverne le devenir des groupes humains ;
• “Autrement dit, si l’évolution a précédé l’histoire, l’histoire aujourd’hui gouverne l’évolution” (p. 19).
• “Il faut du biologique pour faire du social, mais d’une part le social ne saurait se réduire au biologique, et d’autre part c’est le social qui, du point de vue de l’Homme acteur et juge de son évolution, produit la vérité du biologique dans les capacités qu’à travers lui le biologique se révèle apte à dévoiler” (p. 17).
• Comme il existe une continuité (réversive) entre nature et culture, et comme “l’Homme historique n’a pas pour autant cessé d’être un organisme, l’évolution englobe ou inclut l’histoire” (p. 18).
Nous n’allons pas reproduire toute la fameuse citation du chapitre IV de La Filiation de l’Homme, mais seulement deux phrases qui sont fondamentales pour comprendre l’importance des conclusions de Darwin à propos de l’Homme parvenu au stade présent de la “civilisation” : “Une fois ce point atteint, il n’y a plus qu’une barrière artificielle pour empêcher ses sympathies de s’étendre aux hommes de toutes les nations et de toutes les races. Il est vrai que si ces hommes sont séparés de lui par de grandes différences d’apparence extérieure ou d’habitudes, l’expérience malheureusement nous montre combien le temps est long avant que nous les regardions comme nos semblables” (texte cité par Tort p. 23).
En lisant L’Autobiographie 8, que Darwin réservait uniquement à ses proches, on pourra constater qu’il avait parfaitement conscience de la nature révolutionnaire de ses découvertes, notamment du fait qu’elles remettaient en cause la croyance en Dieu, lui-même étant devenu athée. Mais il faisait preuve d’une extrême prudence pour éviter que, dans l’Angleterre victorienne si puritaine et religieuse, son œuvre ne fût mise à l’index. On retrouve dans ce passage la même vision profonde et révolutionnaire du devenir humain : les frontières nationales sont pour lui des barrières artificielles que la civilisation devra franchir et abolir. Sans être communiste, sans même envisager explicitement la destruction des frontières nationales, Darwin inclut de fait dans sa vision l’hypothèse d’une disparition du cadre national. Dans son esprit, la civilisation n’est pas un état de fait, elle est un mouvement constant et douloureux (“le temps est long avant…”), un processus continu de dépassement, qui, une fois atteinte l’unification de l’humanité, doit se poursuivre par le développement du sentiment de sympathie envers tous les êtres sensibles, c’est-à-dire au-delà de la seule espèce humaine.
Rapprochant la perspective forgée par Darwin et celle forgée par Marx, nous estimons quant à nous que c’est sur les épaules du prolétariat et de sa solidarité reconstituée que repose la lourde tâche de renverser la civilisation bourgeoise pour permettre le libre développement de la civilisation humaine.
Contre le matérialisme mécaniste
Une autre conséquence importante est la façon dont nous pouvons concevoir la fameuse “nature humaine”. Nous connaissons l’erreur des socialistes utopiques. Malgré tous leurs mérites, ils étaient dans l’incapacité, du fait de l’époque qui était la leur, de définir quelles étaient les prémisses qui, dans la société bourgeoise, permettraient de bouleverser les rapports sociaux et de construire une société communiste. Il fallait donc inventer de toute pièce une société idéale qui soit conforme à la nature humaine comprise comme un critère absolu. Ce faisant, les socialistes utopiques reprenaient la vision dominante de leur temps, une vision idéaliste largement répandue encore aujourd’hui, selon laquelle la nature humaine est immuable et éternelle. Le problème, répond Marx, c’est que la nature humaine se modifie constamment au cours de l’histoire. En même temps que l’homme transforme la nature extérieure, il transforme sa propre nature.
La conception défendue par Darwin sur les rapports entre nature et culture nous permet d’aller encore plus loin qu’une simple vision abstraite d’une nature humaine éphémère, fluide. Il existe une continuité entre le biologique et le culturel, ce qui implique l’existence d’un noyau constant dans la nature humaine qui est un produit de toute l’évolution. Marx partageait cette vision. C’est ce qui ressort notamment de ce passage du Capital où il répond à l’utilitarisme de Jérémie Bentham : “Pour savoir, par exemple, ce qui est utile à un chien, il faut étudier la nature canine, mais on ne saurait déduire cette nature elle-même du principe d’utilité. Si l’on veut faire de ce principe le critérium suprême des mouvements et des rapports humains, il s’agit d’abord d’approfondir la nature humaine en général et d’en saisir ensuite les modifications propres à chaque époque historique” 9.
Même si les racines profondes de la nature humaine ont été reconnues, l’erreur d’interprétation commise par les socialistes utopiques reste encore dominante aujourd’hui. Patrick Tort met bien en évidence sa nature : “L’erreur n’est pas d’affirmer l’existence d’une “nature” dans l’être humain, mais de la penser toujours sur le mode d’un héritage tout-puissant qui le gouvernerait suivant l’intangible loi d’un déterminisme univoque et subi” (p. 83). Ce déterminisme univoque et subi est le propre du matérialisme mécaniste. Le matérialisme moderne, quant à lui, ajoute une détermination active comme l’avait bien compris Épicure avec sa théorie du clinamen. Dès sa thèse de doctorat, Différence de la philosophie naturelle chez Démocrite et chez Épicure, Marx avait reconnu cet apport considérable d’Épicure qui dépassait le réductionnisme présent dans l’atomisme de Leucippe et Démocrite et qui introduisait la liberté dans la matière. Cette liberté signifie qu’au sein de la nature rien n’est prédestiné, comme le prétendrait un déterminisme absolu, et il y a une place pour la spontanéité des agents. Elle signifie que pour les organismes qui ont acquis une certaine autonomie, “à l’instant t, je puis décider d’un acte, d’un acte contraire ou d’un non-acte sans le devoir à un ‘programme’” (p. 83).
Ce matérialisme actif – et non plus passif et subi –, défendu par Patrick Tort, conduit à cette définition qui devrait s’inscrire dans toutes les mémoires : “la “nature humaine” est l’incalculable somme de tous les possibles de l’humanité. Ou encore, sur un mode délibérément existentialiste : la “nature humaine”, c’est ce qui est entre nos mains” (p. 86).
Le récit du bouc émissaire
Nous avons vu plus haut que la persistance du racisme, du sexisme et de la xénophobie sont les produits d’une société divisée en classes. Il est important de garder cela à l’esprit car il est ainsi possible de comprendre pourquoi la lutte du prolétariat, parce qu’elle est la seule qui puisse conduire à l’abolition des classes, inclut la lutte contre ces différents phénomènes. Alors que l’inverse est faux. Dès que l’antiracisme ou le féminisme prétendent mener une lutte autonome ils deviennent rapidement une arme contre la classe ouvrière et prennent leur place au sein de l’idéologie dominante. Il en est de même avec le pacifisme qui, lorsqu’il n’est pas explicitement relié à la lutte révolutionnaire du prolétariat contre le capitalisme en tant que système social, se transforme en une dangereuse mystification.
Mais il s’agit de problèmes réels pour le prolétariat et nous devons, avec Tort, affiner l’analyse. La xénophobie n’est pas simplement un rejet de l’autre chez qui l’on ne verrait que des traits de caractère totalement différents. C’est flagrant dans le cas du racisme, mais cela peut et doit s’expliquer autrement : “Le racisme est le rejet, sur un être que l’on extériorise, de ce que l’on hait le plus en soi” (p. 22). Fondamentalement, ce qui est rejeté chez l’autre, ce n’est pas le différent, c’est ce que l’on souhaite bannir de soi. “Dans sa version la plus extrême, le racisme doit donc se définir moins comme le simpliste “rejet de l’autre” que comme la négation du semblable dans le semblable à travers la fabrication d’un “autre” fantasmé comme vil et menaçant” (p. 23).
La personne ou la population visée ne représente pas un inconnu menaçant ; elle est considérée comme une menace parce qu’elle est précisément une partie de nous-mêmes, cette partie que nous considérons comme méprisable. Comme le dit Patrick Tort rappelant que juifs et chrétiens allemands vivaient ensemble depuis plus de seize siècles, c’est le plus proche semblable qui est ainsi la victime qu’il faut anéantir. Dans l’Ancien Testament, “Le rituel du “bouc émissaire” est un rituel expiatoire, qui en tant que tel extériorise la partie coupable de soi et la voue au démon et au néant symbolique du désert” (p. 28). Nous savons que la société bourgeoise a été très souvent le théâtre de pogroms ou de génocides et que la classe dominante en porte entièrement la responsabilité. Mais il faut élargir la compréhension et ne pas s’arrêter aux manifestations spectaculaires de ces phénomènes. Il faut percevoir à quel point la recherche d’un bouc émissaire et la mentalité pogromiste, avec la violence extrême qu’elles contiennent, sont ancrées dans le sol de la société capitaliste, où elles trouvent toujours de quoi se nourrir.
Si on relit le passage de La Filiation de l’Homme cité plus haut, on comprend mieux ce que veut souligner Darwin avec ces mots : “le temps est long avant que nous les regardions comme nos semblables”. Le principe même de la civilisation est le processus du développement de la sympathie c’est-à-dire de la reconnaissance du semblable dans l’autre. Comme la civilisation est le produit de la sélection naturelle avant d’en inverser la marche, le processus d’élimination de l’élimination (l’effet réversif selon Tort) est toujours en cours, et un retour en arrière est toujours périodiquement possible. Mais ce que nous avons dit plus haut interdit qu’on puisse parler d’une “nature humaine” encore primitive. “L’anthropologie influencée par Darwin n’a cessé d’user métaphoriquement d’un concept biologique pour interpréter, au sein de la civilisation, la réapparition des comportements ancestraux qui renvoient l’humain à ses origines animales : ce concept c’est celui du retour atavique, malheureusement inflationnel et galvaudé dans la psychiatrie héréditariste française du xixe siècle et dans l’anthropologie criminelle italienne qui s’en inspira, mais qui est néanmoins utile pour penser ce qui en nous demeure, à travers de possibles réaffleurements, la manifestation d’une ancestralité éminemment persistante” (p. 27).
“Race” et culture
L’argument le plus utilisé pour combattre le racisme consiste à expliquer que ce qui apparaît comme de grandes différences dans l’apparence extérieure des êtres humains est objectivement négligeable lorsqu’on se place aux niveaux génétique et moléculaire. On sait très peu de chose sur la “race”, car elle nomme en fait une pseudo-réalité, et ce que l’on en sait paraît suffire pour conclure à son inexistence. Il est donc ridicule d’être raciste. Cet argument est totalement inopérant, répond Patrick Tort. Si la recherche scientifique affirmait demain, grâce à de nouvelles découvertes, que les “races” existent biologiquement, est-ce que cela justifierait le racisme pour autant ? La faille de cet argument vient du fait que le racisme s’adresse à des phénotypes 10 (biologiques et culturels) et non à des génotypes 11 ; à des individus entiers avec leurs caractères observables et non à des molécules. Il est alors facile pour le conservatisme identitaire (Alain de Benoist, Zemmour, Le Pen) et pour tous les racistes d’en appeler au bon sens : les races sont une évidence que tout le monde peut voir, il suffit de comparer un Scandinave et un Indien.
Il est certain que l’utilisation non scientifique qui a été faite du mot “race” disqualifie totalement son usage et nous oblige tout au moins à l’encadrer de guillemets. Mais en réalité, les “races” existent bien, en tant qu’elles correspondent aux “variétés” qui distinguent des subdivisions identifiables au sein d’une espèce. Certes, c’est une notion très difficile à délimiter, elle n’est pas homogène, elle reste floue tout comme – et plus encore que – la notion d’espèce, parce que le vivant évolue sans cesse sous l’effet des variations incessantes et de la modification du milieu. Ainsi les espèces ne sont pas des entités pérennes mais des groupes que la classification range sous des catégories. Elles existent néanmoins. Darwin a montré que les espèces sont en transformation permanente, mais qu’il est possible, en même temps, de les distinguer car elles correspondent à une stabilisation – certes relative et temporaire si l’on se place à l’échelle des temps géologiques – imposée par la présence des autres espèces en compétition avec elles dans la lutte pour l’existence et par les besoins mêmes de la classification. Il y a, sous la régularité des formes spécifiques, une combinaison efficace par rapport à un milieu donné et à une niche écologique qui explique que les individus d’une même espèce se ressemblent. “Même s’il est entendu que dans l’histoire de la science des organismes, les divisions classificatoires n’ont qu’une valeur temporaire et technique, il y a encore un sens naturaliste à dire qu’il y a une seule espèce humaine, et que cette espèce, comme à peu près toutes les espèces biologiques, comprend des variétés. Dans la tradition naturaliste, “race” est un synonyme de “variété”” (p. 33).
Le racisme est un phénomène social, c’est au niveau social qu’il faut y répondre. De ce point de vue le passé colonial continue d’avoir des conséquences nuisibles et le prolétariat devra combattre fermement “une idéologie qui convertit des caractéristiques d’humains en signes d’infériorité native et permanente, ainsi qu’en menace pour d’autres humains” (p. 41).
La problématique est globalement la même pour la question du sexisme. Le sexe est une réalité biologique, mais le “genre” est quant à lui une réalité culturellement construite, et donc un devenir, un possible, qui reste ouvert. L’attitude radicale de certaines féministes ou de certaines “études de genre” qui veulent “dénaturaliser” le sexe est aussi stupide que celle consistant à nier la réalité des différences interraciales visibles. Le combat pour l’égalité sociale des hommes et des femmes, qui n’aboutira jamais dans le capitalisme, le combat pour la sympathie envers l’altérité, c’est-à-dire pour la reconnaissance de l’autre comme semblable malgré toutes les différences culturelles − tous ces combats sont au cœur de l’anthropologie de Darwin. L’éthique prolétarienne porte en elle tout cet héritage. C’est pourquoi la lutte pour le communisme n’est pas l’œuvre d’individus robotisés et indifférenciés et n’a rien à voir avec une négation des différentes cultures humaines, elle se définit comme l’unification dans la diversité, l’inclusion de l’autre au sein d’une association, d’une communauté qui a besoin de la richesse de toutes les cultures 12.
La critique du dualisme et l’exigence d’une continuité réversive entre nature et culture, entre biologie et société, nous a conduits à une définition rigoureuse de la nature humaine et à reprendre la notion darwinienne de civilisation comme processus toujours inachevé. Quelles conséquences pour la lutte révolutionnaire ? Au sein du capitalisme, cette lutte est avant tout une lutte pour l’émancipation du prolétariat, même si elle porte en elle l’émancipation de toute l’humanité. Le prolétariat doit se préparer à une guerre civile particulièrement difficile face à une bourgeoisie qui n’acceptera jamais de céder son pouvoir. Cependant ce n’est pas principalement par la force des armes que le prolétariat emportera la décision. L’essentiel de sa force tient dans sa capacité d’organisation, dans sa conscience de classe et surtout dans son aptitude d’une part à conquérir son unité, d’autre part à entraîner derrière lui toute la masse des couches non-exploiteuses, ou, au moins, à les neutraliser dans les périodes d’indécision sur l’issue du combat. Ce processus d’unification, d’intégration, va-t-il s’opérer automatiquement sous prétexte que l’Homme est un être social et que la nature humaine contient cet avantage évolutif représenté par la généralisation du sentiment de sympathie ? Bien sûr que non ! Mais les résultats et la démarche scientifiques exposés dans le livre de Patrick Tort confirment la vision marxiste de l’importance du facteur subjectif pour le prolétariat, en particulier de la conscience, des mentalités et plus globalement de la culture. Ils confirment la validité du combat de la Gauche communiste contre le fatalisme de la social-démocratie dégénérescente qui défendait la position opportuniste d’un passage graduel, automatique et pacifique du capitalisme au socialisme. Ils confirment que le devenir de l’humanité, c’est ce qui est entre les mains du prolétariat.
Avrom Elberg
1 Sur la nature de la violence au sein de la société bourgeoise, voir notre article, “Terreur, terrorisme et violence de classe”. Revue internationale, no 14, 3e trimestre 1978, ou notre site.
2 Voir les démonstrations qu’il en fait tout au long des 1000 pages de Qu’est-ce que le matérialisme ?, Paris, Belin, 2016. Il s’agit du dernier livre de Patrick Tort dont nous recommandons la lecture à ceux qui voudraient approfondir toutes les questions traitées ici.
3 Nous avons présenté le travail de cet auteur et la notion d’effet réversif de l’évolution dans l’article : “À propos du livre de Patrick Tort, L’Effet Darwin, Une conception matérialiste des origines de la morale et de la civilisation”. Voir Révolution internationale, no 400, avril 2009, ou notre site.
4 Sur France Culture, Jean Gayon, philosophe spécialisé en histoire des sciences et en épistémologie, ne craint pas la banalité en déclarant à propos de Darwin que “ce n’est ni Jésus, ni Marx” (La Marche des Sciences, émission du 4 février 2016 consacrée à “Darwin, sous les feux de l’actualité”).
5 Le Parti communiste international qui publie en France Le Prolétaire appartient incontestablement au club des “jubilateurs précoces”. On pourra le vérifier en lisant sa revue Programme communiste, no 102, février 2014. Dans une polémique visant le CCI, ce groupe, aveuglé par la légende d’un Darwin malthusien, réalise un véritable tour de force en confondant non seulement Darwin et le darwinisme social de Spencer, mais dans le même élan Darwin et la sociobiologie.
6 Par “animaux supérieurs” on entend traditionnellement en histoire naturelle les vertébrés homéothermes (c’est-à-dire à température constante), comme les oiseaux et les mammifères.
7 Voir notre article, “À propos du livre de Carlo Rovelli, Anaximandre de Millet. La place de la science dans l’histoire humaine”. Révolution internationale, no 422, mai 2011, ou notre site.
8 Charles Darwin, L’Autobiographie, Paris, éd. du Seuil, coll. Science ouverte, 2008.
9 K. Marx, Le Capital, Livre premier, septième section, chapitre XXIV : “Transformation de la plus-value en capital, V. – Le prétendu fonds de travail” (labour-fund), note (b), dans Œuvres, tome I, Paris, éd. Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1963, p. 1117.
10 Phénotypes : en génétique, l’ensemble des caractères observables d’un individu.
11 Génotype : ensemble des gènes d’un individu.
12 La vision prolétarienne de la richesse des cultures, considérées comme un facteur positif dans le combat pour l’unité dans la lutte – en opposition totale avec le multiculturalisme et le communautarisme bourgeois qui reproduisent l’idéologie identitaire – est développé, avec de nombreux exemples historiques, dans notre article, “L’immigration et le mouvement ouvrier”, Revue internationale, no 140, 1er trimestre 2010, ou notre site.
Personnages:
- Patrick Tort [62]
Rubrique:
Révolution Internationale n°461 - novembre décembre 2016
- 1582 lectures
Alep, un nouveau crime du capitalisme contre l’humanité
- 1195 lectures
La liste des crimes contre l’humanité du siècle précédent a souvent porté des noms de ville : Guernica, Coventry, Dresde, Hiroshima, Sarajevo... Aujourd’hui la cité historique d’Alep en Syrie, l’une des plus anciennes cités au monde toujours habitées, rejoint la liste. En 1915, Rosa Luxemburg, qui défiait la vague de nationalisme qui submergeait alors l’Allemagne au début de la guerre, reconnaissait que ce conflit ravageant toute l’Europe avait ouvert une nouvelle époque de l’histoire du capitalisme, une époque où l’impitoyable compétition bâtie par ce système plaçait l’humanité devant le choix : socialisme ou barbarie. Cette guerre, écrivait-elle, avec ses massacres d’êtres humains à une échelle industrielle, était une claire illustration de ce que signifie réellement la barbarie. Mais la Première Guerre mondiale n’était que le début et la barbarie du capitalisme a rapidement atteint de nouveaux sommets. Cette guerre a pris fin grâce à la résistance de la classe ouvrière en Russie, en Allemagne et ailleurs, du fait de mutineries, de grèves et d’insurrections qui, un court moment, ont véritablement menacé l’existence de l’ordre mondial capitaliste. Mais ces mouvements ont été isolés et vaincus ; et avec la défaite de la classe ouvrière, qui est le seul véritable obstacle aux menées guerrières du capitalisme, les horreurs des conflits impérialistes ont pris une nouvelle dimension. La première guerre impérialiste était encore, à l’instar des guerres du xixe siècle, un conflit de champs de bataille. L’échelle de la tuerie, proportionnellement à l’étourdissant développement technologique des décennies qui ont mené à la guerre, fut un choc même pour les politiciens et les chefs militaires qui avaient tablé sur un conflit court, décisif, “terminé pour Noël”. Toutefois, dans les guerres qui ont suivi, les principales victimes n’étaient plus les soldats en uniforme, mais les populations civiles. Le bombardement par les aviations allemande et italienne de la ville de Guernica en Espagne, événement immortalisé par Picasso et ses figures torturées de femmes et d’enfants, donne le ton. Au début, le fait de cibler délibérément des civils depuis les airs fut un nouveau choc, quelque chose qui n’avait pas de précédent, un acte que seuls les régimes nazis ou fascistes d’Hitler et Mussolini pouvaient perpétrer. Mais la Guerre d’Espagne ne fut que le prodrome d’une Seconde Guerre mondiale qui a triplé le nombre de morts de la Première et dont l’immense majorité des victimes furent des civils. Les deux camps ont utilisé la tactique du “tapis de bombes” pour écraser des villes, détruire les infrastructures, démoraliser la population et, du fait que la bourgeoisie avait toujours peur d’un possible soulèvement de la classe ouvrière contre la guerre, pour éliminer tout danger prolétarien. De plus en plus, de telles tactiques n’ont plus été dénoncées comme des crimes, mais soutenues comme le meilleur moyen de mettre fin au conflit et d’empêcher de nouveaux massacres et ce avant tout par le camp démocratique. L’incinération d’Hiroshima et de Nagasaki par la toute nouvelle bombe atomique fut justifiée exactement dans ces termes.
Aujourd’hui, lorsque les dirigeants du monde démocratique condamnent le régime d’Assad en Syrie et son allié russe pour leur implacable et systématique massacre de la population civile d’Alep et d’autres villes, nous ne devons pas oublier qu’ils sont porteurs de ce qui est maintenant devenu une tradition établie de la guerre capitaliste. La destruction délibérée d’hôpitaux et d’autres infrastructures-clé comme le système de distribution d’eau, le blocage et même le bombardement de convois d’aide : tout cela fait partie de la guerre de siège moderne, ce sont des tactiques militaires apprises non seulement de la précédente génération de “dictateurs”, mais aussi de démocrates militaristes comme “Bomber” Harris 1 et Winston Churchill.
Les intérêts impérialistes attisent les flammes en Syrie
Cela ne veut pas dire que ce qui se passe à Alep n’a rien d’exceptionnel. La “guerre civile” en Syrie a commencé en 2011 comme une expression des “printemps arabes”, par la révolte d’une population excédée par la brutalité du régime Assad. Mais Assad a appris de la chute de ses collègues dictateurs en Égypte et en Tunisie et il a répondu par une meurtrière puissance de feu aux manifestations. La détermination du régime à survivre et à perpétuer ses privilèges s’est montrée sans bornes. Pour rester au pouvoir, Assad s’est montré prêt à dévaster des villes entières, à assassiner ou expulser des millions de ses propres citoyens. Il y a là un élément de la vengeance du tyran contre tous ceux qui ont osé rejeter sa férule, un plongeon dans une spirale de destructions qui ne laissera rien ou pratiquement rien à diriger. En ce sens, le calcul froidement rationnel derrière les bombardements de terreur des cités syriennes “rebelles” est devenu un nouveau symbole de l’irrationalité grandissante de la guerre capitaliste. Mais la folie de cette guerre ne se limite pas à la Syrie. Faisant suite à l’assassinat massif de manifestants désarmés, des défections dans l’armée syrienne ont donné naissance à une opposition armée bourgeoise, ce qui a rapidement transformé la révolte initiale en un conflit militaire entre camps capitalistes ; cela a permis à un certain nombre de forces impérialistes locales ou plus globales d’intervenir pour leurs propres intérêts sordides. Les divisions ethniques et religieuses qui ont aggravé le conflit en Syrie ont été exploitées par les puissances régionales pour leurs propres desseins. L’Iran, qui se targue d’être le leader mondial des musulmans chiites, soutient Assad et son régime “alaouite” et mène directement une intervention militaire par l’intermédiaire des milices du Hezbollah libanais. Les États musulmans sunnites comme l’Arabie saoudite et le Qatar ont armé les nombreux gangs islamistes qui cherchent à supplanter les rebelles “modérés”, y compris l’État islamique. La Turquie, souvent sous le prétexte d’éliminer l’État islamique, a utilisé ce conflit pour intensifier son affrontement avec les forces kurdes qui ont considérablement progressé dans le nord de la Syrie. Mais dans ce conflit où s’affrontent trois, quatre, peut-être même cinq camps différents, les principales puissances du monde ont elles aussi joué leur rôle. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont appelé Assad à se démettre et ont directement soutenu l’opposition armée au régime, autant les “modérés” que les islamistes, par Arabie saoudite et Qatar interposés. Lorsque l’EI, comme Al Qaïda avant lui, a commencé à mordre la main qui le nourrissait et s’est imposé comme une force nouvelle et incontrôlable en Syrie et en Irak, nombre de politiciens occidentaux ont reconsidéré leur position, avançant qu’Assad est aujourd’hui un “moindre mal” par rapport à l’EI. Obama a menacé le régime Assad d’une intervention militaire en déclarant que l’utilisation d’armes chimiques contre des civils était une ligne rouge à ne pas franchir. Cette menace s’est révélée creuse et, conséquemment, Washington et Westminster ont débattu de comment intervenir contre l’EI sans indirectement remettre Assad en selle. La réponse de Washington, pour indécise qu’elle soit, n’est que le résultat d’un long processus de déclin de l’hégémonie américaine dans le monde, résumée avant tout par les désastreuses interventions en Afghanistan et en Irak provoquées par les attaques terroristes du 11 septembre 2001 à Washington et New York. La “guerre contre le terrorisme”, déchaînée par l’administration Bush, n’a abouti qu’à provoquer le chaos au Proche-Orient, en faisant du terrorisme islamiste une force plus importante qu’elle ne l’avait jamais été avant l’effondrement des Tours jumelles. La guerre en Irak s’est révélée être particulièrement impopulaire aux États-Unis et même le va-t-en-guerre Donald Trump explique aujourd’hui qu’elle a été un désastre. Les États-Unis sont aujourd’hui plus que réticents à se laisser entraîner dans un nouveau bourbier au Proche-Orient.
L’impérialisme ayant horreur du vide, les hésitations des États-Unis ont permis la résurrection de la Russie en lui offrant une chance de réaffirmer sa présence dans une région dont elle avait été largement expulsée à la fin de la guerre froide. La Syrie est le dernier endroit du Proche-Orient où la Russie peut s’accrocher à travers ses bases militaires, et son soutien au régime Assad a été permanent. Mais après s’être embarquée dans une politique de récupération de son empire perdu dans la région de l’ex-URSS (via la guerre en Géorgie et en Ukraine), la Russie de Poutine joue maintenant à accroître son statut de puissance mondiale en intervenant directement dans le conflit syrien. Le prétexte initial était la volonté de riposter face à l’EI qui gagnait du terrain en Irak et en Syrie, menaçant même la seule implantation permanente de la Russie en Méditerranée, la base navale de Tartous. Dans la mesure où elle était posée comme une réponse à l’EI, l’intervention russe était relativement soutenue par les États-Unis. À la suite des atrocités commises par l’EI à Paris, la France était même prête à mener des opérations conjointes avec les forces russes en Syrie. Mais l’impérialisme russe a montré fort peu d’intérêt à attaquer les bases de l’EI et beaucoup plus d’intérêt à raffermir le régime d’Assad qui donnait de sérieux signes d’effondrement. En appelant terroristes tous les opposants à Assad, il est devenu une force majeure de l’assaut menée par Assad contre les bastions rebelles, retournant le cours de la guerre en sa faveur. La réponse de l’impérialisme russe dans le conflit en Syrie est la plus simple qui soit, entièrement en accord avec les méthodes d’Assad, déjà appliquées à Grozny en 1999-2000 en réponse au mouvement nationaliste tchétchène : réduire les villes en cendres et le problème de la rébellion est réglé. L’impérialisme russe ne fait pas mystère de ses ambitions au Proche-Orient. “Tout au long du week-end qui marquait le premier anniversaire de l’intervention russe en Syrie, les médias d’État étaient remplis d’audacieuses déclarations telles que : “la Russie a prouvé qu’elle reste incontestablement une superpuissance”, ou : “la Russie est devenue le principal acteur dans cette région… tandis que les États-Unis ont perdu leur statut de premier violon”” . L’assaut sur Alep, qui a atteint de nouveaux degrés tout de suite après l’échec du cessez-le-feu négocié par les États-Unis, a visiblement aiguisé les tensions entre les bourgeoisies russe et américaine.
Réagissant à l’accusation d’avoir commis des crimes de guerre en Syrie (ce qui est indubitablement vrai), la Russie s’est retirée des négociations de paix sur la Syrie, ainsi que de tout processus visant à réduire les stocks américains et russes de plutonium, Poutine conditionnant la reprise des pourparlers aux conditions les plus irréalistes, comprenant la fin des sanctions contre la Russie et une réduction substantielle des troupes de l’OTAN concentrées en Europe de l’Est.
Hypocrisie à l’Ouest
Face à cette politique de plus en plus brutale du régime de Poutine, en Russie comme vis-à-vis de l’extérieur, avec son idéologie nationaliste réactionnaire, sa propagande ouvertement mensongère, il n’a pas été bien compliqué pour les puissances démocratiques occidentales de prendre une posture “moralement élevée”. Mais nous avons déjà vu que l’utilisation par la Russie des bombardements de terreur en Syrie possède déjà une longue histoire à l’Ouest. Et l’hypocrisie des États démocratiques s’applique toujours à leur récent comportement 2. La condamnation de la Russie par les États-Unis pour la destruction d’Alep et d’autres villes ne peut effacer le souvenir des bombardements de Bagdad en 2003 ou le siège de Falloujah en 2004, qui ont mené des milliers de civils irakiens à la mort, quand bien même les missiles américains sont supposés être “plus précis” que leurs équivalents russes et donc n’avoir visé que des cibles purement militaires. Cela ne masque pas non plus ce que la Grande-Bretagne a fait au Yémen, où elle a fourni aux Saoudiens les armes permettant d’intervenir dans cette sanglante “guerre civile”. Un récent article du Guardian a révélé que plus d’un million d’enfants yéménites sont menacés par la famine, conséquence directe du blocus saoudien et des bombardements visant les zones tenues par les rebelles houtistes. Mais l’hypocrisie occidentale a atteint son sommet avec les millions de Syriens qui ont été contraints de s’enfuir pour sauver leurs vies et qui aujourd’hui souffrent de malnutrition sévère dans des camps de réfugiés sous-équipés en Turquie, en Jordanie ou au Liban ; ou bien, s’ils essaient de rejoindre un “havre de paix” en Europe de l’Ouest, ils tombent aux mains d’impitoyables trafiquants d’hommes qui les poussent à traverser la Méditerranée au péril de leur vie sur des rafiots incapables de naviguer. L’Union européenne s’est montrée incapable de s’occuper correctement de ce que Cameron lui-même a qualifié d’“essaim” de réfugiés venus de Syrie ou d’autres conflits du Proche-Orient ou d’Afrique. Et tandis que certains gouvernements, comme celui d’Allemagne, brandissaient leur “politique de bienvenue” à ceux qu’ils espèrent bien pouvoir exploiter comme main-d’œuvre, murs et barbelés se déploient dans toute l’Europe. De plus en plus de gouvernements et de partis européens s’adaptent ou adoptent carrément une politique d’exclusion ou de bouc-émissaire ouvertement mise en avant par les courants politiques populistes. Nous assistons aujourd’hui aux sinistres échos des massacres de juifs des années 1930 et 1940, lorsque les démocraties se lavaient les mains des persécutions et des assassinats nazis, et faisaient en même temps tout pour fermer leurs frontières aux victimes tout en n’accueillant qu’un nombre symbolique de réfugiés juifs 3. Double langage et hypocrisie sur la Syrie ne se limitent pas aux partis de gouvernement. La majorité des partis “de gauche” a une longue histoire de soutien à la Russie, à l’Iran, au Hezbollah et au régime baasiste en Syrie, dont ils disent pour se justifier qu’ils “combattent l’impérialisme”, ce qui signifie évidemment pour eux uniquement les impérialismes américain, israélien ou d’autres pays occidentaux. La coalition “Stop the war” en Angleterre, par exemple (dans laquelle Jeremy Corbyn a joué plusieurs années un rôle dirigeant) va organiser des manifestations massives contre l’incursion militaire israélienne au Liban et à Gaza, avec des slogans comme “Nous sommes tous le Hezbollah”. On ne verra jamais ces gens organiser des manifestations équivalentes pour dénoncer les actions d’Assad ou de la Russie en Syrie, lesquelles ne sont pas qu’un miroir de ce qu’a fait le militarisme israélien, mais l’a surpassé de beaucoup en nombre de tués et en destructions. D’autres organisations activistes optent pour un soutien aux actions militaires des Américains et de l’Occident. Le groupe Avaaz, qui s’est spécialisé dans des campagnes massives sur Internet et des pétitions, et qui était opposé à l’invasion de l’Irak par les États-Unis, nous dit aujourd’hui que la seule manière de protéger les enfants d’Alep est d’en appeler à Obama, Erdogan, Hollande et May pour renforcer la zone d’exclusion aérienne dans le nord de la Syrie. D’une manière ou d’une autre, on nous demande de soutenir un camp ou un autre dans ce qui est devenu un conflit impérialiste global.
L’alternative prolétarienne
Pour les révolutionnaires, il est essentiel de défendre le principe de l’internationalisme contre toute boucherie impérialiste. Cela signifie conserver une indépendance politique vis-à-vis de tous les États et milices de proto-États, et soutenir la lutte des exploités dans tous les pays contre leur propre bourgeoisie. Ce principe ne dépend aucunement du fait que les exploités se trouvent en lutte ouverte ou pas. C’est un poteau indicateur pour le futur qui ne doit jamais être perdu de vue. En 1914, les internationalistes qui se sont opposés à la guerre n’étaient qu’une toute petite minorité, mais ils ont opiniâtrement défendu les positions de classe alors que tant d’anciens camarades se ralliaient à l’effort de guerre de leur propre bourgeoisie, ce qui fut absolument essentiel à l’émergence d’une lutte prolétarienne massive contre la guerre deux ou trois ans après. En Syrie, il est absolument évident que le prolétariat est absent de la scène. C’est le reflet de la faiblesse numérique et politique de la classe ouvrière syrienne qui a été incapable de se soulever contre le régime Assad et ses différents opposants bourgeois. Mais nous pouvons dire que le sort de la Syrie et du “Printemps arabe” comme un tout résume parfaitement la situation historique à laquelle se confronte la classe ouvrière mondiale. Le capitalisme est dans un état avancé de décadence et n’a pas d’autre futur à offrir à l’humanité que la répression et la guerre. Telle a été la réponse de la classe dominante aux différentes révoltes qui ont balayé l’Afrique du Nord et le Proche-Orient en 2011. Mais cela n’a été possible uniquement parce que la classe ouvrière était incapable de prendre la tête de ces révoltes, incapable de proposer un but et une perspective différents des illusions démocratiques qui dominaient ces mouvements sociaux. Et cela a été un échec non seulement de la classe ouvrière d’Afrique du Nord et du Proche-Orient, mais aussi de la classe ouvrière des pays centraux du capitalisme, laquelle a une tradition révolutionnaire plus profondément ancrée et une plus longue expérience de confrontation avec les obstacles de la démocratie bourgeoise. Ce sont ces bataillons de la classe qui sont les mieux placés pour faire revivre la perspective de la révolution prolétarienne. Ce n’est pas seulement un vœu pieux. Le Printemps arabe a servi d’inspiration aux luttes dans les pays centraux, notamment au mouvement des Indignados en Espagne, mouvement qui a été plus loin en 2011 qu’Occupy et d’autres réactions similaires dans le monde pour poser de sérieuses questions sur le futur du capitalisme tout en s’interrogeant sur les moyens pour lutter contre lui 4. Mais ce ne fut qu’un aperçu du possible, un petit signe que, malgré l’avancée continue de la barbarie capitaliste, l’alternative prolétarienne est toujours vivante.
Amos, 8 septembre 2016
1 Le maréchal qui commandait les forces aériennes anglaises de bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale et à ce titre principal organisateur de la destruction des villes allemandes par la Royal Air Force.
2 Les bombardements aériens meurtriers par les forces de la coalition internationale sur Mossoul au nord de l’Irak et leur recrudescence actuelle sont une autre preuve accablante que cette politique de terreur sur les populations est pratiquée par toutes les puissances.
3 Il ne s’agit pas de dénigrer les efforts sincères des centaines de volontaires qui en Europe ont essayé d’offrir une aide aux réfugiés, ou bien sûr le travail réellement héroïque des médecins, personnels de soin et sauveteurs qui se battent pour sauver des vies dans les plus terribles conditions à Alep ou dans d’autres villes assiégées. Très souvent, ces efforts ont débuté par des initiatives spontanées que les gouvernements et autres forces officielles cherchent très vite à faire passer sous leur propre contrôle.
4 Lire notre article : “Le mouvement du 15 Mai (15-M) cinq ans après [65]”.
Mélenchon, un apôtre du modèle stalinien
- 3823 lectures
“L’idéal inépuisable de l’espérance humaniste, de la révolution”. Ces mots ont été prononcés le 6 mars 2013 par Jean-Luc Mélenchon, à propos du président vénézuélien Hugo Chavez, au lendemain de sa mort. Depuis longtemps, celui qui était à l’époque le coprésident du Parti de gauche manifeste une profonde admiration pour Chavez et ne cache pas son ambition de devenir lui-même cet homme providentiel redonnant espoir aux masses pauvres et tenant tête aux grandes puissances ; et peut-être d’avoir sa statue un jour sur une grande place parisienne… Le discours qu’il prononce ce jour-là avec une émotion réelle, ne peut être plus clair : “Chavez a été la pointe avancée d’un processus large dans l’Amérique latine qui a ouvert un nouveau cycle pour notre siècle, celui de la victoire des révolutions citoyennes. (…) Il n’a pas seulement fait progresser la condition humaine des Vénézuéliens, il a fait progresser d’une manière considérable la démocratie”.
Évidemment quand on voit dans quel état se dépêtre le Venezuela aujourd’hui, on se demande comment on peut faire de ce pays un modèle de “révolution socialiste”. Car le Venezuela “bolivarien” n’est finalement pas loin de cumuler toutes les caractéristiques d’une république bananière, avec une bonne dose de vernis stalinien par dessus !
Pendant les quatorze ans de son “règne”, ponctué par trois élections plus ou moins contestées, Chavez a clamé un bilan exceptionnel, largement relayé par tous les “révolutionnaires” du monde, avec parmi les plus fameux, Mélenchon donc, mais aussi l’ex-président iranien Mahmoud Ahmadinejad. De sacrées références. Ainsi, sous sa présidence, le Venezuela serait passé de pays sous-développé au statut de champion de la croissance, de la lutte contre la pauvreté, de la scolarisation et donc, de la démocratie. Quatrième puissance sud-américaine en terme de PIB par habitant, un revenu par habitant supérieur à la moyenne du sous-continent sud-américain, le Venezuela affiche une espérance de vie au-dessus de 74 ans quand elle peine à dépasser 50 ans dans les pays sous-développés.
Seule petite ombre au tableau : la criminalité n’aura cessé d’augmenter de l’arrivée de Chavez au pouvoir jusqu’à sa mort, faisant de Caracas la ville la plus dangereuse du monde avec 122 homicides pour 100 000 habitants en 2012. Avec 4 850 000 habitants recensés, cela fait donc plus de 5900 personnes tuées par homicide en une seule année, dans une seule ville !
Mais ce bilan “honorable” repose uniquement sur la rente pétrolière. Le Venezuela est en effet le onzième producteur au monde et fondateur de l’OPEP. Le pétrole et le gaz naturel représentent 95 % des exportations du pays. Le Venezuela ne produit rien d’autre. Il tire ses revenus de ses seuls hydrocarbures et doit importer tout le reste. Chavez a su sans aucun doute profiter de cette manne à l’heure où les cours du pétrole se sont littéralement envolés tout au long de ses trois mandats. Quand il arrive au pouvoir en 1999, le baril de Brent est à $ 12,76. A sa mort en 2013, il est à $ 108,56. Près de neuf fois plus. En bon père du peuple, il n’oublie pas d’en faire profiter une partie de sa clientèle, acquise à sa cause depuis qu’il a exalté dans ses discours enflammés la ferveur nationaliste à travers l’érection de Simon Bolivar en héros national (c’est lui, la huitième étoile rajoutée en 2006 au drapeau national) et résumé son programme et ses actions par deux mots lourds de signification : “révolution socialiste”.
Mais la France, c’est bien connu, n’a pas de pétrole. Et quant aux idées, ce ne sont pas celles que Mélenchon emprunterait à Chavez qui vont “révolutionner” quoi que ce soit. Il suffit de voir ce qui se passe au Venezuela quand le cours du pétrole repasse sous la barre des 50 dollars et qu’il ne reste donc que les idées pour continuer le projet “socialiste” du défunt Chavez. Faute de devises suffisantes, le pays ne peut en effet plus importer d’aliments et de médicaments. La pénurie est dramatique et permanente, près de 80 % des produits de base manquent. Les queues s’allongent devant les magasins vides et les moyens manquent pour soigner les malades. Les barrios de Caracas, qui accueillent 60 % de la population de la ville, voient leurs conditions de vie s’aggraver chaque jour. La voilà donc, cette “révolution socialiste”, quand les caisses se vident de leurs pétrodollars.
Il ne reste même plus à Mélenchon le loisir de vanter la “vraie” démocratie du Venezuela en prenant pour exemple la possibilité de renverser un président par un référendum d’initiative populaire. Car c’est très exactement ce qui est en train de se passer. Le désespoir et la colère des affamés sont désormais récupérés par une opposition, majoritaire au parlement depuis 2015, qui souhaite en profiter pour destituer le successeur de Chavez, Maduro, qui poursuit le même programme sans avoir hérité du charisme de son maître... ni du cours du Brent à plus de 100 dollars.
Mais en bon président “socialiste” attaché à la démocratie, Maduro use de tous les stratagèmes pour contrer son opposition : rejet des signatures par une commission toute acquise au pouvoir présidentiel, purge des fonctionnaires convaincus d’avoir apporté leur signature, menaces de sanctions contre les grévistes, etc.
Le modèle vénézuélien a décidément peu de choses à présenter pour soulever l’enthousiasme des prolétaires du monde entier. Tout au plus peut-il, à l’heure de la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis, servir de dernière illustration vivante (mais moribonde) de la variante stalinienne du capitalisme d’État qui a largement contribué depuis près d’un siècle à asservir la classe ouvrière et à enfoncer la planète dans le chaos de la misère et de la guerre. Ce grand mensonge du xxe siècle doit toujours être dénoncé.
Jules, 26 octobre 2016
Personnages:
- Jean-Luc Mélenchon [67]
Rubrique:
Gabon : “L’émirat tropical”, expression de l’enfoncement de l’Afrique dans le chaos
- 1339 lectures
L’élection présidentielle gabonaise du 27 août dernier n’a pas dérogé à une longue tradition sanguinaire. Alors qu’Ali Bongo, comme naguère son père pendant 40 ans, se proclamait vainqueur d’un scrutin truqué, des émeutes prenant l’allure d’une guerre civile éclataient dans tout le pays, aussitôt réprimées par la police et l’armée. Une grande partie des masses pauvres, utilisée comme chair à canon, excitée pour cela et instrumentalisée par la clique de Jean Ping, adversaire de Bongo, a une nouvelle fois chèrement payé le prix de ce règlement de comptes entre des fractions bourgeoises en lutte pour le contrôle de l’État et son système de corruption généralisée. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les chiffres sont encore incertains et manipulés de toutes parts, mais plusieurs sources font état de cinq à sept morts et plus de 1100 arrestations !
À la différence de l’élection de 1990, où l’armée française vint directement réprimer les émeutiers pour sauver le trône vacillant de son pion Omar Bongo, et celle de 2009 où “l’héritier” bénéficia du soutien actif de son “ami” Sarkozy 1, les récents troubles politiques s’inscrivent dans un contexte bien plus délicat pour l’impérialisme français du fait d’une aggravation internationale de la crise économique et l’expansion d’un chaos impérialiste incontrôlable en Afrique.
Une population victime de la crise économique et des règlements de comptes entre cliques bourgeoises
Depuis l’indépendance du Gabon en 1960, l’économie du pays repose presque uniquement sur l’exploitation de son riche sol par des entreprises essentiellement françaises : bois précieux, uranium et surtout pétrole, secteur représentant pas moins de 40 % des recettes de l’État, sont les principales sources de richesse du pays. En dépit de la promesse faite par Ali Bongo, après le décès de son père en 2009, de mettre fin au pillage systématique des deniers publics, l’élite au pouvoir (au premier rang de laquelle se trouve la large famille Bongo elle-même, maîtresses présidentielles incluses 2), a continué à s’enrichir sans vergogne en captant une très large partie des ressources de l’État. Ali Bongo a ainsi hérité de son père, sans rien y changer, d’un système très sophistiqué de corruption et de redistribution officieuse au moyen d’enveloppes soigneusement réparties entre les ethnies, les régions et les nécessités de maintien de la paix sociale.
Mais cette corruption massive a toujours empêché l’État d’opérer une mutation de l’économie pour limiter sa dépendance aux matières premières. La diminution des stocks de pétrole gabonais et la chute du prix du baril à partir de 2014 ont approfondi les effets de la crise économique mondiale, obligeant État et entreprises à limiter leurs investissements. La population, vivant dans des conditions déjà difficiles, a subi de plein fouet l’explosion du chômage, notamment à Port-Gentil, capitale économique du pays, où la colère contre la clique de Bongo est immense. Depuis le début de l’année, les manifestations s’y sont multipliées. À la violence sociale s’est ainsi ajoutée celle d’une police particulièrement brutale et expéditive.
Ce contexte explique l’ampleur de la mobilisation des partisans de Jean Ping. Toute cette exaspération accumulée, Jean Ping a su la canaliser à son seul profit vers l’impasse démocratique. En réalité, l’opposition à Ali Bongo n’est rien d’autre qu’une clique issue du régime Bongo lui-même et ses largesses ; elle n’a pas d’autre objectif que renverser le pouvoir en place et s’approprier les opaques rentes pétrolières ! Le parcours de Jean Ping est à ce titre très significatif. Le prétendu pourfendeur de la corruption d’État est un pur produit de la dynastie Bongo ; il fut ministre pendant 20 ans ( !), profitant de son mariage avec la sœur aînée de l’actuel président (elle-même ancien membre du gouvernement). De sa toute aussi longue carrière de diplomate, Jean Ping a d’ailleurs tiré une importante leçon : l’élection se joue pour l’essentiel... à Paris. Il a ainsi multiplié les démarches auprès du gouvernement français avant l’élection, espérant son soutien par la promesse de chasser la “légion étrangère de nouveaux collaborateurs entourant le chef de l’État” 3, c’est-à-dire les entrepreneurs américains, chinois ou africains dont s’entoure Ali Bongo pour tenter de s’affranchir de la tutelle française. Comme partout ailleurs, la classe ouvrière habitant le Gabon n’a donc strictement rien à attendre de ce pathétique cirque électoral. Bien au contraire ! Les hommes tombés sous les balles des forces de répression, emportés par une indignation légitime et des espoirs parfaitement illusoires dans l’alternance politique, sont morts au seul bénéfice d’une bande tout aussi corrompue que celle au pouvoir, une clique prête à instrumentaliser une foule en colère et à lui faire verser son sang pour goûter elle aussi à l’ivresse du pouvoir, aux voitures de luxe et aux hôtels particuliers parisiens 4 !
Une “Françafrique” moribonde et incapable d’enrayer le développement du chaos en Afrique
Alors que l’influence française sur ses anciennes colonies se réduit depuis plusieurs décennies à peau de chagrin, le Gabon a fait figure d’élève exemplaire de la “Françafrique” jusqu’aux années 2010. Dès les années 1960, Jacques Foccart, le “Monsieur Afrique” du gaullisme, avait fait de l’ancienne province d’Afrique-Équatoriale française la pierre angulaire de la politique française sur le continent, en s’appuyant sur des barbouzes telles que le sulfureux Bob Denard qui fut “instructeur” de la garde présidentielle d’Omar Bongo. Si l’implantation d’entreprises hexagonales au cœur de l’appareil productif gabonais est aujourd’hui encore une réalité confirmée par la présence de 14 000 ressortissants français, les liens qui unissent les deux pays dépassaient largement la seule sphère économique. Les affaires louches (scandales autour d’Elf-Aquitaine ou dans l’immobilier, etc.) sont de notoriété publique mais le principal intérêt du Gabon pour l’État français résidait dans la place qu’il occupe encore aujourd’hui au cœur de son dispositif impérialiste. En plus de la base militaire stratégique que la France occupe à Libreville, le Gabon est lui-même un facteur de relative stabilité dans la région. Il est intervenu, par exemple, lors de la crise ivoirienne de 2010 ou, plus récemment, en Centrafrique.
La montée en puissance du “chacun pour soi” dans le monde, suite à la disparition des blocs issus de la guerre froide, a rapidement entamé le crédit de la France en tant que “gendarme de l’Afrique”, comme en témoigne un mémo diplomatique révélé par Wikileaks : “Les Français accueillent favorablement l’extension de la présence américaine en Afrique comme moyen de contrebalancer l’expansion régionale de la Chine” 5.
Dans ce véritable panier de crabes impérialistes, où petites et grandes puissances s’enfoncent dans une spirale meurtrière sans fin, la situation est devenue hors de tout contrôle : des régions entières sont soumises à la loi des seigneurs de guerre et de bandes mafieuses, de nombreux États sont très affaiblis au point que certains ont carrément perdu le contrôle d’une partie de leur pays, les conflits s’enlisent sous l’œil avide des grands charognards impérialistes... Bien que le Gabon soit encore loin de connaître le niveau d’instabilité du Centrafrique ou du nord du Mali, le pays n’échappe pas aux forces centrifuges du capitalisme et à la logique du tous contre tous.
C’est dans ce contexte qu’Ali Bongo cherche aujourd’hui à jouer plus ouvertement sa propre carte, au détriment de l’ex-puissance coloniale. Il a ainsi facilité l’implantation d’entreprises étrangères, notamment issues des pays asiatiques comme la Chine et la Corée, afin de limiter l’influence française sur le pays. Il s’est même payé le luxe d’une vaine tentative de redressement fiscal contre Total, le géant français du pétrole dans le pays depuis 1956.
Cette crispation dans les relations franco-gabonaises s’est encore accentuée avec l’arrivée au pouvoir du parti socialiste en 2012. Omar Bongo était un fidèle produit du gaullisme. Il a financièrement soutenu de Gaulle et ses héritiers, notamment par l’entremise de réseaux mafieux et l’envoi de “mallettes” au profit du parti gaulliste. D’après plusieurs sources, de l’argent aurait même continué à circuler au profit de Nicolas Sarkozy 6.
En dépit des fortes tensions entre le Parti socialiste et Ali Bongo 7, le gouvernement français s’est montré hésitant, voire impuissant face à la situation politique au Gabon. La France y possède encore d’importants intérêts économiques et militaires qu’il ne s’agirait pas de menacer. Prise dans ses propres contradictions, la bourgeoisie française s’est montrée incapable de défendre une orientation cohérente, encore moins de s’imposer en garant de la stabilité de la région.
Toutes les conditions sont donc réunies pour que le tourbillon du chaos mondial et africain ébranle la stabilité d’un des pays les plus puissants du continent, et de l’ensemble de la région. Le récent appel à la “résistance active” de Jean Ping ne va certainement pas enrayer l’impasse dans laquelle s’enfonce le Gabon, pas plus que le prétendu “dialogue” prôné par la bande de requins impérialistes nommée “communauté internationale”.
L’Afrique nous montre une nouvelle fois le chemin dans lequel nous conduit le capitalisme décadent, celui de la barbarie !
E.-G., 16 octobre 2016
1 Cf. “Au Gabon, une élection pour préserver les intérêts de la Françafrique [69]”, RI no 405 (octobre 2009)
2 Les innombrables maîtresses de l’élite étatique constituent un réseau à la fois significatif de la dépravation de la classe dirigeante et central dans le dispositif politique. À titre d’exemple, Marie-Madeleine Mborantsuo, ancienne maîtresse d’Omar Bongo, occupe le poste stratégique de présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise, notamment chargée d’assurer la validité des élections...
3 “Gabon : les électeurs votent pour une présidentielle sous haute tension”, Le Figaro, 26 août 2016.
4 La famille Bongo est actuellement poursuivie par la justice française dans le cadre d’enquêtes sur des “biens mal acquis” suite à l’acquisition frauduleuse de plusieurs résidences et de voitures de luxe. La dimension politique de ces mesures, dans le cadre de tensions croissantes entre le gouvernement français et Ali Bongo, ne fait aucun doute.
5 Cité par Le Monde du 4 décembre 2010 : “Wikileaks : le reflux de la France en Afrique”.
6 Voir par exemple l’ouvrage de Xavier Harel : Le scandale des biens mal acquis.
7 Plusieurs propriétés ont été récemment saisies à Paris dans le cadre de l’affaire des “biens mal acquis”. Par ailleurs, d’après l’ouvrage de Frédéric Ploquin, Les gangsters et la République, Manuel Valls, l’actuel Premier ministre français, aurait tenté de faire tomber Bernard Squarcini, ancien directeur du renseignement de Nicolas Sarkozy et le mafieux Michel Tomi, tous deux soupçonnés de servir d’intermédiaires entre Libreville et l’UMP.
Personnages:
Rubrique:
Le Front national, une fronde réactionnaire liée à la décomposition de la société
- 955 lectures
Il fut un temps où le Front national en France, avec à sa tête Jean-Marie Le Pen, agglomérait un public hétéroclite, quelque peu marginal, souvent nostalgique d’une époque révolue, comme d’anciens combattants de l’Algérie française, et une frange de jeunes et moins jeunes, anti-staliniens primaires, prêts à en découdre avec le moindre gauchiste ou démocrate patenté. Les meetings du FN étaient l’occasion pour Le Pen de haranguer quelques centaines de commerçants ou artisans radicaux, des petits bourgeois étudiants encadrés par quelques jeunes nazillons au crâne rasé et rangers de circonstance qui n’hésitaient pas à tendre le bras à la mode hitlérienne pour saluer les discours du “borgne”.
La petite foule de paumés des meetings frontistes a aujourd’hui laissé place à des milliers de personnes, toutes plus convenables et honnêtes les unes que les autres, venant en partie du milieu ouvrier, en famille parfois. Plus grand-chose à voir avec le public outrancier d’hier. Entre-temps, le FN est devenu le premier parti de France sur le plan électoral. Arrivé en tête de plusieurs élections intermédiaires, le parti de Marine Le Pen préoccupe aujourd’hui grandement la bourgeoisie française, cette dernière tenant pour acquis que l’extrême-droite accédera très probablement au second tour de la prochaine élection présidentielle avec un score historique.
Le FN propage une idéologie irrationnelle et immorale
La montée en puissance du populisme, loin d’être une exception française, se nourrit des tendances les plus décomposées d’une société capitaliste empêtrée dans une crise généralisée et face à laquelle le prolétariat est pour le moment incapable de défendre une perspective révolutionnaire. De cette situation de blocage historique de la société, les tréfonds de la morale bourgeoise s’épanouissent à la lumière crue des idéologies les plus réactionnaires, haineuses et revanchardes. Marine Le Pen s’est certes affranchie des excès du père (quoique !), a lissé son discours en faisant un plaidoyer pour les laissés-pour-compte de la crise et du chômage. Elle s’est fait une image plus vertueuse et plus intègre et n’a pas de mots assez durs contre les politiciens de droite et de gauche qui se sont succédés au pouvoir pour faire payer la crise aux plus faibles. Mais la marque de fabrique de ce Parti reste pourtant la même : la xénophobie à tous crins, le racisme maintenant presque ordinaire, les réponses simplistes et démagogiques. “On est chez nous !”, entend-on désormais sans complexe dans certaines manifestations ouvertement xénophobes, amplifiées par les récents actes terroristes islamistes ou la délinquance ordinaire dans les cités gangrenées par la drogue et le désœuvrement.
Si le FN a subjugué ces “citoyens intègres”, tous écœurés de l’incapacité de l’État depuis des années à résoudre les problèmes de leur quotidien, exaspérés de voir les promesses de droite ou de gauche “trahies” par une classe politique de plus en plus corrompue, il l’a fait sur la base d’un discours ignoble selon lequel la survie de certains doit se faire aux dépens des autres : l’intérêt national avant tout, les étrangers peuvent bien crever chez eux ! Cette conception du monde “naturellement” divisé en nations concurrentes est profondément ancrée dans l’idéologie bourgeoise, mais le fait de revendiquer cela en se débarrassant sans aucun complexe de toute l’hypocrisie humaniste qui a longtemps édulcoré le nationalisme et le militarisme représente un pas significatif dans le processus de dissolution de la société : la barbarie en bandoulière, l’immoralité en étendard !
Le FN inquiète le reste de la bourgeoisie française
Cette possibilité de voir arriver le FN au pouvoir inquiète beaucoup l’ensemble de la bourgeoisie, tant son programme économique, social et politique demeure inadapté et irresponsable du point de vue des intérêts du capital national. Mais la classe dominante est loin d’être homogène face au phénomène :
• une partie de la grande bourgeoisie tente de “surfer sur la vague” du populisme, d’abord parce qu’elle pense pouvoir juguler sa montée en puissance en adoptant son discours. Nicolas Sarkozy a ainsi théorisé dès 2007 l’idée de “siphonner les voix du FN”. Mais cette “droite décomplexée” est aussi prête à tout pour défendre ses intérêts de clique en se souciant de moins en moins des intérêts généraux de l’État. En adoptant l’argumentaire du FN, elle a néanmoins normalisé et rendu “acceptable” un discours xénophobe auprès d’électeurs qui, préférant l’original à la copie, ont fini par renforcer le FN.
• Une autre partie de la bourgeoisie plus lucide ou consciente du danger, comme Alain Juppé ou le Parti socialiste, a préféré garder ses distances et maintenir les principes de l’“idéal républicain” démocratique et européen, à leurs yeux seuls garants d’une politique économique et sociale cohérente face à la crise et aux risques sociaux.
Mais cette défense de l’État les désigne aussi comme ceux par qui le mal arrive, “l’establishment” qui désire poursuivre comme avant et qui méprise “le peuple”. En effet, si le soutien d’une partie de la classe ouvrière au FN est si fort, c’est qu’à ses yeux la classe politique, de gauche et de droite, ayant tenu les rênes du pouvoir depuis tant et tant d’années, s’est décrédibilisée profondément. Ces partis ont assumé la désindustrialisation, le chômage, les attaques depuis près de 40 ans. C’est donc cet “establishment” qu’il faut en priorité rejeter par les urnes et mener au pouvoir les grandes gueules qui disent vouloir “donner un grand coup de balai”.
Pour la bourgeoisie et l’État, quelles que soient les orientations adoptées, la réponse au populisme n’aura pas l’effet escompté. C’est une dynamique de fond qui ne peut que se poursuivre sur le terrain de la décomposition sociale. Surtout, le populisme est un poison qui aggrave les difficultés politiques de la classe ouvrière, en pourrissant la conscience des plus fragilisés sur le terrain de la xénophobie, mais aussi en renforçant le piège démocratiste au nom de la défense des “valeurs républicaines” contre le “fascisme”.
Quelles sont les causes profondes du développement du populiste dans le monde ? Vers quoi mène-t-il ? Quelle différence et ressemblance avec le fascisme des années 1930 ? Quelle force dans la société peut endiguer ce phénomène ? C’est à toutes ces questions légitimes que plusieurs articles de ce numéro de RI tentent de répondre.
Stopio, 28 octobre, 2015
Situations territoriales:
Personnages:
- Marine Le Pen [35]
Rubrique:
Indignados - Espagne : le mouvement du 15 Mai cinq ans après
- 2117 lectures
Lorsqu’on pose des questions à un lycéen sur la Révolution russe de 1917, il répondra sans doute qu’il s’agissait d’un coup d’État bolchevique, que l’expérience, malgré les bonnes intentions des protagonistes, a fini en cauchemar : la dictature soviétique, le goulag, etc.
Et si on lui demande ensuite ce qui est arrivé le 15 mai 2011, il est possible qu’il réponde qu’il s’agit-là d’un mouvement pour une “démocratie véritable” et qu’il est très lié au parti politique Podemos 1.
Quiconque recherche la vérité ne se contentera pas de ces réponses simplistes qui n’ont rien à voir avec ce qui s’est réellement passé, imprégnées du “bon sens commun”, de l’enseignement déformé qu’on subit et du matraquage des “moyens de communications”, bref, de l’idéologie dominante de cette société.
Il est vrai que le prolétariat se trouve actuellement dans une situation de profonde faiblesse. Mais l’histoire de la société est celle de la lutte des classes et l’État capitaliste sait parfaitement que le prolétariat pourrait reprendre sa lutte. C’est pour cela qu’il l’attaque sur ses flancs les plus sensibles : l’un de ceux-ci est sa mémoire historique. La bourgeoisie a un très grand intérêt à détruire cette mémoire en réécrivant les expériences passées de notre classe. C’est comme si elle formatait un disque dur en y installant un système opérationnel radicalement opposé.
La réécriture la plus intelligente est celle qui se fait en tirant profit des faiblesses réelles et des erreurs des mouvements prolétariens. Ceux-ci traînent toujours un important magma d’erreurs qui permettront a posteriori leur réécriture dans un sens diamétralement opposé à ce qu’ils recherchaient.
Marx, en commentant la différence entre la lutte de la bourgeoisie et celle du prolétariat, met en avant le fait qu’alors que “les révolutions bourgeoises, comme celles du xviiie siècle, se précipitent rapidement de succès en succès, (…) les révolutions prolétariennes, par contre, comme celles du xixe siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà être accompli pour le recommencer à nouveau, raillent impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de leurs premières tentatives, paraissent n’abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre et de se redresser à nouveau formidable en face d’elles, reculent constamment à nouveau devant l’immensité infinie de leurs propres buts” 2.
C’est ainsi que, pour le prolétariat, “le chemin pénible de sa libération n’est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d’erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l’atteindra s’il sait s’instruire de ses propres erreurs. Pour le mouvement prolétarien, l’autocritique, une autocritique sans merci, cruelle, allant jusqu’au fond des choses, c’est l’air, la lumière sans lesquels il ne peut vivre” 3. Il ne s’agit pas dans cet article de faire une analyse critique de la révolution de 1917 4. Nous n’allons faire qu’un petit récapitulatif du mouvement des Indignés de 2011, le 15-M 5. Cette réécriture, se basant surtout sur ses difficultés et ses aspects les plus faibles, nous allons commencer par ceux-ci.
2003-2011, les nouvelles générations prolétariennes entrent en lutte
Après la longue nuit de la contre-révolution qui écrasa la révolution de 1917, le prolétariat reprit sa lutte en 1968. Mais cette renaissance ne parvint pas à se politiser dans un sens révolutionnaire. En 1989, la chute des régimes prétendument “communistes” entraînait un recul important dans la conscience et la combativité dont les effets sont toujours présents aujourd’hui 6.
A partir de 2003, les luttes reprirent de l’élan, mais elles concernaient surtout les nouvelles générations de la classe ouvrière (étudiants, chômeurs, précaires), alors que les travailleurs des grands centres industriels restaient passifs et que leurs luttes demeuraient sporadiques (la peur du chômage étant un élément central d’une telle inhibition). Il n’y eu pas de mobilisation unifiée et massive de la classe ouvrière, mais seulement d’une partie, la plus jeune. La révolte de la jeunesse en Grèce (2008), les mouvements en Tunisie et en Égypte (2011), ont à ce titre été les expressions d’une vague de fond dont les points culminants ont été la lutte contre CPE en France (2006) et le 15 M 7.
Malgré les aspects positifs et prometteurs (nous en parlerons plus loin), ces mouvements eurent lieu dans un contexte de perte d’identité de la classe ouvrière et de manque de confiance en ses propres forces. La perte d’identité signifie que la grande majorité de ceux qui participent aux luttes ne se reconnaissent pas comme faisant partie de la classe ouvrière, ils se voient plutôt comme des citoyens. Même en se disant “ceux d’en bas”, en affirmant être traités comme des “deuxième classe”, ils ne brisent pas le cordon ombilical avec la dite “communauté nationale” car, “même si le slogan “Nous sommes 99 % face à 1 %”, si populaire dans les mouvements d’occupation aux États-Unis, révèle un début de compréhension du fait que la société est cruellement divisée en classes, la majorité des participants dans ces mouvements se voyaient eux-mêmes comme des “citoyens de base” qui veulent être reconnus dans une société de “citoyens libres et égaux”” 8. Cela empêche de voir le fait que “la société est divisée en classes, une classe capitaliste qui possède tout et ne produit rien et une classe exploitée, le prolétariat, qui produit tout et possède de moins en moins. Le moteur de l’évolution sociale n’est pas le jeu démocratique de “la décision d’une majorité de citoyens” (ce jeu est plutôt le masque qui couvre et légitime la dictature de la classe dominante) mais la lutte de classe” 9. Il y a donc deux faiblesses fondamentales au sein du mouvement du 15-M qui se renforcent mutuellement et qui permettent leur actuelle falsification : la plupart de ses protagonistes se concevaient comme des citoyens et aspiraient à un “renouveau du jeu démocratique”.
À cause de cela, le mouvement, malgré ses débuts prometteurs, ne s’est pas articulé “autour de la lutte de la principale classe exploitée qui produit collectivement l’essentiel des richesses et assure le fonctionnement de la vie sociale : les usines, les hôpitaux, les écoles, les universités, les ports, les travaux, la poste...” 10, mais il a fini par se diluer dans une protestation impuissante de “citoyens indignés”. Malgré quelques timides tentatives d’extension aux centres de travail, cela fut un échec, le mouvement restant de plus en plus limité aux places. Malgré les sympathies qu’il avait suscitées, il perdit de plus en plus de force jusqu’à être réduit à une minorité de plus en plus désespérément activiste.
En plus, la difficulté à se reconnaître comme classe fut renforcée par le manque de confiance en ses propres forces, ce qui a donné un poids démesuré aux couches de la petite bourgeoisie radicalisée qui se sont jointes au mouvement en renforçant la confusion, l’inter-classisme et la croyance dans les pires formulations de la politique bourgeoise, telles que “la fin du bipartisme”, “la lutte contre la corruption”, etc.
Ces couches sociales ont fortement contaminé le mouvement avec cette idéologie qui réduit le capitalisme “à une poignée de “méchants” (des financiers sans scrupules, des dictateurs sans pitié) alors que c’est un réseau complexe de rapports sociaux qui doit être attaqué dans sa totalité et non pas se disperser en poursuivant ses expressions multiples et variées (les finances, la spéculation, la corruption des pouvoirs politico-économiques)” 11.
Malgré quelques réponses solidaires basées sur l’action massive contre la violence policière, c’est la “lutte” conçue comme pression pacifique et citoyenne sur les institutions capitalistes qui amena le mouvement très facilement vers l’impasse.
Le mouvement Nuit debout reprend le pire du 15 M
Comme l’affirme notre section en France 12, “Nuit debout n’a rien de spontané. C’est un mouvement mûrement réfléchi, préparé et organisé de longue date par des animateurs et défenseurs radicaux du capitalisme. Derrière ce mouvement prétendument “spontané” et “apolitique” se cachent des professionnels, des groupes de gauche et d’extrême-gauche qui mettent en avant “l’apolitisme” pour mieux contrôler le mouvement en coulisses.”
Le but de ce montage est celui d’encadrer la protestation sociale sur le terrain de la ““pression” sur les “dirigeants” et les institutions étatiques afin de promouvoir un capitalisme plus démocratique et plus humain” 13, car, comme le dit un tract du collectif qui l’anime, Convergence des luttes : “L’humain devrait être au cœur des préoccupations de nos dirigeants...” Ce joli “vœux pieux” ne fait que transmettre l’utopie réactionnaire de gouvernants qui s’occuperaient des êtres humains, ce qui sert à occulter que la seule chose dont ils s’occupent, ce sont des nécessités et des problèmes du capital. Demander à l’État de défendre les intérêts des exploités c’est comme demander à un voleur de s’occuper de notre maison.
Les revendications mises en avant dans Nuit debout sont toutes allées dans le sens de semer l’illusion qu’un capitalisme qui nous dépouille de plus en plus de tout pourrait nous offrir encore quelque chose. On exige un “revenu de base universel”, une alimentation plus saine, un plus grand budget pour l’éducation et bien d’autres “reformes” qui se retrouvent systématiquement dans le catalogue des promesses électorales qui ne se réalisent jamais.
La revendication la plus “ambitieuse” que mettent en avant les promoteurs de Nuit debout est celle de la “république sociale” qui consisterait à “revenir aux idéaux révolutionnaires de 1789” lorsque la bourgeoisie a démoli le pouvoir féodal au cri de “Liberté, Égalité et Fraternité”. On essaye de nous vendre l’utopie réactionnaire de la réalisation “d’une “vraie démocratie” telle que la Révolution française de 1789 l’avait promis ; seulement ce qu’il y avait de révolutionnaire il y a deux siècles et demi, à savoir instaurer le pouvoir politique de la bourgeoisie en France, dépasser le féodalisme par le développement du capitalisme, bâtir une nation... tout cela est aujourd’hui devenu irrémédiablement réactionnaire. Ce système d’exploitation est décadent, il ne s’agit plus de l’améliorer, cela est devenu impossible, mais de le dépasser, de le mettre à bas par une révolution prolétarienne internationale. Ainsi, est semée l’illusion que l’État est un agent “neutre” de la société sur lequel il faudrait “faire pression” ou qu’il faudrait protéger des “actionnaires”, des “politiciens corrompus”, des “banquiers cupides”, de “l’oligarchie”” 14.
Le vrai antagonisme, celui entre le capital et le prolétariat, est remplacé par un “antagonisme” imaginaire entre, d’un côté, une minorité supposée de corrompus, de financiers et de politiciens véreux et de l’autre côté de la barricade, une immense majorité où pourraient rentrer les bons politiciens, les capitalistes entrepreneurs, les militaires, le peuple et tous les citoyens… Le prolétariat est dévoyé de son terrain de la lutte de classe vers le scénario d’un affrontement de “tous les citoyens” contre la poignée fantomatique des méchants d’un film.
Plus encore, de la même façon que le populisme de Trump ou du FN met tous les maux sur le compte de personnes et non pas sur les rapports sociaux de production, les “radicaux” de Nuit debout mettent en avant un projet bien répugnant : la personnalisation. Ceux-là proposent comme bouc émissaire les migrants, ceux-ci proposent quelques banquiers ou quelques politicards. C’est la même logique réactionnaire : les problèmes du monde seraient réglés en éliminant quelques personnes désignées comme étant la cause de tous les maux.
Que reste-t-il du 15-M ?
Nous avons vu la réécriture, le formatage du disque dur proposé par les promoteurs dans l’ombre du mouvement Nuit debout. Mais, alors, que reste-t-il du mouvement 15 M ? Que peut-on retenir pour les luttes futures ?
Les Assemblées
Nous reprenons ici ce que nous disions dans notre tract international de bilan du mouvement des Indignados, d’Occupy et d’autres :
“Les assemblées massives sont la concrétisation du slogan de la Première Internationale (1864) : “L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ou elle ne sera pas”. Elles s’inscrivent dans la continuité de la tradition du mouvement ouvrier qui démarre avec la Commune de Paris et prend son expression la plus élevée en Russie en 1905 et en 1917, se poursuivant en 1918 en Allemagne, 1919 et 1956 en Hongrie, 1980 en Pologne.
“Les assemblées générales et les conseils ouvriers sont les formes distinctives de l’organisation de la lutte du prolétariat et le noyau d’une nouvelle organisation de la société.
“Des assemblées pour s’unir massivement et commencer à briser les chaînes qui nous accrochent à l’esclavage salarié : l’atomisation, le chacun pour soi, l’enfermement dans le ghetto du secteur ou de la catégorie sociale.
“Des assemblées pour réfléchir, discuter et décider, devenir collectivement responsables de ce qui est décidé, en participant tous, autant dans la décision que dans l’exécution de ce qui a été décidé.
“Des assemblées pour construire la confiance mutuelle, l’empathie, la solidarité, qui ne sont pas seulement indispensables pour mener en avant la lutte mais qui seront aussi les piliers d’une société future sans classes ni exploitation” 15.
Les futures assemblées devront se renforcer avec un bilan critique des faiblesses apparues :
– elles ne se sont étendues que très minoritairement vers les lieux de travail, les quartiers, les chômeurs… Si le noyau central des assemblées doit être l’assemblée générale de ville, en prenant les places et les bâtiments, il doit se nourrir de l’activité d’un large réseau d’assemblées dans les usines et lieux de travail principalement.
– les commissions (de coordination, culture, activités etc.) doivent être sous le contrôle strict de l’assemblée générale devant laquelle elles doivent rendre des comptes scrupuleusement. Il faut éviter ce qui est arrivé lors du 15-M où les commissions sont devenues des instruments de contrôle et de sabotage des assemblées manipulées par des groupes en coulisse tel que DRY (Democracia Real Ya) 16.
La solidarité
La société capitaliste dégouline par tous ses pores de “la marginalisation, l’atomisation des individus, la destruction des rapports familiaux, l’exclusion des personnes âgées, l’anéantissement de l’affectivité et son remplacement par la pornographie”, c’est-à-dire, “l’anéantissement de tout principe de vie collective au sein d’une société qui se trouve privée du moindre projet, de la moindre perspective” 17. Un témoignage barbare de cette décomposition sociale est la haine envers les migrants encouragée par le populisme, qui a obtenu un triomphe spectaculaire avec le récent Brexit en Grande-Bretagne.
Face à tout cela, le mouvement 15 M (comme Occupy) a semé une première graine : “il y a eu des manifestations à Madrid pour exiger la libération des détenus ou empêcher que la police arrête des migrants ; des actions massives contre les expulsions de domicile en Espagne, en Grèce ou aux États-Unis ; à Oakland “l’assemblée des grévistes a décidé l’envoi de piquets de grève ou l’occupation de n’importe quelle entreprise ou école qui sanctionne des employés ou des élèves d’une quelconque manière parce qu’ils auraient participé à la grève générale du 2 novembre”. On a pu vivre des moments, certes encore très épisodiques, où n’importe qui pouvait se sentir protégé et défendu par ses semblables, ce qui est en fort contraste avec ce qui est jugé “normal” dans cette société, autrement dit le sentiment angoissant d’être sans défense et vulnérable.”
Cette forteresse pourrait être emportée par la puissance de la vague populiste actuelle (soutenue en fait par ses prétendus “antagonistes” de l’État démocratique). La solidarité prolétarienne doit encore acquérir des racines solides 18.
La culture du débat
La société actuelle nous condamne à l’inertie du travail, à la consommation, à la reproduction des modèles à succès qui entraînent des milliers d’échecs, la répétition de stéréotypes aliénants qui ne font qu’amplifier, ânonner l’idéologie dominante. Face à cela, autant de fausses réponses enfoncent encore plus dans la putréfaction sociale et morale, se font jour “la profusion des sectes, le regain de l’esprit religieux, y compris dans certains pays avancés, le rejet d’une pensée rationnelle, cohérente, construite, y inclus de la part de certains milieux “scientifiques” et qui prennent dans les médias une place prépondérante notamment dans des publicités abrutissantes, des émissions décervelantes ; l’envahissement de ces mêmes médias par le spectacle de la violence, de l’horreur, du sang, des massacres, y compris dans les émissions et magazines destinés aux enfants ; la nullité et la vénalité de toutes les productions “artistiques”, de la littérature, de la musique, de la peinture, de l’architecture qui ne savent exprimer que l’angoisse, le désespoir, l’éclatement de la pensée, le néant” 19.
Contre ces deux pôles de l’aliénation capitaliste, dans les mouvements comme le 15-M ou Occupy “des milliers de personnes ont commencé à rechercher une culture populaire authentique, construite par elles-mêmes, en essayant de forger ses propres valeurs, de manière critique et indépendante. Dans ces rassemblements, on a parlé de la crise et de ses causes, du rôle des banques, etc. On y a parlé de révolution, même si dans cette marmite on a versé beaucoup de liquides différents, parfois disparates ; on y a parlé de démocratie et de dictature, le tout synthétisé dans le slogan de ce distique aux deux strophes complémentaires : ‘‘Ils l’appellent démocratie mais ce n’est pas le cas !, “C’est une dictature mais ça ne se voit pas !”. On a fait les premiers pas pour que surgisse une véritable politique de la majorité, éloignée du monde des intrigues, des mensonges et des manœuvres troubles qui est la caractéristique de la politique dominante. Une politique qui aborde tous les sujets qui nous touchent, pas seulement l’économie ou la politique, mais aussi l’environnement, l’éthique, la culture, l’éducation ou la santé.”20
L’importance de cet effort, même timide et lesté par des faiblesses démocratistes et des approximations petites-bourgeoises, est évidente. Tout mouvement révolutionnaire du prolétariat ne peut que s’appuyer sur un débat de masse, sur un mouvement culturel basé sur la discussion libre et indépendante.
La Révolution russe de 1917 a eu comme colonne vertébrale le débat et la culture massive. John Reed rappelle que “la soif d’instruction, si longtemps réprimée, avec la révolution prit la forme d’un véritable délire. Du seul Institut Smolny, pendant les six premiers mois, sortaient chaque jour des trains et des voitures chargés de littérature pour saturer le pays. La Russie, insatiable, absorbait toute matière imprimée comme le sable chaud absorbe de l’eau. Et ce n’était point des fables, de l’histoire falsifiée, de la religion diluée et des romans corrupteurs à bon marché – mais les théories sociales et économiques, de la philosophie, les œuvres de Tolstoï, de Gogol et Gorki” 21.
Préoccupation pour une lutte internationale
Le prolétariat est une classe internationale avec les mêmes intérêts dans tous les pays. Les ouvriers n’ont pas de patrie et le nationalisme (sous toutes ses variantes) est la tombe de toute perspective possible de libération de l’humanité.
Le capitalisme actuel est pris d’assaut par une contradiction : d’un côté, l’économie est de plus en plus mondiale, la production est de plus en plus entremêlée et interdépendante. Mais, d’un autre côté, tous les États sont impérialistes et les conflits guerriers deviennent de plus en plus destructeurs ; l’environnement se détériore à cause de la barrière infranchissable que tous les capitaux nationaux érigent, en commençant par les plus puissants, les Etats-Unis et la Chine. Face à l’internationalisation patente de la vie économique, sociale et culturelle, se dresse un repli aveugle et irrationnel de prétendues communautés nationales, raciales, religieuses…
Ces contradictions ne pourront être dépassées que par la lutte historique du prolétariat. Le prolétariat est la classe de l’association mondiale. Il produit par-delà les frontières, lui-même est une classe de migrants, un creuset de races, de religions, de cultures. Aucune production, depuis un bâtiment jusqu’à une fraiseuse, ne peut être réalisée par une communauté isolée d’ouvriers enfermée dans un cadre national, encore moins local. La production a besoin de matières premières, de transports, de machines, qui circulent mondialement. Elle ne peut être réalisée que par des ouvriers instruits dans une culture universelle, dans les échanges incessants à une échelle internationale. Internet n’est pas seulement un instrument culturel, mais, surtout un moyen sans lequel la production capitaliste actuelle serait impossible.
En exprimant encore vaguement ces réalités et ce qu’elles peuvent signifier pour la lutte prolétarienne, en 2011, “le mouvement d’indignation s’est étendu internationalement. Il a surgi en Espagne où le gouvernement socialiste avait mis en place un des premiers plans d’austérité et un des plus durs ; en Grèce, devenue le symbole de la crise économique mondiale à travers l’endettement, aux États-Unis, temple du capitalisme mondial, en Égypte et en Israël pays pourtant situés de chaque côté du front du pire conflit impérialiste et le plus enkysté, celui du Moyen Orient.
“La conscience du fait qu’il s’agit d’un mouvement global commence à se développer, malgré le boulet destructeur du nationalisme (présence de drapeaux nationaux lors des manifestations en Grèce, en Égypte ou aux États-Unis). En Espagne, la solidarité avec les travailleurs de Grèce s’est exprimée aux cris de “Athènes tiens bon, Madrid se lève !” Les grévistes d’Oakland (États-Unis, novembre 2011) proclamaient leur “solidarité avec les mouvements d’occupation au niveau mondial”. En Égypte a été approuvée une Déclaration du Caire en soutien au mouvement aux États-Unis. En Israël, les Indignés ont crié “Netanyahou, Moubarak, Assad, c’est la même chose” et ont pris contact avec des travailleurs palestiniens” 22.
Aujourd’hui, cinq ans après, ces acquis semblent avoir disparu sous des tombereaux de terre. Ceci est l’expression d’un trait indissociable des luttes prolétariennes mis en relief dans la citation de Marx cité au début de cet article : elles “paraissent n’abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre et de se redresser à nouveau formidable en face d’elles”.
Il existe, cependant, une tâche vitale que doivent mener les minorités avancées du prolétariat : tirer les leçons, les inscrire dans un cadre théorique marxiste en développement. Voilà la tâche à laquelle nous appelons tous les camarades intéressés et engagés : “En menant un débat le plus large possible, sans restriction ni entrave aucune, pour préparer consciemment de nouveaux mouvements, nous pourrons faire devenir réalité une autre société, différente du capitalisme”.
Acción Proletaria, section du CCI en Espagne, 6 juillet 2016
1 Alors que le rôle de Podemos fut de neutraliser et faire dérailler tout ce qu’il y avait d’authentiquement révolutionnaire dans le mouvement des Indignés, ce que nous avons montré dans l’article “Podemos : des habits neufs au service de l’empereur capitaliste”.
2 Karl Marx, Le 18 brumaire de L. Bonaparte.
3 Rosa Luxemburg, La crise de la social-démocratie.
4 Voir notre brochure Octobre 1917, début de la révolution mondiale [73].
5 Nous avons beaucoup écrit sur cette expérience dans laquelle participèrent activement nos militants, non seulement de la section d’Espagne, mais aussi d’ailleurs. Les 3 documents, entre autres, qui résument notre position sont :
– “2011 : de l’indignation à l’espoir [76]”.
Voir aussi notre “dossier spécial [77]”.
6 Voir : “Effondrement du bloc de l’Est : des difficultés accrues pour le prolétariat [78]” (1990).
7 Des échos plus faibles de ces mouvements ont eu lieu en 2012 au Canada, au Brésil et en Turquie, en 2014 à Burgos, en 2015 au Pérou.
8 Extrait de notre tract international [76] cité plus haut.
9 Idem.
10 Idem.
11 Idem.
12 Voir : “Quelle est la véritable nature du mouvement Nuit debout ? [79]”
13 Idem.
14 Idem.
15 Tract international du CCI [76] déjà cité.
16 Voir : “Le mouvement citoyen “Democracia Real Ya !” : une dictature sur les assemblées massives [80]”.
17 Voir : La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste (mai 1990). Ce texte expose notre analyse sur la période historique actuelle, une période qui se caractérise par la continuité d’un capitalisme caduc et décadent que le prolétariat n’a pas encore réussi à éradiquer de la planète.
18 Voir notre texte d’orientation : “Confiance et Solidarité [81]”.
19 “La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste [82]” (mai 1990).
20 Tract international [76].
21 John Reed, Dix jours qui ébranlèrent le monde.
22 Tract international [76]
Géographique:
- Espagne [83]