Révolution Internationale 2012 - n° 429 - 438
- 2372 lectures
Révolution Internationale n° 429 - février 2012
- 1801 lectures
“Démocratiser le capitalisme”? Le détruire!
- 1558 lectures
La volonté de changer le système capitaliste s’est affirmée et propagée à toute vitesse au cours de ces derniers mois dans le monde, en particulier dans la jeunesse, à travers le mouvement des Indignés et des Occupy. Ce mouvement de contestation, de dimension internationale, est marqué au fer rouge par la violence de la crise économique et la dégradation brutale des conditions de vie. En Espagne, en Grèce, au Portugal, en Israël, au Chili, aux États-Unis, en Grande-Bretagne… aux quatre coins du globe, une même angoisse face à l’avenir traverse toutes les discussions. Mais bien plus que le chômage ou la précarité, ce qui engendre autant d’inquiétude est sans conteste l’absence d’alternative. Que faire ? Comment lutter ? Contre qui ? La finance ? La droite ? Les dirigeants ? Et surtout, un autre monde est-il possible ?
Aujourd’hui, l’une des réponses qui émerge est la nécessité de réformer, de “démocratiser” le capitalisme. En particulier, les médias, les intellectuels et la gauche font la plus grande publicité à ce “combat pour la démocratie”. Le mouvement parti d’Espagne s’est nommé “Indignés” en référence à la courte brochure de Stéphane Hessel Indignez-vous ! qui s’est empressé de publier un second volet Engagez-vous ! afin de rabattre le mécontentement vers les urnes et l’éloigner ainsi de la rue. Les organisations altermondialistes ont orienté eux aussi le mouvement vers la lutte pour “plus de démocratie”. La représentation officielle du mouvement des Indignés s’est faite par la DRY, ¡Democracia real Ya ! (démocratie réelle maintenant). Ce combat démocratique a d’ailleurs réellement un certain succès. Début janvier, les Occupy du village de tentes de Saint-Paul à Londres ont brandi une immense banderole réclamant la démocratisation du capitalisme.
Pourquoi ce mot d’ordre pour “un capitalisme plus démocratique” a-t-il ce succès ? Lors du “printemps arabe”, a été révélé aux yeux de tous que des cliques au pouvoir en Tunisie, Egypte, Syrie, Libye… spoliaient depuis des décennies les populations, maintenant leur domination par la crainte et la répression. La contestation, aiguillonnée par la montée de la misère, est parvenue à soulever cette chape de plomb et a été un immense encouragement pour les exploités du monde entier. En Europe, pourtant berceau de la démocratie occidentale, le mécontentement s’est aussi focalisé sur une “élite dirigeante” incapable, malhonnête… mais riche. En France, la clique du président Sarkozy a été dénoncée par de nombreux livres, comme le Président des riches, et d’autres ouvrages récents comme l’Oligarchie des incapables, écrits par des journalistes, chercheurs ou intellectuels, montrent comment la bourgeoisie française est faite de clans qui spolient toute la société au nom de leurs intérêts particuliers. Ces mœurs de voyous ne peuvent qu’engendrer indignation et dégoût. De Bush à Berlusconi, le même constat a été fait. Mais c’est en Espagne que ce rejet des élites a pris la tournure la plus politique. A l’origine du mouvement des Indignés, un fait a été particulièrement frappant : en pleine campagne électorale, période traditionnellement attentiste et morne pour la lutte, un large mouvement de contestation s’est développé. Alors que tous les médias et responsables politiques focalisaient l’attention sur le pouvoir des urnes, les rues étaient effervescentes d’AG et de discussions en tout genre. Une idée était d’ailleurs particulièrement répandue : “droite et gauche, la même merde”. A même parfois retenti “tout le pouvoir aux assemblées !”. Un de nos camarades a entendu une femme répondre à ceux qui voulaient “faire pression sur le gouvernement” que c’était contradictoire avec ce mot d’ordre de “tout le pouvoir aux assemblées !”.
Qu’est-ce que cela signifie ? Que l’idée grandit que, partout dans le monde, sous tous les gouvernements, c’est effectivement “la même merde”. Qu’ont changé les élections démocratiques en Egypte aussi bien qu’en Espagne ? Rien ! Qu’est ce que le départ de Berlusconi ou de Papandréou a changé en Italie et en Grèce ? Rien ! Les plans d’austérité se sont durcis et sont aujourd’hui devenus encore plus insupportables. Elections ou pas, la société est dirigée par une minorité dominante qui maintient ses privilèges sur le dos de la majorité. C’est d’ailleurs la signification profonde des fameux “1 % et 99 %” mis en avant par le mouvement des Occupy aux Etats-Unis. En fait, fondamentalement, il y a une volonté croissante de ne plus se laisser faire, de prendre les choses en main… l’idée que ce sont les masses qui doivent organiser la société… A partir de “tout le pouvoir aux AG”, il y a une réelle aspiration à construire une société où ce n’est plus une minorité qui dicte nos vies.
Mais la question est : cette nouvelle société passe-t-elle vraiment par un combat pour “démocratiser le capitalisme” ?
Le capitalisme, dictatorial ou démocratique, demeure un système d’exploitation
Oui, être dirigés par une minorité de privilégiés est insupportable. Oui, c’est à “nous” de prendre en main nos vies… Mais qui c’est, ce “nous” ? Dans la réponse donnée majoritairement par les mouvements actuels, “nous” c’est “tout le monde”. “Tout le monde” devrait diriger la société actuelle, c’est-à-dire le capitalisme, via une démocratie réelle. Mais là, apparaissent les vrais problèmes : le capitalisme n’appartient-il pas… aux capitalistes ? Ce système d’exploitation ne constitue-t-il pas l’essence même du capitalisme ? Si la démocratie, telle qu’elle existe aujourd’hui, est la gestion du monde par une élite, n’est-ce pas parce que ce monde et cette démocratie appartiennent à cette même élite ? Allons au bout du raisonnement, imaginons un instant une société capitaliste animée d’une démocratie parfaite et idéale où “tout le monde” déciderait de tout collectivement. D’ailleurs en Suisse ou dans certains villages autogérés en Espagne, ou dans le programme de 2007 de Ségolène Royal (1), on trouve la présence de cette “démocratie participative”. Et alors ? Gérer une société d’exploitation ne signifie pas supprimer cette exploitation… Dans les années 1970, beaucoup d’ouvriers ont mis en avant une revendication autogestionnaire à laquelle ils croyaient de toutes leurs forces : “Plus de patrons, on produit nous-mêmes et on se paye !” Les ouvriers de Lip en France l’ont appris à leurs dépens : ils ont géré collectivement et de façon égalitaire “leur” entreprise. Mais en suivant les lois incontournables du capitalisme, ils en sont venus dans la logique du marché à accepter… l’auto-licenciement et ce de façon très “libre” et très “démocratique”. Nous voyons donc qu’aujourd’hui, dans le capitalisme, la démocratie la plus proche de la perfection ne changerait rien pour construite une nouvelle société. La démocratie, dans le capitalisme, n’est pas un organe du pouvoir de conquête du prolétariat ou d’abolition du capitalisme… c’est un mode politique de gestion du capitalisme ! Pour mettre fin à l’exploitation, il n’y a qu’une seule solution, la révolution.
Qui peut changer le monde ? Qui peut faire la révolution ?
Nous sommes de plus en plus nombreux à rêver d’une société où l’humanité prendrait sa vie en main, où elle serait maîtresse de ses décisions, où elle ne serait pas divisée entre exploiteurs et exploités, mais unie et égalitaire… Mais la question est qui peut construire ce monde ? Qui peut permettre que demain l’humanité prenne en main la société ? “Tout le monde” ? Eh bien, non ! Car “tout le monde” n’a pas intérêt à la fin du capitalisme. La grande bourgeoisie, évidemment, luttera toujours bec et ongles pour maintenir son système et sa position dominante sur l’humanité, quitte à verser en abondance le sang, y compris dans les “grandes démocraties”. Et dans ce “tout le monde”, il y a aussi les artisans, les notables, les propriétaires terriens…, bref la petite-bourgeoise qui soit veut conserver le train de vie que lui offre cette société, soit (quand le déclassement la menace) est prise par la nostalgie d’un passé idéalisé. La fin de la propriété privée ne fait certainement pas partie de ses projets.
Pour devenir maître de sa propre vie, l’humanité doit sortir du capitalisme. Or, seul le prolétariat peut renverser ce système. La classe ouvrière regroupe les salariés d’usines et de bureaux, du privé et du public, les retraités et les jeunes travailleurs, les chômeurs et les précaires (2). Ce prolétariat forme la première classe de l’histoire à la fois exploitée et révolutionnaire (3). Précédemment, ce sont les nobles qui ont mené la lutte révolutionnaire contre l’esclavagisme, puis les bourgeois contre le féodalisme. Chaque fois, un système d’exploitation a été chassé et remplacé par… un nouveau système d’exploitation. Aujourd’hui, enfin, ce sont les exploités eux-mêmes, à travers la classe ouvrière, qui peuvent abattre le système dominant et construire ainsi un monde sans classes et sans frontières. Sans frontières car notre classe est internationale ; elle subit partout le même joug capitaliste, elle a partout les mêmes intérêts. Dès 1848, notre classe s’est d’ailleurs dotée de ce cri de ralliement : “Les prolétaires n’ont pas de patrie. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !”. Tous les mouvements de ces derniers mois, ceux du Moyen-Orient, des Indignés, des Occupy... se réclament d’ailleurs les uns des autres, d’un pays à un autre, d’un continent à un autre, montrant encore une fois qu’il n’y a pas de frontières pour la lutte des exploités et des opprimés. Mais ces mouvements de contestation ont aussi une grande faiblesse : la force vive des exploités, la classe ouvrière, n’y a pas encore conscience d’elle-même, de son existence, de sa force, de sa capacité à s’organiser comme classe… de ce fait, elle se noie dans le “tout le monde” et elle est encore victime du piège idéologique qui se proclame “pour un capitalisme plus démocratique”.
Pour faire triompher la révolution internationale et bâtir une nouvelle société, il faut que notre classe développe SA lutte, SON unité, SA solidarité… et surtout SA conscience de classe. Il faut pour cela qu’elle parvienne à organiser en son sein le débat, les discussions les plus larges, les plus vivantes, les plus effervescentes possibles pour développer sa compréhension du monde, de ce système, de la nature de son combat… Les débats doivent être libres et ouverts à tous ceux qui veulent essayer de répondre aux multiples questions qui se posent aux exploités : comment développer la lutte ? Comment nous organiser ? Comment faire face à la répression ? Et ils doivent être fermés à ceux qui viennent pour se faire les publicistes de l’ordre établi. Il ne s’agit certainement pas de sauver ou de réformer ce monde agonisant et barbare ! C’est en quelque sorte le miroir de la démocratie athénienne, son image inversée : dans la Grèce antique, à Athènes, la démocratie était le privilège des propriétaires d’esclaves, des citoyens masculins, les autres couches de la société en étaient exclues. Eh bien, dans la lutte révolutionnaire du prolétariat, la plus grande liberté existe en son sein mais en sont exclus ceux qui n’ont comme intérêt que de maintenir l’exploitation capitaliste.
Le mouvement des Indignés et des Occupy portent la marque caractéristique de cette volonté de débattre, cette effervescence incroyable, cette créativité des masses en action qui caractérisent notre classe quand elle lutte, comme on a pu le voir, par exemple, en mai 68, où l’on discutait à tous les coins de rue. Mais sa force créatrice est aujourd’hui diluée, voire paralysée, par son incapacité à exclure de sa lutte et de ses débats ceux qui travaillent en réalité corps et âme à la survie du système actuel. Si nous voulons un jour envoyer aux poubelles de l’histoire des mots comme profit, exploitation, répression et être enfin les maîtres de notre propre vie, le chemin à suivre devra nécessairement se séparer de ces appels illusoires à “démocratiser le capitalisme” et de tous les chantres d’un “capitalisme plus humain”.
CCI (28 janvier)
1) Candidate aux élections présidentielles françaises de 2007 au nom du Parti socialiste.
2) Lire notre article “Qu’est-ce que la classe ouvrière ? [2]”.
3) Lire notre article “Pourquoi la classe ouvrière est la classe révolutionnaire [3]”.
Récent et en cours:
Rubrique:
Non, un autre capitalisme n’est pas possible ! (à propos de l’hebdomadaire Marianne)
- 1427 lectures
 En France, la campagne électorale présidentielle commence à battre son plein, tandis que les perspectives économiques s’avèrent toujours plus sombres chaque jour et que chacun y va de ses propositions-miracle pour sortir de la crise. Le président Sarkozy en personne s’est mué naguère en chef de file de la guerre contre la finance mondiale, avec sa “moralisation du capitalisme” et sa toute récente conversion à l’instauration de la taxe Tobin. Dans tout ce fatras de déclarations électoralistes, l’idée directrice est toujours la même, et on ne peut en attendre autre chose : encore et toujours faire perdurer l’idée que le capitalisme est un système économique qui a de beaux jours devant lui, si on prend évidemment les “bonnes” mesures. De façon exemplaire, l’hebdomadaire Marianne, dont la prétention affichée depuis sa création tient dans l’observation et la moralisation de la vie politique française et internationale, a sorti dans son numéro 760 de la mi-novembre 2011 un numéro intitulé : “Oui, un autre capitalisme, c’est possible !”, avec un dossier spécial titré : “Oui, un capitalisme à visage humain, c’est possible !”. Partant du constat de l’aggravation de la crise économique, Marianne s’inquiète que cela “a eu pour conséquence de plonger dans un même sentiment d’impuissance les traditionnels thuriféraires du capitalisme et ses habituels opposants”. L’hebdomadaire, au travers de tout un tas de considérations diverses et variées sur l’état de l’économie mondiale et sur ses plénipotentiaires, contre “l’amoralité constitutive” du capitalisme moderne, se charge de rassurer dans un premier temps les brebis capitalistes égarées et affolées par le séisme économique actuel en leur rappelant avec force que “le capitalisme a connu son âge d’or dans les années 1970” (celles du début des licenciements massifs dans l’industrie !) ou en citant Emmanuel Todd pour lequel : “Notre génération sait bien que le capitalisme à visage humain peut exister, elle l’a vécu jusqu’aux années 80 !” (années où les attaques anti-ouvrières se sont brutalement intensifiées !).
En France, la campagne électorale présidentielle commence à battre son plein, tandis que les perspectives économiques s’avèrent toujours plus sombres chaque jour et que chacun y va de ses propositions-miracle pour sortir de la crise. Le président Sarkozy en personne s’est mué naguère en chef de file de la guerre contre la finance mondiale, avec sa “moralisation du capitalisme” et sa toute récente conversion à l’instauration de la taxe Tobin. Dans tout ce fatras de déclarations électoralistes, l’idée directrice est toujours la même, et on ne peut en attendre autre chose : encore et toujours faire perdurer l’idée que le capitalisme est un système économique qui a de beaux jours devant lui, si on prend évidemment les “bonnes” mesures. De façon exemplaire, l’hebdomadaire Marianne, dont la prétention affichée depuis sa création tient dans l’observation et la moralisation de la vie politique française et internationale, a sorti dans son numéro 760 de la mi-novembre 2011 un numéro intitulé : “Oui, un autre capitalisme, c’est possible !”, avec un dossier spécial titré : “Oui, un capitalisme à visage humain, c’est possible !”. Partant du constat de l’aggravation de la crise économique, Marianne s’inquiète que cela “a eu pour conséquence de plonger dans un même sentiment d’impuissance les traditionnels thuriféraires du capitalisme et ses habituels opposants”. L’hebdomadaire, au travers de tout un tas de considérations diverses et variées sur l’état de l’économie mondiale et sur ses plénipotentiaires, contre “l’amoralité constitutive” du capitalisme moderne, se charge de rassurer dans un premier temps les brebis capitalistes égarées et affolées par le séisme économique actuel en leur rappelant avec force que “le capitalisme a connu son âge d’or dans les années 1970” (celles du début des licenciements massifs dans l’industrie !) ou en citant Emmanuel Todd pour lequel : “Notre génération sait bien que le capitalisme à visage humain peut exister, elle l’a vécu jusqu’aux années 80 !” (années où les attaques anti-ouvrières se sont brutalement intensifiées !).
Marianne se propose donc de revenir à un protectionnisme “raisonnable” comme lors des Trente Glorieuses ou du New Deal de Roosevelt et appelle les politiques à ne plus “laisser le capitalisme agir tout seul : il ne sait pas où il va.” C’est donc une “rupture” avec le capitalisme, dans le capitalisme, pour sortir de la crise. Comme le dit Jacques Julliard, éditorialiste en chef de Marianne : “Depuis que le communisme a cessé de faire peur, le capitalisme a cessé d’être sérieux.” Ce qui ne rassure justement pas du tout la bourgeoisie, c’est que le communisme (et pas le stalinisme) lui fait en réalité de plus en plus peur, car il est vrai que le capitalisme, à partir du moment où il menace sérieusement l’humanité, sa raison d’exister comme son existence elle-même peuvent être de plus en plus souvent remises en cause.
Les propos de l’hebdomadaire reflètent l’illusion de la bourgeoisie que son système économique aurait un avenir devant lui et ont le mérite, sinon de la clarté, de l’honnêteté de son engagement résolu pour la défense du capitalisme.
C’est loin d’être le cas des groupes gauchistes comme Lutte ouvrière ou le Nouveau parti anticapitaliste qui bouffent du capitaliste au petit-déjeuner pour mieux partager le souper avec lui, et dont la raison de vivre est d’effectuer de multiples tours de bonneteau pour faire passer leur défense du système capitaliste pour une politique “révolutionnaire”. LO et le NPA peuvent bien appeler à la “révolution” et au “changement de société” à tous crins, dans les faits, ils entraînent la classe ouvrière derrière des mots d’ordre tout aussi illusoires et mystificateurs que les propositions de Marianne. LO donne ainsi pour mot d’ordre “d’exproprier les banquiers et rassembler les banques dans un seul établissement public”, en fait de pousser au renforcement de l’Etat capitaliste. Et, tout en assénant cette vérité selon laquelle “Les élections ne peuvent pas changer la vie. La lutte des exploités, si !”, LO rabat systématiquement les mêmes exploités vers les urnes, c’est-à-dire les livre à la mystification démocratique bourgeoise. Quant au NPA, qui se revendique prétendument lui aussi de Trotski et de la Révolution russe de 1917, on a vu aux dernières élections régionales son empressement à envoyer voter les salariés. Devant les événements en Egypte du printemps dernier, il n’a par ailleurs pas cessé de soutenir cette “révolution, jusqu’à la victoire” à travers les cliques “démocratiques et populaires” égyptiennes en faisant le tour de force de ne prendre aucunement position sur les luttes ouvrières qui se développaient au même moment dans le pays.
C’est ce qu’on appelle le double langage, celui des menteurs patentés. Nous ne pouvons donc que remercier Marianne d’avoir écrit en gros ce que tous les groupes gauchistes pensent tout bas.
Mitchell (28 janvier)
Géographique:
- France [5]
Rubrique:
Vient de paraître aux éditions Arkhê : DARWINISME ET MARXISME d’Anton Pannekoek
- 1956 lectures
 Enfin ! Cette édition de l’essai d’Anton Pannekoek, Darwinisme et Marxisme, mérite bien cette exclamation. En 2009, nous avions déjà publié dans notre Revue internationale (1) ce texte en français (ainsi qu’en espagnol et en anglais) en nous basant sur une traduction anglaise (due à Nathan Weiser, 1912) de la première édition en allemand (1909). Mais notre publication avait pâti de la piètre qualité de cette traduction malgré notre tentative de l’améliorer à l’aide de l’original néerlandais. Nous disposons maintenant de la première édition française scientifique de ce texte très important, traduite directement à partir de la dernière édition néerlandaise parue du vivant de l’auteur, celle de 1931 (2). Il s’agit donc d’un véritable texte de référence en langue française.
Enfin ! Cette édition de l’essai d’Anton Pannekoek, Darwinisme et Marxisme, mérite bien cette exclamation. En 2009, nous avions déjà publié dans notre Revue internationale (1) ce texte en français (ainsi qu’en espagnol et en anglais) en nous basant sur une traduction anglaise (due à Nathan Weiser, 1912) de la première édition en allemand (1909). Mais notre publication avait pâti de la piètre qualité de cette traduction malgré notre tentative de l’améliorer à l’aide de l’original néerlandais. Nous disposons maintenant de la première édition française scientifique de ce texte très important, traduite directement à partir de la dernière édition néerlandaise parue du vivant de l’auteur, celle de 1931 (2). Il s’agit donc d’un véritable texte de référence en langue française.
Dans notre introduction de la Revue internationale nous soulignions les grandes qualités de Darwinisme et Marxisme, notamment la clarté de sa présentation de ces deux théories et de leur complémentarité, théories que Pannekoek maîtrisait au plus haut degré en tant que scientifique éminent et en tant que militant révolutionnaire. Nous soulignions aussi sa dénonciation de la déformation de la véritable pensée de Darwin et de son instrumentalisation par les idéologues bourgeois, notamment Herbert Spencer, théoricien de l’ultralibéralisme et véritable inventeur du “darwinisme social” dont la vocation est de trouver des justifications “naturelles” aux injustices sociales propres aux sociétés de classes et notamment au capitalisme. En même temps, nous signalions un certain nombre d’insuffisances du livre de Pannekoek liées au fait qu’il ne pouvait évidemment bénéficier à l’époque de sa rédaction de la masse de connaissances accumulées depuis un siècle par la recherche scientifique mais aussi au fait qu’il était encore quelque peu influencé par une compréhension erronée de la véritable pensée anthropologique de Darwin par Marx et Engels eux-mêmes, lesquels avaient eu tendance à lui attribuer les conceptions de ses épigones bourgeois que justement il rejette dans son second ouvrage fondamental, la Filiation de l’homme.
Un des grands mérites de la présente édition de Darwinisme et Marxisme, outre la qualité de sa traduction qui permet de rendre compte bien mieux que la précédente de la profondeur du texte original, réside dans la présence d’un appareil critique étoffé, notamment une chronologie de la vie et de l’œuvre d’Anton Pannekoek, mais aussi et surtout la préface et le commentaire de Patrick Tort (3) intercalé tout au long du texte. Historien des sciences, chercheur au Muséum, responsable de la publication du monumental Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, directeur de l’Institut Charles-Darwin international en même temps que très bon connaisseur des textes de Marx et Engels, Patrick Tort était certainement l’auteur le plus en mesure d’apporter au texte original de Pannekoek tous les enrichissements, actualisations et précisions qu’il mérite, y compris les rectifications nécessaires.
Un des éclaircissements important donné par Patrick Tort concerne les rapports contradictoires de Marx et Engels avec Darwin, ce mélange de respect profond face à un matérialisme fondamental et de scepticisme têtu devant ce qui apparaissait aux fondateurs du socialisme scientifique comme des concessions à l’idéologie victorienne. Les causes de ce “rendez-vous manqué” entre Marx et Darwin, aux multiples conséquences néfastes, sont analysées dans cet ouvrage.
Aujourd’hui, grâce notamment à l’essai de Pannekoek et aux commentaires de Patrick Tort, lesquels font suite à plusieurs de ses travaux autour de cette question dont nous avons rendu compte en partie dans notre presse (4), il est plus aisé de comprendre que Darwin et Marx se situent le long d’un même fil historique : celui qui passe par la naissance de la civilisation, puis par l’émergence du communisme. Voilà qui nous ramène à la perspective d’une société libérée des classes, de l’État et de l’aliénation du travail, cette aliénation qui génère sous le capitalisme les catastrophes humaines et environnementales que l’on sait.
La lecture parallèle d’Anton Pannekoek et de Patrick Tort constitue une stimulation sérieuse de la réflexion sur ces questions vitales pour l’avenir de l’humanité. Bonne lecture !
Avrom E. (28 janvier)
1) Revue Internationale, nos 137 et 138, 2009.
(http ://fr.internationalism.org/rint137/darwinisme_et_marxisme_anton_pannekoek.html [6] et http ://fr.internationalism.org/rint138/darwinisme_et_marxisme_2_anton_pannekoek.html [7])
2) Anton Pannekoek, Patrick Tort, Darwinisme et Marxisme, Paris, éd. Arkhê, 259 pages, 19,90 € (Belles Lettres Diffusion). Cet ouvrage est disponible en librairie à partir du 16 février 2012.
3) Pour connaître l’œuvre et les travaux de Patrick Tort, rendez-vous sur son site www.patrick-tort.org [8].
4) “À propos du livre l’Effet Darwin. Une conception matérialiste des origines de la morale et de la civilisation”, Révolution Internationale, no 400, 2009
Rubrique:
Faillite de Seafrance : toutes les forces de la bourgeoisie unies pour attaquer les ouvriers
- 1502 lectures
Le triste feuilleton de la mise en liquidation de la société Seafrance a quasiment pris fin, et tout a été fait pour que la plus grande confusion règne. De Sarkozy aux syndicats (CFDT en proue), de la SNCF (maison-mère de Seafrance) aux différents repreneurs qui ont offert leurs bons offices, c’est la cacophonie la plus totale qui a été entretenue, le tout sur fond de basses magouilles mafieuses syndicales tellement énorme que Chérèque a été contraint de désavouer et d’exclure purement et simplement la section locale.
Alors que le sort de l’entreprise de ferries et de ses quelque 900 salariés était scellé depuis des mois, après déjà plus de 700 licenciements en 2010, toutes ces voix se sont brutalement réveillées en décembre pour s’élever au plus haut dès le début de l’année.
Sarkozy a ainsi piqué à l'occasion à la gauche ses intonations “sociales” en affichant un ferme soutien gouvernemental et en proposant la création d’une Société coopérative ouvrière de production (SCOP). Il ne s’agissait là évidemment que d’un coup de com’ électoraliste, cette fameuse coopérative ayant en réalité tout d’une coque vide de bonimenteur de foire et d’une arnaque. Le gouvernement, prenant des allures auto-gestionnaires presque dignes de la belle époque des LIP de 1973, décidait de “tout faire” pour que perdure l’activité de la compagnie et sauver un maximum d’emplois, en proposant la création de cette SCOP, dont les salariés seraient les actionnaires, donc les gestionnaires de leur propre exploitation. Discours repris haut et fort par le syndicat CFDT de la compagnie et par les “élus” du Comité d’entreprise qui votaient le 23 janvier dans le sens d’une même création, qui n’intéresse de toute évidence pas les salariés, très méfiants envers ces “solutions” qui les trimballent de mois en mois, de faux espoirs en désillusions. Enfin, les huit “représentants du personnel” ont voté contre le plan de sauvegarde de l’emploi proposé par la SNCF et donc d’engager les procédures de licenciements, prenant la posture radicale et mensongère de ceux qui veulent se battre jusqu’au bout pour la défense des salariés !
Trois cent d’entre eux ont donc reçu leur lettre de licenciement, et recevront “en moyenne” 60 000 euros d’indemnité, c’est-à-dire de quoi survivre 2 ou 3 ans avec leur famille en attendant d’être radiés du Pôle emploi.
Sur les 570 restants, 200 seront “reclassés” un peu partout dans l’Hexagone ainsi que 50 cheminots affectés à Seafrance, mais 150 sont pour le moment maintenus à leur poste parce que “nécessaires à la procédure de liquidation de la compagnie”. Donc en sursis d’être mis à la porte après leurs collègues. Quant aux 150 derniers, il s’agit des représentants du personnel (!) pour lesquels les procédures de licenciement sont spécifiques et bien plus longues, car ce sont des postes “protégés”.
Concernant les repreneurs comme Louis-Dreyfus Armateurs qui gère LD Lines ou le danois DFDS, rien n’est moins sûr qu’au bout du compte ils embauchent certains des 300 licenciés ou de ceux qui attendent de l’être, malgré leur “projet industriel solide”. D’autant que pour alimenter le tout, le Conseil général socialiste du Pas-de-Calais refuse de prêter à LD Lines un des bateaux de la compagnie (dont il est propriétaire) qui aurait permis de faire redémarrer rapidement un minimum d’activité, justifiant cela par le fait qu’il ne lui appartenait pas “d’interférer en faveur de tel ou tel opérateur”. C’est beau l’hypocrisie ! Et ni Hollande, ni Montebourg, qui est plus actif pour défendre ardemment “le soutien-gorge tricolore” chez Lejaby, n’y ont trouvé à redire.
Ainsi, tout a été fait et tous, droite, gauche, gouvernement, patronat et syndicats ont mis la main à la pâte une nouvelle fois pour faire passer des licenciements tout en tentant de nous faire croire qu’ils ont œuvré à la défense des intérêts ouvriers.
Ce type de manœuvres va se multiplier car, avec l’aggravation de la crise économique, les fermetures de boîtes vont se succéder à un rythme infernal. Pour y faire face, les exploités vont devoir apprendre à déjouer ces pièges, à ne pas laisser des spécialistes (syndicaux ou politiques) mener la lutte à leur place pour en réalité mieux la saboter. Il vont devoir prendre la lutte entre leurs propres mains, organiser eux-mêmes les assemblées générales, décider eux-mêmes des mots d’ordres, des revendications et des moyens d’action. Aujourd’hui, nous sommes tous touchés par les attaques incessantes du capital, si nous nous battons chacun dans notre coin, nous perdrons chacun dans notre coin, usine par usine, école par école, hôpital par hôpital. Pour être forts, nous devons nous unir dans la lutte. Si nous parvenons à prendre notre lutte en main, à organiser nos AG, alors nous pourrons aussi tisser des liens entre nous, nous déplacer massivement d’un lieu de travail à l’autre pour entraîner dans le combat la boîte voisine qui, si elle n’est pas touchée aujourd’hui, le sera demain.
Prenons nos luttes en main !
Notre force, c’est l’unité et la solidarité !
Wilmag (28 janvier)
Situations territoriales:
Rubrique:
Le naufrage économique
- 1816 lectures

Vendredi 13 janvier, l’agence de notation américaine Standard & Poor’s (S&P) dégrade la note de crédit de 9 pays de la zone euro. C’est le “black Friday” ! La France, l’Autriche, Malte, la Slovaquie et la Slovénie chutent d’un cran, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et Chypre de deux. Cette décision met la note de l’Italie au même niveau que le Kazakhstan (BBB+) et place celle du Portugal dans la catégorie à risque élevé ! S&P place également 14 pays de la zone sous perspective négative (au total 15 pays sur 17 sont sous perspective négative). Pour résumer, seule l’Allemagne est encore estampillée “AAA – perspective stable” au sein d’une zone euro à la dérive.
Un naufrage économique mondial
 La perte du triple A français est l’indice le plus révélateur de la gravité de la situation économique en Europe. La France formait avec l’Allemagne la colonne vertébrale de la zone euro. Ce sont principalement ces deux pays qui alimentaient les fonds d’aide à la Grèce, l’Italie et l’Espagne. Or, n’ayant plus son AAA, la France ne peut plus être un garant crédible et l’Allemagne se retrouve seule à devoir supporter ce fardeau de l’endettement européen. C’est d’ailleurs pourquoi le Fonds européen de stabilité financière (FESF) a lui aussi vu sa note être dégradée par S&P.
La perte du triple A français est l’indice le plus révélateur de la gravité de la situation économique en Europe. La France formait avec l’Allemagne la colonne vertébrale de la zone euro. Ce sont principalement ces deux pays qui alimentaient les fonds d’aide à la Grèce, l’Italie et l’Espagne. Or, n’ayant plus son AAA, la France ne peut plus être un garant crédible et l’Allemagne se retrouve seule à devoir supporter ce fardeau de l’endettement européen. C’est d’ailleurs pourquoi le Fonds européen de stabilité financière (FESF) a lui aussi vu sa note être dégradée par S&P.
Le tableau est, pour la bourgeoisie, catastrophique. Depuis 2008, le système bancaire est aux abois, il ne doit sa survie qu’à la perfusion permanente d’argent frais des banques centrales. En Allemagne par exemple, pays pourtant censé être le plus solide de la zone euro, toutes les banques sont surendettées et personne ne sait comment elles vont encaisser les prochains chocs inéluctables à venir, telle la faillite annoncée de la Grèce. Aujourd’hui, banques, fonds d’investissement, grands industriels, Etats, banques centrales, institutions internationales (comme le FMI)… tous se soutiennent les uns les autres comme des alcooliques qui, sortant d’un bar, se tiennent par les épaules pour essayer de marcher droit et ne pas tomber. Le résultat est prévisible : une marche sinueuse et improbable, puis… la chute collective.
La bourgeoisie elle-même a, en partie, conscience des jours sombres qui attendent son économie. Pour Ben May, de Capital Economics, “le Portugal et la Grèce vont subir des récessions assez sévères quoi qu’entreprennent les dirigeants dans les semaines ou les mois à venir pour sauver la zone euro” (1). L’économie portugaise va se contracter d’après lui de 8 % l’année prochaine ! Les situations italienne et espagnole ne sont pas meilleures : leur PIB devrait reculer de 2,2 % et 1,7 % !
Et la crise ne ravage pas seulement la zone euro. L’économie britannique s’est contractée de 0,2 % au dernier trimestre 2011 et redoute de perdre à son tour le fameux triple A. Le Japon devrait connaître lui-aussi la récession (– 0,4 % pour l’année fiscale en cours).
Plus généralement, le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2012. Son scénario le plus optimiste anticipe 3,3 % de croissance (et non plus 4 % comme il était avancé en septembre dernier) mais, selon l’aveu même de son chef économiste Olivier Blanchard, “si la crise de la zone euro s’aggrave, le monde replongera dans la récession.”
L’impossible désendettement
Le marasme économique actuel est nommé par les spécialistes “la crise de la dette”. La montagne de créances accumulées en effet depuis les années 1960 par tous les acteurs de l’économie mondiale, des entreprises aux banques, des Etats aux particuliers, a créé une sorte de surendettement généralisé qui pousse l’économie mondiale vers la faillite (2).
Face à cette situation, la bourgeoisie n’a aucune solution. Quand elle tente de désendetter son économie, la récession est immédiate et brutale. L’activité est comme paralysée, tout s’arrête. Et, au bout du compte, les déficits se creusent. Quand elle tente de relancer la croissance en injectant massivement de l’argent, les déficits… se creusent. Deux chemins, une même destination : la faillite.
En Europe, en particulier en Grèce et au Portugal, l’austérité est violente, les coupes claires dans les budgets sont faites à la hache. Résultat ? Des pays au bord du gouffre. Aujourd’hui, le FMI demande d’ailleurs aux banques européennes d’accepter des pertes importantes sur la Grèce (ce qui va menacer à leur tour ces établissements de banqueroute) et souhaite que la zone euro ajoute 1000 milliards au FESF et au MES (Mécanisme européen de stabilité) afin de sauver l’Irlande, le Portugal, l’Espagne et l’Italie qui sont en train de flancher à leur tour. Evidemment, l’Allemagne s’est d’ores et déjà positionnée contre une telle éventualité puisque c’est à elle que reviendrait le privilège de fournir la plus grande partie de la somme.
Aux Etats-Unis, malgré les milliers de milliards injectés depuis 2008, l’économie nationale s’entête à ne pas redécoller. L’Etat va donc devoir continuer à maintenir l’activité sous perfusion d’argent “à bas coût”. La Réserve fédérale vient d’annoncer qu’elle ne prévoyait pas de relever ses taux avant fin 2014, maintenant ceux-ci proche de zéro (entre 0 % et 0,25 %), et nombre d’analystes restent persuadés que la Banque centrale n’échappera pas au lancement d’un nouveau cycle de “relance quantitative” (“QE3”) (3), sous la forme de 500 milliards de dollars de rachats d’actifs titrisés (“mortgage-backed securities”) et de bons du Trésor, en avril ou en juin. Bref, de la dette va encore être ajoutée à la dette et en très très grande quantité ! Tout cet argent créé va couler à flots mais sans engendrer une quelconque relance réelle et durable, un peu comme s’il était versé dans “le tonneau des Danaïdes” (4).
La bourgeoisie pourra bien verser tout l’argent qu’elle veut dans le tonneau de l’économie mondiale, rien n’y fera. Son système est moribond, condamné. C’est d’ailleurs là que s’arrête la comparaison avec les Danaïdes. Si, en mythologie, un supplice peut durer éternellement, dans le monde réel, tout a une fin et celle du capitalisme approche.
Explosion du chômage
L’Espagne en crise vient de franchir la barre “historique” des 5 millions de chômeurs. Chez les moins de 25 ans, plus d’un sur deux (51,4 %) est sans travail. En seulement 4 ans, le pays a multiplié par 3 son taux de chômage !
La France compte officiellement près de 2,8 millions chômeurs sans aucune activité. Avec les départements d’outre-mer, le nombre de demandeurs d’emploi s’établit même à 4,5 millions. Là aussi, l’augmentation est vertigineuse.
Les prolétaires de tous les pays sont confrontés à cette même réalité dramatique. Tous ? Non ! L’Allemagne ferait exception si l’on en croit les bonimenteurs qui nous gouvernent. Jamais, Outre-Rhin, le taux de chômage n’a été aussi bas depuis la réunification (6,9 %). Un véritable “miracle économique”. Sauf si l’on tient compte des millions de chômeurs radiés ou des précaires dépendants de l’aide sociale... Les longs extraits qui suivent de l’article “Chômage : la face caché du “miracle économique allemand”” sont à ce sujet édifiants :
“En 2001, le Chancelier socialiste Schröder […] fait appel à Peter Hartz, directeur des ressources humaines de Volkswagen, qui pense avoir trouvé la solution à la gabegie du système d’allocation. Ce seront les fameuses lois Hartz, dont la plus connue et la plus contestée est la Loi Hartz IV. Celui que toute l’Allemagne appelle bientôt “Doktor Hartz”, veut s’attaquer au “chômage volontaire”, et met en place un système contraignant de recherche d’emplois. Il instaure les fameux “mini-jobs”, payés 400 euros par mois sans cotisation sociale et donc sans assurance, et les “un euro-jobs”, essentiellement des travaux d’intérêt public. Tout le système allemand d’allocations est remis à plat. […] On connaît la suite : des résultats impressionnants, mais en trompe-l’œil. A l’instar de Brigitte Lestrade, auteur d’une étude sur les réformes Hartz IV, certains pointent la mise en place d’un système qui, par vases communicants, aurait progressivement fait passer plusieurs millions d’Allemands des listes de chômeurs à ceux de “quasi-chômeurs” ou travailleurs pauvres.
La chercheuse estime à 6,6 millions de personnes – dont 1,7 millions d’enfants – les “bénéficiaires” d’Hartz IV. Les 4,9 millions d’adultes sont en fait des chômeurs, des “quasi-chômeurs” [qui travaillent moins de 15 heures par semaine] ou des précaires. […] Une responsable de l’Arbeitsagentur d’Hambourg [le Pôle-emploi allemand], souhaitant garder l’anonymat, ne cache pas sa colère : “Qu’on arrête de parler de miracle économique. Aujourd’hui, le gouvernement répète que nous sommes aux alentours de 3 millions de chômeurs, ce qui serait effectivement historique. La réalité est toute autre, 6 millions de personnes touchent Hartz IV, ce sont tous des chômeurs ou des grands précaires. Le vrai chiffre n’est pas de 3 millions de chômeurs mais de 9 millions de précaires” (5).
En fait, il n’y a pas d’îlot paradisiaque sur cette terre dominée par le capitalisme. L’enfer de l’exploitation règne partout et lacère notre dos avec le fouet de la crise économique. Selon l’Organisation international du travail, 1,1 milliard de personnes dans le monde sont au chômage ou vivent sous le seuil de pauvreté. 450 millions de travailleurs pauvres survivent avec moins de 1,25 dollar par jour ! Et cette situation dramatique ne cesse d’empirer.
Le système d’exploitation actuel est en train d’agoniser, nul doute possible. Il n’y a qu’une seule incertitude : l’humanité va-t-elle s’éteindre avec lui ou sera-t-elle capable d’engendrer un autre monde ? Autrement dit, nous, les exploités, allons-nous encore longtemps accepter les mille souffrances que le capitalisme nous fait endurer ?
Pawel (28 janvier)
1) Source : www.lexpress.fr/economie [11].
2) Lire notre article : “La crise de la dette : pourquoi ?” (http ://fr.internationalism.org/icconline/2011/la_crise_de_la_dette_pourquoi.html [12]).
3) Les QE 1 et 2 ont été de plans de relance successifs et également inefficaces de l’économie américaine. Concrètement, à travers eux, 2000 milliards de dollars ont été injectés depuis 2008, ce qui a juste permis à la croissance de ne pas s’effondrer.
4) Les Danaïdes sont les cinquante filles du roi Danaos. Ce roi fit venir ses cinquante neveux qui lui expliquèrent leur désir d’épouser ses filles. Danaos accepta. Pour leurs noces, il offrit à ses filles une dague puis leur fit promettre de tuer leurs époux pendant la nuit. Toutes le firent, sauf Hypermnestre, qui épargna Lyncée. Plus tard, Danaos organisa des jeux pour marier ses 49 filles. Mais Lyncée tua les 49 filles pour venger ses frères. Aux enfers, les Danaïdes reçurent une punition qui consistait à remplir éternellement d’eau un tonneau percé.
5) Source : fr.myeurop.info/2011/10/04/chomage-la-face-cachee-du-miracle-economique-allemand-3478
Géographique:
- France [5]
Récent et en cours:
- Crise économique [13]
Rubrique:
En Russie, les illusions démocratiques entravent le développement de la conscience de classe
- 1384 lectures
Nous publions ci-dessous une prise de position de sympathisants du CCI présents sur le territoire de l’ex-URSS concernant les manifestations contre les fraudes électorales qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans près de 80 villes en Russie en décembre dernier.
Il est particulièrement significatif que ces mobilisations massives se produisent dans le pays épicentre de la contre-révolution mondiale pendant des décennies (depuis le milieu des années 1920), où l’écrasement physique et idéologique du prolétariat par le stalinisme au nom du communisme a été absolu. De plus, l’effondrement et le démembrement de l’URSS dans les années 1990, l’un des phénomènes marquant l’entrée du capitalisme en décadence dans sa phase ultime de la décomposition, avait poussé au paroxysme le déboussolement et la démoralisation de cette partie du prolétariat mondial. Ces mouvements sont aujourd’hui inévitablement fortement marqués par cette histoire et sont, en particulier, porteurs d’importantes illusions sur la démocratie. Pour autant, ils sont avant tout une expression de la dynamique internationale qui, partie des pays arabes, déferle sur de nombreux pays (comme en Roumanie actuellement), voit s’élever la protestation de toutes les couches et classes victimes du capitalisme contre le présent de misère et l’avenir catastrophique auxquels les condamne ce système en faillite. Au-delà du déclencheur immédiat anti-fraude électorale, c’est la profonde insatisfaction de leur condition de vie et de travail qui pousse aussi de larges secteurs de la population et des exploités en Russie à exprimer leur mécontentement et à sortir de la passivité que la clique de Poutine se plaisait officiellement à faire passer pour une approbation de son régime de terreur et d’exploitation sans frein. A ce titre, le surgissement de ces mouvements constitue un événement majeur.
Le 4 décembre 2011, les élections parlementaires ont eu lieu en Russie. Les fraudes électorales y ont été si cyniques et si insolentes qu’elles ont indigné des centaines de milliers de citoyens. Des dizaines de milliers de personnes ont pris part aux manifestations de contestation, “pour des élections honnêtes” dans différentes villes du pays. Mais il est à noter que la grande majorité des indignés s’entretiennent d’illusions démocratiques et luttent pour améliorer le système capitaliste au lieu de le combattre par la lutte des classes.
Riches et pauvres ensemble dans la rue
Les manifestations les plus grandioses se sont déroulées à Moscou, le 10 décembre place Bolotnaïa et le 24, Avenue Sakharov, où le nombre de participants a atteint plusieurs dizaines de milliers de personnes, selon diverses estimations. Les contestations ont vu des forces politiques différentes, les enseignes des libéraux voisiner avec les drapeaux rouges, les bannières des nationalistes avec les étendards rouges et noirs des anarchistes. Mais la plupart des manifestants n’appartenaient à aucune organisation ou tendance politique.
La revendication principale de la manifestation était celle d’“élections honnêtes”. En même temps, beaucoup de gens non engagés politiquement persistaient à ne rien vouloir d’autre que soumettre les autorités à la loi et faire des transformations démocratiques pacifiques. En général, la grande masse faisait la sourde oreille aux appels à la révolution ou à toute action radicale.
Il faut aussi noter la grande bigarrure de la composition sociale des manifestants. D’une part, on y trouvait des hommes d’affaires, d’anciens membres du gouvernement (y compris l’ex-Premier ministre Mikhaïl Kassianov), des stars du show-biz, des journalistes célèbres et même une mondaine, telle que Xénia Sobtchak dont le père Anatoli Sobtchak passe pour être le “parrain” politique de Poutine. D’autre part, il y avait aussi beaucoup de gens ordinaires : des employés de bureau, des étudiants, des ouvriers, des retraités, des chômeurs... D’après certains observateurs, la composition sociale des manifestants en province (ce qui signifie pratiquement l’ensemble de la Russie, sauf pour Saint-Pétersbourg et Moscou) était plus prolétarienne que dans la capitale.
Les raisons des contestations et la réaction du Kremlin
Il ne fait aucun doute que la crise économique mondiale a joué un rôle de catalyseur des contestations en Russie. Malgré l’optimisme affiché des autorités, cette crise se fait ressentir de plus en plus pour les gens ordinaires. Les fraudes électorales lors des élections parlementaires de 2011 n’ont fait que servir de prétexte au déclenchement des manifestations de masse. La revendication d’“élections honnêtes” a été le leitmotiv de presque toutes les actions de masse, de l’Extrême-Orient aux deux métropoles (Moscou et Saint-Pétersbourg).
Les réseaux Internet sont devenus la principale arme idéologique de l’opposition à Poutine. Sur la toile, on peut retrouver des centaines, si ce ne sont des milliers de vidéos où sont enregistrées, à en croire leurs auteurs, les violations à la loi électorale. D’ailleurs, personne n’en a vérifié la crédibilité parce que l’indignation a plutôt trouvé dans les trucages électoraux un prétexte formel, alors que, comme nous l’avons indiqué, sa cause principale en était le mécontentement général de millions de personnes vis-àvis de leur situation.
A leur tour, les autorités prétendent que les accusations de trucage lors des élections sont en grande partie infondées. En outre, le Kremlin mène une campagne médiatique visant à présenter les manifestants sous influence d’agents de l’Occident au service de l’Oncle Sam et du Département d’Etat. Pourtant, craignant ce mécontentement généralisé, le régime de Poutine est obligé de faire certaines concessions. Par exemple, Medvedev vient de promettre quelques réformes démocratiques à la population, notamment de rétablir l’élection directe des gouverneurs de région, abolie il y a quelques années par Poutine sous prétexte de la lutte contre le terrorisme.
Les illusions démocratiques
Il ne fait aucun doute que le mécontentement a des raisons sociales. La Russie, comme partie de l’économie mondiale, traverse la même crise que les autres pays. Les gens ordinaires en Russie tout autant que les millions des travailleurs partout dans le monde, commencent à comprendre que le capitalisme ne leur assure aucun “avenir radieux”. Mais ce sentiment ne s’est pas encore transformé en conscience de classe. Et les illusions démocratiques imposées par la propagande bourgeoise y sont dans une large mesure pour quelque chose. Malheureusement, nombre de gens ne comprennent pas encore que les élections ne sont que le droit des opprimés de choisir un représentant de la classe dirigeante à intervalles réguliers (selon l’expression de Marx). Et quel que soit le visage du pouvoir, sa nature sera toujours la même, capitaliste et exploiteuse. Qu’importe si on a tel ou tel président, tel ou tel député, les prolétaires, les salariés manuels et intellectuels privés de moyens de production et du pouvoir politique demeureront exploités. Les travailleurs n’obtiendront l’émancipation sociale qu’en s’organisant (à l’exemple de la Commune de Paris de 1871 et des Conseils ouvriers de 1905 et 1917) et en renversant le système capitaliste, parce que c’est seulement un changement de système qui leur permettra de faire cesser l’exploitation.
Qui a pris la tête de l’opposition à Poutine ?
Les libéraux, la “gauche” (avant tout les staliniens) et les nationalistes se sont mis à la tête du mouvement. Ensemble, ils ont formé le Centre de coordination “Pour des élections honnêtes”.
Parmi les leaders de l’opposition, on voit des personnages tels que Boris Nemtsov, vice-Premier ministre sous Eltsine qui a pas mal “contribué” au pillage sur le dos des travailleurs de Russie.
En somme, les rivaux de Poutine n’obtiennent aucune sympathie de la part des prolétaires russes. Les gens se souviennent bien encore de la pauvreté, de la misère, des retards du paiement des salaires et des retraites, à l’époque où certains des opposants actuels étaient au pouvoir. Les leaders de l’opposition ne se sont pas gênés pour utiliser le mécontentement des masses à des fins électoralistes. Cette fois-ci, il s’agit de la future présidence. Dans les manifestations de contestation, on appelle les électeurs à voter “comme il faut”. Mais il est tout à fait clair que même si “l’opposition” actuelle succède à Poutine et à son régime, les travailleurs n’en tireront aucun bénéfice.
Les tâches des révolutionnaires
On sait bien que la revendication d’élections honnêtes n’a rien à voir avec la lutte de classes. Mais il faut se rendre compte que parmi les dizaines de milliers des manifestants, il y a beaucoup de nos compagnons de classe. Dans une telle situation, nous devons critiquer ouvertement les illusions démocratiques, même si cela ne contribuera pas à accroître la sympathie pour nos positions parmi les partisans d’“élections honnêtes”. Sans la compréhension qu’à la base de tous les problèmes contemporains, il y a la nature du système capitaliste, il n’y aura pas de développement de la conscience de classe révolutionnaire. C’est pourquoi, malgré le battage médiatique entourant les élections, les révolutionnaires doivent inlassablement démasquer la fausseté et l’illusion des “libertés” bourgeoises. Tout en critiquant les erreurs des participants aux manifs pour des élections honnêtes, il ne faut jamais oublier la différence entre “l’opposition” bourgeoise qui veut utiliser le mécontentement des masses pour gagner de confortables places au sein des organes du pouvoir et les gens ordinaires qui s’indignent sincèrement de l’insolence, de l’impudence et de la perfidie des autorités actuelles du Kremlin.
Et comme le montre même l’expérience de telles contestations aussi stériles et insignifiantes pour le pouvoir que puissent être les manifestations à Moscou, un état d’esprit radical au sein de la société peut très vite émerger. Il y a un mois encore, avant ces actions de masse, personne n’aurait pu supposer que des dizaines de milliers de personnes iraient protester dans la rue contre le régime de Poutine.
Notre devoir révolutionnaire consiste à démasquer la véritable nature de la clique de Poutine et de ses opposants politiques. Nous devons expliquer aux travailleurs que seule la lutte de classe autonome pour le renversement du capitalisme et la construction d’une nouvelle société sans exploitation pourra résoudre réellement leurs problèmes personnels et ceux de l’humanité toute entière.
Des sympathisants du CCI dans l’ex-URSS (janvier 2012)
Géographique:
Rubrique:
A propos du film “Tahrir, place de la Libération”: une vision tronquée de la réalité qui escamote la lutte de classes
- 1476 lectures
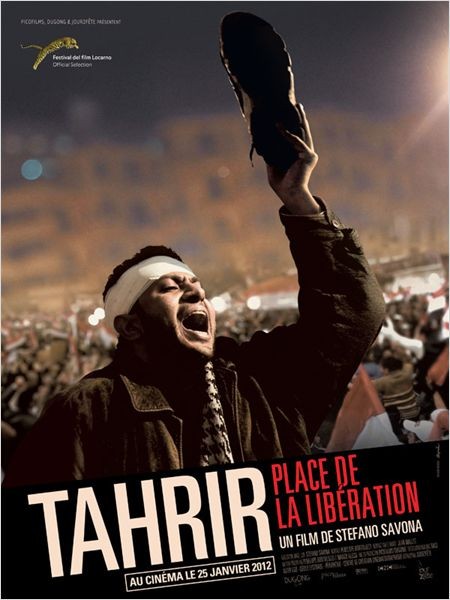 Exactement un an (le 25 janvier) après le début du soulèvement en Egypte, le film Tahrir, place de la libération du documentariste italien Stefano Savona, parrainé par la LIDH (Ligue internationale des droits de l’homme) et soutenu par des producteurs “indépendants” est sorti dans une quinzaine de salles en France.
Exactement un an (le 25 janvier) après le début du soulèvement en Egypte, le film Tahrir, place de la libération du documentariste italien Stefano Savona, parrainé par la LIDH (Ligue internationale des droits de l’homme) et soutenu par des producteurs “indépendants” est sorti dans une quinzaine de salles en France.
En préambule du film, outre une animation proposée par un chanteur et un musicien, célébrant notamment la révolte de Sidi Bouzid en Tunisie, il a été rappelé qu’aujourd’hui encore, la mobilisation sur le place Tahrir continuait et qu’il y avait encore 15 000 détenus politiques dans les geôles bien que l’armée ait relâché symboliquement environ 200 autres prisonniers à l’occasion de l’anniversaire de ce que tous les Egyptiens appellent désormais avec fierté “la Révolution”.
Il faut cependant rappeler que l’armée détient toujours les rênes du pouvoir dans ce pays après les récentes élections où les 2/3 du Parlement sont composés par les partis islamistes (les Frères musulmans qui formellement en détiennent la majorité) plus le parti salafiste (intégriste). Ainsi, rien n’a changé depuis le départ du dictateur remplacé par… la dictature ouverte de l’armée. Et surtout, outre cette répression, il n’y a aucune amélioration quant à la misère et aux conditions de vie des exploités, désormais coincés entre le marteau et l’enclume, entre l’armée, les illusions démocratiques et le poids politique des partis islamistes.
Pour sa “première” à Paris, le film était également suivi d’un débat direct avec le réalisateur, auquel nous avons participé.
Filmé caméra au poing à partir d’un simple appareil photo Canon 5D, ce documentaire nous fait partager au plus près des visages et des mouvements de foule, la vie de dizaines de milliers de participants, s’attachant pendant 12 jours, au hasard des rencontres et au gré des coups de cœur du réalisateur, à suivre quelques uns des protagonistes tout au long des “journées de la colère” depuis le 6e jour de l’occupation jusqu’à l’annonce de la démission de Moubarak le 11 février, et dans les dernières images un peu au-delà avec quelques interrogations sur le futur.
Le problème avec ce film, c’est qu’il prétend de par son aspect documentaire, être un témoignage de l’histoire en train de se vivre et qui se vit de l’intérieur de la place Tahrir, se donnant ainsi le brevet d’une certaine “objectivité” propre au reportage journalistique en montrant la réalité prise sur le vif de ce qui ses passe sous ses yeux. Mais ce cinéma est tout, sauf objectif. Non seulement il ne montre la réalité que d’un certain point de vue, mais son parti pris de filmer cette réalité de l’intérieur aboutit à ne la montrer que plus partiellement, focalisant l’attention sur une surface plus étroite et limitée comme avec une loupe dont les effets grossissants rejettent dans l’ombre ou hors du champ de vision le cadre qui permet de la voir entièrement et de la comprendre.
Alors que précisément le mouvement en Egypte ne se limite pas à ce qui s’est passé sur la place Tahrir, celle-ci nous est présentée comme le seul point de référence. Il n’y a pas un seul écho, ni la moindre préoccupation sur la place de la vague de grèves ouvrières qui a déferlé dans tout le pays et qui a réellement poussé Moubarak, sous la pression des Etats-Unis, à démissionner. Si l’armée n’est pas intervenue à ce moment-là, si par la suite, une de ses premières mesures a été d’interdire les grèves, c’est que ces grèves qui ont quasiment paralysé le pays ont joué un rôle majeur dans le déroulement des événements. Le film donne l’illusion, la vision déformée que la seule force du mouvement provenait de l’occupation de la place Tahrir. Un article sur le film dans le Monde daté du 25 janvier 2012 livre ce commentaire : “Que nous montre le film ? D’abord une extraordinaire effervescence, une ivresse palpable, une reconquête exaltante de la liberté de parole et de mouvement”. C’est vrai. Et cette ivresse envahit le spectateur comme les participants eux-mêmes paralysant tout effort de réflexion. De ce fait, le film nous embarque et nous entraîne d’emblée à partager les émotions et les sentiments de la foule, en se plaçant au milieu des participants sans permettre aucun recul pour la réflexion, il épouse son point de vue avec un maximum d’empathie et d’engagement : ses colères, ses craintes, ses espoirs, ses doutes, ses explosions de joie à l’annonce de la chute du tyran. L’article du Monde poursuit ainsi : “Puis (il montre) une diversité de visages, d’âges, de sexes, d’origines, d’appartenances, d’attitudes qui se mélangent, se respectent, s’unissent dans un même ras-le-bol, dans un même défi, dans un même combat. Des barbus et des glabres, des gens en prière et d’autres en keffieh, des jeunes filles voilées transportant des pierres, des jeunes qui les lancent, des vieillards qui les soutiennent. En un mot, un peuple en marche, une utopie réalisée”. Et cette “utopie” non pas réalisée mais porteuse de dangereuses illusions et d’un maximum de confusion a une double étiquette : Démocratie et Révolution du peuple.
Cependant, même à travers ce prisme déformant et cette réalité tronquée, certains aspects de la situation à ce moment-là sautent aux yeux du spectateur. D’abord le courage donné par un ras-le-bol collectif : “nous n’avons plus peur”, la détermination : “nous irons jusqu’au bout pour que Moubarak dégage” et la solidarité des participants : hommes et femmes inconnus auparavant se parlant les uns aux autres, se côtoyant, dormant côte à côte dans les abris de fortune – toiles de tente ou rideaux de douches – sans le moindre problème, chacun apportant la nourriture de son foyer pour la collectivité. Il montre le combat courageux et à mains nues contre la police, contre les snipers ou contre les hordes de détenus de droit commun, libérés et recrutés par Moubarak comme tueurs à gages grassement payés envoyés à l’assaut des occupants. Il montre l’impuissance d’un haut gradé militaire affublé d’une fleur blanche à la main non parce qu’il serait contesté ou conspué mais parce que, même muni d’un micro, il est incapable de se faire entendre. Il montre l’utilisation de Twitter par certains jeunes pour appeler à se rassembler sur la place ou à se déplacer sur des points stratégiques où il y a besoin de renforts dans les affrontements pour “tenir” la place, les infos qui circulent de bouche à oreille, les déplacements continuels sur la place. Un autre élément frappant est l’absence d’AG malgré la “libre parole” : il n’y a pas de délibération ni de décision collective sur l’orientation du mouvement en dehors de petits groupes de discussion informels sur la situation ou sur l’avenir. Au début du film, certains évoquent des manifestations dans d’autres villes, leurs origines, leur profession. A un moment, cette diversité se reflète quand trois jeunes parlent ensemble : l’un est campagnard, l’autre citadin, un troisième Bédouin, parfois ils donnent leur opinion ou livrent leurs sympathies respectives pour telle ou telle fraction à trois ou quatre, tout au plus. Les gens parlent entre eux fraternellement malgré leurs convictions différentes, notamment religieuses ou laïques, on voit quelques discours suivis par de petits groupes de la part des Frères musulmans, des harangues individuelles enflammées souvent émouvantes devant la caméra et surtout des slogans répétés et scandés à satiété : “Le peuple veut changer de régime”, “Moubarak, dégage”, “Le peuple égyptien, c’est nous, il est ici”, “Vive l’Egypte !” au milieu d’une nuée de drapeaux nationaux brandis à bout de bras ou certains gigantesques déployés au dessus de la foule. Car le nationalisme, la préoccupation du sort et des intérêts du pays est omniprésente sur la place et, semble-t-il, partagé par chacun. Chaque participant se reconnaît avec tous les autres comme “le peuple” sans la moindre connotation de classe. Là, le miroir aux alouettes de la démocratie fonctionne. Et aussitôt, le piège se referme. Le piège c’est précisément toutes les valeurs idéologiques mises en avant par la bourgeoisie et les discours remplis d’illusions que véhicule ce film : un personnage le dit : “le peuple est uni ici comme les doigts de la main” autour d’une seule idée, “chasser Moubarak”. Mais seule cette volonté de chasser Moubarak et son régime exécré crée cette unité interclassiste artificielle : “Ce que nous voulons tous, c’est renverser ce régime”. Jeunes comme vieux, femmes voilées ou pas, intégriste ou pro-laïque, musulman ou chrétien. Après, on verra… A la fin du film, après les scènes de liesse provoquée par l’annonce du départ de Moubarak et que beaucoup lèvent le camp pour rentrer chez eux, une femme prévient pourtant : “maintenant c’est l’armée qui a les pleins pouvoirs et qui suspend nos libertés, il ne faut pas partir d’ici, c’est contre elle que nous devons maintenant continuer à nous mobiliser et nous battre.”
Bref, le film est entièrement à la gloire de la conquête de cette démocratie rêvée dont “le peuple égyptien” serait le héros. D’ailleurs, les nouveaux arrivants sont accueillis aux cris de “Les voilà, les héros de la nation !” Toute disposée à se trouver un héros ou un leader emblématique, la foule fait venir à la tribune un jeune manifestant emprisonné et relâché au bout de 12 jours qui, effrayé par les ovations et le rôle qu’on lui octroie, renonce à prendre la parole.
Le film invite insidieusement à adhérer ou à s’extasier devant ce qui révèle au contraire les grandes faiblesses, l’immaturité de la révolte et surtout le poison nationaliste conforté par cette fierté d’avoir chassé Moubarak comme les illusions démocratiques qui pèsent très lourdement, outre le poids de la religion, sur la population exploitée dans le soulèvement en Egypte.
C’est d’ailleurs les termes de peuple, de démocratie et de révolution qu’on a retrouvé galvaudés tout au long du “débat” organisé à la suite du film. Alors que la plupart des intervenants ont interrogé le cinéaste sur les conditions de tournage ou sur les rencontres avec des personnages qu’on pouvait suivre tout au long du film, trois interventions ont plus ou moins fait part de leur “malaise” ou ont remis en cause le terme de Révolution pour qualifier les événements, l’un d’eux disant que des véritables révolutions, il n’y en avait pas eu beaucoup dans l’histoire et le cinéaste s’est contenté d’y répondre en disant que vivre ces jours avait été une expérience exceptionnelle, que rien ne serait plus comme avant dans les mentalités en Egypte et que cela avait durablement marqué les consciences, y compris la sienne. C’était cela pour lui qui justifiait l’emploi du terme révolution. L’élément “contestataire” dans la salle est brièvement réintervenu pour dire que, les drapeaux nationaux en moins, le phénomène n’était pas sans rappeler Mai 68 en France sans que cela puisse être qualifié de révolution ; la réponse apportée par le cinéaste et son entourage ont été que c’était le début d’un processus révolutionnaire toujours en cours car la mobilisation de ceux de Tahrir n’était pas terminée et ont finalement répondu que le propos de l’intervenant avait une connotation pessimiste injustifiée. Un camarade du CCI est intervenu à plusieurs niveaux : sur l’absence de toute référence à la mobilisation ouvrière dans les événements, sur le fait que le film et le débat prenaient l’Egypte comme un référentiel absolu alors que ce mouvement s’insérait dans un cadre de contestation internationale de la société ces dernières années qui s’était exprimé un peu partout mais que l’on retrouvait dans les mouvement des Indignés en Espagne ou en Grèce ou des Occupy en Grande-Bretagne et jusqu’aux Etats-Unis face à une crise mondiale du système. Enfin pour rappeler que la révolte et la naissance du mouvement en Tunisie partaient de revendications économiques contre le chômage, la misère et la hausse des produits alimentaires et non pas prioritairement pour réclamer plus de liberté et de démocratie. Il a encore insisté sur le fait que cet aspect était sous-estimé dans ce débat sur l’Egypte, alors que la précarité, le chômage et la misère étaient au moins aussi fortes en Egypte, où la protestation contre la vie chère apparaissait uniquement dans le film à travers ce rappel hurlé par les manifestants “l20 livres le kilo de lentilles !”. Le réalisateur a cherché à démentir assez maladroitement l’aspect prioritaire des revendications économiques niant même qu’en Tunisie elles aient joué un rôle majeur ou de détonateur. Un membre de l’équipe associée au film a plus subtilement admis que les grèves ouvrières avaient joué aussi un rôle important dans le soulèvement notamment depuis la vague de grèves de 2007/2008 dans les usines textiles de El Mehalla el Kubra dans le delta du Nil et à la suite de celles-ci par le “mouvement du 6 avril” et qu’à Tahrir il y avait aussi des bouts de pain collés sur des affichettes pour l’exprimer. Après cette intervention, le débat, sans doute pour éviter que la discussion ne prenne une tournure plus “politique”, a été rapidement clos par les organisateurs.
W (26 janvier)
Récent et en cours:
- Luttes de classe [15]
Rubrique:
De l’Iran à la Syrie, les manœuvres impérialistes passent la vitesse supérieure
- 1487 lectures
L’article suivant, traduit depuis World Revolution (organe de presse du CCI en Grande-Bretagne), a été écrit par un sympathisant de notre organisation, avant la récente attaque contre l’ambassade britannique en Iran.
Le 29 novembre, des étudiants ont fait irruption dans le bâtiment, causant des dommages aux bureaux de l’ambassade et à des véhicules. Dominick Chilcott, l’ambassadeur britannique, dans une interview à la BBC, a accusé le régime iranien d’être derrière ces attaques “spontanées”. En représailles, le Royaume-Uni a expulsé l’ambassade iranienne de Londres. Ces événements sont un nouvel épisode de la montée des tensions au Moyen-Orient entre l’Occident et l’Iran, autour de la question des armes nucléaires et de la Syrie. Le récent rapport de l’AIEA sur le nucléaire iranien a déclaré que l’Iran avait développé un programme nucléaire militaire. En réponse, le Royaume-Uni, le Canada et les Etats-Unis ont introduit de nouvelles sanctions. Ces derniers jours, l’Iran a affirmé qu’il a abattu un drone américain qui tentait de recueillir des renseignements militaires. Par rapport à la Syrie, l’article mentionne la collaboration entre le régime d’Assad et la Garde Révolutionnaire Iranienne dans le massacre de la population syrienne. Dans le sac de l’ambassade britannique, on a également vu un coup de main de la part de la section jeunesse du Basij, téléguidé par El-Assad.
De même que les rivalités inter-impérialistes, nous ne devons pas oublier les rivalités internes au sein des bourgeoisies nationales elles-mêmes. L’été dernier, il est devenu clair qu’un fossé croissant se creusait entre le président iranien Mahmoud Ahmadinejad et l’ayatollah Ali Khamenei. Malgré ses diatribes antisémites et sa rhétorique pleine de rodomontades, Ahmadinejad représente une fraction de la bourgeoisie iranienne qui veut maintenir quelques liens avec l’Occident. Khamenei avait arrêté quelques-uns des proches alliés d’Ahmadinejad au sein du gouvernement limogé. En réponse, Ahmadinejad a “fait grève” pendant 11 jours, refusant de s’acquitter de ses fonctions à la tête du gouvernement. Les récents événements autour de la mise à sac de l’ambassade britannique sont considérés par certains analystes des médias dans le cadre de cette querelle. Khamenei et ses partisans conservateurs sont considérés comme étant derrière les attaques pour saper la politique plus conciliante de M. Ahmadinejad et lui nuire en vue des prochaines élections de 2012.
Avec l’aggravation des tensions entre l’Iran et l’Occident, certains pronostiquent le déclenchement d’une troisième guerre mondiale. La question qui se pose dans la réalité est tout autre : est-ce que les ouvriers du Moyen-Orient et de l’Occident sont prêts à être mobilisés pour soutenir une autre guerre majeure ? Les travailleurs du monde entier supportent le fardeau de la crise sur leurs épaules et commencent à riposter. La guerre signifiera encore plus d’austérité, plus de violence contre les travailleurs, plus de désespoir. Les travailleurs n’ont aucun intérêt dans ces massacres impérialistes sanglants et ne sont pas prêts à y être embrigadés de façon massive.
CCI (28 janvier)
Courrier de lecteur
Après huit mois de manifestations, à l’origine parties d’un mouvement régional et international contre l’oppression, le chômage et la misère, impliquant Druzes, Sunnites, Chrétiens, Kurdes, hommes, femmes et enfants, les événements en Syrie continuent à prendre une sinistre allure. Si, par rapport à la défense de leurs propres intérêts et de leur stratégie, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France se méfient d’une attaque directe contre l’Iran, en revanche, ils peuvent contribuer à une agression sur son plus proche allié, le régime d’Assad en Syrie, dans la logique des rivalités interimpérialistes. Les brutales forces de sécurité d’Assad, avec le soutien logistique de “300 à 400 Gardiens de la Révolution” d’Iran (The Guardian du 17 novembre 2011), ont massacré des milliers de personnes et donné naissance à la mensongère et hypocrite “préoccupation pour les civils” de la part des trois principales puissances du front anti-iranien nommées ci-dessus. Comme pour la Libye, les Etats-Unis sont le “leader par l’arrière”, cette fois en poussant la Ligue arabe (tout en l’amenant à se détacher des alliés algériens, irakiens et libanais d’Assad), dont la Syrie était une puissance majeure, à suspendre son adhésion et en la soumettant à des échéances ultérieures humiliantes. Au premier plan de cette préoccupation-bidon pour la vie et l’intégrité physique de la population se trouve le régime meurtrier d’Arabie Saoudite qui, il y a quelque temps, avait envoyé environ deux mille soldats de ses troupes d’élite, formées par la Grande-Bretagne, pour écraser les manifestations à Bahreïn ainsi que pour protéger les intérêts et les bases américaines et britanniques. Comble de l’hypocrisie, la confirmation de la suspension de la Syrie pour son “bain de sang” a été faite par la réunion de la Ligue Arabe dans la capitale marocaine, Rabat, le 16 novembre, alors même que les forces de sécurité de ce pays étaient en train d’attaquer et de réprimer des milliers de ses propres manifestants. Il y a des ramifications impérialistes plus larges par rapport à l’action de la Ligue Arabe, en ce sens que ses décisions ont été condamnées par la Russie, mais soutenues par la Chine.
Ce n’est pas seulement la Ligue Arabe que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis poussent en avant dans cette voie, mais aussi la puissance régionale qu’est la Turquie, qui a également participé aux réunions à Rabat. Après avoir apparemment dissuadé l’Etat turc de mettre en place une sorte de zone tampon ou une “zone de non-survol” sur la frontière entre la Turquie et la Syrie, l’administration américaine a désormais changé d’avis. Ainsi, Ben Rhodes, conseiller d’Obama à la sécurité nationale, a dit la semaine dernière : “Nous saluons fortement l’attitude ferme que la Turquie a prise...” Le chef en exil des Frères Musulmans en Syrie a également déclaré aux journalistes la semaine dernière que l’action militaire turque (“pour protéger les civils”, bien sûr !) serait acceptable (The Guardian du 18 novembre 2011). La possibilité d’une zone tampon le long de la désormais fortement militarisée frontière turco-syrienne verrait la mystérieuse “Armée Syrienne Libre”, largement basée en Turquie (ainsi qu’au Liban) et, pour le moment, largement inférieure en nombre à l’armée syrienne, capable de se déplacer avec un armement beaucoup plus lourd. Au sein de cette convergence d’intérêts impérialistes se trouvent les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la majorité de la Ligue arabe, des gauchistes divers, les Frères musulmans et les djihadistes salafistes de Syrie qui ont également pris un plus grand rôle dans l’opposition à Assad. En outre, la déstabilisation de la région et la perspective d’une aggravation des problèmes sont bien visibles tant dans l’avertissement du président turc Gül adressé à la Syrie et précisant qu’elle aurait à payer pour semer le trouble dans le Sud-est kurde de la Turquie que dans “la volonté renouvelée de Washington de fermer les yeux sur des incursions militaires turques contre les bases de guérilla kurdes dans le nord l’Irak.” (The Guardian du 18 novembre 2011). Toute cette instabilité, alimentée par ces puissances et ces intérêts, rend une intervention militaire de la Turquie dans le territoire syrien d’autant plus probable.
“L’Armée syrienne libre” a elle-même été impliquée dans des meurtres sectaires et des assassinats de civils en Syrie (Newsnight du 17 novembre 2011) et, comme elle opère à partir de ses refuges en dehors du pays, pour combattre et tuer les forces gouvernementales et la police, les représailles s’abattent sur la population civile. Le Conseil National Syrien, qui a fait son apparition le mois dernier, a également appelé à une intervention militaire contre les forces d“Assad, tandis qu’une autre force d’opposition, le Comité National de Coordination, a dénoncé cette position. Le ministre français des Affaires Etrangères, Alain Juppé, a déjà rencontré les forces d’opposition à Paris et, le secrétaire au Foreign Office, Hague, les a rencontrées à Londres le 21 novembre. Il n’a pas été précisé qui étaient ces “forces d’opposition”, ni si elles incluent l’Armée Syrienne Libre, le Conseil National Syrien, le Comité de Coordination Nationale, l’opposition kurde, les Frères Musulmans et les djihadistes salafistes. En outre, les coalitions de l’opposition incluent des staliniens, onze organisations kurdes, des structures tribales et claniques, plus un nombre ahurissant d’amorces d’intérêts contradictoires. En tout cas, Hague a appelé à un “front uni” et a nommé un “ambassadeur désigné” pour eux (BBC News du 21 novembre) !
Téhéran, l’objectif ultime
Depuis maintenant plusieurs années, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et l’Arabie Saoudite ont fait monter l’hystérie anti-iranienne et c’est ce qui se cache derrière leur soutien à l’opposition syrienne et leur “préoccupation pour les civils”. Cette campagne a été considérablement renforcée par un récent rapport de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) qui laissait entrevoir une “possible” dimension militaire aux ambitions nucléaires de l’Iran. Mais les Etats-Unis encerclent l’Iran depuis un certain temps. Sur la frontière orientale de l’Iran, il y a plus d’une centaine de milliers de soldats américains en Afghanistan, au Nord-Est, il y a le Turkménistan avec ses bases militaires américaines. Dans le sud de Bahreïn, ce sont des bases navales américaines et britanniques. De même au Qatar, il y a le siège du commandement avancé des forces américaines et la marionnette anti-iranienne, l’Arabie Saoudite. Le seul espace où l’Iran peut respirer se situe maintenant autour de sa frontière occidentale avec l’Irak et même ici, les forces spéciales américaines et britanniques ont fait un certain nombre d’incursions directes ou indirectes : en 2007, Bush a obtenu l’approbation du Congrès pour un programme de 400 millions de dollars afin de soutenir les groupes “ethniques”, tandis que, plus récemment, Seymour Hersch dans le Daily Telegraph et Brian Ross de la chaîne ABC ont eu des renseignements sur le groupe de gangsters terroristes iranien Joundallah. Le chef de ce groupe, Abdolmalek Rigi, capturé par les services secrets iraniens alors qu’il allait à Doha, affirme qu’il a rencontré la CIA à la base aérienne américaine de Manas au Kirghizistan pour apporter son aide dans des attaques terroristes en Iran. Au large des côtes de l’Iran, il y a une accumulation massive de navires de guerre américains dans le Golfe Persique et dans l’ensemble de la région du Golfe, les Etats-Unis vont renforcer leurs atouts au Koweït, au Bahreïn et dans les Emirats Arabes Unis. Des révélations récentes (The Guardian du 11 mars 2011) ont montré que le Royaume-Uni préparait des plans d’urgence pour la liaison avec les forces américaines en vue d’une possible attaque navale et aérienne contre des cibles en Iran. A seulement environ 1500 km de là se trouve Israël, qui possède l’arme nucléaire, qui a été impliqué dans l’attaque au virus Stuxnet qui a réussi à arrêter définitivement environ un cinquième des centres nucléaires d’Iran, et dans la mort de scientifiques iraniens, dont un expert nucléaire de premier plan, le major général Moghaddam, tué avec 16 autres dans une énorme explosion dans une base des Gardiens de la Révolution, près de Téhéran, il y a dix jours. Encore une fois, l’hypocrisie de la démocratie est presque incroyable : au mépris de leur rhétorique sur le désarmement, le British American Security Information Conseil affirme que les Etats-Unis dépenseront 700 milliards de dollars pour la modernisation de leur installations d’armes nucléaires au cours de la prochaine décennie et “d’autres pays, y compris la Chine, l’Inde, Israël, la France et le Pakistan devraient consacrer des sommes énormes pour les systèmes de missiles tactiques et stratégiques” (The Guardian du 31 octobre 2011). Le rapport poursuit en disant que “les armes nucléaires se voient assigner des rôles qui vont bien au-delà de la dissuasion... de rôles d’armes de guerre dans la planification militaire”. En ce qui concerne Israël, le rapport déclare : “... la dimension des têtes nucléaires des missiles de croisière de sa flotte sous-marine est augmentée et le pays semble être sur la bonne voie, grâce à son programme de lancement de fusée satellite, pour le développement futur d’un missile balistique intercontinental (ICBM)”.
La Grande-Bretagne, qui a contribué à fournir à Israël des armes nucléaires, n’est pas mentionnée dans ce rapport commandé par ce pays. Tout le monde sait qu’une attaque sur l’Iran serait de la folie, même le Mossad et le Shin Bet, les forces secrètes de sécurité externes et internes d’Israël. Utilisant leur canal habituel de fuite contre leurs politiciens, le journal koweïtien Al-Jarida, les deux agences ont exprimé leurs sérieux doutes et le patron du Mossad, qui a récemment pris sa retraite, Meir Dagan, a appelé la perspective d’une attaque sur l’Iran “la plus stupide des idées” dont il n’avait jamais entendu parler. Mais le fait qu’elles soient stupides ou irrationnelles ne les rend pas improbables : il suffit de regarder les guerres en Irak et l’interminable cauchemar, complètement irrationnel, en Afghanistan/Pakistan. La Syrie devient une autre étape manifeste dans la transformation de la guerre secrète contre l’Iran. Cela n’a rien à voir avec “la protection des civils”, mais s’identifie entièrement à l’avancée des objectifs de plus en plus irrationnels imposés par un système capitaliste en pleine décomposition.
Baboon (21 novembre)
Géographique:
- Moyen Orient [16]
Fukushima, un an après (I) : une catastrophe planétaire
- 1671 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction de la première partie d’un article de Welt Revolution, organe de presse du CCI en Allemagne.
Le 11 mars 2011, un gigantesque tsunami inonde les côtes Est du Japon. Des vagues hautes de 12 à 15 mètres causent des dommages incroyables. Plus de 20 000 personnes sont tuées, des milliers sont aujourd’hui encore portées disparues. Un nombre incalculable de personnes ont perdu leur maison.
Mais le pire était encore à venir : la catastrophe nucléaire de Fukushima. Un an après, nous pouvons affirmer qu’il s’agit là d’une catastrophe mondiale encore en cours.
Tchernobyl, Fukushima : partout, l’impuissance et l’absence de scrupules de la classe dirigeante
Face à cette catastrophe nucléaire, la classe dominante a encore une fois étalée son incurie. L’évacuation de la population a commencé trop tard et la zone de sécurité interdite a été insuffisante. Même si on peut objecter que les mesures de sauvetage et d’évacuation ont été retardées et rendues plus difficiles en raison des conséquences du tsunami, le gouvernement a surtout évité une évacuation à grande échelle parce qu’il voulait minimiser absolument les dangers. Il est tout à coup devenu évident que les responsables japonais de la société Tepco qui gère la centrale nucléaire ainsi que le gouvernement n’avaient jamais prévu un tel scénario et que les mesures de sécurité en cas d’un séisme et d’un tsunami d’une telle ampleur étaient inadéquates. Les mesures d’urgence prévues ont été totalement insuffisantes et ont fait apparaître ce pays réputé de haute technologie qu’est le Japon comme un géant pauvrement équipé et impuissant.
Quelques jours après la catastrophe, quand la question d’une évacuation de fait nécessaire de la zone métropolitaine de Tokyo, avec ses 35 millions d’habitants, a été discutée au sein du gouvernement, cette idée a été immédiatement rejetée parce qu’il n’avait tout simplement pas les moyens de la mettre en œuvre et qu’elle aurait impliqué le danger d’un effondrement du gouvernement.
Dans et autour de la centrale nucléaire, les radiations enregistrées ont atteint une intensité fatale. Peu après la catastrophe, le Premier ministre Kan a réclamé la formation d’un commando-suicide de travailleurs qui auraient à entreprendre la tâche de faire baisser le niveau de radioactivité dans l’usine. Les travailleurs qui sont intervenus sur le site étaient très mal équipés. Depuis quelques temps, il manquait des dosimètres, ainsi que des bottes de sécurité appropriées et réglementaires. Un ouvrier a signalé que les travailleurs avaient dû attacher des sacs en plastique avec du ruban adhésif autour de leurs chaussures. Il était très souvent impossible pour les travailleurs de communiquer les uns avec les autres ou avec les centres de contrôle. Beaucoup de travailleurs ont dû dormir sur les lieux même du site et ils ne pouvaient pas se couvrir avec des couvertures de plomb. Le taux critique pour les travailleurs de la centrale dans des situations d’urgence a été augmenté le 15 mars de 100 à 250 millisieverts par an. Dans plusieurs cas, les travailleurs n’ont pu avoir de bilan de santé que des semaines ou des mois plus tard.
Il y a 25 ans, au moment de Tchernobyl, le régime stalinien de l’URSS en voie d’effondrement, à cause de son manque de ressources, n’avait rien trouvé d’autre à faire que d’envoyer de force une armée gigantesque de recrues pour combattre le désastre sur place. Selon l’OMS, environ 600 000 à 800 000 “liquidateurs” ont été envoyés, dont des centaines de milliers sont morts ou sont tombés malades à cause des radiations. Le gouvernement n’a jamais publié de chiffres officiels fiables.
Aujourd’hui, 25 ans plus tard, un pays de haute technologie et très démocratique, le Japon, a désespérément tenté d’éteindre le feu et de refroidir le site, entre autres, avec des lances à incendie et par pulvérisation d’eau à partir d’hélicoptères. En contradiction avec tous les plans précédents, Tepco a été forcée d’utiliser de grandes masses d’eau de mer pour le refroidissement de l’usine et de déverser les eaux polluées dans l’Océan Pacifique. Et comme à Tchernobyl, des milliers de travailleurs ont été contraints de risquer leur vie (non sous la menace de la répression cette fois-ci, mais sous celle de la misère). Tepco a entres autres recruté des travailleurs sans-abri et des chômeurs dans la région la plus pauvre d’Osaka et de Kamagasaki, à qui, dans de nombreux cas, on ne disait pas où ils devaient travailler et qui n’étaient souvent même pas informés des risques encourus.
Et non seulement la vie des liquidateurs a été mise en péril, mais aussi celle de la population civile, en particulier les enfants de la zone irradiée qui ont été exposés à des doses très élevées. Depuis que ces émissions ont été enregistrées, le gouvernement a décidé de relever le seuil de non-dangerosité concernant l’exposition des enfants dans la région de Fukushima, à 20 millisieverts…
En 1986, durant les premiers jours, les dirigeants de l’URSS stalinienne avaient essayé de garder le silence total au sujet de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ; en 2011, le gouvernement du Japon démocratique s’est montré tout aussi déterminé à cacher l’ampleur de la catastrophe. Les responsables au Japon n’ont pas montré moins de cynisme et de mépris pour la vie humaine que le régime stalinien au pouvoir à l’époque de Tchernobyl.
Il est impossible aujourd’hui d’évaluer de façon réaliste les conséquences à long terme. Les barres de combustible fondues ont formé un gigantesque caillot radioactif qui a percé le container sous pression. L’eau de refroidissement est devenue extrêmement contaminée. Les barres de combustible ont besoin d’un refroidissement permanent, et c’est en continu que de nouvelles masses gigantesques d’eau contaminée s’accumulent. Non seulement l’eau mais aussi les réacteurs non protégés émettent des isotopes de césium, de strontium, de plutonium. Ils sont appelés “particules chaudes” et se retrouvent disséminés dans tout le Japon. Jusqu’ici, il n’y a pas de moyens techniques disponibles pour éliminer les déchets nucléaires accumulés à Fukushima. Le processus de refroidissement lui-même prendra de longues années. A Tchernobyl, il était nécessaire de construire un sarcophage qui devrait être démoli, au plus tard, au bout de cent ans, le temps d’être remplacé par un autre. Il n’y a pas encore de solution en vue pour Fukushima. Pendant ce temps, l’eau contaminée s’accumule et les autorités en charge ne savent pas où la stocker. Une grande partie de l’eau de refroidissement est directement déversée dans l’océan, où les courants la répandent à travers le Pacifique, et les conséquences pour la chaîne alimentaire et pour les êtres humains ne peuvent pas encore être mesurées. La côte Nord-Est du Japon, qui compte parmi l’une des plus abondantes zones de pêche est touchée, de même que le sera prochainement le détroit de Béring, avec ses réserves de saumons (1).
Parce que la densité de population dans cette région du Japon est 15 fois supérieure à celle de l’Ukraine, les conséquences sur la population ne peuvent pas encore être évaluées.
L’accident révèle ainsi que les conséquences d’une telle catastrophe nucléaire sont totalement hors contrôle. Les irresponsables politiques avaient le choix entre la peste et le choléra : soit laisser se dérouler l’accident, sans aucun moyen d’intervention, soit tenter de refroidir le cœur des réacteurs avec de l’eau de mer, mais en acceptant ainsi une plus grande propagation de la radioactivité à travers la diffusion qui a infiltré les dispositifs d’extinction. Le gouvernement, impuissant, a opté pour la contamination de l’eau de mer, par des eaux d’extinction hautement radioactives.
La décontamination : au lieu de résoudre les problèmes, ils les aggravent
Les tentatives pour se débarrasser de la terre contaminée ont fait la preuve d’un manque terrible de responsabilité et de scrupule. Jusqu’en août 2011, dans la ville de Fukushima, de 300 000 habitants, 334 cours d’école et crèches ont été nettoyées. Mais les autorités ne savent pas vraiment non plus quoi faire avec la contamination des sols. Par exemple à Koriyama, dans la région de Fukushima, les particules radioactives ont été enfouies dans… les cours d’écoles. 17 des 48 zones préfectorales du Japon, dont Tokyo, font état de sols contaminés. A seulement 20 km de Tokyo, des terres irradiées ont été enregistrées. Des milliers de bâtiments ont besoin d’être nettoyés. Même les montagnes boisées auront probablement besoin d’être décontaminées, ce qui pourrait nécessiter des coupes claires et un véritable curetage du sol. Les médias japonais ont rapporté que le gouvernement doit trouver des dépôts provisoires pour des millions de tonnes de déchets contaminés. Comme il n’existe aucune solution, certaines des décharges contaminées par la radioactivité ont été brûlées. C’est une façon de répandre encore plus la radioactivité par l’intermédiaire des fumées. Ce sentiment d’impuissance vis-à-vis de l’amas de déchets nucléaires jette une lumière crue sur l’impossibilité de la décontamination.
Selon les informations des organisations environnementales japonaises, le gouvernement prévoit de répartir les déchets contaminés de la région de Fukushima à travers le pays tout entier et de les brûler. Le ministère japonais de l’environnement évalue la quantité de déchets à éliminer à environ 23,8 millions de tonnes. Comme Mainichi Daily News en fait état, une première cargaison de 1000 tonnes de décombres de Iwate à Tokyo s’est faite début novembre 2011. Les autorités de Iwate estiment que ces décombres contiennent 133 Becquerels par kilo de matières radioactives. Avant mars 2011, cette opération aurait été illégale, mais le gouvernement japonais a établi de nouvelles normes limites en juillet de 100 Bq / kg à 8000 Bq / kg, et en octobre à 10 000 Bq / kg. La ville de Tokyo a annoncé qu’elle recueillerait pour sa part environ 500 000 tonnes de déchets radioactifs.
La décontamination nucléaire : un héritage désastreux pour l’avenir...
La caractéristique spécifique de la production d’électricité par l’utilisation de l’énergie nucléaire est que le rayonnement ne s’arrête pas une fois que les centrales nucléaires sont à la fin de leur durée de fonctionnement et sont éteintes. Le processus de fission nucléaire n’est pas terminé une fois que la centrale nucléaire a été éteinte. Que faire alors des déchets nucléaires, de toute cette matière qui a été en contact avec des matières radioactives et se trouve contaminée ? Selon la World Nuclear Association, chaque année, environ 12 000 tonnes de déchets hautement radioactifs s’accumulent. Jusqu’à la fin de 2010, environ 300 000 tonnes de déchets hautement radioactifs ont été entassés dans le monde entier. Pour le seul cas de la France, d’après le Canard enchaîné (“Nucléaire, c’est où la sortie ?”), une surface de plus d’un million de mètres cubes de sols est contaminée par les déchets radiocactifs qui y sont stockés. Le stockage géologique qui a été pratiqué ou qui est prévu dans plusieurs pays, par exemple dans d’anciennes mines, n’est rien d’autre qu’une “solution” de fortune, dont les dangers sont plus ou moins passés sous silence par les défenseurs de l’énergie nucléaire. Par exemple, en Allemagne, 125 000 barils de déchets nucléaires sont déposés dans une ancienne mine à Asse. Ces fûts sont rongés par le sel et de la saumure contaminée s’échappe déjà aujourd’hui. Les responsables ordonnent l’entassement de tous les déchets nucléaires dans des dépotoirs, laissant aux générations futures le soin de s’en accommoder.
Et le fonctionnement “normal” d’une centrale nucléaire n’est pas aussi “impeccable” que cela est sans cesse proclamé par les défenseurs de l’industrie nucléaire. En réalité, d’énormes quantités d’eau sont nécessaires pour le refroidissement des barres de combustible. Les centrales nucléaires doivent être construites au bord des rivières ou de la mer. Tous les 14 mois, dans chaque réacteur, le quart des barres de combustible doit être renouvelé. Toutefois, étant donné qu’elles sont extrêmement chaudes, après leur remplacement, elles doivent être placées dans des piscines pour y être refroidies pendant des périodes de 2 à 3 ans. L’eau de refroidissement, qui est pompée dans les rivières, amène une pollution thermique. Une algue s’y développe qui fait périr les poissons. Par ailleurs, des produits chimiques, tels que le sodium, l’acide chlorhydrique, l’acide borique, sont rejetés dans les rivières. Et enfin, cette eau est aussi polluée par la radioactivité, même si c’est seulement à petites doses (2).
A suivre…
Di (25 janvier)
1) Au Nord-Est de Fukushima, deux courants, le chaud Kuoshio et le froid Oyashio fusionnent. C’est l’un des domaines les plus abondants de la terre pour la pêche et dans cette région, les bateaux de pêche japonais attrapent près de la moitié de la quantité des poissons consommée au Japon. Ainsi, l’approvisionnement en poisson du Japon pourrait être mis en danger. puisque “Une émission aussi élevée de radioactivité dans la mer n’a jamais été mesurée”.
2) En France, si pendant les saisons sèches il n’y a pas suffisamment d’eau disponible, certaines centrales nucléaires doivent être refroidies par hélicoptère, tandis que les forêts brûlent ! (Les dossiers du Canard enchaîné, “Nucléaire : c’est où la sortie ?”, le Grand débat après Fukushima, p. 80).
Révolution Internationale n° 430 - mars 2012
- 1631 lectures
L’avenir de l’humanité ne passe pas par les urnes !
- 1272 lectures
Depuis des semaines, les joutes verbales des politiciens patentés occupent le devant de la scène médiatique. Les journaux reprennent en chœur les derniers propos provocateurs de tel homme politique fustigeant tel autre. Et puis les sondages, les sondages et encore les sondages. Bref, l’appareil électoral est en branle dans sa marche grotesque vers la grande mascarade démocratique.
Comme de coutume, toute l’attention est portée sur les propos de tel ou tel personnage politique, sur son style vestimentaire, sur sa stratégie de campagne électorale, sur les restaurants qu’il fréquente, etc. C’est la façon que la bourgeoisie a de toucher… oh pardon… de traiter le fond. Toute cette gesticulation n’a pour but que de masquer l’absence totale de propositions réelles pour améliorer la situation. La bourgeoisie, qu’elle soit de gauche comme de droite, n’a en réalité aucune alternative à proposer à l’enfoncement de cette société vers la misère et la barbarie. Gauche et droite mènent partout la même politique, attaquent partout violemment les conditions de vie. Il suffit de demander aux travailleurs vivant en Grèce, en Espagne et au Portugal ce qu’ils pensent des “socialistes”. Et à ceux qui croient que le PS français est différent, qu’ils se remémorent ce qu’ont été sous Mitterrand les années 1980 et 1990 et sa politique anti-ouvrière.
“Le moins pire” ?
Le seul argument de poids de Hollande auprès des travailleurs, des chômeurs, des précaires, des retraités…, ce n’est pas sa politique (qui sera faite d’une sévère cure d’austérité comme chacun sait), mais la nature horripilante de son concurrent nommé Sarkozy. Ce président sortant, complètement imbu de sa personne, n’hésitant pas à user de ce langage particulièrement grossier qui lui est propre, a cette incroyable capacité à concentrer dans un si petit corps autant d’aspects insupportables. Le “style Sarko” est si stérile et prétentieux qu’il représente même une menace pour la crédibilité de la bourgeoisie française dans son ensemble aux yeux de la communauté internationale. Il n’est donc pas surprenant que de nombreuses critiques viennent remplir les pages de la presse et des médias, y compris de droite.
Mais ce “nabot”, comme certains se plaisent à le nommer, est-il pire que les autres membres de sa classe ? Plus insupportable, certainement. Mais son remplaçant, si remplaçant il y a, ne mènera-t-il pas exactement la même politique anti-ouvrière ?
Les principales réformes menées depuis ces 40 dernières années sont le fruit du travail commun de la gauche et de la droite. En 1991, le fameux “livre blanc” sur les retraites de Rocard1 a constitué les prémices d’une attaque majeure contre le système des retraites. C’est sur cette base qu’a été menée la réforme de Woerth en 2010. L’actuelle loi sur la législation du travail et son fameux article 40 qui impose sans l’accord des travailleurs des conditions de travail nécessaires au patronat est une extension de la loi Aubry sur les 35 heures qui permet à l’Etat et aux patrons de rendre corvéables à merci tous les ouvriers. Ce sont les mêmes paroles de Felipe Gonzales du Parti socialiste ouvrier espagnol qui, en 2003, justifiait une réforme visant à précariser plus le travail sous prétexte que le travail n’est pas la propriété du travailleur (2).
Autrement dit, l’anti-sakozysme mis en avant pour pousser dans les isoloirs est un piège car il entretient une illusion, celle que les autres représentants politiques peuvent mener une politique différente, plus humaine et, ce faisant, elle détourne de la seule riposte possible contre les attaques : la lutte !
Voter ou lutter ?
Cette réalité que droite et gauche sont comme la peste et le choléra est comprise par une partie toujours croissante de la population. Pourtant, nombreux sont ceux pour qui il est impensable de ne pas voter. Ne pas se rendre dans l’isoloir à chaque grande messe électorale est même une chose honteuse pour la société, ceux qui avouent cette “faute” à un repas de famille ou à leurs collègues sont aussitôt montrés du doigt. Et la même phrase sentencieuse revient alors presque toujours : “Mais tu te rends compte que des gens sont morts pour qu’on ait le droit de vote ?” Qui est mort ? Quand ? Pourquoi ? Où ? Lors de quelle lutte ? Personne ne le sait mais tout le monde est persuadé que le droit de vote a été arraché au prix du sang. Quelle est la réalité ?
Au xixe siècle, la lutte ouvrière contre l’exploitation et l’oppression de la bourgeoisie passait nécessairement par une lutte pour des réformes, par d’âpres batailles revendicatives pour conquérir et arracher des améliorations possibles, réelles et durables des conditions de travail et d’existence sur le terrain économique et politique. A cette époque, le parlement pouvait être utilisé comme une tribune grâce à laquelle la classe ouvrière pouvait faire entendre sa voix, s’affirmer comme une force sociale dans un capitalisme encore florissant. De ce fait, tout en combattant les illusions sur la possibilité de parvenir au socialisme par des voies démocratiques, pacifiques, réformistes, les révolutionnaires étaient néanmoins partie prenante du combat pour l’obtention du suffrage universel. Ils appelaient les ouvriers dans certaines circonstances à participer aux élections et au parlement bourgeois pour favoriser l’obtention de telles réformes en jouant sur les oppositions entre fractions progressistes et réactionnaires de la classe dominante qui s’y affrontaient. A cette époque donc, effectivement, il y a avait des manifestations pour le suffrage universel qui étaient réprimées, souvent violemment.
Mais au xxe siècle, l’attitude de la bourgeoisie change. En France et en Belgique par exemple, les femmes accèdent au suffrage universel après la Seconde Guerre mondiale sans qu’il y ait même besoin de descendre dans la rue pour le réclamer. Dans certains pays, les travailleurs sont obligés par la loi d’aller voter, sous peine d’amende. En France, très régulièrement, cette “obligation citoyenne” est avancée par tel ou tel politique, telle que Ségolène Royal en 2007. Et lors de chaque campagne électorale, l’Etat, celui-là même qui tirait dans la foule manifestant pour le droit de vote au xixe siècle, ce même Etat paye aujourd’hui des spots publicitaires pour nous pousser tous, jeunes et vieux, chômeurs ou retraités, à aller poser notre petit bulletin dans l’urne. Pourquoi ? Pourquoi, de gauche comme de droite, tiennent-ils tous tant à nous faire voter ? La raison est simple, c’est eux qui y gagnent, à tous les coups, et non plus nous.
Depuis des décennies, le capitalisme s’enfonce dans la crise, plus aucune réforme progressiste n’est possible. Nos conditions de vie ne cessent de se dégrader. Les fractions bourgeoises n’ont plus rien à nous proposer, nous n’avons plus rien à leur réclamer. Nous n’avons qu’une seule chose à faire, faire face ensemble, collectivement, nous les exploités, aux attaques du capital et, par ce combat, découvrir que nous pouvons construire un autre monde. C’est de ce cheminement de pensée que la bourgeoisie tente en permanence de nous détourner en essayant de nous faire croire qu’il n’y a pas besoin de faire la révolution, qu’un autre capitalisme, plus humain, est possible, “il suffit de bien voter”.
Comme le proclamait un slogan des Indignés : “Nous ne sommes ni de droite ni de gauche, nous sommes ceux d’en bas contre ceux d’en haut !” Ce combat, il faudra le développer, non pas derrière les représentants patentés de la “démocratie” bourgeoise mais en prenant nos luttes en main, internationalement.
Maxime (23 février)
1) Il fut Premier ministre socialiste de François Mitterrand et est un ardent défenseur depuis toujours de la” nécessaire réforme des retraites” (entre autres) : “Michel Rocard note que la réforme menée par Eric Woerth est “non négligeable et courageuse” estimant que “le gouvernement a eu raison de la faire” mais regrettant “que le gouvernement n’ait pas suivi la voie de la négociation”. Il insiste sur le fait que de nombreux problèmes n’ont pas été tranchés, comme ceux des régimes spéciaux” (Sur le site du journal le Monde, page du 24 juin 2010).
2) Le PSOE a même poussé jusqu’à présenter cette réforme comme un concept marxiste contre la propriété privée !
Rubrique:
La tournée des bonimenteurs
- 1644 lectures
Ces dernières semaines, les candidats à l’élection présidentielle ont eu une sévère tendance à confondre les usines avec le salon de l’agriculture, serrant les paluches ouvrières et multipliant les tapes sur l’épaule comme ils caressent le cul des vaches. A ce grand bal des hypocrites, pas un n’a manqué à l’appel !
A l’extrême-gauche, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud (respectivement candidat du NPA et de LO) peuvent bien s’agiter, multiplier les déplacements de terrain, rien n’y fait, la star du moment, celle qui, devant les portes des usines, soulève les foules de micros et de caméras s’appelle Jean-Luc Mélenchon. Au chevet des salariés de Fralib (Thé Eléphant), d’Arcelor Mittal, de la Fonderie du Poitou, d’Arkéma dans le Rhône, de Petroplus et de M-Real en Normandie, de Peugeot Scooters près de Sochaux, d’Alstom à Belfort…, il est partout où une usine se meurt, prônant tout à la fois l’“interdiction des licenciements boursiers”, le remboursement des subventions publiques pour une entreprise restant moins de cinq ans en France, un “droit de préemption” de l’entreprise par les salariés en cas de fermeture… Bref, plus radical, tu meurs !
Evidemment, il était hors de question pour François Bayrou de ne pas essayer de se placer au centre (1) de cette agitation pro-ouvrière. Armé de son slogan incroyablement innovant “Produire en France” (seuls les mauvais esprits y verront une vague ressemblance avec l’appel chauvin du PCF des années 1970 : “Produire français”), le président du Modem a lui aussi visité les centres industriels comme la fonderie de Conty, dans la Somme, pour plaider en faveur d’un étiquetage systématique d’un logo “Produit en France” ce qui devrait selon ses dires susciter “une vraie mobilisation nationale”. Nous n’en doutons pas.
Eva Joly, pour une fois, a refusé de se mettre au vert et de passer son tour. Elle a multiplié elle aussi les déplacements, ciblant les PME de pointe, image de marque oblige. Nul n’ayant compris ses propositions, nous ne pouvons ici vous en faire part.
Plus mouvementées sont les visites de la fille de son père, Marine Le Pen, qui est chaque fois attendue par un comité d’accueil scandant tout le bien qu’il pense de son idéologie encore plus xénophobe et nauséabonde que celle des autres partis de droite. Elle a même été quelque peu chahutée à la porte de l’usine PSA de Sochaux le 18 janvier. Pour autant, elle y retourne car elle joue là sa carte de candidate “du peuple contre les élites”.
Mais à ce petit jeu de celui qui sera le plus fidèle ami des ouvriers, les meilleurs sont indéniablement François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ces deux jumeaux politiques, qui sur des talonnettes pourraient jouer à “grand benêt et benêt grand”, rivalisent en effet de promesses et de soudaines déclarations d’amour empathique pour “ceux qui travaillent et qui souffrent”. Et c’est fou comme ça sonne vrai :
“Perché sur le toit d’une camionnette bleue, entre trois drapeaux de la CFDT, François Hollande tend la main au délégué CGT pour l’aider à grimper. Devant l’usine sidérurgique ArcelorMittal de Florange (Moselle), toute l’intersyndicale rejoint le candidat socialiste à l’Elysée” (2). Et devant ces quelques centaines d’ouvriers, Hollande lance : “Si Arcelor ne veut plus de vous, ce qui serait un grand tort, je suis prêt à ce que nous déposions une proposition de loi pour que, quand une grande firme ne veut plus d’un outil de production, nous lui faisions obligation de le céder.” Et il continue : “Quel que soit mon avenir, soit comme président soit comme député, je reprendrai ce texte parce que je vous le dois.”
Le 20 février, Nicolas Sarkozy a mangé à la cantine de l’usine Alstom à Aytre (Charente-Maritime). Sur les photos, il affiche un air réjoui avec une petite serviette blanche à la main. Oublié le Fouquet’s et les vacances sur le yacht privé du patron Bolloré ! Il l’affirme et il le prouve, il a changé. Il a même pris soudainement conscience qu’en tant que président de la République il devait et il pouvait sauver des emplois. Il a ainsi demandé à son ami Henri Proglio, PDG d’EDF, de reprendre Photowatt (3) et à son ami et témoin de mariage (celui avec son ex femme Cécilia) Bernard Arnault, PDG de LVMH, de reprendre la très médiatique usine de fabrication de soutiens-gorges Lejaby à Yssingeaux (Haute-Loire).
UMP et PS se livrent une vraie bataille, c’est à celui qui sauvera le plus d’usines d’ici les élections : “l’annonce par Laurent Wauquiez d’un rachat par le sous-traitant de LVMH s’est faite juste après la proposition rendue publique par Montebourg d’une éventuelle reprise par l’ex-directrice de collection de la marque Princesse Tam Tam. Rarement un atelier de textile du fin fond de l’Auvergne (4)n’aura intéressé tant de repreneurs…” (5)
Ce grotesque cirque pré-électoral serait comique si, une fois les projecteurs médiatiques éteints, des milliers de familles ouvrières n’allaient pas se retrouver licenciées et démunies. Car tel est l’avenir, le vrai, celui qui va s’abattre sur notre classe. Si, en dix ans, 750 000 emplois industriels ont été détruits en France, la décennie devant nous sera plus impitoyable encore. La crise économique mondiale va ravager les bassins d’emplois, le chômage va battre record sur record. Des plans de licenciements massifs, des fermetures d’usines sont d’ailleurs déjà dans les tiroirs ministériels ; la bourgeoisie française ne fait qu’attendre que les élections passent pour redoubler ses attaques, mais elle n’attendra pas un jour de plus, que ce soit la droite ou à la gauche au pouvoir. Par exemple, tous, de la droite à la gauche en passant par les syndicats, taisent les 32 000 suppressions d’emplois qui attendent les salariés d’Orange et de SFR pour le début de l’été. Et ces mêmes syndicats discutent sans publicité depuis le 17 février avec le patronat et le gouvernement pour savoir comment faire passer sans trop de réaction une nouvelle réduction du coût du travail.
De droite ou de gauche, d’extrême-droite ou d’extrêmegauche, tous les candidats à la présidentielle sont des ennemis de notre classe et des défenseurs acharnés de ce système d’exploitation. Leurs promesses et leurs visites courtoises dans nos usines n’y changent rien. Face aux attaques qui ne manqueront pas de tomber dru sur nos têtes dès le nouveau président élu, quel qu’il soit, nous ne devons compter ni sur les partis politiques ni sur les syndicats mais sur nous-mêmes, sur notre unité et notre solidarité dans la lutte.
Pawel (3 mars)
1) Bayrou est LE candidat centriste, chouchou des médias depuis une décennie.
2) Site de Libération (http ://www.liberation.fr/politiques/01012392182-francois-hollande-a-florange-notre-messie [19]).
3) Rappelons en passant que ces dernières années, 14 000 emplois ont disparu dans la filière photovoltaïque.
4) Surtout quand on sait ce que pensent les éminents membres de l’UMP des Auvergnats…
5) Site de Libération (http ://www.liberation.fr/politiques/01012392179-la-campagne-decouvre-l-industrie [20]).
Géographique:
- France [5]
Situations territoriales:
Rubrique:
Emeutes à La Réunion : seul le développement international de la lutte peut briser le carcan de la misère
- 1713 lectures
L’explosion sociale a eu lieu alors que la majeure partie de la population de l’île de La Réunion déjà exposée à des conditions de vie dramatiques, a été confrontée à une intolérable hausse des prix. Dans ce département de plus de 800 000 habitants, le taux de chômage officiel frise les 30 % et atteint 59 % chez les jeunes de 18-25 ans ! Plus d’un habitant sur deux (52 %) vit sous le seuil de pauvreté. La nouvelle augmentation du prix des carburants dans ce département d’outremer depuis le 1er février a été le détonateur, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. La colère de la population a alors éclaté dans la soirée du 21 février au Port et dans le quartier populaire du Chaudron du chef-lieu Saint-Denis à l’issue d’une journée de grève et de manifestations, virant à l’émeute et à des affrontements de plus en plus violents avec les forces de police appelées en renfort (600 policiers et gendarmes ont été déployés). Ces émeutes et affrontements qui ont culminé dans la nuit du 23 au 24 se sont rapidement propagés, comme une traînée de poudre, à plusieurs communes de l’est et du sud du département. Plusieurs commerces et bâtiments publics ont été saccagés, des poubelles et quelques voitures ont été brûlées, souvent par des bandes de gamins entre 12 et 16 ans. Il y a eu une dizaine de blessés mais plus de 200 personnes, surtout des jeunes, ont été arrêtées et pour la plupart assignées à comparution immédiate devant les tribunaux. Les jeunes émeutiers se sont vus infliger de très lourdes peines “pour l’exemple”, allant de 6 mois à 2 ans de prison.
Le mouvement avait démarré avec la revendication très corporatiste des transporteurs routiers organisant des barrages pour obtenir une réduction de 25 centimes le litre des prix à la pompe. Devant l’échec des négociations, à partir du 17, les routiers ont bloqué l’unique dépôt de carburant de l’île. Puis les chauffeurs routiers ont désavoué le président de leur syndicat, la FNTR quand celui-ci a annoncé la signature d’un accord pour une nouvelle table ronde avec l’Etat et les pétroliers et ils ont lancé un appel à la mobilisation de la population “contre la vie chère”. Cet appel a eu un très large écho car pour beaucoup de familles, la voiture est l’unique moyen de transport (il y a 400 000 véhicules, soit une voiture pour 2 habitants) car le réseau de transports publics est quasiment inexistant : pas de réseau ferré, et des bus non fiables. Ainsi, entre l’assurance, l’entretien et le prix du carburant, la voiture absorbe entre 30 et 50 % du budget des familles. Par ailleurs, dans les grandes surfaces, la nourriture est plus chère qu’en métropole alors que le salaire médian est de 950 € (contre 1600 € en France métropolitaine) ; les légumes sont à des prix exorbitants : les champignons de Paris à 13,95 € le kilo, l’artichaut est vendu 2.35 € pièce, le kilo de la viande de bœuf atteint 24 € et la simple cuisse de lapin est à 7,35 €. Certaines denrées de consommation courante voient leur prix littéralement exploser, comme par exemple le produit vaisselle qui a grimpé jusqu’à 6,70 € le litre. La semaine suivante, le préfet, pour calmer la pression, a promis une baisse de prix des carburants, du gaz et de 60 produits de première nécessité (dont 48 alimentaires), garantis stables jusqu’à… la fin de l’année alors que les salaires seront bloqués pour une période de 3 ans au minimum… ce qui laisse la population très sceptique : “C’est rien du tout ! En 2009, on avait arraché à la grande distribution des diminutions sur 250 produits” (1) déclarait le président de l’Alliance des Réunionnais contre la pauvreté et les effets de cette baisse se sont évaporés en quelques mois. D’ailleurs l’Observatoire des prix et des revenus réunissant associations de consommateurs, syndicats, administrations, représentants de l’Etat, des patrons et de la grande distribution qui publie officiellement la liste des produits qui doivent baisser n’est pas crédible et attire cette réflexion : “C’est du bidon ! L’observatoire n’a jamais permis la moindre avancée sur la transparence des prix” (2). Pour beaucoup, la baisse de prix est un leurre. Il y a de bonnes raisons qui justifient cette méfiance généralisée : la baisse des prix des carburants et du gaz est financée par les collectivités, donc ponctionnée sur les impôts. Un habitant déclarait que c’était une vulgaire arnaque pour faire diversion, la baisse promise concerne surtout des produits qui venaient de subir une très forte augmentation début février : “Ils ont augmenté les prix il y a quinze jours. Je le sais. Je fais tous les supermarchés” (3). Un autre surenchérissait dans le même sens : “les prix ont même monté pendant les grèves. Ca va être des conneries, la baisse !” (4). Déjà touchée par des émeutes récurrentes notamment en 1991 puis en 2009 et alors que les conditions de vie se sont encore dégradées, un mouvement de résistance “démocratique” pour éviter les débordements a déjà été mis en place depuis les précédentes émeutes il y a 3 ans sur le modèle du mouvement en Guadeloupe du LKP et de son collectif contre la “profitation” : le COSPAR (Collectif des organisations syndicales politiques et associatives de La Réunion) dans lequel grenouillent tous les notables politiques et syndicaux pour encadrer ceux qui se nomment eux-mêmes “les indignés du pays” ou les “gouttes d’eau”. Parmi ceux-ci qui se rassemblent devant les mairies en signes de protestation, filtre l’idée exprimée par cette manifestante : “Nous, on reste pacifiques ; mais on comprend les jeunes qui cassent, il n’y a que ça qui marche !” (5). En réalité, les émeutes comme les illusions “démocratiques et citoyennes” conduisent vers le même sentiment d’impuissance alors même que l’Etat, les politiques et les syndicats attisent la division entre prolétaires en prenant comme boucs-émissaires les fonctionnaires qui bénéficient d’une prime de vie chère représentant entre 30 et 53 % du salaire de base, alors qu’un fonctionnaire faisait ce constat désabusé : “On sait bien que tôt ou tard, ce privilège va sauter” (6). La division entre privé et public permet de dévoyer le combat en prenant pour cible précisément ceux qui seront les victimes de la prochaine attaque d’ores et déjà annoncée. Tout cela ne peut qu’entraîner une masse croissante de prolétaires vers le bas.
Pour que ces luttes ne sombrent pas dans des émeutes désespérées et que les prolétaires ne soient pas condamnés à subir la misère toujours plus grande et la répression toujours plus forte, il est nécessaire que ces luttes s’inscrivent dans une toute autre perspective d’un combat non pas localiste mais international et qu’elles soient reliées au combat de leurs frères de classe pour sortir de l’ornière de l’isolement insulaire. Ce n’est que le développement du combat au cœur des métropoles du monde capitaliste qui pourra porter un avenir et ouvrir une perspective, là où sont aussi à l’ordre du jour la même lutte et la même nécessité de résister contre la vie chère et contre l’ensemble des attaques de la bourgeoisie.
W (2 mars)
1) Libération du 27 février 2012.
2) Idem.
3) Le Monde daté du 1er mars 2012.
4) Idem.
5) Libération du 27 février 2012.
6) Le Monde du 1er mars 2012.
Géographique:
- France [5]
Situations territoriales:
Rubrique:
Drame à Port-Saïd en Egypte : une provocation policière pour bâillonner la révolte populaire
- 1387 lectures
Le 2 février dernier, le match de foot qui opposait les équipes de Port-Saïd et du Caire s’est terminé dans un bain de sang : 73 morts et un millier de blessés ! La fin du match était tout juste sifflée par l’arbitre que des supporters locaux, ou prétendus tels, dont l’équipe était pourtant gagnante, ont envahi le terrain et les gradins, agressant avec une violence inouïe joueurs et supporters de l’équipe adverse. Tandis que cette folle mêlée se déroulait, à coups de pierres, de bouteilles, de fusées de feux d’artifice dirigées directement contre les gens dont le plus grand nombre est mort étouffé ou écrasé par le mouvement de foule devenu délirant, la police n’est pas intervenue. Alors que les matches de football sont l’occasion de nombreux et brutaux accrochages entre supporters et, de ce fait, surveillés comme le lait sur le feu par les forces de l’ordre, de nombreuses questions se posent sur leur attitude le 2 février. De l’avis de nombreux observateurs et de témoins, la police a largement laissé faire ce déferlement de haine. Curieusement, on voit des photos de policiers totalement passifs, tournant le dos à l’agitation générale, comme si de rien n’était ; et la question se pose clairement de savoir s’il ne s’est pas agi carrément d’une provocation bien orchestrée, avec des flics infiltrés chez les supporters de Port-Saïd pour “agiter l’ambiance” et pousser au massacre. “Il s’agit d’une guerre programmée”, a accusé le docteur Ehab Ali, médecin de l’équipe de Port-Saïd, devant la passivité des forces de sécurité qui a duré une heure entière (1).
Une première chose est évidente, c’est que le nouveau gouvernement voulait adresser un message aux opposants du nouveau régime composé de l’armée et des Frères musulmans, à travers cette attaque visiblement programmée contre les supporters du club du Caire (Ahly). Ces derniers, dont la plupart sont fils d’ouvriers, ont été des acteurs de premier plan, entre autres, de la lutte contre Moubarak et très présents dans les affrontements avec la police de la place Tahrir. Ils se considèrent eux-mêmes comme faisant partie des “ultras”, c’est-à-dire des plus radicaux d’une jeunesse rebelle qui aspire à un changement réel en Egypte. Un de leur mots d’ordre favoris est : “A bas le régime militaire”, et un de leurs hymnes préférés : “All Cops Are Bastards” s’exprime dans de nombreux tags par l’acronyme “ACAB”. Ils diffusent même un pamphlet intitulé : “Les crimes contre les forces révolutionnaires n’arrêteront ni n’effrayeront les révolutionnaires”.
Lors du match du 2 février, les supporters de Port-Saïd criaient des slogans opposés à ceux du Caire mais en soutien au Conseil militaire des Forces Armées (CSFA) au pouvoir, et ce qui aurait pu être un épisode tragique de plus de la folie nationaliste ou localiste qui gangrène le sport et ses supporters, copieusement alimentée par les médias (2), s’est révélé être une véritable “leçon” pour les opposants au régime en place.
Car elle n’était pas destinée qu’à cette jeunesse qui compose les supporters de foot auto-proclamés “ultras”, et chez lesquels nombre d’entre eux avaient décidé de “faire l’unité” entre différents clubs pour se rassembler autour de l’opposition au régime de l’après-Moubarak, mais voulait être également et surtout un message pour toute la population égyptienne (3).
Cette dernière ne s’y d’ailleurs pas trompée car, au lendemain de ces évènements, Le Caire et d’autres villes ont été le théâtre d’affrontements très violents au cours desquels la police était mise en cause et a tiré à balles réelles et à coups de chevrotines, et qui ont duré deux jours. Dans la capitale, le ministère de l’Intérieur a été assiégé de longues heures et même attaqué par la foule, dans les rangs de laquelle il y a eu officiellement trois morts et des centaines de blessés. La colère était particulièrement grande parmi la population. “Ils savent protéger un ministère, mais pas un stade !”, lançaient des manifestants. Ou encore : “Le peuple veut l’exécution du maréchal Tantaoui ! Dégage !”
Cependant, cette réaction tout à fait légitime de la population est une impasse et tombe dans le piège de la réponse à la répression par l’émeute, même si elle peut largement se comprendre. D’ailleurs, immédiatement après le macabre match de Port-Saïd, la ville était quadrillée par l’armée, et déployée dans la plupart des villes principales du pays, preuve que le pouvoir savait ce qu’il faisait, qu’il s’attendait à des émeutes et les avait prévues.
Il ne faut pas rêver. Ce n’est pas par le combat populaire dans les rues, aussi “ultra” soit-il que nous pourrons changer cette société, et il ne suffira pas à réaliser des “révolutions”. Rappelons que ce qui a changé la donne en Egypte et fait partir Moubarak l’an dernier est lié à la révolte populaire mais aussi et surtout aux grèves ouvrières qui ont progressivement gagné le pays et fait naître une peur réelle au sein de la bourgeoisie égyptienne et internationale, celle de la lutte de la classe ouvrière. C’est la bourgeoisie égyptienne et américaine qui a accéléré le départ du vieux dictateur égyptien, pour qu’elle ne prenne pas le pas sur les mouvements seulement “démocratiques” dans le pays et qu’elle ne serve pas d’exemple à suivre pour les prolétaires du monde entier comme seule vraie perspective pour le renversement du capitalisme.
Wilma (17 février)
1) Henri Michel, qui a entraîné l’équipe égyptienne de Zamalek en 2007 et 2009, déclarait sur RTL : “Je n’ai jamais senti ce danger-là, je ne l’ai jamais senti autour d’aucun terrain en Egypte. La passion est exacerbée, il peut y avoir des accidents mais de là à arriver à ce drame-là, jamais on n’aurait pu y penser.”
2) Il n’y a qu’à voir le temps ahurissant accordé à “l’information sportive” sur les antennes de tous genres, ainsi que les qualificatifs les plus délirants et patriotiques qui accompagnent le galimatias verbal des commentateurs sportifs, que ce soit même dans la défaite.
3) Ce n’est d’ailleurs probablement pas un hasard si ces évènements de Port-Saïd, pour mieux frapper les esprits, se sont passés alors que des manifestations massives étaient prévues devant l’assemblée du peuple en commémoration de la “bataille des chameaux” du 2 février 2011, au cours de laquelle des hommes de main du régime Moubarak avaient attaqué les manifestants place Tahrir.
Géographique:
- Afrique [23]
Rubrique:
Pour un mouvement unitaire contre les coupes et la Réforme du Travail! (tract diffusé en Espagne)
- 1716 lectures
Nos camarades d’Accion Proletaria (section du CCI en Espagne) diffusent depuis la mi-février le tract traduit ci-dessous.
Après les dures attaques du gouvernement du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), voici le Parti populaire (PP) de droite qui lance depuis deux mois les coups les plus mauvais de ces cinquante dernières années :
– forte augmentation des impôts qui va entraîner une perte de 3 à 5 % des revenus pour les salariés, les retraités et les chômeurs ;
– avalanche de coupes dans les budgets des régions surtout dans les secteurs de la santé, des services sociaux et de l’éducation ;
– réforme du code du travail qui réduit l’indemnisation pour cause de licenciement à 33 jours (au lieu de 45 jours jusqu’alors) pour une année de travail, et qui laisse la porte ouverte à la généralisation des licenciements avec seulement 20 jours d’indemnités. Cette réforme permet aussi aux entreprises les licenciements sans autorisation administrative, elle consolide et élargit la loi du gouvernement (socialiste !) précédent qui permet des contrats précaires (“contrats-poubelle” comme on dit en Espagne) d’une durée allant jusqu’à 3 ans et, ce qui est encore plus grave, elle autorise les entreprises à réduire les salaires sans aucune restriction.
Par ailleurs et en tant “que hors d’oeuvre” de cette réforme du code du travail, les syndicats et le patronat ont signé un pacte à peine quelques jours plus tôt pour le gel des salaires jusqu’en 2014, en donnant la possibilité aux entreprises de sortir de ce pacte selon leur bon vouloir.
Ces agressions ont lieu en pleine montée du chômage, avec une multiplication des licenciements (1) et une prolifération des impayés et des retards dans le payement des salaires allant jusqu’à 6 mois.
Il y a une forte indignation, la combativité et les initiatives de lutte “venant d’en bas” ont tendance à augmenter. Cependant, il est nécessaire de comprendre dans quelles conditions cela se produit. Aussi, il faut se poser quelques questions : Comment le gouvernement, l’opposition et les syndicats se situent face aux travailleurs ? Quelle est la conscience de ceux-ci ? Dans quelle mesure les graines plantées par le mouvement social du 15-Mai peuvent-elles favoriser aujourd’hui leur lutte ?
La région de Valence a vécu 2 grandes manifestations : le 21 janvier (pour le secteur de l’éducation) avec 80 000 personnes à Valence et 40 000 à Alicante et le 26 janvier (pour tout le secteur public) avec 100 000 à Valence, 50 000 à Alicante et 20 000 à Castellon. À la suite de ces manifestations, la mobilisation a continué dans des collèges, des lycées, des quartiers…
Et même si la région de Valence a été temporairement la cible principale des attaques, les luttes tendent à augmenter dans les autres régions. À Madrid : manifestation des pompiers, des fonctionnaires et rassemblements contre la réforme du code du travail le jour même de son adoption ; à Bilbao manifestation du secteur public ; 100 000 manifestants à Barcelone venant de tous les secteurs ; dans cette même ville, les travailleurs des écoles primaires se rassemblent, avec des parents et des enfants, devant le gouvernement régional ; il y a eu une manifestation massive du secteur public à Tolède ; 10 000 manifestants à Vigo en solidarité avec le chantier naval ; marche des travailleurs de Ferrol vers La Corogne…
Une confrontation soigneusement préparée
Contrairement à tout ce qu’on veut nous faire croire, nous ne sommes pas des citoyens égaux, la société est divisée entre une classe minoritaire qui possède non seulement les moyens de production mais aussi l’Etat (2), et une immense majorité qui ne peut compter qu’avec sa conscience, sa solidarité, son unité et la force du nombre.
Nous allons vers des affrontements dont l’importance est difficile à prédire, mais ce qui est évident c’est que la minorité – le Capital et son Etat – a préparé un piège politico-idéologique pour bloquer la mobilisation des travailleurs.
Les réajustements se mènent d’une manière échelonnée, région par région, paquet par paquet : en janvier 2011, c’est la région de Murcie qui a commencé ; depuis juin c’est la Catalogne ; en septembre la région de Madrid et maintenant c’est le tour de la région de Valence ; plus tard ce sera, sans doute, le tour de l’Andalousie. Autrement dit, c’est une attaque générale qui apparaît comme une succession d’attaques régionales sans rapports entre elles, en faisant en sorte que les travailleurs luttent bien enfermés chacun dans leur région (3).
Par ailleurs, on manipule la division “traditionnelle” entre les travailleurs du secteur public et du secteur privé. On présente les premiers comme des privilégiés et on essaye de leur faire gober une telle propagande, et c’est ainsi que les syndicats leurs disent, pour se faire “pardonner” en quelque sorte, qu’ils devraient renoncer aux revendications sur leurs salaires et leurs conditions de vie pour ne se concentrer que sur la défense du service public dans l’éducation ou dans la santé.
Cette différence entre travailleurs du public et ceux du privé est totalement battue en brèche par la réalité elle-même : 40 % des travailleurs du public sont des intérimaires, à telle enseigne qu’il y a davantage de précarité dans le secteur public que dans le privé. Les travailleurs du privé par le biais de la réforme du code du travail et les travailleurs du public par celui des coupes et des réductions en tout genre partagent la même réduction de salaires, la même menace généralisée de chômage (4), la même dégradation des conditions de travail. Les coupes sont comme un couteau à double tranchant : avec un coté on taillade les salaires et les conditions de travail des travailleurs du public ; avec l’autre on réduit les services indispensables en les dégradant aux niveaux les plus bas. Les coupes et la réforme du travail ne sont pas des faits reliés à des réalités différentes, mais elles font partie d’une ATTAQUE GLOBALE contre TOUS LES TRAVAILLEURS.
Les syndicats ne nous représentent pas
Lors du mouvement du 15-Mai des critiques très dures se sont exprimées vis-à-vis des syndicats, surtout contre le tandem Commissions ouvrières -Union générale des travailleurs (CO-UGT).
Ce n’est pas pour rien ! D’un coté ces syndicats signent tout ce que le patronat et le gouvernement leur mettent sur la table, mais de l’autre coté, et c’est là le pire de leur boulot, ils organisent des luttes factices qui engendrent la démobilisation et la division au sein des travailleurs, en les amenant à la défaite.
Le capital et son État emploient leurs deux mains contre les ouvriers : avec la droite, gouvernement et patronat abattent des coups de hache, tandis qu’avec la gauche, syndicats et opposition les poussent à mettre la tête sur le billot.
À Madrid, de la main droite, la présidente de la région, Aguirre, a attaqué les travailleurs de l’enseignement avec 3000 licenciements et un allongement du temps de travail, alors que de la main gauche, l’alliance entre 5 syndicats (qui va des CO-UGT jusqu’aux syndicats de droite tels que CSIF ou AMPE) a fait l’impossible pour boycotter les assemblées de base, en contrariant par tous les moyens leur coordination, et, enfin, en dévoyant et en épuisant la lutte vers la fausse dichotomie public-privé, ce qui a permis de faire passer tout ce que le gouvernement régional voulait.
Maintenant, avec les mobilisations à Valence, on nous ressert le même plat : de la main droite, le gouvernement du PP impose des coupes très dures tandis que, de la main gauche, on nous parle de corruption et de gaspillage, en occultant le fait que la crise est globale et mondiale. Avec cela, on essaye de nous isoler entre les quatre murs de chaque région, en demandant de renoncer aux revendications “égoïstes”.
Il est significatif que, face à la prétendue réforme du travail, les syndicats adoptent un profil bas, en essayant d’éviter par tous les moyens que la nécessité d’une lutte vraiment unitaire ne devienne une évidence. Leur politique consiste à échelonner leurs “réponses” pour qu’elles soient le plus fragmentées possibles, pour qu’on ne voit pas le lien entre les coupes sociales et la réforme du travail, entre tout cela et le chômage déchaîné, pour qu’on ne comprenne pas que nous nous trouvons face à des manifestations d’une même et unique crise du système.
Ils ont choisi la tactique de l’usure dans l’isolement pour les employés publics de la région de Valence (comme ça a été fait pour leurs camarades de Murcie, Madrid et Barcelone), ils misent sur leur défaite et alors ils lanceront “une mobilisation générale” contre la réforme du code du travail qui traînera comme un boulet cette défaite préalable.
Les travailleurs peuvent-ils briser cette stratégie hostile qui leur est imposée ?
Après 5 ans de crise, les souffrances sont de plus en plus grandes et la seule chose qu’on voit à l’horizon c’est encore plus de “réajustements”, encore plus de chômage, encore plus de misère... La droite promet – comme le PSOE l’avait fait auparavant – une “sortie de la crise” si on consent à de durs sacrifices, la gauche et les syndicats parlent “d’une issue possible” si l’État mettait son veto “pouvoir démesuré des financiers” et s’il “libérait des ressources budgétaires” pour les créations d’emploi, etc. Mais, est-ce qu’on peut croire en de telles “issues” quand on voit qu’après les “réajustements” arrivent les coupes et après les coupes, les coups de ciseaux dans une chaîne sans fin ? Est-ce qu’il est réaliste de rechercher des “issues” à l’intérieur d’un système qui n’en offre pas ?
Que faire ? Les luttes, même les plus massives, ne réussissent pas à rendre plus vivable la situation. Mais ne pas lutter est encore pire parce que nous perdons notre dignité, nous sommes humiliés en permanence.
Nous devons lutter ! L’acquis principal de la lutte est la lutte elle-même. La lutte est une école où nous prenons conscience des moyens dont nous disposons, de qui sont nos ennemis et nos faux amis, des pièges qu’ils utilisent contre nous. La lutte, si elle est capable de s’auto-organiser à travers des assemblées massives et ouvertes aux autres prolétaires, permet de développer la communication, l’empathie, la discussion et une prise de décisions basée sur la responsabilité et l’engagement de tous. Face à une société qui nous inocule le poison de la concurrence entre nous, les assemblées nous fournissent l’antidote : apprendre à agir ensemble, à prendre nos affaires en mains.
La lutte fait que des foules investissent les rues et les places, nous fait découvrir la possibilité d’AGIR ENSEMBLE et si nous arrivions à le faire à une échelle internationale, nous pourrions réaliser que nous sommes une force capable de transformer le monde, qu’un autre monde différent du capitalisme est possible, parce que, même s’ils sont très puissants et disposent de moyens terrifiants, ils ne sont qu’une minorité parasite dont l’existence dépend entièrement de notre travail collectif et associé.
Avec les luttes qui se déroulent en Italie, en Grèce et ailleurs nous avons pu voir des initiatives, encore minoritaires, qui vont dans cette direction.
À Alicante, plusieurs collèges d’enseignement ont décidé de s’unir en assemblées regroupées à l’échelle géographique, d’organiser des cortèges de rue pour mobiliser tout le monde et marcher ensemble avec une pancarte commune lors des manifestations ; ça fonctionne comme une assemblée ouverte qui, périodiquement, organise des réunions où se rejoignent des travailleurs des services socio-sanitaires, de l’enseignement, du gaz, du nettoyage, etc. À Castellón, le mouvement du 15-Mai a convoqué une assemblée sur la place centrale pour lutter contre les coupes budgétaires. Des travailleurs des crèches et des écoles primaires de Valence ont fait un rassemblement avec les parents et les enfants devant le gouvernement régional. Des assemblées du 15-Mai des cités-dortoirs du sud de la ville de Valence appellent à une manifestation conjointe pour le 18 février contre les coupes et contre la montée des taxes municipales. Dans plusieurs quartiers et villes de la banlieue de Valence, des assemblées de zone se sont organisées qui coordonnent des écoles et des lycées. Appelée “lundis au soleil” (5), c’est une initiative de regroupement de chômeurs qui s’est concrétisée à Valence – et ailleurs en Espagne –, encore très minoritaire. Dans plusieurs villes d’Espagne, il y a aussi eu des rassemblements en solidarité avec les travailleurs grecs.
Lors d’une assemblée de professeurs de Valence dont le présidium était occupé par les syndicats, il y a eu une forte tension entre ceux-ci et les travailleurs. Une intervention a mis clairement en avant la nécessité de s’organiser en assemblées horizontales. Plusieurs interventions ont “mis en garde” les syndicats contre “toute trahison” et contre “toute signature comme ils en ont l’habitude”.
Pour le 20 février, ont été programmées des occupations dans les centres d’enseignement, les délégués de deux lycées ont proposé de faire “une seule occupation centrale” dans le lycée Luis-Vives (en plein centre ville de Valence) où tout le monde pouvait se rendre, autant les travailleurs de l’enseignement que ceux de la santé, les chômeurs etc. On y a proposé que ce soit une occupation pour créer un espace de débats, de rencontres et d’unité qui pourra continuer pendant quelques jours. Les syndicats ont tout fait pour freiner une telle initiative, mais elle a fini par être approuvé… après deux votes !
On voit bien comment les syndicats essayent d’occuper le terrain social, mais on voit aussi, simultanément, un élan, un développement d’initiatives de la part des travailleurs qui essayent de mener une lutte efficace, tout en essayant de la prendre en main. Il y a une forte aspiration à LUTTER ENSEMBLE. Nous avons besoin d’une même lutte contre les coupes sociales, contre le chômage et la prétendue réforme du travail ; une même lutte pour une santé, une éducation et des services sociaux vraiment humains et de qualité.
Notre mouvement est à la fois ancré dans le présent et dans le futur. Il est du présent pour résister aux coupes et autres réformes. Il est du futur pour répondre à des questions dont dépend l’avenir : de quelle société avons-nous besoin comme alternative à celle que nous subissons actuellement ? Comment pouvons-nous y arriver ? Comment pourrons nous faire fonctionner l’éducation, la santé, les services sociaux, les services culturels, etc. ?
CCI (15 février)
1) Spanair et Air Nostrum (deux compagnies aériennes low-cost) ont licencié quelques 5000 travailleurs ; les chantiers navals de Ferrol sont menacés de fermeture avec 6000 travailleurs concernés directement et 10 000 en sous-traitance.
2) L’État n’est pas “à tous”, et il n’est pas non plus neutre. C’est une machine bureaucratique et répressive au service de la minorité dominante qui prend sa légitimité tous les quatre ans par le biais de la farce électorale. Comme cela était scandé dans le mouvement du 15-Mai “on l’appelle démocratie et ce n’est pas le cas”, “c’est une dictature et on ne le voit pas”.
3) Prenons l’exemple de la Région de Valence. Il est vrai que le gouvernement régional est très corrompu, mais comme le disait un tract d’un Collectif de travailleurs de Valence “Il est plus que clair qu’une grosse partie de la classe politique est une bande grotesque de profiteurs du genre coq vaniteux comme de nouveaux riches (Gürtel, Emarsa, Brugal, Aerocas, le scandale des ERE en Andalousie...). Mais ces abus sont la conséquence d’un système social qui prend l’eau partout dans le monde. Les coupes sont générales : en Catalogne, à Madrid, en Castille-La Manche, partout en Espagne !, mais aussi au Portugal, en Grèce, aux USA, en Grande-Bretagne ! La crise de la dette a mis à nu l’échec d’un système dont le seul but est le profit, ce qui favorise la spéculation et l’investissement dans les secteurs financiers et immobiliers, ce qui a fini par créer une bulle qui au moment d’éclater nous a tous éclaboussé”.
4) En Grèce, on a déjà commencé à licencier les fonctionnaires avec un poste de travail sûr.
5) Ce nom est sans doute emprunté au titre d’un film qui racontait les luttes et la vie des chômeurs à Vigo, à la suite d’une gigantesque vague de licenciements dans les chantiers navals [NdT].
Vie du CCI:
Géographique:
- Espagne [25]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [15]
Rubrique:
Pourquoi nous considèrent-ils comme leurs ennemis ?
- 1685 lectures
Nous traduisons ci-dessous un article publié dans Acción Proletaria, organe de presse du CCI en Espagne, à propos des déclarations faites par un chef de la Police sur la répression des lycéens et des étudiants à Valence. Ces déclarations sont effectivement bien éclairantes...
Lors d’une conférence de presse, à la question sur le nombre de policiers employés pour réprimer les étudiants, le chef supérieur de la police de la Région de Valence a répondu : “Il n’est pas prudent, du point de vue de la tactique et des forces de police mises en œuvre, que je dise à l’ennemi quelles sont mes forces et mes faiblesses” (1).
Il faut remercier ce haut fonctionnaire de la police pour la grande leçon de marxisme qu’il vient de donner : un, on nous considère comme des ennemis, et deux, on est impliqués dans une guerre dans laquelle il faut avoir une tactique et où il faut cacher ses propres faiblesses.
Par contre, les politiciens de tout poil, les syndicalistes, les idéologues, les table-rondiers (2) spécialistes en tout genre, prêchent dans l’autre sens : d’après eux, on ferait partie d’une communauté de “citoyens libres et égaux” dans laquelle l’État et ses différentes institutions – dont la police – seraient au “service de tous”. Lorsque le plus hauts responsables de l’État sont obligés de prendre de mesures extrêmement dures, ce serait pour le “bien de tous”. Ainsi la réforme du code du travail serait faite pour “favoriser les chômeurs” et, avec les coupes et autres restrictions, ils essaieraient de préserver “l’État providence”.
Les déclarations du grand chef de la police démentent radicalement de tels discours fumeux. Ce qui s’en dégage c’est, d’abord, que nous ne sommes pas des citoyens libres et égaux, mais que nous sommes divisés entre une classe minoritaire qui possède tout et ne produit rien et une classe majoritaire qui n’a rien et qui produit tout. Et, deuxièmement, que l’immense toile d’araignée bureaucratique que tisse l’Etat, n’est pas au “service des citoyens”, mais qu’elle est le patrimoine exclusif et excluant de cette minorité privilégié, ce qui fait que celle-ci considère comme des ennemis les manifestants qui luttent et qu’elle conçoit ses propres agissements comme une guerre contre l’immense majorité.
On va nous dire que cette haute autorité est de droite et que la droite a une conception patrimoniale de l’Etat et qu’elle ne cache pas son égoïsme et sa vénalité. Cependant, quand on regarde la carrière politique de cet individu haut gradé, on apprend qu’il l’avait commencé au sein de la Brigade politico-sociale à la fin du franquisme et qu’en 2008 il a été nommé à son poste actuel par le ministre de l’Intérieur d’alors, le sieur Rubalcaba, lequel, aujourd’hui chef de l’opposition socialiste, utilise des tons d’une radicalité hautement incendiaire. Dans cette fonction, le chef de la police de Valence était sous le commandement d’un ancien membre du parti dit “communiste” et avocat du travail du syndicat CO, le sieur Peralta. C’est sous leur commandement qu’a eu lieu l’épisode répressif bien connu contre des manifestants dans le quartier des pêcheurs d’El Cabañal (3). Il s’agit donc de quelqu’un qui a servi l’État sous des gouvernements de toutes les couleurs. Ses agissements ne sont pas du tout le fruit d’un “réflexe fasciste de la droite”, mais c’est bien une action d’État, qui a une logique et une continuité qui va bien au-delà de l’étiquette politique du parti aux commandes aujourd’hui.
Il faut se rappeler, pour ne parler que de l’Espagne, que sur les 35 années “d’Etat démocratique”, c’est pendant 21 ans que le gouvernail a été tenu par le PSOE. Ce n’est pas la peine de parler du mandat entre 2004 et 2011 parce qu’il est toujours présent dans les mémoires. En ce qui concerne le premier gouvernement “socialiste”, celui de monsieur Gonzalez (1982-96), rappelons qu’il fut le responsable de 3 assassinats de manifestants ouvriers (Bilbao en 1984, Gijón en 1985 et Reinosa en 1987) et de la destruction d’un million d’emplois.
L’actuel ministre de l’Intérieur, Fernández Díaz, a essayé d’arranger les choses en disant qu’il s’agissait d’un… lapsus. Or, un lapsus consiste à dire involontairement ce que l’on pense… réellement !
La société capitaliste se caractérise par l’hypocrisie et le cynisme les plus repoussants et, en cela, la classe dominante est passée maître. Il n’y a qu’à voir les campagnes électorales où sont affirmées mille promesses par tous les candidats pour appliquer, une fois élu, la politique contraire. Dans le secret de leurs bureaux, les hauts mandataires de la bourgeoisie, classe qui ne représente qu’une petite minorité des populations, parlent tranquillement de tout ce qu’ils vont démentir, nier ou déformer devant les micros. Mais, de temps en temps, un lapsus malvenu, c’est comme une légère déchirure de rideau par laquelle on peut observer ce qu’ils pensent vraiment et qui traduisent leurs vrais mobiles ou leurs crapuleuses machinations contre l’immense majorité, en particulier contre leur pire ennemi, la classe ouvrière, auquel il sont contraints de livrer une guerre permanente.
CCI (23 février)
1) El País, 21 février, supplément pour la Région de Valence.
2) Par ce néologisme, nous voudrions traduire le mot “tertuliano”. Sont nommés ainsi, en espagnol, ces personnages spécialistes en tout et surtout en rien qui pullulent dans ces émissions de débat à la TV, où ils donnent leur avis ou plutôt vomissent leurs sentences de “bon sens”.
Géographique:
- Espagne [25]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [15]
Rubrique:
Mouvement des Occupy à Zurich : quand l’épuisement s’empare du mouvement
- 1237 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article réalisé par nos camarades de Welt Revolution, organe de presse du CCI en Allemagne et en en Suisse.
En réponse à la crise économique, des gens en colère et indignés se sont, en Suisse aussi, rendus le 15 octobre 2011 à la première assemblée générale (AG) du mouvement Occupy. Les rassemblements hebdomadaires ultérieurs devant les grandes banques sur Paradeplatz (la place d’Armes) à Zurich se sont inspirés des mouvements internationaux numériquement beaucoup plus importants, tels les Indignados en Espagne ou Occupy-Wall Street aux États-Unis. Le mouvement Occupy, très hétérogène, est l’expression de l’émergence internationale d’une réflexion et d’une révolte par rapport à l’impasse de la société capitaliste. En dépit de la tendance convergente au plan international de se focaliser (de façon souvent bien trop restreinte) sur le “monde de la finance”, des expériences tout à fait diverses se déroulent dans différents pays, méritant d’être répercutées au niveau international. Et cela justement au moment où la traversée du désert et les désillusions au sein du mouvement Occupy apparaissent partout clairement. Nous voulons donc faire partager ici quelques expériences tirées de notre participation aux activités d’Occupy.
“Faites des propositions pour un capitalisme plus juste” ou les pièges de la démocratie
Comme à New York et dans d’autres villes aux Etats-Unis, le 15 octobre, Paradeplatz s’est transformée en village de tentes, mais au bout de deux jours, menacé d’expulsion par la police, le “village” a du se déplacer dans le Parc central Lindenhof. Le mouvement Occupy à Zurich ne s’est pas trouvé dès le départ confronté à la répression directe comme en Espagne, mais bien plus à la politique de tentative d’intégration au système classiquement utilisée par la classe dirigeante en Suisse visant, à l’aide de la “démocratie directe”, à émousser toute résistance au capitalisme. Et justement en Suisse, la classe dirigeante a tiré la leçon des événements du début des années 1980 qu’il ne lui est pas possible d’étouffer les mouvements sociaux en recourant à la seule brutalité mais qu’elle peut y parvenir bien mieux en offrant des possibilités de participation au système.
Hypocritement, les dirigeants des banques et le gouvernement ont ainsi montré leur “compréhension” envers les préoccupations du mouvement Occupy. Les militants Occupy ont immédiatement été invités à l’une des plus importantes émissions politiques à la télévision ayant pour objectif de réfléchir en concertation avec les principaux banquiers et des professeurs quant aux moyens possibles afin d’améliorer le système financier ; les dirigeants d’aujourd’hui ne pouvant exclusivement adopter l’attitude arrogante du “tout va bien”. Au cours de cette phase initiale, les attaques de la presse bourgeoise se sont principalement restreintes à l’allégation d’absence de propositions politiques concrètes de la part d’Occupy.
Lorsque le mouvement Occupy, dans son enthousiasme du départ, a accepté des offres comme celle de la télévision d’Etat, c’était dans l’espoir d’une plus grande popularité. Mais fin octobre, les AG sont parvenues, la plupart du temps, à percer à jour ce piège des “propositions concrètes” pour l’amélioration du système financier capitaliste et à déjouer le piège de s’intégrer aux mécanismes de la participation démocratique classique.
Pour la classe dirigeante, le plus rentable semblait être alors de tolérer le mouvement dans son ensemble et d’attendre son épuisement plutôt que de l’intégrer immédiatement dans le jeu démocratique ou de le faire matraquer. Outre la culture du débat solidaire quasi-inédite permettant à chacun de prendre la parole, dans la phase initiale des mois d’octobre et novembre, ce fut certainement une grande force du mouvement que de se fixer le principe : “prenons le temps de discuter et ne nous laissons pas mettre sous pression !”
Le village de tentes, le mouvement dans son ensemble et l’extension
Le village de tentes du Lindenhof, bien organisé et accueillant envers tous ceux qui souhaitaient y participer, devint (ainsi que les AG du samedi sur Paradeplatz) rapidement le véritable centre des discussions du mouvement-Occupy. Comme dans le mouvement des Indignados en Espagne, l’occupation collective de l’espace public a fourni un cadre permettant au mouvement de se réunir. Très vite cependant, en dépit de l’attitude ouverte des militants vivant dans le village, apparurent deux dynamiques :
1. L’émergence d’une communauté indépendante à laquelle seules les personnes ayant assez de temps et d’endurance pour passer leur vie en ce lieu pouvaient participer – alors que cela était presque impossible à la plupart des personnes chargées de famille et soumises aux obligations du travail salarié.
2. Le souci quotidien de l’entretien et de l’organisation du village de tentes prenant progressivement le pas sur la place dédiée au débat politique – qui était pourtant l’aspiration à l’origine du mouvement Occupy.
Cette situation n’a pas été librement choisie par les occupants et ne peut pas non plus leur être reprochée ; elle leur a été imposée par la difficulté objective d’assurer au village de tentes une infrastructure habitable, et surtout par la menace permanente d’être expulsés par l’appareil répressif de la police. Contrairement à Zuccotti Park à New York, le mouvement dans son ensemble à Zurich n’est pas allé aussi loin dans la dynamique de repli sur soi et dans la fétichisation du parc, il s’est engagé dans ses assemblées générales dans une intense réflexion sur la façon dont le mouvement pouvait joindre les autres “99 %” restants.
L’AG du 3 novembre au soir qui occupait la cour de l’Université pour y tenir une discussion collective tout autant que pour inviter directement les étudiants à y participer, a constitué une expression de cette aspiration à l’élargissement. Durant cinq semaines, libérées des soucis quotidiens du village de tentes, ces assemblées générales hebdomadaires ont été des moments collectifs encourageants de réflexion sur les questions de politique générale. Face à l’émergence de positions se proposant de façon absurde comme “direction” au mouvement ou se qualifiant de façon fataliste “d’illusionnaires”, les assemblées plénières ont été en mesure d’opposer leur esprit collectif auto-organisé. Mais la colère et la combativité chez les étudiants n’étaient pas assez développées pour déclencher une jonction entre les préoccupations du mouvement Occupy et les leurs propres. Même si l’espoir d’une forte participation des étudiants ne s’est pas concrétisé (en 2009, un mouvement avait éclaté à l’Université de Zurich), ces soirées, qualifiées “d’AG sur le contenu” où quelques nouvelles têtes ont fait leur apparition ont constitué un enrichissement montrant que le mouvement Occupy ne se réduisait pas au village de tentes. Occupy avait tenté de prendre des mesures concrètes pour étendre le mouvement.
Justement, la dynamique positive de telles “AG sur le contenu” démontre qu’à l’avenir, tout mouvement devra éviter de transférer les discussions politiques fondamentales des AG plénières aux “AG sur le contenu” – de même que la vie politique ne doit pas être déléguée exclusivement à des groupes de travail. Au contraire, l’AG plénière doit prendre le temps de se réunir pour clarifier collectivement et calmement les questions politiques fondamentales du mouvement. Occupy-Zurich, fortement influencé par l’activisme, s’est de plus en plus enlisé en décembre dans le problème de ne tenir plus que des AG traitant de façon exténuante de nombreuses questions d’organisation de détail.
L’esprit pionnier, la désillusion et la personnalisation
L’esprit pionnier présent dans les premières grandes mobilisations d’octobre et de novembre sur Paradeplatz s’était tassé. Occupy n’est pas mort, comme l’aurait souhaité la presse bourgeoise fin décembre avec le slogan “Bye Bye Occupy !”, voulant enterrer la protestation contre la crise et les institutions financières. Mais la participation aux AG a rapidement diminué courant décembre. Le village de tentes avait été à nouveau évacué par la police le 15 novembre et des militants s’étaient vu infliger des amendes démoralisantes. Lors de la première AG en 2012, celle du 4 janvier, d’une participation d’environ 70 personnes, il a été souligné par plusieurs interventions qu’“ils étaient de moins en moins nombreux”. En l’espace d’un mois, Occupy était clairement passé d’un mouvement spontané mobilisant de nombreuses personnes à un noyau de militants essayant de maintenir coûte que coûte des actions quasi-quotidiennes.
Une tout autre atmosphère affectait la culture du débat de l’ AG : la patience et l’écoute mutuelles impressionnantes du départ pâtissaient désormais de la fatigue, de l’impatience, des tensions et du sentiment d’être exclu de toute prise de décision. Il se développa une dynamique cherchant à compenser l’isolement croissant par un activisme reposant de plus en plus clairement uniquement sur les capacités et la bonne volonté des militants pris individuellement et non plus sur une perspective portée collectivement. Occupy-Zurich se cramponnait aux nombreuses actions qu’il n’était presque plus possible de réaliser avec une force déclinante, comme le montra la discussion de l’ AG sur le stand d’information installé sur une place publique, au Stauffacher. Quoique sans doute bien intentionnés, mais presque désespérés, les appels à la discipline (sur laquelle il est impossible à tout mouvement social se fixant l’objectif de l’émancipation de l’humanité de se fonder parce que cela équivaut finalement à la morale individualisée de la société capitaliste) ne font que conduire uniquement à des tensions.
C’est un phénomène bien connu dans les mouvements sociaux que les grandes envolées des débuts se transforment rapidement en frustration lorsque le mouvement reste isolé du reste de la classe ouvrière. La question de l’isolement s’est révélé être une question-clé. La fétichisation évidente de Zuccotti Park à New York n’était pas due à l’isolement naissant d’Occupy-Wall Street, mais était plutôt une expression de celui-ci. Il n’existe pas de “recettes de survie” pour un mouvement comme Occupy, parce que comme d’autres mouvements sociaux, il ne provient pas d’une “faisabilité” activiste, mais surgit de la fermentation politique au sein de la société sur la base des conditions de vie objectives.
Marquée par le déclin progressif du mouvement des Occupy-Zurich, l’AG du 4 janvier a ainsi pris la tournure d’une présentation et de l’adoption de projets d’action dans lesquels les participants s’engageaient en bonne partie de façon très individuelle. Dans un tel moment, il est plus productif de se poser les questions : “qu’est-ce que nous voulons ?”, “quelles sont nos forces communes ?”, “quelles sont les raisons du recul du mouvement ?”
Culture du débat, mouvement permanent et alliances comme bouée de sauvetage
Pour les personnes investies dans le mouvement Occupy-Zurich, confrontées à la fatigue et au rétrécissement à l’état de petit noyau, la nécessité de se poser des questions tout à fait fondamentales s’est manifestée clairement dans les deux premières semaines de janvier 2012 à travers la question de la fréquence des AG. Ce qu’a montré cette discussion dans le cadre d’un mouvement social en phase de déclin, c’est la contradiction insoluble entre d’une part le maintien d’AG fréquentes comme poumon du mouvement et d’autre part sa force et la participation déclinantes. Lors de l’AG du 4 janvier, cette question a été tranchée en faveur de la seule solution semblant réaliste et raisonnable (passer immédiatement à une assemblée par semaine) mais uniquement à l’aide du “thermomètre de la fatigue”. Il était absolument correct de la part de l’un des éléments les plus actifs de formuler par écrit dès le lendemain de cette assemblée la critique que “la décision de ne tenir plus qu’une AG par semaine n’était pas une décision prise à l’unanimité, mais une décision à la majorité. Dès le départ, je m’étais clairement prononcé contre la réduction de la fréquence des AG, cependant on a à peine abordé mes arguments et on a ignoré mes préoccupations. Dans le tour de parole où chacun a exprimé son opinion, il ressortait qu’il y avait une majorité pour tenir moins d’AG, ce qui a finalement abouti lorsque j’ai voulu à nouveau soutenir ma position à me faire conspuer par tous. Malheureusement, deux propositions de compromis ont été rejetées sans discussion. Je dois ici présenter mes excuses auprès de ceux qui ont les formulées ; dans cette situation, mis sous pression de toutes parts, j’ai considéré ces propositions de compromis sans contrôle sur mes émotions, ce qui m’a amené à les rejeter d’emblée. Je le regrette. Avec le recul, toutes deux avaient un potentiel si on avait pu les discuter en détails.”
Ce qu’il défend ici n’est pas le principe aveugle d’un rythme élevé des AG indépendamment de la dynamique du mouvement, mais la préservation de la culture du débat. La méthode consensuelle du mouvement Occupy, même si elle recèle la faiblesse latente de prendre souvent prématurément le seul plus petit dénominateur commun comme résultat de la discussion, empêchant aussi souvent la nécessaire polarisation, avait eu, au moins dans la phase initiale, l’avantage de permettre d’accorder une place à toutes les opinions. Il est clair que parfois des décisions concrètes doivent être prises, même si tout le monde n’est pas d’accord. Cependant, quand des décisions sont prises à la majorité, fondamentalement celles-ci ne doivent pas signifier la fin des discussions à leur propos. Lors de l’AG du 11 janvier, la préoccupation du participant engagé cité précédemment n’a justement pu trouver aucune place en raison de la quantité accablante d’informations et de points concernant les actions, bien que sa critique aborde le cœur du problème : les changements intervenus dans la mise en œuvre de la culture du débat.
Il est difficile de dire où va Occupy. Cependant l’AG du 11 janvier comportait clairement une tendance porteuse de la conception d’un “mouvement permanent”, voulant le faire évoluer et le transformer en regroupement politique. Tout comme les luttes pour les conditions de travail ou contre les baisses de salaires dans le capitalisme d’aujourd’hui ne peuvent avoir un caractère permanent sans tomber dans la recherche syndicale de compromis pourris et de la politique de la démocratie représentative, des périls similaires guettent Occupy. L’AG a clairement démontré que, dans le contexte de perte momentanée de sa force et de sa dynamique propres, des voix en faveur de l’alliance avec des groupes gauchistes tels les Jusos, Greenpeace se faisaient plus fortement entendre, sans doute dans l’espoir de regagner de la force. A titre d’exemple, l’AG s’est complètement laissé embarquer par une offre insignifiante de coopération ponctuelle avec un groupe politique spiritualiste. Au lieu de construire l’autonomie du mouvement, de discuter les questions qui sont réellement à l’ordre du jour, l’AG a été contrainte de s’astreindre à un débat pour parvenir à une décision immédiate concernant leur relation à ce groupe et aux groupes religieux en général. Une discussion qui peut être intéressante en soi, mais qu’il est impossible de mener et de clarifier dans une telle précipitation imposée de l’extérieur, et qui donne déjà un avant-goût bien connu de la politique gauchiste bourgeoise. Ce qui, au début du mouvement et dans un réflexe sain, avait été jeté par la porte, à savoir le chantage exercé par la bourgeoisie poussant à se résoudre aux “revendications concrètes” en vue d’améliorer le système financier, en d’autres termes la pression pour obtenir un positionnement dans le cadre de la politique bourgeoise, s’insinue à nouveau furtivement dans le mouvement par la fenêtre.
Si Occupy ne veut pas se disperser et s’égarer dans le soutien aux propositions parlementaires de “divulgation du financement des partis politiques” ou aux initiatives démocratiques contre la spéculation sur les produits alimentaires, que quelques uns des participants ont présenté à l’AG comme leur projet politique, il faut revenir à la question du commencement : pourquoi cette crise du capitalisme ? Le mouvement Occupy devrait se poser la question de savoir si tous les problèmes qui ont été perçus par ses participants avec une sensibilité impressionnante peuvent trouver une solution au sein du capitalisme – ou s’il est temps de dépasser ce mode de production comme un tout. Comme il est impossible que de tels mouvements sociaux se maintiennent en permanence, et qu’il y en aura d’autres, il est important de transmettre toutes les expériences positives faites aux futurs mouvements sociaux, au cas où Occupy ne trouve pas de second souffle. Car la crise du capitalisme, l’élément déclencheur du mouvement Occupy, ne va pas disparaître tant que ce système d’exploitation survivra.
Mario (16 janvier)
Géographique:
- Suisse [27]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [15]
Rubrique:
Fukushima, un an après (II) : le pire est à venir
- 1324 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction de la seconde partie de l’article de Welt Revolution, organe de presse du CCI en Allemagne, dressant un an après un bilan provisoire de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Dans la première partie [28] de cet article, nos camarades soulignaient la gravité de l’événement et l’incurie de la classe dominante qui n’a su opposer au désastre en cours que ses mensonges et ses manipulations. Ici, il s’agit de démontrer que le pire, pour la planète et l’humanité, est encore à venir.
ESt-ce que les détenteurs du pouvoir, les responsables, sont intéressés à aller à la racine du problème du nucléaire dans le monde ? Evidemment non ! Sous le poids de la concurrence et de l’aggravation de la crise, la tendance est au contraire à la baisse drastique des investissements dans l’entretien, la sécurité et le personnel qualifié.
Il est devenu clair que, sur les 442 centrales en exploitation sur la planète, beaucoup d’entre elles ont été construites dans des zones sujettes aux séismes. Concernant le seul Japon, plus de 50 centrales ont été construites dans de telles zones. En Russie, de nombreuses centrales nucléaires ne disposent même pas d’un mécanisme automatique de mise hors-tension, en cas d’incident nucléaire. Vu leur état général, Tchernobyl n’était probablement pas une exception et une telle catastrophe peut se reproduire à tout moment. La Chine a lancé la construction de 27 nouvelles centrales nucléaires alors qu’elle est une des régions les plus actives sur le plan sismologique.
La période de fonctionnement des vieilles centrales nucléaires qui devaient être fermées est prolongée. Aux Etats-Unis, leur durée d’exploitation a été prolongée à 60 ans, en Russie à 45 ans.
Bien que les mécanismes de contrôle par les Etats, à l’échelle nationale, sur l’industrie nucléaire se soient avérés insuffisants, les Etats sont opposés aux normes de sécurité trop restrictives ou trop interventionnistes par les organisations internationales de surveillance. “La souveraineté nationale prime sur la sécurité” affirment-ils.
En Allemagne, le gouvernement a décidé, depuis l’été 2011, d’abandonner l’énergie nucléaire en 2022, puis, comme mesure immédiate, certaines centrales nucléaires ont été arrêtées peu après l’explosion de Fukushima. Est-ce que le capital allemand a agi d’une manière plus responsable ? Pas du tout ! En effet, seulement quelques mois avant Fukushima, le même gouvernement avait prolongé la durée de fonctionnement de plusieurs centrales nucléaires. Si, toutefois, il a décidé d’abandonner l’énergie nucléaire aujourd’hui, cela correspond, d’une part, à une tactique politique, parce qu’il espère améliorer ses chances d’être réélu, et bien sûr à un calcul économique, parce que l’industrie allemande est très compétitive dans la production d’énergies alternatives avec son savoir-faire en ce domaine. L’industrie allemande espère maintenant y obtenir des marchés très rentables. Cependant, la question de se débarrasser des déchets nucléaires n’est toujours pas résolue.
Pour résumer : malgré Fukushima, l’humanité se trouve toujours face à ces bombes nucléaires à retardement qui, dans de nombreux endroits, peuvent déclencher une nouvelle catastrophe, à cause d’un tremblement de terre ou d’autres points faibles.
Le profit au détriment de la société et de la nature
Maintes et maintes fois, nous entendons les arguments avancés par les défenseurs de l’énergie nucléaire selon lesquels l’électricité nucléaire produite est moins chère, plus propre et qu’il n’y a pas d’autre alternative. Il est un fait que la construction d’une centrale coûte des sommes gigantesques qui, grâce à l’aide de subventions de l’Etat, sont prises en charge par les compagnies d’électricité. Mais la majeure partie des coûts de l’élimination des déchets nucléaires n’est pas prise en charge par les sociétés d’exploitation. De plus, les coûts de démolition d’une centrale nucléaire sont énormes. En Grande-Bretagne, on a estimé que le coût de démantèlement des centrales nucléaires existantes s’élèverait à 100 milliards d’euros pour le pays, soit environ 3 milliards d’euros par centrale nucléaire.
Et si jamais survient un incident ou un accident nucléaire, l’Etat doit venir à la rescousse. A Fukushima, les coûts de démolition et de suivi, dont l’importance est encore inconnue, sont estimés à environ 250 milliards d’euros. Tepco n’a pas pu réunir cette somme. L’Etat japonais a donc “promis son aide”, à la condition que les employés fassent des sacrifices : les pensions et les salaires sont abaissés, des milliers d’emplois sont supprimés ! Des charges fiscales spéciales sont prévues dans le budget japonais. Ayant tiré les leçons des accidents précédents, les entreprises opérant en France ont limité leur responsabilité à 700 millions d’euros en cas d’accident, avec la bénédiction grassement rétribuée des politicards locaux et nationaux, ce qui n’est rien en comparaison du coût économique d’une catastrophe nucléaire.
D’un point de vue économique et écologique, le coût réel du fonctionnement des centrales et la question non résolue des déchets nucléaires sont un puits sans fond. A tous égards, la puissance nucléaire est un projet irrationnel. Les sociétés d’énergie nucléaire reçoivent des quantités massives d’argent pour la production d’énergie, mais elles reportent les coûts d’entretien sur l’ensemble de la société. Les centrales nucléaires incarnent la contradiction capitaliste insurmontable entre la recherche du profit et la protection à long terme de l’homme et de la nature.
L’humanité tout entière menacée
L’énergie nucléaire ne constitue pas le seul danger pour l’environnement. Le capitalisme pratique un appauvrissement permanent de la nature. Il pille en permanence toutes les ressources, sans aucun souci de l’avenir pour l’humanité, d’harmonie avec la nature, il traite cette dernière comme une gigantesque décharge.
Aujourd’hui, des pans entiers de la terre sont devenus inhabitables et de vastes zones de la mer sont irrémédiablement intoxiquées. Ce système décadent est lancé dans une dynamique irrationnelle, où de plus en plus de nouveaux moyens technologiques sont développés mais dont l’exploitation devient de plus en plus coûteuse et destructrice pour les ressources naturelles. Lorsqu’en 2010, sur les rivages de la principale puissance industrielle, les Etats-Unis, la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon a explosé, l’enquête sur l’accident a dévoilé des plaies béantes dans les règles de sécurité.
La pression découlant de la concurrence contraint les rivaux, quand ils ont à investir de grosses sommes d’argent dans la construction et l’entretien des sites de production, à économiser et à saper les normes de sécurité. L’exemple le plus récent est la pollution par les hydrocarbures, au large des côtes atlantiques du Brésil. Toutes ces négligences ne se font pas seulement dans les pays technologiquement arriérés, mais prennent des proportions encore plus incroyables précisément dans les pays les plus développés, parce que leurs moyens sont infiniment plus puissants.
L’énergie nucléaire a été développée au cours de la Seconde Guerre mondiale, comme un instrument de guerre. Le bombardement nucléaire de deux villes japonaises a inauguré un nouveau niveau de destruction dans ce système décadent. La course aux armements pendant la Guerre Froide, avec son déploiement systématique de l’arme nucléaire, a poussé la capacité militaire de destruction au point où l’humanité pourrait être anéantie d’un seul coup. Aujourd’hui, plus de deux décennies après 1989 et l’effondrement du bloc de l’Est qui devait permettre la naissance d’une nouvelle ère de “paix”, il subsiste encore quelque 20 000 têtes nucléaires pouvant anéantir de nombreuses fois l’humanité.
Non seulement concernant la question de l’énergie nucléaire, mais aussi la protection de l’environnement, la classe dirigeante est de plus en plus irresponsable, comme l’a montré le véritable fiasco du récent sommet de Durban. La destruction de l’environnement a atteint aujourd’hui une échelle supérieure et la classe dirigeante est totalement incapable de changer de cap comme de prendre les mesures appropriées. La planète et l’humanité sont sacrifiées sur l’autel du profit.
Une course contre le temps a commencé. Soit le capitalisme détruit toute la planète, soit les exploités et les opprimés, avec la classe ouvrière à leur tête, réussissent à renverser le système. Parce que le capitalisme constitue une menace pour l’humanité à différents niveaux (crise, guerre, environnement), il ne peut pas se contenter de lutter seulement contre un aspect de la réalité capitaliste, par exemple, contre l’énergie nucléaire. Il y a un lien indéfectible entre ces différentes menaces et leurs racines dans le système capitaliste. Pendant les années 1980 et 1990, il y a eu beaucoup de mouvements portant sur un seul point (tels que la lutte contre l’énergie nucléaire, contre la militarisation, contre la pénurie de logement, etc.), ce qui avait pour résultat de morceler les luttes. Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de montrer la faillite de l’ensemble du système. Il est vrai que les connexions entre les différents aspects ne sont pas faciles à comprendre, mais si nous ne prenons pas en compte le lien entre la crise, la guerre et la destruction écologique, notre lutte se retrouvera dans une impasse, en croyant à tort que nous pourrions trouver des solutions dans le système, que les choses pourraient être réformées en gardant le même mode de production. Si nous suivions cette voie, notre combat serait un échec.
Di (janvier 2012)
Récent et en cours:
- Catastrophes [29]
Rubrique:
Révolution Internationale n° 431 - avril 2012
- 1615 lectures
Droite ou gauche au pouvoir, les attaques vont redoubler
- 1571 lectures
En avant-première mondiale, le CCI va ici vous révéler un scoop exclusif. Le soir du 6 mai, à 20 heures pétantes, le visage du vainqueur des élections présidentielles françaises qui s’affichera sur tous vos écrans de télé sera celui de… la bourgeoisie.
Quel que soit l’élu, de gauche ou de droite, le gouvernement mis en place va implacablement attaquer nos conditions de vie et de travail au nom de l’intérêt du capital national français. Toutes les promesses de cette campagne, toutes sans exceptions, vont s’envoler et le programme qui sera réellement appliqué portera pour nom Austérité. Réduction des effectifs des fonctionnaires, baisse des pensions de retraites, détérioration des droits des chômeurs et de l’accès aux soins, aggravation de la précarité et de la flexibilité sur le marché du travail, hausse des prix…
Entre la droite et la gauche, seuls les discours changent, les actes, eux, restent les mêmes. Hollande voudrait aujourd’hui nous faire croire que voter pour lui, ce serait mettre fin à la politique liberticide, raciste et brutale de “la clique à Sarko”. Les petites phrases des Guéant, Hortefeux et consorts sont en effet abjectes et insupportables. Et les envies de passer un grand coup de Kärcher dans la salle du Fouquet’s sont tout à fait compréhensibles. Mais il ne faut pas oublier qui sont réellement les socialistes :
Sous l’ère mitterrandienne, ont régné la désindustrialisation, les licenciements massifs et la hausse du chômage. Jamais l’Etat n’a autant privatisé pour supprimer des postes qu’avec Jospin Premier ministre !
Dans les années 1980, la gauche a généralisé le travail précaire en multipliant les petits boulots (par exemple les TUC), a propulsé dans la misère les RMIstes, fabriqué des SDF…
La gauche a “perfectionné” la politique anti-immigrés en mettant en place “les charters collectifs pour les expulsions de sans-papiers” au début des années 1990 lorsque Edith Cresson était Premier ministre de Mitterrand.
Les lois promulguées par Pierre Joxe, ministre socialiste de l’Intérieur dans les années 1980, ont permis de fliquer et quadriller les banlieues.
Il n’ont pas hésité à participer à la guerre du Golfe en 1990 (500 000 morts) ou à jouer un rôle sordide dans le génocide rwandais de 1994 (au moins 800 000 morts). Souvenons-nous de ce qu’avait déclaré à l’époque François Mitterrand à un journaliste qui l’interrogeait sur le rôle “obscur” de l’armée française alors en opération “humanitaire” sur ces terres rwandaises : “Dans ces pays-là, un génocide n’est pas trop important”.
Si Hollande est élu, le Parti socialiste ne barrera pas la route à la politique nauséabonde de Sarkozy, il lui emboîtera le pas. Que la droite ou la gauche soit au pouvoir demain, la vie sera plus dure qu’aujourd’hui. Il n’y a aucune illusion à avoir. Pour reprendre une formule crue mais explicite des Indignés d’Espagne : “Izquierda, derecha, ¡la misma mierda!” (“Gauche, droite, la même merde !”).
Et Mélenchon ? Lui qui clame partout “Prenez le pouvoir !” et “Place au Peuple !”, ne pourrait-il pas être la lueur d’espoir dans un coin de ce tableau si noir ? Fort des quelques millions de voix qui vont le soutenir, ne pourrait-il pas à l’avenir “peser dans la balance” en faveur des faibles, des petits et des exploités ? Encore une fois, regardons les actes. Mélenchon a, il est vrai, tout de l’homme anti-système… à condition de fermer les yeux sur son passé ! En tant que socialiste, il a en effet été successivement rien de moins que conseiller municipal de Massy (1983), conseiller général de l’Essonne (1985), sénateur du même département en 1986, 1995 et 2004, ministre de l’Enseignement professionnel de 2000 à 2002 sous Jospin et député européen en 2009 dans la circonscription du Sud-Ouest. Mais, nous dit-il, il a changé (lui aussi !), il a appris de ses erreurs passées (décidément !). Très bien. Qui est son principal soutien politique actuel ? Le PCF ! Le plus chauvin des partis français, celui dont le “F” jette une ombre démesurée sur les deux autres toutes petites lettres qui l’accompagnent… Faut-il rappeler l’épisode du foyer malien rasé à coups de bulldozers le 24 décembre 1980, à Vitry-sur-Seine, sous les ordres de la mairie “communiste” ? Ou l’ordre donné à la police par Fiterman, le ministre des Transports “communiste”, d’évacuer manu militari les cheminots grévistes de la gare Saint-Lazare en 1984, accusés “d’être manipulés par l’extrême droite” ? Comme ses amis staliniens, Mélenchon prétend défendre les exploités, en paroles, pour mieux protéger les intérêts de sa nation, en actes. Comme ses amis staliniens, Mélenchon discourt de “la nécessaire solidarité internationale des peuples” coiffé du bonnet phrygien et en scandant les slogans les plus cocardiers, du “Produisons et consommons français !” au “Soutenons l’industrie française !”. Monsieur Mélenchon peut bien jouer au pipeau l’air de l’Internationale, il suffit de tendre l’oreille pour entendre que les paroles qu’il nous chante sont sans aucun doute celles de la Marseillaise. Il pourrait presque former un chœur avec “les gars de la Marine” (Le Pen)… lui qui pourtant se présente comme le plus grand adversaire du Front national.
Rien de bon ne peut réellement sortir des urnes. Il ne peut pas y avoir de “bons candidats” pour les exploités lors d’une élection organisée par et pour la bourgeoisie. Jamais. La raison en est simple : le capitalisme est en train de sombrer, la crise économique l’entraîne peu à peu vers le fond. Ce système ne peut plus rien apporter à l’humanité, que toujours plus de misère et de guerre. La seule issue possible, c’est de mettre fin à l’exploitation et à la division du monde en nations concurrentes. Aucune élection (1), aucun référendum ne peut mener à un tel résultat. Au contraire, chaque fois que la bourgeoisie nous demande de voter aux élections présidentielles, elle ne nous impose rien d’autre que de choisir celui qui va se mettre à la tête de l’Etat pour faire perdurer ce système, de choisir celui qui défendra au mieux les intérêts capitalistes du pays. Ce n’est donc pas simplement que “gauche-droite, c’est pareil”, mais bien plus profondément que la démocratie ne cherche, à travers ses élections, qu’à maintenir en vie le système capitaliste et les privilèges d’une minorité au détriment de l’écrasante majorité. Comme l’ont affirmé certains Indignés d’Espagne “Lo llaman democracia y no lo es, es una dictadura y no se ve” (“Ils l’appellent démocratie mais ce n’est pas le cas, c’est une dictature mais ça ne se voit pas !”) (2).
WH et Pawel (27 mars)
1) Nous désignons ici évidemment les élections organisées par les Etats dits démocratiques et non celles pouvant avoir lieu au sein d’organes de luttes ouvrières comme, par exemple, les assemblées générales.
2) Lire notre tract international [31].
Géographique:
- France [5]
Rubrique:
Quelle est la véritable nature du Conseil national de la Résistance (1ère partie)
- 3836 lectures
Depuis plus d’un an, nous assistons à de nombreuses expressions de révolte. De celles qui sont nées dans les pays arabes en passant par le mouvement des Indignés en Espagne et en Grèce, jusqu’au mouvement des Occupy aux Etats-Unis ou encore en Grande-Bretagne, les populations montrent une volonté claire de ne plus se laisser traiter comme moins que rien. Ces mobilisations massives qui regroupent à la fois l’ensemble des laissés-pour-compte de ce système capitaliste moribond comme ceux qui ont encore la “chance” d’avoir du travail sont une réponse immédiate à l’angoisse progressive qui envahit la société avec une conscience à divers degrés que le monde dans lequel nous vivons n’est plus possible. Les mouvements des “Indignés” ont pris ce nom en référence au livre de Stéphane Hessel, ancien résistant français de la Seconde Guerre mondiale, intitulé Indignez-vous et publié en octobre 2010. Ce petit fascicule, largement médiatisé on s’en souvient, a été écrit à la demande de journalistes et de membres d’Attac qui avaient déjà sollicité Hessel lors de la déclaration de mars 2004 d’anciens du Conseil national de la Résistance (CNR) au plateau des Glières 1 , revendiquant les prétendues “valeurs” de la France issue de la “Libération” avec le slogan : “Créer, c’est résister. Résister, c’est créer.”
Dans le sillage de cet appel à faire revivre les idéaux de la Résistance et à défendre “la paix et la démocratie” contre la dictature internationale des marchés financiers, une kyrielle d’associations étaient apparues, ou ont été réactivées, souvent en créant des blogs ou en étant présents dans certains mouvements de résistance aux injustices sociales (luttes des sans-papiers, des sans-logis, etc.). Ces groupes, se voulant apolitiques et citoyens, où l’on retrouve aussi bien des représentants des partis de gauche et de droite traditionnels 2 que des éléments de la gauche radicale, des altermondialistes ou des syndicalistes, ont été très actifs dans le mouvement des Indignés. Ils prétendent lutter contre les ravages du libéralisme économique en s’inspirant des valeurs du CNR de 1944 et militent pour l’idée selon laquelle le mouvement actuel des Indignés serait l’expression d’un mouvement populaire de résistance qui pourrait s’apparenter à celui de la Résistance française contre l’Allemagne nazie en 1939-1945. En d’autres termes, le programme du CNR de 1944 aurait été un programme économique au service des exploités et qu’il suffirait de réactualiser, d’y apporter quelques aménagements pour en faire un programme de société au service du bien-être de tous. Le programme du CNR aurait-il une quelconque viabilité ou une utilité pour les luttes actuelles des exploités ? Pourrait-on s’appuyer sur les grandes lignes de l’idéologie qu’il véhicule ? Pour nous, la réponse est clairement : non.
Nous allons nous efforcer d’étayer cette réponse dans une série d’articles, dont voici la première partie. Avant d’aborder le programme du CNR lui-même, il est nécessaire de rappeler le contexte de la Seconde Guerre mondiale, la division de la classe politique en France entre le Gouvernement de Vichy, de Gaulle et la Résistance. Notre souci est d’ouvrir un débat sur cette période qui est toujours présentée comme un combat entre les forces du mal (régimes fascistes, Allemagne nazie) et les forces du bien (les glorieux mouvements de Résistance, le général de Gaulle et les alliés anglo-saxons “défenseurs de la démocratie”). Pour les jeunes générations qui n’ont pas connu ces événements dramatiques, les livres d’histoire officiels présentent souvent cette période sous l’angle qui arrange la bourgeoisie. Pour notre combat commun contre le capitalisme, il est absolument nécessaire de débattre du passé, de se réapproprier la réalité historique, sans ostracisme, pour éclairer notre présent et savoir ce que nous voulons bâtir pour le futur et comment le faire.
Aux origines du programme du CNR
 On oublie souvent, lorsqu’on aborde la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, que la cause fondamentale de celle-ci est le produit comme aujourd’hui d’une crise économique profonde qui commence en 1929 et qui plonge le monde entier dans une misère insupportable. Le système économique est en train de mourir parce qu’il produit trop de marchandises qu’il n’arrive pas à écouler, à vendre, pendant que des millions de chômeurs affamés cherchent de ville en ville un emploi introuvable. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard si c’est l’Allemagne, grande perdante de la Première Guerre mondiale qui va à nouveau déclencher les hostilités avec le fameux mot d’ordre pan-germanique de Hitler qui était “exporter ou mourir”. Alors que la Première Guerre mondiale avait été interrompue pour faire face à la Révolution russe et à sa menace d’extension à l’Europe, les années 1930 sont marquées par sa dégénérescence et par la défaite de toute la formidable vague révolutionnaire des années 1920, notamment en Allemagne. L’instauration du stalinisme, c’est-à-dire du capitalisme d’Etat en Russie au nom du “socialisme”, aura dans ce contexte une portée catastrophique pour le mouvement prolétarien mondial 3).
On oublie souvent, lorsqu’on aborde la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, que la cause fondamentale de celle-ci est le produit comme aujourd’hui d’une crise économique profonde qui commence en 1929 et qui plonge le monde entier dans une misère insupportable. Le système économique est en train de mourir parce qu’il produit trop de marchandises qu’il n’arrive pas à écouler, à vendre, pendant que des millions de chômeurs affamés cherchent de ville en ville un emploi introuvable. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard si c’est l’Allemagne, grande perdante de la Première Guerre mondiale qui va à nouveau déclencher les hostilités avec le fameux mot d’ordre pan-germanique de Hitler qui était “exporter ou mourir”. Alors que la Première Guerre mondiale avait été interrompue pour faire face à la Révolution russe et à sa menace d’extension à l’Europe, les années 1930 sont marquées par sa dégénérescence et par la défaite de toute la formidable vague révolutionnaire des années 1920, notamment en Allemagne. L’instauration du stalinisme, c’est-à-dire du capitalisme d’Etat en Russie au nom du “socialisme”, aura dans ce contexte une portée catastrophique pour le mouvement prolétarien mondial 3).
Face à cette nouvelle crise économique et à l’écrasement de l’espoir d’une nouvelle société qu’avait représentée la Révolution russe, le monde va basculer dans l’horreur. La barbarie fasciste et l’hystérie antifasciste vont conduire les prolétaires et la population d’Espagne en 1936, puis des principaux pays du monde, au massacre. Sans compter les dizaines de millions d’êtres humains qui seront exterminés dans les camps de concentration staliniens et hitlériens, les combats du conflit de 1939/1945 feront 55 millions de morts, ce qui constitue de loin le plus grand holocauste de l’humanité. Qu’on le veuille ou non, c’est bien pour préserver son système décadent que toute la bourgeoise, quel que soit le camp qu’elle a choisi, fasciste ou antifasciste, s’est vautrée dans la guerre et a sacrifié autant de vies humaines.
C’est en ayant à l’esprit le sordide bilan de cette période que l’on peut examiner la façon dont la France a été impliquée dans cette période tragique, tout en sachant qu’un certain nombre d’éléments sont valables aussi pour d’autres pays, notamment en Europe, qui a été le principal théâtre de cette boucherie.
L’Etat de la bourgeoisie française avant et pendant la guerre mondiale
Pendant quelque temps, l’Etat français avait eu l’illusion que la crise de 1929 ne toucherait que les Etats-Unis et l’Allemagne. Malgré l’instauration d’un fort protectionnisme, pour protéger le marché intérieur, sous la forme de quotas notamment pour les marchandises importés sur le territoire national, la grande dépression va se développer et ses ravages vont être profonds. “Une fois la décélération commencée, avec un effondrement des exportations et des prix agricoles en 1931, il n’y eut plus moyen de l’arrêter” (4). La crise économique va créer une véritable débandade dans la classe politique et démontrer que la IIIe République n’était plus adaptée à la situation, ce qui va d’ailleurs donner un premier point en commun au gouvernement de Vichy et à la Résistance, à savoir celui d’un rejet viscéral des institutions de la IIIe République et du libéralisme anarchique (et archaïque au vu des nécessités du capitalisme d’Etat) qui rendaient l’appareil productif français incapable de faire face à la concurrence mondiale et de rentrer dans la course aux armements en vue de la guerre qui se dessinait déjà. Les différents gouvernements qui vont se succéder, notamment ceux des partis de gauche du Front populaire de Léon Blum de 1936 et 1938, vont en fait préparer la guerre qui semble inévitable. En contrepartie d’augmentations de salaires et de conventions collectives dans certains secteurs, les ouvriers vont travailler plus de 40 heures dans les usines d’armement. Un certain nombre de nationalisations sont réalisées, notamment celle qui compte le plus dans une économie qui va vers la guerre, l’industrie des armements. Le ministère Daladier (Parti radical) devait être le dernier du temps de paix. Le président du conseil se fixa comme objectif primordial la défense nationale, ce qui permit aux socialistes et communistes de rester à l’écart du gouvernement et de ne pas apparaître ouvertement, auprès des ouvriers et de la population en général, comme des fractions va-t-en guerre. De son côté, Hitler, en Autriche, puis en Tchécoslovaquie, lançait l’Allemagne dans sa course à l’expansion impérialiste à travers cette série de provocations (débouchant notamment sur les accords de Munich de 1938 qui accordaient de fait le droit pour Hitler d’annexer la partie allemande de la Tchécoslovaquie – les fameux Sudètes – et préparaient déjà la guerre, mais une guerre à laquelle les futurs “Alliés” n’étaient pas encore prêts). En septembre 1939, c’est le pacte entre les deux brigands Hitler et Staline, entre l’Allemagne nazie et la Russie “socialiste”, dont la première clause est le partage de la Pologne, qui signe en fait l’ouverture généralisée des hostilités militaires. C’est aussi à ce moment là que dans le sillage de l’Angleterre, la France déclare la guerre à l’Allemagne.
La défaite rapide et totale de l’armée française devant les forces allemandes en juin 1940 va créer un véritable séisme dans l’ensemble des partis politiques. C’est au maréchal Pétain, “héros” du carnage de 1914/1918, que revient les pleins pouvoirs en juillet, seule une minorité de députés de la IIIe République s’y oppose et l’armistice avec l’Allemagne est signée dans la foulée. C’est à ce moment là que Pétain proclame aussi son intention d’entreprendre un redressement de la France, dénommé ensuite “Révolution nationale”. La question qui se pose alors pour la classe politique, tous partis confondus, est celle de préserver la continuité de l’Etat français, malgré la présence d’une force d’occupation allemande sur une partie du territoire, la zone Nord, et une zone libre au sud du territoire. C’est ici que la classe politique française va se diviser entre ceux qui sont pour l’alliance avec l’Allemagne et ceux qui se regroupent derrière le général De Gaulle et qui sont pour l’alliance avec les alliés anglo-saxons et donc la poursuite de la guerre pour préserver les intérêts de la France.
Pour le régime de Vichy, il n’y a pas de doute, le rapport de forces est favorable à l’Allemagne nazie et donc il faut collaborer avec celle-ci pour préserver les intérêts de l’Etat français et espérer avoir une place de choix dans une Europe qui serait sous la domination allemande.
Donc pour les dirigeants de Vichy, en 1940, ils ont une stratégie à double objectif, défendre la France de la domination du conquérant allemand et reconstruire les institutions. “En théorie, l’armistice reconnaissait à la France bon nombre des attributs de la souveraineté, y compris l’autorité sur la zone occupée et sur les colonies… Mais, dans les faits, Vichy n’avait d’autorité que ce que lui accordait les Allemands et les réformes n’étaient accordées que dans la mesure où “elles n’allaient pas à l’encontre des objectifs militaires nazis” (5).
Quant au général De Gaulle, réfugié à Londres, il appelle dans son célèbre discours du 18 juin 1940, à résister à l’envahisseur allemand sous la formule : “La flamme de la Résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas”. Il signe un accord avec Churchill qui le reconnaît comme le chef des Français libres et, avec l’argent que lui avance le gouvernement anglais, il va reconstituer un embryon de marine et d’armée, en s’appuyant sur les militaires et politiciens qui partagent son option impérialiste, notamment dans les divers territoires coloniaux que la France possède dans la défense commune des intérêts du capital national.
Le bras de fer entre les pro et anti-allemands au sein de la bourgeoisie française
En fait, il ne s’agit pas d’un combat entre les forces du bien contre les forces du mal, mais plutôt de divergences au sein de la classe politique française, sur l’option militaire et impérialiste à choisir.
Quelles que soient leurs divergences idéologiques, les hommes de Vichy ou ceux de la Résistance autour du général De Gaulle ont pour préoccupation essentielle que l’Etat français retrouve sa place sur l’échiquier européen et mondial : “Malgré des différences évidentes, les réformes proposées par Vichy et par la Résistance avaient beaucoup de points communs. Les unes comme les autres visaient à une renaissance nationale, à une réconciliation sociale, à une restauration morale, à une économie planifiée et plus juste, à un Etat plus dynamique” (6).
Leur peur commune est d’être soit sous le joug allemand, soit sous la coupe des Alliés. Si les relations entre Vichy et l’Etat allemand sont difficiles, du fait des exigences financières de l’occupant (frais pour les troupes d’occupation, production de marchandises pour l’industrie allemande, prélèvement de main d’œuvre qualifiée d’origine française pour travailler dans les usines allemandes) ; il en est de même pour De Gaulle : “Quant au général De Gaulle, son principal souci sera toujours d’affirmer, fût-ce au prix de vifs conflits, sa totale indépendance à l’égard des Alliés… En septembre 1941, il constitua le Comité national français, embryon d’un Conseil des ministres... qui fut accepté de mauvaise grâce par les Anglais… Les Anglais, par-dessus la tête de leur protégé (De Gaulle), recherchèrent un modus vivendi avec Vichy sans aboutir à un accord véritable. Quant aux Américains, systématiquement, ils ne voulaient reconnaître que Pétain” (7).
C’est un véritable bras de fer en permanence entre De Gaulle et les Alliés pour préserver l’indépendance de la France. Les Américains, tout comme l’Allemagne nazie, se verraient bien occuper la France, si les forces alliées gagnaient la guerre. C’est d’ailleurs le sens du débarquement des troupes américaines en novembre 1942 en Afrique du Nord où, comme le souligne l’historien O. Paxton, “L’Afrique du Nord devient en quelque sorte ‘un Vichy à l’envers’ sous occupation américaine” (8). C’est pour cela d’ailleurs, que le général De Gaulle n’a jamais osé critiquer la Russie pour avoir signé en 1939, un pacte avec le “diable” hitlérien, car elle pouvait lui servir comme contrepoids aux ambitions américaines vis-à-vis des territoires français. “Avant le 21 juin 1941 (rupture du pacte Staline-Hitler), il s’est gardé de l’attaquer et de lui reprocher son pacte avec l’Allemagne nazie. Jamais il ne s’en prend à son régime politique. Il affecte d’ailleurs de l’appeler la Russie et de la voir, non pas sous la forme temporaire qu’elle a prise, mais sous l’angle de l’histoire. Le premier point, c’est que l’URSS se bat et se bat bien ; le deuxième, c’est qu’elle est utile, en contrepoids des Anglo-saxons et contre l’Allemagne, aujourd’hui et demain” (9). Le général De Gaulle couvre même d’éloges Staline, le bourreau de la Révolution russe, du fait de la vaillance de ses armées et de leurs chefs.
Comme pour toute bourgeoisie nationale, en temps de guerre, comme en tant de paix, ce qui la préoccupe, c’est la défense de ses intérêts et donc la défense du capital national. A aucun moment, les exploités et la population en général n’ont leur mot à dire, sinon celui d’accepter toujours plus de sacrifices. Suivre le général De Gaulle et la Résistance, ou rejoindre le gouvernement de Vichy, impliquait de toute façon, toujours plus de misère, de privation, pour finalement servir de chair à canon.
Contrairement à la mythologie de l’histoire officielle, il n’est pas vrai que le régime de Vichy était composé exclusivement d’hommes de droite et que les partis de gauche vont rejoindre la Résistance et son héroïque général. La réalité est plus complexe.
Si le régime de Vichy est composé d’éléments de droite qui défendent la France agricole, la moralité, l’ordre, les modernisateurs font leur apparition dans les principaux ministères, ceux que l’on appelait les “planistes”, ceux qui étaient partisans de réformes structurelles pour adapter et préparer le capital français à la grande Europe sous influence allemande. Des hommes politiques de gauche ou des syndicalistes vont participer ou soutenir le régime de Vichy. Par exemple René Belin, un des responsables de la CGT, devint même sous Vichy ministre de la Production et du Travail. “Les dissidents de la gauche que l’on trouve à Vichy présentent un double intérêt : ils sont, bien sûr, le reflet des querelles intestines qui ont déchiré la CGT et la SFIO avant la guerre ; mais surtout – et c’est là l’important – ils attestent que, du moins pendant un an ou deux, les collaborateurs du maréchal Pétain arrivent d’horizons très divers. Loin d’être des nouveaux venus ou d’anciens leaders de l’extrême-droite, les hommes de Vichy se recrutent parmi les notables de la IIIe République, où qu’ils se situent sur l’éventail politique” (10).
Cette diversité politique n’est pas que l’apanage du gouvernement de Vichy, on verra ultérieurement, que dans les forces de la Résistance, se côtoyaient, à la fois des hommes de gauche, dont les staliniens du PCF, des hommes de droite, mais aussi des éléments issus de l’extrême-droite, notamment de l’organisation clandestine de la Cagoule.
Mais le soutien à Vichy ou à de Gaulle n’est pas figé. L’hiver 1942/1943 va être un tournant dans la guerre. Le général allemand Rommel perd la bataille en Afrique du Nord, avec le débarquement des Alliés en novembre 1942 au Maroc et en Algérie, et Staline, qui a rompu son pacte avec Hitler, est maintenant dans le camp des Alliés et infligera une défaite cinglante à l’Allemagne en janvier 1943 lors de la bataille de Stalingrad. Lors du débarquement américain en novembre 1942, en Afrique du Nord, l’amiral Darlan (11), ancien Premier ministre de Pétain, alors commandant en chef des forces armées de Vichy, va passer avec armes et bagages dans le camp des alliés, sous la menace du général américain Marck Clark qui envisage de constituer un gouvernement militaire américain en Algérie. “C’est ainsi que l’armée et l’administration, ardemment pétainistes, se retrouvent en bloc dans l’autre camp... De cette manière, un grand nombre d’officiers et de fonctionnaires fidèles à Vichy peuvent passer de l’autre côté tout à fait légalement et sans renoncer à la révolution nationale (programme de Pétain). Tel est le cas du général Juin qui, onze mois plus tôt, discutait à Berlin avec Goering de ce que ferait la France si Rommel se repliait en Tunisie et qui va gagner son bâton de maréchal en prenant le commandement des forces françaises (fidèles à De Gaulle) pendant la campagne d’Italie en 1943” (12).
Il n’y a rien de surprenant à ces changements d’alliances ou de camps, puisqu’au bout du compte, que cela soit Vichy ou de Gaulle, ce qui importait, c’était de préserver les intérêts de la nation française et de l’Etat français.
De l’économie de guerre à l’économie de la reconstruction, les exploiteurs se retrouvent toujours d’accord pour la défense du capital français
 L’histoire officielle présente souvent les programmes économiques de Vichy et de De Gaulle et la Résistance comme antagoniques, alors que la réalité est bien différente, on peut même parler de continuité, même si l’un à dû gérer l’économie de guerre et l’autre la reconstruction du capitalisme français.
L’histoire officielle présente souvent les programmes économiques de Vichy et de De Gaulle et la Résistance comme antagoniques, alors que la réalité est bien différente, on peut même parler de continuité, même si l’un à dû gérer l’économie de guerre et l’autre la reconstruction du capitalisme français.
Un aspect en commun entre Vichy et la Résistance, notamment des staliniens du PCF, étaient leur phobie des trusts et des sociétés anonymes, issus de la IIIe République. Le souci de Vichy était de donner un cadre dirigiste à l’Etat pour moderniser l’économie, ce qui était d’ailleurs aussi le souci de la Résistance, même si certaines composantes dont les socialistes ou les communistes, l’enrobent d’un discours qui parle de révolte sociale et Vichy de révolution nationale.
La grande force de Vichy sera de créer une administration hyper centralisée pour collecter les données de statistiques économiques, essayer de gérer le rationnement des produits alimentaires et de la pénurie de matières premières, tout cela, dans un contexte où l’occupant allemand se sert en premier pour faire tourner ses propres usines d’armement ou celles de la France à son profit.
En 1940, sont créés les CO (Comités d’organisation), organes corporatistes qui comptent des ouvriers et des patrons pour la gestion du commerce et des affaires. Les CO sont des créations dont les textes datent d’avant-guerre (1938) qui eux-mêmes reprennent des mesures de la guerre de 1914-1918, c’est cela la continuité de l’Etat. Cela se met en place à chaque fois dans le cadre de l’économie de guerre.
Les CO remplacent ce que l’on appelait les consortiums avant la guerre. Pour imprimer la marque de l’Etat au fonctionnement économique, se crée l’OCRPI (Office central de répartition des produits industriels) qui va chapeauter les CO. Cet Office est l’outil idéal à ce moment là pour l’Etat français afin de gérer l’économie de guerre et il sera largement utilisé par les Allemands pour utiliser les capacités productives dont ils ont besoin pour la production, entre autres, d’armes de guerre. Il faut se rendre compte, qu’en fait Vichy va gérer la pénurie. “A la fin de 1940, le rationnement de la consommation touchait non seulement des produits industriels… mais aussi une longue liste de produits alimentaires. Les six mois qui suivirent l’armistice virent s’instaurer plus de rationnement et pire qu’il n’y en avait jamais eu pendant la Première Guerre mondiale. Ce devint pour la plupart des Français une corvée quotidienne que de courir après la nourriture et de tenter de se chauffer. A la suite de la fixation des prix par l’Etat apparaît le marché noir” (13). Un journaliste a pu écrire que la vraie voix de la France pendant la guerre était le grondement de son estomac.
Entre 1938 et 1943, les prix officiels des denrées alimentaires de base doublèrent tandis que les salaires des travailleurs augmentaient tout juste de 30 %.
Cette gestion de la pénurie est non seulement due à l’économie de guerre mais surtout à la politique de l’occupant et des alliés, “les CO (comités d’organisation de Vichy) ne pouvaient être tenus pour responsables de la dégradation générale de l’économie pendant la guerre. Il est plus exact d’attribuer, par exemple, les souffrances dues à un rationnement parcimonieux, à des causes telles que la politique des autorités d’occupation ou le blocus allié” (14).
Dans ce contexte très défavorable, le gouvernement de Vichy, sur le plan de la défense des intérêts du capitalisme français, a fait un travail remarquable.
De toutes les tentatives faites dans les temps modernes pour contrôler et organiser au mieux dans un contexte d’économie de guerre, l’industrie française, ce fût l’organisation des CO et de l’OCRPI qui eut la plus grande portée. Ce n’est pas un hasard si de Gaulle et la Résistance, qui allaient prendre le pouvoir à la Libération pour reconstruire l’appareil productif, vont utiliser ce que Vichy avait mis en place ou prévu de mettre en place.
“Sous un nouveau nom mais avec le même personnel, l’organisme statistique de Vichy devait se trouver comme le ministère de la production incorporé dans l’administration d’après-guerre” (15).
“Ainsi à l’époque même où Vichy amenait le peuple français a se dresser contre les contrôles, la Résistance entreprenait une campagne en faveur d’une forme socialiste de dirigisme et de fait la Résistance devait s’apercevoir qu’une bonne partie de l’appareil de l’Etat français pouvait s’adapter a ses propres desseins” (16).
C’est bien cette continuité de l’Etat qui, au delà des divergences idéologiques, va voir Vichy préparer finalement le terrain à l’équipe suivante qui prendra en charge la reconstruction, à savoir de Gaulle et la Résistance.
Pour mettre en œuvre une économie planifiée à la fin de la guerre, Vichy va confier à la DGEN (Délégation générale à l’équipement national) la mission de rédiger des plans d’équipement, c’est-à-dire une planification de la rénovation de l’appareil productif et bancaire, etc.
“Décidés à mettre en œuvre, après la fin des hostilités, une économie planifiée, les administrateurs du temps de guerre établirent deux plans d’équipement : le plan d’équipement national, ou plan de dix ans, publié en 1942 ; puis une version de ce même document, adaptée aux besoins de l’immédiat après-guerre et intitulé “Tranche de démarrage” (17), qui fût achevée en 1944. Bien que ces projets n’aient jamais été mis directement à exécution, le gouvernement provisoire d’après-guerre (De Gaulle et la Résistance) les utilisa pour élaborer ses propres programmes de rétablissement économique. D’un point de vue historique, ils représentent aussi les premiers vrais plans économiques français.”
Donc, Vichy a œuvré efficacement pour l’après-guerre et une grande partie du plan économique établi par De Gaulle et la Résistance (c’est-à-dire le PCF, les chrétiens, les socialistes) a été mis en œuvre grâce au travail effectué par Vichy.
Ce nouveau plan de démarrage fût rédigé au cours de l’été 1944, alors que la Libération a déjà commencé. Malgré son hostilité au régime de Vichy, le gouvernement du général De Gaulle qui prenait le pouvoir fit une exception pour la planification (élément essentiel de la politique économique pour créer les infrastructures, planifier les importations, assurer la reprise des activités économiques essentielles). De Gaulle “ordonna d’imprimer et de distribuer le projet de la DGEN, à un moment où Pétain et ses ministres avaient déjà fui hors de France” (18).
“Le plan de deux ans (des experts de Vichy) était conçu de façon à pouvoir être appliqué par le gouvernement quel qu’il dût être, qui dirigerait la reconstruction. Ce que nous savons, c’est que les nouveaux planificateurs de 1945-1946 l’utilisèrent pour élaborer les programmes d’après-guerre et que les commandes placées dès 1944 auprès de l’industrie permirent d’accélérer la reprise de l’économie. Des convergences frappantes apparaissent entre ce qu’envisageaient les planistes de Vichy et ce que les experts de Monnet mirent en forme et réalisèrent à partir de 1946. Les deux équipes se trouvèrent d’accord sur les grands obstacles qui pouvaient s’opposer à la renaissance, et sur les solutions à proposer. Toutes deux reconnaissaient le vieillissement de l’appareil productif français et condamnaient d’une même voix l’économie politique de l’avant- guerre, avec son aversion sous-jacente pour l’intervention étatique, qui justement laissait l’Etat agir au hasard, avec ses préoccupations de stabilité financière, avec son penchant pour le protectionnisme. Comme celle de Monnet, celle de Vichy trouvait dans une planification indicative le moyen de mener le navire entre les écueils opposés du libéralisme (au sens des trusts différent du libéralisme dont on parle ces dernières années) d’avant-guerre et du dirigisme de guerre” (19).
C’est cela que l’on appelle la continuité de l’Etat, au delà des gouvernements, l’appareil d’Etat assure sa propre continuité, et bien entendu sur le dos des exploités et de la population.
Il y a bien sûr des différences, notamment Vichy misait sur l’autosuffisance nationale alors que les gouvernements de la Libération attendaient beaucoup de l’aide américaine.
“Quand, au cours de l’été 1944, De Gaulle et la Résistance vinrent remplacer les pétainistes, la continuité fut durement rompue dans l’ordre politique, elle le fut beaucoup moins au niveau de l’administration économique” (20).
L’attitude de la Résistance répondit dans une large mesure aux espoirs de Vichy : “Au niveau institutionnel, l’organisme de planification, l’office statistique, le ministère de la Production se trouvèrent intégrés dans l’administration d’après guerre. Les CO, l’OCRPI, les comités sociaux survécurent également… les personnels de l’administration économique ne subirent pas de purge violente… Cette fois, le besoin de changement suscité par la guerre et les programmes de Vichy allaient se mêler au puissant élan de la Résistance pour amener la France à une économie politique nouvelle” (21).
Là encore, comme sous Vichy, la réalité de la situation des exploités ne va pas changer à la Libération sous le règne de De Gaulle et de la Résistance, il fallait bien accepter de nouveaux sacrifices pour la “grandeur de la France” : “La reconstruction planifiée exigeait envers autre chose que la semaine de travail des ouvriers dépasse les 40 heures et que chacun se résignât à un bas niveau de consommation, tel était le coût de la rénovation” (22).
Dans la seconde partie de cet article, nous aborderons plus précisément ce qui a provoqué la constitution du Conseil national de la Résistance et quel a été son programme de fond ainsi que l’idéologie réelle qui le sous-tendait et avec quelles options politiques.
K (15 mars)
1) Ce plateau de Haute-Savoie incarne le combat de la Résistance contre Vichy et les troupes allemandes en cela que ce fut le théâtre du premier combat des “Résistants” d’une certaine ampleur en cette fin de Seconde Guerre mondiale et de défaite nazie annoncée. La déclaration du 8 mars 2004 “fêtait” le 60e anniversaire de ce combat.
2) Sarkozy ne manque pas lui non plus de se dire inspiré par le CNR de 1944. Voir le site de Rue 89, “Sarkozy ou les indignés, qui sont les héritiers de la Résistance ?”.
3) Voir à ce sujet notre brochure la Terreur stalinienne : un crime du capitalisme, pas du communisme.
4) Voir le chapitre “Les années 30 : expériences et alternatives à l’ordre libéral”, tiré du livre de Richard Kuisel le Capitalisme et l’Etat en France, NRF, Editions Gallimard.
5) Idem, chapitre “La révolution nationale à Vichy, 1940-1944 : survie et rénovation”.
6) Idem, p. 228, chapitre “la révolution nationale à Vichy”.
7) Voir le chapitre “Naissance et extension de la France libre” tiré de l’ouvrage de Henri Michel Histoire de la résistance en France, Presses Universitaires de France.
8) Voir le chapitre “La collaboration de 1942 à 1944”, page 323, tiré de l’ouvrage d’O. Paxton, la France de Vichy, 1940-1944.
9) Voir le chapitre “Le nationalisme” dans le livre de Henri Michel, les Courants de pensée de la Résistance, Presses universitaires de France.
10) O.Paxton, op. cit., chapitre “Les hommes de Vichy”, p. 320. Pour le lecteur qui voudrait une étude plus approfondie sur ce sujet, on recommande de lire l’ouvrage de Rémy Handourtzel et Cyril Buffet la Collaboration…à gauche aussi, collection Vérités et légendes, librairie académique Perrin.
11) L’amiral Darlan est assassiné le 24/12/1942, peu de temps après sa conversion du pétainisme au camp des alliés. Les historiens ne sont pas unanimes sur la question, mais il semble que les Américains n’avaient pas envie à la fin de la guerre qu’il raconte les liens secrets qui ont existé durant toute la guerre entre des émissaires de Pétain et des militaires américains, ce qui ne serait pas surprenant, vu les animosités qui opposaient de Gaulle et la Résistance aux Américains.
12) O.Paxton, op. cit., chapitre “La collaboration de 1942 à 1944”, p. 322-324.
13) R. Kuisel, op. cit., p. 241.
14) Idem., p. 252.
15) Idem., p. 236.
16) Idem., p. 253.
17) Idem., p. 256-257.
18) Idem., p. 266.
19) Idem., p. 269.
20) Ibidem.
21) Idem., p. 270.
22) Idem., p.324.
Rubrique:
2011 : de l’indignation à l’espoir (tract international)
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 133.27 Ko |
- 2886 lectures
 Nous publions ci-dessous le tract international que le CCI diffuse partout où il est présent et qui dresse le bilan des mouvements des Indignés et des « Occupy » qui ont eu lieu en 2011.
Nous publions ci-dessous le tract international que le CCI diffuse partout où il est présent et qui dresse le bilan des mouvements des Indignés et des « Occupy » qui ont eu lieu en 2011.
Téléchargez le tract en pdf [32], imprimez-le et diffusez-le autour de vous !
Les deux événements les plus marquants de 2011 ont été la crise globale du capitalisme1 et les mouvements sociaux en Tunisie, en Egypte, en Espagne, en Grèce, en Israël, au Chili, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne...
L’indignation a pris une dimension internationale
Les conséquences de la crise capitaliste sont extrêmement dures pour l’immense majorité de la population mondiale : détérioration des conditions de vie, chômage qui se prolonge pendant des années, précarité qui rend impossible la plus petite exigence de stabilité vitale, des situations extrêmes de pauvreté et de faim...
Des millions de personnes se rendent compte avec anxiété du fait que toute possibilité « d’une vie stable et normale », « d’un futur pour leurs enfants » devient inatteignable. Ceci a provoqué une indignation profonde, a amené à briser la passivité, à prendre les rues et les places, à se poser des questions sur les causes d’une crise qui dans sa phase actuelle dure déjà depuis cinq ans.
L’indignation est encore montée d’un cran à cause de l’arrogance, la rapacité et l’indifférence vis-à-vis des souffrances de la majorité de la population, avec lesquelles se comportent les banquiers, les politiciens et les autres représentants de la classe capitaliste. Mais aussi à cause de l’impuissance des gouvernements face aux graves problèmes de la société : les mesures qu’ils prennent ne font qu’augmenter la misère et le chômage sans y apporter la moindre solution.
Le mouvement d’indignation s’est étendu internationalement. Il a surgi en Espagne où le gouvernement socialiste avait mis en place un des premiers plans d’austérité et un des plus durs ; en Grèce, devenue le symbole de la crise économique mondiale à travers l’endettement ; aux Etats-Unis, temple du capitalisme mondial ; en Egypte et en Israël pays pourtant situés de chaque coté du front du pire conflit impérialiste et le plus enkysté, celui du Moyen Orient.
La conscience du fait qu’il s’agit d’un mouvement global commence à se développer, malgré le boulet destructeur du nationalisme (présence de drapeaux nationaux lors des manifestations en Grèce, en Egypte ou aux Etats-Unis). En Espagne, la solidarité avec les travailleurs de Grèce s’est exprimée aux cris de « Athènes tiens bon, Madrid se lève !». Les grévistes d’Oakland (Etats-Unis, novembre 2011) proclamaient leur « solidarité avec les mouvements d’occupation au niveau mondial ». En Egypte a été approuvée une Déclaration du Caire en soutien au mouvement aux Etats-Unis. En Israël, les Indignés ont crié « Netanyahou, Moubarak, El Assad, c’est la même chose » et ont pris contact avec des travailleurs palestiniens.
Aujourd’hui, le point culminant de ces mouvements est derrière nous, même si l’on voit apparaître de nouvelles luttes (Espagne, Grèce, Mexico). Alors, beaucoup de gens se posent la question : à quoi a servi toute cette vague d’indignation ? Avons-nous gagné quelque chose ?
« Prends la place ! », slogan commun aux différents mouvements
Il y a plus de trente ans qu’on n’avait pas vu des foules occupant les rues et les places pour essayer de lutter pour leurs intérêts propres au-delà des illusions et des confusions qui peuvent exister.
Ces personnes-là, les travailleurs, les exploités, tous ceux qu’on dépeint comme des ratés indolents, des gens incapables d’initiative ou de faire quelque chose en commun, sont arrivés à s’unir, à partager, à créer et à briser la passivité étouffante qui nous condamne à la sinistre normalité quotidienne de ce système.
Cela a fait un bien fou pour regonfler le moral, le début d’un développement de la confiance en notre propre capacité, de la redécouverte de la force fournie par l’action collective de masse. La scène sociale est en train de changer. Le monopole sur les affaires publiques exercées par les politiciens, les experts, les « grands de ce monde » commence à être mis en question par les foules anonymes qui veulent se faire entendre2.
Il s’agit certes d’un point de départ fragile. Les illusions, les confusions, les inévitables va-et-vient des états d’âme, la répression, les voies de garage dangereuses vers lesquelles poussent les forces d’encadrement que possède l’État capitaliste (les partis de gauche et les syndicats) imposeront des pas en arrière, d’amères défaites. C’est un chemin long et difficile, semé d’obstacles et sur lequel on n’a aucune garantie de succès, mais le fait même de se mettre en marche est déjà une victoire.
Les Assemblées générales sont le cœur du mouvement
Les foules ne se sont pas bornées à crier, passivement, leur malaise, mais ont pris l’initiative de s’organiser en assemblées. Les assemblées massives sont la concrétisation du slogan de la Première Internationale (1864) « L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ou elle ne sera pas ». Elles s’inscrivent dans la continuité de la tradition du mouvement ouvrier qui démarre avec la Commune de Paris et prend son expression la plus élevé en Russie en 1905 et en 1917, se poursuivant en 1918 en Allemagne, 1919 et 1956 en Hongrie, 1980 en Pologne.
Les assemblées générales et les conseils ouvriers sont les formes distinctives de l’organisation de la lutte du prolétariat et le noyau d’une nouvelle organisation de la société.
Des assemblées pour s’unir massivement et commencer à briser les chaînes qui nous accrochent à l’esclavage salarié : l’atomisation, le chacun pour soi, l’enfermement dans le ghetto du secteur ou de la catégorie sociale.
Des assemblées pour réfléchir, discuter et décider, devenir collectivement responsables de qui est décidé, en participant tous, autant dans la décision que dans l’exécution de ce qui a été décidé.
Des assemblées pour construire la confiance mutuelle, l’empathie, la solidarité, qui ne sont pas seulement indispensables pour mener en avant la lutte mais qui seront aussi les piliers d’une société future sans classes ni exploitation.
2011 a connu une explosion de la véritable solidarité qui n’a rien à voir avec la « solidarité » hypocrite et intéressée qu’on nous prêche : il y a eu des manifestations à Madrid pour exiger la libération des détenus ou empêcher que la police arrête des émigrants ; des actions massives contre les expulsions de domicile en Espagne, en Grèce ou aux Etats-Unis ; à Oakland « l’assemblée des grévistes a décidé l’envoi de piquets de grève ou l’occupation de n’importe quelle entreprise ou école qui sanctionne des employés ou des élèves d’une quelconque manière parce qu’ils auraient participé à la grève générale du 2 novembre ». On a pu vivre des moments, certes encore très épisodiques, où n’importe qui pouvait se sentir protégé et défendu par ses semblables, ce qui est en fort contraste avec ce qui est « normal » dans cette société, autrement dit le sentiment angoissant d’être sans défense et vulnérable.
La culture du débat éclaire le futur
La conscience nécessaire pour que des millions de travailleurs transforment le monde ne s’acquiert pas dans des cours magistraux ou en suivant des consignes géniales des chefs illuminés, mais le fruit d’une expérience de lutte accompagnée et guidée par un débat qui analyse ce qui est en train de se vivre en tenant compte du passé et en le projetant toujours vers l’avenir car, comme le disait une pancarte en Espagne, « pas de futur sans révolution ! ».
La culture du débat, autrement dit, la discussion ouverte qui part du respect mutuel et de l’écoute attentive, a commencé à germer pas seulement dans les assemblées mais autour d’elles : des bibliothèques ambulantes ont été montées, des rencontres, des discussions, des échanges se sont organisés... Une vaste activité intellectuelle avec des moyens précaires s’est improvisée dans les rues et sur les places. Et, à l’instar des assemblées, cela a renoué avec l’expérience passée du mouvement ouvrier : « La soif d’instruction, non assouvie pendant si longtemps, est devenue avec la révolution un véritable délire. Rien que de l’Institut Smolny sont sorties chaque jour, durant les six premiers mois, des tonnes de littérature qui, en charrettes ou en trains, se sont déversées sur le pays. La Russie absorbait, insatiable, comme le sable chaud absorbe l’eau. Et non pas des romans grotesques, de l’histoire falsifiée, de la religion diluée, toute cette littérature bon marché qui pervertit, mais des théories économiques et sociales, de la philosophie, les œuvres de Tolstoï, de Gogol, de Gorki »3. Face à la culture de cette société qui propose de lutter pour des « modèles à succès », ce qui est à l’origine de millions d’échecs, contre les stéréotypes aliénants et falsificateurs que l’idéologie dominante et ses médias martèlent jour après jour, des milliers de personnes ont commencé à rechercher une culture populaire authentique, construite par elles-mêmes, en essayant de forger ses propres valeurs, de manière critique et indépendante. Dans ces rassemblements, on a parlé de la crise et de ses causes, du rôle des banques, etc. On y a parlé de révolution, même si dans cette marmite on a versé beaucoup de liquides différents, parfois disparates ; on y a parlé de démocratie et de dictature, le tout synthétisé dans le slogan de ce distique aux deux strophes complémentaires : « ils l'appellent démocratie mais ce n’est pas le cas ! », « C’est une dictature mais ça ne se voit pas ! » »4
On a fait les premiers pas pour que surgisse une véritable politique de la majorité, éloignée du monde des intrigues, des mensonges et des manœuvres troubles qui est la caractéristique de la politique dominante. Une politique qui aborde tous les sujets qui nous touchent, pas seulement l’économie ou la politique, mais aussi l’environnement, l’éthique, la culture, l’éducation ou la santé.
Le prolétariat a entre ses mains les clés de l’avenir
Si tout ce qui précède fait de 2011 l’année du début de l’espoir, nous devons néanmoins avoir un regard lucide et critique sur les mouvements qu’on a vécus, ses limites et ses faiblesses qui sont encore bien nombreux.
Si une quantité croissante de gens dans le monde entier sont convaincus du fait que le capitalisme est un système obsolète, que « pour que l’humanité puisse vivre, le capitalisme doit mourir », on tend à réduire le capitalisme à une poignée de « méchants » (des financiers sans scrupules, des dictateurs sans pitié) alors que c’est un réseau complexe de rapports sociaux qui doit être attaqué dans sa totalité et non pas se disperser en poursuivant ses expressions multiples et variées (les finances, la spéculation, la corruption des pouvoirs politico-économiques).
Si le rejet d’une violence dont le capitalisme dégouline par tous ses pores (répression, terreur et terrorisme, barbarie morale) est plus que justifié, il n’en demeure pas moins que ce système ne pourra pas être aboli par la simple pression pacifique et citoyenne. La classe minoritaire n’abandonne pas volontairement le pouvoir, elle se protège derrière un Etat qui, dans sa version démocratique, est légitimé par des élections tous les 4 ou 5 ans, avec des partis qui promettent ce qu’ils ne feront jamais et font ce qu’ils n’avaient jamais dit, et avec des syndicats qui mobilisent pour démobiliser et finissent par signer tout ce que la classe dominante leur met sur la table. Seule une lutte massive, tenace et persévérante, pourra fournir aux exploités la force nécessaire pour détruire les moyens d’écrasement dont dispose l’État et faire devenir réel le mot d’ordre si souvent repris en Espagne : « Tout le pouvoir aux Assemblées ».
Même si le slogan « nous sommes 99% face à 1% », si populaire dans les mouvements d’occupation aux Etats-Unis, révèle un début de compréhension du fait que la société est cruellement divisée en classes, la majorité de participants dans ces mouvements se voyaient eux-mêmes comme des « citoyens de base » qui veulent être reconnus dans une société de « citoyens libres et égaux ».
Et pourtant la société est divisée en classes, une classe capitaliste qui possède tout et ne produit rien et une classe exploitée -le prolétariat- qui produit tout et possède de moins en moins. Le moteur de l’évolution sociale n’est pas le jeu démocratique de « la décision d’une majorité de citoyens » (ce jeu est plutôt le masque qui couvre et légitime la dictature de la classe dominante) mais la lutte de classe.
Le mouvement social a besoin de s’articuler autour de la lutte de la principale classe exploitée -le prolétariat- qui produit collectivement l’essentiel des richesses et assure le fonctionnement de la vie sociale : les usines, les hôpitaux, les écoles, les universités, les ports, les travaux, la poste... Dans certains mouvements en 2011, la force de cette classe exploitée a commencé à apparaître : à partir du moment où la vague de grèves a éclaté en Egypte, le pouvoir a été obligé de se débarrasser de Moubarak. A Oakland (Californie), les "occupiers"5 ont appelé à une grève générale, ils sont allés au port et ont réussi à avoir le soutien actif des travailleurs du port et des routiers. À Londres, les électriciens en grève et les occupants de Saint-Paul ont convergé vers des actions communes. En Espagne, les assemblées sur les places et certains secteurs en lutte ont tendu à s’unifier.
Il n’existe pas d’opposition entre la lutte du prolétariat moderne et les besoins profonds des couches sociales spoliées par l’oppression capitaliste. La lutte du prolétariat n’est pas un mouvement particulier ou égoïste mais la base du « mouvement indépendant de l’immense majorité au bénéfice de la immense majorité » (Manifeste Communiste).
Reprenant de façon critique les expériences de deux siècles de lutte prolétarienne, les mouvements actuels pourront tirer profit des tentatives du passé de lutte et de libération sociale. Le chemin est long et hérissé d’obstacles, ce dont rendait bien compte un slogan répété maintes fois l’an dernier en Espagne « l’essentiel n’est pas qu’on aille vite ou pas, c’est qu’on aille loin ». En menant un débat le plus large possible, sans aucune restriction et sans ambiguïté pour ainsi préparer consciemment les futurs mouvements, nous pourront agir pour que devienne réalité cet espoir : une autre société est possible !
CCI (12 mars)
1 En rapport avec la crise globale du système, le très grave incident dans la centrale nucléaire de Fukushima au Japon nous montre les grands dangers que l’humanité encourt.
2 Il est assez significatif que Times Magazine ait désigné « Homme de l’année » le « Protester » (l’indigné). Voir www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2101745_2102132_2102... [33]
3 John Reed 10 jours qui ébranlèrent le monde.
4 En espagnol : « lo llaman democracia y no lo es» et «es una dictadura y no se ve ».
5 Participants du mouvement des Occupy, signifiant “les occupants”.
Vie du CCI:
Rubrique:
Commémoration de la fin de la guerre d'Algérie (1954 - 1962) : la "liberté des peuples" est un mythe
- 1602 lectures
En mars dernier, à l’occasion de la commémoration du cinquantenaire des accords d’Evian qui scellaient la fin de la guerre d’Algérie, une série de documentaires et de débats se sont succédés dans les médias, faisant découvrir à ceux d’entre nous qui ne l’ont pas connue, l’ampleur des atrocités et des horreurs commises de part et d’autre pendant les huit ans de guerre (1954-1962). C’est-à-dire près de 400 000 morts et un million de réfugiés. Pour la circonstance, cette commémoration a été accompagnée de cérémonies et de discours officiels en France comme en Algérie, au cours desquels l’Etat français en particulier s’est livré à une sorte de mea culpa pour sa responsabilité dans les massacres. Surprenant ? Pas vraiment… Cela ne lui coûte pas grand-chose de reconnaître ses crimes 50 ans après les faits. Et cela a permis à la bourgeoisie française de profiter de l’occasion pour essayer de nous faire croire que, depuis l’indépendance, le peuple algérien est “libre”.
Derrière la décolonisation, la guerre impérialiste
A en croire la propagande, malgré ses torts, l’Etat français a été finalement capable de libérer l’Algérie du joug du colonialisme. Et l’Etat algérien, qui s’est construit par la suite, serait le produit d’une réelle volonté du “peuple” de vivre “libre et autonome”. Quelle hypocrisie ! Ce qui s’est passé en Algérie entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la proclamation d’indépendance de 1962 est le prototype même de l’énorme mystification des “libérations nationales”. Les prémices de cette guerre, qui jusqu’en 1999 restera officiellement en France “les événements d’Algérie”, reviennent aux massacres de Sétif et Guelma, le 8 mai 1945. Alors que l’Europe fête la victoire des Alliés contre l’Allemagne nazie, l’armée française réprime la naissance d’un fort mouvement nationaliste algérien né de l’obstination de l’Etat français, et de ceux qu’on appelait les “pieds-noirs” c’est-à-dire les colons, de reconnaître une égalité de droits pour la population algérienne, enfermée dans le statut d’un “indigénat” pourtant officiellement abrogé. Cela alors même que près de 70 000 Algériens avaient combattu dans l’armée française. La répression, menée à coups de bombes par la marine et l’aviation (sous les ordres du radical-socialiste René Coty), fera au moins 30 000 morts. Il existait certes dès avant la guerre, un mouvement de militants algériens regroupés dans le Mouvement national algérien (MNA) de Messali Hadj prêts à en découdre avec l’armée française pour secouer l’hégémonie colonialiste. Mais la plupart d’entre eux seront massacrés à Melouza en 1957 pour laisser le champ libre au Front de libération nationale (FLN), peu ou prou instrumentalisé par le bloc de l’Est via la Hongrie, la Tchécoslovaquie ou encore la Yougoslavie. Ces derniers pays fournirent des armes à profusion pour l’Armée de libération nationale du FLN. Les règlements de compte furent ainsi la règle au sein des forces de “libération” algérienne, dans lesquels les assassinats se comptaient déjà à l’époque par dizaines de milliers.
Du côté français, la soupe ne fut pas moins amère. La lutte à mort entre les pro et les anti-colonialistes signera la chute de la IVe République et l’avènement du général De Gaulle et de sa Ve République en 1958. Ce n’est nullement pour des raisons humanitaires que ce dernier finira par emporter la mise, mais parce que les fractions bourgeoises colonialistes, comme celle qu’incarnait l’Organisation armée secrète (OAS), avaient fait leur temps, dans une période où la vague de décolonisation s’ancrait dans la période des nouveaux enjeux impérialistes de la Guerre froide. Les indépendances nationales étaient d’autant mieux acceptées que les pays concernés restaient dans le camp de la puissance de tutelle.
Le mythe du “peuple libéré”
L’Algérie serait donc aujourd’hui un pays “libre et indépendant” où vivrait, par conséquent un peuple “libre et indépendant”. La réalité est évidemment toute autre.
Quarante ans après la fin de la guerre, les travailleurs subissent toujours aussi férocement le même joug de l’exploitation capitaliste… simplement aujourd’hui il n’est plus le fruit de la bourgeoisie française mais de la bourgeoisie algérienne. La preuve en est l’ampleur de la colère sociale qui gronde dans ce pays. L’Algérie a connu au cours des dernières années des grèves importantes, en particulier en 2011 chez les enseignants, les travailleurs communaux, le personnel de la santé, dans toute la fonction publique, les pilotes, les cheminots, comme dans les grands centres industriels (SNVI-Rouiba, Sonatrach…). Et elle n’a pas été épargnée par les soulèvements qui ont secoué les pays arabophones et particulièrement le Maghreb. Ce qui a empêché la rébellion de se poursuivre comme en Egypte par exemple, c’est la main de fer de l’armée, alors même que plusieurs nuits d’émeutes gagnaient le pays face au ras-le-bol général, à la hausse du coût de la vie, à la généralisation d’un système mafieux où le moindre poste ou visa se paie. Pour la jeunesse, dont une majeure partie est condamnée au chômage et à une précarité endémique, il n’y a aucune perspective. La soldatesque algérienne détient les rênes du pouvoir avec des forces de répression qui contrôlent fermement la situation.
Etrangère ou indigène, la bourgeoisie est toujours barbare !
D’autre part, l’Algérie n’a cessé d’être de manière quasi-ininterrompue un terrain d’affrontements violents et de rivalités sanglantes entre fractions et cliques bourgeoises autochtones dont l’ensemble de la population a fait les frais.
Ainsi, après des années de luttes et de rivalités internes au sein du FLN qui ont succédé à l’indépendance du pays comme au sein de l’appareil militaire qui se sont traduites par des règlements de compte, des assassinats ou des “disparitions” ou encore après une répression féroce des soulèvements des minorités berbères notamment en Tizi-Ouzou dans les années 1970 ou en 1986, la violence a encore franchi un nouveau palier. Alors que le FIS (Front Islamique du Salut) avait fait une razzia lors des premières élections “libres” lors des élections locales en 1990, confirmé lors des législatives le 26 décembre 1991, l’armée décidait de pousser à la démission le président Chadli et d’interrompre le processus électoral. Les assemblées dirigées par des élus du FIS ont alors été dissoutes, militants et sympathisants des islamistes jetés en prison ou expédiés dans des camps dans le Sud saharien, tandis que d’autres s’engageaient dans la lutte armée. Le Mouvement islamique armé (MIA), puis les Groupes islamistes armés (GIA) se mirent à proliférer et à perpétrer des tueries et des attentats. Cela a été le début d’une effroyable guerre civile meurtrière qui allait durer une dizaine d’années avec des assassinats et des attentats de toutes sortes, les habitants de villages entiers, femmes et enfants compris, violés et égorgés. De nombreux témoignages, y compris émanant des services secrets de l’armée eux-mêmes, ont depuis largement démontré que le MIA et le GIA se sont vus équipés dès le début par les services secrets de l’armée de “véhicules de services”, et qu’un grand nombre des assassinats avaient été commis par les officines de l’armée qui avaient progressivement infiltré le mouvement et pris le contrôle des GIA ou s’y étaient même carrément substitués. Pendant cette “décennie noire”, la population algérienne s’est trouvée déchirée, et plongée dans la terreur permanente, en proie à la pire des guerres civiles, prise en otage entre le feu des islamistes et celui de l’armée, qui était fréquemment le même. Et durant cette période, l’Etat algérien, de Bouteflika aux militaires, n’a cessé de bénéficier de la totale complicité du gouvernement français qui continue aujourd’hui encore de lui apporter son appui.
Dans ce monde capitaliste, l’indépendance, nationale ou autre, n’existe pas ; tous les discours qui sont brassés autour de cette mystification ne servent qu’à renforcer et justifier l’exploitation, voire le massacre, des masses de la population.
W. (30 mars)
Géographique:
- Algérie [34]
Rubrique:
Révolution Internationale n°432 - mai 2012
- 1708 lectures
Avec les élections, les dirigeants changent mais la crise demeure, l’austérité demeure, l’exploitation demeure et le capitalisme demeure
- 1673 lectures
Depuis 2007, la France avait pour président un homme, Nicolas Sarkozy, d’un mépris, d’une arrogance et d’une bêtise sans bornes. Son amour affiché pour l’argent, ses discours d’une extrême violence à l’encontre des jeunes des banlieues ou des immigrés, ses provocations, sa propension à ne parler que de lui… Tout cela et bien d’autres choses avait créé un profond sentiment de rejet et d’exaspération dans l’ensemble de la population. Bref, c’est sans surprise que les élections présidentielles viennent de consacrer sa défaite. Son remplaçant, le socialiste François Hollande, s’est d’ailleurs appuyé presque essentiellement sur cet anti-sarkozysme pour gagner. Se gardant bien de toutes promesses de lendemains qui chantent, sous-entendant même que l’austérité (nommée hypocritement “maîtrise des budgets” ou “réduction des déficits”) serait un axe majeur de sa gouvernance, Monsieur Hollande s’est contenté de se présenter comme un futur président “normal”, un président qui évitera les provocations inutiles et les fautes de goût. Et cela a effectivement suffi à sa victoire. C’est dire si le dégoût envers Nicolas Sarkozy était profond.
Cela dit, ce serait commettre une erreur grave de ne voir dans ce changement de couleur du pouvoir que le rejet d’une personnalité, aussi antipathique soit-elle. Et il serait tout aussi faux d’espérer une politique plus humaine et plus juste de la gauche maintenant à la tête de l’Etat français.
Il suffit de porter quelques instants son regard par delà les frontières hexagonales pour s’en convaincre. Partout en Europe ces derniers mois, quand une échéance électorale se présente, le pouvoir en place est vaincu, qu’il soit de droite ou de gauche. En Grèce, au Portugal, en Irlande, en Espagne, en Italie, en Finlande, en Slovénie, en Slovaquie..., tous les gouvernements ont été éjectés et remplacés. Pourquoi ? Tout simplement parce que depuis 2007 et l’aggravation considérable de la crise économique mondiale, les gouvernements en place mènent partout, dans tous les pays, la même politique ravageuse faite de “sacrifices”. Il n’y a là aucune différence entre la droite et la gauche, excepté peut-être le discours, la couleur du paquet cadeau emballant ces “réformes”. En Grèce, au Portugal et en Espagne, de 2007 à 2011, les “socialistes” au pouvoir ont matraqué les ouvriers, au travail ou au chômage, à la retraite ou encore sur les bancs des universités. Ils ont imposé mois après mois des mesures toujours plus drastiques, attaquant ainsi sans vergogne les conditions de vie.
Mais il y a un second point commun à toute l’Europe concernant ces changements systématiques de gouvernance. Le remplaçant ne connaît pas d’état de grâce. Immédiatement, il mène à son tour une politique d’austérité brutale et immédiatement il est confronté au mécontentement. La crise économique n’est pas un choix du Capital, elle s’impose à lui ; elle est le fruit d’un système mondial malade et obsolète. Le capitalisme est aujourd’hui en déclin comme l’ont été avant lui l’esclavagisme à l’époque de la décadence romaine ou le féodalisme à l’époque de l’absolutisme. La “crise de la dette” n’est qu’un symptôme 1. Tous les élus, quelle que soit leur tendance politique et quel que soit leur pays, doivent donc appliquer les mêmes orientations : réduire les déficits, éviter la faillite en… attaquant impitoyablement les conditions de vie et de travail. Il n’en sera pas autrement avec le très socialiste François Hollande.
Les élections qu’organisent les Etats ne sont qu’un moment où les “citoyens” choisissent celui qui va gérer au mieux les intérêts de la nation. Elles s’inscrivent dans la cadre du système alors qu’aujourd’hui, pour mettre fin à la paupérisation croissante de la population mondiale, il n’y a qu’un seul chemin : celui de la lutte révolutionnaire. Le capitalisme, ce système inhumain et malade, doit être remplacé par un monde sans classe ni exploitation, sans profit ni compétition. Un tel monde ne peut être bâti que par les masses, les masses de travailleurs, chômeurs, retraités, jeunes précaires… unies et solidaires dans la lutte. Si des votes peuvent engendrer un vrai changement, ce sont ceux que nous organisons, nous les exploités, à main levée, dans nos assemblées générales pour décider ensemble, collectivement, comment nous devons nous battre contre les Etats et leurs représentants.
Pawel (6 mai)
1 Nous ne pouvons ici dans le cadre de cet article expliquer pourquoi le capitalisme est un système décadent qui ne peut mener l’humanité que vers toujours plus de misère et de guerres. Nous renvoyons nos lecteurs aux multiples articles traitant ce sujet sur notre site Internet, en particulier au texte “La crise de la dette, pourquoi ?”.
Rubrique:
Élections présidentielles: quelles leçons pour les travailleurs ?
- 1577 lectures
Les élections présidentielles occupent l’espace médiatique depuis des mois. Au lendemain de ce scrutin, quelles en sont les principales leçons ?
La prétendue victoire des travailleurs
Qui a gagné ? Les travailleurs, les exploités ? Certainement pas ! Contrairement à ce que prétend le PS, sa victoire n’est pas la nôtre. Les expériences de la gauche au pouvoir sont sans appel : seuls ou dans le cadre de la cohabitation, les gouvernements de gauche successifs depuis 1981 et sous l’ère Mitterrand ont appliqué sans discontinuer des plans de rigueur, de licenciements, ou des gels de salaire sans le moindre état d’âme. Et avec l’accélération de la crise mondiale, ceux-ci seront même beaucoup plus rudes encore. Les prolétaires vont subir dès demain les coups redoublés de l’austérité assénés cette fois par la gauche au pouvoir ! L’euphorie et l’illusion d’une victoire seront sans doute comparables à celles qu’avait provoquées l’élection de Mitterrand en mai 1981 mais la période a changé : elle sera de très courte durée et les effets de cette “gueule de bois” vont se dissiper dès le lendemain des législatives. Il n’y aura pas cette fois le moindre “état de grâce”. Car l’ampleur de la crise mondiale va faire très vite l’effet d’une douche froide (voir notre éditorial). Et les exploités d’aujourd’hui le seront encore bien davantage demain !
Le poids des illusions électorales
Dans ce cirque électoral, dopé par une polarisation et un matraquage médiatique intense, le scrutin du premier tour a clairement démontré l’ampleur des illusions électorales (à peine 20,5 % d’abstentions), en particulier dans les jeunes générations (19 % chez les 18-25 ans) même si celle-ci progresse dans les grandes agglomérations, chez les ouvriers et les employés.
La montée du populisme d’extrême droite et le poids de la décomposition sociale
Il est vrai aussi que la polarisation autour du score de Marine Le Pen à 18 %, ralliant plus de 6 millions d’électeurs, soit le plus grand nombre de voix jamais atteint par le FN, traduit la montée générale du populisme qui n’est que le produit des effets d’une décomposition sociale grandissante et du désarroi, d’un no future de beaucoup face à un avenir bouché.
L’illusion d’avoir élu “le moins pire”
Du moins, nous dira-t-on, cette élection aura permis que “Sarko dégage”. S’exprime ainsi surtout l’illusion dans cette élection d’avoir choisi “le moins pire”. Ce sentiment s’est même renforcé dans l’entre deux tours face aux discours nauséabonds de Sarkozy et sa drague effrénée envers les électeurs de la candidate d’extrême-droite présentée tantôt comme “compatible avec la République” (Sarkozy), tantôt comme une “interlocutrice plus présentable que son père” (dixit le ministre Longuet). Sarkozy n’a pas hésité à emprunter sans vergogne l’arsenal idéologique ultra-populiste du FN, tiré des égouts de la société, sur l’immigration et l’insécurité… ce qui a de quoi écoeurer. Cela a finalement été un puissant repoussoir, y compris pour bon nombre des électeurs potentiels de la droite “modérée” et du “centre” 1.
Mais dire que le choix s’est porté sur le “moins pire”… pas sûr, car de toutes façons, tant que l’enfer de l’exploitation capitaliste subsistera, les lendemains seront toujours pires.
Les prolétaires ne peuvent que se faire piéger sur le terrain électoral
C’est pourquoi les exploités n’ont rien à gagner en participant au grand cirque électoral où chacun d’entre nous se retrouve atomisé, impuissant, isolé... précisément dans l’isoloir. Au contraire ! Car c’est là que nos exploiteurs et leur gouvernement parviennent à nous démobiliser du seul terrain où nous pouvons nous affirmer, nous retrouver et nous reconnaître comme une force sociale collective, unie, solidaire, capable de remettre leur pouvoir en cause : la lutte de classe ! A la veille des législatives, nous devons réaffirmer avec énergie que les prolétaires n’ont rien à faire sur le terrain électoral, qui est par excellence celui de notre ennemi de classe.
PS/UMP : le même programme, attaquer nos conditions de vie
Si le PS se retrouve aujourd’hui au pouvoir, le candidat Hollande n’a, contrairement à l’époque de l’élection de Mitterrand en 1981, fait aucune promesse inconsidérée : aucune remise en cause d’ensemble sur la réforme des retraites (le principal “acquis” dont se vante Sarkozy), renforcement annoncé des effectifs de la police et des mesures de sécurité, engagement à poursuivre la politique de son prédécesseur sur la restriction des flux migratoires et les expulsions des immigrés clandestins, maintien des camps de rétention, etc. Il n’y a, sur le fond, pas de vraies différences entre le programme du PS et celui de l’UMP 2.
Une évidente volonté de toute la bourgeoisie de renforcer les syndicats...
Le discours de Sarkozy au Trocadéro, qui était le 1 mai anti-syndical, a en réalité permis de lancer une campagne de réhabilitation des syndicats comme pôle oppositionnel 3. Pourquoi ? Parce que la bourgeoisie française sait parfaitement que les syndicats vont devoir jouer un rôle crucial d’encadrement des luttes à venir. Les mois futurs vont être marqués par de lourdes attaques, surtout que les syndicats ont discrètement passé des accords avec le patronat et le gouvernement pour bloquer l’annonce de tous les nouveaux plans de licenciements prévus dans de très nombreuses entreprises (chez PSA, notamment à Citroën-Aulnay, chez sous-traitants de l’automobile, à Air France, à la SNCM, dans les télécoms, chez Areva, à Carrefour, dans le secteur bancaire et beaucoup d’autres...). Et cela jusqu’à la fin des élections législatives, donc pour que soit respectée “la paix sociale” pendant la période électorale. Tous savent donc bien que des annonces tomberont durant les vacances estivales. De même, les syndicats et le patronat (MEDEF) ont décidé en avril d’un commun accord de suspendre les négociations avec le gouvernement jusqu’après les présidentielles (elles devraient reprendre “discrètement” dès le 13 mai) sur les accords de “compétitivité/emploi” qui vont porter un sérieux coup de canif dans les règles des contrats de travail. En effet, ces “accords” prévoient une flexibilité accrue du temps de travail et des salaires. Il est prévu que cette plus grande “souplesse” puisse permettre aux entreprises d’ajuster le temps de travail et les salaires à la conjoncture sans l’accord individuel du salarié et de déroger à la durée légale de travail, en échange de la vague promesse d’un maintien des emplois.
… et la gauche de la gauche…
De même, la percée électorale de Mélanchon et de son Front de Gauche (bien qu’elle reste inférieure à la prévision des sondages), ne représente pas une réelle alternative sur le plan électoral, car il s’agit d’une mayonnaise montée artificiellement autour de la vieille sauce stalinienne, historiquement condamnée à jouer un rôle d’appoint qui, en plus, n’a fait que rabattre purement et simplement “sans conditions” ses voix vers Hollande pour “barrer la route à Sarko”. Néanmoins, cette fraction est appelée à jouer un autre rôle de premier plan tout à fait essentiel pour l’appareil bourgeois.
… pour encadrer et saboter les luttes ouvrières inévitables à venir
Il est clair que dans l’après-élection, il y aura des luttes face à la recrudescence très forte des attaques. Et le Front de Gauche de Mélenchon, comme le NPA du candidat Poutou et LO de la candidate Arthaud, le savent bien. C’est pour cela qu’ils se présentent comme une gauche oppositionnelle, parlant tous trois à l’unisson d’un “troisième tour social”, et mettant en avant la pression sociale à venir. Ils ont martelé comme jamais le message qu’ils seront bel et bien présents dans ces luttes. Le but est clair : les luttes ouvrières ne doivent surtout pas se développer librement, en-dehors du contrôle idéologique des syndicats et des gauchistes.
A aucun de tous ceux-là nous ne devons faire confiance. Nous devons prendre en mains nous-mêmes nos luttes, qui sont le seul moyen de nous défendre et d’imposer la défense de nos intérêts propres en créant un rapport de forces pour pouvoir abolir les rapports d’exploitation.
W. (6 mai 2012)
1 dont M. Bayrou, représentant de ce centre mou toujours acoquiné et rallié traditionnellement aux gouvernements de droite que les discours très “bleu Marine” de Sarkozy a rejeté dans les bras de Hollande.
2 C’est d’ailleurs pourquoi les “commentateurs” des médias aux ordres ont tellement insisté, notamment lors du fameux “débat télévisé de l’entre-deux tours sur “l’agressivité de la confrontation” et sur les différences de “personnalité entre les deux candidats.
3 Alors qu’en réalité Sarkozy a reçu pendant ces cinq années très régulièrement tous les syndicats, CFDT et CGT en tête, officiellement ou pas, à l’Elysée.
Rubrique:
Jeunes et vieux opprimés, principales victimes de la crise économique en Europe
- 2797 lectures
En Europe, la violence de la crise économique et des politiques d’austérité entraîne une paupérisation accrue de la population. Selon l’organisme statistique officiel européen, Eurostat, 16,4 % de la population de l’Union européenne (80 millions de personnes) vivent désormais sous le seuil de pauvreté en 2010 1, les plus touchés étant les jeunes de moins de 25 ans 2.
La jeunesse d’Europe est durement frappée...
Selon l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES), “dans l’Union européenne, l’emploi des jeunes a reculé davantage que l’emploi total et l’activité économique entre 2007 et 2010. (…) Après quatre années, la crise s’est aussi traduite par une progression des emplois temporaires et des temps partiels, une augmentation du chômage et du chômage de longue durée, une hausse de la proportion des jeunes sans emploi et hors de toute forme d’éducation et de formation (les “NEET”) 3, et plus généralement par une importante dégradation de la situation économique et sociale des jeunes” 4. À tout ceci s’ajoute, dans certains pays comme le Royaume-Uni, le poids énorme de l’endettement privé des étudiants nécessaire au financement de leur formation et les difficultés de remboursement en découlant, faute d’emploi stable à la fin de leurs études. Cela a pour conséquence que, “confrontés à la dégradation du marché du travail, une partie des jeunes l’a quitté ou n’y est pas entré, ayant souvent cédé au découragement, soit en se réfugiant dans le système éducatif et en prolongeant leurs études, soit en restant inactifs.” Résultat, les jeunes quittent leur pays en espérant trouver loin de chez eux un emploi pour pouvoir vivre : “Les chiffres provisoires sont incertains, mais plusieurs sources confirment une forte émigration de jeunes, en particulier des diplômés. (…) En Italie, (…) on estime qu’il y a 60 000 jeunes émigrants chaque année, dont 70 % sont diplômés de l’université” 5.
Parmi tous les pays de l’UE, seule la jeunesse d’Allemagne est pour l’instant relativement épargnée par la paupérisation.
… en France...
Question paupérisation de la jeunesse, la France se situe à un niveau médian, comparée aux autres pays de l’Union européenne. Concrètement, “sur quatre jeunes sur le marché du travail, un est au chômage, un second en emploi précaire et les deux derniers occupent un emploi normal. Et pour y parvenir ils ont, pour la plupart, dû accepter des stages ou des emplois temporaires. Même avec un diplôme, l’insertion dans l’emploi des jeunes est difficile. (…) Ainsi, 29 % des jeunes n’arrivent pas à se loger convenablement ou à se chauffer et 17 % ne parviennent pas à payer leurs factures et se retrouvent par dizaines de milliers en situation de surendettement. Avant 25 ans, les jeunes n’ont toujours pas droit à un revenu minimum, sauf conditions draconiennes” 6. Et la situation est encore pire pour les jeunes dans les “zones urbaines sensibles”, dont le taux de chômage officiel s’élève à 43 % !
… comme en Espagne
Mais l’Irlande, l’Espagne et la Grèce sont actuellement les pays où les conditions de vie des jeunes se sont, de loin, le plus dégradées entre 2007 et 2011 : “Très forte baisse de l’emploi des jeunes, trop peu atténuée par une hausse de l’inactivité, provoquant hausse du travail précaire, explosion du temps partiel subi et du chômage, en particulier du chômage de longue durée, explosion de la proportion de jeunes pauvres ou en danger d’exclusion, forte émigration” 7.
La situation en Espagne est une illustration concrète de ce que signifie cette dégradation ; dans ce pays, “700 000 jeunes de 15 à 29 ans étaient au chômage mi-2007, soit un taux de 14 %, le plus bas des trente années précédentes. En un peu plus de trois ans, on est revenu aux niveaux les plus élevés connus : le nombre de jeunes chômeurs a atteint au 2 trimestre 2011 près de 1,6 million, soit un taux de chômage de 32 %. Le nombre de jeunes chômeurs de longue durée a été multiplié par six dans la période 2007-2011. Aujourd’hui, 42 % des jeunes chômeurs sont de longue durée, alors qu’ils n’étaient que 15 % en 2007” 8, et la dégradation de la situation au premier trimestre 2012 vient même de porter le taux de chômage officiel des moins de 25 ans au-delà de 52 % 9 ! En conséquence, “on assiste à un recul de la part des jeunes quittant le domicile de leurs parents : le taux de décohabitation s’est réduit de près de 5 % chez les 18-34 ans, descendant à 45,6 %. Cette baisse est encore plus accentuée chez ceux de à 29 ans, pour lesquels ce taux baisse de 10 %” 10.
Quelle est la réponse du gouvernement espagnol face à cette misère croissante ? Encore plus d’austérité ! Ainsi, suite aux mesures prises le 20 avril par le gouvernement conservateur, les étudiants devraient bientôt voir leurs frais d’inscription universitaire s’envoler, passant de 1000 à 1500 € en moyenne 11.
Retraites de misère et mort prématurée attendent la vieillesse
Ces dernières mesures du gouvernement espagnol touchent également les retraités, qui avaient jusqu’ici un accès gratuit aux médicaments et qui devront désormais payer, en fonction de leurs revenus, jusqu’à 18 € par mois pour s’en procurer 12.
De fait, même si, à l’échelle de toute l’UE, les vieux sont bien moins touchés que les jeunes par la paupérisation, leur situation se détériore dramatiquement dans les pays ayant déjà adopté de sévères plans d’austérité.
Ainsi, au Portugal, “près de 11 600 personnes sont mortes en février dernier, selon la Direction générale de la santé portugaise (DGS), soit 10 % de plus qu’à la même période l’année passée. La plupart des victimes avaient plus de 75 ans” 13. De nombreux médecins dénoncent les mesures d’austérité et leurs conséquences sur les maigres pensions : dénutrition liée à la hausse du prix de l’alimentation, hypothermie liée à la hausse du prix de l’électricité et aux tentatives de réduire les factures de chauffage, logements insalubres, incapacité de payer transports, frais hospitaliers et médicaments. Des vieux résument ainsi la situation : “Nous pouvons acheter soit de la nourriture, soit des médicaments, mais pas les deux” 14.
En clair, la bourgeoisie portugaise laisse désormais crever de faim, de froid et de maladie les vieux les plus misérables, ces improductifs d’un point de vue capitaliste, impossibles à exploiter. Et avec l’aggravation de la crise économique et l’austérité croissante en résultant, nul doute que cette pandémie de misère et de mort qui commence à frapper la vieillesse du Portugal se propagera bientôt en Europe.
Toutefois, les chiffres mentionnés ici sont en partie trompeurs. D’un côté, certains chiffres, comme ceux du chômage, sont systématiquement falsifiés par les organes étatiques chargés de les produire, via de complexes manœuvres statistiques. De l’autre, ces mêmes organes étatiques rassemblent dans le même panier statistique “les jeunes” ou “les vieux”, comme s’il s’agissait de catégories populationnelles non divisées en classes sociales. Il résulte de tout ceci qu’au sein des classes opprimées, qui représentent l’immense majorité de la population, la situation sociale est encore pire que ce que nous laissent entrevoir ces chiffres !
Le prolétariat ne trouvera d’issue que dans la lutte !
Mais gardons-nous de ne voir “dans la misère que la misère, sans y voir le côté révolutionnaire, subversif, qui renversera la société ancienne” 15.
La classe ouvrière, sa jeunesse en particulier, n’a pas l’intention de subir sans combattre. C’est ce qu’ont montré les mouvements sociaux qui ont parcouru la planète en 2011, au cours desquels les jeunes prolétaires, encore étudiants, déjà au travail ou au chômage, ont été parmi les éléments les plus combatifs 16.
Car chez les ouvriers, jeunes ou vieux, se développe progressivement la conscience que la possibilité d’une vie meilleure ne peut passer que par la lutte.
DM (29 avril)
1 Le seuil de pauvreté est fixé à 60 % du revenu médian national. En France par exemple, ce seuil correspond à un revenu mensuel de 876 pour une personne seule, selon les estimations d’Eurostat.
3 NDLR : NEET (“Not in Education, Employment or Training”) signifie “ni étudiant, ni employé, ni stagiaire”.
4 Dossier de presse, no spécial 133 de la Chronique internationale de l’Ires, “Les jeunes dans la crise Principaux résultats”,
www.ires-fr.org/images/pdf/IresDossierConferencePresseLesJeunesdanslaCri... [37]
5 Idem.
7 “Les jeunes dans la crise”, op. cit.
8 Idem.
10 “Les jeunes dans la crise”, op. cit.
12 Idem.
14 Idem.
15 Karl Marx, Misère de la philosophie, http ://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/06/km18470615g.htm [42]
16 Sur ces luttes, voir en particulier fr.internationalism.org/ri431/2011_de_l_indignation_a_l_espoir.html [31]
Rubrique:
Pourquoi la terreur au Pérou ? Le Sentier lumineux et la lutte de la classe ouvrière
- 2479 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article réalisé par notre nouvelle section au Pérou.
Depuis quelques temps, l’Etat péruvien développe une campagne contre le terrorisme, en particulier contre certains groupes affaiblis mais armés comme le Sentier lumineux. A l’origine, c’était une simple campagne pour affaiblir la tentative de légalisation d’une fraction de Sentier lumineux – le Movadef 1 – qui aspirait à participer au jeu politique avec les autres partis. Lorsque des groupes terroristes, comme ce fut le cas pour l’IRA en Irlande ou actuellement l’ETA en Espagne, tentent de s’intégrer “normalement” au cirque politique, les forces déjà établies au sein de l’Etat déchaînent toujours des campagnes de décrédibilisation, de démolition et de harcèlement pour que les nouveaux venus soient le plus affaiblis possible et ne puissent pas rentabiliser le prestige qu’ils ont acquis préalablement par la lutte armée. Quand les partis bourgeois s’allient, il est courant qu’ils se donnent au préalable le maximum possible de coup bas. Ce n’est en rien paradoxal : chacun tente de s’allier avec un “partenaire” le plus faible possible, car dans ce marchandage impitoyable, ne pas le faire reviendrait à s’exposer à être affaibli à son tour.
Mais après que la tentative de légalisation du Movadef n’ait pas abouti, voilà que la campagne de l’Etat s’attaque à présent à de supposées incursions et à de prétendus actes de violence de la part de SL (cela va des graffitis sur les murs aux voitures piégées, aux assassinats et aux séquestrations, etc.). Et avec le temps, nous voyons l’Etat commencer à faire le lien entre certains secteurs de la population et ce groupe terroriste, en particulier des secteurs comme l’industrie minière où les conflits sont chaque jour plus aigus, comme c’est le cas pour Conga à Cajamarca ou pour les mineurs illégaux de la forêt amazonienne par exemple. Pourquoi l’Etat invente-t-il ce lien ? Pourquoi l’Etat commence-t-il à lier les manifestations contre les mineurs avec le Sentier lumineux ?
La réponse est évidente : parce que cela permet d’exercer plus facilement une répression extrêmement violente, sous prétexte “que dans ces mouvements sont présents des membres infiltrés du Sentier lumineux”. L’Etat a déjà commencé cette répression contre les secteurs paysans appauvris qui luttent contre la pollution minière dans leurs villages, qui luttent pour leur survie. La campagne contre le Sentier lumineux sert à justifier la répression de l’Etat contre les mouvements de protestations et sont un clair avertissement aux mouvements qui apparaîtront dans le futur.
Cette campagne ne se prive pas non plus de tenter de faire un lien entre le communisme et le terrorisme. La lutte de la classe ouvrière n’a rien à voir avec le terrorisme et le terrorisme n’a rien à voir lui non plus avec la classe ouvrière, car le terrorisme est toujours l’ennemi et le destructeur de celle-ci. Les communistes rejettent donc ouvertement les méthodes et les visions du terrorisme, ses pratiques et ses positions sont antagoniques à celles de la classe ouvrière.
“Le terrorisme n’est en rien un moyen de lutte de la classe ouvrière. Expression des couches sociales sans avenir historique et de la décomposition de la petite bourgeoisie, quand il n’est pas directement l’émanation de la guerre que se livrent en permanence les Etats, il constitue toujours un terrain privilégié de manipulation de la bourgeoisie. Prônant l’action secrète de petites minorités, il se situe en complète opposition à la violence de classe qui relève de l’action de masse consciente et organisée du prolétariat” 2.
Le terrorisme est donc une pratique qui n’appartient en rien à la tradition du mouvement ouvrier. Le terrorisme ne permet pas un processus de critique ni de réflexion, il provoque au contraire la peur et l’angoisse ; comme dans un pays en guerre, les bombardements ne favorisent pas la réflexion ni la prise de conscience des raisons de la guerre, mais au contraire provoquent des exodes, des fuites de populations qui sont poussées au sauve-qui-peut, générant ainsi un recul et un obstacle pour la prise de conscience collective de la classe ouvrière.
Les pratiques terroristes (et celles du Sentier lumineux en particulier) n’expriment que le désespoir et la décomposition de la petite-bourgeoisie à travers les “actions exemplaires” de groupes élitistes, pratique qui est totalement à l’opposé de la violence de classe qui, elle, surgit comme action collective et consciente des masses en lutte pour la destruction du capitalisme, comme ce fut le cas lors de l’émergence des soviets dans la Russie de 1917. Les pratiques prolétariennes sont basées sur les assemblées générales, les décisions collectives, la pratique commune, et sur tout ce qui favorise les conditions qui permettent le développement de la conscience. La conscience de la classe ouvrière se forge dans la lutte collective et unitaire.
Nous rejetons donc la politique d’amalgame que la bourgeoisie et l’Etat péruvien, avec à sa tête le guignol Humala, mettent en place pour fourrer dans le même sac “terrorisme et subversion” ou toute autre expression du mécontentement ou de lutte contre l’ordre actuel. Leur fin n’est autre que celle de préparer le terrain pour justifier la répression sanglante contre la classe ouvrière au Pérou, dans un contexte de crise mondiale du capitalisme qui apporte avec elle son chapelet d’attaques et de coupes contre les conditions de vie de notre classe, provoquant des réactions d’indignation et de lutte.
Nous pouvons voir à quel point ces groupes terroristes sont étrangers à la classe ouvrière avec la récente séquestration de trente travailleurs de l’usine de gaz de Camisea. par un supposé groupe du Sentier lumineux, qu’ils voulaient échanger contre le “camarade Artemio” emprisonné. La capture du “camarade Artemio” et la légalisation du Movadef, jointes aux supposées attaques de ce groupe terroriste, servent de cheval de Troie à l’Etat pour préparer le terrain à une répression brutale de la classe ouvrière, qui a commencé à lutter dans d’autres parties du monde (Espagne, Grèce…) et dont la lutte se concrétisera aussi bien au Pérou que sur le reste du continent américain.
Internacionalismo-Pérou (avril)
1 Movadef : “Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales” (Mouvement pour l’amnistie et les droits fondamentaux). Le Sentier lumineux, fondé en 1970, est un mouvement d’inspiration maoïste prônant la lutte armée et les actes terroristes. Sa “tactique de guérilla” a semé la terreur dans tout le pays et provoqué de sanglants massacres de population (environ 70 000 morts) tout au long des années 1980 et 1990 au Pérou, en particulier dans les campagnes et les villages d’où ils menaient leurs “actions” (NDLR).
2 Extrait des “Positions de base” du Courant communiste international.
Géographique:
- Pérou [43]
Rubrique:
Déclaration pour une organisation révolutionnaire, Belgrade
- 1621 lectures
Introduction du CCI
Au cours des années 1990, le territoire de l’ex-Etat de Yougoslavie a été le théâtre d’une série de massacres horribles justifiés par l’idéologie du chauvinisme ethnique. La guerre dans les Balkans a plus rapproché la boucherie impérialiste du cœur du capitalisme qu’à n’importe quel moment depuis 1945. Les bourgeoisies locales ont fait tout ce qu’elles ont pu pour jeter leurs populations dans une haine inter-ethnique et nationaliste frénétique, condition d’un soutien ou d’une participation aux affrontements sanglants de la guerre en Yougoslavie.
Ces haines n’ont pas été éliminées par la paix précaire qui règne maintenant dans la région, aussi il est pour le moins réconfortant de voir des signes qu’il y a dans cette région des gens qui cherchent une issue dans le mouvement social contre le capitalisme et pas dans des rêves quelconques d’expansion nationale. Nous avons vu, par exemple, un certain nombre de luttes d’étudiants en Serbie et en Croatie, qui doivent être considérées comme une autre expression de la même tendance internationale que nous avons vue en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis avec les “indignados” et le mouvement des Occupy. Et maintenant, nous assistons au développement d’une minorité politisée authentiquement internationaliste dans ces deux pays, qui rejette ouvertement les divisions nationales et recherche la coopération avec tous les révolutionnaires internationalistes.
Une expression de ce nouveau mouvement est la déclaration du collectif de Birov en Serbie, qui a récemment émergé d’un noyau qui grandit (voir leur site web : www.birov.net [44] 1). Nous la publions ici. Il nous semble que le plus important dans cette déclaration, c’est la clarté et la façon directe de mettre en avant une série de positions de classe fondamentales :
– L’affirmation de la nature révolutionnaire de la classe ouvrière contre toutes les “mystifications post-marxistes” ;
– La nécessité de l’auto-organisation de la classe ouvrière en opposition aux syndicats définis comme organes de l’Etat capitaliste ;
– L’insistance sur le fait que les assemblées ouvrières et, par la suite, les conseils ouvriers, sont les instruments de la lutte de masse contre le capitalisme ;
– Le rejet de toutes les luttes de libération nationale et des guerres capitalistes, vu comme une “frontière” fondamentale “entre révolutionnaires et la gauche patriotique et social démocrate”.
– La caractérisation des soi-disant “Etats socialistes” comme des régimes capitalistes.
Les deux derniers points sont évidemment spécialement importants étant donné les récents conflits dans la région et l’utilisation croissante de la rhétorique nationaliste par la classe dominante.
Insister sur ces positions révolutionnaires est l’expression de la claire reconnaissance que le capitalisme n’est plus dans sa phase progressive et ne peut plus accorder de réformes permanentes, en d’autres termes, que c’est un système en déclin.
La déclaration fait aussi une observation intéressante sur la période de transition, en reconnaissant le problème du “frein” conservateur exercé par certains organismes semi-étatiques.
Il reste évidemment des domaines de discussion et de clarification entre internationalistes, par exemple sur la question de l’organisation des révolutionnaires, des perspectives pour la lutte de classe et de la signification de l’anarcho-syndicalisme aujourd’hui. Dans l’immédiat, nous pouvons saluer un réalisme plein de santé dans l’affirmation de la Déclaration selon laquelle “aucune organisation révolutionnaire ne peut être plus grande ou plus forte que ce que dicte la position générale actuelle des ouvriers”. Ces points et d’autres, sans doute, ne peuvent être éclaircis que qu’à travers le développement d’un débat ouvert et fraternel.
CCI (février 2012)
Déclaration du Collectif de Birov à Belgrade
“S’il y a un espoir, il doit reposer sur le prolétariat” (George Orwell).
Conscients de la division en classes au sein du système capitaliste, de l’exploitation brutale dont nous sommes tous les victimes, de l’oppression de l’Etat qui rend cette exploitation possible et aussi de l’ordre militariste actuel insoutenable qui nous conduit inévitablement à la catastrophe, nous nous sommes organisés au sein de “Birov”, un collectif dont le but est de s’opposer radicalement à ces phénomènes sociaux et de mener à bien leur éradication totale à travers la lutte de classe.
Conscients que la classe ouvrière, en tant que classe la plus touchée par les contradictions sociales actuelles, détient le plus grand potentiel révolutionnaire, “Birov” organise des militants ouvriers, avec une conscience de classe, avec l’intention de répandre la conscience de classe au sein de la classe ouvrière, et d’orienter cette dernière vers la lutte des travailleurs organisés au moyen des conseils ouvriers. Nous rejetons toutes les mystifications “post-marxistes” sur la mort ou la non existence de la classe ouvrière qui nient donc la lutte de classe et le rôle crucial des ouvriers comme acteurs du changement révolutionnaire. Est membre de la classe ouvrière celui qui doit vendre sa force de travail au capital : un commis-boucher, un employé dans l’industrie du sexe ou une fille qui travaille dans une imprimerie le sont tout autant.
Les actions émancipatrices de la classe doivent reposer sur l’auto-activité des opprimés et sur des conseils ouvriers autonomes, se battant pour la perspective de créer une société autogérée, sans Etat, sans classe et sans les institutions non voulues de la société civile. Chaque nouvelle tentative de renverser la vieille société doit être dirigée vers l’organisation du système de conseils à l’échelle internationale, parce qu’il n’y a qu’un changement radical dans le rapport de force entre les classes qui puisse donner lieu à des transformations progressives des rapports sociaux. La forme des conseils érigée après la dissolution de la machine étatique traditionnelle et hiérarchique, n’est pas le but de la lutte révolutionnaire – à ce moment, la machine étatique ne peut exister que comme organe conservateur pendant la révolution, et l’auto-organisation comme l’émancipation finale de la classe ouvrière menaceront son pouvoir rapidement, tout autant que l’existence de cet ordre lui-même. Dans ce conflit imminent, les révolutionnaires doivent reconnaître dans les ouvriers organisés de manière autonome l’avant-garde révolutionnaire dans la bataille finale et décisive contre l’ordre ancien et pour une société de libres producteurs.
Ce n’est que l’opposition ouverte et sans restriction aux divisions créée par cette société qui libérera le potentiel subversif que recèle la lutte existante des ouvriers aujourd’hui. La lutte des travailleurs doit être axée sur les lieux de travail, où les ouvriers se reconnaissent comme producteurs, et où les différences de classe sont prévisibles et résolues dans leur essence. Nous rejetons le parti parce que complètement inadéquat pour l’organisation révolutionnaire de la classe ouvrière. Les vieux partis réformistes, qu’on nous rappelle avoir gagné des libertés politiques et des réductions d’heures de travail, n’étaient pas cela en premier lieu : leur principal objectif était une lutte pour des réformes économiques et politiques, dans laquelle une conscience anti-politique était encore à venir et qui tendait vers des formes traditionnelles et hiérarchiques de représentation.
Nous pouvons en conclure que “Birov” peut être caractérisé comme une organisation de propagande anarcho-syndicaliste. Elle s’adresse aux ouvriers en lutte et regroupe les anarcho-syndicalistes qui agissent en formant des regroupements de classe des éléments combatifs sur leurs lieux de travail. Ces groupes ne doivent pas être confondus avec des syndicats parce que leur but n’est pas de grossir en nombre mais de participer à des mouvements d’assemblée. Ils n’ont pas de structure formelle et de programme politique. Ces groupes se forment sur les lieux de travail où il y a déjà une tradition d’organisation ouvrière autonome et où un réseau d’ouvriers tend à continuer ses activités et à développer de nouvelles façons de lutter.
Nous considérons qu’aujourd’hui les syndicats ne peuvent pas avoir de programme politique qui ne soit pas réactionnaire et donc, la seule façon possible de s’organiser pour la masse des ouvriers ne peut être que les assemblées ; s’organiser massivement dans une organisation “permanente” n’est pas possible tant que la révolution n’est pas devenue un but immédiat. Les syndicats ont perdu, en tant qu’instruments de lutte pour des réformes et organisation économique séparée, leur raison d’exister dans des conditions dans lesquelles ils ne peuvent plus encore refléter les aspirations de la classe ouvrière. Ils ne sont rien de plus aujourd’hui qu’un instrument qui maintient la dépolitisation de la lutte des ouvriers au sein d’un cadre strictement limité. Ils représentent une sorte de prison pour la classe ouvrière, sans lesquels les ouvriers seraient libres d’exprimer leur tendance à l’auto-organisation. Les bureaucrates syndicaux payés et souvent corrompus, ne sont rien d’autre que des gardiens qui mettent en œuvre une autre sorte de répression de la classe ouvrière. Le capitalisme ne peut plus accorder de réformes durables : chaque lutte pour les intérêts immédiats et quotidiens du prolétariat, quand elles ne sont pas empêchées par les syndicats et les partis, évolue nécessairement vers une orientation révolutionnaire des masses et vers des actions contre les fondements répressifs et exploiteurs de l’ordre capitaliste. C’est pourquoi aujourd’hui, tout ce qui tend à dépolitiser la lutte des travailleurs et à la maintenir dans le cadre imposé par le système est nécessairement réactionnaire. Les affirmations selon lesquelles les organisations anarcho-syndicalistes devraient être “non idéologiques”, ne sont pas une alternative aux fausses divisions imposées par le capitalisme, mais ne sont qu’une réémergence de la vieille idée (inapplicable) sur une organisation économique séparée, et finissent le plus souvent dans la pratique, comme celles des réseaux gauchistes activistes qui reproduisent l’idéologie de la gauche nationaliste officielle. A l’opposé de ces affirmations, les organisations anarcho-syndicalistes sont des organisations de la classe combative et politiques : les seuls principes de l’anarcho-syndicalisme qui sont acceptés par tous les membres sont nécessairement politiques dans leur contenu.
Nous ne nous voyons pas comme une organisation qui tende nécessairement à grandir en nombre, une idée dont le résultat est souvent l’activisme radical, pas plus que nous ne nous considérons comme une espèce d’avant-garde de la classe ouvrière qui impose ses intérêts. Notre but est de développer une organisation qui sera capable d’intervenir dans la lutte des travailleurs. Nous partageons une accumulation d’expériences avec les ouvriers et à partir de là, nous pouvons accroître la capacité de la lutte ouvrière, contribuant ainsi à son extension et à son organisation ultérieure. Une telle relation crée une dépendance mutuelle et en conséquence, aucune organisation révolutionnaire ne peut être plus grande ou plus forte que ce que dicte l’actuelle position générale des travailleurs ; et c’est pourquoi nous n’avons pas peur de l’auto-organisation des travailleurs et d’une “perte de contrôle”, c’est au contraire notre but. En conséquence, la base de l’unification des groupes opprimés dans le capitalisme ne sera pas établie par un quelconque parti ou “front”, ni par un syndicat de masse, ou un groupe anarchiste qui agit dans une phase préparatoire, la phase de regroupement des forces révolutionnaires, mais par une lutte massive anti-capitaliste organisée à travers des conseils ouvriers sous l’aile desquels peut être seulement élaborée la vision émancipatrice. De plus, la meilleure façon d’exprimer la solidarité avec les groupes opprimés est le développement de notre propre lutte sur les lieux de travail et d’une éducation constante sur la question de l’oppression.
Nous condamnons comme complètement réactionnaires tout discours sur le caractère révolutionnaire des luttes de “libération nationale”. Faire un parallèle avec les mouvements nationaux révolutionnaires bourgeois est faux et dans cette période l’anti-nationalisme est une frontière entre les révolutionnaires et la gauche patriotique, social démocrate. Dans la société capitaliste d’aujourd’hui, chaque Etat est impérialiste et la croissance du sentiment d’appartenir à une nation ne peut être vue que comme un moyen de préserver l’ordre capitaliste qui est dans des conditions de crise permanente et de catastrophe imminente. Toute acceptation des discours populistes, nationalistes, ne peuvent que mener les ouvriers à une sanglante guerre impérialiste ; c’est le prélude à un tel moment historique, comme nous en avons été les témoins au début et au milieu du xx siècle.
En opposition totale aux idées du mouvement anti-guerre de la Première Guerre mondiale, l’idéologie soumet les ouvriers aux besoins de la bourgeoisie nationale et tout cela au nom de “l’anti-impérialisme” et de la “libération des peuples”. Les résultats sont visibles historiquement et peuvent être vus dans les “révolutions sociales” après la fin de la période révolutionnaire d’Octobre 1917, qui ont été victimes de l’instrumentation et de la suppression de toute forme d’auto organisation et ont débouché sur des régimes impérialistes totalitaires capitalistes d’Etat, ou du soi-disant “socialisme réel”.
L’émancipation de la classe ouvrière sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ou elle ne sera pas.
Belgrade, Serbie (octobre 2011)
1) Voir leur FAQ qui donne aussi plus d’explication de ceci et d’autres aspects de la politique du groupe.
Rubrique:
Equateur : la “révolution citoyenne”, c’est cogner toujours plus sur la classe ouvrière
- 1730 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article réalisé par notre nouvelle section en Equateur.
Depuis l’arrivée au pouvoir de Correa 1 en Equateur, les attaques contre la classe ouvrière n’ont cessé de pleuvoir, et se sont au contraire intensifiées. Le “corréisme” s’est révélé bien plus efficace que d’autres gouvernements dans sa besogne anti-prolétarienne. Le “corréisme” est ainsi la continuation de tous les gouvernements qui l’ont précédé depuis 1979, quand les militaires, associés aux partis de gauche comme de droite, se répartirent à huis clos les rôles dans le nouveau scénario destiné à gérer le mieux possible la crise du capitalisme enclenchée à la fin des années 1960 et qui s’est exprimé essentiellement à travers la fuite en avant dans l’endettement généralisé des Etats.
Face à l’impasse dans lequel se trouve le capitalisme décadent, marqué par une décomposition galopante qui rend le futur toujours plus incertain, même aux yeux des économistes les plus optimistes, la bourgeoisie ne peut que recourir avec une passion démente à l’endettement et à l’application de politiques économiques d’austérité qui ont comme conséquence de plonger la classe ouvrière dans la misère la plus noire.
L’Etat équatorien n’échappe pas à cette tendance, lui dont les exportations ont tendu à décroître ces trois dernières années. La prétendue santé de l’économie repose sur le montant des revenus nationaux en dollars, basés sur le prix du pétrole qui génère apparemment une expansion des revenus de l’ordre de 13 %. Il s’agit en réalité d’un mirage dû à ce que les réserves mondiales s’épuisent et que la spéculation se déchaîne, mais l’essentiel des mesures pour faire face à l’instabilité se trouve dans le serrage de ceinture des travailleurs. C’est ainsi que tend à disparaître la part de salaire indirect représentée par la réduction des dépenses de santé et d’éducation qui provoquent aussi des licenciements dans la classe ouvrière, comme le font Obama, Sarkozy, Angela Markel, Rajoy ou n’importe quel gouvernement dans le monde.
Correa, protégeant les intérêts de la classe dominante, impose des politiques de flexibilité de l’emploi, de licenciements brutaux, de gel des salaires, de suppression des conventions collectives tout en évitant le “traumatisme” des manifestations de rues… grâce aux enjolivements des discours axés sur la défense de la démocratie et de lois imposées au nom du “pouvoir populaire”.
Quelques exemples concrets de ce que nous venons d’avancer :
– le 30 avril 2008, l’imposition de “l’ordonnance n 8” destinée à normaliser la “Tercerización e Intermediación Laboral” a signifié le licenciement de 39 200 travailleurs, dont une partie seulement fut réembauchée par les entreprises où ils travaillaient auparavant, mais en sous-traitance ;
– à partir du 30 avril 2009 fut appliqué le “décret 1701” destiné à limiter les “privilèges” donnés par les conventions collectives signées par les fonctionnaires publics et l’Etat : des milliers de travailleurs furent aussitôt mis à la retraite anticipée et d’autres, après avoir subi des “évaluations” de leurs capacités, furent forcés de démissionner ; dans l’enseignement, pas moins de 2957 enseignants furent amenés à suivre ce “chemin de croix” ;
– dès le 7 juillet 2011 fut appliqué le “décret exécutif 813”, qui réformait la réglementation du service public et instituait “l’achat de démissions obligatoires2” ; 7093 postes ont ainsi été éliminés depuis 2011, sapant particulièrement le secteur de la santé qui a souffert le plus des licenciements.
Parmi la population active de l’Equateur (qui atteint 55,5 % de la population totale), 57 % n’a pas de travail stable, c’est-à-dire qu’elle est ballottée entre le travail informel (vendre n’importe quoi dans la rue), le travail précaire et la zone des traîne-misère privés de tout…
Mais même les travailleurs qui ont un travail fixe n’ont pas de revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Le salaire d’un travailleur “qualifié” (bac technique ou autre qualification professionnelle) est de 280 dollars par mois, celui d’un médecin issu de l’université après sept années d’études varie entre 500 et 700 dollars mensuels. Les seuls qui ont vu leurs salaires augmenter sont les forces de police. Correa a décrété une augmentation de salaires des militaires qui varie de 5 à 25 %. Aujourd’hui, un simple soldat issu des casernes d’instruction militaire, entraîné à tuer, touche un salaire de 900 dollars mensuels.
C’est là l’essence du “corréisme”, enveloppé dans cette aberration baptisée “révolution citoyenne”, qui fait partie de cette ignoble et abominable idéologie du “socialisme du xxi siècle” cher à Chavez.
Les promesses de Correa et des idéologues du “socialisme du xxiee siècle” ne sont pas des options valables pour les travailleurs, seule leur lutte peut tracer une perspective propre contenant un vrai futur.
Internacionalismo-Equateur (mars 2012)
1 Rafaël Correa Delgado, ancien professeur d’économie politique, formé en Europe et aux Etats-Unis, est issu du sérail de la bourgeoisie. Devenu conseiller du président puis ministre des Finances sous le régime Palacio, se présentant comme “chrétien de gauche et humaniste”, il se fait remarquer par sa brève “croisade” idéologique contre les diktats du FMI et de la Banque mondiale. Porté à la tête d’une coalition entre différents partis de gauche, il est élu au 2e tour des élections présidentielles d’octobre 2006 et se retrouve à la tête de l’Etat équatorien depuis mars 2007. Il réforme la Constitution et se fait réélire dès le 1er tour de nouvelles élections présidentielles anticipées qu’il a provoquées en avril 2009 (NDLR).
2 “Compra de renuncias obligatorias”, facilitant les licenciements.
Géographique:
Rubrique:
Comment aider le CCI ?
- 8894 lectures
La gravité de la situation à laquelle l’humanité est confrontée est de plus en plus évidente. L’économie capitaliste mondiale, après quatre décennies d’efforts pour amoindrir les effets de la crise ouverte, est en train de s’effondrer sous nos yeux. Et les perspectives posées par la destruction de l’environnement apparaissent à chaque enquête scientifique toujours plus sombres. La guerre, la famine, la répression et la corruption sont aussi le lot quotidien de millions de gens.
En même temps, la classe ouvrière et les autres couches opprimées de la société commencent à résister aux exigences du capitalisme pour plus de sacrifices et d’austérité. Révoltes sociales, occupations, manifestations et mouvements de grève ont surgi dans toute une série de pays de l’Afrique du Nord à l’Europe et de l’Amérique du Nord à l’Amérique du Sud.
Le développement de toutes ces contradictions et conflits confirme plus que jamais le besoin d’une présence active des organisations révolutionnaires, capable d’analyser une situation qui évolue rapidement, capable de parler clairement d’une voix unifiée au-delà des frontières et des continents, de participer directement aux mouvements des exploités et d’aider à clarifier leurs méthodes et leurs buts.
Il ne faut pas cacher que les forces du CCI sont extrêmement limitées en regard des énormes responsabilités auxquelles nous devons faire face. Nous voyons l’émergence au niveau mondial d’une nouvelle génération en recherche de réponses révolutionnaires à la crise de ce système. Il est essentiel pour ceux qui sympathisent avec les buts généraux de notre organisation de prendre contact avec le CCI et de faire leur propre contribution à cette capacité d’agir et de grandir.
Nous ne parlons pas seulement ici de rejoindre notre organisation, bien que nous reviendrons sur ce sujet. Nous donnons toute sa valeur à toutes sortes de soutien et d’assistance que tous ceux qui sont en accord général avec nos positions politiques peuvent offrir.
Comment pouvez-vous aider ?
Premièrement, en discutant avec nous. En nous écrivant par courrier, e-mail, ou en prenant part à notre forum de discussion en ligne. En venant à nos réunions publiques et aux réunions organisées pour les contacts. En soulevant des questions sur nos positions, nos analyses, notre façon d’écrire, la manière dont fonctionne notre site web, etc.
Ecrivez pour notre site et nos journaux, que ce soit des comptes rendus sur des meetings auxquels vous avez assisté, ce qui se passe sur votre lieu de travail, votre secteur ou celui d’à côté, ou encore des articles plus développés, des contributions théoriques, etc.
Aidez-nous à traduire à partir de ou dans les différentes langues dans lesquelles nous écrivons : le CCI a différentes pages web de tailles variées en anglais, français, espagnol, allemand, hollandais, italien, portugais, hongrois, suédois, finlandais, russe, turc, bengali, coréen, japonais, chinois et philippin. Il y a toujours beaucoup trop d’articles à traduire dans toutes les langues, y compris certains des textes de base de notre organisation. Si vous pouvez traduire dans telle ou telle langue, faîtes-le nous savoir.
Participez à nos activités publiques : en vendant la presse dans la rue, en discutant et en distribuant notre presse et nos tracts aux piquets de grève, dans les manifestations et les occupations. Aidez-nous à intervenir dans les réunions politiques, allez-y vous-mêmes et défendez les idées révolutionnaires ; contribuez aux forums de discussion Internet dans lesquels nous participons régulièrement comme par exemple, pour la langue anglaise, sur libcom.org [46], ou www.revleft.space/vb [47] (1), www.red-marx.com [48], etc.
Si vous connaissez d’autres personnes qui sont aussi intéressées à discuter de la politique révolutionnaire et de la lutte de classe, mettez en place des cercles de discussion, des comités de lutte de classe ou des regroupements similaires, que nous serions très satisfaits à vous aider à démarrer et à y prendre part nous-mêmes.
Contribuez aux techniques et aux ressources techniques : photos, travaux d’art, informatique…
Aidez-nous à augmenter nos finances très restreintes en faisant des dons réguliers, en souscrivant à notre presse, en prenant des exemplaires supplémentaires de notre presse pour les vendre autour de vous, ou pour les déposer dans des librairies locales.
Rejoindre le CCI
Nous saluons avec enthousiasme les demandes de camarades qui veulent élever leur soutien à l’organisation à un plus haut niveau en devenant membres.
Alors que chaque sympathisant ne rejoint pas l’organisation, nous pensons qu’en devenir membre signifie prendre part à l’histoire de la lutte de classe prolétarienne dans le plein sens du terme. Le prolétariat est par nature une classe dont la force réside dans sa capacité à l’organisation collective, et cela est particulièrement vrai pour ses éléments révolutionnaires, qui ont toujours cherché à s’unir dans des organisations pour défendre la perspective communiste contre l’énorme poids de l’idéologie dominante. Devenir membre du CCI permet aux camarades de participer directement à la réflexion et aux discussions qui traversent constamment l’organisation et de contribuer le plus efficacement à notre intervention dans la lutte de classe. Pour affûter les analyses et la politique de l’organisation, la place la plus utile d’un militant individuel est de se trouver en son sein, car pour l’organisation dans son ensemble, ses membres sont une source irremplaçable sur laquelle elle peut compter et à travers laquelle elle peut développer son activité à une échelle mondiale.
Avant de rejoindre le CCI, il est essentiel pour chaque camarade d’avoir une discussion en profondeur sur nos positions politiques fondamentales, qui sont liées à une cohérence marxiste générale et contenues dans notre plate-forme, afin que ceux qui vont être membres le deviennent avec une véritable conviction et soient capables d’argumenter nos positions politiques parce qu’ils en ont une réelle compréhension. Il est également important de discuter de nos statuts organisationnels et d‘être en accord avec les principes et les règles de base qui guident notre fonctionnement : comment nous sommes organisés au niveau local, national et international, le rôle des congrès et des organes centraux, comment nous conduisons nos débats internes, ce qui est attendu des membres en termes de participation dans la vie de l’organisation, etc. L’approche de base contenue dans nos statuts peut être lue dans ce texte : “Rapport sur la structure et le fonctionnement de l’organisation révolutionnaire” (2).
En ce sens, nous vivons dans la tradition du parti bolchevik, selon lequel un membre était quelqu’un qui, non seulement était en accord avec le programme du parti, mais le défendait activement à travers les activités de l’organisation, et était donc prêt à adhérer à sa méthode de fonctionnement incluse dans ses statuts.
Ce n’est pas un processus d’une nuit et cela prend du temps et de la patience. Contrairement aux groupes gauchistes, trotskistes ou autres, qui se réclament faussement du bolchevisme, nous ne cherchons pas à “recruter” à tout prix, et donc à avoir des membres qui ne sont rien de plus que des pions dans le jeu d’une direction bureaucratique. Une réelle organisation communiste ne peut fleurir que si ses membres ont une profonde compréhension de ses positions et de ses analyses et sont capables de prendre part à l’effort collectif pour les appliquer et les développer.
La politique révolutionnaire n’est pas un hobby : elle implique un engagement à la fois intellectuel et émotionnel pour faire face aux exigences de la lutte de classe. Mais ce n’est pas non plus une activité de moine, coupée de la vie et des inquiétudes que connaît le reste de la classe ouvrière. Nous ne sommes pas une église, cherchant à réguler chacun des aspects de la vie de nos membres, en façonnant des fanatiques incapables de pensée critique. Nous n’attendons pas non plus que chaque membre soit “expert” de tous les aspects de la théorie marxiste, ou d’entrer dans nos rangs avec des techniques hautement développées d’écriture ou des talents d’orateur. Nous reconnaissons que les camarades, les individus, ont des capacités variées dans différents domaines. Nous travaillons sur le principe communiste que chacun contribue selon ses moyens – que c’est la tâche du collectif de renforcer toutes les énergies individuelles de la façon la plus efficace.
La décision d’entrer dans une organisation révolutionnaire n’est pas à prendre à la légère. Mais rejoindre le CCI signifie devenir une partie de la fraternité mondiale luttant pour un but commun – le seul but qui offre un réel futur pour l’humanité.
CCI (novembre 2011)
1) En particulier sur ce dernier le forum de la Gauche communiste [49].
2) Paru dans notre Revue internationale no 33 (disponible sous forme papier sur demande ou à consulter sur notre site Internet [50]).
Rubrique:
Salut aux nouvelles sections du CCI au Pérou et en Equateur !
- 1644 lectures
C’est à la grande joie de notre organisation et de ses militants que viennent d’être constituées deux nouvelles sections du CCI, au Pérou et en Equateur.
La constitution d’une nouvelle section dans notre organisation est toujours pour nous un évènement de la plus grande importance. D’une part, parce qu’elle constitue une vérification supplémentaire de la capacité du prolétariat mondial, malgré ses difficultés, à secréter des minorités révolutionnaires à l’échelle internationale et, d’autre part, parce qu’elle participe du renforcement de la présence dans le monde de notre organisation.
La fondation de ces deux nouvelles sections du CCI intervient dans une situation où le prolétariat commence à récupérer, depuis 2003, de la longue période de recul dans sa conscience et dans sa combativité qu’il a subie à partir des événements de 1989 1. Cette récupération s’est traduite par un ensemble de luttes démontrant une conscience croissante de l’impasse dans lequel se trouve le capitalisme et par l’émergence, à l’échelle internationale, de minorités internationalistes qui recherchent le contact entre elles, se posent de nombreuses questions, recherchent une cohérence révolutionnaire et débattent des perspectives pour développer les combats de classe. Une partie de ce milieu se tourne vers les positions de la Gauche communiste et certains de ses éléments ou groupes viennent rejoindre notre organisation. C’est ainsi qu’en 2007 était créé un noyau du CCI au Brésil 2. En 2009, nous saluions la création de deux nouvelles sections du CCI aux Philippines et en Turquie 3.
Ces deux nouvelles sections sont aussi le produit de l’effort soutenu de toute notre organisation et de ses militants afin de participer à la discussion et à la clarification politique, de tisser des liens partout où il existe des groupes ou éléments en recherche, qu’ils se destinent ou non à entrer dans notre organisation.
Nos nouvelles sections étaient, avant de nous rejoindre, des groupes d’éléments en recherche qui, soit se sont tournés d’emblée vers la clarification politique autour des positions du CCI comme en Equateur, soit proviennent de différents milieux politiques comme au Pérou. Dans un cas comme dans l’autre, elles se sont développées à travers la discussion avec d’autres forces politiques et dans les discussions systématiques avec le CCI, de sa plateforme en particulier. Par ailleurs, elles ont eu à cœur de prendre position sur les évènements majeurs de la situation internationale et nationale 4. Aujourd’hui, elles continuent d’évoluer dans un milieu riche de contacts.
Basées en Amérique du Sud, ces deux nouvelles sections viennent renforcer l’intervention du CCI en langue espagnole, et sa présence en Amérique latine où le CCI était déjà présent au Venezuela, au Mexique et au Brésil.
L’ensemble du CCI adresse un chaleureux et fraternel salut à ces deux nouvelles sections et aux camarades qui les constituent.
CCI (avril 2012)
1 L’effondrement du stalinisme qui avait donné lieu au développement de campagnes de la bourgeoisie identifiant frauduleusement, une nouvelle fois, le communisme et le capitalisme d’Etat tel qu’il s’était développé dans les pays de l’Est suite à la dégénérescence de la révolution russe.
2 Lire “Salut à la création d’un noyau du CCI au Brésil !”. http ://fr.internationalism.org/ri381/salut_a_la_creation_d_un_noyau_du_cci_au_bresil.html [51]
3 Lire “Salut aux nouvelles sections du CCI aux Philippines et en Turquie !”.
http ://fr.internationalism.org/icconline/2009/philippines-turquie [52]
4 Certaines de ces prises de position ont été publiées dans Action Proletaria, organe du CCI en Espagne, et dans ICC on line sur notre site en langue espagnole.
Rubrique:
Le conflit aux Iles Spratly : travailleurs des Philippines et de Chine, unissez vous !
- 2362 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article d’Internasyonalismo, organe du CCI aux Philippines.
“Travailleurs de tous les pays, unissez vous !” C’est la vérité et la réalité dans le système capitaliste. Nous, les travailleurs, n’avons ni intérêt national, ni nationalité à laquelle nous raccrocher, et nous nous défendons en tant que classe internationaliste. Où que nous soyons dans le monde, nous sommes exploités et opprimés par le capital et l’Etat national.
Le patriotisme et l’intérêt national ne servent qu’une classe particulière. L’histoire nous a appris que la souveraineté, le patriotisme et l’Etat ne servent que les intérêts de la bourgeoisie, pour contrôler et exploiter la classe ouvrière et le reste des masses laborieuses.
Le bras de fer actuel aux Iles Spratly entre les bourgeoisies philippine et chinoise, toutes deux revendiquant pour leurs les ressources de cette riche petite île, s’accompagne de déclarations de “souveraineté nationale” et “d’intégrité du territoire”. Des appels à “l’unité nationale” et à la “défense du territoire national” retentissent. Les médias bourgeois empoisonnent maintenant les esprits des masses laborieuses, en inculquant qu’en tant qu’appartenant à la même race et à la même nation, les capitalistes et les ouvriers seraient des frères et des alliés.
La bourgeoisie a injecté aux ouvriers des deux pays “l’amour de la mère patrie” pour diviser les travailleurs, les faire se combattre et s’entre-tuer.
Un conflit pour faire plus de profit et nourrir la concurrence inter-impérialiste en Asie
Le conflit à propos des Iles Spratly n’est pas le fait exclusif de la Chine et des Philippines. D’autres pays, comme le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie1 se querellent avec elles et le Brunei2 s’est joint à la revendication de cette île riche en ressources. Le fondement, pour chaque pays, réside dans leur longue histoire d’agression coloniale et pas de leur “souveraineté nationale”.3
Amasser plus de profit est la principale motivation de chaque bourgeoisie nationale qui se dispute les Iles Spratly. Qui que ce soit qui l’emporte dans la confrontation actuelle, ce ne sont pas les masses laborieuses de Chine et des Philippines qui y gagneront quelque chose, mais le gouvernement, les bureaucrates et les capitalistes.
Une autre raison importante, c’est l’intérêt impérialiste des bourgeoisies nationales en présence ; l’archipel de Spratly est une plate-forme qui peut être stratégique pour une base militaire, raison majeure pour laquelle la Chine, le Vietnam, Taiwan et les Etats-Unis se le disputent. Il y a eu des frictions et des conflits armés pendant des décennies entre la Chine et le Vietnam (aujourd’hui allié des Etats-Unis).
En clair, cette tension à propos des Iles Spratly fait partie de la rivalité impérialiste entre la Chine et les Etats-Unis en Asie. C’est une nécessité pour l’ambitieuse Chine impérialiste d’étendre son territoire du fait de la crise globale du capitalisme. La puissance impérialiste numéro un, les USA, le sait, et fait tous ses efforts pour renforcer et conserver ses positions en Asie.4
Les capitaux nationaux unis contre la classe ouvrière
Malgré la concurrence naturelle entre les différentes factions capitalistes, les capitaux nationaux sont unis pour attaquer la classe ouvrière.
Tant que l’idéologie nationaliste/patriotique empoisonne les travailleurs, la coopération diplomatique et économique entre les pays en conflit continue5. Tandis que des secteurs de la population de ces parties en conflit restent assujettis à ces disputes sur la souveraineté nationale 6, leurs capitalistes et leurs bureaucrates étatiques ont le champ libre et s’en frottent les mains comme leurs concurrents aux Philippines, en Chine, aux Etats-Unis, avec une seule préoccupation : comment renforcer leur emprise économique sur la population. En d’autres termes, ils discutent de comment intensifier leurs attaques contre le prolétariat.
La bourgeoisie nationale des pays en conflit exploite et opprime à fond les travailleurs. Des centaines de milliers de travailleurs en Chine ont déclenché des grèves sauvages ou ont participé à des manifestations presque chaque jour contre leur Etat et les capitalistes. Il y a des grèves au Vietnam à cause des bas salaires et de l’absence de protection sociale. Les ouvriers philippins sont confrontés et soumis à la même réalité. Les difficultés des prolétaires du “tiers monde” ne sont pas différentes de celles de leurs frères/sœurs dans les pays du “premier monde”, en particulier aux Etats-Unis.
L’objectif principal et central de chaque capital national est d’attiser les braises de façon à favoriser chez les masses le mécontentement à l’égard des nations étrangères qui “piétinent notre droit souverain”.
L’unité de la classe et la lutte contre le poison du nationalisme et du patriotisme
C’est la classe capitaliste, qu’elle soit locale ou “étrangère”, le premier et véritable ennemi de la classe ouvrière.
Nous ne devons pas soutenir les appels à la “souveraineté nationale” et à la “défense du territoire national” de notre bourgeoisie nationale. Ce qui est vrai derrière ces appels, c’est que la bourgeoisie est souveraine pour exploiter et opprimer encore plus la classe ouvrière ; c’est le terrain du capital d’amasser encore plus de profit à partir du travail non payé.
Nous devons au contraire unir à la fois les travailleurs philippins et chinois avec nos frères et sœurs de classe dans le monde pour renverser nos “propres” bourgeoisies nationales. Nous devons condamner le tapage incessant de nos gouvernements et les menaces de guerre ; guerre qui ne ferait qu’aggraver nos conditions de vie et nous jeter dans la plus extrême pauvreté, la mort, la destruction de biens et la division entre nous.
Nous savons que, dans le conflit actuel, aucune des parties en conflit n’a pas la capacité ni l’intérêt de déclencher une agression et confrontation militaire de grande ampleur 7. Néanmoins, la propagande sur une guerre possible peut attirer et amener des secteurs de la population qui sont relativement peu conscients à soutenir leur bourgeoisie nationale locale contre une bourgeoisie étrangère. L’objectif principal et central de la bourgeoisie nationale de Chine et des Philippines est d’empoisonner les esprits des masses laborieuses avec l’idéologie et la ferveur nationaliste.
Camarades, ouvriers philippins et chinois, ne nous laissons pas abuser par ces propos d’union nationale, par les discours doucereux et la propagande venimeuse de notre “propre” gouvernement ! Continuons notre lutte contre toutes les attaques du capital, contre notre classe, dans chaque pays ! Continuons à dénoncer la nature exploiteuse et oppressive de la classe capitaliste, locale ou étrangère. Nous devons renforcer notre unité en tant que classe.
“La souveraineté nationale” et “l’unité nationale” sont des chaînes qui nous attacheront pour toujours à notre esclavage salarié dans la prison capitaliste. Ce sont des manœuvres pour diviser la classe ouvrière partout dans le monde. Les mouvements qui suivent une ligne nationaliste sont des mouvements visant à affaiblir encore plus le mouvement prolétarien international.
Prolétaires de Chine et des Philippines, ce n’est pas notre intérêt et nous n’avons rien à gagner, quelle que soit la puissance impérialiste qui gagne et s’annexe l’archipel Spratly. Notre intérêt, c’est de nous libérer nous-mêmes de la pauvreté, de l’esclavage salarié. Notre intérêt, c’est d’en finir avec le capitalisme et de construire une société libérée de l’exploitation et de l’oppression. Nos ennemis, ce sont les gouvernements de Philippines, de la Chine impérialiste et de tous les pays impérialistes 8.
Le capitalisme est la cause des guerres à l’époque de l’impérialisme. La seule garantie pour l’humanité de connaître une paix durable, c’est la destruction du capitalisme.
Travailleurs du monde entier,
unissez vous !
A bas la classe capitaliste,
locale ou étrangère !
Renversons “nos” gouvernements nationaux et l’idéologie nationaliste !
A bas la Chine et les Etats-Unis
impérialistes !
A bas le système impérialiste
mondial !
Internasyonalismo (28 avril)
1) http ://www1.american.edu/ted/SPRATLY.htm
2) http ://en.wikipedia.org/wiki/Spratly_Islands_dispute
3) En plus des territoires reconnus par le droit International, les Philippines revendiquent la possession de Scarborough Shoal depuis l’époque de la colonisation espagnole. (http ://globalnation.inquirer.net/34031/ph-sovereignty-based-on-unclos-principles-of-international-law [53]) tandis que le Vietnam le fait depuis l’ère de la colonisation française. La Chine impérialiste réclame des droits sur des bases analogues. (en.wikipedia.org/wiki/Spratly_Islands [54]).
4) Dans le rapport de forces entre les impérialismes chinois et américain en Asie, la Corée du Nord est le seul allié de la Chine. La conséquence n’est pas que les Etats-Unis soit le premier ennemi en Asie et que les autres pays rivaux et concurrents soient des “ennemis secondaires” ou des “alliés tactiques”. Le premier ennemi du prolétariat mondial est la bourgeoisie mondiale.
5) Les relations économiques entre les Philippines et la Chine s’élargissent continuellement, et il en va de même entre la Chine et les Etats-Unis . En fait, la Chine est le plus grand créancier de l’Oncle Sam.
Sources : (www.mb.com.ph/articles/346111/robust-philippineschina-trade-relations [55]), (www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html [56]), (money.cnn.com/2011/01/18/news/international/thebuzz/index.html).
6) Des hackers de Chine comme des Philippines détruisent des websites de leurs pays “ennemis”.
7) Le conflit de l’archipel Spratly a vu plusieurs petits accrochages militaires entre le Vietnam et la Chine, contrôlés par les deux pays de façon à ne pas exploser dans une guerre à grande échelle puisque leur seul objectif est de porter plus haut l’idéologie nationaliste de leur pays. Entre la Chine et les Philippines, il y a une possibilité d’une confrontation militaire à petite échelle, annoncée avec des roulements de tambour par les forces armées des Philippines, des Etats-Unis et de la Chine. Les médias chinois se sont récemment fait l’écho de cette menace entre la Chine et les Philippines.
8) Le mouvement maoïste philippin aide la bourgeoisie philippine dans sa campagne pour l’idéologie nationaliste au sein des travailleurs philippins. Les maoïstes s’en tiennent fermement à la tactique contre révolutionnaire de “choisir le moindre mal” ce qui s’exprime clairement dans les déclarations de leurs organisations légales, à propos des frictions entre la Chine et les USA.
Cependant, il n’y a pas que le mouvement maoïste à penser ainsi, tout le reste des organisations de gauche colle à la même tactique qui a fait faillite.
Géographique:
- Chine [58]
- Philippines [59]
Rubrique:
Grève des enseignants à Londres : pourquoi ne sommes-nous pas unis ?
- 1399 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction du tract diffusé par nos camarades de World Revolution, section du CCI en Grande-Bretagne, à l’occasion de la manifestation du 28 mars.
Tract
Le 28 mars, des milliers d’enseignants seront en grève à Londres contre les “réformes” gouvernementales sur les retraites.
Mais est-il juste de prétendre que seuls les enseignants ont des raisons de protester ?
Les conditions de retraites sont attaquées pour tous les travailleurs de tout le service public. En fait avec la “granny tax” (taxe sur les personnes âgées) contenue dans le dernier budget, tous les retraités sont touchés de plein fouet. Pourquoi les syndicats n’ont pas décidé d’appeler aujourd’hui tous ces secteurs attaqués à la grève ? C’est tout aussi vrai pour l’ensemble du privé, là où un nombre grandissant d’ouvriers ne peuvent même pas espérer une quelconque sorte de retraite du tout.
S’agit-il seulement de nos retraites ?
Non. De plus en plus d’ouvriers se trouvent confrontés au gel des salaires, à des conditions de travail aggravées – s’ils ont un travail. Plus de 20 % des jeunes entre 16 et 25 ans sont en réalité au chômage.
S’agit-il seulement de Londres ?
Non. Ces conditions sont celles que les ouvriers trouvent partout dans le pays.
S’agit-il seulement de la Grande-Bretagne ?
Non. Les mesures d’austérité brutales qui sont imposées à la classe ouvrière et à toute la population en Grèce, au Portugal et en Espagne, où les salaires et les retraites ont déjà été directement diminuées, et où des centaines de milliers de postes de travail sont “éliminés”, montrent à quel point on nous ment à tous, car la crise de ce système est mondiale et définitive.
Pourquoi alors sommes-nous divisés, si nous avons face à nous les mêmes attaques et qu’il faut résister tous ensemble ?
Il y a beaucoup de raisons. Le sentiment dominant qu’il n’y a pas d’alternative, le faux espoir que les choses vont aller mieux, le manque de confiance sur comment prendre les choses dans nos propres mains.
Ce manque de perspectives et de confiance en nous signifient que ceux qui prétendent faussement représenter nos intérêts – surtout nos représentants syndicaux “officiels” – peuvent se permettre de nous diviser en secteurs, catégories innombrables, qu’ils peuvent nous appeler à des journées de grève séparées, annuler des grèves si la justice le décide, et nous emprisonner dans la législation syndicale qui fait que nous combattons avec les mains liées dans le dos.
Malgré tout cela, pouvons-nous nous unir ?
Oui, si nous allons au-delà des divisions professionnelles et syndicales, et si nous nous réunissons dans des assemblées ouvertes à tous les travailleurs.
Si nous ignorons les lois sur les votes à bulletins secret et utilisons ces assemblées pour rendre effectives les décisions sur comment lutter.
Si nous ignorons les lois syndicales interdisant les “piquets de grève secondaires” et utilisons massivement des délégations pour appeler d’autres ouvriers à rejoindre la lutte.
Si nous nous ouvrons aux ouvriers précaires, aux étudiants, aux chômeurs, aux retraités.
Si nous utilisons les manifestations, les occupations et les assemblées de rue non pas pour écouter passivement des discours d’experts mais pour échanger des expériences de lutte et discuter de comment la poursuivre et l’élargir.
Si nous redécouvrons notre identité de classe – une classe qui partout, dans tous les pays, a les mêmes intérêts et le même but : le remplacement de ce système pourri par une communauté réellement humaine.
CCI (23 mars)
Géographique:
- Grande-Bretagne [60]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [15]
Rubrique:
Au Mali, un coup d'Etat qui accentue le chaos
- 1460 lectures
Le président malien Amadou Toumani Touré (ATT) a été renversé le 22 mars par une poignée de soldats quasi-inconnus qui, n’ayant pas les moyens de contrôler le pays, a dû laisser les rebelles (nationalistes et islamistes) s’emparer de toute la région nord du Mali et y semer la terreur, provoquant le déplacement forcé de plusieurs centaines de milliers de personnes. En réalité, ce coup de force n’a fait qu’accélérer le chaos d’un Etat corrompu et en déliquescence depuis bien longtemps. Par ailleurs, le coup d’Etat s’est déroulé dans un contexte de luttes d’influence et dans une zone qui est le théâtre de trafics en tous genres, notamment d’armes et de drogue, où des groupes criminels (mafieux islamiques et autres) se disputent le marché de la prise d’otages et de la spoliation de migrants. Mais surtout, le Mali est le maillon faible d’une région en décomposition accélérée par les tensions impérialistes qui se déroulent dans la grande région du Sahel, en particulier à travers la guerre qui a ravagé la Libye dont les effets n’ont pas tardé à se faire sentir jusqu’à Bamako.
La responsabilité criminelle des puissances impérialistes occidentales dans l’aggravation du chaos
“En Libye, le gouvernement de transition peine à surveiller les stocks d’armes et à contrôler ses frontières. En septembre, la découverte de la disparition de plus de 10 000 missiles sol-air avait créé la panique sur la scène internationale. (…) Parallèlement, les combattants touaregs embauchés comme mercenaires et armés par Kadhafi sont rentrés dans leurs pays, au Niger et au Mali, après la chute du régime libyen, en août dernier. Depuis janvier 2012, les insurgés touaregs du Mali, issus du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) prennent d’assaut les villes du nord armés de mitrailleuses lourdes et d’armes antichars, relancent un combat vieux de plusieurs décennies pour la création d’un Etat touareg indépendant” (The National, in Courrier international du 11/04/12).
Plus que le Soudan et le Tchad, le Mali constitue aujourd’hui le principal marché d’armements de cette région où tueurs et barbouzes viennent s’approvisionner et échanger leurs “marchandises”, notamment à Gao et Tombouctou. Mais plus sombre encore pour l’avenir du Mali est le fait qu’en plus d’être le “grand marché” des criminels professionnels, ce pays est aussi convoité pour ses matières premières. Outre l’or dont il est l’un des premiers producteurs, le Mali est sur le point de devenir un exportateur de brut et son futur marché est d’ores et déjà le théâtre de rivalités intenses entre des grands vautours bien connus comme Total, GDE-Suez, Tullow Oil, Dana Petrolieum, CNPC, Repsol, etc. En clair, il s’agit des sociétés euro-américaines et chinoises épaulées par leurs Etats respectifs dans la bagarre qu’elles mènent pour le contrôle et l’exploitation des matières premières maliennes.
“Impossible (par exemple) de ne pas noter que le récent coup d’Etat est un effet collatéral des rébellions du Nord, qui sont elles-mêmes la conséquence de la déstabilisation de la Libye par une coalition occidentale qui n’éprouve étrangement ni remord ni sentiment de responsabilité. Difficile aussi de ne pas noter cet harmattan kaki qui souffle sur le Mali, après être passé par ses voisins ivoirien, guinéen, nigérien et mauritanien ” (Le Nouveau Courrier, in Courrier international du 11/04/12).
Loin d’apporter la “paix” et la “démocratie”, l’intervention des forces impérialistes de l’OTAN en Libye n’a fait qu’étendre le chaos et accélérer la décomposition des Etats de la région. En effet désormais pas moins de 12 pays sont touchés par les conflits guerriers et les trafics se déroulant dans une zone vaste de 9 millions de kilomètres carrés.
Le Mali : un “Afghanistan” africain au sud de l’Europe ?
“La boutade en forme de prévision stratégique, lancée naguère par Jean-Claude Cousseran, ancien patron de la DGSE : “L’Afrique sera notre Afghanistan de proximité”, est désormais prise au sérieux. Ne serait-ce qu’en découvrant la banale mais sinistre comptabilité des opérations menées par des groupes islamistes radicaux au Nigeria, en Somalie, en Libye, dans les pays du Sahel et au Mali. (…) Au Quai d’Orsay, l’équipe Juppé s’inquiète pour les otages français et l’avenir des régions et des Etats menacés. A l’état-major, on établit des plans d’intervention, au cas où des chefs africains, l’ONU, voire l’OTAN, décideraient de faire “quelque chose…” Et les services de renseignements, eux, sont en liaison constante avec les officiers français en mission au Mali et les membres du Commandement des opérations spéciales en poste au Burkina, au Niger et en Mauritanie. (…) L’objectif recherché par ces groupes combattants (…) peut aboutir à créer une immense zone grise en Afrique sahélienne, sous la bannière de la religion, où des bandes criminelles tirent profit des différends violents entre partisans de l’islam, tribus nomades, groupes salafistes, rescapés d’Al-Qaida, soldats perdus des combats contre le printemps arabe Avec pour résultat le risque d’une décomposition des Etats” (le Canard enchaîné du 11/04/12).
En effet, l’impérialisme français panique face au développement du chaos au Mali et s’apprête donc à intervenir pour tenter de préserver ses intérêts directement menacés dans cette région du Sahel. En fait, au-delà de ses intérêts économiques et stratégiques, la France cherche à récupérer ses ressortissants pris en otages par des groupes armés (islamiques). Rappelons que l’armée française mène une véritable guerre dans cette zone au nom de la “lutte contre les groupes terroristes islamiques (AQMI)”, tantôt en Mauritanie, tantôt au Niger et la dernière intervention militaire dans ce dernier pays a provoqué plusieurs morts.
Tandis que les Etats-Unis fournissent conseillers et matériels militaires aux mêmes pays, toujours au nom de la “lutte antiterroriste” et de la “sécurisation” de la région, d’où d’ailleurs les liens très étroits que Washington a pu établir avec les différents réseaux maliens.
De leur côté, les puissances rivales locales jouent aussi leurs propres cartes. Ainsi, l’Algérie, la Mauritanie, le Niger et le Mali avaient décidé d’organiser leur propre état major commun dont le siège se trouve à Tamanrasset (en territoire algérien). Mais en réalité, c’est le chacun pour soi qui domine chez tous les gangsters et de ce fait les alliances ne tiennent jamais très longtemps, se faisant et se défaisant selon le rapport de force du moment et le “gain” immédiat.
Au Mali, l’impérialisme américain bouscule son homologue français
“Des ruines de l’Etat malien vient surgir un document de trois pages classé “très sensible”. Il s’agit d’une note remise en février dernier au président Amadou Toumani Touré. Elle s’intitule “La Mauritanie et l’appui secret aux rebelles d’Azwad”. A sa lecture, l’ancien général (ATT) a dû comprendre que sa fin était imminente. Ses services de renseignement l’avertissent, avec force détails, des contacts étroits noués entre les Touaregs, qui viennent de repartir sur le sentier de la guerre et le régime voisin d’Ould Abdelaziz. Le tout nouveau Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA), recevrait une “aide matérielle” de Nouakchott. (…) Au moment où des représentants du MNLA ouvrent un bureau d’information à Nouakchott, d’autres sont reçus à plusieurs reprises au Quai d’Orsay. Une simultanéité qui ne doit sans doute rien au hasard. La Mauritanie, grande alliée de la France dans la région, n’aurait pas prêté main forte aux indépendantistes touaregs, sans l’aval, même tacite, de son mentor. (…) Le MNLA, toujours selon la note secrète, s’engagerait à combattre Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqumi). Une priorité pour la Mauritanie et la France, qui reprochent au président Touré sa mollesse envers les djihadistes. (…) Stupéfaction en Occident et au Sahel : les insurgés touaregs, considérés comme les meilleurs remparts contre Aqmi, combattent aux côtés des islamistes. Après avoir subi l’un de leur pires revers en Afrique, les autorités françaises avouent leur impuissance. “On a un vrai problème, lâche un haut responsable. Les Maliens sont incapables de reconquérir ce qu’ils ont perdu. Et envoyer l’armée française ? Personne n’y songe. La Françafrique, c’est fini !”” (le Nouvel observateur daté du 12/04/12)
En effet, l’Etat français visait à la fois à préserver ses intérêts globaux dans la région et faire libérer ses otages entre les mains des groupes liés à Aqmi. Et, au final, il s’est fait “rouler dans la farine” par des minables et obscurs petits groupes mafieux avec lesquels il magouillait souterrainement tout en apportant publiquement son soutien au président malien ATT. Aujourd’hui, l’impérialisme français est totalement paralysé par l’amateurisme dont il a fait preuve dans cette affaire et risque de perdre sur tous les tableaux.
Outre leur présence militaire dans toute la région en ayant négocié et obtenu des accords de coopération militaire avec tous les régimes, les Américains avaient à la fois l’oreille du président renversé et du chef des putschistes.
“Le camp de DJCORNI, où s’est réfugié ATT le 21 mars, est à deux pas et sous la quasi protection de l’ambassade américaine- laquelle avait, si l’on en croit les télégrammes révélés par Wikileaks, alerté depuis Washington sur l’état de déliquescence du haut état-major malien et sur le climat de corruption qui régnait dans l’entourage proche (y compris familial) du président. Les gardes du corps qui ont protégé le chef déchu pendant sa fuite ont été formés par les célèbres Navy Seals de l’US Army. Et le capitaine putschiste Amadou Sanago fait volontiers étalage de ses stages aux Etats-Unis : la base aérienne de Lackland (Texas) ; Fort Huachua (Arizona), spécialisé dans le renseignement ; l’école des officiers de Fort Benning (Géorgie). Plus un séjour chez les Marines, dont il porte le pin’s sur sa vareuse. Bref, on savait les Américains très implantés et très informés sur le Mali. Sans doute mieux que les Français. On en a la confirmation” (Jeune Afrique du 7/04/2012).
Il est doit être clair que la France n’est pas étrangère au renversement du régime d’ATT et que la cause principale se trouve dans le lien établi entre ce dernier et les Etats-Unis qui font tout, là encore, pour évincer Paris de son ex-pré carré.
Voilà un pays en état de délabrement avancé gouverné par des bandes corrompues en lutte avec divers charognards, mafieux islamistes ou bandits de grand chemin en compagnie des puissances impérialistes en quête d’influence et de matières premières qui déguisent leurs projets de boutiquiers capitalistes “en plans de sécurisation” de la zone. Et pendant ce temps-là, les populations, elles, crèvent de faim et de misère, ou se font carrément massacrer par les uns et les autres.
Amina (17 avril)
Géographique:
- Afrique [23]
Rubrique:
Révolution Internationale n°433 - juin 2012
- 2051 lectures
Gauche au pouvoir: qui croit encore au changement?
- 1161 lectures
Le titre de MIB3, dernière version de la série des Men In Black, aurait pu être le slogan de campagne de François Hollande : “Retour vers le passé pour sauver le futur”. Tout aussi mensonger que “Le changement, c’est maintenant !”, ça sonnait quand même plus “sympatoche” ou plus “djeuns”, comme un clin d’œil aux jeunes générations que le nouveau président de la République française cherche à enfumer par rapport à la réalité qui les attend, à savoir, pour celles-ci comme pour les plus anciennes, misère, chômage et souffrance.
Quel est donc ce programme de Hollande, répété avec force et conviction durant toute la campagne électorale présidentielle, et que nous allons entendre et réentendre jusqu’aux législatives ? Le même que celui de Sarkozy à la sauce “socialiste”. Bon, on enlève le “bling-bling”, on ne va pas au Fouquet’s ni sur le yacht de Bolloré mais, pour le reste, quoi de neuf ? Rien, si ce n’est ce baratin associé aux trains de promesses aussi allusives que vagues, quant à l’avenir de l’ensemble de la classe ouvrière, et de toute la jeunesse. Ce train de promesses va en réalité prendre la forme d’un train d’attaques qui seront déguisées ou enrobées dans le verbiage habituel de la gauche. Pour en retenir quelques-unes des plus médiatisées, citons “Je veux redresser la France”, “Je veux rétablir la justice”, “Je veux redonner espoir aux jeunes générations”, “Je veux une République exemplaire et une France qui fasse entendre sa voix”. Et ce ne sont que quelques titres de son programme en soixante points qui nous promet monts et merveilles !
A part quelques nuances “culturelles” et “politiques”, on a entendu la même chose il y a cinq ans avec le programme de Sarkozy, et en particulier son “travailler plus pour gagner plus”, et qui s’est traduit par “travailler plus et gagner moins”. Qu’est-ce que Hollande va faire de mieux ? Rien. C’est plutôt à pire qu’il faut s’attendre.
A l’époque de Mitterrand, la bourgeoisie disposait encore d’une marge de manœuvre économique qui avait permis à la gauche au gouvernement de bénéficier d’un “état de grâce”. L’illusion qu’avec le PS allié au PC, tout irait mieux, avait constitué un frein au développement des luttes ouvrières. Dès 1983, deux ans après l’élection de Mitterrand, les attaques ont commencé à tomber brutalement dans tous les secteurs. Les baisses de salaires, le non remplacement de fonctionnaires, les licenciements massifs dans la sidérurgie, la déréglementation des lois de licenciement comme l’amendement Lamassoure, qui a ouvert la porte toute grande à la “flexibilité du travail” et donc à la possibilité, dans le public comme dans le privé, de rendre toujours plus corvéables les salariés. Telles ont été les “valeurs” de la gauche entre 1981 et 1998. Pas différentes, en définitive, de celles de la droite. Ce sont les valeurs de la bourgeoisie avec l’exploitation et le mépris de la classe ouvrière comme maîtres mots.
Le Père Noël Hollande peut sortir toute une kyrielle de joujoux de sa hotte, il n’est et ne sera jamais qu’un défenseur de l’intérêt du capital national. Qu’il fasse le beau à Berlin, à Washington, ou au Japon, et qu’il trinque avec Poutine, ne changera rien à la condition des prolétaires. Il n’en peut plus de parler de relance éco nomique ici et là, mais une fois encore, il s’agit d’un thème qui ne tiendra guère plus que le temps d’un été. Politique de relance – comme aux Etats-Unis – ou pas, ce qui va continuer de s’imposer c’est la dure et cruelle réalité de la situation économique mondiale, marquée par l’aggravation de la crise. Aucun pays n’y échappera. Alors, que va faire notre nouvellement nominé Président de la République française, face à un déferlement prévisible de catastrophes économiques, avec des épisodes à la grecque affectant cette fois le Portugal, l’Espagne, l’Italie… et les suivants, dont la France, qui ne sont pas loin derrière.
Il fera non seulement la même chose que son prédécesseur, mais encore pire et bien plus fort. Déjà, les licenciements à Arcelor-Mittal donnent le ton.
Les jeunes générations de la classe ouvrière, qui n’ont pas vécu les attaques anti-ouvrières de la gauche au gouvernement, doivent apprendre qu’elles ne doivent compter que sur la lutte de leur classe et rejeter en toute conscience cette mystification selon laquelle la gauche serait moins pire que la droite. Il n’y a pas de choix à faire entre les différentes fractions de la bourgeoisie.
Wilma (3 juin)
Géographique:
- France [5]
Rubrique:
Avec la crise dans la zone euro, la bourgeoisie n'a pas d'alternative à sa politique d'austérité
- 1333 lectures
Depuis l’année 2008 et le début de la phase actuelle de la crise, partout s’est développée une austérité croissante. Cette politique était censée réduire les dettes et relancer la croissance. Et puis, tel un lapin sorti tout droit du chapeau d’un magicien, est brandie maintenant une nouvelle alternative qui doit remédier à tous les problèmes. Celle-ci a pour nom relance. Elle s’est invitée partout dans les journaux, à la télévision, sur les radios. Véritable magie du discours, la croissance pourrait être de retour et l’endettement généralisé diminué. La dette pourrait être monétisée. Que veut dire ce jargon de spécialistes bourgeois ? En réalité, des questions toutes simples se posent. Pourquoi ce revirement soudain de la plus grande majorité des dirigeants de la zone euro ? Quelle peut être la réalité de cette politique ? L’austérité généralisée va-t-elle prendre fin ? Dans l’avenir tout proche, la crise va-t-elle continuer oui ou non à s’approfondir ?
L'austérité n'a engendré que la récession
En Grèce, Irlande, Italie, Espagne notamment, la population, au cours des dernières années, a été attaquée de toutes parts. La classe ouvrière au travail, les chômeurs, les jeunes, les retraités, chacun et tous à la fois ont vu leur niveau de vie s’effondrer. Les hôpitaux, l’école et tous les services publics ont été massacrés. La justification politique de cette guerre économique contre tous les exploités était claire. A écouter tous les gouvernements en place, accepter ces sacrifices aujourd’hui voulait dire : réduire l’endettement des Etats, l’endettement public, tout en abaissant le coût du travail pour mieux vendre les marchandises produites et ainsi relancer la croissance. Malgré les luttes qui se sont développées, en réaction à cette politique qui considère la classe ouvrière comme du bétail que l’on peut tondre à merci, l’austérité a continué à s’accélérer mais, au plus grand désarroi de la classe capitaliste, sa crise également.
Depuis l’année 2008, le PIB de la zone euro est resté à peu près le même et avoisine les 8900 milliards d’euros. Par contre, la dette globale publique et privée a continué à s’accélérer pour atteindre maintenant 8000 milliards d’euros. Il est incroyable de constater que toute la richesse créée par une année de travail correspond pratiquement à la dette existante et nous ne parlons là que de la partie officielle et reconnue de celle-ci. Pire que cela pour la bourgeoisie, voilà maintenant que l’économie s’installe de nouveau dans la récession. Seule l’Allemagne en 2012 peut afficher un petit 0,5% de croissance. Pour les autres pays de la zone la dégringolade est là. En Grèce et en Espagne, l’activité recule à toute vitesse et le chômage de masse s’est installé. La dette explose et est pratiquement hors de contrôle dans ces pays, au moment même où leur PIB s’effondre. Quant à la France qui est parvenue jusque-là à éviter le pire, elle paye maintenant ses fonctionnaires en empruntant l’argent sur ce que l’on appelle les marchés financiers.
Dans sa grande majorité, la bourgeoisie est alors amenée à faire un constat qui était pourtant depuis bien longtemps évident : l’austérité généralisée et la crise du crédit amènent à la récession et au creusement de sa dette. Alors que faire ?
Une idée apparemment géniale : la relance
Les débats en cours au sein de la bourgeoisie sont au fond toujours les mêmes depuis l’année 2008 : qui va bien pouvoir rembourser la dette, comment et quand ? C’est alors qu’une idée présentée comme nouvelle apparaît. Pour rembourser la dette, il faut créer de la richesse. C’est simple, il suffisait d’y penser. Cette idée qui existe depuis au moins la crise économique des années 1930 refait tout à coup surface. On se demande d’ailleurs pourquoi ils n’y ont pas pensé plutôt, par exemple depuis 2008 et l’apparition du puits sans fond de l’endettement.
Comment relancer la croissance ? Voilà une question qui hante toute la classe bourgeoise. Pour certains, il faut rendre la production de la zone euro compétitive et donc baisser les prix de revient des marchandises produites. En termes clairs, il est nécessaire de poursuivre la baisse des salaires pour concurrencer la production effectuée en Chine, en Inde, au Brésil, ou dans les pays d’Europe centrale par exemple, et empêcher ainsi les délocalisations. Prétendre relancer l’activité par une compétitivité supplémentaire ainsi acquise prêterait à rire tellement elle est absurde, si elle ne se traduisait pas par de nouvelles souffrances pour la classe ouvrière.
Pour d’autres, il faut maintenant que les Etats de la zone euro prennent en main directement la relance de la croissance. Ici, l’idée est la suivante : puisque les banques en situation potentielle de faillite ne peuvent plus prêter suffisamment ni aux entreprises, ni aux particuliers, c’est l’Etat qui va passer directement commande. On va donc construire ici des autoroutes et là des lignes de TGV. Les entreprises concernées vont travailler, embaucher des salariés et participer ainsi à relancer la croissance. Le problème est alors le suivant : d’où va venir l’argent supplémentaire, quel montant faudrait-il investir et pour quel résultat ? Une fois raclés les fonds de tiroirs existants qui représenteraient environ 450 milliards d’euros, il faudrait avoir recours à un endettement supplémentaire effectué par des Etats déjà en situation de risques de faillites. Actuellement, dans les pays occidentaux, pour produire un euro en plus de richesse, il est nécessaire de s’endetter pour 8 euros supplémentaires. Autrement dit, un plan de relance implique ceci : une dette qui augmente huit fois plus vite que le PIB. Mais une marchandise produite n’est pas une marchandise vendue. Combien de crédits supplémentaires faudrait-il encore distribuer à des “consommateurs” exsangues afin qu’ils puissent les acheter. Tout cela est absurde et irréalisable. Le capital engagé est devenu trop important pour le profit réalisé. Alors que le capitalisme ne peut déjà plus faire face actuellement à sa dette, comment pourrait-il alors le faire ? Comment empêcher les déficits publics d’exploser et les marchés financiers d’exiger des intérêts exorbitants pour continuer à prêter éventuellement aux Etats ? Derrière toute la campagne idéologique et médiatique actuelle, cette prétendue relance devra se contenter de fonds actuellement disponibles et non encore utilisés qui ne pourront avoir qu’un effet marginal sur l’activité.
Monétisation et mutualisation de la dette indispensable, mais finalement ingérable
Monsieur Hollande, nouveau président de la France, rejoint en ceci par de très nombreux dirigeants de la zone euro, sauf bien entendu l’Allemagne, entonne un nouveau chant qui devrait nous remplir d’espoir. Le titre de cette chanson qu’il espère devenir populaire s’intitule : monétisation et mutualisation de la dette. Ce qui n’a rien de très poétique. La monétisation revient tout simplement à fabriquer de l’argent. La Banque centrale s’en charge et prend en échange des reconnaissances de dettes de l’Etat ou des banques, et en général cela s’appelle des obligations. La mutualisation veut dire que tous les Etats de la zone euro prennent en charge collectivement la dette. Les Etats les moins en difficultés payent pour les Etats les plus en difficultés.
Lorsque l’on ne crée plus et que l’on ne vend plus assez de richesses pour empêcher la dette d’entraîner tout le système dans l’abîme, les marchés financiers se détournent progressivement de celle-ci. Une relance sans effet réel et une dette toujours plus grande rend les prêteurs de plus en plus rares et les prêts de plus en plus chers. Alors vient le temps de ponctionner l’épargne, première étape de la monétisation de la dette à venir. L’Etat se fait voleur à grande échelle. L’augmentation des impôts de toutes sortes et les emprunts obligatoires pointent leur nez. Cet emprunt est évalué en pourcentage des impôts payés par chacun. Il est susceptible d’être remboursé au bout d’une certaine période et cela doit donner lieu à des intérêts. Celui-ci est actuellement à l’étude en France comme pour toute la zone euro. A charge pour l’Etat de nous rembourser demain avec de l’argent qu’il ne possède déjà plus aujourd’hui ! Il est bien évident que devant le puits sans fond de la dette tout cela n’est que gouttes d’eau dans la mer. De celles qui alimentent pourtant une austérité déjà bien présente.
Mais de nouveau l’alerte générale est là. La Grèce et l’Espagne sonnent le tocsin. Seulement quelques mois après que la Banque centrale européenne ait injecté 1000 milliards auprès des banques, tout le système financier public privé vacille.
Pour la seule année 2012 dans la zone euro, et afin de faire face à la seule partie de la dette arrivant à échéance, il faudrait trouver entre 1500 et 4000 milliards. Chiffres qui bien entendu n’ont rien à voir avec la réalité puisque, à elle seule, la banque Bankia en Espagne réclame officiellement plus de 23 milliards. Les sommes sont énormes et hors de portée du capitalisme. Il ne reste plus donc alors qu’un chemin rempli d’embûches pour le capital afin d’éviter la faillite immédiate. Sur le panneau est écrit : création monétaire massive. La distance à parcourir pour en arriver là se chiffre en quelques semaines. A la mi-juin, la Grèce va tenir de nouvelles élections. Si un parti refusant les plans d’austérité de la zone euro arrive au pouvoir dans ce pays, la sortie de la Grèce de celle-ci est envisageable. Pour la population grecque, cela veut dire un retour à leur monnaie d’origine et une dévaluation du drachme d’environ 50 %. Ce pays s’enfoncerait dans l’autarcie et la misère. Ce qui ne changerait pas grand-chose à ce qui l’attend. Par contre, pour les banques et la Banque centrale de la zone euro, l’addition serait salée. Dans les comptes de ces banques restent encore beaucoup de reconnaissances de dettes grecques, sans doute pour près de 300 milliards d’euros. Mais la question fondamentale n’est pas là. Si la zone euro laisse sortir la Grèce de celle-ci par impuissance à la garder, que va-t-il se passer avec l’Espagne, l’Italie, etc.
La monétisation de la dette ou le moment de l'addition
Et voici venu le temps de l’Espagne, de ses banques toutes en faillites réelles et de ses régions totalement ingérables financièrement. Le morceau est énorme, trop gros pour être avalé. Les marchés financiers et toutes ces institutions qui rassemblent l’argent privé disponible dans le monde ne se trompent pas lorsqu’ils réclament toujours plus d’intérêts pour prêter à ce pays. Actuellement, les taux à 10 ans pour la dette de l’Etat approchent les 7 %. Ce taux est le maximum qu’un Etat peut supporter ; au-dessus, il ne peut plus emprunter. Le président du gouvernement espagnol, Mario Rajoy, a de manière détournée appelé au secours la Banque centrale européenne. Celle-ci en retour a fait la sourde oreille. Le gouvernement espagnol a alors annoncé qu’il allait tenter de financer ses banques en allant sur le marché. Tout ceci n’est qu’un serpent de mer. Des banques dans le monde doivent prêter de l’argent à l’Etat espagnol insolvable pour que celui-ci prête à ses banques insolvables qui, en échange, lui remettra des reconnaissances de dettes insolvables. L’absurdité est totale, l’impasse manifeste.
Alors, il faudra bien qu’à un moment ou à un autre, au moins une partie de la dette soit monétisée et mutualisée. Il faudra créer du papier monnaie que l’Allemagne garantira en partie avec la richesse qu’elle produit. C’est le produit national brut allemand qui autoriserait une certaine création monétaire. L’Allemagne s’appauvrirait et ralentirait l’appauvrissement général en Europe. Pourquoi le ferait-elle ? Tout simplement parce qu’elle vend une grande partie de ses marchandises dans cette zone.
La monétisation de la dette, un aveu d'impuissance
Monétiser la dette en partie revient à démontrer dans la réalité que le capitalisme ne peut plus se développer, même à crédit. C’est le moment officiel où le capitalisme nous dit : “Je vais créer de la monnaie en perdant progressivement de sa valeur pour empêcher ma dette d’exploser tout de suite. J’aimerais mieux investir, créer de la richesse et vendre, mais je n’y parviens plus. La dette est trop immense. Elle me tient à la gorge : vite du papier monnaie, encore du papier monnaie et voici du temps de gagné.”
L’argent, y inclus le crédit, doit représenter la richesse produite et à produire qui sera vendue avec profit. Pendant des décennies, on a maintenu la croissance avec des crédits que l’on a affirmé pouvoir rembourser un jour. Quand ? On ne sait plus. Cette échéance est toujours repoussée dans le temps. La richesse produite dans 10 ans est déjà détruite dans la production et la vente d’aujourd’hui. Que nous reste t-il alors sinon des dettes et encore de nouvelles dettes ?
La monétisation, c’est le triomphe du capital fictif au détriment du vrai capital, celui qui contient en lui de la vraie richesse. Créer ainsi de la monnaie massivement pour s’acheter à soi-même sa propre dette revient à détruire de l’argent. Cela revient à provoquer une inflation galopante des prix, malgré la récession. De ce côté aussi, il y a de l’austérité, car comment survivre avec des prix à la consommation qui s’élèveraient tous les jours ?
Et si la monétisation et la mutualisation n'avaient pas lieu ?
Le capitalisme peut-il accélérer sa propre descente aux enfers ? Et si l’Allemagne refusait la monétisation, paralysant ainsi la Banque centrale européenne ? Personne ne peut totalement écarter cette éventualité, même si elle s’apparenterait à un suicide collectif. La bourgeoisie allemande fait depuis des mois des calculs savants pour évaluer ce que lui coûterait l’éclatement ou son financement de la zone euro. Dans les deux cas, à terme, l’addition est trop lourde et insupportable, mais à court terme, quelle est la perspective la plus terrifiante ?
Dans tous les cas, l’Allemagne exigera l’austérité. L’austérité pour elle est l’espérance que la dette, à travers les déficits publics, se creusera moins rapidement, que l’ardoise sera moins salée. Dans la réalité, tout cela n’est qu’illusions tragiques qui se soldent de toutes façons partout pour les prolétaires par une précarisation encore plus forte de leurs conditions de vie.
L’impasse est à ce point tel pour le capitalisme qu’il en arrive à vouloir mener en même temps relance de l’économie et austérité accrue, création monétaire massive et réduction de la dette. Le capitalisme devient fou. Il perd la boussole. Il ne sait plus où se diriger ni comment manœuvrer pour éviter les récifs qui l’entourent de tous côtes. La zone euro n’a jamais été dans une crise aussi aiguë. Les mois à venir sont des mois de grandes tempêtes économiques, qui vont déboucher sur des naufrages encore plus dévastateurs et révélateurs de la faillite généralisée du capitalisme mondial.
Rossi (30 mai)
Récent et en cours:
- Crise économique [13]
Rubrique:
L'islamophobie, le djihadisme et le capitalisme sont les multiples facettes d'un même ennemi
- 1846 lectures
La lecture des minutes du procès d’Anders Breivik relatant comment il a massacré des douzaines d’adolescents l’année dernière, dans le camp d’été du Parti travailliste norvégien, donne la nausée. Le procès de Breivik a donné lieu à beaucoup de débats sur sa santé mentale, sur le fait qu’il ait agi seul ou comme membre d’un réseau fasciste organisé, ou s’il devait être autorisé à utiliser la cour d’Oslo comme tribune pour défendre sa philosophie politique 1.
Les meurtres commis par Mohamed Merah à Toulouse n’étaient pas à aussi grande échelle mais n’en font pas moins froid dans le dos. Mais les tireurs d’élite de la police française n’ont pas offert de scène à Merah pour exposer sa philosophie : il a été abattu après un siège en règle 2.
Il y a des différences évidentes dans la façon dont ces deux cas ont été traités. Dans The Guardian du 21avril, Jonathan Friedland 3 souligne qu’en règle générale, habituellement, on ne donne pas une chance aux terroristes islamiques, même s’ils sont capturés vivants, d’expliquer leurs motivations comme on l’a fait avec Breivik. Idéologiquement, des gens d’extrême droite comme Breivik et des djihadistes comme Merah semblent se situer à deux pôles opposés. L’obsession de Breivik, c’est la menace “d’islamisation” de l’Europe, alors que les djihadistes déclarent qu’ils agissent non seulement pour venger les attaques contre les musulmans en Irak, en Palestine ou en Afghanistan, mais pour la création d’un califat mondial gouverné par la loi de la Charia.
Mais ce qui est le plus frappant en réalité, qu’il s’agisse des islamophobes et des djihadistes, c’est la similarité de leur idéologie et leur pratique.
Pour commencer, Breivik a exprimé devant la cour son admiration pour la méthode d’al Qaida, son organisation en petites cellules décentralisées. On a suggéré que c’était un modèle dont les groupes d’extrême droite s’inspirent de plus en plus. Breivik a aussi vanté le caractère impitoyable d’al Qaida et son esprit de sacrifice personnel au service d’un idéal plus élevé. Mais quand on regarde de plus près ces idéologies respectives, on voit qu’elles ont beaucoup de choses en commun.
Un racisme partagé
Toutes les deux sont profondément racistes : l’hystérie de droite sur l’islamisation de l’Europe n’est que la dernière version de l’idéologie de la civilisation chrétienne blanche menacée par des hordes d’envahisseurs à peau sombre. Au début du xx siècle, la grande menace était présentée comme étant celle des Juifs fuyant les pogroms en Russie ; il y a quelques décennies, c’était les émigrés asiatiques et noirs importés pour travailler pour des salaires inférieurs à ceux des ouvriers “du pays” ; aujourd’hui, le racisme a dû se déguiser sous les habits de l’anti-islam parce qu’être ouvertement antisémitisme, ou raciste anti-noir est beaucoup plus difficile à faire avaler à une population qui est déjà habituée à un environnement social beaucoup plus diversifié. La English Defence League (EDL) 4 a même des membres juifs et sikhs, unis (pour le moment) par leur haine de l’islam, “religion du mal”, à des troupes d’assaut blanches. Mais derrière tout cela, c’est la même vision d’un monde “aryen”, née comme justification de l’extension impérialiste du capitalisme européen et américain depuis la fin du xix siècle.
Mais les djihadistes ne sont pas moins racistes. Quand l’Islam est apparu, comme les autres religions monothéistes, il était l’expression, en termes idéologiques, d’une réelle tendance à l’unification de l’humanité, au delà du tribalisme. Il était donc ouvert à tous les groupes ethniques et avait une attitude pleine de respect vis-à-vis des religions juives et chrétiennes qu’il considérait comme porteuses d’une révélation précédente. Mais aujourd’hui, le djihadisme est l’expression d’une autre réalité historique : la religion, sous toutes ses formes, est devenue une force au service de la division et du maintien d’un système en déclin. Dans l’esprit des groupes djihadistes, ou de type taliban, les “kaffirs” (incroyants) ne se distinguent pas des “étrangers”, les Juifs ne sont plus le peuple élu de la Bible, mais les diaboliques conspirateurs de la paranoïa nazi, les églises chrétiennes sont des cibles légitimes pour les attentats à la bombe ou les massacres. Cette doctrine de la division s’est même étendue aux disciples de l’islam – al Qaida a probablement tué plus de musulmans chiites en Irak ou au Pakistan que de membres de n’importe quelle autre confession.
Leur haine peut s’adresser à des groupes différents, mais l’extrême droite et les djihadistes s’opposent tous implacablement à tout mouvement réel vers l’unification de l’humanité.
Une morale partagée
Breivik et al Qaida partagent aussi la même conception de la morale : la fin justifie les moyens. Pour Breivik, les ados qu’il a tués n’étaient pas innocents parce qu’ils soutenaient un parti qui incarne “le mal” que représente le “multiculturalisme”. Mais ils ont été tués, avant tout, dans l’intention de déclencher une guerre raciale qui conduirait au nettoyage ethnique de l’Europe et à un nouveau millénaire aryen-chrétien. Pour Merah, les petits enfants juifs peuvent être descendus d’une balle dans la tête parce que les avions israéliens ont tué beaucoup plus d’enfants palestiniens. Pour Ben Laden et ceux de son acabit, tuer des milliers de civils dans les Twin Towers est une réponse justifiée à ce que les Américains ont fait en Afghanistan et servira le but de rallier tous les Musulmans du monde sous le même étendard de la Guerre Sainte et du nouveau califat.
Beaucoup de libéraux peuvent bien sur tenir le même discours – cela fait partie de leur argumentation selon laquelle tous les extrêmes se rejoignent. Mais les extrémistes les plus visibles ne sont que la partie émergée d’un iceberg beaucoup plus grand.
Derrière Breivik, il y a tous les variantes d’EDL (English Defense League) et de politiciens “populistes” comme Le Pen en France et Wilders aux Pays-Bas, qui adoptent la ligne “je ne suis pas d’accord avec sa méthode mais la menace de l’islamisation pose vraiment question…”. Et derrière eux, il y a le flot des journaux dont les titres n’arrêtent pas d’être des plaintes sur les terroristes musulmans parmi nous, l’arrivée croissante de demandeurs d’asile, pendant que les politiciens “responsables” se font concurrence pour montrer qui est le plus ferme contre l’immigration, et sont en tout cas en charge de l’Etat qui expulse à tour de bras dans leur pays d’origine les demandeurs d’asile qui fuient la pire misère que leur offre le système actuel, ou les enferme dans des camps de rétention.
De la même façon, l’idéologie djihadiste n’est que la fille de l’idéologie officielle des Etats arabes qui sont depuis longtemps anti-sionistes et en perpétuel état de guerre avec Israël, une façon de tenter de détourner la colère des masses de leurs propre pratiques dictatoriales et corrompues. “L’Islam radical” a aussi ses apologistes “révolutionnaires” : Galloway 5, le SWP 6 et d’autres fractions gauchistes, dont la réponse à la dernière atrocité du Djihad est aussi : “je ne suis pas d’accord avec leurs méthodes, mais….” parce qu’ils partagent la même conception que les Etats-Unis et le sionisme sont l’ennemi impérialiste numéro 1 et voient le Hezbollah, le Hamas et les djihadistes irakiens ou afghans comme des expressions de “l’anti-impérialisme”.
Tout cela représente la sécrétion idéologique du processus de pourrissement sur pied réel en cours dans la société capitaliste contemporaine : le cours sans fin à la guerre impérialiste qui est devenu de plus en plus chaotique et irrationnel au fur et à mesure que le système se décomposait. La guerre de tous contre tous, qui divise et dresse les populations les unes contre les autres , que ce soit au nom de la race, de la religion ou de la défense de l’Etat, est un maelström qui constitue la menace la plus réelle et la plus dévastatrice à laquelle fait face l’humanité aujourd’hui – la menace d’un enfoncement sans limite dans la barbarie et l’autodestruction. Les “libéraux” ou “bons démocrates” qui incriminent l’extrémisme et nous inondent de leurs discours humanistes ne représentent pas davantage une alternative. Ce sont bien ces derniers qui ont entretenu la guerre en justifiant l’usage de la terreur, de l’envoi de la bombe atomique sur Japon et sur les villes allemandes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc poursuivi la catastrophe et le cauchemar subi par les populations dans cette guerre, parce que c’était un moyen d’assurer la domination du capitalisme dans l’après-guerre.
La seule vision mondiale en opposition à ces divisions idéologiques, c’est l’internationalisme de la classe ouvrière : la simple idée que les exploités sous le joug de toutes les nations, de toutes les religions, ont là défendre les mêmes intérêts de lutter contre leur exploitation et leurs exploiteurs. C’est un combat dont le but est l’unification réelle de l’humanité, dans une communauté mondiale sans Etats. C’est un combat dont les moyens ne peuvent qu’être en adéquation avec ses buts. Ce combat-là cherche à gagner à sa cause ceux qui sont tombés dans l’idéologie des exploiteurs en montrant le besoin réel d’une solidarité humaine, au lieu de prôner le massacre des incroyants ou des infidèles Ce combat rejette la pratique de la vengeance sans discrimination et le meurtre de masse parce qu’il sait que ces méthodes ne pourront jamais aboutir à l’établissement d’une société humaine. Oui, la lutte de la classe ouvrière est une sorte de guerre. Mais elle est vraiment la guerre pour en finir avec toute guerre, parce que ses buts et ses méthodes sont radicalement opposés aux buts et aux méthodes du capitalisme et de la société de classe dont ne peuvent surgir que toujours plus de massacres sanglants.
Amos (3 mai 2012)
1) Voir l’article que nous avons écrit à l’époque de la tuerie : http ://en.internationalism.org/icconline/2011/august/norway [62]
4) Mouvement fondé en 2009 dont le but affiché est de combattre l’islamisation de l’Angleterre et qui organise depuis régulièrement des manifestations dans plusieurs villes du pays dans ce sens.
5) George Galloway d’origine écossaise est un ancien député du Parti travailliste, fervent admirateur de Fidel Castro, qui est surtout connu pour ses prises de postions d’extrême gauche et pro-palestiniennes. En novembre 2007, il a fondé RESPECT Renewal , devenu ensuite le Parti de Respect, qui soutient notamment la Palestine dans le conflit israélo-palestinien. Il a notamment organisé entre 2008 et 2010 des convois d’aide humanitaire à la population de Gaza contre le blocus du territoire baptisés Viva Palestina ! . Battu aux législatives en 2010, il est élu membre de la Chambre des Communes depuis mars 2012.
6) A l’origine Groupe Socialist Review (GSR) , ce groupe fondé autour de Tony Cliff en 1950 analysait la Russie stalinienne comme un régime particulier où la bureaucratie s’était emparée du pouvoir. Partisan d’une politique d’entrisme dans le Parti Travailliste et les syndicats. Rebaptisé SWP début 1977 où il se présente aux élections sous sa propre bannière, il sert encore aujourd’hui de rabatteur au Parti Travailliste lors des consultations électorales. Devenu l’organisation gauchiste la plus importante au Royaume-Uni, le SWP recrute parmi les jeunes ouvriers et surtout les étudiants sur une base de campagnes activistes (conte le désarmement nucléaire pendant la Guerre froide, puis contre la guerre au Vietnam), elle anime toujours les grandes manifestations sur ses thèmes favoris : l’anti-fascisme et l’anti-racisme. Son organe de presse est Socialist Worker.
Rubrique:
Les élections sont un piège pour la classe ouvrière (2012)
- 1121 lectures
Les législatives après les présidentielles en France... : tout le battage médiatique comme chaque nouvelle campagne électorale témoigne de la préoccupation, présente de l’extrême-gauche à l’extrême-droite, que le plus grand nombre possible d’électeurs accomplissent leur “devoir de citoyen”.
Quelle en est la raison ?
Mobilisation électorale = démobilisation de la classe ouvrière
Les arguments avancés par les formations politiques ou candidats en lice pour convaincre les électeurs de leur accorder leur suffrage se ramènent en général à ceci : les élections constituent un moment pendant lequel les “citoyens” seraient confrontés à un choix dont dépendrait l’évolution de la société et, par conséquent, leurs conditions de vie future. Grâce à la démocratie, chaque citoyen disposerait ainsi de la possibilité de participer aux grands choix sociaux.
Or, dans la réalité, il n’en est rien puisque la société est divisée en classes sociales aux intérêts parfaitement antagoniques ! L’une d’elles, la bourgeoisie, exerce sa domination sur l’ensemble de la société à travers la possession des richesses et, grâce à son Etat, sur toute l’institution démocratique, sur les médias, etc. Elle peut ainsi imposer au quotidien son ordre, ses idées, sa propagande aux exploités en général et à la classe ouvrière en particulier. Cette dernière est la seule classe qui, par ses luttes, est capable de remettre en question l’hégémonie de la bourgeoisie et de son système d’exploitation.
Dans ces conditions, il est parfaitement illusoire de penser qu’il soit possible de transformer l’Etat, l’institution démocratique, etc., pour les mettre au service de la grande majorité dans une société sans exploitation. C’est pourquoi tous les partis qui briguent les suffrages des exploités en prétendant défendre leurs intérêts ou améliorer leur sort participent d’entretenir cette illusion. De même l’alternative “gauche-droite” n’est en réalité qu’un faux choix destiné à masquer que, derrière les bavardages électoraux ou parlementaires, seule la bourgeoisie a réellement le pouvoir.
Le suffrage universel représente un pilier de la domination bourgeoise sur la société. Tout comme l’ensemble des institutions démocratiques, il représente en effet la principale légitimité de l’exercice du pouvoir par la classe dominante. Même si la crise économique sape continuellement les bases de la domination bourgeoise et mine son emprise idéologique sur les exploités, met à nu les mensonges continuellement martelés, la classe dominante n’en devient que plus déterminée, plus acharnée à utiliser tous les moyens à sa disposition pour conserver son pouvoir. Pour éviter que son système ne soit directement mis en cause et pour masquer la faillite de son mode de production, celle-ci n’a de cesse, entre autres, de développer des campagnes de mystification électorales. Face à l’angoisse de l’avenir, à la peur du chômage, au ras-le-bol de l’austérité et de la précarité qui sont au cœur des préoccupations ouvrières actuelles, notamment parmi les nouvelles générations, la bourgeoisie utilise et exploite au maximum ses échéances électorales afin de pourrir la réflexion des ouvriers sur ces questions, en exploitant les illusions, encore très fortes au sein du prolétariat, envers la démocratie et le jeu électoral.
L’avenir de l’humanité ne passe pas par le bulletin de vote mais par la lutte de classe. Cependant, le refus de participer au cirque électoral ne s’impose pas de manière évidente au prolétariat du fait que cette mystification est étroitement liée à ce qui constitue le cœur de l’idéologie de la classe dominante, la démocratie. Toute la vie sociale dans le capitalisme est organisée par la bourgeoisie autour du mythe de l’Etat “démocratique”. Ce mythe est fondé sur l’idée mensongère suivant laquelle tous les citoyens sont “égaux” et “libres” de “choisir” par leur vote, les représentants politiques qu’ils désirent et le parlement est présenté comme le reflet de la “volonté populaire”. Le piège de la démocratie parlementaire est d’instiller chez chacun le principe soi-disant égalitaire, un individu = un vote, niant par là même, la division de la société en classes.
Et un constat que chaque prolétaire peut faire de sa propre expérience de participation à la mascarade électorale, c’est que, quel que soit le résultat des élections, que la gauche ou la droite l’emporte, c’est finalement toujours la même politique anti-ouvrière qui est menée.
Finalement cela veut dire que l’Etat “démocratique” parvient à conduire sa politique indépendamment des élections qui sont organisées.
En fin de compte, ce que cherche à faire la bourgeoisie, c’est à remplacer la lutte de classe, l’éliminer au profit du vote, et remplacer la classe ouvrière par une notion fourre-tout de “peuple” qui choisit “librement” ce que la classe dominante a déjà choisi pour lui.
Lors des consultations électorales, la propagande essentielle de la classe dominante se résume à : “Votez ce que vous voulez, mais surtout votez”.
Loin de constituer une arme pour le prolétariat, la “liberté électorale” constitue le fondement même du désarmement de la classe ouvrière.
D’après l’introduction
à notre brochure Les élections : un piège pour la classe ouvrière
Géographique:
- France [5]
Rubrique:
Face à la crise du capitalisme, quelle réaction: nationalisme ou internationalisme?
- 1806 lectures
Avec l’approfondissement de la crise du capitalisme, le nationalisme le plus exacerbé s’étale dans les colonnes des journaux et devant les caméras de télévision. Les prétendues digues idéologiques qui séparaient, paraît-il, l’extrême-droite du “camp républicain” ont depuis bien longtemps volé en éclats. Il suffit pour s’en convaincre de se remémorer la xénophobie ouvertement affichée par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, la traque infâme des Roms ou le populisme décomplexé du Front national. Mais le nationalisme sait adopter de nombreuses formes, beaucoup plus subtiles et pernicieuses. Ainsi, l’ensemble de l’appareil politique bourgeois, y compris l’extrême-gauche, participe à diffuser le poison de la division nationale, fondement de la concurrence capitaliste qui est diamétralement et irréductiblement opposé au terrain, au point de vue internationaliste, aux intérêts et à la conscience que notre classe, le prolétariat, doit affirmer pour développer ses luttes et renverser ce système d’exploitation.
Faut-il “protéger” les frontières contre l’immigration pour sauver les emplois ?
Point de vue nationaliste
La lutte contre l’immigration économique est un thème central du discours de la bourgeoisie et pas seulement de l’extrême-droite, toutes les fractions politiques au gouvernement, de gauche comme de droite, reprennent cette rhétorique à leur compte. C’est le sens des mesures anti-immigrées adoptées par les gouvernements, de gauche comme de droite, dans tous les pays à commencer par les plus développés qui dressent un rideau administratif, policier, judiciaire allant de l’espace Schengen en Europe à la construction de murs aux frontières des Etats-Unis : limitation de la durée des séjours, expulsions par charters ou reconductions massives, harcèlements juridiques, traque policière, patrouilles navales et aériennes aux frontières, camps de rétention face à l’exode de populations fuyant la misère ou la guerre, etc. L’argument peut se résumer dans la célèbre formule du Front national en France : “3 millions de chômeurs, ce sont 3 millions d’immigrés de trop.” Ainsi, si ça va mal, s’il y a trop de licenciements, s’il y a trop de chômeurs dans le pays, “expulsons les immigrés, interdisons leur l’accès au territoire” pour que les travailleurs nationaux puissent occuper les emplois vacants. Si la protection sociale baisse, s’il y a trop de déficits, c’est à cause de ces “étrangers”, qui “profitent” des largesses du système social !
Point de vue internationaliste
Historiquement, la classe ouvrière est une classe d’immigrés, contraints de vendre n’importe où leur force de travail et l’immigration est un élément essentiel du développement du mouvement ouvrier sous le capitalisme 1. Dès le xiv siècle, la bourgeoisie britannique a déplacé des masses de paysans, souvent irlandais, pour les enrôler comme main-d’œuvre dans les premières manufactures. A partir du xviiiee siècle, lorsque le problème de la surproduction apparaît, l’immigration s’étend par-delà les frontières nationales et se massifie progressivement. “Les crises cycliques de surproduction qui frappent l’Europe capitaliste dès le milieu du xixe siècle vont contraindre des millions de prolétaires à fuir le chômage et la famine en s’exilant vers les “nouveaux mondes”. Entre 1848 et 1914, ce sont 50 millions de travailleurs européens qui vont quitter le vieux continent pour aller vendre leur force de travail dans ces régions, notamment en Amérique.
De la même façon que l’Angleterre du xvie siècle a pu permettre le développement du capitalisme grâce à l’immigration intérieure, la première puissance capitaliste mondiale, les Etats-Unis, se constituera grâce à l’afflux de dizaines de millions d’immigrés venus d’Europe (notamment d’Irlande, de Grande-Bretagne, d’Allemagne, des pays d’Europe du Nord).” 2
C’est au xx siècle, avec le déclin du capitalisme, que les flux migratoires ralentissent et que les Etats se dotent d’outils pour lutter contre l’immigration. La bourgeoisie s’appuie sur le fatras idéologique des thèmes anti-immigrés pour désigner des boucs émissaires alors qu’en réalité, s’il y a du chômage, c’est précisément parce que les pays développés ne sont plus en mesure d’intégrer économiquement de nouveaux prolétaires sur le marché du travail, en particulier les jeunes. En fait, le capitalisme, parce qu’il est en crise, n’est pas capable de fournir du travail non seulement à la main-d’œuvre immigrée mais à tous les prolétaires.
Faut-il “produire et acheter français” pour échapper à la crise ?
Point de vue nationaliste
L’idée de consommer préférentiellement la production nationale est le cheval de bataille idéologique des partis politiques bourgeois. Lors de la précédente campagne électorale, pas moins de trois des principaux candidats, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, ont ouvertement prôné de repousser ou de surtaxer les marchandises étrangères qui viendraient étrangler la compétitivité nationale ou exercer une pression déloyale car produites par une main d’œuvre payée à coups de lance-pierre. L’objectif est de favoriser les entreprises nationales contre la concurrence étrangère afin de “protéger les emplois”.
Point de vue internationaliste
Si le protectionnisme ne fonctionne pas, c’est parce que le marché capitaliste est mondial. Des mesures protectionnistes qu’ont pu prendre certains Etats, comme la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis, n’ont eu de validité qu’à une époque où elles pouvaient s’appuyer sur un marché extra-capitaliste paysan ou artisanal suffisamment conséquent et n’avaient jamais qu’une durée limitée. Après le début du xxee siècle, ces mesures se sont avérées souvent désastreuses pour les économies nationales. Les mesures prises par l’Allemagne, censées lui permettre de vivre en autarcie, n’ont fait qu’aggraver démesurément la crise mondiale. Leur principal résultat a été la contraction ou la fermeture des marchés internationaux et l’augmentation du coût des marchandises dans les pays où était pratiquée la fermeture économique des frontières. C’est pour cette raison que la bourgeoisie a essayé de freiner les tentations protectionnistes qui n’ont cessé de se manifester depuis les premiers signes de la crise actuelle dont l’origine remonte à la fin des années 1960.
Accepter de “se serrer la ceinture” pour favoriser la compétitivité nationale ?
Point de vue nationaliste
La défense de la compétitivité est également un grand classique pour l’argumentation nationaliste. Le message est revenu en force avec la crise économique qui est expliquée d’un point de vue national : si le pays est en crise, c’est à cause de la faiblesse de la compétitivité française par exemple, c’est-à-dire à cause du coût trop élevé des marchandises produites en France par rapport à celui des autres pays, comme l’Allemagne, la Chine ou les Etats-Unis. Ainsi, les travailleurs devraient patriotiquement accepter de diminuer leur salaire et baisser toujours plus leur niveau de vie pour faciliter la vente des marchandises nationales à l’étranger. C’est une logique assez voisine qui s’est exprimée récemment par la mise en avant de différents “coupables” à l’ampleur de la dette souveraine des Etats ainsi menacés de faillite : “C’est la faute aux Grecs” qui ont profité des largesses de l’Europe pour vivre au-dessus de leurs moyens et n’ont pas “payé leurs impôts”, dont les fonctionnaires “sont payés à ne rien faire”, etc. Ou encore, les autres nations n’ont pas à payer les “erreurs de gestion ou le gaspillage des Grecs...”. A l’inverse, côté Grec, la source des maux qui accablent ce pays serait “la pression de l’Europe” ou des banques centrales (FMI, Banque mondiale)...
Point de vue internationaliste
En fait, les explications avancées par la bourgeoisie pour justifier les plans de rigueur ou d’austérité au nom de la compétitivité sont grossièrement mensongères : plus les exploités acceptent de “se serrer la ceinture”, plus on leur demande et on leur demandera des “sacrifices”. Cette course sans fin à la productivité a déjà fait ses preuves. Hier, l’Irlande, le “tigre celtique”, était porté aux nues pour l’exemplarité des ouvriers gaéliques qui avaient courageusement accepté les sacrifices… jusqu’à ce que l’Irlande soit ébranlée par la récession et le chômage. De même avec l’Espagne ou le Portugal. Aujourd’hui, c’est l’Allemagne qui fait figure de parangon mais, déjà, le “modèle allemand” se fissure de toute part, comme le Royaume-Uni et il y a quelques années etc. En fait, la racine de la crise réside dans la surproduction généralisée de marchandises face à laquelle la restriction des coûts salariaux ne peut être que totalement impuissante au niveau du capital global.
Les solutions nationalistes avancées par la bourgeoisie de tous les pays sont des leurres lancés à la face du prolétariat pour le diviser et le détourner de la claire compréhension que le capitalisme est un système en faillite. L’identification “du peuple”, des “citoyens” à leur Etat, à leur gouvernement, à leur entreprise ne sert qu’à faire écran à une véritable compréhension des enjeux de la situation historique mondiale, empoisonne la conscience des prolétaires de leur responsabilité historique pour abattre le système.
Les prolétaires n’ont pas à faire cause commune avec leurs exploiteurs mais, au contraire, ils doivent mener la lutte contre eux en s’unissant, se solidarisant par delà les frontières.
Rien ne peut sauver le capitalisme. Cette guerre de tous contre tous et cette concurrence permanente à travers lesquelles toutes les bourgeoisies, tous les Etats tentent de nous dresser le uns contre les autres est à l’opposé de notre perspective. La bourgeoisie distille partout le poison du nationalisme économique afin de démolir la conscience d’appartenir à une même classe internationale qui n’a rien à gagner à soutenir les vieilles recettes chauvines, fondement de ce système et de ses contradictions. Alors que la solidarité internationale à l’œuvre dans la lutte des travailleurs, dans nos combats de classe, nous grandit, élève notre conscience en mettant en avant la perspective d’une société édifiée collectivement à partir des besoins réels de l’humanité, sur d’autres rapports humains, capables d’offrir la seule issue possible à l’humanité face au gouffre de misère et de barbarie dans lequel l’entraîne l’impasse avérée du capitalisme. Les prolétaires n’ont pas de patrie. Prolétaires de tous les pays, unissons-nous !
V. (25 mai)
Récent et en cours:
- Crise économique [13]
Rubrique:
Au Québec, pour les ouvriers, les chômeurs, les précaires ou les étudiants, la lutte unifiée est la seule perspective
- 1683 lectures
Voici déjà près de quatre mois que les étudiants québécois sont mobilisés contre la hausse des frais de scolarité, mais pendant près de 3 mois au milieu d’un black-out quasi-unanime hors du pays. Cette augmentation de près de 80 % vient s’ajouter aux augmentations précédentes et, avec l’attitude répressive et provocatrice du gouvernement Charest, les étudiants en lutte, aux cris de “Manif chaque soir jusqu’à la victoire”, ne sont pas prêts d’accepter passivement une telle mesure. Alors que d’emblée, la plupart des médias traitait de la question sous l’angle très idéologique de “la popularité ou l’impopularité” de la grève au Québec 1, le mouvement quant à lui, a exprimé une tendance à se généraliser et à dépasser le secteur de l’enseignement.
Afin de mieux comprendre le contexte de ce mouvement rappelons les mesures similaires prises par le gouvernement ces dernières années et les conditions actuelles des étudiants.
Une austérité qui ne date pas d’hier…
Dans ces temps d’austérité imposés par la faillite historique du système capitaliste 2, l’augmentation des frais de scolarité, au même titre que toutes les mesures de réduction du déficit, n’a rien de bien nouveau ni de spécifique au Québec. En 1990, le deuxième gouvernement de Robert Bourassa brise le gel des frais de scolarité, établis depuis 1968 à 540 $ CAN par an, pour les élever à 1668 $ CAN par an (soit trois fois plus). Puis en 2007, c’est au tour du gouvernement de Jean Charest (centre-droit) de poursuivre dans ce sens avec une augmentation de 500 $ CAN sur 5 ans, amenant ainsi l’addition à 2168 $ CAN pour l’année scolaire 2011-2012. Avec de tels frais de scolarité (pourtant en deçà de la moyenne de scolarité aux Etats-Unis), bon nombre d’étudiants n’ont plus accès aux études supérieures. Dans ce pays, 80 % des étudiants travaillent et étudient à temps plein, alors même que la moitié de ces étudiants vit avec 12 200 $ par an (avec un seuil de pauvreté pour une personne seule de 16 320 $ en 2010 !).
… mais qui devient insupportable !
Dans le budget du Québec déposé le 18 mars 2011, le gouvernement Charest confirme donc son intention d’augmenter les droits de scolarité de 1625 $ sur 5 ans, les faisant passer à près de 4500 $ par année en 2016, si l’on ajoute les frais afférents exigibles par les universités. Suite à cette annonce, la réaction ne se fit pas attendre. Le 31 mars 2011, une manifestation rassemble quelques milliers d’étudiants à Montréal et, sur l’initiative de la FEUQ 3, un campement est érigé chaque fin de semaine devant les bureaux du ministère de l’Education.
Etait-ce une méthode de lutte adaptée, qui permette au mouvement de s’étendre en allant chercher la solidarité ? Rien n’est moins sûr. Toujours est-il que ce dernier ne connaîtra pas d’événement marquant pendant un an. Il faudra attendre le 22 mars 2012 pour qu’une manifestation étudiante surprenne par son ampleur. Entre 200 000 et 300 000 personnes y participent, rassemblant étudiants et travailleurs dans le centre de Montréal. Les revendications avancées s’inscrivent alors dans un mouvement historique bien plus large. Certains parlent alors de “Printemps érable” en référence aux révoltes dans les pays arabes. La base de la colère qui s’exprime est bien plus vaste que la seule augmentation des frais universitaire, et la solidarité avec le mouvement “Occupy” est clairement affichée. Ce mouvement montre que même dans un pays qui n’est pas réputé pour être le siège de mouvements sociaux d’ampleur, la mobilisation, poussée par des conditions de vie de plus en plus difficiles, gagne une partie croissante de la population. Le 7 avril, lors d’un cycle de conférences à Montréal, Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de la Coalition large de l’association pour la solidarité syndicale étudiante (CLASSE) devait reconnaître l’ampleur du mouvement : “Notre grève, c’est pas l’affaire d’une génération, c’est pas l’affaire d’un printemps, c’est l’affaire d’un peuple, c’est l’affaire d’un monde. Notre grève, ce n’est pas un événement isolé, notre grève c’est juste un pont, c’est juste une halte le long d’une route beaucoup plus longue.” Pour le gouvernement de Charest, il est clair qu’il ne faut pas laisser les étudiants occuper la rue, au risque qu’ils parviennent à trouver la solidarité d’autres secteurs et que le mouvement prenne encore plus d’ampleur 4. C’est donc avec brutalité que ce gouvernement a fait passer une loi le 18 mai dernier, dite “loi 78” qui rend illégale toute manifestation non annoncée. Voici les grandes lignes de cette loi “spéciale” 5 : “Elle interdit tout rassemblement à moins de 50 mètres des établissements scolaires (c’est-à-dire, interdiction des piquets de grève devant les universités) ;
– elle restreint le droit de manifester sans accord préalable avec la police : il faudra fournir huit heures avant, la durée, l’heure, le lieu ,le parcours et les moyens de transports (cette restriction est valable pour tous les regroupements de plus de 50 personnes) ;
– elle prévoit de très lourdes amendes pour les organisateurs de piquets de grève : de 1000 à 5000 dollars (de 770 à 3860 euros) pour un individu seul et de 25 000 à 125 000 dollars (de 19 320 à 96 600 euros) pour une association d’étudiants, le double en cas de récidive.”
Pour le gouvernement en place, il s’agit de taper fort pour casser la mobilisation et pour rappeler aux manifestants qui fait la loi. Ces méthodes répressives ne sont pas sans rappeler la violence à laquelle se sont confrontés les manifestants espagnols ou grecs lors des grands mouvements ces derniers mois. En France, cela rappelle la violence dont la police avait fait preuve pour intimider les étudiants et lycéens qui manifestaient à Lyon en 2010. Elle n’avait pas hésité à les isoler pendant de longues heures sur la place Bellecourt pour finalement les relâcher un à un après identification 6. Cela ressemblait bien à une expérimentation de manœuvre d’intimidation, pour faire peur aux manifestants et casser leur combativité. Il est vraisemblable que ce soit ce même résultat que visait le gouvernement Charest avec sa loi 78.
Visiblement, les événements ne se sont pas tout à fait déroulés comme l’espérait la classe politique québécoise. Bien loin de “casser” le mouvement et de remettre les étudiants dans le rang, cette “mesure spéciale” a été reçue comme une provocation pour les manifestants, ce qui a eu pour effet d’amplifier et de radicaliser le mouvement. L’heure est donc à la contestation et aux “casserolades”.
Pour les manifestants québécois, il s’agit aujourd’hui de répondre spontanément à la provocation du gouvernement par… des manifestations provocatrices ! Et à ce jeu-là, l’Etat est très fort : “Près de 700 personnes ont été arrêtées dans la nuit de mercredi à jeudi à Montréal et à Québec au terme de manifestations jugées illégales par les services policiers. Parmi les 518 arrestations effectuées dans le cadre de la 30 manifestation nocturne consécutive dans la métropole, on compte 506 arrestations de groupe et 12 arrestations isolées, dont 14 en vertu du Code criminel et une en vertu du règlement municipal proscrivant le port d’un masque ‘sans motif raisonnable’.” (le Devoir, 25 mai 2012)
Quelles perspectives pour le mouvement ?
Il est clair que ce qui fait la force de ce mouvement c’est la combativité et la détermination dont fait preuve la jeune génération. Nous ne pouvons que soutenir cette combativité, tout comme l’extension qu’a connue le mouvement avec la présence en son sein des travailleurs d’autres secteurs. Dans un sens, le manque d’habileté et la brutalité de l’équipe Charest peuvent être un facteur de généralisation du mouvement et jouer en faveur des ouvriers en lutte. Toutefois, ce mouvement comporte de nombreuses faiblesses, et il devra éviter bien des pièges pour ne pas se scléroser derrière des revendications trop stériles.
Parmi ces pièges, il en est un de taille : l’illusion que l’on pourrait vivre dans un monde meilleur au sein du capitalisme ; l’illusion que l’on pourrait changer ce système d’exploitation à coups de réformes et par la voie “démocratique” 7. Cette illusion est clairement insufflée par les syndicats, dont la Classe en première ligne avec tout son discours sur la “désobéissance civile” 8. La loi 78 prévoit également une suspension des cours jusqu’au mois d’août dans les établissements en grève, sans annulation de la session, si bien qu’aujourd’hui il est difficile d’affirmer que le mouvement va continuer à se développer. Ce qu’en revanche on peut affirmer, à la lumière des différents mouvements ouvriers qui marquent l’histoire du capitalisme, c’est qu’il n’y a que la recherche de solidarité et l’extension la plus large possible vers toute la classe ouvrière qui puisse offrir un réelle perspective au mouvement. La solidarité avec le mouvement des indignés et “Occupy”, la tenue d’assemblées générales ouvertes à tous où les questions politiques sont débattues collectivement et sans s’en remettre à de soi-disant “professionnels de la lutte”, sont des étapes incontournables pour lutter efficacement contre ce système en pleine décomposition généralisée et pour offrir à l’humanité ce à quoi elle aspire : “un monde meilleur” !
Enkidu (26 mai)
1 Le 19 mai, le Parisien titrait : Québec : les étudiants en grève sont déterminés mais l’opinion reste divisée.
2 Pour bien comprendre cette notion de faillite historique, nous incitons nos lecteurs à consulter notre dossier spécial crise économique, disponible sur notre site web.
3 Fédération étudiante universitaire du Québec.
4 Devant l’ampleur de la mobilisation, le gouvernement québécois tente de restreindre le droit de manifester. Le Point, 18/05/12
5 D’après le site Rue89.
6 Voir nos articles : Face à l’escalade répressive à Valence (Espagne) de mars 2012 et le témoignage sur la manifestation du 19 octobre à Lyon, disponibles sur notre site internet.
7 Ce à quoi des indignés espagnols répondaient par : Ils l’appellent démocratie mais ce n’est pas le cas !, C’est une dictature mais on ne la voit pas !
8 De son côté, Gabriel Nadeau-Dubois, président de la CLASSE, le syndicat le plus radical, a affirmé que le texte était tout simplement anticonstitutionnel et a appelé à la désobéissance civile (le Point, 18/05/12).
Géographique:
- Canada [66]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [15]
Rubrique:
Après l'escroquerie de la "grève générale" du 29 mars en Espagne, comment pouvons-nous impulser une véritable lutte?
- 2184 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article de la publication du CCI en Espagne, Acción Proletaria, qui tire le bilan de la journée d’action du 29 mars (voir notre site Web sur ce sujet) en s’appuyant en particulier sur les différents tracts diffusés dans les cortèges de manifestants et sur les débats qui ont suivi sur différents forums sur la question de “comment lutter ?”.
Sii aujourd’hui les syndicats nous appellent à un arrêt de travail général, qu’ils osent appeler grève, et parlent “d’aller dans la rue”, c’est justement pour saboter notre lutte ; pour nous encadrer, pour nous contrôler, pour maintenir la paix sociale avec des simulacres d’opposition ; pour que les réponses aux attaques contre nos conditions de vie empruntent les voies légales de la démocratie, ce qui signifie que tout continue à l’identique ou bien pire.”
Face à la convocation de grève pour le 29 mars, le CCI a ouvert une rubrique de débat dans notre site Web où l’on a recueilli des réflexions des camarades, des tracts distribués par des collectifs divers, des débats qui ont eu lieu ici ou là, etc. 1. Il s’agit de laisser la parole aux minorités les plus actives et conscientes qui expriment l’effort en train d’émerger au sein de la classe ouvrière pour se libérer des chaînes syndicales et pour mettre en avant une alternative de lutte qui réunisse la défense contre les coupes budgétaires et la perspective de destruction du capitalisme, la construction d’une nouvelle société.
La citation avec laquelle commence cet article est prise d’un des tracts que nous avons inclus dans cette rubrique 2 et qui dénonce clairement ce qu’a représenté le 29 mars : une escroquerie pour nous démobiliser.
Les méthodes syndicales de lutte
Les syndicats créent de plus en plus de méfiance dans les rangs ouvriers, mais il faudrait aller au fond des choses : le problème n’est pas seulement le fait des syndicats en tant qu’organes participant des réseaux de l’Etat capitaliste, le problème est aussi le syndicalisme, c’est-à-dire une manière de concevoir la lutte, une manière de s’organiser et des méthodes d’action qui, malgré les meilleures intentions, nous amènent toujours à la défaite.
Comme le dit un camarade dans le débat sur le site Libcom 3, le syndicalisme limite “les conflits du travail à une entreprise ou à un secteur particulier, en empêchant, avec des entraves diverses, que la lutte ne s’étende au reste des prolétaires”, il répand “une mentalité individualiste et purement économique chez les “citoyens travailleurs”, “en oubliant” et en affaiblissant la réflexion sur la dimension politique et collective des problèmes du prolétariat” et prônant “l’action déléguée et individuelle, en minant la possibilité d’auto-organisation et de solidarité”. Donc, la façon avec laquelle les grèves syndicales sont envisagées “est négative : obéir aux syndicats sans la moindre réflexion ou discussion collective ; mener les actions absurdes des piquets qui, au lieu de renforcer la solidarité, l’union et la confiance en soi au sein de la classe ouvrière, restent fixés sur le fait “que personne ne travaille”, avec le seul objectif d’entasser des chiffres pour les évaluations sur l’emprise syndicale ; cela n’offre aucun espace pour que les millions de chômeurs, les étudiants et les retraités renouent le contact et mènent des luttes communes avec ceux qui ont encore un travail” 4.
La grève est une arme de la classe ouvrière qui sert à développer son unité, à affirmer sa conscience, à créer sa propre organisation ; la grève syndicale sert à tout le contraire, c’est pour cela que les syndicats “alternatifs” (CGT, CNT, etc.), “quelles que soient leurs couleurs, au-delà de leurs propositions ou de leurs dénonciations des syndicats majoritaires, ne sont au fond que l’appendice “radical” des “syndicats responsables”. Ils ont totalement participé à cette “grève” sans dire un mot sur le piège que ces soi-disant luttes représentent. Au contraire, le seul problème qu’ils dénoncent, c’est que les grands syndicats ne fassent pas ce type d’appel plus souvent...” 5.
Dans le débat sur Libcom, un des interlocuteurs dit : “Je pense que ce serait très difficile de faire participer beaucoup de monde dans une grève faite sous le slogan “À bas le capitalisme, révolution de suite !”.” Tout syndicat s’oppose, bien entendu, à une lutte révolutionnaire puisque son existence même en tant que syndicat est liée à la conservation du capitalisme, mais, en plus, il s’oppose aussi à n’importe quelle lutte revendicative véritable, parce que, comme répond le camarade cité : “L’équation “lutte pour améliorer ou défendre les conditions de vie et de travail = syndicalisme” est erronée.”
Sous le capitalisme on ne peut pas vivre
La dynamique des attaques, du chômage déchaîné, de la crise généralisée, pose une question simple : est-ce qu’on peut continuer à vivre sous le capitalisme ?
Depuis qu’on est enfant, on nous éduque avec les idées : “tout dépend de nous”, “si tu fais bien les choses”, tu auras “une vie stable et confortable”, “tu auras comme récompense des enfants, une maison, une voiture, une deuxième résidence, des croisières de vacances” et encore d’autres merveilles consuméristes. “... Nous pensons que si ça va bien pour nous, pour un autre, ce devrait être pareil, et si ce n’est pas le cas, c’est parce que celui-là a dû faire quelque chose de mal ou alors, c’est un fainéant, un inutile ou un incompétent” 6.
Après tant d’années de crise et surtout avec l’accélération des cinq dernières années, ces contes de fées s’écroulent : “On entend la même rengaine : étudie, travaille, fais encore des efforts, ne proteste pas, achète-toi une voiture et un appartement, sois quelqu’un... Et maintenant ? Tout ce pour quoi on nous a éduqués apparaît comme un mensonge” 7. On a beau avoir plein de titres universitaires, on a beau accumuler de l’expérience professionnelle, être consciencieux au travail, le futur se présente comme un tunnel sans fin rempli de précarité, de chômage et de misère.
Nous assistons au lent effondrement d’un système social qui a derrière lui un siècle de décadence. Ce n’est pas seulement la crise économique et sociale si grave déjà en elle-même ! C’est aussi la destruction environnementale, les guerres impérialistes, la barbarie morale la plus dégradée ! C’est pour cela que face à la sous-estimation éhontée de la crise que les syndicats nous dépeignent pour nous faire croire “qu’un autre capitalisme est possible” dûment “reformé”, nous souscrivons à ce que des camarades de la ville de Palencia affirment dans leur dénonciation :
“Pour eux, autant la crise que les coupes faites dans les droits des travailleurs sont la conséquence des actes de certains gouvernements et “de spéculateurs avides”. Ceci est faux, la crise et ses effets sont inhérents au système capitaliste, et non pas la conséquence directe des actions de “quelques individus sans scrupules”. Les crises se succèdent les unes après les autres depuis les débuts du système capitaliste lui-même, et elles ne peuvent être que de plus en plus graves. Si l’on sort de cette crise, on retombera dans une autre bien pire. Le capitalisme est un système économique en décadence.”
Toutes les voix du monde politique, patronal et syndical, en y incluant les “nouveaux radicaux” de DRY, nous prêchent que “tout cela peut s’arranger”. La droite et le patronat proposent comme remède d’autres coupes, plus de flexibilité, des sacrifices… La gauche et les syndicats proposent d’autres mesures : des nationalisations, des impôts supplémentaires pour les riches, des audits sur les dettes et encore d’autres rapiéçages. Des deux cotés, on veut surtout nous écarter de la voie de la lutte massive contre ce système d’exploitation et nous dévoyer vers l’impasse du sacrifice pour faire tenir debout ce système pourri. C’est pour cela que nous soutenons cette analyse de camarades de Barcelone :
“Les réformes, les différentes alternatives qu’on nous offre : un capitalisme à visage humain, avec des formes différentes de production et de distribution, une “bonne gestion citoyenne”, la décroissance, l’anti-globalisation, des changements dans le gouvernement, des négociations syndicales et toutes les autres variantes qui prétendent changer le monde sans révolution ; ce ne sont que des manœuvres pour nous emberlificoter et détruire toute tentative de lutte. Ce sont des mécanismes et des appareils fabriqués dans le but de nous faire gober tout ce qu’ils veulent nous faire gober” 8.
Ce système ne peut pas être reformé et ses bénéficiaires – la classe dominante – fera tout ce qu’elle pourra, quels que soient les dégâts, pour garder ses privilèges : “La vie de l’immense majorité de l’humanité doit être poussée au-delà de toute limite pourvu que les coffres du capital soient sauvegardés, pourvu que la banqueroute de ce système moribond soit évitée. Les gouvernements du monde entier et de toute couleur politique, en tant que représentants du monde de l’argent, appliquent les mêmes mesures terroristes que le capital exige partout” 9.
Comment développer une lutte contre les attaques du capitalisme qui prépare simultanément les conditions pour un changement révolutionnaire ?
Si le capitalisme nous condamne à une éternelle non-vie, si son Etat, ses politiciens, ses syndicalistes, ne font pas autre chose que nous conduire vers l’abîme, alors le fait de nous unir, de nous organiser, de lutter, tous ensemble, à partir de la base, ce n’est pas un bel idéal, mais un besoin vital. “Ensemble, nous pouvons tout changer”, voilà le slogan simple et percutant avec lequel les camarades d’Alicante concluent leur appel : “Il faut en finir avec les têtes qui se baissent, les gosiers qui avalent tout, les yeux qui regardent ailleurs devant les humiliations quotidiennes, parce que lorsqu’on accepte le mauvais avec résignation, on s’enfonce encore pire” 10.
Il est évident que ce combat est difficile parce que “se débarrasser totalement des mensonges dans un monde construit sur la falsification est une tache titanesque (…) Il est difficile de combattre un système dont les tentacules s’étendent aux moindres recoins de notre vie” 11. Mais, pour avancer, le plus important, c’est le développement de l’unité, de la solidarité, de la conscience et de l’auto-organisation dans nos propres rangs.
Face à la “grève syndicale” qui est conçue pour nous broyer et nous réduire à un tas de poussière, d’individus enfermés sur eux-mêmes, “une grève c’est bien plus que ne pas aller travailler un jour. Ce qui est important, c’est ce que l’on vit et ce que l’on crée, c’est la rencontre et les expériences qui en surgissent. C’est là la base du succès ou de l’échec d’une grève et non pas dans les chiffres du suivi ou dans la manif-procession de l’après-midi” 12.
Il s’agit de “devenir conscients de la réalité d’un monde en faillite. Occuper les rues, les libérer de la marchandise et les ouvrir à la communication et à l’action collectives” 13.
Il ne s’agit pas de “se foutre” des appels comme celui pour la grève du 29 mars, en même temps qu’on les dénonce, il faut tout faire pour y porter la lutte en vue du développement des forces du prolétariat ; comme le dit un camarade : ““Sortir de la normalité” du chacun pour soi et de l’acceptation résignée et sans critique de tout ce qui nous tombe dessus, voilà des pas importants” 14.
C’est pour cela que l’initiative des camarades d’Alicante est très importante :
“Nous proposons de créer un espace de participation, critique, unitaire et de lutte pour l’annulation de la réforme du travail et contre toute forme d’exploitation, ayant comme fondement l’auto-organisation en assemblées.”
Dans cet espace, “on pourrait essayer de récupérer sa propre vie : retrouver des gens qui ressentent des choses semblables à celles qui nous remuent les tripes ces derniers temps, partager la rage, les expériences, les émotions et la recherche d’alternatives, s’organiser et lutter pour avoir une vie qu’on puisse considérer comme libre” 15.
Cependant, le chemin est long et plein d’obstacles et, comme le dit un camarade, même s’il commence à se faire jour “une plus grande prédisposition et acceptation des critiques dirigées contre le système capitaliste, et des idées qui parlent de la nécessité d’une protestation massive. Les quatre dernières années de crise (ou de la dernière éruption de la maladie chronique du capitalisme), et tout ce que nous attend, sont en train de faire apparaître un changement d’état d’esprit lent, souterrain mais certain. Ceci dit, une alternative claire au niveau social et politique n’est toujours pas apparue” (16.
Acción Proletaria (20 mai 2012)
1 Voir, en espagnol, Debate sobre la huelga general (Débat sur la grève générale) :
2 Voir (en esp.) https://es.internationalism.org/node/3374 [68]
3 Voir https://es.internationalism.org/node/3381 [69]
4 Idem.
5 Idem.
6 Voir (esp) https://es.internationalism.org/node/3376 [70]
7 Voir (esp) https://es.internationalism.org/node/3379 [71]
8 Idem, note 2.
9 Idem.
10 Idem, note 6.
11 Idem, note 7.
12 Idem.
13 Idem.
14 Voir https://es.internationalism.org/node/3369 [72]
15 Idem, note 6.
16 Idem, note 14.
Géographique:
- Espagne [25]
Rubrique:
La menace d'un cataclysme impérialiste au Moyen-Orient
- 1694 lectures
En Syrie, chaque jour qui passe apporte son nouveau lot de massacres. La récente horreur frappant la ville d’Houla est particulièrement atroce et révoltante Ce pays a rejoint les terrains des guerres impérialistes au Moyen-Orient. Après la Palestine, l’Irak, l’Afghanistan et la Libye, voici maintenant venu le temps de la Syrie.
Malheureusement, cette situation pose immédiatement une question particulièrement inquiétante. Que va-t-il se passer dans la période à venir ? En effet, le Proche et le Moyen-Orient dans leur ensemble paraissent au bord d’un embrasement dont on voit difficilement l’aboutissement. Derrière la guerre en Syrie, c’est l’Iran qui attise aujourd’hui toutes les peurs et les appétits impérialistes, mais tous les principaux brigands impérialistes sont également préparés à défendre leurs intérêts dans la région. Celle-ci est sous la menace permanente de la guerre, d’une guerre dont les conséquences dramatiques seraient irrationnelles et destructrices pour le système capitaliste lui-même.
Destruction de masse et chaos en Syrie : qui est responsable ?
Pour le mouvement ouvrier international, comme pour tous les exploités de la terre, la réponse à cette question ne peut être que la suivante : le responsable et le seul, c’est le capital. C’était déjà le cas pour les boucheries des Première et Seconde Guerres mondiales. Mais aussi des guerres incessantes qui, depuis celles-ci, ont fait à elles seules plus de morts que ces deux guerres mondiales réunies. Il y a un peu plus de 20 ans, George Bush, alors président des Etats-Unis, et ceci bien avant que son propre fils n’accède à la Maison Blanche, déclarait d’un air triomphant “que le monde entrait dans un nouvel ordre mondial”. Le bloc soviétique s’était littéralement écroulé. L’URSS disparaissait et, avec elle, devaient disparaître également toutes les guerres et les massacres. Grâce au capitalisme enfin triomphant et sous le regard bienveillant et protecteur des États-Unis, la paix allait désormais régner dans le monde. Que de mensonges encore une fois démentis immédiatement par la réalité. N’est-ce pas ce même président qui allait, peu après ce discours cynique et hypocrite, déclencher la première guerre d’Irak ?
En 1982 l’armée syrienne avait réprimé dans le sang la population révoltée de la ville de Hama. Le nombre de victimes n’a jamais pu être déterminé avec certitude : les estimations varient entre 10 000 et 40 000. Personne à l’époque n’avait parlé d’intervention pour secourir la population, personne n’avait exigé le départ de Hafez El-Assad, père de l’actuel président syrien. Le contraste avec la situation actuelle n’est pas mince ! La raison en est qu’en 1982, la scène mondiale était encore dominée par la rivalité entre les deux grands blocs impérialistes. Malgré le renversement du Shah d’Iran par le régime des Ayatollahs au début 1979 et l’invasion russe de l’Afghanistan un an après, la domination américaine sur la région n’avait pas été contestée par les autres grandes puissances impérialistes et elle était à même de garantir une relative stabilité.
Depuis lors les choses ont bien changé : l’effondrement du système des blocs et l’affaiblissement du “leadership” américain donnent libre cours aux appétits impérialistes des puissances régionales que sont l’Iran, la Turquie, l’Égypte, la Syrie, Israël... L’approfondissement de la crise réduit les populations à la misère et attise leur sentiment d’exaspération et de révolte face aux régimes en place.
Si aujourd’hui aucun continent n’échappe à la montée des tensions inter-impérialistes, c’est au Moyen-Orient que se concentrent tous les dangers. Et, au centre de ceux-ci, nous trouvons en premier lieu la Syrie, après plusieurs mois de manifestations contre le chômage et la misère et qui impliquaient des exploités de toutes origines : Druzes, Sunnites, Chrétiens, Kurdes, hommes, femmes et enfants tous unis dans leurs protestations pour une vie meilleure. Mais la situation dans ce pays a pris une sinistre tournure. La contestation sociale y a été entraînée, récupérée, sur un terrain qui n’a plus rien à voir avec ses raisons d’origine. Dans ce pays, où la classe ouvrière est très faible et les appétits impérialistes très forts, cette triste perspective était, en l’état actuel des luttes ouvrières dans le monde, pratiquement inévitable.
Au sein de la bourgeoisie syrienne, tous se sont jetés tels des charognards sur le dos de cette population révoltée et en détresse. Pour le gouvernement en place et les forces armées pro Bachar Al-Assad, l’enjeu est clair. Il s’agit de garder le pouvoir à tout prix. Pour l’opposition, dont les différents secteurs sont prêts à s’entre-tuer et que rien ne réunit si ce n’est la nécessité de renverser Bachar el-Assad, il s’agit de prendre ce même pouvoir. Lors des réunions de ces forces d’opposition à Londres et à Paris, il y a peu de temps, aucun ministre ou service diplomatique n’a voulu préciser leur composition. Que représente le Conseil national syrien ou le Comité national de coordination ou encore l’Armée syrienne libre ? Quel pouvoir ont en leur sein les Kurdes, les Frères musulmans ou les djihadistes salafistes ? Ce n’est qu’un ramassis de cliques bourgeoises, chacune rivalisant avec les autres. Une des raisons pour lesquelles le régime d’Assad n’a pas encore été renversé, c’est qu’il a pu jouer sur les rivalités internes à la société syrienne. Ainsi, les chrétiens voient d’un mauvais œil la montée des islamistes et craignent de subir le même sort que les coptes en Égypte ; une partie des Kurdes essaie de négocier avec le régime ; et ce dernier garde le soutien de la minorité religieuse alaouite dont fait partie la clique présidentielle.
De toute façon, le Conseil national n’existerait pas militairement et politiquement de manière significative s’il n’était pas soutenu par des forces extérieures, chacune essayant de tirer ses marrons du feu. Au nombre d’entre elles, il faut citer les pays de la Ligue arabe, Arabie Saoudite en tête, la Turquie, mais également la France, la Grande-Bretagne, Israël et les États-Unis.
Tous ces requins impérialistes prennent le prétexte de l’inhumanité du régime syrien pour préparer la guerre totale dans ce pays. Par l’intermédiaire du média russe la Voix de Russie, relayant la chaîne de télévision publique iranienne Press TV, des informations ont été avancées selon lesquelles la Turquie s’apprêterait, avec le soutien américain, à attaquer la Syrie. A cet effet, l’État turc masserait troupes et matériels à sa frontière syrienne. Depuis lors, cette information a été reprise par l’ensemble des médias occidentaux. En face, en Syrie, des missiles balistiques sol-sol de fabrication russe ont été déployés dans les régions de Kamechi et de Deir ez-Zor, à la frontière de l’Irak. Car le régime de Bachar Al-Assad est lui-même soutenu par des puissances étrangères, notamment la Chine, la Russie et l’Iran.
Cette bataille féroce des plus puissants vautours impérialistes de la planète à propos de la Syrie se mène également au sein de cette assemblée de brigands qui est dénommée ONU. En son sein, la Russie et la Chine avaient à deux reprises mis leur veto à des projets de résolution sur la Syrie, dont le dernier appuyait le plan de sortie de crise de la Ligue arabe prévoyant ni plus ni moins que la mise à l’écart de Bachar Al-Assad. Après plusieurs jours de tractations sordides, l’hypocrisie de tous s’est encore étalée au grand jour. Le Conseil de sécurité des Nations unies, avec l’accord de la Russie et de la Chine, a adopté le 21 mars dernier une déclaration qui vise à obtenir un arrêt des violences, grâce à l’arrivée dans ce pays d’un envoyé spécial de renom, monsieur Kofi Annan, tout cela n’ayant par ailleurs bien entendu aucune valeur contraignante. Ce qui veut dire en clair que cela n’engage en réalité que ceux qui y croient. Tout cela est sordide.
La question que nous pouvons nous poser est alors bien différente. Comment se fait-il que, pour le moment, aucune puissance impérialiste étrangère impliquée dans cet affrontement n’ait encore frappé directement – évidemment en défense de ses intérêts nationaux – comme ce fut par exemple le cas en Libye, il y a seulement quelques mois ? Principalement parce les fractions de la bourgeoisie syrienne s’opposant à Bachar Al-Assad le refusent officiellement. Elles ne veulent pas d’une intervention militaire massive étrangère et elles le font savoir. Chacune de ces fractions a très certainement la crainte légitime de perdre dans ce cas-là toute possibilité de diriger elle-même le pouvoir. Mais ce fait ne constitue pas une garantie que la menace de la guerre impérialiste totale, qui est aux portes de la Syrie, ne fasse pas irruption dans ce pays dans la période qui vient. En fait, la clé de la situation réside certainement ailleurs.
On ne peut que se demander pourquoi ce pays attise aujourd’hui autant d’appétits impérialistes de par le monde. La réponse à cette question se trouve à quelques kilomètres de là. Il faut tourner les yeux vers la frontière orientale de la Syrie pour découvrir l’enjeu fondamental de cette empoignade impérialiste et du drame humain qui en découle. Celui-ci a pour nom Iran.
L’Iran au cœur de la tourmente impérialiste mondiale
Le 7 février dernier le New York Times déclarait : “La Syrie c’est déjà le début de la guerre avec l’Iran”. Une guerre qui n’est pas encore déclenchée directement, mais qui est là, tapie dans l’ombre du conflit syrien.
En effet le régime de Bachar Al-Assad est le principal allié régional de Téhéran et la Syrie constitue une zone stratégique essentielle à l’Iran. L’alliance avec ce pays permet en effet à Téhéran de disposer d’une ouverture directe sur l’espace stratégique méditerranéen et israélien, avec des moyens militaires directement au contact de l’État hébreu. Mais cette guerre potentielle, qui avance cachée, trouve ses racines profondes dans l’enjeu vital que représente le Moyen-Orient au moment où se déchaînent de nouveau toutes les tensions guerrières contenues dans ce système pourrissant.
Cette région du monde est un grand carrefour qui se situe à la croisée de l’Orient et de l’Occident. L’Europe et l’Asie s’y rencontrent à Istanbul. La Russie et les pays du Nord regardent par-dessus la Méditerranée le continent africain et les vastes océans. Mais, plus encore, alors que l’économie mondiale a commencé à vaciller sur ses bases, l’or noir devient une arme économique et militaire vitale. Chacun doit tenter de contrôler son écoulement. Sans pétrole n’importe qu’elle usine se retrouve à l’arrêt, tout avion de chasse reste cloué au sol. Cette réalité fait partie intégrante des raisons pour lesquelles tous ces impérialismes s’impliquent dans cette région du monde. Pourtant, toutes ces considérations ne constituent pas les motifs les plus opérants et pernicieux qui poussent cette région dans la guerre.
Depuis maintenant plusieurs années, les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et l’Arabie Saoudite ont été les chefs d’orchestre d’une campagne idéologique anti-iranienne. Cette campagne vient de connaître un violent coup d’accélérateur. En effet, le tout récent rapport de l’Agence Internationale de l’Energie atomique (AIEA) laisse entendre une possible dimension militaire aux ambitions nucléaires de l’Iran. Et un Iran possédant l’arme atomique est insupportable pour bon nombre de pays impérialistes de par le monde. La montée en puissance d’un Iran nucléarisé, s’imposant dans toute la région, est totalement insupportable pour tous ces requins impérialistes, d’autant plus que le conflit israélo-palestinien y maintient une instabilité permanente. L’Iran est totalement encerclé militairement. L’armée américaine est installée à proximité de toutes ses frontières. Quant au Golfe Persique, il regorge d’une telle quantité de bâtiments de guerre de tous ordres que l’on pourrait le traverser sans se mouiller les pieds ! L’État israélien ne cesse de proclamer qu’il ne laissera jamais l’Iran posséder la bombe atomique et, selon ses dires, l’Iran devrait en être doté dans un délai maximum d’un an. L’affirmation proclamée haut et fort à la figure du monde est effrayante car ce bras de fer est très dangereux : l’Iran n’est pas l’Irak, ni même l’Afghanistan. C’est un pays de plus de 70 millions d’habitants avec une armée “respectable”.
Des conséquences catastrophiques majeures
Économiques
Mais l’utilisation de l’arme atomique par l’Iran n’est pas le seul danger, ni le plus important : ces derniers temps, les dirigeants politiques et religieux iraniens ont affirmé qu’ils riposteraient par tous les moyens à leur disposition si leur pays était attaqué. Celui-ci dispose d’un moyen de nuisance dont personne n’est en mesure d’évaluer la portée. En effet, si l’Iran était conduit à empêcher, y compris en coulant ses propres bateaux, toute navigation dans le détroit d’Ormuz, la catastrophe serait mondiale.
Une partie considérable de la production mondiale de pétrole ne pourrait plus parvenir à ses destinataires. L’économie capitaliste en pleine crise de sénilité serait alors automatiquement entraînée dans une tempête de force maximale. Les dégâts seraient incommensurables sur une économie déjà particulièrement malade.
Écologiques
Les conséquences écologiques peuvent être irréversibles. Attaquer des sites atomiques iraniens, qui sont enterrés sous des milliers de tonnes de béton et de mètres cubes de terre, nécessiterait une attaque aérienne tactique aux moyens de frappes atomiques ciblées. C’est ce qu’expliquent les experts militaires de toutes ces puissances impérialistes. Si tel était le cas, que deviendrait l’ensemble de la région du Moyen-Orient ? Quelles seraient les retombées sur les populations et l’écosystème, y compris à l’échelle planétaire ? Tout ceci n’est pas le produit d’une imagination morbide sortie du cerveau d’un Docteur Folamour totalement fou. Ce n’est pas non plus un scénario pour un nouveau film catastrophe. Ce plan d’attaque fait partie intégrante de la stratégie étudiée et mise en place par l’État israélien et, avec plus de recul pour le moment, par les États-Unis. L’État-major de l’armée israélienne étudie, dans ses préparatifs, la possibilité, en cas d’échec d’une attaque aérienne plus classique, de passer à ce stade de destruction. La folie gagne un capital en pleine décadence.
Humanitaires
Depuis le déclenchement des guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye au cours des années précédentes, le chaos le plus total règne dans ces pays. La guerre s’y poursuit interminablement. Les attentats sont quotidiens et meurtriers. Les populations tentent désespérément de survivre au jour le jour. La presse bourgeoise l’affirme : “L’Afghanistan est sujet à une lassitude générale. A la fatigue des Afghans répond la fatigue des occidentaux”. (le Monde du 21-03-2012) Si, pour la presse bourgeoise, tout le monde semble fatigué de la poursuite sans fin de la guerre en Afghanistan, pour la population ce n’est pas de fatigue qu’il s’agit mais d’exaspération et d’abattement. Comment survivre dans une telle situation de guerre et de décomposition permanente ? Et en cas de déclenchement de la guerre en Iran, la catastrophe humaine serait d’une ampleur encore plus considérable. La concentration de la population, les moyens de destruction qui seraient employés laissent entrevoir le pire. Le pire, c’est un Iran à feu et à sang, un Moyen-Orient plongé dans un chaos total. Aucun de ces assassins de masse à la tête des instances dirigeantes civiles et militaires n’est capable de dire où la guerre en Iran s’arrêterait. Que se passerait-il dans les populations arabes de toutes ces régions ? Que feraient les populations chiites ? Cette perspective est tout simplement humainement effroyable.
Des bourgeoisies nationales divisées, des alliances impérialistes au bord d’une crise majeure
Le fait même d’entrevoir seulement une petite partie de ces conséquences effraie les secteurs de la bourgeoisie qui tentent de garder un minimum de lucidité. Le journal koweïtien Al-Jarida vient de laisser filtrer une information, relayant ainsi comme à son habitude les messages que les services secrets israéliens veulent faire connaître publiquement. Son dernier directeur Meir Dagan vient en effet d’affirmer “que la perspective d’une attaque contre l’Iran est la plus stupide idée dont il ait jamais entendu parler.” Tel est l’avis qui semble également exister au sein de l’autre officine des forces secrètes de sécurité externe israélienne : le Shin Bet.
Il est de notoriété publique que toute une partie de l’état-major israélien ne souhaite pas cette guerre. Mais il est également connu qu’une partie de la classe politique israélienne, rassemblée derrière Netanyahou, veut son déclenchement au moment jugé le plus propice pour l’État hébreu. En Israël, pour des raisons de choix de politique impérialiste, la crise politique couve sous les braises d’une guerre possible. En Iran, le chef religieux Ali Khamenei s’affronte également sur cette question avec le président de ce pays, Mahmoud Ahmadinejad. Mais ce qui est le plus spectaculaire, c’est le bras de fer que se livrent les États-Unis et Israël sur cette question. L’administration américaine ne veut pas, pour le moment, d’une guerre ouverte avec l’Iran. Il faut dire que l’expérience américaine en Irak et en Afghanistan n’est guère probante, et que l’administration Obama a préféré jusqu’ici se fier aux sanctions de plus en plus lourdes. La pression des États-Unis sur Israël, pour que cet État patiente, est énorme. Mais l’affaiblissement historique du leadership américain se fait même sentir sur son allié traditionnel au Moyen-Orient. Israël affirme haut et fort que, de toute manière, il ne laissera pas l’Iran posséder l’arme atomique, quel que soit l’avis de ses plus proches alliés. La main de fer de la surpuissance américaine continue à s’affaiblir et même Israël conteste maintenant ouvertement son autorité. Pour certains commentateurs bourgeois, il pourrait s’agir là potentiellement d’une première rupture du lien États-Unis-Israël, jusqu’ici indéfectible.
Le joueur majeur de la région immédiate est la Turquie, avec les forces armées les plus importantes du Moyen-Orient (plus de 600 000 en service actif). Alors que ce pays était autrefois un allié indéfectible des États-Unis et un des rares amis d’Israël, avec la montée du régime Erdogan la fraction plus “islamiste” de la bourgeoisie turque est tentée de jouer sa propre carte d’islamisme “démocratique” et “modéré”. De ce fait, elle essaie de profiter des soulèvements en Égypte et en Tunisie. Et cela explique aussi le revirement de ses relations avec la Syrie. Il fut un temps où Erdogan prenait ses vacances avec Assad mais, à partir du moment où le leader syrien a refusé d’obtempérer aux exigences d’Ankara et de traiter avec l’opposition, l’alliance a été rompue. Les efforts de la Turquie d’exporter son propre “modèle” d’islam “modéré” sont d’ailleurs en opposition directe avec les tentatives de l’Arabie Saoudite d’accroître sa propre influence dans la région en s’appuyant sur le wahhabisme ultra-conservateur.
La possibilité du déclenchement d’une guerre en Syrie, et peut être ensuite en Iran, est à ce point présente que les alliés de ces deux pays que sont la Chine et la Russie réagissent de plus en plus fortement. Pour la Chine, l’Iran est d’une grande importance puisqu’elle lui fournit 11% de ses besoins énergétiques. Depuis sa percée industrielle, la Chine est devenue un nouveau joueur de taille dans la région. Au mois de décembre dernier, elle mettait en garde contre le danger de conflit mondial autour de la Syrie et de l’Iran. Ainsi elle déclarait par la voix du Global Times : “L’Occident souffre de récession économique, mais ses efforts pour renverser des gouvernements non occidentaux en raisons d’intérêts politiques et militaires est à son point culminant. La Chine, tout comme son voisin géant la Russie, doit rester en alerte au plus haut niveau et adopter les contre-mesures qui s’imposent.” Même si une confrontation directe entre les grandes puissances impérialistes du monde n’est pas envisageable dans le contexte mondial actuel, de telles déclarations mettent en évidence le sérieux de la situation.
Le capitalisme marche tout droit vers l’abîme
Le Moyen-Orient est une poudrière et certains sont tout près d’y mettre le feu. Certaines puissances impérialistes envisagent et organisent froidement l’utilisation de certaines catégories d’armes atomiques dans une prochaine guerre éventuelle contre l’Iran.
Des moyens militaires sont déjà prêts et disposés stratégiquement à cet effet. Comme, dans le capitalisme agonisant, le pire est toujours le plus probable, nous ne pouvons pas écarter totalement cette éventualité. Dans tous les cas, la fuite en avant du capitalisme devenu entièrement sénile et obsolète conduit l’irrationalité de ce système toujours plus loin. La guerre impérialiste, portée à un tel niveau, s’apparente à une réelle autodestruction du capitalisme. Que le capitalisme, maintenant condamné par l’histoire, disparaisse n’est pas un problème pour le prolétariat et pour l’humanité. Malheureusement cette destruction du système par lui-même va de pair avec la menace d’une destruction totale de l’humanité. Cette constatation de l’enfoncement du capitalisme dans un processus de destruction de la civilisation ne doit pas nous conduire à l’abattement, au désespoir ou à la passivité. Dans cette même revue, au premier trimestre de cette année, nous écrivions ceci : “La crise économique n’est pas une histoire sans fin. Elle annonce la fin d’un système et la lutte pour un autre monde.” Cette affirmation s’appuie sur l’évolution de la réalité de la lutte de classe internationale. Cette lutte mondiale pour un autre monde vient de commencer. Certes difficilement et à un rythme encore lent, mais elle est maintenant bien présente et en marche vers son développement. C’est cette force à nouveau en mouvement, dont la lutte des Indignés en Espagne au printemps dernier en est, pour le moment, l’expression la plus marquante, qui nous permet d’affirmer qu’existent potentiellement les capacités de faire disparaître toute cette barbarie capitaliste de la surface de notre planète.
Tino (mai 2012)
Géographique:
- Moyen Orient [16]
Rubrique:
Révolution Internationale n°434 - juillet août 2012
- 1492 lectures
Au Canada, la classe ouvrière se confronte au sabotage syndical
- 1946 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction de larges extraits d’un article réalisé par Internationalism US, organe de presse du CCI aux Etats-Unis.
En revenant sur différentes grèves qui ont frappé le Canada ces deux dernières années, ce texte révèle l’ampleur de la colère qui gronde aussi dans ce coin de la planète, là où pourtant, nous dit-on, le capitalisme est “incroyablement dynamique et relativement épargné par la crise grâce aux réformes structurelles déjà réalisées et donc aux sacrifices consentis”.
En Europe, de ces luttes, rien n’a filtré médiatiquement, le black-out a été total. Tout au plus avons nous eu, à partir de la fin mai, des bribes d’informations sur le “printemps d’érable”, ce mouvement de contestation des étudiants vivant au Québec et s’inspirant des Indignés et des Occupy, alors même que les jeunes se battaient déjà depuis plusieurs mois.
Le premier élément frappant à la lecture des lignes rédigées par nos camarades est la similitude des racines profondes de la contestation qui se développe progressivement à travers le monde, de part et d’autres des continents : ce mécontentement grandissant face à la dégradation continue de nos conditions de vie et de travail et ce refus d’un avenir toujours plus sombre.
Le second élément est le sabotage permanent et pernicieux de tous ceux qui sont estampillés officiellement “professionnels de la lutte” : les syndicats.
A partir de l’été 2011, avec des tensions à Air Canada, la grève puis le lock-out dans les postes, le Canada a connu une série d’actions sur les lieux de travail qui ont touché nombre d’industries centrales au niveau national, provincial et local. De plus, bien que le mouvement Occupy ait été beaucoup moins spectaculaire au Canada qu’ailleurs, les étudiants au Québec se sont engagés dans une lutte déterminée et prolongée contre les plans du gouvernement provincial, couvert de dettes, d’augmenter les droits d’inscription à l’université, arrêtant la circulation dans Montréal à plusieurs reprises et contraignant l’appareil répressif de l’État du Québec à montrer les dents une fois de plus.
La grève des postes canadiennes et le lock-out (juin 2011)
Juste un mois après que les conservateurs aient acquis la majorité gouvernementale, des tensions ouvrières éclatent à la Poste sous la forme d’une série de grèves tournantes dans tout le pays. En colère à cause de l’intransigeance de la direction dans les négociations contractuelles, préoccupés pour leur retraite, et par la détérioration de leurs conditions de vie et de sécurité, la combativité grandit chez les postiers, obligeant le Syndicat canadien des ouvriers de la poste (CUPW) à déclencher des grèves tournantes début juin 2011. Les postiers canadiens sont traditionnellement un des secteurs les plus combatifs du pays, obligeant régulièrement les syndicats à suivre une ligne apparemment plus radicale.
Après douze jours de grèves tournantes dans différentes villes du pays, la Poste canadienne riposte en “lock-outant” l’ensemble des 48 000 ouvriers syndiqués à la mi-juin, arrêtant complètement la distribution du courrier dans tout le pays. Incapables d’ignorer cet événement, les medias bourgeois initient à toute vitesse une grande discussion sur “l’obsolescence technologique” de la Poste et les medias plus à gauche sur le besoin de “protéger le service public vital”. Les medias versent des larmes de crocodile sur les citoyens âgés qui ne vont pas pouvoir payer leurs factures à temps, alors qu’ils n’expriment que fort peu de sympathie pour les travailleurs de la poste “surpayés” dont les services ne sont plus aussi essentiels qu’avant pour l’économie nationale. “Pourquoi les contribuables devraient-t-ils payer pour les postiers quand le même travail peut être fait par des compagnies privées pour beaucoup moins ?” est une question qui revient fréquemment dans les débats et sur les forums Internet.
La direction de la Poste canadienne assure que le lock-out est nécessaire parce que les grèves tournantes affectent le volume de courrier et entraînent déjà une perte de 103 millions de dollars. Comment le lock-out et l’arrêt complet de la distribution de courrier sont-ils supposés y remédier ? Mystère. Dès que le lock-out est annoncé, le gouvernement conservateur commence à faire grand bruit d’une loi à soumettre au parlement sur la reprise du travail – la même tactique qu’il avait adoptée en réponse aux grèves simultanées des agents du service clientèle d’Air Canada (voir plus bas). En fait, la direction de la Poste canadienne a en tête l’intervention du gouvernement fédéral quand elle annonce le lock-out. Sa tactique est claire : lock-outer les travailleurs, créer une “crise nationale” et attendre que le gouvernement fédéral intervienne en faveur de la direction et sorte ainsi le pays de l’impasse.
Et c’est finalement exactement ce que fait le gouvernement fédéral, en imposant aux postiers de reprendre le travail dans des conditions moins favorables que celles proposées précédemment par la direction ! Selon le ministre du travail conservateur, Lisa Raitt, la législation est nécessaire pour “protéger le redressement économique du Canada”. Cela déclenche une véritable campagne à gauche contre la loi sur le retour au travail, plusieurs députés NDP tentant de “toutes leurs forces” d’empêcher la loi de passer au parlement en agitant la menace de… l’obstruction parlementaire dans le style américain. Les experts supposés favorables aux postiers pleurent sur la dégradation de la “démocratie canadienne” et sur le fait que la négociation collective est sapée. Selon eux, à partir de maintenant, les employeurs ne seront plus motivés pour négocier de bonne foi, et attendront que le gouvernement se mette finalement de leur côté. Le futur leader du NDP, Thomas Mulcair, fait part de sa réflexion : “c’est le gouvernement lui-même, à travers une corporation de la Couronne, qui a provoqué le lock-out imposé par les employeurs. Le même gouvernement change maintenant d’avis et critique une situation qu’il a créée lui-même” ([1]).
Finalement, le NDP et le CUPW s’avèrent évidemment impuissants à empêcher la promulgation de la loi sur le retour au travail. Quelles qu’aient été leurs démonstrations théâtrales au parlement, ils ne peuvent pas empêcher le gouvernement conservateur de faire ce qu’il veut. Mobilisés derrière les syndicats et le NDP, les postiers n’ont aucune idée de comment résister à ce que le gouvernement leur impose.
Tensions à Air Canada (printemps 2011-printemps 2012)
Au cours de l’année passée, Air Canada est la seconde grande entreprise nationale frappée par des tensions sociales. Alors que les grèves tournantes à la Poste canadienne entrent dans leur seconde semaine à la mi-juin 2011, les agents du service clientèle de la compagnie aérienne nationale entrent en grève, exaspérés par la politique de la compagnie en matière de retraite qui conduirait à passer d’une pension fixe à un taux variable.
La grève des agents du service clientèle est la première d’une série de luttes qui vont frapper Air Canada tout au long de l’année
Afin de “maintenir en vie la compagnie”, les organisations syndicales acceptent les diminutions de salaires, la modification des règles de travail et un certain nombre de licenciements. La lutte des agents du service clientèle est d’autant plus dure que leurs syndicats acceptent une diminution de 10 % du salaire, l’abandon d’une semaine de congés, du paiement des pauses déjeuners et des congés maladie. En vérité, depuis le début des années 2000, les conditions de travail se dégradent de façon constante au sein de cette compagnie. En 2004 et 2005, le syndicat accepte une diminution supplémentaire de 2,5 % des salaires. Bien qu’on note une modeste amélioration de 2006 à 2008, dès 2009 Air Canada menace déjà d’une nouvelle restructuration qui s’accompagne d’un gel des salaires pour 2009 et 2010. Le projet de la compagnie de lancer une nouvelle ligne “low cost” est la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour beaucoup de travailleurs qui voient dans ce projet un moyen de faire chuter leurs salaires.
Le 14 juin 2011, incapables de trouver un accord avec la direction, quelques 3800 agents du service clientèle d’Air Canada arrêtent le travail. En réponse, le gouvernement Harper ne tarde pas à menacer de promulguer une loi sur la reprise du travail. Face à la menace d’une loi sur le retour au travail, la “Canadian Auto Worker’s Union (CAW)”, le syndicat représentant les agents du service clientèle, met rapidement fin à la grève, au bout de trois jours seulement, acceptant un arbitrage exécutoire sur les questions les plus litigieuses.
Cependant, la fin de la grève des agents du service clientèle est loin de ramener la paix sociale à Air Canada. En octobre, les hôtesses de l’air rejettent une tentative d’accord avec la compagnie, pour la seconde fois en trois mois, menaçant de faire une nouvelle grève qui pourrait perturber les vols sur tout le territoire.
Le sentiment en faveur de la grève est fort, obligeant un officiel de la CUPE à concéder que “le rejet de cette seconde tentative d’accord montre à quel point le personnel est mécontent après des années et des années de concessions” ([2]).
Néanmoins, le gouvernement Harper n’est pas enclin à laisser se développer une grève à ce moment là et avertit qu’il va décréter immédiatement la loi sur la reprise du travail. Le ministre du travail Raitt n’attend même pas que le parlement débatte d’une quelconque loi. Il confie l’arbitrage unilatéral du différend au bureau des relations industrielles canadiennes, avec pour conséquence de rendre illégale toute grève des hôtesses de l’air. Tandis que les universitaires déplorent les entraves des conservateurs à la négociation collective – supposée faire partie intégrante du fonctionnement sain d’une “société démocratique” – les responsables du CUPE insistent auprès de leurs membres sur le fait que toute action de grève serait illégale. Dans une note adressée à ses 6800 membres, la CUPE écrit : “notre grève est suspendue pour une durée indéterminée. Donc, le syndicat vous avertit que vous ne pouvez pas faire grève”. Cependant, afin de conserver la confiance des travailleurs, les négociateurs de la CUPE s’en sont pris au gouvernement Harper. Dans une note séparée, ils écrivent : “Appelons un chat un chat. Ce gouvernement n’est pas notre ami. Il essaie de vous enlever le droit de grève. Il utilisera tous les moyens et tous les mensonges à sa disposition” ([3]).
Le cadre est maintenant posé. Les travailleurs déçus par des années de concessions ripostent au gel des négociations contractuelles ou aux tentatives inadaptées d’accord en maintenant une volonté de faire grève ; la direction s’entête, le gouvernement fédéral menace d’intervenir, les syndicats cèdent sur tout, tout en faisant porter la responsabilité au gouvernement des attaques “au droit démocratique à la négociation collective”. L’idée que les travailleurs pourraient faire grève de toute façon – quoique fassent le gouvernement et les syndicats, quelle que soit la légalité de la grève – n’est pas admise par le syndicat, les politiciens de gauche, les universitaires et encore moins par les médias bourgeois.
De plus, ces derniers n’ont jamais toléré l’idée que des travailleurs d’une industrie ou d’un secteur puissent joindre leurs forces à celles de ceux qui subissent les mêmes menaces d’austérité.
Dans le cas des hôtesses de l’air d’Air Canada, cela aurait pu vouloir dire de se joindre aux agents de sécurité qui, pendant qu’elles faisaient grève, avaient déclenché une grève du zèle à l’aéroport Pearson de Toronto, causant des retards importants pendant trois jours au début d’octobre. Personne, au sein de la hiérarchie syndicale, n’aurait-il remarqué la concomitance de ces événements ? Une évidence de plus que le travail des syndicats n’est pas d’étendre la lutte mais d’isoler les travailleurs dans leur propre secteur et dans les barrières du légalisme bourgeois.
Lors de la grève suivante des travailleurs d’Air Canada, les tensions ne peuvent être contenues aussi facilement avec une menace d’intervention gouvernementale. Fin mars 2012, le personnel au sol d’Air Canada déclenche une grève sauvage à l’aéroport Pearson de Toronto. Bien que d’une durée de 12 heures un vendredi matin, la grève sauvage entraîne 84 annulations et le retard de plus de 80 vols. L’agitation gagne rapidement Montréal, Québec, et Vancouver. La grève sauvage des 150 employés au sol à Pearson était une réponse à la décision d’Air Canada de suspendre trois travailleurs qui auraient soi-disant chahuté le ministre Raitt alors qu’elle traversait l’aéroport la veille. L’attachée de presse de Raitt a dit que la ministre avait été suivie dans l’aéroport et “harcelée” par des employés. En réponse à la “grève illégale”, Air Canada licencie 37 employés qui avaient arrêté le travail. Un médiateur indépendant – qui travaillait déjà sur la question du contrat entre Air Canada et ses mécaniciens et pilotes à la demande de Raitt après que le parlement ait adopté la loi interdisant les grèves et lock-out – recommande d’ordonner aux grévistes de reprendre le travail ([4]).
Néanmoins, l’Association internationale des mécaniciens et des travailleurs d’Aerospace (IAMAW) tente de crier victoire en disant qu’ils n’ont accepté d’arrêter le mouvement qu’en recevant l’assurance d’Air Canada que personne ne perdrait son travail et que tous les travailleurs licenciés seraient réintégrés. Le porte parole de l’IAMAW, Bill Trbovich, est cependant obligé d’admettre que son syndicat n’avait pas un contrôle total sur les travailleurs en grève : “nous voudrions que chacun reprenne le travail. Qu’ils veuillent ou non, c’est à voir” ([5]). Pour sa part, Raitt ne manque pas l’occasion de rappeler aux travailleurs qu’ils encourent des amendes allant jusqu’à 1000 dollars par jour pour action illégale.
En réponse à la grève sauvage, les medias déclenchent une véritable attaque, alimentant la colère du public contre Air Canada et ses employés. Les appels à mettre fin aux subventions gouvernementales à Air Canada et faire jouer la concurrence privée envahissent les débats télévisés et les blogs. Il y a une réelle campagne pour s’assurer que le public en ait assez des arrêts de travail sur les lignes nationales. Cependant, la gauche de la bourgeoisie élève aussi la voix, le ministre des affaires intérieures de Terre-Neuve et du Labrador, Gerry Rogers – dont le vol a été retardé sur le tarmac à l’aéroport Pearson – soutient publiquement les travailleurs. Il dit : “nous ne pouvons pas continuer à avoir un gouvernement qui intervienne de cette façon et casse les syndicats. Cela concerne les droits des travailleurs et je soutiens entièrement leur action. Si je dois attendre dans cet aéroport pendant 10 heures pour avoir mes bagages, qu’il en soit ainsi” ([6]).
Un sentiment commence à clairement émerger dans quelques fractions de la classe dominante canadienne : le gouvernement fédéral va peut être trop loin et trop souvent, avec le risque de provoquer une réponse ouvrière que les syndicats ne seront plus capables de contrôler. Bien que n’ayant duré que quelques heures, la grève sauvage des personnels au sol d’Air Canada est une claire expression du développement de la combativité et de la volonté de résister, et de l’émergence d’un sentiment croissant d’éloignement des structures mises en place pour contrôler la lutte de classe.
L’exemple du personnel au sol d’Air Canada est rapidement suivi par les pilotes qui déclenchent ce que les média appellent une “grève illégale” mi-avril. Les négociations autour de leur contrat avec la compagnie étaient déjà soumises à la décision parlementaire d’arbitrage exécutoire, qui empêchait grève et lock-out, mais les pilotes décident d’un vendredi “de congé de maladie” qui conduit à annuler quelques 75 vols dans le pays, entraînant des retards pendant tout le week-end. Air Canada obtient rapidement que l’arbitrage adopte une décision qui oblige les pilotes à reprendre le travail, mais le sentiment, chez les pilotes, de s’être vraiment fait avoir à failli les amener à la confrontation avec leurs syndicats. Le président Paul Strachan de l’Association des Pilotes d’Air Canada (ACPA) est obligé d’admettre que la colère grandit chez ses membres quand il fait la déclaration suivante : “nous avons tous besoin d’être réellement conscients du risque que les pilotes, à un certain moment, se sentent si attaqués et sans aide, se déchaînent et que cette organisation ne puisse même plus contrôler le déroulement des événements” ([7]).
Le mieux que puisse faire l’ACPA est d’assurer à ses membres qu’elle combat la loi qui implique l’arbitrage des tribunaux, mais tant que c’est en cours, comme cela prend beaucoup de temps par les canaux légaux, aucune grève n’est possible. Dans un mémo adressé à ses membres, l’ACPA dit : “c’est notre devoir d’avertir tous les pilotes que le droit de grève de l’ACPA et le droit d’Air Canada de lock-outer ses employés sont suspendus jusqu’à ce qu’à ce qu’un nouvel accord prenne effet (…). Jusqu’à ce que la loi soit annulée, nous devons tous faire avec çà”. Le légalisme bourgeois triomphe encore ! Selon le syndicat, il ne peut y avoir de grève sans la permission de l’État !
Le gouvernement Harper a eu la main lourde avec la classe ouvrière, mais les syndicats ont été de toute évidence ceux qui ont renforcé la loi anti-grève.
Au cours de l’année dernière, Air Canada a été une référence pour les conflits du travail dans tout le pays ([8]). Pour la plupart, ceux-ci sont restés dans le giron syndical, car les travailleurs ont succombé à la pression de leurs syndicats pour qu’ils respectent les différentes lois anti-grèves adoptées par le parlement.
Henk, 23 mai
[1]) City-TV “Ottawa tables bill to end Canada Post lock-out”, http ://www.citytv.com.toronto/citynews/news/article/138095-ottawa-tables-bill-t... [74]
[2]) Brent Jang, “Air Canada strike called off after Ottawa intervenes”,
http ://www.theglobeans [75] mail.com/globe-investor/air-canada-strike-called-off_after-ottawa-intervenes/article298544
[3]) Idem.
[4]) CBC, Air Canada strike effects felt into weekend: Pearson ground crews in Toronto held wildcat strike that disrupted thousands” at http ://www.cbc.ca/news/canada/story/2012/03/23/air-canada-wildcat.html [76]
[5]) National Post Staff, “Air Canada ground crew sent back to work after wildcat strike causes flight chaos.” at http ://www.google.com/search [77] ?q=Air+Canada+crews+sent+back+to+work&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla :en-US :unofficial&client=firefox-a
[6]) CBC, op.cit.
[7]) Thomson-Reuters, “Update 5-Air Canada back to normal Sat. after pilots strike.“ http ://www.reuters.com/article/2012/04/14/aircanada-pilots-idUSL2E8FD36K20120414 [78]
[8]) Naturellement, une occasion importante de lier les luttes à Air Canada avec celles d’American Airlines a été manquée. Ces dernières faisaient face à de lourdes diminutions de salaires et à des licenciements à cause de la banqueroute de la compagnie. La difficulté d’unir les luttes des ouvriers de ces deux compagnies aériennes est encore plus grande du fait du black-out aux États-Unis sur tout ce qui se passe au Canada.
Géographique:
- Canada [66]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [15]
Rubrique:
Le capitalisme est mondial, sa crise aussi
- 1320 lectures
En 1967 prennent fin les “30 glorieuses”, cette ère brève de relative prospérité économique qui a fait suite à l’effroyable succession “Première Guerre mondiale-Grande dépression-Seconde Guerre mondiale”. Cette année 1967 voit en effet revenir le spectre de la crise économique. Au premier semestre, l’Europe rentre en récession, au second éclate une crise monétaire internationale. Depuis, le chômage, la précarité, la dégradation des conditions de vie et de travail sont devenus le lot quotidien des exploités. Il suffit ainsi de survoler les grands événements du xxe siècle, qui fut l’un des plus catastrophiques et barbares de l’histoire de l’humanité, pour comprendre que le capitalisme est devenu, comme l’esclavagisme ou le féodalisme avant lui, un système décadent et obsolète.
Mais cette crise historique du capitalisme a été en partie masquée, ensevelie sous un tombereau de propagandes et de mensonges. A chaque décennie, la même grosse ficelle est tirée : un pays, une partie de la planète ou un secteur économique qui s’en sort un peu mieux que les autres, est mis en exergue pour faussement démontrer que la crise n’est pas une fatalité, qu’il suffit de mener les bonnes “réformes structurelles” pour que le capitalisme soit dynamique et apporte croissance et bonheur. Dans les années 1980-1990, l’Argentine et les “Tigres asiatiques” sont ainsi brandis comme des modèles de réussite, puis c’est au tour de l’Irlande et de l’Espagne à partir de 2000… Invariablement, évidemment, ces “miracles” se révèlent des “mirages” : en 1997 les “Tigres asiatiques” s’avèrent être de papiers ; à la fin des années 1990, l’Argentine est déclarée en faillite ; aujourd’hui, l’Irlande et l’Espagne sont au bord du gouffre… Chaque fois, “l’incroyable croissance” a été financée à coup de crédits et chaque fois le poids de la dette a fini par emporter de par le fond ces espoirs artificiels. Mais, faisant mine d’avoir la mémoire courte, les mêmes bonimenteurs font entendre à nouveaux leurs voix. A les croire, l’Europe serait malade pour des raisons particulières qui lui seraient propres : difficultés à mener des réformes et à mutualiser les dettes de ses membres, manque d’unité et de solidarité entre les pays, banque centrale qui ne peut pas relancer l’économie faute de pouvoir faire tourner une planche à billets à sa guise. Seulement, cet argument a du plomb dans l’aile, et pas du petit calibre qui picote les fesses, non, du gros qui éparpille et qui disloque ! La crise frappe l’Europe par manque de réforme et de compétitivité, il faut s’inspirer de l’Asie ? Patatras, ces pays sont également touchés. La relance n’est pas suffisamment prise en main par la Banque centrale européenne et sa planche à billets ? Patatras, les États-Unis et sa banque centrale, championne toutes catégories de création monétaire depuis 2007, sont eux aussi mal en point.
Grande découverte : … les BRICs ne flottent pas
L’acronyme “BRICs” désigne les quatre pays dont les économies ont été les plus florissantes ces dernières années : le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. Mais tel l’Eldorado, cette bonne santé relève plus du mythe que de la réalité. Tous ces “booms” sont en effet financés essentiellement par la dette et finiront comme leurs prédécesseurs, en plongeant dans les affres de la récession. D’ailleurs dès aujourd’hui ce vent mauvais commence à se faire ressentir.
Au Brésil, les crédits à la consommation ont explosé ces dix dernières années. Or, comme aux États-Unis, lors des années 2000, les “ménages” ont de moins en moins les moyens de faire face aux échéances de remboursement. Le taux de “défaut des consommateurs” bat donc tous les records ces derniers temps. Pire, la bulle immobilière ressemble comme deux gouttes d’eau à la bulle espagnole d’avant qu’elle n’explose : de grands ensembles de buildings nouvellement construits demeurant désespérément vides.
En Russie, l’inflation est en passe de devenir incontrôlable : 6 % officiellement, 7,5 % pour les instances indépendantes. Et les prix des fruits et des légumes se sont littéralement envolés en juin-juillet, avec une hausse de près de 40 % !
En Inde, le déficit budgétaire se creuse dangereusement (5,8 % du PIB attendu pour 2012), le secteur industriel est en récession (– 0,3% au premier trimestre de cette année), la consommation ralentit fortement, l’inflation est très forte (7,2 % au mois d’avril, en octobre dernier l’envolée des prix alimentaires avait même frôlé les 10 %). L’Inde est aujourd’hui considérée comme un pays à risque par le monde financier : elle est notée BBB- (la note la plus basse de la catégorie “qualité moyenne inférieure”). Elle est menacée d’être prochainement classée aux côtés des pays où il est formellement déconseillé d’investir.
En Chine, l’économie ne cesse de ralentir et les dangers de s’accumuler. L’activité manufacturière s’est contractée en juin pour le huitième mois consécutif. Le prix des appartements s’est effondré et l’activité des secteurs liés à la construction est en chute libre. Un seul exemple très significatif : la ville de Pékin a, à elle seule, 50 % de logements vacants de plus que l’ensemble des États-Unis (3,8 millions de foyers disponibles à Pékin contre 2,5 millions sur les terres américaines). Mais le plus menaçant est sans aucun doute l’état budgétaire des provinces. Car si l’État ne croule pas officiellement sous les dettes, c’est seulement le fait du truchement d’écriture qui fait peser tous les déficits à l’échelle locale. Nombreuses sont ainsi les provinces au bord de la faillite.
Les investisseurs sont tout à fait conscients de la mauvaise santé des BRICs ; c’est pour cette raison qu’ils fuient comme la peste ces quatre monnaies nationales – real, rouble, roupie et yuan – qui plongent de façon continue depuis des mois.
Aux États-Unis, les étudiants bullent… et ça se voit !
La ville de Stockton en Californie a déposé le bilan mardi 26 juin tout comme, avant elle, Jefferson County en Alabama et Harrisburg en Pennsylvanie. Pourtant depuis trois ans, les 300 000 habitants de cette ville ont subit tous les “sacrifices nécessaires à la relance” : réductions budgétaires de 90 millions de dollars, licenciements de 30 % des pompiers et de 40 % des autres employés municipaux, coupe de 11,2 millions de dollars dans les salaires des employés municipaux, réduction drastique du financement des pensions de retraite.
Cet exemple très concret révèle l’état de déliquescence réelle de l’économie américaine. Les ménages, les entreprises, les banques, les villes, les États et le gouvernement fédéral. Tous les secteurs sont littéralement ensevelis sous des monceaux de dettes qui ne seront jamais honorées. Dans ce contexte, la prochaine négociation entre républicains et démocrates lors du relèvement du plafond de la dette à l’automne risque fortement de tourner au psychodrame comme pendant l’été 2011. Il faut dire que la bourgeoisie américaine fait face à un problème insoluble : pour relancer l’économie, elle doit engendrer toujours plus de dettes ; pour ne pas faire faillite, elle doit réduire l’endettement.
Chaque pan endetté de l’économie est une bombe en puissance : ici une banque proche du dépôt de bilan, là une ville ou une entreprise en quasi-faillite… et si une mine explose, attention à la réaction en chaîne.
Aujourd’hui, c’est la “bulle des prêts étudiants” qui inquiète le monde de la finance. Les études coûtent de plus en plus chers et les jeunes trouvent de moins en moins de travail en sortant des bancs de l’université. Autrement dit, les prêts aux étudiants sont de plus en plus importants et les risques de défaut de remboursement de plus en plus probables. Pour être précis :
– au bout de leur cursus universitaire, les étudiants américains sont endettés à hauteur de 25 000 dollars en moyenne ;
– l’encours de leurs prêts dépasse celui de l’ensemble des crédits à la consommation du pays, soit 904 milliards de dollars (il a quasiment doublé au cours des cinq dernières années) ce qui correspond à 6 % du PIB ;
– le taux de chômage des universitaires diplômés de moins de 25 ans est de plus de 9 % ;
– 14 % des étudiants diplômés qui avaient contracté un prêt font défaut trois ans après leurs sortie de l’université.
Cet exemple est très significatif de ce qu’est devenu le capitalisme : un système malade qui ne peut qu’hypothéquer (au sens propre comme au figuré) son avenir. Pour vivre les jeunes doivent aujourd’hui s’endetter et “investir” le salaire que demain… ils n’auront pas. Ce n’est pas un hasard si dans les Balkans, en Angleterre ou au Québec, ces deux dernières années, la nouvelle génération a fortement réagi aux hausses des coûts d’inscription aux universités par de grands mouvements de contestation : crouler sous les dettes à 20 ans en se devinant au chômage ou sous-payés dans quelques années, voilà le parfait symbole du “no future” qu’offre le capitalisme.
Les États-Unis sont, comme l’Europe, comme tous les pays du monde, malades ; et il n’y aura aucune rémission réelle et durable sous le capitalisme car ce système d’exploitation est la source de l’infection.
A la fin de cet article, peut être reste-t-il quelques lecteurs qui veulent tout de même espérer et croire qu’un “miracle économique” est toujours possible ? Si vous êtes de ceux-là… sachez que même le budget du Vatican est dans le rouge.
Pawel, 6 juillet
Récent et en cours:
- Crise économique [13]
Rubrique:
La solidarité humaine et le gène égoïste (article de l'anthropologue Chris Knight)
- 3007 lectures
Nous publions ci-dessous un texte de l’anthropologue Chris Knight, “La solidarité humaine et le gène égoïste” [1]. Ce texte scientifique s’appuie sur la théorie néodarwinienne du gène égoïste [2], dont il résume les bases, pour battre en brèche les allégations selon lesquelles l’Homme serait par essence “un loup pour l’Homme” ; de ce fait, il constitue une précieuse contribution combattant l’idée que le communisme serait incompatible avec la nature humaine, et arrivant à la conclusion que la solidarité serait, au contraire, inhérente à notre nature.
En 1844, suite à un voyage de quatre années autour du monde, Charles Darwin confia à un ami proche qu’il était parvenu à une conclusion dangereuse. Pendant sept ans, écrivit-il, il s’était “engagé dans un travail très présomptueux”, voire “très stupide”. Il avait remarqué que, sur chacune des Îles Galapagos, les pinsons locaux mangeaient une nourriture légèrement différente, et avaient des becs présentant des modifications correspondantes. En Amérique du Sud, il avait examiné un grand nombre de fossiles extraordinaires d’animaux éteints. Réfléchissant à la signification de tout ceci,il s’était senti obligé de changer d’avis sur l’origine des espèces. À son ami, Darwin écrivit : “Je suis presque convaincu (d’une manière assez opposée à mon opinion de départ) que les espèces ne sont pas (c’est comme confesser un meurtre) immuables.”
En ces temps là, la conviction de la transmutation – l’idée que les espèces pouvaient évoluer en d’autres – était politiquement dangereuse. Au moment même où Darwin écrivait à son ami, des athées et des révolutionnaires diffusaient des journaux à bas prix dans les rues de Londres, se faisant les champions des idées évolutionnistes en opposition aux doctrines établies de l’Église et de l’État. À cette époque, le théoricien évolutionniste le plus connu était Jean-Baptiste Lamarck, qui était responsable des expositions des insectes et des vers au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Étroitement assimilé à l’athéisme, au chartisme et à d’autres formes de subversion tenues comme émanant de la France révolutionnaire, l’évolutionnisme en Grande-Bretagne était désigné sous le terme de “lamarckisme”. Tout “lamarckien” – en d’autres termes, tout scientifique qui mettait en question l’immuabilité d’origine divine des espèces – risquait d’être assimilé aux communistes, émeutiers et insurgés. Pris entre ses prudentes opinions politiques libérales et sa science, Darwin était si anxieux qu’il se rendit malade, dissimulant et étouffant ses conclusions comme s’il avait secrètement commis un meurtre.
La période de soulèvements révolutionnaires culmina avec les événements de 1848, quand les ouvriers organisèrent des insurrections et descendirent dans les rues en Grande-Bretagne et à travers l’Europe. Avec la défaite de ces soulèvements, la contre-révolution s’installa. Durant la décennie suivante, la menace provenant de la gauche s’éloigna. En 1858, un autre scientifique – Alfred Wallace – trouva indépendamment le principe d’évolution par sélection naturelle ; si Darwin ne publiait pas, Wallace gagnerait toute la gloire scientifique. Sans danger immédiat de révolution, le courage de Darwin crût et en 1859 il publia enfin l’Origine des espèces.
Dans son remarquable ouvrage, Darwin exposa les grandes lignes d’un concept d’évolution assez différent de celui de Lamarck. Lamarck avait expliqué l’évolution comme la conséquence des efforts constants de tous les animaux pour l’auto-amélioration durant leur existence. L’idée plus sinistre et plus cruelle de Darwin était empruntée au Révérend Thomas Malthus, un économiste employé par la Compagnie des Indes orientales. Malthus ne s’intéressait pas à l’origine des espèces ; son idée était politique. Les populations humaines, affirmait-il, croîtront toujours plus vite que l’offre de nourriture. Lutte et famine en résultent inévitablement. La charité publique, dit Malthus, ne peut qu’aggraver le problème : les aides font que les pauvres se sentent à l’aise, ce qui les encourage à se reproduire. Plus de bouches à nourrir conduit à une plus grande pauvreté et donc à davantage encore de demandes – insatiables – d’aide sociale. La meilleure politique est de laisser les pauvres mourir.
Le génie de Darwin fut de lier la botanique et la géologie à ce plaidoyer, politiquement motivé, en faveur de la libre compétition et de la “lutte pour la survie”. Darwin vit la moralité “laissez-faire” de Malthus à l’œuvre partout dans la nature. La croissance de population dans le monde animal devançait toujours l’offre locale de nourriture ; d’où l’inéluctabilité de la compétition se soldant par la famine et la mort pour les plus faibles. Alors que moralistes et sentimentalistes auraient cherché à adoucir cette image d’une Nature cruelle et sans cœur, Darwin suivit Malthus en la célébrant. Tout comme le capitalisme punissait brutalement pauvres et nécessiteux, la “sélection naturelle” éliminait aussi ces créatures moins à même de se débrouiller. Puisque les moins aptes de chaque génération ne cessaient de mourir, la progéniture des survivants était donc disproportionnellement plus nombreuse, transmettant à toutes les futures générations leurs bénéfiques caractéristiques héréditaires. Famine et mort, par conséquent, étaient des facteurs positifs, dans une dynamique évolutive qui punissait inexorablement l’échec tout en récompensant le succès.
De cette manière, Darwin parvint à transformer les implications politiques de la théorie évolutionniste. Loin de servir à justifier la résistance à l’exploitation capitaliste ou à l’inégalité sociale, cette version malthusienne de l’évolutionnisme était faite pour servir une fonction politique inverse. Darwin décrivit la nature comme un monde sans morale. Par conséquent, ceci donnait une certaine justification à un système économique basé sur une compétition effrénée, libre de toute ingérence “morale” fourvoyée venant de la religion ou de l’État. Du vivant de Darwin, les controverses publiques majeures autour de sa théorie opposèrent les évolutionnistes contre ces philosophes, ecclésiastiques et autres qui craignaient qu’une telle vision puisse mener à l’effondrement de toute morale dans la société.
Après la mort de Darwin en 1881, beaucoup de penseurs influents tentèrent d’émousser la force du raisonnement apparemment dur et amoral de Darwin, cherchant des façons de réconcilier la théorie évolutionniste avec les valeurs religieuses ou humanistes. En Russie, le penseur anarchiste Pierre Kropotkine écrivit l’Entraide, où il affirma que la coopération, non la compétition, était la loi fondamentale de la nature. Une façon très courante de sauver une dimension “morale” du raisonnement de Darwin était de suggérer que le moteur compétitif du changement évolutif opposait des groupes entre eux, et non des individus entre eux. L’expression “survie du plus apte” – comme on disait alors – signifiait la survie du plus apte des groupes ou de la plus apte des espèces, l’un et l’autre considérés dans leur totalité, impliquant une étroite coopération au sein de chaque espèce. Selon ce raisonnement, les individus étaient créés pour favoriser les intérêts de l’espèce. Les membres de n’importe quelle espèce devaient coopérer les uns avec les autres, leur survie individuelle dépendant du sort du plus grand ensemble.
Cette idée devint prisée car elle était tout à fait en accord avec des tendances de la philosophie morale, incluant la tendance “classe moyenne” du socialisme et du nationalisme, au tournant du siècle. Les nations étaient associées aux “races” et comparées aux espèces animales. Chaque espèce, race ou nation était supposée être engagée dans une compétitive lutte à mort contre ses rivales. Ceux dont les membres coopéraient par besoin collectif survivaient ; ceux dont les membres agissaient “égoïstement” finissaient par s’éteindre. Quand des animaux ou des humains affichaient un comportement coopératif, ceci était expliqué en termes “moraux” en référence aux besoins du groupe.
En Grande-Bretagne, Winston Churchill affirma que les plus pauvres éléments de la société ne devraient pas être autorisés à se reproduire, puisqu’ils ne pouvaient qu’affaiblir le “cheptel national” en le faisant. L’eugénisme devint largement prisé, y compris chez un grand nombre de personnes de gauche ; en Allemagne, il joua un rôle clé dans la formation de l’idéologie nazie. Dans les années 1940, l’éthologue pionnier Konrad Lorenz ravit les propagandistes nazis quand il affirma que la guerre était naturelle et précieuse. Il la comparait à un modèle général dans lequel les mammifères mâles, durant la saison des amours, s’engageaient dans un féroce combat mutuel, les femelles ne s’accouplant qu’avec les vainqueurs. Ceci, affirma Lorenz, est un sain mécanisme d’élimination des faibles qui, par conséquent, préserve et améliore la pureté et la vigueur de la race.
La théorie évolutionniste de la “sélection de groupe” – comme elle est appelée actuellement – reçut sa formulation la plus sophistiquée et explicite en 1962, quand le naturaliste écossais V. C. Wynne-Edwards publia un livre intitulé Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour. Pour Wynne-Edwards, suivant en cela Malthus, le problème fondamental rencontré par chaque groupe ou espèce était celui de la reproduction effrénée. La surpopulation menait finalement à des pénuries, provoquant la famine à une échelle qui pourrait menacer la population locale entière. Quelle était la solution ? Selon Wynne-Edwards, c’était l’espèce dans son ensemble qui devait agir. Des mécanismes spéciaux devaient avoir évolué afin d’éviter la reproduction au delà de la capacité de charge de son environnement. On s’attendait à ce que les individus réfrènent leur fécondité dans l’intérêt du groupe.
Sur la base de cette théorie, Wynne-Edwards chercha à expliquer nombre de curieuses caractéristiques de la vie sociale animale et humaine. En particulier, il prétendit expliquer des comportements apparemment répugnants comme le cannibalisme, l’infanticide et le combat ou la guerre entre groupes. En apparence négatives, à un niveau plus large de telles pratiques constitueraient une série d’adaptations bénéfiques par lesquelles chaque espèce s’efforcerait de limiter sa population. Beaucoup de naturalistes avaient été perplexes en observant des cas d’oiseaux en grandes colonies détruire leur progéniture réciproque, ou de lions mordant mortellement des lionceaux à leur naissance. Tout ceci, dit Wynne-Edwards, pouvait maintenant être compris. Ceux présentant un tel comportement n’agissaient pas de façon égoïste ou antisociale ; ils avantageaient l’espèce en contenant la population. Chez l’humain, les activités violentes telles que la guerre avaient une fonction similaire. D’une manière ou d’une autre, les niveaux de populations humaines devaient être limités ; la guerre, accompagnée d’autres formes de violence, aidaient à y parvenir.
Ce genre de pensée “sélectionniste de groupe” resta influent au sein du darwinisme jusqu’aux années 1960. Mais précisément, en le formulant en des termes aussi véhéments et explicites, Wynne-Edwards exposa involontairement le raisonnement de l’”avantage pour l’espèce” à une attaque plus finement ciblée, sapant l’ensemble de l’édifice théorique. Dès que les scientifiques commencèrent à réfléchir aux prétendus “mécanismes de réduction de population”, les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas fonctionner devinrent claires sur un plan purement théorique. Comment une espèce entière pouvait-elle mobiliser ses membres pour une action collective, comme si elle réagissait en prévision de futures pénuries de nourriture ? Supposons, à titre d’exemple, l’existence d’un gène qui susciterait ou faciliterait un comportement présentant les deux caractéristiques suivantes : (a) il bénéficierait à l’espèce à une date ultérieure, et en même temps (b) il entraverait maintenant le succès reproductif de son possesseur. Comment un tel gène pourrait-il bien être transmis au futur, où ses bénéfices supposés se réaliseraient ? Parler d’un gène de moindre succès reproducteur est simplement une contradiction. Celui-ci ne serait pas transmis. Ses futurs bénéfices supposés ne pourraient jamais se réaliser. La théorie de la “sélection de groupe” dans sa totalité était simplement illogique.
Cette compréhension inaugura une révolution scientifique – un des plus monumentaux bouleversements de l’histoire scientifique récente, avec un grand nombre d’implications pour les sciences humaines et sociales. Si Marx et Engels étaient vivants aujourd’hui, ils se placeraient eux-mêmes à la tête de tels développements. Quasiment tous les scientifiques évolutionnistes sont aujourd’hui d’accord que la théorie de la “sélection de groupe” de Wynne-Edwards était erronée. L’idée que le sexe, la violence ou toute autre forme de comportement animal peut évoluer “pour le bien de l’espèce” est maintenant complètement discréditée. Les animaux ne pratiquent pas le sexe “pour perpétuer l’espèce” ; ils le font pour une raison plus terre-à-terre – pour perpétuer leurs propres gènes particuliers. Aucun gène ne peut être conçu pour minimiser sa propre auto-réplication – dans un monde compétitif, il serait rapidement éliminé et remplacé. Supposons qu’un lion tue ses propres lionceaux afin d’aider à réduire le niveau de population totale. Par rapport aux autres lions, cet individu particulier aurait un faible succès reproducteur. Indépendamment de ce qui arriverait finalement au groupe entier, tous les individus de n’importe quelle population future seraient exclusivement les descendants des reproducteurs les plus “égoïstes” – ces lions programmés pour maximiser la transmission de leurs gènes (aux dépens des gènes rivaux) aux générations futures.
Une fois ceci compris, les scientifiques furent capables de montrer que les lions qui tuaient des petits lionceaux ne tuaient effectivement pas leur propre progéniture, mais celles engendrées par des mâles rivaux. La même chose s’appliquait aux autres cas de soi-disant “régulation de population”. Dans tous les cas, il pouvait être montré que les animaux responsables agissaient “égoïstement” d’un point de vue génétique, leurs gènes œuvrant à transmettre autant de copies d’eux-mêmes que possible aux générations futures, sans trop se soucier de quelconques conséquences sur le niveau de population à long terme. La “valeur sélective” signifiait la capacité à faire entrer ses gènes dans le futur ; elle ne pouvait être définie autrement. Une conséquence était que les idées eugénistes telles que celles de Winston Churchill n’avaient aucune signification darwinienne. Churchill estimait que les pauvres se reproduisaient trop rapidement ; étant “moins aptes”, leur fertilité devrait être refrénée. À titre d’exemple, supposons que les pauvres à l’époque de Churchill se reproduisaient effectivement beaucoup plus que les riches. Selon les standards darwiniens modernes, ceci aurait rendu les pauvres plus “aptes”, pas moins. Même chose lorsque des minorités ethniques se reproduisent à un rythme plus élevé que celles les entourant. La “valeur sélective”, comme ce terme est compris par les darwiniens modernes, peut être mesurée en se référant uniquement aux gènes – pas aux races ou aux espèces. À l’avenir, par conséquent, les politiciens réactionnaires, racistes ou autres, devront répandre leurs théories sans l’aide du darwinisme.
Le nouveau darwinisme rendit désormais impossible l’élévation de l’intérêt personnel d’un individu au niveau de celui de l’espèce. Les penseurs “sélectionnistes de groupe” avaient obstinément enveloppé de “morale” l’infanticide, la violence ou l’agression, eu égard aux intérêts supérieurs “de la nation” ou “du groupe”. Les militaristes et les génocidaires avaient été reconceptualisés comme les gardiens d’intérêts supérieurs, abattant la population excédentaire ou éliminant les faibles pour le plus grand bien. Le darwinisme “gène égoïste” mit brusquement fin à tout ceci. Les groupes ou espèces animales ne pouvaient désormais plus être comparés aux États-nations, décrits comme des ensembles cohésifs et moralement régulés. Au lieu de cela, on s’attendait à ce que les animaux cherchent à optimiser leur valeur sélective, œuvrant consciemment ou inconsciemment à propager leurs gènes. En conséquence, on s’attendait aussi à ce que les unités sociales n’affichent pas seulement la coopération mais aussi le conflit, opposant de façon récurrente les femelles et les mâles, les jeunes et les vieux, et même les enfants et leurs propres parents. Cette insistance sur la lutte et le conflit fit converger le darwinisme et le marxisme, qui n’admet pas l’harmonie ou la fraternité mais voit à la place un monde social humain déchiré par des conflits de classes, de sexes et d’autres formes. Là où l’harmonie existe ou est établie avec succès, ceci doit être expliqué, non admis.
Une fois le “sélectionnisme de groupe” renversé, les scientifiques furent contraints d’observer à nouveau la vie, abordant, clarifiant et souvent résolvant une batterie d’énigmes scientifiques en chemin. Comment la vie apparut-elle sur Terre ? Quand et pourquoi le sexe évolua-t-il ? Comment les insectes sociaux devinrent-ils si coopératifs ? Pourquoi, comme tous les organismes vivants, tombons-nous malades et finalement mourrons-nous ? Dès lors, chaque théorie devait démontrer sa cohérence avec l’implacable “égoïsme” sans complaisance des gènes. Le résultat fut une spectaculaire série de percées intellectuelles, représentant une véritable révolution, toujours en cours, dans les sciences de la vie. Le livre de Richard Dawkins, le Gène égoïste, résumait nombre de ces nouvelles découvertes quand il fut publié sous les acclamations générales – et les dénonciations d’une véhémence équivalente de la “gauche classe moyenne” – en 1976.
Tout comme Karl Marx et Friedrich Engels s’opposaient aux théories “utopiques” du socialisme, les darwiniens modernes s’opposent vigoureusement à toutes les théories évolutionnistes larmoyantes et irréalistes. Le socialisme “utopique” échoua car il ne se confronta jamais au capitalisme. Il n’expliqua jamais comment passer de “A” à “B” – de la logique compétitive du capitalisme à son antithèse socialiste ou communiste. Au lieu de cela, les rêveurs “utopiques” ne firent qu’opposer leurs visions idéalistes aux dures réalités de la vie contemporaine, sans jamais se soucier de comprendre le fonctionnement du capitalisme lui-même. D’une façon comparable, avant la révolution “gène égoïste” dans les sciences de la vie, les biologistes avaient fait appel à la “coopération” dans le monde animal en tant que principe explicatif sans avoir jamais expliqué d’où venait ce principe lui-même. Le grand mérite du nouveau darwinisme était de ne pas être “utopique”. Quand on constatait que des animaux s’entraidaient ou même risquaient leur vie l’un pour l’autre – comme cela arrive souvent – un tel altruisme devait être expliqué plutôt que seulement admis. Par dessus tout, tout altruisme au niveau du comportement social devait être concilié avec l’”égoïsme” réplicatif des gènes de ces animaux.
De ce point de vue, le nouveau darwinisme pourrait presque être appelé la “science de la solidarité”. L’égoïsme est facile à expliquer. Le vrai défi est d’expliquer pourquoi les animaux, si souvent, ne sont pas égoïstes. C’est un défi particulier dans le cas des humains, qui – peut-être plus que n’importe quel autre animal – peuvent se lancer dans des actes de courage et de sacrifice de soi pour le bénéfice des autres. Il existe des histoires, à l’authenticité bien établie, sur la façon dont des soldats durant la Première Guerre mondiale se jetaient sur une grenade en train d’exploser, sauvant par là-même leurs camarades. Un tel courage devait-il être laborieusement appris ou inculqué aux humains, ou était-il fait appel à de puissants instincts ? Si, en suivant la plupart des darwiniens, nous supposons que les gens ont en eux-mêmes la capacité d’être naturellement coopératifs et même héroïques, alors se dresse un paradoxe intellectuel. Pourquoi les gènes permettant ou rendant possible l’héroïsme – ces courageux instincts qui, en temps de crise, peuvent outrepasser nos pulsions plus lâches et égoïstes – ne sont-ils pas éliminés au cours du temps évolutif ? L’homme qui meurt au combat n’aura plus d’enfants. Par contraste, le lâche peut laisser de nombreux descendants. Sur cette base, ne devrions-nous pas nous attendre à ce que chaque génération soit moins héroïque – plus égoïste – que la précédente ?
La théorie utopique de la “sélection de groupe” avait obscurci ce problème en proposant une réponse bien trop facile. L’héroïsme œuvrait pour le bien du groupe. Le problème était que ceci échouait à expliquer comment un tel courage pouvait faire partie de la nature humaine, transmis de génération en génération. C’est précisément cette difficulté qui poussa les nouveaux darwiniens à proposer une meilleure réponse. Quand la solution fut trouvée, elle devint la pierre angulaire de la science évolutionniste.
La solution à l’énigme résidait dans l’idée de “valeur sélective inclusive”. La bravoure au combat repose sur des instincts non radicalement différents de ceux motivant une mère à prendre des risques en défendant ses enfants. C’est précisément parce que ses gènes sont “égoïstes” – et non malgré cet “égoïsme” – que le courage d’une mère peut faire appel à de profondes ressources instinctives. En effet, la mère qui prend instinctivement des risques pour ses enfants inclut ces enfants comme partie de son “soi” potentiellement immortel. En termes génétiques, ceci est réaliste car ses enfants partagent ses gènes. Nous pouvons voir aisément pourquoi les gènes “égoïstes” d’une mère peuvent la pousser à se comporter de façon désintéressée – c’est clairement dans le propre intérêt des gènes. Une logique comparable pourrait pousser frères et sœurs à se comporter de façon désintéressée les uns envers les autres.
Loin dans le passé évolutif, les humains évoluaient en groupes de relativement petite échelle basés sur la parenté. Toute personne avec qui tu travaillais, ou avec qui tu t’étais étroitement lié, avait une bonne chance statistique de partager tes gènes. De fait, les gènes auraient dit : “Réplique-nous en prenant des risques pour défendre tes frères et sœurs.” Nous, humains, sommes conçus pour nous aider les uns les autres – et même mourir les uns pour les autres – à condition d’avoir d’abord eu une chance de former des liens. Aujourd’hui, même dans des conditions où nous avons beaucoup moins de chances d’être apparentés, ces instincts continuent à nous pousser aussi fortement qu’autrefois. La notion de “solidarité fraternelle” n’est pas totalement dépendante de facteurs externes et sociaux, tels que l’éducation ou la propagande. Elle n’a pas besoin d’être inculquée chez les gens à l’encontre de leur nature profonde. La solidarité fait partie d’une ancienne tradition – une stratégie évolutive – qui, il y a longtemps, devint centrale à la nature humaine elle-même. C’est une expression sans prix de l’”égoïsme” de nos gènes.
Chris Knight
[1]) "Human Solidarity and The Selfish Gene [79]".
Nous avons déjà publié un autre texte de Chris Knight dans notre presse : “Marxisme et science”.
[2]) La théorie du gène égoïste, bien que combattue par une minorité de théoriciens de l’évolution (notamment par le défunt Stephen Jay Gould dans la Structure de la théorie de l’évolution), est défendue par la majorité d’entre eux (notamment par Richard Dawkins dans le Gène égoïste et The Extended Phenotype).
En décrivant les gènes comme étant « égoïstes », Dawkins n’entend pas par là qu’ils sont munis d’une volonté ou d’une intention propre, mais que leurs effets peuvent être décrits comme si ils l’étaient. Sa thèse est que les gènes qui se sont imposés dans les populations sont ceux qui provoquent des effets qui servent leurs intérêts propres (c’est-à-dire de continuer à se reproduire), et pas forcément les intérêts de l’individu même. Cette vision des choses explique, comme nous allons le découvrir plus loin dans cet article de Chris Knight, l’altruisme au niveau des individus dans la nature, en particulier dans le cercle familial : quand un individu se sacrifie pour protéger la vie d’un membre de sa famille, il agit dans l’intérêt de ses propres gènes.
Rubrique:
"L'affaire des neutrinos" et la méthode scentifique
- 1545 lectures
“L’Affaire des neutrinos” a débuté en septembre 2011, lorsque l’équipe internationale de scientifiques participant à l’expérience OPERA rendit publics ses résultats selon lesquels les neutrinos se déplaçaient à une vitesse supérieure à celle de la lumière, remettant par là-même en question un des cadres théoriques fondamentaux de la physique actuelle, la théorie de la relativité restreinte, élaborée par Albert Einstein en 1905 et jamais infirmée depuis ([1]).
Considérant ses propres résultats comme très probablement erronés mais incapable d’identifier l’origine de cette erreur, l’équipe scientifique d’OPERA comptait ainsi sur l’aide de la communauté scientifique internationale afin de résoudre cette énigme. Après plusieurs mois de minutieuses vérifications couplées à de nouvelles expériences, les conclusions furent officiellement présentées à l’occasion de la 25e Conférence internationale sur la physique du neutrino et l’astrophysique, qui s’est tenue au mois de juin au Japon : “Au final, deux défaillances étaient en cause, d’une part la liaison GPS-ordinateur, mais aussi une horloge atomique mal réglée. Les problèmes étant résolus, l’expérience a été tentée une dernière fois avec succès : les neutrinos se déplacent bien moins vite que la lumière. De plus, trois autres expériences menées en parallèle ont conclu au même résultat” ([2]).
Sans attendre l’annonce officielle, les deux principaux responsables d’OPERA, poussés vers la sortie par certains de leurs pairs suite à de nombreuses tensions internes, avaient déjà démissionné. Quant aux principaux médias, après avoir multiplié les annonces aussi racoleuses que stupides au début de ladite “affaire”, leur attitude oscille désormais entre silence assourdissant et mépris ostensible : un des responsables d’OPERA a ainsi été qualifié de “physicien du flop” par le journal italien Corriere della Sera.
Et pourtant, comme le souligne le communiqué fait lors de la Conférence internationale, il est tout à fait normal que les scientifiques acceptent “le questionnement de principes, même et surtout les plus fondamentaux, et se basent avant tout sur l’expérience et l’examen par les pairs afin de faire progresser notre connaissance des lois de la nature. [...] La démarche critique qui a été effectuée constitue un bel exemple du fonctionnement de la science et du doute scientifique [...] si in fine nous avons eu affaire à une erreur expérimentale, il est impossible de parler de faute” ([3]).
Finalement, quelles leçons tirer de toute cette histoire ? “L’annonce de ces résultats à coups de grands titres dans les médias, puis leur réfutation peu après, a – selon certains – contribué à faire que les gens croient moins en la Science. Cependant, la Science n’est pas la magie, et la Science – souvenons-nous du système solaire géocentrique – n’a pas été exempte d’erreurs au cours de l’histoire. C’est donc à force de remises en question, d’erreurs commises que l’on avance. Cette pensée est au final bien résumée dans la conclusion de l’édito de Nature : “Le message [d’OPERA] est que les scientifiques n’ont pas peur de se frotter aux grandes questions. Ils n’ont pas peur de soumettre à la vue du grand public leur activité de recherche. Et ils ne doivent pas avoir peur de se tromper”” ([4]).
DM, 28 juin
[1]) Pour en savoir davantage sur les aspects scientifiques de cette expérience, voir : sciences.siteduzero.com/news-62-42559-p1-la-relativite-restreinte-remise-en-question.html. Voir aussi notre article de Révolution internationale no 427 : http ://fr.internationalism.org/ri427/confirmation_de_l_existence_des_neutrinos_le_progres_scientifique_est_il_plus_rapide_que_son_ombre.html [81] , dont le titre contient une erreur factuelle importante ; en effet, la confirmation de l’existence des neutrinos date en réalité de... 1956 ! (voir à ce sujet : http ://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_du_neutrino [82]).
[2]) sciences.siteduzero.com/news-62-44749-les-neutrinos-supraluminiques-qui-ne-l-etaient-pas.html
[3]) Idem.
[4]) Idem.
Rubrique:
Existe-t-il un danger fasciste ?
- 1622 lectures
Nous publions ci-dessous l’exposé qui a introduit le débat lors de notre Réunion publique du 30 juin à Paris.
D'élection en élection, depuis longtemps déjà, les scores électoraux de l’extrême-droite alimentent la crainte d’une menace fasciste. Il est vrai que cette frange de la classe politique se distingue par un discours particulièrement haineux, xénophobe, raciste…
C’est aussi vrai qu’un tel discours n’est pas sans rappeler les thèmes nauséabonds mis en avant par les partis fascistes en ascension vers le pouvoir dans les années 1930, en particulier en Allemagne et en Italie.
Cette similitude nous permet-elle de conclure qu’il existe aujourd’hui un danger d’accession du fascisme au pouvoir comme dans les années 1930 ?
Notre réponse à cette question, et sa discussion, sont justement l’objet de cette réunion publique.
Un ensemble d’éléments semblent aller dans le sens d’une réponse affirmative à cette question :
• aujourd’hui, comme dans les années 1930, la crise économique frappe très violemment la très grande majorité de la population ;
• aujourd’hui, comme dans les années 1930, il y a dans les discours de l’extrême-droite la recherche d’un bouc-émissaire aux maux de la société. Hier les juifs, désignés comme les représentants du grand capital apatride ou encore comme liés au péril bolchevique, aujourd’hui les musulmans ou les Arabes qui nous “prennent nos emplois” ou “fauteurs de troubles” de par le monde ;
• aujourd’hui, comme dans les années 1930, les catégories sociales les plus réceptives aux thèmes d’extrême-droite sont souvent des petits artisans ou commerçants ruinés par la crise, mais également une partie de la classe ouvrière ;
• aujourd’hui, l’extrême-droite se développe dans beaucoup de pays, plus nombreux encore que dans les années 1930, et tend à acquérir une importance politique croissante :
– Aux Pays-Bas, le parti de la liberté, eurosceptique et islamophobe, allié au Parti libéral et aux chrétiens démocrates, assurait depuis 2010 une majorité parlementaire au gouvernement dirigé par un Premier ministre libéral, avant de s’en désolidariser en mars de cette année ;
– en Hongrie, le Premier ministre issu des élections législatives de 2010, V. Orban, instaure un gouvernement autoritaire ayant “liquidé la démocratie”, selon les termes de ses opposants démocrates ; et c’est vrai qu’en plus d’attaques très fortes contre les conditions de vie de la classe ouvrière, il a supprimé un certain nombre de mécanismes de la démocratie ;
– en Autriche, aux élections législatives de 2008, les deux principaux partis d’extrême-droite, le FPÖ et le BZÖ, obtenaient à eux deux 29 % des suffrages ;
– aux États-Unis, le Tea Party, qui développe des thèmes de propagande parmi les plus rétrogrades, tel que la demande de l’enseignement du créationnisme dans les écoles, constitue une force très influente au sein de la droite.
• Même des partis qui ne se revendiquent pas de l’extrême-droite reprennent ouvertement ses thèmes. En Suisse, par exemple, la populiste Union démocratique du Centre avait fait une campagne publicitaire présentant un mouton blanc chassant un mouton noir, ce dernier symbolisant les Arabes et les Roumains qui sont les deux nationalités stigmatisées dans ce pays.
Tous ces exemples et éléments d’analyse semblent valider, en première analyse, la thèse d’un danger fasciste dans la période actuelle.
On ne peut cependant en rester à ce niveau d’analyse. Pour comparer deux périodes historiques, en l’occurrence celle des années 1930 et celle que nous vivons actuellement, on ne peut pas se limiter à extraire des éléments de l’une et l’autre, aussi importants soient-ils comme la crise, une poussée de l’extrême-droite, un certain succès des thèmes xénophobes et racistes, etc. Il faut replacer ces éléments dans le contexte de la dynamique de la société et du rapport de force, au sein de celle-ci, entre bourgeoisie et prolétariat.
C’est justement ce qu’on se propose de faire ici.
De quoi le fascisme des années 1930 est-il le produit ?
De la crise, nous l’avons déjà dit. Cependant, pour comprendre l’irruption, dans un certain nombre de pays, de cette forme particulière de la domination du capitalisme sur la société, un autre facteur, essentiel selon nous, doit être pris en compte.
Il s’agit de la plus lourde défaite que la classe ouvrière ait eu à subir de toute son existence, celle de la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23. Rappelons pour mémoire que celle-ci avait pris la forme de la dégénérescence de la révolution russe et de l’écrasement physique et idéologique du prolétariat par la bourgeoisie. Et cela en particulier dans les pays où celui-ci était allé le plus loin, à travers sa lutte révolutionnaire, dans la remise en cause de l’ordre capitaliste. Tous les partis communistes se sont transformés en organes de défense du capitalisme, sous une forme particulière, celle du capitalisme d’État sous sa forme existant en URSS.
Une telle défaite allait donner naissance à la plus longue et profonde période de contre-révolution mondiale, comme le prolétariat n’en avait jamais connu. Le principal signe distinctif de cette contre-révolution, c’est qu’elle a rendu le prolétariat du monde entier toujours plus soumis aux impératifs de la bourgeoisie. Le summum de cette soumission a été son enrôlement, comme chair à canon, dans la Seconde Guerre mondiale impérialiste.
Durant la Seconde Guerre mondiale, parmi les principaux pays belligérants des deux blocs qui s’opposent, on trouve trois modèles différents d’organisation de la société, tous trois capitalistes et tous trois bâtis autour du renforcement du capitalisme d’État, qui est alors une tendance générale affectant tous les pays du monde :
– l’État capitaliste démocratique,
– l’État capitaliste stalinien,
– l’État capitaliste fasciste.
Les différences que présente l’État capitaliste démocratique avec les deux autres modes sont évidentes. Avec le recul dont on dispose aujourd’hui, il est aussi évident qu’il est plus efficient que les deux autres modes, tant en ce qui concerne la gestion de l’appareil de production que le contrôle sur la classe ouvrière. Il existe bien sûr des différences de forme entre l’État capitaliste fasciste et le stalinien, ce dernier s’étant développé sur la base de la bureaucratie étatique qui a progressivement pris la place de l’ancienne bourgeoisie déchue. Mais notre propos n’est pas de nous étendre là-dessus à présent.
Comment expliquer l’existence de l’État capitaliste fasciste à cette époque ?
Le fait que l’État capitaliste fasciste (tout comme le stalinien) soit dénué de tout mécanisme démocratique destiné en premier lieu à mystifier la classe ouvrière, cela ne constitue pas un problème au moment où ces régimes s’instaurent, en URSS, en Allemagne et en Italie. En effet, il n’est alors nullement nécessaire de mystifier le prolétariat vu que celui-ci sort exsangue de la défaite de la vague révolutionnaire (en particulier en URSS et en Allemagne). Ce qu’il faut, c’est le maintenir exsangue au moyen de la violence d’une féroce dictature ouverte.
En Allemagne et en Italie, c’est aux partis fascistes qu’il revient d’assumer, pour les intérêts du capital national, l’option politique capitaliste d’État, dans le contexte d’une économie désorganisée par la guerre, acculée par une crise économique profonde : la bourgeoisie de ces pays ayant devant elle la nécessité de préparer une nouvelle guerre. Celle-ci sera placée sous le signe de la revanche par rapport à la défaite et/ou l’humiliation subie lors de la Première Guerre mondiale. Or les fascistes étaient depuis le début des années 1920 les champions d’une telle option.
Il est à noter que dans ces deux pays la transition de la démocratie au fascisme s’est effectuée de façon démocratique, avec le soutien du grand capital.
Nous avons parlé de défaite profonde de la classe ouvrière comme étant la condition essentielle de l’instauration du fascisme dans les pays où il est arrivé au pouvoir. Selon une croyance largement entretenue par la bourgeoisie, c’est le fascisme qui aurait été l’instrument de la défaite de la classe ouvrière dans les années 1920-1930. Rien n’est plus faux. Le fascisme n’a fait que parachever une défaite dont le principal instrument avait été la gauche de l’appareil politique de la bourgeoisie. Cette dernière était représentée, au moment de la vague révolutionnaire, par les partis de la social-démocratie qui avaient trahi la classe ouvrière et l’internationalisme prolétarien. Lors de la Première Guerre mondiale, ceux-ci avaient en effet appelé le prolétariat à soutenir l’effort de guerre de la bourgeoise dans différents pays, contre les principes même de l’internationalisme prolétarien.
Et pourquoi se sont-ils retrouvés à jouer ce rôle ? Cela a-t-il été circonstanciel ou bien la réponse à une nécessité ? Face à une classe ouvrière qui n’est pas vaincue et, qui plus est, développe sa lutte révolutionnaire en rendant inopérantes certaines forces répressives, il aurait été suicidaire pour la bourgeoisie d’employer d’abord et avant tout la force brute. Cette dernière ne peut être efficace que si elle est mise au service d’une stratégie capable de mystifier le prolétariat pour le “pousser à la faute”, l’orienter vers des impasses, lui tendre des pièges. Et cette basse besogne ne peut être prise en charge que par des partis politiques qui, bien qu’ayant trahi le prolétariat, conservent encore la confiance de fractions importantes de celui-ci.
Ainsi, en 1919, c’est au très démocrate SPD allemand, dernier pilier politique de la domination capitaliste encore debout au moment de la révolution en Allemagne, qu’échoie la tâche d’être le bourreau de la classe ouvrière révolutionnaire. A cette fin, il s’appuie sur les restes de l’armée demeurés fidèles à l’État et met sur pieds les corps francs, corps répressifs, qui constituèrent les ancêtres des troupes de choc du nazisme.
Une vérification supplémentaire du même phénomène a été donnée par les événements en Espagne dans les années 1930. La classe ouvrière est d’abord affaiblie de façon sanglante par la république et, ensuite, elle est immobilisée et livrée par le Front populaire au massacre des troupes franquistes. C’est alors que s’instaure la dictature fasciste de Franco.
C’est la raison pour laquelle, parmi tous les ennemis de la classe ouvrière, droite démocrate, gauche démocrate, extrême-gauche démocrate ou non, populistes fascisants ou non, les plus dangereux sont ceux qui sont à même de mystifier le prolétariat afin de l’empêcher d’avancer dans la direction de son projet révolutionnaire. Ceux-là, qui sont en premier lieu la gauche et l’extrême-gauche du capital, doivent absolument être démasqués pour ce qu’ils sont.
Quelle est la situation dans la période actuelle ?
La grande différence avec les années 1930, c’est que la classe ouvrière a ouvert avec 1968 en France et internationalement un nouveau cours de la lutte de classe, une nouvelle dynamique de celle-ci pouvant déboucher sur des confrontations majeures entre les classes et sur la révolution. Bien que depuis lors elle ait rencontré des difficultés très importantes, la classe ouvrière n’a pas subi de défaite majeure à même d’ouvrir une période de contre-révolution mondiale similaire à celle des années 1930.
C’est la raison pour laquelle la condition essentielle pour l’instauration du fascisme, à savoir un prolétariat défait à l’échelle mondiale, vaincu idéologiquement et physiquement dans certains pays centraux du capitalisme, n’est pas présente actuellement.
Dans la période actuelle, ce qui est le plus à redouter pour le prolétariat, ce n’est pas un péril direct lié à l’instauration du fascisme, mais bien les mystifications démocratiques et l’action de ces partis anciennement ouvriers et passés à l’ennemi de classe. En effet, leur fonction est de saborder tout effort de la classe ouvrière pour se défendre face au capitalisme et affirmer sa nature révolutionnaire. Ce n’est pas un hasard si, aujourd’hui, ces partis sont les premiers à agiter la menace du fascisme afin de rabattre les ouvriers vers la défense de la démocratie et de la gauche.
Dans ces conditions comment expliquer alors la montée actuelle des partis populistes agitant des thèmes propres au fascisme des années 1930 ?
Elle est la conséquence des difficultés de la classe ouvrière à dégager sa perspective propre, celle de la révolution prolétarienne, en tant qu’alternative à la faillite du mode de production capitaliste.
Ainsi, même si la bourgeoisie n’a pas les mains libres pour déchaîner sa logique propre face à la crise de son système, à savoir la guerre impérialiste généralisée, la société, sous les effets de la crise économique, pourrit sur pieds. Ce processus de décomposition de la société sécrète un ensemble d’idéologies obscurantistes, xénophobes, basées sur la haine de l’autre vu comme un concurrent ou un ennemi, etc. Une partie significative de la population, y compris de la classe ouvrière, se trouve influencée à différents niveaux par cette ambiance.
Face à cela, la solution ne consiste certainement pas dans une mobilisation ou une lutte spécifiques contre le fascisme comme le propose Mélenchon, ni dans la défense de la démocratie, mais dans le développement de la lutte autonome du prolétariat contre le capitalisme et toutes ses composantes.
CCI, 30 juin
Vie du CCI:
- Réunions publiques [83]
Rubrique:
La condition de la femme au XXIe siècle
- 7859 lectures
“La condition de la femme au xxie siècle” ; pourquoi un tel titre, pourquoi se pencher sur un tel sujet ? N’est-ce pas anachronique ou dépassé ? Après tout, ne sommes-nous pas en 2012 ? Les droits des femmes à l’égalité ne sont-ils pas reconnus en France et dans une foultitude de conventions et de déclarations à travers le monde ?
En réalité, la question de la souffrance des femmes dans une société qui demeure fondamentalement patriarcale reste entière ([1]). Partout dans le monde, la violence conjugale, la mutilation génitale rituelle, le développement d’idéologies complètement anachroniques, comme le fondamentalisme religieux, par exemple, continuent de sévir et de se développer ([2]).
Ce que les socialistes du xixe siècle appelaient “la question de la femme” reste donc posé : comment créer une société où les femmes ne subissent plus cette oppression particulière ? Et quelle doit être l’attitude des communistes révolutionnaires envers “les luttes des femmes” ?
Une première constatation : la société capitaliste a jeté les bases pour le changement le plus radical que la société humaine ait jamais connu. Toutes les sociétés antérieures, sans exception, étaient fondées sur la division sexuelle du travail. Quelle que soit leur nature de classe, et que la situation de la femme y soit plus ou moins favorable, il allait de soi que certaines occupations étaient réservées aux hommes, d’autres aux femmes. Les occupations masculines et féminines pouvaient varier d’une société à une autre mais le fait de la division était universel. Nous ne pouvons entrer ici dans une étude approfondie sur le pourquoi de ce fait, mais très vraisemblablement il est lié aux contraintes de l’enfantement, et remonte à l’aube de l’humanité. Le capitalisme, pour la première fois dans l’histoire, tend à éliminer cette division. Dès ses débuts, le capitalisme rend le travail abstrait. Là où autrefois il y avait le travail concret de l’artisan ou du paysan, encadré par les règles des guildes ou les lois coutumières, maintenant il n’y a que la main d’œuvre comptabilisée au taux horaire ou à la pièce, et peu importe qui exécute le travail. Puisque les femmes sont payées moins cher, on les fait entrer à l’usine souvent pour remplacer les hommes qui y travaillaient autrefois. C’est le cas des tisserandes notamment. Le machinisme aidant, le travail exige de moins en moins de force physique puisque la force humaine est remplacée par celle, décuplée, des machines. De nos jours, le nombre d’emplois qui exigent encore la force physique masculine est limité et on voit de plus en plus de femmes entrer dans des domaines autrefois réservés aux hommes. Les vieux préjugés sur “l’irrationalité” supposée des femmes tombent presque d’eux-mêmes, et on voit de plus en plus de femmes occuper des postes de chercheurs ou dans les professions médicales autrefois réservées aux hommes.
L’entrée massive des femmes dans le monde du travail associé ([3]) a deux conséquences potentiellement révolutionnaires :
La première conséquence, c’est qu’en mettant fin à la division sexuelle du travail, le capitalisme ouvre la voie vers un monde où hommes et femmes ne seront plus cantonnés dans des occupations sexuellement déterminées mais pourront réaliser pleinement leur talents et leurs capacités humaines. Cela ouvre aussi la perspective d’établir les relations entre les sexes sur des bases entièrement nouvelles.
La deuxième conséquence, c’est que les femmes acquièrent une indépendance économique. Une travailleuse salariée n’est plus dépendante de son mari pour vivre, et cela ouvre la possibilité, pour la première fois, aux masses de femmes ouvrières de participer à la vie publique et politique.
Dans le capitalisme, au tournant du xixe et du xxe siècle, la revendication de participer à la vie politique n’était pas limitée aux femmes ouvrières. Les femmes de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie revendiquaient elles aussi l’égalité des droits, et le droit de vote en particulier. Pour le mouvement ouvrier, cela posait la question de l’attitude à adopter vis-à-vis des mouvements féministes. Car si le mouvement ouvrier s’opposait à toute oppression de la femme, les mouvements féministes, en posant la question sociale à partir du sexe et non pas des classes, niaient le besoin d’un renversement révolutionnaire de la société, réalisé par une classe sociale composée d’hommes et de femmes : le prolétariat. Mutatis mutandis, la même question se pose aujourd’hui : quelle attitude les révolutionnaires doivent-ils adopter envers le mouvement de libération de la femme ?
Dans un article publié en mai 1912 sur la lutte pour le suffrage féminin, la révolutionnaire Rosa Luxemburg fait une nette distinction entre les femmes de la classe bourgeoise et le prolétariat féminin : “Nombre de ces femmes bourgeoises qui agissent comme des lionnes dans la lutte contre les “prérogatives masculines” marcheraient comme des brebis dociles dans le camp de la réaction conservatrice et cléricale si elles avaient le droit de vote (…) Économiquement et socialement, les femmes des classes exploiteuses ne sont pas un segment indépendant de la population. Leur unique fonction sociale, c’est d’être les instruments de la reproduction naturelle des classes dominantes. A l’opposé, les femmes du prolétariat sont économiquement indépendantes. Elles sont productives pour la société, comme les hommes” ([4]). Luxemburg fait donc une distinction très nette entre la lutte pour le suffrage des femmes prolétaires, et celle des femmes de la bourgeoisie, et elle insiste en plus sur le fait que la lutte pour les droits des femmes est une question pour toute la classe ouvrière : “Le suffrage féminin, c’est le but. Mais le mouvement de masse qui pourra l’obtenir n’est pas que l’affaire des femmes, mais une préoccupation de classe commune des femmes et des hommes du prolétariat.”
Le rejet du féminisme bourgeois est tout aussi clair chez Alexandra Kollontaï, membre du Parti bolchevique, qui publie en 1908 : La base sociale de la question de la femme : “Quoiqu’en disent les féministes, l’instinct de classe se montre toujours plus puissant que les nobles enthousiasmes de la politique “au-dessus des classes”. Tant que les femmes bourgeoises et leurs “petites sœurs” [c’est-à-dire les ouvrières, ndlr] sont égales dans leur inégalité, les premières peuvent en toute sincérité faire de grands efforts pour défendre les intérêts généraux des femmes. Mais une fois la barrière détruite et que les femmes bourgeoises ont eu accès à l’activité politique, les défenseurs récents des “droits pour toutes les femmes” deviennent les défenseurs enthousiastes des privilèges de leur classe (…) Lorsque les féministes parlent aux ouvrières de la nécessité d’une lutte commune pour réaliser un quelconque “principe général des femmes”, les femmes de la classe ouvrière sont naturellement méfiante” ([5]).
Que cette méfiance avancée par Kollontaï et Luxemburg était entièrement justifiée, fut montré dans la pratique lors de la Première Guerre mondiale. Le mouvement des “suffragettes” s’est scindé en deux : d’un côté, les féministes menées par Emmeline Pankhurst et sa fille Christabel ont donné leur soutien sans équivoque à la guerre et au gouvernement ; de l’autre, Sylvia Pankhurst en Grande-Bretagne et sa sœur Adela en Australie se sont séparées du mouvement féministe pour défendre une position internationaliste. Pendant la guerre, Sylvia Pankhurst abandonna petit à petit la référence au féminisme : sa “Women’s Suffrage Federation” devint la “Workers’ Suffrage Federation” en 1916, et son journal le Women’s Dreadnought ([6]) changea de nom pour devenir le Workers’ Dreadnought en 1917.
Luxemburg et Kollontaï admettent que les luttes des féministes et celles des femmes prolétaires peuvent se trouver momentanément sur un terrain commun, mais non pas que les femmes prolétaires doivent se fondre dans la lutte des féministes sur le terrain purement des “droits de femmes”. Il nous semble que les révolutionnaires doivent adopter la même attitude aujourd’hui, dans les conditions de notre époque évidemment.
Nous voulons terminer par une réflexion sur “l’égalité” comme revendication pour les femmes. Parce que le capitalisme traite la force de travail comme une abstraction, financièrement comptable, sa vision de l’égalité est également abstraite, comptable : une “égalité des droits”. Mais puisque les êtres humains sont tous différents, une égalité de droits devient très vite une inégalité dans les faits ([7]), et c’est pourquoi les communistes depuis Marx ne se revendiquent pas d’une “égalité” sociale. Au contraire, le slogan de la société communiste est : “De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins”. Et il y a un besoin, et capacité, que les femmes ont, que les hommes n’auront jamais : celui d’enfanter.
Une femme doit donc avoir la possibilité de mettre au monde son enfant, de le soigner pendant ses premières années, sans que cela ne se trouve en contradiction ni avec son indépendance ni avec sa participation à la vie sociale dans toutes ses dimensions. C’est un besoin, un besoin physique, que la société doit soutenir ; c’est une capacité dont la société a tout intérêt à permettre l’expression puisqu’il s’agit là de son avenir ([8]). Il n’est donc pas difficile de voir qu’une société vraiment humaine, une société communiste, ne cherchera pas à imposer une “égalité” abstraite aux femmes, qui ne serait qu’une inégalité réelle dans les faits. Elle cherchera au contraire à intégrer cette capacité spécifique aux femmes dans l’ensemble de l’activité sociale, en même temps qu’elle complétera un processus que le capitalisme n’a pu qu’entamer, et mettra fin pour la première fois de l’histoire à la division sexuelle du travail.
Jens, juin 2012
[1]) Selon l’enquête nationale sur les violences envers les femmes de 2000, “en 1999, plus d’un million et demi de femmes ont été confrontées à une situation de violence, verbale, physique et/ou sexuelle. Une femme sur 20 environ a subi en 1999 une agression physique, des coups à la tentative de meurtre, [alors que] 1,2 % ont été victimes d’agressions sexuelles, de l’attouchement au viol. Ce chiffre passe à 2,2 % dans la tranche d’âge des 20-24 ans”
(cf. http ://www.sosfemmes.com/violences/violences_chiffres.htm [84])
[2]) Pour ne prendre qu’un exemple, selon un article publié en 2008 par Human Rights Watch, les Etats-Unis ont connu une augmentation dramatique de la violence contre les femmes pendant les deux années précédentes
(cf. http ://www.hrw.org/news/2008/12/18/us-soaring-rates-rape-and-violence-against-women [85])
[3]) Les femmes, évidemment, ont toujours travaillé. Mais dans les sociétés de classes antérieures au capitalisme, leur travail restait majoritairement dans le domaine domestique privé.
[5]) Publié dans Alexandra Kollontai : Selected writings, Alison & Busby, 1977, p. 73. Traduit en français par nous.
[6]) Référence aux cuirassées de la marine britannique de l’époque.
[7]) “Le droit par sa nature ne peut consister que dans l’emploi d’une même unité de mesure ; mais les individus inégaux (et ce ne seraient pas des individus distincts, s’ils n’étaient pas inégaux) ne sont mesurables d’après une unité commune qu’autant qu’on les considère d’un même point de vue, qu’on ne les saisit que sous un aspect déterminé ; par exemple, dans le cas présent, qu’on ne les considère que comme travailleurs et rien de plus, et que l’on fait abstraction de tout le reste” (Marx, Critique du Programme de Gotha).
[8]) Nous parlons ici de façon générale. Il est évident que toutes les femmes ne ressentent pas forcément ce besoin.
Rubrique:
Révolution Internationale n° 435 - septembre 2012
- 1761 lectures
Face à la terreur et à l’austérité, l’avenir appartient à la lutte de classe !
- 1527 lectures
Aucun pays n’est épargné par la crise économique qui alimente en même temps l’explosion du chômage (3). En Europe, le taux dépasse déjà le seuil des 10 % et frappe particulièrement les jeunes qui ne peuvent désormais plus s’insérer dans un appareil productif sursaturé. En Espagne et en Grèce, c’est plus de 50 % des jeunes qui se retrouvent sans travail (4) ! Désormais, une grande partie de la population est dans un état de paupérisation absolue, sans logement, uniquement préoccupée par les moyens d’assurer sa propre survie et vivant dans la terreur des pressions policières. En Espagne, par exemple, dans 1 700 000 foyers, personne ne travaille ni ne perçoit plus la moindre indemnité ! Dans certaines régions les plus sinistrées, comme l’Andalousie, 35 % des familles des grandes villes vivent en dessous du seuil de pauvreté (5).
Les expulsions se multiplient et, face aux contestations, la répression policière s’amplifie.
Ce n’est pas un hasard non plus si l’Allemagne autorise désormais l’intervention de l’armée sur son sol, s’empressant aussitôt d’avertir que “ce n’est pas dirigé contre les manifestations” ! Sans commentaire…
La réalité de la récession
Dans ce contexte de crise économique aiguë, la France en récession doit faire face elle aussi à des vagues de licenciements et de multiples plans sociaux. L’annonce en juillet de la suppression de 8000 postes chez PSA à Aulnay-sous-Bois et dans différents établissements n’est qu’un avant-goût de ce qui se prépare. Le secteur automobile est touché de plein fouet. Avec une baisse d’environ 10 % des ventes en Europe, il devient clair qu’il y a surcapacité et que l’avenir se présente très sombre partout. On annonce aussi 5000 suppressions de postes pour les télécommunications chez Alcatel Lucent, idem à Air France, le géant de la pharmacie Sanofi met sur la sellette 2000 salariés, la grande distribution, dont Carrefour, entrevoit de supprimer des milliers de postes... sans compter tous les sous-traitants touchés et les nombreuses PME qui disparaissent chaque jour en France. L’idée du “redressement productif” est une mascarade. Elle cache en réalité la simple volonté de la bourgeoisie française de résister à son recul sur un marché mondial saturé, face à une concurrence exacerbée. C’est d’ailleurs le sens de sa volonté sous-jacente de sacrifier en grande partie l’automobile pour se recentrer sur d’autres secteurs industriels vitaux. Comme le faisait Sarkozy en son temps, lorsqu’il promettait de “sauver des emplois” dans la sidérurgie, le nouveau gouvernement prétend qu’“une solution sera proposée pour chaque salarié” ! Ce mensonge, comme les précédents, permet de gagner du temps pour tenter de faire avaler la pilule.
Partout, que les gouvernements soient de droite ou de gauche, nous voyons le capital opérer des choix drastiques et obéir à une même logique d’attaques massives : fermetures d’usines, d’hôpitaux, salaires gelés (quand ils ne sont pas tout simplement supprimés...), fonctionnaires non remplacés, pensions diminuées, âge du départ à la retraite repoussé, pression fiscale accrue et hausse du coût de la vie.
Que valent, dans un tel contexte, les discours sur la “justice sociale” du gouvernement Hollande ? Rien, si ce n’est une nouvelle imposture ! Il faut ajouter que le chauvinisme, savamment entretenu par la bourgeoisie nationale et ses médias, derrière le soutien à ses athlètes aux JO enveloppés dans le drapeau tricolore, a constitué un véritable enfumage pour masquer l’austérité et tenter de préserver la paix sociale. De l’union nationale autour des jeux sportifs au “patriotisme économique” proclamé par les ministres Ayrault et Montebourg, les discours officiels incitent à un même “sacrifice” soi-disant juste et pour tous, au “dépassement de soi”, pour soutenir la compétitivité de “l’économie nationale”.
Les premières mesures symboliques du gouvernement, comme la baisse de 30 % des salaires des ministres (qui restent plus que très confortables), la retraite à 60 ans pour quelques dizaines de milliers de salariés, le barouf autour de la taxation des 75 % devant compenser la baisse de l’ISF pour les plus riches, le “coup de pouce” au SMIC (22 euros par mois !), etc., ne sont que des cosmétiques, de la poudre aux yeux destinés à “légitimer” les attaques en cours et à justifier d’avance celles bien pires en préparation contre tous les prolétaires. Cela, au nom de “l’effort juste” !
Vers des attaques massives
Car, derrière les beaux discours hypocrites du gouvernement, cherchant à faire diversion face à l’explosion du chômage, ces attaques sont déjà une réalité. L’été, comme toujours, a été un moment privilégié pour augmenter les prix sur le dos des classes exploitées : ceux des biens de première nécessité, du gaz, de l’électricité et des carburants (même si des effets d’annonce du gouvernement prétendent y remédier) sont déjà facturées. Comme nous l’avons vu, c’est surtout au niveau de l’emploi que la situation s’est très fortement dégradée. En juin 2012, on comptait 41 600 demandeurs d’emploi en plus. Les 295 100 radiations représentent 65 % des “sorties” de Pôle Emploi et on enregistre une multiplication des stages-parking, en hausse de 24 % en un an ! Le chômage de longue durée s’est lui aussi accru de plus de 21 % durant la même période ! Et ces chiffres ne prennent pas en compte les 1 312 400 foyers réduits au RSA, ni le million de sans-droits, etc. En réalité, c’est plus de 8,5 millions de demandeurs d’emploi, au bas mot, qu’il faudrait compter aujourd’hui (6).
Et la situation ne peut que s’aggraver ! Les budgets de la majorité des ministères, jugés “non prioritaires”, sont en effet partout revus à la baisse par le gouvernement Ayrault. Le principe du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux de l’ère Sarkozy est non seulement maintenu, mais renforcé, puisqu’il passe à deux fonctionnaires sur trois ! Ce ne sont pas les quelques milliers de postes d’enseignants recréés qui permettront de compenser les pertes ni de redresser la situation de précarité croissante. De grosses coupes claires sont déjà programmées en coulisse dans les collectivités territoriales. De nombreux postes de fonctionnaires dans les mairies, les petites communes, les départements et les régions, sont appelés à disparaître.
Par ailleurs, le gouvernement, qui se vante d’avoir supprimé la “TVA sociale” au nom de la “justice”, se prépare à une mesure aussi injuste que douloureuse : la hausse de la CSG, impôt sur l’impôt, inventée par la gauche elle-même et l’ancien ministre Michel Rocard. Il s’agira là d’une mesure transitoire en attendant une “réforme de la fiscalité” qui ne fera que plomber encore davantage le portefeuille des ménages. Mais les attaques ne s’arrêtent pas là. La question des retraites sera remise sur la table au printemps 2013. Et ce ne sera certainement pas pour une amélioration ! De même, la question du coût de la force de travail et de la flexibilité sera traitée dans l’esprit de ce qui est déjà en œuvre un peu partout ailleurs, comme en Allemagne, avec la profusion de petits boulots à 400 euros par mois. Aux États-Unis, par exemple, les salaires dans le secteur automobile ont déjà été divisés par deux pour des conditions de travail aggravées. Nous avons là un avant-goût de ce qui nous attend ! Et pour mettre en œuvre ces attaques, le gouvernement socialiste pourra compter sur toutes les forces politiques “critiques” de la bourgeoisie : de l’extrême-droite à l’extrême-gauche, en passant par toutes les forces syndicales.
Un partage du travail contre les ouvriers
Alors que le gouvernement prépare ces nouvelles attaques, l’opposition lui facilite le travail en multipliant les critiques par une surenchère démagogique. Mais dans le dispositif politique anti-ouvrier, ce sont surtout les syndicats et l’extrême-gauche, de Lutte ouvrière à Mélanchon, qui s’avèrent les plus utiles pour mystifier et encadrer la classe ouvrière en cherchant à la museler, comme on a pu le vérifier au moment de l’annonce des suppressions de postes à PSA. Le gouvernement était parfaitement au courant des intentions de la direction Peugeot. Les propos du ministre demandant une “expertise” n’étaient que pure hypocrisie, polarisant les responsabilités exclusivement sur la famille Peugeot et sa “mauvaise stratégie” : Hollande déclarait le 14 juillet que le plan social était “inacceptable en l’état” et qu’il devait être “renégocié”. Les syndicats, comme chiens de garde de l’ordre établi, ont alors emboîté le pas exprimant leur volonté d’obtenir “des preuves des difficultés avancées par le constructeur”. Le syndicat SUD, qui appelait à une “grève illimitée” à Aulnay, éteignait sa mèche en demandant en même temps l’appui du gouvernement pour “mettre en place un plan d’ensemble de la filière automobile assurant l’avenir et maintenant tous les emplois du secteur”. Un véritable écho au discours de Montebourg, pour qui “la nation doit se rassembler autour de la défense de PSA”, souci également partagé et appuyé par le Front de gauche patriotard de Mélanchon.
La délégation de la CFDT se vantait du “soutien du ministre” alors que la CGT, plus radicale face aux méfiants, entérinait l’isolement : “on ne peut compter que sur nous-mêmes” (7) ! Mais dans cette partition, tous les syndicats, dont le SIA (syndicat maison), étaient hostiles à la grève et jouaient au maximum la division. Le SIA, par exemple, opposait les ouvriers en distinguant les “traîtres”, les “jaunes”, les “islamistes”. Les syndicats ont tout fait pour éviter la grève au moment où le gouvernement n’avait aucun intérêt au déclenchement de conflits sociaux.
Le pompon revient aux militants de Lutte ouvrière qui, comme éléments radicaux de la CGT, proclamaient qu’“une grève illimitée serait une erreur tactique” et qu’il valait mieux attendre le mois de septembre après les vacances ! S’il est vrai que l’annonce de la fermeture durant les vacances a été un choix délibéré de la direction pour profiter de la démobilisation estivale, la pratique de LO a été dans le sens de la renforcer en essayant de tuer dans l’œuf toute volonté des plus combatifs en appelant à défendre “l’unité syndicale”, enfermant ceux qui voulaient réellement se battre dans un vague projet de “comité de lutte” qui visait à les isoler davantage (8).
Il n’y a pas d’illusions à avoir, le gouvernement est parfaitement préparé face à la colère ouvrière et bénéficie d’une complicité sans faille de toutes les composantes radicales de la gauche, syndicales et d’extrême-gauche !
Si cette préparation de la bourgeoisie et les attaques au niveau mondial rendent plus difficile le combat de la classe ouvrière, il existe néanmoins des signes qui montrent que le prolétariat, comme classe internationale, n’est pas prêt à se résigner (9). Si le chemin vers de futures luttes massives est encore long et difficile, il se poursuit, en exprimant de plus en plus clairement le besoin de solidarité ou en faisant surgir des regroupements de minorités plus conscientes. Cette maturation en profondeur constitue un pas nécessaire pour préparer les luttes massives de demain.
WH, 25 août
1) Voir notre article sur la guerre en Syrie (p. 4)
2) Voir nos articles sur le massacre de Marikana (p. 1) et la traque des Roms (p. 5).
3) HP a ainsi prévu de supprimer 27 000 postes, Nokia 10 000, Sony 10 000 également, RWE, deuxième groupe de services aux collectivités en Allemagne, prévoit de supprimer 5000 emplois supplémentaires en Europe, le groupe japonais d’électronique Sharp va en supprimer 5000 autres dans le monde..., la liste est très longue.
4) Voir le tract diffusé par la section du CCI en Espagne (p. 3).
5) www.liberation.fr [88].
6) http ://www.agoravox.fr [89]
8) Le Prolétaire no 503.
9) Voir nos articles sur la lutte des classes dans le monde (pages 2 et 3).
Récent et en cours:
- Luttes de classe [15]
Rubrique:
En Afrique du Sud, la bourgeoisie lance ses policiers et ses syndicats sur la classe ouvrière
- 1782 lectures

Le 16 août, au-dessus des mines de Marikana, au Nord-Ouest de Johannesburg, 34 personnes tombaient sous les balles de la police sud-africaine qui en blessait 78 autres. Plusieurs centaines de manifestants étaient également interpellées. Immédiatement, les images insoutenables des exécutions sommaires faisaient le tour du monde. Mais, comme toujours, la bourgeoisie et ses médias édulcoraient le caractère de classe de cette grève, la réduisant au sordide affrontement entre les deux principaux syndicats du secteur minier, et jouant la vieille partition du “démon de l’apartheid”.
L’Afrique du Sud n’a pas été épargnée par la crise mondiale
Malgré des investissements de plusieurs centaines de milliards d’euros destinés à soutenir l’économie, la croissance est atone et le chômage massif” (1). Le pays a fondé une partie de sa richesse sur l’exportation de produits miniers tels que le platine, le chrome, l’or et le diamant. Or, ce secteur, qui représente près de 10 % du PIB national, 15 % des exportations et plus de 800 000 emplois, a subi une forte récession en 2011. Le cours du platine, dont l’Afrique du Sud possède 80 % des réserves mondiales, s’effondre ainsi depuis le début de l’année.
Les conditions de vie et de travail des mineurs, déjà particulièrement pénibles, se sont fortement dégradées : payés un salaire misérable (environ 400 euros mensuels), logés dans des taudis, plongés souvent 9 heures au fond de mines surchauffées et asphyxiantes, ils subissent désormais les licenciements, les arrêts de production et le chômage. L’Afrique du Sud a ainsi été le théâtre de nombreuses grèves. En février, la plus grande mine de platine du monde, exploitée par Impala Platinum, avait déjà été paralysée six mois par une grève. C’est cette dynamique que le gouvernement dirigé par le président Zuma, successeur de l’emblématique Nelson Mandela, de concert avec les syndicats, a voulue enrayer. Car le développement des luttes en Afrique du Sud participe pleinement des réactions de la classe ouvrière à l’échelle internationale face à la crise mondiale.
Le massacre de Marikana, un piège tendu par les syndicats
C’est dans ce contexte que, le 10 août, 3000 mineurs de Marikana décident d’arrêter le travail pour réclamer des salaires décents, soit l’équivalant de 1250 euros : “Nous sommes exploités, ni le gouvernement ni les syndicats ne sont venus à notre aide [...]. Les sociétés minières font de l’argent grâce à notre travail, et on ne nous paie presque rien. Nous ne pouvons pas nous offrir une vie décente. Nous vivons comme des animaux à cause des salaires de misère” (2). Les mineurs entament aussitôt une grève sauvage sur le dos de laquelle deux syndicats, l’Union nationale des mineurs (NUM) et le Syndicat de l’association des mineurs et de la construction (AMCU), vont s’affronter violemment pour défendre leurs intérêts réciproques tout en enfermant les ouvriers dans la souricière de l’affrontement avec la police.
La NUM est un syndicat complètement corrompu et inféodé au pouvoir du président Jacob Zuma. La compromission ouverte de ce syndicat et son soutien systématique au parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), a fini par le discréditer aux yeux de nombreux travailleurs. Cette perte de crédit a conduit à la création d’un syndicat au discours plus radical issu de ses propres rangs : l’AMCU.
Mais tout comme la NUM, l’AMCU ne se soucie aucunement des mineurs : après une campagne de recrutement physiquement très agressive, le syndicat a profité de la grève pour que ses gros bras puissent en découdre avec ceux de la NUM. Résultat : dix morts et plusieurs blessés sur le compte des mineurs. Mais, au-delà de la guerre de territoire, ces altercations inter-syndicales ont permis aux forces de l’ordre d’intervenir, de provoquer un nouveau bain de sang, et de faire un exemple pour endiguer la dynamique des luttes ouvrières.
En effet, après plusieurs jours d’affrontement, Frans Baleni, secrétaire général de la NUM, avait évidemment beau jeu d’en appeler à l’armée : “Nous appelons au déploiement d’urgence des forces spéciales ou des forces armées sud-africaines avant que la situation soit hors de contrôle” (3)... et pourquoi pas un bombardement aérien sur la mine, Monsieur Baleni ? Mais le piège était déjà refermé sur les travailleurs. Dès le lendemain, le gouvernement envoyait des milliers de policiers, des véhicules blindés et deux hélicoptères (!) pour “rétablir l’ordre”, l’ordre bourgeois, bien sûr !
D’après plusieurs témoignages qui, vu la réputation des forces de répression sud-africaines, sont probablement authentiques, la police a passé son temps à provoquer les mineurs en tirant sur eux avec des flash-balls et des canons à eau, en envoyant des grenades lacrymogènes et des grenades incapacitantes, sous le prétexte mensonger que les grévistes possédaient des armes à feux.
Le 16 août, évidement, vu la fatigue et l’excitation alimentée par les “représentants syndicaux”, qui avaient – heureux hasard des circonstances – soudainement disparu de la circulation ce jour-là, quelques mineurs ulcérés osèrent “charger” (sic) les flics avec des bâtons. Comment ? La vile canaille “charge” les forces de l’ordre ? Quelle insolence ! Mais que pouvaient donc faire plusieurs milliers de flics, avec leurs armes à feux, leurs gilets pare-balles, leurs véhicules blindés, leurs canons à eau, leurs grenades et leurs hélicoptères face à une horde de 34 “sauvages” qui les “chargent” avec des bâtons ? Tirer dans le tas... “pour protéger leur vie” (4).
Et cela donne les images absolument écœurantes, insoutenables et monstrueuses que nous connaissons. Mais, si la classe ouvrière ne peut qu’exprimer son indignation face à une telle barbarie, elle doit comprendre que la diffusion de ces images avait aussi pour objectif de la mystifier en soulignant combien les prolétaires des pays “vraiment démocratiques” ont de la chance de pouvoir défiler “librement” derrières les banderoles syndicales. C’est également un avertissement implicite jeté à la face de tous ceux dans le monde qui osent se dresser contre la misère et le système qui l’engendre.
La bourgeoisie tente de dénaturer le mouvement
Immédiatement après le massacre, des voix s’élevaient dans le monde entier pour dénoncer le “démon de l’apartheid” et multiplier les déclarations compassées. La bourgeoisie veut désormais donner au mouvement une dimension mystificatrice en déplaçant le questionnement vers des problèmes ethniques et nationalistes. Julius Malenna, exclu de l’ANC en avril, s’est ainsi régulièrement déplacé à Marikana pour dénoncer les compagnies étrangères, réclamer la nationalisation des mines et l’expulsion des “grands propriétaires terriens blancs.”
S’enfonçant dans l’hypocrisie la plus crasse, le président Jacob Zuma déclarait devant la presse : “Nous devons faire éclater la vérité sur ce qui s’est passé ici, c’est pourquoi j’ai décidé d’instaurer une commission d’enquête pour découvrir les causes réelles de cet incident.” La vérité la voici : la bourgeoisie essaye de duper la classe ouvrière en masquant la lutte des classes sous les traits mystificateurs de la lutte des races. Mais la ficelle est un peu grosse : n’est-ce pas un gouvernement “noir” qui a répondu à l’appel d’un syndicat “noir” en déployant ses policiers ? N’est-ce pas un gouvernement “noir” qui fait tout son possible législatif pour contenir les mineurs dans des conditions de vie indignes ? N’est-ce pas un gouvernement “noir” qui emploie les policiers issus de l’époque de l’apartheid et vote des lois les autorisant à “tirer pour tuer” ? Et ce gouvernement “noir”, n’est-il pas issu des rangs de l’ANC, le parti dirigé par Nelson Mandela, célébré dans le monde entier comme le champion de la démocratie et de la tolérance ?
La grève s’étend
Dans la nuit du 19 au 20 août, espérant pousser l’avantage, la direction de Lonmin, entreprise qui exploite la mine, ordonnait aux “3000 employés en grève illégale de reprendre le travail lundi 20 août, faute de quoi ils s’exposent à un possible licenciement” (5). Mais la colère et les conditions de vie des mineurs sont telles qu’ils adressèrent un refus explicite à la direction, préférant s’exposer aux licenciements : “Est-ce qu’ils vont virer aussi ceux qui sont à l’hôpital et à la morgue ? De toutes façons, c’est mieux d’être mis à la porte parce qu’ici, on souffre. Nos vies ne vont pas changer. Lonmin se fiche de notre bien-être, jusqu’à maintenant, ils ont refusé de nous parler, ils ont envoyé la police pour nous tuer” (6). Tandis que Lonmin devait rapidement reculer, le 22 août, la grève s’étendait, avec les mêmes revendications, à plusieurs autres mines, exploitées par Royal Bafokeng Platinum et Amplats.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, il est encore impossible de savoir si les grèves glisseront sur un terrain de conflit inter-racial ou continueront à s’étendre. Mais, ce qu’a explicitement montré le massacre de Marikana, c’est la violence d’un État démocratique. Noirs ou blancs, les gouvernements sont prêts à tous les massacres contre la classe ouvrière.
El Generico, 22 août
1) Le taux de chômage s’élevait officiellement à 35,4 % à la fin de l’année 2011.
2) Cité dans le Monde du 16 août 2012.
3) Communiqué du NUM du 13 août 2012.
4) Déclaration de la police après le massacre. Le porte-parole de la police a même osé affirmer : “La police a été attaquée lâchement par un groupe, qui a fait usage d’armes variées, dont des armes à feu Les policiers, pour protéger leur vie et en situation de légitime défense, ont été obligés de répondre par la force.”
5) Communiqué de Lonmin du dimanche 19 août 2012.
6) Cité sur www.jeuneafrique.com [91], le 19 août 2012.
Géographique:
- Afrique [23]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [15]
Rubrique:
Une même classe, un même combat
- 1135 lectures
Partout, la classe ouvrière paie la note de l’accélération de la crise mondiale du capitalisme à travers une terrible dégradation de ses conditions de vie et de travail. Partout, elle subit les coups de boutoir des attaques de chaque bourgeoisie nationale : paupérisation, chute des salaires, chômage massif, plans de licenciements, précarité, réduction des budgets sociaux… Malgré le poids de l’idéologie démocratique, les manœuvres de division, l’encadrement syndical de ses luttes, la répression directe comme en Afrique du Sud, et les obstacles multiples que dresse la bourgeoisie devant elle, la classe ouvrière ne se résigne pas. Au contraire, elle tend à démontrer son unité et sa solidarité.
Afin de contribuer à rompre l’isolement et le black-out que les médias aux ordres font peser sur les luttes du prolétariat, nous tenons à mettre en évidence quelques unes des mobilisations récentes et significatives du prolétariat mondial qui témoignent du caractère international de la lutte de classe.
Espagne
Alors que de nouvelles mesures d’austérité dictées par l’UE sont annoncées et que le gouvernement Rajoy a décidé de supprimer l’aide de l’État au secteur du charbon, prélude à la fermeture prochaine de toutes les mines restantes, les principaux syndicats (CCOO, UGT) avaient organisé, pour contrer la mobilisation massive des 30 000 mineurs en grève depuis le mois de mai, une marche sur Madrid, le 11 juillet. Elle devait servir d’enterrement de première classe au mouvement des mineurs. Mais d’autres travailleurs ont rejoint cette marche à la recherche de solidarité. Les jours suivants, des rassemblements spontanés ont regroupé des ouvriers du secteur public, mais aussi du secteur privé, pour manifester devant les sièges des partis bourgeois, en-dehors de l’encadrement syndical. La classe ouvrière est donc en train de digérer ses combats antérieurs et de mettre l’unification et la solidarité au cœur de ses luttes.
Portugal
Dans cet autre pays au cœur de la tourmente européenne, où les plans de rigueur se succèdent à un rythme effréné et où le chômage touche officiellement 15 % de la population, une grève des dockers a paralysé les principaux ports le 14 août (notamment ceux de Lisbonne Aveiro, Figueira da Foz, Setubal et Sines) pour protester contre un projet du gouvernement de mettre en place des contrats de travail temporaires ou intermittents et de favoriser la précarisation des emplois. La moitié des salariés du secteur portuaire risquent ainsi de perdre leur travail.
Norvège
Environ 10 % des 6515 employés du secteur pétrolier s’étaient mis en grève le 24 juin pour réclamer des hausses de salaires et le droit de partir à la retraite à 62 ans. La Norvège est le premier producteur de pétrole et de gaz naturel en Europe et cela constitue la 8ème richesse industrielle du monde. Brandissant aux côtés des grands groupes pétroliers, la menace du blocage à l’accès des plateformes offshore en Mer du Nord, le gouvernement “travailliste” a décrété au bout de 15 jours, le 7 juillet, la fin de la grève tout en convoquant une commission d’arbitrage. Cette manœuvre s’est opérée suite à une odieuse campagne idéologique présentant les ouvriers du secteur pétrolier comme des “nantis” et des “privilégiés”, alors que leurs conditions de travail, baptisées “antichambre de l’enfer”, sont parmi les plus pénibles et les plus dangereuses du monde, les exposant pendant de nombreuses heures au froid ou aux tempêtes. Malgré leurs protestations de pure forme et la menace de reprendre la grève dans quelques mois, les syndicats, ont appelé les ouvriers à la reprise immédiate du travail.
Argentine
Les employés du métro de Buenos Aires ont fait grève durant 10 jours, paralysant l’activité de la capitale du 3 au 13 août. Il s’agit de la plus longue grève du métro argentin depuis sa création en 1913. Les salariés demandaient une hausse de salaire de 28 % alors que la hausse annuelle du coût de la vie galope à 25 % par an. Au bout du compte, les syndicats ont appelé les travailleurs à suspendre leur grève, après la “concession” d’une augmentation salariale limitée à 23 %. Mais ce conflit sur un terrain revendicatif a surtout été exploité et dénaturé par la bourgeoisie et ses médias pour, d’une part, tenter de diviser les ouvriers entre employés et usagers du métro et, d’autre part, pour polariser l’attention sur un conflit interne à la bourgeoisie, opposant la présidente Cristina Kirchner de “centre gauche” au maire de “droite” de Buenos Aires, Mauricio Macri. Celui-ci avait signé en janvier dernier un accord de principe pour assumer la gestion du métro, incombant jusque là à l’État. Dans la foulée, il décide de doubler le tarif des tickets de transport. Par la suite, le sieur Macri, mettant en avant le non-respect par l’État de plusieurs clauses du contrat et notamment le mauvais état des wagons et l‘absence d’entretien du réseau, a décidé de renoncer à la gestion du métro. Le gouvernement a alors fait adopter par le Congrès une loi transférant à la ville la gestion du réseau, tandis que le parlement autonome de la capitale votait de son côté une loi transférant l’administration du métro à l’État. Et ce sont les travailleurs, non seulement les employés du métro, mais tous les prolétaires usagers des transports en commun, qui ont fait les frais de cette guerre entre deux clans bourgeois, avec la complicité active des syndicats et leur sale boulot de division.
Turquie
Le secteur des transports est un secteur crucial pour le capitalisme. Pour cette raison, le transport aérien a une grande signification. Un mouvement de grève lancé par le personnel naviguant de la compagnie aérienne nationale, la Turkish Airlines, a paralysé les 29 et 30 mai, le grand aéroport d’Istambul, avec des centaines de vols annulés et d’importants retards. La durée du travail dans le secteur des transports aériens peut en effet s’élever à 16 ou 18 heures par jour en Turquie ! Certaines compagnies obligent même les équipages en cabine à dormir dans la même pièce pour réduire le coût du travail quand ceux-ci sont en dehors de leur résidence. Les navigants doivent ainsi travailler pendant de longues heures en n’ayant dormi que 2 ou 3 heures avant, au mépris de leur santé, de leur vie sociale et de leurs besoins humains. Avant que la grève n’éclate, le ministre de l’industrie avait lancé une véritable provocation en menaçant d’interdire le droit de grève “dans des secteurs stratégiques comme les transports”. Les syndicats, qui n’avaient pourtant rien fait quand des centaines de travailleurs avaient été licenciés à l’aéroport Sabiha Gokeen à Istanbul, ou quand on les avait contraints à travailler davantage d´heures pour des salaires de misère, ont adressé un message “urgent” aux travailleurs les appelant à “exercer leur droit de grève”. Et les travailleurs ont effectivement déclenché une grève “illégale” le 29 mai, ce qui a servi de prétexte aux licenciements par Turkish Airlines. Ainsi, lors d’un piquet de grève, 305 grévistes, essentiellement des femmes, recevaient ce SMS sur leur téléphone portable leur signifiant simplement : “votre contrat de travail a été annulé”. Tout cela démontre que ces attaques de la bourgeoisie ont été menées main dans la main avec les syndicats.
Il était nécessaire, pour les travailleurs, de lutter non seulement contre l’administration de Turkish Airlines et le gouvernement, mais aussi contre les syndicats dont ils étaient membres. Ainsi, l’Association du 29 mai, formée par les travailleurs des compagnies aériennes en tant qu’organe de lutte indépendant des syndicats, a déclaré, à l’image de la Plate-forme des Ouvriers en lutte qui a surgi suite à la lutte de Tekel : “l’administration du syndicat Hava-Is, dont nous sommes membres, a joué un grand rôle dans le fait que cette protestation justifiée ait été déclarée “illégale” en ne prenant même pas la responsabilité d’une action à laquelle ils avaient appelé eux-mêmes. Les patrons de Turkish Airlines comptent bien tirer profit de cette situation pour éliminer des employés et les rendre quasiment esclaves. Est-ce que l’administration de Havas-Is manquait à ce point d’expérience qu’elle ne pouvait prévoir ce qui allait se passer quand elle a laissé des centaines de ses membres seuls face à l’administration de Turkish Airlines ? Quelle sorte de mentalité syndicale cela reflète t-il ?”
La gauche bourgeoise a mené une campagne déplorant le manque de soutien des travailleurs au président du syndicat tandis qu’elle présentait l’Association du 29 mai comme les “diviseurs de la lutte”. Tout au contraire, mettant l’accent sur l’importance de la solidarité, l’Association du 29 mai n’a cessé de pousser à étendre la lutte pour défendre les intérêts de la classe ouvrière toute entière et à l’organisation d’assemblées ouvertes à tous les prolétaires.
Égypte
Plus de 23 000 salariés de la plus grande entreprise de textiles d’Égypte se sont mis en grève, dimanche 15 juillet, en réclamant une revalorisation de leurs salaires. L’usine de la société nationale Mir Spinning and Weaving, à Mahalla dans le delta du Nil, a déjà connu en 2008 des manifestations qui ont déclenché une vague de grèves à travers le pays, considérée par beaucoup comme le catalyseur du soulèvement qui a abouti à la chute d’Hosni Moubarak en février 2011. Sept mille grévistes de Misr Spinning and Weaving ont organisé un sit-in dans l’usine en réclamant une hausse des salaires de base, le renvoi de responsables corrompus et l’amélioration des conditions dans l’hôpital rattaché à l’entreprise. De nombreux salariés égyptiens, encouragés par le soulèvement du début 2011, ont fait grève ces derniers mois dans l’espoir d’obtenir des augmentations et une amélioration de leurs conditions de travail. La majeure partie de ces mouvements sociaux ont pris fin, mais certains arrêts de travail continuent d’être observés de temps à autre. Des manifestations ont lieu devant le palais présidentiel au Caire depuis l’élection de Mohamed Morsi, membre des Frères musulmans. Nombre de ces rassemblements portent sur les questions du chômage et des salaires.
Tunisie
La ville de Sidi Bouzid, berceau du “printemps arabe” et du mouvement qui a conduit à la chute du président Ben Ali, a connu le mardi 14 août une grève générale extrêmement suivie et une manifestation “pour la liberté d’expression et contre la répression”, rassemblant environ 2000 personnes : les protestataires réclamaient la libération d’une quarantaine de personnes arrêtées dans la région depuis fin juillet lors de manifestations contre les difficultés sociales et les coupures d’eau et d’électricité. La population locale, et plus globalement du bassin minier attendent toujours l’aide promise. Il y a ceux qui attendant le versement d’indemnités à tous les proches des victimes du soulèvement de janvier 2011. Il y a aussi ceux qui ne supportent plus les coupures d’eau ou d’électricité récurrentes et ceux qui désespèrent d’être au chômage. C’est la misère et le chômage qui ont d’ailleurs été au cœur du soulèvement de décembre 2010. Depuis, la situation n’a pas changé et les manifestations comme les conflits sociaux se sont multipliés ces dernières semaines dans le pays, face à un gouvernement dominé par les islamistes d’Ennahda. Une manifestation rassemblant plusieurs milliers de personnes a également eu lieu à Tunis le 13 août pour la protection du droit des femmes.
Arno, 31 août
Récent et en cours:
- Luttes de classe [15]
Rubrique:
Les manifestations au Japon sont une expression indignée face à la barbarie capitaliste
- 1286 lectures

Depuis le mois d’avril, une tempête de même nature que celle initiée par le “printemps arabe”, qui avait encouragée ailleurs une multitude de mobilisations de populations “indignées” dans le monde (Espagne, Grèce, États-Unis, Canada, etc.), souffle sur l’archipel japonais. Et comme pour bon nombre de ces mouvements, nous assistons de nouveau à un véritable black-out de la part de la bourgeoisie et de ses grands médias aux ordres. Au Japon même, en dehors des lieux cristallisant le mécontentement, c’est un silence identique à celui des autres moyens d’information démocratiques occidentaux. Ainsi, par exemple, une manifestation de plus de 60 000 personnes, à Tokyo, a pu être complètement occultée aux yeux du grand public. Selon les termes même d’un journaliste japonais “indépendant”, M Uesugi, “au Japon, le contrôle des médias est pire que la Chine et semblable à l’Égypte” (1).
Ces manifestations, de quelques centaines de personnes en avril, passant rapidement à quelques milliers par la suite, ont débouché sur une véritable vague de colère qui s’est amplifiée. Ainsi, au début du mois de juillet, affluant des diverses contrées (région de Tohoku – nord-est –, île de Kyushu – sud –, Shikoku – sud-est –, Hokkaido – nord –, Honshu – centre-ouest –), les protestataires ont convergé en nombre à proximité du parc Yoyogi à Tokyo pour investir la rue. Rapidement, une “manifestation monstre” atteignait près de 170 000 mécontents. On n’avait pas vu pareille manifestation contre les conditions de vie depuis les années 1970. La dernière en date, d’une relative ampleur, en 2003, était contre la guerre en Irak.
Le facteur déclencheur de ce mécontentement est lié au traumatisme de Fukushima, à la forte indignation face aux mensonges des autorités nippones et à leur volonté de poursuivre un programme nucléaire kamikaze. Le dernier plan national prévoyait la construction de 14 nouveaux réacteurs d’ici 2030 ! Suite à la catastrophe de Fukushima, le gouvernement n’a pas trouvé mieux pour “rassurer” et préparer son plan que de dire aux populations : “Vous n’allez pas être affectés immédiatement. (...) Ce n’est pas grave, c’est comme prendre l’avion ou subir des rayons”. Quel cynisme ! Il n’est pas étonnant que la population très en colère demande “l’arrêt du nucléaire”, à commencer par la centrale d’Hamaoka, à 120 km de Nagoya, située sur une zone de subduction fortement sismique.
Outre la massivité qui a été une surprise pour les organisateurs eux-mêmes, on retrouve le même rôle dynamique joué par Internet, par twitter et la nouvelle génération, en particulier les étudiants et les lycéens. Pour bon nombre, il s’agissait de leur première mobilisation. Parmi les manifestations quasi-hebdomadaires qui se sont succédées, certaines ont été organisées par des lycéennes de Nagoya via les réseaux sociaux et par une nébuleuse de groupes antinucléaires (2). Des critiques fusent de partout sur le Web, les vidéos se multiplient et les sites alternatifs s’étoffent. Un peu à l’image du blog d’un ancien ouvrier de la centrale d’Hamaoka, dénonçant les mensonges sur la prétendue “sécurité” des installations nucléaires, les esprits s’animent. Un étudiant à Sendai (Nord-est), Mayumi Ishida, souhaite pour sa part “un mouvement social avec des grèves” (3). Ce mouvement exprime ainsi en profondeur l’accumulation des frustrations sociales liées à la crise économique et à l’austérité brutale. En cela, ce mouvement au Japon se rattache bel et bien aux autres expressions de ce mouvement international des “indignés”.
Des gens très en colère n’hésitent donc plus à prendre la parole, même s’il est difficile d’en rendre compte faute d’informations précises.
Bien entendu, comme partout ailleurs, ce mouvement présente de grandes faiblesses, notamment des illusions démocratiques et des préjugés nationalistes marqués. La colère reste largement canalisée et encadrée par les syndicats et surtout, en l’occurrence, les organisations antinucléaires officielles. Des élus locaux frondeurs, par leur démagogie et leurs mensonges, réussissent encore souvent à entraîner derrière eux des mécontents en les isolant les uns des autres, en poussant à des actions stériles, exclusivement focalisées contre tel ou tel projet de l’industrie nucléaire et surtout contre le Premier ministre “fusible” Naoto Kan.
Malgré ces nombreuses faiblesses, ce mouvement au Japon est symboliquement très important. Il démontre non seulement que son isolement relatif des autres fractions du prolétariat (lié à des facteurs géographiques, historiques et culturels) tend en partie à être dépassé (4) mais aussi que toute la propagande nauséabonde des médias bourgeois sur la prétendue “docilité” des ouvriers japonais repose sur des préjugés destinés à briser l’unité internationale des exploités.
Progressivement, les ouvriers du monde entier commencent à entrevoir la force sociale qu’ils sont potentiellement capables de représenter pour le futur. Peu à peu, ils apprennent que la rue est un espace politique qu’il leur faudra investir par une lutte solidaire. Ils pourront alors retrouver, au Japon comme ailleurs, dans l’élan d’une force révolutionnaire internationale, les moyens de détruire le capitalisme et de construire une société libérée de l’exploitation et ses barbaries. Il s’agit là d’un long, très long chemin, mais c’est aussi et surtout le seul qui mène vers le règne de la liberté.
WH, 21 juillet
1) http ://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/201111/fukushima-occuper-tokyo-des-manifestations-de-ma [92]
4) Voir notre série publiée en 2003 sur l’histoire du mouvement ouvrier au Japon, in Revue internationale nos 112 [95], 114 [96], 115 [97].
Géographique:
- Japon [98]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [15]
Rubrique:
Espagne : La pire des attaques à nos conditions de vie, comment riposter ?
- 1209 lectures
Voici un tract avec lequel notre section en Espagne dénonce la pire attaque contre les conditions de vie de la classe ouvrière, une attaque qui paraîtra pourtant “légère” en comparaison à celles qui vont venir. C’est aussi une analyse de la situation, qui essaie d’apporter des solutions aux dernières luttes.
En 1984, le gouvernement du PSOE (Parti socialiste, de gauche) imposa la première Réforme du travail ; il y a tout juste trois mois, le gouvernement actuel du PP (Parti populaire, de droite) a mis en place la plus grave des Réformes du travail connue jusqu’ici. En 1985, le gouvernement du PSOE fit la première Réforme des retraites ; en 2011, un autre gouvernement de ce même PSOE en imposa une autre. Pour quand la prochaine ? Depuis plus de 30 ans, les conditions de vie des travailleurs ont empiré graduellement, mais depuis 2010 cette dégradation a pris un rythme frénétique et, avec les nouvelles mesures gouvernementales du PP, elle a atteint des niveaux qui, malheureusement, sembleront bien bas lors des futures attaques. Il y a, par-dessus le marché, un acharnement répressif de la part de la police : violence contre les étudiants à Valence en février dernier, matraquage en règle des mineurs, usage de balles en caoutchouc utilisées, entre autres, contre des enfants. Par ailleurs, le Congrès est carrément protégé par la police face aux manifestations spontanées qui s’y déroulent depuis mercredi dernier et qui s’y sont renouvelées dimanche 15 juillet...
Nous, l’immense majorité, exploitée et opprimée, mais aussi indignée ; nous, travailleurs du public et du privé, chômeurs, étudiants, retraités, émigrés..., nous posons beaucoup de questions sur tout ce qui se passe. Nous devons tous, collectivement, partager ces questionnements dans les rues, sur les places, sur les lieux de travail, pour que nous commencions tous ensemble à trouver des réponses, à donner une riposte massive, forte et soutenue.
L’effondrement du capitalisme
Les gouvernements changent, mais la crise ne fait qu’empirer et les coupes sont de plus en plus féroces. On nous présente chaque sommet de l’UE, du G20, etc., comme la “solution définitive”... qui, le jour suivant, apparaît comme un échec retentissant ! On nous dit que les coupes vont faire baisser la prime de risque, et ce qui arrive est tout le contraire. Après tant et tant de saignées contre nos conditions de vie, le FMI reconnaît qu’il faudra attendre… 2025 (!) pour retrouver les niveaux économiques de 2007. La crise suit un cours implacable et inexorable, faisant échouer sur son passage des millions de vies brisées.
Certes, il y a des pays qui vont mieux que d’autres, mais il faut regarder le monde dans son ensemble. Le problème ne se limite pas à l’Espagne, la Grèce ou l’Italie, et ne peut même pas se réduire à la “crise de l’euro”. L’Allemagne est au bord de la récession et déjà, il s’y trouve 7 millions de mini-jobs (avec des salaires de 400 €) ; aux Etats-Unis, le chômage part en flèche à la même vitesse que les expulsions de domicile. En Chine, l’économie souffre d’une décélération depuis 7 mois, malgré une bulle immobilière insensée qui fait que, dans la seule ville de Pékin, il y a 2 millions d’appartements vides. Nous sommes en train de souffrir dans notre chair la crise mondiale et historique du système capitaliste dont font partie tous les Etats, quelle que soit l’idéologie officielle qu’ils professent –“communiste” en Chine ou à Cuba, “socialiste du xxie siècle” en Équateur ou au Venezuela, “socialiste” en France, “démocrate” aux Etats-Unis, “libérale” en Espagne ou en Allemagne. Le capitalisme, après avoir créé le marché mondial, est devenu depuis presque un siècle un système réactionnaire, qui a plongé l’humanité dans la pire des barbaries (deux guerres mondiales, des guerres régionales innombrables, la destruction de l’environnement...) ; aujourd’hui, depuis 2007, après avoir bénéficié de moments de croissance économique artificielle à base de spéculation et de bulles financières en tout genre, il est en train de se crasher contre la pire des crises de son histoire, plongeant les États, les entreprises et les banques dans une insolvabilité sans issue. Le résultat d’une telle débâcle, c’est une catastrophe humanitaire gigantesque. Tandis que la famine et la misère ne font qu’augmenter en Afrique, en Asie et en Amérique latine, dans les pays “riches”, des millions de personnes perdent leur emploi, des centaines de milliers sont expulsées de leur domicile, la grande majorité n’arrive plus à boucler les fins de mois ; le renchérissement de services sociaux ultra-réduits rend l’existence très précaire, ainsi que la charge écrasante des impôts, directs et indirects.
L’Etat démocratique c’est la dictature de la classe capitaliste
Le capitalisme divise la société en deux pôles : le pôle minoritaire de la classe capitaliste qui possède tout et ne produit rien ; et le pôle majoritaire des classes exploitées, qui produit tout et reçoit de moins en moins. La classe capitaliste, ce 1 % de la population comme le disait le mouvement Occupy aux États-Unis, apparaît de plus en plus corrompue, arrogante et insultante. Elle cumule les richesses avec un culot indécent, se montre insensible face aux souffrances de la majorité et son personnel politique impose partout des coupes et de l’austérité... Pourquoi, malgré les grands mouvements d’indignation sociale qui se sont déroulés en 2011 (Espagne, Grèce, Etats-Unis, Egypte, Chili etc.), continue-t-elle avec acharnement à appliquer des politiques contre les intérêts de la majorité ? Pourquoi notre lutte, malgré les précieuses expériences vécues, est si en dessous de ce qui serait nécessaire ?
Une première réponse se trouve dans la tromperie que représente l’Etat démocratique. Celui-ci se présente comme étant “l’émanation de tous les citoyens” mais, en vérité, il est l’organe exclusif et excluant de la classe capitaliste, il est à son service, et pour cela il possède deux mains : la main droite composée de la police, des prisons, des tribunaux, des lois, de la bureaucratie avec laquelle elle nous réprime et écrase toutes nos tentatives de révolte ; et la main gauche, avec son éventail de partis de toutes idéologies, avec ses syndicats apparemment indépendants, avec ses services de cohésion sociale qui prétendent nous protéger..., qui ne sont que des illusions pour nous tromper, nous diviser et nous démoraliser.
A quoi ont-ils servi, tous ces bulletins de vote émis tous les quatre ans ? Les gouvernements issus des urnes ont-ils réalisé une seule de leurs promesses ? Quelle que soit leur idéologie, qui ont-ils protégé ? Les électeurs ou le capital ? À quoi ont servi les réformes et les changements innombrables qu’ils ont faits dans l’éducation, la sécurité sociale, l’économie, la politique, etc. ? N’ont-t-ils pas été en vérité l’expression du “tout doit changer pour que tout continue pareil” ? Comme on le disait lors du mouvement du 15-Mai : “On l’appelle démocratie et ça ne l’est pas, c’est une dictature mais on ne le voit pas.”
Face à la misère mondiale, révolution mondiale contre la misère !
Le capitalisme mène à la misère généralisée. Mais ne voyons pas dans la misère que la misère ! Dans ses entrailles se trouve la principale classe exploitée, le prolétariat qui, par son travail associé – travail qui ne se limite pas à l’industrie et à l’agriculture mais qui comprend aussi l’éducation, la santé, les services, etc. –, assure le fonctionnement de toute la société et qui, par là même, a la capacité tant de paralyser la machine capitaliste que d’ouvrir la voie à une société où la vie ne sera pas sacrifiée sur l’autel des profits capitalistes, où l’économie de la concurrence sera remplacée par la production solidaire pour la pleine satisfaction des besoins humains. En somme, une société qui dépasse le nœud de contradictions dans lesquelles le capitalisme tient l’humanité prisonnière.
Cette perspective, qui n’est pas un idéal mais le fruit de l’expérience historique et mondiale de plus de deux siècles de luttes du mouvement ouvrier, paraît cependant aujourd’hui difficile et lointaine. Nous en avons déjà mentionné une des causes : on nous berce avec l’illusion de l’Etat démocratique. Mais il y a d’autres causes plus profondes : la plupart des prolétaires ne se reconnaissent pas comme tels. Nous n’avons pas confiance en nous-mêmes en tant que force sociale autonome. Par ailleurs, et surtout, le mode de vie de cette société, basé sur la concurrence, sur la lutte de tous contre tous, nous plonge dans l’atomisation, dans le chacun pour soi, dans la division et l’affrontement entre nous.
La conscience de ces problèmes, le débat ouvert et fraternel sur ceux-ci, la récupération critique des expériences de plus de deux siècles de lutte, tout cela nous donne les moyens pour dépasser cette situation et nous rend capables de riposter. C’est le jour même (11 juillet) où Rajoy a annoncé les nouvelles mesures que quelques ripostes ont immédiatement commencé à poindre. Beaucoup de monde est allé à Madrid manifester sa solidarité avec les mineurs. Cette expérience d’unité et de solidarité s’est concrétisée les jours suivants dans des manifestations spontanées, appelées à travers les réseaux sociaux. C’était une initiative, hors syndicats, propre aux travailleurs du public ; comment la poursuivre en sachant qu’il s’agit d’une lutte longue et difficile ? Voici quelques propositions :
La lutte unitaire
Chômeurs, travailleurs du secteur public et du privé, intérimaires et fonctionnaires, retraités, étudiants, immigrés, ensemble, nous pouvons. Aucun secteur ne peut rester isolé et enfermé dans son coin. Face à une société de division et d’atomisation nous devons faire valoir la force de la solidarité.
Les assemblées générales et ouvertes
Le capital est fort si on laisse tout entre les mains des professionnels de la politique et de la représentation syndicale qui nous trahissent toujours. Il nous faut des assemblées pour réfléchir, discuter et décider ensemble. Pour que nous soyons tous responsables de ce que nous décidons ensemble, pour vivre et ressentir la satisfaction d’être unis, pour briser les barreaux de la solitude et de l’isolement et cultiver la confiance et l’empathie.
Chercher la solidarité internationale
Défendre la nation fait de nous la chair à canon des guerres, de la xénophobie, du racisme ; défendre la nation nous divise, nous oppose aux ouvriers du monde entier, les seuls pourtant sur lesquels nous pouvons compter pour créer la force capable de faire reculer les attaques du capital.
Nous regrouper
Nous regrouper dans les lieux de travail, dans les quartiers, par Internet, dans des collectifs pour réfléchir à tout ce qui se passe, pour organiser des réunions et des débats qui impulsent et préparent les luttes. Il ne suffit pas de lutter ! Il faut lutter avec la conscience la plus claire de ce qui arrive, de quelles sont nos armes, de qui sont nos amis et nos ennemis !
Tout changement social est indissociable d’un changement individuel
Notre lutte ne peut pas se limiter à un simple changement de structures politiques et économiques, c’est un changement de système social et, par conséquent, de notre propre vie, de notre manière de voir les choses, de nos aspirations. Ce n’est qu’ainsi que nous développerons la force de déjouer les pièges innombrables que nous tend la classe dominante, de résister aux coups physiques et moraux qu’elle nous donne sans trêve. Nous devons développer un changement de mentalité qui nous ouvre à la solidarité, à la conscience collective, lesquelles sont plus que le ciment de notre union, mais aussi le pilier d’une société future libérée de ce monde de concurrence féroce et de mercantilisme extrême qui caractérise le capitalisme.
CCI,16 juillet
Géographique:
- Espagne [25]
Rubrique:
En Syrie, les grandes puissances gesticulent, les massacres continuent
- 1229 lectures

Voilà plus d’un an et demi que les politiciens occidentaux de tous bords et les médias se penchent avec compassion sur le sort de la population syrienne. On n’entend plus partout que cette incessante litanie : Bachar el-Assad est responsable de “crimes contre l’humanité”. Et en effet, les tueries en règle opérées par le régime syrien s’accumulent avec une effrayante régularité et se sont même notablement accélérées cet été, malgré les appels de l’ONU à cesser les combats. “Droit dans ses bottes”, le dictateur de Damas poursuit une œuvre de mise au pas et de destruction de la “rébellion” syrienne avec détermination, déclarant récemment que “cela [la guerre actuelle] nécessite encore du temps” et que la vague d’exil est au fond “une opération d’auto-nettoyage de l’Etat, premièrement, et de la nation en général”.
Depuis le 15 mars 2011, selon l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme, on dénombre 23 000 morts. Et combien des 200 000 blessés resteront estropiés à vie, ou ne survivront pas à leurs blessures ? Il faut dire qu’Assad leur laisse peu de chances, puisque c’est jusque dans les hôpitaux qu’il bombarde et envoie ses troupes pour mieux écraser et terroriser. Al-Qoubir, Damas, Rifha, Alep, Deraâ, dernièrement Daraya, etc., toutes ces villes-martyres sont le symbole de la brutalité extrême qui se répand dans tout le pays.
S’ajoute à cela une situation de catastrophe humanitaire. Les vivres, le lait pour les enfants, les médicaments (quant aux soins, n’en parlons pas), l’eau manquent de façon catastrophique dans la plupart des villes et dans des régions entières. Les maisons sont détruites en masse et un grave manque d’abris se fait déjà sentir. Les coupures d’électricité durent souvent de 4 à 5 jours pour revenir à peine une heure comme à Alep.
Fuyant les combats et les exactions de l’armée d’Assad mais aussi de l’Armée Syrienne de Libération, de plus en plus pointée du doigt comme responsable de certains massacres, près de 300 000 personnes ont pris la route de l’exil. Que ce soit au Sud de la Syrie, vers le Liban et la Jordanie, au Nord vers la Turquie, et même en Irak, des masses de réfugiés s’agglutinent dans des camps de misère, dans l’attente désespérée de revenir un jour chez eux... où tout est détruit.
Au total ce serait plus de 2,5 millions de personnes, femmes, enfants, personnes âgées, qui sont selon l’ONU en “situation de détresse”.
Evidemment, ces chiffres alarmants sont un prétexte à verser des flots de larmes de crocodile pour les sensibles dirigeants de la planète. On pouvait par exemple entendre, entre autres, Fabius, ministre des Affaires étrangères français, clamer qu’il s’agissait d’une “situation intolérable et inacceptable”. On ne pourrait qu’applaudir des deux mains ces fortes paroles paraissant l’expression d’une révolte légitime devant tant d’horreurs, et accourir apporter son obole au fonds de l’ONU pour la Syrie, s’il ne s’agissait pas d’une lamentable et cynique mascarade.
Le 27 août dernier, François Hollande déclarait : “Je le dis avec la solennité qui convient : nous restons très vigilants avec nos alliés pour prévenir l’emploi d’armes chimiques par le régime [syrien] qui serait pour la communauté internationale une cause légitime d’intervention directe.” Cette intervention emboîtait le pas à celle de Barack Obama qui avait affirmé peu avant que cette question de l’utilisation des armes chimiques constituerait une “ligne rouge” et une raison d’envoyer des troupes contre l’Etat syrien. Autrement dit, tant que les tueries se font à l’arme “traditionnelle”, autrement dit “à la loyale” (!), ça va, c’est “honnête”, c’est de “bon aloi”. Mais attention à la “ligne rouge” !
La tartufferie infecte de la bourgeoisie se montre une fois de plus à l’envi dans cette situation dramatique. Ils menacent tous d’intervenir depuis de longs mois, pour ne pas être en mesure de faire quoi que ce soit, les passades diplomatiques se succédant les unes aux autres, plus hypocrites les unes que les autres. Et même s’ils intervenaient, ce ne serait en aucun cas pour soutenir la population mais pour ouvrir la porte à une nouvelle foire d’empoigne dont les Syriens feraient inévitablement les frais et cela ne constituerait qu’une escalade dans l’horreur.
Car cette guerre de prétendue “libération” ou de “lutte pour la démocratie” est une guerre impérialiste tout court, dans laquelle sont engagées toutes les puissances régionales et au premier chef les principales, Etats-Unis, Russie, Chine, France et Grande-Bretagne. L’implication et la responsabilité de tous ces gangsters ne se manifestent pas seulement par leurs gesticulations à l’ONU ou ailleurs, mais est déjà active par l’armement et/ou l’argent qu’ils fournissent aux deux camps syriens (1).
La question de la création d’une zone-tampon en Syrie à la frontière avec la Turquie, afin d’offrir un soi-disant abri aux dizaines de milliers de réfugiés qui affluent, et dont on nous rebat les oreilles, est une vaste fumisterie ; parce qu’elle ne serait pas viable du fait de l’opposition d’Assad, et nécessiterait quasiment la guerre ouverte avec Damas, justement du fait qu’il s’agirait d’une base arrière de presque tous les requins en présence, sous la bannière de la “défense de la paix” avec au bout du compte tout autant de risques pour les réfugiés. Il faut en ce sens se rappeler avec quelle attention l’ONU, et la France qui en était responsable, avait laissé massacrer des milliers de gens à Srebrenica en Bosnie en 1995 par les troupes de Milosevic.
Si l’ONU intervient, il faudra se souvenir de la sollicitude avec laquelle les Afghans ont été traités depuis 2001, puis les Irakiens, au nom de la lutte “contre le terrorisme” ou bien de celle “pour la démocratie”, et ce qu’il en reste : des champs de ruines et des millions de gens offerts en pâture aux bandes armées de telle et telle clique avec pour perspective la misère et une soumission aux volontés de chefs de guerre plus arriérés les uns que les autres.
Il faut encore se remettre en mémoire la sournoiserie et la violence qui ont présidé à l’établissement des protectorats français et britannique dans cette région du Moyen-Orient au moment de l’effondrement de l’Empire ottoman, lors de la Première Guerre mondiale, et de l’accord Sykes-Picot de 1916 qui était un dépeçage en règle de la Syrie et de l’Irak, sur fond de promesses “libératrices” aux Arabes, et de tueries récurrentes. La bourgeoisie est toujours pleine de bonnes intentions pour cacher ses véritables objectifs et ne peut que surenchérir de mensonges pour les réaliser.
Soyons certains d’une seule chose, c’est que ce qui se passe aujourd’hui sous nos yeux est l’expression, non pas seulement de la folie d’Assad, mais aussi de ce monde décadent. Et c’est sans ambiguïté, quelle que soit l’évolution de ce drame, le prélude à une aggravation sans précédent de la situation de tout le Moyen-Orient. Les conséquences en seront désastreuses, comme on le voit déjà avec l’extension actuelle du conflit au Liban.
Wilma, 31 août
1) Il faut souligner le culot de la Russie qui prétend livrer à Assad des hélicoptères de combat qui étaient en “réparation”, et celui des Etats-Unis qui prétendent ne fournir que “des moyens de communication”, bien qu’ils procurent notoirement à l’ASL des armes antichars par le biais de l’Arabie Saoudite, du Qatar et du Koweït. La France, qui vend des caméras thermiques à la Russie pour ses chars, et dont ne sont prétendument pas équipées les troupes syriennes, n’est pas en reste dans le registre de l’hypocrisie crasse.
Géographique:
- Moyen Orient [16]
Rubrique:
Pour les Roms, le changement, c’est maintenant ! ... et plus ça change, plus ça empire
- 1329 lectures

Comme son prédécesseur, le gouvernement socialiste a profité de l’été pour mobiliser ses flics contre les Roms. Les forces de répression se sont ainsi livrées à une véritable “chasse à l’homme” dans les banlieues de Lille et de Lyon. Rien de tel, en effet, que la période estivale, où les gens sont en vacances, pour utiliser la politique du “nettoyage au Kärcher” sans risquer de trop fortes oppositions de la part des populations !
Le fait que les socialistes poursuivent la même politique que l’UMP ne doit surprendre personne. Dans les années 1980, le gouvernement socialiste avait déjà instauré un véritable arsenal répressif contre les immigrés (1). L’association “La voix des Roms” a d’ailleurs pu ironiser sur le fait que le nouveau ministre de l’Intérieur Manuel Valls “pourrait porter les couleurs de l’UMP en 2017”. Il ne s’agit donc nullement d’une “trahison”, même si, pendant sa campagne présidentielle, François Hollande avait hypocritement déclaré : “On ne peut pas continuer à accepter que des familles soient chassées d’un endroit sans solution” (2).
En réalité, l’acharnement sur les populations fragiles, comme celle des Roms, très marginalisées et faciles à criminaliser, est une pratique généralisée de la bourgeoisie. Tous les gouvernements, partout, quelle que soit leur couleur politique, sont obsédés par “l’ordre public” et recherchent sans cesse des bouc émissaires face à la crise. Ainsi, presque au moment même où Valls et ses flics réprimaient en France, la police grecque engageait à Athènes une vaste opération de chasse aux migrants, baptisée “Xénos Zeus”, au cours de laquelle elle a arrêté 1595 personnes et interpellé 6000 autres. Tout cela pour criminaliser et rendre responsables de la situation sociale dramatique les sans-papiers qui sont, en réalité, les premières victimes de la crise économique ! C’est dans ce sens que le ministre grec Nikos Denias a tenu ces propos nauséabonds : “Au nom de votre patriotisme et de l’instinct de survie du citoyen grec, je vous demande de soutenir cet effort. La question de l’immigration illégale est l’un des grands problèmes du pays (!) avec celui de l’économie” (3). La violence de la police grecque a été telle qu’un Irakien traqué a même trouvé la mort.
La bourgeoisie italienne utilise les mêmes méthodes de chasse aux Roms : très régulièrement, des camps sont brutalement détruits à Milan et à Rome. En Allemagne, même si le passé nazi de ce pays impose une certaine discrétion, les 10 000 Roms qui avaient fui la guerre au Kosovo attendent, dans la crainte, d’être chassés car Berlin a décidé d’opérer des expulsions à hauteur de 2500 personnes par an. Même dans un pays “social” comme la Suède, où 80 % des Roms sont sans emploi, la simple mendicité est un prétexte à l’expulsion. Cinquante Roms on déjà été expulsés cette année (4). On pourrait multiplier les exemples où la terreur, la traque et le mépris sont la règle.
La mise “sous surveillance” de la France par la Commission européenne à propos de la “gestion” des Roms n’est donc qu’une pure hypocrisie, tout comme les propos mensongers et complices des politiciens qui adoptent les mêmes tactiques de communication pour mystifier les populations. Ainsi, Manuel Valls, qui prétend pourtant que sa politique n’a “rien à voir” avec la méthode de Nicolas Sarkozy, utilise exactement les mêmes propos défensifs que Bernard Kouchner lorsqu’il défendait l’ancien président pour couvrir des pratiques identiques : “Jamais le Président de la République n’a stigmatisé une minorité en fonction de son origine” (5). Un véritable copier-coller ! De même, Michel Rocard, à l’époque où œuvrait l’équipe Sarkozy, s’exclamait : “On n’a pas vu cela depuis les nazis !” En réponse, les mêmes prétextes à propos de “l’insalubrité”, de la “criminalité” et des “troubles à l’ordre public” étaient invoqués par la majorité au pouvoir.
En réalité, derrière les discours creux et hypocrites se cache la froide et insensible mécanique du capital. La classe ouvrière ne peut qu’exprimer son indignation et sa colère face à une telle inhumanité.
1) Loi Joxe, arrestation et reconduites aux frontières par charters entiers sous la houlette de la ministre Édith Cresson, etc.
2) Cité in www.ldh-france.org [99]
3) www.lepoint.fr [100]
5) Cité in RI no 415.
Rubrique:
Cosmopolis, un réquisitoire poétique et radical contre le capitalisme
- 1142 lectures
Autant l’avouer, même parmi les cinéphiles acclimatés aux petites salles associatives, certains films sont propices aux cruels préjugés. Cosmopolis, de David Cronenberg, est un exemple parfait de ces remords qui vous saisissent tandis que vous patientez tristement dans la file d’attente qui conduit à la billetterie. D’emblée le titre a de quoi effrayer : référence directe à Metropolis de Fritz Lang, le film de Cronenberg éveille plus d’un doute sur la modestie de son réalisateur. Encore un film prétentieux à vingt millions de dollars sur la finance pourrie et les banquiers véreux ? La critique est d’ailleurs impitoyable : les spectateurs qui ont survécu à l’immonde bande-annonce quittent massivement les salles de cinéma avant la fin du film et les journalistes sont particulièrement virulents ; d’autres, ce qui est probablement pire, jouent les intellectuels verbeux sans visiblement rien comprendre. Et la présence à l’affiche de Robert Pattinson, à la fois acteur principal du film et coutumier des navets pour midinettes, n’arrange rien.
Mais qu’est-ce que Cosmopolis ? C’est d’abord un scénario baroque tiré d’un ouvrage du même nom. Le milliardaire Eric Packer n’a qu’un désir : aller chez son coiffeur ! A l’intérieur de sa limousine blindée, sur le long chemin qui le conduit vers son objectif insignifiant, le capitalisme s’effondre, la population se soulève, des émeutes éclatent. Dès le début du film, deux personnes pénètrent dans un café où le milliardaire s’est arrêté quelques instants. Des rats dans les mains, qui serviront d’ailleurs d’étalon monétaire imaginaire, ils crient les premières lignes du Manifeste communiste de 1848 : “Un spectre hante le monde !”… désormais celui du capitalisme. Mais rien ne semble détourner Packer de son objectif délirant, pas même l’abstraite et mystérieuse menace qui pèse sur lui.
Ce film est plus qu’une critique superficiellement radicale du capitalisme et de ses dérives, typique du cinéma, artistiquement excellent au demeurant, des années 1970. Packer est plus qu’un milliardaire cynique, bien plus qu’un trader diabolique, c’est un symbole, celui du capitalisme lui-même. La clef pour pleinement pénétrer le film est là : à la manière des personnages de Ana y los lobos, de Carlos Saura, illustrations de la composition sociale de l’Espagne franquiste, ceux de Cosmopolis sont des métaphores, des incarnations qui dépassent l’individu proprement dit. Packer verra ainsi défiler sa fiancée, incarnation du milieu artistique, la directrice des théories, un médecin, plein des illusions et des aveuglements des experts bourgeois pour qui tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, le garde du corps, image des forces de répression, un employé au chômage, prolétaire s’élevant difficilement à la conscience de sa force, ainsi qu’à l’inconsistance des banderilles flamboyantes de ce monde “mort depuis cent ans” et duquel il a pourtant tellement espéré : “Je voulais que vous me sauviez !”
Si le film sous-estime le rôle fondamental de l’État dans le capitalisme décadent, son auteur est néanmoins parfaitement conscient du caractère vain des fausses révoltes, des actions symboliques et inoffensives. Un individu, qu’on croit dans un premier temps être la mystérieuse menace, vient ainsi entarter Packer avec un gâteau à la crème. Sous les flashs nourris des photographes, une véritable simulation de bagarre s’ensuit. Après un discours ridicule, vantant ses faits d’arme insignifiants, l’entarteur n’a plus qu’à piteusement ajouter : “Bon, ben… on s’en va !” Loin des fanfaronnades pseudo-héroïques, pour Cronenberg, la révolution est une chose sérieuse, une confrontation violente, une mise à mort radicale de la société bourgeoise.
Mais le réalisateur paraît conscient des limites de l’exercice : comment dénoncer un monde à la dérive avec un film si coûteux, financé par une partie de ceux qui ont justement tout intérêt à le défendre ? Par l’intermédiaire de la fiancée de Packer, Cronenberg répond très honnêtement à cette question. Artiste très fortunée, elle se plait à jouer la déshéritée dans son taxi ou ses bars miteux, et se pique même de critiquer, superficiellement certes, son amant. Dans la chute, si elle décide de prendre publiquement ses distances, simule même la rupture, elle ne peut que continuer à soutenir secrètement le capitalisme. Elle cristallise ainsi toutes les contradictions de l’exercice qui, s’il est une critique vigoureuse contre le capitalisme, obéit malgré tout à ses lois. C’est l’occasion d’une réflexion intéressante sur l’art sous le règne des producteurs et autres vendeurs d’art.
Alors, comment expliquer la réception négative d’une large partie du public ? D’abord, le film est particulièrement dense. Un peu à l’image des œuvres de Stanley Kubrick, Cronenberg n’a rien laissé au hasard. Bien qu’il se soit appuyé sur l’ouvrage de Don De Lillo pour les dialogues, chaque scène, chaque phrase, chaque image donnent à réfléchir. Chaque détail est chargé de sens dans un tout cohérent. Il est vrai qu’un bagage politique sérieux et plusieurs visionnages sont nécessaires pour saisir l’ensemble des éléments du film, tant les références au mouvement ouvrier et à la littérature politique sont nombreuses, tant les détails sont signifiants. Mais il est vraiment rare, vu le prix d’une place de cinéma, que les spectateurs désertent les salles si massivement et si irrités avant la fin d’un film, fut-il mauvais. Il y a sans doute quelque chose de plus fondamental. Beaucoup de personnes ont probablement vu quelque chose qu’ils n’ont pas l’habitude de voir, une forme de claque qui les a peut-être heurtés dans leurs représentations immédiates. Cosmopolis n’est pas une simple démonstration rigoureuse, à laquelle il est possible de répondre par d’autres arguments. S’il s’agit bien d’une critique radicale du capitalisme, elle est d’abord poétique. La force des grands artistes, c’est de donner à leur œuvre une dimension émotionnelle qui pénètre naturellement l’esprit et vient, d’une façon ou d’une autre, titiller la froide mécanique de la raison. Que ces œuvres fassent fuir ou qu’elles enthousiasment, qu’elles heurtent ou qu’elles transportent, elles produisent quelque chose de difficilement explicable et de complexe : l’émotion.
El Generico, 31 juillet
Rubrique:
La liberté sexuelle est impossible dans le capitalisme
- 1284 lectures
Nous publions ici un article écrit par un de nos très proches sympathisants en collaboration avec des militants du CCI. Nous voulons saluer la volonté du camarade de contribuer aux discussions en cours et à la clarification d’une des questions sociales les plus brûlantes de notre époque – les “droits” des gays – d’un point de vue de classe. Nous voulons aussi exprimer notre avis sur ce que le camarade a choisi de cibler en écrivant cet article. Nous pensons qu’il est rafraîchissant d’aborder la question sous l’angle des émotions humaines. Nous sommes aussi d’accord avec la compréhension et l’argumentation politique du camarade. Nous invitons tous nos contacts proches à collaborer avec des militants du CCI pour écrire sur des questions qui aident à la clarification et à l’émancipation des pensées de la classe ouvrière.
Le “débat” sur le “droit” des gays ou des lesbiennes de se marier légalement et de bénéficier, grâce à cette reconnaissance légale, des avantages financiers attribués aux couples hétérosexuels mariés – le bénéfice allant au dernier survivant étant parmi les plus chaudement contestés – est depuis longtemps une de ces questions que la classe dominante sort périodiquement de son chapeau, pour en faire un thème à sensation, notamment en période électorale. Dans cet article, nous voulons mettre en évidence l’hypocrisie de la classe dominante, de gauche, du centre et de droite, qui traite de la question soit d’un point de vue “humaniste” – la gauche et le centre – soit avec une approche moraliste/religieuse, à droite. L’administration Obama aime se présenter comme “libérale” et “progressiste”, d’où ses appels à revenir sur les lois anti-mariage gay passées au niveau de certains États (tout récemment par référendum en Caroline du Nord), sans toutefois essayer de faire du mariage gay un “droit” constitutionnel. La droite a besoin de répondre aux craintes et à l’exagération de l’insécurité de sa base électorale particulièrement conservatrice, d’où le discours anti-mariage gay du candidat du Parti républicain, Mitt Romney. Tout le “débat” est en réalité un stratagème de l’administration Obama pour attirer la jeunesse et “les indépendants d’esprit” en plus de l’électorat gay et pousser Romney à se discréditer vis-à-vis des Évangélistes s’il ne réagit pas clairement et avec force contre le mariage gay. Le glissement encore plus à droite de Romney risque de lui aliéner le secteur indécis et indépendant de l’électorat. Il est clair que cette gesticulation légaliste est complètement hypocrite. Elle vise à utiliser une situation, qui est certainement vécue comme dramatique et humiliante par les gays et les lesbiennes, pour nourrir les divisions, l’animosité et autres incompréhensions pour un profit politique. De plus, l’opposition véhémente par moments au mariage gay exprimée par la droite ne doit pas nous faire croire que la légalisation d’un aspect de la vie personnelle contrarierait d’une certaine manière le système établi de l’exploitation capitaliste.
Aujourd’hui, si vous allumez la télévision et zappez sur n’importe quelle chaîne d’information importante, il y a toutes les chances que vous tombiez sur le “débat sur les droits des gays”. C’est intéressant de voir comment les médias bourgeois insistent sur les différences personnelles entre humains, en nous montrant où nous sommes le moins d’accord en tant que personnes. Mais la bourgeoisie et ses porte-parole dans la presse sont extrêmement hypocrites. Surtout quand la “partialité” est tellement désapprouvée dans le climat politique actuel. Maintenant, certaines fractions de la classe dominante affirment soutenir le mariage gay. Plus encore, elles affirment le faire avec un sentiment humaniste plus profond, se référant souvent à la lutte pour les droits des gays, comme à un combat pour “l’égalité” ou “les droits civils”.
Alors nous devons nous demander : “égalité” au nom de quoi ? Et pour quelles personnes dans la société ? “L’égalité devant le mariage” est-elle même une revendication adéquate de la classe ouvrière ? La liberté sexuelle est-elle-même possible dans le capitalisme ? En tant que travailleurs, nous devons répondre par la négative à toutes ces questions. Construire un monde libéré de l’homophobie et de l’hétéro-sexisme, dans lequel chaque individu est vu et traité comme un être humain plutôt qu’une catégorie est impossible dans le capitalisme.
Depuis quelques temps, des éléments de la classe politique bourgeoise plaident pour la reconnaissance du mariage entre même sexe. Leurs arguments sont souvent codés dans un langage qui interpelle les ouvriers. Ils disent que la légalisation du mariage entre même sexe améliorerait la qualité de vie des travailleurs homosexuels, puisqu’ils auraient accès à des avantages pour les assurances, le divorce, les droits de propriété, etc. Mais dans le capitalisme, les rapports humains sont réduits à une question d’échange. Les émotions ne sont que de simples produits de consommation et de finances pour la bourgeoisie. Nous pouvons voir ainsi le besoin de légaliser le mariage entre personnes du même sexe, mais qu’en est-il du concept du mariage lui-même dans le capitalisme ?
Marx et Engels ont écrit dans le Manifeste du parti communiste que “la bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité touchante qui recouvrait les rapports familiaux et les a réduits à de simples rapports d’argent”. Plus loin, ils continuent : “le prolétaire est sans propriété ; ses relations avec sa femme et ses enfants n’ont plus rien de commun avec celles de la famille bourgeoise. Sur quelle base repose la famille bourgeoise actuelle ? Sur le capital, le profit individuel. La famille n’existe, sous sa forme achevée, que pour la bourgeoisie.”
Ainsi, selon la définition de Marx et Engels du mariage dans le capitalisme, nous pouvons commencer à comprendre que “droits égaux devant le mariage” est un terme qui ne s’applique qu’à ceux qui peuvent s’offrir les avantages du mariage. Des droits qui ne s’appliquent qu’à des classes propriétaires, qu’aux gens qui peuvent s’offrir un mariage légal au départ. Le mariage concerne fondamentalement les droits de propriété et d’héritage. Il a défini historiquement quelles personnes la classe dominante juge dignes d’être propriétaires et même quels gens pouvaient eux-mêmes être possédés ! A l’origine bien sûr, mariage voulait dire possession de la femme et de ses biens par le mari. Aux yeux de la bourgeoisie, le mariage n’a rien à voir avec le respect mutuel et l’amour – c’est une affaire de possession, d’appropriation et de droits de propriété.
Pourquoi avons-nous besoin que la bourgeoisie nous dise ce qu’est le mariage et avec qui on peut, ou pas, se marier ? Comme nous l’avons écrit auparavant dans Internationalism no 130 et dans d’autres articles de la presse du CCI, une société communiste sera au contraire “une société au-delà de la famille dans laquelle les rapports humains seront régulés par l’amour mutuel et le respect et pas par la sanction d’une loi d’État”.
L’État démocratique bourgeois et ses agents ne posent jamais des questions sur les droits des gays en terme de besoins humains. Quels sont les besoins des gays et des lesbiennes ? Ou même quels sont les besoins des êtres humains en général ? Il ne fait aucun doute que la répression des communautés gays soit réelle. Nous voyons l’homophobie, l’hétéro-sexisme, le patriarcat se manifester partout dans le capitalisme ; dire autre chose est simplement démenti. L’intimidation de la jeunesse gay et homosexuelle, par exemple, a récemment été qualifiée d’“épidémique” par les médias bourgeois. Beaucoup d’événements traumatisants au cours desquels des homosexuels ont été agressés conduisent à des dépressions et même, dans quelques cas, au suicide.
Est-ce que la bourgeoisie s’occupe de résoudre ces questions ? Quelle législation parlementaire ? Existe-t-il des lois, des amendements qui concernent ces problèmes sociaux ? Non ! Le débat est presque toujours enfermé dans le cadre de la religion ou du moralisme, surtout dans les médias à grande audience, et particulièrement dans la rhétorique de la classe dominante. Car tous les discours si vantés – tout le charabia légaliste – sur les “droits de l’homme”, qui sont approuvés par l’État capitaliste et reconnus sous couvert du droit, ne peuvent rien faire pour extirper la bigoterie religieuse et moraliste vieille de plusieurs siècles. Les gens religieux sont “blâmés” pour leur attitude arriérée, ce qui contribue à polariser sur cette atmosphère de chasse aux sorcières. Dans des situations comme celle-ci, légaliser le mariage entre personnes du même sexe ne peut qu’aider l’État capitaliste à apparaître comme une entité “juste” et “bienfaisante”.
Même s’il y a une once de sincérité dans le soutien de la classe dominante au mariage entre personnes du même sexe, cela vient de leur besoin de détourner l’attention des travailleurs et de les noyer dans le cirque de la politique électorale et du légalisme. Bien sûr, il est vrai que le soutien croissant à la liberté sexuelle fait partie du développement par l’humanité d’une plus grande compréhension scientifique et d’un plus grand sentiment de solidarité humaine générale. Mais la classe dominante n’en a rien à faire, et pourquoi s’en ferait-elle ? Si vous avez de l’argent, vos droits ne sont jamais menacés ou en débat. “L’égalité devant le mariage” n’est pas identique à une bonne relation ou à une égalité économique : elle revient à une domination de classe accrue par la bourgeoisie.
Les luttes sociales qui ne concernent que partiellement les problèmes fondamentaux du capitalisme, tout en étant l’expression de problèmes sociaux réels qui existent dans notre société, détournent la classe ouvrière de ses discussions et devoirs révolutionnaires. Nous avons déjà discuté de comment la bourgeoisie peut se fixer sur le débat sur les droits des gays, presque jusqu’à l’obsession. Mais cette fixation existe aussi chez les prétendus “révolutionnaires”.
Beaucoup de gens utilisent un langage exclusivement en direction des travailleurs, pour les “organiser” autour d’une question sociale large, qui traverse les classes. L’argument selon lequel les droits des gays nous rapprocheraient “d’une pleine égalité” est complètement hors de propos, un principe fondamental des communistes étant que l’égalité pleine et entière est impossible sous le capitalisme. Pourquoi les révolutionnaires lutteraient-ils pour se “rapprocher” d’une société égalitaire ? Nous devons nous dresser contre toutes les injustices du capitalisme à la fois ! Beaucoup de ces mêmes “révolutionnaires” qualifient les décisions électorales et légales en faveur du mariage gay de “victoires” pour les travailleurs. Mais ces victoires ne font rien d’autre que conforter le recours à la société civile bourgeoise.
Les politiques légalistes, démocratistes, n’ont rien à offrir à la classe ouvrière. La véritable émancipation de l’humanité ne peut venir que de la révolution de la classe ouvrière. Les travailleurs soutiennent toujours les gays et les homosexuels, surtout dans une société où ils sont considérés comme étrangers et ridiculisés de si terrible manière. Mais nous devons être vigilants à l’égard des campagnes bourgeoises qui entourent ces débats. Bien souvent, elle nous détournent et nous dévoient du but final : en finir avec toutes les formes de répression et d’exploitation de qui que ce soit sur terre.
Jam, 11 juin
Rubrique:
Révolution Internationale n°436 - octobre 2012
- 1926 lectures
Espagne, Grèce, Portugal, Italie: face à la crise, la colère grandit, comment passer de l’indignation à l’espérance ?
- 2013 lectures

Le 15 septembre dernier, 700 000 personnes sont descendues dans la rue à Lisbonne et dans une trentaine de villes du Portugal pour manifester contre la politique d’austérité menée par le nouveau gouvernement de Pedro Coelho. La majoration brutale de 7 % des cotisations-sociales (TSU, Taxe sociale unique) des travailleurs, jointe à la diminution de 5,75 % des cotisations du patronat ont été à l’origine de cette réaction spontanée de colère qui a débordé les syndicats officiels. C’est effectivement exclusivement à travers les réseaux sociaux que se sont organisées ces manifestations. Devant la massivité de cette mobilisation, le gouvernement a momentanément fait semblant de reculer. Mais il ne faut pas se faire d’illusions, c’est pour mieux mettre en œuvre les mêmes mesures et d’autres, demain, avec l’accord et l’aide des syndicats comme la CGTP (Confédération générale des travailleurs portugais) qui auront bien balisé le terrain cette fois-ci, comme ils l’ont fait depuis plus d’un an, pour contribuer à faire passer les programmes d’austérité qui s’accumulent. D’ailleurs, la CGTP a très vite réagi ; pour retrouver le contrôle du mouvement, elle appelait immédiatement à une nouvelle manifestation encadrée par ses soins et sous ses mots d’ordre dès le samedi 29 septembre, manifestation qui s’est révélée être bien moins suivie.
En Grèce, suite au troisième mot d’ordre de grève générale donné par les syndicats, dont le plus suivi est le Pame, de nouvelles manifestations ont eu lieu mercredi 26 septembre à Salonique et à Athènes, auxquelles ont participé plus de 30 000 travailleurs. La colère est telle qu’on a vu une nouvelle fois de violents affrontements avec la police, et cette fois-ci même entre policiers en grève et forces de l’ordre !
En Espagne, des dizaines de milliers de manifestants sont venus crier leur rage le mardi 25 septembre devant un parlement protégé par 2000 policiers, avec des débordements de violence policière “comme à l’époque de Franco”, selon de nombreux témoins. Samedi 29, à peine cinq jours plus tard, preuve de la profonde exaspération, le parlement s’est retrouvé de nouveau encerclé toute la soirée.
En Italie encore, 30 000 fonctionnaires étaient dans la rue vendredi 28 à Rome pour protester contre un nouveau train de mesures d’austérité sur les retraites et les “reclassements”.
Bref, la dernière semaine de septembre a été marquée par une montée de la colère dans de nombreux pays d’Europe face à la brutalité des attaques et l’annonce sans fin de nouveaux plans d’austérité.
Ces luttes sont NOS luttes
Évidemment, devant toutes ces mesures drastiques, les responsables désignés par les gouvernements comme par les partis d’opposition et les syndicats, ce sont les membres de la fameuse “troïka” composée de l’Union européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international. Tout ce joli monde veut nous faire croire encore que le problème de la crise pourrait se régler pays par pays et s’efforce d’enfoncer dans les têtes l’illusion que tout le monde n’est pas logé à la même enseigne, qu’il est possible pour certains d’éviter le pire, pour d’autres de se relancer, en faisant les “efforts nécessaires”. Ainsi, les reportages sur la situation économique des fameux PIIGS (Portugal, Irlande, Italie, Grèce et Espagne) n’ont pour but que de conforter l’idée fausse selon laquelle en France, par exemple, les choses iraient mieux. Non, cela ne va pas mieux ! D’ailleurs, les mesures sociales en trompe-l’œil du gouvernement Ayrault vont vite montrer ce qu’elles sont : des attaques pures et simples contre nos conditions de vie et de travail. Et c’est le sort de toute la classe ouvrière, partout dans le monde, une classe qui subit le même joug de l’exploitation pour toujours être moins en mesure de survivre, et la matraque si elle se révolte.
La bourgeoisie fait tout son possible pour empêcher la prise de conscience que partout les ouvriers sont attaqués et que ce sentiment d’appartenir à une même classe ne prenne chair dans les rangs des travailleurs au niveau international. C’est pourquoi les médias ne parlent que très peu, sauf si c’est trop gros, et de toute façon toujours très ponctuellement ou en montrant de préférence la violence repoussoir d’affrontements, les faiblesses ici et là, des nombreuses manifestations qui se déroulent de par la planète. Et c’est pourquoi, pour nous, exploités, il est au contraire absolument nécessaire de regarder autant dans les livres que par dessus les frontières, de discuter des expériences de luttes, passées et présentes, et ainsi tirer les leçons pour les luttes à venir (1.
Qui sont nos ennemis ?
Il n’y a pas d’issue à cette crise ; cela doit être clair et sans ambiguïté, bien que le désir d’un avenir économique plus radieux soit un espoir qui tient à tout un chacun. La paupérisation et la misère sont le lot du futur pour tous dans ce système capitaliste. Cela fait plus de trente ans qu’on nous annonce quotidiennement que ça ira mieux demain si nous consentons des sacrifices aujourd’hui. Mais chaque sacrifice ouvre la porte à un autre encore pire ! Il ne s’agit même pas de mauvaise volonté de la part des capitalistes ou des Etats, c’est la plongée dans la faillite inexorable qui exige cette loi implacable de la brutalité grandissante des attaques )(2.
Alors, comment faire, comment se battre ? Malgré la montée de la colère, qui se traduit par des affrontements de plus en plus réguliers avec la police, les journées d’action montrent qu’elles ne servent à rien. On voit bien depuis des décennies que cette forme “d’action” ne sert que de défouloir stérile et de quadrillage d’une classe ouvrière mise bien en rang derrière les banderoles syndicales, souvent saucissonnée par “corporations”, et prise entre les barrières de la police et le bruit des hauts parleurs des meneurs syndicaux empêchant toute discussion.
La classe ouvrière le ressent plus ou moins, mais si elle n’affirme pas consciemment et massivement la claire compréhension qu’elle doit prendre elle-même ses luttes en main, sur le terrain de ses revendications propres, les avancées du mouvement risquent de rester lettre morte.
A ce titre, l’exemple de l’Espagne est très frappant. L’an dernier, le mouvement des Indignés a été une réelle et puissante démonstration de la volonté de la population et de la classe ouvrière de se retrouver collectivement, en-dehors des syndicats, pour chercher et discuter des moyens de lutte contre les attaques et exprimer son écœurement face aux conditions de misère imposées par l’Etat espagnol. Le plus significatif fut cette création d’espaces de discussion dans les rues à travers de multiples assemblées générales libres et ouvertes à tous et cette ouverture aux souffrances et aux combats menés partout dans le monde. En Espagne, lorsqu’un ouvrier venu “d’ailleurs” prenait le micro pour se porter solidaire du mouvement et parfois raconter comment cela se passait d’où il venait, la sympathie était immédiate et palpable, l’accueil chaleureux et enthousiaste. A ce moment-là, nul drapeau, ni national ni régional, n’était visible, et ceux qui voulaient restreindre la lutte aux combats indépendantistes n’étaient pas particulièrement les bienvenus, en tout cas leurs discours n’entraînaient aucune adhésion. Et le mouvement des Indignés n’est pas resté enfermé dans les frontières hispaniques, il a “fait des petits” dans de très nombreux pays, jusqu’en Israël ou aux Etats-Unis avec le mouvement des “Occupy”.
La bourgeoisie est, elle, consciente du danger potentiel que représente le mûrissement des telles idées “saugrenues” (à ses yeux) dans les cerveaux des exploités ; elle sait qu’il n’est jamais bon, de son point de vue, qu’un sentiment de solidarité DANS la lutte naisse entre les ouvriers, encore moins à l’échelle internationale. Aujourd’hui, en cette fin septembre, une contre-offensive de la bourgeoisie est donc menée, elle tente d’instiller progressivement le poison nationaliste et régionaliste dans l’ensemble de la classe ouvrière. Ainsi, lors de la journée du 15 septembre, le sommet social (autrement dit : CO, UGT () et 200 autres plateformes) a été appelé à Madrid sous le slogan : “Il faut empêcher qu’ils nous volent le pays”. Le 25 septembre, un essaim d’organisations, un éventail qui allait des regroupements ayant une histoire trouble jusqu’à des formations plus ou moins classiques de la gauche du capital (le PC ou la Gauche anticapitaliste), en y incluant les restes décomposés du 15M, ont promu une action de “désobéissance civile” pour protester “contre la séquestration de la souveraineté nationale perpétrée par les marchés”, tournant autour de la Chambre des députés. On sait que le tout s’est soldé par des affrontements (où la provocation d’éléments “troubles” était évidente) avec les flics… pour rien. Le jour d’après, les syndicats les plus exaltés (autrement dit : CGT et CNT ()) appelaient, avec des syndicats nationalistes (ELA, LAB, etc3.), à une autre grève générale dans certaines parties de l’Etat, etc., et dans d’autres, à une journée de lutte. C’est-à-dire à lier les ouvriers derrière les intérêts nationalistes, qui ne sont pas les leurs.
De telles récupérations sont possibles, comme on l’a vu le 15 septembre à Barcelone où un million de personnes ont participé à une manifestation nationaliste catalane ! Et représentent un danger réel et grave pour la classe ouvrière et l’avenir de ses luttes.
Ce que représentait encore le mouvement des Indignés dès ses débuts et que les discussions en son sein ont montré, c’était l’espoir dans un autre monde. Cet espoir, la confiance que la classe ouvrière doit développer en elle-même, doit développer et faire vivre dans ses luttes, sont de puissants et indispensables leviers pour dépasser les pièges qu’une bourgeoisie aux abois ne cessera de nous mettre dans les jambes et dans la tête. Cela permettra de se dégager des mouvements à répétition qui ne donnent rien, sinon la démoralisation et la démobilisation.
Cela ne viendra pas tout seul, par un coup de baguette magique, mais par la compréhension profonde que les seules perspectives qui s’ouvrent pour l’humanité sont celles que peuvent lui offrir la classe ouvrière, unie internationalement, pour ouvrir la voie vers le renversement d’un monde capitaliste en pleine déliquescence. La gravité de la crise, si elle fait grandir en nous une profonde colère, a aussi un aspect effrayant ; elle révèle qu’il ne s’agit pas de faire plier tel ou tel patron, tel ou tel ministre, mais bel et bien de changer radicalement le système, de lutter pour la libération de toute l’humanité des chaînes de l’exploitation. En sommes-nous capables ? Nous, la classe ouvrière, pouvons-nous accomplir une telle tâche ? Comment nous y prendre ? Face à la barbarie croissante et à l’incapacité de plus en plus manifeste du capitalisme à offrir autre chose que toujours plus de misère, toutes ces questions se posent et traînent dans les têtes, consciemment ou non. Le prolétariat a la force de retrouver confiance en lui-même, en sa capacité à s’unir et à faire vivre la solidarité en son sein… l’aube commence d’ailleurs à poindre à l’horizon. Quand ce jour viendra, ces mots de Karl Marx prendront alors tout leur sens : “Les révolutions prolétariennes […] se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà être accompli pour le recommencer à nouveau, raillent impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de leurs premières tentatives, paraissent n’abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre et de se redresser à nouveau formidable en face d’elles, reculent constamment à nouveau devant l’immensité infinie de leurs propres buts, jusqu’à ce que soit créée enfin la situation qui rende impossible tout retour en arrière, et que les circonstances elles-mêmes crient : Hic Rhodus, hic salta !” ( (le 18 Brumaire).
Wilma, 28 septembre
1) Voir nos articles sur la situation au Venezuela, en Turquie et en Espagne, pages 4 et 5 de ce numéro.
2) Nous retiendrons dans le registre Plus menteur, tu meurs !, le dernier éditorial de Lutte ouvrière qui explique qu’il n’y a même pas de crise, mais seulement des patrons qui s’en mettent plein les poches !
() Les Commissions ouvrières (CO) et l’Union générale de travailleurs (UGT) sont les syndicats largement majoritaires en Espagne. Le premier est historiquement lié au PC et le second au Parti socialiste.
() La CGT en Espagne est un syndicat anarchiste, scission du syndicat anarchiste historique CNT.
3) ELA et LAB sont deux syndicats nationalistes basques, le premier modéré (crée à l’origine pour contrer les syndicats marxistes et anarchistes) et le second est lié à la gauche abertzale (patriote).
() C’est ici qu’est la rose, c’est ici qu’il faut danser !
Rubrique:
Sahel: le Mali sombre dans le chaos et la barbarie
- 1432 lectures
Depuis le coup d’Etat militaire du 22 mars qui a mis le pays en lambeaux, le Mali baigne dans un chaos sanglant. Il est la proie de nombreux gangs et puissances impérialistes qui se disputent son cadavre. Tandis que des centaines de milliers d’habitants quittent leurs demeures pour tenter d’échapper aux massacres, d’autres, sur place, sont bastonnés systématiquement, abattus froidement, voire lapidés. Les habitants des villes et des campagnes vivent ainsi dans une misère et une insécurité effroyable que les forces armées sanguinaires se préparent encore à aggraver en généralisant les tueries au nom de la “libération” de la région Nord, entre les mains des groupes islamistes.
Voilà une situation on ne peut plus claire : un coup d’Etat dans le Sud, une rébellion qui ne vise désormais qu’à installer un Etat théocratique d’un autre âge dans le Nord, AQMI et consorts qui narguent le monde entier, leurs chefs, parmi les plus recherchés de la planète, qui se baladent tranquillement à Tombouctou ou à Gao et dont les crimes en série les enverraient aussi sûrement à la CPI [Cour pénale internationale] que tous ceux qui attendent leur procès dans les geôles de Scheveninge, à La Haye.
“A Bamako, le président de la transition, qui n’a pas grand-chose à se reprocher dans l’épreuve que traverse son pays, s’est fait lyncher pendant près d’une heure, devant des bidasses passifs, voire hilares, par des jeunes désœuvrés dont des politiciens, qui n’avaient aucune chance d’exister en dehors du chaos actuel, avaient savamment lavé le cerveau pour les inciter à commettre ce crime impardonnable. Le “sauveur de la nation”, Amadou Haya Sango, chef d’une junte qui a arraché le pouvoir des mains d’un président sur le départ, ne sauve rien du tout. (…) Et ses troupes ne se privent pas de torturer, bastonner et emprisonner arbitrairement tous ceux qui n’adhèrent pas à la “cause”.
[Face au] Mali qui sombre chaque jour un peu plus, on nous explique que tous les ingrédients d’une véritable bombe à retardement sont réunis. Qu’une nouvelle Somalie, plus proche et plus inquiétante, est en gestation. Tout le monde clame sa détermination à ne pas laisser AQMI s’installer et son indignation face à une telle descente aux enfers” ().
Voilà la parfaite description d’un Etat à terre et de sa population prise en otage par les gangsters civils, militaires et islamiques. Fidèles à leur réputation barbare, ces derniers n’ont pas tardé à mettre en branle leur machine à mutiler, à lapider, à expédier dans “l’enfer islamique” tous ceux qui ne se conforment pas à leur “charia”.
Voici une illustration caractéristique de la mentalité et des méthodes de cette “tribu” d’un autre âge qui règne sur Gao : “Gao n’est plus très loin. Le drapeau noir des salafistes flotte sur le barrage dressé au bord de la route. Le jeune qui nous arrête, mon chauffeur et moi, n’a pas plus de 14 ans. Il s’énerve en entendant la musique que crachote le vieil autoradio de notre véhicule. “C’est quoi, ça ? hurle-t-il en arabe.
“– Bob Marley.
“– Nous sommes en terre d’Islam et vous écoutez Bob Marley ? Nous sommes des djihadistes, nous ! Descendez de la voiture, nous allons régler ça avec la charia.
“Un chapelet dans une main, un kalachnikov dans l’autre, il me rappelle ces enfants-soldats croisés vingt ans plus tôt en Sierra Leone… Les enfants sont souvent plus féroces que les adultes. Nous nous empressons de l’assurer de notre fidélité à l’Islam, avant d’être autorisés à reprendre la route. (…) Venus d’Algérie ou d’ailleurs, tous se retrouvent au commissariat de police, rebaptisé siège de la “police islamique” : Abdou est ivoirien ; Amadou, nigérien ; Abdoul, somalien ; El Hadj, sénégalais ; Omer, béninois ; Aly, guinéen ; Babo, gambien… Il y a là toute l’internationale djihadiste ! Lunettes noires sur le nez, le bas du visage mangé par une barbe abondante, un Nigérian explique qu’il est un membre de la secte islamique Boko Haram, responsable de nombreux attentats dans le Nord de son pays. Il parle du Mali comme la “terre promise”, fustige l’Occident et les “mécréants”, et jure qu’il est “prêt à mourir”, si c’est la volonté de Dieu” ().
Ce que vivent les populations sous le “gouvernement” des diverses cliques maliennes, qui rivalisent en barbarie, est abominable. Mais, surtout, le monde bourgeois se fiche des souffrances des victimes en laissant pourrir sordidement la situation et en attendant cyniquement les monstrueux déchaînements qui se préparent.
La décomposition du Mali s’installe pour de bon
Après six mois de gesticulations et de marchandages entre brigands, une coalition hétéroclite de cliques maliennes vient de solliciter officiellement l’aide de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), cela “dans le cadre du recouvrement des territoires occupés du Nord et la lutte contre le terrorisme”. Selon le Monde du 8 septembre 2012, Paris, qui préside le Conseil de Sécurité de l’ONU, a aussitôt annoncé l’organisation d’une conférence internationale sur le Sahel, le 26 septembre à New York en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, dont l’appui est nécessaire pour une intervention militaire au Mali. Et de fait, les pays de la Cédéao n’attendent que le “feu vert” du Conseil de sécurité pour envoyer au front quelques 3300 soldats. On sait aussi que depuis le début de l’occupation du nord du pays par les islamistes, les grandes puissances, en particulier la France et les Etats-Unis, poussent en coulisse les pays de la zone à s’impliquer militairement au Mali en leur promettant financements et moyens logistiques.
En clair, après avoir embrasé le Mali en soutenant ou armant directement les bandes qui assassinent, Français et Américains, avec leurs rivaux, s’apprêtent à se lancer dans une nouvelle aventure guerrière sous prétexte d’aider le Mali à retrouver son “intégrité territoriale” et au nom de la lutte contre le “terrorisme islamiste”.
Malheureusement pour la classe ouvrière et les opprimés de cette région, toutes les forces bourgeoises autour de l’ONU et de l’UA-Cédéao, qui clament hypocritement leur “détermination” et leur “indignation” pour mieux justifier une intervention armée, ne vont certainement pas lancer la soldatesque dans le but de leur épargner la descente aux “enfers”. En effet, qui peut croire que les impérialismes français ou américain s’indignent sincèrement face à la misère que subissent les masses prolétariennes de cette région ? Qui peut penser que ces chefs de gangs s’activent sérieusement contre AQMI et consorts dans le seul but d’établir la “paix” et la “sécurité” des “peuples” de cette zone ?
A l’évidence, la réponse est : personne ! En vérité, nos grands barbares “démocrates” s’apprêtent à brûler toute la région simplement parce que leurs intérêts stratégiques et économiques y sont menacés directement par des groupes armés, empêchant de fait le “bon fonctionnement” des circuits économiques. D’ailleurs, c’est ce qu’il faut comprendre quand les autorités américaines et françaises parlent de “guerre contre les groupes terroristes” et pour la “sécurisation des zones d’approvisionnement des matières premières”. De même certains organes de la presse bourgeoise préparent les “opinions publiques” dans ce sens pour mieux justifier les massacres de masse : “Ce n’est plus une hypothèse, c’est une certitude : plus les jours passent, plus s’accentue la décomposition de cet Etat désormais éclaté, et plus le cauchemar stratégique, humanitaire et politique d’une somalisation du Mali hante l’Afrique de l’Ouest, le Maghreb et bientôt l’Europe. Même ceux qui, il y a deux mois, accordaient à la sécession du Nord quelques circonstances atténuantes par sympathie pour les revendications socio-économiques trop longtemps négligées des Touaregs, sont effarés par la mainmise brutale des groupes islamiques les plus intransigeants sur ce qui reste des populations de l’Azawad. Comment accepter que le terrorisme et les trafics en tous genres trouvent un sanctuaire en plein Sahel, sous le couvert de la charia et la bannière d’un djihadisme dévoyé ?” ()
En effet, de l’Algérie au Nigeria, de la Libye au Niger, du Soudan au Mali, du Tchad au Gabon en passant par la Côte d’Ivoire, toute cette partie de l’Afrique est bourrée des matières premières les plus recherchées dont le contrôle constitue un enjeu hautement stratégique. Donc, même s’ils savent parfaitement qu’ils vont y laisser des plumes, les divers charognards vont cyniquement entretenir le sanglant chaos. On sait que la France n’a jamais cessé d’intervenir militairement dans cette zone, notamment en Mauritanie et au Niger, en compagnie de troupes de ces pays pour protéger ses sociétés, comme AREVA qui exploite l’uranium nigérien. Les Etats-Unis ne sont également pas en reste comme le remarque à nouveau la revue Jeune Afrique : “Leur rôle [des Etats-Unis] est devenu encore plus vital depuis que le Nord du Mali est tombé entre les mains des islamistes et du Mouvement national pour la libération de l’Azawad. (…) La tension qui règne dans le nord malien incite aussi le Pentagone à renforcer sa présence en Mauritanie. (…) Actuellement, affirme le Washington Post, les Américains auraient débloqué plus de 8 millions de dollars pour rénover une base proche de la frontière malienne et mener des opérations de surveillance conjointes avec les forces mauritaniennes. Les deux autres points chauds qui incitent les Etats-Unis à mettre en branle leur dispositif sont le Nigeria, avec la montée en puissance de Bako Haram, et la Somalie (…). Devant le Congrès en mars dernier, le général Carter Ham (qui dirige l’Africom) a souligné : “Si nous ne disposons pas de bases sur le continent, nos moyens en RSR (renseignement, surveillance et reconnaissance) seraient limités et cela contribuerait à fragiliser la sécurité des Etats-Unis.” (...) Lors de son passage devant les parlementaires, le général Carter Hom a aussi déclaré qu’il souhaitait pouvoir établir une nouvelle base de surveillance à Nzara, au Soudan du Sud. Là encore, ce projet s’explique par le contexte local. Les tensions entre le Soudan et son voisin méridional riche en hydrocarbures ne laissent pas indifférent Washington, qui doit assurer la sécurité des compagnies pétrolières présentes dans la région”.
On ne peut être plus clair : le grand gang américain et ses concurrents vont pulvériser toute la région du Sahel, à commencer par le Mali, dans le seul but de sécuriser (entre autres) les zones “riches en hydrocarbures”.
Le Mali n’est pas seulement un “Afghanistan africain” mais le visage du capitalisme moribond
Voilà un pays en décomposition totale qui ne peut offrir aucune perspective vivable à sa population et à ses enfants livrés à eux-mêmes, dont nombreux sont ceux qui, pour survivre, se laissent manipuler ou se font recruter de force par divers mafieux et autres trafiquants qui les transforment en soldats ou en mercenaires. Voilà comment de simples hommes victimes de la misère du capitalisme peuvent devenir, du jour au lendemain, des tueurs, des “apprentis bourreaux” d’une grande cruauté. Tous ces jeunes, chômeurs et éternels sans travail, tous ces “sans rien” se trouvent à la merci de tous les brigands criminels assoiffés de profits et de sang : “démocrates” civils ou militaires, putschistes, nationalistes indépendantistes, “djihadistes” et autres vrais “fous de Dieu”.
Amina, 9 septembre
() Jeune Afrique du 14 juillet 2012.
() Récit d’un journaliste de Jeune Afrique, 4 août 2012.
() Jeune Afrique, 16 juin 2012.
Géographique:
- Afrique [23]
Rubrique:
Film anti-islamiste et manifestations salafistes: haine, obscurantisme et manipulation médiatique
- 1299 lectures

Le film paru sur YouTube le 11 septembre dernier, Innocence of muslims, selon tous les avis d’une rare stupidité et d’une médiocrité à l’avenant, produit par un petit malfrat californien prétendument de confession copte, a été le centre de l’attention internationale durant une quinzaine de jours. En effet, cette dénonciation en règle du prophète Mahomet et de ses disciples, présentés, entre autres caricatures, comme des individus immoraux, pédophiles et brutaux, a provoqué des réactions dans l’ensemble du monde musulman. Ces manifestations de colère ont débouché sur des affrontements et des exactions visant principalement les intérêts des Etats-Unis, allant jusqu’au meurtre de l’ambassadeur américain en Libye.
De nombreuses choses ont été dites sur ces réactions conduites par des radicaux salafistes. Tout cela a bien sûr été allégrement monté en épingle par les médias occidentaux. Car on n’a pas dénombré en tout plus de quelques dizaines de milliers de manifestants épars, de la Tunisie au Daccar indien, en passant par le Yémen. Ce qui, au regard des centaines de millions de musulmans qui peuplent le monde arabe, sans compter les millions de musulmans qui vivent en Europe ou en Amérique, est tout à fait dérisoire.
Il ne s’agit bien sûr pas de minimiser la violence qui s’est exprimée, mais ces événements ont été délibérément grossis pour stigmatiser le “péril musulman”. Pour l’Allemagne, Angela Merkel a fait part de sa “grande inquiétude”, tandis que, pour la France, Manuel Valls tremblait devant cette “menace contre la République” après la mini-manifestation qui s’était produite devant l’Élysée, “à l’insu” des pouvoirs publics. Les Etats-Unis réagissaient quant à eux par la voix d’Hillary Clinton en déclarant que les pays arabes n’avaient “pas troqué la tyrannie d’un dictateur pour celle des foules”, en référence aux “révolutions arabes” du printemps 2011. Jusqu’au pape qui, depuis le Liban, a appelé à “éradiquer” le fondamentalisme, musulman s’entend !
Dans ce concert de réactions offusquées des politiciens, certains commentateurs ont quand même relev0é l’évidente manipulation idéologique, de part et d’autre :
• D’un côté, qu’un tel film (1 sorte dans le contexte de tensions guerrières grandissantes avec la Syrie et l’Iran, mais aussi avec les islamistes radicaux du Mali et du Sahel, et qui plus est le 11 septembre, jour anniversaire de l’attaque des Twin Towers à New-York, qui avait provoqué en 2001 la mort de 4000 personnes puis l’invasion américaine contre les talibans en Afghanistan, vient à point nommé pointer du doigt la sauvagerie des extrémistes musulmans de par le monde.
• De l’autre, ces extrémistes musulmans ne pouvaient faire autrement que de tomber peu ou prou dans le panneau, en faisant preuve une nouvelle fois de leur potentiel destructeur, car ils se devaient de faire montre de leur détermination à en découdre avec l’Amérique et les puissances occidentales afin d’asseoir leur pouvoir grandissant vis-à-vis des autres cliques bourgeoises concurrentes.
Il est donc clair que nous avons eu affaire à une escalade des deux côtés, alors que se profile des interventions militaires et d’autres massacres qui seront justifiés par ce type de préparation idéologique.
Bien sûr, la bourgeoisie et toutes ses fractions, quelle que soit la religion, s’en servent incidemment pour diviser les ouvriers partout dans le monde, comme pour les terroriser, mais l’objectif premier, derrière les discours hypocrites appelant au « calme et à la raison », est de préparer à une nouvelle avancée dans la barbarie guerrière )(2.
Mulan, 28 septembre
1) Il faut aussi s’interroger sur le fait que cette vidéo est restée deux jours sur le site YouTube, filiale de Google, et lié de près au pouvoir américain, dont la charte précise : Nous n’autorisons pas les discours incitant à la haine, qui attaquent ou rabaissent un groupe en raison de la race, l’origine ethnique, la religion, le handicap, le sexe, l’âge, le statut de vétéran ou l’identité sexuelle.
2) Nous invitons les lecteurs à lire notre article : Une vallée de larmes dont la religion est l’auréole, page 8, pour plus de détails sur ce que représente la religion aujourd’hui.
Rubrique:
L’Etat renforce son dispositif sécuritaire pour mieux réprimer les luttes sociales
- 1570 lectures
Ah, qu’il est bon de se sentir en sécurité ! Voilà ce que tout bon travailleur devrait se dire en son for intérieur en se laissant envahir la nuit venue par le sommeil réparateur d’une journée harassante de labeur.
Car oui, vraiment, en matière de sécurité, le gouvernement ne peut pas être taxé d’attentisme ou d’inaction. C’est le moins que l’on puisse dire ! Alors que Claude Guéant avait à peine eu le temps de le rêver et que déjà on l’accusait à l’envi de crime liberticide, voilà que Manuel Valls, son successeur au ministère de l’Intérieur, le fait dans le plus grand calme. Le nouveau ministre n’a pas seulement créé quinze zones de sécurité prioritaires, où les moyens policiers seront significativement renforcés, il a aussi remis sur le tapis législatif la question de l’arrestation préventive.
De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’une idée qui avait germé suite à l’affaire Mohamed Merah à Toulouse, celle d’autoriser l’arrestation de quiconque dont le comportement pourrait laisser penser qu’il présenterait un risque pour la sécurité du pays. Pour étudier ce comportement alarmant, la police a le droit de surveiller les communications, de répertorier les pays visités, de garder trace de tous les sites internet visités. Rien de moins que la légalisation du délit idéologique. Vos idées sont... subversives ? Au trou ! Après tout, on ne sait jamais.
Avec de telles mesures, la France devrait rapidement être ramenée au calme. Mais aussi se couvrir de prisons !
On pourrait presque en rire si derrière tout cela ne se cachait des intentions qui nous conduisent plutôt à une sérieuse inquiétude. Bien sûr, il y a la crainte de la bourgeoisie de voir se développer le banditisme sur le terreau de la crise et le terrorisme sur celui des pressions impérialistes. La décomposition du système capitaliste conduit à un développement violent du chacun-pour-soi et d’une situation de moins en moins contrôlable. Il ne s’agit pas de nier que la bourgeoisie – véritable pompier pyromane – fait face à une vraie problématique sécuritaire et à de vraies menaces terroristes. Mais il n’y a pas que cela. Et pour s’en convaincre, il suffit simplement de s’intéresser à deux exemples voisins en Europe.
D’abord en Allemagne : là-bas existent depuis 1968 (sans doute un hasard), des lois d’urgence qui autorisent l’intervention de l’armée sur le sol national en cas de péril grave, et notamment des agissements d’insurgés armés et organisés. Jusque ici, ces lois étaient rangées bien haut sur les étagères. Un peu trop pour certains puisque la cour constitutionnelle a, le 17 août dernier, autorisé la Bundeswehr à exercer sur son propre sol dans des conditions pour le moins allégées : “en cas de situation exceptionnelle de nature catastrophique” (). D’habitude le droit est connu pour son attachement à la précision des termes. Là, les juristes vont pouvoir s’adonner à l’interprétation jusqu’au dégoût tellement la formule est floue !
Aurions-nous l’esprit assez tordu pour imaginer qu’une telle mesure soit prévue pour faire face à des luttes massives ? L’idée n’avait pas encore eu le temps d’être formulée totalement dans les esprits les plus aguerris que déjà la Cour répondait : non ! Sont exclus “les dangers pouvant émaner d’une foule qui manifeste”. Pourquoi tant d’empressement à le préciser ? Aurions-nous vraiment l’esprit tordu ?
Surtout que, deuxième exemple, d’autres pays ne prennent pas autant de gants. En Espagne, la bourgeoisie se remet avec peine des secousses ressenties autour de la place Puerta del Sol en 2011. L’homologue de Manuel Valls, Jorge Fernandez Diaz, en oublie carrément la langue de bois : désormais, le fait d’organiser par Internet des rassemblements protestataires sera qualifié de participation à une organisation criminelle (). Ceci pour, selon lui, mettre fin à une spirale de violence qui tourne à la guérilla urbaine. C’est qu’il a dû avoir très peur, le Monsieur, car déjà l’arsenal répressif et pénal de l’Espagne n’était pas parmi les plus laxistes sur le continent !
Qu’on se le tienne pour dit : émettre des idées remettant en cause la légitimité du pouvoir, ou même simplement chercher à les lire sur Internet, développer des contacts autour de ces idées, protester contre le pouvoir, chercher à s’organiser pour défendre ses intérêts et construire un rapport de force, tout cela peut nous conduire devant les juridictions pénales, en prison, sous les matraques de la police ou les flingues de l’armée. C’était déjà implicitement le cas, mais maintenant, c’est écrit noir sur blanc ! Ces mesures sont tout autant dirigées contre le banditisme ou le terrorisme que contre… la lutte de classe, elles en font même volontairement l’amalgame pour criminaliser par nature ceux qui refusent de laisser le système nous détruire sans réagir.
Si ces mesures doivent nous rendre conscients et lucides sur la détermination que mettra la bourgeoisie à s’affronter au développement des luttes, elles nous informent aussi, en négatif, de la menace que le prolétariat représente en perspective pour les intérêts du capitalisme. C’est une preuve de plus que l’avenir appartient bien à la lutte de classe.
GD, 26 septembre
() lemonde.fr
() legrandsoir.info
Situations territoriales:
Rubrique:
Espagne: pourquoi les syndicats nous mènent-ils toujours à la défaite?
- 1316 lectures
L’article que nous publions ci-dessous est paru dans Acción Proletaria, journal de la section du CCI en Espagne.
En septembre 2011, les travailleurs de l’enseignement à Madrid ont répondu aux 3000 licenciements et à l’allongement de la journée de travail par des assemblées générales massives unissant professeurs, étudiants et tous les travailleurs du secteur de l’enseignement. Les cinq syndicats de l’Education ont fait de leur mieux pour étouffer cette initiative afin de contrôler la lutte. Quel a été le résultat ? Les assemblées massives ont été remplacées par des “enquêtes” et des réunions de comités syndicaux, les professeurs sont restés isolés, les manifestations étaient chaque fois moins fréquentées. Finalement, la lutte s’est terminée et les mesures du gouvernement autonome ont fini par s’imposer.
En février 2012, les lycéens de Valence, qui ont subi une répression sauvage, sont descendus chaque jour dans la rue et ont appelé à la solidarité des travailleurs. Ce mouvement s’est étendu à toute l’Espagne et le gouvernement central a dû retirer ses mesures répressives. Les syndicats se sont empressés de prendre en mains la lutte contre la répression et la réforme du Code du travail. Ils ont organisé une journée de “grève générale”-défouloir, le 29 mars, qui fut une immense escroquerie. Devant la déception de nombreux travailleurs, ils ont promis de nouvelles mobilisations. Ils se sont limités à appeler à des manifestations pour la fin avril et le 1er mai. Résultat : l’Etat a appliqué la réforme du Code du travail avec toutes ses conséquences dramatiques.
Le 11 juillet, le gouvernement Rajoy a adopté le pire programme d’austérité depuis plus de cinquante ans. Les syndicats sont restés silencieux. Mais, le même jour, des manifestations spontanées ont éclaté, surtout à Madrid. Devant ce phénomène, les syndicats se sont “réveillés” et ont offert leurs “bons et loyaux services” : ils ont appelé à des manifestations dans toute l’Espagne, le 19 juillet. Mais, au vu de l’intérêt et la rage de la population, les syndicats – une fois de plus – ont reporté les actions à une date ultérieure, la plus lointaine possible : une marche sur Madrid pour le 15 septembre, un référendum pour octobre, une nouvelle journée de “grève générale” prévue pour on ne sait quand. Cela revient à balancer un seau d’eau glacée sur la combativité et la colère des travailleurs !
Des rencontres secrètes entre les syndicats et le gouvernement
Quelques jours après la manifestation du 19 juillet, nous apprenions que les chefs des CCOO et de l’UGT avaient rencontré, début juillet, Madame Merkel. Cette visite s’est doublée d’une autre au Palais de la Moncloa pour discuter avec Rajoy. L’objet de ces rencontres secrètes ne fait aucun doute : Merkel, le gouvernement espagnol et les syndicats ont pactisé pour, selon toutes probabilités, élaborer une stratégie contre les travailleurs.
Ainsi, avant la grève du 29 mars, Rajoy a rencontré séparément chaque leader syndical. La vice-présidente du gouvernement a même reconnu la tenue de 33 “réunions techniques” entre les représentants du gouvernement et les syndicats !
Ce n’est là nullement une nouveauté. Tout au long de l’histoire, de nombreux coups ont été portés aux travailleurs à travers des réunions secrètes entre ses ennemis déclarés (les gouvernements) et ses faux-amis (les syndicats et les partis de gauche). Quand en 1980-81, à l’époque du régime soi-disant “communiste”, une grève massive frappait la Pologne, le syndicat Solidarnosc a progressivement démobilisé les ouvriers pour faciliter le coup de grâce : l’Etat de siège décrété par le général Jaruzelski, alors chef de l’Etat, le 13 décembre 1981. Or, deux jours avant le coup d’Etat, une réunion secrète était organisée entre ce général, le cardinal primat de Pologne et le chef de Solidarnosc, Lech Walesa ! () Il ne faut pas être particulièrement clairvoyant pour comprendre que ce conciliabule a préparé la répression qui a envoyé à la mort des centaines d’ouvriers, en prison des milliers d’autres, et l’armée pour inonder les mines avec les mineurs prisonniers à l’intérieur !
Les syndicats mobilisent pour... démobiliser
Nous savons parfaitement ce que font les gouvernements et le patronat. Personne n’entretient plus aucune illusion sur eux. Ils ne cherchent d’ailleurs même plus à cacher leur volonté d’imposer les pires sacrifices aux travailleurs. Mais que font les syndicats ? Quel est leur rôle ?
Une première tâche des syndicats consiste à organiser des mobilisations qui, en réalité, démobilisent et divisent les travailleurs. Les actions de “lutte” des CCOO et de l’UGT servent uniquement à mouiller la poudre. Les appels syndicaux sont systématiquement à contretemps : quand les gens ont envie de lutter, les syndicats démobilisent et ne lancent aucun appel, tandis qu’ils multiplient les “actions de lutte” quand les gens sont fatigués et déboussolés. Beaucoup de personnes en ont marre des gesticulations des journées de “grève générale”, des “manifestations-ballades”, des luttes isolées, enfermées dans un secteur déterminé ou une entreprise particulière.
C’est à ce problème que la grève des mineurs a dû faire face. Ces derniers ont été enfermés dans une lutte pour “sauver les mines de la nation”. Toute la combativité et toute la colère ont été canalisées à travers des affrontements stériles avec la police pour bloquer les lignes ferroviaires ou les autoroutes. Cependant, le 11 juillet, lors de la marche des mineurs sur Madrid, beaucoup de travailleurs de la capitale ont rejoint la manifestation par solidarité et se sont eux-mêmes mis en lutte. Les syndicats ont alors hâtivement renvoyé les mineurs chez eux et ont annulé les appels à la lutte, en promettant des mobilisations futures à des dates très lointaines.
Le piège national
Les syndicats ont appelé à la manifestation du 19 juillet avec pour slogan : “Ils veulent couler le pays !” Selon eux, Merkel veut faire sombrer l’Espagne et le gouvernement Rajoy se comporte comme un domestique complaisant. L’objectif de la lutte aurait donc été de “sauver le pays” face à Merkel et à Rajoy.
Machiavel, le philosophe qui a inspiré depuis le xvi siècle les générations successives de gouvernements, disait que le bon homme d’Etat devait présenter ses intérêts particuliers comme étant l’intérêt de ses sujets. Un des meilleurs mensonges avec lequel la minorité exploiteuse assoit sa domination consiste à nous faire croire que la nation appartient à tous, qu’il s’agit d’une communauté dans laquelle les exploiteurs et les exploités ont un intérêt et un lien communs. Cet “intérêt commun” est le déguisement des intérêts particuliers et égoïstes des capitalistes.
Qu’est-ce que la nation ? La nation est la propriété privée d’un groupe de capitalistes qui opèrent dans un pays. Défendre la nation, c’est défendre cette propriété privée. En d’autres termes, nous, travailleurs, nous renonçons à nos propres intérêts et au futur de toute l’humanité pour servir de pions aux intérêts capitalistes, et, parfois, de chair à canon dans ses guerres contre les autres Etats capitalistes.
Rajoy ne cesse d’ailleurs de répéter que les mesures d’austérité sont prises “pour le bien de tous les Espagnols”. Chaque fois, de moins en moins de personnes croient en ce mensonge. Alors, comment continuer à faire crédit à la mystification selon laquelle l’intérêt national est “l’intérêt de tous” ? C’est ici qu’interviennent les syndicats pour rabattre les travailleurs sur des revendications interclassistes, en lien avec celles des policiers, des politiciens “honnêtes”, des chefs d’entreprise productifs, des “entrepreneurs”, etc., avec qui nous pourrions sauver le pays.
Lutter pour la défense de l’intérêt national est la meilleure manière d’accepter l’austérité, les licenciements, le chômage, les expulsions, et, ce qui reste le sacrifice suprême, la guerre.
De la même manière qu’ils nous ligotent au capital national, les syndicats nous séparent et nous opposent aux travailleurs du monde entier qui sont les seuls sur lesquels nous pouvons compter, avec lesquels nous pouvons forger un front unis et solidaire contre le capital pour créer une société nouvelle, libérée des classes, des Etats, des frontières nationales, une communauté humaine mondiale.
Le piège du référendum
Avant les coupes budgétaires, les syndicats proposent comme alternative un référendum sur le gouvernement Rajoy. Ils font valoir que Rajoy a commis une fraude envers les électeurs, qu’il a été élu sur un programme et qu’une fois au gouvernement, il en applique un autre. Ils ont raison, mais c’est ce que font tous les gouvernements, pas seulement en Espagne, mais dans n’importe quel pays du monde ! Les élections sont toujours une fraude parce que tous les partis promettent des choses et s’empressent de faire le contraire quand ils sont au pouvoir. Quand ils sont dans l’opposition, ils affirment vouloir faire ce que personne ne fait, et quand ils sont au gouvernement, ils font ce que personne n’a dit vouloir faire. C’est là l’essence de l’Etat démocratique : le parti qui gagne poursuit l’œuvre du précédent, tout comme celui qui succédera… Et l’alternative des syndicats, c’est un référendum visant à renverser Rajoy pour fraude au profit d’un nouveau gouvernement et d’une nouvelle fraude ! C’est-à-dire nous lier à une fraude permanente ! Comment pouvons-nous briser cette chaîne sans fin de fraudes ?
D’abord en rompant avec la proposition syndicale et en refusant de participer au référendum et aux élections. Le vote est toujours un piège et il est toujours une escroquerie. Il se base sur la prétendue “liberté de vote” d’une somme de citoyens supposés agir souverainement. Mais c’est une tromperie ! Parce que nous sommes soumis à des conditions de vie aliénantes, atomisés, mis en concurrence les uns les autres ; parce que nous subissons l’intoxication quotidienne des médias et de la communication qui nous manipulent ; parce que l’idéologie dominante nous pousse à un affronter entre nous, à lutter pour les intérêts d’une minorité au lieu de lutter pour nos propres intérêts. Dans de telles conditions, il n’y a pas d’autre choix que d’élire ceux que le capital et l’Etat ont choisi. Voter pour n’importe quel parti, dire oui ou dire non ; toujours seront élus ceux dont le capital a besoin.
D’autre part, le vote consiste à déléguer la gestion de nos affaires à une minorité de politiciens professionnels et de leaders syndicaux à qui nous donnons un chèque en blanc pour “nous défendre” alors que ce qu’ils font toujours – et il ne peut en être autrement – c’est défendre les intérêts du capital et de l’Etat.
En fixant le référendum comme objectif de lutte, les syndicats nous divisent et sabotent ce qui serait le début de la solution aux sérieux problèmes qui se posent aux travailleurs et à l’humanité : les assemblées générales et la lutte unitaire, directe et massive.Ces assemblées se basent sur la force que donne l’association : s’unir de manière solidaire et empathique afin que chacun puisse donner le meilleur de lui-même pour un objectif commun à tous, débattre, décider ensemble, se sentir responsable de toutes les décisions prises. L’alternative est donc la suivante : la lutte syndicale, avec sa démobilisation et ses pièges, ou la lutte autonome de la classe exploitée.
Acción Proletaria, 31 août
() Il faut également signaler que Monsieur Walesa est passé de la fonction de chef du syndicat à celle de chef d’Etat dans les années 1990.
Géographique:
- Espagne [25]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [15]
Rubrique:
Grève sauvage à Antep (Turquie): “nous voulons vivre comme des êtres humains!”
- 1637 lectures
Face au black-out qu’impose la bourgeoisie sur les luttes du prolétariat dans le monde, nous tenons à nous faire l’écho des mobilisations les plus significatives. C’est dans ce cadre que nous publions ci-dessous la traduction de larges extraits d’un article de notre section en Turquie.
“Où allez-vous ?
– Nous sortons, mon frère, nous ne voulons pas travailler.
– Bien, alors sortons tous ensemble, n’allons pas travailler.”
Les ouvriers du textile dans la zone industrielle d’Antep, une ville à la frontière de la zone kurde de la Turquie, ont récemment déclenché une grève contre leurs conditions de travail, les bas salaires et les réductions de leurs primes. La grève, qui a débuté avec trois à cinq mille ouvriers selon différentes sources, s’est rapidement étendue à sept usines dans la zone industrielle, impliquant sept mille travailleurs au total.
Au sujet de leurs conditions de travail dont la durée journalière est en moyenne de douze heures, les ouvriers disaient ceci : “Ce que nous voulons, c’est juste un salaire, qui suffise à nourrir nos familles, et nos droits sociaux. Nous ne demandons rien d’autre. Nous n’avons rien contre quelqu’un en particulier, ni n’avons de mauvaises intentions, nous voulons ce que nous méritons” ().
Un ouvrier qui a participé à la grève explique comment la bourgeoisie turque, qui a pris un tournant important en développant solidement son intégration dans le réseau des rapports impérialistes internationaux avec le mot d’ordre de “devenir une superpuissance”, n’a semé que de faux espoirs dans son adresse à la nation : “Ils disent que nous ne sommes que derrière la Chine au niveau économique. Ils disent que nous sommes des pionniers en ce qui concerne les exportations. Personne ne demande quel impact cela a sur les travailleurs, quelle quantité de pain peuvent ramener les ouvriers à la maison. Personne ne se soucie des travailleurs. Nous avons été en grève ici pendant des jours et les revendications humaines de milliers de personnes ont été ignorées” ()
Une autre caractéristique importante de la grève est la réaction contre le syndicat Oz-Iplik-Is qui fait partie de la confédération Hak-Is () dont une partie significative des grévistes sont membres. Dès le début, la grève était indépendante de la direction et des orientations syndicales ; les ouvriers n’ont pas hésité à critiquer les syndicats. La prise de position la plus claire sur la situation a été celle de Nihat Necati Bencan, le représentant régional du DISK () a Antep, que nous souhaitons citer non seulement pour sa clarté sur la façon dont les syndicalistes ont ressenti la grève, mais aussi pour son ironie : “Les revendications des travailleurs de cinq usines sont formulées par les représentants qu’ils ont délégués parmi eux. Toutefois, des directeurs d’usine ne prennent pas ces revendications au sérieux et ne prennent pas les mesures nécessaires pour satisfaire ces revendications. Des mesures doivent être prises de façon à régler le problème rapidement. Autrement la grève continuera et s’étendre” ().
L’accord sur une augmentation ridicule entre le syndicat et un patron d’usine est une des raisons qui a déclenché la grève. Quand les ouvriers ont réalisé que le syndicat avait négocié une augmentation de 45 TRY (), c’est-à-dire presque rien, ils se sont immédiatement mis en grève en juillet. Mehmet Kaplan, le président régional du syndicat OZ-Iplik-Is à Antep, a même été retenu dans l’usine pendant un moment par les travailleurs après avoir fait face à des slogans comme “Président, traître ! Syndicat, traître” ! Les travailleurs ont donc concrètement et immédiatement fait grève contre un syndicat !
Comme la grève continuait, les laquais de la bourgeoisie ont continué à réprimer par différents moyens. L’Etat, qui a envoyé des meutes de chiens devant les usines dès le début de la vague de grèves, a été très perturbé par les actions ouvrières qui n’étaient pas contrôlées par les syndicats. Les “conseils” donnés par les policiers aux ouvriers pendant la grève étaient à ce titre frappants : “Si vous n’acceptez pas cela, vous ne trouverez plus jamais de travail ailleurs. Les patrons ne peuvent pas se permettre plus. Acceptez et reprenez le travail”. Les forces de l’ordre semblent ainsi aussi bien informées que la police des usines : les syndicats…
Le onzième jour, la grève s’est terminée avec un gain réel pour les travailleurs, notamment une augmentation de salaire allant de 780 à 875 TRY. Les ouvriers de l’usine Motif Textile reviendront même au travail avec une augmentation de 905 TRY par mois. Grâce encore à cette grève, les travailleurs ont obtenu un bonus de dix jours pour chaque grande fête nationale.
Juste après la grève, l’attentat à la bombe, qui a entraîné la mort de neuf civils à Antep, est rapidement devenu le sujet principal en ville et a dissipé la bouffée d’air frais produite par la grève. Dans un pays comme la Turquie, où les événements médiatiques sont très faciles à produire et très aléatoires, les nouvelles, qui sont entièrement contrôlées par la bourgeoisie comme dans tous les autres pays, sont utilisées pour empêcher de tels mouvements d’atteindre le reste de la classe ouvrière. Ainsi, la classe dominante fait tout ce qu’elle peut pour empêcher le reste de la classe ouvrière d’entendre seulement parler de pareilles grèves. Par exemple, alors que les principaux médias turcs ont relayé sans arrêt l’information du massacre des mineurs sud-africains par la police, cette grève, qui avait lieu dans le pays où ils sévissent, n’a évidemment pas fait l’objet de commentaires, même très brefs, dans les journaux et à la télévision. Nous n’en sommes pas surpris, bien sûr ! C’est leur rôle de manipuler.
Malgré ces manœuvres, les travailleurs ont poursuivi leur grève. Les patrons, dans quelques usines, voulaient, en effet, faire signer aux travailleurs un document qui disait : “Je regrette d’avoir participé au mouvement.” Contre ces manœuvres des patrons qui sont capables de toutes sortes de mesures répressives, les ouvriers ont refusé de signer ces documents.
Cette grève est une pierre angulaire pour le mouvement de la classe ouvrière en Turquie, qui a progressé dans une série de luttes isolées au sein des usines et des ateliers après la lutte des ouvriers du tabac de Tekel, comme lors de la lutte des travailleurs de Hey Textile qui ont été mis à pied sans motif valable, ou lors de la grève de Turkish Airlines.
Certains détails mettent en lumière la signification de la grève. Les ouvriers se sont organisés pour satisfaire presque tous leurs besoins au long de la lutte, à côté de quelques aides limitées qui leur ont été données plus tard au cours de la lutte. Ils agissaient ensemble sur des questions comme la nourriture, les transports, etc., et prenaient toutes les décisions avec un comité qu’ils avaient constitué en leur sein. Un des éléments les plus importants de cette grève auto-organisée a été la capacité des travailleurs à agir en dehors des syndicats, à prendre leur lutte en mains ; ce qui constitue un acquis très significatif. Les critiques à l’égard des syndicats pendant la grève démontrent qu’il existe maintenant une question brûlante pour les travailleurs : nous n’avons pas besoin des syndicats dans notre lutte !
Selon toute la presse bourgeoise de gauche, en dépit de cette grève pourtant complètement indépendante des syndicats (et même contre eux), les travailleurs devraient être incités à former des syndicats plus forts ! Affirmer que les ouvriers vont discuter de cela alors que leur lutte a eu lieu en-dehors des syndicats, est une manœuvre politique. Ainsi, au lieu d’écrire sur la grève sauvage elle-même, la gauche bourgeoise ne parle que de ce qui correspond à son programme pro-capitaliste et syndicaliste.
Nous pouvons également constater une différence considérable lorsque nous comparons la durée des luttes et des grèves encadrées par les syndicats et celles qui ne le sont pas. Les premières, tout en suscitant une profonde colère contre les formations syndicales, qui ne sont rien d’autres que des appareils d’Etat, entraînent aussi l’épuisement et le désespoir chez les travailleurs, en particulier quand il leur apparaît nécessaire de prendre le contrôle de leur propre lutte. Cependant, nous pouvons voir, en prenant aussi en considération l’expérience de la classe ouvrière dans le monde, que les mouvements organisés et dirigés par les travailleurs eux-mêmes entrent toujours dans l’histoire du prolétariat et réussissent vraiment à remonter le moral, car les ouvriers organisent et mènent leur lutte eux-mêmes. D’un côté, la capacité des travailleurs à s’organiser et à faire vivre la solidarité développe la confiance en leur capacité et leur dignité et, de l’autre, les grèves organisées par les syndicats aboutissent dans des impasses, gaspillent l’énergie des ouvriers et les poussent au désespoir de l’impuissance ; le résultat en est une nouvelle mauvaise expérience et une amère déception.
“Malgré tout, nos salaires se sont élevés de 780 à 875 TRY. Ce n’est pas beaucoup, mais ce n’est pas une petite augmentation. Cette grève est aujourd’hui terminée mais notre lutte ne l’est pas” (). Suite à la grève, les ouvriers ont décidé que leur comité de lutte organiserait un congrès pour discuter de leur expérience. Alors que les comptes-rendus sur les détails de la grève diffèrent dans les média bourgeois, il est significatif de constater que les ouvriers créent des espaces de discussion pour clarifier les leçons de la grève sauvage et de la lutte.
Nevin, 3 septembre
() Hak-Is est une confédération syndicale pro-gouvernementale et islamiste
() La Confédération syndicale ouvrière révolutionnaire (progressiste, comme se désigne désormais la confédération) est le principal syndicat gauchiste dans le secteur privé turc.
() 45 livres turques, soit environ 20 euros.
Géographique:
- Turquie [106]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [15]
Rubrique:
Elections présidentielles au Venezuela: le “chavisme” et les partis d’opposition contre les travailleurs
- 1472 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article écrit par Internacionalismo, notre section au Venezuela.
Les élections présidentielles du 7 octobre au Venezuela représentent un moment de tension maximale entre les fractions bourgeoises que sont les chavistes et les partis d’opposition. Ces derniers, regroupés dans la Mesa de la Unitad Democrática () (MUD), ayant choisi Henrique Capriles pour candidat, comme le pouvoir officiel misant sur son candidat à perpétuité, Hugo Chàvez, qui dispose de l’appareil de son parti et de centaines de millions de bolivars (), tentent de mobiliser et de gagner des voix, principalement parmi les masses ouvrières épuisées depuis l’arrivée du régime chaviste au pouvoir, par treize années d’affrontements politiques.
Décomposition et crise en toile de fond de la “bataille finale”
L’ascension de Chavez fut le produit de la décomposition de la bourgeoisie vénézuélienne, principalement des forces politiques qui ont gouverné le pays jusqu’à son accession au pouvoir en 1999. En raison de sa forte popularité, divers secteurs du capital l’ont appuyé avec, alors, pour objectif de lutter contre le niveau élevé de corruption, de rétablir la crédibilité des institutions et, par dessus tout, celle du gouvernement, c’est-à-dire d’améliorer le système d’oppression et d’exploitation dans l’intérêt de la nation et de la bourgeoisie. Les forces d’opposition, bien qu’affaiblies, sont rapidement entrées dans un rapport de force avec le régime, notamment lors du coup d’Etat en 2002 () et l’arrêt de la production pétrolière à la fin de la même année, ce qui s’avéra finalement infructueux et renforça le pouvoir de Chavez, se traduisant par sa réélection en 2006.
Après plus d’une décennie de chavisme, la crise a poussé les différentes fractions de la bourgeoisie à se disputer le pouvoir central de l’Etat. Les forces d’opposition bénéficient en effet de la baisse de popularité du régime liée à deux causes principales :
• La décomposition croissante du régime chaviste, que nous caractérisions ainsi dans un précédent article d’Internacionalismo : “De nouvelles élites civiles et militaires se sont constituées et trustent les postes au sommet de la bureaucratie Etatique. Elles ont échoué dans leur objectif de surmonter les problèmes accumulés par les gouvernements précédents bien plus occupées par leurs intérêts personnels et le partage du butin de la manne pétrolière, provoquant une croissance exponentielle de la corruption et un abandon progressif de la gestion de l’Etat. Cette situation, doublée de la mégalomanie du régime chaviste et de sa prétention d’étendre la “révolution bolivarienne” au niveau de tout le continent latino-américain, a peu à peu vidé les caisses de l’Etat. Elle a également exacerbé les antagonismes politiques et sociaux qui ont élevé l’incapacité de gouverner à un niveau bien pire que dans les années 90.”
• L’intensification de la crise du capitalisme en 2007 a joué contre les aspirations du régime chaviste d’implanter son projet de “socialisme du xxi siècle”. Bien que Chavez, comme les autres gouvernements, ait déclaré que l’économie vénézuélienne était “blindée”, la réalité est que la crise mondiale du capitalisme a permis de redécouvrir la fragilité historique de l’économie nationale : elle varie en fonction des prix du pétrole. A cela s’ajoute le fait que les plans populistes ont été possibles grâce aux attaques sur les salaires et à la réduction ou à la suppression des “acquis” comme les conventions collectives que le chavisme avait pourtant octroyé comme “pourboire” aux travailleurs.
La stratégie du candidat d’opposition, Henrique Capriles, basée sur des tournées quotidiennes sillonnant les villes et les villages du pays, “maison par maison”, cherchant à exploiter l‘abandon social des laissés-pour-compte et les échecs du chavisme, ont permis, selon certaines enquêtes d’opinion, une remontée en flèche dans les sondages de sa candidature. Sa tactique consistant à proposer des programmes sociaux, populistes et semblables à ceux du chavisme, tout en évitant la confrontation directe, a donné des résultats. Cependant, Hugo Chavez insiste sur les pseudo-réussites de son projet en direction des pauvres et sur sa qualité de “gardien de l’ordre nécessaire” contre l’anarchie qui pourrait frapper le capital vénézuélien dans son ensemble.
Le chavisme, malgré toutes ses faiblesses (perte de gouvernements de province, conflits d’intérêts dans ses propres rangs, maladie de Chavez, etc.), n’envisage pas d’abandonner le pouvoir et, ces derniers mois, n’a négligé aucun détail dont l’opposition pourrait tirer avantage : inscription obligatoire des employés du secteur public au Parti Socialiste Uni du Venezuela (), obstacles dressés contre le vote des résidents à l’étranger, particulièrement à Miami et en Espagne, neutralisation des partis qui soutiennent l’opposition (PODEMOS, PPT, COPEI) à travers des condamnations prononcées par le Tribunal supérieur de justice, etc. A cela s’ajoute le contrôle exercé sur les médias et les moyens de communications qui offrent à Chavez un avantage décisif sur le plan de la propagande électorale.
Chavez a également élaboré d’autres stratégies pour l’emporter en cas d’échec aux élections. Il a notamment déjà annoncé que l’opposition prépare un plan pour dénoncer une fraude électorale... Pour mener à bien cette stratégie, il s’appuie comme toujours sur le pouvoir d’Etat et particulièrement sur l’armée, qui a abandonné son statut de “force professionnelle au service de la nation, non décisionnelle et apolitique” pour se convertir en “force patriotique, anticapitaliste, anti-impérialiste et chàviste”. En ce sens, on comprend la fréquence des menaces de Chavez et de son entourage contre les opposants.
Le parti au pouvoir accuse également l’opposition de refuser de reconnaître dès maintenant les résultats qui seront proclamés par le Conseil national électoral (CNE) ; c’est pour cela que le gouvernement prétend donner l’alerte afin d’éviter que les opposants excitent la population quand le CNE annoncera le triomphe de Chavez. Pour sa part, l’opposition explique qu’elle ne peut pas donner un chèque en blanc au CNE, à la fois juge et partie, qui a sanctionné l’opposition mais qui n’a pas sanctionné les arrangements du pouvoir avec les règles qu’il avait pourtant imposées. En somme, il s’agit simplement d’un affrontement entre partis bourgeois où chaque clan utilise les ruses propres à sa classe pour assurer le meilleur rapport de forces possible à sa candidature.
Les travailleurs doivent rejeter toute division en leur sein
Le prolétariat vénézuélien doit rester sur ses gardes pour ne pas être la victime de cette “bataille finale” que se livrent les forces du capital national et dans lequel elles vont chercher à l’entraîner.
Le chavisme dispose d’armes idéologiques très puissantes pour mobiliser “les pauvres” et “les exclus” qui ont encore l’espoir que Chavez tiendra ses promesses, surtout celles sur les “Missions”, théoriquement dirigées “contre la bourgeoisie prédatrice, qui veut un retour au passé”. Mais, Chavez se prépare également à un affrontement armé en cas de nécessité. Il sait pouvoir compter sur la milice bolivarienne et sur les troupes de choc qui se sont constituées en différents “collectifs” aussi bien à Caracas qu’à l’intérieur du pays, armés par l’Etat lui-même.
Les forces d’opposition, de leur côté, bien qu’elles n’aient pas de stratégie publique en cas d’épreuve de force, ne vont pas rester les bras croisés. Parmi celles-ci, on trouve des partis traditionnels comme celui de la social-démocratie, Action démocratique, qui ont des décennies d’expérience dans l’organisation de “collectifs” armés. Dans les rangs de l’opposition, on trouve également des organisations de gauche qui ont soutenu le chavisme à ses débuts et qui connaissent parfaitement les méthodes d’affrontement.
Les travailleurs doivent avoir conscience qu’il est impossible de lutter contre la précarité et l’exploitation en changeant de gouvernement. La crise du capitalisme demeure et s’approfondira quel que soit le vainqueur, Chavez ou Capriles. Ce sont les mesures d’austérité et la précarité qui l’emporteront finalement.
Nous ne devons pas tomber dans le piège idéologique que nous tendent ceux qui prétendent que la confrontation électorale oppose le “communisme” et la démocratie, “le peuple” et la bourgeoisie. Chavez et Capriles défendent deux programmes capitalistes d’Etat, qui chacun s’appuie sur la même exploitation de la force de travail du prolétariat vénézuélien.
La dispute électorale est seulement un moment de la confrontation entre les différentes fractions du capital national. Le prolétariat doit éviter de se laisser prendre au jeu des conflits entre fractions bourgeoises. Il doit plutôt rompre avec l’idéologie démocratique, tirer les leçons de ses propres luttes, poursuivre son effort pour retrouver son identité de classe, son unité et sa solidarité.
Internacionalismo, août 2012
() Plateforme de l’Unité démocratique.
() Monnaie locale.
() Du 11 au 13 avril 2002, un coup d’Etat, mené par Pedro Carmona, a vainement tenté de destituer Chàvez.
() Le parti chaviste.
Géographique:
- Vénézuela [107]
Rubrique:
Les conditions de vie et les conduites addictives
- 2713 lectures
 Nous publions ci-dessous la contribution d’une lectrice qui permet, à la lumière des recherches en psychologie sociale et en neurologie, de mieux comprendre les liens entre les conditions de vie et les conduites addictives. En expliquant les mécanismes sous-jacents de ce phénomène croissant, cette contribution illustre un aspect de l’impasse du capitalisme et tout le cynisme de la classe dominante. Prendre conscience de la réalité des souffrances générées par l’exploitation et la barbarie de la société est important. L’appel à la “conscience collective” est à ce titre parfaitement valable car il s’agit d’une arme des exploités pour critiquer et renverser une société inhumaine. Nous tenons donc vivement à saluer l’initiative de la camarade et à encourager cette démarche.
Nous publions ci-dessous la contribution d’une lectrice qui permet, à la lumière des recherches en psychologie sociale et en neurologie, de mieux comprendre les liens entre les conditions de vie et les conduites addictives. En expliquant les mécanismes sous-jacents de ce phénomène croissant, cette contribution illustre un aspect de l’impasse du capitalisme et tout le cynisme de la classe dominante. Prendre conscience de la réalité des souffrances générées par l’exploitation et la barbarie de la société est important. L’appel à la “conscience collective” est à ce titre parfaitement valable car il s’agit d’une arme des exploités pour critiquer et renverser une société inhumaine. Nous tenons donc vivement à saluer l’initiative de la camarade et à encourager cette démarche.
Les individus sans activité professionnelle sont constamment stigmatisés pour leur prétendu manque de volonté, en particulier à cause de la consommation de substances psychoactives () plus importante dans cette population, comme en témoignent de nombreuses études qui sont régulièrement réalisées sur les conduites addictives des jeunes et des personnes sans emploi. A contrario, très peu d’étude sur la consommation de substances psychoactives ont été réalisées chez les personnes en activité. C’est pourtant une réalité qui affecte de nombreux travailleurs et dont les causes sont multiples et souvent travesties. Par ailleurs, les structures et les actions qui sont mises en place par l’Etat pour lutter contre les addictions sont peu efficaces et hypocrites.
La consommation des publics exclus et anxieux face à l’avenir
Les publics en exclusion professionnelle consomment davantage de tabac, d’alcool, de médicaments psychotropes (anxiolytique, antidépresseur, myorelaxant, etc.) et de drogues illicites. Ainsi, selon une étude de l’INPES () réalisée auprès de 2594 chômeurs en 2005, 10,5 % d’entre eux étaient dépendants à l’alcool, 12 % consommaient du cannabis et 17,4 % ingéraient des médicaments psychotropes. Par ailleurs, les allocataires du Revenu de solidarité active sont 45 % à avoir des difficultés avec l’alcool contre 15 % des actifs occupés (). Les jeunes sont également victimes d’une surconsommation de substances psychoactives. Selon les études de l’OFDT (), en 2002, et de l’ADSP (), en 2007, 40 % des jeunes âgés de 18 ans consomment quotidiennement du tabac, contre 29 % des personnes âgées entre 18 et 75 ans. De plus, 10,5 % des jeunes surconsomment des boissons alcoolisées et 13,3 % fument régulièrement du cannabis.
Plusieurs explications à cette surconsommation chez les populations en recherche d’insertion sociale peuvent être avancées. D’une part, certains auteurs pensent que l’adolescence et ses multiples changements (physiologique, psychologique, passage à l’âge adulte, etc.) est la cause principale des conduites à risque des jeunes. En effet, les adolescents perçoivent l’alcool comme un moyen, soit de mieux vivre ce bouleversement générant un mal-être, soit de créer du lien social. Il est vrai que si l’aspect convivial de l’alcool n’est pas propre à l’adolescence, il n’en reste pas moins un moyen perçut comme efficace et facilement accessible par les jeunes. D’ailleurs, les professionnels du secteur des boissons alcoolisées connaissent ce phénomène et développent des stratégies marketing en direction des jeunes consommateurs qui sont attirés par des saveurs sucrées. Des produits appelés “premix” ou “alcopops” sont créés à destination de ce public. Ces boissons fortement alcoolisées (vodka, whisky ou rhum) sont mélangées à des boissons non alcoolisées fortement sucrées (sodas ou jus de fruits) afin de cacher le fort goût d’éthanol. Or, même si la quantité d’alcool ingérée est moindre par rapport à une boisson alcoolisée traditionnelle, le risque est d’oublier leur teneur en alcool et donc d’en consommer en plus grande quantité, ce qui a des conséquences graves sur ces cerveaux encore en développement.
D’autre part, l’anxiété face au futur et la crainte du chômage, liées à la situation économique, accentuent également la consommation de substances psychoactives des populations précaires. A ce titre, Isabelle Varescon montre que la dépendance à l’alcool est la conséquence d’un échec devant une tâche. Cet échec se traduit par un sentiment d’incompétence personnelle et sociale. Par son effet analgésique, la consommation de substances psychoactives est un moyen de pallier la faible estime que l’individu a de lui-même.
La recherche de lien social au moyen de l’alcool et l’effet antalgique des substances psychoactives sont des stratégies d’adaptation dont les consommateurs s’aperçoivent, souvent trop tard, qu’elles les précarisent davantage.
La consommation des travailleurs
La même enquête de l’INPES, réalisée auprès de 15 994 “actifs occupés” âgés de 16 à 65 ans, estime que 28,1 % des répondants présentent un tabagisme régulier, 13,8 % consomment des médicaments psychotropes, 8,1 % présentent une alcoolo-dépendance et 8 % consomment des drogues illicites.
Cette enquête a également montré qu’il existe des liens entre le type de substances psychoactives consommé et le milieu professionnel. Sauf le milieu des activités financières, aucun secteur ne semble épargné. Mais, les domaines du bâtiment et des transports sont les plus touchés dans la mesure où la consommation de tabac, d’alcool, de médicaments psychoactifs et de drogues illicites est supérieure à tous les autres milieux professionnels. Une surconsommation de tabac et de drogues illicites est également démontrée dans le milieu de la restauration. En ce qui concerne les médicaments psychotropes, les activités de ménage et administratives présentent une consommation plus importante que d’autres secteurs comme l’industrie, les services et la restauration.
Des études récentes ont montré que la surconsommation de substances psychoactives en milieu professionnel est la conséquence d’un mal-être au travail se traduisant par du stress. Le stress apparaît lorsqu’une situation de travail dépasse les capacités normales d’un individu (ressources adaptatives) (). Pour faire face à ces situations de travail tendues, les travailleurs développent donc des stratégies d’adaptation. Dans ce cadre, les salariés qui usent de substances psychoactives le font pour mieux gérer leur stress ou augmenter leur capacité de travail (). Concrètement, l’expérience de Niezborala (2000) montre que sur 2106 personnes en activité interrogées à l’occasion de l’examen périodique de santé au travail, près d’une personne sur trois consomme des médicaments psychoactifs pour faire face à des difficultés rencontrées sur le lieu du travail. Ainsi, “20 % utilisent un médicament pour être ‘en forme au travail’, 12 % prennent leur médicament sur leur lieu de travail pour traiter un ‘symptôme gênant’, et 18 % utilisent un médicament ‘pour se détendre au décours d’une journée difficile’”.
D’autres auteurs, comme Reynaud-Maurupt et Hoareau, (2010) et Fontaine et Fontana (2003) pensent également que la consommation excessive de substances psychoactives concerne essentiellement les actifs qui ont des conditions de travail pénibles, induisant “la nécessité de se sentir hyperperformant”. Cette stratégie vise l’amélioration de la performance afin de s’adapter aux exigences professionnelles. D’ailleurs, Angel montre que les salariés qui ont des conditions de travail physiques et pénibles consomment davantage de substances psychoactives que les salariés des autres secteurs d’activité.
La consommation de substances psychoactives est donc bien une stratégie d’adaptation face au stress professionnel. Ce phénomène est le résultat direct de la pénibilité au travail et de la précarité croissante. De même, l’isolement social au sein des entreprises et dans la vie privée, dont sont de plus en plus victimes les travailleurs, entraîne des consommations à risque. Ces consommations permettent d’une part de rétablir du lien social par la consommation collective (tabac et alcool, notamment) et, d’autre part, de mieux supporter les troubles physiques et psychiques liés au travail (alcool, médicaments psychoactifs et drogues illicites, notamment).
Comment répondre au développement des conduites addictives ?
Ces surconsommations de substances psychoactives chez les publics précaires et chez les travailleurs qui ont des conditions de travail qui agissent sur leur santé physique et mentale ont des conséquences dramatiques. En effet, chaque année en France, environ 45 000 décès sont directement liés à la surconsommation d’alcool. Cette surconsommation de substances engendre également des conflits, des accidents du travail, des maladies de courte et de longue durée, des suicides, etc. Hassé Consultants et Angel estiment qu’en moyenne 20 % des accidents et des arrêts de travail sont liés à la surconsommation de substances psychoactives. De plus, dans 40 à 45 % des cas, les accidents mortels au travail sont la conséquence directe d’une surconsommation.
Quelques structures et actions sont mises en place pour lutter contre les dépendances, notamment les centres d’addictologie. Ces centres accueillent, dans le cadre d’une hospitalisation, des personnes en Etat de dépendance à un produit psychoactif (). Dans un premier temps un sevrage physique d’environ une semaine est imposé, puis un sevrage psychologique plus long est proposé. A l’occasion de ce sevrage psychologique, de plus en plus de structures choisissent d’informer les patients sur le fonctionnement physiologique des dépendances. Ainsi, une phase de déculpabilisation est souvent mise en place par la compréhension du mécanisme cérébral de la dépendance.
Dans le cadre d’une surconsommation régulière d’alcool, par exemple, l’éthanol déséquilibre les récepteurs, dits récepteurs GABA, sur les neurones. Ces récepteurs, devenus dépendants, solliciteront, tout au long de la vie, une quantité d’éthanol croissante pour être satisfaits. L’arrêt de la consommation d’alcool se révèle donc extrêmement difficile dans la mesure où un syndrome de sevrage, plus ou moins important selon les individus, apparaît. L’abstinence totale est alors préconisée à vie dans la mesure où ces récepteurs ne retrouveront jamais un fonctionnement normal. Ainsi, une faible quantité d’alcool ingérée suffit pour réactiver ce processus.
Toutefois, le sevrage n’est rien par rapport aux difficultés futures de l’ex-dépendant. En effet, en plus de la difficulté à échapper aux nombreuses sollicitations sociales (fêtes, réunions de famille, dîners professionnels, etc.), tout est fait pour le pousser à consommer des boissons alcoolisées. Les commerces font de ces rayons un passage obligé. Quant aux boissons sans alcool que dire à part que ce n’est pas très “fun” et… qu’elles contiennent pour la plupart de l’alcool ! Oui, une histoire sordide de législation veut qu’en dessous de 1,2° d’éthanol, les boissons puissent porter la mention : “sans alcool”1, sans indiquer dans leur contenu qu’elles en contiennent justement, alors que la moindre quantité d’alcool suffit à la rechute.
Alors, la fête est plus folle sans alcool ? Certainement pour les industriels de la boisson alcoolisée ! Voilà bien la preuve que les rechutes sont liées à un manque de volonté des dépendants !... Quant à leur travail, quand ils en ont un, il ne s’est bien sûr pas amélioré pendant leur cure. Ah, ces travailleurs qui ont bien de la chance d’avoir un travail et un gentil patron qui les attend après leur “petit problème personnel” !... pourvus quand même qu’ils gardent la même docilité qu’avant leur cure ! Sinon, pourvu qu’ils rechutent vite ! Ça restera toujours un moyen de pression supplémentaire pour que le travail soit fait rapidement et sans réclamation.
L’exclusion sociale est grandissante à cause de la précarisation de l’emploi, du chômage, des difficultés financières, etc., et les conditions de travail sont de plus en plus pénibles. L’isolement social, qui en découle souvent, s’accentue et se pérennise. Les individus cherchent des solutions à cette dégénérescence lente et laborieuse. Ces solutions peuvent prendre plusieurs formes : la lutte contre ces conditions de vie ou l’abandon. Lutter contre des conditions de vie pénibles ne devrait jamais se faire par l’adaptation de son organisme à ces dites conditions au moyen de substances psychoactives. Lutter contre l’origine du problème serait bien plus efficace mais, plutôt qu’une réponse individuelle, requiert une conscience collective.
Agnosia, 17 septembre
() Les substances psychoactives (tabac, alcool, médicaments psychoactifs et drogues illicites) agissent sur le fonctionnement cérébral des individus et modifient leurs comportements.
() Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
() Données tirées du site ALPA (Alcool, prévention et accompagnement).
() Observatoire français des drogues et des toxicomanies.
() Actualité et Dossier en santé publique.
() Guillet, Hermand et Py (2003).
() Angel, Amar, Gava et Vaudolon (2005).
() Généralement, l’alcool et les drogues illicites.
1) Article L3321-1 du Code de la santé publique.
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [108]
Rubrique:
Une vallée de larmes... dont la religion est l'auréole
- 4254 lectures
Nous publions ci-dessous de longs extraits de la Contribution à la critique de La philosophie du droit de Hegel écrit par Karl Marx en 1843 (1. Ces lignes, qui ont la force de la beauté poétique, sont aussi d’une brûlante actualité. La religion, la croyance, le mysticisme, l’obscurantisme… y sont dépeints comme un produit de l’aliénation et donc des souffrances et de la déshumanisation infligées aux exploités. La religion n’est donc pas simplement une conscience erronée du monde, elle est aussi une réponse à l’oppression réelle, mais une réponse inappropriée et qui ne conduit qu’à l’échec.
La mise à bas des mille plaies de la société passe inévitablement par l’abolition de l’exploitation et de l’oppression. Alors l’obscurantisme n’aura plus de raison d’être.
Sous la plume de Marx, cette révolution n’est pas seulement absolument nécessaire, elle est surtout possible. Dans ce texte, il exprime en effet toute la confiance qu’il porte dans la capacité du prolétariat à mener une lutte historique et consciente pour l’émancipation de toute l’humanité.
Le texte que nous publions ayant fait l’objet de larges coupes, nous pensons qu’il est nécessaire d’expliquer ce choix à nos lecteurs.
La source fondamentale de la mystification religieuse est l’esclavage économique. Les croyances disparaîtront donc avec l’abolition de la dernière forme d’exploitation, le salariat. Tel est le fond de la pensée de Marx, son aboutissement logique. Néanmoins, au milieu du xix)e siècle, Marx a sous les yeux un capitalisme florissant. En France, la bourgeoisie révolutionnaire et éclairée mène depuis près d’un siècle une lutte décidée et radicale contre les archaïsmes économiques et politiques féodaux qui entravent son développement. La religion faisant partie de ces archaïsmes, elle est combattue par la nouvelle classe dominante et elle recule effectivement au fur et à mesure que le capitalisme se développe. La bourgeoise allemande est, en revanche, économiquement empêtrée dans le passé ; elle ne parvient pas à jeter aux orties les vestiges féodaux qui la paralysent, ce qu’elle fera finalement lors de la guerre franco-prussienne de 1870 et la transformation de la Prusse en Allemagne.
Marx pensait alors que cette tâche revenait au prolétariat allemand qui, par le développement de sa lutte, porterait un coup fatal à l’obscurantisme. C’est pourquoi la version intégrale de la Contribution à la critique de La philosophie du droit de Hegel contient de longs passages sur la particularité de la situation allemande que nous avons choisi ici de couper.
De façon plus générale, Marx pensait que le développement économique du capitalisme allait saper les fondements de la religion. Dans l’Idéologie allemande, par exemple, il affirme que l’industrialisation capitaliste a réussi à réduire la religion à n’être plus qu’un simple mensonge. Pour se libérer, le prolétariat devait perdre ses illusions religieuses et détruire tous les obstacles l’empêchant de se réaliser en tant que classe ; mais le brouillard de la religion devait être rapidement dispersé par le capitalisme lui-même. En fait, pour Marx, le capitalisme lui-même était en train de détruire la religion, à tel point qu’il en parlait parfois comme une forme d’aliénation déjà dépassée pour le prolétariat. Nous savons aujourd’hui qu’il n’en a rien été, bien que le capitalisme et le développement des sciences aient sapé un à un les fondements de toutes les religions. En fait, depuis que le capitalisme a cessé d’être une force révolutionnaire pour la transformation de la société, la bourgeoisie s’est de nouveau tournée pleinement vers l’idéalisme et la religion.
Au-delà des erreurs de prévisions inévitables, liées à ‘époque historique, le fond de la pensée exprimée par Marx reste parfaitement valable : la religion est le résultat de l’exploitation, elle ne disparaîtra qu’avec elle, et seul le prolétariat est capable de mener à bien cette lutte indispensable pour la survie et l’épanouissement de l’humanité.
CCI
“Le fondement de la critique irréligieuse est : c’est l’homme qui fait la religion, et non la religion qui fait l’homme. Certes, la religion est la conscience de soi qu’a l’homme qui ne s’est pas encore trouvé lui-même, ou bien s’est déjà reperdu. Mais l’homme, ce n’est pas un être abstrait blotti quelque part hors du monde. L’homme, c’est le monde de l’homme, l’Etat, la société. Cet Etat, cette société produisent la religion, conscience inversée du monde, parce qu’ils sont eux-mêmes un monde à l’envers. La religion est la théorie générale de ce monde, sa somme encyclopédique, sa logique sous forme populaire, son point d’honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction morale, son complément solennel, son universel motif de consolation et de justification. Elle est la réalisation chimérique de l’être humain, parce que l’être humain ne possède pas de réalité véritable. Lutter contre la religion, c’est donc indirectement lutter contre ce monde-là, dont la religion est l’arôme spirituel.
La misère religieuse est tout à la fois l’expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde sans cœur, comme elle est l’esprit de conditions sociales d’où l’esprit est exclu. Elle est l’opium du peuple.
Nier la religion, ce bonheur illusoire du peuple, c’est exiger son bonheur réel. Exiger qu’il abandonne toute illusion sur son Etat, c’est exiger qu’il renonce à un Etat qui a besoin d’illusions. La critique de la religion est donc en germe la critique de la vallée de larmes dont la religion est l’auréole.
La critique a dépouillé les chaînes des fleurs imaginaires qui les recouvraient, non pour que l’homme porte des chaînes sans rêve ni consolation, mais pour qu’il rejette les chaînes et cueille les fleurs vivantes. La critique de la religion détruit les illusions de l’homme afin qu’il pense, agisse, forge sa réalité en homme sans illusions parvenu à l’âge de la raison, afin qu’il gravite autour de lui-même, c’est à dire de son véritable soleil. La religion n’est que le soleil illusoire qui gravite autour de l’homme tant que l’homme ne gravite pas autour de lui-même.
C’est donc la tâche de l’histoire, une fois l’au-delà de la vérité disparu, d’établir la vérité de l’ici bas. Et c’est tout d’abord la tâche de la philosophie, qui est au service de l’histoire, de démasquer l’aliénation de soi dans ses formes profanes, une fois démasquée la forme sacrée de l’aliénation de l’homme. La critique du ciel se transforme ainsi en critique de la terre, la critique de la religion en critique du droit, la critique de la théologie en critique de la politique. (….)
Il s’agit de faire le tableau d’une sourde oppression que toutes les sphères sociales exercent les unes sur les autres, d’une maussaderie générale mais inerte, d’une étroitesse d’esprit faite d’acceptation et de méconnaissance, le tout bien encadré par un système de gouvernement qui, vivant de la conservation de toutes les médiocrités, n’est lui-même que la médiocrité au gouvernement.
Quel spectacle ! Voici la société infiniment divisée en races les plus diverses qui s’affrontent avec leurs petites antipathies, leur mauvaise conscience et leur médiocrité brutale, et qui, en raison même de leur voisinage équivoque et méfiant, sont toutes, sans exception, traitées par leurs seigneurs comme des existences concédées. Et ce fait même d’être dominées, gouvernées, possédées, elles doivent le reconnaître et le confesser comme une concession du ciel ! Et voici, en face d’elles, ces maîtres eux-mêmes dont la grandeur est inversement proportionnelle à leur nombre ! (…)
Il faut rendre l’oppression réelle encore plus pesante, en lui ajoutant la conscience de l’oppression, rendre la honte plus infamante encore, en la divulguant. (…)
De toute évidence, l’arme de la critique ne peut pas remplacer la critique des armes : la force matérielle doit être renversée par une force matérielle, mais la théorie se change, elle aussi, en force matérielle, dès qu’elle saisit des masses. La théorie est capable de saisir les masses, dès qu’elle argumente ad hominem, et elle argumente ad hominem dès qu’elle devient radicale. Être radical, c’est saisir les choses par la racine. Mais la racine, pour l’homme, c’est l’homme lui-même. (…) La critique de la religion s’achève par la leçon que l’homme est l’être suprême pour l’homme, donc par l’impératif catégorique de renverser tous les rapports sociaux où l’homme est un être dégradé, asservi, abandonné, méprisable ; ces rapports, on ne saurait mieux les rendre que par l’exclamation d’un Français à l’annonce d’un projet d’impôt sur les chiens : Pauvres chiens ! on veut vous traiter comme des hommes ! (…)
[La possibilité de l’émancipation réside] dans la formation d’une classe chargée de chaînes radicales, d’une classe de la société civile qui ne soit pas une classe de la société civile, d’un ordre qui soit la dissolution de tous les ordres, d’une sphère qui possède un caractère universel en raison de ses souffrances universelles et qui ne revendique aucun droit particulier parce qu’on ne lui fait subir non un tort particulier mais le tort absolu, qui ne peut plus s’en rapporter à un titre historique, mais seulement à un titre humain, (…) d’une sphère, enfin, qui ne peut s’émanciper sans s’émanciper de toutes les autres sphères de la société et, partant, sans les émanciper toutes ; en un mot, une sphère qui est la perte totale de l’homme et ne peut donc se reconquérir elle-même sans la reconquête totale de l’homme. Cette dissolution de la société, c’est, en tant que classe particulière, le prolétariat. (…) Lorsque le prolétariat annonce la dissolution de l’ordre présent du monde, il ne fait qu’énoncer le secret de sa propre existence, car il est lui-même la dissolution effective de cet ordre du monde.”
K. Marx
1) Ces extraits s’appuient sur les différentes traductions de ce texte disponibles sur Internet (marxists.org) et sur papier dans la Bibliothèque de la Pléiade (Karl Marx, Œuvres III, Philosophie, 1982, pages 382 à 397).
Rubrique:
Révolution Internationale n° 437 - novembre 2012
- 1533 lectures
Pourquoi est-il si difficile de lutter et comment dépasser ces difficultés ?
- 1367 lectures
Tout semble a priori favorable à une explosion sans précédent de la colère ouvrière. La crise est manifeste, elle n’échappe à personne, et personne n’y échappe. Peu croient encore à la “sortie de crise” dont on nous rebat les oreilles quotidiennement. La planète nous déroule tout aussi quotidiennement son spectacle de désolation : guerres et barbarie, famines insupportables, épidémies, sans parler des manipulations irresponsables d’apprentis-sorciers délirants auxquels les capitalistes se livrent avec la nature, la vie et notre santé, au seul nom du profit.
Face à tout cela, il est difficile d’imaginer qu’un autre sentiment que la révolte et l’indignation puisse occuper les esprits. Il est difficile de penser qu’une majorité de prolétaires croient encore à un avenir sous le capitalisme. Et pourtant, les masses n’ont pas encore pleinement pris le chemin de la lutte. Faut-il alors penser que les jeux sont faits, que le rouleau compresseur de la crise est trop puissant, que la démoralisation qu’il engendre est indépassable ?
De grandes difficultés…
On ne peut nier que la classe ouvrière connaît actuellement des difficultés importantes. Il y a au moins quatre raisons essentielles à cela :
• La première, de loin la plus centrale, c’est tout simplement le fait que le prolétariat n’a pas conscience de lui-même, qu’il a perdu sa propre identité de classe. Suite à la chute du mur de Berlin, toute une propagande s’était en effet déchainée dans les années 1990 pour tenter de nous convaincre de la faillite historique du communisme. Les plus audacieux – et les plus stupides – annonçaient même “la fin de l’histoire”, le triomphe de la paix et de la “démocratie”… En amalgamant le communisme à la carcasse du monstre stalinien putréfié, la classe dominante a cherché à discréditer par avance toute perspective de classe visant à renverser le système capitaliste. Non contente de chercher à détruire toute idée de perspective révolutionnaire, elle s’est aussi efforcée de faire du combat prolétarien une sorte d’archaïsme bon à préserver comme “mémoire culturelle” au musée de l’Histoire, à l’instar des fossiles de dinosaures ou de la grotte de Lascaux.
Surtout, la bourgeoisie n’a cessé d’insister sur le fait que la classe ouvrière sous sa forme classique avait disparu de la scène politique. Tous les sociologues, journalistes, politiciens et philosophes du dimanche rabâchent l’idée que les classes sociales ont disparu, fondues dans le magma informe des “classes moyennes”. C’est le rêve permanent de la bourgeoisie d’une société où les prolétaires ne se verraient qu’en simples “citoyens”, divisés en catégories socioprofessionnelles plus ou moins bien discernées et surtout bien divisées – en cols blancs, cols bleus, employés, précaires, chômeurs, etc. – avec des intérêts divergents et qui ne “s’unissent” que momentanément, isolés et passifs, dans les urnes. Et il est vrai que le battage sur la disparition de la classe ouvrière, répété et asséné à grands renforts de reportages, de livres, d’émissions télévisés… a eu pour résultat que nombre d’ouvriers ne parviennent pour l’instant plus à se concevoir comme partie intégrante de la classe ouvrière et encore moins comme classe sociale indépendante.
• De cette perte de l’identité de classe découle, en second lieu, les difficultés du prolétariat à affirmer son combat et sa perspective historique. Dans un contexte où la bourgeoisie elle-même n’a aucune perspective à offrir autre que l’austérité, le chacun pour soi, l’isolement et le sauve-qui-peut dominent. La classe dominante exploite ses sentiments pour monter les exploités les uns contre les autres, les diviser pour empêcher toute riposte unie, pour les pousser au désespoir.
• Le troisième facteur, comme conséquence des deux premiers, c’est que la brutalité de la crise tend à paralyser de nombreux prolétaires, à cause de la peur de tomber dans la misère absolue, de ne pouvoir nourrir sa famille et de se retrouver à la rue, isolé et exposé à la répression. Même si certains, mis au pied du mur, sont poussés à manifester leur colère, à l’image des “Indignés”, ils ne se conçoivent pas comme une réelle classe en lutte. Ceci, malgré les efforts et le caractère parfois relativement massif des mouvements, limite la capacité à résister aux mystifications et aux pièges tendus par la classe dominante, à se réapproprier les expériences de l’histoire, à tirer des leçons avec le recul et la profondeur nécessaires.
• Il y a enfin un quatrième élément important pour expliquer les difficultés actuelles de la classe ouvrière à développer sa lutte contre le système : c’est l’arsenal d’encadrement de la bourgeoisie, ouvertement répressif, comme les forces de police, ou surtout plus insidieux et bien plus efficaces, comme les forces syndicales. Sur ce dernier aspect, notamment, la classe ouvrière n’est pas encore parvenue à dépasser ses craintes de lutter en dehors de leur encadrement, même si ceux qui ont encore des illusions sur la capacité des syndicats à défendre nos intérêts sont de moins en moins nombreux. Et cet encadrement physique se double d’un encadrement idéologique plus ou moins maîtrisé par les syndicats, les médias, les intellectuels, les partis de gauche, etc. Ce que la bourgeoisie réussit aujourd’hui le plus à développer est sans conteste l’idéologie démocratique. Tout événement est exploité pour vanter les bienfaits de la démocratie. La démocratie est présentée comme le cadre où toutes les libertés se développent, où toutes les opinions s’expriment, où le pouvoir est légitimé par le peuple, où les initiatives sont favorisées, où tout le monde peut accéder à la connaissance, à la culture, aux soins et, pourquoi pas, au pouvoir. En réalité, la démocratie n’offre qu’un cadre national au développement du pouvoir des élites, du pouvoir de la bourgeoisie, et le reste n’est qu’illusion, l’illusion qu’en passant par l’isoloir on exerce un quelconque pouvoir, que dans l’hémicycle s’expriment les opinions de la population au travers du vote de “représentants”. Il ne faut pas sous-estimer le poids de cette idéologie sur les consciences ouvrières, tout comme il ne faut pas oublier le choc extrême qu’aura provoqué l’effondrement du stalinisme à la charnière des années 1980 et 1990. A tout cet arsenal idéologique vient s’ajouter l’idéologie religieuse. Elle n’est pas nouvelle si l’on considère qu’elle a accompagné l’humanité depuis ses premiers pas dans le besoin de comprendre son environnement. Elle n’est pas nouvelle non plus si on se rappelle à quel point elle est venue légitimer toutes sortes de pouvoirs à travers l’histoire. Mais aujourd’hui, ce qu’elle présente d’original est qu’elle vient se greffer aux réflexions d’une partie de la classe ouvrière face au capitalisme destructeur et en faillite. Elle vient dévoyer cette réflexion en expliquant la “décadence” du monde occidental dans son éloignement des valeurs portées depuis des millénaires par la religion, en particulier les religions monothéistes. L’idéologie religieuse a cette force qu’elle réduit à néant la complexité extrême de la situation. Elle n’apporte que des réponses simples, faciles à mettre en œuvre. Dans ses formes intégristes, elle ne convainc qu’une petite minorité d’ouvriers, mais de façon plus générale, elle contribue à parasiter la réflexion de la classe ouvrière.
… et un formidable potentiel
Ce tableau est un peu désespérant : face à une bourgeoisie qui maîtrise ses armes idéologiques, à un système qui menace de misère la plus grande partie de la population, quand elle ne l’y plonge pas directement, y a-t-il encore une place pour développer une pensée positive, pour dégager un espoir ? Y a-t-il vraiment encore une force sociale capable de mener à bien une œuvre aussi immense que la transformation radicale de la société, rien de moins ? A cette question, il faut répondre sans hésitation : oui ! Cent fois oui ! Il ne s’agit pas d’avoir une confiance aveugle dans la classe ouvrière, une foi quasi-religieuse dans les écrits de Marx ou un élan désespéré dans une révolution perdue d’avance. Il s’agit de prendre du recul, d’avoir une analyse sereine de la situation, au delà des enjeux immédiats, tenter de comprendre ce que signifient réellement les luttes de la classe ouvrière sur la scène sociale et étudier en profondeur le rôle historique du prolétariat.
Dans notre presse, nous avons déjà analysé que, depuis 2003, la classe ouvrière est dans une dynamique positive par rapport au recul qu’elle a subi avec l’effondrement des pays de l’Est. De nombreuses manifestations de cette analyse se retrouvent dans des luttes plus ou moins importantes mais qui ont toutes pour caractéristique de montrer la réappropriation progressive par la classe de ses réflexes historiques comme la solidarité, la réflexion collective, et plus simplement, l’enthousiasme face à l’adversité.
Nous avons pu voir ces éléments à l’œuvre dans les luttes contre les réformes des retraites en France en 2003 et en 2010-2011, dans la lutte contre le CPE, toujours en France, en 2006, mais aussi de façon moins étendue en Grande-Bretagne (aéroport d’Heathrow, raffineries de Lindsay), aux Etats-Unis (Métro de New York), en Espagne (Vigo), en Egypte, à Dubaï, en Chine, etc. Les mouvements des Indignés et Occupy, surtout, reflètent une expression beaucoup plus générale et ambitieuse que des luttes se développant au sein d’une entreprise, par exemple. Qu’avons-nous vu, notamment, dans les mouvements des Indignés ? Des ouvriers de tous horizons, du précaire au cadre, simplement venus pour vivre une expérience collective et attendre d’elle une meilleure compréhension des enjeux de la période. Nous avons vu des personnes s’enthousiasmer à la seule idée de pouvoir à nouveau discuter librement avec d’autres. Nous avons vu des personnes discuter d’expériences alternatives et d’en poser les atouts et les limites. Nous avons vu des personnes refuser d’être les victimes impassibles d’une crise qu’ils n’ont pas provoquée et qu’ils refusent de payer. Nous avons vu des personnes mettre en place des assemblées spontanées, y adopter des formes d’expression favorisant la réflexion et la confrontation, limitant la perturbation et le sabotage des discussions. Enfin et surtout, le mouvement des Indignés a permis l’éclosion d’un sentiment internationaliste, la compréhension que, partout dans le monde, nous subissons la même crise et que nous devons lutter contre elle par-delà les frontières.
Certes, nous n’avons pas, ou peu, entendu parler explicitement de communisme, de révolution prolétarienne, de classe ouvrière et de bourgeoisie, de guerre civile, etc. Mais ce que ces mouvements ont montré, c’est avant tout l’exceptionnelle créativité de la classe ouvrière, sa capacité à s’organiser, issues de son caractère inaliénable de force sociale indépendante. La réappropriation consciente de ces caractéristiques est encore au bout d’un chemin long et tortueux, mais elle est indéniablement à l’œuvre. Elle s’accompagne forcément d’un processus de décantation, de reflux, de découragement partiel. Elle alimente cependant la réflexion des minorités qui se situent à l’avant-garde du combat de la classe ouvrière au niveau mondial, et dont le développement est visible, quantifiable, depuis plusieurs années.
C’est un processus sain qui contribue à la clarification des enjeux auxquels la classe ouvrière est confrontée aujourd’hui.
Finalement, même si les difficultés posées à la classe ouvrière sont énormes, rien ne permet dans la situation d’affirmer que les jeux sont faits, que la classe ouvrière n’aura pas la force de développer des luttes massives puis révolutionnaires. Bien au contraire, les expressions vivantes de la classe se multiplient et en étudiant ce qu’elles ont vraiment, non en apparence, où seule leur fragilité est évidente, mais en profondeur, alors apparaît le potentiel, la promesse d’avenir qu’elles contiennent. Leur caractère minoritaire, épars et sporadique n’est là que pour nous rappeler que les principales qualités des révolutionnaires sont la patience et la confiance en la classe ouvrière1 ! Cette patience et cette confiance s’appuie sur la compréhension de ce qu’est historiquement, la classe ouvrière : la première classe à la fois exploitée et révolutionnaire qui a pour mission d’émanciper toute l’humanité du joug de l’exploitation. Il s’agit là d’une vision matérialiste, historique, à long terme ; c’est cette vision qui nous a permis d’écrire en 2003, lorsque nous dressions le bilan de notre XVe congrès international : “Comme le disent Marx et Engels, il ne s’agit pas de considérer “ce que tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier imagine momentanément comme but. Seul importe ce qu’il est et ce qu’il sera historiquement contraint de faire conformément à cet être” (la Sainte famille). Une telle vision nous montre notamment que, face aux coups très forts de la crise du capitalisme, qui se traduisent par des attaques de plus en plus féroces, la classe réagit et réagira nécessairement en développant son combat. Ce combat, à ses débuts, sera fait d’une série d’escarmouches, lesquelles annonceront un effort pour aller vers des luttes de plus en plus massives. C’est dans ce processus que la classe se comprendra à nouveau comme une classe distincte, ayant ses propres intérêts et tendra à retrouver son identité, aspect essentiel qui en retour stimulera sa lutte.”
GD, 25 octobre
1) Lénine aurait ajouté l‘humour !
Récent et en cours:
- Luttes de classe [15]
Rubrique:
Le sport dans la phase ascendante du capitalisme (1750-1914) (Histoire du sport dans le capitalisme I)
- 7479 lectures

Le sport représente depuis longtemps déjà un phénomène que nul ne peut ignorer du fait de son ampleur culturelle et de sa place dans la société. Phénomène de masse, il nous est imposé par le biais d’institutions tentaculaires et d’un matraquage médiatique permanent. Quelle signification peut-on en donner du point de vue de l’analyse historique et de la classe ouvrière ?
Dans le premier article de cette série, nous allons essayer d’apporter quelques réponses en nous penchant sur les origines et la fonction du sport dans la société capitaliste ascendante.
Le mot “sport” est un terme d’origine anglaise. Hérité des jeux populaires et des divertissements aristocratiques, il est né en Angleterre avec les débuts de la grande industrie capitaliste.
Un pur produit du système capitaliste
Le sport moderne se distingue nettement des jeux, divertissements ou exercices physiques du passé. S’il en hérite les pratiques, c’est pour s’orienter exclusivement vers la compétition : “Il a fallu que le développement des forces productives capitalistes soit suffisamment important pour que l’idée abstraite de rendement apparaisse de la masse des travaux concrets (…) de même il a fallu un long développement des pratiques physiques compétitives pour que se dégage peu à peu l’idée de compétition physique généralisée” (1). L’équitation de la noblesse aboutira de la sorte aux courses de chevaux. C’est d’ailleurs à l’occasion d’une course que sera inventé en 1831 le chronographe. Dès 1750, le Jockey-club en Angleterre fera la promotion des nombreuses courses de chevaux qui ne cesseront de se développer par la suite. Il en ira de même avec la course à pieds et les autres sports. Le jeu populaire de la soule fera naitre les rencontres de football (1848 à Cambridge, le football association en 1863), le jeu de paume transformé donnera bien plus tard le premier tournoi de tennis en 1876, etc. En bref, les nouvelles disciplines seront toutes orientées vers la compétition : “Le sport se dégagera ainsi petit à petit de ce chaos confus et complexe de gestes naturels pour former un corpus cohérent et codifié de techniques hautement spécialisées et rationalisées, adaptées au mode de production capitaliste-industriel” (2). De la même manière que le travail salarié est lié à la production dans la société capitaliste, le sport va incarner “la matérialisation abstraite du rendement corporel” (3).
Très rapidement, la recherche de la performance, celle des records, accompagnée des paris et des jeux d’argent, va alimenter une diversité d’activités sportives dont certaines connaitront un véritable engouement populaire permettant d’oublier momentanément l’usine. Ce sera le cas par exemple du cyclisme avec le Tour de France (sorte de “fête gratuite”) dès 1903, de la boxe, du football, etc. En lien avec le développement du système capitaliste, les transports et les communications, le sport va connaitre un essor en Europe comme dans le reste du monde. L’extension et l’institutionnalisation du sport, la naissance et la multiplication des fédérations nationales, vont concorder avec l’apogée du système capitaliste, dès les années 1860 mais surtout dans les dernières décennies du xixe siècle puis du début du xxe siècle. C’est à ce moment que le sport va réellement s’internationaliser. Le football, par exemple, sera introduit en Amérique du Sud par des ouvriers européens venu travailler sur les chantiers des lignes ferroviaires. Le premier groupement international sportif est celui de l’Union Internationale des Courses de yachts en 1875. Puis d’autres vont prospérer : Club international de concours hippiques en 1878, Fédération internationale de gymnastique en 1881, Aviron et patinage dès 1892, etc. Le CIO (Comité international olympique) sera fondé en 1894, la FIFA (Fédération internationale de football association) en 1904. La plupart des organismes internationaux vont se constituer avant 1914.
Contrairement à l’opinion officielle entretenue, le sport version capitaliste ne représente pas une simple “continuité” des jeux antiques. L’olympisme des Grecs anciens ne se basait absolument pas sur l’idée du record ou l’obsession de la performance et du chronomètre. Si la confrontation entre adversaires existait, elle entrait dans un cérémonial religieux et des mythes qui n’ont plus rien à voir avec l’univers matériel et mental des jeux contemporains. Même si l’aspect militaire, la guerre entre cités, la volonté de se “doper” et la dimension mercantile étaient déjà présents. Les jeux Olympiques, comme ceux de Paris en 1900 ou de Londres en 1908, sont déjà de véritables foires commerciales. Mais surtout, ces jeux s’inscrivent dans un contexte de montée des tensions guerrières et participent à alimenter le nationalisme ambiant. L’institution des jeux Olympiques créée en 1896, comme pseudo-tradition de la Grèce ancienne libérant les esclaves et devant correspondre à l’idéal démocratique affiché par Pierre de Coubertin et son célèbre adage, “l’essentiel est de participer”, n’est qu’une imposture ! Ces jeux modernes réactivés pour propager l’hystérie chauvine, le militarisme, se situent dans le cadre de l’aliénation capitaliste où tout repose sur l’élitisme et les rapports de domination liés à la production de marchandises.
Au début du xixe siècle, le sport est d’ailleurs une pratique exclusivement réservée à l’élite bourgeoise, notamment des jeunes éduqués en milieu scolaire. C’est l’occasion pour les bourgeois de se montrer, de se divertir et de rivaliser en permettant aux dames d’exhiber avec ostentation leurs nouvelles toilettes. C’est l’heure des grands rendez-vous aux hippodromes, des grands lieux du nautisme, des premiers sports d’hiver, comme à Chamonix, des clubs de golf qui se multiplient. Ces clubs qui se créent sont donc réservés à une bourgeoisie qui en interdit l’accès aux ouvriers (4).
Du fait même des conditions d’exploitation capitaliste, au début du xixe siècle, les ouvriers n’ont ni les moyens ni le temps de faire du sport. L’exploitation forcenée dans l’usine ou la mine et l’Etat misérable au quotidien ne permettent qu’à peine la reconstitution de la force de travail. Même les enfants de la classe ouvrière, frappés de rachitisme, doivent se sacrifier à l’usine dès l’âge de 6-7 ans. La journée de 10 heures ne sera instituée que tardivement, pas avant 1900 et la journée de repos ne sera obtenue qu’en 1906.
Un enjeu de la lutte de classe pour les ouvriers
Dans un premier temps, le mouvement ouvrier marque une méfiance et une certaine distance vis-à-vis des pratiques sportives bourgeoises. Mais dans leur volonté de se constituer en classe autonome et de développer les luttes revendicatives et les réformes sociales, les ouvriers réussissent à arracher aux capitalistes des activités sportives qui leur étaient jusque-là interdites ou inaccessibles.
Le sport des ouvriers va naître en réalité timidement, avant que ne se constituent officiellement les clubs et les fédérations sportives ouvrières issues et obtenues par de grandes luttes (5). A l’origine, tout attroupement à la sortie de l’usine, même en petit nombre, était illégal. Les jeux populaires risquant les désordres, comme le jeu de la soule, avaient été interdits par les autorités sur la voie publique (Highway act britannique de 1835). La moindre tentative de jeu apparaissait comme suspecte et “dangereuse” aux yeux des patrons. La police la considérait comme un “trouble à l’ordre public”. Confiné initialement dans un espace clôt et discret, le sport des ouvriers ne naîtra vraiment que dans la mouvance des trade-unions et ne se développera qu’après l’ère victorienne. Dans les quartiers ouvriers, un sport informel s’inscrivait alors dans toute une ambiance, une culture, une sociabilité fondée sur l’appartenance de classe. L’activité physique était ressentie comme un besoin alimentant les liens sociaux, celui de se retrouver ensemble.
D’une certaine manière, l’activité sportive était associée par les ouvriers à l’esprit fraternel qui avait donné naissance par solidarité à l’assistance mutuelle. Dès les années 1890, sur ces bases, les clubs ouvriers se multiplient donc (football ou cyclisme) et se développeront plus tard dans les “banlieues rouges”. Il s’agit désormais pour des ouvriers qui se constituent en classe autonome, de trouver une opportunité pour lutter contre l’abrutissement au travail, s’unir pour s’éduquer et développer leur conscience par l’activité politique et la propagande. Ainsi, en France, dès sa création en 1907, l’Union sportive socialiste affirme la nécessité de “faire de la réclame (…) pour le parti, en organisant des fêtes sportives et en participant aux diverses épreuves athlétiques qui se disputent”. La Fédération sportive athlétique socialiste, souligne l’année suivante : “nous voulons créer à la portée de la classe ouvrière des centres de distraction qui se développeront à côté du Parti et qui seront (…) des centres de propagande et de recrutement” (6). Par les activités sportives, les militants de la classe ouvrière ont conscience de permettre en même temps une lutte préventive contre les méfaits de l’alcoolisme et les ravages de la délinquance. Dans sa plateforme, l’USPS (Union sportive du Parti socialiste) souligne par exemple qu’il faut “développer la force musculaire et purifier les poumons de la jeunesse prolétarienne, donner aux jeunes gens des distractions saines et agréables, ce qui serait un palliatif à l’alcoolisme et aux mauvaises fréquentations, ramener au parti de jeunes camarades (…) développer parmi les jeunes socialistes l’esprit d’association et d’organisation” (7).
En Allemagne, ces mêmes préoccupations étaient partagées dans les années comprises entre 1890 et 1914 par le parti social-démocrate (SPD), très influent, qui s’est impliqué dans l’éducation des masses ouvrières, appuyant la constitution de clubs et de fédérations sportives en plus des structures syndicales et des bourses du travail. En 1893, “l’Union gymnique des ouvriers” pouvait ainsi voir le jour et faire contrepoids au nationalisme ambiant. Dans un souci d’unité et d’internationalisme, les ouvriers seront même être amenés à créer en Belgique, en 1913, une “Internationale Socialiste de culture physique”.
Le sport devient un véritable moyen de contrôle social
Bien entendu, face à ces initiatives ouvrières, la bourgeoisie ne restait pas les bras croisés et cherchait à attirer les ouvriers dans ses propres structures, notamment les plus jeunes. Le mouvement ouvrier était parfaitement conscient de cela, comme en témoigne en France un article de l’Humanité publié en 1908 : “Les autres partis politiques, surtout ceux de la réaction, cherchaient par tous les moyens à attirer chez eux la jeunesse en créant des patronages ou l’athlétisme tenait une large place” (8).
Pour le patronat à l’esprit paternaliste, récupérer l’activité physique ouvrière pour la détourner à son profit devenait rapidement un souci majeur, notamment dans la grande industrie. Le baron Pierre de Coubertin lui même était affolé par l’idée d’un “sport socialiste”. Dès lors, pour renforcer la soumission à l’ordre établi, le sport devenait un des outils majeurs à disposition. C’est ainsi que les patrons allaient créer des clubs dans lesquels les ouvriers étaient conviés de s’impliquer. Les clubs des mines en Angleterre, par exemple, permettaient de stimuler l’esprit de concurrence entre ouvriers, d’empêcher les discussions politiques et contribuaient à briser les grèves dans l’œuf. Avec ce même esprit, les patrons en France développaient des clubs, comme le cyclisme des Grands magasins sinueux de Lyon (1886), l’équipe de football du Bon marché (1887), le club Omnisport des usines automobiles Panhard-Levassor (1909), ce sera le cas aussi de Peugeot à Sochaux, du Stade Michelin à Clermont-Ferrand (1911), etc. : des clubs destinés à un contrôle social, à un flicage des ouvriers. On peut prendre pour exemple celui du directeur des Mines de Saint-Gobain “qui notait sur les livrets des sociétaires les présences, les attitudes pendant le travail gymnique et les opinions politiques”. Dans le même esprit, le fondateur du Racing-club de Paris, en 1897, Georges de Saint Clair, pensait qu’il était important d’occuper les jeunes sportifs plutôt que de les “laisser au cabaret pour s’occuper de politique et fomenter des grèves” (9).
Beaucoup plus fondamentalement, dans un cadre codifié, le sport permettait au corps des ouvriers de devenir plus facilement un appendice de la machine et des technologies naissantes. Le corps du sportif comme du travailleur, était en quelque sorte mécanisé, fragmenté, comme pour les gestes à l’entrainement, à l’image même de la division du travail et des mouvements accomplis dans l’usine. La force de travail, comme celle du sportif compartimenté par discipline, était soumise en quelque sorte au rythme du temps industriel : “La concurrence suppose que les travaux se sont égalisés par la subordination de l’homme à la machine ou par la division extrême du travail ; que les hommes s’effacent devant le travail ; que le balancier du pendule est devenu la mesure exacte de l’activité relative de deux ouvriers comme il l’est de la célérité de la locomotive. Alors il ne faut pas dire qu’une heure d’un homme vaut une heure d’un autre homme mais plutôt qu’un homme d’une heure vaut un autre homme d’une heure. Le temps est tout, l’homme n’est plus rien. Il est tout au plus la carcasse du temps” (10). Le sport moderne participe pleinement à transformer l’homme en “carcasse”, en une machine a produire pour battre des records. Il permet au patron d’exercer sa pression sur l’ouvrier qui intériorise en même temps la discipline qui tend à le rendre plus docile et corvéable. Le mouvement ouvrier était capable de déceler et de dénoncer cette réalité capitaliste du sport. Il le fera, par exemple, à propos du football anglais (professionnel depuis 1885) infecté par des “entreprises-spectacles”. La situation des joueurs jugée indigne sera alors comparée à celle d’une “traite des blanches” (11).
Le sport mobilise et prépare la guerre
Le sport, en tant que rouage de la société capitaliste fut également un des moyens privilégiés de la classe dominante pour développer le patriotisme, le nationalisme dans les rangs ouvriers et la discipline militaire. C’est ce que nous avons évoqué avec les premiers jeux Olympiques. Si en marge s’est développé un courant hygiéniste – sous l’impulsion, par exemple, du docteur Ph. Tissié (1852-1935) – soucieux de la santé de la population plus ou moins en lien avec la mode eugéniste, le sport a surtout servi à renforcer l’esprit de compétition et à préparer la guerre. En Allemagne, Ludwig Jahn allait fonder en 1811 le “Turplatz” (club de gymnastique) dans un esprit patriotique et militaire marqué. Il va réussir clandestinement à créer une véritable armée de réserve destinée à contourner la limitation des effectifs militaires imposée par l’Etat français. Dans les années 1860, l’institution scolaire va militariser la gymnastique et inculquer “l’ordre et la discipline” (zucht und ordnung).
En France, il en allait de même avec une culture militariste chauvine. L’Union des sociétés de gymnastique de France était créé en 1873. Et, ce n’est pas un hasard, se développait en même temps le tir comme discipline complémentaire (fondation en 1886 de l’Union des sociétés de tir en France). Le 26 juin 1871, Gambetta déclarait déjà ceci : “il faut mettre partout, à côté de l’instituteur, le gymnaste et le militaire” pour faire “œuvre de patriotes” (12).
Après la défaite de Sedan et l’annexion de l’Alsace-Lorraine, la bourgeoisie française prépare ainsi sa “revanche”. La loi du 27 janvier 1880 fait entrer la gymnastique dans l’école primaire. Le célèbre Jules Ferry va être un grand promoteur de l’éducation militaire des jeunes fils d’ouvriers. Dès juillet 1881, les autorité parisiennes vont organiser les enfants des écoles communales de garçons dans des “bataillons scolaires”. Quatre “bataillons” équipés (en uniformes, bérets de la flotte et vareuses bleues) et armés seront en manœuvre sur le boulevard Arago avant les cours classiques, encadrés par un “chef de bataillon de l’armée territoriale” et quatre professeurs de gymnastiques. Le 6 juillet 1882, après le décret d’officialisation de ces pratiques, Jules Ferry s’adressera à ces enfants de la manière suivante : “Sous l’apparence d’une chose bien amusante vous remplissez un rôle profondément sérieux. Vous travaillez à la force militaire de demain” (13).
Cette “force militaire de demain”, avec l’ensemble des sportifs formés, c’est celle qui va servir de chair à canon dans la grande boucherie de 1914. Ce qui permet au directeur de “l’Auto”, Henri Desgranges, de déclarer le 5 août 1914 avec légèreté et cynisme : “Tous nos petits troupiers qui sont en ce moment à la frontière pour défendre le sol de la patrie ne vivent-ils pas, à nouveau, des impressions déjà vécues, lorsqu’ils étaient aux prises avec l’adversaire dans les compétitions internationales ?” (14).
Durant les massacres, on relève un épisode passé longtemps sous silence et mis en scène par le film “Joyeux noël” : celui d’un match de football improvisé opposant sur le front des soldats allemands et anglais cherchant à fraterniser. Ils furent brutalement déportés et réprimés : de ce sport-là, la bourgeoisie et ses officiers n’en voulaient pas ! La seule “contribution” sportive de cette guerre monstrueuse sera l’importation par les troupes américaines de nouvelles disciplines venues des Etats-Unis en 1917 : le volley-ball et le basket-ball. Maigre “consolation” quand on déplore plus de dix millions de morts.
WH, 29 octobre
A paraître prochainement la deuxième partie de cette série : “Le sport dans le capitalisme décadent (1914 à nos jours)”.
1) J-M Brohm, Sociologie politique du sport, 1976, réédition : Nancy, P.U.N., 1992.
2) Idem.
3) Idem.
4) Il existera ensuite un clivage de classe dans les choix et la pratique du sport. Dans le cricket, on trouvait au sein même de cette discipline un même clivage dans le choix des postes : ainsi, le batsman était de classe sociale élevée, valorisée, alors que le lanceur et ceux qui ramassent les balles sont des classes populaires.
5) Pierre Arnaud, les Origines du sport ouvrier en Europe, L’Harmattan 1994.
6) Le Socialiste, no 208, 9-16/05/1909.
7) P. Clastres et P. Dietschy, Sport, société et culture en France, Hachette Carré Histoire.
8) Idem.
9) Idem.
10) Karl Marx, Misère de la philosophie.
11) Le Socialiste des 8-15/12/1907
12) ht [111]tp ://books.google.fr/books [111].
13) P. Clastres et P. Dietschy Sport société et culture en France, Hachette Carré Histoire.
14) J-M Brohm, Sociologie politique du sport, 1976, réédition : Nancy, P.U.N., 1992.
Rubrique:
«L’Homme qui aimait les chiens» de Léonardo Padura
- 2372 lectures
 Le livre de Léonardo Padura paru en 2011 en français, l’Homme qui aimait les chiens, a connu un succès important dans de nombreux milieux littéraires et politiques. Il retrace la vie de Trotski depuis sa mise à l’écart du pouvoir soviétique par Staline en 1927, puis son exil forcé et sans fin de 1929 à 1940, de la Turquie au Mexique en passant par la France et la Norvège, avec les multiples humiliations que sa femme, ses enfants et lui-même durent subir de la part des autorités. Persona non grata sur cette “planète sans visa”, ce grand révolutionnaire finira reclus dans une maison transformée en bunker pour mourir sous le piolet de Ramon Mercader (alias Frank Jacson ou Jacques Mornard), militant stalinien formaté par Moscou pour devenir le tueur froid et calculateur exclusivement destiné à l’assassinat de Trotski. Comme Léon Trotski, Mercader aime les chiens (d’où le titre du roman) ; des lévriers russes, les barzoïs.
Le livre de Léonardo Padura paru en 2011 en français, l’Homme qui aimait les chiens, a connu un succès important dans de nombreux milieux littéraires et politiques. Il retrace la vie de Trotski depuis sa mise à l’écart du pouvoir soviétique par Staline en 1927, puis son exil forcé et sans fin de 1929 à 1940, de la Turquie au Mexique en passant par la France et la Norvège, avec les multiples humiliations que sa femme, ses enfants et lui-même durent subir de la part des autorités. Persona non grata sur cette “planète sans visa”, ce grand révolutionnaire finira reclus dans une maison transformée en bunker pour mourir sous le piolet de Ramon Mercader (alias Frank Jacson ou Jacques Mornard), militant stalinien formaté par Moscou pour devenir le tueur froid et calculateur exclusivement destiné à l’assassinat de Trotski. Comme Léon Trotski, Mercader aime les chiens (d’où le titre du roman) ; des lévriers russes, les barzoïs.
C’est l’histoire parallèle de ces deux personnages que retrace ce livre, histoire racontée par un troisième, le narrateur, dont la caractéristique est d’être lui-même une victime de l’oppression castriste et un déçu du socialisme. Comme le dit l’auteur : “je voulais écrire un roman sur l’assassinat de Léon Trotski, dire ce que cela avait signifié pour le mouvement révolutionnaire du xxe siècle, l’image de l’utopie, le destin de l’Union soviétique et le reste des pays socialistes. Mais ce devait être un livre cubain, écrit de Cuba par quelqu’un qui vit à Cuba.” De fait, le constat général de cet ouvrage est amer. Léonardo Padura l’assume pleinement et écrit en postface : “J’ai voulu me servir de l’histoire de l’assassinat de Trotski pour réfléchir à la perversion de la grande utopie du xxe siècle, ce processus où nombreux furent ceux qui engagèrent leur espérance et où nous fûmes tant et tant à perdre nos rêves et notre temps, quand ce ne fut pas notre sang et notre vie.”
Cependant, l’auteur s’est efforcé de faire montre d’une honnêteté historique et ne sombre pas, contrairement à de nombreux livres anti-communistes haineux et falsificateurs (cf. le Livre noir du communisme qui fut un chef d’œuvre en la matière !). L’Homme qui aimait les chiens, en gestation pendant près de vingt années, est documenté, assez fidèle à ce que les archives ont révélé aux chercheurs et à ce que les historiens sérieux comme Isaac Deutscher ou Julian Gorkin (ancien poumiste) ont pu rapporter sur la vie de Trotski et les éléments autour de son assassinat comme sur la personnalité de Ramon Mercader.
Effrayant est le récit de l’univers anti-trotskyste : les assassinats en série des membres de la famille de Trotski, de ses amis et alliés politiques, les désertions, les trahisons et infiltrations autour de Trotski. Le livre de Padura montre bien encore la pression implacable de la terreur, des procès de Moscou par lesquels Trotski voit sombrer moralement et mourir ses anciens compagnons de lutte les plus endurcis, tous les crimes staliniens, dans leurs expressions les plus monstrueuses. Face à cela, la désorganisation et l’amateurisme politique des partisans trotskistes à Mexico ne peut pas faire le poids et la maison fortifiée de Coyoacán ne fait que peu illusion. Trotski, malade et prématurément vieilli, sait que Staline pourra frapper quand il l’aura décidé. Il sait également que si ce dernier l’a laissé en vie jusqu’ici c’est pour mieux l’utiliser à ses fins personnelles et comme justification aux purges qu’il infligera de façon massive aux anciens bolcheviks et au prolétariat russe. Mais que son tour viendra inévitablement.
Léonardo Padura décrit pourtant un Trotski toujours combatif et incisif, dont la fibre révolutionnaire n’est pas émoussée, malgré les multiples et dures épreuves. Il continue sans relâche son travail politique, multipliant les correspondances de par le monde et les publications, analysant sans relâche tous les événements de l’époque, comme la guerre d’Espagne. Ce qui ressort du portrait de Trotski dressé par l’écrivain, c’est celui d’un homme résolu, d’une volonté de fer, plein d’exigences qu’il s’impose à lui-même et à son entourage, avec quelques faiblesses très humaines qui n’entachent en rien l’image d’un homme de haute valeur quoi que parfois tyrannique avec son entourage le plus proche. Les débats qu’il ouvre avec André Breton sur l’art et la littérature nous montrent un être totalement ouvert aux idées artistiques et à la liberté de leurs expressions, prônant sans concession aucune la totale licence dans ce domaine. Mais dans ce tableau, une ombre est projetée sur Trotski, c’est celle de l’épisode de 1921 à Kronstadt. A plusieurs reprises, Léonardo Padura lui prête des retours de pensées pleines de remords sur ces événements ; or, Trotski n’a, semble-t-il, pas fait part de ces réflexions, s’il en a eu dans ces termes-là.
Les calculs malsains et inhumains du bourreau Staline s’expriment clairement dans le travail psychologique effectué avec Mercader. On assiste ainsi à la transformation d’un jeune communiste idéaliste en un fanatique prêt à tout pour servir la cause stalinienne. Mercader est une sorte de héros malgré tout, qui est plus le jouet des événements et de son entourage que quelqu’un qui assume pleinement son destin. Sa mère, Caridad Mercader, bourgeoise déchue, droguée et alcoolique, possède un pouvoir entier sur son fils ainsi que son amant, Leonid Eitingon, cynique mentor du NKVD.
Concernant la personnalité de la femme et son parcours politique, Léonardo Padura commet cependant une erreur historique qui peut être due au bain “fidéliste” et anti-anarchiste dans lequel il baigne inévitablement à Cuba. En effet, elle est décrite au début du livre comme quittant régulièrement son domicile et ses enfants pour s’adonner à une vie dissolue dans les milieux anarchistes. Or, ces derniers en Espagne prônaient une sobriété exemplaire et une attitude sociale moralement supérieure, en tant qu’expression de la classe ouvrière et de sa lutte pour la révolution. Il fallait donc rétablir cette vérité à l’honneur des anarchistes espagnols.
Son crime accompli, Mercader est présenté dans l’ouvrage comme un militant courageux et déterminé qui ne parle pas, qui ne trahit pas Staline pendant ses vingt années d’incarcération au Mexique. Pour autant, on sait que Joe Hansen, un des gardes du corps de Trotski, fut le premier à pénétrer dans le bureau du fondateur de la IVe Internationale, quelques instants après l’assaut. Il décrit un Mercader sanglotant, qui balbutiait frénétiquement : “Ils ont emprisonné ma mère… Ils m’ont forcé à le faire”. La terreur de la GPU a en réalité terrassé le jeune idéaliste, et lui a imposé ce silence. Sans jamais se repentir d’un crime dont il avait fini par comprendre qu’il était inutile et barbare, Mercader se taira, non par extrême dévouement à une cause, mais pour se protéger. Il vivra et mourra, probablement empoisonné par une montre radioactive, dernier “cadeau” du KGB, en rebut de la nomenklatura soviétique, méprisé de tous. Comme sa mère, Mercader a été un pion important de l’aristocratie rouge internationale. Homme intelligent et cultivé, il a fait ce choix valorisant. Avant l’assassinat, Mercader avait pourtant saisi la nature de la terreur stalinienne et son modus operandi (notamment lors des procès de Moscou). D’autres individus, dans des conditions similaires, auraient tenté de se rebeller au nom de la morale supérieure de leurs idéaux, et auraient essayé de se sortir du piège que signait cette entreprise. Léonardo Padura insiste ainsi sur l’admiration que porte Mercader à Andres Nin, militant du PC espagnol puis du Poum trotskiste, à son courage exemplaire et à son abnégation, qui lui vaudront d’être assassiné par la Guépéou en 1937. Aussi, peut-être possédé par le doute, individu complexe pris dans l’engrenage de la monstruosité bureaucratique stalinienne, Mercader ira malgré tout jusqu’au bout du projet pour lequel il a été choisi.
Un autre protagoniste non négligeable de l’histoire et du roman se trouve dans la personne de Sylvia Ageloff. Léonardo Padura ne lui donne cependant pas la juste place qu’elle mérite. Jeune assistante sociale de Brooklyn, elle milite dans le Socialist Workers Party, d’obédience trotskiste. L’entourage de Mercader s’arrange pour que celui-ci fasse sa connaissance lors du voyage de l’Américaine à Paris en juin 1939. Elle tombe éperdument amoureuse de cet homme beau et cultivé, qui prétend n’avoir aucun intérêt pour la politique. Mercader la séduit, à la seule fin de pouvoir approcher Trotski sans éveiller de soupçon, quand les deux amants se rendront à Mexico. Le double jeu fonctionnera à la perfection. Mercader trompera doublement Ageloff : sur le plan de ses sentiments personnels, mais aussi sur le plan de ses intentions politiques. Il traite la jeune femme avec mépris ; il la décrit comme naïve, voire idiote, insiste sur sa prétendue laideur. Pour dresser le portrait de la militante trotskyste, Padura reprend des informations tendancieuses et erronées. Dans le roman, elle est décrite comme une personne superficielle et sans épaisseur politique. Pourquoi avoir brossé un tel portrait misogyne et approximatif ? Dans une audition devant une commission d’enquête à la Chambre des représentants en 1950, Sylvia Ageloff s’exprime avec conviction et dans une langue sophistiquée. Elle défendit avec courage son engagement dans la gauche trotskyste pendant la période du maccarthysme. En outre, elle veilla scrupuleusement à la sécurité de Trotski et évita rigoureusement de venir accompagnée de Mercader lors de ses visites à la villa de Coyoacán. Car c’est en gagnant la sympathie des gardes de la villa, puis des époux Rosmer, des camarades français fidèles, à qui il servit de chauffeur et rendit des petits services qu’il put se rapprocher progressivement de Trotski, jusqu’à pouvoir être seul avec lui. Sylvia Ageloff (1910-1995) eut un sort tragique et vécut le reste de sa vie dans l’indignité. Profondément accablée par l’événement, elle refusa jusqu’à sa mort d’en parler avec qui que ce soit mais elle reçut le soutien et l’affection sans faille de Natalia Sedova, la veuve de Léon Trotski. Licenciée par son employeur à son retour de Mexico (où elle fut même un temps suspectée de collusion avec Mercader), elle dut prendre le nom de sa mère (Maslow) pour échapper à ses tourmenteurs.
Sa sœur, Ruth Ageloff-Poulos, fut d’ailleurs secrétaire de la Commission John Dewey qui se tint à Mexico en 1937 et qui blanchit Trotski des accusations portées contre lui par Staline.
Le bilan que tire Léonardo Padura de la période de l’après-révolution d’Octobre est donc très négatif et à l’aune des espoirs déçus à l’égard du socialisme de la part du narrateur, dans lequel on peut reconnaître l’auteur lui-même. Mais son livre est d’une grande qualité, tant littéraire qu’historique, et réussi le tour de force de nous tenir en haleine, sans que nous puissions en rater une ligne tout au long, alors que nous savons dès le début quel sera l’inévitable dénouement final. La lecture de l’Homme qui aimait les chiens nous laisse bien sûr un arrière-goût âcre de cette partie de l’histoire que furent les années 1930 et pourrait démoraliser en donnant l’impression et la certitude que “l’utopie révolutionnaire” est définitivement perdue.
Cependant, pour nous, révolutionnaires, il n’en est rien. Léon Trotski aimait se référer à cette maxime du philosophe Spinoza : “Ni rire, ni pleurer, mais comprendre.” C’est cela qui doit nous guider et nous faire avancer.
Wilma (23 octobre)
Personnages:
- Trotski [112]
Rubrique:
Socialisme ou Barbarie? (Rosa Luxemburg)
- 2249 lectures
 Nous publions ci-dessous de larges extraits du premier chapitre 1 de la brochure de Rosa Luxemburg la Crise de la social-démocratie 2. Ce texte magistral de 1915 doit être une source d’inspiration face aux difficultés actuelles du prolétariat. Alors confrontée à la pire boucherie de l’histoire de l’humanité, la Première Guerre mondiale 3 , et à la trahison de la social-démocratie qui a contribué à embrigader dans ce carnage impérialiste les ouvriers de tous les pays, Rosa Luxemburg ne cède pas au découragement. Au contraire ! Elle plaide pour un marxisme vivant, non dogmatique, empreint de la méthode scientifique, qui regarde les erreurs et les défaites en face pour en tirer les leçons et mieux préparer l’avenir. Car cette révolutionnaire a une confiance inébranlable en l’avenir et dans la capacité du prolétariat mondial à accomplir sa mission historique : lutter consciemment pour l’émancipation de toute l’humanité.
Nous publions ci-dessous de larges extraits du premier chapitre 1 de la brochure de Rosa Luxemburg la Crise de la social-démocratie 2. Ce texte magistral de 1915 doit être une source d’inspiration face aux difficultés actuelles du prolétariat. Alors confrontée à la pire boucherie de l’histoire de l’humanité, la Première Guerre mondiale 3 , et à la trahison de la social-démocratie qui a contribué à embrigader dans ce carnage impérialiste les ouvriers de tous les pays, Rosa Luxemburg ne cède pas au découragement. Au contraire ! Elle plaide pour un marxisme vivant, non dogmatique, empreint de la méthode scientifique, qui regarde les erreurs et les défaites en face pour en tirer les leçons et mieux préparer l’avenir. Car cette révolutionnaire a une confiance inébranlable en l’avenir et dans la capacité du prolétariat mondial à accomplir sa mission historique : lutter consciemment pour l’émancipation de toute l’humanité.
CCI
[…] Finie l’ivresse. […] L’allégresse bruyante des jeunes filles courant le long des convois ne fait plus d’escorte aux trains de réservistes et ces derniers ne saluent plus la foule en se penchant depuis les fenêtres de leur wagon, un sourire joyeux aux lèvres […]. Dans l’atmosphère dégrisée de ces journées blêmes, c’est un tout autre chœur que l’on entend : le cri rauque des vautours et des hyènes sur le champ de bataille. […] La chair à canon, embarquée en août et septembre toute gorgée de patriotisme, pourrit maintenant en Belgique, dans les Vosges, en Masurie, dans des cimetières où l’on voit les bénéfices de guerre pousser dru. […] Les affaires fructifient sur des ruines. Des villes se métamorphosent en monceaux de décombres, des villages en cimetières, des régions entières en déserts, des populations entières en troupes de mendiants, des églises en écuries. […]
Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu’elle est. Ce n’est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l’ordre, de la paix et du droit, c’est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l’anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l’humanité qu’elle se montre toute nue, telle qu’elle est vraiment.
Et au cœur de ce sabbat de sorcière s’est produit une catastrophe de portée mondiale : la capitulation de la social-démocratie internationale. Ce serait pour le prolétariat le comble de la folie que de se bercer d’illusions à ce sujet ou de voiler cette catastrophe : c’est le pire qui pourrait lui arriver. “Le démocrate” (c’est-à-dire le petit-bourgeois révolutionnaire) dit Marx, “sort de la défaite la plus honteuse aussi pur et innocent que lorsqu’il a commencé la lutte : avec la conviction toute récente qu’il doit vaincre, non pas qu’il s’apprête, lui et son parti, à réviser ses positions anciennes, mais au contraire parce qu’il attend des circonstances qu’elles évoluent en sa faveur.” Le prolétariat moderne, lui, se comporte tout autrement au sortir des grandes épreuves de l’histoire. Ses erreurs sont aussi gigantesques que ses tâches. Il n’y a pas de schéma préalable, valable une fois pour toutes, pas de guide infaillible pour lui montrer le chemin à parcourir. Il n’a d’autre maître que l’expérience historique. Le chemin pénible de sa libération n’est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d’erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l’atteindra s’il sait s’instruire de ses propres erreurs. Pour le mouvement prolétarien, l’autocritique, une autocritique sans merci, cruelle, allant jusqu’au fond des choses, c’est l’air, la lumière sans lesquels il ne peut vivre. Dans la guerre mondiale actuelle, le prolétariat est tombé plus bas que jamais. C’est là un malheur pour toute l’humanité. Mais c’en serait seulement fini du socialisme au cas où le prolétariat international se refuserait à mesurer la profondeur de sa chute et à en tirer les enseignements qu’elle comporte.
Ce qui est en cause actuellement, c’est tout le dernier chapitre de l’évolution du mouvement ouvrier moderne au cours de ces vingt-cinq dernières années. Ce à quoi nous assistons, c’est à la critique et au bilan de l’œuvre accomplie depuis près d’un demi-siècle. La chute de la Commune de Paris avait scellé la première phase du mouvement ouvrier européen et la fin de la Ire Internationale. A partir de là commença une phase nouvelle. Aux révolutions spontanées, aux soulèvements, aux combats sur les barricades, après lesquels le prolétariat retombait chaque fois dans son Etat passif, se substitua alors la lutte quotidienne systématique, l’utilisation du parlementarisme bourgeois, l’organisation des masses, le mariage de la lutte économique et de la lutte politique, le mariage de l’idéal socialiste avec la défense opiniâtre des intérêts quotidiens immédiats. Pour la première fois, la cause du prolétariat et de son émancipation voyait briller devant elle une étoile pour la guider : une doctrine scientifique rigoureuse. A la place des sectes, des écoles, des utopies, des expériences que chacun faisait pour soi dans son propre pays, on avait un fondement théorique international, base commune qui faisait converger les différents pays en un faisceau unique. La théorie marxiste mit entre les mains de la classe ouvrière du monde entier une boussole qui lui permettait de trouver sa route dans le tourbillon des événements de chaque jour et d’orienter sa tactique de combat à chaque heure en direction du but final, immuable.
C’est le parti social-démocrate allemand qui se fit le représentant, le champion et le gardien de cette nouvelle méthode. […] Au prix de sacrifices innombrables, par un travail minutieux et infatigable, elle a édifié une organisation exemplaire, la plus forte de toutes ; elle a créé la presse la plus nombreuse, donné naissance aux moyens de formation et d’éducation les plus efficaces, rassemblé autour d’elle les masses d’électeurs les plus considérables et obtenu le plus grand nombre de sièges de députés. La social-démocratie allemande passait pour l’incarnation la plus pure du socialisme marxiste. Le parti social-démocrate occupait et revendiquait une place d’exception en tant que maître et guide de la IIe Internationale. […] La social-démocratie française, italienne et belge, les mouvements ouvriers de Hollande, de Scandinavie, de Suisse et des Etats-Unis marchaient sur ses traces avec un zèle toujours croissant. Quant aux Slaves, les Russes et les sociaux-démocrates des Balkans, ils la regardaient avec une admiration sans bornes, pour ainsi dire inconditionnelle. […] Pendant les congrès, au cours des sessions du bureau de l’Internationale socialiste, tout était suspendu à l’opinion des Allemands. […] “Pour nous autres Allemands, ceci est inacceptable” suffisait régulièrement à décider de l’orientation de l’Internationale. Avec une confiance aveugle, celle-ci s’en remettait à la direction de la puissante social-démocratie allemande tant admirée : elle était l’orgueil de chaque socialiste et la terreur des classes dirigeantes dans tous les pays.
Et à quoi avons-nous assisté en Allemagne au moment de la grande épreuve historique ? A la chute la plus catastrophique, à l’effondrement le plus formidable. […] Aussi faut-il commencer par elle, par l’analyse de sa chute […]. La classe ouvrière, elle, ose hardiment regarder la vérité en face, même si cette vérité constitue pour elle l’accusation la plus dure, car sa faiblesse n’est qu’un errement et la loi impérieuse de l’histoire lui redonne la force, lui garantit sa victoire finale.
L’autocritique impitoyable n’est pas seulement pour la classe ouvrière un droit vital, c’est aussi pour elle le devoir suprême. Sur notre navire, nous transportions les trésors les plus précieux de l’humanité confiés à la garde du prolétariat, et tandis que la société bourgeoise, flétrie et déshonorée par l’orgie sanglante de la guerre, continue de se précipiter vers sa perte, il faut que le prolétariat international se reprenne, et il le fera, pour ramasser les trésors que, dans un moment de confusion et de faiblesse au milieu du tourbillon déchaîné de la guerre mondiale, il a laissé couler dans l’abîme.
Une chose est certaine, la guerre mondiale représente un tournant pour le monde. […] La guerre mondiale a changé les conditions de notre lutte et nous a changés nous-mêmes radicalement. Non que les lois fondamentales de l’évolution capitaliste, le combat de vie et de mort entre le capital et le travail, doivent connaître une déviation ou un adoucissement. […] Mais à la suite de l’éruption du volcan impérialiste, le rythme de l’évolution a reçu une impulsion si violente qu’à côté des conflits qui vont surgir au sein de la société et à côté de l’immensité des tâches qui attendent le prolétariat socialiste dans l’immédiat toute l’histoire du mouvement ouvrier semble n’avoir été jusqu’ici qu’une époque paradisiaque. […] Rappelons-nous comment naguère encore nous décrivions l’avenir :
[…] Le tract officiel du parti, Impérialisme ou socialisme, qui a été diffusé il y a quelques années à des centaines de milliers d’exemplaires, s’achevait sur ces mots “Ainsi la lutte contre le capitalisme se transforme de plus en plus en un combat décisif entre le Capital et le Travail. Danger de guerre, disette et capitalisme - ou paix, prospérité pour tous, socialisme ; voilà les termes de l’alternative. L’histoire va au-devant de grandes décisions. Le prolétariat doit inlassablement œuvrer à sa tâche historique, renforcer la puissance de son organisation, la clarté de sa connaissance. Dès lors, quoi qu’il puisse arriver, soit que, par la force qu’il représente, il réussisse à épargner à l’humanité le cauchemar abominable d’une guerre mondiale, soit que le monde capitaliste ne puisse périr et s’abîmer dans le gouffre de l’histoire que comme il en est né, c’est-à-dire dans le sang et la violence, à l’heure historique la classe ouvrière sera prête et le tout est d’être prêt.” […] Une semaine encore avant que la guerre n’éclate, le 26 juillet 1914, les journaux du parti allemand écrivaient “Nous ne sommes pas des marionnettes, nous combattons avec toute notre énergie un système qui fait des hommes des instruments passifs de circonstances qui agissent aveuglément, de ce capitalisme qui se prépare à transformer une Europe qui aspire à la paix en une boucherie fumante. Si ce processus de dégradation suit son cours, si la volonté de paix résolue du prolétariat allemand et international qui apparaîtra au cours des prochains jours dans de puissantes manifestations ne devait pas être en mesure de détourner la guerre mondiale, alors, qu’elle soit au moins la dernière guerre, qu’elle devienne le crépuscule des dieux du capitalisme” (Frankfurter Volksstimme) […] Et c’est alors que survint cet événement inouï, sans précédent : le 4 août 1914.
Cela devait-il arriver ainsi ? […] Le socialisme scientifique nous a appris à comprendre les lois objectives du développement historique. Les hommes ne font pas leur histoire de toutes pièces. Mais ils la font eux-mêmes. Le prolétariat dépend dans son action du degré de développement social de l’époque, mais l’évolution sociale ne se fait pas non plus en dehors du prolétariat, celui-ci est son impulsion et sa cause, tout autant que son produit et sa conséquence. Son action fait partie de l’histoire tout en contribuant à la déterminer. Et si nous pouvons aussi peu nous détacher de l’évolution historique que l’homme de son ombre, nous pouvons cependant bien l’accélérer ou la retarder. Dans l’histoire, le socialisme est le premier mouvement populaire qui se fixe comme but, et qui soit chargé par l’histoire, de donner à l’action sociale des hommes un sens conscient, d’introduire dans l’histoire une pensée méthodique et, par là, une volonté libre. Voilà pourquoi Friedrich Engels dit que la victoire définitive du prolétariat socialiste constitue un bond qui fait passer l’humanité du règne animal au règne de la liberté. Mais ce “bond” lui-même n’est pas étranger aux lois d’airain de l’histoire, il est lié aux milliers d’échelons précédents de l’évolution, une évolution douloureuse et bien trop lente. Et ce bond ne saurait être accompli si, de l’ensemble des prémisses matérielles accumulées par l’évolution, ne jaillit pas l’étincelle de la volonté consciente de la grande masse populaire. La victoire du socialisme ne tombera pas du ciel comme fatum, cette victoire ne peut être remportée que grâce à une longue série d’affrontements entre les forces anciennes et les forces nouvelles […]. Friedrich Engels a dit un jour : “La société bourgeoise est placée devant un dilemme : ou bien passage au socialisme ou rechute dans la barbarie.” Mais que signifie donc une “rechute dans la barbarie” au degré de civilisation que nous connaissons en Europe aujourd’hui ? Jusqu’ici nous avons lu ces paroles sans y réfléchir et nous les avons répétées sans en pressentir la terrible gravité. Jetons un coup d’œil autour de nous en ce moment même, et nous comprendrons ce que signifie une rechute de la société bourgeoise dans la barbarie. Le triomphe de l’impérialisme aboutit à l’anéantissement de la civilisation – sporadiquement pendant la durée d’une guerre moderne et définitivement si la période des guerres mondiales qui débute maintenant devait se poursuivre sans entraves jusque dans ses dernières conséquences. C’est exactement ce que Friedrich Engels avait prédit, une génération avant nous, voici quarante ans. Nous sommes placés aujourd’hui devant ce choix : ou bien triomphe de l’impérialisme et décadence de toute civilisation, avec pour conséquences, comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière ; ou bien victoire du socialisme, c’est-à-dire de la lutte consciente du prolétariat international contre l’impérialisme et contre sa méthode d’action : la guerre. C’est là un dilemme de l’histoire du monde, un ou bien – ou bien encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. Le prolétariat doit jeter résolument dans la balance le glaive de son combat révolutionnaire : l’avenir de la civilisation et de l’humanité en dépendent. Au cours de cette guerre, l’impérialisme a remporté la victoire. En faisant peser de tout son poids le glaive sanglant de l’assassinat des peuples, il a fait pencher la balance du côté de l’abîme, de la désolation et de la honte. Tout ce fardeau de honte et de désolation ne sera contrebalancé que si, au milieu de la guerre, nous savons retirer de la guerre la leçon qu’elle contient, si le prolétariat parvient à se ressaisir et s’il cesse de jouer le rôle d’un esclave manipulé par les classes dirigeantes pour devenir le maître de son propre destin.
La classe ouvrière paie cher toute nouvelle prise de conscience de sa vocation historique. Le Golgotha de sa libération est pavé de terribles sacrifices. Les combattants des journées de Juin, les victimes de la Commune, les martyrs de la Révolution russe – quelle ronde sans fin de spectres sanglants ! Mais ces hommes-là sont tombés au champ d’honneur, ils sont, comme Marx l’écrivit à propos des héros de la Commune, “ensevelis à jamais dans le grand cœur de la classe ouvrière”. Maintenant, au contraire, des millions de prolétaires de tous les pays tombent au champ de la honte, du fratricide, de l’automutilation, avec aux lèvres leurs chants d’esclaves. Il a fallu que cela aussi ne nous soit pas épargné. Vraiment nous sommes pareils à ces Juifs que Moïse a conduits à travers le désert. Mais nous ne sommes pas perdus et nous vaincrons pourvu que nous n’ayons pas désappris d’apprendre. Et si jamais le guide actuel du prolétariat, la social-démocratie, ne savait plus apprendre, alors elle périrait “pour faire place aux hommes qui soient à la hauteur d’un monde nouveau”.
Junius (1915)
1) Dont le titre est “Socialisme ou barbarie”.
2) Aussi connue sous le nom de “La brochure de Junius”, pseudonyme utilisé par Rosa pour le signer, ce texte est intégralement disponible sur le site marxists.org.
3) De pires atrocités viendront ensuite, comme la Seconde Guerre mondiale.
Personnages:
- Rosa Luxemburg [113]
Rubrique:
Révolution Internationale n° 438 - décembre 2012 et janvier 2013
- 1635 lectures
En Israël et Palestine, les populations otages de la guerre impérialiste
- 1439 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article réalisé par World Revolution, organe de presse du CCI en Grande-Bretagne.
Une fois de plus, les missiles israéliens ont frappé Gaza. En 2008, l’opération « plomb durci » avait tué presque 1500 personnes, souvent des civils, malgré les déclarations prétendant que seuls les terroristes faisaient l’objet de « frappes chirurgicales ». La bande de Gaza est une des régions les plus pauvres et les plus densément peuplées du monde. Il est ainsi absolument impossible de distinguer les « terroristes » des zones résidentielles qui les entourent. Malgré les armes sophistiquées dont Israël dispose, la majorité des dommages de la campagne militaire actuelle touche aussi les femmes, les enfants et les vieillards.
Gaza est une fois de plus punie, comme ce fut le cas non seulement lors du massacre précédent, mais également à travers le blocus qui a paralysé son économie, affamé les populations et brisé les efforts de reconstruction après les ravages de 2008.
Par rapport à la puissance de frappe de l’Etat israélien, les capacités militaires du Hamas et des autres groupes djihadistes radicaux de Gaza sont dérisoires. Cependant, à cause du chaos en Libye, le Hamas a mis la main sur des missiles de longue portée plus efficace. En plus d’Ashdod au Sud (où trois habitants d’un immeuble résidentiel ont été tués par une roquette tirée depuis la bande de Gaza), Tel-Aviv et Jérusalem sont à présent à leur portée. La menace de paralysie qui saisit Gaza commence aussi à se faire sentir dans les principales villes israéliennes.
En clair, les populations des deux côtés de la frontière sont les otages des logiques militaristes adverses qui dominent Israël et la Palestine – avec une aide discrète de l’armée égyptienne qui patrouille aux frontières de Gaza pour empêcher les incursions ou les évasions indésirables. Les deux populations sont victimes d’une guerre permanente – sous la forme de roquettes et de bombes, mais aussi en portant le poids grandissant d’une économie plombée par les besoins de la guerre. De plus, la crise économique mondiale contraint aujourd’hui la classe dominante en Israël comme en Palestine à adopter de nouvelles mesures de restrictions du niveau de vie, à augmenter les prix des produits de première nécessité.
En Israël, l’an dernier, l’augmentation du prix des logements fut à l’origine du mouvement de protestation qui a pris la forme de manifestations massives et d’assemblées – mouvement directement inspiré des révoltes du monde arabe et qui avait pour mots d’ordre « Netanyahou, Assad, Moubarak sont tous les mêmes » et « Arabes et Juifs veulent des logements accessibles et décents ». Pendant ce bref mais stimulant mouvement de lutte, tout dans la société israélienne était ouvert à la critique et au débat – y compris le « problème palestinien », l’avenir des colonies et des territoires occupés.
Une des plus grandes peurs des protestataires était que le gouvernement ne réponde à ce défi en appelant à « l’unité nationale » et en se lançant dans une nouvelle aventure militaire.
De même, l'été dernier, dans les territoires occupés de la Bande de Gaza et de Cisjordanie, l’augmentation du prix du carburant et de la nourriture a provoqué une série de manifestations de colère, des barrages routiers et des grèves. Les ouvriers du transport, de la santé et de l’éducation, les étudiants et les écoliers, ainsi que des chômeurs, se sont retrouvés dans la rue face à la police de l’Autorité palestinienne pour exiger des hausses de salaires, du travail, la baisse des prix et la fin de la corruption. Des manifestations contre le coût de la vie ont même été organisées dans le royaume voisin de Jordanie.
Malgré les différences de niveau de vie entre les populations israélienne et palestinienne, en dépit du fait que cette dernière subit en plus l’oppression et l’humiliation militaire, les racines de ces deux révoltes sociales sont exactement les mêmes : l’impossibilité grandissante de vivre dans un système capitaliste en crise.
Les motifs de la dernière escalade militaire ont fait l’objet de nombreuses spéculations. Netanyahou essaye-t-il d’attiser la haine nationaliste pour améliorer ses chances de réélection ? Le Hamas a-t-il provoqué ces attaques à la roquette pour prouver sa détermination face aux bandes islamistes plus radicales ? Quel rôle sera appelé à jouer dans le conflit le nouveau régime en Égypte ? Comment ces événements vont-ils affecter la guerre civile en Syrie ?
Toutes ces questions sont pertinentes mais ne permettent pas de répondre au problème de fond qui les relie. La réalité, c'est qu'il s'agit d'une escalade guerrière impérialiste, aux antipodes des intérêts et des besoins des populations israéliennes, palestiniennes et plus largement du Moyen-Orient.
Lorsque les révoltes sociales permettent aux exploités de se battre pour leurs intérêts matériels contre les capitalistes et l’État qui les exploitent, la guerre impérialiste crée une fausse unité entre les exploités et leurs exploiteurs, accentuant leur division. Lorsque les avions d’Israël bombardent Gaza, cela offre des nouvelles recrues au Hamas et aux djihadistes dont tout Juif qui se respecte est censé être l’ennemi. Lorsque les roquettes des djihadistes s’abattent sur Ashdod ou Tel-Aviv, encore plus d’Israéliens se tournent vers la protection et les appels à la vengeance de « leur » État contre les « Arabes ». Les problèmes sociaux pressants qui animent les révoltes sont engloutis sous une avalanche de haine et d’hystérie nationalistes.
Petites ou grandes, toutes les nations sont impérialistes ; petites ou grandes, toutes les fractions bourgeoises n’ont jamais aucun scrupule à utiliser la population comme chair à canon au nom des intérêts de la « patrie ». D’ailleurs, devant l’actuelle escalade de la violence à Gaza, quand les gouvernements « responsables » et démocratiques comme ceux des États-Unis et de la Grande-Bretagne appellent à « l’apaisement », au retour vers « le processus de paix », l’hypocrisie atteint des sommets. Car ce sont ces mêmes gouvernements qui font la guerre en Afghanistan, au Pakistan, en Irak. Les États-Unis sont également le principal soutien financier et militaire d’Israël. Les grandes puissances impérialistes n’ont aucune solution « pacifique » pas plus que les États comme l’Iran qui arme ouvertement le Hamas et le Hezbollah. Le réel espoir d’une paix mondiale ne se trouve pas chez « nos » dirigeants, mais dans la résistance des exploités, dans leur compréhension grandissante qu’ils ont les mêmes intérêts dans tous les pays, le même besoin de lutter et de s’unir contre un système qui ne peut rien offrir d’autre que la crise, la guerre et la destruction.
Amos (20 novembre)
Rubrique:
Austérité en France : la gauche poursuit l’œuvre de la droite
- 1887 lectures

Après son élection, François Hollande déclarait : “Une alternance change le pouvoir mais elle ne change pas la réalité”. Ces propos illustrent pleinement combien, depuis plusieurs décennies déjà, les illusions autour des partis de gauche, socialistes en tête, se sont définitivement évanouies, au point que les principaux intéressés ne cherchent désormais même plus à se fendre, la mine compassée et la main tremblante, des traditionnelles postures de défenseurs des opprimés.
Aujourd’hui, la gauche est “responsable” et “moderne” – entendez : prête à toutes les attaques, à toutes les manœuvres pour la défense de son système.
Néanmoins, les règnes de François Mitterrand et de Lionel Jospin n’ont pas complètement écorné l’idée selon laquelle la gauche serait moins brutale et plus protectrice que la droite. L’élection sans enthousiasme de François Hollande est à ce titre significative : aucune illusion sur des lendemains plus heureux ne s’est manifestée autre que le faible espoir de “normaliser” l’exercice du pouvoir et de donner aux inévitables plans de rigueur une coloration plus “juste”.
Pourtant, après sept mois de “hollandisme”, rien ne laisse à penser que la gauche est “moins pire” que la droite : mêmes esbroufes autour des usines en faillite érigées en point de fixation médiatique et destinées à camoufler le défilé sans fin des licenciements ; mêmes ignominies envers les prolétaires immigrés que l’Etat pourchasse avec acharnement ; mêmes plans de rigueur à travers lesquels la classe ouvrière est sacrifiée sur l’autel des “objectifs budgétaires” que le gouvernement n’atteindra vraisemblablement pas... Tout est comme avant, en pire…
Les “justes” attaques du PS
Depuis juillet, le gouvernement multiplie, en effet, les mesures d’austérité en augmentant les impôts et en diminuant les dépenses de l’Etat dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’aide sociale, etc. Ainsi, le budget de 2013 en cours d’élaboration prévoit une économie historique de trente-sept milliards d’euros. Cet “effort historique”, “le plus important depuis 1945”, selon les mots du gouvernement, a même poussé l’OCDE à recommander au gouvernement français de ne pas adopter de nouvelles mesures de rigueur afin de ne pas tomber dans une récession irréversible.
Malgré les déclarations du gouvernement décrivant ces attaques comme un “effort juste”, prétendant même que “les nouvelles hausses d’impôts épargneront neuf français sur dix”, la plupart des mesures concernent évidemment les travailleurs. L’exemple le plus stupéfiant est le rétablissement de la “TVA sociale” 1 en 2014, dispositif imaginé par le gouvernement précédent que le candidat Hollande avait tant décrié, ensuite supprimé une fois élu... puis rétabli six mois plus tard !
Le piège de la “compétitivité nationale”
C’est au nom de la “compétitivité nationale” que droite et gauche font payer la crise à la classe ouvrière. Selon la bourgeoisie, la cause de tous les maux de “la nation” est le coût trop élevé du travail par rapport à celui des pays “vertueux” comme l’Allemagne ou la Chine. Afin de faciliter la vente des marchandises nationales face à la concurrence étrangère, les travailleurs devraient patriotiquement accepter la misère croissante.
En fait, les motifs idéologiques pour justifier les plans de rigueur au nom de la compétitivité sont de grossiers mensonges. Les pays dans lesquels les ouvriers ont “courageusement accepté les sacrifices”, tels l’Irlande, l’Allemagne ou le Royaume-Uni, ont tous été emportés par le raz-de-marée de la crise économique. La vérité, la voici : la bourgeoisie n’a plus aucune solution à la crise du capitalisme. Pourquoi ? Parce que les électeurs font toujours le “mauvais choix” ? Parce que les politiciens sont méchants ? Parce que des “lobbies” tiennent en secret les “rênes du pouvoir” ? Rien de tout cela ! Le capitalisme est arrivé au bout de ses propres contradictions économiques et sociales. L’Etat n’a aucune solution parce qu’il n’y a plus de solution à la surproduction généralisée de marchandises face à laquelle la restriction des coûts salariaux est foncièrement impuissante, tout comme les “coups de pouce” et la “relance” préconisés par l’extrême-gauche.
Dans tous les pays, notre classe subit les coups de boutoir de la bourgeoisie
Partout dans le monde, la classe ouvrière paye chèrement l’effondrement du capitalisme. De droite ou de gauche, libéraux, keynésiens, “pragmatiques” ou “socialistes”, les gouvernements du monde entier n’ont rien d’autre à offrir que la misère et le chômage.
En Espagne, par exemple, l’année 2013 ne s’annonce pas moins brutale que les précédentes : à lui seul, l’Etat central prévoit d’économiser quatorze milliards d’euros en coupes budgétaires et en hausses d’impôts ; les communautés et les provinces, qui assurent la gestion de budgets colossaux devraient naturellement ajouter leur pierre à l’édifice. En Italie, au Royaume-Uni, au Portugal, en Grèce, on observe partout les mêmes attaques, partout les mêmes sacrifices. Et le plus souvent, aux cures drastiques d’austérité s’ajoute l’inflation qui ronge le “pouvoir d’achat” des travailleurs et les pousse vers la misère, comme aux Pays-Bas où, en plus de la “discipline budgétaire”, le taux d’inflation n’a pas cessé d’augmenter depuis 2009 pour atteindre 3.2 % au mois d’octobre 2012.
Les prévisions mondiales de croissance s’annonçant déjà catastrophiques, nul doute que la bourgeoisie poursuivra ses attaques avec frénésie. Le prolétariat a néanmoins en lui les ressources pour résister par ses mobilisations où se forgent son unité et la conscience qu’il est la seule force sociale en mesure d’abattre le capitalisme.
El Generico (5 décembre)
1) Le taux normal de TVA est actuellement de 19,6 % et la France compte deux taux réduits de 7 % et 5,5 %. A partir de 2014, ces taux seront respectivement portés à 20, 10 et 5 %, soit une augmentation de presque sept milliards d’euros.
Géographique:
- France [5]
Rubrique:
Face au “changement”, il n’y a pas d’autre choix que la lutte
- 1722 lectures
Nous publions, ci-dessous, la “Résolution sur la situation en France” que le XXe Congrès de Révolution internationale, section du CCI en France, a récemment adoptée.
Se trouve déjà confirmée, avec l’arrivée de la gauche au pouvoir, la poursuite de l’austérité. Contrairement aux mensonges de la campagne électorale, il n’existe aucune “sortie du tunnel” et la “croissance” promise n’est que celle du chômage et de la pauvreté ! Dans ce contexte de faillite généralisée, une cynique guerre des chefs déchire le principal parti de droite. Ce symbole d’une société qui pourrit sur pied illustre à quel point le seul avenir réside définitivement dans les futurs combats de la classe ouvrière.
1.
Comme l’ensemble des grands pays européens, la France, subit l’impact de la très violente aggravation de la crise que connaît le capitalisme mondial depuis 2008. Cette aggravation est en train de franchir une nouvelle étape depuis la fin 2011 qui provoque une chute de la production dans la plupart des pays européens, notamment en France puisque depuis le quatrième trimestre 2011, les chiffres officiels annoncent que la croissance économique de ce pays est nulle.
Le fait que le taux de croissance en France ait moins baissé que dans les autres pays entre la fin 2009 et la fin 2011 devait déboucher sur une aggravation ultérieure plus importante : les amortisseurs sociaux et la faiblesse des plans d’austérité menés de 2008 à 2012 par l’équipe Sarkozy ont certes permis un plus faible impact immédiat de la crise sur la population, et notamment sur la classe ouvrière, mais ils ont été un facteur de détérioration accrue de la situation pour le capital français. Ainsi, la dette publique sera de 91 % fin 2012 alors qu’elle n’était que de 77,6 % en 2009 et cette évolution a, dès à présent, abouti à la suppression par l’agence Standard and Poor’s de la note AAA de la dette publique française signifiant que la signature de l’Etat français n’était plus tout à fait crédible.
Mais, surtout, cette dégradation de la situation du capital français par rapport à ses concurrents se traduit par un déficit commercial et une diminution des parts du marché mondial de la France qui sont passés de 5 % en l’an 2000 à 3,5 % en 2011 ce qui fait dire à l’économiste P. Artus que “La France détient le record du monde des pertes de parts de marché” 1.
2.
L’affaiblissement de la compétitivité du capital français est amplifié par l’aggravation de la crise économique, mais elle a des causes plus anciennes. Elles proviennent de certaines caractéristiques propres à la bourgeoisie française : elle craint, depuis l’immense mouvement de mai 68, l’éventualité de luttes massives de la classe ouvrière si elle mène de trop fortes attaques de ses conditions de vie. C’est pour cela que la “politique de rigueur” prévue par la présidence Sarkozy n’étaient que de 29 milliards d’euros en 2012, c’est-à-dire un niveau bien inférieur à ce qu’ont réalisé des pays comme le Royaume-Uni et l’Italie, ou l’Allemagne il y a 10 ans.
Le poids de la petite bourgeoisie est encore important sur les partis de la droite française dont certaines fractions (ce fut le cas en particulier de J. Chirac) ne comprennent pas l’importance de la recherche-développement pour le capital des pays développés. C’est la raison pour laquelle cette dernière a baissé en pourcentage du PIB à partir de 2003.
Même si la bourgeoisie française a rattrapé partiellement ces handicaps en renforçant l’intensité du travail ce qui permet une productivité horaire très forte (dont un des résultats est un taux de suicide au travail en France parmi les plus élevés au monde), ce rattrapage n’est que partiel. Les entreprises, pour rester compétitives sont obligées de rogner sur leur taux de profit ce qui handicape leur possibilité d’investissement et accroît d’autant plus les pertes de compétitivité.
Dans ces conditions, dans le cadre d’une crise économique qui ne cesse de s’approfondir, le capital français n’a pas d’autre solution que de tenter de mener des attaques économiques de bien plus grande ampleur contre la classe ouvrière. C’est ce qu’est en train de faire le gouvernement Ayrault avec le dernier plan d’austérité de 37 milliards d’euros, soit plus de 1,7 % du PIB. Ce plan va représenter l’attaque la plus violente contre la classe ouvrière depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et comme nous le montre la situation de l’Espagne ou de la Grèce, de tels plans d’austérité ne peuvent que diminuer la demande et aggraver la situation du capital national, ce qui oblige à de nouveaux plans d’austérité. Contrairement à ce que les hommes politiques nous ont répété depuis quarante ans, le “bout du tunnel” n’est pas en vue ; le capitalisme est dans une impasse et la crise précipite la classe ouvrière de tous les pays vers une dégradation sans fin de ses conditions de vie, dégradation qui s’est accélérée de façon considérable ces dernières années.
3.
En France, un des impacts les plus significatifs de l’aggravation de la crise depuis 2008 est une augmentation massive du chômage. Entre janvier 2008 et septembre 2012, le nombre de chômeurs à temps complet a augmenté d’un million pour dépasser aujourd’hui 3 millions. Et si l’on compte les chômeurs à temps partiel ce sont plus de 5 millions de personnes qui sont touchées.
Cette explosion du chômage n’est qu’une des raisons expliquant l’appauvrissement rapide d’une grande partie de la classe ouvrière ; le développement de la précarité, la baisse des salaires et l’exclusion de tous les régimes sociaux en sont les autres causes. Aujourd’hui, 9 millions de personnes (parmi lesquelles un tiers de familles monoparentales) vivent sous le seuil de pauvreté et 3,7 millions vivent avec moins de 600 euros par mois 2, et ce alors que le prix du logement engouffre une grande partie de leur revenu.
En fait, les mesures fiscales et de réduction des dépenses de santé du plan Ayrault rendent encore plus évident un phénomène partout à l’œuvre ces dernières années : ce sont les conditions de vie de l’ensemble de la classe ouvrière qui sont tirées vers le bas par l’aggravation de la crise et cela met toujours plus clairement en évidence que la situation de la classe ouvrière en Espagne et en Grèce montre l’avenir de la classe ouvrière en France.
4.
Comme pour beaucoup d’autres pays, les conséquences de l’approfondissement de la crise sur la vie de la très grande majorité de la population ont provoqué en France une alternance politique. A cette tendance générale s’est ajouté le fait qu’une grande partie de la bourgeoisie ne souhaitait pas que N. Sarkozy garde le pouvoir, et ce pour plusieurs raisons :
– les initiatives brouillonnes et contradictoires qu’il a prises pendant son quinquennat ont globalement provoqué une dégradation de la position du capital français tant sur le terrain économique qu’au plan impérialiste ;
– du fait de l’agressivité et du rejet des couches ouvrières les plus déshéritées (chômeurs, immigrés), dont N. Sarkozy a fait un des thèmes majeurs de sa propagande, sa réélection aurait été ressentie par une partie importante de la classe ouvrière comme une provocation inutile ou même dangereuse.
Mais, en même temps, cette agressivité a permis à la bourgeoisie de faire de l’anti-sarkozysme un thème important en vue de mobiliser pour une campagne électorale dans laquelle le candidat socialiste – sachant la gravité de la situation du capital français – a tenté de ne promettre que le moins possible.
Le thème majeur de la campagne du candidat F. Hollande a été qu’il mènerait une politique de croissance, c’est-à-dire de relance, prenant le contre-pied de la politique de son prédécesseur. A l’encontre de cette promesse, c’est un plan d’austérité qui a été décidé et qui, de plus, n’est qu’une amplification de celui mené par le gouvernement Fillon-Sarkozy. Quant à la promesse d’une renégociation du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance en zone Euro (TSCG), elle s’est envolée dès le candidat élu. Seul a été sauvegardée, lors du sommet de l’Euro du 19 juin, l’idée d’une “relance européenne” (permettant que ne soient pas reniées en quelques semaines toutes les promesses du candidat) mais les 100 milliards de dépenses supplémentaires décidées devront être, il va de soi, financées ce qui ne peut qu’ajouter à la montagne de dettes qui menace en permanence la finance et l’économie mondiales. D’autre part, si, à l’occasion de ce sommet, Hollande paraît s’être plus rapproché des pays de la zone euro en difficulté (Italie et Espagne) que ne l’avait fait Sarkozy, c’est d’abord parce que l’Allemagne ne peut plus maintenir, comme elle le faisait, la défense d’une politique d’austérité rigide car il est chaque jour plus évident qu’une telle politique ne peut que provoquer l’éclatement de la zone Euro.
5.
Si la nouvelle équipe au pouvoir ne retombe pas dans la politique faite d’improvisations et de coups de menton qui était celle de Sarkozy, le contenu de la politique impérialiste des deux équipes est fondamentalement la même.
Tout d’abord, l’arrivée de Sarkozy au pouvoir a impliqué un rapprochement avec les Etats-Unis, et donc une rupture avec la politique d’opposition à cette puissance que la France pratiquait depuis l’effondrement de l’URSS. Le fait le plus marquant de cette politique est le retour de la France dans le commandement intégré de l’OTAN. La déstabilisation du monde arabe a accru le besoin de ce rapprochement car les deux pays y ont des positions à défendre alors que cette déstabilisation peut être utilisée par l’Iran, la Chine et la Russie pour avancer leurs propres positions. Malgré toutes les proclamations de F. Hollande sur le retrait des troupes françaises d’Afghanistan qui n’est intervenu que quelques mois avant la date prévue par N. Sarkozy, la nouvelle équipe au pouvoir pratique par rapport aux Etats-Unis la même politique ; elle est d’ailleurs célébrée, non sans prétention, par F. Hollande : “Quand les Etats-Unis et la France sont d’accord, le monde avance”. Ainsi, la nouvelle place de la France dans l’OTAN n’a pas été remise en cause et les deux pays sont conjointement en train d’organiser une force d’intervention au Mali et ont la même position par rapport à la Syrie.
En Europe, l’affaiblissement économique de la France par rapport à l’Allemagne la pousse à défendre toujours plus l’existence de l’Union européenne et de la zone Euro car les institutions européennes sont un tremplin important pour que l’impérialisme français puisse avoir un certain poids dans l’arène mondiale. C’est pour cela que la défense des institutions européennes, malgré les désaccords qui existent entre la France et l’Allemagne sur la gestion économique de la zone euro, ont été et sont un élément important de la politique impérialiste tant de la présidence de N. Sarkozy que de celle de F. Hollande.
Sur le continent africain, F. Hollande, comme N. Sarkozy l’avait fait avant lui, fait tout pour maintenir une influence importante de l’impérialisme français dans les zones qui étaient ses chasses gardées et qui sont aujourd’hui les cibles d’autres grandes puissances comme les Etats-Unis et la Chine. La puissance américaine a déjà pris le dessus dans la région des Grands Lacs alors qu’elle s’implante de plus en plus au Sahel (bases militaires américaines en Mauritanie et au Burkina Faso) et au Maghreb (“facilités militaires” en Algérie) et qu’elle porte une responsabilité dans le présent chaos malien pour être proche tant du responsable du récent coup d’Etat, le capitaine Sanago, que du président destitué Amadou Toumani Touré. En même temps, la Chine a supplanté la France et les Etats-Unis en termes d’échanges commerciaux avec le continent africain et on voit s’accroître son influence diplomatique dans plusieurs pays francophones (Côte d’Ivoire, Gabon, Niger, RDC, etc.). C’est ce qui permet de comprendre que le rapprochement franco-américain s’applique aussi à l’Afrique malgré les croupières que la puissance américaine a taillées dans les intérêts français et c’est dans cette logique que l’on a vu la France et les Etats-Unis coopérer dans les guerres civiles en Côte d’Ivoire et en Lybie. Même si elle n’a plus les moyens de ses ambitions, la bourgeoisie française n’est pas disposée à renoncer de son plein gré à ses positions en Afrique. La politique de la France au Mali, les relations entretenues avec le président F. Ouattara de Côte d’Ivoire, la réunion à Malte du sommet 5+5 qui a créé une force de police commune pour lutter contre l’immigration clandestine dans les pays européens, l’organisation à Kinshasa du sommet de la francophonie montrent l’importance que l’impérialisme français continue d’accorder à sa présence en Afrique et le mensonge que représente la proclamation par le candidat socialiste de la fin de la Françafrique.
Comme toujours depuis 1914, le Parti socialiste reste un défenseur déterminé des intérêts impérialistes de la bourgeoisie française.
6.
Cette défense déterminée des intérêts bourgeois, on la retrouve évidemment dans la politique menée par le gouvernement socialiste pour faire passer les attaques toujours plus violentes contre le niveau de vie de la classe ouvrière imposées par l’impasse dans laquelle se trouve le capitalisme. Plusieurs méthodes sont utilisées à cet effet.
La première méthode est le mensonge pur et simple. Ainsi, on donne l’illusion à chaque travailleur que si, individuellement, son revenu diminue, ce n’est pas vrai pour les autres exploités et qu’il est donc vain d’en attendre une mobilisation. De même, à l’encontre de la propagande sur le soutien de la croissance économique par le gouvernement, ce dernier est en train de retarder ou d’annuler une série de grands travaux prévus dans le ferroviaire et le fluvial. De même aussi, derrière la propagande gouvernementale affirmant que l’augmentation des impôts ne frappera que les riches, il y a la réalité d’une augmentation qui frappera même des revenus inférieurs de 16 % à celui du salarié qui gagne le SMIC à plein temps. Dans le même sens, l’agitation très médiatisée du ministre du Redressement Productif A. Montebourg est faite pour donner l’illusion que le gouvernement agit pour sauver usines et emplois alors que les fermetures d’usines se succèdent et que le chômage augmente à une vitesse record.
Ce règne général du mensonge éhonté a pour but de donner un peu plus d’efficacité à l’utilisation que la bourgeoisie française a faite de la victoire du candidat de “gauche” : gagner du temps par rapport aux probables expressions de combativité du prolétariat en France.
Le PS au pouvoir utilise une arme plus redoutable encore que le mensonge ouvert ; il s’agit, de façon pernicieuse, de renforcer les handicaps que rencontre la classe ouvrière dans le développement de sa conscience. Dans la mesure où les grandes masses ouvrières ne sont pas encore parvenues à comprendre la nécessité et, surtout, la possibilité d’une autre société, toute la propagande gouvernementale martelant que la seule possibilité est dans la mise en œuvre d’une “rigueur” de manière juste, c’est-à-dire en favorisant les “pauvres” au détriment des “riches” vise à répandre un rideau de fumée devant la réalité des attaques capitalistes et aussi à renforcer l’idée que vouloir en finir avec le capitalisme et instaurer le communisme est un rêve chimérique.
7.
Si les expressions de combativité se sont caractérisées, comme dans les autre pays, par un éparpillement des luttes, la violence des attaques contre le niveau de vie de la classe ouvrière que provoque la crise économique va pousser les ouvriers vers des expressions de combativité d’une ampleur croissante. Ceci est vrai pour la classe ouvrière de tous les pays et c’est aussi, et surtout, vrai pour la France, car justement, la classe ouvrière de ce pays a une tradition de mobilisations massives.
Cette tradition explique pourquoi, contrairement à des pays comme l’Espagne et le Royaume-Uni, des mouvements analogues à celui des Indignés ou d’Occupy Wall Street n’ont pas réellement eu lieu en France. La cause réside dans le fait que, contrairement aux autres pays, la combativité de la classe ouvrière de ce pays s’était déjà concrétisée par des mobilisations massives comme la lutte contre le CPE en 2006 et, plus récemment, contre la réforme des retraites. De ce fait, le besoin de tels mouvements pour exprimer son mécontentement était moins ressenti au sein de la classe ouvrière ce qui veut dire que l’absence de mouvement analogue à celui des Indignés en France ne signifie pas que la classe ouvrière de ce pays aurait un retard particulier par rapport à celle des autres pays développés tant au plan de sa combativité que de sa prise de conscience. En particulier, les éléments de cette prise de conscience qu’on a pu observer au sein des jeunes générations de la classe ouvrière lors de la lutte contre le CPE en 2006 étaient très similaires à ceux qu’on a pu constater dans le mouvement des Indignés en 2011, par exemple en Espagne, sachant que l’aggravation considérable de la crise entre ces deux dates ne pouvait que renforcer la compréhension de l’impasse politique dans laquelle s’enfonce le capitalisme.
Malgré les gros handicaps qui entravent la classe ouvrière (perte de son identité de classe et absence de perspectives) autant en France que dans les autres pays, la vitesse avec laquelle la dégradation des conditions de vie va se poursuivre va pousser les exploités à tenter d’exprimer leur combativité comme on le voit en ce moment avec les manifestations massives qui ont lieu au Portugal, en Espagne et en Grèce. Même si l’habillage idéologique avec lequel la bourgeoisie tente de faire passer ces attaques va retarder et rendre plus difficiles l’explosion de luttes, il n’est pas suffisant pour l’empêcher.
Par ailleurs, comme nous l’avons vu en France et dans les autres pays, depuis quelques années, l’aggravation de la crise et les difficultés de la classe ouvrière ne peuvent que pousser des minorités à se rassembler soit pour impulser la lutte, soit pour tenter de comprendre les enjeux de la période. Le phénomène d’apparition de ces minorités, même s’il est peu visible est important car il est une manifestation du fait que la classe ouvrière garde toutes ses potentialités ; ces minorités seront un des moteurs pour le déclenchement des luttes à venir et leur développement.
8.
à l’image de l’ancien ministre A. Madelin qui proclame que “le pays est au bord de la rupture sociale”, les médias spécialisés sur les questions économiques ne laissent pas de doute sur le fait que la bourgeoisie a bien conscience tant de la poursuite de l’aggravation de la crise que de la probabilité de mouvement sociaux importants qu’elle qualifie déjà de “chaos social”.
Pour faire face à ce risque, la bourgeoisie compte principalement sur les syndicats comme elle l’a fait en 2010 lors de la réforme des retraites pour laquelle Sarkozy avait donné la gestion de l’encadrement de la lutte à l’intersyndicale et, au premier chef, à la CGT. C’est d’ailleurs en bonne partie pour tenter de renouveler la crédibilité des syndicats face au questionnement qui existe sur le thème “comment lutter” qu’un changement de leurs dirigeants est en cours.
A l’image de ce qui se passe dans les autres pays européens, les manœuvres syndicales se développent ou vont se développer dans deux directions. D’abord en polarisant l’attention, main dans la main avec le gouvernement, sur des attaques particulières très médiatisées comme la fermeture de l’usine PSA d’Aulnay-sous-Bois ou celle de l’aciérie de Florange. Cela permet de développer au maximum l’idée que le problème n’est pas celui de la classe ouvrière en général mais des ouvriers de telle ou telle usine et, en stigmatisant tel ou tel patron, d’empêcher de comprendre que c’est le capitalisme qui est en cause. Le deuxième axe que les syndicats préparent est celui de journées d’action qui auront, pour le moment, la fonction, de défouler le mécontentement, tout en cherchant à démontrer qu’il est inefficace de vouloir une extension de la lutte au-delà de l’entreprise. Enfin, on ne peut pas avoir de doute qu’à un moment où le mécontentement et l’envie de se battre deviendront plus grands au sein d’une partie de la classe ouvrière, la violence minoritaire et stérile sera aussi utilisée pour renforcer l’idée de l’inutilité de la lutte.
9.
Alors qu’il existe une réelle réflexion chez une minorité significative d’ouvriers sur les perspectives, la bourgeoisie a besoin d’un relais politique à l’action des syndicats. Les élections présidentielles lui ont permis la mise en avant du leader du Front de gauche J.-L. Mélenchon du fait de ses capacités tribunitiennes, et aussi du soutien de l’appareil du PCF. La bourgeoisie a bien compris que, pour garder sa crédibilité, le Front de gauche ne devait pas entrer dans le gouvernement socialiste, même si cela a fait grincer les dents d’un certain nombre de caciques du PCF qui étaient habitués aux bénéfices que permet d’obtenir le fait d’être dans l’équipe dirigeante d’un parti de gouvernement. Le rôle de relais politique des syndicats s’appuie aussi sur l’idéologie nationaliste que la bourgeoisie, de manière unanime, de l’extrême-droite à l’extrême-gauche, développe pour empêcher que la classe ouvrière ne parvienne à réfléchir à la seule perspective possible, c’est-à-dire au renversement du capitalisme à l’échelle mondiale et à la nécessaire solidarité des prolétaires de tous les pays.
Les groupes trotskistes n’ont joué qu’un faible rôle dans un passé récent pour les raisons suivantes :
– ils ont eu une attitude très suiviste à l’égard des grands syndicats lors du mouvement contre les réformes des retraites ;
– la bourgeoisie a mis Mélenchon sous les feux des médias pendant les élections présidentielles, ce qui a mis au second plan les candidats trotskistes qui, d’ailleurs manquaient d’envergure.
Cela ne veut pas dire que ces organisations ne seront pas amenées à jouer un rôle important dans l’avenir. Le slogan de la campagne de la candidate de Lutte ouvrière “Nathalie Arthaud, une candidate communiste à l’élection présidentielle” est significatif à cet égard : il s’agit de prendre date pour le moment où un nombre significatif d’ouvriers comprendront que la seule perspective est le communisme ; à ce moment-là, l’organisation Lutte ouvrière fera ce qu’elle a toujours fait : dévoyer et discréditer le communisme en le faisant passer pour le capitalisme d’Etat.
10.
Des mobilisations massives de la classe ouvrière sont probables, en France comme dans les autres pays, dans les années à venir. A l’image de ce que le CCI a fait par rapport aux révoltes arabes, et au mouvement des “Indignés” et des “OWS”, les révolutionnaires auront comme responsabilités :
– de comprendre le sens de ces mouvements ;
– de montrer comment ils font partie et annoncent les mouvements par lesquels le prolétariat retrouvera son identité de classe ;
– de dénoncer toutes les manœuvres des forces de la bourgeoisie pour en bloquer ou dévoyer le développement ;
– de défendre au sein de la classe ouvrière les voies par lesquelles ces mouvements pourront se développer.
Enfin, il appartiendra aux révolutionnaires de mettre à profit les interrogations de plus en plus répandues que ces mouvements feront surgir parmi les travailleurs, les chômeurs, les étudiants-futurs chômeurs ou exploités pour mettre clairement en avant la seule perspective “réaliste” face à l’effondrement de l’économie capitaliste et à la barbarie croissante qu’il provoque : le renversement de ce système par la classe exploitée dont les luttes présentes ne constituent que les préparatifs.
RI (9 décembre)
() Le Monde, 6 février 2012.
() Martin Hirsch à l’adresse http ://www.expression-publique.com/interview_reaction.php [115] ?type=iv&id=33
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [116]
Rubrique:
ArcelorMittal versus Montebourg: "patrons-voyous !” Etat sauveur ?
- 1327 lectures
 “Le problème des hauts fourneaux de Florange, ce n’est pas les hauts fourneaux de Florange, c’est Mittal”. “Nous ne voulons plus de Mittal en France parce qu’ils n’ont pas respecté la France” (1. Le ministre du Redressement productif, excusez du peu, a dernièrement bombé le torse face à la famille indienne Mittal, propriétaire du site sidérurgique ArcelorMittal de Florange, où près de 500 salariés risquent d’être bientôt jetés à la rue. Arnaud Montebourg a même été jusqu’à “menacer” ces “patrons-voyous” de nationaliser l’usine.
“Le problème des hauts fourneaux de Florange, ce n’est pas les hauts fourneaux de Florange, c’est Mittal”. “Nous ne voulons plus de Mittal en France parce qu’ils n’ont pas respecté la France” (1. Le ministre du Redressement productif, excusez du peu, a dernièrement bombé le torse face à la famille indienne Mittal, propriétaire du site sidérurgique ArcelorMittal de Florange, où près de 500 salariés risquent d’être bientôt jetés à la rue. Arnaud Montebourg a même été jusqu’à “menacer” ces “patrons-voyous” de nationaliser l’usine.
Disons-le tout net : il s’agit là d’une véritable arnaque contre la classe ouvrière ! D’abord, en braquant les projecteurs sur le seul site de Florange, une ombre gigantesque est jetée sur les plans de licenciements incessants qui tombent partout ailleurs, comme le prouve la hausse continuelle et spectaculaire du chômage. Ensuite, les 500 salariés d’ArcelorMittal sont aujourd’hui baladés de promesses en promesses pour mieux être abandonnés à leur triste sort demain. Enfin, leur défaite sera d’autant plus cuisante qu’ils seront isolés face à la propagande gouvernementale qui en aura fait un cas spécifique, coupé de leurs frères de classe pourtant victimes, hier, aujourd’hui ou demain, des mêmes attaques.
“Ministre du Redressement productif” ! Ce titre fait penser aux noms donnés par George Orwell aux ministères dans son magnifique roman d’anticipation, 1984. Dans cet ouvrage, le “ministère de la Paix” s’occupe en fait de la guerre ; le “ministère de la Vérité” est celui de la propagande et du mensonge ; le “ministère de l’Amour” s’occupe de la torture et le “ministère de l’Abondance” organise la famine. Dans le monde réel, le “ministère du Redressement productif” orchestre les vagues de licenciements massifs afin que ce fléau engendre le moins de résistance ouvrière possible.
Et il ne s’agit pas là de mettre en cause Arnaud Montebourg ou qui que ce soit d’autre. Les ministres, de gauche ou de droite, d’extrême-gauche ou d’extrême-droite, dans tous les pays, font toujours ce que leur fonction exige : défendre l’Etat et la nation… capitalistes ! Là est le cœur du problème, là est le plus grand mensonge de toute la propagande actuelle. A travers tout ce bruit médiatico-politique sur la “menace” de nationalisation, la bourgeoisie aimerait nous faire croire que l’Etat peut protéger les salariés. Mensonges ! L’Etat est le pire des patrons ! Qui, sous le nom de “réformes”, mène sans cesse des attaques générales contre nos conditions de vie ? Qui réduit continuellement l’accès aux soins, augmente l’âge de départ à la retraite et diminue les pensions ? Qui a rendu impossible la vie aux chômeurs en les culpabilisant, en les radiant massivement des statistiques officielles et en restreignant drastiquement leurs droits ? Et qui s’apprête à cogner encore plus dur sur nos têtes ? L’Etat, toujours l’Etat et encore l’Etat !
Quant aux nationalisations pour le bien-être des ouvriers, parlons-en ! Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’importante vague de nationalisations avait pour objectif de remettre sur pied l’appareil productif détruit en augmentant les cadences de travail. Rappelons-nous les paroles de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti “communiste” français, alors vice-président du gouvernement dirigé par Charles De Gaulle : “Si des mineurs doivent mourir à la tâche, leurs femmes les remplaceront”, “Retroussez vos manches pour la reconstruction nationale !” “La grève est l’arme des trusts”. Bienvenue dans le monde merveilleux des entreprises nationalisées !
“L’Etat moderne, quelle qu’en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l’Etat des capitalistes, le capitaliste collectif idéal. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n’est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble” (F. Engels en 1878). L’Etat, ce Moloch capitaliste, est viscéralement anti-prolétarien ; l’émancipation de l’humanité passe par sa destruction.
Pawel (3 décembre)
1) Les Échos du lundi 26 novembre.
Géographique:
- France [5]
Rubrique:
Réélection du président Obama: la bourgeoisie se prépare à renforcer l’austérité
- 1596 lectures
Nous publions ci-dessous un texte largement inspiré d’un article que nos camarades des Etats-Unis ont publié après l’élection d’Obama. L’intégralité de cet article est disponible sur notre site en anglais (en.internationalism.org [117]).

L’élection présidentielle de 2012 s’est conclue par un résultat positif pour les fractions les plus conséquentes de la bourgeoisie américaine. En battant son rival républicain, Mitt Romney, le président Obama a offert au Parti démocrate de diriger l’Etat quatre années supplémentaires.
Après l’élection, les médias ont fait un tapage assourdissant : Obama a remporté une victoire écrasante avec 332 voix du Collège électoral contre 206 pour Romney, nous dit-on. Il a battu son rival avec plus de 3 millions de votes populaires d’avance. Les scénarios apocalyptiques d’une nouvelle élection contestée, comme celle de 2000, sont réduits à néant. […] Les Républicains lèchent encore les blessures d’une raclée électorale qui les a même vus perdre plusieurs de leurs sièges au Sénat. […] Finalement, après quatre ans d’obstructionnisme obstiné, le GOP 1 va être contraint d’adopter un discours plus rationnel et revenir sur les grandes négociations autour de la réduction du déficit que la bourgeoisie américaine n’a pu traiter durant le premier mandat d’Obama.
Certains experts s’attendent même à ce que les résultats de l’élection marquent la fin de l’influence grandissante du Tea Party au sein du Parti républicain et soulignent que les éléments les plus rationnels pourront à présent s’affirmer et reprendre en main le parti. D’autres prévoient encore une véritable guerre au sein du GOP car ses positions racistes actuelles, sa politique sexuelle rétrograde, ses théories conspiratrices, sa défense des thèses créationnistes comme anti-scientifiques et sa haine des immigrés sont de plus en plus incompatibles avec l’exercice sérieux de la présidence et constituent une entrave réelle au retour de ce parti au gouvernement.
Mais, en dépit de ces diverses interprétations, le résultat de l’élection, et la campagne qui l’a précédée, confirment notre analyse selon laquelle nous assistons au développement d’une “crise politique” profonde au sein de la bourgeoisie américaine 2.
Le poids de la décomposition sociale au sein de la bourgeoisie américaine
Nous pouvons examiner les caractéristiques principales de cette crise selon plusieurs axes.
Les effets de la décomposition sociale exercent plus que jamais une force centrifuge au sein de la bourgeoisie elle-même menant à une incapacité croissante de certaines fractions de celle-ci d’agir dans l’intérêt global du capital national. Toutefois, ce processus n’a pas affecté de la même manière toutes les fractions de la bourgeoisie. Le Parti républicain est particulièrement touché par une dégénérescence idéologique, remettant en cause sa capacité à agir comme parti de gouvernement bourgeois crédible.
L’incapacité de la bourgeoisie à trouver une solution à la crise économique persistante a renforcé les tendances vers des luttes intestines au sein de la bourgeoisie. La décomposition idéologique du Parti républicain signifie qu’il tend à abandonner toute aptitude à gérer la crise économique d’une manière rationnelle, en retombant dans un dogmatisme économique conservateur complètement discrédité et en gaspillant son énergie dans des politiques antisyndicales qui menacent de dépouiller l’Etat de son meilleur rempart contre la classe ouvrière.
Compte-tenu de la situation actuelle, il était trop risqué pour les fractions de la bourgeoisie les plus responsables de remettre à nouveau au Parti républicain la charge du gouvernement national. Et cela, malgré le poids de la crise économique et la nécessité d’adopter une brutale politique d’austérité, alors même que ce contexte devrait pousser la bourgeoisie à ménager dans l’opposition la gauche de son appareil politique afin de mieux préparer les conditions permettant d’encadrer les futurs expressions de la colère ouvrière.
A cause de la dégénérescence du Parti républicain, les Démocrates sont laissés au pouvoir pour diriger le gouvernement national et devront mener la politique d’austérité nécessaire à la défense du capital national. Cela risque de perturber la division idéologique traditionnelle du travail au sein de la bourgeoisie, rendant les Démocrates directement responsables des douloureuses coupes dans les programmes sociaux à venir, à l’inverse de la rhétorique qu’ils ont utilisé pendant la campagne électorale sur la relance de l’économie.
Les fractions les plus responsables de la bourgeoisie sont confrontées à une situation dans laquelle il est plus difficile d’imposer sa volonté sur le processus électoral. La décomposition idéologique du Parti Républicain s’est accompagnée d’un durcissement idéologique généralisé de la société elle-même et le pays se retrouve plus divisé qu’avant en deux blocs politiques – à peu près de taille égale. La présidence d’Obama, tout en fournissant une revitalisation du mythe électoral, notamment parmi les minorités victimes du racisme et stigmatisées par les huit années de la présidence Bush, a seulement suscité un durcissement encore plus marqué et beaucoup plus durable de la droite.
Que peut attendre la classe ouvrière de la réélection d’Obama ?
Nous ne devons avoir aucune illusion sur ce que le second mandat d’Obama signifie pour la classe ouvrière. On peut le résumer en un simple mot : austérité. […] La seule question est de savoir quelle sera la profondeur des attaques et à quel rythme elles seront portées.
C’est en réalité tout à fait simple. La bourgeoisie américaine, qu’elle soit démocrate ou républicaine, de gauche ou de droite, est dans son ensemble d’accord pour dire que les perspectives budgétaires des Etats-Unis sont parfaitement insoutenables. Ils partagent tous la vision que des “réformes” devront s’ajouter aux programmes “prévus” pour tenter de mettre un frein au déficit. […] Il est vrai que les positions défendues par l’ex-candidat à la vice-présidence, Paul Ryan, comme la transformation du Medicare 3 en un système de bonus, était trop draconiennes pour être raisonnablement mise en place actuellement. Il est également vrai que les principales fractions de la bourgeoisie rejettent le mensonge grossier selon lequel la sécurité sociale doit être davantage privatisée afin d’être “sauvée”. Mais cela ne signifie pas qu’ils s’efforceront de préserver ces programmes tels qu’ils sont. Au contraire, de douloureuses attaques sont à prévoir.
Le président Obama a déjà exprimé sa volonté de réduire les programmes sociaux. Il s’agit d’ailleurs d’un élément essentiel du prétendu “grand pacte” issu du processus de négociation avec John Boehner, le président républicain de la Chambre des représentants, lors de la crise de l’été 2011 autour du plafond de la dette de l’Etat. La seule vraie différence en la matière a simplement été le désir du président d’envelopper les coupes du budget de la santé par quelques augmentations d’impôts des plus riches afin de vendre sa camelote à la population avec la rhétorique politicienne bien connue du “sacrifice partagé”.
Seule l’intransigeance du Tea Party a empêché Boehner d’accepter ce “grand pacte”, contraignant le Congrès à des compromis complexes qui posent la nécessité pour la bourgeoisie américaine d’imposer par la force les augmentations automatiques de taxes et les coupes drastiques dans les dépenses budgétaires, et ceci, dès le début de l’année prochaine.
En fait, les commentateurs politiques affirment déjà qu’il s’agit du réel enjeu de l’élection. En effet, Obama a désormais le capital politique dont il a besoin pour forcer les Républicains qui sont toujours majoritaires à la Chambre des représentants à négocier un marché qui, au moins, inclura quelques augmentations d’impôts pour les riches qui pourront, le moment venu, être vendues à la population comme des “sacrifices partagés”. La gauche du Parti démocrate peut crier qu’elle veut “protéger les Big Three” 4, mais peut-on douter réellement que suite à l’accord qui sera signé, ils n’essayeront pas de nous vendre l’idée que cela aurait été pire si les Républicains contrôlaient la Maison Blanche ? Ou essayer de nous sensibiliser à nouveau sur le fait qu’au moins les milliardaires ne seront pas exclus de ce “partage plus juste des sacrifices” ? Mais que restera-t-il exactement de cette aide aux bénéficiaires de Medicare qui ont vu fondre leurs maigres avantages ou grimper leurs prélèvements ? Que restera-t-il de ces mineurs du charbon, âgés de 65 ans, qui devront désormais attendre une ou deux années de plus pour toucher leur pension de retraite ?
Le mieux que les commentateurs puissent faire sur la relance économique est de rappeler les jours glorieux où le président Clinton avait augmenté les taxes et équilibré le budget tout en se présentant comme le président de la “plus grande expansion économique de l’histoire américaine”. Cette vision à courte vue et a-historique de la bourgeoisie fait qu’elle a perdu la mémoire sur le fait que la grande partie de cette prétendue “croissance” des années Clinton était le résultat d’une explosion de la dette alimentée par la réserve monétaire et qu’elle a engendré une véritable bulle spéculative qui a conduit à l’actuelle récession !
Ils semblent croire que les recettes de l’ère Clinton peuvent être ressuscitées et appliquées aujourd’hui, sans considération du contexte économique et historique. Nous ne savons pas si l’administration Obama croit réellement dans cette campagne médiatique qui dit combien l’économie ira mieux sous sa gouvernance. Qu’importe, même si elle reconnaît la nécessité de plus de relance, elle ne pourra rien faire dans ce sens. Quel que soit le nouveau mode de coopération que le Parti républicain va adopter à la suite de sa cuisante défaite électorale, il est peu probable qu’il adhère à une nouvelle politique de relance économique. La Réserve fédérale a récemment été appelée à agir de son propre chef en achetant davantage de valeurs hypothécaires, mais les économistes les plus sérieux sont d’accord pour dire que cela ne fera pas plus d’effet sur l’économie qu’une petite piqûre d’insecte sur le dos d’un éléphant.
En dernier lieu cependant, même s’il y avait une volonté politique pour une telle tentative de relance économique, on ne sait pas d’où viendrait tout l’argent : de la planche à billets ? De plus d’emprunts à la Chine ? Tout cela contrarierait directement le besoin pressant de réduction du déficit. La bourgeoisie est vraiment prise entre deux feux. Même si elle pouvait relancer l’économie une nouvelle fois, ceci ne ferait – à la fin – qu’aboutir à rien de plus qu’un coup d’épée dans l’eau.
Il résulte de tout cela que la victoire d’Obama n’en est pas une pour la classe ouvrière. Au contraire, il sait qu’il a désormais assez de crédit politique pour renforcer les programmes d’austérité qu’il a planifiés et que le capital national exige. Bien qu’il reste un danger pour la bourgeoisie que le Parti démocrate soit perçu comme le parti qui a présidé aux coupes drastiques, ce fait est tempéré à un certain degré par le succès idéologique qu’a eu l’administration Obama à vendre à la population le fait que sous les Républicains, les mesures auraient été pires. C’est principalement pour cette raison, plus qu’avec une profonde conviction ou un soutien à la politique d’Obama, que beaucoup d’ouvriers sont allés aux urnes et ont voté pour les Démocrates. La logique du moins pire semble avoir prédominé 5.
Mais les ouvriers qui ont encore des illusions dans la présidence d’Obama, qui croient encore qu’il peut “sauver la classe moyenne” ou qu’il est une sorte de champion des “droits des ouvriers”, n’ont pas besoin de chercher plus loin que les événements survenus pendant la grève des enseignants de Chicago pour avoir une réelle compréhension du point de vue du chef de la Maison Blanche sur ces problèmes. Nous ne devons pas oublier que ce sont les copains du président qui ont porté les coups sur les enseignants 6. Peut-on sérieusement douter sur le fait que leur conception du secteur éducatif – en réalité pour toute la classe ouvrière – est intimement partagée par le président lui-même ? En effet, la personne à l’origine du plan de réforme du système scolaire de Chicago n’était autre que l’ex-conseiller à l’école de Chicago, Arne Duncan – actuel secrétaire d’Etat à l’Education d’Obama.
Nous devons affirmer contre tous les calculs électoraux possibles que les intérêts de la classe ouvrière sont ailleurs – dans ses luttes autonomes pour défendre ses conditions de vie et de travail. Il est compréhensible que les ouvriers craignent les mesures draconiennes préconisées par le Parti républicain. Il est tout à fait possible que ce parti ait en réalité perdu la tête et n’hésiterait pas à mettre en place la politique la plus rétrograde au niveau national, s’il revenait au gouvernement. Cependant, cela signifie-t-il que nous devrions nous attendre à plus de mansuétude de la part des Démocrates ? Certainement pas ! Il est clair que, à ce niveau, la seule vraie différence entre les deux partis est le rythme et la force avec lesquelles les attaques vont tomber sur nous. Au bout du compte, les deux routes conduisent au même endroit. Lorsque nous votons Démocrates, c’est nous, ouvriers, qui donnons des coups d’épée dans l’eau. La seule véritable solution pour nous défendre est de reprendre le chemin de nos luttes autonomes autour de nos problèmes de classe.
De notre point de vue, la réélection du président Obama ne prédit pas une nouvelle ère de paix, de prospérité et de coopération.
Bien qu’il y aura probablement une tentative des fractions les plus rationnelles du Parti Républicain soucieuses de se démarquer et de regagner du crédit face au Tea Party, il n’y a pas de garantie qu’elles y parviendront. De plus, ce serait une erreur de réduire les problèmes de la bourgeoisie américaine à cet aspect seulement. Les défis qu’elle connaît sont immenses et selon toutes probabilités insurmontables. Pour la classe ouvrière, la conclusion est claire : il n’y a pas de salut dans la politique électorale bourgeoise. Nous ne pouvons défendre nos intérêts que sur un terrain fondamentalement différent.
Henk (14 novembre)
1 Great Old Party, surnom du Parti républicain.
2 Voir aussi sur notre site en français la traduction de l’article “Aux Etats-Unis, scandale à propos de ‘la suppression d’électeurs’ : tromperie politique et illusion démocratique”.
() Il s’agit du système d’assurance-maladie américain
3 Ce sont les mots du tenant et porte-parole de l’aile gauche du Parti démocrate, Ed Schultz, pour parler de la Sécurité sociale, du Medicare (système d’assurance-santé) et du Medicaid (système d’assurance maladie pour les plus démunis).
4 On doit noter, cependant, que la participation électorale était de 10 % inférieure cette année à celle de 2008.
5 Voir notre tract “Solidarity with the Chicago Teachers”
en.internationalism.org/internationalismusa/201209/5162/solidarity-chicago-teachers)
Géographique:
- Etats-Unis [118]
Personnages:
- Barack Obama [119]
Rubrique:
“Super ouragan” Sandy: colère de Mère Nature ou irrationalité du capitalisme ?
- 2489 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction de larges extraits d’un article de notre section aux Etats-Unis sur la catastrophe provoquée par le passage de l’ouragan Sandy sur les côtes américaines.

Dans le monde entier, les gens ont vu les images de destruction de villes côtières et la désolation de centaines de milliers de personnes sans toit – 40 000 dans la seule ville de New-York. Cela rappelle, entre autres, l’ouragan Katrina de 2005, la tornade à Joplin (Missouri) et l’ouragan Irène de l’année dernière. Chaque fois, la même question se pose : alors qu’avec le réchauffement climatique, l’élévation du niveau des mers et les changements dans les courants marins, il est reconnu que la fréquence des tempêtes ne va faire que croître, pourquoi rien n’est fait pour empêcher ces événements climatiques d’engendrer dégâts, catastrophes et disparitions de vies humaines ?
L’Etat d’alerte pré-ouragan : la bourgeoisie est incapable de maîtriser la situation
Après le “super-ouragan Sandy”, la plupart des blâmes face à la souffrance subie par les populations ont porté sur le choix individuel qu’ont fait certains de ne pas quitter leur maison pour rejoindre des abris. Évidemment, depuis les critiques qu’avait déclenchées la réponse à l’ouragan Katrina en 2005, la classe dominante a l’intention de redorer l’image de l’Etat. Dans une tentative de restaurer la confiance des masses, elle a besoin de propager l’idée d’un Etat capable de sauvegarder la protection de la population. En vérité, l’Etat n’est même pas capable de remplir la tâche de rendre la communication plus rapide entre les différentes agences fédérales en charge d’avertir des dangers potentiels d’une tempête. Selon les paroles de Bryan Norcross, un météorologiste respecté depuis plus de 20 ans, “elle (l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère, NOAA) a fait des prévisions remarquables. La puissance de sa prévision était fondamentalement parfaite et sa prévision de l’arrivée de la tempête sur New-York était aussi juste qu’une prévision peut l’être de nos jours”. D’ailleurs, maintenant, les prévisions de tempêtes potentiellement destructrices peuvent se faire très précisément une semaine avant qu’elles n’arrivent sur la terre ferme. Mais le Centre national des ouragans a choisi de ne donner l’alerte à la tempête que la veille du jour où l’ouragan Sandy a frappé les terres.
De toutes les façons, fondamentalement, il semble impossible, dans les conditions actuelles de “développement” urbain sous le capitalisme, d’organiser une protection rationnelle et une évacuation de zones à risque pour plusieurs raisons :
1. le nombre énorme de gens vivant dans ces zones ;
2. le manque d’infrastructures mobilisables et adéquates pour évacuer et fournir un abri aux gens à la suite d’une tempête ;
3. la destruction de l’environnement naturel et le développement urbain continu de zones entières qui ne devraient pas être utilisées à des fins urbaines ;
4. le transfert de gigantesques ressources financières, humaines et techniques vers des objectifs militaires.
Dans le cas du New Jersey, qui a été durement frappé par la tempête, la plupart des communautés sur la barrière d’îles qui borde la côte ont été développées pour attirer les touristes et les résidents d’été. Pendant des décennies, les digues en béton, les jetées rocheuses ou les autres barrières de protection ont doublé la barrière d’îles pour impulser le développement de l’industrie touristique. Les immeubles, les maisons, les routes, encerclent les plages, ce qui contribue significativement à rendre les zones de peuplement plus vulnérables à l’élévation du niveau des mers et aux tempêtes, à la détérioration qui s’en suit de la protection naturelle assurée auparavant par les plages non exploitées. Les plages non exploitées s’avèrent utiles lors des tempêtes. Leur sable se déplace ; les îles servant de barrière peuvent même migrer vers la terre et de cette façon la protéger. Mais les exigences du profit capitaliste, plutôt que d’harmoniser les principes de la nature avec les besoins humains, sont ce qui détermine le choix de continuer à développer des plages artificielles. Dans la logique du capitalisme, les avantages économiques, même temporaires, l’emportent sur le coût de la protection des vies humaines.
La ville de New-York a subi un sort identique, mais à une beaucoup plus grande échelle. Maintenant que le “super-ouragan” Sandy est passé et que chacun réalise à quel point la ville et ses millions d’habitants sont vulnérables, la cacophonie inévitable sur ce qu’il faudrait faire à l’avenir recommence. Des propositions pour des aménagements artificiels de ce qui étaient les barrières naturelles de protection du port sont à l’étude. Certaines de ces propositions sont très intéressantes et créatives ; certaines prennent même en compte l’utilisation de tels projets pour des loisirs et leur attrait esthétique. Cela montre qu’au niveau technologique et scientifique, l’humanité a développé la capacité de mettre potentiellement la science au service des besoins de l’humanité. Des digues contre les lames dues aux tempêtes ont été construites autour de la ville de Saint-Pétersbourg en Russie, à Providence, dans le Rhode Island et aux Pays-Bas. Le savoir-faire technique existe. La situation géographique de New-York, cependant, est telle que construire un brise-lames pour protéger Manhattan et des zones de Brooklyn pourrait affecter les courants de marée de telle façon qu’une lame qui frapperait le brise-lames redoublerait de force contre des zones de Staten Island et les Rockaway, qui sont parmi les zones qui ont été les plus durement frappées par l’ouragan Sandy. Il n’est pas impossible qu’une solution technique puisse être trouvée à ce problème mais, étant donné les réalités de la crise économique, il n’est pas invraisemblable d’imaginer que la ville de New-York va plutôt revenir à ce que les ingénieurs appellent des opérations de “résilience”, un terme qui décrit des interventions à petite échelle telles que l’installation de vannes dans les stations d’épuration ou le relèvement du niveau du sol dans certains endroits du quartier de Queens. Vu que New-York est une ville de plusieurs millions d’habitants qui gère une bonne part de l’économie mondiale et dont l’infrastructure est très complexe, vieille et très étendue, de telles interventions heurtent tout bon sens !
L’après-ouragan : nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes !
La campagne électorale du président Obama a vu dans l’ouragan Sandy une opportunité de réanimer la controverse entre l’aile droite la plus conservatrice de la classe dominante et son aile plus libérale sur le rôle du gouvernement. Bien sûr, elle l’a fait à son propre avantage. On a affirmé que la réponse de l’administration actuelle a été beaucoup plus efficace que la réponse de l’administration Bush après l’ouragan Katrina. En réalité, des centaines de milliers de personnes vivent depuis deux semaines – au moment où nous écrivons – dans des conditions catastrophiques. De la réouverture des écoles qui ont aussi servi d’abris, aux coupures prolongées d’électricité, au rationnement en fuel et au récent plan du maire Bloomberg pour réhabiliter les quartiers les plus dévastés dans la métropole avec le programme Rapid Repair (réparation rapide) – qui promet d’être un rafistolage destiné à étouffer la colère et la frustration de la population – l’épreuve des faits montre que la classe dominante et son appareil d’Etat bureaucratique sont dans une impasse et incapables de répondre aux besoins urgents comme à long terme de la population.
La classe ouvrière est la seule classe qui ait un avenir
A chaque épisode de “désastre naturel”, la classe dominante est particulièrement encline à empêcher que s’élabore tout un questionnement plus profond, d’une nature plus générale et qu’il y ait une réponse révolutionnaire. Quelle est la perspective pour le futur de la planète et l’espèce humaine subissant le joug d’une classe sociale qui montre qu’elle n’a aucune préoccupation pour la sécurité et le bien-être des classes qu’elle exploite ? Si l’avenir dans le capitalisme n’a rien d’autre à nous offrir que plus de destruction environnementale et des menaces toujours plus grandes pour la survie de l’espèce humaine, que doit-on faire ? Quelle alternative y a-t-il pour la construction d’un monde nouveau, différent ? Parce qu’elles n’ont pas d’intérêts économiques particuliers à défendre et aucune position de pouvoir à maintenir et à défendre dans la société capitaliste, la classe ouvrière et ses minorités révolutionnaires sont les seules forces sociales qui puissent donner des réponses débarrassées des mystifications idéologiques et qui visent à chercher la vérité. Ce n’est que sur la base d’une connaissance de comment les facteurs économiques, politiques et sociaux déterminent vraiment notre existence humaine que les classes exploitées peuvent trouver la confiance en elles-mêmes et démontrer leur capacité à offrir et finalement concrétiser une vision différente du monde.
Ana (10 novembre)
Récent et en cours:
- Catastrophes [29]
Rubrique:
Séisme de l’Aquila: quand les politiciens s’emparent des sciences, le monde entier tremble !
- 1560 lectures

Le procès qui s’est tenu à l’Aquila fin octobre est à la hauteur des dernières stupidités de télé-réalité. S’agissait-il de véritables acteurs ? D’une blague de mauvais goût ? On pourrait le penser. Hélas non, on ne rêve pas ! Le tribunal de l’Aquila a bel et bien condamné les cinq scientifiques de la commission “grand risque” à six ans de réclusion pour “homicide par imprudence”. En clair, on leur reproche d’avoir tenu des propos trop rassurants dans un communiqué de presse, tout juste une semaine avant le séisme qui frappait l’Aquila, le 6 avril 2009. Il faut se souvenir que ce séisme, d’une magnitude de 6,3 sur l’échelle de Richter, fit plus de 300 victimes et détruisit de nombreux édifices, en plus des quelques 1500 blessés. Mais de là à faire porter le chapeau à cette petite équipe de scientifiques, la faille est un peu grosse ! Quand on sait toute la complexité de ce type de prévisions, cela n’a pas de sens.
La communauté scientifique n’a d’ailleurs pas manqué de réagir : “On fait porter aux scientifiques la responsabilité d’une catastrophe imprédictible”, a déclaré à l’agence de presse Sipa, Jean-Paul Montagner, professeur de géophysique à l’Institut de physique du Globe de Paris (IPGP) et à l’université Paris-Diderot. “C’est l’ensemble du système qui a failli, et on fait porter le chapeau aux scientifiques.” Ou encore : “C’est assez déconcertant et déroutant”, estime Alexis Rigo, sismologue du CNRS à Toulouse. “Comment peut-on condamner des chercheurs sur quelque chose d’imprévisible ?” 1.
Pour y voir un peu plus clair, un petit retour en arrière, début 2009 s’impose.
La péninsule italienne est alors frappée par de nombreuses secousses qui inquiètent déjà la population. Hormis quelques fissures ça et là, on ne déplore aucun dégât mais la répétition du phénomène occupe les esprits tant et si bien que le président de la protection civile, Guido Bertolaso, avait appelé l’adjointe à la protection civile de la région, Daniela Stati, pour convoquer une réunion de la commission “grands risques” une semaine avant la catastrophe.
Plus récemment, la chaine italienne Repubblica TV a diffusé des écoutes téléphoniques qui nous informent sur ce mystérieux appel entre Bertolaso et son adjointe. L’objet de cet appel ne pourrait être plus clair : “De Bernardis [vice-président de la Protection civile], va t’appeler pour organiser une réunion à l’Aquila au sujet du “buzz” sismique. Comme ça, on fera taire les imbéciles, calmer les suppositions, préoccupations... Dis à tes employés que lorsqu’ils doivent préparer leurs communiqués, ils doivent passer par mon bureau de presse. C’est une opération médiatique, tu as compris ? Comme ça, ces supers experts des séismes diront : c’est une situation normale, ce sont des phénomènes qui se vérifient, mieux vaut 100 secousses de niveau 4 sur Richter que plus rien du tout car ces 100 secousses servent à libérer l’énergie et que donc il n’y aura jamais la secousse, celle qui fait mal” 2.
Voilà comment le pouvoir du capital achète la parole de scientifiques pour faire “taire les imbéciles” et pour se dédouaner de mesures de sécurité trop contraignantes. Cela n’est pas une nouveauté. On se rappelle bien de la fabuleuse histoire du nuage radioactif de Tchernobyl qui, nous disait-on en 1986, ne devait pas franchir la frontière française… Avec une telle démarche, on peut s’y attendre, c’est la catastrophe assurée. Alors, il s’agit pour le pouvoir de désigner des coupables, pour apaiser les esprits et retrouver le calme. Quoi de plus simple et de plus logique que d’inculper les scientifiques pour “négligence, imprudence et inexpérience” 3 ?
Sans enlever la part de responsabilité de ces scientifiques 4, en faire des boucs-émissaires très médiatisés permet aux autorités d’occulter une autre réalité : les raisons des effets si dévastateurs des catastrophes naturelles et les véritables responsables.
En 2000, la situation sismique de la péninsule avait fait l’objet d’un rapport très détaillé. De même qu’à la fin des années 1990, “[le rapport Barberi] 5 regroupait le travail de techniciens chargés de vérifier l’état de milliers de constructions publiques. Tous les maires en avaient obtenu une copie. Nombre de monuments de l’Aquila qui se sont écroulés étaient listés dans ce rapport.”
“Il y avait aussi cet ancien ingénieur qui avait lancé une alerte, en se basant sur la détection du radon, rappelle Jean-Paul Montagner. A plusieurs reprises dans les semaines qui ont précédé le séisme, Giampaolo Giuliani a prédit l’imminence d’un séisme à l’Aquila”. Avec de tels témoignages, la responsabilité des autorités n’est plus à démontrer. Une autre réalité que la bourgeoisie italienne espère sans doute masquer à travers la recherche effrénée de boucs-émissaires, c’est son indifférence et son incapacité à venir en aide à la population de l’Aquila. Comme conclut l’article de Rue89 : “Ici, 37 000 personnes vivent toujours grâce aux aides d’Etat, faute de mieux. Les travaux s’éternisent et l’espoir de voir un jour la ville refaite à neuf s’est envolé en fumée… Et la politique de rigueur du gouvernement Mario Monti n’a pas pour priorité l’aide aux victimes de tremblements de terre.”
Enkidu (5 décembre)
1 Citations issues du Nouvel Observateur du 23/10/12.
2 D’après Rue89, le 26/10/12.
3 Procès-verbal de l’Aquila cité dans le journal italien Fatto quotidiano.
4 On ne peut pas non plus nier qu’ils ont effectivement cédé à la pression politique pour rassurer les habitants.
5 “Le rapport Barberi, du nom de l’ancien chef de la Protection civile, était la plus grande étude jamais réalisée concernant la vulnérabilité sismique du pays”, Rue89, le 26/10/12.
Récent et en cours:
- Catastrophes [29]
Rubrique:
Le sport dans le capitalisme décadent (de 1914 à nos jours) (Histoire du sport dans le capitalisme II)
- 3959 lectures

/*-->*/
(Stade Melbourne Criketground : 100 000 places)
Dans le premier article [120], nous avons vu que le sport était un pur produit du capitalisme et qu'il avait été un véritable enjeu de la lutte de classe. Nous verrons, dans celui-ci, que dans la période de décadence de ce système il est un instrument de l'État destiné à asservir et à réprimer les exploités.
Au moment de la Première Guerre mondiale, le sport possède déjà une dimension planétaire. Il deviendra, en quelques décennies, un véritable phénomène de masse.
Le capitalisme d'État génère le sport de masse
A partir de 1914, l’Éat prend en charge de façon totalitaire l’organisation des grandes manifestations sportives dans chaque nation, tout comme il organise la mobilisation sous les drapeaux au moment des conflits mondiaux : « Le sport mondial comme totalité est devenu une vaste organisation et une structure administrative, une affaire nationale prise en charge par les États, en fonction de leurs intérêts diplomatiques »1. Les États construisent et financent alors des infrastructures pharaoniques : les complexes sportifs, stades de 80 à 100 000 places dont les plus grands ont pu atteindre 200 000 (Maracana au Brésil), gymnases, pistes, circuits (comme le Indianapolis Motor Speedway aux États-Unis avec ses 400 000 places) etc. De véritables parcs géants, des cathédrales d'acier et de béton se dressent, remplies de supporters ou « fidèles », comme au moment des Jeux Olympiques, des coupes du monde de football, des Grands Prix automobiles, etc., avec à chaque fois l'organisation et la logistique militaire d'une véritable armée pour produire du spectacle. Les moyens de transport et de communication sous la coupe des États permettent de drainer les foules vers ces nouveaux temples modernes. Une presse sportive spécialisée s'est développée industriellement au XXe siècle pour couvrir le moindre événement. La radio, puis la télévision, deviennent les outils privilégiés de la propagande d’État qui cherche à populariser la pratique sportive, à promouvoir davantage les spectacles-marchandises et les jeux d'argent. Un des symptômes de cette réalité est également la bureaucratisation d'institutions sportives tentaculaires : « au point qu'aujourd'hui, on ne peut absolument pas parler de sport là où manque l’organisation sportive (fédérations, clubs, etc.) »2. Ce changement d'échelle vers le sport de masse, depuis les années 1920, s'opère donc dans un contexte où l’État capitaliste « est devenu cette machine monstrueuse, froide et impersonnelle, qui a fini par dévorer la substance même de la société civile »3. Tous les grands événements sportifs sont de véritables foires commerciales d'États avec, à chaque fois, une couverture médiatique hypertrophiée. C'est ce qui explique que les effectifs des sportifs et des spectateurs explosent, notamment depuis ces trente dernières années. En France, par exemple, on ne compte qu'un million de licenciés sportifs seulement en 1914. Quarante ans plus tard, ce chiffre a doublé. Il atteindra plus de 14 millions en 2000, soit sept fois plus que dans les années 1950 !4 Aujourd'hui, des manifestations comme les Jeux Olympiques peuvent mobiliser et hypnotiser plus de 4 milliards de téléspectateurs dans le monde !
Un véritable « opium du peuple »

/*-->*/
(Stade Melbourne Criketground : 100 000 places)
Les États capitalistes sont les grands prêtres de cette nouvelle religion universelle, le sport ; un véritable « opium du peuple », une drogue inoculée depuis plusieurs décennies à hautes doses. Dans l'Antiquité, le pouvoir s'affermissait par la religion, « le pain et les jeux ». Dans l'ère du capitalisme décadent et du chômage de masse, le sport-marchandise est lui-même une véritable religion destinée à consoler, distraire et contrôler les familles ouvrières paupérisées. Plus de jeux et moins de pain, voilà la réalité capitaliste contemporaine ! Pour les populations et les masses ouvrières qui ont encore la chance d'avoir un travail, soumises aux rythmes du bureau ou de l'usine, à l'enfer de l'exploitation et à la dépersonnalisation des grands centres urbains, le spectacle sportif ou la pratique du sport deviennent, grâce à la propagande et au marketing, des « loisirs indispensables ». Le sport constitue un des moyens privilégiés pour s’abandonner soi-même aux « forces invisibles du capital ». Ainsi, les activités sportives, assimilées au « temps libre », ne se limitent finalement qu'à l'étroitesse d'un simple moyen de subsistance et de conservation physiologique : « en dégradant au rang de moyen la libre activité créatrice de l'homme, le travail aliéné fait de sa vie générique un instrument de son existence physique ».5 Vécue comme une sorte de « décompression nécessaire » pour des salariés, la pratique sportive n'est en réalité qu'un moyen de reconstituer la force de travail, comme dormir, boire et manger ! Le sport permet d’ailleurs de mieux résister physiquement aux cadences infernales. Il permet donc de faire face à la brutalité des conditions d’exploitation, d'« oublier » l'espace d'un instant les tourments de la société capitaliste. Le véritable paradoxe est que le sport lui-même s’apparente à un travail pénible, chronométré, à des souffrances volontaires enchaînant davantage aux rythmes industriels et à la performance. Il devient pour un nombre croissant d'adeptes une véritable addiction. Des salariés vont même jusqu’à s'inscrire pendant leurs vacances à des activités sportives collectives dont le contenu est proche des stages commandos. Encore une fois, le sport exprime une des réalités de l’aliénation en devenant, par sa massivité, presque indispensable, générant au final une plus grande soumission au capital. Il est reconnu que le sport permet d'accroître la productivité et encourage l'esprit de concurrence ! Dans un quotidien où le travail hérité du taylorisme tend à sédentariser les salariés et à les détruire par des gestes répétitifs et la « malbouffe », une véritable entreprise de culpabilisation accompagne en plus des discours moraux sur la « santé » et la nécessaire « lutte contre l'obésité » par le sport. Il faut être « compétitif », « dynamique » et « performant ». Ces discours sont parfaitement au diapason des nécessités de compétitivité des entreprises qui favorisent et sponsorisent les clubs sportifs tout en cherchant à vendre en même temps leur camelote « amincissante », destinée au « bien être » ou toutes autres marchandises valorisées par l'image du sport. Durant l'été 2012, par exemple, au moment des Jeux Olympiques de Londres, la capitale britannique s'est métamorphosée en une méga-foire commerciale, un véritable hypermarché pour nous inonder de produits commerciaux de toutes sortes. Partout, dans les stades et autres complexes sportifs, les moindres recoins sont placardés d'affiches et d'écrans publicitaires. Les sportifs sont des hommes-sandwichs sponsorisés, avec des tenues bardées de slogans publicitaires pour des grandes marques qu'ils s'efforcent d'exhiber au mieux devant les photographes et les caméras. Cette exhibition mercantile fait d'ailleurs partie intégrante de la stratégie de préparation, au même titre que les exercices physiques à l'entraînement. Le sport est une marchandise au service d'une économie de casino, avec des droits TV, des produits dérivés, des managers, des clubs côtés en bourse, etc. L'inflation du nombre de compétitions correspond à une arène où ce sont des États et des groupes commerciaux qui s’affrontent eux-mêmes directement sur un marché saturé. Les sportifs ne sont plus des hommes, ce sont des marchandises performantes, qui s'échangent entre clubs d'une fédération à l'autre, parfois pour des sommes astronomiques, sans avoir trop leur mot à dire. Cette commercialisation de sportifs dépersonnalisés, ou transformés en stars déifiées, renforçant même les tendances au culte de la personnalité, n'est qu'une des expressions multiples du fétichisme de la marchandise. Devenu un dieu ou une simple chose, un objet à échanger et à exploiter comme capital, le sportif professionnel est soumis de façon drastique à la loi du marché et à la rentabilité, avec obligation de résultats. Il est poussé en permanence à l'exploit extrême, pressuré et contraints au dopage et à l’autodestruction planifiée (nous aborderons ces questions dans le prochain article).

Ces sportifs-machines robotisés, dans un contexte où l'État planifie la dépolitisation et la soumission, alimentent des spectacles grandioses aux contenus extrêmes, pour une sorte de glorification, d'apologie de l'ordre établi et du pouvoir en place. A toutes les grandes manifestations sportives, les hommes d'Etat, sont aux premières loges pour récolter des fruits politiques de cet abrutissement programmé à grande échelle. Des grands spectacles hitlériens aux exhibitions staliniennes d'hier, en passant par les méga-shows des démocraties d’aujourd’hui, ces messes sportives fabriquent du rêve, favorisent l’idolâtrie, en faisant la promotion par le muscle de l'effort et du sacrifice. Elles servent surtout à embrumer les esprits, comme la religion, en les détournant de toute réflexion sur les conditions d'exploitation du capitalisme. Elles cherchent bien souvent à occulter la véritable actualité, ce qui touche à la critique et à la lutte de classe, voire à embrigader dans la guerre, comme ce fut le cas dans les années 1930.
Le sport est clairement un dérivatif à toute forme de « subversion », destiné prioritairement à la jeunesse, notamment dans les écoles, pour un lavage et un formatage des cerveaux. Si ceci fut caricatural dans les régimes nazi et stalinien, cela reste plus subtilement présent dans les démocraties. Après Mai 68 en France, « l'éphémère ministre des sports M. Nungesser, expliquait (…) qu'il fallait rendre le sport obligatoire à l'école » pour maintenir la paix sociale. Dans le même sens, M Cornec, président de la Fédération des parents d'élèves, déclarait en 1969 : « il y a juste un an, la France a été bouleversée par la révolte de la jeunesse. Tous ceux qui cherchent des solutions à ce problème complexe doivent savoir qu'aucun équilibre ne pourra être trouvé sans la solution préalable du sport scolaire ».6 Dans la même veine, les journaux expliquaient à longueurs de lignes qu'il valait mieux « faire du sport » que « d'affronter physiquement la police et les CRS » ! Dompter, mettre au pas par le sport, par ses symboles et son univers de superstitions, tout cela entre très bien dans l'optique de l'idéologie démocratique bourgeoise officielle pour un véritable contrôle social, avec des éducateurs qui doivent promouvoir le mythe du « self-made-man », celui du sportif qui peut « s'en sortir » individuellement par ses propres qualités grâce à une discipline militaire. Cette perspective égalitariste, où « chacun a sa chance » à condition de travail et d'ascèse, ne peut qu'endormir les sens de ceux qui cherchent une critique radicale de la société, de ceux qui cherchent à développer un esprit politique pour lutter contre l'ordre établi !
Le sport au service de la répression
En contribuant à endormir les esprits de la sorte, le sport prépare en même temps à la répression plus directe. Les rencontres sportives sont devenues des prétextes au déploiement de forces de police toujours plus imposantes, au nom de la défense de « l'ordre public » et de la « sécurité ». Dans un contexte où les populations urbaines sont déjà soumises à un véritable quadrillage policier, à une surveillance totale avec présence de militaires qui patrouillent désormais régulièrement dans les lieux publics, comme les gares, ce renforcement des effectifs aux abords des stades paraît « normal ». Par la présence régulière des CRS et des cars de police, l'État habitue graduellement les esprits à accepter la présence massive des forces de répression dont il a le monopole. Il faut se souvenir que dans les années 1970, les États démocratiques en Europe de l'Ouest n'avaient pas de mots assez durs pour stigmatiser les « régimes fascistes » et les « dictatures d'Amérique latine », du fait justement de la présence visible des forces de l'ordre et des militaires dans les lieux publics, près des stades notamment, comme c'était le cas en Argentine, au Brésil ou au Chili à l'époque. En 1972, aux Jeux Olympiques d'Hiver de Sapporo au Japon, la présence des 4000 soldats nippons quadrillant le site ne passait déjà pas inaperçue. Aujourd'hui, ces mêmes pratiques sont non seulement surpassées depuis longtemps dans les pays démocratiques donneurs de leçons, mais renforcées toujours par des mesures encore plus draconiennes. Il n'est plus possible de se rendre actuellement dans un stade sans traverser un véritable cordon sanitaire de flics, sans être palpé et fouillé au corps, puis « accompagné » par des « stadiers » !
Les derniers Jeux Olympiques de Londres de l'été 2012 en donnent d'ailleurs une illustration, l'image d'une véritable situation de guerre. On a compté 12 000 policiers en service et 13 500 militaires disponibles, c'est- à-dire plus que les troupes anglaises déployées en Afghanistan (9500 soldats) ! Plus que les 20 000 soldats de la Wehrmacht à Munich en 1936 ! A cela, on doit ajouter encore 13 300 agents de sécurité privés ! Un dispositif ultra-rapide de missile sol-air avait carrément été installé sur un immeuble, dans une zone densément peuplée, près du principal site olympique pour parachever un bouclier antiaérien. Dans les rues, des voies spéciales avaient été aménagées pour les véhicules officiels et interdits aux gens « ordinaires » (135 livres sterling -170 euros- d’amende au cas où ils s'y glisseraient). Enfin, les contrôles de sécurité étaient dignes de la paranoïa ordinaire de tous les Etats : fouilles systématiques en entrant sur tous les sites, interdiction d'apporter de l'eau de l'autre côté des zones contrôlées, interdiction de « tweeter », de partager ou de poster des photos de l'événement de quelque manière que ce soit !7
Si on prend du recul, l’histoire nous montre que les complexes sportifs sont de véritables points névralgiques permettant de parquer une partie de la population à des fins plus répressives encore et même meurtrières. Un des épisodes les plus célèbres est naturellement la « Rafle du Vel’ d'Hiv’ » en France, organisée par la police et les milices françaises durant l'été 1942. Ce célèbre stade vélodrome a servi alors de camp retranché où les Juifs étaient acheminés et parqués avant leur déportation vers le camp d'extermination d’Auschwitz pour connaître les sommets de l'horreur. Après la Deuxième Guerre mondiale, les exemples d'enceintes sportives au service de la mort et de la répression étatique restent nombreux. En France, après le Vel’ d'Hiv’, d'autres installations sportives sont utilisées lors du massacre d'opposants algériens en octobre 1961. Environs 7000 d'entre eux étaient menés de force vers le Palais des Sports de Versailles et le stade Pierre de Coubertin à Paris, pour y être tabassés, bon nombre finissant en cadavres jetés dans la Seine ! En juin 1966, en Afrique, les opposants au régime Mobutu étaient exécutés devant la foule au « stade des Martyrs » de Kinshasa. En Amérique latine, les stades ne servaient pas uniquement d'exutoires aux populations affamées. Le Stadio nacional chilien servait aussi de lieu « d'interrogatoires » et de « centre de tri » pour les camps de concentration après le coup d'État du général Pinochet (septembre 1973). En Argentine, au moment de la coupe du monde 1978 et de la junte militaire au pouvoir, les clameurs amplifiées par les sonos des tribunes permettaient de couvrir les hurlements des nombreux torturés. Aujourd'hui encore, bon nombre de stades intègrent l'histoire macabre. En 1994, le stade Amahoro de Kigali était un des théâtres du génocide rwandais, dont la France fut largement complice. C'est ce qu'illustre le témoignage du commandant R. Dallaire : « Lorsque la guerre a commencé, le stade s’est rempli et à un moment donné, il y avait là jusqu’à 12 000 personnes, 12 000 personnes qui essayaient d’y vivre. Tout ce qu’on voit, ce sont des gens et des vêtements, et la situation semble échapper à tout contrôle. C’est devenu… comme un camp de concentration... On était là pour les protéger, mais pendant ce temps, ils étaient en train de mourir dans ce grand stade du Rwanda ».8
Plus récemment encore, le stade de football de Kaboul a connu de nombreuses horreurs : des pendaisons sur la barre transversale des buts, des mutilations pour cause de vols, des lapidations de femmes adultères sur le terrain, etc.9. En Afrique du Sud, le nouveau stade du Cap, qui avait été inauguré pour la coupe du monde de football 2010, possède carrément des cellules pour emprisonner les « supporters agités » !
Même si la pratique sportive n'est pas toujours directement impliquée, il existe bel et bien un lien étroit entre le contrôle des esprits par le sport, les infrastructures sportives et la barbarie du capitalisme décadent. L'exacerbation des contradictions entre les classes fait que les stades sont de plus en plus souvent des lieux de confrontations et de tensions, au cours même des épreuves sportives. On a vu ainsi de véritables tueries, des révoltes éclater dans des stades de football. En Argentine, des portraits des disparus ont certes pu être brandis avec calme dans les tribunes lors de rencontres. Mais assez souvent, des tensions ouvertes se sont exprimées un peu partout avec violence, particulièrement à la sortie des stades. Nombreuses sont les situations où les pires idéologies, de la xénophobie la plus primaire au nationalisme débridé, ont conduit à de véritables actes de barbarie.
Dans le prochain et dernier article de cette série, nous reviendrons sur ces aspects pour en prolonger l'analyse.
WH (8 novembre 2012)
1 J-M Brohm, Sociologie politique du sport, 1976, réédition : Nancy, P.U.N., 1992.
2 Idem.
3 Plateforme du CCI
4 C. Sobry, Socio-économie du sport, coll. De Boek.
5 K. Marx, Manuscrits de 1844, Ed. La Pléiade, T. II.
6 Cité par J-M Brohm, Sociologie politique du sport, 1976, réédition : Nancy, P.U.N., 1992
7 Voir notre article sur les JO de Londres dans notre site fr.internationalism.org









