Révolution Internationale - 1980 - n° 69 bis à 80
- 146 lectures
Révolution Internationale n° 69 bis - janvier 1980
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.54 Mo |
- 81 lectures
Rubrique:
Révolution Internationale n° 70 - févier 1980
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.45 Mo |
- 59 lectures
Révolution Internationale n° 72 - avril 1980
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.36 Mo |
- 38 lectures
Rubrique:
Où vont les conférences internationales ?
- 11 lectures
“l’HUMOUR et la PATIENCE sont les principales qualités des révolutionnaires.” (Lénine)
Mai 68 a brisé le monopole politique des "idées-reçues" de la contre-révolution ; il a balayé le mythe de la disparition de la classe ouvrière. Ce formidable réveil de la lutte de classe s'est exprimé dans le surgissement de tout un nouveau milieu politisé. Mais 1'esprit critique, ce souffle de vie resurgi à partir de 1968, faut-il l'exercer dans le vide en pensant que l'histoire recommence à zéro ou ne faut-il pas plutôt l'utiliser pour renouer avec le cadre des acquis de la IIIème Internationale et de la Gauche Communiste ? Faut-il s'organiser comme révolutionnaires ? Le marxisme est-il valable aujourd'hui ? A quoi sert-on ? "To be or not to be !" ,Cette préoccupation a marqué toutes les conférences internationales de cette époque depuis la conférence de Bruxelles en 1969 convoquée par "Informations et Correspondances Ouvrières" (aujourd'hui dissout ), conférence à laquelle assistaient aussi bien Cohn-Bendit, que Paul Mattick, jusqu'à celles de Liverpool en 1973 et de Paris en 1974 et 1975. Entre ceux qui se sont donnés la tâche de définir une plateforme de principes politiques et de retrouver une continuité historique, et ceux qui prétendaient réinventer le monde, les libertaires anarchisants, les modernistes, et d'autres qui, soit rejettent la classe ouvrière comme le sujet de l'histoire, soit rejettent la continuité historique, une séparation nette s'est faite. Cette décantation a été d'autant plus difficile et douloureuse que les groupes qui avaient une continuité propre (essentiellement la gamme des groupes bordiguistes, PCI -Programme en tête) ont largement «ignoré" l'impulsion et même la réalité de 68, du haut d'une défense jalouse de leurs versions particulières de la Gauche Italienne contre les "bâtards".
Mais généralement les groupes modernistes anarchisants, les groupes "anti-groupes", ou les groupes "non-groupes" ne durent que le temps d'un soupir et dès le milieu des années 70 la préoccupation des discussions internationales entres révolutionnaires commencent à changer.
Le nouveau cycle de rencontres initié par le PCI Battaglia Comunista (Italie) et auquel participe le CCI, la CWO (G.B), le NCI (Italie), Il Léninista (Italie) et d'autres groupes -voir les brochures de la 1ère et 2ème conférences internationales publiées par le "Comité Technique"- se conçoit comme discussions entre groupes politiques qui savent déjà pourquoi ils existent et ce qu'ils défendent.
La participation est fixée par des critères politiques et les ordres du jour ont été axés sur l'évaluation de la période actuelle : les perspectives de la crise, les apports de la lutte de classe, l'intervention des révolutionnaires. Il y a un débat de fond sur les positions politiques mais cela ne se situe plus dans l'abstrait mais dans le cadre d'une actualisation du marxisme. Enfin ... c'est l'intention.
Mais si les groupes les plus sérieux durent (généralement !) plus longtemps, après une lecture des brochures de ces conférences il faut constater qu'ils subissent aussi le poids de la "tradition". Si par le passé, il fallait mettre l'accent sur le fait qu'il y a une continuité avec le passé du mouvement ouvrier dans le resurgissement du prolétariat dans la fin des années 60 , aujourd'hui il ne faut pas pour autant perdre de vue la rupture dans cette continuité historique et organisationnelle.
Beaucoup de groupes restent enfermés dans une "orthodoxie" qu’on peut appeler léniniste sur la question du parti (le parti comme unique détenteur ' de la conscience de classe, .appelé à prendre le pouvoir au nom du prolétariat) et même sur la question nationale. Ceci ne fait que traduire la pression de l'idéologie bourgeoise, le poids des générations mortes qui pèse sur le cerveau des vivants.
Cette fausse alternative entre "tout innover" et "ne jamais toucher au passé sacré", entre le modernisme et "l'orthodoxie", est illustrée de façon un peu caricaturale par l'évolution du PIC[1] (Jeune Taupe) et du CGI (Le Communiste).
Les " larges"
Comme nous tous, le PIC ressent le besoin de rencontres internationales pour clarifier l'orientation de l'intervention révolutionnaire. Mais il ne se joint pas aux autres[2]... Il organise sa propre conférence car il ne veut pas se salir les mains à discuter avec des "léninistes" sur la question du parti.
On pourrait rétorquer que par ailleurs de son propre aveu (dans le n° 1 du bulletin de discussions internationales de Jeune Taupe) le PIC "participe en tant que PIC à la revue Spartacus avec des courants très hétérogènes dont certains très éloignés de l'autonomie ouvrière (défense des syndicats, participation aux élections ...)"(p.6) mais il y a certainement là une nuance qui nous échappe.
Pour le PIC, le CCI est à mettre dans le même panier que les "léninistes". Mais sa définition de ce terme reste très vague : soit il s'agit d'une querelle de mots entre les termes "organisation des révolutionnaires" et "parti" (cf. page 18), soit il s'agit d'une évolution dans le groupe jusqu'à considérer que c'est seulement en rejetant et la révolution russe et la IIIème Internationale qu'on peut se libérer des tares léninistes.
Dans ce dernier cas, le PIC s'engage sur une pente glissante vers le modernisme et seule la discussion pourrait clarifier ce point.
À cause de cette fixation sur le côté "anti-parti" de l'autonomie ouvrière, le seul critère politique à l'invitation des groupes à leurs conférences, c'est la formule ambiguë : "ne pas être un constructeur du parti". De ce point de vue, il n'y a pas à avoir peur. Certains des groupes sont si peu "constructeurs" qu'ils ont disparu avant de pouvoir venir (Arbetarmakt, Suède ; Àrbeiderkamp, Norvège ; World To Win, USA ; Teoria et Practica qui devient ex-Teoria et Practica, Espagne). D'autres sont d'accord mais n'ont pas les moyens collectifs matériels en tant que groupe pour pouvoir venir (Kronstadt Kids, G.B. ; Root and Branch[3] (USA);ou sont des individus isolés comme
B.K, Suède. Le Collegamenti devait ramasser ses tentacules fédéralistes entre Naples, Milan et Florence avant de répondre qu'il ne pouvait rien promettre. Le Collectif pour A.O. (Espagne) pour sa part est pour 1'autonomie ouvrière si .par "ouvrier" on entend les étudiants, les ménagères, les prisonniers, les "psychiatrisés", et les professionnels (pages 14-16) !
Bref le manque de critères politiques fait de cette "anti-conférence" un triste exploit dont on reparlera prochainement du compte-rendu.
Les" étroits"
De l'autre côté du glissement vers le flou politique se situe le GCI[4] (une scission du CCI plus récente que le PIC), qui est aujourd'hui le énième petit groupe à se mettre dans la machine à remonter le temps pour devenir Bordiga. Le GCI, cependant, "après discussion avec B.C. et la CWO" (page 36, Le Communiste n° 4) veut bien participer aux conférences internationales, mais il considère "vides et stériles des réunions qui ont pour fonction de communiquer des positions générales de groupe à groupe". Que faire alors ? Il faut se séparer des "centristes". Il faut deviner qui sont ces "centristes" puisque dans le texte publié dans leur revue ne figure pas une note n° 2 qui parait par contre dans la lettre du GCI au comité technique de la conférence (datée du 7.1.80). "Le centrisme se caractérise par le rejet des acquis du marxisme tels que l'anti-frontisme, 1'anti-nationalisme, l'abstention électorale, le défaitisme révolutionnaire, la dictature du prolétariat (jusque-là, ça va encore, mais...) ...la terreur révolutionnaire, la nécessité d'un État ouvrier, et le rôle dirigeant du parti". On a beau refaire le calcul, le CCI est bien le seul groupe qui rejette effectivement les 3 derniers points.
Si le PIC n'a pas de critères clairs pour ses conférences internationales et reste très "large", le GCI veut quant â lui déjà tirer des conséquences organisationnelles, limiter la participation et se débarrasser des troubles fêtes. Le GCI n'est qu'une caricature de la méfiance de ceux qui s'accrochent aux schémas bordiguisants du passé.
Pour le CCI au contraire, la conférence doit s'élargir ; le comité technique a invité plusieurs groupes (Autriche, Grande-Bretagne, Colombie, Suède, USA) à venir à la 3ème conférence en tant qu'observateurs. Le grand (et seul ? ) mérite de ces conférences est de rompre l'isolement, de montrer la nécessité et l'intention de poursuivre une confrontation de positions.
Il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions organisationnelles quelconques. Une lecture des deux bulletins de préparation à la 3ème conférence montre plutôt l'incapacité de synthétiser des résultats, la difficulté à écrire sur un ordre du jour sans tomber dans les "dadas" de chacun ; les accusations et suspicions gratuites pleuvent. On a beau jeu de vouloir reprocher aux ouvriers de ne pas être à la hauteur de tel ou tel schéma abstrait du parti. Mais il faut constater que la discussion entre révolutionnaires a du mal à être à la hauteur des discussions qui ont lieu entre les ouvriers comme pendant les luttes de Longwy, Rotterdam, Fiat, British Steel et autres !
Quel sera le bilan de cette 3ème conférence ? Cela dépend en premier lieu du développement de la lutte de classe et ensuite d'une rupture réelle de la part des groupes qui se veulent communistes avec l'esprit "large" ou "étroit" et finalement toujours borné.
J.A.
[1] PIC : Pour une Intervention Communiste (France)
[2] Cf. "nos censeurs" dans la Revue Internationale n° 20
[3] Quand Internationalism (USA) a demandé à Root and Branch une rencontre pour discuter publiquement de la situation politique, ils nous ont proposé une bière au bar, refusant un "dialogue de sourd"... Ceci montre que si Paris vaut bien une messe, Boston ne vaut qu'une bière.
[4] GCI : Groupe Communiste Internationaliste (Belgique), voir une critique de ce groupe dans Internationalisme n° 40 sur la question des luttes revendicatives.
Vie du CCI:
- Polémique [5]
Courants politiques:
Rubrique:
Révolution Internationale n° 73 - mai 1980
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.41 Mo |
- 42 lectures
Rubrique:
L'alternative guerre ou révolution selon "selon Le Prolétaire" (P.C.I.)
- 45 lectures
Que va-t-il se passer ? Que peut-on faire ? Telles sont des questions qui se posent aujourd'hui au prolétariat dans une situation de convulsions économiques et sociales, politiques et militaires, qui secouent le monde actuel de l'est à l'ouest.
Dans le n° 307 de son journal, "Le Prolétaire", le Parti Communiste International critique la perspective défendue par le C.C.I. ("Le C.C.I. et les bruits de guerre") de la possibilité et de la nécessité pour la classe ouvrière d'imposer à la bourgeoisie des affrontements de classe avant que celle-ci ne mène le monde à la guerre impérialiste généralisée, Le PCI met pour sa part en avant une double perspective : "la révolution contre la guerre ou, si la guerre éclate, le défaitisme révolutionnaire et la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile". Cette perspective est juste en général, mais la question posée aujourd'hui est celle de la capacité ou non du prolétariat d'enrayer la marche vers la guerre généralisée. Pour le PCI, peu importe :
"Ce qui poussera les prolétaires à la révolution, ce ne sera nullement leur "conscience” révolutionnaire, généralisée ou non, mais des déterminations matérielles, parmi lesquelles les ébranlements de la guerre pourront eux aussi jouer un rôle déterminant...". C'est vrai que ce sont les déterminations matérielles qui poussent les prolétaires à la révolution ; mais celles-ci ne sont pas les mêmes selon que le prolétariat se soulève avant ou après que la bourgeoisie ait imposé la guerre généralisée. Qui plus est, la conscience révolutionnaire-la compréhension des moyens et des buts généraux de la lutte- est une des conditions fondamentales de la victoire du prolétariat, étroitement liée aux déterminations matérielles. Le PCI ne dit pas quelles sont les "déterminations matérielles" : l'issue révolutionnaire, pour lui, ne dépend que de la capacité des révolutionnaires de "préparer (le prolétariat) par la propagande générale comme par le "travail révolutionnaire quotidien", à imposer un jour SA solution contre celle de la bourgeoisie", quelles que soient finalement les conditions objectives du développement de la lutte de classe.
---------------------------------
"Si la lutte de classe est suffisamment forte, l’aboutissement dans la guerre généralisée n'est pas possible ; si la lutte s'affaiblit à travers la défaite physique ou idéologique du prolétariat, alors la voie est ouverte à l’expression de la tendance inhérente au capitalisme décadent : la guerre mondiale. Par la suite, ce n'est qu’au cours même de la guerre, comme réponse aux conditions de vie insoutenables, que le prolétariat peut reprendre le chemin de sa conscience et ressurgir dans la lutte. Il ne faut pas se leurrer : on ne peut pas prétendre faire 'La révolution contre la guerre, faire la grève générale au "jour-J", face à l'ordre de mobilisation. Si la guerre est sur le point d'éclater, c'est justement parce que la lutte de classe a été trop faible pour freiner la bourgeoisie et alors il ne s'agit pas de bercer le prolétariat d’illusions" (Revue Internationale n° 15, p. 2)
Dans cette perspective, le PCI trouve, en vrac, "un appel à la résignation au cas où la guerre éclaterait", du "défaitisme", "la petite bourgeoisie effrayée", et, Ô péché suprême, l "anarchisme"... Pourquoi une telle avalanche de qualificatifs peu flatteurs ? Parce que le PCI ne voit qu'une chose : le CCI a dit :
"Il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas prétendre faire la révolution contre la guerre". En effet, si c'était le cas, une telle position serait une absurdité : il faudrait de la peau de saucisson sur les yeux et du plâtre dans les oreilles pour ne pas connaître cette leçon de l'histoire de la lutte ouvrière : le prolétariat peut faire la révolution contre la guerre.
Il l'a prouvé lors de la Commune de Paris en 1870 et plus près de nous en mettant un terme à la 1ère guerre mondiale, avec la vague révolutionnaire des années 17-23, la révolution d'octobre 17 en Russie. Le PCI n'a pas dû lire la phrase qui précède celle qu'il cite, ni la fin de celle -ci :
"On ne peut pas prétendre faire la révolution contre la guerre, faire la grève générale au jour "J", face à l'ordre de mobilisation". Car telle est aussi une des leçons de l'expérience du mouvement ouvrier : à l'heure de la mobilisation du prolétariat dans la guerre, c'est la défaite et la déroute, la dispersion des révolutionnaires, le massacre, l'emprise idéologique et physique de la bourgeoisie sur les prolétaires. Si celui-ci, au cours de la 1ère guerre mondiale, a pu reconstituer sa force de classe , contre les souffrances et les massacres impérialistes, la 2ème guerre mondiale a montré au cours de ce siècle que cette reconstitution n'était pas automatique. La bourgeoisie a tiré elle aussi des leçons de la 1ère guerre mondiale : à la fin de la 2ëme guerre mondiale c'est une féroce occupation militaire partout ; toutes les forces nationalistes, alliés occidentaux et orientaux, partisans et résistants, tous concourent à maintenir la classe ouvrière épuisée par la guerre dans les mailles du capitalisme : toute velléité de lutte est sévèrement réprimée.
C'est une légèreté que d'affirmer que la guerre-est pour le prolétariat une "occasion à saisir", placée quasiment sur le même plan que "l'approche de la guerre" :
"Au lieu de montrer dans l'approche de la guerre -et dans la guerre elle- même- des signes de l'instabilité croissante du capitalisme et donc des occasions à saisir par le prolétariat pour sa lutte (...), au lieu de le préparer par ta propagande générale came par le "travail révolutionnaire quotidien", à imposer un jour SA solution contre celle de la bourgeoisie -la révolution contre la guerre ou, si la guerre éclate, le défaitisme révolutionnaire et la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile-, ces messieurs du CCI bercent leurs lecteurs et se bercent eux-mêmes dans la vision de tout un processus graduel et automatique."
Dans la période actuelle, cette sorte d'"advienne que pourra, la révolution viendra pourvu que le parti soit là" revient à se boucher les yeux. Si le prolétariat est entraîné dans une nouvelle boucherie généralisée, les conditions d'un sursaut prolétarien ne seront certainement pas les mêmes qu'au cours de la guerre de 14- 18. "Ce qui était encore faisable dans les conditions de la guerre de 14, où les soldats des deux camps pouvaient communiquer entre eux, de tranchée à tranchée, n'est plus envisageable aujourd'hui avec la guerre des avions, des missiles, des chars et des armes à longue portée, sur des fronts de guerre couvrant des continents". (R.I. n° 71, "C'est la classe ouvrière qui doit s'insoumettre") La fraternisation, retourner les armes contre les officiers, sera tâche beaucoup plus difficile et de par les aspects techniques de la guerre actuelle et de par l'expérience acquise par la bourgeoisie utilisée à tout mettre en œuvre pour contrer toute agitation sociale dans de telles conditions. Il ne s'agit ni de "défaitisme", ni d'un "appel à la résignation au cas où la guerre éclaterait" mais de ne pas bercer le prolétariat d'illusions dans l'hypothèse où la bourgeoisie parviendrait à imposer aux masses exploitées l'embrigadement dans la guerre impérialiste généralisée.
Les tâches des révolutionnaires
La "propagande générale" et le "travail révolutionnaire quotidien" ne sont pas des abstractions et se situent dans une réalité. Quant au contenu de la propagande, il faut savoir quoi mettre en avant : soit une situation de force potentielle de la classe ouvrière capable d'entraver la marche vers la guerre, soit une situation de défaite et de dispersion qui rejette après le déclenchement d'une guerre mondiale une possibilité de resurgissement du prolétariat. Pour le CCI, la première situation est celle sur laquelle le prolétariat peut et doit miser dans les conditions actuelles de la lutte de classe. Quant au travail révolutionnaire, il dépend fondamentalement de cette situation : il faut savoir si les révolutionnaires se préparent et œuvrent avec le prolétariat à étendre les luttes, à se regrouper, à ouvrir les débats partout où ils le peuvent parce que les conditions le permettent ou s'ils se préparent à conserver les acquis du passé, à résister à une gigantesque vague de chauvinisme et de nationalisme qui fait perdre ces acquis dans les grandes masses et qui emporte l'adhésion du prolétariat derrière sa bourgeoisie nationale dans la guerre. Pour le CCI, c'est cette première perspective pour le travail révolutionnaire qui est permise et nécessaire par les conditions actuelles de la remontée de la lutte ouvrière depuis maintenant plus de dix ans.
Toute "propagande générale" qui se veut marxiste doit comprendre et expliquer "ce qui se déroule sous nos yeux". Une conception qui se résume en quelque sorte à "il faut être prêt à tout, à tout moment", est louable mais oublie quelque peu que le "travail révolutionnaire quotidien" consiste à défendre une volonté d'action vers la perspective communiste certes, mais fondée sur la possibilité ou l'impossibilité concrète de sa réalisation dans une période donnée.
Tant que l'humanité n'est pas détruite, cette possibilité existe "toujours" à un niveau historique, mais cela ne signifie pas qu'elle existe à tout moment et une des tâches des révolutionnaires est de déterminer dans quel moment ils Interviennent.
L’art d'éluder les problèmes
Un proverbe dit : "Lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage". Le PCI, après avoir pendant longtemps ignoré le CCI, est aujourd'hui contraint de réfuter nos argumentations. Il s'essaie pour ce faire à toutes sortes d'amalgames de nos positions avec l'"anarchisme", la "petite bourgeoisie effrayée" et autres incantations destinées probablement à provoquer sur le lecteur un état de grâce lui permettant de rejeter nos diaboliques déviations petites-bourgeoises et d'être réceptif au Saint- Esprit du "parti compact et puissant de demain". Cette pierre philosophale résout toutes les contradictions et permet de boucher tous les trous de l'analyse sommaire du PCI de l'évolution actuelle du capitalisme. Cette analyse élude l'examen des conditions objectives de cette évolution pour ne porter l'accent que sur les conditions subjectives de l'adhésion du prolétariat au parti..."de demain". Mais en attendant que "le parti compact et puissant de demain" existe, dans les conditions subjectives actuelles de faiblesse de l'adhésion de la classe ouvrière au programme communiste, quel est le sens de l'évolution des conditions objectives de la lutte de classe ? Guerre ou révolution ? Pour le PCI, peu importe. Que la révolution ait lieu avant que la guerre ne soit généralisée ou qu'elle ait à surgir dans et contre la guerre généralisée, revient au même : l'important, ce sont les tâches des communistes. La boucle est bouclée.
Le PCI fanfaronne sur la transformation d'une éventuelle guerre impérialiste mondiale en guerre civile révolutionnaire sans montrer que cette probabilité est la plus défavorable pour l'action internationale du prolétariat. Dans le milieu révolutionnaire, le PCI parle bien fort du défaitisme révolutionnaire pour... "demain", mais il montre bien peu d'empressement à se prononcer sur la nature impérialiste des soi-disant guerres "nationales" bien réelles où les prolétaires se font trouer la peau pour des intérêts qui ne sont pas les leurs ! Le PCI parle bien haut de la nécessité de l'antimilitarisme "prolétarien" pour... demain ; il le prépare probablement en faisant du travail "antimilitariste" bras-dessus bras-dessous avec... les trotskystes de la L.C.R., soutiens de l'impérialisme russe!
Le PCI voit la guerre mais est incapable de voir la force de classe, engoncé dans des préjugés dogmatiques, faisant de la force du parti le seul indice de l'activité prolétarienne "authentique"! Paradoxalement, il attend de la guerre l'impulsion révolutionnaire. Le PCI ergote ensuite sur le rôle "fécondateur" du parti qui aura su (quand-même) s'implanter dans la classe avant la situation révolutionnaire; cela devient grotesque!
Pour le PCI nous exagérerions la "capacité actuelle de résistance du prolétariat", mais si celle-ci est si faible malgré le "danger" de guerre, d'où viendra la fameuse influence du "parti de classe compact et puissant"? De l'impuissance du prolétariat, peut- être ?
Non seulement le PCI n'est pas capable d'expliquer pourquoi la guerre mondiale n'a pas encore éclaté (sauf en minimisant la crise économique depuis des années) mais en plus il pense que le prolétariat n'a même pas encore commencé à affronter véritablement l'austérité. Comme si, en temps de crise économique, la lutte prolétarienne (ou son absence) n'avait aucune incidence sur le danger de guerre, comme si la lutte des classes ne devenait pas, à ce moment-là, le facteur déterminant du sort de la société, comme si la solution prolétarienne à la crise du capital (la révolution) et la solution bourgeoise (la guerre généralisée) ne s'excluaient pas mutuellement ! Qui sont les attentistes, sinon ceux qui attendent du renforcement du parti la solution à tous 1es problèmes et qui font dépendre le sort de l'humanité de leur petit volontarisme d'organisation!
Que le PCI tronque et déforme nos positions, c'est polémique, qu'il les déforme, c’est normal, il ne les comprend pas, mais lorsqu'il dit que pour le CCI "aujourd’hui il n'est pas nécessaire de lutter davantage ; et demain (quand le prolétariat sera armé) ce sera...impossible" , c'est de la rigolade et fait partie des grossières manœuvres pour éviter de se poser quelques questions embarrassantes qui touchent aux principes et à l'activité du Saint-Parti.
Vie du CCI:
- Polémique [5]
Rubrique:
La paranoïa du P.I.C.
- 20 lectures
Dans le numéro 30 de "Jeune Taupe”, le PIC consacre une demi-page au CCI.
On aurait pu s'attendre à un texte de polémique cherchant à faire comprendre au lecteur les désaccords entre les deux groupés, à argumenter pour convaincre de la validité de ses propres positions et de l'erreur des autres. On ne trouve rien de cela. Le titre donne déjà le ton : "l'art de la falsification ou Brejnev-Marchais-CCI : même combat".
Et l'article lui-même n'est qu'une série d'accusations d'après lesquelles nous procéderions à une "manipulation proprement stalinienne de textes" visant à "faire disparaître tout tentative d'une analyse révolutionnaire soulignant les insuffisances du mouvement actuel à l'échelle mondiale, ceci pour imposer nos schémas d'ultra-gauche du capital
Le lecteur pourra constater en comparant les deux traductions (celle de Jeune Taupe n°30 et celle de la Revue Internationale n°20) relatant les explosions ouvrières au Venezuela et en relevant les parties que nous avons supprimées , la totale absurdité des accusations du PIC.
D'ailleurs, la stupidité du PIC éclate quand il nous reproche d'avoir traduit "fetraragu?" par "chambre de commerce -et d'industrie" au lieu de “Fédération syndicale", ce qui est le terme français pour désigner ce type d'organisme patronal. Heureusement que le ridicule ne tue pas!
Le PIC s'émeut que nous présentions ce texte comme une "correspondance reçue d'un contact de la ville où se sont produits les événements ; en sous-entendant que cela montrerait l'inexistence de notre section au Venezuela. Nos colonnes ne sont pas ouvertes qu'à nos seuls militants, et nous continuerons à publier toute contribution à l'analyse révolutionnaire, même si cela conduit le PIC à mettre en question l'existence de toutes nos sections.
Sur le fond du problème, le PIC montre qu'il est aujourd'hui surtout préoccupé de souligner : “les insuffisances du mouvement réel actuel". Curieuse évolution de ce groupe, qui fut fondé par des camarades ayant quitté notre organisation en 1973, parce qu'ils estimaient qu'elle n'intervenait pas assez, et qu'elle sous-estimait le niveau de la lutte de classes ! À cette époque, nous nous trouvions au début d'une période de creux des luttes pendant laquelle le PIC, montant en épingle le moindre mouvement, s'est agité à travers toutes sortes de "campagnes" plus stériles les unes que les autres. Aujourd’hui, déçus semble-t-il de la classe, ils commencent à faire la fine bouche alors que celle-ci a justement repris le chemin du combat. Face aux luttes contre les licenciements et le chômage, il fait la moue : "ce qu'il faut, dit-il, c'est engager une campagne pour l'abolition du salariat."
Et d’éditer une affiche journal sur ce thème. Et de publier, dans Jeune Taupe, divers documents dont l'un, intéressant au demeurant, décrit la société communiste, mais dont l'autre dénonce: "la consommation comme ultime consolation", et salue "les pillages à New- York" ou la "fauche" dans un magasin, suite à la grève des caissières, comme autant de moments où : "le rapport de forces est momentanément inversé" (tract du groupe ouvrier Ericson).
Ce qui a toujours distingué les révolutionnaires des réformistes, c'est que les seconds ne donnent aucune perspective générale aux luttes de la classe et leur donnent pour seul objectif la satisfaction de leurs revendications immédiates, alors que les premiers conçoivent ces luttes comme autant de préparatifs en vue de l'affrontement général pour la destruction du capitalisme. Ce faisant, ils ne rejettent nullement ces luttes. Ils en soulignent au contraire le caractère absolument INDISPENSABLE. Face aux slogans réformistes : "le but n'est rien, le mouvement est tout", ils se gardent bien de rétorquer : "le but est tout, le mouvement n'est rien.", comme l'ont fait en leur temps les proudhoniens, certains anarchistes, et ces dernières années, les modernistes à la "Mouvement Communiste".
Aujourd'hui, face aux luttes de la classe qui tendent à se développer, les révolutionnaires doivent mettre en évidence l'importance de ces luttes (même lorsque syndicats et forces de gauche tentent de les récupérer), tant comme moyen pour résister contre une attaque de plus en plus violente du capital, que comme unique obstacle à la course vers une troisième guerre mondiale, que comme préparatifs pour la révolution. Notre propagande ne dit pas autre chose, mais c'est bien plus simple pour le PIC de nous faire dire n'importe quoi, afin, de son côté, de pouvoir dire vraiment n'importe quoi, de tenir les propos les plus aptes, non â convaincre les ouvriers d'aller plus loin dans leurs luttes, mais à les décourager. Après nous avoir joué les docteurs "tant-mieux", pendant des années, après avoir "levé le pied quand l'escalier descendait", le PIC, blasé, joue aujourd'hui les docteurs "tant pis", "baisse le pied alors que 1'escalier monte". Après la dégringolade de ses "campagnes" bidons, il se prépare d'autres chutes.
Et pour se garder des dangers de la Critique, pour esquiver le débat indispensable entre révolutionnaires, pour se refuser à répondre sur le fond et notamment aux arguments donnés dans notre article sur "nos censeurs" (Revue internationale n°20 [9]), le PIC se laisse aller à sa paranoïa et tente de prouver avec des ficelles plus grosses que lui que nous sommes des faussaires.
Tout cela n'est pas très sérieux.
Pour notre part, nous concevons le débat révolutionnaire à un autre niveau.
Vie du CCI:
- Polémique [5]
Récent et en cours:
- Jeune Taupe [10]
- P.I.C. [11]
Courants politiques:
Rubrique:
Révolution Internationale n° 74 - juin 1980
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.62 Mo |
- 30 lectures
Rubrique:
Révolution Internationale n° 75 - juillet 1980
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.14 Mo |
- 50 lectures
Rubrique:
Révolution Internationale n° 76 - août 1980
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.25 Mo | |
| 449.22 Ko |
- 55 lectures
Groupe Communiste Internationaliste - LE BLUFF CHEZ LES RÉVOLUTIONNAIRES
- 41 lectures
Nos lecteurs savent, qu'à égal écart du triomphalisme et du pessimisme, nous regardons sans complaisance l'état de force réel du mouvement révolutionnaire, à l'heure où la situation capitaliste requiert de sa part une intervention qualitativement accrue dans la classe ouvrière.
Dans cet examen des forces et faiblesses réelles, le moins préoccupant n'est pas de constater, parmi nos rangs, sinon de nous-mêmes, CCI, l'existence d'aberrations plus graves encore que le sectarisme et qui ne se jugent même pas d'abord au plan politique, mais à celui de l'infantilisme de groupe et de la pathologie collective.
Telles sont, par exemple, la mythomanie et le bluff érigés en pratiques militantes d'un groupe comme le GCI -groupuscule à la puissance deux au sein d'un mouvement révolutionnaire lui-même tout petit- qui croit sans doute pouvoir relativiser le poids de ses responsabilités propres du fait de 1'état des choses.
De quoi parlons-nous concrètement ?
Le 10 mai courant, à l'occasion de la manifestation de la CFDT et de certains gauchistes "contre" la Loi Bonnet-Stoléru, un collectif émettait à Paris un tract intitulé : "Egalité des droits ou unité de classe". Ce tract dénonçait la mystification des "droits démocratiques" et accusait la manœuvre de dévoiement syndicalo-gauchiste; il appelait enfin à l'unité de classe véritable entre travailleurs français, immigrés, chômeurs et actifs.
Des travailleurs, réfléchissant à ces questions, ont pu, touchés par les distributeurs du tract, l'estimer extrêmement intéressant et indéniablement révolutionnaire, par son contenu autant que par 1'intention d'intervention même qui l'a motivé. Certains d'eux, peut-être, ont pu même par la suite éprouver le besoin d'entrer en contact avec ses responsables, dont les noms, très officiels d’apparence, clinquants en plus, s'étagent au bas du tract : Unité Prolétarienne, Comité des Hospitaliers en lutte, Comité d’intérim, GCI et Groupe Karl Liebknecht. Or, à part celle du Comité d'intérim, aucune adresse de contact !
Simple oubli des signataires, manque de réflexe militant, étourderie de second plan ? A la vérité, les quelques personnes qui auront pu, au-delà du handicap de départ, s'entêter à poursuivre leur idée de contact, seront, le cas du Comité d'intérim mis à part, peut-être, tombés sur du vent : les groupes "Karl Liebknecht" et "Unité Prolétarienne", inédits le 9 mai se sont évanouis le 11 dans la nature. Ou plutôt : derrière eux (et même les deux comités), ces personnes supposées -des membres du CCI par exemple- ont pu avoir la surprise de retrouver sous des casquettes différentes, les mêmes quelques militants du GCI en France.
Qu'est-ce que signifie ce tour de passe-passe, ce jeu de travestissement et d'escamotage de la réalité?
A quelle idée politique douteuse correspond-il ? C'est assurément au GCI qu'il faut le demander d'abord.
Pour notre part, nous avons été amenés à connaître d'assez près les méthodes du GCI, dans le cadre hospitalier, à travers ses membres ou ses sympathisants directs. Sous le prétexte d'opérer l’"alliance de la théorie et de la pratique" dans le creuset de la lutte vive, les militants du GCI et affiliés, fixent autour d'eux quelques éléments ouvriers plus combatifs peut-être, de leur propre milieu professionnel, et, suivant qu'on parle des nécessités de la lutte immédiate ou qu'on discute de la question syndicale à un niveau plus politique et général, on s’organise" occasionnellement avec ces éléments pour faire ici : un "comité de lutte", là un "groupe Karl-Liebknecht" (noyau politique ou cercle de discussion, on ne sait trop, ni le GCI sans doute !).
Et voilà comment, à notre avis, le GCI à partir de trois ou quatre personnes, parvient à faire cinq groupes. Ni vu, ni connu, je t'embrouille, et conseil pratique aux autres candidats mégalomanes ! La classe ouvrière là-dedans, quelle importance !
Nous faisons confiance au GCI pour argumenter politiquement ses attitudes, lui dont les membres ont quitté le CCI, il y a deux ans, entre autres raisons à propos de cela. Ils le feront, peut-être, et nous aurons alors l'occasion de discuter plus sur le fond. Mais soyons sérieux, dans cette affaire de groupe "Karl-Liebknecht" et autres, il ne s'agit pas de politique en premier lieu. Les révolutionnaires ne sont pas en accord mais ils peuvent -et doivent- discuter sur : comment intervenir auprès de la classe ouvrière; sur le fait de savoir qu'un militant politique est aussi, en tant que travailleur, élément direct de la lutte ouvrière; sur la question de la réalité de "noyaux ouvriers", qui peuvent en effet surgir spontanément de la lutte et se faire d'eux-mêmes et de leur rôle une idée plus ou moins fausse ou vraie. Nous pouvons discuter là-dessus, outre avec ces "noyaux" eux-mêmes quand ils existent vraiment, avec le GCI aussi bien qu'avec le PIC ou Battaglia Comunista, ces derniers, malgré toutes leurs confusions, montrant, à la limite, un plus grand sérieux que le GCI.
Mais là, en faisant exister des groupes sur le seul papier à tract, on pourrait taxer le GCI d'esbroufe, voir d'escroquerie politique. A ce niveau de quoi discuter...? Mais peut-être ne s'est-il agi pour le GCI que de se soulager de cette angoisse que parfois éprouvent les révolutionnaires devant leur isolement prolongé face à l'ensemble de la classe ouvrière ? Le GCI aurait voulu se sentir moins seul. L'essentiel est de dire que, si les révolutionnaires peuvent se bluffer eux-mêmes, leur propre fantasme peut contribuer à semer les illusions et les mystifications en dehors d'eux. L'exemple du tract démontre que les révolutionnaires peuvent avoir des positions ponctuellement justes à côté d'attitudes inconséquentes.
Ramenons toutefois les choses à leurs justes proportions. Aujourd'hui, l'impact des révolutionnaires dans leur classe est encore trop infime pour que des aberrations comme celles du GCI aient des conséquences profondes, sinon à dégoûter les quelques ouvriers qu'ils touchent. Mais dans une perspective qui va conduire les révolutionnaires à développer leur rôle politique, il n’est pas possible que ceux-ci ne cherchent à se décharger des lourdes tares infantiles que la longue période de contre-révolution continue à faire peser sur eux, et qui auraient demain des incidences catastrophiques.
Il importe, en tout cas, qu'un tel fantasme volontariste, n'entrave pas le chemin réel du développement de la lutte et de la conscience de classe. Il revient en toute première instance à la classe ouvrière elle-même, par le cours pratique de sa lutte et en fonction de ses vrais besoins politiques de condamner impitoyablement les bluffs "révolutionnaires"; de rejeter sur la touche ceux des communistes qui, tout en offrant leurs services de direction, sont inaptes, ainsi que le GCI l'a montré lors de la Troisième Conférence Internationale, à comprendre, un tant soit peu, ce que sont les responsabilités de militants de la classe ouvrière. Qui plus est à l'heure, répétons-le : très grave, où la situation capitaliste les commande impérativement aux révolutionnaires.
Courants politiques:
POLOGNE - URSS : LES OUVRIERS EN LUTTE CONTRE L’ETAT CAPITALISTE
- 19 lectures
Depuis le 1er juillet, une vague de luttes ouvrières ébranle pour la troisième fois en 10 ans l'Etat polonais. C'est là un fait hautement significatif du courage exemplaire et de la volonté combative d'un prolétariat à qui l'on impose encore plus nettement qu’ailleurs en Europe les ravages de la crise, la formidable pression de l'économie de guerre, le militarisme et les rigueurs de la répression.
Ce mouvement éclate -comme en 70 et en 76- à l'annonce d'une hausse des prix de produits alimentaires : les tarifs de la viande de second choix disponible directement sur les lieux de travail sont relevés de 60 % (elle était jusque-là à environ moitié prix par rapport à la "viande en magasins" qui venait de subir une série de hausses successives). Ce système particulier de double vente a une fonction précise : "les ventes directes en usine permettent aux autorités d'assurer un ravitaillement minimum et contrôlé dans les concentrations industrielles jugées sensibles" (‘le Monde’ du 4 juillet) dans le cadre d'une pénurie chronique des produits alimentaires... Une telle hausse intervient au moment où la plupart des entreprises exigent des quotas de rendement supérieurs en vue "d'un accroissement sensible" de la productivité.
Spontanément et de façon quasiment simultanée, dans des dizaines d'entreprises, les ouvriers se mettent en grève à travers tout le pays -notamment à l'usine de tracteurs d'Ursus qui s'était déjà trouvée au cœur de la confrontation avec le pouvoir en juin 1976 et dans une usine de boîtes de vitesses à Tczew à proximité de Gdansk et de la Baltique. Le mouvement de grèves s'étend très rapidement à d'importants centres industriels : à Varsovie, la capitale (usine de matériel électrique, ouvriers de l'imprimerie, livreurs de journaux...), à l'usine d'aviation de Swidnick, à Lodz, à Gdansk... Un peu partout, les ouvriers forment des comités de grève.
Le gouvernement s'empresse, cette fois, de faire ouvrir des négociations, usine par usine.
A Ursus, par exemple, une bonne partie des revendications ouvrières est immédiatement accordée : 10% d'augmentation des salaires, hausse des indemnités pour les travaux les plus nocifs et ... majoration de la prime de production. Ces concessions gouvernementales, destinées à éteindre les foyers d'agitation ont au contraire pour effet d'encourager d'autres secteurs à entrer en lutte. Le mouvement s'étend à d'autres villes. A Lublin où 17 usines sont en grève ainsi que les cheminots, c'est toute la population qui manifeste sa solidarité avec les grévistes.
Tandis que les négociations se poursuivent au coup par coup, les autorités cédant en moyenne près de 50% des hausses de salaire revendiquées, d'autres centres sont tour à tour touchés par des grèves : Zeran, Krasnik, l'aciérie Skolowa Wola, la ville de Chelm (proche de la frontière russe), Wroclaw notamment.
A l'heure actuelle, il serait prématuré de vouloir tirer un bilan exhaustif de ce mouvement. Cependant, par rapport aux vagues précédentes de l'hiver 70/71 et de l'été 76, apparaissent des différences nettes au moins sur deux points :
1) c'est l'ensemble des pays et des centres industriels parmi les plus importants (et pour la première fois la capitale) que le mouvement a touché, tandis que les événements de 70/71, malgré leur radicalité et leur degré d'organisation sont restés géographiquement limités aux ports de la Baltique (Gdansk, Gdynia, Szczecin ). Même la grève dans le textile à Lodz en février 71 qui se situait dans leur prolongement a été marquée par l'isolement. En juin 76, les foyers d'agitation de Radom et d'Ursus sont restés pratiquement complètement isolés (malgré la proximité de Varsovie).
En dépit d'un manque flagrant de coordination réelle entre les différents secteurs, villes, régions, la rapidité avec laquelle le mouvement de grève s'est propagé dans toute la Pologne représente une incontestable maturation de la situation.
2) La seconde particularité, la plus marquante, est que, les luttes ayant jusqu'ici été dominées par leur caractère insurrectionnel, cette caractéristique n'est pas apparue lors des dernières grèves. L'affrontement direct et violent avec l'appareil d'Etat dont l'expression la plus claire fut l'incendie du siège local du parti, c'est à dire du pouvoir d'Etat, par les ouvriers de Szczecin en 70 et de Radom en 76 a été étouffé. Ce n'est pas la détermination de résistance des ouvriers qui a varié, mais l'attitude du gouvernement. Depuis dix ans, les dirigeants polonais vivent dans la hantise de nouvelles insurrections, et les événements de 76 ont confirmé le bien-fondé de cette crainte dans le passé récent.
Ils ont acquis l'expérience que la plus féroce répression ne suffit pas pour enrayer la colère ouvrière. Chaque fois, ils ont dû renoncer à appliquer "le réajustement normal" des prix. Comme substitut, le gouvernement a tenté -notamment depuis 76- de développer ses échanges commerciaux avec l'ouest ; le résultat a été catastrophique : la dette extérieure de l'Etat polonais envers les pays occidentaux et de 1'OPEP s'est portée à plus de 20 milliards de dollars (représentant à elle seule le tiers de la dette globale des pays de l'Est). En même temps, l'Etat d'anarchie de l'agriculture, la situation de crise mondiale aiguë d'un secteur clef du pays comme les chantiers navals et surtout la pression renforcée de l'économie de guerre pour alimenter l'offensive russe en Afghanistan et le maintien des positions stratégiques du bloc dans le monde, conjugués aux difficultés habituelles des pays de l'Est (pénurie de biens de consommation, mauvaise qualité des produits, faible productivité...) ont fait de ce pays une des économies les plus délabrées dans le glacis de 1'Est.
A la mi-juin, lors de la session du Comecon, les dirigeants polonais faisaient valoir comme leurs acolytes hongrois en particulier, leurs efforts pour opérer ce qu'ils appellent pudiquement "un assainissement économique" du pays et pour rétablir "la vérité des prix". Et d'énumérer la campagne de presse officielle pour la suppression des subventions d'Etat à la consommation, la réduction du budget de l'administration, les hausses importantes sur des produits dits "de luxe", comme le matériel électro-ménager ou les cigarettes, tout en insistant fortement sur "la prudence" qu'il leur fallait manifester dans la mise en application de telles mesures.
Cette prudence ne s'est pas démentie tout au long des grèves : pas de répression frontale, ce qui contraste avec les massacres perpétrés lors des affrontements dans les ports Baltes et des événements de Radom, une politique de négociations systématiques. Mais elle n'est pas nouvelle : les lourdes peines prononcées après les événements de 76 ont été peu à peu largement commuées, la censure sur la presse a été relâchée, permettant l'expression de revues culturelles comme "Nowa", non-alignées sur les critères de propagande officielle. Toutefois cela s'est surtout marqué en ce que le gouvernement a laissé se développer les activités "oppositionnelles" du KSS-KOR (Comité de défense des ouvriers de Pologne et d'auto-défense sociale) qui a pu s'implanter dans les principaux centres industriels du pays, diffuser (jusqu'en occident) des brochures de propagande contenant nom, adresse et numéro de téléphone de ses animateurs.
De son propre aveu, le KOR entend agir "dans un cadre légal et non-clandestin" pour “le respect des droits des travailleurs définis par la constitution polonaise", dans le souci "d'améliorer la situation économique du pays par des réformes à petits pas" dont le but avoué est "l'indépendance nationale et la démocratie".
Dans cet esprit, ils préconisent le développement de "syndicats libres" dont le modèle serait les "commissions ouvrières" en Espagne (qui sont, on le sait, dominées par l'influence du PC).
Le KOR semble avoir disposé de toute latitude pour apparaître en première ligne aujourd'hui -notamment pour jouer un rôle important d'agence de presse dans les récentes grèves alors que le gouvernement gardait le silence sur elles. Ce serait un leurre terrible de croire à la possibilité réelle d'assouplissement du capitalisme d'Etat ; au contraire le développement de la crise du capitalisme laisse à la bourgeoisie de l'Est une marge de manœuvre de plus en plus réduite ne pouvant préfigurer qu'une oppression et une exploitation grandissantes de la classe ouvrière, ainsi qu'une répression de plus en plus sanglante. Le KOR, contrairement â ce qu'il laisse croire ne représente pas une quelconque relève "démocratique" mais a pour seule fonction d'insuffler des mystifications au sein de la classe ouvrière que le gouvernement s'avère incapable de faire accréditer. En premier lieu, l'amélioration du sort des ouvriers, la possibilité de réforme du système pour tenter de conjurer un affrontement inévitable. Mais la nature bourgeoise du KOR est identifiable le plus sûrement à l'un des traits dominants de sa propagande : le NATIONALISME.
Le KOR ne manque pas d'évoquer que la Pologne a toujours été -même sous les tsars- "le pays des insurrections contre la domination russe". Selon lui, plus il y aura des tentatives d'imposer des réformes au pouvoir d'Etat et de manifestations de volonté d'indépendance nationale, plus les autorités russes auront peur d'intervenir avec leurs chars.
Les événements de 56 en Pologne même et en Hongrie, de 68 en Tchécoslovaquie se sont chargés de démontrer exactement le contraire, et le PCP a pu rappeler en demi-teintes que les grèves étaient de nature à éveiller l'inquiétude des amis du pays?
Non ! La défense des ouvriers polonais contre la menace réelle des chars russes ne se trouve pas dans le cadre national.
DES LUTTES QUI NE SONT PAS ISOLEES
A l'inverse, la question du lien entre les luttes des ouvriers polonais et le prolétariat soviétique est fondamentale.
Début mai, la plus grande usine de fabrication d'automobiles d'URSS à Togliattigrad sur la Volga, assurant à elle seule 55 % de la production du pays (700 000 voitures par an) était paralysée pendant 48 heures par la grève d'au moins 70 000 ouvriers et lancée
à l'initiative des chauffeurs d'autobus urbains qui voyaient leur charges de travail alourdies, pour protester contre les insuffisances chroniques de produits laitiers et de viande dans le pays. A la même période, dans une autre importante usine de fabrication de voitures et de camions, à Gorki (200 000 ouvriers), une grève éclatait pour des raisons similaires, 2 000 tracts manuscrits ont été distribués dans la ville et ont circulé de mains en mains.
En juin, c'est à son tour, une usine de fabrication de poids lourds, à Kama, dans la région de la Volga où des arrêts de travail ont eu lieu. De telles grèves, selon les déclarations du dissident Borissov ne constituant pas des faits exceptionnels, elles seraient même de plus en plus fréquentes mais ce sont des informations difficiles â obtenir et à contrôler.
Ainsi, pour la première fois, les luttes ouvrières se sont généralisées en Pologne â l'ensemble du pays, et pour la première fois, avec des grèves qui se manifestent en URSS, elles n'apparaissent pas comme un phénomène isolé dans l'ensemble des pays de l'Est.
Cette tendance affirmée à la généralisation des luttes dans les pays de l'Est représente une des caractéristiques essentielles des luttes actuelles par rapport aux luttes du passé. Même si les luttes comme en 70/71 en Pologne développaient un aspect plus radical que les luttes à l'heure actuelle, le seul fait que celles-ci vont dans le sens d'une généralisation A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR DES FRONTIERES représente un pas qualitatif autrement important pour le mouvement ouvrier.
Plus immédiatement encore qu'ailleurs, la question de l'internationalisation de la lutte, promesse ouverte par la multiplication des luttes ouvrières non seulement en Europe de l'Est mais dans tous les pays du monde, se pose de manière aiguë.
C'est non seulement la seule voie qui se dessine, 1'unique possibilité des ouvriers polonais, russes ou de n'importe quelle autre nationalité de sortir du cadre capitaliste et de l'enfer de 1'exploitation, mais aussi de rompre en même temps avec la logique belliciste de la bourgeoisie et son issue meurtrière.
Si à l'Est, des manifestations de l'opposition â la guerre s'expriment (ainsi deux femmes animant une revue féministe qui ont été expulsées d'URSS pour avoir publié un article contre la guerre en Afghanistan), c'est l'internationalisation de la lutte de classe qui représente le plus sûr barrage contre la guerre.
La généralisation des luttes dans tous les pays de l'Est ne peut que saper les bases de la mystification nationaliste, mai s elle est aussi un facteur de première importance à l'Ouest où ces luttes alimentent la prise de conscience du caractère identique de l'exploitation dans les deux blocs constituant une des meilleures cuirasses contre les tentatives de propagande guerrière des bourgeoisies occidentales.
Derrière cette propagande faite au nom de la défense des libertés et des droits de l'homme, contre qui essaie- -t-on d'entraîner les ouvriers d'Occident à aller se battre ? Contre d'autres prolétaires qui, sous nos yeux montrent à l'évidence que leur véritable guerre est dirigée, comme à l'Ouest, aujourd'hui, contre leurs exploiteurs et leur condition d'exploités.
Y.D
Géographique:
- Pologne [17]
Rubrique:
Révolution Internationale n° 77 - septembre 1980
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.56 Mo | |
| 448.85 Ko |
- 38 lectures
GENERALISONS LE "MAUVAIS EXEMPLE" DES OUVRIERS POLONAIS !
- 13 lectures
Le grand mensonge copieusement et unanimement défendu par toutes les bourgeoisies du monde, à l’Est et à l'Ouest, parce qu'il les sert toutes, le mensonge de la nature "communiste" des rapports sociaux dans les pays de l'Est est aujourd'hui dénoncé et mis en pièces par la lutte des ouvriers en Pologne.
Ce que le monde entier peut aujourd'hui contempler dans la situation sociale en Pologne, ce n'est pas "l'échec du socialisme", mais la fin de ce mensonge et la réalité du capitalisme d’Etat et de la lutte de classe exposée au grand jour.
- "Ces luttes ne sont pas une gifle aux seuls tenants de l’idéologie stalinienne'' et à tous les théoriciens du capitalisme d'Etat, mais également une gifle à toutes les autres fractions de la bourgeoisie mondiale à qui ce mensonge profite tout autant. Car elles ont toutes intérêt à ce que le prolétariat reste coincé dans ce faux dilemme : "capitalisme privé ou capitalisme d'Etat", présenté comme "libéralisme ou socialisme".
Le premier mérite du prolétariat en Pologne et son apport essentiel à la lutte de classe internationale de la classe ouvrière, c'est de montrer qu'il existe une autre alternative.
L'UNITE DE TOUTES LES BOURGEOISIES CONTRE LA CLASSE OUVRIERE.
Naturellement divisée, déchirée, toujours prête à s'entre-égorger, une seule chose peut pousser la bourgeoisie à s'unifier : la lutte des ouvriers. Cette réalité, mille fois vérifiée par l'histoire aux dépens de la classe ouvrière, se confirme encore aujourd'hui : la lutte du prolétariat en Pologne a un tel impact et représente un tel pas en avant pour le mouvement ouvrier international, une telle menace pour la bourgeoisie mondiale que toutes les bourgeoisies du monde retrouvent, face à lui, une touchante unité.
II y a quelques semaines encore, les tensions entre les deux blocs impérialistes (URSS/USA) ne cessaient de s'aiguiser, leurs rapports, face à la crise économique mondiale, de s'envenimer. L'éventualité d'une troisième guerre mondiale était calmement envisagée, et l'invasion de l'Afghanistan par les troupes russes venait sombrement illustrer cette possibilité.
Aujourd'hui, comme par enchantement, de Washington à Moscou, de Bonn à Varsovie, c'est un seul cri qui s'échappe : "Ouvriers polonais, n'allez pas trop loin ! Il faut être réaliste !"
Quand, après deux à trois semaines, les luttes semblent gagner un second souffle et s'étendre sur tout le territoire polonais, les appels internationaux au calme sont redoublés. La bourgeoisie occidentale, Allemagne et USA en tête, offrent leurs services et leur argent pour "aider la Pologne à faire face à sa crise sociale", et ce n'est certainement pas dans l'espoir de voir la Pologne changer d'alliance, ce qui dans la situation internationale actuelle s'avère impossible.
Alors que la crise mondiale du capitalisme, à l'Est comme à l'Ouest, plonge la planète dans un désordre de plus en plus grand et menace de précipiter l'humanité dans une troisième guerre mondiale, les appels au calme que la bourgeoisie internationale lance au prolétariat le sont au nom de "l'ordre" et de la “paix" mondiale...
Pape, chrétiens, gauchistes, "socialistes", "communistes", nationalistes, humanistes, toute la bourgeoisie "comprend" ou "appuie" ou "soutient" le mouvement des ouvriers en Pologne. Rarement une lutte ouvrière d'une telle ampleur n'aura reçu une telle sollicitude-
C'est un véritable chantage qui est fait au prolétariat en Pologne, le chantage à l'intervention russe. Le contenu de ce chantage, inauguré, il faut le noter, dès le début du mouvement par la bourgeoisie d'Etat polonaise elle-même, est tout aussi simple que mensonger : "Si vous allez trop loin, la Russie sera contrainte d'intervenir, et une intervention russe en Pologne constituerait une menace pour la paix mondiale".
Pourtant, ce n'est pas la répression des luttes en Pologne de 1970-71 , menée conjointement par l'Etat russe et l'Etat polonais qui a depuis aiguisé les antagonismes entre les blocs, pas plus d'ailleurs que ne l'a fait l'écrasement des émeutes en Corée du Sud par l'armée sud-coréenne, sous commandement américain, et pas plus, d'ailleurs que ne 1' aurait fait une intervention des USA en Iran.
Contrairement à ce que laisse entendre le chantage de la bourgeoisie mondiale : "La lutte de classe peut entraîner la guerre mondiale”, les luttes en Pologne montrent que seule la lutte de classe peut empêcher la guerre. Chaque pas en avant du mouvement ouvrier nous démontre cette réalité et l'illustre chaque fois mieux. Il en est ainsi des luttes ouvrières aujourd'hui en Pologne, qui démontrent de façon éclatante que :
- face au prolétariat, la bourgeoisie mondiale remise au second plan ses antagonismes pour faire face à la menace, commune à toutes ses fractions : la classe ouvrière ;
- la lutte des ouvriers contre l'Etat lie les mains de celui-ci pour les mobiliser en vue d'un conflit militaire ;
- il est impossible d'envoyer se massacrer mutuellement des ouvriers qui partout dans le monde subissent les mêmes problèmes, la même crise et qui fondamentalement, se battent pour les mêmes raisons.
Après la dénonciation pratique et directe du mensonge sur la nature communiste des pays de l'Est, la démonstration claire, dans la pratique là aussi, que seule la lutte de classe peut empêcher la guerre est le deuxième aspect de la contribution du prolétariat en Pologne au mouvement ouvrier international : du fait de l'existence internationale de cette lutte, la perspective actuelle est révolutionnaire et non pas guerrière ; le fait d'avoir repoussé d'autant la perspective d'une troisième guerre mondiale a fait avancer d'un pas la lutte du prolétariat international face à la crise du capitalisme.
CONTRE E ISOLEMENT ET LE POISON NATIONALISTE
En 1970-71, l'isolement de la révolte à Gdansk et à Szczecin a été fatal. Sans avoir à craindre que la répression ne provoque un soulèvement général, la bourgeoisie polonaise, appuyée par la Russie, avait pu réprimer sauvagement et écraser dans le sang les révoltes ouvrières.
Aujourd'hui, la situation et les conditions ont changé, ou plutôt se sont développées. Le mouvement en Pologne même n'a cessé de s'étendre, soudé par un très fort sentiment de solidarité. Au niveau international, partout les ouvriers ont à faire face à la même crise qui s'approfondit et ont engagé des combats ; ils se sentent donc plus spontanément solidaires des ouvriers polonais.
Ajoutées à la force du mouvement lui-même, la situation et les conditions dans lesquelles il se déroule, lui confèrent un impact et une importance d'un autre niveau que celui de 1970-71.
C'est pour ces raisons que fondamentalement, les réactions de la bourgeoisie internationale contre la lutte en Pologne sont une tentative d'isoler le mouvement, en ne cessant de marteler que c'est "une affaire strictement polonaise", spécifique à la Pologne, une réaction à une crise économique “polonaise", sans rapport aucun avec la crise générale qui signifie la faillite du capitalisme mondial. De ce point de vue, le poison le plus dangereux que la bourgeoisie tente d'administrer à la classe ouvrière, c'est le nationalisme.
UNE EXPERIENCE FONDAMENTALE POUR LA CLASSE OUVRIERE
Ne céder ni au chantage, ni à la provocation, imposer et maintenir un rapport de force, et, sans se précipiter, aller le plus loin possible : telles sont l'attitude et la conduite exemplaires de la classe ouvrière en Pologne. Sa force, elle la tient d'elle seule, de son unité, de sa conscience et de son expérience ; cette force, elle la rend effective, efficace, par son organisation autonome où c'est l'assemblée générale et souveraine de tous les ouvriers qui décide.
La lutte des ouvriers polonais a le mérite de commencer à répondre, par l'exemple, aux questions essentielles qui se sont posées dans toutes les luttes que les ouvriers du monde entier ont menées ces derniers mois, et c'est également un pas en avant pour tout le mouvement ouvrier international.
En premier lieu, les ouvriers polonais ont démontré, de manière éclatante que la classe ouvrière peut faire reculer l'Etat, même un Etat stalinien et sous la menace constante des chars qu'on n’a cessé de leur brandir, même dans une situation économique catastrophique.
En deuxième lieu, les ouvriers polonais ont montré comment imposer, entretenir et renforcer le rapport de forces :
- en conservant une autonomie totale par rapport à l'Etat. Ce qui veut dire ne faire confiance à aucune fraction de l'Etat avec lequel on peut, certes, négocier mais ne pas composer.
- en organisant de la façon la plus large et la plus unitaire le mouvement. Ce qui veut dire une organisation générale et centralisée, et non pas corporatiste et fédérée, sous le contrôle et la direction constante des assemblées générales qui, en toutes occasions restent souveraines.
D'ailleurs, il suffit de considérer la "tactique" de l'Etat vis-à-vis des ouvriers pour comprendre oû est la force du mouvement. Les négociations entre le pouvoir et les ouvriers ne sont jamais une conciliation, comme voudraient le faire croire les démocrates, mais font partie du combat où le plus fort impose son point de vue. Dans ce combat, les "autorités" polonaises ont justement tout fait pour briser cette force, en voulant négocier usine par usine, en voulant isoler les centres de lutte les uns des autres (blocage des communications radio, téléphoniques, etc...) et surtout en faisant pression sur le comité central de grève (M.K.S.) pour le couper de l'assemblée générale des ouvriers. Sur tous ces aspects du combat l'attitude des grévistes a toujours été exemplaire : le rétablissement des liens entre les différents centres de lutte a été posé comme préalable aux négociations et, en gardant un contrôle constant sur le comité central de grève, l'assemblée générale des grévistes a pu, à plusieurs reprises, contrecarrer l'influence des pressions de l'Etat qui s'y faisait jour.
Le haut niveau de conscience que les ouvriers polonais ont manifesté dans la lutte est lui aussi exemplaire :
- en ne cédant ni au chantage, ni à la provocation, les ouvriers ont montré qu'ils ne concevaient pas le rapport de forces avec l'Etat d'un point de vue strictement policier et militaire, mais du point de vue social, par l'extension en largeur et en profondeur du mouvement, en étant vigilants à ne pas se laisser placer sur ce terrain militaire par une éventuelle provocation de 1'Etat.
- l'unité que les grévistes ont établie entre revendications politiques et économiques est aussi une manifestation de cette conscience.
Depuis dix ans que la crise économique ne fait que s'approfondir, il devient de plus en plus évident qu'une réaction à une situation immédiate est nécessaire mais pas suffisante. Ainsi, derrière l'unité établie par les grévistes entre revendications économiques et politiques ressort la nécessité de dégager une perspective tout en réagissant à une situation immédiate.
Vouloir dégager cette perspective et la défendre au travers de "syndicats", même "libres", est une illusion; aucune organisation qui ne soit celle de la 1utte elle-même, n'aurait la force de s’opposer et d'imposer quoi que ce soit à l'Etat (comme dans les pays occidentaux) et se donnerait pour tâche d'imposer une vision "réaliste" aux ouvriers.
Ce qu'il est important de voir c'est ce qui se cache et s'exprime maladroitement dans la revendication du "syndicalisme libre" : la nécessité de dégager une perspective ouvrière face à la crise économique et pouvoir l'imposer.
Quoiqu'il arrive, quoiqu'il se passe maintenant en Pologne, répression brutale ou enterrement "national et démocratique" du mouvement derrière les apprentis bureaucrates nommés "dissidents", ou tout simplement que la lutte ouvrière, ayant épuisé les possibilités du moment s'arrête d'elle-même, dans tous les cas, ce que la classe ouvrière en Pologne a déjà fait, représente un immense pas en avant pour l'ensemble du mouvement ouvrier international. Quoique la bourgeoisie fasse ou dise maintenant, elle ne pourra plus effacer cet acquis de la conscience du prolétariat mondial, comme elle n'a pas pu effacer les acquis et l'expérience des luttes de 1970-71 et de 1976 en Pologne dont la classe ouvrière, dans les luttes d'aujourd'hui, tire le maximum de profit.
le 30.08.80
H. Prenat
Géographique:
- Pologne [17]
Rubrique:
KOR : UNE "OPPOSITION" AU SERVICE DU CAPITAL POLONAIS
- 18 lectures
Une des meilleures armes de la bourgeoisie contre la classe ouvrière consiste à faire passer ses luttes pour autre chose que ce qu'elles sont, et en particulier à les désigner du nom de ces fractions bourgeoises dont la fonction est justement de saboter la lutte ouvrière tout en prétendant la représenter. Dans nos régions dites "démocratiques", nous avons l'habitude de voir les mass-médias faire tout leur possible pour présenter toute grève ouvrière comme étant celle de telle ou telle officine syndicale. S'il n'y a pas de "pluralisme syndical" en Pologne, les mouvements d'"opposition démocratique", et le KDR en particulier, font parfaitement l'affaire! L'ensemble de la presse a voulu faire passer ce dernier pour le "meilleur soutien", 1'"expression politique", ou encore 1'"inspirateur" des grèves.
Cette volonté de camouflage du véritable antagonisme social veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes : d'un côté la détermination de ceux qui n'ont à perdre que leurs chaînes, de l'autre, 1'"opposition" qui, le jour même de l'entrée en grève des chantiers de Gdansk, appelle à une manifestation à Varsovie sur le thème de la défense de la patrie polonaise; d'un côté la mise en pratique par les ouvriers de la solidarité prolétarienne avec le développement de son organisation autonome et centralisée, de l'autre, l'appel du KOR à la solidarité internationale... des "dirigeants occidentaux", des "dirigeants des grandes banques et institutions financières internationales", pour qu'ils apportent "leur soutien moral et éventuellement économique" pour sauver la Pologne !
Le KOR nous désigne bien là quelle est la classe qu'il soutient, exprime et prétend inspirer. A 1'instar de tous les mouvements de "contestation", de "dissidence" qui fleurissent dans quasiment tous les pays de l'Est, il ne se présente lui-même que comme une opposition très responsable, respectrice "du cadre légal" et parfaitement consciente des impératifs nationaux imposés tant par la dégradation de la situation économique que par les conditions de l'appartenance au bloc de l'Est. "J'essaie de me placer du point de vue du pouvoir", disait J. Kuron en 77, tout en suggérant à ce dernier "le redressement de la situation économique du pays par des réformes à petits pas avec l'assentiment des travailleurs", et surtout -et c'est bien là que le KOR se montre la plus responsable des oppositions- en tirant la sonnette d'alarme, au lendemain des émeutes de 76, sur la trop grande vulnérabilité de l'Etat polonais face aux assauts de la classe ouvrière :
"Les événements ont montré que, dans le système actuel, les citoyens n'ont qu'un seul moyen pour exprimer leur position: celui de manifester pour traduire leur mécontentement. Il faut élargir les libertés démocratiques pour éviter de nouvelles explosions populaires". (Lettre des onze au Parlement en juin 76, signée par les co-fondateurs du KOR, dont J. Kuron).
Depuis sa fondation en 76, le KOR développe sa propagande autour des moyens d'obtenir cet "assentiment des travailleurs" et d'éviter les explosions de la lutte de classe, avec en première place la "création de syndicats libres", sur le modèle des commissions ouvrières espagnoles, qui ont fait la preuve de leur efficacité dans ce domaine comme le décrit si bien le journal du KOR "Robotnik":
- "Peu à peu les directions ont compris qu'un contact avec les commissions ouvrières était dans leur propre intérêt, parce que ce sont elles qui représentent les travailleurs, avec lesquels on ne peut s'entendre que par leur intemédiaire. En effet, les directions n’obtenaient rien par l'intermédiaire des syndicats officiels." (souligné par nous)
Ces pourfendeurs de l'"Etat totalitaire", ces "défenseurs des ouvriers" se montrent les conseillers attentifs des bureaucrates, qu'en bourgeois cohérents, ils aspirent à devenir eux-mêmes. Selon la formule du sinistre Kuron: "Je suis moi-même un apparatchik", mais un apparatchik qui sort de son chapeau la recette pour "obtenir quelque chose des ouvriers", ce à quoi a échoué le gouvernement actuel.
UNE RELEVE DEMOCRATIQUE?
En opposant à l'Etat polonais son programme "à coloration ouvrière", J. Kuron avouait lui-même "ne se faire aucune illusion sur la possibilité de ces réformes". L'opposition polonaise est suffisamment consciente des impératifs nationaux pour savoir que, plus que jamais, avec l'aggravation de la crise économique l'Etat ne peut que durcir encore plus son contrôle sur la société et renforcer l'attaque contre la classe ouvrière. Cependant, si la bourgeoisie ne s'illusionne guère sur la marge de manœuvre de son propre système, et si l'opposition se sait finalement condamnée à rester... dans l'opposition, celle-ci ne s'est développée jusqu'à présent que pour redonner quelque crédit à des illusions qui s'écroulent par pans entiers sous les effets de la crise et que le gouvernement ne parvient de toutes façons plus à entretenir. Les "lendemains qui chantent" du socialisme sont repeints à la sauce démocratique sous les traits d'un "débat national" retrouvé. Il s'agit surtout de convaincre les ouvriers que la confrontation directe avec l'Etat peut être évitée, que l'amélioration de leur sort ne peut passer que par l'union de la nation pour l'obtention de ces fameux "droits démocratiques".
Aujourd'hui, décrivant -dans un article paru dans "Le Monde" du 20 août- 1'enjeu de la situation ouverte par les grèves et leur extension, Kuron explicite clairement l'attitude du KOR :
- "Lorsque l'inflation aura mangé les augmentations et que les promesses d'un meilleur approvisionnement n'auront pas été tenues, les grèves reprendront un nouvel essor. La colère des ouvriers sera plus grande, et plus grande encore, si c'est possible, leur méfiance vis à vis du pouvoir. Or celui-ci sera encore plus impuissant...La révolte sera alors inévitable, avec comme conséquence une tragédie â l'échelle nationale.".
C'est pourquoi explique-t-il: "la tâche principale de l'opposition démocratique consiste à transformer les revendications économiques en revendications politiques".
Alors que le gouvernement, tant qu'il a pu le faire n'a cessé de développer l'argument: "Nous pouvons discuter des problèmes économiques. Mais ne touchez pas aux problèmes politiques", la propagande du KOR s'articule autour de 1' l'idée qu'il faut que les ouvriers abandonnent le terrain économique pour le terrain politique, car "s'élever contre la hausse des prix porterait un coup au fonctionnement de l'économie". En un mot, le mouvement actuel doit cesser "de ne parler qu'au nom des ouvriers" pour comprendre que "seul un immense effort de tous, accompagné d'une profonde réforme, peut sauver l'économie du pays."
Tel est l'objectif que propose 1"opposition", au moment où la classe ouvrière en Pologne, en refusant d'opposer revendications politiques et revendications économiques, en imposant toute la pression de son auto-organisation, affirme plus que jamais son autonomie de classe face à l'ensemble de la société.
UNE FRACTION CREDIBLE DE LA BOURGEOISIE
Devant une détermination ouvrière bien plus puissante que celle qu'elle avait réprimée dans le sang en 70 et 76,1a bourgeoisie fait la démonstration qu'elle sait aussi tirer les leçons de l'histoire. Non seulement tout est fait pour éviter le risque que constituerait l'utilisation de la répression directe, mais le capital polonais a su produire ses propres anti-corps à la lutte de classe.
De l'église à l'opposition, en passant par les différentes tendances du POUP, la bourgeoisie fait tout son possible pour offrir aux yeux de la classe ouvrière de multiples facettes qui, à quelques nuances de langage près, se rejoignent pour appeler la classe ouvrière à modérer son élan revendicatif.
N'est-ce pas le KOR lui-même qui, au moment de l'établissement par le comité inter-entreprises de Gdansk de la liste des revendications, met en garde les ouvriers contre "des revendications qui, soit acculent le pouvoir à la violence, soit entraînent sa décomposition. Il faut leur laisser une porte de sortie",
Le libre cours laissé au développement du KOR depuis 76 -qui lui permet aujourd'hui de se réclamer d'une implantation directe dans les grands centres industriels et de publier sa presse au grand jour- lui donne les moyens d’assumer la fonction pour laquelle il est né : celle, tout en cherchant à récupérer pour son propre compte les formes prises par la vague de luttes actuelle, d'essayer d'entraîner les grèves ouvrières sur le faux terrain de la défense de la démocratie, celle d'appeler les ouvriers à resserrer les rangs derrière "leur" Etat national. C’est dans ce sens que, dans la situation de quasi-blocage où se trouve le capital polonais, le KOR peut prétendre constituer aujourd’hui son serviteur le plus zélé.
La fin de non-recevoir qui accueille de tels arguments, et qui se résume dans la réponse d'un ouvrier : "on leur laisse une porte de sortie, puisqu'on les laisse gouverner", traduit bien tout le clivage entre la volonté ouvrière et l'orientation "responsable" que le KOR voudrait bien parvenir à donner au mouvement.
La vague d’arrestations opérées le 20 août ne doit pas faire illusion. Celles-ci ont eu lieu au moment même où le gouvernement, mesurant toute la force du mouvement, se décidait à assouplir sa politique et à entamer des négociations. En arrêtant les dirigeants du KOR, le gouvernement pouvait espérer orienter la négociation autour de leur libération, ou du moins redonner à celui-ci une image de marque plus oppositionnelle capable d'en faire des "interlocuteurs valables", c'est à dire valables aux yeux des ouvriers, capables de récupérer toute leur confiance. Dans l'ensemble, la manœuvre a relativement échoué pour le moment, et, même dans la négociation -terrain sur lequel la bourgeoisie se sent généralement la plus à l'aise, parce qu'il lui est plus facile d'y opérer des manœuvres de division- la détermination ouvrière ne s'est pas épuisée.
Pour que le rapport de forces imposé par la classe ouvrière puisse se maintenir et ne laisse aucune prise à de telles tentatives, les ouvriers doivent poursuivre dans la voie dans laquelle ils se sont engagés : développer et renforcer le contrôle des assemblées générales sur les organes dont ils se sont dotés.
Tout en cherchant à éviter pour le moment l'emploi de la répression directe contre les ouvriers, la bourgeoisie mobilise toutes ses forces pour tenter de diviser, enfermer, dévoyer le mouvement vers un terrain qui n'est pas le sien. Dans ce cadre , 1'"opposition démocratique", incapable d'apparaître comme une relève cohérente à la bureaucratie en place, peut peut-être espérer de la situation actuelle eue ses bons et loyaux services sauront être payée d'une reconnaissance "légale" de la société bourgeoise, du droit ou non de former une officine syndicale à son image. Mais, avant tout, elle n'a de raison d'exister au sein de la classe dominante en Pologne que si elle parvient à se faire ce flanc-garde dont a tant besoin aujourd'hui l'Etat capitaliste polonais.
Le 30-08-80
J.U.
Géographique:
- Pologne [17]
Courants politiques:
- Trotskysme [20]
Rubrique:
LES FAUX-AMIS DES OUVRIERS
- 18 lectures
"Vive la Pologne", "Bravo aux grévistes de Gdansk", "Salut à la remarquable maîtrise des ouvriers", "Solidarité a- vec le peuple polonais", rarement une lutte prolétarienne comme celle qui se déroule en Pologne n'aura reçu de gens comme Giscard, Schmidt, Jean-Paul II, Carter, "libéraux", "socialistes", "communistes", syndicalistes, gauchistes, une telle sol 1icitude.
Les ouvriers ne doivent pas se faire d'illusions : le mouvement de masse des travailleurs polonais n'a acquis â la cause des ouvriers tout ce beau monde qu'en apparence, fondamentalement pour leur prêcher la sagesse. Car les mobiles qui animent toutes les voix de ce chœur unanime son+, comme ils l'ont toujours été, totalement étrangers aux intérêts des ouvriers. Et cette "solidarité" ne fait qu'obscurcir les perspectives d'une réelle solidarité dans et par la lutte autonome du prolétariat dans tous les pays, en l'ensevelissant sous une avalanche de bénédictions de curés, de sollicitudes de bureaucrates, de conseils de "démocrates". Si les uns et les autres divergent souvent profondément quant aux motivations de leur "appui" ou de leur "compréhension", tous concourent à cacher les causes, les moyens et l'enjeu réel de la lutte des ouvriers de Pologne :
- un Etat capitaliste aux prises avec la crise mondiale ; une bourgeoisie nationale qui tente de pressurer au maximum les ouvriers ;
- une lutte ouvrière de résistance, spontanée et tendant vers une autonomie de classe et une remise en cause générale du système d'exploitation.
Sans parler de la droite qui appuie bien haut la "renaissance nationale" en Pologne, parce qu'elle voit dans T événement un affaiblissement de l'ennemi de l'Est, et rien de plus, la gauche quant à elle développe à son habitude une prétendue "défense des intérêts des ouvriers".
UN APPUI DU R. C.?
Il n'est pas besoin de chercher bien loin les raisons de l'appui du PC aux "revendications démocratiques" des ouvriers polonais. Face à un mouvement trop puissant pour être ouvertement dénoncé comme "réactionnaire", le PC manœuvre, comme il le fait toujours en pareille occasion, pour contrer le plus efficacement possible toute velléité d'autonomie de la classe ouvrière. Ici, le PC fixe pour but au prolétariat l'expropriation des patrons privés, pour défendre ce qui n'est, en fait, ni du socialisme, ni du communisme mais du capitalisme d'Etat. Aujourd'hui, avec une mobilisation massive d'ouvriers qui dévoile cette vérité, dans un pays où cet objectif est réalisé, le PC brouille les pistes en prétendant approuver les ouvriers polonais. Le PC rassure ceux qui douteraient des bienfaits de ce "socialisme" en montrant leur "droit" de se défendre "démocratiquement"...
En tait, cette acrobatie de propagande pour ne pas perdre le crédit du plus énorme mensonge de l'histoire du mouvement ouvrier - l'existence du "socialisme en un seul pays"-, ne saurait effacer les expériences tragiques répétées de ce qu'est la vraie nature de la politique "ouvrière" du PC : Chine 1927, Espagne 37, Allemagne de l'Est 53, Pologne 53-56-70, Hongrie 56, la liste est longue des massacres perpétrés directement contre les ouvriers soulevés contre l'exploitation par ces sinistres agents du capitalisme déguisés en "communistes" et authentiques fils de Staline, le boucher de plusieurs dizaines de millions de personnes en URSS.
Pour le PCF plus précisément, que les ouvriers se souviennent des bombardements de Sétif en Algérie après la guerre, qui firent plusieurs milliers de morts, sous un ministère PC, de l'appui aux "libérateurs" de 1'Armée Rouge en Hongrie 56, du soutien réservé ou du silence autour des répressions de Tchécoslovaquie 68, Pologne 70 et 76.
Non moins significative, et tout près de nous, la collaboration étroite de la CGT avec les forces de police au cours de la manifestation des sidérurgistes du 23 mars 1979 font aussi partie de ces épisodes qui doivent se graver dans la conscience des ouvriers, comme autant de preuves répétées de la nature totalement anti-ouvrière et bourgeoise de ce parti.
Les ouvriers doivent savoir qu'à 1' heure où la répression s'abattrait en Pologne, le PC sera là pour la justifier, ouvertement ou en la critiquant, cela selon les besoins de sa politique nationale du moment.
UN SOUTIEN DES "SOCIALISTES" ?
La gauche non stalinienne, quant à elle, lance de vibrants: "Vive la Pologne", trop heureuse de prouver la validité du rejet "du totalitarisme", de redorer le blason de la "démocratie", des "droits de l'homme", de l'"autogestion".
Les "revendications démocratiques" des ouvriers polonais sont présentées comme ces acquis de l'Ouest -"droit de grève", "syndicats libres"- la voie à suivre pour l'amélioration du sort de la classe ouvrière, là-bas à conquérir, ici à améliorer par le moyen syndical et parlementaire.
Mais que sont ces acquis pour le prolétariat : n'est-ce pas en Suède, "modèle socialiste", que l'ouvrier paie une amende de deux jours de salaire pour un jour de grève, lorsque la grève n'est pas la grève officielle du "syndicat socialiste" ? N'est-ce pas en Belgique, où le taux de chômage est un des plus élevés d'Europe que le syndicat "socialiste" embauche et licencie les ouvriers ? Les exemples sont multiples. Au fur et à mesure que la crise s'approfondit, la "démocratie" à la "socialiste" se révèle pour ce qu'elle est : un "luxe" des pays développés qui n'est qu'un paravent idéologique d'une réalité toujours plus rude pour les ouvriers. C'est dans cette impasse que la gauche "socialiste" voudrait voir se fourvoyer les ouvriers polonais.
Les attaques "socialistes" contre les régimes politiques de 1’Est n'ont rien à voir avec la lutte ouvrière : elles ne font qu'exprimer la défense du camp impérialiste occidental contre le camp impérialiste adverse.
En France, le gauchiste reconverti en présidentiable qu'est Rocard a dévoilé la signification profonde de la solidarité ouvrière à la sauce "socialiste" : se préparer à envoyer des navires au
large des côtes polonaises pour recueillir les "réfugiés" en cas d'intervention militaire russe... La solidarité, le soutien... par les "boat people" le rêve d'un alibi renforcé pour une mobilisation guerrière au nom de la "liberté", tous unis bourgeois et prolétaires, contre le bloc "totalitaire".
Cette racaille "socialiste" ou "sociale- démocrate" est empressée de trouver dans 1"opposition" ou la "dissidence" des pays de l'Est, ses pairs en ravalement de la façade démocratique du capitalisme décadent en crise ouverte. De ces gens-là, les ouvriers ne peuvent attendre que des mots creux et de la mitraille.
LA SOLIDARITE DES GAUCHISTES ?
Chez ceux qui se présentent "révolutionnaires", les "vrais comme des défenseurs" des ouvriers, les trotskystes, le soutien aux ouvriers polonais les plus "radical" : dénonciation du régime polonais, appui à toutes les revendications, aux comités de grève, aux "Conseils Ouvriers", solidarité de classe, etc.
La LCR commence par rappeler la légende du trotskysme, soi-disant la seule véritable opposition de toujours au stalinisme, avec pour "preuve" ...l'assassinat de Trotsky par des agents de Staline. Ce rappel de ces "médailles" en quelque sorte, ne vient que pour mieux faire passer, par ailleurs, l'idée que la Pologne est un pays "où le capital ne fait plus la loi" (Rouge), où donc finalement un simple changement du personnel politique suffirait pour que les ouvriers polonais bénéficient d'un "vrai socialisme".
L’OCI a d'ailleurs déjà trouvé cette relève dans le KOR, cette opposition bourgeoise et nationaliste à la bureaucratie en place.
LO est moins explicite, mais vient tout autant se ranger aux côtés de ses amis concurrents, sinon par ce qu'elle dit, du moins par ce qu'elle ne dit pas : des tartines sur l'organisation de la grève, pas une ligne sur la nature de classe du régime polonais contre lequel le prolétariat est en grève.
Quel que soit le verbiage "radical" de solidarité avec les ouvriers en Pologne, pour tous ces groupes, il y a quelque chose à défendre, des "acquis" pour les ouvriers dans les pays de 1' Est, une différence de nature avec ceux de l'Ouest.
Mais s'il existe des différences, il est vital pour les ouvriers de comprendre qu'elles résident dans le degré de développement, les modalités de nationalisation des entreprises capitalistes, le droit constitutionnel bourgeois, la répartition des zones d'influence des blocs impérialistes ; en rien au niveau de l'exploitation de la classe ouvrière, de la crise du système capitaliste, des nécessités, des moyens et des buts de la lutte.
Passés dans le camp de la contre-révolution avec leur participation â la 2è guerre mondiale dans l'un des camps impérialistes, abandonnant ainsi définitivement le terrain prolétarien, les trotskystes ne sont que des fractions plus “radicales" de la bourgeoisie de gauche ; ils en font une fois encore la preuve, s'il en était besoin, dans leur action et leur prise de position dans le mouvement des ouvriers polonais
Les ouvriers ne doivent jamais oublier que ces "socialistes" sont les petit-fils des Noske et Scheidemann, les massacreurs des ouvriers allemands en 1919-23, qui inaugurèrent une des plus sanglantes contre-révolutions de l'histoire ; les fils des Blum et autres embrigadeurs des ouvriers derrière leur bourgeoisie nationale pour aller s'entretuer contre leurs frères de classe dans la boucherie impérialiste ; qu' ils ont déjà été eux-mêmes les pourvoyeurs de chair à canon pour l'Indochine et l'Algérie.
Tout ce verbiage vient s'ajouter à l’inflation journalistique sur les événements de Pologne qui ne fait que noyer les véritables questions posées par les grèves ouvrières de Pologne et auxquelles le mouvement tente de répondre par lui-même, en pratique.
Au stade où elle en est, la lutte des ouvriers en Pologne a déjà constitué un jalon efficace de la lutte générale du prolétariat mondial, au plan de l'organisation autonome des ouvriers comme au plan de la conscience de l'enjeu du mouvement. La classe ouvrière doit prendre garde à tous ces faux amis qui conjuguent leurs efforts pour la maintenir sur le terrain de sa "spécificité" polonaise, de la défense de "sa" nation, du capital et de 1'exploitation.
M.G.
Courants politiques:
- Gauchisme [21]
Rubrique:
Révolution Internationale n° 78 - octobre 1980
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.62 Mo |
- 39 lectures
Rubrique:
LIBRE OU PAS, LE SYNDICALISME EST UNE IMPASSE
- 27 lectures
LA VICTOIRE DES OUVRIERS POLONAIS, CE N'EST PAS LE SYNDICAT LIBRE. LOIN DE CONSITUER UN PROLONGEMENT DE LA FORMIDABLE LUTTE QUE LA CLASSE OUVRIERE A IMPOSE AU MONDE BOURGEOIS, LE SYNDICAT LIBRE, COMME TOUS LES SYNDICATS, CONSTITUE LA NEGATION DE TOUT CE QUI A FAIT LA FORCE DU MOUVEMENT.
-------------------------------------------
"Croyez-moi, on a obtenu aujourd'hui tout ce qui était possible, pour nous et pour tout le pays. Le reste, on l'aura avec notre syndicat." (Walesa, discours consécutif aux accords de Gdansk)
C'est ainsi que s'exprimait le "leader" de Gdansk à des ouvriers sceptiques (1/3 environ étaient contre la reprise du travail), réduisant la formidable lame de fond qui a ébranlé la Pologne â cette fin, à cet "acquis" : le syndicat libre.
Pourtant, quand les grèves entamées depuis juillet ont culminé le 14 août avec l'entrée en grève des chantiers de Gdansk, les syndicats libres ne tenaient pas le haut du pavé : les revendications d'alors étaient : augmentation de salaires de 50%, dissolution des syndicats, suppression des privilèges, retransmission des informations sur les luttes. La rapidité de la généralisation du mouvement, la fermeté de son organisation ont imposé la force ouvrière.
Mais, en Pologne, c'est la 3ème fois depuis 10 ans que le problème se pose de façon cruciale. Les deux dernières fois, le gouvernement avait reculé... pour mieux sauter. Les mesures d'austérité "annulées" devant la force du mouvement ouvrier avaient été réintroduites par d'autres biais, sous la pression inexorable des lois d'une économie capitaliste qui s'effondre. '
C'est dans la réalité quotidienne depuis plus de 10 ans que la conscience s'est fait jour chez les ouvriers que gagner aujourd'hui ne suffit pas, et qu'il faut "autre chose". Cette autre chose, les ouvriers l'ont vu dans la possibilité de veiller en permanence à ce que le les promesses soient tenues, en rendant permanents leurs comités de grève. A partir de là, les "syndicats libres" sont entrés en scène,
se présentant comme LA solution, la panacée permettant la défense des intérêts ouvriers.
Mais quand on compare les buts et les moyens du "syndicat libre et autogéré" avec ce qui a fait la force et la conscience des ouvriers en Pologne, en 70 comme en 80, il apparaît clairement que ces institutions s'opposent en tous points à ce qui avait permis aux ouvriers en Pologne de s'imposer. Loin d'être une continuation de la dynamique du mouvement, elles en sont la négation sur tous les plans.
LES BUTS DU SYNDICAT LIBRE: CONCILIER L’INCONCILIABLE
- "Le syndicat se donne pour but (...) de tenter d'harmoniser les intérêts des travailleurs avec le fonctionnement de l'entreprise... de former une attitude active des travailleurs pour le bien de la patrie." (Projet de statuts pour les syndicats libres établis à Gdansk)
Etait-ce le sens des grèves de masses que de se préoccuper de la santé de la patrie? Quand les ouvriers réclamaient une augmentation de salaire "énorme", tout en sachant très bien que la Pologne était en plein marasme économique, ils opposaient consciemment LEURS intérêts à ceux de la "nation", c'est â dire â ceux du capital polonais.
- Quand les ouvriers ont demandé la dissolution des anciens syndicats, c'était parce que "le rendement du travail" était la seule chose qui préoccupait ces institutions, et que "l'harmonisation" entre les intérêts des travailleurs et les "intérêts de l'entreprise" était faite sur le thème : " l'intérêt de l'entreprise et de la nation est le vôtre", donc "il n'y a pas de contradiction, mais une nécessité de faire plus d'efforts et de se priver plus."
C'est le même chemin qu'ont déjà pris les syndicats libres, en acceptant dans les accords de Gdansk un accroissement de la productivité "pour réparer le mal causé par la grève". Pendant que la discussion se centrait sur le syndicalisme "libre", le gouvernement en a profité pour instaurer de nouvelles restrictions sur la consommation de charbon, et une nouvelle réduction des dépenses publiques (écoles, santé, etc.).
C'est le même chemin qu'ont pris ces nouveaux syndicats en acceptant de se soumettre à l'Etat et au parti. Quand les ouvriers ont demandé l'abolition des privilèges, quand ils se sont préparés à affronter la répression de l'Etat, ils allaient dans le sens d'une remise en question de l'ordre établi. Les syndicats libres, au nom du "réalisme" ont signé la soumission.
C'est la logique à laquelle est nécessairement ramené tout organe qui se propose de "concilier" des intérêts inconciliables : le "bien-être" ouvrier n'est pas en accord avec le bien-être d'une économie capitaliste, surtout lorsque celle-ci est en crise et doit en conséquence chercher la plus grande compétitivité, c'est à dire exploiter toujours plus les masses salariées. La base au capitalisme est un vol, le vol du travail de l'ouvrier pour les besoins d'une économie de profit au profit de quelques-uns. Et quand la crise dicte de voler encore plus, il n'est pas question de voir si on peut arranger voleur et volé en même temps. C'est la méfiance qu'exprimait un des délégués lors de la discussion des statuts lorsqu'il disait : "les anciens syndicats se mêlaient eux aussi de production, on a vu ce que ça a donné." (cité par "Rouge").
Si les revendications économiques n'arrêtent pas l'aggravation des conditions de vie ouvrières, ce n'est pas une question de "mauvais syndicats" ou "d'erreurs de gestion',' mais le fait d'une situation mondiale : c'est de plus en plus vite que les parties du monde qui ne connaissent pas encore un degré aigu de dégradation y courent, unissant le monde capitaliste entier, avec ses syndicats et ses gestionnaires, dans une même banqueroute.
- "Le syndicat libre, c'est le contrôle des choix à tous les niveaux. Par exemple, le gouvernement a décidé d'en construire une autre (usine) a côté. C'est absurde, elle est inutile. Le Comité Central ne le sait peut-être pas, mais nous, les ouvriers, nous le voyons tous les jours." (Lech Walesa)
Dans l'illusion sur le syndicalisme libre, il n'y a pas qu'une question de forme d'organisation : il y a encore l'illusion d'une vie meilleure dans le système en place, un manque de vision de l'ampleur du néant vers lequel il court, l'idée qu'il suffit de supprimer les aberrations les plus criantes (et il n'en manque pas dans le capitalisme d'Etat polonais). Mais ce qui est dans la continuité du début de prise de conscience des ouvriers polonais, ce n'est pas une vision de gestionnaire. Les ouvriers ont commencé à comprendre qu'il n'y avait pas d'améliorations DURABLES, même à moyen terme du capitalisme, au contraire. Cela contredit la base même du syndicalisme soucieux de l'entreprise, de la patrie et de l'Etat. En posant la question de la force ouvrière dans ce contexte, ils ont posé une question POLITIQUE, un début de remise en question de l'Etat lui-même, du parti et de la patrie. Or c'est justement cela qu'ont refusé les "syndicats libres" qui se sont "engagés à ne pas faire de politique."

LFS MOYENS DU SYNDICAT LIBRE: PRIVER LE MOUVEMENT DE SA FORCE
- "Le syndicat réalise ses buts (...) en collaborant avec les autorités et les organes d'administration de l'Etat dans le cadre défini par la loi." (Projet de statuts, idem)
Ce que la classe ouvrière en Pologne a montré une fois de plus, c'est que l'Etat ne cède à la pression ouvrière que lorsqu'elle menace sa loi, son ordre. "Collaborer" avec l'Etat n'a pas de sens dans la réalité du rapport de forces qui doit se mener pour la défense des intérêts ouvriers. L'expérience l'a montré mille fois : l'Etat n'est pas tendre avec les ouvriers lorsque ceux-ci décident de "collaborer avec lui".
Il ne relâche sa poigne de fer que sous la pression la plus violente et ferme des ouvriers. Il est prévu que le gouvernement dissoudra les syndicats si leurs "activités et leurs structures ne sont pas conformes à la loi." Une grève générale organisée centralement au niveau du pays pendant plusieurs semaines sera-t-elle jamais dans le cadre de la loi capitaliste?
Le ré-enfermement dans la légalité étatique que constituent les syndicats "indépendants" est la négation de la possibilité de pousser plus avant la lutte ouvrière.
Négocier avec l'Etat, sans la vigilance active d'ouvriers déterminés à se battre, ne peut forcément amener qu'à composer. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et les ouvriers ne sont jamais forts dans le cadre des lois inventées et défendues par et pour l'Etat, contre eux.
Dans ses structures mêmes, le syndicat autogéré va à l'encontre de tout ce qui a fait la force de la classe, son unité, son organisation.
- Le syndicat libre, comme tout syndicat, a pour base l'entreprise et la branche d'industrie, alors qu'une des forces du mouvement a été l'unité au-delà des spécificités, des secteurs, des professions : c'est un même comité de grève qui unissait à l'échelle régionale métallos, ouvriers des chantiers, conducteurs de bus, etc, et non des fédérations par branches mettant au point leurs revendications communes. La lutte ETAIT commune, et l'organisation aussi. Le syndicalisme réintroduit le sectarisme, la lutte chacun pour soi dans une classe qui par ses grèves de masses avait largement dépassé ce cadre étroit.
- Une autre force du mouvement de cet été a été la volonté absolue des assemblées générales de contrôler les évènements : les négociations se menaient ouvertement, retransmises par haut-parleur, et c'est 1'AG qui y intervenait en retour.
Quand le comité de grève de Gdansk penchait pour la reprise du travail et que I'AG en a décidé autrement, elle a révoqué son comité de grève, sans délai. La révocabilité, avec le syndicat libre, va se trouver enfermée dans un cadre rigide, de rythmes d'élections. Déjà, à la fin des négociations, les haut-parleurs "ne marchaient plus très bien" : il a fallu les protestations de l'AG pour qu'ils se remettent soudain à fonctionner et que la négociation qui atteignait des points critiques ne soit pas réglée "entre experts responsables et réalistes". Depuis, de plus en plus, les délégués reprennent l'image du permanent affairé qui n'a plus de "contact avec la base", et les discussions se déplacent de l'AG vers les bureaux tout neufs des nouveaux syndicats, pendant qu'à l'usine on cherche à faire que le travail reprenne à une cadence accrue, accaparant l'énergie et les préoccupations ouvrières.
UNE ILLUSION A DEPASSER
L'illusion sur laquelle s'est renforcé le syndicat libre, qui avant la grève se réduisait à une poignée de "dissidents", c'est celle de la possibilité de maintenir le rapport de forces par une organisation unitaire permanente en dehors d’une lutte acharnée de l'ensemble des ouvriers.
Malgré la volonté des ouvriers de garder le contrôle de tout prétend "les représenter", ce qui la structure syndicale, avec son corporatisme, sa tendance au "dialogue" avec l'Etat, contient en elle-même la séparation entre une base et un sommet : entre d'une part une masse de plus en plus contrainte, pour survivre, de mettre en question les fondements mêmes de l’ordre existant, et d'autre part, une structure qui s'est donné pour fonction de "concilier" : en installant un syndicat, malgré leur volonté de rester en alerte, les ouvriers délèguent leur pouvoir â une "minorité agissante", à des "permanents" voués à la "défense des intérêts ouvriers" pendant que les autres travaillent.
Privé de la force que constitue la classe en action, tout organe de négociation ne peut que se soumettre aux diktats de l'Etat et être happé par lui : "Au 20ème siècle, seules la vigilance, la mobilisation ouvrière peuvent faire avancer les intérêts ouvriers. C'est une vérité amère et difficile que de réaliser que tout organe permanent sera inévitablement happé dans l'engrenage de l'Etat à l'Est comme à l'Ouest." (voir “Pologne 80, une brèche s'est ouverte", Revue Internationale n°23).
Il est possible que, malgré le service qu'elle lui rend, l'Etat polonais ne parvienne pas à digérer cette nouvelle structure syndicale : la bourgeoisie a une telle faiblesse à l'Est qu'elle tolère mal la moindre divergence dans la structure rigide qui lui permet de se maintenir. C'est d’ailleurs pour ça qu'elle tente de transformer ses anciens syndicats en nouveaux, noyautant les syndicats libres pour recréer une structure unique dont elle ait le contrôle absolu.
Mais fondamentalement, le syndicat libre est une expression de son intérêt profond et non de celui des ouvriers. Quand les anciennes structures syndicales ne parviennent plus à tromper les travailleurs, il faut bien en trouver d'autres pour pallier à ce vide. En Occident, on fait grand tapage autour du "syndicalisme de base" qui doit "redonner vie aux syndicats" : la fonction qu'ils remplissent est la même : transformer la conscience croissante chez les ouvriers de la nécessité d'une lutte permanente en une soumission à des structures permanentes et institutionnalisées.
Pour des ouvriers qui, comme à l'est, n'ont pas connu les syndicats "libres" à l'occidentale, le syndicalisme "libre" semble ouvrir un autre monde. Mais cet autre monde n'est pas celui de l'activité consciente des masses : il est celui des bureaucrates "libres" à la Séguy, Maire et Bergeron.
Ce qui rendra la tâche difficile aux dirigeants polonais, ce ne sont pas les syndicats libres, même s'ils ne correspondent pas à ses possibilités, mais la pression ouvrière, si elle continue à se maintenir, et ce que seront ses prochaines réactions à la réalité inévitable du capital : la continuation des restrictions, que le syndicat autogéré n'empêchera pas, reposera la question â une classe qui a appris à réfléchir : OU EST LA FORCE DES OUVRIERS?
D.N.
Géographique:
- Pologne [17]
POLOGNE - UN PAS EN AVANT POUR LE PROLETARIAT MONDIAL
- 13 lectures
Innombrables sont les luttes ouvrières qui, ces dernières années, malgré leur élan initial, se sont trouvées impuissantes à faire céder l'Etat capitaliste. Que 1'on prenne les exemples des luttes pourtant très combatives de Longwy-Denain, celles de la sidérurgie en Grande-Bretagne qui ont mobilisé pendant plusieurs mois des centaines de milliers d'ouvriers ou celle du port de Rotterdam qui s'était pourtant dotée d'un comité de grève non-syndical, et beaucoup d'autres encore, les luttes ont été victimes soit d'un manque d’unité entre les différents secteurs de la classe, soit de l'isolement, soit de l'absence d'une auto-organisation des travailleurs, soit de plusieurs de ces facteurs.
Les défaites subies en ces différentes occasions montraient de façon négative combien ces carences sont fatales pour le combat de la classe.
Aujourd'hui, c'est de façon positive que l'expérience des ouvriers de Pologne vient confirmer quelle force la classe peut avoir -même si sa victoire contre l'Etat capitaliste ne peut être qu’éphémère tant qu'elle ne l'aura pas renversé- lorsqu'elle se dote de ces trois éléments essentiels de sa lutte: l’unité, l'auto-organisation et l'extension massive du mouvement.
L’UNITE, c’est l’extension de la lutte
• Les divisions en catégories professionnelles, en régions, par usines, ayant soi-disant leurs "problèmes propres", les ouvriers polonais les ont déjouées. En effet, la grève s'est étendue géographiquement, et non par branches d'industrie :
- 1er juillet : grève à l'usine de tracteurs d'Ursus, contre la hausse des prix. En moins de 24 heures, le mouvement fait tache d'huile à Tczew, près de Gdansk, et entraîne les 10 000 ouvriers de WSK Mielec et WSK Swidnik, deux usines d'aviation et de matériel de communication. C'est alors la grève du département Kl du chantier naval de Gdansk, suivie, à plusieurs centaines de km de là, près de Varsovie, de la grève des sidérurgistes de Nowa-Warszawa.
- à partir du 8 juillet, les grèves s'étendent à tout le pays, à Elblag (sur la Baltique) à Poznan, à Zeran (le "Billancourt" polonais), à Varsovie même, à Zyrardow.
- A partir du 9 juillet, pendant une semaine, les cheminots de Lublin entrent en scène : leur lutte déclenche une grève générale de toute la ville.
- du 14 août au début septembre, c'est enfin quasiment toute la Pologne qui est en grève : l'ensemble de la côte Balte (Gdansk, Szczecin» Elblag), la Silésie, la Posnanie, la région de Cracovie, les régions frontalières. Les comités de grèves inter-entreprises qui se créent (MRS) ne sont pas "professionnels" : ils englobent tous les ouvriers en lutte, quelles que soient leur métier ou leurs qualifications.
Le manque de solidarité qui souvent brise la lutte et sur lequel compte la bourgeoisie, les ouvriers polonais l'ont rejeté.
Le ciment de l'unité, cette volonté unique de toute une classe, c'est la solidarité : les usines qui, comme à Ursus, Elblag, Poznan avaient repris le travail, une fois les augmentations de salaires accordées, se sont sans hésiter remises en grève, lorsque la région de Gdansk est entrée en lutte le 14 août. A Gdynia, les ouvriers, malgré l'obtention de TOUTES leurs revendications, ont refusé de reprendre le travail, parce que "c‘est tous ensemble qu'il faut gagner" et ont même été convaincre les chantiers de Gdansk de ne pas reprendre. La prétendue "aristocratie ouvrière" des mineurs de Silésie, mieux payée pourtant que la moyenne des ouvriers, par solidarité elle aussi, a rejoint le mouvement, fin août. Et c'est justement cet événement qui a contraint l'Etat à céder rapidement, alors qu'il avait tergiversé pendant des semaines.
La diversité des conditions d'exploitation, qui entraîne souvent des revendications économiques éparses, spécifiques, les ouvriers polonais l'ont dépassée.
Les ouvriers ont vite compris qu'il fallait opposer contre la division, l'unité des revendications. C'est pourquoi les revendications économiques sont rapidement devenues politiques, avec les 21 points du MKS de Gdansk, le 16 août.
L'unité du mouvement, c'est sa politisation, contrairement aux affirmations de tous les Walesa, qui demandent qu'on ne fasse "pas de politique". Exiger que l'Etat mette fin au blocus du téléphone, que les médias retransmettent les revendications ouvrières, que l'Etat reconnaisse le droit de grève et d'organisation pour tous les ouvriers, c'est "faire de la politique".
Ainsi, à l'anarchie apparente des revendications locales, par usine, s'est substituée la simplicité des revendications tant économiques que politiques touchant toute la classe ouvrière : toute une classe s'est dressée contre l'ensemble de la classe capitaliste concentrée dans l'Etat.
L’AUTO-ORGANISATION : spontanéité et conscience
L'hésitation à prendre en main sa propre lutte, en la confiant à des professionnels de la négociation autour du tapis vert, entre "gens bien", le prolétariat polonais - au début du moins- l'a très résolument balayée. Le remède radical à cette hésitation, c'est la volonté d'auto-organisation.
La tendance vers l'unité est un effort à la fois spontané et conscient qui se parachève dans l'auto-organisation. Face à l'Etat totalitaire, à tout son arsenal de répression, la spontanéité et la rapidité de la réaction ouvrière sont une question de vie ou de mort pour l'issue du mouvement de grèves. En quelques jours, parfois en quelques heures, les ouvriers polonais ont été capables de réagir comme un seul homme.
En affirmant dès le début : "NOUS SOMMES TOUS NOS REPRESENTANTS", ou bien "NOUS N'AVONS CONFIANCE QU'EN NOUS-MEMES", les ouvriers ont manifesté une conscience de classe aiguë’. C'est pourquoi ils ont été capables de se doter d'organisations propres :
- les ASSEMBLEES GENERALES rassemblant plusieurs milliers d'ouvriers pour être capables d'une réflexion collective, et donc consciente, des buts et des moyens de la grève.
- les COMITES DE GREVE, organes exécutifs des assemblées, ELUS ET REVOCABLES, responsables devant elles, la publicité des débats et des décisions prises par les comités MKS étaient la condition de cette responsabilité et du contrôle par la “base": "Les délégués faisaient la navette entre le chantier Lénine et leur entreprise, rendaient compte du déroulement de la grève et des négociations. Ils pouvaient être révoqués à tout moment. L'usage des magnétophones à cassettes s'est généralisé. Ainsi dans chaque boîte, tous les travailleurs pouvaient suivre le déroulement des travaux du MKS et des négociations enregistrées." (“Imprécor'', n°84).
La rédaction d'un quotidien de la grève ("Solidarité"), le va-et-vient incessant des délégués mandatés par les assemblées, venant souvent de très loin (comme ces mineurs silésiens envoyés à Gdansk) donnent une idée d'une vraie lutte ouvrière, lorsqu'elle jaillit de masses prolétariennes organisées et militantes.
Tous ces faits montrent admirablement les réserves infinies de créativité spontanée, lorsque c'est toute une classe qui lutte. Cette spontanéité, cette maturité, cette conscience sont le plus puissant démenti aux affirmations arrogantes de ceux qui prétendent que par elle-même, la classe ouvrière est incapable de s'organiser, ou est spontanément "trade-unioniste" Que tous les stratèges en chambre, " "chefs d'États-majors" auto-proclamés de la classe, regardent bien la lutte de classe en Pologne. Qu'y a-t-il de plus organisé, de plus discipliné que ces milliers de prolétaires qui mettent en place des piquets de grève? Est-ce 1'"anarchie", anathème lancé par tous ces fins "stratèges", lorsque le comité ouvrier élu met en place dans le plus grand ordre, service de ravitaillement et milice ouvrière, pour empêcher toute provocation de 1'Etat?
LA GREVE DE MASSE
Pour parvenir à cette unité et à cette conscience, la lutte de classes ne suit pas une voie droite, tracée d'avance. La généralisation de la grève, après plusieurs semaines, se fait par des avancées et des reculs momentanés de la grève : débrayages, reprise du travail, grève générale locale, reprise du travail, puis de nouveau le mouvement bondit en avant, plus puissant, en se généralisant région par région, pour tendre à devenir national. La grève de masse en Pologne est "un océan de phénomènes éternellement nouveaux et fluctuants", où "tantôt elle se divise en un réseau infini de minces ruisseaux ; tantôt elle jaillit du sol comme une source vive, tantôt elle se perd dans la terre". Ces phrases de R. Luxembourg sur la grève de masse en 1905 en Russie et en Pologne peuvent s'appliquer à la Pologne de 1980.
Malgré ses méandres, ses fluctuations en apparence "capricieuses", la grève de masse est le contraire du modèle de la grève générale préconisé par les anarchistes au début du siècle et aujourd'hui encore. La grève de masse n'est pas la grève des bras croisés, où chacun rentre chez soi en attendant que "ça se passe". Elle ne fait pas suite au décret de quelque état-major qui manipulerait savamment les pions sur l'échiquier de la lutte de classes. Elle n'est pas un simple phénomène quantitatif, où tout le monde miraculeusement, au même moment, fait grève, mais un phénomène profondément qualitatif. Elle est la dynamique d'un mouvement qui se cherche et se trouve finalement sans schéma préétabli. Elle ne peut être statique, puisqu'elle incorpore des forces toujours nouvelles. Elle ne se décrète pas, mais se réalise progressivement, se calquant sur la lente mais sûre explosion de la conscience de classe.
Rien ne serait plus absurde que de voir dans le phénomène de la grève de masse que le simple mot "grève". La participation au MKS d'usines qui n'étaient pas en grève, la reprise du travail dans des usines vitales pour la bonne marche de tout le mouvement, s'inscrivent en faux contre tout schématisme. Dans la grève de masse, la volonté de tous -toute la classe- prédomine sur celle de quelques-uns :
- "Le MKS avait en outre toute prérogative pour conduire la grève. (II)...décidait si certaines entreprises devraient continuer à travailler pour assurer les besoins des grévistes. Ainsi la raffinerie produisait au ralenti l'essence nécessaire aux transports, des bus et des trains circulaient ; l'industrie alimentaire dépassait les plus hautes normes fixées par les bureaucrates auparavant, pour assurer l'approvisionnement de la population." (Imprécor -idem)
En fait, la grève de masses c'est l'autorégulation d'un mouvement qui, dans sa diversité tend à battre au même rythme. Derrière l'anarchie apparente des revendications, des moles d'action (occupations d'usines, débrayages) la grève de masse tend vers une unité consciente : l’auto-organisat|ion.
Les grèves de masse de juillet et août en Pologne, sont une magnifique leçon de choses pour le prolétariat de tous les pays, à 1'Est comme à l'Ouest. Elles sont une véritable réponse à toute une série de questions que confusément se posent les ouvriers, de Longwy-De-nain à la Grande-Bretagne, du Brésil aux USA : comment éviter l'amertume de la défaite, et marcher de façon assurée sur une route qui mène vers la victoire ?
Malgré ses faiblesses (cf. V article sur les syndicats libres dans ce numéro), malgré la reprise du travail, malgré toutes les manœuvres de la bourgeoisie, malgré toutes les menaces lancées par l'URSS, les ouvriers polonais ne sont pas isolés. Leur lutte contribuera, même si cela n'est pas immédiatement perceptible, à agrandir la brèche creusée par la crise du bloc russe. La référence aux luttes de Pologne que faisaient il y a peu les ouvriers de Fiat menacés par les licenciements montre que la leçon donnée par les ouvriers polonais ne sera pas perdue, à l'Ouest non plus.
Le prolétariat polonais a posé des questions qui ne peuvent être résolues qu'à l'échelle internationale ; il a donné des réponses encore partielles qui ne pourront être assimilées et pleinement enrichies qu'à l'échelle mondiale.
Chardin
Géographique:
- Pologne [17]
Rubrique:
RÉSOLUTIONS DU 4e CONGRES DE RÉVOLUTION INTERNATIONALE
- 17 lectures
RESOLUTION SUR LA SITUATION EN FRANCE
1. Comme cela a déjà été noté au cours de l'histoire, la situation actuelle en France exprime de façon très nette et typique un nombre important de grandes tendances de la société mondiale. Cela se manifeste aujourd'hui tant sur le plan de la situation économique, que de la vie politique de la bourgeoisie et que de la lutte de classe.
2. Sur le plan économique, cette caractéristique d'exemplarité s'est exprimée par la situation médiane du capital français :
- qui n'a pas réussi, face à la crise, d'aussi bonnes performances que les "bons élèves" de la classe (bourgeoise): l'Allemagne et le Japon ;
- qui a été cependant moins atteint que les capitaux anglais, espagnol ou même américain, notamment en ce qui concerne le taux d'inflation, le chômage, les déficits budgétaires, les balances commerciales et la stabilité monétaire.
Les potions administrées énergiquement par le professeur Barre, et en particulier dans le domaine de la modernisation de l'appareil productif et de l'amélioration de la trésorerie des entreprises viables, ont redonné au capitalisme français un dynamisme qui l'a placé en 79 au 3ème rang des exportateurs mondiaux.
3. Cependant, ces résultats relativement consolants pour le capital français et qui lui permettent de bénéficier d'un certain sursis par rapport a la récession qui se développe actuellement, ne peuvent masquer le fait que, à l'image de tous les autres, ce capital ne saurait échapper longtemps à l'aggravation de la crise mondiale. D'ores et déjà, cette aggravation s'est traduite pour l'économie française par l'apparition d'un déficit commercial très important qui se monte à 1,5 milliards de dollars en 1979 et s'élèvera à 4,7 en 1980.
L'aggravation de l'exploitation qui s'est déjà abattue sur la classe ouvrière ces dernières années, notamment en 1979 où les chiffres officiels eux-mêmes rendent compte d'une baisse de son niveau de vie, est donc appelée à s'intensifier dans la période qui vient, notamment avec une nouvelle augmentation du chômage et des cadences ce travai1.
4. L'impact de l'aggravation de la crise sur le pian des tensions impérialistes se manifeste également de façon très nette en France et ceci dans les différents domaines où il s'exprime à l'échelle internationale :
- le développement des armements : augmentation du budget militaire et fabrication de nouvelles armes (bombe à neutrons, missiles à support mobile);
- la discipline des blocs : l'apparente "indépendance" de la politique étrangère est typique de la façon "souple" dont le bloc américain est en mesure d'assurer sa cohésion (contrairement à la discipline rigide et militaire du bloc russe) et qui lui permet une plus grande efficacité sur le plan international par un partage des tâches (actions diplomatiques et militaires de la France en Afrique et au Moyen-Orient qui se situent dans ce cadre, même s'il s'agit aussi pour la France de défendre ses intérêts propres) ;
- la création d'une psychose de guerre (dont Giscard a été un des grands promoteurs) destinée à faire accepter un surcroît d'austérité et notamment celui lié à l'effort d'armements, mais surtout à préparer l'ensemble de la société aux sacrifices suprêmes de la guerre impérialiste.
5. De même que la contre-offensive bourgeoise des années 70, basée sur "l'alternative de gauche", avait connu en France avec le "Programme Commun", une de ses formes les plus typiques, l'orientation présenta de la bourgeoisie occidentale s'exprime dans ce pays de façon particulièrement nette. Dès avant les élections de 1578, une partie des secteurs de gauche de la bourgeoisie, ceux ayant l'impact le plus grand dans la classe ouvrière (PC et CGT), ont amorcé leur reconversion en forces d'opposition et une radicalisation de leur langage face à un épuisement de la carte du "gouvernement de gauche" et la reprise de la combativité ouvrière qui en résultait. Après les élections, cette tendance à la radicalisation du langage de la gauche, son installation dans l'opposition, s'est étendue au parti socialiste qui s'est donné une direction plus "à gauche" (éviction de Rocard-Mauroy, intégration de Chevènement).
6. Les caractéristiques du renouvellement par la bourgeoisie de son arsenal anti-ouvrier face au mouvement général de reprise prolétarienne (qui s'est exprimé notamment aux U.S.A, dès 1977 et par la suite en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, au Brésil, etc.), se manifestent actuellement en France de façon très nette.
D'une part, cette carte de la "gauche dans l'opposition" ne doit pas être comprise comme un renforcement de la bourgeoisie mais bien comme un moyen de pallier à des faiblesses croissantes résultant de la détérioration de l'infrastructure économique de la société. La nouvelle orientation de la vie politique française ne se fait pas sans aggravation des contradictions internes au sein de l'appareil politique. En particulier, en ne permettant pas la mise en œuvre de la carte de "centre-gauche" à laquelle aspirent des forces non négligeables de la bourgeoisie (notamment le secteur "centriste"),elle crée des difficultés tant dans le secteur gouvernemental qui ne peut s'appuyer que sur des forces qui restent divisées, qu'au sein du parti Socialiste tiraillé entre l'orientation favorable à une accession au gouvernement (Rocard, Mauroy) et l'orientation dominante de maintien dans l'opposition.
D'autre part, 1'exemple de la situation en France illustre très bien les moyens et l'efficacité de cette carte de "la gauche dans l'opposition". Parmi ces moyens, il est nécessaire de souligner :
- l'utilisation intensive des syndicats (y compris sous forme de "syndicalisme de base" cher aux gauchistes, de sections syndicales ou d'unions locales particulièrement "combatives") dont une des formes d'action préférées devient la surenchère verbale, la multiplication des journées d'action destinées à défouler le mécontentement ouvrier, à émietter la combativité, à utiliser celle-ci en vue d'une politique capitaliste (mystifications nationaliste, électoraliste, populiste, etc.), à fatiguer les travailleurs pour tenter finalement de les écœurer et de les démoraliser ;
- l'exploitation des divisions réelles existant au sein de la gauche (PC et PS, CGT et CFDT) pour augmenter le désarroi des travailleurs, divisions qui peuvent être mises momentanément sous le manteau quand cela s'avère utile pour renforcer l'encadrement ;
- la sécrétion du poison pacifiste destiné à minimiser l'aggravation des tensions inter-impérialistes : la dénonciation du fait -réel- que Giscard utilise l'inquiétude face à la guerre pour faire accepter un surcroît d'austérité, parce qu'elle n'est qu'une vérité partielle, participe en réalité de toute une politique destinée à masquer à la classe ouvrière l'enjeu véritable de ses luttes .
L'efficacité de la carte de "la gauche dans l'opposition" s'est également manifestée avec beaucoup de clarté. C'est lorsque cette carte n'était pas encore jouée à fond en 78 et début 79 que la classe ouvrière a mené en France ses luttes les plus déterminées et débordant le plus le cadre syndical, notamment dans la sidérurgie. Par contre, la radicalisation de la gauche aù printemps 79 (qui traduit bien la capacité et la volonté d'adaptation de ce secteur politique) est l'élément déterminant qui permet d'expliquer la reprise en main syndicale, et dont la grève, d’Alsthom à l'automne 79, est une des premières étapes.
Ainsi, s'il est nécessaire de savoir que la carte de la "gauche dans l'opposition" n'est pas le signe d'une amélioration d'ensemble de la situation de la bourgeoisie, il est indispensable d'être conscient tant de la capacité d' adaptation de ces forces politiques que de l'impact que leurs manœuvres peuvent avoir sur la combativité et la conscience de la classe ouvrière.
7. L'aggravation considérable des conditions de vie de la classe ouvrière qui s'annonce, l'épuisement de toute une série de mystifications basées sur l'idée qu'on pouvait "sortir du tunnel" de la crise, créent les conditions de surgissements importants de la lutte de classe en France comme dans l'ensemble des autres pays. De tels surgissements devront surmonter l'obstacle de la radicalisation de la gauche, de toutes les tentatives de celle-ci de s'opposer â l'autonomie de la classe et à la généralisation des luttes, de séparer deux composantes indissociables du combat de classe. Il revient aux révolutionnaires de participer activement à cette reprise des combats en dénonçant de façon efficace et non schématique, de l'intérieur de la lutte, même si elle est lancée par les syndicats, les multiples et multiformes manœuvres de ces organismes, de relier les revendications mises en avant par les travailleurs aux enjeux généraux de leur classe et notamment au problème de la guerre, de se tenir prêt à des explosions soudaines et massives du mécontentement ouvrier, puisque c'est de cette façon que s'exprime, dans la période présente, le surgissement de la classe, la généralisation de ses luttes.
RESOLUTION SUR LE REGROUPEMENT
L'ouverture depuis 1968 d'un cours historique aux affrontements de classe généralisés, la remontée des luttes, la gravité de la situation actuelle, de par l'approfondissement des tensions inter-impérialistes, nécessitent plus que jamais le regroupement des maigres forces révolutionnaires afin d'œuvrer de concert pour assumer les tâches immenses qui d'ores et déjà leur incombent.
L'échec et le sabotage des conférences internationales, comme ce fut le cas lors de la troisième conférence des groupes de la gauche communiste, n'entament nullement notre conviction dans la nécessité de celles-ci. Cette situation montre que le sectarisme prévaut encore largement dans le milieu révolutionnaire et a été plus fort que la pression de la lutte de classe. C'est la démonstration du manque de maturité de l'ensemble du milieu révolutionnaire, immaturité qui est le reflet du développement encore faible de la lutte de classe elle-même et le produit de la coupure organique entre les groupes d'aujourd'hui et les fractions du passé.
Au vu de la période actuelle, compte-tenu de l'importance des groupes participants, de la teneur des contributions et des discussions, de l'énergie déployée au niveau international et du rôle attractif qu'elles constituaient pour l'ensemble du milieu révolutionnaire, il faut reconnaître l'échec et le préjudice réel que représente ce sabotage, échec et préjudice qui accentueront d'autant plus le retard présent des révolutionnaires par rapport aux exigences de la lutte de classe.
Nous devons également regretter et condamner la part d'irresponsabilité qu'ont eue certaines organisations participantes ; irresponsabilité qui va de la dénonciation pure et simples des conférences comme "entreprises mystificatrices" (GCI), jusqu'à la volonté de constituer un parti par l'élimination pure et simple des groupes en désaccord... Toutes ces propositions démontrent l'incompréhension même du processus de regroupement des révolutionnaires. En ce qui nous concerne, nous restons fermement convaincus de l'utilité de mettre en place un cadre de discussions au niveau international dont les deux seuls objectifs réalistes dans la période actuelle sont la clarification des positions et analyses entre groupes révolutionnaires et la constitution d'un pôle de discussions et de regroupement.
Si, avec la rupture de ce cycle de conférences, il faut constater l'état de dispersion dans lequel se retrouve le mouvement révolutionnaire, pour notre part, il faut en nuancer le bilan : les conférences ont pu dégager certains points positifs :
a) elles ont permis au Nucléo Communista Internazionalista de se dégager des aberrations du PCI (Programma Comunista) sur la question du regroupement et d'apporter une contribution très positive à la discussion entre révolutionnaires.
b) elles ont été un catalyseur dans l'évolution de certains groupes (Travailleurs Immigrés en Lutte, Il Léninista). Même Battaglia Comunista et la Communist Workers Organisation ont été contraints d'évoluer et de préciser leurs positions.
c) elles ont permis que se dégagent les meilleurs éléments révolutionnaires du bourbier constitué par le milieu politique Scandinave.
d) elles ont permis la polarisation d'un milieu révolutionnaire au niveau international et ont forcé la clarification et la démarcation par rapport au problème de la discussion entre révolutionnaires (PCI, Spartacusbond, PIC)
e) elles ont été et seront un point de référence pour le travail de l'ensemble des courants révolutionnaires.
Tout cela doit nous faire comprendre que, malgré les échecs, nous ne devons pas tomber dans le découragement, qu'il faut réagir avec énergie pour poursuivre la dynamique de discussion au niveau international.
Dans cette perspective, le Congrès de la section du CCI en France appelle l'ensemble de la section territoriale à redoubler d'efforts dans le suivi et la discussion avec le milieu politique.
Nous ne devons pas sous-estimer notre capacité à influencer l'évolution de ce milieu en France malgré sa confusion présente. Tel est le souci de cette résolution.
Vie du CCI:
LE COMMUNISME DE GAUCHE : UNE MALADIE INFANTILE ?
- 91 lectures
IL Y A 60 ANS, EN 1920, LES DELEGUES QUI ASSISTAIENT AU SECOND CONGRES DE LA TROISIEME INTERNATIONALE REÇURENT CHACUN LA COPIE D'UNE BROCHURE ECRITE PAR LENINE : " LE COMMUNISME DE GAUCHE, UNE MALADIE INFANTILE". DANS CETTE BROCHURE, LENINE CRITIQUAIT AVEC VIRULENCE LES ORGANISATIONS QUI SE NOMMAIENT "COMMUNISTES DE GAUCHE". AUJOURD'HUI, CES CRITIQUES SONT COURAMMENT REPRISES PAR LES GAUCHISTES QUI VOIENT DANS LE TEXTE DE LENINE UN CLASSIQUE DE LA DIALECTIQUE ET DE LA TACTIQUE MARXISTE.
QUI ETAIENT CES COMMUNISTES DE GAUCHE OU "ULTRA-GAUCHE"?
LES COMMUNISTES DE GAUCHE
Il y a 60 ans le courant des "communistes de gauche" du mouvement révolutionnaire marxiste représentait l'expression la plus avancée de la grande vague de lutte de classe qui secoua le monde à la fin de la guerre. Contre les distorsions de Lénine même et les mensonges grossiers des trotskystes aujourd'hui, nous devons affirmer :
- que les communistes de gauche étaient une tendance MARXISTE et non pas anarcho-syndicaliste.
- qu'il ne s'agissait pas d'ouvriers immatures nouveaux dans le mouvement communiste mais d'une tendance solide qui s'était développée A L'INTERIEUR des partis de masse de la social-démocratie avant la guerre pour s'opposer â la dégénérescence de ceux-ci et défendre les principes révolutionnaires.
- qu'ils ont rejeté catégoriquement le social-chauvinisme quand la guerre de 14 a éclaté ; ils étaient sur les positions de Lénine à la Conférence de Zimmerwald et Kienthal et prônaient le défaitisme révolutionnaire.
- qu'ils ont été parmi les premiers à se rallier à la nouvelle internationale en 1919 et qu'ils ont pris la défense de la révolution russe en appelant à l'extension du mouvement révolutionnaire aux pays d'Europe de l'ouest et d'ailleurs.
C'est précisément PARCE QUE les communistes de gauche défendaient les principes de base du bolchevisme et de la troisième internationale qu'ils ont été conduits à s'opposer aux premières manifestations de dégénérescence qui surgissent dès 1920.
La brochure de Lénine elle-même, expression d'une rupture incomplète avec la social-démocratie, fut un signe de cette dégénérescence précoce.
C'est parce que les communistes de gauche étaient marxistes qu'ils furent capables de voir les implications de la nouvelle époque ouverte par la guerre, celle de la décadence du capitalisme et en particulier de comprendre l'importance historique des soviets ou CONSEILS OUVRIERS qui avaient joué un rôle primordial dans la révolution d'octobre.
Le groupe le plus important des communistes de gauche à cette époque était le KAPD (Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne) qui s'était formé au début de 1920 à partir de la majorité expulsée du KPD en 1919 pour avoir refusé d'assumer une activité parlementaire.
En Italie, les communistes de gauche étaient représentés par la fraction communiste abstentionniste du Parti Socialiste Italien, regroupée autour d'Amadeo Bordiga, qui défendait la ligne marxiste intransigeante contre le marais social-démocrate du PSI. C'est l'aile gauche "bordiguiste" qui a constitué le noyau de base et la tête du Parti Communiste Italien (PCI) en 1921.
Les communistes de gauche avaient compris, avec justesse, l'impossibilité de continuer à utiliser de telles institutions bourgeoises qui étaient devenues le principal point de ralliement des forces contre-révolutionnaires et qui ne pouvaient désormais qu'œuvrer à détruire les propres organes du pouvoir ouvrier : les conseils.
Ce faisant, les communistes de gauche étaient dans la lignée directe de la 3ème internationale lorsqu'elle annonçait l'entrée du capitalisme dans "l'ère des guerres et des révolutions" et la mort de la démocratie bourgeoise. Les combattants de la classe ouvrière, comme le KAPD, avaient compris la nécessité des conseils ouvriers comme la "forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat" à l'encontre de tous les mensonges sur la "voie" ou la "tribune" parlementaire.
LE 2ème CONGRES DE LA 3ème INTERNATIONALE
Contrairement à ce que pensent les trotskystes, les communistes de gauche ne furent pas frappés de mutisme, ensorcelés par la rhétorique et la logique de la brochure de Lénine. Ils défendirent leurs positions au 2ème et 3ème Congrès de 1'IC avant d'être finalement expulsés.
Après le fiasco de 1'"action de mars" en Allemagne en 1921, l'Etat bolchevik, (et le mouvement révolutionnaire comme un tout!) a commencé à se résigner à une période d'isolement. On pouvait constater de plus en plus l'effet de l'isolement dans le retournement d'attitude de 1'IC en faveur de l'aile gauche de la social-démocratie, c'est à dire les indépendants allemands -USPD- et les centristes du PSI conduits par Serrati, derrière lesquels s'abritait en fait l'aile droite du PSI conduite par Turati.
Le revirement était déjà clair au 2ème Congrès. La demande du PSI à être membre de 1'IC et leur acceptation immédiate des fameuses "21 conditions" fut attaquée par les communistes de gauche, qui connaissaient la social-démocratie et savaient que ses chiens n'hésiteraient pas à mordre sauvagement le moment venu. Les gauches soulignaient le danger de rechercher l'alliance des faussement séduisants partis de masses comme le PSI et dénonçaient cette politique de la direction de l'IC comme une trahison de ses anciennes positions sur la social-démocratie.
Les gauches allemande, hollandaise, considéraient que la façon la plus concrète d'aller de l'avant était de développer à l'extrême la conscience révolutionnaire dans le prolétariat en particulier sur les questions parlementaire et syndicale.
Ce rejet de tout compromis avec la social-démocratie allait conduire par la suite les gauches à leur exclusion de l'internationale tandis que l'aile droite devenait la force dominante.
Contre ce cours opportuniste, Gorter et le KAPD affirmaient que la social-démocratie était partout exclusivement bourgeoise :
- "Au lieu d'appliquer maintenant aussi à tous les autres pays cette tactique éprouvée, et de renforcer ainsi de l'intérieur la 3ème Internationale, on fait présentement volte-face et tout comme la social-démocratie jadis, on passe à l'opportunisme. Voici qu'on fait tout entrer : les syndicats, les Indépendants, le centre français, une partie du Labour Party.
Pour sauver les apparences du marxisme, on pose des conditions, qu'il faut SIGNER (!!). Kautsky, Hilferding, Thomas, etc., sont certes mis à l'index. Mais les grosses masses, 1'élément moyen est admis à rentrer et tous les moyens sont bons pour 1'inciter à le faire. Pour que le centre se renforce mieux, les "gauchistes" ne sont pas admis s’ils ne veulent pas passer au centre ! LES TOUT MEILLEURS ELEMENTS REVOLUTIONNAIRES, tels que le KAPD, SONT AINSI TENUS à L’ECART !"
LES POSITIONS DU KAPD
Dans sa réponse au camarade Lénine, Gorter démontre que Lénine et le parti bolchevik n'ont pas pleinement compris la nature de classe de la social-démocratie et des syndicats -spécialement en ce qui concerne la nature des syndicats que le KAPD, lui, confronté à un des plus puissants syndicats du monde, était bien placé pour comprendre:
- "De par leur nature, les syndicats ne sont pas de bonnes armes pour la révolution en Europe de l'ouest. Même s'ils n'étaient pas devenus les instruments du capitalisme, même s'ils n'étaient pas entre les mains des traîtres, et si -dans les mains de quelques chefs que ce soit- ils n'étaient pas, par nature, voués à faire de leur leurs membres des esclaves et des instruments passifs, ils n'en seraient pas moins inutilisables."
Gorter avait ainsi discerné quelque chose qui manque complètement dans l'analyse de Lénine.
Pour Lénine, et plus tard pour l'IC, le seul problème était réellement de trouver la bonne direction révolutionnaire pour les ouvriers à l'inférieur des syndicats existants.
Pour la gauche allemande, les syndicats ne pouvaient pas être les instruments du renversement du capitalisme puisqu'ils s'étaient INTEGRES A L'APPAREIL D'ETAT aux côtés des partis sociaux-démocrates. Les syndicats, tout comme la social-démocratie, devaient être DETRUITS.
C'est cette idée que Gorter et le KAPD martelèrent constamment.
En essayant de tirer les leçons de la lutte de classe, Gorter et le KAPD ont suivi les traces de Rosa Luxembourg qui dans "Grèves de masses" discerne les changements en train de se produire dans le mouvement historique : le caractère de masse des luttes ouvrières, leur signification de plus en plus politique et l'inadéquation des vieilles formes organisationnelles. Le KAPD resituera cette analyse dans le contexte des nouvelles conditions du capitalisme décadent après que là social-démocratie ait définitivement trahi la classe ouvrière. Si leur travail comporte inévitablement des faiblesses, ils ont eu le mérite de saisir des vérités fondamentales.
Ils n’ont pas jeté aux orties le rôle du parti, au contraire de ce qu'a affirmé Lénine mais étaient en fait pour une discipline et un centralisme rigoureux à l'intérieur du parti. Ils ont cependant analysé le rôle du parti sous le nouvel éclairage du changement de période, spécialement avec le surgissement des soviets, qui étaient pour le KAPD l'arme de la destruction du capitalisme, le moyen pour le prolétariat d’exercer son pouvoir et d'engager l'humanité dans la voie du communisme.
Le rôle du parti, comme le KAPD le comprenait en 1921, était de rassembler les "combattants les plus conscients et les plus mûrs" :
- "Le parti communiste doit avoir une base programmatique solidement élaborée et doit être organisé et discipliné dans son entier à partir de la base, comme une seule volonté. Il doit être la tête et l'arme de la révolution... La tâche principale du parti communiste— est...d’être la boussole la plus infaillible du communisme. Il doit en toutes occasions savoir montrer le chemin aux masses pas seulement dans les mots, mais aussi dans les faits. Dans toutes les situations de la lutte politique avant la prise du pouvoir, il doit montrer, de la façon la plus claire, la différence entre réforme et révolution et dénoncer toute concession au réformisme comme une trahison de la révolution." (2)
Pour le KAPD, le compromis de 1'IC avec la social-démocratie au 2ème Congrès était précisément une "déviation réformiste" et une "trahison de la révolution".
Dans les dernières 50 années, la classe ouvrière a chèrement payé ces confusions, ces premiers compromis de TIC : des années d'illusion sur la nature de classe des syndicats et des partis sociaux-démocrates. La polémique de Lénine contre les communistes de gauche sert aujourd'hui aux gauchistes -trotskystes, maoïstes, etc., pour justifier leurs intérêts profonds à défendre de tels corps et attaquer les révolutionnaires qui soutiennent et renforcent la compréhension grandissante de des ouvriers de la nécessité de se battre contre la gauche du capital.
Les positions de la gauche communiste, malgré toutes leurs confusions et leur caractère inachevé, sont devenues aujourd'hui des fondations essentielles pour la défense des positions de classe. Pour nous, ces organisations "infantiles" ont jeté des bases pour la prochaine vague révolutionnaire. Ce n'est pas par hasard que leur travail a été enterré et délibérément déformé. Mais aujourd'hui, leur combat est notre combat, leurs leçons sont les nôtres, doublement enrichies aujourd'hui. La gauche communiste a disparu dans la contre-révolution bourgeoise, mais leur travail n'est pas perdu, et sera repris par le les nouvelles générations qui remettront à l'ordre du jour le cri de guerre du KAPD : "la révolution est prolétarienne ou elle n'est rien!"
D'après "World Revolution" N°32
Révolution Internationale n° 79 - novembre 1980
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.29 Mo |
- 30 lectures
CONTRE LES MENSONGES TROTSKYSTES - EN POLOGNE AUSSI IL FAUT DÉTRUIRE LE CAPITALISME
- 21 lectures
LE SOULEVEMENT DES OUVRIERS EN POLOGNE A FAIT TREMBLER LA SOCIETE SUR SES BASES. CELA FAIT PEUR EN POLOGNE, MAIS PAS SEULEMENT EN POLOGNE. LES FAITS SONT TROP PARLANTS, ET LA BOURGEOISIE OCCIDENTALE NE TIENT PAS A CE QUE LE MYTHE DU SOCIALISME A L'EST S'ECROULE. TOUTE SON INSISTANCE PORTE SUR LE CARACTERE PROFONDEMENT "REFORMATEUR ET DEMOCRATIQUE" D’UN MOUVEMENT QUI POSE EN FAIT DES QUESTIONS PROFONDEMENTS REVOLUTIONNAIRES.
EN SON SEIN, LES TROTSKYSTES, TOUT EN CRITIQUANT LES "EXCES" DU SYSTEME, SE FONT SES DEFENSEURS EN POSANT TOUT EN TERMES DE "REVOLUTION DEMOCRATIQUE CONSERVANT LES BASES DU SYSTEME SOCIALISTE". LES OUVRIERS N'AURAIENT, SELON EUX, AUCUNEMENT REMIS EN QUESTION L'ORGANISATION SOCIALE, MAIS SEULEMENT DEMANDF "D'INTERVENIR PLUS DANS SA GESTION". C'EST CELA? POUR EUX, LA "NOUVELLE REVOLUTION" A FAIRE A L'EST!
il n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre. Pour les trotskystes, les derniers évènements en Pologne sont la confirmation éclatante de leurs thèses sur les "Etats ouvriers dégénérés". D'après cette théorie, inventée par Trotsky dans l'entre-deux guerres, pour expliquer la nature de classe de la Russie stalinienne, dans un "Etat ouvrier dégénéré" les ouvriers devraient, pour s'émanciper, faire une révolution, mais une révolution "partielle": l'économie y serait déjà socialiste, et les ouvriers n'auraient donc qu'une révolution "politique et démocratique" à faire.
Comme les staliniens, les trotskystes affirment que l'oppression que subissent les ouvriers en Pologne n'est pas capitaliste. Que contrairement â leurs pareils en occident, ce n'est pas contre l'ordre capitaliste que les ouvriers se battent à l'est. Pour eux, les travailleurs des pays de l'est ne devraient accomplir que des changements de forme, puisque les bases sociales sont largement socialistes. Planification, nationalisation, telles sont pour eux les mamelles du communisme. C'est avec ce genre de boniments que les trotskystes contribuent S brouiller les cartes en dénaturant la perspective même du communisme : si le communisme, c'est de l'URSS plus un peu de démocratie, Marchais plus un peu de Mitterrand non merci.
Pour qui ne se fie qu'aux apparences, et surtout aux travestissements de la presse bourgeoise, à l'est comme à l'ouest, le mouvement de grève de masse en Pologne peut sembler avant tout un mouvement pour une "démocratisation du système", les ouvriers essayant d'imposer des organes syndicaux, la liberté de presse, de réunion, etc. Mais pour qui a une vision claire de l'exploitation, la lutte des ouvriers en Pologne est avant tout la preuve que les ouvriers se battent fondamentalement contre la même oppression dans le monde, en s'opposant â la logique d'un système qui domine la terre entière.
DES BASES ECONOMIQUES PUREMENT CAPITALISTES
-les nationalisations
- "La révolution que la bureaucratie prépare contre elle-même ne sera pas sociale comme en octobre 17. Il ne s'agira pas de changer les bases économiques de la société, de remplacer une forme de propriété par une autre." (Trotsky, "La révolution trahie")
- "Pour instaurer le socialisme, les travailleurs en Pologne ne remettront pas en cause la nationalisation des moyens de production". ("Dossier Rouge" N°1, publié par la LCR).
Une des confusions essentielles sur laquelle se basent aujourd'hui ceux qui défendent le capitalisme d'Etat, c'est de confondre rapports de propriété et rapports de production.
Trotsky considérait la forme INDIVIDUELLE de la propriété privée comme une des caractéristiques essentielles du capitalisme. Or, ce qui est la caractéristique essentielle du capitalisme, c'est que la propriété des moyens de production est privée à ceux qui produisent. Que ce soit l'Etat ou un patron individuel qui soit propriétaire de ces moyens de production ne change rien au fait que l'ouvrier est totalement séparé de ce qu'il produit,
que les moyens de production, au lieu d' être des instruments au service de son bien-être, sont utilisés contre lui, comme des machines qui le pressurent pour lui extorquer toujours plus. Est-ce que pour un OS il y a une différence essentielle entre Renault et Michelin?
La panacée trotskyste de la nationalisation est appliquée à grande échelle à l'Est. Est-ce que les ouvriers en cessent pour autant d' être exploités? Est-ce que les. usines, les marchandises, tout ce qui est produit est fait en fonction de leurs intérêts? Les ouvriers polonais ne se sont-ils pas révoltés contre la situation qui leur est faite, tout comme à l'ouest : celle de marchandise qu'on entretient au plus bas coût possible, en augmentant sans trêve la productivité et les cadences et en leur accordant le strict minimum de ce qui est nécessaire pour qu'ils "entretiennent leur force de travail" comme on entretient une machine.
La bourgeoisie privée a été expropriée â l'Est. Mais l'Etat, propriétaire, exploite tout autant les ouvriers. Et cette exploitation se fait suivant les règles fondamentales du capitalisme : salariat, accumulation du capital, orientation de la production en fonction de la rentabilité et de la compétitivité du capital national sur le plan du commerce mondial.
L'Etat à l'est comme à l'ouest est un Etat capitaliste. La révolution ouvrière, qui consiste en premier lieu dans la DESTRUCTION de l'appareil d'Etat bourgeois est, de ce fait rnême, destruction des fondements de l'économie gérée par cet Etat.
Ce n'est pas uniquement contre les POLITICIENS au pouvoir que les ouvriers polonais se battent, mais AUSSI contre les lois économiques qui font d'eux des exploités et de l'Etat, et de ses membres, des exploiteurs capitalistes.
Il n'y a pas plus de choses à sauvegarder de l'actuelle société à l'Est qu'à l'Ouest.
Mais, insistent les trotskystes, la preuve que c'est SEULEMENT une question "politique" de démocratie et de participation, c'est que tout est fait en Pologne et à l'est en général pour que l'économie ne fonctionne plus selon les lois aveugles du capitalisme, mais selon des décisions conscientes.
-la planification
- "La logique de la production n'est plus, pour l’essentiel, la logique du profit, mais elle est déterminée par un plan." Ce qui est très différent de l'ouest OÙ "les biens sont produits pour être vendus sur le marché et c'est en fonction du profit plus ou moins grand réalisé dans tel ou tel secteur que se dirigent les investissements." (Dossier Rouge, op. Cit.)
LE PLAN, voilà ce qui suivant les trotskystes faciliterait grandement la tâche dû prolétariat. Il suffirait d'en changer la "direction consciente" pour que par miracle exploitation et oppression disparaissent. C'est le même écho qu'on retrouve chez Walesa quand il clame : "seule une participation ouvrière aux décisions du plan peut sortir le pays de la crise". Il en faudra plus pour que la Pologne réorganise entièrement la société selon une autre logique, que production, distribution, circulation de marchandises soient dictées par les besoins humains.
A l'Ouest aussi, il y a des plans, et l'Etat tente de les respecter avec d'ailleurs plus de succès qu'à l'Est. Cela ne prouve en rien un quelconque changement dans le caractère "conscient" de l'orientation de la production. Pourquoi ces plans seraient-ils si différents à l'Est? Qu'est-ce qui les dicte, en fonction de quoi sont-ils établis? Qu'est-ce qu'ils planifient?
Est-ce en fonction d'une "décision consciente" que la Pologne exporte son charbon pendant que ses habitants se gèlent ou en fonction des lois aveugles et impitoyables de l'échange capitaliste suivant lesquelles il faut vendre pour produire et produire pour vendre? Est-ce en fonction d'une "décision consciente" de quelques bureaucrates agressifs qu'au moins 20% (12 officiellement) de la production est destinée à la guerre, ou en fonction des lois capitalistes de la concurrence inter-impérialiste mondiale? Est- ce en fonction d'une "décision consciente" que l'économie nationale sombre dans la faillite, ou en fonction de la loi implacable de la crise mondiale du système capitaliste dans son entier qui s'enraye à ne plus pouvoir vendre?
La gestion de l'activité productive ne pourra devenir une activité réellement CONSCIENTE au sens vrai du terme, que lorsque les lois capitalistes auront-elles- mêmes disparues. Quand la production humaine sera orientée par l'ensemble des membres de la société vers la satisfaction de leurs besoins quels qu'ils soient. Quand l'abondance succédera à la pénurie, quand les forces productives ne seront plus entravées par les aberrations des lois économiques du capitalisme, de la rentabilité à courte vue. Alors et alors seulement la planification sera un outil conscient pour le bien- être des hommes. En attendant, dans le cadre des lois capitalistes la planification aveugle et empirique de l'exploitation et de l'absurdité du système est la seule possible, avec ou sans "contrôle ouvrier".
Les revendications "sociales" des ouvriers en Pologne, salaires, conditions de vie, santé transports, etc., (dont les trotskystes parlent le moins possible) ne sont pas seulement incompatibles avec le "plan" mal établi par des bureaucrates pervertis. Elles sont incompatibles avec le système capitaliste qui règne en Pologne, comme ailleurs, et dont la crise dicte une aggravation des conditions de vie de la classe ouvrière.
- les classes
Autre agrément des pays de 1'Est pour les trotskystes : il n'y a plus de classe dominante. Certes, les ouvriers ont devant eux un Etat, mais la couche qui le dirige, disent-ils, N'EST PAS UNE CLASSE, simplement une couche parasitaire sans force., sans assise économique :
- "La capitulation immédiate de la bureaucratie face à une mobilisation massive n'est pas une nouveauté (...), ce sera encore le cas demain, y compris en URSS. Pour nous, trotskystes, ceci est lié à la nature de cette bureaucratie gui ne peut agir que comme "fondé de pouvoir" de la classe ouvrière. C'est bien sûr un fondé de pouvoir qui vole la classe ouvrière, la bureaucratie ment, vole, réprime, pille, mais elle n'a ni rétabli le capitalisme, ni su établir une nouvelle société d'exploitation qui ait sa logique propre." ("Dossier Rouge"N°1)
En d'autres termes, le pouvoir, c'est les ouvriers qui l'ont, seulement ils l'ont délégué à une bureaucratie qui ne s'en sert pas bien. Aussi dès que les ouvriers lèvent la voix, la bureaucratie se soumet immédiatement à son maître .Seuls les cerveaux de petits aspirants bureaucrates peu vent concevoir une telle vision. La réalité est tout autre, et les ouvriers le savent eux, qui ont toujours vu les "capitulations" apparentes de l'Etat être suivies de sa victoire : en 70, après une répression féroce, des revendications ont été accordées, et effacées par l'inflation en quelques mois. 6 ans plus tard, une nouvelle hausse des prix provoquait un nouveau soulèvement. Le gouvernement a "cédé", mais ce sont les mêmes problèmes qui se posent en 80. La "capitulation" immédiate a certes une racine dans la force de la classe en comparaison de la force de la bureaucratie assise sur un système pourri. Mais ce sont justement les lois implacables de l'économie capitaliste nationale qui reprennent le dessus dès que la force de la classe ouvrière marque le pas.
LA BUREAUCRATIE EST-ELLE UNE CLASSE?
C'est "le capital qui produit le capitaliste et non le capitaliste qui produit le capital" (Marx). Les gestionnaires du capital, ceux qui décident quelle part de la production sera réinvestie, quelle sera pour eux et quelle ira aux ouvriers, sont des capitalistes. Ils constituent une classe qui gère l'exploitation ouvrière et en tire profit : la bourgeoisie. Qu'ils soient "salariés" ou non ne change rien à l'affaire. A elle seule, l'existence de l'Etat suffit à prouver l'existence de classes opposées, exploiteuses et exploitées : "L'Etat est le produit et la manifestation de ce fait que les contradictions de classes sont inconciliables" (Lénine).
Ce que la LCR trouve "révolutionnaire" dans les revendications des ouvriers polonais est justement ce qui véhicule les pires confusions, diffusées en particulier par le KOR : par exemple la revendication selon laquelle il faut désigner les directeurs "selon leur qualification et non en fonction de leur appartenance au parti ", et d'ajouter : "dans quel pays capitaliste verrait-on un ancien dirigeant gréviste devenir patron? (Dossier Rouge)" Comme le disait L.0. lors d'une campagne électorale : "ce n'est pas juste que ce soit toujours les mêmes qui soient présidents." Voilà bien le piètre communisme que nous offre les trotskystes : le communisme, c'est d'avoir de bons contremaîtres!
Comprendre que la bureaucratie est une classe, la bourgeoisie, dans un système décadent et totalitaire, c'est comprendre la vraie dimension du combat contre elle : le combat du prolétariat mondial contre le système de la bourgeoise mondiale.
Trotsky le reconnaissait : si ces rapports (Etat-bureaucratie-classe ouvrière) se stabilisaient, ils finiraient par la liquidation complète des acquis de la révolution prolétarienne. " (La révolution trahie).
Depuis plus de 50 ans qu'ils se stabilisent, les trotskystes n'ont pas encore compris ce que signifiait le capitalisme d'Etat, et en sont venus à colporter les pires des mystifications nationalistes bourgeoises cherchant des replâtrages du système. Les ouvriers polonais, eux, comprennent de plus en plus clairement de quelle nature est l'oppression qu'ils subissent. Quand ils comprendront qu'elle est de même nature que celle que subissent leurs pareils dans le monde entier, mensonges trotskystes et trotskisants qui entravent encore à certains moments leurs combats seront balayés avec tout le fatras qui soutient le système d'exploitation. La révolution de la classe ouvrière mondiale est partout sociale, économique ET politique. Partout les tâches qui l'attendent sont :
- Destruction de l'Etat bourgeois et mise en place du pouvoir des conseils ouvriers.
- Transformation des rapports de production, destruction de l'exploitation, du salariat.
- Transformation du but de la production : vers la satisfaction des besoins de l'humanité toute entière.
D.N.
Courants politiques:
- Trotskysme [20]
Rubrique:
LA RELIGION AU SERVICE DE L’EXPLOITATION
- 37 lectures
Iran, Brésil, Pologne, autant de pays où les contradictions inextricables dans lesquelles s'enfonce le capitalisme décadent ont donné lieu au développement de l'agitation sociale et en particulier à des explosions ouvrières parmi les plus importantes de la période actuelle. Autant de pays aussi où le rôle de l'Eglise semble être -ou avoir été à un moment donné- sur le devant de la scène, offrant ainsi l'occasion aux médias de recouvrir du voile pudique de la "question religieuse" la trop présente réalité sociale. Au-delà de ce camouflage dont se satisfait certes l'explication bourgeoise du monde, le poids que conservent les fractions religieuses dans ces pays, et le rôle qu'elles sont appelées à y jouer n'est pas complètement étranger à la situation sociale qui s'y développe. La contribution de la religion dans une telle situation se résumé à la capacité de cette subsistance féodale à constituer, pour une bourgeoisie moribonde, un rempart à la lutte de classe.
Avant même qu'on ait entendu parler de l'existence d'une "opposition démocratique" en Pologne, quelle autre fraction que l'Eglise pouvait prétendre être suffisamment implantée dans la classe ouvrière pour, sinon l'endormir, du moins la contrôler du mieux possible ? Parés de l'auréole des opprimés du stalinisme, les évêques se sont fait les premiers -dès 1956- les porteurs de la contestation démocratique vis-à-vis de l'Etat totalitaire et du parti unique. Dans le mouvement de grèves de 80, on les voit se présenter comme le soutien moral des grévistes, protester le plus énergiquement contre les conditions de vie ouvrière, pour mieux lancer des appels "au calme, à l'esprit mutuel, à la prudence, à la responsabilité et à l'esprit de vérité" , pour mieux rappeler que "l'abandon prolongé du travail, d'éventuelles émeutes ou des effusions de sang sont contraires à l'intérêt de la nation". Au sein des organes chargés des négociations, les intellectuels catholiques, aux côtés de ceux du KOR et autres oppositionnels se font les colporteurs des illusions démocratiques, syndicalistes et nationalistes.
Au Brésil, le Pape débarque en personne dans les bidonvilles pour apporter son soutien à l'opposition syndicale et pour déclarer, au nom de “l’Eglise des pauvres", que "la société sans classe est une utopie basée sur la haine et la destruction". Plus radicaux, les "curés progressistes" ouvrent grand leurs églises à la lutte de classe pour mieux l'y enfermer, transforment en messes les assemblées ouvrières, se partagent avec les leaders syndicaux, tel le fameux "Lula", le contrôle des luttes ouvrières et la tâche d'enfermer celles-ci dans les illusoires réformes sociales et démocratiques.
En Iran, ce sont encore les religieux qui se chargent de canaliser une révolte qui mettait en mouvement pratiquement l'ensemble de la population. L'absence ou l'extrême faiblesse d'une opposition politique de gauche laissait les fractions religieuses comme seule capables d'offrir à l'agitation sociale l'illusion d'une alternative nationale à la dictature du Shah contre l'impérialisme américain.
La force de la religion dans tous ces pays traduit la situation qui prévaut dans les pays les moins développés du globe, là où les subsistances précapitalistes se mêlent aux caractéristiques les plus poussées du capitalisme décadent. Le poids des couches paysannes, terrain même de développement de la religion, y imprègne l'ensemble de la vie sociale, en même temps que la survie de la nation impose le développement à outrance du totalitarisme de l'Etat.
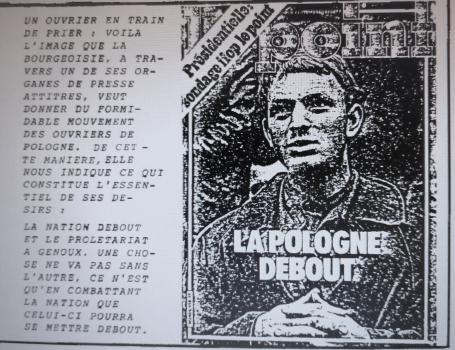
Dans ce cadre, ce n'est pas un hasard si le développement des fractions religieuses se fait, parmi tous ces pays, dans ceux où la poussée de la lutte de classe impose à la bourgeoisie de chercher à occuper tout le terrain social, alors que l'Etat totalitaire ne peut aucunement semer l'illusion d'un possible partage du pouvoir. L'Iran impérial, comme le Brésil militaire ou la Pologne stalinienne n'échappent pas à la règle qui prévaut pour toutes les bourgeoisies du monde face à la reprise internationale de la lutte de classes : le besoin impérieux de sécréter, dans l'opposition, des forces capables de contrôler l'ensemble de la société et la classe ouvrière en particulier. Tel est le sens du rejet dans une opposition plus "radicale" des fractions de gauche et syndicales de la bourgeoisie dans les pays développés à tradition "démocratique". Qu'ailleurs ce soit à la religion que ce rôle soit dévolu n'exprime pas tant la force de la mystification religieuse que la faiblesse d'une bourgeoisie incapable de développer réellement en son sein une "gauche" qui puisse apparaître comme la représentante historique de la lutte ouvrière, à l'image des partis et syndicats sociaux-démocrates ou staliniens.
Le moins qu'on puisse dire est que les limites de l'encadrement religieux se font rapidement sentir dès que le mécontentement social tend à prendre la forme de véritables explosions ouvrières. A ceux qui n'ont voulu voir dans les grèves en Pologne que des ouvriers à genoux, il suffit de rappeler que les appels au calme répétés de l'Eglise se sont heurtés à l'indifférence croissante d’un mouvement qui prenait conscience de sa propre force et pour qui la religion était peut-être beaucoup, mais certainement pas une voie pour la lutte.
Avant cela, l'exemple de l'Iran a montré que si les ayatollahs pouvaient s'appuyer sur la colère populaire, ils étaient par contre largement débordés par la combativité ouvrière que l'arrivée au pouvoir de Khomeiny ne parvint pas à enrayer. Aujourd'hui, la situation intérieure iranienne, même marquée par un recul des luttes ouvrières, est bien la preuve des limites du rôle politique que peut jouer la religion : sur le terrain de 1'encadrement de la classe ouvrière, elle a dû laisser la place à une opposition stalinienne, plus capable aujourd'hui d'entraîner les ouvriers derrière la défense de la nation dans la guerre avec l'Irak.
En tant que fraction de gouvernement, les ayatollahs ne sont guère plus reluisants, et la pression américaine, entre autres, est là pour imposer leur remplacement à la tête de l'Etat par des fractions plus cohérentes de la bourgeoisie autour de Bani Sadr.
Quant au Brésil, si l‘Eglise semble parvenir à réaliser un encadrement relativement efficace, vu le caractère explosif de la situation sociale, cela est dû essentiellement à la collusion étroite qui se fait dans ce pays entre l'Eglise et les syndicats : c'est bien plus comme promoteurs du syndicalisme que de la parole de Dieu, que les "curés de base" parviennent à assurer tant bien que mal le contrôle sur la combativité ouvrière.
L'OPIUM DU PEUPLE
"La misère religieuse est en même temps l'expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, le cœur d'un monde sans cœur, de même qu’elle est l'esprit d'un monde sans esprit. Elle est l'opium du peuple." disait Marx, décrivant clairement la fonction de la religion : une protestation contre la réalité, opposant à celle-ci la "consolation" que peut donner l'idée qu'il n'existe aucune alternative, sinon en dehors de cette réalité.
Aujourd'hui que la réalité de la misère se fait de plus en plus sombre, la bourgeoisie ne manque pas de continuer de faire appel à cette fonction séculaire de la religion. Ne choisit-on pas un Pape polonais, élevé au rang de star internationale, pour porter devant les peuples la bonne parole cartésienne : celle de la campagne pour les "droits de l'homme" et pour la guerre.
Mais l'effondrement du capitalisme, avec son cortège de misère, porte aussi avec lui celui de toutes les idéologies sur lesquelles peut s'appuyer la bourgeoisie; la consolation du ciel, si profondément implantée soit-elle dans la conscience des exploités, est bien impuissante à barrer la route au réveil d'une classe entière qui se dresse contre l'exploitation. On l'a vu, la religion doit, elle aussi, radicaliser son langage, "reconnaître la lutte de classes", si elle veut continuer d'être cet opium du peuple. Mais, là encore, le "radicalisme" qu'il soit syndical, politique ou religieux traduit le recul des places fortes idéologiques de la bourgeoisie devant la montée de l'alternative unique qui se dessine de plus en plus clairement aux yeux du monde: la révolution prolétarienne. Il ne s'agit pas pour nous de nier le poids encore très lourd des sentiments religieux dans la conscience de ceux qui subissent tout le poids de l'exploitation, mais les illusions qui ont servi depuis des siècles à perpétuer la dictature des classes dominantes ne cesseront totalement d'encombrer la conscience des vivants que dans la société sans classe.
- "La religiosité des masses ne disparaîtra complètement qu'avec la société actuelle, quand l'homme, au lieu d'être dominé par le procès social, le dominera et le dirigera consciemment". (Rosa Luxemburg: "Le socialisme en France".).
Rappelons-nous seulement que les milliers d'ouvriers qui en 1905 s'étaient mis en marche derrière un pope, partaient trois mois plus tard à l'assaut du ciel, répandant partout les Conseils ouvriers.
JU.
Questions théoriques:
- Religion [25]
Révolution Internationale n° 80 - décembre 1980
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.28 Mo |
- 38 lectures
POLOGNE : MALGRE LES SYNDICATS LA CLASSE OUVRIÈRE NE LÂCHE PAS PRISE
- 17 lectures
Si la classe ouvrière en Pologne n'a pas fait de nouvelles avancées et si aujourd'hui elle marque le pas, on ne peut pas dire qu'elle ait reculé. Aujourd'hui, comme hier, elle ne plie ni aux diktats de l'Etat ni ne cède au chantage "à la catastrophe" des nouveaux bureaucrates du syndicat dit " libre".
Malgré la pression de la bourgeoisie mondiale, malgré le barrage des "nouveaux" syndicats, par sa combativité et sa mobilisation générale la classe ouvrière en Pologne conserve les positions gagnées dans la lutte.
Depuis bientôt maintenant cinq mois l'Etat polonais assisté et financé par la bourgeoisie mondiale ne parvient plus à imposer l'ordre ; l'ordre de la pénurie, de la crise, de la misère et du sacrifice, "l'ordre national" de la police et de l'armée.
Dans la situation mondiale actuelle, un mouvement de l'ampleur de celui qu'a mené la classe ouvrière en Pologne ne recule pas comme ça.
Pour que la classe ouvrière recule il faudrait, soit que l'Etat l'écrase militairement, lui impose son point de vue par la force des fusils et des chars, soit qu'elle suive docilement l'orientation de "reconstruction nationale" des syndicats qui n'ont finalement fait que remplacer l'ancien syndicat officiel.
Chaque jour qui passe apporte avec les événements autant de nouvelles preuves de l'intégration de plus en plus effective des syndicats dans l'Etat polonais. Négociations secrètes de Walesa et Kanya, appels quotidiens à l'ordre et à la reconstruction nationale.
Mais si il est évident que les "nouveaux" syndicats ont réussi â constituer un BARRAGE à la lutte.il est tout aussi évident qu'ils n'ont par contre pas réussi à persuader les ouvriers de se sacrifier à nouveau pour la patrie, de laisser de côté revendications économiques et politiques, d'abandonner 1eur mobilisation générale. Pour i1ustrer cette situation et ne prendre qu'un exemple parmi les plus récents, on peut se référer aux événements que relate "Le Monde" du 22-11-80 :
- "Mercredi à Szczecin, la commission nationale de Solidarité a réussi pour la première fois à travailler une jo journée durant dans un ordre parfait... Mais le soir, pendant un énorme meeting en plein air, les dirigeants du syndicat se sont trouvés face à un tel déluge de questions directes et violemment politiques, qu'ils ont du prendre l'engagement de lancer des grèves...
Au dîner, ensuite, beaucoup se demandaient, consternés, comment ils pourraient freiner cette lame de fond."
La première victoire de la classe ouvrière en Pologne a été de faire reculer l'Etat et sans se presser d'aller le plus loin possible, sa seconde victoire consiste à ne pas lâcher prise.
Cela dit si la classe ouvrière conserve aujourd'hui encore ses positions acquises dans sa lutte face à l'Etat et que celui n'arrive pas à reprendre l'initiative, malgré l'aide précieuse de ses syndicats l'avenir de la lutte ne dépend pas de la classe ouvrière en Pologne mais de la classe ouvrière mondiale.
Nationalisme ou internationalisme
Ce que craint fondamentalement la bourgeoisie, c'est une extension internationale de la lutte de classe, elle craint par-dessus tout que l'exemple des ouvriers polonais refusant fermement les conséquences de la crise économique, ne pouvant et ne voulant plus vivre comme auparavant ne fasse tâche d'huile.
C'EST POUR CELA QUE LA CAPACITE DE LA BOURGEOISIE A COMBATTRE LA LUTTE DES OUVRIERS POLONAIS PASSE AVANT TOUT PAR SA CAPACITE A LA MAINTENIR DANS LE CADRE DES FRONTIERES POLONAISES.
Ce qui retient le bras armé de la bourgeoisie, ce qui l'empêche d'écraser dans le sang la révolte des ouvriers polonais, c'est bien sûr la puissance du mouvement ouvrier en Pologne mais c'est surtout la lutte de classe internationale, la peur qu'une telle répression ne provoque des mouvements ouvriers de solidarité dans les pays de l'Est comme dans les pays
occidentaux.. Ce n'est sûrement pas la volonté de régler "démocratiquement" les conflits sociaux comme l'affirme le pseudo parti communiste français. Comme les gigantesques crédits alloués à l'Etat polonais par tous les pays occidentaux, ne sont pas le fruit de leur sympathie pour les Etats du bloc russe, encore moins pour la classe ouvrière.
Cette situation est la preuve formelle que le rapport de forces entre prolétariat et bourgeoisie est un rapport de forces international. Si ce rapport de forces international a permis à la classe ouvrière polonaise d'aller jusqu'où elle est allée, sans se faire stopper par les chars, ils faut aussi noter que la classe ouvrière en Pologne ne peut aller beaucoup plus loin dans sa lutte sans se confronter aux limites du cadre national. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si la défense de la "patrie" et de "l'économie nationale" est le principal thème et recours des syndicats "libres" et qu'en même temps ils constituent le barrage le plus efficace à la lutte de classe.
Aujourd'hui, dans sa pratique, le prolétariat polonais pose la question de l'internationalisation de la lutte de classes, mais ce n'est pas lui qui peut y répondre : seule la classe ouvrière mondiale au travers du développement de sa lutte.au delà et contre les frontières nationales résoudra la question.
M. Prénat
Géographique:
- Pologne [17]
Rubrique:
Pologne : DE 70 A 80, UN RENFORCEMENT DE LA CLASSE OUVRIÈRE
- 38 lectures
LES LUTTES OUVRIERES EN POLOGNE 70 SONT ENCORE VIVANTES. AUJOURD'HUI, LES OUVRIERS EN POLOGNE ONT SU TIRER, DANS LEURS LUTTES, LES LEÇONS DE LA LUTTE QUI LES AVAIT OPPOSE A L'ETAT DANS L'HIVER 70-71.
DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL BEAUCOUP PLUS FAVORABLE, LES OUVRIERS NOUS MONTRENT COMMENT LA CLASSE AVANCE DANS SA PREPARATION AUX AFFRONTEMENTS DECISIFS DE DEMAIN.
Dans la grève de 1980, une chose est certaine : la position de force des ouvriers, la masse, la cohésion, la détermination de leur mouvement, MALGRE 1'Eglise, MALGRE les "syndicats libres", MALGRE le KOR.
A première vue, certaines faiblesses sont apparues plus clairement qu'en 70 : les illusions sur la "démocratie" et le nationalisme en particulier.
En 70, les ouvriers en Pologne ont ATTAQUE les centres de l'Etat, en réponse à la répression, force contre force. En s'attaquant aux syndicats, la police, au parti, ils mettaient au clair la nature de l'affrontement entre la classe ouvrière et l'Etat : deux intérêts antagoniques qui ne peuvent plus se faire de concessions. En 80, les syndicats libres paraissent avoir occulté un temps le vrai problème en le posant en termes de conciliation dans le cadre de la patrie commune.
Il y a 10 ans, les ouvriers ne chantaient pas l'hymne national, et quand le drapeau polonais apparaissait dans une manifestation, c'était trempé dans le sang des ouvriers tués lors des affrontements. Cet été, certains chantaient l'hymne national, et les drapeaux polonais flottaient sur des autobus en grève.
Mais les apparences ne suffisent pas. Profondément, les illusions ne pèsent pas plus sur le mouvement qu'elles ne pesaient en 70, et les mouvements actuels marquent une plus grande force, une plus grande maturité que ceux de l'hiver 70-71, y compris sur la question de l'affrontement avec l'Etat. Les évènements actuels sont UNE CONTINUATION de 70, un pas en avant dû à 1'expérience.
Les illusions sur l'Etat iront fait que diminuer.
Les ouvriers aujourd'hui n'ont pas encore incendié de local du parti, pas pendu de bureaucrates. Pourtant, ils n'ont pas plus d'illusions sur ceux qui les gouvernent. Ils savent qu'il faudra les affronter.
Les ouvriers en Pologne n'ont guère d'illusions sur le "coude à coude" avec la classe dirigeante. Nous sommes loin de la liesse avec laquelle avait été accueilli Gomulka en arrivant au pouvoir en 56, arrivée ressentie comme la victoire d'une tendance "ouvrière" dans 1'Etat.
En 70, la rupture était déjà nette : la répression, ils ne l'attendaient pas non plus de Gomulka, et ils l'ont eue... Bien que les concessions de Gierek soient soi-disant "sans précédent" (discuter avec des comités de grève, promettre qu'aucune répression ne sera exercée), c'est avec méfiance que les ouvriers ont accueilli ses promesses et ses tirades quand il déclarait à Szczecin : "Nous sommes de la même pâte et nous avons le même but." D'autant que, lorsqu'il s'est rendu aux chantiers de Szczecin pour "négocier", l'armée encerclait les chantiers, des renforts étaient, mobilisés dans tout le pays, l'eau et les vivres étaient coupées. L'épreuve de force était claire.
Aujourd'hui, cette rupture n'a fait que se renforcer. Gierek, le "mineur de Silésie" avait promis l'augmentation du niveau de vie... les ouvriers ont eu le travail du dimanche, les cadences renforcées, pour en arriver à la situation d'aujourd'hui : plus de viande, plus de lait, plus de beurre, plus de chauffage; Gierek avait promis de ne pas réprimer, et les ouvriers grévistes ont été pourchassés un par un, traqués comme des lapins. La classe ouvrière ne croit plus aux promesses de la bourgeoisie. Kanya a remplacé Gierek dans l'indifférence la plus totale.
La maturation de la force de la classe ouvrière contre l'Etat.
Les ouvriers ne provoquent pas un affrontement sans se sentir assez forts pour le faire. En 1970, ils ne l'ont pas PROVOQUE. Ce fut une réponse à la répression, la seule : force contre force. Pourtant, le mouvement n'était pas prêt au départ à une telle épreuve de force. A Szczecin sûrs du caractère pacifique de leur manifestation, les manifestants avaient placé en tête femmes et enfants. La police était là, elle a tiré. A Slupsk, c'est sur une manifestation pacifique aux cris de “nous voulons du pain", que la police a tiré. La rapidité de réaction de la classe n'en a été que plus impressionnante.
Aujourd'hui, aucune délégation n'a été arrêtée, aucun coup de feu n'a été tiré, comme ce fut le cas en 70. Les ouvriers, au mois d’août, y étaient prêts : par mesure de précaution, les délégations ne sortaient pas de l'usine, et des milices avaient été organisées. Mais sans répression la classe ouvrière a choisi de se RENFORCER, de préparer sa cohésion : géant auquel les syndicats libres tâchent d'attacher des menottes trop petites.
Aujourd'hui, les ouvriers ont tiré les leçons de 70 : on n'affronte pas l'Etat en ordre dispersé. En 70, pendant la répression, il n'y avait aucun lien entre les villes, tout juste entre les usines. Ce n'est qu'à la fin de la grève que ces liaisons ont commencé à apparaître. A Szczecin, en 70, le rétablissement des liaisons entre les villes venait en 18ème condition de "revendications non reconnues par le gouvernement". En août, ce fut le PREALABLE imposé par les ouvriers : d'abord, l'extérieur, la circulation des informations, permettre une organisation la plus large de la force ouvrière.
En 70, des pas énormes, y compris dans l'organisation de la lutte, ont été faits. Il est manifeste que la rapidité d'organisation de la classe cette fois-ci puise ses racines dans l'expérience antérieure. En 70, par exemple, il est clair que ce sont les comités de grève qui ont organisé les manifestations : en réponse à l'arrestation de leur délégation, les ouvriers partent en manifestation devant le parti, manifestation grossie par la population. La police est là, et lors des affrontements, les manifestants reculent... pour se diviser immédiatement en 3 chercher la solidarité : vers les chantiers encore au travail, vers les universités, vers la radio : le rendez-vous est le soir même une attaque du local du parti qui se terminera par un incendie. A Krakov, Varsovie, Wroclaw, et dans bien d'autres villes, les ouvriers agissent comme une force autonome et décidée. L'importance du noyau fort de l'usine est encore plus manifeste quand on voit l'exemple de Gdynia, où la bourgeoisie a pu faire une répression sans précédents : alors que dans les autres villes, l'armée, même après avoir reconquis la rue, ne put pas rentrer dans les usines, à Gdynia, elle a commencé par investir les usines AVANT que les évènements ne prennent un tour violent. Après, elle a PROVOQUE un affrontement en tirant sur des ouvriers isolés se rendant à l'usine le matin. La bataille qui s'en suivit fut la plus meurtrière de toute la Pologne : aveuglées de colère, des masses inorganisées et sans cohérence se battaient dispersées, dans les rues, les gares. Ce fut plus un massacre qu'un affrontement. En 80, les ouvriers ne l'ont pas oublié : la fermeture des usines correspondait aussi à l'affirmation de la classe ouvrière en tant que telle.
Par la suite, en 70, l'organisation des ouvriers se développa. A Szczecin, en janvier 71, la force ouvrière était telle que "la ville s'est transformée en une véritable république ouvrière, où tous les pouvoirs étaient exercés par le comité de grève... la grève ne prit fin que lorsque le comité de grève reçut l'assurance de l'immunité complète pour tous." A ce stade-là, des liaisons existent un peu partout, entre la Baltique, Poznan, Ursus, Varsovie...
Cette conscience de la nécessité de se renforcer face au pouvoir en étendant la lutte, les ouvriers aujourd'hui ne l'ont pas oublié : d'emblée, ils se sont affirmés en dehors des secteurs d'industrie, et se sont organisés en 4 organisations régionales ayant pour base les délégués d'assemblées générales.
L'étendue de la force qu'ils peuvent avoir sur la société, ils ne l'ont pas oublié non plus : c'est au siège du comité de grève central, devant le chantier Lénine, que la population s'est massée, c'était là le cœur de l'action. La façon dont les ouvriers ont su organiser transports, hôpitaux, ravitaillement, n'expriment pas une tentative d'autogestion, mais la conscience de la nécessité de maintenir certaines fonctions vitales aux ouvriers et à la grève même : le début d'une concrétisation de la possibilité qu'a la classe ouvrière de prendre la direction de la société.
En 70, les ouvriers avaient conscience qu'il leur restait des pas à faire : "Nous reprenons le travail. C'est au moins ce que nous savons faire de mieux, car nous ne savons pas encore faire grève." (président du comité de grève de Szczecin ). En 80, les ouvriers ont su organiser une grève de masse à l'échelle du pays. Ils ont mis en action la conscience tirée de 70 qu'une organisation plus étendue de la classe ouvrière était nécessaire pour lutter contre l'Etat.
En 80, la classe ouvrière ne s'est pas jetée les mains nues contre les chars. Mais elle a étendu sa puissance jusqu'à faire trembler tous les remparts de la société bourgeoise. C'est de cette force là que la classe ouvrière a besoin contre l'Etat, contre l'armée. L'affrontement ne suffit pas. Il faut encore le gagner.
La dynamique de dépassement du nationalisme
Dans les pays de l’Est, plus encore qu'à l'ouest, c'est une entrave énorme. Le sentiment viscéral anti-russe, vu le degré d'exploitation qu'impose sa mainmise sur la Pologne amène le prolétariat à penser en termes de "nation" à affirmer contre l'URSS... ce qui empêche de voir l'URSS en termes de classe ouvrière russe.
En 70, cet aspect était occulté par la violence de l'affrontement entre Etat national et classe ouvrière. Une bourgeoisie qui massacre les ouvriers peut difficilement faire appel au “patriotisme", avec ses allures "démocratiques" et "syndicalistes". Bien que l'opposition syndicaliste ait quand même fait un bon travail de barrage, en 80, travail rendu plus facile par l'absence de répression, cette conscience de la rupture entre l'Etat national et les ouvriers n'a pas disparu. L'expérience est là, et les ouvriers n'ont aucune raison concrète d'avoir confiance dans le langage des "efforts pour le bien national", même dans une nation "rénovée".
Mais pour que l'illusion d'une possibilité de changement dans le cadre national disparaisse, cela ne dépend pas que de la Pologne. Un mouvement de grève en Russie ferait plus avancer la question que 10 affrontements en Pologne.
Et, du point de vue international, les conditions ont évolué depuis 70. Ce qui avait pu être ignoré de la Pologne en 70, en Europe de l'ouest notamment (où la grande affaire d'alors était "Puig Anti ch", tentative antifasciste vite oubliée), n'est plus possible à cacher en 80. Les ouvriers polonais aujourd'hui SAVENT que le monde les regarde. Et les grèves en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Allemagne, plus directement encore que celles qui se sont développées de par le monde, sont autant de feux de reconnaissance de la classe ouvrière internationale.
Du point de vue international, les conditions vont dans le sens d'un dépassement du nationalisme. En Pologne même, il reste aux ouvriers à apprendre que, de la même façon qu'une grève ne peut prendre sa force que dans la généralisation à d'autres secteurs, une grève de masse doit chercher sa prochaine force dans la lutte de classe internationale. L'issue de la lutte, répression ou renforcement, dépend d'elle. Malgré un regain d'illusions dû au matraquage de "l'opposition" sur les réformes nationales, la classe ouvrière en Pologne a créé aujourd'hui un ébranlement de l'Etat pire que 70. Et ébranler l'Etat dans ses fondements, même en chantant l'hymne polonais, porte une dynamique qui dépasse même ceux qui la font.
D.N.
Géographique:
- Pologne [17]
Rubrique:
VERS L’UNIFICATION DU PROLÉTARIAT MONDIAL
- 10 lectures
Quand, pour éclairer la route, nous avons une torche aussi flamboyante que celle du combat du prolétariat en Pologne, comment ne pas nourrir la plus grande assurance dans notre avenir ! Prolétaires, camarades, l'heure est à la confiance dans notre force. Lucidement, sans emballement aucun ni exagération, rendons-nous compte que le temps est en train de travailler en notre faveur. Sachons-nous en saisir.
Qu'est-ce que nous dit la formidable lutte que les ouvriers mènent en Pologne depuis 5 moisi Qu'il n'y avait aucun hasard à la succession des grands mouvements ouvriers de ces dernières années, des sidérurgistes de Longwy et Denain en 79 à leurs frères de Grande- Bretagne, en 80 ; des dockers de Rotterdam aux métallurgistes de Sao Paulo, au Brésil, en 79. Le magnifique combat de Pologne n'est donc que le couronnement et l'explication de tout un processus qui a nom : le développement généralisé de la lutte ouvrière dans le monde. A côté de ces grands mouvements cités, ce sont cent, mille autres exemples qui, a divers degrés, viennent certifier cette réalité. Parlons des grandes grèves dans l'automobile, en Espagne et en Italie, de la dure lutte des ouvriers du textile d'Izmir en Turquie, des mineurs aux USA. On pourrait allonger indéfiniment la liste des luttes, des secteurs de travail et des contrées touchées par elles : Suède,
Corée, Tunisie (Gafsa), Algérie (Tizi- Ouzou), Soudan, Liberia, Zimbabwe, Afrique du Sud, Pérou, Venezuela, Colombie, Inde, Portugal, Iran... entre 1977 et 1980. Voilà maintenant que la lutte allumée en Pologne commence à se répandre en Hongrie, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, en RDA et en URSS même.
Oui, l'heure est au développement de la lutte ouvrière. Nous assistons déjà à une internalisation dans les faits de la lutte de classe. C'est que la crise capitaliste, en s'approfondissant, n'a pas manqué d'harmoniser le désillusionnement des ouvriers et de déterminer, partout, les mêmes nécessités de lutte, et les mêmes objectifs du combat ouvrier. C'est jusque dans les formes même de cette lutte, qu'on voit une tendance à l'unification. A la situation d'hier dans laquelle les ouvriers croyaient encore pouvoir s'en sortir chacun dans leur coin, donnant pièce aux grandes tromperies bourgeoises sur les spécificités et les particularismes nationaux, depuis les prétendus privilèges du prolétariat des pays d’Occident jusqu'à la voie spéciale de lutte des prolétariats du tiers-monde, commence à faire place un état de fait oû le mouvement ouvrier s'aperçoit comme une dynamique unique, cimentée par une réalité capitaliste identique. C'est cependant du sein même de ces pays que la mystification bourgeoise, à l'Est comme à l'Ouest, présente comme socialistes que la lutte des travailleurs en Pologne vient sans doute apporter la preuve la moins discutable de la profondeur du mouvement ouvrier actuel et du réalisme qui le porte.
Cette progression au réalisme et l'usure des mystifications bourgeoises qu'elle traduit, s'exprime généralement dans la société par une multiplication des explosions sociales de par le monde, de Bristol à Miami, Amsterdam et Zurich. Cela se manifeste encore par la perte de crédibilité des hommes politiques (voir les sondages), par l'abstentionnisme aux élections (voir l'exemple américain récent), la désyndicalisation ou même parce que la presse bourgeoise française nomme l'effet Coluche. Ce qui rend cependant ce contexte d'insoumission vraiment menaçant pour la bourgeoisie, c'est la question ouvrière, car le prolétariat est capable de donner à la révolte sociale une orientation révolutionnaire, anti-étatique.
"Gdansk, Turin, même combat", clamait récemment un ouvrier italien de la Fiat. Cela mieux que tout, traduit l'internationalisation de fait de la lutte ouvrière et l'homogénéisation mondiale de la conscience de classe. Cela annonce le pas prochain du prolétariat : le passage de l'internalisation factuelle à l'internationalisme prolétarien. La classe ouvrière, luttant simultanément aux quatre coins du monde, n'est pas encore au point, cependant, de poser le cadre international de chacune de ses luttes. Mais c'est à travers l'expérience répétée, simultanée de l'impasse de ses multiples combats encore localisés et parcellisés par la gauche dans l'opposition, que sont créées pour elle les conditions d'y parvenir. C'est l'obligation oû la pousse la crise capitaliste de devoir lutter sans rémission pour la satisfaction de ses exigences les plus vitales et, à travers cela, la prise de conscience de l'impossibilité pour la bourgeoisie de les satisfaire, même momentanément qui, faisant nécessairement sortir la classe ouvrière hors de tous les cadres de la conciliation avec le capitalisme : lois, nations, syndicats, pacifisme, qui, lui révélant ses amis et ses ennemis, ce qui aide sa lutte et ce qui l'entrave, qui, l'amenant à surmonter les divisions installées en son sein par la bourgeoisie (comme la division entre travailleurs immigrés et ouvriers du pays) conduiront le prolétariat à la proclamation de son grand mot d'ordre historique du combat révolutionnaire :
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous
Géographique:
- Pologne [17]