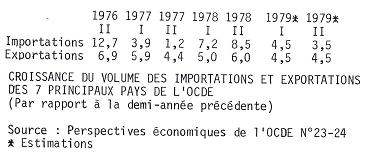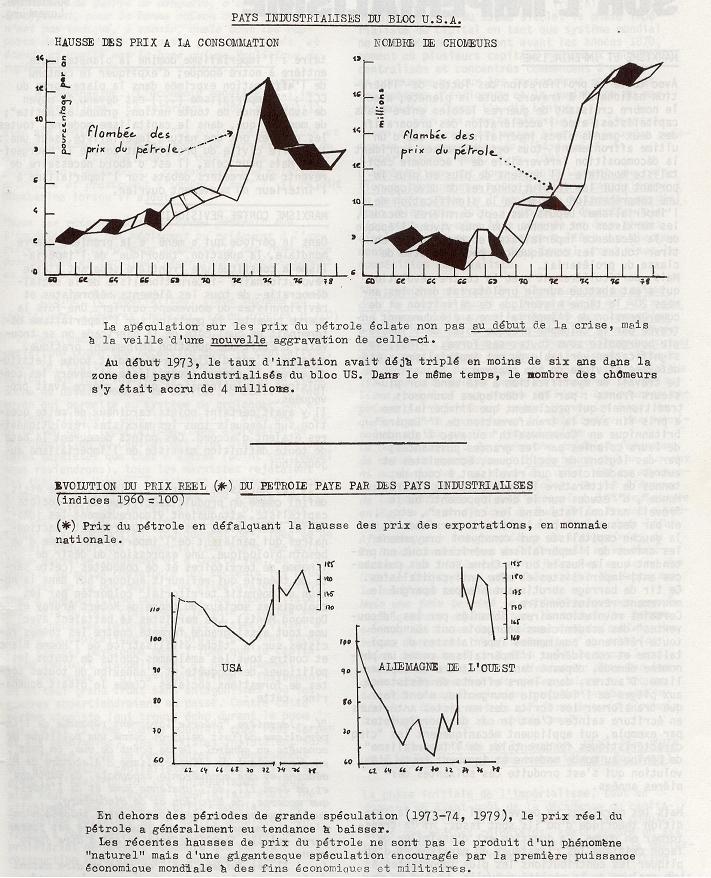Revue Int. 1979 - 16 à 19
- 3674 reads
Revue Internationale no 16 - 1e trimestre 1979
- 3034 reads
Crise, révolte et grèves ouvrières
- 3262 reads
Plus de 10.000 morts en un an ; tous les jours et pendant plusieurs mois, la répétition incessante des manifestations et de la répression; l'ensemble du pays paralysé par la grève quasi-générale des ouvriers du pétrole, mais aussi des hôpitaux et des banques, des transports et de la presse; les universités et les écoles fermées; les avertissements jusqu'aux menaces d'intervention des grandes puissances ; les évacuations des ressortissants étrangers; les tergiversations de l'armée et du Shah, de l'opposition religieuse et du Front National; tels sont les événements qui ont révélé ouvertement la décomposition sociale, la crise politique et la paralysie du système, illustration dans un pays des caractéristiques et des perspectives de la situation actuelle du monde capitaliste dans son ensemble.
La crise mondiale
Au plan économique d'abord, le mythe de l'Iran, longtemps donné comme l'exemple d'une nation en développement, promise par le Shah au 5ème rang mondial pour la fin de ce siècle, s'est écroulé comme un château de cartes.
En 1973, pour la première fois, le déficit extérieur chronique de l'Iran se résorbait et en 1974 les exportations dépassaient les importations de 52%. Ce bond fit croire alors au "décollage" économique, tout comme ce fut le cas pour le Brésil ; enfin, disait-on, un pays du Tiers-Monde montrait la possibilité de sortir du sous-développement. Mais l'illusion s'est rapidement dissipée avec un excédent ramené à 23% dès 1975. En fait, dépendant à 96% du pétrole pour ses ressources d'exportation, l'Iran n'avait fait que bénéficier du quadruplement du prix du pétrole tout à fait conjoncturellement. Ceci ne correspondait pas au profit de la vente d'un produit devenu subitement "rare" sur le marché, comme le battage sur la "pénurie" de pétrole tentait de le faire croire, mais à une hausse des prix, voulue par les Etats-Unis et ses grandes compagnies pour remettre en ordre, à leur profit, le marché sursaturé de l'or noir. Par cette hausse en effet, les Etats-Unis, se trouvant eux-mêmes parmi les principaux producteurs de pétrole, accentuaient la mise sous rationnement de leurs alliés et concurrents, l’Europe et le Japon, en rendant la production américaine plus compétitive sur le marché mondial tout en faisant payer par ceux-ci l'armement des pays pétroliers (avec les Eurodollars fournis à l’OPEP par les achats de pétrole).
La "nouvelle richesse" des pays producteurs de pétrole devait vite céder sous les coups de la compétition acharnée issue de la surproduction mondiale dans tous les domaines et dans celui* du pétrole, amenant l'Iran à réduire ses ambitions de grandeur et à concentrer ses efforts sur les secteurs vitaux de l'économie nationale. Le "décollage" de l'Iran a fait long feu : il n'a pas été un souffle juvénile de santé du capital national mais un sursaut de l'agonie du capitalisme mondial. Il n'est plus question de prospérité désormais ; seul subsiste un endettement croissant pour les achats massifs d'armements ultra-perfectionnés et la fourniture d'usines "clés en mains" que la bourgeoisie n'a jamais pu faire réellement tourner.
Au plan politique ensuite, la bourgeoisie iranienne dont le pouvoir repose tout entier sur l'armée, seule force capable dans un pays sous-développé d'assurer à l'Etat un minimum de cohésion, dispose d'une marge de manoeuvre de plus en plus réduite. La monarchie du Shah tout-puissant ne représente pas un féodalisme retardataire et anachronique, dont la bourgeoisie pourrait se débarrasser pour aller de l'avant, mais bien une forme de capitalisme d'Etat concentré issu de la faiblesse historique et structurelle du capital national. L'évolution de l'Iran, marquée par des tentatives de "modernisation" et la mise à l'écart des secteurs archaïques de l'appareil productif, orientée toute entière par l'économie de guerre sur le pétrole et l'armement, seuls domaines du "développement" et du profit, est une évolution irréversible.
Aucune politique de la bourgeoisie ne peut aujourd'hui remettre en question le rôle prépondérant de l'armée et l'orientation de l'économie nationale sur la seule maigre ressource dont elle dispose dans l'économie mondiale. Dans un tel régime, caractéristique des pays sous-développés, tout est à importer et les "affaires" se traitent avec l'argent fourni par les exportations, avec tout ce que cela suppose de combines, marchandages, détournements de fonds, etc. De la surgissent des oppositions dans la bourgeoisie, mais qui ne peuvent pour autant réellement remettre en question la source des revenus et le fonctionne ment du système. Aucune politique de la bourgeoisie ne peut s'opposer réellement à l'élimination des secteurs non rentables de l'appareil productif sous peine d'accentuer encore la faillite. Pour ces raisons, il n'existe aucune alternative stable réelle et à long terme à la crise qui a mis en mouvement toutes les couches et classes de la population. La bourgeoisie n'est en dernier recours capable de proposer que la mitraille et les massacres répétés des masses paupérisées soulevées ; les oppositions de l'Eglise et Front National ne peuvent jouer que sur la manière d'utiliser l'Etat et l'armée pour mettre en oeuvre le seul véritable intérêt dans la situation : trouver les moyens d'une remise en marche du pays.
L'alternative d'une "Révolution de 1789" en Iran, mise en avant par toute une propagande prompte à fournir ses bons conseils et son appui à la domination bourgeoise secouée par la crise, n'est qu'un mensonge, A l'heure de la crise mondiale du système capitaliste, il n'y a plus de place pour la prospérité et le développement dans le cadre du capitalisme. L'histoire de l'Iran de ces cinquante dernières années est toute entière marquée non par la féodalité à laquelle la bourgeoisie pourrait opposer aujourd'hui une perspective de progrès, mais par la décadence capitaliste, la contre-révolution qui a suivi la vague révolutionnaire des années 1917-23 et le partage du monde issu de la deuxième guerre mondiale. Lorsque le Général des Cosaques Reza Khan, père du Shah actuel, prit le pouvoir en 1921 et se fit proclamer empereur en 1925, l'ère des révolutions bourgeoises était terminée et le régime s'instaurait avec la bénédiction des "alliés" sur les ruines de la guerre généralisée et sur la défaite du prolétariat mondial. Chancelant pendant la deuxième guerre mondiale, parce que penchant vers les puissances de l"Axe", le régime était remis sur pied par les vainqueurs occidentaux après le partage de Yalta entre l’Est et l'Ouest, l'ordre restauré à leur profit par le soutien au Shah contre un Mossadegh au nationalisme pas assez plié à leurs intérêts.
La crise iranienne actuelle s'inscrit toute entière, par ses caractéristiques historiques, économiques et politiques dans la crise mondiale du système capitaliste.
DECOMPOSITION SOCIALE, CRISE POLITIQUE ET LUTTES OUVRIERES
La crise du système provoque, en frappant l'ensemble des moyens de subsistance des couches et classes qui composent la société, une dislocation de sa cohésion et une décomposition sociale. De plus en plus repliée sur l'essentiel de ce qui lui assure le maintien de sa domination, la bourgeoisie est impuissante à fournir des remèdes matériels à la situation. Au contraire, les salaires et le nombre des ouvriers, les subsides et les divers expédients de survie des chômeurs et des sans-travail, les débouchés des étudiants, les profits du petit commerce, les investissements non rentables, sont irrémédiablement laminés par la bourgeoisie. Les contradictions sociales vont alors se révéler ouvertement. D'une part, au sein même de la classe dominante, les pratiques de racket, le bakchich et la corruption de ceux qui ont en mains les rênes gouvernementales, vont provoquer la colère de ceux qui en sont écartés. D'autre part, la misère grandit et la masse des éléments paupérisés grossit, accroissant le mécontentement et poussant de plus en plus à la révolte. Face à un pouvoir d'Etat réduit et identifié à une clique, lorsque toutes ces conditions convergent, le soulèvement de la population surgit d'autant plus vaste et d'autant plus décidé. Car plus les fondements de la domination de classe sont faibles et affaiblis par la crise, plus cette domination est arrogante et crûment imposée.
Comme au Nicaragua contre le dictateur Somoza, en Iran, les récriminations et la colère se sont cristallisées contre le Shah, sa famille, sa police politique. Comme au Nicaragua, à "tout un peuple" regroupé dans les manifestations pour réclamer le départ du tyran, le régime répondait de façon répétée par la répression de l'armée, laissant chaque fois nombre de morts sur le terrain (en septembre à Téhéran, 3000 à 5000 morts en une journée). Mais lorsque les grèves ont surgi, d'abord dans les usines pétrolières puis dans les autres secteurs, la bourgeoisie a dû céder aux revendications de salaires des ouvriers (jusqu'à 50% d'augmentation) pour faire redémarrer sa production. Et pour s'en assurer, l'armée a quadrillé les centres pétroliers, instauré la loi martiale, interdit les rassemblements, arrêté les "meneurs" de la grève. Les grèves ont alors repris contre la répression et l'armée, bloquant à nouveau la production et, en cela, fourni une nouvelle vigueur au mouvement.
Cette fois, au contraire du Nicaragua, l'attaque du symbole de la domination capitaliste était doublée d'une paralysie des bases mêmes de cette domination. La revendication du départ du Shah, au début voeu pieux utilisé pour leurs manoeuvres par les oppositions de l'Eglise et du Front National, auquel le gouvernement pouvait répondre par la seule répression, devenait une question vitale pour la bourgeoisie dès lors que son profit était mis en question par les grèves. Distincte du "peuple", la classe ouvrière se montrait une force capable de résister aux attaques de la bourgeoisie. Au sein des revendications des couches et classes aux motivations aussi disparates et aux intérêts aussi divergents que ceux des bourgeois de plus en plus ruinés des "Bazars" ou excédés par les exactions de la clique du Shah, des sans-travail jetés dans la misère, des étudiants sans débouchés, de la petite bourgeoisie indécise et fluctuante, la classe ouvrière défendait collectivement, sur une base matérielle, ses intérêts, concrétisant en même temps les aspirations des couches paupérisées de la société.
Au contraire de la petite-bourgeoise et des couches intermédiaires qui, dispersées en une multitude d'intérêts particuliers, ne peuvent aller par leur propre mouvement que vers la soumission ou la révolte désespérée, la classe ouvrière, regroupée en corps collectif au coeur de la production capitaliste, peut résister à la misère et aux massacres aujourd'hui et oeuvrer par là à la seule véritable alternative historique, la destruction du capitalisme. C'est cette réalité qui ie déroule en Iran au delà de l'écran de fumée des appels au secours d'Allah et de son prophète Khomeiny ou des tractations du Front National.
"(La classe ouvrière) n'a pas à réaliser d'idéal mais seulement à libérer les éléments de la société nouvelle que porte dans ses flancs la vieille société bourgeoise qui s'effondre". (Troisième Adresse du Conseil Général de l'AIT à la Commune de Paris en I871 Marx).
Avec ce mouvement se sont accentuées les caractéristiques de la crise politique et la rupture du fragile équilibre de l'Etat iranien. Aux premières difficultés, l'Etat a répondu sans ménagement par la répression ouverte. Le Shah recevait l'appui réitéré des Etats-Unis et le président Carter, après le massacre de septembre, tous "droits de l'homme" réduits à leur réalité de vent et de papier, réaffirmait la nature "libérale" du régime. L'URSS respectait une bienveillante neutralité. Le ministre des Affaires Etrangères britannique apportait au Shah un ferme soutien. La Chine, avec le voyage de Hua Kuo Feng, avait aussi donné son appui. Pour tous, la seule possibilité résidait dans le régime du Shah et de son armée. Aucun n'avait quelqu'un d'autre à proposer, une alternative à avancer. L'extension du "chaos" devait pousser la bourgeoisie à préparer des tentatives de relève. Déjà, la France, meilleure auxiliaire de la politique extérieure occidentale, avait récupéré et mis en réserve sous son aile l'opposition religieuse en accueillant comme "réfugié" l'Ayatollah Khomeiny, héraut de l'opposition,"expulsé" d'Irak où il était installé. Le Shah sortait des prisons les éléments du Front National. La valse-hésitation déclenchée par la nécessité de remise en ordre ne pouvait trouver fondamentalement d'autre point d'appui que l'armée, ce qui se traduisit par la remise du gouvernement formellement entre les mains de l'armée, et de la part de l'opposition, par des appels répétés à l'armée à passer à ses côtés. Dans le même temps, la bourgeoisie s'activait à trouver des justifications face à la population et à tenter de se rallier les fractions de la bourgeoisie et la petite-bourgeoise neutres, passives ou opposées à la corruption, en cherchant des "hommes intègres" et"non compromis" avec le régime. L'Ayatollah Khomeiny et le Front National maintenaient la radicalité de façade nécessaire pour éviter les débordements en réclamant toujours plus haut le départ du Shah. Au même moment, c'est le Front National qui fournissait l'homme susceptible de faire une première tentative, Bakhtiar ("l'homme des français") et l'Ayatollah Khomeiny créait une commission du pétrole destinée à demander aux ouvriers la reprise du travail sous couvert de la "consommation populaire".
Cette tâche n'est déjà pas facile lorsque le "peuple" est dans la rue. Et lorsque les ouvriers sont mobilisés et organisés, de tels appels de l'opposition, même la plus crédible et la plus décidée, se retournent contre ses intérêts. Ainsi, les ouvriers acheminèrent effectivement sous leur contrôle le ravitaillement. L'armée dut intervenir pour l'interrompre et l'Ayatollah faire le silence sur cette opération. Le "peuple" n'est bien pour ces fantômes du passé qu'un mot creux pour servir les intérêts nationaux. S'il a un sens pour le prolétariat, il ne peut être que celui de sa force autonome capable de vraie solidarité avec les immenses masses paupérisées. Il ne peut jamais être celui qu'entendent les "humanistes", les "démocrates" et les "populistes" qui, proposant leurs bons offices pour la défense du capital national, volent dans le "peuple" la masse de manoeuvre pour appuyer leurs ambitions.
Cette illustration de la crise politique montre la bourgeoisie en Iran, comme cela le sera de plus en plus partout dans le monde, sans aucune véritable issue à sa crise. Les "hommes politiques" de la bourgeoisie sont aujourd'hui de plus en plus des "hommes de transition", des "techniciens", cachant ou non selon les possibilités et les besoins de la bourgeoisie, les véritables "hommes" de la bourgeoisie, ceux de l'armée, de la police et de tous les corps de répression de l'Etat. En Iran, l'alternative n'est pas Khomeiny ou l'armée, ou Sandjabi ou l'armée : tant que l’Etat capitaliste existe, l'armée sera toujours là, avec un Khomeiny, avec un Sandjabi, comme avec un Shah. Les "relèves" ne peuvent constituer qu'un nouveau masque pour l'armée et ses fonctions d'encadrement car elle est la seule force sur laquelle la bourgeoisie peut asseoir son pouvoir. Et historiquement, les deux seules forces qui sont appelées à s'affronter de façon décisive sont la bourgeoisie et le prolétariat, l'armée et les ouvriers.
Dans l'immédiat, la bourgeoisie, pour faire face à la classe ouvrière, essaie de dissoudre ses intérêts dans l'ensemble de la population pour la démobiliser et perpétuer la dictature du capital. Les fondements des discussions et des manoeuvres politiques de la bourgeoisie, du gouvernement et de l'opposition, et au sein même de l'armée, sont de mater la révolte et/ou de dissocier dans l'esprit de la population et des ouvriers soulevés, le Shah et l'Etat, pour leur jeter, s'il le faut, le Shah en pâture sans rien toucher à l'Etat.
"La révolution jusqu'au départ du Shah", criaient les manifestants de Téhéran. Si le départ du Shah est la condition de l'arrêt de la marche du prolétariat, la bourgeoisie fera tout pour en arriver là, pousser les ouvriers à prendre la proie pour l'ombre, à croire que le but de la lutte est la chute du Shah, la fin de leur mouvement et de leur mobilisation.
Par la bourgeoisie, aucune perspective n'existe aujourd'hui, ni à court, ni à long terme. L'abandon du Shah et un autre gouvernement ne sont que la perpétuation et l'accélération des mêmes conditions de crise, de misère, de guerre et de répression.
Pour le prolétariat, à long terme, par l'extension et la généralisation de son combat au monde entier et fondamentalement dans les grandes concentrations industrialisées du capital, la perspective est celle de la destruction de ce système par la révolution communiste. Le combat de la classe ouvrière en Iran est un moment de ce combat général. Il n'est pas circonscrit à l'Iran, il a ouvert de nouvelles expériences vers des possibilités d'extension et de généralisation, par sa propre organisation et vis-à-vis des masses paupérisées de la société; il a montré, pour le prolétariat du monde entier, dans un pays situé sur la ligne des affrontements inter impérialistes, qu'il pouvait enrayer les attaques de la bourgeoisie.
Pour la classe ouvrière en Iran, le danger est à court terme de laisser diluer ses intérêts dans ceux de toute la population si elle accepte une union contre-nature du capital et du travail avec une quelconque fraction de la bourgeoisie, le danger d'une exploitation et d'une répression renforcées. Sa force réside dans sa capacité à rester mobilisée sur son terrain de classe.
M.Gr
Géographique:
- Moyen Orient [1]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [2]
2eme conférence internationale des groupes de la GAUCHE COMMUNISTE
- 3362 reads
Dans la première quinzaine de Novembre s'est réunie à Paris la deuxième Conférence des groupes communistes en continuation de la première qui a eu lieu sur l'initiative de Parti Communiste Internationaliste (Battaglia Communista) en Mai 1977 à Milan. Il n'est pas dans notre Intention de donner, dans le cadre de cet article, un compte-rendu détaillé des débats. Celui-ci fera l'objet d'une brochure spéciale qui paraîtra prochainement en anglais, français, et italien afin de permettre à tous les militants révolutionnaires de suivre l'effort de clarification au travers de la confrontation des groupes qui ont participé à cette conférence. Plus modestement, nous nous proposons dans cet article, de dégager â grands traits, la signification importante à nos yeux de la tenue d'une telle conférence, tout particulièrement dans la situation actuelle et répondre en même temps à l'attitude très négative que certains groupes ont jugé bon d'adopter à rencontre de cette conférence.
Tout d'abord nous devons souligner que cette deuxième conférence a été mieux préparée, mieux organisée que la première, et cela aussi bien du point de vue politique quforgan1sat1one1. Ainsi 1'Invitation a été faite sur la base de critères politiques précis. L'Invitation s'adressait à tous les groupes qui :
1) Se réclament et défendent les principes fondamentaux qui ont présidé à la Révolution prolétarienne d'Octobre 1917 et à la constitution de la Troisième Internationale de 1919 et qui a partir de ces principes entendent soumettre à la critique constructive les positions politiques et la pratique élaborée et énoncée par l'IC à la lumière de l'expérience.
2) Rejettent sans la moindre réserve toute prétendue existence dans le monde de pays à régime socialiste ou de gouvernement ouvrier, même avec le qualificatif de "dégénéré". Rejettent toute distinction de classe à établir entre les pays du bloc de l'Est ou de la Chine avec les pays du bloc de l'Ouest et dénoncent comme contre-révolutionnaire tout appel à la défense de ces pays.
3) Dénoncent les P.S. et les P.C. et leurs acolytes comme des partis du capital.
4) Rejettent catégoriquement l'idéologie de l’ « antifascisme », établissant une frontière de classe entre le fascisme et la démocratie en appelant les ouvriers à défendre ou à soutenir la démocratie contre le fascisme.
5) Proclament la nécessité pour les communistes d'oeuvrer pour la reconstruction du Parti, arme indispensable pour la victoire de la Révolution Prolétarienne.
Un simple énoncé de ces critères fait comprendre à tout ouvrier qu'il ne s'agit pas d'un ramassis de toutes les "bonnes volontés" mais de groupes authentiquement communistes se démarquant nettement de toute la faune gauchiste : maoïstes, trotskystes, modernistes, et autres conseil listes bêlants "anti-parti".
Ces critères, certes insuffisants pour établir une plate-forme politique pour un regroupement sont par contre parfaitement suffisants pour savoir avec qui on discute et dans quel cadre, afin que la discussion soit réellement fructueuse et constitue un point positif.
D'autre part et en amélioration de la première conférence, l'ordre du jour des débats a été établi, longtemps avant la conférence elle-même, permettant ainsi aux groupes de présenter leurs points de vue dans des textes écrits â l'avance, rendant plus clairs les débats à la Conférence. L'ordre du jour était le suivant :
- 1) L'évolution de la crise et les perspectives qu'elle ouvre pour la lutte de la classe ouvrière.
- 2) La position des communistes face aux mouvements dits de "libération nationale".
- 3) Les tâches des révolutionnaires dans la période présente.
Un tel ordre du jour démontre que la conférence n'avait rien de commun avec ces colloques académiques de singes savants, de sociologues et économistes se gargarisant de "théorie" dans l'abstrait. C'est une préoccupation militante qui présidait à la conférence, cherchant à dégager une plus grande compréhension de la situation mondiale actuelle, de la crise dans laquelle est plongé le capitalisme mondial et ses perspectives du point de vue de classe du prolétariat, ainsi que les tâches qui en découlent pour les groupes révolutionnaires au sein de la classe.
C'est dans le cadre de ces critères et dans un souci militant qu'ont été invités une douzaine de groupes de divers pays. La plupart ont répondu favorablement à cette initiative, même si certains n'ont pu à la dernière minute et pour des raisons diverses y assister. Ce fut le cas d'"Arbetarmakt" de Suède, d'HORCIAM de France et "Il Leninista" d'Italie. On doit cependant noter que quatre groupes ont refusé toute participation. Ce sont le Spartacusbond" de Hollande, le P.I.C. de France et les deux « partis » communiste international (PCI " Pogramme" et PCI "Il Partito Communista") d'Italie.
Il n'est pas sans Intérêt d'examiner de plus près les arguments avancés par chacun de ces groupes et les vraies motivations qui ont décidé leur refus. Pour le "Spartacusbond" de Hollande, la chose est simple : le groupe Spartacus est contre toute idée de Parti. Le seul mot de Parti lui fait hérisser les cheveux. C'est en vain que ce groupe, né le lendemain de la deuxième guerre, prétend se réclamer de la tradition et comme continuité de la gauche communiste hollandaise et allemande dont il est une pâle caricature. C'est tout au plus de l'Otto Rhule assaisonné de Sneevliet qu'il pourrait se réclamer, mais certainement pas de Gorter et de Pannekoek qui eux n'ont jamais nié le principe de la nécessité d'un Parti communiste. Spartacus s'avère être la fin sénile du Courant Communiste Conseilliste devenu une petite secte, repliée sur elle-même, isolée et s'isolant chaque jour plus du mouvement ouvrier international. Son refus ne fait que montrer l'épuisement définitif du courant conseilliste pur, se confondant et s'Intégrant chaque jour plus avec le marais gauchiste. C'est une triste fin d'une évolution Irréversible produit d'une trop longue période de contre-révolution.
De différente façon se présente l'attitude du P.I.C. Après avoir donné son accord de principe pour la première conférence de Milan, il revient sur sa décision à la veille de celle-ci, estimant que dans les circonstances présentes, cela serait un "dialogue de sourds". Pour la deuxième conférence, il fonde ainsi son refus de principe : refus de participer à des conférences "Bordigo-Léninistes". Là aussi, nous assistons à une évolution précise. Quand, il y a quelques cinq ou six ans, les quelques camarades qui ont quitté Révolution Internationale pour constituer le groupe "Pour une Intervention Communiste" fondaient leur séparation sur le reproche d'une Intervention insuffisante de la part de R.I. En mettant de côté l'activisme verbal du P.I.C qui l'a conduit à toutes sortes de "conférences" et de "campagnes" (sic!) plus artificielles les unes que les autres, il reste évident aujourd'hui ce que nous avons toujours affirmé : que le vrai débat n'était pas "intervention ou non Intervention" mais bien "de quel type d'intervention, sur quel terrain, et à côte de qui". Ainsi le P.I.C. qui se livre de temps à autre à des "conférences" avec toutes sortes de groupes et d'éléments anarchisants ou des groupes "autonomes" plus que fantomatiques et qui se terminent à chaque fois en queue de poisson, est vraiment bien placé pour parler de "dialogue de sourds" quand il s'agit de discussions entre des groupes vraiment communistes. Ceci n'est pas tout. Revenu de ses tentatives malheureuses de constituer un courant anti-CCI avec "Revolutionary Perspectives", "Workers Voice", et le "RWG" (ces deux derniers disparus depuis dans la nature sans laisser de traces), le P.I.C., quelque peu refroidi pour ce qui concerne les groupes de la gauche communiste, s'est rabattu sur les éléments de la gauche socialiste et participait au groupe initiateur qui a relancé la vieille revue socialiste de gauche "Spartacus", sous la haute direction de son fondateur René Lefeuvre. Dans cette revue, où s'étalent à longueur de pages la glorification de l'armée républicaine de la guerre d'Espagne de 36-39, les hauts faits de "l'anti-fascisme" promoteur actif de la deuxième boucherie mondiale, les hommages chaleureux de Marceau Pivert, du PSOP (le PSU d'avant-guerre), du POUM, les louanges et souvenirs attendrissants de l'action héroïque trotskyste dans la Résistance durant la guerre, le PIC se trouve à son aise et fait partie de la rédaction. Ses narines délicates qui ne sauraient supporter l'odeur horrible des "Bordigo-Léninistes" se dilatent voluptueusement à l'encens parfumé du Socialisme de gauche et de 1'anti-autoritarisme. Dans cette basse-cour de la Social Démocratie ([1] [3]) on PICore tout à son aise et on peut même s'offrir de temps à autre le plaisir de faire des critiques "radicales" et de jouer "l'enfant terrible" ultra-révolutionnaire. Il est vrai que "Spartacus" est une revue très ouverte, très large. Mais le fait d'être large est loin d'être toujours une qualité ! Ce qui fait l'unité, le ciment de l'équipe de "Spartacus", c'est l’antibolchevisme tripal qu'il confond volontairement et sournoisement avec le stalinisme. Les socialistes de "gauche" n'ont jamais attendu le stalinisme pour dénigrer les bolcheviks, les Lénine et combattre au nom "du socialisme démocratique" la révolution d'Octobre et le communisme. Au nom de l’antibolchevisme, les socialistes de gauche ont toujours été la queue misérable de la Social -Démocratie, des Scheidemann-Noske, des Turati et des Blum. Cela ne gêne pas le PIC de marcher et de collaborer avec eux. Ce n'est pas dans l'arsenal et la continuité de la Gauche Communiste que le PIC va chercher sa critique contre telle ou telle position des bolcheviks et de Lénine, mais dans les poubelles des consulats tsaristes et de Kerenski ou encore en PICorant sur le fumier de la gauche socialiste. Dans sa fougue antibolchevik, le PIC oublie que, quelles que puissent être nos divergences avec les bolcheviks, elles ne peuvent changer notre jugement sur la social-démocratie, qu'elle soit de droite ou de gauche, car ce qui sépare les communistes de la social-démocratie est ce fossé infranchissable : l'appartenance à deux classes mortellement ennemies : les communistes appartenant au prolétariat, la social-démocratie à la bourgeoisie. Ne serait-ce que cette leçon, nous la devons entièrement à Lénine et au parti bolchevik. Ce n'est donc pas par hasard, mais pour avoir oublié cette leçon, que le PIC peut, des creux des colonnes de Spartacus où il a fait sa niche douillette, refuser de se déranger pour discuter avec les "bordigo-léninistes". On peut se demander si c'est son "anti-léninisme" viscéral qui fait s'approcher le PIC de la gauche socialiste ou, au contraire, si c'est son rapprochement du socialisme de gauche et du gauchisme qui le rend si farouchement antibolchevik ? Ou encore les deux à la fois ? Une chose reste certaine : c'est que le PIC se trouve sur un point situé quelque part entre les socialistes de gauche et Lénine, c'est-à-dire violemment antibolchévik (radicalisme en paroles) en collaboration avec les socialistes de gauche (opportunisme dans la pratique).
Pas le moins cocasse de cette histoire est l'article de critique publié par la "Jeune Taupe" à l'égard du groupe "Combat Communiste". Dans cet article, le PIC "gronde" "Combat Communiste" de leur non-rupture totale avec les trotskystes et leur rappellent à cette occasion (une fois n'est pas péché mortel) : "Comme le disait Lénine à Zimmerwald par rapport aux sociaux-démocrates, c'est-à-dire (que ces derniers) étaient hors du camp du prolétariat et donc dans celui de la bourgeoisie. Si on est tant soit peu conséquent, on ne peut pas les considérer comme des camarades dans l'erreur et à plus forte raison militer a leurs côtés". ([2] [4]) (souligné par nous). Le PIC n'est donc pas complètement amnésique -même s’il est un peu faible de la tête. Quand il s'agit d'admonester "Combat Communiste", il se rappelle bien que : "pour lui (Lénine) les sociaux-démocrates étalient des ennemis de classe avec lesquels il appelait à rompre. Ainsi la Troisième Internationale se constituera en opposition aux tentatives de reconstitution de la deuxième Internationale-.." ([3] [5]). Excellente mémoire ! Mais à croire que le PIC ne se regarde jamais dans la glace. A moins, à moins que ... ce qu'il considère comme indispensable : la rupture avec le trotskisme, devienne moins évidente lorsqu'il s'agit de collaborer avec la gauche socialiste. Nous serons encore d'accord avec la conclusion de l'article cité : "Les années qui viennent et qui devraient voir le prolétariat ressurgir sur la scène de l'histoire comme sujet de son propre devenir ne toléreront pas la moindre confusion théorique. Ce qui est aujourd'hui inconsistance et fantaisie deviendra demain danger mortel et théorie contre-révolutionnaire. C'est maintenant qu'il faut se prononcer clairement, qu'il faut choisir son camp." ([4] [6]). Exactement ! C'est tout à fait exact ! Faut-il conclure que le PIC, en refusant de venir à la Conférence de crainte d'être contaminé par les "Bordigo-Léninistes" et en restant tranquillement dans les rangs de Spartacus, a déjà choisi son camp ? Le proche avenir nous le dira.
Pour ce qui concerne les deux PCI bordiguistes, ils n'ont pas daigné faire savoir directement leur refus mais se sont contentés de publier chacun un article dans leur presse, plus dénigrant et persiflant l'un que l'autre. Quand on se dit Parti Communiste International, on garde son rang et on ne se rabaisse pas à répondre â d'autres qui ne sont que de simples groupes On a sa dignité a sauvegarder que diable, même si on n'est en réalité qu'un petit groupe, lui-même divisé et subdivisé en quelques trois [ou quatre partis communiste! Internationaux, qui s'ignorent entre eux !
Provenant, après la mort de Bordiga, d'une scission obscure avec l'organisation de Programma, le groupe de Florence, dans la stricte tradition du bordiguisme où il ne saurait exister dans tout l'univers qu'un seul Parti, s'est tout simplement auto-proclamé "Parti Communiste International". Ce grand "Parti International" de Florence est donc tout indiqué pour vilipender les "misères des faiseurs de Parti". ([5] [7]). Comment rassurer ces gens ombrageux que personne dans la Conférence n'en voulait à ce qu'ils considèrent être leur bien exclusif. Personne dans la Conférence ne posait le problème d'une constitution immédiate du Parti, même pas celui de la constitution d'une organisation unifiée et cela pour la simple raison que tous les groupes étaient parfaitement conscients de l'immaturité d'un tel projet. Ce n'est rien comprendre au problème du Parti de classe, que de penser qu'il se décrète par la simple volonté de quelques militants et dans n'importe quelles conditions. Cette conception volontariste et idéaliste du Parti qui se décrête n'importe quand, indépendamment de l'état et du développement de la lutte de classe n'a rien â faire avec la réalité qui fait que le Parti est un organisme vivant de la classe qui ne surgit et se développe que quand les conditions sont données pour qu'il puisse assumer effectivement les tâches qui sont les siennes. Les jongleries bordiguistes sur le Parti formel et le Parti historique ne servent qu'à couvrir leur ignorance totale de la différence entre les fractions ou groupes et le Parti, et par là même leur incompréhension de la formation effective du Parti.
La conception qu'on a de la nature et la fonction du Parti est une question qui a soulevé le plus de débats passionnés dans l'histoire du mouvement marxiste. Il suffit de rappeler les divergences qui opposèrent Rosa Luxembourg et Lénine, le Parti bolchevik et la Gauche Allemande, la fraction de Bordiga à l'Internationale Communiste, et la fraction Italienne de Bilan au PCI reconstitué a la fin de la deuxième guerre. Elle reste encore aujourd'hui un sujet de discussions et de précisions au sein du mouvement des Communistes de Gauche. Libre à des groupes dans une ville provinciale quelconque, de se proclamer un beau jour "Parti unique et mondial", aucune loi ne peut les empêcher de le faire. Mais de là qu'il le soit réellement, et d'y croire, relève d'une douce mégalomanie. Mais pour le courant bordiguiste, il ne saurait être question de mettre en discussion leur conception du Parti unique et monolithique, qui prend le pouvoir et exerce sa dictature au nom du prolétariat, même à l'encontre de la volonté de la classe. Car, menace "Il Partito" : "Qui s'oppose à cette conception ou n'accepte pas cette discipline programmatique et organisationnelle se trouve en dehors du camp de la Gauche". Inutile de dire que cette conception est très loin d'être celle de Marx et Engels qui ne s'amusaient pas à se proclamer a tout bout de champ le "Parti", ni a celle d'une Rosa Luxembourg, ni même celle de Lénine, ni celle de Bilan, ni celle de la Gauche Italienne en général; elle appartient, mais strictement, en propre au bordiguisme. Et que cela soit dit sans crainte d'être excommuniés, elle n'est pas non plus la nôtre.
On comprend que les bordiguistes évitent toute discussion avec d'autres groupes communistes et la confrontation de leurs positions avec eux. Ils ne discutent pas déjà entre eux (centralisme organique oblige). Car aucune secte ne saurait mettre en question les dogmes de sa bible invariante. Leur seule dispute est pour savoir qui d'entre leurs nombreux partis sera l'unique, reconnu universellement comme tel. Ces disputes ressemblent étrangement a celles de cette maison d'aliénés où chacun se prend pour le vrai, l'Unique Napoléon !
Le dernier rejeton de 1'avant-dernière scission des bordiguistes : le Parti florentin, n'est pas le moins farouche. Offensé qu'on ait osé 1'inviter à la Conférence, il jette comme une foudre son avertissement : "Les missionnaires de l'unification, groupes politiques de diverses traditions tendent "nolens-vo1ens" à constituer une organisation politique objectivement contre la Gauche et la Révolution". Passons sur les "missionnaires", qui se veut être blessant, et répétons une fois de plus que jamais la Conférence ne posait comme objectif la discussion sur l'unification. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut entendre. L'heure n'a pas encore sonné pour l'unification dans un seul Parti des différents groupes communistes qui existent aujourd'hui. Mais l'heure, pensons-nous, a largement sonné pour que les groupes communistes sortent de leur isolement hivernal qui n'a que trop longtemps duré. Pendant cette période qui a duré cinq décennies, la contre-révolution a eu raison non seulement de la classe, mais inévitablement aussi du mouvement communiste international qui a été réduit à sa plus simple expression. Peu de groupes de la Gauche Communiste ont résisté et survécu à cette avalanche. Et ceux qui ont réussi à survivre ont été profondément marqués par ce repli général qui a développé chez eux un réflexe d'isolement, un renfermement sur eux-mêmes et un esprit de secte.
Un autre réflexe était la fuite en avant, faire bonne figure contre mauvais sort et qui se traduisait dans cette construction artificielle des Partis, dont les trotskystes se sont rendus maîtres avant la seconde guerre, et que les bordiguistes ont repris après ceux-ci, en dépassant les premiers et, à leur habitude, en le poussant à l'absurde. Dans ces conditions, la constitution du Parti bordiguiste devenait une marche à contre sens de la réalité et ne pouvait qu'accuser échec sur échec. Autant le développement de la lutte de classe est un puissant facteur d'un processus d'homogénéisation dans la classe, et donc aussi celui de l'organisation des communistes. Le Parti autant une période de réaction et de contre-révolution est un facteur d'un processus d’atomisation dans la classe et de dispersion de l'organisation des communistes . Le Parti bordiguiste ne pouvait échapper à cette loi, d'où un processus de scissions incessantes dans ses rangs.
On sait que Bordiga était plus réservé quant à l'opportunité de la constitution immédiate du Parti. Il en était de même de Vercesi, qui deux ans après, mettait cette constitution carrément en question, en accord avec la critique que lui-même a développée dix ans avant dans Bilan, à l’encontre de la démarche de Trotsky. Mais au moins chez Trotsky, la constitution du Parti est une conclusion correcte, fondée sur une analyse erronée de la situation. Trotsky voyait dans la France du Front Populaire et dans la guerre civile en Espagne le "début d'une montée révolutionnaire", ce qui impliquait la nécessité de la constitution Immédiate du Parti. Le Parti bordiguiste ne peut même pas invoquer une fausse analyse. C'est pourquoi, il a développé une théorie aberrante qui fait que la constitution du Parti est complètement détachée de tout lien avec la situation réelle de la lutte du prolétariat. Même chez Bordiga, dans sa conception pyramidale du Parti, ce dernier tout en haut de la pyramide repose néanmoins sur la base de la classe dont il est le produit direct. Par contre dans la dialectique des bordiguistes d'aujourd' hui, le Parti reste suspendu, comme dans une lévitation, en l'air, complètement détaché du mouvement réel de la classe; il peut se constituer même si la classe subit les pires conditions de la défaite et de la démoralisation, il lui suffit pour cela de sa connaissance théorique et de sa volonté. Tournant ainsi le dos à toute l'histoire du mouvement ouvrier, faisant fi de ses enseignements et chaque petit groupe bordiguiste se proclamant pour son propre compte le Parti Mondial Unique Reconstitué; il n'est pas étonnant qu'ils ne comprennent absolument pas ce que signifie une période de remontée de la lutte de classe et le processus qu'elle implique nécessairement, de la tendance au regroupement des révolutionnaires. Ainsi les bordiguistes continuent à marcher à contre-sens. Hier, ils levaient le pied quand les marches descendaient, aujourd'hui ils le baissent quand elles sont ascendantes. Il y a une vingtaine d'années, ils lançaient dans le désert des appels au regroupement des révolutionnaires. Aujourd'hui quand de telles possibilités apparaissent, ils ne cessent de les dénigrer et de s'enfermer, eux et leur "dignité" dans leur cocon et dans l'isolement. Toute idée de discussion entre révolutionnaires est pour eux pur blasphème sans parler déjà de regroupement qui leur paraît ne pouvoir jamais être autre chose que "constituer une organisation politique objectivement contre la gauche et la révolution". Faut-il penser qu' ils ignorent à ce point l'histoire, réelle et non critique du mouvement révolutionnaire? La constitution de la Ligue des Communistes, de la première, de la deuxième et de la troisième Internationale, de tous les partis ouvriers, ne se sont-elles pas faites au travers de rencontres, de discussions, entre des groupes éparpillés dans un mouvement de convergence vers une unité politique et organisationnelle? N'était-ce pas le processus préconisé par 1'ancienne Iskra de Lénine de sortir de l'éparpillement de Cercles afin de donner naissance au Parti Russe ? La constitution (tardive) du PC d'Italie à Livourne a-t-elle suivi une autre vole ? Et la reconstruction précipitée du PCI à la fin de la seconde guerre n'était-elle pas elle aussi l'oeuvre de rencontres de plusieurs groupes ?
Le PCI de Florence termine son article en se plaignant : "il est pénible de devoir assister périodiquement à ces misères". Au fond il a raison; il est largement servi par sa propre misère pour que cela lui suffise.
Peu différent -quant au fond de l'argumentation - est l'article, réponse du deuxième PCI, celui de Programma. Ce qui le distingue essentiellement est sa grossièreté. Le titre de l'article "La Lutte entre Fottenti et Fottuti " (littéralement entre "enculeurs et encules") montre déjà la "hauteur" où se place le PCI Programma hauteur vraiment peu accessible à d'autres. Faut-il croire que Programma est à tel point imprégné de moeurs staliniennes qu'il ne peut concevoir la confrontation de positions entre révolutionnaires que dans les termes de "violeurs" et "violés" ? Pour Programma aucune discussion n'est possible entre des groupes qui se réclament et se situent sur le terrain du communisme, surtout pas entre ces groupes. On peut à la rigueur, marcher avec les trotskystes et autres maoïstes dans un Comité -fantôme- de soldats, ou encore signer avec les mêmes et autres gauchistes des tracts communs pour "la défense des ouvriers immigrés", mais jamais envisager la discussion avec d'autres groupes communistes, même pas entre les nombreux partis bordiguistes. Ici, ne peut régner qu'un rapport de forces, si on ne peut les détruire, alors ignorer jusqu'à leur existence ! Viol ou impuissance, telle est l'unique alternative dans laquelle Programma voudrait enfermer le mouvement communiste et les rapports entre les groupes. N'ayant pas d'autre vision, il la voit partout , et l'attribue volontiers aux autres. Une Conférence internationale des groupes communistes ne peut, à ses yeux, être autre chose, et avoir un autre objectif que celui de débaucher quelques éléments d'un autre groupe. Et si Programma n'est pas venu, ce n'est certes pas par manque de désir de "violer" mais parce qu'il craignait d'être impuissant. En vain Programma débite-t-il un chapelet de sarcasmes contre les critères qui servaient de cadre pour les Invitations des groupes. Aurait-il préféré l'absence de tout critère ? Ou aurait-il voulu d'autres critères, et lesquels s’il vous plaît ? Les critères qui ont été établis visaient à délimiter un cadre permettant une discussion des groupes qui se réclament de la Gauche communiste, éliminant les tendances anarchisantes, trotskystes, maoïstes et autres gauchistes. Ces critères constituent un tout organique, et on ne peut pas les séparer les uns des autres comme se plait à le faire Programma. Ils ne prétendent pas être une plateforme pour une unification, mais plus modestement, un cadre, pour savoir avec qui, et dans quelle orientation on mène la discussion. Mais pour Programma, on ne peut discuter qu'avec soi-même. Par crainte d'être impuissant dans une confrontation des positions avec d'autres groupes communistes, Programa se réfugie dans le "plaisir solitaire". C'est la virilité d'une secte et l'unique moyen de sa satisfaction.
De sa grosse voix, Programma fait de sévères remontrances contre ceux qui mettent en question "le mode par lequel le parti bolchevik... a posé le rapport entre parti communiste et classe ouvrière". Quoiqu'en pense Programma, ce "mode" n'est pas un tabou intouchable et peut être discuté, comme il l'a toujours été dans le mouvement communiste, et ce "mode" n'a certainement rien gagné par la caricature outrée qu'en ont fait les bordiguistes. Et quand Programma s'écrie : "Oui, l'Internationale a rompu avec la social-démocratie, mais elle a rompu auparavant avec toutes les versions infantiles, spontanéistes, anti-parti, illuministes, et du point de vue idéologique, bourgeoises" elle arrange l'histoire à sa convenance. Les groupes invités au premier Congrès et qui vont fonder la Troisième Internationale sont infiniment plus hétéroclites que Programma ne prétend. Nous trouvons dans ce Congrès depuis les anarcho-syndicalistes jusqu'aux Gauches socialistes à peine dégrossies. Les seuls point précis dans ce manque de cohésion et confusion sont : 1) la rupture avec la social-démocratie et 2) le soutien à la révolution d'Octobre. Ce n’est qu'après que commencent les ruptures, et il est vrai qu'elles sont essentiellement dirigées contre la Gauche (même pas toujours cohérente} alors qu'on ouvre toute grande la porte aux opportunistes et autres gauches socio-démocrates. Depuis quand les bordiguistes se sont-ils mis à exalter et à applaudir à cette orientation dé dégénérescence opportuniste de l'Internationale Communiste ? Les thèses du second Congrès sur le parlementarisme révolutionnaire, sur la conquête des syndicats, sur la question nationale et coloniale, la politique de conférences avec la seconde et l'Internationale 2 1/2 sont autant de pas marquants de cette involution de l'Internationale Communiste. Voilà l'orientation que les bordiguistes glorifient aujourd'hui depuis qu'ils se sont proclamés le nouveau Parti Communiste International. N'est-ce pas cela "se moquer véritablement de ses propres adhérents "comme le dit si bien l'article de Programa ?
Programma nous fait violemment grief d'être "des anti-parti". Pure invention bordiguiste qui contient autant de vérités que cette autre affirmation (du PIC par exemple) qui nous traite de "bordigo-léninistes". Aucun des groupes présents à la Conférence ne mettait en question la nécessité du Parti. Ce qui est en question est : quel type de Parti , quelle est sa fonction et quels sont et doivent être les rapports entre le Parti et la classe. Il n'est absolument pas vrai que le premier congrès de l'IC ni les 21 conditions aient donné une réponse complète et définitive à ces questions. L'histoire de l'IC, l'expérience de la révolution russe et leur dégénérescence posent aujourd'hui, avec la remontée des luttes du prolétariat, devant les révolutionnaires la tâche impérieuse de répondre d'une façon plus précise à ces questions. La conception bordiguiste d'un Parti infaillible, omni conscient et tout puissant nous semble relever bien plus d'une vision religieuse que du marxisme. Chez les bordiguistes, à l'instar de la religion monothéiste des hébreux, tous les rapports se trouvent inversés. Tout marche sur la tête. Dieu (le Parti) n'est pas un produit de la conscience humaine, mais c'est Jéhovah (le Parti) qui choisit son peuple (sa classe). Le Parti n'est plus une manifestation d'un mouvement historique de la classe, mais c'est le Parti gqi fait que la classe existe. Ce n'est pas Dieu à l'image de l'homme mais c'est l'homme qui est à l'image de Dieu. On comprend alors que dans la Bible (Proqramma) un tel Dieu unique (Parti) ne parle pas à son peuple, mais "ordonne, exige et commande" à tout moment. C'est un dieu jaloux de ses prérogatives. Il peut s'il le veut, accorder tout à son peuple, le paradis et l'Immortalité, mais il n'admettra jamais que l'homme puisse manger les fruits de l'arbre de la connaissance. La conscience, toute la conscience est le monopole exclusif du Parti. C'est pour cela que ce dieu (Parti) exige la pleine confiance , l'absolue reconnaissance, la totale soumission à sa toute puissance, et pour le moindre doute ou mise en question, il deviendra le dieu sévère de la rancune, de la punition et de la vengeance ("jusqu'à la dixième génération") d'un Cronstadt que les bordiguistes revendiquent pour hier et pour demain. Ce dieu terrifiant -de la terreur rouge- voilà le modèle du Parti bordiguiste et c'est ce type de Parti que nous rejetons.
Le bordiguisme n'a pas construit le parti international. C'est une mythologie qu'il a inventée : le mythe –parti. Son Parti réel n'a pas grande consistance, mais le mythe -parti- est d'autant plus consistant. Ce qui avant tout caractérise ce parti-mythe, c'est son plus profond mépris de la classe à qui on dénie toute conscience et toute capacité de prise de conscience. Et cette conception mythologique du Parti, du Parti-épouvantai1 est devenue aujourd'hui une entrave réelle à l'effort nécessaire pour la construction du Parti communiste mondial de demain. C'est sincèrement, sans aucun esprit de polémique que nous pensons et disons, que les groupes bordiguistes se trouvent aujourd'hui à la croisée des chemins : ou ils s'engagent honnêtement, sans esprit de "fottenti et fottuti" sans ostracisme, dans la vole de confrontation et de discussion dans le mouvement communiste révolutionnaire renaissant, ou ils se condamnent à l'isolement et à se convertir sans retour en une petite secte sclérosée et impuissante.
La Conférence devait encore connaître un de ces coups de théâtre du fait du comportement étrange du groupe "FOR". Celui-ci, après avoir donné sa pleine adhésion à la première conférence de Milan, et son accord pour la réunion de la seconde, en contribuant par des textes de discussions, s'est rétracté à l'ouverture de celle-ci sous prétexte de ne pas être d'accord avec le premier point à l'ordre du jour, à savoir sur l'évolution de la crise et ses perspectives. Le "FOR" développe la thèse que le capitalisme n'est pas en crise économiquement. La crise actuelle n'est qu'une crise conjoncturelle, comme le capitalisme a connu et surmonté tout au long de son histoire. Elle n'ouvre de ce fait aucune perspective nouvelle, surtout pas une reprise de luttes du prolétariat, mais plutôt le contraire. Par contre, le "FOR" professe une thèse de "crise de la civilisation" totalement indépendante de la situation économique. On retrouve dans cette thèse les relents du modernisme, héritage du situationnisme. Nous n'ouvrirons pas ici un débat pour démontrer que pour des marxistes il paraît absurde de parler de décadence et d'effondrement d'une société historique, en se basant uniquement sur des manifestations super structurelles et culturelles sans se référer à sa structure économique, en affirmant même, que cette structure -fondamentale de toute société- ne connaît que son renforcement et son plus grand épanouissement. C'est là une démarche qui se rapproche plus des divagations d'un Marcuse qu'à la pensée de Marx. Aussi le "FOR" fonde-t-il l'activité révolutionnaire moins sur un déterminisme économique objectif que sur un volontarisme subjectif, qui est l'apanage de tous les groupes contestataires. Mais devons-nous nous demander : ces aberrations sont-elles la raison fondamentale qui a dicté le "FOR" à se retirer de la Conférence ? Non certainement pas. Dans son refus de participer à la Conférence, et en se retirant de ce débat, se manifestait avant tout l'esprit de chapelle, de chacun chez soi, esprit qui imprègne encore si fortement les groupes se réclamant du communisme de Gauche, et qui ne sera surmonté qu'avec le développement de la lutte de classe du prolétariat et par la prise de conscience des groupes révolutionnaires.
Rompre avec cet esprit d'isolement et de repli sur soi, héritage de cinquante années de contre-révolution, montrer la nécessité et la possibilité d'établir des contacts et des discussions entre les groupes révolutionnaires, était ce qu'il y avait de plus positif dans les travaux de la Conférence. Si à Milan, nous n'étions que deux groupes, dans cette deuxième Conférence à Paris, ce sont cinq groupes de plusieurs pays qui ont participé au débat, et cela constitue à nos yeux un pas très important et qu'il faudrait poursuivre. Il n'est pas sorti de la Conférence une hypothétique unification, ni un Parti éphémère, parce que la Conférence ne le posait pas comme un objectif immédiat. La Conférence n'a même pas donné lieu à des résolutions communes. Elle a pu constater l'existence de nombreuses divergences réelles, et encore plus nombreuses des incompréhensions, des malentendus qui existent dans le milieu révolutionnaire. En aucune sorte, cela ne doit nous décourager car nous n'avons jamais semé les illusions sur une unité de vue et de position qui seraient déjà existantes. Cette unité de vue elle-même, ne saurait tomber du ciel. Elle ne peut être le fruit que d'une longue période de discussions, de confrontations entre les groupes révolutionnaires dans un cours de montée de la lutte du prolétariat. Elle dépend donc également de la capacité et de la volonté des groupes de rompre avec l'esprit de secte, de savoir s'engager et persévérer dans le difficile chemin et dans l'effort vers le regroupement des révolutionnaires.
Les débats de la Conférence -qu'on lira dans la prochaine publication des procès-verbaux- a montré bien des insuffisances, des lacunes et des confusions, aussi bien dans les analyses que dans la perspective. Mais elle a démontré aussi, que les rencontres et la discussion peuvent déboucher vers des résultats positifs même si très limités. Elle a démontré ce qu'Engels ne cessait de répéter, que c'est de la discussion que Marx et lui, attendaient le développement ultérieur du mouvement ouvrier.
La Conférence a dégagé une volonté unanime de poursuivre cet effort, de préparer et mieux préparer de nouvelles conférences et de les élargir à d'autres groupes se réclamant du communisme de Gauche, entrant dans le cadre des critères établis. C'est là une tentative bien limitée et nous sommes conscients que, comme telle, elle n'offre pas de garantie certaine de la réussite. D'ailleurs, l'histoire nous enseigne qu'il n'existe pas de garantie absolue. Mais ce dont nous sommes convaincus, c'est qu'il n'existe pas d'autre vole qui mène au nécessaire regroupement des révolutionnaires, pour l'indispensable constitution du Parti Communiste mondial, arme du triomphe de la révolution prolétarienne. Dans cette voie, le CCI entend s'engager sans réserves, de toute sa conviction et de toute sa volonté.
M.C.
[1] [8] "Car il n'est aucune continuité organisationnelle ou programmatique dont un révolutionnaire non fossilisé puisse (aujourd'hui) se réclamer". (Jeune Taupe n°23, p. 10). "Aucune continuité", proclame le PIC, c'est pourquoi il est "tombé tout chaud, tout rôti" contre les mamelles avachies de la Gauche Socialiste;
[2] [9] Article "Combat Communiste" (Jeune Taupe, n°23)
[3] [10] Idem
[4] [11] Idem
[5] [12] Titre de l'article paru dans "Il Partito Comunista" n°48, août 1978,
Courants politiques:
- Gauche Communiste [13]
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Théories économiques et lutte pour le socialisme
- 3529 reads
Ce texte est une réponse à une invitation à défendre les analyses économiques du CCI dans les pages de "Revolutionary Perspective ? Nous ne proposerons pas d'entrer dans la toile embrouillée des faux rapports et des confusions qui constituent "la critique" du CWO sur les analyses économiques de Luxembourg et du CCI: des réponses plus détaillées aux questions soulevées par le CWO apparaîtront dans des prochains numéros de la "Revue Internationale". Ici, nous répondrons aux principales accusations dirigées par le CWO contre le CCI et "contre l'économie luxemburgiste" en général.
LA LOI DE LA VALEUR
On trouve surtout une affirmation qui apparaît constamment dans les textes du CWO : la théorie de la saturation des marchés de Luxembourg "abandonne le marxisme et la théorie de la valeur". Peut-être que le CWO pense qu'en répétant assez souvent cette étonnante assertion, elle va se vérifier dans la réalité. Pourtant, le langage autoritaire avec lequel le CWO bannit Rosa Luxembourg du royaume du marxisme ne peut pas cacher la signification réelle de ces prétentions : la profonde incompréhension de la part du CWO, de la"théorie de la Valeur" et son rôle dans l'analyse économique marxiste. Le CWO prétend que Luxembourg "a abandonné la théorie de la Valeur en affirmant que la baisse du taux de profit ne pouvait pas être la cause de la crise capitaliste" ([1] [16]). Mais l'Inévitabilité des crises et la nécessité historique du socialisme ne peut pas simplement s'expliquer par telle ou telle tendance de la production capitaliste, comme par exemple la baisse du taux de profit, mais par la compréhension marxiste de la production de la valeur elle-même.
La détermination de la valeur des marchandises selon le temps de travail contenu en elle n'est pas spécifique au marxisme. Comme il est bien connu, cette conception était le point central du travail des plus importants économistes classiques bourgeois, jusqu'à Ricardo Inclus. Mais la compréhension marxiste de la valeur est complètement opposée à celle des économistes bourgeois. Pour ces derniers, le système capitaliste de production de marchandises et l'échange des marchandises selon leur valeur est un rapport social harmonieux qui exprime l'égalité dans l'humanité à travers l'échange égal des produits du travail humain par des individus libres. Ainsi la production de la valeur assure la distribution équitable de la richesse de l'humanité
Sous-jacente à cette conception se trouve celle dé la production de la valeur comme la forme rationnelle du travail humain. Comme disait Rosa Luxembourg : "De la même façon que l'araignée produit sa toile de son propre corps ainsi l'homme qui travaille (selon les économistes bourgeois) produit la valeur". Contre la vision bourgeoise qui présente la société capitaliste non seulement fondée sur des principes d'égalité -liberté-fraternité- mais aussi comme un système éternel, la vision marxiste de la production capitaliste se fonde sur la compréhension de la contradiction inévitable entre la production de valeurs d'échange et la production de valeurs d'usage. Selon le marxisme, la production généralisée de valeurs d'échange n'est ni la forme naturelle, ni la forme éternelle de la production humaine. Elle est une forme historique spécifique de la production qui caractérise une société dont le but est devenu la production pour la production, opposée et ceci de façon inéluctable dès le début à la production en fonction des besoins humains. La production de valeurs d'échange sous la forme de la production généralisée de marchandises n'est pas un mécanisme d'échanges égalitaire mais inégal dont la réalité n'est autre que l'extorsion de valeur de la classe ouvrière (tout comme des capitalistes mineurs et des producteurs indépendants) avec comme but l'accumulation du capital, c'est-à-dire la restriction de la consommation afin de développer les moyens de production.
Ce système répond aux nécessités de l'humanité à une certaine étape de développement. Mais à un certain degré de développement ultérieur, la production de valeurs d'échange, la concentration des énergies humaines vers le seul but du développement des moyens de production, pose des restrictions sociales accrues à l'utilisation rationnelle des moyens de production. Il doit alors céder la place à une nouvelle société : le socialisme, où la production est réalisée directement pour les besoins humains, où l'abondance potentielle créée par le capitalisme est transformée en réalité sociale, c'est-à-dire en bien-être matériel de l'ensemble de l'humanité.
Mais la théorie marxiste de la valeur, ne fournit pas uniquement un fondement à l'Idée de la nécessité historique du socialisme. Elle per-pet aussi de définir les moyens par lesquels il doit être réalisé. Le but de la production de la valeur entraîne la restriction de la consommation en faveur du développement des moyens de production; les moyens par lesquels ceci est accompli sont et ne peuvent être que l'exploitation de la classe ouvrière. Selon la conception bourgeoise de la valeur, l'échange de marchandises permettrait à l'ensemble de l'humanité de profiter du développement des forces productives. Marx a démontré que c'est le contraire qui est vrai, le rapport social et économique fondamental dans le capitalisme, le rapport capital-travail où la force de travail elle-même est transformée en marchandise revêt l'appauvrissement permanent de la classe ouvrière. Plus grand est le développement des forces productives, plus grande est l'exploitation de la classe ouvrière, et plus limitées sont les possibilités pour la classe ouvrière de profiter de l'abondance potentielle créée par le développement des forces productives. La contradiction entre la valeur d'usage et la valeur d'échange,entre le potentiel matériel de la production capitaliste et les restrictions sociales à la réalisation de ce potentiel, est exprimée dans l'accroissement des antagonismes de classes et surtout dans la lutte entre le producteur de la richesse, le prolétariat, et le représentant du capital, la bourgeoisie. La nécessité objective du socialisme se reflète dans la nécessité subjective pour le prolétariat d'arracher le contrôle des moyens de production à la bourgeoisie : seul le prolétariat, à travers sa propre émancipation peut libérer l'humanité.
La théorie marxiste de "la valeur-travail" n'est donc pas un modèle économique de l'accumulation capitaliste mais surtout une critique sociale et historique du capitalisme. Certes, seul le marxisme permet l'élaboration des modèles de ce genre. Mais les principes socialistes ne découlent pas d'un tel modèle. Au contraire, c'est ce modèle qui découle d'une analyse dont la prémisse est la compréhension de la nécessité historique du socialisme contenue dans la théorie marxiste de la valeur.
Comment donc définissons-nous une analyse de la valeur en termes marxistes ? Les principes de base de la théorie marxiste de la valeur se retrouvent non pas dans les analyses détaillées du troisième tome du Capital par exemple, mais dans le programme révolutionnaire du prolétariat énoncé par Marx et Engels dans le"Manifeste Communiste". Ceux-ci sont :
1) la nature historiquement transitoire du capitalisme et la nécessité historique du socialisme au niveau mondial
2) la nature révolutionnaire de la classe ouvrière.
"LA THEORIE DE LA BAISSE DU TAUX DE PROFIT" COMME CRITIQUE ABSTRAITE
Définir l'analyse de la valeur comme le fait la CWO dans les termes d'une adhésion à un modèle économique fondé sur l'abstraction d'un aspect partiel du développement du capitalisme (la tendance à la baisse du taux de profit) en fait, enlève au marxisme son contenu révolutionnaire. Car cela remplace la critique historique et sociale du capitalisme contenue dans la théorie marxiste de la valeur par une critique purement économique. L'interaction des classes sociales est remplacée par l'Interaction des catégories économiques qui, en soi, n'explique ni la nécessité historique du socialisme, ni la nature révolutionnaire de la classe ouvrière.
L'analyse de Marx de la tendance à la baisse du taux de profit se fonde sur la compréhension que le travail est la source de toute valeur. L'investissement du capital peut être divisé en deux catégories : le capital variable, c'est-à-dire la force du travail vivant et le capital constant c'est-à-dire les matières premières, les machines et autre capital fixe : mais tandis que la valeur du capital constant est simplement transférée dans les marchandises produites, le capital variable fournit lui, une valeur additionnelle qui forme le profit du capitaliste. Mais avec le développement du capitalisme, la composition organique du capital (c'est-à-dire le rapport entre capital constant et capital variable)tend à augmenter et donc le taux de profit (c'est-à-dire le rapport du profit à l'investissement total) tend à diminuer. Comme la productivité du travail augmente avec le développement de l'industrie, une proportion de plus en plus grande des dépenses du capitaliste est vouée aux matières premières et aux machines plus sophistiquées et l'élément producteur de valeur dans son investissement, la force de valeur humaine, baisse en proportion.
Dans RP n°8, la CWO suivant les analyses de Grossman et Mattick, tentent de montrer que, une fois arrivé à un certain point, la valeur globale du"capital constant devient si grande que la plus-value produite ne suffit plus à fournir les fonds pour davantage d'investissement".([2] [17]) Ici se trouve le coeur de toute analyse qui, comme celle de la CWO, tente de comprendre la crise du capitalisme seulement en fonction de la baisse tendancielle du taux de profit.
Ces analyses admettent en général que cette tendance pose dans les faits des problèmes immenses au niveau du capitaliste individuel, mais que cet aspect doit être considéré comme entièrement secondaire par rapport au problème principal de la rentabilité du capital au niveau global. Comme le dit Mattick, dans son commentaire sur les travaux de Grossman : "Pour comprendre l'action de la loi de la valeur et l'accumulation, il faut laisser de côté ces mouvements individuels et marginaux et envisager l'accumulation du point de vue du capital global". ([3] [18])
Dans cette analyse, comme suggère la citation de la CWO, la cause de la crise est donc vue comme une pénurie absolue de plus-value au niveau global. Ici apparaissent les conséquences de cette façon de raisonner qui consiste à faire abstraction du monde réel du développement capitaliste pour ne voir le capitalisme que dans son aspect global, sous forme de rapports entre catégories économiques abstraites telles le capital constant et le capital variable. Dans le monde réel, le capitaliste individuel a besoin d'une masse définie de plus-value à investir s'il veut que son Investissement se fasse à un niveau de profit suffisant. Mais le niveau de profit et la masse de plus-value préalable est déterminée entièrement par la lutte concurrentielle entre capitalistes. S'il est incapable de produire à un niveau de rentabilité équivalent ou supérieur à celui de ses concurrents, le capitaliste disparaît. Il est vrai qu'avec le développement de l'industrie, le taux de profit tend à baisser, tandis que la masse de plus-value nécessaire pour réaliser des investissements à des niveaux compétitifs de rentabilité s'accroît toujours. Mais sans tenir compte de cette lutte concurrentielle entre capitalistes, comment peut-on déterminer le point où le capital global est incapable de produire "assez" de plus-value pour investir à un niveau nécessaire de rentabilité ? Dans un monde capitaliste théorique sans concurrence, cette question devient un non-sens car le facteur qui détermine le niveau requis de rentabilité, la lutte concurrentielle, est absent.
Dans son modèle abstrait de l'accumulation capitaliste, Grossman présume que le niveau de rentabilité nécessaire pour le capital global doit permettre au capital constant de s'accroître de 10 % chaque année, et au capital variable de 5 %. Quand le taux de profit tombe largement en dessous de 10 % cette croissance devient impossible et, selon Grossman, la crise commence. Il est assez évident que, dès que le taux de profit tombe au-dessous de 10 %, on ne peut continuer longtemps à accroître le capital constant de 10 % et le capital variable de 5%. Une table statistique n'est pas nécessaire pour faire une telle constatation. Mais pourquoi cela poserait-il un problème insurmontable pour le capital global ? Cela reste obscur. Malgré le vernis statistique impressionnant de l'analyse de Grossman, il ne démontre pas pourquoi le capitalisme qui n'accroîtrait son capital constant que de 9 % par an ou son capital variable de 4 % aboutirait ai| désastre, (pas plus d'ailleurs que si ces chiffres étaient de 8 et 3 % ou même 3 et 1 %). Bien sûr, les chiffres des tableaux de Grossman sont purement fictifs. Mais ces tableaux tentent de décrire "la loi inhérente du développement capitaliste" en montrant que, dès que le taux global de profit et donc d'accumulation, tombe au-dessous d'un certain niveau, l'ensemble du procès de production est disloqué et une période de convulsions économiques commence. Selon Mattick, il y a deux raisons pour qu'une chute dans le taux d'accumulation mène à une crise du capital global:
Premièrement, parce qu'elle produit le chômage : la croissance du capital variable ne peut plus marcher de pair avec la croissance de la population. Deuxièmement, parce qu'au-dessous d'un certain taux de croissance du capital constant "l'appareil productif ne peut pas être renouvelé et élargi à la même vitesse que le progrès technique"([4] [19]). Cette obsession des catégories économiques mène ainsi à la conclusion que la crise du capitalisme est due à une incapacité technique du capitalisme à satisfaire les besoins de l'accumulation continue et par là de l'humanité. Mais rien ne pourrait être plus loin de l'analyse de Marx lui-même, pour qui la crise résulte de contradictions réelles provenant du développement de la capacité technique du capitalisme à satisfaire ces besoins. A un niveau global abstrait, coupé de la réalité sociale, la chute du taux de profit en soi ne menace pas le capitalisme. La chute du taux de profit et donc la chute du taux d'accumulation en termes de valeurs d’échange reflète simplement la croissance de la productivité de la main-d'oeuvre, ce qui veut dire que, malgré la croissance de plus en plus rapide de la richesse sociale en termes de valeurs d'usage (les éléments matériels de la production et de la consommation), cette croissance dépend de moins en moins de la croissance de la main-d'oeuvre employée. Comme le travail est la source de toute valeur, la plus-value extraite de la classe ouvrière, et donc le taux de profit et d'accumulation tend à diminuer malgré la croissance continue en termes matériels. L'aboutissement éventuel de cette tendance serait la production entièrement automatisée, l'exclusion totale du travailleur du procès de production. A ce point, même avec une croissance fantastique de la production de marchandises, le taux d'accumulation serait zéro c'est à dire, en termes de valeurs d'échanges, la production stagnerait. Bien sûr, ce point hypothétique ne peut être atteint. Mais il sert à illustrer le fait que la chute du taux d'accumulation exprime, non pas l'incapacité du capitalisme à produire assez de plus-value, mais le fait que la croissance de la production dépend de moins en moins de l'extraction de plus-value. Elle exprime la tendance du mode de production capitaliste "vers le développement absolu des forces productives sans égard pour la valeur et la plus-value qu'elles contiennent";([5] [20])
Voilà pour ce qui est de l'incapacité de l'appareil productif à "marcher de pair avec le progrès technique". Si cette tendance était "la seule contradiction" du capitalisme, il pourrait, a travers une distribution rationnelle de la plus-value, continuer à vivre à jamais avec en même temps une baisse du taux de profit et une capacité croissante à satisfaire les besoins de l'humanité...et cela aussi bien en termes d'abondance de marchandises que de bien-être physique pour l'humanité, puisqu'ainsi la croissance du chômage signifierait tout bêtement l'augmentation du temps de loisirs. Ceci au sein d'un capitalisme dynamique qui se libérerait de la nécessité de s'appuyer sur le travail humain pour produire des marchandises. Cela serait vrai pour un taux global de profit de 10 %, 5 %, 3 % ou même moins. En ce sens, Luxembourg avait parfaitement raison de dire que : "il y a toujours un certain temps à passer avant que le capitalisme s'effondre à cause de la baisse du taux de profit -à peu près jusqu'à ce que le soleil s'éteigne".([6] [21])
En fait cette distribution rationnelle de la plus-value est, en termes généraux, le but de l'économie de Keynes, dont l'analyse est fondée explicitement sur la reconnaissance de la baisse du taux de profit. "Dans la vue de Keynes, la stagnation du capital exprime l'incapacité ou le manque de volonté du capitaliste d'accepter une rentabilité décroissante...Keynes est venu finalement à la conclusion que le devoir de planifier le volume courant d'investissement ne peut être laissé sans risques entre les mains des capitalistes privés." ([7] [22])
Keynes ne voyait pas pourquoi la chute de la rentabilité poserait des problèmes insolubles pour le capitalisme. Sa vision bourgeoise l'empêchait de comprendre comment les rapports sociaux dans le capitalisme empêchaient une distribution rationnelle de la plus-value telle qu'il l'a préconisée. Le but du capitalisme, disait Marx, c'est de "préserver l'auto-expansion du capital existant et de pousser cette auto-expansion au plus haut niveau" ([8] [23]). Dès lors nous n'avons plus affaire à une distribution rationnelle de la plus-value à une échelle globale, mais aux tentatives de chaque capital individuel pour maximiser sa propre plus-value. Les origines de la crise ne résident pas principalement dans le rapport entre capital constant et capital variable, mais dans le rapport social entre capitaux individuels, dont la lutte compétitive fi nit par rendre impossible la réalisation de la plus-value à l'échelle mondiale.
La CWO, en même temps qu'elle est obsédée par cette tendance abstraite et en fait fictive vers une pénurie absolue de la plus-value au niveau global tend à minimiser la concurrence entre les capitaux individuels. Par contre, la CWO souligne les mécanismes variés tels que les crédits et les emprunts internationaux qui permettent au capitalisme d'atténuer les pires effets de la concurrence ([9] [24]). Cette préoccupation au sujet du développement d'un capital "supranational" qui tend à aller au-delà du cadre de l'Etat national est, comme on va le voir, un aspect commun à toutes ces analyses fondées exclusivement sur la baisse du taux de profit, et la tendance correspondante vers la centralisation du capital. Cette conception renvoie l'effondrement inévitable du capitalisme (à cause de la baisse du taux de profit) à un avenir indéterminé et plutôt flou tandis qu'elle ignore, ou même nie, le facteur principal du monde réel de l'accumulation capitaliste, propulsé vers la crise et le délabrement : la concurrence entre les capitaux individuels.
"LA THEORIE DE LA BAISSE DU TAUX DE PROFIT" COMME CRITIQUE HISTORIQUE
Le capital "individuel" peut être constitué par un grand trust, ou par l'économie capitaliste d'Etat moderne. Aujourd'hui, il pouvait sembler qu'avec l'intégration d'économies nationales séparées sous le contrôle global de blocs impérialistes, nous pouvons voir l'émergence d'une unité capitaliste qui irait au delà-même de l'économie nationale. Mais en réalité cela reflète les rapports de force entre capitaux nationaux à l'intérieur de chaque bloc et la domination militaire et économique des deux forces économiques les plus puissantes du monde : l'URSS et les USA. Plutôt que l'émergence d'une économie internationale planifiée au niveau du bloc impérialiste. Mais de toute façon, l'essentiel, c'est que la centralisation du capital au niveau de la nation ou même du bloc impérialiste, ne représente aucunement un mouvement vers une vraie économie capitaliste "supranationale": au contraire, elle représente, à travers l'émergence des antagonismes impérialistes sur une échelle encore plus grande, 1'incapacité du capitalisme à se transformer en une économie mondiale unique, c'est cette incapacité qui finit par conduire à la destruction du capitalisme.
Dans ce sens, ce que Rosa Luxembourg a écrit dans "Qu'est-ce que l'Economie Politique" est encore vrai de nos jours :
"... Tandis que les innombrables pièces détachées - et une entreprise privée actuelle, même la plus gigantesque, n'est qu'une infime parcelle de ces grands ensembles économiques qui s'étendent à toute la terre- tandis donc que les pièces détachées sont organisées rigoureusement, l'ensemble de ce que l'on appelle "l'économie politique", c'est à dire l'économie capitaliste mondiale, est complètement inorganisée. Dans l’ensemble qui couvre les océans et les continents, ni plan, ni conscience, ni réglementation ne s'affirme; des forces aveugles, inconnues, indomptées, jouent avec le destin économique des hommes. Certes, aujourd'hui aussi, un maître tout puissant gouverne l'humanité qui travaille, c'est le capital. Mais sa forme de gouvernement n'est pas le despotisme, c 'est l'anarchie." "Introduction à l'économie politique". Chap.I. Collection 10-18. P. 85.86
Dans le développement historique de cette "anarchie", nous pouvons néanmoins distinguer une tendance constante : l'absorption des capitaux individuels par les grands trusts par la concurrence jusqu'à la fusion de ces trusts dans les monopoles nationaux et la consolidation progressive de l'ensemble du capital national dans un seul capital d'Etat défendu par le pouvoir militaire de l'Etat.
Simultanément le capitalisme envahissait les coins les plus lointains du monde, détruisant les vieux rapports de la société pré-capitaliste et les remplaçant par les siens.
A la veille de la première guerre mondiale, les capitaux "murs" de l'Europe et de l'Amérique s'étaient entièrement partagés le monde entre eux, et dans la lutte des puissances coloniales pour le contrôle du marché mondial, la concurrence économique faisait naître son enfant monstrueux : la guerre impérialiste.
Depuis 1914, deux guerres mondiales ont détruit les plus faibles puissances impérialistes et le capitalisme a révélé le point final de son développement : deux grandes puissances impérialistes se confrontent, leurs Etats de tutelle regroupés autour d'eux en blocs rivaux, les moyens de production sont dédiés au développement de nouveaux et terribles moyens de destruction, tandis que plus de la moitié de l'humanité plonge plus profondément dans le dénuement et la misère. Pour la classe ouvrière, même la maigre compensation par quelques "biens de consommation" aux longues années de crise ouverte et de guerre, à l'intensification toujours croissante de l'exploitation, à l’insécurité constante de l’existence quotidienne et de l'inhumanité du travail sous le capitalisme-même cette maigre compensation est perdue progressivement, à un moment où le chômage et l'austérité deviennent la norme journalière. La destruction de l'humanité elle-même apparaît comme la conclusion logique de l'anarchie capitaliste.
Comment les révolutionnaires de la classe ouvrière peuvent ils comprendre ce développement et la situation où ils se trouvent aujourd'hui? Ce n'est certes ni à travers la sèche érudition d'Hilferding, ni grâce aux tables mathématiques de Grossman, pas plus qu'à travers les affirmations narquoises de la CWO suivant lesquelles notre jour viendra quand le taux de profit sera tombé à tel ou tel niveau, même si "nous sommes encore très loin d'une telle situation". C'est seulement à travers l'analyse vivante et historique de Rosa Luxembourg que nous pouvons embrasser réellement la réalité complexe du monde capitaliste ! Quels que soient les défauts de l'analyse de Luxembourg, celle-ci a le grand mérite de reposer sur la compréhension, qu'une analyse marxiste concrète et historique est, surtout une analyse historique et sociale. Parce que les lois générales du développement capitaliste élaboré par Marx ne concernent pas le développement économique capitaliste pris en soi, mais un cadre pour la compréhension du développement capitaliste au sein de la réalité sociale. Une analyse qui se limite aux bords restreints des catégories économiques est aussi inadéquate pour comprendre le développement du capitalisme autant que pour saisir la nécessité historique du socialisme.
Pour illustrer ceci, ne prenons qu'un aspect du capitalisme moderne, la caractéristique la plus importante du capitalisme moderne à comprendre pour la classe ouvrière : la différence qualitative entre les crises de croissance du capitalisme au XIXème siècle et les crises de la décadence au XXème siècle. Evidemment celle-ci ne surgit pas des taux globaux de profit différents pendant les deux périodes mais des conditions historiquement différentes dans lesquelles la crise a lieu.
Bien sûr, une analyse fondée sur la baisse tendancielle du taux de profit n'est pas contradictoire avec une telle analyse historique. On voit cette préoccupation du développement historique du capitalisme, des restrictions sociales au développement capitaliste, dans une des meilleures analyses contemporaines de Luxembourg, basée sur cette baisse tendancielle du taux de profit. C'est l'analyse de Boukharine dans "L'économie mondiale et l'impérialisme" :
"On constate un manque d'harmonie grandissant entre la base de l'économie sociale du monde et la structure de classe spécifique de la société où la classe dirigeante elle-même (la bourgeoisie) est scindée en groupes nationaux aux intérêts économiques discordants, groupes qui, tout en étant opposés au prolétariat mondial* agissent en même temps en concurrents dans le processus du partage de la plus-value produite dans la totalité du monde..." (Page 103)
Dans le cadre étroit des frontières nationales s'opère le développement des forces productives qui ont déjà débordé ce cadre. Dans ces conditions le conflit éclate fatalement. Il est tranché sur la base capitaliste par l'élargissement violent des frontières nationales dont la conséquence est de provoquer de nouveaux conflits de plus en plus considérables..." (Page 104)
La concurrence atteint son développement maximum : la concurrence des trusts capitalistes nationaux sur le marché mondial. Dans le cadre des économies nationales, la concurrence est réduite au minimum pour rebondir en dehors dans des pro portions fantastiques, inconnues des époques historiques précédentes " (Page 118)
L'analyse de la CWO, aussi bien que celle de Mattick et Grossman où les conditions historiques de développement capitaliste ne sont qu'un élément périphérique marquant une nette régression par rapport à cette analyse historique et sociale de Boukharine qui est proche de la description de l'anarchie capitaliste dans "L'introduction à l'économie politique". Néanmoins, même dans l'analyse de Boukharine, il y a une certaine insuffisance. Boukharine considère la guerre impérialiste comme l'aboutissement inévitable du développement capitaliste mais elle est considérée aussi à un certain degré comme une partie du processus du développement capitaliste, une continuation de l'expansion progressive du capitalisme pendant le XIXème siècle.
" La guerre est un moyen de reproduction de certains rapports de production. La guerre de conquête est un moyen de reproduction élargie de ces rapports. Si la guerre "impérialiste" ne peut arrêter le cours général du développement du capital mondial ... elle est au contraire l'expression d'une expansion maximum du processus de centralisation... Par son influence économique, la guerre rappelle sous bien des rapports, les crises industrielles dont elle se distingue, cela va de soi, par une plus grande intensité, bouleversements et de ravages..." (souligné par nous) (Page 111 - Pagel49. 150)
Dans l'analyse de Boukharine, la guerre est donc la crise cyclique traditionnelle élargie et intensifiée au nième degré. Mais la guerre impérialiste est beaucoup plus que cela : elle reflète l'impossibilité historique du développement capitaliste. La première guerre mondiale n'était pas tout bêtement une nouvelle forme historique de la crise cyclique, elle inaugure une nouvelle époque de crise permanente où la crise n'est pas simplement l'aboutissement logique du développement capitaliste mais la seule alternative possible à la révolution prolétarienne.
On peut voir l'erreur de Boukharine répétée dans l'analyse de la CWO : "Chaque crise mène (à travers la guerre) à une dévalorisation du capital constant, élevant ainsi le taux de profit et permettant au cycle de reconstruction -le boom, dépression, guerre- de se répéter encore". RP n°6. Ainsi pour la CWO, les crises du capitalisme décadent sont vues en terme économique, comme les crises cycliques du capitalisme ascendant, répétées à un plus haut niveau.
Voyons ce point de plus près. Si c'était en fait le cas, on s'attendrait à voir évidemment les mêmes caractéristiques à la fois dans les périodes de reconstruction suivant les guerres mondiales et â la fois dans les périodes d'expansion économique suivant les crises cycliques du XIXème siècle. Il y a en effet, certaines similitudes superficielles entre les deux périodes. Les niveaux de production, par exemple se sont beaucoup accrus au moins dans la période qui a suivi la deuxième guerre mondiale. Ceci à cause de la croissance continue de la productivité du travail pendant toute la période de la décadence : le développement technique des moyens de production n'a pas cessé un seul instant et il ne pouvait en être autrement, à moins que la production capitaliste ne s'arrête complètement. C'est le même phénomène pour le processus de concentration du capital qui a continué sans Interruption depuis le début du capitalisme jusqu'à nos jours.
Mais la production capitaliste ne cesse pas brutalement et totalement avec le début de la décadence. Elle continue et continuera jusqu'à ce que la société capitaliste soit bouleversée par le prolétariat. Nous devons être capables d'expliquer la forme spécifique de la production capitaliste pendant sa période décadente, en l'absence de la révolution prolétarienne, c'est à dire le cycle de guerre-reconstruction-crise Cet en particulier la période de croissance rapide qui a suivi la deuxième guerre mondiale). Mais surtout, notre analyse doit expliquer l'impossibilité de tout développement capitaliste progressif pendant toute la période de décadence capitaliste, non pas seulement pendant les guerres et les crises, mais également pendant les périodes de reconstruction.
Afin de clarifier ce point, voyons les caractéristiques les plus importantes de la période progressiste de l'expansion capitaliste au XIXéme siècle.
1) La croissance numérique du prolétariat : l'absorption d'une proportion croissante de la population mondiale dans le travail salarié.
2) Le surgissement de nouvelles puissances capitalistes telles que les USA, la Russie et le Japon.
3) La croissance du commerce mondial dans le sens que les économies non capitalistes et les "jeunes" capitalismes jouaient un rôle de plus en plus important.
En un mot, le développement du capitalisme du XIXème siècle s'exprimait dans l'internationalisation du capital. Une partie de plus en plus importante de la population mondiale était intégrée dans le processus du développement des moyens de production que permettaient les rapports sociaux capitalistes. C'était pour cette raison que le mouvement révolutionnaire du XIXème siècle soutenait la lutte pour l'établissement de rapports capitalistes de production dans les régions sous-développées et non pas seulement dans les pays coloniaux mais aussi dans des pays tels que l'Allemagne, l'Italie ou la Russie, où les conditions politiques et sociales archaïques menaçaient d'arrêter le processus de développement capitaliste.
On peut voir que dans le capitalisme décadent, aucune de ces caractéristiques n'est présente ([10] [25]):
1) Dans les régions développées, la croissance du prolétariat n'a pas suivi la croissance de la population. Dans certaines ères telles que la Russie, l'Italie ou le Japon, des couches non capitalistes ont été absorbées dans le prolétariat; mais cette augmentation a été insignifiante par rapport à la tendance globale vers l'exclusion de larges secteurs de la population mondiale de toute activité économique. Cette tendance s'exprime dans la croissance, historiquement sans précédent de la famine et de la pénurie massive pendant ces soixante dernières années.
2) Aucune nouvelle puissance capitaliste n'a surgi pendant cette période. Bien sur, il y a eu quelques développements industriels dans les pays sous-développés, mais en général, l'écart économique entre les vieilles économies capitalistes et les économies du "Tiers-Monde" -même les plus riches en ressources naturelles comme la Chine s'est approfondi toujours plus vite. Par exemple comme nous l'avons montré dans "La Décadence du capitalisme" : ."Entre 1950 et 1960,(le sommet de la reconstruction de l'après-guerre) en Asie, Afrique et Amérique Latine, le nombre de nouveaux salariés pour chaque centaine d'habitants était neuf fols plus bas que dans les pays développés.
3) Parallèlement, la part des nations sous-développées dans le commerce mondial ne s'est pas accru mais a tendu à diminuer depuis 1914.
Du point de vue de l'internationalisation de la production capitaliste, les années depuis 1914 ont été pour le moins une période de stagnation économique. Et c'est là la façon la plus fondamentale de voir le développement capitaliste, puisqu'elle permet de comprendre pourquoi le développement économique a été presque entièrement restreint à un petit nombre de nations qui était déjà des puissances économiques majeures avant 1914, et plus généralement de comprendre la différence immense entre les niveaux d'accumulation qui auraient pu être possibles si on avait pris en compte le seul taux global de profit et ceux qui ont été en fait atteints. Il suffit de considérer l'ampleur de la proportion des forces productives qui ont été consacrées aux différentes formes de production de gaspillage (armements, publicité, obsolescence planifiée, etc.) qui ne contribuent pas à l'accumulation du capital, ou la réserve immense de potentiel productif "cachée" qui se révèle pendant les guerres mondiales, pour avoir une idée de l'importance de cet écart.
Si la guerre impérialiste, selon la CWO, en élevant le taux de profit, fournit les conditions pour une nouvelle période du développement capitaliste, pourquoi toutes les caractéristiques du développement progressif du capitalisme ont elles été absentes depuis 1918 ? Et si par contre, la CWO reconnait la nature qualitativement différente du développement capitaliste depuis 1914, quelles sont les raisons économiques de cette différence ?
Nous avons déjà montré que la baisse tendancielle du taux de profit, en tant que tendance globale et abstraite, ne peut pas expliquer les limites historiques da 'développement capitaliste. Mais l'analyse historique de la "théorie de la baisse du taux de profit", qui voit le capitalisme décadent comme une continuation des crises cycliques du XIXème siècle, exception faite de la constatation que la concurrence ne voit plus s'affronter des capitalistes individuels mais des économies nationales étatisées, n'est pas non plus capable d'expliquer la restriction croissante du développement économique depuis 1914. En fait, lorsqu'on a écarté la conception erronée selon laquelle la crise est le résultat d'une pénurie absolue de la plus-value, il est clair qu'une analyse fondée sur la seule baisse du taux de profit mène à la conclusion opposée : la guerre devrait, comme cela est sous-entendu dans l'analyse de Boukharine, commencer une nouvelle période de croissance économique vigoureuse, la création de nouvelles économies capitalistes développées et l'intégration de vastes secteurs des couches non prolétariennes dans la production capitaliste. Dans les derniers travaux de Boukharine, "L'Impérialisme et l'Accumulation du Capital", la conclusion logique de ses analyses antérieures est explicitement constatée : une telle vision d'un capitalisme dynamique de l'après-guerre "révélant les prodiges éclatants du progrès technique" n'est utilisée que pour justifier l'abandon de la politique révolutionnaire par la troisième Internationale décadente. La CWO, qui ne reconnait pas que celle-ci est aussi la conclusion logique de sa propre analyse, prétend que les "minables conclusions politiques" de Boukharine, ne découlent pas "de son analyse économique". Mais Lénine avait montré clairement dans sa préface à "L'Economie Mondiale et l'Impérialisme" les conséquences politiques dangereuses de ce type d'analyse :
"Peut-on cependant contester qu'une nouvelle phase du capitalisme, après l'impérialisme, à savoir : une phase de super-impérialisme (c'est-à-dire une unification internationale d'impérialismes nationaux qui seraient capables d'éliminer les conflits les plus naïfs et les plus gênants tels que les guerres, les convulsions politiques, etc.), soit dans l'abstrait"concevable" ? Non. On peut théoriquement imaginer une phase de ce genre. Il ne fait aucun doute que le développement suit la direction de la marche vers un seul trust mondial qui intégrerait toutes les entreprises, tous les Etats sans exception. Mais, en pratique, si l'on s 'en tenait à cette conception, on serait un opportuniste qui prétend ignorer les plus graves problèmes de l'actualité pour rêver à des problèmes moins graves qui se poseraient dans l'avenir".
Ici Lénine exprime l'insuffisance théorique de l'économie marxiste "orthodoxe" contemporaine qui était à la base des analyses de Boukharine et de Lénine lui-même pour expliquer la réalité politique à laquelle était confronté le prolétariat : la décadence du capitalisme et la nouvelle époque des guerres et des révolutions. Fournir une explication économique et théorique de cette réalité politique fut la tâche que s'est donné Rosa Luxembourg dans "L'Accumulation du Capital". Cette explication exigeait une analyse capable de prendre en considération l'autre contradiction fondamentale de la production capitaliste : la contradiction des marchés.
L'ANALYSE DE ROSA LUXEMBOURG
Au fur et à mesure que le capitalisme développe les forces productives, la classe ouvrière ne peut consommer qu'une proportion de plus en plus petite de la production croissante des marchandises. Dans les termes les plus simples possible, c'est cela "la théorie des marchés" sur laquelle Rosa Luxembourg fonde son analyse. Dans ce sens, l'analyse de Luxembourg, découle directement d'une compréhension marxiste de la production de la valeur dont nous avons exposé les lignes générales au début de ce texte : le "problème des marchés" surgit directement de la caractéristique de la production capitaliste -c'est-à-dire "la restriction de la consommation afin de développer les moyens de production". Nous avons déjà démontré à travers nos analyses que le problème des marchés joue un rôle central dans la théorie marxiste.([11] [26])
En fait les deux aspects de la crise capitaliste reflètent la même tendance profonde : la composition organique croissante du capital. Celle-ci amène non seulement la baisse tendancielle du taux de profit, mais aussi la contraction du marché : ceci parce que la classe ouvrière ne peut que consommer une valeur en marchandises égale à la valeur totale des salaires et parce que la croissance de la productivité du travail (c'est-à-dire la composition organique croissante du capital) signifie que la totalité des salaires représente une proportion toujours diminuant de la production totale.
Pourtant ces deux tendances ne constituent pas au début un problème insoluble pour le capitalisme. Au contraire, pendant la période ascendante du capitalisme, elles fournissaient l'impulsion la plus puissante au développement du capitalisme. La baisse du taux de profit poussait à l'élimination des capitaux arriérés ou de petite taille et à leur remplacement par des capitaux produisant à une échelle plus large et techniquement plus avancé qui pouvait compenser la baisse du taux de profit par une masse croissante de profit. La contradiction relative du "marché domestique" par ailleurs, poussait à l'extension géographique du capitalisme au fur et à mesure que la recherche pour des nouveaux marchés amenait la destruction des types de production pré-capitaliste, et l'ouverture de nouvelles régions au développement capitaliste.
Ces deux tendances sont évidemment reliées ([12] [27]); la baisse du taux de profit nécessite que chaque capitaliste réduise le plus possible les salaires de la force de travail, ce qui restreint encore plus le marché Interne de l'ensemble du capitalisme et pousse à son expansion vers les réglons extérieures de la production non capitaliste. La saturation des marchés impose la nécessité pour chaque capital de vendre ses marchandises au prix les plus bas possible, ce qui aggrave encore plus le problème de la rentabilité, et stimule la concentration et la rationalisation du capital existant. Ensemble, elles expliquent les traits caractéristiques de la phase ascendante du capital : le développement technologique rapide des moyens de production et en même temps l'expansion rapide des rapports capitalistes, de la production aux points les plus é1oignés de la planète.
Nous n'avons pas ici la place de décrire en détails le rôle joué par les marchés non capitalistes dans le développement du capitalisme. Mais l'importance cruciale de ces zones consistait dans l'occasion qu'elles fournissaient pour le capitalisme d'entrer dans un rapport d'échange (l'échange de marchandises très variées contre les matières premières vitales à l'accumulation continue) avec des économies, qui, parce qu'elles ne produisaient pas sur la base de la rentabilité, fournissaient un débouché pour le surplus capitaliste sans être une menace pour le marché domestique. Il est important de comprendre que le capitalisme ne pouvait pas utiliser n'importe quelle communauté paysanne ou tribale pour ses marchandises excédentaires. Seules les économies précapitalistes bien développées, telles que l'Inde, la Chine ou l'Egypte qui pouvaient offrir des biens en échange du surplus capitaliste étaient vraiment capables de remplir ce rôle. Mais ce processus lui-même (comme l'a montré de façon vivante Luxembourg dans la troisième partie de "L'Accumulation du Capital") amène inévitablement la transformation de ces économies en économies capitalistes, qui non seulement ne peuvent plus fournir un débouché pour la production excédentaire des métropoles capitalistes, mais encore doivent dépendre pour leur propre survie, d'une nouvelle extension du marché mondial. Ce fut dans ces circonstances que le capitalisme a tourné ses yeux vers les régions inexplorées du monde telles que l'Afrique. Mais les nouveaux marchés créés dans la lutte coloniale pour ces terrains économiquement vierges devenaient Insignifiants par rapport au marché demandé par la croissance rapide du capitalisme mondial.
Selon Luxembourg, c'est à partir de ce point, c'est-à-dire quand il n'y a plus assez de zones de production non capitaliste capables de fournir des nouveaux marchés pour compenser la contraction du marché capitaliste existant, que la période ascendante du capitalisme se termine, et que la période de la décadence, celle de la crise permanente commence. Les deux tendances qui fournissaient jadis l'impulsion au développement capitaliste deviennent un cercle vicieux ce qui forme une entrave à l'accumulation capitaliste. La recherche de nouveaux marchés devient une compétition impitoyable où chaque capitaliste individuel est obligé de réduire ses marges de profit au minimum afin d'être compétitifs sur un marché mondial entrain de se rétrécir. La production rentable devient de plus en plus impossible, non seulement pour les capitaux arriérés et inefficaces, mais aussi pour tous les capitaux quel que soit leur niveau de développement. Les salaires réels sont de plus en plus restreints avec la recherche d'une plus grande rentabilité du capital. Mais au fur et à mesure que les salaires baissent et que l'investissement diminue, les marchés se contractent de plus en plus vite, réduisant ainsi la possibilité d'une plus haute rentabilisation de la production. Les deux aspects les plus Importants de notre analyse, résumée ci-dessus, sont :
1) C'est la saturation du marché mondial qui est le point historiquement décisif entre les périodes d'ascendance et de décadence du développement capitaliste.
2) La crise permanente du capitalisme décadent n'est pas compréhensible si on ne prend pas en compte les deux aspects de la crise qui sont en 1nter-relation : saturation du marché mondial et baisse tendancielle du taux de profit.
En fait, nous pouvons dire simplement que toutes les contradictions qui découlent de la baisse du taux de profit, pourraient être résolues par une hausse du taux d'exploitation, comme le reconnait Mattick quand il dit qu'une "situation où l'exploitation ne peut pas être augmentée suffisamment pour compenser la baisse tendancielle du taux de profit n'est pas possible" ([13] [28]) si la crise résultant du problème des marchés n'exacerbait encore plus le problème de la rentabilité.
En fait, nier que la surproduction est une contradiction inhérente au capitalisme amène dans les faits à proclamer l'immortalité du système. L'ironie veut que Grossman lui-même ait montré clairement ce point, en écrivant sur l'économiste bourgeois Say :
"La théorie des marchés de Say, c'est-à-dire la doctrine d'après laquelle toute offre est simultanément une demande, et conséquemment que toute production, en produisant une offre crée une demande menait à la conclusion qu'un équilibre entre l'offre et la demande est possible à n'importe quel moment. Mais ceci implique la possibilité d'une accumulation du capital et d'une expansion de la production sans limite, corme s'il n'y avait aucune entrave au plein emploi de tous les facteurs de production. ([14] [29])
De même, le problème du marché pourrait se résoudre en augmentant l'investissement afin d'absorber les surplus autrement invendables, comme par exemple le souligne Mattick -"tant qu'il existe une demande adéquate et continue pour les biens produits par le capitalisme, 11 n'y a pas de raison pour que les marchandises qui arrivent sur le marché ne puissent être vendues"-([15] [30]), si la baisse du taux de profit n'imposait pas à ce nouvel Investissement des niveaux de rentabilité qui aggraveraient encore plus le problème du marché.
Cette interrelation entre les deux aspects de la crise est implicite dans l'analyse de Luxembourg car bien que la CWO prétende que Luxembourg ne prend pas en compte la baisse tendancielle du taux de profit, toute son analyse est fondée sur la restriction du marché à cause de la composition organique du capital (et donc la baisse du taux de profit). Les schémas de Marx de la reproduction élargie (c'est-à-dire l'accumulation du capital) dans le "Capital, tome II" montre que chaque année, toute la plus-value produite, en termes de biens de production et de consommation est réabsorbée en tant qu'éléments nouveaux de la production (capital variable et capital constant). C'est sur la base de ces schémas que la CWO et d'autres prétendent qu'il n'y a pas de problème de marché pourvu que l'accumulation continue à un taux suffisant. Mais ces schémas ne tiennent pas compte de la composition organique croissante du capital. Luxembourg montre que, quand on en tient compte, c'est le processus de 1’accumulation 1ui-même qui, en diminuant toujours le capital variable par rapport au capital constant, crée le problème de la surproduction.
Le besoin permanent de réduire les frais de capital variable veut dire que le nouvel investissement, loin de résoudre le problème existant au niveau du marché (en réalisant la plus-value), aggrave le problème en demandant comme condition première l'expansion du marché et ceci de façon plus urgente qu'avant.
La CWO prétend aussi que Luxembourg abandonne Marx et la théorie de la valeur en "cherchant en dehors du rapport entre le travail et la valeur, en dehors des royaumes où la valeur règne en maître, sa fameuse saturation des marchés, sa fameuse insuffisance du consommateur". Mais il est évident que ceci traduit une incompréhension et une falsification délibérée de la pensée de Luxembourg4 Celle-ci voit l'expansion du capitalisme aux aires périphériques de la production pré-capitaliste en tant que solution au problème des marchés saturés dans les aires existantes de la production capitaliste. C'est à travers l'extension géographique du capitalisme que les nouveaux marchés sont créés afin de compenser la contraction du marché domestique.
Ici Luxembourg suivait la conception propre à Marx, comme nous l'avons déjà montré dans "Marxisme et Théorie des Crises" (Revue Internationale n°13). Là où Luxembourg va au-delà de Marx, c'est dans la détermination des limites historiques de ce processus de "l'expansion des champs de production". Mais par là même, elle détermine ainsi les limites historiques de l'accumulation elle-même; la conjoncture historique ou la baisse tendancielle du taux de profit ainsi que la contraction du marché cessent d'être les éperons du développement capitaliste et deviennent les aspects complémentaires d'une crise mortelle qui condamne le capitalisme à un cycle toujours plus approfondi de diminution de la rentabilité et de contraction des marchés et dont l'aboutissement est la seule alternative : guerre ou révolution, socialisme ou barbarie.
Quand la CWO affirme que l'analyse économique de Luxembourg amène à des confusions politiques sérieuses, qui peuvent conduire à des positions anti-communistes, nous pouvons leur répondre que c'est Luxembourg qui a fourni la réponse la plus claire à la question politique la plus importante pour le prolétariat durant les soixante dernières années : la décadence historique et globale du capitalisme. C'est de la compréhension claire de la décadence en tant que réalité permanente du capitalisme contemporain, que toutes les positions défendues par les minorités révolutionnaires dépendent.
Aucune des analyses basées seulement sur la baisse du taux de profit n'a pu, jusqu'à aujourd'hui, expliquer cette réalité. Les tables mathématiques de Grossman prétendent montrer comment éventuellement, le moment longuement attendu va surgir où le capitalisme ne pourra plus fonctionner à cause d'une pénurie absolue de la plus-value. Mais Grossman était incapable de faire le rapport entre son modèle abstrait et la réalité alors que d'autres forces avaient déjà projeté le capitalisme dans une époque de déclin irréversible. Mattick, qui en discutant avec le CCI a insisté sur le fait que la crise finale du capitalisme n'arriverait peut-être pas avant mille ans, a enfin reconnu dans ses oeuvres récentes ([16] [31]) que cette analyse économique n'amène aucune conclusion définitive sur le futur du capitalisme. Mattick et Grossman en plus insistent sur le fait que les économies du capitalisme d'Etat, telles la Russie et la Chine, sont immunisées contre les effets de la crise. Grossman a soutenu la Russie stalinienne jusqu'à la fin de sa vie. La CWO, elle aussi, malgré sa compréhension politique de la décadence, comme phénomène global et permanent, a une analyse économique qui repousse l'effondrement du capitalisme à un futur indéfini. Cela les conduit à la position absurde et contradictoire que le capitalisme est décadent mais "que la fin du capitalisme n'est pas en vue" ([17] [32]).
Nous n'avons pas la place dans ce texte de discuter plus avant des sérieux dangers politiques qui accompagnent cette sous-estimation de la profondeur de la crise actuelle. Mais tout cela nous rappelle curieusement les critiques faites à l'époque à Luxembourg par les "petits experts de Dresde" (adeptes du marxisme orthodoxe), qui, tandis que le capitalisme plongeait à toute vitesse vers la première guerre mondiale, spéculaient sur la possibilité d'une nouvelle époque de "capitalisme paisible" et qui adhérant strictement à"l'orthodoxie marxiste" insistaient sur le fait "qu'éventuellement, dans le futur lointain, le capitalisme s'effondrerait à cause de la baisse du taux de profit".
Bien sûr, tous ceux qui adhérent à là théorie de la baisse du taux de profit ne suivent pas ces renégats dans le chemin de la contre-révolution. Comme nous l'avons montré, une analyse politiquement correcte ne découle pas directement d'une analyse économique ; au contraire, elle dépend d'une capacité à s'en tenir fermement aux principes fondamentaux du marxisme: nécessite historique du socialisme et nature révolutionnaire de la classe ouvrière.
De même, la détermination des intérêts de la classe ouvrière ne découle pas des analyses économiques» mais directement de l'expérience et des leçons de la lutte de classe. C'est sur cette base que Lénine et Boukharine pouvaient» malgré les limites de leur analyse économique, défendre les Intérêts du prolétariat mondial en 1914. Par contre, une analyse "luxembourgiste" ne garantit pas en sol une adhésion aux positions révolutionnaires : deux "luxembourgistes" de l'après-guerre, par exemple, Steinberg et Lucien Couvât, soutenaient politiquement des sociaux-démocrates contre-révolutionnaires.
Mais si nous rejetons le rapport mécanique que la CWO volt entre l'analyse économique et les positions politiques, cela ne veut pas dire que nous considérions l'analyse économique comme superflue. Au contraire, nous reconnaissons qu'une analyse économique cohérente est un facteur vital pour la conscience prolétarienne. En soudant toutes les leçons de l'expérience de la classe ouvrière en une vue unifiée du monde, elle donne au prolétariat la capacité de comprendre et donc d'affronter de façon plus décidée tous tes problèmes qu'11 rencontre pour son émancipation.
Evidemment, nous avons une longue route à parcourir avant de pouvoir comprendre complètement le développement du capitalisme depuis 1914 et particulièrement depuis 1945. Comme nous avons dit au début de ce texte, ces points seront soulevés dans des textes futurs de cette revue. Mais nous affirmons encore qu'une analyse "luxemburgiste" peut fournir une analyse cohérente de la réalité politique à laquelle s'affronte le prolétariat aujourd'hui.
Pour résumer : nous rejetons l'analyse de la CWO, fondée exclusivement sur la baisse tendancielle du taux de profit parce que :
- c'est une analyse partielle qui ne peut pas en soi expliquer les forces économiques qui mènent à l'effondrement du capitalisme. En tant que théorie abstraite, elle mène logiquement à la conclusion que la production capitaliste peut continuer Indéfiniment;
- de plus, elle mène à une sous-estimation ou même un rejet de la profondeur et des conséquences de la crise actuelle.
Nous suggérons vigoureusement que les camarades de la CWO cessent d'essayer de montrer que nous sommes loin de la fin du capitalisme, risquant ainsi de faire un pas hors des pages du tome III du "Capital" et des analyses abstraites de Grossman et Mattick. Ainsi, pourront-Ils porter leur attention sur la crise actuelle et ses Implications politiques pour la lutte prolétarienne et le mouvement révolutionnaire.
Quant à nous, nous nous proposons de continuer le travail Important de l'analyse économique et nous nous donnons les deux tâches suivantes :
- développer notre analyse du capitalisme depuis 1914 et particulièrement depuis 1945 afin de situer la crise actuelle dans le cadre de la crise permanente du capitalisme depuis 1914;
- exposer toutes les théories qui ont surgi hors et dans le camp prolétarien et qui nient la réalité de la crise actuelle, rejettent la crise du capitalisme & un futur Indéterminé ou prétendent que les contradictions du capitalisme peuvent être surmontées dans le cadre de l'économie du capitalisme d'Etat ou de"l'Etat ouvrier".
Nous prenons pour cadre de notre travail la compréhension marxiste de l'économie politique souligné par Luxembourg en 1916 :
"Dans la théorie de Marx, l'économie politique a trouvé son achèvement et la conclusion. La suite ne peut plue être -à part certains développement de détails de la théorie de Marx- que la transposition de cette théorie dans l'action, c'est-à-dire la lutte du prolétariat international pour réaliser l'ordre économique socialiste. La fin de l'économie politique comme science est une action historique de portée mondiale : la traduction dans la pratique d'une économie mondiale organisée selon un plan. Le dernier chapitre de la doctrine de l'économie politique, c'est la révolution sociale du prolétariat mondial".
R.Weyden
[1] [33] Voir "The Accumulation of Contradictions" dans "Revolutionary Perspectives" (RP) n°6.
[2] [34] "Crédit and Crisis" dans RP n°8, page 20.
[3] [35] Mattick : "Grossman's Interpretation of Marx's Theory of Capitalist Accumulation's"
[4] [36] Mattick, Idem page 7.
[5] [37] Marx : "Capital, tome III".
[6] [38] Luxembourg : "L'Anti-critique" dans "l'Accumulation du Capital".
[7] [39] Mattick : "Marx et Keynes"
[8] [40] Marx, idem
[9] [41] Voir "Crédit and Crisis" dans RP n°3
[10] [42] Voir la brochure du CCI "La Décadence du Capitalisme" pour une description plus détaillée des points suivants.
[11] [43] Voir "Marxisme et Théorie des Crises" dans la Revue Internationale n°13
[12] [44] En fait, le contraire serait étonnant puisque le marxisme a toujours compris que la production de la valeur et sa réalisation (c'est-à-dire la vente), sont deux aspects intimement liés du même processus. Les crises dans le processus de production elle-même se reflètent au niveau de l'échange et vice-versa. Quand la CWO condamne Luxembourg parce quelle voit surgir la crise dans le "domaine secondaire" de la distribution, ils oublient évidemment la longue lutte de Marx et Engels contre le "socialisme vulgaire qui reprenait des économistes bourgeois le fait de considérer et de traiter de la distribution comme Indépendante du mode de production" -contre, comme Engels l'a dit plus violemment "la bêtise qui en arrive à écrire sur l'économie politique sans avoir compris le lien entre la production et la distribution". (Marx : "Critique du Programme de Gotha, et Engels : "Anti-Dühring").
[13] [45] Mattick : "Marx et Keynes".
[14] [46] Grossman : "Marx, l'Economie Politique Classique et le problème de la Dynamique"
[15] [47] Mattick, idem
[16] [48] Voir par exemple "Critique of Marcuse".
[17] [49] RP n° 8, page 28
Questions théoriques:
- L'économie [50]
Heritage de la Gauche Communiste:
Ascension et déclin de l’autonomie ouvrière
- 2946 reads
Les événements de l'année dernière ont vu se braquer les projecteurs de l'actualité sur l'Autonomie Ouvrière (notamment en Italie), nouvelle incarnation du démon pour la presse bourgeoise. Mais ils ont mis aussi en évidence la façon dont ce "milieu autonome" a perdu tout motif de se réclamer de la classe ouvrière. En effet, aujourd'hui, on parle de "l'Aire de l'Autonomie" et non plus de l'Autonomie Ouvrière. Celle-ci est devenue un écumeux ramassis de toutes sortes de franges petites-bourgeoises : des étudiants aux acteurs de rue, des féministes ceux professeurs à l'emploi précaire, tous unis dans l'exaltation de leur propre "spécificité" et dans le refus effrayé de la nature de la classe ouvrière corme seule classe révolutionnaire de notre époque. Dans ce marais, les autonomes "ouvriers" se distinguent par une plus grande dureté sur les grandes questions politiques d'aujourd'hui : faut-il utiliser les cocktails Molotov dans le sens offensif ou défensif ? Le P.38, ce mythique passe-partout du communisme doit-il être pointé sur les jambes des flics ou plus haut ?
Il y a tout de même, dans ce cadre de dégénérescence totale, une réaction aux tentatives critiques des conceptions confusionnistes et interclassistes, d'éléments restés liés à une vision plus classiste. Même s’il faut encourager ces tentatives, il faut aussi dénoncer les graves dangers dans lesquels ces dernières risquent de tomber en considérant ces déviations comme des "incidents de parcours" et en conclure de nouveau qu'il est possible "de recommencer à nouveau".
Cet article traite essentiellement de l'Autonomie Ouvrière en Italie, car c'est là que ce mouvement s’est essentiellement développé. Mais ses conclusions sont autant applicables aux partisans de la recherche du nouveau gadget politique, "l'Autonomie", partisans qui ont germé dans le monde entier. [Lire à ce sujet Rupture avec CPAO). Dans cette contribution à la discussion, nous avons analysé les bases théoriques mêmes de l'Autonomie Ouvrière, en indiquant comment elles se fondent en fait sur le rejet du matérialisme marxiste et laissent la porte ouverte à toutes les dégénérescences qui se sont manifestées ultérieurement.
C'est aussi à travers la critique la plus radicale du mouvement de l'Autonomie ouvrière et toutes ses erreurs que demain dans sa lutte, le prolétariat retrouvera le contenu politique de son autonomie de classe.
Avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, les manifestations des luttes ouvrières se sont profondément modifiées, car les longs combats, qui ont duré parfois des années, pour obtenir des améliorations comme la journée de huit heures, etc., n'ont plus de sens, étant donné l'impossibilité d'obtenir une quelconque amélioration de fond dans un système qui ne peut plus rien offrir. Par contre, les luttes ouvrières dans la période de décadence sont caractérisées par des explosions imprévisibles et souvent très aiguës, suivies par de longues périodes de calme apparent tandis que de nouvelles explosions se préparent.
En Italie, il a été particulièrement difficile de comprendre cette nature discontinue de la riposte ouvrière à la crise, à cause de l'extraordinaire continuité des luttes, ouvertes par le "69 de l'automne chaud", poursuivies en 70-71 avec "l'automne rampant' et terminées avec les derniers soubresauts de "l'automne 72 à mars 73" (occupation à la Fiat Mirafiori). Dans cette dernière période de lutte, les groupes extraparlementaires se sont clairement caractérisés comme les chiens de garde des chiens de garde (syndicats) du capital en perdant une bonne partie de l'influence acquise dans les années 69 dans les secteurs ouvriers les plus combatifs. "Les conventions de 1972-73 sont de ce point de vue la limite extrême au-delà de laquelle les groupes n'ont fait que survivre" (Potere Operaio n°50, novembre 73).
Les groupes autonomes d'usine ont leur origine dans la méfiance qu'ils éprouvent envers les groupuscules, mais cette méfiance n'aboutit pas à une opposition â leur contenu politique. Aussi différents que puissent être les motifs de des groupes et des individus qui se sont reconnus dans le milieu de l'autonomie, il y a un point commun à tout le monde : la tendance à mettre au centre de leurs préoccupations le point de vue ouvrier. C'est pourtant justement de ce point de vue du rappel d'une conception cl assiste de la lutte politique que le milieu autonome enregistre sa faillite la plus éclatante. A la disparition ou pire à la transformation en noms vides de sens de la grande majorité des groupes autonomes ouvriers, a correspondu un développement incroyable d'une autonomie qui, loin d'être ouvrière, possède une seule unité, celle de la négation de la classe ouvrière comme axe fondamental de leurs préoccupations.
Féministes et homosexuels, étudiants angoissés par la perte du mirage d'un petit emploi dans les bureaux de l'administration locale ou dans l'enseignement et artistes "alternatifs" en crise par manque d'acheteurs, forment un seul pour revendiquer leur "spécificité" précieuse autonomie par rapport à 1 mi nation ouvrière dans les groupes extraparlementaires (?!!!). Contrairement à ce qu'écrivent les journaux bourgeois, ces mouvements marginaux ne représentent pas les "cent fleurs" du printemps révolutionnaire, mais quelques uns des mille et un pièges purulents de cette société en dégénérescence. Cette année écoulée, le processus de dégénérescence est arrivé à un tel niveau que certains éléments plus "classistes" sont contraints de prendre un certain recul par rapport à l'ensemble du milieu autonome et de commencer un processus de critique des expériences passées. Même si ces tentatives sont positives, elles possèdent en elles-mêmes de profondes limites : en effet, elles prennent et dénoncent seulement les positions plus facilement critiquables du marginalisme pour leur opposer les options "classistes" comme positions ouvrières, sans qu'aucun fondement sur lesquels s'est fondée l'aire de l'autonomie ne soit réellement remis en cause.
Le but de cet article est donc de régler les comptes avec les fondements théoriques de l'autonomie et de montrer comment le marginalisme, même"ouvrier" n'est pas seulement son fils bâtard et dégénéré, mais représente bien sa conclusion logique et inévitable. Pour ce faire nous analyserons la théorie de la "crise de la direction" qui est à la base de toutes les positions politiques de l'Area dell'Autonomia (traduction approximative:"milieu autonome").
(°) L'Area dell’Autonomia peut se comprendre comme étant la zone d'influence des idées autonomes dans laquelle évoluent ses différents éléments.
AUX ORIGINES DE LA "CRISE DE LA DIRECTION": LE REJET DU CATASTROPHISME ECONOMIQUE MARXISTE
Si la longue période de prospérité de la fin du XIXème siècle avait pu donner naissance à toute une série de théories sur le passage graduel du capitalisme au socialisme, par l'élévation de la conscience des travailleurs, l'entrée du système dans sa phase décadente avec la première guerre mondiale, marque la confirmation historique des vieilles formulations "catastrophiques" de Marx sur l'effondrement inévitable de l'économie marchande. Alors, il est devenu clair qu'une seule alternative se pose à l'humanité : révolution ou réaction, et la révolution n'est pas"ce que pense devoir faire tel ou tel prolétaire ou même le prolétariat tout entier à un moment donné mais ce qu'il sera historiquement contraint de faire "(Marx). C'est pourquoi après la défaite de la vague révolutionnaire des années 20 et le passage de l'Internationale Communiste à la contre-révolution, les groupes révolutionnaires naissants ont toujours défendu le principe marxiste qu'"une nouvelle vague révolutionnaire surgirait seulement d'une nouvelle crise" (Marx). Cependant, l'absence d'une reprise prolétarienne après la deuxième guerre mondiale -selon le schéma de l'Octobre Rouge- mais aussi la période de santé du capital liée à la reconstruction a dispersé ces petites fractions en les condamnant le plus souvent à la disparition.
Comme produit de cette période, on a vu surgir de nouvelles théories prétendant dépasser la vision marxiste des crises et comme le faisait le groupe Socialisme ou Barbarie ([1] [52]) en France affirmant que le capitalisme avait dépassé ses contradictions économiques. Les conclusions anti-marxistes de Socialisme ou Barbarie se sont propagées au travers de toute une série de groupes dont l'un des plus connus fut certainement l'Internationale Situationniste.
Mai 68 fut le chant du cygne d'une telle position : la réapparition du mouvement ouvrier sur la scène de l'histoire, quand la crise économique ne s'était pas encore développée dans toute -son ampleur, a fait croire à ces malheureux que le mouvement n'avait pas de base économique :
"Quant aux débris du vieil ultra-gauchisme non trotskiste (...) maintenant qu'ils ont reconnu une crise révolutionnaire en Mai, il leur faut prouver qu'il y avait donc là, au printemps de 68 cette crise économique invisible. Ils s'y emploient sans crainte du ridicule en produisant des schémas sur la montée du chômage et des prix".
(Internationale Situationniste n912, décembre 1969)
En effet, pour les théoriciens de la "société du spectacle", seulement une crise spectaculaires pouvait être visible. Les marxistes, par contre, n'ont pas besoin d'attendre que l’évidence des choses s'impose sur les couvertures de la presse ou arrive à pénétrer dans le cerveau des notables de la bourgeoisie, pour reconnaître et saluer l'imminence et la portée de la nouvelle crise. Même s'ils étaient éloignés du centre du monde capitaliste, une poignée de camarades au Venezuela, "ultragauchistes", pouvait écrire en janvier 68 dans leur revue Internacionalismo :
"L'année 67 nous a laissé la chute de la livre-sterling et 68 nous apporte les mesures de Johnson (...) Nous ne sommes pas des prophètes, et nous ne prétendons pas savoir quand et de quelle façon les événements futurs vont avoir lieu. Nous sommes certains, par contre, qu'il est impossible d'arrêter le processus que subit actuellement le capitalisme avec des réformes ou des dévaluations, ou avec un autre genre de mesures économiques capitalistes et qu'inévitablement, ce processus le mène vers la crise. Par là même, le processus inverse, celui du développement de la combativité de la classe, qui en général, a lieu actuellement, va conduire le prolétariat à une lutte sanglante et directe en vue de la destruction des Etats bourgeois".
L'irruption sur la scène historique de la classe ouvrière à partir de 68, enlève aux partisans de la "fête révolutionnaire", toute possibilité de parler en son nom : en 1970, l'IS se dissout dans une orgie d'exclusions réciproques; à partir de là, les explosions périodiques de révolte qui expriment la décomposition de la petite-bourgeoise ne sont jamais arrivées même à constituer une Internationale Situationniste. Toutes les expressions postérieures n'ont réussi qu'à être du simple folklore.
LE VOLONTARISME A COULEUR OUVRIERE ET LA CRISE de la DIRECTION
L'entrée sur la scène historique de la classe, en plus de la disparition des situationnistes et des différents contestataires, impose un renouvellement des théories sur le contrôle de la crise pour tenir compte de la nouvelle réalité. Au lieu de simplement nier la possibilité de la crise (comment peut-on le faire maintenant ?) on réévalue le côté actif de la thèse : étant donné que le capitalisme contrôle la crise économique, ce qui ouvre la voie à la véritable crise économique est la crise de ce contrôle même à la suite de l'action ouvrière ([2] [53]).
Ce thème, qui était déjà présent dans les derniers textes des situationnistes parmi les pastorales sur "la critique de la vie quotidienne'' devient Taxe des positions des nouveaux social-barbares, qui seront donc"marxistes"et"ouvriers". C'est significatif qu'en France, la tentative avortée de création sur cette base d'une gauche marxiste pour le pouvoir des conseils des travailleurs en 1971, soit partie du groupe Pouvoir Ouvrier, héritier "marxiste" de Socialisme ou Barbarie.
En Italie ces positions étalent exprimées fondamentalement par le groupe Potere Operaio et nous allons donc analyser ces conceptions ([3] [54]).
Le groupe part de la reconnaissance de (a toute puissance du "cerveau théorique du capital", manipulateur expérimenté d'une société sans crise.: " après 1929, le capital apprend à contrôler le cycle économique, à s'emparer des mécanismes de la crise, à ne pas être écrasé et à les utiliser de façon politique contre la classe ouvrière", pour proposer cette solution : "l'objectif stratégique de la lutte ouvrière -plus d'argent et moins de travail- lancé contre le développement, a vérifié le théorème duquel nous étions parti il y a 10 ans : introduire un nouveau concept de crise de l'état du capital, plus de crise économique spontanée, à cause de ses contradictions internes, mais crise politique provoquée par les mouvements subjectifs de la classe ouvrière, par ses luttes revendicatives".([4] [55])
Ayant nié "qu'une nouvelle vague révolutionnaire ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une nouvelle crise", il faut encore expliquer pourquoi cette subjectivité ouvrière a décidé de se réveiller en 1968-1969 et non pas, par exemple, en 1954 ou 1982. Les explications sur les origines du cycle des luttes révèlent toute l'incompréhension ou, pour dire mieux, la méconnaissance, par Potere Operaio, de l'histoire du mouvement ouvrier.
La défaite des années 20, l'expulsion et ensuite l'extermination des camarades par l'Internationale passée à la contre révolution, tout cela n'existe pas d'après Potere Operaio, étant donné que tout cela sort des limites de l'usine. Pour PO, le fait central est l'introduction du travail à la chaîne, qui "déqualifie tous les ouvriers, faisant reculer la vague révolutionnaire" et ce serait seulement dans les années 30, pour n'avoir pas compris la restructuration de l'appareil productif faite sur la base des théories économiques de Keynes, que les organisations historiques se seraient trouvées "à l'intérieur du projet capitaliste". Ayant posé ainsi la question, ayant rejeté l'expérience historique de la classe, il ne vaut pas la peine de se demander pourquoi c'est seulement en 68 que les ouvriers ont appris (...)" qu'une nouvelle société et une nouvelle vie sont possibles, qu'un monde nouveau, libre, est à portée de la lutte". Il suffira de répondre : "Où sont elles ces conditions objectives sinon dans la volonté politique subjective, organisée, de parcourir jusqu'au bout la voie révolutionnaire ? "(PO n°38-39 - Mai 1971). Sur cette base la proposition organisationnelle que PO fait à toutes les avant-gardes ne pourra se fonder que sur le mépris le plus absolu de tout l'autonomie réelle de la classe ouvrière, considérée comme cire molle dans les mains du Parti qui, pour grande consolation, "est à l'intérieur de la classe" ": "Nous avons toujours combattu la lie opportuniste qui appelait "spontanéisme" la spontanéité, au lieu d'appeler impuissance sa propre incapacité à la diriger et à la plier à un projet organisationnel à une direction de parti" (PO n*38-39-Page4, souligné par nous).
Le centre des contradictions de PO est que quand il parle du Parti comme fraction de la classe, il ne veut pas parler de l'organisation qui regroupe autour d'un programme clair, donc sur une base politique claire, les éléments les plus conscients qui vont se former dans les luttes ouvrières quelle que soit leur origine sociale; il veut parler d'une couche, d'un pourcentage de la classe, qui est directement indiqué, du point de vue sociologique, dans "l’ouvrier-masse, l'avant-garde de masse de la lutte contre le travail". Le menchévik Martov défendait contre le bolchevik Lénine la thèse que "chaque gréviste est membre du parti". Les "bolcheviks" de PO ont remis à neuf Martov : "Chaque gréviste dur est membre du Parti". Le Parti n'est qu'un grand comité de base et son seul problème est de soumettre à l'hégémonie de l’ouvrier-masse""!a passivité et la résistance de certaines couches de la classe".
Pour réveiller les ouvriers, il faut leur donner le plan organisationnel tout prêt : "Pourquoi (...) le syndicat a t'il encore en mains la gestion des luttes ? Seulement à cause de sa supériorité organisationnelle. Donc, nous avons à faire face à un problème de gestion. Un problème de réalisation d'un minimum d'organisation, au-delà duquel une possibilité de gestion du combat est crédible et acceptable". Quand on superpose le Parti aux fractions combatives de la classe, il est inévitable que face au reflux progressif de la combativité, le parti va toujours plus se substituer à la classe, dans une progression "complètement subjective" d'ascétisme et de militarisation".
LA FORMATION DE LA RE A DELL' AUTONOMIA ET LA DISSOLUTION DE POTERE OPERAIO
Les luttes ouvrières de l'automne 72, terminées avec l'occupation à la Fiat-Mirafiori en mars 73 provoquèrent d'un côté une perte de crédibilité des groupuscules gauchistes chez les ouvriers (ce qui mena à l'extension des organismes autonomes), et de l'autre côté la crise interne de PO. La ligne hyper-volontariste et militarisée et critiquée, parce que celle-ci théorise que : "la structure militaire est la seule qui est capable de remplir un rôle révolutionnaire, en niant la lutte de classe et le rôle politique des comités ouvriers." (P0n°50, novembre 73). Cependant cette dénonciation n'arrive pas à s'attaquer aux bases théoriques de cette dégénérescence, et elle se présente plus comme réaffirmation des thèses de PO que comme une critique de celle-ci.
En effet ce qui se passe, c'est un renouvellement de la vieille thèse, pour expliquer d'une certaine manière pourquoi, en l'absence de luttes ouvrières, la crise allait s'aggraver dans tous le les pays : si avant, on insistait sur la crise provoquée par les avant-gardes, maintenant c'est la thèse qui aura la plus grande chance de prendre le dessus, c'est-à-dire la thèse de la crise provoquée à dessein par les capitalistes. "Les capitalistes crient et éliminent la crise économique toutes les fois qu'ils le croient nécessaire, toujours dans le but de battre la classe ouvrière. ("Des luttes au développement de l'organisation autonome ouvrière" des Assemblées autonomes Al-fa-Romeo et Pirelli et Comité de lutte Sit-Siemens, mai 73).
Encore une fois, il y a le refus d'un bilan de l'expérience historique du prolétariat, en se bornant à rire justement de la forme du parti propre à la Troisième Internationale", Or, quand la classe réfléchit sur son propre passé, elle ne le fait pas pour en rire ou en pleurer mais pour comprendre ses erreurs, et sur la base de ses expériences tracer une ligne qui soit de classe et de démarcation de l'ennemi de classe. Le prolétariat révolutionnaire ne "rit" pas du "marxisme-léninisme dépassé de Staline" pour mieux glorifier celui remis à "neuf" par Mao Tsé Toung, mais les dénonce tous les deux en tant qu'armes de la contre-révolution. C'est justement ce que nos néo-autonomistes ne veulent pas faire : De ce point de vue, nous refusons toute dogmatique (?!) distinction entre léninisme et anarchisme : notre léninisme est celui de "l'Etat et la Révolution", et notre marxisme-léninisme est celui de la révolution culturelle chinoise".(PO n°50, page 3)
Quel est en conclusion le rôle des révolutionnaires ? "Nous devons être capables de réunir et organiser la force ouvrière, ne pas nous substituer à elle" (4). Cette phrase représente la limite insurmontable au-delà de laquelle l'Autonomia Opérai a n'a jamais été capable d'aller, c'est-à-dire de considérer substitutionnistes seulement les conceptions d'après lesquelles la révolution est faite par les députés avec des réformes ou les étudiants "militarisés" avec les cocktails molotov. Par contre, est substitutionniste, celui qui nie la nature révolutionnaire de la classe ouvrière, avec tout ce que cela signifie. Quand on dit que la tâche des révolutionnaires est d'organiser la classe, on nie justement la capacité de la classe à s'auto-organiser par rapport à toutes les autres classes de la société. Les conseils ouvriers de la première vague révolutionnaire ont été créés spontanément par les masses prolétariennes, ce que Lénine a fait en 1905 n'a pas été de les organiser mais de les reconnaître et de défendre en leur sein les positions révolutionnaires du parti.
Si "l'organisation, le parti, se fonde aujourd'hui dans la lutte", une fois que la lutte est terminée, comment peut-on justifier la survivance de ce parti sans tomber dans le substitutionnisme ? Les avant-gardes, les révolutionnaires ne se regroupent pas autour de la lutte mais autour d'un programme politique, et c'est sur la base de celui-ci, qu'en tant que produit des luttes, ils deviennent à leur tour un facteur actif de celles-ci, sans ni dépendre des hauts et des bas du mouvement, ni vouloir les remplir avec leur oeuvre "organisationnelle" pleine de bonne volonté. L'incapacité de voir que classe et organisation révolutionnaire sont deux réalités distinctes, mais non opposées, est à la base des conceptions substitutionnistes qui, toutes, identifient parti et classe. Si les léninistes identifient la classe au parti, les autonomes (descendants Inconscients du conseillisme dégénéré) ne font que renverser les choses en identifiant le parti à la classe. Cette incapacité est le symptôme d'une rupture incomplète avec les groupes gauchistes et ceci est exprimé de façon éclatante par l'Assemblée Autonome de Alfa Romeo, qui arrive à théoriser un partage des tâches d'après lequel les groupes politiques font les luttes politiques (à savoir, droits politiques et civils, ant1-fascisme, en un mot tout l'arsenal des mystifications anti-ouvrières) et les organismes autonomes, les luttes dans les usines et les bureaux. Tout cela est logique pour ceux qui pensent que : "la capacité de faire sortir des prisons Valpreda avec le vote devenait un moment de lutte victorieuse contre l'Etat bourgeois (!) Alfa Romeo journal ouvrier de la lutte 1972-73, par l'assemblée autonome, octobre 1973).
Comme nous l'avons vu, l'Autonomia Operaia partait avec des bases un peu plus confuses que PO, tandis que les changements de situation en exigeaient de beaucoup plus claires. Toutes ces poussées prolétariennes qui exprimaient, bien que confuses, une saine réaction à la misérable pratique des gauchistes, étaient destinées à tourner en rond et à se perdre si elles restaient dans ce cadre confus.
LES COMPTES FAITS: BILAN D'UNE DEFAITE
"En Italie, les journées de mars 1973 à Mirafiori sont la sanction officielle du passage à la deuxième au mouvement, de la même façon que les journées de la Place d'Etat furent la première phase. La lutte armée, prônée par l'avant-garde ouvrière dans le mouvement de masse constitue la forme supérieure de la lutte ouvrière... Le devoir du parti est celui de développer dans une forme moléculaire, généralisée et centralisée, cette nouvelle expérience d'attaque". (PO novembre 73)
Avec ces paroles pleines d'illusions béates sur la "formidable continuité du mouvement italien, PO annonçait sa propre dissolution dans"l'aire de l'autonomie" et l'imminente centralisation de cette aire en tant que : "fusion de volonté subjective, capacité de battre le cycle des luttes dominées par le patronat et par les syndicats, pour imposer au contraire l'initiative de 1 'attaque (PO, 1973), Comme on voit le sigle change mais les vieilles illusions sur la possibilité de mettre sur pied à volonté des cycles de luttes ouvrières sont dures à nourrir. Hélas pour les illusions, Mirafiori 73 n'a pas été le tremplin vers l'extension d'un nouveau niveau de lutta armée mais le dernier sursaut du mouvement avant d'entrer dans une longue période de reflux. Comment expliquer cette interruption dans la formidable continuité du mouvement italien ? En se souvenant qu'elle est une caractéristique typique des luttes ouvrières aujourd’hui, luttes qui se déroulent dans le cadre du capitalisme décadent, incapable d'améliorer en général les conditions de vie des travailleurs. De plus, même les miettes accordées lors du "boom" de la reconstruction après la seconde boucherie mondiale ont été récupérées; la crise économique ouverte depuis les années 60 est revenue exaspérer cette situation.
Avec le premier véritable effondrement de l'économie italienne, qui se vérifie justement en 1973, la marge: de manoeuvre déjà étroite des syndicats pour demander des augmentations de salaires se resserrera de manière draconienne (c'est à ce moment que se produit l'écroulement des dernières illusions sur un syndicalisme combatif, autonome par rapport aux partis, et sur le rôle des conseils d'usines). De plus en plus souvent, les grèves mêmes longues et violentes se terminent sans qu'aucune des revendications de la classe ouvrière n'ait été obtenue; en un tout, les ouvriers découvrent, défaite après défaite, que pour défendre leurs conditions de vie, 11 faut désormais s'attaquer directement à l'Etat, dont les syndicats ne sont qu'un rouage. Pour caractériser cette phase, qui avec des particularités différentes s'est présentée dans tous les pays industrialisés, nous avons souvent dit que c'était comme si la classe ouvrière reculait face à ces nouveaux obstacles pour mieux pouvoir prendre son élan. Ces années d'apparente passivité ont été des années de maturation souterraine et celui qui croyait que ce reflux serait éternel peut s'attendre déjà à quelques désillusions. En fait, la difficulté de défendre victorieusement ses propres conditions de vie, peut désorienter et démoraliser les ouvriers, mais à la longue elle ne pourra que les rejeter de nouveau dans la lutte, avec une rage et une détermination cent fois plus grande.
Face aux reflux, les réponses de "l'autonomie" sont essentiellement de deux types :
1) la tentative volontariste de contrebalancer le reflux, grâce à un activisme toujours plus frénétique et toujours plus "substitutionniste" par rapport à la classe.
2) Le déplacement graduel de la lutte de l'usine à de nouveaux terrains de combat, évidemment "supérieurs".
Sur cette progressive différenciation entre les "durs" et les "alternatifs", trébuche et se brise le projet de centralisation de "l'Aire de l'Autonomie" ambitieusement ressorti au moment où PO se fondait au sein de la constitution de la Coordination Nationale. Ces deux lignes ont été, grosso modo le terrain sur lequel se sont développées les deux déviations symétriques, le terrorisme et le marginalisme, qui finissent toujours par se recouper.
Sans avoir la prétention d'analyser à fond ces deux "filons", à propos desquels nous reviendrons certainement, il est quand même important de démontrer qu'ils sont le développement logique de leur origine ouvriériste et non sa négation.
"Quand la lutte ouvrière pousse le capital à la crise, à la défensive, l'organisation ouvrière doit déjà avoir des instruments techniquement préparés (souligné par nous), solides, grâce auxquels on pourra étendre, renforcer et pousser la volonté d'attaque de la classe... Susciter, organiser la révolution ininterrompue contre le travail, déterminer et vivre tout de suite des moments de libération... Telle est la tâche de V} avant-garde ouvrière et notre conception de la dictature" (4)
Comme on le voit déjà, PO exprime clairement les positions de fond qui sont à la base de sa "ligne" terroriste.
1) D'une part la vision de la crise comme étant Imposée par la lutte de classe.
2) D'autre part la conception de révolutionnaires organisateurs techniques de la lutte de classe; c'est pourquoi il leur faut arriver à un certain type d'organisation" pour être crédible face à la classe ouvrière et pouvoir rivaliser les syndicats sur le terrain de la "gestion" des luttes.
Au fur et à mesure que la vague de 68 s'est effilochée, on augmente les "trucs" qu'un bon technicien de la guérilla en usines doit connaitre pour conduire ses camarades de travail vers la "terre promise". Ainsi nait et se développe la Rustique de "l'enquête ouvrière" c'est-à-dire de l'étude, de la part de l'avant-garde, de la structure de l'usine -et du cycle productif, pour en repérer les points faibles : il suffira de toucher ceux-ci pour bloquer le cycle entier et "coincer" les patrons. Mais comme d'habitude, ce qu'il y a de bon n'est pas nouveau, et ce qui est nouveau n'est pas bon. L'idée de frapper sans préavis au moment et là où cela causera le plus grand préjudice aux patrons sans qu'il y ait trop de perte pour les ouvriers, ceci n'est pas une idée mais une découverte pratique pour la classe et a un nom précis : grève sauvage. Ce qu'il y a de nouveau, c'est l'idée (et ceci n'est pas qu'une idée), que la grève sauvage peut être programmée par les avant-gardes, ce qui est une contradiction dans les termes.
On pourrait nous répondre que tout ceci est vrai mais que si on ne connait pas l'usine, on ne peut unir les luttes des différents services, on se perd, etc. Très juste, mais il n'est pas certain que c'est avec les "études" nocturnes de quelques militants que les ouvriers, par exemple du "vernissage" apprendront à s’orienter dans la carrosserie ou la presse. C'est au cours de sa lutte que la classe résout pratiquement le problème des grilles : en les défonçant.
Ce point, qui pourrait sembler secondaire, montre clairement qu'une telle vision technico-militariste considère la lutte de classe sous un faux angle. Ce n'est pas le fait d'avoir dans chaque groupe des camarades avec le plan de l'usine imprimé en tête qui permet l'unification des luttes; c'est l'exigence d'unifier les luttes pour sortir des impasses aveugles des luttes sectorielles qui pousse la classe à dépasser les obstacles qui s'opposent à cette unification. Pour partir en cortège appeler les ouvriers des autres usines, la chose fondamentale n'est pas de savoir où est la sortie mais d'avoir compris que seule la généralisation des luttes peut mener à la victoire. En réalité les obstacles les plus redoutables ne sont pas les grilles, mais ceux qui à l'intérieur de la classe s'opposent avec leur démagogie à la maturation de sa conscience. Le vrai mur à abattre c'est celui fabriqué jour après jour par les délégués syndicaux, par les activistes des partis et des groupuscules"ouvriers", c'est le mur invisible mais solide qui enferme le prolétariat à l'intérieur du "peuple italien" et le sépare de ses frères de classe du monde entier, c'est la chaîne visqueuse qui le lie au sort de l'économie nationale en difficulté. Dépouiller ces obstacles de leurs travestissements démagogues et extrémistes, en dénoncer la nature contre-révolutionnaire, voilà le rôle spécifique des révolutionnaires à l'usine et en dehors, voilà leur contribution indispensable pour forger cette conscience et cette unité de classe qui abattront bien d'autres portes que celles de la Fiat, (il est clair que ceci n'a rien à voir avec une conception qui ferait des révolutionnaires des "conseillers" de la classe, puisque pour qu'il en soit ainsi, ils est nécessaire que ceux-ci aient une fonction active au sein du mouvement prolétarien).
C'est désormais devenu un lieu commun de voir dans les publications de l'Autonomie une critique des "Brigades Rouges" parce qu'ils "exagèrent" avec leur militarisme, parce qu'ils se coupent des masses, etc.. Les Brigades Rouges ont simplement parcouru jusqu'au bout la pente inclinée du volontarisme dans la tentative impossible de répondre par un "saut qualitatif" des avant-gardes aux nouvelles difficultés du mouvement de classe.
Le fait que toutes les critiques de l'Autonomie Ouvrière aux Brigades Rouges ne sont jamais allées au-delà des habituelles lamentations opportunistes sur le caractère prématuré de certaines actions, etc., sans jamais arriver à l'essentiel, n'est certainement pas un hasard, mais trouve ses racines dans les théorisations mêmes de l'Autonomie Ouvrière :
"Une théorie insurrectionnelle "classique" n'est plus applicable aux métropoles capitalistes; elle se révèle dépassée^ comme est dépassée l'interprétation de la crise en termes d’effondrement... La lutte armée correspond à la nouvelle forme de la crise imposée par l'autonomie Ouvrière de même que l'insurrection était la conclusion logique de la vieille théorie de la crise comme effondrement économique". (PO mars 197Z)
On ne peut pas rejeter le marxisme au nom de la volonté subjective des masses et puis être en mesure de critiquer sérieusement celui qui, s'étant autoproclamé "parti combattant", cherche à accélérer le cours de l'histoire en apportant aux masses un peu de sa propre "volonté". Le militarisme des Brigades Rouges n'est que le développement cohérent et logique de l'activisme ouvriériste des trop célèbres "enquêtes ouvrières".
Il reste à constater que, durant ces derniers mois, tant de cohérence et de prévoyance n'a pas empêché les Brigades Rouges de devoir poursuivre à coups de communiqués et d'appels les jeunes séduits par le "parti du P.38" et qui^pouf passer à la lutte armée, n'ont pas cru devoir bon de passer par les Brigades Rouges. On pourrait parler d'apprentis sorciers incapables de contrôler des forces imprudemment déchaînées. Rien de plus faux : cette incapacité à contrôler les pistoleros métropolitains est la preuve aveuglante que cela n'a pas été l’action exemplaire"des BR, mais le processus inexorable de la crise économique qui jette dans le désespoir d'amples couches de la petite-bourgeoise.
Les "détachements d'acier du parti armé", les "chiens déchaînés" du P.38 ne peuvent rien imposer, en bien ou en mal. C'est la logique des faits qui les a imposés, ce sera la logique des faits qui les balayera.
LE MARGINALISME PAR LA LUTTE DE CLASSES EN DEHORS DE L'HISTOIRE
Tandis que les "durs" se militarisent pour se substituer au mouvement de reflux dans les usines, la plus grande partie du mouvement autonome est à la recherche de chemins de traverse plus praticables vers le communisme. Aussitôt dit, aussitôt fait : le mouvement n'est pas en reflux, voyons, il est en train d'attaquer d'un autre côté pour désorienter les patrons. C'est le lieu "magique" du territoire, comme "nouvelle dimension de l'Autonomie Ouvrière". En réalité, le déplacement de la lutte sur le "plan social", ne facilite absolument pas "le débordement" de l'initiative ouvrière de l'usine vers le territoire". La lutte contre l'augmentation des prix, des loyers, en général la lutte des quartiers ne peut que se baser I sur toute la population des quartiers. En effet, une auto-réduction du paiement de l'électricité mise en avant seulement par les familles ouvrières serait absurde et destinée à une fin rapide. Ceci signifie que l'autonomie ouvrière. Loin de s'étendre, va être au contraire emportée par le flot de la petite-bourgeoise et s'immobiliser dans l'ensemble de la population. La généralisation tant vantée de la lutte se révèle être le passage de la lutte pour la défense I de ses conditions matérielles de vie en tant qu'ouvriers à la lutte pour des droits en tant que citoyens. La réalité historique des explosions ouvrières est bien différente: elle ne suggère pas des comités populaires et interclassistes. Par sa dynamique interne déclasse, le prolétariat, aux moments cruciaux de la lutte, trouve en lui la force de dépasser les limites suffocantes de l'usine, et d'annoncer aux patrons et à ses valets ce débordement futur auquel ne pourra plus succéder nul "retour au calme". Petrograd 1917, Pologne 1970, Grande-Bretagne 1972, Espagne 1976, Egypte 1977, c'est toujours dans tes grandes concentrations ouvrières que s'est réalisée l'unification du corps collectif du prolétariat et la fissure du "peuple uni" en deux camps distincts et opposés. Ainsi la logique même de ces divers mouvements "autonomes" a été celle d'une progressive dilution du mouvement des luttes dans les usines vers les luttes petites-bourgeoises et marginales.
Du territoire comme "aire de recomposition de l'Autonomie Ouvrière" aux cercles du jeune prolétariat, du pouvoir ouvrier au pouvoir des "indiens métropolitains", la trajectoire est connue. Chaque couche de la petite-bourgeoise bousculée par la crise s'érige en "fraction de classe" et arbore le drapeau de sa propre "autonomie". Ne prenons qu'un exemple, celui du féminisme. En Italie, son"développement de masse", comme celui de tous les mouvements marginaux, est précisément lié à la"crise des groupes " (gauchistes), à la déception qui marque le reflux de la lutte de classe, quand le communisme "tout et tout de suite" n'est pas venu se placer comme le saint-esprit sur les fronts volontaires des ouvriers de la F1at-Mirafiori.
Comme toutes les conceptions idéalistes, le féminisme croit que ce sont les idéologies qui déterminent l'existence et non l'inverse. C'est pourquoi il suffirait de nier, de refuser les rôles imposés, pour provoquer la crise de la société bourgeoise. Quand on essaie d'appliquer cela à la lutte de classe, cela donne simplement une interprétation fausse (par exemple : c'est le refus du travail qui détermine la crise économique) qui devient une pure idéologie réactionnaire. C'est l'affirmation de la part de chaque couche "opprimée" de la société de sa propre autonomie, qui mettra en cause la "direction capitaliste".
Ce n'est pas par hasard si la "nouvelle façon de faire de la politique" découverte par les féministes a principalement consisté en de petits groupes "d'auto conscience" !!! C'est le destin de chaque "catégorie" de la société bourgeoise (noirs, femmes, jeunes, homosexuels, etc.) d'être totalement impuissante face à l'histoire et aussi incapable de se forger une conscience historique et de finir par se réfugier dans le giron de "l'auto-conscience" de sa propre misère. Si le prolétariat est la classe révolutionnaire de notre époque, ce n'est pas parce qu'il a été convaincu par les socialistes et qu'il s'est habitué à cette idée, mais c'est par sa situation pratique au centre de la production capitaliste.
"Si les auteurs socialistes attribuent au prolétariat ce rôle historique mondial, ce n'est pas comme le prétend la Critique, parce que nous considérons les prolétaires comme des dieux. C'est plutôt le contraire... Ce qui est important, ce n'est pas de savoir ce que pense tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat dans son ensemble... mais ce qu'il sera contraint historiquement de faire conformément à son être".(Marx et Engels : "La Sainte Famille)
Le fait que les femmes ne sont pas une couche sociale capable de conduire la lutte de classe dépend du fait qu'elles ne sont ni une classe, ni une fraction de classe mais une des nombreuses catégories que le capital oppose les unes aux autres (division en races, sexes, nations, religions, etc) pour tenter de diluer la contradiction centrale que seul le prolétariat peut résoudre :
"(Le prolétariat) ne peut se libérer sans supprimer ses propres conditions d'existence. Il ne peut supprimer ses conditions d'existence sans supprimer toutes les conditions inhumaines d'existence de la société actuelle.."(Marx, Engels : "La Sainte Famille")
C'est précisément parce qu'11 s'adresse aux femmes, c'est-à-dire à une catégorie qui, face à la crise se sépare inexorablement en deux, le long d'une frontière de classe, que le féminisme se révèle être pour le capital une mystification de seconde catégorie, incapable de détourner un nombre considérable de prolétaires de la ligne de combat de leur classe. Pour avoir une quelconque utilité, le féminisme doit être une simple carte bien mélangée dans le jeu truqué du capital avec son atout majeur 'l'alternative populaire et de gauche", la seule capable de dévier encore le prolétariat.
Le sort de tous ces mouvements marginaux est déjà signé. Durant la première boucherie mondiale, les suffragettes anglaises suspendirent toute agitation et accoururent à l'appel de l'Etat bourgeois, pour la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la patrie en remplaçant comme volontaires les hommes envoyés au front. Aux suffragettes modernes du capital ne sera pas réservé un rôle moins répugnant.
COMPRENDRE TOUT DE SUITE, RECOMMENCER! RECOMMENCER QUOI?
Les événements de ces derniers mois ont montré que le danger de ne pas aller jusqu'au bout de la critique n'était pas un produit de notre invention. Dans un texte distribué à Milan et appelé significativement "Comprendre tout de suite, recommencer !", il était écrit :
"Si quelqu'un se faisait des illusions sur le caractère "immédiat" et "linéaire" de l'affrontement, aujourd'hui cela est fini. Beaucoup de secteurs du mouvement ont affronté le heurt de classe avec une rudesse et des illusions "insurrectionnelles", avec des formes de luttes aussi soudaines et spontanées qu'incapables de poser le problème réel dans l'affrontement. L'Etat, sa structure ne se balaient pas comme un fantasme en un instant... Les masses –camarades ! - ne se mobilisent pas en un matin, à coup de baguette magique", (souligné par nous) (Tract signé par différents comités ouvriers et comités maoïstes)
Les faits sont têtus -disait Marx- et cette évidence -comme la nature de "chiens de garde"de la "légalité démocratique" des groupuscules gauchistes- a commencé à s'imposer à l'intérieur du mouvement. Mais le danger est dans l'illusion que l'on peut comprendre tout de suite, et de recommencer la même chose demain matin."Le poids des morts pèse sur la tête des vivants". Ce n'est pas en reconnaissant simplement que certaines erreurs ont été faites mais en en faisant une critique radicale que ce qu'il y a de vivant dans l'Autonomie ouvrière pourra s'enlever de la tête et du coeur le fantasme obsédant de l’ouvriérisme.
Dans les discussions avec des militants de l'Autonomie ouvrière, on en arrive toujours au même point : "Ca va, vous avez raison, mais que faire ?". Camarades, l'ambiguïté cesse immédiatement si, comme élément de l'avant-garde, on prend toutes ses responsabilités face à la classe. Et ceci ne peut se faire qu'avec un programme clair et une organisation militante. Mais un programme n'est pas une plate-forme syndicale alternative au"contrat social"de l'année, c'est une plate-forme politique qui délimite clairement les frontières de classe mises en lumière par l'expérience historique du prolétariat. Comprendre tout de suite ? Mais pendant longtemps, l'Autonomie Ouvrière a soutenu la Chine rouge, la lutte des peuples anti-impérialistes, etc… et aujourd'hui que la Chine est démasquée, que dans le Cambodge "libéré" règne la terreur, comment réagit l'Autonomie Ouvrière ? Et bien tout simplement, elle n'en parle plus. Camarades, si on ne comprend pas tout cela, si on n'arrive pas à intégrer tous ces faits "mystérieux" dans un ensemble cohérent de positions de classe, sur le capitalisme d'Etat, sur les luttes de libération nationale, sur les "pays socialistes", etc. ... on construit sur du sable et on trompe le prolétariat.
Notre but n'est pas de faire des citations, de pontifier, mais de travailler avec ténacité à ce qui est aujourd'hui la tâche fondamentale des révolutionnaires : le regroupement International pour préparer la bataille future et décisive. Remplir un tel rôle ne signifie pas pour nous la chasse aux militants pour renforcer nos rangs, mais cela signifie donner de manière organisée et militante notre propre contribution et stimulation au processus encore confus et discontinu de clarification en cours dans le mouvement de classe. C'est cette clarification qui renforcera les rangs des révolutionnaires. Nous n'avons pas de raccourcis à offrir, il n'en n'existe point. Si quelqu'un a encore l'illusion qu'il est possible de trafiquer une quelconque coordination des comités de base en parti révolutionnaire, elle lui passera et vite;: du temps a déjà été perdu, et beaucoup trop.
BEYLE
[1] [56] Scission du trotskysme dans les années 50.
[2] [57] Pour une analyse de l'interprétation marxiste de la crise, voir la brochure : "La décadence du capitalisme".
[3] [58] Nous ne voulons pas soutenir qu'il y a une descendance directe entre Socialisme ou Barbarie et Potere Operaio; ce qui est intéressant par contre, c'est de souligner que les positions que les militants et sympathisants de PO ont toujours comprises comme le produit de la reprise de la lutte de classe, ne sont que des versions ouvriéristes des vieilles positions dégénérescentes qui ont fleuri sur la défaite de la classe ouvrière. D'autre part, il faut rappeler que PO a été le seul groupe italien qui a exprimé, même si c'est de manière très confuse, cette reprise de la lutte ouvrière et que sa fin malheureuse ne doit pas faire oublier que les autres groupes, ont fini au parlement.
[4] [59] Les citations sont prises de la brochure " "Aile avanguardie per il Partito" élaborée par le secrétariat national^ de PO, en décembre 1970.
Géographique:
- Italie [60]
Courants politiques:
- Gauchisme [61]
Notes sur la gauche hollandaise, 1ere partie
- 3541 reads
Dans cet article, nous voulons présenter quelques notes sur l'histoire de la Gauche Hollandaise pour défendre le caractère marxiste de cette fraction de la Gauche Communiste qui s'est détachée de la Troisième Internationale en dégénérescence. Aujourd'hui, ce sont surtout les bordiguistes qui reprennent la vieille accusation selon laquelle la Gauche Hollandaise faisait partie du courant anarchiste. Mais hélas, ce ne sont pas seulement eux qui, par ignorance ou par manque de textes traduits de la Gauche Hollandaise et d'une analyse de son développement d'un point de vue communiste, accusent cette Gauche Communiste d'un"vie11 Idéalisme" antimarxiste ([1] [62]). Ce sont aussi les conseil listes qui prétendent être la continuation de la Gauche Hollandaise, qui soutiennent implicitement cette falsification de la nature fondamentalement marxiste de "leur origine". Dans ce dernier cas, la falsification est plus subtile : d'abord, on falsifie le marxisme lui-même avec le but de lui donner un contenu anarchiste et ensuite, on dénature habilement les textes de la Gauche Hollandaise en les torturant pour les mettre en accord avec ce"marxisme " reconstruit.
marx anarchiste?
Cajo Brendel, membre du groupe conseilliste hollandais "Daad en Gedachte" et connu internationalement comme théoricien du conseillisme et "spécialiste" de l'histoire de la Gauche Hollandaise ([2] [63]), fait de grands efforts pour trouver des citations anarchistes chez Marx et Engels. Pour prouver sa thèse selon laquelle "la révolution prolétarienne n'a pas un caractère politique mais un caractère social" ([3] [64]), il cite Engels qui dit : "La révolution sociale est tout à fait différente des révolutions politiques qu'on a vu jusqu'à présent" (souligné par nous). En ce qui concerne ce que Brendel appelle "la différence entre la révolution politique bourgeoise et la révolution sociale prolétarienne ",il se réfère aux textes de Marx: "Gloses marginales critiques à l'article : "Le Roi de Prusse et la réforme sociale par un prussien"" ([4] [65]). Lorsque Cajo Brendel cite en fait des références, il est toujours intéressant de "se rendre compte de cette charlatanerie littéraire" comme nous le dit Marx dans cet article.
Que dit Marx exactement ?:
" Une révolution "sociale" à âme politique est (...) un non-sens complexe si le "Prussien" (ou notre légataire de la Gauche Hollandaise Cajo Brendel) comprend par révolution sociale une révolution "sociale" opposée à une révolution politique {...). Toute révolution dissout l'ancienne société : en ce sens, elle est sociale. Toute révolution renverse l'ancien pouvoir: en ce sens, elle est politique (...).
La révolution en général, -le renversement du pouvoir existant et la dissolution des anciens rapports- est un acte politique. Hais, sans révolution, le socialisme ne peut se réaliser. Il a besoin de cet acte politique dans la mesure où il a besoin de destruction et de dissolution. Mais là où commence son activité organisatrice, et où émergent son but propre, son âme, ~le socialisme rejette son enveloppe politique." (souligné par Marx)
(Gloses marginales critiques â l'article : "Le Roi de Prusse et la Réforme sociale par un prussien". Edition Spartacus - n°33- Pages 89-90)
Paraphrasant Marx, nous conclurons sur la question en demandant si notre "hollandais" ne se sent pas l'obligation, vis à vis de son public de lecture, de s'abstenir provisoirement de toute journalistique historique sur le marxisme et la Gauche Hollandaise, et de commencer plutôt à réfléchir sur sa propre position anarchisante?
Heureusement, nous n'avons pas besoin d'écrire autant de pages pour démystifier les erreurs de notre "hollandais" comme Marx a dû le faire pour l'article du "Prussien". Toute sa vie, Marx, et les marxistes après lui, ont défendu le caractère politique de la révolution prolétarienne, non comme un but en sol ni pour reparler des "révolutions politiques qu'on a vu jusqu'à présent", mais parce que : ([5] [66])
"Il s'ensuit également que toute classe qui aspire à la domination, même si sa domination détermine l'abolition de toute l'ancienne forme sociale et de la domination en général comme c'est le cas pour le prolétariat il s'ensuit donc que cette classe doit conquérir d'abord le pouvoir politique pour représenter à son tour son intérêt propre comme étant l'intérêt général, ce à quoi elle est contrainte dans les premiers temps".
Le programme de la révolution prolétarienne est bien défini dans la lutte Idéologique contre "les Idéologues allemands" et l'anarchisme (voir la conclusion de "Misère de la philosophie") en tant que programme politique. La tentative de Brendel de contribuer au marxisme avec des thèses anarchisantes, est tout bonnement ridicule.
La gauche hollandaise anarchiste?
Mais peut-être que la Gauche Hollandaise avait des positions anarchisantes ? C'est clair que certaines positions conseil listes comportent des éléments anarchisants. Mais cela n'est pas vrai pour la Gauche Hollandaise telle qu'elle a existé comme partie de la Gauche Communiste Internationale jusqu'après la seconde guerre mondiale.
La Gauche Hollandaise s'est formée comme aile gauche de la jeune Social-Démocratie au Pays-Bas qui combattait fermement les restants d'anarchisme à la Domela Nieuwenhuis ([6] [67]). Soyons clairs: Domela Nieuwenhuis, bien qu'il eût quitté le marxisme pour défendre un anti-parlementarisme idéaliste, n'a jamais quitté le camp de la classe ouvrière comme le montre sa position internationaliste contre la première guerre mondiale et pour la Révolution d'Octobre. Mais contrairement à Domela Nieuwenhuis, la Gauche Hollandaise a basé son internationalisme prolétarien sur une analyse marxiste C'est pourquoi ses contributions sont encore aujourd'hui des acquis de la classe ouvrière pour le programme communiste du futur parti ouvrier mondial. Gorter, Pannekoek, Canne Meyer et tous les autres représentants de la Gauche Hollandaise ne sont pas les élèves de Domela Nieuwenhuis comme quelqu'un qui ne connait pas l'histoire du mouvement ouvrier au Pays-Bas, pourrait le croire. C'est une toute autre chose lorsqu'un membre de "Daad en Gedachte" qui vient de l'anarchisme, reproche à l'anarchiste hollandais Anton Constandse d'avoir trahi l'internationalisme dans la seconde guerre mondiale ([7] [68]). Pour les marxistes, un tel comportement n'est pas étonnant : on ne fait des reproches à l'anarchisme que si on a des illusions dessus.
Si on étudie les positions de Gorter et de Pannekoek dans la Social-Démocratie Hollandaise, il est évident que contre la direction de Troelstra, ils défendaient le parlementarisme révolutionnaire dans la question agraire (1901) et dans la question du soutien à l'enseignement confessionnel (1902). Dans les grèves de masse de 1903, la Gauche reprochait à la direction de la Social-Démocratie d'avoir brisé la combativité et la volonté des ouvriers hollandais par son attitude hésitante. A cette époque, la Gauche Hollandaise ne s'est pas posé le faux choix entre anarchisme et réformisme, mais le posait de façon juste entre"réforme ou révolution". En 1909, Pannekoek déduit "le caractère hautement contradictoire du mouvement ouvrier moderne" à la fois "réformiste et révolutionnaire" du fait que le capitalisme dont le prolétariat est le produit est au même moment expansif et destructeur en accord avec les formulations du Manifeste Communiste qui définit le capitalisme comme un système en expansion constante, développant de plus en plus les forces productives ([8] [69]). Pannekoek condamne clairement le réformisme qui "ruine la conscience de classe si péniblement acquise" et l'anarchisme qui rejette le lent et minutieux travail qu'il a fait naitre et n'est pas capable d'appliquer un esprit révolutionnaire à la combativité. ([9] [70]) Ainsi l'antiparlementarisme que la Gauche Hollandaise a défendu dans la période décadente du capitalisme après 1914, n'a rien à voir avec l'anti-parlementarisme de Domela Nieuwienhuis avant,qui ignorait complètement la phase ascendante dans laquelle se trouvait à cette époque le capitalisme et les réformes que la classe ouvrière pouvait encore obtenir.
Ce n'est pas la Gauche Hollandaise qui déniait avant 1914 à la Social-Démocratie son caractère socialiste. C'est "Daad en Gedachte" groupe conseil liste par excellence, qui défend cette position anarchisante dans sa brochure de rupture avec le "Spartacusbond" ("Was de sociaal démokra tie ooit socialistisch ?"Amsterdam 1965). Dans cette brochure, on cherche en vain une référence à l'opposition de la Gauche dans la social-démocratie.
Quand en 1909, l'opposition de la Gauche dans le Parti n'a plus été possible parce qu'on exigeait la suppression de son organe "Tribune", elle a quitté le SDAP (pour les abréviations, voir table à la fin) et a fondé un parti marxiste appelé -et c'est caractéristique- le "sociaal-démokratische Partij". Le SDP a demandé par l'intermédiaire de Lénine au Bureau Socialiste International d'être accepté dans la deuxième Internationale et au Congrès de Copenhague en 1910, l'Internationale l'a accepté. C'est clair que le SDP n'était pas anarchiste. On peut même dire que le SPD défendait plus les positions de "centre" kautskyste contre le révisionnisme ouvert du SDAP, que les positions de Rosa Luxembourg contre Kautsky.
. Mais depuis le débat de 1910 sur la grève de masse dans la social-démocratie allemande, Herman Gorter défendait les mêmes positions que Karl Liebknecht, Franz Mehring, Karl Radek, Rosa Luxembourg et ... Anton Pannekoek qui était actif en Allemagne à cette époque.
P internationalisme prolétarien
Avant la première guerre mondiale Pannekoek à travers un engagement Intense dans les débats du Parti social-démocrate allemand, était le représentant le plus productif de la Gauche hollandaise. Sa polémique contre Kautsky est bien connue et a été reprise par Lénine dans "l'Etat et la Révolution". Pendant la première guerre mondiale, Gorter s'est aussi engagé dans le débat international avec sa brochure : "Het Impérialisme, de Wereldoorlog en de sociaal-démocratie".
"Contre l'impérialism, contre la politique de tous les Etats : le nouveau Parti international. Contre les deux, l'action de masse. Telle est la phase que nous vivons aujourd'hui. Le reflet de cette pensée, sa matérialisation en actes ce doit être la nouvelle Internationale".
Dès lors, l'Internationalisme prolétarien devient Taxe fondamental de la Gauche hollandaise:
"Le changement le plus important, l'approfondissement et l'aggravation dans la relation entre capital et travail produite par l'impérialisme (pour la première fois dans l'histoire mondiale d'aujourd'hui), c'est que tout le prolétariat international y compris celui d'Asie, d'Afrique et des colonies peut s'opposer à la bourgeoisie mondiale. Et cette lutte, il est le seul à pouvoir la mener de façon unie".
A la fin de la première guerre mondiale, Gorter et Pannekoek prenaient la parole dans les débats Internationaux sur la tactique des jeunes partis communistes. Lorsque le SDP s'est appelé "Communistische Partij 1n Nederland"(novembre 1918), deuxième parti à prendre ce nom, Gorter était déjà en désaccord avec la direction Wijnkoop/Van Ravesteyn du parti à cause de sa défense de "l’Impérialisme démocratique" de l'Entente ([10] [71]), sa collaboration opportuniste avec les anarcho-syndicalistes ([11] [72]), et son hésitation par rapport à la préparation d'une nouvelle Internationale ([12] [73]). Bien que Gorter ait salué la révolution d'Octobre et le rôle joué par le Parti bolchevik, il critiquait la politique de répartition des terres et du "droit des nations à disposer d'elles-mêmes". Toute la brochure de Gorter sur la révolution mondiale est une défense du caractère International de la révolution prolétarienne.
"La guerre n'a pu se produire et peut se poursuivre que parce que le prolétariat mondial n'est pas uni. La révolution russe, trahie par le prolétariat européen et surtout d'Allemagne, est la preuve que toute révolution ne peut être qu'un échec si le prolétariat international ne se révolte pas comme un corps, comme une unité internationale contre l'impérialisme mondial." (Gorter : "De Wereldrevolutie")
Gorter et Pannekoek étalent surtout engagés dans le mouvement communiste allemand. Lorsque l'opposition du KPD qui constituait la majorité du parti, a été expulsée selon "les pratiques les plus corrompues des messieurs de la vieille social-démocratie" (Pannekoek), ils ont choisi le camp de l'opposition qui, en 1920, fondait le Kommunistische Arbelter Partel Deutschiands (KAPD).
En septembre 1921, on fondait un KAP hollandais.
Il se trouvait alors que la direction de la Troisième Internationale et du Parti bolchevik appuyaient la tactique de la direction Levi du KPD (S) et de Mijnkoop et Van Ravesteyn qui de venaient les disciples les plus fidèles de Moscou. La Gauche hollandaise au contraire, par son adhésion au programme prolétarien de la révolution mondiale, devenait l'une des représentantes de l'opposition "gauchiste" (selon Lénine) contre la direction du Komintern. Se basant sur l'analyse de la décadence du capitalisme, les touches allemande et hollandaise proposaient une politique révolutionnaire Internationale contre les tactiques opportunistes du parlementarisme, de frontisme, de syndicalisme préconisées par le Kominterm. Nous supposons que les positions de la Gauche communiste allemande et hollandaise sur le parlementarisme et le syndicalisme sont bien connues dans le milieu révolutionnaire International ([13] [74]) à travers les textes des années 20 réédités ces dernières années. Dans la partie suivante, nous nous limiterons donc à la question du parti pour souligner une caractéristique de la Gauche hollandaise, sa compréhension du matérialisme historique, les aspects forts et faibles de cette compréhension et la théorisation des points faibles par le conseil Usine.
La question du PARTI
On dit souvent que la Gauche hollandaise était un courant anti-parti, anti-chefs, anti-politique. Contre le fétichisme des mots des conseillistes et contre l'apologie scolastique des bordiguistes sur le parti, il nous faut souligner que la Gauche hollandaise a défini le terme "parti" différemment selon les époques, et par ailleurs, que Gorter, Pannekoek et le GIC (groupe des communistes Internationalistes dans les années 30) n'ont rien à voir avec Ruhle et sa position anti-parti.
Dans le fond, la Gauche hollandaise n'est pas devenue le sujet de critiques, et même de ridiculisation et d'insultes de la part des meneurs de la troisième Internationale parce que Pannekoek et Gorter auraient changé de position sur le rôle des partis communistes mais parce que l'Internationale, elle, a changé de position avec son deuxième congrès et 1es "21 conditions" d'adhésion qui prescrivent aux communistes, entre autres, de militer à l'intérieur des syndicats et d'utiliser les élections et le parlement pour conquérir de larges masses. C'est une manifestation des relents de la période passée, du réformisme, marquée par les chefs de l'Internationale 2 1/2. A cette époque, l'IC et ses partis adhérents se transforment et d'instruments de propagande et d'agitation communistes qu'ils étaient, deviennent un corps fermement centralisé qui prétendait"diriger" les masses conquises vers la révolution, par des tactiques /opportunistes tes. La dissolution du Bureau d'Amsterdam a constitué un moment: Important de cette évolution. L'Internationale suivait l'exemple du Parti bolchevik non tel qu'il était lors de la révolution d'Octobre, mais tel qu'il était devenu à cette époque, un Parti d'Etat qui avait déjà commencé à subordonner les soviets. Pannekoek écrit :
"La référence à la Russie où le gouvernement communiste non seulement n'a pas reculé quand les grandes masses d'ouvriers s'en sont détournées démoralisés mais au contraire a fermement pratiqué la dictature et défendu la révolution de toutes ses forces,ne peut pas être appliqué ici. Là-bas, il ne s'agissait pas de conquérir le pouvoir y la situation était déjà décidée, la dictature prolétarienne disposait déjà de toutes les modalités de pouvoir et ne pouvait pas s'en abstenir. Le vrai exemple russe, c'est avant novembre 1917 qu'on peut le trouver. A cette époque, le parti communiste n 'avait jamais dit ou penser qu'il faudrait prendre le pouvoir et que sa dictature serait la dictature des masses travailleuses. Il a déclaré maintes et maintes fois que les soviets, représentant les masses, prendraient le pouvoir; lui-fi&me devait définir le programme, lutter pour le programme et quand finalement la majorité des soviets reconnaitrait ce programme comme le sien, il prendrait le pouvoir alors. Les organes exécutifs des communistes, le PC étaient naturellement le soutien puissant à qui revenait tout ce travail". (Pannekoek ; "Der Neue Blanquismus", 1920)
Face à la stagnation de la révolution mondiale, Pannekoek et Gorter pensaient qu'on ne pouvait pas abréger la voie qui mène à la victoire en agissant comme minorité révolutionnaire à la place de l'ensemble de la classe. La défaite du pouvoir du capital dans les pays industriels, de sa domination idéologique sur la conscience du prolétariat pouvait seulement être précipitée par la propagande des buts et des moyens de la lutte prolétarienne dans la période de décadence, et non par l'utilisation opportuniste des formes de lutte de la période ascendante d'un côté, ni par le putschisme de 1'autre. Tel était aussi le contenu du programme du KAPD ([14] [75]). Ce souci de former une avant-garde du prolétariat basée sur des positions communistes claires, ayant pour tâche de défendre et de diffuser activement ces positions dans la lutte, a toujours été celui de la Gauche Hollandaise.
F.K.
Table des abréviations :
SDAP : Sociaal-Democratische Arbeiderspartj (Parti Ouvrier Social-Démocrate) hollandais;
SDP : Sociaal-Democratische Partij (Parti Social-Démocrate) hollandais
KPD : Kommunistische Partei Deutschlands (Parti Communiste d'Allemagne)
KAPD : Kommunistische Arbeiter Partei Deutschlands. (Parti communiste ouvrier d'Allemagne).
GIC : Groep van Internationale communisten (Groupe des communistes internationaux).
[1] [76] Tract de "Programme Communiste"
[2] [77] Presque toutes les études sur la Gauche Hollandaise se basent en partie, directement ou indirectement sur des informations et des interprétations données par C. Brendel.
[3] [78] C.Brendel: "Revolutie en Contrarevolutie in Spanje", Baam 1977, Page 158.
[4] [79] Cet article écrit par Marx en 1844 est paru dans le "Vorwarts ! " de Paris.
[5] [80] Marx : "L'Idéologie Allemande", Editions Sociales, page 50.
[6] [81] Sur Domela Nieuwenhuis, Bricianer écrit dans "Pannekoek et les Conseils Ouvriers" (EDI. Paris- Page 42) : "Le mouvement socialiste avait donc présenté en Hollande, du moins à ses débuts, un caractère plus "français", c'est à dire plus axé sur l’anarchisme que sur 1e marxisme. Son Inspirateur fut un homme de grand talent, Tex-pasteur Domela Nieuwenhuis. (il fut) élu député tout d'abord dans le seul dessein d'utiliser la tribune parlementaire pour la propagande du mouvement social-démocrate."
[7] [82] "Daad en Gedachte", Avril 1978, Page 10
[8] [83] Pannekoek. "Die taktlschen differenzen in der Arbeiterbewegung", Hambourg 1909. En Français : "Les divergences tactiques au sein du mouvement ouvrier" publié en partie dans "Pannekoek et les Conseils Ouvriers" par Bricianer. EDI. Paris. Page 51.
[9] [84] Ibidem.
[10] [85] Ibidem.
[11] [86] Comme le PCI aujourd'hui, Wijnkoop /Van Ravesleyn attaquaient seulement "leur" impérialisme propre, l'Impérialisme allemand auquel la bourgeoisie hollandaise dans sa majorité s'était ralliée. (Les Pays-Bas n'étalent pas directement impliqués dans la guerre mondiale).
[12] [87] Les ouvriers anarcho-syndicalistes étalent antiallemands et pacifiques, ce qui a amené le SDP à prendre des positions opportunistes par rapport à la violence prolétarienne.
[13] [88] La direction Wijnkoop/Van Ravesteyn préférait une attitude sectaire vis à vis de la conférence de K1enthaï.
[14] [89] Des textes du KAPD sont publiés en français dans le livre "La Gauche Allemande", La Vieille Taupe -Paris 1973.
Géographique:
- Hollande [90]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [13]
Revue Internationale no 17 - 2e trimestre 1979
- 2894 reads
France: Longwy, Denain : nous montrent le chemin
- 4708 reads
Le silence de la presse internationale sur les violents affrontements qui opposent depuis près de trois mois bourgeoisie et prolétariat en France ne doit pas nous étonner. Depuis toujours les révolutionnaires, les bolcheviks les premiers ont dénoncé "l'abominable vénalité" de la presse, dont la fonction en période de luttes de classe est d'empêcher par le mensonge, et plus efficacement par le silence, tout mouvement de solidarité prolétarienne. Battage intense sur la "paix au Moyen-Orient", silence sur les affrontements violents entre ouvriers et police. La bourgeoisie française et internationale a raison de craindre le réveil du spectre de la lutte de classe internationale :
• fin 1978 : pendant plusieurs mois, grèves totale des ouvriers iraniens que Bazargan et Khomeiny ont remis à grand peine au travail ;
• novembre-décembre : grève des métallos de la Ruhr en Allemagne Fédérale ;
• janvier-février 1979 : grève des camionneurs anglais, suivie d'autres grèves des travailleurs des hôpitaux, des métallos ; les ouvriers obtiendront jusqu'à 20-30 % d'augmentation de salaire ; au moment où nous écrivons, le mouvement de grèves ne s'est pas encore éteint ;
• février 1979 : grèves des ouvriers de Renault à Valladolid en Espagne, en mars grève des métallos de Bilbao ;
• mars 1979 : grèves qui débordent les syndicats au Brésil à Sao Paulo, plus de 200000 métallos se réunissent en assemblées générales.
On commettrait une lourde erreur si on voyait dans ces affrontements simultanés de simples escarmouches prolongeant la vague de luttes de 1968-73, parce que bien souvent les ouvriers ne remettent pas ou peu en cause les syndicats, ne réussissent pas ou peu à étendre leurs luttes. Nous devons savoir reconnaître dans cette simultanéité et cette combativité les premiers signes d'un mouvement plus vaste, en train de mûrir. La violence décidée de l'attaque bourgeoise contre le prolétariat pousse celui-ci au combat. Comme en France, les ouvriers sentent de plus en plus que "l'heure n'est plus aux paroles mais à l'action", devant le cynisme, la morgue d'une classe dominante qui part dans la guerre économique "fraîche et joyeuse" en licenciant, en réprimant ouvertement les ouvriers toujours plus exploités et mutilés, humiliés dans leur travail et aux quels elle ne peut réserver que la mutilation suprême : la boucherie impérialiste.
Cette reprise de la lutte de classe, ces symptômes d'une nouvelle vague de combats, nous la voyons se dérouler déjà sous nos yeux. Certes, elle n'est encore qu'en gestation, elle ne prend pas l'aspect d'explosion généralisée de 1968-69 Mais ce qu'elle perd en spectaculaire elle le gagne en profondeur, en plongeant ses racines dans toutes les strates du prolétariat. Plus personne ne peut nier que le prolétariat est aujourd'hui la seule clé de la situation historique. Les sociologues et autres journalistes ont dû enterrer le "mouvement étudiant" et constatent avec effroi que la classe ouvrière n'est pas un mythe, mais une réalité bien vivante. Certes, le surgissement est lent et encore souterrain, mais décidé. Le prolétariat ne se lance pas tête baissée dans le feu du combat. A une crise lente, mais inexorable, il répond encore au coup par coup et de longs et difficiles combats attendent encore la classe ouvrière internationale, combats qui seront autrement plus décisifs que les luttes actuelles.
Quelles sont les leçons des affrontements en France ?
Face aux silences et aux mensonges de la bourgeoisie il est nécessaire de donner un aperçu chronologique des affrontements en Lorraine et dans le Nord, avant de dégager quelques leçons et perspectives pour le futur proche.
L’HEURE N'EST PLUS AUX PAROLES MAIS A L’ACTION!
Après 1971, le prolétariat français était peu à peu tombé dans l'apathie. La gauche de l'appareil politique avait promis aux ouvriers monts et merveilles avec son"programme commun de gouvernement". Pendant des années, les syndicats ont promené les ouvriers dans des manifestations sans lendemain. De grèves catégorielles en grèves de 24 heures, ils les ont enfermés dans l'usine par des occupations, des séquestrations de patrons, ils les ont amusés dans les actions autogestionnaires (Lip en 1973). Les syndicats ont soigneusement usé les soupapes de sécurité en attendant la fameuse venue au pouvoir du PC et du PS. La crise politique au sein de la gauche, les déclarations en faveur des sacrifices après 1975 ont peu à peu érodé certaines illusions. L'échec de la gauche aux élections de mars 1978 a signé l'acte de décès du "programme commun" et persuadé peu à peu les ouvriers qu'il fallait reprendre le chemin de la lutte. Des grèves dures -bien que contrôlées par les syndicats- ont éclaté dès l'été 1978 dans les arsenaux, chez les contrôleurs aériens, à Moulinex, chez les immigrés à Renault-Flins.
Le "plan Barre" dit de "redéploiement industriel" a été un facteur décisif du mécontentement ouvrier qui couvait depuis plusieurs années. Plus de trente mille licenciements par mois prévus, alors que le chômage atteint déjà un million et demi de travailleurs, blocage des salaires, hausse des prix, augmentation brutale en décembre 1978 des cotisations ouvrières à la Sécurité Sociale, diminution et même suppression de certains indemnités de chômage, autant de coups de matraque économiques répétés sur la classe ouvrière. Presque toutes les couches de travailleurs sont désormais visées : employés de Banque, des Assurances, techniciens, enseignants... Mais pour la première fois, c'est le coeur de la classe ouvrière qui est touché par l'offensive bourgeoise : ouvriers des chantiers navals et sidérurgistes, menacés de trente mille licenciements dans l'année à venir. C'est ce que la bourgeoisie appelle cyniquement la "politique" de dégraissage des effectifs".
Dans les dernières années, les ouvriers de secteurs périphériques ou faiblement concentrés avaient peu réagi ou étaient restés isolés. L'attaque contre les sidérurgistes fortement concentrés dans le Nord et la Lorraine est un pas décisif dans toute l'offensive bourgeoise contre la classe ouvrière. Les syndicats ont tout naturellement accepté les mesures de l'Etat capitaliste en négociant le chômage. La bourgeoisie française, pleine de morgue et d'assurance, a alors ajouté à la violence économique la violence politique par un matraquage systématique des ouvriers en grève, par les expulsions des ouvriers occupant les usines.
Peu à peu, l'idée s'est fait jour dans la conscience des ouvriers, qu'en abandonnant l'usine, forteresse gardée par les miradors syndicaux, pour gagner la rue, c'est leur liberté qu'ils gagneraient, que pour faire reculer la bourgeoisie, il fallait s'affronter sans plus hésiter aux forces de l'Etat. Débordement syndical, affrontement violent de classe ont surgi. Surpris par son audace, le prolétariat s'est peu à peu enhardi.
De novembre 1978 à mi-janvier 1979, les affrontements vont s'engager lentement pour se durcir progressivement.
17/11/78 : à Caen ([1] [92]), la promenade syndicale débouche sur un affrontement avec la police ; et "incontrôlés".
20/12/78 : séquestrations de cadres dans les chantiers navals de Saint-Nazaire (les plus grands en France); la police intervient, des affrontements se produisent.
21/12/78 : Saint-Chamond (région de Saint-Étienne) : une petite usine occupée par quelques ouvriers en grève est prise de nuit par la police qui expulse le piquet de grève et le remplace par des vigiles (hommes de main embauchés par les patrons pour la "surveillance" de leurs entreprises); dans cette région, fortement touchée par le chômage, la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre ; au matin, environ cinq mille travailleurs de Saint-Chamond, de Saint-Etienne, de Rive de Giers menacent de prendre d'assaut l'usine gardée par des vigiles armés qui se réfugient sur les toits ; ils ne devront leur salut qu'à l'intervention conjointe des syndicats et de la police; l'usine est alors réoccupée par les ouvriers.
L'annonce des vingt mille licenciements dans la sidérurgie prévus par le plan Barre va accélérer le processus à partir de décembre 78. Plus aucun espoir n'est permis : les premiers licenciements sont fixés pour janvier 79. La détermination de la bourgeoisie va accroître d'autant la détermination des ouvriers qui n'ont plus rien à perdre dans les centres de Lorraine et du Nord qui ne vivent que de la sidérurgie.
EN PRELUDE...
4/1/79.: à Nancy, capitale de la Lorraine, la manifestation de cinq mille ouvriers tourne en affrontements violents avec les CRS (police spécialement entraînée pour la répression). A Metz le même jour, les ouvriers essaient de s'emparer de la sous-préfecture gardée par la police.
17/1/79 : Dans la région Lyonnaise, la seconde concentration industrielle française, le directeur de PUK (Péchiney Ugine Kulmann), est séquestré et délivré par les CRS. Au même moment, des grèves commencent à s'étendre dans les Assurances à Paris, Bordeaux et Pau dans le sud-ouest.
DENAIN LONGWY- PARIS
Denain et Longwy vont devenir rapidement le symbole de la contre-offensive ouvrière. La fermeture des aciéries Usinor qui dominent exclusivement ces deux villes, excluant toute possibilité de retrouver nulle part du travail, fermeture prévue dans les semaines à venir, pousse les ouvriers à réagir d'autant plus rapidement que la répression policière se fait plus violente.
26/1/79 : les sidérurgistes d'Usinor brûlent les dossiers de la perception des impôts et sont matraqués durement par la police (Denain).
29.30/1/79 : de violents affrontements éclatent à Longwy, près de la frontière belgo-luxembourgeoise , région où les ouvriers se sentent peu "lorrains" (italiens, espagnols, maghrébins, belges), tous travaillent dans l'industrie locale .En dépit des appels de la CGT à sauver le "pays" de l'empire des trusts "allemands", les sidérurgistes vont cette fois déborder nettement les syndicats et attaquer le commissariat de police, à la suite de l'expulsion par la policé d'une usine où les ouvriers séquestraient quatre directeurs. Au maire (PCF) de la ville qui déclara aux ouvriers : "ne répondez pas à la violence par la violence, rentrez dans vos entreprises", ceux-ci répliquaient : "la prochaine fois on aura du"matériel"". février, début mars connaissent une suite quasi ininterrompue d'affrontements face auxquels les syndicats tentent de diviser le mouvement, de le dévoyer sur des objectifs nationalistes (campagne du PCF contre "l'Europe allemande", attaque par des commandos PC de wagons de fer et de charbon "étrangers", de le dénigrer par la dénonciation de "provocateurs" et "d'incontrôlés" contre les ouvriers combatifs qui échappent à leur emprise.
2/2/79 : dans le port de Dinard en Bretagne, les pompiers en grève manifestent et réussissent à enfoncer le cordon des CRS.
6/2/79 : dans le bassin des mines de fer de Briey en Lorraine (mairie PCF), la sous-préfecture est occupée par les ouvriers qui affrontent la police.
A Denain le même jour, les syndicats arrivent avec peine à obtenir la libération des cadres Usinor séquestrés.
7/2/79 : Longwy, occupation de la sous-préfecture, affrontements avec la police.
8/2/79 : Nantes, port sur l'Atlantique -ville d'où partirent les premiers mouvements d'occupation d'usines en 1968- manifestations, affrontements au cours d'une tentative d'assaut de la sous-préfecture.
9/2/79 : A l'appel des syndicats, les sidérurgistes de Denain montent sur Paris. Les syndicats n'arrivent pas à empêcher l'affrontement avec les CRS qui se produit aux abords de l'aéroport de Roissy.
C'est presque au même moment que début la grève à la Société Française de Production (SFP) des techniciens de radio et de télévision, techniciens qui ont reçu 450 lettres de licenciements Cette grève va durer plus de trois semaines• Les techniciens SFP cherchent à prendre contact avec les sidérurgistes lorrains. Le même jour, journée "ville-morte" à Hagondange (aciérie lorraine) à l'appel des syndicats.
13/2/79 : séquestration des cadres Usinor à Denain ; affrontements entre pompiers et policiers à Grenoble dans le sud-est. A ce moment, les syndicats, qui tentent de contrôler le mouvement en lançant des mots d'ordre de manifestation, de grèves régionales pour le 16/2 n'arrivent plus à contrôler leurs propres adhérents. De jeunes ouvriers CGT déclarent : .à l'heure actuelle, les syndicats ont du mal à tenir le terrain. D'ailleurs, on ne se sent plus syndiqué, on agit par nous-mêmes"."On les a suppliés, on a couru après, il n'y a plus rien eu à faire", avoue avec amertume une militante PCF de Longwy. La CGT, à la différence de la CFDT, qui plus subtilement suit le mouvement, ne sait que verser des torrents d'ordures nationalistes : "1870, 1914, 1940, ça suffit ! la Lorraine ne sera pas bradée aux grands trusts allemands". La réponse des ouvriers ? C'est celle des ouvriers de Nantes qui manifestent le 8/2 aux cris de : "A bas la bourgeoisie". Voyant le mouvement prendre de l'ampleur dans plusieurs réglons, les syndicats tentent d'iso1er les sidérurgistes du Nord et de Lorraine, en appelant à une grève générale... régionale pour le 16/2. Ils espèrent que les autres ouvriers ne bougeront pas, que ce sera un bel enterrement. Mal leur en prit :
16/2/79 : la manifestation syndicale "dégénère": â Sedan, les ouvriers dressent des barricades et se battent six heures durant avec la police. A Roubaix, des affrontements se produisent.
20/2/79 : Rouen, affrontements entre grévistes et police. La CGT dénonce les "éléments incontrôlés".
Cette violence ouvrière va-t-elle s'organiser, se demandent avec Inquiétude les syndicalistes ? "Ce qu'on redoute maintenant, c'est que des gars s'organisent entre eux et montent des coups sans nous avertir, parce qu'ils sauraient qu'ils ne peuvent plus compter sur notre soutien!! Cette crainte des syndicats va se confirmer de plus en plus.
20/2/79 : Début de grèves dans les PTT, dans plusieurs centres de Paris de banlieue et de province. La grève s'étend lentement et ne dure que quelques jours dans les centres touchés, mais une grande combativité et une grande méfiance vis-à-vis des syndicats apparaissent. Pour la première fois, on voit des délégations de postiers de la banlieue parisienne aller d'eux-mêmes chercher la solidarité dans les autres centres pour les faire débrayer. L'échec de la grève des postiers de 1974 n'est pas oublié : la conscience des travailleurs a mûri. Les mots d'ordre qui surgissent sont "Hier à Longwy, aujourd'hui à Paris", "plus de lamentations, des actions efficaces". L'Idée d'une coordination de la grève entre tous les centres va se faire jour chez les postiers. Les syndicats vont tout faire pour étouffer dans l'oeuf une coordination de lutte Indépendante de leur contrôle. Le travail reprend début mars, mais l'Idée de coordination est l'acquis essentiel de cette lutte.
21/2/79 : occupation par des sidérurgistes CFDT de l'émetteur de télévision de Longwy. Pour les ouvriers, son fonctionnement, alors que les travailleurs de la SFP sont encore en grève est une provocation d'autant plus que des salles de rédaction, des torrents de mensonges sur les luttes se déversent. Les journalistes seront séquestrés et seront délivrés sur l'intervention de la Centrale CFDT. Il est â noter combien les ouvriers haïssent "les valets de plume". Un journaliste faillit se faire corriger par un ouvrier en colère quelques jours après.
22/2/79 : à Paris, des employés de la Bourse occupent avec des employés de Banque en grève, après avoir bousculé le service d'ordre syndical, le"temple du capital" aux cris de : "les syndicats sont débordés".
23/2/79 : depuis le 21/2, l'émetteur de Longwy occupé par les sidérurgistes diffuse des informations sur la crise en Lorraine. La police occupe alors l'émetteur. Les ouvriers aussitôt s'assemblent dans la nuit et la police évacue l'émetteur ; d'autres ouvriers réoccupent la télévision, la foule grossit avec l'arrivée de nouveaux sidérurgistes prévenus par sirènes et tocsin ; au son de chants révolutionnaires, les ouvriers vont attaquer au matin le commissariat de police. Quelques-uns parlent de se munir de fusils. Le maire PCF (Porcu) dénonce les groupes incontrôlés. Les sidérurgistes attaquent la chambre patronale, brûlent les dossiers et toutes les routes d'accès a Longwy sont bloquées.
Devant l'ampleur des événements, les syndicats vont essayer d'empêcher tout affrontement entre police et ouvriers dans le Nord où les sidérurgistes sont prêts à reprendre le flambeau. "Longwy montre le chemin" est un slogan qui aura beaucoup de succès.
28/2/79 : mise à sac de la chambre patronale à Valenciennes dans le Nord. Les syndicats tentent d'éviter que les ouvriers n'attaquent le commissariat de police et les bâtiments publics. Un syndicaliste CFDT déclare : "11 faut que les gars puissent se défouler, on a prévu pour cela un catalogue d'actions". Mais les syndicats n'avaient pas prévu les brutalités délibérées des CRS et des gardes mobiles contre les ouvriers à Denain.
7.8/3/79 : la C6T tente d'entraîner les ouvriers vers des actions de commando pour bloquer le charbon et le fer "étranger" aux frontières. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que des compagnies de CRS vont arrêter des cars de sidérurgistes, casser des vitres, lancer des grenades, matraquer et fouiller les ouvriers. La nouvelle aussitôt connue déclenche la grève des ouvriers d'Usinor-Denain qui tiennent un meeting et décident d'attaquer le commissariat de police armés de boulons, de cocktails Molotov, de lance-pierres et même d'un bulldozer. Les affrontements durent toute la journée. Le soir, l'Intersyndicale regroupant CFDT et C6T appellent les ouvriers à "rentrer immédiatement dans l'entreprise pour l'occuper". Les ouvriers refusent de quitter la rue et piétinent sans le lire le tract syndical en criant : "il n'est plus temps de discuter, mais d'y aller". Les combats ne s'arrêtent pas, ils reprennent plusieurs heures encore, quelques ouvriers armés de fusils tirent sur les CRS.
10/3/79 : Suite aux affrontements, les syndicats, le PC et le PS décident de tenir un grand meeting d'enterrement de la lutte dans le flonflon des discours électoraux à Denain. Rapidement, des centaines d'ouvriers désertent le stade où la gauche a rassemblé les ouvriers aux cris de : "Plus de paroles, des actions".
LE SABOTAGE DE LA MARCHE SUR PARIS
Depuis quelques semaines, ce sont des centaines de grèves qui éclatent localement dans toute la France. Les grands centres, Paris (à l'exception des postiers, des agents hospitaliers et des travailleurs des Assurances et de la télévision) et Lyon sont relativement peu touchés par la vague de grèves qui court d'une usine à l'autre, d'une région à l'autre. Les syndicats savent qu'il faut tout faire pour empêcher une extension du mouvement de plus en plus explosif du mécontentement ouvrier vers Paris, centre politique et principale concentration prolétarienne. Les syndicats décident des "journées d'action" sectorielles, qui seront d'ailleurs fortement suivies : instituteurs, enseignants, cheminots.
En effet, chez les ouvriers du Nord et de Lorraine, une Idée est née qui a germé à travers les combats : Il faut marcher sur Paris, ce qui a une valeur de symbole pour tout le mécontentement accumulé chez les ouvriers. Pour empêcher tout risque d'explosion comme en 1968, les syndicats vont entrer en action. La CGT va appeler à une marche sur Paris pour le 23 mars; CGT, CFDT et tous les autres syndicats vont saboter le mouvement de mécontentement à Paris. Ils vont s'employer à faire reprendre les employés de Banque, les techniciens de la SFP, les postiers et comme l'ensemble de la presse bourgeoise, ils mentent en prétendant que chaque mouvement de grève est Isolé. Ils dissimulent l'ampleur du mécontentement et des grèves et font reprendre le travail"petit paquet par petit paquet
Mais vis-à-vis des ouvriers du Nord et de Lorraine, la stratégie syndicale de dévoiement et d'épuisement de la combativité est beaucoup plus délicate. Le but des syndicats est d'épuiser lentement, mais sûrement cette combativité des sidérurgistes lorrains et du Nord avant qu'à Paris les ouvriers ne réagissent, risquant de mettre "le feu aux poudres". Il n'est pas sûr que la marche sur Paris, choisie à une date où certains secteurs ont repris le travail ne remette pas en grève des milliers de travailleurs qui se joindraient à cette marche.
La politique des syndicats en premier lieu de la CGT, va être un chef-d'oeuvre de sabotage de la manifestation. Tout est fait pour empêcher que les ouvriers de la région parisienne, du Nord, de la Lorraine s'unissent dans la lutte. La CGT,.qui appelle dès le 10/2 à une marche sur Paris abandonne quelques jours après cette idée, parle de marche régionale. Elle laisse planer le doute sur la tenue d'une marche qui est née spontanément chez les ouvriers lorrains et du Nord qui sentent confusément que leur force ne peut se développer qu'en union étroite avec le principal centre indus triel (Paris et sa banlieue). Une minutieuse division du travail, planifiée dans les Etats- majors syndicaux, va se faire entre la CGT et la CFDT pour dégoûter les ouvriers de l'idée de "monter" sur Paris* La CFDT annonce qu'elle ne participera pas à la marche. La CGT, à son tour, annonce qu'elle n'appellera pas à la grève générale dans la région parisienne pour le 23 Mars. La CGT espère faire de cette marche une preuve de son encadrement de la classe ouvrière et montrer dans les faits qu'elle mérite bien d'être largement subventionnée par la bourgeoisie. Plus de 300 nervis du PCF membres de la CGT, plus les employés des mairies communistes, sont mobilisés pour assurer le service d'ordre, empêcher toute solidarité entre les ouvriers du Nord, de Lorraine, de Paris. Jusqu'à la dernière minute, on ne saura pas quand, par quels moyens (cars, trains,) les ouvriers du Nord et de Lorraine viendront sur Paris. Ils seront mis en pleine nuit dans les cars PC-CGT et réceptionnés à leur descente en 5 points différents de la banlieue parisienne, dans les mairies communistes, où les élus locaux les attendent ceints de leur chiffon tricolore, la bouche pleine de slogans nationalistes.
Mais ce n'est pas tout. La CGT va modifier au dernier moment l'Itinéraire de la manifestation pour éviter que les ouvriers soient en contact avec les travailleurs rentrant du travail. La manifestation est déviée de la gare Saint-Lazare, par où transitent chaque jour des centaines de milliers de travailleurs, vers les beaux quartiers de l'Opéra. C'est pourquoi, la rage au ventre, les travailleurs les plus combatifs du Nord et de Lorraine vont se trouver frustrés d'une marche de solidarité avec les ouvriers de Paris. La manifestation sera moins importante que prévu : cent mille manifestants, mais sur ces cent mille, 11 faut enlever les milliers de flics du service d'ordre syndical et tous les fonctionnaires de l'appareil du PCF. Certes, malgré le sabotage, il y a un assez grand nombre de travailleurs, SFP, EDF (électriciens) cheminots, quelques ouvriers de Renault. Les ouvriers de Denain, de Longwy, ont été dispersés dans les cortèges syndicaux pour éviter toute contamination de la manifestation et empêcher qu'ils apparaissent comme un corps uni. Néanmoins, les flics syndicaux n'arriveront pas à empêcher que les sidérurgistes de Longwy enfoncent le cordon syndical et prennent la tête du cortège.
Une étroite collaboration s'établit entre CRS, gardes mobiles et police syndicale pour empêcher qu'à la dispersion les ouvriers ne tiennent des meetings. La police est présente partout, le service d'ordre syndical disperse immédiatement les ouvriers arrivés au bout du parcours, prenant prétexte de la présence d'autonomes dans le cortège et la police arrosera abondamment de grenades lacrymogènes les ouvriers tandis que les nervis PC-CGT cogneront sauvagement de jeunes manifestants et en livreront même certains à la police. Les syndicalistes enfin protégeront de la colère des sidérurgistes des CRS qui frappent les manifestants. Jamais la collaboration entre police syndicale et police tout court n'aura été aussi manifeste.
Mais le plus écœurant pour les combattants de Longwy et de Denain, en plus d'être bombardés par les grenades des policiers, fut d'entendre les incessants slogans et litanies nationalistes du PC et de la CGT, du genre "Sauver l'indépendance nationale" ou "Se protéger des trusts allemands". Les ouvriers, repoussés jusque dans les trains par les grenades et les matraques de la police se souviendront des appels à la dispersion, de la dénonciation des combattants comme "agents du pouvoir". Ceci provoquera des heurts au sein même du syndicat.
La leçon est amère mais nécessaire : pour gagner, il faut enfoncer le cordon syndical. Pour les ouvriers qui ont combattu pendant des semaines contre la bourgeoisie, la leçon n'est pas négative. La bourgeoisie a pu triompher en dénonçant la "violence des autonomes" et étaler dans ses journaux avec complaisance les photos de centaines de CRS chargeant les manifestants.
Messieurs du PC, du PS, du RPR, de l'UDF, ceints de vos écharpes tricolores, messieurs les rabatteurs gauchistes, à la solde de la gauche de la bourgeoisie, messieurs les anarchistes qui vous réclamez de la "liberté, égalité, fraternité", de la justice de classe capitaliste, quoique vous déclariez, les travailleurs qui par centaines se sont ce jour-là affrontés à la police sont forts d'une expérience que, sans votre pouvoir et malgré eux, ils sauront ajouter et Intégrer à celle de toutes les luttes ouvrières.([2] [93])
Bien qu'isolés les ouvriers du Nord et de Lorraine n'ont pas épuisé leur combativité et leur volonté de se battre. Les ouvriers de Paris ont été peu nombreux à participer à la manifestation. Beaucoup d'ouvriers sont dégoûtés par les manoeuvres syndicales. Mais cette manifestation est une leçon : ou reculer en acceptant les licenciements ou approfondir le mouvement, s'organiser par nous-mêmes en dehors des syndicats. Les ouvriers ont perdu le goût des manifestations syndicales-promenades, des grèves sectorielles et régionales. Ils ont senti leur force et détermination en s'affrontant avec l'Etat en dehors des syndicats.
QUELQUES LEÇONS
En lisant ce récit des événements en France, événements qui se sont précipités depuis février, il faut se garder à la fois :
- d'une sous-estimation : l'ampleur des affrontements, le débordement des syndicats, la violence ouvrière ne font juste que commencer à se déployer. Ces manifestations, ces bagarres de rues ont déjà une couleur différente. Il y a un mouvement montant qui est loin d'avoir atteint son point culminant.
- d'une surestimation : bien que débordés, les syndicats n'ont pas perdu le contrôle des ouvriers. Ils ne peuvent le perdre qu'à la condition que la lutte prolétarienne passe à un stade qualitativement supérieur : l'organisation des ouvriers en dehors des syndicats dans leurs assemblées générales. Celles-ci ne sont apparues qu'embryonnairement et ponctuellement dans l'organisation de la violence ouvrière contre la police. Il reste encore aux ouvriers à organiser -pas énorme à franchir- eux-mêmes leurs manifestations, à aller eux-mêmes en masse chercher partout la solidarité des ouvriers qui hésitent encore à se lancer dans l'action. Cela demande une clarté de conscience dans les buts et les moyens de la lutte qui ne peut se développer, non dans l'abstrait, mais dans le feu de l'expérience. Le prolétariat a seulement commencé son combat, 11 est loin d'avoir engagé la guerre de classe généralisée. Et des illusions subsistent encore sur la gauche et les élections (comme le triomphe du PS et du PC l'ont montré aux élections cantonales „ avec une forte participation ouvrière).
Cependant en dépit du poids de la gauche dans; le prolétariat, les illusions tombent peu à peu :
- les syndicats liés au PC et au PS ont signé avec le patronat et l'Etat les accords qui acceptent que les ouvriers licenciés pour cause de faillite de l'entreprise, ne touchent plus 90 % de leurs salaires (ils n'étaient déjà pas très nombreux à le toucher !), mais seulement 65 % avec une diminution des allocations chômage. "Une grande victoire" clame la CGT et la CFDT !
- le gouvernement Barre, en dépit de la combativité ouvrière s'efforce de ne pas revenir sur les licenciements prévus. La bourgeoisie est prisonnière des exigences économiques. Elle espère gagner du temps et compte surtout sur l'arrogance et la répression, habituée depuis plusieurs années à une classe ouvrière contrôlée par les syndicats et chloroformée par le programme commun. Du point de vue économique, la bourgeoisie n'a pas de choix : ses choix lui sont imposés par la crise qui, loin de permettre une souplesse politique entraîne plus de rigidité.
Face à la bourgeoisie qui n'est pas prête à céder et face au PS par la voie de Rocard, qui justifie les mesures d'austérité, le prolétariat n'a pas d'autre choix que de répondre coup par coup à ce qui se poursuit. Onze mille licenciements dans l'industrie du téléphone, du chômage prévu dans l'automobile, trente mille postes d'enseignants supprimés, telle est la réalité des promesses de reclassement faites aux sidérurgistes !
Le prolétariat en France est à la croisée des chemins. Ce n'est pas sa combativité qui a surpris la bourgeoisie depuis 68, celle-ci a appris à trembler devant la facilité avec laquelle les ouvriers sont capables de lutter massivement. Ce qui l'inquiète, c'est de voir non seulement des ouvriers s'affronter résolument à l'Etat, mais surtout le débordement des syndicats. Cela ne s'était pas produit même en 1968.
"Il y a un vide politique" s'écrient toutes les fractions de la bourgeoisie. "Il y a un vide syndical" répondent en coeur les trotskystes, qui s'inquiètent "d'une désaffection envers les organisations syndicales puisque 50 % des adhérents cégétistes de la métallurgie de la Moselle n'avaient pas repris leur carte syndicale en mars 1973 et 20 % pour les adhérents de la CFDT". ([3] [94])
Ce "vide"" dont la bourgeoisie s'inquiète, c'est l'érosion des illusions chez le prolétariat. Cette désillusion, c'est l'espoir. Et le prolétariat l'a bien montré par son énergie farouche à résister à l'offensive bourgeoise, par sa joie enfin à Longwy et à Denain de voir qu'il peut faire reculer la bourgeoisie. Un prolétariat qui peut croire en sa force n'est pas une classe qui s'avoue vaincue. Il sait que maintenant il faut aller plus loin, qu'il n'est pas possible de reculer. Se sacrifier pour sa bourgeoisie nationale sur le terrain de sa guerre économique aujourd'hui, c'est se sacrifier pour sa guerre tout court demain !
Certes, le chemin de la lutte de classe est lent, avec de brusques avancées, suivies de retombées brutales. Mais le prolétariat apprend par son expérience et ne connait pas d'autre école que la lutte elle-même !
1) la lutte paye
2) plus la lutte trouve ses propres instruments et ses propres objectifs, plus elle paye.
Le stade supérieur de la lutte ne se trouve pas dans la multiplication des actions ponctuelles et isolées des syndicats mais dans l'extension d'actions massives organisées indépendamment de tous les appareils syndicaux et politiques de la bourgeoisie.
Dans ce but, les ouvriers doivent prendre la parole dans les assemblées générales, aller chercher eux-mêmes la solidarité là où luttent d'autres ouvriers, là où se trouvent les chômeurs. La classe ouvrière doit prendre confiance en elle-même, doit prendre conscience que "l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes".
La classe ouvrière hésite encore, tout étonnée de sa propre audace. Elle doit maintenant encore, redoubler d'audace !
Chardin
[1] [95] Caen, ville normande qui avait annoncé Mai 68 par toute une journée d'affrontements avec les CRS en janvier 1968
[2] [96] Après la manifestation du 23 mars, il y a eu un procès (pour juger les « casseurs »), procès où notamment les anarchistes se sont désolidarisés des actes de violences commis pendant la manifestation.
[3] [97] Imprecor : revue théorique de la « Ligue Communiste Révolutionnaire », un des plus important groupe trotskiste en France. N° du 15/03/79.
Géographique:
- France [98]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [2]
2eme conférence internationale
- 3569 reads
Fin 1978 s'est tenue une Conférence Internationale des groupes se réclamant de la gauche communiste. Cette Conférence, appelée par la Conférence de Milan de mai 1977 organisée par le Partito Comunista Internazionalista (Battaglia Comunista) à laquelle avait participé le Courant Communiste International, avait à son ordre du jour : 1) la croise actuelle et les perspectives, 2) la question des luttes de libération nationale et 3) la question du parti. Deux brochures sont en cours de parution qui contiennent la correspondance entre les groupes, les textes préparatoires à la Conférence et le compte-rendu des débats. A cette Conférence, le pas le plus important qui a été franchi a été l'élargissement de la participation ; ainsi, en plus du PCI(BC) et du CCI, ont participé : la Comunist Workers'Organisation de Grande-Bretagne, le Nucleo Comunista Internazionalista d'Italie, le Marxist Study Group (For Kormnmismen) de Suède. Deux autres groupes ont donné leur accord pour participer mais n'ont pas pu assister à la Conférence pour diverses raisons : l'Organisation Communiste Révolutionnaire Internationaliste d'Algérie (Travailleurs Immigrés en lutte) et Il Leninista d'Italie. Ce dernier groupe a fait parvenir des contributions qui paraîtront dans la brochure de la Conférence. Le Ferment Ouvrier Révolutionnaire de France et d'Espagne a quitté la Conférence dès l'ouverture et n'a donc pas pris part aux débats ; d'autres groupes invités ont refusé de participer (voir à ce sujet l'article paru dans la Revue Internationale n° 16).
Nous publions ici un article qui fait suite à l'article précédent du n°16 de la Revue Internationale essentiellement consacré aux groupes qui ont rejeté l'invitation. Cet article répond à certains points des articles de la CWO (Revolutionnary Perspectives n°12) et du PCI (Battaglia Comunista 1978-16) consacrés à la Conférence et introduit les résolutions du CCI qui ont été refusées par la Conférence en rappelant les points essentiels des interventions du CCI. Nous publions également en annexe une RESOLUTION SUR LE PROCESSUS DE REGROUPEMENT DES REVOLUTIONNAIRES prise par le CCI et qui synthétise nos orientations sur cette question.
Dans l'article consacré à la deuxième Conférence Internationale (Revue Internationale n°16), nous avons expliqué la place que nous accordons à ce travail de discussions entre les groupes révolutionnaires et réfuté les arguments de ceux qui ont refusé de participer. Nous avons particulièrement Insisté sur le fait que ces groupes manifestent fondamentalement une attitude sectaire. Pour le CCI, cette attitude est en elle-même un obstacle à la clarification politique Indispensable au mouvement ouvrier, parce que, sans confrontation des positions, il n'existe pas de possibilité de clarification.
Nous reviendrons sur cette question pour rectifier certaines affirmations contenues dans les prises de position du Partito Comunista Internationalista, Battaglia Comunista (BC) et de la Communist Workers Organisation (CWO) ([1] [99]) sur la participation a la Conférence, prises de position qui qualifient allègrement le CCI d’"opportuniste" et qui nient qu'il existe un problème de sectarisme. Il est donc nécessaire de faire une mise au point. Nous donnerons ensuite brièvement notre point de vue sur le contenu des discussions pour souligner l'Importance que nous accordons au débat politique face à nos détracteurs qui affirment que nous le reléguons au second plan. Enfin, nous expliquerons pourquoi nous avons proposé à la Conférence des résolutions sur les différents points à l'ordre du jour, résolutions que nous publions à la fin de cet article.
D'où vient le sectarisme?
BC nous prête "la volonté opportuniste d'estomper d'importantes divergences de principes pour rassembler n'importe comment des groupes qui sont par ailleurs distants entre eux". BC nous prête l'intention de nous cacher derrière une critique de l’"esprit de chapelle" pour gommer les divergences politiques. Répétons-le, nous ne cachons pas les divergences politiques et si nous insistons sur la nécessité de combattre le refus de discuter, nous qualifions précisément ce refus, de refus de discuter les divergences et de peur de confronter les positions politiques en se cachant derrière l'auto-proclamation de la détention de la vérité. Nous ne détenons pas la vérité et nous défendons une plate-forme politique que nous confrontons le plus possible à la réalité de la situation dans nos interventions, dans la confrontation avec les groupes et éléments qui se réclament de la révolution communiste.
Etrange purisme que celui de BC qui nous accuse de cacher les divergences par opportunisme. Faut-il rappeler la convocation de la première Conférence Internationale par BC ? BC, partant d'une analyse de "1'euro-communisme" émettait trois hypothèses pour les perspectives de la situation d'une part, et face à la gravité de la situation appelait à une Conférence internationale en mettant en avant trois "armes efficaces du point de vue de la théorie et de la pratique politiques" :
a) avant tout, sortir de l'état d'Infériorité et d'impuissance où l'ont menée (la Gauche Communiste) le provincialisme de querelles culturelles empreintes de dilettantisme, l'infatuation incohérente qui ont pris la place de la modestie révolutionnaire, et surtout l'affaiblissement du concept de militantisme compris comme sacrifice dur et désintéressé ;
b) établir une base programmatique historiquement valable, laquelle est, pour notre parti, l'expérience théorico-pratique qui s'est incarnée dans la Révolution d'Octobre et, sur le plan international l'acceptation critique des thèses du deuxième congrès de l’I.C. ;
c) reconnaître que l'on ne parvient ni à une politique de classe ni à la création du parti mondial de la révolution, ni d'autant moins à une stratégie révolutionnaire si l'on ne décide pas d'abord de faire fonctionner, dès à présent, un Centre International de liaison et d'information qui soit une anticipation et une synthèse de ce que sera la future Internationale, comme Zimmerwald et plus encore Kienthal furent l'ébauche de la Troisième Internationale. ([2] [100])
BC donnait donc trois points pour cadre de la convocation, en d'autres termes : 1) rompre l’isolement, 2) des critères politiques, 3) des implications organisationnelles. A cette convocation, le CCI a répondu positivement et a d'une part réclamé des critères politiques plus précis et d'autre part jugé prématurée la possibilité immédiate d'un Centre International de liaison et d'Information :
"Nous ne pensons évidemment pas qu'une telle Conférence puisse se dérouler sans qu'il y ait au moins une base minimale d'accord entre les groupes participants, et sans toucher aux questions principielles les plus fondamentales du mouvement prolétarien d'aujourd'hui, afin d'éviter tout malentendu et donner un cadre solide pour un déroulement fructueux des débats.(...) Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de nous prononcer maintenant sur votre seconde proposition de création d'un centre de liaison international qui ne pourrait être que la conclusion de la Conférence internationale. (2)
BC disait hier qu'il faut surmonter le "provincialisme", nous étions d'accord, nous le sommes toujours.
C'est pourquoi nous revenons sur cet aspect et nous répondrons aux critiques d'opportunisme qui nous sont adressées par BC ainsi qu'aux critiques de la CWO qui vont dans le même sens. Dans l'incompréhension et la critique au CCI sur son attitude décidée à condamner le refus de la confrontation politique comme tel au delà des divergences politiques qui servent de "noble" prétexte à cette attitude, il y a la persistance d'un réflexe d'isolement et d'auto-protection. Ce réflexe, hérité de la période de reflux des luttes ouvrières, de la contre-révolution, quand il s'agissait alors de rester ferme, même seul sur les positions de classe, se change en une entrave à l'heure où l'ouverture du débat, dans un contexte de montée de la lutte de classe, peut se faire, peut s'élargir sans pour autant impliquer de renoncer à sa plate-forme politique, à son programme.
C'est là le premier point fondamental qui sous-tend la prise de position du CCI envers les groupes qui se refusent à la discussion : il ne s'agit pas d'écarter les divergences politiques pour regrouper n'importe qui n'importe comment mais, sur la base d'une analyse de la période actuelle à la remontée des luttes et à l'accroissement des capacités révolutionnaires du prolétariat, il s'agit de comprendre que le terrain est favorable à la confrontation des divergences tracé par la lutte de classe aujourd'hui, une montée, une généralisation de la lutte et des débats qu'elle fait surgir. L'attitude du CCI sur la question de la participation se fonde sur une position politique précise qu'il ne cache pas : la fin de la contre-révolution, la perspective d'affrontements de classe généralisés. Ce changement de période implique un changement dans la façon qu'ont les révolutionnaires d'envisager la confrontation : il ne s'agit plus de se protéger des dangers de contamination de la dégénérescence des organisations ou de résister à la démoralisation du prolétariat, mais, avec le prolétariat qui a rouvert une brèche dans la domination bourgeoise, d'oeuvrer à l'élaboration des positions communistes les plus claires et les plus cohérentes possibles.
Pour cela, il faut d'abord être capable de faire la distinction entre incompréhension et malentendu d'une part, divergences politiques réelles d'autre part. Les incompréhensions ou les malentendus sur ce que chaque groupe veut dire sont inévitables : ils sont le tribut que les révolutionnaires payent à cinquante ans de contre-révolution. Pendant cette période, les organisations révolutionnaires se disloquent, les groupes se replient, tout comme le prolétariat : c'est là le véritable triomphe de la bourgeoisie. Les révolutionnaires subsistent tant bien que mal en infimes minorités, isolées entre elles. Ceci crée des habitudes qui pèsent à l'heure de la reprise. A l'image du prolétariat, ce géant endormi, les révolutionnaires resurgissent engourdis par cinquante ans de dispersion et d'isolement. Soit les vieilles habitudes pèsent à l'heure où la période change, soit l'inexpérience et la méconnaissance de l'histoire du mouvement ouvrier des nouveaux groupes qui surgissent du réveil de la classe ouvrière, font qu'au premier reflux temporaire de la lutte, ceux-ci disparaissent, sombrent dans l'activisme, se disloquent en de multiples mini-fractions, et se retrouvent avec des habitudes où l'arrogance de l'ignorance devient le credo, où l'on refait l'histoire au gré de sa fantaisie. L'isolement, la dispersion, l'inexpérience des révolutionnaires sont des problèmes réels qu'aucune organisation ne peut ignorer. Ne pas voir qu'il existe un problème de sectarisme, c'est-à-dire la théorisation de la dispersion, c'est ignorer ces problèmes.
BC et la CWO ne volent pas l'existence d'un problème de sectarisme et d'esprit de chapelle, problème inventé par le CCI par opportunisme selon BC. Il n'y a pas si longtemps pourtant, BC semblait consciente de ce problème. Aujourd'hui, BC ne prétend voir dans l'attitude des groupes comme Programma Comunista, le PIC ou le FOR ([3] [101]) que des questions de divergences politiques. Mais les divergences politiques existent entre les groupes participants à la Conférence, parfois plus profonds sur certains points qu'avec des groupes qui se refusent à participer. Il n'y a pas un lien direct et immédiat permettant d'expliquer toute l'attitude par la seule divergence politique. C'est trop facile et c'est oublier une des plus violentes conséquences de la contre-révolution, l'atomisation du prolétariat, l’émiettement des révolutionnaires dont les formulations des positions politiques se maintiennent en vase clos, sans confrontation permanente.
Dans la période de reflux, dans les années 30, dans les années 50, la clarification ne pouvait se faire véritablement qu'en sachant ne pas se laisser emporter, en sachant rester seul s'il le faut, à contre-courant. Dans une période de montée, la clarification ne peut se faire que par la participation active à tous les débats qui surgissent par et dans la lutte. Aujourd'hui, l'attitude des révolutionnaires vis-à-vis de la clarification politique doit être celle qui a toujours guidé l'attitude des révolutionnaires par le passé dans de tels moments.
Lorsque les Eisenachiens font des concessions aux Lassaliens, Marx critique très fermement les concessions des marxistes aux Lassaliens qu'il juge inutiles. Pour autant, et en fonction de la période, il insiste sur un point : "Tout pas fait en avant, toute progression réelle importe plus qu'une douzaine de programmes." ([4] [102]) Marx était-il opportuniste ? Le sectarisme existe et est un problème en lui-même qui n'est pas "normalement" lié aux positions politiques. Lénine combat le sectarisme pour pousser à la création du POSDR ([5] [103]) tout en critiquant fermement les positions politiques et sans pour autant faire des concessions.
Cette attitude de pousser à la discussion est d'autant plus valable que même dans les périodes d'isolement, où les conditions rendent difficiles les possibilités de contact, la volonté constante de discussions subsiste toujours chez les révolutionnaires les plus conséquents (Bilan) ([6] [104]).
Par un curieux renversement dont seule BC a le secret, on nous donne aujourd'hui une leçon d'intransigeance politique après avoir à plusieurs reprises, et sans aucun critère, appelé à des rencontres comme il y a quelques années avec Lotta Comunista et Programma Comunista pour aboutir à un constat de divergences, comme au début des années 60 avec News and Letters de R.Dunayevskaya et le FOR de Munis, après avoir entretenu des contacts avec Lutte Ouvrière, groupe trotskyste en France, il n'y a pas si longtemps encore. Faut-il croire que lorsque BC initie des rencontres de ce type et entretient de tels contacts, c'est la juste position et que lorsque le CCI défend la nécessité de la confrontation entre groupes réellement révolutionnaires sur la base de critères politiques, c'est de l'opportunisme ?
De même, par un tout aussi curieux renversement, l'attitude de la CWO qui, il n’y a pas si longtemps, rejetait le CCI dans le camp de la contre-révolution, a aujourd'hui changé. Faut-il croire que les positions politiques de la CWO ont si profondément changé qu'elle daigne aujourd'hui participer activement aux Conférences Internationales (première Conférence de Milan, Conférence d'Oslo, deuxième Conférence de Paris) ; ou faut-il plutôt y voir un changement d'attitude, la reconnaissance qu'il ne sert à rien de se proclamer le seul détenteur de la vérité, qu'il est nécessaire de débattre des divergences politiques et de ne pas chercher des prétextes à éviter le débat, la reconnaissance implicite qu'il y a donc un problème d'attitude des groupes révolutionnaires.
Pour terminer sur ce premier point, signalons simplement l'incohérence qui consiste à inviter des groupes à se joindre à la Conférence internationale, à réclamer des contributions sur les questions à l'ordre du jour, pour ensuite considérer "normal" leur refus de participer, puisque de tels groupes, par les positions qu'ils développent, "n'ont pas leur place dans de telles conférences". Alors pourquoi les inviter ? Par souci "démocratique" ? Si de tels groupes ont raison de ne pas venir, il faudrait se rendre à l'évidence et constater que nous avons fait une erreur en les invitant. Nous ne le pensons pas. Quelles que soient les aberrations politiques que de tels groupes défendent, ils se situent au sein du camp prolétarien, et la confrontation directe et publique est le meilleur moyen à notre avis de balayer ces aberrations qui subsistent encore aujourd'hui dans le mouvement ouvrier.
Les positions
politiques erronées, sclérosées ou confuses sont à combattre par les
organisations révolutionnaires dignes de ce nom. Nous ne reconnaissons à aucun
groupe politique un "droit à
l'erreur" en soi, nous ne "respectons"
pas les positions politiques qui ne font que jeter un peu plus de fatras dans
un mouvement qui a déjà eu bien du mal à se dégager des conséquences de la
contre-révolution. Nous ne "respectons"
pas le refus de discuter au nom des divergences, car ce serait reconnaître
implicitement une validité et une cohérence politiques des positions défendues
par chacun des groupes : chacun défend ses positions et tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes révolutionnaire ! Nous appelons au contraire tous
les groupes du camp prolétarien comme l'ensemble de la classe ouvrière à
prendre la parole dans la confrontation publique, ouverte et internationale,
dans les Interventions et les actions de classe, à défendre leurs positions.
Les travaux de la conférence
C'est dans cet esprit que le CCI a défendu la nécessité de se prononcer clairement sur les questions à l'ordre du jour, questions qui ne sont pas des problèmes académiques, mais qui impliquent des orientations vitales de plus en plus urgentes dans la lutte de la classe ouvrière. Pour pousser à se prononcer clairement, pour cerner accords et désaccords, le CCI a proposé, en plus des textes préparatoires, de courtes résolutions synthétiques! Sur la crise actuelle et la perspective, sur la question nationale, et sur l'organisation des révolutionnaires. Le principe de proposer des résolutions a été rejeté.
Nous rappelons ici les axes essentiels de nos interventions au cours des débats à la Conférence.
1 - Sur le premier point, CRISE ET PERSPECTIVE DE LA PERIODE ACTUELLE, le CCI a insisté sur la nécessité de dégager une perspective claire, étayée par une analyse solide, concrétisée par la situation qui se déroule sous nos yeux : allons-nous vers des affrontements de classe généralisés ou des affrontements inter-impérialistes se généralisant ?? En tant qu'organisations révolutionnaires intervenant dans la classe ouvrière, qui prétendent défendre des orientations politiques -une direction politique-, nous avons à nous prononcer sur le sens général de la lutte de classe aujourd'hui. Les révolutionnaires par le passé ont pu se tromper sur la période, mais ils se sont toujours prononcés.
Sur cette question, BC a défendu la position suivante :
"En 1976, nous avions formulé trois hypothèses possibles :
•1) que le capitalisme dépasserait temporairement sa crise économique ;
•2) que l'ultérieure aggravation de la crise créerait une situation subjective de peur généralisée telle qu'elle conduirait à une solution de force et à la troisième guerre mondiale ;
•3) l'anneau le plus faible de la chaîne se briserait, d'où la réouverture de la phase révolutionnaire du prolétariat, continuité historique de l'Octobre bolchévik. {...) Deux ans après, nous pouvons affirmer que la situation actuelle a pris les contours et les lignes de notre deuxième hypothèse" ([7] [105])
La CWO quant à elle ne se prononce pas clairement : les deux possibilités sont ouvertes, la guerre ou la révolution. Cette réponse "peut-être bien que oui, peut-être bien que non" s'infléchit cependant dans le sens d'une insistance de la CWO sur la passivité, le reflux de la lutte de classe actuelle.
Pour le CCI, depuis dix années de crise ouverte du système capitaliste, les conditions ont été â nouveau réunies du point de vue des contradictions Internes du système pour des affrontements impérialistes tendant à se généraliser. Les points forts de cette évolution sont les suivants : l'Europe et le Japon reconstruits se retrouvent à nouveau en concurrence directe avec les Etats-Unis ; la crise impose un resserrement des blocs Impérialistes: le bloc occidental impose la "pax americana" au Moyen-Orient et redéploie sa stratégie en Asie du sud-est pour intégrer définitivement la Chine à son orbite ; etc. Du point de vue des antagonismes inter-impérialistes, aux plans économique, politique et stratégico-militaire, la question qui se pose n'est pas : "à quel moment la guerre impérialiste va-t-elle se généraliser ? ", mais plutôt pourquoi la guerre ne s'est-elle pas généralisée.
Pour la CWO, la courbe "magique" de la baisse tendancielle du taux de profit n'est pas encore assez infléchie: il reste au capitalisme nombre de possibilités -des mesures d'austérité (?)-avant que ne soient réunies les conditions d'une guerre généralisée : "le prolétariat a encore le temps et l'opportunité de détruire le capitalisme avant qu'il ne détruise la civilisation." ([8] [106])
Que sont les interventions militaires croissantes des puissances capitalistes dès que s'ouvrent des possibilités guerrières : Zaïre, Angola, Vietnam-Cambodge, Chine-Viêtnam ? Que sont les campagnes sur les "droits de l'homme" et autres battages idéologiques ? Qu'est-ce que cet accroissement accéléré et pléthorique de l'industrie de guerre ? La CWO répond très justement que ce sont des préparatifs de guerre. Pour autant, selon la CWO, ce n'est pas la lutte de classe qui entrave la généralisation, "scénario absurde du CCI". Pour la CWO, les luttes de la classe ouvrière sont "sectorielles, avec une faible possibilité de généralisation à des batailles de l'ensemble de la classe". Conclusion "logique" de la CWO : "la crise n'est pas encore assez profonde pour rendre la guerre un pas nécessaire pour la bourgeoisie". Ceci n'est qu'une tautologie et revient à dire : si la guerre n'est pas là, c'est que les conditions ne sont pas réunies (!). D'accord, mais nous sommes alors revenus à la question de départ : quelles conditions ? Ne pas saisir une argumentation théorique peut se comprendre, mais ne pas s'inquiéter lorsque les faits eux-mêmes restent inexpliqués est difficile à admettre. Les événements tels que l'assassinat d'un archiduc à Sarajevo ont servi de prétexte au déclenchement d'un conflit mondial ; aujourd'hui, des événements autrement plus importants -guerres de 1967 et 1973 au Moyen-Orient, Viêt-nam, Chypre, Chine Viêtnam, etc..- n'ont pas ouvert un tel conflit. Pourquoi ? Pourquoi l'URSS n'est-elle pas intervenue directement au Viêt-nam ? Pourquoi les Etats-Unis ne sont-ils pas intervenus en Angola ou en Ethiopie ? Les dialecticiens nous répondent que les conditions objectives ne sont pas réunies. Nous sommes d'accord mais pour le CCI la condition majeure qui fait aujourd'hui défaut est l'adhésion, l'embrigadement de la population et au premier rang du prolétariat, derrière la défense des intérêts de la nation capitaliste.
Pour les autres conditions déterminant la possibilité d'un conflit généralisé, l'existence de blocs impérialistes constitués, la crise ouverte du système capitaliste, elles sont globalement réunies. Si la CWO et BC ne le pensent pas, leur thermomètre de la baisse tendancielle du taux de profit ne leur permet pas d'argumenter, sinon de dire que les blocs ne sont pas "assez" renforcés ou que la crise n'est pas "assez" profonde. Peut-être que "le scénario du CCI" est "absurde" (CWO), mais alors il faut le démontrer. Par contre, les implications politiques de la vision de BC d'une "situation subjective de peur généralisée" ou de la CWO d'un "prolétariat confus, désorienté et pessimiste quant â la lutte" sont, elles, assez incroyables.
A un prolétariat
combatif qui, depuis dix ans, a repris
le chemin de la lutte, à un prolétariat qui, nulle part dans le monde n'adhère
aux idéaux bourgeois
de défense de la "patrie
démocratique" ou "socialiste",
aux justifications de l’austérité, les
révolutionnaires vont dire : les dés sont jetés ! ? Nous ne sommes plus dans
les années 30, les conditions ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Tout cela est
négligeable pour la CWO qui ne volt pas la reprise des luttes actuelles mais
toujours un reflux ou pour BC pour qui, par exemple, les récentes grèves
anti-syndicales des hospitaliers en Italie sont négligeables, ou pour qui il
ne s'est rien passé ou presque en 1969 sinon un vague mouvement sans
signification profonde pour la classe ouvrière... Tout simplement parce que BC
n'était pas là. Le CCI non plus, mais pour nous, l'histoire existait avant nous
! Dans l'analyse de la période actuelle et ses implications dans la mise en
avant d'une orientation claire, ce n'est pas sur la querelle académique
-théorie de la baisse tendancielle du taux de profit "contre" saturation des marchés, dans laquelle la CWO comme BC
veulent fourvoyer les débats que nous nous battrons. Pour nous, la théorie de
la saturation du marché mondial constitue un cadre cohérent permettant de comprendre
toute la période depuis la première guerre mondiale et la crise actuelle, cadre
qui inclut la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit et qui ne
1'exclut pas. Ce qui nous importe dans ce débat sur la crise d'aujourd'hui, ce
sont ses implications pour notre intervention. Il y a une énorme faiblesse
dans l'analyse économique de la CWO et de BC au plan théorique, mais
fondamentalement la faiblesse principale réside dans la sous-estimation du
niveau de la lutte de classe aujourd'hui, dans l'incapacité de dégager de ce
qui se déroule sous nos yeux, les éléments embryonnaires qui portent
concrètement la perspective d'affrontements de classe,comme préalables à la
possibilité d'une explosion généralisée des contradictions capitalistes en un
nouvel holocauste mondial.
2 - La seconde question abordée à la Conférence a été LA QUESTION NATIONALE. Sur ce point, si pour tous les groupes présents, à l'exception du Nucleo Comunista Internazionalista (NCI), le prolétariat ne peut pas soutenir aujourd'hui les luttes de libération nationale, beaucoup de nuances et divergences d'analyses séparent encore les groupes de la Conférence.
Le NCI pour sa part, a repris à la lettre la position défendue par TIC, le soutien aux libérations nationales vues comme un affaiblissement de l'impérialisme et donc un facteur positif pour l'aide a la lutte du prolétariat destiné à en prendre la tête. Que, depuis 50 ans, cela ne se soit pas produit, que, depuis 10 ans, chaque fois l'entrée en lutte de la classe ouvrière dans tous les pays ait rejeté jusqu'à les affronter tous les courants politiques de la "libération nationale", cela n'ébranle guère le NCI qui n'y voit là aucune "démonstration" de l'invalidité d'une telle théorie .Le NCI nous ressert intelligemment rajeunie, la théorie de la "soudure" entre mouvement social des aires sous-développées et mouvement prolétarien des pays avancés. Sans comprendre que la "soudure" ne peut être que souder les rangs du prolétariat mondial, quelles que soient les "aires" faibles ou fortes du capitalisme, le NCI n'a pas encore entièrement ôté les lunettes déformantes du bordiguisme : il voit encore une continuité entre l'embrigadement des masses dans les luttes nationales et la mobilisation prolétarienne -et toute l'expérience de ce siècle le confirme-, il ne peut y avoir que rupture sans concession aucune avec le terrain national de la part du prolétariat, où qu'il se trouve, quelle que soit sa force numérique au sein de l'Etat national qui l'exploite.
La condamnation par le CCI de toutes les luttes nationales n'est en rien indifférence, abstraction ou mépris de la révolte populaire au sein de laquelle se trouve aussi souvent le prolétariat, mais au contraire dénonciation de ceux qui la manoeuvrent à des fins impérialistes ou nationalistes, c'est-à-dire toutes les fractions qui reconnaissent un quelconque pas en avant possible au niveau national. Ce sont les luttes ouvrières et elles seules qui peuvent donner un sens à la révolte ; en leur absence, il n'y a pas d'autre issue que misère, massacres, et guerres. Et qu'on ne nous dise pas qu'en l'absence du parti cette rupture est impossible ! Sans parti, les ouvriers sont déjà capables aujourd'hui par 1eurs grèves d'enrayer les ardeurs nationalistes comme cela s'est produit en Angola, en Israël, en Egypte, en Algérie, au Maroc. La rupture avec la "libération nationale" n'est pas une abstraction que défend le CCI mais la réalité d'aujourd'hui.
Plus subtile est l'ambiguïté qui subsiste sur cette question dans un groupe comme BC qui, tout en qualifiant les guerres de "libération nationale" de moments de la guerre impérialiste, trace comme perspective au prolétariat mondial -donc aussi à celui de ces pays- de "dresser les mouvements de libération nationale1 en révolution prolétarienne", par la construction de la future Internationale Communiste. Autant la position du NCI a une cohérence sur la question, autant celle de BC est pour le moins "le cul entre deux chaises". Il faut choisir. Ou bien les "luttes de libération nationale ont achevé complètement leur fonction historique" (BC, souligné par BC) et il faut en tirer les conséquences : elles sont inutilisables pour le prolétariat qui, lui, a une mission historique. Pour un parti de classe a fortiori, son rôle n'est pas de les transformer en quoique ce soit mais appeler à abattre toutes les agences d'embrigadement dans la guerre impérialiste. Ou bien, il est possible de les "dresser en révolution prolétarienne" et il faut alors leur reconnaître une fonction historique au sein de la tâche historique du prolétariat. Il faut dire alors qu'elles ne contiennent pas seulement des caractéristiques impérialistes.
Il ne s'agit pas de transformer la libération nationale en révolution prolétarienne, mais de dresser le prolétariat contre tout mouvement national. BC nous répondra probablement une fois de plus que le CCI est bien peu "dialectique". Encore une fois, le CCI peut avoir tort, mais ce n'est pas avec la "dialectique" à toutes les sauces, à 1'instar du médecin qui, pour toute maladie, répond "c'est une allergie", que la discussion avancera d'un pouce sur la question. Le parti est pour BC la réponse à toutes ces contradictions qui restent inexpliquées. Mais pour que le parti de classe agisse encore faut-il qu'il existe. Et d'où va-t-il surgir ? Des luttes nationales ? Certainement pas. Il grossira ses rangs des éléments ayant rompu définitivement avec toutes les politiques nationalistes quelles qu'elles soient. Et d'où surgiront ces éléments ? Des mouvements de classe dans tous les pays, y compris ceux qui sont soumis aujourd'hui au déluge de fer et de sang de l'impérialisme mondial que leur imposent les "mouvements de libération nationale".
La compréhension claire, pratique et théorique par le prolétariat mondial, qu'il ne peut se battre que sur son terrain, le terrain internationaliste, qu'il n'y a aucune possibilité d'utiliser un mouvement, surgi des intérêts impérialistes antagoniques locaux et mondiaux, dans lequel les masses ne servent que de chair à canon, est une condition fondamentale de sa capacité à lutter.
Des révolutionnaires qui tergiversent encore aujourd'hui sur cette question, ne font que participer à la confusion ambiante sur le nationalisme qui existe aujourd'hui dans la classe ouvrière et accréditer cette idée bourgeoise que le nationalisme a un tout petit quelque chose de révolutionnaire. Par quelle casuistique expliquer aux ouvriers, qui appréhendent dans leur pratique quotidienne que la lutte est la même dans tous les pays, qu'elle est la même mais qu'elle n'est pas tout à fait la même,ou que par stratégie, le prolétariat peut se glisser dans les rangs nationalistes pour les dresser contre le nationalisme. Autant demander d'entrer dans la police pour lutter contre la police.
Quant à la CWO, très soucieuse au départ de se démarquer du soutien aux mouvements nationaux, qui voulait faire de cette question un critère d'exclusion de la discussion, elle n'a rien argumenté contre la position de TIC défendue par le NCI, mais a surtout insisté sur l'idée que tous les pays n'étaient pas impérialistes, ou plutôt pas tous "vraiment" impérialistes, que l'impérialisme était une politique des seules principales puissances capitalistes.
Nous n'entrerons pas dans le détail de cette question, mais nous relèverons simplement la simplification de la question par la CWO. Dans l'article de Reyolutionary Perspectives (RP) ([9] [107]) sur la Conférence, la CWO pose une question : "comment peut-on argumenter que, par exemple, Israël est une puissance impérialiste indépendante ?" N'est pire sourd que celui qui ne veut entendre. On ne peut pas en effet. prétendre qu'aucun pays n'échappe aujourd'hui â l'impérialisme; le fait que tous les pays du monde soient aujourd'hui impérialistes signifie précisément qu'il n'y a plus d'indépendance nationale possible. Les plus puissants disposent d'une marge de manoeuvre plus grande, non parce qu'ils seraient impérialistes et que les plus faibles ne le seraient pas, mais simplement parce qu'ils sont les plus compétitifs sur le marché mondial et/ou les plus puissants sur le champ de bataille international. Que tous les pays soient aujourd'hui impérialistes signifie précisément qu'aucune bourgeoisie nationale ne peut défendre ses intérêts sans se heurter aux limites objectives d'un marché mondial qui a envahi la planète jusqu'en ces derniers recoins. Nous répondrons à la question de la CWO : Israël est un Etat impérialiste, mais n'est pas un Etat Indépendant.
Mais le plus important réside dans les implications politiques d'une telle vision de la CWO. Si seules les grandes puissances ont les moyens de mener une politique impérialiste, et si les pays de second ordre ne les ont pas, il faut être cohérent et affirmer que les gouvernements nationaux de ces derniers ne sont que de simples "agents" de l'impérialisme des plus grands ou, pour utiliser la terminologie gauchiste, des "valets" des Etats-Unis, des grandes puissances, de l'URSS. C'est certes vrai mais c'est insuffisant. La condamnation des luttes nationales n'est pas une question morale, une dénonciation des fractions nationalistes comme de simples "vendus" à l'impérialisme, mais elle se fonde sur une réalité sociale : il n'y a pas de possibilité pour qui que ce soit de défendre la nation hors des nécessités impérialistes.
3. Dans la troisième partie, au cours de la discussion sur LA QUESTION DU PARTI, le CCI a insisté particulièrement sur un point : le parti doit-il prendre le pouvoir ? A cette question, le groupe For Kommunismen a répondu non et le FOR, quoi qu'absent de la Conférence a contribué par son texte de façon claire à ce que le CCI estime être une des leçons essentielles de la révolution en Russie. Le rôle du parti n'est pas de prendre le pouvoir ; la prise du pouvoir est l'oeuvre des conseils ouvriers qui sont les organes unitaires de la dictature du prolétariat au sein de laquelle les partis constituent l'avant-garde communiste de la classe, regroupant les éléments les plus clairs et les plus conscients sur la marche vers le communisme, le dépérissement de l'Etat, la disparition des classes, la libération totale de l'humanité.
Le NCI a défendu la position de la prise du pouvoir par le parti en se revendiquant de la critique de Lénine aux communistes de gauche dans "La Maladie infantile du communisme", en ne comprenant pas que la critique de l'erreur de TIC sur cette question ne doit rien à la démocratie bourgeoise .Elle s'appuie sur l'expérience du prolétariat en Russie, sur les bolcheviks, sur Lénine capable, malgré les théorisations fausses qu'il a pu développer, de fulgurante clarté lorsqu'il exprime les plus hauts moments de la lutte prolétarienne sur "la nécessité de faire passer immédiatement tout le pouvoir aux mains de la démocratie révolutionnaire guidée par le prolétariat révo1ut1onnaire"(soul1gné par Lénine).
S'il est une question restée en débat avec la défaite de la révolution mondiale des années 1917-23, c'est bien celle du pouvoir qui surgit de la révolution. L'erreur de TIC sur cette question s'est avérée être un facteur accélérateur de la contre-révolution à partir du moment où, isolé, le pouvoir en Russie assimilait chacun des reculs que lui imposait la situation à un acquis pour le prolétariat et où ce pouvoir s'autonomisait chaque fois plus de l'organisation générale de la classe, jusqu'à la tragédie de Kronstadt qui vit s'affronter les armes à la main l'Etat et le Parti bolchevik à sa tête, aux ouvriers. La conception de la prise du pouvoir par le parti est une position immature des révolutionnaires du début du siècle, encore imprégnés d'une période où le schéma bourgeois restait la référence de base pour l'appréhension du processus révolutionnaire.
La CWO reconnaît les fondements du pouvoir du prolétariat dans les conseils ouvriers mais remet à jour la vieille conception gradualiste du parlementarisme révolutionnaire et la transpose dans les conseils. Pour la CWO, la prise du pouvoir signifie la conquête de la majorité des conseils aux positions révolutionnaires, et, puisque ces positions sont portées par le parti, c'est donc le parti qui s'empare "en pratique" du pouvoir une fois qu'il est majoritaire dans les conseils. Le tour est joué. La classe ouvrière ne s'exprime selon la CWO lorsqu'elle s'empare du pouvoir qu'en singeant le parlementarisme bourgeois, ses majorités et ses minorités, et la lutte prolétarienne devient une lutte de "partis" où chacun essaie de conquérir à ses positions la majorité pour assumer le pouvoir.
Ni la Commune de Paris, ni la révolution de 1917 ne nous montrent un tel processus numérique parlementaire mais l'évolution d'un rapport de forces profond entre classes sociales qui n'a rien de la simple sanction parlementaire d'une domination déjà existante, figée dans des rapports de production précis. Ceci est le propre de la bourgeoisie. Pour le prolétariat, la prise du pouvoir relève de l'action consciente et organisée d'une classe en devenir.
BC affirme justement dans son texte préparatoire à la Conférence que "sans parti, il n'y a pas de révolution et de dictature du prolétariat, comme il n'y a pas de dictature prolétarienne et d'Etat ouvrier sans les conseils ouvriers" (quoique nous réfutions la formulation d'"Etat ouvrier" pour qualifier l'Etat qui surgit au sortir de la révolution). BC prétend par ailleurs se démarquer du "super partidisme" des bordiguistes pour qui le parti est tout et l'organisation en conseils de la classe ouvrière une simple forme à laquelle seul le parti donne un contenu révolutionnaire. Mais sur la question de la prise du pouvoir, en dernier ressort, pour BC aussi, c'est le parti qui prend le pouvoir ! La dialectique si chère à BC du rapport parti-classe se simplifie considérablement et tous les beaux discours sur les conseils ouvriers et la dictature du prolétariat, les méchantes critiques aux bordiguistes et à leur "super partidisme" tombent. Il faut être clair : il y a deux organismes essentiels dans la révolution, conseils et partis. Si le pouvoir revient au parti, quel est le rôle des conseils ? Où est la différence de conception avec ceux qui volent le pouvoir du prolétariat comme celui de l'adhésion de la base (les conseils) à un sommet (le parti) qui assume en fait ce pouvoir ? La question du pouvoir est une fois encore vue comme le pouvoir d'une partie de l'ensemble au nom de l'ensemble. Ceci n'est pas possible pour le prolétariat. Sa seule force réside précisément dans sa capacité collective à détenir le pouvoir politique. Ou le prolétariat prend le pouvoir collectivement, ou il ne peut pas le prendre, et personne à sa place. Lorsque le parti bolchevik prend le pouvoir, c'est avec pour mot d'ordre "tout le pouvoir aux soviets" et non "tout le pouvoir au parti". Que dans l'esprit de Lénine et des bolcheviks la distinction soit loin d'être claire est compréhensible. Les bolcheviks étaient les premiers surpris de leur propre audience auprès de la classe ouvrière et c'est l'initiative des masses qui pousse le parti bolchevik sur la question de l'insurrection, sur la question de la prise de pouvoir, alors que Lénine lui-même était réticent à être Président du Conseil des Commissaires du Peuple.
C'est ultérieurement, avec le reflux de la révolution que devait tragiquement se révéler l'impossibilité pour le parti de se substituer à un pouvoir de la classe déclinant sous les coups de l'isolement international, de l'épuisement. Si la classe ouvrière mobilisée peut faire surgir la plus grande clarté au sein de son parti, y faire s'exprimer la plus grande fermeté révolutionnaire, la meilleure fermeté révolutionnaire du meilleur des partis ne peut maintenir le pouvoir prolétarien d'une classe démobilisée. Pourquoi ? Fondamentalement parce que la nature du pouvoir du prolétariat découle de sa nature de classe exploitée qui ne possède comme force que sa force collective. La question de la prise du pouvoir est complexe et ce n'est pas la mégalomanie de tous les groupes politiques qui l'éludent en réclamant le pouvoir qui la résoudra. Le pouvoir du parti ne sera jamais une garantie ; la seule garantie se trouve dans la classe ouvrière elle-même et c'est le rôle du ou des partis révolutionnaires de défendre cette seule garantie contre toute démobilisation, démobilisation qui ne peut être qu'accentuée par ceux qui disent et diront au prolétariat "donnez-nous le pouvoir, nous vous ferons la révolution".
Remarques sur la conclusion
Le pas le plus important qui a été fait par la Conférence Internationale est l'élargissement du débat à de nouveaux groupes qui n'avaient pas participé à la 1ère Conférence de Milan : la confrontation directe des positions des différents groupes, la clarification des divergences qui les séparent, les précisions de formulation qu'impose une telle confrontation sont vitales pour des organisations qui Interviennent dans la lutte de classe.
C'est pourquoi le CCI a insisté tout au long de la Conférence comme après sur la question du sectarisme. Dans ce sens également, deux points sont à notre avis à déplorer dans les conclusions Si les groupes ont pu se mettre d'accord pour poursuivre un tel travail, la Conférence ne s'est pas prononcée comme telle et n'a pas été capable d'une déclaration commune officielle sur ce travail. En ce sens, la Conférence est restée muette comme corps et n'a pas été capable de tracer collectivement les accords et les désaccords des différents groupes sur les questions à l'ordre du jour.
C'est le principe même de résolutions issues d'une telle Conférence qui a été rejeté. En proposant les résolutions de dessous, il ne s'est agi pour le CCI, ni de forcer l'accord de quiconque, ni d'altérer ses propres positions politiques. Il faut savoir si nous sommes des bavards ou des militants révolutionnaires. Nous ne participons pas aux Conférences Internationales pour la seule satisfaction d'une publication commune issue d'une rencontre où chacun vient exprimer ses positions et s'en retourner à son travail comme si de rien n'était. Les textes préparatoires et les débats sont des moments qui doivent permettre de clarifier des points d'accord et de désaccord ; ceci doit se traduire par une capacité à mettre noir sur blanc publiquement non seulement une simple juxtaposition des positions et déclarations des uns et des autres mais également une rédaction commune si cela est possible.
Cela n'a pas été possible et c'est une faiblesse de la Conférence. Paradoxalement, cette volonté de rester muet en tant que Conférence en refusant d'envisager une déclaration commune, s'est accompagnée d'un souci de rajouter des critères, envisages comme critères de "sélection" pour BC et d'"exclusion" pour la CWO, pour la tenue de prochaines Conférences. Nous nous retrouvons à la fois en présence de propositions s'orientant vers une sorte de plateforme minimum au lieu d'un souci de cadre de discussion et à la fois en présence d'un refus de se prononcer en commun sur quoi que ce soit. Comprenne qui pourra. Même les décisions prises telles que la préparation d'une prochaine Conférence restent "dans l'air": au bon soin du lecteur de la brochure d'interpréter les implications pratiques du travail fourni.
M.G.
RESOLUTION SUR LA CRISE
1) Y compris pour les secteurs les moins lucides de la classe dominante, la crise mondiale du capitalisme est devenue aujourd'hui une évidence indiscutable. Mais si les économistes, ces apologistes appointés du mode de production capitaliste, commencent à renoncer â attribuer les difficultés présentes de l'économie à la hausse du prix du pétrole ou au dérèglement du système monétaire international institué en 1944, ils n'en sont pas pour autant capables, compte tenu de leurs préjugés de classe de comprendre la signification réelle de ces difficultés.
2) Cette signification, seul le marxisme permet de l'appréhender. Il enseigne, comme l'a mis en évidence l'Internationale Communiste que, depuis la première guerre impérialiste, le système capitaliste est entré dans sa phase de décadence. Aux crises cycliques du siècle dernier, qui étaient comme les pulsations d'un corps en pleine santé, a succédé une crise permanente où le système ne se survit plus qu'à travers un cycle infernal -véritables râles de son agonie- de crises aiguës, guerres, reconstruction, nouvelles crises aiguës..,
3) Sont ainsi à rejeter les théories -y compris celles se réclamant du marxisme- qui font de la crise présente une simple crise "cyclique", ou de "restructuration", ou "d'adaptation", ou de "modernisation". Le capitalisme est absolument incapable de surmonter la crise présente et tous ses plans, qu'ils soient destines à limiter l'inflation ou à relancer la production, ne peuvent aboutir finalement qu'à des échecs. La seule "issue" à laquelle le capitalisme, livré à ses propres lois, puisse aboutir, est une nouvelle guerre impérialiste mondiale.
4) Si la seule perspective que le capitalisme offre à l'humanité est la guerre généralisée, l'histoire a montré notamment en 1917 en Russie et en 1918 en Allemagne qu'il existe dans la société une force capable de s'opposer, de faire reculer et d'anéantir une telle perspective : la lutte révolutionnaire du prolétariat. L'alternative que pose l'aggravation inexorable des contradictions économiques du capitalisme, est donc : guerre impérialiste ou surgissement révolutionnaire de la classe ouvrière ; l'issue qui finalement l'emportera étant la traduction des rapports de forces entre les deux classes principales de la société : bourgeoisie et prolétariat.
5) Par deux fois, la bourgeoisie a réussi à imposer sa "solution" aux contradictions de son économie : en 1914, grâce à la gangrène opportuniste et à la trahison des grands partis ouvriers ; en 1939, grâce à une terrible défaite imposée au prolétariat dans les années 20, parachevée par la trahison de ses partis communistes et par la chape de plomb du fascisme et des mystifications anti-fascistes et démocratiques. Mais tout autre la situation présente :
• L’encadrement du prolétariat par les partis de gauche PC et PS est incomparablement moins efficace que ne l’était celui des partis sociaux-démocrates en 1914 ;
• les mythes démocratiques ou anti-fascistes -même s'ils sont fréquemment agités-, la puissance mystificatrice du soi-disant "Etat ouvrier", sont passablement usés et émoussés.
6) Ainsi la perspective ouverte par l'aggravation des contradictions capitalistes à la fin des années 60 n'est pas guerre impérialiste généralisée mais guerre de classe généralisée : ce n'est qu'après avoir imposé une cuisante défaite au prolétariat que le capitalisme pourrait se laisser aller à une troisième guerre mondiale ; c'est ce qu'a démontré la réaction prolétarienne de 68 en France 69 en Italie, 70 en Pologne et dans beaucoup d'autres pays à la même période. Et si la bourgeoisie a pu, grâce à une contre-offensive politique et idéologique, principalement animée par les partis de gauche, faire taire momentanément les luttes, les réserves de combativité du prolétariat sont loin d'être épuisées. Avec l'aggravation de la crise, de l'austérité et du chômage, et contrairement à ce qu'espère la bourgeoisie, cette combativité ne manquera pas de s'exprimer à nouveau en de formidables combats contre le capitalisme.
RESOLUTION SUR QUESTION NATIONALE
1) A la base de la constitution de l'Internationale Communiste résidait la reconnaissance du fait que le capitalisme était entré dans sa phase de décadence, mettant à l'ordre du jour la révolution prolétarienne. Comme elle l'écrivait, avec la première guerre mondiale, "s'est ouverte l'ère des guerres impérialistes et des révolutions". Aujourd'hui, toute formulation cohérente des positions de classe prolétarienne repose sur la reconnaissance de cette caractéristique essentielle de la vie de la société.
2) Depuis le "Manifeste Communiste", le marxisme a toujours reconnu la tendance du mode de production capitaliste à unifier les lois de l'économie mondiale, de la bourgeoisie "à créer un monde à son image". En ce sens, il est étranger au marxisme de considérer qu'il puisse exister, alors que la révolution prolétarienne est à Tordre du jour, des aires géographiques données échappant à l'évolution d'ensemble du capitalisme où des "révolutions démocratiques bourgeoises" ou bien des "luttes de libération nationale" seraient à 1'ordre du jour.
3) L'expérience de plus d'un demi-siècle a démontré que ces prétendues "luttes nationales" ne sont pas autre chose que des moments des différents conflits inter-impérialistes qui culminent dans la guerre mondiale et que tout le battage qui tente d'entraîner les prolétaires dans la participation à ces luttes ou dans leur soutien n'ont d'autre résultat que le dévoiement des véritables luttes du prolétariat et participe de la préparation à la guerre impérialiste mondiale.
RESOLUTION SUR L'ORGANISATION DES REVOLUTIONNAIRES
1) Depuis qu'il existe, le mouvement ouvrier a reconnu dans l'organisation et la conscience les deux armes essentielles de la lutte de classe prolétarienne. Au même titre que toute activité humaine et notamment les révolutions du passé, la révolution communiste est un acte conscient mais à un degré considérablement plus élevé. C'est tout au long de son expérience comme classe que le prolétariat se forge la conscience de son être, de ses buts et des moyens pour y parvenir. C'est là un processus douloureux, heurté, hétérogène, dans lequel la classe secrète des organisations politiques regroupant ses éléments les plus conscients, ceux qui "ont sur le reste de la masse prolétarienne l'avantage de comprendre les conditions, la marche et les résultats généraux du mouvement" (le "Manifeste"), organisations qui ont pour tâche de participer activement à cette prise de conscience, à sa généralisation et donc aux combats de la classe.
2) L'organisation des révolutionnaires constitue un organe essentiel de la lutte du prolétariat tant avant qu'après l'insurrection et la prise du pouvoir : sans elle, sans le parti prolétarien et, parce que cela exprimerait une immaturité de sa prise de conscience, la classe ouvrière ne peut réaliser sa tâche historique : détruire le système capitaliste et édifier le communisme.
3) Avant la révolution et comme préparation de celle-ci, les communistes interviennent activement dans les luttes de la classe et encouragent, stimulent toutes les manifestations et possibilités qui se font jour en son sein, exprimant sa tendance vers l’auto-organisation et le développement de sa conscience : assemblées générales, comités de grève, comités de lutte ou d'action, comités de chômeurs, cercles de discussion ou noyaux ouvriers... par contre, sous peine de contribuer à la confusion et à la mystification entretenues par la bourgeoisie, les communistes doivent interdire toute participation à la vie de ces organes du capitalisme que sont devenus aujourd'hui et de façon définitive les syndicats.
4) Pendant et après la révolution, le parti prolétarien participe activement à la vie de l’ensemble de la classe regroupée dans son organisation unitaire, les conseils ouvriers, afin de l'orienter vers la destruction de l'Etat capitaliste, la prise du pouvoir politique, la destruction des rapports de production capitalistes et l'instauration de rapports sociaux communistes. Cependant, et même si son action est indispensable, le parti, contrairement au schéma qui prévaut dans la révolution bourgeoise, ne peut se substituer à l'ensemble de la classe pour la prise du pouvoir et l'accomplissement de sa tâche historique. En aucun cas, il ne peut constituer une délégation de la classe ; la nature du but à teindre, le communisme, est telle que seule la prise du pouvoir par l'ensemble de la classe, son activité et son expérience peuvent y conduire.
5) Après la plus profonde contre-révolution de l'histoire du mouvement ouvrier, une des tâches les plus importantes qui revient aux révolutionnaires est de contribuer activement à la reconstitution de cet organe essentiel de la lutte révolutionnaire : le parti prolétarien. Si le surgissement de celui-ci est conditionné par le développement et l'approfondissement de la lutte de classe, par l'éclosion d'un cours vers la révolution communiste, un tel surgissement n'est pas un produit fatal et mécanique ; il ne peut en aucune façon être improvise. Sa préparation passe aujourd'hui par :
- la réappropriation des acquis fondamentaux des expériences passées de la classe ;
- l'actualisation de ces acquis à là lumière des nouvelles données de la vie du capitalisme et de la lutte de classe ;
- l'effort de discussion entre les différents groupes communistes, de confrontation et d'éclaircissement de leurs positions respectives, seules conditions pour l'établissement de bases programmatiques claires et cohérentes qui doivent nécessairement présider à la fondation du parti mondial prolétarien.
RESOLUTION SUR LE PROCESSUS DE REGROUPEMENT
1) Depuis le début du mouvement ouvrier, l'unité des révolutionnaires a constitué pour ceux-ci une préoccupation fondamentale. Cette exigence fondamentale de l'unité entre les éléments les plus avancés de la classe est une manifestation de l'unité profonde des intérêts immédiats et historiques de celle-ci et constitue un facteur décisif dans le processus qui conduit à son unification mondiale, à la conquête de son propre être. Que ce soit dans la tentative de constitution en 1850 d'une "Ligue Mondiale des Révolutionnaires Communistes", regroupant la "Ligue des Communistes", les "Blanquistes" et les "Chartistes" de gauche, dans la fondation de l’AIT en 1864, celle de la Deuxième Internationale en 1889 ou de l'Internationale Communiste en 1919, chaque étape importante du mouvement ouvrier a été ponctuée par cette recherche du regroupement mondial des révolutionnaires.
2) Bien que répondant à une exigence fondamentale de la lutte de classe, cette tendance vers l'unité des révolutionnaires -au même titre que celle vers l'unité de la classe dans son ensemble- a constamment été entravée par toute une série de facteurs comme :
- les vestiges du cadre ancien où s'est développé le capitalisme lui-même avec ses diversités régionales, nationales, culturelles et évidemment économiques, cadre que ce système tend à bouleverser mais ne peut réellement dépasser et qui pèse sur la lutte et la conscience de la classe ;
- l'immaturité politique des révolutionnaires eux-mêmes, leurs incompréhensions, les insuffisances de leurs analyses, leurs difficultés à se dégager du sectarisme, de l'esprit de chapelle et de toutes autres sortes d'influence des idéologies petites-bourgeoises et bourgeoises en leur propre sein.
3) La capacité de cette tendance vers l'unité des révolutionnaires à surmonter ces obstacles est en général une traduction assez fidèle du rapport de forces entre les deux classes fondamentales de la société : la bourgeoisie et le prolétariat,
Si aux périodes de reflux de la lutte de classe, correspond généralement un mouvement de dispersion et d'isolement mutuel des courants et éléments révolutionnaires, aux périodes de montée prolétarienne est associée la concrétisation de la tendance fondamentale vers l'unité des révolutionnaires. Ce phénomène se manifeste de façon particulièrement nette lors de la formation des partis du prolétariat, formation qui prend place dans le cadre d'un développement qualitatif de la lutte de classe et qui résulte en général du regroupement de différentes tendances politiques de la classe comme ce fut le cas notamment :
- lors de la fondation de la Social-Démocratie Allemande en 1875 à Gotha ("lassaliens" et "marxistes");
- lors de la constitution du Parti communiste en Russie en 1917 (bolcheviks et autres courants comme le groupe de Trotsky et celui de Bogdanov)
- lors de la fondation du Parti communiste en Allemagne en 1919 (Spartakistes, "gauches radicales", etc) ;
- lors de la fondation du Parti communiste en Italie en 1921 (courant Bordiga et courant Gramsci) .
Quelles que soient les faiblesses de certains de ces courants constitutifs et bien, qu'en général, l'unification se soit faite autour d'un courant politiquement plus solide que les autres, le fait demeure que la fondation du parti n'est pas le fait d'une proclamation unilatérale mais le produit d'un processus organique de regroupement des éléments les plus avancés de la classe.
4) L'existence d'un tel processus de regroupement aux moments de développement historique de la lutte de classe s'explique :
- par la dynamique unitaire qui s'empare de la classe et se répercute sur les révolutionnaires eux-mêmes les poussant à dépasser leurs divisions artificielles et sectaires ;
- par la responsabilité accrue qui repose sur les révolutionnaires comme facteurs actifs et influents des luttes immédiates et dont la prise en charge impose une concentration des forces et des moyens ;
- par la clarification des problèmes, par le dépassement des divisions portant sur des questions que la pratique de la classe se charge de trancher.
5) La situation présente du milieu révolutionnaire se caractérise par son extrême division, par l’existence de divergences importantes sur des questions fondamentales, par l'isolement de ses différentes composantes, par le poids du sectarisme, de l'esprit de chapelle, de la sclérose de certains courants et de l'inexpérience de certains autres, toutes manifestations de la terrible pression exercée par un demi-siècle de contre-révolution.
6) Une approche statique de cette situation peut induire l'idée, notamment défendue par le FOR (Fomento Obrero Revolucionario) qu'il n'existe aucune possibilité, ni présente, ni future de rapprochement entre les différentes positions et analyses existant à l'heure actuelle, rapprochement qui seul peut permettre l'acquisition d'une cohérence et d'une clarté communes, bases indispensables de toute plateforme pour la constitution d'une organisation unifiée. Une telle approche ignore deux éléments essentiels :
- la capacité de la discussion, de la confrontation des positions et analyses à clarifier les questions ne serait-ce que parce qu'elles permettent une meilleure compréhension des positions respectives et l'élimination des fausses divergences ;
- l'importance de l'expérience pratique de la classe comme facteur de dépassement des incompréhensions et divergences.
7) Aujourd'hui, la plongée du capitalisme dans la crise aigue et le resurgissement mondial du prolétariat mettent à l'ordre du jour de façon pressante le regroupement des forces révolutionnaires. L'ensemble des problèmes auxquels la classe sera confrontée dans la pratique, les enseignements qu'avec elle les révolutionnaires seront conduits à tirer de son expérience concrète :
- constitue un terrain favorable à un tel processus de regroupement,
- permettra une clarification sur les questions essentielles qui divisent aujourd'hui l'avant-garde du prolétariat, comme les perspectives du capitalisme, la nature des syndicats et l'attitude des communistes à leur égard, la nature des luttes nationales, la fonction du parti prolétarien, etc..
Mais la mise à l'ordre du jour et l'exigence de l'unité et en dernier lieu l'ouverture de débats entre révolutionnaires, s'ils constituent une nécessité absolue, ne se traduisent pas mécaniquement en une réalité s'ils ne s'accompagnent pas d'une prise de conscience de cette nécessité et d'une volonté militante d'en assumer la prise en charge. Ceux des groupes qui, à l'heure actuelle, n'ont pas pris conscience de cette nécessité et refusent de participer au processus de discussion et de regroupement sont condamnés, s'ils ne révisent pas leurs positions, à devenir des entraves au mouvement et à disparaître comme expressions du prolétariat.
8) C'est l'ensemble de ces considérations qui anime la participation du CCI aux débats développés dans le cadre de la conférence de Milan en mai 1977 et celle de Paris en novembre 1978. C'est fondamentalement parce qu'il analyse la période actuelle comme celle d'une reprise historique de la classe ouvrière que le CCI attache une telle importance à cet effort, qu'il condamne avec fermeté l'attitude des groupes qui négligent ou rejettent un tel effort et considère que cette attitude sectaire constitue une position politique en soi et dont les implications sont au moins aussi importantes que les autres positions erronées qui peuvent peser sur le courant communiste. Il estime donc que ces discussions sont un élément très important dans le processus de regroupement des forces révolutionnaires devant conduire à leur unification au sein du parti mondial du prolétariat -arme essentielle de son combat révolutionnaire.
[1] [108] Revolutionnary Perspectives n°12, Battaglia Comunista 1978-16
[2] [109] Textes et compte-cendu de la Conférence Internationale de Milan (mai 1977)
[3] [110] Parti Communiste International (Programma Comunista en Italie, Programme Communiste en France) Pour une Intervention Communiste (Jeune Taupe) en France
[4] [111] Marx, Lettre de K.Marx à W.Bracke, 5 mai 1875, Avant-Propos à la Critique du Programme de Gotha, Ed.Sociales.
[5] [112] POSDR : Parti Ouvrier Social-Démocrate Russe
[6] [113] Bilan n°l
[7] [114] Textes et Compte-Rendu de la Conférence Internationale de Paris (novembre 1978)
[8] [115] Idem.
[9] [116] Revolutionnary Perspectives n°12
Courants politiques:
- Gauche Communiste [13]
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Le Parti, les conseils et le problème du substitutionnisme
- 3538 reads
Dans le jeune mouvement révolutionnaire, engendré par la résurgence de la lutte de classe à la fin des années 60, le premier et le plus persistant obstacle à la reconstruction d'une organisation de révolutionnaires, était ce que l'on peut généralement appeler : le conseillisme. Traumatisée par la dégénérescence "du parti bolchevik et l'expérience désastreuse du stalinisme et du trotskysme, la majorité de ces nouveaux courants révolutionnaires proclamaient que la classe ouvrière n'a pas besoin de parti révolutionnaire, que les organes unitaires de la classe, les conseils ouvriers, étaient seuls nécessaires à l'accomplissement de la révolution communiste. D'après ce point de vue, les révolutionnaires devaient éviter de s'organiser et d'agir comme avant-garde dans la lutte de classe ; certains courants allaient même jusqu'à rejeter toute forme de groupe révolutionnaire comme rien de moins qu'un "racket" dicté par les besoins du capital et non par ceux de la classe ouvrière.
Depuis le début de son existence, notre Courant International a rejeté clairement ces aberrations et est intervenu activement pour les combattre -par exemple à la Conférence Internationale appelée par le groupe français "Informations Correspondances Ouvrières" en 1969. Nous avons toujours insisté sur le fait que la répudiation de 'l'héritage contre-révolutionnaire du stalinisme et du trotskysme et la nécessaire critique des erreurs des anciens partis prolétariens ne devraient pas conduire à nier le besoin d'une organisation unifiée des révolutionnaires aujourd'hui, à nier le rôle indispensable du parti communiste dans la révolution prolétarienne. Si cette défense intransigeante du besoin de l'organisation est dénoncée comme du "léninisme" par des conseillistes et divers libertaires, et bien, grand bien leur fasse! Le CCI s'est toujours réclamé de la contribution historique de Lénine et du parti bolchevik comme partie de notre propre héritage.
L'idéologie conseilliste qui met tout l'accent sur son interprétation particulière de la "spontanéité de masse" de la classe ouvrière, peut parfois fleurir dans les périodes d'activité montante de la classe, quand la créativité de la classe atteint un haut niveau et laisse les minorités révolutionnaires dans son sillage. Ainsi, Mai 68 en France vit l'épanouissement d'innombrables tendances conseillistes : de l'Internationale Situationniste au GLAT. Mais de telles tendances n'allèrent plus si bien quand l'explosion de la lutte de classe entra dans une phase de reflux. Après la retombée de la vague de lutte de 68-72 dans les capitalismes avancés, la grande majorité de ces tendances, basées comme elles l'étaient sur une conception immédiatiste et activiste du travail révolutionnaire, éclatèrent ou devinrent des sectes académiques stériles. La liste de l'hécatombe est longue : l'Internationale Situationniste, la Gauche Marxiste, Pouvoir Ouvrier, Noir et Rouge, le GLAT, Combate (Portugal), et les diverses tendances modernistes anti-organisationnelles : Invariance, le Mouvement Communiste, Kommunismen (Danemark), Internationell Arbeitarkampf (Suède), Négation, For Ourselves (USA)...
Dans l'atmosphère difficile et parfois démoralisante des quelques dernières années, pendant lesquelles s'est développé un décalage entre l'approfondissement de la crise et le niveau de la lutte de classe, les seuls groupes communistes qui ont survécu ou qui se sont développés ont été ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont mis en évidence la nécessité de l'organisation : le CCI, Battaglia Comunista, et malgré sa dégénérescence politique, le Parti Communiste International (bordiguiste). De même qu'à un niveau historique plus grand, la clarté de la Gauche italienne sur la question de l'organisation lui permit de mieux survivre à la période de contre-révolution (plus sûrement) que d'autres fractions communistes de Gauche, aussi ces groupes furent mieux équipés pour faire face aux effets de la période actuelle de relatif calme social.
Mais, si les déviations conseil listes et anti-organisationnelles peuvent fleurir pendant les périodes d'activité croissante de la classe, les déviations opposées tendent à prendre le dessus dans les périodes de défaite ou de calme de la classe, quand les révolutionnaires perdent souvent leurs convictions dans la capacité du prolétariat à lutter de façon autonome et à réaliser sa nature révolutionnaire. La caricature substitutionniste qui apparaît dans le "Que Faire" de Lénine fut en grande partie un produit de la période de "paix sociale" internationale dans la dernière partie du 19ème siècle. Dans le réveil de 1905 et surtout dans les révolutions de 1917, Lénine fut capable de critiquer ces exagérations et de lier ses propres positions politiques à l'activité autonome de masse de la classe. Le déclin de la vague révolutionnaire de l'après-guerre conduisit cependant Lénine et les bolcheviks à reprendre sur de nombreux points les distorsions socio-démocrates. De même le prix payé par la Gauche italienne pour son maintien sur des positions de classe pendant les longues années de la contre-révolution, fut, surtout après la seconde guerre mondiale, une importance croissante accordée au rôle du parti, culminant dans le Parti mégalomane des bordiguistes.
Dans la conjoncture présente, à cause du désarroi de la majorité des conseillistes, leur banqueroute prouvée par leur propre désintégration, le CCI est de plus en plus confronté à la déviation inverse : le substitutionnisme, la sous-estimation de l'importance de l'auto-activité des masses, et la surestimation du rôle du parti, au point que le parti est chargé des tâches que seule la classe dans son ensemble peut mener à bien, en particulier, la prise et'1'exercice du pouvoir politique. Après avoir été dénoncés comme léninistes par les conseillistes, le CCI est maintenant dénoncé comme conseilliste par les léninistes... Non seulement cela, mais des organisations qui avaient, à 1'origine,une claire compréhension des relations entre classe et parti, comme la CWO, ont commencé à régresser vers des positions ouvertement substitutionnistes. Ainsi en 1975, la plateforme de "Revolutionary Perspectives" établissait que l'organisation des révolutionnaires :
"Ne peut pas agir "au nom de" la classe,, mais seulement comme partie de celle-ci, reconnaissant clairement que la principale leçon de 1917 en Russie et en Allemagne est que l'exercice du pouvoir politique pendant la dictature du prolétariat et la construction du communisme sont des tâches de la classe elle-même et de ses organisations unitaires (conseils, milices d'usine, milices armées)."
Aujourd'hui, la CWO affirme que le parti "dirige et organise" la lutte pour le pouvoir (souligné par nous, texte de la CWO pour la Conférence de Paris) et que :
"Au moment victorieux, l'insurrection sera transformée en révolution, et un soutien majoritaire pour le communisme se manifestera dans la classe -via le parti dans les conseils tenant le pouvoir".
Au sein du CCI lui-même, des idées similaires ont été développées, menant des camarades de France et d'Italie dans les dogmes rassurants du bordiguisme. Demain, quand le prolétariat resurgira de façon décisive sur la scène, nous pourrions bien être confrontés à une seconde vague de conseillistes, d'ouvriéristes et d'autonomes de toutes sortes. La résolution "le rôle du parti dans la révolution prolétarienne" qui fut adoptée au troisième Congrès de WR (World Révolution) est une tentative de contrer à la fois les deux sortes de déviation et fournit un cadre général pour le développement d'une analyse détaillée et plus précise du rôle du parti -analyse qui restera nécessairement incomplète jusqu'à ce que la future lutte révolutionnaire de la classe réponde aux questions non encore résolues. Si nous centrons cette contribution sur la question du substitutionnisme, c'est que nous pensons que la persistance de cette idéologie dans le mouvement ouvrier d'aujourd'hui est une barrière au développement d'une réelle compréhension des tâches positives du parti révolutionnaire. Le substitutionnisme est pour nous quelque chose que l'expérience historique a déjà clarifié. Si l'avant-garde révolutionnaire veut assumer ses tâches dans les batailles de classe de demain, elle doit carrément rompre avec tout le bois mort du passé.
LE SUBSTITUTIONNISME: EXISTE-T-IL?
D'après certains, le "substitutionnisme" n'est pas un problème. On a recours à des profondeurs philosophiques telles que : "comment le parti qui représente l'intérêt historique du prolétariat, pourrait-il se substituer à la classe ?" Bien sûr, l'intérêt historique de la classe ne peut se substituer à la classe mais, le problème est que les partis prolétariens ne sont pas des entités métaphysiques mais des produits du monde réel de la lutte de classe. Quel que soit le degré de clarté théorique atteint à un moment donné, ils ne sont pas immunisés complètement contre l'idéologie bourgeoise ni automatiquement protégés des pressions bien réelles du vieux monde, des dangers du conservatisme, de la bureaucratie et de la trahison. Assez de partis ont dégénéré ou trahi pour que cela nous semble évident. Et même quand les partis sont loin d'avoir trahi, il est toujours possible qu'ils agissent contre l'intérêt historique de la classe. Nous n'avons qu'à voir la réponse initiale du parti bolchevik à la révolution de Février pour le comprendre. Il n'y a pas de garantie absolue que les actions et les positions du parti prolétarien coïncident invariablement avec les intérêts historiques du prolétariat. Les actions que les révolutionnaires croient être du plus grand intérêt pour la classe peuvent avoir l'effet le plus désastreux à la fois pour la classe et pour le parti.
Mais un groupe comme la CWO a un argument beaucoup plus convaincant contre la notion de substitutionnisme. Ils admettent que le substitutionnisme pourrait signifier " qu'une minorité de la classe tente de remplir les tâches de toute la classe" ("Quelques Questions au CCI, Revue Internationale n°12). Pour eux, ce serait une critique juste de l'idée blanquiste de la prise du pouvoir par une minorité sans le soutien actif et la participation de la majorité de la classe; ou alors c'est une description pure et simple de la situation objective dans laquelle les bolcheviks se trouvèrent du fait de l'isolement de la révolution russe. Ils ne trouvent rien de substitutionniste dans la "prise du pouvoir" par le parti, s'il a gagné le soutien de la majorité de la classe. De même, ils ne voient aucun lien entre la conception bolchevik du rôle du parti en 1917 et les affrontements qui ont suivi avec la classe, notamment à Kronstadt. Mais cela laisse trop de questions sans réponses. Le problème aujourd'hui n'est pas de rejeter les théories de Blanqui ; le marxisme l'a fait depuis longtemps, et même les bordiguistes admettront que les putschs et les complots ne peuvent mener au communisme. Ce que nous voulons mettre en avant, c'est que la notion même de parti prenant le pouvoir -même s'il est démocratiquement élu pour le faire- est une variété de substitutionnisme puisqu'elle signifie qu'une "minorité de la classe tente de mener à bien les tâches de toute la classe". Et ainsi que nous essaierons de le démontrer, la confusion des bolcheviks sur cette question fut un facteur de sa dégénérescence ultérieure. Pour nous le problème du substitutionnisme n'est pas une pure invention du CCI mais une question essentielle, prenant racine dans tout l'histoire du mouvement ouvrier.
CONTEXTE HISTORIQUE DE L'IDEOLOGIE SUBSTITUTIONNISTE
Contrairement à ceux qui s'imaginent que le programme communiste et le parti de classe existent dans les sphères de l'abstraction invariante, le programme et le parti de la classe ne sont rien d'autre que des produits historiques de l'expérience de la classe. Cette expérience est donnée par les conditions objectives du développement capitaliste à un moment donné, et par le niveau général de lutte et d'activités de la classe qui ont lieu dans le cadre de ce développement. Ainsi, si Marx et Engels étaient capables d'avoir une vision générale claire de la nature de la révolution prolétarienne et des tâches des communistes dès 1848, il leur était objectivement impossible d'avoir une compréhension précise de la façon dont le prolétariat viendrait au pouvoir, de la nature du parti communiste et de son rôle dans la dictature du prolétariat. Leurs illusions sur la possibilité pour la classe ouvrière de se saisir de l'Etat bourgeois existant, ne pouvaient être dissipées que par l'expérience pratique de la Commune (et même de façon partielle). De la même façon, leur imprécision sur la nature et le rôle du parti ne sera dépassée que par le développement du mouvement ouvrier.
Nous voudrions rappeler que le marxisme surgit dans une période où, même les partis politiques bourgeois ne faisaient que commencer à se donner la forme unifiée et relativement cohérente qu'ils ont aujourd'hui -développement déterminé par la montée du suffrage universel qui rendit les vieilles coalitions parlementaires caduques dans un tel contexte. A cette époque, le mouvement prolétarien n'avait même pas une claire conception de ce qu'il entendait par le terme parti. De là vient l'extrême imprécision chez Marx dans l'utilisation du terme qui servait indirectement pour désigner quelques individus unis par un point de vue commun, ou la classe entière agissant dans un combat politique commun, ou encore une organisation de l'avant-garde communiste, ou enfin une association de différents courants et tendances. Aussi, la fameuse phrase du "Manifeste Communiste" : "l'organisation des prolétaires en classe et donc en parti politique...", est à la fois un jugement profond de la nature politique de la lutte de classe et du besoin du parti politique prolétarien, et aussi une expression de l'immaturité du mouvement qui n'était pas encore arrivé à une claire définition du parti comme étant une partie de la classe. Le même manque de clarté a inévitablement embrouillé la compréhension marxiste des tâches du parti dans la révolution prolétarienne :
"Bien que les révolutionnaires dans la période d'avant la première guerre mondiale aient repris le mot d'ordre de la 1ère Internationale "l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes", ils avaient tendance à considérer la prise du pouvoir par le prolétariat comme la prise du pouvoir par le parti du prolétariat. Les seuls exemples de révolution qu'ils pouvaient analyser étaient des révolutions bourgeoises, révolutions dans lesquelles le pouvoir pouvait être délégué à des partis politiques. Tant que la classe ouvrière n'avait pas fait sa propre expérience de la lutte pour le pouvoir, les révolutionnaires ne pouvaient pas être très clairs sur cette question." "Les Tâches présentes des révolutionnaires" (Révolution Internationale n°27)
L'héritage idéologique de la révolution bourgeoise était renforcé par le contexte dans lequel la lutte de classe se menait dans la seconde moitié du 19ème siècle. A la suite de la défaite des combats insurrectionnels des années 1840 (qui permirent à Marx de voir la nature communiste de la classe ouvrière et le lien profond entre ses luttes "économiques" et "politiques"), le mouvement ouvrier entra dans la longue période des luttes pour les réformes au sein du système capitaliste. Cette période institutionnalisa plus ou moins la séparation entre les aspects économiques et politiques de la lutte de classe. En particulier, dans la période de la IIème Internationale, cette séparation fut codifiée par les différentes organisations de masse de la classe : les syndicats étaient définis comme des organes de la lutte économique et le parti comme organe de la lutte politique, que cette lutte politique soit à court terme pour l'obtention des droits démocratiques pour la classe ouvrière ou à long terme pour la prise du pouvoir politique, elle se plaçait sur le terrain parlementaire, le terrain de la politique bourgeoise, par excellence. Les partis ouvriers qui luttaient sur ce terrain étaient inévitablement imprégnés de ses prémisses et de ses méthodes.
La démocratie parlementaire signifie la remise de l'autorité dans les mains d'un corps de spécialistes dans l'art de gouverner, de partis dont la raison d'être est de rechercher le pouvoir pour eux-mêmes. Dans la société bourgeoise, la société des "hommes égoïstes", des hommes séparés des autres hommes et de la communauté" (Marx "Sur la Question Juive"), le pouvoir politique ne peut que prendre la forme d'un pouvoir au-dessus et sur l'individu et la communauté, de même que "l'Etat est l'intermédiaire entre l'homme et sa liberté" (ibid), dans une telle société, il doit y avoir un intermédiaire entre "les gens" et leur propre dirigeant. Les masses atomisées, qui vont ensemble à la mascarade des élections bourgeoises, ne peuvent trouver un semblant d'intérêt et de direction collectifs qu'à travers un parti politique qui les représente. Précisément parce qu'elles ne peuvent se représenter elles-mêmes. Bien qu'incapable d'en tirer toutes les conséquences pour sa propre pratique, le Parti Communiste Internationaliste d'Italie exprime très bien la réalité de la représentation bourgeoise. L'Etat démocratique bourgeois était basé sur :
"Cette caractéristique fictive et trompeuse d'une délégation de pouvoir, d'une représentation par l'intermédiaire d'un député, d'un bulletin de vote ou d'un parti. La délégation signifie, en fait, renoncer à la possibilité de l'action directe. La prétendue "souveraineté11 des droits démocratiques n'est rien d'autre qu'une abdication,et dans la plupart des cas, une abdication en faveur d'une canaille." ("Dictature du prolétariat et parti de classe", Battaglia Comunista n°3, 4, 5, 1951)
La révolution prolétarienne met fin à ce genre de délégation de pouvoir qui est en réalité une forme d'abdication. La révolution d'une classe qui est organiquement unie par des intérêts de classe indivisibles, offre la possibilité à l'homme de reconnaître et d'organiser "ses propres forces comme forces sociales, ainsi cette force n'est plus séparée de lui sous forme de force politique (Marx "Sur la Question Juive). La praxis de la lutte prolétarienne, tend à se débarrasser de la séparation entre pensée et action, dirigeant et exécutant, forces sociales et pouvoir politique. La révolution prolétarienne n'a, de ce fait, aucun besoin d'une élite spécialisée et permanente qui"représente" les masses amorphes et accomplit leurs tâches à leur place. La Commune de Paris, premier exemple d'une dictature prolétarienne, commença à éclairer ce fait, en prenant des mesures pratiques pour éliminer la séparation entre les masses et le pouvoir politique : abolition de la séparation parlementaire entre le législatif et l'exécutif, exigence que tous les délégués soient élus et révocables à chaque instant, liquidation de la police et de l'armée permanente, etc.. Mais l'expérience de la Commune fut prématurée et trop brève pour éliminer complètement les conceptions démocratiques bourgeoises de l'Etat et du rôle du parti, du programme du mouvement ouvrier. Ce que la Commune montra, cependant, c'est que, même sans parti communiste à sa tête la classe ouvrière peut aller jusqu'à la prise du pouvoir politique ; mais les hésitations des partis prolétariens et petits-bourgeois qui se trouvèrent à la tête du soulèvement, confirment aussi que, sans la présence active d'un véritable parti communiste, la révolution prolétarienne est handicapée dès le début. Quant au rapport exact entre un tel parti et l'Etat-Commune, cette question ne sera pas encore résolue par 1'histoire.
Plus important encore peut-être, c'est le fait que l'expérience de la Commune ne mit pas fin aux illusions des révolutionnaires sur la république démocratique. En 1917, Lénine comprenait que la Commune était le résultat de l'écrasement du vieil Etat bourgeois par la révolution, de la base au sommet. Mais dans la dernière partie du 19ème siècle, et au début du 20ème, les marxistes tendaient à voir la Commune comme un modèle pour les ouvriers dans leur lutte pour prendre le contrôle de la république démocratique ; "se débarrasser" de ces plus mauvais aspects, et la convertir en instrument du pouvoir prolétarien.
"Le socialisme international considère que la république est la seule forme possible de l'émancipation socialiste, à la condition que le prolétariat l'arrache aux mains de la bourgeoisie et le transforme, d'"une machine pour l'oppression d'une classe par une autre", en une arme pour l'émancipation socialiste de l'humanité". (Trotski "Trente-cinq ans après 1871-1906)
Et, sous divers aspects, la Commune, basée sur la représentation territoriale, le suffrage universel, gardait beaucoup de faiblesses de l'Etat démocratique bourgeois. En ce sens, elle ne permit pas réellement au mouvement ouvrier de dépasser l'idée selon laquelle le pouvoir prolétarien est exercé par un parti. Ce ne fut qu'avec le surgissement des conseils ouvriers à la fin de a période d'ascendance du capitalisme, que ce problème commença à être résolu. Dans les conseils, la classe était organisée comme classe ; elle était capable d'unifier ses tâches économiques, politiques et militaires, de décider et d'agir consciemment, sans intermédiaire. L'émergence des conseils permit aux révolutionnaires de rompre définitivement avec l'idée que la république démocratique est une forme d'Etat qui pourrait de quelque façon être utilisée par le prolétariat ; en fait, c'était la dernière barrière, et la plus insidieuse à la révolution prolétarienne. Mais, si en 1917, les révolutionnaires pouvaient se débarrasser de toutes les illusions parlementaires sur la question de l'Etat, la persistance de vieilles habitudes de pensée pesait encore lourdement sur leur conception du parti.
Nous avons vu que, dans la vision social-démocrate, les luttes économiques de la classe sont menées par les syndicats, les luttes politiques, jusqu'à la prise du pouvoir, par le parti. Précisément parce qu'il était question de 1a "conquête" du pouvoir d'Etat bourgeois, l'idée d'organes politiques de masse de la classe n'existait pas ; le seul organe politique du prolétariat, c'était le parti L'Etat ne prenait une fonction prolétarienne que dans la mesure où il était contrôlé par le parti prolétarien. Ainsi, il était inévitable que l'insurrection et la prise du pouvoir soit organisées par le parti; aucun autre organe ne pouvant unifier la classe au niveau politique ; en théorie, cependant le parti devait devenir un parti de masse, une armée disciplinée et nombreuse afin d'accomplir ses tâches révolutionnaires. Le modèle social-démocrate de la révolution ne fut jamais, et ne put jamais, être mis en pratique. Mais son importance réside dans l'héritage qu'il laissa aux révolutionnaires qui passèrent par l'école de la social-démocratie. Et cet héritage ne pouvait être que le substitutionnisme. Même si la révolution était conduite par un parti de masse, c'était encore une conception qui attribuait au parti les tâches qui ne peuvent revenir qu'à l'ensemble de la classe.
Il est certain que ces conceptions ne jaillissent pas d'une faiblesse morale de la part de la social-démocratie. L'idée d'un parti agissant au nom de la classe était le produit de la pratique du mouvement ouvrier dans le capitalisme ascendant, et elle était profondément ancrée dans l'ensemble de la classe. Dans cette période, les luttes quotidiennes pour les réformes, au niveau économique et politique, pouvaient en grande partie être confiées à des représentants permanents : négociateurs syndicaux et porte-paroles parlementaires spécialisés. Mais les pratiques et les conceptions qui étaient possibles pendant l'époque ascendante, devinrent impossibles et réactionnaires au moment où la décadence capitaliste mit fin à la période des luttes pour les réformes. Les tâches révolutionnaires qu'affrontait le prolétariat impliquaient des méthodes de lutte très différentes.
Au début du 20ème siècle, des révolutionnaires comme Lénine, Trotski, Pannekoek et Luxembourg, tentèrent de clarifier les relations entre parti et classe à la lumière des nouvelles conditions historiques, et des luttes de masse que ces conditions provoquaient, spécialement en Russie. Si nous retenons les aspects les plus profonds de leurs contributions, riches mais souvent contradictoires, nous pouvons discerner une prise de conscience sur le fait que le parti social-démocrate de masse ne valait que pour la période des luttes pour les réformes. Lénine fut le plus apte à comprendre que le parti révolutionnaire ne pouvait être qu'une avant-garde communiste peu nombreuse et strictement sélectionnée ; et Luxembourg,en particulier, fut capable de voir que la tâche du parti n'était pas d'"organiser" la lutte de la classe. L'expérience avait montré que la lutte éclate spontanément et contraint la classe à passer des luttes partielles aux luttes générales. L'organisation de la lutte jaillit de la lutte elle-même et embrase toute la classe. Le rôle de l’avant-garde communiste dans ses luttes de masse, n'était pas un rôle d'organisation, dans le sens de donner à la classe une structure préexistante pour organiser sa lutte.
"Plutôt que de se casser la tête sur l'aspect technique, sur le mécanisme de la grève de masse les sociaux-démocrates sont appelés à assumer la direction politique dans le feu de la période révolutionnaire". (Luxembourg :"La Grève de masse")
Autrement dit, la tâche du parti était de participer activement à ces mouvement spontanés afin de les rendre aussi conscients et organisés que possible , afin d'indiquer les tâches que la classe dans son ensemble, organisée dans ses organes unitaires, serait amenée à assumer.
Mais, il aurait été impossible que tout cela soit clair d'emblée, pour les révolutionnaires de cette époque. Et là nous revenons au problème du substitutionnisme. La persistance de conceptions sociales-démocrates, pas seulement dans l'ensemble de la classe, mais aussi dans l'esprit de ses meilleurs éléments révolutionnaires,le manque de toute expérience réelle de ce que cela signifie pour la classe de détenir le pouvoir, devaient peser très lourdement sur la classe quand elle allait se lancer dans les combats révolutionnaires de 1917-23.
Les séquelles de l'idéologie social-démocrate se voient, par exemple, dans la position officielle de l'Internationale Communiste sur les syndicats. A la différence de la Gauche allemande, qui commençait à voir que la forme syndicale de lutte, était impossible dans l'époque de décadence, l'Internationale Communiste (IC) restait encore attachée à l'idée du parti organisant les luttes défensives de la classe et les syndicats étaient considérés comme le pont entre parti et classe. Ainsi l’IC ne fut pas capable de tirer la signification des organes autonomes que les masses créaient dans le feu de la lutte, en dehors et contre les syndicats.
Plus importante, dans ce contexte, est la façon dont les vieux schémas de pensée dominaient dans l’IC par rapport aux relations entre parti et conseils. Bien qu'à son premier congrès, les "thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature du prolétariat" de Lénine, aient, comme "L'Etat et la Révolution", mis l’accent sur les soviets comme organes du pouvoir prolétarien direct, au second congrès, les effets des défaites que la classe avait subies en 1919, leur faisaient déjà perdre cette idée. L'accent était mis sur le parti, non plus sur les soviets. Les "thèses sur le rôle du parti communiste dans la révolution prolétarienne" de l’IC, établissaient clairement que "le pouvoir politique ne pouvait être pris, organisé et dirigé, que par un parti politique, et d'aucune autre façon"
D'une façon ou d'une autre, cette vision était partagée par tous les courants du mouvement ouvrier jusqu'à 1920. Tous, même Luxembourg qui critiquait l'idée de "la dictature du parti", gardaient une vision à demi-parlementaire des soviets élisant un parti au pouvoir. Seule la Gauche allemande commença à rompre avec cette idée, mais elle ne développa qu'une critique partielle qui dégénéra rapidement en une position conseilliste. Mais dire que le pouvoir politique du prolétariat ne peut s'exprimer que par un parti, c'est dire que les soviets ne sont pas capables eux-mêmes d'être ce pouvoir. C'est substituer le parti aux soviets dans leurs tâches les plus essentielles et ainsi les vider de leur contenu réel.
En 1917, ces questions ne furent pas particulièrement urgentes. Quand la classe est en mouvement à une grande échelle, le problème du substitutionnisme n'est pas posé. Dans de tels moments, il est impossible au parti de prétendre "organiser" la lutte. La lutte est là, les organisations de la lutte sont là. Le problème du parti est de savoir comment établir une réelle présence au sein de ces organisations et avoir une influence directe sur elles. Ainsi, ceux qui se posent la question : "le parti bolchevik s'est-il substitué à la classe en Octobre 1917" tombent à côté de la plaque. Non ! Il n'y a pas eu de substitutionnisme dans l'insurrection d'Octobre. L'insurrection ne fut pas organisée et exécutée par le parti bolchevik mais par le Comité Militaire Révolutionnaire du Soviet de Petrograd, sous la direction politique du parti bolchevik. Ceux qui pensent qu'il s'agit d'une distinction purement formelle devraient se référer à "L'Histoire de la Révolution Russe" de Trotski, où il souligne l'importance politique que les bolcheviks attachaient au fait que Tin-surrection soit menée au nom du Soviet -organe unitaire de la classe- et non en celui de l'avant-garde communiste. Il est vrai que quand la classe va de l'avant, les relations entre le parti et les organisations de masse tendent à être très étroites et harmonieuses. Mais ce n'est pas une raison pour masquer la distinction entre parti et organes unitaires ; en vérité, une telle confusion des rôles ne peut qu'avoir des conséquences fatales, plus tard, si le mouvement de classe entre dans une période de reflux provisoire ou long. Ainsi, dans la révolution russe, le problème du substitutionnisme surgira dans toute son ampleur après la prise du pouvoir, dans l'organisation de l'Etat des Soviets et à cause des difficultés posées par la guerre civile et l'isolement de la révolution. Mais quoique les difficultés objectives que rencontrèrent les bolcheviks et la révolution russe constituent une explication sous-jacente de pourquoi les bolcheviks finirent par" se"substituer" aux conseils ouvriers et terminèrent du côté de la contre-révolution, ce n'est pas une explication suffisante. Autrement, il n'y aurait pas de leçons a tirer de l'expérience russe, hormis le fait évident que la contre-révolution est causée par la.contre-révolution. Si les révolutionnaires veulent éviter de rejeter les erreurs du passé, ils doivent analyser comment les confusions politiques du parti bolchevik ont accéléré le processus de la dégénérescence de la révolution et leur propre passage dans le camp du capital. En particulier, nous devons montrer en quoi les confusions des bolcheviks sur le rapport entre parti et classe et Etat ont conduit à une situation où :
• le parti bolchevik entra en conflit avec les organes unitaires de la classe presque immédiatement après qu'il est devenu un parti de gouvernement et bien avant que la masse des ouvriers aient été décimés par la guerre civile ou que la vague révolutionnaire internationale ait reculé.
• ce fut le parti, l'expression la plus avancée du prolétariat russe qui devint l'avant-garde de la contre-révolution ; cela détruisit le parti de l'intérieur et causa la naissance du monstre stalinien, une trahison historique qui fit plus pour désorienter le mouvement prolétarien que toute autre trahison d'organisation prolétarienne.
Si nous voulons éviter d'expliquer ces faits en ayant recours aux naïves théories libertaires ("les bolcheviks ont fait tout cela parce qu'ils étaient autoritaires", "tous les partis cherchent le pouvoir pour eux-mêmes", "le pouvoir corrompu"...), nous devons regarder de plus près le problème du parti, des conseils et de l'Etat dans la révolution prolétarienne.
PARTI ET CONSEILS
Pour certains courants conseillistes, l'opposition d'intérêts est si grande entre les organisations politiques révolutionnaires d'une part et les organes unitaires de la classe d'autre part qu'ils préconisent la dissolution de tous les groupes politiques dès qu'apparaissent les conseils ou alors ils ont peur de parler de l'existence d'un ou plusieurs partis au sein des conseils, hantés qu'ils sont par la vision bourgeoise du parti, comme rien d'autre qu'un corps de spécialistes dont la seule fonction est de manoeuvrer pour prendre le pouvoir. Pour ces courants, il y a dans les groupes politiques et les partis un "péché originel" qui les conduit ; inévitablement à trahir la classe et à essayer j de supplanter et "noyauter" ses organes unitaires. N'insistons pas sur l'infantilisme de cette vision, il faut surtout se rendre compte qu'en réalité elle va à rencontre de l'autonomie de la classe. La tragique expérience de la] révolution allemande amena l’IC à conclure très justement que :
"L'existence d'un parti communiste fort est nécessaire pour vendre les soviets capables de remplir leurs tâches historiques un parti qui ne "s'adapte" pas aux soviets mais qui est capable de les amener à "ne pas s'adapter" à la bourgeoisie et à la garde blanche social-démocrate". ("Thèses sur le rôle du parti communiste" 2ème congrès de l’IC)
Mais l'insistance sur la nécessité pour le parti d'intervenir dans les conseils pour contribuer à une orientation politique claire ne doit pas conduire à ignorer l'expérience du passé (particulièrement sur la révolution russe), et prétendre qu'il n’y a pas de problème dans les relations entre parti et conseils, que le danger de substitutionnisme du parti aux conseils n'est que le produit d'une névrose conseilliste. En fait, les aberrations du conseillisme ont pu avoir tant d'écho parce qu'elles furent une fausse solution à un vrai problème.
Après tous les débats passionnés qui ont eu lieu dans le mouvement révolutionnaire durant ces cinquante dernières années, il est plutôt triste de voir un groupe comme la CWO édulcorer tout le problème avec une argumentation purement sophistique. D' après la CWO :
"Pour qu'il prisse y avoir une conquête révolutionnaire du pouvoir, le parti doit avoir une majorité de délégués dans les conseils ouvriers. Sinon, cela revient à dire que "la révolution pourrait vaincre alors que la majorité de la classe n'est pas consciente du besoin du communisme ou que la majorité des délégués aux conseils ne sont pas communistes". (Revue Internationale n°12
Dans la mesure où le parti a une majorité de délégués, il est effectivement au pouvoir.
Voilà! La logique est impeccable, mais basée sur des prémisses complètement fausses. Pour commencer, elle révèle une vue absurdement formaliste et démocratiste de la conscience de classe. Indubitablement, le développement de la présence et de l'influence des militants révolutionnaires au sein des conseils est une condition nécessaire au succès de la révolution. Mais, définir cette influence exclusivement en termes de majorité statique de délégués est absurde : un conseil pouvait très bien être gagné aux positions révolutionnaires alors que seule une minorité de ses délégués était militants du parti. La CWO, de toute façon, semble considérer que seuls les membres du partis sont capables de pensée et d'action révolutionnaires. Les autres délégués, qu'ils soient membres d'autres courants politiques prolétariens, ou ouvriers "indépendants", sont présentés comme entièrement inconscients, complètement dominés par l'idéologie bourgeoise. Dans la réalité, la conscience de classe ne se développe pas selon ce schéma stérile. Le développement de la conscience révolutionnaire dans la classe ne signifie pas qu'un parti conscient dirige une masse inconsciente, il signifie au contraire que toute la classe, à travers ses luttes, à travers des actions de masse, se dirige vers les positions communistes, le parti indiquant la direction que l'ensemble de la classe commence déjà à prendre. Dans une situation révolutionnaire la conscience se développe à une allure très rapide, et la dynamique du mouvement conduit beaucoup d'ouvriers à prendre des positions bien plus avancées indépendamment de leur "affiliation formelle au parti". En fait, la formation même des conseils, quoique insuffisante en soi à faire aboutir tout le processus révolutionnaire montre déjà qu'un haut niveau d'activité révolutionnaire s'impose à la classe. Comme le KAPD l'exprimait dans ses "Thèses sur le rôle du parti dans la révolution prolétarienne" (1921) :
"Les conseils ouvriers politiques (soviets) sont la forme unitaire, historiquement déterminée, du pouvoir et de l'administration prolétarienne à tout moment, ils dépassent les points particuliers de la lutte de classe et posent la question du pouvoir total".
Dans le mouvement ouvrier, il ne peut y avoir de séparation entre conscience et organisation, un certain niveau d'auto-organisation suppose un certain niveau de conscience de classe. Les conseils ne sont pas de pures formes dans lesquelles un contenu révolutionnaire est injecté par le parti ; ils sont eux-mêmes des produits d'une conscience révolutionnaire naissante dans la classe. Le parti n'y injecte pas la conscience, il aide à son développement et à sa généralisation jusqu'au point le plus haut.
Reconnaissant la complexité et la richesse du processus par lequel la classe devient consciente, l'avant-garde révolutionnaire (que ce soit le parti ou l'avant-garde plus large des délégués aux organes centraux des soviets), ne peut jamais mesurer la profondeur du mouvement communiste des masses par des moyens purement statistiques. Comme le disait Luxembourg dans sa brochure sur la "Révolution russe" :
"...Les bolcheviks ont résolu le fameux problème de "gagner la majorité du peuple", problème qui a toujours pesé sur la social-démocratie allemande comme un cauchemar. Nourris dans le berceau du crétinisme parlementaire, ces sociaux-démocrates appliquent simplement à la révolution le dicton : "Pour faire passer quelque chose, il faut avoir la majorité !". De même dans la révolution : "devenons d'abord majoritaires". La véritable dialectique de la révolution retourne ce précepte ,1e "taupe" parlementaire, non pas par la "majorité vers la tactique révolutionnaire" mais par la "tactique révolutionnaire vers la majorité".
La seconde fausse prémisse de l'argumentation de la CWO est la suivante : si le parti gagne la majorité des délégués aux conseils, ceci équivaut à l'installation du parti au pouvoir. Ceci était la grosse confusion du mouvement ouvrier à l'époque de la révolution russe et devait avoir les conséquences les plus pernicieuses. Aujourd'hui, une telle vision n'est plus excusable. Comme l'écrivait RI en 1969 :
"Il est possible et même probable qu'à certains moments de la lutte un ou plusieurs conseils seront en complet accord avec les positions de telle ou telle organisation révolutionnaire. Cela signifie simplement qu'à un moment donné le groupe en question correspond exactement au niveau de conscience du prolétariat; en aucune façon cela ne signifie que les conseils doivent abandonner leur pouvoir au "Comité Central" de ce groupe. Il est même possible que les délégués élus par les conseils soient tous des membres de ce groupe. Cela n'est pas important et n'implique pas que le conseil soit dans un état de subordination à l'égard de ce groupe, aussi longtemps que le conseil garde son pouvoir de révoquer ses délégués".
Ce n'est pas là du formalisme démocratique, mais une question de principe vitale à laquelle le schéma de la CWO ne répond pas, La question réelle est ceci : qui prend les décisions? Qui les fait respecter? Les délégués aux conseils sont-ils révocables à tout moment, ou seulement jusqu'à la"conquête du pouvoir par le parti"? L'élection et le rappel des délégués ne seraient que des moyens pour le parti de venir au pouvoir -après quoi ils peuvent être abandonnés-ou bien correspondent-ils aux besoins les plus profonds du prolétariat? Une autre question ignorée par la CWO mais évidente aux bordiguistes qui ne font même pas semblant de dire qu'ils se soumettrait au mécanisme démocratique des conseils : si le parti est un parti mondial, comme il le sera dans la prochaine vague révolutionnaire, alors l'exercice du pouvoir par le parti#même dans un seul pays, signifie que le pouvoir doit être dans les mains de l'organe central du parti mondial. Et comment peuvent faire les ouvriers dans un bastion pour maintenir leur contrôle sur un organe qui est organisé au niveau mondial?
La vérité, en l'occurrence, est qu'on ne peut être simultanément pour le pouvoir du parti et pour le pouvoir des conseils. Comme nous l'avons vu auparavant, la délégation de pouvoir au parti est inévitable dans les parlements bourgeois où les électeurs "choisissent" un appareil pour les gouverner pour une période donnée. Mais un tel schéma est en complète contradiction avec le fonctionnement des conseils qui cherche à rompre la séparation entre les masses et leur pouvoir politique, entre décision et exécution, entre les "dirigeants" et les "dirigés". La structure de classe collective des conseils, leur mécanisme d'élection et de révocation, fait que le pouvoir de prendre et d'appliquer des décisions reste entre les mains des masses à tout moment. Les délégués des conseils, membres du parti ne cacheront pas leur appartenance politique; en fait ils défendront activement les positions de leurs organisations mais cela ne change pas le fait qu'ils sont élus par des assemblées, par des conseils pour appliquer les décisions de ces assemblées ou conseils, et seront révoqués s'ils ne le font pas. Même quand il y a une étroite harmonie entre les positions du parti et les décisions des conseils, cela ne signifie pas que le pouvoir ait été délégué au parti. La délégation de pouvoir veut dire en réalité la délégation de la capacité de prendre et d'imposer des décisions à un appareil qui ne coïncide pas avec les conseils, et qui ne peut pas par conséquent, rester sous leur contrôle. Une fois qu'on en arrive là, l'élection et la révocabilité perdent tout leur sens; des postes de la plus haute responsabilité peuvent être désignés par le parti, des décisions des plus cruciales peuvent être prises sans se référer aux conseils. Graduellement, les conseils cessent d'être le foyer de vie de la révolution et se transforment en simples tampons pour les décisions du parti.
Il est important d'insister sur ce point, non pas que nous fassions un fétiche de la forme démocratique -comme nous l'avons dit, la conscience de classe ne peut pas être mesurée seulement par des votes. Mais cela ne change pas le fait que, si les conseils ne conservent pas leurs mécanismes "démocratiques" (élections et révocations, prises de décisions collectives) ils seront incapables de remplir leur rôle politique essentiel comme centres vivants de la clarification et de l'action pour l'ensemble de la classe. Les formes démocratiques sont indispensables parce qu'elles rendent la classe capable d'apprendre comment penser, décider et agir pour elle-même. Si le socialisme est le contrôle conscient des producteurs sur leur propre produit, alors, seule une classe ouvrière auto-agissante et auto- consciente peut réaliser le projet socialiste.
Certains peuvent objecter que la démocratie prolétarienne des conseils n'est pas une garantie que les conseils agiront de manière révolutionnaire. C'est évident qu'il n'y a pas de garantie. En fait, cette ouverture laisse les conseils "ouverts" à l'influence des organisations bourgeoises et de leur idéologie. Mais de telles influences ne peuvent être éliminées par des décrets de parti : le parti ne peut les contrer que par une dénonciation politique face à la classe, en démontrant comment ils obstruent les réels besoins de la lutte. Si la majeure partie des ouvriers doivent comprendre pleinement la différence entre les positions des révolutionnaires et les positions des contre-révolutionnaires, ils ne peuvent le comprendre que par la pratique, en voyant les conséquences de leurs actions et décisions. Le maintien du pouvoir de décision dans les conseils est une précaution nécessaire bien qu’en étant pas une garantie suffisante pour le développe) ment de la conscience communiste. D'autre part, comme la confirmé l'expérience russe, le contrôle sur un système de soviets passif et dompté par le meilleur parti du monde ne peut agir que contre le développement d'une telle conscience.
Maintenant, contrairement à ce que clament les conseillistes, le processus par lequel le pouvoir de décision passa des conseils aux bolcheviks ne fut pas fait en une nuit et ne fut certainement pas le résultat d'un effort systématique des bolcheviks pour saper, le pouvoir des conseils. La théorisation de la "dictature du parti" par des éléments comme Zinoviev et Trotski ne vient qu'après la guerre civile et les massacres du blocus impérialiste qui décimèrent la classe ouvrière et sapa les bases matérielles de l'auto activité des soviets. Avant I cela (et en fait jusqu'à la fin de sa vie)
Lénine insistait perpétuellement sur la nécessite de régénérer les soviets, de les remettre à la place centrale qu'ils avaient occupée au début de la révolution. Mais ce serait faux de penser que les positions erronées défendues par les bolcheviks ne jouèrent aucun rôle dans le procès par lequel le parti se substitua aux conseils, que la perte de pouvoir et d'influence des conseils fut le résultat purement automatique de l'isolement de la révolution. En réalité, la transformation du parti bolchevik en parti de gouvernement, la délégation du pouvoir au parti, commença immédiatement à affaiblir le pouvoir effectif des soviets, A partir de 1917, de plus en plus de postes exécutifs et de commissions furent institués par le parti avec de moins en moins de références aux assemblées du soviet; les délégués au soviet étaient mis en place ou déplacés par le parti "par en haut" plutôt que par les organes du soviet eux-mêmes. Les organes unitaires comme les comités de fabrique furent absorbés par les syndicats, organes du parti/Etat; la combativité ouvrière fut dissoute dans l'Armée Rouge de la môme façon Et cela commença avant que la grosse concentration ouvrière ait commencé a être brisée par la guerre civile. Notre but n'est pas de faire ici un catalogue des erreurs des bolcheviks sur cette question, mais de montrer comment leurs positions politiques, leur conception du parti, accéléra la tendance à la subordination des organes unitaires à l'appareil administratif et répressif de l'Etat. La justification politique de ce processus peut être trouvée dans une déclaration de Trotski en 1920 :
"Aujourd'hui nous recevons des propositions de paix du gouvernement polonais. Qui décide sur cette question ? Nous avons un Sovnarkom mais il doit être l'objet d'un certain contrôle. Quel contrôle ? Le contrôle de la classe ouvrière comme masse informe et chaotique ? Non, le comité central du Parti a été rassemblé pour discuter la proposition et décider s'il fallait répondre. La même chose vaut pour la question agraire, la question du ravitaillement et toutes les autres questions. "
Discours au 2ème Congrès de TIC
L'idée qui sous-tend cette attitude est celle de la social-démocratie, pour qui, une fois que le parti prolétarien a pris le pouvoir, l'Etat est automatiquement dirigé dans l'intérêt du prolétariat. La classe "charge" le parti de son pouvoir, et le besoin pour les soviets de prendre réellement les décisions s'en va avec. En fait, cela ne pourrait être L qu'une abdication de responsabilité par les soviets, les rendant de moins en moins capables de résister à la tendance à la bureaucratisation qui se développe de façon chronique pendant la guerre civile.
Afin d'éviter toute incompréhension, reprécisons ce point. Nous ne disons pas que le parti ne doit pas chercher un soutien ou une représentation dans le soviet. Au contraire, il est essentiel pour le parti d'essayer d'obtenir une influence décisive dans les conseils. Mais cette influence, ce rôle ne peut être que politique. Le parti ne peut intervenir dans les prises de décisions qu'en convaincant les conseils de la justesse de ses positions. Au lieu de s'arroger la «responsabilité du pouvoir de décision, il doit insister encore et toujours pour que toutes les décisions majeures affectant le cours de la révolution soient discutées, comprises et mises en acte au sein des conseils. Et c'est pourquoi, il est profondément faux de parler de parti "prenant le pouvoir", avec ou sans la majorité formelle dans les conseils. Le parti ne peut être "au pouvoir" que s'il a la capacité d'imposer ses positions à la classe, aux conseils. Cela implique que le parti doit avoir un appareil de pouvoir qui est séparé des conseils. Les partis, eux-mêmes ne possèdent généralement pas un tel appareil, et le parti bolchevik ne fait pas exception. En fait, le seul mode par lequel le parti bolchevik pouvait réellement être au pouvoir était de "s'identifier à l'Etat". C'est pourquoi, il est impossible de comprendre le problème du substitutionnisme sans comprendre le problème de l'Etat post-révolutionnaire
PARTI ET ETAT
Certains courants politiques, y inclus la CWO et par ailleurs divers conseillistes, ne voient pas de problème au sujet de l'Etat dans la période de transition. L'Etat, c'est les Conseils ouvriers, un point c'est tout î Partant, toute discussion sur de possibles conflits entre les organes unitaires de la classe, et l'Etat transitoire est un pur non-sens. Malheureusement, c'est une vision idéaliste de la révolution. En tant que marxistes, nous devons baser nos conceptions de la révolution, non pas sur ce que nous aimerions voir arriver, mais sur ce que la nécessité historique a impliqué dans le passé et ce qu' elle impliquera dans l'avenir. Le seul exemple réel de la classe ouvrière prenant le pouvoir -la révolution russe- nous oblige à admettre qu'une société en révolution fait naître obligatoirement des formes d'organisation d'Etat qui ne sont pas seulement distinctes des organes unitaires de la classe, mais qui peuvent entrer en contradiction profonde et même violente avec elle. La nécessité d'organiser une Armée Rouge, une police d'Etat, un appareil administratif, une forme de participation politique pour toutes les classes et couches non exploiteuses, ces nécessités matérielles sont ce qui donne naissance à une machine d'Etat qui ne peut -qu'on lui donne ou non l'étiquette de "prolétarien"- être assimilée aux conseils ouvriers. Contrairement à ce que disent certains conseillistes, les Bolcheviks n'ont pas créé cette machine ex-nihilo pour servir leurs fins machiavéliques. Bien que nous devions comprendre comment les conceptions bolcheviques de leur rôle en tant que parti de gouvernement accéléra la tendance de cette machine à échapper au contrôle des soviets ouvriers, ils ne faisaient que mouler et adapter un organe d'Etat qui avait déjà commencé à émerger avant la révolution d'Octobre. Les congrès des soviets d'ouvriers et de paysans et de soldats évoluaient vers une nouvelle forme d'Etat avant même le renversement du régime Kerensky. La nécessité de donner à la société post-insurrectionnelle une forme organisée, consolida ce processus en Etat des soviets. Comme Marx l'écrivait dans "Notes critiques "Le toi de Prusse et la réforme sociale" : "Du point de vue politique, l'Etat et l'organisation de la société ne sont pas deux choses différentes. L'Etat, c'est l'organisation de la société."
Si la révolution russe a quelque chose à nous apprendre à propos de cet Etat, c'est que l'isolement de la révolution, l'affaiblissement des conseils ouvriers tendront à renforcer l'appareil d'Etat au détriment du prolétariat. Ils commenceront à transformer cet Etat en instrument d'oppression et d'exploitation contre la classe. L'Etat est le point le plus vulnérable aux forces de la contre-révolution. C'est l'organisme par lequel le pouvoir impersonnel du capital pourrait s'exprimer, transformant une révolution prolétarienne en un cauchemar bureaucratique de capitalisme d'Etat. Ceux qui prétendent que ce danger n'existe pas désarment la classe devant ses futures batailles.
Certaines tendances, en particulier celles qui ont eu connaissance de la contribution de la Gauche Italienne sur cette question, comprennent qu'il y a un problème. Ainsi"Battaglia Communista" en même temps qu'il déclare à la récente conférence internationale de Paris que le parti doit vraiment prendre le pouvoir, dit dans sa plate-forme que le parti doit "tenir l'Etat sur la voie de la continuité révolutionnaire" mais ne "doit en aucune façon être confondu avec l'Etat et y être intégré". Comme "Bilan" dans les années 1930, ces tendances veulent que le parti prenne le pouvoir, exerce la dictature du prolétariat, et contrôle l'appareil d'Etat -mais ne fusionne pas avec l'Etat comme le fit le parti bolchevik, dans la mesure où ils reconnaissent que la confusion entre le parti bolchevik et l'appareil d'Etat contribua à la dégénérescence du parti et de la révolution. Mais cette position était contradictoire. Pour "Bilan", cette contradiction était fertile, dans la mesure où il était engagé dans un mouvement de clarification des relations entre parti et classe, mouvement qui fut à notre avis, continué et avancé par le travail de la Gauche Communiste de France après la guerre, et par le CCI aujourd'hui. Mais en revenir aujourd'hui aux contradictions de "Bilan" ne peut être qu'une régression.
Cette position est contradictoire parce que le parti ne peut pas "contrôler" l'Etat sans avoir des moyens d'imposer ce contrôle. Pour cela, soit le parti doit avoir ses propres organes de coercition pour s'assurer que 1'Etat suit ses directives, soit, comme c'est plus probable, et comme cela est arrivé en Russie, le parti doit s'identifier de plus en plus avec les sommets dirigeants de l'Etat, avec les mécanismes de l'administration et de la répression. Dans tous les cas, le Parti devient un organe d'Etat. Prétendre que le parti peut l'éviter, soit par sa simple clarté programmatique, soit par des mesures organisationnelles comme la mise en place d'un sous-comité spécial pour diriger l'Etat, supervisée par le comité central, c'est ne pas comprendre que ce qui est arrivé en Russie était le résultat d'énormes forces sociales. On ne peut éviter sa répétition que par l'intervention de forces sociales encore plus grandes, et pas seulement par des mesures idéologiques et organisationnelles.
L’Etat transitoire, bien qu’absolument nécessaire pour la défense de la révolution, ne peut pas être un facteur dynamique du mouvement vers le communisme. C'est au mieux, un instrument que la classe utilise pour protéger et codifier les avances faites par le mouvement social communiste. Mais le mouvement lui-même est conduit par les organes unitaires de la classe, qui expriment réellement la vie et les besoins de la classe, et le parti communiste qui met sans cesse en avant les buts généraux du mouvement. Les organes unitaires de la classe ne peuvent être soumis au poids du fonctionnement au jour le jour de l'Etat. Ils ne peuvent remplir leur rôle qu'en créant un bouleversement permanent, brisant incessamment les limites étroites des constitutions des lois et des routines administratives qui, de toute façon sont l'essence de l'Etat. Ce n'est que de cette manière qu'ils pourront répondre de façon créative aux immenses problèmes posés par la construction du communisme et forcer la ma chine d'Etat à obéir aux besoins globaux de la révolution. C'est la même chose pour le parti, qui aussi bien avant qu'après la conquête du pouvoir, doit s'enraciner dans les masses et leurs organes de lutte, les poussant infatigablement de l'avant, critiquant leurs hésitations. La fusion entre le parti et l'Etat sapera, comme ce fut le cas pour les bolcheviks, ce rôle dynamique et transformera le parti en force conservatrice, préoccupé avant tout par les besoins immédiats de l'économie et par des fonctions purement administratives. Le parti perdrait alors sa fonction primordiale qui est de donner une direction politique, à laquelle toutes les tâches administratives doivent être subordonnées.
Le parti interviendra certainement dans tous les organes représentatifs de l'Etat, mais organisationnellement il maintiendra une séparation complète avec la machine étatique. La direction qu'il sera capable de donner à l'Etat dépendra de sa capacité à convaincre politiquement les dé1élégués des soviets territoriaux, des comités de soldats, des masses de petits paysans, des paysans sans terre...etc., de la validité de ses positions. Mais il ne peut pas "diriger" l'Etat sans devenir lui-même un organe d'Etat. Seuls les conseils ouvriers peuvent réellement contrôler l'Etat, dans la mesure où ils restent armés durant le processus révolutionnaire et peuvent imposer leurs directives à l'Etat à travers des actions de masse. Et "l'arène" primordiale de l'intervention du parti est les conseils ouvriers où il fera une agitation continuelle pour assurer que le contrôle vigilant des conseils sur l'ensemble des organes d'Etat ne vacille pas un moment.
PARTI ET CLASSE
Tôt ou tard, tous les groupes du camp révolutionnaire devront mettre un terme aux ambiguïtés et contradictions de leurs positions sur le parti. Il y a un certain côté rassurant à dire que le parti doit prendre le pouvoir, et, à notre avis l'exposé le plus logique de cette position revient dans le camp prolétarien aux bordiguistes.
"L'Etat prolétarien ne peut être "animé" que par un parti unique; et il serait un non-sens de vouloir que ce parti organise dans ses rangs une majorité statistique et qu’il soit soutenu par une telle majorité dans des "élections populaires" -ce vieux piège bourgeois le parti communiste dirigera seul, et n'abandonnera pas le pouvoir sans lutte physique. Cette audacieuse déclaration de ne pas céder aux apparences toujours trompeuses des chiffres et de n'en pas faire usage, aidera la lutte contre la dégénérescence de la révolution".
"Dictature du prolétariat et Parti de classe"
Comparé au formalisme démocratique de la CWO, cette position est rafraîchissante de clarté. Le parti communiste qui défend invariablement "les intérêts historiques de la classe ouvrière" n'utilise les mécanismes démocratiques des conseils que pour prendre le pouvoir. Une fois au pouvoir, il utilise l’Etat pour imposer ses décisions aux masses. Si les masses agissent contre ce que le parti juge être ses propres intérêts historiques, il usera de violence, la fameuse terreur rouge, pour obliger la classe à rester dans la ligne de "ses propres intérêts historiques". Ceux qui veulent que le parti prenne le pouvoir mais hésitent à suivre cette logique, tombent à côté de la réalité historique. Mais l'impitoyable façon dont cette logique s'impose fut démontré de manière caricaturale par la CWO à la récente conférence de Paris, où ils affirmèrent très explicitement que, une fois au pouvoir, le parti ne devrait pas hésiter à user de la violence contre les expressions "retardataires" ou "contre-révolutionnaires" de la classe.
Il est vraiment ironique que la CWO, qui a si longtemps insisté sur le fait que le massacre de Kronstadt marque le passage du parti bolchevik dans le camp bourgeois, qui même dénonçait le CCI comme "apologiste" du massacre parce qu'il considère que 1921 n'est pas la fin des bolcheviks comme parti prolétarien, puisse maintenant préparer idéologiquement la voie à de nouveaux Kronstadt. Nous ne devons pas oublier que Kronstadt n'est que le point culminant d'un processus dans lequel le parti eut de plus en plus recours aux mesures de coercition contre la classe. La leçon de l'ensemble de ce processus, tragiquement illustré par le désastre de Kronstadt, c'est qu'un parti prolétarien -avec ou sans le soutien de la majorité de la classe- ne peut utiliser la répression physique contre un secteur de la classe sans affaiblir la révolution et pervertir sa propre essence. Cela fut exprimé très clairement par la Gauche Italienne en 1938 :
"La question à laquelle nous sommes confrontés est la suivante : des circonstances peuvent exister dans lesquelles un secteur du prolétariat -et nous admettrons toujours qu'il puisse être la victime inconsciente de l'ennemi -entre en lutte contre l'Etat prolétarien. Que faire dans une telle situation ? NOUS DEVONS COMMENCER PAR LE PRINCIPE QUE LE SOCIALISME NE PEUT PAS ETRE IMPOSE A LA CLASSE PAR LA FORCE ET LA VIOLENCE. Il aurait été préférable de perdra Kronstadt si le conserver du point de vue géographique ne pouvait avoir qu'un résultat : une distorsion dans la substance même de l'activité du prolétariat. Nous connaissons l'objection à cela; la perte de Kronstadt aurait été une perte décisive pour la révolution, peut-être même la perte de la révolution elle-même. Nous prenons là la question par le petit bout. Quels critères sont utilisés dans cette analyse ? Ceux qui dérivent des principes de classe, ou d'autres qui dérivent simplement d'une situation donnée ? Partons-nous de l'axiome qu'il est meilleur pour les ouvriers de faire des erreurs même fatales ou de l'idée que nous devrions suspendre nos principes, parce que, par la suite, les ouvriers nous seront reconnaissants de les avoir défendus, même par la violence ?
Chaque situation donne naissance à deux séries opposées de critères, qui conduisent à deux conclusions tactiques opposées. Si nous basons notre analyse sur de pures formes, nous arriverons à la conclusion qui dérive de la proposition suivante : tel et tel organe est prolétarien, et nous devons le défendre comme tel même si cela signifie l'écrasement d'un mouvement ouvrier. Pourtant, si nous basons notre analyse sur des questions de substance, nous arriverons à une conclusion très différente; un mouvement prolétarien manipulé par l'ennemi contient en son sein une contradiction organique entre le prolétariat et son ennemi de classe. Afin d'amener cette contradiction à la surface, il est nécessaire de faire de la propagande parmi les ouvriers qui, dans le cours des événements, retrouveront leur force de classe et seront capables de déjouer les plans de l'ennemi. Mais si par hasard il était vrai que tel ou tel événement pouvait signifier la défaite de la révolution, alors il est certain qu'une victoire ne serait pas seulement une distorsion de la réalité (les événements historiques comme la révolution -russe ne peuvent réellement dépendre d'un seul épisode et seul un esprit superficiel pourrait croire que l'écrasement de Kronstadt aurait pu sauver la révolution), mais fournirait aussi les conditions de la perte de la révolution. Le bradage des principes ne resterait pas localisé mais s'étendrait inévitablement à toutes les activités de l'Etat prolétarien. "
("La question de l’Etat" Octobre-1938)
Même si "Octobre" continuait à défendre la dictature du parti, pour la Gauche Communiste de France et pour nous aujourd'hui, la seule façon d'aller jusqu'au bout de cette analyse, c'est d'affirmer que le parti prolétarien ne cherche pas le pouvoir, ne cherche pas à devenir un organe d'Etat. Autrement, on compte seulement sur la volonté ou les bonnes intentions du parti pour le prémunir contre les risques de conflits violents avec la classe, mais, une fois qu'il est devenu un organe d'Etat, la meilleure volonté du meilleur parti communiste du monde n'est pas suffisante pour l'immuniser contre l'inexorable pression de l'Etat. C'est pourquoi la Gauche Communiste de France concluait en 1948 :
"Pendant la période insurrectionnelle de la révolution, le rôle du parti n'est pas de demander le pouvoir pour lui-même, ni de demander aux masses de lui faire confiance. Son intervention et son activité visent à stimuler l'auto-mobilisation de la classe pour la victoire des principes révolutionnaires.
La mobilisation de la classe autour du parti auquel elle se confie, ou plutôt abandonne sa direction, est une conception qui reflète un état d9immaturité dans la classe. L'expérience a montré que dans de telles conditions, la révolution ne peut pas vaincre et cette conception mène finalement à la dégénérescence du parti et au divorce entre parti et classe. Le parti serait bientôt forcé d'avoir recours de plus en plus aux méthodes de coercition pour s 'imposer à la classe, et deviendrait ainsi un formidable obstacle à la révolution". (Sur la nature et la fonction du parti politique du prolétariat. Bulletin d'Etudes et de Discussions n°6)
Les révolutionnaires sont confrontés aujourd'hui à un choix. D'un côté, ils peuvent adopter des positions qui mènent au bordiguisme, à l'apologie d'une théorisation de la dégénérescence du parti bolchevik, au substitutionnisme dans sa forme la plus développée. Mais, ils découvriront que le substitutionnisme est, en effet exclu et impossible pour le mouvement prolétarien, parce qu'il conduit à des pratiques et à des positions qui sont directement contre-révolutionnaires. Ou bien ils peuvent reprendre l'esprit profondément révolutionnaire qui conduisait Lénine à dire dans son appel à "la population" quelques jours après l'insurrection :
"Camarades ouvriers ! Souvenez-vous que vous administrez vous-mêmes l'Etat maintenant. Personne ne vous aidera si vous ne vous unissez pas et ne prenez pas toutes les affaires de l'Etat dans vos propres mains. Vos soviets sont désormais les organes du pouvoir d'Etat, des organes avec tous les pouvoirs des organes de décision."
C'est dans cet esprit, aidé par la compréhension du rapport entre parti-classe-Etat, léguée par l'expérience russe, que nous devons chercher un guide aujourd'hui. C'est un esprit en accord profond avec les buts et la méthode de la révolution communiste, de la nature révolutionnaire de la classe ouvrière. Si nous devons le dire un millier de fois, nous le ferons. Le communisme ne pourra être créé que par l'activité consciente du prolétariat, e t l’avant-garde communiste ne peut jamais agir dans un sens qui va à l'encontre de cette réalité fondamentale. Le parti révolutionnaire ne peut en aucun cas utiliser le manque d'homogénéité dans la classe, le poids de l'idéologie bourgeoise, ou les menaces de la contre-révolution, pour justifier l'usage de la force pour "contraindre" la classe à être révolutionnaire. C'est une contradiction dans les termes et cela exprime le poids de l'idéologie bourgeoise sur le parti. La classe ouvrière ne peut se débarrasser du poids de l'idéologie bourgeoise que par sa propre activité de masse, par son expérience. A certains moments, il peut paraître plus simple de confier ces tâches, les plus cruciales, à l'organisation des révolutionnaires, mais quels que soient les "gains" apparents à court terme que cela semble donner, les effets à long terme ne peuvent être que l'affaiblissement de la classe. Il ne peut pas y avoir d'arrêt dans la révolution prolétarienne ; "ceux qui font les révolutions à moitié, creusent leur propre tombe" (Saint-Just). Pour la classe ouvrière, cela signifie lutter incessamment pour dépasser toutes les tendances passives et conservatrices dans ses propres rangs tendances qui sont les fruits amers des siècles de la domination de l'idéologie bourgeoise. Cela signifie un développement et une extension infatigable de son auto organisation et son auto-conscience, avant, pendant et après la prise du pouvoir politique. Les polémiques de Pannekoek contre les tactiques parlementaires de l’IC peuvent aussi bien être appliquées à ceux qui voient un rôle essentiellement parlementaire du parti dans les soviets
"La révolution exige quelque chose de plus, que l'acte combatif des masses qui abat un système de gouvernement et dont nous savons qu'il n'est pas déterminé par les chefs, qu'il ne peut jaillir que de la poussée profonde des masses. La révolution exige que l'on affronte les grandes questions de la reconstruction sociale, que l'on prenne les graves décisions, que tout le prolétariat soit lancé dans un mouvement créateur -et cela n'est possible que si l'avant-garde d'abord, et puis une masse toujours plus grande prend entre ses mains toutes les questions, sache en prendre la responsabilité, cherche, fasse de la propagande, lutte, réfléchisse, ose, agisse et exécute. Mais tout cela est difficile, et pénible. Aussi, dès que la classe ouvrière croira apercevoir un chemin plus facile, en laissant les autres agir pour son compte, conduisant l'agitation d'une tribune élevée, donnant les signaux de l'action, faisant les lois -la masse hésitera et demeurera passive sous l'influence des vieilles habitudes mentales et des faiblesses anciennes.(la Révolution Mondiale et les Tactiques Communistes)
Il y a beaucoup de gens qui veulent être les dirigeants de la classe ouvrière. Mais la plupart "confonde la conception bourgeoise de direction et la façon dont le prolétariat se donne sa propre direction. Ceux qui, au nom de la direction appellent la classe à abandonner ses tâches les plus cruciales à une minorité ne dirigent pas la classe vers le communisme, mais renforcent lai vieille idéologie bourgeoise dans la classe. Idéologie qui, du berceau à la tombe, essaie de convaincre les ouvriers qu'ils ne sont pas capables de s'organiser eux-mêmes, qu'ils doivent laisser à d'autres la tâche de les organiser. Le parti révolutionnaire n'aidera le prolétariat à aller vers le communisme qu'en stimulant et généralisant la conscience, qui d'elle-même, va à l’encontre de 1'idéologie bourgeoise, une conscience de l'inépuisable capacité de la classe à s'organiser et à prendre conscience d'elle, comme sujet de l'histoire. Les communistes, sécrétés par une classe qui ne contient pas de nouvelles relations d'exploitation en son sein, sont uniques dans l'histoire des partis révolutionnaires du fait qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour rendre la fonction du parti inutile au fur et à mesure de l'homogénéisation et de la généralisation de la conscience de classe Plus le prolétariat ira sur le chemin du communisme, plus l'ensemble de la classe deviendra l'expression vivante de 1'auto-connaissance positive de l'homme", d'une communauté humaine libérée et consciente.
CD WARD
Courants politiques:
- Gauche Communiste [13]
Heritage de la Gauche Communiste:
La Grande-Bretagne depuis la 2e guerre mondiale
- 16839 reads
L'analyse de la situation sociale à un moment donné -au niveau international comme national -ne peut jamais être une simple photographie. Les événements ponctuels ne sont que des moments dans un rapport de forces dynamique qui se développe graduellement Nos analyses précédentes de la situation en Grande-Bretagne se sont limitées à examiner essentiellement la période depuis 1967, année de la dévaluation de la livre-sterling, qui a annoncé le début de l'actuelle crise ouverte du système capitaliste mondial. Ce texte tente de donner une perspective plus large de la situation en Grande-Bretagne en examinant l'évolution depuis la seconde guerre mondiale.
SIGNIFICATION GENERALE DE LA PERIODE POUR LA GRANDE-BRETAGNE
1 - La signification générale de cette période peut être résumée par les points suivants :
• la capacité de la Grande-Bretagne à rester un pouvoir impérialiste dominant, a été brisée par les efforts systématiques des USA pendant et après la seconde guerre mondiale". Les USA ont fait en sorte d'amener la Grande-Bretagne à une position de dépendance économique et militaire totale au sein du bloc occidental constitué après la guerre.
• la charge de "parti naturel de gouvernement" s'est irréversiblement transmise des conservateurs au parti travailliste. Cette aptitude du parti travailliste à répondre globalement aux besoins du capital britannique n'est pas le simple produit des circonstances conjoncturelles de ces dernières années mais est bien la caractéristique fondamentale de toute la période depuis la seconde guerre. En effet, ce qui est le produit de circonstances conjoncturelles spécifiques, ce sont les périodes pendant lesquelles les conservateurs étaient appelés au gouvernement.
• le rapport de forces entre la bourgeoisie et le prolétariat a subi un changement historique. Si la deuxième guerre mondiale a marqué l'apogée de la bourgeoisie et le creux du prolétariat, aujourd'hui le prolétariat s'est renforcé à tel point que non seulement il constitue un frein à la troisième guerre mondiale, mais aussi qu'il peut aller plus loin afin d'imposer sa solution révolutionnaire à la crise historique du capitalisme. Bien que ce changement du rapport de forces se situe au niveau international, sa manifestation en Grande-Bretagne a eu un effet profond sur la situation locale. Tels sont les principaux thèmes de ce texte.
LA G.B. ET LA FORMATION DU BLOC U.S.
2 - La deuxième guerre mondiale a changé la physionomie du système impérialiste mondial du capitalisme. Elle a transformé la situation avant 1939, caractérisée par plusieurs "mini-blocs" rivaux en deux grands blocs mondiaux, chacun sous l'hégémonie d'une bourgeoisie nationale dominante, les USA et la Russie. La guerre ne s'est pas uniquement poursuivie militairement entre "Alliés" et pays de l'Axe mais économiquement entre les "Alliés" eux-mêmes -ou plutôt entre les USA et chacun des autres pays. Pour la Grande-Bretagne, sa "guerre" avec les USA a été l'élément décisif pour sa position après-guerre.
3 - Dans les années 30, la pierre angulaire de l'économie britannique est toujours restée son empire, c'est-à-dire ses colonies officielles (telle que l'Inde) et les demi colonies (telles que la Chine et l'Argentine). On peut se rendre compte aisément du rôle primordial, irremplaçable, de l'empire en tant que source principale des richesses pour son économie. Sur une base 100 en 1924, l'indice du revenu national global s'élève à 114 en 1934 tandis que l'indice du revenu national venant d'outre-mer s'élève à 140. En 1930, les investissements de la Grande-Bretagne à l'étranger dépassent ceux de tout autre pays au monde; ces investissements apportent 18 % de toute la richesse nationale. Pendant toute cette période, la Grande-Bretagne domine, par rapport aux autres pays, la plus grande partie du commerce mondial : 15,4 % en 1936.
En termes absolus et relatifs, les investissements de la Grande-Bretagne dépassent largement ceux des USA. Par exemple, en 1930 (à la veille de la grande crise), l'investissement de la Grande-Bretagne à l'étranger s'élève à 80-85 milliards de marks, celui des USA à 60-65 milliards de marks- En 1929, le revenu de la Grande-Bretagne venant des investissements à long terme à l'étranger se chiffre à 1219 millions de dollars-or tandis que pour les USA, le chiffre est de 876 millions de dollars-or. Cependant, l'énorme économie des USA (dont la richesse nationale était de 1760 milliards de marks en 1930 par rapport à 450 milliards de marks pour la Grande-Bretagne) s'est développée beaucoup plus rapidement que celle de la Grande-Bretagne et le besoin de marchés étrangers devenait de plus en plus urgent pour les USA comme on peut le voir par exemple, en comparant la croissance respective des investissements du capital à l'étranger. Le capital britannique investi à l'étranger en 1902 est de 62 milliards de francs (à la parité d'avant-guerre), il s'élève à 94 milliards en 1930; les chiffres pour les USA sont de 2,6 milliards de francs en 1900 et 81 milliards en 1930. Il est évident qu'avec un tel appétit pour les marchés étrangers, les USA ne pouvaient que désirer ardemment l'empire auquel s'accrochait désespérément la bourgeoisie britannique à cause de ses marchés et matières premières.
Avec la concurrence de plus en plus acharnée (surtout des USA et de l'Allemagne), la perte de l'empire aurait été une catastrophe. Mais en même temps, maintenir un tel empire est très coûteux. Des menaces venaient de tous côtés : l'extension militaire japonaise et allemande, les bourgeoisies coloniales luttant pour élargir leurs propres positions aux dépens de la Grande-Bretagne, la pression » surtout celle des USA, pour mettre fin aux privilèges économiques dans l'empire et pour ouvrir les marchés à leur propre expansion économique. Certaines fractions de la bourgeoisie britannique se battaient depuis longtemps pour essayer de trouver une façon moins onéreuse de maintenir les avantages de la Grande-Bretagne mais elles s'étaient heurtées à des intérêts très enracinés. C'est pourquoi, jusqu'au commencement de la guerre et même durant la première année, la bourgeoisie britannique restait très divisée sur la meilleure voie à suivre.
Le choix essentiel était : aller à la guerre ou l'éviter. Parmi ceux qui désiraient la guerre, se trouvaient une petite fraction pro-allemande dans le Parti conservateur, mais des fractions beaucoup plus larges de la bourgeoisie voyaient un plus grand intérêt à vaincre l'Allemagne. Celles-ci comprenaient l'aile gauche du Parti Travailliste et la fraction du Parti conservateur conduite par Churchill. Cependant, d'autres fractions bourgeoises comprenaient que, quel que soit le camp choisi par la Grande-Bretagne, la guerre conduirait forcément au démembrement de l'empire au profit soit de l'Allemagne, soit des USA. Ce point de vue était celui du gouvernement Chamberlain -d'où la politique d'apaisement qui a abouti à l'accord de Munich en 1938. C était seulement en esquivant la guerre que la Grande-Bretagne pouvait éviter de devenir dépendante soit de l'Allemagne,soit des USA. Cependant, pour des raisons objectives générales, la guerre était inévitable et la seule question réelle était : avec qui la Grande-Bretagne va-t-elle s'allier et contre qui ? En essayant d'éviter la guerre, Chamberlain a tenu le rôle ridicule d'un canut et depuis lors le reste de la bourgeoisie l'a profondément méprisé.
4 - Dans les faits, l'intervention de l'Allemagne en Autriche, en Tchécoslovaquie et Pologne associée au pacte de non-agression entre Hitler et Staline signifiait que la prochaine extension allemande se ferait vers l'Ouest. La menace envers le littoral britannique était claire et Chamberlain déclara la guerre à l'Allemagne. Il s'ensuivit cependant une période d'indécision pendant laquelle la bourgeoisie anglaise fut dirigée par ceux qui avaient voulu éviter la guerre; pendant ce temps, la bourgeoisie allemande espérait que la situation se tasserait à l'Ouest de façon à ce qu'elle puisse s'étendre à l'Est aux dépens de la Russie. Cette période fut celle de la "drôle de guerre". Elle se termina par l'avancée de l'armée allemande à travers les Ardennes et la capitulation de la France en Mai 1940. Ces événements précipitèrent la chute de Chamberlain et la montée au pouvoir de la coalition des forces rassemblées autour de Churchill, qui s'engagea coûte que coûte à trouver une solution aux problèmes du capital britannique, par la défaite de l'expansionnisme allemand. Comme il était clair que la capacité productive de la Grande-Bretagne était insuffisante pour assumer les exigences de la guerre, la bourgeoisie britannique fut forcée de demander de l'aide aux USA.
5 - Les objectifs de la politique de la bourgeoisie américaine à l'égard de la guerre était :
• de vaincre l'Allemagne et le Japon
• d'empêcher la montée de la Russie en Europe
• de réduire la Grande-Bretagne et son empire à une dépendance des USA.
En poursuivant ces buts, la politique de la bourgeoisie américaine était faite de manoeuvres; pour assurer la victoire au coût le moins cher possible. Cela signifiait saigner les alliés autant que possible pour les paiements du matériel de guerre sans toutefois porter atteinte à leur engagement dans l'effort de guerre; utiliser l'énorme marché crée par la guerre pour stimuler l'économie américaine et absorber le chômage dans le processus de production; minimiser le mécontentement face à la guerre en s'assurant que la plus grande partie des massacres sur les champs de bataille serait encaissée par les armées alliées.
Dans les premières phases de la guerre, l'application de cette politique frappa l'économie I britannique plus fortement que l'aviation allemande. A cause du système du "cash and carry" I (1), les réserves financières britanniques s'épuisèrent de plus en plus pour payer le matériel de guerre, l'essence et la nourriture dont une importante partie n'atteignit de toute façon jamais la Grande-Bretagne à cause des na-1 vires coulés dans l'Atlantique Nord. La bourgeoisie américaine pouvait donc affaiblir systématiquement la capacité de la bourgeoisie britannique à résister aux conditions économiques et militaires imposées dans ces arrangements. Et ainsi, lorsqu'en 1941, les accords pour le "lend lease" ([1] [117]) vinrent remplacer le système du "cash and carry" ([2] [118]) (qui avait couté au capital britannique près de 3,6 milliards de dollars), la Grande-Bretagne ne possédait plus que 12 millions de dollars en réserve.
Dans les principaux accords du "lend lease", les USA commencèrent tout un programme "d'arrangement" afin d'obliger la Grande-Bretagne à se défaire de ses privilèges dans l'empire après la guerre : en fait à le démanteler. Et pour s'assurer que la Grande-Bretagne ne pourrait pas différer les remboursements jusqu'à la fin de la guerre, le remboursement du "lend lease" fut prévu pour l'été 1943. Il était exigé payable en nature, en matières premières, en denrées alimentaires, en équipement militaire et en soutien à l'armée américaine dans le théâtre des opérations en Europe. De plus, des évaluations régulières des réserves britanniques étaient faites et lorsque le gouvernement des USA considérait qu'elles étaient "trop volumineuses", des paiements en espèces étaient exigés selon les accords du "lend lease". Les avantages gagnés par les USA aux dépens de la Grande-Bretagne pendant la guerre furent poursuivis et renforcés dès la fin de la guerre. Le jour de la victoire contre le Japon, le "lend lease" prit fin, avec une évaluation s'élevant à 6 milliards de dollars dus aux USA par la Grande-Bretagne. Bien que les USA en aient déduit une proportion substantielle, la somme qui restait à payer était suffisamment élevée pour assurer une domination sur l'ensemble de l'économie britannique. Cette somme résiduelle était de 650 millions de dollars, ce qui était supérieur aux réserves britanniques en devises étrangères. En plus, les USA refusèrent de prendre part au soutien de la livre-sterling (près de 14 milliards de dollars) nécessaire à cause des dettes accumulées pendant l'effort de guerre.
A la fin de la guerre, les USA avaient quasiment réalisé leurs objectifs de guerre par rapport à la Grande-Bretagne et à son empire. Mais il leur fallut quelques années encore pour les réaliser entièrement. Ces objectifs se mêlèrent au besoin de construire et de consolider le bloc occidental face à celui de la Russie. A la fin des années 40, les possibilités d'une troisième guerre mondiale étaient réunies.
6 - Les USA n'ont pas essayé de répéter la politique suivie après la première guerre mondiale, à savoir : acculer l'Europe à la faillite en la forçant à payer ses dettes de guerre et en relevant les tarifs douaniers. Les principaux objectifs des USA étaient d'appliquer des mesures financières visant à la reconstruction des pays du bloc dans le but de favoriser et de stimuler l'économie américaine. La reconstruction de l'Europe et du Japon fourniraient ainsi des marchés pour l'industrie et l'agriculture des USA, en même temps, la reconstruction permettrait à ces pays de contribuer à la capacité militaire du bloc.
Ces plans furent mis en place avant la fin même de la guerre -de façon nette dans les accords de Bretton Woods (Fonds Monétaire International et Banque Mondiale). Cependant, dans le contexte de cette stratégie d'ensemble, les USA choisirent pour la Grande-Bretagne un"traitement" spécial. Puisque les actions d'arrière garde de Churchill résistaient aux efforts des USA pour "libérer" l'empire de l'étreinte de la bourgeoisie britannique, les USA maintinrent une pression constante sur l'économie britannique. En retour des 3,75 milliards de dollars prêtés pour aider -vu les difficultés de la liquidation du "lend lease"-, le gouvernement britannique devait accepter d'aider les USA à imposer le plan Bretton Woods au reste du bloc. Il devait rendre aussi la livre sterling convertible au milieu de l'année 1947, ce que voulaient les USA, afin de rendre la Grande-Bretagne plus vulnérable et l'obliger à faire appel à ses réserves (et en effet ceci réussit trop bien : quand la Grande-Bretagne perdit 150 millions de dollars-or et de dollars de réserve en un mois, les USA permirent une suspension de la convertibilité).
Lorsque la rivalité entre les USA et la Russie devint plus intense, les USA sentirent le besoin d'accélérer le processus de reconstruction et d'accroître la dépense militaire européenne. Le Plan Marshall fournit les fonds entre 1948-1951 et l'OTAN fut crée en 1949. La pression sur la bourgeoisie britannique fut maintenue pendant toutes les années autour de 1940 afin d.'obtenir une contribution élevée à cette force militaire. Tandis que les USA démobilisaient assez rapidement, la Grande-Bretagne devait fournir des forces considérables en Europe (en 1948, la Grande-Bretagne avait encore 1 million d'hommes en armes). En 1950, les USA engagèrent dans la guerre de Corée, d'abord leurs troupes, puis les troupes alliées (celles de la Grande-Bretagne inclus). Ils demandèrent aussi un accroissement énorme du budget militaire britannique -4,7 billions de livres en 1950. Avec le réarmement de l'Allemagne en 1950, la facture de l'armée d'occupation britannique fut retirée à la bourgeoisie allemande et soumise à la bourgeoisie britannique.
D'autres mesures furent prises pour maintenir la pression économique sur le capital britannique : par exemple, lorsque les USA donnèrent le "feu vert" aux Japonais pour réarmer en 1957, ils abrogèrent alors les réparations du Japon à la Grande Bretagne; et lorsque la Grande-Bretagne essaya de laisser ses propres dettes à ses colonies (par le non-paiement des matériaux et des services), les USA s'y opposèrent.
7 - Avec plus ou moins de succès, les gouvernements britanniques successifs essayèrent de défendre l'économie des attaques de la bourgeoisie américaine contre leur marché national et leurs marchés coloniaux. Ils essayèrent aussi de maintenir la position britannique comme pouvoir impérialiste à part entière. Mais à cause des USA, qui cyniquement se posèrent en champion de 1'anti-colonialisme et de 1'indépendance nationale, la Grande-Bretagne, épuisée par la guerre fut complètement incapable de maintenir son système colonial anachronique. La guerre avait donné une immense impulsion aux mouvements nationaux dans les colonies -des mouvements soutenus par la Russie et les USA, qui tous deux avaient intérêt à démanteler l'empire britannique. Les retraits britanniques en Inde et en Palestine ont été les moments les plus spectaculaires de la démolition de l'empire et le "fiasco" de Suez en 1956 a mis fin à toute illusion que la Grande-Bretagne était encore "une puissance mondiale de premier ordre". Les USA ont clairement démontré qu'ils ne toléraient pas les actions indépendantes ne correspondant pas à leurs intérêts. Le gouvernement britannique était désemparé devant cette situation et n'avait qu'à capituler, et en le faisant, il se montrait incapable de défendre ses marchés et ses colonies.
Le démantèlement de l'empire s'est accéléré et les années 60 ont vu un cortège continu de colonies revendiquer leur "indépendance". Le dernier retrait des forces britanniques de "l'est de Suez" en 1964 pendant le gouvernement Wilson venait clore - par une dernière formalité- un processus qui avait commencé bien des années auparavant.
8 - Les principales conclusions que nous pouvons tirer du processus de la formation du bloc US et en particulier de la place de la Grande-Bretagne, peuvent être résumées comme suit :
• la bourgeoisie américaine s'est employée à réduire la nation britannique à l'état de puissance économique et militaire secondaire. L'objectif essentiel des USA était de démolir l'empire britannique, considéré comme le principal obstacle à l'expansion américaine. En développant une politique appropriée et en utilisant son énorme pouvoir économique et politique, ils ont réalisé leurs buts pendant la guerre et la reconstruction ensuite.
• le "cash and carry" et le "lend lease" ont été utilisés pour obtenir des droits sur les concessions britanniques et pour avoir accès aux matières premières. Cela signifiait que le contrôle des dépôts de matériaux stratégiques tel que le pétrole, le caoutchouc, les minerais passait des mains de la bourgeoisie britannique à la bourgeoisie américaine. Un endettement financier permanent était instauré et maintenu.
• l'aide d'après-guerre était canalisée en Europe de façon à stimuler à la fois l'économie américaine et à accroître les capacités militaires du bloc occidental. Ainsi, la politique économique de la Grande-Bretagne était dictée essentiellement par les besoins d'une économie de guerre permanente à l'ouest contrôlée par la bourgeoisie américaine.
• bien que la reconstruction ait apporté un boom provisoire à l'économie occidentale, les bénéfices de l'économie britannique ont été considérablement atténués par les USA, au nom de ses propres intérêts. La perte de l'empire et le début de la 'crise économique mondiale dans les années 60 trouvèrent le capital britannique en position de faiblesse, moins capable que d'au très économies (telles que l'Allemagne, le Japon, la France) de faire face à la crise.
• le "rapport particulier" liant la bourgeoisie américaine à la bourgeoisie britannique si souvent revendiqué, est simplement une relation de complète hégémonie de la part des USA. Dans le cadre du renforcement du bloc occidental qui s'est effectué ces dernières années, comme résultat de l'approfondissement des antagonismes inter-impérialistes, la Grande-Bretagne a donc été le plus obéissant des principaux alliés des USA.
C.Marlowe
[1] [119] "Lend and lease" : relâchement de la part des USA pour le paiement des factures de la Grande-Bretagne. Retour à un système de crédit.
[2] [120] "Cash and carry" : littéralement : payer comptant une fois les marchandises reçues. Système d'échange qui contraignait la Grande-Bretagne à payer comptant les marchandises qu'elle recevait. Aucun crédit n'était accordé.
Géographique:
- Grande-Bretagne [121]
Questions théoriques:
- Décadence [122]
Notes sur la gauche hollandaise (2° partie)
- 3311 reads
Dans cette partie, nous tenterons de montrer que la préoccupation de former une avant-garde du prolétariat basée sur des positions communistes claires, ayant pour tâche de défendre activement ces positions dans la lutte, a toujours été celle de la Gauche Hollandaise. On ne peut vraiment comprendre la position de la Gauche Hollandaise sur le Parti que si on s'abstient de faire des jeux de mots comme les conseillistes actuels et autres "spécialistes" de l'histoire. Il faut, par contre, chercher à comprendre vraiment le débat qui avait lieu chez les révolutionnaires des années 20, 30 et 40, ces longues années de contre-révolution qui ont suivi la vague révolutionnaire de 1917-23.
LE CADRE DU DEBAT SUR LE PARTI
Les organisations révolutionnaires qui se sont regroupées dans l'Internationale Communiste, tout en ayant eu une approche différente, se trouvaient toutes confrontées au problème de comprendre les conséquences de la nouvelle période, cette "ère de guerres et de révolutions" -la décadence du capitalisme- sur la question du parti.
Dans la période ascendante du capitalisme, le parti était une organisation unitaire de la classe qui luttait pour des réformes parlementaires et au sein de laquelle les révolutionnaires étaient actifs dans la défense du programme de la révolution prolétarienne. A côté du parti politique, le mouvement syndical était constitué par des organismes unitaires au niveau économique. Ces deux types d'organisations unitaires pouvaient exister de façon permanente au sein de la société car le capitalisme pouvait encore accorder des réformes à la classe ouvrière qui, en conséquence, luttait dans le cadre du système capitaliste au niveau politique parlementaire et au niveau économique, de façon distincte et séparée. Avant la première guerre mondiale, Pannekoek, en accord avec Rosa Luxembourg, considérait déjà la grève de masse comme pouvant mettre en oeuvre une action politique par les organismes de masse du prolétariat. Dans une telle action, les buts différents du mouvement politique et du mouvement syndical étaient confondus et unis dans des buts politiques. Les grèves de masse n'exigeraient plus les seules capacités des représentants et des porte-paroles de la classe, mais la force, la conscience de la classe et la discipline des masses. Loin de nier la nécessité du parti, la Gauche Hollandaise partageait la conception de toute la Gauche de la Deuxième Internationale : le parti de masse (à l'exemple du parti allemand) serait l'instrument de l'émancipation du prolétariat dans la révolution. Telle était l'idée de Lénine, de Luxembourg, de Gorter, de Pannekoek. La Gauche Hollandaise et Allemande se distinguait déjà à l'époque des bolcheviks, par son insistance sur la nécessité de développer les forces créatives, "spontanées" des masses prolétariennes sans lesquelles la victoire de la révolution serait impossible. Les bolcheviks, eux, ont apporté leur contribution sur un autre aspect de la question du parti. Dans les circonstances particulières de la Russie tsariste, Lénine était forcé de bâtir une organisation des révolutionnaires pour préparer un parti de masse social-démocrate. Une telle organisation des éléments les plus conscients de la classe était bien adaptée au changement de période dans la vie du capitalisme. Avec la fin de la possibilité des réformes au sein du système, les syndicats et les partis parlementaires n'ont pu sauver leur existence en tant qu'organisations permanentes, qu'en quittant le camp de la classe ouvrière pour s'intégrer dans l'Etat bourgeois en 1914. Par contre, des actions révolutionnaires de masse ont surgi les nouvelles organisations unitaires du prolétariat : les assemblées générales, les comités de grève, les conseils ouvriers. Comme avant 1914, les révolutionnaires étaient des éléments actifs au sein de ces organismes unitaires. Mais tandis que ce nouveau type d'organisation de par la nature du but qu'elle se donnait, un but révolutionnaire, ne pouvait plus exister qu'en période de lutte et pendant la lutte , les révolutionnaires eux s'organisaient comme minorité de la classe en se donnant pour objectif de contribuer à la clarification du but et des moyens de la lutte. De telles organisations révolutionnaires, tout en s'appelant des "partis", n'étaient pas identiques aux partis de la période ascendante du capitalisme : la classe ouvrière fermement unie sur la base de la conscience du programme communiste.
Ce sont surtout les Gauches allemande et hollandaise qui ont compris que le caractère nécessairement minoritaire de l'organisation des révolutionnaires, du parti, ne permettait pas d'identifier parti et classe à moins de tomber dans des formes de substitutionnisme. C'est surtout par la conscience qu'elles avaient de la nécessité de la spontanéité de masse que les Gauches allemande et hollandaise ont défendu l'organisation des révolutionnaires sans tomber dans le substitutionnisme, Par contre, les Gauches allemande et hollandaise avaient aussi des faiblesses dans la conception du parti ; elles étaient le résultat d'une incompréhension que dans la période nouvellement ouverte de décadence du capitalisme, les organisations unitaires de la classe ne pouvaient exister que pendant la lutte, et l'organisation des révolutionnaires ne pouvait avoir une influence réelle dans la classe -être le parti- que dans une vague révolutionnaire.
C'est sur le premier problème que le KAPD s'est séparé en diverses fractions pendant la remontée de la lutte de classe. Sur ce même problème, la Gauche hollandaise a apporté des contributions importantes et a finalement résolu le problème.
Sur le deuxième (le parti), bien que la Gauche hollandaise n'ait pas atteint la clarté de la Gauche italienne en exil (surtout Bilan et Internationalisme ), elle a su assumer les tâches qui reviennent aux révolutionnaires dans une phase de reflux (dans les années 20 et 30) et a travaillé à préparer à nouveau le futur parti dans la perspective d'une reprise révolutionnaire après la seconde guerre mondiale. Sur la question du parti, les conseillistes actuels sont en régression sur la Gauche hollandaise ; ils défendent la position anti-parti de Ruhle, que n'ont jamais partagée Gorter, Pannekoek, Hempel ou Canne Mayer.
Bien que le KAP hollandais n'ait pas créé d'AAU (Union Générale des Ouvriers), il était divisé en deux tendances comme le parti allemand (KAPD). Gorter représentait la tendance d'Essen du KAP tandis que Pannekoek n'a pas pris position mais a publié des textes sur le sujet du débat. Nous verrons qu'en fait les positions de Pannekoek contenaient déjà les données de la solution du problème qui fut résolu après la mort de Gorter en 1927,
LES SCISSIONS DANS LE KAPD HOLLANDAIS SUR LE A.A.U.
Les débats qui ont finalement mené à l'éclatement dans le parti avaient lieu surtout sur la question du rapport entre le parti et l'AAU. TAAUD prétendait être la synthèse des organisations d'usine nées de la révolution allemande. Le programme du KAPD considérait les organisations d'usine comme des"organisations de lutte purement prolétariennes" qui avaient la double tâche de contribuer à la dénonciation et à la destruction de l'esprit contre-révolutionnaire des syndicats et de préparer la construction de la société communiste. Dans les organisations d'usine, les masses devaient s'unifier par la conscience de leur solidarité de classe. L'AAUD définissait ainsi cette seconde tâche :
"Dans la phase de prise du pouvoir politique l'organisation d'usine devient elle-même une partie de ta dictature prolétarienne, pratiquée dans l'usine par les conseils d'usine qui se structurent sur la base de l'organisation d'usine. L'organisation d'usine est une garantie pour que le pouvoir politique soit toujours entre les mains du comité exécutif des conseils".
Programme de l’AAUD (décembre 1920)
Selon le KAPD, l'organisation d'usine en tant qu'organisme unitaire de combat, était une garantie pour la conquête du pouvoir par le prolétariat et non par "quelques leaders de parti et leur clique" (Programme du KAPD). La tâche du parti, du KAPD. n'était pas la prise du pouvoir mais "le recoupement des éléments les plus conscients de la classe ouvrière sur la base du programme du parti . Le KAP doit intervenir dans les organisations d'usine et y mener une propagande infatigable" mais ce qu'on attendait n'eut pas lieu. Les tâches assignées aux organisations d'usine qui devaient s'organiser entre elles dans l'AAUD et regrouper bientôt tout le prolétariat allemand, ne furent pas remplies. Très tôt déjà, Pannekoek avertissait -dans une lettre datée du 5 juillet 1920- qu'il pensait fausse l'idée de deux organisations des ouvriers les plus conscients, qui toutes deux "se trouvaient être des minorités au sein des grandes masses qui n'étaient pas encore actives et restaient encore dans les syndicats". A long terme, une telle double organisation serait inutile puisqu'en fait elles regroupaient et recouvraient les mêmes personnes. La démocratie prolétarienne doit se baser sur tous ceux qui travaillent dans l'entreprise et "qui au travers de leurs représentants, de leurs conseils d'usines, prennent en mains la direction politique et sociale". Selon Pannekoek, les communistes étaient une minorité plus consciente qui avaient pour tâche de diffuser les positions de classe et de donner une orientation et un but à la lutte. Une deuxième organisation, les Unions est inutile pour la révolution. D'après lui, donc, il fallait abandonner l'AAUD pour le parti, bien qu'il dît que l'organisation en Union était peut-être nécessaire quand même dans la situation spécifique en Allemagne.
OTTO RULHE ET LE A.A.U.
La scission d'Otto Ruhle et de son groupe s'es faite sur l'idée exactement opposée à celle de Pannekoek. Ruhle abandonnait le parti en faveur de d'union qu'il considérait comme la véritable organisation unitaire qui supprimait la nécessité du parti, Ruhle voyait le parti comme un énorme appareil qui voulait diriger les luttes d'en haut, jusque dans les moindres détails ; c'est une conception du parti que Rosa Luxembourg avait reproché à Lénine. Mais le KAPD considérait sa tâche comme une contribution au "développement de la conscience de soi du prolétariat allemand" (Programme du KAPD). Dans son texte de rupture avec le KAPD ("Grundfrogen der Organisation"), Ruhle laissait de côté cette tâche de clarification que se donnait le parti. Mais déjà dans le Programme de l'AAU (E) (E = "Einheits organisation" ou organisation unitaire ; le E distingue l’AAU de Rhuhle de l’AAUD du KAPD), on retrouve les tâches propagandistes bien que l’organisation fédéraliste qu’était l’AAU (E)) se trouve dans l’impossibilité de remplir ces tâches, vu la multitude de mic mac de positions qu’elle avait. Comme toutes ces positions existaient en son sein sans être discutées, l’AAU (E) n’a pratiquement pas contribué au "développement de la conscience de soi" de la classe ouvrière qui constituait pourtant l’un des points de son programme. Et malgré la conception anti-parti de Ruhle,, il n’a pas pu empêcher qu’en 1921 un groupe politique sorte de l’organisation unitaire", un groupe qui s’appelait « Gruppe de Ratekommnisten" (Groupe des Communistes de Conseils).
La majorité du KAPD défendait le centralisme à la base, contre le fédéralisme de Riihle : "le fédéralisme devient un non-sens s'il équivaut à séparer les entreprises ou les districts alors qu'ils représentent un tout" (Karl Schroder : "Vom Werden einer neuen Gesellschaft"). Dans la brochure "Die Klassenkampf - Organisation des Prolétariats " ("l'organisation de la lutte du de classe du prolétariat"), Gorter défendait l'idée de l'existence distincte du KAPD par rapport à l’"Union".
Il est clair qu'on ne peut identifier les positions de Gorter et Pannekoek avec celles de Ruhle. Au début des années 20, Gorter et Ruhle étaient opposés sur la question du parti alors que tous deux croyaient encore que l'Union" pourrait croître jusqu'à devenir une organisation vraiment unitaire. A ce moment-là, Pannekoek soulignait déjà le caractère minoritaire de l'Union et suggérait la suppression de l'AAU. La fin tragique du KAPD, conséquence directe de la défaite de la révolution mondiale, a fait que ce n'est pas dans le parti mais dans les restes des Unions que s'est fait sentir la nécessité du regroupement des rares éléments restés fidèles à la révolution. Ce regroupement a donné le "Kommunistische Arbeiter-Union" (Union des Ouvriers Communistes), résultat d'une fusion des restes de TAAU (E) et de l'AAU (D), fraction de Berlin en 1931. La Gauche hollandaise a eu une grande influence sur ce regroupement. Dans un texte de la fin des années 40, Henk Canne Meyer se souvient :
"Ce nouveau nom (KAU) était en fait l'expression de la conscience d'une évolution graduelle dans les conceptions du mouvement pour l'organisation d'usine. Et cette évolution portait notamment sur ce qu'était la classe organisée. Auparavant, l'AAU avait pensé qu'elle organiserait la classe ouvrière et que les millions d'ouvriers adhéreraient tous à cette organisation. Mais au cours des années, l'AAU avait toujours défendu l'idée que les ouvriers eux-mêmes devraient organiser leurs mouvements de grève et leur lutte m mettant en relation tous les comités d'action, 'ri faisant cela, ils agissaient aussi comme classe organisée tout en n'étant pas membres de 'AAU. En d'autres termes, la lutte comme classe organisée n'était plus considérée comme dépendante de la construction préalable d'une organisation déjà créée (...). Le rôle de l'AAU, ou plus tard du KAU, c'était de faire de la propagande communiste au sein des masses en lutte ; sa signification, c'était de contribuer à la lutte en indiquant le chemin conscient à parcourir vers le but poursuivi". ("De Economische Grondslagen van de Radenmaatschappy")
DU PARTI A LA FRACTION: LE GIC
Vers la fin des années 20 et au début des années 30, il était clair que les révolutionnaires avaient perdu toute influence réelle dans la lutte de classes. En conséquence, le parti tendait à se diviser en tendances qui défendaient différentes positions sur la défaite de la révolution mondiale. Henk Canne Meyer qui avait été un représentant de la tendance de Berlin dans le KAP hollandais, quittait le parti en 1924 avec la déclaration suivante :
"Le KAP (durant presque toute son existence) n'a pas été autre chose qu'une fondrière qui produisait toujours plus de nouvelle boue. Toutes les puanteurs qui se sont ainsi développées sont connues de vous. On ne peut plus rien faire en son sein et de nouvelles forces fraîches réussiront certainement à se garder du marais l'.
En 1927, se tint une série de réunions de discussions entre membres du KAP hollandais, d'ex-membres et des révolutionnaires allemands sur les problèmes de la période de transition. Hempel avait commencé le plan d'un texte, basé sur les voyages qu'il avait faits en Union Soviétique, en tant que délégué du KAPD, sur le Capital et la Critique du Programme de Gotha de Marx. Pendant la première de ces discussions, Pannekoek était présent et s'était opposé à ce plan, en se référant à 1'Etat et la Révolution de Lénine. Le 15 septembre 1927, Gorter mourait et avec lui, disparaissait la dernière force de cohésion du KAP hollandais. De ces réunions de discussions sur la période de transition, est né le "Groupe des Communistes Internationalistes" (GIC), sans doute le groupe le plus fructueux des groupes communistes de conseils hollandais. Beaucoup d'ex-membres du KAPD se trouvaient alors en exil en Hollande, dans leur fuite de la contre-révolution en marche. Le GIC publiait le "Persmateriaal du GIC" (hollandais), "Ratekorrespondenz" (allemand) et "Klasbatalo" (espéranto); il était en contact étroit avec "Council Correspondance" (de l'émigré allemand Paul Mattick) aux Etats-Unis et avec le reste du KAPD en Allemagne. A côté de son activité de propagande en direction des chômeurs et des ouvriers, le GIC voulait élaborer les expériences des années révolutionnaires passées. Dans ce cadre, le GIC a développé le plan du texte de Hempel de manière collective et a publié en 1930-31 "De Grundbegrinselen des Communistische Productie en Distributie" (Principes Fondamentaux de la Production et de la Distribution Communistes"). Ce texte est une intéressante contribution aux questions économiques de la période de transition, bien qu'on puisse critiquer ses faiblesses et ses lacunes sur les aspects politiques de la période de transition au communisme, aspects qu’il faut clarifier avant de trancher sur les aspects économiques. H.Wagner, ex-membre de la tendance "Essen" du KAPD développait alors la fausse Idée que la révolution en Russie avait été à la fois prolétarienne et bourgeoise, idée qu'on peut déjà trouver dans le programme du "Kommunistische Arbeiter-Internationale" ([1] [123]), dans les "Thèses sur le Bolchévisme". Pannekoek, après de longues années de passivité quasi-totale, était en contact étroit avec le GIC. En 1938, il publiait "Lénine Philosophe'1, critique philosophique du bolchévisme basée sur les Thèses de Wagner ([2] [124]).
En ce qui concerne la question du parti à laquelle nous nous limiterons ici, le texte de Canne Meyer "Naar een nieuwe arbeidersbewegung" ("Pour un nouveau mouvement ouvrier") est intéressant comme contribution publiée à l'époque en hollandais, allemand et anglais. Face à l'avancée de la contre-révolution et à l'impuissance de la classe ouvrière, le GIC proposait une nouvelle..."synthèse organisations lie des ouvriers relativement peu nombreux pour qui la lutte pour le mouvement autonome de notre classe est devenue une raison de vivre", synthèse qui de/ait se faire dans des "groupes de travail". Canne Meyer croyait qu'un regroupement de ces "groupes de travail" était impossible pour le moment car "l'écroulement du vieux (mouvement) n' a pas encore permis de produire suffisamment de convergence de positions" ("Naar een nieuwe arbeidersbewegung, 1935).
Le GIC a mis définitivement fin aux confusions du KAP sur l'organisation unitaire. Bien que le GIC fût pour la création de "noyaux révolutionnaires d'usine" orientés dans le même sens que les "groupes de travail" : des organisations propagandistes dans les usines, il distinguait clairement cette organisation d'usine de l'organisation des révolutionnaires :
"L'organisation d'usine> en tant qu'expression de l'unité de la classe ouvrière à un moment donné, disparaîtra toujours avant la révolution et sera seulement la forme d'organisation permanente des ouvriers aux moments décisifs de bouleversement des rapports de force". (Nelbingen omtrent révolutionnaire bedrigjfshernen" Amsterdam 1935)
La position de PANNEKOEK dans les années 30-40
Pour les conseillistes actuels, il est :
"Évident que Pannekoek ne pense pas seulement que le parti bolchevik était l'opposé d'une organisation prolétarienne3 mais encore tout parti de quelque type que ce soit. Sa critique de la conception du parti de Lénine est aussi une critique de la conception du parti en général.." (Cajo Brendel "Anton Pannekoek, theoritikus von Ret Socialisme", p.99/100)
Quelques lignes plus loin, Brendel dit après quelle sorte de parti il en a : le KAP. Très correctement, Brendel montre la position de Pannekoek en 192a, selon laquelle un parti prolétarien est nécessaire avant et pendant la révolution prolétarienne. Mais Brendel a tort lorsqu'il veut prouver, par toute une série de citations de Pannekoek, que :
"... la pratique -de ce type de partis et surtout de la lutte ouvrière- montre à Pannekoek non pas qu'à chaque type de révolution correspond un type propre de parti, mais que le parti quelle que soit sa forme est un phénomène limité à la révolution bourgeoise et à la société bourgeoise. La frontière ne se situe pas entre parti bourgeois et parti prolétarien mais entre le parti bourgeois et l'organisation de la lutte prolétarienne'' (ibid, p.100):
Mais toutes les citations de Pannekoek que donne Brendel dans son livre de Lénine Philosophe, des Conseils ouvriers (1945), des Cinq Thèses sur la Lutte de Classe (1946) ne font que souligner la critique à la conception substitutionniste des bolcheviks et la nécessité de l'activité clarificatrice de l'organisation des révolutionnaires. Brendel a complètement oublié de noter que c'est seulement le Pannekoek de la fin des années 20 qui parle du "parti" au sens des partis sociaux-démocrates, bolchevik ou des vieux partis bourgeois. Ce n'est pas surprenant car le KAP avait alors disparu comme parti prolétarien ayant une influence réelle. Mais Brendel est obligé de noter que Pannekoek utilise "un ton un peu différent" (ibid, p.105) dans les thèses de 1946. Ce n'est pas un autre ton. C'est que Brendel a une surdité politique pour des termes comme "clarification politique". Selon Brendel, ce ton "un peu différent" de Pannekoek trouve son explication dans le texte du "Spartacusbond" : "Taak en wezen van de nieuwe partij" ("Tâches et nature du nouveau parti"), que Brendel considère comme un compromis opportuniste entre les positions du GIC et celles du groupe de Sneevliet qui se sont regroupés à la fin de la seconde guerre mondiale. Bien que ce texte contienne beaucoup de confusions, c'était l'un des derniers signes de vie de la Gauche hollandaise qui, après la guerre, espérait une reprise de la lutte de classe ouvrière et se préparait à former le parti de classe, en tant qu'instrument indispensable de la révolution mondiale. Hélas, la Gauche hollandaise s'était affaiblie pendant la guerre et n'a pas survécu à la période de reconstruction qui a permis *u capitalisme de continuer la contre-révolution. En 1947, Canne Meyer quittait le "Spartacusbond" qui était dominé par une tendance activiste voulant reconstruire une sorte d'AAU. Le texte "Economische Grondslagen van de Radenmaatschappy" fut publié par Canne Meyer dans "Radencommunisme" après qu'il a quitté, ainsi que les autres membres du GIC, le "Spartacusbond". Ceci n'a pas fait hésiter "Spartacusbond à répondre aux critiques du CCI (Revue Internationale n°12 ) en se cachant derrière ce texte pour éviter toute discussion avec le milieu révolutionnaire existant actuellement et qui se réclame du KAPD. Canne Meyer, Hempel et d'autres anciens membres du GIC, par contre, n'ont jamais rompu le contact avec "Internationalisme" des années 40 dont le CCI se réclame directement.
Mais pourquoi Brendel suggère-t-il dans son livre sur Pannekoek que le regroupement entre le Snevliet et le GIC était opportuniste ? Parce que lui-même n’a rejoint le "Spartacusbond" qu’après 1947 ? Quelle fut son attitude à l'égard des positions du GIC ? Dans les années 30, Brendel était membre d'une tendance communiste de Conseils dont le GIC disait qu’elle voit le chemin du mouvement de masse dans la simple provocation des conflits de classe"(PIC 1932, n°19). Le GIC pensait au contraire "que la simple provocation de conflits de classe mène à vider de son énergie la partie révolutionnaire du prolétariat, mène de défaites en défaites sans contribuer à la formation d'un front de classe réel" (ibidem) Et justement contre cela, le GIC préconisait que "dans le choix de la résistance, il fallait directement faire de la propagande pour le front de classe "(ibid).
Le groupe de Brendel critiquait le texte du GIC sur Je "nouveau mouvement ouvrier" car "la classe ouvrière ferait son apprentissage dans la pratique, complètement indépendamment des groupes d'étude" (Brendel, in "Jahrbuch Arbeiterbe-wegung"). Aujourd'hui, il essaie d'élaborer des formules théoriques pour un nouveau mouvement ouvrier et pense que "le GIC se distinguait de façon principielle du vieux mouvement ouvrier mais n'était pas le nouveau mouvement ouvrier et ne pouvait pas 1'être parce que sa formation ne pouvait être comprise que comme un long processus" (ibid). Pauvre Brendel qui tombe maintenant dans le même piège que dans les années 30 ; il voit la classe dans son ensemble d'un côté et les révolutionnaires de l'autre, complètement séparés. Pour le GIC, la classe dans son ensemble constituait le mouvement des ouvriers et l'organisation des révolutionnaires était le (nouveau) mouvement ouvrier ([3] [125]). Alors que le GIC était en faveur d'un nouveau mouvement ouvrier, "Daad en Gedachte", groupe actuel de Brendel, non seulement ne voit pas le mouvement des ouvriers, mais s'oppose à tout mouvement ouvrier, le vieux et aussi le nouveau qui se développe maintenant dans la discussion et le processus de regroupement des révolutionnaires. Telle est la fin tragique de la Gauche hollandaise. Les activistes d'hier ne subsistent que pour dénaturer toutes les contributions positives du communisme des conseils et les transformer en des absurdités conseil listes.
F.K
ABREVIATIONS :
AAU : Union Générale Ouvrière
AAUD : Union Générale Ouvrière d'Allemagne
AAUE : Union Générale Ouvrière d'Allemagne (Organisation Unitaire)
GIC : Groupe des Communistes Internationalistes
KAI : Internationale Communiste Ouvrière
KAPD : Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne
KAP Hollandais: Parti Communiste Ouvrier de Hollande
KAU : Union Ouvrière Communiste
Sneevliet : Nom d'un groupe formé autour de Sneevliet, trotskyste hollandais.
[1] [126] La KAI (Internationale Communiste Ouvrière) correspondait à une tentative des tendances "Essen" des deux KAP de regrouper la Gauche communiste Internationale. A part le KAPD et le KAP hollandais, elle se réduisait à la Gauche bulgare, la Gauche anglaise et la Gauche russe.
[2] [127] On trouve la critique de ces thèses dans "Octobre 1917 : début de la révolution mondiale" (Revue Internationale n°12)
[3] [128] "Daad en Gedachte" a toujours été confus dans ses définitions du mouvement ouvrier et du mouvement des ouvriers. Dans le n°1976-4, il est dit qu’Otto Rhule était l’un des pionniers du nouveau mouvement ouvrier. Dans le n°1978-10, il est dit que Marx et Gorter étaient des membres du mouvement ouvrier qui était distinct du mouvement des ouvriers. Il semble que dans sa sympathie pour l'AAU (E) de Ruhle, "Daad en Gedachte" confonde parfois le nouveau mouvement ouvrier avec le mouvement des ouvriers.
Géographique:
- Hollande [90]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [13]
Revue Internationale no 18 - 3e trimestre 1979
- 2767 reads
Troisième congres du CCI.
- 2673 reads
Les organisations politiques du prolétariat ont le leur source de vie dans la pratique historique et vivante de leur classe. Le CCI n'échappe pas à cette loi et le 3ème Congrès a été, dans tous ses aspects, traversé des problèmes qui se posent aujourd'hui dans les combats de la classe ouvrière. Le Congrès a commencé par le bilan de deux ans d'activités dans la lutte de classe ; en ce domaine, avec trois an et demi d'existence comme organisation internationale centralisée, le CCI dispose d'une petite expérience, néanmoins déjà riche de quelques enseignements importants. Le premier enseignement est qu'à cette inexpérience organisationnelle correspond une faiblesse théorique quant à la capacité à approfondir les questions posées dans le mouvement ouvrier du passé. Dans le processus constant d'approfondissement de la compréhension de la réalité sociale, historique et actuelle, le CCI balbutie encore tout comme l'ensemble des organisations révolutionnaires, expressions de la lutte de la classe ouvrière. Le deuxième enseignement est la difficulté, mais également la nécessité et la possibilité de vivre avec des divergences politiques. L'amélioration de la capacité à poser les questions surgies de la lutte de classe présuppose un débat constant comportant inévitablement des divergences politiques, des différentes appréciations, qu'il faut être capable de résoudre au sein de la même organisation. Le troisième enseignement est la nécessaire adéquation et modulation de l'intervention en fonction de la période dans laquelle on se trouve. Tous ces aspects de réactivité d'une organisation révolutionnaire, approfondissement théorique et politique, développement de l'organisation et regroupement des révolutionnaires, intervention active dans les luttes de la classe ouvrière- ont plus qu'auparavant été examinés comme formant un tout, un ensemble cohérent de plus en plus lié directement à la pratique de la classe ouvrière elle-même, et une insistance particulière a été portée sur la question des publications de l'organisation.
C'est pourquoi les travaux du Congrès ont consisté principalement en un bilan de la situation internationale.
Lors du deuxième Congrès, nous avions pu constater la confirmation de ce qui était déjà notre analyse avant même la constitution officielle du CCI, à savoir : la fin de la période de reconstruction et l'entrée du système capitaliste dans une nouvelle phase de la crise permanente historique du système. Nous avions pu également mettre en évidence le développement lent de la crise et dégager les raisons de cette lenteur. Contrairement aux apologistes intéressés ou encore aux chercheurs confus, à qui le rythme lent de la crise inspirait des théories fallacieuses et de vains espoirs sur de possibles issues de la crise (restructuration de l'appareil productif, ouverture du marché chinois ou de celui du bloc de l'Est, et autres fantaisies), nous énoncions, sur la base d'une analyse marxiste, son caractère permanent, historique et non contingent, son aggravation inéluctable, ce qui n’ouvre dans le capitalisme décadent et dans le cadre de ses lois immanentes qu’une seule issue : la marche vers la guerre généralisée.
Cette analyse, comme le démontre le rapport CRISE ET ANTAGONISMES INTERIMPERIALISTES est pleinement confirmée par l'évolution de la crise de ces deux dernières années. Partant de l'évolution de la crise et d'un examen correct de la condition où se trouve la classe ouvrière dans la période actuelle, nous avons mis en évidence l'inéluctabilité du resurgissement de la lutte de classe du prolétariat, sa capacité énorme et intacte à affronter la politique d'austérité que le capitalisme tend à lui imposer. Cette perspective de reprise du combat du prolétariat, également dégagée au deuxième Congrès, se trouve pleinement vérifiée et confirmée.
Il est vrai que nous avons parfois commis des erreurs d'appréciation et des exagérations sur des luttes ponctuelles et momentanées, que nous n'avons pas toujours perçu immédiatement le mouvement en dents de scie de la lutte du prolétariat. Mais ces erreurs, corrigées plus ou moins rapidement, n'ont jamais infirmé le fond de la perspective tracée. C'est pour répondre à toutes les tendances au pessimisme qui se manifestent jusque dans nos rangs chaque fois que la lutte ouvrière se trouve momentanément dans le creux du mouvement en dents de scie, c'est pour nous prémunir à l'avenir contre ces tendances au scepticisme à qui l'arbre cache la forêt, c'est pour répondre jusque dans le détail à des objections déjà entendues et toujours susceptibles de se renouveler, c'est pour fonder une bonne fois solidement la perspective, qu'il a été jugé nécessaire de présenter un rapport sur L'EVOLUTION DE LA LUTTE DE CLASSE long et détaillé, mais essentiel pour la compréhension de cette perspective et de 1'orientation de l'activité pratique.
Il en est de même en ce qui concerne le cours historique qui se dégage de la situation actuelle. Il est absolument nécessaire de rejeter
la théorie absurde de deux cours parallèles, l'un vers la guerre, l'autre vers la révolution, qui ne font que se poursuivre à l'infini sans jamais se rencontrer, sans agir et réagir l'un sur l'autre. Une telle "théorie" relève d'une démarche normande : "Peut-être ben qu'oui, peut-être ben qu' non". Une classe révolutionnaire ne saurait se contenter d'une théorie de constat de fatalité, de "qui vivra verra". Il est mille fois préférable l'investigation avec tous les risques d'erreur que l’absence de toute investigation. L'investigation à laquelle le CCI s'est livré montre d'abord la validité de la démarche et permet ensuite de répondre non pas à la question "quelles sont les forces qui poussent à la guerre ?", mais à la question "comment et par qui ces forces de la guerre sont entravées et leur aboutissement empêché ?". C'est à cela que répond le rapport sur le COURS HISTORIQUE, dont l'argumentation repose sur l'analyse générale de la période et de l'évolution de la crise et dont elle est une partie intégrante.
Toutefois, il n'en est pas de même pour ce qui est de l'analyse de la. CRISE POLITIQUE de la bourgeoisie et de la nécessaire arrivée de la gauche au pouvoir qui a constitué durant des années et notamment au deuxième Congres, l'axe des conclusions politiques à court terme. Une contribution spécifique sur cette question complète les rapports sur le changement intervenu dans la situation et ses implications pour l'intervention.
Une RESOLUTION SUR LA SITUATION INTERNATIONALE a été adoptée qui fait la synthèse des trois rapports généraux sur la situation
Une autre partie des travaux du Congrès a consisté en l'adoption de la RESOLUTION SUR L'ETAT DANS LA PERIODE DE TRANSITION, concrétisation de plusieurs années de discussions sur la question, question qui fera l'objet d'une brochure dans laquelle seront publiés les débats qui se déroulent au sein du CCI. Complément indispensable des activités et des analyses de la situation, les questions théoriques de la période de transition, du contenu du socialisme, des "buts généraux du mouvement", restent un souci constant dans les orientations du CCI.
Enfin, nous tenons à saluer la présence à ce Congrès de délégations de la Communist Workers'Organisation, du Nucleo Comunista Internizionalista, d'Il Leninista et d'un élément participant des Conférences Communistes de Scandinavie. Les débats du CCI sont des débats dans le mouvement ouvrier et n'ont rien de confidentiel et les invitations des groupes aux travaux ne peuvent que contribuer à une meilleure connaissance de vivo des positions du CCI et donc à la clarification politique au sein du milieu révolutionnaire.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
La situation internationale 1979
- 3138 reads
L'évolution de la situation mondiale est déterminée par le rapport complexe entre deux tendances historiques : le cours de la crise économique du capitalisme et le cours de la lutte prolétarienne. Le cours de la crise économique, devenue permanente à l'époque de la décadence du capitalisme, est fondamentalement dicté parles lois aveugles qui régissent le processus de l'accumulation capitaliste. Ces lois condamnent le capitalisme à survivre uniquement à travers un cycle de crise-guerre-reconstruction-crise; inexorablement, elles poussent la bourgeoisie vers la guerre impérialiste mondiale, comme seule réponse capitaliste à la crise ouverte de surproduction généralisée. D'autre part, le cours de la lutte de classe prolétarienne, quoiqu'étroitement liée au déroulement de la crise économique n'en est pas un produit mécanique. Il est aussi déterminé par toute une série de facteurs super structurels. Par conséquent, si le cours de la crise économique en provoquant une dépression mondiale constante est un facteur puissant qui pousse la classe ouvrière dans la lutte contre la dégradation de ses conditions de vie et de travail, la capacité du prolétariat à généraliser et à politiser sa lutte est déterminée en fin de compte par le développement de sa conscience de classe, par son organisation autonome, par la contribution de ses minorités révolutionnaires et par le poids plus ou moins grand de l'idéologie bourgeoise (le nationalisme, "le légalisme", l'électoralisme, 1'antifascisme, le "communisme national", etc.) en son sein.
Le cours de la lutte de classe prolétarienne lui-même devient un facteur important qui influe sur le cours même de la crise économique. En empêchant le fonctionnement des palliatifs capitalistes (la déflation, la politique des revenus, les pactes sociaux, les licenciements, les "rationalisations", la militarisation du travail, etc.), la combativité de la classe ouvrière aggrave et intensifie la crise, plongeant la bourgeoisie dans le désarroi. Si le cours de la lutte de classe refluait définitivement, lors d'une période de crise mondiale, le chemin serait ouvert à la "solution" capitaliste, la guerre mondiale, mais si la lutte de classa monte, avec un approfondissement de la lutte de classe et le développement des organes unitaires et politiques de la classe, elle peut transformer la crise économique en crise révolutionnaire, en début d'une transformation communiste de la société.
C'est sur la base d'une compréhension de cette interaction complexe entre la crise et l'activité du prolétariat -compréhension qui constitue l'essence du marxisme- que les révolutionnaires peuvent déterminer si la perspective historique est aujourd'hui vers la guerre impérialiste ou vers la montée de la lutte de classe. De cette compréhension dépend la forme de l'intervention de l'organisation des révolutionnaires dans la lutte.
Dans ce rapport sur la situation internationale, nous analyserons d'abord le déroulement de la crise économique ainsi que l'aggravation considérable des antagonismes inter-impérialistes que la dépression mondiale a provoquée et aussi la crise politique dans laquelle les difficultés économique croissantes ont plongé la bourgeoisie de chaque nation. Nous tracerons ensuite le cours de la lutte de classe prolétarienne, son impact sur le déroulement de la crise économique et sur les tendances qui poussent la bourgeoisie vers la guerre mondiale. Enfin, sur la base de notre étude de l'interaction entre le cours de la crise économique et celui de la lutte de classe, du rapport de forces entre la bourgeoisie et la classe ouvrière, nous montrerons quelle est la perspective historique aujourd'hui et les facteurs qui peuvent influer sur elle.
CRISE ET CONFLITS INTERIMPERIALISTES
LA CRISE ECONOMIQUE
Douze ans après que les pays ravagés par la deuxième guerre mondiale (Europe et Japon) ont atteint des balances commerciales favorables et devenus donc capables de concurrencer les USA sur le marché mondial, signalant ainsi la fin de la reconstruction d'après-guerre; huit ans après que l'effondrement du système monétaire mondial établi à Bretton Woods a inauguré une période de chaos monétaire incessant; quatre ans après le plus fort déclin de la production et du commerce mondial depuis les années 30, l'économie mondiale en 1979 est au bord d'une nouvelle catastrophe économique encore plus dévastatrice.
Dans les pays industrialisés du bloc américain (OCDE) dont la production s'est accrue de 60 % entre 1963 et 73, l'accroissement a été de moins de 13 % entre 1973 et 78, soit 2/5 du taux réalisé précédemment. Le ralentissement drastique de la croissance de la production industrielle -maintenant au bord de la stagnation- est le triste témoignage de la saturation du marché mondial et de la crise ouverte de surproduction qui affecte les géants industriels du bloc.
Une des manifestations les plus claires de la crise de surproduction est la sous-utilisation de la capacité productive, les usines qui ne tournent pas. Les USA, même au prix d'une inflation galopante, destructrice (les prix augmentent de 14 % par an) qui, si elle n'est pas rapidement maîtrisée, amènera à la ruine économique , n'ont pas été capables de reproduire leur réussite des booms des années 50 et 60, quand l'industrie fonctionnait à plein rendement : en 1978, les industries de transformation tournaient seulement à 83 % de leur capacité, et dans une industrie clé comme l'acier, la production était tombée de 7 % par rapport au niveau déjà bas de 1974. Mais ce sont les alliés des Etats-Unis qui sont aujourd'hui les plus dévastés par le fléau d'une capacité productive excédentaire, qui, dans nombre d'industries vitales a atteint des proportions épidémiques. Cela suscite une série de plans d'urgence pour essayer d'éliminer cette capacité excédentaire de façon coordonnée au niveau du bloc, pour prévenir ainsi le danger des guerres commerciales intestines.
La contraction de la production d'acier a déjà atteint des proportions monumentales : entre 1974 et 1978, la production a baissé de 9,4 % en Grande-Bretagne, 12 % au Japon, 18 % en France, 20,5 % en RFA,'22 % en Hollande, 26,2 % en Belgique, et 26,6 % au Luxembourg, et ce n'est pas fini ! En Belgique, l'industrie de l'acier ne tourne qu'à 57 % de sa capacité, tandis qu'au Japon 20 % des hauts-fourneaux sont éteints. L'évidence de l'engorgement de l'acier se manifeste de façon éclatante : a Tokyo, dans les nouveaux hauts-fourneaux (trois millions de tonnes par an) que le propriétaire Nippon Kekan, hésite à mettre en route, car ceux-ci ne feraient qu'ajouter à la capacité excédentaire existante; dans la nouvelle aciérie de Lorraine en France, qui va se rouiller avant même d'avoir produit de l'acier.
La situation dans la construction navale est encore plus catastrophique. Les commandes mondiales qui se maintenaient à 74 millions de tonnes brut enregistrées en 1973 sont tombées à 11 millions en 1977 (même pas de quoi permettre aux chantiers navals japonais de se maintenir en activité, sans parler de ceux de l'ensemble du bloc); qui plus est les commandes sont tombées de 30 % depuis 1977 ! Ce sont les pays du bloc américain qui ont été le plus durement touchés par cette crise actuelle de l'industrie navale. En France, par exemple, les nouvelles commandes n'apporteront pas plus qu'un quart de la capacité de production. Le Japon -qui construit la moitié des navires du monde- prévoit d'éliminer au moins 35 % de sa capacité de construction navale, tandis que la CEE prévoit d'éliminer presque la moitié de sa capacité productive.
Dans l'industrie chimique, l'industrie de l'Allemagne de l'Ouest-qui domine le marché mondial de même que ses compagnies dominent la scène industrielle allemande ne fonctionne qu'à 70 % de sa capacité. Dans la pétrochimie, il y a 30 % de capacité excédentaire dans le marché mondial et cela augmente. Dans les secteurs des fibres synthétiques, les usines de la CEE ne marchent aujourd'hui qu'à 66 % de leur capacité productive et un plan pour trois ans de "désinvestissement" est prévu pour réduire la capacité de 20 % ; dans le même temps, le Ministre du Commerce International et de l'Industrie du Japon dit que le secteur des fibres synthétiques doit être réduit définitivement de 25 % de sa capacité productive.
Dans les industries comme la navigation ou l'automobile, le tableau est également sombre pour le capital : dans les pays où le secteur de la navigation est le pilier de l'économie, un certain nombre de flottes les plus actives sont déjà réduites : en Grèce 11 %, en Norvège 23 %, en Suède 27 %. Dans l'industrie automobile, alors que la production dans la CEE tourne aujourd'hui à environ 10,6 millions d'automobiles par an (les usines sont capables de tourner à 12 millions d'automobiles par an) d'après les pronostics actuels, la capacité industrielle ne dépassera pas les 13 millions d'automobiles par an en 1982. Une contraction planifiée et coordonnée (comme dans l'acier, les constructions navales et les fibres), une vague de faillites ou du protectionnisme sont les seules alternatives également pour ces industries-clé. Une lenteur de l'investissement dans les nouvelles usines vient s'ajouter à une capacité excédentaire persistante et en fait croissante de la production dans les principales industries. Autrement dit, les obstacles croissants à la réalisation de la plus-value ont provoqué par leur apparition un ralentissement du taux d'accumulation. Dans un monde courbé sous le poids d'une capacité de production inutilisée, les investissements dans de nouvelles usines ne peuvent que stagner et ensuite décliner. Et cela, comme nous le verrons lorsque nous tracerons les perspectives économiques pour les années 80 n'est qu'un signe avant-coureur d'une chute nouvelle et violente de la production!
Les banquiers et les technocrates, qui cherchent vainement à coordonner la politique économique du bloc américain -malgré l'impuissance de leur "science économique"- ont au moins été capables de reconnaître le problème. Ainsi, les savants de l'OCDE signalent " (. ..) la lenteur dans l'expansion de l'investissement fixe des entreprises observée ces dernières années dans pratiquement tous les pays membres (..}; même dans les pays où la somme totale de dépense de capital a augmenté jusqu'à ce jour à un taux relativement haut, a été telle que le niveau de l'investissement fixe des entreprises est resté faible par rapport à ces maximums antérieurs." La Banque des Règlements Internationaux signale également"(...)la faiblesse persistante des dépenses en capital fixe des entreprises"- ( 1ère citation : "Perspectives économiques de l'OCDE, 23 Juillet 78; 2ème citation : "Banque des Règlements Internationaux", Rapport annuel N°47, Bâle 1977). L'importance du problème peut se voir clairement dans le cas de l'Allemagne de l'Ouest où le taux de croissance annuel moyen de la capacité de production est passée de 6,1% pour la période 1960-1965 (dernière phase de la reconstruction d'après-guerre) à 3,9% pour 1966-70 (début de la crise ouverte) et ensuite à 1,8% en 1975, à 1,5% en 1976 et à 1% en 1977. Cette chute catastrophique du taux d'accumulation en Allemagne de 1'Ouest avec ses surplus commerciaux encore importants illustre le désastre économique que traverse l'économie mondiale. En étant incapable de saisir ni les causes fondamentales, ni les causes immédiates de la crise économique mondiale, la bourgeoisie formule parfois son dilemme (d'une part, un capital inutilisé et d'autre part, l'inutilité de nouveaux investissements) en constatant: "Si les USA devaient investir approximativement 20% de leur PNB dans de nouvelles capacités, il n'y aurait pas assez d'entrepôts pour stocker toutes les marchandises invendues ni assez d'ordinateurs pour comptabiliser les allocations chômage" (Business Week, janvier 77).
On peut aussi voir les dimensions de la crise économique actuelle dans l'immense et toujours croissante masse de chômeurs. Il y a actuellement 18 millions de chômeurs dans les pays industrialisés du bloc américain! La légion des chômeurs ne constitue pas simplement une armée de réserve industrielle permettant d'exercer une pression sur les salaires comme ce fut le cas pendant la période ascendante du capitalisme au siècle dernier. Les chômeurs ne sont pas non plus un simple sous-produit de l'offensive bourgeoise contre le prolétariat, le fruit d'un effort de "rationnaliser" la production et d'extraire plus de plus-value de moins d'ouvriers. Bien que ces deux tendances s'exercent sans aucun doute, les chômeurs par leur nombre massif aujourd'hui, loin d'être un bien fait pour le capitalisme, sont devenus un incroyable fardeau pour la rentabilité du capital global que la bourgeoisie est incapable de contrôler. Aujourd'hui, le chômage est une manifestation supplémentaire des contradictions insurmontables du mode de production capitaliste; il est d'abord et avant tout la matérialisation de la sous production chronique de la marchandise force de travail.
On doit ajouter à la surproduction du capital constant qui se manifeste par une capacité de production excédentaire et des usines fermées, la surproduction du capital variable qui se traduit par une explosion massive du chômage. On doit ajouter au volume croissant de capital monétaire inutilisé pour lequel aucun investissement productif n'est possible, une génération inemployée de jeunes ouvriers (en France, par exemple, 1 ouvrier sur 7 de moins de 25 ans est au chômage) dont la force de travail ne peut plus accroître le capital. L'agonie du capitalisme mourant a confirmé la prédiction de Marx et Engels d'un mode de production capitaliste qui "... ne peut plus assurer l'existence de l'esclave à l'intérieur même de son esclavage : il est forcé de le laisser déchoir si bas qu'il doit le nourrir au lieu d'être nourri par lui". (Manifeste Communiste)
La crise économique mondiale du capitalisme, contrairement à l'insistance des trotskystes selon laquelle les pays du bloc russe sont des Etats ouvriers (sic!), n'a pas épargné les dix nations qui composent le COMECON ([1] [130]). Les violentes ondes de choc de la crise de surproduction ouverte ont aussi secoué le bloc russe et ont entraîné le même ralentissement drastique de la croissance de la production industrielle et la même chute du taux d'accumulation qui afflige le reste du monde capitaliste.
En Russie, le taux de croissance annuel de la production industrielle, qui tournait autour de 10% en 1950-60, est tombé à environ 7% entre 60 et 70 et, avec le dernier plan quinquennal (1971-76) il est tombé à un taux anémique de 4,5% -juste un peu au-dessus du taux annuel moyen de croissance de tous les pays de l'OCDE pendant la même période. De plus, les planificateurs russes ont déjà dû admettre que les objectifs de croissance industrielle de leur plan quinquennal actuel (1976-80) ne seront pas atteints. Dans tous les satellites de la Russie en Europe de l'Est, la croissance de la production industrielle en 1978 n'a pas atteint ses objectifs. Et en Allemagne de l'Est où le PNB a crû à un taux proche de 4% en 1978 (au lieu des 5,2% estimé) l'espoir d'atteindre les objectifs est vain.
Les pays du bloc russe souffrent aussi d'une chute dans le taux d'accumulation. Ainsi, en Bulgarie, la croissance de l'investissement s'est ralentie : de 6% en 1977 à seulement 4,4% en 1978. En Hongrie, les investissements seront pratiquement gelés en 1979 (on prévoit une hausse de seulement un peu plus de 1%) et on ne commencera aucun grand projet d'investissement cette année.
Un certain nombre d'industries clé dans le bloc russe sont déjà touchées par la surproduction et les limites du marché mondial saturé. Des industries qui produisent en grande partie pour le marché mondial tel que les chantiers navals de Pologne, les immenses nouvelles industries d'automobiles en Pologne et en Russie qui fournissent les Polski et les Lada, les usines d'engineering comme la Raba de Hongrie qui exportent un quart de sa production (430 Millions de dollars par an) à l'Ouest, sont toutes confrontées à la même amère alternative: une capacité de production inemployée ou un dumping systématique. Le dumping, qui a été adopté par ces industries n'est qu'une autre manifestation de la crise de surproduction et ses effets se feront sentir dans l'économie de tout le bloc russe puisque la vente de marchandises en dessous de leur coût de production dans une branche de production doit être compensée par des coûts plus élevés dans d'autres secteurs.
Cependant, le gros de l'industrie du bloc russe n'a pas encore été directement confronté aux limites du marché saturé. En effet, la Russie et ses satellites souffrent d'une pénurie chronique de capital, ce qui apparemment est l'opposé de la crise qui frappe les métropoles du bloc américain. Cependant, le capital inutilisé dans le bloc américain et la pénurie de capital dans le bloc russe, la capacité de production excédentaire dans le bloc américain ET la capacité productive insuffisante du bloc russe, sont les différentes manifestations de la MEME crise globale de surproduction qu'entraîne la saturation du marché mondial.
Les manifestations spécifiques de cette crise dans les pays du bloc russe -effet de la pénurie de capital- sont le résultat de l'arriération relative de leur économie. Le PNB de tous les satellites russes en Europe de l'Est n'égale pas le PNB de la France seule; le PNB de la Russie même n'atteint pas les PNB de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie ensemble (dont on ne peut pas dire qu'ils sont les géants industriels du bloc américain). Cette arriération est manifeste dans tous les secteurs-clé qui déterminent la compétitivité d'une économie sur le marché mondial. Malgré l'étatisation presque complète de l'industrie du COMECON, la concentration du capital dans les entreprises de grande échelle est beaucoup plus avancée dans le bloc américain : les 50 plus grandes compagnies fournissent près d'un tiers de la production industrielle américaine; en Russie, il faut rassembler les 660 plus grandes entreprises pour atteindre cette même proportion. La composition organique du capital est beaucoup plus élevée dans le bloc américain que dans le bloc russe (l'industrie tchécoslovaque -une des plus avancées technologiquement du COMECON- utilise un quart de plus d'ouvriers que la moyenne dans la CEE ([2] [131])) ce qui permet au bloc américain de s'approprier une part disproportionnée de la plus-value globale. La productivité du travail est aussi beaucoup plus grande dans le bloc américain que dans le bloc russe (les ouvriers spécialisés russes sont un quart moins productifs que les ouvriers spécialisés américains). Enfin, le bloc russe subit le poids d'une agriculture arriérée dont la main d'œuvre est très élevée (25 à 40% de la population active des pays du C0MEC0N vivent de l'exploitation de la terre alors que dans pratiquement tous les pays industrialisés du bloc américain, la proportion correspondante est inférieure à 10%).
Le fait que le capitalisme russe n'ait commencé sa course pour le pouvoir mondial qu'une fois le mode de production capitaliste déjà entré en crise permanente, implique qu'il ne pouvait pas égaler les puissances économiques dominantes -devenues impérialistes- qui avaient réalisé une formidable accumulation de capital quand le marché mondial était encore en expansion. La saturation du marché mondial, la crise globale de surproduction, a limité sévèrement le développement des industries d'exportation russes, sa capacité à réaliser la plus-value par-delà ses frontières, malgré le recours à un dumping systématique pendant la crise ouverte des années 30 et aujourd'hui); la capacité à importer la technologie avancée nécessaire pour dépasser son arriération relative s'est donc trouvée extrêmement restreinte. Malgré une capitalisation forcée, et la tentative de compenser la pénurie de capital par une étatisation presque totale (et par le pillage du stock de capital des pays conquis pendant la seconde guerre mondiale), la Russie impérialiste n'a pas été capable de supprimer l'écart qui la sépare du bloc américain rival. L'approfondissement de l'actuelle crise ouverte de surproduction mondiale n'a fait qu'accentuer l'arriération économique de la Russie, et son incapacité à produire à la même échelle que ses concurrents. Cela se manifeste à l'Est de l'Elbe sous la forme d'une pénurie chronique de capital dans le gros de l'industrie (et de l'agriculture), et d'un dumping sans lequel la production de certaines industries d'exportation clé serait invendable. Ainsi, la même crise économique globale, entraînée par la saturation du marché mondial, avec des manifestations différentes a déjà conduit à un ralentissement persistant et croissant de la croissance de la production industrielle et à un ralentissement du taux d'accumulation des deux blocs.
Dans les pays sous-développés, où vit la plus grande partie de la population-mondiale, la crise ouverte mondiale de surproduction a énormément accentué la dépendance et l'arriération auquel ces nations "indépendantes" sont irrémédiablement condamnées par la décadence du capitalisme. La petite poignée de pays parmi ceux des pays sous-développés, où l'industrialisation a atteint un poids considérable dans l'économie nationale est en train de subir sur une échelle de plus en plus grande les mêmes ralentissements dans la croissance de la production industrielle, la même chute dans le taux d'accumulation et le même chômage massif que les géants industriels. Ceci malgré un protectionnisme croissant destiné à écarter la concurrence des géants industriels tel que les USA, la RFA, le Japon et le dumping pratiqué par l'industrie russe.
En Argentine, la production industrielle globale a chuté de 6% en 1978 et tous les secteurs de l'industrie lourde -automobile (Gênerais Motors a fermé toutes ses usines), machine agricole, acier, chimie, pétrochimie- ont le dos au mur. Au Brésil, la croissance anticipée de 5% du PNB cette année (qui est déjà, devenu problématique face à la compression de crédits résultant d'un taux d'inflation galopante de plus de 60% par an) est égale seulement à la moitié du taux annuel réalisé durant le "miracle" économique d'il y a 10 ans, et il est beaucoup trop bas pour permettre la création d11.250 000 nouveaux emplois chaque année sans lesquels le chômage ne cessera de croître. Au Mexique, où le PNB réel s'est accru de 6-8% par an entre 1958-73, la croissance du PNB n'était que de 2,5% en 1977. L'investissement qui a augmenté à un taux annuel de 23,1% entre 1965 et 1970 s'est ralenti à un taux annuel de 17,8% entre 1971 et 1978. De plus, alors que l'Etat ne participait que pour 1/3 de cet investissement en 1965-70, le taux encore élevé d'investissement entre 1971 et 1978 ne fut possible que parce que l'Etat, à l'aide d'emprunts très lourds aux banques étrangères fournissait presque 90% de celui-ci - produisant non pas une accumulation de capital mais une accumulation massive de dettes. A tout ceci doit s'ajouter le fait que le chômage total ou partiel est déjà le lot de 52% de la population active ! En Afrique du Sud, la croissance économique s'est ralentie l'an dernier au faible taux de 2,5%, beaucoup trop bas pour empêcher un accroissement du chômage qui touche déjà environ 2 millions de travailleurs.
Dans la plupart des pays sous-développés, l'économie nationale tourne presque exclusivement autour de l'extraction de matières premières ou de la production agricole (généralement une ou deux récoltes entièrement exportées). La crise ouverte a exacerbé à un degré extrême les tendances qui avaient caractérisé ces économies depuis le tout début de la décadence capitaliste il y a plus de 70 ans: crise agricole permanente et dépendance absolue des denrées alimentaires importées dans ces économies à prédominance agraire ; la croissance énorme d'un sous-prolétariat coupé des villages ruraux dont le capital l'a séparé et condamné à une existence sans travail dans les immenses périphéries des villes et bidonvilles qui ont grandi autour des centres urbains, commerciaux et politiques; en deux mots, misère et famine.
L'impossibilité pour les pays sous-développés de dépasser leur arriération et leur dépendance n'est que trop claire : en supposant une croissance zéro dans les pays industriels du bloc américain, il faudrait 65 ans de croissance au taux de 1970-76 aux pays sous-développés qui ont déjà une base industrielle (Argentine, Brésil, Mexique, Afrique du Sud, etc.) pour atteindre le PNB par tête des pays industrialisés ; pour la plus grande partie des pays sous-développés - en supposant les mêmes conditions - cela prendrait 746 ans! Cependant de même que la crise conduit inexorablement les pays industrialisés à la stagnation et même au déclin de la production industrielle, elle condamne encore plus sûrement les pays sous-développés à l'effondrement économique. Et il est absolument certain que l'énorme écart qui existe déjà entre les géants industriels et ces pays ne va aller qu'en s'agrandissant dans les années à venir.
Le ralentissement global de la croissance de la production et du taux d'accumulation a entraîné un ralentissement de la croissance du commerce mondial. Après la forte chute d'environ 10% du commerce des pays de l'OCDE dans la première moitié de 1975, le commerce extérieur de ces pays n'est remonté en 1976 que pour stagner l'année suivante ; après un autre bond en 1978 - bien que beaucoup plus faible qu'en 1976 - et largement dû à la reflation américaine, leur commerce extérieur est à nouveau aujourd’hui pratiquement stagnant. Le tableau qui suit montre la croissance du volume des importations et des exportations des 7 principaux pays de l'OCDE (USA, Japon, RFA, France, Grande-Bretagne, Canada, Italie) qui comprend la majeure partie du commerce mondial et illustre clairement la stagnation qui caractérise cet élément vital de la santé de l'économie capitaliste globale : le commerce international.
Cependant, l'incapacité du commerce mondial de se développer est minimisée et considérablement cachée par les statistiques que l'OCDE, la Banque Mondiale, le FMI et d'autres agences et institutions capitalistes utilisent pour contrôler les conditions du commerce international ([3] [132]). La bourgeoisie n'arrive pas à comprendre que 70% du commerce extérieur des pays de 1'OCDE se passe entre eux - et que c'est ce commerce interne au bloc qui compte pour la plus grande part de la croissance qu'indiquent les statistiques ([4] [133]). Lorsque le commerce mondial a chuté de façon extrêmement rapide et catastrophique dans la crise ouverte des années 30, six parmi les sept principaux pays dans le commerce d'aujourd'hui (à l'exception du Canada) étaient alors des rivaux impérialistes. Aujourd'hui ces sept pays se trouvent eux-mêmes fermement au sein du même bloc impérialiste et le commerce entre aux indique autant la nature de la division complexe du travail et l'interpénétration économique que les USA ont imposé sur leur bloc qu'une véritable croissance dans ce qui a été traditionnellement le commerce international. On peut dire la même chose pour le COMECON : 56% du commerce de ces pays se fait entre eux et c'est cette composante qui s'accroît le plus rapidement dans le commerce de chaque pays.
De plus, en analysant la très faible croissance du commerce mondial de ces cinq dernières années, la bourgeoisie est incapable de saisir la signification de la composition de ce commerce. A peu près 25 % de la valeur du commerce mondial en 1977 est venu des voyages à l'étranger, des dividendes des investissements et autres faux frais qui en aucune façon ne constituent une véritable expansion du commerce. De la même manière, une part considérable de la valeur et du volume du commerce mondial consiste directement en armement (43,7 milliards de Dollars entre 1971 et 1975 dont 76 % avec les pays sous-développés) qui, du point de vue du capital global, représente non pas une croissance mais une stérilisation des valeurs, non pas une expansion mais une destruction du capital global ([5] [134]). Le développement fantastique des dépenses improductives - spécificité de la décadence capitaliste dont un des aspects est l'accroissement du commerce des armes- est obscurci par le fait qu'une partie très considérable du commerce mondial pour des buts militaires est cachée dans les chiffres sur la croissance du commerce des matières premières comme le pétrole brut, le cuivre, le nickel, le zinc, le plomb, le molybdène, l'étain, etc. dont environ 10% au moins est pour l'armement, et du commerce en équipements électroniques et en ,machinerie lourde dont la plupart est pour la production militaire (réacteurs nucléaires par exemple).
Finalement, une part énorme de la croissance du commerce mondial - particulièrement ces cinq dernières années - a sa contrepartie de déficits commerciaux croissant rapidement et une hausse astronomique des dettes des pays sous-développés. Le déficit commercial annuel d'ensemble des pays sous-développés est passé de 7,5 milliards de Dollars en 1973 à 34 milliards de Dollars en 1978; la dette extérieure de ces mêmes pays est passée de 74,1 milliards de Dollars en 1973 à 244 milliards de Dollars en 1978, et est l'élément essentiel dans le financement de ces déficits commerciaux croissants. Cette dette énorme indique que la croissance du commerce mondial que les économistes bourgeois ont enregistrée cache en réalité le fait qu'il n'y a pas eu de véritable expansion du marché mondial. En fait, comme nous le verrons, la demande effective à l'échelle mondiale se rétrécit à un taux que l'expansion du crédit mondial ne peut plus compenser.
La stagnation du capital mondial au cours de ces quatre dernières années - qui a brisé les espoirs que la bourgeoisie entretenait sur une reprise après la chute brutale de 1974-75 - menace maintenant de laisser la place à une autre chute beaucoup plus dévastatrice de la production, de l'investissement et du commerce mondial avec l'approfondissement incessant de la crise de surproduction.
Après la chute économique qui a frappé les pays du bloc américain en 1970-71, pratiquement tous les gouvernements ont fait une politique de relance (et l'expansion du crédit ? nourri l'inflation galopante qui s'en est suivie). Avec le retour d'une chute beaucoup plus sévère en 1974-75 - qui a secoué les deux blocs simultanément - seuls les USA ont fait une politique de relance et il leur est revenu la charge de soutenir le reste du bloc pendant les quelques années qui ont suivi. Pendant ce temps, l'Allemagne de l'Ouest et le Japon se sont lancés dans une offensive exportatrice qui a grossi leurs surplus commerciaux et leurs profits alors que le marché intérieur stagnait. En 1978, cependant, la compétitivité déclinante des marchandises américaines sur le marché mondial, les déficits commerciaux astronomiques et la chute du Dollar des USA, ont signifié que Washington aussi devait effectuer un freinage économique. Le sommet économique de Bonn en juillet dernier fut décidé en vue de faire pression sur l'Allemagne de l'Ouest et le Japon pour qu'ils contrôlent leurs exportations et qu'ils relancent leurs économies pour soulager par là la pression sur les USA et pour éviter une nouvelle chute de l'économie mondiale.
Les mois qui ont suivi le sommet économique ont démontré que les USA ont réussi à un degré considérable à imposer leurs diktats sur leurs alliés résistants. Le Japon a prévu un déficit budgétaire de 80 milliards de Dollars (40% de son budget total et beaucoup plus que celui des USA) pour cette année fiscale ; et les importations du Japon se sont accrues à un taux deux fois plus rapide que celui des exportations. L'Allemagne de l'Ouest a adopté un budget qui devrait injecter 15,5 milliards de DM supplémentaires dans son économie (1% de son PNB). Un des résultats de la politique monétaire plus restrictive aux USA, et de la relance allemande et japonaise, a été une hausse importante du Dollar : entre novembre 1978 et avril 1979, le Dollar a pris plus de 10% par rapport au DM et 22% par rapport au Yen.
Cependant, même les prévisions les plus optimistes de la bourgeoisie (l'OCDE par exemple) ont montré que l'expansion allemande et japonaise en 1979 ne compenserait pas le ralentissement de la croissance du PNB américain. Par conséquent, une estimation réaliste des tendances économiques ne peut amener qu'à la conclusion que la stagnation de ces dernières années devrait donner lieu à une chute en 1979. La réalité a été même plus brutale dans les premiers mois de 1979. Le PNB aux USA n'a augmenté que de 0,7% (moins de la moitié du taux prévu par l'OCDE en décembre) et est maintenant réellement en baisse. L'inflation galopante qui fait rage aujourd'hui aux USA empêche tout stimulant véritable par une politique monétaire et fiscale pour enrayer le déclin. Dans le même temps, les politiques monétaires stimulantes et les budgets déficitaires de relance de l'Allemagne de l'Ouest et du Japon ont rapidement rallumé les feux de l'inflation dans ces pays (le taux annuel d'inflation était de 10% en Allemagne de l'Ouest en mars et de 11% au Japon en février) ; ceci a maintenant provoqué une compression du crédit et l'échec des politiques de relance, ce qui a fait voler en éclats les espoirs d'accroissement substantiel des PNB pour enrayer même partiellement la chute en Amérique. Le cauchemar qui a hanté les technocrates et les banquiers de l'OCDE et du FMI devient une réalité : pratiquement tous lies pays industrialisés du bloc américain vont ralentir leur économie simultanément !
La capacité de production inutilisée et la récession dans le bloc américain ne peuvent être compensées par une nouvelle expansion du commerce avec le bloc russe ou avec les pays sous-développés. L'énorme dette des pays du bloc russe envers le bloc américain s'est élevée de 32-35 milliards de Dollars en 1976 à environ 50 aujourd'hui. La Pologne - qui doit environ 15 milliards de Dollars -est déjà au bord de la banqueroute. Les banquiers occidentaux, qui essaient de récupérer leurs investissements antérieurs, ne sont pas en mesure de fournir les nom/eaux crédits énormes qui seuls rendraient possible le financement des déficits commerciaux croissants du bloc russe vis-à-vis de l'Ouest, déficits commerciaux qui sont passés de 4,9 milliards de Dollars en 1977 à 6 en 1978. De plus, les bureaucrates des pays du bloc russe sont aujourd'hui occupés à limiter leurs importations de l'Ouest - même s'ils s'engagent vers un dumping massif de leurs propres marchandises sur les marchés occidentaux - pour réduire leurs déficits commerciaux vertigineux.
Vis-à-vis des pays sous-développés, les pays du bloc américain sont confrontés au même dilemme. Avec 244 milliards de Dollars de dette extérieure, les pays sous-développés sont actuellement en faillite et réduits à réclamer des moratoires. Dans de pays comme l'Algérie, la Zambie et le Zaïre, la dette extérieure atteint plus de la moitié du PNB annuel. Les 5 milliards de Dollars payés sur la dette extérieure du Brésil en 1978 équivalaient à presque 55% de la valeur totale de ses exportation pour l'année; le Mexique a dépensé 6 milliards de Dollars pour rembourser sa dette extérieure en 197 alors que ses énormes ressources de pétrole n'avaient permis que 1,7 milliards de Dollars d'exportation. Face à l'immensité évidente de telles dettes et la difficulté croissante à les rembourser, de nouveaux prêts - que l'Ouest est de plus en plu hésitant à fournir - loin d'étendre le commerce seront utilisés d'abord pour assurer les remboursements des dettes antérieures et pour empêcher la débâcle financière des banques occidentales.
Alors que l'énorme expansion du crédit dans le bloc américain, vis-à-vis du bloc russe et des pays sous-développés, avait, au cours de la décade passée, masqué, dans une certaine mesure, le resserrement de la demande effective à une échelle globale Ile résultat de l'inflation galopante et des dettes non payables - une masse de papier - est pratiquement de mettre fin au recours à de tels palliatifs aujourd'hui.
Le marché chinois, qui il y a seulement un an soulevait de tels espoirs dans les cercles d'affaires du bloc américain, ne peut pas fournir de débouchés suffisants pour les usines sous-utilisées dans les principales industries. Le besoin de la Chine d'importation massive de technologie et de machinisme n'est pas équilibré par des ressources pour payer ses importations. Après les plans ambitieux annoncés en mars 1978, la Chine a dû geler les commandes de 30 importations d'usines importantes avec le Japon en février, la bureaucratie de Pékin y regardant à deux fois sur les conséquences de ces plans initiaux de "modernisation". La Chine va certainement s'accroître comme marché pour le bloc américain (en particulier pour les armements), mais pas aussi vite que le pensait l'Ouest il y a un an. La Chine ne compensera pas non plus la stagnation et la chute imminente du commerce mondial en particulier par le fait que dans la compétition acharnée entre pays occidentaux pour le marché chinois, il y aura plus de perdants que de gagnants. De plus, la Chine va essayer d'inonder les marchés occidentaux saturés avec les textiles, les chaussures, etc., ce qui compliquera la surproduction globale qui caractérise déjà les industries de biens de consommation pour lesquelles le capitalisme chinois est dès maintenant compétitif.
Pour l'Allemagne de l'Ouest et le Japon - les pays du bloc américain dont les économies sont les plus compétitives sur le marché mondial - la fin de la relance chez eux et les limites sévères à l'extension de larges crédits signifient qu'une offensive exportatrice effrénée aux dépens de leurs rivaux commerciaux apparaît comme le moyen le plus viable pour essayer d' enrayer les difficultés économiques croissantes. Une telle orientation des bourgeoisies japonaise et allemande ne peut manquer de rallumer les tendances protectionnistes dans les économies plus faibles du bloc américain (Grande-Bretagne, Italie, France) et même aux USA.
La réponse possible sous la forme de dévaluations compétitives et de contrôle des importations, qui bouleverseraient le Système Monétaire Européen et feraient échouer le "Tokyo Round" orchestré par l'impérialisme américain, tout juste conclu, en accélérant la chute du commerce mondial et en provoquant une poussée vers l'autarcie, ouvre des questions à prendre en compte pour comprendre la crise politique de la bourgeoisie. Pour le moment il est suffisant de montrer qu'une nouvelle offensive exportatrice de l'Allemagne et du Japon ne peut qu'approfondir la crise mondiale.
L'approfondissement inexorable de la crise de surproduction, et l'échec des nombreux palliatifs avec lesquels la bourgeoisie a vainement visé à contenir les ravages des lois aveugles qui déterminent le cours de la crise économique, ont ainsi amené le capital mondial au bord d'un autre déclin de la production, de l'investissement et du commerce - plus aigu que les chutes de 1971-74 - pour le début des années 80. ([6] [135]).
LES ANTAGONISMES INTER IMPERIALISTES
Il n'y a qu'un seul secteur de l'économie mondiale qui va se développer dans les prochaines années : l'industrie d'armement, la production de guerre. Le cas de la Syrie, où les dépenses militaires constituent 57,2% du budget de l'Etat, alors que le secteur productif de l'économie s'écroule, est caractéristique de la production des pays sous-développés aujourd'hui. Les pays sous-développés qui ont un important secteur industriel, comme l'Afrique du Sud, Israël, l'Argentine ou le Brésil, dépensent des milliards de Dollars pour construire des bombes nucléaires et des systèmes de lancement, tandis qu'une inflation galopante et une énorme dette extérieure sapent leur base économique. Même les pays où l'industrie reste confinée à quelques pitoyables îlots, comme l'Inde ou le Pakistan, dans un océan d'agriculture arriérée et d'industrie artisanale, épuisent leurs maigres réserves de devises étrangères pour créer ou développer leur capacité à mener la guerre nucléaire. Dans les métropoles impérialistes, la production d'armement va monter en flèche, tandis que le reste de l'économie va se contracter dans les années à venir. Le bloc russe déploie ses nouveaux missiles nucléaires 5520 qui sont capables de détruire toutes les villes principales de l'Europe de l'Ouest. Il développe ses armées de terre afin d'être capable d'atteindre la côte atlantique en quelques jours. A cela, il faut ajouter le prodigieux développement de la marine russe, avec laquelle le Kremlin voudrait détruire l'hégémonie américaine sur les mers. Les pays du bloc américain développent aussi de façon significative leurs budgets militaires, même s'ils réduisent par ailleurs d'autres dépenses (le budget militaire de la France s'est accru cette année de 5% alors que le plan Barre demande la réduction de secteurs entiers de l'économie). L'OTAN est en train de planifier l'introduction d'un nouveau système de missiles nucléaires capables de détruire des cibles à objectifs précis en Russie depuis l'Europe occidentale et de développer largement toute l'infrastructure des ports, aéroports, dépôts d'essence, facilités de stockage, etc. afin de faciliter le transport rapide des troupes américaines et d'équipements sur le front européen en cas de guerre.
Pendant ce temps, les USA sont déjà en train de réexaminer leurs décisions de ne pas produire la bombe à neutrons et se préparent à construire un système de missiles balistiques intercontinentaux complètement nouveau : le MX. Et enfin, le bloc amé ricain s'est joint de façon enthousiaste à Pékin dans son programme massif et coûteux de modernisation de toutes les branches des forces armées chinoises.
L'économie de guerre, c'est-à-dire la production des moyens de destruction comme centre et axe de la production industrielle, n'est pas un phénomène nouveau. L'éclatement de la Première Guerre Mondiale en 1914, qui a clairement marqué, 1'entrée du système capitaliste dans sa phase de décadence, avait pour corollaire le développement de l'économie de guerre. Tout comme la crise historique du capitalisme est une crise permanente, chaque capital national est caractérisé par une économie de guerre permanente à l'époque de la décadence capitaliste. Cependant, tout comme la crise permanente est marquée par un cycle de crise-guerre-reconstruction, cycle durant lequel il y a des répits après les ravages de la crise ouverte et les dévastations de la guerre mondiale, l'économie de guerre permanente est aussi marquée par un mouvement de zigzags durant lequel il y a parfois des courtes périodes où a lieu un déclin de la production de guerre (Europe et USA pendant la période de reconstruction des années 20 et aussi USA entre la fin de la 2ème Guerre Mondiale et l'éclatement de la Guerre de Corée en 1946-50). Néanmoins, tout comme la crise historique elle-même, l'économie de guerre a été une caractéristique constante du capitalisme depuis 1914. La phase actuelle de dépression mondiale amène dans son sillage un renforcement incroyable de l'économie de guerre - pas simplement à l'échelle nationale, mais dictée, coordonnée et organisée par un capitalisme d'Etat continental gigantesque, les USA et le Russie qui dominent chacun les deux blocs impérialistes qui s'affrontent.
La phase actuelle de croissance monstrueuse de l'économie de guerre n'est ni un palliatif à la crise économique ni un facteur qui peut présenter ne serait-ce qu'une façade momentanée de "prospérité" Quelles que soient les conditions, la production de guerre par 1'hyper développement du secteur improductif de l'économie, draine la plus-value des îlots restant de l'activité rentable. Dans toutes les circonstances, l'économie de guerre veut dire une attaque contre le prolétariat : "... La production de guerre est réalisée aux dépens des masses travailleuses dont l'Etat par diverses opérations financières : impôts, emprunts, conversion, inflation et autres mesures, draine des valeurs avec lesquelles il constitue un pouvoir d'achat supplémentaire et nouveau" (Rapport sur la situation internationale, Conférence Nationale de la Gauche Communiste de France, juillet 1947). Si les programmes de réarmement d'Hitler, Blum et Roosevelt dans les années 30 ont pu stimuler momentanément leurs économies et même amener des éléments de la Gauche Communiste à penser que l'économie de guerre pourrait ouvrir une période d'expansion économique et ainsi amener une hausse du niveau de vie de la classe ouvrière ([7] [136]), la brièveté de vie de ce stimulant économique comme les illusions qu'il a engendrées, étaient dues aux dettes massives contractées par l'Etat et aux politiques inflationnistes menées par les gouvernements capitalistes. Aujourd'hui, le renforcement de l'économie de guerre a lieu alors qu'il y a déjà un niveau intolérable de dettes d'Etat et une inflation galopante (elles-mêmes étant en large part la rançon que le capital a payée pour 40 ans de croissance quasi ininterrompue de la production de guerre), et donc le recours à la dette et à l'inflation comme moyens spécifiques pour faire payer à la classe ouvrière l'économie de guerre est impossible. Au contraire, la phase actuelle de croissance de la production de guerre va s'accompagner de déflation, de coupes dans tous les budgets qui ne concernent pas la partie militaire, et de programmes draconiens d'austérité empêchant par là ne serait-ce qu'un effet momentanément stimulateur sur l'ensemble de l'économie. En fait, à cause de l'énorme gaspillage représenté par la plus-value cristallisée dans les armements dont la réalisation intensifie la spirale inflationniste, et qui ne peut entrer à nouveau dans le processus productif - devenant ainsi une perte sèche pour le capital global, l'économie de guerre ne peut qu'exacerber le déclin économique et accélérer la baisse du niveau de vie du prolétariat.
Néanmoins, la production de guerre continuera de croître vertigineusement aux dépens de toutes les autres activités économiques, absorbant l'ensemble des secteurs de l'industrie (construction navale, électronique, construction, etc.), tout comme les activités non militaires ralentissent inexorablement. Le renforcement de l'économie de guerre est une nécessité absolue pour le capital, bien que "la production de guerre n'ait pas pour objectif la solution d'un problème économique" ([8] [137]). L'économie de guerre est vitale pour le capitalisme seulement de par 1'inévitabilité de la guerre mondiale si le prolétariat ne détruit pas l'ordre bourgeois. La production de guerre comme axe de l'économie, voilà la réponse de la bourgeoisie aux lois aveugles qui, en condamnant le capitalisme à un approfondissement inexorable de la crise économique, aiguisent les antagonismes inter impérialistes jusqu'au point de rupture. La seule fonction de l'économie de guerre, c'est...la guerre!
Dans la phase décadente, la guerre impérialiste mondiale est devenue la condition même de la survie du capitalisme :
"Plus se rétrécit le marché, plus devient âpre la lutte pour la possession des sources de matières premières et la maîtrise du marché mondial. La lutte économique entre divers groupes capitalistes se concentre de plus en plus, prenant la forme la plus achevée : des luttes entre Etats. La lutte économique exaspérée entre Etats ne peut finalement se résoudre que par la force militaire. La guerre devient le seul moyen par lequel chaque impérialisme national tend à se dégager des difficultés auxquelles il doit faire face, aux dépens des Etats impérialistes rivaux"([9] [138])
Alors que c'est la crise économique qui dicte la nécessité pour la bourgeoisie de faire la guerre mondiale, la capacité de la bourgeoisie à imposer sa "solution" qu'est la guerre impérialiste est STRICTEMENT DETERMINEE par le rapport de forces entre la bourgeoisie et le prolétariat. C'est à cette question que nous reviendrons dans le rapport sur le cours historique.
Avant d'examiner les stratégies des blocs impérialistes et ce qui se passe dans les zones d'affronte ment inter impérialiste, il y a quelques commentaires généraux à faire sur la physionomie du capitalisme dans l'époque impérialiste, d'autant plus que des confusions se sont exprimées et persistent sur un nombre de caractéristiques du capitalisme à l'époque où il est traversé de convulsions permanentes (qui s'expriment dans la guerre impérialiste latente ou ouverte) au sein du mouvement révolutionnaire.
Le processus de concentration et de centralisation du capital qui est l'une des marques de "fabrique" du mode de production bourgeois a été transposé par certains révolutionnaires sur le plan de l'échiquier impérialiste où il est vu comme un processus pratiquement téléologique menant irréversiblement à une unité mondiale finale du capital, marquant l'aboutissement du processus de concentration dans l'époque impérialiste :
"Il faut voir dans les guerres de l'époque impérialiste les moments décisifs dans le processus de concentration mondiale du capital et du pouvoir, non pas simplement des luttes pour de nouveaux partages du monde, mais l'acheminement vers la domination universelle d'un seul groupe exploiteur. et la limite de ce processus si la révolution prolétarienne n'intervient pas, est nécessairement la domination du monde par un seul Etat impérialiste". (Pierre Chaulieu, "Situation de l'Impérialisme et Perspectives du prolétariat", Socialisme ou Barbarie n°14).
Cette vision des guerres impérialistes qui mènent à l'unité mondiale du capital -qui est une nouvelle version de la théorie de Kautsky sur le super impérialisme- réalisée cette fois-ci non de façon pacifique mais au travers de boucheries impérialistes "...perd le contact avec la réalité du monde capitaliste décadent dont la tendance est, malgré les antagonismes inter-impérialistes qui font apparaître le monde capitaliste comme momentanément deux unités uniques aux prises. Au contraire, le monde capitaliste décadent va vers la désagrégation, la désintégration, la dissociation, la dislocation des unités... La tendance du capitalisme décadent au schisme de plus en plus, au chaos, c'est là que réside la nécessité essentielle du socialisme voulant réaliser le monde comme une unité" (Internationalisme, n°37 -1948-). A /travers le capitalisme d'Etat, les luttes de libération nationale et les guerres mondiales, le capital tend, dans sa phase de décadence, à détruire le degré limité d'unité qu'il a lui-même développé ! dans sa phase ascendante avec la création du marché mondial et la division internationale du travail. A la place, le capitalisme décadent emprisonne les forces productives dans les limites étroites d'une véritable pléthore d'Etats nationaux séparés. ([10] [139]). A côté de la stérilisation de la valeur à travers la production de guerre et de l'énorme destruction des guerres impérialistes, la formation de nouveaux Etats nationaux est l'une des manifestations de l'incapacité du capitalisme décadent à développer les forces productives.
La formation de deux blocs impérialistes gigantesques dominés par la Russie et les USA a amené certains révolutionnaires à voir la classe dominante de chaque Etat national comme un simple pion, une cinquième colonne de Moscou ou de Washington. Ainsi, pour les bordiguistes de la fin des années 40, les partis staliniens qui rivalisaient alors pour le pouvoir en Europe occidentale, ne pouvaient qu'être les instruments purs et simples de la classe dominante russe : "Pour caractériser de façon succincte les différents partis communistes, nous pourrions dire : "Ce sont les cinquièmes de l'impérialisme russe dans le camp ennemi" (Chazé, "L'impérialisme russe contre-attaque", L'Internationaliste, nov.1947). Un tel point de vue ne permet pas du tout de comprendre le fait que la constitution des deux grands blocs n'est pas seulement fonction des intérêts impérialistes de Moscou et de Washington mais est aussi fonction des nécessités pour chaque bourgeoisie locale de mettre en avant et de défendre ses propres intérêts nationaux et impérialistes le plus qu'elle peut : "La défense de l'intérêt national dans l'époque de l'impérialisme ne peut se faire que dans un cadre élargi de blocs impérialistes. Ce n'est pas en tant que cinquième colonne, en tant qu'agent de l'étranger mais en fonction de ses intérêts immédiats ou lointains bien compris qu'une bourgeoisie nationale opte et adhère à un des blocs mondiaux qui se constitue. C'est autour de ce choix pour l'un ou l'autre bloc que se font la division et la lutte interne au sein de la bourgeoisie, mais c'est toujours en partant d'un fond et d'un but commun : l'intérêt national, l'intérêt de la bourgeoisie nationale" (Internationalisme n°30 -1948-).
Le point de vue de la CWO est aussi étroitement lié à l'incapacité de voir les intérêts vitaux de chaque bourgeoisie nationale dans la constitution de blocs impérialistes rivaux et dans le choix de l'un d'entre eux. Selon la CWO, à l'époque actuelle, bien que d'autres pays puissent aspirer à devenir impérialistes, seules la Russie et l'Amérique sont des Etats impérialistes : "...L'impérialisme est une politique des principales puissances capitalistes L'idée que tous les pays seraient impérialistes sous-entend l'idée de blocs impérialistes. Comment peut-on expliquer alors, avec une telle vision, pourquoi Israël est une puissance impérialiste indépendante ? " (Revolutionary Perspectives, n°12).
C'est sur qu'Israël n'est pas une puissance "indépendante" quelle que soit la signification exacte que la CWO veut mettre sous ce terme. L'Etat juif est forcé par les réalités du capitalisme décadent d'essayer de satisfaire ses appétits impérialistes très réels et voraces (le Grand Israël, tout l'ancien mandat palestinien, le sud de la rivière Litani au Liban, le Golan syrien, une partie du Sinaï, presque toute la Jordanie) et de défendre ses non moins réels -quoique plus modestes- acquisitions récentes, dans le cadre d'un bloc impérialiste. Les marxistes révolutionnaires ont compris que, dans le capitalisme décadent, tout Etat national est impérialiste. Déjà Rosa Luxemburg avait compris que durant la première guerre mondiale un Etat comme la petite Serbie "cherchait à conquérir la côte adriatique où elle avait engagé un véritable conflit impérialiste avec l'Italie sur le dos des albanais" (Brochure de Junius). Et le CCI reconnaît aujourd'hui que les affrontements récents entre le Vietnam et le Cambodge qui se sont transformés en une invasion à grande échelle par Hanoï sont..."la conséquence des intérêts impérialistes propres des deux pays, et particulièrement du Vietnam dont la supériorité militaire écrasante lui permet d'envisager de façon réalisme une 'fédération indochinoise' placée sous sa domination" (Internationalisme n°29 -février 1979). Ce n'est qu'en partant de cette conception –tout Etat national est impérialiste- que l'interaction complexe entre les intérêts nationaux d'une bourgeoisie locale et les besoins globaux du bloc impérialiste auquel elle est liée peut-être cernée et qu'on peut comprendre la nature réelle des guerres inter-impérialistes localisées et des luttes de libération nationale.
Certains révolutionnaires défendent aussi l'idée que le fondement des, antagonismes entre les Etats -et donc la composition d'un bloc impérialiste-est seulement déterminé par le commerce dominant ou par les rivalités commerciales sur le marché mondial. C'est le point de vue du PCI (Programma Comunista) qui, dans son analyse des antagonismes inter-impérialistes en Afrique, s'est fixé sur les rivalités entre les USA, l'Allemagne de l'Ouest, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie qui sont aujourd'hui le résultat de la guerre commerciale, et a pratiquement exclu et laissé de côté les luttes titanesques entre les blocs américain et russe pour lesquels des nécessités géopolitiques, militaires et stratégiques strictement liées aux intérêts économiques globaux de chacun- sont des facteurs déterminants. Mais c'est chez le PIC que ce point de vue, qui réduit de façon erronée les intérêts économiques à un seul et unique facteur : l'origine des importations d'un pays et la destination de ces exportations, est devenu le fondement d'une "nouvelle" théorie qui s'avère incapable de rendre compte du développement des antagonismes inter-impérialistes aujourd'hui. Puisque l'Allemagne de l'Ouest et le Japon sont les principaux rivaux commerciaux des Etats-Unis, le PIC a mis 1'accent pendant des années sur la perspective de l'effritement du bloc américain; puisque le commerce entre l'Allemagne de l'Ouest et les satellites Est-européens de la Russie s'est développé de façon vertigineuse, le PIC a mis en évidence M'effritement du bloc russe. Tout cela,, avec en plus l'idée que les intérêts strictement commerciaux des USA et de la Russie seraient complémentaires (les Russes ont besoin delà technologie américaine et les américains ont besoin des matières premières russes), a amené le PIC à développer la théorie de l'émergence d'un nouveau bloc : l'URSS et les USA dans le même bloc, l'Europe dominée par l'Allemagne, le Japon et la Chine dans un autre .
Ni la constitution de blocs impérialistes, ni l'éclatement de guerres impérialistes ne s'expliquent exclusivement par les stricts intérêts commerciaux des différents Etats. Si, comme semble le croire le PIC, ce sont les stricts intérêts commerciaux qui en constituent le facteur déterminant, alors, dans les années 30, c'est entre les USA et la Grande-Bretagne qu'aurait du éclater la guerre impérialiste (et non pas, comme ce fut le cas, entre l'impérialisme anglo-américain et l'impérialisme allemand). Les Etats-Unis étaient de loin le plus dangereux rival commercial pour la Grande-Bretagne sur les marchés où les surplus commerciaux et les paiements de l'Empire Britannique étaient cruciaux (Inde, Chine, Asie Australe, Canada, Amérique du Sud) alors que l'Allemagne n'avait rivalisé avec la domination britannique que dans les marchés est-européens d'importance secondaire. En dernière instance, c'est la considération géopolitique et stratégico-militaire selon laquelle une Europe dominée par l'Allemagne serait une menace fatale pour l'empire britannique (dépendant comme il l'était de la Méditerranée comme clé de sa survie économique) et mènerait à son extinction économique, c'est cette considération qui a déterminé la configuration des blocs impérialistes. De même pour ce qui est des intérêts commerciaux des Etats-Unis dans les années 30, Washington aurait infiniment préféré le Japon (qui était un excellent partenaire commercial) à la Chine (avec qui les possibilités de commerce étaient loin d'être aussi bonnes). Aussi, ce n'est pas le commerce au sens strict mais la question géopolitique de la domination militaire -et donc économique au sens large- du Pacifique qui a dicté le cours des événements qui menèrent à l'éclatement d'une guerre impérialiste entre l'Amérique et le Japon.
Aujourd'hui, la supériorité écrasante de l'Amérique sur son bloc (le Dollar qui est la monnaie de réserve dominante, le rôle du FMI, le Tokyo Round, etc.) et la dépendance absolue sur le plan stratégique et militaire de l'Europe occidentale et du Japon à l'égard de l'impérialisme américain (pétrole, matières premières, protection des voies maritimes) d'un côté, et de l'autre côté la supériorité militaire de l'impérialisme russe sur son glacis (Pacte de Varsovie) démontrent de façon concluante que la tendance dominante est celle de la consolidation et du renforcement des blocs américain et russe existants. La consolidation de l'économie de guerre à l'échelle intercontinentale des blocs et les foyers de guerres inter impérialistes localisées, tout démontre que les blocs sont déjà constitués pour une troisième boucherie impérialiste. La troisième guerre mondiale à laquelle mènent irrésistiblement les lois aveugles du capitalisme et le cours de la crise économique -à laquelle seule la lutte de classe du prolétariat barre aujourd'hui la route- ne peut être qu'un conflit titanesque entre l'impérialisme russe et l'impérialisme américain pour la domination du monde ([11] [140]).
Le fondement de la stratégie des impérialismes russe et américain est déterminé par leur poids économique relatif sur le marché mondial. De par sa faible compétitivité et son arriération technique, l’avenir de l'impérialisme russe est étroitement lié à l'acquisition d'une infrastructure industrielle et d'une technologie avancée, ce qui, à l'époque présente, dépend de sa capacité à dominer militairement les centres industriels de l'Europe de l'Ouest et/ou du Japon. Le PNB de la Russie en 1976 était de moins de la moitié du PNB des USA. Si Ton y ajoute l'infrastructure industrielle japonaise, le bloc russe atteindrait la capacité industrielle américaine; si l'on y ajoute le poids industriel de l'Europe occidentale, l'impérialisme russe dépasserait facilement son rival américain dans la capacité productive, et concurrencerait sérieusement son potentiel militaire. C'est pour cette raison que le réel objectif de l'impérialisme russe, ce sont les centres industriels gigantesques d'Europe et d'Extrême-Orient, et qu'un défi direct envers l'autre conduirait immédiatement à l'explosion des hostilités entre les USA et l'URSS. De toute façon, la stratégie de l'impérialisme russe n'est pas l'attaque frontale, mais tend à priver l'Europe et le Japon de leurs sources d'énergie et de matières premières vitales au Moyen-Orient et en Afrique, à couper les route commerciales dont dépend leur économie et ainsi à exercer une énorme pression sur leurs classes dirigeantes pour qu'elles envisagent la préservation de leurs intérêts nationaux et impérialistes par une réorientation vers le bloc russe. En ce sens, l'effort soutenu de Moscou pour déstabiliser le Moyen-Orient et l'Afrique -via les luttes de "libération nationale"- et pour obtenir des bases militaires sûres dans ces régimes, a pour objectif réel le potentiel industriel de 1'Europe et du Japon. Les pays sous-développés de l'hémisphère Sud sont le maillon faible par lequel l'impérialisme russe cherche à atteindre son objectif d'ensemble le changement décisif de l'équilibre entre les blocs.
Si l'un des éléments essentiels de la stratégie de l'impérialisme américain est la protection de la vaste zone qu'il a accaparée lors des deux précédentes boucheries impérialistes, cela ne veut pas dire que la position américaine soit simplement défensive. Les 2/3 du monde que l'impérialisme américain domine déjà, ne sont plus suffisants pour préserver son équilibre économique. Le souffle dévastateur de la crise économique oblige les USA à lutter pour une part plus grande encore de la production mondiale, de la plus-value globale, donc pour le contrôle d'un nombre d'ouvriers plus important et encore plus de ressources mondiales de matières premières et de capacités industrielles. La profondeur de la crise est telle que seul un contrôle total sur l'ensemble du marché mondial peut permettre aux USA ne serait-ce qu'un très court répit qui est la seule chose possible dans le capitalisme décadent. Et déjà la nature même du capitalisme à l'époque impérialiste avec ses tendances dominantes vers la division et la désintégration empêche une telle évolution.
Les années passées ont vu un renforcement considérable de l'impérialisme américain et un affaiblissement de son rival russe. L'intégration de la Chine dans le bloc américain et la participation au réarmement de Pékin signifient que le Kremlin rencontrera une force de plus en plus puissante sur sa frontière Est -une force qui barrera fermement la route vers les bases industrielles japonaises. Même les efforts de l'impérialisme russe pour chasser la Chine de la péninsule indochinoise ne peuvent compenser cette victoire de l'impérialisme américain en Extrême-Orient. Par ailleurs la vaste ceinture islamique qui s'étend à travers l'Asie -de l'Inde à la Turquie- malgré la domination russe en Afghanistan et la chute du Shah d'Iran, est loin d'être tombée dans les mains du Kremlin. La perspective de la désintégration de l'Iran et le développement des luttes de libération nationale en Azerbaïdjan, au Kurdistan, au Turkménistan peuvent bénéficier aux USA et non à l'URSS. Le soutien américain à l'opposition islamique au régime de Kaboul laisse prévoir une défaite pour la Russie en Afghanistan. Au Moyen-Orient, tandis que la "pax americana" est loin d'être achevée et que l'abcès palestinien continue à s'envenimer donnant à l'impérialisme russe une base importante pour déstabiliser la région, l'opposition des régimes arabes pro-russes comme l'Irak à l'invasion inspirée par les russes du nord Yémen par le sud Yémen montre les difficultés de l'impérialisme russe dans cette zone cruciale. Enfin, en Afrique, le poids économique des USA et l'intervention militaire française (et bientôt égyptienne) sont et seront un obstacle important à de nouvelles initiatives russes. En Afrique, les points d'appui du Kremlin sont loin d'être surs où que ce soit. Tandis que les quelques prochaines années verront de nouveaux et sanglants affrontements en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, la réponse de l'impérialisme américain à l'attaque russe a été, jusqu'à présent et de loin, couronnée de succès.
La crise politique
L'effondrement économique vis-à-vis duquel tous les palliatifs utilisés se sont avérés sans efficacité, l'incroyable exacerbation des antagonismes inter impérialistes et la combativité croissante du prolétariat ont provoqué une crise au sein de la bourgeoisie et exacerbé les divergences dans ses rangs. La bourgeoisie est incapable de réaliser une unité et une cohérence en tant que classe : elle est non seulement divisée en une multitude de fractions nationales aux intérêts irréconciliables, mais encore en un grand nombre de différentes fractions en compétition au sein même de chaque Etat national. Dans la phase ascendante du capitalisme, les divisions au sein de chaque bourgeoisie nationale correspondaient aux différents types de capital engagé dans le processus d'accumulation (capital industriel, capital commercial, capital bancaire, propriétaires fonciers, etc.), aux différents types de marchandises produites (industrie lourde, industrie légère, mines, etc.) ou à la taille du capital (grands, moyens et petits capitalistes). Dans le capitalisme décadent, quand le capitalisme d'Etat est devenu une tendance universelle, la bourgeoisie en tant que propriétaire individuel d'un quantum spécifique de capital national global, est soit expropriée par l'Etat, soit, à travers la fusion graduelle du grand capital et de l'Etat, il se fond et s'intègre à la bureaucratie d'Etat. Le résultat est que le bourgeois individuel- en particulier dans les couches supérieures - n'est plus seulement ni même en premier lieu intéressé par les profits d'une compagnie particulière ou par la valorisation de son capital personnel, mais bien plutôt les intérêts de chaque bourgeois sont liés de façon croissante aux intérêts et à la rentabilité du capital national global, et à sa personnification, 1'Etat capitaliste.
Cependant, le fait que la bourgeoisie de chaque Etat national développe une homogénéisation croissante de ses intérêts autour des besoins du capital national global - ce qui s'exprime dans le pouvoir croissant de l'appareil d'Etat capitaliste - n'élimine pas les divergences et les fractions au sein de la classe dominante. Des divisions se produisent dans la bourgeoisie sur les questions de l'interprétation des besoins du capital national, du programme et des orientations qui expriment le mieux ces besoins, du chemin précis pour assurer la stabilité de l'Etat. Aussi, à l'heure actuelle, des divisions ont lieu dans pratiquement toutes les fractions nationales de la bourgeoisie sur :
- le degré d'étatisation (avec les secteurs les plus anachroniques qui essaient vainement de résister à l'avancée du capitalisme d'Etat) ;
- les politiques économiques à poursuivre face à la crise (inflation ou déflation, protectionnisme ou "libre échange") ;
- quel bloc impérialiste offre le meilleur cadre pour la défense du capital national ou le degré d'intégration dans le bloc auquel chaque capital est lié;
- à quelles couches ou classes de la population il faut faire appel afin de constituer un soutien massif aux besoins du capital national, quelles mystifications sont le plus appropriées (nationalisme, religion, populisme, "démocratie", racisme, "socialisme").
Alors que les débats font rage autour de ces questions dans les cercles les plus élevés de la bureaucratie, de l'armée et des grandes entités économiques et financières de chaque Etat national, nous entrons dans les années 80 avec le début du resurgissement mondial de la lutte de classe, et c'est l'encadrement du prolétariat qui préoccupe le plus la bourgeoisie aujourd'hui dans tous les pays. Dans les pays industrialisés du bloc américain, alors que la gauche au pouvoir durant ces dernières années a été le meilleur véhicule des mesures capitalistes d'Etat que l'approfondissement de la crise économique rend nécessaires, et pour une intégration plus grande dans le bloc américain que dicte le renforcement des antagonismes inter impérialistes, la droite au pouvoir est aussi capable de mettre en place de telles politiques. Cependant, seule la gauche a une chance réelle d'encadrer un prolétariat non défait. Et ce fut la tâche essentielle de la gauche quand elle vint au pouvoir, partagea le pouvoir ou se prépara à l'assumer pays après pays, au moment de la poussée la plus forte de la vague de luttes prolétariennes qui a commencé en 1968 et duré jusqu'en 72-74. Au Portugal, en Grande-Bretagne, en Italie par exemple où la violence de la classe ouvrière ébranla la bourgeoisie jusqu'à ses fondements, la gauche au pouvoir (ou apportant son soutien indispensable au gouvernement dans le cas de l'Italie), réussit très bien sa tâche dans ces dernières années en renversant de façon drastique l'équilibre entre les profits et les salaires au bénéfice du capital, en imposant des mesures draconiennes d'austérité au prolétariat, et en brisant la première réponse violente de la classe ouvrière à la crise ouverte.
Cependant, comme l'a clairement démontré la vague de grèves de l'hiver dernier qui, en Grande-Bretagne, a fait éclater le contrat social, la gauche au pouvoir ou encore modérant sa "rhétorique" prolétarienne quand elle est en marche vers le pouvoir, a maintenant aliéné sa base ouvrière et perdu sa faible emprise idéologique sur le prolétariat qui s'était brièvement renforcée entre 1972 et 1978. Une cure d'opposition durant laquelle la gauche pourra "radicaliser" son langage et à nouveau faire appel aux ouvriers combatifs au nom du "socialisme" et de la "révolution prolétarienne" est maintenant vitale si la gauche veut avoir une chance de remplir son rôle indispensable d'encadrement de la lutte de classe.
Il est aujourd'hui impératif pour la bourgeoisie que la reprise de la lutte de classe trouve la gauche non au pouvoir, mais dans l'opposition. Ce sera lors du plus haut point de cette nouvelle vague de luttes qu'une gauche plus "extrémiste" viendra au pouvoir comme dernier rempart du capital.
Le surgissement du prolétariat et les préparatifs de la bourgeoisie pour y faire face avec la gauche dans l'opposition démontrent de façon irréfutable la vérité de la compréhension marxiste selon laquelle la lutte de classes est le moteur de l'histoire.
[1] [141] Cet autre soi-disant Etat ouvrier, la Chine, plie aussi sous le poids de la même crise économique et c'est l'approfondissement de cette crise qui constitue la base matérielle de l'extrême exacerbation des antagonismes qui poussent la Russie et la Chine à la guerre et dont nous parlerons plus loin.
[2] [142] La nécessité de compenser la très faible composition organique du capital par une mobilisation par l'Etat de toutes les réserves de force de travail pour essayer d'égaler la production du bloc américain est la principale raison pour laquelle le bloc russe n'est pas autant frappé parle chômage massif.
[3] [143] Dans pratiquement tous les cas, la manière qu'ont les économistes bourgeois de décrire l'économie mondiale, les catégories qu'ils utilisent, sont en contradiction avec les catégories marxiennes qui seules permettent de saisir les véritables lois du mouvement du mode de production capitaliste et le cours actuel de la crise économique. Comme avec toute idéologie, l'économie bourgeoise déforme et voile les conditions réelles qu'elle se propose d'étudier.
[4] [144] A l'exception des importations de pétrole.
[5] [145] Bien sûr, ceci est vrai aussi pour la production beaucoup plus vaste d'armements par chaque pays qui n'est pas commercialisée.
[6] [146] Bien que le gouvernement américain stimulera presque à coup sûr l'économie pendant la campagne présidentielle de 1980, les effets seront extrêmement courts, et ne changeront que .très peu la perspective économique que nous avons tracée.
[7] [147] C'était le point de vue de la tendance Vercesi de la Gauche Communiste Internationale.
[8] [148] C'était le point de vue de la tendance Vercesi de la Gauche Communiste Internationale.
[9] [149] C'était le point de vue de la tendance Vercesi de la Gauche Communiste Internationale.
[10] [150] Cette tendance à la désintégration n'est que partiellement contrecarrée par la formation de deux blocs impérialistes géants et par la coordination économique imposée par les Etats-Unis et la Russie aux pays industrialisés de leur bloc respectif.
[11] [151] Bien qu'il faille rappeler que les tendances dés intégratrices et centrifuges qui prévalent dans le capitalisme décadent, rendent l'unité mondiale du capital autour d'un seul pôle d'accumulation impossible.
Récent et en cours:
- Crise économique [152]
Questions théoriques:
- Guerre [153]
Le cours historique (1979)
- 2747 reads
La deuxième Conférence Internationale des groupes de la Gauche Communiste (novembre 1978) a mis en évidence la confusion extrême qui règne à l'heure actuelle dans les rangs révolutionnaires sur le problème de la période historique présente et plus précisément :
- sur l'existence d'une alternative historique (révolution prolétarienne ou guerre impérialiste généralisée) ouverte par l'entrée du capitalisme dans une nouvelle phase de crise aiguë (le sommet étant évidemment atteint par les groupes qui ne "voient" pas la crise) ;
- sur la possibilité de se prononcer sur la nature du cours historique (guerre ou révolution) ;
- sur la nature du cours actuel lui-même ;
- sur les implications politiques et organisationnelles de l'analyse que l'on fait du cours.
Plus généralement, les incompréhensions portent :
- sur la possibilité et la nécessité pour les révolutionnaires de faire des prévisions ;
- sur l'existence de périodes différentes dans le cours de la lutte de classe et dans la nature du rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat.
C'est à l'ensemble de ces questions que tente de répondre ce texte.
1) LES RÉVOLUTIONNAIRES PEUVENT-ILS ET DOIVENT-ILS FAIRE DES PRÉVISIONS ?
La nature même de toute activité humaine suppose la prévision, le projet. Par exemple, Marx écrit : "... l'abeille confond par la structure de ses cellules de cire l'habileté de plus d'un architecte. Mais ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche". Chaque acte de l'homme procède d'une telle démarche : de fait, cette capacité à prévoir, à projeter est une composante essentielle de la conscience humaine. Et cela est d'autant plus vrai dans la démarche scientifique. C'est de façon constante que celle-ci utilise la prévision : c'est uniquement en transformant en prévisions les hypothèses formulées à partir d'une première série d'expériences et en confrontant ces prévisions à de nouvelles expériences que le chercheur peut vérifier (ou démentir) le bien-fondé de ces hypothèses et avancer dans la connaissance.
Se basant sur une approche scientifique de la réalité sociale, la pensée révolutionnaire du prolétariat adopte nécessairement une telle démarche à la seule différence que, contrairement aux chercheurs, les révolutionnaires ne peuvent créer en laboratoire les conditions de nouvelles expérimentations. C'est la pratique sociale qui, en confirmant ou en infirmant les perspectives qu'ils ont définies, vient valider ou invalider leur théorie. De fait, ce sont tous les aspects du mouvement historique de la classe ouvrière qui s'appuient sur la prévision : elle permet d'adapter les formes de lutte à chaque époque de la vie du capitalisme mais, surtout, c'est sur elle et notamment sur la perspective d'une faillite du capitalisme que se base le projet communiste. Comme la cellule de l'architecte, le communisme est d'abord conçu -évidemment à grands traits- dans la tête des hommes avant que d'être édifié dans la réalité.
Contrairement donc à ce que pense par exemple Paul Mattick, pour qui l'étude des phénomènes économiques ne peut déboucher sur aucune prévision utilisable pour l'activité des révolutionnaires, la définition de perspectives, la prévision sont une partie intégrante et très importante de cette activité.
La question qui peut se poser alors est la suivante :"quel est le champ d'application de la prévision pour les révolutionnaires ?"
- le long terme ? certainement : le projet communiste ne se base pas sur autre chose ;
- le court terme ? également : c'est le propre de l'activité humaine courante et donc aussi de celle des révolutionnaires ;
- le moyen terme ? parce qu'elle ne peut se cantonner dans des généralités comme dans le long terme et, qu'en même temps, elle dispose de bien moins d'éléments que pour le court terme, c'est sans doute dans ce domaine que la prévision est la plus difficile à faire pour le prolétariat mais en même temps qu'elle ne saurait être négligée car elle conditionne directement son mode de lutte à chaque époque de la vie du capitalisme.
La question peut alors se poser plus précisément : "dans le cadre de prévisions à moyen terme, peut-on et doit-on prévoir l'évolution du rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat ?", ce qui suppose qu'on admette la possibilité d'une telle évolution et qu'on ait donc répondu à la question préliminaire :
2) EXISTE-T-IL DES PÉRIODES DIFFÉRENTES DANS LE COURS DE LA LUTTE DE CLASSE ?
Il peut sembler curieux qu'on soit conduit à se poser des questions aussi élémentaires. Dans le passé, elles ne venaient même pas à l'esprit des révolutionnaires tant leur réponse paraissait évidente. S'il se posait une question, ce n'était pas : "existe-t-il un cours de la lutte de classe ?" ou "est-il possible et nécessaire de l'analyser ?", mais uniquement "quelle est la nature du cours ?". Et c'est là-dessus que portaient les débats entre révolutionnaires. Dès 1852, Marx pouvait décrire le cours particulièrement heurté de la lutte de la classe ouvrière : "les révolutions prolétariennes se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà être accompli pour le recommencer à nouveau..., paraissent n'abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre et de se redresser à nouveau formidable en face d'elles, reculent constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts." (18 Brumaire). Il y a plus d'un siècle, la question paraissait donc claire. Mais force est de constater que la terrible contre-révolution dont nous sortons a introduit une telle confusion dans le milieu révolutionnaire (cf. la lettre du FOR -Fomento Obrero Revolucionario- à RI publiée dans Révolution Internationale n°56 et 57) qu'il est aujourd'hui nécessaire de reposer ce type de questions.
En général, les confusions dans ce domaine s'appuient sur une ignorance de l'histoire du mouvement ouvrier (mais, comme disait Marx "l'ignorance n'est pas une excuse"). L'étude de celle-ci nous permet de constater la vérification de ce qu'avait signalé Marx, c'est-à-dire l'alternance des poussées, souvent très vives et fulgurantes de la lutte prolétarienne (1848-49, 1864-71, 1917-23) et de reculs de celle-ci (à partir de 1850, 1872 et 1923) qui d'ailleurs, à chaque fois, ont conduit à la disparition ou à la dégénérescence des organisations politiques que la classe s'était données dans la période de montée des luttes :
- Ligue des Communistes : création en 1847, dissolution en 1852 ;
- AIT (Association Internationale des Travailleurs) : fondation en 1864, dissolution en 1876 ;
- Internationale Communiste : fondation en 1919, dégénérescence et mort dans le milieu des années 20 ;
- la vie de l'Internationale Socialiste (1889-1914) ayant suivi un cours globalement similaire mais de façon moins nette.
C'est probablement la durée extrêmement longue (un demi-siècle) de la contre-révolution qui suit la vague révolutionnaire culminant en 1917 et durant laquelle la classe ouvrière reste de façon pratiquement uniforme en position de faiblesse, qui permet d'expliquer qu'il y ait aujourd'hui des révolutionnaires incapables de comprendre qu'il puisse exister une telle alternance entre périodes d'avancées et périodes de recul de la lutte de classe. L'étude sans préjugés (mais c'est tellement plus confortable de ne pas étudier et de ne pas se remettre en cause !) de l'histoire du mouvement ouvrier et des analyses marxistes aurait permis à ces révolutionnaires de surmonter le poids de la contre-révolution ; elle leur aurait également permis de savoir que les poussées de la lutte de classe accompagnent les périodes de crise de la société capitaliste (crise économique : 1848 ou guerre : 1871, 1905, 1917) du fait :
- de l'affaiblissement de la classe dominante ;
- de la nécessité pour les prolétaires de résister à la dégradation de leurs conditions de vie ;
- de l'élévation de leur conscience qui résulte de la mise à nu des contradictions du système.
3) PEUT-ON FAIRE DES PRÉVISIONS SUR LE COURS HISTORIQUE DE LA LUTTE DE CLASSE ?
L'histoire nous montre que les révolutionnaires peuvent commettre des erreurs considérables dans ce domaine. Les exemples ne manquent pas :
- Tendance Willich-Schapper de la Ligue des Communistes ne comprenant pas le reflux des luttes après 1849 et poussant l'organisation vers des actions aventuristes ;
- courant bakouniniste de l’AIT s'attendant encore, après l'écrasement de la Commune de 1871, à une révolution imminente et tournant le dos à une préparation à long terme ;
- KAPD ne prenant pas conscience du recul de la révolution au début des années 1920 et se perdant dans le volontarisme et même le putschisme ;
- Trotski déclarant en 1936 que la "révolution avait commencé en France" et fondant en 1938, au creux de la vague, une "4ème Internationale" mort-née.
Cependant, l'histoire a également mis en évidence que les révolutionnaires avaient les moyens d'analyser correctement le cours et de faire des prévisions justes sur le devenir des luttes de classe :
- Marx et Engels saisissant le changement de perspective après 1849 et 1871 ;
- Gauche Italienne comprenant le reflux de la révolution mondiale après 1921 et en tirant des conclusions correctes quant aux tâches du parti et quant à la signification des événements d'Espagne 36.
L'expérience a également montré, qu'en général, ces prévisions justes n'étaient pas le fait du hasard mais étaient basées sur une étude très sérieuse de la réalité sociale englobant à la fois une analyse du capitalisme lui-même, et en premier lieu de la situation économique, mais aussi une évaluation de la dynamique des luttes sociales tant sur le plan de la combativité que de la conscience. C'est ainsi que :
- Marx et Engels concluent au recul de la révolution au début des années 1850 à partir de la constatation de la reprise économique qui fait suite à la crise de 1847-48 ;
- Lénine et les bolcheviks misent sur une montée révolutionnaire au cours du premier conflit mondial en se basant sur le fait que la guerre impérialiste constitue une manifestation de la crise mortelle du capitalisme mettant ce système en situation de faiblesse extrême.
Mais, condition nécessaire pour une reprise ouvrière, la crise du capitalisme n'est pas suffisante, contrairement à ce que pensait Trotski à la suite de la crise de 1929. De même, la combativité ouvrière n'est pas un indice suffisant de la reprise réelle et durable si elle ne s'accompagne pas d'une tendance à la rupture avec les mystifications capitalistes : c'est ce que méconnait la minorité de la Fraction Communiste Italienne qui voit dans la mobilisation et l'armement des ouvriers espagnols en juillet 1936 le début d'une révolution alors que ceux-ci sont en fait désarmés politiquement par "l'antifascisme" et, partant, incapables de s'attaquer réellement au capitalisme. On peut donc constater qu'il est possible aux révolutionnaires de faire des prévisions sur l'évolution du rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat et que, loin d'aborder cette tâche comme une loterie, ils disposent de critères tirés de l'expérience qui, sans être infaillibles, leur permettent de ne pas marcher à l'aveuglette. Mais une autre objection surgit chez certains révolutionnaires : "Même s'il est possible de faire des prévisions sur le cours historique, elles ne présentent aucun intérêt pour la lutte de classe et ne conditionnent en rien l'activité des communistes. Tout cela est de la spéculation intellectuelle sans impact sur la pratique". C'est à ces arguments qu'il s'agit de répondre.
4) EST-IL NÉCESSAIRE DE FAIRE DES PRÉVISIONS SUR LE COURS HISTORIQUE ?
Pour répondre à cette question, on pourrait presque dire que les faits parlent d'eux-mêmes mais la contre-révolution a fait de tels ravages dans certains groupes révolutionnaires que, soit ils ignorent carrément ces faits, soit ils ne sont plus capables de les lire. Il suffit d'évoquer le sort tragique de la Gauche Allemande -complètement désorientée, disloquée et finalement détruite à la suite de son erreur sur le cours de la lutte de classe, et malgré la valeur de toutes ses positions programmatiques- pour se convaincre de la nécessité pour l'organisation des révolutionnaires d'une analyse correcte de la perspective historique. On se souviendra aussi de la triste errance de la minorité de la Fraction Italienne s'enrôlant dans les milices antifascistes, du sort non moins pitoyable de l'Union Communiste pratiquant pendant des années une politique de "soutien critique" aux socialistes de gauche du POUM en espérant qu'il en sortirait une avant-garde communiste capable de prendre la tête de la "révolution espagnole", pour constater l'impact désastreux que peut avoir sur les révolutionnaires une incompréhension du problème du cours.
De fait, l'analyse du cours de la lutte de classe conditionne directement le type d'organisation et d'intervention des révolutionnaires. De même que, pour remonter le courant d'une rivière, on nage sur le bord et que pour le descendre on nage au milieu, de même les rapports que les révolutionnaires établissent avec leur classe sont différents suivant qu'ils se portent à la tête de son mouvement quand il va vers la révolution ou qu'ils luttent à contre-courant d'un mouvement qui entraîne le prolétariat vers l'abîme de la contre-révolution.
Dans le premier cas, leur préoccupation essentielle sera de ne pas se couper de la classe, de suivre attentivement chacun de ses pas et chacune de ses luttes afin d'en faire épanouir le plus possible les potentialités. Sans jamais négliger le travail théorique, le travail de participation directe aux luttes de la classe sera donc privilégié. Sur le plan organisationnel, les révolutionnaires auront une attitude confiante et ouverte à l'égard des autres courants pouvant surgir dans la classe. Tout en restant, comme en toutes circonstances fermes sur les principes, ils miseront sur une évolution positive de ces courants, sur les possibilités de convergence de leurs positions respectives et porteront un maximum d'attention et d'efforts à la tâche du regroupement.
Tout autre sera la démarche des révolutionnaires dans une période de reflux historique des luttes. Il s'agira alors, en premier lieu, de permettre à l'organisation de résister à ce reflux et donc de préserver ses principes de l'influence délétère des mystifications capitalistes tendant à submerger toute la classe, en second lieu, de préparer les futurs resurgissements de celle-ci, en consacrant l'essentiel de ses maigres forces à un travail théorique d'examen et de bilan des expériences passées et notamment des causes de la défaite. Il est clair qu'une telle démarche tend à couper les révolutionnaires du reste de la classe, mais ils doivent assumer une telle conséquence à partir du moment où ils ont constaté que la bourgeoisie est pour l'heure victorieuse et que le prolétariat se laisse entraîner sur son terrain, sinon ils risquent d'être entraînés eux aussi. De même, sur le plan du regroupement des révolutionnaires, et sans jamais tourner le dos à cet effort, il serait vain en de telles périodes de miser sur des perspectives très positives, la tendance étant plutôt à un repliement jaloux de l'organisation autour de ses positions, au maintien de désaccords dont le dépassement se heurte à l'absence d'expérience vivante de la classe. On voit donc que l'analyse du cours a un impact sur le mode d'activité et d'organisation des révolutionnaires et qu'il ne s'agit nullement de "spéculations académiques". De fait, de même qu'une armée a besoin, à tout moment, de connaître la nature précise du rapport de forces avec l'armée ennemi afin de savoir si elle doit attaquer ou se replier en bon ordre, de même, la classe ouvrière a besoin d'apprécier correctement le rapport de forces avec son ennemi : la bourgeoisie. Et il appartient aux révolutionnaires, comme éléments les plus avancés de la classe, de lui fournir le maximum d'éléments pour une telle appréciation. C'est là une de leurs raisons essentielles d'exister. Cette responsabilité, les révolutionnaires l'ont, avec plus ou moins de réussite, toujours assumée dans le passé mais l'analyse du cours historique prend une importance encore bien plus grande avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence dans la mesure où l'enjeu lui-même de la lutte de classe acquiert une dimension plus considérable.
5) L'ALTERNATIVE HISTORIQUE DANS LA PÉRIODE DE DÉCADENCE DU CAPITALISME
À la suite de l'Internationale Communiste, le CCI a toujours affirmé qu'avec la décadence du capitalisme s'était ouverte "l'ère des guerres impérialistes et des révolutions prolétariennes". La guerre n'est pas une spécificité du capitalisme décadent, comme d'ailleurs elle n'est pas une spécificité du capitalisme lui-même. Mais la fonction et la forme de la guerre changent suivant que ce système est progressif ou qu'il est devenu une entrave au développement des forces productives de la société :
"À l'époque du capitalisme ascendant, les guerres (nationales, coloniales et de conquêtes impérialistes) exprimèrent la marche ascendante de fermentation, de renforcement et d'élargissement du système économique capitaliste. La production capitaliste trouvait dans la guerre la continuation de sa politique économique par d'autres moyens. Chaque guerre se justifiait et payait ses frais en ouvrant un nouveau champ d'une plus grande expansion, assurant le développement d'une plus grande production capitaliste.
À l'époque du capitalisme décadent, la guerre au même titre que la paix exprime cette décadence et concourt puissamment à l'accélérer.
Il serait erroné de voir dans la guerre un phénomène propre, négatif par définition, destructeur et entrave au développement de la société, en opposition à la paix qui, elle, sera présentée comme le cours normal positif du développement continu de la production et de la société. Ce serait introduire un concept moral dans un cours objectif, économiquement déterminé.
La guerre fut le moyen indispensable au capitalisme lui ouvrant des possibilités de développement ultérieur, à l'époque où ces possibilités existaient et ne pouvaient être ouvertes que par le moyen de la violence. De même, le croulement du monde capitaliste ayant épuisé historiquement toutes les possibilités de développement, trouve dans la guerre moderne, la guerre impérialiste, l'expression de ce croulement qui, sans ouvrir aucune possibilité de développement ultérieur pour la production, ne fait qu'engouffrer dans l'abîme les forces productives et accumuler à un rythme accéléré ruines sur ruines.
Il n'existe pas une opposition fondamentale en régime capitaliste entre guerre et paix, mais il existe une différence entre les deux phases ascendante et décadente de la société capitaliste et partant une différence de fonction de la guerre (dans le rapport de la guerre et de la paix) dans les deux phases respectives. Si dans la première phase, la guerre a pour fonction d'assurer un élargissement du marché, en vue d'une plus grande production de biens de consommation, dans la seconde phase, la production est essentiellement axée sur la production de moyens de destruction, c'est-à-dire en vue de la guerre. La décadence de la société capitaliste trouve son expression éclatante dans le fait que des guerres en vue du développement économique (période ascendante), l'activité économique se restreint essentiellement en vue de la guerre (période décadente).
Cela ne signifie pas que la guerre soit devenue le but de la production capitaliste, le but restant toujours pour le capitalisme la production de la plus-value mais cela signifie que la guerre, prenant un caractère de permanence, est devenue le mode de vie du capitalisme décadent."
(Rapport à la Conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France)
De cette analyse des rapports entre capitalisme décadent et guerre impérialiste, on peut tirer trois conclusions :
- Livré à sa propre dynamique, le capitalisme ne peut échapper à la guerre impérialiste : tous les bavardages sur la "Paix", toutes les "Sociétés des Nations" et "Organisations des Nations-Unies", toute la bonne volonté de certains de ces "grands hommes" n'y peuvent rien et les périodes de "paix" (c'est-à-dire où la guerre n'est pas généralisée) ne sont que les moments où il reconstitue ses forces pour des affrontements encore plus destructifs et barbares.
- La guerre impérialiste est la manifestation la plus significative de la faillite historique du mode de production capitaliste, elle met en évidence la nécessité et même l'urgence du dépassement de ce mode de production avant qu'il n'entraîne l'humanité dans l'abîme ou la destruction définitive, .c'est le sens de la formule citée de l'Internationale Communiste.
- Contrairement aux guerres de la période ascendante qui ne touchaient que des zones délimitées du globe et ne déterminaient pas toute la vie sociale de chaque pays, la guerre impérialiste implique une extension mondiale et une soumission de toute la société à ses exigences et en premier lieu évidemment de la classe productrice de l'essentiel de la richesse sociale : le prolétariat.
C'est pour cela que, classe qui porte en elle la fin de toutes les guerres et le seul devenir possible de la société, le socialisme, mais aussi classe qui est en première ligne des sacrifices imposés par la guerre impérialiste et qui, exclue de toute propriété, soit la seule à ne pas avoir de patrie, à être réellement internationaliste, le prolétariat tient entre ses mains le sort de toute l'humanité. Et plus directement de sa capacité à réagir sur son terrain de classe à la crise historique du capitalisme, dépend la possibilité ou non de ce système d'y apporter sa propre réponse -la guerre impérialiste- et de l'imposer à la société.
Avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, les implications de la nature du cours historique sont donc presque sans commune mesure avec ce qu'elles pouvaient être au siècle dernier. Au 20ème siècle, la victoire capitaliste signifie la barbarie sans nom de la guerre impérialiste et la menace d'une disparition de l'espèce humaine ; la victoire prolétarienne, par contre signifie la possibilité d'une régénération de la société, la "fin de la préhistoire humaine et le début de son histoire véritable", la "sortie du règne de la nécessité et l'entrée dans celui de la liberté". Tel est l'enjeu que les révolutionnaires doivent avoir en vue quand ils examinent la question du cours. Mais tel n'est pas le cas chez tous les révolutionnaires notamment chez ceux qui se refusent à parler d'alternative historique (ou, s'ils en parlent, qui ne savent pas de quoi il s'agit), pour qui la guerre impérialiste et le surgissement prolétarien sont simultanés ou même complémentaires.
6) L'OPPOSITION ET L'EXCLUSION DES DEUX TERMES DE L'ALTERNATIVE HISTORIQUE
À la veille de la seconde guerre mondiale, s'est développée, dans la Gauche Italienne, la thèse que la guerre impérialiste ne serait plus le produit de la division du capitalisme entre États et puissances antagoniques luttant chacune pour l'hégémonie mondiale. Au contraire, ce système ne recourrait à cette extrémité que dans le but de massacrer le prolétariat et d'entraver la montée de la révolution. C'est à cette argumentation que répondait la Gauche Communiste de France en écrivant :
"L'ère des guerres et des révolutions ne signifie pas qu'au développement du cours de la révolution répond un développement du cours de la guerre. Ces deux cours ayant leur source dans une même situation historique de crise permanente du régime capitaliste, sont toutefois d'essence différente n'ayant pas des rapports de réciprocité directe. Si le déroulement de la guerre devient un facteur direct précipitant les convulsions révolutionnaires, il n'en est pas de même en ce qui concerne le cours de la révolution qui n'est jamais un facteur de la guerre impérialiste. La guerre impérialiste ne se développe pas en réponse au flux de la révolution, mais c'est exactement le contraire qui est vrai, c'est le reflux de la révolution qui suit la défaite de la lutte révolutionnaire, c'est l'évincement momentané de la menace de la révolution qui permettent à la société capitaliste d'évoluer vers le déclenchement de la guerre engendrée par les contradictions et les déchirements internes du système capitaliste".
D'autres théories ont également surgi plus récemment suivant lesquelles "avec l'aggravation de la crise du capitalisme, ce sont les deux termes de la contradiction qui se renforcent en même temps : guerre et révolution ne s'excluraient pas mutuellement mais avanceraient de façon simultanée et parallèle sans qu'on puisse savoir laquelle arriverait à son terme avant l'autre". L'erreur majeure d'une telle conception est qu'elle néglige totalement le facteur lutte de classe dans la vie de la société. La conception développée par la Gauche Italienne pêchait par une surestimation de l'impact de ce facteur. Partant de la phrase du "Manifeste Communiste" suivant : laquelle "l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte de classes", elle en faisait une application mécanique à l'analyse du problème de la guerre impérialiste en considérant celle-ci comme une réponse à la lutte de classe, sans voir au contraire qu'elle ne pouvait avoir lieu qu'en l'absence de celle-ci ou grâce à sa faiblesse. Mais pour fausse qu'elle fût, cette conception se basait sur un schéma correct, l'erreur provenant d'une délimitation incorrecte de son champ d'application. Par contre, la thèse du "parallélisme et de la simultanéité du cours vers la guerre et du cours à révolution" fait carrément fi de ce schéma de base du marxisme car elle suppose que les deux principales classes antagonistes de la société puissent préparer leurs réponses respectives à la crise du système -la guerre impérialiste pour l'une et la révolution pour l'autre- de façon complètement indépendante l'une de 'autre, du rapport entre leurs forces respectives, de leurs affrontements. S'il ne peut même pas s'appliquer à ce qui détermine toute l'alternative historique de la vie de la société, le schéma du "Manifeste Communiste" n'a plus de raison d'exister et on peut ranger tout le marxisme dans un musée au rayon des inventions farfelues de l'imagination humaine. En réalité, l'histoire se charge de démontrer l'erreur d'une telle conception du "parallélisme". En effet, contrairement au prolétariat qui ne connait pas d'intérêts contradictoires, la bourgeoisie est une classe profondément divisée de par l'antagonisme existant entre les intérêts économiques de ses différents secteurs : dans une économie où règne sans partage la marchandise, la concurrence entre fractions de la classe dominante est en général insurmontable ; là réside la cause profonde des crises politiques qui s'abattent sur cette classe, de même que des tensions entre pays et entre blocs qui toutes s'exacerbent au fur et à mesure qu'avec la crise, s'aggrave la concurrence. Le niveau le plus élevé où le capital peut se donner une certaine unité est le niveau national, c'est d'ailleurs un des attributs essentiel de l'État capitaliste que d'imposer cette discipline entre secteurs du capital national. à la limite on peut considérer l'existence d'une certaine "solidarité" entre nations d'un même bloc impérialiste : c'est la traduction du fait que, seul contre tous les autres, un capital national ne peut rien et qu'il est obligé d'abandonner une part de son indépendance pour pouvoir mieux défendre ses intérêts globaux, mais cela n'élimine pas :
- les rivalités entre pays d'un même bloc ;
- le fait que jamais le capitalisme ne peut s'unifier à l'échelle mondiale (contrairement à ce que prétendait par exemple la thèse de Kautsky du "super-impérialisme") les blocs se maintiennent toujours et leurs antagonismes ne peuvent aller qu'en s'aggravant.
Le seul moment où la bourgeoisie peut se redonner une unité à l'échelle mondiale, où elle peut faire taire ses rivalités impérialistes, c'est lorsqu'elle est menacée dans sa survie même par son ennemi mortel : le prolétariat. Mais alors, et l'histoire l’a amplement démontré, elle est capable de faire preuve de cette solidarité qui lui fait défaut dans les autres circonstances. C'est ce qu'illustre :
- dès 1871, la collaboration entre la Prusse et le gouvernement de Versailles face à la Commune (libération des soldats français qui allaient être utilisés lors de la "semaine sanglante") ;
- en 1918. la "solidarité" de l'Entente à l'égard de la bourgeoisie allemande menacée par la révolution prolétarienne (libération des soldats allemands utilisés ensuite dans le massacre des Spartakistes).
C'est donc de façon non pas parallèle et indépendante mais bien antagonique et se déterminant mutuellement que se développent le cours historique vers la guerre et celui vers la révolution.
De plus, ce n'est pas seulement sur le plan du devenir de la société que guerre impérialiste et révolution s'excluent mutuellement comme réponses de deux classes historiquement antagonistes, c'est également de façon quotidienne dans leurs préparatifs respectifs que se manifeste leur opposition.
La préparation de la guerre impérialiste suppose pour le capitalisme le développement d'une économie de guerre dont le prolétariat, évidemment, supporte le plus lourd du fardeau. Ainsi, c'est déjà en luttant contre l'austérité qu'il entrave ces préparatifs et qu'il fait la démonstration qu'il n'est pas prêt à supporter les sacrifices encore plus terribles que lui demanderait la bourgeoisie lors d'une guerre impérialiste. Pratiquement, la lutte de classe, même pour des objectifs limités, représente, pour le prolétariat, une rupture de la solidarité avec "son" capital national, solidarité qu'on lui demande justement de manifester dans la guerre. Elle exprime également une tendance à la rupture avec les idéaux bourgeois comme la "démocratie", la "légalité", la "patrie", le faux "socialisme", pour la défense desquels on appellera les ouvriers à se faire massacrer et à massacrer leurs frères de classe. Elle permet enfin que se développe son unité, condition indispensable de sa capacité à s'opposer, à l'échelle internationale, aux règlements de comptes entre brigands impérialistes.
L'entrée du capitalisme, au milieu des années 60, dans une phase de crise économique aiguë signifie l'imminence de la perspective définie par l'IC : "guerre impérialiste et révolution prolétarienne", comme réponses spécifiques de chacune des deux principales classes de la société à une telle crise. Mais cela ne signifie pas que les deux termes de cette perspective vont se développer de façon simultanée. C'est sous forme d'alternative, c'est-à-dire d'exclusion réciproque que ces deux termes se présentent :
- ou bien le capitalisme impose sa réponse et cela signifie qu'il a au préalable vaincu la résistance de la classe ouvrière ;
- ou bien le prolétariat apporte sa solution et, cela va sans dire, qu’il a réussi à paralyser la main meurtrière de l'impérialisme.
La nature du cours présent, vers la guerre impérialiste ou vers la guerre de classe, est donc la traduction de l'évolution du rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat. Comme l'ont déjà fait avant nous la plupart des révolutionnaires, et notamment Marx, ce sont ces rapports de forces qu'il s'agit d'étudier. Mais cela suppose qu'on dispose de critères pour une telle évaluation qui ne sont pas nécessairement identiques à ceux utilisés par le passé. La définition de tels critères suppose donc à la fois la connaissance de ceux du passé, la distinction parmi ceux-ci entre ceux qui sont encore valables et ceux qui sont devenus caducs compte-tenu de l’évolution de la situation historique, ainsi que la prise en compte des nouveaux critères éventuels imposés par cette évolution. En particulier, il ne saurait être question d'appliquer mécaniquement les schémas du passé bien qu'il soit nécessaire de partir de l'étude de celui-ci et notamment des conditions qui ont permis l'éclatement de la guerre impérialiste en 1914 et en 1939.
7) LES CONDITIONS DE LA GUERRE IMPÉRIALISTE EN 1914 ET EN 1939
"C’est l’arrêt de la lutte de classe, ou plus exactement la destruction de la puissance de classe du prolétariat, la destruction de sa conscience, la déviation de ses luttes, que la bourgeoisie parvient à opérer par l'entremise de ses agents dons le prolétariat, en vidant ses luttes de leur contenu révolutionnaire et les engageant sur les rails du réformisme et du nationalisme, qui est la condition ultime et décisive de l’éclatement de la guerre impérialiste.
Ceci doit être compris non d'un point de vue étroit et limité d'un secteur national isolé, mais internationalement.
Ainsi, la reprise partielle, la recrudescence de luttes et de mouvements de grèves constatés en 1913 en Russie ne diminue en rien notre affirmation. à regarder les choses de plus près, nous verrons que la puissance du prolétariat international à la veille de 1914,les victoires électorales, les grands partis sociaux-démocrates et les organisations syndicales de masse, gloire et fierté de la IIème Internationale, n'étaient qu'une apparence, une façade cachant sous son vernis le profond délabrement idéologique. Le mouvement ouvrier miné et pourri par l'opportunisme régnant en maître devait s'écrouler comme un château de cartes devant le premier souffle de guerre.
La réalité ne se traduit pas dans la photographie chronologique des événements. Pour la comprendre, il faut saisir le mouvement sous-jacent, interne, les modifications profondes qui se sont produites avant qu'elles n'apparaissent à la surface et soient enregistrées par des dates. On commettrait une grave erreur en voulant rester fidèle à l'ordre chronologique de l'histoire et présenter la guerre de 1914 comme la cause de l'effondrement de la IIème Internationale, quand, en réalité, l'éclatement de la guerre fut directement conditionné par la dégénérescence opportuniste préalable du mouvement ouvrier international. Les fanfaronnades de la phrase internationaliste se faisaient sentir d'autant plus extérieurement qu'intérieurement triomphait et dominait la tendance nationaliste. La guerre de 1914 n'a fait que mettre en évidence, au grand jour, l'embourgeoisement des partis de la IIème Internationale, la substitution à leur programme révolutionnaire initial, par l'idéologie de l'ennemi de classe, leur rattachement aux intérêts de la bourgeoisie nationale.
Ce processus interne de la destruction de la conscience de classe a manifesté son achèvement ouvertement dans l'éclatement de la guerre de 1914 qu'il a conditionné.
L'éclatement de la seconde guerre mondiale était soumis aux mêmes conditions.
On peut distinguer trois étapes nécessaires et se succédant entre les deux guerres impérialistes.
La première s'achève avec l'épuisement de la grande vague révolutionnaire de l'après-1917 et consiste dans une suite de défaites de la révolution dans plusieurs pays, dans la défaite de la Gauche exclue de l'IC où triomphe le centrisme et l'engagement de l'URSS dans une évolution vers le capitalisme au travers de la théorie et de la pratique du "socialisme dans un seul pays".
La deuxième étape est celle de l'offensive générale du capitalisme international parvenant à liquider les convulsions sociales dans le centre décisif où se joue l'alternative historique du capitalisme/socialisme : l'Allemagne, par l'écrasement physique du prolétariat et l'instauration du régime hitlérien jouant le rôle de gendarme en Europe. à cette étape correspond la mort définitive de l'IC et la faillite de l'opposition de Gauche de Trotski qui, incapable de regrouper les énergies révolutionnaires, s'engage par la coalition et la fusion avec des groupements et des courants opportunistes de la gauche socialiste, s'oriente vers des pratiques de bluff et d'aventurisme en proclamant la formation de la IVème Internationale.
La troisième étape fut celle du dévoiement total du mouvement ouvrier des pays "démocratiques". Sous le masque de défense des "libertés" et des "conquêtes" ouvrières menacées par le fascisme, on a en réalité cherché à faire adhérer le prolétariat à la défense de la démocratie, c'est-à-dire de la bourgeoisie nationale, de sa patrie capitaliste. L 'antifascisme était la plate-forme, l'idéologie moderne du capitalisme que les partis traîtres au prolétariat employaient pour envelopper la marchandise putréfiée de la défense nationale.
Dans cette troisième étape s'opère le passage définitif des partis dits communistes au service de leur capitalisme respectif, la destruction de la conscience de classe par l'empoisonnement des masses, par l'idéologie antifasciste, l'adhésion des masses à la future guerre impérialiste au travers de leur mobilisation dans les "fronts populaires", les grèves dénaturées et déviées de 1936.
La guerre antifasciste espagnole, la victoire définitive du capitalisme d'État en Russie se manifestant entre autres par la répression féroce et le massacre physique de toute velléité de réaction révolutionnaire, son adhésion à la SDN ; son intégration dans un bloc impérialiste et l'instauration de l'économie de guerre en vue de la guerre impérialiste se précipitant. Cette période enregistre également la liquidation de nombreux groupes révolutionnaires et des communistes de Gauche surgis par la crise de l'IC et qui, au travers de l'adhésion à l'idéologie antifasciste, à la "défense de l'État ouvrier" en Russie, sont happés dans l'engrenage du capitalisme et définitivement perdus en tant qu'expression de la vie de la classe. Jamais l'histoire n'a encore enregistré pareil divorce entre la classe et les groupes qui expriment ses intérêts et sa mission. L'avant-garde se trouve dans un état d'absolu isolement et réduite quantitativement à de petits ilots négligeables.
L'immense vague de la révolution jaillie à la fin de la première guerre impérialiste a jeté le capitalisme international dans une telle crainte qu'il a fallu cette longue période de désarticulation des bases du prolétariat pour que la condition soit requise pour le déchaînement de la nouvelle guerre impérialiste mondiale." (Idem)
À ces lignes lumineuses, on peut encore ajouter les éléments suivants :
- l'évolution opportuniste et la trahison des partis de la deuxième Internationale ont été permises par les caractéristiques du capitalisme à son apogée, qui, par ses progrès économiques, par son absence apparente de convulsions profondes, par les réformes qu'il était en mesure d'accorder à la classe ouvrière, avait favorisé l'idée d'une transformation progressive, pacifique et légale vers le socialisme de la société bourgeoise ;
- un des éléments essentiels du désarroi prolétarien entre les deux guerres était l'existence et la politique de l'URSS qui, soit avait dégoûté les ouvriers de toute perspective de socialisme, soit les avait ramenés dans le giron de la social-démocratie, soit, pour ceux qui continuaient d'y voir "la patrie du socialisme", avait soumis leurs luttes aux impératifs de la défense de ses intérêts impérialistes.
8) LES CRITÈRES D'ÉVALUATION DU COURS HISTORIQUE
De l'analyse des conditions qui ont permis le déclenchement des deux guerres impérialistes, on peut tirer les enseignements communs suivants :
- le rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat ne peut se juger que de façon mondiale et ne saurait tenir compte d'exceptions pouvant concerner des zones secondaires : c'est essentiellement de la situation d'un certain nombre de grands pays qu'on peut déduire la nature véritable de ce rapport de forces ;
- pour que la guerre impérialiste puisse éclater, le capitalisme a besoin d'imposer préalablement une défaite profonde au prolétariat, défaite avant tout idéologique mais également physique si le prolétariat a manifesté auparavant une forte combativité (cas de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Espagne entre les deux guerres) ;
- cette défaite ne se suffit pas d'une passivité de la classe mais suppose l'adhésion enthousiaste de celle-ci à des idéaux bourgeois ("démocratie", "antifascisme", "socialisme en un seul pays") ;
- l'adhésion à ces idéaux suppose :
a) qu'ils aient un semblant de réalité (possibilité d'un développement infini et sans heurt du capitalisme et de la "démocratie", origine ouvrière du régime qui s'est établi en URSS) ;
b) qu'ils soient associés d'une façon ou d'une autre à la défense d'intérêts prolétariens ;
c) qu'une telle association soit défendue parmi les travailleurs par des organismes qui aient leur confiance pour avoir été dans le passé des défenseurs de leurs intérêts, en d'autres termes que les idéaux bourgeois aient comme avocat des organisations anciennement prolétariennes ayant trahi.
Telles sont, à grands traits, les conditions qui ont permis par le passé le déclenchement des guerres impérialistes. Il n'est pas dit a priori qu'une éventuelle guerre impérialiste à venir ait besoin de conditions identiques, mais dans la mesure où la bourgeoisie a pris conscience du danger que pouvait représenter pour elle un déclenchement prématuré des hostilités (malgré tous ces préparatifs préalables, même la seconde guerre mondiale provoque une riposte des ouvriers en 1943 en Italie et en 1944/45 en Allemagne), on ne s'avance pas trop en considérant qu'elle ne se lancera dans un affrontement généralisé que si elle a conscience de contrôler aussi bien la situation qu'en 1939 ou au moins qu'en 1914. En d'autres termes, pour que la guerre impérialiste soit de nouveau possible, il faut qu'il existe au moins les conditions énumérées plus haut et si tel n'est pas le cas, qu'il en existe d'autres en mesure de compenser celles faisant défaut.
9) LA COMPARAISON DE LA SITUATION PRÉSENTE AVEC CELLES DE 1914 ET DE 1939
Dans le passé, le terrain principal sur lequel s'est décidé le cours historique était l'Europe, notamment ses trois pays les plus puissants, l'Allemagne, l'Angleterre et la France et accessoirement des pays secondaires comme l'Espagne ou l'Italie. Aujourd'hui, cette situation reste partiellement semblable dans la mesure où c'est ce continent qui est encore l'enjeu essentiel de l'affrontement entre les deux blocs impérialistes. Toute évaluation du cours passe donc par l'examen de la situation de la lutte de classe dans ces pays mais en même temps, ne saurait être complète si elle ne prenait pas en considération la situation en URSS aux USA et en Chine.
Si on examine l'ensemble de ces pays, on peut constater que nulle part, depuis plusieurs décennies, le prolétariat n'a subi de défaite physique ; la dernière en date des défaites de cet ordre a touché un pays aussi marginal que le Chili. De même, on ne peut relever dans aucun de ces pays de défaite idéologique comparable à celle de 1914, c'est-à-dire permettant une adhésion enthousiaste des prolétaires au capital national :
- les anciennes mystifications comme "l’antifascisme" ou le "socialisme en un seul pays" ont fait long feu ne serait-ce que face à l'absence d'un "fascisme épouvantail" et à la mise à nu de la réa1ité de ce "socialisme" ;
- la croyance en un progrès permanent et pacifique du capitalisme a été sérieusement ébranlé par plus d'un demi-siècle de convulsions et de barbarie, et les illusions qui se sont développées avec la reconstruction du second après-guerre sont aujourd'hui malmenées par le développement de la crise ;
- le chauvinisme, même s'il se maintient d'une façon non négligeable parmi un certain nombre d'ouvriers, n'a pas le même impact que par le passé ;
- ses bases sont battues en brèche par le développement du capitalisme qui, chaque jour, abolit un peu plus les spécificités et les différences nationales ;
- à l'exception des deux grandes puissances, l'URSS et les USA, il se heurte aux nécessités de mobilisation non derrière un pays mais derrière un bloc ;
- dans la mesure où c'est au nom de l'intérêt national qu'on demande de plus en plus de sacrifices aux ouvriers face à la crise, cet "intérêt national" va apparaître de plus en plus comme l'ennemi direct de leurs intérêts de class ; de fait, à l'heure actuelle, le chauvinisme, sous couvert d'indépendance nationale, ne trouve de véritable refuge que dans les pays les plus arriérés ;
- la défense de la "démocratie" et de la "civilisation" qui a pris aujourd'hui la forme des campagnes cartériennes sur les "droits de l'homme" et qui a l'avantage d'assurer une unité idéologique pour l'ensemble du bloc occidental, ne rencontre de succès important que parmi les habituels signataires de pétitions du milieu intellectuel et "nouveaux philosophes" mais très peu parmi les nouvelles générations de prolétaires qui ne voient pas tellement quel rapport il peut exister entre leurs intérêts et ces "droits de l'homme" que leurs promoteurs eux-mêmes bafouent cyniquement ;
- les anciens partis ouvriers sociaux-démocrates et "communistes" ont depuis trop longtemps déjà trahi leur classe pour qu'ils puissent avoir un impact comparable à celui du passé : les premiers sont depuis plus de 60 ans de loyaux gérants du capitalisme, leur fonction anti-prolétarienne est avérée et reconnue par beaucoup d'ouvriers. Enfin, ce sont eux qui ont eu ces dernières années la tâche, dans la plupart des pays d'Europe occidentale, de diriger des gouvernements synonymes d'austérité et de mesures anti-ouvrières et, si elle permet de redorer un peu leur blason, leur cure d'opposition actuelle ne saurait leur redonner une adhésion enthousiaste de la part des prolétaires. Quant aux partis staliniens, c'est peu dire que les prolétaires ne leur témoignent aucune confiance là où ils gouvernent : ils les haïssent, et dans les pays dont l'appartenance au camp occidental les confine dans l'opposition et où ils peuvent avoir un certain impact sur la classe, cet impact n'est pas directement utilisable pour une mobilisation derrière le bloc américain présenté comme "principal ennemi des peuples" par eux. Globalement, pour être vraiment efficace, la trahison d'un parti ouvrier doit l'être de fraîche date et ne servir, telles les allumettes, qu'une seule fois pour une mobilisation massive derrière la guerre impérialiste : c'est le cas de la social-démocratie dont la trahison ouverte date de 1914 et, dans une moindre mesure, des partis "communistes", qui trahissent au cours des années 20 avant de jouer leur rôle de rabatteurs pour la guerre dans les années 30, le poids du décalage entre les deux dates étant partiellement compensé par le fait que c'est justement, ce qu'ils clament bien fort, contre la trahison social-démocrate qu'ils s'étaient formés. à l'heure actuelle, la bourgeoisie ne dispose donc plus de cet atout considérable qui dans le passé avait fait la décision : les gauchistes, et notamment les trotskystes, ont bien posé leur candidature à la succession des sociaux-démocrates et des staliniens pour ce sale travail, mais d'emblée, ils possèdent deux handicaps de taille : d'une part, leur impact est loin de valoir celui de leurs aînés, et d'autre part, avant que cet impact ait pu se développer de façon notable, ils révèlent ouvertement leur nature bourgeoise en se spécialisant dans un rôle de rabatteurs pour les partis de gauche.
Comme on peut donc le voir, aucune des conditions qui avaient permis l'embrigadement dans les conflits impérialistes du passé n'existe aujourd'hui, et on ne voit pas quelle nouvelle mystification pourrait dans l'immédiat prendre la relève de celles qui ont failli. C'est une telle analyse qui était déjà à la base de la prise de position des camarades d'Internacionalismo quand ils saluaient début 68 l'année qui venait comme étant riche de promesses de luttes de classe face à la crise qui se développait. C'est cette même analyse qui permettait à Révolution Internationale d'écrire en 68, avant donc l'automne chaud italien de 69, l'insurrection polonaise de 70 et toute la vague de luttes qui va jusqu'en 1974 :
"Le capitalisme dispose de moins en moins de thèmes de mystifications capables de mobiliser les masses et de les jeter dans le massacre... Dans ces conditions, la crise apparaît dès ses premières manifestations pour ce qu'elle est : dès ses premiers symptômes, elle verra surgir dans tous les pays des réactions de plus en plus violentes des masses... Mai 68 apparait dans toute sa signification pour avoir été une des premières et une des plus importantes réaction de la masse des travailleurs contre une situation économique mondiale allant en se détériorant." (Révolution Internationale n°2, ancienne série)
C'est cette analyse, se basant sur les positions classiques du marxisme (caractère inéluctable de la crise et provocation par celle-ci d'affrontements de classe), ainsi que sur l'expérience de plus d'un demi-siècle, qui a donc permis à notre courant, alors que beaucoup d'autres groupes ne parlaient que de contre-révolution et ne voyaient rien venir, de prévoir la reprise historique de la classe à partir de 1968, de même que la remontée présente, suite à un recul temporaire entre 1974 et 1978.
Mais il est des révolutionnaires qui, plus de 10 ans après 1968 n'ont pas encore compris sa signification et pronostiquent le cours vers une troisième guerre impérialiste. Voyons leurs arguments :
10) DÉFENSE DE L'IDÉE DU COURS VERS UNE TROISIÈME GUERRE MONDIALE
a) L'existence présente de conflits inter-impérialistes localisés :
Certains révolutionnaires ont parfaitement compris que derrière les prétendues luttes de libération nationale se dissimulent (de plus en plus mal, il est vrai, au point que même un courant aussi myope que le bordiguisme est quelquefois obligé de le reconnaître) des conflits inter-impérialistes. De la persistance pendant des décennies de tels conflits, ils n'ont pas, à raison, conclu à une "montée de la révolution" suivant l'expression trotskiste. Nous les suivons sur ce point. Mais ils vont plus loin et concluent que la simple existence de tels conflits et leur intensification récente signifie que la classe est battue mondialement et ne pourra pas s'opposer à une nouvelle guerre impérialiste. La question qu'ils ne se posent pas, démontrant ainsi le caractère erroné de leur démarche, est : "pourquoi la multiplication et l'aggravation des conflits locaux n'ont-elles pas déjà dégénéré en un conflit généralisé ?" à cette question, certains, comme la CWO (Communist Worker's Organisation) (cf. la Conférence de novembre 78) répondent : "parce que la crise n'est pas encore assez profonde", ou bien "les préparatifs militaires et stratégiques ne sont pas encore achevés". L'histoire apporte elle-même un démenti à ces interprétations :
- en 1914, la crise et les armements étaient bien moindres quand le conflit de Serbie a dégénéré en guerre mondiale.
- en 1939, après le New Deal et la politique économique nazie, qui avait partiellement rétabli la situation de 1929, la crise ne se faisait pas sentir plus violemment qu'aujourd'hui ; de même, à cette date, les blocs n'étaient pas complètement constitués puisque l'URSS se trouvait alors pratiquement au côté de l'Allemagne et que les USA étaient encore "neutres".
De fait, les conditions sont plus que mûres pour une nouvelle guerre impérialiste, la seule donnée militaire manquante est l'adhésion du prolétariat... mais ce n'est pas la moindre.
b) Les nouvelles données technologiques de l'armement :
Pour certains, emboîtant le pas à ceux qui avaient dans le passé déclaré la guerre impossible à cause des gaz asphyxiants ou de l'aviation, l'existence de l'arsenal atomique interdit désormais le recours à une nouvelle guerre généralisée qui signifierait la menace d'une destruction totale de la société. Nous avons déjà dénoncé les illusions pacifistes contenues dans une telle conception. Par contre, d'autres estiment que le développement de la technologie interdit toute possibilité pour le prolétariat d'intervenir dans une guerre moderne du fait que celle-ci utilise surtout des armes très sophistiquées maniées par des spécialistes et très peu de masses de soldats. La bourgeoisie aurait ainsi les mains libres pour mener sa guerre atomique sans craindre aucune menace de mutinerie comme ce fut le cas en 1917-18. Ce qu'ignore une telle analyse, c'est que :
- l'armement atomique ne constitue pas, et de loin, le seul dont dispose la bourgeoisie, les dépenses d'armements classiques sont encore bien plus élevées que celles d'armes nucléaires ;
- si cette classe fait la guerre, ce n'est pas à priori, pour faire un maximum de destructions, mais pour s'emparer de marchés, de territoires et de richesses de l'ennemi ; en ce sens, même si c'est là le recours extrême, elle n'a pas intérêt à utiliser d'emblée l'arme atomique, et le problème de la mobilisation d'hommes pour l'occupation des territoires conquis continue à se poser : ainsi se maintient, comme par le passé, la nécessité de l’embrigadement de dizaines de millions de prolétaires comme condition de la guerre impérialiste.
c) La guerre-accident :
Il y a dans le processus de généralisation d'un conflit impérialiste un aspect d'engrenage involontaire échappant à tout contrôle de quelque gouvernement que ce soit. Un tel phénomène fait dire à certains que, quel que soit le niveau de la lutte de classes, le capitalisme peut plonger l'humanité dans la guerre généralisée "par accident", suite à une telle perte de contrôle de la situation. Il n'y a évidemment pas de garantie absolue que le capitalisme ne nous servira jamais un tel menu, mais l'histoire a démontré que ce système se laisse d'autant moins aller à ce type de "penchants naturels" qu'il se sent menacé par le prolétariat.
d) L'insuffisance de la réaction prolétarienne :
Certains groupes, tel "Battaglia Communiste", estiment que la riposte prolétarienne à la crise est insuffisante pour constituer un obstacle au cours vers la guerre impérialiste ; ils estiment que les luttes devraient être de "nature révolutionnaire" pour qu'elles puissent contrecarrer réellement ce cours et basent leur argumentation sur le fait qu'en 1917-18, c'est la révolution seule qui a mis fin à la guerre impérialiste. En fait, ils commettent une erreur en essayant de transposer un schéma en soi juste sur une situation qui n'y rentre pas. Effectivement, un surgissement du prolétariat dans et contre la guerre prend d'emblée la forme d'une révolution :
- parce que la société est alors plongée dans la forme la plus extrême de sa crise, celle qui impose aux prolétaires les sacrifices les plus terribles ;
- parce que les prolétaires en uniforme sont déjà armés ;
- parce que les mesures d'exception (loi martiale, etc.) qui sévissent alors rendent tout affrontement de classe plus violent et frontal ;
- parce que la lutte contre la guerre prend immédiatement une forme politique d'affrontement avec l'État qui mène la guerre sans passer par l'étape de luttes économiques qui, elles, sont beaucoup moins frontales.
Mais tout autre est la situation quand la guerre ne s'est pas encore déclarée.
Dans ces circonstances, toute tendance, même limitée à la montée des luttes sur un terrain de classe suffit à enrayer l'engrenage dans la mesure où :
- elle traduit un manque d'adhésion des ouvriers aux mystifications capitalistes ;
- l'imposition aux travailleurs de sacrifices bien plus grands que ceux qui ont provoqué les premières réactions risque de déclencher de leur part une réplique en proportion.
Ainsi, alors que les menaces de guerre impérialiste généralisée ne cessent de se profiler au début du 20ème siècle, que les occasions de son déclenchement ne manquent pas (guerre russo-japonaise, heurts franco-allemands à propos du Maroc, conflit dans les Balkans, invasion de la Tripolitaine par l'Italie), le fait que jusqu'en 1912 la classe ouvrière (manifestations de masse) et l'Internationale (motions spéciales aux Congrès de 1907 et 1910, Congrès Extraordinaire en 1912 sur la question de la guerre) se mobilisent lors de chaque conflit local n'est pas étranger à la non-généralisation de ces conflits. Et ce n'est qu'au moment où la classe ouvrière, endormie par les discours des opportunistes, cesse de se mobiliser face à la menace de guerre (entre 1912 et 1914) que le capitalisme peut déchaîner la guerre impérialiste à partir d'un incident (l'attentat de Sarajevo) en apparence bénin par rapport aux précédents.
À l'heure actuelle, point n'est besoin que la révolution frappe déjà à la porte pour que soit barré le cours vers la guerre impérialiste.
e) La guerre, condition nécessaire à la révolution :
Le constat que, jusqu'à présent, les grandes vagues révolutionnaires du prolétariat (la Commune de 1871, Révolutions de 1905 et 1917-18) ont surgi à la suite de guerres, a conduit certains courants, dont la Gauche Communiste de France, à considérer que c'était uniquement d'une nouvelle guerre que pouvait surgir une nouvelle révolution. Si cette approche, bien que fausse, était défendable en 1950, son maintien aujourd'hui relève d'un attachement fétichiste et non critique au schéma du passé. Le rôle des révolutionnaires n'est pas de réciter des catéchismes bien appris dans les livres d'histoire en considérant que celle-ci se répète de façon immuable. En général, l'histoire ne se répète pas et s'il est nécessaire de bien la connaître pour comprendre le présent, l'étude de ce présent, avec toutes ses spécificités, est encore plus nécessaire. Un tel schéma de la révolution surgissant uniquement de la guerre impérialiste est aujourd'hui doublement erroné :
- il méconnait la possibilité d'un surgissement révolutionnaire à la suite d'une crise économique (conformément au schéma envisagé par Marx, si cela peut rassurer les fétichistes) ;
- il mise sur une perspective qui n'a rien d'inéluctable (comme l'a démontré l'issue de la guerre impérialiste de 1939-45} et qui suppose une étape -une troisième guerre généralisée- qui risque fort, compte-tenu des moyens actuels de destruction, de priver définitivement l'humanité de toute possibilité de réaliser le socialisme ou même de son existence.
Enfin, une telle analyse risque d'avoir des implications désastreuses pour la lutte comme nous allons le voir.
11) LES IMPLICATIONS D'UNE ANALYSE ERRONÉE DU COURS
Les erreurs sur l'analyse du cours ont toujours eu, comme on l'a vu, des conséquences graves. Mais le niveau de cette gravité est différent suivant que le cours est vers la remontée de la lutte de classe ou vers la guerre impérialiste. Se tromper lorsque la classe recule peut-être catastrophique pour les révolutionnaires eux-mêmes (exemple du KAPD) mais a peu d'impact sur la classe elle-même auprès de laquelle, de toute façon, ils ont peu d'audience. Par contre, une erreur lors d'une reprise de la lutte de classe, au moment où l'influence des révolutionnaires augmente en son sein, peut avoir des conséquences tragiques pour l'ensemble de la classe. Au lieu de la pousser à la lutte, d'encourager ses initiatives, de permettre le développement de ses potentialités, un langage de "docteurs tant-pis" agira à ce moment-là comme un facteur de démoralisation et deviendra un obstacle à la poursuite du mouvement.
C'est pour cela qu'en l'absence de critères décisifs démontrant la réalité d'un recul, les révolutionnaires ont toujours misé sur le terme positif de l'alternative, sur la perspective d'une montée des luttes et non sur celle d'une défaite : l'erreur du médecin qui abandonne les soins d'un malade ayant encore une chance même minime de survie est bien pire que celle du médecin qui s'acharne à soigner un malade qui n'en a aucune.
C'est pour cela aussi qu'aujourd'hui ce n'est pas tellement aux révolutionnaires, qui prévoient un cours de reprise, d'apporter la preuve irréfutable de leur analyse, mais bien à ceux qui annoncent un cours vers la guerre.
À l'heure actuelle, dire à la classe ouvrière, alors qu'on n'en est pas parfaitement sûr, que la perspective qu'elle a devant elle est celle d'une nouvelle guerre impérialiste au cours de laquelle peut-être, elle pourra surgir, relève de l'irresponsabilité. S'il existe une chance, même la plus minime, que ses combats puissent empêcher l'éclatement d'un nouvel holocauste impérialiste, le rôle des révolutionnaires est de miser de toutes leurs forces sur cette chance et d'encourager au maximum les luttes de la classe en faisant ressortir l'enjeu pour elle et pour l'humanité.
Notre perspective ne prévoit pas l'inéluctabilité de la révolution. Nous ne sommes pas des charlatans et nous savons trop bien, à l'inverse de certains révolutionnaires fatalistes que la révolution communiste n'est pas "aussi certaine que si elle avait déjà eu lieu". Mais, quelle que soit l'issue définitive de ces combats, que la bourgeoisie essaiera d'échelonner afin d'infliger à la classe une série de défaites partielles préludes à sa défaite définitive, le capitalisme ne peut plus, d'ores et déjà, imposer sa propre réponse à la crise de ses rapports de production sans s'affronter directement au prolétariat.
C'est en partie de la capacité des révolutionnaires à être à la hauteur de leurs tâches, et notamment à définir les perspectives correctes pour le mouvement de la classe, qu'il dépend que ces combats soient victorieux et qu'ils débouchent sur la révolution et sur le communisme.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [13]
Questions théoriques:
- Le cours historique [154]
Dans l'opposition comme au gouvernement, la «gauche» contre la classe ouvrière
- 2660 reads
Il suffit de jeter un bref coup d'œil pour constater que, si la crise politique de la bourgeoisie s'est effectivement approfondie, l'arrivée de la gauche au pouvoir ne s'est pas vérifiée, mieux encore, la gauche été cette dernière année systématiquement écartée du pouvoir dans la majeure partie des pays de l'Europe. Il suffit de citer-le Portugal, l'Italie, l'Espagne, les pays scandinaves, la France, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre ainsi qu'Israël pour le constater. Il ne reste pratiquement que deux pays en Europe où la gauche reste au pouvoir : l'Allemagne et l'Autriche.
Ceci pose d'emblée une première question : le CCI s'est-il trompé durant des années dans l'analyse de la situation internationale et ses perspectives, notamment celle de la gauche au pouvoir ? Nous pouvons répondre catégoriquement : non. Car pour ce qui concerne l'analyse générale, les données actuelles, comme le font ressortir les rapports, ne font que la confirmer amplement. Pour ce qui est de "la gauche au pouvoir", la réponse est plus complexe mais également : non.
Suite à l'apparition de la crise et aux premières manifestations de la lutte ouvrière, la gauche au pouvoir était la réponse la plus adéquate du capitalisme durant les premières années de la gauche dans les gouvernements, tout comme la gauche posant sa candidature au gouvernement remplissait efficacement sa fonction d'encadrement du prolétariat, le démobilisant et le paralysant par ses mystifications du "changement" et de l'électoralisme.
La gauche devait rester et est restée dans cette position tant que cette position lui permettait de remplir sa fonction. Il ne s'agit donc pas d'une erreur que nous aurions commise dans le passé mais de quelque chose de différent et de plus substantiel, d'un changement qui est intervenu dans l'alignement des forces politiques de la bourgeoisie. Ce serait une grave erreur de ne pas reconnaître à temps ce changement et de continuer à répéter dans le vide sur le "danger de la gauche au pouvoir". Avant de poursuivre l'examen du pourquoi de ce changement et de sa signification, il faut insister tout particulièrement sur le fait qu'il ne s'agit pas là d'un phénomène circonstanciel et limité à tel ou tel pays, mais d'un phénomène général, valable à court et peut-être à moyen terme pour l'ensemble des pays du monde occidental. Cette reconnaissance préalable est nécessaire pour permettre l'examen et la compréhension du changement intervenu et les implications que cela apporte et notamment la rectification de "tir" politique nécessaire dans le proche avenir.
Après avoir efficacement réalisé sa tâche d'immobilisation de la classe ouvrière durant ces dernières années, la gauche au pouvoir ou en marche vers le pouvoir ne peut plus assumer cette fonction qu'en se plaçant aujourd'hui dans l'opposition. Les raisons de ce changement sont multiples; elles relèvent notamment de conditions particulières spécifiques aux divers pays, mais ce sont là des raisons secondaires; les principales raisons résident dans l'usure subie par la gauche et le lent dégagement des mystifications de la gauche de la part des masses ouvrières. La récente reprise des luttes ouvrières et leur radicalisation en sont le témoignage évident.
Rappelons les trois critères dégagés lors des analyses et discussions antérieures pour la gauche au pouvoir :
- nécessité de renforcement des mesures capitalistes d'Etat ;
- meilleure intégration dans le bloc impérialiste occidental sous la domination du capital des USA ;
- encadrement efficace de la classe ouvrière et immobilisation de ses luttes.
La gauche réunissait le mieux et le plus efficacement ces trois conditions, et les USA, leader du bloc, appuyaient plus volontiers son arrivée au pouvoir avec des réserves toutefois pour ce qui concerne les PC. C'est à ces réserves que répondait l'inauguration de la politique dite "eurocommunisme" des PC en Espagne, en Italie et en France, politique cherchant à donner des garanties de loyauté au bloc occidental. Mais si les USA restaient quand même méfiants pour ce qui concerne les PC, leur soutien au maintien ou à l'arrivée des socialistes au pouvoir, partout où cela était possible, était total.
Ce serait une erreur de croire que la raison de l'écartement de la gauche du pouvoir résiderait dans la méfiance à l'égard des PC, même si cette raison avait une importance dans certains pays comme la France et l'Italie. L'écartement des socialistes des gouvernements comme au Portugal, en Israël, en Angleterre et ailleurs, prouve qu'il s'agit d'un phénomène qui dépasse la simple méfiance à l'égard des PC et dont les raisons doivent être cherchées ailleurs.
Revenons aux critères pour la gauche au pouvoir. En les examinant de plus près, nous voyons que même si la gauche les représente le mieux, ils ne sont pas tous le patrimoine exclusif de la gauche. Les deux premiers, les mesures de capitalisme d'Etat et l'intégration dans le bloc peuvent parfaitement être accomplis, si la situation l'exige, par d'autres forces politiques de la bourgeoisie comme les partis du centre ou même carrément de la droite. L'histoire récente abonde en exemples pour qu'il ne soit pas nécessaire d'insister plus là-dessus. Par contre, le troisième critère, l'encadrement de la classe ouvrière, est l'apanage propre et exclusif de la gauche. C'est sa fonction spécifique, sa raison d'être.
Cette fonction, la gauche ne l'accomplit pas uniquement, et même pas généralement au pouvoir. La plupart du temps, elle 1'accomplit plutôt en étant dans 1'opposition parce qu'il est généralement plus facile de 1'accomplir en étant dans l'opposition qu'au pouvoir. En règle générale, la participation de la gauche au pouvoir n'est absolument nécessaire que dans deux situations précises :
- dans l'Union Sacrée en vue de la guerre pour entraîner les ouvriers à la défense nationale;
- dans une situation révolutionnaire pour contrecarrer la marche de la révolution. [1] [155]
En dehors de ces deux situations extrêmes, dans lesquelles la gauche ne peut pas ne pas s'exposer ouvertement comme défenseur inconditionnel du régime bourgeois en affrontant ouvertement et violemment la classe ouvrière, la gauche doit toujours veiller à ne pas trop dévoiler sa véritable identité et sa fonction capitaliste et à maintenir la mystification que sa politique vise la défense des intérêts de la classe ouvrière.
Tout parti bourgeois est mû par des intérêts propres de clique politique et de clientèle électorale en concurrence avec les autres partis, pour aller au pouvoir. Mais aucun parti ne peut échapper aux impératifs de sa fonction de classe qui prédominent sur ses intérêts immédiats de clique, au risque de disparaître. Ceci est également vrai pour les partis de gauche qui doivent avant tout exécuter les impératifs de leur fonction. Ainsi, même si la gauche comme tout autre parti bourgeois aspire "légitimement" à accéder au pouvoir étatique, on doit cependant noter une différence qui distingue ces partis des autres partis de la bourgeoisie pour ce qui concerne leur présence au pouvoir. C'est que ces partis de la gauche prétendent être des partis "ouvriers" et comme tels ils sont obligés de se présenter devant les ouvriers avec un masque, une phraséologie "anticapitaliste" de loups vêtus de peau de mouton. Leur séjour au pouvoir les met dans une situation ambivalente plus difficile que pour tout autre parti franchement bourgeois. Un parti ouvertement bourgeois exécute au pouvoir ce qu'il disait être, la défense du capital, et ne se trouve nullement discrédité en faisant une politique anti-ouvrière. Il est exactement le même dans l'opposition que dans le gouvernement. C'est tout le contraire en ce qui concerne les partis dits "ouvriers". Ils doivent avoir une phraséologie ouvrière et une pratique capitaliste, un langage dans l'opposition et une pratique absolument opposée dans le gouvernement.
Tous les partis ouvertement bourgeois trompent sans vergogne les masses populaires. Les masses ouvrières ne sont cependant pas leur clientèle. A leur égard, les ouvriers savent à quoi s'en tenir, se font peu d'illusions. Mais ces mêmes masses ouvrières sont la clientèle de prédilection des partis de gauche dont la fonction première consiste à les mystifier, à les tromper, à les fourvoyer. Dans l'opposition, ces partis de gauche disent ce qu'ils ne font pas et ne feront jamais. Une fois au gouvernement, ils sont amenés à faire ce qu'ils n’ont jamais dit, jamais osé avouer.
Ils ne peuvent remplir leur fonction bourgeoise que dans ces conditions contradictoires. Dans des situations "normales" du capitalisme, leur présence au gouvernement est toujours aléatoire et ils occupent de préférence des places secondaires dans une coalition plutôt que d'en assumer la direction. Leur présence au gouvernement les rend plus vulnérables, leur usure au pouvoir plus grande et leur crédibilité se trouve plus rapidement mise en question. Dans une situation d'instabilité, cette tendance est encore accélérée. Or, la baisse de leur crédibilité les rend inaptes pour assurer leur fonction d'immobilisation de la classe ouvrière et rend donc ainsi également superflue leur présence au gouvernement. Leur position incommode peut se résumer dans : être au pouvoir sans y être tout en y étant. C'est pourquoi leur séjour au gouvernement ne peut être de trop longue durée, et comme "certaines espèces qui doivent remonter constamment à la surface de l'eau pour respirer, la gauche éprouve un besoin impérieux de faire constamment des cures d'opposition. Il ne s'agit nullement de voir en cela un esprit machiavélique qui guiderait la bourgeoisie. Il s'agit d'une nécessité qui s'impose à elle restant que classe exploiteuse, et d'une division du travail et des fonctions en son sein indispensables pour assurer sa domination sur la société. Classe exploiteuse et dominante, la bourgeoisie doit occuper toute l'aire sociale; elle ne peut laisser échapper aucun espace, aucune couche, à aucun niveau, à son contrôle et surtout pas la classe ouvrière. Si un parti "ouvrier" compromet pour une raison ou pour une autre son aptitude à assurer sa fonction de dévoiement de la classe de sa lutte, alors la bourgeoisie doit faire surgir au plus vite un autre parti plus apte à assurer cette fonction. En général, elle engendre -tout comme la ruche des abeilles produit toujours plusieurs reines de rechange- plusieurs partis, les uns plus à gauche que les autres (voir PS, socialistes de gauche, PC, gauchistes et ainsi de suite). Cette fonction est tellement importante qu'elle ne saurait souffrir d'aucun arrêt de continuité. Ainsi l'avantage que possèdent les partis de gauche d'être aussi efficaces au gouvernement que ceux de la droite dans certaines situations extrêmes, devient leur talon d'Achille dans des situations "normales", et il faut alors qu'ils reprennent normalement leur place dans l'opposition, où ils sont infiniment plus efficaces que les partis de la droite.
Nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation. Après une première explosion de mécontentement et de convulsions sociales qui avait surpris la bourgeoisie, et n’a été neutralisée que par la "gauche au pouvoir", la continuation de la crise qui s'aggrave, les illusions de la gauche au pouvoir qui se dissipent, la reprise de la lutte qui s'annonce, il devenait urgent que la gauche retrouve sa place dans l'opposition et radicalise sa phraséologie pour pouvoir contrôler cette reprise des luttes qui se fait jour. Evidemment cela ne peut être un absolu définitif, mais c'est actuelle ment et pour le proche avenir un fait général. Il est caractéristique que les pays où la gauche reste au pouvoir comme l'Allemagne et l'Autriche sont précisément les pays où la lutte ouvrière est la plus faible. Non seulement la gauche s'écarte du pouvoir, mais doit encore donner une impression de se radicaliser. Cela est évident pour les PC, comme en Italie où le PCI rompt avec "le compromis historique" ou en France où le PCF a provoqué la rupture de l'Union de la gauche et du Programme Commun à la veille des élections; ce dernier parle maintenant de l'union à la base, met en sourdine le slogan de l'union du peuple de France et lui préfère la "défense des travailleurs" et un parti de lutte de classe. Son 23ème Congrès retrouve "un bilan globalement positif" du socialisme de l'Est après un 22ème Congrès qui avait abandonné la dictature du prolétariat et s'était livré à une critique violente du manque de démocratie dans les pays "socialistes" et à un rejet du modèle russe [2] [156].
Ce durcissement des PC oblige les PS -dans les pays où les PC sont forts et où ils sont directement en concurrence- à une égale radicalisation de la phraséologie pour ne pas perdre leur emprise sur les ouvriers. Tel est le cas par exemple en France, où dans le dernier Congrès on a vu la direction Mitterrand rompre avec le courant Rocard pour se rapprocher de celui du CERES. On a même pu1 voir le PS s'associer à la manifestation du 23 mars, en opposition à la CFDT. Mais cela est également évident dans les pays où une telle concurrence d'un PC fort n'existe pas. C'est le cas en Angleterre où les travaillistes provoquent les élections, mettent fin au "contrat social"; au Portugal où Soares élimine une tendance par trop droitière, ou encore plus récemment, où l'ancienne direction de Gonzales est écartée au Congrès par une grande majorité lui reprochant le "consensus", au nom d'un parti voulant se revendiquer du "marxisme". La fin de la politique de la gauche au pouvoir, une fois constatée on doit se demander quel impact aura ce retour de la gauche dans l'opposition ? La gauche politique et syndicale va tendre à redorer son blason, faire oublier ce qu'elle a fait hier, coller le plus possible aux masses, et à la place de sa politique d'hier d'opposition aux luttes, elle va aujourd'hui tendre à les "radicaliser" à sa manière, les multiplier en les dispersant afin de mieux les saboter de l'intérieur, se gauchisant afin d'éviter son débordement. En somme, au lieu de conduire le train sur des voies de garage en étant dans la locomotive, elle va de façon pernicieuse tenter de le faire dérailler. Ainsi, cette gauche se présente plus dangereuse en tant que "défenseur de la classe ouvrière" qu'en tant qu'accusateur. C'est ce danger qu'aura à affronter la classe ouvrière, et il sera plus difficile de le combattre. Dans cette nouvelle situation, les gauchistes risquent de perdre un peu leur identité d'extrême-gauche. Après avoir été les champions de "PC, PS au pouvoir", ils mettront l'accent sur le "front unique", sur des "comités à la base" sur l'initiative et l'égide des partis et des syndicats réunis.
Il ne faut pas se faire d'illusions. La capacité de récupération et de manipulation de la gauche et des gauchistes est énorme. Il y aura à les combattre dans des conditions nouvelles. Hier lorsqu'ils tenaient fermement le gouvernail conduisant allègrement le train ouvrier sur des rails capitalistes, il fallait rester sur les bords du parcours appelant les ouvriers à quitter le train. Aujourd'hui lorsque le train ouvrier s'engage lentement sur les rails de classe, la tâche est d'être dedans, partie prenante et active de la lutte, renforcer la voie et veiller à ce qu'il n'y ait pas d'acte de sabotage de la part des agents du capitalisme.
C'est au sein de la lutte, au cours de son développement qu'il faut dénoncer concrètement les agissements de la gauche et lui arracher son masque "radical". C'est là une tache difficile d'autant plus que manque l'expérience d'une telle situation. Il ne s'agit pas de faire une surenchère de radicalisme, mais savoir pratiquement, concrètement en tout te occasion montrer ce que cache le "radicalisme" de la gauche. Cette vision s'imbrique parfaitement dans l'analyse générale de la situation internationale et de la reprise de la lutte ouvrière. Elle constitue une pièce qui lui a manqué, et notamment en ce qui concerne le cours historique, car un cours vers la guerre ne rend pas nécessaire une radicalisation de la gauche dans l'opposition. Au contraire, la classe ouvrière atomisée et apathique laisse à la gauche sa liberté et rend possible et nécessaire son association au gouvernement.
C'est à cette nouvelle situation qu'il faut adapte» l'activité et l'intervention -une situation pleine d'embûches, mais également pleine de promesses.
[1] [157] Encore faut-il remarquer une différence de comportement des partis "ouvriers" dans ces deux situations. En temps de guerre ils s'intègrent ou soutiennent un gouvernement d'Union nationale sous la direction des représentants officiels de la bourgeoisie, alors que dans une période révolutionnaire c'est généralement la grande bourgeoisie qui s'abrite derrière un "gouvernement de "gauche ou ouvrier". C'est à la gauche que revient l'honneur et la tâche d'assassiner la révolution prolétarienne au nom de la "démocratie", du "socialisme" et de "la bonne marche de la révolution" comme le montre l'histoire des menchéviks en Russie et de la social-démocratie en Allemagne.
[2] [158] Ainsi prend fin le fameux "eurocommunisme" qui a tant inquiété des groupes comme Battaglia Comunista qui voulait voir en lui on ne sait quel changement fondamental et définitif des PC et de leur nature stalinienne. Ce qui n'était qu'une apparence et un tournant tactique devenait pour ces groupes la "social-démocratisation" des PC. Comme on peut le constater aujourd'hui, il n'en est rien.
Géographique:
- Europe [159]
Questions théoriques:
- Le cours historique [154]
Heritage de la Gauche Communiste:
Résolution sur la situation internationale 1979
- 2625 reads
1 - A l'exception de quelques révolutionnaires particulièrement bornés, plus personne ne songe aujourd'hui à nier la réalité de la crise mondiale du capitalisme. Malgré les différences de forme avec celle de 1929, sur lesquelles se basent ceux qui essayent d'en minimiser la gravité, la crise actuelle révèle toute son ampleur :
- par une sous-utilisassions massive et croissante des moyens de production et de la force de travail notamment dans les grands pays industriels du bloc US où des secteurs aussi significatifs que l'acier, la construction navale ou la chimie sont en pleine débandade;
- par une incapacité de plus en plus nette des pays du bloc de l'Est de réaliser des plans économiques pourtant de moins en moins ambitieux et qui accentue le manque de compétitivité de leurs marchandises sur le marché mondial ;
- par la catastrophe qui secoue les pays sous-développés où les "miracles" à la brésilienne ont fait long feu pour laisser la place à une inflation débridée et à un endettement colossal;
- par la chute constante du taux de croissance du commerce mondial.
Si les chiffres officiels font apparaître les difficultés présentes de l'économie mondiale et révèlent qu'elles trouvent leurs causes dans un engorgement généralisé du marché, ils masquent souvent la gravité de celles-ci en négligeant le poids énorme des productions et des ventes d'armements qui constituent le pire gaspillage de forces productives puisque, ni comme capital variable, ni comme capital constant ces armements n'entrent dans un cycle productif ultérieur.
Après plus d'une décennie de dégradation lente mais inéluctable de son économie et d'échec de tous les "plans de sauvetage" mis en œuvre, le capitalisme a administré la preuve de ce que les marxistes n'ont cessé d'affirmer depuis longtemps : ce système est entré dans sa phase de déclin historique et il est absolument incapable de surmonter les contradictions économiques qui l'assaillent aujourd'hui.
Dans la période qui vient, nous allons assister à un nouvel approfondissement de la crise mondiale du capitalisme sous forme notamment d'une nouvelle flambée d'inflation et d'un ralentissement sensible de la production qui risque de faire oublier celui de 1974-75 et provoquera une aggravation brutale du chômage.
2 - L'effondrement de l'infrastructure économique se répercute sur l'ensemble de la société et, en premier lieu, par une exacerbation des tensions inter-impérialistes. Au fur et à mesure de l'aggravation de ces conflits se révèle notamment l'absurdité de la théorie de "l'effritement des blocs impérialistes" : en réalité, le corollaire de cette aggravation est la nécessaire intégration chaque jour plus forte de chaque pays au sein d'un des blocs, ce qu'illustre par exemple :
- la prise en charge croissante par la France des tâches du bloc américain particulièrement comme gendarme de l'Afrique;
- l'insertion complète du Vietnam dans le bloc russe;
- l'insertion plus grande de la Chine dans le bloc américain.
Plus encore que sur le plan économique, le renforcement des blocs impérialistes sur le plan militaire est une réalité qui s'inscrit dans la préparation de la seule "issue" que le capitalisme puisse donner à sa crise : la guerre impérialiste généralisée.
De même, il serait faux de considérer, comme certains le font, qu'on s'achemine vers une réorganisation des alliances fondamentales existant aujourd'hui, qui serait la condition indispensable pour qu'une guerre généralisée puisse avoir lieu. D'une part, l'expérience a montré que les changements d'alliance peuvent intervenir après le déclenchement de la guerre. D'autre part, l'ampleur des liens économiques, politiques et militaires qui unissent les principales puissances constituant les blocs ne permettent pas une redistribution brutale des cartes conduisant, par exemple, à la reconstitution des blocs de la deuxième guerre. Une telle redistribution des cartes ne peut, à l'heure actuelle, toucher que les pays périphériques, notamment ceux du tiers-monde, qui justement continuent à être le terrain privilégié des règlements de comptes entre brigands impérialistes.
Si l'année 1978 a vu le continent africain en pre. mi ère ligne de ces affrontements, la relative stabilisation de la situation dans cette zone, liée essentiellement au repli de l'URSS, n'a pas signifié pour autant la fin des conflits ou même une pause dans ceux-ci : sitôt contenue en un endroit, l'incendie impérialiste se ranimait en Extrême-' Orient mettant à mal le mythe de la libération nationale et de la "solidarité entre pays socialistes". Les affrontements entre la Chine et le Vietnam, parce qu'ils ont mis directement aux prises les deux principales puissances militaires de la région, parce qu'ils ont jeté sur les champs de bataille des centaines de milliers d'hommes et provoqué en quelques jours des dizaines de milliers de morts constituent un moment important de l'aggravation des tensions impérialistes et présentent aux prolétaires du monde entier le visage hideux de ce qui attend toute la société s'ils laissent les mains libres au capitalisme.
3 - La crise de son économie ne provoque pas seulement une aggravation des déchirements entre fractions nationales de la bourgeoisie. Elle se répercute également à l'intérieur de chaque pays sous forme de crise politique. Celle-ci touche toutes les parties du monde mais connait ses formes les plus violentes dans les pays arriérés. L'exemple de l'Iran où le départ du Shah n'a pas réussi à stabiliser la situation et où l'unanimité qui s'était faite contre lui a laissé place à des affrontements chaotiques, est à cet égard significatif. Mais cette crise politique frappe également le pays les plus développés et a connu, en particulier ces derniers mois, des soubresauts importants en Europe.
Une crise politique résulte en général des difficultés d'adaptation de la classe capitaliste aux nécessités contradictoires qui trouvent leur origine dans les contradictions de l'infrastructure économique. Dans les années passées cette adaptation avait en Europe, pour axe un renforcement de la gauche, en particulier la social-démocratie, comme alternative gouvernementale. Cette orientation correspondait à la fois à des préoccupations de politique internationale (fidélité de la social-démocratie au bloc américain) et à des préoccupations de politique intérieure (renforcement des mesures de capitalisme d'Etat et dévoiement du mécontentement ouvrier). Mais aujourd'hui se manifeste une tendance à un rejet dans l'opposition des forces de gauche qui répond, non pas à la fin de la fonction essentielle de ces forces dans la défense du capitalisme contre la classe ouvrière, mais à une meilleure adaptation à l'accomplissement de cette fonction liée :
- au discrédit subi par les partis de gauche, quand ils ont effectivement dirigé les gouvernements comme l'illustre de façon éclatante la situation en Grande-Bretagne;
- à l'épuisement de la mystification de "l'alternative de gauche" quand elle n'a pu finalement se réaliser comme ce fut notamment le cas en France;
- à la nécessité de saboter "de l'intérieur" les luttes ouvrières qui tendent à réapparaître après I les avoir contenues et dévoyées par des alternatives illusoires.
Ainsi, après avoir eu pendant des années comme principal ennemi la gauche au pouvoir ou en marche vers le pouvoir, la classe ouvrière dans la période qui vient retrouvera de façon quasi générale le même ennemi dans l'opposition n'hésitant pas à radicaliser son langage pour pouvoir mieux saboter ses luttes.
4 - Les données présentes de la crise de l'appareil politique de la bourgeoisie font donc apparaître le poids croissant de la lutte de classe dans la vie de la société. C'est là la traduction du fait qu'a près une période de relatif recul des luttes couvrant le milieu des années 70, la classe ouvrière tend à renouer aujourd'hui avec une combativité qui s'était manifestée de façon généralisée et souvent spectaculaire à partir de 1968. Cette vague de combativité prolétarienne, qu'un nombre important de courants révolutionnaires (comme le FOR et Battaglia Comunista) n'a pas su reconnaître, constituait la première réponse de la classe révolutionnaire à l'aggravation de la crise du capitalisme qui suivait la fin de la reconstruction. Elle révélait qu'avait pris fin la terrible contre-révolution qui s'est abattue sur le prolétariat au cours des années 20. Après un premier temps de surprise, la bourgeoisie a mené une contre-offensive en règle avec comme fer de lance la gauche qui, s'appuyant sur les faiblesses tout à fait normales d'un mouvement à ses débuts, a réussi à canaliser et étouffer les luttes à travers :
- la mystification démocratique ;
- la perspective de la gauche au pouvoir ;
- les "solutions nationales" à la crise.
Cet étouffement et encadrement idéologique des ouvriers a été complété par un renforcement considérable des préparatifs de la terreur étatique notamment au moment des "affaires" Baader en Allemagne et Moro en Italie, ce qui démontre que, si certains révolutionnaires ont été incapables de comprendre la reprise prolétarienne, la bourgeoisie, elle, sur ce point a été beaucoup plus lucide
La tendance actuelle au développement des luttes (mineurs américains des Appalaches, sidérurgistes allemands, hospitaliers italiens, camionneurs et travailleurs du secteur public en Grande-Bretagne, ouvriers espagnols et travailleurs du téléphone au Portugal, ouvriers de la sidérurgie en France, etc.) marque l'épuisement de cette contre-offensive de la bourgeoisie et, loin de se résumer à un simple feu de paille, constitue l'annonce d'une reprise générale du prolétariat qui viendra combler le décalage qui s'était développé dans les années passées entre le niveau de gravité atteint par la crise et le niveau de la riposte ouvrière au détriment du second. Par la détérioration inéluctable qu'elle continuera à provoquer sur les conditions de vie des ouvriers, la crise obligera même les plus hésitants à reprendre le chemin de la lutte.
Bien qu'elle n'apparaisse pas immédiatement en pleine lumière, une des caractéristiques essentielles de cette nouvelle vague de luttes sera de redémarrer au niveau qualitatif le plus élevé atteint par la vague précédente. Cette caractéristique se manifestera essentiellement par une tendance plus marquée que par le passé à un débordement des syndicats à l'élargissement des combats au delà des limites catégorielles et professionnelles, à une conscience plus claire du caractère international de la lutte de classe. Par ailleurs, un élément tendra à devenir décisif dans ces luttes : le développement du chômage. Après avoir, dans un premier temps, lors de son apparition massive après 1974, contribué à paralyser le prolétariat, cet élément tend aujourd'hui à devenir un des facteurs les plus explosifs de mobilisation prolétarienne poussant d'emblée les ouvriers à dépasser les différentes divisions catégorielles. C'est ce qu'a d'ailleurs bien compris la bourgeoisie européenne et qui explique sa campagne présente sur les 35 heures.
5 - Si d'un côté donc, l'aggravation de la crise pousse ce système de façon inexorable vers la guerre impérialiste, d'un autre côté, elle pousse la classe ouvrière vers des combats de plus en plus acharnés contre lui. Ainsi se trouve de nouveau posée l'alternative historique définie par l'Internationale Communiste pour la période de décadence du capitalisme : guerre impérialiste ou révolution prolétarienne. La question qui se pose aux révolutionnaires et à laquelle ils donnent aujourd'hui les réponses les plus contradictoires est donc : le capitalisme a-t-il les mains libres pour imposer sa "solution" à la crise : la guerre généralisée, ou au contraire, la montée prolétarienne interdit-elle pour le moment un tel aboutissement ?
Une réponse correcte à cette question suppose qu'o se la pose correctement et notamment qu'on rejette l'idée de l'existence de deux cours simultanés, parallèles et indépendants vers la guerre impérialiste et vers la guerre de classe. En fait, comme réponses des deux classes irrémédiablement antagoniques, ces deux issues sont elles-mêmes antagonique et s'excluent mutuellement. L'histoire a démontré que, classe divisée en multiples fractions aux intérêts contradictoires, notamment entre fractions nationales, la bourgeoisie n'est capable d'une unité que face à une offensive de la classe ouvrière. C'est pour cela que les révolutionnaires ont affirmé depuis le début du siècle que la lutte de classe constituait le seul obstacle véritable à la guerre impérialiste.
La question à laquelle il faut donc répondre est bien : "le niveau actuel de la combativité ouvrière est-il suffisant pour barrer la route à la guerre mondiale ?" Certains révolutionnaires, se basant sur le fait que seule une révolution met fin en 1917 pour la Russie, en 1918 pour l'Allemagne, à la guerre impérialiste, estiment qu'aujourd'hui seules des luttes révolutionnaires pourraient empêcher un nouveau conflit et que celles-ci n'existant pas encore, la voie est libre pour le capitalisme. En réalité, le problème se pose en termes différents suivant que la guerre généralisée a déjà éclaté ou qu'elle est seulement en cours de préparation. Dans le premier cas, l'histoire a effectivement montré que des luttes à caractère révolutionnaire étaient nécessaires pour mettre fin à la guerre ; dans le deuxième cas, elle a fait apparaître, notamment au cours des longs préparatifs pour la deuxième guerre mondiale, que le capitalisme ne pouvait se lancer dans une telle aventure que lorsqu’il avait embrigadé la classe ouvrière derrière le capital national. La comparaison entre les situations qui prévalent en 1974 et 1939 et la situation présente démontrent que le capitalisme n'a pas réuni aujourd'hui les conditions lui permettant d'apporter à la crise sa propre réponse : la guerre impérialiste généralisée. Bien que sur le plan de la gravité de la crise, les préparatifs militaires et stratégiques, les conditions d'un nouvel holocauste soient mûres depuis longtemps, la combativité présente de la classe ouvrière constitue un obstacle décisif sur la voie d'un tel holocauste.
6 - Dans la mesure où le capitalisme ne peut éventuellement imposer sa propre réponse à la crise qu'après avoir brisé la combativité ouvrière, la perspective présente n'est donc pas celle d'un affrontement impérialiste généralisé mais celle d'un affrontement de classe. C'est à cet affrontement décisif, puisque de son issue dépend le sort de toi te la société, que préparent les combats présents de la classe. Le rôle des révolutionnaires est donc d'intervenir dans ces combats pour en faire ressortir l'importance et l'enjeu. Toute attitude ou conception de leur part qui tend à sous-estimer cet enjeu, à négliger le rôle essentiel de ces combats comme obstacle à la guerre impérialiste ou à démoraliser les ouvriers en annonçant - à tort - l'inéluctabilité d'une telle issue, conduit à un affaiblissement de ces combats et favorise donc la victoire finale du capitalisme.
Aujourd'hui, seule une attitude résolue des révolutionnaires tendant à démontrer l'importance cruciale de ces combats, non pour les paralyser mais pour les stimuler, favorise l'issue positive de l'affrontement qui se prépare : la révolution prolétarienne, le communisme.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [161]
Questions théoriques:
- Guerre [153]
Résolution sur l'Etat de la période de transition
- 2885 reads
L'existence, dans la période de transition, d'une division de la société en classe, aux intérêts antagoniques fait surgir au sein de celle-ci un Etat. Un tel Etat devra avoir pour tâche de garantir les acquis de la société transitoire, d'une part contre toute tentative intérieure et extérieure de restauration du pouvoir des anciennes classes exploiteuses et, d'autre part pour maintenir la cohésion contre le danger de déchirement résultant des oppositions entre les différentes classes non exploiteuses qui subsistent en son sein.
L'Etat de la période de transition comporte un certain nombre de différences d'avec celui des sociétés antérieures :
- pour la première fois de l'histoire, c'est un Etat non pas au service d'une minorité exploiteuse pour l'oppression de la majorité mais au contraire au service de la majorité comprenant les classes et couches exploitées ainsi que celles non exploiteuses contre la minorité des anciennes classes dominantes déchues;
- il n'est pas l'émanation d'une société et de rapports de production stables mais au contraire d'une société dont la caractéristique permanente est le constant bouleversement dans lequel s'opèrent les plus grandes transformations que l'histoire ait connues;
- il ne peut s'identifier à aucune classe économiquement dominante dans la mesure où il n'existe aucune classe de ce type dans société de la période de transition;
- contrairement à l'Etat des sociétés passées, celui de la société transitoire n'a plus le monopole des armes. C'est pour l'ensemble de ces raisons et de leurs implications que les marxistes ont pu parler de "demi-Etat" au sujet de l'organe surgissant dans la période de transition.
Par contre, cet Etat conserve un certain nombre de caractéristiques de ceux du passé. Il reste en particulier l'organe du statuquo, chargé de codifier, légaliser un état économique déjà existant, de le sanctionner, de lui donner force de loi et dont l'acceptation est obligatoire pour tous les membres de la société. Dans la période de transition, l'Etat tendra à conserver l'état économique existant, et, de ce fait, l'Etat reste un organe fondamentalement conservateur tendant :
- non à favoriser la transformation sociale mais à s'opposer à celle-ci,
- à maintenir en vie les conditions qui le font vivre la division de la société en classes,
- à se détacher de la société, à s'imposer à elle et perpétuer sa propre existence et à développer ses propres prérogatives,
- à lier son existence à la coercition, à la violence qu'il utilise nécessairement pendant la période de transition et à tenter de maintenir et renforcer ce type de régulation des rapports sociaux,
- à être un bouillon de culture pour la formation d'une bureaucratie, offrant ainsi un lieu de rassemblement aux éléments transfuges des anciennes classes et cadres que la révolution avait détruits.
C'est pour cela que l'Etat de la période de transition a été depuis le début considéré par les marxistes comme un "fléau", "un mal nécessaire" dont il s'agit de "limiter les effets les plus fâcheux" (Engels). Pour l'ensemble de ces raisons, et contrairement à ce qui s'est produit dans le passé, la classe révolutionnaire ne peut s'identifier avec l'Etat de la période de transition.
D'une part, le prolétariat n'est pas une classe économiquement dominante. Il ne l'est ni dans la société capitaliste ni dans la société transitoire. Dans celle-ci, il ne possède aucune économie, aucune propriété même collective mais lutte pour la disparition de l'économie, de la propriété. D'autre part, le prolétariat, classe porteuse du communisme, agent du bouleversement des conditions économiques et sociales de la société transitoire, se heurte nécessairement à l'organe tendant, lui à perpétuer ces conditions. C'est pour cela qu'on ne peut parler ni "d'Etat socialiste" ni "d'Etat ouvrier" ni "d'Etat prolétarien" durant la période de transition.
Cet antagonisme entre prolétariat et Etat se manifeste tant sur le plan immédiat que sur le plan historique.
Sur le terrain immédiat, le prolétariat devra s'opposer aux empiétements et à la pression de l'Etat en tant que manifestation d'une société dans laquelle subsistent des classes aux intérêts antagoniques aux siens. Sur le terrain historique, la nécessaire extinction de l'Etat dans le communisme, déjà mise en évidence par le marxisme, ne sera pas le résultat de sa dynamique propre mais le fruit d'une pression soutenue de la part du prolétariat, conséquence de son mouvement en avant, qui le privera progressivement de tous ses attributs au fur et à mesure de l'évolution vers la société sans classe.
Pour ces raisons, si le prolétariat doit se servir de l'Etat de la période de transition, il doit conserver sa complète indépendance à l'égard de cet organe. En ce sens, la dictature du prolétariat ne se confond pas avec l'Etat. Entre les deux, existe un rapport de forces constant que le prolétariat devra maintenir en sa faveur : la dictature du prolétariat s'exerce par la classe ouvrière au travers de son organisation générale, unitaire, indépendante et armée : les conseils ouvriers qui, comme tels, participent dans les soviets territoriaux (où est représenté l'ensemble de la population non-exploiteuse, et d'où émane la structure étatique), sans s'y confondre, afin d'assurer son hégémonie de classe sur toutes les structures de la société de la période de transition.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [161]
Questions théoriques:
- Communisme [162]
Heritage de la Gauche Communiste:
L'évolution de la lutte de classe
- 2783 reads
1. INTRODUCTION
Personne ne peut nier que la situation actuelle de la lutte de classe est très différente de celle de 1977-78. A cette époque, surtout dans les pays européens, l'apathie et la désorientation régnaient parmi les ouvriers. Des nuages noirs s'amoncelaient à l'horizon : plans d'austérité, licenciements massifs, aggravation dangereuse des guerres impérialistes... Le capitalisme pouvait imposer tout cela sans susciter de riposte particulière de la part de la classe ouvrière. Il n'en est pas de même aujourd'hui : avec l'expérience du mouvement de lutte qui a démarré avec les grèves aux Etats-Unis et en Allemagne au début de 1978, et qui a culminé avec les formidables combats de Longwy et Denain en France au printemps 1979, c'est toute l'Europe qui a été touchée ; on peut affirmer que, face à la crise capitaliste et à sa marche funèbre vers l'holocauste se lève à nouveau le géant prolétarien pour transformer la crise actuelle en une crise révolutionnaire qui ouvre les portes à l'émancipation communiste de toute l'humanité.
Bien sûr, il existe encore beaucoup de doutes, d'hésitations, de méfiance dans les rangs prolétariens ; les ouvriers combatifs eux-mêmes ne sont pas toujours conscients dp l'ampleur et de la portée des luttes qu'ils ont vécues. Les prolétaires n'ont pas encore retrouvé l'enthousiasme et la détermination de la dernière vague révolutionnaire et on peut souvent constater une apathie apparente une certaine désorientation -ce qui est normal aux débuts d'une nouvelle vague révolutionnaire. Comme disait Rosa Luxembourg :
"L'inconscient précède le conscient et la logique du processus historique objectif précède la logique subjective de ses protagonistes"'. ("Marxisme contre Dictature")
Ce rapport, qui exprime la discussion qui a eu lieu dans notre IIIème Congrès International sur l'état actuel de la lutte de classe a un clair objectif pratique et militant : rendre conscients les prolétaires combatifs de la "logique du processus historique", c'est-à-dire, des conditions globales -économiques, politiques, sociales- des luttes vécues, de leur portée et de leurs perspectives. C'est seulement en possédant cette "logique du processus historique" ou, comme disait le "Manifeste Communiste" : "une claire vision des conditions, de la marche et des résultats généraux du mouvement prolétarien", que notre classe pourra renforcer sa confiance en elle-même, renforcer sa détermination et annihiler la puissance de la classe ennemie.
Cependant, il y a encore dans le mouvement révolutionnaire actuel trop d'aveugles qui ne veulent pas ou ne savent pas voir. Tel est le cas du F.O.R. (Ferment Ouvrier Révolutionnaire), P.CI. (Battaglia Comunista) ou PCI (Programa Comunista). Ces groupes s'obstinent à ne pas voir "le pain et le sel" des luttes ouvrières actuelles. Et ce n'est pas de maintenant : ces groupes méprisent les grands combats ouvriers qui ont secoué les cinq continents dans les années 60 et les considèrent comme des escarmouches sans importance.
Précisément, ce rapport nous sert a réaffirmer les axes essentiels qui caractérisent la période historique actuelle face à 1'évidente cécité de ces camarades :
1) Les luttes des années 60 (mai 68, Pologne, Italie) représentent la fin de la période de contre-révolution qu'a subie la classe ouvrière à partir des années 20, ouvrent la perspective d'une nouvelle période révolutionnaire.
2) Le reflux relatif qui a dominé le prolétariat européen à partir de l°73-74 est dû aux faiblesses qui caractérisent la vague des années 60 et à la contre-attaque de la bourgeoisie.
3) Ce reflux n'est en aucune façon une défaite et, par conséquent, il ne remet pas en question le cours révolutionnaire des années 60.
4) Les luttes qui, depuis l'automne 78, se sont succédées dans un grand nombre de pays, et principalement dans les métropoles capitalistes, annoncent la fin du calme précédent et la maturation d'une nouvelle offensive prolétarienne.
Programa Comunista et Battaqlia Comunista commencent à entrevoir quelque chose, tant bien que mal et avec des analyses à contresens, ils commencent à reconnaître l'importance des luttes, mais le FOR continue mordicus dans son aveuglement, dans son mépris olympien des luttes actuelles ; pour lui, ce qui s'est passé en Iran n'est qu'une simple manipulation des Ayatollah et les événements de Longwy et Denain sont complètement récupérés par les syndicats.
Le FOR révèle au grand jour la logique extrême et caricaturale de tous les groupes et militants révolutionnaires qui ne comprennent pas la dynamique les conditions et les caractéristiques de la lutte de classe, qui n'ont pas et n'essaient même pas <' de trouver une perspective concrète du cours historique actuel.
Ne pas voir les perspectives qui se dégagent des "pauvres" et "petites" grèves actuelles, c'est, camarades du FOR, nier "la logique du processus historique", c'est laisser les militants prolétariens au stade inconscient, c'est mettre des obstacles au pas nécessaire vers la conscience. Le FOR défend l'essentiel des positions de classe, mais, à l'heure de la vérité, à l'heure de comprendre la réalité, l'évolution de la lutte de classe, il ne les met pas en pratique. Parce que les positions de classe ne sont pas une bande magnétique qu'on répète comme un perroquet jusqu'à ce qu'elles entrent dans les têtes, parce qu'elles ne sont pas un beau sermon pour convertir les consciences, parce qu'elles ne sont pas un bourrage de crâne pour prosélytes mais sont avant tout et surtout un cadre global pour comprendre la lut-,te de classe, pour voir où on va et comment, par le biais de quel processus et de quelles perspectives ; elles sont 1'instrument pour comprendre la logique du processus historique et agir de façon active et consciente dans sa direction. Défendre de manière générale les positions de classe mais en même temps ne pas voir "le pain et le sel" des luttes actuelles et manquer de toute perspective concrète sur la période présente, comme le font le les camarades du FOR, c'est jeter par dessus bord le précieux trésor qu'elles contiennent pour comprendre la réalité de la lutte de classe et participer en son sein à une direction révolutionnaire, c'est les réduire à une pure idéologie.
Le texte présent, contenant nos conclusions sur :
- les conditions qui ont déterminé le reflux relatif de 1973-78 ;
- les conditions de l'évolution de la crise, de l'approfondissement de la crise politique de la bourgeoisie et de son rapport de force avec lé prolétariat, qui déterminent la fin de ce reflux ;
- le bilan et les perspectives concrètes des luttes vécues depuis novembre 1978, est un appel militant à tout le mouvement révolutionnaire actuel pour un effort pour se donner une compréhension globale du mouvement prolétarien des étapes qu'il a franchies et qu'il devra franchir et être à tout moment conscient d'où nous sommes et vers où nous allons dans le mouvement prolétarien actuel.
2 LE POURQUOI DU REFLUX
Depuis 1973-74, la grande vague de luttes des années 60 a presque disparu des pays du centre du capitalisme, pour laisser la place à un calme social. Pourquoi ce reflux ?
Dans le rapport sur la situation internationale qu'a élaboré notre organisation au début de 1978 (voir R.INT. n°13), il y a une explication générale de pourquoi le mouvement de la classe ouvrière n'a jamais suivi une ligne droite mais une suite de flux et de reflux. Sa caractéristique d'être en dents de scie, d'avancer par à-coups, s'aggrave dans la période de décadence du capitalisme, à cause :
- du totalitarisme étatique qui empêche, soit par la répression, soit par l'intégration -ou souvent la combinaison des deux- l'existence de toute organisation permanente de masse de la classe ouvrière ;
- de l'impossibilité d'obtenir des améliorations et des réformes durables, ce qui empêche toute lutte stable et structurée.
Il faut comprendre le reflux qui a suivi les luttes des années 60 dans le cadre des caractéristiques générales de la lutte prolétarienne, celles-ci étant le produit immédiat :
- des faiblesses de la vague de luttes des années 60,
- de la contre-offensive idéologique et politique de la bourgeoisie.
En ce qui concerne le premier point, on ne va pas faire ici un bilan complet de cette vague de lut tes; il a déjà été fait dans plusieurs textes de notre organisation (voir RI ancienne série, les textes d'AP : "Perspectives mondiales de la lutte de classe" n° 12 et 13 et "Sur l'était actuel de le lutte de classe" n° 18 ; et le texte de la R.INT "Mai 68", n° 14). Ici, nous nous bornerons à :
- rappeler schématiquement les faiblesses essentielles du mouvement des années 60 (illusions sur un économisme radical, rupture fréquente avec la forme syndicale mais pas avec le contenu, relatif isolement des luttes, manque de perspectives) ;
- voir les conditions générales qu'a trouvées cet te vague (niveau encore limité de la crise, rythme lent et inégal de celle-ci, expérience limitée du prolétariat qui part à zéro après cinquante ans d< contre-révolution) pour expliquer à la lumière de celles-ci les racines de ces faiblesses ;
- et, finalement, les comprendre comme partie intégrante de la première étape d'une nouvelle époque révolutionnaire, laquelle, logiquement, à côté d'un formidable potentiel révolutionnaire, traîne beaucoup d'immaturité et de points, faibles.
Il est important de comprendre -et nous abordons par là le second point- que la bourgeoisie a profité consciemment des limitations et des points faibles des luttes de 68 pour passer à une vaste contre-offensive politique et idéologique qui visait à freiner et à tenter de défaire la poussée prolétarienne,
C'est à partir des conditions générales où se trouvent les luttes que la bourgeoisie établit se mystifications et son offensive anti-ouvrière.
Les luttes de mai 68 s'inscrivent dans les premiers stades d'approfondissement de la crise capitaliste (récession de 66-67 et 70-71) qui ne permettent pas encore de deviner la profondeur de l'écroulement du capitalisme sénile et qui, y coït pris lors du mini-boom de 72 (de nombreux pays battirent les records de production d'après-guerre) sont pour ainsi dire le "chant du cygne" de la fameuse "prospérité'.'.
C'est ce contexte de :
- développement lent de la crise,
- rythme différent de ce développement selon les pays, régions et entreprises,
- une tendance générale aiguë au capitalisme d'Etat qui permet, dans un premier temps et pour éviter tout choc frontal avec les ouvriers, de dévie partiellement les effets de la crise vers des secteurs non-prolétariens ou des fractions faibles de celui-ci. Ceci a entravé le développement des lui tes, a constitué le bouillon de culture à la formation de toutes sortes d'illusions dans les rangs ouvriers et a permis la contre-offensive bourgeoise. En effet, le rythme lent de la crise a pour conséquence dans la conscience du prolétariat :
- la difficulté à comprendre la crise du capita1isme,
- les illusions sur les garanties légales, syndicales ou réformistes contre la dégradation des conditions de vie. L'autogestion et le-"pouvoir ouvrier" sont l'expression la plus radicale de c illusions,
- l'illusion selon laquelle, grâce à des pactes sociaux de négociation, la participation à l'administration de la société, on peut pallier à la situation et trouver une issue favorable aux travailleurs,
- une surestimation de la stabilité et de la cohérence du capitalisme. Idée entretenue selon la- quelle la classe dominante peut gouverner éternellement.
Le rythme inégal selon les entreprises, les régions ou les pays a facilité :
- l'illusion d'une solution nationale a la crise, entraînant l'idée de collaboration décelasse et de "sacrifice pour tous",
- la confiance dans des revendications d’entreprises, de secteurs ou de catégories, et la croyance dans des solutions d'entreprises, secteurs, régions...
Enfin, l'accentuation de la tendance au capitalisme d'Etat qui se renforce dès les premiers signes de la crise entretient diverses illusions :
- identifier capitalisme d'Etat et socialisme et présenter les interventions de l'Etat et les nationalisations comme autant de pas vers le socialisme,
- faire passer les mesures indirectes de concentration du capital et de répercussion de la crise sur les couches moyennes et les secteurs anachroniques comme la preuve du caractère "justicier , "social" et "progressiste" de l'Etat,
- donner aux principaux représentants de ces mesures -la gauche et son appareil syndical- une image "ouvrière", et "combative", en présentant les mythes d'un "gouvernement ouvrier" et de 1 union de la gauche" comme "une solution à la crise favorable aux travailleurs".
Cet ensemble de bases matérielles donnent le cadre général du renforcement politique et idéologique de la bourgeoisie gui lui permet de passer à la contre-offensive.
Les faits principaux de cette contre-attaque destinée â freiner les luttes et démobiliser les ouvriers sont :
1) la mystification démocratique qui se présente dans les moments d'agitation sociale à travers "la démocratie directe" et le "pouvoir populaire" et qui redeviennent, lorsque les luttes commencent à diminuer, la "démocratie classique" ;
2) la montée de la gauche au pouvoir présentée comme le "grand changement" pacifique, légal, quoique radical, qui doit solutionner tous les problèmes,
3) la solution nationale à la crise qui exige, au travers de pactes, plans de restructurations, etc. "la solidarité nationale des classes", ce qui justifie le sacrifice des ouvriers.
Facteur actif de ce réarmement idéologique et politique de la bourgeoisie, on a vu la réadaptation de ses appareils syndicaux et de gauche qui, à partir des années 60 (vers la fin des années 60) :
- se "démocratisent" et se "débureaucratisent",
- se "radicalisent" dans leur attitude et intègrent toute la "lutte moderne" : autogestion, "changer la vie",
- proposent de "nouveaux programmes de "changement social" qui associent lutte avec "légalité".
Les gauchistes furent précisément les anticorps sécrétés par la société bourgeoise, chargés dans un premier temps d'immobiliser les luttes et de crédibiliser cette "rénovation" des syndicats et des partis de gauche.
L'Etat bourgeois sclérosé par des années de calme social et trop préoccupé par tous les problèmes de la période de reconstruction dut subir une rapide réadaptation qui lui permit de renforcer son image "d'organe neutre" entre les classes, instrument démocratique pour la participation de tous les citoyens, bref, tout un arsenal qui devait permettre à la bourgeoisie de faire face au renouveau prolétarien.
On vérifie le processus de cette offensive idéologique et politique contre le prolétariat à travers plusieurs faits :
"Dans un grand nombre de pays, particulièrement là où la classe ouvrière a manifesté le plus de combativité est mise en place toute une mystification tendant à démontrer :
- que la lutte ne paie pas,
- qu'il faut un "changement pour faire face à la crise,
- suivant les pays, ce changement prend la forme :
. en Grande-Bretagne, de l'accession des travaillistes au pouvoir à la suite des grandes grèves de l'hiver 1972-73,
. en Italie, "du compromis historique", destiné avec la venue du PCI au gouvernement à "moraliser" la vie politique,
. en Espagne, de la "rupture démocratique" avec le régime franquiste,
. au Portugal, de la "démocratie" d'abord, du "pouvoir populaire" ensuite,
. en France, du "programme commun" et de l'union de la gauche" qui doivent mettre fin à 20 ans de politique de "grand capital". (R.INT. n° 13, "Rapport sur la situation mondiale").
Ce processus de réarmement permit dans un premier temps â l'Etat bourgeois d'isoler les luttes les plus dangereuses pour ensuite liquider l'agitation générale. L'étape suivante devait conduire les luttes dans des impasses, sur des faux terrains, et aboutir à la démoralisation des ouvriers. Ceci a permis aux syndicats de devancer et reprendre en main les luttes en avançant des "simulacres" de luttes pour finir de démobiliser les ouvriers.
A la confiance dans leur force s'est substituée la confiance dans toutes sortes d'actions légales, d'union interclassiste, de programme de gouvernement, etc.
Ceci s'est confirmé en France. Parvenue à dépasser le moment difficile de mai 68, la bourgeoisie a isolé les luttes les plus fortes -par exemple, la grève SNCF de 69- et a laissé pourrir les grèves radicales et isolées de 71 et 72, pour lancer, en 72, 73, 74 -via les syndicats- les fameux "nouveaux mai", moyen de conjuration pour empêcher qu'une telle situation ne se reproduise.
Depuis 75, on a vu une période de calme maximum, durant laquelle toute perspective fut ramenée au sinistre programme commun de la gauche. Les mystifications syndicales et démocratiques ont affaibli et épuisé momentanément le premier cycle de luttes ouvert dans les années 60. Le grave approfondissement de la crise en 74-75, premier signe clair du caractère décisif et mortel de 1'actuelle dépression économique a trompe complètement les ouvriers démobilisés en produisant une phénomène d'aggravation du reflux de la lutte de classe. "La forte aggravation de la crise à partir de 74 essentiellement marquée par l'explosion du chômage, n'a pas provoqué immédiatement une réponse de la classe. Au contraire, dans la mesure où elle a frappé celle-ci au moment du ressac de la vague précédente, elle a plutôt une tendance à engendrer momentanément un plus grand désarroi et une plus grande apathie". (R.INT. n°13, "Rapport sur la situation mondiale").
L'année 77 a marqué un moment des plus durs du prolétariat. Cette offensive capitaliste a eu d'importantes conséquences anti-ouvrières tant sur le terrain économique que sur le terrain répressif.
1)-Sur le terrain économique, si, jusqu'à 75-76, la bourgeoisie fut extrêmement prudente, lente et progressive dans son attaque économique contre la classe ouvrière, une fois celle-ci relativement démobilisée, la bourgeoisie est passée à une offensive brutale, surtout depuis 77 et 78. Aujourd'hui, on peut faire un bilan qui nous montre une chute significative de la situation de la classe ouvrière :
- les salaires qui, jusqu'à 74, avaient, non sans peine, rattrapé l'inflation, ont brutalement chuté et le phénomène d'une diminution absolue s'est généralisé ;
- le chômage a non seulement pris des proportions quantitativement monstrueuses, mais qualitativement, il touche de plus en plus les grandes concentrations de la production,;
- les cadences qui avaient augmenté d'une manière ininterrompue depuis les années 50 se sont subitement accélérées depuis 3 ans ;
- la journée de travail a augmenté de façon constante sous différentes formes : suppression de certaines fêtes, augmentation des horaires. Les revendications syndicales des "35 heures" sont une manœuvre tactique et temporaire qui n'entrave pas ce processus.;
- une diminution sensible des services de la Sécurité Sociale au niveau qualitatif et quantitatif (augmentation des versements, réduction des remboursements) ;
- les pensions de retraite sont diminuées ;
- les fameuses promesses à propos de l'enseignement gratuit, des logements sociaux, etc. ont disparu.
2) Sur le terrain répressif, la sinistre idéologie "anti-terroriste" déployée jusqu'au paroxysme par la bourgeoisie allemande à propos de la "bande à Baader", par la bourgeoisie italienne à propos du cas "Moro" et espagnole à propos de 1"'ETA", a servi pour :
- renforcer l'appareil de répression policier et juridique,
- créer un climat de terreur et d'insécurité.
Le premier a été destiné à prévenir les affrontements de classe inévitables en dotant l'Etat d'un arsenal gigantesque de répression physique et militaire.
Le deuxième cherchait la terreur et la paralysie au sein des ouvriers.
D'une manière générale, ce renforcement de l'Etat par le biais de 1'"anti-terrorisme" a servi à ce que :
"Avant même que la classe ouvrière, à l'exception d'une toute petite minorité, ait compris l'inéluctabilité de l'affrontement de classes violent avec la bourgeoisie, celle-ci a déjà mis en branle tout un dispo&itif pour y faire face". (Revue Internationale N°13. Page 5)
3-CONDITIONS DE LA REPRISE PROLETARIENNE
Les luttes en Allemagne et aux USA au début de 78, la courte mais néanmoins violente succession de luttes de mai-juin en France, le grand mouvement de classe en Iran, la grève des hôpitaux en Italie la lutte dans la sidérurgie en Allemagne, les grèves en Espagne depuis 79 et les grandes luttes de Longwy-Denain en France, la grève du téléphone au Portugal, tout cet ensemble de mouvements de classe peut-il être interprété comme une éprise effective de la lutte de classe ? Peut-on le voir comme un nouveau jalon dans l'époque révolutionnaire ouverte par les grèves de 68 ?
La prudence est nécessaire. On ne peut se lancer dans une évaluation prématurée. Mais il serait équivoque de se laisser paralyser dans l'indéfini et le possibilisme. Il est nécessaire de prendre position et dire avec clarté dans quel contexte s'inscrivent ces luttes et quelles perspectives elles ouvrent. Mieux vaut une position erronée que la sécurité de positions vagues, éclectiques et attentistes-.
La prise de position claire et décidée comporte des risques mais elle est obligatoire afin que les révolutionnaires accomplissent leurs tâches de facteur actif dans la lutte de classe.
La grande crainte qui peut nous assaillir est : ces mouvements de grève ne sont-ils pas les dernières flammes de la résistance prolétarienne ?
Ce serait du pessimisme que de s'incliner devant cette théorie. La faiblesse qu'ont manifesté ces luttes -leur difficulté très grande encore à s'étendre (sauf la Grande-Bretagne, l'Iran et la France), l'apparent contrôle syndical, le manque, en général, d'apparition de formes d'auto-organisation ... tout cela est utilisé par les pessimistes de tout bord pour nous dire "il n'y a pas de reprise, ce sont simplement les derniers soubresauts".
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de rappeler clairement un point théorique général la direction que prend la lutte du prolétariat ne peut se mesurer à travers ses formes de combats e d'organisation en soi.
Le critère est erroné qui dit : pour leur extension, les grèves actuelles présentent des formes d'organisation et de combat d'un niveau plus bas que celles de 68 ; donc, nous assistons à un recul.
C'est certain qu'au niveau tant qualitatif que quantitatif, les grèves actuelles sont plus faibles que celles de 68, mais il est faux d'en conclure à un recul. L'expérience montre que, quand surgit une avalanche de luttes prolétariennes, elles mettent un certain temps à renouer avec les formes de combat, le contenu et l'organisation maximum des luttes antérieures.
Pour cela, le plus important à voir est le contexte général et social des luttes qui comprend l'évolution de la crise et l'évolution du rapport de forces entre les classes.
L'erreur des autonomes et autres courants qui considèrent les luttes ouvrières en elles-mêmes comme si elles étaient indépendantes de la réalité sociale, oublient que le prolétariat n'est pas dans le capitalisme un être en soi, mais que son action naît d'un ensemble de conditions engendrées par le mouvement général du capitalisme. Son autonomie de classe ne réside pas dans le fait qu'elle serait une classe indépendante des conditions imposées par le capitalisme, mais qu'à l'intérieur de celui-ci, elle s'oppose et se constitue en une force révolutionnaire pour le détruire.
C'est pour cela que nous ne pouvons répondre à la question que nous nous sommes posés dans ce chapitre.que de la façon suivante :
1) en considérant que le reflux de 1973-78 a été un reflux relatif qui n'a pas signifié une défaite décisive du prolétariat mais une phase de calme et de repli laissant présager de nouveaux assauts prolétariens ;
2) en analysant les conditions globales qu'affrontent les luttes (développement de la crise, impact des armes politiques et idéologiques de la bourgeoisie) ;
3) en dressant un bilan des luttes vécues depuis novembre 1978 dans toute l'Europe qui marquent de façon de plus en plus claire la reprise du prolétariat.
Nous allons développer ici le premier et le deuxième point, le troisième fera l'objet du prochain chapitre.
1) Dans AP n° 18, nous expliquions pourquoi le calme social ne pouvait être identifié à une défaite du mouvement :
"Que signifie ce repli? Marque-t-il une défaite définitive du prolétariat ? Y a-t-il changement du cours qui élimine tout espoir de révolution? Une analyse globale et mondiale de la lutte de classe nous permet d’affirmer que nous nous trouvons dans une phase de repli temporaire du prolétariat, mais non face à une défaite décisive qui mettrait fin à la perspective révolutionnaire ouverte dans les années 60 :
1) Le prolétariat n'a subi aucune défaite décisive dans aucun pays. Y compris les défaites partielles les plus importantes comme celles du Chili, de l'Argentine ou du Portugal n'ont pas écrasé les luttes qui devaient ré émerger avec force en 77, surtout en Argentine.
2) La bourgeoisie ne peut se lancer dans une attaque totale et définitive contre le prolétariat, en premier lieu parce que la crise économique n'a pas atteint le niveau extrême qui l'obligerait à imposer une économie de guerre basée sur une austérité draconienne. En second lieu parce que la bourgeoisie s’est davantage efforcée ces dernières années à préparer son attaque, plutôt qu'à la lancer de manière définitive. Pour cela, il n'a toujours pas été livré de bataille décisive entre bourgeoisie et prolétariat.
3) Malgré le reflux dans les pays du centre du capitalisme, la lutte prolétarienne s'est développée avec force dans les pays périphériques. Malgré leurs faiblesses, ces luttes sont d'une grande importance pour le prolétariat mondial :
- en démontrant que, dans les pays où l'exploitation a atteint des limites extrêmes, le prolétariat est loin de tout accepter et de se sacrifier ;
- en Algérie, au Maroc, Egypte ou Israël, les grèves ont momentanément freiné la guerre impérialiste ;
- enfin, elles ont contribué à la prise de conscience des bases objectives de l'unité mondiale de la classe ;
4) Même en Europe, malgré le contexte général de calme, de fortes luttes ont surgi "quoique isolées" et sporadiques, chacune est importante comme celles d'Espagne et de Pologne 76... Les grèves qui ont commencé en Allemagne et celles des USA (mineurs) ont également une valeur". (Accion Proletaria N°18)
Un des signes qui montre de manière concluante le caractère relatif du reflux prolétarien est le résultat limité et les faibles impacts qu'ont eu les forces de gauche au sein du prolétariat. Si 1 'on compare avec les années 30, on ne peut que constater des différences absidales. A cette époque, et de manière pratiquement majoritaire, la gauche et les syndicats sont parvenus à mobiliser l'enthousiasme et l'adhésion volontaire des ouvriers derrière la politique criminelle de l'an-ti-fascisme, le front populaire, la défense de la démocratie, etc.
Aujourd'hui, de tels cauchemars paraissent être exclus de l'histoire. La gauche et les syndicats se sont imposés non avec l'enthousiasme et l'adhésion consciente des prolétaires, mais par manque de perspectives et parce qu'ils n'ont rien d'autre en vue. Cela signifie deux choses :
a) une base très précaire pour le contrôle de la gauche et des syndicats sur le prolétariat,
b) que nous sommes loin d'une période de défaite du prolétariat qui est la base matérielle de l'atomisation et de la "débandade" dont la conséquence est l'adhésion désespérée au programme de la bourgeoisie.
D'une manière générale, on peut dire que la classe suit les propositions syndicales et de gauche sans grande confiance, sans trop se faire d'illusions et comme un moindre mal.
Ceci est positif à condition de se transformer ensuite en un progrès de la lutte et de la prise de conscience. A ce propos, on peut voir que le grand "lavage de cerveau" qu'ont constitué les élections en France en mars 78, loin d'avoir intimidé, a impulsé les explosions de luttes de mai-juin 78. Avec la prudence nécessaire, on peut dire que le grand mythe de l'union de la gauche et du programme commun est mort plus vite que prévu.
Parallèlement à ce qui précède, il faut noter que, dans une période de reflux, la lente maturation de la conscience de classe se poursuit. On n'a pas vu disparaître les noyaux ouvriers, les cercles de discussions, les groupes d'action; quoique dispersés et très confus, ils ont exprimé un effort de conscience du prolétariat. De la même manière, les relativement fréquentes "crises des militants à la base" de plusieurs groupes gauchistes et même des centrales syndicales ont révélé une tendance contradictoire mais réelle à 1'éloignement de fractions du prolétariat du contrôle idéologique de la bourgeoisie. Y compris dans certains groupes gauchistes s'est développée une crise idéologique à l'issue de laquelle de petites fractions sont sorties, avec plus ou moins de résultats pour tenter de rejoindre des positions révolutionnaires.
Enfin, les groupes révolutionnaires, expression la plus avancée de la conscience de classe, se sont développés, ont retrouvé leurs forces, ont fortifié leurs positions programmatiques et ont étendu le terrain et l'impact de leur intervention. Quoiqu'ils manifestent encore de grandes faiblesses et quoiqu'ils soient encore ultra-minoritaires, leur progression est un témoignage clair des progrès de la conscience de classe.
Comme Marx l'a dit, la conscience de classe est comme une taupe qui, lentement, dans le sous-sol de la société, ronge les fondements politiques et idéologiques de la bourgeoisie, on perçoit son souffle mais elle tarde à sortir en plein jour. Son existence n'en est pas moins indiscutable. Dans les périodes de calme social, il y a une sombre apparence de passivité, d'apathie, d'hésitation dans les rangs ouvriers. La bourgeoisie, classe basée sur l'échange, et, par conséquent, spectatrice et active par nature, donne une impression de domination, de contrôle de la société, ce qui ne correspond pas à la réalité. A la base, chez les exploités, les doutes, le manque de confiance et les intuitions sont toujours présents.
Des événements plus significatifs, des luttes ouvrières plus décidées et l'activité des révolutionnaires vont transformer ces entraves en certitudes, conclusions, programmes d'action. Tôt ou tard, l'édifice monolithique de l'ordre bourgeois vacillera sous une nouvelle avalanche de luttes prolétariennes.
Voilà un début de réponse à la première question que nous nous posions. Une conclusion se dessine : le reflux est momentané. Les embryons de lutte et de conscience qui lui ont répondu permettent de supposer sa disparition et un nouvel assaut prolétarien.
2) Répondons maintenant à la deuxième question.
Nous avons assisté depuis 1974-75 à une aggravation importante de la crise capitaliste. Les illusions de la soi-disant reprise de 75 ont donné lieu à une augmentation explosive du chômage et à une dégradation générale du niveau de vie des ouvriers, le chômage a atteint des branches clés de la production, la sidérurgie, les arsenaux, le textile, la métallurgie... et a entraîné les pays principaux Allemagne, France, USA. Il a cessé d'être réservé à des secteurs marginaux ou périphériques de la classe ouvrière -ce qui empêchait celle-ci de prendre conscience de sa gravité- pour attaquer les grandes concentrations du prolétariat, les centres vitaux de la classe.
Cette avance de la crise est un des facteurs fondamentaux de la lutte de classe. Elle ouvre les yeux à la nécessité de se défendre, et mine le fondement des promesses, programmes et solutions que nous assène continuellement la classe dominante
Mais, est-ce la crise, en elle-même, qui est la condition suffisante pour 1 'explosion de la lutte de classe ?
Non ! La crise détermine un ensemble de convulsions de tout l'ordre bourgeois et la révolte de la classe ouvrière, mais il est nécessaire de savoir à quel niveau est arrivée cette convulsion de l'ordre social et quel est le degré d'autonomie du prolétariat.
Une deuxième condition pour la lutte de classe est la crise politique de la classe dominante. Par principe général, la bourgeoisie n'est pas et ne sera jamais une classe avec des intérêts unitaires ; son intérêt d'ensemble -l'exploitation de l'ouvrier- engendre une lutte constante pour la répartition de la plus-value : la bourgeoisie est divisée en mille intérêts particuliers, déchirée par des heurts entre ses diverses fractions. La tendance générale vers le capitalisme d'Etat propre à la période décadente du système n'a pas unifié, ni homogénéisé la bourgeoisie, éliminé ses conflits internes, au contraire, elle les a amplifiés, elle leur a donné une caisse de résonance plus vaste avec des implications dans tous les domaines de l'activité sociale de l'Etat.
En réalité, les conflits internes, du capital pouvaient être atténués et limités pendant que le système était en expansion vers des aires non capitalistes, développant ses tendances innées vers la socialisation, et l'universalisation des marchandises. Mais, quand ce processus atteint les limites objectives -début du 20ème siècle, décadence- et quand les conflits internes de la bourgeoisie se multiplient et se radicalisent, le capitalisme d'Etat apparaît dans ce contexte comme une tentative désespérée pour les limiter, à travers une concentration nationale forcée du capital, qui, loin d'y arriver, même s'il y arrive momentanément- les amplifie, ou les retarde uniquement pour les aggraver.
Le développement accentué des conflits internes de la bourgeoisie s'exprime dans ses constantes crises politiques qui convulsionnent son appareil gouvernemental, ce qui signifie :
1) l'affaiblissement de la force et de la cohésion de l'Etat qui voit diminuer son autorité, surtout sur les exploités;
2) la désunion et la dispersion de la bourgeoisie, mettant en évidence les divisions et contradictions qui la désagrègent;
3) la viabilité et la cohérence des programmes et alternatives du gouvernement de la bourgeoisie restent enfermées dans des compromis et arrangements visant la conciliation de divergences de plus en plus insurmontables ;
4) l'impact des mystifications anti-prolétariennes est ébranlé à sa base par les intérêts en conflit, les manœuvres, les sales combines qui annulent leur crédibilité. La crise politique de la bourgeoisie, conséquence générale de la crise historique du capital, facilite le surgissement de la lutte de classe, étant donné qu'elle :
- démontre l'incapacité de la bourgeoisie de "gouverner comme avant",
- rompt la peur et la passivité des ouvriers,
- prouve la faiblesse et le manque d'autorité de la bourgeoisie, et anime, pour autant, la lutte contre elle.
La deuxième condition de la lutte de classe, la crise politique du capital, est un facteur nécessaire mais non suffisant, il manque la troisième condition : le propre développement préalable de la lutte prolétarienne, son rapport de force avec la bourgeoisie.
Si le prolétariat est préalablement défait et est complètement atomisé et aplati, ni le développement de la crise économique, ni la crise politique de la bourgeoisie ne peuvent aider à la lutte de classe ; au contraire, ils se convertissent en un moyen de dévoiement et d'annihilation de la lutte.
Un prolétariat écrasé et atomisé reçoit la crise économique comme un mobile de plus de démoralisation et de déroute. La crise se convertit en un facteur aggravant de sa dégradation et de sa désagrégation comme cela s'est passé pendant la crise de 29.
Par contre, un prolétariat en développement, qui n'a pas été défait, et dont les expériences sont récentes, reçoit la crise comme un élément d'indignation et de compréhension de la misère de l'ordre bourgeois, de détermination à la lutte. La crise se transforme en un facteur de mobilisation et de combat, comme cela s'est passé, jusqu'à un certain point, dans la crise révolutionnaire de 17. De la même façon, si le prolétariat se présente défait et atomisé, les crises politiques du capital, loin de réveiller sa conscience, sont utilisées par la classe dominante pour 1'encadrer et le mystifier par une des fractions du capital en conflit. Les années 30 ont vu comment le prolétariat était transformé en chair à canon dans les luttes internes de la bourgeoisie a travers les "fronts populaires", le "socialisme dans un seul pays" ou la "défense de la démocratie contre le fascisme". C'est précisément cet encadrement complet du prolétariat qui a permis la limitation des conflits entre les diverses fractions bourgeoises. Mais, au contraire, les tendances non écrasées du prolétariat vers son indépendance politique et son unité de classe qui peuvent être en recul, et pouvaient donner l'impression d'avoir disparu, s'accentuent devant la crise politique de la bourgeoisie, se transformant en un facteur de révolte et de désobéissance, d'absence de prestige de la classe dominante, d'animation de la lutte et de recherche des alternatives prolétariennes.
Nous disions que trois grandes mystifications ont réussi à immobiliser le prolétariat et à freiner son offensive de lutte dans les années 68. Ces mystifications sont :
- la gauche au pouvoir,
- la solution nationale à la crise,
- l'idéologie démocratique et anti-terroriste.
Aujourd'hui, nous pouvons voir que tous les aspects combinés de la crise, des convulsions politiques de la bourgeoisie et la non-défaite du prolétariat, font que le poids de ces mystifications va en se réduisant, et lentement apparaissent les conditions pour que le prolétariat s'en 1ibère.
Dans toute une série de pays, la solution "gouvernement de gauche", comme formule d'encadrement et de mystifications du prolétariat est, au moins, momentanément très usée. Nous ne doutons pas que. la bourgeoisie peut la revivifier sous de nouveaux habits, et dans les pays où il y avait peu d'expérience d'une telle solution (en Espagne par ex.) où ceux où la gauche réalise une ample "cure d'opposition" (au Portugal par ex.), elle peut encore être ressortie avec un certain succès. Mais ce qui est hors de doute, est que "l'union de la gauche" a perdu beaucoup de crédibilité à travers toute une série d'échecs :
- En France : l'échec du programme, commun a porté un très fort coup aux illusions sur 1'électoralisme, et sur son caractère "ouvrier" et "progressiste" qui se maintenait dans la classe. Nous ne croyons pas que, au moins immédiatement, la cure d'opposition du PCF sur des bases ultranationalistes puisse avoir une force de mobilisation.
- En Angleterre : deux gouvernements travaillistes en douze ans liés à de durs blocages de salaire et à des mesures anti-ouvrières de tous types, commencent à détériorer la confiance dans le travaillisme. La solution de rechange -la gauche travailliste- n'offre pas, au moins pour le moment, une perspective claire.
" En Allemagne : dix ans de social-démocratie ont déprécié, lentement mais effectivement, les alternatives de gauche ; ses mesures "anti-terroristes" ses attaques de la condition ouvrière et l'impact des luttes ouvrières de 1^78 et 79, sont allées en affaiblissant son influence sociale.
De façon globale, deux grands faits minent la crédibilité des alternatives de gauche vis-à-vis de la classe ouvrière :
a) le discrédit progressif des cirques électoraux,
b) les besoins qu'impose à la gauche la crise politique générale de la bourgeoisie.
Le parlement et les élections ont récupéré leur attraction de façon relative entre 72 et 78. Devant un développement non encore décisif de la crise, devant la nécessité d'alternatives globales et politiques, il y eut une certaine renaissance de la confiance dans 1'électoralisme chez les ouvriers. L'expression la plus claire de cela était le programme commun de la gauche française. Son écroulement rapide et son échec ultérieur sont précisément les signes d'un changement de tendance et du développement au sein de la classe ouvrière de la compréhension du caractère mystificateur et anti prolétarien du parlementarisme et de l'électoralisme. Nous pouvons voir une certaine confirmation encore non absolue, de cette tendance dans le développement des abstentions enregistrées dans les élections espagnoles.
Il y a un deuxième facteur qui a miné le prestige de la gauche dans les rangs ouvriers : c'est la politique qu'elle s'est vue obligée de mener devant le développement des conflits internes de la bourgeoisie, tant /au niveau mondial qu'à l'intérieur de chaque pays.
Au niveau mondial, l'alignement inévitable des pays centraux du capitalisme à l'intérieur du bloc occidental a privé les PC d'un puissant mobile de mystification de la classe ouvrière : le mythe de "pays socialistes" et son corollaire, le "socialisme dans un seul pays" qui a fait tant de mal à la classe ouvrière.
Le fameux "eurocommunisme" qui s'était cristallisé dans l'abandon de la "dictature du prolétariat", de "1’internationalisme prolétarien" et autres paravents idéologiques, s'est retrouvé, comme nous l'avons montré dans d1autres textes du CCI, par le fait que les PC sont les représentants les plus fidèles du capital national comme un tout, devant la nécessité -l'unique option possible à moyen terme étant, dans la majorité des pays du centre, le bloc américain- de prendre plus ou moins fortement leurs distances avec le bloc russe. Tout cela les a obligés à un changement de langage! Mais ce changement de langage avait des conséquences de plus en plus importantes en ce qui concerne l'encadrement du prolétariat, vu que les nouveaux thèmes qui remplacent les anciens manque de force combative et de contenu concret. "Socialisme dans la liberté", "consolidation et approfondissement de la démocratie", "union nationale" ont un poids mystificateur très inférieur à "socialisme dans un seul pays", "dictature du prolétariat" ou "internationalisme prolétarien", face à l'avance de la crise et au développement de la lutte de classe.
Au niveau des conflits internes de la bourgeoisie de chaque pays, les obligations de maintenir à tout prix la cohésion du capital national ont contrainte la gauche à faire des "concessions" aux secteurs plus retardés ou plus liés aux intérêts particuliers du capital national. Ces concessions ont impliqué dans la gauche un langage plus "conciliateur" et moins de "luttes de classe", et a débilité ses vieux slogans mystificateurs ("capitalisme d'Etat = socialisme", "droite = capitalisme") et a amené, de plus, la gauche à améliorer ses relations avec l'Eglise, l'armée, les "fascistes" et toutes sortes de fractions et institutions du capitalisme plus ouvertement contre-révolutionnaires. Tout cela prive la gauche de son langage "retentissant" et de "dénonciation", perdant lentement la cohérence et la solidité de ses vieux engrenages mystificateurs.
On commence à observer un changement, avant tout au niveau des positions qui lui permet de se donner un langage "ouvrier combatif", essentiellement destiné à encadrer et mobiliser idéologiquement le prolétariat. Cependant, il n'y a pas lieu d'exagérer les possibilités de succès de ce mouvement/ malgré l'énorme "enthousiasme" avec lequel le reçoivent les gauchistes. La gauche se voit déchirée entre :
- d'un côté, son poids, chaque fois plus important au sein du capital national, dû essentiellement au développement de la crise, et la tendance au capitalisme d'Etat, ce qui l'oblige à de plus grands compromis, directs ou non, avec le gouvernement du capital national qui, nécessairement, la pousse à une politique "modérée", "conciliatrice", "eurocommuniste" ou. de "solidarité nationale" ;
- mais, d'un autre côté, la nécessité d'encadrer et de mystifier le prolétariat les oblige à une cure d'opposition et à un langage combatif, tout cela dans le contexte général d'une très forte usure de tous ces vieux thèmes de mystifications des années 30.
Les équilibres et les virages auxquels se voient contraints les partis de gauche rendent de plus en plus difficile leur impact mystificateur dans la classe, et plus encore, si la lutte de classe tend à se développer.
Il est démontré que toute mystification ne se fait pas dans le vide, n'est pas comme une drogue qui s'administre à volonté ; au contraire, pour s'imposer dans la classe ouvrière, la mystification doit se fonder sur des nécessités et des problèmes réels auxquels elle donne une interprétation, une version, une alternative totalement idéaliste, dans le cadre du camp bourgeois. Ce sont précisément toutes les analyses faites précédemment qui nous permettent de voir que peu à peu vont s'écroulant les bases matérielles des mythes "gouvernements de gauche", "union des partis ouvriers" qui sont d'importantes colonnes de l'ordre bourgeois contre la classe ouvrière.
Le grand mythe de la possibilité d'une solution nationale à la crise a été l'arme la plus forte pour :
- empêcher la lutte indépendante du prolétariat,
- inculquer dans ses rangs la nécessité du sacrifice et de l'austérité.
La base matérielle d'une telle mystification, nous l'avons vue dans le chapitre antérieur : le rythme lent et inégal de la crise selon les pays. Cependant, ce rythme lent et inégal de la crise est en train de disparaître. L'importante accélération de 74/75 a cédé le pas à un effondrement pur et simple sans perspective visible de récupération alors même que se développent les conditions de nouvelle aggravation de la crise.
En premier lieu, ces accélérations et cet effondrement pur et simple effacent les illusions et les espoirs potentiels que beaucoup d'ouvriers peuvent avoir ; devant eux, l'horizon est toujours plus noir, et ils comprennent de plus en plus que l'unique perspective qu'offre le capitalisme est une réédition, en pire, des temps de la 2ème guerre mondiale et de 1'après-guerre de nos aines, à qui on avait justement dit que ces maux étaient la promesse d'une éternelle prospérité.
En deuxième lieu, les ouvriers des pays, régions ou entreprises les plus prospères voient tomber leur niveau de vie au même niveau, ou presque, que celui de leurs camarades moins fortunés. Nous avançons vers une égalisation de la misère des ouvriers de tous les pays, entreprises et régions. C'est une tendance qui s'affirme de plus en plus et qui enlève toute base réelle aux mystifications de solutions nationales, régionales, techniques, d'étatisation, etc. Au contraire, se développent les conditions générales pour l'unification et l'internationalisation des luttes.
L'internationalisation effective des luttes est un des faits les plus marquants de la vague de combativité ouvrière dans les pays du centre -vague encore faible et limitée- que nous analyserons dans le chapitre IV.
Troisième grand axe de l'offensive idéologique du capital contre le prolétariat, la mystification démocratique et anti-terroriste perd lentement de son impact anti-prolétarien. C'est en Allemagne, en 77, que se sont produits les moments les plus historiques de la campagne anti-terroriste du capital, et où celle-ci est passée de l'intoxication idéologique à la mobilisation politique concrète des ouvriers. Il y a eu des grèves en signal de deuil pour la mort du patron Schleyer. Les grèves devaient être réduites à des actions symboliques d'une à cinq minutes par les ouvriers; comme l'ont signalé nos camarades allemands, les ouvriers en ont profité pour bavarder ou fumer une cigarette. Quelques mois plus tard, se sont produites les grèves de janvier-avril 78 qui ont révélé que les "poisons" anti-terroristes avaient eu un impact bien moindre que ce qu'on attendait. En Italie, les moments les plus intenses de la campagne anti-terroriste ; se situent pendant la séquestration d'Aldo Moro en avril 78. Les camarades italiens ont signalé le même phénomène : passivité des ouvriers devant les appels à la grève et aux manifestations, développement de la conscience de classe, sous la forme de cercles ouvriers qui prennent leurs distances aussi bien vis-à-vis de l'idéologie anti-terroriste que du mythe "ouvrier combatif" = "ouvrier armé", etc. La grande grève des hôpitaux d'octobre 78 a justement été un signe prometteur de reprise prolétarienne en Italie. En Espagne, la gigantesque campagne anti-terroriste déployée par tout l'Etat bourgeois, racine des prouesses de l'ETA, a enregistré une retentissante banqueroute politique, annoncé la faillite du référendum constitutionnel et des élections législatives. Ainsi, la manifestation convoquée après une campagne hystérique par les CO, 1'UGT, etc. eut une faible participation, et il n'y eut pas moyen d'organiser des grèves, des assemblées... L'échec relatif, au moins momentanément, de l'idéologie démocratique et anti-terroriste n'est rien d'autre que le fruit de l'évidente décomposition de l'idéologie bourgeoise et, par suite, du caractère gangster et de racket que prennent tous les affrontements internes à la bourgeoisie. Les luttes intestines ne peuvent plus, ainsi, se présenter aussi facilement qu'avant sous les habits d'un grand idéal moral capable de mobiliser le prolétariat et l'ensemble de la population.
En ce qui concerne ce troisième point, l'emploi de nouvelles mystifications partielles aura une importance capitale comme nous venons de le voir, en combinant mystification et répression. Un des plus importants problèmes qu'affronte la bourgeoisie est la recrudescence du choc prolétariat-syndicats.
Après avoir récupéré l'initiative entre 1972-78, le bastion syndical de la bourgeoisie parait entrer de nouveau dans une période d'usure et d'affrontement violent avec les ouvriers. Les indices visibles dans la grève des hôpitaux en Italie, commencent à se retrouver, encore très partiellement et très faiblement en France, en Angleterre, en Espagne, etc. Les syndicats ont-ils des bases nouvelles pour s'affronter idéologiquement au prolétariat ?
Comme en général ses mères-partis, les syndicats réalisent des cures d'opposition dans un grand nombre de pays. De telles cures d'opposition leur permettent de récupérer leur image de marque "combative" et "ouvrière", laquelle va leur donner durant un certain temps une capacité pour prendre la tête des mouvements de grèves et les utiliser, avec plus ou moins de succès. Même s'ils ne peuvent rompre les mouvements les plus radicaux, ils tenteront, au moins, et par tous les moyens, de maintenir l'idée que les syndicats sont à la queue des luttes, mais qu'ils sont avec elles. Un mythe oui peut, prendre force est que syndicats et assemblées ou conseils ouvriers ne sont pas incompatibles.
Une autre tendance qui commence à se dégager est la distance qu'ils prennent par rapport aux partis et à la politique. Les courants du syndicalisme "révolutionnaire" et de 1'"anarcho-syndicalisme" peuvent reprendre une certaine splendeur, comme dernier effort de l'appareil syndical, pour récupérer son ancienne force. La renaissance de la CNT ou de la USI en Italie n'est nullement un mouvement vers des positions prolétariennes du syndicalisme, mais un replâtrage de l'édifice syndical du capital pour mieux affronter le prolétariat.
Finalement, les tendances vers un syndicat unique sont aujourd'hui un autre élément qui, bien que très usé, commencent à se présenter comme "garantie" d'un syndicalisme "efficace" et "combatif".
Aussi pouvons-nous dire que nous assistons non seulement à la déroute des mystifications bourgeoises qui ont coupé momentanément la renaissance prolétarienne de 1965-72, mais encore, à un niveau historique, que nous assistons à un début d'effondrement de tous les mythes de 50 années de contre-révolution ; nous ne pouvons pas dire que le poids de tant de campagnes de tromperies peut disparaître sans laisser de traces du jour au lendemain. Au contraire, leurs effets pernicieux vont se maintenir encore au sein du prolétariat. Les idéologies et les mystifications naissent de relations capitalistes de production, aussi, -provenant de ces dernières-, elles se convertissent en un facteur actif de conservation et de défense du régime de telle sorte qu'elles acquièrent un certain degré d'autonomie relative, laquelle leur permet de survivre durant un certain temps et à des niveaux déterminés, à l'ébranlement des conditions sociales qui les ont engendrées et les ont rendues possibles.
De là le poids de l'intense "lavage de cerveau" de ces dernières années d'offensive idéologique de la bourgeoisie et tous les reflets théoriques et idéologiques liés aux 50 années de contre-révolutions qui vont être encore très forts et mineront la base, la puissance de beaucoup de luttes ouvrières:
"Les hommes font leur propre histoire mais ils ne la font pas arbitrairement dans les conditions choisies par eux, mais dans les conditions directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur les cerveaux des vivants. Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, à créer quelque-chose de tout-à-fait nouveau, c'est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu'ils évoquent craintivement les esprits du passé, qu'ils leur empruntent leurs noms, leurs mots d'ordre, leur contenu, pour apparaître sur la nouvelle scène de l'histoire sous ce déguisement respectable et avec ce langage emprunté". (Marx, "Le 18 Brumaire")
Les effets de ces "générations mortes" vont être considérables et vont peser très lourdement dans le renouvellement prolétarien, effets qui s'usent aujourd'hui très lentement :
- pendant un certain temps, le décalage entre la gravité de la crise et la force de la réponse prolétarienne continuera,
- il y aura encore un puissant décalage entre la force objective du 'mouvement et la conscience de cette force,
- le décalage plus grand que par le passé entre les dimensions et la force des organisations révolutionnaires et la maturation des conditions pour la révolution continuera également.
Mais nous ne devons pas perdre de vue que toutes les contre-tendances que nous venons de signaler n'annulent pas le cours général vers une nouvelle tentative de révolution prolétarienne mondiale ouverte dans les années 60. Plus encore, la reconnaissance consciente et globale de tous les dangers, risques et faiblesses, qu'affronte notre classe doit être la base matérielle pour les affronter et les éliminer.
Une autre conséquence à tirer du constat du poids des "générations mortes" est que, non seulement nous le souffrirons jusqu'au bout dans les tentatives du renouement prolétarien qui mûrit aujourd'hui mais surtout qu'il sera un facteur puissant et négatif dans une période d'insurrection et de révolution. Ce poids des "générations du passé" fondera la base matérielle de toutes les forces qui tenteront de dévier, diviser, miner et affaiblir la révolution prolétarienne. Ces forces constitueront la 5ême colonne du capital contre le prolétariat révolutionnaire.
De là, la chute lente que nous voyons aujourd'hui de l'idéologie et des mystifications bourgeoises, ne rend pas inutile et superflu sa dénonciation la plus intransigeante, patiente, tenace et détaillée ; aujourd'hui, comme hier, 1'arme de la critique continue d'être la préparation nécessaire pour la critique par les armes du criminel ordre capitaliste.
4-BILAN DES DERNIERES LUTTES
Avant de définir les perspectives qui ressortent de l'ensemble des conditions analysées, il serait nécessaire de faire un bilan des vagues prolétariennes d'Octobre-Novembre 1978 et de Janvier-Mars 1979 qui motivent sa considération comme indices d'un renouement général de la lutte de classe. Ce bilan ne peut-être que provisoire et limité étant donné qu'il nous manque un recul suffisant et que beaucoup de ces luttes ne sont pas encore terminées. Les leçons les plus importantes à tirer sont :
1) La première et principale : 1'internationalisation objective des luttes.
Grèves d'importance relative, bien sûr, mais dont certaines, comme celle d'Angleterre, ont secoué simultanément les pays centraux du capitalisme : Angleterre, France, Allemagne, Espagne, Italie, USA. D'autre part, la réémergence du prolétariat des pays centraux s'est vue accompagnée par la continuation des luttes dans des pays périphériques : Iran, Maroc, Mexique, Arabie Saoudite, Zaïre, Polynésie, Jamaïque... qui sont les exemples les plus récents. Cristallisant la reconnaissance de cette internationalisation par la classe, nous voyons comment en Belgique et au Luxembourg, eurent lieu des grèves de solidarité avec les sidérurgistes en Lorraine. Sans être la manifestation la plus adéquate de la solidarité internationale du prolétariat, elle en est pour le moins une tentative très importante. Il y a une leçon générale .de cette internationalisation : l'agitation internationaliste, la défense de l'internationalisme vont reposer chaque fois plus sur des expériences et des faits concrets relativement immédiats, cessant d'être des questions "théoriques" ou lointaines comme elles apparaissaient jusqu'à présent.
Nous disions dans le rapport sur la situation mondiale de Janvier 1978 qu'une des manifestations du prochain resurgissement prolétarien devrait être : "Une plus ample conscience du caractère international de la lutte qui pourrait se traduire dans la pratique par des mouvements de solidarité internationale, de l'envoi de délégations d'ouvriers en lutte d'un pays à un autre (et non des délégations syndicales)".(Revue Internationale N°13.) Jusqu'à un certain point et encore avec beaucoup de limites, cette tendance commence à se dessiner à l'horizon.
2) Reprise de l'affrontement ouvert prolétariat-syndicats
L'appareil syndical très fustigé par les coups de la première vague prolétarienne des années 60, a pu refaire son image de marque, profitant avec adresse des faiblesses de cette vague prolétarienne et restaurer un contrôle assez fort sur les ouvriers à partir de 1972.
Des dernières luttes, nous pouvons dire : petites mais pleines de promesses.
- des luttes extra-syndicales apparaissent.
- l'initiative autonome des ouvriers réapparaît sans attendre l'invitation syndicale.
- des chocs frontaux commencent à apparaître entre prolétariat et syndicats.
Ces trois tendances, évidemment liées entre elles, sont minoritaires dans l'ensemble des luttes, mais /par l'exemple qu'elles supposent, par la force ; qu'elles ont prises et par la dynamique qu'elles M paraissent ouvrir, leur poids qualitatif est très supérieur à leur faible poids numérique, La rupture et l'affrontement du prolétariat avec les syndicats vont être un processus très pénible et, jusqu'à un certain point et durant toute une période vont se convertir en l'axe central de la bataille de classe.
Nous disions que ce processus va être pénible parce que les syndicats sont, comme on le sait, le principal bastion de l'ordre bourgeois contre la classe ouvrière, et leurs armes de tromperie et contrôle tendent à être des plus raffinées, de telle sorte que les syndicats qu'affronte aujourd'hui la classe ouvrière ne sont pas les mêmes que ceux des années 50. Leur arsenal de mystifications et leur machinerie de contrôle sont de loin supérieurs et beaucoup plus rôdas. Pour cela, la rupture sera beaucoup plus difficile et pénible mais aussi beaucoup plus décisive parce qu'elle aura un caractère complètement politique et révolutionnaire sans les ambiguïtés et paliers du passé. Si dans les luttes des années 60, le potentiel politique de la rupture avec le syndicalisme a pu être camouflé et dévié par les mythes de la "dé bureaucratisation" ou de "l'unité syndicale", aujourd'hui ces mythes commencent à se rompre et il devient beaucoup plus difficile d'enrober le choc frontal de la classe. Si dans les luttes les plus radicales et avancées, la rupture totale, absolue et sans ambiguïtés entre les grévistes et les syndicats est vitale, il ne faut pas prendre seulement le fait formel de cette rupture comme thermomètre pour mesurer la force et la répercussion de chaque lutte concrète.
Dans la majorité des cas, la rupture tendra à se donner une corrélation des forces prolétariat-syndicats qui se cristallisant de diverses manières au niveau formel, représentera le devenir et les 1imites de la lutte. Dans le pire des cas, ce sera les organismes syndicaux qui s'imposeront, ce qui signifierait l'effondrement de toute perspective immédiate de la lutte; dans le meilleur des cas, ce sera le triomphe des Comités de grèves ouvriers, ce qui ouvrira une dynamique de la radicalisation de la lutte.
Les révolutionnaires devront se battre dès le début pour que la grève s'organise dans des Assemblées, pour qu’elles soient réellement souveraines et pour qu'il y ait aucune ambiguïté dans la rupture et l'affrontement avec les syndicats. Cela ne veut pas dire que la dimension, conséquences et perspectives d'une lutte ait à se mesurer exclusivement par la forme concrète dans laquelle elle a cristallisé à un moment donné la relation de force prolétariat-syndicats.
Le danger de la simple revendication des formes, sans se fonder suffisamment avec son lien, du contenu, peut donner une base à une nouvelle tromperie bourgeoise que nous pourrons apercevoir dans le futur :"création de Comités antisyndicaux" basés sur des "Assemblées" mais avec des fonctions identiques aux syndicats. En réalité, avec ces mythes, on essaiera non seulement de s'opposer aux luttes, mais encore et surtout, de limiter leur portée, de bloquer leur développement et de dévier leur contenu en posant des formes extra-syndicales en soi.
Dans le rapport sur la situation mondiale, nous avons vu une deuxième condition de la future reprise prolétarienne en:
"Un débordement des syndicats beaucoup plus clair que dans le passé et son corollaire: la tendance vers une plus ample auto-organisation de la classe ouvrière (Assemblées générales souveraines, instauration de Comités de grève élus et révocables, coordination de ceux-ci entre les entreprises de la même ville, région, etc...)".(Revue Internationale N°13.)Avec cela, nous avons commencé et il reste encore beaucoup de travail sur la planche et beaucoup de mystifications à affronter.
3) Toutes les luttes ont constitué un affrontement du prolétariat au plan d'austérité du capital,-base matérielle de leur internationalisme objectif.
Pour cela ces luttes sont un début prometteur de la résistance prolétarienne contre les tendances à l'austérité et à la guerre impérialiste que porte en lui le capitalisme et posent déjà les bases de la transformation de l'actuelle aggravation de la crise capitaliste en une crise révolutionnaire.
Il reste démontré une chose que les années de calme social ont quelque peu estompé, c'est que la lutte prolétarienne contre l'austérité est possible, qu'elle peut donner des fruits même s'ils sont temporaires et que le remède prolétarien à la crise n'est pas d'accepter des sacrifices ni de limiter les revendications pour "réduire le chômage" sinon la lutte de classe.
4) Certaines luttes vécues ces derniers temps ont posé le fait que le prolétariat est le candidat historique à l'émancipation de toute l'humanité.
L'Iran a démontré que la lutte prolétarienne donne un biais complètement distinct, incontrôlable à la révolte sans perspective des marginaux, paysans pauvres et petite bourgeoisie paupérisés. L'Iran a posé une possibilité, un potentiel qu'enferme le prolétariat, indépendamment du fait qu'en Iran, cela ne pouvait être complètement obtenu. Ce vieux principe du mouvement ouvrier -le prolétariat est l'unique classe capable de s'émanciper et émanciper toute l'humanité- prend une réalité et devient un problème concret maintenant. Après 50 ans de contre-révolution cette fameuse phrase de Lénine redevient réalité :
"La force du prolétariat dans un pays capitaliste est infiniment supérieure à sa valeur numérique dans la population'.' Et c'est ainsi, parce que le prolétariat occupe une position clé dans le cœur de l'économie capitaliste et aussi, parce qu'il exprime dans le domaine économique et politique, les intérêts réels de l'immense majorité de la population laborieuse sous la domination capitaliste. Durant la grève des hôpitaux en Italie, les travailleurs portaient une pancarte qui disait : "Nous n'allons pas contre les malades, nous allons contre les syndicats, le patronat et le gouvernement"(souligné par nous). Cette préoccupation du prolétariat de gagner ou faire valoir sa lutte auprès de l'ensemble des couches opprimées et non exploiteuses est un indice prometteur de la maturation générale de la conscience de la classe. C'est même plus que cela, c'est la prise de conscience d'un problème qui va se poser en se répétant dans le futur. La bourgeoisie est consciente que le mouvement du prolétariat peut, se convertir en un détonateur du mécontentement des diverses couches de la population; elle est consciente que l'intervention du prolétariat peut donner un caractère incontestable aux protestations des couches opprimées; elle est consciente en définitive, que le mécontentement des couche opprimées peut être gagné au bénéfice de la révolution par le prolétariat. Pour tout cela, un des axes essentiels de la bourgeoisie est, et sera de neutraliser ces couches marginales, les isoler, les séparer politiquement du prolétariat et, si c'est possible, les lancer contre lui.
En Angleterre, la bourgeoisie a monté une campagne hystérique autour des grèves des camionneurs et des services publics. Elle a. monté des manifestations de ménagères et a organisé des piquets de "citoyens" contre les piquets de grève des ouvriers, "but l'axe de la campagne a été de réveiller les sentiments petit-bourgeois, les paranoïas de ces couches pour les utiliser contre le prolétariat. Les erreurs qui se sont fait jour, parfois dans les groupes révolutionnaires, de voir ces couches uniquement comme des ennemies du prolétariat, doivent être éliminées. En soi, ces couches sont vacillantes, elles tendent à la décomposition et à la prolétarisation; en soi, ces couches n'ont pas de volonté propre. Si la bourgeoisie parvient à utiliser les caractères réactionnaires et le devenir de leurs conditions derrière des programmes loufoques, de capitalismes "non monopolistes" etc.. alors elles seront canalisées contre le prolétariat. Mais si le prolétariat, sans céder un pouce à des programmes au "bénéfice" de la petite bourgeoisie lutte de façon autonome en leur faisant voir concrètement l'absence d'alternative à leur situation sans devenir et vouée à la décomposition, alors, il pourra les gagner dans une lutte contre le capital.
Cette perspective n'enlève rien à l'autonomie de classe du prolétariat et c'est la solution concrète contre les mystifications que la bourgeoisie lancera très souvent dans le futur :
- le prolétariat ne doit pas dans sa lutte porter "préjudice" au peuple.
- le prolétariat doit lutter pour le triomphe du peuple en général.
- le mouvement du prolétariat et celui du "peuple" sont identiques.
Comprendre la nécessité pour le prolétariat de gagner à lui les couches marginales et opprimées ne signifie pas :
- rabaisser le programme maxima du prolétariat ou quelconque revendication immédiate et historique.
- appuyer les programmes illusoires et réactionnaires qui découlent de la position sociale de la petite bourgeoisie.
- dissoudre le prolétariat comme partie du "mouvement populaire".
5) La violence de classe et la lutte contre la répression.
Comme nous l'avons affirmé auparavant, la répression sera chaque fois plus ouverte, massive et systématique. Le problème de la lutte contre la répression et la violence de classe va se poser d'une façon aiguë. Sur ce point, et partant des expériences vivantes de ces derniers temps, on peut dégager des leçons très claires :
- la fameuse position du "terrorisme ouvrier" que certains camarades a l'intérieur du CCI, le PCI (Programa) et les gens de "1'Autonomia" en Italie, préconisaient comme un moyen efficace pour préparer les luttes ou pour réveiller la conscience ouvrière, s'est dissoute comme le sucre dans l'eau, devant les récentes expériences. En Iran, les grèves et les révoltes ont brisé la répression d'une des plus puissantes armées du monde, elles ont aggravé les convulsions internes et ont permis qu'une partie importante de son armement ultramoderne soit tombée en des "mains incontrôlées". En France, quelle était la meilleure défense des ouvriers d'une usine occupée devant le siège en règle de la police et des milices patronales ? C'était précisément la grande Manifestation des ouvriers des autres usines qui ont entouré les attaquants. Nos théoriciens du "terrorisme ouvrier" ont pu constater que leurs "groupes de combat" ne sont apparus d'aucun côté, et que la violence de classe, ce qu'ils appelaient "une originalité abstraite et mystificatrice" s'est manifestée d'une façon claire et concrète.
- contre les mystifications que sans aucun doute, la bourgeoisie d'opposition lancera, la meilleure défense contre la répression n'est et ne sera jamais les garanties légales et juridiques du "droit de grève" mais la lutte propre du prolétariat. Ce ne sera pas une police "démocratique", "nationale" et "fille du peuple" comme le clame aux quatre vents le PCF, mais les assauts ouvriers de masse contre les commissariats, pour arracher les détenus des griffes policières; ce ne sera pas un gouvernement de gauche qui sera "moins répressif" qu'un gouvernement de droite, mais le débordement dans la lutte de tous les carcans syndicaux légaux et de gauche.
6) Le prolétariat comme frein à la guerre impérialiste.
L'Iran a pu confirmer une tendance qui s'est manifestée encore faible et embryonnaire, dans le prolétariat international, à savoir : IL EST L'UNIQUE FORCE MONDIALE CAPABLE DE S'OPPOSER A LA GUERRE IMPERIALISTE. En Iran, un dispositif ultrasophistiqué et moderne d'armements est resté totalement désorganisé devant l'impact des affrontements de classe. On ne peut pas dire que ce dispositif abandonné par les USA soit passé au bloc russe, étant donné que ce dernier a pris garde, au moins pour le moment, de se mettre dans l'aventure de contrôler une 'ruche’. En Egypte et en Israël, un des facteurs qui les a poussés à rechercher une "paix" à tout prix, était les luttes prolétariennes dans les deux pays. Le contentieux Maroc-Algérie a marqué un temps d'arrêt non seulement par le tour qu'a pris les manœuvres inter-impérialistes, mais aussi' à cause des grèves dures qui ont eu lieu en Algérie en Mai-Juin 1978 et de l'actuelle vague au Maroc. Cuba n'a pas aujourd'hui les mains aussi libres pour faire le pion de l'impérialisme russe à cause des grèves et des convulsions sociales qui se sont produites en avril 1978. La grève dans les arsenaux français en juin 1978 a eu un impact direct sur l'industrie de guerre comme l'ont démontré postérieurement les grèves dans les chantiers navals anglais de sous-marins atomiques. Il reste à voir quelle sera la réponse des prolétaires de Russie, de Chine et du Vietnam contre les préparatifs de guerre. Mais le chemin de la résistance prolétarienne a commencé à se dessiner.
7) Perspectives et intervention des révolutionnaires
La perspective qui surgit est une nouvelle offensive du prolétariat mondial. Comme nous avons pu le voir tout au long de ce rapport, nous sommes en présence de quelques indices puissants mais nous ne pouvons perdre de vue que la perspective n'est pas immédiate, et que le chemin dans cette direction est hérissé de très sérieuses difficultés. Sans oublier la fragilité de cette nouvelle impulsion prolétarienne, nous devons mettre en évidence que cette perspective a des répercussions bien plus grandes que n'importe quelle vision immédiatiste pourrait donner à entendre. Nous sommes dans le début de la fin de l'époque de la contre-révolution. Toutes les conditions historiques qui avaient permis 50 ans de contre-révolution commencent à se défaire effectivement devant les impulsions de la crise capitaliste et la lente reprise des luttes ouvrières. Les combats des années 60 ont été des escarmouches qui avaient ouvert la première brèche dans le monolithe de la contre-révolution et préparèrent sa future dislocation. Ceci exige des révolutionnaires :
1) d'éviter les fausses querelles comme l'avait souligné le premier congrès du CCI et d'approfondir l'effort de discussion et de regroupement dans la perspective de concentrer et donner un cadre le plus unitaire possible aux énergies révolutionnaires qui mûrissent sans cesse dans la classe.
2) de renforcer le cadre programmatique à tous les niveaux et en conséquence, leur intervention.
3) de devenir un facteur actif et positif dans les luttes de classe, dépassant l'étape antérieure de réappropriation des positions de classe et la reconstruction programmatique et organique.
5- PERSPECTIVES
Les luttes que nous venons de mentionner prépareront, mûriront une nouvelle offensive du prolétariat mondial pour laquelle nous pouvons dresser les perspectives suivantes :
1) Généralisation internationale de la lutte prolétarienne
Nous voulons insister sur ce point que nous avons clairement dégagé dans le chapitre antérieur, mettant en évidence que, si le centre des luttes s'est déplacé de nouveau vers les grandes concentrations ouvrières d'Europe et des Etats-Unis, ceci ne veut pas dire qu'il y ait un repli de la lutte prolétarienne dans le Tiers-Monde, mais au contraire, un renforcement de celle-ci.
Le Brésil, importante concentration prolétarienne de la périphérie, a été bouleversé par les importantes grèves de mai 1978 et, surtout, de mars 79, où la grève générale par solidarité s'est imposée dans la région de Sao Paulo, avec des assemblées générales massives de 50.000 et 70.000 ouvriers contre la répression policière. En Iran, la grève des dockers de Korramanshar-Abadan ainsi que les mouvements de chômeurs démontrent que les tentatives de Khomeiny et sa clique n'ont pas réussi à mettre fin à la lutte prolétarienne. En Amérique du Sud, des grèves combatives ont eu lieu au Mexique, au Pérou, au Salvador, en Bolivie, en Argentine, en Colombie et en Jamaïque. En Afrique, le prolétariat marocain a mené une grande vague de grèves en dehors des syndicats et de l'Union Nationale de la bourgeoisie. Il faut également souligner les combats et révoltes ouvrières au Libéria, au Zaïre, dans l'Empire Centrafricain et en Ouganda avant et après la chute d'Amin Dada. En Asie, il faut souligner les grèves en Inde, la grande grève dans les champs pétroliers de Dehrram en Arabie Saoudite et les révoltes en Chine. Dans les pays de l'Est, malgré le rideau de fer qui bloque l'information, des nouvelles de grèves en RDA, en Pologne, en Roumanie, en Yougoslavie ont filtré l'année dernière.
La réponse simultanée du prolétariat dans les cinq continents est la meilleure condition pour l'affirmation de son unité internationale et la maturation de son alternative révolutionnaire.
2) Développement lent du mouvement de classe
On peut se sentir déçu à cause de la lenteur et la difficulté avec laquelle s'avance l'offensive prolétarienne. Mais cette lenteur n'est pas nécessairement un signe de faiblesse mais 1'évidence de la profondeur et de l'ampleur des affrontements de classe qui se préparent. On n'est plus, comme dans les luttes des années 60, face à un ennemi relativement surpris par le réveil subi du prolétariat après des années de contre-révolution mais face à un capitalisme armé jusqu'aux dents et qui met en place contre les luttes ouvrières toute sa machine idéologique, politique et répressive. Du côté prolétaire, les flambées spectaculaires mais courtes des années 60 ont ouvert le chemin -comme l'ont montré récemment les combats de Longwy et Denain-à un combat tenace où les constantes tentatives des syndicats, de la police et du gouvernement pour enterrer les luttes échouent les unes près les autres, en laissant la voie libre à une agitation intermittente et très difficile à décourager. Il est important que reste clair que la lenteur du mouvement de la classe ne favorise nullement une voie gradualiste ou de "petits pas". On assiste à une infatigable accumulation de luttes, à des ripostes coup-pour-coup, ce qui prépare les conditions à de grandes explosions prolétariennes sur des bases profondes et radicales.
3) La réponse capitaliste contre les luttes
Elle va s'accentuer de plus en plus sur l'axe de la répression. L'Italie reflète cela : arrestations massives de militants ouvriers antisyndicaux dans les usines organisées par toutes les forces du "compromis historique" : patrons, police, syndicats, Parti Communiste et Démocratie Chrétienne. En France, on a pu voir non seulement la répression brutale des luttes avec le déploiement des armées de CRS, mais également les procès contre les combattants ouvriers arrêtés lors de la Marche du 23 mars sur Paris ou après les combats de Longwy-Denain. Mais il ne faut pas oublier que la répression ira main dans la main avec un renforcement de la mystification représentée par la "cure d'opposition" que vont faire la gauche et les syndicats, ce qui tendra à leur redonner une nouvelle image de "combativité ouvrière" et "d'ouvriérisme" afin de mieux détruire les luttes ouvrières de l'intérieur, en essayant non pas de freiner ou de dévier le train prolétarien vers une voie morte, mais de le faire dérailler en pleine action. Cependant, il ne faut pas oublier les limites objectives de cette tendance, limites imposées par l'approfondissement des conflits internes de la bourgeoisie et par le rythme effréné de la crise, auxquels la gauche doit aussi faire face, ce qui rendra beaucoup plus difficile sa tâche de mystification. Dans le camp de la bourgeoisie, minée par ses contradictions qui, avec la montée de la crise, éclatent à tous les niveaux de la vie sociale, la tendance va être vers un dépouillement progressif des vêtements idéologiques de l'Etat, et à un durcissement de la répression qui sera soutenue par sa "cinquième colonne" dans le mouvement ouvrier : la gauche, les gauchistes et les syndicats.
4) L'affirmation de plus en plus cl aire de l'alternative prolétarienne contre la crise historique du capital :
Si 1979 a montré quelque chose, c'est bien le spectacle sans fards de la barbarie inexorable du capital : les centrales nucléaires, les réfugiés indochinois, le Skylab, les horribles massacres au Nicaragua, le spectacle "instructif" de la "révolution islamique" en Iran...Tout cela a mis en évidence l'irrémédiable décadence du système, l'effondrement dans des bains de sang de sa civilisation. Et face à cela, les cache-sexe que la bourgeoisie a utilisé pendant des années pour cacher sa barbarie et les utiliser politiquement contre le prolétariat, éclatent irréversiblement en mille morceaux : le "socialisme dans un seul pays", la "libération nationale", la "démocratie", les "droits de l'homme"... Dans cette atmosphère pourrie qui étouffe et empoisonne toute l'humanité, face à tous les déshérités de la terre, des paysans pauvres, des marginalisés, le prolétariat tend à s'affirmer comme la seule force révolutionnaire, comme la seule alternative de libération contre la barbarie du capital:
- parce que ses "modestes" et "humbles" luttes revendicatives, si méprisées par tous, y compris par beaucoup de groupes révolutionnaires, démontrent qu'il est possible de faire reculer le capital, qu'il est possible de riposter coup-pour-coup aux attaques du capital, et minent de façon définitive les lois aveugles du capital.
- parce que, avec ses luttes pratiques, avec ses formidables exemples de solidarité et de violence de classe, le prolétariat apparaît, dans les faits, comme la seule réponse à la répression, les guerres et tous les phénomènes concentrés dans la barbarie capitaliste qui affectent toute l'humanité.
CONCLUSION
Toutes les forces idéologiques et politiques de la bourgeoisie (mass-média, partis de gauche et de droite, syndicats...) nous matraquent le cerveau avec l'image du prolétariat comme une masse de citoyens amorphes et définitivement passifs. Mais la force de la crise, l'effort de conscience réveillée de nouveau à partir des luttes des années 60, la position même de notre classe au centre de toute la société, le poids de deux siècles de luttes prolétariennes héroïques, tout cela pousse les prolétaires à réagir contre ce tissu de passivité et d'impuissance et à ouvrir clairement la brèche vers la révolution mondiale.
Le chemin va être plus difficile que jamais; on va trouver des moments amers d'hésitation et de défaite momentanée, mais il faut le: parcourir, parce que c'est une question de vie ou de mort, parce que c'est la seule voie pour sortir du cauchemar capitaliste.
COMMUNISME OU BARBARIE ! PROLETAIRES, VOUS AVEZ L A PAROLE !
Récent et en cours:
- Luttes de classe [2]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La lutte Proletarienne [163]
Revue Internationale no 19 - 4e trimestre 1979
- 2714 reads
La hausse du prix du pétrole : une conséquence et non la cause de la crise
- 25386 reads
La hausse du prix du pétrole constitue depuis la fin de 1973 le principal argument avec lequel les gouvernements et les économistes expliquent dans le monde occidental la crise économique et ses conséquences : le chômage et l'inflation. Quand une entreprise ferme ses portes, les travailleurs jetés dans la rue s'entendent dire : "c'est la faute au pétrole11. Lorsque les travailleurs voient leur salaire réel diminuer sous le poids de la hausse des prix, les mass-médias leur expliquent : "c'est à cause de la crise du pétrole". La "crise du pétrole" est devenue l'alibi, le prétexte avec lequel la bourgeoisie en crise entend tout faire gober aux exploités. Elle est devenue dans la propagande des classes dominantes une sorte de cataclysme naturel contre lequel les hommes ne pourraient rien, sinon subir impuissants toutes ces calamités qui ont nom : chômage et inflation.
Et pourtant qu'y-a-t-il de "naturel" dans le fait que des marchands de pétrole vendent plus cher leur produit à d'autres marchands. La hausse du pétrole est une péripétie, non pas de la nature, mais du commerce capitaliste. La classe capitaliste, comme toutes les classes exploiteuses dans l'histoire attribuent ses privilèges aux volontés de la nature. Les lois économiques qui font d'eux les maîtres de la société sont dans leurs imaginations aussi naturelles et immuables que la loi de la pesanteur, lorsque la subsistance de ces lois -devenues avec le temps inadaptées- provoque des crises qui plongent la société dans la misère et la désolation, les nantis attribuant toujours la raison aux imperfections de la "nature" : la nature est trop pauvre ou les hommes sont trop nombreux. Jamais leur esprit ne parvient à concevoir que ce puisse être le système économique existant qui soit devenu anachronique, obsolète.
A la fin du moyen-âge, dans la décadence du XIV° siècle, des moines annonçaient la fin du monde à cause de l'épuisement de terres fertiles. Aujourd'hui on nous assène 10 fois par jour que si tout va mal, c'est à cause de l'épuisement du pétrole.
Y A-T-IL VRAIMENT EPUISEMENT DU PETROLE DANS LA NATURE ?
En mars 1979, les pays producteurs de pétrole de l'OPEP se réunissaient pour proclamer solennellement qu'ils allaient réduire leur production, une fois de plus. Ils réduisent leur production pour maintenir le prix réel, tout comme des paysans détruisent des excédents de fruits pour empêcher que leur prix ne s’effondre.
L'Europe risque de manquer de pétrole en 1980 nous annonce-t-on. Peut-être, mais qui croira encore qu'il s'agit d'une pénurie naturelle, physique ?
Les pays de l'OPEP ne produisent pas à pleine capacité, loin de là. Depuis quelques années, des gisements nouveaux et importants ont été mis en service en Alaska, en Mer du Nord, au Mexique. Chaque semaine, on découvre quelque part dans le monde de nouveaux gisements. Par ailleurs, on nous dit que des réserves de pétrole sous la forme de schistes bitumeux, relativement plus chers à exploiter, sont énormes par rapport aux réserves de pétrole connues actuellement. Comment dans ces conditions peut-on parler de pénurie physique de pétrole ? On peut concevoir qu'un jour un minerai servant de matière première arrive à être épuisé dans la planète à cause d'une exploitation sans limites de l'homme. Mais cela n'a rien à voir avec le fait que des marchands décident de réduire leurs ventes afin de préserver leur profit. Dans le premier cas, il s'agirait effectivement d'un épuisement dans la nature, dans le second, il s'agit d'une vulgaire opération de spéculation marchande.
Si la situation économique mondiale était par ailleurs "saine" dans tous ses aspects, si le seul problème existant actuellement était celui d'un épuisement physique et imprévu du pétrole dans la nature, nous assisterions non pas à un ralentissement de la croissance- du commerce et des investissements comme c'est le cas actuellement, mais au contraire à un boom économique mondial extraordinaire : la réadaptation du monde à de nouvelles formes d'énergie se traduirait par une véritable nouvelle révolution industrielle. Il y aurait certes des crises de restructuration ici et là dans certains secteurs avec des fermetures d'entreprises et des licenciements, mais ces fermetures et ces licenciements seraient immédiatement compensés par l'ouverture de nouvelles entreprises et la multiplication de nouveaux postes de travail.
Or, nous assistons à quelque chose de complètement différent : les pays qui produisent le pétrole le plus rentable réduisent leur production; les entreprises qui ferment ne sont pas remplacées par d'autres; les travailleurs licenciés ne trouvent pas de travail ailleurs; les investissements dans la recherche de nouvelles formes d'énergie restent insignifiants dans la plupart des puissances.
La thèse de l'épuisement physique du pétrole dans la nature est utilisée par les médias et les économistes pour expliquer la hausse vertigineuse du prix du pétrole en 1974 et en 1979. Mais comment explique-t-on alors les hausses spectaculaires de l'ensemble des produits de base, autres que le pétrole, sur le marché mondial en 1974 ou en 1977 ? Comment explique-t-on les accès de fièvre qu'ont connu les prix des métaux de base tel le cuivre, le plomb, l'étain au début de 1979 ? A suivre les "experts" de la bourgeoisie, il faudrait croire qu'il n'y a pas que le pétrole qui est en train de s'épuiser dans la nature, mais aussi la plupart des métaux, et même les denrées alimentaires. En effet, entre 1972 et 1974, l'indice des prix des minéraux et des métaux exportés dans le monde, autres que le pétrole a plus que doublé, celui des denrées alimentaires a lui, presque triplé. Au deuxième trimestre de 1977, ces mêmes denrées coûtaient encore sur le marché mondial trois fois plus qu'en 1972. Nous serions donc en train d'assister au tarissement de la nature non seulement en pétrole mais dans tous les domaines. Ce qui est une pure absurdité.
La théorie de l'épuisement physique de la nature parvient difficilement à expliquer la hausse des prix du pétrole; mais elle est en plus grande difficulté encore lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi le prix réel du pétrole, payé par les pays importateurs industrialisés, c'est à dire le prix payé compte tenu de l'évolution de l'ensemble de l'inflation mondiale et de l'évolution de la valeur du dollar US ([1] [164]), a régulièrement diminué avant 1973-1974 et après jusqu'en 1978. Entre 1960 et 1972, le prix réel du pétrole brut importé a diminué de 11% pour le Japon, de 14% pour la France, de 30% pour l'Allemagne! En 1978, ce même prix avait diminué par rapport aux niveaux de 1974 ou 1975 de 14% au Japon, de 6% en France, de 11% en Allemagne.
Comment le prix de matières en cours d'épuisement définitif dans la nature pourrait-il diminuer au point de contraindre les producteurs à réduire leur production artificiellement afin d'éviter l'effondrement des cours ?
Si l'on veut comprendre les actuelles hausses et baisses des cours des matières premières, ce n'est pas vers la plus ou moins grande générosité de la mère nature qu'il faut tourner ses regards, mais vers le monde en décomposition du commerce capitaliste.
Nous sommes en présence non pas de la découverte soudaine de certaines pauvretés grotesques de la nature, mais de gigantesques opérations de spéculations marchandes sur les matières premières. Ce n'est pas là un phénomène nouveau; toutes les crises économiques importantes du capitalisme sont accompagnées de fièvres spéculatives sur des matières premières.
LA SPECULATION : UNE CARACTERISTIQUE TYPIGUF DES CRISES ECONOMIQUES DU CAPITALISME
La source réelle de tous les profits capitalistes réside dans l'exploitation des prolétaires au cours du processus de production. Le profit, la plus-value, c'est du surtravail extirpé aux salariés. Lorsque les affaires des capitalistes vont bien, c'est à dire lorsque tout ce qui est produit parvient à être vendu avec des taux de profit suffisants, les capitalistes réinvestissent les profits ainsi obtenus dans le processus de production. L'accumulation du capital, c'est ce processus qui consiste à transformer le surtravail des ouvriers en capital, c'est à dire en nouvelles machines, nouvelles matières premières, nouveaux salaires pour exploiter de nouvelles quantités de travail vivant.
C'est ainsi que les capitalistes font ce qu'ils appellent "travailler l'argent". Mais lorsque les affaires vont mal, l’orque la production ne rapporte plus par manque de débouchés, ces masses de capitaux sous forme monétaire qui cherchent à s'investir tendent à se réfugier dans des opérations spéculatives.
Ce n'est pas qu'ils raffolent de ce genre d'opérations avec des risques aussi élevés où l'on peut se retrouver ruiné du jour au lendemain. Ils lui préfèrent mille fois mieux la paisible exploitation par la production. Mais, lorsqu'il n'y a plus de placement rentable dans la production, que faire ? Garder l'argent dans un coffre, c'est le voir perdre tous les jours de la valeur sous l'effet de l'érosion monétaire. La spéculation constitue alors un placement risqué certes, mais qui peut rapporter très gros en très peu de temps.
C'est ainsi que lors de chaque crise économique capitaliste, on a assisté à des phénomènes de spéculation d'une ampleur extraordinaire. La loi interdit la spéculation mais ceux qui spéculent ne sont autres que ceux qui ont fait les lois. Très souvent cette spéculation s'est polarisée sur une matière première. Ainsi, par exemple, lors de la crise économique de 1836, le directeur de la Banque des Etats-Unis, un certain BEAGLE, avait profité du fait que la demande de la Grande-Bretagne était encore forte pour s'emparer de toute la récolte de coton et la vendre à prix d'or aux anglais plus tard. Malheureusement pour lui, sous le coup de la crise, la demande de coton s'effondra en 1839 et les stocks soigneusement cumulés dans la folie spéculative devinrent invendables. Les cours de coton s'effondrèrent sur le marché mondial. Ce qui vint faire croître le nombre déjà élevé de faillites (1000 banques en banqueroute aux USA).
La crise économique, après avoir provoqué la hausse des prix des matières premières de manière spectaculaires, fait s'effondrer celles-ci par manque de demande.
Ces montées subites du prix d'une matière première suivie d'un effondrement vertigineux sont typiques de la spéculation en temps de crise. Ces phénomènes se produisent de façon particulièrement nettes lors des crises de 1825, 1836 et 1867 sur le coton ou sur la laine; lors des crises de 1847 et de 1857 sur le blé; en 1873, 1900 et 1912 c'est sur l'acier et sur la fonte; en 1907, c'est sur le cuivre; en 1929, c'est sur presque tous les métaux.
La spéculation est l'œuvre non pas de quelques individus épars, assez troubles, travaillant dans l'illégalité ou de petits "détenteurs" comme le laisse entendre la presse. Les spéculateurs, ce sont les gouvernements, les Etats, les banques grandes et petites, les grands industriels, bref, les détenteurs de l'essentiel de la masse monétaire qui cherche à se rentabiliser, à faire des profits.
La spéculation n'est pas non plus "une tentation" à laquelle les capitalistes peuvent échapper en temps de crise économique. Le banquier qui a la responsabilité de faire rapporter des milliers de comptes d'épargne n'a pas le choix. Lorsque le profit se fait de plus en plus rare, il faut le prendre quel qu'il soit et où qu'il soit. Les scrupules hypocrites des temps de prospérité où l'on promulgue des lois "interdisant la spéculation" disparaissent, et les plus respectables institutions financières se jettent tête baissée dans la tourmente spéculative. Dans la jungle capitaliste, seul celui qui fait du profit survit. Les autres sont dévorés. Lorsque la spéculation devient le seul moyen de faire des profits, la loi devient : celui qui ne spécule pas ou qui spécule mal est dévoré.
Ce qu'on a coutume d'appeler "la crise du pétrole" constitue en fait une gigantesque opération spéculative au niveau de la planète.
POURQUOI LE PETROLE ?
Le pétrole n'a pas été au cours des dernières années le seul objet de spéculation. Depuis la dévaluation de la Livre Sterling en 1967, la spéculation n'a cessé de se développer dans le monde entier s'attaquant à une liste toujours plus longue de produits : les monnaies, l'immobilier, les matières premières, végétales ou minérales, l'or, etc. Mais la spéculation sur le pétrole marque pour son importance financière. Elle a provoqué des mouvements de capitaux d'une ampleur et d'une rapidité probablement sans précédent dans l'histoire. En quelques mois, un flot gigantesque de dollars s'est mis à couler vers les grands pays exportateurs de pétrole, à partir de l'Europe et du Japon. Pourquoi en se portant sur le pétrole, la spéculation a-t-elle réussi de tels profits ? Premièrement^ parce que toute l'industrie moderne repose sur l'électricité et l'électricité, elle repose pour l'essentiel sur le pétrole. Aucun pays ne peut produire aujourd'hui sans pétrole. Le chantage spéculatif à la pénurie de pétrole est un chantage qui a l'atout de la force économique. Mais le pétrole n'est pas seulement un moyen indispensable pour produire et construire. Il est tout aussi indispensable pour détruire et faire la guerre.
L'essentiel de l'armement moderne, des chars aux bombardiers, des porte-avions aux camions et aux jeeps, tout cela fonctionne avec du pétrole. S'armer, c'est non seulement produire des armes mais aussi se procurer les moyens pour les faire fonctionner aussi longtemps que nécessaire. La course aux armements est aussi une course au pétrole. La spéculation sur le pétrole touche donc à un produit dont l'importance économique et militaire est de premier ordre. Et c'est cela une des raisons de son succès au moins momentané. Mais elle n'est pas la seule.
LA BENEDICTION DU CAPITAL AMERICAIN
Un des thèmes favoris du bla-bla-bla des commentateurs des médias sur le pétrole est celui de la "revanche des pays sous-développés sur les pays riches". Par leur simple décision de réduire la production et d'augmenter le prix du pétrole,, des pays qui font partie du peloton des nations du tiers-monde, condamnées depuis des décennies à produire et vendre à bon marché des matières premières pour les pays industrialisés, ont réussi à prendre à la gorge les principales puissances industrielles. C'est le David et Goliath des temps modernes.
La réalité est tout autre. Derrière la "crise du pétrole" il y a le capital américain. Il suffirait pour s'en convaincre de prendre en considération deux facteurs simples et évidents :
1) les pays les plus puissants de l'OPEP se comptent en même temps parmi les plus inconditionnellement soumis à l'impérialisme US. Les gouvernements de l'Arabie Saoudite, premier exportateur de pétrole mondial, de l'Iran du Shah ou du Venezuela, pour ne prendre que quelques exemples, ne prennent aucune décision importante sans l'accord explicite de leur puissant "protecteur";
2) la quasi totalité du commerce mondial du pétrole se trouve sous le contrôle des grandes compagnies pétrolières américaines: les profits réalisés par ceux-ci grâce aux variations des prix du pétrole sont si gigantesques que le gouvernement US a dû organiser une parodie de procès à la télévision pour tenter de canaliser sur les "7 big sisters" -les "7 grandes sœurs"- la colère de la population américaine qui se voit imposer des plans d'austérité au nom de la "crise pétrolière".
Mais au cas où cela ne suffirait pas pour se convaincre du rôle déterminant joué par les USA dans la "hausse du prix du pétrole", rappelons quelques uns des avantages qu'a tiré la première puissance économique mondiale de la "crise pétrolière":
1) Sur le marché international, le pétrole est payé en dollars US. Concrètement, cela veut dire que les USA peuvent se procurer du pétrole en faisant simplement fonctionner leur planche à billets alors que tous les autres pays doivent se procurer des dollars ([2] [165]);
2) les Etats-Unis ne dépendent du pétrole importé que pour 50% de leurs besoins nationaux. Leurs concurrents directs sur le marché mondial -l'Europe et le Japon- par contre, doivent importer la quasi totalité de leur pétrole. Toute augmentation du prix du pétrole se répercute donc de façon beaucoup plus puissante sur les coûts de production des marchandises européennes et japonaises. La compétitivité des marchandises US s'en trouve augmentée automatiquement d'autant. Ce n'est pas par hasard si les exportations US connaissent
des progressions spectaculaires au détriment de celles de leurs concurrentes au lendemain de chaque hausse du pétrole.
3) Mais c'est certainement sur le plan militaire que les USA ont tiré les plus grands avantages de la "crise pétrolière".
Comme on l'a vu, le pétrole demeure un instrument majeur de la guerre. La hausse du prix du pétrole a permis la rentabilisation de nouveaux gisements à proximité du territoire US (Alaska, Mexique, ainsi qu'au sein même des USA). De ce fait, le potentiel militaire américain se trouve moins dépendant des sources de pétrole du Moyen-Orient, trop distantes de Washington et trop proches de l'URSS. D'autre part, les énormes revenus pétroliers ont permis le financement de la "Pax Americana" au Moyen-Orient par l'Arabie Saoudite interposée. En effet, le passage de l'Egypte dans le bloc US a été payé à prix d'or, en partie par les aides financières de l'Arabie Saoudite au nom de la fraternité arabe. L'Arabie Saoudite a influencé directement la politique de pays tels que l'Egypte, l'Irak, le Syrie (pendant le conflit du Liban) moyennant de substantielles "aides" payées avec les revenus pétroliers. L'actuel rapprochement de l'O.L.P. du bloc américain n'est pas complètement étranger à l'aide financière que l'Arabie Saoudite fournit à 1'O.L.P.
L'impérialisme américain s'est ainsi payé le luxe de faire financer sa politique internationale par ses concurrents et alliés européens et japonais.
Ainsi, pour des raisons aussi bien économiques que militaires, les USA ont eu tout intérêt à laisser se développer, voire à encourager, la hausse du prix du pétrole.
L'attitude du gouvernement Carter lors de la fièvre spéculative déclenchée par l'interruption des livraisons de pétrole de l'Iran est éloquente à cet égard. Au moment même où l'Allemagne et la France cherchaient à juguler les hausses spéculatives qui se développaient au premier semestre de 1979 sur le "marché libre" de Rotterdam, le gouvernement US a cyniquement annoncé qu'il était prêt à acheter toute quantité de pétrole à un cours supérieur aux plus élevés atteints dans le port hollandais. Malgré l'envoi de délégués spéciaux de Bonn et de Paris à Washington pour "protester énergiquement" contre ce "coup de poignard dans le dos", la Maison Blanche n'est pas revenue sur son offre.
Quelle que soit la raison de cette hausse, une question demeure : quels ont été ses effets sur l'économie mondiale. La propagande officielle a-t-elle raison lorsqu'elle affirme que c'est la hausse des prix du pétrole qui a engendré la crise économique ?
LES EFFETS DE LA HAUSSE DU PRIX DU PETROLE
Il ne fait aucun doute que la hausse du prix d'une matière première constitue une entrave à la rentabilité d'une entreprise capitaliste. Pour le capital industriel, les matières premières constituent en frais de production, une dépense. Si ses frais augmentent, sa marge de profit tend à se réduire d'autant. Pour lutter contre les effets de cette réduction de sa rentabilité, il ne dispose que de deux moyens :
- réduire les autres frais de production, en particulier les frais en main-d’œuvre;
- répercuter l'augmentation de ses frais dans le prix de vente.
Les capitalistes se servent généralement des deux moyens en même temps. Ils s'appliquent à réduire leurs frais de production en imposant des politiques d'austérité sur les salariés ; ils cherchent à maintenir leurs profits en alimentant l'inflation. Il est donc certain que la hausse des prix du pétrole est un facteur qui impose à chaque capital national de nouveaux efforts de rentabilisation : élimination des secteurs les moins productifs, réduction des salaires, concentration du capital. Tout comme il est vrai que la hausse du pétrole est en partie responsable de l'inflation.
La hausse du prix du pétrole a effectivement constitué un facteur aggravant de la crise. Mais, contrairement à ce que prétend la propagande des médias, elle n'a été que cela : un facteur aggravant et non la cause, ni même une cause importante de la crise économique.
Il suffit pour s'en convaincre de constater que la crise économique n'a pas commencé avec la hausse du pétrole. La spéculation pétrolière n'a été qu'une des conséquences de la série de bouleversements économiques qui ont secoué le capitalisme mondial dès la fin des années 60.
A entendre "les experts" de la bourgeoisie, on croirait qu'avant la date fatidique du second semestre 1973, tout allait pour le mieux dans l'économie mondiale.
Pour mieux justifier leur politique d'austérité, ces messieurs oublient, ou feignent d'oublier, qu'au début de 1973, avant les premières grandes hausses du prix du pétrole, le taux d'inflation avait, en moins d'un an, doublé aux USA, triplé au Japon; ils prétendent oublier que de 1967 à 1973, le capitalisme avait déjà connu deux récessions importantes : une en 1967 (le taux de croissance annuel de la production diminua de moitié aux USA -1,8 % au premier semestre 1967- et tomba au dessous de zéro en Allemagne) ; l'autre en 1970-71 : aux USA, la production recule de façon absolue. Ils oublient ou cachent que le nombre officiel de chômeurs dans la zone de l'O.C.D.E. (les 24 pays industrialisés du bloc US) avait presque doublé en six ans, passant de 6 millions et demi en 1966 à plus de 10 millions en 1972. Ils font semblant d'ignorer qu'au début de 1973, après six ans d'instabilité monétaire commencée avec la dévaluation de la livre sterling de 1967, le système monétaire international s'était définitivement effondré avec la seconde dévaluation du dollar en moins de deux ans.
La spéculation pétrolière n'éclate pas dans un climat de sereine prospérité économique. Elle apparaît au contraire comme une nouvelle convulsion du capitalisme, secoué depuis six ans par la crise la plus profonde qu'il ait connue depuis la 2ème guerre mondiale.
A moins de vouloir expliquer les bouleversements de la période 1967-1973 par les hausses pétrolières de 1974, il est absurde d'affirmer que l'augmentation du prix du pétrole est la cause de la crise économique du capitalisme.
La spéculation sur le pétrole a porté un coup à l'économie mondiale, mais il n'était ni le premier ni le plus grave. La relativité du coup porté par la hausse du pétrole peut être mesurée "en négatif" en observant la situation d'un pays industrialisé qui a réussi à éliminer le problème du pétrole grâce à l'exploitation de gisements propres. Tel est le cas de la Grande-Bretagne qui n'a plus besoin d'importer du pétrole grâce à ses gisements de la Mer du Nord. En 1979, le taux de chômage en Grande-Bretagne est deux fois supérieur à celui de l'Allemagne, trois fois supérieur à celui du Japon, deux pays qui pourtant continuent d'importer la quasi totalité de leur pétrole. Quant à l'inflation des prix à la consommation, elle y est le double qu'en Allemagne et neuf fois plus importante qu'au Japon. Enfin, quant au taux de croissance de la production, il est le plus faible des sept grandes puissances économiques occidentales (au premier semestre de 1979, la production brute n'a pas augmenté : elle a même diminué de 1 % en taux annuel).
Les causes de l'actuelle crise du capitalisme sont autrement plus profondes que les péripéties de la spéculation sur le pétrole.
Depuis le milieu des années 60, le capitalisme vit dans une permanente fuite en avant pour tenter de retarder les conséquences de la fin de la période de reconstruction. Depuis plus de dix ans, les régions industrielles détruites pendant la seconde guerre mondiale ont non seulement été reconstruites -faisant disparaître ce qui avait constitué le débouché principal des exportations américaines-mais sont devenues de puissants concurrents des USA sur le marché mondial. Les Etats-Unis sont devenus un pays qui exporte moins qu'il n'importe et qui doit, pour financer son déficit, inonder la planète de papier monnaie sans couverture. Depuis dix ans, avec la fin de la reconstruction, la croissance mondiale repose essentiellement sur les ventes à crédit aux pays sous-développés et sur la capacité des USA à maintenir son déficit. Or, aussi bien les uns que les autres sont au bord de la banqueroute financière. L'endettement des pays du tiers-monde a atteint des proportions insoutenables (l'équivalent du revenu annuel d'un milliard d'hommes dans ces régions). Quant aux USA, ils sont actuellement contraints de se jeter dans une nouvelle récession pour parvenir à réduire leurs importations et la croissance de leur endettement. La récession qui commence aux USA annonce inévitablement une nouvelle récession majeure au niveau mondial. Une récession qui, suivant le déclin engagé en 1967, sera plus profonde que les trois précédentes.
Les spéculations sur le prix du pétrole ne sont qu'un aspect secondaire d'une réalité autrement plus importante : l'inadaptation définitive des rapports de production capitalistes aux possibilités et aux nécessités de l'humanité.
Après près de quatre siècles de domination sur le monde, les lois capitalistes ont fait leur temps. Après avoir été des forces de progrès, elles sont devenues des entraves à la survie même de l'humanité.
Ce ne sont pas quelques pétroliers venus du désert qui ont mis à genoux la production capitaliste. Le capitalisme s'effondre économiquement de lui-même parce qu'il est de plus en plus rongé par ses contradictions internes, et, en premier lieu, par son incapacité à créer des débouchés suffisants pour écouler sa production avec profit. Nous vivons la fin d'un nouveau tour du cycle crise-guerre-reconstruction, que le capitalisme impose à l'humanité depuis plus de soixante ans.
Pour l'humanité, l'issue n'est ni dans des baisses des prix de vente du pétrole, ni dans des baisses de salaires, mais dans l'élimination de la vente et du salariat, dans l'élimination du capitalisme comme système à l'Est comme à l'Ouest.
Seule une nouvelle organisation de la société mondiale, suivant des principes réellement communistes, peut lui permettre d'échapper à l'holocauste sans fin que lui promet le capitalisme en crise.
R. VICTOR
[1] [166] Constater que le prix courant du pétrole augmente ne veut en soi rien dire puisque l'inflation mondiale touche tous les produits et revenus. Pour un pays importateur de pétrole, la vraie question c'est de savoir si les prix du pétrole augmentent plus vite ou plus lentement que celui de ses exportations. Pour un pays importateur de pétrole, la hausse des prix du pétrole n'a de conséquence négative qu'à partir du moment où elle est plus rapide que celle des prix des marchandises qu'il exporte lui-même, c'est-à-dire, la source de ses revenus sur le marché mondial. Que lui importe de payer le pétrole 20 % plus cher s'il peut simultanément augmenter le prix de ses propres exportations d'autant.
[2] [167] De ce fait, le danger de nouvelles pressions vers la dévaluation du dollar, du fait des nouvelles masses de dollars-papier introduites par les USA sur le marché mondialise trouve relativement limité par l'accroissement de la demande de dollars provoqué par la hausse du prix du pétrole.
Récent et en cours:
- Crise économique [152]
Questions théoriques:
- Décadence [122]
Sur l'impérialisme
- 6761 reads
MARXISME ET IMPERIALISME
Avec toute la prolifération des luttes de "libération nationale" à travers toute la planète; avec le nombre croissant de guerres locales entre Etats capitalistes; avec l'accélération des préparatifs des deux grands blocs impérialistes en vue d'un ultime affrontement -tous ces phénomènes exprimant la décomposition irréversible de l'économie capitaliste mondiale- il devient de plus en plus important pour les révolutionnaires de développer une compréhension claire de la signification de l'impérialisme. Depuis les sept dernières décades, les marxistes ont reconnu que nous vivons 1'époque de la décadence impérialiste, et ont tenté d'en tirer toutes les conséquences pour la lutte de classe du prolétariat.
Mais -particulièrement avec la contre-révolution qui s'est abattue sur le prolétariat dans les années 20- la tâche historique de définition et de compréhension de l'impérialisme a été durement entravée par le triomphe presque total de l'idéologie bourgeoise sous toutes ses formes. Ainsi, la signification véritable du mot impérialisme a été déformée et vidée de son contenu. Le travail de mystification a été mené sur plusieurs fronts : par les idéologues bourgeois traditionnels qui proclament que l'impérialisme a pris fin avec la transformation de 1'"Empire" britannique en "Commonwealth" ou avec l'abandon de leurs colonies par les grandes puissances; par des légions de sociologues, économistes et autres académiciens qui rivalisent à coup de tonnes de littérature illisible sur le "Tiers-Monde", d'"études sur le développement" ou le "réveil nationaliste dans les colonies", etc. ; et par dessus tout par les pseudo-marxistes de la gauche capitaliste qui conspuent bruyamment les crimes de l'impérialisme américain tout en prétendant que la Russie ou la Chine sont des puissances anti-impérialistes et même anticapitalistes. Ce tir de barrage abrutissant n'a pas épargné le mouvement révolutionnaire.
Certains révolutionnaires, ébranlés par les "découvertes" des académiciens bourgeois ont abandonné toute référence aux menées impérialistes du capitalisme et considèrent l'impérialisme comme un phénomène démodé, dépassé dans l'histoire du capitalisme. D'autres, dans leurs efforts de résistance aux pièges de l'idéologie bourgeoise, n'ont fait que transformer les écrits des marxistes antérieurs en écriture sainte. C'est le cas des bordiguistes par exemple, qui appliquent mécaniquement les "cinq caractéristiques fondamentales de l'impérialisme" de Lénine au monde moderne et ignorent toute l'évolution qui s'est produite ces soixante dernières années.
Mais les marxistes ne peuvent, ni ignorer la tradition théorique d'où ils sont issus, ni la transformer en dogme. La question est d'assimiler de façon critique les classiques du marxisme et d'appliquer les contributions les plus importantes à une analyse de la réalité actuelle. Le but de ce texte est de mettre en lumière la signification réelle et contemporaine de la formulation élémentaire : l'impérialisme domine la planète toute entière à notre époque; d'expliquer le contenu de 1'affirmation exprimée dans la plate-forme du CCI : "l'impérialisme (...) est devenu le moyen de subsistance de toute nation, grande ou petite"; de montrer que, dans le capitalisme moderne, toutes les guerres ont une nature impérialiste, sauf une : la guerre civile du prolétariat contre la bourgeoisie. Mais pour cela, il est d'abord nécessaire de revenir aux premiers débats sur l'impérialisme à l'intérieur du mouvement ouvrier.
MARXISME CONTRE REVISIONISME
Dans la période qui a mené à la première guerre mondiale, la question "théorique" de l'impérialisme a constitué une frontière séparant l'aile révolutionnaire -internationaliste de la social-démocratie- de tous les éléments réformistes et révisionnistes du mouvement ouvrier. Une fois la guerre ouverte, la position sur l'impérialisme déterminait de quel côté de la barricade on se trouvait. C'était une question éminemment pratique, puisque, c'est d'elle que dépendait toute l'attitude envers la guerre impérialiste et envers les convulsions révolutionnaires que la guerre avait provoquées.
Il y avait certains points cardinaux de cette question sur lesquels tous les marxistes révolutionnaires étaient d'accord. Ces points demeurent la base de toute définition marxiste de l'impérialisme aujourd’hui.
1) Les marxistes, pour qui l’impérialisme était défini comme un produit spécifique de la société capitaliste, attaquaient vigoureusement les idéologies bourgeoises les plus ouvertement réactionnaires qui parlaient de l'impérialisme comme d'un besoin biologique, une expression du désir de l'homme de territoires et de conquêtes (cette sorte de théorie qui refleurit aujourd'hui dans la notion d’"impératif territorial" colportée par les zoologistes sociaux du genre de Robert Ardrey et Desmond Monis). Les marxistes se battaient avec une tout aussi grande fermeté contre les thèmes racistes sur la "tâche civilisatrice de l'Homme Blanc et contre tous les amalgames confus de toutes les politiques de conquête et d'annexion de toutes sortes de formations sociales. Comme le disait Boukharine, cette :
"(..)dernière "théorie" largement répandue de l'impérialisme définit celui-ci comme une politique de conquête en général. De ce point de vue3 on peut en dire autant de l'impérialisme d'Alexandre de Macédoine et des conquérants espagnols> de Carthage et de Jean III, de l'ancienne Rome et de l'Amérique moderne, de Napoléon et de Hindenburg.
Quelle que soit sa simplicité3 cette théorie n'en n'est pas moins absolument fausse. Elle est fausse parce qu'elle "explique" tout c'est à dire juste rien.
(….) Il est évident que l'on peut en dire autant de la guerre. La guerre est un moyen de reproduction de certains rapports de production. La guerre de conquête est un moyen de reproduction élargie de ces rapports. Or, donner à la guerre la simple définition de guerre de conquête, c'est tout à fait insuffisant3 pour la bonne raison que l1essentiel n'est pas indiqué, à savoir, quels sont les rapports de production que cette guerre affermit et étend, et quelle est la base qu'une "politique de rapine" donnée est appelée à élargir". N. BOUKHARINE. L'économie mondiale et l'impérialisme". Ed.anthropos, 1969, p.110-111)
Bien que Lénine dise que "la politique coloniale et l'impérialisme existaient avant ce dernier stade du capitalisme, et même avant le capitalisme ; Rome, fondée sur l'esclavage, poursuivait une politique coloniale et pratiquait l'impérialisme" ; il rejoint Boukharine lorsqu'il ajoute :
"Mais les raisonnements "d'ordre général" sur l'impérialisme, qui négligent ou relèguent à l'arrière plan la différence essentielle des formations économiques et sociales, dégénèrent infailliblement en banalités creuses ou en rodomontades". LENINE. L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme". Œuvres choisies, Ed. du Progrès, p.720)
2) Deuxièmement les marxistes définissaient l'impérialisme comme une nécessité pour le capitalisme, comme le résultat direct du processus de l'accumulation, des lois inhérentes du capital. A un stade donné du développement du capital, c'était le seul moyen qui permette au système de prolonger son existence. Il était donc irréversible. Bien que l'explication de l'impérialisme comme expression de l'accumulation du capital est plus claire chez certains marxistes que chez d'autres (point sur lequel nous reviendrons), tous les marxistes rejetaient les thèses de Hobson, Kautsky et d'autres qui considéraient l'impérialisme comme une simple "politique" choisie par le capitalisme ou plutôt par des fractions particulières du capitalisme. Ces thèses s'accompagnaient logiquement de l'idée qu'on pouvait prouver que l'impérialisme était une politique mauvaise, coûteuse et à courte-vue, et qu'on pouvait au moins convaincre les secteurs les plus éclairés de la bourgeoisie qu'elles avaient avantage à une politique généreuse, non impérialiste. Tout cela ouvrait clairement la voie à toutes sortes de recettes réformistes, pacifistes, visant à rendre le capitalisme moins brutal et moins agressif. Kautsky développa même l'idée que le capitalisme évoluait graduellement et pacifiquement vers une phase d’"ultra-impérialisme", fusionnant en un seul grand trust sans antagonismes, où les guerres appartiendraient au passé. Contre cette vision utopiste (qui trouva écho durant le boom qui suivit la 2ème guerre mondiale chez Paul Cardan et ses semblables), les marxistes insistaient sur le fait que, loin de représenter un dépassement des antagonismes capitalistes, l'impérialisme exprimait l’exacerbation des antagonismes à leur plus haut degré. L'époque impérialiste était inévitablement une époque de crise mondiale, de despotisme politique et de guerre mondiale; confronté à cette perspective catastrophique, le prolétariat ne pouvait répondre que par la destruction révolutionnaire du capitalisme.
3) L'impérialisme était ainsi, considéré comme une phase spécifique de l'existence du capital.
Sa phase ultime et finale. Bien qu'on puisse parler d'impérialisme britannique et français dans la première partie du 19ème siècle, la phase impérialiste du capital en tant que système mondial ne commence pas vraiment avant les années 1870, moment où plusieurs capitaux nationaux hautement centralisés et concentrés commencent à entrer en concurrence pour les possessions coloniales, les sphères d'influence et la domination du marché mondial. Comme l'a dit Lénine :
"un des traits essentiels de l'impérialisme est la rivalité entre plusieurs grandes puissances à la poursuite de l'hégémonie". (Impérialisme, chap. 7, p. 109) L'impérialisme est donc essentiellement une relation de concurrence entre les Etats capitalistes à un certain stade de l'évolution du capital mondial. Pour aller plus loin; l'évolution de cette relation peut elle-même être séparée en deux phases distinctes qui sont directement liées aux changements du milieu global dans lequel prend place la compétition impérialiste.
"La première période de l'impérialisme se situa dans le dernier quart du 19ème siècle et fit suite à l'époque des guerres nationales par lesquelles s 'était cimentée la constitution des grands Etats nationaux et dont la guerre franco j-allemande marqua à peu près le terme extrême. Si la longue période de dépression économique qui succéda à la crise de 1873 portait déjà en germe La décadence du capitalisme, celui-ci put encore utiliser les courtes reprises qui jalonnèrent cette dépression pour, en quelque sorte, parachever l'exploitation des territoires et des peuples retardataires. Le capitalisme, à la recherche aride et fiévreuse de matières premières et d'acheteurs qui ne fussent ni capitalistes, ni salariés, vola, décima et assassina les populations coloniales, Ce fut l'époque de la pénétration et de l'extension de l'Angleterre en Egypte et en Afrique du Sud, de la France au Maroc, à Tunis et au Tonkin, de l'Italie dans l'Est Africain, sur les frontières de l'Abyssinie, de la Russie tsariste en Asie Centrale et en Mandchourie, de l'Allemagne en Afrique et en Asie, des USA aux Philippines et à Cuba, enfin du Japon sur le continent asiatique.
Mais une fois terminé le partage entre ces grands regroupements capitalistes, de toutes les bonnes terres, de toutes les richesses exploitables, de toutes les zones d'influence, bref de tous les coins du monde où peut être volé du travail qui, transformé en or, allait s 'entasser dans les banques nationales des métropoles, alors se trouva terminée aussi la mission progressive du capitalisme... il est certain qu'alors devrait s'ouvrir la crise générale du capitalisme". (Le problème de la guerre. 1935. Par JEHAN, un militant de la gauche communiste en Belgique)
La phase initiale de l'impérialisme, tout en donnant un avant-goût de la décadence du capitalisme, apportant misère et massacres aux populations des régions coloniales, avait encore un aspect progressif, en ce qu'il établissait la domination du capital à l'échelle mondiale, condition préalable à la révolution communiste. Mais une fois cette domination du monde accomplie, le capitalisme cesse d'être un système progressif, et les fléaux qu'il avait fait subir aux peuples coloniaux rebondissent alors au cœur du système, ce que confirme l'éclatement de la première guerre mondiale.
" Lrimpérialisme actuel n’est pas le prélude à l'expansion capitaliste. Il est la dernière étape de son processus historique d'expansion : la période de la concurrence mondiale accentuée et généralisée des Etats capitalistes autour des derniers restes de territoires non capitalistes du globe. Dans cette phase finale, la catastrophe économique et politique constitue l'élément vital, le mode normal d'existence du capital, autant qu'elle l'avait été dans sa phase initiale, celle de l''accumulation primitive. La découverte de l'Amérique et de la voie maritime pour l'Inde n'était pas seulement un exploit théorique de l'esprit et de la civilisation humaine, comme le veut la légende libérale, mais avait entraîné une suite de massacres collectifs de populations primitives du Nouveau Monde et introduit un trafic d'esclaves sur une grande échelle avec les peuples d'Asie et d'Afrique. De même, dans la phase finale de l'impérialisme, l'expansion économique du capital est indissolublement liée à la série de conquêtes coloniales et de guerres mondiales que nous connaissons. Le trait caractéristique de l'impérialisme en tant que lutte concurrentielle suprême pour l'hégémonie mondiale capitaliste n'est pas seulement l'énergie et l'universalité de l'exportation -signe significatif que la boucle de l'évolution commence à se refermer- mais le fait que la lutte décisive pour l'expansion rebondit des régions qui étaient sa convoitise, aux métropoles. Ainsi l'impérialisme ramène sa catastrophe de la périphérie de son champ d'action à son point de départ. Après avoir livré pendant quatre siècles l'existence et la civilisation de tous les peuples non-capitalistes d'Afrique, d'Asie, d’Amérique et d'Australie à des convulsions incessantes et au dépérissement en masse, l'expansion capitaliste précipite aujourd’hui les peuples civilisés de l'Europe elle-même dans une suite de catastrophes dont le résultat final ne peut être que la ruine de la civilisation ou l'avènement de la production socialiste". Rosa Luxemburg, ("Critique des critiques ou : ce que les épigones ont fait de la théorie marxiste", V., Petite Collection Maspéro 48, 1969, p.222, in "L'accumulation du capital")
Le capitalisme dans sa phase impérialiste finale entre dans "l'ère des guerres et des révolutions" comme l'affirma l'Internationale Communiste, une ère ou l'humanité est confrontée au strict choix : socialisme ou barbarie. Pour la classe ouvrière, cette époque signifie l'érosion de toutes les réformes gagnées au 19ème siècle et une attaque grandissante de son niveau de vie par l'austérité et la guerre. Politiquement, elle signifie la destruction ou la récupération de ses organisations antérieures et l'oppression impitoyable de l'Etat-Léviathan impérialiste, Etat astreint par la logique de la concurrence impérialiste et par la décomposition de l'édifice social à prendre en charge tous les aspects de la vie sociale, économique et politique. C'est pourquoi, confrontée au désastre de la 1ère guerre mondiale, la gauche révolutionnaire tira la conclusion que le capitalisme avait définitivement achevé son rôle historique, et que la tâche immédiate de la classe ouvrière internationale était de transformer la guerre impérialiste en guerre civile, de renverser le capitalisme en attaquant la racine du mal :
- le système capitaliste mondial. Naturellement, cela signifiait une rupture totale avec les traîtres de la Social-Démocratie qui, comme Scheideman, Millerand et d'autres, étaient devenus ouvertement les avocats chauvins de la guerre impérialiste, ou avec les "Social-pacifistes", comme Kautsky, qui continuaient à répandre l'illusion que le capitalisme pouvait exister sans impérialisme, sans dictature, terreur ou guerre.
- Jusque là, il ne pouvait y avoir de désaccord entre les marxistes, et en fait, ces points de base étaient suffisants pour le regroupement de l'avant- garde révolutionnaire dans l'Internationale Communiste. Mais les désaccords qui existaient alors et qui existent encore aujourd'hui dans le mouvement révolutionnaire surgirent lorsque les marxistes tentèrent de faire une analyse plus précise des forces motrices de l'impérialisme et de ses manifestations concrètes, et quand ils tirèrent les conséquences politiques de cette analyse. Ces désaccords tendaient à correspondre aux différentes théories de la crise du capitalisme et du déclin historique du système, puisque l'impérialisme était une tentative du capital pour surmonter ses contradictions mortelles, ce sur quoi tous s'accordaient. Ainsi, Boukharine et Luxemburg par exemple, insistèrent sur des contradictions différentes dans leurs théories des crises, et donc rendaient compte différemment de la force motrice de l'expansion impérialiste. Ce débat fut encore compliqué du fait que le gros du travail de Marx sur les questions économiques avait été écrit avant que l'impérialisme ne soit vraiment établi, et ce trou dans son travail donna lieu à différentes interprétations sur la façon dont les écrits de Marx pouvaient être appliqués à l'analyse de l'impérialisme. Il n'est pas possible dans ce texte de revenir sur tous ces débats sur la crise et l'impérialisme dont la plupart ne sont pas encore résolus aujourd'hui; ce que nous voulons faire, c'est examiner brièvement les deux grandes définitions de l'impérialisme développées à l'époque - thèse de LENINE/BOUKHARINE et thèse de LUXEMBURG - et voir comment s'adaptent les deux définitions à la fois à l'époque d'alors et à l'époque actuelle. Ce faisant, nous tenterons de préciser notre propre conception de l'impérialisme aujourd'hui.
LA CONCEPTION DE L' IMPERIALISME DE LENINE
Pour Lénine, les traits caractéristiques de l'impérialisme étaient :
1. Concentration de la production et du capital parvenue à un degré de développement si élevé qu'elle a créé des monopoles dont le rôle est décisif dans la vie économique.
2. Fusion du capital bancaire et du capital industriel, et création, sur la base de ce 'capital financier1, d'une oligarchie financière.
3. L'exportation des capitaux, à la différence de l'exportation des marchandises, prend une importance toute particulière.
4. Formation d'unions internationales monopolistes de capitalistes se partageant le monde.
5. Fin du partage territorial du globe entre les grandes puissances capitalistes.
("L'impérialisme, stade suprême du capitalisme", VII Ed. du Progrès, Moscou 1971, p.726)
Bien que la définition de l'impérialisme de Lénine contienne un nombre d'indications importantes, sa principale faiblesse est d'être plus une description de certains effets de l'impérialisme qu'une analyse des racines de l'impérialisme dans le processus d'accumulation. L'évolution organique ou intensive du capital vers des unités de plus en plus concentrées, et le développement géographique ou extensif du champ d'activité du capital (la recherche de colonies, la division territoriale du globe) sont fondamentalement des expressions de son processus interne d'accumulation. C'est la composition organique croissante du capital, avec la baisse tendancielle du taux de profit et le rétrécissement du marché intérieur qui contraignent le capital à chercher des débouchés nouveaux, rentables pour l'investissement de capital et à étendre continuellement le marché pour ses marchandises.
Mais bien que la dynamique profonde de l'impérialisme ne change pas, les manifestations extérieures de cette dynamique sont soumises à des modifications, de telle sorte que de nombreux aspects de la définition de Lénine de l'impérialisme sont inadéquats aujourd'hui, et même au temps où il les avait élaborés. C'est ainsi que la période où le capital semblait être dominé par une oligarchie du "capital financier" et par des "groupements de monopoles internationaux" ouvrait déjà la voie à une nouvelle phase pendant la 1ère guerre mondiale; l'ère du capitalisme d'Etat, de l'économie de guerre permanente. A l'époque des rivalités inter-impérialistes chroniques sur le marché mondial, le capital tout entier tend à se concentrer autour de l'appareil d'Etat qui subordonne et discipline toutes les fractions particulières du capital aux besoins de survie militaire/économique. La reconnaissance du fait que le capitalisme était entré dans une phase de luttes violentes entre les "trusts capitalistes d'Etat" nationaux était beaucoup plus claire chez Boukharine que chez Lénine (voir "L'économie mondiale et l'impérialisme" Ed.Anthropos, 1969), bien que Boukharine soit encore prisonnier du rapport impérialisme-capital financier, ce qui fait que son "trust capitaliste d'Etat" est en grande partie présenté comme un instrument de l'oligarchie financière, alors que l'Etat est en réalité l'organe dirigeant suprême à notre époque. Plus encore, comme le soulignait Bilan :
"Définir l'impérialisme comme 'produit du capital financier' comme le fait Boukharine, c'est établir une fausse filiation et surtout c'est perdre de vue l'origine commune de ces deux aspects du processus capitaliste : la production de plus-value." (Bilan n°ll, p.387)
L'échec de Lénine à comprendre la signification du capitalisme d'Etat devait avoir de graves conséquences politiques dans un certain nombre de domaines : les illusions sur la nature progressive de certains aspects du capitalisme d'Etat qui ont été appliqués, avec des conséquences désastreuses, par les bolcheviks dans la révolution russe ; l'incapacité à voir l'intégration des anciennes organisations ouvrières à l'Etat, et la théorie confuse de 1'"aristocratie ouvrière", des "partis ouvriers-bourgeois" et des "syndicats réactionnaires" mais toutefois distincts de la machine étatique (le problème avec ces organisations n'était alors plus qu'un des dirigeants traîtres avait été corrompu par les "superprofits impérialistes", mais que l'appareil tout entier était incorporé au colosse qu'est l'appareil d'Etat). Les conclusions tactiques tirées de ces théories erronées sont bien connues : front unique, travail syndical, etc. De même, l'insistance de Lénine sur le fait que les possessions coloniales étaient un trait distinctif et même indispensable de l'impérialisme n'a pas tenu l'épreuve du temps. Malgré la prévision que la perte des colonies, précipitée par les révoltes nationales dans ces régions, ébranlerait le système impérialiste jusque dans ses fondements, l'impérialisme s'est adapté tout à fait facilement à la "décolonisation". La décolonisation n'a fait qu'exprimer le déclin des anciennes puissances impérialistes et le triomphe des géants impérialistes qui n'étaient pas entravés par un grand nombre de colonies au moment de la 1ère guerre mondiale. C'est ainsi que les Etats-Unis et l'URSS purent développer une politique cynique "anticoloniale" pour mener à bien leurs propres objectifs impérialistes, pour s'appuyer sur les mouvements nationaux et les transformer immédiatement en guerres inter-impérialistes par "peuples" interposés.
La théorie de l'impérialisme de Lénine devint la position officielle des bolcheviks et de l'Internationale Communiste, en particulier en liaison avec la question nationale et coloniale, et c'est là que les manques de la théorie devaient avoir les conséquences les plus sérieuses. Si l'impérialisme est essentiellement défini par des caractéristiques superstructurelles, il devient facile de diviser le monde en nations impérialistes, oppresseuses, et en nations non-impérialistes, opprimées, et même pour certaines puissances impérialistes de "cesser" tout d'un coup d'être impérialistes, lorsqu'elles perdent une ou plusieurs de ces caractéristiques. En même temps s'est développée une tendance à noyer les différences de classe dans les "nations opprimées" et à défendre que le prolétariat -comme champion national de tous les opprimés- devait rallier les nations opprimées sous sa bannière révolutionnaire. Cette position s'appliquait principalement aux colonies, mais Lénine, dans sa critique à la "brochure de Junius", défend l'idée que même les pays capitalistes développés de l'Europe moderne, pourraient, dans certaines circonstances, combattre dans une guerre légitime pour l'indépendance nationale. Pendant la première guerre mondiale, cette idée ambiguë n'eut pas de conséquence, grâce à l'évaluation correcte de Lénine, selon laquelle le contexte impérialiste global de la guerre ne permettait pas au prolétariat de soutenir une politique d'indépendance nationale de quelque belligérant que ce soit. Mais les faiblesses de cette théorie furent démontrées de façon éclatante après la guerre : avant tout, avec le déclin de la vague révolutionnaire et l'isolement de l'Etat russe. L'idée d'un caractère "anti-impérialiste" des "nations opprimées" fut démentie par les faits en Finlande, en Europe de l'Est, en Perse, en Turquie et en Chine, où les tentatives de mener des politiques d'"autodétermination nationale" et de "fronts uniques anti-impérialistes" furent impuissantes à empêcher les bourgeoisies locales de s'allier aux puissances impérialistes et d'écraser toute initiative en faveur de la révolution communiste ([1] [168]). La plus grotesque application des idées avancées par Lénine dans son "à propos de la brochure de Junius" fut peut-être l'expérience "nationale bolchevik" en Allemagne en 1923 : selon ce concept sans fondement, l'Allemagne aurait soudain cessé d'être une puissance impérialiste avec la perte de ses colonies, et le pillage que l'Entente lui avait fait subir. Une alliance anti-impérialiste avec certains secteurs de la bourgeoisie allemande était donc à Tordre du jour. Bien sur, il n'y a pas une ligne directe qui relie les faiblesses théoriques de Lénine à ces trahisons totales. Entre les deux, il y a tout un processus de dégénérescence. Néanmoins il est important que les communistes démontrent que c'est précisément les erreurs des révolutionnaires du passé qui peuvent servir aux partis en dégénérescence ou contre-révolutionnaires pour justifier leur trahison. Ce n'est pas un hasard si la contre-révolution, sous ses formes stalinienne , maoïste ou trotskyste, fait abondamment référence aux théories de Lénine sur l'impérialisme et la libération nationale, pour "prouver" que la Russie ou la Chine ne sont pas impérialistes (voir le truc typique des gauchistes : "où sont les monopoles et les oligarchies financières en URSS ?"); ou aussi pour "prouver" que de nombreuses cliques bourgeoises des pays sous-développés doivent être soutenues dans leur lutte "anti-impérialiste". Il est vrai qu'ils déforment et corrompent nombre d'aspects de la théorie de Lénine, mais les communistes ne devraient pas avoir peur d'admettre qu'il y a de nombreux éléments dans la conception de Lénine qui peuvent être repris plus ou moins "tels quels" par ces forces bourgeoises. Ce sont précisément ces éléments que nous devons être capables de critiquer et de dépasser.
L'IMPERIALISME ET LA BAISSE TENDANCIELLE DU TAUX DE PROFIT
Dans Lénine, il est pratiquement implicite que l'expansion impérialiste puise ses racines dans le processus d'accumulation dans la nécessité de surmonter la baisse tendancielle du taux de profit en cherchant de la main d'œuvre bon marché et des matières premières dans les régions coloniales. Cet élément est plus explicitement mis en évidence par Boukharine, et ce n'est peut-être pas par hasard si l'analyse plus rigoureuse de l'impérialisme par Boukharine était, du moins au début, accompagnée d'une position plus claire sur la question nationale -(pendant la première guerre mondiale et les premières années de la révolution russe, Boukharine a combattu la position de Lénine sur l'auto-détermination nationale. Plus tard, il changea de position : ce fut la position de Luxemburg sur la question nationale -intimement liée à sa théorie de l'impérialisme ([2] [169])- qui s'est avérée la plus consistante.)- Sans aucun doute, la nécessité de contrecarrer la baisse tendancielle du taux de profit fut un élément primordial de l'impérialisme, puisque l'impérialisme commence précisément au stade où un grand nombre de capitaux nationaux à haute composition organique arrivent sur le terrain du marché mondial. Mais, bien que nous ne puissions pas traiter davantage la question ici ([3] [170]), nous considérons que les explications de l'impérialisme qui se réfèrent plus ou moins exclusivement à la baisse tendancielle du taux de profit souffrent de deux faiblesses majeures.
1) De telles explications tentent de dépeindre l'impérialisme comme le fait des seuls pays hautement développés -pays a forte composition organique du capital, obligés d'exporter le capital pour surmonter la baisse tendancielle du taux de profit.
Cette idée a atteint un niveau caricatural avec la CWO ([4] [171]) qui assimile l'impérialisme à l'indépendance économique et politique et conclue qu'il n'y a aujourd'hui que deux puissances impérialistes dans le monde - les USA et l'URSS, parce qu'ils sont les seuls à être vraiment "indépendants" (les autres pays n'ont que des tendances impérialistes qui ne peuvent jamais être réalisées). C'est la conséquence logique du fait de voir le problème du point de vue des capitaux individuels plutôt que du capital global. Comme le soulignait Rosa Luxemburg :
"La politique impérialiste n'est pas l'œuvre d'un pays ou d'un groupe de pays. Elle est le produit de l'évolution mondiale du capitalisme à un moment donné de sa maturation. C'est un phénomène international par nature, un tout inséparable qu'on ne peut comprendre que dans ses rapports réciproques et auquel aucun Etat ne saurait se soustraire." ("La crise de la Social-Démocratie" (Brochure de Junius) - Edition la Taupe, 1970 p.177)
Ceci ne veut pas dire que la conclusion de la CWO es la conséquence inévitable du fait d'expliquer l'impérialisme uniquement en se référant à la baisse tendancielle du taux de profit. Si on prend le point de vue du capital global, il devient clair que si c'est le taux de profit des pays les plus développés qui détermine le taux de profit global, les menées impérialistes des pays avancés qui en découlent ont aussi un écho dans les capitaux les plus faibles. Mais dès l'instant où on considère réellement le problème du point de vue du capital global, une autre contradiction du cycle de l'accumulation apparaît -l'incapacité du capital global à réaliser toute la plus-value à l'intérieur de ses propres rapports de production. Ce problème, posé par Luxemburg dans L'Accumulation du Capital fut nié par Lénine, Boukharine et leurs successeurs, qui l'ont considérée comme un abandon du marxisme. Il n'est pourtant pas difficile de montrer que Marx était préoccupé par le même problème ([5] [172]):
"Plus la production capitaliste se développe, plus elle est forcée de produire à une échelle qui n'a rien à voir avec la demande immédiate mais qui dépend d'une expansion constante du marché mondial. Ricardo recourt à l'affirmation rebattue de Say selon laquelle les capitalistes ne produisent pas dans le but du profit, de la plus-value, mais qu'ils produisent des valeurs d'usage directement pour la consommation -pour leur propre consommation. Il ne tient pas compte du fait que la marchandise doit être convertie en argent. La consommation des ouvriers ne suffit pas, puisque le profit provient précisément du fait que la consommation des ouvriers est inférieure à la valeur de leur produit et qu'il (le profit) est d'autant plus grand que la consommation est, relativement, petite. La consommation des capitalistes eux-mêmes est également insuffisante." (Théories sur la plus-value, 2ème partie, chap. XVI "La théorie de Ricardo sur le profit" - traduit de 1'anglais par nous)
Ainsi, toute analyse sérieuse de l'impérialisme doit prendre en compte cette nécessité d'une "expansion constante du marché mondial". Une théorie qui ignore ce problème est incapable d'expliquer pourquoi ce fut précisément au moment où le marché mondial devint incapable de poursuivre son expansion -avec l'intégration des secteurs les plus importants de l'économie précapitaliste dans l'économie capitaliste mondiale aux débuts du 20ème siècle- que le capitalisme est jeté dans la crise permanente de sa période impérialiste finale. La simultanéité historique de ces deux phénomènes peut-elle être rejetée comme une simple coïncidence ? Alors que toutes les analyses marxistes de l'impérialisme ont vu que la chasse aux matières premières et à la force de travail, toutes deux à bon marché, a été un aspect central de la conquête coloniale, seule celle de Rosa Luxemburg comprend 1'importance décisive des marchés précapitalistes des colonies et des semi-colonies, puisqu’ils fournissent le terrain pour une "expansion constante du marché mondial" jusqu'aux premières années du 20ème siècle. Et c'est précisément cet élément qui est la "variable" dans l'analyse. Le capital peut toujours trouver la force de travail pas chère et les matières premières bon marché dans les régions sous-développées : ceci est vrai à la fois avant et après l'incorporation des colonies et semi-colonies dans l'économie capitaliste mondiale, à la fois dans les phases ascendante et décadente du capital.
Mais d'une part la demande globale de ces régions cesse d'être "extra-capitaliste" et d'autre part le gros de cette demande est intégré dans les rapports de production capitalistes; le capital global n'a pas de nouveaux débouchés pour la réalisation de cette fraction de la plus-value destinée à l'accumulation, il a perdu sa capacité d'étendre continuellement le marché mondial. Maintenant les "régions coloniales" sont-elles mêmes productrices de plus-value, concurrentes des métropoles. La force de travail et les matières premières dans ces régions peuvent rester encore bon marché, elles peuvent rester des aires d'investissement profitables, mais elles ne peuvent plus aider le capital mondial à résoudre les problèmes de réalisation : elles sont devenues parties prenantes du problème. De plus, cette incapacité à étendre le marché mondial des quelques degrés requis par la productivité du capital prive aussi la bourgeoisie d'une des principales contre-tendances à la baisse du taux de profit : l'accroissement de la masse de profit par la production et la vente d'une somme croissante de marchandises. Ainsi se trouvent confirmées les prévisions du Manifeste Communiste :
"Les institutions bourgeoises sont devenues trop étroites pour contenir la richesse qu'elles ont créé. Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'une part, en imposant la destruction d'une masse de forces productives ; d'autre part, en s'emparant de marchés nouveaux et en exploitant mieux les anciens. Qu'est-ce à dire ? Elle prépare des crises plus générales et plus profondes, tout en réduisant les moyens de les prévenir". MARX. ("Manifeste du Parti Communiste.")
C'est la théorie de l'impérialisme de Rosa Luxemburg qui est la meilleure continuation de la pensée de Marx sur cette question.
LA CONCEPTION DE LUXEMBURG SUR L'IMPERIALISME ET SES CRITIQUES
"L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde. Géographiquement, ce milieu représente aujourd'hui encore la plus grande partie du globe. Cependant le champ d'expansion offert à l'impérialisme apparaît comme minime, comparé au niveau élevé atteint par le développement des forces de production capitalistes. Il faut tenir compte en effet de la masse énorme de capital déjà accumulé dans les vieux pays capitalistes et qui lutte pour écouler un surproduit et pour capitaliser sa plus-value et, en outre, de la rapidité avec laquelle les pays précapitalistes se transforment en pays capitalistes.
Sur la scène internationale, le capital doit donc procéder par des méthodes appropriées. Avec le degré d'évolution élevé atteint par les pays capitalistes et l'exaspération de la concurrence des pays capitalistes pour la conquête des territoires non-capitalistes, la poussée impérialiste, aussi bien dans son agression contre le monde non-capitaliste que dans les conflits plus aigus entre les pays capitalistes concurrents, augmente d'énergie et de violence. Mais plus s'accroissent la violence et l'énergie avec lesquelles le capital procède à la destruction des civilisations non-capitalistes, plus il rétrécit sa base d'accumulation. L'impérialisme est à la fois une méthode historique pour prolonger les jours du capital et le moyen le plus sûr et le plus rapide d'y mettre objectivement un terme. Cela ne signifie pas que le point final ait besoin d'être atteint à la lettre. La seule tendance vers ce but de l'évolution capitaliste se manifeste déjà par des phénomènes qui font de la phase finale du capitalisme une période de catastrophes." R.LUXEMBURG.("L'accumulation du capital." Ed. Maspéro. Page 111. Ch.31)
Comme on peut le voir dans ce passage, la définition luxemburgiste de l'impérialisme se concentre sur les bases du problème, c'est à dire le processus d'accumulation, et en particulier la phase du processus qui concerne la réalisation, plus que les ramifications superstructurelles de l'impérialisme. Par ailleurs, cependant, elle montre que le corollaire politique de l'expansion impérialiste est la militarisation de la société et le renforcement de l'Etat : l'essoufflement de la démocratie bourgeoise et le développement de formes ouvertement despotiques de la domination capitaliste, la brutale dégradation du niveau de vie des ouvriers pour maintenir le secteur militaire hypertrophié de l'économie. Bien que "1'Accumulation du Capital" contienne des idées contradictoires sur le militarisme vu comme un "département de l'accumulation", Luxemburg avait fondamentalement raison de voir l'économie de guerre comme une caractéristique indispensable du capitalisme impérialiste décadent. Mais l'analyse fondamentale de la force motrice de l'impérialisme de Luxemburg a été l'objet de nombreuses critiques. La plus importante fut écrite par Boukharine dans son ".L’impérialisme et Accumulation du Capital" (1924). Le gros de ses arguments contre la théorie de Luxemburg a trouvé récemment un écho dans la Communist Workers'Organisation (voir leur revue Revolutionary Perspectives n°6 :"1'Accumulation des contradictions"). Nous répondrons ici aux deux plus importantes critiques émises par Boukharine :
1) Selon Boukharine, la théorie de Luxemburg, selon laquelle le moteur de l'impérialisme réside dans la recherche de nouveaux marchés, rend l'époque impérialiste indifférenciée des autres périodes du capital :
" Le capitalisme commercial et le mercantilisme, le capitalisme industriel et le libéralisme, le capitalisme financier et l'impérialisme -toutes ces phases du développement capitaliste disparaissent et se fondent dans le capitalisme en tant que tel". (Boukharine, "Impérialisme et Accumulation", Ed.EDI, Ch.IV, p.l2l) "
Et pour la CWO :
" (...) et son analyse de l'impérialisme basée sur la "saturation des marchés" est extrêmement faible et inadéquate. Si comme l'admettait Luxemburg... les métropoles capitalistes contenaient encore des enclaves précapitalistes (serfs, paysans), pourquoi le capitalisme a-t-il besoin de s'étendre à l'extérieur, loin des métropoles capitalistes depuis le tout début de son existence ? Pourquoi n'a-t-il pas d'abord intégré ces couches dans le rapport capital-travail salarié s'il cherchait uniquement de nouveaux marchés? L'explication réside non dans le besoin de Mouvaux marchés, mais dans la recherche des matières premières et du profit maximum. Deuxièmement, la théorie de Luxemburg implique que l'impérialisme est une caractéristique permanente du capitalisme. Comme le capitalisme, pour Luxemburg, a toujours cherché à étendre le marché pour accumuler , sa théorie ne peut faire la distinction entre l'expansion originelle des économies de commerce et d'argent à l'aube du capitalisme en Europe et son expansion impérialiste ultérieure...le capital mercantile était nécessaire à l'accumulation originelle, mais c'est un phénomène qualitativement différent de la façon dont le capitalisme accumule une fois qu'il s'est établi comme mode de production dominant."
("Revolutionary Perspectives" n°6, P.18-19)
Dans ce passage; la virulence de la CWO contre le "luxemburgisme" surpasse même la polémique acérée de Boukharine. Un certain nombre de points doivent être établis avant de poursuivre. D'abord, Luxemburg n'a jamais dit que l'expansion impérialiste était due uniquement à la recherche de nouveaux marchés : elle a clairement décrit sa quête planétaire à la recherche de main d'œuvre bon marché et de matières premières, comme la CWO le note à la même page de Revolutionary Perspectives n°6. Deuxièmement, il est étonnant de présenter le besoin du capitalisme "d'étendre ses marchés pour accumuler" comme une découverte de Luxemburg, alors que c'est une position fondamentale défendue par Marx contre Say et Ricardo, comme nous l'avons déjà vue. Boukharine lui-même, n'a en aucune manière nié que l'impérialisme recherchait de nouveaux marchés, en fait, il considère ce fait comme une des trois forces motrices de l'expansion impérialiste :
" Nous avons mis à nu trois mobiles fondamentaux de la politique de conquête des Etats capitalistes modernes. Une compétition accrue sur le marché de la vente, sur le marché des matières premières et pour la sphère d'investissement du capital...Ces trois racines de la politique du capital financier, toutefois, représentent en substance seulement trois facettes d'un même phénomène, qui n'est autre que le conflit entre l'accroissement des forces productives et les limites "nationales" de l'organisation de la production".
BOUKHARINE. ("L'économie mondiale et l'impérialisme." Ch. 4. P. 101-102)
Néanmoins, l'opposition demeure : pour Lénine, Boukharine et autres, c'est "1'exportation des capitaux" et non celles des "marchandises" qui distinguent la phase impérialiste du capital de sa phase précédente. Est-ce que la théorie de Luxemburg ignore cette distinction et donc implique que l'impérialisme était une caractéristique du capital dès le début ?
Si nous nous référons aux passages de Luxemburg cités dans le texte, particulièrement à la longue citation de la "Critique des critiques", nous pouvons voir que Luxemburg faisait elle-même clairement une distinction entre la phase d'accumulation primitive et la phase impérialiste, qui est indubitablement présentée comme une phase déterminée dans le développement du capital. Est-ce que ce sont des mots creux ou est-ce qu'ils correspondent à la substance de la théorie de Luxemburg ?
En fait, il n'y a pas là de contradiction dans l'analyse de Luxemburg. L'impérialisme à proprement parler débute après les années 1870, lorsque le capitalisme mondial arrive à une nouvelle configuration significative : la période où la constitution des Etats nationaux d'Europe et d'Amérique du Nord est achevée, et où, au lieu d'une Grande-Bretagne "usine du monde", nous avons plusieurs "usines" capitalistes nationales développées en concurrence pour la domination du marché mondial -en concurrence non seulement pour l'obtention des marchés intérieurs des autres mais aussi pour le marché colonial . C'est cette situation qui provoque la dépression des années 1870 -"germes de la décadence capitaliste" justement parce que le déclin du système est synonyme de la division du marché mondial entre capitaux concurrents- avec la transformation du capitalisme en un "système fermé" dans lequel le problème de la réalisation devient insoluble. Mais, bien sûr, dans les années 70, la possibilité de briser le cercle fermé existait encore, et cela explique en grande partie la course désespérée de l'expansion impérialiste à cette époque.
Il est vrai, comme le souligne la CWO, que le capital a toujours recherché des marchés coloniaux, mais il n'y a pas de mystère à cela -les capitalistes chercheront toujours des zones d'exploitation rentables et des bonnes ventes, même si les marchés disponibles "chez soi" ne sont pas totalement saturés. Il serait absurde de s'attendre à ce que le capitalisme suive un cours de développement régulier -comme si les capitalistes s'étaient rencontrés pour dire ensemble : "d'abord nous allons épuiser tous les secteurs précapitalistes en Europe, ensuite nous nous étendrons à l'Asie, ensuite à 1'Afrique, etc ..."
Néanmoins, derrière le développement chaotique du capitalisme, on peut voir une caractéristique bien déterminée : le pillage des colonies par le capitalisme naissant; l'utilisation de ce pillage pour accélérer la révolution industrielle dans la métropole; ensuite, sur la base du capitalisme industriel, une nouvelle poussée dans les régions coloniales. Bien sûr, la première période de l'expansion coloniale n'était pas une réponse à une surproduction intérieure, mais correspondait aux nécessités de l'accumulation primitive. Nous ne pouvons commencer à parler d'impérialisme que 1orque l'expansion coloniale devient une réponse aux contradictions d'une production capitaliste pleinement développée. Dans cette mesure, nous pouvons situer les débuts de l'impérialisme à l'époque où les crises commerciales du milieu du 19ème siècle agissent comme aiguillon de l'expansion du capital britannique vers les colonies et semi-colonies. Mais, comme nous l'avons dit, l'impérialisme dans le plein sens du terme implique une relation de concurrents entre Etats capitalistes; et c'est lorsque le marché des métropoles a été partagé de façon décisive entre plusieurs géants capitalistes que l'expansion impérialiste devient une nécessité inévitable pour le capital. C'est ce qui explique la transformation rapide de la politique coloniale britannique dans la dernière partie du 19ème siècle. Avant la dépression des années 1870, avant l'accroissement de la concurrence des USA et de l'Allemagne, les capitalistes britanniques se demandaient si les colonies existantes valaient les dépenses qu'elles entraînaient et étaient hésitants à s'emparer de nouvelles colonies; ils furent à cette époque convaincus de la nécessité pour la Grande-Bretagne de maintenir et d'étendre sa politique coloniale. La course aux colonies de la fin du 19èmé siècle ne fut pas le résultat d'une soudaine vague de folie de la part de la bourgeoisie ou d'une recherche orgueilleuse de prestige national, mais était une réponse à une contradiction fondamentale du cycle d'accumulation : la concentration grandissante du capital et le partage du marché dans les métropoles, aggravant simultanément la baisse tendancielle du taux de profit, et le fossé entre la productivité et les marchés solvables, c'est à dire le problème de la réalisation.
L'idée que l'orientation vers l'ouverture de nouveaux marchés fut un élément de l'expansion impérialiste n'est pas, contrairement à ce que proclame la CWO dans RP n°6 (P.19) contredit par le fait que le gros du commerce mondial à cette époque était constitué par le commerce des métropoles capitalistes entre elles. Le phénomène avait été souligné par Luxemburg elle-même :
" (...) Avec le développement international du capitalisme, la capitalisation de la plus-value devient de plus en plus urgente et précaire. Il élargit d1rautre part la base dû capital constant et du capital variable en tant que masse, aussi bien dans l'absolu que par rapport à la plus value. De là le phénomène contradictoire que les anciens pays capitalistes, tout en constituant les uns pour les autres un marché toujours plus large et en pouvant de moins en moins se passer les uns des autres, entrent en même temps dans une concurrence toujours plus acharnée pour les relations avec les pays non capitalistes". R.LUXEMBURG ("L'Accumulation du Capital" Ch.26, p.39)
Les marchés "extérieurs" étaient pour le capital global un espace d'air frais dans une prison plus forte et plus peuplée. Plus l'espace d'air frais se rétrécit par rapport à la surpopulation de la prison, et plus les prisonniers se jetaient désespérément dessus.
Le fait que durant cette période, il y eut un net accroissement des exportations de capital ne signifie pas non plus que l'expansion impérialiste n'ait rien à voir avec un problème de marchés. L'exportation de capital vers les régions coloniales était nécessaire non seulement parce qu'elle permettait au capitalisme de produire dans des zones où la force de travail était bon marché et donc d'augmenter le taux de profit, mais encore parce qu'elle étendait le marché mondial :
a) parce que l'exportation de capitaux inclut l'exportation de biens de production qui sont eux-mêmes des marchandises qui doivent être vendues;
b) parce que l'exportation de capital -que ce soit sous la forme de capital monétaire pour l'investissement ou de biens de production- servait à étendre 1'ensemble du marché pour la production capitaliste en l'implantant dans de nouvelles régions et en amenant de plus en plus d'acheteurs solvables dans son orbite. L'exemple le plus évident est la construction de chemins de fer, qui ont servi à étendre la vente des marchandises capitalistes à des millions et des millions de nouveaux acheteurs.
Le problème du "marché" peut aider à expliquer une des caractéristiques les plus nettes de la façon dont l'impérialisme a étendu la production capitaliste à travers le monde : la "création" du sous-développement. Parce que les impérialistes voulaient un marché soumis -un marché d'acheteurs qui ne deviendraient pas des concurrents des métropoles en devenant producteurs capitalistes eux-mêmes. Il en découle le phénomène contradictoire par lequel l'impérialisme a exporté le mode de production capitaliste et a détruit systématiquement les formations économiques précapitalistes, tout en freinant simultanément le développement de capital indigène en pillant impitoyablement les économies coloniales, en subordonnant leur développement industriel aux besoins spécifiques de l'économie des métropoles et en appuyant les éléments les plus réactionnaires et les plus soumis des classes dominantes indigènes. C'est pourquoi, contrairement aux prévisions de Marx, le capitalisme n'a pas crée une image réfléchie de lui-même dans les régions coloniales. Dans les colonies et les semi-colonies, il ne devait pas naître de capitaux nationaux indépendants -pleinement formés avec leur propre révolution bourgeoise et leur base industrielle saine- mais plutôt des caricatures grossières des capitaux des métropoles, affaiblies par le poids des vestiges en décomposition des modes de production antérieurs, industrialisées au rabais pour servir les intérêts étrangers, avec des bourgeoisies faibles, nées séniles, à la fois au niveau économique et politique. L'impérialisme avait ainsi crée le sous-développement et ne serait plus jamais capable de l'abolir; en même temps, il s'assurait qu'il ne pourrait pas y avoir de révolutions bourgeoises dans les zones arriérées.
En grande partie, les répercussions profondes du développement impérialiste, répercussions qui ne sont que trop évidentes aujourd'hui où le "Tiers-Monde" sombre dans la barbarie, ont leurs origines dans la tentative impérialiste d'utiliser les colonies et les semi-colonies pour résoudre les problèmes des marchés.
Selon Boukharine, la définition de l'impérialisme par Luxemburg signifie que l'impérialisme cesse d'exister lorsqu'il n'y a plus de vestige du milieu non-capitaliste à se disputer :
" (...) Il suit de cette définition que la lutte pour des territoires DEJA capitalistes n'est pas de l’'impérialisme, ce qui est absurde ... il suit de la même définition que la lutte pour des territoires qui sont déjà "occupés" n1est pas non plus de l'impérialisme. La fausseté de ce moment de la définition saute aux yeux lui aussi... Citons un exemple typique qui permettra d'illustrer le caractère insoutenable de la conception luxemburgienne de l'impérialisme. Nous songeons à l'occupation de la Ruhr par les français (1923).
Du point de vue de la définition de Rosa Luxemburg, il n'y a ici aucun impérialisme, car :
1) il manque ici les "derniers territoires"
2) il n'existe ici aucun "territoire non-capitaliste"
3) le territoire de la Ruhr possédait déjà avant l'occupation un propriétaire impérialiste.".
("Impérialisme et Accumulation", p.121-122)
Cet argument a été repris dans la question naïve posée par la CWO à la 2ème Conférence Internationale à Paris : "Où sont les marchés précapitalistes ou autres dans la guerre entre Ethiopie et Somalie pour le désert de l'Ogaden ?" Une telle question trahit une compréhension bien faible de ce que dit Luxemburg, ainsi qu'une tendance regrettable à voir l'impérialisme, non comme "un phénomène international par nature, un tout inséparable" mais comme "l'œuvre d'un pays ou d'un groupe de pays"; en d'autres termes, une tendance à voir le problème du point de vue partiel et individuel des capitaux nationaux.
Si Boukharine s'est soucié de citer plus que la première phrase du passage de "L'Accumulation du capital" dé Luxemburg que nous avons cité entièrement TpTl3), il aurait montré que pour Luxemburg, l'épuisement grandissant du milieu non-capitaliste ne signifiait pas la fin de l'impérialisme, mais l'intensification des antagonismes impérialistes entre les Etats capitalistes eux-mêmes. C'est ce que voulait dire Luxemburg quand elle écrivait que : "l'impérialisme ramène sa catastrophe de la périphérie de son champ d'action à son point de départ" ("Critique des critiques"). Dans la phase finale de l'impérialisme, le capital est plongé dans une horrible série de guerres où chaque capital ou bloc de capitaux, incapable de s'étendre "pacifiquement" à de nouvelles zones, est contraint de s'emparer des marchés et des territoires de ses rivaux. La guerre devient le mode de survie de tout le système.
Bien sûr Luxemburg pensait que la révolution mettrait fin au capitalisme bien avant que le milieu non capitaliste n'en soit réduit à l'insignifiant facteur qu'il est aujourd'hui. L'explication de la façon dont le capitalisme décadent a prolongé son existence en l'absence de fait de ce milieu n'est pas l'objet de ce texte ([6] [173]). Mais tant qu'on considère l'impérialisme comme un "produit de l'évolution mondiale du capitalisme à un moment donné de sa maturation", "un phénomène international par nature, un tout inséparable", nous pouvons voir la validité de la définition de Luxemburg. Elle nécessite seulement d'être modifiée dans la mesure où aujourd'hui, les politiques impérialistes de conquête et de domination sont déterminées par la quasi complète disparition d'un marché extérieur, au lieu d'être une lutte directe pour des vestiges précapitalistes. Il est importait de souligner un changement global dans l'évolution du capitalisme mondial -l'épuisement des marchés extérieurs- qui pousse chaque fraction particulière du capital à se comporter de façon impérialiste.
Revenons aux objections de Boukharine : il n'est pas nécessaire de chercher des "milieux non-capitalistes" dans chaque conflit impérialiste, parce que c'est le capital comme un tout, le capital global, qui nécessite un marché extérieur pour son expansion. Pour le capitaliste individuel, les capitalistes et les ouvriers offrent un marché parfaitement valable pour ses marchandises : de même, pour un capital national, une nation capitaliste rivale peut être utilisée pour absorber sa plus-value. Tout marché que se disputent les Etats impérialistes n'a pas toujours été précapitaliste, et c'est de moins en moins le cas au fur et à mesure que ces marchés s'intègrent au capital mondial. Chaque lutte inter-impérialiste n'est pas non plus une lutte directe pour des marchés, loin de là. Dans la situation actuelle, la rivalité globale entre les USA et l'URSS est conditionnée par l'impossibilité d'étendre progressivement le marché mondial. Mais beaucoup, et peut-être la plupart des aspects spécifiques des politiques étrangères des USA et de l'URSS sont dirigés vers la consolidation d'avantages stratégico-militaires sur l'autre bloc. Par exemple, Israël n'est pas plus un marché pour les USA que Cuba pour l'URSS. Ces positions sont entretenues principalement pour leur valeur stratégico-politique, au prix de considérables dépenses de la part de leurs souteneurs. A une plus petite échelle, le pillage par le Vietnam des champs de riz cambodgiens n'est que cela, un pillage. Le Cambodge n'en constitue pas pour autant un "marché" pour l'industrie vietnamienne. Mais le Vietnam est contraint de piller les champs de riz cambodgiens parce que la stagnation industrielle de son secteur agricole ne lui permet pas de produire suffisamment pour nourrir la population vietnamienne. Et sa stagnation industrielle est déterminée par le fait que le marché mondial ne peut pas s'étendre, est déjà partagé, et n'admettrait pas de nouveaux arrivants. Une fois encore, ces
questions ne trouvent leur sens qu'en partant du point de vue global .
CONCLUSIONS POLITIQUES : L’IMPERIALISME ET L'IMPOSSIBILITE DES GUERRES NATIONALES
Les implications politiques du débat théorique sur l'impérialisme ont toujours été centrées sur une question : l'époque de l'impérialisme a-t-elle rendu plus probables les guerres nationales révolutionnaires comme l'affirmait Lénine, ou les a-t-elle rendues impossibles, comme l'affirmait Luxemburg ? Pour nous 1'histoire a de façon irréfutable confirmé l'affirmation de Luxemburg selon laquelle :
"La tendance générale de la politique capitaliste actuelle domine la politique des Etats particuliers comme une loi aveugle et toute puissante, tout comme les lois de la concurrence économique déterminent rigoureusement les conditions de production pour chaque entrepreneur particulier". ("Brochure de Junius", p.178)
Et en conséquence :
"A l'époque de cet impérialisme déchaîné, il ne peut plus y avoir de guerres nationales. Les intérêts nationaux ne sont qu'une mystification qui a pour but de mettre les masses populaires laborieuses au service de leur ennemi mortel : l'impérialisme."
(Idem, p.220)
La première citation a les applications concrètes suivantes à cette époque -qui vérifient toutes deux de façon éclatante la seconde citation :
a) Toute nation, toute bourgeoisie en puissance, est contrainte de s'aligner derrière un des blocs impérialistes dominants, et donc de se conformer et de se plier aux impératifs du capitalisme mondial. Encore une fois, selon les mots de Luxemburg :
"Les petites nations, dont les classes dirigeantes sont les jouets et les complices de leurs camarades de classe des grands Etats, ne sont que des pions dans le jeu impérialiste des grandes puissances et tout comme les masses, ouvrières des grandes puissances, elles sont utilisées comme instruments pendant la guerre pour être sacrifiées après la guerre aux intérêts capitalistes". ("La crise de la Social-Démocratie" (Brochure de Junius) p.221)
Contrairement à l'espoir de Lénine que les révoltes des "nations opprimées" affaibliraient l'impérialisme, toutes les luttes nationales à notre époque ont été transformées en guerres impérialistes par l’irréversible domination des grandes puissances; comme le reconnaissait Lénine lui-même, l'impérialisme signifie que le monde entier est divisé entre les grands Etats capitalistes : "de telle sorte que dans l'avenir seul un repartage est possible, c'est à aire que les territoires ne peuvent que passer d'un "propriétaire" à un autre, au lieu de passer du stade de territoire libre à celui de "propriétaire". ("L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme")
L'expérience des 60 dernières années a montré que ce que Lénine appliquait aux "territoires" peut être appliqué aussi à toutes les nations. Aucune ne peut échapper à l'étau impérialiste. C'est particulièrement évident aujourd'hui où le monde a été partagé, depuis 1945, en 2 blocs impérialistes constitués de façon permanente. Alors que la crise s'approfondit et que les blocs se renforcent, il devient clair que même les géants capitalistes comme le Japon et la Chine doivent se soumettre humblement aux diktats de leur maître, les USA. Dans une telle situation, comment peut-on encore avoir des illusions sur la possibilité d'indépendance nationale" des pays chroniquement faibles que sont les anciennes colonies ?
b) Toute nation ([7] [174]) est contrainte d'agir de façon impérialiste par rapport à ses concurrents. Même en étant subordonnée à un bloc dominant, toute nation est obligée de tenter d'en soumettre d'autres, plus petites, à son hégémonie. Luxemburg a noté ce phénomène pendant la première guerre mondiale, par rapport à la Serbie :
" Formellement, la Serbie mène sans aucun doute une guerre de défense nationale. Mais sa monarchie et ses classes dominantes sont bourrées de velléités expansionnistes comme le sont les classes dominantes de tous les Etats modernes... Ainsi, la Serbie avance aujourd'hui vers les côtes adriatiques où elle mène un véritable conflit impérialiste avec l'Italie sur le dos des Albanais." ("Brochure de Junius". p.181.182)
L'état d'asphyxie du marché mondial fait de la décadence l'époque de la guerre de chacun contre tous. Loin de pouvoir échapper à cette réalité, les petites nations sont contraintes de s'adapter totalement. La militarisation extrême des capitaux les plus arriérés, les fréquentes guerres locales entre les Etats des régions sous-développées, sont les manifestations chroniques du fait qu'"aucune nation ne peut rester à l'écart" de la politique impérialiste aujourd'hui.
Selon la CWO, "l'idée que tous les pays sont impérialistes contredit l'idée des blocs impérialistes". (Revolutionary Perspectives.n°12. p.25). Mais cela n'est vrai que si on limite la discussion à l'avance en affirmant que seules les puissances "indépendantes" sont impérialistes. Il est vrai que toute nation doit s'inscrire dans l'un ou l'autre bloc impérialiste, mais elle le fait seulement parce que c'est la seule façon de défendre ses propres intérêts impérialistes. Les conflits et les conflagrations à l'intérieur de chaque bloc n'en sont pas éliminés pour autant (et ils peuvent même prendre la forme de guerres ouvertes comme entre la Grèce et la Turquie en 1974) : ils sont seulement subordonnés à un conflit qui prévaut sur tous les autres. Les blocs impérialistes, comme toutes les alliances bourgeoises, ne peuvent être réellement unifiés ou harmonieux. Les voir ainsi, ou du moins considérer les nations faibles d'un bloc seulement comme des pantins dans les mains des puissances dominantes, rend impossible à comprendre les contradictions réelles et les conflits qui surgissent au sein du bloc, non seulement entre les nations faibles elles-mêmes, mais entre les besoins des nations les plus faibles et ceux de la puissance dominante. Le fait que ces conflits se règlent presque toujours en faveur de l'Etat dominant, ne les rend pas moins réels. De même, ignorer les menées impérialistes des petites nations rend pratiquement impossible à expliquer les guerres entre ces Etats. Le fait que ces menées soient invariablement utilisées pour les intérêts des blocs ne signifie pas qu'elles soient purement produites par les décisions secrètes de Moscou ou de Washington. Elles proviennent des tensions et des difficultés réelles au niveau local, difficultés qui donnent inévitablement lieu à une réponse impérialiste de la part des Etats locaux. Il ne tient pas debout de dire que les plus petites nations ont seulement des tendances impérialistes lorsqu'on voit par exemple le Vietnam envahir le Cambodge, renverser son gouvernement, installer un régime qui lui est soumis, piller son économie, et faire des appels pour la formation d'une "Fédération Indochinoise" sous l'hégémonie Vietnamienne. Le Vietnam n'a pas seulement des appétits impérialistes; il les satisfait concrètement en gobant ses voisins.
Si nous rejetons l'idée que cette politique est l'expression d'un Etat ouvrier livrant une guerre révolutionnaire, si nous ne considérons pas le clan dominant au Vietnam comme le protagoniste d'une lutte bourgeoise historiquement progressive pour l'indépendance nationale, il n'y a qu'un seul mot pour une politique et des actes de cet acabit : impérialisme.
GUERRE IMPERIALISTE OU REVOLUTION PROLETARIENNE
Si toutes les "luttes nationales" servent les intérêts d'Etats impérialistes grands ou petits, alors il est impossible de parler de guerre de défense nationale, de libération nationale, ou de mouvements révolutionnaires nationaux à cette époque. Il est nécessaire de rejeter toute tentative de réintroduire la position de l'Internationale Communiste sur la question nationale et coloniale. Ainsi par exemple, le Nucleo Comunista Internazionalista ([8] [175]) suggère qu'il serait possible d'appliquer les thèses de l'IC aux régions sous-développées si un vrai parti communiste existait :
"(...) dans les zones extra-métropolitaines, la mission d'un parti communiste passe, obligatoirement par l'accomplissement de tâches qui ne sont pas ''siennes" (en termes immédiats), même 'démocraties-bourgeoises' (constitution d'un Etat national indépendant, unification territoriale et économique, réforme agraire, nationalisation, "
(Notes pour une orientation sur la question nationale et coloniale. Textes préparatoires, vol.I, 2ème Conférence Internationale. Paris. Nov.78). La préoccupation du NCI est que le prolétariat et son avant-garde ne peuvent être indifférents aux mouvements sociaux des masses opprimées dans ces régions, doivent prendre la tête de leurs révoltes, les rattacher à la révolution communiste mondiale : ceci est parfaitement correct. Mais pour cela, le prolétariat doit aussi reconnaître que l'élément "national" ne vient pas des masses opprimées et exploitées, mais de leurs oppresseurs et exploiteurs. Dès 1'instant où ces révoltes sont entraînées dans une lutte pour des tâches "nationales", elles sont déviées sur le terrain de la bourgeoisie. Dans le contexte actuel national implique impérialisme :
"Depuis lors, l'impérialisme a complètement enterré le vieux programme bourgeois démocratique : l'expansion au-delà des frontières nationales (quelles que soient les conditions nationales des pays annexés) est devenue la plate-forme de la bourgeoisie de tous les pays. Certes la phrase nationale est demeurée, mais son contenu réel et sa fonction se sont mués en leur contraire. Elle ne sert plus qu'à masquer tant bien que mal les aspirations impérialistes, à moins qu'elle ne soit utilisée comme cri de guerre, dans les conflits impérialistes, seul et ultime moyen idéologique de capter l'adhésion des masses populaires et de leur faire jouer le rôle de chair à canon dans les guerres impérialistes." ("Brochure de Junius", p.178)
Cette vérité a été confirmée par tous les soi- disant mouvements de "libération nationale" du Vietnam à l'Angola, du Liban au Nicaragua. Avant et après leur accession au pouvoir, les forces bourgeoises de libération nationale agissent invariable ment comme agents de Tune ou l'autre des grandes puissances impérialistes. Dès le moment où elles s'emparent de l'Etat, elles commencent à poursuivre leurs propres buts impérialistes. Donc, la question n'est pas de diriger la révolte des masses "opprimées dans un "moment" de la lutte nationale démocratique bourgeoise, mais de les conduire hors du terrain national bourgeois, sur le terrain prolétarien de la guerre de classe. "Transformer la guerre impérialiste en guerre civile" est le cri de |ralliement du prolétariat dans toutes les parties du monde aujourd'hui.
Le caractère impérialiste actuel de toutes les fractions de la bourgeoisie et de tous leurs projets politiques ne peut pas être inversé, pas même momentanément, pas même par le meilleur parti communiste du monde. C'est une réalité historique profonde, basée sur une évolution sociale objectivement déterminée.
"L'ère des guerres impérialistes et des révolutions prolétariennes n'oppose plus des Etats réactionnaires et des Etats progressistes dans des guerres où se forge, avec le concours des masses populaires, l'unité nationale de la Bourgeoisie, où s'édifie la base géographique et politique servant de tremplin aux forces productives.
Elle n'oppose plus davantage la Bourgeoisie aux classes dominantes des colonies dans des guerres coloniales fournissant air et espace aux forces capitalistes de production déjà puissamment développées.
Mais cette époque oppose des Etats impérialistes, entités économiques se partageant et se repartageant le monde, incapables cependant de comprimer les contrastes de classe et les contradictions économiques autrement qu'en opérant, par la guerre, une gigantesque destruction de forces productives inactives et d'innombrables prolétaires répétés de la production.
DU POINT DE VUE DE L'EXPERIENCE HISTORIQUE, ON PEUT AFFIRMER QUE LE CARACTERE DES GUERRES QUI EBRANLENT PERIODIQUEMENT LA SOCIETE CAPITALISTE, AINSI QUE LA POLITIQUE PROLETARIENNE CORRESPONDANTE, DOIVENT ETRE DETERMINES NON PAR L'ASPECT PARTICULIER ET SOUVENT EQUIVOQUE - SOUS LEQUEL CES GUERRES PEUVENT APPARAITRE, MAIS PAR LEUR AMBIANCE HISTORIQUE ISSUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DU DEGRE DE MATURITE DES ANTAGONISMES DE CLASSE."(Souligné par nous) (Le problème de la guerre. 1935. Jehan.)
Quand nous concluons que dans le contexte historique actuel, toutes les guerres, toutes les politiques de conquête, toutes les relations concurrentes entre Etats capitalistes, ont une nature impérialiste, nous ne sommes pas en contradiction avec ce qu'affirmait avec raison Boukharine, qu'il fallait juger du caractère d'une politique des guerres et des conquêtes à partir de la question : "Quels rapports de production sont renforcés ou étendus par la guerre." Nous n'affaiblissons pas la précision du terme "impérialisme" en élargissant son emploi. Car, si les marxistes identifiaient les guerres nationales à des guerres au service d'une fonction progressive par l'extension des rapports de production à l'époque où ceux-ci servaient encore de base pour le développement des forces productives, ils opposaient les guerres de ce type aux guerres impérialistes - guerres historiquement réactionnaires en ce qu'elles servent à maintenir les rapports capitalistes alors qu'ils sont devenus une entrave à tout développement ultérieur. Aujourd'hui, toutes les guerres de la bourgeoisie et toutes les politiques extérieures visent à préserver un mode de production décadent, pourri : on peut donc toutes les qualifier à juste raison d'impérialistes. En effet, un des traits les plus caractéristiques de la décadence du capitalisme est que, alors que dans sa phase ascendante, "la guerre a pour fonction d’assurer un élargissement du marché, en vue d'une plus grande production de moyens de consommation, dans la phase (décadente) la production est essentiellement axée sur la production de moyens de destruction, c'est-à-dire en vue de la guerre. La décadence de la société capitaliste trouve son expression éclatante dans le fait que des guerres en vue du développement économique (période ascendante), l'activité économique se restreint essentiellement en vue de la guerre." (Gauche Communiste de France, "Rapport sur la situation internationale", 1945)
Bien que le but de la production capitaliste reste la production de plus-value, la subordination croissante de toute l'activité économique aux nécessités de la guerre représente une tendance du capital à se nier lui-même. La guerre impérialiste née de la course aux profits de la bourgeoisie assume une dynamique au cours de laquelle les lois de la rentabilité et de l'échange sont de plus en plus balayées. Les calculs des profits et des pertes, les rapports normaux de vente et d'achat sont laissés en marge de la course folle du capital vers son autodestruction. Aujourd'hui, la "solution" qu'offre le capital à l'humanité logique de son auto cannibalisme, est un holocauste nucléaire qui pourrait détruire la race humaine toute entière. Cette tendance à 1'auto-négation du capital dans la guerre s'accompagne d'une militarisation universelle de la société : un processus qui apparaît dans toute son ampleur dans le tiers-monde et dans les régimes staliniens mais qui, si la bourgeoisie a la voie libre, deviendra bientôt une réalité pour les ouvriers des "démocraties" occidentales également. La subordination totale de la vie économique, politique et sociale aux besoins de la guerre : telle est la terrible réalité de l'impérialisme dans tous les pays aujourd'hui. Plus que jamais, la classe ouvrière mondiale se trouve devant 1'alternative mise en avant par Rosa Luxemburg en 1915 :
"Soit le triomphe de l'impérialisme et la destruction de toute culture comme dans la Rome ancienne, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un immense cimetière soit la victoire du socialisme, c'est-à-dire la lutte consciente du prolétariat international contre l'impérialisme."
("Brochure de Junius", traduit de l'anglais par nous)
C.D.Ward
[1] [176] Voir la brochure du CCI "Nation ou Classe" pour une argumentation plus détaillée.
[2] [177] Ici nous devons corriger une mauvaise compréhension de la CWO lorsqu'elle rejette l’idée que "la vision de Luxemburg sur la question nationale a pour base sa vision économique : la première précède la seconde de plus de 10 ans." (Revolutionary Perspectives n°12, p.25). De toute évidence, la CWO n'est pas au courant de ce passage écrit par Luxemburg en 1898 et publié dans la première édition de "Réforme ou Révolution" :
"Quand nous examinons la situation économique actuelle, nous devons certainement admettre que nous ne sommes pas encore entrés dans la phase de pleine maturité capitaliste qui est prévue par la théorie de Marx des crises périodiques. Le marché mondial est encore dans une phase d'expansion. Donc, bien que nous n'en soyons plus au stade de ces soudains surgissements de nouvelles zones d'ouverture à l'économie qui avaient lieu de temps en temps jusque dans les années 1870, et avec eux, des premières crises pour ainsi dire de 'jeunesse' du capitalisme, nous n'en sommes pas encore à ce degré de développement, de pleine expansion du marché mondial, qui produira des collisions périodiques entre les forces productives et les limites du marché, ou, en d'autres termes, les crises réelles d'un capitalisme pleinement développé...Une fois que le marché mondial est plus ou moins pleinement étendu, de telle sorte qu'il ne peut plus y avoir d'ouverture brutale de marchés, la croissance incessante de la productivité du travail produit tôt ou tard ces collisions périodiques entre les forces productives et les limites du marché qui deviennent de plus en plus violentes et aiguës avec leur répétition."
(cité par Sternberg, "Capitalisme et Socialisme", traduit de l'anglais par nous).
[3] [178] Voir "Théories économiques et lutte pour le socialisme", Revue Internationale n°16.
[4] [179] Communist Workers' Organisation qui publie Revolutionary Perspectives : c/o 21 Durham St. Pelaw,Gateshead, Tyne and Wear, NE10 OXS, GB.
[5] [180] Voir "Marxisme et théories des crises", Revue Internationale n°13.
[6] [181] Voir la brochure à paraître sur "La décadence du capitalisme".
[7] [182] Quand nous disons "toute nation est impérialiste", il est clair que nous faisons une généralisation et que, comme dans toute généralisation, des exceptions peuvent être trouvées, des exemples de tel ou tel Etat qui n'est jamais apparu commettre des crimes impérialistes ; mais, de telles exceptions ne démentent pas l’ensemble. Pas plus que le problème ne peut être évité par des questions stupides du genre "Où est l1impérialisme des Seychelles, de Monaco, de San Remo ?" Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les paradis de la finance ou des tours joués par l'histoire, mais des capitaux nationaux qui, bien qu'ils ne soient pas indépendants, ont une existence palpable et une activité sur le marché mondial !
[8] [183] Partito e Clase : c/o P.Turco Stretta Matteoti 6, 33043 Cividale, Italie.
Questions théoriques:
- Impérialisme [184]
Heritage de la Gauche Communiste:
La Grande Bretagne depuis la 2eme guerre (II)
- 3525 reads
LE PARTI TRAVAILLISTE : EQUIPE GOUVERNEMENTALE ET OPPOSITION LOYALE
9. Le parti de la bourgeoisie qui correspond le mieux aux besoins globaux du capital national britannique - pas seulement dans la crise conjoncturelle actuelle mais dans toute la période de décadence — est le Parti Travailliste. Sa structure spécifique et son orientation sont celles qui correspondent le mieux pour répondre aux exigences du capital britannique, en particulier depuis la 2ème guerre mondiale, par rapport aux nécessités de :
- l'étatisation de l'économie,
- le soutien au bloc occidental,
- contenir la classe ouvrière.
Bien qu'il serait erroné de ne pas reconnaître la souplesse du Parti Conservateur, produit de sa maturité en tant que parti le plus expérimenté de la plus vieille nation capitaliste, l'expérience de ces derniers temps n'a fait que souligner le rôle du Parti Travailliste. En effet, ces derniers dix ans ont vu une crise économique profonde, une intensification des rivalités inter-impérialistes et une combativité ouvrière comme on n'en n'avait pas vue depuis la dernière vague révolutionnaire. A première vue, cet argument peut ne pas paraître si évident : depuis la fin de la guerre, les deux partis ont été au pouvoir environ 17 ans chacun. Cette statistique cache en fait deux facteurs importants:
- La plus longue période de gouvernement conservateur, de 1951 à 1964, avait comme objectif principal d'essayer de maintenir l'unité de l'Empire Commonwealth comme marché de réserve au capital britannique. Son effort n'a pas réussi et une telle situation exigeant un gouvernement semblable ne se reproduira plus.
- Depuis le début de la crise ouverte, les deux occasions où le Parti Travailliste a été chassé du pouvoir ont été produites par des poussées de luttes de classe qui ont considérablement usé la capacité du Parti Travailliste et des syndicats à contenir le prolétariat, usure accentuée par les périodes où le parti de gauche au gouvernement avait attaqué le niveau de vie des ouvriers. Pendant ces périodes, le Parti Travailliste et les syndicats ont traversé des phases d'"opposition" pendant lesquelles ils ont essayé de regrouper leurs forces le plus efficacement possible pour pouvoir répondre aux exigences de la combativité ouvrière. Mais, même dans l'opposition, le rôle de dévoiement de la lutte de la classe ouvrière demeure de manière prédominante et propre à cette fraction de la bourgeoisie.
Ainsi, on peut voir, lorsqu'on étudie l'évolution de la situation depuis 1945, que le défenseur le plus efficace du capital national est le Parti Travailliste. Il est par conséquent l'ennemi le plus dangereux de la lutte du prolétariat.
10. Lorsque nous examinons les manœuvres des partis dans cette période et que nous les relions aux questions qu'affronte la bourgeoisie, on doit se rappeler que :
- Si les différences entre Parti Travailliste et Parti Conservateur ne sont pas aussi grandes que leur propagande essaye de le faire croire, elles correspondent néanmoins à des visions différentes du programme nécessaire au capital britannique. Par exemple, le Parti Travailliste est de loin le plus engagé dans le contrôle de l'Etat sur l'économie que les Conservateurs qui gardent une loyauté plus grande envers les intérêts particuliers de la société ; les Travaillistes sont plus fortement liés à l'appareil syndical, ce que les Conservateurs ne peuvent faire.
- Les programmes défendus par chacun de ces partis ne sont pas figés, mais changent en fonction de la pression imposée au capital national et en fonction des options présentées dans une période donnée. Cette pression provient des circonstances immédiates aussi bien que des effets à long terme de la crise permanente du capitalisme. Par exemple, par rapport à l'accroissement de l'étatisation (qui est maintenant une nécessité historique pour tout capital national), les Conservateurs ont glissé vers une position beaucoup plus à gauche que celle prise, disons il y a environ 10 ans.
- Chaque parti possède plusieurs courants ou fractions en son sein qui reflètent différents programmes pour traiter les problèmes du capital national. Qu'un parti bourgeois puisse tenter de paraître monolithique, il n'empêche que des fractions internes se combattent continuellement. Les changements dans les politiques du parti peuvent ainsi s'effectuer par l'affirmation d'une fraction aux dépends d'une autre.
- Les Travaillistes et les Conservateurs sont tous deux contraints par la structure parlementaire et par le système électoral qui l'exige, d'avoir "recours" à différents secteurs de l'électorat ; ceci est un fardeau sur la capacité de la bourgeoisie à mettre en place la fraction gouvernante qu'elle souhaite, bien que dans le cas de la Grande-Bretagne, le parlementarisme ait constitué une source importante de mystification contre la classe ouvrière. Cependant, la bourgeoisie a la volonté et  la capacité d'interrompre la mascarade électorale lorsque le besoin s'en fait sentir, comme elle l'a fait par exemple entre 1939 et 1945 avec la formation de la coalition nationale.
11. Au début de la 2ème guerre mondiale, la bourgeoisie britannique était gouvernée par la fraction du Parti Conservateur qui avait essayé d'éviter la guerre. Cette fraction tomba à la fin de la "drôle de guerre" et fut remplacée par une alliance de ces secteurs de la bourgeoisie qui considéraient que leur tâche première était d'arrêter l'expansionnisme allemand. Le gouvernement de coalition a conduit par Churchill incluait une représentation substantielle du Parti Travailliste pour deux raisons principales :
- Le Parti Travailliste possédait la capacité nécessaire pour organiser et imposer la domination de l'Etat sur tous les aspects de l'économie et I pour subordonner l'économie aux besoins de la production de guerre.
- Seul le Parti Travailliste était capable de mobiliser la classe ouvrière par d'une part l'austérité et des taux élevés d'exploitation exigés pour lai production de guerre, et d'autre part pour la conscription dans l'armée. Malgré la majorité des Conservateurs dans le gouvernement, le poids réel de l'organisation de la société pour la guerre était assumé par le Parti Travailliste et les syndicats. Et en fait, même la chute de Chamberlain et le choix des Conservateurs de le remplacer par Churchill étaient dus en grande partie aux efforts du Parti Travailliste.
La guerre s'est poursuivie sur plusieurs objectifs dont la plupart étaient partagés par les USA : la défaite de l'Allemagne et du Japon et la résistance à la menace russe en Europe. Cependant, le gouvernement de coalition résista à la menace que représentaient les USA sur l'économie britannique et sur ses colonies. La bourgeoisie britannique ne voulait pas devenir une dépendance des USA. Pour donner une idée de cette résistance, on peut mentionner le fait que, malgré tous les efforts de la bourgeoisie US, ce n'est qu'avec la crise du Canal de Suez en 1955 que la Grande-Bretagne a finalement et ouvertement perdu sa place de puissance mondiale.
Le rôle important qu'a joué le Parti Travailliste dans la coalition a permis à la bourgeoisie de voir plus facilement la nécessité de mettre en place un programme adapté à la période de l'après-guerre qui permettrait de désamorcer toute lutte ouvrière potentielle ; la bourgeoisie avait tiré les leçons des conséquences de la fin non planifiée de la 1ère guerre mondiale. Le rapport Beveridge fut ainsi décrété pour poursuivre et pousser plus loin l'étatisation tout en ayant l'apparence d'offrir des palliatifs consacrés spécifiquement à la classe ouvrière.
12. Le gouvernement Travailliste sous Attlee, élu en 1945, correspondait à la situation de l'immédiat après-guerre. Confronté à une dislocation profonde de l'économie, il maintint beaucoup de mesures prises en temps de guerre pour continuer à répartir ouvriers et matières premières entre les industries. Il mit en œuvre un programme de nationalisation massive qui incluait la Banque d'Angleterre, le charbon, le gaz, l'électricité, le fer et l'acier ainsi que des secteurs de beaucoup d'autres industries. En politique extérieure, le gouvernement reconnût qu'il ne pouvait pas y avoir de renversement du nouvel ordre mondial -les USA étaient les maîtres de ce bloc- et que les jours de l'Empire britannique étaient comptés, puisque le coût économique et militaire pour le préserver ne pouvait plus être soutenu. La concession de l'indépendance à l'Inde ne fut pas par conséquent un coup aussi rude qu'il l'aurait été pour des secteurs du Parti Conservateur. Bien qu'il ait essayé de minimiser les pires des mesures économiques américaines contre la Grande-Bretagne, le Parti Travailliste était mieux adapté à réaliser les mesures d'austérité réclamées par les USA. En travaillant avec l'appareil syndical, il était capable d'enfoncer le niveau des ouvriers pendant des années. Devant les ouvriers, il se présentait avant tout comme le parti du "plein emploi".
- Le Parti Travailliste n'est revenu au pouvoir qu'en 1950 et tomba lors des élections de l'année suivante. Ce tournant électoral vers la droite était le résultat de plusieurs facteurs :
- La reconstruction avait aidé à stimuler l'économie et tendait à renforcer la résistance des secteurs de la bourgeoisie aux projets de nationalisation accrue et de pertes possibles d'autres colonies.
- L'encadrement des travailleurs réussi par le gouvernement Travailliste avait dissipé la crainte de la part de la bourgeoisie dans son ensemble d'un soulèvement social important.
- La résistance aux politiques économiques des USA envers la Grande-Bretagne s'accroissait. Ceci joua contre l'administration Attlee qui était associée à leur mise en œuvre.
13. Les 13 années pendant lesquelles le Parti Conservateur resta au pouvoir ont correspondu aux années de profit économique important dû à la reconstruction d'après-guerre, bien qu'une succession de mesures d'inflation et de déflation ont été nécessaires pour maintenir l'équilibre économique. De plus, il y avait une inertie générale du prolétariat : la lutte de classe était étouffée par la capacité retrouvée de la bourgeoisie à trouver des palliatifs issus de la santé relative de l'économie. Les politiques des Conservateurs du point de vue économique étaient devenues plus appropriées à la période du fait du changement dans le parti vers une acceptation plus réaliste d'un plus haut niveau de capitalisme d'Etat, qui fut entériné par l'adoption de la "Charte Industrielle" de 1947. Les secteurs du parti qui ont ratifié ce document étaient à ce moment-là majoritaires, d'abord sous Churchill, puis sous Eden, et finalement sous Macmillan qui représentait le plus clairement la tendance capitaliste d'Etat dans le parti depuis les années 30.
Macmillan représentait aussi dans le parti la tendance qui voyait que l'Empire britannique ne pourrait pas se maintenir comme avant et il avait soutenu une reconsidération des mesures nécessaires du maintien des anciennes colonies sous la domination économique britannique. Cette tendance fut par conséquent portée au pouvoir après que l'intervention sur Suez d'Eden ait démontré l'impossibilité de maintenir les colonies. L'une de ses principales tâches fut d'établir un programme pour l'indépendance coloniale et ce but fut souligné par Macmillan en 1961 dans le discours de CapTown sur le "vent de changement" soufflant sur l'Afrique.
Sur la question "Europe ou Commonwealth", la bourgeoisie essaya encore de miser sur les deux voies, tenter d'avoir accès aux marchés constitués en Europe tout en maintenant le système des privilèges du Commonwealth. Bien que le gouvernement Conservateur ait favorisé la tenue à l'écart de la Grande-Bretagne lors de la formation de la CEE en 1957, dans les années 60, il y eut des négociations ouvertes pour rejoindre la CEE, puisque les bénéfices du vieux commerce du Commonwealth s'évaporaient devant ses yeux. Mais ce ne fut pas avant les années 70 que les principales fractions de la bourgeoisie sentirent l'affaiblissement de la position économique de la Grande-Bretagne et la nécessité de rejoindre la CEE, outil essentiel pour l'organisation d'une partie importante de l'activité économique du bloc occidental.
Dès les années 60, il était clair que les Conservateurs n'avaient pas d'autre solution politique pour stimuler l'économie et la rendre plus productive, ce qui devenait de plus en plus urgent face à l'accroissement de la compétition allemande et japonaise Il y a eu aussi, lors de la seconde moitié des années 50, une résistance croissante de la part des ouvriers, aux tentatives du gouvernement d'imposer des "restrictions de salaire" et d'accroître l'exploitation. Bien que le niveau de lutte de classe ait été en général bien plus bas qu'à la fin des années 60 ou qu'au début des années 70, la bourgeoisie s'alarma de l'accroissement des grèves illégales.
14. Pour s'occuper de ces problèmes, le gouvernement Travailliste de Wilson fut porté au pouvoir. Il visait à entreprendre une intervention étatique dans l'économie encore plus poussée que celle du gouvernement Conservateur. Il avait des buts limités en matière de nationalisation officielle (principalement une renationalisation de la sidérurgie) ; il s'engageait davantage dans la voie de la planification étatique globale des ressources économiques afin de développer la productivité du capital britannique. Il visait aussi à renforcer le contrôle sur la masse salariale en attirant les organisations patronales et syndicales sous le parapluie de la planification étatique, et à contrôler la vague montante de grèves sauvages en votant des lois sur les syndicats. Afin d'alléger l'économie du fardeau des charges militaires, Wilson retira de l'Est du canal de Suez la plus grande partie du potentiel militaire anglais. De même que le gouvernement précédent d'Attlee, Wilson avait une politique favorable aux USA comme le montre son soutien à l'intervention américaine dans le Sud-est asiatique.
le Parti Travailliste parlementaire, et depuis le début des années 70, entre le gouvernement et le TUC par l'intermédiaire d'un comité de liaison (une partie importante des membres du Parti Travailliste est en fait parrainée par les syndicats). Au niveau idéologique, on peut en gros distinguer deux groupes principaux dans le Parti Travailliste -la gauche et la droite- bien qu'en réalité aucune d'elles ne soit homogène. Quoi que sujettes à des variations, les principales différences d'orientation entre ; ces deux tendances sont :
- En ce qui concerne l'économie, la gauche tend à passer dans le sens d'une plus grande étatisation directe par le biais des nationalisations totales et des contrôles physiques directs. La droite, elle, insiste plus sur le mélange des composantes étatiques et privées de l'économie avec un contrôle étatique moins direct.
Cependant, les plans grandioses de cette administration pour régénérer l'économie britannique s'écroulèrent face à deux problèmes primordiaux :
- La ruée sur la Livre Sterling qui était un trait habituel de l'économie anglaise depuis la guerre, culmina en une attaque massive que la bourgeoisie ne put soutenir. Il s'ensuivit la dévaluation de la Livre Sterling en 1967 qui non seulement marquait la fin du rôle de la Livre en tant que monnaie de réserve internationale, mais en fait annonçait la nouvelle période de crise ouverte du capital mondial.
- L'éruption d'une vague de lutte prolétarienne jamais vue depuis 40 ans et qui signifiait un changement qualitatif dans la nature de la période. Dans les années qui suivirent, une profonde rupture apparut dans le gouvernement Travailliste, au sein du Parti Travailliste, entre le gouvernement et les syndicats, etc. La bourgeoisie était donc en plein désarroi au moment même où elle avait le plus besoin d'un appareil politique uni pour faire face à l'accroissement des luttes ouvrières. Le gouvernement Travailliste tomba en 1970 mais pour être remplacé par l'administration Heath encore plus inadaptée. Pour expliquer le pourquoi de ce désarroi et comment le Parti Travailliste et les syndicats regroupèrent leurs forces entre 1970 et 1974 afin d'affronter la classe, il est nécessaire d'examiner les principales tendances dans le parti et l'appareil syndical.
- Bien que le parti travailliste dans son ensemble accepte la domination américaine sur le bloc occidental, l'aile droite a toujours été plus complaisante que la gauche qui s'est prononcée pour une ligne plus "indépendante" -immédiatement après guerre, une fraction de la gauche s'opposa résolument à la politique américaine et plaida pour la création d'une "3ème force" afin de contrer à la fois la Russie et la domination US sur la Grande-Bretagne.
- Par rapport aux ouvriers la gauche a beaucoup plus insisté sur la nature de classe de la société que la droite. Par exemple, elle a beaucoup plus défendu la "démocratie industrielle" et le "contrôle ouvrier", idée que la droite tendait à laisser tomber.
Ces courants idéologiques se répartissent dans tout le Parti Travailliste et dans l'appareil syndical en des forces et concentrations qui dépendent de plusieurs facteurs, entre autres :
- en général, la situation objective de l'économie et les problèmes militaires qu'affronte le capital britannique; la pression de la classe ouvrière;
- la proximité relative de ces différents secteurs du centre de l'appareil d'Etat ;
- les fonctions spécifiques remplies par ces différentes fractions de l'appareil ; par exemple, les sections de base des circonscriptions électorales et les syndicats, quoiqu'étant tous deux au service du capital britannique, remplissent des tâches différentes;
- la fragilité de ces différentes fractions de l'appareil face aux pressions électorales.
15. A cause de ses origines historiques, le "système" du Parti Travailliste est un amalgame complexe d'institutions reliées à différents niveaux et avec des liens plus ou moins forts. A la Conférence annuelle, les principales organisations représentées sont les sections de base des circonscriptions électorales et les syndicats qui siègent, avec le Parti Travailliste parlementaire, au Comité National Exécutif. En dehors de cette structure, dans le Parlement, les membres du Parti Travailliste élisent le chef de file et quelques autres, la composition du cabinet ou "Shadow Cabinet" (cabinet fantôme) est déterminée par ce chef de file. Il existe aussi des liens directs entre le Comité National Exécutif et
Avec ces différences entre les principaux courants idéologiques qui existent dans tout l'appareil, on peut comprendre pourquoi différentes " fractions ont dominé le parti et les syndicats en diverses occasions, et ce que leurs rivalités ont signifié.
16. La composition du gouvernement Travailliste d'après-guerre fut déterminée par la nécessité de se conformer aux diktats économique et militaire des USA, par le maintien d'un contrôle étatique solide sur l'économie et par l'imposition d'un programme d'austérité à la classe ouvrière. Le parti et les syndicats étaient dominés par l'aile droite pour la bonne raison que la bourgeoisie anglaise dominait une classe ouvrière qui a été écrasée pendant les années 30 et la guerre.
L'administration Attlee correspondait donc bien à la situation :
- Elle consolida le contrôle étatique commencé dans les années de guerre en évitant une trop grande résistance des fractions de la bourgeoisie privée encore puissantes. A cet égard le gouvernement dut aussi restreindre le programme de nationalisations à une limite tolérable pour les USA. La bourgeoisie US a imposé des restrictions au processus de nationalisations à travers les conditions qu'elle dicta à la Grande-Bretagne moyennant l'aide du plan Marshall ; les USA voyaient en effet dans ce processus de nationalisation de l'Etat britannique, une menace possible contre son propre programme d'exportation.
- Dans cette période de rivalité aiguë avec l'URSS, le gouvernement Attlee était d'accord pour maintenir un potentiel militaire puissant en Europe, et particulièrement en Allemagne.
- Même si le rapport de forces était bien en faveur de la bourgeoisie, le gouvernement voyait encore la nécessité de mystifier les ouvriers, de faire accepter l'austérité avec l'idée que le pays devait être reconstruit dans le but évident d'élever le niveau de vie des ouvriers. Pour gérer le "Welfare State", un représentant de la gauche, Bevan, fut désigné comme Ministre de la Santé; cette utilisation de la gauche fut encore renforcée quelques années plus tard lorsque ce même Bevan, un de ses principaux porte-parole, devint Ministre du Travail.
17. Durant la période où le Parti Travailliste passe dans l'opposition, des années 50 au début des années 60, une redistribution des forces intervient dans le Parti Travailliste et l'appareil syndical. Au début des années 50, il y a un renforcement de la gauche dans les sections des circonscriptions électorales à propos des questions de politique étrangère et de réarmement. Comme la menace d'une troisième guerre mondiale recule, la gauche se bat contre des dépenses militaires élevées (et accrues par la réduction du soutien de l'Allemagne aux forces britanniques basées dans le pays) et contre les conséquences de la politique militaire américaine en Extrême-Orient. Les dépenses étant trop importantes, la résistance de la gauche aux exigences américaines grandit. Néanmoins, la droite reste forte à la tête de l'appareil syndical car le faible niveau de la lutte de classe ne favorise pas le développement de la gauche.
A partir du milieu des années 50 le tableau commence à changer. L'amélioration progressive de la situation économique provoque une poussée électorale vers la droite, ce qui fit pression sur le Parti Travailliste parlementaire pour suivre le mouvement pour conserver son corps électoral. La fraction Gaitskill fut celle qui exprima le mieux la réponse du Parti à ces pressions lorsqu’elle demanda de revoir le programme du Parti à la Conférence Travailliste de 1960. Elle proposait l'abandon de l'engagement théorique sur la voie des nationalisations de l'ensemble des moyens de production. Ceci se heurta à une forte opposition de la gauche non seulement dans la base électorale mais aussi dans les syndicats au sein desquels se dessinait une évolution vers la gauche dès la seconde moitié des années 50. La lutte de classe se développait. Elle s'exprimait par une augmentation considérable des grèves non officielles contre lesquelles l'aile droite des syndicats n'a pas tenu longtemps. Le premier pas significatif d'une avancée de la gauche fut l'élection de Cousins à la tête du TGWU en 1956 après la mort de Deakin. Cette évolution se poursuivit dans les années 60 avec Lowther et Williamson remplacés par Scanlon, Jones et d'autres.
La fin des années 50 et le début des années 60 fut une période d'agitation intense dans le Parti Travailliste; la gauche avait suffisamment de force dans le Parti et les syndicats pour vaincre les tentatives de Gaitskill d'abandonner la voie des nationalisations. A cette même Conférence, la gauche parvint à faire passer une résolution appelant au désarmement nucléaire unilatéral britannique (bien que cette décision fut renversée dans les années qui suivirent). Alors que la droite dominait encore le Parti, la gauche avait nettement renforcé sa position; ce fut avec ce mélange de forces agissantes au sein du Parti Travailliste que Wilson (qui prit la succession de Gaitskill à sa mort) vint au pouvoir en 1964.
18. Nous avons déjà présenté dans ce texte les buts généraux de l'administration de Wilson, y compris ceux qui visaient la classe ouvrière. Ce gouvernement s'est trouvé presque immédiatement confronté à des difficultés économiques, surtout en ce qui concerne la faiblesse de la Livre Sterling et a donc été obligé de mettre en place un programme contre la classe ouvrière. Ce qui devait être réalisé par l'imposition d'une politique concertée pour contrôler les salaires et par des lois tendant à contrôler les grèves sauvages. L'espoir était de mieux contrôler les grèves par un rapprochement légal entre syndicats et le gouvernement. A cette fin, la commission Donovan fut créée en 1965 pour préparer le terrain aux mesures qui allaient apparaître plus clairement dans le document "à la place des luttes" ("in place of strife") en 1969. Cette approche reflétait directement la forte présence de la fraction de Gaitskill dans le gouvernement et mettait en évidence le décalage grandissant entre cette administration et les syndicats qui devaient faire face directement aux luttes ouvrières. Par conséquent, plutôt que la grève des marins de 1966 soit comprise comme une mise en garde, pour une attitude plus souple envers les syndicats, elle a tout bonnement durci la détermination du gouvernement à agir d'une manière plus rigide et inflexible envers eux. Sous la pression combative des ouvriers, une rupture s'est opérée au niveau idéologique entre les syndicats et le gouvernement. A cette occasion, le gouvernement a été obligé de reculer et d'accepter une politique de salaires décidée "volontairement" par les syndicats. Incapable de venir à bout des luttes ouvrières et divisé par le conflit avec les syndicats, le gouvernement devait tomber avec les élections de 1970.
19. Le principal souci de toute la bourgeoisie pendant la période suivante du gouvernement de Heath (Parti Conservateur) fut la lutte ouvrière. La capacité de ce gouvernement à maîtriser la situation n'était pas meilleure que celle de la précédente équipe travailliste. Le Parti Conservateur appliquait la politique de son aile gauche et c'était ce qu'il pouvait faire de mieux. Il fit les mêmes erreurs que le gouvernement Travailliste qui le précédait et fit passer une loi sur les rapports sociaux dans l'industrie (The Industrial Relations Act) que les syndicats ont combattue.
Dans l'opposition le Parti Travailliste et l'appareil syndical ont regroupé leurs forces avec deux aboutissements essentiels :
- un renforcement significatif de l'aile gauche;
- la création de liens organisationnels entre le TUC et le Parti Travailliste à travers un comité de liaison afin d'éviter les erreurs des années précédentes où ils n'opéraient pas de façon concertée.
La chute de Heath devant la ferme combativité des mineurs en 1974 a ramené les Travaillistes, par une petite majorité, au pouvoir. Pendant les élections, les syndicats et le Parti Travailliste ont pu fonctionner ensemble et entraîner les ouvriers aux urnes.
20. Sous le nouveau gouvernement Travailliste, la consolidation du travail des années précédentes s'est poursuivie et a produit :
- un gouvernement avec une plus forte représentation de la gauche ;
- un "Contrat Social" qui a permis au gouvernement et aux syndicats d'affronter ensemble les ouvriers pour imposer l'austérité et la discipline dont l'économie en crise avait besoin.
A cause de l'inexpérience de la classe ouvrière et malgré une forte combativité, les perspectives de luttes ouvrières restaient très limitées. De plus les ouvriers avaient devant eux le Parti Travailliste au gouvernement et les syndicats, tous deux de nouveau réunis contre les luttes ouvrières. Il s'en est suivi que les luttes ouvrières ont reflué comme elles avaient commencé à refluer dans les autres pays avancés. Dans la phase qui suit le reflux des luttes ouvrières, l'austérité a été de plus en plus durement imposée.
Malgré le mouvement vers la gauche sous le nouveau gouvernement de Wilson et, encore plus sous Callaghan, cette tendance a été freinée par le besoin de faire attention aux intérêts de l'ensemble de la bourgeoisie qui redoutait une évolution trop poussée vers la gauche et par le besoin de calmer la bourgeoisie américaine. En définitive, l'accélération du mouvement vers la gauche devenait de moins en moins nécessaire au fur et à mesure que refluait la lutte de classe. Cependant, dans le contexte de resurgissement des luttes de classe depuis la fin de 1978, de nouvelles pressions se sont fait sentir imposant un nouveau virage à gauche de la politique et des membres du Parti Travailliste. Chassé du pouvoir en mai 1979 à cause de son incapacité à imposer son programme d'austérité à une classe de plus en plus combative, le Parti Travailliste se retrouve une fois de plus dans le rôle de parti d'opposition et, une fois de plus secoué par des luttes de fractions, tentatives pour le rendre apte à affronter la future tourmente.
21. Les conclusions principales qu'on peut tirer du rôle des Partis Travailliste et Conservateur :
- Le Parti Travailliste est le plus approprié à la défense globale des intérêts du capital national britannique, non seulement pour la situation présente, mais aussi dans cette période historique. Ceci est souligné par le fait que, chaque fois que les Conservateurs viennent au pouvoir, ils ne peuvent changer de façon significative la politique des Travaillistes.
- Les manœuvres du Parti Travailliste face au problème du capital britannique doivent être considérées en rapport avec celles des syndicats. Nous pouvons constater que pendant les deux dernières décennies, les liens idéologiques et organisationnels indispensables entre les différentes fractions du mouvement Travailliste se sont considérablement renforcés.
Le cadre parlementaire dans lequel la bourgeoisie britannique a évolué ces dernières années a eu une grande influence sur la manière dont le Parti Travailliste et les syndicats accomplissent leur tâche. Il s'ensuit qu'ils n'ont pas une position permanente dans le gouvernement et leur attaque du prolétariat est différente selon qu'ils se trouvent au pouvoir ou dans l'opposition. Ce passé de l'appareil d'Etat est très dangereux pour les ouvriers parce qu'il a évolué avec la reconnaissance que le prolétariat est le fossoyeur du capital.
LE RAPPORT DE FORCES ENTRE LES CLASSES
22. L'évolution dans le rapport de forces des deux principales classes de la société depuis la 2ème guerre mondiale a pris une dimension historique. La période de la guerre était marquée par l'apogée du pouvoir de la bourgeoisie et le plus bas niveau de la force du prolétariat. Mais aujourd'hui, le prolétariat n'est pas seulement un frein à la guerre mais il montre à travers son défi et sa résistance à l'austérité que le cours historique est de nou veau vers la révolution. Le fait que la 2ème guerre mondiale n'ait pas été immédiatement suivie par une 3ème guerre entre l'URSS et les USA est dû à la re construction contrôlée de l'économie mondiale qui a suffisamment atténué les rivalités inter-impérialistes pour créer une pause dans la tendance vers la guerre de l'époque de décadence du capitalisme. Parce que la reconstruction de l'économie s'est faite à un niveau global et mondial, il y a eu une période de stimulation économique plus longue que celle qui a suivi la 1ère guerre. Cette période prolongée qui a duré plus d'une génération, a permis à la classe ouvrière de se débarrasser des effets accablants de la longue période de contre-révolution qui a débuté à la fin des années 20. Bien que ces évaluations du cours historique viennent d'une perspective globale des rapports de forces entre les classes, il est néanmoins possible et nécessaire d'analyser les expressions de ce changement de cours dans des pays spécifiques.
23. Pendant toute la période de la contre-révolution, les ouvriers n'ont jamais cessé de lutter. Avec toute sa faiblesse, la classe n'a jamais complètement perdu sa combativité même pendant la guerre. En Grande- Bretagne, malgré le fait que toutes les grèves étaient déclarées illégales selon le "Décret 1305", il y a eu plusieurs grèves sauvages surtout parmi les mineurs et les métallurgistes, catégories qui étaient parmi les plus brutalement exploitées pendant la guerre. Une propagande féroce a été dirigée contre eux à la veille de la grève des apprentis- métallos et ils ont été menacés d'un envoi immédiat; au front s'ils ne reprenaient pas le travail. Les mineurs de Betteshanger ont été emprisonnés, mais la grève a été si combative que les bureaucrates de l'Etat ont dû poursuivre les négociations avec les grévistes emprisonnés. Cependant, le rapport de forces était, bien sûr, largement en faveur de la bourgeoisie qui a réussi une mobilisation totale de la population pour l'effort de guerre, surtout au niveau de la production où l'appareil syndical et les shop-stewards ont réussi à imposer des niveaux d'exploitation que le reste de la bourgeoisie enviait.
Dans la période d'après-guerre -sous le gouvernement travailliste- les conditions d'austérité brutale ont été maintenues (le rationnement par exemple n'a pris fin que vers le milieu des années 50). La résistance des ouvriers n'était encore que fragmentaire, mais il y avait des poches de forte résistance chez les mineurs et les dockers. Pendant leur grève, des ouvriers ont été jetés en prison et persécutés par le gouvernement en utilisant des lois du temps de guerre. Le poids de la bourgeoisie était encore d'une force énorme. Au début des années 50, le niveau de la lutte de classe tendait à baisser ; les mesures d'austérité se sont relâchées peu à peu et les ouvriers ont gagné pas mal d'avantages, dont le plein emploi. Les syndicats continuaient néanmoins à appuyer la politique de "restriction des salaires" des gouvernements travailliste et conservateur. C'est seulement en 1956 que le TUC a retiré son appui formel à cette politique, reconnaissant ainsi la résistance grandissante qui se développait parmi les ouvriers.
24. La fin des années 50 a été caractérisée par une reprise importante des luttes, ce qui a particulièrement préoccupé la bourgeoisie, dans la mesure où les luttes ont surgi dans des secteurs-clé, dockers, électriciens et ouvriers de l'industrie automobile en tête. La bourgeoisie a utilisé plusieurs tactiques pour faire face aux revendications salariales et aux grèves :
- prolonger les "négociations" entre le syndicat et le patronnât afin de retarder les grèves pour des revendications salariales ;
- dévoyer les luttes sur le terrain des rivalités entre les différents syndicats : des luttes pour déterminer "la compétence" d'un syndicat par rapport à un autre, étaient courantes à la fin des années 50 (et ceci relié au processus de concentration au sein de l'appareil syndical à ce moment-là) ;
- la concession d'augmentations salariales : dans la mesure où l'expansion de l'économie pouvait le permettre, la bourgeoisie accordait des augmentations de salaire (qui, avec le taux d'inflation relativement faible de l'époque, ne subissaient qu'une érosion lente).
Pendant les années 60, la pression des ouvriers n'a cessé d'augmenter et les palliatifs ne pouvaient être trouvés que dans un accroissement de productivité, ce qui accélérait le taux d'exploitation vers des niveaux explosifs pour plus tard. En même temps, plusieurs industries ont procédé à des licenciements massifs à cause de l'introduction de nouvelles technologies telles que l'automation. Dans ces industries a surgi le plus haut niveau de combativité : mines, industrie automobile, docks, chemins de fer, sidérurgie, etc. Au milieu des années 60, juste avant de la crise ouverte, certaines conditions allaient influer sur le déroulement des luttes à venir entre les deux principales classes de la société.
La classe ouvrière a eu le temps, pendant toute la période de reconstruction, de se remettre des défaites passées, mais elle n'a connu que des expériences de lutte à un faible niveau qui pouvaient être contenues dans le cadre de l'expansion économique.
La bourgeoisie avait également peu d'expérience récente de luttes très combatives et, en plus, son principal appareil politique pour contrôler et mystifier les ouvriers -Parti Travailliste plus appareil syndical- n'était pas complètement "synchronisé" et connaissait en son sein des différends idéologiques prononcés.
25. Avec l'ouverture de la crise et l'intensification de la lutte de classe, l'équilibre économique, politique et social a été détruit. La première vague de combativité prolétarienne en Grande-Bretagne se caractérise par plusieurs aspects importants:
- elle a duré longtemps -68-74- avec des phases de montée et de reflux avec une évolution relativement lente;
- elle a entrainé, à un niveau ou un autre, toute la classe ouvrière et dans ce sens elle se distingue nettement des luttes des années 40, 50 et début 60;
- Malgré les convulsions dans lesquelles la société se trouvait à cause de ces grèves, la lutte n'a jamais pris une dimension explicitement politique.
La réaction de la bourgeoisie a été d'abord de reculer, de regrouper ses forces les plus puissantes et puis quand la lutte a commencé à refluer, elle est passée à la contre-offensive.
Le "recul" a été un pas en arrière devant le danger de confrontations directes avec les ouvriers tant que la montée continuait. En reconnaissant ces dangers, la bourgeoisie a limité l'emploi des armes répressives de l'Etat contre les ouvriers. Les dirigeants syndicaux, eux aussi, ont dû reculer dans la mesure où, dans un premier temps, ils étaient incapables de contenir les ouvriers. L'exemple le plus dramatique de cela a eu lieu en 1970, lorsque les mineurs ont manifesté devant le siège du syndicat national des mineurs (NUM), furieux contre les dirigeants syndicaux qui avaient essayé de briser la grève sauvage et en affrontant la police qui protégeait le bâtiment syndical. De telles menaces étaient claires et les syndicats furent forcés de laisser faire la classe pendant un temps. C'est à cette période que le gouvernement de Wilson a été renversé.
Le gouvernement de Heath a reconnu ces dangers, mais pas aussi clairement que la gauche de la bourgeoisie; il s'est laissé entraîner dans la voie de l'affrontement; on l'a considéré ainsi comme "l'incarnation de la force anti-ouvrière dans la société" pour le plus grand profit du Parti Travailliste et des syndicats qui du coup arrivaient à "organiser" la plus grande mobilisation des ouvriers depuis les années 20 dans la lutte contre 1'"Industrial Relations Act". C'est au cours de cette période que s'est fait le rapprochement et le regroupement des forces entre le Parti Travailliste et les syndicats que nous avons analysés plus haut. Entretemps, les shop-stewards ont pris la relève avec la tactique de "coller" à la classe pour pouvoir plus tard reprendre les rênes et freiner les luttes. Ils ont concentré leurs forces pour isoler les grèves les unes des autres, entre elles, et avec les autres fractions de la classe qui n'étaient pas en grève : cette stratégie a été éprouvée pendant les grèves avec occupation d'usines en 71 et 72. L'utilisation de la semaine de trois jours, ainsi que les élections de février 74 pour briser la grève des mineurs, ont permis à un nouveau gouvernement travailliste, renforcé par cette épreuve, de faire face à la classe. La contre-offensive a commencé juste après les élections contre une vague de combativité déjà en déclin. Travaillant ensemble d'une façon plus concertée qu'ils n'avaient pu le faire dans les années 60, le gouvernement travailliste et les syndicats ont construit progressivement toute une campagne pour le "Contrat Social", jusqu'à le sceller en 1975. Après avoir cédé pendant un moment des augmentations de salaire relativement fortes, le gouvernement travailliste reprenait une fois de plus son rôle naturel : en se cachant derrière le sacro-saint principe de l'intérêt national, il redevenait encore le parti de 1'austérité. 26. Les mesures d'austérité durent depuis longtemps en Grande-Bretagne et ont été un modèle pour toute la bourgeoisie occidentale. A mesure que le reflux s'est précisé, l'austérité s'est renforcée. En 1977, après deux ans de Contrat Social, les syndicats ont fait semblant de ne pas vouloir le poursuivre. Le Contrat Social a encore duré; l'austérité a continué, mais les syndicats ont essayé de diminuer en apparence leur part de responsabilité directe dans les mesures d'austérité. Malgré cette mise en scène, le plan d'austérité a érodé la crédibilité des syndicats et de la gauche. Par conséquent, la bourgeoisie s'est trouvée devant un problème majeur, à savoir, que l'utilisation de son visage de gauche aujourd'hui diminue sa crédibilité. C'est ce qu'on a vu tout au long de l'année 1979, avec les défis lancés à l'autorité des syndicats et des shop-stewards et dans l'indifférence totale des ouvriers par rapport aux manœuvres du Parti Travailliste.
27. La récente vague de grèves montre que la classe ouvrière a commencé à sortir de la période de reflux et à s'affirmer sur son propre terrain de classe.
Et si la principale fraction de gauche de la bourgeoisie, le Parti Travailliste, est passé à une position d'"opposition loyale" pour se remettre à neuf, ce n'est pas à cause d'un renforcement, mais d'un affaiblissement de la classe dominante, pour affronter un prolétariat de plus en plus combatif. La lutte ouvrière devient un facteur de la crise politique de la classe dominante et redevient l'axe essentiel de toute la situation sociale.
Ce texte n'a fait que tracer les lignes générales de l'évolution de la situation en Grande-Bretagne depuis la deuxième guerre mondiale. Il a couvert une période dans laquelle le rapport de forces a été de manière prédominante en faveur de la bourgeoisie, et il a souligné le contexte général à partir duquel surgiront las mouvements titanesques futurs du prolétariat. La façon spécifique dont se développe cette deuxième vague de luttes actuelle depuis la crise ouverte de 1968 est décrite dans le Rapport sur la situation en Grande-Bretagne paru dans World Révolution n° 26.
Marlowe
Géographique:
- Grande-Bretagne [121]
Questions théoriques:
- Décadence [122]
Le caractère réactionnaire des nationalisations dans la phase impérialiste du capitalisme (gauche mexicaine 1938).
- 3266 reads
Dans le n° 10 de la REVUE INTERNATIONALE (juin-août 1977), nous avons présenté le "Groupe des Travailleurs Marxistes" du Mexique, groupe surgi dans les années les plus sombres du mouvement ouvrier international. Son surgi s sèment dans les années 1937-39 ne pouvait signifier l’annonce d'une reprise du mouvement mais l'expression d'un dernier sursaut de conscience communiste de la classe face au cynisme sanglant du capitalisme triomphant qui se préparait à fêter ce triomphe dans l'ivresse de la deuxième guerre mondiale.
L'évolution vers le capitalisme d'Etat accéléré par la crise et les préparatifs de la guerre, trouvait son expression majeure dans la campagne pour les nationalisations. De DE MAN à BLUM, de la CGT aux Partis Staliniens, des Travaillistes anglais aux Fronts Populaires, les nationalisations étaient devenues la plateforme par excellence de la gauche du capital et présentées par elle aux ouvriers comme la marche vers le socialisme. Les Trotskistes, et Trotski en personne, comme d'autres extrême-gauche, n'ont pas su échapper à cette idéologie. Ils sont tombés dans le panneau et ont embouché le même clairon. A les entendre, les nationalisations, si elles n'étaient pas encore du socialisme, étaient cependant un pas très progressif que la classe ouvrière devait soutenir de toutes ses forces.
Aujourd'hui, comme dans les années 30, les nationalisations continuent à servir de programme économique de la gauche, comme le montre encore récemment feu le "Programme Commun" en France ; et l'ampleur des nationalisations préconisées sert de signe de "radicalité" et de certificat d'authenticité prolétarienne avec lesquels ces partis cachent leur nature capitaliste. Aujourd'hui, comme hier, trotskystes, maoïstes, anarchistes et autres gauchistes cachent la vérité que les nationalisations ne font que renforcer l'Etat capitaliste et s'efforcent de convaincre les ouvriers que ces mesures affaiblissent le capital. Aujourd'hui comme hier, les révolutionnaires doivent dénoncer cette démagogie, démontrer théoriquement et dans le concret le véritable contenu capitaliste et anti-ouvrier des nationalisations. C'est pour contribuer à cela que nous publions cette étude de la gauche mexicaine, parue dans le premier numéro de La revue "COMMUNISME" en 1938.
AVEC LA NATIONALISATION DES INDUSTRIES, LA BOURGEOISIE SE PROTEGE CONTRE LA REVOLUTION PROLETARIENNE
F.Engels disait en 1878 :
"Mais ni la transformation en sociétés par actions, ni la transformation en propriété d'Etat ne supprime la qualité de capital des forces productives. Pour les sociétés par actions, cela est évident. Et l'Etat moderne n'est à son tour que l'organisation que la société bourgeoise se donne pour maintenir les conditions extérieures générales du mode de production capitaliste contre des empiétements venant des ouvriers comme des capitalistes isolés. L'Etat moderne, quelle qu'en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l'Etat des capitalistes, le capitaliste collectif idéal. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble. Mais, arrivé à ce comble, il se renverse. La propriété d'Etat sur les forces productives n'est pas la solution du conflit, mais elle renferme en elle le moyen formel, la façon d'accrocher la solution : (...) la prise du pouvoir d'Etat par le prolétariat."
(F.Engels, "L'Anti-Duhring", Ed.Sociales 1963, p.318)
Ces simples et claires paroles du compagnon de K.Marx, prononcées il y a 60 ans, s'appliquent expressément à la récente transformation de l'industrie pétrolière et de chemin de fer en propriété de l'Etat des capitalistes mexicains. Il est d'une importance primordiale, pour le prolétariat du Mexique, de comprendre la vérité fondamentale contenue dans ces phrases : "l'Etat moderne n'est qu'une organisation que se donne la société bourgeoise pour défendre les conditions matérielles du système capitaliste de production contre les attaques des ouvriers comme des capitalistes individuels. L'Etat moderne, quel que soit sa forme, est une machine essentiellement capitaliste; c'est l'Etat des capitalistes; c'est le capitaliste collectif idéal." Combien sont-ils aujourd'hui, parmi ceux qui se disent "marxistes", qui connaissent la vérité de ces affirmations d'un des fondateurs du marxisme ? Combien sont-ils qui admettent que ces affirmations s'appliquent à tous les Etats capitalistes, quelle que soit leur forme, c'est à dire également aux Etats capitalistes qui se disent "ouvriéristes"? Combien se risquent à dire que ces Etats "ouvriéristes" exploitent les ouvriers, et que cette exploitation s'étend chaque fois que de nouvelles forces productives deviennent sa propriété ? Combien se risquent à dire que dans chaque nouvelle "nationalisation", les relations capitalistes entre possesseurs et producteurs (c'est à dire entre capitalistes et prolétariat), loin d'être abolies par de telles mesures, sont aiguisées et accrues ? Qui se risque, aujourd'hui, au Mexique, à dire que toutes ces affirmations s'appliquent aussi aux récentes "nationalisations" de l'industrie pétrolière et des chemins de fer ? Pourquoi les "marxistes" du Mexique n'appliquent-ils pas les enseignements du marxisme aux problèmes actuels ?
Pourquoi, en premier lieu, ne pas expliquer que "nationalisation" ne signifie en aucune manière "propriété de la'nation'", mais uniquement, exclusivement propriété de 1'Etat, c'est à dire propriété d'une partie de la "nation" : la bourgeoisie, dont l'Etat est l'instrument ? En d'autres termes, pourquoi ne pas expliquer qu'avec la "nationalisation", la propriété passe simplement des capitalistes individuels ou des compagnies capitalistes au, "capitalisme collectif" (pour employer la formule d'Engels) c'est à dire l'Etat des capitalistes ?
Pourquoi ne pas dire tout cela ? Nous le savons très bien : en le disant, comme devrait le faire celui qui s'appelle "marxiste", on ne peut rester le serviteur loyal de la bourgeoisie "progressiste" du Mexique, on perd sa popularité, peut-être sa liberté, et sa vie ... Mieux vaut ne pas appliquer les enseignements du marxisme aux problèmes du jour! Il est utile de s'appeler "marxiste", mais être marxiste est trop dangereux pour ces messieurs qui s'intitulent "leaders ouvriers".
LA VERITABLE SIGNIFICATION DE LA NATIONALISATION DU PETROLE ET DES CHEMINS DE FER
Quelles sont alors, d'après le marxisme, la portée et la signification de "l'expropriation" de la propriété des compagnies pétrolières? Cela signifie tout simplement que cette propriété est passée des mains d'un groupe d'exploiteurs (les compagnies pétrolières) aux mains d'un autre groupe : l'Etat mexicain. Ni plus, ni moins. La nature de cette propriété n'a, en rien, était modifiée, elle reste capitaliste comme auparavant. Les travailleurs restent dans la même situation de prolétaires obligés de vendre leur force de travail aux propriétaires des instruments de production, à savoir au maître des champs pétrolifères, des installations de l'appareillage de distribution, et le propriétaire (aujourd'hui l'Etat mexicain) conserve la plus-value produite par les travailleurs, c'est à dire les exploite,.
En d'autres termes, l'industrie pétrolière mexicaine s'est convertie en une seule et gigantesque "Pétrolex" avec des directeurs et techniciens "nationaux" au lieu d'étrangers, et la tâche principale de cette grande "pétromex" est exactement la même qu'auparavant celle de la petite "pétromex" (le gouvernement mexicain était, avant les "nationalisations" récentes, propriétaire d'une compagnie pétrolière) : empêcher ou briser les grèves, comme ce fut le cas pour la grève des protestations de 1'année dernière.
Dans l'industrie pétrolière du Mexique, depuis la dite expropriation, précisément comme avant, s'opposent les deux classes fondamentales de la société capitaliste : capitalistes et prolétaires, exploiteurs et exploités. L'industrie pétrolière reste ce qu'elle était auparavant : le bastion du système capitaliste au Mexique, d'autant plus que ce bastion est actuellement plus fort qu'auparavant, parce qu'au lieu d'avoir à faire à plusieurs compagnie étrangères seulement protégées par l'Etat mexicain, les travailleurs ont, aujourd'hui, en face d'eux, directement cet Etat, avec sa démagogie "ouvriériste", ses comités de conciliation, sa police, ses prisons, son armée. La lutte des travailleurs de l'industrie du pétrole est aujourd'hui mille fois plus difficile qu'avant. L'Etat protégeait la propriété capitaliste parce que telle est sa fonction fondamentale, aujourd'hui cette protection a changé de forme : pour être plus efficace et pour mettre l'industrie pétrolière à l'abri des attaques des travailleurs, l'Etat a déclaré comme sa propriété celle qui a besoin de protection : la propriété des capitalistes américains et anglais.
L'ETAT "OUVRIERISTE" DEFEND LE SYSTEME CAPITALISTE CONTRE LA REVOLUTION PROLETARIENNE
Selon les enseignements du marxisme, l'Etat est une institution née de la division de la société en classes ayant des intérêts irréconciliables, et sa fonction est de perpétuer cette division et avec elle "le droit de la classe possédante d'exploiter celle qui ne possède rien, et la domination de la première sur la seconde" (Engels). L'Etat moderne est l'organisation que se donne la bourgeoisie pour défendre ses intérêts collectifs, ses intérêts de classe, contre les attaques des ouvriers d'une part et des capitalistes individuels d'autre part (en premier lieu contre ceux des capitalistes et compagnies qui ne veulent pas abandonner une partie de leurs intérêts individuels en faveur de la défense des intérêts collectifs de la classe bourgeoise contre les travailleurs). Toute l'activité de la classe capitaliste, bien qu'il se dise "ouvriériste", ne sert qu'à une seule fin : le renforcement du régime capitaliste. Dans la phase de l'expansion du capitalisme, le renforcement de celui-ci avait un caractère progressif, en dépit de l'oppression constante qui en résultait, parce qu'en ce temps-la l'histoire n'avait pas encore posé la révolution prolétarienne à l'ordre du jour. L'unique progrès possible était le capitalisme. Aujourd'hui, dans sa phase de décomposition, c'est à dire dans la phase impérialiste que nous vivons, le renforcement ou la "réforme" du capitalisme prend un caractère extrêmement réactionnaire et contre-révolutionnaire, parce qu'aujourd'hui la destruction du capitalisme seulement peut sauver l'humanité de la barbarie. Le rôle actuel de l'Etat est de défendre le capitalisme contre la révolution prolétarienne. Dans la phase impérialiste, l'Etat capitaliste, quelle que soit sa forme, est la véritable incarnation de la réaction et de la contre-révolution. Aujourd'hui, il n'y a, et ne peut y avoir, un Etat capitaliste progressif. Tous sont réactionnaires et contre-révolutionnaires. Renforcer l'Etat équivaut donc à prolonger la vie du barbare système capitaliste. Seuls ceux qui luttent pour la destruction de l'Etat capitaliste sont au côté du prolétariat et de tous les exploités et opprimés luttant avec eux pour leur émancipation par la révolution prolétarienne.
QUAND LA NATIONALISATION EST PROGRESSIVE ?
Les paroles déjà citées, d'Engels au sujet de la signification de la conversion de la propriété des capitalistes individuels en propriété des compagnies anonymes, et concernant la transformation de celles-ci en propriété de l'Etat capitaliste, s'appliquent à la phase ascendante du capitalisme, à la phase de son expansion, lorsque le système capitaliste constituait un progrès. Dans cette phase, la concentration des forces de production dans les mains de groupes de capitalistes signifiait un important pas en avant, dans le sens de la socialisation croissante de la production, laquelle, pour sa part, posait devant 1'humanité la tâche de la socialisation de la propriété de ces forces de production. Citons une autre fois Engels :
La période de haute pression industrielle avec son crédit enflé sans limites, aussi bien que le krach lui-même par la ruine de grands établissements capitalistes, poussent à la socialisation de masses considérables de moyens de production; et cette socialisation s'opère sous la forme des diverses espèces de sociétés par action. Beaucoup de ces moyens de production et de communication sont dès l'abord si colossal qu'ils excluent toute autre forme d'exploitation capitaliste : c'est le cas par exemple des chemins de fer. Mais à un certain degré de développement, cette forme même n'est plus suffisante; le représentant officiel de la société capitaliste, l'Etat, est contraint de prendre la direction de ces moyens de production et de communication. La nécessité de les transformer en propriété de l'Etat apparaît d'abord pour les grands établissements servant aux communications (postes, télégraphes, chemins de fer)."
Mais ajoutait Engels, "c'est seulement au cas où les moyens de production et de consommation échappent réellement à la direction des sociétés par action, c'est seulement lorsque l'étatisation est devenue économiquement inévitable, c'est seulement alors que, même réalisée par l'Etat actuel, elle marque un progrès économique, un stade préliminaire à la prise de possession de toutes les forces productives par la société même. Mais il est né récemment, depuis que Bismarck s'est mis à étatiser, un faux socialisme qui, dégénérant même ça et là en complaisance servile, déclare socialisme dés l'abord toute étatisation, même celle de Bismarck. Mais si l'étatisation du tabac était socialiste, Napoléon et Metternich compteraient parmi les fondateurs du socialisme. Quand l'Etat belge, pour des raisons politiques et financières tout à fait banales, construit lui-même ses principales lignes de chemin de fer, quand Bismarck, en dehors de toute nécessité économique, étatise les principales lignes de Prusse, tout simplement pour pouvoir mieux les organiser et les utiliser en vue de la guerre, pour faire des employés de chemins due fer un troupeau d'électeurs dociles, et surtout pour se procurer une nouvelle source de revenus indépendante des décisions du Parlement, ce ne sont là à aucun degré, ni directement ni indirectement, ni consciemment ni inconsciemment, des mesures socialistes. Sans cela, le commerce maritime royal, la manufacture de porcelaine royale, et même le tailleur de la compagnie dans l'armée seraient des institutions socialistes. "
F.Engels. ("L'Anti-Dühring", Ed. Sociales, 1963, p.316-317)
Personne ne dira que la nationalisation de l'industrie pétrolière du Mexique fut économiquement inévitable, parce que son administration, depuis le moment de la production, avait débordé le cadre des compagnies. Et personne ne verra un progrès économique dans la transformation de la propriété des grandes compagnies internationales, mille fois mieux organisées et plus puissantes que l'Etat mexicain, en propriété de ce dernier. En réalité, des paroles d'Engels que nous venons de citer, les seules qui conviennent, dans le cas des récentes nationalisations au Mexique, ce sont celles qui parlent des "raisons politiques et financières" et de l'intérêt de l'Etat à créer une "nouvelle source de profit" et à transformer le personnel des chemins de fer en "troupeaux d'électeurs dociles".
Une telle nationalisation, dit Engels, ne représente aucun progrès.
LE CARACTERE REACTIONNAIRE DES NATIONALISATIONS DANS LA PHASE IMPERIALISTE DU CAPITALISME
C'est seulement en analysant les récentes nationalisations au Mexique comme faisant partie du processus de décomposition du capitalisme que nous pouvons comprendre leur véritable signification historique.
Dans la phase ascendante du capitalisme, existait la possibilité de nationalisations progressives bien que beaucoup d'entre elles, comme nous venons de le voir par les exemples cités par Engels, n'avaient pas un tel caractère. Aujourd'hui dans la phase de décomposition du système capitaliste, il n'y a pas la possibilité de nationalisation de caractère progressif, de même qu'il n'y a pas une seule mesure progressive de la part de la société capitaliste en décomposition et de son représentant officiel, l'Etat capitaliste. Dans la phase ascendante du capitalisme, les signes de l'expansion de la production et de la concentration de la propriété étaient, en principe, l'Etat national unifié, dont la formation constituait un progrès en comparaison avec les entités féodales dispersées. Mais, rapidement, l'expansion de la production et la concentration de la propriété débordèrent les limites des Etats nationaux. Les grandes compagnies anonymes prirent de plus en plus un caractère international, créant à leur manière une division internationale du travail, et cela, en dépit de son caractère contradictoire, constituant une des contributions les plus importantes du capitalisme au progrès de l'humanité.
Le caractère, de plus en plus international de la production, commence alors a se heurter avec la division du monde en Etats nationaux. "L'Etat national", affirme le 1er Congrès de l'Internationale Communiste en 1919, "après avoir donné un élan vigoureux au développement capitaliste est amené à être trop étroit pour l'expansion des forces productives".
Durant la phase pendant laquelle l'Etat national constituait un facteur progressif, c'est à dire dans la phase ascendante du capitalisme (et seulement à elles s’appliquent les citations d'Engels concernant le caractère progressif de certaines nationalisations), la conversion de la propriété des compagnies anonymes - lesquelles, dans le même temps ne débordaient pas encore des limites de l'Etat national- en propriété de celui-ci, était progressive.
Mais, au moment de convertir les sociétés anonymes en organismes qui embrassaient déjà plusieurs Etats, les nationalisations commencèrent a changer de signification : dirigées chaque fois davantage contre la croissante division internationale du travail, elles constituèrent par conséquent, au lieu d'un progrès, une régression. L'unique progrès possible est aujourd'hui la transformation de la propriété des grandes compagnies anonymes et de l'Etat capitaliste en propriété de l'Etat prolétarien qui surgira de la révolution communiste^ Surtout les nationalisations faites pendant et depuis la guerre mondiale montrèrent, dans tout le monde capitaliste, cet aspect réactionnaire en une forme chaque fois plus accentuée. Leur objet n'étant déjà plus 1'expansion de la production mais sa restriction... avec une exception significative: les industries de guerre. Restreindre la production des objets de consommation et organiser la production des instruments pour la destruction des produits et des propres producteurs, cela est une des fins primordiales des nationalisations pendant la guerre mondiale de 1914-1918 et pendant les récentes guerres en Ethiopie, en Espagne et en Chine. Et ceci s'applique, non seulement aux pays qui entrèrent directement en guerre, mais à tous, que les gouvernements soient fascistes ou démocratiques. Voir les nationalisations des deux côtés en Espagne, et la récente nationalisation des chemins de fer et industries de guerre en France. Destruction et non construction, voilà le grand actif de la société capitaliste dans ses heures d'agonie.
Tandis que les nationalisations dans le passé étaient l'expression de la croissance et de l'expansion du capitalisme, actuellement, elles sont, au contraire, l'expression de la régression et de la décomposition chaque fois plus violente du système capitaliste. Avant de disparaître de la scène historique, le capitalisme détruit une grande part de ce qu'il a crée lui-même : son magnifique appareil de production, le prolétariat moderne et la division internationale du travail, enchaînant chaque fois davantage les forces de production dans les limites des Etats nationaux.
Le prolétariat, au contraire, quand sonnera son heure historique, "libérera les forces productives de tous les pays des chaînes des Etats nationaux, unifiant les peuples en étroite collaboration économique" (Manifeste du premier congrès de TIC).
Ce sont des paroles claires, en opposition irréductible avec les idées de ceux qui veulent combiner les mots d'ordre de la révolution prolétarienne, laquelle a un caractère international, et ceux aits de "l'émancipation nationale".
L'unique possibilité de libérer les peuples opprimés réside dans la destruction des Etats nationaux par la révolution prolétarienne triomphante et dans 1'unification du monde entier en une étroite coopération fraternelle.
LE TRIOMPHE DU "BON VOISIN"
Ce qui vient d'être dit d'une façon générale, concernant la signification des nationalisations dans la phase de décomposition du capitalisme nécessitent certains compléments et modifications dans le cas des pays semi-coloniaux, comme le Mexique. Tout d'abord, s'il fût possible de placer une partie de la propriété des grandes compagnies internationales sous le contrôle effectif d'un petit Etat national, il est clair qu'une telle nationalisation n'accroîtra pas la division internationale du travail, crée par le capitalisme, mais au contraire, la minera et la détruira, révélant ainsi son caractère réactionnaire, plus encore que dans le cas des grands Etats impérialistes.
Mais en réalité, une nationalisation effective de la part des petits Etats est impossible, surtout quand elle s'applique à la propriété des grandes compagnies internationales, parce que ce sont les Etats impérialistes et leurs gouvernements qui contrôlent complètement la gestion économique et politique des petits Etats. Seuls, les Etats impérialistes peuvent aujourd'hui nationaliser, soit au dedans de leur domaine politique direct, soit dans les petits Etats contrôlés par eux. Les "nationalisations" effectuées par eux ne sont, par conséquent, rien de plus qu'une farce, un changement d'étiquette. Celui qui "nationalise " est en réalité, non le petit Etat "libre" et "anti-impérialiste", mais son propre maître impérialiste. L'unique changement possible, c'est que le petit Etat, comme dans notre cas, le Mexique, passe du contrôle de quelques compagnies impérialistes et de leur Etat, au contrôle d'autres compagnies et de leur Etat.
Et c'est précisément ce qui s'est passe dans le cas de la récente "nationalisation" du pétrole au Mexique : les grandes sociétés nord-américaines (la Huestee Standart Oil et la Gulf) et leur Etat ne pouvaient, jusqu'à maintenant, que partager le contrôle de la richesse pétrolière, et de tous les destins du Mexique, avec la société anglaise El Aguila (Royal Dutch Shell) et avec l'Etat anglais; avec la dite "nationalisation", ce contrôle est passé aux mains des maîtres exclusifs de ce que la bourgeoisie mexicaine appelle "notre patrie". Ce qui s'est passé dans ce cas est uniquement ce qui peut se passer dans la phase impérialiste du capitalisme. Toutes les fondamentales "rédemptions nationales" signifient inévitablement le triomphe de l'un ou l'autre impérialisme. Dans le cas du Mexique, celui qui a triomphé est " le fameux" " voisin".
La bourgeoisie internationale admet cela en toute franchise, comme le montre l'opinion ou Bulletin du service des Archives de Genève (nous citons seulement les dernières notes du 7 juin : "Dorénavant, les Etats-Unis sont les maîtres indiscutables dans tous les domaines au Mexique. La dernière forteresse anglaise (en Amérique Latine) a été démolie jusque dans ses fondations ... Les Etats-Unis ont adopté l'unique moyen de chasser l'Angleterre du Mexique sans tirer un coup de fusil..."
Ce fut Cardenas, insinue le bulletin, "qui finalement a aidé les Etats-Unis à expulser les Britanniques. Apparemment, tout fut très simple. Quand précisément les Anglais étaient heureux de posséder 60% du pétrole mexicain contre les 40% qu'avaient les Etats-Unis, Cardenas s'est approprié le tout. Mais, alors que Londres déchaînait une tempête contre les expropriations, Washington accueillait la chose avec un calme extraordinaire...
Que vient-il alors à l'esprit ?" Le Bulletin penche pour une entente entre Washington et Mexico, par laquelle tout le pétrole devient américain, "démolissant ainsi définitivement la dernière forteresse britannique dans cet hémisphère". Ceci nous est dit par un périodique bourgeois de Suisse... (texte traduit de l'espagnol, faute de posséder l'original).
"El Nacional", organe du gouvernement du Mexique, donna la même interprétation quand il annonça la rupture des relations diplomatiques avec le gouvernement anglais par les deux titres suivants : "Le Mexique rompt avec l'Angleterre" et "Les conversations avec les Compagnies américaines sont en bonne voie".
Il n'est pas meilleure illustration de la transformation du Mexique en une colonie exclusivement nord-américaine que l'adulation pour l'impérialisme yankee qui apparaît dans chaque numéro de "El Nacional" et dans tous les discours des autres mandataires mexicains. Selon eux, l'impérialisme nord-américain est aujourd'hui, en réalité, "anti-impérialiste", seul l'impérialisme anglais est impérialiste.
... Et le grand maître, Léon Trotski, les appuie dans cette propagande, avec ses lettres ouvertes dans lesquelles également "impérialisme" équivaut à "impérialisme anglais", cependant que l'auteur de ces lettres ne dit pas une seule parole sur l'impérialisme américain...
"L'ADMINISTRATION OUVRIERE" DOIT SAUVER LA PROPRIETE DES CAPITALISTES
Le système capitaliste se trouve dans une situation sans issue. Sa destruction par le prolétariat révolutionnaire est historiquement inévitable.
Mais, actuellement, le prolétariat affaibli et désorienté par tant de défaites et trahisons, au lieu de lutter contre le capitalisme, avec le but de l'abattre et de construire sur les ruines une nouvelle société, est, au contraire, en train de le défendre. Appuyée par tous les prétendus "leaders ouvriers", la bourgeoisie est parvenue à dévier les travailleurs de la lutte de classes et à les lier aux intérêts du capitalisme par le canal de l'Etat.
Aveuglés par les idées de démocratie et de patrie, les prolétaires défendent ce qu'ils devraient détruire; ce que nous voyons en Espagne, en Chine, au Mexique, dans le monde entier.
Au lieu de profiter de la crise mortelle du système capitaliste pour le détruire, les travailleurs, ne croyant pas au triomphe de leur propre cause, se sont temporairement transformés en ses meilleurs défenseurs. Exactement, comme au temps de la guerre mondiale, quand ils sacrifièrent leurs conquêtes économiques et leurs vies en luttes fratricides, sous le commandement de leurs ennemis de classe. Bien entendu, aujourd'hui, comme alors, la responsabilité n'en revient pas aux travailleurs, mais à ces "marxistes" qui, par leurs capitulations devant les fétiches de la démocratie et de la patrie ont trahi le marxisme et la cause de la révolution prolétarienne. Et il est également inutile d'insister sur le fait que la situation actuelle ne peut durer toujours et que, tôt ou tard, le prolétariat prendra le chemin de la révolution. Historiquement, la révolution prolétarienne reste inévitable et invincible.
En Espagne, et surtout en Catalogne, nous avons vu, dans ces dernières années, comment la bourgeoisie parvient à conjurer le danger de la révolution prolétarienne au moyen de l'armement des travailleurs et de la "socialisation" des industries, avec leur "livraison" aux travailleurs. Ceux-ci, sous l'illusion d'être alors les maîtres du pays, renoncèrent à l'attaque contre les institutions capitalistes et commencèrent à défendre, au prix de sacrifices inouïs, ce qui, maigre certains changements d'étiquette, continuait d'être la propriété capitaliste et l'Etat capitaliste. A la faveur du massacre quotidien sur les champs de bataille en Espagne, le capitalisme s'est renforce politiquement, remplissant ses objectifs avec le sang des exploités qui luttaient des deux côtés.
Suivant l'exemple de la bourgeoisie espagnole, la bourgeoisie mexicaine et son bon "voisin" nord-américain tentent de conjurer le danger de révolution prolétarienne au Mexique par la "livraison" des industries aux ouvriers. Une fois que celles-ci seront "aux mains" des travailleurs, l'ennemi mortel du système capitaliste se transformera en son meilleur défenseur ... ainsi calcule la bourgeoisie au Mexique et à Washington.
La bourgeoisie mexicaine et américaine connaissait la haine des masses travailleuses du Mexique et de toute l'Amérique Latine contre les grandes compagnies étrangères. Une attaque du prolétariat contre celles-ci équivaudrait à une attaque contre le cœur du système capitaliste. Ce serait le commencement de la fin de la domination impérialiste au Mexique et dans tous les pays coloniaux et semi-coloniaux... et la bourgeoisie de ces pays, en premier lieu celle du Mexique, sait fort bien que, ce qui, uniquement, la maintient et la protège contre "ses" ouvriers et paysans, c'est précisément la domination impérialiste. On comprend pourquoi elle considère la bourgeoisie nord-américaine comme sa "bonne voisine".
Face à l'accroissement quotidien de la colère des masses contre les compagnies impérialistes, il fallait éviter à tout prix une attaque frontale des travailleurs contre elles. Cette tâche revenait bien entendu au gouvernement du Mexique. Ce qui se passe avec les gouvernements semi-coloniaux, quand ils ne peuvent accomplir de telles tâches, est bien connu de tous : ils disparaissent, comme ont disparu tant de gouvernements au Mexique, à Cuba et autres pays latino-américains, au moment où ils se montrent incapables de dévier l'attaque des ouvriers contre la sacro-sainte propriété impérialiste. Le "bon voisin" a besoin de serviteurs efficaces, et il est démontré que le serviteur le plus efficace est un gouvernement "ouvriériste" .
Pour un gouvernement capitaliste "ouvriériste", il ne fut pas difficile de trouver la solution du problème. Les faux "marxistes" du type staliniens et trotskystes l'avaient proposée depuis longtemps : le front unique contre le prolétariat et la bourgeoisie. Contre qui ? Et bien, contre 1'impérialisme, quoique vous ne le croyiez pas!
En Espagne et en Chine, ce front unique entre exploiteurs et exploités a déjà été réalisé, avec des résultats magnifiques pour les exploiteurs, qu'ils soient fascistes ou antifascistes, impérialistes ou anti-impérialistes, et avec des résultats funestes pour les exploités des deux côtés. Au Mexique, quelque chose de très ressemblant se développait depuis quelques années. A la fin, cela prit une forme définitive, quand commença la farce de la prétendue "rédemption nationale". Simulant une lutte implacable contre l'impérialisme (en paroles), la bourgeoisie américaine et son gouvernement purent livrer (en fait) le contrôle chaque fois plus absolu des désunis de la prétendue "patrie mexicaine".
En même temps, simulant la remise de l'industrie pétrolière et des chemins de fer aux travailleurs, elle pourra tirer d'eux les sacrifices les plus inouïs.
Plein triomphe sur toute la ligne! Sous la forme de la "nationalisation", la bourgeoisie et son gouvernement purent remettre l'industrie la plus importante du pays au contrôle exclusif de l'impérialisme yankee; dans cette transaction, le gouvernement de la bourgeoisie mexicaine contracte une dette d'"honneur" avec la bourgeoisie nord-américaine et anglaise, dette que paieront bien entendu les travailleurs; et c'est non seulement eux qui seront tenus de supporter ce sacrifice ("volontairement", comme l'affirment leurs leaders traîtres), mais qui devront offrir sur l'autel de la patrie, bien entendu toujours "volontairement", les 50 millions demandés par les Compagnies il y a deux ans! Suivant un communiqué du Comité Exécutif du Syndicat des Travailleurs du Pétrole, publié dans la presse du 28 avril 1938, ce syndicat :
" était parfaitement d'accord avec son gouvernement, au moment où cela était nécessaire pour la Nation, et acceptait, par considération patriotique, que les bénéfices qui découlent de la décision des juntes de conciliation et d'arbitrage, groupe 7, malgré le sacrifice que représentent pour les travailleurs du pétrole (évidemment pas pour leurs leaders !) les longues années de lutte pour obtenir une vie plus humaine dans les champs pétrolifères ne s 'appliquent pas pendant que prévaudra la situation actuelle; en outre les travailleurs de cette industrie remettront à divers organismes pour un total approximatif de 140 millions de pesos; indépendamment de cela, nos diverses sections, conscientes de leur devoir comme mexicains, remettront une journée de salaire mensuel, pour un temps indéfini, afin de contribuer à résoudre la dépression économique de la nation, ce qui équivaut à une somme mensuelle de plus de 150.000 pesos" .
En additionnant ces quantités, la fameuse "rédemption nationale" coûte aux travailleurs du pétrole la respectable somme de plus de 190 millions de pesos, (pour ne parler que de ces travailleurs ), sans considérer les autres millions perdus pendant ces deux dernières années, pour s'être confiés aux juntes de conciliation au lieu d'obliger les compagnies, au moyen de la grève, à payer de plus hauts salaires. Au lieu d'obtenir que, sur les 50.millions qui étaient demandés aux Compagnies, il leur soit payé au moins les 20 millions que la décision "favorable" des juntes leur promettait, ils sont obligés de payer aux compagnies impérialistes, par le canal du gouvernement "anti-impérialiste" du Mexique, une somme cinq fois plus grande. Au lieu de recevoir 20 millions, ils sont obligés de payer plus de 190 millions, comme contribution à la prétendue "dette d'honneur".
Il serait difficile de trouver, dans toute l'histoire de la bourgeoisie mondiale, un autre exemple d'une tromperie si parfaitement exécutée. Dans le chœur des palabres patriotiques au sujet de la "libération économique du Mexique", se cache le vol le plus gigantesque que connaisse l'histoire. Les ouvriers sentent instinctivement qu'en réalité il ne s'agit de rien d'autre que d'un vol, mais, aveuglés par l'idée de la "patrie en danger", ils ne parvenaient pas à percer la vérité. Puisse notre faible voix permettre à certains de comprendre la véritable situation et les aider à se débarrasser de leurs songes et illusions!
LA TACHE DU PROLETARIAT FACE AUX RECENTES NATIONALISATIONS
Si aux faux "leaders marxistes" du Mexique, il manquait la valeur pour caractériser la véritable signification de la "nationalisation" du pétrole et des chemins de fer, il était tout de même moins risqué de parler de la tâche du prolétariat face à ces nationalisations faites par la bourgeoisie et au bénéfice de la bourgeoisie.
Engels parlait en toute clarté et franchise de cette tâche. Lui, bien entendu, ne voulait rien savoir de "l'appui au gouvernement" que préconisaient les traîtres à leur classe. Au contraire, l'unique chemin qu'il signalait, face aux nationalisations de la bourgeoisie, c'est la prise du pouvoir d'Etat par le prolétariat, et la transformation de la propriété des capitalistes, y compris la propriété" de l’Etat capitaliste, en propriété de l'Etat prolétarien
Il indiquait clairement quelle était l'unique leçon que les travailleurs devaient tirer de la transformation de la propriété des capitalistes individuels et des compagnies capitalistes en propriété de l'Eta-c capitaliste :
" Le régime capitaliste de production ... en poussant progressivement à transformer les grands moyens de production en propriété de l'Etat, indique lui-même les moyens d'accomplir cette révolution : le prolétariat s'empare du pouvoir d'Etat et transforme les moyens de production en propriété de l'Etat ...
F. ENGELS. (L'Anti-Dühring p.319)
La tâche du prolétariat mexicain est, alors, non de se sacrifier pour que l'industrie pétrolière et les chemins de fer soient profitables pour les capitalistes impérialistes et nationaux, ni d'accepter la farce de la "remise" des industries à une prétendue "administration ouvrière" mais de les conquérir, c'est à dire, de les arracher à la bourgeoisie au moyen de la révolution prolétarienne.
Telle est l'unique leçon que nous devons tirer des récentes nationalisations.
Géographique:
- Mexique [186]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [13]
Questions théoriques:
- Impérialisme [184]